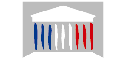______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 septembre 2015.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE
en conclusion des travaux de la mission (1)
sur la Banque publique d’investissement Bpifrance
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Laurent GRANDGUILLAUME
Rapporteur
Mme Véronique LOUWAGIE
Présidente
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information commune à la commission des affaires économiques, à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la banque publique d’investissement Bpifrance est composée de : Mme Véronique Louwagie, présidente, M. Laurent Grandguillaume, rapporteur, M. Éric Alauzet, Mme Sabine Buis, MM. Yves Censi, Jean-Christophe Fromantin, Joël Giraud, Mme Anne Grommerch et M. Arnaud Leroy.
SOMMAIRE
___
Pages
AVANT-PROPOS DE MME VÉRONIQUE LOUWAGIE, PRÉSIDENTE DE LA MISSION 7
INTRODUCTION 9
I. LA CRÉATION DE BPIFRANCE : UNE RATIONALISATION DES STRUCTURES PUBLIQUES DE FINANCEMENT POUR UNE INTERVENTION EFFICACE 15
A. UNE INSTITUTION ORIGINALE AUX MISSIONS MULTIPLES 15
1. L’installation rapide de la nouvelle structure 15
a. Une mise en place rapide entre la loi de 2012 et le décret de juillet 2013 15
b. Le déploiement d’une large gamme d’instruments financiers 19
c. La montée en puissance des interventions de Bpifrance 22
d. La dotation en fonds propres et le schéma de refinancement de Bpifrance 25
2. Une structure hybride à la structuration duale 27
a. Un actionnariat à parité entre l’État et la Caisse des dépôts 28
b. Des structures assurant le financement et l’investissement distinctes mais agissant en synergie 30
c. Un mécanisme de décision plus ou moins décentralisé selon les activités 32
B. … QUI S’INSTALLE DANS LE PAYSAGE ÉCONOMIQUE 33
1. Le déploiement de Bpifrance sur l’ensemble du territoire 33
a. Des régions associées de façon limitée à la gouvernance 33
b. … mais des partenariats dynamiques avec les conseils régionaux 34
c. … qui s’appuient sur un réseau d’interlocuteurs de proximité 36
d. Une organisation spécifique outre-mer 38
2. L’inscription incomplète des actions de Bpifrance dans la politique de filières et les plans industriels 39
a. Bpifrance en tant qu’opérateur des investissements d’avenir 40
b. Développer l’intégration de l’action de Bpifrance et des politiques de filières et de soutien aux entreprises industrielles 41
C. À LA RECHERCHE D’UN FONCTIONNEMENT EXEMPLAIRE 43
1. Une politique des ressources humaines qui doit être irréprochable 43
a. Des rémunérations encadrées, conformément aux engagements du Président de la République 44
b. Un effort d’harmonisation au niveau de BPI-Groupe 44
c. Des recrutements nécessaires 46
2. Une gestion qui doit être performante et aussi transparente 47
a. Une politique de communication ambitieuse 47
b. Un nouvel axe fort qui pourrait être la transparence 48
3. La qualité du service aux entreprises 50
a. Une banque au service de toutes les entreprises 50
b. Un effort notable de simplification et de réduction des délais 52
c. Une mission d’accompagnement qui mériterait d’être mieux définie 54
II. UNE STRATÉGIE REPOSANT SUR LA DYNAMISATION DU MARCHÉ PRIVÉ MAIS DONT LE CADRE POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ 56
A. UNE DOCTRINE D’INTERVENTION LARGE MAIS SOUMISE A DES CONTRAINTES FORTES 56
1. Les questions posées par la doctrine d’intervention 56
a. L’étendue des missions attribuées à Bpifrance par la loi ne se retrouve pas complètement dans sa doctrine d’intervention 56
b. La correction des failles de marché 59
c. Les principes structurants de la doctrine d’intervention sont contraints par le droit européen 61
d. Le cofinancement et le co-investissement : des principes dont les contours pourraient être assouplis 65
e. La recherche d’un effet de levier 67
f. Une réponse insuffisante apportée aux très petites entreprises 68
2. Démultiplier l’action de Bpifrance au niveau européen 72
a. Le « plan Juncker » comme une opportunité ? 72
b. La présence de Bpifrance au sein des institutions européennes de financement 75
c. L’accès de Bpifrance (et de la BEI) au financement de la BCE pour la partie investissement : un enjeu majeur ? 75
d. Comparaison avec la KfW : un modèle différent 76
3. La politique du risque et les attentes de BPI en matière de rentabilité 78
a. Bpifrance prend-elle suffisamment de risques ? 78
b. Les niveaux de rentabilité attendus en matière de participations et de financement 82
4. L’aide aux entreprises en difficulté et la question spécifique du retournement : une intervention insuffisante de Bpifrance 83
a. Les modalités d’intervention de Bpifrance en matière d’aides aux entreprises en difficulté 84
b. Le recours aux fonds de fonds 86
c. Créer une capacité de retournement publique 87
B. LA STRATÉGIE ET L’ACTION DE BPIFRANCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 89
1. La stratégie globale 89
2. L’action de Bpifrance en matière d’investissement et la division entre fonds de fonds et investissement direct 91
3. L’intervention majoritaire à travers des fonds de fonds : démission intellectuelle ou nécessité opérationnelle ? 95
4. Le recours aux obligations convertibles 98
5. L’aide aux ETI et aux grandes entreprises : quelles participations Bpifrance doit-elle prendre ? 99
a. L’action de Bpifrance comme fonds souverain 99
b. Une démarche légitime qui pose la question du niveau du risque 100
C. L’ACTION DE BPIFRANCE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 103
1. Une vaste gamme de produits s’appuyant sur quelques modalités 103
2. Un déploiement en partenariat pour un coût public maîtrisé 108
3. Des points de vigilance 110
a. Les difficultés apparues dans l’activité de préfinancement du CICE 110
b. Une clarification indispensable sur les rôles respectifs de Bpifrance et des banques en matière d’analyse des risques 113
c. Le manque de visibilité sur le coût des commissions de garantie 115
d. Un effort doit être fait pour maintenir les conditions de prêts à des taux favorables 118
III. LA VALEUR AJOUTÉE DE BPIFRANCE DANS LA POLITIQUE PUBLIQUE DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 119
A. BPIFRANCE : ACTEUR ESSENTIEL DU SOUTIEN À L’INNOVATION 119
1. Une croissance rapide des aides à l’innovation qui bénéficie prioritairement aux PME innovantes. 120
a. Panorama des aides déployées par Bpifrance en matière d’innovation 120
b. Une progression continue des aides tant en financement qu’en investissement 122
c. Des investissements exemplaires 123
d. L’appui de l’Union européenne à l’innovation 124
e. La mise en place du Hub et l’ouverture à l’international : un effort nécessaire pour renforcer l’écosystème technologique français 124
2. La faiblesse des dotations budgétaires dédiées à l’innovation: un danger pour l’écosystème technologique français 125
a. La baisse continue des dotations budgétaires du programme 192 126
b. La non-substituabilité entre PIA et aides individuelles 127
3. Le projet de constitution d’une fondation 127
B. LE SOUTIEN AUX POLITIQUES SECTORIELLES 128
1. La transition énergétique 128
a. La promotion de la compétitivité énergétique et écologique par une offre de prêts adaptés 128
b. Des aides à l’innovation et au développement qui doivent être mieux coordonnées dans le cadre de la politique de filière 130
2. L’économie sociale et solidaire 132
a. Une nouvelle gamme de produits en cours de déploiement 132
b. La reconnaissance de nouvelles formes d’innovation 133
c. Une répartition des tâches peu claire avec la Caisse des dépôts et consignations 134
C. LE SOUTIEN À L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 135
1. Une rationalisation des structures publiques 135
a. Un processus engagé depuis plusieurs années 135
b. Une nouvelle étape de rationalisation grâce à Bpifrance 137
c. Le rattachement de la direction des garanties publiques de Coface à Bpifrance finalement acté 138
2. Une priorité stratégique en 2015 140
a. L’amélioration du continuum de financement 140
b. Le renforcement de l’accompagnement, en partenariat 142
EXAMEN EN COMMISSION 145
PROPOSITIONS DE LA MISSION 155
ANNEXE 1 : DOTATION ET CONSOMMATION DES FONDS DIRECTS GÉRÉS PAR BPIFRANCE 159
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 179
AVANT-PROPOS DE MME VÉRONIQUE LOUWAGIE,
PRÉSIDENTE DE LA MISSION
Le Président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a annoncé le 2 octobre 2013 que 2014 serait « l'année de l'évaluation des grandes lois votées par le Parlement », dont la Banque publique d'investissement fait partie.
Après avoir acté sa création en début d'année, nous avons débuté les travaux de la mission que j’ai eu l’honneur de présider. Je tiens à souligner la qualité des auditions, la pertinence des interventions et surtout le travail en commun que nous avons pu mener avec le Rapporteur Laurent Grandguillaume.
Ce rapport d’information a aussi une vocation pédagogique. Il démontre que la mission de contrôle du Parlement s’exerce pleinement.
Institution « jeune », Bpifrance figure désormais pleinement dans le paysage institutionnel français, ce qui implique aussi que la définition de ses missions soit affinée pour plus de cohérence et de pragmatisme, afin que tout dirigeant d’entreprise puisse connaître Bpifrance : c’est là tout l’enjeu d’un recentrage souhaitable de la politique de communication du groupe.
Bpifrance s’engage, aux côtés des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les Régions, pour renforcer le soutien nécessaire dans les phases clés d’évolution des entreprises. En effet, dans l’environnement économique que nous connaissons, l’accompagnement des mutations des PME en ETI est essentiel, et c’est dans ce sens que l’articulation des relations entre Bpifrance et les nouvelles grandes Régions va être décisive.
Il convient toutefois, plus généralement, de « recréer » dans notre pays un environnement favorable à l’entreprise, à l’envie d’investir, avec un système fiscal incitatif et non dissuasif, l’entreprise n’étant pas notre ennemie !
Il faut également créer un « cercle de confiance » permettant aux chefs d’entreprises de passer à la vitesse supérieure l’an prochain et il convient absolument d’éviter aux chefs d’entreprises de sombrer dans l’« archéologie administrative », autrement dit la constitution de dossiers, étape chronophage. Certes les retards pris sur le poste « investissements » pendant la crise expliquent pour une bonne part la baisse de la croissance dans les pays européens. C’est ainsi que nous avons pu constater des retards significatifs et parfois préjudiciables dans le renouvellement de l’équipement des entreprises et des infrastructures, qui en conséquence sont vieillissants.
Ainsi donc, Bpifrance est une « institution jeune » dont l’avenir fera l’objet d’une attention particulière.
La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et conduites par les régions (1).
La création de la Banque publique d’investissement (BPI), – dénommée Bpifrance –, par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, répond au premier des soixante engagements du candidat François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012. Celui-ci était formulé de la façon suivante : « Je créerai une Banque publique d’investissement. À travers ses fonds régionaux, je favoriserai le développement des PME, le soutien aux filières d’avenir et la conversion écologique et énergétique de l’industrie. Je permettrai aux régions, pivots de l’animation économique, de prendre des participations dans les entreprises stratégiques pour le développement local et la compétitivité de la France. Une partie des financements sera orientée vers l’économie sociale et solidaire ».
Il faut, en effet, rappeler que dans un contexte où le PIB avait retrouvé progressivement son niveau d’avant-crise, les investissements des entreprises demeuraient, quant à eux, inférieurs de 12 % à ceux constatés en 2008. Ainsi, après avoir avoisiné les 300 milliards d’euros par an entre 2006 et 2009, le volume annuel global des crédits nouveaux aux entreprises en France varie entre 200 et 250 milliards d’euros depuis 2010. De la même manière, l’activité du capital-investissement en France, supérieure à 10 milliards d’euros en 2008, n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant-crise (8,7 milliards d’euros investis par le capital-investissement dans l’économie en 2014, à comparer aux 4,9 milliards d’euros investis en 2009, année d’effondrement général de l’investissement dans le monde).
Véritablement opérationnelle à partir de juillet 2013, date à laquelle les apports de l’État et de la Caisse des dépôts au capital de la nouvelle structure ont été réalisés, Bpifrance ne s’est pas bâtie sur du vide : elle réalise la fusion de trois structures déjà existantes que sont Oséo (banque de prêt aux PME et de soutien à l’innovation), CDC Entreprises et le Fonds stratégique d’investissement (FSI). Elle reprend et regroupe leurs missions au sein d’une structure unique.
Aux termes de la loi, les missions confiées à Bpifrance sont très larges : de l’amorçage à l’internationalisation des entreprises, en particulier des PME et des ETI, en passant par le soutien en fonds propres des entreprises, de manière directe ou via des fonds de fonds, Bpifrance possède un large éventail d’outils, qui lui permettent d’agir simultanément comme société de financement et comme investisseur institutionnel. La structure de Bpifrance, à travers ses deux branches (Bpifrance Financement et Bpifrance Participations), correspond à cette nature hybride.
Plus précisément, Bpifrance couvre six domaines d’intervention. Deux concernent spécifiquement la branche financement :
– la garantie (des crédits des banques privées faits aux PME) ;
– le prêt (prêts de trésorerie et prêts d’investissement) ;
Trois concernent la branche investissement :
– les fonds de fonds (ces fonds de fonds permettent d’alimenter des fonds privés de capital développement, capital d’amorçage, capital-risque ou encore de capital-retournement) ;
– l’investissement direct dans les PME (afin d’alimenter celles-ci en fonds propres) ;
– l’investissement direct dans les ETI et les grandes entreprises (notamment pour contribuer à stabiliser leur capital ou pour contribuer au développement de secteurs stratégiques).
Enfin, le domaine du soutien à l’innovation (subventions, prêts, avances remboursables, investissement) emprunte à chacun des modes d’action.
Son action s’inscrit dans un contexte économique difficile. En 2014, l’investissement a continué de reculer (– 1,6 % après – 0,8 % en 2013). Le regain de confiance entrevu au printemps s’est rapidement dissipé et, avec un acquis de croissance de 0,3 % à la fin du 3e trimestre, la France a connu une troisième année consécutive de croissance limitée. En particulier, l’activité dans l’industrie a été atone, en raison entre autres du manque de vitalité de l’activité en zone euro. La baisse de l’euro du second semestre ne s’est, par ailleurs, pas encore traduite par une accélération des exportations. Dans le sillage de ce repli, la demande de financement est restée limitée. La production de nouveaux crédits aux entreprises a atteint 168 milliards d’euros entre janvier et novembre 2014, soit une baisse de 12 % par rapport à 2013. Pour les plus petits crédits (inférieurs à 1 million d’euros, essentiellement à destination des PME), la baisse a été plus modeste mais significative (59 milliards d’euros de nouveaux crédits entre janvier et novembre 2014, en baisse de 6 %).
C’est dire si l’action de Bpifrance est attendue par de nombreux acteurs publics comme privés. Bpifrance, à la date des travaux de la mission d’information de l’Assemblée nationale, ne compte néanmoins que deux ans d’existence réelle et n’a pas encore déployé la totalité de ses moyens. Sa montée en puissance est cependant indéniable : le total du bilan consolidé de Bpifrance Financement s’élève à 40,2 milliards d’euros au 31 décembre 2014, contre 34,7 au 31 décembre 2013, soit une augmentation de 5,5 milliards d’euros. Avec une progression comparable à celle de 2012 à 2013 (16 %), le total du bilan a ainsi augmenté de 10,3 milliards d’euros en deux ans. Pour la période 2014-2017, le plan stratégique prévoit encore près de 12 milliards d’euros de financement et 850 millions d’euros d’investissements directs dans les PME. Les crédits accordés aux entreprises par Bpifrance représentent désormais environ 4,3 % des nouveaux crédits annuels aux entreprises.
L’ampleur des moyens déployés n’est cependant pas le seul critère permettant d’apprécier l’efficacité de Bpifrance. En matière institutionnelle, elle a permis d’offrir un interlocuteur unique aux entreprises et a facilité leurs démarches, malgré la lourdeur encore réelle du traitement de certains dossiers. Néanmoins, les délais d’intervention ont globalement été réduits et permettent de dynamiser l’intervention publique en matière de soutien aux entreprises. En 2014, 82 000 entreprises (hors grandes entreprises et autres bénéficiaires), totalisant 1 300 000 emplois, ont reçu une aide de sa part.
Face à cette dynamique nouvelle engendrée par la création de la BPI, la mission d’information de l’Assemblée nationale a souhaité établir un premier bilan de sa valeur ajoutée par rapport à l’ancien dispositif public d’aide aux entreprises. Elle a également cherché à analyser l’action de cette institution, son cadre et ses limites, notamment au regard des règles européennes mais aussi de sa propre doctrine, espérant ainsi resituer l’action de Bpifrance face aux espoirs et aux attentes mais aussi parfois aux déceptions et aux désillusions suscitées par son action.
Elle a ainsi pu constater la pertinence de l’intervention de Bpifrance dans de nombreux domaines, notamment celui du soutien à l’innovation, et le service rendu à des milliers d’entreprises, mais elle a pu aussi s’interroger sur certaines pratiques, que le déploiement relativement récent, et encore inachevé, de Bpifrance justifie en partie. Il n’est ainsi pas toujours aisé de comprendre les mécanismes de décision et de gouvernance de la banque, qui diffèrent d’ailleurs suivant le type de ses interventions. La complexité ne résulte pas seulement d’une organisation duale, autour des deux activités juridiquement distinctes de financement et d’investissement. Elle se retrouve également dans la conduite de ses missions : si Bpifrance agit la plupart du temps en tant que structure autonome et indépendante, elle peut également agir en tant qu’opérateur de l’État, notamment dans le cadre de la gestion du programme d’investissement d’avenir (PIA). L’impulsion donnée par les deux actionnaires principaux que sont l’État et la Caisse des dépôts et consignation est ainsi variable d’un domaine à l’autre, tantôt inexistante, tantôt plus directive, notamment lorsque Bpifrance agit en tant qu’opérateur des PIA.
Aux termes de la loi, la BPI est tenue d’accompagner « la politique industrielle nationale » et d’apporter « son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ». Elle doit, dans cette optique, coordonner son action avec la direction générale des entreprises du ministère de l’Économie, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), l’Agence des participations de l’État (APE) ou encore l’Agence pour le développement durable et la maîtrise de l’énergie (Ademe). Ces interactions multiples, n’ont pas toujours paru suffisantes au rapporteur comme aux personnes auditionnées. En particulier, la place des régions et des services de l’État en région, malgré la mise en place de comités régionaux et de conventions signées avec ces dernières, ne semble pas partout assurée et laisse apparaître des différences significatives entre les régions.
Au-delà du pilotage stratégique des interventions, le Rapporteur s’est interrogé sur les modalités, le coût et l’efficacité des interventions de Bpifrance au service des entreprises. Il a ainsi pu constater la montée en puissance continue des interventions de Bpifrance depuis sa création, bien que certaines enveloppes peinent encore à être consommées, notamment dans le domaine de l’investissement. Cependant, la mission d’information a pu relever que les coûts d’intervention de Bpifrance, notamment dans sa fonction de prêteur, étaient parfois supérieurs à ceux du marché, bien que plus simples et moins risqués à mettre en œuvre pour les entrepreneurs.
Par ailleurs, la politique du risque de Bpifrance semble s’être rapprochée, par effet de capillarité, de celle en vigueur dans le secteur privé, à quelques exceptions notables près, comme le soutien à l’innovation dans lequel Bpifrance joue un rôle actif, même lorsque le risque est important. Si l’on comprend aisément que les dirigeants de Bpifrance et les actionnaires souhaitent pérenniser l’existence de la structure en ne lui faisant pas courir de risques excessifs, cette protection doctrinaire peut parfois agir comme un rempart qui prive Bpifrance de sa capacité à agir dans le soutien aux entreprises, notamment lorsque celles-ci connaissent une situation délicate.
De la même manière, certains éléments de doctrine de Bpifrance, tels que le principe de co-intervention avec le secteur privé (qui n’est d’ailleurs pas général puisque l’innovation y échappe) ou l’utilisation des dividendes perçus, peuvent soulever des interrogations. L’on comprend en effet mal la logique qui veut que toute l’action de Bpifrance soit tournée vers la correction des défaillances de marché, c’est-à-dire là où les acteurs privés n’interviennent pas, et qu’elle soit dans le même temps contrainte d’agir systématiquement à leurs côtés. Si l’effet d’entraînement joué par Bpifrance sur le financement et l’investissement privé explique en grande partie ce paradoxe, il ne semble cependant pas l’épuiser.
Ce cadre d’action, qui s’impose également aux autres institutions européennes de financement public telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) doit être appréhendé pour mieux comprendre l’action de Bpifrance et ses éventuelles limites. C’est notamment dans ce cadre que peuvent être mentionnées des idées dépassant le champ de la mission, tout en étant en lien étroit avec son objet, telle la possibilité pour la Banque centrale européenne (BCE) de financer directement des institutions publiques d’investissement comme la BEI ou le FEI (idée notamment portée par le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz), ce qui aurait pour conséquence d’augmenter par ricochet la capacité de Bpifrance à accorder des prêts ou à intervenir en fonds propres, notamment en favorisant le développement de fonds de capital-risque ou de fonds de garantie à l’échelle européenne.
Enfin, le fonctionnement interne de Bpifrance a également fait l’objet de l’attention du rapporteur. Si l’unification d’une partie des structures publiques de financement a permis leur rationalisation, elle a également nécessité une harmonisation des statuts, des rémunérations, ainsi que le déploiement d’un nouveau réseau sur le territoire. Apprécier l’adéquation des effectifs, des moyens et des manières de communiquer de l’institution, au regard de ses objectifs et de ses ambitions, est également essentiel.
Concernant la méthode, le bilan qu’ont tenté d’établir les membres de la mission a reposé largement sur des auditions, des entretiens, des déplacements sur le terrain ou le recueil de témoignages et de réponses à des questions écrites tant auprès des administrations, de Bpifrance ou directement auprès des entreprises (2). Elle a notamment consisté à mettre en lumière l’articulation entre ce que le législateur attendait de Bpifrance et ce qu’elle est réellement devenue, après presque trois années d’existence. À cet égard, force est de constater qu’il existe parfois un décalage lorsque l’on compare les objectifs fixés par la loi à la BPI à la formulation de sa propre doctrine, qui agit comme une constitution interne. En effet, sur la large palette des missions confiées à la banque publique, toutes ne font pas l’objet de la même attention, ni du même investissement. L’analyse ne pouvait cependant entrer dans le détail de chaque dispositif, au regard de leur diversité et du fait que chacun pourrait appeler des commentaires particuliers. Elle s’est fondée sur les principaux d’entre eux, ceux qui mobilisent les financements les plus importants, tels que la garantie ou le prêt de développement, ou bien, dans le domaine de l’investissement, sur la stratégie générale de Bpifrance puisqu’il n’est pas possible matériellement de conduire une analyse détaillée des différents investissements effectués par les 300 fonds partenaires.
De manière générale, la valeur ajoutée de Bpifrance dans le paysage économique est réelle et positive. Toutefois, l’approche financière de Bpifrance, qui lui permet de garantir son sérieux et sa pérennité, pourrait ainsi être complétée par une approche plus industrielle et plus sociale. C’est aussi cela que les citoyens sont en droit d’attendre d’une banque publique financée très majoritairement par de l’argent public. En effet, si le rôle de Bpifrance est de « permettre à l’ensemble de l’écosystème de prendre des risques » (3), elle doit également être davantage en mesure d’en prendre elle-même. L’investisseur avisé doit aussi être un investisseur assumé pour jouer pleinement son rôle en appui de la politique économique et industrielle de la Nation.
I. LA CRÉATION DE BPIFRANCE : UNE RATIONALISATION DES STRUCTURES PUBLIQUES DE FINANCEMENT POUR UNE INTERVENTION EFFICACE
La montée en puissance de Bpifrance au cours de la période 2013-2015 constitue indéniablement un succès pour ses promoteurs comme pour ses équipes. En deux ans, la Banque publique d’investissement a su organiser son fonctionnement interne, déployer un réseau important sur le territoire, roder ses procédures et sa doctrine et mettre en place un système de refinancement efficace.
C’est ainsi qu’a été déployée la structure unique Bpifrance qui est venue se substituer à de précédents organismes de financement public. Elle doit pourtant continuer de définir le périmètre de son action et organiser la complémentarité de celle-ci avec les autres acteurs publics du financement de l’économie.
La mise en place fonctionnelle de Bpifrance, comme son insertion dans le paysage institutionnel et économique national et son adéquation à la volonté du législateur, constitue un des premiers enjeux de la réflexion conduite par la mission.
A. UNE INSTITUTION ORIGINALE AUX MISSIONS MULTIPLES
1. L’installation rapide de la nouvelle structure
a. Une mise en place rapide entre la loi de 2012 et le décret de juillet 2013
La création d’une banque publique d’investissement était le premier des soixante engagements pour la France de François Hollande lorsque, au printemps 2012, il a été élu Président de la République. Quelques mois plus tard, le 17 octobre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à mettre à œuvre cet engagement. La loi du n° 2012-1559 relative à la création de la Banque publique d’investissement a finalement été promulguée le 31 décembre 2012.
Bpifrance s’est constituée en plusieurs étapes à partir du début d’année 2013 en fusionnant Oséo, CDC Entreprises et le Fonds stratégique d’investissement (FSI), trois organismes dont les métiers et les statuts étaient différents. Oséo était une banque, dont le total de bilan s’élevait à environ 25 milliards d’euros, qui agissait dans le domaine du financement, de la garantie et de l’innovation. CDC Entreprises était une filiale de la Caisse des dépôts et consignations principalement chargée d’investir dans les PME. Quant au FSI, doté d’un capital de 20 milliards d’euros, il avait pour objectif principal de sécuriser le capital d’entreprises stratégiques, selon le modèle des fonds souverains.
Issue principalement de la fusion de ces trois organismes, Bpifrance s’est mise en place et est devenue opérationnelle dans le courant de l’année 2013. La rapidité de son installation a été unanimement saluée par les personnes auditionnées dans le cadre de la mission d’information.
● Plusieurs étapes ont présidé à sa constitution.
La loi précitée du 31 décembre 2012 a créé la Banque publique d’investissement sous la forme d’un groupe public dont la société anonyme BPI-Groupe est la société de tête.
Une fois la loi promulguée, les organes directeurs de Bpifrance sont rapidement entrés en fonction. Dès le 21 février 2013 s’est tenu le premier conseil d’administration. Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a été élu président du conseil d’administration (4). Le comité exécutif de Bpifrance a été désigné le même jour ainsi que le directeur général, Nicolas Dufourcq. Le 17 avril 2013 a eu lieu la première réunion du comité national d’orientation (CNO) à Caen.
La doctrine d’intervention de Bpifrance a été présentée aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le 15 mai 2013 (5), avant d’être adoptée par le conseil d’administration du 25 juin. À partir du printemps 2013, des comités régionaux d’orientation (CRO) ont été mis en place et ont organisé leurs premières réunions. Le lancement du label Bpifrance Export est intervenu en mai 2013, proposant une nouvelle offre de financement et d’accompagnement destinée aux PME et ETI en partenariat avec la Coface et Ubifrance.
Les agréments requis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et de l’Autorité des marchés financiers ont été notifiés respectivement le 28 juin et le 10 juillet 2013.
Finalement, en juillet 2013, Bpifrance a été constituée de manière effective à l’issue d’un processus d’apports multiples :
– l’État a apporté à la société BPI-Groupe 49 % du capital et des droits de vote du FSI (aujourd’hui Bpifrance Participations) ainsi que sa participation dans la société pour le financement des restructurations de la défense (Sofired) ;
– l’établissement public BPI-Groupe a apporté à la société BPI-Groupe 62,81 % du capital et des droits de vote d’Oséo (aujourd’hui Bpifrance Financement) ;
– la Caisse des dépôts et consignations a apporté à la société BPI-Groupe 51 % du capital et des droits de vote du FSI (aujourd’hui Bpifrance Participations), la totalité du capital et des droits de vote de CDC-Entreprises et 62,81 % du capital et des droits de vote d’Oséo (aujourd’hui Bpifrance Financement) ainsi que des actifs complémentaires ;
– BPI-Groupe a apporté au FSI (aujourd’hui Bpifrance Participations) des actifs reçus le jour même de la Caisse des dépôts et consignations.
À la suite de ces apports, l’État via l’établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations sont devenus actionnaires paritaires de BPI-Groupe, chacun à raison de 50 % du capital et des droits de vote.
À l’automne 2013, l’organisation du groupe et l’installation des équipes ont été terminées. Les équipes parisiennes de Bpifrance ont été réunies sur un seul site, boulevard Haussmann, tandis que les fonctions centrales ont été dans le même temps rassemblées au siège situé à Maisons-Alfort. Le 20 décembre 2013, le premier plan stratégique de Bpifrance a été approuvé par le conseil d’administration, définissant les ambitions stratégiques du groupe à l’horizon de 2017.
À la fin de l’année 2013, Bpifrance est ainsi devenue pleinement opérationnelle, soit un an après l’adoption de la loi qui l’a créée.
● Les statuts de Bpifrance
Le décret n° 2013-529 du 21 juin 2013 précise les statuts de la société anonyme BPI-Groupe codétenue à parité par l’établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations.
La société anonyme, dont le nom commercial est Bpifrance, détient Bpifrance Financement et Bpifrance Participation – qui lui-même détient Bpifrance Investissement. (cf. schéma infra).
SCHÉMA DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE DE BPIFRANCE
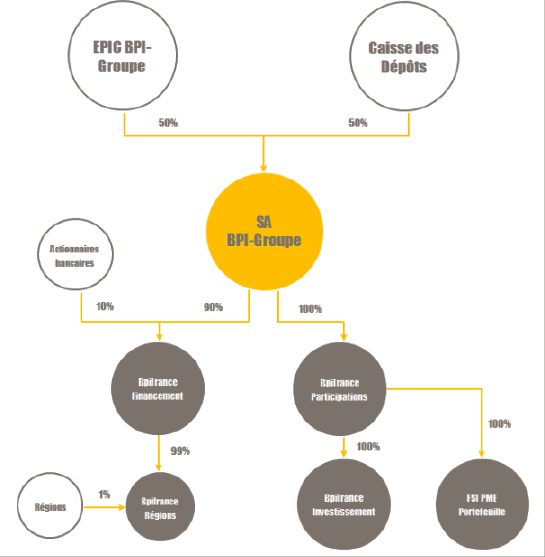
Source : rapport annuel de Bpifrance Financement 2014.
La société anonyme Bpifrance est une « holding » au statut de compagnie financière. En effet, elle détient 90 % environ du capital de Bpifrance Financement (une de ses deux filiales) qui est, pour sa part, un établissement de crédit (6). À l’inverse, la filiale Bpifrance Investissement est agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que société de gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive AIFM (7).
Par conséquent, Bpifrance Financement dispose d’un agrément bancaire qui lui permet de se refinancer auprès de la Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre des instruments de politique monétaire ouverts aux acteurs bancaires (appels d’offres de durées variées incluant, notamment, la procédure Targeted Longer-Term Refinancing Operations ou TLTRO et portant sur des actifs financiers répondant à certains critères de qualité).
b. Le déploiement d’une large gamme d’instruments financiers
Pour assurer le développement de son activité et répondre aux besoins du marché, Bpifrance a développé une gamme très vaste de produits financiers qui apparaît relativement complexe comme en témoignent les différentes matrices de présentation des dispositifs employées dans les bilans et les documents de communication produits par l’institution. Les produits y sont classés par finalité, par étapes du cycle de vie de l’entreprise, par secteur ou par type de dispositif, selon le lectorat visé.
Bpifrance s’attache en premier lieu à classer ses produits par étapes du cycle de vie de l’entreprise, démontrant ainsi qu’elle offre un continuum de financement conformément à sa vocation de guichet unique. Dans cette classification, les produits de financement à proprement parler, et les produits d’investissement sont volontairement rapprochés : création, innovation, croissance, international, transmission, trésorerie.
La classification par type de dispositif distingue, en revanche, clairement les instruments de financements, des garanties, des investissements en fonds propres, des avances remboursables et des subventions, ces instruments présentant des risques différents et relevant de régimes juridiques distincts.
La matrice de présentation des dispositifs la plus commune mêle ainsi étape du cycle de vie de l’entreprise et type de dispositif (cf. maquette page suivante).
MATRICE CLASSIQUE : TYPE DE PRODUIT ET ÉTAPE DU CYCLE DE VIE DE L’ENTREPRISE
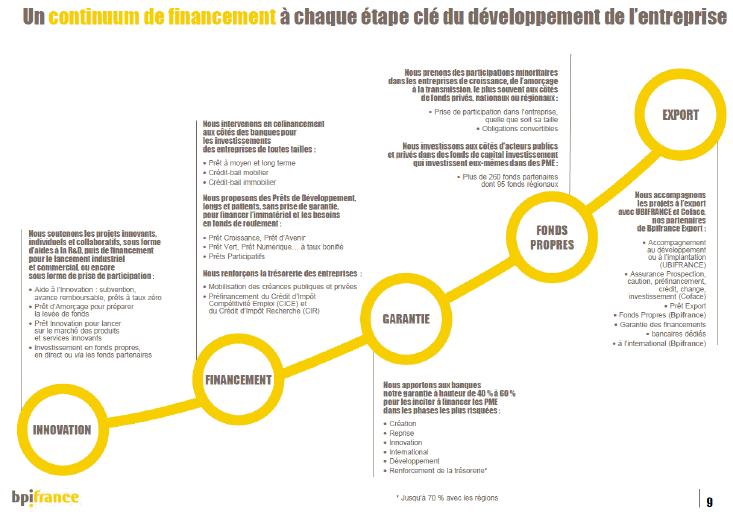
Source : site Internet de Bpifrance, document daté de juillet 2014.
Le présent rapport n’exclut aucune de ces approches et cherche à rapprocher les activités de Bpifrance des objectifs qui lui ont été fixés par la loi. La lecture et la compréhension des statistiques d’activité produites se heurtent toutefois fréquemment à la coexistence de ces différentes matrices. De manière générale, les chiffres communiqués par Bpifrance et leur mode de calcul gagneraient à être mieux explicité. C’est pourquoi le Rapporteur souligne l’important travail fourni par les équipes de Bpifrance en ce sens en réponse à ses demandes. Cet effort doit être poursuivi.
Au cours des auditions, une simplification de la gamme de produits – le site Internet de Bpifrance dénombre 89 « solutions » – a été maintes fois demandée. Les dirigeants de Bpifrance sont conscients de cet enjeu : selon Pascal Lagarde, directeur exécutif de Bpifrance, chargé de l’international, de la stratégie, des études et du développement, « le challenge pour nous est d’avoir une gamme de produits simplifiée et transparente tout en proposant des produits adaptés aux différents besoins des entreprises » (8).
La problématique est particulièrement saillante s’agissant des produits de financement. Les libellés commerciaux ont eu tendance à se multiplier, comme le montre le tableau ci-dessous sachant que dans le cadre des partenariats conclus avec les régions, Bpifrance propose aussi des produits spécifiques sur certains territoires, qui participent d’un processus d’expérimentation et d’amélioration continu (cf. infra). Toutefois, il conviendra de veiller à ce que ces produits locaux n’affectent pas la lisibilité de l’offre de produits et qu’ils bénéficient d’une visibilité suffisante. Par exemple, on peut regretter que les « prêts Rebond » proposés aux entreprises en difficulté grâce à un partenariat avec le conseil régional d’Île-de-France ne bénéficient pas d’une meilleure publicité.
L’OFFRE DE PRODUITS DE FINANCEMENT BPIFRANCE PAR FINALITÉ
Finalité |
Type de produit |
Principaux produits |
Cofinancer l’investissement |
Prêts en cofinancement avec un partenaire bancaire et une prise de garantie § Prêt à moyen et long terme § Crédit-bail mobilier § Crédit-bail immobilier |
§ Prêt Croissance § Prêt de développement territorial § Prêt Restauration § Prêt Hôtellerie … |
Garantir les crédits bancaires des PME dans les phases risquées |
Garantie des prêts bancaires entre 40 et 70 % dans les phases risquées (création, reprise d’entreprise, innovation, international, développement) en partenariat avec les régions |
§ Garantie bancaire de renforcement de la trésorerie § Garantie Transmission § Garantie Création … |
Financer l’immatériel |
§ Prêts de développement de 7 ans, sans prise de garantie, avec un amortissement différé de 2 ans § Prêts de développement avec taux bonifié |
§ Prêt Éco-énergie § Prêt Numérique § Prêt d’Avenir § Prêt d’Amorçage § Prêt Export jusqu’à 150 000 euros … |
Financer la trésorerie |
§ Mobilisation de créances § Préfinancement des crédits d’impôts |
§ Avances de trésorerie sur les marchés publics et grands comptes domestiques (Avance +) § Avances de trésorerie sur les marchés export (Avance + Export) § Préfinancement du CICE § Préfinancement du CIR |
Soutenir l’innovation |
§ Subventions § Avances remboursables § Prêts à taux zéro |
§ Prêt Innovation pour lancer sur le marché des produits et services innovants… |
Source : synthèse réalisée à partir des auditions et du site Internet de Bpifrance.
c. La montée en puissance des interventions de Bpifrance
Les interventions de Bpifrance ont connu une croissance régulière et soutenue depuis 2012.
• Une activité de financement en croissance forte et linéaire.
Le total du bilan consolidé de Bpifrance Financement s’élevait à 40,2 milliards d’euros au 31 décembre 2014, contre 34,7 au 31 décembre 2013 et 29,9 en 2012 – en comparaison, le total de bilan consolidé d’Oséo était de 25,9 milliards d’euros en 2011 (9). Cela équivaut à une augmentation annuelle d’environ 15 %, qui représente un effort majeur de l’État au profit du financement des entreprises dans une période difficile. Cette augmentation concerne les trois activités de Bpifrance Financement : la garantie, l’innovation, et le financement proprement dit, hors innovation.
L’activité garantie a connu une croissance annuelle progressive. Le nombre de concours garantis est relativement stable, de 86 049 en 2013 à 86 207 en 2014. L’encours total de risques couverts est en hausse, de 12,7 milliards d’euros en 2013 à 13,5 en 2014. En répartition des garanties par finalité, c’est la création d’entreprise (+ 4 %) et la transmission (+ 10,8 %) qui croissent le plus de 2013 à 2014.
L’activité innovation est dynamique. Bpifrance distribue des aides individuelles, des prêts de développement ainsi que des financements pour des projets collaboratifs – par exemple, avec le Fonds unique interministériel ou avec les projets structurants des pôles de compétitivité. Les objectifs pour 2014 ont été dépassés dans tous les domaines. Après une diminution entre 2012 et 2013, les aides individuelles (subventions, avances remboursables et prêts à taux zéro) ont crû de 24 % en 2014 (de 364 millions d’euros en 2013 à 443 en 2014). Les prêts de développement se sont très fortement accrus, doublant presque, de 113 millions d’euros en 2013 et 215 en 2014 (en engagement) grâce aux liquidités mobilisées dans le cadre du programme d’investissement d’avenir. Le financement de projets collaboratifs connaît une croissance également importante, passant de 270 millions d’euros en 2013 à 434 en 2014.
L’activité de cofinancement est en nette hausse. L’encours total augmente de 18,1 %, de 17,8 milliards d’euros en 2013 à 21 en 2014. L’encours des prêts de développement – produit phare de Bpifrance spécifiquement dédié au financement de l’investissement, y compris immatériel – croît de 27 % en 2014, après + 14 % en 2013, avec une croissance de 39 % en engagements. La prise en charge du préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) explique en grande partie la hausse de l’activité de financement ; elle a crû de 196 % de 2013 à 2014 (de 795 millions d’euros en 2013 à 2,350 milliards d’euros en 2014).
• Une activité d’investissement à l’évolution plus contrastée
Au contraire de la branche Financement, la branche Investissement connaît une évolution de son activité plus contrastée et pour un montant global plus limité puisqu’il représente environ 19,7 milliards d’euros à la fin de l’année 2014 (16,8 milliards d’euros à la fin 2013). Les actifs sous gestion ont néanmoins progressé de 3,9 milliards d’euros entre 2013 et 2014, notamment en raison du lancement du fonds ETI 2020, doté de 3 milliards d’euros.
Il faut par ailleurs noter que la lecture de l’évolution des investissements est rendue plus difficile par leur nature cyclique. Lorsque de fortes souscriptions sont réalisées en année n, celles-ci seront en principe en diminution en année n+1 ; en effet, les investissements de Bpifrance se distinguent par une maturité longue (mais qui n’excède pas dix années en principe), impliquant un délai de plusieurs années entre la souscription et la cession. L’investissement dans les fonds qui ne sont pas des sociétés de capital-risque (dont la durée de vie est illimitée) se déroule, en outre, en trois phases : d’investissement (de cinq ans), de maturation (de cinq ans) et de liquidation. Le schéma classique consiste à investir dans un premier fonds pendant cinq ans, puis dans un deuxième pendant que le premier est en maturation et ainsi de suite. Pendant cette période le premier fonds est passé en phase d’extinction.
Le bilan total de Bpifrance Participations est ainsi passé de 17,2 milliards d’euros en 2012, à 16,8 en 2013, avant de remonter à 19,7 en 2014. Il convient de souligner que les cessions de participation détenues par Bpifrance constituent un des moyens de son financement ainsi qu’un élément d’appréciation de la rentabilité de ses investissements. Cependant, ces deux objectifs ne doivent pas entrer en contradiction avec des considérations de stratégie industrielle ou de bonne santé des entreprises.
La branche Investissement est organisée selon les quatre métiers suivants dont les dynamiques sont différentes.
Le métier Fonds de fonds assure principalement la gestion des participations de la BPI dans les fonds partenaires de Bpifrance, soit près de 300 fonds par lesquels Bpifrance investit indirectement et de façon minoritaire dans les entreprises. Après une année 2013 soutenue (425 millions d’euros de souscriptions), l’activité Fonds de fonds a fortement cru en 2014 avec 761 millions d’euros de souscriptions nouvelles, dans 39 fonds différents. L’investissement global via les fonds de fonds s’élève à 924 millions d’euros pour Bpifrance en 2014. Le stock de capital détenu par Bpifrance en fonds de fonds s’élève ainsi à 1,7 milliard d’euros à la fin 2014.
Le métier Fonds Propres PME est en charge de la gestion des fonds France Investissement Régions, France Investissement Croissance, des Fonds filières et des Fonds sectoriels (dont Patrimoine et Création, FSFE, Fonds Stratégique Bois, Mode et Finance, Patrimoine et Création 2, Bois 2, Mode et Finance 2).
En 2013, 121 millions d’euros ont été souscrits via ces fonds, en repli par rapport à 2012. En 2014, l’activité accompagnant la reprise du marché du capital développement est repartie à la hausse avec 242 millions d’euros investis et 159 millions d’euros souscrits (+ 13 % en nombre d’opérations et + 28 % en montants investis comparés à 2013).
Le métier Innovation est en charge de la gestion de l’activité Large Venture et de la gestion des fonds souscrits par Bpifrance tels que les fonds Bioam et Innobio ou des fonds financés par le PIA comme le fonds ambition numérique. En 2014, le montant des investissements représente 245 millions d’euros et le montant des souscriptions s’est élevé à 127 millions d’euros pour 46 opérations réalisées. L’essentiel de cette hausse a été porté par le fonds Large Venture.
Le métier Fonds propres ETI-GE est le quatrième métier du pôle Investissement distingué lors de la création de Bpifrance. Les équipes de ce pôle assurent la gestion des participations stratégiques dans les grandes entreprises (par exemple Orange), des participations prises dans les ETI avec le fonds ETI 2020 ou détenues historiquement par Bpifrance Participations, et des fonds sectoriels en charge de l’accompagnement des équipementiers du secteur de l’automobile. En 2014, la branche ETI-GE a investi 615 millions d’euros et souscrit pour 516 millions d’euros, soit directement, soit par le biais de fonds.
Ainsi, Bpifrance est désormais un acteur puissant dans le paysage du financement et de l’investissement en France. Il ne faut cependant pas surestimer son importance et sa capacité à agir sur tous les fronts : les parts de marché de la BPI en matière de financement des entreprises ne représentent que 6,1 % en 2014 (11,3 milliards d’euros de crédits nouveaux octroyés par Bpifrance en 2014 contre 184 milliards d’euros pour le secteur privé selon les chiffres de la Fédération bancaire française) tandis qu’en matière de capital investissement, les fonds levés par Bpifrance et par ses fonds partenaires représentent un peu plus de 20 % du marché (10) à la fin 2013.
d. La dotation en fonds propres et le schéma de refinancement de Bpifrance
Pour soutenir la montée en puissance progressive de ses interventions, Bpifrance dépend de sa dotation initiale en capitaux, mais aussi d’un système de refinancement complexe qui présente de nombreuses similarités avec celui des organismes privés.
En premier lieu, sa dotation en fonds propres représente près de 20,9 milliards d’euros. Trois milliards proviennent d’Oséo. 20 milliards d’euros de l’ex-FSI, notamment grâce à une augmentation de capital de 3,6 milliards d’euros, souscrite en 2009 par ses actionnaires actuels (l’État et la Caisse des Dépôts), et non encore totalement libérée (2,3 milliards d’euros peuvent encore être libérés d’ici 2018). Parmi les derniers développements, en mai 2015, l’assemblée générale de Bpifrance a validé la décision d’augmenter le capital de Bpifrance Financement par la création de 9 998 897 actions représentant (prime d’émission incluse) un montant de 299 millions d’euros.
Bpifrance est soumise aux ratios prudentiels applicables aux établissements de crédits. C’est dans ce contexte qu’interviennent les projets d’augmentation du capital ou encore l’idée récurrente de vendre des participations de l’État (détenues notamment par l’APE) en vue d’alimenter les fonds propres de la BPI.
Au-delà de ses capitaux propres, Bpifrance doit organiser le refinancement régulier de ses opérations. Celui-ci s’opère principalement auprès du marché, à travers les différents outils que sont l’émission de titres obligataires, l’épargne durable (LDD), l’emprunt auprès de banques commerciales ou d’institutions publiques (KfW, État, Banque européenne d’investissement) ou dans le cadre des facilités monétaires de la BCE, auxquelles Bpifrance a accès comme les autres banques, mais qui ne représentent qu’une part réduite de son refinancement.
RÉPARTITION DES REFINANCEMENTS | ||
(en millions d’euros) | ||
Encours en capitaux au 10/04/15 |
Montant |
% |
Institutions publiques |
3 497 |
15 |
État français |
1 300 |
6 |
Institutions internationales (BEI, KfW, CEB) |
1 197 |
5 |
Banque centrale européenne (TLTRO) |
1 000 |
4 |
Emprunts bilatéraux sur ressources LDD |
5 266 |
23 |
Caisse des Dépôts |
3 596 |
16 |
Banques françaises |
1 670 |
7 |
Marchés financiers |
14 314 |
62 |
Emprunts obligataires |
11 164 |
48 |
Bons à moyen et long terme |
750 |
3 |
Certificats de dépôts |
2 400 |
10 |
Total |
23 077 |
100 |
Source : Bpifrance. |
||
En forte progression par rapport à 2013 (+ 41 %), les ressources obligataires ont représenté la plus grande part du financement de l’activité en 2014 : sur les 13 milliards d’euros de financement obligataire installés, 3,25 milliards d’euros ont été émis sur cette même année.
Dans ce domaine complexe et néanmoins essentiel du refinancement, Bpifrance profite actuellement de taux très bas (bien que légèrement supérieurs à ceux de l’État) mais demeure exposée à un risque sur ses capacités opérationnelles si les taux d’intérêt venaient à remonter.
Comme tous les établissements de crédit, Bpifrance recourt également aux opérations de refinancement de la banque centrale (au jour le jour et à plus long terme). Le financement à moyen et long terme de l’activité de cofinancement en 2014 a ainsi été complété par un tirage de 300 millions d’euros sur le prêt de 750 millions d’euros accordé en 2013 par la Banque européenne d’investissement pour le financement des entreprises innovantes, d’une part, et par des tirages auprès de la Banque centrale européenne, dans le cadre du TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operations) de 300 millions d’euros en septembre puis 700 en décembre, d’autre part. Il convient cependant de souligner que le recours au TLTRO est limité par la nécessité pour la BPI d’immobiliser en contrepartie des créances.
En complément de ces ressources longues, Bpifrance a procédé à des émissions de certificats de dépôts et de bons à moyen terme négociables (BMTN), qui ont contribué à hauteur de 900 millions d’euros en net au financement de l’activité : les encours se sont élevés à 2,5 milliards d’euros au 31 décembre 2014.
Les refinancements de l’activité de Bpifrance Financement s’élèvent actuellement à 23 milliards d’euros. Les financements de marché en représentent 59 %, soit 14 milliards d’euros:
– 11,1 milliards d’euros (soit 46 %) dans le cadre d’un programme obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) d’un montant autorisé de 20 milliards d’euros qui permet maintenant d’offrir aux investisseurs une large gamme d’émissions dont les durées vont de un à quinze ans ;
– 2,4 milliards d’euros (soit 10 %) dans le cadre d’un programme autorisé de 4 milliards d’euros de certificats de dépôts ;
– 750 millions d’euros (soit 3 %) dans le cadre d’un programme autorisé de 4 milliards d’euros de BMTN récemment activé.
Les emprunts bilatéraux sur des ressources LDD (livret de développement durable) provenant de la Caisse des dépôts et consignations ou des banques s’élèvent 5,3 milliards d’euros (soit 22 %).
Les emprunts auprès des institutions publiques représentent 3,5 milliards d’euros (soit 14 %) ; ils se répartissent entre des ressources apportées par l’État, notamment dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, des prêts d’institutions internationales (BEI, KfW et CEB (11)) et le recours au financement de la BCE dans le cadre du TLTRO.
À l’exception des refinancements à la BCE, qui ont un dispositif spécifique de collatéral, l’ensemble de ces ressources bénéficient d’une garantie de l’EPIC BPI-Groupe.
Enfin, la capacité de financement de Bpifrance provient aussi des dividendes versés par les entreprises dans lesquelles Bpifrance a des participations (environ 461 millions d’euros en 2014), des ventes de participation (723 millions d’euros en valeur nette en 2014, principalement en raison des cessions dans Orange et Valéo) ou des profits réalisés (le résultat net de Bpifrance en 2014 se situe à 1,27 milliard d’euros, chiffre en nette progression par rapport à 2013 en raison de l’importance des produits de cession).
2. Une structure hybride à la structuration duale
Évaluer l’action de Bpifrance suppose d’en apprécier les natures multiples : structure agissant à la fois pour son compte et comme opérateur de l’État, société de financement et investisseur institutionnel, société anonyme et outil contrôlé par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
a. Un actionnariat à parité entre l’État et la Caisse des dépôts
Aux termes de la loi (12), les grandes lignes du pacte d’actionnaires entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont fait l’objet d’une transmission au Parlement.
Ces deux institutions sont représentées au sein du conseil d’administration, lequel est présidé par le directeur général de la CDC.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple à l’exception de certaines décisions importantes qui doivent être votées à une majorité qualifiée avec vote favorable conjoint des représentants des actionnaires. Il s’agit notamment des décisions relatives au budget du groupe, aux modifications de son capital ou de celui de ses filiales, à la modification de la doctrine d’intervention ou aux opérations d’acquisition ou de cession d’un montant significatif.
Le directeur général de Bpifrance dirige les trois filiales Bpifrance Participations, Bpifrance Investissement et Bpifrance Financement et préside leur conseil d’administration.
Le pacte d’actionnaire définit également les règles de gouvernance de chaque filiale et la composition de leur conseil d’administration. Ainsi, Bpifrance participation et Bpifrance investissement sont chacune dotées d’un conseil d’administration composé de dix membres.
● Pour la branche Investissement, en plus du directeur général, trois administrateurs représentent l’État, trois administrateurs représentent la Caisse des dépôts et trois administrateurs indépendants sont nommés sur proposition de cette dernière. Le pacte d’actionnaires précise que la CDC jouit d’une « prééminence » quant à la gouvernance du pôle investissement. Le conseil d’administration est assisté d’un comité d’investissement et d’un comité d’audit et de risque, ainsi que d’un comité des nominations et des rémunérations.
● Une structure de gouvernance légèrement différente s’applique au pôle financement. Son conseil d’administration est composé de douze membres :
– le directeur général de Bpifrance ;
– trois administrateurs représentant l’État ;
– trois administrateurs nommés sur proposition de la CDC ;
– deux administrateurs indépendants nommés sur proposition de l’État ;
– un administrateur représentant les actionnaires minoritaires (c’est-à-dire les banques commerciales qui possèdent 10 % du capital de Bpifrance Financement) ;
– et deux administrateurs élus par les salariés de Bpifrance Financement et de ses filiales.
Contrairement au pôle investissement, ce sont ici les représentants de l’État qui bénéficient de la « prééminence », comme le montre le mode de désignation des administrateurs indépendants.
Ce modèle apparaît globalement satisfaisant aux membres de la mission d’information. Néanmoins, en pratique, la répartition égalitaire entre les deux actionnaires principaux que sont l’État et la CDC peut parfois conduire à une posture de retrait des actionnaires face à la direction de Bpifrance dont l’autonomie se trouve ainsi accrue. En effet, ce jeu d’acteur permet difficilement à l’un ou l’autre des actionnaires d’imposer une décision.
● Les conséquences sur le contrôle de Bpifrance
Le contrôle pesant sur chacune des filiales de BPI-Groupe diffère en fonction de leur statut.
Le contrôle de Bpifrance Financement, initialement exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a été transféré en novembre 2014 directement à la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la mise en place de l’union bancaire. En tant que société de gestion de fonds d’investissement alternatif, Bpifrance Investissement est soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers qui applique la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM).
Lorsqu’un groupe exerce à la fois des activités bancaires et d’investissement, les règles édictées en matière de gestion des conflits d’intérêts ou de respect du secret professionnel doivent être respectées. Ainsi, la directive européenne sur les « Marchés d’instruments financiers », dite « directive MIF », prévoit que chaque prestataire de services d’investissement doit établir et maintenir opérationnel, un dispositif organisationnel et administratif en vue de prendre toutes les mesures raisonnables lui permettant de détecter, de gérer et d’assurer un suivi des éventuels conflits d’intérêts résultant de l’exercice de ses activités.
Une charte de gestion des conflits d’intérêts a donc été signée en mars 2014, au moment de la fusion des sociétés de gestion du pôle investissement et qui concerne avant tout les fonds gérés pour compte de tiers.
Par ailleurs, le respect des dispositions relatives au secret professionnel a conduit la direction générale de Bpifrance à rappeler les règles et bonnes pratiques applicables en matière de partage de l’information entre Bpifrance Investissement et Bpifrance Financement (article L. 511-33 et suivants du code monétaire et financier).
Enfin, le décret prévu à l’article 10 de la loi du 31 décembre 2012 a été publié le 16 juin 2015 (13). Il prévoit le transfert à l’État des données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier, afin de permettre d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises menée par Bpifrance.
Les services de l'État destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n'est permise que sous une forme statistique garantissant l'impossibilité d'identifier individuellement les entreprises bénéficiaires. Trois années ont donc été nécessaires pour mettre en œuvre cette disposition légale. Une convention d’une durée de dix ans entre les services de l’État et Bpifrance précise les conditions dans lesquelles les données sont transmises ainsi que les conditions de la participation de tiers à leur exploitation dans le respect des règles de confidentialité.
Le Rapporteur souhaite que ces données puissent donner lieu à un suivi régulier de l’impact de l’action de Bpifrance et de son inscription dans la politique industrielle.
b. Des structures assurant le financement et l’investissement distinctes mais agissant en synergie
• Le pôle bancaire : Bpifrance Financement
À la différence de la plupart des banques privées, Bpifrance Financement ne reçoit pas de dépôts et se finance principalement sur les marchés financiers. La société est détenue à 90 % par la société BPI-Groupe et à 10 % par des banques privées – ce choix ayant été guidé par la volonté d’associer ces dernières à l’action et aux objectifs de Bpifrance. Celle-ci est d’ailleurs, en tant qu’établissement doté d’un statut bancaire, adhérente de la Fédération bancaire française, à la gouvernance de laquelle elle est pleinement intégrée puisqu’elle participe, notamment, à sa commission Banque de détail et banque à distance et, depuis 2014, à son comité Export. Si Bpifrance est une banque particulière, elle est donc, pour les adhérents de la fédération, un partenaire et un « confrère » selon l’expression employée par Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, devant les membres de la mission d’information (14).
Bpifrance Financement détient elle-même 99 % de Bpifrance Régions, qui prend la succession d’Oséo Régions et intervient en financement, en garantie et pour l’innovation dans les régions en s’appuyant sur les moyens de la société mère.
L’effectif de Bpifrance Financement s’établit au total à 1 717 salariés équivalents temps plein en 2014, dont 83 % de cadres.
• Le pôle investissement : Bpifrance Investissement
Prenant la suite du FSI et de CDC-Entreprises, Bpifrance Participations détient à 100 % Bpifrance Investissement. La première constitue la holding des participations, tandis que la seconde a pris place en tant que société de gestion. En 2014, l’ensemble des salariés de Bpifrance Participations a ainsi rejoint la société de gestion de manière à regrouper les équipes.
Environ 300 salariés équivalents temps plein dont 280 cadres travaillent à Bpifrance Investissement.
SCHÉMA DE L’ORGANISATION DE BPIFRANCE PARTICIPATIONS

Le Fonds de modernisation des équipements automobiles (FMEA) est devenu en 2014 le Fonds d’avenir de l’automobile (FAA).
Source : rapport annuel 2014 de Bpifrance Participations.
• Une distinction réglementaire
Conformément à la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (dite « directive MIF »), Bpifrance Financement et Bpifrance Participations sont deux entités séparées et indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts pour l’attribution de financements à des entreprises au capital desquelles Bpifrance Participations a souscrit – ou l’inverse –, sans que cela interdise des interventions concomitantes de l’un ou l’autre dans la même entreprise.
Bpifrance suit d’ailleurs un indicateur dont l’objet est de rendre compte de l’évolution du taux de recouvrement des activités de financement et d’investissement. Cet indicateur porte sur l’activité d’investissement direct dans les entreprises (hors fonds de fonds). Il indique que 70 % des entreprises dans lesquelles Bpifrance a investi ont également bénéficié d’un financement Bpifrance.
La doctrine d’intervention des deux activités est en conséquence en partie différenciée.
Bpifrance Investissement intervient en tant d’investisseur avisé opérant aux conditions de marché en vue de créer, via des prises de participation minoritaires, un effet d’entraînement de l’investissement privé par l’investissement public au service de l’intérêt collectif. C’est en outre un investisseur « patient », accompagnant sur le long terme les entreprises et appliquant des « due diligences ESG » (vérifications économiques, sociales et en termes de gouvernance).
Bpifrance Financement a pour vocation d’entraîner, au bénéfice des entreprises, l’ensemble des partenaires du financement, au premier plan desquels les banques. Elle oriente ses interventions vers les entreprises dans leurs phases les plus risquées comme la création d’entreprise ou la transmission, l’innovation, l’international mais aussi dans le cadre d’investissements de capacité.
En définitive, l’organisation de Bpifrance est structurée en deux branches autonomes de financement et d’investissement, dont le statut et les objectifs sont différenciés mais dont la coordination des interventions est un gage d’efficacité économique.
c. Un mécanisme de décision plus ou moins décentralisé selon les activités
Directeur général de Bpifrance (SA BPI-Groupe), Nicolas Dufourcq a été également désigné président-directeur général des trois filiales. Comme indiqué précédemment, la gouvernance de Bpifrance est assurée par son conseil d’administration, mais d’autres organes, tel que le comité des régions, jouent aussi un rôle d’orientation et de dialogue au niveau territorial. Un comité de surveillance spécialisé a également été mis en place au sein de la CDC, présidé par Henri Emmanuelli. Pour l'instant, il est prévu qu’il se réunisse selon un rythme de deux réunions par an, sur le même principe que celles du comité d'examen des comptes et des risques de la commission de surveillance, qui étudie les comptes de la CDC et assure le pilotage de ses ratios prudentiels.
Les prises de décision s’effectuent, en dehors du conseil d’administration, au niveau du comité exécutif ainsi qu’au niveau des comités d’engagement et d’investissement. Il convient cependant de souligner que les mécanismes de décision diffèrent suivant que l’on considère l’activité de financement ou celle d’investissement. Concernant cette dernière, la direction des fonds propres, située au siège, se charge de la quasi-totalité des opérations d’investissement en capital, soit directement, soit à travers des fonds de fonds dont elle assure le suivi grâce à une équipe dédiée.
En revanche, les activités de financement en région bénéficient d’une latitude et d’une autonomie nettement plus développées comme le montre notamment la proportion des effectifs des directions régionales consacrée au financement, soit la quasi-totalité, dans la plupart des cas.
B. … QUI S’INSTALLE DANS LE PAYSAGE ÉCONOMIQUE
1. Le déploiement de Bpifrance sur l’ensemble du territoire
a. Des régions associées de façon limitée à la gouvernance
La loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 a organisé l’association des régions à la gouvernance de Bpifrance.
En premier lieu, au niveau national, les régions sont représentées au conseil d’administration de Bpifrance (15), au conseil d’administration de Bpifrance Régions, ainsi qu’au comité national d’orientation (CNO) (16).
Aux termes de la loi du 31 décembre 2012, le comité national d’orientation est « chargé d’exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d’intervention et les modalités d’exercice par la société et ses filiales de leurs missions d’intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ». Pour marquer l’ancrage territorial de ce comité, ses réunions se déroulent généralement en région ; la première réunion a ainsi eu lieu le 17 avril 2013 à Caen.
En deuxième lieu, au niveau local, les régions sont représentées dans les comités régionaux d’orientation (CRO). Présidé par le Président du Conseil régional et convoqué par lui, chaque comité régional d’orientation formule un avis sur l’action de Bpifrance dans la région et veille à sa cohérence avec la stratégie de développement économique régional, en associant les acteurs économiques du territoire.
Au total, 83 réunions de CRO se sont tenues en 2013 et 2014.
Le décret n° 2013-445 du 30 mai 2013 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités régionaux d’orientation de la société anonyme BPI-Groupe ainsi que le mode de désignation de leurs membres prévoit que doivent se tenir deux réunions au minimum par an. La nouveauté du dispositif ou le manque d’informations concernant ses objectifs pourraient expliquer que cette prescription n’ait pas toujours été respectée en 2014. De surcroît, les conseils d’orientations régionaux semblent avoir un ordre du jour limité, à l’exception de régions très dynamiques telles que Rhône-Alpes. Par ailleurs peu de documents leur sont transmis en avance, ce qui limite leur efficacité. Comme l’a fait remarquer Mme Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de Bpifrance, chargée des partenariats régionaux et de l’action territoriale, « la fréquence de réunion de ces comités, le contenu de leur ordre du jour, le périmètre des sujets évoqués varient selon les souhaits exprimés par le président de la région » (17).
Cette double représentation nationale et locale devait permettre d’associer les régions à la gouvernance de Bpifrance, sans toutefois leur conférer de pouvoir de décision. Il convient, en effet, de rappeler que les CRO sont des instances stratégiques et non des comités d’engagement et que l’autonomie de Bpifrance constitue un principe cardinal de son organisation. Les craintes parfois exprimées d’une emprise trop forte des régions sur la gouvernance de Bpifrance n’apparaissent finalement pas fondées. Au contraire, les régions semblent en définitive, sur le plan institutionnel, trop peu associées à l’action de la BPI, ce qui peut nuire à la complémentarité stratégique des actions engagées sur le terrain.
Dans le cadre de la réforme territoriale et de la montée en puissance des régions en matière économique, il apparaît donc nécessaire de mieux associer les régions à l’action locale de Bpifrance afin de favoriser les synergies. Les exemples cités par la directrice exécutive au cours de son audition montrent en effet une grande diversité, certains conseils régionaux faisant preuve d’un remarquable dynamisme.
Proposition: Inviter les présidents de région à jouer leur rôle de « force motrice » :
– en réunissant plus régulièrement qu’aujourd’hui les comités d’orientation régionaux (CRO) qui doivent être le lieu de définition d’une stratégie régionale ;
– en veillant à l’information régulière des CRO par Bpifrance.
b. … mais des partenariats dynamiques avec les conseils régionaux
Bpifrance et les régions coopèrent dans le cadre de partenariats en créant des outils communs. Les plateformes régionales d’orientation sont des services en ligne destinés à donner plus de visibilité et de simplicité aux offres communes de Bpifrance et des régions résultant de ces partenariats (il en existe treize à ce jour).
La formalisation de ces partenariats financiers s’opère par des conventions cadres qui ont pour objectif de coordonner les actions de Bpifrance avec les régions pour offrir aux entreprises des services et des solutions de financement (haut et bas de bilan) les plus adaptés à leurs besoins. Dix-sept conventions cadres ont été signées à ce jour.
Ces partenariats prévoient deux types d’interventions principales :
– des outils de financement adaptés à chaque territoire (fonds régionaux de garantie, prêt de développement territoriaux, fonds régionaux innovation,…) ;
– des fonds régionaux ou interrégionaux dédiés au capital-risque et développement. Ce sont des véhicules d’investissement dans lesquels Bpifrance souscrit, souvent aux côtés des régions, et d’autres acteurs privés. Ils sont gérés par des équipes de gestion tierces.
Les outils de financement sont eux-mêmes de trois ordres : les fonds régionaux de garantie, les fonds régionaux d’innovation et les prêts participatifs de développement.
● Les fonds régionaux de garantie gérés par Bpifrance interviennent systématiquement en complément des fonds nationaux. Ils permettent d’augmenter la part du risque garanti jusqu’à 70 % et facilitent l’accès des entreprises au crédit pour les projets à risque élevé. En 2014, ce sont 246 millions d’euros qui ont été employés au titre des fonds régionaux de garantie (+ 10 % par rapport à 2013) pour 2 618 entreprises soutenues (permettant de garantir 786 millions d’euros de crédits accordés).
● Les fonds régionaux d’innovation permettent de mobiliser les cofinancements de projets innovants entre les régions et Bpifrance, à tous les stades (faisabilité, expérimentation, développement commercial) à travers trois types d’aides : une subvention, une avance remboursable en cas de succès et un prêt à taux zéro pour l’Innovation. En 2014, ce sont 39 millions d’euros qui ont été employés au titre des fonds régionaux d’innovation (+ 5 % par rapport à 2013) pour 593 entreprises financées.
● Les prêts participatifs de développement visent à s’adapter aux spécificités régionales et sont mis en place avec des finalités particulières : prêt écologique, prêt régional de revitalisation, prêt export etc. La région soutient le dispositif au moyen d’une dotation permettant de bonifier le taux du prêt. Sans garantie ni caution personnelle, ces financements bénéficient en outre d’un différé de remboursement en capital qui permet d’alléger la charge financière dans un premier temps. En 2014, ce sont 27 millions d’euros qui ont été employés au titre des prêts participatifs de développement (+ 40 % par rapport à 2013) pour 247 entreprises financées.
Bpifrance souscrit dans les fonds régionaux le plus souvent via ses fonds propres, ou dans certains cas particuliers, via des fonds gérés pour le compte de tiers comme, par exemple, le FNA (Fond national d’amorçage) dans le cadre du PIA. Les autres souscripteurs présents aux côtés de Bpifrance sont généralement les régions, les banques régionales, les mutuelles ou des personnes physiques. Les fonds régionaux ont évolué vers une approche interrégionale, condition le plus souvent nécessaire pour qu’un fonds atteigne la taille critique lui permettant de présenter un modèle économique robuste.
Au 31 décembre 2014, le portefeuille des fonds régionaux/interrégionaux compte 95 véhicules d’investissement. L’apport total des investisseurs s’élève à 2 208 millions d’euros, dont 549 millions d’euros souscrits par Bpifrance, répartis de la manière suivante :
– 18 fonds d’amorçage (155 millions d’euros souscrits par Bpifrance sur un total de 397 millions d’euros) ;
– 13 fonds de capital création/capital risque (53 millions d’euros souscrit par Bpifrance sur un total de 199 millions d’euros) ;
– 64 fonds de capital développement (341 millions d’euros souscrits par Bpifrance sur un total de 1 612 millions d’euros). Il convient de noter que certains fonds dits de capital développement ont une approche généraliste et peuvent réaliser également des opérations de capital création/capital risque.
L’importance des sommes mobilisées à travers ces différents outils renforce d’autant plus la nécessité d’associer plus concrètement les régions à l’élaboration des décisions stratégiques de Bpifrance au niveau national car c’est finalement principalement à travers la gestion des fonds régionaux auxquels elles contribuent que les régions sont associées de manière directe à l’action de Bpifrance.
Chaque collectivité étant désireuse de faire connaître sa participation dans les dispositifs Bpifrance, la gamme de produits peut s’enrichir des nouvelles dénominations (« Prêt Vert », « Prêt régional », etc.) au risque que cette recherche compréhensible de visibilité n’aboutisse à une trop grande complexité.
La question du partage du risque avec les conseils régionaux peut se poser. Certains élus régionaux déplorent, par exemple, de n’avoir pas le taux de rentabilité interne (TRI) des projets refusés par Bpifrance. Ils craignent de voir émerger un modèle dans lequel Bpifrance transmettraient les plus mauvais risques aux régions. Certains, enfin, sont un peu frustrés du manque de visibilité de la région pour les cofinancements.
c. … qui s’appuient sur un réseau d’interlocuteurs de proximité
Bpifrance a cherché à développer un réseau régional répondant à une logique de proximité. Elle dispose de 42 implantations locales, qui constituent un point d’entrée unique pour les entreprises, dont 25 directions régionales et deux directions interrégionales outre-mer.
Ce réseau s’appuie, en pratique, sur une organisation hiérarchisée impliquant, pour chaque niveau, des pouvoirs de décision différents, suivant un schéma bancaire classique.
Bpifrance est ainsi organisée en six grands réseaux. Un réseau est constitué de quatre ou cinq directions régionales et d’une direction de réseau, c’est-à-dire d’un siège décentralisé abritant les services supports chargés de la mise en place concrète des accords signés.
POUVOIRS DE DÉCISION AU SEIN DU RÉSEAU BPIFRANCE
(en euros, par dossier)
Niveau décisionnel |
Capacité maximale de décision |
Délégué |
jusqu’à 1,5 million |
Directeur régional |
jusqu’à 2 millions |
Directeur de réseau |
jusqu’à 3 millions |
Comité d’engagement national |
plus de 3 millions |
Source : audition de Joël Darnaud, directeur du financement et du pilotage du réseau, 26 mars 2015.
Des outils d’aide à la décision (OAD), qui prennent en compte à la fois la situation financière de l’entreprise, la nature du projet et les garanties liées au financement, dégagent une orientation – favorable, réservée, très réservée ou défavorable –, qui permet de graduer les pouvoirs de décision des directeurs régionaux et de réseau. Si l’orientation du dossier est favorable, le directeur régional peut prendre une décision d’un montant maximal de 2 millions d’euros et le directeur de réseau d’un montant maximal de 3 millions. Si l’orientation est réservée, la compétence de décision remonte d’un cran ; en cas d’orientation défavorable et de montant élevé, la décision est prise par le comité des engagements de Bpifrance. Le degré de décision est donc fonction à la fois du montant et du degré de risque déterminé par l’OAD.
Les chargés d’affaires n’ont aucun pouvoir de décision : la réglementation bancaire interdit en effet que les personnes qui prennent les décisions soient les mêmes que celles qui ont étudié les dossiers. Chaque directeur régional a une vision de l’ensemble de la palette des interventions et une capacité de décision jusqu’à 2 millions d’euros. Ainsi, plus de 90 % des décisions sont prises dans les directions régionales.
Cette organisation décentralisée doit favoriser la proximité et des délais de réponse courts.
La densité et l’efficacité de ce réseau régional sont donc primordiales. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la CDC, a estimé, au cours de son audition, qu’un effort s’était avéré nécessaire en termes de couverture territoriale : « la qualité d’une banque se mesure bien sûr à la qualité de ses directeurs d’agence et de ses directeurs régionaux mais les salariés doivent être en nombre suffisant et, lors du dernier comité de suivi, Nicolas Dufourcq a réclamé une dotation importante en personnel supplémentaire, pour répondre à un besoin patent » (18).
L’adoption de la nouvelle carte régionale issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions ne devrait pas entraîner une réduction du nombre d’implantations de Bpifrance. Quatre ou cinq implantations supplémentaires seraient même ouvertes prochainement dans des villes dont le potentiel entrepreneurial justifie cette relation de proximité.
d. Une organisation spécifique outre-mer
Bpifrance doit déployer Outre-mer la gamme de produits qu’elle propose en métropole. Elle a ainsi suscité de fortes attentes dans les collectivités ultramarines. C’est pourquoi le Rapporteur a souhaité organiser une table ronde sur ce thème en réunissant les responsables de Bpifrance, des représentants de la direction générale des outre-mer, les commissaires au redressement productif de ces collectivités ainsi que des représentants du réseau consulaire et des entreprises ultramarins (19).
Selon Marc Del Grande, sous-directeur des politiques publiques à la direction générale des outre-mer, le bilan est indéniablement positif : « les objectifs fixés à Bpifrance pour 2014 ont été atteints et au-delà même de 100 % puisque la production complète est de 524 millions d’euros. On constate que le nombre de dossiers présenté à la médiation du crédit dans les DOM est passé de soixante-six à trente-quatre, soit une baisse de 48 %, entre 2013 et 2014. Les encours de crédit accordés aux entreprises ultramarines ont augmenté d’un peu plus d’un milliard d’euros – une hausse de 5,6 % –, pour un total supérieur aujourd’hui à 20 milliards d’euros (20) ».
L’action de Bpifrance outre-mer s’appuie sur l’Agence française de développement (AFD), dans le cadre d’une convention de prestation de service. Ce choix s’inscrit dans une continuité. Depuis 2009, en effet, les activités d’Oséo dans les collectivités ultramarines étaient portées par l’AFD qui distribuait les lignes de produits pour l’innovation, la mobilisation de créances publiques et des prêts de développement. Le fonds de garantie spécifique que gérait l’AFD pour son propre compte en partageant les risques avec l’État – le fonds DOM – a été clôturé et Bpifrance a repris à son compte cette activité de garantie, par le biais des fonds nationaux que gère Bpifrance pour le compte de l’État.
Deux directeurs interrégionaux de Bpifrance animent sur place les équipes de l’AFD. Outre leur mission de formation et d’animation, ils sont seuls décideurs sur place de plus de 90 % des décisions de crédit et de garantie (non délégables à l’AFD) et assurent également toutes les missions de représentation et les négociations avec les collectivités et les acteurs économiques locaux.
Ce fonctionnement ne satisfait toutefois pas complètement les acteurs. Si la mobilisation des directeurs interrégionaux a été plusieurs fois saluée au cours de la table ronde, les représentants des entreprises et du réseau consulaire souhaiteraient davantage de présence in situ, une meilleure visibilité de Bpifrance et davantage d’accompagnement.
Parmi les initiatives à retenir, figure la mise en place, en partenariat avec le conseil régional de Guyane, d’un prêt de développement territorial d’un montant de 50 000 euros sans cofinancement bancaire, du fait d’un assouplissement des contraintes communautaires sur ce territoire. Disponible en Guyane, ce dispositif devrait bientôt être décliné à La Réunion, puis dans les autres territoires. Par ailleurs, le développement du produit « Avance + » (21) a été ralentie par un problème de conversion de ses systèmes informatiques de l’euro au franc Pacifique que le Rapporteur espère voir rapidement résolu.
Le développement des interventions en fonds propres se heurte en revanche à plus de difficultés. Selon Dominique Caignart, directeur du réseau Île de France de Bpifrance Financement et chargé de l’Outre-mer, « il faut des représentations locales très professionnelles, car il s’agit d’un métier autrement plus complexe que le crédit. Cela suppose une volonté forte et partagée par les trois territoires pour constituer un fonds de taille critique. Un fonds d’investissement ne peut être crédible s’il n’a pas 30 ou 40 millions à investir, et lever de telles sommes pour financer des TPE ou PME ultramarines est irréaliste, ne serait-ce que parce qu’il faut de l’argent privé en miroir de l’argent public. C’est difficile même en métropole, et ce même quand les régions sont prêtes à considérablement investir ».
Enfin, comme l’a reconnu Dominique Caignart, alors que les TPE ne sont pas les cibles prioritaires de la gamme de produits de Bpifrance – même si des produits spécifiques comme des prêts d’amorçage ou l’octroi de garantie pour les investissements des business angels ont permis d’améliorer la situation – celles-ci forment la majorité des entreprises outre-mer.
Dernier point, le déploiement de la gamme de produits et son adaptation aux territoires nécessitent des contacts fréquents avec les interlocuteurs de Bpifrance dans les réseaux bancaires et les collectivités ultramarines. Celui-ci semble pâtir des fréquents changements d’interlocuteurs, comme l’a indiqué Dominique Caignart. Renforcer les équipes de Bpifrance sur le terrain serait certainement un moyen d’accélérer la mise en place de la gamme de produits et d’améliorer la visibilité de Bpifrance en outre-mer.
Proposition : renforcer la présence de Bpifrance outre-mer pour favoriser le déploiement de la gamme de produits et l’information de l’ensemble des acteurs locaux
2. L’inscription incomplète des actions de Bpifrance dans la politique de filières et les plans industriels
Bpifrance doit organiser la complémentarité de son action avec les autres acteurs étatiques pour s’insérer efficacement dans la politique industrielle de l’État.
Sur le plan industriel, cela se traduit notamment par la valorisation d’une expertise sectorielle des chargés de mission de Bpifrance et par la mise en place de fonds dédiés qui contribuent au financement et à la structuration des secteurs et des filières, ce qui est notamment le cas pour des filières comme l’aéronautique, l’agroalimentaire, le nucléaire ou encore les biotechnologies.
Par ailleurs, Bpifrance en tant qu’opérateur de l’État pour le programme d’investissement d’avenir, est directement associée à la mise en œuvre des plans industriels d’avenir sous l’autorité de la direction générale des entreprises (DGE) et du commissariat général à l’investissement (CGI) qui définissent les grandes orientations et les modalités de mise en œuvre de ces programmes.
L’articulation d’ensemble de ces interventions demeure cependant complexe à appréhender puisqu’elle fait intervenir différents acteurs qui entretiennent entre eux des relations tantôt ponctuelles tantôt plus organisées.
À cet égard, les services du ministère de l’Industrie, en particulier les commissaires au redressement productif, ont souvent exprimé leur déception de ne pas trouver l’appui de Bpifrance dans le traitement des divers dossiers industriels, notamment d’entreprises en difficulté dont ils ont connaissance à travers le territoire.
a. Bpifrance en tant qu’opérateur des investissements d’avenir
Lorsqu’elle agit en tant qu’opérateur de l’État, notamment dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA), Bpifrance met en œuvre une politique définie au niveau national. En 2014, la banque publique s’est ainsi vu confier 2,8 milliards d’euros de ressources nouvelles, dédiées au financement des priorités économiques déterminées par l’État. Par exemple, la gamme de prêts de développement « Usine du Futur », faisant partie des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, couvre 4 thématiques :
– 340 millions d’euros de prêts verts bonifiés, accordés à des entreprises qui investissent pour améliorer leur compétitivité via l’amélioration de la performance environnementale de leur process industriel ou de leurs produits ;
– 300 millions d’euros de prêts robotiques bonifiés, destinés à financer l’investissement des entreprises engagées dans des projets structurants d’intégration d’équipements de production automatisés comme les robots ;
– 270 millions d’euros de prêts pour l’industrialisation, non bonifiés, destinés à créer l’effet déclencheur nécessaire pour permettre l’industrialisation et la commercialisation d’un produit, d’un procédé ou d’un service innovant ;
– 300 millions d’euros de prêts numériques bonifiés, destinés à financer l’investissement des entreprises engagées dans la transition numérique pour renforcer leur compétitivité. À noter que cette enveloppe a été intégralement distribuée en 2014.
Par ailleurs, et toujours en appui des 34 plans, 425 millions d’euros de fonds propres ont abondé le Fonds SPI (Sociétés de Projets Industriels), premier fonds d’investissement de Bpifrance destiné à financer des sociétés, spécialement créées pour porter un projet, aux côtés de partenaires industriels. Bpifrance se mobilise également pour la French Tech (Fonds French Tech Accélération, pour des investissements en fonds propres dans les structures d’accélération) ou bien encore dans le cadre du programme de soutien aux innovations majeures, avec 150 millions d’euros de fonds propres sur les sept thématiques de la commission présidée par Anne Lauvergeon.
Cette cohérence dans le domaine des investissements d’avenir ne se retrouve pas nécessairement en termes de politique industrielle, et notamment de soutien aux filières, bien que Bpifrance ait cherché à organiser son action par la mise en place de fonds et de dispositifs spécifiques correspondant à chaque filière.
b. Développer l’intégration de l’action de Bpifrance et des politiques de filières et de soutien aux entreprises industrielles
L’avis du Conseil national de l’industrie (CNI) sur le financement des entreprises industrielles, publié le 3 décembre 2014, rappelle les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises travaillant dans le secteur industriel pour accéder au financement bancaire. Conjointement avec la politique de filières élaborée par l’État, Bpifrance doit jouer un rôle spécifique pour combler cette défaillance de marché.
C’est pourquoi le CNI recommande l’extension des capacités de Bpifrance en matière de prêts de développement, qui constituent un moyen de financement particulièrement apprécié des PME industrielles, avec un effet de levier sur les établissements de crédit qui interviennent en cofinancement (70 % de ces prêts de développement sont accordés à des entreprises industrielles). Les encours de 1,3 milliard d’euros en 2013, méritaient en conséquence d’être augmentés. La mission d’information prend ainsi acte de la décision récente du gouvernement de porter sur la période 2015-2017 à 8 milliards d’euros l’enveloppe des prêts de développement, soit environ 2,6 milliards d’euros par an.
L’analyse par Bpifrance de ses interventions de toute nature (hors Bpifrance Participation) en fonction des secteurs d’activité en 2014 montre en effet que son action en faveur de l’industrie ne représente que 25 % de ses engagements, soit 5,1 milliards d’euros, et 6,2 milliards d’euros (soit 31 %) si on y inclut le numérique. La part et le montant alloués à l’industrie ont toutefois sensiblement progressé en 2014, faisant suite à cinq années d’une quasi-stabilité en montant et d’une baisse en pourcentage. L’analyse par type d’intervention montre que ce sont les prêts de développement et les prêts à l’innovation qui sont à l’origine de cette dynamique. En effet, compte tenu de sa forte propension à innover, l’industrie capte 75 % de l’aide à l’innovation, 94 % en comptant le numérique.
Cependant, la part de l’industrie dans l’activité d’investissement de Bpifrance (hors Bpifrance Participation) n’atteint que 20 %, soit 344 millions d’euros. Même avec le numérique, elle atteint à peine 550 millions d’euros en 2014, soit 32 %. Bpifrance précise toutefois que c’est une évaluation minorante car elle ne dispose pas des informations en provenance des fonds affiliés.
La mission d’information rejoint la proposition du CNI et recommande qu’un suivi statistique plus précis soit mis en place sur cet axe d’intervention de Bpifrance, essentiel à la stratégie de consolidation des PME industrielles évoquée ci-dessus.
Proposition : mettre en place un suivi statistique plus précis sur les financements octroyés aux entreprises industrielles par Bpifrance, en exigeant notamment des équipes de gestion des fonds de fonds des informations spécifiques à ce titre.
La représentation de l’industrie dans l’activité de garanties de prêts bancaires apparaît également faible (21 %). Le résultat est meilleur pour les prêts à moyen et long terme (prêts de développement et cofinancement) mais la part de 30 % reste en dessous des attentes que porte le CNI à l’action de Bpifrance en faveur des PME et ETI industrielles. Compte tenu de son intensité capitalistique, l’industrie génère en effet un besoin de financement largement supérieur aux autres secteurs de l’économie.
Les membres de la mission d’information rejoignent les interrogations exprimées par le CNI. Ils se sont également étonnés du fait que des entreprises s’inscrivant pleinement dans le cadre d’une politique de filière ou d’implantation industrielle définis par l’État n’aient parfois pas bénéficié d’une attention et d’un soutien financier de la part de Bpifrance lorsqu’elles en faisaient la demande.
Proposition : accorder une priorité au soutien aux entreprises qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan industriel ou d’une filière érigée en priorité de la politique industrielle de l’État lorsqu’elles émettent des demandes de financement ou d’investissement en fonds propres.
Enfin, une meilleure articulation entre l’État et ses opérateurs serait de nature à éviter le dépérissement de certains outils de politique industrielle, tel que le fond de modernisation des équipementiers automobile (FMEA), lancé par le FSI en 2009 et dont la banque publique a hérité lors de sa création. En effet, ce fonds sectoriel doté de 650 millions d’euros n’a opéré que trente investissements pour un montant total de 330 millions d’euros, soit un taux de consommation à peine supérieur à 50 %.
Si Bpifrance ne peut être tenue responsable de cet échec (22), qui trouve également son origine dans l’inertie déployée par les grands constructeurs automobiles associés à ce fonds qui s’y sont montrés hostiles pour des raisons de concurrence, cette expérience démontre néanmoins qu’une vision industrielle plus cohérente et mieux articulée entre les différents échelons permettrait certainement un meilleur emploi de l’argent public.
De la même manière, la conduite de certains projets industriels, pourtant favorablement perçus par les autorités déconcentrées de l’État et les autorités territoriales, se heurtent parfois à un refus de la part de Bpifrance, en particulier lorsqu’il semble difficile de conduire ces investissements à parité avec un partenaire privé. Parmi d’autres, le cas du sidérurgiste Celsa, à Bayonne s’inscrit dans ce cas de figure. Cela renvoie au constat plus général d’une difficulté de gouvernance potentielle puisque la CDC, n’étant pas actionnaire majoritaire, et malgré la prééminence dont elle est censée jouir en matière d’investissement, ne peut guider la décision de la BPI.
Plus généralement, la capacité d’appel des autorités déconcentrées de l’État à Bpifrance, qu’elles émanent des préfectures ou des commissaires au redressement productif, devrait être renforcée, notamment dans le cas des entreprises en difficulté qui fait l’objet d’un développement spécifique au sein ce rapport.
Proposition : favoriser la coopération entre les services déconcentrés de l’État et Bpifrance en matière d’investissement et de soutien aux entreprises en difficulté afin de renforcer la cohésion de la politique industrielle dans les territoires.
C. À LA RECHERCHE D’UN FONCTIONNEMENT EXEMPLAIRE
Bpifrance est une entreprise publique créée par la loi, fonctionnant grâce à des fonds et des crédits publics. À ce titre, son fonctionnement ne doit pas simplement être économiquement efficace mais aussi moralement et socialement irréprochable. Outre le dynamisme, la réactivité, la performance et la satisfaction du client, Bpifrance doit faire siennes les valeurs de transparence, de bonne gestion de l’argent public – tant dans son fonctionnement que dans son action – et d’impartialité exigée du service public.
1. Une politique des ressources humaines qui doit être irréprochable
La politique sociale de la banque publique d’investissement repose sur un équilibre subtil. Outre la nécessité de créer des synergies entre des entités fusionnées ou rapprochées par le groupe, Bpifrance doit être suffisamment attractive pour répondre à ses besoins de recrutement sur un marché où évoluent d’autres employeurs redevenus très compétitifs, tout en respectant le cadre imposé par le Gouvernement en matière de rémunération dans les entreprises publiques. De surcroît, plusieurs personnes auditionnées ont aussi souligné l’importance de diversifier les recrutements opérés par Bpifrance, en faveur de profils issus du monde industriel et non seulement du métier de la banque.
a. Des rémunérations encadrées, conformément aux engagements du Président de la République
Conformément aux engagements du Président de la République sur l’encadrement et la moralisation des rémunérations dans les grandes entreprises publiques, les rémunérations des collaborateurs de Bpifrance sont encadrées par des dispositions législatives et réglementaires.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 2012 prévoit que le montant des rémunérations est rendu public sur une base annuelle. Le décret du 26 juillet 2012 (23) fixe à 450 000 euros bruts le plafond de la rémunération annuelle d’activité des dirigeants d’entreprises publiques, soit vingt fois la moyenne des plus bas salaires de ces entreprises. Comme l’a affirmé justement le ministre de l’Économie et des finances dans sa communication au Conseil des ministres du 13 juin 2012, « les excès en matière de rémunérations, qui sont dommageables pour les entreprises comme pour la cohésion sociale, imposent de prendre des mesures pour moraliser et encadrer les rémunérations des dirigeants d’entreprises. »
La plus haute rémunération – celle du directeur général de Bpifrance – est donc plafonnée à 450 000 euros, dont une part fixe de 400 000 euros et une part variable attribuée sur objectifs quantitatifs (60 %) et qualitatifs (40 %) de 50 000 euros.
S’agissant des niveaux et écarts de salaires, la moyenne des rémunérations fixes au 31 décembre 2014 pour l’ensemble du groupe Bpifrance (salaire de base temps plein, brut annuel) est de 54 643 euros pour une médiane de 46 740 euros. L’écart entre les 10 % des rémunérations les plus hautes et les 10 % les moins importantes est de 4,1. L’écart entre la plus basse et la plus haute rémunération au sein de Bpifrance est de 1 à 18.
b. Un effort d’harmonisation au niveau de BPI-Groupe
Fusion d’entités préexistantes, la Banque publique d’investissement doit aussi parvenir à une politique de rémunération harmonisée.
La politique de rémunération est déterminée par les instances dirigeantes, à savoir par les conseils d’administration de chaque entité et du groupe. Chaque conseil d’administration s’est doté d’un comité des rémunérations qui émet des avis et des recommandations. Coexistent donc, au sein de Bpifrance, deux politiques de rémunération distinctes : une pour l’entité Bpifrance Financement, l’autre pour Bpifrance Investissement. Un effort d’harmonisation est néanmoins poursuivi dans le cadre de BPI-Groupe.
ÉVOLUTION DU MONTANT TOTAL DES RÉMUNÉRATIONS
(en millions d’euros)
Année |
2013 |
2014 |
Évolution |
Montant des rémunérations |
122,6 |
128,5 |
+ 4,8 % |
Source : rapport annuel 2014 de BPI-Groupe.
Selon Nicolas Dufourcq (24), « les différences de rémunérations versées par les quatre entités qui ont formé Bpifrance étaient assez marquées. Nous avons entièrement révisé la structure des rémunérations et nous entendons parvenir à l’harmonisation en six ans. Nous corrigerons progressivement les décalages en commençant par les plus bas salaires, ceux des fonctions support en particulier ; nos actionnaires ont aussi donné leur accord pour que certaines catégories salariales soient repositionnées. »
Pour Bpifrance Investissement, il existait, avant le regroupement au sein de la société des équipes d’investisseurs du FSI et FSI Régions, trois systèmes de rémunération (CDC Entreprises, FSI, FSI Régions). Depuis le rapprochement des équipes, ces dispositifs ont été harmonisés dans le cadre de la construction sociale de la société de gestion unique. D’après les éléments transmis par Bpifrance, cette harmonisation repose principalement sur trois volets :
– l’intéressement est désormais limité à 9 % du salaire brut de référence, contre 10 % de la rémunération incluant la part variable ;
– une formule dérogatoire prévoit que la participation est plafonnée à 1 % du salaire brut de référence pour Bpifrance Financement et à 8 % pour Bpifrance Investissement ;
– la prime variable sur objectifs (PVO) n’est plus garantie à 80 % mais versée uniquement en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Au jour de la publication du présent rapport, Bpifrance ne dispose pas d’une enquête de rémunération complète permettant de comparer toutes les rémunérations aux moyennes du marché. Deux études ciblées, conduites en 2014, ont cependant mis en lumière un risque de « perte de talents » sur les métiers de service à la clientèle, qui concernerait environ 500 collaborateurs, et un risque juridique en ce qui concerne l’égalité de traitement des collaborateurs de Bpifrance Financement avec celui de leurs homologues de Bpifrance Investissement.
Ces études ont conduit à prévoir deux enveloppes budgétaires pluriannuelles bien identifiées pour revaloriser la rémunération de deux catégories de collaborateurs de Bpifrance Financement notoirement en décalage avec celles du marché : parmi les collaborateurs des fonctions support, ceux dont la rémunération est inférieure de 10 % à la médiane du marché ; parmi les chargés de clientèle, ceux dont la rémunération est inférieure de 15 % à la médiane du marché. Ces revalorisations (respectivement de + 1,9 % et + 1,8 % de la masse salariale) ont été étalées sur quatre ans.
c. Des recrutements nécessaires
Le suivi des effectifs et de la masse salariale à partir des rapports annuels de Bpifrance présente des difficultés. Bpifrance SA ayant été constituée le 12 juillet 2013, le compte de résultat 2013 ne présentait qu’un semestre d’activité. Les chiffres présentés dans les tableaux ci-dessous sont donc issus de retraitements proposés par Bpifrance pour permettre une comparaison.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2010
(en nombre de salariés, sauf mention contraire)
Nombre de salariés au |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Évolution 2010-2012 |
Évolution 2013-2014 |
Bpifrance Financement |
1 641 |
1 641 |
1 655 |
1 820 2 |
1 853 2 |
+ 0,9 % |
+ 1,8 % |
Bpifrance Participations |
55 |
56 |
63 |
73 1 |
18 1 |
+ 14,5 % |
– 75,3 % 3 |
Bpifrance Investissement |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
265 2 |
299 2 |
- |
+ 12,8 % |
BPI-Groupe |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
2 085 2 |
2 152 2 |
- |
+ 3,2 % |
s.o. : sans objet. (1) Désormais inclus dans les effectifs de Bpifrance Investissement. (2) Données fournies par Bpifrance après retraitements. (3) La baisse de 75,3 % s’explique par l’intégration progressive de Bpifrance Participations dans Bpifrance Investissement.
Source : rapports annuels, Bpifrance.
ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE DEPUIS 2010
(en milliers d’euros, sauf mention contraire)
Masse salariale au 31 décembre |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Évolution 2010-2012 |
Évolution 2013-2014 |
Bpifrance Financement |
91 670 |
100 697 |
100 584 |
100 187 |
108 843 |
+ 9,7% |
+ 8,2% |
Bpifrance Investissement |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
n.c. |
n.c. |
- |
n.c. |
BPI-Groupe |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
219 000 |
240 500 |
- |
+ 9,8 % |
s.o. : sans objet. n.c. : non connu. Les données relatives à Bpifrance Financement sont issues des rapports annuels. Les données relatives à BPI-Groupe ont été transmises par Bpifrance après retraitements. Les données relatives à Bpifrance Investissement ne sont pas disponibles.
Source : rapports annuels, Bpifrance.
Entre 2013 et 2014, les effectifs de BPI-Groupe ont crû de 3,2 %. Les charges de personnel sont en hausse de 9,8 % entre 2013 et 2014.
En 2015, 172 CDI capacitaires (équivalent temps plein de fin d’année) seront recrutés, soit 8 % de l’effectif 2014. Ces forts besoins de recrutement s’expliquent par la nécessité d’accompagner la croissance de Bpifrance, en particulier sur certains métiers stratégiques bien identifiés, comme le financement de l’innovation, mais aussi par la montée en puissance de la mission de préfinancement du CICE.
En dépit des recrutements annoncés, le Rapporteur estime que les ressources humaines de la branche Investissement sont encore en décalage avec les ambitions de Bpifrance. Une étude comparative transmise par Bpifrance au Rapporteur fait apparaître que les chargés d’affaires de Bpifrance ont des responsabilités (en nombre de dossiers suivis et en montants) significativement plus élevées que dans les autres fonds d’investissement comparables. Dans ces conditions, on peut douter de la capacité des chargés d’affaires de Bpifrance à évaluer réellement le respect des normes sociales et environnementales ambitieuses qu’elle dit pourtant fixer pour ses investissements (cf. partie II. B. 3. , page 95).
Par ailleurs, il est souhaitable que Bpifrance, qui recrute majoritairement des profils à compétences financières, diversifie ses recrutements. Le financement des entreprises innovantes, en particulier, est un métier pour lequel Bpifrance doit recruter des profils industriels. Ainsi, afin de couvrir l’ensemble des domaines techniques et de compléter les compétences existantes, Bpifrance a recruté en 2014 des profils dans les domaines de l’énergie, des transports et de l’aéronautique. Les volumes restent cependant faibles au regard de l’ensemble des recrutements.
2. Une gestion qui doit être performante et aussi transparente
a. Une politique de communication ambitieuse
Bpifrance est une organisation jeune, issue de la fusion d’entités préexistantes, dont le positionnement institutionnel et stratégique n’est pas toujours facile à comprendre de ses clients ou de ses partenaires. Sa gamme de produits est particulièrement vaste. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 2012, la banque publique d’investissement a aussi une mission d’accompagnement : « elle développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises tout au long de leur développement. » Tous ces éléments concourent à faire de la communication un enjeu fort du déploiement de Bpifrance.
Comme l’indiquait M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, au cours de son audition, « il a fallu remplacer quatre marques – OSÉO, FSI, FSI Régions, CDC Entreprises – par une seule […] faire savoir aux entrepreneurs que Bpifrance est leur banque, qu’elle les considère comme des clients et non comme des risques et qu’elle est à même de leur redonner du dynamisme et de les inciter à voir loin et grand […] faire connaître à tous les publics – clients et partenaires – les missions et les métiers de Bpifrance. » (25).
Ces enjeux ont poussé Bpifrance à une politique de communication innovante et multi vectorielle dont les résultats sont indéniables. La marque s’est imposée dans le paysage national et la réussite du lancement de Bpifrance a été unanimement saluée au cours des auditions.
En 2014, les dépenses de communication paraissent raisonnables au regard des enjeux précités et des sommes dépensées par des entreprises comparables (26). Elles ont ainsi représenté 11,7 millions d’euros (27), détaillées de la manière suivante :
– 4,1 millions d’euros, au titre des partenariats média et campagnes d’information (presse quotidienne régionale, presse quotidienne nationale, digital, télévisions locales, affichage, achat d’espace) (28) ;
– 2,4 millions d’euros de communication interne (notamment les Rencontres en région, le Lab, Cap Invest...) ;
– 1,85 million d’euros, au titre des évènements et salons (notamment les salons en région, le Salon des Entrepreneurs, Planète PME, ainsi que les événements en propre comme le lancement du fonds ETI 2020 et de fonds sectoriels) ;
– 1 million d’euros pour la production de contenus et divers frais techniques (édition, publications, évènements en région) ;
– 1 million d’euros au titre des déplacements, des bases de données, des frais de locaux et divers ;
– 850 000 euros pour des prestations externes d’agences de conseil (29) ;
– 540 000 euros pour les outils et les sites web (sites Bpifrance, Le Lab, les applications mobiles, etc.)
En outre, la direction de la communication de Bpifrance peut s’appuyer sur 22 équivalents temps plein tandis que celle des relations institutionnelles et des médias en compte 9.
D’après les éléments transmis en réponse aux questions de la mission d’information, les dépenses de communications de Bpifrance seront stables dans les prochaines années.
b. Un nouvel axe fort qui pourrait être la transparence
Le Rapporteur invite cependant Bpifrance à davantage de sobriété dans sa communication. À l’heure où le redressement des comptes publics impose des efforts à toutes les administrations et à quelques semaines de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, l’envoi en masse de versions reliées des rapports d’activité 2014 est discutable. Des responsables de l’administration déconcentrée rencontrés par le Rapporteur ont ainsi jugé « dispendieux » les coffrets envoyés par Bpifrance. Chaque parlementaire a été destinataire de ces tirages luxueux, à l’heure de choix parfois difficiles sur les crédits de certaines missions du budget de l’État.
Dans le même temps, force est de constater que les informations contenues dans les rapports de Bpifrance s’amenuisent. Alors que le bilan d’activité 2013 était remarquable par la clarté de sa présentation, son effort de pédagogie et la quantité de données disponibles, facilement exploitables, la version 2014 constitue une présentation avantageuse et beaucoup plus succincte. Les rapports annuels de BPI-Groupe, Bpifrance Financement, Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement sont, à certains égards, moins détaillés qu’en 2013. Les comparaisons sont rendues difficiles par des changements de présentation ou de périmètre dont la justification est difficile à comprendre.
Au cours des auditions, des déplacements et par le biais d’échanges avec des entrepreneurs tout au long de la mission, le Rapporteur a eu le sentiment que Bpifrance n’était pas toujours un acteur bien identifié et que son rôle n’était pas toujours compris des très petites entreprises. Un commissaire au redressement productif, rencontré sur le terrain, a ainsi évoqué « une réussite nationale mais des frustrations locales. ». Le Rapporteur n’a pu que constater que les très fortes attentes formulées à l’égard de Bpifrance se heurtaient souvent à la réalité.
En dépit de la mobilisation de plusieurs outils en leur faveur, la recherche d’une complémentarité avec le secteur bancaire ou avec les régions peut contribuer à rendre Bpifrance peu visible des plus petites entreprises. C’est une préoccupation structurelle, qu’elle partage avec son homologue allemande, la KfW. En outre, les responsables de Bpifrance ainsi que certains membres de son conseil d’administration ont pu estimer que les plus petites entreprises n’étaient pas le cœur de cible d’une banque publique d’investissement censée préparer l’avenir et les champions nationaux de demain.
Le Rapporteur rappelle néanmoins qu’aux termes de la loi, la banque publique d’investissement « oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. » Il souligne enfin que les ressources de Bpifrance sont majoritairement publiques. Toutes les entreprises expriment des attentes fortes envers la banque publique d’investissement qui, si elles doivent être conciliées entre elles et faire l’objet d’arbitrages, méritent des réponses et un effort de pédagogie.
Le Rapporteur recommande donc que Bpifrance, en lien avec ses actionnaires, et plus particulièrement l’État, se dote d’un axe de communication destiné à rendre compte de son action auprès du plus grand nombre.
Proposition : normaliser le contenu des principaux documents d’information produits par Bpifrance et veiller à ce que la communication de Bpifrance soit déployée auprès de toutes les entreprises, y compris auprès des plus petites.
3. La qualité du service aux entreprises
a. Une banque au service de toutes les entreprises
En 2014, Bpifrance a soutenu 82 000 entreprises (30) (hors grandes entreprises et autres bénéficiaires (31)) totalisant 1,3 million d’emplois pour un total de financement de 18,1 milliards d’euros.
● 69 % de très petites entreprises (TPE) qui ont bénéficié de 26 % des financements. Ces entreprises (57 000) sont principalement des entreprises en création, soutenues via un dispositif de garantie ou bénéficiant d’un prêt pour la création d’entreprise ou PCE (59 %) (32).
● 26 % de PME (33) qui ont reçu 49 % des financements. Bpifrance a ainsi soutenu 15 % des 125 000 PME françaises. Les PME financées, l’ont été principalement via la mobilisation de créances pour financer leur cycle d’exploitation (52 %). L’investissement, représente plus de 31 % des financements reçus par les PME.
● 5 % des bénéficiaires appartiennent à des ETI (34) et ont reçu 25 % des financements. Plus d’une ETI française sur trois a ainsi été soutenue par Bpifrance en 2014. Elles ont bénéficié de soutiens pour financer leur cycle d’exploitation, via le préfinancement du CICE et la mobilisation de créance (70 %) et de soutien en investissement. Le financement de l’investissement représente plus de 41 % des financements octroyés aux ETI.
POSITIONNEMENT DE BPIFRANCE DANS SON ENVIRONNEMENT EN 2014
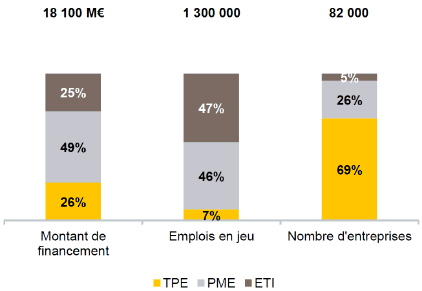
Source : Bpifrance.
CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES PAR FINALITÉ ET PAR DISPOSITIF EN 2014
(en nombre de bénéficiaires)
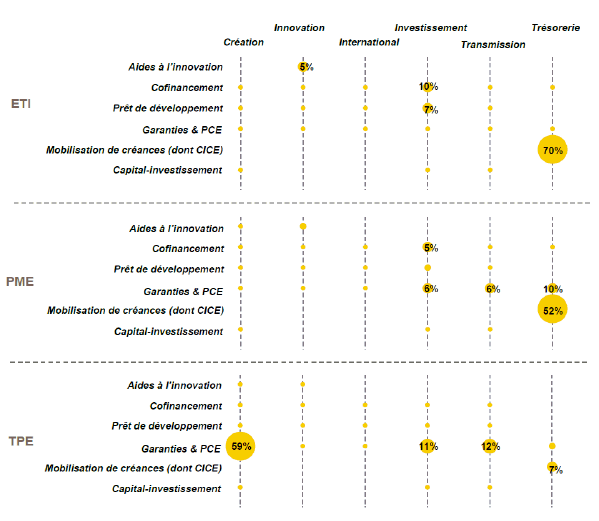
Source : Bpifrance.
b. Un effort notable de simplification et de réduction des délais
Bpifrance a été conçue avec l’objectif de simplifier l’accès au financement des entreprises. Ainsi, Nicolas Dufourcq affirmait au cours de sa première audition que « les principes qui régissent notre intervention sont une attention portée de manière primordiale au client, la simplicité, la réduction des délais et la lutte contre toutes les dérives bureaucratiques ».
Cet effort de simplification a pris des formes différentes selon les activités.
● L’activité Innovation est sans conteste celle pour laquelle l’enjeu de simplification et de réduction des délais était le plus important. Les multiples sources de financement public de l’innovation (programme d’investissements d’avenir, crédits budgétaires, aides de la direction générale des entreprises (DGE), fonds européens) frein à l’efficacité administrative. Un plan stratégique, dit « Nova », a permis :
– de diviser par trois les délais d’instruction des programmes collaboratifs ;
– de diminuer de 23 % les délais de décision pour les projets individuels ;
– de passer de quinze à un formulaire pour les demandes d’aides à l’innovation.
L’action de Bpifrance au service du financement de l’innovation a été saluée unanimement au cours des auditions et suscite un remarquable consensus en dépit des nombreux défis que cette performance implique, notamment en termes de coordination des acteurs publics (cf. partie III).
● S’agissant de l’activité Financement, la décentralisation des décisions a permis de réduire les délais. Elle devrait aussi rendre les échanges avec Bpifrance plus aisés de manière à mieux faire partager le sens de ces décisions.
L’analyse de l’évolution des délais (entre la date de demande de l’entreprise et la date de réponse) entre 2012 et 2014 montre une amélioration de la situation en dépit d’une croissance soutenue de l’activité.
ÉVOLUTION DES DÉLAIS ENTRE LA DATE DE DEMANDE ET LA DATE D’ACCORD
(en jours)
Décisions |
2012 |
2013 |
2014 |
Cofinancement |
50 |
48 |
44 |
dont prêts de développement |
53 |
48 |
42 |
Court terme |
43 |
24 |
27 |
Garantie |
17 |
16 |
15 |
Source : Bpifrance.
Seule exception, selon Bpifrance : les délais concernant les produits de court terme ont eu tendance à augmenter entre 2013 et 2014 : cette dégradation est le fruit de l’augmentation des délais concernant les demandes de préfinancement du CICE, elle-même conséquence de l’augmentation des délais de traitement du service des impôts des entreprises (SIE) de la direction générale des finances publiques (DGFiP) chargé de la délivrance du certificat de créance fiscale, plus précisément indispensable s’agissant du préfinancement. La mission de préfinancement du CICE a en effet pris une importance inattendue qu’il convient d’analyser (cf. partie II. C. 3. a. page 110).
Les personnes entendues au cours des auditions par la mission d’information n’ont fait état que de quelques retards observés localement. Ils relèvent, selon Nicolas Dufourcq, du management, tandis que d’autres personnes auditionnées ont évoqué un manque de moyens humains et financiers.
Il serait sans doute souhaitable que Bpifrance présente une évolution de ces délais de réponse par région pour identifier, le cas échéant, la nécessité de renforcer sa présence sur le terrain.
● S’agissant de l’activité Investissement, Bpifrance n’a pas précisé ses délais de réponse, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’elle n’investit jamais seule mais participe à des « tours de table ». Sa performance dépend donc de celle des autres acteurs de la place.
Elle fait valoir que son enquête auprès des entreprises investies met en évidence un jugement positif quant aux délais de prise de décision. Près de 6 entreprises sur 10 jugent que Bpifrance est aussi réactive que ses co-investisseurs privés, 3 sur 10 plus réactive, et seulement 1 sur 10 juge Bpifrance moins réactive. Mais cette enquête ne vise que les entreprises dans lesquelles Bpifrance a finalement investi.
Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, membre de la commission de surveillance de la CDC, a estimé, devant la mission d’information, que la constitution de dossiers de demande de fonds propres restait complexe : Bpifrance « contraint les PME qui la sollicitent à effectuer des audits très onéreux. De tels réflexes seraient plus pertinents à l’égard des grands groupes. Dans le dialogue avec les PME, la BPI ne témoigne pas de souci de simplification. Bien qu’elle se comporte mieux que les autres banques, elle pourrait donc encore progresser. (35) »
Le Rapporteur n’a pas recueilli d’éléments convergents allant dans ce sens. Au cours d’une même réunion, un entrepreneur a ainsi fait part de ses difficultés face à des demandes complexes tandis qu’une dirigeante d’entreprise rétorquait qu’elle se rendait directement à la direction régionale de Bpifrance, son dossier à la main, où on l’accueillait avec beaucoup de bienveillance.
Bpifrance insiste quant à elle sur le fait que ses enquêtes de satisfaction – dont le détail n’est pas public et n’a pas été communiqué au Rapporteur – ne mettent pas en lumière une insatisfaction des sondés sur la complexité administrative et rappelle que les entrepreneurs peuvent s’adresser directement aux directions régionales.
c. Une mission d’accompagnement qui mériterait d’être mieux définie
L’accompagnement des entreprises fait partie des missions fixées à Bpifrance par la loi, qui dispose que la banque publique d’investissement « développe une offre de service et d’accompagnement des entreprises tout au long de leur développement » (36). C’est pourquoi Bpifrance a mis en place une offre de produits financiers adaptée à chaque étape. Elle accompagne aussi les PME et ETI en tant qu’actionnaire minoritaire lorsqu’elle intervient en fonds propres.
Mais l’accompagnement des entrepreneurs et non seulement des entreprises est une autre lecture possible du texte de loi. Il fait d’ailleurs partie des priorités annoncées par le directeur général de Bpifrance pour 2015, ce dont le Rapporteur se félicite.
Une stratégie nationale d’accompagnement a ainsi été mise en place. Il s’agit de mettre à la disposition des chefs d’entreprise une offre de diagnostics stratégiques de bonne qualité et un suivi et de mobiliser les acteurs publics ou ceux de « l’écosystème » dans lequel se trouve l’entreprise.
● Le programme « Accélérateur PME » propose des outils de diagnostic commercial, de gestion des ressources humaines et de reporting. Il est destiné à environ 75 PME qui seront suivies pendant trois ans par un accompagnement à la définition puis à l’exécution de projets de développement. Une première « promotion » a été lancée en 2015, une deuxième devrait suivre l’an prochain.
● Le programme « Initiative Conseil » est destiné aux ETI. Il consiste à inciter les dirigeants de ces sociétés à rédiger, avec l’aide de Bpifrance, le plan stratégique qui leur fait défaut – l’entreprise versant pour cela 5 000 euros, Bpifrance autant. 150 de ces « flashes stratégiques » seraient réalisés en 2015 avant d’être évalués, dans trois ans.
● Le programme « French Tech » est destiné à des entreprises innovantes en croissance rapide et repose sur la coordination des actions de Business France, de la Coface, des pôles de compétitivité et de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
● Le programme « Bpifrance Export » destiné à 1 000 ETI et PME de croissance (cf. partie III-C-2 du présent rapport, page 142).
● Bpifrance Université propose des formations de haut niveau répondant à des besoins très divers, conçues en partenariat avec les écoles de commerce HEC et EMLYON. Bpifrance a également créé, avec les régions, un portail de formation en ligne proposant des modules courts.
● Bpifrance Excellence est un réseau social permettant aux entrepreneurs d’échanger leurs bonnes pratiques.
Au-delà du financement, les entreprises sont demandeuses de conseils, de mises en relation. Selon les équipes de la direction régionale de Bpifrance Paris Ouest, le contact direct avec les chefs d’entreprise est primordial. Un bon chargé d’affaires se doit de devenir une référence sur le territoire. Sa carte de visite doit circuler de façon autonome.
L’accompagnement des TPE, des PME et la formation des chefs des petites entreprises restent en outre un sujet majeur, qui dépasse le seul cadre de Bpifrance. Selon Augustin Landier, professeur à l’École d’économie de Toulouse et coauteur d’une étude sur le financement des PME (37), « notre étude sur le financement des PME a clairement mis en lumière que ces dernières souffraient souvent d’une méconnaissance de base des mécanismes comptables, administratifs et financiers, qui pénalisait les chefs d’entreprise. Il y a donc là un véritable besoin, auquel entend d’ailleurs répondre la BPI en lançant Bpifrance Université ».
Le Rapporteur a pu appréhender la diversité des pratiques dans les directions régionales. Elles manifestent souvent un vrai souci d’information et d’accueil des entrepreneurs, tout en soulignant un décalage entre les moyens humains du réseau Bpifrance et les besoins. En moyenne, une direction régionale regroupe une vingtaine de personnes. Dans ces conditions, un suivi individuel de masse paraît devoir s’appuyer sur d’autres acteurs. Pourtant, les chargés d’affaires de Bpifrance, comme la plupart des personnes auditionnées sur ce thème, estiment que l’accompagnement et la formation des dirigeants des TPE et PME sont primordiaux et mériteraient d’être renforcés.
Il existe donc un enjeu de coordination très fort avec les conseils régionaux, les chambres de commerce et d’industrie, les associations professionnelles et les banques commerciales. Si ces enjeux paraissent bien identifiés par les cadres de Bpifrance, il existe peu d’indicateurs qui permettent de mesurer les besoins et les réponses apportés par Bpifrance. Avec le temps, il serait souhaitable de disposer de davantage d’informations sur l’impact des programmes d’accompagnement menés par Bpifrance et, plus généralement, sur l’évolution des besoins d’accompagnement des chefs d’entreprise dans l’accès au crédit. Une telle évaluation pourrait être conduite sous l’égide de l’Observatoire du financement des entreprises.
Proposition : poursuivre le développement de la mission d’accompagnement de Bpifrance
– en établissant des partenariats clairs avec les acteurs consulaires, associatifs ou régionaux ;
– en informant davantage les chefs d’entreprise dans les supports de communication sur l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier ;
– en se dotant d’indicateurs sur l’évolution des besoins d’accompagnement des chefs d’entreprise.
II. UNE STRATÉGIE REPOSANT SUR LA DYNAMISATION DU MARCHÉ PRIVÉ MAIS DONT LE CADRE POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ
A. UNE DOCTRINE D’INTERVENTION LARGE MAIS SOUMISE A DES CONTRAINTES FORTES
1. Les questions posées par la doctrine d’intervention
a. L’étendue des missions attribuées à Bpifrance par la loi ne se retrouve pas complètement dans sa doctrine d’intervention
L’article 1er de la loi créant la BPI prévoit un éventail large de missions entrant dans son champ d’action. En effet, celui-ci dispose que la banque publique :
– agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les régions ;
– en soutien de la croissance durable et de l’emploi ;
– qu’elle favorise l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises ;
– qu’elle oriente en priorité son action vers les TPE, les PME et les ETI en particulier celles du secteur industriel ;
– accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement des filières et le développement des secteurs d’avenir ;
– apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique ;
– ou encore stabilise l’actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité.
Ce vaste éventail de missions conférées par la loi à Bpifrance n’offre a priori que peu de limites à l’action de celle-ci. En se fondant sur les propos de diverses personnalités qui ont participé directement ou indirectement à la mise en place de Bpifrance, il apparaît que de nombreux ministères ont cherché à faire prendre en considération leurs thématiques propres dans les missions attribuées à la banque, espérant ainsi trouver une source de financement supplémentaire.
A contrario, la doctrine n’a été discutée qu’au niveau des représentants de la direction du Trésor, de la CDC et de la BPI. Plus restrictive, elle encadre les diverses missions attribuées à la banque en en fixant les modes opératoires.
Cette doctrine mérite d’être précisée sur plusieurs points. À cet égard, la doctrine d’intervention veut que l’ensemble des interventions de Bpifrance, y compris celles qui lui sont confiées par les pouvoirs publics, soient financièrement soutenables, c’est-à-dire qu’elles doivent viser a minima un retour sur les capitaux investis afin d’assurer la pérennité de la société et de ses missions. Cela conduit notamment le conseil d’administration de la société à définir des cibles en matière de rentabilité et de niveau de risque pour chacune de ses activités.
La doctrine précise également que Bpifrance privilégie les secteurs et les filières en croissance et peut ainsi concentrer ses interventions à leur profit, ce qui n’apparaît pas aussi clairement dans la loi.
La loi et la doctrine s’accordent sur le fait que Bpifrance doit se comporter en investisseur avisé, élément important au regard du respect des règles européennes. Toutefois, la doctrine précise que Bpifrance peut exceptionnellement, et à titre temporaire, prendre des décisions de financement ou d’investissement dérogatoires à cette règle.
En matière d’investissement, l’ambiguïté des missions confiées à Bpifrance se retrouve dans le concept « d’investisseur avisé opérant aux conditions de marché au service de l’intérêt collectif » que retient la doctrine. Cela signifie donc à la fois que Bpifrance doit consacrer une part significative de ses moyens à des secteurs qui attirent peu d’investisseurs classiques, tel que l’amorçage ou le capital-risque, mais qu’elle doit le faire dans des conditions similaires à celles qui s’imposent aux investisseurs privés, notamment en matière de rentabilité.
Pour ce faire, Bpifrance intervient systématiquement en co-investissement et de façon minoritaire, deux exigences qui ne se retrouvent pas dans la loi mais qui ont pour effet de prévenir le risque en matière d’aide d’État et d’éviter un effet hypothétique de substitution du public au privé. Il semble cependant paradoxal que Bpifrance ait pour objectif premier de combler les failles de marché, en intervenant là où les acteurs privés ne sont pas présents, mais qu’elle doive dans le même temps systématiquement agir en co-investissement ou en cofinancement avec ces mêmes acteurs privés et tout en restant minoritaire.
À ce titre, si la doctrine de Bpifrance prévoit la recherche d’un effet de levier maximal qui a pour but de pousser des acteurs privés à intervenir sur des secteurs qu’ils n’auraient pas spontanément investis, il demeure difficile d’apprécier le nombre d’interventions qui ont été rendues impossibles par absence de cofinanceurs ou de co-investisseurs. Les interrogations des membres de la mission d’information sur ce sujet sensible n’ont pu être dissipées.
Proposition : prévoir un mécanisme d’alerte rapide et un recensement systématique par les services de l’État des cas où l’absence de partenaire privé a conduit Bpifrance à renoncer à une opération de financement ou d’investissement pourtant jugée pertinente.
Cette règle ne s’applique d’ailleurs pas en matière d’innovation, domaine dans lequel la banque publique peut agir seule et sans partenaires privés. Les membres de la mission d’information remarquent également que la KfW allemande n’est pas tenue par de telles limitations puisque l’ensemble des financements qu’elle accorde sont versés par l’intermédiaire de banques privées (on lending), tout en étant de l’argent public, ce qui permet d’éviter tout risque de requalification en aide d’État, y compris lorsque la KfW accorde la totalité du prêt puisqu’elle le fait de manière indirecte. Ainsi, selon le Dr Lutz-Christian Funke, responsable opérationnel de la KfW auditionné par la mission d’information (38), « Nos prêts respectent un principe de « on-lending » ; autrement dit, ils sont indirects. Nous ne faisons pas de cofinancement. Un accord de non-concurrence nous lie aux banques qui distribuent nos prêts aux entreprises moyennant une commission, dans le cadre de programmes désignés comme étant ceux de la KfW. Nous pouvons ainsi, par exemple, financer la totalité de ces prêts ou y contribuer à hauteur de 50 %, la banque assumant alors le complément. »
Si la recherche d’un effet de levier maximal auprès de partenaires privés apparaît parfaitement légitime, le principe du cofinancement et du co-investissement comme points centraux de la doctrine pose en effet la question des restrictions qu’elle entraîne. En effet, la loi comme la doctrine prévoient une prise en compte de l’intérêt collectif, notamment au travers des effets sur l’emploi et sur le développement des territoires, objectifs qui peuvent parfois nécessiter d’intervenir sans partenaire privé ou sans considération de rentabilité immédiate. C’est également sur ce type d’engagement que les citoyens peuvent apprécier le service rendu par leur banque publique.
De la même manière, la doctrine pose un certain nombre de limitations en matière de retournement d’entreprise, lesquelles ne sont pas prévues par la loi. Bpifrance prévoit en effet d’agir en faveur du retournement d’entreprise en difficulté principalement par le biais de participation dans des fonds privés, donc de manière indirecte et minoritaire. Cependant, le retournement d’entreprise suppose généralement un investissement majoritaire permettant de disposer de l’ensemble des leviers d’action.
Sur ce plan du retournement d’entreprise, la doctrine se montre donc plus restrictive que la loi, non sans raison, mais avec une rigidité qui peut s’avérer préjudiciable pour la survie d’entreprises dont l’intérêt économique et social pour la Nation justifierait un engagement de la puissance publique. De trop nombreuses faillites d’entreprises entraînent non seulement des pertes d’emplois mais également la disparition de savoir-faire et un impact négatif fort sur le développement des régions concernées (39).
Enfin, on note que de telles restrictions s’appliquent également à Bpifrance financement qui ne peut accorder de prêt aux entreprises en difficulté avérée et qui doit opérer aux conditions de marché, sans soutien abusif ni crédit ruineux, conformément à la réglementation bancaire.
Dans ce cadre, le Rapporteur s’interroge sur la possibilité de développer en France, sans changer le cadre général d’action de la BPI, des dispositifs indirects de financement, via les banques privées, pour être en mesure de financer des entreprises mêmes en cas d’absence d’un partenaire privé agissant en cofinancement et en dehors des politiques spécifiques telles que l’innovation.
Proposition : assouplir les règles existantes en matière de cofinancement ou permettre le recours à des financements indirects sur le modèle de la KfW allemande. |
b. La correction des failles de marché
La doctrine de Bpifrance précise qu’elle intervient dans les TPE, les PME et les ETI qui, notamment du fait de leur taille, du caractère amont de leur stade de développement et du caractère risqué de leur projet de croissance, rencontrent des difficultés structurelles de financement auprès du système bancaire comme des investisseurs privés (défaillance de marché).
Une faille de marché peut être définie simplement comme une situation où un bon projet, c’est-à-dire un projet générant des flux de capital supérieurs en valeur actualisée au coût des investissements initiaux, ne trouve pas de financeur. Elle peut résulter d’une crise systémique, comme en 2008, ou d’asymétries d’information, autrement dit de difficultés à évaluer les risques du projet. Outre ces failles de marché, la puissance publique peut chercher à favoriser le financement de projets non rentables mais qui produisent des « externalités positives » pour l’ensemble de l’économie (recherche fondamentale, infrastructures…). Cette intervention est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État dans le souci d’éviter les distorsions de concurrence entre les États membres.
Dans ce contexte, Bpifrance consacre une part significative de ses interventions aux segments de marché sur lesquels le manque de fonds privés est le plus marqué et qui sont structurellement déficitaires en capitaux, comme l’amorçage, le capital-risque, le capital développement et les transmissions de petites entreprises.
Afin de détecter les défaillances de marché sur lesquelles agir, Bpifrance s’appuie sur sa capacité à détecter les entreprises cibles grâce à la connaissance fine de ses équipes du tissu économique régional, des secteurs d’activité et de leurs besoins ainsi que des entreprises elles-mêmes.
L’action de Bpifrance en la matière fait l’objet d’un processus de revue stratégique périodique, s’appuyant sur les axes de développement qui ont présidé à sa création qui aboutit à la validation par les organes de gouvernance compétents des propositions réalisées afin de répondre aux besoins identifiés en matière de couverture des défaillances de marché.
À l’heure actuelle, de nombreuses initiatives contribuent à combler les défaillances de marché :
– en matière d’innovation, il s’agit de fluidifier la chaîne du financement en s’assurant que chaque entreprise innovante ait accès aux financements qui lui sont nécessaires à chaque étape de son développement, depuis le stade amont de la R&D jusqu’au renforcement du capital (voir chapitre consacré à l’innovation) ;
– en financement, Bpifrance a lancé une offre de prêts de développement dont les caractéristiques répondent à un besoin non couvert par le marché. En particulier, le besoin de fonds de roulement (ou trésorerie) d’une entreprise peut être récurrent du fait du hiatus entre les délais de paiement des clients et ceux des fournisseurs, dans le cas d’une production saisonnière, ou encore du fait des modalités de paiement de l’impôt. Les banques commerciales proposent normalement une offre de financement adaptée ou des services d’affacturage (40). Mais cette offre s’est considérablement réduite, en particulier pour les petites entreprises. Les coûts de gestion sont jugés trop élevés par les banques. Les prêts de Bpifrance ont donc pour objet de financer le besoin en fonds de roulement ainsi que l’immatériel des entreprises, sans caution ni garanties, et avec un différé de remboursement du capital de deux ans (jusqu’à trois ans sur les prêts dits « d’avenir ») ;
– en matière d’export, Bpifrance s’est fortement engagé. À titre d’exemple, dans un contexte de baisse marquée des contrats civils garantis par Coface (DGP) et de désintérêt des banques commerciales depuis 2009, principalement pour les « petits » contrats, Bpifrance a lancé en 2015 une offre nouvelle de crédit comprise entre 5 et 25 millions d’euros visant à soutenir les exportations via l’octroi de prêts accordés directement aux acheteurs étrangers de biens ou de services de fournisseurs français ;
– enfin, en matière d’investissement, l’activité de Bpifrance en fonds de fonds permet, du capital-amorçage au capital-développement dans des secteurs risqués et transmission, de soutenir les équipes privées dans un contexte de raréfaction structurelle des fonds provenant d’acteurs institutionnels privés. Par ailleurs, son action en investissement direct repose sur la volonté de venir en complément de l’action du privé afin de permettre aux tours de table de se boucler au niveau nécessaire. Ainsi que le rappelle Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation, « dans le capital-risque, on chasse volontiers en meute. Il existe un double effet de levier : Bpifrance met de l’argent dans un fonds sectoriel, ce qui permet à celui-ci de lever cinq, six ou sept fois ce qu’elle apporte, et, quand nous montons un dossier, des fonds généralistes qui hésiteraient beaucoup à investir parce qu’ils connaissent mal le secteur, faute de spécialistes dans leurs équipes, viennent avec nous pour la moitié, voire les deux tiers, du tour de table ».
Comme l’a bien souligné Augustin Landier, professeur à l’école d’Économie de Toulouse, au cours de son audition, la difficulté de trouver des financeurs pour ces projets tient à un environnement que la puissance publique peut aussi faire évoluer en changeant les règles fiscales ou la réglementation, par exemple. Elle peut aussi résulter des insuffisances d’un dossier de financement : soit le porteur de projet n’arrive pas à faire la preuve de sa compétence et de sa crédibilité aux yeux des prêteurs, soit l’évaluation du projet est trop chronophage pour que cela soit rentable : « aucun banquier n’acceptera en effet de consacrer une semaine entière, à l’étude d’un investissement d’une valeur de 5 000 euros ».
Les failles de marché peuvent donc être appréciées de différentes façons. Certaines sont structurelles ; d’autres sont transitoires ou pourraient être résolues à terme par le marché. Elles n’en appellent pas moins des réponses urgentes. Bpifrance s’inscrit dans un éventail de réponses de la puissance publique à ces difficultés. Elle doit faire preuve de réactivité et de pragmatisme tout en veillant à ce que son action soit comprise. Comme l’a souligné Augustin Landier, on peut regretter que le discours de Bpifrance et de ses tutelles ne soit pas plus explicite sur l’analyse qu’elle fait des défauts de financement.
L’action de Bpifrance demeure néanmoins, dans ses modalités d’intervention, largement contrainte par les règles européennes.
c. Les principes structurants de la doctrine d’intervention sont contraints par le droit européen
Le droit européen a un impact déterminant sur les principes structurants et sur l’action réelle de Bpifrance. En particulier, le concept d’« investisseur avisé », c’est-à-dire d’acteur se comportant comme le ferait un acteur de marché, dont par nature il semble que l’on suppose qu’il soit toujours avisé, implique de :
– recourir au cofinancement ou au co-investissement avec le secteur privé ;
– ne pas venir en aide à des entreprises en difficulté sous peine de tomber sous la réglementation des aides d’État ;
– ne pas entrer en concurrence avec le secteur privé ;
– ou encore de rechercher des investissements ou des financements rentables.
Ces critères ont pour objet de vérifier que l’opération financée par les pouvoirs publics serait « raisonnablement » financée par un investisseur privé en économie de marché, c’est-à-dire qu’elle s’apparente à un apport de capital à un niveau de risque acceptable selon les pratiques du marché et avec des perspectives de rentabilité réelle dans des délais raisonnables. Le fondement de l’analyse de la Commission est de s’assurer que l’entreprise publique n’obtienne pas d’avantages, de quelque nature qu’ils soient, qu’un investisseur privé ne pourrait consentir.
S’il n’entre pas dans l’objet de la mission d’analyser le système mis en place au niveau de l’Union européenne en matière d’aides d’État et de concurrence, il n’était cependant pas possible de comprendre les fondements de l’action de Bpifrance, ainsi que ses limites, sans rappeler et analyser ce que sont les règles européennes en la matière car celles-ci sont aussi au cœur de ce que peut ou ne peut pas faire la banque publique
l Il s’agit en premier lieu de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui dispose que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Ce même article dispose cependant que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
a) Les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b) Les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
c) Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun,
e) Les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission européenne.
Ce système repose sur le principe d’une notification à la Commission européenne des aides attribuées aux entreprises par les organismes publics. L’application stricte de ces principes par les services de la Commission pourrait représenter un risque pour les États qui y recourent. Bpifrance a donc fait le choix d’éviter a priori tout risque de cette nature en choisissant d’agir exclusivement en cofinancement ou en co-investissement.
Cette prudence peut se justifier au regard du risque financier que pourrait représenter pour la banque publique et donc pour l’État une requalification des aides accordées par cette dernière. Ces principes d’intervention, qui anticipent les exigences des institutions européennes, ont par ailleurs autorisé l’entité qu’est Bpifrance à ne pas notifier l’ensemble de ses opérations aux services de la Commission européenne, ce qui lui permet d’échapper à un contrôle strict de l’ensemble de son action comme le prévoit la communication de la Commission européenne à propos de Bpifrance rendue en mai 2015.
Cependant, force est de constater que la liberté d’action de Bpifrance s’en trouve limitée, parfois au-delà même des restrictions imposées par le droit européen, lequel, comme cela vient d’être rappelé, prévoit un certain nombre d’exceptions au principe général d’interdiction des aides d’État.
En effet, les apports en capitaux sont considérés comme une aide d’État lorsque les perspectives économiques de la société bénéficiaire sont telles qu’aucune rémunération normale du capital, par référence à une entreprise privée comparable, ne peut être attendue dans des délais raisonnables. Dans son examen, la Commission s’appuie sur une analyse de l’écart entre l’investissement consenti et sa valeur actualisée, compte tenu du plan d’affaires ajusté à la situation du marché en termes de tendance et de parts de marché contrôlées par l’entreprise. Le niveau de risque est évalué à partir des ratios de liquidité et de solvabilité de la société bénéficiaire.
Les exceptions au principe général d’interdiction des aides d’État
À cet égard, deux éléments permettent de présumer l’absence d’aide d’État : le financement aurait pu être obtenu, dans les conditions définies par l’État, sur le marché ; une intervention privée est concomitante à l’intervention publique et s’effectue dans les mêmes conditions, ce qui justifie le principe de co-intervention. Pour ne pas s’exposer à la qualification d’aide d’État, les prêts accordés par les pouvoirs publics doivent refléter, dans le taux d’intérêt et dans les garanties, le niveau de risque porté par l’entreprise. Par conséquent, dès lors que le prêt n’est pas conforme aux conditions bancaires, l’élément d’aide doit être quantifié, par l’écart entre le taux que l’entreprise paierait sur le marché et le taux pratiqué en réalité. Cependant, l’existence d’un écart ne préjuge pas d’une aide d’État, puisque l’avantage est par suite considéré comme un apport en capital, qui est examiné au regard du critère de l’investisseur avisé décrit plus haut.
Quelle que soit leur nature, les garanties octroyées par les pouvoirs publics, peuvent à leur tour constituer des aides d’État si elles ont pour conséquence d’introduire un écart entre le taux que l’emprunteur paierait sur un marché libre et le taux effectivement obtenu grâce à cette garantie. La Commission est ainsi conduite à examiner si les entreprises publiques dont le statut exclut le recours à la faillite, bénéficient à ce titre d’une aide équivalent à une garantie, la question étant de savoir si ce statut permet effectivement à l’entreprise d’obtenir des crédits dans des conditions plus favorables.
l D’autre part, une aide d’État reste compatible avec la réglementation communautaire si elle peut être qualifiée d’aide d’État au sauvetage et à la restructuration compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui implique le respect des trois lignes directrices énoncées par les directives 94/368/05 CE du 23 décembre 1994 :
– elle doit s’inscrire dans un programme viable de redressement consigné dans un plan sur le respect duquel s’engage l’État. Par conséquent, toute nouvelle aide est exclue pendant une durée minimale de dix ans ;
– les distorsions de concurrence doivent être aussi modérées que possible, et à cette fin, le montant de l’aide doit être limité au strict nécessaire pour atteindre son but ;
– enfin, l’entreprise doit fournir une contribution importante au financement du plan de redressement, en consentant notamment un effort rigoureux de restructuration.
L’ensemble de ces critères permet aux acteurs publics du financement, sans contrevenir aux règles européennes, de disposer de marges de manœuvre appréciables pour apporter des capitaux ou des financements aux entreprises, sans nécessairement rechercher une association systématique avec des partenaires privés. Ils peuvent également justifier une action spécifique en faveur d’entreprises en difficulté.
Le Rapporteur regrette que ces marges de manœuvre ne soient pas utilisées par Bpifrance, sauf exceptions, traduisant à un phénomène d’autocensure préjudiciable au développement économique et au maintien de notre tissu industriel. Il recommande par conséquent de réfléchir, en lien avec les institutions européennes, à la manière dont pourraient se déployer des aides financières émanant de la BPI qui seraient à la fois conformes au droit européen et qui ne se heurteraient pas à des délais d’instruction les condamnant à l’inefficacité et à l’insécurité juridique et financière.
Proposition : mener une réflexion conjointe avec les institutions européennes afin de permettre le déploiement d’aides financières directes aux entreprises dans des délais raisonnables et de manière conforme aux exceptions prévues à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
d. Le cofinancement et le co-investissement : des principes dont les contours pourraient être assouplis
Comme indiqué plus haut, les doctrines du cofinancement ou du co-investissement, qui conditionnent l’ensemble de l’action de Bpifrance, répondent en premier lieu au cadre réglementaire européen, en particulier aux règles relatives aux aides d’État. La doctrine précise également que Bpifrance a vocation à être un acteur de place neutre dont l’action doit permettre de stimuler l’ensemble des partenaires du financement, au premier rang desquels les banques, les réseaux de développement de l’innovation et les investisseurs privés.
Bpifrance inscrit ces exigences au cœur de son action, s’interdisant ainsi de financer ou d’investir seule dans des projets, quels que soient leur valeur ajoutée ou leur intérêt industriel pour la vie économique de la Nation, à l’exception notable des investissements et des financements réalisés dans le domaine de l’innovation, lequel est exclu de ces règles en accord avec les institutions européennes.
Toutefois, la doctrine de Bpifrance précise que, si la situation le justifie, Bpifrance ne s’interdit pas, exceptionnellement et à titre temporaire, de prendre des décisions de financement dérogatoires à sa doctrine. Cette décision doit être prise par les instances de gouvernance compétentes, conformément aux règles prévues par le statut de Bpifrance Financement et par le pacte d’actionnaires de Bpifrance. Ainsi, il existe aujourd’hui quatre exceptions principales :
‒ les prêts Export (41) d’un montant inférieur à 150 000 euros, du fait du montant très limité de ceux-ci ;
‒ le crédit Export (42), pour les montants d’intervention inférieurs à 25 millions d’euros, segment de marché sur lequel les banques commerciales ne souhaitent pas se positionner (faille de marché) ;
‒ les prêts de développement territorial pour les régions Pays-de-la-Loire et Nord-Pas-de-Calais, en accord avec les conseils régionaux ;
‒ certaines interventions en court-terme, lorsque les réseaux bancaires ne souhaitent pas intervenir en cofinancement.
Une autre exception peut concerner les prêts de développement territoriaux qui ont été mis en place avec une trentaine de collectivités (dont douze régions). Sans garantie ni caution personnelle, ces outils à fort effet de levier bénéficient d’un différé de remboursement en capital qui permet d’alléger la charge financière des entreprises. La collectivité territoriale soutient le dispositif au moyen d’une dotation permettant de bonifier le taux du prêt. Dans ce cadre, il peut arriver que Bpifrance accepte d’intervenir sans contrepartie bancaire (en raison notamment des difficultés particulières d’accès au crédit rencontrées dans certains de ces territoires).
L’ensemble de ces dispositifs ne posent pas de difficulté vis-à-vis de Bruxelles. Les prêts comportent un élément de bonification qui conduit à calculer un équivalent subvention brut (ESB) couvert par le régime de minimis. Le niveau de cet ESB est majoré en cas d’intervention sans contrepartie bancaire.
En dehors de ces exceptions instituées et admises par les institutions européennes, une interrogation subsiste sur la capacité de Bpifrance à agir seule, sans recours à des partenaires privés, dans le cadre des exceptions prévues par l’article 107 du TFUE. Ce principe de co-intervention peut en effet être préjudiciable au développement ou au soutien d’entreprise, en particulier d’entreprises connaissant des difficultés passagères ou durables, lesquelles se retrouvent sans aucune possibilité de soutien de la part de la puissance publique dès lors qu’aucun financeur ou investisseur privé n’est prêt à aider l’entreprise concernée.
Bpifrance a cependant jusqu’à maintenant fait le choix de s’interdire a priori tout type d’intervention unilatérale de sa part, notamment en raison des délais de notification et du risque financier qu’entraînerait une requalification en aide d’État d’un financement unilatéral de sa part au profit d’une entreprise.
Cette position ferme, inscrite dans la doctrine, a suscité de nombreux débats et continue de soulever des interrogations. Beaucoup d’acteurs, notamment en régions, s’interrogent ainsi sur le fait que Bpifrance soit contrainte à l’inaction dès lors qu’aucun financeur ou investisseur privés ne souhaite s’associer à son action au profit d’une entreprise. Il serait en effet dommage, alors que les défaillances d’entreprises ont atteint un record en 2014, notamment en ce qui concerne les ETI, que Bpifrance ne puisse financer que des entreprises dont la rentabilité suffisante pour attirer des investisseurs privés.
Proposition : assouplir les régimes de cofinancement et de coinvestissement pour les projets de soutien financier ou d’investissement en fonds propres dans des entreprises dont la poursuite pour le développement de l’activité présente un fort intérêt social, économique, écologique ou industriel.
e. La recherche d’un effet de levier
Le principe général de l’intervention de Bpifrance est de prendre en charge une partie du risque (technologique ou financier) pour favoriser l’intervention des financeurs et investisseurs privés et permettre ainsi la réalisation de l’opération d’investissement. L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises en minimisant la part d’euro public mobilisé et en maximisant l’effet de levier auprès du secteur privé. Les produits mobilisant le plus de fonds public sont utilisés pour les projets les plus risqués, les plus difficiles à financer, ou dont l’intérêt pour l’économie est fort (externalités de connaissances, environnementales…).
Apprécier l’effet de levier opéré par les interventions de Bpifrance suppose de distinguer entre différents secteurs.
Un des secteurs pour lequel l’effet de levier est le moins important est l’aide à l’innovation (subventions et avances remboursables) qui couvrent une partie des dépenses de R&D des entreprises. 1 euro de fonds publics permet le financement de 3 à 4 euros de dépenses de R&D.
De la même manière, l’investissement dans des fonds de capital investissement gérés par des sociétés de gestion tierces privées (activité de fonds de fonds) permet un effet de levier de 4 (ainsi en moyenne, sur la période 1998-2013, pour 1 euro investi par Bpifrance dans des fonds d’investissement, plus de 4 euros sont investis par des investisseurs tiers).
À l’inverse, dans d’autres secteurs l’effet de levier est maximisé . Il s’agit notamment des prêts de développement, prêts de long terme à différé de remboursement, qui financent des dépenses à faible valeur de gage habituellement couvertes par de l’autofinancement (par exemple un développement à l’export). Ils sont adossés à des fonds de garantie et sont conditionnés à l’obtention d’un prêt bancaire ou d’un apport en fonds propres. L’effet recherché ici est un effet d’entrainement. En moyenne, 1 euro de fonds publics immobilisé permet la mise en place de 10 euros de prêt de développement et de 20 euros de financement bancaire.
Enfin, l’effet de levier s’apprécie également en termes de mobilisation du crédit bancaire. Les garanties de crédits bancaires couvrent le risque de défaillance des entreprises. En cas de défaut de paiement, Bpifrance prend en charge la perte à hauteur du risque couvert. Ce dispositif réduit donc le coût en capital de l’opération du banquier financeur. L’effet de levier dépend du niveau de risque couvert par Bpifrance et est d’autant plus faible que le risque couvert est élevé. (En moyenne, le dispositif de garantie couvre de 30 % à 40 % du risque en développement et 70 % du risque en création et en renforcement de trésorerie). En moyenne, 1 euro de fonds publics immobilisé permet par conséquent l’octroi de 15 euros de crédit bancaire en soutien à la création d’entreprise de 18 euros en soutien à la transmission et de 28 euros en soutien au développement. Le complément apporté par les fonds de garantie régionaux peut s’avérer extrêmement utile pour augmenter ce niveau de couverture.
La recherche d’un effet de levier est ainsi au cœur de la stratégie de Bpifrance, ce qui se justifie pleinement au regard de l’effet d’entraînement que peut et que doit exercer l’action publique sur les acteurs économiques privés. La mesure et le suivi de cet effet de levier par Bpifrance concernant ses différentes activités et outils constituent un élément appréciable tant pour rendre compte de son activité que pour guider son action.
f. Une réponse insuffisante apportée aux très petites entreprises
Aux termes de la loi du 31 décembre 2012 relative à la création de la banque publique d’investissement, cette dernière « oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. »
Les très petites entreprises (artisans, commerçants, professions libérales…) connaissent en effet des difficultés spécifiques d’accès au financement, recensées récemment dans un rapport de l’Observatoire du financement des entreprises (43), qui contient plusieurs propositions. Un tiers des TPE présentent un solde de trésorerie quasi nul. Leurs difficultés de trésorerie sont souvent aggravées par une sous-capitalisation : un tiers des TPE présente une insuffisance notoire de fonds propres. Les besoins de trésorerie sont massivement financés par le recours au découvert bancaire, bien plus cher qu’un crédit (44). Du fait d’un taux de défaut plus élevé sur les crédits de trésorerie des TPE, les banques se montrent réticentes à satisfaire les demandes. Des garanties personnelles sont plus souvent demandées quand les montants de crédits sont importants, et in fine, si l’on pondère par les montants demandés, les garanties personnelles demandées varient de 30 % à 70 % des crédits selon les réseaux. Le rapport mentionne également l’autocensure comme un frein important quoique difficile à mesurer.
Le rôle assumé par Bpifrance vis-à-vis des TPE est ambigu. Les éléments fournis à la mission d’information montrent qu’elles représentent près de 70 % des entreprises soutenues, notamment grâce au préfinancement du CICE (cf. infra). Mais lors de sa première audition, Nicolas Dufourcq s’était montré circonspect sur cette activité : « les TPE concernent des millions d’individus. Bpifrance, avec un effectif de mille personnes sur le terrain, n’est pas outillée pour les traiter, et n’a pas été conçue pour cela. La tâche revient aux réseaux bancaires, qui ont chacun plusieurs dizaines de milliers de salariés. Nous n’avons de relations avec les TPE que pour le préfinancement du CICE – ce qui représente 15 000 contrats par an. » Les dispositifs de financement et de fonds propres semblent efficacement mobilisés au service de la croissance des start-ups mais les artisans, les commerçants et les professions libérales ne semblent pas faire partie des priorités stratégiques de Bpifrance.
La gamme des produits Bpifrance s’est d’ailleurs avérée peu adaptée aux besoins des TPE. Leur besoin de fonds de roulement peut théoriquement être financé :
– grâce à la garantie Bpifrance ;
– grâce au préfinancement du CICE ;
– par les prêts de développement qui financent l’investissement immatériel et le besoin de fonds de roulement.
Mais ces derniers sont délibérément fléchés sur les PME et les ETI en croissance dans le cadre des orientations du programme d’investissements d’avenir (PIA). C’est en effet le PIA qui finance les bonifications de taux et les garanties attachées aux prêts de développement.
La garantie Bpifrance est quant à elle soumise à l’avis favorable préalable de la banque commerciale sur le dossier de financement.
Il n’existe donc aucune possibilité d’accès direct à Bpifrance pour les petites entreprises qui souhaitent un crédit de trésorerie. La décision d’accorder ou non le crédit, comme celle d’en obtenir garantie auprès de Bpifrance relève de la banque commerciale, et ce pour des prêts pouvant atteindre 200 000 euros, sachant que l’immense majorité des besoins de trésorerie exprimés par les TPE sont inférieurs à 15 000 euros. Les banques commerciales préfèrent en conséquence « prêter » sous forme de découverts autorisés (au taux de 13 % environ en intégrant les commissions diverses, par exemple les commissions sur plus fort découvert), ou non autorisés (en moyenne 22 % en intégrant les commissions d’intervention) en lieu et place de crédits à 2,6 %, même garantis à hauteur de 50 % par Bpifrance. C’est ainsi que dans 84 % des cas, selon un sondage réalisé par le Syndicat des indépendants, le conseiller bancaire ne mentionne même pas la possibilité pour le chef d’entreprise d’assortir son emprunt d’une garantie Bpifrance.
Un micro crédit de trésorerie compris entre 5 000 et 15 000 euros pourrait pallier cette déficience (lequel couvrirait approximativement 75 % des besoins de crédits de trésorerie sollicités par les TPE), soit directement auprès de Bpifrance (ce qui poserait néanmoins certainement un problème en termes de ressources humaines nécessaires pour traiter de nombreux dossiers), soit comme aujourd’hui par l’intermédiaire des banques privées, mais en les incitant davantage à recourir à ce type de financement (par exemple en augmentant le pourcentage garanti sur ces faibles sommes) ou en mettant en place des conventions les incitant plus largement à recourir à ce type de dispositif. Un financement direct exceptionnel, sur sollicitation du Médiateur du crédit, pourrait être instauré comme voie de recours pour les entreprises dont la demande de crédit aurait été rejetée.
En outre, comme l’a annoncé Nicolas Dufourcq au cours de son audition du 7 juillet 2015, Bpifrance travaille à la mise en place d’une plateforme en ligne de petits prêts de développement à sept ans avec deux ans de différé, de l’ordre de 50 000 euros, prêts qui seront assis sur un fonds de garantie. Ce produit dédié aux TPE serait disponible fin 2015 ou début 2016.
Le Rapporteur se félicite de cette avancée qui permettra de compléter le continuum de financement et de répondre à une demande très forte. Le choix d’une offre en ligne permettra de limiter les coûts de gestion de ce nouveau produit.
Le Rapporteur propose en outre de renforcer les partenariats avec les sociétés de garantie pour mieux accompagner les TPE dans l’accès au crédit et ainsi lutter contre le risque d’autocensure décrit par l’Observatoire du financement des entreprises.
Bpifrance s’appuie d’ores et déjà aujourd’hui sur des sociétés de garantie mutuelle telles que la SIAGI et les SOCAMA, sociétés dont elle est également actionnaire. Ces sociétés, créées à l’origine par les réseaux consulaires, apportent leur expertise au banquier pour évaluer les projets. Aujourd’hui, le mode opératoire est celui d’une délégation de décision donnée par Bpifrance à ces sociétés, plafonnée individuellement en montant de crédit garanti (400 000 euros au 1er janvier 2015) et en pourcentage de garantie donnée (70 %). Les critères d’éligibilité sont ceux de Bpifrance. Les critères de décision sont ceux de la société de garantie.
Par exemple, pour la SIAGI, un plafond collectif est négocié chaque année (180 millions d’euros pour l’exercice 2015 soit 27 % des objectifs de production 2015) et réparti entre quatre finalités de crédit : création ex nihilo, création par première installation, transmission-reprise et développement. En fonction des programmes publics s’y ajoute une finalité de renforcement de la trésorerie. La SIAGI intervient comme chef de file, c’est-à-dire qu’elle instruit, négocie, décide, notifie, encaisse et restitue à Bpifrance la rémunération lui revenant.
En cas de défaut, la banque déclare à la SIAGI la défaillance et met en jeu les deux garanties. Les procédures d’appel en paiement restent propres à chaque garant ainsi que le versement de l’indemnité de garantie.
Selon Michel Cottet, le directeur général de la SIAGI, le mécanisme de garantie des crédits de faible montant aux petites entreprises est divisé en deux régimes :
– jusqu’à 200 000 euros, la banque dispose d’une délégation de garantie de Bpifrance ;
– entre 200 000 et 400 000 euros, Bpifrance a délégué la décision de garantie à la SIAGI.
En d’autres termes, selon Michel Cottet, ce sont paradoxalement les plus petits dossiers qui sont privés de l’accompagnement de la SIAGI. Cet accompagnement permet de présenter à banquier une lettre de pré-garantie. Il contribue à réduire le coût d’information pour le banquier, qui peut ainsi passer moins de temps à expertiser le dossier. Il serait particulièrement utile pour lutter contre l’autocensure qui constitue une cause importante – quoique difficile à mesurer – des difficultés d’accès au crédit pour les plus petites entreprises.
Cet accompagnement a un coût évalué entre 0,60 % et 2,10 % du montant emprunté. Les commissions de garanties des sociétés de garantie rémunèrent à la fois le service d’accompagnement proposé et le fonds de garantie mutuel. Les sociétés de garantie font supporter le coût des garanties aux entrepreneurs, selon un principe mutualiste, tandis que Bpifrance le finance par la solidarité nationale. Combiner la garantie de ces sociétés avec la garantie Bpifrance entraînerait donc une hausse de la commission de garantie. Michel Cottet estime que Bpifrance pourrait accepter de prendre en charge une partie de ce surcoût : l’expertise des sociétés de garantie pourrait limiter la sinistralité et donc s’avérer avantageuse in fine pour Bpifrance.
Compte tenu des besoins d’accompagnement des dirigeants de TPE, reconnus unanimement par les personnes rencontrées au cours de la mission, le Rapporteur estime que cette piste devrait être étudiée. Il ne s’agit pas de contraindre les banques mais de leur offrir une garantie complémentaire.
Enfin, en ce qui concerne les paiements inter-entreprises, les retards contractés par les services de l’État et les collectivités territoriales atteignent un encours de 7,5 milliards d’euros, même s’il faut reconnaître que l’État a récemment consenti des efforts. Bpifrance pourrait également proposer des produits de subrogation des créances permettant aux PME et TPE qui ne sont pas réglées en temps et en heure par les collectivités territoriales de pouvoir être très rapidement financées par une banque publique d’investissement, sur le principe du produit Avance + déjà fourni par la Bpifrance.
Proposition : déployer un véritable continuum de financement adapté pour les très petites entreprises, en proposant notamment :
– un micro crédit de trésorerie compris entre 5 000 et 15 000 euros, en accès direct via une plateforme en ligne ou via une convention avec les banques commerciales ;
– un prêt de développement de 50 000 euros aux TPE via une plateforme en ligne ;
– la garantie de Bpifrance en combinaison avec les pré-garanties des sociétés de garantie mutuelle pour les montants inférieurs à 200 000 euros.
2. Démultiplier l’action de Bpifrance au niveau européen
L’action de Bpifrance doit également se penser au niveau européen, tant en relation avec les institutions européennes en charge du développement économique, telles que la Banque centrale européenne (BCE), la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qu’en lien avec les institutions similaires des autres pays (KfW allemande, Casa di depositi italienne, etc…).
La coordination avec ces institutions permet en effet de démultiplier l’impact de l’action de Bpifrance sur le territoire et de favoriser le développement économique en Europe. Cela est particulièrement le cas à travers la réflexion sur les modalités de mise en œuvre du plan Juncker.
Enfin, dans une optique de politique comparée, le fonctionnement des grandes institutions de développement économique dans les autres pays européens, à l’instar de la KfW, apparaît riche d’enseignements.
a. Le « plan Juncker » comme une opportunité ?
La mission d’information s’est interrogée sur les possibilités qui pourraient être offertes à Bpifrance par les instruments mis en place au niveau européen, notamment dans le cadre du « plan Juncker » plan d’investissement pour l’Europe de 315 milliards d’euros présenté le 26 novembre. Ce plan est une opportunité de soutenir des projets concrets qui peuvent améliorer l’accès au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et d’associer les banques de développement nationales (BDN) à sa mise en œuvre.
Une action au profit de l’innovation
La BPI a ainsi été la première institution européenne à signer un accord avec la banque européenne d’investissement – BEI – pour le financement de l’innovation dans le cadre de ce plan.
440 millions de prêts à l’innovation financés via le Fonds européen d’Investissement sont ainsi mis à disposition des PME et ETI françaises depuis le mois de mai 2015, via les Prêts Innovation et le Prêt Amorçage Investissement de Bpifrance. Ces deux nouveaux outils de financement permettront d’octroyer des prêts aux entreprises françaises avec une garantie du FEI sur deux segments clés de leur financement c’est-à-dire :
– le lancement industriel et la mise sur le marché d’innovations pour les PME et petites ETI et
– pour le renforcement de la structure financière des jeunes entreprises qui réalisent des levées de fonds.
Cette capacité à mettre en œuvre rapidement le « plan Juncker » confirme le rôle actif de Bpifrance auprès des institutions européennes, en particulier dans ce domaine clé de l’innovation qui échappe au principe du cofinancement et permet l’instauration d’aides directes au profit des entreprises. Cet accord complète le « Prêt innovation FEI » mis en place par Bpifrance début 2014 dans le cadre du programme RSI (Risk Sharing Instrument) de la Commission européenne. Il permettra utilement de renforcer l’exposition au risque de Bpifrance sur ce segment de l’innovation.
Une opportunité de développer le capital-risque
Le règlement du Fonds européen d’investissement dispose que « l’EFSI pourra également financer, conjointement avec les États membres et des investisseurs privés, des plateformes d’investissement au niveau national, régional ou Sectoriel ». En outre, « la garantie de l’Union est accordée, par l’intermédiaire de la BEI, au soutien à des plateformes d’investissement spécialisées et des banques nationales de développement qui investissent dans des opérations répondant aux exigences du présent règlement. » (Article 5).
Dans ce cadre, Bpifrance cherche à juste titre à développer et à organiser la complémentarité des actions entreprises au niveau national comme au niveau européen pour le financement du capital-risque. Celui-ci est en effet une source vitale de financement pour les entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance. Toutefois il connaît de graves difficultés en raison de la crise financière mondiale depuis 2007. Selon les statistiques de l’EVCA (European private equity and Venture Capital Association), les sommes levées par les fonds de capital-risque ont baissé de 50 % entre 2007 et 2013, passant ainsi de 8,3 à 4 milliards d’euros.
En conséquence, les sommes investies par le capital-risque dans les PME ont diminué de près de 50 % au cours de la même période (passant de 6 milliards d’euros en 2006 à 3,4 en 2013). Cette évolution se double d’un marché européen qui demeure fragmenté et dominé par des fonds de petite taille (en dessous de 70 millions d’euros alors que la taille moyenne de leurs équivalents américains est de 130 millions d’euros), ce qui les empêche souvent d’opérer à l’échelle transnationale et de saisir les meilleures opportunités d’investissement à travers l’Europe.
C’est pourquoi les membres de la mission d’information soutiennent les efforts de Bpifrance visant à obtenir des institutions européennes la mise en place de fonds européens de capital-risque agissant conjointement avec la Banque européenne d’investissement. En corrélation avec les programmes européens de soutien aux projets collaboratifs de recherche, de développement et d’innovation (RDI), il est proposé d’encourager un développement « par la base » du marché par la création de fonds de fonds de capital-risque avec l’implication des opérateurs nationaux, et qui viendrait compléter l’approche « par le haut » des programmes européens gérés par le FEI.
Cette approche permettrait de s’appuyer sur l’expertise qu’ont les opérateurs nationaux des marchés locaux et d’optimiser l’effet de levier du budget européen. Il s’agirait ainsi d’encourager la mise en place de fonds de fonds de capital-risque multi-pays gérés par les opérateurs nationaux. Pour la France, la taille cible d’un tel fonds de fonds pourrait être de 300 millions d’euros dont une contribution de Bpifrance de 40 millions d’euros.
Agir pour les PME et les ETI, cœur de l’économie française
Bpifrance envisage sa participation au volet soutien financement des PME et Midcaps du plan Juncker au travers d’accords de co-financement et de co-investissement avec le FEI et la BEI. Cette contribution impliquerait notamment la flexibilisation d’instruments existants et la création de nouveaux instruments. Selon le point de vue de Bpifrance, les points essentiels en sont les suivants :
– flexibiliser les instruments de garantie en assouplissant les critères d’éligibilité InnovFin SME et InnovFin MidCap Guarante pour y inclure le CIR et les financements mezzanine.
– mettre en place des garanties de type couvrant des prêts immatériels aux PME et ETI dans des domaines clés pour leur compétitivité ;
– soutenir le fonds SPI (Sociétés de projets industriels) : créé début 2015, il soutient le passage à l’industrialisation de nouvelles technologies et de nouvelles filières. Cette étape d’industrialisation est en effet marquée par une forte défaillance de marché, notamment en raison d’un important niveau de risque et d’une forte intensité capitalistique.
À cet égard, le Rapporteur souhaite que le SPI puisse être abondé plus largement par la BEI, ce qui permettrait de développer sa force de frappe.
En outre, le Rapporteur souligne que les subventions européennes, vitales pour bon nombre d’associations, sont sujettes à des procédures lourdes, entraînant des délais importants. Il souhaite que soit étudiée la possibilité pour Bpifrance d’offrir des produits spécifiques pour alléger les contraintes de trésorerie pesant ainsi sur le secteur associatif.
b. La présence de Bpifrance au sein des institutions européennes de financement
En 2014, Bpifrance s’est dotée d’un bureau de représentation à Bruxelles, en commun avec la Caisse des dépôts, afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques européennes. Bpifrance inscrit en particulier son action dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et du Livre vert relatif au financement de long terme de l’économie européenne.
L’engagement européen de Bpifrance s’est également manifesté en 2014 par la reprise de la participation de la CDC au sein du Fonds Européen d’Investissement (FEI), par la souscription à son augmentation de capital et par la cooptation d’un membre représentant Bpifrance au sein de son conseil d’administration. Ainsi, Bpifrance est devenu le premier actionnaire financier du FEI, à parité avec la KfW, portant sa participation à 2,3 %. En décembre 2014, Bpifrance signait avec le FEI un protocole d’accord visant un potentiel de co-investissement entre 500 et 600 millions d’euros sur 4 ans dans les fonds français de capital investissement ayant pour cible principale les PME et les ETI françaises.
Cet engagement augmenté auprès du FEI renforce la portée de l’accord de coopération signé en 2013 avec le Groupe BEI et permet de renforcer les liens de Bpifrance avec les banques et institutions européennes actives dans le développement des PME. Par ailleurs, 2014 a vu le renforcement de partenariats existants avec des acteurs européens, notamment avec la KfW ou encore la Cassa Depositi e Prestiti, mais également le développement d’un partenariat avec la British Business Bank, nouvellement créée. Ces partenariats visent, entre autres, à mettre en place des dispositifs communs à destination de l’internationalisation des PME.
c. L’accès de Bpifrance (et de la BEI) au financement de la BCE pour la partie investissement : un enjeu majeur ?
Bpifrance recourt régulièrement aux instruments de la banque centrale européenne (BCE) pour se refinancer (voir première partie), soit à travers des opérations au jour le jour soit sur des opérations à plus long terme telles que le programme LTRTO (Long Term Refinancing Targeted Operations). En effet, il existe, au sein de Bpifrance, un établissement de crédit, la filiale financement, qui a un accès direct au guichet de la BCE. Cependant, ce recours n’existe pas pour la partie investissement.
En effet, l’article 21 du statut de la BCE prévoit qu’« il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite ». Toutefois, ce même article précise qu’il « ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit ».
Dans une perspective visant à renforcer la relance de l’investissement en Europe, et dans le cadre de la montée en puissance de la banque européenne d’investissement et du fonds européen d’investissement au niveau européen, il pourrait être utile d’aller plus loin en permettant un financement direct, par le biais de la création monétaire, de la banque européenne d’investissement par la banque centrale européenne. Une telle idée a notamment été recommandée par le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz afin de développer le financement de l’investissement en Europe. De telles réflexions ne sont évidemment pas étrangères à l’objet de la mission, en ce qu’elles pourraient offrir à la BPI de nouvelles possibilités d’action. Évidemment, ces investissements, qui pourraient être financés par voie de création monétaire, devraient pleinement s’inscrire dans le cas des priorités économiques décidées au niveau de l’Union européenne.
Proposition : permettre à Bpifrance et à la BEI d’accéder directement au financement de la BCE pour des projets spécifiques d’investissements cohérents avec les priorités économiques décidées au niveau de l’Union européenne.
d. Comparaison avec la KfW : un modèle différent
Par ailleurs, Bpifrance, qui a emprunté quelques traits à la KfW lors de l’élaboration de son modèle, pourrait encore s’inspirer de celle-ci. Pour rappel, la KfW a connu un développement exceptionnel depuis sa fondation, qui avait été inspirée par l’ancienne institution qu’était le Crédit national français. Ainsi, alors qu’en 1980 le total du bilan de la KfW ne s’élevait qu’à environ 28 milliards d’euros, celui-ci s’élevait à 353 milliards d’euros en 2007 puis à près de 495 en 2014, ce qui la place au troisième rang des établissements bancaires du pays, juste derrière Deutsche Bank et Commerzbank. Le résultat net de la KfW est également impressionnant : 2 milliards d’euros en 2014, après 2,6 l’année précédente. Les profits dégagés par la KfW servent ensuite exclusivement à améliorer les conditions de financement des entreprises en baissant le plus possible les taux d’intérêt exigés.
Le succès de la KfW tient en partie aux conditions exceptionnelles de refinancement dont elle dispose. La garantie de l’État allemand lui assure une notation triple A auprès des agences de notation, qui lui permet de se refinancer jusqu’à 1,5 % moins cher que la concurrence.
L’activité de la KfW se concentre principalement sur du crédit bancaire, par le biais d’un système original dans lequel les crédits sont accordés par les banques privées avec des fonds issus de la KfW selon un principe dit de « on-lending ». Ce mécanisme permet l’institution allemande de contourner la réglementation sur les aides d’État d’autant plus facilement que l’activité de la KfW est uniquement contrôlée par le régulateur allemand.
Il en résulte également que son activité fonds de fonds est plus limitée que celle de Bpifrance. En effet, le principal dispositif public présent en Allemagne (voir les dispositifs existants ci-après) est géré depuis 2003 par le Fonds européen d’investissement, sur fonds ERP1 du ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie. Toutefois, le capital-risque investi dans le pays en 2012 représentait environ 0,22 % du PIB. Le marché de capital-risque en Allemagne, comparé à sa puissance économique et aux autres pays, est donc tenu pour être en retrait, notamment si on le compare aux marchés français (0,27 % du PIB) et surtout britannique (0,39 %). La KfW a néanmoins investi dans quelques fonds tels que le High tech Start up Fund (High-Tech Gründerfonds) dans lequel la KfW a investi 40 millions d’euros sur les 301,50 millions d’euros réunis par le fonds depuis 2011. Il s’agit d’un mécanisme hybride dans lequel le fonds acquiert 15 % de la société et accorde un prêt convertible subordonné. Ce fonds est voué à permettre aux start-up technologiques d’appliquer leurs plans de R&D pour mise au point de prototypes, preuve de concept ou lancement industriel et commercial.
La KfW gère également directement des petits fonds tels que le ERP Start-up Fund, qui fonctionne sur un modèle de co-investissement en direct avec un lead-investor (fonds de capital-risque, business angels, etc.) dans des entreprises innovantes (logiciels, BioTech, MedTech, e-commerce) au stade de l’amorçage et du capital-risque. Les investissements dans l’ERP Start-up Fund ont diminué graduellement depuis 2011, de 10 à 13 millions d’euros en moins chaque année. Cela s’explique notamment par les inconvénients des petits fonds de capital-risque, ce qui renforce l’intérêt du projet porté par Bpifrance de développer des fonds de capital-risque au niveau européen.
Fin 2014, la KfW a entrepris de renforcer son activité en fonds propres par deux biais :
– en fonds direct : en collaboration avec le ministère fédéral des affaires économiques et de l’énergie se créerait un fonds de co-investissement dans lequel la KfW investirait moins de 20 %. Ce fonds viendrait ensuite bénéficier aux entreprises technologiques à 50 %, les autres 50 % venant d’investisseurs privés. Cela permettrait d’adresser un plus grand nombre d’acteurs du marché du capital-risque ;
– en fonds de fonds : la KfW investirait moins de 20 % dans des fonds de capital-risque privés, avec un investissement maximum de 25 millions d’euros par fonds. Le reste des capitaux viendrait d’investisseurs privés. La KfW se positionnerait ainsi comme pierre angulaire des investisseurs. Ces fonds investiraient par la suite dans les PME innovantes au stade « start-up » ou en croissance. Cela aboutira à un déblocage d’environ 2 milliards d’euros de capitaux pour le marché du capital-risque.
Si l’activité d’investissement et de soutien à l’innovation de la BPI semble plus développée que celle de la KfW, l’originalité du modèle allemand en matière de financement public des entreprises semble permettre un financement plus large et à de meilleures conditions que le modèle français. Une inflexion en ce sens pourrait être recherchée.
3. La politique du risque et les attentes de BPI en matière de rentabilité
a. Bpifrance prend-elle suffisamment de risques ?
La prise de risque de Bpifrance est au cœur de l’évaluation de son action. Bpifrance doit en effet à la fois préserver son capital, constitué d’argent public, respecter les règles communautaires, notamment celles sur les aides d’État et celle relative à l’investisseur avisé, mais aussi faire preuve d’audace en aidant au développement ou au maintien d’entreprises utiles à la vie économique et sociale de la Nation.
Ces objectifs peuvent parfois apparaître contradictoires. Il convient donc de rappeler en premier lieu que la BPI est soumise à une exigence de rentabilité de la part de ses actionnaires, État et Caisse des dépôts, dont le taux est compris entre 3 % et 4 %. Cette exigence de rentabilité, inférieure à la rentabilité moyenne exigée dans le secteur privé, contraint cependant Bpifrance à accorder une grande attention aux entreprises qu’elle décide de soutenir par la voie du crédit ou par l’investissement direct. Il convient à cet égard de souligner que l’exigence de rentabilité pèse davantage sur la branche investissement, pour laquelle il est plus aisé d’obtenir des rendements élevés que pour les crédits octroyés à travers la branche financement.
À cet égard, Bpifrance a parfois choisi d’investir dans des entreprises très rentables, à l’instar de Verallia, filiale de Saint-Gobain et numéro trois mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, alors même que de nombreux investisseurs privés avaient déjà déposé des offres eu égard au dynamisme économique de cette entreprise.
Paradoxalement, la BPI s’attire ainsi une double critique : d’une part, certains investisseurs privés redoutent un effet d’éviction ou de substitution du public au privé pour les entreprises rentables ; d’autre part, de nombreux entrepreneurs et acteurs publics (commissaires au redressement productif, élus locaux, membres du corps préfectoral, etc.) critiquent le fait que Bpifrance recherche prioritairement des investissements rentables au détriment du soutien à des entreprises en difficulté.
La réalité est plus contrastée : Bpifrance a certes investi à plusieurs reprises dans des entreprises rentables, lesquelles n’auraient certainement eu aucune difficulté à se financer sur le marché, mais elle est également entrée au capital d’entreprises moins rentables, voire d’entreprises en difficulté. À titre d’exemple, le fond direct PME, qui comprend un portefeuille de près de 450 entreprises, finance près de 130 entreprises dont la situation financière est fragile. Cependant, les membres de la mission d’information ne peuvent que constater le peu d’intérêt de Bpifrance pour le sauvetage de grands dossiers industriels, à l’instar de Florange ou de Petroplus, qui lui apparaissent risqués et peu profitables. Ces choix, s’ils dépendent en partie de Bpifrance, résultent également des priorités et de la volonté propres aux deux actionnaires principaux que sont l’État et la CDC, lesquels disposeraient, s’ils le souhaitaient, de tous les leviers nécessaires pour infléchir l’action de la banque publique. Force est de constater qu’en pratique l’État et ses représentants au sein du conseil d’administration de Bpifrance n’ont pas adopté jusqu’ici de posture volontariste dans la manière d’orienter les choix de la banque publique.
Par ailleurs, la sauvegarde d’une entreprise connaissant d’importantes difficultés financières peut entraîner une requalification de l’aide apportée en aide d’État, contraire à l’objectif de concurrence libre et non faussée, ce qui a pour effet de contraindre au remboursement de l’aide augmentée d’une amende. Pourtant, dès lors qu’il est démontré qu’une entreprise peut avoir un avenir malgré des difficultés temporaires, ou qu’elle présente un intérêt particulier pour le dynamisme économique d’une région, alors son sauvetage apparaît non seulement légitime mais également conforme au droit européen (cf. partie II.A.1.c). C’est notamment ce qu’a exprimé, lors des auditions de la mission d’information, le président du conseil de surveillance de la CDC Henri Emmanuelli en recommandant la prise en compte du carnet de commandes de l’entreprise comme indicateur permettant de juger si un sauvetage est légitime.
De manière générale, l’activité de Bpifrance témoigne d’une prise de risque modérément supérieure à celle des banques privées. Elle se traduit notamment par une action de soutien de la trésorerie des entreprises qui se caractérise par une part d’entreprises de solvabilité faible (cotation de la banque de France : 5+ à 9) dans le portefeuille de celles financées en trésorerie plus élevée que celle des entreprises cotées Banque de France. Pour le seul préfinancement du CICE, près de 70 % des entreprises concernées ont un niveau de solvabilité faible alors qu’elles représentent 47 % des entreprises cotées Banque de France. On remarque également que l’activité de Bpifrance s’est fortement développée au cours des deux dernières années, ce qui a naturellement induit une augmentation de sa prise de risque dans la mesure où l’augmentation de l’encours de la banque se fait sans augmentation proportionnelle de ses fonds propres. Pour poursuivre dans cette voie, Bpifrance cherche désormais à augmenter son capital.
Malgré ses caractéristiques, qui tiennent aux missions confiées à la BPI, le coût du risque apparaît en définitive assez faible.
Pour la partie financement, en 2014, le coût du risque (qui correspond aux variations de provisions et aux pertes constatées sur des créances) s’est ainsi élevé à 57,60 millions d’euros dans les livres de Bpifrance Financement « consolidé » pour un encours total de 24,4 milliards d’euros. Ce montant comprend, pour 32,40 millions d’euros, une provision pour dépréciation collective et pour le solde aux risques individualisés qui ne sont pas couverts par une garantie (réelle ou financière). Il convient cependant de souligner que ce coût est calculé après intervention du mécanisme d’assurance fondé sur l’utilisation de fonds de garantie par Bpifrance Financement. Ces fonds de garantie sont dotés par l’État pour amortir le risque, et comptabilisés dans le bilan de Bpifrance Financement, mais n’assurent pas le risque total pris sur les financements garantis. L’insuffisance d’un fonds de garantie face aux risques pris est in fine couverte par les fonds propres de Bpifrance Financement. Comme le montrent les chiffres ci-dessus, les fonds propres de Bpifrance Financement n’ont été jusqu’à présent que peu impactés par ce biais. Quant à l’utilisation des fonds de garantie, elle serait en moyenne, selon les informations données à la mission d’information, d’environ 100 millions d’euros par an. À titre d’exemple : les charges et provisions contentieuses dans les comptes des fonds de garantie publics représentent 340 millions d’euros en 2014, tandis que le résultat comptable des fonds de garantie 2014 est de – 88 millions d’euros.
Les dotations de Bpifrance financement en fonds de garantie pour l’année 2014 se composent de la manière suivante :
Dotations externes issues :
– du Programme 134, pour un montant de 25 millions d’euros ;
– de l’Exécution budgétaire, pour un montant 15 millions d’euros.
Réallocations internes issues :
– des produits financiers issus du Fonds de réserve, pour un montant de 6,5 millions d’euros ;
– de redéploiements de résidus probables futurs de fonds de garantie en gestion extinctive, pour un montant de 228,73 millions d’euros ;
– de redéploiement de résidus probables futurs de fonds de garantie, pour un montant de 86,31 millions d’euros.
BUDGET 2014 DES FONDS DE GARANTIE DE BPIFRANCE FINANCEMENT
(en milliers d’euros)
Besoin de dotation |
Dotation État Programme 134 |
Dotation État Exécution |
Produits financiers issus du Fonds de réserve |
Redéploie-ment de fonds en gestion extinctive |
Redéploie-ment entre fonds |
Redéploie-ment de résidus probables futurs |
Création |
70 000 |
32 040 | ||||
Transmission |
33 000 |
14 710 | ||||
Renforcement de la trésorerie (ex RSF &RT CCE) |
6 000 |
29 320 |
23 570 | |||
Court terme |
13 810 |
2 840 | ||||
Fonds propres |
10 000 |
4 900 |
||||
Innovation |
8 000 |
3 760 |
||||
Prêt d’amorçage (PA) |
7 000 |
5 800 |
2 000 |
|||
Cautions sur projets innovants |
1 000 |
|||||
Financements structurés |
2 500 |
5 000 |
Besoin de dotation |
Dotation État Programme 134 |
Dotation État Exécution |
Produits financiers issus du Fonds de réserve |
Redéploie-ment de fonds en gestion extinctive |
Redéploie-ment entre fonds |
Redéploie-ment de résidus probables futurs |
Fasep-Garantie/garantie de projet à l’international |
540 |
500 |
7 290 |
|||
Avance + |
4 000 |
8 000 |
||||
Préfinancement CICE |
5 350 | |||||
Prêt à la création d’entreprise (PCE) |
18 030 |
|||||
Renforcement de haut de bilan (prêt croissance) |
35 000 |
|||||
Prêt pour l’innovation (PPI) |
14 000 |
6 800 | ||||
Prêt pour l’économie sociale et solidaire (PESS) |
780 |
|||||
TOTAL |
25 000 |
15 000 |
6 500 |
228 730 |
15 000 |
86 310 |
Source : Bpifrance
Pour la partie fonds propres, le coût du risque est principalement constitué de provisions pour dépréciations et représente près de 42 millions d’euros de charges en 2014. Sont classées dans cette catégorie les dépréciations d'obligations convertibles, comptes courants et intérêts courus sur titres disponibles à la vente. Il s'agit en général de sociétés en difficulté mais là encore, le coût du risque est extrêmement faible par rapport aux volumes de participations qu’elle détient (22,4 milliards d’euros).
Il existe toutefois un mécanisme de garantie (France Investissement Garantie) doté depuis 1994 par la CDC. Ce fonds a fait l’objet en 2014 d’un audit externe diligenté par la CDC qui a abouti au renouvellement de la convention cadre pour 6 ans (2014 à 2019) prévoyant une dotation globale de 100 millions d’euros. Les bénéficiaires sont des sociétés de capital-risque (SCR) nationales et régionales, des FPCI, des FCPR et des SIBA (sociétés d’investissement de business angels) et le dispositif vise ainsi à garantir les investissements en capital-risque et en petit capital développement. Depuis sa création, ce dispositif a permis de garantir près de 3,2 milliards d’euros investis en 20 500 opérations par les organismes de fonds propres. Entre 130 et 160 millions d’euros investis par 140 organismes sont garantis chaque année ce qui représente environ 50 % des montants investis en capital-risque déclarés par l’AFIC. La sinistralité de ces dispositifs est plus élevée que celle enregistrée par les fonds de garantie des opérations bancaires mais elle est parfaitement maîtrisée par un mécanisme de stop-loss (plafond d’indemnisation) prévu dans chacune des conventions. En outre, ces dispositifs prévoient également un retour de 10 % sur les plus-values réalisées par les organismes garantis (30 millions d’euros encaissés à ce jour).
Cette présentation de la prise effective de risque par Bpifrance apparaît complexe mais peut se justifier en termes de communication financière, notamment pour permettre aux établissements qui souscrivent aux émissions obligataires de Bpifrance de formaliser une appréciation pertinente du risque associé. Elle ne représente cependant pas le risque effectivement pris par Bpifrance en tant que banque publique grâce au soutien apporté par ces dotations.
Pour la partie fonds propres, des fonds généralistes ont également pour finalité de garantir des opérations de haut de bilan. Pour une part, ils peuvent donc couvrir une partie de l’activité du pôle investissement de Bpifrance. C’est notamment le cas des interventions où Bpifrance participations est souscripteur par l’intermédiaire des fonds de fonds. Au titre de ces fonds, la part d’indemnisation (après application du % de participation) qui a été versée par Bpifrance Financement en prélèvement sur les fonds de garantie représente un montant d’environ 2,8 millions d’euros.
La politique de risque de la banque étant sa colonne vertébrale, elle ne peut être ajustée que très progressivement avec un temps d’observation des résultats (ce qui a été fait par exemple pour lancer les prêts de développement). Un certain infléchissement paraîtrait cependant souhaitable.
b. Les niveaux de rentabilité attendus en matière de participations et de financement
Si l’objectif moyen de rentabilité attendue de Bpifrance par ses actionnaires est proche de 4 %, celle-ci s’apprécie différemment en fonction des activités.
Pour la partie fonds propres, dans laquelle il est plus aisé d’obtenir des niveaux de rentabilité élevés, l’objectif est proche de 6 % ou 8 %. Par conséquent, Bpifrance est dans l’obligation de réaliser de bons placements, comme celui dans Constellium. En 2011, le Fonds stratégique d’investissement (FSI) était ainsi entré au capital du spécialiste de l’aluminium, héritier d’une partie des actifs de Pechiney.
À l’inverse, en matière de financement, le niveau de rentabilité moyen est plus proche de 2 % (innovation et garantie inclus, or, par définition, la garantie n’a pas d’objectif de rentabilité). Toutefois, si l’on s’en tient strictement à l’activité de prêteur traditionnelle, la rentabilité est plus proche de 6 %.
En choisissant d’être contrôlée et régulée par la BCE, Bpifrance, et avant tout ses actionnaires, ont fait un choix exigeant, qui pourrait devenir très contraignant dès lors que les effets de la politique d’assouplissement monétaire s’effaceront. En effet, selon Arnaud Caudoux « la BPI se voit imposer, à ce titre, des ratios de solvabilité dont les minima réglementaires augmentent depuis plusieurs années et continueront à augmenter jusqu’en 2019, pour atteindre environ 12 %. Parallèlement, elle est soumise à des exigences de rentabilité par ses actionnaires qui, pour augmenter le ratio de solvabilité, apportent des fonds propres qui ne peuvent pas baisser à proportion de l’augmentation du ratio. Cette spirale représente pour le financement de l’économie un risque, qui a été un peu masqué par le quantitative easing de la BCE mais qui est réel et qui va perdurer.[…] Notre chance tient à deux éléments. Tout d’abord, les exigences de rentabilité de notre actionnaire tiennent compte de nos métiers, de sorte qu’il nous demande, non pas 10 % à 12 % de retour sur fonds propres, mais 3 % à 4 %, soit le coût du capital de l’État. Aujourd’hui, il nous est possible de parvenir à ce niveau de rentabilité, grâce au second élément, qui est que nous gérons des ressources publiques. Les fonds de garantie sont en effet un amortisseur de risque considérable, donc un lisseur de résultats. La caractéristique de notre profil risque-rentabilité est ainsi d’être beaucoup plus stable que celui d’une banque et globalement un peu moins élevé. Depuis 2008, le retour sur investissement – je parle ici uniquement du financement bancaire et non de l’investissement, qui n’est pas soumis à ces contraintes – est toujours compris entre 2 % et 4 % ».
Si l’exigence de rentabilité est un peu inférieure à celles du secteur privé et que la politique de risque lui est au contraire légèrement supérieure les écarts avec celui-ci sont somme toutes assez faibles. Toutefois, la direction de Bpifrance a confirmé aux membres de la mission d’information que le retour global attendu sur fonds propres se situerait désormais autour de 3,5 %, augmentant ainsi la capacité de Bpifrance à prendre des risques, à accorder des crédits à de meilleurs coûts ou tout simplement à investir dans des entreprises moins rentables. Mais cela sera-t-il suffisant pour permettre à la BPI de prendre davantage de risques ?
4. L’aide aux entreprises en difficulté et la question spécifique du retournement : une intervention insuffisante de Bpifrance
La question spécifique de l’aide directe aux entreprises en difficulté, a suscité de nombreux débats sur le rôle et la spécificité d’une banque publique d’investissement. En effet, à l’heure où les défaillances d’entreprises ont connu un record en 2014 (45), notamment pour les ETI, la prévention de Bpifrance à agir directement en retournement d’entreprises en difficulté a ainsi pu être pointée comme une faiblesse par de nombreux interlocuteurs, tant au niveau national qu’en région.
Dans le domaine des fonds propres en particulier, la mission a parfois été confrontée à un décalage entre la perception de la BPI que peuvent avoir certains acteurs locaux ou nationaux, du privé comme du public, et la réalité de ses possibilités et de son action. Sans doute Bpifrance pourrait-elle utiliser plus largement les marges de manœuvre dont elle dispose pour se comporter un peu plus comme un « investisseur assumé », au service de l’intérêt général, et non pas seulement comme un « investisseur avisé » au sens de la réglementation européenne, laquelle n’exclut d’ailleurs pas toujours de plus larges interventions, notamment au profit d’entreprises en difficulté. Il ne tient en effet qu’à elle, ainsi qu’à ses principaux actionnaires, de faire mentir la citation de George Bernard Shaw selon laquelle « une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut ».
a. Les modalités d’intervention de Bpifrance en matière d’aides aux entreprises en difficulté
Il convient avant tout de rappeler que Bpifrance n’intervient que très rarement en « haut de bilan ». Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la doctrine d’intervention précise que l’ensemble des interventions de la banque doivent être financièrement soutenables conformément à la règle européenne de l’investisseur avisé ce qui implique la réalisation d’un retour global sur capitaux investis permettant d’assurer la pérennité de la société et de ses missions. Le conseil d’administration de Bpifrance définit ainsi des cibles de niveau de rentabilité et de risque pour le groupe et pour chacune de ses activités, et en assure le suivi sur la base d’indicateurs quantitatifs dédiés.
En investissement, Bpifrance peut intervenir exceptionnellement sur le segment du capital retournement qui vise au redressement des entreprises en difficulté. Elle privilégie pour cela des investissements minoritaires aux côtés d’investisseurs privés dans des fonds gérés par des équipes indépendantes spécialisées. Ce mode d’action est justifié par les équipes de Bpifrance par son incapacité à investir de façon majoritaire dans des entreprises et à la présomption d’aide d’État en cas d’investissement dans des entreprises en difficulté (nécessité de notification aux autorités de la concurrence). De manière plus singulière et moins compréhensible, s’agissant d’une banque publique, le risque d’image inhérent à la restructuration d’entreprises en difficulté est également invoqué par Bpifrance pour justifier sa prévention à intervenir directement au profit d’entreprises en difficulté.
En financement, Bpifrance est soumis aux réglementations des aides d’État, qui interdisent le financement des entreprises en difficulté avérée ou celles qui ne sont pas à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. Ces notions sont parfois sujettes à caution et peuvent s’appliquer selon une géométrie variable. En effet il est possible d’apporter une aide à des entreprises fragilisées. Dans ce contexte, le terme « fragile » qualifie des entreprises rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origines structurelles. À l’inverse, est considérée comme entreprise en difficulté avérée : « une entreprise qui est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec des ressources que sont prêts à leur apporter des propriétaires actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une aide directe des Collectivités Publiques, vers une mort économique quasi certaine, à court ou moyen terme ». La frontière n’est pas toujours clairement établie.
Enfin, protégée par le mécanisme de « cession Dailly » (46), principalement dans le cadre des marchés publics, Bpifrance réussit néanmoins à intervenir en mobilisation de créances au bénéfice d’entreprises plus fragilisées.
Il semble cependant que Bpifrance n’utilise pas toujours pleinement les marges de manœuvre dont elle dispose, tant sur la partie financement que sur la partie investissement.
Les membres de la mission d’information ont ainsi eu connaissance d’un dossier dans lequel une entreprise en croissance dans le domaine du e-commerce, qui sollicitait une intervention de Bpifrance afin de préserver son indépendance et de garantir son développement futur face à un fonds vautour, s’est vu refuser sa demande en raison de son insuffisance en fonds propres, ce qui n’a pourtant rien d’exceptionnel dans ce domaine particulier. Les banques commerciales ont refusé d’apporter leur aide pour le même motif. Or, cela est d’autant plus dommageable que l’activité de cette entreprise s’inscrit directement dans la politique industrielle de l’État, au travers des plans industriels, et que son pillage, voire sa fermeture, aurait un impact négatif sur l’ensemble du territoire concerné. D’autres exemples portés à la connaissance de la mission vont dans ce sens.
Il n’y a pas lieu de généraliser à partir de cas isolés mais il semble néanmoins que la politique de limitation des risques suivie par Bpifrance la prive parfois de la capacité d’agir en soutien des entreprises qui connaissent des difficultés ou sont confrontées à des investisseurs étrangers qui font peser un risque sur l’existence même de l’entreprise, y compris lorsque celles-ci sont rentables.
À cet égard, le recours systématique aux outils d’aide à la décision (OAD), programmes informatiques automatiques permettant de décider s’il convient d’accorder ou non une aide financière, et qui a été décrit aux membres de la mission d’information, mériterait un réexamen sous peine d’exclure d’office un certain nombre d’entreprises qui pourraient pourtant s’inscrire légitimement dans la politique de la BPI.
A contrario, certaines initiatives locales mériteraient d’être généralisées. Il s’agit par exemple de la mise en place par Bpifrance et la région Île-de-France d’un « prêt Rebond », prêt de développement destiné à financer des projets structurants dans des entreprises en difficulté, c’est-à-dire ayant connu des pertes sur les quatre derniers exercices mais dont au moins un bilan sur les quatre est positif et qui ont des commandes à venir. Le montant moyen de ces prêts est d’environ 300 000 euros et Bpifrance se concentre sur le financement du besoin de fonds de roulement ou des investissements immatériels (prospection commerciale à l’étranger, par exemple) ; elle doit convaincre une banque de participer pour un même montant mais sur d’autres segments.
C’est une des rares situations dans lesquelles Bpifrance est à la fois pourvoyeuse d’un crédit et d’une garantie. La garantie est de 80 % : 40 % par la région et 40 % par Bpifrance. C’est une véritable valeur ajoutée et cela répond à une forte demande à laquelle le marché ne répond pas. Il est important que ce type d’entreprise puisse redémarrer. Mais seules les entreprises industrielles porteuses d’emploi sont ciblées. Les critères de décision sont ceux de la région ; il arrive que celle-ci juge le projet trop peu risqué et qu’elle préfère mobiliser son fonds de garantie pour des projets qui en ont plus besoin. Au total, seule une centaine de prêts rebonds est accordée chaque année.
Proposition : généraliser sur l’ensemble du territoire la mise en place de « prêts rebond » avec un niveau de garantie d’État supérieur destiné aux entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles et permettant de financer un investissement de compétitivité ou de développement commercial.
b. Le recours aux fonds de fonds
Comme indiqué ci-dessus, l’activité de retournement "pure" contrevient aux principes d’intervention de Bpifrance :
– elle suppose généralement un investissement majoritaire afin de disposer de l’ensemble des leviers d’action. Or Bpifrance intervient systématiquement de manière minoritaire et ce aux côtés d’investisseurs privés majoritaires, sauf de rares exceptions ;
– les investissements publics dans les entreprises en difficulté font l’objet d’une présomption d’aide d’État et doivent, de ce fait, être systématiquement notifiés aux autorités européennes, induisant des délais plus longs, voire un risque de non-réalisation de l’opération d’investissement.
C’est pourquoi, en matière de retournement, Bpifrance privilégie la souscription dans des fonds partenaires dédiés au financement du retournement des entreprises. Sur les années 2013 et 2014, ce sont 123 millions d’euros qui ont été engagés dans des fonds partenaires dont la capacité d’investissement totale est de 365 millions d’euros, à comparer à quelques dizaines de millions d’euros sur les cinq années précédentes.
FONDS DE RETOURNEMENT FINANCÉS PAR LA BPI | ||
(montants en millions d’euros) | ||
NOM DU FONDS |
MONTANTS INVESTIS |
NOMBRE TOTAL DE SOCIÉTÉS INVESTIES |
France SPÉCIAL SITUATION I |
15 |
7 |
France SPÉCIAL SITUATION II |
25 |
Closing récent, activité d’investissement en cours. |
FCDE I |
90 |
16 |
FCDE II |
90 |
1er closing récent, activité d’investissement en cours. À terme 20 investissements prévus |
VERMEER |
4,9 |
5 |
Opportunités et Régions 1 |
3,4 |
9 |
Opportunités et Régions 2 |
7,2 |
Closing récent activité d’investissement en cours. À terme, 15 investissements prévus dont 3 déjà réalisés |
Franche Comté Défis 2010 |
0,5 |
13 |
Franche Comté Défis 2 |
1 |
3 investissements réalisés. |
Fonds Lorrain de Consolidation |
2,3 |
12 |
Source : Bpifrance |
||
Si cet effort en faveur de la structuration d’un secteur de capital retournement en France est positif, il demeure cependant extrêmement limité tant dans les moyens alloués que dans la capacité des acteurs privés ainsi soutenus à pouvoir agir dans le cas de restructuration d’envergure nécessitant des moyens importants et une prise de risque telle que la plupart des acteurs privés ne souhaitent pas l’assumer. Lorsque ces deux éléments sont présents, il serait souhaitable de disposer d’une capacité de retournement publique.
c. Créer une capacité de retournement publique
Le débat sur la création d’une capacité de retournement publique ne date pas de la création de Bpifrance. Ainsi, l’intervention sur le segment du capital-retournement a été discutée plusieurs fois en comité de direction de CDC Entreprises, qui intervenait dans une phase ultérieure (dite de post-retournement), c’est-à-dire dans une logique de consolidation de l’entreprise, une fois la restructuration effectuée. Ainsi, CDC Entreprises s’interdisait par principe de racheter une entreprise engagée dans un processus de faillite ou de liquidation judiciaire.
L’activité de retournement est, en effet, très sensible : elle donne lieu à une restructuration importante de la société (restructuration de sa dette, changement du management, cession partielle d’actifs, licenciements, fermetures de sites voire délocalisations, etc.), que certains jugent incompatible avec la notion d’investisseur d’intérêt général inhérente à l’activité d’un opérateur public. Elle soulève également un problème juridique, dans la mesure où le retournement requiert la détention de la majorité du capital de l’entreprise et est donc difficilement praticable par une structure publique soumise au droit des aides d’État d’une part et aux autres règles s’appliquant à raison de l’appartenance au secteur public d’autre part.
Néanmoins, une telle capacité manque actuellement dans le paysage économique français, ce qui fragilise sa capacité de mutation et de résilience aux chocs économiques, en particulier dans le domaine industriel. De nombreuses entreprises se voient acculées à la faillite par effet systémique dû à l’atonie de la croissance alors même que ne sont en cause ni la solidité de leur modèle ni leurs perspectives de croissance à l’avenir. Des commissaires au redressement productif ont notamment évoqué l’absence de cet outil (à l’exception du Fonds de développement économique et social (FDES), dont la capacité d’intervention est limitée à 200 millions d’euros dans la loi de finances pour 2015.
Le Rapporteur propose donc de développer une capacité publique de retournement spécifique au sein de Bpifrance qui disposerait, le cas échéant, de la garantie de l’État afin de ne pas fragiliser l’ensemble de la structure.
Proposition : créer une capacité de retournement publique – ou semi-publique via des fonds régionaux – dotée de moyens suffisants pour agir dans des dossiers industriels délaissés par les acteurs privés spécialisés dans le domaine du retournement d’entreprise et bénéficiant d’une garantie renforcée de l’État. Intervenir à ce sujet au niveau européen.
Les modalités peuvent cependant être discutées et l’idée avancée par le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron lors de son audition du 15 septembre 2015 apparaît des plus intéressantes. Ainsi, celui-ci indiquait : « Quant au fond de retournement, j’y suis, pour être clair, favorable (…) Actuellement, nous utilisons le FDES et l’aide à la réindustrialisation (ARI), qui sont des mécanismes discrétionnaires, à notre main, pour accompagner des retournements. Par ailleurs, certaines expériences sont concluantes. Deux régions, Rhône-Alpes et Franche-Comté – et j’ai écrit à leurs présidents pour que l’on puisse étudier la manière dont nous pourrions développer et généraliser leurs initiatives – sont parvenues à mettre en place des fonds régionaux de retournement. Nous réfléchissons donc – et mon engagement sur ce point est plein et entier, car je veux que nous aboutissions – à la création d’un fonds de retournement qui pourrait être détenu à 49 % par l'État, Bpifrance et les régions, et à 51 % par le privé. Nous ne développons pas suffisamment cette action, dont nous avons pourtant besoin ».
Le Rapporteur soutient également cette idée car l’association de partenaires privés, qui peut également se penser dans le cadre des filières lorsque certains grands groupes souhaitent apporter leur expertise et leur soutien financier à une entreprise sous-traitante en difficulté, apparaît comme un moyen pragmatique pour pousser à une réelle structuration du secteur du capital-retournement en France.
La création d’une telle capacité de retournement publique, ou semi-publique, doit s’accompagner d’une action au niveau européen afin que les règles européennes en matière d’appréciation des aides d’État soient assouplies, comme cela est déjà le cas en matière d’innovation. Pour rappel, le régime de minimis avait été grandement assoupli entre 2009 et 2012 avant d’être à nouveau resserré en 2013 alors même que la situation économique ne s’était pas améliorée et que les faillites étaient toujours en progression.
B. LA STRATÉGIE ET L’ACTION DE BPIFRANCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
La première source de financement des entreprises sont les fonds propres, appelés à juste titre capitaux à risques. Ces derniers apportés par les actionnaires permettent de prendre les risques que le créancier ne prend habituellement pas. Il est généralement admis que la problématique récurrente du financement des entreprises en France provient fondamentalement d’une insuffisance de fonds propres. C’est pourquoi l’action de la branche investissement de Bpifrance est décisive bien qu’elle n’égale pas les montants engagés par la branche financement.
Bpifrance participations regroupe ainsi, depuis novembre 2014, l’ensemble des participations et des investissements opérés par la BPI. À la fin du premier semestre 2015, son bilan représente 16,338 milliards d’euros dont 441 millions d’euros de résultat semestriel et après distribution de 784 millions d’euros de dividendes. En termes de trésorerie, celle-ci est passée de 2,037 milliards d’euros à 1,236. Cette baisse est la conséquence de la distribution évoquée ci-dessus mais aussi des flux nets entre les acquisitions (– 707 millions d’euros), les cessions (+ 439 millions d’euros) et les revenus du portefeuille (+ 219 millions d’euros).
Pour l’année 2014, le résultat financier de Bpifrance Participations (556 millions d’euros) est composé à 83 % de distributions des dividendes reçus des participations.
Les investissements de Bpifrance investissement, dans les fonds comme dans les entreprises, s’effectuent de façon sélective, en fonction du potentiel de création de valeur (pour l’investisseur et pour l’économie nationale) des entreprises ou des fonds financés. Toutefois, Bpifrance investissement n’est pas un investisseur comme un autre mais intervient en complément de l’offre d’investissement des segments de marché caractérisés par une insuffisance de fonds privés.
L’ensemble de ses opérations sont guidées par les deux principes directeurs suivants :
– Bpifrance Investissement intervient en vue de créer, via des prises de participation minoritaires, un effet d’entraînement de l’investissement privé par l’investissement public. Qu’elle investisse ses ressources propres ou celles d’autres souscripteurs – publics ou privés – dont elle a la gestion, Bpifrance Investissement recherche des co-investisseurs privés auxquels elle laisse une part significative, afin de stimuler le marché de l’investissement ;
– Bpifrance investissement est un investisseur avisé opérant aux conditions de marché. Lorsqu’elle co-investit, Bpifrance Investissement intervient selon les mêmes dispositions financières et juridiques que les co-investisseurs (pari passu). Dans la mesure du possible, elle siège au sein des organes de gouvernance des sociétés de son portefeuille et aux comités consultatifs et stratégiques des fonds partenaires.
Bpifrance, via ses investissements en fonds propres, a donc pour principal objectif de dynamiser et développer les acteurs privés du marché, en incitant à la prise en compte des meilleures pratiques, notamment en matière d’investissement de long terme, d’investissement socialement responsable (ISR) et de prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Bpifrance Investissement finance cependant aussi le développement et la croissance des TPE, des PME et des ETI, dans la continuité du programme FSI France Investissement 2020 et de la doctrine d’investissement du FSI. Ces deux programmes visent à l’émergence, la consolidation et la multiplication des ETI, maillon essentiel à la compétitivité de l’économie française et au développement des exportations. Bpifrance peut donc investir, en tant que fonds souverain, les capitaux qui lui ont été confiés en gestion par l’État, et ce dans des configurations dans lesquelles il n’est pas toujours observé de faille de marchés. À ce titre, Bpifrance pratique des interventions (directes ou indirectes) de trois natures différentes, correspondant chacune à une catégorie d’entreprises.
Bpifrance doit consacrer une part significative de ses interventions aux segments de marchés sur lesquels le manque de fonds privés est le plus marqué et qui sont structurellement déficitaires en capitaux pour ce qui est des interventions dans les TPE, les PME et les plus petites des ETI qui, notamment du fait de leur taille, du caractère amont de leur stade de développement et du caractère risqué de leur projet de croissance, rencontrent des difficultés structurelles de financement auprès du système bancaire comme des investisseurs privés.
S’y ajoutent des interventions ciblées auprès des acteurs de référence de chaque secteur ou filière justifiés par leur caractère stratégique, quelle qu’en soit la taille, PME, ETI et, dans une moindre mesure, grandes entreprises de croissance. Pour ces opérations, de capital-développement et dans une moindre mesure de capital-risque, Bpifrance agit dans une logique de consolidation et de croissance, notamment par le soutien à l’innovation et à l’export.
Enfin, Bpifrance conduit des investissements ponctuels au capital des plus grandes entreprises considérées comme stratégiques pour l’économie nationale, notamment dans une logique de stabilisation de leur actionnariat.
• Une volonté de coopération loyale avec le secteur privé
Pour répondre aux craintes de certains acteurs privés de voir Bpifrance se substituer au secteur privé, Bpifrance a signé, le 26 novembre 2013, une charte de bonnes pratiques avec l’Association française des investisseurs en capitaux (AFIC). Cette charte précise les conditions d’intervention de Bpifrance. Quand elle identifie un projet d’investissement, Bpifrance recherche les co-investisseurs privés potentiellement intéressés pour participer de manière significative aux « tours de table » auxquels elle se joint pari passu. Ceci permet soit de confirmer la situation de défaillance de marché en cas de constatation de la carence effective d’investisseurs privés, soit, dans le cas contraire, de les mobiliser.
Toutefois, il est précisé que, lorsque Bpifrance Investissement investit dans un contexte d’insuffisance de fonds privés (notamment par l’intermédiaire de certains fonds sectoriels et/ou fonds filières), la présence de co-investisseurs privés reste recherchée mais n’est pas toujours possible. Dans ce cas, la BPI peut agir seule mais doit investir conformément au principe européen de l’investisseur avisé en économie de marché.
Enfin, en ce qui concerne les appels d’offres et processus compétitifs structurés de recherche de fonds, notamment les processus d’enchères organisés, Bpifrance s’engage à n’effectuer aucune surenchère sur les propositions des acteurs privés. Dès lors qu’une opération de financement fait l’objet d’offres privées, Bpifrance ne surenchérira pas sur les conditions proposées par les acteurs privés. Ces bonnes pratiques peuvent souffrir des exceptions dans le cas des investissements ponctuels au capital d’entreprises stratégiques.
2. L’action de Bpifrance en matière d’investissement et la division entre fonds de fonds et investissement direct
L’investissement dans les différentes catégories d’entreprises se fait de manière directe ou indirecte. Bpifrance dispose ainsi de plusieurs fonds qu’elle contrôle directement – ce qui n’exclut pas l’intervention de ces fonds auprès d’investisseurs privés –, mais la majeure partie des investissements se fait via des fonds de fonds.
LES MOYENS CONSACRÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT | |||
(en millions d’euros) | |||
2012 |
2013 |
2014 | |
Intervention directe | |||
– Capital-amorçage |
2 |
2 |
1 |
– Capital-risque |
73 |
113 |
128 |
– Capital-développement |
1 325 |
637 |
674 |
– Capital-transmission | |||
– Capital-retournement | |||
Intervention via les fonds de fonds | |||
– Capital-amorçage |
146 |
96 |
34 |
– Capital-risque |
61 |
318 |
187 |
– Capital-développement/capital-transmission |
182 |
97 |
455 |
– Capital-retournement |
0 |
1 |
90 |
Source : Bpifrance |
|||
• Les fonds directement contrôlés par Bpifrance
Les fonds contrôlés directement par Bpifrance sont de deux natures : il s’agit soit de fonds abondés exclusivement par elle, mais qui agissent en lien avec d’autres fonds privés, soit de fonds dans lesquels des partenaires privés apportent une partie du capital mais dont elle contrôle largement la stratégie.
La répartition de ces fonds s’opère suivant les objectifs et la taille des entreprises visées, il peut ainsi s’agir de fonds spécialisés dans le soutien aux PME et aux ETI, de fonds thématiques (nucléaire, biotechnologies, numérique, etc.) ou encore de fonds destinés à investir dans les grandes entreprises.
Après une année 2013 marquée par un soutien aux PME et petites ETI dans un marché du capital développement atone, Bpifrance a accompagné en 2014 la reprise du marché. Avec 109 opérations pour 159 millions d’euros d’investissements, la direction Fonds propres PME a vu son nombre d’opérations croître de 13 % pour un montant de souscriptions en hausse de 28 % par rapport à 2013.
En particulier, avec 90 opérations pour 96 millions d’euros investis, France Investissement Régions a démontré un fort dynamisme au service des PME régionales et un fort effet d’entraînement des fonds de place : avec 74 co-investisseurs différents dans plus de 90 % des dossiers investis à partir de 2014, ce sont 2,40 € de capitaux tiers qui ont été investis pour 1 euro octroyé par Bpifrance. Au total, 73 % des participations de France Investissement Régions se trouvent hors d’Île-de-France, (contre 56 % pour le reste de la profession). Ces résultats traduisent le fort engagement de Bpifrance au sein des territoires, en s’appuyant sur le réseau d’investisseurs présents au sein des directions régionales.
En matière de fonds thématiques, le fonds de développement des entreprises nucléaires (FDEN), abondé de 133 millions d’euros par Bpifrance et les principaux acteurs industriels de la filière (Alstom, EDF, Areva, Vinci et Eiffage), vise des investissements de 1 à 13 millions d’euros dans des entreprises ayant une activité significative dans le secteur nucléaire, fort pourvoyeur d’emplois pérennes.
En matière d’innovation, avec son fonds Large Venture, Bpifrance a effectué 40 opérations en 2014, soit cinq de plus qu’en 2013. En 2013, ce fonds a notamment profité à des entreprises innovantes comme Withings, Medtech, Nétatmo, ou encore Sigfox.
Sur certains de ces fonds, le Rapporteur constate cependant une lenteur de l’utilisation des fonds disponibles qui pose la question complexe des critères d’investissement mais aussi, une nouvelle fois, de la prise de risque. En effet, plusieurs années après leur mise en place, certains fonds peinent à consommer leurs crédits. À titre d’exemple, le fonds Ecotechnologies, lancé en juin 2012, dispose de 150 millions d’euros mais n’en a investi que 31,7 au 31 décembre 2014. Cela concerne également les fonds gérés par la BPI au titre du PIA : le fonds « ambition numérique », lancé en juin 2011, dispose ainsi de 300 millions d’euros mais n’en a investi que 82 à la fin avril 2015. Or, ces fonds ne sont pas réellement fongibles, ce qui signifie qu’en l’absence d’investissements, les capitaux demeurent immobilisés.
Bpifrance explique à juste titre qu’il est nécessaire d’instruire correctement les dossiers et de trouver des partenaires privés (en application de la doctrine du co-investissement), ce qui nécessite un certain temps. Toutefois, dans une optique de relance de l’économie, il convient de faire attention à ce que la réactivité des fonds publics puisse être suffisante. À noter que la même remarque peut globalement s’appliquer aux fonds de fonds, bien qu’étant donné leur nombre, il soit difficile d’en tirer un enseignement unique.
En dehors de cette réserve, l’investissement direct permet une meilleure sélectivité des investissements, une plus grande réactivité, un meilleur contrôle des investissements effectivement réalisés et des données directement exploitables en termes d’effet de levier.
• La majorité des investissements s’opère de manière indirecte
Malgré les avantages liés à l’investissement direct, plus des deux tiers des investissements annuellement réalisés par Bpifrance s’opèrent via des fonds de fonds dans lesquels Bpifrance a souscrit des participations. L’action de Bpifrance en matière d’investissement repose ainsi sur près de 300 fonds partenaires. Par cette action, la BPI contribue à structurer l’offre privée en matière de capital-risque et de capital-développement mais le suivi de ces investissements est plus difficile à réaliser.
Il s’agit d’une activité par nature cyclique puisque ses participations sont prises pour plusieurs années, ce qui explique les écarts notables en termes de montants investis d’une année sur l’autre. Ainsi, en 2013, 444 millions d’euros ont été investis dans 41 fonds. L’activité fonds de fonds a, de nouveau, fortement cru en 2014 avec 641 millions d’euros de souscriptions nouvelles, dans 39 véhicules différents.
Ces souscriptions se sont réparties entre 466,8 millions d’euros pour compte propre et 174,2 millions d’euros pour compte de tiers (Programme d’investissements d’avenir, etc.). À noter que le capital développement a représenté plus de 85 % des montants souscrits en 2014 (soit 548 millions d’euros), pour 24 véhicules, principalement du fait des cycles de levées des équipes de gestion.
En matière de fonds de fonds régionaux et interrégionaux, Bpifrance a poursuivi son soutien aux équipes de gestion proches des territoires ; ainsi, 53,50 millions d’euros ont été souscrits dans dix véhicules dont deux nouvelles souscriptions et huit souscriptions complémentaires. À noter que, contrairement à l’activité nationale, l’action en fonds de fonds régional s’est majoritairement inscrite en amorçage, avec 32,70 millions d’euros de souscriptions, aux côtés des Régions.
Conformément à l’objectif de renforcement de la taille des fonds souscrits, et en cohérence avec les besoins du marché, le ticket moyen de Bpifrance en fonds de fonds a progressé de plus de 39 % en 2014, pour s’établir à plus de 16,40 millions d’euros. Les fonds de capital croissance Keensight IV et Partech Growth ont, par exemple, chacun reçu 70 millions d’euros de souscriptions de la part de Bpifrance. Bpifrance cherche ainsi à répondre à l’insuffisance du financement des entreprises dans leurs dernières phases de développement.
En 2014, Bpifrance a également lancé deux nouveaux fonds de fonds gérés pour compte de tiers. D’une part, le FFI3+, doté de 70 millions d’euros complémentaires, après 50 millions d’euros en 2013 totalement souscrits à date, a pour objectif d’investir dans des fonds de capital développement d’une taille importante. D’autre part, le fonds de fonds MultiCap Croissance (FFMC2), doté de 400 millions d’euros par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) qui vise à déployer des souscriptions de 20 à 60 millions d’euros dans des fonds de capital-risque et capital croissance d’une taille cible de 200 millions d’euros. Ces deux fonds de fonds ont d’ores et déjà souscrit à neuf véhicules pour un montant total de 140 millions d’euros.
Plusieurs acteurs, tels que Henri Emmanuelli (qui siège également au comité des investissements de Bpifrance qui examine les dossiers supérieurs à 50 millions d’euros), ont néanmoins posé la question de l’expertise métier et industrielle de Bpifrance. En effet, les données recueillies par la mission d’information montrent une prééminence nette des profils financiers, y compris dans la branche investissement ce qui peut conduire à une analyse des dossiers centrée sur le seul rendement économique. Il serait ainsi souhaitable de veiller au recrutement de personnalités spécialisées dans le domaine du développement industriel pour étoffer les équipes de la branche investissement de Bpifrance.
Proposition : accroître les recrutements de collaborateurs spécialisés dans le domaine du développement industriel au sein de la branche investissement de Bpifrance.
3. L’intervention majoritaire à travers des fonds de fonds : démission intellectuelle ou nécessité opérationnelle ?
Lors de son audition devant les membres de la mission d’information, Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint-Gobain, a regretté que l’activité de Bpifrance en matière de fonds de fonds ne soit assimilable à une « démission intellectuelle ». Cette formule étonnante, qui excède sans doute un peu la pensée de son auteur, renvoie aux interrogations concernant la répartition des moyens de la BPI entre investissement direct et investissement indirect, le second étant, comme indiqué ci-dessus, largement privilégié.
En effet, si le recours aux fonds de fonds peut se justifier par des nécessités opérationnelles, il n’est pas sans présenter des inconvénients.
Parmi les raisons invoquées pour justifier ce mode d’intervention, l’une des principales réside évidemment dans l’effet multiplicateur sur le nombre de PME financées : près de 3 000 entreprises ont déjà bénéficié indirectement (au travers des fonds partenaires) d’un investissement de Bpifrance. Un tel nombre d’entreprises serait impossible à atteindre via des investissements directs décidés par les équipes de Bpifrance Investissement (l’activité d’investissement en capital n’est à ce titre pas comparable au nombre de PME finançables en direct sous forme de prêts), ou alors au prix d’un accroissement significatif des effectifs et, partant, des charges de gestion, de la société. À cet égard, et compte tenu des moyens mis à disposition de Bpifrance pour l’investissement, il semble nécessaire, sans bien sûr renoncer à l’activité fonds de fonds, de renforcer les équipes de la branche investissement.
Par ailleurs, le recours aux fonds de fonds se justifie pleinement s’agissant de la mise en place de fonds internationaux. À titre d’exemple, Bpifrance a concrétisé un partenariat avec la China Development Bank qui a permis la naissance du fonds transfrontalier Sino French Midcap Fund, géré par Cathay Capital Private Equity. La BPI a apporté 100 millions d’euros à parité avec CDB Capital (sur 500 millions d’euros). Le fonds vise à développer les échanges économiques entre la Chine et la France au travers de l’internationalisation des PME des deux pays.
Une autre raison tient directement aux contraintes exercées par le droit européen et reprises par la doctrine d’investissement de Bpifrance, selon lesquelles l’intervention directe de Bpifrance ne s’entend que sous forme de co-investissement. Un tissu de fonds partenaires robustes et susceptibles de co-investir aux côtés de Bpifrance est dès lors indispensable. Par son action de structuration de la chaîne du financement et de professionnalisation des gérants, l’activité fonds de fonds de Bpifrance contribue à développer cet écosystème indispensable de fonds partenaires.
Enfin, il convient de souligner que les fonds partenaires agissent sur tous les segments de la chaîne du financement (amorçage, capital-risque, capital croissance, capital développement, capital transmission, mezzanine, retournement,…) ce qui nécessite des montants significatifs, dont Bpifrance apporte une part.
l Il n’en demeure pas moins que la sélection des priorités de ces fonds, leur coût de gestion et le contrôle effectif de leurs investissements pour s’assurer de leur conformité avec les objectifs pour la BPI a été créé, posent question. En outre, bien qu’il soit difficile de quantifier leur nombre et leur importance en l’absence de recensement précis, des projets ne se font pas faute de partenaires en raison du principe de cointervention.
Les équipes de Bpifrance en charge de la sélection, du suivi et du contrôle des fonds de fonds se limitent à dix-huit personnes au sein d’une direction dédiée. Comme précisé plus haut, ces dix-huit personnes doivent assurer le contrôle de plus de 300 fonds partenaires, qui ont eux-mêmes souscrit dans plus de 3 000 entreprises, ce qui limite nécessairement les capacités effectives de contrôle. Bpifrance indique néanmoins que la signature des conventions d’investissement fait l’objet de négociations très approfondies avec les gérants des fonds partenaires en matière de stratégie d’investissement (orientation des sommes collectées vers des cibles précises) et de frais de gestion. Par ailleurs, les sommes effectivement investies dans les entreprises font l’objet de reporting trimestriels et tous les rapports sont certifiés deux fois par an par le commissaire aux comptes du fonds.
Proposition : donner les moyens à Bpifrance de renforcer les équipes de la branche investissement, tant sur la partie fonds de fonds que sur la partie investissement direct, afin de permettre un meilleur suivi et une meilleure sélectivité des investissements en fonds propres.
l Le calcul de l’impact des fonds investis par Bpifrance sur l’investissement privé, c’est-à-dire leur effet de levier, n’apparaît pas toujours significatif. En effet, l’effet de levier se mesure en rapportant le montant souscrit par Bpifrance au montant total des souscriptions réunies par le fond, mais sans qu’il soit possible de distinguer les sommes qui auraient été réunies en l’absence de participation de Bpifrance. Il est certain que la souscription de Bpifrance à certains de ses fonds a un effet bénéfique sur leur capacité générale à lever des fonds. À titre d’exemple, le premier fonds de capital croissance « Partech growth » n’aurait clairement pas atteint la taille de 200 millions d’euros pour son premier closing réalisé en fin d’année 2014 sans la souscription de la part de Bpifrance de 90 millions d’euros. De la même manière, le fonds de 4ème génération KEENSIGHT IV a atteint une taille finale de 250 millions d’euros grâce à la souscription de 75 millions d’euros de Bpifrance. À titre indicatif, la taille du fonds précédent, dont la levée avait été très difficile, n’était que de 100 millions d’euros.
Enfin, on constate que les coûts d’intervention et de gestion (2 % en moyenne pour les fonds de fonds), bien qu’encadrés et plafonnés dans certaines circonstances, représentent des sommes significatives. Pour un stock de capital détenu par Bpifrance à travers des fonds de fonds représentant 1,7 milliard d’euros, le montant des commissions de gestion payées aux fonds/sociétés partenaires représente 50,5 millions d’euros en 2014, soit un coût non négligeable. À cet égard, le Rapporteur note avec intérêt que, désormais, la BPI entend plafonner le total de ces coûts autour de 20 % sur la durée de vie des fonds et inciter les gérants à investir dans les entreprises 100 % de la taille des fonds, ce qui a pour effet d'effacer les frais de gestion. Dans ce cas, tout le fonds est investi dans les entreprises. Le déploiement à 100 % n'est cependant possible que lorsque le gérant l'accepte, mais aussi tous les autres souscripteurs du fonds. Certains de ces derniers refusent, car ils souhaitent recevoir les produits de cession plutôt que de les voir réinvestis par les gérants.
Cela mérite d’autant plus d’être souligné que les commissions de gestion de Bpifrance, pour la gestion de ses fonds et des fonds de fonds qu’elle gère directement, sont inférieures à celles observées sur le marché (entre 0,75 % et 1 %). À titre d’exemple, les fonds actuellement en période d’investissement ont les taux de commission de gestion suivants en 2014 :
– fonds National d’Amorçage (fonds de fonds lié au PIA) : 0,4 % ;
– fonds de fonds Multicap Croissance (fonds de fonds lié au PIA) : 0,25 % ;
– fonds de fonds France Investissement III : 0,63 % ;
– fonds de fonds FFI3 + (fonds de fonds souscrit pas la Direction des fonds d’Épargne de la CDC) : 0,45 %.
Élément positif, l’activité fond de fonds s’inscrit cependant dans un contexte de consolidation du secteur. En effet, les investisseurs institutionnels, dont le portefeuille de fonds est très large, cherchent désormais à restreindre le nombre de gérants avec lesquels ils sont en relation d’affaires, tout en déployant des montants unitaires de souscription plus élevés. D’autre part, les évolutions en matière de règlementation, en particulier l’entrée en vigueur de la « directive AIFM » en juillet dernier, contribuent, du fait de nouvelles exigences en matière de gestion, à une concentration du secteur ; tendance qui devrait se poursuivre en 2015 et qui devrait faciliter le suivi des investissements réalisés par Bpifrance.
4. Le recours aux obligations convertibles
Bpifrance développe par ailleurs une activité spécifique en quasi-fonds propres à travers le recours aux obligations convertibles. Cette pratique semble satisfaisante et particulièrement bien adaptée aux besoins des entrepreneurs, notamment des PME, qui se montrent parfois réticents à ouvrir le capital de leurs entreprises et se privent ainsi de source de financement pour se développer.
En cas de non-conversion en capital des obligations, le coût pour l’entreprise correspond aux dispositions du contrat d’émission d’emprunt obligataire négocié et signé lors de l’émission des obligations convertibles. Ce coût est exprimé en un taux appelé prime de non-conversion. Il dépend de la situation de la société, de sa structure financière, du financement global de l’opération : généralement Bpifrance pratique à un taux de rendement interne compris entre 10 % et 15 % l’an, incluant les intérêts cash payés annuellement et qui s’élèvent à 4-5 % par an.
Ce taux correspond aux pratiques du marché. Pour en apprécier le niveau, il faut prendre en compte le fait que ce taux ne pèse pas sur la trésorerie de l’entreprise pendant la durée de vie de l’obligation.
Il s’agit donc d’un dispositif dans lequel le souscripteur à l’obligation (Bpifrance) prend un risque supérieur à celui pris par un prêteur : le capital n’est pas remboursé au fil de l’eau, mais à terme. Ce remboursement dépend par conséquent de la bonne fortune de l’entreprise à l’issue de la période.
MONTANTS INVESTIS SOUS FORME D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES | ||
(en euros) | ||
PÔLE MÉTIER |
MONTANT INVESTI EN OBLIGATIONS |
NOMBRE |
PME |
492 029 779 |
407 |
ETI /GE |
317 536 690 |
34 |
INNOVATION |
9 985 401 |
10 |
TOTAL |
819 551 870 |
451 |
Source : Bpifrance |
||
5. L’aide aux ETI et aux grandes entreprises : quelles participations Bpifrance doit-elle prendre ?
Si l’action de Bpifrance vise en priorité les TPE et les PME, ainsi que les ETI en croissance, celle-ci peut également concerner les ETI d’une taille conséquente où les grandes entreprises. Une direction spécifique de Bpifrance, la direction ETI/GE, est en charge de ces dossiers. Ce type d’intervention vise notamment à stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises stratégiques mais permet également la BPI de disposer de participations rentables. La division des tâches entre l’agence des participations de l’État (APE) et la banque publique, sur ce dossier les grandes entreprises, n’apparaît cependant pas toujours évidente.
a. L’action de Bpifrance comme fonds souverain
Le pôle ETI / GE a connu une activité très soutenue en 2014, à l’image du marché du capital développement. La reprise du marché se manifeste notamment par une hausse des montants investis sur des tickets compris entre 15 et 30 millions d’euros (+ 59 % par rapport à 2013) et des opérations enregistrées sur des tickets supérieurs à 30 millions d’euros (aucune opération au premier semestre 2013 contre 214 millions d’euros au premier semestre 2014) ou encore sur le marché du capital transmission (+ 34 % en valeur au premier semestre 2014), qui constitue un enjeu majeur pour les ETI. En ce qui concerne les ETI, 18 opérations ont été réalisées pour 425 millions d’euros, montant en hausse de 400 % par rapport à 2013 et au-delà de l’objectif annuel minimal de 300 millions d’euros investis pour le fonds ETI 2020. Illustrant le rôle d’investisseur patient de Bpifrance, accompagnant le développement des entreprises dans la durée, la moitié de ces investissements se sont dirigés vers les entreprises déjà en portefeuille, pour un montant de 111 millions d’euros.
L’année a également été marquée du sceau du réinvestissement dans les grandes entreprises (quatre opérations pour un total de 82,40 millions d’euros) et pour le FMEA (Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, trois opérations pour 8,50 millions d’euros). Parmi les entreprises accompagnées par la direction ETI – Grandes Entreprises, quatre nouveaux investissements l’ont été sur les marchés boursiers, pour un montant total de 70,40 millions d’euros. Dans le cas des sociétés MVG et Gascogne, il s’agissait d’accompagner le projet de croissance d’entreprises déjà cotées. Pour les sociétés Serge Ferrari et Euronext, il s’agissait d’accompagner les entreprises lors de la cotation initiale, mettant ainsi en valeur le rôle de Bpifrance comme investisseur de confiance.
Enfin, Bpifrance dispose d’une enveloppe pour les investissements exceptionnels qui lui permet d’investir au capital de grandes entreprises stratégiques pour l’économie française dans le cadre de la consolidation d’un fleuron de l’industrie, stratégique pour sa filière, ou de la stabilisation de l’actionnariat d’une entreprise majeure ou encore dans un secteur clé pour l’emploi français. À titre d’exemple, en 2010, 335 millions d’euros ont été investis dans la société Vallourec en vue de soutenir sa stratégie de croissance sur ses marchés à haute valeur ajoutée. En 2011, Bpifrance a racheté la part détenue par Areva (696 millions d’euros) dans STMicroelectronics afin de devenir l’actionnaire institutionnel de référence durable, aux côtés de l’actionnaire public italien, d’un leader européen sur une industrie à fort contenu technologique et soumise à de fortes variations de cycle. En 2012, 776 millions d’euros ont été investis dans Eramet pour stabiliser le capital du seul groupe minier français d’envergure internationale et l’accompagner dans ses projets de développement. Enfin, en 2013, 150 millions d’euros ont été investis dans CMA CGM pour accompagner une société leader sur le marché mondial du transport maritime par conteneurs.
b. Une démarche légitime qui pose la question du niveau du risque
Lors de sa création, Bpifrance a conservé le portefeuille de participations du Fonds stratégique d’investissement (FSI) et l’a depuis considérablement augmenté. Comme ce dernier, la BPI a continué de prendre des participations dans des entreprises qui, a priori, ne semblaient pas avoir de difficultés à se financer sur les marchés. Dans son action vers les grandes entreprises, Bpifrance n’agit donc pas pour corriger des failles de marché mais bien pour défendre les intérêts industriels et économiques nationaux, tel un fonds souverain. Par ailleurs, cette action est également essentielle à la pérennité du modèle économique de la banque publique. En effet, ses prises de participations au capital de grandes entreprises françaises lui permettent de disposer des moyens nécessaires pour réaliser des investissements plus risqués et moins liquides dans des PME ou dans des start-up innovantes. À titre d’exemple, en 2014, la seule cession de 1,9 % du capital d’Orange avait permis à la banque publique de multiplier son résultat net par plus de trois.
À titre d’exemple, après Sermeta (échangeurs thermiques) en 2014 (180 millions d’euros), Bpifrance vient de racheter à Safran un large bloc d’actions d’Ingenico, le spécialiste des terminaux de paiement, pour 363 millions d’euros : il s’agit de l’opération la plus importante conduite par la banque depuis sa création. Dans cette opération, Safran a obtenu cinq fois la valeur initiale de ses titres sans que les capitaux propres d’Ingenico ne soient augmentés. Le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, avait ainsi déclaré que : « la BPI est heureuse d’accompagner dans la durée l’une des plus belles aventures françaises de la révolution digitale. Elle confirme son rôle de fonds souverain attaché à soutenir les grandes entreprises du pays ». Cela confirme que la BPI agit également pour soutenir les intérêts industriels économiques des grandes entreprises nationales, en concertation avec l’État.
Ce type d’investissement peut également avoir pour intérêt de fixer l’emploi sur le territoire national, répondant ainsi à une logique sociale et industrielle qui figure également au cœur des missions de la banque publique. À titre d’exemple, Bpifrance a investi dans Verallia, une des filiales de Saint-Gobain et numéro trois mondiales de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, afin d’assurer l’ancrage de l’entreprise en France alors même qu’en raison du dynamisme économique de cette entreprise, de nombreux financiers se sont portés acquéreurs. Cela représente un investissement potentiel de 140 à 420 millions d’euros pour la banque publique. Dans cet exemple, comme dans d’autres, les actionnaires, à commencer par l’État, peuvent utiliser leurs prérogatives. À cet égard, le ministre de l’Économie et de l’industrie, Emmanuel Macron, s’était engagé, avant que ne soit connue l’offre d’investissement de Bpifrance, à veiller à ce que « l’entité soit préservée, les investissements maintenus et le caractère productif de l’investissement décidé garanti ».
Cette proposition a cependant suscité des réserves et des critiques sur le rôle de Bpifrance dont certains estiment qu’elle devrait se concentrer sur les entreprises en difficulté et sur les réponses à apporter aux failles de marché. Certains investisseurs privés ont notamment pu accuser la BPI de fausser les règles du jeu et de se substituer au secteur privé, dès lors que de nombreuses offres avaient été déposées concernant Verallia.
Le Rapporteur ne partage pas ces craintes ni ces critiques puisque l’action de la BPI au profit de la stabilisation du capital de certaines entreprises stratégiques est le meilleur moyen de prévenir leur démantèlement futur et de défendre les intérêts économiques nationaux, (ce qui n’a d’ailleurs pas empêché Bpifrance d’investir ou d’accorder des prêts à des entreprises en difficulté telle que Sequana ou Doux). Par ailleurs, suivant la charte signée avec l’AFIC, Bpifrance s’abstient généralement de surenchérir sur les offres émanant du privé. Enfin, il apparaît que ce sont souvent les grandes entreprises françaises elles-mêmes qui, lorsqu’elles prévoient de se désengager d’une activité stratégique, font appel à la BPI. Il ne serait donc pas souhaitable que la France prive d’une capacité d’action directe au profit des entreprises que d’autres pays pratiquent d’ailleurs abondamment.
Cependant, ces investissements stratégiques ne doivent pas conduire à mener une stratégie d’évitement sur les dossiers de restructuration.
De manière générale, et malgré quelques opérations indéniables au profit d’entreprises en difficulté, il apparaît que Bpifrance ne cherche pas à développer une action spécifique de sauvetage d’ETI ou de grandes entreprises en difficulté. Ce constat rejoint et renforce la recommandation de la mission de créer une capacité spécifique en matière de retournement confiée à la banque publique, en complément des actions menées pour la structuration d’un secteur privé de capital retournement, qui répondrait à une véritable nécessité économique et sociale.
La BPI a en effet parfois su se mobiliser au profit d’entreprises traversant des épisodes difficiles : les équipes de Bpifrance se sont ainsi récemment mobilisées avec succès auprès du groupe Gascogne, fleuron du papier, dans les Landes, de Clestra à Strasbourg, de l’entreprise de chaudronnerie CPI dans le Loiret, ou encore dans le sauvetage d’Altia (dont Caddie) contribuant ainsi directement au développement de l’activité locale et à l’ancrage des emplois en mobilisant la totalité de ses modes d’action, en fonds propres, fonds de fonds et financement. Dans le cas d’Altia, par exemple, l’administrateur judiciaire a ainsi récemment fait le bilan de la procédure collective pour constater que, grâce aux concours de Bpifrance, 90 % des emplois avaient pu être sauvegardés. Néanmoins, aux termes de la procédure l’opposant à Altia, Bpifrance accusera des pertes de plusieurs millions d’euros (son investissement initial se montait à 18 millions d’euros).
Les critiques ont également concerné le cas d’Eramet, seul groupe minier français coté en Bourse, avec comme plus gros actif des mines de nickel en Nouvelle Calédonie. Alors que l’unité mines d’Areva (essentiellement les mines d’uranium) souhaitait se désengager du nickel, l’État avait en effet incité le FSI et la CDC à récupérer les 26 % du capital qu’Areva détenait dans ce groupe. Au-delà de l’aide apportée à Areva, force est de reconnaître que l’intérêt stratégique d’une telle opération est demeuré flou. Depuis quatre ans, le chiffre d'affaires du groupe s'est maintenu autour de 3,5 milliards d’euros, mais la rentabilité s'est fortement dégradée : le résultat d'exploitation est passé de 554 millions d’euros en 2011 à 75 en 2014 tandis que le premier semestre 2015 fait apparaître une perte 70 millions d’euros. Surtout, une gouvernance complexe, organisée autour d'un conseil d’administration de 19 membres avec des représentants des actionnaires aux objectifs différents (Famille Duval, Bpifrance, Carlo Tassara, Nouvelle Calédonie, Gabon), complique la gestion stratégique du groupe. Or, ces 776 millions d’euros représentent une somme très importante (une provision de 275 millions d’euros est inscrite dans les comptes de Bpfrance). La transparence sur ce type d’investissement devrait être renforcée.
Enfin, Bpifrance a également perdu 55 millions d’euros dans le papetier Sequana mais a persévéré dans son investissement car cette entreprise a un avenir. Elle est également la seule banque française à avoir consenti un prêt au groupe Doux depuis mai 2012.
S’il est très difficile de tirer des enseignements de ces épisodes, le Rapporteur s’interroge cependant sur la faiblesse des moyens humains consacrés à la branche investissement (moins de 300 personnes si l’on exclut le cas particulier de l’innovation) alors que les participations détenues par Bpifrance représentent plus de 17 milliards d’euros.
La période est par ailleurs propice renouvellement de l’action de la BPI en matière d’investissement puisque, dans un contexte d’abondance de liquidités et d’arrivée à échéance des premiers investissements réalisés par le FSI (l’horizon d’investissement du FSI comme de Bpifrance étant généralement de six ou sept ans en moyenne), la BPI s’est récemment séparée d’un grand nombre de participations accumulées au capital de PME et ETI françaises. À titre d’exemple, la vente de 1,7 % du capital de l’équipementier automobile Valeo, fin mars 2015, pour 188 millions d’euros, représente près de dix fois la mise initiale. Bpifrance dispose désormais de la capacité de réallouer une partie des 17 milliards d’euros de participations qui lui ont été confiées et cela alors même que ses réserves de plus-values latentes sont estimées à près de 5 milliards d’euros.
C. L’ACTION DE BPIFRANCE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
La vocation de la banque publique d’investissement était d’offrir, via un guichet unique, l’ensemble des outils du financement des TPE, PME et ETI, ainsi que les dispositifs d’aide publique qui leur sont réservés. La gamme de produits devait également évoluer pour combler les « failles de marché » (47), ou défauts de financement, identifiées en matière de financement des entreprises.
1. Une vaste gamme de produits s’appuyant sur quelques modalités
Bpifrance a rassemblé et enrichi une gamme de produits complète pour répondre aux besoins des entreprises. Ces produits sont le plus souvent proposés en cofinancement, c’est-à-dire en partenariat avec une banque commerciale qui doit accepter un risque équivalent à celui de Bpifrance. En dépit de leur apparence foisonnante, les dispositifs reposent en réalité sur quelques modalités simples.
DONNÉES SYNTHÉTIQUES SUR L’ACTIVITÉ DE BPIRANCE FINANCEMENT
(en millions d’euros, sauf mention contraire)
Activité |
2012 |
2013 |
Évolution 2013 |
2014 |
Évolution 2014 |
Subventions à l’innovation |
744 |
634 |
– 14,8 % |
877 |
+ 38,4 % |
Montant des risques garantis |
3 296 |
3 455 |
+ 4,8 % |
3 482 |
+ 0,8 % |
Montant des risques garantis Bpifrance Régions |
181 |
224 |
+ 23,8 % |
245 |
+ 9,7 % |
Cofinancement de l’investissement |
4 701 |
5 073 |
+ 7,9 % |
5 752 |
+ 13,4 % |
Mobilisation de créances |
2 944 |
3 244 |
+ 10,2 % |
3 557 |
+ 9,6 % |
Préfinancement du CICE |
– |
795 |
– |
2 350 |
+ 196 % |
Source : rapport annuel 2014 de Bpifrance Financement.
• Les subventions à l’innovation
Subventions, avances remboursables et prêts à taux zéro peuvent être regroupés dans une même catégorie. Une des ambitions de la banque publique d’investissement était de mieux coordonner les moyens publics mobilisés en faveur de l’innovation.
Ces solutions sont dérogatoires par rapport au marché. Lorsqu’elles dépassent un certain montant, ce sont des aides d’État qui doivent être notifiées à la Commission européenne qui vérifie qu’elles ne constituent pas un élément de concurrence déloyale par rapport aux entreprises des autres États membres (cf. partie A. 1. c. page 61).
Sont acceptables les subventions des projets qui ne sont pas viables à moyen terme mais qui présentent un intérêt sur le long terme ou pour l’économie entière, c’est-à-dire :
– les projets innovants ;
– les projets mis en œuvre dans certains territoires, comme les territoires ultramarins, du fait de leur insularité, notamment (cf. partie I. B. 1. d. page 38).
Après un ralentissement en 2013, les subventions, avances remboursables et prêts à taux zéro dédiés à l’innovation se sont accrus de 38,4 % en 2014. Ces données sont commentées de manière plus détaillée dans la troisième partie du présent rapport.
• Les garanties
À l’instar de l’ex-Oséo, Bpifrance garantit les prêts aux TPE et PME. Elle cherche ainsi à créer un effet multiplicateur en réduisant l’en-cours de risques des banques commerciales.
L’activité de garantie est globalement stable par rapport à 2013 (cf. tableau infra). D’après le rapport annuel 2014 de Bpifrance Financement, les prêts garantis concernent surtout des phases risquées de la vie de l’entreprise : création (36,8 %), développement (23,2 %) et transmission (18,7 %). Les garanties relatives à la trésorerie représentent toutefois une part significative (14,0 %).
EN-COURS DE RISQUES DE BPIFRANCE FINANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2014 | |||
(en millions d’euros, sauf mention contraire) | |||
Activité (hors ligne globale) |
2013 |
2014 |
Évolution (en %) |
Montant des risques (hors fonds internes) |
3 455 |
3 482 |
+ 0,8 % |
Création |
1 232 |
1 282 |
+ 4,0 % |
Transmission |
588 |
652 |
+ 10,8 % |
Développement |
793 |
809 |
+ 2,1 % |
Innovation |
134 |
119 |
– 11,2 % |
International |
223 |
135 |
– 39,6 % |
Trésorerie (1) |
485 |
485 |
+ 0,1 % |
Répartition par type d’interventions garanties |
3 455 |
3 482 |
+ 0,8 % |
Crédits bancaires |
3 036 |
3 082 |
+ 1,5 % |
Fonds propres |
143 |
111 |
– 22,5 % |
Court terme |
276 |
289 |
+ 4,6 % |
Nombre de concours garantis |
86 049 |
86 207 |
+ 0,2 % |
Montant net des risques couverts |
4 394 |
4 783 |
+ 8,9 % |
Encours total de risque au 31 décembre (sains) |
12 719 |
13 520 |
+ 6,3 % |
Note de lecture : l’activité de garantie est globalement stable par rapport à 2013. Les montants de risques en matière d’innovation et d’international sont en baisse, ce qui traduit l’état de la situation sur le marché bancaire. (1) Fonds Court Terme + RT CCE. Source : rapport annuel 2014 de Bpifrance Financement. | |||
Intervenant en cogarantie avec les fonds nationaux, les fonds régionaux présentent une croissance d’activité plus marquée vers les finalités création, développement et transmission, et plus centrée sur le secteur de l’industrie.
EN-COURS DE CRÉDITS DE BPIFRANCE FINANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2014 | |||
(en millions d’euros, sauf mention contraire) | |||
Activité |
2013 |
2014 |
Évolution |
Financement |
|||
Production nouvelle (2) |
5 073 |
5 752 |
+ 13,4 % |
Encours au 31 décembre (1) (2) |
17 842 |
21 075 |
+ 18,1 % |
Cofinancement Moyen et Long Terme |
3 697 |
3 781 |
+ 2,3 % |
Prêt à Long et Moyen Terme |
2 413 |
2 506 |
+ 3,8 % |
Crédit-Bail |
1 284 |
1 275 |
– 0,7 % |
Prêts de développement (2) |
1 376 |
1 972 |
+ 43,3 % |
dont Prêt de croissance |
791 |
665 |
– 15 ,9 % |
dont Prêt à la création d’entreprise (3) |
63 |
58 |
– 7,9 % |
Court Terme |
|||
Mobilisation de Créances |
3 244 |
3 557 |
+ 9,6 % |
Préfinancement du CICE |
795 |
2 350 |
+ 196 % |
(1) Hors financement Court Terme. (2) Dont Prêts de Financement de l’Innovation 2013 : 113. – 2014 : 214. (3) Supprimé en mars 2015. Source : rapport annuel 2014 de Bpifrance Financement. | |||
• Le cofinancement de l’investissement
L’activité de crédit est dynamique avec une hausse de 13,4 % des nouveaux contrats signés par rapport à 2013 (cf. tableau supra). L’en-cours au 31 décembre 2014 atteint un niveau historiquement élevé à 21 milliards d’euros. Les prêts en cofinancement relèvent d’une logique de partage du risque avec les banques commerciales sur des segments délaissés par les banques en raison du risque qu’ils représentent. Il s’agit en quelque sorte de promouvoir certains types de risques, en l’occurrence ceux des crédits aux TPE, PME et ETI. Comme l’a remarqué une des personnes entendues par le Rapporteur, il s’agit finalement d’aider les banques à prêter davantage et non d’aider directement l’entrepreneur.
Certains prêts peuvent être consentis à taux bonifié, sans demander de garantie ou de caution à l’entrepreneur pour encourager des projets que la puissance publique juge prioritaires pour l’économie : les investissements dans l’efficacité énergétique, dans la robotisation, le numérique etc.
Les prêts de développement (sept ans, sans prise de garantie, avec différé d’amortissement de deux ans) ont augmenté de 43,3 %, grâce notamment au prêt Numérique ou au prêt d’Avenir, confirmant l’attractivité de ce type de produits.
Nicolas Dufourcq rappelait ainsi que « les prêts de développement, qui sont au cœur de l’objectif de financement de l’investissement, sont consentis sans garantie, pour sept ans, avec un différé de remboursement de deux ans ; ils sont assis sur des fonds de garantie dépendant entièrement des financements de l’État par le biais du programme d’investissements d’avenir et, marginalement, du Fonds européen d’investissement. Ces prêts ont un effet puissant puisque l’entreprise est libre de choisir comment l’utiliser au mieux pour se développer. Par ce moyen, Bpifrance finance l’immatériel, ce que les banques privées font mal, si bien que nous occupons une place centrale sur ce marché ; il n’est pas surprenant que cette activité ait augmenté de 40 % en 2014. Nous avons pour objectif de parvenir en 2015 à un volume de prêts de développement sans garantie compris entre 1,9 et 2 milliards d’euros. »
De façon dérogatoire, il peut arriver que Bpifrance accorde des prêts sans contrepartie bancaire en raison, notamment, des difficultés particulières d’accès au crédit rencontrées. Il existe aujourd’hui quatre exceptions principales :
‒ les prêts Export (48) d’un montant inférieur à 150 000 euros, du fait du montant très limité de ceux-ci ;
‒ le crédit Export (49), pour les montants d’intervention inférieurs à 25 millions d’euros, segment de marché sur lequel les banques commerciales ne souhaitent pas se positionner (faille de marché) ;
‒ les prêts de développement territorial pour les régions Pays-de-la-Loire et Nord-Pas-de-Calais, en accord avec les conseils régionaux ;
‒ certaines interventions en court-terme, lorsque les réseaux bancaires ne souhaitent pas intervenir en cofinancement.
Ces dispositifs ne posent pas de difficulté vis-à-vis de Bruxelles. Les prêts comportent un élément de bonification qui conduit à calculer un « équivalent subvention brut » (ESB), qui doit rester inférieur à 200 000 euros en vertu du régime de minimis (50). En cas d’intervention sans contrepartie bancaire, l’ESB du prêt est majoré.
• Le financement de la trésorerie
Les prêts de court terme (trésorerie) connaissent aussi une hausse remarquable : + 9,6 % pour la mobilisation de créances, + 196 % pour le préfinancement du CICE.
Le succès des crédits de court-terme confirme leur pertinence. D’après les informations obtenues par le Rapporteur, les dispositions de la loi de modernisation de l’économie sur les délais de paiement ne seraient en effet pas respectées, de sorte que plusieurs clients de Bpifrance seraient aujourd’hui totalement dépendants de ces lignes de crédits.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), mis en place par le Gouvernement dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, constitue une modalité de soutien à l’emploi dans les entreprises. Pour accélérer ses effets, Bpifrance a été chargée d’offrir un préfinancement public du CICE. Initialement limité aux seules entreprises bénéficiant d’un CICE supérieur à 25 000 euros, ce préfinancement a été étendu à toutes les entreprises en juin 2013, les banques commerciales ayant renoncé à s’impliquer sur ce marché. En définitive, Bpifrance a traité 90 % des dossiers, dans la plupart des cas des TPE et des PME (51).
La tarification du préfinancement par Bpifrance est globalement faible et varie selon le montant accordé : les dossiers de plusieurs millions d’euros sont facturés moins de 2 %, les dossiers plus risqués de 4 à 5 %. Des montants à comparer avec le taux du découvert bancaire pour les TPE et les PME, qui atteint quant à lui 8 à 9 %.
Le préfinancement du CICE a pu se déployer grâce à l’expertise acquise par Bpifrance dans la mobilisation de créances. Les entreprises peuvent céder leurs créances à Bpifrance qui leur en assure l’avance dans le cadre d’un prêt de trésorerie baptisé Avance +. Les produits de Bpifrance présentent une vraie valeur ajoutée ; ils sont confirmés alors que les produits de court-terme des banques peuvent être dénoncés au bout de quelques jours par simple recommandé. Bpifrance a investi, il y a quelques années déjà, dans un outil informatique permettant des économies d’échelle. Le court-terme apparaît donc comme une activité rentable pour Bpifrance alors qu’elle a été abandonnée par les banques traditionnelles.
2. Un déploiement en partenariat pour un coût public maîtrisé
Bpifrance intervient en complémentarité avec le marché bancaire. Ce choix s’explique par des contraintes juridiques – la nécessité de respecter le droit de l’Union européenne (cf. partie A. 1. c. ) – et opérationnelles, particulièrement saillantes s’agissant de l’activité Financement de Bpifrance.
En dépit d’un réseau déjà étendu et en croissance, il n’est pas prévu que Bpifrance Financement devienne un réseau bancaire alternatif. Le coût d’un réseau bancaire parallèle serait exorbitant pour les finances publiques et il ferait concurrence au secteur bancaire traditionnel, qui pourrait être tenté de délaisser les segments les moins rentables de son activité pour laisser la puissance publique les prendre en charge. C’est en substance ce qu’indiquait M. Nicolas Dufourcq, au cours de sa première audition : « le risque est toujours partagé. Nous nous en tenons strictement à cette règle fondamentale, établie pour éviter que Bpifrance ne se trouve encombrée de tous les mauvais risques de la place et pour garder de bonnes relations avec les établissements bancaires, nos partenaires. »
Pour ne pas devenir « le déversoir des pertes des TPE et PME », Bpifrance ne garantit les prêts bancaires qu’à 60 % au maximum (les partenariats régionaux permettent de compléter la garantie jusqu’à 70 %) et impose un délai de carence de neuf mois aux banques, c’est-à-dire que la garantie n’est effective qu’au bout de neuf mois. L’objectif c’est d’inciter la banque à évaluer correctement le risque et à ne pas engager la garantie de Bpifrance à perte.
Cet élément de responsabilisation permet de donner une large autonomie aux banques commerciales pour accélérer le traitement des dossiers. Bpifrance donne ainsi aux établissements de crédit une délégation qui les dispense, pour les montants inférieurs à 200 000 euros, de l’obligation de remonter vers elle pour utiliser sa garantie. Dans ce cas, aucun dossier n’est à déposer auprès de Bpifrance.
Ce mode de fonctionnement subsidiaire présente quand même des limites, rappelées par M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la CDC, au cours de son audition : « Bpifrance étant, par doctrine, exclusivement co-financeur, il peut se produire que, alors qu’elle s’est prononcée favorablement et vite, elle ne trouve pas de partenaire. J’ai eu connaissance d’un cas de ce type dans les Landes : alors que la garantie de prêt avait été accordée en février 2014, les fonds n’ont été versés qu’en février 2015, une année ayant été nécessaire pour trouver un coprêteur. » Malheureusement, Bpifrance ne dispose pas d’outils statistiques permettant de suivre le nombre de ces dossiers en souffrance et le délai moyen d’attente pour ceux-ci.
Comme cela a été dit, Bpifrance ne s’interdit pas, exceptionnellement et à titre temporaire, de prendre des décisions de financement dérogatoires à sa doctrine. Cette décision doit être prise par les instances de gouvernance compétentes, conformément aux règles prévues par le statut de Bpifrance Financement et par le pacte d’actionnaires de Bpifrance.
La relation avec les réseaux bancaires est donc un élément primordial du fonctionnement de Bpifrance. Conformément à la pratique qui prévalait avec les organismes qui l’ont précédée, les réseaux bancaires sont actionnaires de Bpifrance à hauteur de 5,8 % (52) ; elles ont, à ce titre, un représentant au conseil d’administration de Bpifrance Financement et sont présentes au sein de son comité financement et garanties. Un « guide banques » leur est spécialement destiné. Ce catalogue de produits renvoie à un extranet pour de plus amples précisions sur les conditions financières de chaque produit et des simulations.
Le Rapporteur estime qu’un meilleur suivi serait nécessaire. Au regard des travaux conduits par la mission d’information, il semble que l’articulation des rôles respectifs de Bpifrance et des banques commerciales puisse être améliorée et surtout mieux expliquée (cf. infra).
Deux ans après sa création, un an après ses débuts, Bpifrance remplit le rôle qui lui a été assigné en matière de financement même si le bilan de la mission permet de mettre en évidence d’appeler à la vigilance sur certains points précis. Outre les auditions conduites par la mission, le Rapporteur s’est tenu à l’écoute des entrepreneurs et des acteurs de terrain, des élus et des représentants de l’État dans les territoires.
a. Les difficultés apparues dans l’activité de préfinancement du CICE
Bpifrance s’est activement engagée dans l’activité de préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui a représenté 11 % du total d’en-cours de Bpifrance, soit 2,3 milliards d’euros, en 2014 ; 22 000 entreprises, dont 15 000 TPE, en ont bénéficié, pour des montants compris entre 1 000 euros et 10 millions d’euros. La multiplication par trois du nombre de dossiers entre 2013 et 2014 témoigne du succès de ce produit, dont la gestion représente un coût croissant pour Bpifrance.
Sans que cela ait été anticipé, les banques commerciales se sont en effet montrées réticentes à intervenir dans ce domaine. Alors que l’intervention de Bpifrance aurait dû se limiter aux dossiers représentant les plus gros montants, elle a rapidement été amenée à préfinancer le CICE de toutes les entreprises quelle que soit leur taille. D’après le dernier rapport du comité de suivi du CICE abrité par France Stratégie, Bpifrance a traité 90 % des dossiers, lesquels concernent dans la plupart des cas des TPE et des PME. Les éléments recueillis par le Rapporteur suggèrent que la crainte d’une remise en cause du CICE à moyen terme ne soit à l’origine des réticences des réseaux bancaires. Ces derniers n’auraient pas souhaité recruter davantage de chargés de clientèle pour traiter des flux qui pourraient être taris par une transformation du dispositif en baisse de cotisations sociales.
Bpifrance a mis en place un site Internet sur lequel les entreprises peuvent déposer leur demande de préfinancement en ligne. Les délais de traitement sont réduits : en moyenne, trois semaines s’écoulent entre le dépôt de la demande de préfinancement et le versement à l’entreprise. Pour ce faire, Bpifrance a accru ses moyens humains en recrutant des intérimaires qui ont, depuis, été embauchés sur des postes pérennes.
Le besoin de moyens humains a encore été accru, en 2015, par les précautions supplémentaires dont s’est entourée Bpifrance pour vérifier l’existence de la créance.
Le taux de sinistralité s’est en effet avéré beaucoup plus élevé que prévu. Lorsque Bpifrance préfinance le CICE, la créance n’existe pas encore aux yeux de l’administration fiscale. Si l’entreprise verse les salaires jusqu’à la fin de l’exercice, ce préfinancement ne pose aucun problème mais de nombreux dossiers – de TPE comme d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) – ont donné lieu à des contentieux en raison de difficultés de recouvrement. Le plus souvent, l’entreprise n’a pas fait sa déclaration en temps voulu ou l’administration fiscale conteste la créance en l’absence de déclaration. Lorsque l’entreprise est mise en liquidation, les dossiers disparaissent : il est ensuite impossible de recouvrer auprès de l’administration fiscale une créance qui n’existe pas aux yeux de celle-ci. Ces difficultés de recouvrement ont représenté des sommes importantes en 2013 : 50 millions d’euros seraient actuellement en retard de recouvrement, soit environ 6 % de l’en-cours 2013.
C’est pourquoi les dirigeants de Bpifrance ont revu les procédures d’accès au préfinancement du CICE en 2015 :
– les équipes de Bpifrance ont systématiquement téléphoné aux entreprises et à l’administration fiscale pour vérifier que les documents étaient bien remplis ;
– les entreprises en grande difficulté devaient fournir une preuve de l’existence de la créance auprès de l’administration fiscale pour obtenir le déblocage des fonds, preuve qui n’est disponible qu’à la clôture de l’exercice comptable.
En outre, contrairement aux PME, qui bénéficient de la restitution de la créance du CICE dans l’année, cette créance est imputée sur l’impôt éventuellement dû au titre des trois exercices suivants pour les ETI : les montants unitaires pour Bpifrance sont d’autant plus importants. C’est pourquoi, avant de préfinancer le CICE de 2015, Bpifrance a demandé la régularisation des déclarations de 2013 et de 2014.
D’après M. Joël Darnaud, directeur du financement et du pilotage du réseau, le préfinancement des dossiers supérieurs à 50 000 euros a ainsi été décalé de quatre à cinq mois en moyenne.
Cette situation a alarmé plusieurs acteurs de terrain qui ont alerté la mission sur les délais de traitement des dossiers de préfinancement du CICE.
Le 15 septembre 2015, le ministre de l’Économie a néanmoins confirmé, au cours de son audition, que l’administration avait pris les mesures nécessaires à la restauration des conditions antérieures.
La direction générale des finances publiques a ainsi accepté de simplifier le dispositif, en supprimant l’obligation de dépôt des comptes, et la profession des liquidateurs a été sensibilisée à la nécessité d’accomplir les démarches nécessaires pour que le CICE soit versé à Bpifrance. Par ailleurs, le préfinancement du CICE des PME a été adossé au fonds de garantie du financement des créances professionnelles, afin de simplifier le traitement des sinistres et de les couvrir à hauteur de 70 %. Ces mécanismes correctifs ont permis de revenir aux conditions de préfinancement du CICE qui prévalaient jusqu’à la fin de l’année 2014.
Le Rapporteur se félicite qu’une solution ait pu être trouvée compte tenu de l’importance du préfinancement du CICE pour beaucoup de petites entreprises.
Il souhaite en effet que l’équilibre du préfinancement du CICE soit préservé afin de permettre à toutes les entreprises de pouvoir en bénéficier.
En raison de l’existence de frais de dossier incompressibles, Bpifrance réalise des pertes sur les montants de préfinancement les plus modestes, inférieurs à 25 000 euros, qui sont normalement compensées par la rentabilité des dossiers les plus importants. Préfinancer le CICE sans remettre en cause son taux de sinistralité pour se conformer à sa politique de risque très prudente pourrait amener Bpifrance à s’engager sur des segments concurrentiels sur lesquels les banques commerciales sont déjà présentes.
Les réseaux bancaires sont très vigilants à cet égard, comme l’a indiqué Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française : « de petites difficultés ont en effet pu surgir, çà et là, notamment lorsque Bpifrance a souhaité, probablement pour rééquilibrer son portefeuille, intervenir auprès d’ETI de taille importante qui auraient pu se financer directement auprès des banques. Cependant, je ne veux pas donner le sentiment que ce problème se pose de manière générale : il a pu se poser, dans certains cas, et notamment lors de la distribution des préfinancements du CICE. Dans ce domaine, Bpifrance a été très active auprès des PME et des TPE, et il faut saluer son action, compte tenu des risques que cela comportait. Mais, souhaitant répartir ses risques, elle a pu être amenée à démarcher des entreprises plus facilement finançables directement par une banque. Il a donc été convenu avec les dirigeants de la BPI que, lorsqu’elles apparaissent, ces difficultés concurrentielles puissent être résolues dans le cadre d’un échange avec les banques concernées. »
Le Rapporteur juge indispensable de préserver l’équilibre du préfinancement du CICE, aujourd’hui vital pour beaucoup d’entreprises. Il serait en effet regrettable que les entreprises connaissant des difficultés modérées se voient refuser le préfinancement d’un crédit d’impôt qui peut permettre leur survie ; d’autant plus si cet interdit repose sur l’impossibilité, pour Bpifrance, d’équilibrer son portefeuille de risques, dans le but de ne pas concurrencer des banques commerciales qui ont délibérément déserté le marché du préfinancement du CICE.
Proposition : préserver le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi :
– en s’assurant de l’efficacité des solutions trouvées pour accélérer le traitement des dossiers ;
– en garantissant le préfinancement du CICE des entreprises en procédure amiable.
b. Une clarification indispensable sur les rôles respectifs de Bpifrance et des banques en matière d’analyse des risques
Comme rappelé précédemment, les relations entre Bpifrance et les banques commerciales sont primordiales. Elles sont au cœur du fonctionnement de Bpifrance Financement et à l’origine de l’effet de levier qui est attendu de ce fonctionnement.
Dans ces conditions, il serait souhaitable que Bpifrance intensifie ses actions d’information et de formation vis-à-vis des chargés de clientèle des réseaux bancaires. Selon M. Fabrice Pesin, médiateur du crédit aux entreprises, en effet « de part et d’autre des guichets, le manque de connaissance des produits constitue un réel handicap. Les patrons de TPE connaissent souvent mal les instruments qui pourraient les aider, et les chargés de clientèle des grands réseaux ne maîtrisent pas toujours la palette des outils existants. Il y a un véritable besoin de produits très simples – et, paradoxalement, cela n’est pas facile à mettre en place. »
Dans ses éléments de réponse aux questions du Rapporteur, Bpifrance admet d’ailleurs que des progrès sont possibles dans ce domaine : « si les conseillers bancaires spécialisés dans le crédit aux entreprises, là où ils existent, connaissent bien Bpifrance, les chargés d’affaires généralistes ne maîtrisent pas nécessairement l’ensemble de la gamme Bpifrance. C’est pourquoi des contacts réguliers sont organisés avec les chargés d’affaires Bpifrance afin de les sensibiliser à tel ou tel produit ou nouveau dispositif. »
Le Rapporteur souhaiterait que ce travail de sensibilisation puisse faire l’objet d’un suivi, par exemple dans le rapport d’activité publié chaque année. Il n’existe pas d’indicateurs précis sur ce thème, les contacts n’étant pas recensés.
En outre, le Rapporteur appelle à une clarification sur les rôles respectifs de Bpifrance et des banques dans l’analyse des demandes de financement. Une mauvaise compréhension de ce fonctionnement pourrait en effet être à l’origine d’effets pervers. Selon plusieurs commissaires au redressement productif, Bpifrance jouerait parfois le rôle illogique d’une agence de notation locale. Ainsi, en région Basse-Normandie, le Rapporteur a entendu dire que le refus d’un dossier par Bpifrance influencerait les investisseurs ou les acteurs du crédit qui y verraient un signal négatif, supposant – à tort – que Bpifrance dispose de plus d’informations sur l’entreprise.
À l’inverse, lors de la table ronde organisée sur l’action de Bpifrance outre-mer, un commissaire à la vie des entreprises et au développement productif paraissait le souhaiter, estimant que « si les banques recevaient un signal fort en amont, elles pourraient plus facilement se positionner sur les dossiers. Si la BPI, sans violer sa doctrine, pouvait donner une réponse de principe sous réserve d’obtenir ensuite un co-financement, cela déclencherait l’intention d’une banque, qui saurait à l’avance que la BPI porte un regard positif sur le dossier. Les banques ont aujourd’hui des réticences à utiliser la délégation de garantie de la BPI, un produit pourtant très simple d’utilisation, et préfèrent saisir la BPI sur chaque dossier : il est donc clair qu’elles attendent des signaux de la BPI pour prendre des risques. »
Le Rapporteur a interrogé plusieurs acteurs pour mesurer le phénomène et évaluer ses conséquences possibles. Les avis sont pour l’instant partagés.
Il reste que Bpifrance a aussi une mission d’accompagnement, dans le cadre de laquelle elle sélectionne des entreprises, qui ont pu se prévaloir de leur participation aux programmes de Bpifrance comme d’un label. En entrant au capital de certaines entreprises, Bpifrance donne aussi un signal au marché.
En tout état de cause, selon Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française, « il serait inadapté, voire dangereux, qu’elle soit amenée à remplir de fait ou, pire, de droit, un tel rôle. » Plusieurs collaborateurs de Bpifrance ont souligné que la banque publique d’investissement ne devait pas devenir le service d’étude des banques commerciales. Ses ressources humaines sont insuffisantes pour ce faire et cela pourrait entraîner un désengagement des banques préjudiciable in fine aux entreprises.
Le Rapporteur juge donc qu’il est indispensable de mieux faire comprendre le rôle de Bpifrance et son articulation avec les banques commerciales. Il est particulièrement nécessaire de rappeler que Bpifrance ne dispose pas de davantage d’informations du fait de son statut public et, en particulier, qu’elle n’a pas accès aux informations relatives à la situation financière des entreprises et des dirigeants transmises à l’administration fiscale, comme le Rapporteur a pu l’entendre craindre. Il convient également de rappeler que Bpifrance est tenue au secret bancaire et ne communique pas d’informations à l’administration.
Proposition : veiller à ce que Bpifrance ne joue pas le rôle d’une agence de notation et que ses refus ne soient pas mal interprétés des autres investisseurs et prêteurs :
– en clarifiant les rôles respectifs de Bpifrance et des banques commerciales ;
– en rappelant chaque fois qu’il est possible que Bpifrance ne dispose pas de davantage d’information que les banques sur les demandes de financement, et en particulier qu’elle n’a aucun accès aux informations transmises à l’administration fiscale ;
– en intensifiant la formation destinée aux chargés de clientèle des réseaux bancaires.
c. Le manque de visibilité sur le coût des commissions de garantie
Bpifrance accorde sa garantie aux prêts distribués par les banques commerciales aux entreprises moyennant une commission. La moitié du produit de cette commission est reversée aux fonds de garantie qui doivent couvrir les banques en cas de défaut de paiement, l’autre moitié alimente le compte d’exploitation de Bpifrance. Au cours des travaux de la mission, le montant et les modalités de prélèvement de cette commission de garantie ont parfois été contestés. Certaines entreprises ont en effet été surprises du montant élevé réclamé par leur banque au nom de Bpifrance dès le décaissement du prêt. Plus surprenant, il est arrivé que le montant initialement annoncé soit révisé après discussion.
En théorie, le montant de la commission de garantie n’est pourtant pas négociable. Il résulte d’un taux de commission défini par l’autorité de tutelle, en l’occurrence l’État, et validé en conseil d’administration de Bpifrance. Ce taux de commission dépend de la quotité garantie qui varie elle-même selon le fonds de garantie mobilisé. Les conditions de l’octroi de la garantie sont régies par le biais de conventions signées entre Bpifrance et les bailleurs des fonds. Chaque fonds de garantie génère un grand nombre de scénarios possibles.
ÉLÉMENTS DU MODE DE CALCUL DU TAUX DE LA COMMISSION DE GARANTIE
Quotité maximale garantie d’un échantillon de fonds de garantie
Fonds de garantie |
Quotité maximale garantie (1) |
Développement |
40 % |
Transmission |
50 % |
Trésorerie |
50 % * |
Création reprise ou première installation |
50 % |
Création ex nihilo |
60 % |
Innovation |
60 % |
International |
60 % |
(*) A été réduit récemment de 60 % à 50 %.
Taux de commission en fonction de la quotité maximale garantie
Quotité maximale garantie 1 |
Taux de commission (2) |
50 % |
0,7 % |
60 % |
0,8 % |
70 % |
0,9 % |
(1) Si la quotité garantie choisie par la banque commerciale est finalement moindre, le taux de commission est réduit proportionnellement.
(2) Par an, sur l’en-cours du prêt restant dû.
Source : mission d’information, d’après les éléments communiqués par Bpifrance.
Le montant de la commission de garantie dépend in fine des éléments suivants :
– la quotité garantie, définie par le fonds de garantie mobilisé, en lien avec la finalité du projet ;
– le taux de commission, dans le cadre de conventions avec l’État pour chaque fonds utilisé ;
– la durée du crédit ;
– les modalités du crédit (taux, mode d’amortissement, périodicité, différé…).
Bpifrance gère aujourd’hui de l’ordre de cinquante fonds de garantie distincts, nationaux ou régionaux, conduisant à la création d’environ 1 000 scénarios différents. En conséquence, elle juge qu’une communication globale sous forme d’une grille tarifaire n’est pas possible et serait inexploitable.
Lorsque les établissements de crédits décident de rechercher une garantie sur un dossier particulier en fonction de leur politique de risque, ils interrogent la direction régionale de Bpifrance qui leur communique après étude les conditions précises de cette intervention. Cette validation leur est notifiée ainsi qu’à l’entreprise et celle-ci dispose ainsi de toutes les informations préalables (conditions générales et conditions particulières dont la commission) pour accepter l’offre globale du crédit proposé par la banque.
Autrefois, le paiement de la commission de garantie – annuel, trimestriel, voire mensuel – dépendait du rythme d’amortissement du crédit. En 2011, avant la création de Bpifrance, une modalité de prélèvement unique, au moment du déblocage des fonds, a été décidée. Il s’agissait d’améliorer la couverture du risque pour les banques et ainsi, de les inciter à prêter davantage. M. Joël Darnaud, directeur du financement et du pilotage du réseau, a ainsi expliqué, au cours de son audition, que Bpifrance devait percevoir sa commission pour maintenir sa garantie. Si l’entreprise arrêtait de la verser, la banque créditrice perdait la garantie de Bpifrance.
La commission unique simplifiée (CUS) est donc entrée en vigueur progressivement entre 2011 et 2013 dans les réseaux bancaires.
Exemple de calcul de commission de garantie unique simplifiée (CUS)
pour un prêt de 100 000 euros garanti à 50 %
Pour un prêt de 100 000 euros garanti à 50 %, le taux de commission est de 0,7 % de l’encours du prêt restant dû. Les commissions sont calculées sur toute la durée du prêt mais additionnées dans un seul prélèvement (flat) effectué dans les trois mois suivant le décaissement.
Pour un prêt de cinq ans, la CUS s’élèverait donc à 1 880,76 euros.
Pour un prêt de sept ans, la CUS s’élèverait à 2 622,76 euros.
Pour un prêt de dix ans, la CUS s’élèverait à 3 761,47 euros.
Source : Bpifrance.
Lorsque le montant de la commission est important, les banques peuvent proposer de l’intégrer dans le plan de financement du programme pour diminuer l’impact en trésorerie pour leur client. Certaines banques prennent aussi en charge une partie du coût de la garantie dans le cadre de leur politique commerciale. Bpifrance n’est cependant pas en mesure de communiquer des données sur le nombre de banques proposant un étalement du financement de la CUS ou sur le nombre d’entrepreneurs « découragés » par le montant de la commission de garantie.
Le Rapporteur estime qu’il serait souhaitable de se doter d’un outil de suivi pour s’assurer que les commissions de garantie ne suscitent pas de problèmes d’accès au financement.
Proposition : S’assurer que le coût et les modalités de la commission unique de garantie ne soient finalement pas un frein dans l’accès au financement en veillant à mieux en informer les entreprises. Mettre en place un outil de suivi sur les pratiques bancaires en la matière et sur les éventuels problèmes rencontrés par les entrepreneurs.
d. Un effort doit être fait pour maintenir les conditions de prêts à des taux favorables
La diversité des produits de financement distribués par Bpifrance rend difficile une évaluation d’ensemble des taux qu’elle propose aux entreprises qui en font la demande. Les conditions de financement sont par ailleurs différentes suivant qu’il s’agisse de prêts à vocation écologique, qui s’inscrivent dans le cadre du PIA, de prêts de développement ou encore de prêts à l’innovation.
Sans pouvoir établir une comparaison systématique avec les prêts des autres banques bancaire, le retour d’expérience d’un certain nombre d’entrepreneurs qui ont été en relation directe avec Bpifrance, et qui en ont informé la mission à travers les réponses aux questions qui leur ont été envoyées, permet de dégager certaines tendances. Ainsi, la quasi-totalité de ces entrepreneurs ont été satisfaits du niveau et de la qualité de leurs échanges avec les équipes de Bpifrance. En ce qui concerne spécifiquement l’accès au crédit, ceux-ci ont souligné que le différé d’amortissement, la possibilité d’une garantie et l’absence de caution personnelle sont des éléments qui apparaissent particulièrement adaptés aux besoins d’entreprises en développement.
Toutefois, ces mêmes entreprises font généralement état de conditions de taux soit proches du marché soit supérieures, parfois de manière significative (certains font état de taux 1 à 2 % supérieurs à ceux du marché), hors distribution de produits spécifiques tels que le prêt vert (à 0 %).
Face à ce constat, il convient de veiller à ce que la politique de rentabilité en matière de financement, qui représente une moyenne de 6 % environ dans la fonction de prêteur traditionnel de la BPI (c’est-à-dire hors garantie), ainsi que la politique de dividendes exigés par les actionnaires, puissent permettre le maintien de taux les plus favorables possibles pour les entreprises, afin que la banque publique soit mieux en mesure d’atteindre ses cibles.
Proposition : Veiller à ce que la politique de risque et de dividendes de Bpifrance permette que ses prêts se fassent au meilleur taux possible pour les entreprises.
III. LA VALEUR AJOUTÉE DE BPIFRANCE DANS LA POLITIQUE PUBLIQUE DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
Un des objectifs de la BPI est également de contribuer au renforcement des politiques prioritaires conduites par l’État. Elle développe ainsi des actions spécifiques en matière de soutien l’innovation, de transition énergétique, de financement de l’économie sociale et solidaire, de financement participatif et de soutien à l’exportation. Certaines de ces politiques sont bien établies, à l’instar du soutien à l’innovation, et connaissent un franc succès. D’autres, telles que le soutien sont en train de monter en puissance. Enfin, des thématiques telles que l’économie sociale et solidaire et le financement participatif ne sont pour l’instant l’objet que d’engagements limités mais devraient connaître une croissance dans les prochaines années.
A. BPIFRANCE : ACTEUR ESSENTIEL DU SOUTIEN À L’INNOVATION
Parmi l’ensemble des politiques thématiques menées par Bpifrance, celle du soutien de l’innovation représente un cas particulier, tant en raison de la place prééminente qu’elle occupe dans les missions de la banque que des règles dérogatoires qui s’appliquent dans ce domaine.
Le soutien à l’innovation incarne en effet la préparation de l’avenir économique et industriel du pays et constitue dans le même temps la faille de marché par excellence puisque les créanciers se montrent souvent réticents à financer des actifs risqués, peu liquides et contractés généralement sur des périodes moyennes longues. D’autant plus que l’innovation est désormais perçue de manière large comme en témoigne Paul-François Fournier, directeur de l’innovation de Bpifrance : « l’innovation nouvelle génération peut prendre des formes très variées, et pas seulement technologiques. Ainsi, Blablacar bouleverse notre usage des transports, sans qu’il y ait une technologie très poussée à la base de son concept. L’innovation nouvelle génération comprend donc des changements dans les usages, mais aussi le design, l’organisation, les procédés technologiques ou de distribution, ou encore les modèles d’affaires. Il s’agit donc, en quelque sorte, de « libérer » l’innovation » (53).
Or, le marché du capital-innovation français est aujourd’hui au niveau des grands pays européens, mais reste modeste par rapport aux leaders mondiaux : en 2012, le poids des investissements en capital innovation rapporté au PIB (0,03 % du PIB) est proche de celui du Royaume-Uni (0,04 %) et de l’Allemagne (0,02 %), mais reste éloigné de celui d’Israël (0,36 %) ou des États-Unis (0,17 %).
C’est en vertu de ce constat et de ces caractéristiques que les règles européennes – et par ricochet la doctrine de la BPI – placent le soutien à l’innovation en dehors des règles applicables au financement et à l’investissement, en particulier celles relatives au cofinancement, au coinvestissement ou à la règle de l’investisseur avisé. Dans ce domaine, Bpifrance peut donc agir seule en ne dépendant que de ses propres choix pour la sélection, le suivi et les modalités d’octroi des aides qu’elle accorde.
En effet, Bpifrance réalise plus de 70 % de ses investissements supérieurs à 20 millions d’euros via des fonds qu’elle contrôle directement. Autrement dit, en matière d’innovation, Bpifrance dispose d’une capacité d’intervention directe et de larges marges de manœuvre qui contribuent à rendre son action fluide et efficace dans la durée. L’absence d’obligation de recourir à des partenaires privés en cofinancement ou d’opérer via des fonds de fonds dont les objectifs peuvent être multiples et le suivi aléatoire représente un atout considérable pour l’efficacité et la lisibilité de l’action publique en matière d’innovation. À cet égard, le Rapporteur recommande de recourir plus largement, en matière d’investissement, à une gestion fondée sur ce modèle (54).
De manière générale, on note que les fonds utilisés pour soutenir les entreprises innovantes sont de moins en moins issus de ressources budgétaires elles-mêmes contraintes. Les interventions de Bpifrance dans ce domaine s’effectuent, en conséquence, principalement sous forme de prêts.
Il demeure toutefois que la création de Bpifrance a permis une transversalité nouvelle entre les métiers du financement de l’innovation (ex-Oséo) et les métiers de l’investissement en recherchant le développement industriel et commercial des entreprises qui ont d’abord bénéficié d’aides publiques, afin de créer un continuum : par des prêts de développement, des garanties ou des prêts bonifiés, en cofinancement ou pas. L’accompagnement des entreprises innovantes dans la « vallée de la mort » s’en trouve ainsi amélioré. Le changement de logique est patent : la logique de guichet est abandonnée au profit d’une logique de projet.
À cet égard, l’accompagnement des financements et des investissements en matière d’innovation reposent notamment sur un réseau de 150 chargés d’affaires spécifiquement formés au métier du capital-risque. Cette équipe importante, bien plus large que les effectifs de la branche investissement de Bpifrance – pour des montants pourtant inférieurs – constitue un élément fort de l’action de Bpifrance en matière de soutien à l’innovation.
1. Une croissance rapide des aides à l’innovation qui bénéficie prioritairement aux PME innovantes.
a. Panorama des aides déployées par Bpifrance en matière d’innovation
Le soutien à l’innovation se divise principalement entre soutien à des projets individuels, qui reposent essentiellement sur des crédits budgétaires, et financement de grands programmes collaboratifs, qui s’inscrivent notamment dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA).
Les principaux dispositifs composant ces deux modes d’intervention sont présentés ci-dessous :
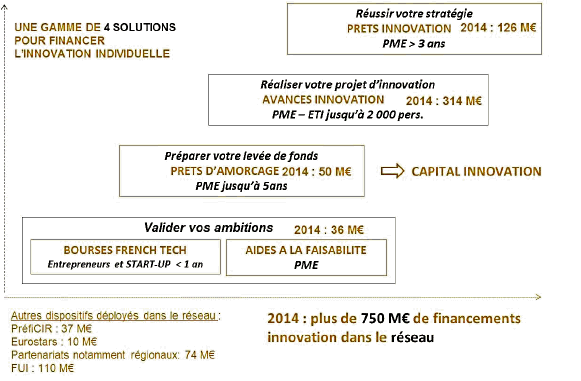
Source : Bpifrance.
FINANCEMENT DES GRANDS PROGRAMMES COLLABORATIFS
(en millions d’euros)
2013 |
2014 | |
ISI-PSPC (Innovation stratégique industrielle et Innovation et Projets Structurants des Pôles de Compétitivité) |
146 |
196 |
FIS |
19 |
42 |
Concours mondial d’innovation |
21 | |
Fonds national pour la société numérique (FSN) |
62 | |
TOTAL |
164 |
321 |
Source : Bpifrance.
PROGRESSION EN VOLUME DES AIDES ACCORDÉES
SUIVANT L’ANCIENNETÉ DE L’ENTREPRISE
Subventions |
2013 |
2014 |
2014 vs 2013 | ||
< trois ans |
736 |
40 % |
1 008 |
54 % |
+ 37 % |
entre trois et cinq ans |
171 |
11 % |
186 |
10 % |
+ 9 % |
entre cinq et huit ans |
148 |
9 % |
142 |
8 % |
– 4 % |
Supérieure à huit ans |
555 |
40 % |
543 |
29 % |
– 2 % |
Avances remboursables et prêt à taux zéro pour l’innovation (PTZi) |
2013 |
2014 |
2014 vs 2013 | ||
< trois ans |
346 |
26 % |
424 |
28 % |
+ 23 % |
entre trois et cinq ans |
157 |
12 % |
214 |
14 % |
+ 36 % |
entre cinq et huit ans |
149 |
11 % |
177 |
12 % |
+ 19 % |
Supérieure à huit ans |
707 |
52 % |
703 |
46 % |
– 1 % |
Source : Bpifrance.
b. Une progression continue des aides tant en financement qu’en investissement
En 2014, l’ensemble des composantes du continuum de financement de l’innovation proposé par Bpifrance a connu une croissance forte. À travers ses différents outils d’aides (subventions, avances remboursables, prêts à taux zéro), et de prêts, les sommes mobilisées par Bpifrance en faveur de l’innovation ont représenté 1,09 milliard d’euros, en hausse de 46 % par rapport à 2013, ce qui a permis la mobilisation de financements totaux en faveur de l’innovation de l’ordre de 2,9 milliards d’euros au total si l’on considère l’effet d’entraînement sur les partenaires privés.
Ainsi, près de 1 000 entreprises innovantes supplémentaires ont pu être soutenues en 2014, soit 4 582 (+ 27,5 %). En matière d’aides individuelles et collaboratives, le montant des accords s’est élevé en 2014 à 878 millions d’euros, en hausse de plus de 38 % sur un an.
La croissance, s’agissant des aides individuelles, s’établit à 27 % en valeur, tandis que les projets collaboratifs ont connu une hausse de 53 % des montants d’accords. Cette augmentation significative résulte, entre autres, d’un effort de forte simplification des processus engagé avec l’État dès la création de Bpifrance. Celle-ci vise deux objectifs principaux : la baisse des délais d’instruction et de décision et la mise en cohérence systématique des programmes financés. Ainsi, les délais d’instructions des projets collaboratifs ont été divisés par trois en 2014.
À noter qu’en matière d’aides, Bpifrance a opéré en 2014 la première phase du Concours mondial d’innovation, visant à faire émerger les entreprises leaders de demain sur sept ambitions identifiées par la commission présidée par Anne Lauvergeon. Au titre du PIA, ce sont ainsi 110 lauréats qui ont été financés sur cette phase. Enfin, le taux de renouvellement des entreprises aidées en aides à l’innovation a dépassé les 80 %, conformément aux ambitions stratégiques de Bpifrance et le nombre d’entreprises de moins de cinq ans accompagnées a progressé de plus de 30 %.
En matière de prêts, on constate également une montée des engagements, notamment à travers le lancement en avril 2014 du Prêt d’Amorçage Investissement (PAI). Ce prêt, d’un montant de 100 000 à 500 000 euros, vise à accompagner les entreprises innovantes lors de leur première levée de fonds propres en amorçage. Par effet de levier, il renforce et augmente les moyens disponibles. Comme en matière d’aides, l’exercice 2014 a vu l’activité en prêts à l’innovation augmenter fortement, avec des accords en hausse de 90 %, soit 214 millions d’euros pour 827 entreprises. Le montant unitaire moyen accordé en prêt est, lui, en augmentation de plus de 19 %. Il s’agit ainsi de donner plus de moyens aux entreprises innovantes dans les phases de mise sur le marché, afin de leur permettre un développement plus rapide.
En particulier, la gamme de prêts de développement pour l’innovation a capitalisé sur le lancement du prêt Innovation (PI) et du prêt pour l’Industrialisation des pôles de compétitivité en 2013. Cette gamme a, en effet, connu une croissance des accords de 119 % en 2014. L’apport par le Fonds européen d’investissement (FEI) d’une garantie pour les prêts Innovation a permis d’assurer la croissance de ces prêts et d’en augmenter les montants. Cette garantie pourrait être étendue à d’autres types de prêts en 2015. Il démontre le vif intérêt des institutions européennes au financement de cette phase cruciale de l’innovation.
Enfin, l’activité d’investissement en innovation a, elle aussi, connu une croissance importante en 2014, tant en valeur qu’en volume. En effet, les souscriptions se sont élevées à 127 millions d’euros pour 46 opérations, soit une augmentation de l’ordre de 11 % des montants souscrits. Bpifrance a mis cette année l’accent sur le soutien des sociétés déjà en portefeuille : en effet 25 opérations réalisées concernent des réinvestissements ce qui traduit une volonté d’accompagnement dans la durée des sociétés innovantes.
Le fonds spécialisé de la BPI en matière d’innovation, dénommé « Large Venture », a représenté la moitié des montants souscrits. Lancé en 2013, celui-ci est monté en puissance et a réalisé treize opérations en 2014, pour un montant total de 63,7 millions d’euros. Ainsi, par son intermédiaire, Bpifrance a participé à de nombreuses opérations de place d’un montant supérieur à 10 millions d’euros.
Bpifrance dispose également d’autres fonds spécialisés qui opèrent dans des thématiques particulières. En particulier, Innobio a réalisé neuf réinvestissements sur douze opérations, pour un montant total de 24,7 millions d’euros. Le fonds Biothérapies innovantes et maladies rares a, lui, réalisé son second investissement pour 1,10 million d’euros. De même, le fonds Écotechnologies, géré par Bpifrance pour le compte du PIA, a accompagné deux participations (dans le cadre de leurs projets d’entrée en Bourse) sur quatre investissements, pour un montant total de 10,4 millions d’euros. Enfin, le fonds Ambition numérique, géré lui aussi par Bpifrance au titre du PIA, a investi dans onze projets, à hauteur de 18 millions d’euros, dont quatre nouvelles souscriptions pour 11,5 millions d’euros.
c. Des investissements exemplaires
En matière d’innovation, la BPI a été associée, au cours des deux dernières années, à la plupart des levées de fonds importantes réalisées par des start-up. En particulier, dans le cas de Sigfox, la plus grosse levée de fonds de l’histoire de capital investissement en France, Bpifrance a investi près de 15 millions d’euros sur un total de 100. De la même manière, dans le cas de l’entreprise Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, la BPI a participé à hauteur de 6 millions d’euros à la levée de 24 millions d’euros. Les exemples sont nombreux : le site de e-commerce Sarenza, qui a levé 74 millions en juin 2014, ou le spécialiste du traitement des allergies DBV, coté depuis le mois d’octobre au Nasdaq.
Pour Bpifrance, ce type d’investissement est doublement utile puisqu’il permet à la fois de favoriser l’émergence d’entreprises françaises à haute valeur ajoutée technologique mais également de renforcer son assise financière dans le temps, en anticipant sur les plus-values qui pourront être réalisées lors de la revente de ses participations. À cet égard, on peut ainsi rappeler qu’au premier semestre 2014, ce type de vente a rapporté 691 millions d’euros, en hausse de 53 % par rapport à l’an dernier.
En ce qui concerne spécifiquement la partie innovation, on remarque dès à présent que le TVPI (« total value per investment » qui mesure la performance déjà réalisée et la performance latente) s’élève pour l’activité Capital Innovation à 1,29 au 31 décembre 2014, ce qui représente une bonne performance eu égard au caractère risqué de ses investissements.
d. L’appui de l’Union européenne à l’innovation
Bpifrance et le Fonds européen d’investissement (FEI), entité de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le capital-risque, ont signé une première opération de soutien au financement des sociétés innovantes le 12 mai 2015. Cet accord permettra à la banque publique d’investissement de dégager, au cours des deux prochaines années, une enveloppe de 420 millions d’euros sous deux formes.
Le prêt Innovation, doté de 320 millions d’euros, financera la commercialisation d’innovations réalisées par les PME et les ETI de moins de 500 salariés. Ces prêts, d’un montant maximum de 5 millions d’euros, seront garantis à 50 % par le FEI.
Le prêt Amorçage investissement, dont l’enveloppe est fixée à 100 millions d’euros, renforcera le bilan d’entreprises qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs. Le montant unitaire maximal est fixé à 500 000 euros. Cette enveloppe est garantie à 40 % par le FEI. L’accord repose donc sur des garanties de 200 millions d’euros. Celles-ci seront couvertes par le budget européen dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) – même si ce dernier n’existe pas encore.
e. La mise en place du Hub et l’ouverture à l’international : un effort nécessaire pour renforcer l’écosystème technologique français
Début avril 2015, Bpifrance a ouvert dans ses locaux au centre de Paris le Hub, un vaste espace adoptant les codes du design de la Silicon Valley. Ce lieu matérialise un service, baptisé également Hub, entièrement dédié à l’open innovation. Ce lieu d’échange doit favoriser la mise en relation entre les grands groupes et les start-up innovantes susceptibles de changer les modèles économiques établis. Déjà huit grands groupes, dont Allianz France, Valeo ou Icade, ont signé un contrat de prestation avec le Hub. Ces grandes entreprises doivent faire face à la révolution numérique mais la plupart n’ont pas encore investi les moyens nécessaires pour anticiper ces changements. Ainsi, les banques sont confrontées à la fintech, les commerçants au e-commerce, les médias à la mobilité ou les groupes énergétiques à l’ecotech.
La banque publique conduit ainsi une action d’analyse des besoins de ces grandes entreprises sur leur mise en relation avec les start-up qui peuvent répondre à ses besoins. Cela peut conduire à des partenariats, à la signature de contrats ou même des opérations de rachat. Pour être efficace, ce travail repose sur l’exploitation des données recueillies par Bpifrance dans un fichier concernant environ 50 000 sociétés innovantes. Il doit notamment permettre de faciliter la transition numérique des grandes entreprises françaises ce qui rappelle les effets du « Small business act » américain qui a favorisé le décollage de l’écosystème de la Silicon Valley.
Il en résulte que la banque publique conduit ainsi à renforcer les capacités et le modèle économique des entreprises dans lesquelles elle investit. Cet accompagnement vise notamment à développer les incitations pour les grandes entreprises françaises à acquérir des start-up innovantes. En effet, selon une étude réalisée par Bpifrance le lab, les entreprises françaises privilégient généralement la recherche et le développement en interne pour donner naissance à de nouveaux produits, ce qui diffère du modèle américain si l’on en croit l’étude : « En trois ans Google a réalisé 70 acquisitions d’entreprises innovantes pour près de 30 milliards de dollars, soit plus que l’ensemble de celles réalisées par les entreprises du CAC 40 . »
À noter que cette logique d’accompagnement s’est également traduite par l’ouverture par Bpifrance d’un bureau à San Francisco afin de faciliter le développement à l’international les entreprises innovantes françaises. Il s’agit d’identifier les entreprises françaises implantées aux États-Unis ou désireuses de le faire, pour mieux les soutenir. Bpifrance accompagne également l’installation et le développement des entreprises françaises et les aide à nouer des partenariats locaux. Enfin, la BPI recherche activement des partenariats, auprès de fonds de capital-risque et institutions financières américains.
2. La faiblesse des dotations budgétaires dédiées à l’innovation: un danger pour l’écosystème technologique français
Malgré les succès constatés en matière d’innovation, les membres de la mission d’information ont cependant été sensibles aux risques engendrés par la baisse continue des crédits alloués dans le cadre du programme 192 intitulé Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle de la mission Recherche et enseignement supérieur dont dépendent en grande partie les aides individuelles accordées par Bpifrance en matière d’innovation.
a. La baisse continue des dotations budgétaires du programme 192
Entre 2009 et 2015, le budget Innovation inscrit sur le programme 192 a été réduit de plus de 50 %.
ÉVOLUTION DES CRÉDITS DU PROGRAMME 192
(en euros)
Dotation d’intervention |
Dotation de fonctionnement |
Total | |
2009 |
293 500 000 |
50 389 986 |
343 889 986 |
2010 |
292 000 000 |
50 039 552 |
342 039 552 |
2011 |
264 930 265 |
48 668 443 |
313 598 708 |
2012 |
195 931 798 |
43 903 361 |
239 835 159 |
2013 |
195 969 686 |
39 045 290 |
235 014 976 |
2014 |
175 000 000 |
0 |
175 000 000 |
2015 |
159 012 800 |
0 |
159 012 800 |
TOTAL |
1 282 844 549 |
181 656 646 |
1 464 501 195 |
Source : Bpifrance.
Absence de dotation de fonctionnement depuis 2014. Application systématique d’une réserve de précaution (7-8 %)
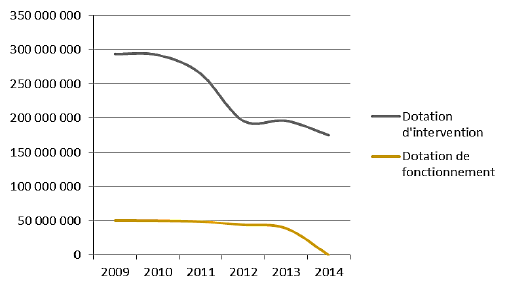
(en euros) | ||
2014 |
2015 | |
Dotation d’intervention |
||
Loi de finances initiale |
200 531 868 |
172 840 000 |
Réserve de précaution |
14 037 231 |
13 827 200 |
Annulation de crédits |
11 494 637 |
|
Dotation versée |
175 000 000 |
159 012 800 |
Dotation de fonctionnement |
||
Loi de finances initiale |
0 |
0 |
Source : Bpifrance.
Ces crédits sont inscrits sur le programme 192 et sont donc concernés par l’ensemble des dispositifs de régulation budgétaire tels que l’application d’une réserve de précaution ou le recours aux annulations de crédit. En 2014 comme en 2015, la dotation votée en loi de finances a ainsi été considérablement réduite en gestion.
Le Rapporteur partage les préoccupations exprimées par la BPI concernant cette baisse continue de la dotation initiale, dont l’effet est amplifié par les mesures de régulation budgétaire. En effet, le système des aides individuelles à l’innovation repose en grande partie sur ces dotations budgétaires, – bien que pas exclusivement, – et c’est à travers lui que les jeunes entreprises innovantes peuvent bénéficier d’un soutien.
b. La non-substituabilité entre PIA et aides individuelles
Une des justifications parfois avancées pour légitimer cette baisse de la dotation initiale serait la montée en puissance parallèle des crédits consacrés à l’innovation dans le cadre du programme d’investissements d’avenir. En effet, ce dernier a permis de débloquer des montants tels que l’effort global en faveur de l’innovation a indéniablement progressé au cours des dernières années. Cependant, ce raisonnement est contredit par le fait que les crédits accordés dans le cadre du PIA ont essentiellement pour vocation de financer les grands programmes collaboratifs alors que les dotations budgétaires du programme 192 contribuent exclusivement au financement des aides individuelles. Ces crédits ne sont pas substituables.
C’est pourquoi le Rapporteur recommande que la dotation budgétaire repose sur un plancher effectif proche de 200 millions d’euros, déduction faite de l’application de la réserve de précaution et, dans la mesure du possible, les annulations de crédits qui peuvent être anticipées.
Proposition : maintenir les crédits du programme 192 au-dessus du niveau plancher de 200 millions d’euros afin de soutenir les dispositifs d’aide individuelle aux PME innovantes.
3. Le projet de constitution d’une fondation
Afin de soutenir l’effort global de la BPI en faveur de l’innovation, cette dernière a présenté un projet visant à instaurer une fondation dont la dotation budgétaire reposerait sur les dividendes assis sur un portefeuille d’actions actuellement détenues par l’agence des participations de l’État. Ce système alternatif aurait pour but de compenser la baisse constatée de la dotation budgétaire du programme 192 et ainsi de permettre à la BPI de verser davantage d’aides individuelles.
Si les membres de la mission d’information comprennent la démarche de Bpifrance et partagent son inquiétude relative à la baisse de la dotation budgétaire, ils n’adhèrent cependant pas à la création d’une fondation dont le fonctionnement, tel qu’il est actuellement envisagé, conduirait à institutionnaliser un mécanisme de débudgétisation qui n’apparaît conforme ni aux règles de la loi organique relative aux lois de finances ni aux principes de vote et de contrôle du Parlement sur l’ensemble du budget. Dans ce cadre, il semble préférable d’agir en faveur d’une augmentation puis d’une stabilisation de la dotation budgétaire à hauteur de 200 millions d’euros lors du débat budgétaire.
B. LE SOUTIEN AUX POLITIQUES SECTORIELLES
Conformément aux vœux du législateur, le financement de la transition énergétique est une des missions de Bpifrance. Des produits dédiés à la transition énergétique ont ainsi été mis en place en même temps que des produits dédiés aux entreprises innovant dans les écotechnologies.
a. La promotion de la compétitivité énergétique et écologique par une offre de prêts adaptés
Les investissements susceptibles d’améliorer l’impact environnemental des PME et des ETI de plus de trois ans sont éligibles aux prêts de développement de Bpifrance. Il s’agit d’encourager la transition énergétique de toutes les entreprises et la modernisation des processus industriels dans une logique de compétitivité.
● Les prêts Éco-énergie mis en place en mars 2012, s’adressent aux TPE et aux PME (durée de cinq ans, différé de remboursement d’un an, sans garantie sur l’entreprise, montant compris entre 10 000 et 50 000 euros, dans la limite des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entrepreneur, taux bonifié). Ils permettent de financer l’installation et les travaux de mise aux normes de certains postes particulièrement consommateurs en énergie.
L’enveloppe de 33 millions d’euros du ministère de l’Écologie permet de distribuer et garantir 100 millions d’euros de prêts.
● Un prêt Vert a aussi été développé spécifiquement pour l’industrie, à taux préférentiel grâce aux financements du programme des investissements d’avenir (PIA). Il s’agit d’un prêt de développement (durée de sept ans, différé de remboursement de deux ans, sans garantie sur l’entreprise, montant compris entre 100 000 et 3 millions d’euros) qui permet de financer une amélioration de la compétitivité dans un sens favorable à l’environnement : réduction des consommations (intrants et énergie), réduction des émissions (gaz à effet de serre, pollution, déchets), optimisation des ressources et des processus de production, valorisation des déchets, service de diagnostic de la performance énergétique et écologique de l’entreprise. Si les investissements corporels doivent représenter 60 % des montants empruntés, la part immatérielle (diagnostic, notamment) n’est pas oubliée. Le prêt s’adresse à toutes les entreprises et non pas seulement aux entreprises du secteur de la transition énergétique. Sont d’ailleurs exclus les programmes d’exploitation de fermes éoliennes on-shore ou les installations photovoltaïques. Le chef d’entreprise doit être en mesure de transmettre des éléments d’évaluation à Bpifrance pour améliorer le ciblage du dispositif.
Du fait de leurs taux préférentiels, ces prêts bénéficient d’une aide de l’État régie par les règles européennes dites de minimis.
Un bilan du déploiement de la première génération de prêts Verts entre octobre 2010 et décembre 2013 a été réalisé par Bpifrance. 449 prêts ont ainsi été accordés à 430 entreprises le plus souvent des ETI, solides financièrement, industrielles pour les deux tiers d’entre elles. D’après le document transmis au Rapporteur, « la lourdeur des investissements consentis par les entreprises grâce aux prêts verts a des conséquences sur leur structure de bilan, puisque leur taux d’endettement passe en moyenne de 71 % à 94 %. Cette fragilisation structurelle illustre le risque pris pour renouveler massivement leur outil de production tout en faisant écho à leur souci environnemental : par exemple, pour la moitié des PME, le projet représente 131 % de l’appareil productif immobilisé, qui dès lors doit être complètement repensé. »
La réduction de la consommation d’énergie est le premier objectif des bénéficiaires, bien avant la valorisation des déchets ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, les bénéfices attendus diffèrent quelque peu selon la taille des entreprises : les PME ciblent davantage l’augmentation de la part des déchets valorisés (13 % contre 7 % pour les ETI), tandis que les ETI ciblent davantage la réduction des gaz à effet de serre (11 % contre 5 % pour les PME).
On peut s’interroger sur la pénétration de ce dispositif dans l’économie française. Plus de la moitié des bénéficiaires des prêts Verts étaient déjà des clients de Bpifrance, dont 30 % pour un soutien à l’innovation. Le prêt Vert viendrait surtout en renfort de projets d’innovation et à l’appui d’une démarche de réduction des coûts.
Le 19 février 2015, une deuxième génération de prêts Verts a été lancée par Bpifrance. Depuis septembre 2015, 76 projets sont en voie d’être financés pour un total de 77 millions d’euros et un montant moyen d’un million d’euros par projet. Les premières données confirment les observations réalisées sur la première génération.
b. Des aides à l’innovation et au développement qui doivent être mieux coordonnées dans le cadre de la politique de filière
Outre le prêt Vert destiné à toutes les entreprises, Bpifrance mobilise également ses dispositifs de prêts et de garanties et ses fonds d’investissement au profit des entreprises de la transition énergétique dans une perspective de croissance. Ces interventions nécessitent une coordination étroite avec les autres acteurs de la filière pour éviter les redondances et conduire une politique industrielle cohérente : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et le comité stratégique de la filière éco-industries (COSEI), abrité par le Conseil national de l’industrie.
La répartition des rôles semble a priori claire : le comité stratégique de filière est le cadre de la concertation entre les pouvoirs publics et les entreprises du secteur et grâce aux PIA 1 et 2, l’Ademe et Bpifrance financent les entreprises de la transition énergétique avec des doctrines différentes.
● L’Ademe dispose de 3 milliards d’euros (2 au titre du PIA 1 et 1 au titre du PIA 2) pour financer des projets structurants par deux modes de financement non cumulables sur un projet :
– des subventions, principalement destinées aux organismes de recherche (qui reçoivent ainsi 10 % des fonds des PIA) et des aides partiellement remboursables, pour des montants importants, attribuées via des appels à manifestation d’intérêt, les deux ayant le statut d’aides d’État et étant dûment notifiées à la Commission européenne ;
– des opérations en fonds propres destinées aux ETI et aux grandes entreprises, impliquant un intéressement de l’État au résultat du projet et un cofinancement dans la logique de l’investisseur avisé, sans appels à manifestation d’intérêt.
● Bpifrance, elle, démarche les TPE, PME et ETI de la transition énergétique pour financer leur développement par :
– des prêts et garanties accordées avec un partenaire bancaire ;
– des aides et des subventions à l’innovation.
En 2014, elle a ainsi distribué, selon son directeur général, Nicolas Dufourcq, pour 800 millions d’euros de prêts en faveur de la transition énergétique (éolien, photovoltaïque, biomasse ou hydroélectrique), de sorte que l’objectif que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé pour 2017 est déjà atteint. Bpifrance représenterait désormais entre 25 et 30 % du marché du financement de ce secteur, particulièrement risqué.
En outre, Bpifrance gère le fonds Écotechnologies, doté par l’Ademe de 150 millions d’euros à partir des fonds des PIA. Elle intervient dans une logique de co-investissement avec des fonds de capital-risque privés. Ces participations sont destinées à des entreprises émergentes qui ne sont pas encore rentables, ayant besoin de fonds pour accompagner leur croissance. Chaque projet bénéficie d’un investissement de 2 à 5 millions d’euros.
Ainsi, l’Ademe à la charge des projets structurants, portés par des grands groupes ou des consortium, régis par la réglementation relative aux aides d’État, qui imposent un suivi particulier et une expertise industrielle d’ailleurs saluée au cours des auditions.
Bpifrance démarche et accompagne quant à elle un grand nombre d’entreprises de plus petite taille avec des produits régis par les règles « de minimis » dans l’optique de compléter des tours de table sur des projets risqués et de très long terme.
Comme l’a précisé M. Benjamin Stremsdoerfer, directeur adjoint des investissements d’avenir à l’Ademe, « ces deux modes d’intervention en fonds propres sont de nature différente, ce qui se reflète dans le processus de décision. Pour le fonds Écotechnologies, qui vise à financer, de façon assez darwinienne, les meilleurs projets, la décision finale appartient à Bpifrance, dans le cadre fixé par l’État. Pour l’allocation des fonds propres, la décision finale appartient à l’État : tous les investissements sont autorisés par le Premier ministre, après avis des différents ministères concernés et du CGI et s’articulent à une stratégie industrielle de long terme de la puissance publique.» (55)
Si cette répartition paraît claire en théorie, les modalités d’intervention de Bpifrance et de l’Ademe sont pourtant voisines, en particulier pour l’activité Fonds propres. Dans ces conditions, plusieurs membres de la mission ainsi que des parties prenantes entendues se sont interrogés sur l’absence d’échanges systématiques entre l’Ademe et Bpifrance, que le directeur général, M. Nicolas Dufourcq, attribue essentiellement à un manque de temps.
De tels échanges sont néanmoins souhaitables. L’expertise des collaborateurs de l’Ademe, largement reconnue, est utile aux chargés d’affaires de Bpifrance Investissement, dont il a été souligné que l’expertise ne devait pas être uniquement financière. En outre, ils permettraient de compléter l’important travail de synthèse réalisé par M. Jean-Claude Andréini, président du comité de filière éco-industries, sur l’argent public dépensé au profit de la filière.
Enfin, si l’on peut admettre que les deux opérateurs participent en premier lieu à des politiques différentes – la transition énergétique pour l’une, la lutte contre les failles de marché en matière de financement des entreprises pour l’autre – il est évidemment souhaitable que les deux soient coordonnées pour favoriser leur cohérence. C’est d’ailleurs au nom de cette même cohérence que le législateur a voulu identifier des secteurs prioritaires, comme la transition énergétique, dans les objectifs de Bpifrance.
Suivant cette même logique, l’action de Bpifrance en faveur de la transition énergétique devrait également tenir compte des priorités stratégiques de la Caisse des dépôts et consignations qui intervient aussi dans ce domaine.
Proposition : veiller à une meilleure articulation des priorités stratégiques de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations en matière de transition énergétique et instaurer notamment une étroite coordination entre l’Ademe, Bpifrance et le comité stratégique de la filière éco-industries.
2. L’économie sociale et solidaire
L’économie sociale et solidaire représente environ 10 % du PIB français et 2,4 millions de salariés. L’article premier de la loi du 31 décembre 2012 précitée en fait un secteur prioritaire d’action de la banque publique.
L’année 2014 a été marquée par l’adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette loi donne une définition légale à ce secteur, conformément à un engagement du Président de la République, pour mieux reconnaître ses spécificités et ses besoins de financement. Cette définition est inclusive : au-delà des acteurs historiques (associations, mutuelles, coopératives, fondations), elle intègre les sociétés à utilité sociale pouvant être constituées sous forme de sociétés anonymes. La loi définit également la notion d’innovation sociale.
a. Une nouvelle gamme de produits en cours de déploiement
Deux prêts de développement sont proposés par Bpifrance spécifiquement pour l’économie sociale et solidaire en cofinancement avec un partenaire bancaire, aux PME de plus de trois ans, aux associations et aux fondations :
– le prêt Économie sociale et solidaire, prêt de développement (durée de cinq ans, différé de remboursement d’un an, sans garantie) à partir de 20 000 jusqu’à 50 000 euros (et 100 000 euros, en cas d’intervention de la région), en complément d’un prêt bancaire d’égal montant ;
– le prêt Quartiers, prêt de développement jusqu’à 50 000 euros.
Il a fallu deux ans pour déployer ces produits, qui imposaient la création et l’alimentation d’un fonds de garantie spécifique par l’État. Ils commencent donc seulement à être distribués par le réseau de Bpifrance en régions et le premier bilan est encore bien en-deçà des ambitions et des attentes de ce secteur en croissance.
Certes, comme l’a souligné le délégué Économie sociale et solidaire de la direction régionale de Basse-Normandie rencontré par la mission, des acteurs de l’économie sociale et solidaire sont déjà clients de Bpifrance, comme la coopérative d’Isigny-Sainte-Mère par exemple. Ainsi, Bpifrance aurait accompagné 958 structures de l’économie sociale et solidaire en 2014 (56). En outre, d’après son rapport d’activité 2014, Bpifrance aurait engagé plus de 100 millions d’euros à destination des entreprises de l’ESS pour cette année à travers de financements et de garanties.
Bpifrance a également pris des participations au capital de plusieurs coopératives telles que Limagrain et Sofiprotéol. En 2014, elle a apporté des ressources dans Citizen Capital et Impact Partenaires, les deux seuls fonds qui alimentent en fonds propres des entreprises situées dans des zones défavorisées. Selon Nicolas Dufourcq, « nous serons amenés à renforcer leurs moyens car ils ont d’autres idées. Des fonds de cette sorte, il en faudrait dix, mais les équipes d’investisseurs entrepreneurs à composante sociale capables de sélectionner les risques sans se rémunérer comme on se rémunère dans les fonds classiques, ne sont pas légion.» (57)
Le Rapporteur souhaite que les efforts soient poursuivis pour accroître les financements à destination de ce secteur et pour améliorer la gamme de produits qui lui est destinée.
b. La reconnaissance de nouvelles formes d’innovation
La loi du 31 décembre 2012 précitée fait figurer explicitement l’économie sociale et solidaire parmi les secteurs d’avenir, au même titre que la conversion numérique ou la transition énergétique. Le programme d’investissements d’avenir (PIA) prévoit des aides dédiées à ce secteur.
Grâce à sa définition élargie de l’innovation – qui dépasse l’innovation technologique – Bpifrance peut financer l’économie sociale et solidaire par le biais du Fonds d’investissement dans l’innovation sociale (FISO), doté en partenariat avec huit régions volontaires de 10 millions d’euros, alloués dans les régions par les équipes Innovation de Bpifrance.
Comme l’a souligné Nicolas Dufourcq, au cours de son audition, « les Français ont brillé par leur créativité dans des innovations d’usage avec des inventions telles que le stylo Bic ou le minitel. C’est moins le cas maintenant car nos dispositifs de financement de l’innovation nous imposaient de ne financer que des produits ; en Scandinavie, 30 % des aides à l’innovation vont à l’innovation non technologique et une partie à l’innovation sociale. Notre vision de l’innovation est maintenant élargie.» (58)
Sont éligibles à ce soutien les PME, associations, sociétés coopératives participatives, sociétés coopératives d’intérêt collectif et entreprises avec l’agrément « entreprises solidaires », délivré par le Préfet établies dans une région participante au dispositif FISO et portant un projet d’innovation économiquement viable et à impact social.
Sont éligibles les projets qui, cumulativement :
– proposent une solution innovante répondant à un besoin social non ou mal satisfait ;
– cherchent à démontrer la faisabilité de la solution, sa viabilité et ses possibilités de duplication et d’essaimage ;
– s’inscrivent dans un objectif de modèle économique viable ;
– créent de l’emploi et/ou apportent un bénéfice social et/ou environnemental ;
– et s’engagent dans une démarche participative avec implication des parties prenantes.
Le dispositif permet de financer jusqu’à 50 % des dépenses éligibles pour des montants à partir de 30 000 euros et dans la limite des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise. Le FISO intervient selon deux modalités.
● L’aide peut être accordée sous forme d’avance récupérable versée en deux tranches (60 % au début du projet, 40 % à la fin) en cas de succès technico-économique du projet. En cas d’échec technico-économique total ou partiel du projet, le montant du remboursement dû en tout état de cause par l’entreprise de plus de trois ans est fixé à 40 % du montant de l’aide versée (plancher de 20 % pour les moins de trois ans).
● Pour les entreprises de plus de trois ans, prioritairement, l’aide pourra être accordée sous forme de prêt à taux zéro pour l’innovation (PTZI). Ce dispositif de financement offre la possibilité de pouvoir bénéficier d’un versement en une seule tranche au démarrage du projet. À la différence de l’avance récupérable ce prêt est remboursable en tout état de cause.
c. Une répartition des tâches peu claire avec la Caisse des dépôts et consignations
L’offre reste complexe pour les plus petites entreprises. La CDC gère en effet une partie des crédits du PIA dédiés à l’économie sociale et solidaire. À ce titre, elle finance de nombreuses entreprises avec des modalités proches de celle de Bpifrance, un partage des tâches jugé « peu clair » par M. Emmanuel Landais, directeur général de l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), qui invitait à davantage de rationalisation (59) .
Schématiquement, on peut considérer que la CDC joue un rôle dans la structuration de l’offre et des acteurs en octroyant des subventions selon des priorités stratégiques, tandis que Bpifrance octroie des crédits aux TPE et PME en tenant compte de leurs spécificités sectorielles.
Rappelons que la Caisse finance les grands réseaux d’aide à la création d’entreprise (ADIE, Initiative France, Réseau Entreprendre, Boutiques de gestion, France Active, Planet Finances, …) et gère des dispositifs pour compte de tiers (dispositif NACRE pour la création d’entreprises par des demandeurs d’emploi ou allocataires de minima sociaux – distribué prioritairement par France Active et Initiative France), participe à des fonds structurants pour le secteur, comme le fonds SIFA, et accorde des subventions à des associations représentatives de secteurs entiers de l’économie sociale et solidaire.
Si Bpifrance intervient quant à elle à travers ses dispositifs généraux auprès de PME et d’ETI à activité commerciale relevant de l’économie sociale et solidaire, il n’en demeure pas moins que la question de la coordination des nouveaux outils créés par Bpifrance – notamment le FISO – avec la politique de financement de la CDC reste posée.
Proposition : définir des priorités stratégiques pour le développement de l’économie sociale et solidaire en veillant à une clarification des rôles respectifs de l’État, des conseils régionaux, de Bpifrance et de la Caisse des dépôts et consignations.
C. LE SOUTIEN À L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES
1. Une rationalisation des structures publiques
a. Un processus engagé depuis plusieurs années
Le rapprochement des structures d’accompagnement des entreprises à l’export a été initié il y a plusieurs années. Les acteurs impliqués dans l’accompagnement et le financement de l’export étaient et sont toujours multiples : administrations, structures publiques, réseaux consulaires, associations professionnelles, cabinets de conseils, missions diplomatiques, et collectivités territoriales. Mais la volonté de mieux répondre aux besoins des entreprises a guidé leurs efforts de coordination. Le projet d’une « maison de l’export » avait déjà été proposé en 1996 par M. Jean-Claude Karpelès, sur la base du constat d’une offre de services et de financements illisible, en particulier, pour les PME.
Il a fallu attendre 2004 pour que l’établissement public industriel et commercial Ubifrance soit créé, à la suite de la fusion de l’Agence pour la coopération technique, industrielle et économique (ACTIM), du Centre français des manifestations extérieures et du Centre français du commerce extérieur. Il s’agissait de consacrer l’existence d’un opérateur unique du soutien au commerce extérieur au profit des entreprises et notamment des PME.
En 2009, lui ont été transférées les missions d’appui commercial assumées jusqu’alors par les services économiques de la direction générale du Trésor. Cette réforme a permis de mettre en place deux réseaux distincts aux compétences clairement définies :
– le réseau des services économiques chargé des missions régaliennes (suivi de la situation économique et financière des pays, relations avec les autorités locales, appui aux grands contrats, négociations multilatérales) placés sous l’autorité des ambassadeurs ;
– et le réseau des missions économiques d’Ubifrance proposant des prestations aux PME et ETI souhaitant se développer sur les marchés extérieurs.
Le 15 novembre 2013, la ministre du Commerce extérieur a annoncé un rapprochement des acteurs de « l’équipe de France de l’export » (Ubifrance, CCI International et CCI France).
En 2014, le processus de rapprochement d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (Afii) a abouti à la création d’une nouvelle agence : Business France, chargée de l’internationalisation des entreprises au sens large.
À l’issue de ce processus, comme l’ont souligné deux rapports successifs (60) de MM. Patrice Prat et Jean-Christophe Fromantin, présentés au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale en 2013 et 2014, sur le soutien public aux exportations, le nombre d’interlocuteurs restait élevé pour les entreprises.
INTERLOCUTEURS DES ENTREPRISES
POUR LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DE L’EXPORT
En France
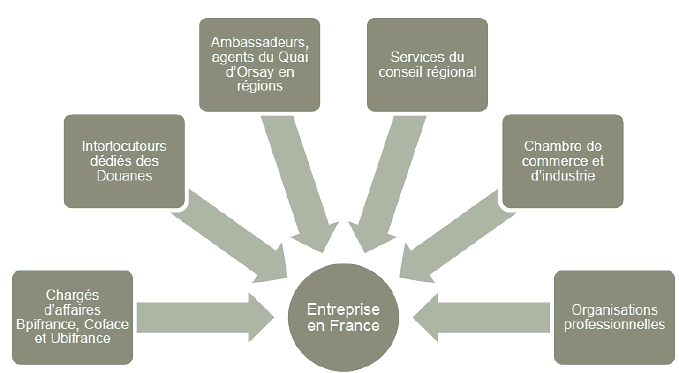
À l’étranger
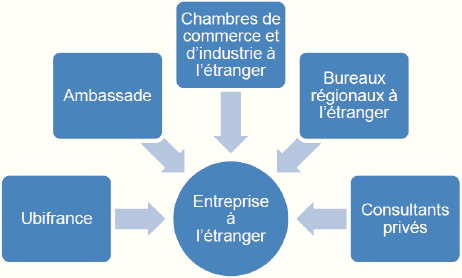
Source : synthèse illustrée du Rapport sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information (n° 1225) du 4 juillet 2013 sur l’évaluation du soutien public aux exportations, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2052, 19 juin 2014.
b. Une nouvelle étape de rationalisation grâce à Bpifrance
Dans ce contexte, le label Bpifrance Export représente une modalité d’unification et de simplification remarquable. Banque de démarchage et non guichet, devenue l’interlocutrice privilégiée des entreprises pour le financement des projets risqués, Bpifrance s’est naturellement imposée comme portail des dispositifs de soutien aux exportations.
À cette fin, des chargés d’affaires internationales de Business France ont rejoint le réseau déconcentré de Bpifrance dès 2012. En mai 2013, a été mis en place le label Bpifrance Export qui rassemble les trois opérateurs publics : Business France, Bpifrance et Coface. Des personnels de Coface chargés du développement ou de la commercialisation des produits de l’assureur-crédit auprès des PME ont rejoint les directions régionales de Bpifrance.
LE GUICHET UNIQUE « BPI FRANCE EXPORT »
Besoins |
« Bpifrance Export vous accompagne dans la prospection de votre projet » |
« Bpifrance Export vous soutient dans le financement de votre projet » |
« Bpifrance Export vous assure pour la réalisation de votre projet » | |||
Finalité |
Accompagner dans l’élaboration de la stratégie |
Soutenir la prospection |
Aider à financer le projet |
Inciter les banques à financer le projet |
Assurer contre les risques liés au paiement de la transaction |
Protéger les investissements à l’étranger |
Produits |
Prestations Ubifrance |
Assurance-prospection |
Contrat de financement du BFR à l’international |
Assurance risque exportateur |
Assurance-crédit et assurance-change |
Assurance investissement et Fasep garantie |
Entité gestionnaire |
Business France |
Coface |
Bpifrance |
Coface |
Coface |
Coface et |
Distribution |
Réseau Bpifrance Export | |||||
Source : Rapport sur l’évaluation du soutien public aux exportations, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1225, 4 juillet 2013.
En septembre 2014, une deuxième vague de chargés d’affaires internationales, personnel détaché de Business France, a rejoint Bpifrance.
Celle-ci a tiré des leçons du passé récent ; elle se présente comme un portail et affiche visiblement ses partenariats avec les chambres de commerce (CCI France, CCI France International), avec les banques (HSBC, Société générale), les conseillers du commerce extérieurs et les cabinets privés (OSCI). Elle évite ainsi les critiques adressées à ses prédécesseurs sur une concurrence vécue comme déloyale.
L’insertion de l’offre de produits et d’accompagnement pour l’export dans un continuum de financement lisible et cohérent constitue le premier résultat de cette intégration (cf. infra).
c. Le rattachement de la direction des garanties publiques de Coface à Bpifrance finalement acté
Dans leur rapport sur l’évaluation du soutien public aux exportations précité, MM. Prat et Fromantin avaient déjà proposé le rattachement de la direction des garanties publiques de Coface à Bpifrance. Il s’agissait de parachever la rationalisation de la gamme de produits, l’unification de la distribution, la simplification des procédures, la circulation de l’information, la réduction du nombre des interlocuteurs des entreprises, et finalement, l’efficacité du dispositif public de soutien aux exportations. Les Rapporteurs indiquaient que « ce regroupement ne constituerait pas une singularité française car plusieurs pays ont déjà rapproché leur assureur crédit et leur banque publique de développement des PME. »
Plus encore, l’intégration de la direction des garanties publiques de Coface à Bpifrance se justifiait par l’intention annoncée du principal actionnaire de Coface, Natixis, de se désengager d’une activité jugée par lui-même comme non stratégique. Selon les deux rapporteurs, « l’entrée en bourse de Coface et son ouverture à d’autres actionnaires pourrait constituer une menace pour les données des entreprises françaises gérées par la direction des garanties publiques de Coface. Celle-ci manipule en effet des informations sur de nombreux groupes du CAC40 ainsi que sur les entreprises du secteur de la Défense, aujourd’hui protégées par une réglementation ad hoc (habilitation des chargés d’affaires). »
« En l’absence de certitudes sur la capacité de l’État à s’opposer à une prise de participation significative de la part d’acteurs de marchés étrangers », les rapporteurs estimaient que « les conditions juridiques et financières d’une intégration de Coface à la banque publique d’investissement devraient faire l’objet d’une réflexion plus poussée ».
Comme l’a indiqué Nicolas Dufourcq lors de son audition du 7 juillet 2015, le secrétariat général de l’Élysée a demandé à la direction générale du Trésor d’instruire à nouveau ce sujet en juillet 2014. Le 29 juillet 2015, un accord a pu être trouvé avec Coface qui prévoit le versement d’un montant de 77,2 millions d’euros pour le transfert de l’activité des garanties publiques à Bpifrance au premier semestre 2016.
Le Rapporteur se félicite de cette intégration qui était indispensable à la construction d’une offre cohérente
Ces évolutions ont amené M. Christophe Viprey, directeur des garanties publiques de Coface, à formuler trois perspectives d’amélioration du système actuel au moment d’un transfert des garanties publiques à Bpifrance (61) :
– apporter aux contrats la garantie directe de l’État pour améliorer la compétitivité ;
– améliorer la dimension commerciale de l’assurance-crédit en adoptant une démarche active de promotion des produits de garantie publics auprès des exportateurs français mais aussi de leurs clients étrangers ;
– simplifier le processus de décision en exonérant les décisions relatives aux PME d’un passage long et fastidieux en Commission interministérielle des garanties et du crédit au commerce extérieur (62).
Le Rapporteur ne doute pas que ces propositions soient entendues par Bpifrance et qu’elle soit bientôt en mesure de proposer une offre encore plus complète avec la simplicité et la dimension commerciale qui manquaient jusqu’à présent.
2. Une priorité stratégique en 2015
Dès sa première audition, le directeur général de Bpifrance avait annoncé que l’export serait, avec l’accompagnement, une priorité stratégique pour 2015. En pratique, les deux priorités se rejoignent puisque l’accompagnement consiste notamment à encourager l’internationalisation des entreprises.
a. L’amélioration du continuum de financement
Avant la création de Bpifrance, une certaine concurrence était observable entre Oséo et Coface, qui développaient des gammes de produits parallèles pour le financement du développement à l’export. Depuis 2013, une rationalisation de l’offre a été opérée sous le label Bpifrance Export.
Bpifrance distribue les assurances et les cautions de Coface et les prestations de Business France pour la prospection commerciale. Elle propose en outre une gamme de produits spécifiques pour financer le développement à l’international des PME et ETI.
LE CONTINUUM DE FINANCEMENT BPIFRANCE EXPORT

Source : Bpifrance.
Le financement du développement international – export ou implantation à l’étranger – représente un risque important du point de vue des banques, qui ne peuvent prendre de garanties sur les investissements immatériels ou sur ceux qui sont consentis à l’étranger. Bpifrance a étoffé sa gamme de produits en matière de financement de l’export, de sorte de combler les failles de marché identifiées, en particulier pour des crédits export de petits montants, insuffisamment proposés par les banques commerciales, ou encore pour des produits risqués.
● La garantie de projets à l’international, à hauteur de 50 %, est proposée par Bpifrance aux banques commerciales pour des projets d’implantation à l’international de PME ou d’ETI jusqu’à 1,5 million d’euros.
● Le prêt Export est un prêt de développement proposé directement par Bpifrance à une PME ou ETI française pour financer son développement international. Comme les autres prêts de développement, il s’agit d’un prêt long : sur sept ans, avec deux ans de différé de remboursement, sans garantie, de 30 000 euros à 5 millions d’euros. Bpifrance peut proposer ce produit seule jusqu’à 150 000 euros, et avec un partenaire bancaire si le montant est plus élevé. Produit phare de Bpifrance, le prêt Export a connu une forte croissance en 2014.
● Lancé en 2014, le produit Avance + Export est une avance de trésorerie, qui permet la mobilisation de créances nées à l’étranger. Là, où les MCNE (mobilisations de créances nées à l’étranger) couvrent les exportations corporelles, Bpifrance propose avec Avance + Export un champ d’éligibilité beaucoup plus large, en incluant entre autres, les prestations de services ou marchés de travaux. Risqué, ce produit semblait répondre à un besoin patent des entreprises. Il se développe néanmoins plus lentement que prévu, ce que la direction de Bpifrance explique par le temps nécessaire à son appropriation par le réseau et les entreprises.
● Dans un contexte de baisse des contrats civils garantis par la Coface et de désintérêt des banques commerciales depuis 2009, une faille de marché a été identifiée pour des crédits acheteurs ou fournisseurs de faible montant. Bpifrance a donc lancé en 2014 un crédit Export pour des montants inférieurs à 25 millions d’euros (et jusqu’à 75 millions d’euros en cofinancement). Le crédit Export concerne les entreprises françaises ou étrangères ayant une filiale implantée en France, qui vendent des biens d’équipement et prestations de services. Il leur permet de proposer à leur acquéreur, à côté de leur offre commerciale, une solution financière, soit sous forme d’un crédit acheteur, soit sous forme d’un rachat de crédit fournisseur. Ce produit a connu des débuts relativement modestes au regard de l’intérêt qu’il présente. Selon Nicolas Dufourcq, un certain temps étant nécessaire, là aussi, pour mieux faire connaître le produit et ses avantages.
● L’activité Fonds de fonds s’est aussi adaptée à la priorité donnée à l’internationalisation des entreprises. Selon Nicolas Dufourcq, « sous l’impulsion de Nicole Bricq, nous avions créé dans notre activité fonds de fonds un label Export, grâce auquel nous pourrons doter davantage les fonds qui accompagnent à l’international. Nous réalisons un audit pour savoir comment les fonds produisent de l’accompagnement intelligent. Le fonds MBO Partenaires a un bureau à Singapour, Sao Paolo et New York, qu’il finance sur la commission de gestion que nous lui accordons. Il accompagne de bout en bout les entreprises et n’investit que dans celles qui possèdent un potentiel international significatif. Nous donnons davantage à ce fonds qu’aux autres. Quant aux fonds dédiés aux ETI et aux PME de taille déjà significative qui n’accompagnent pas à l’international, non seulement nous ne leur accordons pas de label, mais nous leur faisons comprendre qu’il ne faudra pas compter sur nous à la prochaine levée. » (63)
Enfin, il faut rappeler qu’une solution de financement existe aussi pour les plus gros projets qui présentent un haut niveau de risque. La société de financement local (SFIL) pourra être mobilisée pour les refinancer pour des montants compris entre 250 millions d’euros et 2 milliards d’euros. Le bilan de Bpifrance s’élevant à 50 milliards d’euros, elle sortirait du cadre tracé par les ratios prudentiels, et contrôlé par la Banque centrale européenne, en finançant des prêts de ces montants.
b. Le renforcement de l’accompagnement, en partenariat
Le 6 novembre 2012, a été signé le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi qui vise à instaurer un accompagnement personnalisé à l’international, dans la durée, à 1 000 ETI et PME de croissance, par Bpifrance et Business France. Il s’agit de combiner des dispositifs de financement et d’accompagnement au profit d’entreprises déjà bien implantées sur le marché national et qui hésitent à se lancer à l’international. 50 % des ETI françaises ne sont en effet pas internationalisées. Ces entreprises se voient proposer un programme sur deux ans par Bpifrance pour l’élaboration d’une stratégie commerciale intégrant l’internationalisation.
Pour détecter les entreprises à potentiel, chargés d’affaires de Bpifrance a se déplacent dans les entreprises – souvent le chargé d’affaires internationales accompagne le chargé d’affaires Innovation. Selon les chargés d’affaires de Business France intégrés au sein du réseau Bpifrance, il s’agit surtout de « dédramatiser l’international ». Un système de vidéo-conférence permet de mettre facilement et rapidement l’entrepreneur avec des bureaux de Business France à l’étranger et ainsi de répondre à des questions simples.
L’accompagnement à l’export se veut partenarial, la mobilisation des acteurs de l’équipe de France de l’export s’adaptant à la taille des entreprises.
● Les plus grandes entreprises peuvent financer leur développement international avec les grandes banques de la place et, pour des projets particulièrement risqués, Bpifrance ou la Caisse française de financement local (SFIL). Pour les accompagner sur des projets spécifiques, elles peuvent notamment recourir aux cabinets privés représentés, sur le site Internet de Bpifrance, par l’organisation des sociétés de commerce international (OSCI).
● Les entreprises de taille intermédiaire et PME en croissance sont la cible privilégiée de Bpifrance. Selon Nicolas Dufourcq, il est urgent d’agir : « nos entrepreneurs conservent un rapport au monde conservateur, voire démodé : 50 % des ETI et 70 % des PME ne sont pas dans la mondialisation, ce qui est grave. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas changé cette situation, en faisant du porte-à-porte, en rencontrant les entrepreneurs les uns après les autres. » Sous le label Bpifrance Export, Coface, Bpifrance et Business France proposent un ensemble de produits et de services adaptés pour un développement à l’international dont la coordination est assurée par Bpifrance.
● L’accompagnement à l’export des PME et TPE serait, lui, assuré prioritairement par les chambres de commerce et d’industrie, Business France et les régions. En sus des 1000 ETI accompagnées par Bpifrance, un accord signé le 11 mars 2015 entre les CCI et Business France prévoit, lui, l’accompagnement de 3 000 PME. Dans ces conditions, l’implication des régions dans la gouvernance de Bpifrance est primordiale pour éviter d’éventuelles redondances. Or, le Rapporteur souligne qu’à ce jour, les régions semblent s’impliquer diversement dans la gouvernance.
Enfin, en dépit de leur taille, les start-ups restent plutôt dans le giron de Bpifrance pour mobiliser rapidement l’ensemble des financements dont elles ont besoin. M. Alain Renck, directeur de Bpifrance Export, rappelait ainsi qu’un traitement spécial était réservé aux entreprises innovantes : « il existe deux types d’entreprises innovantes : les start-ups, qui sont internationales par nature, et des entreprises traditionnelles qui innovent en permanence. En ce qui concerne les start-ups, nous mettons en place, avec Business France, des programmes, ubi i/o et Mobility, qui consistent à immerger ces jeunes entrepreneurs français dans les milieux où l’investissement et l’innovation sont très prometteurs. Nous sélectionnons ainsi huit start-ups potentiellement mondiales et nous les installons pendant dix semaines dans la Silicon Valley, où elles rencontrent, lors de rendez-vous organisés par Business France à San Francisco, les acheteurs et les développeurs des plus grands groupes. Au terme de la première année de ce programme, on a pu constater que chacune de ces entreprises, partie avec une technologie de pointe, était revenue avec un produit. La France, est une nation d’ingénieurs où l’on sait développer une technologie mais sans toujours se demander si celle-ci est adaptée au client. Nous allons, par exemple, mettre en contact des entreprises françaises qui développent des technologies embarquées destinées aux voitures sans chauffeur avec les grands constructeurs américains et avec Google, qui sera sans doute l’un des principaux constructeurs automobiles demain » (64).
Au cours de sa séance du mercredi 30 septembre 2015, la Commission examine le rapport de la mission d’information sur la banque publique d’investissement Bpifrance.
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information commune sur Bpifrance. Le président de l’Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, a annoncé le 2 octobre 2013 que 2014 serait « l’année de l’évaluation des grandes lois votées par le Parlement ». La loi du 31 décembre 2012 relative à la création de la banque publique d’investissement (BPI) en fait partie.
Je tiens à souligner la qualité des auditions et la pertinence des interventions entendues lors des travaux de la mission, en insistant surtout sur le travail en commun que nous avons pu mener depuis le début de l’année avec le rapporteur, Laurent Grandguillaume. Ce rapport d’information a une vocation pédagogique car il démontre que la mission de contrôle du Parlement s’exerce pleinement.
Structure jeune, Bpifrance figure désormais pleinement dans le paysage institutionnel français, ce qui implique que la définition de ses missions soit précisée pour plus de cohérence et de pragmatisme, afin que tout dirigeant d’entreprise sache ce qu’il peut en attendre. C’est l’enjeu du recentrage souhaitable de la politique de communication du groupe.
Bpifrance s’engage régulièrement aux côtés des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les régions, pour renforcer le soutien aux entreprises dans les phases clés de leur développement. En effet, dans l’environnement économique que nous connaissons, l’accompagnement des mutations des PME en entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des très petites entreprises (TPE) en PME est essentiel. C’est dans ce sens que l’articulation des relations entre Bpifrance et les nouvelles grandes régions sera décisive dans les mois qui viennent.
Il convient, plus généralement, de « recréer » dans notre pays un environnement favorable aux entreprises et à l’envie d’investir, avec un système fiscal incitatif et non dissuasif. L’entreprise n’est pas notre ennemie ! Nous devons créer un « cercle de confiance » permettant aux chefs d’entreprise de passer, l’an prochain, à la vitesse supérieure, et il faut absolument d’éviter que ces derniers ne soient submergés par la constitution chronophage de dossiers même si les retards pris sur le poste « investissements » pendant la crise expliquent pour une bonne part la baisse de la croissance, et les retards préjudiciables dans le renouvellement de l’équipement des entreprises et des infrastructures, qui en conséquence sont vieillissants.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information commune sur Bpifrance. Bpifrance a permis d’offrir un interlocuteur unique aux entreprises et, malgré la lourdeur encore réelle du traitement de certains dossiers, elle a facilité leurs démarches. Plusieurs de nos interlocuteurs ont insisté sur la complexité des dossiers à monter : elle rend parfois nécessaire le recours à des cabinets spécialisés, ce qui peut générer des frais supplémentaires. Néanmoins, les délais d’intervention ont globalement été réduits, ce qui a permis de dynamiser l’intervention publique en matière de soutien aux entreprises.
En 2014, 82 000 entreprises, totalisant 1,3 million d’emplois, ont ainsi reçu une aide de la part de la BPI. En matière de soutien à l’innovation, l’action de la BPI est particulièrement exemplaire. Elle permet notamment de renforcer et de structurer le marché français du capital-risque. Mais l’activité de la BPI est aussi fortement soumise à des contraintes externes et internes, qui encadrent son action et sa doctrine.
En premier lieu, il convient de rappeler que le mode d’action de la BPI repose presque exclusivement sur un principe de complémentarité obligatoire avec le secteur privé – le soutien à l’innovation constituant l’exception à ce principe. Ces modes d’intervention, en cofinancement ou en co-investissement, veulent que pour un euro d’argent public prêté ou investi, au moins un euro d’argent privé participe à la même opération de crédit ou d’investissement. Ces principes, qui sont au cœur de la doctrine de Bpifrance, sont largement imposés par le droit européen qui exige que toute structure publique de financement de l’économie se comporte comme un « investisseur avisé », sous peine de tomber sous la réglementation des aides d’État.
Ces règles aboutissent cependant à un paradoxe que la BPI ne résout pas entièrement : l’on comprend en effet mal la logique qui veut que son action soit tournée vers les secteurs pour lesquels les acteurs privés n’interviennent pas et qu’elle soit, dans le même temps, contrainte d’agir systématiquement à leurs côtés.
Bien sûr, l’action de la BPI a un effet d’entraînement sur le financement et l’investissement privé. Mais des projets solides, potentiellement créateurs d’emplois, que Bpifrance aurait pu financer, n’intéressent pas toujours les partenaires privés, qui opèrent des arbitrages financiers en faveur d’opérations plus rentables à court terme et moins risquées. Ces situations ne sont pas recensées systématiquement aujourd’hui ni par Bpifrance ni par les services de l’État. C’est pourquoi nous proposons de mettre en place un mécanisme d’alerte des services de l’État dans de tels cas de figure.
Nous proposons aussi d’assouplir les règles en matière de cofinancement et de co-investissement. Les traités européens prévoient en effet de nombreuses exceptions au principe de l’investisseur avisé. Elles ouvrent la possibilité aux aides d’État lorsque l’intérêt social ou économique, ou encore celui des territoires, le justifient. Or, la BPI ne s’autorise pas réellement à utiliser ces dérogations, et elle se montre parfois plus « royaliste que le roi ». Ce n’est d’ailleurs pas injustifié car, pour s’affranchir des règles européennes, il faut passer par un système de notification complexe auprès de la Commission européenne, qui s’accorde difficilement avec le temps économique. Il y aurait donc matière à étudier, avec les services de la Commission, le moyen d’accélérer cette procédure. Sur ce sujet, l’exemple allemand a retenu notre attention : la banque publique allemande, la KfW, accorde des prêts par l’intermédiaire de banques privées avec qui elle passe des conventions de gestion, évitant ainsi les questions relatives aux aides d’État. Sans remettre en cause le principe général de la co-intervention avec le secteur privé, un mécanisme de ce type pourrait être étudié en France pour des secteurs particuliers.
La question de la capacité d’intervention de la BPI est posée. La Banque centrale européenne ne pourrait-elle pas, par exemple, financer directement les institutions publiques d’investissement pour favoriser le développement de fonds de capital-risque ou de fonds de garantie européens ? Nous constatons avec satisfaction que la BPI a été la première à établir un accord avec la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le cadre du plan Juncker pour développer le soutien à l’innovation à travers la mise en place d’instruments cofinancés par l’Union européenne. Il est nécessaire de poursuivre dans cette voie pour augmenter les moyens publics au service de l’investissement.
J’en viens plus concrètement aux outils dont dispose la BPI en matière de financement et d’investissement.
Pour le financement, deux outils sont principalement utilisés : la garantie et le prêt. Bpifrance déploie une vaste gamme de produits destinée à toutes les entreprises – cette gamme est peut-être même parfois trop vaste, puisqu’elle compte plus de quatre-vingts produits. Toutefois, nous avons pu constater que la réponse apportée aux TPE et aux PME était encore insuffisante. Les banques commerciales sont réticentes à prêter aux plus petites entreprises, et Bpifrance ne propose pas directement de produits de faible montant répondant à leurs besoins de trésorerie spécifiques. Nous proposons qu’en plus d’un petit prêt de développement, qui sera proposé dès le début de l’année prochaine aux TPE via internet, Bpifrance offre des micro-crédits avec les banques commerciales et renforce l’accompagnement des TPE en lien notamment avec les sociétés de cautionnement mutuel comme la SIAGI.
Il conviendrait aussi de faire plus pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Nous proposons de généraliser, sur l’ensemble du territoire, les « prêts rebonds » proposés dans certaines régions, comme l’Île-de-France, pour les entreprises connaissant des difficultés passagères.
Nous soulignons les enjeux du préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Bpifrance occupe aujourd’hui 90 % de ce marché qui a été déserté par les banques commerciales. La BPI s’est montrée particulièrement efficace dans le traitement des dossiers. Il faut saluer son action car le préfinancement du CICE est vital pour beaucoup de petites entreprises. Des difficultés sont toutefois survenues et à la suite des défaillances de certaines des entreprises bénéficiaires, le taux de sinistralité a fortement augmenté. Bpifrance s’est, en conséquence, montrée plus prudente, ce qui a eu tendance à ralentir le traitement des dossiers. Le décalage observé a alarmé plusieurs acteurs de terrain, par exemple en Basse-Normandie, qui ont alerté notre mission d’information commune. Le 15 septembre dernier, le ministre de l’économie nous a confirmé que l’administration avait fait le nécessaire. La direction générale des finances publiques a ainsi simplifié le dispositif en supprimant l’obligation de dépôt des comptes, et la profession des liquidateurs a été sensibilisée à la nécessité d’accomplir les démarches nécessaires pour que le CICE soit versé directement à Bpifrance. Par ailleurs, le préfinancement du CICE des PME a été adossé au fonds de garantie du financement des créances professionnelles afin de simplifier le traitement des sinistres et de les couvrir à hauteur de 70 %. Ces mécanismes correctifs ont permis de revenir aux conditions de préfinancement du CICE qui prévalaient jusqu’à la fin de l’année 2014.
En ce qui concerne la branche investissement, la BPI opère essentiellement de deux manières : soit elle procède à des investissements directs dans des PME ou dans des ETI et des grandes entreprises, soit elle a recours à des fonds de fonds qui permettent d’alimenter des fonds privés de capital-développement, capital d’amorçage, capital-risque ou encore de capital-retournement.
Nous constatons la faiblesse des moyens humains dont dispose la BPI dans le domaine de l’investissement en fonds propres : moins de trois cents personnes travaillent pour l’ensemble de la branche participations, pour un avoir global de plus de 22 milliards d’euros. Pour l’équipe fonds de fonds, seulement dix-huit personnes assurent le suivi de près de trois cents fonds partenaires qui investissent eux-mêmes dans plus de trois mille entreprises pour un stock d’environ 1,7 milliard d’euros. Le suivi réel des investissements publics et la définition des priorités stratégiques s’en ressentent malgré la grande qualité des personnels. Il nous semble qu’un effort supplémentaire pourrait être mis en œuvre pour renforcer la branche investissement de la BPI. Cet effort pourrait en outre passer par le recrutement de personnes spécialisées dans le développement industriel alors que les profils financiers ont jusqu’à maintenant été privilégiés.
Force est de constater que, si l’on met à part les participations détenues dans les grandes entreprises, la majeure partie des investissements en fonds propres de la BPI s’opère via des fonds de fonds, c’est-à-dire de manière indirecte. Ce type d’intervention démultiplie les possibilités d’intervention de la BPI et renforce en même temps le secteur du capital-investissement en France, mais il réduit la capacité, la sélectivité et le ciblage des interventions de la banque publique. Nous invitons à procéder à un rééquilibrage en faveur de l’investissement direct, bien que les deux modes d’intervention ne poursuivent pas tout à fait les mêmes objectifs. Cela permettrait notamment de mieux répondre aux besoins d’entreprises qui s’inscrivent dans le cadre des politiques de filières décidées par l’État, et qui ne trouvent parfois pas à Bpifrance une oreille attentive à leurs problèmes spécifiques.
Enfin, la question cruciale des entreprises en difficulté ne nous semble toujours pas avoir trouvé de réponse satisfaisante. C’est pourquoi nous proposons la création d’une capacité publique, ou semi-publique, de retournement. Aujourd’hui Bpifrance n’intervient qu’indirectement en retournement, via des fonds privés qu’elle finance, pour une force de frappe qui demeure loin des nécessités du marché. M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, a souligné, devant notre mission d’information commune, que cette capacité de retournement faisait défaut en France, ce qui aggrave la désindustrialisation. Dès lors, deux options se présentent : créer une capacité de retournement spécialisée au sein de Bpifrance, dont les activités seraient cloisonnées et garanties par l’État, ou mettre en place des fonds régionaux de retournement, en lien avec les régions et des acteurs privés, dans lesquels la banque investirait de manière importante. Ce débat mérite d’être mis en avant et nous pouvons espérer que des solutions concrètes se dessinent rapidement.
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information commune. Après que le rapporteur a évoqué le cadre d’action de Bpifrance et ses outils, j’en viens à la question de son insertion dans le paysage économique national.
Il n’est pas toujours aisé de comprendre les mécanismes de décision et de gouvernance de la Bpifrance, qui diffèrent d’ailleurs suivant le type d’intervention. La complexité ne résulte pas seulement d’une organisation duale, autour des deux activités juridiquement distinctes de financement et d’investissement, elle se retrouve également dans la conduite des missions de l’institution car, si la BPI agit la plupart du temps en tant que structure autonome et indépendante, elle peut également agir en tant qu’opérateur de l’État, notamment dans le cadre de la gestion du programme d’investissements d’avenir (PIA). L’impulsion donnée par les deux actionnaires principaux que sont l’État et la Caisse des dépôts est ainsi variable d’un domaine à l’autre. La question de l’actionnariat à 50/50 de la BPI peut aussi être posée : lorsque deux capitaines dirigent un même navire, malgré leur étroite coordination, des divergences peuvent survenir et il est plus difficile de définir un cap.
Par ailleurs, la BPI doit coordonner son action avec d’autres acteurs comme la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, les commissaires au redressement productif, la Caisse des dépôts ou encore l’Agence des participations de l’État ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Ces interactions multiples mériteraient d’être clarifiées.
Enfin, il est clair que des partenariats dynamiques ont été mis en place avec la plupart des régions pour la constitution de fonds permettant des interventions communes avec Bpifrance. Pour autant, l’association des régions à la gouvernance nationale de Bpifrance demeure trop limitée, et leur implication dans la gouvernance reste variable d’une région à une autre. Les comités régionaux d’orientation (CRO) ne sont pas réunis selon les mêmes agendas. Les présidents de conseils régionaux doivent être des « forces motrices » encore plus qu’ils ne le sont aujourd’hui : ils doivent réunir plus souvent les CRO et veiller à ce que leurs membres soient régulièrement informés par Bpifrance.
Le déplacement de notre mission d’information commune à Caen, en Basse-Normandie, a été riche d’enseignement. Les entrepreneurs que nous avons rencontrés étaient motivés et enthousiastes concernant le déploiement de Bpifrance.
En conclusion, la valeur ajoutée de la BPI dans le paysage économique est réelle et positive. Toutefois, l’approche financière qui lui permet de garantir son sérieux et sa pérennité pourrait être complétée par une approche plus industrielle et sociale. C’est aussi cela que les citoyens sont en droit d’attendre d’une banque publique financée très majoritairement par de l’argent public. L’investisseur avisé doit aussi être un investisseur assumé pour jouer pleinement son rôle en appui de la politique économique et industrielle de la nation.
M. Guillaume Bachelay. Ce rapport d’information montre que Bpifrance remplit aujourd’hui sa mission. Cette jeune institution est devenue en très peu de temps un acteur reconnu de la vie économique nationale et territoriale grâce à la qualité de ses équipes et au rôle essentiel qui est le sien en matière de stratégie d’investissement. La présidente de la mission d’information vient de le dire : « La valeur ajoutée de la BPI dans le paysage économique est réelle et positive. »
Le nombre d’entreprises que Bpifrance a pu soutenir dans le cadre de sa doctrine mérite d’être souligné. Tournée vers les PME, les ETI et les TPE, Bpifrance les a soutenues pour innover, grandir, exporter et embaucher. L’année dernière, le rapporteur a rappelé que 82 000 entreprises, totalisant 1,3 million d’emplois, ont reçu une aide de la part de la BPI. J’ajoute que la mission d’information de notre assemblée sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, que présidait Olivier Carré, et dont le rapporteur était Yves Blein, a montré le rôle de Bpifrance dans le préfinancement du CICE dès 2013-2014.
L’ensemble de ces éléments font de Bpifrance un acteur incontournable et irremplaçable. Le rapport d’information montre cependant que des améliorations sont possibles sur plusieurs points.
La mission fait des préconisations utiles concernant l’assouplissement des règles de cofinancement. Il faut également accroître la coordination sur le territoire entre les acteurs publics du soutien à l’innovation. Ce soutien ne relève pas uniquement de Bpifrance, qui peut toutefois jouer un rôle d’animation, même s’il s’agit de l’une des vocations des comités régionaux d’orientation. Il est enfin nécessaire d’améliorer encore la coopération entre Bpifrance, la Caisse des dépôts et consignations, et l’Agence des participations de l’État. Nous avons désormais la chance de disposer d’un « pack » de la puissance publique pour l’investissement ; il faut soutenir le « maul » – vous me permettrez d’utiliser ce vocabulaire en période de coupe du monde de rugby – et accroître la réactivité dans l’examen des dossiers car les entrepreneurs ont besoin de réponses rapides.
Lors des débats parlementaires qui ont présidé à la création de Bpifrance, nous avions insisté sur la prise en compte des enjeux européens pour le soutien à l’innovation, je pense en particulier à la mise en place de fonds européens de capital-risque qui agiraient conjointement avec la Banque européenne d’investissement. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les jeunes entreprises innovantes et pour leur localisation en Europe. Après une phase d’amorçage, elles sont bien souvent la cible de multinationales extra-européennes dont nous constatons parfois la voracité. Quelles sont les préconisations de la mission d’information commune sur ce sujet ?
M. Éric Alauzet. Il semble que des marges de manœuvre existent encore pour que Bpifrance agisse davantage sur le territoire en faveur des PME et TPE. Il est sans doute plus facile pour une banque de se tourner vers les grands projets qui permettent de faire du chiffre. Il faudra voir comment se mettront en place sur les territoires les plateformes évoquées dans le rapport : elles permettraient de davantage irriguer les petites entreprises pour des prêts de 10 000 à 20 000 euros. Oserais-je dire qu’une certaine paresse pourrait ne pas avoir incité la BPI à aller vers les petits projets ? La BPI est un « monument » qui publie de très belles plaquettes ; les petits projets ne sont peut-être pas assez valorisants pour elle. Il faut qu’elle ait envie de « faire bouillonner » le territoire.
En matière de préfinancement du CICE, un certain volontarisme ferait défaut. J’ai aussi entendu parler de prêts accordés dans ce cadre à des taux d’intérêt relativement élevés. Ces sujets ont-ils été abordés dans le cadre de vos travaux ?
Lors de la création de Bpifrance, nous imaginions une sorte de pré-banque du développement durable et de la transition énergétique. Les résultats ne sont pas aujourd’hui tout à fait à la hauteur. Que préconisez-vous dans ce domaine ?
Si les bilans de la BPI sont bons, ils peuvent aussi laisser penser que cette dernière ne prend finalement pas beaucoup de risques. Peut-être pourrait-elle aller davantage vers les entreprises qui ont besoin que l’on prenne un peu plus de risques pour elles ? Nous parlons de retournement et d’entreprises en mutation qui s’inscrivent dans le XXIe siècle.
Mme Monique Rabin. Les directions régionales de Bpifrance ne fonctionnent pas nécessairement toutes de la même manière. Existe-t-il bien une volonté exprimée au niveau national pour soutenir les TPE, notamment celles qui innovent ? Éric Alauzet vient de le dire : les TPE ont souvent le sentiment que la BPI n’est pas faite pour elles. Des responsables de chambres de métiers m’ont récemment confié qu’ils avaient du mal à obtenir un simple rendez-vous.
Monsieur le rapporteur, j’apprécie beaucoup que, dans votre rapport écrit, vous invitiez Bpifrance à « davantage de sobriété dans sa communication ». Sur les territoires, l’on se demande souvent si l’argent investi pour produire de volumineux documents de communication ne serait pas mieux utilisé s’il finançait les TPE.
Les auditions que vous avez menées vous permettent-elles de disposer d’informations sur le développement international ? Vous reprenez les constats issus des travaux menés par Patrice Prat et Jean-Christophe Fromantin, dans le cadre du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale, sur le soutien public aux exportations, mais il y a eu la volonté de donner un véritable élan par la collaboration entre Business France et Bpifrance. Je suis cependant dubitative quand je constate la persistance de doublons pour certaines missions à l’étranger. Un rapport d’information ultérieur pourrait traiter de ces sujets.
M. Michel Vergnier. Le rapport d’information demande à juste titre que les comités régionaux d’orientation se réunissent plus souvent. Cela me semble indispensable, surtout dans le contexte d’une nouvelle organisation territoriale de notre pays. Je pense même qu’il faudra organiser des relais dans le cadre des anciennes structures car je crains que la réactivité des CRO ne s’amoindrisse s’ils sont uniquement situés dans la capitale régionale de très grande région.
M. Lionel Tardy. L’annexe 1 du rapport est consacrée à la dotation et à la consommation des fonds directs gérés par Bpifrance. Même si certains fonds ont été lancés assez récemment, l’écart entre leur taille et les montants investis m’étonne. La taille du fonds Écotechnologies, lancé en juin 2012, soit 150 millions d’euros, est à comparer aux 31,7 millions investis au 31 décembre 2014. Dans les faits, 80 millions d’euros sont encore disponibles. Est-ce dû au faible nombre de dossiers présentés ou à une trop grande sélectivité, à moins que l’on ne se tourne jamais vers les petits dossiers ? Le fonds Biothérapies innovantes et maladies rares est doté de 50 millions d’euros : 4,7 millions seulement ont été investis, et environ 38 millions d’euros restent disponibles. Quant aux montants encore disponibles du fonds Ambition numérique créé en décembre 2011, ils dépassent les 100 millions. Comment expliquez-vous la faible utilisation de ces fonds alors que nous savons que les entreprises et les projets ont besoin d’être soutenus ?
M. Pascal Terrasse. En raison des règles prudentielles et notamment de l’application des accords de Bâle III, les établissements financiers restent très en retrait sur de nombreux projets. Cette grande prudence suscite toujours des interrogations de la part des entreprises et au sein des chambres consulaires. En créant Bpifrance, le législateur visait précisément à ce que cette institution se substitue en partie aux organismes financiers traditionnels. J’ai pourtant le sentiment qu’elle se conforme aujourd’hui à des règles identiques. On ne saurait vraiment l’en blâmer, les règles prudentielles sont une réalité. Mais à quoi aura servi la création d’une banque publique d’investissement si elle fait la même chose qu’un organisme classique ?
Le refus de Bpifrance de s’engager auprès de certaines entreprises qui l’ont sollicitée peut comporter un risque pour ces dernières en termes de solvabilité et de crédibilité. Il est d’ailleurs judicieusement proposé dans le rapport d’information de « veiller à ce que Bpifrance ne joue pas le rôle d’une agence de notation ».
Aujourd’hui, s’il y a un conseil à donner aux porteurs de petits projets, ce n’est ni d’aller voir leur banque ou ni de solliciter la BPI, c’est de faire de faire appel au crowdfunding. Comment est-il donc possible de mieux accompagner les petits projets ?
Certaines entreprises de l’économie collaborative ont pu se développer grâce à des aides. Pour que leur activité dépasse les frontières du territoire national, elles ont cependant besoin de faire appel à des ressources très importantes qu’elles ne peuvent trouver en France. Elles sont alors dans l’obligation d’aller dans la Silicon Valley pour lever 5 ou 6 millions d’euros. C’est dommage ! Si nous ne prenons pas en compte les grandes plateformes de l’économie numérique qui se développent aujourd’hui, nous risquons de passer à côté de la troisième révolution industrielle qui va transformer la nature de notre économie. La France a bien Meetic ou Blablacar, mais cela ne sera pas suffisant. Les plus grandes entreprises aujourd’hui ne passent plus par un financement national et cela pose un véritable problème.
M. Jean-Louis Gagnaire. L’activité de la BPI est très hétérogène selon les territoires mais je peux témoigner que le CRO fonctionne en région Rhône-Alpes. Il appartient aussi aux élus et aux conseils régionaux de se montrer exigeants et de mobiliser les partenaires sociaux afin que Bpifrance soit au rendez-vous d’un certain nombre de financements. Dans ma région, les organisations salariales se sont manifestées fortement. Un peu comme cela se pratique déjà en Allemagne, il me paraît très sain que les représentants des salariés et les représentants patronaux puissent parler à la banque et à la BPI.
Dans ma région comme au niveau national, la BPI est sous-dotée, notamment pour ce qui concerne l’innovation. Chaque année, il lui manque une cinquantaine de millions d’euros et les choses ne vont pas en s’améliorant. Nous mettons en péril l’innovation et la reconquête industrielle dans notre pays pour 50 millions d’euros ! Nous devons régler ce problème lors de l’examen du budget. Si nous n’agissons pas, sur le terrain, le financement de ces projets cesse en septembre faute de crédits budgétaires !
Le ministre de l’économie a évoqué le financement du retournement. Pour se conformer aux règles édictées par Bruxelles, j’ai cru comprendre que Bpifrance ne serait jamais en première ligne, et que l’on s’abriterait derrière des organismes privés. Le sujet est très complexe et nécessite que l’on définisse les termes utilisés. Les PME et les ETI ont certainement de réels besoins en termes de retournement. Sachant qu’il faut faire intervenir des opérateurs privés, comment agir et dans quels délais ?
Mme Véronique Louwagie, présidente de la mission d’information commune. Monsieur Terrasse, vous évoquiez la timidité des organismes financiers dans le soutien à un certain nombre de petits projets portés par les TPE et PME. Bpifrance doit être un organisme différent des autres et combler les failles de marché en intervenant là où les acteurs privés ne sont pas présents.
Les TPE et les PME n’ont pas été les premières « cibles » de Bpifrance, mais il nous a semblé, au cours des auditions, que cette dernière avait pris conscience de cette situation. Nous proposons, en tout état de cause, qu’une attention particulière soit accordée par Bpifrance aux PME et aux TPE qui ont de réels besoins de financements à court terme, en particulier des besoins en fonds de roulement pour du fonctionnement. Nous proposons notamment la mise en place d’une plateforme permettant de délivrer des micro-crédits de trésorerie.
Globalement, Bpifrance fonctionne bien partout en France, mais elle fonctionne différemment d’une région à l’autre selon la force des liens créés entre l’antenne régionale et les institutions locales régionales. Il faudra aborder ce sujet en tenant compte des nouvelles grandes régions, sachant que Bpifrance entend maintenir le nombre de ses antennes. De nouvelles politiques économiques régionales devront permettre l’établissement de liens forts afin que tous les acteurs coordonnent leurs actions pour rendre service aux entreprises.
Le préfinancement du CICE a permis à Bpifrance de se faire connaître par les entreprises. Nous avons constaté une certaine réticence ces derniers mois en raison de difficultés de recouvrement en cas de défaillance des entreprises. Bpifrance a évolué cependant sur ce point.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information commune. La BPI n’avait pas pour objectif d’intervenir directement auprès des micro-entreprises et des TPE. En la matière, elle passe par les banques commerciales qui peuvent mobiliser la garantie de Bpifrance directement à hauteur de 200 000 euros. Notre rapport propose cependant d’aller plus loin grâce à un continuum de financement adapté pour les très petites entreprises. Il s’agirait de mettre en place un micro-crédit de trésorerie, des prêts de développement, et des sociétés de caution mutuelle qui permettraient aux entrepreneurs de s’adresser aux banques commerciales en disposant d’une lettre de pré-garantie. Cette « inversion » du système de garantie pourrait constituer une bonne solution pour les TPE et les micro-entreprises.
Il faut créer une capacité publique en matière de retournement mais il faut aussi qu’il y ait plus de partenaires privés qui interviennent. M. Emmanuel Macron a abordé la question ; nous devrons avancer sur ce dossier. Ce qui est certain, c’est que nous manquons de moyens pour exercer ce retournement. Certaines régions, comme la Franche-Comté, ont mis en place des outils pour intervenir en la matière. Sur ce sujet aussi, il y a une faille de marché et il est possible de faire intervenir nos capacités publiques en complément de partenaires privés. Nous attendons les propositions du ministre de l’économie.
Lionel Tardy a évoqué le programme d’investissement d’avenir et l’activité fonds de fonds de la BPI. La situation qu’il constate peut sans doute avoir plusieurs explications : la BPI fait, à coup sûr, parfois preuve d’une trop grande prudence. Elle a fait cependant de nombreux efforts mais j’ai déjà souligné qu’une équipe de moins de vingt personnes gérait près de trois cents fonds. Il faudrait à coup sûr intervenir plus finement pour permettre l’exécution des différents objectifs.
La BPI est très présente dans la Silicon Valley et suit de près les innovations qui apparaissent dans cette zone très dynamique. La BPI innove et accompagne les mutations ; nous ne sommes pas inquiets sur ce sujet.
Concernant les enjeux européens de soutien à l’innovation évoqués par Guillaume Bachelay, je rappelle que Bpifrance a été la première institution européenne à signer un accord avec la BEI. Il est évidemment possible d’aller plus loin et, en particulier, de saisir les opportunités qui se présentent dans le cadre du plan Juncker.
La mission d’information soutient les efforts de la BPI visant à obtenir des institutions européennes la mise en place de fonds européens de capital-risque agissant conjointement avec la BEI. Il s’agirait ainsi d’encourager la mise en place de fonds de fonds de capital-risque multi-pays gérés par les opérateurs nationaux. Pour la France, la taille cible d’un tel fonds de fonds pourrait être de 300 millions d’euros dont une contribution de Bpifrance de 40 millions d’euros.
Nous souhaiterions aussi que le fonds Sociétés de projets industriels (SPI), qui soutient le passage à l’industrialisation de nouvelles technologies et de nouvelles filières, soit abondé plus amplement par la BEI.
Un débat plus large existe concernant la création monétaire et la Banque centrale européenne. Nous proposons de permettre à Bpifrance et à la BEI d’accéder directement au financement de la BCE pour des projets spécifiques d’investissements cohérents avec les priorités économiques décidées au niveau de l’Union européenne.
La BPI est présente dans les institutions européennes. Elle pèse pour que notre pays attire des capacités supplémentaires et que jouent des effets de levier afin que nos entreprises puissent investir.
La Commission autorise, en application de l’article 145 du Règlement, la publication du rapport d’information commune sur la banque publique d’investissement Bpifrance.
*
* *
I. S’ATTAQUER À TOUTES LES FAILLES DE MARCHÉ
Assouplir les régimes de cofinancement et de coinvestissement pour les projets de soutien financier ou d’investissement en fonds propres dans des entreprises dont la poursuite pour le développement de l’activité présente un fort intérêt social, économique, écologique ou industriel.
Assouplir les règles existantes en matière de cofinancement ou permettre le recours à des financements indirects sur le modèle de la KfW allemande.
Créer une capacité de retournement publique – ou semi-publique via des fonds régionaux – dotée de moyens suffisants pour agir dans des dossiers industriels délaissés par les investisseurs spécialisés dans le retournement d’entreprise et bénéficiant d’une garantie renforcée de l’État. Intervenir à ce sujet au niveau européen.
II. AMÉLIORER LE CONTINUUM DE FINANCEMENT POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Déployer un véritable continuum de financement adapté pour les très petites entreprises, en proposant notamment :
– un micro crédit de trésorerie compris entre 5 000 et 15 000 euros, en accès direct via une plateforme en ligne ou via une convention avec les banques commerciales ;
– un prêt de développement de 50 000 euros aux TPE via une plateforme en ligne ;
– la garantie de Bpifrance en combinaison avec les pré-garanties des sociétés de garantie mutuelle pour les montants inférieurs à 200 000 euros.
Généraliser sur l’ensemble du territoire la mise en place de « prêts rebond » avec un niveau de garantie de l’État supérieur pour les entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles et permettant de financer un investissement de compétitivité ou de développement commercial.
Préserver le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
– en s’assurance de l’efficacité des solutions trouvées pour accélérer le traitement des dossiers ;
– en garantissant le préfinancement du CICE des entreprises en procédure amiable.
S’assurer que le coût et les modalités de la commission unique de garantie ne soient finalement pas un frein dans l’accès au financement en veillant à mieux en informer les entreprises. Mettre en place un outil de suivi sur les pratiques bancaires en la matière et sur les éventuels problèmes rencontrés par les entrepreneurs.
Veiller à ce que la politique de risque et de dividendes de Bpifrance permette que ses prêts se fassent au meilleur taux possible pour les entreprises.
Veiller à ce que Bpifrance ne joue pas le rôle d’une agence de notation et que ses refus ne soient pas mal interprétés des autres investisseurs et prêteurs
– en clarifiant les rôles respectifs de Bpifrance et des banques commerciales ;
– en rappelant chaque fois qu’il est possible que Bpifrance ne dispose pas de davantage d’information que les banques sur les demandes de financement, et en particulier qu’elle n’a aucun accès aux informations transmises à l’administration fiscale ;
– en intensifiant la formation destinée aux chargés de clientèle des réseaux bancaires.
III. RENFORCER L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT DE BPIFRANCE
Prévoir un mécanisme d’alerte rapide et un recensement systématique par les services de l’État des cas où l’absence de partenaire privé a conduit Bpifrance à renoncer à une opération de financement ou d’investissement pourtant jugée pertinente. Accroître les recrutements de collaborateurs spécialisés dans le domaine du développement industriel au sein de la branche investissement de Bpifrance. Donner les moyens à Bpifrance de renforcer les équipes de la branche investissement, tant sur la partie fonds de fonds que sur la partie investissement direct, afin de permettre un meilleur suivi et une meilleure sélectivité des investissements en fonds propres. |
IV. JOUER UN RÔLE MOTEUR AUPRÈS DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES POUR FAIRE COMPRENDRE LES BESOINS DE NOS ENTREPRISES
Mener une réflexion conjointe avec les institutions européennes afin de permettre le déploiement d’aides financières directes aux entreprises dans des délais raisonnables et de manière conforme aux exceptions prévues à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Permettre à Bpifrance et à la Banque européenne d’investissement (BEI) d’accéder directement au financement de la Banque centrale européenne (BCE) pour des projets spécifiques d’investissements cohérents avec les priorités économiques décidées au niveau de l’Union européenne.
V. FAIRE DE BPIFRANCE LE « BRAS ARMÉ » DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE L’ÉTAT
Maintenir les crédits du programme 192 au-dessus du niveau plancher de 200 millions d’euros afin de soutenir les dispositifs d’aide individuelle aux PME innovantes.
Accorder une priorité au soutien des entreprises qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan industriel ou d’une filière érigée en priorité de la politique industrielle de l’État lorsqu’elles émettent des demandes de financement ou d’investissement en fonds propres.
Mettre en place un suivi statistique plus précis sur les financements octroyés aux entreprises industrielles par Bpifrance, en exigeant notamment des équipes de gestion des fonds de fonds des informations spécifiques à ce titre.
Favoriser la coopération entre les services déconcentrés de l’État et Bpifrance en matière d’investissement et de soutien aux entreprises en difficulté afin de renforcer la cohésion de la politique industrielle dans les territoires.
Veiller à une meilleure articulation des priorités stratégiques de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations en matière de transition énergétique et instaurer une étroite coordination entre l’Ademe, Bpifrance et le comité stratégique de la filière éco-industries.
Définir des priorités stratégiques pour le développement de l’économie sociale et solidaire en veillant à une clarification des rôles respectifs de l’État, des conseils régionaux, de Bpifrance et de la Caisse des dépôts et consignations.
VI. POURSUIVRE L’INTÉGRATION DE BPIFRANCE DANS LE PAYSAGE NATIONAL
Inviter les présidents de région à jouer leur rôle de « force motrice » :
– en réunissant plus régulièrement qu’aujourd’hui les comités d’orientation régionaux (CRO) qui doivent être le lieu de définition d’une stratégie régionale ;
– en veillant à l’information régulière des CRO par Bpifrance.
Renforcer la présence de Bpifrance outre-mer pour favoriser le déploiement de la gamme de produits et l’information de l’ensemble des acteurs locaux.
Poursuivre le développement de la mission d’accompagnement de Bpifrance
– en établissant des partenariats clairs avec les acteurs consulaires, associatifs ou régionaux ;
– en informant davantage les chefs d’entreprise dans les supports de communication sur l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier ;
– en se dotant d’indicateurs sur l’évolution des besoins d’accompagnement des chefs d’entreprise.
Normaliser le contenu des principaux documents d’information produits par Bpifrance et veiller à ce que la communication de Bpifrance soit déployée auprès de toutes les entreprises, y compris auprès des plus petites.
ANNEXE 1 : DOTATION ET CONSOMMATION DES FONDS DIRECTS GÉRÉS PAR BPIFRANCE
Fonds Large Venture | |
Segment du fonds |
Capital Risque intensif |
Descriptif du fonds |
Le fonds Large Venture investit dans des sociétés fortement innovantes, principalement dans les domaines des sciences de la vie, des écotechnologies et du numérique, avec des besoins de financement élevés. Large Venture peut investir dans des sociétés cotées et non cotées, aux côtés de co-investisseurs privés professionnels et avec des tickets moyens supérieurs à 10 millions d’euros. Avec cette capacité d’intervention, Large Venture contribue à assurer le continuum de financement sur les sociétés en hyper croissance |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Fonds direct. Présence dans la gouvernance des entreprises |
Année de lancement |
juillet 2013 |
Taille du fonds |
600 millions d’euros y compris la reprise de 9 investissements réalisés par le FSI entre 2009 et mi-2013 |
Montant investi au 31/12/14: |
250 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
c. 200 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
23 dont 15 sociétés cotées |
Ticket Moyen |
11 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Innobio | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque - Développement/Transmission |
Capital Amorçage et Risque |
Descriptif du fonds |
L'objectif principal du fonds est d'investir directement en fonds propres et quasi-fonds propres en titres de capital ou donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés fournissant des produits et services technologiques innovant dans le domaine de la santé. Le Fonds vise la constitution d’un portefeuille de 15 à 20 investissements dans des entreprises, avec des investissements compris entre EUR 3 millions et EUR 10 millions au total par entreprise. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Bpifrance est gestionnaire du fonds et à ce titre prend les décisions d’investissement. Le comité consultatif est composé de représentants des souscripteurs du Fonds (9 laboratoires pharmaceutiques). |
Année de lancement |
Novembre 2009 |
Taille du fonds |
173 millions d’euros : |
Montant investi au 31/12/14 |
95 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de |
20 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
17 |
Ticket Moyen |
5,6 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Ecotechnologies | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Risque |
Descriptif du fonds |
Fonds dédié au financement des PME écotechnologiques en phase de « capital risque » et « capital développement ». Le Fonds vise la constitution d’un portefeuille de 15 à 20 investissements dans des entreprises, avec des investissements compris entre 2 millions d’euros et 10 millions d’euros au total par entreprise. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Bpifrance est gestionnaire du fonds et à ce titre prend les décisions d’investissement. L’État est consulté sur les projets d’investissement dans le cadre d’un comité consultatif composé de représentants de l’État et de la Caisse des Dépôts. |
Année de lancement |
Juin 2012 |
Taille du fonds |
150 millions d’euros (dans le cadre du PIA) |
Montant investi au 31/12/14 |
31,7 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Environ 80 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
7 au 31/12/14 (8 au 30/04/15) |
Ticket moyen |
4,5 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Biothérapies Innovantes et Maladies Rares | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement /Transmission |
Amorçage |
Descriptif du fonds |
Le Fonds vise prioritairement des entreprises exerçant leurs activités dans le domaine des thérapies innovantes ciblant les maladies rares, incluant les nouvelles approches thérapeutiques, dont certaines arrivent à un stade de maturité compatible avec le développement industriel : thérapie génique, thérapie cellulaire, modulation pharmacologique de l’expression de gènes, anticorps monoclonaux, protéines thérapeutiques et immunothérapies. Le Fonds peut accessoirement investir dans des entreprises apportant des innovations pour le diagnostic, les biomarqueurs et les dispositifs médicaux, toujours dans le domaine des maladies rares. Le Fonds vise la constitution d’un portefeuille de 7 à 9 investissements dans des entreprises, avec des investissements compris entre 1 et 5 millions d’euros au total par entreprise. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Bpifrance est gestionnaire du fonds et à ce titre prend les décisions d’investissement. L’État est consulté sur les projets d’investissement dans le cadre d’un comité consultatif composé de représentants de l’État et de l’AFM Téléthon. |
Année de lancement |
Mai 2013 |
Taille du fonds |
50 millions d’euros (30 millions d’euros AFM – 20 millions d’euros FNA/dans le cadre du PIA) |
Montant investi au 31/12/14 |
4,7 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Environ 38 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
2 |
Ticket moyen |
2,3 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
France Investissement Régions | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Financer les projets de développement (croissance interne et externe) et de transmission (cession, réorganisation du capital). PME et petite ETI : – dont le CA est supérieur à 2 ou 3 millions d’euros (selon les fonds), – créées depuis 2 ou 3 ans (selon les fonds), ou en création dans le secteur du tourisme et des loisirs, – non cotées, – en croissance – ayant un projet de développement identifié. Dans tous les secteurs d’activité : industries, commerces, services et tourisme … à l’exception de l’immobilier, des établissements bancaires et des compagnies d’assurance |
Descriptif du fonds |
Intervention en fonds propres (actions) ou quasi-fonds propres (obligations convertibles ou obligations à bons de souscription d’actions adaptée aux projets de développement de la société : Ø Prise de participation minoritaire sur des opérations de capital-développement et de capital-transmission. Ø Recherche systématique de co-investissement. Via trois solutions de produits sur des tickets compris entre 250 000 euros et 4 millions d’euros, selon les fonds gérés : • En actions : dédié au financement en fonds propres des PME ou petites ETI en phase de croissance interne ou externe, ou ayant des projets de transmission. Ticket d’investissement compris entre 0,5 et 4 millions d’euros. • En mezzanine de capital développement / obligations convertibles en actions : dédié au financement en quasi fonds propres des PME ou petites ETI en phase de croissance interne ou externe, ou ayant des projets de transmission. Ticket d’investissement compris entre 0,25 et 4 millions d’euros. Possibilité d’introduire une tranche non convertible dans la limite de 50 %. • En obligations convertibles à bons de souscription d’actions : dédié au financement des PME en phase de rebond (après restructuration) ou PMI à fort BFR. Intervention en quasi fonds propres (obligations associées à des bons de souscription d’actions). Ticket maximum de 4 M€. Investisseur patient, France Investissement Régions soutient les PME avec une perspective de durée en moyenne de 5 à 7 ans. |
Modalité de gouvernance et de suivi : |
Processus de décision d’investissement décentralisé – 90 % des décisions sont prises en régions. |
Année de lancement : |
30 ans d’expérience, France Investissement Régions a été créé à partir de FSI Régions, lui-même créé à partir d’Avenir Entreprises. |
Taille du fonds : |
|
Montant investi au 31/12/14: |
385 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
|
Nombre d’entreprises investies au 31/12/14 |
353 entreprises |
Ticket moyen : Fonds actions Fonds « petits tickets mezzanine » |
1,5 millions d’euros 351 000 euros |
Fonds Ambition Numérique | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Risque et Développement |
Descriptif du fonds |
Le Fonds FSN PME – Ambition Numérique s’inscrit dans le cadre du Programme d’investissements d'avenir (PIA) lancé par l'État. Le fonds investit en fonds propres ou quasi- fonds propres dans des entreprises du domaine numérique, obligatoirement aux côtés de co- investisseurs privés. Il cible des entreprises à fort potentiel de croissance, développant des technologies innovantes ou déployant des produits/services nouveaux ou des « business models » innovants. Le fonds effectue des investissements initiaux compris entre 1 million d'euros et 10 millions d'euros. Il intervient en co-investissement pari passu aux côtés d'autres investisseurs privés, en ayant pour objectif de ne pas dépasser, en général, un tiers du montant total du tour de table auquel il participe. Il intervient dans des sociétés non cotées ayant dépassé le stade de l’amorçage, générant des revenus, et éligibles à un investissement en capital-risque ou capital développement. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Bpifrance est gestionnaire du fonds et à ce titre prend les décisions d’investissement. L’État est consulté sur les projets d’investissement dans le cadre d’un comité consultatif composé de représentants de l’État et de la Caisse des Dépôts. |
Année de lancement |
Décembre 2011 |
Taille du fonds |
300 millions d’euros (200 millions d’euros souscrit à ce jour) |
Montant investi au 31/12/14 |
62 millions d’euros (82 millions d’euros au 30/04/15) |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Environ 100 millions d’euros au 30/04/15 (sur base de 200 millions d’euros souscrit) |
Nombre d’entreprises investies |
20 au 31/12/2014 (22 au 30/04/2015) |
Ticket Moyen |
2,5 millions d’euros en montant initial |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds France Investissement Croissance (FIC) | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Fonds de développement et de transmission (c. 50/50 des montants déployés) |
Descriptif du fonds |
5 fonds sous gestion : FIC 1 (millésime 2007) : fonds equity focalisé sur tous les segments de marché (yc amorçage et retournement) ; Fonds FIC2 (millésime 2010) : fonds equity focalisé sur développement et transmission ; Fonds FIC3 (anciennement OC+A, millésime 2009) : fonds obligataire sur tous les segments de marché ; Fonds FIC4 (millésime 2014) : fonds obligataire focalisé sur développement et transmission ; Fonds FIC5 (millésime 2015) : fonds equity focalisé sur développement et transmission. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Comité d’investissement du fonds composé de 4 membres internes à Bpifrance dont le DG. Représentation systématique de Bpifrance au Conseil d’administration des entreprises investies |
Année de lancement |
Depuis 2007 |
Taille du fonds |
FIC1 : 180 millions d’euros FIC2 : 180 millions d’euros FIC3 : 160 millions d’euros FIC4 : 150 millions d’euros FIC5 : 195 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
FIC1 : 100%, fonds clos |
Montant disponible pour investissement dans de |
FIC4 : c. 100 millions d’euros FIC5 : c. 150 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
67 entreprises actuellement en portefeuille |
Ticket Moyen |
c. 6 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds ETI 2020 | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Capital développement et capital transmission |
Descriptif du fonds |
Le fonds ETI 2020 investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres essentiellement dans des Entreprises de Taille Intermédiaire porteuses de compétitivité et de croissance, en vue, notamment, de leur permettre d’accélérer leur développement et d’en faire des futurs acteurs de référence de leur secteur ou de leur filière. Il prend des participations minoritaires, dans des conditions financières et juridiques correspondant aux conditions de marché et de façon prioritaire avec des co-investisseurs en vue de créer un effet d’entraînement de l’investissement privé par l’investissement public. Il investit dans des sociétés dont le siège social est situé en France ou dont une part significative de l’activité est exercée en France. Il investit des montants à partir de 10 millions d’euros. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Le fonds est représenté dans la gouvernance des sociétés dans lesquelles il investit le plus souvent par (i) un administrateur externe à l’équipe d’investissement choisi au regard des problématiques de l’entreprise qui ont justifié l’investissement du fonds et par (ii) un membre de l’équipe d’investissement en charge du suivi de la participation. Les décisions d’investissement du fonds sont prises pour des investissements inférieurs à 25 millions d’euros par un comité interne à Bpifrance dont fait partie le directeur général. Pour des montants supérieurs à 25 millions d’euros, le comité décisionnaire intègre des membres de la gouvernance de Bpifrance dont des représentants des 2 actionnaires et des membres indépendants. |
Année de lancement |
2014 |
Taille du fonds |
3 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
331 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
2 669 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
10 |
Ticket moyen |
33 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds d’Avenir Automobile (ex- FMEA Rang 1) | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Développement et transmission |
Descriptif du fonds |
Le Fonds a pour objet de contribuer au développement de la filière automobile, afin de faire émerger des équipementiers plus grands, moins sensibles aux retournements des marchés, plus rentables et capables de nouer des partenariats durables avec les constructeurs, et de leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés. Il pourra intervenir dans une entreprise seul ou préférentiellement en co-investissement avec d’autres investisseurs. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Avis du Comité Stratégique composé des souscripteurs (Bpifrance, Renault, PSA), décision du Comité d’Investissement de la Société de Gestion |
Année de lancement : |
2009 |
Taille du fonds : |
600 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
330 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Estimé à environ 155 millions d’euros (nouvelles entreprises et réinvestissements) |
Nombre d’entreprises investies |
19 |
Ticket moyen |
De 5 à 60 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
FMEA Rang 2 (futur Fonds d’Avenir Automobile Rang 2) | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Développement et transmission |
Descriptif du fonds |
Le Fonds interviendra dans des équipementiers de Rang 2 et supérieur jugées stratégiques pour la filière automobile, dans le cadre de participations minoritaires en fonds propres ou quasi fonds propres. Les investissements du Fonds seront réalisés dans des conditions de marché, de préférence avec des co-investisseurs. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
Avis du Comité de Sélection et du Comité d’Investissement composés des souscripteurs (Fonds d’avenir automobile, Valeo, Bosch, Plastic Omnium, Faurecia, Hutchinson), décision du Comité d’Investissement de la Société de Gestion |
Année de lancement |
2009 |
Taille du fonds |
50 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
23 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Estimé à environ 15 millions d’euros (nouvelles entreprises et réinvestissements) |
Nombre d’entreprises investies |
11 |
Ticket moyen |
De 1 à 5 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Croissance Rail | |
Segment du fonds : Développement/Transmission |
Le fonds a pour objectif de financer les projets de développement (croissance interne, externe) et de transmission (cession, réorganisation du capital) d’entreprises de la filière ferroviaire française avec la prise de participations, directes ou indirectes, au capital de PME et de petites ETI créées depuis au moins 3 ans et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2m€. |
Descriptif du fonds |
Croissance Rail contribue à la consolidation et au renforcement de la compétitivité de la filière ferroviaire française en sélectionnant des entreprises : • Capables de fédérer et consolider des ensembles plus performants dans les filières de l’équipement ferroviaire, • À forte capacité innovante et en croissance, avec des activités industrielles et de R&D significatives, • Ayant des besoins en fonds propres pour financer leur développement, • à l’exclusion des entreprises en difficulté structurelle. Le fonds privilégie les co-investissements et intervient avec des prises de participations minoritaires, en fonds propres (actions) ou quasi-fonds propres (obligations convertibles), comprises entre 1m€ et 4m€. Le fonds a été doté de 40 millions d’euros par 5 souscripteurs : Alstom, Bpifrance, SNCF, Bombardier, RATP. |
Année de lancement |
Le fonds a été lancé en juillet 2013, avec une durée de vie de 8 ans et une période d’investissements de 4 ans. |
Modalité de décision |
Chaque projet d’investissement est présenté aux souscripteurs du fonds qui émettent un avis consultatif. La décision d’investissement est prise lors d’un comité d’investissement interne à Bpifrance. Bpifrance Investissement assure le suivi des participations en tant que société de gestion. |
Montant investi au 31/12/14 |
0 euro |
Nombre d’entreprises en portefeuille au 31/12/14 |
0 entreprise |
Montant investi au 30/04/15 |
4 millions d’euros |
Nombre d’entreprises en portefeuille au 30/04/15 |
1 entreprise |
Ticket moyen |
n.a. |
Fonds de Développement des Entreprises Nucléaires (FDEN) | |
Segment du fonds : Développement/Transmission |
Fonds d’investissement sectoriel qui a pour objectif de financer les projets de développement (croissance interne, externe, innovation et R&D) et de transmission (cession, réorganisation du capital) d’entreprises de la filière nucléaire française avec la prise de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises rentables. Les entreprises prioritaires seront des fournisseurs de biens et de services qui ont un savoir-faire et contribuent à la création de valeur de la filière nucléaire française, qui ont des projets de croissance dans le domaine du nucléaire, souhaitent accélérer leur développement, innover ou renforcer leur présence à l’international. Ces entreprises doivent présenter les caractéristiques suivantes : • Savoir-faire industriel ou de services important dans le secteur du nucléaire, • Un résultat d’exploitation au moins une fois positif au cours des 3 derniers exercices, • Un flux de trésorerie libre (free cash-flow) en provenance des opérations au moins une fois positif au cours des 3 derniers exercices. |
Descriptif du fonds |
Le FDEN a été doté de 133 millions d’euros par 6 souscripteurs : Alstom, Areva, Bpifrance, EDF, Eiffage, Vinci. Intervention en fonds propres (actions) ou quasi-fonds propres (obligations convertibles, remboursables en actions ou à bons de souscription d’actions) : Ø Prise de participation minoritaire seul ou associé à d’autres investisseurs industriels ou financiers. Ø Investissement compris entre 1 et 13 millions d’euros par investissement. Ø Le fonds n’investira pas plus de 20 % de l’engagement total dans des investissements inférieurs à 4 millions d’euros. |
Année de lancement |
Le fonds a été lancé en janvier 2014, avec une durée de vie de 8 ans et une période d’investissements de 4 ans. |
Modalité de décision d’investissement et de suivi (gouvernance) |
Les décisions relatives aux investissements ainsi qu’au suivi des participations sont prises par la société de gestion du FDEN qui est assistée d’un Comité de Sélection et d’un Comité des Investisseurs. Ces deux comités consultatifs sont composés de représentants des souscripteurs. |
Montant investi au 31/12/14 (stock) |
0 M€ |
Nombre d’entreprises en portefeuille au 31/12/2014 |
Aucune (1er investissement annoncé le 21 mai 2015) |
Fonds Bois | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Développement/Transmission PME avec CA > 5 millions d’euros |
Descriptif du fonds |
L’objectif principal du Fonds est de contribuer au développement des entreprises de la filière bois, et éventuellement à leur regroupement, afin de faire émerger un tissu d’entreprises de taille suffisante pour structurer la filière et répondre à la demande en produits bois. L'objectif du Fonds consiste également dans l'émergence progressive de structures françaises plus robustes et mieux organisées, de regroupement avec d’autres acteurs français ou étrangers. Le Fonds investit en fonds propres ou quasi fonds propres et prend une participation minoritaire. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité de surveillance (dont la présidence) qui se réunit 1 fois par trimestre ; Mise en place d’un reporting mensuel |
Année de lancement |
2009 |
Taille du fonds |
20 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
14,9 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Néant |
Nombre d’entreprises investies |
9 |
Ticket moyen |
1,7 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Bois 2 | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Développement/Transmission PME avec CA > 5 millions d’euros |
Descriptif du fonds |
Le Fonds a pour principal objectif de poursuivre, en l’amplifiant, l’action du Fonds Bois 1. Aux fins d’accélérer le développement de la filière, le Fonds soutient les investissements productifs et les regroupements dans les industries de transformation du bois. Il contribuera au développement d’une offre française de produits bois à même de répondre à la demande des marchés de la construction et de l’aménagement, notamment, en remplacement des produits importés. Le Fonds investit en fonds propres ou quasi fonds propres et prend une participation minoritaire. |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité de surveillance (dont la présidence) qui se réunit 1 fois par trimestre ; Mise en place d’un reporting mensuel |
Année de lancement |
2014 |
Taille du fonds |
25 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
0 € |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* : |
25 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
0 |
Ticket moyen |
NA |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Patrimoine et Création | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Développement/Transmission PME avec CA > 5 millions d’euros |
Descriptif du fonds |
Le Fonds a vocation à intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres dans des petites et moyennes entreprises (PME) françaises « culturelles et patrimoniales » à la fois indépendantes, matures et structurellement rentables, dont l’activité s’exerce notamment dans les secteurs de l’édition littéraire, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, des industries du luxe et des métiers d’art (définies comme les « Entreprises Cibles »). |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité de surveillance (dont la présidence) qui se réunit une fois par semestre ou trimestre ; Mise en place d’un reporting mensuel |
Année de lancement : |
2005 |
Taille du fonds |
40,2 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
31,0 euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* : |
Néant |
Nombre d’entreprises investies |
9 |
Ticket moyen |
3,4 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Patrimoine et Création 2 | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Développement/Transmission PME avec CA > 5 millions d’euros |
Descriptif du fonds |
Le Fonds a vocation à intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres dans des petites et moyennes entreprises (PME) françaises « culturelles et patrimoniales » à la fois indépendantes, matures et structurellement rentables, dont l’activité s’exerce notamment dans les secteurs de l’édition littéraire, de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, des industries du luxe et des métiers d’art (définies comme les « Entreprises Cibles »). |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité de surveillance (dont la présidence) qui se réunit une fois par semestre ou trimestre ; Mise en place d’un reporting mensuel |
Année de lancement |
2010 |
Taille du fonds |
45 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
13,3 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* : |
Néant |
Nombre d’entreprises investies : |
5 |
Ticket Moyen : |
2,7 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Mode et Finance | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/Transmission |
Capital-risque PME avec CA > 500 000 euros |
Descriptif du fonds |
Le fonds a pour objectif de financer des entreprises créatives indépendantes par un investissement en fonds propres de long terme Faire émerger de nouvelles marques créatives essentielles au renouvellement des industries de la mode et du luxe Pallier le manque de capitaux pour les entreprises rentables de ces secteurs Mode et Finance : seul intervenant en fonds propres sur le créneau des jeunes marques créatives du luxe (mode, accessoires, bijouterie…) |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité stratégique (dont la présidence) qui se réunit une fois par semestre ; Mise en place d’un reporting mensuel ou trimestriel y compris tableau de trésorerie |
Année de lancement |
1999 avec une prorogation en 2009 |
Taille du fonds |
12,4 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
5,8 millions d’euros |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
Néant |
Nombre d’entreprises investies |
7 |
Ticket moyen : |
835 000 euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Mode et Finance 2 | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Capital risque PME avec CA > 500 00 euros |
Descriptif du fonds |
Le fonds a pour objectif de financer des entreprises créatives indépendantes par un investissement en fonds propres de long terme. Faire émerger de nouvelles marques créatives essentielles au renouvellement des industries de la mode et du luxe Pallier le manque de capitaux pour les entreprises rentables de ces secteurs Mode et Finance : seul intervenant en fonds propres sur le créneau des jeunes marques créatives du luxe (mode, accessoires, bijouterie…) |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au comité stratégique (dont la présidence) qui se réunit une fois par semestre ; Mise en place d’un reporting mensuel ou trimestriel yc tableau de trésorerie |
Année de lancement |
2014 |
Taille du fonds |
18 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
Néant |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
18 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
0 |
Ticket moyen |
NA |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
Fonds Savoir Faire d’Excellence | |
Segment du fonds : Amorçage – Risque – Développement/ Transmission |
Développement/Transmission PME avec CA > 500 K€ |
Descriptif du fonds |
Le Fonds a pour objet principal d’intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres dans des petites et moyennes entreprises (« PME ») françaises détentrices d’un « savoir-faire d’excellence » à la fois indépendantes, matures et structurellement rentables (les « Entreprises Cibles »). Les secteurs concernés sont les suivants : les segments « Mode et beauté », « Arts de la table », « Décoration », « Loisirs », « Gastronomie », « Patrimoine bâti », « Mobilier » et « Équipement professionnel ». |
Modalité de gouvernance et de suivi |
2 places sur 3 au conseil de surveillance (dont la présidence) qui se réunit 1 fois par trimestre ; Mise en place d’un reporting mensuel |
Année de lancement |
2013 |
Taille du fonds : |
20 millions d’euros |
Montant investi au 31/12/14 |
4,2 M€ |
Montant disponible pour investissement dans de nouvelles entreprises* |
15,8 millions d’euros |
Nombre d’entreprises investies |
3 |
Ticket moyen |
1,4 millions d’euros |
*Une partie non investie peut être mise en réserve pour des réinvestissements dans des participations.
ANNEXE 2 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Auditions du 29 janvier 2015
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement Bpifrance. 183
Auditions du 5 février 2015
M. Pascal Lagarde, directeur exécutif de Bpifrance, chargé de l’international, de la stratégie, des études et du développement. 194
M. Daniel Balmisse, directeur des fonds de fonds de Bpifrance. 201
Mme Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de Bpifrance, chargée des partenariats régionaux et de l’action territoriale. 209
Auditions du 12 février 2015
M. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. 218
M. Fabrice Pesin, médiateur du crédit aux entreprises, et M. Daniel Gabrielli, médiateur national délégué. 230
Auditions du 19 février 2015
Table ronde réunissant MM. Bernard Cohen-Hadad, président de la commission Financement de la CGPME, Jean-Guilhem Darré, délégué général du syndicat des indépendants, Emmanuel Landais, directeur général de l’ADIE, André Marcon, président de CCI France, Alexandre Montay, délégué général de l’ASMEP-ETI et Thibault Lanxade, président du pôle entrepreneuriat et croissance du Medef.. 235
Auditions du 5 mars 2015
M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. 248
M. Bertrand Finet, directeur exécutif Fonds propres PME et M. Jean-Yves Gilet, direction ETI et grandes entreprises, de Bpifrance 256
Auditions du 12 mars 2015
Table ronde sur l’innovation : M. Benjamin Stremsdoerfer, directeur adjoint des investissements d’avenir, M. Jean-Claude Andreini, vice-président du Comité stratégique des filières éco-industries (COSEI), M. Loïc Riviere, délégué général de l’association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL), et M. Paul François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance 267
M. Alain Schmitt, chef du service de la Compétitivité et du développement des PME à la direction générale des entreprises, et M. Sébastien Raspiller, sous-directeur du Financement des entreprises et du Marché financier à la direction générale du Trésor 281
Auditions du jeudi 19 mars 2015
M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement 291
M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations 298
M. Régis Turrini, commissaire à l’Agence des participations de l’État 303
Auditions du jeudi 26 mars 2015
M. Joël Darnaud, direction financement et pilotage du réseau – Bpifrance 308
Table ronde sur l’aide aux entreprises en difficulté réunissant M. Patrick Blasselle, président du directoire d’Invest PME, M. Jean-Louis Grevet, président de Perceva, et Mme Muriel Pernin, fondatrice de la société coopérative d’intérêt collectif Les Atelières 316
Auditions du jeudi 2 avril 2015
Table ronde dédiée au soutien à l’exportation et à l’ouverture à l’international des entreprises réunissant Mme Sandrine Gaudin, cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises, M. Christophe Viprey, directeur des garanties publiques de la COFACE, M. Alain Renck, directeur de BPI Export, M. Jean-Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme, et président du conseil d’administration d’UBIFRANCE, M. Henri Baïssas, directeur général délégué Export de BUSINESS France, M. Jean-Claude Karpelès délégué du président en charge du développement international et des affaires, et Mme Véronique Etienne-Martin, directeur des Affaires publiques et de la Valorisation, de la Chambre de commerce et d’industrie région Paris Île-de-France et Mme Jocelyne de Montaignac, administrateur du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) 328
M. Florian Poirier, responsable du pôle collectivités locales, et de Mme Audrey Duquenne, chargée de mission partenariats de la Fédération des Entreprises publiques locales. 341
Auditions du jeudi 9 avril 2015
Table ronde sur le financement des entreprises artisanales réunissant : M. François Moutot, directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), M. Henry Brin, président du conseil de l’artisanat de la Fédération française du bâtiment (FFB), M. Patrick Gérion, directeur général de la Caisse mutuelle de garantie de la mécanique (CMGM) et de la Centrale de garantie des industries mécaniques, électriques et électroniques (CEMECA), M. Michel Cottet, directeur général de la société de caution mutuelle pour les entreprises d’artisanat et de proximité (SIAGI), M. Jean-Pierre Crouzet, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA) et M. Pierre Burban, secrétaire général. 346
M. Gaspard Koenig, président de Génération libre, M. Sébastien Laye, entrepreneur et Mme Delphine Granier, analyste 353
Auditions du jeudi 16 avril 2015
Table ronde sur les fonds d’investissement : M. Michel Chabanel, président de l’association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), M. Paul Perpère, délégué général de l’AFIC, Mme Françoise Palle-Guillabert délégué général, de l’ASF, association française des sociétés financières et M. Philippe Audouin, Président de la DFCG - Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion 362
M. Augustin Landier, professeur à l’École d’économie de Toulouse et Prix du meilleur jeune économiste 2014 369
Audition du mercredi 13 mai 2015
M. Arnaud Caudoux, directeur exécutif, directeur financier de Bpifrance et directeur en charge des garanties 375
Auditions du jeudi 21 mai 2015
Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et de M. Pierre Michel, délégué général de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), M. Jean Vecchierini De Matra, président du Comité des investissements de la FFSA, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires de la FFSA 387
M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance 395
Dr Lutz-Christian Funke, senior vice-président de KfW Bankengruppe 400
Auditions du jeudi 28 mai 2015
M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 406
Table ronde sur les fonds d’investissement, réunissant M. Pierre Remy, directeur général de Keensight, M. Olivier Guize, président d'Agro Invest, M. Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation, et M. Jean-Marc Patouillaud, gérant associé de Partech International Venture 412
Audition du 4 juin 2015
Table ronde sur la politique de filières, réunissant Mme Odile Kirchner, secrétaire générale du Conseil national de l’industrie (CNI), et des représentants des Comités stratégiques de filière : M. Christian Béchon, président du LFB (CSF santé), M. Bernard Espannet, secrétaire général du Groupement des industries françaises aéronautiques (GIFAS), M. Jean-Michel Isaac-Dognin (CSF aéronautique), et M. Jean-Philippe Girard, vice-président du CSF alimentaire. 419
Audition du 24 juin 2015
Table ronde sur l’outre-mer : M. Dominique Caignart, directeur du réseau Île-de-France de Bpifrance Financement et en charge de l’Outre-mer ; M. Marc Del Grande, sous-directeur des politiques publiques, et M. Gilles Armand, chargé de mission pour les affaires bancaires, monétaires et financières à la direction générale des outre-mer ; les commissaires au redressement productif : Mme Marie-Claude Derné (Martinique), M. Vincent Launay (La Réunion), M. Lionel Loutoby (Guyane) ; M. Jean-Paul Tourvieille, directeur général de l’Association des chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer (ACCIOM) et M. Philippe Mouchard, délégué général de la Fédération des entreprises d’outre-mer (FEDOM). 430
Audition du 7 juillet 2015
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement BPI-Groupe) 442
Audition du 15 septembre 2015
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique 456
Audition du 29 janvier 2015
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement Bpifrance
La mission d’information entend, en audition ouverte à la presse, M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement Bpifrance.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous commençons ce matin les travaux de la mission d’information commune sur la Banque publique d’investissement Bpifrance par l’audition de M. Nicolas Dufourcq, son directeur général, que je remercie de sa présence.
Nous voulons évaluer l’activité de Bpifrance en appréciant la conformité du bilan de son action à ce jour avec les objectifs qui lui ont été fixés dans la loi du 31 décembre 2012. Nous vous entendrons donc, monsieur le directeur général, avec grand intérêt.
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement Bpifrance. Bpifrance exerce ses activités depuis maintenant près de trente mois, dans des conditions qui ont évolué depuis que j’ai été nommé, le 17 octobre 2012, préfigurateur puis, le 7 février 2013, directeur général de ce qui était encore une coquille vide. Cette coquille a été remplie le 12 juillet 2013, mais, dès décembre 2012, j’avais fait comme si la Banque existait déjà, de manière que, dès sa création effective, Bpifrance soit à même de répondre le plus rapidement possible aux besoins des entrepreneurs. La mission de préfiguration a donc été pilotée avec le double impératif de bon sens et de vitesse.
Au Portugal – et je puis vous annoncer que le contentieux de marque qui nous opposait à la banque privée portugaise BPI est heureusement réglé – le projet de banque publique d’investissement en est, depuis trente mois, toujours au stade de la préfiguration.
L’année 2013 a donc été celle du lancement de Bpifrance à marche forcée ; 2014 a été celle de la croissance et, aussi, de la finalisation de l’harmonisation des statuts et de la fusion des entités. En 2015, la croissance se poursuivra selon la trajectoire engagée en 2014. Il en résultera que, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, les en-cours de la Bpi, dans la partie bancaire de ses activités – les crédits de court, de moyen ou de long terme – auront augmenté de moitié. La croissance des activités « fonds propres » a été d’environ 30 % entre 2014 et 2013 ; celle de l’activité « prêts à l’innovation », domaine dans lequel nous recevons de l’État les capitaux que nous redistribuons aux entrepreneurs, de 35 %, et elle sera à nouveau significative en 2015.
Bpifrance est maintenant une entreprise intégrée, très homogène. Elle compte environ 2 200 salariés qui ont le feu sacré. Nous avons significativement recruté en 2014 et la croissance de nos activités justifie que nous continuions de le faire en 2015.
La Banque a six métiers. Le premier, la garantie, est de tous celui dont la croissance est la plus faible. Nous garantissons les crédits des banques privées. Le groupe BPCE, avec 22 % de parts de marché, est notre premier partenaire, puis vient le Crédit agricole mais tous les réseaux sont représentés. Le volume de crédit annuel aux PME qui est garanti s’établit entre 8 et 9 milliards d’euros. Sa croissance, qui reflète celle du marché bancaire français, est faible, mais elle existe, ce qui signifie qu’il n’y a pas réellement d’asséchement du crédit en France : les en-cours augmentent et le nombre de crédits à long et moyen terme également.
Ce métier dépend entièrement de la discussion budgétaire que nous avons chaque année avec l’État sur l’alimentation du fonds de garantie. Nous avons besoin de 100 millions d’euros par an environ pour remplir cette mission, et certaines années sont meilleures que d’autres. Nous avons convaincu la direction du budget de la pertinence d’un mécanisme tel que, au moins pour les trois ans à venir, le dividende de Bpifrance qui revient à l’État soit réinjecté pour partie vers les fonds de garantie. Cela nous donne un horizon clair ce qui n’était pas le cas initialement. Je me rappelle avoir été amené, le 15 octobre 2012, à dire au président de la République que Bpifrance allait certes être créée mais que l’activité « garantie » avait été débudgétisée pour les années 2013 à 2015. Nous avons résolu la difficulté de la manière que je vous ai dite et nous pouvons exercer notre mission.
Les prêts garantis sont des prêts à la création, des prêts de développement, des prêts à la transmission d’entreprise ; nous garantissons quelques 35 000 crédits bancaires privés chaque année, qui concernent à 60 % les TPE. Pour tous les crédits inférieurs à 200 000 euros, notre garantie est automatique : lorsque le crédit accordé est supérieur à ce plafond, nous ré-instruisons le dossier.
Un autre de nos métiers est celui du crédit, à court terme d’une part, à moyen et long terme d’autre part. Le crédit à court terme s’est développé de manière fulgurante grâce au préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), produit emblématique de Bpifrance. Cela représentait plus de 2 milliards d’euros d’en-cours en 2014 ; 22 000 entreprises, dont 15 000 TPE, en ont bénéficié, pour des montants s’étageant entre 1 000 euros et 10 millions d’euros. Cette activité se développe à marche forcée. Elle nous a demandé de gros investissements – le recrutement d’intérimaires – car c’est le seul de nos métiers où nous sommes en contact direct avec les TPE, sans intermédiation des banques.
Le crédit à moyen et à long terme prend diverses formes : crédit-bail, crédit classique avec prise de sûretés et prêts de développement sans garantie.
Notre activité de crédit-bail matériel a crû l’an dernier de 26 %, sur un volume relativement limité de 500 millions d’euros ; dans le crédit-bail immobilier, domaine dans lequel Oséo était très puissant, nous maintenons une part de marché élevée, de l’ordre de 12 %, avec une croissance raisonnable de 10 %. Les prêts de développement, qui sont au cœur de l’objectif de financement de l’investissement, sont consentis sans garantie, pour sept ans, avec un différé de remboursement de deux ans ; ils sont assis sur des fonds de garantie dépendant entièrement des financements de l’État par le biais du programme d’investissements d’avenir et, marginalement, du Fonds européen d’investissement. Ces prêts ont un effet puissant puisque l’entreprise est libre de choisir comment l’utiliser au mieux pour se développer. Par ce moyen, Bpifrance finance l’immatériel, ce que les banques privées font mal, si bien que nous occupons une place centrale sur ce marché ; il n’est pas surprenant que cette activité ait augmenté de 40 % en 2014. Nous avons pour objectif de parvenir en 2015 à un volume de prêts de développement sans garantie compris entre 1,9 et 2 milliards d’euros.
Nous sommes une banque de place : notre objectif est de créer un effet multiplicateur et d’entraînement sur le marché bancaire. Aussi bien, un crédit n’est consenti que si la règle du « un pour un » est respectée, autrement dit à la condition expresse qu’une banque consente à l’entreprise considérée le même volant de crédit dans les trois à quatre mois qui suivent – le risque est toujours partagé. Nous nous en tenons strictement à cette règle fondamentale, établie pour éviter que Bpifrance ne se trouve encombrée de tous les mauvais risques de la place et pour garder de bonnes relations avec les établissements bancaires, nos partenaires.
Ce principe connaît une exception : les prêts à l’innovation – qui sont les prêts les plus risqués – alloués à des entreprises dont le résultat opérationnel est négatif et qui sont pour cette raison peu bancarisables. Le prêt à l’innovation est en effet une autre de nos activités, financée par la deuxième vague du programme d’investissements d’avenir. Bpifrance est chargée, dans ce cadre, de gérer 3 milliards d’euros. Les principes qui régissent notre intervention sont une attention portée de manière primordiale au client, la simplicité, la réduction des délais et la lutte contre toutes les dérives bureaucratiques. Avec M. Louis Gallois puis avec M. Louis Schweitzer, et avec le soutien des ministres, celui de M. Arnaud Montebourg en particulier, nous avons réussi à imposer comme discipline la rapidité d’exécution de l’allocation d’une subvention à une entreprise ou à une université. Nous voulons que les fonds soient injectés dans l’économie française le plus vite possible ; de fait, les délais, qui étaient de 15, et parfois 18 mois, ont été réduits à 3 mois.
Autre métier de Bpifrance : la contribution à la constitution de fonds propres, avec une gamme complète de possibilités. Nos investissements dans les fonds de fonds privés français ont connu une croissance phénoménale de 50 % : en 2014, nous avons injecté 800 millions d’euros dans les fonds français, car cette année-là les levées de fonds ont été nombreuses ; nous ne ferons pas cela tous les ans. Nous finançons environ 300 fonds. C’est une réalité méconnue que la France, par l’action de la Caisse des dépôts (CDC) et maintenant de Bpifrance, est, ex aequo avec le Royaume-Uni, la deuxième place mondiale du capital- risque et du capital-développement des PME. Il existe dans notre pays 100 fonds de capital-risque, et seulement 5 en Allemagne. On comprend que les Allemands puissent considérer la France comme la Californie de l’innovation, au point de nous demander de mettre des capitaux dans leurs fonds, sous condition de réinvestissement en France. KfW Bankengruppe, notre partenaire allemand, qui a décidé de lancer une politique de prêt à l’innovation en Allemagne, y consacrera 400 millions d’euros en cinq ans, soit dix fois moins que Bpifrance. Le secteur financier français d’investisseurs – nous finançons 1 700 professionnels de l’investissement - est un actif stratégique pour le pays.
Outre que nous investissons dans les fonds de fonds, nous avons aussi des fonds directs. Les premiers sont les fonds directs de capital-risque, qui concernent le Bio’Tech, l’Internet, la transition énergétique, les Med’Tech, tous secteurs en effervescence : nous sommes presque débordés par le nombre de dossiers à traiter, tant les élèves ingénieurs préfèrent désormais créer leur entreprise plutôt que de rejoindre un grand groupe. Nous finançons donc des incubateurs et des accélérateurs. Grâce au Fonds national d’amorçage, qui dispose d’un milliard d’euros, nous commençons par allouer des prêts d’amorçage avant de faire des prêts de capital-risque puis d’accompagner la phase de croissance internationale par des participations en capital, grâce au fonds Large Venture, créé en 2013 et doté de 600 millions d’euros. Notre boîte à outils est donc complète : on peut partir d’une aide à l’innovation de 200 000 euros pour parvenir progressivement, de prêt d’amorçage en co-investissements avec des business angels, à une participation en capital de 10 millions d’euros. Mais les innovations sont si nombreuses que, pour être à la hauteur de cette révolution de l’économie française, nous avons dû recruter des investisseurs et investir de plus en plus dans des fonds privés de capital-risque. Le développement de l’innovation, loin d’être exclusivement parisien, est un phénomène constaté partout sur le territoire. C’est un grand facteur d’espoir pour notre pays, et cela commence à être reconnu à l’étranger.
Un autre type d’intervention en fonds propres directs se fait par le biais de l’ancien Fonds stratégique d’investissement (FSI), devenu la division « ETI et grandes entreprises » de Bpifrance. En 2014, nous avons déployé un tiers de capital de plus qu’en 2013, en quinze opérations qui ont concerné des ETI, non de grandes entreprises – même si nous avons passé beaucoup de temps sur le dossier Alstom, qui a été reporté à 2015. Nous avons en particulier investi 44 millions d’euros dans l’opérateur boursier Euronext et nous sommes entrés au capital de Technicolor pour l’aider à résister à l’activisme d’un fonds étranger qui se proposait de démanteler l’entreprise. Je citerai aussi une prise de participation de 180 millions d’euros, à Morlaix, dans Sermeta, leader européen des échangeurs thermiques pour chaudières à gaz, très belle entreprise avec laquelle nous avons signé un partenariat de dix ans.
Notre dernier métier est le capital développement des petites et moyennes entreprises, qui s’opère par l’entremise d’un réseau d’investisseurs en province. Nous avons investi dans cent entreprises pour 1 million d’euros en moyenne, dans 60 % des cas en capital pur, dans 40 % des cas en obligations convertibles. Cette activité aussi est en forte croissance.
On pourrait craindre que l’augmentation de l’activité de la Bpi dans tous ses métiers, qui se poursuivra en 2015 selon la même trajectoire, ne s’assortisse de l’accroissement corrélatif du coût du risque. Ce n’est pas le cas. Dès ma nomination, j’ai signifié que la création de Bpifrance ne modifierait pas la politique de risque. On a pu croire, un temps, que Bpifrance apporterait la solution à tous les maux du pays, si bien que nos chargés d’affaires bancaires ont été soumis à très forte pression pour accorder des crédits dans des conditions difficiles. J’ai fait savoir que la politique de sinistralité qui avait fait le succès d’Oséo ne changerait pas. Il résulte de ces consignes que notre très forte croissance en 2014 s’est faite avec un coût du risque bancaire, dérisoire, de 36 millions d’euros pour un bilan de 55 milliards d’euros.
En fonds propres, le coût du risque est plus élevé. Nous avons été conduits à prévoir des provisions substantielles pour Sequana, qui a été sauvée ; pour certaines entreprises cotées opérant dans le secteur parapétrolier – Technip, Vallourec, CGG – ; pour Eramet, en raison de la crise du nickel. Mais le total des provisions passées sur des participations en fonds propres est un multiple du coût du risque bancaire d’une activité qui permet de financer, directement et indirectement, 30 000 PME françaises par an. Toujours et en tous lieux, l’investissement en fonds propres est dix fois plus risqué que le crédit, mais nos comités d’investissements sont extrêmement exigeants.
Je conclurai par quelques mots sur la gouvernance de Bpifrance. Au conseil d’administration de la société de tête siègent notamment des représentants de la CDC, de l’État, des régions – M. Jean-Paul Huchon et Mme Marie-Guite Dufay – et des salariés, ainsi que des personnalités qualifiées indépendantes : M. Eric Lombard, président de Generali Europe, qui dirige le comité d’audit, et Mme Amélie Faure, entrepreneure, qui dirige le comité des nominations. Ce conseil d’administration élabore le plan stratégique et le budget ; il se prononce, exceptionnellement, sur les opérations qui excédent 200 millions d’euros.
La société de tête chapeaute des filiales. Au conseil d’administration de Bpifrance Investissement siègent également des administrateurs indépendants : M. Frédéric Saint-Geours dirige le comité d’investissement aux côtés de Mme Florence Parly, par ailleurs présidente du comité des nominations. Le capital de Bpifrance Financement étant détenu à 90 % par l’État et à 10 % par des banques et des compagnies d’assurance, celles-ci sont représentées au conseil d’administration : c’est le cas de la Société générale, le comité d’audit étant présidé par Mme Catherine Halberstadt, de la BPCE. Siègent également des personnalités qualifiées indépendantes telles M. Jean-Luc Petithuguenin, président-directeur-général du groupe Paprec, ou Mme Marie-Christine Levet, présidente de MCL Consulting. Cette structure est d’une gestion un peu lourde, mais les débats se passent bien.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Jugez-vous satisfaisante la coordination entre Bpifrance et les autres acteurs chargés de l’internationalisation des entreprises que sont Business France, la Coface et le Fonds international de la CDC ? Vous avez fait état d’une forte demande de crédits à l’innovation, ce qui est réjouissant, mais vous avez indiqué que le volume des dossiers à examiner vous pose problème. Ces difficultés traduisent-elle un manque de moyens humains ou financiers ? Quelles suggestions pouvez-vous faire à ce sujet ? Enfin, quels critères président à vos choix ? Avez-vous retenu des secteurs d’action prioritaires ou appréciez-vous les dossiers au cas par cas ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Comment sont résolus les éventuels désaccords entre l’État et la Caisse des dépôts, qui contrôlent Bpifrance à parité ? Quels sont les frais fixes de Bpifrance, et notamment sa masse salariale ? Quelle est votre stratégie de rémunération et quel est l’écart entre le plus hauts et les plus bas salaires ? Sur un autre plan, comment coordonnez-vous votre action avec le Commissariat général à l’investissement et l’ADEME ? Comment les fonds dont dispose Bpifrance sont-ils dirigés vers les TPE, l’innovation, la transition énergétique et l’économie sociale et solidaire ? En particulier, qu’en est-il du mécanisme de soutien de la BPI aux sociétés de recherche sous contrat et de son enveloppe de 10 millions d’euros en subventions ? Comment la Banque applique-t-elle les 19 recommandations du rapport Beylat-Tambourin destinées à stimuler l’innovation, qui reconnaissent l’importance des Instituts Carnot, des centres techniques industriels et des structures de recherche sous contrat ?
M. Nicolas Dufourcq. Pour l’international, notre partenaire Business France, né de la fusion de l’Agence française pour les investissements internationaux et d’Ubifrance, nous a délégué 40 chargés d’affaires internationaux chargés de convaincre les entrepreneurs de se projeter à l’export. Nous avons équipé toutes nos agences d’un système de visio-conférence branché sur le réseau mondial de Business France. Nous avons développé une gamme de produits export. Pour le principal d’entre eux, le prêt export, qui est un prêt de développement sans garantie de 3 millions d’euros, l’enveloppe a doublé en 2014 et continuera de croître. C’est un axe stratégique majeur pour Bpifrance car les entreprises qui innovent et qui exportent sont en croissance. Aussi prenons-nous l’initiative, par un porte-à-porte – 75 000 visites en 2014 – de faire savoir aux entreprises que nous pouvons financer leur croissance par l’internationalisation. Outre le prêt export, nous disposons pour cela de plusieurs instruments. Nous nous attachons à mobiliser les créances nées à l’étranger, conformément à un dispositif lancé en septembre dernier et qui prend son essor. Nous distribuons l’assurance prospection de la Coface par le biais de vingt développeurs Coface qui sont pour partie à la BPI. Nous avons aussi une activité de crédit acheteur à l’export, également lancée en septembre dernier pour les ETI françaises ; elle nous permet de financer les acheteurs étrangers de biens d’équipement français. Tout cela concerne des contrats compris entre 10 et 40 millions d’euros. Au-delà, les banques françaises sont correctement équipées pour pourvoir aux besoins.
Je souhaite renforcer notre excellente collaboration avec Business France. Le déficit commercial de la France étant celui que l’on sait, les 40 chargés d’affaires internationaux qui nous ont été dépêchés ne suffisent pas ; leur effectif devrait passer à 150 personnes, autant qu’en compte notre réseau chargé des prêts à l’innovation. Je continuerai de pousser en ce sens. De même, nous pourrions faire beaucoup plus avec la Coface que de distribuer son assurance prospection ; la tutelle en discute. Le partage des tâches à l’international avec la Caisse des dépôts est connu : la CDC a créé CDC International Capital, structure qui reçoit des capitaux de certains fonds souverains, dont ceux du Qatar et d’Abou Dhabi, et qui les réinvestit dans des infrastructures et, le cas échéant, dans les ETI françaises. Nous essayons de travailler en bonne intelligence avec ce fonds. Je souligne que Bpifrance investit uniquement dans le financement des entrepreneurs, aucunement dans les infrastructures.
Pour ce qui est des prêts à l’innovation, nous avons fait de grands progrès dans les délais de traitement, et les dérapages ponctuels qui ont pu être observés dans certaines régions relèvent du management. Une faiblesse potentielle demeure : si les ressources issues du programme d’investissement d’avenir sont sanctuarisées dans la durée, il n’en va pas de même des crédits du programme 192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. Ces crédits permettent d’accorder des aides de 200 000 à 500 000 euros à 3 000 entreprises françaises chaque année. C’est le cœur du financement de l’innovation : il n’est pas une entreprise innovante qui ait commencé ses activités sans un prêt de ce type. Or, il nous faut batailler à chaque instant pour préserver l’intégralité de ce budget, au demeurant relativement modeste à l’échelle du pays, et qui est tous les ans en danger. En proportion de leur PIB respectif, la Suède et la Finlande consacrent à cet objet de 5 à 8 fois plus que nous. Avec un budget annuel oscillant entre 175 et 180 millions d’euros, nous sommes à l’étiage ; il ne faut en aucun cas faire moins. En l’état, dès le 15 octobre, nous n’avons plus rien à distribuer, non que nous ayons été trop larges au premier semestre, mais parce que la ligne budgétaire allouée au programme 192 est épuisée. Cela nous contraint, pendant tout le dernier trimestre, à inviter les entreprises à réitérer leur demande en janvier ; c’est peu satisfaisant. Nous nous interrogeons donc sur les moyens de pérenniser un montant compris entre 200 à 250 millions d’euros destiné au cœur du financement de l’innovation en France. J’appelle à comparer ces 250 millions d’euros, destinés à 3 000 PME et directement créateurs d’emplois, aux 700 millions d’euros qui seront injectés dans le seul programme de recherche et développement « Nano 2017 ». Il faut préserver cette ligne, absolument.
Nos relations avec le Commissariat général à l’investissement, dont nous sommes l’opérateur, sont permanentes. Pour éviter d’allonger indûment les délais d’exécution, les rôles doivent être clairement répartis : au Commissariat la définition de la stratégie et le pilotage de l’allocation des ressources, à Bpifrance le soin de les mettre en œuvre. La Banque est entièrement centrée sur le client : sur le terrain, nos 150 scientifiques choisissent et instruisent les dossiers, les font remonter, et la décision, positive ou négative, est prise sans que d’autres équipes aient à refaire les additions.
Avec l’Ademe, qui conduit ses opérations spécifiques en fonds propres, et sans doute faute de temps de part et d’autre, nous avons très peu de relations, si ce n’est dans le cadre de notre fonds EcoTech, qui mobilise 250 millions d’euros en faveur de la transition énergétique.
Vous m’avez interrogé sur les critères qui déterminent nos choix. Dans le volet « fonds propres » de nos activités, on trouve des fonds thématiques : un fonds Internet, un fonds BioTech, un fonds NetTech, un fonds EcoTech. De même, dans le volet « fonds de fonds », il y a une classe d’actifs BioTech, une classe d’actifs Internet et aussi une très petite classe d’actifs « transition énergétique ». Ce secteur du capital investissement est en effet dangereux, coûteux et rapporte peu, si bien qu’en France, deux fonds seulement se sont spécialisés dans ce domaine. Les fonds d’amorçage sont également spécialisés.
En revanche, pour le milliard d’euros que nous distribuons chaque année dans le cadre de nos activités bancaires – aides à l’innovation, subventions, programmes collaboratifs du programme d’investissements d’avenir, subventions du Fonds unique ministériel, programme d’innovations de rupture de Mme Anne Lauvergeon, prêts pour l’innovation et prêts d’amorçage –, nous n’avons défini a priori ni enveloppe ni quota par grand secteur d’avenir. Ce qui compte pour nous est la qualité de l’entrepreneur : nous ne voulons donner de capitaux ni à des professeurs Cosinus incapables de passer au stade du développement industriel de leurs inventions, ni à d’excellents entrepreneurs dont l’envergure scientifique est insuffisante. C’est dire l’importance de nos talentueuses équipes sur le terrain.
Nous finançons l’économie sociale et solidaire par le biais du Fonds d’investissement dans l’innovation sociale (FISO), doté de 10 millions d’euros alloués dans les régions par nos équipes « Innovation ». Nous avons lancé lundi dernier notre nouvelle politique d’allocation, dans laquelle nous insistons sur les projets d’innovation non technologiques – ceux qui concernent les usages. Les Français ont brillé par leur créativité dans des innovations d’usage avec des inventions telles que le stylo Bic ou le minitel. C’est moins le cas maintenant car nos dispositifs de financement de l’innovation nous imposaient de ne financer que des produits ; en Scandinavie, 30 % des aides à l’innovation vont à l’innovation non technologique et une partie à l’innovation sociale. Notre vision de l’innovation est maintenant élargie et nous avons d’autre part commencé de déployer un prêt de développement « Économie sociale et solidaire » sans garantie. Cela a pris du temps, le fonds de garantie qui permettait de le lancer n’étant jusqu’alors pas alimenté par l’État ; il l’est maintenant. Enfin, nous allons lancer le prêt « quartiers » de 50 000 euros, autre prêt de développement sans garantie. Voilà pour les crédits.
Pour ce qui est des fonds propres, nous avons pris des participations au capital de plusieurs coopératives telles que Limagrain et Sofiprotéol. Outre cela, nous avons injecté en 2014 des ressources dans Citizen Capital et Impact Partenaires, les deux seuls fonds qui alimentent en fonds propres des entreprises situées dans des zones défavorisées ; nous serons amenés à renforcer leurs moyens car ils ont d’autres idées. Des fonds de cette sorte, il en faudrait dix, mais les équipes d’investisseurs entrepreneurs à composante sociale capables de sélectionner les risques sans se rémunérer comme on se rémunère dans les fonds classiques, ne sont pas légion.
Les TPE concernent des millions d’individus. Bpifrance, avec un effectif de mille personnes sur le terrain, n’est pas outillée pour les traiter, et n’a pas été conçue pour cela. La tâche revient aux réseaux bancaires, qui ont chacun plusieurs dizaines de milliers de salariés. Nous n’avons de relations avec les TPE que pour le préfinancement du CICE – ce qui représente 15 000 contrats par an.
Pour les TPE de l’économie sociale et solidaire, ce sont les réseaux d’Initiative France, de France Active et de l’ADIE qui interviennent. Ces réseaux entrent dans le périmètre de la CDC ; nous ne les finançons pas, mais ils distribuent notre prêt « économie sociale et solidaire ».
Vous m’avez interrogé sur le règlement des désaccords éventuels entre nos deux actionnaires, l’État et la CDC. Ce qui concerne Bpifrance passe pour l’essentiel par M. Régis Turrini, Commissaire de l’Agence des participations de l’État, d’une part, M. Franck Silvent, directeur du pôle Finances, stratégie et participations du groupe Caisse des dépôts d’autre part. La politique de dividendes est maintenant définie et il n’y a pas de désaccords entre eux. Nous entretenons un dialogue créatif avec la direction du Trésor et il n’y a pas davantage de conflits, ni sur la gestion de la garantie, ni sur les nouveaux produits bancaires. Avec la direction générale des entreprises, le dialogue sur l’innovation se déroule bien.
Les deux plus hauts salaires de Bpifrance – le mien et celui de l’ancien directeur général du Fonds stratégique d’investissement – sont, comme c’est la règle, plafonnés à 450 000 euros. Je pense que l’écart entre les plus hauts et les plus bas salaires est d’environ 1 à 18. Les différences de rémunérations versées par les quatre entités qui ont formé Bpifrance étaient assez marquées. Nous avons entièrement révisé la structure des rémunérations et nous entendons parvenir à l’harmonisation en six ans. Nous corrigerons progressivement les décalages en commençant par les plus bas salaires, ceux des fonctions support en particulier ; nos actionnaires ont aussi donné leur accord pour que certaines catégories salariales soient repositionnées.
Vous m’avez interrogé sur nos frais fixes. Pour le fonds d’investissement, la mesure se fonde sur deux indicateurs : le nombre d’investissements réalisés par an et par investisseur et le nombre de lignes d’investissement suivies par an et par investisseur. Avec, en moyenne, 7,5 lignes et 5 investissements annuels par investisseur contre respectivement 4,5 et 3 sur le marché, nos chargés d’affaires, très productifs, ont une plus lourde charge que leurs homologues. C’est une des raisons pour lesquelles nos actionnaires ont accepté que nous recrutions en 2015.
Pour les activités de crédit, les frais fixes se mesurent en calculant le coefficient d’exploitation et sa stabilité dans le temps. Le nôtre est stable à 62 % pour une activité très particulière, puisque la garantie ne rapporte rien ; le crédit rapporte 5 % et les prêts à l’innovation, parce qu’ils ont été débudgétisés pour les frais de fonctionnement, nous font perdre, structurellement, 30 millions d’euros par an. En partant d’une base 100 en 2009, le volume des en-cours de prêts de garantie est de 240 dans le budget 2015, les frais de personnel s’établissant à 133. Pour une activité qui a été multipliée par 2,3 depuis 2009, les frais de personnel ont été multipliés par 1,3 et les effectifs par 1,16 – en tenant compte des recrutements à venir en 2015. Nous sommes d’une frugalité extrême, et aucun recrutement n’a lieu si le conseil d’administration de la maison mère n’en a pas voté le budget.
M. Arnaud Leroy. J’avais milité en faveur d’un fort partenariat entre l’Ademe et Bpifrance ; je suis donc surpris par ce que vous nous avez dit à ce sujet et nous devrons nous y intéresser. Je partage votre opinion sur l’importance du capital-risque français ; la loi Macron devrait d’ailleurs nous doter d’un outil qui nous permettra de lutter contre nos concurrents luxembourgeois pour attirer les fonds internationaux.
Deux fonds, nous avez-vous dit, se sont spécialisés dans le financement de la transition énergétique. Ce secteur, outre qu’il est très capitalistique, demande des engagements de très long terme de 15 ans, parfois de 30 ans. J’entends que le rôle de Bpifrance n’est pas de financer des infrastructures, il n’empêche : nous avons besoin d’un soutien pour car la transition énergétique forme un écosystème de PME et d’ETI. Comment satisfaire ce besoin d’investissements de long terme dont le rythme de rendement n’est pas le rythme habituel ?
Le plan Juncker tend, en mobilisant 21 milliards d’euros, à en mettre par effet de levier, 315 milliards à disposition de l’économie européenne. Dans ce cadre, Bpifrance sera certainement sollicitée, soit pour donner des garanties, soit pour prendre des participations en capital ; quel rôle imaginez-vous jouer dans ce chantier important pour la relance de l’économie européenne ? Comment pouvons-nous vous aider si des évolutions législatives sont nécessaires ?
M. Gilles Carrez. Le plan Draghi de rachat massif d’actifs se fera à 80 % par le biais des banques centrales nationales. Selon le gouverneur de la Banque de France, la Banque centrale européenne espère susciter un enchaînement vertueux, ces rachats de dette souveraine entraînant une réallocation d’actifs financiers plus orientée vers les entreprises. On en comprend l’idée, mais cela aura-t-il un impact sur vos conditions de financement et vos conditions d’interventions en fonds propres ?
M. Louis Schweitzer a indiqué que, pour le plan Juncker, les propositions françaises seront gérées par le Commissariat général à l’investissement, plus précisément M. Thierry Francq, commissaire général adjoint. Enfin, l’opérateur principal du programme d’investissements d’avenir en matière de recherche est l’Agence nationale de la recherche (ANR). Existe-t-il une articulation entre l’ANR et Bpifrance ?
M. Nicolas Dufourcq. Nous sommes le premier banquier de la transition énergétique française. En 2014, nous avons distribué 800 millions d’euros de crédits pour l’éolien, le photovoltaïque, la biomasse ou encore l’hydro-électrique ; c’était l’objectif stratégique que nous nous étions fixé pour 2017 ! Nous avons désormais de 25 à 30 % de parts de ce marché. Ce sont des crédits à 20 ou 25 ans pour lesquels nous prenons des hypothèques sur l’ensemble des infrastructures. Je vous l’ai dit, nous ne financerons pas des équipements autoroutiers ou des infrastructures du type du viaduc de Millau – c’est le rôle de la CDC – mais, depuis le 1er janvier 2015, nous gérons un nouveau fonds, doté de 425 millions d’euros, qui investit dans les sociétés de projets – pour moitié dans la transition énergétique, pour moitié dans les « usines du futur » – par des crédits de 10 à 15 millions d’euros. Nous faisons des crédits à 25 ans, mais pas encore de crédits à 30 ans.
Comme l’a signalé M. Gilles Carrez, M. Thierry Francq centralise les propositions françaises relatives au plan Juncker. Nous en avons quatre. Notre ressource rare, je vous l’ai dit, c’est l’argent public dans les fonds de garantie. En aurions-nous davantage que nous allouerions plus de crédits sans garantie, de prêts de développement, de prêts à l’innovation, de prêts export, avec un formidable effet multiplicateur – il est de 10, et parfois de 12. Il n’y a pas mieux en termes d’allocation d’argent public que des fonds de garantie à effet multiplicateur, correctement gérés. Nous voulons donc que de l’argent du plan Juncker soit injecté dans nos fonds de garantie, par le canal du programme de partage de risque (Risk sharing instruments, RSI) du Fonds européen d’investissement. Bpifrance est parfaitement équipée pour mettre en œuvre un système de garantie qui a fait ses preuves ; le FEI n’a donc aucune raison de la contourner.
Ensuite, s’il y a suffisamment d’argent public dans le capital développement et dans le capital-risque, les fonds privés demeurent insuffisants, ce qui nous oblige à faire le tour du monde pour trouver des capitaux. Cela tient en particulier aux obligations prudentielles fixées par la directive Solvabilité II. Il conviendrait donc, pour permettre aux assureurs vie européens d’investir, de leur accorder la garantie gratuite de leurs opérations de capital investissement. Nous recommandons la mise au point d’un tel mécanisme.
Notre troisième proposition est d’appeler à la constitution d’un fonds de fonds européen de capital-risque, fonds commun des grandes banques de développement européennes associant les fonds français, britanniques, scandinaves et l’amorce de fonds allemand. Le principe serait le suivant : pour tout investissement dans un fonds français, ce fonds européen centralisé, dans lequel auront été injectées des ressources issues du plan Juncker, co-investirait automatiquement.
Notre dernière proposition est que le plan Juncker accompagne les tentatives de création de fonds transnationaux, pour permettre aux PME européennes de se mondialiser plus rapidement. Pour cela, elles ont tout intérêt à ce que les fonds entrés à leur capital aient un bureau à Paris et aussi à Munich ou à Stockholm. Nous avons quelques fonds transnationaux, notamment le Fonds franco-chinois, dans lequel nous avons investi 250 millions d’euros. Jamais les billets de banque chinois n’auraient intégré des éléments de sécurité de la société française Hologram Industries si le Fonds franco-chinois n’avait eu une équipe à Shanghai. Les fonds transnationaux sont essentiels à l’économie, mais difficiles à monter et à financer. Le plan Juncker nous rendrait donc un signalé service s’il avait pour effet que, lorsque nous décidons d’investir 10 millions d’euros dans un fonds allemand à condition qu’il réinvestisse en France, un abondement du même montant soit automatique.
J’ajoute que le plan Draghi a pour conséquence directe l’écrasement des taux, et donc des marges des banques.
M. Gilles Carrez. Il va aussi provoquer la baisse du cours de l’euro. Bpifrance pourrait alors être confrontée à un afflux de demandes d’intervention de la part de PME enclines à penser que certains de leurs produits qui n’étaient pas compétitifs jusqu’alors peuvent le devenir. Vous êtes-vous préparés à cette éventualité ?
M. Nicolas Dufourcq. Oui, en nous fixant pour 2015 un objectif de prêts à l’export très élevé. Nous avons deux priorités stratégiques : l’international et l’accompagnement des entreprises. Aux Assises du financement et de l’investissement, nous avons annoncé la création d’un dispositif de déconsolidation des crédits aux PME et ETI dans les bilans des banques françaises pour les revendre aux assureurs vie. Ainsi, nous proposerons à une banque qui a un portefeuille de 80 milliards d’euros de crédit aux PME qu’elle nous en cède la moitié. Nous logerons cette créance dans un fonds de prêt à l’économie garanti à 100 %, et nous en revendrons le rendement aux assureurs vie – rendement qui, même diminué du coût de la garantie, est plus élevé que celui des dettes souveraines qui ne rapportent plus grand-chose.
M. Gilles Carrez. Un tel mécanisme suppose un processus de titrisation des prêts à des PME dont je ne sais s’il existe.
M. Nicolas Dufourcq. La créance sera stockée : elle n’a pas vocation à être revendue sur le marché ; l’assureur vie prendra le rendement. L’opération allégera le bilan des banques, qui pourront donc distribuer plus de crédits. En revanche, leur produit net baissera. Aussi, le dispositif n’intéressera que celles des banques qui souhaitent disposer d’une marge de solvabilité supplémentaire. Nous sommes en discussion à ce sujet avec le secteur bancaire.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Si Bpifrance n’a pas de politique sectorielle et prend pour seul critère la qualité de l’entrepreneur, ne risque-t-elle pas finalement de simplement se substituer aux banques traditionnelles ?
M. le rapporteur. J’aimerais vous entendre à propos de l’action Bpifrance pour les structures de recherche sous contrat. D’autre part, comment analysez-vous le fait que le nombre d’ETI diminue en France en dépit des efforts déployés pour les accompagner ?
M. Nicolas Dufourcq. Nous ne sommes jamais en concurrence avec les établissements bancaires car nous ne consentons jamais un crédit qui ne soit cofinancé par une banque. Dans la grande majorité des cas, nous concluons les pools bancaires en apportant un prêt sans garantie. Nous sommes assez puissants dans le secteur du crédit-bail mais, là encore, la condition sine qua non de notre intervention est qu’une banque fasse un crédit à moyen ou long terme. Nos taux d’intérêt sont ceux du marché, c’est-à-dire ceux de nos partenaires bancaires, et notre présence bancaire par secteur est assez proche de la répartition par secteur du PIB français, avec une sous-pondération dans le secteur agro-alimentaire que nous souhaitons corriger en 2015. Je le redis, nous ne concurrençons les banques à aucun moment.
Les ETI sont au cœur de notre stratégie. Nous pensons qu’il y a en France 650 « champions cachés » ; certes, c’est beaucoup moins que les 4 000 ETI allemandes, mais c’est beaucoup plus qu’on ne le pensait. On a récemment constaté, au nombre des 60 000 défaillances d’entreprise annuelles, celles de quelques ETI. Cela résulte du fait qu’elles ne sont pas assez mondialisées. Les ETI françaises réalisent en moyenne 20 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation (la proportion est de 70 % pour les ETI allemandes) parce que souvent, le capital de ces sociétés n’est pas ouvert ; en corollaire, la gouvernance, assez stable, tend au conservatisme. Après six ans de crise et de traversée du désert, les ETI sont très prudentes. Notre travail est de les convaincre d’investir, d’exporter, d’ouvrir leur capital en les persuadant que nous allons les propulser à l’international pour que leur chiffre d’affaires double, puis triple. Notre tâche consiste à les équiper et à les motiver ; il y faudra du temps.
Dans deux semaines, nous lancerons un accélérateur, autrement dit un cocktail multivitaminé destiné à 75 PME que nous suivrons pendant trois ans par un accompagnement à la définition puis à l’exécution de véritables business plans. Nous lancerons également une « initiative conseil » essentiellement destinée aux ETI. Elle consistera à inciter les dirigeants de ces sociétés à rédiger, avec notre aide, le plan stratégique qui leur fait défaut – l’entreprise versant pour cela 5 000 euros, Bpifrance autant. Nous comptons réaliser 150 de ces « flashes stratégiques » en 2015, sortir ainsi les ETI de leur routine et apprécier dans trois ans les résultats obtenus.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur, je vous remercie.
Audition du 5 février 2015
M. Pascal Lagarde, directeur exécutif de Bpifrance, chargé de l’international, de la stratégie, des études et du développement
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Lagarde, merci de bien vouloir présenter vos fonctions. Pourquoi avoir réuni dans la même direction l’international, la stratégie, les études et le développement ?
M. Pascal Lagarde, directeur exécutif de Bpifrance, chargé de l’international, de la stratégie, des études et du développement. Je dirige une direction transversale qui regroupe quatre grands thèmes interconnectés.
Le premier est l’international, qui regroupe la coordination des activités internationales, les contacts avec la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), la coopération ou l’assistance technique à nos homologues internationaux, et enfin le développement à l’international, notamment en Afrique.
Deuxième thème, la stratégie, qui concerne la construction du plan stratégique annuel de Bpifrance et le suivi de sa mise en œuvre ; le suivi du programme des investissements d’avenir ; des activités thématiques sur divers secteurs, comme le tourisme ou le transport ; le secrétariat du Comité national d’orientation (CNO) ; l’élaboration et le suivi de la doctrine.
Troisième thème : les études économiques, l’évaluation et la prospective. Nos activités regroupent les études microéconomiques et macroéconomiques, l’évaluation de l’impact de nos programmes, les synthèses utiles à la préparation de l’avenir, ainsi que le travail de Bpifrance Le Lab, un think thank dédié aux échanges entre les mondes académique et entrepreneurial afin de valoriser la connaissance sur les PME et les ETI et de leur ouvrir nos données.
Quatrième thème, le développement, qui a pour objectif de coordonner le développement de nos produits, le travail sur les besoins émergents, mais aussi de mettre au point la doctrine ESG (environnement, sociétal et gouvernance) et d’introduire les principes qui en relèvent dans l’exercice de nos métiers.
Après avoir approuvé le premier plan stratégique de Bpifrance fin 2013, nos instances l’ont mis à jour dès 2014 pour tenir compte de nos observations sur le terrain et des mesures que nous jugions utiles pour les années à venir. Ce travail stratégique a été repris dès le début de l’année 2015.
Trois axes structurent le plan stratégique de 2013. Le premier est l’accompagnement de la croissance des entreprises, grâce à notre rôle contracyclique sur le financement à long terme, en garantissant les investissements les plus risqués et en structurant la chaîne du capital-investissement.
Le deuxième axe consiste à préparer la compétitivité de demain, en contribuant à l’augmentation du nombre et de la taille des ETI, en nous positionnant comme opérateur public du financement de l’innovation et des secteurs d’avenir, et en accompagnant les entreprises à l’export et à l’international.
Notre troisième axe est de stimuler l’écosystème de l’entreprenariat, grâce à l’accompagnement des entrepreneurs – que nous avons précisé au titre de notre deuxième plan stratégique – et le développement de l’esprit d’entreprise, en lien avec nos partenaires, au premier rang desquels les régions.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. J’aurai plusieurs questions précises.
Qu’est-ce qui différencie la doctrine d’intervention de Bpifrance de celle d’un investisseur « normal » ?
Le site Internet de la BPI recense 64 solutions différentes de financement. La variété des solutions et des produits que vous proposez n’entre-t-elle pas en contradiction avec les objectifs de simplicité et d’accessibilité ?
La doctrine d’intervention diffère-t-elle d’une région à une autre ?
La pratique de due diligence ESG (environmental, social, governance) n’est-elle pas trop contraignante s’agissant des TPE et PME ?
La BPI vient de publier un nouveau référentiel censé définir de manière plus large la notion d’innovation, jusqu’alors réduite à l’innovation technologique. Qu’en est-il exactement ?
La doctrine de cofinancement n’entre-t-elle pas en contradiction, dans certains cas, avec la volonté de répondre aux défaillances de marché ? Dans quelle mesure est-elle contrainte par la réglementation européenne ? En pratique, est-il difficile de trouver des partenaires privés ? Quelle est la procédure pour sélectionner ces partenaires et dans quels délais ? L’impossibilité de trouver des partenaires privés a-t-elle parfois conduit à l’échec de certains dossiers ?
Enfin, quel va être le positionnement de Bpifrance par rapport au plan Juncker ?
M. Pascal Lagarde. Nous intervenons principalement en accompagnement des financeurs privés, à la fois dans les segments où sont constatées des failles du marché et dans les domaines où nous avons un rôle à jouer pour compléter les tours de table.
Nos durées de détention sont largement supérieures à la moyenne du marché – dix ans en investissement, contre cinq ans pour le marché. Ainsi, nous intervenons sur des zones de marché où la maturation est beaucoup plus lente et le besoin d’investisseurs ou de financeurs publics très fort.
Notre doctrine, approuvée en 2013, présente de nombreuses similitudes avec celle des organismes européens proches de Bpifrance. Nous sommes très présents en capital-risque, en direct et en indirect, et nos interventions dans les fonds d’investissement font de nous le principal investisseur en France dans ce domaine.
Autre spécialité de la Bpifrance : nos tickets d’investissement moyens représentent la moitié de la moyenne du marché.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Quel en est le montant ?
M. Pascal Lagarde. Il est de 1,5 million d’euros, contre 3 millions pour la moyenne du marché.
Pour la partie financement, Bpifrance propose toute la palette, des prêts à court terme aux prêts à moyen et long termes en passant par le crédit-bail. Dans notre portefeuille, la part des entreprises dans une situation de cotation difficile est très supérieure à celle du marché.
Un autre élément nous différencie des autres investisseurs : la constance de notre activité, quels que soient les remous du marché. C’est ce que nous appelons notre rôle contracyclique, qui évite au marché de se déliter – ce fut le cas lors de la crise financière en 2007-2008, où OSEO est intervenu massivement pour soutenir les tours de table via les garanties et les prêts, et après la chute brutale du capital-risque à la suite de l’éclatement de la bulle Internet.
Pour répondre à votre observation, Bpifrance a notablement simplifié la gamme des produits. Le challenge pour nous est d’avoir une gamme de produits simplifiée et transparente tout en proposant des produits adaptés aux différents besoins des entreprises. Si nous gérons un fonds d’investissement spécialisé dans la filière automobile, c’est bien parce que celle-ci a des besoins particuliers.
Nous avons aussi effectué un important travail en vue d’améliorer la présentation de l’offre. En outre, nos 42 implantations en régions permettent aux entrepreneurs de rencontrer nos chargés d’affaires pour obtenir des réponses adaptées à leurs besoins. Cette entrée commerciale unique au niveau des régions simplifie la vie des entrepreneurs. Nous avons d’ailleurs lancé l’année dernière une grande étude de satisfaction clients, que nous allons renouveler tous les ans.
La doctrine d’intervention de Bpifrance ne diffère pas d’une région à une autre. Par contre, nos partenariats avec les régions peuvent donner lieu à des produits spécifiques pour des régions données.
La doctrine ESG est inscrite dans la loi de création de Bpifrance. L’application de principes ESG dans le monde des entreprises est un facteur de compétitivité au regard de l’activité même de la société, mais aussi parce que de plus en plus de grands investisseurs internationaux souhaitent voir leurs allocations d’actifs orientées vers des actifs respectueux de la doctrine ESG et de la démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises).
Dans la pratique, pour chaque opération d’investissement ou de financement, nous menons une analyse systématique ESG. Par ailleurs, en investissement notamment, nous prenons avec l’entrepreneur des engagements RSE sur les sujets qui nous semblent importants, comme la réduction de la consommation énergétique, la baisse des accidents du travail ou encore la mise en place d’administrateurs indépendants dans les conseils d’administration. Nous assurons un suivi de ces engagements.
Nous avons mené un important travail avec de nombreux partenaires pour redéfinir le cadre de l’innovation. Nous avons la volonté d’intégrer les nouvelles formes d’innovation – innovations sociales, de process ou d’usage –, tout en maintenant notre soutien à l’innovation technologique. Paul-François Fournier, notre directeur exécutif à l’innovation, pourra vous apporter des précisions sur ce point : sa direction regroupe en effet des activités de soutien à l’innovation – aides, avances remboursables, produits spécifiques de financement –, mais aussi d’intervention directe en capital-risque.
Pour la plupart de nos produits – à l’exclusion des produits d’aide à l’innovation ou d’avances remboursables que nous gérons pour le compte de l’État –, nous intervenons en cofinancement et co-investissement avec le marché. Notre rôle est, en effet, d’entraîner l’investissement ou le financement privé – base de la doctrine européenne –, ce qui fait de Bpifrance un opérateur de marché. Les règles ont évolué positivement : la Commission européenne a reconnu, dans le domaine du capital-risque, par exemple, que la part des financements privés pouvait se réduire à 30 % pour les investissements directs.
Nous ne nous substituons pas au marché : nous avons un rôle d’accompagnement et ne prenons jamais le risque de nous entendre reprocher par nos partenaires banquiers ou investisseurs de prendre des opérations à leur place. Nous sommes à la fois investisseurs minoritaires dans les fonds d’investissement privés, mais aussi investisseurs directs, et cette activité d’investissement dans les fonds privés permet d’attirer des partenaires pour investir en direct. Pour la partie financement, notre activité de garantie est très appréciée des banques. Ainsi, ce double effet de levier amène les opérateurs de marché sur des segments moins attractifs car plus risqués ou plus petits – les petits prêts sont peu rentables, par exemple.
Il nous arrive de connaître des échecs, faute d’investisseurs ou de financeurs privés. À titre d’exemple, après avoir décidé très tôt d’être investisseur dans un projet de fonds de fonds qui nous semble intéressant, nous ne trouvons pas toujours les investisseurs privés pour compléter le tour de table. Lorsque nous détectons de vraies failles de marché, où il est quasiment impossible de trouver des investisseurs privés, nous cherchons des solutions. C’est ainsi que nous gérons le Fonds national d’amorçage qui permet à la part publique dans les fonds d’être supérieure à 50 %, régime pour lequel nous avons obtenu l’accord de la direction générale de la concurrence.
Enfin, nous avons travaillé sur des programmes d’aides conformes aux nouvelles règles européennes relatives aux aides d’État. La dynamique du plan Juncker laisse augurer des évolutions de doctrines ; je note, par exemple, que le plafond mid-cap est passé de 250 à 3 000 salariés pour les PME, ce qui leur permettra de trouver des financements plus facilement. Nous étudions avec la Commission européenne et l’État les domaines dans lesquelles cette réglementation peut s’appliquer.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’intervention sur des failles de marché ? Nous souhaiterions également que vous nous donniez des cas d’échecs dus à l’impossibilité de trouver des partenaires privés.
Pouvez-vous nous communiquer la liste de vos critères ESG ?
Au cours de son audition, M. Dufourcq a indiqué que le soutien à l’exportation est une priorité stratégique pour 2015. Comment cette priorité se manifeste-t-elle ? Les prêts à l’export proposés par la BPI font-ils l’objet d’une forte demande ? Y a-t-il une adéquation entre l’offre et la demande ? La création de nouveaux produits est-elle envisagée ?
Quelles sont les mesures de coopération entre Bpifrance, Ubifrance et l’AFII ? Qu’est-il attendu concrètement de la fusion de ces deux organismes pour créer Business France ? BpifranceExport, chargé de coordonner Bpifrance et la COFACE, est-il opérationnel et des synergies avec l’activité de CDC International sont-elles envisageables ?
Les fonds franco-chinois Cathay Capital Private Equity et SinoFrench font-ils la preuve de leur efficacité ? Quelle est leur gouvernance ? Les apports de la BPI demeurent-ils bien investis en France ? La formation d’autres fonds internationaux est-elle prévue ?
Où en est le projet de mise en place d’un crédit acheteur à l’export ?
Enfin, quel est le montant des mobilisations de créances nées à l’étranger ? Cette offre fait-elle l’objet d’une forte demande ?
M. le rapporteur. Nous avons abordé la situation d’Eramet lors de l’audition de M. Dufourcq, lequel nous a indiqué que des provisions avaient été faites pour prendre en compte la crise du nickel. Y a-t-il eu d’autres provisions ? Comment distinguez-vous ce qui a trait au contexte international et ce qui a trait à la structure elle-même ? Et comment estimez-vous les risques ?
M. Éric Alauzet. Quels sont les changements que l’action de Bpifrance a apportée ? Pouvez-vous nous donner des exemples qui montrent que l’existence de la BPI a permis de dénouer des situations ? Sommes-nous en mesure de dire que la BPI a permis de doper l’économie ?
M. Pascal Lagarde. Notre activité pour combler les failles du marché est en très forte croissance, notamment avec le préfinancement du CICE qui a permis de soutenir un grand nombre de TPE PME pour leurs besoins de liquidité. Nous vous communiquerons des chiffres sur la répartition des entreprises en fonction de leur niveau de risque en matière de crédit court terme.
Notre gamme de prêts de développement finance l’immatériel. Ces financements sans garantie ni caution pour l’entreprise servent à financer notamment la R&D des entreprises matures ou encore les dépenses liées à la mise en place de l’export – adaptation des produits, installation d’équipes commerciales. Pour ces projets, la Bpifrance finance en prêts ces activités immatérielles et les banques cofinancent le plus souvent les investissements matériels. Ainsi, nous pouvons intervenir en cofinancement sur des parties de projets en fonction des appétences de nos partenaires.
Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir, nous avons distribué les prêts verts, avec un coefficient multiplicateur de cinq ou six. Ces prêts ont servi à financer les études de mise en place de nouvelles chaînes de production dans les entreprises industrielles, par exemple, ce qui a permis de financer des achats de chaudières notamment. Pour ces exemples de produits, nous pourrons vous fournir des données chiffrées.
Concernant les diligences ESG, nos priorités – qui figurent dans notre charte ESG – sont l’emploi des jeunes, l’entrepreneuriat féminin, la qualité de la gouvernance, la transition écologique et énergétique. Les critères découlent de ces quatre priorités ; je vous communiquerai des éléments plus précis ultérieurement.
La problématique du manque d’investissement en fonds de fonds touche deux secteurs : d’une part, le capital-risque, notamment pour l’amorçage et l’investissement massif dans les entreprises technologiques non stabilisées ; d’autre part, le capital-développement, en particulier pour les petites transmissions. Daniel Balmisse, que vous allez également auditionner après moi, pourra vous en dire plus.
J’en viens à l’activité de prêts à l’exportation. Ces produits, qui entrent dans la catégorie des prêts de développement, sont ciblés sur les phases amont de l’internationalisation des entreprises. La demande en la matière est très forte, puisque nous avons dépassé en 2014 nos objectifs de 56 %, et nous visons une production de l’ordre de 500 millions d’euros en 2015. Ces chiffres, plus importants que ceux que nous avions anticipés, démontrent que les entreprises se préparent à l’international.
Pour accompagner ce mouvement vers l’internationalisation, Bpifrance propose deux nouveaux types de produits. D’abord, une gamme de produits de mobilisation de créances nées à l’étranger. Depuis octobre 2014, date de la mise en œuvre de cette solution de financement de court terme, nous avons enregistré 176 demandes pour près de 800 acheteurs et 140 millions d’encours assurables. Pour cette première phase, notre taux d’accord avec notre assureur crédit est de 62 %. Nous sommes maintenant dans la phase de mise en place de ces accords, avec 32 lignes ouvertes pour 13 millions d’euros. La montée en charge de cette activité est également plus élevée que nos prévisions.
Mme la présidente Véronique Louwagie. La demande de ces entreprises aurait-elle pu être couverte par le marché bancaire traditionnel ? Pourquoi se sont-elles adressées à Bpifrance ?
M. Pascal Lagarde. Nous avons estimé que la demande très forte des PME était insuffisamment couverte par le marché. Ces 176 entreprises représentant 800 contreparties à l’étranger se sont adressées à nous pour deux raisons. D’abord, ce produit était très attendu, comme l’ont montré les sondages que nous avions réalisés auprès de nos clients. Ensuite, notre réseau, qui fait la force de Bpifrance, a assuré la promotion de ce produit auprès de nos clients dont nous connaissons parfaitement les besoins.
Notre deuxième nouveau produit à l’international est le crédit acheteur. Pour 2015, nous prévoyons une production modeste, de 100 millions d’euros pour 15 dossiers. Cet outil d’intervention en direction des PME et ETI comble également une faille de marché, constatée par Bercy et l’Inspection des finances, notamment pour les crédits export de taille modeste.
Nous sommes pleinement satisfaits de notre partenariat avec Ubifrance : ce service complémentaire et de proximité apporté aux PME est d’une très grande qualité et sa fusion avec l’AFII pour la création de Business France ne remet aucunement en cause ce que nous avons mis en place : nous projetons même d’augmenter ce partenariat. Nous étudions avec l’ex-AFII la possibilité d’un partenariat plus opérationnel avec la partie attractivité de Business France. BpifranceExport continue à jouer son rôle d’animation pour amener les entreprises qui en ont la capacité à s’orienter vers l’internationalisation.
Nous sommes plutôt satisfaits du fonds franco-chinois. Un nombre significatif d’entreprises se sont développées sur le marché chinois, grâce au soutien fort de partenaires locaux. Pour les entreprises françaises, c’est l’attractivité du marché qui prime, alors que les entreprises chinoises cherchent plutôt à nouer des partenariats propices au développement du marché chinois.
Nous avons lancé l’année dernière un fonds plus ambitieux avec China development Bank, qui vise les ETI. Daniel Balmisse pourra vous en parler tout à l’heure.
L’activité de CDC International Capital, directement pilotée par la Caisse des dépôts, a pour objectif d’attirer les capitaux des grands fonds internationaux. Les classes d’actifs sont plutôt l’immobilier et l’infrastructure. L’activité d’investissement, très ciblée sur des entreprises avec des demandes de très forte rentabilité, est un peu différente de l’activité classique de Bpifrance. Néanmoins, il y a des synergies, que nous examinons avec notre actionnaire Caisse des dépôts.
M. Jean-Yves Gilet connaît le dossier Eramet sur le bout des doigts : il pourra vous en parler.
Monsieur Alauzet, la BPI apporte deux choses. D’abord, une intégration financière beaucoup plus forte et, partant, une capitalisation sur des fonds propres plus importants pour l’ensemble de notre activité. Ensuite, une très forte synergie entre les activités, grâce à une vision précise du marché en France et une palette complète d’instruments financiers adaptés aux entreprises. Nous avons démontré notre utilité lorsque nous avons travaillé sur les besoins de l’économie sociale et solidaire.
Dernier point : nous avons acquis une stature européenne. Nos partenaires européens nous considèrent désormais comme étant du même niveau que KfW ou Cassa Depositi e Prestiti – ce qui nous permet de peser au niveau européen, notamment dans le cadre du plan Juncker. L’année dernière, nous avons pris la décision de participer à l’augmentation de capital du Fonds européen d’investissement ; je siège moi-même au conseil d’administration du FEI qui sera un des instruments du plan Juncker. Nous travaillons avec l’État pour étudier notre insertion dans ce dispositif. Il y a là une grande opportunité pour nous dans deux domaines fondamentaux. Le premier est le capital-risque, notamment pour faire émerger des fonds d’investissement paneuropéens ; nous y travaillons avec nos partenaires. Le second concerne les garanties de la Commission, qui permettront d’abaisser le niveau de risque des prêts aux PME et, ainsi, de développer l’investissement de ces entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de cette présentation.
Audition du 5 février 2015
M. Daniel Balmisse, directeur des fonds de fonds de Bpifrance
Mme la présidente Véronique Louwagie. Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions avec M. Daniel Balmisse, directeur exécutif de Bpifrance chargé des fonds de fonds. À côté de l’investissement direct, en effet, la Banque publique d’investissement (BPI) investit également dans des fonds de fonds, activité qui a connu un essor considérable comme nous l’a précisé la semaine dernière Nicolas Dufourcq, qui a d’ailleurs parlé de croissance phénoménale des investissements de Bpifrance dans les fonds de fonds privés français, avec 800 millions d’euros investis en 2014.
Nous souhaitons ainsi en savoir plus sur les orientations de ces investissements, les objectifs poursuivis et le suivi que la BPI en effectue.
M. Daniel Balmisse, directeur des fonds de fonds chez Bpifrance. Je suis heureux de pouvoir vous présenter cette activité de fonds de fonds qui est méconnue, probablement mal comprise et pourtant importante.
Il est vrai que l’on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles Bpifrance, qui a pour objet de participer au développement des PME, investit dans des fonds. Cette activité s’appelle l’activité de fonds de fonds, puisque nous gérons des fonds de fonds qui investissent eux-mêmes dans des fonds, qui in fine investissent dans les PME.
La première raison fondamentale est qu’une activité fonds de fonds permet d’avoir un effet démultiplicateur sur le nombre de PME financées. Aujourd’hui nous sommes ainsi indirectement présents dans plus de 3 000 PME. Ce serait impossible par le seul investissement direct.
La deuxième raison fondamentale est que nous sommes ainsi en mesure d’agir sur le développement de l’écosystème du financement. Cela nous permet d’agir sur les parties de la chaîne du financement qui sont insuffisamment développées. Par exemple, grâce au Programme des Investissements d’Avenir (PIA) et au Commissariat Général à l’Investissement (CGI) qui nous ont confié le Fonds national d’amorçage (FNA) nous avons pu régénérer une activité d’investissement dans l’amorçage, puisqu’aujourd’hui nous avons investi plus de 300 millions d’euros dans dix-sept fonds. Cela donne au total près de 650 millions d’euros disponibles pour la phase d’amorçage, c’est-à-dire la première phase de développement des entreprises technologiques.
La troisième raison est que nous attachons une importance forte à la fois à l’impact socio-économique de notre action dans les territoires, et aussi à un retour sur investissement soutenable à long terme pour permettre à Bpifrance d’exercer son activité à long terme.
Les moyens pour y parvenir sont de trois natures :
– la structuration de la chaîne de financement, j’y reviendrai ;
– l’effet d’entraînement sur les investisseurs privés vers les PME, car nous agissons très en amont de la mise en place des fonds. Nous sommes souvent conseil sur la structuration du fonds, nous sélectionnons les équipes, nous effectuons des « due diligences » très poussées et in fine nous négocions les termes et conditions, c’est-à-dire tout ce qui va gérer la vie du fonds, dont les frais de gestion. Ainsi, dès lors que nous avons apporté notre label sur les fonds, les investisseurs privés nous font confiance, pour ensuite venir investir à nos côtés.
– la professionnalisation des équipes de gestion, pour laquelle nous avons des exigences très fortes. En tant que souscripteur, nous travaillons en lien très étroit avec les investisseurs privés dont nous exigeons des reporting très précis et des actions au niveau de l’investissement socialement responsable. Nous demandons également que les gérants des fonds accompagnent de plus en plus les PME, avec la volonté, par exemple, de développer l’activité à l’export de nos entreprises.
Au centre de l’écosystème, se trouvent les PME dans lesquelles investissent en direct Bpifrance Investissement mais aussi tout un ensemble de fonds, fonds d’amorçage, de capital-risque, de capital-développement... Via l’activité de fonds de fonds nous sommes souscripteurs d’une partie de ces fonds, au même titre que les assureurs et les banques régionales et – de moins en moins, il faut bien le dire – les banques nationales. Nous investissons également au côté des collectivités territoriales dans les fonds régionaux, mais aussi au côté d’investisseurs étrangers, d’autres fonds de fonds privés ou des caisses de retraite, en bref toute la panoplie des investisseurs institutionnels.
Notre direction gère plusieurs fonds de fonds puisqu’un fonds de fonds peut avoir une spécificité : il peut être orienté plutôt vers les fonds régionaux, ou les fonds de capital-risque ; il peut être également généraliste. Ces fonds de fonds sont bien sûr souscrits par Bpifrance puisque nous y investissons les fonds propres de la Bpi, mais aussi par des investisseurs qualifiés « de tiers ». Parmi ces investisseurs tiers nous pouvons citer le Fonds Européen d’Investissement (FEI), l’État avec le PIA, la Direction des fonds d’épargne mais aussi historiquement une banque italienne qui a souscrit à un de nos fonds de fonds régionaux.
À partir de ces fonds de fonds nous investissons dans les fonds partenaires qui eux-mêmes investissent dans les PME et sont susceptibles de co-investir entre eux mais aussi avec Bpifrance dans son activité d’investissement direct. Dans ces fonds partenaires nous sommes aux côtés des souscripteurs privés.
Au sein de la direction des fonds de fonds nous avons une activité commune : l’investissement dans des fonds mais avec trois spécificités, ce qui explique que la direction soit organisée en trois pôles.
Le premier pôle est celui des fonds régionaux, qui sont très importants puisque 90 de nos 300 fonds sont des fonds régionaux. Il existe une équipe dédiée pour répondre à cette problématique particulière. En effet, participent à ces fonds régionaux des collectivités locales, des banques mutualistes et Bpifrance mais aussi parfois des industriels locaux. Des échanges permanents ont lieu entre les conseils régionaux, les banques mutualistes et Bpifrance sur l’orientation de la gestion et la structuration des fonds. Cette activité est donc très intense et nécessaire puisque les fonds régionaux sont à la fois très proches des territoires et des entreprises.
Le deuxième pôle est orienté capital technologique et international. Il y sera traité tout ce qui concerne les entreprises de haute technologie et les fonds internationaux. Nous avons, en effet, mis en place des fonds bilatéraux, comme, par exemple, le fonds franco-chinois, dans le but d’accompagner les entreprises françaises en Chine et nous avons d’autres projets de cette nature. Ce sont là des problématiques très particulières, qui concernent de jeunes entreprises qui n’ont pas encore de marché ni de modèle économique et qui nécessitent une compréhension très fine de ces sujets.
Troisième pôle, l’équipe fonds de capital développement. Cette équipe va s’intéresser au capital développement au sens où l’on investit en fonds propres dans des sociétés existantes plutôt traditionnelles pour les aider à se développer. Mais elle va aussi traiter les sujets de fonds de retournement, de fonds de mezzanine (qui sont intermédiaires entre des fonds de dette et des fonds propres), ainsi que des fonds de dette.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Quels sont les effectifs de cette direction ?
M. Daniel Balmisse. Nous sommes aujourd’hui dix-huit personnes et nous avons recruté cette année trois chargés d’affaires, puisque l’activité est en forte expansion. Nous avons de plus en plus de fonds dans les portefeuilles, ces recrutements sont donc nécessaires.
C’est une équipe modeste en termes d’effectifs pour gérer des montants très significatifs.
L’histoire des fonds de fonds est née pour nous en 1994 avec les fonds régionaux. Il s’agissait, après l’arrêt des sociétés de développement régional (SDR), de reconstituer un tissu de fonds régionaux de capital-investissement très actifs et impliqués dans les régions. En 1998, a été créé le Fonds public/Fonds BEI pour le capital-risque à la suite de la privatisation de France Télécom. En 1999, ont eu lieu les premiers financements de fonds d’amorçage. En 2006, la même logique a été poursuivie avec le lancement de l’activité fonds de capital développement pour les PME. En 2013, lors de la création de la BPI, le constat a été fait que la nécessité de densifier le tissu des gérants de capital-risque et de capital-développement s’était estompée mais qu’il fallait faire croître les fonds plus méritants, c’est-à-dire consolider le secteur, pour que des fonds plus gros puissent accompagner plus fortement les entreprises dans leur besoin de financement. Au terme de cette phase marquée par le lancement de fonds dédiés au capital-risque, au capital-développement, au capital-investissement régional, aujourd’hui, la BPI gère 13 fonds de fonds.
Aujourd’hui, un enjeu majeur est celui de la structuration de la chaîne de financement. C’est pourquoi nous investissons à tous les stades. Nous faisons du capital-amorçage (pour une équipe qui a un projet mais n’a pas encore de modèle économique) ; nous faisons également du capital-risque (démarrage commercial quand le marché commence à se dessiner) à tous ses stades ; nous faisons aussi du capital développement. Cela concerne des sociétés traditionnelles ou technologiques – dans ce dernier cas, on se rapproche plus du capital-innovation en raison de l’hyper croissance, de l’ordre de 50 à 60 % par an qui n’existe pas pour les entreprises traditionnelles. Nous faisons également du capital-transmission, sans être présent sur le secteur des LBO car nous ne recherchons pas les opérations financières. Notre objectif est bien de permettre le transfert d’une entreprise d’un dirigeant qui part à la retraite à une nouvelle génération de managers pour pérenniser le tissu industriel et nous effectuons uniquement des opérations primaires. Enfin, nous avons une activité d’investissement dans ce qu’on appelle pudiquement les entreprises « sous-performantes », ce qui revient à du capital-retournement. Nous sommes toujours à la recherche de fonds dans ce secteur, dès lors que les gérants respectent une certaine équité.
J’aimerais maintenant évoquer notre méthode de travail qui consiste à effectuer une sélection approfondie des fonds et des équipes de gestion. Afin de s’assurer de leur qualité, nous rencontrons les équipes de gestion, nous en interrogeons les membres individuellement et nous sollicitons leurs interlocuteurs. Cela permet de vérifier l’éthique de l’équipe gérante. Une fois la décision de souscription autorisée par les instances dirigeantes de Bpifrance, nous négocions le contrat qui va régir la relation entre le fonds et ses souscripteurs. Ce contrat vaut souvent pour une période de quinze ans. Cela contribue à l’effet d’entraînement sur les investisseurs privés car nous sommes toujours minoritaires et en co-investissement. Nous réalisons le premier « closing », sans exclure de participer aux suivants s’il y a de nouvelles levées de fonds. Cet effet d’entraînement se traduit par le fait que pour 1 euro apporté par Bpifrance, 4 euros viennent des souscripteurs privés.
Corollairement, nous aidons également à la professionnalisation des équipes de gestion. Nous répondons à leurs interrogations et nous les orientons. Nos exigences en matière de reporting sont très élevées. Nous exigeons des données très précises sur la situation socio-économique de l’entreprise mais aussi en matière sociale, environnementale et de gouvernance, et nous demandons aux gérants d’être proactifs en la matière.
Enfin, il y a un suivi dynamique des participations par notre présence au comité consultatif d’investissement – quand il existe – et systématiquement au comité des souscripteurs. C’est ainsi que nous pouvons contribuer à la réorientation éventuelle de la stratégie du fonds. Le suivi se traduit par une valorisation de nos investissements tous les trimestres ou tous les semestres en fonction des fonds de fonds. Un système de gestion des risques très pointu nous permet d’estimer le retour que l’on peut attendre à terme.
Nous avons aujourd’hui 300 fonds partenaires gérés par 130 gérants. S’y ajoutent 30 à 40 fonds nouveaux par an en moyenne. 3,7 milliards d’euros sont souscrits dans ces fonds avec un effet d’entraînement de 5, ce qui fait au total 17,5 milliards disponibles dans 300 fonds au service des PME. La moitié de ces véhicules sont actifs et continuent à investir. Les fonds peuvent être soit des SCR (Société de capital risque) soit des FPCI (Fonds professionnel de capital investissement). Les SCR ont une durée de vie illimitée. Les FCPI sont limités dans le temps à 10-15 ans. Ils s’autoliquident donc au bout de 15 ans. L’investissement dans les FCPI se déroule, en effet, en trois phases : d’investissement (de 5 ans), de maturation (de 5 ans) et de liquidation. La moitié des véhicules sont actifs, les autres étant dans la phase de maturation ou d’extinction. Le schéma classique consiste à investir dans un premier fonds pendant 5 ans, puis dans un deuxième pendant que le premier est en maturation et ainsi de suite. Pendant cette période le premier fonds est passé en phase d’extinction.
3 000 entreprises sont financées en bout de la chaîne, ce qui serait impossible par du financement direct.
Je voudrais illustrer la diversité de nos actions. Dans le domaine de l’innovation, nous avons financé CapAgro Innovation qui est un nouveau fonds dédié au capital-amorçage et capital-risque dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie et le seul dans ce secteur. Nous avons financé l’année dernière Electranova fonds de capital-risque spécialisé dans les énergies renouvelables. Nous avons également financé le fonds régional Aquitaine Création Investissement qui est une SCR à vocation généraliste et Cap’Innovest, fonds d’amorçage interrégional qui intervient dans les régions Alsace, Franche-Comté et Bourgogne. Nous avons aussi une action à impact social, puisque nous avons investis dans le fonds Impact Partenaires qui finance des entreprises créées dans les cités. Je souhaiterais citer le Fonds Perceval qui est un fonds de retournement dans lequel nous sommes souscripteurs depuis mars 2014 ; ce fonds a levé 200 millions d’euros et notre part s’est élevée à 25 millions d’euros. Je voudrais parler aussi du fonds FCDE (Fonds de consolidation et de développement des entreprises) mis en place en partenariat avec des banques et des assurances pour investir dans ces situations spéciales. Nous y avons investi 70 millions d’euros fin 2014 sur une levée de fonds de 140 millions, et nous avons pour objectif d’investir 20 millions supplémentaires dès lors que le fonds attendra 200 millions d’euros.
Quelques exemples permettent de mesurer l’impact de ces fonds. LDR est une société qui travaille dans le secteur des implants ; elle a été financée par un de nos fonds d’amorçage régional, puis par un deuxième fonds Keensight, qui a accompagné cette entreprise de quelques milliers d’euros de chiffres d’affaires jusqu’à plus de 100 millions. Cette société est aujourd’hui cotée sur le NASDACQ. Le même scénario s’est produit pour DBV technologie : deux de nos fonds d’amorçages avaient investi, puis avaient été rejoints par des fonds de capital-risque, ensuite par Bpifrance en direct, et cette société a fini par être cotée sur le marché boursier américain. La majorité de son activité est en France bien sûr. Critéo a été financé dès le départ par un de nos fonds de capital-risque.
Enfin, je soulignerai le cas de Juratoys. Cette société a bénéficié d’un investissement de notre fonds franco-chinois qui l’a accompagné sur le marché chinois. Ses produits sont désormais commercialisés dans l’enseigne chinoise Kingsland, un des premiers distributeurs de jouets en Chine, et la société connaît un très fort développement. Elle représente un exemple très concret de soutien à l’exportation.
Je peux citer d’autres exemples, tels Adista, opérateur de services dans l’Est de la France, qui emploie 300 personnes et dégage un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros, ou Mecachrome, active dans l’aéronautique. La BPI a un fonds entièrement dédié à ce domaine si important pour notre pays, AeroFund. Elle est ainsi présente aux côtés des industriels du secteur quand cela est nécessaire. J’évoquerai enfin BH Technologies, spécialisée dans les équipements de gestion d’énergie et d’environnement. Très innovante, elle est financée par un de nos fonds partenaires historiques, Siparex.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Ma première question porte sur vos objectifs : on comprend bien l’intérêt de l’« accompagnement démultiplié des PME de croissance », dont l’impact financier est multiplié par cinq, du « développement de l’écosystème du financement des PME » et du « retour sur investissement soutenable à long terme ». Pouvez-vous préciser la part de chacun de ses objectifs dans vos actions et quelles sont vos attentes en matière de retour sur investissement ?
Vous avez souligné par ailleurs l’intérêt de la participation des banques régionales dans la constitution de vos fonds de fonds, en observant toutefois que les banques nationales répondaient moins à l’appel. Quelles en sont les raisons ? Quelles actions permettraient de les mobiliser ?
Enfin, entre le premier contact avec le gestionnaire et le versement des fonds aux entreprises, vous avez décrit plusieurs étapes. Combien de temps cela prend-il ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Parmi vos 330 fonds partenaires, quelle est la part des fonds de retournement, que l’on sait présenter un risque particulier ? Comment suit-on ces 330 fonds qui pour certains réinvestissent dans d’autres fonds qui eux-mêmes investissent ailleurs ? Cela peut créer une escalade dans les risques qui sont pris. Il est important pour les PME que des risques soient pris, mais jusqu’où peut-on aller et comment évaluer la part de ces risques ?
Pouvez-vous nous expliquer comment votre système fonctionne concrètement ? Par exemple, comment la BPI participe à un fonds régional ?
Enfin, avez-vous des outils de comparaison, un avis sur les différences de fonctionnement entre les fonds existant en France, dans nos régions, et les fonds allemands ? Comment pourrait-on monter en gamme ?
M. Daniel Balmisse. S’agissant du retour sur investissement dit soutenable, il est important de souligner que notre attente n’est pas de même nature que certains autres souscripteurs qui demandent traditionnellement un retour de l’ordre de 15 %. Bien sûr comme nous souscrivons aux côtés d’investisseurs privés nous pouvons nous trouver dans des fonds qui ont ce type de retour, mais nous participons aussi à d’autres fonds qui ont un retour beaucoup plus modeste. Au total, nos objectifs sont compris entre 4 et 6 % sur l’activité de fonds de fonds.
Comment s’en assure-t-on ? Un fonds évolue selon une courbe une courbe en J. En tant que fonds de fonds nous investissons, par exemple, dans un fonds partenaire qui aurait levé 100 millions d’euros sur lesquels est perçue annuellement une commission de gestion de l’ordre de 2 %, si l’on retient le taux moyen. Les fonds levés ne sont pas versés immédiatement. Le gérant ne les appelle que lorsqu’il en a besoin, soit pour investir dans des PME, soit pour payer ses frais de gestion. La première année, il peut ne mobiliser que 10 % des fonds, soit 10 millions d’euros, dont 2 millions d’euros (2 % de 100 millions) seront utilisés pour ses frais de gestion. Au début, n’apparaissent donc, mécaniquement que des sommes en négatif. Cependant, à un moment donné, les participations qui auront été prises sont revalorisées – plus ou moins rapidement selon que l’on est en capital-risque ou en capital-développement – et les comptes deviennent positifs. En réalité, cette première phase négative, qui peut durer cinq à sept ans, ne veut rien dire. Pour donner un exemple, un de nos fonds de fonds en capital-risque, créé en 2001, est resté négatif jusqu’en 2013, puis est devenu très positif en juillet 2013 grâce à deux sociétés, dont Critéo, et il restera positif.
Nous avons un suivi des risques très précis : deux fois par an nous notons chaque fonds. Notre avis se fonde sur plusieurs critères, qualitatifs et quantitatifs. Nous disposons d’un algorithme qui compare les profils de nos fonds, nos appréciations qualitatives et quantitatives, avec une base de données sur des fonds historiques et mondiaux similaires et, par des méthodes stochastiques, permet d’estimer le retour à terme. Il existe peu d’outils aussi performants, même dans le privé. Je l’ai lancé il y a quatre ans pour prendre en compte diverses préoccupations : la mise en œuvre de la réglementation applicable à la Caisse des dépôts et celle de la directive AIFM pour le private equity, mais aussi pour mesurer opérationnellement les risques que nous prenons en tant que fonds de fonds.
Qu’en est-il des risques d’escalade ? Nos fonds de fonds n’investissent que dans des fonds auxquels il est interdit d’investir dans d’autres fonds, mais seulement dans des PME. Nous n’excluons pas cependant d’investir, de façon très limitée, dans d’autres fonds de fonds dès lors qu’ils agissent dans le même champ d’action que le nôtre et contribuent ainsi à apporter de l’argent privé sur les segments de marché qui en manquent. C’est particulièrement le cas du capital-risque, du capital d’amorçage et plus généralement des petits fonds en capital-développement. Les investisseurs privés veulent en général déployer des montants importants dans de grands fonds. Or, plus nous avons de capitaux privés à nos côtés, mieux nous pouvons agir sur ces secteurs. Mais ces dérogations ne concernent que quelques fonds de fonds. La chaîne s’arrête après deux niveaux, ce qui nous permet de contrôler les effets de cascade. Et nous nous attachons à maîtriser les frais de gestion.
Il faut comprendre enfin que nous nous inscrivons dans un temps long. Quant à comparer avec d’autres pays, si nous considérons l’Allemagne, nous nous rendons compte qu’il n’y a pas eu, au cours des années, de politique stable de soutien à l’industrie du capital-investissement au bénéfice des PME. Avant la crise de 2001, notre homologue, KFW, avait une activité de fonds de fonds ; après la crise presque tous les fonds de capital-risque ont disparu en Allemagne et KFW a abandonné cette activité. Aujourd’hui ils souhaitent relancer leur activité de fonds de fonds. La situation française est incomparablement meilleure que celle de l’Allemagne en matière de capital-investissement et notamment de capital-risque. La constance de la politique française à soutenir ces domaines depuis vingt ans a été très positive. Grâce à elle, nous disposons d’une industrie du capital-investissement au tissu très dense, même si on doit l’améliorer, en faisant croître certaines équipes.
S’agissant des fonds régionaux, l’Allemagne a bien une logique différente de celle pratiquée dans notre pays. Nous avons eu l’occasion de découvrir le fonds régional de Bavière : de taille conséquente avec 200 millions d’euros de fonds propres et 100 millions d’euros de dettes, il est financé par l’État fédéral, l’État de Bavière et la Bayerisch landesbank. Les actionnaires n’y perçoivent jamais de dividendes, grâce à quoi ils ne font jamais d’augmentation de capital. Ce modèle est intéressant et mériterait réflexion.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. J’ai rencontré récemment plusieurs représentants d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Une de leurs difficultés est de n’avoir pas aisément accès aux financements de long terme nécessaires à leur développement. Cela pourrait expliquer, pour partie au moins, la diminution du nombre des ETI entre 2013 et 2014. Les outils qui existent sont probablement insuffisants.
M. Daniel Balmisse. Vous pourrez interroger sur ce sujet M. Jean-Yves Gilet de la direction dédiée aux ETI et grandes entreprises au sein de BPI France.
Dans le cadre de l’activité fonds de fonds, nous sommes également mobilisés sur cette question, à travers, par exemple, du Fonds Industrie et finances qui est entièrement spécialisé dans le Build up. Il est en effet aussi important de créer que de soutenir la croissance externe d’une ETI. Ce fonds se consacre à la construction, à partir de petites entités, d’entreprises susceptibles de devenir des ETI.
Néanmoins, nous constatons souvent des réticences, parmi les actionnaires familiaux, à ouvrir le capital de leur entreprise, ce qui a pu les inciter à privilégier un financement par la dette, plutôt qu’un financement par fonds propres. Un important travail doit être mené afin de rassurer ces actionnaires familiaux, et d’établir des liens de confiance, grâce à un accompagnement en amont et dans la durée.
S’agissant des fonds de retournement et de leur part dans notre portefeuille : dix fonds de retournement, pour des « situations spéciales », sont gérés par six équipes. Ces fonds représentent un montant total de souscriptions près de 204 millions d’euros, sur un total de 3,7 milliards d’euros. Plus de trente millions d’euros sont par ailleurs en attente de souscription, notamment 20 millions d’euros pour le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises 2 (FCDE 2) et environ quinze millions d’euros destinés au Fonds Opportunités Régions. Il s’agit donc d’un sujet important, mais les risques afférents restent maîtrisés. Est également en cours d’examen un projet lancé par une équipe d’une grande éthique ; ce critère s’avère fondamental pour Bpifrance, pour prendre la décision d’investir.
S’agissant de la présence des banques nationales et régionales, les secondes sont naturellement intéressées par notre présence dans leur territoire, du fait de l’attention qu’elles portent au renforcement des fonds propres de leurs clients. Elles sont aussi à nos côtés dans les fonds régionaux, tout en créant parfois des fonds qui leur sont propres, ou en réactivant de structures anciennes. Quant aux banques nationales, elles se tournent largement vers leurs sociétés d’assurance-vie et n’investissent plus en fonds propres. Plusieurs d’entre elles prennent part au programme Bpifrance Assurance, axé sur l’investissement dans des fonds dédiés à des PME. Ce programme vise à inciter les établissements bancaires et d’assurance à réaliser des co-investissements avec Bpifrance : avec cinq partenaires – CNP, Cardiff, Crédit Agricole Assurance, Allianz et Axa France, près de 700 millions d’euros ont été déployés depuis 2012. La phase 3 de ce partenariat sera engagée en mars prochain, afin de développer cet engagement et le pérenniser.
Enfin, les délais d’instruction des dossiers diffèrent de ceux constatés en matière d’investissement direct, puisque nous pouvons être sollicités très en amont. Le temps d’instruction s’avère très variable et il est difficile de faire une moyenne : le délai oscille entre trois mois et plus d’un an, sans que cela ait de conséquence puisqu’il n’y a pas derrière chaque fonds une entreprise qui aurait besoin immédiatement de capitaux. Ce délai n’est pas lié à notre propre fonctionnement, mais davantage aux caractéristiques spécifiques de notre activité. Nous devons souvent procéder au « formatage » d’un projet, pour que celui-ci soit attractif pour les investisseurs privés, et ce formatage peut être très long, voire ne pas aboutir.
Audition du 5 février 2015
Mme Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de Bpifrance, chargée des partenariats régionaux et de l’action territoriale
Mme la présidente Véronique Louwagie. Mes chers collègues, nous accueillons Mme Marie Adeline-Peix, directrice exécutive Bpifrance, chargée des partenariats régionaux et de l’action territoriale. Je précise que vous n’êtes pas en charge de la gestion du réseau Bpi en région qui est assurée par M. Joël Darnaud que nous auditionnerons également, mais du partenariat avec les régions, de l’animation des Comités régionaux d’orientation (CRO) prévus par la loi et du conventionnement avec les régions.
Quels montants Bpifrance mobilise-t-elle aux côtés des régions ? Comment répondent-ils aux stratégies régionales ? Pouvez-vous nous donner des exemples de partenariats ?
Mme Marie Adeline-Peix, directrice exécutive de Bpifrance, chargée des partenariats régionaux et de l’action territoriale. Mesdames, messieurs les députés, les partenariats régionaux sont importants compte tenu de l’attachement de Bpifrance à la territorialisation de son action.
Quand on parle de partenariats régionaux, on évoque deux éléments, à la fois complémentaires et différents. D’une part, nous sommes en lien étroit avec les régions parce qu’elles sont membres de notre gouvernance. D’autre part, nous avons mis en place avec elles des dispositifs qui nous permettent d’accompagner au mieux les entreprises de leur territoire. C’est une forme de partenariat qui est moins « gouvernementielle », moins stratégique et beaucoup plus concrète.
Les régions sont partie prenante de la gouvernance de Bpifrance à plusieurs niveaux et d’abord au niveau national puisqu’elles sont membres du conseil d’administration et qu’elles président le Comité national d’orientation (CNO).
Il existe vingt-sept comités régionaux d’orientation – ils sont présents également outre-mer. Ils sont présidés par le président du conseil régional et mobilisent vingt-six membres, représentants de la société civile, élus, mais aussi représentants du monde économique via les CESER, les chambres consulaires, les partenaires sociaux, les représentants qualifiés.
On constate que le mode de fonctionnement des CRO varie selon les régions. Nous y sommes systématiquement associés, puisque les directeurs régionaux de Bpifrance en assurent le secrétariat. Mais la fréquence de réunion de ces comités, le contenu de leur ordre du jour, le périmètre des sujets évoqués varient selon les souhaits exprimés par le président de la région.
Depuis la mise en place de Bpifrance, quatre-vingt-trois comités se sont réunis, certains avant les décrets créant ces CRO. L’année dernière, quarante-cinq comités se sont réunis. Il existe quelques régions où les CRO ne se sont pas réunis, parfois pour des raisons très conjoncturelles. Je pense, par exemple, à la région Languedoc-Roussillon. Dans certaines régions, les CRO se sont réunis régulièrement. C’est le cas de la région Champagne-Ardenne qui réunit son comité une fois par trimestre, alors que la loi prévoit deux réunions par an.
Il s’agit bien de comités d’orientation et non d’engagement : ils ne prennent pas de décision sur les dossiers, ils n’ont pas vocation à examiner les dossiers individuels. Ils travaillent sur des aspects plus stratégiques et opérationnels de mise en œuvre de l’action de Bpifrance sur le territoire. Ils ont vocation à donner un avis sur la façon dont Bpifrance agit, notamment en lien avec la stratégie régionale de développement économique.
Dans certaines régions, il a été fait le choix de ne pas concentrer exclusivement le contenu et les missions de ce comité à la seule action de Bpifrance mais d’en élargir le champ à d’autres sujets, notamment à la stratégie régionale de développement économique, aux priorités du territoire, à la présentation des stratégies en matière d’innovation, ce que l’on appelle les 3S. Par exemple, la région Limousin a fait le choix, dans le périmètre de son comité, de réunir à la fois les membres du CRO et ceux du comité de pilotage qui préexistait de sa stratégie régionale de développement économique afin d’assurer le lien entre Bpifrance et l’écosystème local. Il est important, me semble-t-il, que les CRO ne se focalisent pas uniquement sur l’action de Bpifrance mais qu’ils mettent cette action en perspective avec les réalités territoriales.
Nous faisons systématiquement le point sur l’action de Bpifrance durant les mois précédents et sur les problématiques économiques du territoire. La Banque de France est très souvent représentée et elle apporte une vision de la situation économique et des entreprises.
Des sujets plus particuliers sont mis à l’ordre du jour du CRO en fonction du souhait de son président. Plusieurs comités ont évoqué par exemple l’économie sociale et solidaire, le financement des TPE, parfois des sujets plus sectoriels comme l’économie résidentielle. Certains territoires ont travaillé ces derniers mois sur des stratégies spécifiques. Je pense à la Lorraine avec le Pacte Lorraine, ou à la Bretagne avec le Pacte d’avenir. De même, les conventions de partenariat, qui portent plus sur le deuxième aspect de notre action avec les régions, que l’on a signées ou validées avec dix-sept régions en France, ont souvent été examinées par le comité avant d’être adoptées. Ces conventions mettent en valeur la stratégie régionale, les priorités du territoire et les actions qui peuvent être mises en place avec Bpifrance.
Le CRO, dont le fonctionnement varie selon les régions et l’implication, permet donc l’instauration d’un débat.
Les régions sont partie prenante de notre gouvernance. À l’inverse, ou en complémentarité, nous sommes très souvent associés à un certain nombre de structures régionales. Par exemple, la BPI est souvent membre des agences régionales et acteurs de ces agences. Nous avons été sollicités récemment par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a fusionné deux de ses outils pour créer une agence pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises. Nous sommes membre fondateur de cette agence. De la même manière, la région Île-de-France, qui a fusionné un certain nombre de ses outils pour créer Paris Region Entreprises (PRE), nous a demandé d’en être membre fondateur. Nous participons à leur gouvernance avec la vision de Bpifrance pour ce qui concerne les conditions d’accompagnement des entreprises. Nous sommes systématiquement partie prenante des plates-formes d’orientation physiques qui ont souvent été mises en place par les régions et qui étaient préalablement portées par la Caisse des dépôts. Ce sont des outils de coordination de l’ensemble des acteurs locaux qui sont plus ou moins dynamiques, très dynamiques en Franche-Comté par exemple où l’ensemble des acteurs de l’écosystème d’accompagnement des entreprises sont mobilisés sous l’impulsion de la région pour mieux accompagner les besoins des entreprises.
Nous sommes extrêmement attachés à un autre aspect de l’action de la BPI qui consiste à répondre, concrètement et au quotidien, aux besoins des entreprises. Nous avons mis en place, principalement avec la collectivité régionale, qui est le chef de file du développement économique, des outils qui couvrent l’ensemble de ces besoins.
Nous avons d’abord mis en place avec les régions les fonds régionaux de garantie (FRG) qui nous permettent de faciliter l’accès au financement des entreprises de leur territoire. Comme vous le disait la semaine dernière le directeur général de Bpifrance, ces fonds de garantie sont l’un des dispositifs les plus utiles et les plus faciles pour accéder aux besoins de financement des TPE. Il y a actuellement vingt-deux fonds de garantie en France. Ces fonds sont abondés par les régions qui fixent les priorités d’utilisation des financements. Ils nous permettent d’accompagner davantage d’entreprises et surtout d’augmenter la quotité de risques pris. Avec des fonds nationaux, nous intervenons en général au maximum à 50 %. Grâce à l’intervention de la région, la part du risque garanti est de 70 %, ce qui permet d’accompagner des projets plus risqués que des banques n’accepteraient pas, même avec 50 % de garantie. Ces fonds nous permettent de couvrir environ 250 millions d’euros de risques par an pour une dotation des régions de 30 à 40 millions d’euros. Il y a donc un effet de levier considérable. Ces 250 millions d’euros de risques permettent de couvrir un peu moins de 800 millions de prêts. Avec les fonds de garantie, nous avons donc une vraie capacité d’intervention et de facilitation de l’accès au crédit pour les entreprises, notamment pour les TPE.
Cet outil a aussi l’avantage de permettre une grande réactivité et une adaptation quasiment en temps réel aux besoins constatés des entreprises. Par exemple, lors de la crise de 2008-2009 les régions se sont demandé comment faire pour soutenir l’économie locale et résoudre l’accès au crédit. La plupart d’entre elles ont utilisé ces fonds de garantie mis en place à l’époque avec Oséo, ce qui a permis de soutenir les trésoreries et de faciliter la structuration financière des entreprises. Ces outils s’adaptent très bien aux stratégies régionales.
La région Rhône-Alpes a souhaité que l’on intervienne principalement en transmission avec les fonds de garantie. En Bretagne, un dispositif spécifique nous permet de garantir les entreprises de la pêche. Les outils s’adaptent donc en fonction des priorités régionales, même s’ils sont construits de façon systématique au niveau national.
Nous avons également développé avec les régions un dispositif de soutien à l’innovation via les fonds régionaux d’innovation (FRI) qui nous permettent d’intervenir en subvention, avance remboursable et prêt. Avec les régions PACA, Centre et Haute-Normandie, nous utilisons ces fonds régionaux d’innovation pour financer les projets de pôle de compétitivité soutenus dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI). Bpifrance apporte l’argent de l’État via le FIU et mobilise l’argent des régions via les fonds régionaux d’innovation quand elles nous le demandent.
En 2014, grâce à ces fonds nous avons soutenu environ 600 entreprises et accordé 40 millions d’euros d’aides. Le montant de la dotation de 2014 est plus important que le montant des aides accordées. Cela s’explique par le fait que ce ne sont pas des financements annuels. Parfois, les régions dotent le fonds de façon pluriannuelle. En réalité, le montant de nos interventions est supérieur au montant de la dotation mobilisée.
Le fonds régional d’innovation et le fonds régional de garantie permettent de mobiliser auprès des régions de l’argent de Bpifrance. C’est un avantage pour les entreprises car, même si on les accompagne avec des financements qui proviennent souvent de différentes sources – de l’État, de la région, parfois de l’Europe –, elles n’ont qu’à constituer un seul dossier. Les délais ne se cumulent pas et la décision est prise plus rapidement que si elle nécessitait un passage en commission permanente. Nous intervenons aux côtés des régions, ce qui veut dire que lorsque la région mobilise un euro, nous en garantissons deux. Et en réalité, grâce à un effet de levier, nous en garantissons cinq et même dix – cinq euros avec un euro de la région et cinq de notre côté.
Ces outils permettent donc de mobiliser l’argent public dans le domaine de l’innovation, là où l’argent est rare alors que les besoins sont très nombreux. Là encore, ce sont les priorités régionales qui sont prises en compte dans la mobilisation de ces financements.
Il existe aussi les prêts de développement territoriaux (PDT) d’une durée de sept ans, avec un différé d’amortissement en capital de deux ans. Quand la région mobilise un euro, nous prêtons cinq euros à l’entreprise et ces prêts s’adaptent, là encore, aux priorités de la région. Par exemple, nous avons un très grand partenariat sous forme de prêt de développement avec la région Bretagne et nous avons mis en place, lorsque le secteur agroalimentaire a connu des difficultés à la fin de l’année 2011 et en 2012, un prêt de développement territorial spécifiquement pour les ETI de l’agroalimentaire. La région nous a dotés de financements pour faciliter le rebond de ces entreprises.
De la même manière, avec la région Nord-Pas-de-Calais, la région Champagne-Ardenne, et la région Île-de-France sous une forme un peu différente, nous avons mis en place un prêt – qui s’appelle prêt rebond en Île-de-France mais dont le nom est différent selon les régions – qui permet d’accompagner des entreprises qui ne sont plus en difficulté – la réglementation européenne ne nous permet pas d’aider les entreprises dites en difficulté – mais dont la situation financière rend difficile l’accès au crédit bancaire classique alors qu’elles ont un vrai projet de développement et des besoins de financement matériels ou immatériels. Grâce aux financements de la région, nous sommes en mesure d’accompagner des entreprises qui ont de réels besoins de financement.
Enfin, même si nous ne sommes pas tout à fait dans la même relation de partenariat avec les régions, nous sommes aussi coactionnaires de quatre-vingt-quinze fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement. Les régions ne sont pas toutes parties prenantes à ces fonds. Les régions sont souvent coactionnaires à nos côtés des fonds d’amorçage qui sont les plus récents et montés pour des investissements d’avenir. Ces fonds, qui contribuent à la structuration de l’écosystème local du financement, permettent d’investir dans des domaines plus petits, plus risqués. Là encore, nous sommes aux côtés des régions pour ce faire.
Les fonds mobilisés par les régions et auprès desquels Bpifrance se mobilise interviennent en fonction des priorités stratégiques régionales. C’est essentiel pour nous. Ce sont les régions qui les définissent. Il existe un principe de codécision, mais la région peut faire le choix de nous déléguer entièrement cette décision. C’est ce que font certaines en dessous d’un certain plafond, c’est-à-dire quand le niveau de garantie ou le prêt sont faibles. Quand on est seul à décider, on décide plus vite.
Quand il y a des garanties, la région sait qu’elle doit décider très rapidement parce que la banque a besoin d’une réponse quasiment dans la semaine. Tout se passe très bien : nos chargés d’affaires échangent avec les chargés d’affaires de la région. Dans certaines régions, un vice-président est désigné pour donner un avis politique sur le dossier, dossier qui ne peut pas passer en commission permanente en raison de délais très courts. Mais la possibilité de codécision existe toujours.
De son côté, l’entreprise bénéficiaire est systématiquement informée du fait que l’aide est accordée avec l’argent de la région. Il y a une conotification des aides, parfois même une cosignature du président du conseil régional quand il le souhaite. Dans les contrats de prêts ou d’aide, il est systématiquement mentionné que la région participe, de même que le FEDER est systématiquement mentionné s’il est mobilisé. Nous proposons à la région de mener avec nous, si elle le souhaite, des actions de communication pour faire connaître ces dispositifs et les valoriser.
De façon plus large que la simple valorisation de ces dispositifs, nous avons déployé avec un peu moins de quinze régions des plates-formes d’orientation dématérialisées qui permettent de mettre en valeur, sur des sites extrêmement simples, l’ensemble de l’offre de Bpifrance et des partenaires sur le territoire. Cette valorisation de l’action commune est extrêmement importante parce que notre priorité c’est d’abord que l’entreprise ait une réponse rapide et efficace à son besoin. Nous sommes donc bien dans une logique où un seul dossier est déposé par l’entreprise et où une seule expertise est faite par Bpifrance. La décision peut être prise éventuellement par deux interlocuteurs, mais cela ne nécessite pas que le bénéficiaire soit obligé d’aller frapper à toutes les portes pour chercher des financements.
J’ajoute que ces dispositifs cherchent à être les plus performants possible en termes d’effet de levier et d’optimisation des financements publics. D’une certaine manière, Bpifrance gère l’argent des régions, elle mobilise des financements aux côtés des régions mais surtout elle assume les risques d’épuisement de ces fonds, c’est-à-dire que si le fonds devenait un jour déficitaire, elle ne demanderait pas de l’argent supplémentaire aux régions. C’est donc bien plus qu’un simple opérateur qui gérerait l’argent des régions comme un service financier. À ce titre-là, Bpifrance est un partenaire à part entière et elle est très attachée à ce partenariat.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez indiqué qu’il y avait vingt-sept comités régionaux d’orientation et que l’année dernière quarante-cinq comités s’étaient réunis. Cela veut donc dire que certains CRO ne se sont pas réunis à deux reprises, contrairement à ce que prévoit la loi. Y a-t-il un lien entre une mobilisation moindre de certaines régions qui pourrait transparaître au regard du nombre de réunions et les montants éventuellement déclinés dans les régions ? On s’aperçoit, en lisant les documents que vous nous avez donnés, qu’il y a des distorsions très importantes d’une région à l’autre.
Vous avez évoqué des partenariats avec l’Europe. Existe-t-il des partenariats avec les métropoles, avec de grandes intercommunalités ? Cela pourrait-il être le cas ultérieurement ?
Le dispositif de l’interlocuteur unique est-il toujours respecté ? Une entreprise qui serait implantée dans plusieurs régions aurait-elle la possibilité de faire des demandes dans chaque région ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Les dispositifs existants sont nombreux. Il existe aussi de multiples aides publiques aux entreprises. Le rapport Queyranne fait mention de plus de 5 400 aides dans les différents territoires de notre pays. Comment vous y retrouvez-vous vous-même ?
Les territoires d’outre-mer font-ils l’objet d’actions spécifiques compte tenu des difficultés auxquelles ils sont confrontés ?
Comment sont articulés les différents dispositifs avec le FEDER ?
Mme Marie Adeline-Peix. Vous me demandez s’il y a un lien entre le nombre de réunions du CRO et les montants déclinés dans les régions. En réalité, il n’y en a pas. Les CRO peuvent ne pas s’être réunis à deux reprises pendant l’année pour des raisons conjoncturelles. Par exemple, certains CRO ont changé de président durant l’année. Il est clair qu’un président de région qui s’installe a peut-être d’autres priorités que de réunir un CRO de Bpifrance.
Par ailleurs, il ne faut pas regarder les montants mobilisés de façon brute. On ne peut pas comparer le montant mobilisé par la région Limousin et celui de l’Île-de-France. Pour autant, le Limousin nous confie 80 % de ses budgets d’investissement en faveur de l’innovation. Cela représente beaucoup moins d’euros que ce que nous donne l’Île-de-France, mais ces montants sont essentiels pour accompagner au quotidien les entreprises innovantes en Limousin. Pour nous, c’est la traduction d’un partenariat et d’une confiance très forte. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les régions qui nous donnent beaucoup d’argent ne nous font pas confiance.
Je pense que c’est aux régions qu’il faudrait demander pourquoi elles réunissent ou non leur comité régional d’orientation. En réalité, nous avons des contacts quotidiens avec la région qui ne passent pas par ces comités. Ces contacts portent sur des échanges sur la situation de telle ou telle entreprise. Les CRO sont des réunions qui visent à entendre et échanger avec l’ensemble d’un écosystème. Mais ils n’ont pas vocation à être opérationnels au quotidien.
Nous sommes convaincus que la notion de guichet ne correspond pas à la réalité du fonctionnement d’un entrepreneur au xxie siècle. L’entrepreneur n’a pas besoin qu’un endroit soit ouvert de neuf heures à douze heures et de quatorze heures à seize heures à l’exception des veilles de fête où il serait fermé à quinze heures trente. Il a besoin de pouvoir avoir, quasiment en temps réel, et si besoin à trois heures du matin, une information sur la façon dont il peut trouver un soutien dans le territoire où il est implanté. C’est pourquoi nous avons mis en place des plates-formes dématérialisées. Celles-ci ont aussi vocation à permettre à l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement des entreprises sur le territoire de s’orienter dans la masse des dispositifs de soutien et d’intervention. Ces plates-formes ne fournissent pas soixante-quinze pages d’informations à un entrepreneur qui devra les lires de la première à la dernière page. Ces plates-formes sont vraiment construites comme des outils d’orientation. Par exemple, une entreprise innovante, de moins de trois ans, avec un capital de tant qui veut investir à l’international doit pouvoir savoir rapidement quels dispositifs existent sur son territoire et quel sera l’interlocuteur le plus performant qui pourra répondre à sa question. Nous travaillons donc avec les régions pour connaître les besoins des entreprises de leur territoire, savoir quel sera le meilleur interlocuteur qui pourra répondre à telle ou telle question.
M. le rapporteur. M. Balmisse nous a indiqué tout à l’heure que la BPI avait investi dans 330 fonds et qu’il existait 95 fonds régionaux et interrégionaux. Quelle est la distinction entre ces fonds ? Certains fonds sont-ils gérés par la direction des fonds de fonds ? Les choses se recoupent-elles et comment ?
Mme Marie Adeline-Peix. Les fonds sont tous gérés par la direction des fonds de fonds qui comprend une division qui ne s’occupe que des fonds régionaux. Les interlocuteurs sont répartis par territoire et chacun siège dans ces fonds régionaux, souvent aux côtés de notre directeur régional. Nos directeurs régionaux ont une vision à 360 degrés, du financement à l’investissement en passant par l’investissement en fonds de fonds. Nos directeurs régionaux connaissent l’ensemble de la palette et sont les interlocuteurs de l’entreprise.
M. le rapporteur. Cela veut-il dire que sur le montant total des souscriptions de la BPi dans les fonds, 575 millions sont consacrés aux fonds régionaux et interrégionaux ?
Mme Marie Adeline-Peix. Les ordres de grandeur sont bien ceux que vous indiquez.
En même temps, les fonds nationaux interviennent sur le territoire. Il y a des logiques qui font que l’on choisit plutôt d’intervenir au niveau national que régional et interrégional ou l’inverse. S’agissant des fonds d’amorçage par exemple, on intervient systématiquement sur des fonds interrégionaux puisque cela fait partie de la doctrine d’investissement du programme d’investissement d’avenir (PIA) pour avoir un niveau de deal flow suffisant, mais on intervient aussi dans des fonds d’amorçage nationaux.
Ce qui est important, c’est que tout cela soit totalement transparent pour les entreprises. Nos directeurs régionaux – et Joël Darnaud reviendra sûrement sur ce sujet – doivent être en mesure de répondre aux besoins des entreprises qui ne sont d’ailleurs pas forcément exprimés et de faciliter le financement de leur projet. Parfois, l’entreprise arrive avec l’idée qu’il lui faut absolument un prêt à taux zéro ou une subvention alors qu’en réalité elle a besoin de fonds propres ou d’une aide internationale. Voilà quel est notre métier au quotidien.
M. le rapporteur. Un document de la BPI indique que 3,7 milliards ont été souscrits dans des fonds de fonds. Que représentent les investissements dans des fonds régionaux compte tenu de l’effet d’entrainement ?
Mme Marie Adeline-Peix. Les 575 millions sont souscrits dans les fonds régionaux, ce qui a permis de mobiliser des capitaux en gestion à hauteur de 2 milliards d’euros. Il y a donc un effet démultiplicateur avec la mobilisation de financeurs privés et parfois la mobilisation de financeurs publics, notamment des régions.
Historiquement, les fonds de garantie étaient portés par les départements. Il y en a encore quelques-uns, mais de moins en moins. Nous avons quelques partenariats avec des métropoles, par exemple avec Paris.
Les départements et collectivités d’agglomération de la région Franche-Comté ont chacun monté un fonds d’innovation à nos côtés qui intervient en complémentarité du fonds régional d’innovation de la région. De même, la communauté urbaine de Lille accompagne les projets innovants sur son territoire en complément du fonds régional de la région Nord-Pas-de-Calais.
Nous avons aussi un grand nombre de prêts de développement à une échelle infrarégionale. Ce sont des petits outils très ciblés et très réactifs qui permettent à la collectivité concernée – souvent un département – d’intervenir précisément en financement d’un projet. Tout l’aspect technique – gestion des remboursements, des prêts – est géré par Bpifrance. Là encore, il y a un effet de levier.
Les partenariats à l’échelon infrarégional sont tout à fait possibles. Ils se feront forcément dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et en lien avec la région puisque c’est elle qui préside le CRO. Il serait donc très compliqué pour nous de monter des dispositifs sans que la région soit au courant et qu’elle les accepte. Mais les choses se passent avec une certaine fluidité.
Onze de nos fonds régionaux de garantie mobilisent des fonds européens de la génération qui s’achève et quatre fonds régionaux d’innovation mobilisent également des fonds européens. Par ailleurs, nous étions un organisme intermédiaire pour le compte de l’État en innovation sous forme de subvention globale.
Nous sommes persuadés que si nous voulons mobiliser de façon simple et efficace des fonds européens pour les entreprises, il faut le faire via des outils d’ingénierie financière. En effet, avec un outil d’ingénierie financière, l’aide à l’entreprise arrive le jour où le projet est validé. En revanche, quand il s’agit d’une subvention globale, l’aide à l’entreprise intervient le jour où la dernière de ses factures a été certifiée par l’autorité de certification. Il y a un délai administratif considérable qui est souvent critiqué par les bénéficiaires finaux qui, du coup, cherchent désespérément des préfinancements. Parfois même, ils nous disent préférer avoir moins de soutien et pas d’argent de l’Europe plutôt que de l’argent de l’Europe. Je pense que beaucoup de régions souhaitent mobiliser des financements via des outils d’ingénierie financière dont ceux qui sont mis en place par Bpifrance.
Permettez-moi de faire passer deux messages.
Premièrement, il est absolument essentiel que les conditions de mobilisation de ces fonds soient stabilisées le plus rapidement possible pour les opérateurs et surtout pour les bénéficiaires finaux. Demander des justificatifs à une entreprise, c’est possible ; lui demander à nouveau quatre ans après la fin du programme parce que la règle aura changé, c’est inimaginable. Il est indispensable pour les opérateurs et surtout pour les entreprises que les règles soient fixées le plus tôt possible et qu’elles ne bougent pas en cours de programmation. Je dis toujours que l’on sait faire les pieds au mur, mais qu’il ne faut pas faire bouger les murs pendant l’exercice sinon tout le monde se casse la figure.
Deuxièmement, il me semble très important que la réglementation nationale ne vienne pas renforcer les exigences de la réglementation communautaire car c’est très pénalisant pour nos entreprises. Si les conditions de mobilisation de ces fonds sont rendues encore plus compliquées par un niveau de réglementation nationale supplémentaire, à la fin de la programmation on rend l’argent à Bruxelles.
Nous sommes aux côtés des régions et nous travaillons avec elles au quotidien pour voir comment on peut mobiliser de l’argent européen dans nos fonds. Nous adapterons nos systèmes pour le faire de façon performante et efficace, mais les règles doivent être claires.
J’en viens maintenant à la question des DOM. En Guyane, par exemple, nous avons mis en place un prêt de développement spécifique avec des planchers d’intervention plus faibles que pour nos prêts de développement classiques et des exigences un peu moindres en termes d’obligation de contreparties bancaires. Les outils de garantie y sont très utiles, sauf que même avec une garantie de 80 %, parfois les banques ne prêtent pas. Les régions nous demandent de monter avec elles des outils de prêts. Le prêt est alors fait par Bpifrance, ce qui ne pose plus de problème d’accès au crédit ou du moins de mobilisation de la banque. La contrepartie bancaire existe toujours, mais quand Bpifrance s’engage directement, la banque est souvent plus encline à le faire.
Au début de 2014, nous avons monté un fonds de garantie pour répondre aux problèmes survenus à la Réunion suite au passage du cyclone Béjisa. Nous nous adaptons en fonction des demandes des territoires.
Nous avons la capacité d’apporter des réponses à l’entreprise sur notre offre mais aussi sur ce qui se passe autour. Ce qui est important, c’est que les différents interlocuteurs possibles se parlent.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Dans les régions, avez-vous des demandes d’intervention du commissaire au redressement productif ?
Mme Marie Adeline-Peix. Nous avons des relations avec les services déconcentrés de l’État et nous essayons systématiquement de trouver, avec les commissaires au redressement productif, des solutions qui sont souvent un peu mixtes. Je rappelle que comme nous sommes très contraints en termes de soutien aux entreprises en difficulté, une partie de la solution ne peut pas être apportée par Bpifrance. Cela dit, nous pouvons aider financièrement une entreprise entre le moment où elle doit passer ce cap difficile et la construction d’un projet d’avenir. Nous sommes en contact avec les commissaires au redressement productif et nos directeurs régionaux travaillent au quotidien avec eux, de même qu’au niveau national nous avons des relations avec le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) et avec l’ensemble de cet écosystème.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions pour votre présentation et vos réponses à nos questions.
Audition du 12 février 2015
M. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
Mme la présidente Véronique Louwagie. Après l’audition du directeur général de Bpifrance et de trois de ses directeurs exécutifs, qui nous a permis d’aborder les différents champs d’activité de la banque publique d’investissement dans leurs aspects opérationnels, nous recevons maintenant M. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Je vous propose de commencer, monsieur Lemas, par une présentation des relations entre la Caisse des dépôts et consignations et la BPI, des questions de gouvernance, du déroulement du processus d’intégration de certaines activités de la CDC dans la BPI, ainsi que de l’articulation des missions respectives de ces deux organismes, notamment dans le champ du financement des entreprises. Nous vous poserons ensuite quelques questions portant sur des points plus précis.
M. Pierre-René Lemas, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je me présente à vous à double titre : d’une part, en tant que directeur général de la Caisse des dépôts, dont Bpifrance est la première filiale – elle est détenue à parité par l’État et la CDC –, d’autre part, en tant que président de l’exécutif du conseil d’administration de Bpifrance, une fonction qui me conduit à diriger les débats de son conseil d’administration et à être le gardien de certaines de ses prérogatives, notamment pour ce qui est de l’approbation de la stratégie de son budget et de l’arrêté des comptes.
Je veux souligner en préambule la réussite que constitue, dix-huit mois après sa naissance juridique en juillet 2013, la création effective de Bpifrance. L’idée était de rassembler en une même structure – une banque publique d’investissement – les principaux outils d’intervention publique en matière d’entreprise. Cela n’allait pas de soi, car chacun de ces outils pris séparément avait sa propre histoire et sa trajectoire, qu’il s’agisse d’Oséo, reconnu comme un outil de financement efficace, des filiales d’investissement en fonds propres de la Caisse des dépôts telles que CDC Entreprises – dédiée depuis près de vingt ans aux « petits tickets » de capital-investissement, ou fonds de fonds –, ou du FSI, créé plus récemment et intervenu dans plusieurs grosses opérations au cours des dernières années. Toutes ces entités avaient leur propre légitimité et ont fait preuve, dans la durée, d’une efficacité reconnue.
Je veux en profiter pour faire une incise. Parmi les trois structures essentielles ayant donné naissance à Bpifrance, il en est une qui se trouve sous les feux de l’actualité depuis hier : je veux parler de CDC Entreprises, qui a fait l’objet d’observations assez sévères de la part de la Cour des comptes dans le rapport que celle-ci a présenté au Parlement. Il s’agit d’une affaire remontant à 2007 et concernant l’attribution d’actions gratuites au personnel de cette filiale de la Caisse des dépôts, dans le cadre d’un mécanisme de type actionnariat salarié, introduit dans une filiale à 100 % de la Caisse des dépôts – c’est sans doute cet élément-là qui mérite que l’on s’y attarde.
La construction juridique du dispositif est sans doute solide, mais les dérives auxquelles on a pu assister sont inacceptables. De ce point de vue, la Cour des comptes a formulé un certain nombre de recommandations, que la Caisse des dépôts va suivre et qu’elle a d’ailleurs assez largement anticipées. Nommé à mon poste en mai 2014, j’ai souhaité engager une réorganisation de la Caisse des dépôts, qui s’est d’ores et déjà traduite par la création d’une direction des ressources humaines du groupe – et non plus seulement de l’établissement public –, assurant la mise en cohérence de l’ensemble des politiques de personnel du groupe Caisse des dépôts.
J’ai également renforcé les fonctions de pilotage des filiales de la Caisse des dépôts, ce qui m’a amené à prendre la décision de supprimer un certain nombre de filiales – celles dont l’autonomie n’est pas justifiée – pour les internaliser au sein de l’établissement public : c’est une politique que j’ai l’intention de continuer tout au long de l’année qui vient, et qui va permettre à la fois de réaliser des économies d’échelle et de mettre en cohérence les politiques, notamment en matière d’investissement.
Toujours en ce qui concerne la gestion des personnels, j’ai demandé à la direction des ressources humaines d’engager un recensement exhaustif des rémunérations des cadres dirigeants du groupe, quel que soit leur statut – comme vous le savez, le groupe comprend d’une part des salariés de droit privé, d’autre part des agents de droit public ou des fonctionnaires, qui ont des statuts juridiques et salariaux différents –, et demandé que l’on élabore un référentiel des rémunérations, notamment des cadres dirigeants, qui soit cohérent avec les missions d’intérêt général de la Caisse des dépôts.
J’ai naturellement confirmé à mon arrivée les décisions prises par mon prédécesseur : je pense notamment à la suppression de toutes les formules de stock-options qui existaient dans certaines des filiales de la Caisse des dépôts, ou encore au respect strict de la règle de plafonnement des rémunérations fixée par une loi de 2012, qui devait nécessairement s’appliquer à la Caisse des dépôts. Je serai sans doute amené, dans les semaines qui viennent, à prendre d’autres décisions résultant du travail déjà engagé.
En ce qui concerne le travail commun des trois filiales, l’objectif de la BPI était de retrouver un élan au service du développement économique et de l’intérêt général, tout en préservant le succès de ce qui avait été engagé précédemment. Le choix fait à l’époque a consisté à renverser le prisme, c’est-à-dire à partir des clients plutôt que des institutions, et à considérer que, du point de vue des entreprises, la mise en place d’un guichet unique, venant se substituer aux anciennes entités, avait du sens. Évidemment, les métiers du financement et de l’investissement sont bien distincts, mais le pari qui a été fait de les rassembler – un pari que l’on peut aujourd’hui estimer réussi – avait pour objectif de créer des synergies et surtout d’offrir une plus grande lisibilité aux entrepreneurs sur la gamme des outils dont ils disposent. Il s’agissait donc de créer une dynamique contribuant à la relance de l’investissement et de la croissance.
Le bilan 2014 présente une activité en hausse pour tous les métiers de Bpifrance, et la création d’une dynamique qui semble très encourageante : plus 35 % pour les prêts de développement, un décollage du préfinancement du CICE largement dû à l’action de la BPI – avec un doublement des engagements –, un milliard d’euros pour le financement de l’innovation, soit plus 40 % par rapport à 2013, et une progression de 73 % du pôle investissement – ce qui représente actuellement 154 millions d’euros investis en direct dans les PME, 500 millions d’euros dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, et environ 800 millions d’euros dans les fonds de capital-investissement. Le lancement du fonds Large Venture, dédié à des opérations de capital-risque, est également un succès.
Enfin, je me félicite de la signature de dix-sept conventions-cadres avec les régions. C’est l’un des aspects que j’ai souhaité donner à l’action de la Caisse des dépôts, consistant à être plus présente dans sa dimension territoriale, en partant de l’idée simple que le développement, l’initiative, l’action économique et les entreprises ne se font pas hors sol, mais d’abord sur les territoires, et que la dimension territoriale des activités de la Caisse en général, et de Bpifrance en particulier, est une priorité très forte. Un effort considérable a été accompli en ce sens par les antennes de Bpifrance, qui se sont mobilisées. Je suis persuadé que la proximité est l’une des clés de la réussite, et j’insiste beaucoup, dans les fonctions qui sont les miennes, pour que les décisions soient prises au niveau territorial aussi souvent que possible – c’est le cas pour 90 % d’entre elles à l’heure actuelle –, car c’est en étant près des entreprises que nous sommes efficaces : l’écosystème est d’abord local.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la construction de Bpifrance, qui s’est faite entre 2012 et 2013 avec beaucoup de dynamisme – j’en profite pour rendre hommage aux équipes qui s’en sont chargées. La culture commune du groupe s’articule autour d’une doctrine d’intervention, communiquée au Parlement, qui n’a pas été créée ex nihilo, mais s’inspire des cadres d’intervention des entités constitutives de Bpifrance. Il était important de disposer d’entrée de jeu de ce cadre d’intervention, à la fois pour montrer le cap et pour assurer une certaine protection contribuant à asseoir la légitimité et la crédibilité de place de Bpifrance. À mon sens, cela permet aussi et surtout d’expliquer aux entreprises sollicitant Bpifrance quelles sont les raisons sous-jacentes des réponses qui leur sont faites. Enfin, l’intérêt de se fonder sur une doctrine est aussi de garantir, aux yeux des institutions européennes, que Bpifrance se comporte en investisseur avisé.
De ce point de vue, je sais que la règle de cofinancement « un pour un » que nous appliquons actuellement peut susciter des interrogations, mais je veux souligner que cette règle est plus souple que celle qui prévalait antérieurement, puisque les financements privés exigés par Oséo pour octroyer un prêt représentaient souvent deux fois leur montant et non leur simple équivalent – c’était la règle du « deux pour un ». De plus, en cette phase de lancement, il est important de montrer à Bruxelles que nous intervenons en accompagnant un partenaire privé.
Pour ce qui est de la gouvernance, Bpifrance est détenue à 50 % chacun par l’État et la Caisse des Dépôts. Sa création s’est accompagnée d’un pacte d’actionnaires dont les principaux éléments ont été portés à la connaissance du Parlement comme le prévoit l’article 12 de la loi créant la BPI. Ce pacte fixe les grandes lignes des relations entre la Caisse des dépôts et l’État – en pratique, l’Agence des participations de l’État (APE). Nous avons fait le choix de voir la Caisse des dépôts disposer d’une prépondérance dans les métiers qu’elle exerçait précédemment, c’est-à-dire dans les instances de gouvernance de la branche investissement de Bpifrance ; cette branche réunit régulièrement des comités d’investissement auxquels le président Emmanuelli assiste en tant qu’observateur. En pratique, les échanges entre actionnaires – l’APE, la direction du Trésor et l’équipe de la Caisse des dépôts chargée des finances, dirigée par Franck Silvent – sont quasi quotidiens.
Quelle est la place de Bpifrance dans le groupe Caisse des dépôts ? J’ai fait en arrivant le choix de prendre la présidence du conseil d’administration de Bpifrance, considérant que celle-ci était la première filiale de la Caisse des dépôts, dont elle mobilise près de la moitié des fonds propres. Ceci explique que Bpifrance ait obtenu une place majoritaire dans la branche investissement de la Caisse des dépôts – à laquelle elle est intégrée en transparence, ce qui permet de disposer d’une vision précise des activités et des investissements de la Caisse et de Bpifrance – et que cette branche soit soumise au modèle prudentiel spécifique de la Caisse des dépôts.
Nous échangeons actuellement avec les services de l’État sur la question des dividendes versés par Bpifrance qui, de notre point de vue, doivent être portés à un niveau normatif pour montrer à Bruxelles que nous versons des dividendes comme le font toutes les banques : si le capital n’était pas rémunéré, nous risquerions d’être considérés comme « hors marché ». J’estime que ce dividende a vocation à sécuriser les dotations de l’État au service de l’innovation – ce que nous souhaitons – et doit permettre à la Caisse des dépôts, qui, faute d’actionnaires, est aujourd’hui la seule institution financière européenne à ne pas avoir bénéficié d’une augmentation de ses fonds propres, de renforcer sa capacité à investir dans ses missions d’intérêt général.
Plus largement, Bpifrance partage les mêmes valeurs que la Caisse des dépôts, à savoir la défense de l’intérêt général et l’appui des politiques publiques, mais c’est une banque – non pas une banque comme les autres, mais une banque publique dont le rôle est de prêter de l’argent aux entreprises auxquelles le marché bancaire ou les autres investisseurs seuls ne donneraient pas nécessairement leur chance.
Enfin, j’estime que la BPI doit s’intégrer dans la dynamique que je souhaite donner à la Caisse des dépôts, et que j’avais exposée devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Mes priorités pour la Caisse des dépôts sont l’investissement, l’appui aux territoires – sur lequel nous devons encore progresser – et la thématique des transitions – numérique, énergétique et environnementale. Bpifrance assume son rôle de banque publique dans tous ces domaines, mais je souhaite qu’elle s’intègre davantage dans les stratégies de la Caisse des dépôts. Ainsi, dans le cadre de la réorganisation en cours, nous sommes en train de créer une nouvelle direction de l’investissement afin de rassembler tous les moyens d’investissement sur les projets de la Caisse des dépôts, ce qui est tout à fait cohérent avec la mobilisation de la BPI sur les petites et moyennes entreprises ; un lien de travail quotidien a été mis en place à cet effet.
J’ai souhaité que la Caisse des dépôts et la BPI travaillent de manière conjointe sur le thème de l’international et des affaires européennes, notamment sur le plan Juncker. Nous avons donc organisé des réunions de travail en Allemagne, en Italie et auprès des instances communautaires, que ce soit auprès des directions générales ou du commissaire Katainen, et nous espérons bien rencontrer prochainement le président Juncker. Nous avons plusieurs idées communes, à commencer par celle voulant que nous ayons intérêt à démultiplier la force de frappe de nos capacités d’initiative. Par ailleurs, nous avons l’intention, en ce qui concerne les projets – essentiellement pour la Caisse des dépôts – comme en ce qui concerne les entreprises – plutôt pour la BPI –, de pousser les feux d’un mécanisme de cofinancement et de co-investissement. Cela signifie que nous ne souhaitons pas entrer directement dans un fonds européen de garantie qui, avec la Banque européenne d’investissement (BEI), assurerait la gestion de l’ensemble des projets provenant des vingt-huit pays de l’Union européenne : nous préférerions un système plus simple de co-investissement, soit au moyen de véhicules dédiés à vocation bilatérale ou multilatérale, tel le fonds Marguerite, soit au moyen de projets.
Enfin, il nous semble que nous pouvons gagner beaucoup de temps, d’énergie et d’efficacité en nous appuyant sur les réseaux dont nous disposons déjà – les directions régionales et interrégionales de la Caisse des dépôts, ainsi que les agences de la BPI, qui connaissent bien le tissu industriel – et sur leur expérience plutôt qu’en créant de nouveaux réseaux européens. Avec nos collègues allemands de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), nos collègues italiens de la Cassa Depositi e Prestiti et nos collègues espagnols de la Caja General de Depósitos y Consignaciones, nous défendons auprès de la Commission européenne une position qui nous paraît de bon sens, selon laquelle investir dans des projets suppose que l’Union européenne accepte que les investisseurs institutionnels que nous sommes puissent bénéficier du même type de garanties que celles accordées à la Banque européenne d’investissement – notamment la garantie de première perte –, travailler en s’appuyant sur des véhicules dédiés par projet ou par type de projets et mettre à disposition de l’Union européenne leurs réseaux respectifs. Un tel dispositif nous paraît plus simple que celui envisagé actuellement, dont la mise en œuvre se traduirait par le recrutement de personnels au niveau de l’Union européenne afin de recréer des niveaux d’instruction des projets au niveau communautaire.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous nous avez exposé les axes et objectifs de la Caisse des dépôts, similaires à ceux de Bpifrance. Si cette similitude paraît logique, elle peut également soulever des questions en termes de dualité des structures. Pour ce qui est du succès que constitue la création de Bpifrance, je voudrais citer un rapport de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris publié il y a quelques mois dans lequel il est indiqué que 61 % des entreprises franciliennes ont été amenées à abandonner un projet innovant faute de financement. Que pensez-vous de ce chiffre ?
Par ailleurs, vous avez évoqué un appui fort de la Caisse des dépôts sur les territoires, matérialisé par la signature de dix-sept conventions-cadres avec les régions. Dans la mesure où l’on constate de grandes disparités entre les régions, existe-t-il des solutions pour intervenir davantage au profit de certains territoires ?
Enfin, au sujet de l’attribution d’actions gratuites de la CDC Entreprises à près de soixante de ses salariés, dénoncée par le rapport public annuel 2015 de la Cour des comptes, vous avez parlé d’une dérive inacceptable et fait état des mesures que vous envisagiez de mettre en place, consistant notamment en un relevé exhaustif des rémunérations des cadres dirigeants. Ne serait-il pas souhaitable de disposer d’un référentiel s’étendant sur un panel plus large de rémunérations au sein du groupe ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Monsieur le directeur général, la pratique dénoncée par le rapport de la Cour des comptes, qui suscite l’indignation de tous, appelle des mesures fortes et concrètes tirant les leçons de cet épisode malheureux et allant dans le sens d’une plus grande transparence – mais je ne m’étendrai pas sur ce point, puisque nous avons déjà posé des questions en ce sens au directeur exécutif de Bpifrance et que, de votre côté, vous avez déjà engagé des actions.
Mes questions porteront plutôt sur la structure d’ensemble du financement public des entreprises en France. Bpifrance avait pour vocation d’unifier les sources publiques de financement des entreprises et, si elle a atteint cet objectif, elle n’est pas la seule à intervenir dans ce domaine : à ses côtés, on trouve le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), qui a pour mission d’aider les entreprises industrielles en difficulté, mais aussi la Médiation du crédit aux entreprises, qui facilite les relations entre les banques et les entreprises, Atout France, qui aide les entreprises dans le secteur du tourisme, Business France, qui favorise l’export, CDC International Capital, chargée d’attirer les investissements des fonds souverains, enfin la CDC, qui intervient elle-même en tant qu’investisseur d’intérêt général pour favoriser le financement des entreprises en croissance et leurs projets de développement – en co-investissements directs, fonds directs, fonds de fonds, fonds internationaux, nationaux et régionaux. Ce constat soulève la question de la cohérence d’ensemble du dispositif. La Caisse des dépôts et consignations vient de créer une direction des investissements, avec pour objectif de « renforcer le métier d’investisseur au sein du groupe et de le positionner comme investisseur économique majeur au service du développement des territoires. » Pouvez-vous nous indiquer comment s’opère concrètement l’articulation des opérations de la Caisse des dépôts et de la BPI en tant qu’investisseurs ?
Par ailleurs, il a été décidé de ne pas intégrer Qualium Investissement à la BPI qui est une société de gestion filiale de la Caisse des dépôts et consignations, investissant en fonds propres dans les PME et les ETI et développant des activités concurrentielles en matière de transmissions – au travers des leveraged buy-out (LBO) – et d’opérations de capital-développement. Quelles sont les raisons de cette décision ?
Enfin, la Caisse des dépôts accorde à Bpifrance des financements affectés aux prêts faits aux PME : sur quels critères ces prêts sont-ils attribués, et quelle part de l’activité de la BPI représentent-ils ? Selon vous, l’activité des prêts aux PME est-elle suffisamment dynamique ?
M. Éric Alauzet. J’ai noté que vous parliez de démultiplier la force de frappe. S’agit-il d’être plus en prise avec les territoires, par exemple en investissant davantage dans des fonds de fonds, qui permettent d’aider des projets de taille plus modeste que les projets à dimension européenne ?
Subsiste-t-il, selon vous, des points de faiblesse dans le dispositif de financement des entreprises, notamment en comparaison de ce qui se fait en Italie ou en Allemagne, et estimez-vous que nous pourrions faire des progrès ?
Vous avez cité deux projets de transition numérique et énergétique – des domaines auxquels je suis particulièrement sensible. Rencontrez-vous des difficultés sur l’un ou l’autre de ces chantiers, notamment celui de la transition énergétique qui, lancée plus tardivement, a peut-être plus de mal à se développer ?
Enfin, quel est selon vous l’équilibre global entre l’offre et la demande de financement, étant précisé que les avis sur cette question sont contradictoires, certains affirmant qu’il n’y a pas de demande, tandis que les autres considèrent que ce sont les financements qui font défaut – mais peut-être la réponse diffère-t-elle en fonction des territoires concernés ? À titre d’exemple, je citerai le cas d’une entreprise située sur mon territoire, près de Besançon. Cette papeterie considérée comme une vieille industrie a présenté aux banques un projet de conversion et de modernisation au moyen de la mise en place d’une centrale biomasse, mais n’a essuyé que des refus, y compris auprès de la CDC, et c’est finalement une banque libanaise – le repreneur est lui aussi libanais – qui est venue en appui avec HSBC. Un an après, c’est un succès pour ce projet du xxie siècle – que les banques françaises ont considéré à tort comme un projet du xxie siècle, ce qui me paraît dommage.
M. Pierre-René Lemas. Il faut reconnaître que la structure globale du dispositif de financement reste compliquée, même si la création de la BPI l’a un peu simplifiée. L’innovation est l’une des missions permanentes de Bpifrance, et cette orientation figure même dans la loi. Cela se traduit dans les chiffres par une très forte hausse des engagements, qui sont passés de 700 millions d’euros à environ un milliard d’euros pour 2014. Ces engagements sont très diversifiés puisqu’ils comprennent aussi bien des aides à l’innovation au sens classique du terme que des prêts ou du capital-innovation, et nous souhaitons continuer dans cette direction.
J’ai lu le rapport de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et, si je laisse aux spécialistes le soin de débattre de la méthodologie utilisée, toujours est-il que les baromètres semestriels d’Ernst & Young, entre autres, aboutissent à d’autres conclusions. En tout état de cause, je considère que la Caisse des dépôts et surtout Bpifrance ont assez largement contribué à la bonne tenue du marché du capital-innovation en France : nous sommes désormais quasiment ex aequo avec l’Allemagne, et même premiers dans certains secteurs. Certes, des marges de progrès subsistent, mais l’innovation constitue pour nous une priorité structurelle et la démarche engagée en ce sens, qui s’est traduite par une forte augmentation des volumes, doit se poursuivre.
Cela renvoie à une difficulté que l’on connaît bien, à savoir le fait que les ressources publiques consacrées au financement de l’innovation – je pense à toutes les ressources, qu’il s’agisse des programmes collaboratifs, des aides individuelles, des concours et des avances remboursables, des prêts à l’innovation – ont subi une baisse importante au cours des dernières années : la dotation de l’intervention de l’État a quasiment diminué de moitié entre 2008-2009 et aujourd’hui. La politique de l’État a consisté à compenser une bonne part de cette diminution des dotations par les engagements du Programme d’investissements d’avenir (PIA), à peu près à due proportion – je dis « à peu près » parce la compensation n’est pas intégrale : elle l’est peut-être en dépenses, mais pas en engagements. J’ai appelé l’attention de nos interlocuteurs de l’État sur notre souhait de voir fixer un objectif raisonnable afin de sanctuariser au moins un volume, de l’ordre de 150 à 180 millions d’euros en exécution, qui nous permette de poursuivre sur la voie que nous nous sommes fixée. L’une des pistes que nous avons soumises au Gouvernement pourrait consister dans le recyclage par l’État d’une partie du dividende de Bpifrance, qui permettrait sans doute de minorer l’effet des baisses de dotations. En tout état de cause, il n’est pas question de baisser les bras : nous voulons continuer à considérer l’innovation comme un axe très fort de notre action.
L’appui au développement territorial constitue désormais une orientation forte de la Caisse des dépôts. Historiquement, la CDC a d’abord été un établissement public ancré sur les territoires, accordant des prêts aux collectivités locales, intervenant dans le développement économique des territoires comme acteur des sociétés d’économie mixte – dont elle avait pris l’habitude de boucler les financements – et accompagnant les collectivités sur l’ensemble des projets de développement local. Si tout cela est encore en grande partie vrai aujourd’hui, la Caisse des dépôts a, entre-temps, traversé une autre période historique durant laquelle les pouvoirs publics ont souhaité qu’elle se bancarise, se financiarise, s’ouvre au marché et soit en situation de jouer son rôle contracyclique dans une économie globale et ouverte. Si nous ne sommes pas entièrement sortis de ce contexte, la nécessité de s’appuyer à nouveau sur les territoires s’est fait jour, car la capacité de développement est locale, départementale ou régionale, et c’est à cette échelle que la Caisse des dépôts doit jouer son rôle au sein des écosystèmes.
En pratique, cela s’est traduit pour la Caisse par deux décisions. La première a consisté à créer une direction de l’investissement ne venant pas s’ajouter à l’existant, mais ayant pour objet de regrouper tous les moyens d’investissement territorialisés de la Caisse des dépôts. En effet, la capacité à fournir de l’actif se trouvait répartie entre la Caisse des dépôts, certaines de ses filiales – CDC Infrastructure, CDC Climat et CDC Numérique – et les directions régionales, ce qui ressemblait davantage à un saupoudrage qu’à un dispositif faisant apparaître des thèses d’investissement clairement identifiées. Le regroupement va se traduire par la suppression, dans les semaines qui viennent, des filiales que je viens de citer. La nouvelle direction de l’investissement aura pour mission de définir des thèses d’investissement, des gammes de projet sur lesquelles nous souhaitons pouvoir investir de manière plus forte, en mobilisant les crédits de façon plus ciblée. Cette nouvelle organisation nous permettra de soutenir des projets auxquels nous ne nous serions peut-être pas intéressés auparavant.
La seconde décision prise par la Caisse a consisté à recréer une décision du territoire et des réseaux, afin de disposer d’une direction dédiée aux territoires, rattachée au directeur général et permettant le renforcement des directions interrégionales et régionales, dont le nombre de vingt-huit sera amené à évoluer prochainement pour tenir compte de la nouvelle carte des régions. Cela dit, nous ne pourrons nous calquer strictement sur cette nouvelle carte des régions, car nous devons veiller à maintenir une certaine proximité avec les acteurs locaux : nous devrons donc rechercher d’ici à la fin de l’année – ce travail a été engagé – le découpage le plus pertinent entre le nouveau niveau régional et les niveaux infrarégionaux, en concertation avec les acteurs locaux.
L’idée n’est pas simplement de modifier le découpage géographique. Il s’agit surtout de donner aux directions régionales de la Caisse des dépôts la possibilité de représenter toute la Caisse, et donc de déconcentrer le pouvoir : les directions régionales pourront prendre des décisions à leur niveau, sans que tout remonte systématiquement à des comités d’engagement parisiens, et cela sur une gamme de produits.
La Caisse des dépôts propose par exemple des prêts aux collectivités locales : nous disposons d’une enveloppe de 20 milliards d’euros de prêts au taux du livret A plus 100 points de base, pour des durées parfois très longues, et au sein de cette enveloppe de 5 milliards au taux du livret A plus 0,75 point de base, c’est-à-dire 1,75 % pour les prêts « croissance verte ».
Nous avons aussi une capacité d’intervention en fonds propres, d’accompagnement du développement des sociétés d’économie mixte, d’ingénierie financière que nous pouvons mettre à disposition des acteurs locaux pour imaginer des modèles de financement nouveaux. En effet, traditionnellement, on cherchait une subvention, puis on demandait un prêt… Or les dotations de l’État diminuant, les subventions diminuent aussi : il faut donc imaginer de nouveaux modèles, et mobiliser des fonds propres. La Caisse des dépôts met son savoir-faire à la disposition des acteurs locaux.
S’agissant de la Banque publique d’investissement, nous souhaitons nous appuyer davantage sur les comités régionaux d’orientation, qui ont été créés par la loi, et qui doivent devenir de véritables comités de place régionaux, permettant aux différents acteurs locaux – banques, organisations patronales, syndicats, région, autorités déconcentrées de l’État, société civile – de partager leur analyse des besoins, et donc d’orienter l’action de Bpifrance.
La BPI noue de nombreux partenariats avec les régions – dix-sept à ce jour, je l’ai dit, mais nous devrions à mon sens établir un partenariat-cadre avec chacune des régions. Vingt-deux d’entre elles disposent maintenant d’un fonds de garantie, abondé par les régions elles-mêmes. Il existe également désormais une vingtaine de fonds d’innovation. Une douzaine de régions ont aujourd’hui créé des produits de financement spécifiques, mais toutes ne souhaitent pas le faire, ce qui est un choix parfaitement légitime. Toutefois, je constate que, l’an dernier, 130 millions de fonds régionaux ont été confiés à Bpifrance : nous pouvons à mon sens aller au-delà et élargir nos partenariats.
En élargissant la focale, on constate qu’il existe environ quatre-vingt-dix fonds régionaux avec une participation régionale. C’est, je crois, la bonne direction.
Il me paraît essentiel de souligner que, lorsqu’une région souscrit, même pour une petite somme, à un fonds d’investissement, elle doit nécessairement participer aux instances de gouvernance, y compris au comité d’investissement ; c’est la clé de la confiance. La BPI est prête à aller plus loin : je pense que nous pouvons pousser un peu les feux.
Sur la complexité du dispositif et l’unification des sources de financement, monsieur le rapporteur, je commencerai par la Caisse des dépôts. Les filiales de la Caisse ont été intégrées à Bpifrance. Certaines demeurent marginales : c’est notamment le cas de Qualium Investissement, dont le statut est très particulier, et que l’on cite en général pour donner des exemples d’investissements incongrus de la Caisse des dépôts – dans Quick, par exemple, ou naguère dans La Foir’Fouille.
Qualium Investissement est une société de gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui investit notamment en capital-transmission dans des entreprises non cotées. C’est une société indépendante – la Caisse des dépôts ne peut pas donner d’instructions –, qui est souvent actionnaire majoritaire, ce qui n’est pas le cas de la BPI. Qualium n’a donc pas vocation à faire partie de Bpifrance ; en revanche, on pourrait se demander si elle doit rester à tout jamais filiale de la Caisse des dépôts, puisqu’elle atteint aujourd’hui sa maturité, avec un niveau de savoir-faire et d’efficacité tout à fait reconnu.
Les autres institutions que vous citez – Médiation du crédit, CIRI… – occupent des fonctions différentes, même si l’objet de nos attentions est le même. Bpifrance a des relations avec la Médiation du crédit, mais leurs rôles sont différents. Le CIRI est une institution d’État, et nous participons parfois à ses travaux. Nos relations avec les outils que sont Atout France ou Business France sont très étroites. Une partie des équipes de Business France sont même aujourd’hui hébergées dans les locaux de la Caisse des dépôts.
On peut, je crois, faire mieux encore, mais l’évolution est très positive.
Quant à CDC International Capital, filiale de la Caisse des dépôts dont le statut est un peu particulier, sa situation est un peu différente, puisque cette filiale doit notamment servir de porte d’entrée en France des capitaux des fonds souverains étrangers. Elle doit donc mettre en place des partenariats pour créer des objets juridiques, des véhicules communs avec les fonds étrangers prêts à investir en France, afin de définir des doctrines d’investissement. Intervient-on dans le pays d’origine du fonds souverain et en France, ensemble en France, ensemble ailleurs… ? Nous souhaitons attirer des capitaux étrangers vers des thèses d’investissement qui vont dans le sens de l’intérêt national français, sans se limiter aux seules entreprises. Nous sommes prêts également à accompagner des entreprises françaises qui vont investir dans le pays d’origine du fonds souverain, et ainsi y créer de l’activité, mais aussi par là même créer de l’activité et de l’emploi en France.
C’est un métier en soi. Ensuite, il reste la gestion des projets, du travail avec les entreprises : nous travaillons actuellement avec Bpifrance pour éviter toute déperdition d’énergie en chemin.
M. le rapporteur. Pour donner un exemple concret des difficultés rencontrées, je prendrai l’exemple d’un projet de centrale solaire thermodynamique, qui a le soutien de collectivités locales et de la BPI – sous la forme d’un prêt à l’industrialisation des projets issus des pôles de compétitivité. La Caisse des dépôts et consignations s’était engagée, au départ, à prendre 35 % des fonds propres. La négociation était en cours sur les concours bancaires, avec la BEI, la BPI et d’autres intervenants privés. Or, du jour au lendemain, la Caisse des dépôts a annoncé son possible retrait.
Il faut donc sans doute améliorer le suivi des projets : si la BPI négocie un concours bancaire tandis que la CDC se retire d’un projet qui pourrait créer 200 emplois industriels, c’est qu’il y a un problème. Les investisseurs ont besoin de visibilité.
Il faudrait d’ailleurs, concrètement, commencer par identifier les difficultés.
M. Pierre-René Lemas. Je ne connais pas cet exemple précis. Mais la réponse à ce type de problèmes est forcément territoriale – c’est là, je le disais, que sont nos vraies marges de progression.
BPI est une banque ; la Caisse des dépôts peut apporter des fonds aux collectivités locales. Les métiers sont distincts. La Caisse intervient d’ailleurs souvent aujourd’hui pour boucler des tours de table, alors que je souhaiterais qu’elle participe d’entrée de jeu à la discussion des projets – on perdrait moins de temps à refondre des projets sur le plan financier.
Les métiers sont distincts, mais les directions régionales de la Caisse des dépôts et les agences de Bpifrance doivent absolument se concerter. Cet automne, j’ai visité plusieurs régions en m’entourant systématiquement du délégué de Bpifrance et du directeur régional de la Caisse des dépôts. Souvent, ils se connaissent, mais ce n’est pas toujours le cas ; il faut les amener à travailler ensemble. C’est l’une des missions que j’ai données à la nouvelle direction du réseau et des territoires. Je crois vraiment que la décision au niveau territorial est la piste à suivre.
En matière de transition énergétique et écologique, Bpifrance a aujourd’hui acquis, je crois, la bonne dimension : elle dispose d’une gamme de produits à destination des entreprises de la transition énergétique comme d’une gamme de produits à destination de celles qui s’adaptent à la transition énergétique.
La responsabilité sociale et environnementale (RSE) est un sujet essentiel, qui sera de plus en plus d’actualité. La sphère financière publique n’en a pas encore pris toute la mesure. Cela fait partie des axes de travail de la Caisse des dépôts.
Bpifrance travaille bien – elle peut aller plus loin, mais le mouvement est engagé, et la volonté est là. La Caisse des dépôts a fait beaucoup de choses, mais souvent de façon très éparpillée, en inventant chemin faisant la cohérence de la doctrine d’investissement. Je souhaite retrouver cette cohérence, et c’est pourquoi j’ai voulu créer cette direction de l’investissement, qui s’occupera notamment des entreprises de la transition énergétique et environnementale.
Par ailleurs, la CDC est à la fois apporteur d’actifs, prêteur, notamment sur les fonds d’épargne, et mandataire de l’État. Ce sont trois métiers qui ne sont pas gérés par les mêmes personnes : on ne peut pas les mélanger mais il me paraît essentiel d’agir de façon cohérente. Nous avons ainsi une enveloppe de prêt de 5 milliards d’euros – qui est bien plus consommée qu’on ne le dit, puisqu’elle l’est à hauteur de 2,3 milliards d’euros d’engagements, alors qu’elle a été créée au mois de septembre ; les collectivités locales ont des projets et nous demandent des financements. Il y a aussi ce que nous faisons par convention et ce que nous faisons en matière de fonds propres.
Le projet de loi relatif à la transition énergétique veut donner de la cohérence, en créant un fonds de la transition écologique et énergétique, qui pourrait bénéficier de financements complémentaires. Nous travaillons à sa mise en place : l’idée est de mettre dans un pot commun les moyens d’intervention de l’État, de la Caisse des dépôts et d’éventuels financements complémentaires ; leur gestion serait confiée à la Caisse des dépôts. La Caisse serait ainsi opérateur pour l’État et opérateur pour son propre compte : d’un point de vue comptable et budgétaire, ce sont deux choses différentes, mais nous y veillerons. Ce serait là, je crois, une bonne solution, qui viendrait en complément des actions d’autres institutions publiques dont la thèse d’investissement est particulière, comme l’ADEME.
S’agissant de l’offre et de la demande, monsieur le député, la réalité que nous percevons est qu’il y a aujourd’hui beaucoup de liquidités. En 2008, nous étions appelés à la rescousse pour en apporter ; aujourd’hui, c’est le contraire, et les décisions de la BCE vont dans le sens d’une abondance de liquidités sur le marché.
Ce qui est compliqué aujourd’hui, ce sont les tuyaux, c’est-à-dire l’ingénierie financière. Toutes les entreprises n’en bénéficient pas de façon égale. Il est extrêmement difficile pour beaucoup de petites entreprises d’obtenir des banques une aide à la trésorerie. La BPI occupe 60 % à 70 % du financement par avance du CICE, par exemple : elle a mis longtemps à prendre ce marché ; on aurait pu imaginer qu’il le soit par le système bancaire. Les banques doutaient-elles de la réalité du versement du CICE ? Je ne sais. Toujours est-il que, via le CICE, la BPI finance aujourd’hui la trésorerie de nombreuses petites entreprises.
De plus, pour employer un vocabulaire partagé par la banque et le tennis, « la raquette a des trous » : nous pourrions améliorer le financement des petites entreprises en croissance, qui ont du mal à trouver du financement à court terme, à long terme et des quasi-fonds propres. La Caisse des dépôts a donc décidé la création de fonds nouveaux, les fonds Novo, Nova et Novi. Ces outils financiers permettent de répondre à des situations particulières, qui peuvent être très exaspérantes pour les entreprises. Ainsi, les propriétaires de petites entreprises familiales ont souvent envie de continuer à être maîtres chez eux, et lorsqu’ils ont besoin d’apport financier, il est difficile de les aider. Nous créons donc des véhicules idoines.
Le problème de l’ingénierie financière est au fond assez simple : on ne peut pas tout faire sur la base des crédits publics ; nous devons donc arriver à mobiliser des capitaux qui sont entre les mains notamment des investisseurs institutionnels et des compagnies d’assurance. Avec ces capitaux publics et privés, investis dans des fonds et dans des fonds de fonds, nous pouvons essayer d’orienter davantage l’épargne vers le financement des entreprises. En raison des règles bancaires et prudentielles, mais aussi en raison des risques de faible rentabilité, c’est assez compliqué, et c’est pourquoi la Caisse des dépôts essaie de se mettre au premier rang : comme acteur de place, elle pourra aider à la mobilisation de capitaux privés.
La France est ainsi l’un des pays européens où n’existe aucun marché du viager : le viager, dans notre culture, c’est horrible, c’est Balzac, Zola et Pierre Tchernia réunis. Un tel marché peut pourtant présenter des avantages, notamment celui d’assurer une rente au vendeur. Nous avons donc expérimenté la création d’un fonds viager, avec des investisseurs privés, et cela a très bien fonctionné : peut-être allons-nous réussir à faire exister ce marché.
De la même façon, nous savons qu’il existe des besoins considérables en matière de logements intermédiaires, c’est-à-dire de logements destinés à ceux dont les revenus sont trop élevés pour obtenir des HLM mais trop faibles pour qu’ils puissent se loger dans le parc privé : il manque sans doute 40 000 logements, et cela ne concerne pas que les agglomérations. Mais attirer des investisseurs privés, ou même des investisseurs institutionnels, sur le marché du logement, est aujourd’hui une gageure. Via notre filiale SNI, nous avons donc créé un nouveau fonds en nous associant avec des investisseurs privés. Ainsi, le potentiel d’investissement devient significatif et le taux de rendement raisonnable. Nous pouvons lancer, avec des promoteurs, des programmes de logements : sans la mobilisation de la Caisse des dépôts, ces logements n’auraient sans doute pas été construits. C’est là une nouvelle manière d’envisager la capacité d’investissement d’outils publics comme la Caisse des dépôts et comme BPI. L’une et l’autre, chacune dans leur rôle propre, doivent jouer un rôle de catalyseur, d’amorceur pour mobiliser des capitaux privés au service du développement économique.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci de vos explications, monsieur le directeur général.
Audition du 12 février 2015
M. Fabrice Pesin, médiateur du crédit aux entreprises, et M. Daniel Gabrielli, médiateur national délégué
Mme la présidente Véronique Louwagie. La Médiation du crédit a été fondée en 2008 avec la double mission d’observer les difficultés de financement des entreprises grâce à une structure spécifique, l’Observatoire du financement des entreprises, et de répondre aux demandes des entreprises en les orientant vers des solutions de financement. Votre regard sur l’action de la BPI sera donc précieux.
M. Fabrice Pesin, médiateur du crédit aux entreprises. Madame la présidente, nos relations avec Bpifrance sont évidemment très étroites : Bpifrance est présente dans presque tous les dossiers importants que nous traitons, et l’est, pour les plus petits dossiers, dans au moins la moitié des cas. De plus, un représentant de Bpifrance siège au comité exécutif de la Médiation du crédit. Bpifrance organise pour nos équipes des séances de formation et de présentation de ses produits. De façon générale, c’est un partenaire que nous aimons avoir avec nous, car sa présence crée de la confiance et facilite les accords.
Vous l’avez dit, la Médiation du crédit a été fondée en 2008 : nous avons donc peu de recul. La Médiation a été créée à un moment de très grande tension entre le secteur bancaire et les entreprises ; depuis, heureusement, le contexte s’est largement apaisé. Il n’est donc pas évident de faire le départ entre ce qui tient au changement de contexte économique et financier et ce qui découle du rôle spécifique de Bpifrance par rapport à ses prédécesseurs.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de dossiers instruits par la Médiation, et de la proportion d’entre eux dans lesquels Bpifrance intervient ? Combien d’entre eux aboutissent, et lorsqu’ils échouent, pourquoi ?
Selon vous, certains instruments de financement manquent-ils aujourd’hui ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Les établissements de taille intermédiaire (ETI) sont essentiels pour notre économie. Ces entreprises créent de nombreux emplois – elles ont, ces deux dernières années, créé plus d’emplois que n’en ont détruit les entreprises du CAC40, mais elles sont trop peu nombreuses, car nos TPE et PME ont du mal à grandir ; et nous avons moins d’ETI en 2014 qu’en 2013, ce qui est inquiétant. Comment l’expliquer ? Est-ce dû prioritairement à des problèmes de financement ? À cet égard, la mise en place de la Banque publique d’investissement a-t-elle changé quelque chose ?
Par ailleurs, Bpifrance Le Lab a été mis en place par la BPI avec l’objectif de mieux connaître les ETI et PME. Cette structure est-elle complémentaire de l’Observatoire du financement des entreprises, ou bien y a-t-il redondance ?
On se rappelle la polémique sur les « canards boiteux ». Quel est votre regard sur la question des « fonds de retournement » ? Bpifrance doit-elle plus s’investir dans ce domaine ? Une intervention publique est, je le crois, nécessaire.
M. Éric Alauzet. Vos moyens sont-ils adaptés à la demande des entreprises ? Y a-t-il à votre sens des points faibles, des attentes non résolues ?
M. Fabrice Pesin. Bpifrance joue un rôle essentiel dans un grand nombre de nos dossiers, mais nous n’avons pas établi de statistiques précises concernant son implication.
M. Daniel Gabrielli, médiateur national délégué. En 2014, nous avons traité en médiation environ quatre mille dossiers dont 95 % impliquaient des PME. Parmi celles-ci, on comptait 80 % de très petites entreprises (TPE).
M. Fabrice Pesin. Bpifrance intervient dans la quasi-totalité des dossiers relatifs aux PME, hors TPE. La médiation nationale dispose de moins d’informations concernant ces dernières car les dossiers les concernant sont généralement traités au niveau des médiations départementales qui utilisent les outils mis à disposition par Bpifrance dans au moins un cas sur deux. Nous parlons donc d’un partenaire incontournable pour une très grande partie des dossiers, en particulier pour ceux à fort enjeu.
Dans le cadre de la Médiation du crédit, nous sommes toutefois loin d’utiliser tous les produits de Bpifrance. Les accords font principalement intervenir deux d’entre eux : d’une part, le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), ou même du crédit impôt recherche, et, d’autre part, les produits de garantie. D’autres outils, comme les produits de cofinancement ou de financement de l’innovation, sont utilisés extrêmement rarement, ce qui s’explique sans doute par la nature spécifique des cas que nous avons à connaître. En général, les banques ne se pressent pas pour financer, ou cofinancer, les entreprises qui font appel à nous.
Lors des négociations, la seule présence de Bpifrance permet de débloquer des dossiers et suscite la confiance de ceux qui se trouvent autour de la table. Au-delà de l’utilité réelle des instruments qu’elle propose, Bpifrance joue donc un puissant rôle de facilitateur.
Il est vrai que la Médiation du crédit ne sauve pas toutes les entreprises qui s’adressent à elle. Même lorsque nous nous appuyons sur Bpifrance, il arrive que nous ne trouvions pas de solution. Nous ne prenons parfois conscience qu’au cours de la négociation que la situation structurelle d’une entreprise est trop dégradée.
Par ailleurs, Bpifrance ne peut intervenir en garantie en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI). La Commission européenne avait autorisé Oséo à s’affranchir temporairement de cette règle lors de la mise en place du plan de relance en 2010-2011, mais nous sommes aujourd’hui revenus au principe initial. Il arrive en conséquence que certains dossiers d’ETI n’aboutissent pas parce que le levier de la garantie de Bpifrance n’a pu être mobilisé.
M. le rapporteur. Je suis perplexe. Nous ne sommes toujours pas sortis de la crise. Pourquoi Bpifrance ne peut-elle pas intervenir en faveur d’ETI pourtant essentielles à notre économie ?
M. Daniel Gabrielli. La situation actuelle est difficile, mais elle n’a rien de comparable avec celle qui prévalait lorsque la Commission européenne a autorisé Oséo à élargir le périmètre de ses interventions en garantie aux ETI. À l’époque le blocage du crédit était quasi-total et l’on pouvait légitimement avoir peur d’une crise majeure. Lorsque la Commission a considéré que cette situation extrême n’était plus de mise, elle a demandé un retour aux règles antérieures.
M. Fabrice Pesin. Pour mettre en œuvre ses instruments de garantie, Bpifrance est tributaire de la décision des banques privées : sans leur soutien, elle se trouve parfois dans l’incapacité d’intervenir.
Monsieur le rapporteur, vous m’interrogez sur l’incapacité des TPE à croître pour devenir les ETI de demain. Il ne faut pas tout ramener à la question du financement car il existe aussi des freins sociaux, fiscaux ou culturels à leur développement.
Ce semestre, l’Observatoire du financement des entreprises a mis à son ordre du jour la question des entreprises en croissance et de leur financement. Dans chaque grand secteur d’activité, nous observerons comment les entreprises qui ont connu un très fort dynamisme depuis deux ou trois ans ont évolué en termes de structures de financement dans les dix ou quinze années précédentes : ont-elles fait appel aux marchés, ont-elles ouvert leur capital ou n’ont-elles utilisé que le financement bancaire, ont-elles crû par acquisition externe, se sont-elles tournées vers l’export ?
Concernant l’analyse des blocages culturels à l’essor des TPE, une intéressante étude, déjà menée au Québec, est actuellement reproduite en France.
Vous me demandez de comparer Bpifrance le Lab et l’Observatoire du financement des entreprises. Ce dernier, que j’ai l’honneur de présider, à vocation à être totalement neutre – neutralité renforcée par celle du médiateur. Il réunit toutes les parties, dont Bpifrance, afin qu’apparaissent des diagnostics partagés permettant de recommander des bonnes pratiques. Bpifrance relève aussi de la sphère publique mais reste l’un des acteurs concernés disposant d’instruments et de produits qu’il peut vouloir tester. Nos approches sont donc assez différentes.
Publié en juin 2014, le dernier rapport de l’Observatoire porte sur le financement des TPE en France. À partir de nos observations – l’analyse statistique a par exemple permis de montrer que les très petites entreprises avaient trop tendance à utiliser les découverts bancaires –, la Fédération bancaire française, présente au sein de l’Observatoire, a pris cinq engagements de bon sens : réponse aux demandes de crédit dans un délai de quinze jours, explication en cas de refus et mention de la Médiation du crédit, incitation à la stabilité des chargés de clientèle… Je ne pense pas que ce type de travail aurait pu être effectué au sein de Bpifrance Le Lab dont ce n’est pas la mission.
Madame la présidente, vous souhaitez savoir si certains instruments nous manquent. Si, en termes de dynamique, la situation globale des PME a connu en 2014 une réelle amélioration – nous avons traité moins de dossiers, et le nombre de défauts est revenu à celui enregistré en 2008 –, il n’en est pas de même pour les TPE pour lesquelles j’ai eu la surprise de constater que la tendance ne s’inversait pas. Le contexte économique fournit sans doute certaines explications, mais il faut aussi s’interroger sur les outils et les dispositifs d’accompagnement mis en place. La population concernée est également très différente de celle des PME et des ETI. Elle est par exemple moins à l’aise avec la multiplicité des guichets et des acteurs, et elle a moins facilement accès à l’information. Les TPE n’ont d’ailleurs pas assez recours à la Médiation ; elles sont trop nombreuses à en ignorer jusqu’à l’existence. Évidemment, rien ne garantit que nous puissions les sauver, mais nous réussissons globalement dans deux cas sur trois.
Le 15 septembre dernier, lors des assises du financement et de l’investissement, le Président de la République a annoncé que les TPE bénéficieraient de leur propre dispositif de soutien à la trésorerie grâce à Bpifrance. Un fonds de garantie des crédits de trésorerie se met en place pour soutenir dix mille très petites entreprises. Nous verrons dans le cours de l’année si cette impulsion est efficace. La tâche est d’autant plus complexe que toutes les TPE n’ont pas vocation à grandir et ne sont pas des start-up. Il n’est pas simple de calibrer des instruments correspondant à des besoins hétérogènes.
Cela dit, nous pouvons toujours fabriquer les mécanismes les plus raffinés, ils ne seront d’aucune utilité si personne ne s’en saisit. À défaut de raisonner en termes d’instrument manquant, je crois qu’il faut surtout que nous nous assurions que chaque patron de TPE saura à quelle porte frapper le jour où il en aura besoin.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous nous avez indiqué que la Médiation du crédit utilisait fréquemment les produits de garantie et le préfinancement du CICE.
Ce dernier outil est un instrument classique de Bpifrance. Pourquoi les entreprises n’y ont-elles pas recours avant de faire appel à vous ? En ignorent-elles l’existence ou rencontrent-elles des problèmes pour y avoir accès ?
Le soutien apporté par Bpifrance grâce aux produits de garantie s’inscrit-il nécessairement dans un partenariat avec un organisme financier ?
Arrive-t-il que la Médiation travaille sur un dossier particulièrement crédible et ne trouve aucun écho du côté de Bpifrance ou des organismes bancaires – même si je comprends bien que le recours au médiateur du crédit s’explique précisément par le manque de soutien des banques ?
M. Fabrice Pesin. Il est extrêmement rare que les diagnostics de la Médiation et de Bpifrance divergent : nos appréciations des dossiers sont quasiment toujours identiques.
M. Daniel Gabrielli. Lorsqu’une entreprise entre en médiation, nous explorons avec elle tout le champ des outils utilisables. Nous lui demandons systématiquement de mobiliser le préfinancement du CICE dont il est vrai qu’elle ne connaît pas toujours l’existence, mais il arrive aussi qu’elle ait déjà utilisé cet instrument.
Les produits de garantie permettent de consolider les crédits de trésorerie dénoncés par les banques. Nous recherchons un accord pour empêcher les banques de sortir rapidement de ces crédits en les persuadant de consolider leur engagement à moyen terme, par exemple sur trois ans. La garantie apportée par Bpifrance sur 50 à 70 % des montants nous aide à les convaincre, même si le délai de carence de neuf mois ne les rassure pas.
La garantie de certains fonds régionaux, qui interviennent souvent en partenariat avec Bpifrance, peut donner lieu à des cofinancements. De façon générale, cela a été dit, la situation des entreprises qui font appel à nous n’est plus propice au cofinancement. Elles ont souvent des problèmes de trésorerie et la new money n’est pas chose courante dans les dossiers que nous traitons. Cela s’explique aussi par la conjoncture difficile ; son retournement pourrait évidemment modifier la donne.
M. le rapporteur. Malgré les convergences des appréciations de Bpifrance et de la Médiation, que se produit-il en cas de désaccord au niveau national ou régional ?
M. Fabrice Pesin. La mission de la Médiation lui interdit de pousser les banques à intervenir à perte sur un dossier. Cela nous place dans une situation proche de celle de Bpifrance. Nos motivations étant similaires, nos positions sont quasiment toujours les mêmes. Au niveau national elles ne divergent pas. Au niveau régional, Bpifrance peut tarder à donner une réponse. Il nous suffit alors d’interroger son représentant au sein de notre comité exécutif. De la même façon, nous pouvons intervenir au niveau national pour demander le réexamen d’un dossier lorsqu’il y a un blocage du côté des banques en région.
M. le rapporteur. Les artisans sont fréquemment confrontés à des difficultés de trésorerie, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour que Bpifrance entre en relation directe avec eux. Dans les dossiers relatifs au TPE, pouvez-vous toutefois faire appel à Bpifrance sachant qu’elle n’intervient pas directement auprès des très petites entreprises, et qu’elle passe pour cela par les banques commerciales ?
M. Fabrice Pesin. Les délégations aux réseaux des banques commerciales permettent en effet à Bpifrance, qui ne dispose en propre que d’une quarantaine de guichets, de diffuser ses produits auprès d’une large population.
Le problème vient souvent de ce que, de part et d’autre des guichets, le manque de connaissance des produits constitue un réel handicap. Les patrons de TPE connaissent souvent mal les instruments qui pourraient les aider, et les chargés de clientèle des grands réseaux ne maîtrisent pas toujours la palette des outils existants. Il y a un véritable besoin de produits très simples – et, paradoxalement, cela n’est pas facile à mettre en place.
M. le rapporteur. Si un artisan vous sollicite, vous vous tournez vers une banque commerciale et non vers Bpifrance ?
M. Daniel Gabrielli. Si une médiation a lieu, Bpifrance n’assistera pas à la première réunion mais, en cas de besoin, elle pourra intervenir au cours du processus si nous considérons que sa présence peut débloquer une situation.
M. Fabrice Pesin. La diffusion des produits Bpifrance par les banques commerciales vise, dans une phase préalable, à éviter le passage par la médiation.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Gabrielli, vous évoquiez un délai de carence pour les financements de Bpifrance. De quoi s’agit-il ?
M. Daniel Gabrielli. Bpifrance impose un délai de carence de neuf mois pour ses interventions afin de se garantir contre les pertes qu’entraînerait la liquidation d’une entreprise. Cette période permet aussi d’éviter de déresponsabiliser les banques qui sont alors en première ligne. Évidemment ces dernières demandent que ce délai soit réduit – durant le plan de relance, Oséo l’avait d’ailleurs ramené à quatre mois. Il reste qu’un instrument public ne peut pas devenir le déversoir systématique des pertes des PME et TPE.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Messieurs, nous vous remercions vivement pour l’ensemble de vos interventions.
Table ronde réunissant MM. Bernard Cohen-Hadad, président de la commission Financement de la CGPME, Jean-Guilhem Darré, délégué général du syndicat des indépendants, Emmanuel Landais, directeur général de l’ADIE, André Marcon, président de CCI France, Alexandre Montay, délégué général de l’ASMEP-ETI et Thibault Lanxade, président du pôle entrepreneuriat et croissance du Medef.
Mme la présidente Véronique Louwagie. La mission d’information commune sur la banque publique d’investissement Bpifrance poursuit ses travaux avec une table ronde portant sur le service rendu par cette institution aux petites et moyennes entreprises pour déterminer en quoi Bpifrance a-t-elle permis de répondre aux besoins de financement des entreprises ?
M. Bernard Cohen-Hadad, président de la commission Financement de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Dès février 2011, alors que le sujet n’était pas d’actualité, nous avions appelé de nos vœux la création d’une banque publique d’investissement, avant de préciser notre attente en avril 2012 : ce devait être une véritable banque publique des entreprises regroupant tous les métiers du financement des petites et moyennes entreprises (PME), mais aussi des très petites entreprises (TPE). Le monde des aides publiques aux entreprises était atomisé, le besoin d’un guichet unifié – par préférence à un guichet unique – s’adressant à tous types d’entrepreneurs se faisait sentir. Les intéressés avaient besoin de se développer tant sur le marché national que sur le marché européen ou dans les pays tiers. La création de Bpifrance, en 2013, a répondu à nos attentes.
Aujourd’hui, sous réserve de possibles aléas liés à la crise, la CGPME considère que l’opération est réussie. Bpifrance a su capitaliser sur la bonne image d’OSEO, ce qui, en janvier 2013, alors qu’il était question de conserver ce nom pour la nouvelle institution, n’était pas évident. Si le pari a été tenu, c’est grâce à la qualité, à la compétence, au dynamisme et au dévouement des équipes, c’est grâce à Nicolas Dufourcq – dont l’action a été d’autant plus méritoire qu’il n’est pas issu du monde des PME, mais de celui de la grande entreprise –, et aux directeurs qui ont su assembler au sein d’une entité unique trois ou quatre métiers au départ disparates.
Alors que nous pensions que le préfinancement n’était pas le meilleur outil pour nos entreprises, j’ai pu écrire, depuis, qu’il ne fallait pas tirer sur le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Ce dispositif bénéficie aussi aux TPE ; pouvoir leur fournir un préfinancement parfois de 850 euros constitue une mesure d’ordre public.
Bpifrance a su présenter des offres lisibles en période de crise. Les patrons de PME et de TPE ne sont pas des spécialistes du financement. Bpifrance a réuni six métiers qui vont de la garantie jusqu’au capital développement. Ces offres ne s’adressent pas à toutes les entreprises, car l’institution n’est pas une banque universelle et ne propose pas d’accès direct, mais vient souvent en garantie pour nos entreprises. Elle constitue donc un élément complémentaire et permet un effet de levier pour les entreprises à la recherche de capitaux.
Comment assurer la pérennité de cette réussite ? Nous sommes encore en période de crise et nos entreprises ont besoin de soutien : le niveau d’investissement est faible et, dans le domaine de l’export, c’est le désert. La BPI doit rester une banque publique et ne pas se prendre pour une banque comme les autres, car son attrait réside précisément dans sa singularité. Il faudra qu’elle dispose de davantage de moyens humains pour s’adapter à un monde du financement qui a changé. Les banques universelles sont devenues plus agressives – ce qui est une bonne chose – et elles appliquent la règle du « un pour un ». La BPI doit continuer à mettre en place ses outils, à accompagner les entreprises en conservant son rôle de levier et à inciter les entrepreneurs à aller là où ils ne pensent peut-être pas à s’aventurer.
Il ne saurait y avoir de développement ni de croissance sans PME présentes sur l’ensemble des territoires. Même si l’on constate parfois des retards, imputables à des manques de moyens financiers et humains, Bpifrance doit continuer d’accompagner les entreprises, particulièrement à l’export. Si l’Europe constitue le premier échelon, les autres pays sont une cible incontournable. On met en avant quelques belles PME qui réussissent, mais le résultat global reste très faible. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder les résultats de la balance de nos paiements extérieurs.
M. Emmanuel Landais, directeur général de l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE). L’Association pour le droit à l’initiative économique, fondée il y a vingt-cinq ans et présidée par Catherine Barbaroux, se consacre au microcrédit. Nous soutenons et accompagnons des entreprises qui n’ont pas accès au crédit bancaire. En 2014, nous avons financé près de 14 000 entreprises en primo développement. La plupart de nos interlocuteurs sont des demandeurs d’emploi ou des titulaires de minima sociaux. Nous sommes au bas de la pyramide de la création d’entreprises. Les personnes concernées sont, en général, créatrices de leur propre emploi – il ne s’agit pas de micro-entreprises au sens juridique et fiscal. Le taux moyen d’emploi est de 1,2. Ces entreprises connaissent un bon taux de viabilité qui les place dans la moyenne des entreprises françaises. Elles ne sont cependant pas très visibles, particulièrement pour Bpifrance. Il s’agit d’un petit segment dont l’importance ne cesse cependant de croître. La création d’entreprises connaît un boom depuis quinze ans : 550 000 ont été créées, dont la moitié – soit 318 000 – ont démarré avec moins de 16 000 euros. Seules 40 % d’entre elles démarrent avec un financement bancaire.
Nos relations avec Bpifrance sont ténues. C’est surtout OSEO qui a géré le prêt à la création d’entreprises (PCE) pendant de nombreuses années, et ce jusqu’à la fin du mois prochain. OSEO garantissait aussi nos prêts d’honneur ainsi que ceux de confrères d’autres réseaux de soutien à la création d’entreprises.
Nous avons vécu la création de la BPI comme une mesure de rationalisation intéressante, d’autant plus qu’il était annoncé que 500 millions d’euros seraient consacrés à l’économie sociale et solidaire (ESS). Je rappelle toutefois que cela a nécessité deux ans de mise en route : les instruments dévolus à l’ESS étaient mal adaptés. Nous n’en avons pas moins bénéficié, de la part de Bpifrance, d’un prêt de 5 millions à de très bonnes conditions – 1 %. Cela répondait parfaitement à nos besoins, car nous empruntons directement aux banques pour fournir aux entreprises des financements à long terme, c’est-à-dire à cinq ans. Certes, au regard des encours de la BPI, ces 5 millions sont modestes, mais ils nous permettront de soutenir 4 000 micro-entreprises. Cependant, je crois comprendre que pour ce prêt nous n’avons pas bénéficié des avantages réservés à l’ESS.
Nous considérons donc le bilan comme positif, tout en regrettant la suppression du PCE : nous n’étions que peu concernés, mais cela constitue un message contradictoire avec la volonté affichée de soutenir l’initiative économique.
M. Thibault Lanxade, président du pôle entrepreneuriat et croissance du Mouvement des entreprises de France (MEDEF). BPI est aujourd’hui une marque installée dans le paysage et auprès des chefs d’entreprise. La mutation d’OSEO en Bpifrance s’est remarquablement bien déroulée dans un contexte difficile car, depuis 2007, les entreprises souffrent énormément. BPI a eu un rôle complémentaire mais capital, dans le domaine de la garantie mais aussi pour les nombreuses créations en cours. Certes, quelques améliorations restent à apporter, mais, à travers les quatre-vingts produits financiers qu’elle propose, Bpifrance offre une gamme exhaustive susceptible de répondre à nombre de besoins. Ces produits, telle la prise de participation, sont déterminants pour beaucoup d’entreprises, particulièrement pour les start-up qui trouvent ainsi une partie de leurs fonds d’amorçage grâce à un effet de levier. D’autres financements d’aide à la maturation de projet ou d’aide à l’innovation illustrent la place tenue par la BPI dans la dynamique entrepreneuriale. Elle est, bien sûr importante pour les PME, mais l’aide aux TPE doit être améliorée, car, du fait de leur petite taille, celles-ci peinent à trouver leur formule de financement.
En termes d’organisation régionale, la BPI a su se rendre visible auprès des chefs d’entreprise. En revanche, on observe des problèmes dus aux délais : si les comités d’engagement prennent rapidement leurs décisions, le mécanisme administratif est plus long à libérer les fonds.
En tant qu’organisation patronale, nous considérons cependant qu’un effort de pédagogie auprès des entrepreneurs reste à faire. Bpifrance n’a pas pour rôle de pallier les insuffisances d’une banque quand un élément de scoring pourrait montrer une défaillance. Il faut éviter les financements désespérés d’entreprises en situation très complexe, qui risquent de donner de faux espoirs, mais financer celles qui sont en phase de développement.
Enfin, en ce qui concerne les paiements dus aux entreprises, les retards des services de l’État et des collectivités territoriales atteignent un encours de 7,5 milliards d’euros même s’il faut reconnaître que l’État a récemment consenti des efforts. La BPI devrait proposer des produits de subrogation de créances permettant aux PME et TPE qui ne sont pas réglées en temps et en heure par les collectivités territoriales de pouvoir être très rapidement financées par la banque publique d’investissement.
M. André Marcon, président de Chambre de commerce et d’industrie de France (CCI). La création de la BPI constitue une innovation positive qui se situe dans la continuité d’OSEO, organisme qui avait déjà regroupé les pratiques de financement. On peut, néanmoins observer quelques erreurs de jeunesse. Bpifrance se montre trop sélective dans l’appréciation de l’innovation. Or, pour 80 % des entreprises, celle-ci n’est pas seulement technologique mais incrémentale ou endogène. Certes, la haute technologie doit être prise en compte, mais, dans le cadre du retournement d’entreprise notamment, l’innovation est très importante et ne doit pas être négligée.
Le monde de la petite entreprise est familier d’une logique de guichet, alors que la BPI s’inscrit dans une logique de projets, singulièrement de projets viables. Les chefs de PME sont quelque peu désorientés. La publication annoncée d’un guide de l’innovation, actualisé, sera l’occasion d’une clarification pour une meilleure compréhension.
J’appelle l’attention sur un risque de dérive bancaire constaté à l’usage chez OSEO, où se trouvaient des gens remarquables dans le domaine de l’innovation avec l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) comme dans celui de la garantie. Mais, peu à peu, à la tête d’OSEO, la banque avait pris le pas et on ne trouvait plus de directeurs régionaux issus de l’ANVAR ou de la Société française pour l’assurance du capital-risque des PME (SOFARIS). Cela a changé avec la BPI, mais il convient de rester vigilant.
À l’échelon régional, la BPI n’est pas assez visible, alors que c’était un axe majeur du projet. Les chambres de commerce manquent d’éléments pour assister l’institution.
Par ailleurs, on a l’impression que Bpifrance devient un peu attrape-tout. Dans le secteur de l’export, par exemple, elle indique dans ses publications être le « guichet unique pour accompagner les entreprises à l’export ». Le patron de PME désireux de se lancer dans l’export va donc s’en remettre à la seule BPI, qui ne fait que du financement. Il devrait plutôt se tourner vers Business France, les réseaux d’organisations professionnelles et les CCI. L’institution doit apprendre à fonctionner en relation avec les autres acteurs sous peine de se renfermer sur elle-même. Une meilleure circulation de l’information de la part de la BPI, particulièrement au sujet des dossiers difficiles, nous permettrait de mieux orienter les entreprises faisant appel à elle. Le réseau bancaire doit être capable de résoudre beaucoup de problèmes et il faut soumettre à Bpifrance des dossiers pertinents. Nous souhaiterions donc que ce retour d’expérience en direction des opérateurs de proximité augmente.
Le préfinancement du CICE constitue une très bonne initiative, mais ses coûts sont nettement plus élevés que ceux des réseaux bancaires habituels. L’absorption des formules de crédit relevant antérieurement du PCE et l’héritage d’OSEO ont conduit l’établissement à gérer des crédits de faibles montants – entre 2 000 et 3 000 euros – avec une certaine rigidité. Il s’en est suivi une baisse drastique du nombre des présentations de dossiers. Dès lors, ce type d’aide relèvera des banques, ce qui impliquera une garantie et, partant, plus de complexité qu’auparavant. À défaut de Bpifrance, nous disposons pour ces financements modestes de plates-formes d’initiative qui fonctionnent parfaitement. Il faut trouver des outils adaptés à ces petites entreprises qui sont l’avenir.
M. Alexandre Montay, délégué général du Syndicat des entreprises patrimoniales et des entreprises de taille intermédiaire (ASMEP-ETI). Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) que je représente disposent d’une surface financière plus robuste que les PME. Depuis cinq ans, elles se sont engagées dans une action de consolidation de bilan, d’augmentation de la part des fonds propres et de meilleure gestion de la trésorerie. C’est un secteur dynamique pour lequel les financements par les banques sont plus rapides et plus aisés : les chiffres de la Banque de France pour le quatrième trimestre 2014 donnent 88 % d’obtention de lignes de crédit et 93 % pour le crédit à l’investissement.
S’il faut saluer la création de la BPI, le slogan trop répandu « BPI égale ETI » ne correspond pas à la réalité, qui est plus complexe. L’apport de l’établissement, plutôt que financier, a été de nous faire mieux connaître dans le débat public. Les travaux conduits par Bpifrance, en termes d’information sur cette catégorie d’entreprises, donnent corps à cette réalité que défend notre syndicat. Nous avons récemment établi un baromètre du financement des ETI par la BPI sur l’ensemble du territoire national : nos adhérents saluent la bonne lisibilité de l’offre. On remarque aussi une meilleure cohérence des leviers de financement. La présence territoriale constitue aussi un atout, même si elle doit être améliorée. Il arrive parfois que des dirigeants d’ETI ne trouvent pas d’interlocuteurs locaux. La communication relative à la présence locale, qui a été l’un des éléments structurants de la création de la BPI, doit être augmentée. Autre point fort : l’ambition d’internationalisation. La BPI sert d’aiguillon aux ETI à l’international.
La reprise des métiers antérieurement dévolus à OSEO donne satisfaction : en la matière, on continue « business as usual ». Au moment de l’élaboration du projet, nous avions fait savoir que nous attendions une amélioration de la qualité du service rendu. Les solutions de crédit telles la garantie, le prêt participatif ou l’avance remboursable interviennent dans des délais satisfaisants et à des taux encourageants, même si cela dépend de la solidité financière de l’entreprise concernée.
J’apporterai un bémol au sujet de l’action de la BPI dans le domaine de la prise de participation equity – en d’autres termes, en capital fermé —, peu adaptée au mode de financement des ETI compte tenu de leur caractère familial ou patrimonial. Au demeurant, je reconnais la réussite de fonds sectoriels tel Aerofund ou de prises de participations dans de belles ETI à très forte croissance, comme Criteo, mais les ETI ont-elles l’usage de ce type de financement ? Le sujet ici n’est pas vraiment le financement, car le cash est disponible, mais plutôt les projets d’investissement.
Enfin, le parent pauvre du financement d’entreprise demeure la quasi-ETI qui se caractérise par des investissements plus lourds que les PME classiques, sans avoir pour autant la solidité d’une ETI. L’investissement, plus risqué, freine les grands réseaux bancaires. Par ailleurs, la doctrine d’intervention de la BPI, de façon très claire, ne s’adresse pas à ces entreprises, qui constituent pourtant le réservoir des ETI de demain. Il ne faudrait pas que les quasi-ETI se trouvent exclues du champ des politiques de financement des établissements bancaires, que ceux-ci relèvent du droit privé ou du droit public.
M. Marc Sanchez, secrétaire général du Syndicat des indépendants. Nous avons conduit une enquête auprès de nos adhérents sur la base d’un échantillon de 2 000 entreprises existant depuis cinq ou dix ans et sur une durée de deux ans. Ces entreprises emploient entre zéro et neuf salariés. 90 % d’entre elles ont indiqué connaître des problèmes de trésorerie. L’enquête a montré que, après deux ans d’existence, la BPI n’est pas connue dans sept cas sur dix. Il semble donc que l’établissement doive développer son action en direction de cette catégorie d’entreprises.
Les PME sont toutes d’anciennes TPE. Celles-ci, quel que soit leur secteur d’activité, doivent pouvoir bénéficier des actions d’aide et de financement, et plus encore dans les périodes difficiles. Elles ont donc besoin d’un accès direct à un organisme qui puisse les aider dans leur financement : jusqu’à présent, cela ne s’est fait qu’avec le CICE et son préfinancement par le biais de la BPI. En 2013, seules 3 300 TPE ont été ainsi financées. Ces chiffres modestes montrent combien il est nécessaire que la BPI accentue son action auprès des entreprises de ce type. L’organisation du financement n’est pas étrangère à ce blocage. En matière de crédit de trésorerie, l’interlocuteur demeure la banque. Certes, le médiateur du crédit peut intervenir, mais il le fait rarement, car la banque évite de mentionner ce recours, comme celui de la BPI, qui peut venir en garantie.
Le chef d’entreprise ignore donc l’existence de Bpifrance et la banque ne joue pas son rôle d’informateur. La question de l’intérêt du recours à la BPI pour un banquier susceptible de financer une TPE est posée. La pratique bancaire en matière de découverts, autorisés ou non, rend inutile le recours à ces relais. Nous avons ainsi constaté que, pour des entreprises qui ne sont pas à risque, le montant des frais et agios liés à un prêt de 2 000 euros par mois est équivalent à la somme avancée.
Cela fait plusieurs années que nous dénonçons cet état de fait. Certes, Bpifrance ne peut pas tout régler en deux ans, mais elle doit se donner des perspectives pour le développement des TPE. Il ne s’agit pas seulement d’entreprises en difficulté, mais d’entreprises qui ont un avenir et pourront, à terme, créer des emplois. Si on lui en donne les moyens, la BPI pourra devenir un relais très positif : ce sera peut-être l’objet de la présente mission d’information.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Le fonctionnement du dispositif à l’échelon régional a été évoqué, notamment par MM. Marcon et Montay. Bpifrance travaillant avec les conseils régionaux, constatez-vous des différences de performance entre les régions ?
Nos entreprises connaissent des difficultés dans le secteur de l’export. La BPI a un rôle important à jouer en la matière et M. Dufourcq a fait de 2015 l’année de l’export. Des entreprises vous ont-elles fait part de leur souhait de voir l’établissement s’impliquer davantage à travers des produits tels que le crédit acheteur à l’export ou la mobilisation de créances nées à l’étranger ?
Il a été signalé à plusieurs reprises que nombre de chefs de TPE ignoraient l’existence de la BPI, dont la porte d’entrée se limiterait au préfinancement du CICE. Maintenant que ce dispositif est connu, pensez-vous que les chefs d’entreprise pourraient, par ce biais, recourir plus souvent aux services de Bpifrance ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Comment améliorer concrètement l’action de la BPI dans nos territoires ? Comment faire en sorte que la BPI aide les entreprises aux différentes étapes de leur parcours de croissance – celles de la création, de l’innovation et de la transmission – ainsi qu’en cas de difficultés, lorsqu’elles ont besoin de fonds de retournement ?
Le lien entre la Caisse des dépôts et consignations et la BPI vous semble-t-il poser problème ? On s’est aperçu que certains dossiers bénéficiaient du soutien de l’une mais pas forcément de l’autre : avez-vous constaté des difficultés de cet ordre ou celles-ci restent-elles atypiques ?
En raison des règles européennes, les ETI ne peuvent bénéficier de la garantie bancaire de la BPI : cela vous paraît-il problématique ? Avez-vous des propositions à formuler en la matière ?
Enfin, la règle du « un pour un » permet-elle de compenser efficacement les failles du marché ou constitue-t-elle un frein, voire un blocage, pour les entreprises ?
M. André Marcon. Nous espérions être associés au comité de suivi de la BPI afin de pouvoir donner notre avis sur l’action régionale de la BPI. Aujourd’hui, il nous est impossible de partager les informations qui nous remontent des entreprises. Il existe certes de nombreuses aides à la création, à la transmission et au retournement, au point que l’on a pratiquement couvert tout le champ de l’aide aux petites entreprises. Encore faut-il que ces dernières en connaissent l’existence. Or, si nous avons pour mission de réduire la complexité qui entoure ces dispositifs, il nous est difficile d’y parvenir dès lors que nous ne disposons d’aucune information en amont. Une entreprise qui investit 100 000 euros sur un territoire peut lui apporter la croissance ; or on voit très peu de dossiers de demande d’entreprises de ce type à la BPI.
Il importe que la BPI soutienne les entreprises à l’export, et ce avec l’ensemble des partenaires concernés. En ce domaine, l’un des chantiers qu’elle n’a pas encore suffisamment ouverts est celui de la première aide à l’export. Dans la mesure où il faut deux à trois ans pour qu’une PME réussisse son pari en ce domaine, le financement à l’export de la matière grise des PME ne peut se faire qu’à l’aide de Business France et du réseau des CCI qui aident les entreprises à calibrer leurs besoins et leur succès.
Si les entreprises, notamment les petites, ne se sont pas ruées sur le CICE, c’est qu’elles ont été traumatisées par le crédit impôt recherche, qu’elles associent au risque de subir un contrôle fiscal de plus, ce qui est très chronophage.
Enfin, lorsqu’une petite entreprise vit en bonne intelligence avec son banquier, celui-ci peut accepter de la préfinancer, car il croit au CICE. Mais cela ne figure pas dans les statistiques.
M. Thibault Lanxade. J’aborderai la question régionale sous un angle différent : la structuration de départ d’OSEO s’appuyait beaucoup sur les périmètres départementaux et régionaux. Or, aujourd’hui, compte tenu du flux de dossiers qui sont déposés à Paris, les chargés d’affaires se retrouvent très rapidement submergés. En conséquence, certains entrepreneurs parisiens vont immatriculer leur entreprise dans les Hauts-de-Seine auprès d’un autre chargé d’affaires afin que leur dossier soit traité plus rapidement que dans la capitale. Bref, si l’approche de Bpifrance est très régionale, il conviendrait d’en renforcer la transversalité, car le fait que des directions gèrent différemment leurs dotations peut influencer les choix d’implantation de certains entrepreneurs dans la phase de création de leur entreprise.
En ce qui concerne l’export, nous sommes en phase avec la position des CCI.
S’agissant du ciblage du CICE sur les TPE, il aurait bien évidemment été beaucoup plus simple d’instaurer un allègement de charges immédiat. L’obtention du préfinancement du CICE suppose d’accomplir des démarches auprès de l’administration et des banques, démarches qui, bien qu’elles ne soient pas très compliquées, ne sont probablement pas effectuées par les TPE compte tenu du faible montant en jeu : une entreprise de dix personnes employant plusieurs cadres ne bénéficiera en effet que d’un CICE de 2 000 à 4 000 euros. Or l’obtention d’un préfinancement n’est pas systématique pour de tels montants.
Si la règle du « un pour un » est importante, la BPI ne doit pas être une banque comme une autre. L’effet de levier est significatif et peut atteindre les « un pour cinq » dès lors que sont en jeu plusieurs produits au lieu d’un seul.
La cession-transmission est pour nous une forte préoccupation, plus importante que l’enjeu de l’information au sens large. En effet, quelque 800 000 chefs d’entreprise vont partir à la retraite d’ici à dix ans, soit 80 000 par an, ce qui représente un volume considérable. Si la cession-transmission doit s’inscrire dans un parcours d’accompagnement, de formation et de financement, la BPI peut jouer en la matière un rôle complémentaire à celui d’acteurs traditionnels afin d’apporter des mécanismes de garantie à des fonds ou à des organisations spécialisés. Des initiatives pourraient être prises en ce sens par certains acteurs, mais il conviendra alors de s’assurer qu’ils recueillent la bienveillance de la BPI. Celle-ci devra assimiler les enjeux spécifiques de la cession-transmission et assurer le suivi de ces initiatives. Notez que la cession-transmission d’une ETI n’est pas celle d’une TPE ou d’une PME.
Enfin, j’ai l’impression que les relations entre la BPI et la Caisse des dépôts se sont normalisées. Il faut dire que, une dotation de 300 millions d’euros ayant été consacrée au numérique et aux projets innovants, une attente assez forte s’était fait sentir chez les entreprises de ce secteur. Toutefois, ces points d’appui restent complexes pour le chef d’entreprise, le guichet unique n’ayant pas encore tout à fait pris forme.
M. Bernard Cohen-Hadad. Il reste aux entrepreneurs à s’approprier Bpifrance. Or, moi qui suis entrepreneur depuis une vingtaine d’années, j’ignorais, avant d’adhérer à la CGPME il y a huit ans, ce qu’étaient la Banque de développement des PME (BDPME) et OSEO. Un patron de TPE, qui, tous les jours, a le nez dans le guidon, n’aura jamais connaissance de l’existence de Bpifrance si son banquier ne lui en parle pas, s’il n’assiste pas à nos réunions ou s’il ne voit pas la publicité dans les magazines. Ces chefs d’entreprise ont donc du chemin à parcourir, mais les organisations patronales, les CCI et les experts-comptables sont là pour valoriser le rôle de Bpifrance.
Cependant, Bpifrance n’est pas et ne doit surtout pas devenir une banque comme les autres. Elle est loin d’avoir les moyens des grands réseaux bancaires. Évitons donc de lui confier des missions qui ne sont pas les siennes.
Cela dit, au terme de ses deux dernières premières années d’existence, je constate que les choses fonctionnent bien sur le terrain, où il existe des TPE dynamiques, qui n’innovent d’ailleurs pas que dans le domaine technologique.
Quant à l’information régionale, les organisations patronales s’y emploient par le biais de la représentation territoriale et des comités d’orientation régionaux de Bpifrance : ceux-ci comprennent des entrepreneurs de tous niveaux et fonctionnent bien.
À l’export, la communauté d’intérêts qu’est Business France est une bonne chose pour nous. Mais ce n’est pas en quelques mois que nous pourrons inverser une tendance qui prévaut depuis plusieurs années. Jean-François Roubaud a été l’auteur de deux rapports au Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur l’importance du développement des PME à l’export.
Ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, la transmission et les fonds de retournement sont des enjeux décisifs. Nos PME les plus dynamiques doivent pouvoir compter sur tous les soutiens et sur toutes les « assurances » en matière de crédit-bail et d’assurance-crédit afin de pouvoir répondre aux commandes qui leur sont adressées et exaucer leur souhait de développement, de reprise ou de transmission.
Enfin, vous avez raison, il convient d’être attentif aux « failles » du marché, marché qui a beaucoup évolué depuis deux ans. Grâce au travail qu’elles ont accompli dans le cadre des Assises du financement des entreprises, les organisations patronales ont obtenu que la garantie de 100 000 euros que nous accordait OSEO soit portée à 200 000 euros. C’est une bonne chose, même si cela a un coût pour les banques.
Nous disposons aujourd’hui d’une palette d’outils comprenant notamment le financement des PME par le marché – avec Euronext et Alternext, la bourse des PME – et le capital-développement – qui avait jusqu’à présent été délaissé. Ne bridons pas les initiatives privées : il ne faudrait pas que Bpifrance marque trop le chemin de la libre concurrence et du marché. Nous sommes très attachés à ce que le capital-développement puisse investir dans les entreprises, surtout par le biais de tickets d’un montant inférieur à ceux qu’accorde Bpifrance, qui s’élèvent au minimum à 1 million d’euros, afin d’aider nos TPE à franchir une étape supplémentaire. Nous avons besoin aussi de la titrisation et de l’émission d’obligations par les PME – dispositif qui se met en place aujourd’hui. Nous sommes demandeurs d’une législation plus souple en matière de financement participatif – condition d’un développement de proximité.
Enfin, ne négligeons pas le rôle des banques : ayant contribué à deux rapports de l’Observatoire du financement des entreprises, l’un relatif au financement des TPE en février, l’autre portant sur les PME et les ETI en avril 2014, je puis vous assurer que, depuis quelques mois, les banques ont beaucoup plus tendance à jouer leur rôle dans le financement des PME. Le seul problème que nous ayons est celui de l’autocensure des entrepreneurs : seuls 8 à 9 % des fonds PME leur sont distribués. Peut-être la palette d’outils mise en place par Bpifrance pourrait-elle nous redonner de la confiance et nous permettre de nous développer.
M. Marc Sanchez. Nous ne sommes favorables à la régionalisation de Bpifrance que si elle contribue à améliorer l’information et la connaissance qu’ont les TPE de l’existence et de l’utilité de cet organisme.
Il n’est pas question de remettre en cause le rôle joué par Bpifrance ni son développement, mais, de manière pragmatique, de déterminer ce qu’elle apporte aujourd’hui aux TPE. Or, de fait, en regard de leurs besoins, elle ne leur apporte pas grand-chose. Prenons l’exemple du CICE : quelque 3 300 entreprises ont bénéficié du préfinancement en 2013, le montant moyen par salarié s’élevant à 548 euros lorsque le taux du crédit d’impôt était de 4 %. Lorsque nous avons sollicité Bpifrance pour ce type de demande, son guichet unique a réagi très vite, ce qui est tout à fait positif, mais on nous a fait comprendre qu’il n’était pas forcément utile de monter des dossiers pour des sommes aussi peu importantes. On ne peut donc pas dire que le contact établi entre les TPE et Bpifrance ait abouti à un résultat.
Qu’attend-on exactement de Bpifrance ? Doit-elle jouer un rôle actif auprès des TPE ? Dans quelle mesure et pour quels types de produits ? Ne devrait-elle pas créer certains produits, en partenariat avec les organismes bancaires existants, afin d’aider les PME à se développer ? Doit-elle au contraire s’en tenir au rôle marginal qu’elle joue actuellement vis-à-vis de ces TPE ?
M. Alexandre Montay. Bpifrance n’est pas la solution à tous les problèmes des entreprises de taille intermédiaire. Celles-ci se situent dans un écosystème de compétitivité qui n’est pas raisonnablement aligné sur la moyenne européenne. Pour nos entreprises, cet organisme est un outil comme un autre, mais les dirigeants d’ETI verraient d’un bon œil que les conditions de compétitivité soient rétablies, ce qu’a d’ailleurs entrepris le Gouvernement, notamment en instaurant le CICE et en concluant le Pacte de responsabilité et de solidarité.
S’agissant de l’action territoriale de la BPI, un travail important a été mené, en particulier par BPI Participations, dans le cadre du fonds ETI 2020. Il visait à faire connaître la marque et à établir un contact avec les chefs d’entreprise au niveau régional, les entreprises ayant souvent été en lien direct avec les chargés d’affaires d’OSEO. Toutefois, les dossiers bancaires remontent de plus en plus souvent à Paris, si bien qu’un écart se creuse entre les tickets bancaires selon qu’ils sont accordés dans la capitale ou en province, ce qui interpelle ceux qui se soucient de la régionalisation des financements de la BPI. Les conseils régionaux se sont saisis de la question dans des bassins très dynamiques, tels que l’Aquitaine ou la région Rhône-Alpes. Bref, pour les ETI, la régionalisation semble bien engagée.
En ce qui concerne les garanties accordées par la BPI, nous nous sommes trouvés bloqués, tant en termes de volume de financement que d’accès à certains outils, par le statut européen de la PME qui conduit à exclure les ETI du bénéfice des aides publiques alors qu’elles auraient besoin de financements particuliers pour continuer à se développer. Il est difficile de régler à l’échelle française un problème que connaissent les PME des autres pays de l’Union européenne, qui ont du mal à grossir, sauf en Allemagne.
Dans le domaine de l’export, les entreprises se retrouvent confrontées à des compétiteurs internationaux qui n’évoluent pas dans le même écosystème fiscal et social. C’est là, selon nous, le nœud principal du problème, compte tenu des capacités de financement de cette catégorie d’entreprises.
En ce qui concerne les fonds de retournement, j’ai bien noté que la BPI disposait, dans le cadre de fonds de fonds, de capitaux qui sont ensuite mis au service de sociétés de gestion : ces fonds ont-ils fait l’objet d’un audit ou d’une présélection ? Une garantie particulière a-t-elle été imposée lorsque la BPI a sélectionné les fonds de retournement dans lesquels elle souhaitait investir ?
M. Emmanuel Landais. C’est dans les phases de développement, de transmission et d’innovation que le rôle de la BPI me semble important. Toutefois, il ne faut pas trop lui en demander : j’imagine mal qu’elle puisse jouer un rôle plus actif en matière d’aide à la création d’entreprises. Le travail que nous menons nous-mêmes en la matière nécessite une grande proximité avec les entreprises et ne relève pas d’une approche nationale ou régionale, mais locale. Il exige aussi de nous de la réactivité et de la souplesse pour s’adapter aux situations individuelles. Je vois mal la BPI s’engager directement dans le soutien à la création de microentreprises. Son rôle consiste plutôt à s’appuyer sur les acteurs qui en sont chargés au quotidien. Bref, il ne faut pas demander à la BPI de résoudre l’ensemble des problèmes de défaillance du marché du financement des entreprises.
S’agissant des relations de la BPI avec la Caisse des dépôts, je citerai l’exemple du financement du secteur de l’économie sociale et solidaire qui relève des missions de la BPI, mais aussi de celles de la Caisse des dépôts. En l’occurrence, le partage des tâches est peu clair puisque la Caisse gère le programme d’investissements d’avenir (PIA) en faveur de l’ESS qui concerne de nombreuses petites entreprises et que, parallèlement, la BPI vient de créer des instruments de financement ressemblant étrangement à ceux du PIA. Il peut certes être intéressant de mettre plusieurs guichets à disposition des opérateurs qui savent s’y retrouver, mais sans doute l’offre mériterait-elle d’être rationalisée.
M. le rapporteur. Avez-vous constaté des liens entre les sociétés de cautionnement mutuel et la BPI ?
S’agissant des procédures de délégation, avez-vous eu, lorsque vous avez défendu ou traité des dossiers, des difficultés à déterminer qui prend les décisions ?
Enfin, je vous indique que lorsque nous avons auditionné le directeur chargé des fonds de fonds au sein de Bpifrance, nous lui avons demandé de nous fournir des renseignements qui nous permettent d’identifier avec précision l’activité de ces différents fonds.
M. André Marcon. Certaines sociétés de cautionnement mutuel fonctionnent très bien, telles que la SIAGI et la SOCAMA pour les TPE et les PME.
J’ai parlé de transparence, mais nous n’avons pas à savoir dans le détail qui prend réellement les décisions au sein de la BPI. J’exprimais tout à l’heure ma crainte de voir la culture bancaire prendre le pas sur les autres cultures au sein de l’établissement : les banquiers sont tout à fait respectables, ils doivent se soumettre à certaines contraintes et être très précautionneux, mais, si je voulais être provocateur, je dirais que cela me dérangerait que la BPI ait un très bon bilan. Il me semble qu’elle doit prendre plus de risques que les autres établissements bancaires afin de contribuer au développement de notre pays.
M. Thibault Lanxade. Pour vous répondre en ce qui concerne les fonds de fonds, nous songeons à doter plusieurs fonds et structures en drainant une partie des liquidités de plusieurs organisations paritaires chargées de la protection sociale et en les orientant vers des véhicules de financement de l’économie. On encourage ce système en ce moment : encore faut-il déterminer les règles qui permettent de l’instaurer sans risque pour les assurés ou les adhérents de ces structures. Or la BPI a un rôle à jouer en la matière : elle doit faire en sorte que certains risques soient mieux maîtrisés, offrir des garanties de liquidités aux nouvelles structures qui seront créées et améliorer leur capital de solvabilité requis afin de les conformer aux règles de Solvency II. De nombreux acteurs souhaitant se financer par le biais de tels véhicules, il conviendrait que la BPI sécurise ces investissements.
Pour ce qui est des procédures de délégation, la BPI, parce qu’elle ne dispose pas de l’historique de la phase de démarrage d’activité de nombreuses entreprises, mène de longues enquêtes qui conduisent parfois l’entrepreneur à fournir une présentation formelle de sa demande de financement, ce qui coûte fort cher, car, dans bien des cas, il doit faire appel à un cabinet de conseil à qui il versera un pourcentage des fonds qu’il aura levés auprès de la BPI. Bref, il est certes cohérent d’exiger un certain formalisme, mais celui-ci peut conduire les entreprises à présenter une exécution quelque peu éloignée de la réalité afin de justifier l’investissement demandé au regard des critères identifiés par l’entreprise chargée de prendre en charge leur financement complémentaire. Obliger les entreprises à faire appel à des cabinets spécialisés pour obtenir des financements auprès de la BPI est très coûteux. Or la BPI n’a pas pour mission de financer des entreprises de conseil, même si leur expertise peut être utile. Cela pose d’ailleurs moins de problèmes aux banques, qui peuvent répondre à une matrice simple, qu’aux jeunes TPE qui ne savent guère comment procéder.
M. Bernard Cohen-Hadad. La CGPME apprécie beaucoup et soutient les sociétés de cautionnement mutuel que sont la SIAGI et la SOCAMA. Il faut d’ailleurs reconnaître qu’elles sont en difficulté aujourd’hui, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux de prêts bancaires. Il conviendrait donc que la BPI soutienne ces sociétés qui favorisent le développement des métiers de l’artisanat. Des réseaux tels que le groupe Banque populaire Caisses d’épargne (BPCE) jouent également un rôle en la matière.
André Marcon affirmait tout à l’heure que la BPI ne devait pas avoir de trop bons résultats. Mais, s’ils étaient mauvais, ce serait la fin de Bpifrance. Et, par conséquent, heureusement qu’ils sont bons ! En 2011, Jean-François Roubaud et moi-même avons demandé à Augustin de Romanet, alors directeur général du groupe Caisse des dépôts et consignations, pourquoi il proposait des produits rapportant 15 % à la Caisse quand nous aurions souhaité qu’ils lui rapportent 3 ou 4 %, le rôle de l’État consistant à aider les entreprises. Si l’on peut se réjouir des bons résultats de Bpifrance, tant pour nos entreprises que pour l’État, cela ne veut pas dire pour autant que le coût du crédit doive être trop cher. La culture du risque est bienvenue, mais faisons confiance aux entreprises pour nous présenter de bons risques. Aujourd’hui, un mauvais risque refusé par les établissements financiers peut être accepté par ceux-ci dès lors que Bpifrance apporte sa garantie. En d’autres termes, un risque peut être mauvais de façon temporaire et devenir très vite un bon risque.
Enfin, je partage les propos de Thibault Lanxade s’agissant des fonds de fonds. De bonnes initiatives ont été prises puisque la BPI a soutenu 3 000 PME par ce biais. Et nous avons été à l’origine d’une belle réussite, celle de l’orientation du financement des assureurs par le biais des fonds Nova et Novo de la Caisse des dépôts. Si le projet n’était pas gagné d’avance, nous avons créé ensemble ce dispositif il y a trois ans afin d’orienter l’épargne des Français vers le financement des entreprises – objectif qui a fait l’objet d’un rapport de Mme Karine Berger et de M. Dominique Lefebvre. Cette orientation doit être ouverte, même aux plus petites des entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Cohen-Hadad, dans votre propos introductif puis en réponse à nos questions, vous avez indiqué que Bpifrance ne devait pas être une banque comme les autres. Le dites-vous à titre de précaution ou avez-vous constaté des dérives sur le terrain ?
M. Bernard Cohen-Hadad. Je n’ai constaté aucune dérive. J’ai dit qu’il fallait éviter que Bpifrance n’en vienne à aider les canards boiteux. Bpifrance n’a pas pour mission d’aider les entreprises en fin de vie qui n’ont pas les moyens de se développer et doivent savoir s’arrêter. Les modalités de financement existantes, la mondialisation des échanges et ce qui se passe en Europe font que nous sommes en voie de désintermédiation. Il convient donc de renforcer la capacité de Bpifrance à aider les entrepreneurs et non pas de lui faire remplacer les banques. Elle n’en a pas les moyens, notamment en termes de dotations budgétaires. Les banques de réseau doivent faire leur travail. Je m’exprime peut-être de façon lapidaire, mais telle est la vision du monde économique que j’ai acquise dans le cadre du travail que j’ai mené à la CGPME et en tant que membre de l’Observatoire du financement des PME. Si nous voulons protéger cet outil public que nous avons appelé de nos vœux, ne lui faisons pas faire n’importe quoi.
M. Alexandre Montay. Jusqu’en 2005, OSEO et la BDPME réalisaient une excellente étude concernant la réalité des transmissions d’entreprise en France, véritable outil de pilotage des politiques publiques. Ces deux entités ont cessé de la produire pour des raisons budgétaires, mais, compte tenu de l’enjeu que représentent les transmissions d’entreprises pour l’ensemble du tissu économique, la BPI ne pourrait-elle pas relever le flambeau ? De grands réseaux bancaires se sont intéressés à la question : le groupe BPCE a produit deux années de suite une étude fournie sur le sujet. Mais, compte tenu de la nécessité d’analyser les situations de transmission d’entreprise en termes d’emploi, d’investissement et d’obsolescence du tissu économique, il serait intéressant que BPI s’en saisisse.
M. Thibault Lanxade. Le réseau BPI Excellence, ancien OSEO Excellence, est une formidable initiative qui met en avant certaines TPE, PME et ETI. J’ignore le coût que représente pour Bpifrance l’existence d’un tel réseau, mais il convient d’en maintenir l’existence et d’en assurer une promotion plus large, d’abord parce que c’est un excellent outil de communication pour la BPI et ensuite, parce qu’il permet de valoriser de belles entreprises.
D’autre part, nous traversons une période de mutation du financement intermédié : les outils proposés non seulement par les banques mais par d’autres acteurs vont se diversifier progressivement. La BPI va voir son rôle se renforcer. Mais il est urgent d’assurer l’accompagnement des chefs d’entreprise. Les cinq années de crise que nous venons de traverser ont été très violentes : les chefs d’entreprise se sont démenés pour maintenir leur activité et ont connu une croissance très faible. Or, s’il est simple de financer son entreprise en allant voir son banquier au coin de la rue, il est plus difficile de renforcer ses fonds propres et il est nécessaire que les entreprises utilisent des produits plus structurés. Il va donc falloir que Bpifrance entreprenne un travail de pédagogie auprès des chefs d’entreprise afin de leur faire connaître les différents instruments financiers existants. Les chefs d’entreprise étant très axés sur leur développement mais ayant néanmoins besoin de maîtriser ces outils, la BPI a un rôle important à jouer afin d’améliorer leurs compétences en la matière, en lien avec les organisations professionnelles.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie d’avoir participé à cette table ronde.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je remercie de sa présence M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans le cadre du pacte d’actionnaires, la commission de surveillance de la CDC que vous présidez a pour mission de contrôler les orientations majeures et les décisions stratégiques de Bpifrance. À votre demande, monsieur Emmanuelli, un comité de suivi de Bpifrance a été créé au sein de cette commission. Nous vous entendrons donc avec un intérêt particulier.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Aucun parlementaire ne l’ignore, mais il lui arrive de l’oublier : l’article L 518-2 du code monétaire et financier place la Caisse des dépôts et consignations « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative ». Le groupe Caisse des dépôts (CDC) partage le souci qu’a l’État de développer l’activité et de soutenir, autant que faire se peut, l’investissement. Cette volonté commune s’est traduite par la création de la Banque publique d’investissement, Bpifrance, détenue à parité par BPI-Groupe et par la CDC, laquelle a apporté Oséo, le fonds stratégique d’investissement (FSI) – qui avait lui-même été doté lors de sa constitution par l’Agence des participations de l’État –, CDC Entreprises et quelques autres fonds dont le fonds franco-chinois.
C’est toujours un exercice un peu dangereux que de s’associer avec l’État à parité : parce qu’il incarne l’intérêt public, ses prérogatives et sa puissance sont d’une tout autre mesure que celles de ses partenaires, si bien que cette parité théorique n’empêche pas des relations quelque peu déséquilibrées. La CDC et le ministère des finances sont convenus d’un accord dont le Parlement a eu connaissance. Le texte stipule que l’activité de prêt est du ressort de l’État et l’investissement du ressort de la CDC, ce qu’il faut parfois rappeler aux ministres tentés de prendre des décisions d’investissement ou d’essayer de les imposer. L’équilibre atteint est donc fragile, mais l’essentiel est que, sous l’action de Bpifrance, les en-cours de crédit augmentent et les hauts de bilan se développent.
La CDC ayant apporté quelque 10 milliards d’euros de fonds propres à la nouvelle entité, j’ai souhaité la création d’un comité de suivi de Bpifrance, qui est venu s’ajouter aux autres comités de la Commission de surveillance : le comité d’examen des comptes et des risques, le comité du fonds d’épargne, le comité des investissements, ainsi que le comité des nominations et des rémunérations – qui est appelé à s’étoffer. En 2014, le comité de suivi de Bpifrance s’est réuni une fois pour examiner l’activité d’investissement, une autre fois pour examiner l’activité de financement.
Cette seconde réunion nous a permis de constater que les en-cours bancaires se développent de manière très satisfaisante, Bpifrance jouant activement le rôle de garant qui lui a été assigné. Le dispositif qui connaît le plus grand succès est le prêt de développement à 7 ans, dont le différé de remboursement de 24 mois facilite l’amortissement en permettant un premier retour sur investissement avant d’initier le remboursement. La palette des prêts fait cependant l’objet d’une terminologie foisonnante et l’offre gagnerait à être simplifiée : les chefs d’entreprise s’y perdent alors même que les formules de base ne sont en réalité qu’au nombre de deux ou trois. Le comité de suivi en a fait l’observation à M. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance ; il a convenu que ces nombreuses dénominations sont plus justifiées par un souci de communication que par des considérations d’ordre économique.
Le comité de suivi a relevé que Bpifrance étant, par doctrine, exclusivement co-financeur, il peut se produire que, alors qu’elle s’est prononcée favorablement et vite, elle ne trouve pas de partenaire. J’ai eu connaissance d’un cas de ce type dans les Landes : alors que la garantie de prêt avait été accordée en février 2014, les fonds n’ont été versés qu’en février 2015, une année ayant été nécessaire pour trouver un coprêteur. C’est fâcheux, car l’entrée en production du laminoir concerné en a été retardée d’un an. Le même obstacle vaut de manière plus marquée encore pour les investissements, car si l’ancien Oséo et le système bancaire avaient coutume de travailler ensemble et que ces habitudes ont perduré, elles n’existent pas en matière d’investissement.
Le comité de suivi a ensuite constaté une situation paradoxale. Alors que l’on avait craint qu’un afflux de demandes de crédits nouveaux à la solvabilité incertaine ne fasse de Bpifrance un gouffre, on ne peut qu’être frappé par la faiblesse de la provision affectée aux crédits non remboursés. Le comité de suivi en a déduit que la Banque privilégie les opérations les plus sûres. En atteste un coût du risque, dérisoire, de 36 millions d’euros seulement en 2014, pour un en-cours de 5 milliards.
M. Gilles Carrez. Du temps d’Oséo déjà, le taux de sinistralité était extrêmement faible.
M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. C’est exact, mais cette extrême faiblesse persistante nous a conduits à nous interroger sur des critères très rigides de sélection des risques.
Pour 2015, trois chantiers demeurent dont les niveaux de priorité diffèrent. Il y a d’une part le projet de titrisation des créances des petites et moyennes entreprises (PME), destiné à réorienter pour partie les en-cours d’assurance-vie vers le développement économique. Le sujet suscite la controverse au sein même de la commission des finances de l’Assemblée nationale, où l’on garde en mémoire le rôle déclencheur joué par la titrisation des créances immobilières dans la crise de 2008. S’il faut se garder des excès, il n’y a pas lieu de décréter par principe que la titrisation serait par nature source de contentieux inéluctables : tout dépend des garanties imposées. Le taux d’épargne des Français est exceptionnellement élevé et l’en-cours actuel de l’assurance-vie en France est de 1 500 milliards d’euros. L’un des problèmes majeurs auxquels nous nous trouvons confrontés est de parvenir à rediriger efficacement une part de cette épargne vers l’investissement dans l’industrie ou les services. Je comprends les raisons des réticences qui s’expriment mais ce serait selon moi une erreur d’écarter l’hypothèse par principe au lieu d’examiner attentivement les conditions d’une titrisation qui permettrait aux compagnies d’assurance-vie d’investir dans les PME.
Autre chantier d’importance : le développement d’une offre de crédit export. Les banques commerciales françaises n’ayant plus eu accès au dollar – sans que je puisse dire de façon certaine qu’il s’est agi d’une manœuvre délibérée de la City londonienne et de Wall Street –, se sont trouvées contraintes de réduire considérablement leur service export, sinon de le supprimer. Il en résulte que la France, qui aspire à exporter, n’a pas de dispositif de financement de ses exportations. Bpifrance offrira donc un crédit acheteur en prêteur unique pour les tickets compris entre 5 et 25 millions d’euros et en co-financement pour les tickets compris entre 15 et 75 millions d’euros.
La Société de financement local (SFIL), qui a repris le portefeuille de créances de Dexia, s’occupera des plus gros tickets. À l’origine, la SFIL était chargée du financement des collectivités locales mais en ce domaine la surabondance a succédé à la pénurie. D’ailleurs, le taux de rémunération du Livret A et du Livret de développement durable a pour conséquence que le fonds d’épargne de la CDC, dont l’en-cours est de quelque 350 milliards d’euros, n’est plus particulièrement compétitif au regard des taux offerts par la Banque européenne d’investissement ou même par certaines banques commerciales – au point que la Banque postale va racheter les créances des opérateurs sociaux. Aujourd’hui, le taux des bons du Trésor à 10 ans est de quelque 0,60 ; il s’établissait à 2,6 en février 2014. Le Bund allemand à 10 ans s’établit à 0,30 et, pour les durées inférieures, le taux d’emprunt est négatif. J’ajoute que l’écart – spread – entre le taux du bon du Trésor français et celui du Bund allemand s’est réduit de 20 points de base. En 2014, la CDC a émis pour 350 millions d’euros d’obligations dites Samuraï bonds au Japon, à un taux négatif, une première depuis la création de la Caisse en 1816. On ne peut manquer de s’interroger sur la chute continue des taux et sur son incidence.
M. Gilles Carrez. C’est une bonne chose pour le déficit public.
M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Soit, mais dans le même temps, comment assurer une certaine rentabilité aux investissements ?
Le troisième chantier à poursuivre est celui du financement de l’innovation. La commission des finances de votre Assemblée ne l’ignore pas puisque la question a été débattue lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015. La dotation est insuffisante, et c’est regrettable. Dans un pays de 65 millions d’habitants, Bpifrance ne reçoit que 175 millions d’euros à ce titre, cependant que la Finlande, qui compte 5,4 millions d’habitants, consacre 250 millions d’euros de crédits budgétaires au développement de ses entreprises industrielles innovantes. Lors du débat budgétaire, j’avais soumis à l’Assemblée un amendement tendant à créer un « crédit d’impôt investissement » sur le modèle du « crédit impôt recherche » ; il n’a pas été retenu. On a vu, en 1982-1983, les limites de la politique de la demande, mais l’on sait aussi qu’une politique de l’offre ne fonctionne pas sans demande ; autrement dit, nous devons mettre au point une politique économique « à deux jambes » au lieu d’en rester à une vision obsessionnellement exclusive l’une de l’autre.
M. Gilles Carrez. J’ai rencontré il y a quelques jours à Berlin des membres de la commission des finances du Bundestag, des représentants du ministère de l’économie, du ministère des finances et de la Chancellerie ainsi que des directeurs d’instituts de réflexion économiques ; tous ont mis l’accent sur le manque d’investissement privé. La méthode classique pour remédier à un tel défaut étant l’incitation fiscale, j’avais considéré, lors du débat budgétaire, que l’amendement que vous proposiez méritait d’être étudié. Pour le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), tout a été concentré sur le coût du travail, si bien que l’on ne traite qu’une partie du sujet. Le souci de pragmatisme devrait conduire à définir une politique plus équilibrée, conçue à la fois pour réduire le coût du travail et pour favoriser l’investissement. Même si les économistes reçus par la commission des finances considèrent presque unanimement que dans une période de chômage élevé les politiques de l’emploi les plus efficaces sont celles qui visent à réduire le coût du travail, je souhaite comme vous que l’on aborde ces questions de manière plus empirique et moins catégorique.
M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Je pense qu’en matière de politique de l’emploi, le dopage de l’investissement – dont l’investissement public – a un effet à court terme plus efficace que la baisse des coûts du travail ; M. Pierre-Alain Muet avait fait la démonstration que l’effet de tels dispositifs se fera sentir à moyen et long terme mais qu’il n’est pas garanti à court terme. Mais je ne souhaite pas me lancer dans une controverse qui tient de la guerre de religions.
Pour en revenir à Bpifrance, j’ai indiqué que l’activité de financement a été très dynamique, comme en témoigne l’essor spectaculaire – il a été de 35 % en 2014 – des prêts de développement, qui sont donc des prêts sans garantie de 7 ans assortis d’un différé de remboursement de 2 ans. Cette possibilité intéresse tout patron de PME ou d’entreprise de taille intermédiaire (ETI), car c’est une formule idéale pour moderniser un parc de machines ou des équipements et améliorer ainsi la productivité.
Le préfinancement du CICE a décollé : les engagements ont doublé et le financement de l’innovation par Bpifrance s’est établi à un milliard d’euros, en hausse de plus de 40 % par rapport à 2013. Mais l’on m’a signalé récemment que les conditions d’octroi du CICE auraient été compliquées et que Bpifrance refuserait d’aller vers les entreprises en difficulté – alors que, souvent, l’allocation du CICE permet de monter un tour de table. Nous vous ferons part de ce qu’il en est quand nous en saurons davantage.
La culture entrepreneuriale française rend la question de l’investissement de toutes la plus complexe. Nos entreprises ne sont pas spontanément portées à ouvrir leur capital ; comme dans les autres pays latins, on préfère rester en famille ou entre associés initiaux. Ces réticences ne se manifestent pas dans les pays anglo-saxons, où l’ouverture du capital est perçue comme un facteur de croissance évident. En revanche, les entreprises françaises disposent, en grande partie grâce à la CDC, d’une bonne structure de financement des fonds propres. Contrairement à ce que nous avons fait, l’Allemagne n’a pas constitué des fonds et des fonds de fonds, mais elle parvient à un résultat similaire par le biais des banques régionales. On ne dit sans doute pas suffisamment que 40 % du produit net bancaire allemand est fait par les banques d’investissement et les banques locales du secteur public. La forte interpénétration entre entreprises et banques locales fait que la question du renforcement des fonds propres ne se pose pas dans les mêmes termes en Allemagne et en France.
L’objectif d’investissement de Bpifrance pour 2014 était de 1,5 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros réservés aux opérations exceptionnelles dans des grandes entreprises – ainsi aurions-nous pu être sollicités pour Alstom ou les opérateurs de télécommunication. Dans le milliard d’euros restant, 150 millions seulement des 200 millions d’euros prévus ont été consacrés à l’injection de fonds directs dans les PME ; 800 millions d’euros doivent aller aux ETI, dont 300 millions proviennent des fonds de fonds. Les résultats auxquels les fonds de fonds permettent de parvenir sont certes d’une faible lisibilité, mais en les alimentant on a doté la France d’un dispositif de financement des hauts de bilan et, en une dizaine d’années, la CDC a permis de structurer le marché puisque, sur 2 euros investis en fonds propres, presque 1,5 euro est un investissement public. La part de l’investissement privé est faible parce que les particuliers s’orientent vers l’assurance vie et l’épargne réglementée dont l’épargne logement, et parce que les compagnies d’assurance vie ne peuvent se risquer dans le système de production. J’ai déjà dit les arguments en faveur de la titrisation des créances des PME ; je ne les répéterai pas.
Un effort demeure en matière de couverture territoriale. La qualité d’une banque se mesure bien sûr à la qualité de ses directeurs d’agence et de ses directeurs régionaux mais les salariés doivent être en nombre suffisant et, lors du dernier comité de suivi, M. Nicolas Dufourcq a réclamé une dotation importante en personnel supplémentaire, pour répondre à un besoin patent. On notera d’autre part que beaucoup d’employés de Bpifrance, formés chez J.P. Morgan ou Goldman Sachs, ont une vision toute financière des dossiers qui leur sont soumis. Des efforts d’adaptation ont eu lieu, mais il y aura toujours une certaine dose d’incompréhension entre les parlementaires sollicités pour intervenir en faveur d’entreprises en grande difficulté et des banquiers qui, ne considérant ces sociétés que comme des canards boiteux, ne les voudront pas en portefeuille.
Enfin, la doctrine d’investissement de Bpifrance est la même qu’en matière de prêt : elle est exclusivement co-investisseur, à parité. Cela lui donne la qualité d’investisseur avisé, conçue pour éviter qu’elle ne prenne, seule, des risques inconsidérés en accueillant toute la misère du monde économique, mais c’est un facteur de plus grande difficulté encore que pour l’activité de prêt : que faire si Bpifrance, prête à investir, ne trouve pas de partenaire ? M. Nicolas Dufourcq et le directeur de la stratégie de la CDC s’accordent pour considérer que l’on mettrait beaucoup d’huile dans les rouages en utilisant le plan Juncker pour accorder la garantie gratuite des opérations de capital investissement aux co-investisseurs européens. Si cette idée aboutit, les choses iront mieux, mais elle sera difficile à mettre en œuvre.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Bpifrance envisage-t-elle une solution du même type pour les prêts bancaires ? Dans un autre domaine, la Commission européenne a récemment adressé au gouvernement français un questionnaire sur l’activité de Bpifrance. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. La cohérence ne commande-t-elle pas d’intégrer Qualium Investissement, société de gestion filiale de la CDC qui investit en fonds propres dans les PME et les ETI, au sein de la BPI ? Qu’en est-il également de l’articulation entre Bpifrance et CDC International ? Ne conviendrait-il pas de simplifier ces structures ? Pouvez-vous nous donner aussi quelques indications sur les coûts de gestion des fonds de fonds ?
M. Éric Alauzet. Dans le Doubs, une papeterie ancienne devait être reprise par un industriel libanais très intéressé par le projet de centrale de cogénération biomasse de l’entreprise, mais il ne s’est trouvé aucune agence bancaire régionale pour consentir les prêts qui auraient permis, dans un premier temps, la reprise de l’activité. Si le projet a finalement pu aboutir, il y a deux ans, c’est grâce à l’intervention d’une banque libanaise relayée par HSBC, et la papeterie tourne à nouveau. Je regrette l’erreur d’appréciation du projet commise par les banques françaises et par la CDC ; l’analyse industrielle était fondée sur une perception fausse du projet, dont la modernité n’a pas été comprise.
M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Le problème en matière de crédit est beaucoup moins prégnant qu’en matière d’investissement. Le cas du laminoir landais que j’ai cité tout à l’heure est le seul que je connaisse dans ma région, car la mécanique liant Oséo et le secteur bancaire privé était bien huilée, si bien que, en général, les choses fonctionnent assez bien ; mais la question se pose en effet dans les mêmes termes pour les deux activités, madame la présidente.
Monsieur le rapporteur, vos questions concernent la CDC plus que Bpifrance, puisque Qualium investissement est le nouveau nom de l’ancien CDC Capital-Investissement, une filiale de la CDC qui a pour mission de prendre des participations majoritaires à revendre dans les cinq ans, pour nourrir les fonds propres de la Caisse – l’État ne prélève-t-il pas l’intégralité du résultat du fonds d’épargne de la CDC, et 87 % du total de ses résultats ? La CDC est le plus maltraité des contribuables français ! Le fait que Qualium investissement soit une filiale de la CDC suscite la confiance. Le chef d’une entreprise prospère qui atteint l’âge de la retraite sans héritier a besoin de temps pour organiser sa succession ; il sait que Qualium investissement lui laissera les cinq ans nécessaires. J’ai vu trois exemples de cette sorte au cours des deux dernières années, qui concernaient de belles ETI. Qualium investissement représente 1,5 milliard d’actif et 30 000 emplois ; c’est un bel opérateur de la place de Paris.
CDC International Capital, autre filiale de la Caisse, ne peut être intégrée dans Bpifrance car elle est vouée aux partenariats d’investissement avec les fonds souverains, dans une démarche originale qui en est à ses débuts et qui vise à financer des entreprises ou des infrastructures. Un partenariat paritaire a ainsi été conclu avec le fonds souverain qatari à hauteur de 150 millions d’euros pour chacune des deux entités associées, ainsi qu’avec un fonds souverain émirati. Un autre fonds était en cours de constitution avec les Russes, mais les circonstances font que le dossier est en repos ; cependant, le président de CDC International Capital est membre du comité d’engagement du fonds souverain russe.
Il existe enfin un fonds souverain franco-chinois au sein de Bpifrance, et c’est peut-être plutôt à ce sujet qu’une erreur aurait été commise. Bpifrance a en effet des velléités d’extension à l’étranger et je pense que ce n’est pas son rôle : la Banque a été créée pour soutenir le développement économique en France, non pour émigrer sous les cieux de l’Est américain, du Brésil ou d’Afrique. Or, il y a une sorte de génie français à multiplier les structures qui font double emploi. La mission de CDC International Capital est d’aller chercher des fonds à l’étranger, en mettant un euro pour en obtenir un autre. L’idée est de faire de cette filiale de la Caisse une plateforme capable de faire travailler des fonds souverains entre eux.
M. le rapporteur. Bpifrance avait aussi exprimé la velléité de s’investir davantage dans l’activité assurée par la Coface ; qu’en est-il ?
M. le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Bpifrance a pour rôle de se substituer au système bancaire privé français défaillant dans le soutien à l’exportation. La principale question que nous pose la Commission européenne est « Y a-t-il une faille ? ». En matière d’exportation, la réponse est incontestablement « Oui », et la faille est énorme. Pour les crédits à l’investissement, l’approche est plus compliquée et nous n’avons pas les réponses ; l’examen doit être fait dossier par dossier. Bpifrance est parfaitement dans son rôle de financement de l’export en gérant les garanties publiques à l’exportation avec la Coface. Je rappelle que la Coface appartenait à une société privée, qui avait un mandat public pour la partie « grands contrats » du crédit export. J’avais alerté sur le danger que représenterait la vente de cette société : ceux de nos concurrents qui en deviendraient propriétaires pourraient alors freiner nos exportations pour favoriser les leurs.
Pour ce qui est de CDC International Capital, il en va autrement. Certains des fonds souverains avec lesquels traite cette filiale de la Caisse sont énormes. Nous avons fait savoir d’emblée que nous irions à notre rythme. C’est ainsi que le fonds monté avec le fonds souverain qatari n’a été doté que de 150 millions d’euros par chacune des deux parties; son équivalent italo-qatari a été doté d’un milliard d’euros par chacun des deux associés. L’intérêt pour nous est d’aller chercher de l’argent à l’étranger et de l’orienter peu à peu vers le financement des infrastructures. Ce sont les investissements que recherchent ceux qui, tels les fonds de pension, veulent des rendements stables – entre 5 et 8 % -, à long terme, et réputés sûrs.
Quant aux coûts de gestion des fonds de fonds, auxquels la BPI est très attentive, ils sont généralement compris entre 1,5 % et 2,5 % des fonds levés. Ce taux, qui peut paraître faible, s’explique par la double rémunération des dirigeants de sociétés de gestion, lesquels perçoivent un salaire et bénéficient du fameux carried interest, que CDC Entreprises a d’ailleurs malencontreusement appliqué il y a quelques années, ainsi que la presse s’en est fait l’écho. La distribution d’actions gratuites ne peut en effet se justifier que par la prise de risques : pour bénéficier du carried interest, le dirigeant d’une société de gestion doit souscrire à l’opération, avec le risque de tout perdre – ce qui est rare, au demeurant. J’ajoute que Bpifrance, qui est très structurante sur ce marché, a beaucoup réduit le nombre de fonds de fonds auxquels elle souscrit, afin de se concentrer sur les plus efficients et les plus sérieux, dont la liste est d’ailleurs disponible.
Mme la présidente Véronique Louwagie. S’agissant du questionnaire relatif à l’activité de Bpifrance que la Commission a adressé au Gouvernement, vous avez évoqué l’existence de failles. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce point ? Par ailleurs, quel regard portez-vous sur les relations de Bpifrance avec les organismes publics qui apportent un soutien aux entreprises – je pense à la Médiation du crédit, au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), à Atout France ou à Business France ? Ces relations doivent-elles être améliorées, développées ?
M. le président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Ce dossier est en cours d’instruction et je ne puis vous en dire beaucoup plus. Néanmoins, nous pourrons vous faire parvenir nos réponses au questionnaire de Bruxelles.
Par ailleurs, la structuration des différents organismes n’est pas mauvaise dans notre pays. La situation des Papeteries de Gascogne, par exemple, qui allaient très mal, a pu être rétablie grâce à Bpifrance, qui a réalisé un investissement presque équivalent à celui des actionnaires privés. En combinant le Fonds de développement économique et social (FDES), qui répond souvent à une demande du CIRI, et Bpifrance, on peut réaliser des tours de table qui permettent de sauver certaines entreprises, mais pas toutes.
À ce propos, ce qui manque cruellement – je serai prudent et précis sur ce point –, c’est un véritable fonds de retournement public. Bpifrance affirme jouer ce rôle, mais, compte tenu de son taux de sinistralité, on peut penser qu’elle retourne les jolies fleurs et non celles dont la tige a souffert… Quoi qu’il en soit, cette hypothèse n’est bien vue ni du système bancaire, ni de la haute administration française, dont on sait qu’ils sont séparés par une frontière poreuse. Elle préjuge, sans doute à raison, que si un tel fonds existait, il deviendrait rapidement le dépotoir du système bancaire commercial. Je crois pourtant, contrairement à Bpifrance et aux ministres de l’économie successifs – quoi que le précédent et l’actuel ministre n’aient pas forcément le même point de vue à ce sujet –, qu’il est simple de distinguer les entreprises sauvables des entreprises qui ne le sont pas : celles qui ont un carnet de commandes peuvent être sauvées. Quant aux autres, si le produit qu’elles fabriquent ne se vend pas, on peut y mettre autant d’argent que l’on veut, elles se transformeront rapidement en tonneau des Danaïdes. Mais, encore une fois, cette idée est mal vue des hautes sphères de l’administration. C’est regrettable, car on voit opérer en France des fonds de retournement, notamment des fonds anglo-saxons, aux méthodes prédatrices : huit fois sur dix, leur action aboutit au démantèlement. J’ai cru, pendant un an et demi, que l’on parviendrait à combler cette lacune, mais je suis maintenant découragé : on se heurte à un tel mur…
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la BPI, priorité a notamment été donnée aux investissements dans le domaine environnemental. Or, on constate qu’il existe très peu de liens entre Bpifrance et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
M. le président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. J’y ai fait allusion, mais je ne veux pas y insister, car nous n’avons pas, hélas, la capacité de refaire le monde et l’administration française. Celle-ci obéit à un réflexe biologique : tout corps vivant composé de plus de deux cellules a tendance à se développer et à démultiplier le nombre de ses cellules à l’infini. Ainsi, non seulement nos structures administratives veulent rester indépendantes, mais elles veulent empiéter sur le champ d’action de leurs voisines. Au demeurant, l’ADEME ne dispose plus des mêmes moyens qu’autrefois. En revanche, la CDC est concernée, davantage que la BPI, par la transition énergétique : elle a tenté de mettre en place, à travers le Fonds d’épargne, des prêts destinés à la requalification énergétique de logements sociaux et elle participera, à hauteur de 1 milliard, aux fameux fonds de garantie. Le Fonds d’épargne, je le rappelle, est une section de la CDC, qui est traitée comptablement à part au motif que le Livret A bénéficie de la garantie de l’État. Je crois pourtant savoir quels seraient les résultats d’un sondage dans lequel on demanderait aux épargnants à qui, de l’État ou de la Caisse des dépôts, ils font le plus confiance. Dans la tête des gens, l’État prend, la Caisse garantit…
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions, monsieur le président, pour votre présence, votre contribution et les éléments que vous avez pu nous fournir.
M. Bertrand Finet, directeur exécutif Fonds propres PME et de M. Jean-Yves Gilet, direction ETI et grandes entreprises, de Bpifrance
Mme la présidente Véronique Louwagie. Mes chers collègues, nous accueillons à présent M. Bertrand Finet, directeur exécutif Fonds propres PME, et M. Jean-Yves Gilet, direction ETI et grandes entreprises de Bpifrance, pour aborder plus concrètement l’apport de la BPI en matière de financement direct des entreprises.
Messieurs, je vous laisse la parole pour que vous nous présentiez les contours de l’activité de la BPI dans ce domaine, ainsi que la façon dont celle-ci peut répondre aux besoins des entreprises. Ces derniers ont-ils évolué depuis la création de la BPI et quelles sont les principales difficultés que vous identifiez dans ce domaine ?
M. Jean-Yves Gilet, direction ETI et grandes entreprises de Bpifrance. La direction ETI-GE assume deux missions distinctes. Pour les ETI et certaines PME ayant des besoins importants, nous nous inscrivons dans une logique de projet et de développement. Nous intervenons près d’entreprises en croissance, rentables, cotées ou non et dont les besoins de financement sont supérieurs à 10 millions d’euros, cette somme constituant la ligne de partage entre ma direction et celle des fonds propres PME. Nous investissons sur le long terme, contrairement à beaucoup de fonds d’investissement privés, avec le souhait d’accompagner l’entreprise dans son évolution et la réalisation de son projet. Pour ce faire, nous participons à la gouvernance de l’entreprise, en ayant la possibilité de proposer la désignation d’un administrateur qui sera en quelque sorte notre source d’information privilégiée au sein du conseil d’administration.
En ce qui concerne les grandes entreprises stratégiques, qui constituent le socle du patrimoine économique et industriel de la France, nous jouons un rôle de stabilisation du capital lorsque celui-ci est fragmenté, donc fragile. La participation de Bpifrance à hauteur de 5 % à 10 % témoigne en effet de l’intérêt stratégique de l’entreprise pour la France.
Dans l’un et l’autre cas, nous investissons dans l’ensemble des secteurs, à l’exception de la promotion immobilière et de la finance, et toujours de façon minoritaire.
Quelles sont les caractéristiques de notre doctrine ? Nous cherchons à être un partenaire de confiance pour les entreprises, en étant très proches de leurs intérêts sur le long terme. Il est important de noter que nous recherchons des co-investisseurs chaque fois que cela est possible. Il est parfois difficile de trouver des fonds privés pouvant s’engager sur le long terme, mais nous y parvenons dans 70 % à 80 % des cas. Par ailleurs, nous nous devons d’être un investisseur avisé – l’argent qui nous est confié provient de l’épargne des Français et notre responsabilité est de le leur rendre avec une rentabilité minimale – et d’être attentifs à l’intérêt général : nous tenons donc compte de la place de l’entreprise dans son écosystème, qu’il s’agisse d’une filière industrielle ou d’une zone géographique.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par un investissement de long terme ?
M. Jean-Yves Gilet. Nous nous fixons une échéance de huit ans, mais nous avons la possibilité d’adapter la durée de notre investissement au cycle du projet de l’entreprise, qui peut être très long – c’est le cas, par exemple, pour Limagrain, qui mène des recherches en matière de semences. En tout état de cause, cette échéance n’est pas une limite absolue. Certes, nous n’avons pas vocation à être éternellement présents dans le capital d’une entreprise, mais si son dirigeant a un nouveau projet, nous sommes a priori prêts à prolonger notre bail. C’est une des raisons pour lesquelles le fonds ETI 2020, doté de 3 milliards d’euros, a été créé pour 99 ans. Cela ne signifie pas que nous resterons 99 ans au capital d’une entreprise – même si mon rêve serait que, de projet en projet, nous soyons amenés à être encore présents dans un siècle. Mais notre objectif est de créer des champions, et cela nécessite de s’inscrire dans la durée.
Nos trois principales thèses d’investissement sont l’accélération du développement des entreprises en croissance, l’accompagnement de la mutation d’entreprises, qu’il s’agisse d’une reprise ou d’un changement de modèle, et le renforcement de l’actionnariat d’entreprises stratégiques.
Le nombre total de nos lignes d’investissement, dont certaines ont été apportées par les deux actionnaires historiques du Fonds stratégique d’investissement, s’élève à une petite centaine. J’ajoute que nous disposons également d’un outil destiné à l’accompagnement des acteurs de l’automobile, le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, qui a été rebaptisé l’année dernière Fonds pour l’avenir automobile, afin de bien marquer la rupture avec la logique de retournement qui était auparavant celle de ce fonds.
M. Bertrand Finet, directeur exécutif Fonds propres PME de Bpifrance. La direction dont j’ai la charge a vocation à investir, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans des entreprises très petites, petites ou moyennes, pour des montants inférieurs à 10 millions d’euros. Sa mission principale est de leur permettre de se développer plus rapidement afin qu’elles deviennent, peut-être, les ETI de demain. À l’instar de la direction ETI-GE, nous investissons dans l’ensemble des secteurs, à l’exception du secteur immobilier et du secteur financier. En revanche, contrairement à cette dernière, la direction Fonds propres PME est présente dans les vingt-deux directions régionales de Bpifrance, de sorte que celle-ci peut présenter aux entrepreneurs la palette complète de ses produits, qu’il s’agisse de financements, de garanties ou de fonds propres.
Mon équipe compte 80 investisseurs, dont cinquante se trouvent en régions, répartis dans quatre équipes : France investissement régions s’occupe des investissements régionaux, qui sont d’ailleurs les moins importants – jusqu’à 4 millions d’euros ; France investissement croissance, basée à Paris, investit à la fois en fonds propres et en mezzanine – qui est un produit se situant entre la dette classique et les fonds propres – des tickets compris entre 4 et 10 millions d’euros dans des entreprises un peu plus importantes ; la troisième équipe, dite sectorielle, investit, par l’intermédiaire de fonds dédiés – le fonds Savoir-faire d’excellence, le fonds Mode et finance et le fonds Patrimoine et création – dans les industries créatives, qui participent de l’exception culturelle française ; enfin, la quatrième équipe gère un fonds Bois, un fonds Ferroviaire et un fonds Nucléaire, qui investissent dans ces secteurs industriels. Ces filières comprennent des donneurs d’ordres importants qui investissent eux-mêmes dans les fonds que nous gérons ; le fonds Ferroviaire compte ainsi parmi ses investisseurs la SNCF, la RATP, Bombardier et Alstom. Dans ces fonds dits « filières », la part apportée par Bpifrance est minoritaire.
J’ai sous gestion environ deux milliards d’euros, dont une bonne moitié est d’ores et déjà investie dans des entreprises, le reste étant disponible pour l’être dans les prochaines années. Mon portefeuille est par nature plus important en volume que celui de Jean-Yves Gilet, puisqu’il compte 450 sociétés, ce qui représente un véritable défi en termes de suivi des participations. Mon équipe est donc structurée pour assurer ce suivi, qui est essentiel.
Par ailleurs, en tant qu’investisseurs professionnels et soucieux de l’intérêt général, nous devons savoir « sortir ». Historiquement, mes équipes étant en partie issues notamment de CDC Entreprises et de FSI régions, mon portefeuille comprend des entreprises que nous accompagnons depuis plus de dix ans. L’année 2014 a ainsi été marquée par un nombre important de sorties. Lorsque l’entreprise a été accompagnée pendant un certain temps, il est en effet important qu’elle puisse être revendue, en accord avec l’entrepreneur et les actionnaires ; le rôle de Bpifrance est alors de s’assurer que le repreneur est sérieux.
La direction Fonds propres PME mène une centaine d’opérations par an, ce qui est très significatif par rapport aux sociétés d’investissement privées ; nous sommes du reste la société de gestion française la plus importante en termes d’effectifs. Bien entendu, dans le cadre de son activité bancaire, Bpifrance intervient dans des milliers, voire des dizaines de milliers d’entreprises chaque année, mais la logique dans laquelle nous nous inscrivons est très différente : l’investissement en fonds propres relève du sur-mesure, et il est beaucoup plus long à mettre en place puisque nous entrons dans le capital d’entreprises qui sont souvent familiales.
Enfin, je précise que dans 95 % des cas, nous investissons avec des fonds privés ou régionaux. C’est un point important, qui témoigne de l’effet d’entraînement suscité par Bpifrance. En 2014, France investissements régions a réalisé 90 investissements en partenariat avec 74 investisseurs privés ou régionaux.
M. Jean-Yves Gilet. En raison de sa spécificité, Bpifrance ne peut avoir une approche pointilliste. Nous cherchons donc à comprendre la logique des secteurs et des domaines d’intervention, tout en nous intéressant à la localisation des entreprises et, bien entendu, à la question de l’emploi, qui est un élément majeur. Nous avons également le devoir d’aller au-devant des entrepreneurs. C’est ainsi que j’ai lancé, l’année dernière, l’initiative ETI 2020, qui a d’abord consisté à recenser ces entreprises. Nous avons dénombré 3 500 ETI indépendantes au-devant desquelles nous sommes allés dans les régions, afin de leur expliquer en quoi Bpifrance pouvait leur apporter davantage qu’un autre investisseur.
En effet, non seulement Bpifrance est un acteur de confiance et une référence, mais elle présente également l’avantage de disposer d’une palette d’opérations qui répondent à l’ensemble des besoins des entreprises. Même si les processus internes sont distincts, pour éviter de confondre prêts et investissements en fonds propres, le chef d’entreprise a désormais un interlocuteur unique, le directeur régional, qui peut l’accompagner en assurant un continuum des financements, puisque nous avons des outils qui permettent de répondre graduellement à chaque problème. Ainsi, une des vingt entreprises dans lesquelles nous avons investi en 2014 était, à l’origine, une participation des fonds PME, qui s’est développée de telle manière qu’elle a eu besoin d’un ticket supérieur à 10 millions d’euros. Cet exemple illustre bien le fait que nous accompagnons les entreprises sur le long terme, notamment grâce à la multiplicité et à la complémentarité de nos outils.
L’offre de Bpifrance est reconnue par les chefs d’entreprise comme différente de celle qui existait auparavant, et c’est un élément très positif, comme le démontrent certaines enquêtes de clientèle ou de notoriété. En effet, de par son évolution – on est passé de financements réalisés directement par les banques à des financements de type obligataire –, le monde du financement est souvent considéré comme confus par les chefs d’entreprise. À cet égard, notre offre très cohérente – soutien public à l’innovation, prêts, y compris de court terme, prêts immobiliers, prêts de développement et fonds propres – constitue une réponse appréciée des entrepreneurs, d’autant plus qu’ils savent, par le bouche-à-oreille, qu’elle est très favorable au développement de leur entreprise.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Gilet, vous avez indiqué que Bpifrance disposait d’une palette d’outils importante qui lui permet de répondre à un grand nombre des besoins des entreprises. Cette diversité ne nuit-elle pas à la simplicité de l’offre qui leur est proposée ? Par ailleurs, que se passe-t-il lorsque vos co-investisseurs ne souhaitent pas investir à aussi long terme que Bpifrance ?
Monsieur Finet, pouvez-vous nous donner des indications sur le nombre des refus opposés aux entreprises qui souhaitent ouvrir leur capital et nous dire quelles en sont les raisons ? Je souhaiterais également savoir ce qu’il en est de la suggestion du Commissariat général à l’investissement de prévoir des actions de préférence sans droit de vote, afin que le renforcement des fonds propres des PME ne remette pas en cause leur contrôle par leur fondateur.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Nous avons abordé tout à l’heure avec le président de la Commission de surveillance de la CDC la question des fonds de retournement. La question est importante car, si l’on rapporte le coût du risque aux encours de Bpifrance, on peut se demander si celle-ci ne fait pas preuve de frilosité dans ses investissements.
Pourtant, dans le dossier ERAMET, que je souhaiterais évoquer avec vous, une provision de 300 millions d’euros a été réalisée qui pourrait traduire la moins-value des actions de l’État. Pour l’expliquer, on invoque la crise du nickel. Pourquoi pas ? Mais l’on constate que cette entreprise a perdu de sa compétitivité en voyant ses coûts de production augmenter de 50 % depuis les années 2000 ; elle est ainsi reléguée au 57e rang mondial en matière de coût de revient. Par ailleurs, les tonnages ont diminué de près de 15 % depuis 2006 et des investissements qui auraient dû être réalisés ne l’ont pas été. Je pense notamment à la construction d’une centrale électrique en Nouvelle-Calédonie ou à des investissements, à hauteur de 500 millions d’euros, qui devaient être faits en Indonésie et qui n’ont pas été autorisés par les autorités locales.
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 20 février dernier, il a été indiqué que Bpifrance jouait un rôle important dans cette entreprise, dont elle détient en effet 26 % des actions. Je souhaiterais donc savoir de quelle manière vous suivez l’évolution de ce groupe et si vous pouvez influer sur les décisions qui sont prises. Comment expliquer une provision de 300 millions d’euros quand la sinistralité de Bpifrance est de 36 millions ?
M. Éric Alauzet. Monsieur Finet, vous avez indiqué, d’une part, que les participations de Bpifrance étaient toujours minoritaires et, d’autre part, que cette dernière suscitait un effet d’entraînement auprès des autres investisseurs. De deux choses l’une : soit les banques investissent dans l’entreprise et vous êtes un partenaire apportant une plus-value, mais alors le plan de financement ne pose pas de problème ; soit les banques refusent et, dans ce cas, je ne vois pas en quoi une participation minoritaire de Bpifrance peut produire un effet de levier. Pour les entreprises en retournement, avez-vous éventuellement une stratégie différente qui consisterait à réaliser un investissement plus important, qui ne soit pas forcément minoritaire, pour produire précisément cet effet d’entraînement ?
M. Bertrand Finet. En ce qui concerne les actions sans droit de vote, nous proposons, parmi les produits de Fonds propres PME, des obligations convertibles, qui donnent accès au capital de l’entreprise, non pas immédiatement, mais à terme. Ce type de produit peut séduire le chef d’une entreprise familiale, par exemple, qui a des besoins de financement mais ne souhaite pas forcément ouvrir son capital. Arrive toutefois le moment où la conversion doit intervenir. Si, à ce stade, le chef d’entreprise ne souhaite toujours pas que nous ayons accès au capital, il doit nous rembourser et nous verser une prime de non-conversion (PNC). Au plus fort de la crise financière, en 2008 et 2009, ce type de produits a été beaucoup utilisé. Or, aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il aurait fallu éviter de faire de fausses promesses au chef d’entreprise, qui n’est pas toujours conscient que la non-dilution de son capital a un coût. De plus, les intérêts se cumulant, trois ou quatre ans plus tard, la somme due peut lui paraître très importante. Ce produit, dans lequel certains de nos fonds sont spécialisés, doit donc être utilisé avec prudence – l’entrepreneur ne doit pas y voir une sorte de « Canada dry de fonds propres ». Je rappelle en effet que nous avons l’obligation à la fois d’agir en investisseur avisé et d’être soucieux de l’intérêt général.
Par ailleurs, je répondrai à M. Alauzet que le fait d’investir en fonds propres dans une entreprise avec un acteur privé non seulement démontre que la présence de Bpifrance est perçue comme un signe positif par les autres investisseurs et que nous investissons, conformément à notre mission, comme un acteur de marché, mais permet de compléter un tour de table. Cet effet d’entraînement est réel. Cependant, beaucoup d’entreprises très dynamiques, qui se développent rapidement, se financent exclusivement auprès du secteur privé.
M. Éric Alauzet. La question reste posée pour les entreprises qui sont réellement en difficulté et manquent de fonds propres : pouvez-vous aller, dans un tel cas, au-delà d’une participation minoritaire ?
M. Bertrand Finet. Notre doctrine est d’être toujours minoritaire, quoi qu’il arrive ; devenir majoritaire reviendrait en effet à nationaliser l’entreprise. En matière de retournement, question chère au président Emmanuelli, Bpifrance n’investit pas directement dans ce secteur. En revanche, elle investit dans des fonds spécialisés dans le retournement. En outre, elle peut donner sa garantie aux banques participant à la reprise d’une entreprise en difficulté ; cette garantie porte sur 50 % à 70 % du montant investi. Si nous entrions en direct dans des entreprises en difficulté, le coût du risque exploserait. Nous essayons donc de respecter un équilibre subtil en la matière.
M. Éric Alauzet. Cet engagement plus important de Bpifrance permet-il de faire basculer des dossiers dans lesquels les banques rechignaient à s’engager ?
M. Bertrand Finet. Cela arrive. Le risque est que, voulant bien faire, le chef d’entreprise argue, auprès d’autres investisseurs, de l’intervention de Bpifrance pour les convaincre de s’engager. Il faut donc trouver le juste milieu pour ne pas se faire instrumentaliser.
S’agissant des refus opposés aux entreprises, il faut savoir que le monde de l’investissement en fonds propres est totalement différent de celui du financement bancaire. Les décisions des banques sont prises sur le fondement des comptes historiques : des logiciels d’aide à la décision produisent une notation et, pour le dire de façon caricaturale, si cette notation est bonne, le prêt sera accordé quasi automatiquement. L’investisseur en fonds propres, quant à lui, s’intéresse davantage au business plan et aux perspectives de croissance de l’entreprise. Il doit donc rencontrer l’équipe de direction et mener des investigations financières, stratégiques et juridiques très poussées. Dès lors, le taux d’échec est forcément beaucoup plus important. Ainsi, l’an dernier, ma direction a reçu plus de 1 500 dossiers ; nous avons travaillé activement sur 300 d’entre eux, et nous en avons retenu 100. Les autres n’ont pas abouti, soit parce que le chef d’entreprise a changé d’avis, soit parce qu’un acteur privé a décidé de payer un peu plus cher que nous – et, gérant de l’argent public, nous n’avons pas vocation à surenchérir –, soit parce que nos investigations n’ont pas été concluantes.
En tout état de cause, nous nous efforçons de répondre au chef d’entreprise rapidement et professionnellement, surtout lorsque nous lui disons non, ce qui nous arrive beaucoup plus souvent qu’à nos collègues en charge du financement. Du reste, notre refus se traduira plutôt par une proposition de réorientation. Nous avons en effet créé, au sein de Bpifrance, une cellule deal flow, dont le métier est de recevoir les entrepreneurs et de les orienter soit vers des fonds partenaires ou des fonds privés, soit vers d’autres solutions, comme un financement.
M. Jean-Yves Gilet. L’une de nos missions est d’aider les entreprises à mieux formuler leurs demandes : souvent, les réponses négatives viennent du fait que la demande est mal formulée.
Je voudrais insister sur la durée des investissements, qui est un facteur crucial. Investir en fonds propres, c’est rentrer dans l’intimité d’une entreprise ; l’ouverture du capital est une transformation profonde, difficile, longue. De plus, nous travaillons au cas par cas : nous voulons comprendre la stratégie de l’entreprise, sa vision à moyen terme, ses comptes… Ce sont des dossiers très complets. Beaucoup ont l’impression que nous sommes lents ; mais, l’année dernière, à une occasion, trois semaines se sont écoulées entre le contact avec l’entreprise et le décaissement des fonds ! Nous pouvons donc être très réactifs lorsque tous les documents nous sont fournis. Nous voulons aller vite quand c’est possible mais surtout répondre aux besoins des entreprises, et cela nécessite un travail approfondi.
Je voudrais également revenir sur le retournement. On parle ici d’entreprises qui vont mal – leur business model, leur gestion ne sont pas bons –, mais dont les fondamentaux sont solides. Très souvent, il est alors nécessaire de changer d’attelage. Or nous ne pouvons pas changer les équipes en étant actionnaire minoritaire. Il est donc important de passer soit par des fonds de retournement, soit par l’accompagnement d’un repreneur. Le président Emmanuelli le sait mieux que personne, puisqu’il y a dans les Landes une entreprise papetière, Gascogne, qui a été reprise ; notre présence a permis d’entraîner l’ensemble de la place financière, ce qui était essentiel, car il a fallu une importante restructuration financière, des investissements lourds. Touchons du bois : pour le moment, l’entreprise va plutôt bien.
Nous faisons du retour à la normale – je préfère ce terme à celui de retournement, trop connoté – tous les jours, pour des entreprises qui se posent des questions, non pas sur leurs fins de mois mais sur leurs perspectives à deux ans.
Dans ce type de situations, nous apportons de la rationalité, et je peux vous assurer que nous ne faisons preuve d’aucune frilosité. Nous prenons même plus de risques que d’autres ! Je souligne que nous investissons pari passu, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que les autres investisseurs, à la fois pour des raisons d’équité et pour respecter les normes bruxelloises. La comparaison que vous esquissiez entre le coût du risque et la frilosité, monsieur le rapporteur, n’est pas, si je puis me permettre, parfaitement juste. L’exemple d’ERAMET que vous citez montre bien d’ailleurs que nous prenons des risques, puisque nous sommes parfois amenés à constater des pertes.
J’insiste sur la diversité des outils. Nous cherchons à construire les outils les plus adaptés à chacun des besoins, afin d’être efficaces et d’éviter aux entreprises d’avoir à s’adresser un peu partout. Cette diversité serait nuisible si elle n’était pas orchestrée, mais la création de Bpifrance a justement permis de mieux l’organiser. Les plus grandes entreprises s’adressent directement au siège, mais le point d’entrée pour la plupart des entreprises est le directeur régional : il connaît tous les outils et il est à même d’orienter les entreprises. Les Ateliers ETI 2020 déjà évoqués ne visaient pas à dresser un catalogue exhaustif des outils existants, mais à présenter les principes et à inviter les entreprises qui ont des projets à venir nous voir pour trouver la meilleure solution pour elles. La première étape de l’accompagnement, c’est l’accueil !
J’en reviens maintenant à ERAMET – en précisant que je ne peux pas m’étendre ici sur le détail des comptes d’une entreprise cotée. Tout d’abord, je n’ai pas exactement les mêmes chiffres que vous, monsieur le rapporteur, mais au fond peu importe. Il faut distinguer deux choses. Vous m’avez posé des questions sur la stratégie industrielle d’ERAMET, sur ses investissements… ; il y a aussi la question de la valorisation. L’un et l’autre aspects ne sont pas déconnectés : le marché se pose les mêmes questions que vous, et constate que la fluctuation des cours des matières premières conduit à des hauts et des bas pour l’entreprise. Les coûts de production d’ERAMET avaient fortement augmenté sous l’effet de la hausse du cours de l’euro par rapport au dollar – c’est une entreprise qui fonctionne en dollars – et de la hausse du coût de l’énergie. Mais, depuis six mois, la baisse de l’euro et celle du prix du pétrole – événements externes – lui ont permis de regagner de la compétitivité. Tout cela a nourri les interrogations du marché sur cette entreprise.
Quant aux provisions, il faut bien comprendre que nous évoluons dans un monde très normé : lorsque le cours de bourse fluctue de façon significative, ce qui a été le cas, nous sommes obligés de le prendre en compte. Ce sont les règles : nous nous conformons aux standards internationaux, dits IFRS (International Financial Reporting Standards). Je ne rentre pas dans les détails ce matin, mais nous pourrons y revenir si vous le désirez.
Le rôle de l’actionnaire minoritaire est un rôle difficile. Souvent, nous demandons certains droits particuliers, sur l’approbation des investissements, sur les alliances… Nous sommes donc un actionnaire minoritaire, mais pas un actionnaire passif ; nous essayons d’être incisifs sans être intrusifs. Nous essayons d’influencer certaines décisions, ce qui prend parfois du temps. Mais, si nous étions actionnaires majoritaires, les risques seraient beaucoup trop élevés.
S’agissant enfin du retournement, j’ai déjà cité Gascogne, je peux également citer Clestra, fabricant de cloisons de bureau : nous avons là aussi accompagné un repreneur. Globalement, les deux résultats sont plutôt positifs. Si l’entreprise a un potentiel réel – ce que l’on peut évaluer – et qu’elle est entre les mains de quelqu’un qui sait où il va, généralement, cela donne de bons résultats.
M. le rapporteur. Quel est le volume global des provisions aujourd’hui ?
Nous ne pouvons pas vous demander de faire mieux que l’Agence des participations de l’État (APE), puisque, comme chacun sait, il existe des entreprises françaises dont l’État est actionnaire et qui utilisent leurs filiales aux Pays-Bas, par exemple, pour se livrer à l’optimisation fiscale – c’est un journal néerlandais qui avait révélé ces faits, en janvier 2013. Mais, en tant qu’actionnaire, vous posez-vous ces questions ? Rencontrez-vous des problèmes éthiques ?
M. Jean-Yves Gilet. Une partie des entreprises dans lesquelles nous investissons ont leur siège, ou une partie de leurs comptes, hors de France. Ce qui nous guide, c’est la création de valeur ajoutée en France, ainsi que la présence de centres de décisions – sièges administratifs, parfois différents des sièges sociaux, principales usines, centres de recherche…
Certaines des entreprises dans lesquelles nous investissons bénéficient de montages, en effet, mais ce ne sont pas du tout les montages très décriés des quatre grandes entreprises américaines de l’électronique, Google, Facebook, Apple, Amazon. Il est de la responsabilité de chacune des entreprises de voir comment elle peut optimiser ses résultats.
Je constate que le barycentre des activités des entreprises présentes dans notre portefeuille se situe très largement en France : la majeure partie de l’activité, et donc de la création de valeur, se fait en France. Nous sommes naturellement très attentifs aux prix de transfert. Pour d’autres entreprises, dont les caractéristiques géographiques, et notamment l’implantation des centres de décisions, sont différentes, la situation sera différente.
Nous ne rencontrons pas, en tout cas, de problèmes éthiques particuliers.
S’agissant du montant des provisions, les comptes de Bpifrance seront publiés la semaine prochaine, et c’est à ce moment que Nicolas Dufourcq et Arnaud Caudoux pourront répondre à cette question.
M. le rapporteur. Par rapport à Coface, à Ubifrance, comment voyez-vous le rôle de Bpifrance au-delà de nos frontières ?
M. Jean-Yves Gilet. Je ne connais guère de champions qui soient uniquement nationaux – on pourrait peut-être en trouver dans le domaine des services à la personne, où les spécificités nationales sont fortes. La plupart du temps, à partir d’une certaine taille, une entreprise doit sortir des frontières ; si elle rencontre de grands succès en France, il y a de fortes chances que son modèle puisse être exporté. Les deux principales entreprises européennes dans le secteur de la gestion des maisons de retraite – marché en croissance – sont d’origine française : cela peut nous indiquer qu’il y a là un modèle de management exportable.
Nous sommes donc favorables au fait que les entreprises avec lesquelles nous travaillons réalisent des investissements à l’étranger, qu’il s’agisse de rachats d’entreprises, d’implantations nouvelles, de développements commerciaux. Nous avons donc des liens avec Coface comme avec Ubifrance. Évidemment, nous nous demandons toujours s’il s’agit de croissance de l’entreprise ou de délocalisation – ce qui serait, pour le coup, entièrement contraire à notre mission d’intérêt général.
Dans la plupart des cas, lorsqu’une entreprise en rachète une autre, leurs carnets de commandes sont complémentaires : les synergies commerciales sont fortes, et l’effet d’entraînement réel. Le développement à l’étranger est donc favorable à la valeur ajoutée en France, et c’est pourquoi nous soutenons ce type d’investissements.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Deux fonds spécialisés dans le financement de la transition énergétique et environnementale ont été créés. Bpifrance agit-elle en ce domaine ? Doit-elle aller plus loin ?
Avec deux années de recul, pensez-vous que Bpifrance joue bien son rôle ? Avez-vous des suggestions d’amélioration ?
M. Bertrand Finet. S’agissant du bilan et des perspectives, j’ai moi-même intégré le Fonds stratégique d’investissement en 2009, c’est-à-dire dans une période de crise profonde. Je peux donc comparer l’action du FSI et celle de Bpifrance. Nous sommes aujourd’hui clairement, je crois, dans notre rôle – celui d’un investisseur un peu différent des autres, et qui prend un peu plus de risques que les autres. Nos actions ont permis de développer l’emploi, d’éviter des délocalisations.
Quant au chemin qui nous reste à parcourir, je voudrais insister sur la nécessité de développer l’accompagnement. Nous connaissons la solitude de coureur de fond des chefs d’entreprise, notamment dans les TPE et PME : ils sont au four et au moulin, ne disposent pas toujours de comité de direction… Nous pouvons les aider à prendre un peu de recul, à mieux comprendre leur environnement. L’année 2015 sera pour nous l’année de l’accompagnement. Nous faisons déjà, tous, de l’accompagnement, mais nous mettons aujourd’hui en place Initiative Conseil, petite équipe dont la vocation est de présenter aux différents entrepreneurs des conseillers préalablement accrédités et qui sauront les aider de différentes façons : mise en relation avec les chargés d’affaires Business France, ex-Ubifrance, ou avec des cabinets de fusions-acquisitions, missions d’optimisation industrielle réalisées par nos équipes ou par des conseils extérieurs…
Nous travaillons aussi depuis plusieurs mois sur l’Accélérateur PME, qui sera présenté cet après-midi même en présence d’Emmanuel Macron. Ce projet, que je sponsorise au sein du comité exécutif de Bpifrance, a pour parrains Bpifrance et la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’économie. Nous avons sélectionné un peu plus d’une cinquantaine d’entreprises, en fonction de leur chiffre d’affaires, de leur rentabilité, de leur croissance, du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé en recherche et développement… Ces PME d’une certaine taille – leur chiffre d’affaires se situe entre 10 et 50 millions d’euros – ont vocation à devenir les ETI de demain. Le but du programme Accélérateur PME est de concentrer, avec l’aide de la DGE et des DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), tout ce que nous savons faire – d’apporter des offres de conseil et de diagnostic, de mobiliser l’université Bpifrance pour former ces chefs d’entreprises… Pour chaque entreprise, le programme dure deux ans ; l’idée est d’avoir en permanence entre 100 et 120 entreprises dans le programme : la première promotion est lancée tout à l’heure, et il devrait y en avoir une deuxième l’an prochain.
M. Jean-Yves Gilet. Notre force est de pouvoir montrer aux entreprises quels sont les défis et les opportunités de l’avenir. L’Accélérateur PME est un bon exemple de notre démarche. Très souvent, la vitesse de croissance est déterminante pour le succès futur. Le directeur de l’innovation de Bpifrance, Paul-François Fournier, parle souvent d’innovation « nouvelle génération ».
Mon programme, cette année, c’est de dire aux entreprises que la transition numérique concerne absolument tout le monde – pas seulement les objets connectés, pas seulement les start-up. Toutes les entreprises vont connaître une modification colossale de leur modèle économique ! Apple prévoit maintenant de construire des voitures : cela va changer considérablement le marché de l’automobile, pourtant considéré comme traditionnel. De même, l’e-commerce a bouleversé les chaînes de valeur.
Notre rôle est d’apporter ce recul, cet éclairage aux chefs d’entreprise pour qu’ils lancent des projets de transformation. Il y a de l’argent en France ; ce qui manque, ce sont les projets, notamment dans les ETI. Si nous pouvons – par la logique des accélérateurs, par la logique de l’innovation, par la logique de la transition numérique – être des accélérateurs de projet, alors nous aurons rempli notre mission.
S’agissant de la transition énergétique et environnementale, deux fonds ont en effet été créés. Mais nous faisons de la transition énergétique comme M. Jourdain faisait de la prose : nous en faisons tous les jours. Je peux vous citer ici trois noms d’entreprises dans lesquelles nous avons investi : Vergnet, l’un des rares fabricants français d’éoliennes, ce qui nous intéresse beaucoup ; Paprec, spécialiste du recyclage – la logique de la transition environnementale étant bien celle du passage d’une économie linéaire à une économie circulaire ; Neoen, l’un des spécialistes français dans le domaine du solaire. Cette dernière entreprise va gérer la plus grande ferme solaire du monde, à Cestas, dans les Landes : cela représente, en superficie, l’équivalent de 300 terrains de football. Nous réalisons donc des investissements très lourds dans des entreprises qui représentent le futur de notre consommation énergétique.
M. Éric Alauzet. Il ne faudrait pas que ces 300 terrains de football soient pris sur des terres agricoles : dans le domaine de la transition environnementale, il y a beaucoup d’enthousiasme, mais il faut savoir s’en méfier, et bien mesurer les contradictions qui peuvent exister entre différents objectifs… Mais je ne vous apprends certainement rien.
M. Jean-Yves Gilet. Il faut pointer une autre contradiction : la France n’a malheureusement pas aujourd’hui les moyens de construire des éléments d’éoliennes de grande dimension, notamment. Mon rêve serait d’arriver à développer une filière.
M. Éric Alauzet. Vous avez raison. Mais ces éléments ne représentent que 20 % de la valeur ajoutée.
Plus généralement, vous regrettiez le manque de projets à financer. Quel est finalement le problème principal : l’absence de projets, le financement, la complexité administrative… ?
M. Bertrand Finet. À mon sens, le principal problème, c’est le manque de croissance : il y a un cercle vicieux. Les chefs d’entreprise, voyant que la croissance est atone, repoussent leurs investissements, ne créent donc pas d’activité, ne recrutent pas, et finalement ne créent pas de croissance… Notre rôle, c’est d’apporter de l’optimisme, de la confiance.
M. Jean-Yves Gilet. J’allais moi aussi parler de confiance et de stabilité. C’est un besoin essentiel. Nous nous voulons des accélérateurs de projet : nous ne nous contentons pas d’apporter des financements ou d’accompagner ; nous apportons notre « gnaque », et c’est en cela que nous sommes différents des autres.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous nous avez cité trois entreprises qui travaillent dans le domaine de la transition énergétique et environnementale. Envisagez-vous de construire une véritable politique de filière ?
M. Jean-Yves Gilet. Je ne peux malheureusement pas citer les projets en cours, mais ils sont nombreux dans le domaine de la transition environnementale. En revanche, notre rôle n’est pas d’être les promoteurs d’une politique industrielle : ce serait nous élever au-dessus de notre condition. Mais nous pouvons être un outil déterminé de cette politique. La transition énergétique est l’une de nos priorités, surtout en cette année de COP21.
M. Bertrand Finet. Nous disposons, je l’ai dit, d’un fonds Bois, avec une équipe dédiée ; nous sommes en train d’achever la mise en place du fonds Bois 2, qui concernera la première transformation du bois.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci beaucoup de vos réponses.
Table ronde sur l’innovation : M. Benjamin Stremsdoerfer, directeur adjoint des investissements d’avenir, M. Jean-Claude Andreini, vice-président du Comité stratégique des filières éco-industries (COSEI), M. Loïc Riviere, délégué général de l’association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL), et M. Paul François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance
Mme la présidente Véronique Louwagie. Avant de commencer cette table ronde consacrée à l’innovation, je rappellerai simplement que le renforcement du soutien à l’innovation des entreprises est l’un des trois objectifs qui ont été assignés à Bpifrance lors de sa création. Depuis le soutien aux activités de recherche et développement jusqu’au renforcement du capital des entreprises innovantes en passant par la transition énergétique et environnementale, elle a vocation à jouer un rôle moteur dans la montée en gamme de l’économie française.
À cet égard, il est essentiel d’avoir une idée précise des actions que la banque publique d’investissement développe ainsi que de leurs financements pour apprécier la façon dont celles-ci répondent aux besoins rencontrés.
M. Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l’innovation à Bpifrance. Pour soutenir l’innovation, Bpifrance dispose de trois principaux leviers d’action.
Le premier est le financement de l’innovation, qui prend principalement deux formes. Il s’agit, d’une part, des aides individuelles aux entreprises : elles recouvrent une gamme de produits allant des bourses French Tech – de l’ordre de 30 000 euros – jusqu’aux prêts innovation pouvant atteindre 3 millions. Elles sont principalement financées par le programme budgétaire 192 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle, dont la baisse des dotations nous préoccupe car elle nous paraît contracyclique par rapport à la tendance actuelle et aux besoins de l’économie. Il s’agit, d’autre part, des programmes collaboratifs financés en majeure partie par le programme d’investissements d’avenir (PIA). En forte progression ces dernières années, ils permettent d’accélérer la création de filières ou de faire collaborer certains acteurs de tailles différentes, y compris des laboratoires de recherche, autour de projets innovants.
En 2014, le financement aux entreprises innovantes a représenté plus de 1 milliard d’euros, soit 40 % de plus par rapport à 2013, et ces moyens sont appelés à quasiment doubler, conformément au chemin tracé dans le premier plan stratégique de Bpifrance. Sur ce milliard, une grosse moitié est consacrée aux aides individuelles et une petite moitié aux programmes collaboratifs. Cette importante mobilisation du financement public, que l’on retrouve dans les écosystèmes innovants de pays comme la Suède, la Finlande, Israël ou la Corée, permet de bancariser des secteurs qui ne sont pas bancarisables, en raison du niveau de risques des projets, puis de les conduire vers un écosystème privé de financement. En 2014, 90 % de ces financements ont été attribués à des entreprises de moins de cinquante salariés, qui connaissent une croissance plus forte que la moyenne des entreprises en France.
Le deuxième levier est constitué par les investissements directs de Bpifrance dans le capital-risque. Elle gère ainsi cinq fonds d’investissement : le fonds Ambition numérique, le fonds Écotechnologies, le fonds French Tech Accélération, tous trois soutenus par le programme d’investissements d’avenir ; le fonds Pôle Sciences de la vie, doté à partir des fonds propres de Bpifrance et des financements des principaux laboratoires pharmaceutiques opérant en France ; le fonds Large Venture, lancé il y a dix-huit mois pour des tickets de plus de 10 millions d’euros, et doté de plus de 600 millions d’euros à partir de nos fonds propres. À travers ces fonds, Bpifrance prend des participations directes dans des entreprises au même titre que des sociétés de gestion privées de capital-risque.
Le troisième levier d’action est majeur : il s’agit de l’activité de fonds de fonds, dont est chargé Daniel Balmisse que votre mission a déjà auditionné. La Bpifrance finance chaque année, à hauteur de 250 millions à 350 millions d’euros, une centaine de sociétés de gestion et de fonds de capital-risque de la place de Paris, au travers de financements du programme d’investissements d’avenir – c’est le cas du Fonds national d’amorçage – ou de nos fonds propres. Cette politique de la France, constante depuis une quinzaine d’années, nous a permis de créer une véritable économie du capital-risque, extrêmement en avance par rapport à d’autres pays d’Europe continentale. La France tient là l’occasion de devenir l’une des premières plateformes de capital-risque européen – évolution que nous encourageons dans le cadre du plan Juncker –, aux côtés du Royaume-Uni, mais selon un modèle différent. L’Allemagne, comme nous avons pu le constater avec Nicolas Dufourcq lors d’une récente visite, ne compte qu’une dizaine de fonds de capital-risque alors que l’on en dénombre près de deux cents en France.
Les fonds de fonds, j’insiste sur ce point, sont notre principal levier en matière de capital-risque. Chaque euro d’argent public peut générer ainsi jusqu’à trois euros d’investissement, les deux euros complémentaires provenant de fonds privés français ou internationaux.
Pour coordonner sa politique en matière de soutien à l’innovation, Bpifrance a créé une direction de l’innovation dont j’ai la chance d’occuper la tête depuis maintenant deux ans. Elle a un statut un peu particulier puisqu’elle a en charge à la fois le financement de l’innovation et l’investissement direct dans le capital-risque. Nous entendons nous placer au cœur de l’écosystème de l’innovation et dégager une vision d’ensemble des outils de soutien à l’innovation. Quels que soient nos clients, de l’entrepreneur ayant besoin d’une bourse French Tech de 30 000 euros pour acheter des ordinateurs à la société s’apprêtant à faire une importante levée de fonds – nous venons ainsi de contribuer à hauteur de 17 millions à la levée de 100 millions d’euros de Sigfox –, nous voulons faire en sorte d’industrialiser leur parcours, de manière fluide et efficace, afin que leur croissance soit la plus rapide possible. C’est ainsi que nous créerons les champions de demain.
Pour rendre plus efficace l’utilisation des moyens publics dans le développement de l’innovation, nous avons élaboré il y a dix-huit mois un plan de transformation, travail qui a permis à l’ensemble de nos collaborateurs de s’exprimer et aux acteurs de l’écosystème de faire part de leurs remarques sur les points positifs et négatifs. Ce plan baptisé Nova repose sur trois axes principaux.
Le premier axe est la simplification.
Nous essayons de mettre en cohérence les divers financements dont nous bénéficions – programme d’investissements d’avenir, programme 192, aides de la direction générale des entreprises (DGE), fonds européens – et de rendre le plus fluide et le plus efficace possible le processus d’allocation des moyens.
Nous sommes ainsi parvenus à réduire les délais de décision : ils ont été divisés par trois s’agissant des programmes collaboratifs et réduits de 23 % s’agissant de l’aide à l’innovation. Par ailleurs, nous avons mis en place un formulaire unique et mené une enquête de satisfaction auprès de nos clients, qui nous permet d’avoir un retour sur ce qu’ils veulent voir simplifier.
Le deuxième axe est l’accompagnement.
Notre conviction est que, au-delà du financement, il importe de veiller à ce que l’entreprise s’insère dans un écosystème où elle pourra puiser compétences technologiques et expériences. C’est toute la force des écosystèmes de la Silicon Valley ou d’Israël.
Nous avons formé nos 120 chargés d’affaires, qui sont au contact quotidien des entrepreneurs, aux enjeux du capital-risque de façon qu’ils puissent les sensibiliser aux exigences des investisseurs, dimension essentielle au continuum de financement.
Nous avons lancé l’initiative French Tech, sorte de « pass VIP » à destination des entreprises en hypercroissance, qui repose sur la coordination des actions de Business France, de la Coface, des pôles de compétitivité et de l’Institut national de la propriété industrielle, (INPI).
En outre, avec les acteurs de l’écosystème, nous avons lancé un travail approfondi de réflexion sur les critères de l’innovation, partant du constat qu’en France, les outils d’évaluation de l’innovation étaient trop centrés sur la technologie en tant que telle. Certes, elle constitue l’un des atouts de notre pays mais pour la valoriser, il est nécessaire de mettre en œuvre des processus reposant sur d’autres éléments d’innovation. De plus, certaines entreprises comme BlaBlaCar ont transformé des usages sans que la technologie soit au cœur de l’innovation.
Nous avons ainsi élaboré un guide intitulé Innovation nouvelle génération qui met en avant de nouveaux repères intégrant six dimensions de l’innovation : innovation technologique ; innovation de procédé et d’organisation ; innovation de produit, service et usage ; innovation de modèle d’affaires ; innovation marketing et commerciale ; innovation sociale. La prise en compte de ces nouveaux critères nous a permis en 2014 de doubler le financement du design, qui représente pour nous une voie extrêmement importante de valorisation de la technologie. Nous entendons diffuser très largement cette analyse afin qu’elle soit partagée.
Le troisième axe du plan Nova est la continuité entre tous les types de financement de l’innovation.
Nous avons mobilisé des moyens importants grâce au programme d’investissements d’avenir et au Fonds européen d’investissement (FEI) avec lequel nous avons lancé le prêt innovation dont les dotations, de 200 millions en 2014, ont doublé par rapport à 2013.
Nous avons, par ailleurs, mis en place le fonds Large Venture, qui permet d’octroyer des financements de plusieurs dizaines de millions d’euros à des entreprises appelées à devenir des leaders mondiaux alors que ce type de financement provenait auparavant principalement de fonds anglo-saxons. En 2014, Bpifrance a ainsi directement participé à 70 % des levées de plus de 20 millions d’euros de sociétés mises en bourse sur Alternext.
Nous avons également financé des fonds de capital-risque comme Partech à hauteur de 200 millions d’euros. Notre objectif est de faire en sorte que des acteurs privés français soient en mesure de participer à des levées de fonds de plus de 100 millions d’euros.
Simplification, accompagnement, mobilisation de moyens sont nos axes d’action pour accompagner une période que nous considérons comme exceptionnelle : l’écosystème de l’innovation est en train de changer de dimension en France, s’approchant des modèles d’Israël et des pays nordiques. Une multitude de signaux nous le laissent penser : qualité des entreprises, mobilisation des acteurs, expérience accrue, multiplication des levées de fonds approchant la centaine de millions d’euros – citons BlaBlaCar, Sarenza, Sigfox. Le nombre d’entreprises cotées au Nasdaq augmente : près de dix ans après Business Objects, il y a eu, en 2013, Criteo, valorisée à près de 2 milliards de dollars, suivie en 2014 de DBV Technologies, valorisée à 1 milliard de dollars après une levée de fonds de 100 millions, et, dans quelques semaines, de Selectis.
En conclusion, je ferai part de nos deux principales préoccupations.
La première a trait au programme 192. Le dispositif de l’aide individuelle aux entreprises est un élément essentiel de la stratégie que nous menons car il permet d’irriguer le financement d’entreprises encore fragiles, start-up ou PME. Certes, nous comprenons les impératifs budgétaires qui s’imposent, compte tenu de la réalité des finances publiques. Il n’empêche que la pression qui s’exerce sur ce programme est contracyclique : chaque année, des entrepreneurs toujours plus nombreux présentent des projets tous plus passionnants les uns que les autres. Or, la base de la pyramide que nous nous efforçons de construire avec les acteurs de l’écosystème est potentiellement en danger. Avec la baisse des crédits de ce programme, ce sera autant d’entreprises qui ne pourront se créer ou développer leurs projets. Il nous faut donc rechercher des solutions pérennes pour stabiliser ces crédits.
Notre deuxième préoccupation porte sur la nécessité de mieux connecter l’écosystème de l’innovation à l’écosystème des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire française. Nous nous situons au deuxième rang pour le capital-risque en Europe mais sommes au quatrième rang en termes d’acquisitions. Les entreprises françaises attirent de plus en plus d’investisseurs étrangers, en particulier américains – je vous renvoie à l’exemple récent du fonds d’investissement créé par CISCO. Pourquoi les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire français ne se montrent-ils pas aussi actifs pour valoriser notre écosystème ? Il nous appartient de montrer à ces entreprises l’importance de tirer profit de la formidable transformation de notre tissu industriel et des innovations qu’il porte. Dans cette perspective, nous avons créé un Hub start-up afin de mieux faire connaître le potentiel de ces nouvelles entreprises.
M. Benjamin Stremsdoerfer, directeur adjoint des investissements d’avenir à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Je centrerai mon propos sur les programmes d’investissements d’avenir dont l’ADEME a la charge. Ils représentent 3 milliards d’euros : 2 milliards au titre du PIA 1 et 1 milliard au titre du PIA 2. Ces fonds sont destinés à hauteur de 10 % aux laboratoires de recherche et à hauteur de 90 % aux entreprises, avec une petite moitié seulement dédiée aux PME. Par rapport à Bpifrance, nous sommes en effet davantage tournés vers le financement de projets collaboratifs de taille significative, généralement portés par de grands groupes.
Nous privilégions les thématiques liés aux compétences de l’ADEME – environnement, énergie, mobilité et transports, recyclage – et les projets entrant en cohérence avec la vision de long terme que l’agence construit avec ses administrations de tutelle.
Les outils développés dans le cadre des PIA sont de deux types.
Il s’agit principalement d’aides d’État, soumises à la réglementation européenne : avances remboursables et, dans une moindre mesure, subventions. Elles soutiennent des projets de taille importante et se montent à 10 millions d’euros environ par projet. L’objectif que l’État et le commissariat général à l’investissement (CGI) ont fixé à l’ADEME est en effet de créer des changements stratégiques grâce à des apports massifs et orientés, tandis que Bpifrance a pour but d’irriguer le tissu des entreprises.
Il s’agit, en outre, de fonds propres destinés au financement des PME ou des grands groupes. Cet outil a rencontré un réel succès depuis quatre ans.
Nous avons ainsi doté le fonds Écotechnologies à hauteur 150 millions d’euros : géré conjointement avec Bpifrance, il repose sur une logique de co-investissement avec des fonds de capital-risque privés. Il est destiné à des entreprises émergentes qui ne sont pas encore rentables, ayant besoin de fonds pour accompagner leur croissance. Chaque projet bénéficie d’un investissement de 2 à 5 millions d’euros.
Par ailleurs, nous intervenons en fonds propres pour soutenir les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans la réalisation de projets d’innovation lourds comportant un risque qu’ils souhaitent partager avec l’État. Pour ces investissements, qui atteignent parfois plusieurs dizaines de millions d’euros, nous retenons des projets entrant dans le cadre d’une stratégie industrielle plus globale. Je prendrai l’exemple de l’investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros que nous avons réalisé avec Alstom pour la construction d’usines de production d’énergie éolienne off-shore, en réponse à un appel d’offres de l’État.
Ces deux modes d’intervention en fonds propres sont de nature différente, ce qui se reflète dans le processus de décision. Pour le fonds Écotechnologies, qui vise à financer, de façon assez darwinienne, les meilleurs projets, la décision finale appartient à Bpifrance, dans le cadre fixé par l’État. Pour l’allocation des fonds propres, la décision finale appartient à l’État : tous les investissements sont autorisés par le Premier ministre, après avis des différents ministères concernés et du CGI et s’articulent à une stratégie industrielle de long terme de la puissance publique.
Au-delà du soutien financier, l’ADEME est à même de fournir des conseils en matière de stratégie grâce à la bonne connaissance que nos experts ont du spectre des innovations, des plus farfelues aux plus abouties, et des évolutions en cours. C’est d’ailleurs un aspect de notre accompagnement qu’apprécient fortement les entreprises.
Les programmes d’investissements d’avenir gérés par l’ADEME sont pilotés par le commissariat général à l’investissement et le PIA 2 a été l’occasion de revoir de fond en comble nos processus pour les rendre beaucoup plus efficients, plus simples, plus rapides. Nous essayons de nous rapprocher autant que possible de Bpifrance et de renforcer la cohérence entre les opérateurs d’État afin que les entreprises ne soient pas perdues et sachent ce que la puissance publique attend d’elles. Grâce à ce travail mené conjointement avec nos équipes et différents ministères, nous sommes parvenus à établir des délais d’instruction des dossiers et de contractualisation extrêmement performants.
M. Jean-Claude Andreini, vice-président du Comité stratégique de filière pour les éco-industries (COSEI). Permettez-moi de préciser en préambule que je suis également chef de projet de l’un des trente-quatre plans industriels, celui dédié aux énergies renouvelables, et président de l’association des éco-entreprises de France, qui regroupe six mille des douze mille entreprises de ce type, ce qui me met en position de parler au nom de l’ensemble des professionnels du secteur.
Le financement public de l’innovation est perçu par les entreprises comme quelque chose de complexe. D’une part, il leur faut distinguer financements en amont, comme ceux provenant de l’Agence nationale de la recherche (ANR), et financements en aval, comme les fonds démonstrateurs qui accompagnent quasiment la mise sur le marché. D’autre part, elles font face à une multitude de sources de financement : internationales – Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) –, européennes – Banque européenne d’investissement –, nationales – ANR, Fonds unique interministériel (FUI), fonds Écotechnologies –, mais aussi, réalité moins connue, régionales. Personne n’a véritablement de vision globale de la nature et de la destination des financements ou de la granulométrie des aides.
C’est la raison pour laquelle j’ai créé au sein du COSEI un groupe de travail consacré au financement, en plus d’un autre groupe consacré à l’innovation. Quatre questions simples ont structuré la réflexion : combien d’argent public est orienté vers les entreprises de l’environnement ? L’aide publique porte-t-elle plutôt sur l’amont ou l’aval de la recherche ? Quelles sont les filières financées ? Quels types d’entreprise bénéficient des aides publiques ? Nous sommes parvenus à établir une synthèse, nous manquent seulement les chiffres de l’ADEME et de Bpifrance pour les deux dernières années – mais nous ne désespérons pas de les obtenir.
Première question : combien d’argent public est orienté vers les entreprises de l’environnement ? Chaque année, elles reçoivent environ 600 millions d’euros : 300 millions d’euros au titre des investissements d’avenir et 300 millions au titre du crédit d’impôt recherche. Pour les deux dernières années, je le disais, je ne dispose pas d’éléments très précis, d’autant que Bpifrance travaille non par filières mais par produits, ce qui suppose des calculs supplémentaires. Cependant, nous pouvons raisonnablement penser qu’il y a eu une accélération : le CIR n’a pas diminué, les investissements d’avenir sont montés en puissance.
Deuxième question : l’aide publique porte-t-elle sur l’amont ou l’aval de la recherche ? Nous avons pu constater une bonne répartition entre la recherche académique et les fonds démonstrateurs, mais une moindre accentuation sur la mise le marché. À cet égard, on oublie souvent de dire que l’innovation au sens strict du terme ne représente que 10 % des moyens nécessaires pour l’entrée en bourse d’une société.
Troisième question : quelles sont les filières financées ? Il y a eu des modes : au photovoltaïque a succédé l’éolien puis telle ou telle filière. Je déplore que certaines filières de la transition écologique soient insuffisamment financées alors que leur poids économique est plus important que celui des filières énergétiques. Ainsi, la filière du recyclage, exportatrice nette avec 3 milliards d’euros d’excédents, et la filière de l’eau, particulièrement puissante en France, regroupent davantage d’emplois – respectivement 126 000 et 125 000 – que la filière des énergies renouvelables – 100 000 emplois. Il est important de savoir quelle filière les politiques publiques entendent encourager. En 2014, l’énergie photovoltaïque a été au premier rang des investissements énergétiques, avant le pétrole et le nucléaire. Pour les industriels du pétrole, la messe est dite : le solaire est l’énergie d’avenir, celle qui sera la plus distribuée et la plus vendue dans le monde et si nous nous montrions plus agressifs, nous pourrions, malgré notre faiblesse nationale en ce domaine, gagner des parts de marché.
Quatrième question : quels types d’entreprise bénéficient des aides publiques ? Pour simplifier, disons qu’elles vont pour un tiers aux PME, un tiers aux ETI et un tiers aux grands groupes. En nombre, il est évident que ce sont les PME qui sont davantage financées. En termes de montants, l’essentiel des moyens va plutôt à de grandes entreprises.
Dans le plan « Énergies renouvelables » dont j’ai la charge, j’ai insisté sur deux orientations prioritaires. D’une part, il me paraît essentiel que les aides aillent aux entreprises ayant une orientation forte vers l’export, condition essentielle de réussite, compte tenu de la petite taille du marché français qui ne représente que 3 % à 5 % du marché mondial. Bpifrance soutient d’ailleurs l’activité à l’export par des aides spécifiques. D’autre part, il me paraît important d’encourager les entreprises de taille intermédiaire afin de créer un Mittelstand à la française dans le secteur des énergies renouvelables. À cet égard, je me félicite que Bpifrance ait choisi les ETI comme cible principale. Toutefois, je souhaiterais que nos actions soient mieux coordonnées car parmi les entreprises que je suis, plusieurs ont vocation à développer leurs activités à l’export, à s’inscrire dans le Mittelstand, à établir un ancrage territorial sur un segment de marché. De la même manière, j’aimerais que les échanges avec l’ADEME soient renforcés.
Pour finir, j’évoquerai le guide de financement des éco-entreprises que nous avons élaboré. Nous avons identifié les milliers de financeurs qui existent en France pour les rassembler dans un seul document montrant vers quelles filières vont les financements, à quelle hauteur ils se situent – milliers, millions ou dizaines de millions d’euros –, à quel stade de développement de l’entreprise – amorçage ou mise sur le marché – ils interviennent. Nous espérons que nos deux partenaires s’impliqueront pleinement dans cette initiative.
En conclusion, je dirai que nous y voyons plus clair dans le financement des entreprises comme dans le financement de l’innovation, même si le panorama est moins précis pour les deux dernières années faute des données nécessaires. J’appelle de mes vœux une meilleure collaboration entre ADEME, Bpifrance et la filière que je représente en vue de définir une véritable politique publique : qui fait quoi ? Vers quelle direction va-t-on ? Est-on en compétition ? Vise-t-on les bonnes sociétés, les bons segments de marché, les bons marchés ? Nos échanges sont encore insuffisants, il y a moyen de les améliorer.
M. Loïc Rivière, délégué général de l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL). L’AFDEL regroupe trois cents entreprises éditrices de logiciels et actrices de l’Internet : des grands groupes nationaux et internationaux mais surtout un écosystème de PME et de start-up.
Je m’attacherai tout d’abord à cerner les besoins de financement des entreprises que nous représentons, puis à vous faire part de leurs retours sur les produits de Bpifrance, enfin, à dessiner une problématique liée à la politique industrielle et à la dimension stratégique de la politique de filière en lien avec l’action de Bpifrance.
Nos entreprises appartiennent à un secteur à forte intensité capitalistique due à un effort majeur de R & D en amont – il faut parfois trois années de recherche avant qu’un produit ne puisse sortir sur le marché. Elles se plaignent à juste titre d’une faible éligibilité aux dispositifs d’aides publiques à la R & D que sont, par exemple, le crédit d’impôt-recherche ou les aides destinées aux jeunes entreprises innovantes (JEI). La recherche expérimentale dans le domaine du logiciel et d’internet répond peu aux critères mis en avant pour bénéficier de soutiens.
Il s’agit d’un secteur peu attractif financièrement pour le non-initié. Il est avant tout constitué de PME – la centième entreprise française éditrice de logiciels réalise un peu plus de 5 millions de chiffres d’affaires – et repose sur des modèles économiques dont les analystes financiers ont une connaissance assez faible et qui ne sont pas toujours faciles à lire, il faut le reconnaître. Ainsi, le freemium¸ qui consiste dans un premier temps à offrir gratuitement un produit dans l’espoir de vendre une offre premium, est contre-intuitif pour un banquier ; quant au logiciel en tant que service, où la rémunération repose sur l’abonnement, il suppose d’apprécier sur trois ans les modèle de revenus. La R & D exige des apports immédiats alors que les revenus tardent à venir, les entreprises ayant tendance à accumuler les pertes à leurs débuts.
Il s’agit, par ailleurs, d’un secteur où le risque est important. Il connaît beaucoup de défaillances, caractéristique propre aux secteurs innovants. Les possibilités de sorties pour les investisseurs ne sont pas légions en France. Les grands groupes industriels français s’intéressent malheureusement assez peu à ces entreprises, à quelques exceptions notables comme Schneider Electric. Les sorties boursières se jouent pour leur très grande majorité sur d’autres marchés que les marchés français et européen et nous sommes loin du modèle israélien et de ses cinquante sociétés cotées chaque année au Nasdaq. Criteo vient d’y être côtée, mais la précédente entrée remontait à plus de dix ans avec Business Objects.
Le financement constitue cependant un enjeu très important pour ces entreprises qui enregistrent des taux de croissance bien supérieurs au PIB et participent au mouvement profond de transformation numérique de l’économie et de la société.
Bpifrance répond-elle aux besoins de ces entreprises ? Nous avons posé la question à nos adhérents et je peux vous dire qu’ils considèrent que oui, très majoritairement. Ils soulignent la qualité de la relation qui s’établit avec les interlocuteurs de Bpifrance, en mettant en avant la rapidité d’examen et de traitement des dossiers, la compétence des chargés d’affaires, leur volontarisme affiché. Ils insistent sur le besoin d’accompagnement, et je me réjouis que Bpifrance souhaite améliorer cette dimension. Bref, c’est le jour et la nuit entre Bpifrance et le secteur bancaire classique qui ne joue pas son rôle en matière de financement de l’innovation.
Nos adhérents soulignent encore la bonne compréhension des modèles économiques et des enjeux du numérique chez leurs interlocuteurs et se félicitent que Bpifrance mise sur le financement de l’immatériel, en offrant une multitude de produits correspondant aux divers stades de développement des entreprises, de l’amorçage de la R & D jusqu’à la stratégie à l’export.
Toutefois, ils considèrent que les critères d’appréciation restent assez classiques : ils renvoient principalement à la rentabilité, ce que l’on peut comprendre puisque Bpifrance est une banque.
Il leur apparaît également que la technologie semble davantage privilégiée dans le financement de l’innovation. À cet égard, je me réjouis des nouveaux critères mis en avant dans Innovation nouvelle génération que Bpifrance a publié avec la Fondation internet nouvelle génération (FING). Cette volonté constante d’amélioration est très appréciable et nous attendons beaucoup de la traduction dans les faits de ce nouveau référentiel, compte tenu de la tendance des investisseurs à financer des brevets plutôt que des innovations liées à l’usage ou aux modèles d’affaires.
Enfin, les petits acteurs, tels que les entreprises misant sur des développements à forts risques, se plaignent d’être moins considérés.
Reste que Bpifrance joue un rôle d’irrigation du secteur du capital-risque qui revêt une importance stratégique : notre pays a pu se positionner à la deuxième place en Europe en ce domaine. Nous ne pouvons que nous en réjouir, compte tenu du fait que le modèle du capital-risque est incontournable dans notre secteur.
Les besoins en fonds propres font partie des attentes que les entreprises du secteur parviennent le moins à satisfaire. Certes, le fonds Ambition numérique (FSN PME) a permis de financer pour des deuxièmes ou des troisièmes tours de table une vingtaine d’entreprises dont les taux de croissance atteignent deux voire trois chiffres. Cependant, il est loin de couvrir l’ensemble des besoins.
Je finirai par la stratégie pour le numérique. Force est de constater qu’il n’y a pas d’équivalent de l’ADEME pour le numérique en France. La stratégie industrielle de la France repose sur trente-quatre plans industriels différents. Ils font l’objet d’un louable effort de synthèse de la part des services de l’État, qui conduira sans doute à la réduction du nombre des plans dédiés au numérique. À cela s’ajoutent des comités stratégiques de filière, presque aussi nombreux que ces plans industriels. Je dois dire que je déplore, en tant que vice-président du comité stratégique de filière numérique, que ce secteur ne figure pas dans le viseur du Gouvernement pour la définition de la feuille de route stratégique des investissements publics de l’État. La France a aussi besoin d’avoir des champions dans ce domaine. Les pouvoirs publics doivent soutenir les acteurs susceptibles de conquérir des marchés. Dans le domaine de la cybersécurité, qui compte plusieurs pépites, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est ainsi bien consciente de l’enjeu de souveraineté attaché au rayonnement de nos entreprises à l’international. Il m’apparaît donc primordial de revoir la définition de cette feuille de route stratégique, grâce à un travail conjoint de Bpifrance, d’autres acteurs de l’État et de l’écosystème.
M. Jérôme Billé, délégué général de l’Association des structures de recherche sous contrat (ASRC). Issue de l’Association des sociétés indépendantes de recherche et développement pour l’industrie (ASIRDI) créée dans les années quatre-vingt, l’Association des structures de recherche sous contrat a été fondée en 2000.
Le dénominateur commun de nos membres est qu’ils réalisent plus de 50 % de leur activité sous forme de prestations de R & D pour le compte de tiers, qu’il s’agisse de start-up, d’ETI, de grands groupes, voire de laboratoires de recherche, et qu’ils ont une activité très forte en matière de R & D de ressourcement, c’est-à-dire de recherches menées sur fonds propres pour maintenir les compétences au niveau de l’état de l’art, voire pour le dépasser. Nos quarante-cinq adhérents – PME ou ETI réalisent 125 millions de chiffres d’affaires. Ils assurent un continuum entre travaux issus du monde académique et problématiques industrielles. Pour eux, la technologie est un moyen et non une finalité : elle a peu de valeur en elle-même car ce sont les produits, les process, les modèles économiques qui permettent de générer de la valeur.
Quelles relations entretenons-nous avec Bpifrance ? Nous sommes tout d’abord des partenaires puisqu’elle nous soutient historiquement dans nos activités de R & D de ressourcement. En tant que fournisseurs, nous bénéficions par ailleurs du soutien qu’elle apporte à nos clients : nous avons tout intérêt à ce qu’ils soient en position de payer la facture que nous leur présentons pour les travaux très risqués que nous effectuons pour leur compte. Elle nous rassure en examinant les projets, d’un point de vue financier et qualitatif. Je dois dire pourtant que ce sont d’abord des inquiétudes qu’elle a suscitées chez nous. À sa création, son statut de banque était un sujet de préoccupation, les banques n’étant pas connues pour prendre des risques, mais fort heureusement, cette aptitude qui caractérisait l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) a été préservée par la direction de l’innovation de Paul-François Fournier.
Je dirai à sa suite que les aides individuelles à l’innovation sont essentielles. J’insiste sur ce point. Elles ne pourront jamais être remplacées par les projets collaboratifs, même s’ils ont leur intérêt – nous sommes membres d’une cinquante de pôles de compétitivité et participons à des projets de l’ANR, du Fonds unique interministériel, parfois même de l’ADEME. Il me semble donc nécessaire de soutenir très fortement le programme 192, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à des parlementaires et des représentants des ministères, car ce sont ces aides qui permettent d’amorcer la pompe, étape incontournable pour assurer un continuum jusqu’à l’entrée en bourse.
Autres outils importants : les aides au partenariat technologique (APT) et les aides aux programmes européens (APE), qui permettent de candidater aux projets européens lancés en réponse aux appels à projets de Horizon 2020, programme communautaire doté d’un budget de 80 milliards destiné au soutien à la R & D et à l’innovation. La France est loin d’avoir récupéré l’argent qu’elle a investi dans le septième programme-cadre de recherche et de développement de l’Union européenne et nous espérons qu’il n’en ira pas de même pour Horizon 2020. Nous nous réjouissons que Bpifrance ait pu mettre en place l’APE, car elle engendre un effet de levier qui est loin d’être négligeable : les euros investis par BPI pour monter des projets de ce type ont de grande chance de générer auprès de Horizon 2020 beaucoup de financements sous forme de subventions à hauteur de 70 %, chose aujourd’hui rare dans le paysage français.
Il serait bon que Bpifrance accentue sa fonction de passerelle entre les PME innovantes et les grands groupes français, qui doivent davantage assumer un rôle de grand frère. On sait les difficultés qu’ont ces PME à se construire une première référence. Il me paraît tout de même dommage que leur premier client soit souvent un grand groupe étranger.
Bpifrance nous assure un soutien décisif. Sans son intervention, nous serions incapables de porter les risques liés aux projets de nos clients, risques générés par la R & D de de ressourcement, au cœur de notre activité. Historiquement, si nous n’avions pas eu l’ANVAR à nos côtés, les structures de recherche sous contrat auraient disparu. Or les différents organismes de recherche publique et les outils liés aux investissements d’avenir ne peuvent se substituer à l’aide à l’innovation industrielle que nous apportons aux entreprises pour franchir la vallée de la mort technologique.
Le discours que tient aujourd’hui Bpifrance nous rassure pleinement : elle se montre prête à soutenir des projets très risqués à contenu technologique mais à finalité économique. Reste qu’il faut absolument maintenir les dotations du programme 192 à un haut niveau.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Fournier, vous avez indiqué que Bpifrance intervenait au même titre que les fonds de sociétés privées de capital-risque. Est-ce bien là sa mission ?
Par ailleurs, monsieur Andreini, j’aimerais que vous nous précisiez si c’est vous qui avez adressé ces questions aux groupes de travail ou si ce sont eux qui les ont formulées.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. J’aimerais tout d’abord avoir des précisions sur les relations entre l’ADEME et Bpifrance car il me semble nécessaire de clarifier leurs rôles respectifs. De nombreux parlementaires, dont Arnaud Leroy, avaient d’ailleurs soulevé cette question au moment de l’examen de la loi relative à la création de Bpifrance.
À votre sens, comment peut-on articuler pôles de compétitivité, politiques de filière, plans industriels ? Comment assurer une cohérence entre ces structures et les différents acteurs de l’innovation ? N’y a-t-il pas des redondances ? Ne peut-on craindre un saupoudrage à force de disperser les énergies ?
Bpifrance a fait évoluer son référentiel pour l’innovation en établissant une note d’intensité de l’innovation entre 0 et 4 et en mettant en point six critères différents : produits et services, procédé et organisation, marketing et commerce, technologie, innovation sociale. Comment pouvez-vous distinguer les innovations de rupture, que notre pays a tendance à valoriser, des innovations incrémentales ?
Enfin, nous avons bien compris que le programme 192 constituait un grand sujet de préoccupation. Le Président de la commission des finances, Gilles Carrez s’est exprimé à ce sujet la semaine dernière. Sachez que nous avons pleinement conscience de ce problème.
Mme Clotilde Valter. L’année dernière, dans le cadre de mes travaux en vue de la rédaction d’un rapport que j’ai remis au Premier ministre sur les centres techniques industriels, j’ai pu mesurer à quel maquis d’aides à l’innovation et à la recherche les PME et ETI étaient confrontées, car aux dispositifs soutenus par l’État s’ajoute une multitude de dispositifs locaux.
M. Paul-François Fournier. S’agissant des fonds directs de Bpifrance, je précise qu’il s’agit de fonds de co-investissement dans une logique de pari passu avec les fonds de capital-risque de la place. Quand les entreprises ont un degré de maturité suffisant, il est nécessaire de basculer leur financement dans le domaine privé pour assurer un meilleur effet de levier. Nous nous voulons une banque différente, qui finance le risque lié à l’innovation, mais la logique veut que le secteur privé prenne le relais afin de trouver les dizaines de millions d’euros nécessaires pour créer les champions dont nous avons besoin. Notre action en direct est, en réalité, relativement mineure. Nous avons essentiellement vocation à comprendre les dynamiques du marché et à intervenir conjointement avec des acteurs privés. Il ne s’agit pas pour nous de combler une faille du marché. C’est ainsi que nous ne soutenons pas directement l’amorçage, dont le financement renvoie à une expertise très fine. Nous considérons que nous ne disposons ni des moyens ni des compétences pour exercer ce métier compliqué. Nous préférons nous adosser à la compétence qui émerge des quinze ans d’expérience du capital-risque français.
Pour ce qui est des relations de Bpifrance et de l’ADEME, nous travaillons à coordonner nos actions à travers le programme d’investissements d’avenir. Nous nous distinguons de l’ADEME par l’accent privilégié que nous mettons sur le financement des PME et des ETI : elles représentent 80 % de la valeur de nos financements et 70 % de la valeur des programmes collaboratifs – 10 % allant aux grands groupes et 20 % aux laboratoires. 90 % des aides individuelles sont versées à des entreprises de moins de cinquante salariés. On saisit bien là la complémentarité entre nos deux structures. Il n’en demeure pas moins que s’agissant de certaines thématiques, l’existence d’un double guichet peut être source d’une relative complexité. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons chacun de notre côté de réorienter au mieux les dossiers des entreprises.
La question de la redondance et du saupoudrage est tout à fait légitime. J’y répondrai de deux façons. Premièrement, nous voyons arriver un nombre impressionnant de projets. En 2014, les financements des entreprises de moins de cinq ans au titre de l’innovation ont crû de 30 %. Nous souhaitons accompagner ce mouvement chez les étudiants et les jeunes entrepreneurs mais nous manquons de moyens. Ainsi avons-nous dû arrêter l’attribution de bourses French Tech en octobre 2014 et demander à leurs potentiels bénéficiaires d’attendre le mois de janvier pour postuler. Deuxièmement, dans le cadre du plan Nova, nous avons effectué un énorme travail de toilettage de la base des clients : en 2014, 80 % de nos clients ont été de nouveaux clients. Nous avons mis l’accent sur le renouvellement afin d’éviter que certaines entreprises ne se retrouvent en position d’être aidées trop souvent ou trop massivement par l’argent public.
S’agissant de la cohérence, nous avons beaucoup œuvré à simplifier nos procédures et à combler la lacune du marché en matière de financement de la démarche commerciale qui garantit le succès d’une entreprise. Toutefois, nous ne nous considérons pas comme étant en charge de la stratégie des filières. Nous avons des contacts étroits avec la direction générale des entreprises et comptons mettre la compétence de Bpifrance au cœur de la réflexion sur les filières. Et s’agissant du numérique en particulier, nous avons l’intention de travailler à une meilleure compréhension de ses nouveaux modèles.
Innovations incrémentales ou innovations de rupture, c’est une question essentielle. Nous souhaitons décloisonner les différentes dimensions de l’innovation et la panoplie des outils nous y aidera. Nous voulons faire en sorte que des financements bancaires traditionnels puissent financer des innovations plus incrémentales, pour lesquelles les risques sont plus modérés.
Vous avez souligné, madame Valter, la complexité des différentes aides. Ce maquis est encore une réalité malgré tous nos efforts. Nos donneurs d’ordre sont divers et veulent chacun imprimer leurs marques sur les dispositifs de financement, qu’il s’agisse de l’Union européenne, de l’État ou des régions. Nous essayons en quelque sorte d’être le témoin de l’entreprise pour utiliser de manière optimale les dispositifs existants. Et pour cela, nous pouvons compter sur la compétence de nos chargés d’affaires.
M. Benjamin Stremsdoerfer. Les relations entre l’ADEME et Bpifrance renvoient tout d’abord au Fonds Écotechnologies, qu’elles gèrent ensemble de manière efficace : depuis trois ans qu’il a été créé, aucun accroc n’est à déplorer, ce qui permet un bon financement des entreprises. Je préciserai seulement que l’ADEME présélectionne les dossiers de manière à inscrire le fonds dans la stratégie plus globale du PIA.
Cette expérience commune du Fonds Écotechnologies me conduit toutefois à tempérer les propos de M. Fournier s’agissant de la prise de risques. Les sociétés de capital-risque avec lesquelles ce fonds peut co-investir sont peu nombreuses et se montrent frileuses, si bien que la puissance publique est amenée à prendre beaucoup plus de risques que le secteur privé pour financer certaines entreprises.
Par ailleurs, la convention entre l’État et l’ADEME relative au PIA 2 a évité tout risque de recouvrement en précisant que l’action Projets industriels d’avenir (PIAVE) opérée par Bpifrance « s’adresse aux projets issus des trente-quatre plans de la nouvelle France industrielle et ne bénéficiant pas de soutiens dédiés dans le cadre d’appels à projets thématiques du programme d’investissements d’avenir ». Il s’agit d’une logique extrêmement cohérente : le projet est porté par l’acteur spécialiste, quand il y en a un, et quand il n’y en a pas, par un acteur généraliste. Toute innovation s’inscrit en effet dans un écosystème donné et des secteurs compliqués comme le recyclage nécessitent la connaissance très fine d’un acteur spécialiste car chaque type de produit recyclé constitue à lui seul un écosystème.
M. Jérôme Billé. Maquis, c’est bien le mot, madame Valter. Les PME ont beaucoup de difficultés à identifier les sources de financement, à déterminer quelles sont les plus pertinentes au regard de leur projet et à choisir les acteurs qui peuvent les accompagner.
Au maquis des aides s’ajoute un autre maquis. Le programme d’investissements d’avenir a poussé beaucoup de structures vers notre périmètre historique : la prestation de services de recherche et développement. Cela porte préjudice à tout le monde, en premier lieu à nous, dirai-je égoïstement, mais également aux PME et aux ETI qui ont beaucoup du mal à s’y retrouver. J’ai essayé un jour d’établir une cartographie des acteurs de la R & D en France et je suis parvenu à un résultat totalement illisible.
Il existe beaucoup de guichets. Ils sont globalement assez complémentaires, mais ils appliquent des règles de financement différentes. Ainsi, pour les coûts indirects, un taux de 25 % est retenu par les instances européennes, un taux de 20 % par Bpifrance, et un taux encore différent par l’ADEME. Une harmonisation constituerait un gain de temps précieux et ne coûterait rien.
M. Jean-Claude Andreini. Madame la présidente, c’est moi qui ai décidé de créer un groupe de travail sur l’innovation et qui lui ai demandé d’étudier ces quatre questions. Après un beau travail collaboratif avec les acteurs de l’innovation, nous avons pu publier un document identifiant financeurs et financements.
Y a-t-il une bonne articulation entre plans industriels et politiques de filières ? Il faut savoir que la plupart des plans industriels ont été élaborés à partir du travail des filières. S’agissant des éco-industries, j’ai ainsi procédé au regroupement d’une vingtaine de filières en quatre grands ensembles : eau et biodiversité ; déchets, recyclage, sols pollués, air pollué ; énergies renouvelables ; efficacité énergétique dans l’industrie, les transports et le bâtiment. Les plans industriels correspondent aux groupes de travail du comité stratégique des éco-industries : au groupe « Énergies renouvelables » correspond un plan industriel « Énergies renouvelables » et il en va de même pour le recyclage ou l’efficacité énergétique des bâtiments. Les mêmes industriels ayant siégé dans les groupes de travail du COSEI et dans les instances préparatoires des plans industriels, ils ont procédé eux-mêmes aux articulations. En cas de difficultés ou de heurts d’ambitions, j’ai procédé à des arbitrages.
La répartition des rôles entre plans industriels et comités de filière est assez simple : tout ce qui est collectif, public et concerne la structuration des filières, les ressources humaines, la législation et la réglementation relève du comité stratégique tandis que tous les projets relatifs à une entreprise en particulier relève du plan industriel, compte tenu de leur caractère confidentiel.
En tant que chef de projet du plan industriel « Énergies renouvelables », j’ai à traiter ces questions au quotidien. Diverses demandes sont présentées par les entreprises et c’est en concertation avec un représentant de l’ADEME, un représentant de Bpifrance et divers autres acteurs publics, tous astreints à la confidentialité, que je les examine. J’ai mis au point trois critères principaux d’évaluation : volonté de développer l’activité à l’export, positionnement dans le Mittelstand, structuration territoriale. Et je fais appel aux divers organismes publics ou privés selon la nature des projets. Une répartition de fait s’est opérée de manière assez simple.
M. Loïc Rivière. La politique industrielle se justifie par des priorités stratégiques nationales qui nécessitent l’intervention de l’État, sans pour autant qu’il se substitue au marché. La transition numérique appelle une logique différente de la transition énergétique. De ce point de vue, l’attitude de Bpifrance, qui ne juge des projets que par la capacité des entreprises à croître jusqu’à devenir des ETI voire des champions nationaux, est tout à fait justifiée.
S’agissant de la gouvernance des trente-quatre plans, je dois dire que nous sommes assez dubitatifs. Une dizaine d’entre eux relève du numérique stricto sensu mais ils sont marqués par une très grande disparité : il s’agit soit de secteurs très matures, comme les télécommunications, qui sont soumis à des problématiques de concurrence internationale, soit de technologies transversales comme le cloud computing dont on se demande si elles relèvent bien d’une politique industrielle, soit de secteurs qui ne reposent pas sur un tissu industriel comme le big data.
Par ailleurs, contrairement aux énergies renouvelables, la gouvernance des plans relatifs au numérique est déconnectée des organisations professionnelles et des comités stratégiques de filière qui relèvent du Conseil national de l’industrie. Elle a été confiée à des entreprises, qui agissent avant tout selon des stratégies individuelles entrant parfois en concurrence. C’est ainsi que ces différents plans s’apparentent à un millefeuille de projets, dont certains ont peu à voir avec une logique de politique industrielle.
Erreur de conception initiale et redondances nécessitent de réformer cette gouvernance. Nous travaillons avec les services de l’État à une synthèse afin de resserrer les plans vers des secteurs qui relèvent pleinement de la politique industrielle, c’est-à-dire où un tissu industriel existe et où des priorités stratégiques nationales peuvent être définies.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
M. Alain Schmitt, chef du service de la Compétitivité et du développement des PME à la direction générale des entreprises, et M. Sébastien Raspiller, sous-directeur du Financement des entreprises et du Marché financier à la direction générale du Trésor.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons maintenant M. Alain Schmitt, chef du service de la compétitivité et du développement des petites et moyennes entreprises (PME) à la direction générale des entreprises (DGE), et M. Sébastien Raspiller, sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier à la direction générale du Trésor. Je précise qu’en raison de vos fonctions respectives à la DGE et au Trésor, vous siégez au conseil d’administration de Bpifrance Financement.
M. Sébastien Raspiller, sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier à la direction générale du Trésor. Lorsque je suis entré en fonction, en juillet 2012, comme chef du bureau financement et développement des entreprises, cette unité assurait la tutelle d’Oséo, de sorte que ma première tâche fut de préparer la création de Bpifrance, à laquelle j’ai ainsi participé dès l’origine. La loi a créé la structure en rapprochant des entités existantes : Oséo, le fonds stratégique d’investissement (FSI) et CDC Entreprises. Mon bureau et la sous-direction suivent les activités de capital-risque et de capital développement à Bpifrance, mais pas l’investissement direct qui relevait du FSI.
La nouvelle structure constitue un guichet unique qui offre aux entreprises un accès plus facile au financement public, tant en fonds propres qu’en dette. Une fois la loi adoptée, les choses sont allées très rapidement, puisqu’à peine un an sépare la fusion effective, intervenue en juillet 2013, de la décision initiale. Cela s’explique naturellement par une forte demande des autorités politiques.
Le plan stratégique a été établi de l’été 2013 à fin 2013, période au cours de laquelle ont été abordées les questions de gouvernance, notamment les relations entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) selon les différentes entités constitutives. Depuis 2013-2014, Bpifrance est entré dans une phase de fonctionnement pérenne et permanent. Assumant une fonction d’établissement de place, Bpifrance s’emploie à démultiplier les effets des politiques publiques sur l’économie réelle. Faisant preuve de réactivité pour améliorer la trésorerie des entreprises, elle a aussi la capacité de participer à une réorientation des flux d’investissement, jouant ainsi un rôle contra-cyclique. Son activité a crû de manière significative au cours de ses premières années de fonctionnement.
CDC Entreprises occupait une place de choix dans le paysage du capital investissement français, deuxième marché européen après le marché londonien. Bpifrance représente aujourd’hui plus de la moitié du marché français et s’attelle à une meilleure structuration de celui-ci, en s’attachant à pérenniser les bonnes pratiques et en évitant surtout d’évincer les investisseurs privés. Elle vise au contraire à concourir à l’action des fonds privés, de manière à développer l’offre globale de capital investissement. Le plan stratégique met ainsi l’accent sur le développement des entreprises, soutenues dans leurs efforts pour passer du statut de petite et moyenne entreprise (PME) à celui d’établissement de taille intermédiaire (ETI).
L’export constitue enfin un sujet crucial dans le développement des entreprises. Les outils existants ont été rationalisés pour donner naissance à un guichet unifié. De nouvelles activités ont également vu le jour, de façon à développer une palette d’outils complète qui pallie les défaillances de l’offre privée.
M. Alain Schmitt, chef du service de la compétitivité et du développement des petites et moyennes entreprises (PME) à la direction générale des entreprises (DGE). Bpifrance a eu pour premier objectif de rassembler en un seul acteur la palette des outils publics de financement des entreprises au service des politiques publiques de développement économique. La structure agit, en complément des acteurs privés, sur des créneaux ou des segments d’activité où ils ne sont pas suffisamment présents : l’innovation, les fonds propres ou la dette, l’export… De ce point de vue, l’objectif est atteint. Un guichet unique puissant s’est développé, qui intervient en propre, mais aussi pour le compte de tiers, tels l’État ou les collectivités territoriales.
La DGE suit plus spécialement le volet innovation, car elle dispose des dotations budgétaires correspondantes. Sa stratégie a été formalisée fin 2013 par le plan « Une nouvelle donne pour l’innovation ». Le document prend acte de ce que l’innovation ne recouvre pas seulement la recherche et développement, mais aussi des produits et des services significativement nouveaux, même s’il s’agit seulement de méthodes d’organisation ou de procédés de commercialisation. Au-delà de la recherche et développement stricto sensu, sont donc développés quatre axes principaux : le développement de la culture de l’entreprenariat et l’innovation ; l’accroissement de l’impact économique de la recherche publique grâce au transfert de technologie ; la croissance des entreprises grâce à l’innovation ; l’évaluation par l’État de ses propres politiques en faveur de l’innovation.
Dans tous ces domaines, Bpifrance intervient. Elle participe à une grande partie des actions prévues par le plan, notamment lorsqu’un financement est nécessaire. Qu’elle agisse en soutenant la constitution de fonds propres ou en proposant des produits de dette, elle a pris acte de la réorientation souhaitée de la politique de l’innovation.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Raspiller, vous soulignez que Bpifrance doit plutôt structurer les bonnes pratiques du marché que se substituer à lui. Dans les projets qu’elle soutient, Bpifrance tient-elle compte des éléments économiques, ou s’en tient-elle seulement à des critères financiers ?
Monsieur Schmitt, vous établissez un lien entre innovation et entreprenariat. Bpifrance est présent dans de nombreux domaines, mais non dans tous. Devrait-elle faire plus ?
Quelles suites ont été données au rapport annuel 2015 de la Cour des comptes qui a relevé les « dérives d’un dispositif d’actionnariat salarié », à savoir l’attribution d’actions gratuites ? Quelles sont, le cas échéant, les autres formes d’intéressement ou de rémunération à la performance ? Quelles incitations créent-elles ? Quelles garanties existent au sein de Bpifrance pour se préserver de nouvelles dérives ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Le rapport de la Cour des comptes a lancé un débat qui doit être approfondi. Mais je me félicite de ce que Bpifrance pratique des salaires qui respectent l’écart maximal voulu par le président de la République. Encore faut-il rester attentif à cette question, notamment en se penchant sur les primes.
Parfois mentionnée comme source de difficulté, la parité entre l’État et la CDC dans le capital de Bpifrance fait-elle apparaître entre les deux acteurs une convergence ou des divergences ? Comment se répartissent les rôles entre les deux actionnaires ? Quelle influence l’État exerce-t-il sur l’orientation de Bpifrance ?
Nous évoquions déjà ce matin la question de l’innovation. Les crédits budgétaires du programme 192 et les crédits des programmes d’investissement d’avenir (PIA) ne se révèlent-ils pas à l’usage substituables ? Nous avons entendu des inquiétudes au sujet de la baisse de la dotation budgétaire.
Quant au lien entre l’écologie et l’innovation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) assure le financement de PME, par l’intermédiaire du fonds commun de placement « Écotechnologies », et d’ETI, via un dispositif de coopération avec l’État. N’y a-t-il pas un risque de chevauchement entre les financements proposés par l’Ademe et ceux de Bpifrance ? Ne pensez-vous pas qu’il serait préférable d’intégrer complètement ces deux dispositifs au sein de Bpifrance ?
Enfin, quel regard portez-vous sur l’articulation des activités de Business France résultant de la fusion entre Ubifrance et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) ?
M. Sébastien Raspiller. L’arbitrage sur la structuration générale de Bpifrance a été rendu au plus haut niveau de l’État. Auparavant, l’État détenait les deux tiers d’Oséo, tandis que la CDC détenait 51 % et l’État 49 % du FSI et que CDC Entreprise était détenu en totalité par la Caisse. D’autres modèles que la parité capitalistique ont été évoqués pour Bpifrance. Mais ce modèle a été retenu parce qu’il est en parfaite adéquation avec l’objectif d’un guichet unifié qui met fin aux anciennes chapelles, en préservant une gamme complète d’offres de financement, que ce soit en fonds propres ou en dette. La holding se partage donc entre une filiale chargée du financement et une filiale chargée des activités de capital investissement. Une muraille de Chine les sépare, puisqu’il s’agit de rôles différents et qu’il faut tirer les enseignements de la crise bancaire.
Dans les activités d’Oséo, l’État n’est plus majoritaire, mais la CDC ne l’est plus non plus en matière de capital investissement. Fruit de longues discussions, le pacte d’actionnaire a prévu des solutions en cas de conflits éventuels. C’était indispensable car Bpifrance est une compagnie financière qui est placée sous le contrôle du régulateur, à savoir maintenant la Banque centrale européenne (BCE), à qui il doit être possible de montrer que les règles sont respectées et que l’entreprise ne sera pas bloquée s’il y a désaccord entre ses actionnaires. Ce cas ne s’est heureusement encore jamais produit.
En effet, les relations entre l’État et la CDC sont bonnes, les deux partenaires partageant l’impression d’être dans un même bateau. La coopération semble meilleure encore qu’au temps d’Oséo. La CDC partage pleinement les objectifs de la politique publique sous-jacente. Pour les objectifs financiers, il s’agit bien sûr d’éviter les pertes. La recherche d’un rendement important n’est cependant pas primordiale.
Toutes les décisions importantes font l’objet de réunions préparatoires visant à arrêter une position commune entre les deux actionnaires. En aplanissant ainsi les difficultés, généralement mineures, le fonctionnement s’avère satisfaisant.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Et au sujet de la gouvernance territoriale ?
M. Alain Schmitt. Si vous le permettez, je voudrais seulement ajouter, à propos des relations entre l’État et la CDC, que leurs points de vue convergent, notamment en matière d’innovation. La CDC nourrissait davantage d’interrogations à son endroit, au temps d’Oséo. Cela sortait en effet du cadre habituel de son action. Aujourd’hui, plus personne ne doute qu’il s’agisse d’une activité importante.
M. Sébastien Raspiller. Pour la gouvernance territoriale, l’existence de comités d’orientation régionaux, en sus du comité d’orientation national, permet au dialogue entre l’État et la CDC de se nouer également au niveau territorial, puisqu’y siègent tant des représentants de l’un que de l’autre. Ces comités d’orientation représentent une nouveauté par rapport à la gouvernance classique par le conseil d’administration. Cela se traduit par une implication concrète dans les territoires, où Bpifrance s’appuie sur des antennes régionales, sans qu’il y ait cependant d’agence de Bpifrance dans chaque ville, comme pour une banque de détail privée.
Aussi Bpifrance passe-t-elle, comme établissement de place, des conventions avec des réseaux bancaires. Les entrepreneurs qui se rendent auprès de ces réseaux peuvent se voir proposer des produits de Bpifrance, voire en bénéficier directement grâce à des conventions de délégation passées, pour de petits montants, entre Bpifrance et les établissements bancaires privés.
Les présidents de régions avaient insisté pour que la décision de soutien puisse intervenir au niveau du chef d’agence régionale, en tenant compte des caractéristiques du tissu économique dans les différents territoires.
M. Alain Schmitt. La coopération locale dépasse le cadre strict des comités d’orientation. Il y avait déjà, au temps d’Oséo, des projets d’investissement local, en matière d’innovation. Bpifrance agit dans ce domaine comme partenaire de l’État, ou comme partenaire des collectivités territoriales, qui confient à l’État des fonds en gestion, notamment pour des projets d’innovation. Elle participe aussi à la constitution de fonds régionaux de capital investissement. La coopération territoriale va donc au-delà des aspects de gouvernance.
M. Sébastien Raspiller. Quant à l’influence de l’État sur la politique de Bpifrance, elle s’exerce dans le cadre de la gouvernance classique, à parité avec la CDC, quand il s’agit des moyens propres et du bilan de la structure. La CDC et l’État s’accordent sur un plan stratégique triennal, mis en œuvre par la direction de Bpifrance. Si un besoin conjoncturel se fait sentir, ou au contraire disparaît, des ajustements ponctuels sont possibles.
Mais Bpifrance peut agir aussi comme opérateur et comme gestionnaire de fonds de tiers, en premier lieu de l’État, notamment pour développer des fonds d’amorçage ou des types particuliers de financement en garantie. Chaque année, à l’occasion de la discussion du budget, la problématique de l’innovation est également abordée sous cet angle. Les produits ainsi distribués portent le label Bpifrance, mais font l’objet de conventions avec l’État contenant des instructions précises.
D’autres tiers confient leurs fonds à Bpifrance de la même façon, qu’il s’agisse encore de l’État dans le cadre des PIA, ou des régions, de la CDC, de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou même, à la marge, d’opérateurs privés. Les règles de gouvernance s’appliquent à la gestion des fonds propres, tandis que Bpifrance applique simplement, dans les autres cas, le mandat de gestion qui lui est donné.
Un partage des risques s’opère ainsi naturellement, ce qui évite les difficultés avec la CDC. Les projets soutenus par les PIA sont tendanciellement plus risqués que les projets financés sur fonds propres. D’un côté, les fonds propres sont employés en fonction du plan stratégique de Bpifrance, dans des domaines où le risque n’est pas trop élevé, hors d’une logique de subvention ; la coopération entre l’État et la CDC se fait sans difficulté, puisque les objectifs sont partagés. De l’autre côté, les donneurs d’ordres interviennent directement, par le biais de leurs instructions, dans l’activité de Bpifrance, quand ils lui confient des fonds pour développer des projets de financement ou d’investissement.
Le contrôle général économique et financier s’exerce sur Bpifrance, puisque la banque est gestionnaire d’argent public. Un commissaire du gouvernement siège dans toutes les entités de Bpifrance. Le contrôleur économique et financier veille à ce que Bpifrance remplisse ses fonctions dans le respect des intérêts publics. Des comités des rémunérations existent, tant au niveau du groupe que de ses deux filiales. La cohérence de la politique de rémunération se définit au niveau du groupe.
La création de Bpifrance a constitué un défi pour la gestion de la politique salariale au sein de l’ensemble, qui doit passer par des outils communs de gestion des ressources humaines. Or des écarts significatifs subsistent entre les deux filiales qui pratiquent des métiers différents. Dans la filiale d’investissement, un personnel en petit nombre et hautement qualifié compare ses conditions de rémunération avec le secteur privé, tandis que les standards de rémunération de la fonction publique sont appliqués dans les anciennes unités d’Oséo, comme à l’Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar), se situant donc à des niveaux inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les banques privées.
Un écart trop important de rémunération de Bpifrance Financement avec le secteur privé risquerait d’en faire partir les meilleurs éléments. Il serait au demeurant difficile de justifier, notamment pour les fonctions support, qu’un mécanisme de participation existe pour les uns et non pour les autres. Un tel mécanisme a donc été introduit à Bpifrance Financement, par un décret de la fin de l’année 2014 mais qui limite cette part variable des rémunérations à 1 % de la masse salariale. L’harmonisation des outils salariaux de gestion des ressources humaines doit ainsi permettre de créer une culture de groupe en rapprochant ses composantes, également au niveau régional.
Dans la filière investissement, le décret sur le plafonnement de la rémunération des dirigeants de groupes publics a été appliqué, ce qui a conduit à une baisse substantielle de certaines rémunérations, même si elles demeurent élevées. Il n’en reste pas moins important qu’un bon niveau de rémunération subsiste, ne serait-ce que pour faire face aux tentatives de débauchage en provenance du secteur privé. Le coefficient d’exploitation, c’est-à-dire le rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire, s’établit ainsi à 60 %, soit un montant légèrement supérieur à celui des banques privées, parfois soumises à une pression plus forte de leurs actionnaires, mais ce montant correspond aux objectifs fixés et aux standards en usage.
Je rappelle que les deux entités n’emploient pas le même nombre de personnes, puisque la filiale d’investissement n’en emploie qu’une centaine, contre 1 800 pour l’autre filiale. C’est pourquoi le rapprochement prend du temps.
Quant à la rémunération des cadres dirigeants, elle comporte, chez Bpifrance Financement, une part variable à hauteur de 25 % de la part fixe. La réglementation bancaire prévoit que cette part peut s’élever jusqu’à 200 % de la part fixe. Même si les objectifs sont collectifs, les éléments variables et individualisés conservent leur importance pour la rémunération des dirigeants. Il n’y a pas en revanche de système de retraites à cotisations définies.
Le rapport de la Cour des comptes relatif à la rémunération au sein de CDC Entreprises contient les réponses des ministres des finances et de l’économie. Ils y rappellent que cette entreprise était détenue à 100 % par CDC, dont la commission de surveillance n’avait pas eu connaître des attributions d’actions gratuites. Or c’est dans cette instance que siège la direction générale du Trésor comme représentant de l’État. Ce sujet a été réglé, par la CDC, avant la fusion donnant lieu à la création de Bpifrance. Comme y ont insisté les représentants de l’État et ceux de la CDC, au cours des premières réunions du conseil d’administration de Bpifrance, il n’y aura pas de dispositif prévoyant, chez Bpifrance, l’attribution d’actions gratuites, et il n’y en aura jamais.
Remontant à 2007 et 2008, les pratiques de ce type, en réservant à quelques-uns un traitement privilégié, nuiraient au demeurant à l’objectif principal fixé à la création de Bpifrance, à savoir l’émergence d’une culture propre à l’ensemble du groupe.
M. Alain Schmitt. Dans le domaine de l’innovation, il faut élargir l’approche. Car la politique de l’innovation ne repose pas toujours sur des outils de financement, comme l’a mis en lumière le plan « Une nouvelle donne pour l’innovation ». Le financement ne saurait donc focaliser toute l’attention. L’innovation est aussi affaire d’état d’esprit, de culture, de mesures d’attractivité, de développement d’écosystèmes favorables à la naissance d’initiatives. Par exemple, l’État a créé la labellisation French Tech, rendant visible à l’étranger des écosystèmes favorables à l’innovation, tandis que Bpifrance s’engage dans le financement des start-up.
La sensibilisation à l’entreprenariat et à l’innovation dans l’enseignement scolaire et supérieur dépend de l’État. Dans le domaine réglementaire, l’indicateur 040 de la Banque de France, qui marquait au fer rouge tout dirigeant d’entreprise ayant connu une liquidation et l’empêchait de facto d’obtenir de nouveaux financements, a été supprimé l’an dernier. Une nouvelle approche et une nouvelle gestion de l’échec se développent ainsi. Dans le domaine fiscal, le dispositif jeunes entreprises innovantes ou le crédit d’impôt recherche constituent aussi des incitations.
Quant à la commande publique, les achats innovants de l’administration peuvent être doublement bénéfiques, car ils apportent non seulement une référence client au fournisseur, mais induisent aussi un changement de culture au sein des services.
Quand on parle de financement de l’innovation on retrouve quasiment tout le temps Bpifrance. C’est l’opérateur du financement de la politique d’innovation, et elle me paraît intervenir au bon niveau dans le domaine de l’innovation. Une cohérence se dégage donc de la plupart des actions engagées. Mais cette politique publique dépend globalement de l’État.
En matière de crédits, nous sommes en face d’un paradoxe apparent. Certes, depuis 2013, la dotation du programme 192 est en baisse tendancielle, dans le cadre de l’effort de maîtrise des dépenses publiques mais du point de vue des entreprises, le montant total des financements de Bpifrance en faveur de l’innovation a cependant largement augmenté, bondissant de 40 % en 2014 à un milliard d’euros.
D’autres sources de financement complètent en effet le programme 192. Les actions du PIA, qui montent en puissance, constituent une ressource budgétaire même si cela apparaît moins nettement et même s’ils poursuivent des objectifs propres et que les règles de gestion en sont différentes. Ils portent surtout des projets collaboratifs de recherche et développement, tels les projets structurants pour la compétitivité, le Concours mondial d’innovation, ou la part subvention et avances remboursables du Fonds national pour la société numérique (FSN), apportant des financements à hauteur de 265 millions d’euros en 2014.
Les partenariats entre Bpifrance et les régions ont quant à eux représenté 70 millions d’euros d’aides publiques en 2014.
Les prêts sur fonds propres de Bpifrance ou les prêts adossés à des fonds de garantie financés par des dotations de l’État constituent la troisième source de financement.
Les prêts développent un double effet de levier. En interne, ils accroissent d’un à cinq, parfois six, la capacité de financement qui résulterait de la seule dotation budgétaire ; et ils jouent également un rôle d’entraînement vis-à-vis du secteur bancaire car, en général, ce sont des instruments qui interviennent en co-financement. Pour 50 millions d’euros en 2014, les prêts d’amorçage, sans garantie à long terme, ont accompagné les premières levées de fonds des start-up. Ces prêts existaient déjà, mais sont développés de façon importante par Bpifrance. Pour les prêts pour l’innovation, Bpifrance n’intervient pas en co-financement, mais finance l’aval des projets d’innovation. Ces prêts ont été de 125 millions d’euros en 2014. À l’avenir, la Banque européenne d’investissement (BEI) prendra le relais de l’État qui en finançait la garantie. Le préfinancement du crédit d’impôt recherche a mobilisé de son côté 37 millions d’euros. En 2014, un total de 250 millions d’euros a ainsi servi au financement de l’innovation.
Le programme 192 finance quant à lui à hauteur de 370 millions d’euros des aides à des projets individuels, par le biais de subventions, d’avances remboursables ou de prêts à taux zéro et là aussi avec l’effet de levier. Compartiment nouveau, la Bourse French Tech aide à la création d’entreprises. Il faut donc relativiser la baisse des crédits du programme 192, notamment au vu des efforts consentis sur les PIA.
La nouvelle organisation nous oblige à essayer de rationaliser la gamme. Au temps d’Oséo, l’innovation pâtissait encore d’une vision trop restreinte. Avec Bpifrance, une branche innovation agglomère désormais les aides classiques à de nouveaux types de financement, donnant naissant à un continuum des outils de financement. La synergie entre ces divers instruments maximise l’effet des aides. Les évolutions budgétaires ont donc conduit à une remise en ordre de la gamme des instruments disponibles.
Il est ainsi apparu que certains grands projets collaboratifs du programme Innovation stratégique et industrielle étaient redondants avec des projets soutenus par les PIA. Les crédits correspondants ont ainsi été redéployés au bénéfice de l’innovation individuelle. Dans le domaine de l’aide à l’innovation, Bpifrance réfléchit en ce moment à la manière de structurer sa gamme de produits, qui va de l’amorçage, à l’aide au projet d’innovation, en passant par l’aide à l’industrialisation et le soutien à la levée de fonds.
Les PIA se focalisent davantage sur des projets collaboratifs de recherche et développement, tels les projets structurants des pôles de compétitivité (PSPC) ou les projets industriels d’avenir (PIAVE). Mais ils financent également le Concours mondial de l’innovation. D’autres projets reçoivent d’abord de petites subventions, puis bénéficient d’avances remboursables.
Quant aux relations entre Bpifrance et les autres acteurs dans le domaine du soutien à l’innovation, elles ne concernent pas seulement l’Ademe, mais aussi l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance aussi des projets industriels. Jusqu’où faut-il uniformiser leurs approches ? Pour l’heure, l’Ademe détient une expertise dans le secteur de l’environnement qui justifie qu’elle conserve son domaine d’action. À l’avenir, une coopération plus approfondie serait peut-être souhaitable cependant.
De même, faut-il rassembler toutes les formes de soutien aux ETI au sein de Bpifrance ou faut-il maintenir une forme de diversité ? En tout état de cause, il me semble important de conserver les expertises sectorielles et de ne pas casser les outils existants.
M. Sébastien Raspiller. Je vais prendre deux exemples. Dans le domaine de la défense, la société SOFIRED a été intégrée à Bpifrance. Dans le domaine du soutien aux activités culturelles et au cinéma, Bpifrance n’a noué qu’un simple partenariat avec l’Institut pour le financement du cinéma et des institutions culturelles (IFCIC), car ses fonds propres sont en partie détenus par des actionnaires privés. En matière d’intégration, il faut donc adopter une approche au cas par cas.
L’origine du financement ne rend pas compte à elle seule de la complexité des relations entre les acteurs. Bpifrance peut ainsi gérer des fonds de l’Ademe. En étant plus visible par les entreprises et en menant une démarche proactive, elle apporte une valeur ajoutée.
Quand Bpifrance a été créé, on observait une certaine concurrence entre Oséo et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), qui développaient des gammes parallèles de produits de financement du développement à l’export. Dès 2013, conformément à la logique de guichet unique, une rationalisation de l’offre a pu avoir lieu sous le label « Bpifrance Export ». Bpifrance assure désormais des prêts à l’export, tandis que la Coface agit de manière complémentaire en apportant des cautions, une offre de préfinancement et assure la phase de développement du projet. Une réflexion est en cours sur un transfert éventuel vers Bpifrance de l’activité de garanties publiques effectuée aujourd’hui par la Coface. La décision sera prise d’ici la fin de l’année.
La SFIL, société de financement local, a un objet très différent. Alors que Bpifrance assure de petits tickets de crédit acheteur, cette société opère le refinancement de montants qui varie entre 250 millions d’euros et deux milliards d’euros et n’a pas vocation à avoir une activité de relation avec les entreprises. Le bilan de Bpifrance s’élevant à 50 milliards d’euros, elle sortirait du cadre tracé par les ratios prudentiels, et contrôlé par la BCE, en finançant des prêts de ces montants. Chaque structure agit selon ses capacités.
Ce qui compte c’est que les entreprises s’y retrouvent bien. L’activité de Bpifrance de crédit acheteur direct sera un élément nouveau mais le financement classique continuera à passer par les banques que les entreprises connaissent et qui fonctionne. Simplement cela devrait permettre aux banques de répondre favorablement plus souvent et plus facilement aux demandes de financements relatifs à l’exportation.
Quant au marché du capital développement, il a été créé en France par CDC Entreprises, en particulier sur les segments les plus risqués, c’est-à-dire en amont, en capital risque et en amorçage, sur lesquels les acteurs privés n’étaient pas présents. Sur le marché américain, des fonds de pension n’ont pas hésité à retirer leur mandat de gestion sur ces segments d’amont qui sont moins rentables, voire pas rentables. Bpifrance intervient, dès lors, pour combler une réelle faille de marché et son rôle est fondamental. La rentabilité financière est toujours un critère mais on peut admettre que la rentabilité globale de ces opérations très risquées soit nulle, tant que les pertes sont évitées, que de belles réussites se détachent et que – et c’est tout le débat – sont aussi recherchés des co-investissements là où la probabilité d’une plus value est plus importante.
Dès lors se pose la question de l’articulation de Bpifrance et des acteurs privés : il faut pouvoir pallier la défaillance de marché sans pour autant se substituer aux acteurs. La situation idéale est celle où Bpifrance complète un tour de table avec les opérateurs privés ; Bpifrance fait alors du reste porter une moindre responsabilité à ses équipes puisque l’instruction a déjà été conduite par les acteurs privés. Mais, trop souvent, Bpifrance ouvre encore ce tour de table et c’est son intervention qui le rend possible. Or les choix opérés sont lourds de conséquences. Il faut permettre la multiplication des équipes de personnes très compétentes sur des domaines très pointus et auxquelles les investisseurs font confiance. Aux États-Unis, il n’est pas rare de voir des dizaines de millions de dollars confiés à des dirigeants dont le profil a retenu l’attention d’un investisseur institutionnel, qui peut apporter jusqu’à 80 % du capital de leur entreprise sans vouloir plus de 10 % des droits de vote, pour ne pas s’embarrasser avec sa gestion. Pour repérer ces profils créatifs, il faut de solides équipes d’investissement capables de parier sur des personnalités et des idées. Bpifrance a de très bonnes équipes mais pour que le marché du capital développement soit pérenne, elle doit être présente, sans que ce soit systématique, afin de laisser libre cours à l’expansion naturelle du marché. Or, au travers des investissements directs et des fonds de fonds elle participe, en réalité, à un très grand nombre d’opérations.
À volumétrie constante pour Bpifrance, on souhaiterait donc que le développement du marché du capital risque permette de réduire sa part de marché relative. Le gouvernement a pris des mesures pour renforcer l’attractivité de ce marché, notamment pour attirer les capitaux privés étrangers ou domestiques. Cette croissance, en renforçant les équipes d’investisseurs privés, devrait permettre de prévenir toute atrophie des équipes de gestion dont certaines se limitent à des domaines où le rendement est purement fiscal. C’est pourquoi dans le plan stratégique de Bpifrance, il lui a été demandé de faire des choix pour miser sur des équipes de gestion qu’ils auront sélectionnées, pour des montants qui pourront être importants. Mais, encore une fois, Bpifrance ne doit pas être la seule à opérer ces choix. Elle doit être accompagnée par les acteurs privés.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions, messieurs, de vos interventions.
M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous allons maintenant aborder l’action de la BPI en tant qu’opérateur de l’État pour la mise en œuvre des crédits du programme d’investissements d’avenir destinés au soutien aux entreprises et aux filières industrielles. Il est en effet essentiel que nous ayons une vision précise des contours de cette action et des financements qui y sont consacrés, notamment pour pouvoir en apprécier la cohérence, voire les synergies avec les autres opérations de la Bpi en matière d’innovation.
Nous accueillons donc ce matin M. Thierry Francq, commissaire général adjoint à l’investissement.
M. Thierry Francq. La Bpi qui est la résultante de deux opérateurs historiques –Oséo pour l’innovation et les prêts et CDC Entreprise pour les opérations en capital (fonds et fonds de fonds) – est un opérateur extrêmement important pour le programme d’investissements d’avenir (PIA).
Aujourd’hui, la Bpi opère au total d’une enveloppe de 7 milliards d’euros au titre des PIA I et II (sur un total de 47 milliards d’euros) pour mener, pour le compte de l’État, des actions qui sont de trois ordres :
– le financement de l’innovation par des subventions et des avances remboursables pour des projets de recherche-développement, par exemple par le programme collaboratif PSPC (projet structurant pour la compétitivité) ;
– des prêts aux PME qui sont des prêts ciblés visant à renforcer la compétitivité de ces entreprises en cherchant à réduire l’empreinte énergétique de leurs opérations ou à développer le numérique et la robotique. Ce sont pour la plupart des prêts bonifiés ;
– des opérations en capital regroupant deux types actions d’une logique un peu différente. D’une part, des fonds de fonds ont pour objectif de combler les lacunes du capital-investissement. Il s’agit d’abord de rendre possible l’amorçage – en renforçant les capacités d’action de cette industrie au service des entreprises innovantes, c’est le rôle du fonds national d’amorçage (FNA) – ou encore, comme le fait le fonds de fonds Multicap, de régler un problème de taille des tickets d’investissement en permettant des investissements importants car ceux-ci restent en France bien inférieurs à ceux des États-Unis par exemple. D’autre part, des opérations en capital par des fonds en direct permettent de financer des projets spécifiques – le fonds Ecotech favorise par exemple le développement durable. Je pourrais également citer le fonds numérique. Un dernier fonds de ce type est en cours de constitution pour la mise en œuvre des 34 plans industriels pour la France. Le PIA II a pour vocation de financer les innovations qui ont un caractère d’excellence dans ce cadre. Cela n’est cependant pas exclusif d’autres projets industriels de mise en œuvre d’innovations qui peuvent également être éligibles au PIA.
Pour revenir à l’analyse de l’action de la BPI, trois points méritent d’être soulignés.
Premièrement, nous sommes satisfaits de manière générale de la performance de la BPI en tant qu’opérateur. Du fait de sa génétique – Oséo et l’Anvar –, elle permet une alliance avantageuse de compétences techniques en matière d’innovation et de compétences financières.
Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de soutien aux PME en fonds propres, le fait d’avoir un réseau suffisamment capillaire et pro-actif dans les territoires est un atout pour la BPI, que n’avaient pas ses prédécesseurs. Pour qu’il soit efficace, le PIA se doit, en effet, d’être parfaitement irrigué afin que les initiatives viennent du terrain. C’est une des raisons qui a conduit à transférer une partie du programme numérique de la CDC vers la BPI dans l’objectif qu’elle aille au-devant des entreprises. Les dirigeants de PME ne sont pas en permanence au courant des appels à projets. La Bpi a vocation à effectuer cette démarche pour permettre, in fine, le choix du meilleur dossier.
Enfin, la capacité de la BPI à industrialiser les processus est essentielle car c’est un gage de rapidité. Nous avons par exemple élaboré un dispositif « fast track » qui permet de traiter de bout en bout, en trois mois, des dossiers de R&D collaboratifs afin d’atteindre l’objectif de déploiement du PIA.
On peut effectivement s’interroger sur la manière dont se fait le départ entre les actions en compte propre de la BPI et celles effectuées pour le compte de l’État.
En matière de prêt, la BPI dispose d’éléments génériques : elle offre des catalogues de produits simples qui irriguent tous les types de secteurs, pas forcément avec une logique d’innovation. Les prêts robotiques, numériques ou les prêts verts sont accordés dans le cadre d’une action appelée Usine du futur. Dans les territoires, les régions vont contribuer à détecter les entreprises ayant un fort potentiel de modernisation et éventuellement les accompagner pour définir des solutions techniques qui leur permettent de moderniser profondément leur processus de production. C’est ce qui distingue, dans le domaine des prêts, les opérations menées pour le PIA par rapport aux opérations en compte propre de Bpifrance.
Par ailleurs en matière d’innovation, une banque ne pouvant distribuer en compte propre des subventions et des avances remboursables, Bpifrance ne peut être qu’un opérateur pour ce type d’actions.
S’agissant des opérations en fonds propres, Bpifrance est essentiellement un opérateur de type fonds de fonds, qui vise à irriguer l’industrie du capital-investissement. Le PIA finance des opérations qui portent sur des projets précis, comme le numérique, les technologies écologiques et les projets industriels.
Je tiens à souligner que Bpifrance est une banque : lorsqu’elle investit ses fonds propres dans le capital d’une entreprise, cela étant par définition plus risqué que les prêts, la logique prudentielle impose des limites aux risques de ces opérations. Cela n’est pas le cas pour le PIA puisqu’il s’agit de fonds d’État qui ne sont pas soumis à ces mêmes contraintes et permettent de prendre des risques que les banques ne pourraient assumer. Par exemple, dans le cadre des projets industriels, nous envisageons une opération importante en fonds propres dans une unité de production qui sera une première mondiale dans le domaine médical. Nous pourrions imaginer un investissement au titre du PIA de l’ordre de 80 millions d’euros, ce qui pour une banque ne serait pas possible.
Tout ceci est en réalité un continuum et nous investissons parfois à parité entre Bpifrance pour son compte propre et Bpifrance opérateur du PIA, notamment dans le capital-développement. Cela permet d’avoir des tickets plus élevés, ce qui est un des objectifs recherchés pour la croissance des entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je voudrais revenir sur le pilotage des investissements d’avenir opérés par la BPI. Existe-t-il des comités régionaux qui réunissent des représentants du CGI et ceux de la BPI et par qui sont prises les décisions d’investissement ?
Quel est le niveau d’utilisation aujourd’hui par la BPI des 7 milliards d’euros que vous avez évoqués ? Pouvez-vous nous indiquer la répartition du montant utilisé entre les différentes actions menées ?
S’agissant enfin des investissements en fonds de fonds, existe-t-il des financements d’autres organismes qui interviendraient en complément ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. S’agissant de l’innovation, l’expertise industrielle en matière d’innovation de la BPI est-elle suffisante ? Les difficultés de l’action Plateforme mutualisée d’innovation à sélectionner des projets en raison de l’exigence communautaire d’investissement avisé – un seul projet sélectionné sur treize présélectionnés – vous ont conduit à réorienter cette action vers un programme qui n’intervient qu’en aide d’État, ce qui a permis de finaliser plus rapidement et plus simplement trois projets de plateformes. Pouvez-vous nous donner plus d’explications sur ce point et cela change-t-il le rôle de Bpifrance dans la mise en œuvre de ce programme à moyen terme ?
S’agissant de l’offre de financement aux entreprises en matière de prêt et d’investissement, considérez-vous qu’une réorientation des instruments publics est nécessaire ? Y a-t-il suffisamment de visibilité ?
Mme la présidente Véronique Louwagie. Comment s’opère le suivi des investissements d’avenir par le CGI et quels sont les critères d’évaluation ?
M. Thierry Francq. Bpifrance en tant qu’opérateur du PIA a, comme tous les autres opérateurs, trois fonctions :
Premièrement, elle est l’interlocuteur des porteurs de projet, souvent en amont même du dépôt d’un dossier, pour les informer des attendus d’une action.
Deuxièmement, elle instruit le dossier : la BPI va mobiliser ses compétences financières et techniques pour évaluer la pertinence du projet sur le plan de l’innovation, c’est-à-dire analyser le potentiel d’innovation tant sur le plan technologique que du point de vue du marché, et se poser la question de savoir si le porteur de projet aura financièrement les moyens de le mener à bien, c’est-à-dire la capacité de rembourser son prêt ou dans le cas de fonds propres, si une rentabilité correcte peut en être attendue.
Selon les actions la gouvernance est différente : pour les prêts la loi bancaire s’applique. Ce dont de petits dossiers dont nous déléguons la décision au réseau bancaire de Bpifrance. Pour les fonds, le principe de la gestion d’actifs s’applique : c’est la société de gestion d’actifs logée à l’intérieur de Bpifrance qui est responsable en dernier ressort des décisions d’investissement. Un comité consultatif où sont représentés le CGI, les ministères de tutelle et les personnes qualifiées, donne un avis sur les opérations. Aujourd’hui dans les fonds que nous structurons avec Bpifrance, si l’on ne peut pas forcer Bpifrance à faire une opération, le CGI a cependant un droit de veto.
S’agissant des opérations d’aide – subventions et avances remboursables –, nous sommes dans la gouvernance classique du PIA : sur la base de l’instruction, c’est le comité de pilotage interministériel, auquel sont adjointes des personnalités qualifiées, qui propose la sélection des projets. Nous déléguons parfois la décision au comité de pilotage pour les petits dossiers, mais là encore le CGI garde un droit de veto, qui est toutefois très rarement utilisé. Le projet remonte sinon au premier ministre, qui l’autorise ou délègue cette autorisation au CGI.
La troisième fonction de Bpifrance, qui est fondamentale, est d’assurer le suivi des projets. Il y a d’abord un suivi comptable et financier. Dans des projets d’innovation, il peut y avoir des jalons, il faut alors revenir sur le projet, vérifier que le jalon est atteint pour libérer les sommes ultérieures. Dans les opérations de fonds propres un fonds n’est pas inerte, il suit ses investissements, il lui faut gérer les actifs. Enfin, comme dans la gestion bancaire classique d’un prêt, il y a un suivi à effectuer. Ceci représente le suivi opérationnel.
Ensuite, l’évaluation de l’impact de l’action doit être menée. L’opérateur est chargé de récupérer les indicateurs nécessaires pour l’évaluation, il peut participer à la définition de la méthodologie applicable qui est décidée par le comité de pilotage, il nous aide donc à mener ces évaluations et peut d’ailleurs aussi mener ses propres évaluations en interne.
Mais, à terme, le principe est celui d’une évaluation indépendante. L’opérateur organisera sous l’égide du comité de pilotage une expertise externe, dont les budgets ont été prévus dans les crédits du PIA.
Cette évaluation n’est pas encore faite. Elle ne pourra être réalisée, complètement et scientifiquement, que quand les actions auront produit tous leurs effets. S’agissant de celles en cours depuis un certain temps, nous commençons à disposer d’éléments pour juger de leur efficacité. Nous sommes, par exemple, en train d’étudier une première série de prêts verts du PIA 1. Un premier bilan de cette action, relativement complet, pourra être effectué dans le courant de l’année.
À ce stade, il est donc très difficile de faire un bilan dans le domaine de l’innovation puisque la plupart des projets ne sont pas terminés. Il est difficile de porter un jugement tant que l’on n’a pas abouti à la phase de commercialisation. Ceci dit, notre sentiment est que nous avons beaucoup de bons dossiers avec de vraies innovations. Certes, il y aura des défauts car ces projets sont risqués, ce qui est normal. D’une certaine manière, si aucun projet n’échouait, cela voudrait dire que l’action n’a pas atteint son objet.
S’agissant des fonds, nous avons procédé aux premières réalisations d’actifs. Deux entreprises dans le domaine écotech ont déjà été revendues – et même introduites en bourse - avec des plus-values, et pour un cas une plus-value très importante.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Concrètement, de quels éléments disposez-vous pour suivre les fonds de fonds ?
M. Thierry Francq. Les éléments dont nous disposons sur le fonds national d’amorçage (FNA) nous semblent assez positifs. Ce fonds est opérationnel depuis l’été 2011. Il a souscrit dix-sept fonds dont la taille totale est de 657 millions d’euros. On constate un effet de levier d’un pour un alors que l’objectif minimal était de deux pour un. La taille moyenne des fonds est proche de 40 millions d’euros alors que nous avions un objectif de 25 millions d’euros. Par rapport à nos attentes en termes de nombre de fonds, de taille et de coinvestissement, le bilan est donc positif même s’il n’est pas, à ce stade, définitif. On ne peut pas encore juger de la rentabilité de ces fonds mais nous n’avons pas d’alerte sur ce point.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Comment contrôlez-vous ces fonds de fonds ?
M. Thierry Francq. Le fond de fonds fait un reporting régulier sur les opérations qui sont menées et sur la situation des fonds dans lesquels il a investi.
Aujourd’hui, 67 millions d’euros sont investis dans les entreprises par les fonds bénéficiaires de capitaux du FNA. Ce chiffre peut surprendre, car il semble bas. Mais il ne nous inquiète nullement pour deux raisons. Premièrement, un fonds de fonds a une période d’investissement de quatre à six ans et il investit dans des fonds qui ont, eux-mêmes, une période d’investissement de même durée. Un certain temps est donc nécessaire avant que les fonds parviennent aux entreprises. Deuxièmement, en règle générale dans l’amorçage, lorsque vous investissez 100 euros au premier tour, vous investirez lors des autres tours – sauf si cela se passe mal – entre 300 et 400 euros. À ce stade, n’ont été réalisés essentiellement que des premiers tours. La réalité de l’apport total est donc plus beaucoup important que ces 67 millions d’euros. Nous considérons que nous sommes sur un bon rythme.
L’autre fonds de fonds, le Midcap, qui a démarré depuis un an, connaît aussi des débuts positifs. Depuis l’été dernier, le fond a engagé 115 millions d’euros dans des fonds sur un total de 400 millions. Ce démarrage est prometteur et il est possible que nous remettions au pot prochainement.
Aujourd’hui, sur l’enveloppe de 7 milliards d’euros, les montants engagés sont de 3,798 milliards, les montants contractualisés sont de 3,554 milliards, et les montants décaissés sont de 2,928 milliards. Ce qui reste à engager relève essentiellement du PIA 2 qui vient de démarrer. Globalement, sur les actions de Bpifrance, nous n’avons donc pas de difficulté liée à la consommation des crédits.
Les 7 milliards d’euros se répartissent de la façon suivante : 1,9 milliard de subventions, 0,9 milliard d’avances remboursables, 2,8 milliards de prêts, 1,3 milliard de fonds propres. 600 millions d’euros abondent des fonds de garantie.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Vous avez indiqué que les sociétés de gestion d’actifs participaient à la décision et que le comité consultatif avait un droit de veto. Avez-vous utilisé ce droit de veto et à combien de reprises ?
M. Thierry Francq. À ma connaissance, le droit de veto a été utilisé deux fois depuis un an et demi que je suis en poste. Dans le premier cas, l’opération a été jugée très risquée et peu porteuse d’avenir. Dans le second cas, qui est un peu particulier, nous avons estimé qu’il existait un risque de réputation. Nous représentons l’État et nous sommes sans doute plus attentifs qu’un gestionnaire d’actif à ce type de risque, d’autant que ce cas concernait le domaine financier qui n’est pas, pour nous, prioritaire.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Ces fonds de fonds sont une forme d’externalisation de l’action de la BPI en matière d’investissement. Cette externalisation vous semble-t-elle plus efficace qu’un investissement direct ? Comment sont maîtrisés et suivis ces investissements ? Les investissements directs ne permettent-ils pas une meilleure maîtrise des choix ?
M. Thierry Francq. Notre action doit être suffisamment plastique dans le choix des instruments. Par ailleurs, nous poursuivons deux objectifs distincts dont l’un peut être atteint par les fonds de fonds, et l’autre par un investissement direct.
Le fond de fonds répond à une logique macro-économique. Nous intervenons par ce moyen lorsque l’on constate que le marché français n’a pas une capacité suffisante par rapport aux besoins des entreprises, dans l’objectif de pallier une défaillance du marché pour un type donné d’opération, par exemple l’amorçage. L’enjeu, pour nous, n’est pas de connaître précisément et finement quelles sont les opérations ou les entreprises soutenues, même si nous pouvons le faire grâce à notre participation aux comités consultatifs de ces fonds. L’action du FNA en matière d’amorçage paraît à cet égard satisfaisante au regard des témoignages et des éléments dont nous disposons. Ceci peut cependant évoluer très vite. La principale difficulté de ce type d’action est que, lorsque vous détectez une faille de marché, plusieurs générations de projets seront impactées car la durée de vie fonds peut être de dix ans.
Les fonds en direct procèdent d’une logique très différente. Ils sont mis en œuvre soit lorsque l’on considère qu’il n’y a pas assez de capital-risque dans un domaine particulier, par exemple dans l’écologie, soit pour soutenir une stratégie de filière et pour apporter des capitaux à des projets spécifiques.
Je considère toutefois qu’il y a trop d’instruments d’intervention. Les entrepreneurs peuvent se sentir perdus, même si le rôle d’un opérateur de la BPI est de le diriger vers le bon instrument. C’est la raison pour laquelle, pour une question de lisibilité, nous avons limité le nombre d’instruments dans le PIA 2. Par exemple, nous n’avons constitué qu’un seul fond pour l’ensemble des projets industriels, quel que soit le secteur.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. N’y a-t-il pas une forme de contradiction ? Dans la phase d’amorçage, les projets qui n’arrivent pas à émerger sont souvent ceux qui disposent de peu de fonds propres. Or, 80 % des interventions sont gérées par des fonds de fonds et en suivant une logique financière, l’investissement n’ira peut-être pas forcément là où se trouve le besoin. Un investissement direct n’est-il pas préférable ?
M. Thierry Francq. Il me paraît naturel que la majorité des interventions se fasse par l’intermédiaire de fonds de fonds. Cependant, cela est appelé à évoluer lorsque la demande provient du terrain. La logique du PIA est, en effet, que les besoins soient définis pas le terrain et non pas décrétés d’en haut. Ce sont les parties concernées d’un secteur qui imaginent des projets structurants pour leur secteur. Certes, il existe des orientations politiques qui mettent l’accent sur tel ou tel secteur. Mais les projets doivent venir du terrain.
Ainsi, dans le PIA 2, le fonds que nous créons est pour l’essentiel un fonds direct car il existe des stratégies de filière élaborées, en partenariat entre l’État et les industriels du secteur dans le cadre des plans pour la nouvelle France industrielle. Le fonds direct se justifie pleinement dans ce cas. Il serait dangereux de procéder autrement, sauf à opter pour une logique de planification économique qui n’est pas adaptée.
Si l’on devait constater – ce qui n’est pas le cas actuellement – que, dans l’amorçage, la masse des capitaux disponibles paraît suffisante, il faudra en rester au fond de fonds existant dans ce domaine. Un tel fond de fonds ne rendrait, en effet, pas service au marché car il conduirait à une inflation des prix. L’intervention par un fonds de fonds ne doit pas relever d’une politique permanente et l’idéal est qu’à terme l’on n’en ait plus besoin. Il ne serait pas opportun de créer une situation de confort pour les gestionnaires d’actifs dont le métier est de rechercher et de convaincre des investisseurs, et non de solliciter le concours de l’État. Il faut maintenir une certaine tension dans le système.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Êtes-vous en mesure, aujourd’hui, de vérifier le niveau de fonds propres demandé sur ces projets d’amorçage pour voir si l’on soutient des entrepreneurs qui ont peut-être peu de fonds propres mais de très bonnes idées ?
M. Thierry Francq. C’est évidemment très difficile. Une étude macro-économique est nécessaire pour savoir s’il y a besoin de fond de fonds et dans quel domaine. Un jugement micro-économique sur une collection de projets n’est pas pertinent.
Les fonds sont utiles mais les entreprises doivent un jour en sortir. Il faut prêter attention à la bourse. Il faut intégrer cet élément au regard de la chaîne de financement des PME de croissance.
Je dois encore vous répondre sur les PFMI (plateformes mutualisées pour l’innovation) et nos relations avec les régions. S’agissant des PFMI, la situation était assez complexe à analyser sur le plan des aides d’État au sens du droit européen car il y avait tout à la fois des fonds propres et des subventions à viser. Ce type de dossier doit être évité dans la mesure où la commission européenne a tendance à les mettre en doute avec le risque de requalification des fonds propres en aide d’État. Je précise que nous avons financé huit projets sur les treize présentés dans ce cadre-là : trois projets ont abouti en tant que PFMI et cinq autres ont été redirigés avec succès sur d’autres outils.
Enfin, je souligne qu’un dispositif spécifique et expérimental sera mis en œuvre dans cinq régions dans le cadre du PIA 2, dans lequel Bpifrance jouera un rôle d’instruction et les régions et l’État, représenté par le Préfet, co-décideront des investissements.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
Audition du jeudi 19 mars 2015
M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons M. Jean-Louis Beffa, membre du comité de surveillance de la CDC et donc du comité spécialisé de suivi de la BPI qui a été créé en son sein, avec lequel, nous souhaitons aborder notamment la question des relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Bpifrance.
M. Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain, membre de la commission de surveillance de la CDC. Malgré l’existence du comité spécialisé de suivi que vous venez de citer, la relation entre la CDC et Bpifrance n’est pas très étroite. La BPI a adopté d’emblée une attitude indépendante, en raison de la façon dont son capital a été constitué : 50 % provenant de l’État et 50 % de la Caisse. Il n’est jamais bon qu’une entreprise ait deux tuteurs. Pour réparer ce que je considère comme une erreur, je considère qu’il faudrait transférer ne serait-ce qu’une action de Bpifrance du Trésor vers la CDC.
Si j’émets un jugement positif sur la BPI, je regrette cependant que celle-ci ne porte pas d’attention particulière à la politique industrielle et adopte un comportement purement financier. J’y vois l’influence du Trésor, extrêmement libéral et réticent à l’égard de toute action qui ne serait pas strictement bancaire. En créant la BPI, l’État a manqué son but politique. Quelles que soient les positions de son directeur actuel, Bpifrance obéit à la pensée unique, qui conduit à privilégier la dimension financière classique.
Les positions du directeur général de la CDC vont dans le bon sens. Il aurait été dommage qu’il n’assume pas lui-même la présidence de la BPI, ce qui a été, un temps, envisagé. De son côté, le président de la commission de surveillance s’implique fortement dans les réunions de suivi, malheureusement trop rares, ce qui ne nous permet pas d’examiner en détail l’ensemble des questions.
Vous m’avez appris, par les questions posées, l’ouverture d’un bureau de représentation commune de Bpifrance et de la CDC à Bruxelles. Pour défendre leurs intérêts communs et suivre les dossiers, ces deux organismes doivent avoir un lien étroit avec la Commission et le Parlement européens. Je me réjouis par conséquent de cette nouvelle.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Il est regrettable que vous n’en soyez pas informé.
M. Jean-Louis Beffa. La manière dont nous travaillons – sur des sujets très importants pour les décisions gouvernementales – ne nous laisse pas le temps d’entrer dans certains détails d’organisation.
Je vais prendre dans l’ordre les questions que vous m’avez adressées.
Les règles européennes, en matière d’aides d’État, semblent ridicules, quand on les compare à celles qui s’appliquent au Japon ou en Chine. Alors que le Japon consent des efforts considérables pour soutenir ses entreprises, la Commission adopte une vision ultra-libérale, qui revient, pour l’Union européenne, à se tirer une balle dans le pied. L’affaiblissement industriel français et européen tient pour beaucoup aux règles extrêmement néfastes que j’ai dénoncées avec Gerhard Cromme, dans un rapport que nous avons remis à M. Hollande et à Mme Merkel.
Depuis longtemps, la Commission a choisi de protéger les consommateurs au détriment des producteurs. Bientôt, les premiers resteront seuls face aux Chinois ou aux Américains, car, dans bien des secteurs, les producteurs français, voire européens auront disparu. Une telle politique est irréaliste. Désormais, la mondialisation est non une concurrence entre des entreprises qui adopteraient une règle du jeu commune, mais une bataille entre des États qui soutiennent leurs champions. La Direction générale de la concurrence l’a-t-elle bien compris ?
Je ne sais pas précisément quelles sont les règles européennes concernant le comportement « avisé » de l’investisseur et du financeur, ni celles qui consistent à rechercher avant tout la rentabilité et à se méfier le plus possible de la prise de risque qu’implique par nature toute politique industrielle. On ne veut pas comprendre que les entreprises d’Europe – même d’Allemagne – perdent peu à peu la lutte contre les Américains, les Japonais, les Coréens ou les Chinois. Les règles européennes qui s’appliquent face au conglomérat Samsung témoignent d’une méconnaissance absolue de la dureté de la concurrence internationale. Les pays émergents ont renoncé à ces règles, qui avaient cours dans un monde occidental fermé.
Bpifrance a suffisamment de priorités pour ne pas créer de nouvelles structures afin de soutenir les entreprises à l’international. Nombre d’organismes jouent déjà ce rôle. Celui sur lequel Bpifrance doit se concentrer consiste à assurer des financements.
La BPI se distingue des banques privées et comble des failles de marché, mais non de manière significative. Certes, elle se montre ouverte en matière de crédit, car elle conserve l’orientation d’OSÉO, qui était la banque des PME, mais elle est très réticente en matière de fonds propres. Elle contraint les PME qui la sollicitent à effectuer des audits très onéreux. De tels réflexes seraient plus pertinents à l’égard des grands groupes. Dans le dialogue avec les PME, la BPI ne témoigne pas de souci de simplification. Bien qu’elle se comporte mieux que les autres banques, elle pourrait donc encore progresser.
Dans certains cas, elle pourrait s’engager dans l’activité de capital-retournement, qui consiste à prêter de l’argent à risque à une entreprise qui va mal, afin que sa situation se rétablisse. La Banque n’a cependant pas à assumer la responsabilité de tous les canards boiteux que certains responsables politiques voudraient lui confier. Elle doit faire preuve de prudence et de rigueur, sans quoi, faute d’experts, elle s’intéresserait à des entreprises qui, même aidées, ne se relèveront pas.
Mme la présidente Véronique Louwagie. À quel type d’experts songez-vous ?
M. Jean-Louis Beffa. Il faut des experts techniques et industriels. Pour un dossier de financement dans le secteur de l’automobile pour lequel vingt-cinq emplois étaient en jeu, le chef d’entreprise avait un bon projet, mais il lui manquait 900 000 euros de capital. Le personnel était prêt à en fournir 100 000. Je lui ai suggéré de solliciter quatre de ses clients, qui pourraient apporter chacun 100 000 à 150 000 euros. Dans pareil cas, la BPI peut jouer un rôle utile, à condition que le chef d’entreprise ne soit pas seul, et qu’il apporte au moins l’engagement d’un client.
L’industrie n’est une priorité ni pour la BPI ni pour le Trésor. Or, si l’on peut fonder une entreprise de services avec très peu de capitaux propres – les Français ne s’en privent pas –, des capitaux sont nécessaires pour former un projet industriel. Dans ce domaine, la BPI ne s’engage pas de manière significative.
Il serait facile de sauver certaines entreprises en difficulté, qui doivent rester dans des mains françaises. La Compagnie générale de géophysique, que son management a trop endettée, traverse une crise conjoncturelle. La BPI lui apporterait un confort précieux en la dotant de fonds propres. Elle pourrait aussi aider les groupes Technip ou Vallourec à faire évoluer leur structure. On éviterait ainsi que la France ne les perde à l’occasion d’une OPA.
Le Fonds stratégique d’investissement (FSI) avait procédé à de bons investissements, que la BPI n’a pas renouvelés de manière significative, sans doute par manque de fonds. L’Agence des participations de l’État (APE) possède désormais l’argent que l’État peut vendre sans changer sa stratégie vis-à-vis des sociétés concernées. Le problème est que cet argent ne sert pas à restructurer des capitaux, comme l’ont fait, pour Peugeot, l’État et la famille, associés à un investisseur chinois. J’aurais souhaité, par exemple, que le FSI, joint à un partenaire japonais et aux membres de la famille Bouygues aide le groupe General Electric à former une structure.
Je le répète : les moyens manquent et ils ne se placent pas où il faudrait. Il est dommage de valoriser les actifs de l’APE sans en consacrer une partie à doter la BPI, ce qui aiderait les grands groupes qui peuvent se redresser à restructurer leur capital. Il faut vendre des actions de l’APE et les transférer vers un fonds de la BPI, conçu sur le modèle du FSI.
Le recours par Bpifrance à d’une activité de fonds de fonds, que j’ignorais, car elle n’a pas été évoquée au comité, est une démission intellectuelle, comme peut l’être, pour une société, le fait de racheter ses actions. On fait des fonds de fonds – activité financière et passive – quand on n’est pas assez fort pour investir. À quoi bon avoir créé la BPI pour arriver à ce résultat ? Mieux vaut développer des prises de participation directes. Il est probable qu’une banque ordinaire, comme la BNP, n’aurait pas investi dans Peugeot.
Le fond de fonds est une activité financière, qui ne correspond pas à ce qu’on attend de la BPI. Aux termes de la loi du 31 décembre 2012, elle a pour objectif de soutenir les stratégies de développement des filières. Il est essentiel de financer celles qui exportent, en sachant que, dans le monde industriel, certains métiers affrontent la concurrence mondiale, alors que d’autres ne se mesurent qu’aux acteurs nationaux.
C’est en fonction de ce critère que j’ai orienté l’activité de Saint-Gobain pour me prémunir de la concurrence chinoise. Les points forts du CAC 40 sont les entreprises multirégionales, que la France détient à hauteur de 12 %. On constate en effet un décalage entre la difficulté d’exporter, qui est manifeste, et la force du CAC 40.
Sous le Président Jacques Chirac, j’avais créé l’Agence de l’innovation industrielle, qu’a supprimée le Président Nicolas Sarkozy. Elle aidait les grands groupes à mener des projets ambitieux, tournés vers l’exportation, n’en déplaise à ceux qui dénonçaient un « interventionnisme d’État ». L’instance a fusionné avec le FSI qui, sous l’égide de la BPI, poursuit deux activités. L’activité financière m’inspire plus de réserves que l’activité stratégique, celle de la branche innovation, dont le directeur, M. Fournier, est un homme de grande valeur.
M. Macron a bien fait de réduire le nombre des plans de reconquête de trente-quatre à dix. Le Commissariat général à l’investissement est une bonne instance, mais ses procédures, lourdes et complexes, s’accordent mal au financement de plans industriels ambitieux.
Je ne suis pas hostile au principe des pôles de compétitivité, mais beaucoup d’entre eux ne produisent rien de concret. On découvre, après des années, que leur activité ne justifie pas les financements qu’ils ont reçus. Mieux vaudrait les structurer autour d’un projet.
À mes yeux, le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) n’est rien de plus qu’une infirmerie.
Enfin, il est difficile de parler de cohérence quand les acteurs sont aussi nombreux. À chaque étape interviennent deux entités : le Trésor, qui, compte tenu de son libéralisme financier, ne considère pas la politique industrielle comme une priorité, et le Budget, qui veille à ce qu’on n’octroie pas de crédits à tout instant. Cette dualité allonge les délais et entraîne des complications considérables.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Comment peut-on améliorer le fonctionnement du comité spécialisé de suivi de la BPI, dont vous regrettez qu’il se réunisse trop peu, et qu’il n’aborde que des questions d’orientation générale ?
M. Jean-Louis Beffa. Pour définir une stratégie d’investissement, il faut faire le bilan de l’action du FSI. À mon sens, on doit intervenir dans des groupes qui ont de l’avenir et qui éprouvent un besoin temporaire de soutien en capital. Avant notre prochaine réunion, M. Emmanuelli et M. Dufourcq devraient dresser la liste des sujets délicats, qu’il faut absolument aborder. Nous travaillerions alors de manière plus précise.
M. le rapporteur. Parmi les différentes phases du développement des entreprises – création, amorçage, développement, transmission –, c’est en matière d’amorçage qu’on constate le plus de lacunes. Peut-être ne concentre-t-on pas suffisamment l’intervention sur les sociétés qui ont peu de fonds propres mais de bonnes idées.
M. Jean-Louis Beffa. Les industries ont besoin de plus de fonds propres que les sociétés de services. Dans les start-up de services, qui marchent bien, l’important est surtout d’intervenir au bon moment, quand la société est en train de grandir.
Pour être moi-même business angel – je suis un petit investisseur et je siège au conseil d’administration de start-up –, je suis frappé de voir que les sociétés de qualité sont très vite rachetées par des étrangers. Il importe de trouver des fonds. En France, le capital-risque, y compris technologique, est assez faible. En outre, il est géré de manière financière et court-termiste, selon une mentalité que la BPI n’a pas réussi à faire évoluer.
Si l’on veut financer les entreprises et investir en actions dans les grands groupes, il faut sortir du schéma actuel. Pour se conformer à Solvabilité II, les compagnies d’assurances ont vidé leur portefeuille d’actions, et les groupes étrangers, qui les possèdent désormais, ont une vision anglo-saxonne. Ceux-ci ont hurlé contre la loi Florange qui réforme le mode de gouvernance en instaurant un vote double. Ils exercent un chantage auquel se soumettent de nombreux patrons français.
Il faut remédier à une autre aberration française. Nous possédons, sous forme d’assurance-vie, une épargne considérable qui n’aide en rien l’investissement en actions. Il faudrait créer à cette fin un fonds spécial doté par l’assurance-vie. La Caisse en gérerait les investissements de base et la BPI, dans l’esprit de l’ancien FSI, opérerait les restructurations industrielles.
À défaut, les centres de décision risquent de quitter la France. L’exemple du groupe Lafarge est inquiétant. Il n’est pas impossible que notre pays perde en un jour le centre de décision de la moitié des entreprises du CAC 40, ce qui réduirait du même coup son poids politique. La localisation du centre de décision et la structure du capital sont des questions essentielles dont les parlementaires doivent se saisir. M. Macron est conscient du problème. Il faut doter la BPI de moyens supplémentaires si on veut qu’elle puisse agir à cet égard.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Si le comité spécialisé de suivi se penchait sur des questions spécifiques, voire techniques ne ferait-il pas double emploi avec les conseils d’administration de la Bpi dans lesquels siègent aussi des représentants de la CDC ?
M. Jean-Louis Beffa. Nous travaillerions plus efficacement si les administrateurs faisaient remonter des informations vers le comité spécialisé. Je ne vois aucune objection à ce qu’ils soient présents quand celui-ci se réunit, ni à ce qu’ils suggèrent des points à porter à l’ordre du jour, ni même à ce qu’ils préparent l’examen de ces points par un rapport. Il est regrettable que les administrateurs de la Caisse, présents dans de nombreuses filiales, ne transmettent aucune information à la commission de surveillance.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
Audition du jeudi 19 mars 2015
M. Régis Turrini, commissaire à l’Agence des participations de l’État
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons M. Régis Turrini, sur la question de l’articulation de l’action de Bpifrance et de l’Agence des participations de l’État (APE) dans la gestion des investissements dans les grandes entreprises, et sur le regard qu’il porte sur l’action de Bpifrance dans ce secteur.
M. Régis Turrini, commissaire à l’Agence des participations de l’État. Lors de la mise en place du Fonds stratégique d’investissement (FSI) en 2009, une stratégie d’investissement avait été définie dont je rappelle les principales thèses : apport de fonds propres permettant aux entreprises de dynamiser leur croissance, souscription au capital d’entreprises en mutation pour accompagner leur transformation ou la consolidation du secteur, stabilisation de l’actionnariat des entreprises disposant de positions concurrentielles solides, et dont les compétences et les technologies sont importantes pour le tissu industriel du pays.
À sa création, l’Agence des participations de l’État (APE) a été conçue non comme une entité pouvant légitimement prendre de manière souple des participations dans le capital des entreprises, mais comme la gestionnaire d’un stock d’actifs issus pour l’essentiel des anciens monopoles. Le FSI, par sa doctrine, avait donc vocation à assurer une intervention plus flexible de l’État auprès des entreprises, en particulier en période de crise.
La formalisation d’une stratégie de l’État actionnaire, sous la forme d’une doctrine, a été une démarche importante réalisée par mon prédécesseur en 2014. Cette doctrine, qui a fait l’objet d’une communication en Conseil des ministres le 15 janvier 2014, a partiellement estompé les différences qui pouvaient exister entre l’APE et les modalités d’intervention de l’ancien FSI, incorporé depuis lors au sein de Bpifrance.
Selon cette doctrine, l’État doit posséder la capacité d’intervenir en fonds propres, à titre majoritaire ou minoritaire, dans des sociétés commerciales, cotées ou non. Il se comporte en investisseur avisé avec une vision stratégique, une appréciation des risques, une capacité d’intervention ou d’anticipation qui lui sont propres. Son intervention doit pouvoir s’inscrire dans la durée, notamment afin de soutenir des projets qui supposent un retour sur investissement différé.
Une réflexion menée en 2013 a permis d’identifier quatre objectifs clairs et explicites qui doivent guider l’intervention de l’État en fonds propres. L’APE doit s’assurer d’un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics stratégiques intervenant dans des secteurs particulièrement sensibles en matière de souveraineté. Elle doit s’assurer de l’existence d’opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du pays. Elle doit accompagner le développement et la consolidation d’entreprises, en particulier dans des secteurs et des filières déterminantes pour la croissance économique. Enfin, elle doit intervenir ponctuellement, dans le respect des règles européennes, dans des opérations de sauvetage d’entreprises dont la défaillance présenterait des risques systémiques. La doctrine de l’État actionnaire prévoit explicitement que celui-ci puisse intervenir aussi bien directement par l’intermédiaire de l’APE qu’indirectement, via Bpifrance.
Dans ce cadre, Bpifrance s’est dotée d’une doctrine d’investissement complémentaire à celle de l’APE. Pour simplifier, quatre grandes complémentarités peuvent être identifiées.
Bpifrance a un rôle de financement de l’économie, au sens où son action doit contribuer à augmenter le volume de financements apportés aux entreprises françaises, tant par l’effet direct de ses interventions que par leur effet d’entraînement lié à la recherche de cofinancement.
Pour satisfaire ce premier objectif, Bpifrance concentre prioritairement son action sur les TPE, PME et ETI, alors que celle de l’APE porte sur un nombre limité de grandes entreprises, les unes cotées, les autres issues des anciens monopoles.
Dans la mesure où Bpifrance intervient en vue de créer un effet d’entraînement, elle recherche systématiquement des co-investisseurs auxquels elle laisse la majorité des parts. À l’inverse, l’APE peut conserver une position d’actionnaire majoritaire, voire unique dans de nombreuses entreprises.
Enfin, Bpifrance poursuit un objectif de rotation du portefeuille d’actifs en synergie avec les co-investisseurs, dans un souci de bonne gestion des risques, de libération de marges de manœuvre pour financer de nouveaux investissements et de valorisation de son patrimoine. Par conséquent, son horizon de détention est fini, de l’ordre de cinq à sept ans. L’APE intervient dans des entreprises pour lesquelles l’horizon de détention peut être beaucoup plus long, par exemple lorsque l’intervention est guidée par des enjeux de souveraineté.
La complémentarité des deux types d’action mérite cependant d’être nuancée. La question du bon véhicule d’intervention de la sphère publique s’est posée dans certains cas, comme dans celui d’Alstom. Néanmoins, ces hésitations traduisent plus souvent une incertitude sur les raisons de l’investissement – entreprise stratégique, consolidation d’une position, durée de détention – que sur l’outil à utiliser.
Cette complémentarité et ces divergences dans les objectifs ont une traduction concrète en termes d’effectifs. Alors que l’APE dispose d’une cinquantaine de collaborateurs dont un peu moins de quarante cadres opérationnels, Bpifrance Participations possède un personnel plus important avec près de 200 personnes affectées aux questions de participation et d’investissement.
Enfin, au-delà des relations entre l’APE et Bpifrance, l’APE dispose, lors des prises de participations, d’autres interlocuteurs dans la sphère publique, notamment la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Néanmoins, l’APE étant actionnaire de Bpifrance, leur dialogue est intense et fluide.
Bpifrance entretient des relations étroites avec d’autres services de l’État comme la direction générale du Trésor et la direction générale des entreprises, notamment dans le cadre de son suivi, mais le positionnement de l’APE demeure particulier, compte tenu de la proximité de l’action des deux véhicules.
J’en viens aux questions que vous m’avez posées par écrit.
Les grandes entreprises occupent une place à part au sein du portefeuille hérité de la CDC et du FSI que Bpifrance a reçu lors de sa création. En cédant ces participations, Bpifrance opère un mouvement de bascule par lequel elle se dégage des grandes entreprises pour accompagner les PME et les ETI.
L’action de Bpifrance auprès des grandes entreprises se fait principalement au travers de la filiale Bpifrance Participations et du métier fonds propres ETIGE (ETI/grandes entreprises). Au-delà du suivi du portefeuille hérité du FSI, qu’elle assure avec grand professionnalisme – comme le prouvent les résultats pour l’exercice de 2014 –, Bpifrance permet des échanges entre les grandes entreprises et développe des interactions au sein du secteur industriel français, que ces entreprises continuent à marquer de leur présence. Elle s’acquitte ainsi de sa mission de financement de l’économie.
Les échanges entre les services de l’APE et ceux de Bpifrance concernant ces grandes entreprises sont nombreux, afin de rendre l’action publique le plus efficace possible. Le portefeuille de Bpifrance Participations est marqué par une forte présence des entreprises du secteur des télécommunications, via Orange, qui constitue plus de 30 % de la valeur nette comptable du portefeuille des grandes entreprises cotées, mais aussi par le biais d’entreprises connexes à ce secteur, comme Technicolor ou Eutelsat.
Parmi les participations directes héritées du FSI, certaines ont été vendues ; les autres appartiennent encore au portefeuille de Bpifrance, pour des montants relativement importants. Les actifs de l’APE, très différents de ceux de la BPI, composent un inventaire à la Prévert. Ce sont des d’entreprises très diverses, dans lesquelles notre niveau de participation varie considérablement. L’APE est présente dans soixante-quatorze entreprises pour une valeur nette comptable de 110 à 120 milliards, dont 80 dans des entreprises cotées, alors que Bpifrance dispose directement d’environ soixante-dix participations ETIGE pour une valeur nette comptable d’un peu plus de 10 milliards.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Un rapprochement entre l’APE et Bpifrance, qui exercent le même métier, est-il envisageable, voire souhaitable ?
M. le rapporteur. Les doctrines de gestion de l’APE et de Bpifrance s’opposent-elles parfois ? Le cas échéant, comment réglez-vous les divergences de points de vue ? Comment coordonnez-vous la gestion des investissements ? Quand l’APE et Bpifrance détiennent des participations dans les mêmes entreprises, comment accordez-vous vos décisions d’investissement et de cession de parts ? Existe-t-il des synergies d’expertise entre les deux instances ?
M. Régis Turrini. L’APE et Bpifrance ne sont pas les seules instances publiques qui détiennent des participations dans les entreprises françaises, et dont les relations pourraient d’être clarifiées. C’est aussi le cas du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ou de l’IFP Énergies nouvelles (IFPEN). Si l’on veut examiner la cohérence de l’action de l’État, on devrait, sans doute, le faire dans un cadre plus vaste.
L’État, actionnaire à 50 % de la holding de tête Bpifrance SA, est présent au sein de tous les organes de gouvernance de Bpifrance et de ses différentes structures. Des membres de l’APE sont plus particulièrement présents, en tant que représentants de l’État, dans les instances de gouvernance de la holding de tête et dans les sociétés du pôle investissement Bpifrance Participations et Bpifrance Investissement. Les échanges entre les services de l’APE et ceux de Bpifrance sont donc nombreux et approfondis. D’autres représentants de l’État, avec qui nous échangeons sur une base régulière, sont présents au sein du pôle financement. L’APE possède à tout instant une vue de l’ensemble de l’entreprise, qu’elle partage avec les autres services de l’État, ainsi qu’avec la CDC, coactionnaire à 50 % de Bpifrance SA.
Par ailleurs, l’APE partage avec Bpifrance des participations au sein de certaines entreprises, notamment Orange. Elle a mené avec Bpifrance des opérations conjointes de prise de participation. Une opération de ce type concernant Alstom pourrait se concrétiser. Nous menons également des échanges afin d’optimiser la détention des participations au sein de la sphère publique, en fonction de la doctrine de chacune des entités. Je puis citer, à titre d’exemple, le transfert de la BPI vers l’APE de la participation dans STX, ou la réflexion que nous menons sur Eramet.
Orange est la principale participation de la BPI et c’est aussi celle que nous partageons. Son poids est important dans le bilan de Bpifrance. Elle représente 22 % de la valeur nette comptable de son portefeuille, ce qui constitue 11,6 % du capital d’Orange. Un pacte d’actionnaires entre l’État et Bpifrance concernant cette participation nous engage à tout mettre en œuvre pour trouver des positions communes sur les sujets qui ont trait à la vie de la société.
La monétisation intervenue en octobre 2014, qui s’est traduite par la cession de 1,9 % du capital d’Orange, a souligné les interactions existant entre les équipes de Bpifrance et celles de l’APE. Ce sujet, qui a fait l’objet de consultations au sein des organes de gouvernance où l’APE est présente avec la CDC, a donné lieu à des échanges techniques entre les services, notamment en vue de l’examen par la Commission des participations et des transferts. Nous travaillons ainsi avec la BPI et la CDC, avec lesquelles nos relations sont simples, fluides et informelles.
Dès lors que les doctrines d’intervention de l’APE et de Bpifrance, quoique différentes sur certains points, peuvent s’avérer complémentaires, il est légitime d’envisager des actions conjointes, chaque fois que cela s’avère pertinent. S’agissant de l’opération Alstom, l’État a noué avec Bouygues un accord qui lui offrira la possibilité d’entrer au capital d’Alstom à hauteur de 20 %, une fois que l’opération entre GE et Alstom sera finalisée. Cet accord laisse ouverte la manière dont l’État pourra entrer au capital. Il prévoit notamment que l’option d’achat dont il dispose pourra être exercée par toute entité contrôlée par l’État, donc par Bpifrance. Aucune décision n’a encore été prise – nous en sommes toujours à la phase de l’instruction –, mais il est certain que nous poursuivrons une étroite collaboration avec Bpifrance sur ce dossier, dès lors que son association à cette acquisition pourrait être une option à considérer sérieusement.
Le reclassement des titres STX de Bpifrance vers l’État en juin 2014 a permis de rationaliser l’actionnariat de la sphère publique dans STX France en confiant à l’APE tant la propriété des titres que le suivi de la cession engagée par les créanciers de STX. L’APE est ainsi devenue le seul interlocuteur du groupe, comme actionnaire minoritaire, et son seul interlocuteur pour la cession de la participation majoritaire de STX dans STX France. Le reclassement a permis une mise en conformité avec la doctrine de l’État actionnaire définie par le Gouvernement, qui attribue à l’APE la responsabilité d’investir dans des entreprises liées à la défense nationale. On connaît les capacités de construction de navires militaires de STX.
Au même titre que pour d’autres participations, on pourrait se poser la question de l’intérêt, pour la cohérence de l’action de la sphère publique, du transfert d’Eramet du portefeuille de Bpifrance Participations vers l’APE – ou du transfert inverse.
M. le rapporteur. Un tel transfert est-il envisagé ?
M. Régis Turrini. Pas encore, mais il pourrait l’être, compte tenu du rôle d’Eramet, notamment en Nouvelle-Calédonie. La société n’étant pas étrangère aux questions liées à notre souveraineté, il serait logique qu’elle appartienne au périmètre de l’État plutôt qu’à celui de la BPI. En outre, la doctrine de la BPI prévoyant une rotation du portefeuille, une sortie d’Eramet est prévisible à terme. L’État étant un actionnaire de plus long terme que la BPI, il serait pertinent que cette participation lui revienne. On pourrait mener la même réflexion sur d’autres actifs de Bpifrance ou de l’APE.
M. le rapporteur. Qui tranche, en cas de désaccord sur une prise de participation ?
M. Régis Turrini. Je n’ai pas eu à connaître de désaccord, notamment sur les cas très concrets que je viens de citer. Si un désaccord survenait, il serait tranché par l’autorité politique.
En termes de gestion, nous travaillons à optimiser l’efficacité de l’action publique. Nous sommes présents au sein de différentes instances de gouvernance de la BPI et de ses filiales. De plus, des échanges sont fréquents au niveau technique. M. Saintoyant, directeur de participations services et finances, suit les relations avec la BPI au sein de l’APE. Il est l’interlocuteur privilégié de la BPI sur ces échanges, lors desquels on s’assure que les intérêts des deux parties sont pris en compte.
Dans le cas d’Orange, toutes les décisions sont prises dans le cadre du pacte d’actionnaires. Une coordination existe pour les grandes entreprises. Lors de la tentative d’OPA de Technip sur CGG – sociétés dont Bpifrance est actionnaire –, nous avions organisé des échanges pour réfléchir à une éventuelle participation de Bpifrance.
Le projet d’opération sur Alstom a montré que des synergies sont possibles. Celles-ci ne sont pas financières, car Bpifrance, qui a son propre intérêt social, doit assurer sa rentabilité. Elle n’a pas à financer à titre gracieux les services de l’État, qui, inversement, n’a pas à engager de dépenses en faveur d’une société privée. En revanche, les synergies d’expertise et de fonctionnement existent, bien que, étant informelles, elles soient difficiles à quantifier. Nous échangeons beaucoup sur les bonnes pratiques, notamment le reporting, la gouvernance et le rôle à tenir dans les conseils d’administration. Ces liens sont constructifs, quoique les deux instances poursuivent des objectifs différents.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
Audition du jeudi 26 mars 2015
M. Joël Darnaud, direction financement et pilotage du réseau – Bpifrance
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous auditionnons Monsieur Joël Darnaud, responsable à Bpifrance de l’activité de crédit. Vous intervenez également en caution et en garantie. C’est en outre à travers votre direction que Bpifrance assure le préfinancement du CICE. Sur tous ces points, ainsi que sur la structuration du réseau et l’articulation des interventions de la BPI avec les acteurs locaux, nous avons des questions à vous poser, notamment à la suite du déplacement que le rapporteur et moi-même avons effectué en Basse-Normandie et qui suscite quelques interrogations.
Monsieur Darnaud, je vous laisse la parole pour une présentation de l’activité de votre direction.
M. Joël Darnaud, direction financement et pilotage du réseau – Bpifrance. J’ai fait toute ma carrière dans le groupe Bpifrance, dont j’ai connu les différentes étapes de l’existence avec la création successive du Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la Banque de développement des PME (BDPME), d’Oséo, puis de Bpifrance. Mon parcours m’a conduit du réseau à la direction générale.
Je suis chargé, à la fois, du financement à moyen et long terme sous forme de prêts sans garantie et du financement à court terme, lequel intègre le préfinancement du CICE.
J’ai, de plus, la responsabilité directe du pilotage du réseau, qui est décliné en six directions de réseau, et de son animation, au siège où il existe un directeur de l’animation du réseau , ainsi que la responsabilité de l’« offre produits » : je suis donc responsable de tous les produits de financements que nous sommes amenés à créer et dirige, en support de l’activité des réseaux, la mise en place de la gestion des opérations. Enfin, je préside le comité des engagements de Bpifrance et j’ai la responsabilité du contentieux du financement.
Mme la présidente Véronique Louwagie. L’« offre produits » de Bpifrance fait l’objet, à destination des réseaux et des chargés d’affaires, de plaquettes présentant toute la gamme des produits. Nous souhaiterions en avoir communication.
Quels sont par ailleurs les seuils ou les critères qui déterminent les niveaux de décision ? Quelle est la part des décisions prises tant au niveau national que de façon autonome au niveau régional ?
M. Joël Darnaud. Nos différents produits de financements se répartissent entre, d’une part, les produits à moyen et long termes et, d’autre part, les produits à court terme.
Les produits à moyen et long termes concernent deux grandes familles de produits.
La première grande famille, qui vise à financer l’investissement des entreprises, regroupe des prêts à moyen et long termes ou des crédits-bails immobiliers ou mobiliers, qui sont toujours accordés dans le cadre d’un cofinancement avec un partenaire bancaire. Il s’agit de produits bancaires communs, sans évolution forte. L’évolution concerne davantage les secteurs d’activité dans lesquels nous sommes susceptibles d’intervenir, comme le financement de la transition énergétique. Ces crédits d’investissements sont accompagnés d’une prise de garantie.
La seconde grande famille regroupe des prêts de développement à moyen terme sans garantie, prêts qui sont la grande spécificité de Bpifrance. Ces prêts nous permettent en effet de financer l’immatériel, des besoins qui sont mal couverts par le secteur bancaire classique en l’absence justement de prise de garantie possible. Leur durée est de sept ans et le différé d’amortissement de deux ans. Aucune garantie n’est prise, ni sur l’entreprise ni sur le chef d’entreprise. Ces prêts ne font donc pas l’objet d’une caution. Cette gamme de produits, qui est en forte progression, exige des offres fréquentes et des développements nouveaux. Bpifrance a la possibilité d’octroyer ce type de concours aux entreprises car elle bénéficie à cette fin de fonds de garantie dotés par l’État, les régions, l’Europe ou le grand emprunt – c’est particulièrement le cas à l’heure actuelle. Les responsables publics nous confient cet argent pour des produits à forte spécificité, comme ceux du PIA qui portent sur des projets d’usines du futur. Nous sommes ainsi appelés à financer les économies d’énergies des entreprises, via des prêts verts, leurs investissements numériques, via des prêts numériques, leurs investissements robotiques, via des prêts robotiques, ou encore leurs investissements industriels lourds via des prêts croissance industrie. Tous ces produits, qui appartiennent à la même gamme, ont toujours les mêmes caractéristiques, que j’ai déjà évoquées : une durée de sept ans, un différé d’amortissement de deux ans et l’absence de garantie.
Nos équipes travaillent avec les différents responsables qui souhaitent la mise en place de ces produits. Les concours peuvent aller jusqu’à 5 millions d’euros mais sont souvent d’un montant beaucoup plus faible. Nous proposons deux nouveaux produits de développement : le prêt Quartier, dont le montant maximal est de 50 000 euros, et le prêt Économie sociale et solidaire, qui est, lui aussi, un petit prêt de développement. Ces deux nouveaux prêts, dont la visée est spécifique, répondent aux mêmes caractéristiques que nos autres prêts de développement.
Cette diversité de produits a pour effet, évidemment, de complexifier notre offre : toutefois, c’est cette diversité qui nous autorise à bénéficier de dotations importantes de la part de différents canaux. En revanche, leurs caractéristiques toujours identiques nous permettent de les regrouper au sein d’une même famille, celle des prêts de développement.
Notre seconde gamme de produits est celle des financements, à court terme, de la trésorerie des entreprises. Cette activité, qui était celle de la Caisse nationale des marchés de l’État, vise à monétiser les créances publiques au bénéfice des entreprises qui travaillent avec l’État et les collectivités et qui doivent faire face à des délais de règlement. Les crédits d’impôts nous ont, de plus, conduits à développer une activité de mobilisation d’une créance publique non plus commerciale mais fiscale, dans le cadre, tout d’abord, du crédit impôt recherche, puis, depuis deux ans, du CICE. Pour assurer son préfinancement – nous avons été amenés à travailler avec l’État pour concevoir et proposer ce nouveau produit aux entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. J’avais cru comprendre que Bpifrance préfinançait le CICE dans tous les cas : or il semble que ce ne soit plus le cas depuis quelques semaines.
M. Joël Darnaud. Nous avons lancé le préfinancement en 2013 à hauteur de 800 millions d’euros. Nous avions prévu pour 2014 un budget d’1,2 milliard : nous avons prêté 2,3 milliards. Notre activité est donc allée bien au-delà de nos objectifs du fait que nous avons été les seuls, ou presque, à préfinancer le CICE.
Je rappelle que, pour bénéficier du CICE, l’entreprise doit tout d’abord faire, dans un délai prescrit, une déclaration spécifique à l’administration fiscale qui renvoie un document matérialisant la créance. Lorsque Bpifrance préfinance le CICE, la créance n’existe pas encore aux yeux de l’administration fiscale. Lorsque l’entreprise verse les salaires jusqu’à la fin de l’exercice, ce préfinancement ne pose aucun problème : malheureusement, de nombreux dossiers, de TPE comme d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), vont au contentieux en raison de difficultés de recouvrement. Le plus souvent, l’entreprise n’a pas fait sa déclaration en temps voulu, ou l’administration fiscale conteste la créance en l’absence de déclaration. Lorsque l’entreprise est mise en liquidation, les dossiers disparaissent – c’est le cas de nombreux petits dossiers : il nous est donc ensuite impossible de recouvrer auprès de l’administration fiscale une créance qui n’existe pas aux yeux de celle-ci. Ces difficultés de recouvrement représentent des sommes considérables pour Bpifrance.
C’est pourquoi nous avons été conduits à prendre deux décisions.
La première est de nous assurer que les documents administratifs ont bien été remplis. Nos équipes téléphonent à cette fin aux entreprises et à l’administration fiscale. À l’heure actuelle 50 millions d’euros sont en retard de recouvrement. La seconde décision concerne les entreprises en grande difficulté : pour obtenir le préfinancement du CICE, elles doivent nous fournir le document qui établit la créance. Si nous ne leur demandions pas, le CICE deviendrait pour Bpifrance une activité très déficitaire, ce qu’aucune banque ne peut se permettre.
La direction du Trésor a pris conscience de la situation. Nous travaillons actuellement avec l’administration fiscale à un meilleur échange d’informations et à une modification des modalités de paiement.
Compte tenu de notre expérience, nous avons donc bien changé nos modalités d’octroi du préfinancement en 2015. Il faut savoir que, contrairement aux PME, qui bénéficient de la restitution de la créance du CICE dans l’année, pour les ETI cette créance est imputée sur l’impôt éventuellement dû au titre des trois exercices suivants : les montants unitaires pour Bpifrance sont d’autant plus importants. C’est pourquoi, avant de préfinancer le CICE de 2015, nous demandons la régularisation des déclarations de 2013 et de 2014.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Les 50 millions de retard concernent-ils uniquement l’année 2014 ?
M. Joël Darnaud. Nous espérons recouvrer cette somme, qui court sur 2013 et sur 2014 en fonction de la date d’arrêté des bilans. Nous faisons en tout cas tout ce qu’il faut pour être remboursé. Toutes les entreprises qui sont en cause ne sont pas en dépôt de bilan, fort heureusement ! Elles ont donc encore la possibilité de régulariser leurs déclarations fiscales.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Il s’agit donc d’un encours de 50 millions sur un montant de quelque 2,35 milliards.
M. Joël Darnaud. Non : sur un montant de 800 millions d’euros, puisque ce retard concerne l’année 2013.
Nous n’avons aucune possibilité de recouvrer les préfinancements des entreprises qui sont en liquidation – cela nous le savons. En revanche, nous espérons recouvrer les préfinancements d’entreprises encore en activité, préfinancements qui auraient déjà dû nous être remboursés mais qui ne l’ont pas été pour diverses raisons. C’est pourquoi nous agissons tant auprès de ces entreprises que de l’administration fiscale pour obtenir ces remboursements.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Si vous attendez désormais le document fiscal, jouez-vous encore votre rôle de préfinancement de la créance ? En effet, ce document fiscal n’est délivré par l’administration qu’à la clôture de l’exercice comptable qui établit la liquidation de l’impôt. Vous n’assurerez donc plus le préfinancement du CICE pour l’exercice en cours…
M. Joël Darnaud. Tout dépend du degré du risque.
Je rappelle qu’à l’origine Bpifrance ne devait pas traiter les dossiers inférieurs à 50 000 euros. Malheureusement, les banques n’ont pas joué le rôle qui leur était dévolu en la matière pour une question de fonds de garantie. Bpifrance a donc dû prendre la relève. Pour ces petits dossiers, nous bénéficions d’un fonds de garantie qui nous assure partiellement le risque. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas changer notre politique de risque à l’égard de ces petits dossiers. En revanche, nous nous sommes vus contraints de décaler de quatre à cinq mois le préfinancement des dossiers supérieurs à 50 000 euros.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je suppose que vous avez diffusé, à cette fin, une note à destination du réseau : pourrions-nous en avoir connaissance ?
M. Joël Darnaud. Nous avons rédigé une note de politique générale de risque, qu’il convient évidemment d’appliquer au cas par cas, en fonction de la situation financière des entreprises.
Auparavant, lorsque nous avions des doutes sur la pérennité à court terme d’une entreprise, nous préfinancions le CICE par étapes, en suivant la vie de l’entreprise. Désormais, nous attendons la présentation du document fiscal, pour nous garder d’un double risque. Le premier est lié à la date du dépôt de bilan de l’entreprise ; le second est d’ordre administratif : l’entreprise peut ne pas avoir rempli à la bonne date le bon document.
Nous sommes devant un vrai problème d’ordre administratif : nous sommes certains qu’il y aurait moyen pour l’administration fiscale de reconnaître les créances.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Ce sujet mérite en effet d’être creusé car les conditions de mobilisation du préfinancement CICE influent évidemment sur la vie des entreprises. Ce débat existe dans les régions.
La plupart des entrepreneurs que nous rencontrons nous font part de leurs bonnes relations avec Bpifrance, et des projets créateurs de richesses et d’emplois que l’aide de la Bpi permet de mener à bien. En revanche, d’autres expériences nous laissent perplexes. Je citerai le cas d’une entreprise qui a sollicité une garantie de Bpifrance à hauteur de 400 000 euros. Or les frais de commission étaient de 65 000 euros : ils ne sont passés à 35 000 – une somme qui reste élevée – qu’après négociation. Comment expliquer des frais aussi élevés, surtout de la part d’une banque publique dont la vocation est d’être accessible au plus grand nombre ? Que répondre à un chef d’entreprise qui n’a pas intégré cette somme dans son plan de financement ?
Nous avons, du reste, adressé à Bpifrance un questionnaire portant sur les frais afférents au montage d’un dossier : sont-ils définis au plan national ou une libre appréciation est-elle laissée en la matière aux directions régionales ? Avez-vous des objectifs en termes d’optimisation du retour sur investissement, objectifs qui conduiraient à maximiser les commissions ?
Par ailleurs, ses décisions peuvent conduire Bpifrance à jouer indirectement le rôle d’une agence de notation régionale : en effet, votre refus d’un dossier peut inciter les autres banques commerciales à aligner leur décision sur la vôtre. La politique menée par Bpifrance sur un territoire n’est donc pas sans conséquences sur l’ensemble des partenaires financiers des entreprises. Qu’en pensez-vous ?
M. Joël Darnaud. Il existe deux niveaux de décision, qui correspondent respectivement aux directions régionales et aux directions de réseau.
La compétence de décision maximale des directeurs régionaux s’élève à 2 millions d’euros ; celle des directeurs de réseaux à 3 millions. Pour les dossiers supérieurs à 3 millions, la décision est prise, au siège, par le comité des engagements. En 2014, les directeurs régionaux ont pris 91 % des décisions. Notre politique est d’apporter une réponse rapide aux dossiers qui nous sont présentés, y compris aux plus importants, ceux qui remontent au comité : Bpifrance est en effet la seule banque à réunir son comité deux fois par semaine – le mardi matin et le jeudi après-midi.
Les commissions concernent les dossiers non pas de financement mais de garantie : Bpifrance garantit les banques sur des dossiers à risque, par exemple de transmission ou de création. Pour de tels dossiers, les banques souhaitent bénéficier de la garantie de Bpifrance avant d’accorder un crédit. Cette garantie est accordée sur des fonds publics, puisque nous bénéficions pour cela de dotations budgétaires. Je tiens également à rappeler que nos garanties ont un effet multiplicateur.
Les commissions que vous avez évoquées ne correspondent pas aux frais de Bpifrance mais aux commissions de garantie, dont le taux est fixé de manière unilatérale à 0,7 % par an sur l’encours du crédit restant dû. Ce taux est toujours de 0,7 %. L’État nous a demandé, il y a quatre ans, à un double titre, réglementaire et de simplification, de ne plus prélever annuellement ou trimestriellement cette rémunération sur le compte de l’entreprise mais de la percevoir en une seule fois en totalité, dès que les fonds sont débloqués. D’un point de vue réglementaire, il faut savoir que, pour que Bpifrance puisse maintenir sa garantie, elle doit percevoir sa commission. Si l’entreprise arrête de la verser, la banque créditrice perd la garantie de Bpifrance. Or les banques sont intéressées à la garantie de Bpifrance à la fois en termes de garantie du risque lui-même et en termes d’encours de risques, puisqu’elles n’ont pas à inclure les risques couverts par Bpifrance dans leur ratio prudentiel. De plus, il s’agissait, très fréquemment, de prélèvements de l’ordre d’un euro ou deux, le public concerné étant constitué en grande partie de TPE. Demander à l’entreprise de verser la commission en une seule fois a permis de simplifier la gestion de sa perception.
La somme que vous avez évoquée correspond donc à la capitalisation de la commission de garantie sur toute sa durée. Le versement des commissions pour des garanties d’un faible montant et de courte durée ne pose évidemment aucun problème. Tel n’est pas le cas, en revanche, des opérations, assez rares, d’un montant important et de longue durée. C’est pourquoi nous proposons à l’entreprise d’intégrer le calcul de la commission dans l’assiette et de la financer, afin que son versement ne pose pas de problème de trésorerie à l’entreprise.
Je tiens à préciser que la moitié de la commission est reversée au fonds de garantie, dans le cadre d’un cautionnement mutuel, et l’autre moitié alimente le compte d’exploitation de Bpifrance dans le cadre de cette activité de garantie qui doit faire l’objet d’une rémunération minimale.
M. le rapporteur. Dans l’exemple que j’ai donné – 65 000 euros de commission pour 400 000 euros de garantie –, sur sept ans, le taux de rémunération n’est pas de 0,7 %.
M. Joël Darnaud. Le taux de garantie est fixé par contrat entre Bpifrance et l’État. Je vous communiquerai un calcul précis au vu du dossier.
M. le rapporteur. Quels sont les niveaux de décision ? Comment le directeur régional prend-il en compte le degré de risque ? Sur quels critères le dossier est-il transféré à l’échelon supérieur ?
M. Joël Darnaud. Les chargés d’affaires n’ont aucun pouvoir de décision : en effet, la réglementation bancaire interdit que les personnes qui prennent les décisions soient les mêmes que celles qui ont étudié les dossiers.
Le pouvoir de décision des délégués oscille entre 1 million et 1,5 million, selon leur expérience.
Les niveaux de compétence que je vous ai donnés sont les niveaux supérieurs. Des outils d’aide à la décision (OAD), qui prennent en compte à la fois la situation financière de l’entreprise, la nature du projet et les garanties liées au financement, dégagent une orientation favorable, réservée, très réservée ou défavorable, qui permet de graduer les pouvoirs de décision des directeurs régionaux et de réseau. Si l’orientation du dossier est favorable, le directeur régional peut prendre une décision d’un montant maximal de 2 millions d’euros et le directeur de réseau d’un montant maximal de 3 millions. Si l’orientation est réservée, la compétence de décision remonte d’un cran ; en cas d’orientation défavorable et de montant élevé, la décision est prise par le comité des engagements de Bpifrance. Le degré de décision est donc fonction à la fois du montant et du degré de risque déterminé par l’OAD. C’est un schéma bancaire classique.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez évoqué trois modalités successives de paiement de la commission de garantie : annuel, trimestriel et en une seule fois, lors du déblocage des fonds. Cette dernière modalité est-elle désormais appliquée dans tous les cas ?
M. Joël Darnaud. Auparavant, le paiement, annuel, trimestriel, voire mensuel, dépendait du rythme d’amortissement du crédit : la commission était prélevée à chacune des échéances. Désormais, à savoir depuis une dizaine d’années, le prélèvement est effectué lors du déblocage des fonds. Cette modalité de prélèvement a été décidée avant la création de Bpifrance.
M. le rapporteur. Entre votre politique de risque, qui, étant déterminée par vos actionnaires, doit rester prudente, et le fait que vous ne disposiez pas, contrairement aux autres banques, de ressources en provenance de produits bancaires, quels sont vos moyens d’action et vos marges de manœuvre pour répondre aux objectifs qui vous sont assignés ?
M. Joël Darnaud. Bpifrance Financement recouvre trois grands métiers : l’aide à l’innovation, la garantie et le financement.
Dans le cadre de l’aide à l’innovation, nous intervenons sur des projets que les banques ne financent pas. Notre prise de risque est alors maximale et ne correspond en rien au modèle bancaire traditionnel puisque, statistiquement, Bpifrance est remboursé une fois sur deux. Bpifrance aide, dans ce cadre, des jeunes pousses ou, plus généralement, des entreprises qui ont des projets importants en recherche & développement. S’il est du rôle de Bpifrance d’assumer ces risques majeurs, elle ne peut le faire que si elle bénéficie elle-même de dotations publiques, notre expérience nous donnant la capacité de modéliser le risque. C’est parce que les dotations publiques sont adaptées à ces risques, que nous pouvons les prendre. Vous avez reçu mon collègue Paul-François Fournier : ce modèle était celui de l’ex-ANVAR. L’avance d’un euro est une subvention, celle de deux euros est une avance remboursable et celle de trois ou de quatre euros se fait dans le cadre d’un prêt à taux zéro. Nous ne demandons aucune contrepartie bancaire, puisque ces avances ne se font pas dans le cadre d’un cofinancement.
Notre deuxième métier est de garantir une banque pour des dossiers à risques, comme la création d’entreprise. Il n’est pas du tout anormal qu’une banque demande une garantie publique pour financer la création d’une entreprise. C’est cette garantie que nous apportons aux banques. Nous ne pouvons le faire que grâce aux dotations publiques que nous recevons. La valeur ajoutée de la Bpi provient de nos vingt-cinq années d’expérience qui nous permettent de modéliser et d’appréhender les risques : avec un euro, nous pouvons en garantir jusqu’à dix, voire quinze en fonction de la modélisation du risque. Cet effet de levier est, de plus, doublé par le financement bancaire puisque nous garantissons la banque à hauteur de 50 %. Si un euro de dotation publique garantit dix euros, cette garantie permet donc un prêt bancaire de vingt euros. On a, dans ce cas, l’effet de levier de un à vingt.
Notre troisième métier est le financement. Les prêts de développement, qui deviennent l’activité majeure de Bpifrance Financement, bénéficient d’un fonds de garantie, que j’ai déjà évoqué, alimenté par différents canaux. Ils nous permettent de financer des entreprises en phase, notamment, de gros investissement, en dehors du modèle bancaire classique. Aucune banque en effet ne pourrait accorder un crédit sur sept ans sans aucune garantie pour financer de l’immatériel. Notre modèle est celui de la banque publique, capable de prendre des risques plus importants que les autres banques.
Dans les années 1990, en période de crise très sévère pour les PME, la CEPME a pris des risques non modélisés et en l’absence de fonds de garantie, mais avec l’assurance d’être recapitalisée. Une telle pratique n’est plus possible aujourd’hui. Le modèle actuel est plus vertueux. Nous n’intervenons jamais seuls en matière de crédits d’investissement mais toujours en cofinancement avec une banque. Nous finançons sans garantie l’immatériel, tandis que la banque finance la part matérielle en prenant une garantie.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Les régions sont des partenaires importants de votre réseau. Entretiennent-elles toutes les mêmes relations avec Bpifrance ou, au contraire, ces relations varient-elles selon les régions ?
M. Joël Darnaud. Nos relations avec les régions sont historiques, puisqu’elles existaient déjà du temps d’Oséo. Elles n’ont fait que se renforcer avec la création de Bpifrance. Les régions complètent les fonds de garantie nationaux, ce qui permet, en cas de dossier difficile, d’apporter des garanties plus importantes à la banque. C’est ainsi qu’aux 50 % de garantie apportés par Bpifrance, la région peut en ajouter encore 20 %, ce qui permettra à la banque d’être couverte à 70 % dans le financement d’un projet.
La quasi-totalité des régions se sont dotées de fonds de garantie permettant de compléter la garantie nationale apportée par Bpifrance.
La moitié des régions ont également créé des fonds de garantie à l’innovation pour intervenir à nos côtés dans le financement de programmes innovants, soit sous forme de subventions soit sous forme d’avances remboursables. Certaines régions souhaitent toutefois intervenir seules sur cette activité. Dans l’ensemble, les relations entre Bpifrance et les régions sont très fortes, grâce notamment aux comités régionaux d’orientation qui se réunissent deux ou trois fois par an et assurent la proximité de Bpifrance avec l’écosystème régional. Travailler avec les régions est devenu à nos yeux un enjeu majeur pour l’innovation, surtout depuis qu’elles sont devenues les bénéficiaires des dotations du Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces dotations nous permettront de financer des projets innovants avec les régions, surtout en période de restrictions budgétaires, lesquelles nous obligent à rechercher différentes ressources.
Mme la présidente Véronique Louwagie. J’avais cru comprendre que les prêts que vous accordez dans le domaine de l’innovation sont sans garantie : or vous venez d’évoquer le complément de garantie apporté par les fonds régionaux pour financer l’innovation.
M. Joël Darnaud. Bpifrance ne prend aucune garantie sur l’entreprise. En revanche, pour exercer cette activité risquée, nous devons disposer d’une ressource budgétaire : la garantie de la région est cette ressource budgétaire.
M. le rapporteur. Malheureusement, les comités régionaux d’orientation ne se réunissent pas si souvent.
M. Joël Darnaud. Bpifrance n’est pas à l’origine de l’absence de leur convocation.
M. le rapporteur. Les comptes rendus d’activités de ces comités ne font pas une place suffisante au débat sur les orientations, ce qui est paradoxal, puisqu’il s’agit de comités régionaux d’orientation.
M. Joël Darnaud. C’est un constat. Je rappellerai simplement que le président du comité régional d’orientation est le président de région.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie, monsieur le directeur.
Audition du jeudi 26 mars 2015
Table ronde sur l’aide aux entreprises en difficulté réunissant M. Patrick Blasselle, président du directoire d’Invest PME, M. Jean-Louis Grevet, président de Perceva, et Mme Muriel Pernin, fondatrice de la société coopérative d’intérêt collectif Les Atelières.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons à présent, dans le cadre d’une table ronde sur l’action en faveur des entreprises en difficulté, deux gestionnaires de fonds d’investissement intervenant dans le retournement, M. Patrick Blasselle, président du directoire d’Invest PME, et M. Jean-Louis Grevet, président de Perceva, accompagné de M. Franck Kelif, ainsi que Mme Muriel Pernin, fondatrice de la société coopérative d’intérêt collectif Les Atelières.
Madame, Messieurs, je vous inviterai tout d’abord à présenter vos activités de façon à nous éclairer sur le point de savoir si la Banque publique d’investissement (BPI) répond à la problématique des entreprises en difficulté.
M. Patrick Blasselle, président du directoire d’Invest PME. Invest PME est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), aux normes AIFM (Alternative Investment Fund Managers), et qui a pour actionnaire principal le groupe Siparex. Alors que ce dernier pèse environ un milliard d’actifs sous gestion, Invest PME, représente une cinquantaine de millions d’euros en gestion directe, montant qui devrait passer à soixante-dix millions d’ici à quelques semaines. Nous sommes donc petits, régionaux, et fiers de l’être.
Nous contribuons à l’activité régionale du groupe Siparex, qui se déploie sur plusieurs régions françaises. Invest PME est essentiellement présente dans les régions Bourgogne et Franche-Comté, ainsi que, par le biais d’un fonds national d’amorçage (FNA), en Alsace, aux côtés d’un partenaire, Alsace Capital.
Nous gérons en Bourgogne et en Franche-Comté une large palette d’interventions concernant les PME, entreprises qui sont notre cœur de métier, plutôt que les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cette palette va de l’amorçage à la post-création, au développement, à la transmission, en passant, depuis fin 2009, par la consolidation financière. Nous ne sommes pas à proprement un fonds de retournement mais plutôt un fonds de redéploiement et un fonds de consolidation des entreprises « en difficultés conjoncturelles et surmontables ». Ce dernier terme est de notre invention, mais il est parlant. Il ne s’agit pas d’accompagner des entreprises qui n’ont pas de projet et vont a priori dans le mur, mais des entreprises confrontées à une difficulté financière et qui, pour assurer leur rebond, nécessitent une intervention en haut de bilan. En outre, à la différence d’un fonds de retournement, nous n’apportons pas un nouveau management. Nous sommes en effet toujours minoritaires et nous travaillons avec le management en place, en tentant d’améliorer la gouvernance par l’apport de méthodes de travail et d’outils différents, y compris des méthodes de reporting. Nous ouvrons également des portes.
Notre action repose sur le professionnalisme et la rapidité. Dès lors que nous sommes saisis, nous mettons très rapidement en place une commission des accompagnateurs de ces entreprises, qu’il s’agisse des banques, de la BPI, des régions, voire de l’État par le biais des procédures Cochef, qui permettent l’échelonnement des dettes fiscales et sociales. Notre expérience, en matière de PME, c’est qu’il n’y a de rebond possible que si tout le monde va dans le même sens et si aucun intervenant ne profite d’une opération pour se retirer de l’entreprise. Ces fonds sont aujourd’hui sous la responsabilité d’une personne qui a vécu des dépôts de bilan en tant que gestionnaire de trésorerie et a travaillé pour des cabinets de consultants contactés par des syndicats et des comités d’entreprise dans des affaires en grande difficulté.
Le fonds numéro un a terminé sa période d’investissement. Il a accompagné treize entreprises au total, ce qui représente quelque mille emplois sauvegardés. Certaines de ces PME ont connu un véritable rebond. L’une d’entre elles est passée de trois millions à dix millions d’euros de chiffre d’affaires en moins de dix-huit mois, grâce à des marchés certes exceptionnels mais pérennes. Nous savons que ce chiffre d’affaires, ne serait-ce que par le besoin en fonds de roulement (BFR) engendré, aurait pu financièrement condamner cette société. D’autres sont devenues des leaders dans leur secteur en termes d’investissement. Quelques reprises post-redressement judiciaire (RJ) ont également eu lieu, qui se sont concrétisées par des succès. Ce fonds a connu trois échecs, lesquels ont tout de même été amortis par les mécanismes de garantie, notamment de la BPI, à la satisfaction des souscripteurs de ces fonds.
Il est important de citer ces souscripteurs, qu’il a été de notre tâche de convaincre. L’entreprise en difficulté n’est pas un segment sur lequel on peut facilement mobiliser des investisseurs. Ces souscripteurs sont majoritairement privés – à une toute petite majorité. Dans la partie publique, on trouve les régions, mais aussi Bpifrance Investissement. Parmi les investisseurs privés, figurent essentiellement les banques mutualistes régionales, qui ont trouvé dans ce fonds le moyen d’accompagner des entreprises régionales mais aussi une forme d’investissement citoyen, qui peut s’avérer rentable. Petite particularité : nous sommes parvenus, pour les deux générations de fonds, à mobiliser des industriels, par le biais de fonds de revitalisation.
Le fonds numéro deux est tout jeune. Il a déjà réalisé trois investissements, dont une belle consolidation dans la filière bio en Franche-Comté. Quant au fonds en Rhône-Alpes, de trente millions d’euros, il a déjà pris dix-huit participations, pour un montant d’investissement de l’ordre de 9 millions.
En conclusion, le point fondamental pour nous, c’est notre présence minoritaire, sans intervention dans la gestion. Ces PME souffrant cependant tout autant de défauts de fonds propres que d’insuffisances en termes de gouvernance, il est nécessaire de renforcer la gouvernance, quitte, le cas échéant, à procéder à des recrutements.
M. Jean-Louis Grevet, président de Perceva. Perceva est un fonds de retournement français capitalisé à hauteur de 350 millions d’euros, dont le métier est d’apporter des capitaux propres de long terme à des entreprises françaises fragilisées. Nous n’investissons qu’au bénéfice de PME et ETI françaises. Nous recevons 150 dossiers par an, de la part de sociétés réalisant entre 20 et 500 millions de chiffre d’affaires. Il s’agit souvent d’entreprises qui n’ont pas déposé de bilan. Nous réalisons deux à trois investissements par an. Notre métier est très exigeant et consomme beaucoup de notre temps. L’équipe de Perceva est animée par dix personnes. Avec mon associé Franck Kelif, nous avons près de vingt ans d’expérience dans ce métier.
Nous sommes intervenus au profit d’une vingtaine de sociétés, parmi lesquelles je peux citer, récemment, Dalloyau, Monceau Fleurs, ou encore la PME alsacienne de fabrication de poêles à bois et d’inserts de cheminée Supra, que nous avons rachetée à EDF il y a quatre ans, ainsi que d’autres entreprises telles que Rémy Cointreau ou le groupe Flo dans la restauration.
Le métier du retournement est un métier exigeant car les dirigeants à qui nous avons affaire vivent des situations très complexes. Notre action repose sur trois niveaux de confiance.
Nous devons tout d’abord établir une relation de confiance avec l’entreprise. Nous ne sommes pas dans une approche de coûts financiers. On associe souvent le retournement à des investisseurs prédateurs qui viennent réaliser une opération à court terme et dépecer une entreprise. Cette image vient de démarches qui ont existé, et qui existent encore, notamment de la part de grands fonds anglo-saxons. Notre conception correspond plutôt aux pratiques d’un actionnaire industriel. Nous investissons sur le long terme : quand nous prenons un dossier, c’est à l’horizon de dix ans au minimum.
De même, nos capitaux profitent à l’entreprise, dont ils reconstituent les capitaux propres ; nous n’apportons pas un chèque à l’actionnaire qui souhaite vendre ses titres ou rembourser des créanciers.
Enfin, il faut qu’existe une proximité culturelle et physique. Ces sociétés ont besoin d’avoir un actionnaire majoritaire – car nous prenons le contrôle de nos sociétés – qui soit extrêmement présent pour toutes les décisions qu’ils doivent prendre.
Nous mettons pour cela un réseau d’experts à leur disposition. En vingt ans d’expérience, nous avons construit un réseau d’experts opérationnels de bureaux d’études, de marketing, de gestion de force commerciale, de développement de plans médias, de réorganisation industrielle… Notre travail est un travail de chef de projet : il s’agit de manager ces ressources au profit de l’émergence d’une solution pour l’entreprise. La confiance naît d’un professionnalisme et d’une éthique forte.
Nous devons ensuite établir une relation de confiance avec les investisseurs. Nos capitaux nous sont confiés par les investisseurs institutionnels finançant le capital-investissement dans le monde. Il y en a environ 3 000. Cela représente quelque 3 000 milliards d’euros au plan mondial, mais pour le retournement pur, on tombe très vite à un chiffre bien plus faible, de l’ordre de 100 à 150 milliards d’euros, et, en France, ce chiffre est évidemment encore plus réduit.
Il nous faut donc créer une dynamique de confiance avec ces investisseurs, qui nous confient de l’argent sur des horizons très longs. Nous ne sommes pas sur un métier de hedge fund, où un investisseur doit pouvoir récupérer son argent quasiment toutes les semaines. Dans les fonds que nous gérons, l’argent est mobilisé et bloqué au profit des entreprises sur des horizons de dix à quinze ans. Nous n’avons aucune obligation de verser un dividende ou de rembourser ces sommes ; ce n’est qu’au moment de la sortie du capital, que les investisseurs peuvent espérer un retour sur investissement.
Nos investisseurs – une vingtaine au total – sont pour les deux tiers des étrangers, américains et européens. Bpifrance fait partie de nos investisseurs français, à hauteur de 10 %.
Le troisième axe de confiance, c’est la relation avec les pouvoirs publics. Les sociétés dont nous prenons le contrôle ont besoin de contacts avec les élus locaux. Nous rencontrons régulièrement des élus très impliqués et responsabilisés quant au devenir de sociétés qui sont des employeurs importants de leurs régions. Il y a ensuite les services de l’État, tels que les comités interministériels de restructuration industrielle (CIRI) et les comités départementaux d’examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI), les commissaires au redressement productif, les commissions départementales des chefs des services financiers (CCSF), ainsi que les représentants des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Quand une entreprise est en difficulté, elle ne peut pas toujours, par exemple, mettre son site aux normes environnementales dans les délais impartis ; nous sommes alors amenés à rencontrer les représentants de la DREAL afin d’expliquer que nous apportons des moyens et qu’il convient de prévoir un engagement compatible avec la problématique de l’entreprise.
Malheureusement, les acteurs français équivalents à Perceva, ne sont pas assez nombreux en France, alors qu’il existe un véritable besoin de fonds de retournement professionnels et modernes. Il y a au contraire beaucoup trop de fonds anglo-saxons, bénéficiant d’effets de taille et de volume, qui prennent le contrôle de très grandes entreprises en raison du manque de solutions françaises alternatives. Perceva peut représenter cette alternative ; c’est en tout cas notre ambition.
Mme Muriel Pernin, fondatrice de la société coopérative d’intérêt collectif Les Atelières. Je suis la présidente-fondatrice des Atelières, une société coopérative d’intérêt collectif. C’est une coopérative qui avait la particularité, contrairement à une SCOP, de posséder un actionnariat mixte, investisseurs et salariés. L’entreprise a été liquidée par le tribunal de commerce le 18 février. Au moment où je vous parle, notre atelier est dépourvu de son personnel, mais en l’état, avec ses machines et son stock, donc avec un potentiel de vente. Les salariés coûteraient moins à l’État à travailler dans notre entreprise qu’à être indemnisés par l’assurance chômage.
Cette aventure est née d’un pari. Il y a trois ans, au moment de la fermeture de l’entreprise Lejaby et de sa reprise par un consortium dirigé par Alain Prost. Celui-ci ne pouvant pas, avec l’argent dont il disposait à l’époque, reprendre la totalité de l’activité, il décida de se séparer des ateliers de fabrication. La région Rhône-Alpes s’est faite sur l’industrie textile, sur le textile lui-même et sur l’habillement, donc la fabrication. J’étais à l’époque chef d’entreprise, je travaillais avec de nombreuses sociétés pour développer des stratégies de changement, et je me suis dit que, si je me rapprochais des ouvrières ayant le savoir-faire, nous pourrions agréger nos compétences afin de le faire vivre.
L’entreprise Lejaby a été reprise et s’appelle aujourd’hui Maison Lejaby. Nous avons monté l’atelier de fabrication qui pouvait lui apporter la compétence de fabrication 100 % française. Maison Lejaby, notre premier donneur d’ordres, souhaitait se développer dans le luxe, sachant que tout le moyen de gamme est depuis vingt ans fabriqué en Tunisie. C’est ainsi que notre aventure est née. Les femmes de notre atelier ne venaient pas forcément de Lejaby ; certaines étaient des femmes d’expérience, d’autres sortaient de l’école.
La première difficulté que nous avons rencontrée a été de financer cette activité. Les portes s’ouvrant peu, j’ai lancé deux appels de fonds par voie médiatique. Nous avons réuni de cette manière un million d’euros sur trois ans. Il s’agit d’argent privé. Je le précise car on croit parfois que nous avons reçu beaucoup d’argent public ; il n’y en a quasiment pas eu. Les personnes ayant investi étaient des citoyens ordinaires. L’entrée au capital était de 5 000 euros. Celui qui a le plus apporté a mis 300 000 euros et j’ai moi-même investi 110 000 euros. Nous étions cinquante-huit associés au total.
J’ai bien évidemment rencontré les acteurs de la BPI ; j’y reviendrai. Les acteurs publics régionaux se sont mobilisés et nous ont aidés : le président de la région Rhône-Alpes nous a accordé une subvention de 60 000 euros, le préfet a permis de mobiliser les dispositifs de l’État.
La deuxième difficulté a été de relancer une fabrication en France alors que l’ensemble de la production en lingerie-corsetterie avait été délocalisé. Pour trouver une machine, un mécanicien, il faut appeler en Tunisie. Je me suis vite rendu compte que nous ne pouvions fabriquer de la petite série de luxe dans les temps demandés par nos clients car ce modèle de production n’existait pas. Il existe le taylorisme, pour les grande et moyenne séries, c’est-à-dire pour plus de quinze mille pièces à la commande. Nous étions à cent pièces à la commande, ce qui est la norme du luxe. Or, nous ne savons pas produire de la petite série en France.
J’ai donc démarché l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon-Villeurbanne, une école d’ingénieurs, avec laquelle nous avons mis en place un partenariat qualitatif, nous permettant de travailler sur la problématique de la fabrication de lingerie-corsetterie en petite série.
La troisième difficulté a été la formation du personnel. Les jeunes femmes étaient formées à la couture mais non à la lingerie-corsetterie. Il fallait donc réveiller les compétences existant en France.
Nous avons tenu vingt-cinq mois. Nous nous sommes positionnés sur deux segments. Le premier était le travail de façonnage. Nos clients étaient de grandes marques françaises qui n’étaient plus habituées à travailler avec des Français, contractant avec des ateliers à l’étranger, donc selon des codes différents, et avaient perdu l’humanité de la relation professionnelle directe. Dans mon entreprise, je connais mes clients, nous nous voyons, nous échangeons.
Par ailleurs, nous avons essayé de lancer notre collection en fin d’année mais, les difficultés financières s’accumulant, nous nous sommes arrêtés sans avoir pu terminer. C’est pourquoi nous avons 3 000 pièces en stock, qui seront vendues sur les marchés en dégriffé.
Nous nous sommes retrouvés en cessation de paiement le 5 février. L’année 2014 a été terrible pour le textile, en particulier pour nos donneurs d’ordres, qui s’étaient positionnés sur le marché russe. En raison de la chute du rouble, nos commandes ont été soit annulées soit divisées par deux. Nous avons souffert également des retards de financement des banques : alors que l’engagement avait été pris en mars, avec une décision de la BPI de nous soutenir en garantie d’emprunt, les fonds n’ont été débloqués qu’à la fin du mois de septembre, et, pour la dernière banque, fin novembre. Nous sommes donc arrivés tard sur le marché de décembre. Nous pensions profiter du mois de janvier, qui est le mois de la lingerie-corsetterie, mais les événements qui se sont produits n’ont pas été favorables à la consommation.
Nous étions un tout petit navire et nous avons rencontré de terribles vents contraires. Je n’ai pas perçu de salaire durant tout ce temps ; c’était mon engagement personnel, mais la bataille de la France, c’est la bataille de l’emploi. Chaque fois que l’on crée trente emplois, c’est un peu de précarité sociale en moins. Ce secteur est très difficile. Peut-être faut-il se dire que c’est la fin des métiers de savoir-faire dans notre pays ? De même qu’il n’existe plus de moines copistes, il faudrait accepter que ces métiers disparaissent. C’est dommage.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Dans le cadre de votre activité, monsieur Blasselle, la présence de Bpifrance a-t-elle facilité la levée de fonds ?
De même, vous indiquez, monsieur Grevet, que Bpifrance représente 10 % de vos capitaux français. Cela vous aide-t-il à lever d’autres capitaux ? Vous constatez que les fonds anglo-saxons sont mieux armés ; que pourrait vous apporter Bpifrance pour faire face aux besoins ?
Madame Pernin, de quelle manière Bpifrance vous a-t-elle accompagnée ? Les problèmes de délais auxquels vous avez été confrontée portaient-ils sur des garanties ? Ces problèmes ont-ils été le fait du partenaire financier devant accompagner Bpifrance dans le cadre de la règle du « un pour un » ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information. Ma question portera sur votre expérience de terrain. Dans l’écosystème du financement des entreprises, qui, entre acteurs publics et privés, est somme toute assez complet – bien que les fonds de retournement français ne soient pas encore assez nombreux –, quels sont les freins qui empêchent de suivre certains dossiers ?
M. Patrick Blasselle. Pour les fonds régionaux de proximité que nous gérons, la BPI, à savoir Bpifrance Investissement, en tant que fonds de fonds, est incontournable. Sans elle, il faut être clair, les fonds ne se montent pas. Elle représente 25 % de nos fonds.
Cette participation a deux mérites. Le premier, parce qu’elle exerce un effet de levier sur l’ensemble de l’écosystème : régions, banques régionales, industriels. Le second tient au fait que la palette de la BPI comprend un accompagnement par le biais de garanties, sur les prêts ou les fonds propres. Ce dernier point présente à mon sens des possibilités d’amélioration, car la situation a été plus favorable qu’elle ne l’est actuellement.
L’effet de levier est particulièrement indispensable dans les fonds de consolidation ou de retournement, car le principal frein, s’agissant des entreprises en difficulté, est le risque. Nos investisseurs, même publics, n’ont pas vocation à abonder des fonds pour perdre de l’argent ou en faire perdre au contribuable. Qu’ils ne veuillent pas forcément gagner des sommes considérables, cela fait partie de la stratégie d’aménagement du territoire, mais l’argent public, pour nous, gestionnaires privés, est aussi précieux que l’argent privé, et il faut y faire tout autant attention.
Le frein principal est donc constitué par les notions de risque et d’exposition, qui justifient l’intervention des professionnels que nous sommes. Car investir dans une entreprise en difficulté, c’est aussi faire prendre des risques à l’investisseur : même une affaire qui tourne sans problème majeur – encore que la plupart des entreprises soient amenées à passer par de bonnes et de mauvaises phases – induit une exposition de l’investisseur sur le plan financier, mais aussi sur celui de la responsabilité, ce que la plupart des investisseurs de nos fonds ne souhaitent pas : Jean-Louis Grevet, Franck Kélif et moi-même sommes en quelque sorte rémunérés pour être exposés en direct et prendre nos responsabilités.
Le frein que constitue le risque doit être atténué d’une part par l’action publique – des régions et de la BPI –, d’autre part par des garanties qui n’existent presque plus sur la partie fonds propres. Ceci est dommage, car si on trouve une vraie stratégie d’accompagnement par la garantie dans l’innovation, ce qui me paraît normal, elle n’existe pratiquement plus en ce qui concerne les entreprises en difficulté, alors qu’elles pourraient ainsi bénéficier d’un effet multiplicateur.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information. Pouvez-vous développer ce que vous nous avez dit au sujet des garanties fonds propres ?
M. Patrick Blasselle. L’investisseur que nous sommes travaille depuis très longtemps avec ce qui s’est appelé Oséo, la CDC, et aujourd’hui la BPI – en particulier avec la garantie Bpifrance. Lorsque nous avons monté notre premier fonds Défis en 2010, les investisseurs privés ont accepté d’y entrer à condition que nous obtenions un certain nombre de garanties sur les opérations que nous prenions. Pour diverses raisons, notamment budgétaires, ces garanties se sont réduites et ont même complètement disparu dans certains cas, ce qui fait prendre des risques supplémentaires aux investisseurs privés. Ceux-ci ont donc été beaucoup plus difficiles à convaincre pour entrer dans le fonds numéro 2. Or, au-delà de l’investissement direct dans les fonds, la garantie est un mode d’action relativement peu onéreux et présentant le plus fort effet de levier. En tant qu’investisseur minoritaire, j’estime qu’il serait bon de retrouver le niveau de garantie que nous avions il y a cinq ans : cela permettrait de lever beaucoup plus de fonds privés.
Il existe d’autres moyens de produire un effet de levier sur les actions régionales, auxquels nous pourrions réfléchir avec Bpifrance.
M. Jean-Louis Grevet. Pour ce qui est des 10 % que représente Bpifrance au sein de notre pool de 350 millions d’euros, j’insiste sur le fait que nous choisissons nos investisseurs autant qu’ils nous choisissent. Nous avions, pour gérer nos fonds, tout à fait la capacité de trouver suffisamment d’argent à l’étranger, étant donné le fort intérêt pour le métier que nous pratiquons en France : il y a une forte demande, à laquelle les équipes présentes ne suffisent pas à répondre. Si nous avons choisi de nous associer à Bpifrance, c’est en raison d’un effet d’image évident, pas tant pour Perceva – bien que nous soyons ravis de pouvoir dire que Bpifrance figure dans le tour de table – que vis-à-vis des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Au-delà de la nécessité de gagner de l’argent, le rôle de l’actionnaire consiste aussi à rassurer les dirigeants sur la pérennité du projet et la qualité de l’actionnariat. Quand on cite le nom de Bpifrance, cela contribue grandement à les rassurer.
Vous m’avez également demandé comment on pouvait réussir à contrer les dynamiques de fonds plus spéculatifs, visant des dossiers plus importants. Fin 2014, le verrier Arc International a été repris par PHP, un fonds américain dont je n’avais jamais entendu parler. Cet exemple est loin d’être le seul. Dans de nombreux dossiers, l’investisseur qui se présente doit être capable d’investir 50 à 100 millions d’euros pour l’augmentation de capital. Or, bien que disposant de fonds importants, Perceva doit respecter des règles de division des risques imposées par ses investisseurs. Ainsi, un fonds doit comprendre six ou sept investissements dont chacun peut atteindre 40 millions d’euros : si nous voulons aller au-delà, nous devons construire un tour de table afin d’apporter un complément en fonds propres et éventuellement sous forme de dette, c’est-à-dire d’emprunt – ce que font très bien les Anglo-saxons. Certains de nos investisseurs étrangers sont prêts à compléter le tour de table en fonds propres, mais souhaitent en contrepartie être partie prenante à la décision. Dès lors que nous sortons de l’enveloppe de 40 millions d’euros, cela implique un processus de décision d’investissement. Dès lors, ceux qui vont examiner le dossier sont le plus souvent basés à New York, Londres, Amsterdam, ou en Suisse et, même s’ils nous font confiance, ils sont très loin de la réalité de l’entreprise. De ce point de vue, Bpifrance présente un avantage considérable, celui d’être sur le terrain, au contact direct des situations, ce qui lui permet de très bien comprendre notre métier, donc de faciliter les cofinancements avec Perceva.
Pour ce qui est de l’apport sous forme de dette, nous aimions le système proposé par Oséo à l’époque où cet établissement existait encore. Aujourd’hui, Bpifrance s’est considérablement outillée et professionnalisée – elle fait appel à des personnes extrêmement compétentes –, mais nous ressentons une difficulté liée à la décentralisation des décisions de financements. Ce mode de décision décentralisée est très performant pour les entreprises qui vont bien – la BPI fait intervenir des décideurs régionaux très efficaces – mais, pour ce qui est des entreprises en difficulté, il me semble qu’il serait plus judicieux de recourir à des mécanismes de type « affaires spéciales » – des services dédiés aux entreprises en difficulté – comme on en trouve au sein de toutes les grandes banques françaises.
M. Franck Kélif, associé de Perceva. Nous sommes confrontés à deux problématiques : celle du temps – il faut se décider vite –, et celle du financement du besoin en fonds de roulement (BFR). Alors que dans le dispositif Oséo, il était procédé à une analyse individualisée de chaque dossier au niveau central, c’est désormais au niveau local que se font les analyses de la BPI, et selon le critère de la PME européenne : quand une PME est recapitalisée de façon majoritaire par un fonds d’investissement, elle n’est plus éligible en tant que PME européenne, ce qui a pour effet de la priver de l’intégralité des supports que BPI peut lui accorder pour son activité courante.
Notre objectif essentiel consiste à recapitaliser l’entreprise, lui redonner une virginité par rapport à l’ensemble des partenaires de financement – banquiers, assureurs crédit, fournisseurs, sociétés d’affacturage. Dès lors que l’on vise le cycle d’exploitation normal de l’entreprise, il est important, pour que celle-ci puisse croître et se redéployer, qu’elle soit en mesure de bénéficier de concours bancaires classiques – généralement au bout d’un an ou deux. Aujourd’hui, la BPI ne peut pas intervenir sur les sociétés dont nous sommes actionnaires, ni comme caution, ni en garantie de bonne fin. Nous avons recapitalisé des groupes industriels qui soumettaient des appels d’offres sur des marchés importants vis-à-vis de grands groupes, mais aucune de nos participations n’est éligible aux garanties de bonne fin habituellement mises en œuvre par la BPI. De ce fait, il n’est pas rare que des entreprises fragilisées, mais ayant retrouvé le chemin de la croissance après avoir été recapitalisées, et ayant un BFR croissant du fait de bonnes performances économiques, ne soient pas éligibles aux garanties que pourrait leur procurer la BPI. C’est là un vrai frein à l’activité.
Dans le cadre de nos tours de table, nous bénéficions souvent d’une très bonne visibilité, d’un très bon accompagnement des pouvoirs publics locaux ou des partenaires bancaires régionaux. Dans l’équation globale initiale d’une recapitalisation, il faut être capable de dire assez rapidement si la BPI va pouvoir intervenir. Le fait de devoir discuter au niveau local sur des engagements parfois trop importants au regard des délégations régionales pose problème, c’est pourquoi une centralisation nationale, calquée sur ce qu’était le dispositif d’Oséo, serait utile pour offrir une solution durable aux entreprises que nous recapitalisons.
Mme Muriel Pernin. Il y a trois ans, la BPI était encore embryonnaire : c’est donc avec la Caisse des dépôts que j’étais en contact et, dès le départ, nous avons eu des relations quelque peu tumultueuses. Si le dossier que j’ai présenté était atypique, il a néanmoins retenu l’attention de mes interlocuteurs, qui ont tout de suite estimé terriblement dommage d’abandonner les métiers de savoir-faire : ils n’ont pas eu envie de me dire que, s’il était louable et courageux de vouloir les sauver, c’était également irréaliste, lesdits métiers appartenant déjà au passé. Il aurait peut-être fallu qu’ils sachent me dire. Il appartient à la BPI de faire des choix économiques en matière d’accompagnement de tel ou tel type d’entreprises, et peut-être n’a-t-elle pas su faire entendre sa parole à ce moment – mais je ne vais pas me plaindre qu’elle nous ait ainsi donné la chance de vivre l’expérience que nous avons vécue.
Par deux fois, j’ai dû m’exprimer dans les médias pour protester contre le fait que nous ne soyons pas aidés. En conséquence, notre dossier a bénéficié d’une première réouverture, avec un apport de 80 000 euros de la Caisse des dépôts. Si je m’en suis réjouie à l’époque, je regrette aujourd’hui de m’être montrée si innocente. En effet, cette somme était inutile car d’un montant insuffisant : il aurait fallu, dès le départ, prendre la mesure du bon niveau de capitalisation privée et d’apport public. La somme de 450 000 euros dont nous disposions au départ était loin d’être suffisante : il aurait fallu commencer avec deux ou trois millions d’euros, ce qui nous aurait permis de perdre un peu d’argent dans les premiers temps pour en gagner par la suite. Avec le recul, je considère que la Caisse des dépôts aurait dû me dire que commencer avec 450 000 euros n’était pas réaliste.
Mon deuxième contact – avec la BPI, cette fois – m’a permis de rencontrer des acteurs régionaux très engagés, en lesquels j’ai trouvé de vrais soutiens. Cependant, j’ai également ressenti l’effet d’un certain jacobinisme : on ne s’entend pas dire la même chose à Paris qu’en région. À cette époque – il y a environ un an – nous n’avions plus de fonds propres, et la seule solution envisageable consistait à lancer une souscription nationale pour recapitaliser par des fonds privés : ce n’est qu’à cette condition que la BPI consentait à entrer dans le tour de table. J’ai réussi à réunir 750 000 euros de recapitalisation mais cette somme, bien que considérable, n’était toujours pas suffisante, en raison de la sous-capitalisation initiale : nous comptions le moindre sou, alors qu’aucune entreprise ne peut vivre ainsi – pour avancer, il faut savoir dépenser. Au vu de la somme que j’avais réunie, et grâce au petit coup de pouce qu’a constitué le passage de notre dossier par le bureau du ministre du redressement productif, les banques ont accepté de nous prêter 350 000 euros, cet emprunt étant garanti à 70 % par la BPI. Malheureusement, il m’a encore fallu batailler durant six mois avant d’obtenir les fonds promis par les banques, ce qui fait que nous n’avons pu lancer qu’en décembre 2014 notre collection initialement prévue pour le mois de mai. Que de temps et d’argent perdus !
J’avais suggéré à la BPI d’entrer à notre capital, ce qui lui aurait permis d’observer de l’intérieur l’entreprise-laboratoire que nous étions, mais elle n’a pas accepté, ce que je regrette. De même, je déplore qu’après avoir accordé sa garantie d’emprunt, la BPI ne se soit pas assurée que les banques honoraient leurs engagements dans des délais raisonnables. Enfin, alors que Maison Lejaby, notre principal donneur d’ordres, faisait également appel à la BPI, celle-ci a considéré les deux entreprises comme deux entités sans rapport entre elles, alors que nous étions les deux maillons d’une même chaîne. Quand le donneur d’ordres est frappé par la crise russe, son fabricant est déjà quasiment mort : notre atelier, qui devait tourner durant six mois pour fournir Maison Lejaby, n’a reçu des commandes que pour un mois. Je regrette que la BPI n’ait pas su porter un regard sur l’écosystème que nous formions avec notre donneur d’ordres et agir en conséquence : à mon sens, elle aurait dû réunir les parties prenantes, et faire en sorte qu’elles travaillent autrement. Faute d’avoir joué ce rôle, elle a contribué à l’énorme perte d’énergie et d’argent qui a résulté de notre fermeture.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Le montant initial de 450 000 euros avec lequel vous avez commencé votre activité résultait-il d’une évaluation réalisée dans le cadre d’un audit ? Est-ce vous qui aviez sollicité ce montant, ou était-il le fruit d’une réflexion collective ?
Mme Muriel Pernin. Les 450 000 euros avec lesquels nous avons commencé constituaient une projection réalisée avec le concours de l’Union régionale des sociétés coopératives et d’autres acteurs. Aujourd’hui, je sais que ce montant n’était pas celui qui nous aurait convenu, mais dans le contexte de l’époque – on ne parlait pas encore de la crise russe – on pouvait penser qu’il allait suffire à créer une dynamique.
Quant au montant de 350 000 euros de prêt complémentaire que nous avons obtenu – une somme répartie sur trois banques et garantie à 70 % –, il correspondait à ce que les banques estimaient pouvoir investir – mais, là encore, il aurait fallu davantage.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Blasselle, vous avez indiqué que si les garanties d’emprunt constituaient l’un des effets de levier, il existait d’autres moyens de nature à favoriser les actions régionales. Pouvez-vous nous préciser quels sont ces autres moyens ?
M. Patrick Blasselle. Je ne compte plus le nombre de fois où nous avons dit à des chefs d’entreprise que si nous ne souhaitions pas nous engager auprès d’eux pour un certain montant, nous étions en revanche disposés à étudier leur dossier pour le double. L’idée n’est pas d’investir le plus possible, quitte à ce que l’argent dorme ou soit mal investi, mais il faut savoir porter un regard entrepreneurial sur les situations, avoir conscience du fait que c’est toujours plus long, plus risqué, plus cher que prévu, et anticiper les imprévus.
Les investisseurs dans les entreprises en difficulté ne sont pas légions. C’est un métier indispensable à l’économie française, mais qui fait un peu peur. C’est pourquoi, à notre petite échelle, nous sommes nous-mêmes souvent à la recherche de co-investisseurs, qu’il s’agisse des équipes de la BPI en région – notamment pour la garantie – ou de l’État. Cela dit, nous devons respecter des règles de division des risques. Avec notre implantation prochaine en Bourgogne, nos fonds vont doubler de taille et nous permettre d’atteindre des niveaux d’intervention supérieurs, tout en restant minoritaires.
Je considère qu’une réflexion devrait s’engager au sein de la BPI afin de monter un fonds national de co-investissement dédié à des opérations régionales – toujours en mode minoritaire – afin de produire un effet de levier. Aujourd’hui, Bpifrance n’intervient pas comme investisseur direct en fonds propres dans les entreprises en difficulté, l’une de ses règles d’investissement excluant la présence de pertes au cours des trois années précédentes. Or, lorsque nous investissons 500 000 euros ou 600 000 euros dans une affaire, il serait intéressant que BPI puisse co-investir au moyen d’un fonds spécifique. Dans le cadre de notre fonds de première génération, un euro investi dans une entreprise se traduisait parfois par l’entrée de dix euros dans les caisses de cette entreprise : il est évident que cet effet serait démultiplié si nous pouvions compter sur un co-investisseur.
Mme Muriel Pernin. Je précise que la BPI fait intervenir en région de vrais acteurs de proximité – certains sont venus visiter notre entreprise, par exemple – et que c’est seulement quand le dossier devient un peu spécial qu’il est soumis aux instances parisiennes, qui portent sur lui un regard parisien. J’emploie sciemment cet adjectif, car les échanges avec certains cadres de la BPI vous donnent franchement l’impression d’être un petit provincial débarquant à Paris : c’est ce que je voulais dire en parlant d’un certain jacobinisme. J’ai dû déployer beaucoup d’énergie et de force de conviction pour démarrer Les Atelières, et j’ai eu la surprise de constater que l’on me mettait parfois en garde contre les effets que pouvait avoir un tel niveau d’engagement : « Prenez garde à ne pas vous mettre trop en danger sur un tel projet, me disait-on, car vous pourriez laisser une mauvaise impression susceptible de compromettre vos chances de monter un jour une autre entreprise avec notre concours ». Vos interlocuteurs ne vous donnent pas l’impression d’avoir conscience des enjeux de l’acte consistant à entreprendre en France. De ce point de vue, je pense qu’un peu d’élégance dans les relations entre les entrepreneurs et leurs interlocuteurs, notamment publics, ne serait pas superflue.
M. Jean-Louis Grevet. Pour conclure d’une façon optimiste, je dirai qu’il faut parfois très peu de chose pour qu’un dossier connaisse le succès. L’idée évoquée par M. Blasselle d’un partenaire venant co-investir dans les entreprises régionales est très intéressante, car il y a effectivement de vrais besoins en la matière. Ainsi, Perceva ne constitue pas la réponse à ces dossiers régionaux, notre fonds ayant vocation à investir au moins dix millions d’euros par dossier. Située à l’opposé du spectre, notre problématique consiste plutôt à chercher comment concurrencer intelligemment des initiatives spéculatives et financières d’origine anglo-saxonne, visant des dossiers importants pour le tissu industriel français.
Bpifrance est un partenaire évident pour nous et nous avons de très bonnes relations de travail avec M. Daniel Balmisse, directeur des fonds de fonds. Nous échangeons beaucoup avec lui, notamment afin de trouver des solutions visant à faire émerger d’autres fonds de retournement. Nous connaissons plusieurs équipes qui, pour amorcer le fonds qu’elles cherchent à monter, ont besoin de trouver deux ou trois investisseurs – dont le premier est toujours le plus difficile à convaincre. À l’évidence, Bpifrance a un rôle à jouer vis-à-vis de ces équipes.
Un autre sujet important est celui de la centralisation : nous aimerions avoir chez Bpifrance un interlocuteur identifié chargé spécifiquement des entreprises en difficulté – je dirai même que c’est un besoin que nous ressentons fortement –, comme c’est le cas dans la plupart des autres banques. Enfin, il y a le sujet du critère de la PME européenne : dans le métier du retournement, faire des exceptions à ce qui n’est qu’une recommandation constituerait une façon intelligente de permettre à certains dossiers d’accéder à des sources de financement d’origine publique provenant de Bpifrance, des régions ou d’autres acteurs publics. Cela enverrait un signal très favorable aux dirigeants de nos entreprises.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information. Selon vous, serait-il souhaitable que la BPI intervienne directement dans le retournement, et pas seulement via des fonds de fonds ? Au cours de ses travaux, notre mission a constaté que Bpifrance jouait parfois un peu le rôle d’agence de notation régionale : quand elle refuse un dossier, les autres investisseurs y voient un signal très négatif qui les dissuade de s’engager. Partagez-vous notre impression sur ce point ?
M. Patrick Blasselle. Les équipes de Bpifrance en région jouent vraiment le jeu : les dossiers sont tous examinés avec bienveillance, et quand la décision est prise de ne pas accorder la garantie de prêts bancaires à un projet, c’est dans la grande majorité des cas parce que ces dossiers souffrent de problèmes allant au-delà des simples difficultés conjoncturelles « rattrapables ».
Pour ce qui est de la notion d’investissement direct, je me garderai d’émettre un avis sur ce que devrait être la stratégie de Bpifrance. Les observations que j’ai faites sur le terrain me conduisent néanmoins à penser que le métier consistant à investir dans les entreprises en difficulté est avant tout un métier de proximité, je dirai même de complicité - au sens noble du terme – entre l’investisseur et le chef d’entreprise. L’investissement direct réalisé depuis Paris me semble très compliqué, même s’il peut exister des équipes spécialisées dans cette activité. Quant aux équipes régionales, bien qu’elles soient d’une grande qualité, en raison de leur nature généraliste, elles ne disposent pas des multiples compétences qu’exigerait l’investissement direct : ce sont avant tout des financiers, là où il faudrait qu’elles disposent d’une expérience d’entrepreneur aguerri. Investir dans les entreprises en difficulté, ce n’est pas le métier de la finance, à quelque échelle que ce soit.
En résumé, je n’ai rien contre l’idée de voir Bpifrance procéder à de l’investissement direct, mais j’estime que cela nécessiterait beaucoup de moyens humains et entraînerait beaucoup de risques et d’exposition. Je le dis clairement, il est sans doute plus facile d’être souscripteur d’un fonds dont l’équipe est exposée que d’être exposé en direct. En revanche, sans la BPI, les fonds de retournement et de consolidation ne peuvent pas exister. Il convient donc plutôt de renforcer les moyens de travailler avec les équipes régionales ou nationales afin de monter éventuellement des fonds de co-investissement – en investissement direct – destinés à produire un effet de levier au bénéfice d’équipes spécialisées et aguerries.
M. Jean-Louis Grevet. Il ne m’appartient pas non plus de faire des commentaires sur la stratégie de Bpifrance en termes d’investissement dans le retournement, la question de l’intervention publique sur les entreprises en difficulté étant très complexe. Nous considérons qu’il est très important que nous effectuions notre travail d’actionnaire majoritaire en première ligne, car le dirigeant a besoin d’une forte proximité au quotidien. Pour certains sujets particulièrement difficiles, la présence d’un acteur public peut rendre la discussion plus difficile. Ainsi certains fournisseurs peuvent-ils être tentés de profiter de la présence de la BPI au capital pour en tirer avantage dans les négociations commerciales, en considérant qu’avec la BPI, il ne devrait pas y avoir de problèmes de trésorerie.
Nous manquons en France d’un écosystème d’entrepreneurs-investisseurs qui ne soient pas des financiers, qui s’intéressent au monde de l’entreprise fragilisée et qui aient une approche d’actionnaires industriels. Je suis sûr qu’il existe au sein de BPI des gens très compétents pour tenir ce rôle mais, je le répète, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l’opportunité pour la BPI d’intervenir en direct. Il n’est pas rare qu’au bout d’un ou deux ans de retournement, nous engagions la discussion avec les services de la BPI, qui peuvent décider de réexaminer le dossier et parfois d’apporter des capitaux propres en tant qu’investisseur minoritaire afin de consolider un projet.
Notre action s’inscrit généralement sur une durée de dix ans. Une première phase du travail doit être effectuée quand les banquiers se retirent, que les fournisseurs sont inquiets, qu’il y a une forte crise de liquidités et, plus généralement, une crise de confiance. C’est là que nous intervenons pour reconstruire l’entreprise et rétablir un passage entre celle-ci et le monde financier, qui prend parfois peur un peu vite et est très volatil. Après avoir effectué ce travail comportant une part de risque, nous pouvons faire appel à d’autres acteurs, notamment Bpifrance.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame, messieurs, nous vous remercions pour votre contribution.
Audition du jeudi 2 avril 2015
Table ronde dédiée au soutien à l’exportation et à l’ouverture à l’international des entreprises réunissant Mme Sandrine Gaudin, cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises, M. Christophe Viprey, directeur des garanties publiques de la COFACE, M. Alain Renck, directeur de BPI Export, M. Jean-Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme, et président du conseil d’administration d’UBIFRANCE, M. Henri Baïssas, directeur général délégué Export de BUSINESS France, M. Jean-Claude Karpelès délégué du président en charge du développement international et des affaires, et Mme Véronique Etienne-Martin, directeur des Affaires publiques et de la Valorisation, de la Chambre de commerce et d’industrie région Paris Île-de-France et Mme Jocelyne de Montaignac, administrateur du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF)
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons ce matin les travaux de la mission d’information commune sur la banque publique d’investissement par une table ronde, dédiée au soutien apporté par Bpifrance à l’internationalisation des entreprises et à la question de la coordination des différents acteurs publics qui agissent en faveur de cet objectif. Comment les soutiens à l’exportation s’organisent-ils ? Quelle est la place, le rôle et l’efficacité de Bpifrance dans ce domaine ?
M. Jean-Paul Bacquet, député du Puy-de-Dôme et président du conseil d’administration d’UBIFRANCE. Rappelons pour commencer l’historique de l’action commune entre Bpifrance et BUSINESS France – organisme né de la fusion entre l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et UBIFRANCE. En janvier 2008, une convention est signée entre la Direction générale du Trésor, UBIFRANCE, l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger (UCCIFE), le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF), l’Association des régions de France (ARF), la COFACE et OSEO, dans l’optique de trouver des complémentarités pour éviter à tous ces organismes de travailler chacun de son côté, gaspillant énergie et efficacité. En octobre 2008, les synergies sont renforcées par une convention entre UBIFRANCE et OSEO. En 2009, les deux organismes lancent des prêts pour l’export. En 2012, Bpifrance reçoit un soutien financier et opérationnel sous la forme de chargés d’affaires internationales (CAI). Le 6 novembre 2012, est signé le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi qui vise à instaurer un accompagnement personnalisé à l’international, dans la durée, à mille ETI et PME de croissance, par Bpifrance et BUSINESS France. À partir de 2013, les volontaires internationaux en entreprise (VIE) de Bpifrance sont hébergés au sein des bureaux d’UBIFRANCE. En mai 2013, le label Bpifrance Export qui rassemble les trois opérateurs publics : UBIFRANCE, Bpifrance et la COFACE est lancé. Fin 2013, 280 entreprises sont accompagnées dans la durée. En mars 2014, UBIFRANCE est inclus dans le programme de formation HEC destiné aux dirigeants du réseau Bpifrance Excellence. En septembre 2014, la deuxième vague des chargés d’affaires internationales, personnel détaché de BUSINESS France, arrive à Bpifrance.
Comme pour la fusion entre UBIFRANCE et l’AFII – dont la cohérence n’était pas immédiatement perceptible –, cette opération de coordination cherche à accroître l’efficacité des différents organismes. La mutualisation des investissements et du fonctionnement permet d’augmenter à la fois l’attractivité de la France pour les entreprises étrangères et celle des partenariats avec les entreprises étrangères installées dans notre pays pour leurs homologues françaises. Nous avons aujourd’hui la volonté de disposer d’un outil opérationnel susceptible d’intervenir dans les domaines de l’investissement, de l’internationalisation et de l’innovation.
M. Christophe Viprey, directeur des garanties publiques de la COFACE. Dans l’accompagnement à l’export, la COFACE joue le rôle de l’assureur : elle distribue et gère des produits d’assurance liés aux risques que l’exportation peut représenter pour les entreprises. Même si elle s’est fortement développée ces dernières années, la part du travail que la COFACE consacre aux PME et ETI n’est pas majoritaire : environ la moitié de nos trois cents collaborateurs qui s’occupent des garanties publiques à l’export gèrent les produits destinés à ces entreprises ; l’autre moitié travaillant sur les grands contrats des grandes entreprises – la mission historique de l’organisme. En revanche, plus de 90 % des 80 milliards d’euros que représente l’encours de risque garanti par la COFACE pour le compte de l’État sont concentrés sur moins de cent grandes entreprises et leurs grands contrats internationaux, les PME et les ETI totalisant moins de 5 milliards.
Comme M. Bacquet l’a rappelé, Bpifrance Export – un partenariat entre Bpifrance, la COFACE et UBIFRANCE – a été créé en mai 2013 afin d’homogénéiser le catalogue des aides, évitant ainsi les zones de frottement entre les produits des uns et des autres – question définitivement réglée –, d’améliorer les produits – domaine où l’on peut encore progresser – et d’organiser des transferts de personnel pour donner de la cohérence aux équipes. Ainsi, à côté des CAI d’UBIFRANCE, des personnes chargées du développement ou de la commercialisation des produits de la COFACE auprès des PME ont rejoint les directions régionales de Bpifrance. En effet, les grandes entreprises viennent à nous, mais nous devons aller vers les plus petites. S’il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif de ce partenariat, ses premiers résultats apparaissent positifs.
Il est essentiel pour les entreprises françaises désireuses d’exporter de bénéficier de la gamme des produits la plus large possible. En effet, ce n’est pas son manque de performance sur telle ou telle niche de financement que l’on a longtemps reproché au système français – qui s’est par exemple toujours montré efficace pour Airbus –, mais les « trous dans la raquette » qui doivent aujourd’hui être comblés. La gamme des services ne permet pas de répondre aux besoins de toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes. Tout l’objet des annonces récentes est d’y remédier. Ainsi, l’arrivée de Bpifrance sur les crédits export de montant limité – jusqu’à 25 millions d’euros – permettra de combler une lacune de marché dans l’offre bancaire. Désormais, si les banques se retirent, Bpifrance y suppléera. À l’autre extrémité, la création de la Société de financement local (SFIL) permet de pallier le manque de compétitivité dont souffraient les crédits de montant élevé. Cet organisme de refinancement de l’export – que le Président de la République a qualifié de banque de l’exportation – nous rapproche des modèles américain ou allemand qui offrent aux banques la possibilité soit de suppléer leurs lacunes, soit de se refinancer auprès d’un établissement public, comblant ainsi le défaut éventuel de compétitivité des très gros financements.
Il ne m’appartient pas de commenter l’annonce de l’étude sur le transfert des garanties publiques vers Bpifrance ; le travail est lancé, l’étude et les discussions suivent leur cours. Cependant, ce transfert seul – qui demandera un travail complexe et sans doute coûteux – n’apportera pas grand-chose, et il me semble essentiel d’en profiter pour perfectionner le système.
Pour commencer, il faudrait améliorer la garantie des financements. Dans le système français, unique au monde, l’État donne sa garantie à la COFACE – ou demain à Bpifrance –, qui garantit le contrat, le caractère indirect de la garantie lui faisant perdre en compétitivité par rapport aux garanties directes apportées aux contrats par l’État. Il faut ensuite développer la dimension commerciale de l’assureur. La COFACE n’a jamais eu pour mission d’aller vers les PME pour leur proposer ses produits, ni vers les clients étrangers des grandes entreprises pour leur montrer que l’équipe France appuie les banques, les exportateurs ou les groupements d’exportateurs pour rendre l’offre française performante. Cette tâche devrait être confiée à la nouvelle entité. Enfin, troisième amélioration possible, il faut assouplir et simplifier les processus de décision – grand combat que je mène parfois contre la direction dont je suis issu. Il est aberrant que les PME soient soumises, comme les grandes entreprises, à la décision de la Commission interministérielle des garanties et du crédit au commerce extérieur, créée en 1946 par ordonnance et reprise dans la loi de 1949. Cet organisme qui, ne visant à l’origine que les grands contrats, ne correspond pas aux besoins de souplesse et de réactivité des petites entreprises. Il serait dommage de ne pas profiter de ce travail de réflexion sur les garanties publiques pour revoir également les processus de décision.
M. Alain Renck, directeur de Bpifrance Export. Bpifrance est entrée dans le jeu du commerce extérieur pour aider les entreprises qui veulent exporter et s’internationaliser, sur la base d’un triple constat. D’abord, nos clients entrepreneurs évoquent systématiquement deux facteurs de croissance : l’innovation et l’international. Présents depuis longtemps dans le domaine de l’innovation que nous finançons notamment par le biais du crédit d’impôt recherche, nous avons donc décidé de nous lancer également dans ce deuxième domaine dont nous nous occupions peu il y a encore dix ans.
Ensuite et nous sommes nombreux à partager ce jugement –, notre pays manque d’exportateurs. Voyant tous les ans, en face-à-face, 70 000 à 75 000 chefs d’entreprise, Bpifrance peut profiter de ces moments privilégiés de discussion pour leur parler d’exportation.
Enfin, Christophe Viprey l’a rappelé, il existe dans le système de financement des failles de marché. En effet, organiser une activité d’export représente, pour une PME ou une ETI, un effort de très long terme qui s’assimile à un marathon ; or les durées longues impliquent des besoins d’argent importants. De plus, le financement de l’international – tout comme celui de l’innovation – renvoie pour l’essentiel à des dépenses immatérielles, que les banques n’aiment guère car elles ne sont en général assorties d’aucune garantie. Pour donner à l’entrepreneur le temps d’effectuer sa démarche sans se soucier de sa trésorerie au quotidien, nous avons décidé de créer les prêts export : prêts de durée longue, sans garantie, portant sur des volumes importants – jusqu’à 5 millions d’euros –, avec deux années de franchise.
Le point d’orgue de notre nouvelle action en faveur de l’exportation a été la création de Bpifrance Export en mai 2013. Cet organisme répond à un souci de simplification ; alors que le maquis des organismes d’aide à l’export apparaît particulièrement touffu, nous avons rassemblé l’ensemble des soutiens publics nationaux – en matière d’assurance, de financement et d’accompagnement – sous un même toit. Banque de démarchage et non de guichet, Bpifrance se rend auprès des clients et met toute la gamme des produits à leur disposition.
M. Henri Baïssas, directeur général adjoint de BUSINESS France. En matière d’exportation, la mission d’intérêt général de BUSINESS France se décline en trois grands volets. Nous faisons de la prospection sur les marchés étrangers afin d’aider les PME à identifier les partenaires commerciaux – importateurs et distributeurs – et à générer des courants d’affaires ; nous renseignons ainsi quelque 9 000 entreprises par an. Nous assurons ensuite le suivi dans la durée des entreprises de croissance, l’ambition fixée dans le pacte de compétitivité étant d’accompagner 1 000 champions de demain dans leur dynamique mondiale. Enfin, nous développons la formule du VIE qui correspond à la décision n° 16 du pacte de compétitivité, en cherchant à augmenter le nombre des entreprises utilisatrices. Actuellement, 8 500 VIE sont en poste, contre un peu moins de 7 000 il y a trois ans. Il s’agit d’un dispositif remarquable pour le développement des entreprises.
La création de Bpifrance Export répond à un besoin des entreprises : celui d’efficacité et de simplicité. Cet outil opérationnel puissant réunit les solutions de financement avec Bpifrance, d’assurance avec la COFACE et d’accompagnement des entreprises avec BUSINESS France. Le pacte de compétitivité cible précisément les ETI et les PME de croissance, l’enjeu étant d’aider les entreprises capables de devenir les champions de demain à se développer pleinement, l’ambition étant de doubler leur chiffre d’affaires à l’international en captant la croissance sur les marchés étrangers. Cette démarche est complémentaire du travail de prospection que nous menons avec les chambres de commerce.
Le dispositif a été pensé pour les entreprises et même s’il est encore tôt pour en dresser un bilan définitif, il apparaît indéniablement plébiscité. Comme le montrent les résultats d’une enquête, les deux tiers des 1 200 entreprises visitées par nos trente-huit CAI installés dans les directions régionales de Bpifrance Export souhaitent intégrer la démarche. Autre résultat marquant : 98 % des entreprises qui en ont bénéficié sont satisfaites par le dispositif. Plus intéressant encore, à la question : « Dans quelle mesure le dispositif Bpifrance Export peut-il contribuer à votre développement international ? », 99 % des entreprises répondent : « de manière importante ». Les attentes sont donc fortes et l’on s’attachera à mesurer la valeur générée pour le compte des entreprises qui bénéficient du dispositif.
Pour terminer, je citerai quelques mots des entreprises, les grandes absentes de cette table ronde : « dispositif d’appui export simplifié et plus visible » ; « qualité des interlocuteurs permettant une compréhension rapide des problématiques des entités du groupe, avec innovation, financement et international » ; « de façon générale, malgré un a priori négatif sur les organismes publics, très satisfait car disponible et efficace ; interlocuteur dédié fondamental, évite de se perdre et de perdre du temps ; bonne connaissance de l’offre ».
Mme la présidente Véronique Louwagie. D’autres tables rondes ainsi que des auditions nous permettent de rencontrer les entreprises ou leur représentant.
M. Jean-Claude Karpelès, délégué du président en charge du développement international et des affaires européennes de la CCI de la région Paris Île-de-France. Le premier rôle des chambres de commerce et d’industrie est la proximité : implanté dans tous les départements, notre réseau nous assure un contact permanent avec les entreprises. C’est à ce niveau que nous agissons, en complémentarité avec nos partenaires et avec lesquels nous devons aujourd’hui construire une nouvelle forme de collaboration plus régionale. Nous détectons, informons, formons, préparons et orientons les entreprises, l’objectif étant de les suivre dans la durée pour en permettre le développement à l’international.
Nous devons offrir aux entreprises de toutes les tailles un véritable complément d’action cohérente dans le temps. Pour cela, nous devons éviter la concurrence, privilégiant la complémentarité des offres, et procéder à quelques aménagements afin d’éviter les doublons. Alain Renck et moi-même nous rencontrerons bientôt pour trouver une solution intelligente et pragmatique à notre façon de travailler.
Les chambres de commerce sont en contact permanent avec près de 2 000 entreprises par an ; l’accord que nous venons de signer doit nous amener à en contacter plus encore. C’est en matière de complémentarité des compétences qu’il nous faut avancer, afin d’apparaître aux yeux des entreprises comme un partenaire global dénué de tout conflit interne. Sur ce point essentiel, nous pouvons encore progresser.
M. Gilles Dabezies, directeur général adjoint chargé des actions internationales et européennes à la CCI de la région Paris Île-de-France. Jean-Claude Karpelès fait référence à l’accord signé le 11 mars entre BUSINESS France et l’ensemble des chambres de commerce de France et des chambres françaises à l’étranger. En plus de vérifier que nous ne faisons pas deux fois la même chose, ce document fixe l’objectif d’un travail commun sur 3 000 entreprises. Si l’accord entre Bpifrance et BUSINESS France portait sur 1 000 ETI et PME de croissance, l’accord du 11 mars ajoute à notre « tableau de chasse » 3 000 PME à moins forte croissance, mais susceptibles d’exporter. Pour arriver à ce chiffre, il nous faut en détecter 4 000 ou 5 000 sur le terrain, car le taux de déperdition est important. Il serait dommage de réserver les produits financiers de Bpifrance aux 1 000 ETI et PME de croissance, et nous devrons travailler région par région pour en faire bénéficier ces 3 000 entreprises supplémentaires que le Gouvernement nous a demandé de traiter.
Mme Sandrine Gaudin, chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises au ministère de l’économie et des finances. Un mot sur la direction générale du Trésor et son rôle en matière de commerce extérieur et de soutien financier à l’exportation. La direction travaille pour les deux ministres de Bercy et s’occupe de la définition et de la mise en œuvre de la politique économique. À ce titre, elle est chargée de promouvoir la compétitivité des entreprises – vaste concept qui recouvre une série de mesures permettant de créer les meilleures conditions pour que les entreprises, grandes et petites, puissent évoluer, notamment à l’international.
Le commerce extérieur est porté par une pluralité d’acteurs et la politique qui y correspond, elle aussi plurielle, constitue une « soft policy » reposant sur l’interaction des différents acteurs du secteur privé ou public – l’État ou les opérateurs de l’État – qui accompagnent le développement à l’international des entreprises aux besoins diversifiés. C’est d’ailleurs ce qui explique la complémentarité, déjà soulignée, des intervenants réunis autour de cette table. En effet, une PME peut avoir besoin de formation ou de ressources humaines supplémentaires pour prospecter un marché, mais également d’une assurance financière ou d’un accompagnement pour contacter un partenaire à l’étranger. Selon le besoin, chacun des acteurs ici présents de l’écosystème de l’export peut intervenir à un moment ou à un autre.
Dans cet écosystème – qui peut faire penser à un maquis sans en être un –, la direction générale du Trésor promeut des réformes qui visent à rationaliser et à faire mieux connaître la palette des outils disponibles. C’est elle qui contrôle l’activité de gestion des garanties publiques à l’exportation, la COFACE agissant pour le compte de l’État. Une plaquette que je mets à votre disposition résume les différents produits financiers à l’export. Un dispositif de prêts concessionnels permet également à la direction générale d’aider des clients étatiques étrangers à financer de grands projets d’infrastructures.
Au-delà de la mise en œuvre de ces dispositifs de soutien, la direction générale du Trésor a en charge le suivi et la tutelle des opérateurs de l’État, à commencer par BUSINESS France. Elle a notamment œuvré pour le rapprochement entre Ubifrance et BUSINESS France pour en faire un opérateur qui, en faisant jouer toutes les synergies, peut agir à la fois sur l’export, l’attractivité et la promotion de l’image de la France. En effet, le Gouvernement considère la politique de l’attractivité comme une priorité, d’où ce nouveau chapitre ajouté aujourd’hui au spectre des compétences de BUSINESS France.
Un écosystème aussi riche – au point de ressembler à un maquis – peut apparaître complexe et insuffisamment lisible, et mérite un effort de simplification. Pour justifier les grandes politiques publiques comme celle prônée par l’étude en cours sur le rapprochement entre la COFACE et Bpifrance, on invoque régulièrement la nécessité d’un guichet unique. Cependant ce dernier constitue un mythe car l’entreprise unique elle-même n’existe pas. Tout en s’efforçant d’apporter une plus grande lisibilité au système, il faut garder une certaine spécialisation dans les guichets. Il en va de même en matière de procédures douanières où l’idée d’un guichet unique – a priori un bon objectif – se révèle en pratique difficile, les différentes réglementations ne pouvant être abritées sous un seul pavillon. Aussi, tout en continuant à tendre vers le guichet unique, il ne faut pas sacraliser cet objectif, sous peine de nier la grande diversité des besoins des entreprises – PME, ETI et grands groupes. L’assurance-crédit pour le contrat de vente des Rafales – que la COFACE vient de réaliser – n’équivaut pas à celle dont a besoin une petite PME qui se heurte à des obstacles bien identifiés dans l’accès à un marché de niche d’un pays émergent. Certes, le dispositif peut parfois paraître émietté et l’on s’efforce de le rationaliser en complétant la palette des produits de Bpifrance, des petits montants aux mécanismes de refinancement importants. Mais il ne faut pas se leurrer : malgré tous les efforts, chartes et dispositifs, malgré les préoccupations de nos autorités politiques et de nos Gouvernements successifs, malgré la rationalisation et la simplification des procédures, le commerce extérieur, sa promotion et son soutien financier resteront des politiques délicates, difficiles à faire entrer sous un même chapitre. En revanche, évitons l’écueil de multiplier des dispositifs ou des structures inutiles ; n’oublions pas non plus que nous – opérateurs et acteurs publics – agissons en subsidiarité du secteur privé, les banques restant le premier financeur de l’export. En réfléchissant à la meilleure manière d’appréhender la promotion et le soutien à l’exportation, il ne faut jamais perdre de vue ces éléments de complexité.
Mme Jocelyne de Montaignac, administratrice du CNCCEF. Les entreprises ne sont pas exclues de cette table ronde puisque j’en représente plus de 4 000 ! Volontaires déployés dans ces entreprises présentes dans 146 pays, les conseillers du commerce extérieur (CCE) forment un réseau puissant qu’un changement de gouvernance rend aujourd’hui plus moderne et plus dynamique. Issus du monde de l’entreprise, experts et praticiens passionnés du commerce extérieur qu’ils connaissent tous parfaitement et qu’ils pratiquent tous les jours, les CCE remplissent plusieurs missions.
Pour commencer, ils assurent une mission de conseil, à l’international et en France, qui concerne essentiellement des PME et des ETI membres de notre réseau ou rencontrées en régions ou à l’étranger. La première fois que je suis allée en Lybie, en 1988, j’ai été accueillie par un CCE ; en arrivant dans un pays difficile dont on ne connaît ni les coutumes, ni les difficultés politiques, ni les problèmes de sécurité, on apprécie que quelqu’un vous décrypte le contexte. C’est le rôle de chacun d’entre nous au quotidien à l’étranger. En France, nous dirigeons les PME et les ETI vers Bpifrance et les autres acteurs ici présents, et les aidons à s’orienter dans ce maquis en cours de simplification, à prospecter les marchés et à structurer leurs actions internationales.
Nous avons également une mission d’accompagnement par le parrainage d’entreprises. Nous soutenons le développement du VIE – institution éminemment utile qui permet aux jeunes de découvrir l’étranger et de devenir progressivement eux-mêmes des acteurs. Nous menons enfin des actions de formation auprès des BTS et des écoles de commerce en matière de commerce international.
Si notre rôle est important, c’est que nous arrivons réellement à toucher les PME. Comme l’a souligné M. Viprey, c’est le soutien de ces entreprises – et non celui d’EADS ou d’Alstom, fort bien accompagnés – qui pose problème en matière de commerce extérieur. À cet égard, l’action de Bpifrance est très intéressante. Il y a une vingtaine d’années, la Banque française du commerce extérieur (BFCE) comme les banques ordinaires soutenaient les exportateurs ; disposant désormais de moins de moyens et de temps, les banques ont quelque peu abandonné ce rôle de conseil et de soutien, et il faut que d’autres acteurs y suppléent. C’est ainsi que nous tenons la main des primo-exportateurs ou des exportateurs de petite taille pour leur expliquer comment procéder pour ne pas se perdre dans un pays, pour structurer leur organisation et se faire payer, beaucoup de PME n’ayant pas conscience des risques dans ce domaine. Les crédits fournisseurs et les crédits acheteurs de petite taille, actuellement redéveloppés par Bpifrance, représentent à cet égard des outils très utiles. Nous nous félicitons de la multiplication des pistes intéressantes et de la dynamique que l’on sent se créer. L’organisation actuelle de Bpifrance nous satisfait, mais il faut continuer à avancer Il faut repenser complètement l’organisation de la COFACE dont l’action ne doit pas être réservée à une dizaine, une vingtaine ou une centaine d’entreprises. Pour arriver à porter le commerce extérieur, essayons de copier nos amis allemands ou italiens qui arrivent beaucoup mieux à faire bouger les choses en profondeur. Nous sommes sur la bonne voie et le CNCCEF tient à soutenir la réflexion et à s’en faire le relais sur le terrain auprès des entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. De fait, les entreprises que vous représentez ont déjà une activité d’exportation.
Mme Jocelyne de Montaignac. Certes, mais nous aidons de plus en plus d’entreprises qui souhaitent se tourner vers l’exportation en raison de la situation de l’économie française.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Dans un rapport de 2013 intitulé L’efficacité des aides publiques aux entreprises, le cabinet Ernst & Young souligne qu’une majorité des entreprises jugent le montage des dossiers d’aide à l’exportation trop complexe et souhaiteraient un dossier unique. Des évolutions sont intervenues dans ce domaine, mais elles font l’objet d’appréciations différentes.
Par ailleurs, vous avez indiqué, monsieur Viprey, que les aides de la COFACE se concentraient sur une centaine d’entreprises. Qu’en est-il des autres ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Force est de constater qu’en matière de simplification et de rationalisation des modalités du soutien à l’export et à l’internationalisation de nos entreprises, un choc de simplification ne suffirait pas, tant il y a à faire.
Monsieur Renk, la gamme proposée aux TPE et PME est-elle complète ou comporte-t-elle encore des lacunes ? Existe-t-il des trous dans la raquette, pour reprendre l’expression de M. Viprey ?
Madame Gaudin, comment appréciez-vous les failles de marché ? Pouvez-vous préciser les modalités du crédit acheteur et fournisseur récemment mis en place et nous indiquer le nombre des entreprises qui y ont eu recours ?
Toutes les petites entreprises innovantes sont-elles encouragées à exporter ? Sont-elles suffisamment armées pour résister à de grands groupes étrangers ? L’intelligence économique n’est-elle pas un enjeu, comme nous avons pu le voir lors de notre déplacement en Basse-Normandie ? Enfin, si BUSINESS France et Bpifrance accompagnent les entreprises à l’export, comment les deux organismes se répartissent-ils les tâches ?
M. Alain Renck. Il reste probablement, ici ou là, quelques trous dans la raquette. Je pense notamment aux cautions sur marché. Les banques ayant parfois des difficultés à délivrer des cautions supplémentaires, on nous demande, dans le cadre du lancement des crédits export, crédit acheteur et crédit fournisseur, d’intervenir dans ce domaine. Mais je ne peux vous répondre que pour la partie financement, assurance et accompagnement. S’agissant du financement, je crois que la palette est complète. Pour le dire trivialement, de l’argent, il y en a ! Le principal problème de notre commerce extérieur réside plutôt dans la motivation des entreprises à se tourner vers l’export. C’est pourquoi il faut leur parler franchement, et c’est ce que nous faisons. À celles qui disposent de la structure financière et des produits adaptés à l’exportation, nous leur disons de se lancer, faute de quoi elles auront disparu dans cinq ans. Au moment où nous parlons, des Américains, des Chinois, des Japonais prennent des parts de marché aux entreprises françaises en France.
Les chefs d’entreprise ont tout d’abord besoin d’être rassurés, car ils jugent la plupart du temps l’export compliqué et craignent d’y perdre de l’argent. À cet égard, les dispositifs de Bpifrance, qu’il s’agisse du prêt export de longue durée ou de l’assurance prospection, un produit très ancien mais très performant qui permet de partager le risque d’une prospection qui échouerait, sont de nature à les rassurer.
Mais nous devons aller plus loin et aider les entrepreneurs à se préparer. Ils n’ont souvent pas pris la peine d’analyser le marché qu’ils convoitent. Il est important pour ceux qui dirigent des entreprises de petite taille de bien s’entourer. Si c’est bien évidemment au dirigeant de faire la démarche export, quelqu’un doit s’occuper de l’entreprise lorsqu’il est à l’étranger. Les entrepreneurs doivent également arrêter de financer sur leur trésorerie les dépenses qu’ils engagent pour traduire leur site internet ou adapter leur produit au marché chinois ou américain, par exemple. La trésorerie, est le pouvoir d’achat des entreprises.
M. Christophe Viprey. La concentration est liée à la gamme de produits. Celle-ci comprend, à une extrémité, l’assurance prospection, un produit assez subventionnel qui intéresse les PME, et, à l’autre extrémité, l’assurance-crédit, qui se perfectionne pour offrir aux très grandes entreprises les financements les plus compétitifs possibles. Entre ces deux extrémités, on trouve des produits de couverture de risque de change, de couverture de risque exportateur sur les cautions et les préfinancements, ainsi qu’une assurance investissement qui rencontre un succès assez mitigé.
La concentration est ce qu’elle est. En 2015, en deux contrats, nous avons pris six milliards de risque sur l’Égypte, de sorte que la part de notre flux consacré aux grandes entreprises sera probablement portée de 92 % à 95 % ou 96 %. Toutefois, l’encours COFACE évolue très clairement à l’avantage des PME et des ETI. En 2011, le Premier ministre nous avait fixé pour objectif de porter le nombre d’entreprises bénéficiant de l’assurance prospection de 6 000 à 10 000. Cet objectif nous paraissait difficile à atteindre ; nous l’avons finalement dépassé, puisque 12 500 entreprises en bénéficient aujourd’hui, nous pouvons faire davantage encore. Mais se pose alors la question budgétaire : le fait-on avec 50 millions ou avec 100 millions ? Le déficit de l’assurance prospection se gère au mois le mois. Il est tout à fait pilotable mais c’est une question d’objectif.
Par ailleurs, s’il existe des trous dans la raquette, ils sont moins liés à la gamme des produits qu’à la qualité de ceux-ci. Nombre d’entre eux sont en effet assortis de règles qui, si elles pouvaient se justifier dans le cadre de contrats de grandes entreprises, ne sont pas adaptées aux PME. Je pense tout d’abord à la question de la part française. Cette règle existe dans d’autres pays, mais sous un autre nom, celui d’intérêt national – ce qui est significatif : on s’intéresse, d’un côté, au contenu du contrat en produits français, de l’autre, à l’intérêt pour l’économie nationale. Les deux approches sont radicalement différentes. Tous les rapports consacrés au commerce extérieur – ceux de la Cour des comptes, de l’IGF, des missions parlementaires – ont préconisé une simplification dans ce domaine. Mais la décision est politique ; il faut savoir ce que l’on veut en matière de soutien à l’export des PME et des ETI. En tout état de cause, maintenir les règles actuelles, c’est leur compliquer la vie car, pour chaque demande, elles doivent adresser – même pour de très petits contrats – un tableau très complet des intrants à la direction générale des entreprises du ministère de l’industrie. On a proposé à de multiples reprises de privilégier une base annuelle ou de prendre en compte l’entreprise plutôt que les contrats, en vain.
Un second facteur de complexité est épargné à nos concurrents étrangers. Actuellement, lorsque nous soutenons des contrats export, il s’agit d’un « one shot », ce qui se conçoit pour de grandes entreprises ou de grands contrats. En revanche, lorsqu’on décide, dans le cadre du pacte de compétitivité, de soutenir 1 000 entreprises – 750 actuellement –, mieux vaut les accompagner pendant un an et dresser le bilan à la fin de l’année, plutôt que d’examiner chaque contrat, comme nous sommes obligés de le faire actuellement.
Telles sont les principales lacunes de notre dispositif, lacunes dont ne pâtissent pas les concurrentes étrangères de nos entreprises. Je pense ici surtout aux entreprises de taille moyenne, déjà actives à l’export, qui sont, me semble-t-il, bien plus aidées dans leur approche des marchés par l’agence de crédit export que par COFACE, beaucoup plus tatillonne en raison de cette approche contrat par contrat.
M. Henri Baïssas. La répartition des tâches se fait de manière assez simple : Bpifrance s’occupe du financement, COFACE de l’assurance et BUSINESS France de la prospection des marchés, sa vocation étant d’être le bras armé commercial du développement des entreprises françaises. Les trois organismes agissent donc de manière complémentaire. On peut avoir deux ambitions en matière d’export : faire en sorte que de nombreuses entreprises exportent – et il est nécessaire pour cela que la capillarité des chambres de commerce soit très étendue – et faire accéder, comme cela est prévu dans le pacte de compétitivité, des champions au niveau mondial dans le cadre de la construction de notre mittelstand. Dans l’un et l’autre cas, les besoins sont différents.
M. Jean-Paul Bacquet. Je m’exprimerai davantage en tant que parlementaire qu’en tant que président de BUSINESS France. Je sais, pour avoir été pendant treize années rapporteur du budget du commerce extérieur à l’Assemblée nationale, que c’est un sujet très complexe, auquel, du reste, très peu de parlementaires s’intéressent. Moi, il m’a rendu cyclothymique : je traverse des périodes d’euphorie et des périodes de grand pessimisme…
Lorsque M. Renk nous dit que l’entrepreneur sait à peine dans quel pays il atterrit et qu’il ne parle pas anglais, je déprime d’autant plus que c’était déjà vrai il y a trente ans. C’est affligeant ! En revanche, lorsque j’entends le représentant de COFACE nous expliquer la façon dont il se bat pour connaître les PME, je suis euphorique. Quelle révolution ! Il paraît loin, en effet, le temps où, interrogé sur l’action de COFACE en faveur des PME, son représentant me répondait que l’activité privée rapportait beaucoup d’argent et qu’il n’était pas intéressé par l’activité de garantie publique. L’action de M. Drouin à la tête d’Oséo m’a rendu également optimiste.
Il est vrai cependant que tout n’est pas réglé. Que veut l’entreprise ? Un accompagnement, une assurance, indispensables, et une aide. Elle doit en effet être aidée dans sa prospection des marchés. Interviennent dans ce domaine BUSINESS France et les CCI, qui connaissent bien les entreprises. Mais leurs actions respectives ne doivent pas être cloisonnées. Je dois me rendre à Moscou la semaine prochaine dans le cadre du dialogue franco-russe et, lorsque j’ai demandé à rencontrer certains chefs d’entreprise, la directrice d’Ubifrance m’a répondu que, selon la convention, cela relevait désormais de la chambre de commerce ! Plus que la convention, c’est la pratique qui compte, et elle suppose une véritable coordination. Nous savons tous que d’une région à l’autre les résultats sont différents : les uns ont choisi l’ouverture quand les autres préfèrent rester dans leur pré carré. Le rôle des régions, qui est du reste discuté dans le cadre du débat parlementaire sur la loi NOTRe, est important à cet égard.
Il est un autre élément, fondamental, que personne n’a encore évoqué et sur lequel je veux insister : l’évaluation. Tous les gouvernements, qu’ils soient de gauche ou de droite, veulent améliorer la situation de notre commerce extérieur ; tous ont identifié nos points forts et nos points faibles dans ce domaine. Mais qu’en est-il de l’évaluation ? Ce qui compte pour une entreprise, c’est le bilan financier. Or, sur ce point, le mutisme est total. Il peut s’expliquer par le secret des affaires, mais le bilan du commerce extérieur se fonde sur des chiffres et non simplement sur des courants d’affaires.
L’évaluation peut-elle être fondée sur le nombre des entreprises exportatrices ? Cela n’a aucune signification : mieux vaut avoir 120 000 entreprises exportatrices qui gagnent que le double, dont 80 000 n’y réalisent pas de bénéfices. La préparation à l’export et l’accompagnement de celles qui réussissent sont donc une nécessité.
L’évaluation peut-elle être fondée sur le nombre de Volontariats internationaux en entreprise (VIE) ? Ce dispositif est extraordinaire s’il est bien utilisé : les VIE, qui parlent anglais ou espagnol et sont formés pour créer du relationnel et un partenariat avec les entreprises sur place, accompagnent les PME pour les faire réussir à l’export. Mais une diminution de leur nombre serait un bon signe, car cela signifierait que les entreprises accompagnées ont réussi.
Ce qui compte, c’est la qualité de l’évaluation. Or, dans ce domaine, nous sommes insuffisants. Pourriez-vous me dire aujourd’hui quelles sont les parts respectives de la baisse du prix du pétrole, de la baisse de l’euro et des gains des entreprises dans l’amélioration de notre commerce extérieur ? Je ne connais pas la réponse…
Mme Sandrine Gaudin. Je tiens à préciser que la plupart des 12 000 entreprises qui bénéficient de l’assurance prospection sont des PME. Il s’agit d’un outil nouveau développé par la COFACE, qui s’est en effet adaptée d’une manière assez impressionnante aux réalités et aux besoins du marché.
Quant à la part française, il s’agit d’un problème ancien et complexe. Il est vrai que ce critère est aujourd’hui un peu périmé au regard des stratégies des entreprises à l’international. C’est pourquoi, dans le cadre d’une réflexion menée avec la direction des entreprises de Bercy, nous avons proposé à M. Macron et à M. Sapin un allégement des formulaires et des procédures ainsi que la mise en place d’un dispositif incitatif qui, s’il était validé par les ministres, serait quelque peu révolutionnaire. Ce dispositif permettrait en effet de ne pas priver de soutien à l’export une entreprise dont la part française est très faible en prenant en compte d’autres éléments tels que la localisation en France de sa recherche et développement. Il permettrait aussi de soutenir davantage les entreprises qui s’efforcent de maintenir leur localisation en France – je pense notamment à Alstom.
M. Jean-Claude Karpelès. Je veux dire à M. Bacquet que je suis, quant à moi, optimiste. Lorsque nous avons créé Ubifrance, nous avons voulu que cet organisme soit au service du développement international des entreprises, ce qui inclut d’autres actions que l’aide à l’exportation. Les « co-contractances » sur des marchés à l’étranger, par exemple, qui se développent de plus en plus, sont une forme d’action à l’international pour les PME. Il nous arrive en effet de déconseiller à certaines entreprises qui n’en ont pas les moyens, de se développer à l’international en exportation pure. En revanche, elles peuvent chercher un partenaire à l’étranger en vue d’une implantation, et il nous faut alors trouver l’environnement financier et administratif qui leur permet de le faire. Ce volet n’est pas suffisamment mis en avant.
Pour le reste, chaque mois, la CCI Paris Ile-de-France organise, dans les départements, avec les conseillers du commerce extérieur, des réunions d’information auxquelles participe notamment Bpifrance, pour présenter aux entreprises les financements existants. Souvent, elles ne savent pas à quel type de dispositifs elles peuvent avoir accès. D’importants progrès ont été accomplis en matière de guichet, mais il faut encore faire un effort dans ce domaine.
M. Alain Renck. Je souhaiterais vous donner un exemple de ce que fait Bpifrance Export en matière d’innovation. Il existe deux types d’entreprises innovantes : les startups, qui sont internationales par nature, et des entreprises traditionnelles qui innovent en permanence. En ce qui concerne les startups, nous mettons en place, avec BUSINESS France, des programmes, ubi i/o et Mobility, qui consistent à immerger ces jeunes entrepreneurs français dans les milieux où l’investissement et l’innovation sont très prometteurs. Nous sélectionnons ainsi huit startups potentiellement mondiales et nous les installons pendant dix semaines dans la Silicon Valley, où elles rencontrent, lors de rendez-vous organisés par BUSINESS France à San Francisco, les acheteurs et les développeurs des plus grands groupes. Au terme de la première année de ce programme, on a pu constater que chacune de ces entreprises, partie avec une technologie de pointe, était revenue avec un produit. La France, est une nation d’ingénieurs où l’on sait développer une technologie mais sans toujours se demander si celle-ci est adaptée au client. Nous allons, par exemple, mettre en contact des entreprises françaises qui développent des technologies embarquées destinées aux voitures sans chauffeur avec les grands constructeurs américains et avec Google, qui sera sans doute l’un des principaux constructeurs automobiles demain.
Mme Jocelyne de Montaignac. Je crois, monsieur Bacquet, que le VIE est un outil extraordinaire. Certes, ces volontaires accompagnent les entreprises, mais ils se forment également, et lorsqu’ils reviennent en France, ils sont devenus de véritables exportateurs. Il faut donc conserver cet outil, mais aussi le développer, et non le réduire.
M. Jean-Paul Bacquet. J’ai simplement dit que le jour où le nombre de VIE diminuera, cela signifiera sans doute que nous aurons gagné la partie. Du reste, ce que vous dites est tellement vrai que 93 % des volontaires trouvent un emploi après leur VIE, dont 80 % dans l’entreprise où ils l’ont accompli.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Karpelès, vous avez indiqué qu’une vision globale de l’accompagnement des entreprises était nécessaire pour pouvoir les orienter, le cas échéant, vers des solutions plus appropriées que l’exportation. Qui, de Bpifrance ou des CCI, joue ce rôle de conseil ?
M. Jean-Claude Karpelès. Nous intervenons très directement auprès des entrepreneurs en leur proposant un diagnostic. Nous leur présentons les formes d’implantation à l’étranger, les plus adaptées à leur situation : exportation mais aussi partenariat, cession de licence… Il faut être assez directif au niveau du diagnostic ; ensuite, c’est au chef d’entreprise de décider, bien entendu.
M. Gilles Dabezies. Je précise que la CCI établit ce diagnostic dans le cadre de ses autres missions, le développement international de l’entreprise n’étant qu’un des aspects de son développement. L’important n’est pas qu’un grand nombre d’entreprises partent à l’étranger mais que celles qui y partent soient prêtes. Or, ce n’est pas toujours le cas.
Le diagnostic est donc très approfondi. Il est du reste suivi d’une action de formation : si nous estimons qu’en l’état actuel de ses possibilités, une entreprise ne peut pas partir à l’étranger, nous lui proposerons de travailler avec elle pour qu’un jour elle puisse le faire. Une entreprise peut passer une, deux ou trois années de préparation. L’objectif final est qu’elle gagne de l’argent et se développe à l’étranger, sous des formes diverses : export, partenariat, investissement… Hélas, 30 % seulement des entreprises connaissent nos actions ; à nous de nous faire mieux connaître.
Par ailleurs, le financement comporte un volet macroéconomique dont sont en charge les grands organismes – et, dans ce domaine, les outils proposés par Bpifrance Export et d’autres représentent un progrès extraordinaire – et un volet microéconomique. Hier, par exemple, j’ai rencontré les représentants de trois chambres de commerce françaises aux États-Unis afin de discuter de la façon de présenter aux PME françaises intéressées par ce marché les financements proposés par le gouvernement américain aux entreprises étrangères qui souhaitent s’implanter sur son territoire. Nos PME ont droit à cette information et elles ont besoin d’être accompagnées pour bénéficier de ces aides.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame Gaudin, M. Viprey a évoqué les faiblesses et les améliorations possibles de la gestion des garanties à l’export. Pensez-vous que le transfert de l’activité de gestion des garanties publiques au groupe Bpifrance est de nature à apporter les améliorations attendues ?
Mme Sandrine Gaudin. Je précise que ce transfert est, pour l’instant, étudié sous ces différents aspects – financier, social, informatique – avec les acteurs concernés ; aucune décision n’a encore été prise en la matière.
L’annonce du lancement de cette étude a été motivée par le souci de poursuivre le rapprochement autour de Bpifrance de l’ensemble des dispositifs de soutien à l’export, en raison du lien très net et de plus en plus étroit qui existe entre innovation et exportation. Un tel rapprochement permettrait, de surcroît, de créer un guichet unique, en regroupant un certain nombre de dispositifs sous un même toit.
En ce qui concerne les procédures et le fonctionnement de la commission des garanties, dont les lourdeurs ont été décrites par Christophe Viprey, il faut rappeler que nos dispositifs datent de l’après-guerre. Si leur amélioration s’est faite par retouches successives, c’est notamment pour des raisons de compatibilité avec le droit européen. Ce régime d’aides d’État est en effet antérieur à l’entrée en vigueur du traité de Rome, et tout big bang dans ce domaine pourrait nous obliger à soumettre notre dispositif de soutien à l’export à l’examen de la Commission européenne. Ces dispositifs, qui datent d’un autre temps, ont donc été modernisés autant que possible dans ce cadre contraint – c’est du reste un élément qu’il faut prendre en compte dans l’étude du rapprochement de Bpifrance et de COFACE.
Nous nous efforçons cependant d’imprimer un réel mouvement à tous ces dispositifs. Certes, nous avons un temps de retard, car les entreprises évoluent très vite, mais la présentation, il y a quelques jours à Bercy, de la politique d’assurance-crédit et des nouveaux instruments financiers témoigne de cet effort permanent. La politique du commerce extérieure est difficile à appréhender car elle est en perpétuel mouvement.
Le lancement de l’étude du rapprochement entre Bpifrance et COFACE permettra-t-il d’alléger les procédures et d’améliorer l’efficacité de la commission de garantie ? Bien entendu, nous le souhaitons, mais, encore une fois, si nous sommes amenés à maintenir certains aspects de ces processus anciens, c’est aussi pour des raisons de légalité communautaire. Certains de nos outils sont irréprochables à cet égard, mais on peut avoir quelques doutes sur la conformité au droit européen de l’assurance prospection, par exemple. En tout état de cause, il faudrait notifier officiellement ce dispositif à la Commission, ce qui prendrait beaucoup de temps et aurait pour conséquence de suspendre son utilisation effective, alors qu’il remporte un véritable succès.
M. Alain Renck. Je souhaiterais préciser un point. Il est bien évident que les 3 000 entreprises concernées par le programme qu’a évoqué Gilles Dabezies peuvent bénéficier de tous les supports financiers de Bpifrance.
Mme la président Véronique Louwagie. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre contribution à nos travaux.
Audition du jeudi 2 avril 2015
M. Florian Poirier, responsable du pôle collectivités locales, et de Mme Audrey Duquenne, chargée de mission partenariats de la Fédération des Entreprises publiques locales
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame, monsieur, bienvenue.
La Fédération des entreprises publiques locales représente des sociétés d’économie mixte (SEM) et des sociétés publiques locales (SPL), autant d’acteurs de terrains liés aux collectivités locales. Vous avez souhaité être entendus par la Mission d’information parce que la Banque publique d’investissement est l’un de vos interlocuteurs, les entreprises publiques locales (EPL) étant éligibles à ses financements. Votre président, M. Jacques Chiron, siège d’ailleurs au conseil national d’orientation de la BPI.
M. Florian Poirier, responsable du pôle « collectivités locales » de la Fédération des entreprises publiques locales. Les entreprises publiques locales sont toutes des sociétés anonymes, certes un peu particulières puisqu’elles sont créées à l’initiative des collectivités locales pour gérer des missions d’intérêt général. Aujourd’hui, les EPL, ce sont environ 1 000 SEM – des entreprises dont le capital est pour partie public et pour partie privé ; ce sont également environ 200 sociétés publiques locales, créées – depuis leur naissance en mai 2010 – exclusivement par des collectivités locales dans un souci de mutualisation et de coopération. Demain, nous aurons également des SEM à opération unique, créées par la loi du 1er juillet 2014 : les premiers projets sont en cours d’instruction. Je profite de cette occasion pour vous remercier, madame la présidente, de votre signature apposée à cette proposition de loi, déposée dans les deux chambres en termes identiques.
Notre fédération rassemble ces quelque 1 200 entreprises publiques locales. Nous proposons à nos adhérents une gamme de services – services juridiques, information, formation… Nous informons également les collectivités locales et les élus des opportunités offertes par les EPL, et nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets.
Les EPL représentent aujourd’hui 74 000 emplois et plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Elles empruntent chaque année plus de 6 milliards d’euros auprès des différentes institutions financières. Un quart d’entre elles exercent leur activité dans le domaine de l’aménagement du territoire, un autre quart dans le secteur du logement. Les autres interviennent dans les secteurs du développement économique, de la production d’énergie renouvelable, de réseaux de mobilité ou d’eau, de la construction, gestion et réhabilitation d’équipements touristiques… Elles investissent donc parfois dans le cadre de contrats passés avec des collectivités locales, parfois – notamment dans le cas des SEM – dans le cadre d’investissements consentis pour elles-mêmes. À ces 1 200 entreprises, il faudrait d’ailleurs ajouter 550 filiales de SEM, qui ont elles-mêmes vocation à réaliser des projets peut-être plus risqués, mais toujours dans l’intérêt général.
Ce mouvement se développe aujourd’hui : soixante nouvelles EPL sont créées en France chaque année, à l’initiative principalement du bloc communal et intercommunal, et notamment dans les secteurs de l’énergie, du tourisme et du développement économique. Nous voyons aussi la création de SEM de production d’énergie, souvent à l’initiative des syndicats départementaux d’énergie, par exemple dans la Vienne, la Loire, les Landes… Nous connaissons également un développement des SEM patrimoniales, qui visent à développer des bâtiments destinés aux entreprises, afin d’accompagner la croissance de l’activité économique du territoire concerné.
Les EPL vont donc bien, et cela entraîne des besoins de financement. Nous avons bien sûr dû nous adapter à la conjoncture ; le retrait de Dexia en particulier nous a obligés à changer nos pratiques. La Banque postale intervient maintenant sur le marché des EPL, et la Caisse des dépôts dispose d’une enveloppe spécifique pour le très long terme. Enfin, la BPI est arrivée dans le paysage, créant beaucoup d’espoirs et d’attentes chez nos adhérents.
Notre fédération entretient d’abord avec la BPI des relations institutionnelles. Le président de la Fédération des entreprises locales, Jacques Chiron siège au conseil national d’orientation de la BPI. Nous voulons surtout mettre en avant l’éligibilité de principe des EPL aux produits de la BPI, éligibilité prévue par la loi mais dont nous regrettons qu’elle soit peu mise en pratique : très peu de dispositifs sont aujourd’hui ouverts aux EPL, car beaucoup sont réservés aux entreprises qui sont des PME au sens de la Commission européenne. Or les EPL n’entrent pas dans cette définition. Nous y reviendrons.
Depuis la création de Bpifrance en 2013, nous essayons d’obtenir des précisions sur la doctrine d’investissement mise en œuvre. Un travail en commun a eu lieu mais n’a pas été très concluant, puisque Bpifrance ne nous a pas expliqué clairement quelle est sa doctrine d’investissement pour le cas des SEM ou des SPL. La représentation nationale s’est pourtant mobilisée pour obtenir des réponses : le sénateur Thierry Foucaud a interrogé Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, lorsque celui-ci a été entendu par la Commission des finances du Sénat ; le député Jean-Marie Sermier en a fait de même, ainsi que le sénateur Jean-Léonce Dupont, ancien président de la Fédération des EPL. Aucune réponse claire n’a été formulée, ce qui constitue pour nous une vraie difficulté et une réelle source d’insatisfaction.
Au-delà de ces relations institutionnelles, notre principale préoccupation est la relation opérationnelle entre les EPL et Bpifrance. Je commence par préciser qu’il existait des relations anciennes entre Oséo et les SEM – beaucoup de SEM patrimoniales, notamment, ont bénéficié de prêts d’Oséo, par exemple dans la Vienne ou dans l’Yonne. Or, en particulier dans ce domaine de l’immobilier et du foncier, nous constatons aujourd’hui que les relations sont de plus en plus compliquées. Des entreprises publiques locales qui bénéficiaient de prêts d’Oséo n’arrivent plus à bénéficier des dispositifs similaires de Bpifrance – je pense par exemple à la SEM Yonne équipement. Il faut le redire, les SEM sont éligibles, en particulier aux prêts de moyen ou long terme. Sur le terrain, une ambiguïté semble pourtant exister.
Toujours dans le domaine de l’immobilier et du foncier, certaines EPL qui, à notre sens, pourraient profiter des dispositifs de Bpifrance, s’en sont vues refuser le bénéfice. Je pense par exemple au groupe d’entreprises publiques locales d’aménagement de l’agglomération dijonnaise, composé d’une SEM et d’une SPL, et qui a sollicité Bpifrance ces derniers mois sans obtenir de réponse positive. Cette aide paraîtrait pourtant très légitime : cette SEM envisage de racheter le bâtiment d’une entreprise qui connaît des difficultés financières, pour le lui louer, et permettre ainsi à celle-ci de continuer son activité sur le territoire de l’agglomération dijonnaise. Bpifrance n’a pas souhaité donner suite à ce projet, ce qui constitue pour nous une source d’étonnement.
Nous souhaitons donc une clarification de la doctrine de Bpifrance sur ce volet immobilier et foncier ; nous souhaitons également, tout simplement, que soit rappelée l’éligibilité des EPL à ces différents dispositifs.
Je souhaite également évoquer le domaine de la production d’énergie, en vous donnant un exemple : la SEM de production d’énergie du département de la Vienne a bénéficié, en juin 2013, de deux prêts successifs de la BPI, de près de 17 millions d’euros, pour des projets de production d’énergie éolienne. C’est un élément positif, nous regrettons néanmoins que dans d’autres départements, d’autres entreprises qui exercent les mêmes activités se voient refuser des prêts du même type. Cela pose, vous le voyez, la question de la doctrine d’investissement : celle-ci devrait être homogène pour l’ensemble du territoire français.
Il faut également évoquer l’innovation. Bpifrance dispose de prêts spécifiques, mais ils sont limités aux PME qui répondent à la définition de la Commission européenne. Nous le regrettons, car nous disposons d’exemples d’EPL dont l’activité est remarquable. Je pense par exemple à la SEM Valagro, constituée à l’initiative du conseil régional de Poitou-Charentes, et dont la mission est de chercher à remplacer le carbone fossile par du carbone végétal dans les procédés industriels. C’est une entreprise qui fait de la recherche et dépose des brevets, puis met ceux-ci à disposition d’entreprises qui souhaiteraient les utiliser sur le territoire de la région, avec l’aide de celle-ci. Il s’agit donc bien d’innover et de contribuer à l’activité économique locale. Or cette entreprise ne peut pas bénéficier des dispositifs de Bpifrance pour l’innovation : nous nous en étonnons, et nous le regrettons.
De la même manière, je peux citer SUDE, filiale de la SEMIACS, à Nice. Cette entreprise développe des logiciels dans le domaine de la ville intelligente ; elle a reçu un prix au congrès des World Smart Cities à Barcelone en 2011, a créé un groupement d’intérêt économique (GIE) avec des homologues européens, dispose de brevets internationaux. Elle est donc évidemment innovante, mais n’a pas non plus pu avoir accès aux dispositifs de la BPI. C’est, là encore, un regret.
Il semble bien que ce soit la définition européenne des PME qui pose problème. Nous avons demandé aux équipes de la BPI de nous dire s’il s’agissait là de contraintes légales – afin d’essayer de notre côté d’apporter des réponses d’ordre juridique – ou d’éléments de doctrine. Je souligne que les EPL peuvent en principe accéder aux prêts de moyen ou long terme : pour ceux-ci, il n’y a pas de limitation. Tout cela est donc très flou, ce qui est pour nous source de préoccupation : la Fédération des entreprises publiques locales ne peut pas communiquer en direction de ses adhérents, ne sachant pas s’ils sont, ou pas, éligibles aux différents dispositifs.
Aujourd’hui, seules 2 % des entreprises publiques locales françaises bénéficient d’un prêt de la BPI. Ce chiffre nous semble faible, et en tout cas bien faible par rapport à ce que nous avions cru comprendre lors de la création de Bpifrance.
Enfin, j’ajouterai que nos entreprises ont de plus en plus de mal à obtenir des garanties. Les banques ont en effet accru leurs exigences. Il nous semblait, en 2013, intéressant d’envisager que les EPL puissent bénéficier des dispositifs de garantie. Sur ce point non plus, la BPI ne nous a pas apporté de réponse.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Les situations semblent différer beaucoup d’une région à l’autre. Est-ce pour vous lié à des situations politiques locales et aux relations locales entre Bpifrance et les régions ? Votre président siège au comité national d’orientation. Vous semblerait-il intéressant de disposer également de représentants dans les comités régionaux ?
Que vous a répondu Bpifrance sur la distinction entre doctrine d’investissement et contraintes légales ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. J’espère que la publicité de cette audition aura permis que votre message soit entendu !
S’agissant de la doctrine, vos questions restent, dites-vous, sans réponse, ce qui est inquiétant. Pourquoi cette absence de réponse, malgré votre participation au conseil national d’orientation ?
Vous évoquez également la question des garanties ; au-delà des difficultés que vous avez constatées, les coûts sont-ils importants, et constituent-ils un problème ? C’est un sujet qui est apparu au cours de nos auditions.
M. Florian Poirier. Notre fédération ne ressent pas de lien entre les difficultés que nous connaissons et les différences politiques régionales. Le flou que je regrettais concerne l’ensemble du territoire ; le problème tient vraiment, selon nous, à une incertitude de la doctrine de la BPI. J’imagine d’ailleurs que les équipes de Bpifrance, dont certaines venaient d’Oséo, ont été un peu déstabilisées par le changement subit que nous avons constaté : hier, ils répondaient positivement, aujourd’hui, ils ne le peuvent manifestement plus.
Les EPL sont, c’est vrai, des entreprises qu’il faut traiter de façon un peu particulière. Mais nous avons tous intérêts à construire ensemble cette approche, et nous souhaitons pour notre part apporter notre pierre à cet édifice.
S’agissant du conseil national d’orientation, notre président ne s’y est pas senti décisionnaire. Le sentiment de la Fédération aujourd’hui est que ce conseil ne joue pas son rôle d’orientation, et qu’il se contente plutôt d’avaliser des décisions prises ailleurs. Notre participation aux instances régionales aurait évidemment un sens, mais nous ressentons avant tout le besoin, au préalable, d’une clarification nationale.
S’agissant des garanties, nos adhérents ne bénéficient pas de celles de la BPI. À ma connaissance, ils ne rencontrent pas particulièrement de problèmes de coût. Il est vrai que les EPL ont la particularité de pouvoir aisément bénéficier de garanties de collectivités locales, en tout cas dans les limites prévues par la loi Galland. Notre problème réside plutôt dans la possibilité de bénéficier de toute la richesse des produits de la BPI. Ceux-ci sont en effet très divers et adaptés à des situations très particulières, dont certaines que nous connaissons fréquemment – je pense à l’innovation, mais aussi aux investissements numériques.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous regrettez manifestement de ne pouvoir travailler plus étroitement avec Bpifrance. Pourquoi la préférez-vous à d’autres partenaires financiers, comme par exemple la Caisse des dépôts et consignations ?
M. Florian Poirier. Les EPL entretiennent bien des relations avec la Caisse des dépôts, mais celle-ci prête plutôt à très long terme. Elle ne répond donc qu’à une partie des questions qui se posent, et son action est complémentaire de celle de Bpifrance.
Nous travaillons avec l’ensemble des institutions financières des différentes places bancaires, et au niveau local, les choses se passent généralement bien. Nous constatons néanmoins de véritables difficultés à obtenir des prêts bancaires, soit parce que les volumes de prêts proposés sont insuffisants – ce qui oblige à impliquer plusieurs opérateurs – soit parce que les contreparties bancaires sont trop fortes. Vous n’ignorez pas en effet que la modification des ratios prudentiels a entraîné un renforcement des demandes de contreparties.
Bpifrance a donc un vrai rôle à jouer pour financer des projets dont je souligne à nouveau qu’ils sont très concrets. L’avenir d’entreprises est en jeu, comme le montrait l’exemple dijonnais que j’ai donné plus haut ; je peux prendre ici un autre exemple, celui de l’entreprise Recytherm du village de Brienon qui, si aucune solution pour racheter son patrimoine immobilier n’est trouvée, quittera ce village. Notre mission est de contribuer efficacement à l’activité économique, mais sur des projets souvent plus réduits que ceux financés par la Caisse des dépôts. Nous avons besoin d’interventions certes ponctuelles, souvent modestes, mais indispensables pour que les EPL jouent leur rôle d’accompagnement du développement des entreprises.
L’activité des EPL profite aux PME, et cela implique une grande réactivité. Nous pensons que le soutien de la BPI nous serait utile.
Mme Audrey Duquenne, chargée de mission « partenariats » de la Fédération des entreprises publiques locales. Je voudrais souligner que les EPL sont bien des entreprises, et pour la plupart des PME. En effet, 94 % des EPL emploient moins de 250 salariés, et ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. Un quart d’entre elles répondent même à la définition de la très petite entreprise – au plus dix salariés, et un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.
Seules 2 % des EPL, cela a été dit, bénéficient pourtant des dispositifs de la BPI. Nous sommes en effet très souvent renvoyés au fait que les EPL ne répondent pas à la définition des PME donnée par la Commission européenne dans sa recommandation 2003/361/CE, d’après laquelle une entreprise dont le capital est public à plus de 25 % ne peut être considérée comme une PME. Une telle définition exclut complètement les EPL, puisque même le capital des SEM à opération unique sera toujours public à hauteur d’un tiers au moins. Cette recommandation n’est pourtant pas contraignante, et la référence systématique à cette définition européenne ne nous paraît pas justifiée.
M. le rapporteur. S’agissant d’investissement, quelle est votre position sur l’intérêt de l’intervention de la BPI pour les entreprises que vous représentez ?
M. Florian Poirier. L’investissement en fonds propres n’est pas notre demande prioritaire : aujourd’hui, nous trouvons des opérateurs qui acceptent d’investir à long terme – je pense notamment à la Caisse des dépôts, qui joue ici pleinement son rôle. L’intervention de Bpifrance comme investisseur pourrait être intéressante dans des cas très particuliers, par exemple lorsque des SEM créent des filiales pour investir et développer des projets très spécifiques dans des domaines précis, par exemple l’innovation. Les SEM patrimoniales pourraient également être concernées, car si la Caisse des dépôts comme les établissements bancaires jouent pleinement leur rôle, les fonds propres nécessaires sont extrêmement importants – ainsi, la SEM patrimoniale du Territoire de Belfort est aujourd’hui capitalisée à 30 millions d’euros. Une intervention de Bpifrance pourrait donc être utile, sans que cela nous apparaisse comme une priorité forte.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
Audition du jeudi 9 avril 2015
Table ronde sur le financement des entreprises artisanales réunissant : M. François Moutot, directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), M. Henry Brin, président du conseil de l’artisanat de la Fédération française du bâtiment (FFB), M. Patrick Gérion, directeur général de la Caisse mutuelle de garantie de la mécanique (CMGM) et de la Centrale de garantie des industries mécaniques, électriques et électroniques (CEMECA), M. Michel Cottet, directeur général de la société de caution mutuelle pour les entreprises d’artisanat et de proximité (SIAGI), M. Jean-Pierre Crouzet, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA) et M. Pierre Burban, secrétaire général.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons les travaux de la mission d’information commune par une table ronde consacrée au financement des entreprises artisanales. La question de l’accès au crédit se pose en effet dans des termes bien spécifiques pour les TPE et pour les artisans, dont les stratégies de croissance nécessitent un accompagnement particulier. Qu’attendent les artisans, dans le paysage bancaire actuel, de la création d’une banque publique d’investissement ? Comment voient-ils le positionnement de Bpifrance, son rôle et son efficacité ? Quelles sont les évolutions qui leur paraîtraient nécessaires ?
Je précise que M. François Moutot, directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, qui devait également participer à cette table ronde, ne pourra nous rejoindre en raison de la grève des contrôleurs aériens.
M. Henry Brin, président du conseil de l’artisanat de la Fédération française du bâtiment. Les entreprises artisanales connaissent des problèmes de trésorerie, notamment depuis la crise de 2008 et l’entrée en vigueur, la même année, de la loi de modernisation de l’économie, dont les dispositions relatives aux délais de paiement affectent particulièrement les métiers du bâtiment. Cette loi a créé un véritable choc. Aujourd’hui, non seulement nous devons payer nos fournisseurs en temps et en heure sans bénéficier de la souplesse qui existait auparavant, mais nous avons davantage de difficultés à recouvrer nos créances.
Les institutions consulaires et la Fédération française du bâtiment ont fait la promotion de Bpifrance, mais force est de constater que les artisans ont davantage de relations avec leur propre banque, qui est plus proche d’eux, qu’avec Bpifrance, qui est implantée dans les chefs-lieux de région. Au-delà, nous avons pu profiter, même si ce fut à doses homéopathiques, du CICE qui, après quelques ratés, a permis à certains d’entre nous de stabiliser leur fonds de roulement et leur trésorerie même si la situation n’est pas encore pérennisée.
Par ailleurs, nous déplorons que le bâtiment soit tenu à l’écart des actions en faveur de l’innovation car nous pourrions, compte tenu des préconisations actuelles en matière d’amélioration du bâti et de normes environnementales, être plus innovants et développer des process qui ne sont pas encore suffisamment utilisés en France.
Enfin, nous souhaiterions que les financements de Bpifrance soient un peu plus en phase avec la réalité. Nombre d’entreprises ont en effet, je le répète, des problèmes de trésorerie : même si leurs carnets de commandes sont remplis, elles ont bien souvent du mal à assurer à la fois le recouvrement de leurs créances et le paiement de leurs factures.
M. Patrick Gérion, directeur général de la Caisse mutuelle de garantie de la mécanique et de la Centrale de garantie des industries mécaniques, électriques et électroniques. La filière de l’industrie mécanique compte 40 000 entreprises, 11 000 PME et 29 000 TPE, qui réalisent un chiffre d’affaires de 120 milliards par an.
S’agissant de Bpifrance, je souscris aux propos de M. Brin : ce n’est pas une banque de proximité. Or, les petites entreprises sont habituées à travailler avec leurs banquiers locaux. Un groupe comme celui des banques populaires, par exemple, détient 50 % des parts du marché des TPE et des PME et offre des produits adaptés aux besoins de ces entreprises. Par ailleurs, ses méthodes de travail sont à la fois différentes et complémentaires de celles de la société de caution mutuelle que j’ai l’honneur de diriger. Quand Bpifrance travaille par scoring, sans rencontrer les PME et en délégant les pouvoirs de décision à la banque, nous, nous examinons chaque dossier que nous soumettons à des comités d’agrément composés de chefs d’entreprise qui analysent son aspect économique plutôt que son aspect financier.
J’ajoute que nous nous interrogeons sur le coût réel de l’intervention de Bpifrance, car le coût affiché est souvent un coût net des ponctions opérées sur les fonds de garantie. Nous souhaiterions connaître le coût brut de ses engagements, car nous sommes, quant à nous, précautionneux dans nos interventions, de sorte que nos coûts de sinistre sont très bien maîtrisés.
M. Michel Cottet, directeur général de la société de caution mutuelle pour les entreprises d’artisanat et de proximité. Selon les statistiques de la Banque de France – qui sont partielles puisqu’elles ne comptabilisent que les déclarations de concours supérieures à 25 000 euros –, 38 milliards d’euros de crédits ont été distribués l’an dernier aux TPE, lesquelles sont pour moitié des entreprises artisanales à hauteur de 60 % des entreprises individuelles. Les sociétés de garantie, qui ont vocation à accompagner le financement de ces entreprises, ont été créées pour combler des failles de marché. Elles ont pour mission d’encourager les entreprises, ou de les dissuader lorsque le projet économique ne semble pas viable. N’oublions pas en effet qu’il s’agit d’une économie de proximité, dont les marchés sont très étroits ; il convient donc de porter une attention particulière à l’analyse du risque de crédit.
Le capital de la SIAGI, créée en 1966, est détenu à 60 % par les chambres de métiers et de l’artisanat, à 25 % par les banques et à 15 % par Bpifrance, laquelle est d’ailleurs actionnaire d’autres sociétés de garantie – je pense à l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) et à la Société de garantie mutuelle des associations (SOGAMA). La SIAGI, quant à elle, intervient dans le secteur artisanal. Outre le partage du risque avec la banque, elle assume un rôle d’expertise.
La garantie représente environ 10 % des 38 milliards de crédits distribués, ce qui ne signifie pas pour autant que les failles de marché représentent 10 % de l’ensemble. Toutefois, selon le dernier rapport de l’observatoire du financement des TPE et de l’institut supérieur des métiers (ISM), en date de février 2014, 75 % à 80 % des demandes de financement des TPE sont satisfaites. La part de demandes non satisfaites s’explique sans doute par de bonnes raisons, notamment économiques, mais aussi par le manque d’éclairages donnés au réseau bancaire.
À cet égard, je voudrais insister sur la différence qui existe entre les mécanismes de garantie et Bpifrance et sur leur complémentarité. Cette différence est nécessaire dans la mesure où le financement de l’économie suppose que le spectre d’intervention soit large, à la fois généraliste et spécialisé.
En quoi sommes-nous complémentaires ? Nous avons décidé, il y a quelques années, de travailler le plus en amont possible de la décision de la banque. Ainsi les chargés de clientèle bancaires nous sollicitent-ils pour se faire une première opinion de la faisabilité d’un projet – sur 10 000 sollicitations, nous en écartons rapidement 2 000, soit parce que le projet ne tient pas la route, soit parce qu’il est dangereux pour l’entrepreneur.
Mais nous intervenons encore plus en amont, puisque nous avons mis en place un dispositif de pré-garantie, pour lequel nous nous appuyons sur les réseaux consulaires et les organisations professionnelles, chargés de réaliser le premier tri économique. Nous nous sommes en fait inspirés des lettres d’intention créées par une société de garantie croate mais, à la différence de cette dernière, qui émet ces lettres directement, nous avons choisi de faire intervenir les corps constitués, afin de bénéficier d’un meilleur maillage du territoire et d’assurer un traitement individuel des TPE. J’ajoute que nous veillons à ce que le coût économique de ce type de dispositifs reste raisonnable. De fait, ces interventions très en amont constituent la partie la plus dépensière de la chaîne de valeur car, pour les 2 000 dossiers que nous écartons, nous avons réalisé une expertise sans être rémunérés.
Par ailleurs, nous partageons avec Bpifrance un quart de nos dossiers, selon la problématique de risque. C’est ici que joue notre complémentarité : la garantie publique intervient lorsque le risque devient moins supportable pour un système mutuel. Je rappelle que les banques privées peuvent assumer environ 80 % des risques, les 20 % restants étant assumés pour une part par le cautionnement mutuel, qui repose sur la solidarité professionnelle, et pour une autre part par la solidarité régionale ou nationale.
M. Jean-Pierre Crouzet, président de l’Union professionnelle artisanale. L’UPA représente 55 branches professionnelles et 1,3 million d’entreprises, qui réalisent 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En outre, une entreprise exportatrice sur trois est une entreprise artisanale. Pourtant, Bpifrance n’intervient qu’auprès d’1,4 % des entreprises de ce secteur. Force est donc de constater que nos entreprises ignorent son existence ; le manque de communication est un véritable problème à cet égard. Du reste, les études réalisées par l’Institut supérieur des métiers et la Direction générale des entreprises (DGE) montrent que le monde de l’artisanat s’autofinance.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Si le préfinancement du CICE a permis de faire connaître Bpifrance à de nombreuses entreprises, cela n’a manifestement pas été suffisant, puisque vous nous dites, monsieur Crouzet, que les entreprises artisanales ignorent son existence. Avez-vous une idée de la manière dont on pourrait les informer ?
Monsieur Cottet, pourriez-vous nous donner quelques éléments sur le coût de la garantie de la SIAGI ? Est-il comparable à celui de Bpifrance ?
Monsieur Gérion, vous avez fait état du défaut de proximité de Bpifrance. Pensez-vous que les chargés de clientèle des banques traditionnelles sont bien informés de ses produits et qu’ils pourraient mieux les faire connaître des entreprises ?
Enfin, monsieur Brin, vous avez évoqué l’amélioration du préfinancement du CICE. Ce processus d’amélioration est-il, selon vous, toujours en cours ou constate-t-on un tarissement de ces financements ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Nous savons que les TPE et les travailleurs indépendants – dont la contribution à la création de richesses, à l’emploi et à l’animation des territoires n’est plus à démontrer – rencontrent des difficultés pour financer leur trésorerie, obtenir des garanties et accéder au financement. Toutefois, Bpifrance n’a pas été concue pour s’adresser directement à l’ensemble des entreprises françaises ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a conclu des partenariats avec des banques commerciales. Néanmoins, les sociétés de caution mutuelles peuvent, grâce à des dispositifs innovants tels que la lettre de pré-garantie de la SIAGI, aider les TPE à avoir accès à ces financements. Dès lors, ne faudrait-il pas « muscler » ces sociétés de cautionnement en leur apportant des moyens supplémentaires afin d’en faire le bras armé du financement des TPE et des travailleurs indépendants ? Par ailleurs, il semblerait qu’il existe actuellement des difficultés d’accès au préfinancement du CICE. Pourriez-vous nous apporter un éclairage sur ce point ?
M. Jean-Pierre Crouzet. N’y voyez pas de l’hostilité envers les startups ou les grandes entreprises, mais force est de constater qu’en dépit des déclarations d’amour adressées aux TPE, la plupart des décisions prises concernent les grandes entreprises : l’activité artisanale et le commerce alimentaire de proximité sont démobilisés. Aussi est-il nécessaire de communiquer en direction de ces entreprises, notamment celles qui exportent, car elles ignorent les aides qu’elles peuvent obtenir de Bpifrance.
Cette communication doit tout d’abord, me semble-t-il, être adaptée à ces entreprises, dont les dirigeants exercent divers métiers : commerçant, investisseur, producteur, manager… Par ailleurs, pourquoi le secteur bancaire de proximité n’informe-t-il pas les entreprises de l’accompagnement dont elles pourraient bénéficier ? Nous nous sommes félicités de la création de Bpifrance, mais son évolution suscite de nombreuses interrogations ; cela ne fonctionne pas. Le secteur de l’artisanat recèle une richesse extraordinaire, certaines branches investissent et, pourtant, Bpifrance n’intervient pas dans ces investissements. Comment expliquer que cette catégorie d’entreprises, qui est majoritaire, ne profite pas d’un tel outil ?
Mme la présidente Véronique Louwagie. Ne serait-ce pas aux réseaux consulaires ou aux organismes professionnels tels que l’UPA d’informer les entreprises plus efficacement ?
M. Jean-Pierre Crouzet. Je ne peux pas m’exprimer au nom des réseaux consulaires mais, pour ce qui est des organisations professionnelles, il est incontestable qu’elles peuvent contribuer à cette communication. En ce qui concerne la médiation du crédit, par exemple, grâce aux échanges que nous avons eus avec la médiatrice, Mme Prost à l’époque, nous avançons progressivement mais très lentement, compte tenu du nombre d’entreprises concernées. Nos organisations professionnelles sont en effet de bons relais pour transmettre ces informations. Encore faut-il que leurs responsables aient des relations avec Bpifrance, ce qui n’est pas le cas actuellement.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Bpifrance ne vous reçoit-elle pas régulièrement ?
M. Henry Brin. S’agissant du CICE, il me semble qu’après les ratés observés lors de sa mise en œuvre, nous sommes parvenus à une certaine stabilité dans les remboursements. Il est vrai que le CICE a permis à nos entreprises de reprendre un peu leur souffle dans la tempête qu’elles traversent, mais elles rencontrent toujours des difficultés de financement.
Tout à l’heure, Mme la présidente a suggéré que les chargés de clientèle des banques pourraient informer les entreprises de l’existence de Bpifrance. Mais, sur le terrain, nous avons le sentiment qu’ils sont davantage concurrents que partenaires. Or, l’artisan entretient une relation privilégiée, de proximité, avec son banquier.
La Fédération française du bâtiment a mené des actions d’information concernant Bpifrance, mais nous nous sommes aperçus que le système n’était pas forcément en adéquation avec les attentes des artisans. Ainsi, le secteur du bâtiment essaie de s’adapter aux priorités définies par le Gouvernement en matière d’innovation, mais nous constatons qu’il n’entre pas dans le cadre défini par Bpifrance. Peut-être faudrait-il faire un effort dans ce domaine afin de permettre à un certain nombre d’artisans de se développer et, au-delà, de trouver des solutions à des problèmes récurrents.
Autre enjeu majeur pour l’artisanat : la transmission d’entreprise. Là encore, Bpifrance aurait un rôle à jouer. Non seulement une entreprise a davantage de chances de réussir lorsqu’elle est transmise que lorsqu’elle est créée, mais la transmission permet de contribuer au lien entre les générations et à la perpétuation des savoir-faire.
M. Michel Cottet. Le coût est la traduction du modèle économique. Il est donc délicat de comparer les coûts de la garantie pour la SIAGI, d’une part, et pour Bpifrance, d’autre part. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, au cours du dernier trimestre 2014, le taux d’intérêt moyen des crédits aux TPE était de 2,65 %. S’y ajoute, lorsque nous intervenons, le coût additionnel du mécanisme de garantie, qui est compris entre 0,60 % et 2,10 %. Le taux maximal, appliqué notamment à une création d’entreprise, devrait même être beaucoup plus élevé, mais nous réalisons une péréquation afin de permettre un accès au crédit à un prix mesuré. Bpifrance, quant à elle, applique un taux qui se situe entre 0,45 % et 0,60 %, quelle que soit la finalité du financement.
Ce différentiel s’explique par le fait que Bpifrance délègue la décision alors que la SIAGI se déplace et rencontre les entreprises : cela a un coût, que nous répercutons sur le bénéficiaire de la garantie. M. Dufourcq vous a indiqué, lors de son audition, que la garantie coûtait 100 millions d’euros par an à Bpifrance, sans rien lui rapporter. Nous, nous nous devons d’être rentables.
J’ajoute que, pour éviter que l’amplitude ne soit trop importante, nous sommes obligés de conquérir des risques de bonne qualité pour financer les risques de moins bonne qualité. Cela paraît facile sur le papier, mais les taux d’intérêt étant très bas, la concurrence entre banques est assez féroce et le choix du mécanisme de garantie dépend, sauf dans le cas de la lettre de pré-garantie, de la banque.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. La lettre de pré-garantie a précisément ceci d’intéressant qu’elle permet à l’entrepreneur de se présenter devant un banquier en disposant déjà d’une garantie, ce qui peut favoriser l’acceptation de son projet.
M. Michel Cottet. Au plan micro-économique, cet outil nous permet de capter un flux en amont et, au plan macro-économique, c’est un remède à l’autocensure des entreprises et des banques, dont nous facilitons le travail puisque la lettre de pré-garantie comprend l’analyse économique du projet réalisée par les réseaux consulaires et professionnels. Il s’agit donc d’un passeport qui bénéficie d’un véritable label, car nous avons une obligation de résultat. Dès lors que, lorsque nous accordons une garantie, nous nous engageons à indemniser la banque en cas de défaillance. Je précise que la SIAGI donne, dans la lettre de pré-garantie, une garantie minimale de 20 %, à laquelle on ajoute un quantum supplémentaire selon les régions, en fonction des accords bilatéraux conclus avec chaque organisme. Si Bpifrance pouvait ajouter automatiquement 20 % à 30 %, chacun jouerait un rôle de levier et contribuerait au maintien de l’écosystème.
M. Jean-Pierre Crouzet. Je souhaitais évoquer un autre sujet, celui de la fiscalité des entreprises de l’artisanat. En effet, 60 % d’entre elles sont assujetties, non pas à l’impôt sur les sociétés (IS), mais à l’impôt sur le revenu (IR). Leur bilan ne fait donc pas apparaître de fonds propres, ce qui suscite l’incompréhension de leurs interlocuteurs lorsqu’elles présentent un dossier de financement. À ce propos, monsieur Grandguillaume, le rapport de la commission ad hoc créée lors des assises de la fiscalité, dont vous étiez membre, devait être connu avant le 30 juin 2014 ; or, nous ne l’avons toujours pas eu. Vous savez que nous sommes opposés au système actuel, que nous jugeons injuste dans la mesure où les capitaux réinvestis sont soumis aux charges sociales. En tout cas, on ne peut que déplorer que nos interlocuteurs bancaires ignorent les caractéristiques propres aux très petites entreprises.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Il est vrai que le rapport de ce groupe de travail aurait dû nous parvenir il y a déjà six mois. La création du statut unique de l’entrepreneur individuel, qui a fait l’objet d’un engagement collectif, permettrait, au-delà de l’amendement au projet de loi Macron sur la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels, d’aller plus loin en matière de fiscalité, et donc de faciliter la compréhension par les différents acteurs de ce qu’est une entreprise individuelle. J’attends, comme vous, avec impatience, que le Gouvernement nous transmette les conclusions du groupe de travail, et j’espère qu’il respectera ses engagements.
En ce qui concerne le financement, la lettre de pré-garantie me paraît intéressante, dans la mesure où elle est émise a priori et non a posteriori, comme le fait Bpifrance, qui intervient à la demande de la banque commerciale. Il me semble que c’est le cœur du problème.
M. Patrick Gérion. Il est bien évident que l’ensemble des commerciaux des réseaux bancaires connaissent les conventions TPE qui ont été signées avec Bpifrance mais, pour eux, celle-ci est davantage une procédure qu’un établissement. À mon avis, ce n’est pas par leur intermédiaire que l’on rapprochera Bpifrance des très petites entreprises.
Par ailleurs, nous avons constaté un renchérissement important du coût de la garantie de Bpifrance. Je précise que cette garantie est prise au début du crédit et qu’elle est payée flat, quoi qu’il arrive, alors que notre organisme facture sa garantie à l’entreprise à échéances régulières, de sorte que si celle-ci ne peut plus payer, nous percevons plus de commission. Il s’agit, selon moi, d’une petite distorsion. J’ajoute que nous vivons surtout grâce aux fonds de garantie que nous faisons souscrire aux bénéficiaires lorsque nous leur accordons un cautionnement et que nous leur remboursons à la fin du prêt. Ce n’est donc pas une charge, alors que le coût de la commission de Bpifrance, qui est très important, en est une et apparaît en tant que telle dans le compte de résultat de l’entreprise le jour où le crédit est accordé, c’est-à-dire au moment où elle est le plus fragile.
Enfin, je le répète, nous souhaiterions avoir une vision globale du coût du risque de Bpifrance. Nous avons, quant à nous, toujours restitué les fonds de garantie : notre exploitation permet de couvrir le risque. En revanche, nous ne parvenons pas à savoir quels prélèvements Bpifrance opère sur les fonds publics au titre de la sinistralité.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je suppose que le paiement de la garantie s’effectue au rythme des échéances du prêt ?
M. Patrick Gérion. Chez nous, oui. Bpifrance adresse à l’entreprise une seule facture lorsque le crédit est accordé, et cette facture peut représenter jusqu’à 3 % à 4 % du montant du crédit.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur Brin, si, comme vous nous l’avez dit, les organismes financiers et Bpifrance sont en concurrence, il paraît difficile que les chargés de clientèle soient les relais naturels de Bpifrance auprès des TPE et des PME. Avez-vous des exemples précis à nous citer ou s’agit-il plutôt d’un ressenti ?
M. Henry Brin. Il s’agit d’un ressenti, mais il est confirmé par la réalité du terrain. Lorsque l’artisan fait appel à son banquier pour avoir de la trésorerie, il a souvent besoin d’une réponse très rapide. Or, Bpifrance n’est pas très réactive. Je connais par ailleurs des entreprises qui se sont tournées vers Bpifrance, en vain, car le système est trop complexe. Encore une fois, on a le sentiment que les organismes financiers et Bpifrance sont plus concurrents que partenaires.
M. Michel Cottet. La garantie n’est pas une formule innovante puisqu’elle existe depuis très longtemps, mais il est possible de trouver des formules novatrices en matière de financement. M. Crouzet a rappelé tout à l’heure qu’un quart des entreprises artisanales autofinançaient leurs investissements en ponctionnant leur trésorerie. Fort de ce constat, nous avons créé une garantie a posteriori, la « garantie relais », qui intervient dans le cadre d’un prêt accordé à l’entreprise pour qu’elle reconstitue sa trésorerie. La première opération, d’un montant de 40 000 euros, a concerné une entreprise du Loiret qui fabrique des billots de boucher pour les particuliers.
M. Jean-Pierre Crouzet. Je souhaiterais revenir sur la transmission et la reprise d’entreprise, car c’est un sujet important. Les repreneurs sont souvent des salariés qui ont suivi une formation initiale mais qui n’ont pu capitaliser – c’est aujourd’hui impossible – pour disposer des fonds nécessaires à la reprise. Il me semble que Bpifrance pourrait intervenir dans ce cadre, à condition, bien entendu, qu’elle soit connue et puisse être sollicitée. Elle éviterait ainsi au repreneur d’effectuer un véritable parcours du combattant ou d’aller chercher des fonds en amont, chez des fournisseurs, ce qui n’est pas très sain.
M. Patrick Gérion. C’est un point très intéressant. Il est d’ailleurs paradoxal que Bpifrance ait décidé d’abandonner les Prêts aux créateurs d’entreprise (PCE). Ces prêts scorés, d’un montant compris entre 10 000 et 50 000 euros, s’étendaient, me semble-t-il, à la transmission d’entreprise.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Messieurs, je vous remercie pour votre participation à cette table ronde.
Audition du jeudi 9 avril 2015
M. Gaspard Koenig, président de Génération libre, M. Sébastien Laye, entrepreneur et Mme Delphine Granier, analyste
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons maintenant M. Gaspard Koenig, président de Génération libre, M. Sébastien Laye, entrepreneur, et Mme Delphine Granier, analyste.
Le think-tank Génération libre a publié en juillet 2014 une analyse très critique du rôle confié à la Banque publique d’investissement (BPI) et de son action, qui s’intitulait de façon très parlante : Bureaucratie, Protectionnisme, Inefficacité : Pour en finir avec l’interventionnisme public débridé, rapport auquel d’ailleurs la banque publique a répondu.
Depuis cette date, vous avez mis en place un observatoire Bpiwatch qui suit l’actualité des investissements de la BPI. Je propose de vous laisser la parole sans plus tarder pour que vous nous fassiez part de vos analyses les plus récentes sur ces questions.
M. Gaspard Koenig, président de Génération libre. Nous sommes très honorés que vous preniez le temps de nous recevoir. Je vous présenterai les motivations qui ont inspiré ce rapport, avant que Sébastien Laye vous présente le détail technique de nos analyses concernant l’activité de la BPI et nos recommandations.
Génération libre est un think-tank qui défend le libéralisme français classique. La BPI s’est logiquement imposée à nous comme un objet de réflexion. L’institution vise-t-elle à pallier prudemment les carences de marché ou produit-elle au contraire des effets de long terme dommageables sur l’économie française ?
Le président de la République a déclaré en janvier, devant les représentants de la BPI : « En deux ans, vous avez construit une banque presque unique en Europe, qui a assuré une bonne part du financement des entreprises de notre pays. Ce bilan est impressionnant, car la BPI a augmenté de 30 % le volume de ses prêts ». À nos yeux, c’est précisément cet interventionnisme qui pose problème, tout comme l’impression que nous avons qu’elle aurait pour objectif de financer le plus possible les entreprises.
Lorsque Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI, déclare dans des conférences qu’il est un banker for entrepreneurs et que sa mission est de faire du bon business, il nomme justement ce qu’il ne doit pas être ou ne doit pas faire. Car l’État doit aller là où des problèmes de financement se posent, pour prendre les risques qui ne peuvent être assumés par le secteur privé. Des investisseurs et des entrepreneurs ont réagi à la publication de notre rapport, sous le couvert de l’anonymat, la BPI pouvant exercer des pressions dans le milieu des affaires. Leurs réactions nous ont donné l’idée de créer l’observatoire BPIWatch. Ces investisseurs nous ont dit avoir été chassés de certains marchés du fait de l’intervention de la BPI, qui prêtent à des taux ou à des conditions plus avantageuses que les leurs.
En outre, si la BPI n’est pas première au tour de table des investisseurs, les acteurs privés prennent peur et ne se risquent plus à investir dans un projet, la BPI apportant pour ainsi dire une garantie parapublique. D’autres entrepreneurs ont témoigné de ce que, levant du capital auprès de fonds de private equity, ils vont vu la BPI forcer la porte de leurs projets d’investissement en prenant l’ascendant grâce aux conditions avantageuses qu’elle peut offrir. Ces exemples peuvent paraître anecdotiques et devraient être quantifiés ; ils n’en sont pas moins révélateurs, comme notre rapport s’efforce de le montrer.
La question de la BPI est au cœur du modèle français et renvoie à des débats vieux de plus de deux siècles : faut-il encourager les acteurs privés ou leur préférer des institutions publiques ? Ainsi, en 1770, sur le sujet épineux du commerce des grains, Turgot critiquait, dans l’une de ses lettres à l’abbé Terray, l’extravagance qu’il y aurait à créer une compagnie publique en charge des grains, qui ne servirait qu’à produire, par les moyens les plus compliqués, les plus dispendieux, les plus susceptibles d’abus de toute espèce, les plus exposés à manquer tout à coup, précisément ce que le commerce laissé à lui-même doit faire infailliblement à infiniment moins de frais et sans aucun danger.
Remplacez grain par capital-risque et vous aurez une description à peu près exacte de l’activité de la BPI. Il y a certes un problème de financement du capital risque en France. Selon une étude récente d’Ernst & Young, ce marché s’est contracté en France de 8 % en 2014, alors qu’il augmente dans d’autres pays. Mais, s’il faut trouver une solution à ce problème, c’est en amont, dans le domaine de la réglementation et de la taxation, plutôt qu’en aval.
L’on connaît pourtant la conception explicitement à l’origine de la BPI. Dans son livre La Bataille du made in France, son père fondateur Arnaud Montebourg explique qu’il entendait lutter contre le modèle libéral financier – entendez : le secteur privé. « Lentement, sûrement », écrit-il, « l’État redevient le grand frère associé des entrepreneurs ». C’est bien notre crainte !
La BPI est très présente dans le paysage du private equity français, en participant à un financement de fonds propres sur dix. Cette proportion pourrait monter à 30 % ou 50 % s’agissant des PME. Pendant ce temps, Nicolas Dufourcq s’aventure à dire qu’il y a trop de fonds de capital-risque en France ... Sébastien Laye vous exposera les problèmes concrets qui se sont posés depuis la naissance de la BPI. Selon nous, la BPI crée des effets de distorsion de marché et d’éviction du secteur privé, qu’une banque publique responsable et raisonnable devrait éviter.
À la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD des comités évaluent chaque projet pour apprécier s’ils détruisent ou pas d’activité privée et s’il est légitime d’investir. Même si tout n’est pas parfait à la BERD, force est de constater que de tels garde-fous n’existent pas à la BPI. J’ai été frappé de voir qu’elle fait sa publicité, sur le quai de l’Eurostar, par une affiche qui annonce : Entrepreneurs, venez à nous. La BPI va ainsi jusqu’à faire sa promotion alors qu’elle ne devrait intervenir qu’en dernier recours.
M. Sébastien Laye, entrepreneur. Je m’exprimerai à un double titre, comme membre de Génération libre, mais aussi comme entrepreneur. Notre think-tank a conduit sous trois formes, des travaux sur la BPI. D’abord, il a publié le rapport de juillet 2014 que le magazine Challenges a couvert ; la BPI a réagi à cette parution, ou plutôt au résumé qui en était donné dans cet organe de presse. Ensuite, nous avons mis en place un observatoire de la BPI qui, depuis dix mois, analyse cas par cas ses décisions d’investissement ; il s’est penché sur le soutien apporté à Viadeo ou sur les pertes de capital constatées sur certaines lignes dans le portefeuille d’investissement de la BPI. Enfin, Génération libre a conduit récemment une comparaison entre la BPI et la BERD.
Le rapport de juillet 2014 est le fruit d’un travail engagé en janvier de la même année. La première partie est consacrée à BPI Investissement. Dans la deuxième partie, nous saluons le recadrage opéré grâce à la création de la BPI, mais déplorons des failles dans la gouvernance et les structures, pouvant faire naître des conflits d’intérêts. Nous ne reviendrons pas sur chacun d’eux, mais nous efforcerons de montrer que, parce que les règles actuelles sont défaillantes, une latitude trop grande est laissée aux hauts fonctionnaires au détriment des hommes politiques, qu’ils appartiennent à l’exécutif ou qu’ils soient parlementaires. Des dérives ont ainsi pu être constatées et d’autres le seront encore sans nul doute à l’avenir. La troisième partie formule des propositions de recadrage des missions de la BPI.
Je souligne que la décision de créer le Fonds stratégique d’investissement (FSI) avait été prise sous la législature précédente. Il s’agissait de s’inspirer du modèle des fonds souverains qatari ou norvégien. Nous avons depuis longtemps jugé cette idée irréaliste. Notre pays ne dispose pas d’une manne pétrolière ou d’excédent budgétaire à réinvestir, bien au contraire. Peut-être l’existence du FSI se justifiait-elle en 2009, mais il faudrait sans doute réévaluer la situation aujourd’hui pour mieux encadrer ses activités. S’il peut être légitime de défendre des intérêts industriels stratégiques, il est permis de douter que des opérations de financement de Daily motion entrent dans cette catégorie, plutôt que des investissements dans Alstom. Mais, comme il n’existe pas de définition législative du secteur stratégique, une large latitude est laissée aux responsables de la BPI.
L’ex-FSI a donné naissance à BPI Investissement, dont les participations sont diluées dans l’actif global de la BPI. La fusion n’a entraîné tout au plus qu’une liquidation de quelques lignes comptables, tandis que des investissements nouveaux étaient réalisés dans Naturex ou CMA-CGM (Compagnie maritime d’affrètement – Compagnie générale maritime). Nous sommes donc en présence d’une sorte particulière de jardin à la française, d’une mégastructure qui coiffe l’empilement des entités existantes, sans que des choix aient été opérés ni que soit posée la question du retour sur investissement.
Nous saluons la volonté politique d’aider les petites et moyennes entreprises plutôt que les grandes. Mais la BPI a continué en pratique de s’impliquer dans des entreprises comme Vallourec ou Eramet. La loi de décembre 2012 lui donne en effet un mandat trop vague, laissant l’institution s’engouffrer dans tout le champ des investissements. Institution unique au monde, à défaut d’être sans précédent dans l’histoire de France, elle pratique à la fois la participation aux fonds propres, le prêt direct, la garantie de prêts, l’investissement dans des fonds et même le soutien à l’export, par une récupération des tâches de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE). Nulle part ailleurs vous ne trouverez d’entité couvrant un champ de compétences aussi large, qu’il s’agisse de fonds souverains ou de banques publiques.
Se pose alors la question des conflits d’intérêt, qui naissent d’eux-mêmes lorsqu’une même entité est à la fois actionnaire d’une entreprise, prêteuse à cette entreprise et encore partie à des fonds minoritaires dans le capital de cette entreprise. En cas de difficultés financières ou de faillite de l’entreprise financée, quel intérêt doit primer, entre celui de l’actionnaire, du créancier ou du fonds qui investit ? Il s’agit d’un problème de gouvernance.
La loi du 31 décembre 2012 donne une liste des missions qui ressemble à un inventaire à la Prévert : « La Banque publique d’investissement favorise l’innovation, l’amorçage, le développement, l’internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres. Elle oriente son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel. Elle accompagne la politique industrielle nationale. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire. Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. Elle favorise une mobilisation de l’ensemble du système bancaire sur les projets qu’elle soutient. » La BPI n’a en fait aucun mandat précis.
Le rapport s’étend ensuite sur le problème de la gouvernance, le manque d’encadrement par les autorités politiques et la trop grande latitude laissée aux équipes de Nicolas Dufourcq. Dans une troisième partie, nous recommandons enfin la création d’une commission qui pourrait réfléchir à une modification de la loi portant création de la BPI, et nous proposons notre propre liste de missions pour la BPI.
Selon nous, elle n’a pas sa place au capital des entreprises. Mieux vaut qu’elle finance l’innovation de long terme dans le domaine de la recherche, des biotechnologies, des nanotechnologies, de la recherche médicale et de la transition énergétique. Peut-être conviendrait-il de réfléchir à la manière dont ces investissements pourraient s’articuler avec les programmes d’investissement d’avenir (PIA) et avec le plan Juncker au niveau européen, même s’ils devraient être spécifiquement concentrés sur le financement de l’innovation de long terme, et non sur des grands projets d’infrastructures.
À la BERD, non seulement des comités de crédit rigoureux se prononcent sur les décisions de financement, mais des comités d’évaluation économique examinent d’abord en amont de toute intervention si le secteur privé n’offre pas lui-même ce type de financement. Car la BERD n’intervient que s’il n’est pas présent et qu’il n’est pas à même d’assurer ce financement de long terme. A contrario, la BPI intervient à l’heure actuelle, sa doctrine ayant évolué, lorsque le secteur privé est déjà présent, puisqu’elle réalise des co-investissements avec des fonds. Elle se repose même sur les équipes de ces fonds pour l’analyse des projets (due diligence). Elle n’a pas de véritable philosophie d’investissement, mais une simple doctrine d’intervention qui se résume à un document interne dépourvu de valeur juridique. Une révision de la loi pourrait fournir l’occasion de définir une philosophie d’investissement qui permette un meilleur encadrement.
À notre sens, la BPI pourrait, plutôt que d’accorder directement des prêts, jouer un rôle de multiplicateur de crédits dans l’économie française, comme le fait en Allemagne le KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), qui consacre 90 % de son activité à refinancer les institutions de crédit local. La BPI aiderait par exemple les branches de la Banque populaire à financer le logement social ou des opérations se rattachant à la transition énergétique. Grâce à sa surface financière, l’État viendrait ainsi en aide aux acteurs du crédit, mais sans prendre directement de décisions de prêt ou d’octroi de crédits.
Ainsi, nous ne préconisons pas la disparition de la BPI, mais sa réorientation suivant des choix clairs qui lui confieraient un rôle de multiplicateur de crédits et de financement de l’innovation. Quant à reprendre la vieille antienne de la banque publique présente au capital des entreprises, cela nous ramène au temps du Crédit lyonnais et de ses errances.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie. BPI France avait publié dans le journal Challenges un droit de réponse à votre publication. Pourriez-vous nous faire part de votre propre réaction à cette réponse ?
Le capital de BPI France se partage par moitié entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’État. Pensez-vous que cette répartition du capital, avec la gouvernance qu’elle implique, est l’une des causes des dérives que vous déplorez ?
Un article du 24 mars 2015 de Génération Libre a constaté que le capital-risque a baissé de 8 % en 2014 par rapport à 2013 et vous avez pointé du doigt l’inefficacité de BPI France dans ce domaine. Que recommanderiez-vous pour améliorer l’activité du capital-risque ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Admettez-vous qu’il existe des failles de marché et, si oui, lesquelles ? D’une manière générale, à partir de quand l’État peut-il selon vous intervenir ?
Je serais heureux que vous nous donniez des exemples de conflits d’intérêts. Pensiez-vous aux situations où la BPI participe à la fois au capital des donneurs d’ordre et à celui des sous-traitants d’un même projet ?
Que proposez-vous pour améliorer la gouvernance de BPI France ? Vous évoquez un risque de politisation : comment peut-on y remédier ?
Enfin, croyez-vous à un effet de levier du financement de la BPI si l’encadrement était plus strict ? Recommanderiez-vous l’abandon de sa doctrine de cofinancement ?
M. Éric Alauzet. Je retire de votre intervention liminaire, monsieur Koenig, que vous reprochez à BPI France de livrer une concurrence déloyale aux autres institutions de crédit. Faut-il considérer que son activité est nuisible à la société en général, aux autres acteurs, à la logique de développement ? Pourriez-nous vous nous préciser en quoi et quels sont exactement les effets négatifs ?
Alors que les conflits d’intérêts découlent d’une détention de capital conjointe avec une activité de prêt, vous paraissez soutenir que les fonds seraient mieux utilisés s’ils n’étaient pas stérilisés au capital de certaines sociétés qui n’auraient pas besoin de la présence de la BPI. Comment pourraient-ils être employés en pratique dans les secteurs d’avenir, comme la recherche, et dans le domaine de l’innovation ?
M. Gaspard Koenig. Oui, monsieur le député, nous considérons que la BPI se livre à une concurrence déloyale. Elle finance des activités de private equity avec des moyens publics, évinçant ainsi des concurrents privés. Un propriétaire de start-up dans le secteur numérique, dépourvue de tout lien avec l’innovation ou avec les nanotechnologies, s’est trouvé, levant des fonds pour son développement, devoir de signer avec la BPI un protocole de financement, car celle-ci est devenue un acteur incontournable, offrant des conditions si avantageuses que les intérêts de son entreprise lui dictent pour ainsi dire ce choix. Il n’ose donc plus s’exprimer publiquement au sujet de la BPI, sur les activités de laquelle règne ainsi une forme d’omerta.
M. Éric Alauzet. Permettez-moi de vous demander, comme législateur en charge de l’intérêt général, si vous admettez défendre des intérêts particuliers ?
M. Gaspard Koenig. Aucunement. Notre think-tank est financé de manière indépendante – et minimale – par des personnes qui n’ont rien à voir avec la BPI et avec ses activités. Nous nous intéressons à beaucoup d’autres thèmes, comme la liberté d’expression, la Caisse des dépôts et consignations ou encore le revenu universel. La voix que nous portons est une voix peu portée et peu entendue. Un certain consensus politique existe sur la BPI. Un rapport en opposition aussi frontale à l’opinion dominante n’aurait pu être publié par un autre think-tank, car les autres fondations sont financées de manière différente. Mais je reconnais que nous tirons nos arguments au maximum pour clarifier notre voix. Dans la suite de la discussion, nous sommes conscients du besoin de nuancer et nous avons formulé des propositions concrètes.
M. Sébastien Laye. Quant au droit de réponse exercé par la BPI, madame la présidente, je dirais que c’est manquer de respect aux autorités politiques que de prétendre que « les présidents de région ne décident d’aucun financement particulier ». Ces derniers veulent, comme il est légitime, attirer des investissements dans leur région. Qui se connecte sur le site de la région Bourgogne y lira ainsi que la région mobilisera très prochainement BPI afin de mettre en place de nouveaux outils d’investissement en Bourgogne. Il y a donc bel et bien une co-gouvernance avec les autorités politiques. Nous déplorons même qu’elles ne contrôlent pas plus étroitement le travail des hauts fonctionnaires.
Aussi Nicolas Dufourcq a-t-il tort, quand il répond au magazine Challenges, de se présenter comme le gérant d’un fonds classique, dénué de dimension politique, tels Blackstone ou BlackRock. S’il a déclaré que « les lignes de l’ancien FSI ne sont pas de si mauvais investissements pour le patrimoine des Français puisque les cessions ont rapporté en 2013 quatre cents millions d’euros de plus-value », force est de constater qu’un milliard d’euros ont été perdus depuis cette date dans Eramet, CGC, Vallourec ou encore Technip.
L’État doit-il vraiment être un gérant de hedge fund pour générer des plus-values ? Je ne le crois pas ; ce n’est d’ailleurs pas la fin poursuivie par l’établissement du FSI puis de la BPI. Nous avons formulé quelques propositions à périmètre et à budget constant pour l’État. Nous suggérons qu’il opère une sélection dans ses 6 milliards d’euros de participations cotées. Qu’il possède 26 % ou 15 % d’Eramet ne change pas grand-chose pour lui, mais les fonds ainsi dégagés, aux environs de trois ou quatre milliards d’euros, pourraient être mobilisés pour d’autres projets.
Nicolas Dufourcq se défend de ce que l’action de Bpifrance au service de l’innovation et des start-ups relèverait de la seule communication, en soulignant que la France se hisse au premier semestre 2014 au deuxième rang en Europe dans le domaine du capital-risque. Malheureusement, le capital-innovation a diminué en France de 8 % sur l’ensemble de l’année 2014, contrairement à ce qu’il annonçait. Faut-il considérer que la BPI comble dès lors un vide énorme ou, au contraire, qu’elle évince encore les entrepreneurs et les sociétés de capital-risque ? En d’autres termes, la situation serait-elle pire sans la BPI ou décourage-t-elle en réalité l’initiative privée dans le domaine du financement de l’innovation ?
Il nous est également reproché de ne pas faire de présentation ex ante à la BPI des analyses de notre observatoire BPIWatch. En réalité, ils ont été informés, puisque nous avions rencontré M. Antoine Boulay, directeur des relations institutionnelles de la BPI.
M. Gaspard Koenig. Nous sommes en effet en contact régulier avec le département de communication de la BPI et nous nous sommes engagés auprès d’eux à transmettre vingt-quatre heures avant leur publication nos analyses des investissements de la BPI, de façon à laisser à l’institution la possibilité de signaler des erreurs matérielles que nous nous faisons alors un devoir de rectifier.
M. Sébastien Laye. Pour reprendre sur la revue critique des activités de la BPI et les besoins réels des entreprises en France, je dirais qu’en matière d’export, aucun problème particulier n’est à signaler. Au contraire, la COFACE fait un travail admirable et mérite de n’être pas déshabillée de ses compétences au profit de la BPI. En matière d’amorçage, des problèmes existent, mais je ne saurais dire si la BPI est vraiment la mieux armée pour les résoudre, car il s’agit surtout de mieux flécher et de mieux orienter l’épargne des ménages français. La BPI s’est en revanche saisie à juste titre de la question de l’affacturage. Les délais de paiement des clients posent en effet des problèmes aux entreprises, y compris quand ces clients sont les pouvoirs publics. La Banque postale a d’ailleurs lancé une initiative concernant les créances de ce client particulier qu’est l’État.
Quant au financement des entreprises en France, les règles de Solvabilité II ont, depuis la crise, imposé aux banquiers et aux assureurs des limites qui ne les incitent pas à investir dans des secteurs risqués. La fiscalité a elle aussi évolué depuis trois ans, celle du capital étant alignée sur celle du travail, tandis que les gains sur le capital étaient davantage taxés. Il y aurait une réflexion à conduire sur l’articulation entre ces règles et les besoins des entreprises, d’autant qu’avec la création de la BPI, l’État paraît maintenant donner tout à coup d’une main ce qu’il avait pris de l’autre.
La partage paritaire entre la CDC et l’État dans la répartition du capital de la BPI est héritée du FSI. Si des participations aux fonds propres des entreprises sont vendues, la question de la présence de la CDC se posera naturellement. Mais il s’agit d’un point technique et, en l’état actuel, la participation de la CDC ne constitue pas à nos yeux un frein au développement de la BCI, sur le plan de la gouvernance.
Génération libre demande que les autorités politiques, tant les membres de l’exécutif que les parlementaires, se saisissent de la question de la BPI. Une commission composée de parlementaires et d’experts indépendants pourrait réfléchir à une modification de la loi portant création de la BPI et définir de manière claire les missions qu’elle lui assigne. Le pouvoir politique n’ayant pas jusqu’à présent donné ces indications, la BPI a pu jouer beaucoup de rôles différents, faisant naître le risque de conflits d’intérêts. Son directeur général a pu ainsi étendre l’emprise de ses activités.
Il convient désormais d’en définir et d’en circonscrire les missions. En outre, il faudrait définir une philosophie d’investissement et instituer à la BPI des comités de crédit rigoureux tels que ceux de la BERD. Dans cette dernière, des comités d’économistes et d’investisseurs se prononcent en outre systématiquement, au-delà d’un certain montant d’investissement, sur la carence de l’offre privée et sur l’opportunité corollaire d’une intervention financée par des moyens publics. Leurs appréciations sont au demeurant accessibles aux citoyens.
M. Gaspard Koenig. J’ajoute qu’ils jouissent, au sein de la banque, d’une complète indépendance institutionnelle.
M. Sébastien Laye. La question de la diffusion d’une information librement accessible et exploitable se pose. Génération libre avait imaginé un projet d’ouverture des données (open data). Dans le rapport annuel de la BPI, vous trouvez l’annonce de chiffres records, mais aucune information sur les critères d’investissement, leur masse, leur taux de rendement ou encore l’actif net. Toutes ces données figurent dans le rapport annuel du fonds souverain norvégien. Le législateur devrait imposer un minimum de reporting financier à la BPI.
La pratique du cofinancement s’est développée du fait de l’absence de mission précise assignée à la BPI. Si elle ne devait légalement intervenir que là où le secteur privé n’est pas présent, il n’y aurait jamais de cofinancement. Que ferait d’ailleurs la BPI si le secteur privé n’intervenait pas ? Elle se contente de se reposer sur les fonds privés pour l’analyse des projets d’investissement. Le meilleur moyen d’encourager le développement du capital-innovation serait plutôt de revisiter Bâle III, Solvency II et les dispositions fiscales.
M. Gaspard Koenig. Nous estimons que des travaux de recherche plus poussés seraient sans doute nécessaires sur les points que nous évoquons, mais nous sommes persuadés de soulever du moins les bonnes questions.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous estimez que le financement de l’export ne pose pas de problème, la COFACE répondant aux besoins des entreprises. Or Nicolas Dufourcq a précisément défini le financement de l’export comme priorité pour 2015. Qu’en pensez-vous ? Par ailleurs, votre observatoire des activités de la BPI a-t-il relevé des disparités entre les situations d’une région à l’autre ?
Enfin, comment se définit un comité de crédit plus rigoureux ? Jugez-vous que la BPI adopte aujourd’hui une approche trop financière et pas assez économique ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Vous mettez en balance les failles de marché rendant une intervention publique nécessaire et le risque d’éviction que cette intervention fait courir à l’égard des investisseurs privés. Dans ces circonstances, estimez-vous que le cofinancement est une bonne chose ou non ?
M. Éric Alauzet. Vous nous dites que l’argent serait mal utilisé, voire stérilisé, ou qu’il serait du moins mieux employé autrement. Comment peut-il être concrètement employé différemment ? Qui peut conduire des aventures plus prospectives, plus novatrices ? La BPI en est-elle capable ?
M. Sébastien Laye. Dans notre rapport, nous ne formulons pas de critique sur le soutien à l’export. Avec la faiblesse actuelle de l’euro, qui améliore mécaniquement la position des exportateurs de la zone euro, il s’agit d’un non-sujet. J’attends de voir ce que la BPI peut apporter dans ce domaine. L’idée de procéder à une simplification administrative et de créer un guichet unique, englobant donc aussi le soutien à l’export, était sans conteste une idée salutaire. Peut-être la BPI est-elle un bon cadre pour ce soutien.
J’attire cependant votre attention sur le fait que multiplier les activités et faire feu de tout bois, c’est courir le risque de tout faire mal. Il me paraît difficile de suivre à la fois toutes ces lignes d’investissement comme actionnaire, de prêter, de conseiller les entreprises et de les accompagner à l’export…
Quant aux comités de crédit, je souligne que la BPI se prononce aujourd’hui sur la base de critères qui ne sont pas connus. Qu’ils soient financiers ou d’autre nature, les citoyens doivent avoir accès à cette information. Or aujourd’hui, la direction de la communication institutionnelle nous signale seulement que la BPI n’est pas tenue de l’offrir. Nous ne prétendons pas définir ces critères d’avance, mais une discussion doit au moins s’engager sur eux avec les membres de l’exécutif et avec les parlementaires.
Le cofinancement est une réponse ad hoc et pragmatique à l’absence d’une philosophie d’investissement qui soit inscrite dans le marbre. Il procède d’une décision des dirigeants de la BPI, qui s’épargnent ainsi le soin de conduire leurs propres travaux d’investigation et de due diligence. Le choix qu’elle a fait va à l’opposé de celui de la BERD. Cette dernière investit seule là où le financement privé fait défaut, mais s’efface dès qu’il existe.
M. Gaspard Koenig. Nous devrons nous pencher à nouveau sur la question du refinancement. En soi, il ne constitue pas un problème, mais il peut faire naître aussi bien un effet d’éviction qu’un effet d’entraînement. Si je puis apporter cette précision, la BERD pratique d’ailleurs elle aussi le cofinancement.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Et quant aux éventuelles disparités régionales qu’aurait pu relever votre observatoire ?
M. Sébastien Laye. Nous n’en avons pas décelé, mais nous sommes plutôt intéressés à des cas nationaux.
M. Gaspard Koenig. Pour ce qui est d’une meilleure utilisation des fonds, je voudrais rappeler que des fonds sont eux-mêmes levés sur les marchés, c’est-à-dire empruntés, par la BPI. Le but d’une institution publique ne peut être de financer toujours plus. Au contraire, il doit être possible de dépenser moins ; cela ne doit pas constituer un sujet de préoccupation. Le refinancement étant chose facile aux banques publiques, qui jouissent de conditions de crédit très favorables par rapport aux autres banques, la masse de financement accordé ne saurait être ni une preuve de qualité, ni un critère pour juger du bien que la BPI peut faire à l’économie.
M. Sébastien Laye. Pour l’emploi des trois milliards qui seraient dégagés par la cession de certaines participations, je voudrais dire que le secteur privé assure déjà en France le financement des projets d’innovation tels que le covoiturage de type BlaBlaCar, la BPI n’intervenant que par surcroît. Mais l’innovation de rupture sur le long terme –un chercheur qui veut développer une molécule contre le cancer– peine quant à elle à être financée, car le secteur privé n’est pas présent sur ce segment de marché. Peut-être est-ce un domaine où la BPI devrait s’impliquer davantage.
M. Éric Alauzet. La BPI est-elle outillée pour cela ? Dispose-t-elle des équipes nécessaires ?
M. Sébastien Laye. À vrai dire non. Mais elle ne dispose pas plus d’équipes pour orienter ses investissements dans les fonds propres des entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions, messieurs, de vos interventions.
Audition du jeudi 16 avril 2015
Table ronde sur les fonds d’investissement : M. Michel Chabanel, président de l’association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), M. Paul Perpère, délégué général de l’AFIC, Mme Françoise Palle-Guillabert délégué général, de l’ASF, association française des sociétés financières et M. Philippe Audouin, Président de la DFCG - Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion
Mme la présidente Véronique Louwagie. Mesdames et Messieurs, nous avons déjà abordé avec la BPI la question de ses investissements, directs ou via des fonds de fonds. Nous souhaitons ce matin disposer du regard de professionnels du capital-investissement sur le rôle de la BPI dans ce domaine pour répondre à plusieurs questions : que doit-on attendre d’une banque publique sur ce marché ? Avec quelle efficacité la BPI intervient-elle et quelles sont les limites de ses interventions ?
M. Michel Chabanel, président de l’association française des investisseurs pour la croissance (AFIC). L’AFIC représente les investisseurs en capital en France, depuis les investisseurs en capital innovation – finançant les start-up notamment –, en passant par le capital-développement, jusqu’au capital-transmission. Les entrepreneurs qui partent à la retraite ont, en effet, besoin d’assurer la transmission de leur société. Nos membres exercent également des activités connexes comme le capital-investissement dans les infrastructures. L’AFIC compte aujourd’hui 272 membres actifs, dont Bpifrance, et 159 membres associés qui sont des experts-comptables, des consultants ou des intermédiaires qui accompagnent les entreprises. L’AFIC existe depuis 31 ans avec pour rôle de représenter et de défendre les intérêts des acteurs du secteur. L’association assure aussi la déontologie du métier grâce à un code de déontologie et une commission de déontologie qui dispose d’un pouvoir de sanction. En outre, nous avons créé une société de formation agréée qui forme mille stagiaires par an. L’année dernière nous avons investi 8 700 millions d’euros dans les entreprises françaises. 1 600 entreprises en moyenne sont accompagnées chaque année par le capital-investissement, avec environ 5 500 entreprises en portefeuille. Nous réalisons également des études comme celle sur l’activité du capital-investissement qui est effectuée tous les six mois. Elle montre les montants investis et les montants levés. Depuis la crise de 2008-2009, on constate que les levées de fonds ont baissé. Cela explique que les montants d’investissement ont diminué jusqu’à 6 à 7 milliards d’euros, alors qu’ils étaient supérieurs à 10 milliards auparavant. Enfin, 75 % des entreprises que nous finançons sont des PME et 90 % sont des entreprises françaises.
Mme Françoise Palle-Guillabert, déléguée générale de l’Association française des sociétés financières (ASF). L’ASF regroupe 300 adhérents dans les métiers de financement spécialisés – crédits à la consommation ou au logement, affacturage, caution, crédit-bail etc. Cela représente en tout 40 000 emplois et concentre 20 % du crédit à l’économie française réelle, c’est-à-dire environ 300 millions d’euros d’opérations en cours. Les métiers de l’ASF qui nous intéressent aujourd’hui sont le financement des entreprises, l’affacturage, mais aussi et surtout le crédit-bail et les cautions. Je rappelle que le crédit-bail est un contrat de location assorti d’une option d’achat qui permet à l’entreprise de disposer immédiatement d’un équipement ou d’un immeuble. En crédit-bail immobilier, nous finançons des bâtiments ou des entrepôts situés sur le territoire français, et en crédit-bail mobilier, nous finançons l’équipement des entreprises depuis le matériel informatique et de bureautique jusqu’aux flottes de véhicules utilitaires ou les équipements agricoles. Les deux métiers de l’affacturage et du crédit-bail sont une excellence française, ce qui n’est pas toujours connu. L’affacturage se situe au troisième rang mondial et au deuxième rang européen, derrière les Chinois et les Anglais, tandis que nous sommes numéro un européen en crédit-bail. Le métier de la caution est une spécificité française ; c’est un mécanisme de garantie qui facilite l’accès des entreprises au crédit.
Si vous me le permettez, je voudrais revenir à la question de la doctrine de la BPI et aux principes qui ont présidé à la création d’une banque publique aux côtés d’opérateurs privés. L’objet social de BPI est d’intervenir là où les opérateurs privés ne vont pas. C’est un principe de subsidiarité, consistant à compléter les failles du marché. Dans la doctrine que la BPI s’est elle-même fixée, elle se considère comme un outil financier au service de l’intérêt collectif qui doit favoriser l’émergence d’un écosystème complet et qui soit performant pour le financement et l’investissement des entreprises. Elle intervient toujours en co-financement ou en co-investissement au côté de partenaires privés et dans le respect des règles de concurrence. C’est ce qu’on appelle la règle du un pour un. Elle intervient sur fonds publics dans le cadre d’enveloppes d’intervention fixées par l’État. Sa cible d’intervention sont les TPE, PME et ETI qui du fait de leur nature risquée, de leur petite taille, peuvent rencontrer des difficultés de financement. C’est là la faille de marché.
À mon sens, la question qui devrait se poser est bien de s’assurer que les principes d’intervention qui ont été fixés à l’origine sont respectés. La présence d’une grande banque publique peut assez naturellement créer un effet d’éviction du marché des acteurs privés plus petits ou plus chers. Il faut veiller ne pas assécher le marché et à évaluer correctement le risque sur les TPE et PME.
M. Philippe Audouin, président de l’Association nationale des directeurs financiers et du contrôle de gestion (DFCG). L’Association nationale des directeurs financiers et du contrôle de gestion est une association d’environ 3 000 membres cotisants, répartis dans 14 directions régionales. Nous organisons environ 400 manifestations par an. Nous éditons une revue, Finance et gestion, qui a 20 000 lecteurs. Nos membres exercent essentiellement des fonctions financières dans le secteur privé, mais nous avons également de plus en plus de membres qui viennent de la sphère publique ou parapublique, car les contraintes, notamment de contrôle de gestion, sont de plus en plus fortes dans les établissements publics. Nous avons un rôle d’information et d’échange entre nos membres, mais nous disposons également d’un centre de formation très actif. Nous avons créé il y a trois ans une fondation visant à aider des jeunes qui n’ont pas de moyens financiers et qui se destinent aux métiers du chiffre à effectuer leurs études. Notre association existe depuis 50 ans.
Je suis également membre du directoire d’Euraseo, une société d’investissement qui est, par sa capitalisation boursière, une des deux plus grandes sociétés d’investissement en private equity cotée de la zone euro. Nous avons investi l’an dernier environ 10 % des sommes investies en France. Euraseo est une société créée en 1881, qui bénéficie d’un fort ancrage national. Elle se différencie d’un fonds d’investissement en ceci qu’elle investit ses propres ressources, c’est-à-dire les ressources qui figurent à son bilan. Nous ne dépendons donc pas de levées de fonds pour exercer notre activité, ce qui nous confère une grande souplesse en matière d’horizon temporel et nous permet d’investir durablement dans les entreprises.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je souhaiterais savoir ce que, selon vous, BPI France a changé dans le secteur du capital-investissement ? Son activité a-t-elle eu un impact sur le fonctionnement de vos structures ?
Il y a aussi d’autres points à aborder. Le baromètre du capital-risque d’Ernst & Young pour 2014 évaluait à 2,5 millions d’euros le montant moyen d’une opération. L’intervention de BPI France permet-elle accroître ces montants moyens d’investissement ?
Une autre question concerne le capital-amorçage, qui apparaît comme le parent pauvre du capital-investissement, avec, toujours selon Ernst & Young, un montant de 43 millions d’euros sur 897 millions en 2014. Pensez-vous que BPI France devrait se concentrer sur le capital-amorçage et laisser les autres métiers de l’investissement au secteur privé ?
M. le rapporteur. Selon vous, y a-t-il concurrence ou complémentarité entre BPI France et les acteurs de la place ? Y a-t-il des domaines – capital-amorçage, transmission – dans lesquels vous estimez que l’action publique pourrait exercer un effet d’entraînement supérieur en matière d’investissement ? Je souhaiterais aussi vous demander si BPIfrance ne joue pas à certains égards, surtout au niveau régional, le rôle d’une agence de notation, dans la mesure où un refus de sa part peut influencer les autres acteurs.
Selon le rapport d’activité de 2013, la rentabilité des fonds propres de BPI France est de 4 % et la sinistralité représente 36 millions d’euros. Est-ce que, selon vous, BPI France prend suffisamment de risques ?
Une autre question est celle de la transparence de ses décisions d’investissement et de l’absence d’une expertise indépendante comme à la Berd ? Quelles sont les spécificités de vos propres procédures d’investissement ?
Par ailleurs, l’activité fonds de fonds de BPI France est-elle selon vous efficace économiquement, ou constituerait-elle, selon l’expression de Jean-Louis Beffa, une forme de démission intellectuelle ? D’après votre expérience, estimez-vous possible de contrôler, par l’intermédiaire de participations dans des fonds de fonds, la pertinence des investissements ?
Enfin, BPI France a cherché à créer des espaces de rencontre, comme BPI France Le Lab, entre investisseurs et entrepreneurs. Ces initiatives vont paraissent-elles satisfaisantes ? Pourraient-elles être améliorées ?
M. Philippe Audouin. Je laisserai Michel Chabanel répondre sur les montants alloués au capital-risque en France. Je rappellerai toutefois que le capital-risque ne peut fonctionner qu’au sein d’un écosystème global qui ne se limite pas à la seule question du financement des entreprises.
Je voudrais insister sur la question que vous posiez, madame la présidente, sur l’activité fonds de fonds qui renvoie au cœur de la stratégie de la BPI telle qu’elle est déployée. Je pense que pour la BPI, le fait de s’appuyer sur des fonds ou des sociétés d’investissement pour exercer son activité, présente de nombreux avantages. Le premier avantage est de permettre à l’activité du capital-investissement, qui est dynamique en France, de continuer de se développer sans pâtir de la concurrence d’un établissement qui disposerait de moyens moins coûteux ou plus importants. Ce ne serait, en effet, pas judicieux de risquer de fragiliser ce secteur simplement pour faire de la place à la BPI. Un autre avantage tient à l’effet de multiplicateur financier : quand la BPI participe à une levée de fonds, par exemple à hauteur de 10 millions sur 100 millions, cela peut aider ce fonds à trouver les 90 millions restants. Dans ce cas, un euro d’argent public se traduit par dix euros effectivement investis dans l’entreprise. Il y a aussi un élément plus difficile à apprécier mais au moins aussi important, que je qualifierais d’effet multiplicateur en industrie. Le rôle d’un fonds ou d’une société d’investissement n’est pas uniquement d’apporter de l’argent à une entreprise, mais aussi de l’accompagner, souvent assez activement, en l’aidant à recruter, à définir sa stratégie, à faire des acquisitions ou à se développer à l’international. En s’appuyant sur les équipes des fonds ou des sociétés d’investissement, la BPI peut contribuer activement au développement des sociétés.
S’agissant du contrôle qui peut être exercé sur les investissements à travers les participations dans des fonds de fonds, je ne poserais pas la question de cette façon. Ces participations permettent d’avoir un regard sur un plus grand nombre d’entreprises. Ce regard peut être utile. Si ces entreprises se trouvent en difficulté, ou si leur actionnaire cherche à les céder, la BPI pourra assurer un relais et continuer à contribuer à leur développement. Cette activité d’investissement au travers de fonds me paraît donc pleinement cohérente avec ce que pourrait ou devrait être la stratégie de la BPI, et elle me paraît extrêmement opérationnelle d’un point de vue pratique et parce qu’elle permet de démultiplier l’investissement public.
M. Michel Chabanel. Je partage ce qui vient d’être dit. Je souhaiterais rappeler quelques éléments sur le capital-investissement français, qui est le deuxième en Europe. Il ne représente encore que la moitié du capital-investissement en Angleterre, mais il est devant le capital-investissement allemand. Aujourd’hui, le métier du capital-investissement est actif de l’amorçage à la transmission, de la petite PME jusqu’à la grosse ETI. Il serait dommage de mettre cette activité en concurrence avec des organismes publics. Quand nous en sommes en relation avec des investisseurs institutionnels, notamment étrangers, ils nous demandent si notre métier se déroule sur un marché concurrentiel ou si notre activité rencontre des freins. Si c’est le cas, il est difficile de lever des fonds auprès des investisseurs internationaux.
Je voudrais revenir sur un autre point important. Nous levons nos capitaux auprès de trois types de sources. Les personnes privées sont une première source, notamment grâce aux FCPI. Les investisseurs institutionnels français sont une deuxième source, mais à la suite de la crise, les changements de réglementation (Bâle III, Solvency II) ont entraîné une division par 3, 4 ou 5 des allocations des banques pour le non coté. En outre, il n’y a pas en France de grands fonds de pension, mais des caisses de retraite qui pour des raisons de structure investissent très peu dans le non coté. Le manque de financements en France nous oblige à nous tourner vers une troisième source de financements qui sont des institutionnels fonds à l’étranger. Or il faut atteindre une taille critique pour pouvoir lever des capitaux étrangers. Les petits fonds qui financent les PME n’ont pas accès à ces financements étrangers. L’activité fonds de fonds de la BPI a permis, sinon de compenser la désaffection des assureurs et des banques, au moins de soutenir le métier. Cette activité a aussi, effectivement, un effet démultiplicateur. La présence de Bpi constitue un gage pour ces petits fonds qui facilite leurs levées de fonds et permet d’attirer d’autres investisseurs.
Mme la présidente Véronique Louwagie. En quoi consistent les effets négatifs des interventions de la BPI que vous avez évoqués ?
M. Michel Chabanel. Je voulais dire que le fait la BPI n’investisse pas dans un fonds pouvait être vu comme une source de défiance qui pouvait pénaliser la société de gestion en question.
M. Paul Perpère. Je souhaite apporter une précision sur les levées de fonds en fonction de l’origine des capitaux qui sont levés. À la page 14 du document que nous vous avons remis, figurent des précisions sur la baisse des levées auprès des banques et la montée des levées dans le secteur public.
M. Michel Chabanel. Il faut insister sur le rôle fédérateur que la BPI peut jouer auprès d’institutions telles, par exemple, que les caisses de retraite qui n’ont pas les moyens de sélectionner les fonds privés dans lesquels investir, soit en opérant des levées de fonds publics via des « fonds de fonds », soit par un accompagnement de leurs décisions.
Mme la présidente Véronique Louwagie. C’est un souhait que vous émettez ?
M. Michel Chabanel. Oui, car le tissu des institutions financières françaises est très différent de celui des pays anglo-saxons, dans lesquels de gros fonds de pension sont structurés pour investir. Étant donné la taille de nos structures, il est bon que la BPI intervienne ainsi, soit via des « fonds de fonds », soit via des conseils en investissements, pour permettre une orientation de l’épargne vers les capitaux privés.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Mme Françoise Palle-Guillabert a fait état d’un risque d’éviction des acteurs privés au regard de l’intervention de BPI France. Ce risque est-il réel ? Comment l’éviter ?
Mme Françoise Palle-Guillabert. Il est difficile de répondre à cette question, qu’il faudrait poser aux opérateurs. L’ASF ne dispose pas d’éléments pour répondre à cette interrogation qui est assez naturelle, étant donné la taille et le dynamisme de la BPI et de la complexité des missions qui lui ont été confiées à l’origine. Elle doit intervenir en substitution, en cofinancement, exercer un effet d’entraînement. La conciliation de tous ces principes est assez délicate sur le terrain.
M. le rapporteur. Le rôle de la BPI est-il d’investir largement via des fonds de fonds ou de se concentrer sur le soutien à certaines filières au regard des priorités définies par l’État au travers des plans industriels ? La BPI doit-elle être partout ou, au contraire, cibler ses interventions ?
M. Michel Chabanel. La BPI ne doit pas être un concurrent direct pour l’activité de capital-investissement mais doit intervenir de manière complémentaire. Dès la création de la BPI, une charte a défini les modalités de son intervention en partenariat avec les fonds privés. Par ailleurs, une activité de fonds de fonds n’empêche pas de soutenir telle ou telle filière privilégiée par les pouvoirs publics. Il existe des fonds sectoriels ou ciblant certains stades du développement des entreprises.
Je rappelle que la profession finance 1 600 entreprises chaque année. Notre rôle est d’orienter l’épargne – près de 10 milliards d’euros vers les entreprises et les PME chaque année (soit 75 % des financements mis en place). L’on n’a pas besoin d’un acteur qui risque de déstabiliser un marché qui fonctionne et qui a un vrai potentiel de croissance.
M. le rapporteur. La BPI ne soutient que faiblement les investissements dans les fonds de retournement, alors que les entreprises concernées ont besoin d’un intervenant public.
M. Michel Chabanel. La BPI peut intervenir en direct, dès lors qu’il existe une défaillance du marché. Le capital retournement est un métier difficile, pour des raisons d’organisation et des raisons juridiques. Ces difficultés font qu’il y a très peu de fonds de retournement en France.
M. le rapporteur. Que veut faire la BPI sur ce secteur ?
M. Paul Perpère. Il ne faut pas sous-estimer, les difficultés juridiques pour les fonds de retournement, qui résultent de la régulation du capital-investissement, y compris en raison des dispositions des directives européennes qui interdisent, par exemple, les démantèlements d’actifs. Ces règles valent pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Sur le sujet de la transmission des entreprises, il faut rappeler que nous connaissons en France des difficultés tenant au management de ces entreprises et à leur financement. Auriez-vous des recommandations à présenter sur ce point ?
M. Philippe Audouin. C’est un sujet complexe, mais essentiel. Nous avons en France beaucoup de PME qui ne font pas toujours tout ce qu’elles pourraient faire. Je peux donner en revanche l’exemple d’une petite entreprise de 50 personnes que nous avons soutenue, présente dans le secteur de l’étanchéité qui a procédé à des acquisitions, s’est internationalisée et faisait travailler 1 250 personnes, lorsque nous l’avons cédée. Elle n’aurait pu parvenir à ce résultat seule. Le capital-investissement peut vraiment aider les entreprises à changer de taille et de nature.
Les difficultés de transmission se posent dans les entreprises familiales, car il est difficile de convaincre un manager actionnaire de se faire accompagner pour passer la main et ouvrir le capital. La fiscalité n’est d’ailleurs pas incitative sur ce plan aujourd’hui. Cela crée des blocages et je crains que pour certaines entreprises il ne soit un jour trop tard pour évoluer. La BPI, peut être associée à un investisseur, pourrait apporter l’image d’un actionnaire rassurant qui pourrait faciliter les évolutions.
M. le rapporteur. La BPI ne joue-t-elle pas dans les faits un rôle d’agence de notation dans les régions ?
Mme Françoise Palle-Guillabert. Nous avons interrogé les adhérents de l’ASF sur ce point. Il est de fait que la présence de la BPI rassure et qu’elle permet de déclencher des investissements.
M. le rapporteur. En sens contraire, le refus de financement par la BPI n’entraîne-t-il pas un blocage des autres acteurs de financement ?
M. Michel Chabanel. En matière de capital investissement, les investisseurs ne tiennent pas compte, en principe, de la position de la BPI et procèdent à leur propre analyse pour investir ou pas.
Mme Françoise Palle-Guillabert. Le banquier ou le crédit bailleur mène une analyse financière indépendante. Le crédit bailleur reste propriétaire du bien et il apparaît qu’un refus de la BPI n’influe pas sur sa décision de soutenir ou non l’entreprise.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Pour poursuivre sur les métiers de la BPI, je souhaiterais vous interroger sur les garanties données aux financements bancaires.
Mme Françoise Palle-Guillabert. Le marché des cautions-garanties est un marché particulier, de petits acteurs, à la différence de ceux du crédit-bail et de l’affacturage qui sont très concurrentiels et avec des acteurs de taille très importante. C’est un écosystème plus fragile. Il existe, malgré tout, une collaboration, car BPI est actionnaire d’un certain nombre d’acteurs dans le secteur des cautions-garanties.
Sur le fait que la BPI ne soit pas une banque, il faut rappeler que ses statuts prévoient qu’elle est une compagnie financière holding ayant deux filiales qui sont des établissements de crédit ayant accès à la BCE. BPI France financement est une banque et BPI France régions est un établissement de crédit spécialisé. L’accès de ses filiales à la BCE peut permettre à la BPI d’accéder aux programmes des financements existants.
M. Philippe Audouin. La rentabilité des fonds propres de la BPI est de 4 %. Étant donné que l’activité est très cyclique, cette faible rentabilité pourrait être source de difficultés en cas de retournement du cycle. La période 2002-2006 a été très favorable, ce qui n’a pas été le cas entre 2007 et 2011.
Je vous remercie de nous avoir reçus et observe que la BPI a effectué un travail remarquable en très peu de temps.
M. Michel Chabanel. S’agissant du capital-innovation, on peut observer que des initiatives ont été prises notamment avec le fonds national d’amorçage. Il reste que c’est le métier le plus difficile car le moins profitable. Il peine donc à attirer des investisseurs comme on l’a vu en 2014, année pendant laquelle les fonds levés en capital-innovation ont été en forte baisse. Il faut focaliser notre attention sur ce segment très important. La Bpi peut accompagner utilement ses investissements.
Un mot sur le montant des tickets qui reste encore insuffisant bien qu’ils soient de plus en plus élevés. La Bpi avec le fonds Large venture participe à ce mouvement mais il faut que l’on réussisse encore à attirer plus d’investisseurs sur ces fonds de capital innovation.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions pour votre contribution.
Audition du jeudi 16 avril 2015
M. Augustin Landier, Professeur à l’École d’économie de Toulouse et Prix du meilleur jeune économiste 2014
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous accueillons à présent M. Augustin Landier, professeur à l’École d’économie de Toulouse.
Monsieur, nous avons souhaité vous entendre ce matin afin d’avoir le regard d’un économiste sur le positionnement que devrait avoir une banque publique dans le paysage économique actuel – qui n’est d’ailleurs plus celui qui avait conduit à la création de la BPI. À quels besoins répond-elle aujourd’hui et quelles seraient, selon vous, les conditions de l’efficacité de son intervention ?
M. Augustin Landier. Ce qui fait la pertinence d’un outil comme la BPI aujourd’hui, c’est qu’elle semble répondre à la vague entrepreneuriale que connaît la France, que ce soit chez les travailleurs très qualifiés, dans le domaine des high-tech par exemple, ou chez les moins qualifiés, qui souhaitent devenir autoentrepreneurs ou développer des projets même modestes. Cela répond à un besoin de réinventer l’emploi dans notre pays, qui connaît notamment un problème de chômage massif chez les peu qualifiés.
Il s’agit donc pour l’État d’accompagner les PME et la création d’entreprises, et d’éviter à tout prix les situations où de bons projets, c’est-à-dire des projets générant des flux de cash supérieurs en valeur actualisée au coût des investissements initiaux, ne trouvent pas de financeur.
L’analyse de ces situations est tout l’objet de la finance d’entreprise, qui a identifié trois types de cas dans lesquels peuvent survenir des défauts de financement.
Le premier est lié aux asymétries d’information, qui empêchent le financeur d’investir dans un projet. Soit le porteur de projet n’arrive pas à faire la preuve de sa compétence et de sa crédibilité aux yeux des prêteurs, soit l’évaluation du projet requiert de la part du prêteur trop d’investissement en temps pour que cela soit rentable : aucun banquier n’acceptera en effet de consacrer une semaine entière, à l’étude d’un investissement d’une valeur de 5 000 euros.
Le second cas est celui où l’incitation à entreprendre n’est pas assez forte. Cela peut se produire lorsqu’un entrepreneur est obligé de faire intégralement financer son projet par la banque. Dans ce cas, même si le projet était viable à l’origine, il n’en retirerait qu’un revenu trop faible pour le motiver, car une partie importante des revenus générés par son activité sera prélevée par la banque en remboursement de son prêt.
Il y a enfin ce que j’appellerais les situations historiques extrêmes, caractérisées par un dysfonctionnement majeur du marché du crédit. Ce peut être le cas lors d’une crise systémique, comme la crise de 2009 aux États-Unis, qui fut pour le système bancaire un véritable accident nucléaire, ou lors des périodes de transition économique : la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale ou la réunification allemande. Dans ces situations particulières, les banques ont tendance à adopter des positions attentistes, conscientes que la transition n’aura qu’un temps. L’État peut alors avoir un rôle à jouer, d’autant que ces périodes de transition ont souvent pour origine des chocs politiques majeurs.
Hormis ce dernier cas, les marges de manœuvres de l’État sont limitées. Lorsqu’il existe des asymétries d’information ou lorsque l’incitation à entreprendre est trop faible, le banquier public est soumis aux mêmes contraintes que l’investisseur privé. Il me semble donc que, si une banque publique d’investissement peut avoir un rôle à jouer dans la gestion de chocs politiques lors de transitions historiques, il faut se poser la question de sa pertinence en régime de croisière.
Il faut ensuite se pencher sur la question des projets non viables – au sens où l’argent qu’ils génèrent directement ne suffit pas à couvrir les investissements initiaux – mais qui engendrent des externalités positives sur le reste de l’économie. C’est essentiellement le cas des projets innovants : en matière d’innovation, un entrepreneur ne s’appropriera qu’une petite partie des rendements générés par son idée, qui sera reprise et transformée par d’autres. C’est également vrai pour l’éducation, et il est établi que les bénéfices à tirer de l’éducation dépassent l’accroissement de salaire induit pour celui qui la reçoit et irriguent, grâce à la diffusion des savoirs et des idées, le reste de l’économie.
On peut enfin évoquer les externalités en termes d’emploi. En période de fort chômage financer un projet créateur d’emplois, même peu rentable, peut être plus intéressant que de subventionner des emplois publics. Dans ce cas pourtant, une banque publique n’est pas nécessairement l’outil le plus approprié, et l’on peut plutôt envisager de recourir soit à des baisses de charges sur les bas salaires pour inciter les PME à embaucher, soit à des allègements fiscaux.
Ce qui suscite ma critique en tant qu’économiste, c’est le discours peu explicite que tient la BPI. Nous sommes certes dans une période où l’État doit restaurer la confiance des acteurs économiques et leur délivrer un discours positif, et c’est exactement dans cette tonalité que s’inscrit la BPI, tant dans sa communication publique que dans sa communication en direction des investisseurs. N’est-il pas naïf cependant d’affirmer comme elle le fait qu’elle va financer des entreprises viables dans un mouvement gagnant-gagnant ? Le rôle de la BPI est-il de gagner de l’argent ou d’en perdre, et n’est-il pas étrange, s’il y a tant d’argent à gagner dans ces investissements, que le système bancaire ne s’y engage pas ? Je rappelle que nous ne sommes plus dans le même contexte qu’en 2009 et que la situation des banques françaises est particulièrement saine par rapport à leurs homologues européennes. C’est ce que démontre une étude que j’ai cosignée avec Jacques Cailloux et Guillaume Plantin pour le Conseil d’analyse économique sur la situation du crédit aux PME en France.
Certes, il y aura toujours des entrepreneurs pour s’étonner que des banquiers leur refusent des prêts, mais il s’agit souvent de problèmes d’informations, face auxquels l’État n’a pas d’avantage comparatif. En revanche, il peut agir pour tenter de limiter les asymétries d’information, par exemple grâce au fichier positif, qui permettrait aux personnes peu qualifiées de prouver qu’elles sont sérieuses sur le marché du crédit, ou encore, comme le prévoit la loi Macron, en élargissant l’accès au fichier bancaire des entreprises, le FIBEN. Le droit des faillites a également toute son importance car, si les banquiers sont parfois frileux, c’est qu’ils savent, en cas de faillite, ils ne récupéreront qu’une faible part de leurs fonds.
La doctrine de la BPI doit être clairement affichée. Son but est-il de financer des projets très rentables – auquel cas elle entre directement en concurrence avec les banques privées – ou entend-elle se spécialiser dans le financement de projets trop incertains pour des banquiers privés, ce qui implique une forte prise de risque et des pertes d’argent ? En tout état de cause, il serait injuste qu’elle gagne trop d’argent, car cela signifierait qu’elle entre dans une concurrence déloyale avec le secteur privé, dans la mesure où un organisme public a toujours l’avantage sur un organisme privé de bénéficier de la signature de l’État et de n’être pas soumis aux mêmes contraintes en termes de gestion du risque.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous vous êtes interrogé sur le fait de savoir si le rôle d’une banque publique d’investissement était d’intervenir sur l’ensemble des marchés, y compris pour financer des projets dont la rentabilité était assurée, où si elle devait se concentrer sur les failles de marché ? Au regard de cette alternative théorique, comment jugez-vous l’action de Bpifrance ?
Pourriez-vous nous donner des éléments de comparaison étrangers sur le financement public : je pense en particulier à la KfW allemande ?
Enfin, que pensez-vous des obligations auxquelles est soumise Bpifrance en matière de cofinancement ? Ne sont-elles pas contraires à l’objectif qui consiste à combler les failles de marché ?
M. Augustin Landier. Il est très difficile d’évaluer la pertinence de l’action de la BPI à partir des documents officiels disponibles. Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est qu’elle axe clairement sa communication sur le fait qu’elle est rentable et affiche des performances comparables à celles du privé.
Quant à son rôle de cofinanceur, c’est une manière pour elle d’écarter toute idée de concurrence avec le secteur privé, dont elle s’affirme le partenaire, arguant du fait qu’elle n’est pas une banque à proprement parler mais un établissement de coopération, qui offre cofinancement et garanties. Cela revient, de manière indirecte et implicite, à subventionner des projets qui ne trouvent pas preneurs, et il me semble qu’il serait plus approprié dans ce cas d’agir par des moyens plus directs, par exemple en baissant l’impôt sur les sociétés. Mais le fait que la BPI n’affiche pas de pertes semble indiquer qu’elle n’assume pas réellement sa doctrine, selon laquelle elle est censée financer des projets à très fortes externalités mais médiocres en termes de cash-flow direct.
Par ailleurs, au lieu de se spécialiser dans un domaine très précis, la BPI est présente partout, témoignant d’une implication croissante de l’État dans le domaine du capital-investissement – private equity –, ce qui n’est nullement nécessaire compte tenu du niveau de développement qu’a atteint dans notre pays ce secteur, qui n’a pas besoin de coup de pouce particulier.
Le fait que la BPI s’engage dans un grand nombre d’affaires est un choix tout à fait judicieux pour assurer sa pérennité, car vous trouverez très peu d’acteurs privés prêts à la critiquer publiquement, par peur d’être mis sur la touche. Reste qu’au bout du compte il n’est pas certain que le secteur privé bénéficie réellement de l’action de la BPI car, si celle-ci affiche des profits, c’est bien le signe qu’elle les confisque pour partie aux investisseurs privés. C’est toute la faiblesse de son positionnement actuel, et je m’interroge sur sa pertinence à présent que nous sommes sortis de la crise systémique pendant laquelle les banques n’étaient plus en mesure de remplir leur rôle.
On est, bien sûr, toujours à la merci de chocs systémiques, et il est important que l’État puisse intervenir, mais il est tout aussi important qu’il le fasse grâce à des dispositifs « biodégradables », c’est-à-dire qui peuvent s’éteindre une fois la crise passée. Or le risque est que ces institutions cherchent à organiser leur propre pérennité, à l’exemple du Plan, judicieusement mis en place au moment de la reconstruction de l’après-guerre. C’est donc là-dessus qu’il faut interroger la BPI : Doit-elle continuer d’exister lorsque l’économie retrouve son rythme de croisière ? En affichant des objectifs contracycliques, elle semble reconnaître elle-même qu’elle a vocation à prendre de l’importance dans les périodes de crise et à réduire la voilure en temps normal.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Formé à l’école de Bernard Schmitt et du circuit, école minoritaire chez les économistes, je m’intéresse aux questions d’amorçage et de fonds de retournement ; c’est en effet là que le bât blesse.
En ce qui concerne l’amorçage, ne conviendrait-il pas de recentrer les actions de la BPI vers ceux qui ne sont pas déjà introduits dans les dispositifs et qui, faute de disposer des informations suffisantes et du bon carnet d’adresses, n’ont pas accès aux financements ? Il s’agit souvent de porteurs de projet qui ont de bonnes idées mais manquent de carburant.
Quant aux fonds de retournement, même si on a dépassé la crise financière, il y a encore des entreprises qui souffrent de difficultés qui n’ont rien à voir avec leur carnet de commandes mais relèvent davantage d’un défaut de gouvernance ou de stratégie. Or, les fonds de retournement tels qu’ils existent actuellement ne sont pas suffisants pour faire face à ce type de situation, et certaines entreprises qui en ont pourtant la capacité ne parviennent pas à rebondir faute de financements. Sans doute la BPI n’est-elle pas suffisamment présente sur ce front ; c’est en tout cas ce qui ressort des propos qu’Henri Emmanuelli a tenus devant nous. Je ne dis pas que la BPI doit être partout, mais il conviendrait qu’elle fasse la preuve de son efficacité là où on attend davantage d’elle.
M. Augustin Landier. La question de l’amorçage renvoie à celle du risque, parfois trop important pour que l’entrepreneur puisse démarrer son projet, alors que celui-ci a globalement de la valeur pour la société. Mais il faut alors admettre clairement que l’on se situe dans une logique de subvention, et il existe déjà de nombreux dispositifs prévus à cet effet.
Quant à l’accompagnement, je partage ce que vous dites, mais nous sommes dans un autre registre que celui de la banque. Notre étude sur le financement des PME a clairement mis en lumière que ces dernières souffraient souvent d’une méconnaissance de base des mécanismes comptables, administratifs et financiers, qui pénalisait les chefs d’entreprise. Il y a donc là un véritable besoin, auquel entend d’ailleurs répondre la BPI en lançant Bpifrance Université.
Par ailleurs, il existe en France de nombreux dispositifs de subventions à l’entreprenariat. Je pense notamment aux mesures incitatives à destination des chômeurs souhaitant créer leur entreprise. Je vous renvoie ici à un article de David Thesmar, qui livre une évaluation plutôt positive de ces dispositifs, dans la mesure où les entreprises créées par des chômeurs fonctionnent plutôt mieux que ce qu’on pourrait imaginer.
En ce qui concerne les fonds de retournement, la BPI a délibérément pris la précaution d’éviter le sujet, car elle sait pertinemment qu’en tant qu’acteur public il lui sera impossible de supprimer des emplois. Dès qu’il s’agira d’entreprises d’une certaine taille, elle risque de s’exposer à subir des pressions politiques et aura les plus grandes difficultés à imposer un changement de business model. J’insiste par ailleurs sur le fait qu’imaginer que les investisseurs privés ne sont que de méchants financiers toujours enclins à supprimer des emplois en réalité rentables à court terme relève de la mythologie. Les professionnels du private equity savent identifier les sources de profit et en tirer parti. Je ne vois donc guère ici de faille de marché ; en revanche, j’attire votre attention sur les risques de conflit d’intérêts pour une institution publique placée dans une situation où elle serait contrainte de détruire des emplois.
Encore une fois, les questions de rentabilité renvoient à la fiscalité, au droit des faillites et aux diverses frictions administratives, qui diminuent in fine la part des bénéfices. Mais je persiste à croire qu’il vaudrait mieux user du levier fiscal que de subventions à l’amorçage et que ce circuit qui consiste à redistribuer ce que l’on a prélevé fiscalement dans un premier temps, s’apparente à de la fausse générosité. Si ces procédés sont légitimes en tant de crise, ils ont tendance à perdurer et le système s’auto-entretient : dès lors, en effet, que la fiscalité est élevée peu de projets sont viables.
M. le rapporteur. En tant que députés, nous rencontrons régulièrement des acteurs économiques et des porteurs de projet – j’ai récemment été saisi du cas d’un boulanger souhaitant monter son affaire – qui, malgré un apport conséquent, se voient refuser l’accès au crédit, et ce malgré l’aide de la SIAGI – Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissement. Il existe donc des failles de marché, et ce peut être le rôle de la BPI que de les pallier. Certes, elle va parfois au-delà, mais Joseph Stiglitz a suggéré hier, dans Les Échos, que la Banque européenne d’investissement pourrait gérer directement des fonds de la BCE : ne pourrait-on donc pas envisager de faire également, demain, de la BPI, un bras armé de la BCE ?
M. Augustin Landier. Paradoxalement, la BPI ne finance pas directement les infrastructures – auxquelles Joseph Stiglitz fait sans doute référence – alors que c’est précisément un domaine dans lequel l’État a, comme investisseur, un avantage comparatif : en effet, s’il est parfois difficile de trouver des financements privés pour les infrastructures, c’est que les investisseurs ont toujours peur que l’État ne change les règles du jeu ex post.
En revanche, j’ai du mal à croire que les banques ne soient pas capables de distinguer un projet de boulangerie viable. Peut-être ne disposent-elles pas des bonnes informations, auquel cas il faut trouver le moyen de mieux les informer. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une faille de marché, car je vois mal, en l’occurrence, la BPI faire mieux que les banquiers.
M. le rapporteur. La SIAGI peut fournir une lettre de prégarantie certifiant que la viabilité du projet a été examinée en amont par un organisme indépendant. Muni de ce document, le porteur de projet devrait pouvoir obtenir un prêt de sa banque. On pourrait envisager des procédures de ce type pour permettre à des entrepreneurs de ne pas être exclus des circuits de financement.
M. Augustin Landier. Vous parlez ici d’une subvention, du même type que les garanties accordées aux propriétaires contre les défauts de loyers. Croire que cela n’a pas de coût est une fiction, et c’est la raison pour laquelle les organismes privés sont très vigilants en la matière. Je trouve dangereux qu’un organisme disposant de la signature de l’État puisse distribuer des garanties ; il doit en tout cas être soumis à la même culture de gestion des risques qu’un organisme privé.
M. le rapporteur. Ne considérez-vous pas que la rationalité des acteurs économiques connaît des limites ? À vous entendre, dans une situation de concurrence libre et non faussée, on devrait parvenir à un équilibre qui rendrait tout le monde heureux, mais c’est faire fi des asymétries d’information, dont vous avez vous-même parlé, et de toute une série d’entraves qui sont bien réelles.
M. Augustin Landier. Une partie de mes recherches porte précisément sur la psychologie des acteurs, notamment dans l’entrepreneuriat. Or il me semble que l’entrave majeure dont souffre le marché en la matière, c’est l’optimisme des entrepreneurs. Dans la majorité des cas, les gens sont trop confiants sur la valeur de leur projet, et le rôle du banquier est précisément de tempérer cet optimisme.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous assimilez les garanties à des subventions. Or il s’agit d’une part importante de Bpifrance qui, depuis janvier 2015, garantit des projets à hauteur de 200 000 euros, contre 100 000 euros auparavant, sans étude de dossier préalable. Ce dispositif vous choque-t-il ? L’assimilez-vous à une manière de subvention ?
M. Augustin Landier. Il s’agit très clairement selon moi d’une subvention, notamment parce que la BPI ne prétend pas avoir en matière d’évaluation des dossiers une compétence que n’aurait pas le banquier. Cette garantie ne serait pas assimilable à une subvention si la BPI détenait un savoir ou des informations confidentielles que ne possédait pas le banquier. Dans ce cas, elle ferait en quelque sorte office d’agence de rating, pouvant procéder à une certification. Mais ce n’est absolument pas le cas : la BPI en sait plutôt moins que les banques sur l’entrepreneur. Je ne pense donc pas que ces garanties aient un fondement économique. Elles se justifient à la limite sur de petits dossiers, à l’évaluation desquels le banquier n’a guère de temps à consacrer, mais pour un montant de 200 000 euros, je ne vois pas comment nommer ces garanties autrement que subventions. Cela étant, un système de subventions peut être utile. C’est une manière de contourner le droit de la concurrence, et il existe des raisons économiques pour subventionner l’innovation et la recherche : c’est en partie le rôle du crédit impôt recherche. Je persiste en tout cas à penser qu’il faut appeler les choses par leur nom.
Un mot pour conclure sur l’exemple allemand, qui doit nous mettre en garde contre les dysfonctionnements de ces organismes, puisqu’une des filiales de l’équivalent allemand de la BPI avait beaucoup investi dans les subprimes américaines. Ce cas d’école illustre parfaitement ce qui peut se produire lorsqu’une institution n’a pas de doctrine très claire sur sa politique et qu’elle n’est pas directement exposée aux mêmes contraintes de gestion des risques que les banques.
Tous les acteurs bancaires n’ont évidemment pas eu un comportement irréprochable mais on peut s’interroger sur les risques de dérive à long terme et les problèmes de gouvernance auxquels peut-être exposée la BPI. Je ne doute pas que ses intentions initiales étaient bonnes mais son action manque de lisibilité et, compte tenu de la prolifération de ses activités et de l’absence de doctrine claire sur la cible de ses interventions, il faut rester vigilants. Nous sommes dans une période où la BPI aurait tout intérêt à recentrer ses actions.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions pour votre contribution.
Audition du mercredi 13 mai 2015
M. Arnaud Caudoux, directeur exécutif, directeur financier de Bpifrance et directeur en charge des garanties
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons les travaux de la mission d’information commune sur Bpifrance par l’audition de M. Arnaud Caudoux, directeur exécutif, directeur financier de Bpifrance et directeur en charge des garanties.
M. Arnaud Caudoux. La direction financière de BPI-Groupe comprend la direction financière à proprement parler, qui regroupe les fonctions classiques telles que le contrôle de gestion, la comptabilité, la salle de marchés qui intervient essentiellement sur les marchés de dettes et de taux, et la direction capitaux et bilan, qui s’assure que les équilibres sont respectés, en termes de liquidités et de taux, entre l’actif – c’est-à-dire les prêts que nous accordons aux entreprises et les investissements que nous réalisons – et le passif, c’est-à-dire nos fonds propres, les dettes correspondant aux emprunts réalisés sur les marchés ou auprès de tiers et les ressources issues de l’État ou des régions. La direction financière de BPI-Groupe comprend également la direction financière de Bpifrance Investissement, ainsi que la direction des risques, qui fixe la doctrine en matière de gestion des risques et s’assure que celle-ci est respectée lors de l’exécution et du suivi des opérations, et la direction informatique, qui gère environ 500 000 dossiers « vivants » en stock, tous traités par nos systèmes d’information, lesquels sont par ailleurs connectés au système bancaire puisqu’en tant qu’établissement de place, nous interagissons avec l’ensemble des banques.
Quant à la garantie, dont je suis également en charge, elle est un des métiers historiques de Bpifrance Financement. Elle consiste à partager avec les établissements commerciaux le risque lié aux prêts que ceux-ci accordent aux entreprises, en l’espèce aux PME et aux TPE, en s’adossant à des fonds de garantie dotés par l’État – par des dotations budgétaires ou grâce au programme d’investissements d’avenir (PIA) – et par les régions.
J’en viens maintenant à la présentation du modèle économique de Bpifrance. À l’instar des autres établissements bancaires, nous disposons de trois types de ressources. Cependant, si les deux premières sont communes à l’ensemble des banques, la troisième nous est spécifique.
Premier type de ressources : les fonds propres. Notre capital est détenu principalement par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, qui possèdent chacun 50 % de BPI-Groupe. Par ailleurs, les banques commerciales sont actionnaires, à hauteur de 10 %, de Bpifrance Financement, ce qui nous permet de nous assurer que nous demeurons bien un établissement de place qui aide les différents établissements à financer le mieux possible les entreprises, dans une logique d’adaptation à leurs besoins et à ceux des banques. Notre capital s’élève à environ 22 milliards d’euros, dont deux milliards n’ont pas été formellement payés et sont donc encore potentiellement libérables.
Deuxième type de ressources : celles que nous empruntons, principalement sur les marchés. Dès lors que, contrairement aux autres établissements, nous ne prenons pas de dépôts auprès de nos clients, il nous faut refinancer intégralement notre portefeuille de prêts. Actuellement, environ 25 milliards d’euros sont prêtés à des entreprises françaises, dont 2,7 milliards de fonds propres qui relèvent de Bpifrance Financement. Au-delà de ces 2,7 milliards, tout ce que nous prêtons doit être refinancé en empruntant sur les marchés obligataires et en souscrivant des prêts bilatéraux auprès d’un certain nombre d’institutions. Nous n’émettons pas de dettes dans un autre but que celui-là. Nous n’investissons ainsi que nos fonds propres : nous nous interdisons formellement – cela figure dans nos statuts – d’émettre de la dette pour investir en fonds propres dans des entreprises. Cette pratique peut se rencontrer chez des investisseurs de très court terme. Nous sommes, quant à nous, des investisseurs de long terme et, en tant que tels, nous devons être prêts à subir la baisse de valeur des entreprises dans lesquelles nous investissons. Ces investissements se font donc en fonds propres ou, le cas échéant, avec de l’argent que nous gérons pour le compte de tiers, qu’il s’agisse d’acteurs industriels, dans le cadre de fonds sectoriels ou de fonds filières, ou du Programme d’investissements d’avenir (PIA) qui nous confie de l’argent pour investir dans l’amorçage.
Le troisième type de ressources dont nous disposons est propre à la BPI ; il s’agit des fonds de garantie, qui sont très importants dans notre modèle. L’activité de garantie est la plus risquée, puisqu’elle consiste précisément à partager le risque avec les banques sur leurs dossiers les plus durs. Ces fonds de garantie protègent nos fonds propres de ce que l’on appelle les premières pertes, qu’ils encaissent avant que nous soyons à risque en tant qu’établissement. Tout l’art consiste donc à trouver l’effet de levier optimal pour les dotations de l’État. Avec un euro de dotation publique, nous devons en faire le plus possible tout en assurant un niveau de sécurité qui protège l’établissement et son capital, qui appartient à l’État.
Ces trois types de ressources nous permettent de prendre des risques, y compris de manière très agressive par rapport à un établissement normal, grâce aux fonds de garantie, et d’exercer un effet de levier important, grâce au niveau de nos fonds propres et au fait que nous sommes une banque régulée. En théorie, nous pouvons aujourd’hui « faire » dix fois nos fonds propres, mais nous considérons que ce ne serait pas raisonnable, compte tenu du poids des investissements en capital dans les entreprises. Quoi qu’il en soit, nous avons une capacité de levier très forte, que nous pouvons matérialiser par l’émission de dette pour faire des prêts.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez indiqué que Bpifrance n’était pas une banque ordinaire et que, de ce fait, elle pouvait prendre des risques de manière plus agressive qu’un établissement normal. Pourtant, son taux de sinistralité ne nous paraît pas important, comparé à celui de banques traditionnelles. On peut donc se demander si Bpifrance prend des risques suffisants.
M. Arnaud Caudoux. C’est une très bonne question. Les fonds de garantie nous permettent de prendre, en partenariat avec d’autres établissements, un risque beaucoup plus important qu’une banque qui n’en dispose pas, car ce risque affecte d’abord les fonds de garantie, qui sont des éléments séparés dans notre bilan ; il n’affecte pas le coût du risque comptable. Celui-ci, qui figure dans notre compte de résultat – il s’élève, en 2014, à une vingtaine de millions d’euros – porte sur le risque que nous prenons directement sur nos fonds propres. L’année dernière a été, pour nous comme pour les autres établissements, une bonne année en la matière. Parallèlement, les fonds de garantie sont impactés, en 2014 à hauteur de 300 millions d’euros, qui correspondent à des risques que nous avons pris en partenariat avec des banques en les garantissant sur leurs crédits.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Quel est le montant des provisions ?
M. Arnaud Caudoux. Il convient de distinguer les provisions que nous passons sur les fonds de garantie eux-mêmes – et qui s’élèvent aujourd’hui à environ 2 milliards d’euros – et les provisions que nous passons sur fonds propres, lesquelles relèvent de deux catégories : la provision collective – que nous passons parce que nous savons que, sur les 25 milliards d’euros de prêts que nous avons accordés aux entreprises, nous aurons des pertes, pertes que nous savons estimer statistiquement et que nous comptabilisons aujourd’hui à hauteur de 500 millions d’euros – et les provisions que nous passons sur les risques avérés, c’est-à-dire lorsque les dossiers ont fait défaut dans l’année. Le coût du risque est égal à la différence entre les provisions passées pour risque avéré et celles que nous avons reprises sur d’anciens dossiers qui ont fait défaut. Ce coût s’élève, en 2014, à une vingtaine de millions d’euros, soit dix points de base de notre encours de 25 milliards, ce qui est très faible. Ce résultat est lié notamment à des reprises de provisions – les recouvrements s’étant mieux passés que prévu – et, de manière générale, au taux de défaut très bas des entreprises en 2014.
Mme Anne Grommerch. Bpifrance a indiqué, hier, qu’elle ne prendrait pas de participation dans Ascométal, alors que M. Montebourg avait annoncé, au printemps 2014, que l’État, accompagné de la BPI, entrerait au capital de l’entreprise, laquelle, je le rappelle, emploie 1 740 salariés, dont 580 en Lorraine. Bpifrance n’a pas expliqué les raisons de sa décision, mais il se dit qu’elle jugerait l’investissement trop risqué. Pouvez-vous nous donner quelques explications à ce sujet ?
M. Arnaud Caudoux. Je précise que je n’ai évoqué, pour l’instant, que le coût du risque pris par Bpifrance Financement, c’est-à-dire lié à de la dette qui ferait défaut. Il comprend une deuxième partie, constituée des pertes que l’on peut subir dans les dossiers d’investissement. Mais il se trouve que, pour des raisons comptables, cette partie est classée, non pas en coût du risque, mais en perte sur investissement, donc en moins-value ou en dépréciation.
S’agissant d’Ascométal, je crois qu’une solution a été trouvée sans Bpifrance. En effet, celle-ci – c’est un élément important de notre doctrine, qui a été votée par le Parlement – ne peut pas prendre le risque d’être l’actionnaire majoritaire d’une société en situation de retournement qui a besoin d’une action très forte pour revenir à une situation financière saine.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Que représente la provision concernant ERAMET, qui est de 300 millions ? Par ailleurs, j’ai le sentiment que vous agissez plus en pompiers, sans véritable gestion en amont du contentieux, qui permettrait d’éviter qu’il ne survienne. Quelles sont les procédures existantes ou en cours d’élaboration en la matière ?
M. Arnaud Caudoux. En ce qui concerne ERAMET, il s’agit d’investissements. Les 300 millions d’euros que vous évoquez figurent donc dans nos comptes en tant que dépréciation ; il ne s’agit pas d’une provision au sens du coût du risque. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans la provision collective qui couvre les 25 milliards d’euros de prêts. ERAMET est un investissement en fonds propres, en l’espèce une mise en équivalence. Le cours du titre a beaucoup baissé en 2013, puis il s’est apprécié en 2014. Cela se traduit, dans nos comptes, par une moins-value de l’ordre de 300 millions d’euros, qui s’ajoute donc aux 500 millions de la provision collective.
S’agissant de la gestion du contentieux, il est important que nous sachions accompagner les entreprises, que nous soyons actionnaires ou prêteurs. En tant qu’actionnaires, nous sommes présents tout au long de la vie de l’entreprise et, si des difficultés se présentent, nous cherchons, avec le management et les autres actionnaires, à les résoudre de manière active, non seulement parce que c’est notre intérêt d’actionnaire, mais aussi parce que, pour les entreprises, notre valeur réside essentiellement dans leur accompagnement sous différentes formes.
Lorsque nous intervenons en tant que prêteurs, le sujet est un peu plus complexe. Nos chargés d’affaires parlent à leurs clients plusieurs fois par an, ce qui nous permet de connaître leurs difficultés, mais nous n’avons pas les moyens d’influence directe dont dispose l’actionnaire. En tout état de cause, nous anticipons : le coût du risque comprend une analyse de situation. Il existe ce que l’on appelle, dans le jargon de la BCE, une watchlist, c’est-à-dire une liste d’entreprises pour lesquelles nous passons des provisions car nous savons que, même si elles continuent de rembourser leur dette, elles commencent à avoir des difficultés. Cette liste est suivie très attentivement par le chargé d’affaires et par le siège. Nous cherchons donc, avec ces entreprises, des solutions avant que leurs problèmes ne deviennent à proprement parler des problèmes financiers.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Existe-t-il un service dédié à cette activité, en amont de la gestion du contentieux ?
M. Arnaud Caudoux. En amont du contentieux et du recouvrement, il y a une phase durant laquelle, comme dans tous les établissements bancaires, nous cherchons des solutions de restructuration financière. Avant cette étape, nos chargés d’affaires, qui ont pour mission de parler à leurs clients et de limiter leur coût du risque, se rapprochent de l’entreprise en cas de difficultés et cherchent avec leur interlocuteur à anticiper les problèmes. Suivant les situations, nous jouons un rôle d’alerte auprès de l’entrepreneur ou celui-ci nous saisit d’un problème. Quoi qu’il en soit, cette relation de proximité est fondamentale : le seul qui puisse aller voir le chef d’entreprise et parler avec lui des problèmes qu’il rencontre, c’est celui qui lui a prêté de l’argent et qui a avec lui une relation de confiance. Cela ne se voit pas, mais c’est le cœur du métier de prêteur.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Ce suivi de proximité des entreprises est-il effectué de la même façon dans l’ensemble des régions ?
Par ailleurs, je souhaiterais que vous reveniez sur l’activité de garantie de Bpifrance : des évolutions sont-elles intervenues depuis sa création, qu’il s’agisse de l’orientation de l’activité ou du ciblage de certains secteurs ? Nous savons, par exemple, que le montant en deçà duquel la garantie de Bpifrance peut être déléguée a été porté de 100 000 à 200 000 euros.
Enfin, la société de caution mutuelle pour les entreprises d’artisanat et de proximité, la SIAGI, propose une lettre de pré-garantie, qui permet à l’entreprise de disposer d’un accord de principe avant que le prêt ne lui soit accordé. Qu’en pensez-vous ?
Mme Anne Grommerch. Pourriez-vous nous présenter l’accord que vous avez signé avec le Fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre du plan Juncker ?
M. Arnaud Caudoux. Tous les chargés d’affaires ont le même profil et sont placés sous l’autorité de directeurs régionaux, eux-mêmes rattachés à Joël Darnaud. La gestion est donc homogène sur l’ensemble du territoire. Bien sûr, chaque situation est particulière, mais l’ensemble de nos chargés d’affaires utilisent les mêmes modes d’évaluation et de management, ont les mêmes objectifs, la même culture et la même formation.
S’agissant de la garantie, nous avons fait effectivement, il y a deux ans, un choix fondamental en matière d’orientation. Ce choix consiste à faire davantage confiance aux banques et à travailler plus vite avec elles, en augmentant le plafond de la délégation que nous leur confions.
Il existe en effet deux façons de faire de la garantie. Soit nos chargés d’affaires sont sollicités par des banques ou des entreprises auxquelles ils vont proposer une garantie afin de partager le risque ; c’est la méthode que nous appliquions pour les dossiers supérieurs à 100 000 euros. Soit nous offrons aux chargés d’affaires des banques la possibilité, pour des montants donnés et en fonction de critères prédéfinis, de déclarer directement des garanties, sans même nous demander une autorisation préalable. Cette procédure, qui présente l’avantage d’être très rapide, très souple et très efficace en termes de coûts pour les TPE, était applicable aux dossiers inférieurs à 100 000 euros. Nous avons décidé de porter ce plafond à 200 000 euros. Il s’agit d’un acte fort, car nous renonçons à toute forme d’instruction avant de prendre notre part de risque. Nous faisons donc confiance aux banques pour activer notre garantie à bon escient. Elles peuvent ainsi faire beaucoup plus, très rapidement.
Nous avons, en outre, étendu le champ de cette garantie en délégation au financement de la trésorerie, alors qu’auparavant, comme il s’agit de financements plus complexes qui comportent un risque plus important, nous étudiions chaque dossier. Nous espérons pouvoir ainsi atteindre un plus grand nombre de TPE, qui sont les entreprises les plus concernées par les problèmes de trésorerie. J’ajoute que nous avons également étendu ces garanties à l’outre-mer, ce qui n’était pas le cas avant pour des raisons techniques.
L’autre choix important qui a été fait il y a deux ans a consisté précisément à relancer les garanties de trésorerie, que nous avions testées dans le cadre du plan de relance. Il s’agit d’un domaine dans lequel nous n’intervenions pas auparavant, dans la mesure où le financement de la trésorerie, par découvert ou par ligne de crédit, est l’objet même du marché bancaire. Mais, compte tenu des tensions qui sont apparues il y a deux ans, nous avons décidé de garantir les banques lorsqu’elles financent de la trésorerie à moyen terme, c’est-à-dire cinq ans. Nous offrons ainsi un confort à l’entreprise en lui donnant une visibilité sur ses crédits de trésorerie.
Par ailleurs, nous ne définissons pas d’orientation sectorielle a priori. Nous ne cherchons pas à être plus forts que les banques ; ce sont elles qui savent quand et sur quel type de dossiers elles ont besoin d’une garantie. Si l’on prend en compte l’ensemble des agences bancaires, les chargés d’affaires qui s’adressent aux TPE sont au nombre de 20 000, contre 500 à Bpifrance. Nous leur faisons donc confiance, et la délégation nous permet de nous démultiplier.
Il convient enfin de noter que le montant des garanties est assez stable, ce qui tombe bien, car nous n’avons pas les moyens de faire davantage. On constate, depuis quelques mois, un renversement qui reflète assez bien l’évolution de la conjoncture : les financements de créations et de transmissions d’entreprise, très complexes pour les banques, augmentent, tandis que les recours défensifs à la garantie, donc les financements d’investissements – qui sont, comme pour la trésorerie, des crédits assez classiques pour les banques –, diminuent un peu. On retrouve ainsi les finalités d’un cycle économique dynamique : en 2014, les créations représentent environ 2 milliards d’euros, les transmissions environ 1,4 milliard et les investissements environ 1,3 milliard.
L’innovation, quant à elle, représente 230 millions d’euros. Cela peut paraître peu, mais il s’agit d’une finalité très ciblée : ces crédits s’adressent à des entreprises labellisées innovantes et au financement de R&D. Nous encourageons les banques à intervenir dans ce secteur mais, en réalité, les activités de ce type sont assez peu financées par des crédits bancaires. Pour les banques qui le souhaitent, il est possible alors de bénéficier d’une garantie supérieure à la moyenne, mais il s’agit d’objets assez spécifiques, qui se développeront sans doute que si le marché bancaire et l’économie repartent.
Au demeurant, un financement bancaire garanti ne remplacera jamais les aides à l’innovation, qui interviennent en amont de la dette bancaire et même du capital-risque et qu’il est donc absolument indispensable de préserver. Le risque est très important – on perd un dossier sur deux –, mais tous les success stories de ces dix dernières années ont bénéficié de l’aide à l’innovation. Il faut donc trouver des solutions au manque de dotations.
L’accord que nous venons de conclure avec le Fonds européen d’investissement (FEI) dans le cadre du plan Juncker est une de ces solutions. Il nous permettra en effet de consacrer environ 400 millions à des Prêts Innovation (PI-FEI), que nous accorderons nous-mêmes et qui seront garantis à la fois sur fonds d’État et sur fonds du FEI. Le profil de risque se rapproche d’une aide à l’innovation : ce type de prêts est moins agressif qu’une subvention ou qu’une avance remboursable mais beaucoup plus risqué qu’un prêt bancaire, même garanti.
Mme Anne Grommerch. Ces prêts s’adresseront à des PME et à des ETI innovantes. Qu’en est-il des TPE ?
M. Arnaud Caudoux. Ils peuvent, le cas échéant, s’adresser également à des TPE très ambitieuses – je pense à des start-ups qui auraient un programme d’investissement très important –, mais la cible du Prêt Innovation est constituée d’entreprises qui ont une capacité d’endettement. Ce produit-là ne remplacera donc ni l’avance remboursable ni la subvention. En revanche, il nous permettra d’améliorer grandement le financement de la R&D d’entreprises dont la trajectoire de croissance très forte est difficile à appréhender pour un banquier normal, qui a besoin de prévisibilité. Je pense à des entreprises dont l’EBITDA (les résultats avant frais financiers, impôts, dépréciations et amortissements) peut être encore négatif et dont les prévisions de croissance sont tellement vertigineuses qu’elles sont difficiles à croire.
Mme Anne Grommerch. J’ai moi-même pu constater, dans ma circonscription, que les banques avaient peur de ce type d’entreprises dont elles ne connaissent pas le modèle économique, si bien que certaines ne sont pas parvenues à se faire financer alors même que la BPI était à leurs côtés. Ne faut-il pas apprendre aux banques traditionnelles à travailler avec ces start-up innovantes, qui seront de plus en plus nombreuses ?
M. Arnaud Caudoux. Il faut être conscient du fait que les banques souhaitent entrer au bon moment dans ces entreprises, et elles s’appuient, pour cela, sur Bpifrance. Pour autant, elles ne sont pas faites pour financer une entreprise dont le taux de croissance sera peut-être de 50 % par an mais qui a aussi 50 % de chances de ne pas se développer du tout. Pour ce modèle-là, il existe le capital-risque, qui s’est particulièrement bien développé en France, grâce à l’action de CDC Entreprises puis de Bpifrance.
L’une de nos missions est d’assurer le passage de relais entre le capital-risque et la banque ou l’investisseur plus classique. C’est l’objet des outils intermédiaires que sont les prêts mezzanine ou les venture loan, auxquels s’apparentera d’ailleurs le PI-FEI. Ces produits nécessitent cependant des compétences très pointues dont les banques ne disposent pas de manière délocalisée. Dans la mesure où, grâce à l’innovation et au capital-risque, nous connaissons le business model de ces entreprises, nous pouvons leur expliquer la manière dont elles fonctionnent et quantifier le risque mais la banque de réseau classique est rarement adaptée à ce type d’opérations. En revanche, certaines banques, dans certains secteurs, ont des experts centralisés qui sont capables de fixer au crédit – qui vaut beaucoup plus cher – un prix beaucoup plus élevé, mais cela reste encore assez rare. À cet égard, la centralisation peut avoir du bon. Néanmoins, encore une fois, ce sont les subventions – elles existent d’ailleurs dans tous les pays – qui rendront le dossier « digeste » pour les acteurs financiers.
J’en viens à la lettre de pré-garantie proposée par la SIAGI, société que nous connaissons très bien pour en être le premier actionnaire après les chambres de métiers et d’artisanat. Il s’agit d’un dispositif que nous avons testé dans les années 1990 et dont nous sommes un peu revenus. Je le vois comme le pendant de la délégation de décision. Notre objectif est de faciliter le travail de l’entrepreneur et celui de la banque. Pour cela, le « parcours client » doit être le plus simple et le plus rapide possible. Or, dans le cas de la lettre de pré-garantie, il nous faudrait recevoir l’entrepreneur et étudier son dossier une première fois avant qu’il n’ait vu sa banque, puis une seconde fois après qu’il aura présenté à celle-ci sa lettre de pré-garantie sous conditions. Une telle procédure nous a paru, d’une part, assez complexe, pour la BPI, pour l’entreprise et pour la banque et, d’autre part, chronophage pour nos chargés d’affaires. En effet, ce type de produits n’attire pas seulement les entrepreneurs qui ont une véritable démarche d’emprunt, mais aussi ceux qui se demandent simplement s’ils auraient la garantie dans l’hypothèse où ils emprunteraient. Pour ces raisons, nous avons fait le choix de ne pas explorer cette piste et de privilégier la délégation, qui fonctionne de manière inverse puisqu’elle permet à la banque de savoir, lorsqu’elle rencontre un entrepreneur, s’il aura droit ou non à la garantie de Bpifrance.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Ma première question est d’ordre politique : entre les ratios de solvabilité, qui sont fixes, et les ratios de rentabilité qui lui sont imposés par ses actionnaires, la BPI ne se trouve-t-elle pas prise dans une contradiction ? Comment, en effet, être rentable en soutenant des projets qui peuvent être risqués ?
Par ailleurs, la France est le deuxième pays européen en matière de capital-risque, ce dont nous pouvons nous féliciter. En revanche, nous ne sommes pas très bien classés en matière d’amorçage. Du reste, nous rencontrons régulièrement des entrepreneurs qui nous font part de leurs difficultés au cours de cette phase de développement de leur entreprise. Comment expliquer un tel décalage ?
M. Arnaud Caudoux. En ce qui concerne l’équilibre entre solvabilité et rentabilité, nous sommes pris dans la même spirale que l’ensemble des banques. Le choix a été fait de soumettre la banque publique de développement française à la régulation de la BCE – de nombreux pays n’ont pas fait le même choix. Cette régulation est de nature à rassurer le contribuable, elle nous oblige à adopter les meilleures pratiques bancaires et à jouer notre rôle d’établissement de place de manière plus efficace. Loin de moi, donc, l’idée de remettre en cause ce choix, mais il est exigeant.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Est-ce un choix ou une obligation découlant de la taille de la BPI ?
M. Arnaud Caudoux. C’est une obligation dès lors que l’on considère que la BPI, même si elle est publique et partenaire des autres banques, est d’abord une banque de marché fonctionnant comme les autres. Certaines banques publiques, notamment la KfW allemande, ne sont pas régulées par la BCE. La KfW est pourtant dix fois plus importante que la BPI, puisque son champ de mission couvre à la fois celui de la BPI et celui de la Caisse des dépôts. Celle-ci, d’ailleurs, n’est pas non plus régulée par la BCE, alors qu’elle ressemble à bien des égards à une banque. Être régulé par la BCE reste donc d’une certaine façon un choix, celui de fonctionner d’abord comme une banque. Ce choix reflète ce que sont nos métiers, qui sont strictement bancaires, et traduit la volonté d’avoir les meilleures pratiques et d’être établissement de place.
Quoi qu’il en soit, la BPI se voit imposer, à ce titre, des ratios de solvabilité dont les minima réglementaires augmentent depuis plusieurs années et continueront à augmenter jusqu’en 2019, pour atteindre environ 12 %. Parallèlement, elle est soumise à des exigences de rentabilité par ses actionnaires qui, pour augmenter le ratio de solvabilité, apportent des fonds propres qui ne peuvent pas baisser à proportion de l’augmentation du ratio. Cette spirale représente pour le financement de l’économie un risque, qui a été un peu masqué par le quantitative easing de la BCE mais qui est réel et qui va perdurer.
Notre chance tient à deux éléments. Tout d’abord, les exigences de rentabilité de notre actionnaire tiennent compte de nos métiers, de sorte qu’il nous demande, non pas 10 % à 12 % de retour sur fonds propres, mais 3 % à 4 %, soit le coût du capital de l’État. Aujourd’hui, il nous est possible de parvenir à ce niveau de rentabilité, grâce au second élément, qui est que nous gérons des ressources publiques. Les fonds de garantie sont en effet un amortisseur de risque considérable, donc un lisseur de résultats. La caractéristique de notre profil risque-rentabilité est ainsi d’être beaucoup plus stable que celui d’une banque et globalement un peu moins élevé. Depuis 2008, le retour sur investissement – je parle ici uniquement du financement bancaire et non de l’investissement, qui n’est pas soumis à ces contraintes – est toujours compris entre 2 % et 4 %.
Au demeurant, les métiers du financement de l’innovation et de la garantie, ne ressemblent pas à des métiers bancaires. Si l’on ne retient que le métier de prêteur, notre rentabilité est nettement plus élevée, puisqu’elle se situe autour de 6 %. Elle traduit notre volontarisme et notre discernement dans le choix des dossiers que nous finançons. C’est important, car le coût du risque est un dragon qui dort : on ne sait pas exactement quand il va se mettre à cracher du feu mais on est certain que cela va arriver. Il faut donc y être attentif, pour le bien des entreprises elles-mêmes puisque notre capacité à intervenir en dépend directement.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Cela signifie-t-il a contrario que si l’État et la Caisse des dépôts demandaient une rentabilité moindre, vous pourriez prendre davantage de risques ?
M. Arnaud Caudoux. Le risque n’est pas un continuum. Il n’y a pas de voie moyenne : soit le dragon dort, soit il crache du feu. Si on me dit, demain, que je peux diminuer le ROE (Return on equity) de 5 %, je ne pourrai pas régler mon curseur pour augmenter le coût du risque de 5 %. C’est une question de discipline, qui vaut pour la banque comme pour l’entreprise : prêter à une entreprise qui n’a pas les moyens d’emprunter n’a aucun sens – à l’exception de l’existence d’outils adaptés à des cas particuliers, comme les start-up qui entrent en phase de croissance.
Notre niveau de rentabilité correspond, pour ce qui est du financement, à la rentabilité accessible, aujourd’hui en France, au métier de prêteur, dans le cadre réglementaire bancaire que vous avez évoqué et avec une efficacité opérationnelle assez satisfaisante. L’autre mesure importante de la rentabilité est le coefficient d’exploitation, c’est-à-dire le rapport entre le produit net bancaire et les charges opérationnelles de la société. Ce coefficient d’exploitation est, pour la BPI, de 45 %, ce qui, comparé à celui des autres banques intervenant dans ce secteur d’activité, est plutôt satisfaisant.
Mme Anne Grommerch. Ces bons résultats sont notamment liés à la régionalisation de la BPI qui permet à ses directeurs régionaux d’avoir une bonne connaissance du terrain. Comment allez-vous vous organiser dans le cadre de la nouvelle carte régionale ? Allez-vous conserver la structure actuelle, qui montre son utilité ?
M. Arnaud Caudoux. Il est hors de question de fermer des directions régionales ; elles ne seront donc plus régionales au sens administratif du terme, mais elles auront toujours des directeurs régionaux à leur tête. Nous allons même ouvrir des délégations, c’est-à-dire des succursales d’antennes régionales, dans quelques villes – nous avons ouvert la première à Bourg-en-Bresse la semaine dernière – où nous considérons qu’il existe un potentiel entrepreneurial qui justifie cette relation de proximité. Il est en effet important d’être proche des PME et des ETI, pour la qualité du service comme pour la maîtrise des risques. Les modèles quantitatifs sont utiles, mais si l’on s’en contente, on s’expose à de très mauvaises surprises car il faut connaître l’entreprise, pour appréhender réellement le risque. Ainsi, nos chargés d’affaires et notre comité d’engagement sont capables de déjuger un modèle de risque parce qu’ils savent soit que l’entreprise est très bonne, soit, au contraire, qu’elle rencontre des difficultés qui ne se traduisent pas dans les chiffres. La proximité est donc absolument fondamentale pour l’équilibre de la banque et pour notre rôle de conseil aux entrepreneurs.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Est-ce à dire que la BPI mène une politique d’ouverture de nouvelles antennes ?
M. Arnaud Caudoux. Il y a actuellement 24 directions régionales et 42 antennes, et la décision a été prise, en accord avec nos actionnaires, d’ouvrir quatre ou cinq agences supplémentaires.
Par ailleurs, contrairement à M. le rapporteur, je n’ai pas le sentiment que la France soit mal classée au plan européen en matière de capital-amorçage. Qu’elle porte sur la présence des fonds d’amorçage ou sur le nombre d’accélérateurs ou d’incubateurs sur le terrain, il me semble que la comparaison ne nous est pas défavorable. En tout état de cause, la BPI fait beaucoup pour soutenir l’amorçage sous toutes ses formes. Aux entrepreneurs dont les projets ne sont pas suffisamment ambitieux pour qu’ils aient besoin de lever des fonds propres et de recourir au capital-amorçage, nous proposons, avec France active et le Réseau Entreprendre, des outils de soutien tels que des petits prêts d’accompagnement à la naissance de l’entreprise. Quant à ceux qui ont besoin de lever du capital, ils peuvent s’adresser au Fonds national d’amorçage, créé par le PIA et doté de 400 millions d’euros – ce qui est beaucoup –, qui finance des fonds d’amorçage capables de faire des premiers tours de table, voire des premiers tours de table bis si cela se justifie.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. À ce propos, je suppose que nous allons assister, dans le cadre de la réorganisation territoriale, au regroupement de fonds régionaux. En ce qui concerne l’amorçage, la difficulté est liée au fait qu’on ne peut pas attendre le niveau de rentabilité d’une banque commerciale lorsque l’on intervient dans des secteurs où beaucoup de projets sont risqués.
M. Arnaud Caudoux. La gestion des outils régionaux, notamment des fonds d’investissement, qui est le plus souvent assurée par des acteurs privés, est à la main des régions. Il leur appartient donc de mener ou non une politique de fusion. Nous y sommes, quant à nous, plutôt favorables, car nous estimons que la bonne gestion d’un fonds d’investissement dépend d’abord de sa taille : plus son aire d’action sera étendue et plus le montant qu’il a sous gestion sera important, plus il sera en mesure d’identifier les bons investissements, d’avoir des équipes capables de les analyser puis d’accompagner les entreprises de manière professionnelle. Quant aux fonds d’innovation et aux fonds de garantie régionaux que nous gérons directement, ils sont aux mains des régions, mais nous faisons le pari qu’un regroupement aura lieu ; nous sommes au service des conseils régionaux dans ce domaine.
En ce qui concerne l’amorçage, son financement a peu à voir avec la dette bancaire. Nous traitons en effet le financement de la création à travers la garantie, de sorte que nous ne nous heurtons pas, dans ce domaine, aux exigences de rentabilité. Ce sont les fonds publics qui nous permettent de soutenir France active aussi bien que la Société générale ou la BNP lorsqu’elles accordent un prêt à un entrepreneur. Qu’il s’agisse des banques commerciales ou des différents réseaux d’accompagnement – France Initiative, France active et le Réseau entreprendre –, ils le font mieux, avec notre garantie, que nous ne le ferions directement. La BPI ne finance donc pas la création en dette, sur ses fonds propres, mais elle soutient ceux qui le font en leur apportant sa garantie. Quant aux entrepreneurs qui ont besoin d’aller plus vite, à une échelle plus importante, ils peuvent faire appel au capital-risque. C’est, là aussi, un secteur que nous connaissons bien et que nous soutenons fortement, en particulier grâce au PIA. Mais il s’agit effectivement d’un segment difficile, voire impossible, pour le marché.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous avons eu l’occasion d’évoquer la question du coût de la commission de garantie. Pouvez-vous nous confirmer que le mécanisme de la garantie est appliqué de manière uniforme dans l’ensemble du territoire et que cette commission est appelée dans toutes les situations en une seule fois au moment où les prêts sont accordés ?
Par ailleurs, le taux de la commission dépend-il du risque tel qu’il est apprécié par Bpifrance dans son analyse du dossier de l’entreprise ?
M. Arnaud Caudoux. Pour un fonds donné, donc une situation de risque donnée, les commissions sont appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Lorsque les fonds de garantie régionaux que nous gérons co-garantissent avec des fonds nationaux, nous veillons à ce que le tarif de la garantie régionale soit bien homogène. Nous ne négocions pas le niveau de tarification avec les régions : il est le même dans tous les territoires.
Par ailleurs, il est exact que nous avons choisi, il y a maintenant plusieurs années, de prélever la commission en une seule fois ; c’est préférable pour nous et pour l’entrepreneur. C’est la banque qui paie la commission de garantie car c’est elle qui sera indemnisée en cas de problème, et non l’entrepreneur. Or, lorsque le paiement de la commission de garantie était échelonné dans le temps, nous observions deux dérives :
– Premièrement, la banque reportait souvent directement sur l’entrepreneur la charge du paiement de la garantie, ce qu’il nous était très difficile de contrôler en amont. Ainsi, nous pouvions nous trouver contraints de prélever les entrepreneurs. Le seul moyen d’empêcher cette pratique, qui n’est pas très correcte, est de négocier les modalités de paiement de la commission en amont.
– Deuxièmement, on court le risque qu’en cours de route, du fait de l’entrepreneur ou du banquier, la garantie ne soit plus payée. Or, dans ce cas, nous déchoyons le bénéficiaire de la garantie, ce qui est très désagréable pour la banque – mais après tout, elle est victime de sa mauvaise gestion – mais aussi pour l’entrepreneur, qui n’est plus protégé contre l’hypothèque sur sa résidence principale et le recours à ses sûretés personnelles. Pour ces deux raisons, nous avons donc fait le choix de prélever la commission up front, c’est-à-dire en une fois au moment où la garantie est accordée.
Le coût de celle-ci reste le même, 0,7 % du prêt par an – soit 3 % à 3,5 % du montant total d’un prêt de sept ans amortissable –, mais il est, de ce fait, plus visible, surtout dans un contexte où les taux sont très bas. Payer 0,7 % par an, ce n’est en effet pas la même chose lorsque l’on emprunte à 1 % ou à 4 %.
Nous sommes donc victimes de deux phénomènes qui ont modifié la perception du coût de la garantie : d’une part, il a, du fait de la baisse des taux, beaucoup augmenté en proportion relative et, d’autre part, il est prélevé up front. Toutefois, la banque n’est pas tenue de le reporter directement : elle peut également intégrer la commission dans le montant du prêt ou la rééchelonner auprès de son client. Nous ne sommes pas en mesure d’imposer une de ces options à la banque. Or, le fait est que les retours de perception que nous avons eus correspondent aux situations où la banque a reporté directement le coût de la commission. Elle est libre de faire mais, pour les entreprises auxquelles cela poserait un véritable problème, il est parfaitement possible de s’accorder avec la banque sur un rééchelonnement.
J’ajoute qu’il est plus efficace opérationnellement d’avoir un seul flux financier plutôt que d’en avoir un par trimestre pendant sept ans, par exemple. De fait, la commission n’est pas chère et, en fin de vie d’un prêt, elle ne se monte qu’à quelques dizaines d’euros, de sorte qu’il arrivait que nous ayons des coûts d’opération supérieurs aux montants des commissions…
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je souhaiterais revenir sur la répartition des refinancements de Bpifrance, dont 62 % sont effectués auprès des marchés financiers. Le coût est-il, pour vous, différent selon que vous avez recours aux institutions publiques ou aux marchés ? Par ailleurs, Bpifrance envisage-t-elle de solliciter de manière plus importante la BCE ?
M. Arnaud Caudoux. Dans nos financements, la part des marchés obligataires est effectivement de 60 % – et même probablement de 65 % aujourd’hui –, et elle va croître, compte tenu de l’augmentation de nos besoins de refinancement. La part des prêts bilatéraux devient donc marginale. Le fait d’être présent sur les marchés nous donne un prix de marché ; il nous est donc très difficile d’obtenir des conditions différentes dans le cadre de ces prêts – même si cela arrive : nous sommes, avec la BEI, à quelques points de base en dessous de notre prix de marché. Nous parvenons cependant à maintenir notre équilibre économique sans difficultés particulières.
Étant régulés par la BCE, nous avons accès, en contrepartie de la réglementation à laquelle nous sommes soumis, à ses facilités, c’est-à-dire au dépôt au jour le jour, au refinancement à un mois et à trois mois et aux opérations de refinancement ciblées à long terme (TLTRO) lorsque l’occasion se présente. Les TLTRO sont fléchées sur des augmentations d’encours de financement de l’économie, et compte tenu des perspectives de croissance de notre encours nous en avons profité à hauteur d’1 milliard d’euros. Ces facilités de dépôt et d’emprunt au jour le jour sont d’une importance majeure, pour nous comme pour les autres banques, pour gérer la trésorerie au quotidien.
En conclusion, je souhaiterais dire un mot de la dotation pour le financement de l’innovation. Dans le tableau que nous vous avons communiqué, la baisse des dotations se lit d’abord comme une baisse du Fonds unique interministériel, qui soutient les pôles de compétitivité. Or, il faut avoir conscience qu’au-delà de ce fonds, la dotation dont nous bénéficions pour l’aide à l’innovation est passée de 195 millions en 2013 à 175 millions en 2014 et à 159 millions en 2015, avant l’annulation de crédits qui va intervenir. Si cette annulation est équivalente à ce qu’elle fut les années précédentes, nous serons passés en deux ans de 195 millions à 145 millions d’euros.
Jusqu’à présent, nous nous sommes efforcés d’être inventifs pour pallier cette évolution. Nous avons proposé des produits un peu plus sélectifs, et nous avons pu, grâce aux dotations du PIA, nous développer dans d’autres champs de soutien. Mais, en fin d’année, si nous n’avons pas trouvé de solution, nous ne pourrons pas financer des projets que nous jugeons pourtant parfaitement valables, et la situation sera plus critique encore l’année prochaine.
Je me permets d’insister sur le fait que, dans le domaine de l’innovation, rien ne remplace les subventions et les avances remboursables. Encore une fois, tous les pays ont un dispositif puissant dans ce domaine. En taillant dans ce budget, on compromet l’avenir des entreprises innovantes en France. En effet, ces dernières années, toutes les success stories ont bénéficié des aides à l’innovation de l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), puis d’OSEO, puis de Bpifrance. Qui plus est, le potentiel entrepreneurial se développant, nous estimons les besoins dans ce domaine à 200 millions d’euros par an.
Conscients des contraintes budgétaires de l’État, nous avons proposé des solutions. La création d’une fondation pour l’innovation est une option. Elle est probablement complexe à réaliser financièrement, mais il faut étudier toutes les possibilités pour sécuriser ce domaine de notre action, qui est indispensable pour permettre aux entreprises de vivre la suite de l’aventure.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions, monsieur Caudoux, pour votre participation à nos travaux.
Auditions du jeudi 21 mai 2015
Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et M. Pierre Michel, délégué général de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), M. Jean Vecchierini de Matra, président du Comité des investissements de la FFSA, et M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires de la FFSA
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons les travaux de la mission d’information commune sur Bpifrance par une table ronde réunissant des représentants du secteur bancaire et de celui des assurances.
Madame, Messieurs, nous vous remercions de votre présence. Nous avons souhaité compléter le regard porté sur l’activité de Bpifrance par l’analyse qu’en font les autres opérateurs du secteur financier que sont les banques et les assurances. Je rappelle que la Fédération bancaire française compte 383 entreprises bancaires adhérentes, de toutes origines – commerciales, coopératives ou mutualistes - ; la Fédération française des sociétés d’assurance regroupant, quant à elle, 231 entreprises qui représentent 90 % du marché français de l’assurance et près de 100 % de l’activité internationale des entreprises de ce marché.
Les différentes questions qui nous intéressent vous ayant été communiquées, je propose de nous présenter, pour commencer, votre vision de l’action de Bpifrance et des relations qui s’établissent entre elle et les fédérations que vous représentez.
Mme Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française. La Fédération bancaire française regroupe en effet l’ensemble des réseaux bancaires, lesquels ont établi de longue date un partenariat avec Bpifrance et les organismes qui l’ont précédée. Celle-ci est d’ailleurs, en tant qu’établissement doté d’un statut bancaire, adhérente de la Fédération bancaire française, à la gouvernance de laquelle elle est pleinement intégrée puisqu’elle participe, notamment, à sa commission Banque de détail et banque à distance et, depuis 2014, à son comité Export. Si Bpifrance est une banque spécifique, elle est donc, pour les adhérents de la fédération, un partenaire et un « confrère ».
En 2012, exprimant sa vision de ce que pourrait être la mission de la BPI, la FBF s’était déclarée favorable à sa création, dans la mesure où elle permettrait d’harmoniser, de rationaliser et de rendre plus efficaces et cohérents les différents dispositifs publics et sectoriels existants, nationaux et régionaux, et de mener, dans le respect des règles concurrentielles et bancaires, une action complémentaire de celle des banques pour répondre aux besoins non satisfaits des PME, des ETI et des TPE.
J’ajoute que, conformément à la pratique qui prévalait avec les organismes qui l’ont précédée, certaines des banques adhérentes de la FBF sont actionnaires de Bpifrance à hauteur de 8 % ; elles ont, à ce titre, un représentant au conseil d’administration de Bpifrance Financement et sont présentes au sein de son comité financement et garanties.
Par ailleurs, les 105 comités territoriaux de la FBF – plus connus des élus locaux sous le nom de Comités des banques – ont tissé des liens très étroits avec Bpifrance qui, grâce à son organisation régionale, entretient un dialogue suivi avec les partenaires bancaires sur le terrain. Au reste, nous constatons aujourd’hui que le partenariat entre Bpifrance et les réseaux bancaires joue à plein, que ce soit en matière de cofinancement sur les prêts à moyen et long terme ou de garantie des crédits bancaires. Cette garantie, qui est un outil extrêmement utile, préexistait à Bpifrance, mais son maintien et son bon fonctionnement étaient pour nous un enjeu fondamental. En 2014, la BPI a ainsi garanti, dans le cadre d’un partage du risque de perte finale avec la banque, 7,8 milliards d’euros de prêts bancaires souscrits par 66 000 entreprises.
Pour situer l’action de Bpifrance au sein de l’activité générale des banques, il faut rappeler que sa part de l’encours des prêts bancaires aux sociétés non financières sur le territoire français, qui est actuellement de 849 milliards d’euros, s’élevait, fin 2014, à 23,8 milliards d’euros, soit 2,8 % de cet encours qui a un taux de croissance annuelle de 3,4 %. S’agissant de la production des prêts bancaires – dont le rythme s’accélère, puisqu’elle est passée de 184 milliards d’euros fin 2014 à 190 milliards d’euros –, le cofinancement de Bpifrance a porté, en 2014, sur 5,5 milliards d’euros, soit environ 6 % de la production.
Dans le cadre de leur partenariat, Bpifrance déléguait aux banques la décision de garantie pour le financement d’opérations en faveur des TPE d’un montant inférieur à 100 000 euros. Une nouvelle version de la convention, entrée en vigueur en 2015, a porté le plafond de la délégation de garantie à 200 000 euros et étendu le dispositif à l’ensemble des PME. Nous nous félicitons de cette évolution, qui permettra de fluidifier l’activité des banques et la distribution des produits de garantie de Bpifrance.
Globalement, ce partenariat fonctionne bien. La profession considère en effet que Bpifrance joue correctement son rôle d’acteur de place, qui est utile là où le marché a le plus de mal à répondre aux besoins des PME et des TPE. Elle estime néanmoins nécessaire de veiller à ce que l’action de Bpifrance soit bien complémentaire de celle des banques, et qu’elle ne s’y substitue pas ou ne la concurrence pas là où il n’y a pas de carence du marché. De petites difficultés ont en effet pu surgir, çà et là, notamment lorsque Bpifrance a souhaité, probablement pour rééquilibrer son portefeuille, intervenir auprès d’ETI de taille importante qui auraient pu se financer directement auprès des banques. Cependant, je ne veux pas donner le sentiment que ce problème se pose de manière générale : il a pu se poser, dans certains cas, et notamment lors de la distribution des préfinancements du CICE. Dans ce domaine, Bpifrance a été très active auprès des PME et des TPE, et il faut saluer son action, compte tenu des risques que cela comportait. Mais, souhaitant répartir ses risques, elle a pu être amenée à démarcher des entreprises plus facilement finançables directement par une banque. Il a donc été convenu avec les dirigeants de la BPI que, lorsqu’elles apparaissent, ces difficultés concurrentielles puissent être résolues dans le cadre d’un échange avec les banques concernées.
Enfin, Bpifrance mène une action spécifique dans le domaine de l’export, notamment en simplifiant l’accès aux financements pour les PME et les ETI. Bpifrance Export s’est ainsi développée sur le marché du crédit export, en subsidiarité des banques pour les contrats inférieurs à 25 millions d’euros et en cofinancement pour des montants pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros. Or, il nous semble que son intervention en subsidiarité est surtout nécessaire pour les tickets inférieurs à 15 millions d’euros. Il s’agit cependant d’une activité nouvelle ; nous allons donc surveiller la manière dont elle se développe avant d’évoquer, le cas échéant, le sujet avec Bpifrance.
M. Pierre Michel, délégué général de la Fédération française des sociétés d’assurance. L’action de Bpifrance prolonge les projets et partenariats qui avaient été élaborés avec les assureurs français ces dernières années par les opérateurs qui l’ont précédée et qui sont désormais rassemblés en son sein. Je pense notamment au programme France Investissement, né en 2006 d’une initiative prise avec CDC Entreprises, qui permet aujourd’hui de financer en fonds propres des PME et des ETI à hauteur d’environ 700 millions d’euros. De même, les assureurs français qui, jusqu’en 2012, souscrivaient aux émissions obligataires d’OSÉO, souscrivent désormais à celles de Bpifrance pour un encours total aujourd’hui supérieur à 5 milliards d’euros. Celle-ci s’inscrit donc dans la continuité de l’action de ses prédécesseurs et nous permet d’adapter nos programmes et nos partenariats à l’évolution de la situation économique et des besoins des entreprises.
Par ailleurs, l’intervention de Bpifrance présente une spécificité par rapport à celle de nos autres partenaires. En effet, lorsqu’elle participe à un programme avec nos adhérents, elle le fait de manière directe, sans que la fédération joue le rôle de structuration ou de coordination qu’elle assure, par exemple, dans les opérations de financement entreprises avec la Caisse des dépôts. Ces relations directes s’inscrivent dans un cadre souvent multilatéral - le programme France Investissement concerne ainsi cinq assureurs et peut-être davantage demain – ou bilatéral, comme dans le cas du programme de prêts intitulé Prêts d’avenir, mis en œuvre avec un grand acteur de la place.
Bpifrance occupe donc un positionnement intermédiaire entre, d’une part, les décisions d’investissement prises au cas par cas par les assureurs dans le cadre de leur politique d’allocation d’actifs et, d’autre part, les actions de place qui peuvent être en partie coordonnées par la fédération professionnelle. En jouant ce rôle original, qui peut également l’amener, par exemple, à labelliser des fonds d’investissement, Bpifrance complète le paysage du financement des entreprises en France.
Mme la présidente Véronique Louwagie. La commission que Bpifrance facture aux banques lorsqu’elle garantit un prêt est prélevée en une seule fois, dès le début, mais il apparaît que les banques la facturent ensuite aux entreprises selon des modalités variables. La commission peut ainsi être prélevée également en une seule fois ou à chaque échéance. Quels sont les critères qui déterminent leur choix en la matière ?
Ma seconde question porte sur les relations entre Bpifrance et les sociétés d’assurances. Ces dernières sont traditionnellement tournées vers des actifs sans risque et à long terme, mais elles sont de plus en plus sollicitées pour financer les PME. Quels sont, selon vous, les types d’action que Bpifrance et les sociétés d’assurances pourraient mener conjointement pour renforcer le financement des PME ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Lors d’un de nos déplacements, en Basse-Normandie, nous avons constaté que Bpifrance pouvait parfois apparaître comme une agence de notation locale, dans la mesure où, lorsqu’elle refuse un dossier, les banques commerciales, craignant un mauvais risque, peuvent être tentées de ne pas s’engager. Avez-vous le sentiment que Bpifrance joue un tel rôle dans les régions et pensez-vous que sa capacité d’expertise du risque est supérieure à celle des banques commerciales ?
Par ailleurs, la valeur ajoutée du cofinancement de Bpifrance est-elle reconnue dans le domaine des prêts de développement avec garantie destinés à financer notamment l’investissement matériel ? Des failles de marché sont-elles identifiées dans ce secteur ?
Mme Marie-Anne Barbat-Layani. La commission unique de garantie est un mécanisme qui ne semble pas poser de problème particulier aux banques. À notre connaissance, cette commission est également payée en une seule fois par l’entreprise, mais les modalités de facturation dépendent de la politique commerciale des réseaux.
M. Pierre Bocquet. Bpifrance a en effet modifié son mode de facturation afin de prélever sa commission en une seule fois. À ce jour, nous n’avons pas eu de retours négatifs, même si nous n’avons pas une connaissance exhaustive de ce qui se passe dans l’ensemble des réseaux. En revanche, les banques ont soulevé la question de la communication des informations financières liées à cette garantie, communication qui mérite sans doute d’être améliorée. Ces informations sont en effet nécessaires pour que calcul du TEG, dans lequel la banque doit intégrer cette commission, puisse être fait dans de bonnes conditions juridiques.
M. Pierre Bocquet. Que le prélèvement de la commission de garantie en une seule fois pose des problèmes dans certains cas, c’est compréhensible. En effet, la somme doit être décaissée immédiatement et elle est prélevée par la banque pour le compte d’un tiers, en l’espèce Bpifrance, ce qui peut être délicat dans le cadre d’une relation commerciale. Il est donc important que le mécanisme puisse être bien expliqué et que la banque dispose de tous les éléments financiers pour que l’entreprise soit le mieux informée possible. Qu’il s’agisse de co-financement ou de co-garantie, je rappelle que ce sont les banques qui sont à l’origine des dossiers. Les entreprises ne s’adressent pas directement à Bpifrance ; elles vont d’abord voir leur banque, laquelle pourra leur proposer, afin de faire aboutir plus facilement leur dossier, de partager soit le risque dans le cadre d’une co-garantie, soit le financement en tant que tel si le projet est plus important.
Mme Marie-Anne Barbat-Layani. S’agissant du rôle d’agence de notation locale que jouerait Bpifrance, je crois qu’il ne faut pas se méprendre : il serait inadapté, voire dangereux, qu’elle soit amenée à remplir de fait ou, pire, de droit, un tel rôle. Au demeurant, les banques commerciales ont leur propre analyse du risque ; c’est leur métier. Dès lors, il est possible que si Bpifrance est amenée à refuser un dossier, les banques de la place le refusent également pour les mêmes raisons : il n’est pas illogique que leurs analyses de risque respectives coïncident. Bpifrance comme les banques examinent d’ailleurs d’assez près l’étude de la situation de l’entreprise faite par la Banque de France – même si celle-ci n’est pas une agence de notation.
Bpifrance peut jouer dans certains cas – c’est même le cœur de son action – un rôle de catalyseur, en permettant le financement d’un projet qui n’aurait pas été possible sans son intervention. Mais, dans l’immense majorité des dossiers, il n’est pas fait appel à Bpifrance. Accorder des prêts à leurs clients, parmi lesquels se trouvent des millions d’entreprises, relève de l’activité habituelle des banques.
M. Pierre Bocquet. Au sein même de la banque, plusieurs regards sont portés sur un même dossier, en particulier lorsqu’un refus est envisagé. L’avis de Bpifrance peut être sollicité par la banque, si celle-ci estime qu’un co-financement ou une co-garantie peut permettre au projet d’aboutir. Cet avis est un élément à prendre en considération, mais ce n’est jamais qu’un des éléments pris en compte dans l’analyse du risque, le plus important d’entre eux étant la connaissance que la banque a de l’entreprise et son dialogue avec l’entrepreneur. Deux notations ne font pas l’accord de crédit : il ne s’agit pas d’un guichet de distribution automatique, et c’est heureux.
Mme Marie-Anne Barbat-Layani. La question des refus de crédit est extraordinairement sensible. Or, actuellement, la France est dans une situation extrêmement favorable en matière d’accès au crédit des PME. C’est, du reste, le message que nous adressons aux entrepreneurs sur le terrain : le moment est particulièrement propice pour emprunter. Non seulement les taux d’intérêt sont extrêmement favorables, mais 94 % des demandes de crédit d’investissement et 83 % des demandes de crédit de trésorerie des PME sont acceptées par les banques. Ces taux d’acceptation, qui sont en augmentation constante depuis un an, sont les meilleurs de la zone euro et de l’Union européenne.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Bien entendu, ces statistiques prennent en compte les dossiers qui ont fait l’objet d’une analyse du risque et d’une décision écrite de la banque…
M. Pierre Bocquet. Ils sont issus d’une enquête de la Banque de France qui a été réalisée auprès des entreprises elles-mêmes et dont il ressort que le taux de refus est limité à 2 %. Évidemment, lorsqu’un dossier n’est manifestement pas finançable, il n’est de l’intérêt ni de l’entrepreneur ni de la banque d’aller au terme de la démarche. En revanche, il est important de dialoguer avec l’entrepreneur afin d’identifier les défauts de son projet. Les banques se sont d’ailleurs engagées à expliquer les raisons de leur refus : elles veulent être de véritables partenaires de l’entreprise avec laquelle elles se sont engagées sur le long terme. Leur intérêt est en effet de faire du crédit et d’accompagner le développement de l’entreprise.
Quant aux prêts de développement de Bpifrance, qui sont perçus comme du quasi-fonds propres, ils sont extrêmement utiles et leur développement n’est pas étonnant. On connaît en effet les réticences qu’ont parfois les entreprises à ouvrir leur capital pour continuer à croître. Le fait qu’elles décident, le plus souvent conseillées par leur banque, de souscrire un prêt de développement, qui est une alternative à l’augmentation de capital, est donc une bonne chose.
M. Jean Vecchierini de Matra, président du Comité des investissements de la Fédération française des sociétés d’assurances. Bpifrance est un excellent partenaire pour les compagnies d’assurances, comme en témoigne le programme France Investissement, par exemple. Mais elle est un partenaire parmi d’autres. D’autres types de coopération sont-ils envisageables ? Pourquoi pas, nous sommes à l’écoute. Cependant, nous avons déjà l’expérience de coopérations très efficaces avec la Caisse des dépôts en matière de financement des ETI et des PME. Les assureurs, pleinement conscients du nombre insuffisant de ce type d’entreprises dans notre pays, contribuent en effet volontiers à l’effort consenti pour les développer. Au demeurant, la conjoncture actuelle, notamment la faiblesse des taux d’intérêt, incite nos financiers à se tourner vers ce type d’investissement, qui peut être à la fois prometteur et utile à la rentabilité des fonds de nos assurés.
Nous avons ainsi constitué, avec la Caisse des dépôts, des fonds de prêt ou de capital en faveur des ETI et des PME : les fonds NOVA, en 2012, et les fonds NOVO, en 2013. Ces opérations se font dans un cadre collaboratif entre des compagnies d’assurances volontaires, la Caisse des dépôts et d’autres organismes qui lui sont proches, tels que le Fonds de réserve des retraites. Le fonds NOVO, premier fonds de prêts à l’économie, a été créé par les assureurs et la Caisse des dépôts pour les assureurs et la Caisse des dépôts. Ses résultats financiers ainsi que ceux des fonds NOVA, consacrés au marché boursier des mid cap, sont extrêmement satisfaisants depuis l’origine. Par ailleurs, nous achèverons, la semaine prochaine, la mise en œuvre d’un troisième fonds, NOVI, une SICAV de long terme qui financera, pour 20 %, des actions cotées d’entreprises, pour 40 %, de la dette non cotée et, pour 40 %, des actions d’entreprises non cotées. Ce fonds de 600 millions d’euros réunit 23 investisseurs, tous volontaires ; il est confié à deux gestionnaires que nous avons choisis au terme d’une compétition très sélective et dont les frais de gestion sont fort raisonnables – ce qui n’est pas toujours le cas dans le monde du private equity.
Ces opérations sont conformes à l’intérêt de nos assurés et contribuent à des politiques publiques, mais de manière volontaire et sélective. Je ne vous cache pas que les assureurs français sont allergiques au fléchage que l’on a pu connaître à certaines époques et que certains acteurs ont la velléité de rétablir. Ce type de dispositif, assez peu moderne est non conforme aux règles communautaires.
Nous menons donc déjà des actions conséquentes avec des entités publiques, et nous entendons les poursuivre. Nous avons ainsi le projet de constituer, avec les mêmes entités et dans le même esprit, un quatrième fonds qu’il serait prématuré d’évoquer plus en détail. Bpifrance peut-elle s’inscrire dans cette démarche ? Il faudrait poser la question au directeur général de la Caisse des dépôts.
M. Pierre Michel. Vous avez dit, Madame la présidente, que les assureurs avaient tendance à investir en actifs sans risque et de longs termes. De longs termes, c’est vrai. Sans risque : ce propos doit être nuancé. En effet, près de 60 % des investissements des assureurs se font dans les entreprises – de tous pays et de toutes tailles, cotées et non cotées –, pour deux tiers sous forme d’obligations, donc de prêts, et pour un tiers en fonds propres. Le montant de ces investissements (en direction des PME et des ETI) s’élève à 51 milliards d’euros. Cette somme conséquente correspond cependant à une fraction modérée des placements totaux des assureurs dans les entreprises, puisque ceux-ci s’élèvent à plus de 1 200 milliards d’euros. En effet, la politique d’allocation d’actifs des assureurs est d’abord dictée par le souci d’être en mesure de régler un sinistre lorsqu’il se produit et de conserver une certaine solvabilité en détenant un portefeuille d’actifs diversifiés et certains. Une fois cette règle d’or respectée, les assureurs sont naturellement des financeurs des entreprises, notamment des PME et des ETI.
En ce qui concerne le fléchage, il est vrai que le droit communautaire interdit aux États membres de contraindre l’allocation d’actifs des assureurs. Cette interdiction est réaffirmée dans la directive « Solvabilité 2 », qui entrera en vigueur dans les États membres au 1er janvier 2016. Bien entendu, cette directive n’empêche pas les assureurs d’investir de plus en plus dans les PME, mais force est de constater qu’elle impose une contrainte supplémentaire dans ce domaine. Nous estimons, pour notre part, que la Commission européenne, qui réfléchit actuellement à une réduction du coût en fonds propres supporté par les assureurs lorsqu’ils investissent dans des projets d’infrastructure, doit aller plus loin et revoir également le coût en fonds propres qui leur est imposé lorsqu’ils investissent en fonds propres ou en dette dans des entreprises non cotées, ce qui est le mode typique de financement des PME et des ETI.
J’ajoute que, pour financer les PME, il est évidemment nécessaire de connaître leur situation financière, c’est-à-dire leur bilan et leur compte de résultat. Il est donc impératif que le projet de loi sur la croissance et l’activité, en cours d’examen, préserve et sanctuarise l’accès des assureurs aux données des entreprises qu’ils sont appelés à financer, faute de quoi ce financement sera impossible.
M. Pierre Bocquet. Nous formulons bien entendu la même demande. Il est en effet essentiel de connaître non seulement la stratégie de l’entreprise, mais aussi ses aspects financiers : c’est la première pierre d’un projet de financement.
Mme Marie-Anne Barbat-Layani. À l’instar de nos collègues assureurs, nous rencontrons des difficultés liées à la réglementation européenne applicable au financement, notamment celui des PME. Je n’en donnerai qu’une illustration. Lorsque les principes de Bâle, qui régissent la réglementation bancaire, ont été transcrits dans une directive européenne relative à la solvabilité des banques, l’Europe a fait le choix de traiter le financement des PME de manière moins stricte que ne le préconisait le Comité de Bâle. Or, à l’automne dernier, celui-ci a passé en revue l’application de ses principes dans les différentes juridictions, et l’Europe a été « épinglée » pour ce choix, dont j’estime pourtant qu’il doit être défendu et maintenu. Nous tenons à exprimer notre inquiétude à ce sujet, car certaines réglementations, en vigueur ou envisagées, notamment dans le domaine comptable, pourraient avoir un impact important sur notre capacité à maintenir la croissance, continue depuis la crise – et, j’y insiste, la France est le seul pays à être dans cette situation –, des crédits aux PME et aux ETI.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Le caractère automatique de la garantie accordée par Bpifrance pour des montants désormais inférieurs à 200 000 euros ne contribue-t-il pas à en faire bénéficier des entreprises auxquelles les établissements commerciaux auraient eux-mêmes accordé leur cautionnement ?
Par ailleurs, ainsi que vous l’avez relevé, Bpifrance est dans la plupart des cas sollicitée par les banques, et non par les entreprises elles-mêmes. Or, dans ses opérations de communication, elle s’adresse directement aux PME et aux TPE. Ces campagnes sont-elles conformes à son objectif, qui est de combler les failles de marché ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Les lettres de pré-garantie proposées notamment par la SIAGI facilitent-elles l’octroi de crédits aux petites structures, notamment artisanales, qui se plaignent d’y avoir un accès difficile ?
Mme Marie-Anne Barbat-Layani. Tout d’abord, je ne crois pas que l’on puisse parler, madame la présidente, de garantie « automatique ». Bpifrance donne aux établissements de crédit une délégation qui les dispense, pour les montants inférieurs à 200 000 euros, de l’obligation de remonter vers elle pour utiliser sa garantie. Une analyse du risque est réalisée. Ce n’est pas parce qu’une délégation est confiée aux banques que celles-ci utilisent automatiquement la garantie.
Ensuite, Bpifrance a tenu à souligner, dans sa communication récente, qu’elle était le partenaire des banques, ce qui est extrêmement important pour la communauté bancaire dans son ensemble. Il serait du reste inutile et absurde qu’elle ne mette pas en avant sa vocation à intervenir à leurs côtés dans un certain nombre de cas. Encore une fois, l’immense majorité des prêts aux entreprises se fait aujourd’hui sans l’intervention de Bpifrance.
Quant aux garanties qui peuvent être accordées par des sociétés de cautionnement telles que la SIAGI, elles sont extrêmement utiles, notamment pour les très petites entreprises, car elles permettent d’éviter le recours aux garanties personnelles des chefs d’entreprise. Nous avons d’ailleurs mis en place, avec la Banque européenne d’investissement (BEI), des dispositifs qui permettent à certains réseaux bancaires de distribuer des prêts sans garanties personnelles.
M. Pierre Bocquet. Je souhaiterais compléter les propos de ma collègue sur ces trois points.
Tout d’abord, je veux rappeler à mon tour que l’immense majorité des dossiers de crédit ne sont pas assortis de la garantie de Bpifrance, qui ne concerne que quelques dizaines de milliers de dossiers parmi le 1,5 million d’entreprises ayant contracté un emprunt. En outre, cette garantie n’est pas automatique : il ne suffit pas de la demander pour en bénéficier. La délégation est précisément encadrée ; elle permet surtout d’accélérer le montage d’un dossier, dans l’intérêt de l’entreprise et de Bpifrance. La garantie est donc accordée lorsqu’elle est nécessaire – et dans l’immense majorité des cas, elle ne l’est pas –, car je rappelle qu’elle a un coût pour l’entreprise. On ne peut donc pas dire qu’il y soit fait un recours généralisé.
En ce qui concerne les opérations de communication de Bpifrance, je rappelle que le financement de l’économie est la première priorité des banques, qui se livrent une concurrence féroce dans ce secteur et pratiquent les taux les plus bas d’Europe. Bpifrance, quant à elle, joue le rôle d’un facilitateur dans les dossiers les plus sensibles. Elle permet le financement de projets dont le niveau de risque est analysé comme important, mais qui sont bien entendu finançables.
Quant à la pré-garantie offerte par la SIAGI, elle est utile, notamment pour les TPE. Elle a pour principal avantage d’amorcer un dialogue entre le chef d’entreprise et un financier, quel qu’il soit. Une partie des difficultés provient en effet de la structuration du dossier, voire de la compréhension de ce qu’implique un besoin de financement ; d’où la nécessité d’un accompagnement des entrepreneurs. La Fédération bancaire a mis en ligne un site - lesclesdelabanque.com – dont une rubrique est spécifiquement destinée aux chefs d’entreprise, qui peuvent y trouver toutes les informations concernant les différents produits. Un nouveau site, très pragmatique et opérationnel – aveclespme.fr – est venu enrichir ce programme d’accompagnement. C’est en effet grâce à une compréhension mutuelle et à une relation de confiance entre l’entreprise, d’une part, et la banque ou une société de garantie comme la SIAGI, d’autre part, qu’un projet pourra aboutir dans de bonnes conditions et que les difficultés qui pourront survenir par la suite seront plus facilement gérables.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame, messieurs, nous vous remercions pour votre contribution à nos travaux.
M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons nos travaux avec l’audition de M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance.
Monsieur le directeur, la BPI est une institution jeune qui, pour être efficace, a besoin d’être visible s’adressant au bon public, que ce soit les entreprises ou les banques mais aussi les institutions partenaires – régions, élus locaux, chambres consulaires.
Malgré des efforts notables, il nous est apparu au fil des auditions que la BPI n’est pas toujours un acteur aussi bien identifié qu’elle devrait l’être. C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons souhaité vous entendre ce matin.
M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance. Vous l’avez dit, la BPI est jeune – elle a été créée par la loi le 13 décembre 2012 mais elle a vu le jour le 12 juillet 2013, à l’issue de six mois de préfiguration au cours desquels ont été définis l’identité visuelle et les chartes associées, autant d’outils nécessaires à la réussite du changement de marque. Il a fallu remplacer quatre marques – OSEO, FSI, FSI Régions, CDC entreprises – par une seule.
Notre action en matière de communication a pour but de faire savoir aux entrepreneurs que la BPI est leur banque, qu’elle les considère comme des clients et non comme des risques et qu’elle est à même de leur redonner du dynamisme et de les inciter à voir loin et grand.
La BPI est une banque exportatrice d’optimisme et de volonté. Elle se doit d’être un outil de motivation pour tous les entrepreneurs sur tous les territoires. Nous souhaitons imposer une marque heureuse et positive le plus vite possible. La BPI est partenaire de confiance des entrepreneurs.
Notre travail s’organise autour de trois objectifs principaux : accompagner, préparer et développer les entreprises en portant les quatre valeurs essentielles que sont la simplicité, la proximité, la volonté et l’optimisme.
Notre action est guidée par le souci constant d’associer le meilleur du public et du privé pour favoriser la croissance et l’emploi. Nous travaillons pour cela en partenariat avec les différentes directions nationales et régionales.
La direction de la communication est chargée de concevoir, de coordonner et de relayer l’ensemble des actions de communication interne mais aussi de mettre en place une stratégie pour faire connaître à tous les publics – clients et partenaires – les missions et les métiers de Bpifrance.
La direction de la communication, née du rapprochement des services de communication des quatre entités précitées, est organisée autour de cinq pôles :
– le premier, marque et image, permet de garantir le positionnement de la marque, d’assurer la création et le développement d’éléments visuels ainsi que de piloter la production publicitaire et l’édition ;
– deuxième pôle, la communication interne et internationale (en interne, il s’agit de renforcer la cohésion des équipes et la fierté d’appartenance) et à l’international, il s’agit de contribuer à augmenter le nombre d’entreprises françaises exportatrices accompagnées par BPI et ses partenaires, notamment Business France et la Coface ;
– troisième pôle, le pôle événements, digital et animation du réseau qui a pour rôle de faire connaître BPI via les audiences en ligne mais aussi par une présence sur le terrain à travers plus de 400 événements sur tout le territoire, événements propres à BPI ou dont nous sommes partenaires. Ce pôle est aussi en charge de l’animation au quotidien avec les directions régionales dans les 42 implantations de BPI sur le territoire ; quatrième pôle, Bpifrance Excellence dont l’objectif est de fédérer et d’animer une communauté de 2 000 entrepreneurs sélectionnés par le réseau commercial de BPI afin de créer une synergie entre ses membres et de les accompagner dans leur croissance en France comme à l’international ;
– dernier pôle, le pôle projets et supports permet d’accompagner les équipes dans le déploiement de leurs projets et d’assurer un suivi budgétaire transversal.
La direction de la communication a pour mission de donner une visibilité et d’expliquer l’action de BPI au service des entreprises, des territoires et des Français.
Bpifrance Excellence rassemble 2 100 entrepreneurs qui représentent environ 460 000 emplois et 74 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ce sont des entreprises qui exportent, innovent et sont en croissance. Lorsqu’ils ont des rendez-vous à Paris avec des investisseurs, des clients ou des partenaires, nous mettons notamment à leur disposition un business lounge. Je vous transmettrai des éléments complémentaires sur le programme d’accompagnement proposé par Bpifrance Excellence.
Le budget de la communication s’élève en 2014 à 11,7 millions d’euros. Il comprend les partenariats avec les médias et les campagnes d’information. Nous avons mis en place un partenariat avec l’ensemble des titres de la presse quotidienne régionale afin de mettre en avant, tous les quinze jours, des entrepreneurs dans les régions. Dans ce même esprit, une émission quotidienne est diffusée sur les 29 télévisions locales. Nous travaillons également avec la presse quotidienne nationale. 85 à 90 % du budget médias est consacré aux médias régionaux.
Ce budget finance également la communication interne. Troisième poste de dépenses, les événements et les salons : Bpifrance est partenaire de 400 événements. Elle organise également ses propres événements, sur les fonds sectoriels ou les ETI par exemple. Le reste des dépenses est consacré au site internet, aux applications mobiles et à la production de contenus.
Mme la présidente Véronique Louwagie. La table ronde sur le financement des entreprises artisanales a mis en lumière le déficit de notoriété de Bpifrance dans les TPE. Quelles sont les pistes de réflexion, associant les banques qui sont censées être les premiers relais de BPI, pour combler ce déficit ?
En 2014, Bpifrance a publié une version de son rapport annuel sous la forme d’une bande dessinée. Quelle analyse a conduit à ce choix inhabituel ? Quel est le public destinataire de ce document ? À combien d’exemplaires et par quels canaux a-t-il été distribué ?
J’ai été étonnée de relever dans les journaux gratuits de la publicité pour Bpifrance. Quelles cibles visez-vous au travers de ces médias ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Nous avons adressé à la BPI un questionnaire le 20 mars. Il reste aujourd’hui des questions précises auxquelles les réponses n’ont pas encore été apportées ; elles portent sur les rémunérations, les contraintes communautaires, l’accompagnement, les fonds de fonds ou l’innovation.
Je m’interroge : alors que BPI met en œuvre des moyens pour communiquer. Il serait souhaitable que le délai ne se prolonge pas. Dans le cas contraire, deux solutions s’offrent à nous : contrôler sur place ou informer le Trésor. J’espère que nous n’aurons pas à recourir à l’un de ces moyens.
La BPI semble développer fortement son rôle d’accompagnement alors que de nombreux autres acteurs exercent déjà cette mission. La BPI entend-elle se positionner comme un nouvel acteur à part entière dans ce domaine ou travaille-t-elle en synergie avec les intervenants existants ?
M. Patrice Bégay. En réponse à votre première question, je vous rappelle que Bpifrance est une banque de place qui travaille au quotidien et de manière complémentaire avec ses partenaires dont font partie les banques.
L’objectif est de créer un effet démultiplicateur et d’entraînement sur le marché bancaire. À ce titre, BPI a mis en place des conventions de délégation en garantie avec les partenaires bancaires pour apporter des solutions de financement plus rapides aux entreprises, notamment aux TPE. Cela fonctionne. Avec la garantie Bpifrance, les TPE peuvent obtenir une réponse immédiate à un besoin de financement urgent. J’ajoute que le montant des prêts garantis par ce biais a été porté récemment de 100 000 à 200 000 euros.
Nous communiquons en direction des banques pour leur faire connaître nos produits d’investissement. Notre site internet est relié aux sites des banques. Les directions régionales et les chargés d’affaires organisent régulièrement des réunions avec les banques pour leur présenter les offres de Bpifrance. Nous faisons un travail quotidien d’information et de pédagogie auprès d’elles. Le « guide banques » que nous mettons à leur disposition est très utilisé.
Quant à la bande dessinée, il est vrai que cette présentation du rapport annuel n’est pas commune. Cette initiative, qui rompt avec les codes de la communication financière, a été plébiscitée par l’ensemble des acteurs. Ce support, qui colle aux évolutions de la communication, s’inscrit pleinement dans la stratégie de BPI en la matière. Les valeurs de proximité et de simplicité que nous souhaitons porter irriguent toutes nos réflexions.
Chacun sait que les rapports annuels ne sont pas lus. Nous avons donc cherché le moyen d’être lus. La bande dessinée a permis de donner un coup de jeune à la communication financière et de mettre en avant de nombreuses femmes chefs d’entreprise. Nous avons reçu beaucoup de courriers de félicitations. Les chefs d’entreprise, dont le temps est compté, sont demandeurs d’une information simplifiée. En outre, la contribution du secteur public au rajeunissement des codes de la communication est pour nous un motif de fierté. Bpifrance, en tant que banque de l’innovation, se devait de faire savoir que l’année 2014 avait été une année record pour elle et pour les entreprises qu’elle a soutenues. Ce format étonnant et inattendu a permis d’élargir la diffusion de notre message.
M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles de Bpifrance. S’agissant du questionnaire, à ma connaissance, il nous reste cinq réponses à apporter. Les autres éléments vous ont été transmis.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous serons sans doute amenés à revenir vers vous pour les réponses dont la précision n’est pas suffisante à nos yeux.
M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet. Des réponses vous ont été fournies. Si vous souhaitez des précisions, nous sommes évidemment à votre disposition.
M. le rapporteur. Les questions posées sont claires alors que les réponses apportées sont parfois floues.
M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet. Nous sommes à votre disposition pour dissiper d’éventuelles imprécisions.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous n’avez pas répondu à ma question sur la communication par le biais des journaux gratuits.
M. Patrice Bégay. Nous avons mené des études sur le mode de vie des entrepreneurs. Compte tenu de la mobilité de ces derniers, l’affichage de proximité et la presse gratuite font partie, avec la presse quotidienne régionale, des premiers vecteurs de communication à leur intention. Nos partenaires bancaires investissent également dans la presse gratuite qui est aussi un moyen de toucher les jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise.
Quant à l’accompagnement, l’un des vecteurs en est Bpifrance Excellence. Notre stratégie est de favoriser les bijections entre la mise en relation des entrepreneurs et le business ainsi que le partage d’expérience entre les membres – l’entrepreneur croit en ses pairs.
Pour ce faire, nos actions sont multiples : l’enrichissement d’une base de données des membres, la création d’une application mobile et d’un site internet dédiés – Bpifrance Excellence est un véritable réseau social d’entrepreneurs. S’y ajoute l’organisation d’événements locaux. Nous avons fait trois tours de France en 24 mois au cours desquels nous avons réuni plus de 11 000 entrepreneurs. Ce succès a été construit main dans la main avec nos partenaires régionaux et les médias locaux.
BPI propose une autre forme d’accompagnement avec Bpifrance Université au sein de laquelle les chefs d’entreprise trouvent des formations de haut niveau répondant à leurs besoins très divers, conçues en partenariat avec HEC et l’EMLYON. Nous avons également créé, avec les régions, un portail d’e-learning proposant des modules courts.
Je mentionne aussi l’accélérateur PME, un programme d’accompagnement sur mesure sur 24 mois pour une soixantaine de PME prometteuses, auquel sont associés l’institut du mentorat entrepreneurial, Pacte PME et Business France.
Enfin, dernière activité d’accompagnement, Initiative conseil permet d’établir un diagnostic flash stratégique et opérationnel sur l’entreprise. Ce diagnostic, que nous finançons à 50 %, est proposé aux dirigeants qui ont besoin de prendre du recul et de faire le point.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Quelles sont les prévisions d’évolution du budget de la communication pour 2015 ?
M. Patrice Bégay. En 2012, le budget de la communication pour les quatre entités avoisinait 15 millions d’euros. Depuis, il a diminué alors même que nous avons dû créer une nouvelle marque et que nous informons de plus en plus de secteurs.
Pour 2015, le budget reste identique. Ce n’est pas facile mais cela nous oblige à trouver de nouvelles idées et à avancer en dépit des contraintes.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous en avons terminé avec les questions. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour les précisions si nécessaire.
M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet. À ma connaissance, nous vous avons fait parvenir toutes les réponses relatives à l’accompagnement. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter les précisions que vous souhaitez.
M. le rapporteur. Nous allons vous adresser un courrier dressant la liste des éléments qui manquent.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Messieurs, je vous remercie pour votre contribution.
Dr Lutz-Christian Funke, senior vice president de KfW Bankengruppe
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie, monsieur Funke, d’avoir répondu à notre invitation. Notre mission d’information qui a été créée à l’initiative du président de l’Assemblée nationale a pour objectif d’établir un premier état des lieux de l’action de Bpifrance, la Banque publique d’investissement, dont la création fut décidée au lendemain de la crise de 2008-2009, et qui a été constituée en juillet 2013.
La KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau – existe depuis bien plus longtemps. Si son modèle est différent de celui de Bpifrance, il nous a paru cependant intéressant de situer l’action recherchée par les pouvoirs publics français par rapport aux choix de son premier partenaire économique. Nous vous remercions donc de nous faire partager votre analyse et votre expérience sur ce que peuvent être le rôle et les moyens d’action d’une blanque publique.
Dr Lutz-Christian Funke, senior vice président de KfW Bankengruppe. La KfW a été fondée en 1948 avec l’argent du plan Marshall, dans l’idée de ne pas verser des subventions directes mais plutôt de subventionner les prêts accordés, de façon à pouvoir récupérer de l’argent. C’est ce que nous faisons depuis presque soixante-dix ans.
La KfW appartient à la République fédérale à hauteur de 80 % et aux länder à hauteur de 20 %. Les länder ne relèvent cependant pas, à proprement parler, de la stratégie de la KfW dans la mesure où chacun d’eux dispose de sa propre banque.
Le siège de la KfW est à Francfort mais nous avons également des succursales à Berlin – depuis la chute du Mur –, à Bonn – après la faillite de la Deutsche Ausgleichsbank – et à Cologne. La KfW a également des bureaux à l’étranger, mais principalement dans le cadre de ses activités d’aide au développement, à l’instar de celles que mène l’AFD, l’Agence française de développement.
Son bilan avoisine aujourd’hui les 530 milliards d’euros, chiffre variable en fonction de la parité avec le dollar. Elle emploie 5 500 personnes environ, contre 1 500 il y a vingt ans.
Elle a donc beaucoup grandi en taille, pour devenir la troisième banque allemande aujourd’hui, et bientôt la deuxième devant la Commerzbank. Cette évolution n’était pas prévue, mais elle donne matière à réfléchir sur celle du marché bancaire.
L’élément le plus important, au regard de nos capacités de refinancement, est la notation AAA. La KfW bénéficie, aux termes de ses statuts légaux, de la garantie de la République fédérale pour son refinancement, mais selon un mécanisme – « l’Anstaltslast » – qui signifie plutôt, en fait, qu’elle ne peut pas faire faillite.
Fait nouveau, la KfW est désormais soumise à la loi bancaire, et relève, comme les autres banques, du régulateur allemand, le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
La banque ne distribue pas de bénéfices. Cette année, ceux-ci ont atteint 1,5 milliard d’euros, et ils sont utilisés pour subventionner les taux d’intérêt des prêts accordés. En d’autres termes, nous subventionnons des programmes via les taux d’intérêt, notre capacité de refinancement nous offrant des marges de manœuvre en la matière. En moyenne, nos taux d’intérêt sont de 1 %. C’est évidemment moins intéressant que par le passé compte tenu du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE. Cela signifie que si une entreprise n’emprunte pas maintenant, elle ne le fera jamais.
Nos prêts respectent un principe de « on-lending » ; autrement dit, ils sont indirects. Nous ne faisons pas de cofinancement. Un accord de non-concurrence nous lie aux banques qui distribuent nos prêts aux entreprises moyennant une commission, dans le cadre de programmes désignés comme étant ceux de la KfW. Nous pouvons ainsi, par exemple, financer la totalité de ces prêts ou y contribuer à hauteur de 50 %, la banque assumant alors le complément.
Mme la présidente Véronique Louwagie. L’intervention de la KfW est donc bien visible pour l’entreprise emprunteuse ?
Dr Lutz-Christian Funke. Oui, et cette visibilité est d’ailleurs nécessaire. Nous avons, pendant un certain temps, pratiqué le « global loan », versant ainsi 1 milliard d’euros à la Deutsche Bank ou 500 millions à la Commerzbank, dans le cadre de prêts aux PME. Or, le client final, dans ces opérations, ignorait la contribution de la KfW. Nous nous sommes donc réorientés vers des programmes plus spécifiques, dédiés en particulier aux start-ups et à l’innovation. Cette visibilité est rendue nécessaire par le niveau de nos taux d’intérêt, sachant qu’un crédit général est plus cher qu’un crédit fléché vers un domaine spécifique. Notre système fonctionne mieux, bien entendu, dans les périodes où les taux d’intérêt sont plus hauts : une entreprise peut aujourd’hui obtenir, de la part des banques, des prêts à 1 % compte tenu de l’abondance des liquidités en Allemagne, et c’est plutôt le niveau d’investissement par les entreprises qui pose problème.
Nos missions sont multiples ; elles résident d’abord dans la promotion de l’économie allemande, et ensuite dans des opérations internationales. S’agissant du premier volet, la « Mittelstandsbank » est dédiée à la promotion des PME, la « Kommunal und Privatkundenbank et le Kreditinstitute », aux constructions de logements, à l’éducation et au financement de projets d’infrastructures communaux. L’ensemble de ces activités représente de 40 à 50 milliards d’euros par an. Quant au second volet, la KfW Banque de développement se consacre à la promotion des pays en développement et des pays émergents ; la KfW IPEX-Bank, elle, est notre bras armé commercial. Nous avons eu, à ce sujet, des discussions avec les banques privées et la direction générale de la concurrence à Bruxelles, discussions qui ont conduit, il y a quinze ans, à l’accord dit Monti 2. La plupart des opérations de financement de l’export sont assurées par cette filiale notée AA. Nous n’avons pas de problème particulier avec les banques privées car les règles sont claires ; au reste, des représentants de ces banques siègent dans notre conseil de surveillance, ce qui leur permet d’exprimer d’éventuels désaccords, en toute transparence.
La KfW est dotée d’un conseil d’administration présidé, selon une alternance annuelle, par les ministres des finances et de l’économie. Ce fonctionnement pose parfois quelques problèmes, au vu des préoccupations parfois différentes de ces deux ministères. Le conseil d’administration comprend notamment sept membres désignés par des ministères ainsi que des délégués du Bundestag et du Bundesrat, dont les sept membres assurent ainsi une représentation des länder. Les autres sièges se répartissent entre des représentants des banques, des caisses d’épargne, de l’industrie, des communes, ainsi que des représentants des secteurs de l’agriculture et du commerce. Au total le conseil d’administration comprend trente-sept membres : c’est trop, bien entendu, et les discussions y sont parfois difficiles, mais cette organisation permet une représentativité complète de l’économie allemande. La KfW dispose aussi de comités dédiés, par exemple aux risques et aux crédits.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Comment la KfW se refinance-t-elle ? Le fait-elle, par exemple, à travers des dotations budgétaires ou des emprunts sur les marchés ? Les excédents réinvestis au bénéfice de vos programmes le sont-ils dès l’année qui suit la publication des résultats, ou de façon étalée dans le temps ?
La KfW investit-elle en fonds de fonds et, dans l’affirmative, à quelle hauteur ? Avez-vous une doctrine en la matière ?
Dr Lutz-Christian Funke. La KfW se refinance presque exclusivement sur les marchés : elle émet ainsi de 50 à 65 milliards de « bonds » chaque année, ce qui fait d’elle le quatrième émetteur en volume après la France, l’Allemagne et l’Italie. Ces opérations sont rendues possibles par la garantie de l’État fédéral.
Nous recevons peu de subventions de ce dernier, même si cela peut arriver dans le cadre de l’aide au développement, pour un montant d’environ 2 milliards d’euros, et parfois pour les programmes spéciaux. Par exemple dans le domaine de la rénovation énergétique, 1,5 milliard d’euros de subventions ont été alloués.
Nos profits annuels avoisinent le milliard d’euros ; ils peuvent être utilisés, par exemple, pour consolider nos réserves. Ils proviennent, pour l’essentiel, de notre filiale commerciale et des marges obtenues sur les crédits de long terme – dont la durée est néanmoins limitée à six ou sept ans. Nos autres activités ne génèrent pour ainsi dire pas de profits, même si, globalement, nous n’y perdons pas d’argent.
La KfW n’investit pas en fonds des fonds et très peu en capital-risque, domaine dans lequel il y a eu de mauvaises expériences – ces investissements ont, en effet, été à l’origine de la faillite de la Deutsche Ausgleichsbank. De plus, le marché allemand est suffisamment liquide. Nous avons cependant recommencé à investir dans certains fonds et à participer à des cofinancements, pour un montant de 500 millions d’euros, afin de promouvoir les start-ups déjà établies : en ce domaine, le retard avec les États-Unis nous paraissait en effet problématique.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. La loi prévoit-elle des évaluations régulières de vos programmes ?
Vos activités de conseil aux entreprises en matière d’investissement supposent des moyens importants, notamment humains. Cela ne tend-il pas à évincer les cabinets spécialisés ?
Dr Lutz-Christian Funke. La KfW développe peu d’activités de conseil sauf dans le financement de l’export, même si, bien entendu, toute opération de financement implique un dialogue. Dans le cadre de la promotion de l’économie allemande, nous organisons, tous les mois, des rencontres avec les start-ups auxquelles participe le ministère de l’économie.
Quant aux évaluations, elles sont systématiques, en amont comme en aval, pour l’aide au développement : elles sont alors réalisées par d’autres institutions, conformément aux règles internationales. Pour les autres programmes, nous faisons les évaluations nous-mêmes. Un programme d’innovation décidé avec le ministère de l’économie, par exemple, peut être évalué au bout de deux ou trois ans, et le Comité d’audit central allemand publie chaque année un rapport pour faire des recommandations.
Mme la présidente Véronique Louwagie. La KfW s’astreint-elle à la règle de parité en matière de cofinancement ? Si oui, cette règle admet-elle des exceptions ?
Comment les banques privées se rémunèrent-elles sur les prêts octroyés par la KfW ? Une commission est-elle versée ?
Faudrait-il selon vous une connexion plus étroite entre les banques publiques d’investissement et la Banque centrale européenne (BCE) ?
Dr Lutz-Christian Funke. En général, la KfW n’intervient pas par des opérations de cofinancement, compte tenu du système de prêts indirects. Elle ne l’a fait que dans des situations extrêmes, par exemple il y a six ans, lorsque l’Allemagne a rencontré d’importants problèmes de liquidités : les grandes entreprises nous avaient alors alertés sur le fait que les banques ne prêtaient plus. Notre intervention, au demeurant, se limitait en fait à la participation aux risques, au côté des banques : cette participation pouvait aller de 50 à 80 %. Les banques ont ainsi pu retrouver des liquidités, et même, parfois, bénéficier de notre garantie. Cette pratique n’a cependant duré qu’un an et demi, car elle ne correspond pas à nos missions fondamentales.
Le cofinancement est en revanche plus courant dans le cadre des prêts directs consentis aux grandes entreprises par notre filiale IPEX-Bank ; la Banque européenne d’investissement (BEI) peut y participer, au côté de quelques autres banques.
Quant à la rémunération des prêts indirects, les banques perçoivent effectivement une commission qui tire à la hausse le taux d’intérêt final. Cela dit, la KfW n’ayant ainsi que peu de filiales, ses coûts sont limités : il est beaucoup moins coûteux, pour elle, de s’appuyer sur un réseau de banques auxquelles nous versons une commission dont, bien entendu, elles discutent âprement le niveau.
Nous n’avons guère de contacts avec la BCE, étant entendu que notre refinancement est rendu relativement facile par la notation AAA issue de la garantie de l’État – si KfW avait un problème de refinancement, cela signifierait que l’Allemagne en a un…
Actuellement la BCE, engagée dans un programme d’assouplissement quantitatif, rachète nos « bonds » de préférence aux « bundesanleihein », dits « bunds », car ils offrent la même garantie tout en étant moins chers.
Mme la présidente Véronique Louwagie. De combien d’agences votre réseau bancaire est-il composé ? Avez-vous une délégation générale, fixée pour une période donnée, ou les banques viennent-elles frapper à votre porte en fonction de leurs besoins ponctuels ?
M. le rapporteur. Avez-vous des relations avec Bpifrance ? Quel regard portez-vous sur elle ?
Dr Lutz-Christian Funke. Nous travaillons avec les grandes banques allemandes ; pour les plus petites banques, une procédure est prévue, incluant des tests de résistance. La plupart des banques, cependant, obtiennent la qualification pour les opérations de prêt indirect.
Les grandes banques s’adressent aux entreprises pour leur proposer tel ou tel financement, en leur précisant ce qu’elles peuvent aussi obtenir via la KfW : il n’y a pas à proprement parler de limites.
Bien entendu, nous nous efforçons de contrôler nos investissements dans le temps, notamment en jouant sur les taux d’intérêt, dont les ajustements, définis chaque mois, dépendent de l’intérêt des programmes. Les taux d’intérêt sont néanmoins si bas sur le marché, en ce moment, que l’on se demande si on ne va pas en arriver des taux négatifs.
Nous avons toujours entretenu des relations avec Bpifrance, comme naguère avec OSEO : nous sommes en contact régulier avec leurs équipes qui sont très dynamiques.
Cela dit, la KfW est centrée sur l’Allemagne, et ses interventions en Europe restent limitées. Nous avons, par exemple, participé à un prêt global avec Bpifrance, et envisageons d’investir en capital-risque dans le cadre du plan Juncker. Peut-être participerons-nous encore à des prêts globaux destinés aux PME en France, ce qui suppose quelques procédures bureaucratiques. Reste que l’activité de prêt aux entreprises est la spécialité de Bpifrance, et dans une moindre mesure de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Mme la présidente Véronique Louwagie. Les financements de KfW peuvent-ils être fléchés, non seulement vers les investissements mais aussi vers les trésoreries ou fonds de roulement à court terme des entreprises ?
D’autre part, quel est votre point de vue sur le plan Juncker ?
Dr Lutz-Christian Funke. Nous ne faisons pas de financement à court terme : c’est plutôt le rôle des banques. Quant à nos prêts, ils sont toujours fléchés vers l’investissement.
S’agissant du plan Juncker, les choses ne sont pas encore très claires. Le Parlement s’est lui aussi penché sur le sujet, et il faudra réfléchir aux questions de régulation. Le point positif, cependant, est que, pour la première fois, le système ne repose pas sur des subventions directes mais sur des garanties à l’investissement. Reste à savoir s’il sera possible de mobiliser effectivement les 300 milliards d’euros annoncés. La principale difficulté, pour la BEI, n’est pas de trouver des liquidités mais des projets intéressants et financièrement viables.
Quant aux programmes du Fonds européen d’investissement (FEI), ils sont intéressants mais les procédures restent trop bureaucratiques. Les programmes trop complexes ne fonctionnent pas, en raison notamment de l’abondance des liquidités sur le marché : peut-être ont-ils un impact dans les pays économiquement plus faibles, du sud de l’Europe, mais en Allemagne – et sans doute en France –, ce n’est pas le cas. Les entreprises s’orienteront toujours vers les programmes les moins compliqués, même s’ils sont un peu plus chers. Nous avons fait part de ces critiques à M. Hoyer, le président de la BEI : nous comprenons les exigences du contrôle budgétaire mais, en Allemagne, il est d’usage d’expliquer la façon dont l’argent doit être employé. Cette règle n’a pas cours à Bruxelles, ce qui rend les choses plus difficiles.
Les critères d’éligibilité et d’additionnalité doivent aussi être clarifiés : il faudra trouver les projets qui ne pouvaient voir le jour sans les garanties annoncées. J’ai évoqué le sujet hier avec des responsables de la CDC ; chacun œuvre donc dans le même sens auprès de la BEI.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez plus de quatre-vingts bureaux et représentations dans le monde entier – dont aucun en France, me semble-t-il. Quels sont vos critères d’implantation ?
Dr Lutz-Christian Funke. Nous n’avons malheureusement pas de bureaux à Paris ! Nous en avons à Francfort et à Berlin, et je dispose d’un bureau à Bruxelles. La KfW IPEX-Bank, elle, possède des bureaux à Hong-Kong, aux États-Unis et à Londres. Pour la Banque de développement, les bureaux sont placés auprès des représentations diplomatiques, principalement en Afrique et en Asie : activité, comparable à celle de l’AFD, est d’une autre nature.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous vous remercions pour ces analyses. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter ?
Dr Lutz-Christian Funke. Je vous remercie pour votre invitation : l’exercice m’est familier en Allemagne, mais c’est la première fois que je m’y adonne en France. Nous avons des échanges réguliers, toutefois, avec nos collègues de Bpifrance et de la CDC : au départ, nous comprenions mal leurs rôles respectifs, mais les choses sont désormais plus claires. La coopération fonctionne bien ; nous participons, au niveau européen, à un club des investisseurs de long terme auquel s’associent également la Cassa dei depositi italienne, l’Instituto de credito oficial espagnol et la PKO Bank polski polonaise. Nous organisons des rencontres tous les deux ou trois mois – auxquelles participe M. Hoyer –, dans le cadre du plan Juncker mais aussi, plus généralement, pour conjuguer nos efforts en Europe.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci encore d’avoir répondu à notre invitation.
Auditions du jeudi 28 mai 2015
M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L'ACPR est l'organe de supervision français de la banque et de l'assurance. Elle joue un rôle de régulateur national en lien avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et elle est l'autorité compétente nationale pour la France dans la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique. Dans le cadre de ce mécanisme, elle assiste la Banque centrale européenne (BCE) dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle. Cette surveillance prudentielle de la Bpifrance est exercée directement par la BCE en liaison avec l'ACPR, sur la base des comptes de BPI-Groupe.
Pour toutes ces raisons et compte tenu de votre expertise en matière de contrôle et de surveillance des marchés financiers, nous avons souhaité que vous puissiez apporter votre contribution à nos travaux.
M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Comme vous l’avez indiqué, un changement important s’est produit à compter du 4 novembre 2014 : en raison de sa taille, la BPI a été inscrite sur la liste des établissements dits significatifs, établie par la BCE. Pour tout ce qui concerne le dispositif prévu dans ce qu’on appelle le paquet CRD IV (capital requirements directive ou fonds propres réglementaires), c'est-à-dire toutes les dispositions prudentielles harmonisées au niveau européen, la supervision directe relève désormais de la compétence de la BCE.
L’ACPR avait agréé Bpifrance en 2013, au terme du processus qui a conduit à la constitution du groupe qui fait l’objet de votre mission d’information, et avant la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance unique au niveau européen. Depuis le 4 novembre 2014, la BCE est devenue l’autorité d’agrément de Bpifrance. Tout changement dans les agréments, l’actionnariat ou l’organisation de ce groupe devra être examiné dans le cadre d’une procédure d’instruction conjointe entre l’ACPR et la BCE, étant entendu que la décision ultime sera prise par la BCE. L’ACPR conserve ses pouvoirs purement nationaux, et veille notamment au respect des textes sur la lutte contre le blanchiment ou sur la protection de la clientèle. Chacun comprend intuitivement que ces textes ne sont pas les plus importants pour la BPI, compte tenu de la mission qui lui a été confiée par l’État.
D’un point de vue prudentiel, la BPI est surveillée comme tous les autres établissements. Notre rôle, aux côtés de la BCE, n’est pas de nous prononcer sur la manière dont le groupe s’acquitte de la mission d’intérêt public qui lui a été conférée par la République française ; nous devons seulement vérifier qu’il respecte les règles de gestion prudente qui sont communes à tous les établissements de crédit agréés au niveau européen.
À cet égard et au vu des documents publiés – les seuls auxquels je vais me référer compte tenu de la nature publique de cette audition – nous pouvons dire que Bpifrance ne rencontre aucune difficulté particulière. Chacun peut constater que le groupe dispose de fonds propres importants – y compris selon la définition la plus stricte qui est désormais appliquée par toutes les autorités prudentielles européennes et mondiales – si on les compare à l’ensemble de son bilan et de ses risques pondérés. Dans ce domaine, il n’y a rien de particulier à signaler à votre commission. La croissance importante du bilan de Bpifrance est cohérente et elle correspond à ce qu’on attend d’elle. Si cette croissance se poursuit, les autorités prudentielles devront s’assurer que les fonds propres soient augmentés de façon proportionnelle pour que le groupe garde ses marges de manœuvre actuelles.
Si elles sont attentives au critère quantitatif qu’est la mesure des fonds propres rapportés aux risques, les autorités de contrôle s’intéressent aussi à un indicateur qualitatif : les mécanismes de contrôle interne de gestion des risques dans l’établissement. Lorsqu’un groupe développe et diversifie ses interventions, nous veillons à ce que les moyens consacrés au contrôle interne soient renforcés. Les limites de risque doivent être non seulement définies mais aussi respectées dans la vie de tous les jours de l’établissement, et elles doivent faire l’objet de débats impliquant les organes de gouvernance.
Cette année, la BCE a décidé de s’intéresser tout particulièrement à ces dispositifs de gouvernance interne des établissements de crédit. L’une de ses priorités sera de s’assurer que les conseils d’administration soient bien impliqués dans la définition de ce qu’on appelle parfois l’appétit pour le risque, c’est-à-dire les limites de risques que l’on considère être capable de gérer de façon satisfaisante à l’intérieur d’un établissement. Cette gestion suppose à la fois une organisation interne de l’établissement et une remontée des délibérations dans les organes de gouvernance. Nous devons nous assurer que ces derniers disposent bien de toutes les informations nécessaires pour avoir une discussion fondée, utile et pertinente sur le niveau de risque accepté.
Pour l’instant, il n’y a pas de modification fondamentale par rapport à la situation que l’ACPR avait agréée en 2013 et, par conséquent, je n’ai pas de point particulier à vous signaler. Si Bpifrance poursuit son expansion, ce qui serait tout à fait conforme à sa mission, nous devrons vérifier, sur le plan quantitatif, que ses fonds propres augmentent de manière proportionnée et corrélative, et, sur le plan qualitatif, que ses mécanismes de contrôle internes sont adaptés aux éventuels changements d’activités, d’interventions ou d’intervenants. Les dispositifs de limites doivent être adaptés si les volumes d’activité augmentent, si les types d’intervention se diversifient ou si l’établissement s’ouvre à une clientèle un peu différente. Dans tous les cas, il doit y avoir un suivi rapproché au niveau le plus élevé des organes de gouvernance. Conformément aux priorités établies par la BCE, les autorités de contrôle vont renforcer les échanges avec les organes de gouvernance des établissements pour s’assurer de leur implication dans ce pilotage des risques.
Pour conclure, je dirais que, fort heureusement, il n’y a pas de questions particulières à aborder concernant Bpifrance. Cela étant, je suis à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions plus précises tant sur notre rôle ou les règles techniques qui s’appliquent à l’activité de Bpifrance que sur tout autre sujet.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez évoqué la lutte contre le blanchiment et la protection de la clientèle qui ne concernent pas vraiment la BPI puisque celle-ci n’est pas une banque de particuliers. Pourriez-vous néanmoins développer les aspects particuliers qui peuvent exister pour la BPI et les autres organismes financiers ?
Vous portez une attention particulière à l’organe de gouvernance. Le capital actuel de Bpifrance est réparti à égalité entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cet actionnariat suscite-t-il de votre part des recommandations particulières en ce qui concerne la gouvernance ?
Une partie de votre mission est liée au contrôle des procédures dans les organismes financiers. Dans le cadre des contrôles de procédures de la BPI, avez-vous émis des recommandations ? Si oui, lesquelles ?
Enfin, êtes-vous amenés à entrer en contact avec les comités régionaux de pilotage de la BPI ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. En réponse à votre première question, je précise que Bpifrance est soumise, comme tous les autres établissements de crédit, aux règles qui concernent la lutte contre le blanchiment des capitaux ou la protection de la clientèle, et qui demeurent une compétence nationale. Cela étant, compte tenu de la nature de ses activités, ce groupe ne présente pas le même degré d’exposition aux risques de blanchiment qu’une banque spécialisée dans les transferts de fonds, par exemple. Il en va de même du respect des règles de protection de la clientèle par cet établissement qui a été créé pour aider ses clients et pour veiller à leur intérêt. Nous demandons à Bpifrance d’avoir des procédures de prévention du risque de blanchiment ou d’afficher les taux effectifs globaux (TEG) de ses crédits, mais nous sommes bien conscients que nos contrôles n’auront pas à porter en priorité sur ces points.
Pour ce type d'établissement – et pour tous les autres – nous sommes en revanche très attentifs à la gouvernance. C’est l’une des leçons tirées de la crise par les autorités de contrôle : les organes de gouvernance doivent s’impliquer davantage dans la gestion des risques. Dans un établissement de crédit agréé, plus que dans toute autre société, les organes de gouvernance ont une responsabilité particulière en la matière. Avec 60 milliards d’euros de total de bilan, Bpifrance doit disposer d’outils de contrôle correspondant aux meilleurs standards de la profession bancaire ; elle doit gérer ses risques dans les règles de l’art : les définir, les analyser et les soumettre à discussion. Sur ce terrain, la BCE pourrait être amenée à faire des recommandations. Rappelons qu’en ce domaine et pour ce qui concerne des groupes de la taille de Bpifrance, l’ACPR n’a qu’un rôle d’assistance et de préparation.
Est-ce que ça peut nous amener à entrer en contact avec les comités régionaux de pilotage ? Ce n’est pas impossible. Dans les textes, rien ne l’empêche. Pour l’instant, ne serait-ce que pour des raisons d’économie de moyens – qui sont encore plus prégnantes pour la BCE, qui doit suivre 123 grands groupes européens, que pour nous – nous nous sommes focalisés sur le niveau central. Nous dialoguons avec les organes centraux et nous nous intéressons aux rapports qu’ils entretiennent avec les comités régionaux. Dans le cadre du contrôle classique et permanent que nous effectuons de ce groupe, nous n’envoyons pas d’inspecteur dans les comités régionaux de pilotage. Lors de nos échanges avec les interlocuteurs centraux du groupe, nous vérifions qu’une synthèse satisfaisante de la situation globale du groupe est bien réalisée. C’est très important dans un groupe dont la structure est un peu complexe et décentralisée. Si nous décelions un problème, nous remonterions à sa source et nous chercherions à savoir si la décentralisation est en cause.
Quant à la structure de l’actionnariat, elle n’a pas changé depuis que l’ACPR a agréé Bpifrance en 2013. Cet actionnariat particulier correspond à la mission confiée à cet établissement par les pouvoirs publics. Pour notre part, nous avons seulement vérifié qu’il permettait une gestion conforme aux standards internationaux applicables aux établissements de crédit. Nous n’avons pas à nous prononcer sur la constitution du tour de table tant qu’elle permet une gestion prudente de l’établissement.
L’autorité de contrôle n’intervient qu’en deuxième ligne : les actionnaires et les dirigeants sont responsables de la gestion du groupe ; nous vérifions que leurs décisions respectent des normes globales de prudence qui sont désormais définies à l’échelle européenne. Nous ne dictons pas un mode d’organisation mais nous vérifions que celui qui a été choisi permet une gestion prudente, telle que définie par les règles européennes.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. La BPI comble parfois des failles de marché mais, compte tenu de l’importance de ses interventions, on peut redouter un effet de substitution au détriment d’intervenants du secteur concurrentiel. Constatez-vous des difficultés de cette nature ?
Ma deuxième question est également liée à la manière dont cet établissement est perçu par les autres acteurs du secteur bancaire. Sur le terrain, la BPI peut être vue comme une agence de notation locale. Si elle refuse un dossier, les banques commerciales se monteront d’autant plus réticentes, par aversion pour le risque. Pensez-vous qu’il s’agit d’un phénomène général ou très localisé ?
Vous avez parlé des contrôles opérés par la BCE. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur la nature de ces contrôles ?
La BPI possède une part importante du capital de certaines entreprises comme Orange ou Eramet. Certaines participations contribuent fortement à ses bénéfices ; d’autres, comme dans le cas d’Eramet, la contraignent à passer des provisions. Le poids de ces dossiers représente-t-il un risque pour la solidité et les capacités de financement de la BPI ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. S’agissant du risque de substitution, aucune difficulté ne nous a été signalée mais cela n’a rien d’étonnant dans la mesure où ce n’est pas vraiment de notre compétence.
Votre deuxième question m’inspire une réponse un peu similaire. La BPI n’est clairement pas une agence de notation reconnue comme telle. Il existe des normes précises, d’ailleurs en cours d’évolution, en ce qui concerne les notations dont peuvent se prévaloir les banques. Le jugement de la BPI n’a-t-il pas, malgré tout, une influence sur le comportement des autres banques ? Non pas ès qualités mais en me fiant à mon expérience, je vous répondrais que cela me paraît vraisemblable. La BPI doit faire des bénéfices pour consolider ses fonds propres, mais elle remplit plutôt une mission d’intérêt général puisqu’elle a été créée pour favoriser le financement des PME. Si elle refuse un dossier, il est probable – c’est tout ce que je peux dire – que son refus ait une influence sur le jugement des autres banquiers. Cela étant, son refus ne signifie pas forcément qu’elle considère que le dossier est trop risqué : comme tous les établissements de crédit, elle doit faire des arbitrages entre les investissements possibles car les ressources sont rares. Un dossier rejeté par la BPI ne doit donc pas être stigmatisé à un titre ou un autre par les autres banquiers.
Quelles sont les spécificités du contrôle de la BCE ? En fait, elle tente d’élaborer des règles moins spécifiques que celles existant dans chaque État ; elle essaye de construire un référent de contrôle identique pour les dix-neuf membres de l’Union bancaire européenne. Un contrôle de la BCE se caractérise par une demande d’informations très granulaire. Quand elle est passée sous la supervision de la BCE, la BPI a été soumise à un exercice d’évaluation complète de ses bilans pour lequel il lui a été demandé jusqu’à 100 informations par ligne d’actifs évaluée. La BCE veut disposer d’une base de données extrêmement précise sur la quantité et la qualité des crédits octroyés dans l’ensemble de la zone euro, en s’appuyant notamment sur des bases existantes telles que notre fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Tout le monde doit intégrer le fait que les exigences de remise d’information à l’autorité de contrôle vont aller en s’accroissant fortement. La BPI est évidemment très concernée puisqu’elle a pour mission d’octroyer des crédits y compris à de très petites entreprises (TPE). Considérant que l’un des freins à l’octroi de crédit aux PME et aux TPE est précisément la non-disponibilité d’informations, la BCE va mettre l’accent sur ce point lors de ses contrôles prudentiels des établissements.
Votre dernière question portait sur les risques que pouvaient présenter certaines participations importantes. Il existe en la matière une réglementation applicable à l’ensemble des établissements de crédit. Cette réglementation relative aux grands risques prévoit qu’ils fassent l’objet d’un suivi particulier et qu’ils respectent certaines limites : aucun d’eux ne doit dépasser 25 % des fonds propres de l’établissement en question et leur montant cumulé doit être contenu en deçà d’un certain seuil. En outre, la gouvernance de chaque établissement de crédit doit définir son propre appétit pour le risque : ce n’est pas parce que la réglementation fixe une limite maximum qu’il faut nécessairement l’atteindre. La manière dont un établissement se situe non seulement par rapport à la règle générale mais aussi par rapport à sa propre définition du risque, est l’un des éléments d’appréciation de la prudence de sa gestion.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Je vais peut-être préciser ma question : l’application des normes prudentielles ne peut-elle pas conduire les banques commerciales à reporter les risques les plus importants sur la BPI ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. Pour les grands risques, la norme est fixée à 25 % des fonds propres, ce qui représente un montant très important pour les grandes banques françaises. Si vous regardez leurs bilans consolidés, vous constaterez que ce seuil n’est pas un obstacle. Les banques sont davantage freinées par leurs normes internes et leur politique en matière de risques. Un banquier peut dire : je n’y vais pas si la BPI n’y va pas mais à mon avis ce n’est pas la norme prudentielle qui est déterminante. Le raisonnement vaut aussi pour la BPI puisque la même norme s’applique à tous.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Chaque organisme financier définit son propre appétit pour le risque à l’intérieur de la norme, dites-vous. Puisque vous avez une vision globale sur l’ensemble des établissements financiers de notre pays, comment pourriez-vous qualifier l’appétit pour le risque de la BPI, comparé à celui des autres banques ? La BPI ayant pour mission d’intervenir sur des failles de marché, on pourrait imaginer que ses normes internes soient différentes de celles des autres. Constatez-vous une différence ?
J’aimerais aussi savoir si l’ACPR a donné à la BPI d’autres agréments que celui que vous avez évoqué.
M. Édouard Fernandez-Bollo. Sur le premier point, je confirme vos impressions : les appétits pour le risque varient nécessairement d’un établissement à l’autre et c’est une bonne chose. Nous voulons que chaque établissement définisse sa propre politique et il n’y a pas de raison qu’ils aient tous la même. La diversité des approches du risque est aussi un élément de la solidité et de la variété de l’offre de crédit. La BPI agit en fonction du rôle qui lui a été donné par l’État, tandis que les autres établissements n'ont pas particulièrement de mission d’intérêt public en matière d’octroi de crédits. En revanche, la BPI n’a pas de raison de prendre des risques sur le marché des produits dérivés sur actions, par exemple, qui se situe en grande partie à New York. Les établissements qui interviennent sur ce type de marchés devront, quant à eux, en évaluer le risque et en tirer les conséquences en matière de fonds propres. L’allocation des fonds propres s’effectue en fonction de l’ensemble des activités d’un établissement. Il est donc tout à fait normal que la BPI, qui remplit une mission très particulière, ait une politique de gestion des risques spécifique.
Quant aux agréments, nous n’en donnons que lors de dépassements de seuils de participation, précisés par la réglementation française ou européenne. Depuis 2013, la BPI n’a pas fait de demande d’agrément complémentaire.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Avez-vous des informations à ajouter qui pourraient éventuellement intéresser la mission ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. L’ACPR a pour rôle de s’assurer que la BPI applique les normes prudentielles internationales. Dans ce cadre-là, nous n’avons aucune difficulté particulière à vous signaler la concernant.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour votre contribution.
Auditions du jeudi 28 mai 2015
Table ronde sur les fonds d’investissement : M. Pierre Remy, directeur général de Keensight, M. Olivier Guize, président d'Agro Invest, M. Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation, et M. Jean-Marc Patouillaud, gérant associé de Partech International Venture
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous recevons à présent quatre représentants de différents fonds dans lesquels la Banque publique d’investissement (BPI) est partenaire.
M. Pierre Rémy, directeur général de Keensight. Le fonds Keensight Capital est un fonds de 250 millions d’euros qui a pour vocation d’investir des montants entre 10 et 50 millions dans des entreprises technologiques, sur deux thématiques essentiellement : les technologies appliquées à la santé et celles de l’information. Accompagnant les entreprises dans leur développement à l’international, nous sommes un fonds de capital-développement pour des entreprises d’une dizaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, en vue de les transformer en entreprises de taille intermédiaire (ETI) de 50 à 100 millions de chiffre d’affaires.
La BPI est chez nous un investisseur très significatif. Ils sont extrêmement professionnels et, avant d’engager des fonds, mènent des diligences très approfondies. Ils passent plusieurs jours au sein de nos bureaux, passent en revue les dossiers, appellent systématiquement toutes les personnes avec qui nous travaillons, intermédiaires, avocats, entrepreneurs.
La BPI a des exigences très fortes en ce qui concerne le règlement régissant les relations entre un fonds et ses souscripteurs, et ce en faveur des investisseurs. La puissance qu’elle a en termes d’investissement, ainsi que son image, lui donnent ce pouvoir. De nombreux acteurs s’appuient sur le travail de la BPI pour décider d’investir ou non. Celle-ci a ainsi une responsabilité très forte vis-à-vis de l’écosystème français du capital-investissement.
Elle contribue à mes yeux à professionnaliser cet écosystème car elle exerce, dans un univers où les fonds manquent, un effet d’entraînement sur les autres investisseurs. Dans les opérations de LBO (leveraged buyout) classiques, les capitaux sont relativement abondants ; dans le capital-développement, le capital-risque, le financement d’entreprises technologiques de croissance, les capitaux sont en revanche difficiles à trouver parce que les temps d’investissement sont longs. L’effet d’entraînement de la BPI sur l’écosystème est donc extrêmement positif, et sans elle nous aurions de grandes difficultés à survivre.
M. Jean-Marc Patouillaud, gérant associé de Partech International Venture. Je ne peux que reprendre à mon compte les termes de Pierre Rémy sur l’attitude professionnelle de la BPI dans le domaine du capital-investissement et, en particulier, dans son activité de fonds de fonds. Elle joue un rôle de navire amiral vis-à-vis des investisseurs privés. L’effet d’entraînement qu’elle exerce, en France mais aussi, dans certains cas, à l’international, tient au grand professionnalisme des due diligences qu’elle mène sur les performances passées – en conduisant par exemple des interviews individuelles avec chacun des associés du fonds – ainsi que sur les stratégies d’investissement.
Les termes du contrat passé entre la BPI et les gérants de fonds correspondent strictement aux grands standards internationaux, que ce soit en termes de frais de gestion – extrêmement frugaux eu égard à ce que nous pouvons constater pour des produits plus exotiques voire franco-français – ou bien de performance des fonds. Sur ce dernier point, vous n’ignorez pas l’existence du carried interest, qui rémunère les équipes de gestion à la performance sur la base de minima à garantir, les hurdles, qui obligent les gérants à délivrer un certain rendement avant de pouvoir toucher le moindre bonus.
Les investissements de la BPI ont un caractère très vertueux pour le territoire français, sachant qu’il nous est dans la plupart des cas demandé, pour chaque euro apporté par la BPI, d’en investir entre deux et trois sur le territoire.
M. Olivier Guize, président d’Agro Invest. Agro Invest est un fonds de capital-développement sectoriel intervenant dans le secteur de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire, un secteur économique extrêmement important en France et qui nécessite des investissements assez considérables en capitaux propres. Les pouvoirs publics, ainsi que de grands acteurs privés institutionnels, ont constaté que ce secteur perdait des positions concurrentielles et que sa balance commerciale commençait à se dégrader dans certaines filières.
Bpifrance est présente au capital d’Agro Invest depuis la création du fonds en 2007. Elle a joué un rôle important dans sa constitution, aux côtés d’autres acteurs institutionnels, et a exercé un effet d’entraînement à la fois sur la vision stratégique du fonds, sa gouvernance, et les exigences de performance et de maîtrise des frais de gestion. Le reporting est d’une très grande rigueur, parfois même un peu lourd, mais cela oblige les équipes de gestion à faire preuve de transparence.
Nous apprécions énormément le concours de Bpifrance. Elle apporte une vision de long terme tout en permettant aux autres acteurs institutionnels de s’inscrire dans cette vision, dans un secteur où les durées d’investissement doivent justement être assez longues.
M. Jean-Baptiste Cuisinier, président de Capagro Innovation. Capagro Innovation est un fonds de capital-risque existant depuis un an et spécialisé dans le financement des start-ups innovantes dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation. C’est un secteur où il existe très peu de fonds spécialisés, alors que beaucoup d’innovations commencent à y voir le jour et que les entreprises innovantes ont besoin de fonds propres et ont du mal à les trouver. Si Bpifrance n’avait pas été là, notre fonds n’existerait pas.
Le fonds a été créé par Bpifrance et des acteurs industriels, Sofiprotéol et Tereos, avec quelques autres acteurs financiers. Grâce au professionnalisme de ses équipes, Bpifrance a permis de sécuriser des groupes industriels qui n’ont pas l’habitude d’investir dans un fonds professionnel de capital-investissement. Bpifrance a largement mené cette négociation, avec beaucoup de rigueur.
Cela nous a permis d’obtenir, pour les fonds investis par Bpifrance, un multiple supérieur à quatre, qui sera probablement supérieur à six ou sept pour l’ensemble des souscripteurs du fonds, dans des activités réparties sur tout le territoire français. L’effet de levier est extrêmement important.
Je partage la remarque d’Olivier Guize sur la rigueur et la lourdeur du reporting qui nous est imposé, mais c’est la règle du jeu et nous nous y soumettons. C’est d’ailleurs conforme aux habitudes de la profession sur les marchés internationaux, ce qui permettra à d’autres souscripteurs, français ou étrangers, qui souscriront peut-être à notre fonds, de retrouver des dispositions dont ils sont familiers.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez tous les quatre souligné l’effet vertueux de la présence de la BPI, ainsi que la rigueur qu’elle imposait dans les règles du jeu.
Vous avez indiqué, monsieur Rémy, qu’il était difficile de trouver des investisseurs sur de longues durées. Quelles sont vos propositions pour surmonter cette difficulté ?
Bpifrance, monsieur Cuisinier, a joué un rôle déterminant dans la création de votre fonds. Est-ce vous qui avez pris contact avec elle, ou bien est-elle venue vers vous ? Comment cela s’est-il passé ?
Avez-vous, les uns et les autres, des propositions à formuler pour que la BPI permette à notre pays de disposer de davantage de fonds et réponde aux failles du marché ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur de la mission d’information commune. Il serait intéressant que nous puissions bénéficier de la transmission d’exemples de contrats passés avec la BPI, en complément des informations que nous avons déjà obtenues de celle-ci.
Connaissez-vous des fonds qui n’ont pas été retenus à l’issue de la procédure ? Vous-mêmes avez-vous porté des projets qui n’ont pas été retenus par Bpifrance ? Quelles sont les raisons qui font qu’un dossier n’aboutit pas ?
Quelles sont les exigences de rentabilité qui vous sont demandées ? Le niveau de ces exigences impacte-t-il votre prudence sur tel ou tel projet ?
Quels sont, par ailleurs, les profils de vos chargés d’investissement ? Sont-ils plutôt financiers ou industriels ?
Quelle est, selon vous, la bonne articulation entre fonds généralistes et sectoriels ?
Enfin, avez-vous des chiffres qui démontrent l’effet d’entraînement à long terme de Bpifrance sur d’autres investisseurs ? Quels sont les mérites comparés de l’intervention dans des fonds ou en direct ? C’est un débat qui existe dans d’autres pays européens : est-il préférable que l’intervenant prenne directement des participations ou bien passe par des fonds d’investissement ?
M. Jean-Marc Patouillaud. Ces dix dernières années, dans des opérations de capital-développement menées en France pour des sociétés déjà mûres, telles que Vente-Privée, Criteo, Neolane, qui souhaitaient lever des fonds de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros, 80 % des tours de table ont été menés par des fonds anglo-saxons. Les acteurs de la place, dont la BPI, sont entrés en discussion pour pallier cette situation et apporter à des fonds français des moyens pour peser sur ce marché stratégique.
Le constat a été dressé que l’argent public, en l’occurrence celui de la BPI, était trop saupoudré et qu’une certaine sélectivité des fonds était nécessaire. La meilleure manière d’investir l’argent public est de respecter une certaine exigence de performance. Si cela ne doit pas conduire à une concentration sur un petit nombre d’acteurs, il ne convient pas non plus de saupoudrer sur tout le territoire car cela empêche de constituer des équipes ayant une taille critique, capables de traiter tout le spectre de l’investissement – de la société en amorçage à la société avant une introduction en Bourse – et pouvant répondre à des investissements réalisés depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis.
Des fonds ne sont pas retenus, et je pense que c’est tout à fait normal. Le métier attire beaucoup de monde : il faut faire le tri, certains candidats n’ont pas le profil requis. Cette sélectivité est naturelle et nécessaire.
S’agissant des exigences de performance, j’ai déjà évoqué les hurdles, ou « obstacles », avant de pouvoir toucher le carried interest. Cette rentabilité minimale est en général de 7 à 8 % par an, ce qui est important eu égard au coût de l’argent sur les marchés actuellement. Les exigences de la BPI conduisent à une véritable responsabilité de l’équipe de gestion, car il n’est pas possible de lever de l’argent auprès de la BPI sans que chacun des membres du fonds investisse de son propre argent dans le fonds, à titre individuel. Ces montants pouvant varier entre 1 et 5 % du montant du fonds. C’est extrêmement important, d’autant plus qu’il s’agit d’argent après impôt.
Les profils, dans nos métiers, sont très variés. Chez Partech, nous avons des profils d’entrepreneurs de start-up, de conseil en stratégie, de banque d’affaires, mais aussi des personnes issues de grands groupes industriels tels que Dassault Systèmes ou Casino. C’est une représentation large de l’économie française.
M. Jean-Baptiste Cuisinier. C’est moi qui ai pris l’initiative de contacter Bpifrance, afin de lui signaler un trou dans la raquette en matière de capital-risque français dans l’agro-alimentaire. La BPI a conduit sa propre analyse, qui a très vite rejoint la mienne concernant le deal flow futur et la pertinence d’investir dans le secteur. Le dialogue a été très simple et très rapide. La BPI, du fait de ses relations avec les pôles de compétitivité notamment, possède une très bonne visibilité sur ce qui se fait en matière d’innovation.
Notre équipe est à dominante scientifique. Si j’ai, pour ma part, une expérience opérationnelle, de direction de PME et de création d’entreprise, en plus d’une expérience dans l’administration, nous mettons l’accent sur la formation scientifique car elle nous paraît fondamentale pour comprendre les chercheurs, innovateurs et entrepreneurs qui viennent nous voir. Pour les questions juridiques, ainsi que pour les montages financiers, qui, dans le capital-risque, sont relativement simples, nous faisons appel à des partenaires extérieurs. De même, nous avons un réseau de chefs d’entreprise qui nous aident dans la gestion des participations. Le cœur du métier reste la capacité à comprendre le discours scientifique et l’innovation, qui est le fond du sujet, avant de nous intéresser aux chiffres et aux finances.
Il faut que les souscripteurs, qui prennent un risque relativement important – plus important chez nous que dans le capital-développement – reçoivent une rémunération également significative avant que l’équipe n’améliore son salaire fixe. L’engagement personnel des membres de l’équipe est élevé ; quand je fais un investissement, je commence par signer un chèque et j’appelle ensuite le fonds.
Des fonds généralistes viennent souvent en co-investissement, en s’appuyant sur notre expertise. Dans le capital-risque, on chasse volontiers en meute. Il existe un double effet de levier : Bpifrance met de l’argent dans un fonds sectoriel, ce qui permet à celui-ci de lever cinq, six ou sept fois ce qu’elle apporte, et, quand nous montons un dossier, des fonds généralistes qui hésiteraient beaucoup à investir parce qu’ils connaissent mal le secteur, faute de spécialistes dans leurs équipes, viennent avec nous pour la moitié, voire les deux tiers, du tour de table.
M. Olivier Guize. Je suis arrivé il y a deux ans à Agro Invest, dont l’équipe de gestion a été complètement renouvelée en 2014. Il y avait eu des accidents d’investissement, la performance du fonds n’était pas très bonne. Bpifrance a été l’un des acteurs demandant à poursuivre l’expérience. La durée de la société a été prolongée d’une dizaine d’années par l’ensemble des souscripteurs présents au tour de table, y compris ceux qui étaient hésitants. Bpifrance a joué un rôle très important d’entraînement.
Notre stratégie d’investissement est très précise et prévoit notamment une quasi-interdiction d’investir hors du territoire français, sauf exceptions à délibérer en conseil de surveillance. Le niveau d’exigence de rentabilité, qui peut paraître paradoxal s’agissant d’argent public, est au contraire un gage de performance et de réflexion sur la prise de risque.
Nous sommes une petite équipe de trois investisseurs, aux profils très complémentaires. Bpifrance exigeait une personne ayant une expérience suffisamment longue dans le métier d’investisseur. La deuxième personne vient de la banque d’affaires et connaît parfaitement le secteur dans lequel nous intervenons. Grâce à ce profil, nous parvenons à générer des dossiers non intermédiés, avec des prises de contact directes avec des entrepreneurs, ce qui nous permet de gagner un temps considérable dans la constitution du deal flow. Mon profil est beaucoup plus opérationnel et apporte également la dimension du conseil en stratégie. Ces profils complémentaires sont une garantie de succès.
L’articulation avec des fonds généralistes est pratiquement automatique dans notre cas, car nous n’intervenons qu’en participation minoritaire. Il est rare que nous intervenions seuls. Comme pour Capagro, nous sommes appréciés pour notre connaissance sectorielle, qui exerce un effet d’entraînement sur les fonds généralistes. Cela permet aux souscripteurs, dont Bpifrance, de davantage mutualiser le risque.
En matière de doctrine, je pencherais plutôt pour l’intervention via des fonds, sauf exceptions : de mon point de vue, Bpifrance pourrait intervenir en direct dans des situations de rebond, pour des entreprises fragilisées. Nous avons de tels dossiers dans notre portefeuille, mais très peu de fonds osent intervenir dans ces cas parce que la prise de risque est beaucoup plus importante.
M. Pierre Rémy. Je prendrai un exemple pour illustrer le rôle de Bpifrance. Nous avons été actionnaires d’une société, LDR Médical, basée à Troyes, qui fabrique des implants pour la colonne vertébrale. C’est une société qui est aujourd’hui cotée au NASDAQ, où elle capitalise plus d’un milliard. Au cours de cette aventure de dix ans, elle est passée de zéro à quatre cents salariés, dont les deux tiers sur le territoire français, tout en réalisant 90 % de ses ventes à l’international. Le marché français de la chirurgie du dos est relativement petit en volume, et c’est par ailleurs le pays où les prix sont sans doute les plus bas, ce qui est très bon pour la dépense publique mais n’aide pas au développement de l’écosystème.
Le dispositif médical est l’un des secteurs où la France possède un très grand savoir-faire. La chirurgie du dos a été inventée en France, portée par une société française, Sofamor, qui a été rachetée par l’Américain Medtronic, devenu le leader mondial de la chirurgie du dos, un marché de 7 ou 8 milliards de dollars dont il occupe la moitié grâce à l’acquisition il y a une vingtaine d’années de cette société française. L’essentiel du savoir-faire est passé aux États-Unis ; l’activité française de Medtronic a beaucoup diminué au fil du temps.
Avec LDR Médical, nous avons recréé un acteur mondial dans ce domaine. Créer un tel acteur demande beaucoup de capitaux. Un essai clinique coûte 50 millions de dollars. Les quelque 80 millions de dollars investis ne pouvaient être trouvés sur place. Bpifrance a apporté 5 millions d’euros, nous avons trouvé des capitaux extérieurs, et la société a levé des capitaux aux États-Unis. Nous avons ainsi créé beaucoup de valeur, de même que beaucoup d’emplois en France, avec des capitaux – ainsi que des payeurs, puisque les produits sont vendus aux États-Unis – essentiellement américains. L’effet de levier pour le pays est donc excellent.
Le problème, c’est que nous étions soumis au bon vouloir d’investisseurs américains. Si nous ne les avions pas trouvés, l’entreprise n’aurait pu exister. C’est un peu dommage de ne pas avoir les capacités d’accompagner de tels projets. Il faut trouver les moyens de combler le manque d’ETI dans le tissu industriel français.
Chez nos voisins, les fonds longs se trouvent dans les fonds de pension. Notre système d’assurance vie en est un peu l’équivalent. On pourrait donc prévoir des incitations pour que l’assurance vie investisse dans le private equity. Alors que les actifs non cotés représentent 10 % des actifs des fonds de pension, ils sont infimes dans l’assurance vie. Les contraintes réglementaires pesant sur les assureurs leur permettraient toutefois difficilement d’investir dans cette classe d’actifs.
Nous avons, en ce qui nous concerne, un profil très industriel. La plupart des gens de l’équipe ont passé une dizaine ou une quinzaine d’années dans l’industrie, notamment à l’étranger.
M. Olivier Guize. Les souscripteurs d’Agro Invest sont au nombre de six. Les trois principaux sont le groupe Crédit Agricole, Bpifrance et Avril-Sofiprotéol, un groupe industriel spécialiste de la filière des oléagineux-protéagineux. Les trois autres souscripteurs, plus minoritaires, sont le groupe Agrica, une mutuelle de prévoyance agricole, et deux banques, Natixis et Arkéa, qui est le crédit mutuel de Bretagne. Ce sont des profils assez variés.
M. Jean-Marc Patouillaud. Le crowdlending, qui permet à des individus, des acteurs institutionnels ou des fonds de prêter directement à des PME, se généralise. Il présente l’intérêt d’accélérer l’accès à l’argent, sur des taux tout à fait raisonnables et avec des systèmes de scoring performants. C’est très complémentaire de ce que peut offrir le système bancaire. En France, quatre sociétés sont actives dans le domaine. Est-il plus naturel que Bpifrance investisse en tant qu’acteur du marché en direct dans l’une d’entre elles, en compétition avec des professionnels de l’investissement qui feraient d’autres choix, ou bien qu’elle investisse dans les fonds qu’elle considère être les plus performants et les plus professionnels, en leur laissant le loisir d’assurer la sélection des meilleures sociétés sur des critères financiers, managériaux et stratégiques ?
M. Jean-Baptiste Cuisinier. L’appareil public français de subventions, d’avances remboursables et de prêts qui était largement géré par Oséo et a été intégré dans Bpifrance couvre assez bien les cas de figure qui intéressent les sociétés dans lesquelles nous investissons, qui sont souvent au stade préindustriel. Il faut que l’intégration des différentes équipes – CDC Entreprises, Oséo… – se poursuive, que ces dispositifs et leur articulation soient les plus simples possibles, et l’information facile à trouver.
M. Pierre Rémy. Bpifrance investit déjà directement dans des entreprises, mais j’aurais du mal à imaginer que ce soit le seul acteur, car cela nécessiterait un champ de compétences très large. Chaque segment est très spécialisé, et il faut avoir accumulé beaucoup d’expérience pour prendre les bonnes décisions. L’action de la Caisse des dépôts et consignations puis de Bpifrance a favorisé l’émergence d’un écosystème. Pour créer un écosystème de capital-risque technologique, il faut vingt-cinq ou trente ans. Cette action commence à porter ses fruits. Je ne vois pas comment la BPI pourrait totalement se substituer à cette expertise accumulée en dehors d’elle. Par ailleurs, certains entrepreneurs sont moins ouverts que d’autres à la logique d’investissement de Bpifrance ou de l’État actionnaire. Il faut conserver des sources de financement multiples, à la fois pour être plus intelligents et pour répondre aux attentes des différents entrepreneurs.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci aux uns et aux autres.
Audition du 4 juin 2015
Table ronde sur la politique de filières : Mme Odile Kirchner, secrétaire générale du Conseil national de l’industrie (CNI), et des représentants des Comités stratégiques de filière : M. Christian Béchon, président du LFB (CSF santé), M. Bernard Espannet, secrétaire général du Groupement des industries françaises aéronautiques (GIFAS), M. Jean-Michel Isaac-Dognin (CSF aéronautique), et M. Jean-Philippe Girard, vice-président du CSF alimentaire.
Mme Véronique Louwagie. Je propose que, dans un premier temps, vous nous fassiez part de vos réflexions sur l’enjeu qu’a représenté la création de la BPI et sur la façon dont, selon vous, son action s’inscrit dans les priorités des politiques industrielles telles qu’elles ont été définies dans le cadre des différentes filières et des plans stratégiques. Je rappelle en effet que, parmi les missions confiées à la BPI par l’article 1er de la loi qui l’a créée, figure celle d’« accompagner la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières ».
Mme Odile Kirchner, secrétaire générale du Conseil national de l’industrie. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, je suis heureuse de pouvoir évoquer devant vous la question, extrêmement importante pour l’industrie, du rôle de Bpifrance. Permettez-moi cependant de débuter mon intervention par quelques mots sur le Conseil national de l’industrie, qui reste méconnu.
Créé à la suite des états généraux de l’industrie qui se sont tenus en 2009, il a pour objectif de fédérer les acteurs industriels – fédérations professionnelles, chefs d’entreprise et organisations syndicales de salariés – autour d’une vision partagée de l’avenir de l’industrie en France et des principaux enjeux industriels du pays, afin de renforcer le tissu productif et de retrouver des perspectives de croissance de l’activité et de l’emploi industriels.
Le conseil assume une double mission. La première consiste à éclairer les pouvoirs publics et à leur adresser des recommandations, émises de façon indépendante et approuvées par chacun des collèges, sur les politiques publiques concernant l’industrie et sur les actions prioritaires à mener pour la renforcer. Le Conseil national de l’industrie est donc un lieu de dialogue social qui favorise la convergence de vues des fédérations professionnelles et des organisations de salariés sur les principaux enjeux industriels du pays.
Sa seconde mission est plus directement opérationnelle, puisqu’elle consiste à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de filière au travers de quatorze Comités stratégiques de filière (CSF). Ces derniers sont également des instances tripartites : ils sont composés de représentants des entreprises et des fédérations professionnelles, des syndicats de salariés et des pouvoirs publics – c’est-à-dire de l’État et, de plus en plus, nous l’espérons, des régions – ainsi que des autres acteurs économiques concernés, tels que les pôles de compétitivité. Les membres de chaque comité s’accordent sur une vision partagée des enjeux de la filière et sur les actions à mettre en œuvre. Formalisées dans un contrat de filière, qui comprend des engagements de l’État et des industriels, ces actions visent notamment à renforcer la cohésion de la filière et à améliorer la compétitivité et la performance des entreprises, en particulier les PME et les ETI, dans les domaines de l’export, de l’emploi et des compétences, de la formation, de l’innovation, de l’accès au financement et du développement de l’économie circulaire.
Je précise que le lien entre le CNI et les CSF, d’une part, et le Parlement, d’autre part, a été récemment renforcé. En effet, sur la proposition de M. Jean Grellier, député et membre du CNI, et avec l’accord de MM. Brottes et Bartolone, un référent parlementaire, désigné parmi les membres de la commission des affaires économiques, a été nommé auprès de chaque CSF. Ainsi, Mme Valter est référente du CSF nucléaire et M. Giraud référent du CSF ferroviaire. Nous jugeons cette évolution très positive, dans la mesure où elle permettra une meilleure compréhension et une meilleure prise en compte des enjeux industriels du pays.
Les quatorze contrats de filière ont permis l’élaboration, depuis 2013, de 360 actions dont l’état d’avancement fait l’objet d’un rapport semestriel : 72 % d’entre elles ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, 12 % sont entravées par divers obstacles et 14 % restent à lancer.
Parmi ces actions, celles qui visent à améliorer l’accès des entreprises au financement portent, tout d’abord, sur la création de fonds dédiés, tels que le Fonds de développement des entreprises du nucléaire (FDEN), le fonds Croissance Rail, consacré aux entreprises du secteur ferroviaire, ou le Fonds d’avenir automobile (FAA), qui a succédé au Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA).
Un deuxième type d’actions consiste à améliorer l’information des PME sur les outils de financement adaptés à leurs besoins et leur formation à l’utilisation de ces outils.
Enfin, un troisième type d’actions concerne le financement de l’innovation, dont Bpifrance est un acteur central. S’il convient de saluer le développement des projets collaboratifs et le foisonnement des outils de financement de la recherche et développement, on peut regretter que le nombre des acteurs engendre une certaine complexité, même si les pôles de compétitivité jouent très bien leur rôle à cet égard.
Quelles sont les attentes des PME en la matière ?
Premièrement, le montage des dossiers est parfois trop complexe. Il faut donc encourager des initiatives telles que celle qui a été prise par le Programme d’investissement d’avenir (PIA) pour alléger les dossiers de financement des PME. Deuxièmement, ces dernières recherchent avant tout un partage du risque. Or, on observe que la part des subventions diminue fortement au profit d’avances remboursables. Troisièmement, il est important de financer non seulement la R&D, mais aussi la phase d’industrialisation et le lancement sur le marché des produits innovants. À cet égard, il nous paraît important d’encourager le développement de financements adaptés tels que les Prêts pour l’innovation (PPI) de Bpifrance. Enfin, il convient de prendre en compte l’innovation non technologique, par exemple en matière de marketing ou d’organisation, comme le fait Bpifrance depuis peu à travers le concept d’innovation nouvelle génération.
J’en viens maintenant aux questions que vous nous avez adressées. La première porte sur le lien entre les comités stratégiques de filière et les 34 plans, devenus les dix solutions, de la Nouvelle France industrielle.
Il importe, tout d’abord, de bien comprendre les rôles respectifs de ces plans et des CSF. Ces derniers sont chargés de mettre en œuvre des actions destinées à renforcer la cohésion et la structuration de la filière, alors que les plans ont pour objet de fédérer des acteurs industriels, c’est-à-dire les chefs d’entreprise, pour accélérer le développement d’objets ou d’activités industriels dans des secteurs particulièrement porteurs où la France dispose d’un avantage compétitif. Leurs objectifs sont donc complémentaires. La solution mobilité écologique, par exemple, concerne le véhicule consommant moins de 2 litres aux 100 km, les bornes électriques de recharge, le véhicule dit « autonome » – afin de ne pas laisser Google prendre le leadership dans ce domaine – et les solutions de stockage de l’énergie.
Si l’identification des 34 plans est en partie issue de la réflexion des CSF, l’ensemble du dispositif est coordonné par la direction générale des entreprises et par le cabinet du ministre de l’industrie, en liaison avec les autres ministères impliqués. Les chefs de projet de chaque plan ont cependant pu présenter leur feuille de route aux comités stratégiques de filière concernés et il est prévu, dans le cadre du nouveau dispositif annoncé par M. Macron le 18 mai dernier à Nantes, que les CSF continuent d’entretenir une relation étroite avec les solutions pour une Nouvelle France industrielle. Par ailleurs, les relations entre les solutions et les CSF ont été clarifiées. Ainsi, certaines compétences des CSF que les chefs de projet estimaient nécessaires à l’accomplissement de leur mission – notamment en matière d’évolution de la réglementation ou de création d’une offre de formation – ont été réaffirmées. Au demeurant, les mêmes acteurs occupent parfois des fonctions dans l’un et l’autre des dispositifs : c’est le cas de Jean-Philippe Girard, ici présent, qui est à la fois vice-président du CSF agroalimentaire et chef de projet de la solution agroalimentaire. Nous cherchons donc à faire avancer ces deux actions au profit de l’industrie française ensemble et en bonne intelligence, en nous soutenant mutuellement.
Je veux dire un mot du plan Usine du futur, devenu la solution Industrie du futur, qui a la particularité d’être transversal et dont l’ambition a été étendue, puisqu’y ont été associées l’ensemble des fédérations professionnelles concernées par la modernisation de l’outil productif et la création d’une offre technologique française pour l’industrie du futur. Une confédération a été créée, qui regroupe ces fédérations professionnelles et les acteurs académiques qui porteront le déploiement du plan. Le ministre, qui présidera le comité de pilotage de cette solution, a demandé au CNI de s’impliquer dans le groupe de travail consacré à l’évolution des métiers et des formations.
M. Christian Béchon, président du LFB et membre du Comité stratégique de la filière santé. Le comité stratégique de la filière santé regroupe les industries du médicament, du dispositif médical et du diagnostic, c’est-à-dire l’ensemble des solutions de santé, y compris l’e-santé. Il s’agit d’une filière très exportatrice, qui représente à ce titre un enjeu majeur pour la balance du commerce extérieur, et très innovante, si bien qu’elle compte de nombreuses start-up dans les secteurs des biotechs, de la medtech ou de l’e-santé.
Bpifrance est pour nous un acteur indispensable dont nous avons une très bonne image – le secteur de la santé est du reste concerné par toutes ses formes d’intervention, parfois de manière très significative.
Je ferai deux commentaires plus généraux. Le premier concerne le financement de l’économie. Il est certain que, dans ce domaine, Bpifrance comble un manque, mais il faut s’interroger sur les raisons de cette lacune : pourquoi nous retrouvons-nous dans l’obligation de confier de l’argent public à une banque pour financer l’économie ? Parce qu’en France, l’épargne est orientée, non pas vers le système productif, comme elle devrait l’être, mais vers le déficit public. Le second point que je souhaite aborder concerne le développement des entreprises. Si les dispositifs d’amorçage – qui ne coûtent pas trop cher au contribuable – sont très satisfaisants et fonctionnent bien, il est en revanche très difficile pour une petite entreprise de passer au stade de l’entreprise de taille intermédiaire et plus difficile encore à une ETI de devenir une grande entreprise, car, dans ce domaine, les moyens de Bpifrance sont insuffisants. Au demeurant, et cela rejoint ma première remarque, est-ce bien à elle, c’est-à-dire à l’argent public, de financer le développement des entreprises ?
En résumé, Bpifrance fonctionne très bien, grâce à des personnes compétentes qui font au mieux, mais il faut réfléchir à ce que nous faisons collectivement.
M. Jean-Michel Isaac-Dognin, membre du Comité stratégique de la filière aéronautique. Je rappellerai tout d’abord quelques caractéristiques du secteur industriel de l’aéronautique. Celui-ci est bien entendu très impliqué dans l’innovation. Les coûts de développement des nouveaux programmes sont très lourds, mais ils ne sont plus assumés exclusivement, comme c’était le cas autrefois, par les grands avionneurs ou motoristes : aujourd’hui, le flow down permet d’y faire participer la filière à différents niveaux. Dans certains métiers, les investissements sont lourds. Les cycles sont longs. L’activité à l’exportation, notamment sous la forme d’implantations à l’international, se développe de plus en plus, y compris pour les PME et les ETI, qui participent aux programmes de Boeing, Embraer ou Bombardier, ou à des programmes russes ou chinois. Enfin, la monnaie de référence est le dollar.
En conséquence, la filière a besoin, en matière de capitaux propres, d’engagements dans la durée, une durée souvent plus longue que celle des fonds d’investissement classiques. En ce qui concerne l’innovation et de développement, il s’agit, là aussi, de financements à moyen terme qui doivent prendre en compte, au-delà des corporels, les immatériels ainsi, éventuellement, que la notion de risque programme. Par ailleurs, la monnaie de référence étant le dollar, on a souligné, notamment dans le rapport du CNI, la nécessité de disposer d’outils de couverture de change de moyen terme car, sur le court terme, l’offre du réseau bancaire est suffisante.
L’offre de Bpifrance est très largement adaptée à ces caractéristiques. Je citerai quelques-uns de ces outils. En ce qui concerne l’innovation – laquelle ne se limite plus à l’innovation technologique au sens où l’entendait l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) –, elle est un partenaire de la Banque européenne d’investissement dans le cadre de son programme InnovFin, ce qui lui permet de bénéficier d’un niveau supérieur de garantie et de ressources financières. Elle accorde également, et c’est un élément très important, des prêts de développement ; ces prêts de moyen terme, qui tiennent compte du corporel et de l’incorporel, permettent aux entreprises de traverser les vallées de la mort. Par ailleurs, Bpifrance gère une ligne d’avance remboursable dans le cadre d’une convention conclue avec la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), tournée plus particulièrement vers les PME. Ce produit a pour caractéristique de prendre en compte un risque programme : en cas d’échec, l’avance remboursable peut se transformer partiellement en subvention.
Dans le domaine de la trésorerie et du financement courant, Bpifrance offre, outre les produits de garantie, un outil intéressant, Avance +, qui permet de faire, en mobilisation de créances, des choses que ne permettent pas les dispositifs Dailly ou l’affacturage.
Dans le domaine des fonds propres, Bpifrance est, en tant qu’héritière du Fonds stratégique d’investissement (FSI), partenaire des grands industriels regroupés au sein du fonds de notre secteur, Aerofound.
Enfin, je rappelle que Bpifrance s’adresse aux entreprises de toutes tailles, à tous les stades de développement.
La collaboration entre Bpifrance et la filière aéronautique est ancienne, structurée et forte. La filière elle-même est très structurée : le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), qui existe depuis très longtemps, a pour particularité de regrouper l’ensemble de la profession, depuis Airbus jusqu’aux TPE. S’y ajoutent le Comité stratégique de filière national et ses déclinaisons dans certaines régions, ainsi que les pôles de compétitivité, dont trois sont consacrés à l’aéronautique, et, dans les régions où ces pôles sont absents, des clusters, qui sont membres associés du GIFAS. Enfin, le Conseil pour l’orientation de la recherche dans l'aviation civile (CORAC), qui est antérieur au CSF, prend en charge en liaison avec celui-ci le volet recherche de la profession.
Nous offrons ainsi à Bpifrance une structure idéale pour diffuser son message. Membre actif du groupe de travail « Financement » du CSF national, elle a du reste présenté ses produits devant le GIFAS et dans les régions, de sorte que son offre a irrigué l’ensemble de la filière.
M. Jean-Philippe Girard, vice-président du Comité stratégique de la filière alimentaire. Le secteur de l’aéronautique et celui de l’alimentaire, quoique différents, ont des préoccupations similaires. Je commencerai par rappeler le périmètre de l’industrie agroalimentaire en citant dix chiffres clés : son chiffre d’affaires est de 156 milliards d’euros ; elle représente 500 000 emplois directs et un peu plus de 2 millions d’emplois indirects en incluant l’agriculture et la distribution ; elle compte 16 000 entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions, d’où son importance pour l’aménagement du territoire ; elle réalise 43 milliards à l’exportation et 8 milliards d’excédent commercial ; la filière transforme 70 % de la production agricole française et consomme 80 % de produits français. J’ajoute que 530 entreprises ont élaboré, dans le cadre du contrat stratégique de filière, des projets de modernisation et d’innovation. Enfin, la filière regroupe vingt fédérations nationales sectorielles et 23 associations régionales des industries agroalimentaires.
Cinq mots-clés permettent de présenter les enjeux en matière de financement : innovation – ou, plutôt, créativité : dans un hypermarché, un produit sur deux est remplacé en l’espace de cinq années – ; modernisation des outils industriels ; exportation ; consolidation des entreprises et mutation, puisque le numérique est en train de révolutionner la distribution alimentaire et l’alimentaire lui-même. Dans ces différents domaines, le métier a besoin de financements de court terme pour les crédits de campagne – on fait une récolte par an, il faut donc financer une année de stock –, de moyen terme, pour la modernisation des entreprises, et de long terme, en vue d’investissements ou d’acquisitions, car mieux vaut être chasseur que chassé ; or, actuellement, chaque mois, une entreprise alimentaire française passe aux mains de capitaux étrangers.
Chef d’entreprise, j’anime également le contrat stratégique de filière et le plan industrie et je préside le Salon international de l’alimentation.
En ce qui concerne Bpifrance, je dirai, au risque de vous surprendre, qu’il s’agit d’un merveilleux aiguillon. Sa création n’avait pas été accueillie très chaleureusement, mais elle a aujourd’hui trouvé sa place. Lorsqu’OSÉO et le FSI cohabitaient, nous avions en effet quelques difficultés à savoir qui faisait quoi et à identifier les rôles respectifs de la banque publique et des banques privées. Nous avions du reste proposé la création d’un comité stratégique national réunissant les financeurs publics et privés autour des gros projets nécessitant d’importants investissements. C’est une proposition que je réitère, car elle traduit une véritable attente.
Quels sont les points forts de Bpifrance ? Premièrement, elle est très présente dans les territoires : en régions, l’indice de satisfaction est très élevé. Deuxièmement, elle réveille les banques privées lorsque celles-ci hésitent à accompagner une entreprise qui connaît des difficultés. Troisièmement, elle offre des outils adaptés au secteur.
Quels sont ses points faibles ? Tout d’abord, ses taux sont élevés au regard de ceux du marché – mais on m’a dit que cela s’améliorait, notamment dans certains secteurs. Ensuite, elle est moins présente auprès des sociétés fragiles : on a le sentiment que Bpifrance cible un peu les entreprises qu’elle finance. Or, l’agroalimentaire est un secteur où la rentabilité est faible et dont les besoins sont très spécifiques. Il ne faut pas l’oublier, car il y a de belles entreprises qui sont actuellement en difficulté alors qu’elles pourraient, grâce à des crédits de trésorerie, éviter ces trous d’air.
En conclusion, Bpifrance a su apaiser les inquiétudes nées de la disparition d’OSÉO : elle a réussi à se positionner dans l’accompagnement de l’innovation et celui des entreprises. C’est une belle performance, en très peu de temps !
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame Kirchner, vous avez exprimé le souhait d’une intervention plus importante des régions. Pourriez-vous nous dire la manière dont vous envisagez cette intervention dans les mois et les années qui viennent ?
Monsieur Béchon, soulignant combien il était difficile pour nos PME de devenir des ETI, vous vous êtes demandé s’il était opportun de confier à une banque publique le soin d’accompagner cette transformation. Avez-vous des pistes de réflexion à nous suggérer sur ce point ? La création d’un comité stratégique regroupant financeurs privés et publics, souhaitée par M. Girard, en est peut-être une.
Monsieur Girard, pourriez-vous nous donner davantage d’informations sur les lacunes que vous observez en matière de financement des stocks ?
Enfin, M. Isaac-Dognin, vous avez indiqué qu’il convenait de prendre en compte l’immatériel et le risque programme. Quel regard portez-vous sur l’activité de Bpifrance dans le domaine des fonds de fonds et du « haut de bilan » ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Bien que le Gouvernement intervienne pour simplifier l’écosystème entrepreneurial, comme en témoignent les mesures récemment annoncées, on s’aperçoit que le montage des dossiers de Bpifrance demeure parfois complexe. Nous sommes d’accord pour reconnaître que, dans ce domaine, des efforts peuvent être faits.
Ma première question portera sur la traduction, dans les régions, des priorités nationales affichées dans les différentes solutions pour une Nouvelle France industrielle. Comment le lien se fait-il entre ces priorités et les choix de Bpifrance sur le terrain ? Nous avons en effet rencontré des entreprises qui, bien que leur projet corresponde à l’une de ces priorités, ne trouvent pas d’écho suffisant. Par ailleurs, comment êtes-vous accompagnés à l’export par Bpifrance ? Son action dans ce domaine est-elle suffisante ou doit-elle être améliorée ?
Mme Odile Kirchner. Permettez-moi, avant de répondre à vos questions, d’évoquer rapidement l’action de Bpifrance en faveur de l’industrie, action qui a fait l’objet d’une note qui figurera pour la première fois dans le rapport annuel du CNI. En 2014, les financements accordés par Bpifrance au secteur de l’industrie ont atteint 5,1 milliards – 6,2 milliards si l’on inclut le numérique – soit 25 % et 31 % avec le numérique de l’ensemble des financements accordés par la banque publique. Le CNI se félicite que ces financements aient augmenté par rapport à l’année précédente, mais il déplore que la part de l’industrie ne soit pas plus importante.
Si l’on analyse leur répartition par type d’intervention, on observe que l’industrie capte 75 % (90 % si l’on inclut le numérique) des aides à l’innovation, mais qu’elle ne représente que 20 % (32 % avec le numérique) soit 344 millions d’euros, de l’activité d’investissement de Bpifrance, qui comprend les prises de participation directes de France investissement régions, ainsi que l’action des fonds de fonds et des fonds gérés directement par la banque publique. Or, le renforcement en fonds propres des PME industrielles est nécessaire à leur consolidation et à l’émergence d’ETI, dont on sait qu’elles ne sont pas assez nombreuses en France. Nous sommes bien conscients qu’il est difficile de convaincre ces entreprises, souvent familiales, de se rapprocher de certaines de leurs concurrentes, mais c’est un enjeu extrêmement important. Le CNI a ainsi demandé, dans son avis sur le financement, que les gestionnaires de fonds identifient les freins à lever pour favoriser ces investissements – le fonds Croissance rail et le FDEN, par exemple, n’ont réalisé qu’un seul investissement chacun en 2015.
Il convient néanmoins de nuancer cette appréciation, car les 344 millions que j’ai évoqués représentent le flux de 2014. Nous souhaiterions donc, d’une part, que Bpifrance améliore sa connaissance de la nature des entreprises dans lesquelles investissent les fonds de fonds – entreprises qui sont parfois difficilement identifiables, notamment lorsque les financements sont accordés à une holding – et, d’autre part, qu’elle nous fournisse les chiffres du stock, car on s’aperçoit, par exemple, que 240 des 360 entreprises dans lesquelles France investissements régions investit sont des entreprises industrielles.
La part de l’industrie dans l’activité de garantie de prêts bancaires – 1 milliard sur 5 milliards, soit 21 % – apparaît également faible. Or, la garantie de Bpifrance produit un effet de levier très important et permet aux PME industrielles d’obtenir des financements bancaires. Du reste, celles-ci regrettent que Bpifrance se montre un peu frileuse lorsqu’elles connaissent des difficultés conjoncturelles, même quand leurs fondamentaux sont bons. Les acteurs industriels sont satisfaits de la proximité et de la qualité de l’expertise de Bpifrance, mais ils attendent d’une banque publique qu’elle soit davantage à leurs côtés, notamment dans les moments difficiles, car il en va de la sauvegarde de l’activité et de l’emploi.
Enfin, la part de l’industrie dans les prêts à moyen et long terme, c’est-à-dire les prêts de développement et le cofinancement, est plus satisfaisante, puisqu’elle s’élève à 34 %, soit près de 2 milliards sur 6,5 milliards. Ces prêts sont un outil de financement particulièrement adapté aux projets industriels. Aussi le CNI est-il satisfait que le Premier ministre ait suivi sa recommandation, en annonçant au mois d’avril dernier que le montant de l’enveloppe consacrée aux prêts de développement serait porté à 8 milliards, sur la période 2015-2017.
J’ajoute, pour conclure sur ce point, que Bpifrance pourrait utilement développer pour l’ensemble de ses activités de financement l’approche filière retenue dans le cadre de l’action menée avec le CSF bois.
J’en viens maintenant aux réponses à vos questions, madame la présidente, monsieur le rapporteur.
Mme la présidente m’a interrogée sur le rôle des régions. Les CSF nationaux ne sont pas suffisamment articulés avec leurs homologues en régions. Si les secteurs de l’aéronautique, du bois et de l’alimentaire travaillent en filière, c’est moins le cas pour les autres secteurs. Nous allons donc favoriser cette articulation et, dans ce cadre, l’implication de Bpifrance sera particulièrement importante, car ses réseaux peuvent assurer un relais dans l’accès au financement des entreprises.
Monsieur le rapporteur, je partage votre avis, mais j’émettrai tout de même une petite réserve. Bien entendu, les priorités définies au plan national doivent pouvoir bénéficier de financements disponibles importants. C’est du reste la raison pour laquelle a été créé, à la suite du PIA 1, le comité Projets industriels d’avenir (PIAVE), dont Bpifrance est opérateur et qui est doté de 314 millions d’euros en financement et de 425 millions d’euros en apports de fonds propres dans des sociétés de projets. Y seront présentés les besoins de financement non seulement des solutions industrielles mais aussi des actions structurantes des filières – je siège moi-même au sein de ce comité en tant que personnalité qualifiée.
Mais l’industrie française ne se résume pas aux solutions de la Nouvelle France industrielle. Il est donc très important que Bpifrance continue d’offrir un continuum de financements à l’ensemble des PME industrielles du territoire. Une part importante de ces financements est consacrée à l’économie du vivant, au numérique, aux éco-industries, à l’alimentaire et au transport, mais il faut veiller à ce que Bpifrance soit aux côtés de l’ensemble des entreprises industrielles, notamment celles qui appartiennent au secteur de la mécanique.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Un industriel du secteur de la robotique, par exemple, qui s’inscrit donc dans la solution Usine du futur, a-t-il le sentiment que son dossier est examiné de manière plus approfondie et bénéficie d’un soutien plus important ?
Mme Odile Kirchner. Je ne peux pas vous apporter une réponse précise sur ce point, mais j’interrogerai la fédération des industries mécaniques. J’espère que cette réponse sera positive, car nous incitons les entreprises françaises à acquérir ce type de technologies pour moderniser leurs outils productifs. Dans le cadre de la solution Industrie du futur, par exemple, des prêts robotiques et des prêts verts, qui sont des dispositifs spécifiques de Bpifrance, seront mobilisés pour permettre à toutes les entreprises qui seront accompagnées dans le cadre de cette solution – dont je rappelle qu’elle prévoit de diagnostiquer 15 000 entreprises et d’en accompagner 2 000 – de bénéficier de moyens de financement pour moderniser leur outil de production.
M. Bernard Espannet, secrétaire général du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. En ce qui concerne l’aéronautique, grâce à la structuration de la filière, les sujets de l’Industrie du futur y compris la robotique, sont repris dans les régions, jusque dans les sociétés de rang 2 ou 3.
Jean-Philippe Girard. Dans le secteur alimentaire, nous avons élaboré un schéma permettant de concilier contenant et contenu, l’emballage et le produit, mais aussi le process. Nous y avons intégré les dimensions mécanique et robotique, ainsi que l’emballage et la transition énergétique. Toute entreprise du secteur alimentaire connaît pratiquement les dispositifs d’accompagnement concernant la robotisation et la modernisation.
M. Jean-Michel Isaac-Dognin. La consolidation des entreprises est une préoccupation ancienne de la filière aéronautique, en raison de la taille des programmes, des enjeux liés au risque, de la maîtrise du dollar ou de la mondialisation. Depuis plusieurs années, les grands donneurs d’ordres font pression dans le sens d’une structuration du secteur : soit les entreprises suivent ce mouvement, soit elles se retrouvent marginalisées. La consolidation est donc nécessaire, et il faut pour cela orienter l’épargne sous toutes ses formes vers l’industrie. En la matière, l’argent public doit jouer le rôle d’un fertiliseur, rôle qu’affiche du reste Bpifrance, qui se voit, comme l’a titré la presse, marieuse de PME pour créer des ETI. Du reste, l’intérêt des fonds de fonds est de démultiplier les moyens et de diversifier les possibilités d’action. Face à ce besoin de consolidation, le secteur aéronautique a choisi de faire appel à des capitaux qui connaissent ses problématiques, d’où la création d’Aerofound. Certains peuvent, de ce fait, avoir le sentiment que les financements proviennent de leurs clients, mais ce fonds a rempli son rôle, seul ou avec le FSI, et il a produit un effet d’entraînement : à côté de Bpifrance, les capitaux des assurances se sont organisés. Le Fonds stratégique de participations (FSP), qui réunit quelques grands assureurs, a ainsi annoncé il y a quelques jours un investissement de 200 millions dans le groupe Zodiac Aerospace. Même l’UIMM a créé des fonds obligataires.
Puisque l’on a évoqué la question de la perte de contrôle des entreprises patrimoniales, je précise que l’obligataire est désormais accessible aux PME. Dans ce domaine, des initiatives avaient d’ailleurs déjà été prises par le FSI, qui avait créé le fonds OC +, lequel présentait l’intérêt pour le chef d’entreprise de ne pas modifier la géographie de son capital. Les fonds obligataires mutualisés se développent et sont désormais accessibles aux PME, alors qu’ils étaient réservés auparavant aux grandes entreprises et aux ETI. Mais le financement des TPE et des PME relève encore la plupart du temps des réseaux bancaires.
M. Christian Béchon. L’entreprise que je dirige, par exemple, dont le chiffre d’affaires est de 500 millions, est désintermédiée, c’est-à-dire qu’elle est financée, du point de vue obligataire, non plus par les banques mais par le marché. Le seuil de désintermédiation a beaucoup baissé avec l’évolution de la réglementation applicable aux banques.
Par ailleurs, n’oublions pas que Bpifrance exerce le métier d’une banque, et qu’une banque sélectionne ses risques. Il est donc normal que vous ayez connaissance de dossiers sur lesquels l’entreprise et la banque ont un point de vue différent. Dans le domaine de la biotech, la gestion du risque par Bpifrance appelle deux commentaires. Tout d’abord, toutes les start-up du secteur sont financées par Bpifrance. Ensuite, l’action des fonds de fonds est très importante, car elle relance le capital-risque privé, qui avait disparu en France, de sorte qu’actuellement, les start-up biotech françaises sont davantage financées par la bourse que leurs homologues européennes. Mais, encore une fois, si l’on peut se féliciter que Bpifrance contribue à la réapparition du capital-risque, demandons-nous pourquoi il avait disparu. Aujourd’hui, l’inversion de la courbe des taux permet au système de fonctionner, mais que se passera-t-il s’ils remontent ?
Nous proposons, quant à nous, d’orienter vers l’industrie une petite partie de l’épargne de l’assurance-vie, y compris dans les fonds à taux fixe. Compte tenu du niveau des taux d’intérêt, ils gagneront peu ; il n’est pas illégitime de leur demander de prendre des risques. Nous craignons que la directive Solvabilité 2ne limite l’accès aux fonds des assureurs. Or, ce sont ces fonds qui ont prêté de la dette à ma société, par exemple.
Encore une fois, on peut vraiment se féliciter de l’action de Bpifrance. Bien entendu, monsieur le rapporteur, certaines entreprises auraient pu être davantage financées, mais, dans l’industrie de la santé en tout cas, il n’existe pas de problème systémique : nous n’avons pas connaissance d’entreprises dotées de très bons projets à qui l’on aurait opposé durablement un refus. Il n’y a donc pas de sélection adverse du risque.
En ce qui concerne le rôle des régions, chacune d’entre elles ne peut pas avoir sa grande entreprise. Il faut que nous nous concentrions sur nos points forts en mettant fin au saupoudrage, qui est une particularité française. À cet égard, les pôles de compétitivité illustrent très bien la manière dont on « tartine » la dépense publique dans de nombreux secteurs et de nombreuses régions, afin que chacune ait ses start-up, ses ETI et sa grande entreprise. Il ne s’agit pas de se focaliser sur quelques secteurs en excluant les autres, mais la modification de l’équilibre actuel n’est pas une priorité. D’autant que les régions ont les possibilités juridiques et les moyens financiers d’agir. Laissons donc à l’initiative entrepreneuriale publique le choix des secteurs où elle entend intervenir. Prenons l’exemple du secteur de la santé. Il existe deux ou trois grandes usines de vaccins en France : chaque région ne peut pas avoir la sienne. Plutôt que se focaliser sur les orientations régionales, mieux vaut, me semble-t-il, encourager le développement de champions nationaux, grâce à une certaine concentration. Mais il est vrai qu’en France, nous avons des difficultés dans ce domaine, pour de nombreuses raisons, notamment culturelles – ce n’est la faute ni de Bpifrance ni de l’État.
Enfin, madame la présidente, comment une entreprise passe-t-elle du stade de la PME à celui de l’ETI ? Nous avons, en la matière, une difficulté majeure, car tous les dispositifs que nous avons évoqués ne sont pas prévus pour lever entre 10 et 100 millions d’euros. Lorsqu’une entreprise de biotech ou de medtech a besoin de telles sommes, elle part aux États-Unis et devient de fait en partie américaine, car une société a aussi la nationalité de ses actionnaires. Or, ceux-ci demandent des comptes en fonction de leur propre vision du monde et non de la nôtre. C’est pourquoi, si j’avais une seule proposition à vous soumettre, ce serait celle d’orienter l’épargne de l’assurance-vie vers ce segment spécifique, pour empêcher le départ de nos entreprises. Car tous les efforts consentis par le contribuable, à travers Bpifrance, pour amener l’entreprise jusqu’à ce stade sont réduits à néant si, ensuite, elle n’a pas d’autre solution que de partir.
M. Jean-Philippe Girard. En ce qui concerne le financement des stocks, madame la présidente, je rappelle qu’il faut compter, depuis 2008, avec la volatilité des prix des matières premières. Il convient donc de développer des outils de couverture adaptés aux PME. Aujourd’hui, il faut prendre des positions à terme, et c’est une pratique qui n’est pas familière aux TPE et aux PME du secteur de l’agroalimentaire. Aussi Bpifrance pourrait-elle, au-delà du financement, accompagner les entreprises et leur apporter une expertise. On peut grouper des achats à terme, par exemple.
Pour conclure, je rappellerai les cinq mots-clés de la filière agroalimentaire.
Innovation : elle inclut le progrès et l’amélioration, jusqu’à l’invention, et nécessite des financements à court, moyen et long terme. Modernisation : la robotisation et l’amélioration de l’ergonomie sont nécessaires en termes de compétitivité. Exportation : elle doit se faire, pour les TPE, en grappes et, pour les grandes entreprises, pourquoi pas, de manière concertée et alignée. Consolidation : une réflexion doit être menée sur le rapprochement, sans brutalité, de certaines des 16 000 entreprises que compte la filière. J’avais d’ailleurs proposé à Bpifrance de créer des équipes de rapprochement. Le fonds OC + offrait, à cet égard, une solution intelligente, car beaucoup de sociétés de l’agroalimentaire sont familiales et les chefs d’entreprise envisagent difficilement d’ouvrir le capital à un étranger. Pourquoi ne pas relancer un fonds de ce type, avec des exigences de rentabilité moindres ? Mutation : le digital, ce que j’appelle l’« alimentation connectée », est un enjeu crucial. L’hypermarché de demain est dans les smartphones !
En ce qui concerne la traduction des priorités nationales dans les régions, le contrat de filière de l’agroalimentaire a la particularité d’être né des régions, puisque les sept priorités que nous avons retenues sont issues d’une enquête menée auprès de l’ensemble des entreprises du secteur. J’en citerai deux : le froid, qui représente 8 % du chiffre d’affaires dans l’alimentaire et doit être plus écologique et moins cher, et l’emballage intelligent, qui doit permettre d’exporter les produits français les plus fragiles. Bpifrance est présente dans ces projets. Il est vrai cependant qu’il est difficile de faire des tours de table supérieurs à 20 millions, d’autant plus que notre lenteur nous fait perdre des dossiers. Mais, globalement, l’action de Bpifrance donne satisfaction.
M. Bernard Espannet. Pour un chef d’entreprise, le temps de réaction, dans le cadre d’un tour de table ou d’une demande de financement, est en effet fondamental. Nos outils doivent s’adapter à l’accélération, et Bpifrance a encore, dans ce domaine, une marge d’amélioration.
M. Jean-Philippe Girard. Je viens de racheter une entreprise à Chicago. Nous avons mis deux semaines pour monter le dossier là-bas, et j’attends toujours la réponse d’une banque française…
Mme Odile Kirchner. Je souhaite apporter une précision en ce qui concerne le financement des stocks, qui est en effet un élément important. Le CNI a pu constater qu’à la différence de l’Allemagne, la France dispose de très peu d’outils de financement gagés sur les stocks, en raison d’une contradiction juridique entre le code de commerce et le code civil. Nous avons donc évoqué ce problème avec MM. Macron et Sapin, qui ont prévu, en conséquence, d’insérer dans le projet de loi sur la croissance et l’activité un article qui permettra de légiférer par ordonnance afin de supprimer cette contradiction juridique et de mettre sur pied ces outils de financement. Nous espérons bien que Bpifrance, dont nous avons souligné à plusieurs reprises le rôle d’entraînement, sera la première à créer cet outil.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Madame, messieurs, nous vous remercions pour votre contribution à nos travaux.
Audition du 24 juin 2015
Table ronde sur l’outre-mer : M. Dominique Caignart, directeur du réseau Île-de-France de Bpifrance Financement et en charge de l’Outre-mer ; M. Marc Del Grande, sous-directeur des politiques publiques, et M. Gilles Armand, chargé de mission pour les affaires bancaires, monétaires et financières à la direction générale des outre-mer ; les commissaires au redressement productif : Mme Marie-Claude Derné (Martinique), M. Vincent Launay (La Réunion), M. Lionel Loutoby (Guyane) ; M. Jean-Paul Tourvieille, directeur général de l’Association des chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer (ACCIOM) et M. Philippe Mouchard, délégué général de la Fédération des entreprises d’outre-mer (FEDOM).
Mme la présidente Véronique Louwagie. Nous poursuivons les travaux de la mission d’information commune sur Bpifrance par une table ronde consacrée aux actions de la Banque publique d’investissement (BPI) en outre-mer. Je vous laisse, madame et messieurs, la parole sans plus tarder pour que vous nous fassiez part de votre analyse de l’action de la BPI.
M. Dominique Caignart, directeur du réseau Île-de-France de Bpifrance Financement et en charge de l’Outre-mer. Le réseau que j’anime couvre à la fois l’Île-de-France et l’Outre-mer, et ce depuis le 1er janvier 2014, date de l’implantation de la BPI hors de la métropole, avec la nomination de deux directeurs régionaux sur place.
Nous travaillons dans le cadre d’une convention de prestation de service avec l’Agence française de développement (AFD), laquelle nous représentait historiquement sur une ligne de produits majeure dans les DOM, le financement des commandes publiques. La loi nous fixant comme objectif de nous implanter sur la totalité du territoire, nous avons conservé ce prestataire de services, en élargissant ses interventions à l’ensemble de la gamme de Bpifrance. Le fonds de garantie spécifique que gérait l’AFD pour son propre compte en partageant les risques avec l’État – le fonds DOM – a été clôturé et nous avons repris à notre compte cette activité de garantie, fondamentale sur les marchés ultramarins, par le biais des fonds nationaux que gère Bpifrance pour le compte de l’État.
Les deux directeurs régionaux de la BPI animent sur place les équipes de l’AFD, selon une forme de management et d’animation originale. Ils sont en relation avec l’ensemble des collectivités pour construire des solutions spécifiques selon les priorités et les budgets disponibles de chaque collectivité. Ils ont également une mission de représentation sur place auprès des grands décideurs : partenaires bancaires locaux, chambres consulaires et les différentes fédérations. Ils représentent aussi l’État pour des actions spécifiques, telles que le préfinancement du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), une action majeure dans les outre-mer sur laquelle nous étions particulièrement attendus.
Alors que l’on pouvait craindre que le passage d’un fonds à un autre ne crée une période de turbulence, les chiffres ont progressé sur les activités historiques. Le lancement des nouveaux produits, sur de petits marchés où les banques n’ont pas l’habitude d’avoir la BPI comme partenaire, qui plus est à un moment où l’investissement n’était pas très porteur et où les banques avaient des disponibilités importantes, exigeait que nous arrivions à pas mesurés vis à vis de nos partenaires bancaires. Comme vous le savez, toute intervention de la BPI se fait en cofinancement avec un réseau bancaire ; nous n’avons pas de produit en intervention propre, à l’exception d’un produit spécifique que nous venons de créer en Guyane et que nous dupliquerons sur les autres territoires ultramarins. Nous nous sommes adaptés de cette manière à une spécificité de marché, les banquiers ne souhaitant pas intervenir dans certains secteurs. Avec la région de Guyane, nous avons monté un produit unique en France.
Nous nous sommes imposés sur les grandes lignes de produits pour lesquelles nous étions attendus, à savoir le financement de l’immobilier via des solutions de crédit-bail immobilier peu pratiquées sur place jusqu’alors les structures bancaires ou financières ne souhaitant pas généralement être propriétaire immobilier dans les territoires. Bpifrance a investi dans l’immobilier dès la première année, ce qui est relativement probant car la prise de position dans ce type d’opérations est assez longue.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce produit spécifique à la Guyane ?
M. Dominique Caignart. Il est dans l’essence de la BPI d’aller là où les banquiers ont besoin de nous car ce sont nos partenaires, mais aussi là où les entreprises ont nous attendent car ce sont elles les bénéficiaires finaux. Il existait en Guyane, un problème d’accès au financement pour les petites opérations. Nous nous sommes donc dit que si la région avait les budgets disponibles, nous pourrions créer un produit spécifique. Le prêt en question s’élève à 50 000 euros et permet à de petites entreprises de monter une marche dans leur croissance. Ce n’est pas une aide à la création d’entreprise car nous intervenons quelque temps après. Il s’agit d’un prêt de développement territorial « Guyane », qui pourra être décliné dans les autres territoires. Les négociations sont en cours pour cela. Le produit a été lancé il y a quelques mois et nous en avons accordé une vingtaine. C’est le seul produit que nous proposons sans partenaire bancaire car le risque est partagé avec la région. En métropole pour ces produits, on impose un partenariat bancaire.
M. Marc Del Grande, sous-directeur des politiques publiques à la direction générale des outre-mer. Le choix fait en juin 2013, au moment de créer la BPI en outre-mer, a été celui de la continuité. Depuis 2009, les activités d’Oséo étaient portées par l’AFD, et c’est l’AFD qui assure le front office de la BPI pour les activités de financement avec l’objectif pour le ministère, à la fois que tous les produits « hexagonaux », de droit commun, soient commercialisés en outre-mer et que le dispositif évolue vers une plus grande proximité par le biais de produits adaptés à chacune des géographies. Le fonds DOM a été placé en gestion extinctive au bénéfice des fonds de garantie nationaux de Bpifrance Financement. Nous avions aussi la volonté que les élus, notamment les présidents des conseils régionaux, qui président les comités régionaux d’orientation (CRO), soient placés au premier plan, puisqu’ils assurent la gestion du FEDER et, souvent, du FSE.
Il est encore un peu tôt pour en dresser un bilan définitif avec seulement un an de recul sur l’intervention de la BPI en outre-mer mais, vu du ministère des outre-mer, au moins quantitativement ce ne n’est pas un échec. Les objectifs fixés à Bpifrance pour 2014 ont été atteints et même au-delà de 100 % puisque la production complète est de 524 millions d’euros. On constate que le nombre de dossiers présenté à la médiation du crédit dans les DOM est passé de soixante-six à trente-quatre, soit une baisse de 48 %, entre 2013 et 2014. Les encours de crédit accordés aux entreprises ultramarines ont augmenté d’un peu plus d’un milliard d’euros – une hausse de 5,6 % –, pour un total aujourd’hui supérieur à 20 milliards d’euros.
Les attentes du ministère se concentrent sur le Pacifique et sur le préfinancement du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) – succédant au fonds européen pour la pêche (FEP) – qui est en voie d’être réglé selon une méthode originale. Le Premier ministre, lors de son déplacement dans l’océan Indien, s’est engagé à ce que de premiers décaissements aient lieu avant la fin du mois de juin, et je crois que nous sommes capables de relever le défi.
Nous avions également une attente en matière de préfinancement du nouveau dispositif de crédit d’impôt. Depuis le 1er janvier 2015, il est substitué au mécanisme de défiscalisation existant, un crédit d’impôt à la fois pour le logement social et l’investissement productif, qui permet d’économiser les frais d’intermédiation. S’agissant du logement social, le préfinancement est assuré par la Caisse des dépôts. Sur l’investissement productif, s’il reste quelques réglages à effectuer, nul doute que les choses vont dans le bon sens.
Le ministère des outre-mer est satisfait de pouvoir compter sur deux intervenants de qualité, l’AFD et la BPI, qui se complètent sur le marché privé sans se concurrencer. Bpifrance est en première ligne sur les projets de taille réduite et de maturité plus courte, selon un traitement informatique plus mécanique, tandis que l’AFD conserve une capacité d’intervention pour de plus gros tickets ; ce que montre la tendance de l’intervention de l’AFD en outre-mer qui, inférieure à un milliard d’euros en 2010 est aujourd’hui supérieure à 1,5 milliard. À telle enseigne que nous avons obtenu le principe, qui reste à mettre en œuvre, d’un déplafonnement de l’intervention de Bpifrance dans le contrat d’objectifs et de moyens de l’AFD afin que l’activité de financement des petits tickets ne soit pas gênée par un plafond trop théorique et qui ne met pas en jeu les fonds propres de l’AFD.
Les aides d’État dans les DOM suivent les règles posées par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ces règles sont plus souples dans les régions ultrapériphériques, les taux d’intensité plus forts et les investissements initiaux peuvent être financés quelle que soit la taille des entreprises. La direction générale de la concurrence a trouvé des solutions innovantes pour assurer l’euro-compatibilité de nos dispositifs sur le logement social et l’investissement productif. À compter du 1er juillet 2014, la Commission européenne ayant souhaité renverser la charge de la preuve vers les États membres, les règles ont été assouplies afin que les États prennent eux-mêmes la responsabilité de se placer sous le parapluie du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) pour leurs aides à l’investissement et au fonctionnement.
Mme Marie-Claude Derné, commissaire au redressement productif de Martinique. Notre analyse de la situation en Martinique avant l’arrivée de la BPI montrait une défaillance du marché sur certains segments. Il existait par exemple une offre abondante en termes de garantie – fonds de garantie à l’initiative des femmes, fonds de garantie pour les micro-projets… –, mais pas de dispositif pour les projets structurants. La panoplie de prêts était également assez large, prêts à taux zéro ou prêts bancaires classiques, mais là encore le marché était défaillant sur les plus gros projets, s’agissant notamment de l’offre de fonds de retournement ou de fonds de rebond et s’il y existe une société de capital-risque portée par les deux conseils régionaux, son ticket ne dépasse pas 500 000 euros. La BPI était attendue sur ces défaillances.
Depuis son installation, l’investissement a effectivement augmenté. Sur la région Antilles-Guyane, 380 millions d’euros ont été versés en 2015. Cependant, plus de 60 % de ces sommes vont en garantie, 30 % servent à des avances aux marchés publics, et seuls 10 % sont affectés aux nouveaux produits. Ces chiffres confirment le ressenti des chefs d’entreprise sur le terrain : la BPI intervient surtout en garantie, plutôt que d’assurer un accompagnement plus porteur par le biais de prêts ou de capital-développement.
Cette situation s’explique selon moi par plusieurs raisons. Tout d’abord, la BPI intervient toujours en aval de la décision bancaire, laissant ainsi la décision aux banques. Ensuite, même sur des projets porteurs qui affichent des taux de croissance importants, elle considère parfois que le risque est trop important. La BPI n’a pas répondu à l’attente d’une intervention plus directe, en levier. Les TPE-PME martiniquaises sont de manière générale sous-capitalisées et connaissent, conjoncturellement, des pertes d’exploitation ; ce sont là des caractéristiques qui ne permettent pas à la BPI d’intervenir de manière plus offensive.
En tant que commissaire au redressement productif, je m’efforce de développer une approche nouvelle en Martinique. Si l’approche financière ne doit pas être négligée, il faut aussi intégrer les éléments d’évolution du marché, la capacité de l’entreprise à se positionner sur d’autres segments, l’organisation de l’équipe, l’ensemble des facteurs qui concourent au développement de l’entreprise. De même, nous essayons de développer une approche d’accompagnement par phases. Les entreprises en Martinique étant sous-capitalisées, le premier geste serait de l’aider à la restructuration de leur capital, en cofinancement avec un partenaire bancaire classique. Une seconde phase consisterait à accompagner les projets dans son développement. Cette double approche, globale et par phases, permettrait de minimiser le risque, en le partageant et en le découpant dans le temps.
M. Vincent Launay, commissaire à la vie des entreprises et au développement productif à La Réunion. Il existait une très grande attente du tissu économique réunionnais vis-à-vis de la BPI, en raison des défaillances du marché. De cette très grande attente est née la déception des chefs d’entreprise, parce que le dispositif mis en place n’y répond pas. Le déficit de l’AFD, localement, en termes d’appréciation des dossiers, du caractère innovant ou structurant de tel ou tel investissement, se retrouve dans le fonctionnement de la BPI.
Le représentant local de la BPI à La Réunion est très présent, il accompagne la préfecture ainsi que mes missions sur différents sujets tels que le préfinancement du CICE, sur lequel il a été extrêmement pugnace et où de bons résultats ont été obtenus. L’accompagnement est important, mais sur des projets qui auraient a priori trouvé une réponse dans le cadre du système bancaire classique. Le dispositif BPI, c’est paradoxal, donne le sentiment de conforter le système bancaire dans sa démarche vers les entreprises plutôt que d’aider spécifiquement ces dernières. Les bénéficiaires du dispositif sont d’abord les banques et seulement ensuite, par ricochet, les entreprises.
Toutes les dispositions européennes s’appliquent sur nos territoires en ce qui concerne les financements de la BPI. Des négociations sont en cours pour appliquer le prêt de développement territorial à La Réunion. La difficulté vient de ce que le conseil régional a choisi de structurer son prêt autour du dispositif FEDER, ce qui ne permet pas à la BPI d’intervenir. Cette difficulté ne peut se résoudre puisque le comité d’orientation régionale ne se réunit pas.
En conclusion, le dispositif fonctionne, techniquement, et il permet une intervention assez rapide, mais il existe une difficulté au niveau de l’appréciation des dossiers par des équipes AFD qui sont davantage outillées mentalement pour gérer des autoroutes, des ports maritimes ou des aéroports que les TPE de cinq salariés qui forment le tissu économique local. Je rejoins Mme Derné sur ses propositions de phasage et la nécessité d’un travail sur la capitalisation des entreprises qui leur permettrait de retourner d’elles-mêmes rapidement vers le secteur bancaire privé.
M. Lionel Loutoby, commissaire à la vie des entreprises et au développement productif, en Guyane. Non seulement la place bancaire est particulièrement frileuse en Guyane, plus que dans les autres DOM, mais nous connaissons en outre cette particularité que les groupes bancaires ont tous, à l’exception d’une seule banque, une direction régionale hors du territoire, ce qui peut donner le sentiment que les décisions sont prises ailleurs et que la Guyane est reléguée au second plan.
Il existait donc une très forte attente vis-à-vis de la BPI, et c’est pourquoi la Guyane a été la première à installer son CRO et à développer un prêt de développement territorial. Nous pouvons à cet égard saluer le dynamisme de la directrice pour la région Antilles-Guyane, Michèle Papalia, ainsi que l’implication très forte du président de région.
Les chiffres montrent une explosion des crédits et des garanties. En revanche, le retour que je reçois des chefs d’entreprise montre qu’ils n’ont pas le sentiment que les choses aient beaucoup changé en termes de suivi et d’accompagnement, ni que le financement ait été facilité. Ce dernier point tient à la doctrine de la BPI, qui intervient en co-financement et en co-investissement. Dans les faits, les équipes sur place attendent la réponse d’une banque avant de prendre une décision. Or, si les banques recevaient un signal fort en amont, elles pourraient plus facilement se positionner sur les dossiers. Si la BPI, sans violer sa doctrine, pouvait donner une réponse de principe sous réserve d’obtenir ensuite un co-financement, cela déclencherait l’intention d’une banque, qui saurait à l’avance que la BPI porte un regard positif sur le dossier. Les banques ont aujourd’hui des réticences à utiliser la délégation de garantie de la BPI, un produit pourtant très simple d’utilisation, et préfèrent saisir la BPI sur chaque dossier : il est donc clair qu’elles attendent des signaux de la BPI pour prendre des risques.
Les attentes des chefs d’entreprise sont déçues en raison également d’un manque de communication de la part de la BPI. Il conviendrait de développer une approche commerciale offensive. Il manque un chargé d’affaires qui se rende sur le terrain et rencontre les chefs d’entreprise. Tous ceux que je vois me disent que leur seul contact avec la BPI est la directrice régionale – et c’est très bien que celle-ci assure de tels déplacements – mais une présence plus importante serait nécessaire pour offrir un meilleur service aux chefs d’entreprise, qui sont demandeurs d’un service de proximité. Il me semble que l’on ne peut faire l’économie d’une équipe BPI sur place en Guyane.
Le capital-investissement a du mal à se développer. Au bout d’un an et demi, la BPI n’est entrée au capital d’aucune entreprise en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Il faut assouplir les critères localement, notre tissu économique étant constitué d’entreprises bien plus petites. Une telle souplesse permettrait de faire grandir de belles pépites sur nos territoires.
M. Philippe Mouchard, délégué général de la Fédération des entreprises d’outre-mer. Le ressenti de nos adhérents, entreprises mais aussi collectivités d’outre-mer, recoupe totalement les remarques qui viennent d’être exprimées par les commissaires au redressement productif.
Les attentes sont très fortes dans les trois collectivités du Pacifique. Une montée en puissance est prévue mais les attentes sont encore déçues, notamment en Polynésie française.
En Guyane, en dépit de l’indéniable mobilisation des agents de la BPI et de l’AFD, le retour de nos adhérents souligne le manque d’une présence in situ qui permette de prendre en considération les spécificités du territoire. La Guyane connaît une croissance démographique entre quatre et six fois celle de la moyenne nationale : dans vingt ans, elle sera plus peuplée que la Martinique et la Guadeloupe. La BPI ayant une structure commune à La Réunion et à Mayotte, la même problématique se posera dans une vingtaine d’années à Mayotte par rapport à La Réunion.
Il ne faut pas non plus oublier les territoires que j’appelle orphelins, angles morts des politiques publiques, les collectivités de l’Atlantique : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Saint-Martin a la particularité d’être à la fois une région ultrapériphérique, qui doit tenir compte des contraintes communautaires, et une collectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie fiscale et ne bénéficiant pas, à ce titre, du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation. Ces trois collectivités ne devraient pas être exclues du dispositif.
Les chiffres indiquent une mobilisation et une reprise des crédits aux investissements, mais une certaine frilosité subsiste en matière de capital-investissement et de financement de l’innovation. Les produits d’Oséo innovation étaient déjà insuffisamment développés outre-mer, alors que ces territoires ont justement besoin de davantage de recherche pour se développer. La R&D dans les outre-mer est de 0,65 % du PIB, contre 2,24 % en métropole, pour un objectif européen fixé à Lisbonne à 3 %. Alors que les projets existent, sur l’énergie thermique des mers par exemple, les banques et la BPI manquent d’audace pour financer des projets, certes risqués mais qui créeront à terme de la valeur ajoutée.
M. Jean-Paul Tourvieille, directeur général de l’Association des chambres de commerce et d’industrie d’outre-mer. L’ACCIOM, qui regroupe les onze chambres de commerce et d’industrie ainsi que les chambres interprofessionnelles de l’ensemble des DOM-COM se retrouve très bien dans les propos des trois commissaires au redressement productif, dont je salue la bonne vision du terrain.
Nous avions alerté dès 2013, très en amont, sur le fait qu’il ne fallait surtout pas dupliquer le système AFD-Oséo dans un système AFD-BPI. J’avais personnellement rencontré Nicolas Dufourcq, en présence d’Oséo, pour lui dire qu’il ne fallait pas reproduire la même erreur. Or, si l’on est passé d’une convention de partenariat à une convention de sous-traitance, sous les mots, la réalité est identique.
Le Premier ministre avait, à Nouméa, le 27 juillet 2013, insisté sur la mise en place de la BPI au niveau local. Un document commun émanant des chambres consulaires et de la CGPME, du MEDEF et de l’UPA, a été produit. Il ne s’est rien passé. L’instance de concertation et d’orientation appelée de leurs vœux par les socio-professionnels n’existe pas, et leur déception est à la mesure des annonces qui avaient été faites. Faute de délégation locale, la BPI n’est pas identifiée.
Dans l’océan Indien, le comité d’orientation s’est réuni une seule fois, le 18 février 2014, le jour du lancement de la BPI, et n’a plus rien fait depuis. Le contact entre la BPI et les entreprises n’est pas des plus faciles, et les dispositifs semblent hors de portée des TPE. De même, nous ne sommes pas convaincus que les conseils des banques de la place maîtrisent parfaitement les produits proposés, et, en termes de communication, il n’y a strictement rien. Je présume que vous avez eu connaissance de la lettre du 4 décembre 2014 que le président de la chambre de commerce de La Réunion a adressée au Président de la République afin d’appeler son attention sur ces manques. Je n’ai pas entendu dire qu’il ait reçu une réponse.
Dans l’Atlantique, le bilan est un peu plus nuancé dans la mesure où le travail de Mme Papalia est reconnu en Guadeloupe et en Guyane. Il est plus discret, semble-t-il, en Martinique. Mais comme l’a souligné M. Loutoby, elle est seule : ses moyens d’intervention sont extrêmement limités. Les interlocuteurs physiques sont restés les mêmes. Les nouveaux produits ne font l’objet d’aucune promotion. Le comité régional s’est réuni trois fois en Guyane, deux fois en Guadeloupe, une fois en Martinique, et puis plus rien.
Le produit spécifique « Guyane » a été apprécié et je me réjouis d’entendre qu’il devrait s’appliquer ailleurs. Force est de constater, cependant, que les professionnels ne sont pas alertés. Je présume que les discussions se passent entre la BPI et les conseils régionaux ; il est dommage que les acteurs économiques ne soient pas associés.
En conclusion, entre la communication nationale sur la BPI et le résultat, la déception est évidente. Malgré nos avertissements, le système ancien, qui ne fonctionnait pas, a été dupliqué. Il existe certes des points positifs, des chiffres qui parlent, mais le sentiment général est que la BPI est suiveuse, plutôt que moteur comme cela avait été annoncé.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci aux uns et aux autres. Pouvez-vous apporter quelques éléments complémentaires sur les implantations existantes ? Existe-t-il aussi des antennes ? Quels sont moyens humains affectés par la BPI à l’outre-mer ?
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Je souhaiterais quelques précisions sur les dispositifs aujourd’hui applicables dans le Pacifique, car je crois comprendre qu’ils sont encore peu déployés. Par ailleurs, il me semble que le ministère des outre-mer a été sollicité financièrement par le biais d’une dotation à la BPI. Cette dotation est-elle définitive ou bien sera-t-elle reversée au ministère ?
Mme Maina Sage. La Polynésie a en effet tardé à mettre en place ces produits. Nous avons la chance d’avoir une société locale d’aide au financement des entreprises et, à entendre mes collègues d’outre-mer, je me dis que c’est la meilleure solution pour garantir de la proximité et une bonne compréhension du marché.
Je souhaiterais avoir davantage d’éléments sur la structure des entreprises que soutient la BPI. Quelle est la proportion de dossiers retenus ? Certains secteurs sont-ils plus aidés que d’autres ?
La réticence des banquiers que vous retrouvez un peu partout en outre-mer est-elle due à une méconnaissance du tissu économique, à une frilosité traditionnelle, à un manque de vision sur le développement de ces territoires ? Ma crainte est que les dispositifs de garantie deviennent un recours facile pour les banques. Je note avec intérêt la proposition d’une inversion de la démarche par une garantie préalable de la BPI pour faciliter l’octroi de prêts.
M. Dominique Caignart. Merci, de la part de mes directeurs régionaux, du bien que vous avez dit d’eux.
Chaque site de l’AFD porte un double panneau AFD et BPI : la BPI est présente sur tous les territoires. Elle est fléchée sur les sites internet et les annuaires téléphoniques. Les agents de l’AFD assurent la promotion des produits BPI. Ces agents sont complètement détachés et ils sont plusieurs sur chaque site à conduire cette démarche de prospection, d’information des chambres consulaires, de rencontre avec les partenaires bancaires, de montage et d’étude des dossiers.
Nous avons réalisé l’année dernière 2 300 opérations de financement de garanties en outre-mer. Ces 2 300 dossiers ont été, pour 95 % d’entre eux, signés par les collaborateurs de la BPI sur place. C’est une grande fierté car, en un an, nous avons fait basculer vers l’AFD tous les outils de gestion et de prise de décision. Nous formons, sur un site en Guadeloupe, les équipes de l’AFD à tous nos outils, en leur donnant accès à l’ensemble des connaissances de la BPI. Nous « upgradons » la complexité des analyses qui leur sont demandées, ce qui explique peut-être le retard au démarrage que certains ressentent mais qui ne se traduit pas dans les chiffres.
Afin d’accélérer les procédures, nous sommes en train de signer avec les banques locales des conventions de délégation de décision. M. Loutoby demande que la BPI donne son avis à la banque avant que celle-ci prenne une décision ; nous faisons mieux puisque, sous réserve du respect de ratios, ces conventions permettront à la banque de consentir un crédit à l’entreprise et de bénéficier automatiquement de la garantie BPI, jusqu’à 200 000 euros, ce qui couvre 80 ou 90 % des opérations en outre-mer. Cela raccourcira encore les délais, un processus qui a déjà débuté en 2014 grâce à l’envoi d’outils BPI sur place. Nous avons également amélioré l’appétit des banquiers pour nos solutions.
Ce n’est pas nous qui convoquons les CRO. Nous n’y sommes que scrutateurs. Les régions qui ont souhaité accélérer le processus, comme la Guyane, ont pris un peu d’avance dans le déroulement de notre installation. La Réunion, pour sa part, reçoit de tels subsides du FEDER que nous avons du mal à nous intégrer dans le processus, les attentes à notre égard étant bien moindres.
Nous sommes en train de négocier un prêt de développement territorial avec chaque territoire. Nous négocions également la création d’un fonds de garantie complémentaire aux fonds nationaux, qui nous aiderait à mieux traiter les priorités régionales, mais je ne le promets pas pour 2015. En métropole, toutes les régions ont créé un fonds spécifique complémentaire à l’intervention des fonds nationaux. Nous l’avons proposé aux régions ultramarines mais elles ont souhaité attendre de connaître les subsides en provenance du FEDER avant de nous répondre.
Dans le Pacifique, la signature de la convention a été ralentie par un changement de Gouvernement qui est intervenu entretemps. Chaque fois que nous parlons avec quelqu’un, il n’est plus là au bout de trois mois. Nous allons lancer un prêt de développement territorial qui sera géré par la Sofidep avec une garantie de la Sogefom, fonds de garantie géré par l’AFD dans lequel la BPI n’a rien à voir – l’AFD a conservé, avec ce fonds, une spécificité dans le Pacifique. Nous serons en revanche, comme dans beaucoup d’autres régions, opérateurs du produit « pour le compte de ».
L’adhésion du marché à un nouveau produit, même si celui-ci a été conçu en tenant compte des spécificités locales, demande des relais efficaces et prend du temps. Sur certains produits, nous partons de rien. À noter, cependant, que les barrières géographiques sont en train de tomber : il n’est pas plus difficile de se connecter à une page de la BPI depuis la Polynésie que depuis la métropole.
La priorité, aujourd’hui, est l’ETI de croissance, mais nous ne négligerons pas les TPE et PME. Le premier poste de garantie de la BPI en outre-mer, ce sont les prêts d’honneur aux entreprises. L’accès au crédit d’un créateur d’entreprise est donc déjà garanti par la BPI.
Il existe certainement un sujet sur les petites opérations de fonds propres dans les DOM. Nous n’en faisons pas non plus en métropole car le produit n’est pas adapté à de petits tickets : on ne peut entrer dans le capital d’une TPE sous forme de prise de participation, il faut trouver des produits alternatifs. C’est pourquoi nous avons créé des prêts d’amorçage, ainsi que l’octroi d’une garantie aux business angels. De même, la BPI garantit et dote 300 fonds régionaux de prise de participation. Les structures régionales de participation reçoivent non seulement des dotations budgétaires pour pouvoir investir, mais leurs investissements dans les entreprises sont en outre garantis. Dans les Antilles, il faut recréer un fonds d’investissement ultramarin, et le doter suffisamment en capital, avant de pouvoir engager le processus normal. Il manque pour l’instant un acteur local. Les îles n’ont pas, prises isolément, la surface suffisante pour jouer un tel rôle ; il faut essayer de fédérer les territoires.
M. Marc Del Grande. En ce qui concerne le préfinancement du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), nous avons trouvé une solution innovante consistant à prélever 2,5 millions d’un fonds de garantie géré par l’AFD au profit du fonds national de garantie de Bpifrance, mais, une fois l’opération terminée, les fonds « remigreront » vers leur emplacement initial.
M. le rapporteur. À quelle date ?
M. Marc Del Grande. Le ministère des outre-mer a été très ferme dans les négociations sur le sujet, car nous ne souhaitions pas perdre 2,5 millions d’euros qui émanaient du ministère des outre-mer. Les fonds qui avaient perduré au-delà de la gestion extinctive du fonds DOM ont été transférés sur des fonds nationaux et ne sont pas revenus à l’outre-mer. Nous ne souhaitions pas que cela se reproduise.
Les fonds du budget du ministère qui abondent des interventions au profit des prêts de l’AFD représentent un peu plus de 20 millions d’euros. Il s’agit de sur-bonifications pour le secteur public sur des thèmes très précis sachant que l’intervention de l’AFD pour le secteur public finance par ricochet les entreprises dans la mesure où elle dope la commande publique.
Les prêts de développement territoriaux sont en bonne voie dans le Pacifique. Le ministère des outre-mer ne souhaitait pas que ce soit la seule intervention de la BPI. Celle-ci fait tous ses efforts pour mettre au moins en place le produit « Avance + ». Elle se heurte à cet égard à un problème de conversion de ses systèmes informatiques de l’euro au franc Pacifique. Cela peut paraître un détail mais c’est un problème complexe.
M. le rapporteur. On devrait pouvoir y arriver. J’espère que nous aurons des réponses précises sur les dates de mise en œuvre de ces dispositifs dans le Pacifique. Pouvez-vous confirmer, par ailleurs, que les 2,5 millions d’euros consentis à la BPI retourneront prochainement au ministère ?
M. Dominique Caignart. C’est marqué expressément dans la convention qui circule pour signature. Nous consentons un découvert à des entreprises devant recevoir des subventions dont la forme et les montants ne sont pas encore décidés. Cela durera le temps que l’administration mette en place ces subventions, les estime, les paye aux entreprises, et que les entreprises nous remboursent. C’est la première fois que nous avons accepté, sous pression bienveillante, d’offrir un tel produit. Il n’y a pas de cession de cette créance puisqu’elle n’existe pas ; nous avons tordu nos règles et notre système à la demande du ministère. Celui-ci nous a dit qu’une fois le dispositif purgé il faudrait leur rendre les fonds; cela a été inscrit dans la convention. On parlait ce matin du 31 décembre 2016 mais c’est sans doute optimiste. On peut prévoir un retour début 2017. Nous attendrons, quant à nous, que la dernière ligne que nous avons financée sur ce produit soit réglée pour purger l’opération.
M. Marc Del Grande. Cela dépendra de la mise en place des crédits et de l’avancée des règlements par la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la commission européenne. Le risque sur cette opération est nul : la ressource halieutique dans les DOM est bonne et les fonds arriveront. Il s’agit seulement d’une question de bonne transition entre l’ex-FEP (Fonds européen pour la pêche) et le FEAMP.
M. le rapporteur. Comment expliquez-vous qu’il n’y ait dans les DOM-COM aucune intervention en capitalisation ?
M. Dominique Caignart. Ces interventions sont possibles et nous avons réalisé des opérations intéressantes. J’ai visité à La Réunion une entreprise dans laquelle la BPI est au capital. C’est toutefois une activité pour laquelle il faut des représentations locales très professionnelles, car il s’agit d’un métier autrement plus complexe que le crédit. Cela suppose une volonté forte et partagée par les trois territoires pour constituer un fonds de taille critique. Un fonds d’investissement ne peut être crédible s’il n’a pas 30 ou 40 millions à investir, et lever de telles sommes pour financer des TPE ou PME ultramarines est irréaliste, ne serait-ce que parce qu’il faut de l’argent privé en miroir de l’argent public. C’est difficile même en métropole, et ce même quand les régions sont prêtes à considérablement investir.
L’une des tâches de la BPI, dans son activité de fonds de fonds, est de donner envie aux bons acteurs. Nous jouons tous notre crédibilité car un fonds peut exploser très vite. Il existe à La Réunion un fonds géré par une société de gestion crédible que nous avons validée. Nous lui envoyons des clients un peu plus petits que ceux sur lesquels travaille Bpifrance.
Le prêt de développement est le produit majeur de l’action de la BPI sur le terrain, car, très complémentaire du produit des banques, il finance tout ce qu’il est difficile de financer : besoins en fonds de roulement, acquisition d’entreprise, développement à l’international… Sur les 6 milliards de production de la BPI attendus cette année en financement d’investissement, 2 milliards relèvent de ce produit. Nous avons avec ce dernier réalisé la percée la plus évidente en outre-mer, car nous complétons vraiment l’offre locale. Les banquiers nous voient là d’un très bon œil. Il n’y a plus du tout de barrière entre notre gamme nationale et l’outre-mer. C’est là une idée qu’il faut faire tomber. Le produit n’est peut-être pas encore commercialisé en outre-mer avec la même vigueur, mais nous nous efforçons de former notre prestataire.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Un manque de communication a été souligné. Quelles sont les orientations prises en la matière ?
M. Dominique Caignart. La meilleure promotion d’un établissement est assurée par les hommes et les femmes qui en constituent les équipes. Pour bien parler des produits, il faut bien les connaître. Pour la première fois, la BPI a organisé cette année une convention des agents de l’AFD des Antilles et de la Guyane pour les former à la communication sur les produits. Ce ne sont pas des affiches que nous voulons, en termes de communication, mais des gens capables de parler avec les socio-professionnels. J’ai moi-même entendu les chefs d’entreprise de Guyane se plaindre de ne pas être informés. Il faut que nos représentants soient formés et confiants.
Mme la présidente Véronique Louwagie. En métropole, un certain nombre de communications passent par des affiches ou des panneaux, dans les gares, les stations de métro… Des actions de même nature sont-elles envisagées dans les DOM ?
M. Dominique Caignart. Nous sommes en train de lancer des démarches de fédérations d’entrepreneurs, « Bpifrance Excellence » par exemple. Nous communiquons auprès de chefs d’entreprise pour qu’ils deviennent eux-mêmes des relais de communication et de promotion de nos produits en direction de leurs pairs. Nous avons également doté les directeurs régionaux de budgets de communication sur les bons supports, mais je suis un fervent défenseur de la communication par la présence sur le terrain, car c’est la plus efficace.
Pour répondre à Mme la députée, la BPI intervient dans tous les secteurs dès lors que le projet est de qualité et répond aux critères de responsabilité sociétale des entreprises. Les quelques exceptions ne sont pas liées à la situation de la Polynésie : dans l’activité de capital, on s’interdit, par exemple, d’investir dans la presse. Quand on crée un produit, on s’appuie beaucoup sur les partenaires locaux pour estimer la taille et les spécificités du marché et la nature des entreprises. En Polynésie, nous avons demandé à la Sofidep et à l’AFD les marchés pour lesquels la demande était la plus urgente. Leur réponse correspond parfaitement au prêt de développement territorial de 50 000 euros : c’est là que la demande existe et que nous pourrons monter rapidement en puissance, et nous développerons le même produit en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, c’est davantage l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), l’INSEE et les chambres de commerce qui peuvent vous fournir les données statistiques que vous demandez, madame la députée.
Le problème informatique qui explique une grande partie des retards, est – plus que la parité monétaire – lié au numéro SIREN. Le logiciel permettant à toutes les entreprises concernées de gérer leur trésorerie en bénéficiant d’aides de la BPI demande des vérifications par SIREN afin d’effectuer des contrôles : c’est ce logiciel que nous essayons de « forcer » pour proposer des produits « Avance + », tête de gondole sur cette activité, dans les COM – car ces produits marchent déjà remarquablement bien dans les DOM, où ils ont véritablement changé la donne.
M. Lionel Loutoby. Depuis trois ans, les élus locaux des différents territoires ne parviennent pas à se mettre d’accord pour développer un produit commun d’intervention en capital. Il est un peu dommage que la BPI s’impose une contrainte en outre-mer alors qu’elle utilise ces outils sur le reste du territoire national sans être dépendante des choix des élus. L’outil existant pourrait être adapté à des tickets un peu moins élevés.
Mme Marie-Claude Derné. En Martinique, plus de 85 % des entreprises sont des TPE, avec parfois un salarié et un capital en-dessous de 1 000 euros. Ce type d’entreprises ne correspond pas aux critères d’intervention de la BPI. La panoplie existe, les équipes sont présentes et je travaille quotidiennement avec elles. Mme Papalia, que j’ai rencontrée la semaine dernière, présente les choses de la façon suivante : la panoplie est là, c’est à présent de notre capacité à faire de l’ingénierie que dépendra le succès de la BPI. Les acteurs doivent apprendre à mutualiser les outils et les coordonner de manière à les rendre plus efficaces. Les banquiers classiques ont leur rôle à jouer mais ils restent pour l’instant dans l’attentisme : pour preuve, en Martinique, la convention de délégation n’a pour l’instant été signée que par une seule banque. Les banquiers ne sont pas encore entrés dans la dynamique que les chefs d’entreprise attendent.
M. Jean-Paul Tourvieille. M. Caignart dit que les banques voient la BPI d’un très bon œil. Nous en sommes ravis. J’espère que, dans un an ou deux, il pourra dire aussi que les entreprises voient la BPI d’un très bon œil, car c’est l’objectif.
Je conviens qu’il faut du temps pour former les collaborateurs de l’AFD, et c’est bien pour cela que nous disions il y a deux ans qu’il ne fallait pas organiser le travail de cette manière. Le jour où ils seront formés, nous en serons ravis. Sachez que les portes des chambres de commerce, de leurs clubs d’entreprises, de tous les groupes d’entrepreneurs leur sont ouvertes, quand ils accepteront de venir porter le message.
Enfin, si vous pouviez éviter de parler des problèmes de SIREN informatique ! Les entreprises ne supportent plus ces questions techniques. Une entreprise, en outre-mer, attend déjà deux mois son certificat de naissance, et la situation ne s’améliore pas, contrairement aux annonces de la ministre de la Justice. Sur ces problèmes techniques, il faut trouver des solutions. Nous en proposons une pour le registre du commerce et des sociétés, et nous espérons être entendus. Il serait dommage que ces aspects techniques brouillent le message et provoquent de l’agacement.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Merci aux uns et aux autres.
Audition du mardi 7 juillet 2015
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement BPI-Groupe).
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur le directeur général, nous vous accueillons de nouveau, après vous avoir auditionné au début de nos travaux afin de faire le point avec vous au terme de nos auditions, notamment sur les points suivants :
– les déclarations récentes montrent que Bpifrance s’est donné en autres objectifs de soutenir la croissance durable, la politique industrielle, l’emploi, la compétitivité et de développer l’exportation. Ces objectifs ne sont-ils pas trop nombreux et trop ambitieux ? S’il fallait les réduire, lesquels retiendriez-vous en priorité ?
– Bpifrance doit à la fois faire des bénéfices, en bon gestionnaire des deniers publics, et prendre plus de risques que les banques privées, afin de combler les failles du marché. Ces deux objectifs ne sont-ils pas contradictoires ? Où faut-il placer le curseur ?
– le niveau de sinistralité retenu par Bpifrance n’est pas très élevé, comparé à celui d’autres organismes financiers. N’est-ce pas le signe que cet établissement ne répond pas suffisamment à la demande de certaines entreprises ?
M. Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement BPI-Groupe. Dans le cadre de la préparation du plan stratégique, nous sommes en train de reformuler nos objectifs. Un séminaire stratégique, qui se tiendra le 24 juillet, réunira les membres du conseil d’administration de Bpifrance. Ces décisions ne seront cependant pas définitives. Après l’été, le conseil d’administration reviendra sur les aspects quantitatifs de ce plan à moyen terme.
En 2015, nous allons réaliser notre budget, qui prévoyait une croissance moins élevée qu’en 2014. Le montant des crédits à moyen et long terme avec prise de garantie ou d’hypothèque atteindra 3,9 milliards d’euros, pour 3,7 milliards 2014.
Le premier semestre a été en ligne avec notre budget, car, si nous avons éprouvé quelques inquiétudes en mars et en avril, le mois de juin a été extrêmement dynamique. Il confirme notre intuition. L’investissement est en train de repartir en France. Selon les prévisions de l’INSEE, l’investissement va croître de 0,6 % au troisième trimestre et de 0,8 % à 0,9 % au quatrième. Après six à sept ans durant lesquels il a connu une décroissance ou une stabilité, cette évolution constitue une excellente nouvelle.
Les prêts sans prise de garantie – les prêts de développement à sept ans avec deux ans de différé d’amortissement en capital – représenteront cette année 1,8 à 1,9 milliard d’euros. J’ai demandé à ce qu’on approche le chiffre de 2 milliards.
Pour le court terme, nous avons toujours une activité forte dans le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Par rapport à l’an dernier, cette activité baisse en termes de flux, mais augmente en termes de stock, le préfinancement jouant de plus en plus sur plusieurs années. En 2015, le stock dépasse 3 milliards d’euros, les ouvertures nouvelles représentant environ 800 millions.
Le reste de notre activité de court terme – factoring, mobilisation de créances, etc. – connaît toujours une forte augmentation, de 7 % au premier semestre. Les résultats sont cependant un peu plus faibles pour la mobilisation de créances nées à l’étranger. Le produit que nous venons de lancer démarre plus lentement que prévu.
Pour l’innovation, nous distribuons cette année ce que nous avons, soit 1,2 à 1,3 milliard d’euros. Nous serons donc dans le budget.
La situation est plus contrastée en ce qui concerne les fonds propres. La partie capital-risque en direct – numérique, biotech, maladies rares – réalise de belles performances. Nous recevons un grand nombre de dossiers que nous examinons avec soin, car les valorisations commencent à être élevées.
Pour le capital-développement des PME, nous avons doublé la taille moyenne des tickets, les faisant passer en moyenne de 750 000 euros à 1,5 million d’euros. Nous tenions à réduire le nombre d’entreprises financées et à leur proposer plus d’argent pour leur permettre de se développer plus vite. Nous y sommes parvenus. En revanche, dans le segment des PME, nous n’avons pas atteint nos objectifs pour le nombre d’entreprises financées en fonds propres. En effet, les valorisations se sont envolées et nous sommes prudents quant à l’utilisation des deniers publics. Il ne faut pas s’emballer sur les achats car on le paie dramatiquement à la sortie – dans sept, huit ou dix ans. Par ailleurs, le marché est très animé par nos partenaires que nous finançons également en activité de fonds de fonds.
Pour le financement des ETI, l’activité de 2015 sera stabilisée par rapport à 2014, comme nous le voulions, et nous y ajoutons une participation importante prise dans Ingenico.
Via les fonds de fonds, nous investissons nos fonds propres ainsi que ceux de l’État, au titre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de partenaires privés. Nous sommes en baisse par rapport à l’an dernier, en raison des effets de millésimes. En 2015, peu de fonds sont levés, mais nous injecterons cependant sur le marché plus de 500 millions d’euros, ce qui est considérable. Dans les années qui viennent, nous continuerons de croître sur la base de 2015.
La période 2007-2014 a été terrible. Actuellement, en France, le montant de l’investissement est toujours inférieur de 10 % à ce qu’il était en 2007. Je rappelle que 10 % de l’investissement représentent un point de PIB. Une croissance de 0,2 % au premier trimestre et de 0,8 % au quatrième trimestre ne permettra pas de rattraper le retard.
Nous construisons précisément notre plan stratégique sur l’hypothèse que la France rattrapera son retard en investissement. Je signale au passage que le Royaume-Uni et l’Allemagne sont dans la même situation que nous. Nous pensons que toute l’Europe va se remettre à investir, ce qui justifie que nous croyions à la croissance de Bpifrance.
Selon notre plan stratégique, 2016 sera une année de croissance relativement faible, au cours de laquelle nous espérons que toutes les banques vont accélérer et que l’investissement repartira. En 2017 et 2018, nous attendons une trajectoire de 10 % de croissance par an, ce dont la France a absolument besoin.
Certains sous-objectifs seront plus difficiles à atteindre que d’autres. En matière de transition énergétique, l’année 2014, durant laquelle nous avons réalisé deux fois notre objectif, a connu une bulle. Beaucoup de développeurs se sont dépêchés de s’endetter avant que le mécanisme des tarifs de rachat garantis ne prenne fin. Il est normal que les résultats en 2015 soient plus faibles, même si nous consacrons plusieurs centaines de millions d’euros au financement de la transition énergétique. Dans les années qui viennent, si nous ne réalisons pas nos objectifs dans ce domaine, nous le ferons dans d’autres, comme l’Usine du futur. Nous atteindrons donc, quoi qu’il arrive, la croissance promise.
En ce qui concerne la mobilisation de créances nées à l’étranger, nous pensions atteindre 150 millions d’euros la première année. Nous n’en réaliserons que la moitié, mais nous serons à 150 millions l’an prochain. On constate parfois ces petits effets de décalage sur les nouveaux produits, un peu compliqués pour les équipes et les entrepreneurs.
Les résultats seront également plus faibles que prévu sur le crédit acheteur à l’export, qui démarre lentement mais sur lequel nous allons progresser. On peut expliquer cette situation par l’acculturation du réseau, le fait qu’il s’agisse d’un produit compliqué et l’obligation de bâtir le partenariat bancaire.
Cela dit, au total, nous réalisons nos budgets et nous continuerons de le faire.
La collectivité nous a confié 20 milliards d’euros, que nous rendrons, majorés du rendement attendu. Lors de la création de Bpifrance, on escomptait un retour sur fonds propres d’environ 4 %. Le plan stratégique que nous ferons valider cet été est fondé sur un taux non plus de 4 % mais de 3,5 %, d’une part parce que nous prenons plus de risques que prévu, d’autre part, parce que nous céderons moins de valeurs pour faire du résultat.
Il serait possible de réaliser un retour sur fonds propres de 6 % à 7 % en vendant tout et en encaissant les plus-values, mais ensuite nous nous retrouverions avec des ressources entamées. Bpifrance construit son autorité et sa réputation sur le long terme. Nous devons être capables de maintenir à travers le cycle un rendement sur fonds propres de qualité. Je ne veux pas d’une banque dont le rendement atteindrait 7 % à 8 % quand il fait beau et tomberait à 0 % quand le temps se gâte, comme le font les autres banques.
Dans la phase positive du cycle qui commence, je donne à mes équipes la mission de stocker des réserves, surtout en fonds propres car nous en aurons besoin quand la conjoncture se retournera. C’est pourquoi le plan stratégique ne prévoit aucune croissance sur l’activité d’investissement en fonds propres dans les prochaines années. Nous ne sommes pas là pour alimenter la bulle, que ce soit en fonds de fonds ou par nos investissements directs.
Le taux de 3,5 % correspond au retour sur fonds propres moyen de tous les métiers, sachant que les chiffres varient pour chacun d’eux. Pour le crédit, le retour sur fonds propres se situe entre 5 % et 6 %. Pour la garantie, il est nul puisqu’il ne s’agit pas de nos fonds propres. Pour l’innovation, comme l’État débudgétise, le rendement est fortement négatif. Pour le capital-risque, il est de 2 % au bout de dix ans. Pour le capital-développement des PME – le petit capital-développement risqué des territoires –, il atteint 3 % au bout de dix ans. Pour le capital-développement des ETI, l’ancien Fonds stratégique d’investissement (FSI), il est de 5 %. Pour les sociétés cotées, c’est le CAC, pour lequel nous avons établi une hypothèse de croissance de 4 % à 5 % par an. Et pour les fonds de fonds, qui financent du capital-risque et du capital-développement des PME, le rendement est de 3 % au bout de dix ans.
À l’heure actuelle, les taux de rendement d’Ardian, Paribas Affaires Industrielles, Eurazeo ou de sociétés qui font du LBO (leveraged buy out) ou du capital-développement PME très sélectif, se situent entre 15 % et 30 %, ce qui signifie qu’il s’agit de segments risqués. Aucune entreprise privée n’accepterait des rendements aussi faibles que ceux dont peut se contenter une banque publique.
Vous m’avez demandé si le taux de sinistralité sur les crédits était trop faible. C’est le cas – de manière impressionnante – pour l’ensemble de la profession bancaire. Tout le monde se demande où est le risque. Il est forcément quelque part et il va finir par sortir de sa boîte. En 2014, le coût du risque net de reprise de provisions était de 36 millions d’euros. Nous avons fait une quinzaine de reprises de provisions, ce qui représente 50 millions bruts. On doit y ajouter ce qu’on a brûlé dans les fonds de garantie, car, quand nous consentons des prêts de développement, nous les auto-garantissons sur nos fonds à hauteur de 60 % à 70 %. La part non garantie est totalement en blanc. Elle se retrouve dans les 36 millions, alors que la partie garantie est imputée sur les fonds de garantie. Nous brûlons ainsi environ 100 millions d’euros par an.
De ce fait, nous avons besoin d’une dotation de l’État et nous avons aussi mis en place un dispositif de recyclage du dividende pour les trois prochaines années. Au total, nous brûlons 150 millions d’euros par an en coût du risque. Ce montant n’est pas très élevé pour un encours de 22 milliards, mais il n’est pas non plus négligeable. Il faut rapporter cette somme au résultat net de Bpifrance Financement, qui est de 100 millions. Si la proportion paraît raisonnable, on ne doit pas aller au-delà.
Il faut noter que la sinistralité du préfinancement du CICE est en train de monter. Pour Altia, dont Bpifrance était actionnaire, nous avons choisi de préfinancer massivement le CICE, alors que nous savions le groupe était en train de tomber. Dans les comptes de 2015, nous enregistrons de ce fait une perte de 5 millions d’euros. Quand il faut prendre un risque, nous sommes prêts à le faire, mais nous le payons, car rien n’est jamais gratuit dans nos métiers.
Enfin, il faut distinguer le taux de sinistralité bancaire de celui des fonds propres, ceux-ci étant dix à quinze fois plus risqués. Il faut être très prudent en matière de fonds propres, car ils peuvent faire perdre beaucoup plus. Rappelons-nous ce que nous avons perdu sur Sequana ; même si nous en regagnerons la moitié, nous avons provisionné 55 millions. Rappelons-nous aussi ce que nous avons perdu sur Cegedim, entreprise cotée, achetée par le FSI, qui a été frappée de plein fouet : nous avions provisionné 90 millions d’euros, soit le résultat net d’une année de la banque. Nous sommes donc très prudents dans ce secteur.
Nous avons atteint un bon niveau d’équilibre entre les risques qu’on nous demande de prendre, grâce aux fonds de garantie et à nos faibles exigences en matière de retour sur fonds propres, et la discipline du résultat, qui fait que nous rendrons les montants qu’on nous a donnés.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Lors de votre précédente audition, vous avez indiqué que le fonds de garantie public n’avait pas été utilisé en 2014, ce qui ne semble pas exact. Qu’en est-il exactement ?
M. Jean-Louis Beffa s’est montré très critique à l’égard des règles européennes. Quel regard portez-vous sur celles-ci, notamment sur la règle de l’investisseur avisé ? Le système de prêt indirect mis en place par la KfW – le prêt transitant par les banques privées sans cofinancement – est-il adaptable en France ?
Au sein de la KfW, le contrôle bancaire est réalisé par le régulateur allemand, alors qu’à Bpifrance, il est effectué par la Banque centrale européenne (BCE). De ce fait, Bpifrance est encadré plus strictement que l’établissement allemand, alors même que son bilan comptable est moins élevé. Que pensez-vous de cette situation ?
M. Nicolas Dufourcq. Je me souviens avoir dit que le fonds de garantie que nous avions construit pour préfinancer le CICE des TPE n’a pas été utilisé, puisque nous l’avons préfinancé nous-mêmes.
Début 2013, nous avions tenté un schéma – conforme à ce que faisait la BPI – qui était le suivant : pour les petites quotités, le réseau bancaire intervient et nous apportons notre garantie ; pour les plus grandes, nous intervenons en direct. Aucune banque ne s’étant saisie du préfinancement du CICE, nous l’avons organisé nous-mêmes, ce pour quoi nous avons recruté des intérimaires. En 2015, nous préfinançons le CICE de plus de 15 000 TPE. Personne ne le ferait si nous n’étions pas là.
Dès lors que nous intervenons nous-mêmes, nous n’avons pas utilisé le fonds de garantie doté par le ministère des Finances par le biais d’un abondement du fonds de renforcement de la trésorerie pour la croissance, la commission et l’emploi (RTCCE). En revanche, nous utilisons par définition tous les autres fonds de garantie. J’ai toujours dit, notamment au Président de la République, qu’on ne pouvait pas débudgétiser la garantie de Bpifrance. Il faut absolument que, chaque année, des dotations budgétaires alimentent ses fonds.
Fin 2012, quand je suis arrivé, la garantie avait été totalement débudgétisée. Elle représentait zéro dans le plan de l’État en 2013, 2014 et 2015. J’ai obtenu du Président de la République une dotation de 100 millions d’euros. Prise sur le Programme d’investissements d’avenir (PIA), elle nous a permis de tenir, avant que nous ne recyclions le dividende, que nous ne révisions le modèle de calcul des multiplicateurs des fonds de garantie et que nous ne trouvions le moyen de réaliser des économies. Heureusement que nous avons pu convaincre le Trésor de procéder au recyclage du dividende ce qui permet d’alimenter les fonds de garantie.
Il est un point sur lequel je suis moins inquiet qu’il y a neuf mois : la direction générale de la concurrence de la Commission européenne nous a indiqué par courrier qu’elle ne nous demanderait pas de notifier l’objet Bpifrance. Elle se range à nos arguments, selon lesquels l’établissement est un produit de l’histoire financière de notre pays, puisqu’il agrège des entités qui avaient déjà été notifiées : Sofaris, l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), la Banque du développement des petites et moyennes entreprises (BDPME), le Crédit d’équipement des PME (CEPME), le FSI, CDC Entreprises et le FSI Régions.
Cette décision constitue pour nous un grand soulagement. Elle écarte le risque de nous voir imposer les conditions auxquelles ont été soumises la British Business Bank, la banque publique d’investissement portugaise et toutes les banques publiques d’investissement qui émergent au sein de petits Etats, par exemple en Hongrie et en Roumanie. Celles-ci ont dû procéder à des séparations d’activités qui auraient rendu impossible de construire une banque « client-centrique ».
Nous nous réjouissons que ce risque soit écarté, même si la régulation des aides d’État reste contraignante. Elle nous encadre à tout moment. Réaliser certains investissements en fonds propres nous mettrait sous le coup d’une sanction de Bruxelles. C’est la raison pour laquelle nous avons renoncé à Kem One, sur la plate-forme de Fos-sur-Mer. C’est le Fonds de développement économique et social (FDES) qui l’a fait, ce qui oblige à présent l’État à notifier cette entreprise. Pour la même raison, nous n’avons pas pu intervenir pour Fagor ou Mory, parce que cette démarche aurait manifestement constitué une aide d’État. La régulation stricte est une discipline qui nous évite, sous l’effet d’un stress collectif important, de brûler du capital public. Nous ne cherchons pas à tout prix à respecter la règlementation d’aide d’Etat ; il peut nous arriver de jouer avec les zones grises mais on la respecte. Désormais nos relations avec la Commission européenne sont bonnes.
Il y a trois semaines, j’ai rencontré à Bruxelles le député du Parlement européen qui dirige la commission PME. Nous lui avons fait passer mille propositions. Nos propositions sur le plan Juncker ont été très écoutées. Ce n’est pas pour rien que Bpifrance est la première banque européenne à avoir annoncé une opération dans le cadre du plan Juncker.
Nous sommes également très écoutés par le conseil d’administration du Fonds européen d’investissement. Nous rencontrons régulièrement toutes les grandes directions de la Commission et nous sommes reçus au plus haut niveau. Quand nous avons rencontré M. Jyrki Katainen, il nous a demandé de faire un tour d’Europe. Il souhaite que nous rendions nos partenaires jaloux, afin de les encourager à nous imiter.
Je comprends l’analyse de Jean-Louis Beffa, mais, pour travailler au quotidien avec la Commission, je me réjouis du tour qu’ont pris nos relations, puisqu’elle nous finance bien et qu’elle écoute nos propositions.
Chaque fois que nous rencontrons les représentants de la KfW, ils nous disent que nous avons de la chance d’avoir accès directement aux clients. Ils tentent de développer un canal direct par le biais d’internet. Il est trop tard pour eux, en effet, pour développer un réseau physique. Le système actuel – qui fait bénéficier les Landesbanken de la garantie de la KfW – existe en Allemagne depuis cinquante ans, mais, pour ma part, je ne comprends pas comment on peut fonctionner quand on n’a pas accès aux clients. Nous devons à nos clients entrepreneurs français 95 % de notre intelligence de banquiers.
Je me réjouis que, depuis les années cinquante, mes prédécesseurs aient imposé le principe d’un réseau physique. La Caisse nationale des marchés de l’État (CNME) et le Crédit hôtelier ont eu leur réseau. Les créateurs de l’ANVAR ont eu l’intelligence de créer un réseau régional, dont la fusion est à l’origine de celui d’OSÉO puis de Bpifrance et qui est notre cœur de valeur. Chaque fois qu’on remporte un succès c’est parce que des chargés d’affaires innovation, bancaires, garantie ou investissement sont sur le terrain.
En matière de régulation, je n’envie pas tellement la KfW. Figurer parmi les treize banques systémiques françaises régulées par la Banque centrale européenne, confère à Bpifrance sur le marché d’une forte autorité, qui renforce sa dimension de banque de place vis-à-vis de nos partenaires. Nous procédons actuellement à une augmentation de capital, qui a intéressé nombre de banques françaises. BNP-Paribas, la Société générale, Crédit mutuel Arkéa et la Banque postale réinvestissent dans Bpifrance, signe que celle-ci est et reste vraiment une banque de place.
J’envie cependant la KfW sur un point : elle ne paie pas d’impôt, ce qui lui permet de stocker des fonds propres. Elle se ménage ainsi pour l’avenir une grande latitude dans le financement de sa mission d’intérêt général. La KfW jouit d’un statut très particulier. Les deux chefs de bureau du ministère des finances allemand, qui assurent sa tutelle, n’ont aucun pouvoir. Quand le Bund lui demande de faire des investissements en fonds propres – pour lesquels elle a une certaine aversion – la KfW lui demande de les garantir à 100%. Le Bund garantit à 100 % sa participation dans EADS. Le même taux de garantie s’applique à l’activité de fonds de fonds, que la KfW est en train de lancer, sur le modèle de la nôtre.
À l’égard de la BCE, nous nous sommes bien équipés, même s’il faut que nous continuions à recruter, ce qui nous prend beaucoup de temps. Un léger risque demeure cependant : la BCE pourrait ne pas admettre que la machinerie française des fonds de garantie est unique et constitue un métier assurantiel. Nous gérons des fonds qui permettent de prendre des risques statistiques. Parce que ce système n’existe dans aucune autre banque, la BCE nous pose mille questions à son sujet, ce qui suscite de notre part une certaine inquiétude.
M. Arnaud Leroy. Comment évoluera en 2017 et 2018 le financement participatif, qui devient, pour les TPE et les PME, un mode de financement de plus en plus recherché ? Comme vous situez-vous par rapport à ce dispositif innovant qui perturbe le système bancaire classique ? Comment faire pour muscler ce secteur qui comble des failles du marché et répond à la demande des territoires ?
M. Nicolas Dufourcq. C’est un point important pour nous. Partis du monde du crowdfunding, inspiré par une vision un peu scout de l’économie participative, nous en arrivons à la « fintech », terme formé sur le modèle de « biotech » ou « d’écotech ». Les plateformes digitales de crowdfunding sont confrontées à une telle demande de petits crédits qu’elles n’ont pas assez de prêteurs. C’est pourquoi, en fait, elles se tournent de plus en plus vers des institutions financières, qui leur confient des capitaux en gestion, leur laissant le soin de les distribuer. Le modèle rend ce mode de financement assez populaire, mais, dans la coulisse, celui-ci devient de plus en plus de la banque classique : il s’agit de lever des liquidités, et via une plateforme de les distribuer.
Nous allons observer attentivement ce secteur en le finançant. Notre activité de fonds de fonds nous permet d’injecter des capitaux dans ces gestionnaires de plateformes pour notre propre compte, pour le PIA ou pour des investisseurs tiers. Nous pouvons également prendre directement du capital dans ces plateformes. Nous venons de le faire dans Unilend. Nous allons aussi monter notre propre plateforme de distribution de petits prêts en ligne pour les TPE. Cette décision est un axe majeur du plan stratégique. Elle devrait être validée par la gouvernance dans les prochaines semaines. Cela créé un continuum dans la réponse aux besoins.
Enfin, nous proposerons à nos actionnaires de nous autoriser à créer un fonds d’investissement dans les « fintech », qui nous permettra de prendre des participations dans tous ces modèles. Il existe en effet une mosaïque de modèles différents, puisque ce secteur se cherche. Nous devons comprendre comment va se déplacer la valeur, pour la banque, et la demande, de la part des clients. Malheureusement, la grande place européenne d’invention de ces modèles est Londres. Nous consacrerons l’intelligence et les capitaux nécessaires pour que Paris devienne compétitif.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Vous avez indiqué que le ticket pour les PME était passé de 750 000 euros à 1,5 million, ce qui semble signifier que vous vous consacrez davantage à un certain niveau d’investissement. Votre dernière remarque nuance ce propos.
La politique de Bpifrance est-elle de suivre tous les préfinancements du CICE ou agit-elle avec plus de discernement ?
Comment réagissez-vous au projet de faire assurer les garanties publiques à l’export, actuellement gérées par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), par Bpifrance ?
M. le rapporteur. La création d’une plateforme dédiée aux TPE et aux micro-entreprises est une bonne nouvelle. On regrette parfois que les artisans, agriculteurs et entrepreneurs individuels n’aient pas directement accès à la BPI. Les lettres de garantie proposées par la SIAGI, dont vous êtes actionnaire, vous permettront-elles de vous pencher sur leur cas, par l’intermédiaire des banques commerciales ?
M. Nicolas Dufourcq. Nous voulons créer rapidement à destination des TPE une plateforme en ligne de petits prêts de développement à sept ans avec deux ans de différé, de l’ordre de 50 000 euros, prêts qui seront assis sur un fonds de garantie. Nous couvrirons ainsi l’essentiel des besoins.
Nous renforcerons le partenariat avec la SIAGI. En revanche, nous hésitons beaucoup à généraliser le système des lettres de prégarantie que des entrepreneurs pourraient montrer à leur banquier et somme toute leur demander de s’exécuter. Ce n’est pas ainsi qu’on travaille le mieux et notamment avec nos partenaires bancaires quand on procède de cette manière. Si nous mettons en place le prêt que je viens d’évoquer, nous traiterons l’essentiel des difficultés.
En ce qui concerne les fonds propres, quand les TPE ouvrent leur capital – ce qu’elles font rarement– ce n’est pas pour 500 000 euros mais pour 100 000. Ce métier n’est pas le nôtre. Il est entièrement délégué à des petits fonds régionaux, qui accusent des pertes car plus le ticket est petit, et plus grand est le risque de perdre de l’argent. Ces petits fonds perdent en moyenne 40 % de la mise. Dès lors, le sujet relève de la politique industrielle, voire du sociétal. Historiquement, un fonds est alimenté à hauteur de 15 millions par an par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour les garantir. Pour faire plus, il suffit de mettre plus d’argent dans ce fonds de garantie. Mais j’ai observé que les conseillers régionaux n’étaient pas très allants quand on évoque ces fonds, connus pour perdre énormément d’argent.
En tout état de cause, pour les TPE et les petites PME, la solution n’est pas à chercher du côté des fonds propres. Pour devenir rentables, elles doivent d’abord être accompagnées. Ensuite, il faut qu’elles contractent une dette qui leur convienne.
Le Président de la République avait mentionné la COFACE dans son programme, mais n’en a plus parlé ensuite. En juillet 2014, le secrétariat général de l’Élysée a formellement demandé à la direction du Trésor de réinstruire ce sujet, ce qui constituait pour nous une bonne nouvelle.
Selon notre logique client-centrique, il est bon que notre boîte à outils des produits de financement de l’export contienne des éléments de garantie publique en assurance-crédit. Cela permettra à Bpifrance de devenir rapidement une banque française du commerce extérieur. Cela dit, dans mon entourage managérial, tous ceux qui ont connu OSÉO ou la BDPME demandaient depuis vingt-cinq ans que les garanties publiques de la COFACE leur soient rattachées, car c’est la voix du client qui doit parler.
Cela va se faire, je n’en doute pas. Quelque 250 personnes nous rejoindront bientôt. Il faut simplement négocier avec la COFACE, société privée cotée, un prix de transfert compréhensible par ses actionnaires et assis sur des éléments de fait. Il faut notamment valoriser le système d’information et l’accès à la base de données de risque. En l’espèce, c’est l’État qui est à la manœuvre ; ce n’est pas Bpifrance qui négocie avec la COFACE et Natixis.
Normalement, l’Etat et Coface/Natixis devraient conclure un accord sur le prix du transfert qui sera sans doute annoncé par Coface le 29 juillet. La logistique du transfert sera alors mise en place, ce qui doit se faire de manière paisible, avec la collaboration et le soutien de la COFACE, au cours des deux prochaines années. La décision, fondamentale pour l’export français, est systémique.
Nous choisirons des locaux qui nous permettront d’installer nos 250 nouveaux collaborateurs à côté des équipes de Bpifrance. Dès qu’ils nous auront rejoints, nous les entraînerons dans la dynamique de Bpifrance, c’est-à-dire dans le développement, le déploiement et dans tout ce qui fait que notre couleur est le jaune.
Vous m’avez demandé si nous préfinancions tous les CICE. Ma réponse est oui, sauf quand les entreprises sont sous le coup d’une procédure judiciaire. Il serait absurde de préfinancer le CICE d’un établissement proche de la liquidation. Tous les préfinancements sont adossés à un fonds de garantie à 70 % doté par l’État, ce qui nous a permis de ne plus imposer les conditions que nous exigions depuis cinq à six mois, parce que les contentieux liés au CICE commençaient à monter de manière vertigineuse. J’ai fait le point ce matin en revue d’affaires. Nous sommes revenus au calme.
M. Arnaud Leroy. L’intégration prochaine de la COFACE à la BPI me semble une bonne nouvelle. Parvenez-vous à extrapoler une tendance à l’export quand vous entrez dans les fonds propres d’une entreprise ? Réussissez-vous à lui faire comprendre la nécessité stratégique de soutenir ou de développer cette activité ?
M. Nicolas Dufourcq. Nous ne sommes pas encore en mesure de fournir des indicateurs de résultats ni de « payback ». En revanche, sous l’impulsion de Nicole Bricq, nous avons créé dans notre activité fonds de fonds un label Export, grâce auquel nous pouvons doter davantage les fonds qui accompagnent à l’international. Nous réalisons un audit pour savoir comment les fonds produisent de l’accompagnement intelligent.
Le fonds MBO Partenaires a un bureau à Singapour, Sao Paolo et New York, qu’il finance sur la commission de gestion que nous lui accordons. Il accompagne de bout en bout les entreprises et n’investit que dans celles qui possèdent un potentiel international significatif. Nous donnons davantage à ce fonds qu’aux autres.
Quant aux fonds dédiés aux ETI et aux PME de taille déjà significative qui n’accompagnent pas à l’international, non seulement nous ne leur accordons pas de label, mais nous leur faisons comprendre qu’il ne faudra pas compter sur nous à la prochaine levée.
Pour notre part, l’ensemble des fonds de l’activité de capital développement direct, possèdent 450 participations, dont 130 sont en difficulté. Autant dire que nous gérons du risque PME au quotidien. Le problème tient au fait qu’elles n’exportent pas et qu’elles n’innovent pas. Nous les accompagnons. Nous faisons entrer les plus dynamiques dans notre accélérateur de PME. Celui-ci comporte soixante-cinq entreprises, que nous avons rassemblées hier soir. Et nous allons créer un accélérateur d’ETI pour environ vingt-cinq entreprises par an.
Malheureusement, 50 % des ETI françaises ne sont pas internationalisées. Le rapport de nos PME et de nos ETI à la mondialisation est notre problème central. Il explique le travail que nous menons avec Business France et les crédits que nous développons : prêt à l’export, crédits acheteur à l’export, crédits fournisseur, etc.
M. Jean-Louis Gagnaire. Nous savons tous que vous êtes régulièrement sollicité pour aider des entreprises en difficulté. Sur une échelle d’un à dix, comment évaluez-vous la pression du politique sur le choix des dossiers ? Avez-vous les moyens d’y résister ?
BPI est une banque qui, comme un couteau suisse, possède un grand nombre d’instruments adaptés aux établissements qui la sollicitent. Comment segmentez-vous votre offre commerciale pour vous adresser de manière pertinente à chaque réseau ?
Quelle est votre manière d’investir dans les entreprises ? Vous comportez-vous en actionnaire ou en un investisseur patient qui n’interfère pas dans le quotidien de l’entreprise ?
Enfin, quels sont vos besoins réels en matière d’innovation ?
M. Nicolas Dufourcq. En trente mois, la BPI a prouvé qu’elle était capable de s’acquitter de son mandat, qui lui prescrit de mener de front le soutien de l’entreprenariat français et de la politique industrielle, le développement de l’innovation, la préparation de l’avenir du pays, l’absorption d’une partie du stress français et la discipline du résultat.
Nous sommes sans a priori. Quand un cabinet ministériel nous demande de regarder un dossier, nous le faisons toujours, considérant qu’il serait arrogant de refuser. Je précise que, sur des dossiers qui sont arrivés par nos propres canaux ou ceux de nos partenaires de marché – car nous co-investissons toujours en fonds propres –, nous avons pu connaître des sinistres importants. Il serait simpliste d’opposer ce qui vient du politique, et conduirait inévitablement à des pertes, et ce qui est issu du privé, dont les résultats seraient mirobolants. Nul n’avait demandé au FSI d’investir dans Cegedim. Le dossier Sequana est venu de Fiat, qui en était actionnaire, et de l’assureur allemand Allianz. Tous deux sont venus nous dire qu’ils remettaient de l’argent dans l’entreprise et nous proposaient de faire de même. On voit qu’il n’y a pas lieu d’être manichéen.
En revanche, quand nous pensons qu’il ne faut pas suivre, nous sommes raides comme la justice. Ce « nous » désigne, outre moi-même, nos comités d’investissement composés d’administrateurs indépendants comme Frédéric Saint-Geours, Florence Parly, Martine Gerow, Éric Lombard et Amélie Faure. Dans un comité d’investissement, il n’est jamais arrivé que les représentants de la CDC ou de l’Agence des participations de l’État (APE) nous somment d’intervenir. Aucun des dossiers qui a défrayé la chronique comme Florange, Pétroplus, Kem One, Mory ou Fagor n’a reçu la participation de Bpifrance. Le seul ayant une dimension territoriale très forte concernait le groupe Gascogne. Nous l’avons retenu parce que, raides comme la justice, nous avons appliqué notre doctrine en matière de retournement : dès lors qu’il y a un repreneur qui apporte beaucoup de capital et prend son risque d’entrepreneur, il faut le suivre. Dominique Coutière a investi quinze millions. Nous en avons apporté onze.
Nous sommes intervenus dans d’autres dossiers de restructuration, comme Clestra, pour accompagner le repreneur Jacques Veyrat. Nous avons aidé CPI, le plus grand imprimeur européen, dans les mêmes conditions, le repreneur étant cette fois Impala.
Certains dossiers hérités du FSI ont fait l’objet d’une décision collégiale à haut niveau. C’est le cas d’Altis, fabricant de semi-conducteurs situé à Corbeille-Essonne, sur lequel nous nous sommes engagés pour plusieurs dizaines de millions d’euros en obligations convertibles. Les équipes ont beaucoup hésité, mais l’entreprise, qui met en œuvre une technologie si rare qu’elle a du mal à produire ses commandes, est en train de repartir. Nous sommes dans un monde incertain, ce qui suppose des outils de gouvernance très clairs.
Pour l’innovation, l’État nous donne à la fois beaucoup et peu d’argent. Le PIA se monte à des centaines de millions d’euros. En revanche, pour les petites aides à l’innovation que nous attribuons à 3 500 entreprises par an, il n’y a pas assez de financements et pourtant elles sont tout aussi importantes, peut-être plus. Pour avoir livré bataille à plusieurs reprises, je pense que les pré-arbitrages budgétaires nous accorderont un minimum, mais avoir un minimum est insuffisant. Il faut 200 millions d’euros par an pour financer les prêts à taux zéro et les avances remboursables et nous ne l’avons pas. C’est bien beau de mettre des milliards dans les programmes collaboratifs mais si nous ne pouvons pas accorder 4 000 aides à l’innovation par an – aide sans laquelle aucune boîte française n’aurait pu démarrer –, on tue l’écosystème.
C’est pourquoi nous n’hésitons pas à faire entendre notre voix sur le sujet. Nous ne pouvons pas accepter que le programme 192 soit débudgétisé, d’autant que, compte tenu de ce que dépense l’État et des effets multiplicateurs, les montants en jeu ne sont pas considérables. Le Danemark, la Suède ou la Finlande dépensent cinq fois plus que nous en matière d’aide à l’innovation.
Enfin, vous m’avez interrogé sur la segmentation de l’offre. Les TPE sont financées par nos banques partenaires, sauf pour le préfinancement du CICE et le nouveau petit prêt. Pour l’économie sociale et solidaire, nous intervenons en complémentarité avec la Caisse des Dépôts, financeur historique des réseaux d’accompagnement et de micro-crédit, et des réseaux bancaires privés par le biais de petits prêts de développement (sans garantie), comme le prêt ESS et le prêt quartiers. Pour les PME, le couteau suisse n’a que trois lames : le prêt de développement sans garantie à sept ans avec deux ans de différé, le crédit-bail et le prêt à long et moyen terme. Pour les ETI, l’offre est la même, à ceci près qu’on ne peut pas faire de garantie. La garantie de l’ex-Sofaris concerne les PME. Enfin, il y a les fonds propres. Nos clients jugent l’offre assez simple.
M. le rapporteur. Existe-t-il des simulateurs permettant de calculer le montant de la commission de garantie, qui peut être important ?
Bpifrance communique beaucoup sur son action et son ambition pour les entreprises, ce qui a pu agacer certaines banques commerciales. La mutualisation vous permettra-t-elle certaines économies dans ce domaine ?
M. Nicolas Dufourcq. Les commissions varient en fonction des crédits garantis. Notre grille se résume à un tableau de sept lignes, que je vous transmets. Il distingue, au regard des sept catégories de prêt, la quotité maximale et la commission.
En 2014, nous avons pris une décision importante en faisant passer le seuil de délégation totale de la garantie aux banques de 100 000 à 200 000 euros, ce qui a fait grimper considérablement le taux de couverture de la garantie par extranet. Les banques n’ont plus qu’à appuyer sur un bouton.
Au-dessus de ces montants, nos équipes instruisent au cas par cas. Elles communiquent en même temps à l’entreprise et à la banque la quotité maximale comme le taux de commission de garantie. On trouve dans l’accès sécurisé extranet un simulateur permettant de calculer le montant précis de la commission afin de déterminer le taux effectif global du crédit, nécessaire pour l’édition des contrats de prêts. Il n’existe pas de simulateur sur le site internet pour les entreprises souhaitant obtenir une garantie supérieure à 200 000 euros et en savoir le coût, mais l’accès public à tel outil ne se justifie pas dans la mesure où l’entreprise connaît les conditions de l’octroi de la garantie au moment de l’offre commerciale.
Notre budget de communication annuel se monte à 10 millions d’euros, ce qui correspond à la somme des budgets de communication des entités qui nous préexistaient. Cependant, nos résultats dans ce domaine sont bien meilleurs. Beaucoup de personnes ont envie que Bpifrance réussisse. Le directeur de la communication, Patrice Bégay, et moi-même avions beaucoup communiqué lors de l’aventure Wanadoo. Nous connaissons les acteurs. Lors du lancement de Bpifrance, ils nous ont proposé des conditions qui nous permettent d’être extrêmement visibles et de déployer notre marque de manière puissante. C’est le cas tant pour les partenariats médias que pour les partenariats sportifs. Ainsi, nous détournant des partenaires les plus coûteux, nous avons renoncé au foot pour nous intéresser au volley-ball, au handball et au basket-ball. Nous nouons avec des clubs territoriaux très appréciés des partenariats non de quelques dizaines de milliers mais de quelques milliers d’euros, qui nous donnent une visibilité appréciable.
Les entrepreneurs, dont la psychologie a été modelée par sept ans de crise, ont besoin d’avoir un partenaire installé. Leur banque doit les accompagner et leur rendre le goût d’investir. Notre budget nous permet non seulement de faire de la publicité mais d’organiser de nombreux événements. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, j’ai fait trois tours de France. Il faut rassembler les entrepreneurs, les haranguer et les sortir de la prison du non-désir. Nous faisons de la psychoéconomie, car la relance de l’investissement part de la psychologie. Le secteur bancaire français a fait l’erreur de l’oublier. Avant de parler aux entrepreneurs de dette ou de fonds propres, il faut leur parler de futur, de projets, de construction et d’aventure. Les 38 meetings auxquels j’ai participé entre juillet et décembre 2014 ont rassemblé 11 000 entrepreneurs. C’est à cet investissement que nous devons notre croissance du premier semestre.
Ce travail de proximité, qui consiste à prendre l’entrepreneur par la manche, profite à toutes les banques – BNP Paribas, BPCE, Arkéa –, puisque nous cofinançons. Au début, nous avons été les seuls à le faire, mais nos partenaires sont en train de s’y mettre. Ils créent des incubateurs, des événements avec des startups, même s’ils ne se dirigent pas encore vers les PME. Il y a des banques dont le directeur régional dit n’avoir pas de budget pour organiser un petit-déjeuner avec des entrepreneurs. Or c’est la base même de leur travail.
Avec BIG (Bpifrance Inno Génération), il s’est passé quelque chose de merveilleux : 15 000 personnes se sont inscrites et 10 000 sont venues. Les entrepreneurs veulent que les banquiers se comportent comme des entraîneurs. Les Landesbanken allemandes gèrent des académies d’entrepreneurs. Du fait de la crise et des accords de Bâle III, les banquiers français ont cessé de jouer ce rôle. Je souhaite que tout le monde s’y remette et que cela s’entende.
Mme la présidente Véronique Louwagie. En matière du coût du crédit, quelle est votre politique ? Comment la BPI se situe-t-elle par rapport aux autres organismes financiers ?
Où en est votre projet de créer une fondation pour l’innovation ?
M. Nicolas Dufourcq. Au premier semestre 2015, les prêts sans garantie accordés en comité d’investissement sont en légère baisse par rapport à 2014. Souvent, pour ces prêts nous sommes un peu trop chers, car la réglementation européenne sur les primes-plancher pour les PME européenne, place Bpifrance hors marché. Ce n’était pas le cas l’an dernier. Entre janvier et avril, nous avons subi la forte concurrence du marché bancaire – ce qui est un excellent signe. Cela signifie que les taux sont très bas, ce qui justifie le discours que nous tenons aux entrepreneurs, en leur disant que c’est maintenant qu’il faut s’endetter.
Concernant le projet de fondation pour l’innovation, nous essayons d’imaginer la suite. Il est malheureusement à craindre que le programme 192 du Budget Général (comme beaucoup d’autres) qui porte notamment les crédits budgétaires de l’innovation sera progressivement mais méthodiquement érodé dans l’ajustement structurel du budget de l’État. Comment faire pour sanctuariser les moyens que l’Etat consacre à quelques 3500 projets de premiers stades de l’innovation chaque année, comme nous avons sanctuarisé la garantie avec le recyclage du dividende ?
Une solution aurait été que l’État nous accorde une franchise d’impôt pendant trois ans, comme la KfW. On nous l’a refusé. Nous avons imaginé un autre schéma. Dès lors qu’il existe 90 milliards d’euros de fonds propres gérés par l’APE et 20 milliards d’euros de fonds propres gérés par Bpifrance, dont 25 %, soit 5 milliards, uniquement sur Orange, on pourrait placer 7 de ces 110 milliards dans une fondation – la fondation pour l’innovation – qui gérerait cet actif, recevrait les dividendes et injecterait chaque année 200 millions dans le financement des aides à l’innovation.
On sait déjà qu’en 2025, l’État ne vendra pas 110 milliards d’euros de capital. Il en aura probablement 130, puisque le montant aura fructifié. En isoler une partie dans une fondation qui générerait un rendement fléché vers un produit phare, historique, puisqu’il remonte à la fin des années soixante – le financement de l’innovation française –, serait une solution d’une visibilité très pure. La fondation pour l’innovation garantirait aux Français que, pendant les trente prochaines années, il y aurait toujours des aides à l’innovation. Les entrepreneurs demandent avant tout de la prédictibilité et de la visibilité. S’ils ont compris le discours de l’État sur la sanctuarisation du crédit impôt recherche, ils ne croient pas à celle des aides à l’innovation, puisque chaque année, auparavant en novembre, désormais en octobre, les guichets sont fermés.
J’ai parlé de la création de cette fondation pour l’innovation au Premier ministre, au secrétaire général de la présidence de la République, ainsi qu’à Emmanuel Macron et à Michel Sapin.
La semaine dernière, le comité exécutif de Bpifrance a organisé un séminaire stratégique. En conclusion de nos travaux, j’ai rappelé que Bpifrance est la banque de la reprise de l’investissement en France et du rattrapage du retard de l’investissement français. Puisqu’il existe un point de PIB à rattraper, nous devons nous considérer avant tout comme un catalyseur et une banque de croissance. La taille du bilan va continuer d’augmenter et la banque va se déployer. Nous n’allons surtout pas nous arrêter lorsque la reprise économique sera là, car si l’économie reprend peut-être grâce à la consommation, l’investissement fait toujours défaut.
Bpifrance est une banque du service public. Elle en a les valeurs et elle assume des missions d’intérêt général. Elle est fière de son appartenance au secteur public, mais cette situation est lourde de conséquences. Bpifrance n’accepte pas d’être débudgétisée et être lentement poussée vers la banalisation. C’est le pire qui puisse lui arriver. Il faut qu’elle puisse financer l’innovation et la garantie, continuer de gérer des fonds propres et disposer de toute la gamme des instruments qui font d’elle une banque publique.
C’est aussi une banque publique au sens où elle a des préoccupations de responsabilité sociales et environnementales claires. Peut-être serons-nous notés un jour par des agences qui évalueront la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) mais l’essentiel, c’est d’y croire. Bpifrance est sincèrement engagée dans la RSE. Bpifrance va se mobiliser très fortement sur la transition énergétique et environnementale. Au quotidien, elle exerce sa responsabilité sociale dans le choix des crédits qu’elle accorde et des investissements en fonds propres auxquels elle procède.
Notre banque a une relation unique avec ses clients qui vient d’un long historique de solidarité. Elle les a accompagnés dans les phases les plus difficiles. Parce qu’elle avait les moyens publics de le faire et que telle était sa mission, elle est restée au côté des entrepreneurs ; ce qui a créé une relation intime, émotionnelle, qu’il faut absolument entretenir. Les maîtres mots sont qualité et simplicité des produits, simplicité du comportement, intelligence, écoute, présence sur le terrain, accompagnement. Bpifrance se considérera de plus en plus comme un réseau social d’entrepreneurs, qui possède une banque au-dessus de lui.
Ensuite, il faudra réinventer une version moderne de la Banque française du commerce extérieur. Notre déficit commercial est insoutenable. Nos entrepreneurs ont toujours un rapport conservateur au monde, voire démodé : 50 % des ETI et 70 % des PME ne sont pas dans la mondialisation, ce qui est gravissime. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas changé cette situation, en faisant du porte-à-porte, en rencontrant les entrepreneurs les uns après les autres. L’Allemagne est bien plus mondialisée que nous.
Bpifrance est le canal du financement de l’innovation française. Il y a un petit frottement de territoire avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), que nous ne pouvons pas cacher. Si l’on veut être client-centrique, il faut traiter le sujet, car il est étrange qu’il existe deux guichets régionaux dans le secteur de la transition énergétique, de l’automobile et du transport.
Enfin, nous sommes une banque partenariale, qui ne souhaite pas devenir une grosse organisation. Avec nos 2 500 salariés, nous sommes une ETI de la banque. La beauté de Bpifrance réside dans sa flexibilité. Les décisions prises le matin sont exécutées le soir même, et l’entrepreneur en est informé le lendemain matin. Pour ne pas devenir une grosse organisation, nous refusons l’intégration verticale. Tout ce que nous faisons, nous le co-faisons : nous co-finançons, nous co-investissons, nous co-accompagnons. Nous travaillons avec des consultants privés, mais nous n’en recruterons. Devenir une entreprise tentaculaire n’entre pas dans le projet qui nous a été confié. Notre petite taille nous permet d’être dynamiques et de catalyser les énergies. Elle fait de nous l’Astérix de la place.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Je vous remercie.
Audition du mardi 15 septembre 2015
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur le ministre de l’économie, je vous remercie au nom de l’ensemble de mes collègues, de votre présence aujourd’hui.
Notre mission d’information, qui a été constituée à la demande du président de l’Assemblée nationale, a pour objet de dresser un premier bilan de l’action de Bpifrance, dont je rappelle qu’elle a été créée par la loi du 31 décembre 2012. Nous souhaiterions donc connaître votre position sur des sujets qui ont occupé une place importante dans notre réflexion, notamment celui du positionnement stratégique de Bpifrance et de son mode de gouvernance. À ce propos, l’État vous paraît-il en mesure de jouer le rôle qui doit être le sien dans le pilotage paritaire qui a été mis en place avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ? Est-il convenablement informé des activités de Bpifrance et des effets de son action sur le terrain ?
Il convient de rappeler également que les missions, nombreuses, que le législateur a confiées à la Banque publique d’investissement – dont l’efficacité est, du reste, saluée – avaient notamment vocation à inscrire son action dans le cadre de la politique industrielle de l’État. Celui-ci peut-il réellement s’assurer que Bpifrance contribue efficacement aux priorités assignées à cette politique ? Ces priorités sont-elles devenues secondaires par rapport à l’objectif de soutien à l’écosystème de financement qui a été fixé par la doctrine d’intervention de Bpifrance, dont je rappelle qu’elle repose sur les règles du cofinancement et de l’investissement en minoritaire ? Les missions de Bpifrance vous paraissent-elles devoir être recentrées et, si oui, de quelle manière ?
M. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. La création de Bpifrance, dont je rappelle qu’elle avait fait l’objet d’un engagement du Président de la République, devait permettre de rassembler et de rationaliser l’ensemble des instruments de financement des entreprises et de soutien à l’innovation de l’État. Ces instruments relevaient en effet jusqu’alors de différents opérateurs dont le bilan, qu’il s’agisse d’Oséo ou de la Banque des PME, était du reste plutôt positif. L’un des principaux intérêts que présentait la création de Bpifrance était donc, j’insiste sur ce point, d’une part, d’augmenter la puissance de feu de l’opérateur et, d’autre part, de simplifier les dispositifs présents sur le territoire. Et, de fait, elle a contribué, de même que la création de Business France, à réellement simplifier l’écosystème de soutien public à nos PME et à nos ETI (entreprises de taille intermédiaires).
La gouvernance de Bpifrance, qui consiste en effet, dans un pilotage paritaire de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, a été définie dès la fin de l’année 2012 et, dans l’ensemble, elle a démontré son adéquation à la structure et aux objectifs du groupe. Je ne porte donc pas un regard sévère sur cette gouvernance, qui ne saurait, en tout état de cause, se substituer à la réalité opérationnelle de l’opérateur. Compte tenu de la complexité de la structure, il me semble que, si elle peut sans doute être améliorée, la gouvernance actuelle a montré son efficacité.
L’État est représenté dans l’ensemble des organes de gouvernance de la structure et de ses filiales, par des administrateurs et par le commissaire du Gouvernement. Nous avons en outre, avec la CDC et les équipes opérationnelles de Bpifrance, des échanges aussi nourris que nécessaires, notamment sur l’ensemble des mécanismes que nous mettons à disposition de la banque publique d’investissement. À cet égard, celle-ci a su prendre sa place dans notre politique industrielle. Je pense, par exemple, aux prêts de développement qu’elle a accordés dans le cadre de la solution « Industrie du futur » ; l’enveloppe de 8 milliards d’euros qui y est consacrée est un des leviers de notre politique industrielle.
La gouvernance est le reflet d’un équilibre capitalistique qui a été défini à la fin de l’année 2012. Si simplification il peut y avoir, elle se fera donc au regard de cet équilibre actionnarial, dans le cadre du dialogue que nous avons avec la CDC. Mais cette gouvernance ne me semble pas être un obstacle au bon fonctionnement de Bpifrance sur le terrain.
Par ailleurs, tant sur les cas particuliers de certaines entreprises que sur la mise en œuvre de notre politique, nous disposons d’un niveau d’information satisfaisant. Les priorités d’action de Bpifrance sont conformes à nos souhaits. Ainsi, les activités qu’elle a menées au cours de l’année 2014 reflètent les demandes que nous lui avions adressées ; je pense, par exemple, pour la partie BPI Financement, à la ventilation entre les prêts classiques et les prêts de développement. J’ai cependant appelé à plusieurs reprises l’attention de M. Dufourcq sur le financement à court terme des TPE et des PME, domaine dans lequel je considère que Bpifrance peut faire mieux – si je devais mentionner un point de vigilance, ce serait celui-là.
Bpifrance a su développer son activité dans les failles de marché, en particulier dans les premiers tours de table concernant le financement de l’innovation et du développement des entreprises. Sa part de marché, très largement dominante sur ce segment, peut du reste finir par être préoccupante. On constate ainsi qu’une faille de marché réapparaît à propos des tickets légèrement supérieurs à 20 millions d’euros pour les entreprises innovantes, obligeant ces dernières à se tourner vers l’international.
En ce qui concerne l’innovation, il faut bien dire que ce sont les régulations budgétaires auxquelles nous procédons qui peuvent parfois freiner l’action de Bpifrance en la matière, et qu’elle ne saurait en être tenue pour responsable. Mon souhait est donc que nous améliorions notre dispositif de financement de l’innovation, en faisant en sorte que notre politique budgétaire offre une meilleure lisibilité dans ce domaine.
S’agissant du financement à court terme, comme je l’ai indiqué, Bpifrance comble en partie les lacunes des banques commerciales, mais elle ne le fait pas suffisamment, de sorte que ce sujet demeure préoccupant.
Il importe également que Bpifrance s’adapte au contexte macroéconomique. À cet égard, le fonds de garantie que nous avons pu mettre en œuvre cet été dans le secteur de l’élevage, grâce à la réactivité de ses équipes, a été un élément probant. De même, elle a su faire preuve de réactivité lorsqu’il s’est agi d’adapter le process de préfinancement du CICE pour faire face à l’augmentation des contentieux.
J’en viens maintenant à la question du cofinancement. Celui-ci est, compte tenu des contraintes communautaires, un des moyens les plus sûrs d’éviter la requalification en aides d’État de nombre d’interventions de Bpifrance. Il demeure en outre un élément de discipline important dans plusieurs secteurs, et il est aujourd’hui structuré, dans le cadre du financement des sociétés les plus innovantes, avec l’intervention des business angels. Néanmoins, nous veillons, notamment pour les entreprises dont la situation est examinée par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ou par nos services, à ce que ce mécanisme ne conduise pas à bloquer les interventions de Bpifrance lorsque certains acteurs bancaires ou d’autres investisseurs font preuve d’une frilosité accrue ; sinon, ses capacités de combler les failles de marché s’en trouveraient réduites. Ce sujet ne fait pas encore l’objet d’une alerte, mais nous devons être collectivement extrêmement vigilants. Le cofinancement donne de la force à l’outil, mais il ne peut être une politique exclusive si nous ne sommes pas en mesure de motiver certains investisseurs.
J’ajoute que certains champs d’intervention de Bpifrance ne relèvent pas du cofinancement. Je pense en particulier aux prêts de développement, dont les conditions hors marché permettent à l’entreprise de disposer de deux ans avant de commencer à rembourser. Par ailleurs, je crois que nous devons continuer à réfléchir à la possibilité – je sais que certains, ici, y sont attachés, et je partage leur souci – d’intervenir en retournement dans des secteurs identifiés. Un tel mécanisme ne figure pas dans la doctrine d’intervention de Bpifrance et consommerait davantage de fonds propres, mais il compléterait utilement la panoplie de la Banque publique d’investissement car il apparaît comme nécessaire dans certains secteurs ou certains territoires.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur. Est-il préférable que Bpifrance intervienne directement ou qu’elle intervienne par l’intermédiaire de fonds de fonds, comme c’est le cas actuellement ? Ces fonds sont d’ailleurs nombreux, si bien que l’on peut s’interroger sur les capacités de la Banque publique d’investissement de suivre l’ensemble de cette activité.
En ce qui concerne le financement des TPE et des micro-entreprises, qui a fait l’objet de plusieurs remarques de la part de différents acteurs, ne faut-il pas renforcer l’intervention de Bpifrance auprès de sociétés de caution mutuelle telles que la SIAGI ?
Par ailleurs, le coût du risque étant assez faible pour Bpifrance – environ 50 millions d’euros par an (hors fonds de garantie) –, on peut se demander si sa politique de risque est adaptée aux besoins de l’économie.
Le niveau des commissions de garantie, qui est assez élevé, a été souvent évoqué au cours de nos auditions. Prend-il bien en compte la situation des entreprises ?
Enfin, le portage du préfinancement du CICE a fait l’objet de nombreuses remarques négatives. Il semble, en effet, que Bpifrance ait freiné son intervention en raison d’un niveau de risque assez élevé.
M. Pascal Cherki. Il avait été prévu que Bpifrance consacre environ 500 millions d’euros au financement de projets relevant de l’économie sociale et solidaire, dont je rappelle qu’elle représente 10 % de l’activité économique de notre pays. Or, les remontées du terrain sont contrastées à ce sujet. Peut-on obtenir l’engagement que, d’ici à la fin de la législature, cette enveloppe aura été effectivement consommée ? L’intervention de Bpifrance est d’autant plus nécessaire que l’on connaît les difficultés rencontrées par les entreprises du secteur pour avoir accès au crédit bancaire.
M. Marc Goua. Dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA), une convention a été conclue entre l’ADEME et Bpifrance pour financer l’innovation. Or, il semble que quelques tensions sont apparues, la seconde se montrant plus prudente que la première. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
M. Hervé Pellois. Les TPE et les PME se plaignent de ne pas être assez conseillées, alors que Bpifrance devrait jouer ce rôle, notamment en cas de refus de financement. Elles ont en effet besoin d’être confortées dans leur envie d’investir et de développer l’emploi. Il est gênant, comme on a pu l’entendre, qu’un chef d’entreprise n’obtienne pas de Bpifrance qu’elle lui explique les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu de financement.
Mme la présidente Véronique Louwagie. En ce qui concerne le financement des TPE et des PME, il est vrai que, sur le terrain, nous constatons une certaine frilosité des acteurs bancaires, frilosité qu’ont tendance à accroître les nouvelles dispositions, dont on peut par ailleurs se réjouir, prises dans le cadre de la loi qui porte votre nom et qui visent à protéger les entrepreneurs individuels. Bpifrance va-t-elle pouvoir remédier à ce problème ?
M. le ministre. Les fonds de fonds sont en effet un sujet important, monsieur le rapporteur. Ce mode d’intervention est conforme à la doctrine de Bpifrance, qui a fait l’objet d’une communication en Conseil des ministres en janvier 2014. Parmi les leviers régaliens dont l’État dispose pour intervenir dans le financement de l’économie, figurent, d’un côté, l’Agence des participations de l’État (APE) et, de l’autre, Bpifrance, qui intervient à la fois en direct et en tant que co-investisseur dans des fonds privés. Le recours à ces fonds de fonds, qui a constitué l’une des innovations majeures de CDC Entreprises, lui permet, d’une part, de démultiplier son action, grâce à un effet de levier de un pour un, et, d’autre part, de recourir à des équipes professionnelles, puisque les fonds de fonds sont sectoriels. En tout état de cause, ce mode d’intervention poursuit le même objectif final que l’investissement direct, à savoir l’accompagnement des entreprises dans leur croissance lorsqu’elles en ont besoin.
L’activité de fonds de fonds offre ainsi en quelque sorte un « double dividende », puisqu’en structurant un écosystème de capital développement et de capital investissement français, elle permet non seulement le développement d’entreprises mais aussi l’émergence de sociétés de gestion capables de lever plusieurs millions d’euros. Cette activité est donc une modalité intéressante de l’intervention de Bpifrance et doit être poursuivie.
Quant à son activité d’investissement direct dans les PME, sur ses fonds propres ou pour le compte de l’État à travers les investissements d’avenir, elle peut se justifier dans des marchés qui font l’objet d’une défaillance de financements plus marquée. De fait, dans les situations où un redressement rapide est nécessaire, il faut s’affranchir de la contrainte du cofinancement et s’impliquer beaucoup plus directement. Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible d’intervenir à travers des fonds de fonds, il convient de recourir à des mécanismes alternatifs, tels que le Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), qui permettent, dans des entreprises en plus grande difficulté et en l’absence de co-investisseurs, de réaliser un investissement direct. L’intervention au sein de Perceva en est un bon exemple.
M. le rapporteur. Le coût des commissions versées par Bpifrance aux gestionnaires des fonds est d’environ 50 millions d’euros. On peut donc légitimement s’interroger sur ce type d’interventions indirectes.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Le coût de gestion est pourtant de 1,5 % ou 2 %...
M. le ministre. Le coût du risque, porté par Bpifrance, reste maîtrisé sur son activité de cofinancement, c’est-à-dire les prêts qu’elle octroie directement aux PME, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les activités historiques de financement de Bpifrance, c’est-à-dire la mobilisation de créances sur les grands donneurs d’ordres publics et privés – qui correspond au produit Avance Plus – et le crédit-bail sont deux modalités de financement dont les sinistralités sont maîtrisées, compte tenu de l’existence de garanties solides. Ensuite, le cofinancement avec des établissements privés permet de croiser les analyses crédit, de partager les risques et d’exercer un effet de levier sur les financements bancaires privés, de sorte que le coût du risque est, là aussi, très maîtrisé. Enfin, les prêts de développement et le préfinancement du CICE, qui sont des produits en très forte croissance depuis quelques années, sont adossés à des fonds de garantie financés par l’État ; une partie importante du risque est donc portée par ces fonds, et non par le bilan de Bpifrance. Ces produits peuvent ainsi être orientés vers des entreprises plus risquées, qui ont des difficultés à trouver des financements bancaires classiques, tout en limitant le coût du risque porté par Bpifrance. Les fonds de garantie de l’État servent en quelque sorte de rehausseur de crédit pour la Banque publique d’investissement, qui intervient en amont des banques pour combler les failles de marché.
Bpifrance a développé, par ailleurs, une activité de garantie des crédits bancaires accordés aux PME, qui permet de lui transférer une partie du risque de crédit et de faciliter ainsi l’accès de ces entreprises au financement bancaire. En 2014, 9 milliards d’euros de crédits bancaires ont bénéficié de cette garantie. Le risque de crédit est porté en partie par le bilan de Bpifrance, mais surtout par des fonds de garantie internes à Bpifrance qui sont abondés chaque année par des financements publics, que l’on retrouve dans les documents budgétaires. Ce mécanisme gigogne de garantie par Bpifrance et de Bpifrance permet de limiter le coût du risque tout en ayant un effet de démultiplication sur les crédits accordés.
J’en viens au financement des TPE et des PME, pour lequel plusieurs dispositifs sont mobilisés : préfinancement du CICE, financement de garantie, Avance Plus et garantie des factors, qui permet de contribuer au financement de leur trésorerie. Par ailleurs, des sociétés de cautionnement mutuel, telles que la SIAGI, bénéficient, dans le cadre d’une intervention en co-garantie, d’une délégation de Bpifrance pour tous les crédits inférieurs à 400 000 euros, sans plancher, si bien que la SIAGI sert de bras armé à Bpifrance pour les tout petits crédits. Ce dispositif permet d’obtenir des réponses rapides. L’instruction des dossiers est en effet déléguée aux directions régionales puis à la SIAGI et aux autres sociétés de caution mutuelle pour les tout petits tickets.
Bpifrance se trouve ainsi au cœur du financement de l’écosystème des TPE et participe déjà à la médiation du crédit et à certains réseaux de chefs d’entreprise, au-delà de l’offre de services classique. Les garanties offertes par les sociétés de caution mutuelle ne sont pas des produits de Bpifrance ; elles n’ont pas vocation à figurer dans le catalogue de son offre, mais c’est un élément important de son action.
Le préfinancement du CICE a rencontré un véritable succès auprès des entreprises, avec 1,7 milliard d’euros d’engagements pour l’année 2014. Bpifrance a fortement développé ce dispositif, sachant qu’en cas de défaillance d’une entreprise, les pertes seraient faibles compte tenu de la constitution de la créance au fil de l’eau. En 2014, elle a cependant constaté, à propos des préfinancements au titre de l’année 2013, qu’en cas de liquidation de l’entreprise, les formalités nécessaires pour que la créance de CICE donne lieu à remboursement par l’État, à savoir le dépôt des comptes et du formulaire CICE, n’étaient généralement pas remplies par le liquidateur. Dans une telle situation, l’administration fiscale ne procède pas au remboursement de la créance, et Bpifrance constate une perte.
La politique de risque de Bpifrance a donc été renforcée au premier semestre 2015, le temps de trouver une solution. Des travaux ont été conduits entre Bpifrance, la direction générale du Trésor et la direction générale des finances publiques, afin d’accroître les possibilités de recouvrement en liquidation. La direction générale des finances publiques a ainsi accepté de simplifier le dispositif, en supprimant l’obligation de dépôt des comptes, et la profession des liquidateurs a été sensibilisée par nos services à la nécessité d’accomplir les démarches nécessaires pour que le CICE soit versé à Bpifrance. Par ailleurs, le préfinancement du CICE des PME a été adossé au fonds de garantie du financement des créances professionnelles, afin de simplifier le traitement des sinistres et de les couvrir à hauteur de 70 %. Ces mécanismes correctifs permettent de revenir au niveau antérieur de sélection des risques ; Bpifrance a rétabli les conditions de préfinancement du CICE qui prévalaient jusqu’à la fin de l’année 2014.
Je reviens un instant sur la question des fonds de fonds pour préciser que Bpifrance abonde plus de 270 fonds privés nationaux et régionaux, et que le stock des investissements en fonds de fonds s’élevait, à mi-2015, à 1,7 milliard d’euros. Dès lors, le coût de gestion, qui est de 50 millions d’euros, ne paraît pas aberrant.
En ce qui concerne le PIA, Bpifrance n’est qu’un canal de distribution, en lien avec l’ADEME. Le pilotage est assuré par le Commissariat général à l’investissement (CGI) – je vais regarder si des problèmes se posent. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà modifié la convention conclue entre l’ADEME et le CGI, compte tenu des doublons constatés dans le traitement des dossiers au début de la législature.
Par ailleurs, l’engagement en faveur de l’économie sociale et solidaire est en effet de 500 millions d’euros pour la législature. Plusieurs outils sont utilisés : le prêt participatif de social et solidaire, compris entre 10 000 et 50 000 euros sur sept ans, le Fonds d’investissement social (Fiso), en partenariat avec les régions, et des fonds de fonds.
M. Henri Emmanuelli. Qu’en est-il de la consommation ?
M. le ministre. Ces mécanismes ont été mis à disposition dès 2014. La consommation des prêts participatifs a débuté au milieu de l’année dernière ; son niveau est encore modeste. Mais, en ce qui concerne le Fiso et les fonds de fonds, nous commençons, depuis le début de l’année 2015, à être en ligne avec l’objectif de consommation de 500 millions. Il est vrai néanmoins, et je partage votre point de vue, monsieur Cherki, que l’on a tardé à mettre en œuvre cette mesure. Carole Delga puis Martine Pinville s’en sont préoccupées, mais il faut mobiliser l’ensemble de l’écosystème de ce secteur autour de ces instruments afin de les faire vivre. Quoi qu’il en soit, je vous confirme notre engagement dans ce domaine ; Martine Pinville et moi-même, nous nous assurerons que l’ensemble des dispositifs sont mobilisés et que la consommation est conforme aux engagements pris.
Par ailleurs, monsieur Pellois, il est du devoir de Bpifrance, en particulier de ses directions régionales, de conseiller les entreprises. Il ne s’agit pas de leur apporter une réponse binaire ; l’accompagnement des TPE et des PME, au-delà du simple financement, fait partie de l’ADN d’OSEO et de l’ANVAR, et c’est un élément de différenciation de l’offre. Ce sujet est d’autant plus important que la Banque publique d’investissement et les banques commerciales se sont engagées, à notre demande, à expliquer leurs décisions et à répondre sous quinze jours ; ces engagements ont été formalisés dès juin 2014. Le Médiateur du crédit fera du reste, d’ici au mois d’octobre, un point précis sur ce sujet. Dans la période actuelle, compte tenu de la frilosité des acteurs, il convient d’être extrêmement attentif ; c’est pourquoi nous avons demandé à la médiation du crédit d’être particulièrement vigilante quant au comportement des banques commerciales.
Je rappelle en outre que, suite à la demande du Conseil national de l’industrie (CNI), nous avons insisté, Michel Sapin et moi-même, pour qu’un suivi de l’autocensure des entreprises soit assuré. Nous avons en effet beaucoup de difficultés à mesurer le taux de refus de prêt, en particulier des prêts à court terme, par les banques. Les demandes de garantie, les conseils ou l’absence de conseils verbaux contribuent en effet à accroître l’autocensure des chefs d’entreprise. Le dispositif que nous sommes en train de mettre en place devrait donc nous permettre de mesurer ce phénomène, afin de compléter les informations mises à disposition du médiateur du crédit et de mieux identifier les failles de marché. On constate en effet un décalage entre les chiffres de la Banque de France, qui révèlent un taux de refus très faible, et le fait que, sur le terrain, de nombreux chefs d’entreprise considèrent qu’ils ne peuvent pas financer leurs projets.
Le fait qu’une grande partie du financement des PME et des TPE par Bpifrance passe par la garantie peut créer un malentendu, car, dans ce cadre, ce sont les agences bancaires commerciales, et non les agents de Bpifrance, qui sont en contact avec le client final. Les directions régionales comptent parmi leurs membres des personnels de Business France et de la COFACE qui se consacrent à l’accompagnement à l’exportation. Je crois nécessaire d’améliorer la qualité de cet accompagnement.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Je suis content de vous voir, monsieur le ministre, car j’ai tellement entendu parler de vous pendant ce mois d’août que je me suis demandé si nous n’assistions pas à une seconde assomption.
En ce qui concerne la gouvernance, je crois que l’association, à parts égales, de l’État et de la Caisse des dépôts est une fausse solution. Il est en effet normal, cela ne me choque pas, que, dans une telle situation, l’État ait la main – et non la Caisse : je reste légitimiste. Cette association est donc fictive. Si je dis cela, c’est parce que je vois se profiler d’autres associations à « 50-50 », avec l’Agence française de développement (AFD) et d’autres. Je le dis franchement, ce n’est pas une bonne idée. Si le Gouvernement souhaite filialiser la Caisse des dépôts, et le débat est légitime, il doit le dire mais il ne doit pas agir de manière insidieuse en proposant ce type d’association, alors qu’il s’agit – appelons un chat un chat – de prendre à la Caisse l’argent qu’il n’y a plus dans le budget de l’État. Je ferai donc en sorte que nous ayons un débat sur ce sujet.
Du reste, on dit que la gouvernance de Bpifrance est satisfaisante, mais j’ai tout de même le sentiment, monsieur le ministre, qu’il était parfois difficile de se faire entendre. Quand on n’obtenait pas ce que l’on voulait à Bercy, on allait le chercher rue de Lille, et inversement. On était de partout et de nulle part ! D’autant que le Gouvernement, qui tenait la plume, et le Parlement ont commis l’erreur de faire nommer le directeur général de Bpifrance en Conseil des ministres. Car, qu’on le veuille ou non, toutes les personnes qui sont nommées en Conseil des ministres se prennent peu ou prou pour des ministres, et il est très difficile pour les véritables ministres de leur expliquer que tel n’est pas le cas. Cela vaut pour Bpifrance comme pour la Caisse des dépôts qui, bien qu’elle soit soumise au contrôle du Parlement, a un directeur général nommé en Conseil des ministres. Montesquieu aurait bien du mal à s’y retrouver ! Tout cela n’est pas sain.
Je crois donc qu’il est nécessaire de revoir – et je crois que vous êtes capable de le faire – l’organisation des relations entre l’APE, Bpifrance et la Caisse des dépôts. Contrairement ce que beaucoup croient, Bpifrance n’est pas le fonds souverain de l’État français. Certains chefs d’entreprise sont flattés de la voir entrer au capital de leur entreprise, mais d’autres sont effrayés car ils ont le sentiment qu’ils vont être étatisés, nationalisés ou « souverainisés ». Le fonds souverain de l’État, c’est l’APE, puisqu’elle gère le portefeuille de ses actifs financiers. Pourtant, elle ne se comporte pas toujours comme tel. Quand je vois qu’elle vend une partie d’une belle société, filiale d’une entreprise du secteur de l’armement, dont la réussite technologique dans le domaine des solutions de paiement est fabuleuse, à Bpifrance pour qu’elle ne passe à l’étranger, je me dis, là encore, que ce mélange des genres n’est pas sain. Je pars du principe qu’à Bercy, les gens sont intelligents, rationnels et cherchent la clarté mais, parfois, on ne comprend pas grand-chose. Je compte donc sur vous pour mener une réflexion sur les rôles respectifs de l’APE, de Bpifrance et, accessoirement, de la Caisse des dépôts, qu’il s’agisse de son action contracyclique ou, éventuellement, de son rôle de porte-avions financier, qui lui permettrait de contribuer à combler la faille de marché que vous avez mentionnée pour les tickets supérieurs à 20 millions et d’empêcher ainsi certaines sociétés qui ne trouvent pas les relais financiers nécessaires en France de se délocaliser.
Je crois donc que la gouvernance actuelle n’est pas la meilleure et – mais je sais que cet avis n’est pas partagé par tous – que l’un des deux acteurs, l’État ou la Caisse des dépôts, devrait prendre la main : il faut sortir du « 50-50 ».
Cela dit, que les choses soient claires : Bpifrance est une réussite. Elle s’est installée dans le paysage en un temps record et elle joue un rôle considérable, notamment dans le domaine du financement, grâce au fameux prêt à sept ans – deux ans de différé et cinq ans de remboursement –, qui est un outil de développement très intéressant pour les PME, les PMI, voire des sociétés plus importantes.
En ce qui concerne les crédits à court terme, vous avez évoqué la question du CICE, que j’ai découverte assez tardivement et qui m’a stupéfié. Qu’il faille des mois de concertation entre la direction des finances, celle du Trésor et celle des services fiscaux pour résoudre ce problème, alors qu’il suffisait de concevoir un formulaire ou de prendre un arrêté, c’est tout de même un peu agaçant. Cependant, les crédits à court terme sont, vous le savez, parmi les plus risqués, et nous avons un problème dans ce domaine.
Par ailleurs, il serait utile que nous disposions d’une étude de l’activité bancaire de Bpifrance, car il me semble que, comme dans toutes les banques du reste, les résultats sont très variables d’une région à l’autre. Dans certaines d’entre elles, cela fonctionne très bien ; dans d’autres, il faut appeler plusieurs fois, et il arrive qu’on ne vous rappelle même pas. Or, si l’on ne rappelle pas le président de la commission de surveillance de la Caisse – et cela m’est arrivé trois fois –, il n’est pas certain qu’on rappelle les chefs d’entreprise…
Quant à la question du cofinancement, elle est très complexe – je n’ai pas de solution miracle en la matière. Si l’on déroge à la règle du cofinancement, on perd aux yeux de Bruxelles la qualité d’investisseur avisé et l’intervention de Bpifrance entre dans la catégorie des aides d’État. Mais, si l’on colle à cette doctrine, que ce soit dans le domaine de l’investissement ou du crédit, on peut se trouver dans des situations difficiles. Ainsi, une entreprise qui s’était vu accorder une garantie par Bpifrance au mois de février dernier n’avait toujours pas l’argent au mois d’août, faute de cofinanceur. Il en est de même dans le domaine de l’investissement. Bpifrance fait son travail, mais que faire si elle ne trouve pas de cofinanceur ?
Je ne reviendrai pas sur le retournement, mais je me demande si la solution ne consisterait pas à créer, à côté de Bpifrance, un outil approprié à ces cas-limites. Je sais que vous ne laissez pas tomber ces entreprises : dans le cas de Gascogne, par exemple, votre ministère a fait intervenir massivement le Fonds de développement économique et social (FDES) pour apporter le complément nécessaire. Mais il s’agit d’une forme d’acrobatie qui n’est pas satisfaisante. Nous pourrions donc créer un véritable fonds de retournement – auquel pourraient être associés des gens du privé, si on les incite fortement –, ce que n’est pas, contrairement à ce que dit M. Dufourcq, le Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), qui est un fonds de rebond. Ce fonds de retournement, vous le savez, est attendu, mais tout le monde est contre, notamment à Bercy où, sans doute parce que Schumpeter y règne sur les consciences, les membres des corps prestigieux considèrent que les canards boiteux sont à fuir.
Enfin, faut-il rappeler que le Fonds stratégique d’investissement (FSI) puis Bpifrance ont mis pas mal d’argent dans les fonds de fonds, qui sans ces deux opérateurs auraient eu bien des difficultés à lever des fonds ? Les sociétés de gestion sont formidables, mais il n'y a pas moyen d’obtenir quoi que ce soit d’elles : elles sont indépendantes. Elles perçoivent leur commission mais, lorsqu’on a besoin d’elles, elles ne sont pas là. En tant que ministre, vous n’avez donc aucun pouvoir sur le pilotage des fonds de fonds. Il est tout de même curieux qu’alors que la part des fonds d’origine publique y est si importante, les sociétés de gestion puissent faire ce qu’elles veulent au nom du dogme anglo-saxon de l’investisseur avisé et de la libre décision. Je suis choqué que, lorsqu’on demande à ces fonds de faire un geste sur des dossiers un peu difficiles mais intéressants, ils ne bougent pas. Je précise néanmoins que Bpifrance a réduit le nombre des fonds de fonds auxquels elle souscrit afin d’assainir le marché financier français dans ce domaine. Mais il faut trouver une solution pour que, lorsqu’on les appelle au secours à propos d’entreprises qui en valent la peine, ces gens se souviennent qu’ils gagnent pas mal d’argent grâce aux fonds publics.
M. le rapporteur. Je précise qu’actuellement, 18 personnes suivent 1,7 milliard d’euros d’engagements dans les fonds de fonds.
M. Gilles Carrez, président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le ministre, je souhaiterais, quant à moi, connaître votre point de vue sur trois sujets.
Premièrement, l’activité de financement de Bpifrance – prêts, garanties, cofinancement –, qui s’inscrit dans la lignée de ce que faisait OSEO, fonctionne bien. Mais je tiens à appeler votre attention sur les risques que représente le financement à court terme. Lorsque la crise est intervenue, en 2008-2009, on a actionné des aides en trésorerie, mais celles-ci étaient adossées à des créances sur l’État, comme c’est le cas aujourd’hui avec le CICE ; c’est tout à fait sain. En revanche, il faut être extrêmement vigilant quant au financement direct de trésorerie ou de fonds de roulement, car c’est dans ce domaine, notamment pour les petites entreprises, que le taux de sinistralité est le plus important.
Ma deuxième question porte sur l’investissement en fonds propres et les prises de participations. Nous assistons, dans ce domaine, à un véritable changement d’échelle. Certes, il faut tenir compte de la reprise du FSI et de CDC entreprises, mais le montant des engagements – 1,7 milliard – est considérable. Or, ces derniers temps, on m’a rapporté à plusieurs reprises que la labellisation « Bpifrance » faisait monter les prix de façon artificielle, de sorte que l’on se retrouve dans une situation paradoxale où l’intervention de Bpifrance fausse le marché, d’autres investisseurs étant prêts à payer ces participations moins cher. C’est d’autant plus paradoxal que l’on n’est toujours pas parvenu à mettre en place un fonds de retournement qui interviendrait dans des situations d’urgence où le risque est très important. Il faut donc veiller à ce que Bpifrance n’intervienne pas tous azimuts dans des secteurs où des investisseurs sont prêts à prendre des participations.
Troisième point : il est question que Bpifrance reprenne les activités que la COFACE exerce pour le compte de l’État. Si une telle opération doit avoir lieu, elle posera de véritables problèmes, qu’il s’agisse du transfert des équipes ou de l’indemnisation des actionnaires privés de la COFACE, qui est logé depuis plus de vingt ans dans le secteur concurrentiel de l’assurance et de la banque. Je m’interroge donc sur la valeur ajoutée que peut apporter une telle évolution, qui doit, au demeurant, faire l’objet d’une autorisation législative.
M. le ministre. En ce qui concerne la gouvernance, il convient de distinguer le cas de Bpifrance de celui de l’AFD, qui me semble d’une nature très différente, compte tenu de leurs modalités d’intervention et de l’adossement recherché. Il en va du « 50-50 » actuel comme des gardes partagées : tout dépend de la discipline des deux parents. Sans doute peut-on améliorer et clarifier les règles de nomination afin d’aboutir à un meilleur équilibre. Mais les questions importantes sont celles de savoir si nous avons le bon niveau d’information, si nous savons définir les bonnes orientations et si nous savons nous-mêmes, État et Caisse des dépôts, ce que nous voulons et ce que nous voulons mesurer. Lorsque nous serons irréprochables dans ce domaine, nous pourrons être plus encore rigoureux avec l’opérateur. Pour aller au bout de ma pensée, cette question ne me semble pas être la priorité du moment, dès lors que l’action de cet opérateur public est un succès, y compris sur le terrain. En revanche, pour avoir été moi-même confronté à certaines incohérences optiques, j’estime également nécessaire, M. Emmanuelli, la clarification des rôles respectifs des différents acteurs que vous appelez de vos vœux.
Comment les choses s’articulent-elles ? La Banque publique d’investissement a vocation à financer les TPE et les PME et à investir dans des entreprises innovantes et stratégiques, notamment pour accompagner des entreprises vers des investisseurs privés de long terme. Dans le cas d’Ingenico, auquel vous avez fait allusion, c’est de cela qu’il s’agit : accompagner une entreprise en « haute mer » en recourant à Bpifrance faute d’avoir trouvé dans un délai bref un investisseur de long terme. L’APE, quant à elle, intervient dans le secteur des actifs stratégiques et des grandes entreprises. Mais il est vrai que les portefeuilles respectifs des deux opérateurs recèlent des incohérences et que, dans ce domaine comme en matière de gouvernance, une clarification est nécessaire. Je partage donc votre opinion sur ce point, M. Emmanuelli : nous devons clarifier la répartition des rôles, notamment parce que, pour des raisons historiques, certains actifs se trouvent dans le portefeuille de l’un ou de l’autre alors qu’ils ne correspondent pas à leur mission.
Quant au fonds de retournement, j’y suis, pour être clair, favorable. Vous avez raison d’indiquer que le FCDE n’en est pas un à proprement parler. Actuellement, nous utilisons le FDES et l’Aide à la réindustrialisation (ARI), qui sont des mécanismes discrétionnaires, à notre main, pour accompagner des retournements. Par ailleurs, certaines expériences sont concluantes. Deux régions, Rhône-Alpes et Franche-Comté – et j’ai écrit à leurs présidents pour que l’on puisse étudier la manière dont nous pourrions développer et généraliser leurs initiatives – sont parvenues à mettre en place des fonds régionaux de retournement. Nous réfléchissons donc – et mon engagement sur ce point est plein et entier, car je veux que nous aboutissions – à la création d’un fonds de retournement qui pourrait être détenu à 49 % par l'État, Bpifrance et les régions, et à 51 % par le privé. Nous ne développons pas suffisamment cette action, dont nous avons pourtant besoin.
En revanche, M. Emmanuelli, nous ne nous retrouverons peut-être pas sur les fonds de fonds. La logique est totalement différente. Lorsque l’on intervient à travers des fonds de fonds, on participe à l’écosystème de financement de l’économie. Aussi est-ce une bonne chose, me semble-t-il, que de ne pas intervenir dans leur gestion. Tout d’abord, nous ne pouvons pas interférer avec les règles d’indépendance et le contrôle qui relève de l’AMF. Ensuite, l’objectif de ces acteurs dépend de ce qu’ils ont vendu à leurs actionnaires, et nous avons décidé en conscience de cofinancer ces fonds. On peut donc éventuellement se demander, dans le cadre de la stratégie de Bpifrance, si l’on y met trop d’argent ou pas assez, mais il ne faut pas essayer de tuer deux oiseaux avec la même pierre et chercher à faire, à travers le financement des fonds de fonds, ce que l’on doit faire en direct. Là, nous contribuons à l’accélération du développement d’un écosystème de financement privé.
M. Henri Emmanuelli. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !
M. le ministre. Je clarifie les choses. Il est important que l’indépendance des sociétés de gestion soit complète. Bpifrance ne financera pas l’ensemble de l’économie française. Il est donc bon que des sociétés de gestion et des fonds à capital français se développent, et il faut faire réussir les meilleurs d’entre eux. Nous avons un manque dans ce domaine. Historiquement, nous avons financé notre économie grâce aux investisseurs institutionnels, qui y ont été contraints – et sans doute avons-nous failli depuis plusieurs années dans ce domaine – par la régulation. Or, l’épargne de nos concitoyens est placée dans l’assurance vie, laquelle peut de moins en moins financer l’equity. Nous n’aurons pas de souveraineté économique si nous ne développons pas un financement privé national. C’est précisément ce que Bpifrance contribue à faire à travers le mécanisme des fonds de fonds ; il s’agit donc d’un élément vertueux. Encore une fois, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’on y met trop d’argent ou pas assez, mais celui qu’on y investit doit l’être dans cette logique-là. Il ne faut pas chercher à intervenir dans les dossiers, même de manière occasionnelle ou limitée. Ce mécanisme relève d’une philosophie d’intervention différente, qu’il faut assumer car notre économie en a besoin.
En résumé, nous devons faire preuve de volontarisme pour créer un véritable fonds de retournement et faire preuve d’exigence en ce qui concerne les mécanismes d’intervention directe de Bpifrance et nous devons assumer notre rôle dans le développement d’un écosystème de financement privé, qui est encore insuffisant en France, comparé à celui des autres grands champions.
M. Henri Emmanuelli. Quel angélisme !
M. le ministre. Non, il s’agit de faire preuve de rigueur dans la définition des catégories : je ne vous ai pas dit que j’étais opposé aux fonds de retournement. Si nous mélangeons les différents leviers, nous aurons de mauvaises sociétés de gestion et nous ferons fuir les co-investisseurs privés. Or, nous n’en avons pas trop.
Par ailleurs, je partage ce qui a été dit sur le besoin d’un financement de trésorerie à court terme. Bien entendu, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés, mais la régulation se fait par le mécanisme que j’ai évoqué tout à l’heure. Bpifrance intervient en garantie des acteurs bancaires. Elle doit donc développer ces produits-là, mieux les cibler – et nous devons être vigilants sur ce point. Les banques commerciales, même si elles bénéficient d’un rehausseur de crédit, n’iront pas chercher des entreprises qui présentent un risque inconsidéré.
Enfin, le projet concernant COFACE et Bpifrance est en effet celui qui est aujourd’hui retenu. Il apporte une plus-value, dans la mesure où il permet de présenter une offre intégrée et simplifiée aux PME, et donc d’améliorer leur accompagnement. Quant à l’indemnisation, elle a déjà été discutée avec l’actionnaire actuel : elle sera au maximum de 77 millions d’euros. J’ajoute qu’il faudra en effet modifier le code des assurances en loi de finances rectificative pour parachever cet adossement.
Mme la présidente Véronique Louwagie. Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir répondu à nos questions et d’avoir ainsi contribué aux travaux de notre mission d’information.
1 () Article 1er de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement.
2 () La Mission d’information de l’Assemblée nationale a ainsi envoyé un questionnaire en avril 2015 à de nombreuses entreprises qui ont été en relation directe avec la BPI, ce qui lui a permis de recueillir plus d’une cinquantaine de témoignages directs d’entrepreneurs relatant les points positifs mais aussi les difficultés ou les insatisfactions nées de leur démarche auprès de la BPI.
3 () Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/2014ParlonsCash-avec-Nicolas-Dufourcq-les-6-points-a-retenir
4 () Il a été remplacé en avril 2014 par M. Pierre-René Lemas.
5 () Conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 2012 précitée.
6 () Selon les termes de l’article L. 517-1 du code monétaire et financier, une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l’article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement ou établissements financiers. Il en résulte notamment que la surveillance prudentielle est exercée sur la base des comptes consolidés de BPI-Groupe SA et directement par la BCE (en liaison avec l’ACPR).
7 () Directive sur les gestionnaires de FIA, 2011/61/UE.
8 () Audition du 5 février 2015
9 () Rapport annuel 2014 de Bpifrance Financement.
10 () Source : AFIC, rapport 2014 : sur un montant total de capitaux levés de 8,58 milliards d’euros en 2013, la BPI représente 850 millions d’euros (à travers ses fonds directs) auquel il convient d’ajouter 1,47 milliard d’euros levés par ses fonds partenaires.
11 () Banque de développement du Conseil de l’Europe.
12 () Article 12 de la loi du 31 décembre 2012 précitée.
13 () Décret n° 2015-679 du 16 juin 2015 pris en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.
14 () Audition du 21 mai 2015.
15 () Deux représentants des régions sont membres du conseil d’administration de la BPI (Mme Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional de Franche Comté et M. Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Ile-de-France
16 () Trois représentants des régions (M. Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine et de l’Association des Régions de France, Mme Marie-Guite Dufay, présidente du conseil régional Franche-Comté, et M. Laurent Beauvais, président du conseil régional de Basse-Normandie) siègent au CNO.
17 () Audition du 5 février 2015.
18 () Audition du 5 mars 2015.
19 () Audition du 24 juin 2015.
20 () Tous établissements de crédit confondus.
21 () Il s’agit d’avances de trésorerie sur les marchés publics et grands comptes domestiques.
22 () Un deuxième fonds a été lancé, le fonds Avenir automobile doté de 625 millions d’euros (pour 400 millions d’euros réalisés)
23 () Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'État sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques.
24 () Audition de M. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, 29 janvier 2015.
25 () Audition de M. Patrice Bégay, directeur de la communication de Bpifrance, 21 mai 2015.
26 () Le chiffre des dépenses de communication doit être comparé, selon Bpifrance, aux actions « business to business » ou institutionnelles des banques (LCL entreprises, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société générale, Crédit Mutuel) qui représentent 262 millions d’euros en 2014. Il peut également être comparé aux dépenses de même nature de Pôle Emploi (20 millions d’euros) ou de La Poste (15 millions d’euros).
27 () Hors frais des personnels affectés à la communication.
28 () Selon Bpifrance, cela représente 1,1 % des investissements média du secteur bancaire (pour mémoire, la part de marché de Bpifrance dans le financement bancaire est d’environ 5 %).
29 () Selon Bpifrance, cela représente moins de 8 % des dépenses, la norme du marché étant à 15 %.
30 () Ce chiffre repose sur le nombre d’unités légales et non le nombre de groupes.
31 () 89 grandes entreprises et 376 associations, laboratoires, établissement publics ont également reçu 1,3 milliard d’euros de financement en 2014.
32 () La décision de suppression du PCE a été prise en 2014 (arrêt effectif fin mars 2015) en raison de l’impact décroissant du PCE sur l’économie et d’un coût en fonds publics très élevé. En contrepartie, Bpifrance s’est engagé à renforcer son intervention en garantie des prêts bancaires privés sur le segment de la création et la reprise d’entreprise.
33 () 21 000 filiales ou têtes de groupe appartenant à 17 600 PME.
34 () 3 946 filiales ou têtes de groupe appartenant à 1 673 ETI.
35 () Audition de M. Jean-Louis Beffa président d’honneur de Saint-Gobain, membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, 19 mars 2015.
36 () Article 1 de la loi n° 2012-1559 relative à la création de la Banque publique d'investissement du 31 décembre 2012.
37 () Jacques Cailloux, Augustin Landier et Guillaume Plantin, Crédit aux PME : des mesures ciblées pour des difficultés ciblées, note du Conseil d’analyse économique n° 18, décembre 2014.
38 () Audition du 21 mai 2015.
39 () Rapport de la de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le thème « Prévention et accompagnement par la puissance publique des plans de sauvegarde de l’emploi » présenté par M. Christophe CASTANER et Mme Véronique LOUWAGIE le 2 octobre 2013.
40 () L’affacturage est une technique de financement et de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises et consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé : l'affactureur.
41 () Le prêt Export est un prêt proposé directement par Bpifrance à une entreprise française pour lui donner les ressources financières de son développement international. C'est un prêt long sur sept ans, avec deux ans de différé de remboursement, sans garantie, de 30 000 euros à 5 millions d’euros. Bpifrance peut proposer ce produit seule jusqu’à 150 000 euros, et avec un partenaire bancaire si le montant est plus élevé.
42 () Le crédit Export concerne les entreprises françaises ou étrangères ayant une filiale implantée en France, qui vendent des biens d'équipement et prestations de services. Il leur permet de proposer à leur acquéreur, à côté de leur offre commerciale, une solution financière, soit sous forme d'un crédit acheteur, soit sous forme d'un rachat de crédit fournisseur (cf. partie III du présent rapport, sur l’export).
43 () Rapport de l’Observatoire du financement des entreprises sur le financement des TPE, juin 2014.
44 () Seules 24% des demandes de crédits de trésorerie des TPE sont satisfaites par un crédit échéancé. Dans 24% des cas, la réponse apportée par la banque est la mise en place d’un découvert, dans 19% des cas, l’augmentation d’une autorisation de découvert déjà existante, tandis que dans 33% des cas, la banque refuse d’accorder le financement demandé.
45 () À fin juin 2015, selon les chiffres de la Banque de France, le cumul sur douze mois du nombre de défaillances s’est élevé à 63 202, soit au même niveau qu’en juin 2014. Les défaillances cumulées baissent dans le transport, l’information, le soutien aux entreprises, le commerce et l’industrie. En revanche, elles augmentent dans l’hébergement-restauration, les activités immobilières et la construction.
46 () La cession Dailly est régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Elle est une forme particulière de la cession de créance, prévue par les articles 1689 et suivants du Code civil. La cession Dailly n'est donc qu'une opération juridique par laquelle un créancier cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.
47 () Une faille de marché peut être définie simplement comme une situation où un bon projet, c’est-à-dire un projet générant des flux de capital supérieurs en valeur actualisée au coût des investissements initiaux, ne trouve pas de financeur. Elle peut résulter d’une crise systémique, comme en 2008, ou d’asymétries d’information, autrement dit de difficultés à évaluer les risques du projet. Outre ces failles de marché, la puissance publique peut chercher à favoriser le financement de projets non rentables mais qui produisent des « externalités positives » pour l’ensemble de l’économie (recherche fondamentale, infrastructures…). Cette intervention est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État dans le souci d’éviter les distorsions de concurrence entre les États membres (cf. partie II.A du présent rapport.).
48 () Le prêt Export est un prêt proposé directement par Bpifrance à une entreprise française pour lui donner les ressources financières de son développement international. C'est un prêt long sur sept ans, avec deux ans de différé de remboursement, sans garantie, de 30 000 euros à 5 millions d’euros. Bpifrance peut proposer ce produit seule jusqu’à 150 000 euros, et avec un partenaire bancaire si le montant est plus élevé.
49 () Le crédit Export concerne les entreprises françaises ou étrangères ayant une filiale implantée en France, qui vendent des biens d'équipement et prestations de services. Il leur permet de proposer à leur acquéreur, à côté de leur offre commerciale, une solution financière, soit sous forme d'un crédit acheteur, soit sous forme d'un rachat de crédit fournisseur (cf. partie III du présent rapport, sur l’export).
50 () L’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce l’obligation de notification des aides d’État à la Commission européenne afin d’établir leur compatibilité avec le marché commun selon les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. La règle de minimis a ainsi été mise en œuvre afin d’exempter les subventions de faible montant. Ainsi les aides inférieures à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux sont exemptées de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne.
51 () France Stratégie, Rapport 2015 du comité de suivi du CICE, septembre 2015.
52 () D’après la nouvelle répartition faisant suite à l’augmentation de capital réalisée en 2015. BPI-Groupe SA détient quant à elle 92 % du capital.
53 () Audition du 12 mars 2015.
54 () Cela nécessite cependant que la BPI puisse disposer des moyens humains nécessaires et, surtout, que les contraintes européennes en la matière soient assouplies.
55 () Audition du 12 mars 2015.
56 () Source : réponses de Bpifrance aux questions du Rapporteur (septembre 2015).
57 () Audition du 29 janvier 2015.
58 () Audition du 29janvier 2015.
59 () Audition du 19 février 2015.
60 () MM. Jean-Christophe Fromantin et Patrice Prat, Rapport sur l’évaluation du soutien public aux exportations, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1225, 4 juillet 2013, et Rapport sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information (n° 1225) du 4 juillet 2013 sur l’évaluation du soutien public aux exportations, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2052, 19 juin 2014.
61 () Audition du 2 avril 2015.
62 () La Commission interministérielle des garanties et du crédit au commerce extérieur, créée en 1946 par ordonnance et reprise dans la loi de 1949, doit donner son aval pour l’octroi des garanties publiques.
63 () Audition du 7 juillet 2015.
64 () Voir le compte rendu de la table ronde dédiée au soutien à l’exportation et à l’ouverture à l’international des entreprises organisée le 2 avril 2015, annexé au présent rapport.
© Assemblée nationale