

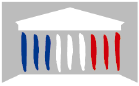
N° 3829
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION
sur le paritarisme (1)
M. Arnaud RICHARD,
président
et
M. Jean-Marc GERMAIN,
rapporteur
Députés.
___
La mission d’information sur le paritarisme est composée de :
M. Arnaud Richard, président, M. Jean-Marc Germain, rapporteur ; M. Pierre Aylagas, M. Guy Bailliart, M. Philippe Bies, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, Mme Valérie Boyer, M. Olivier Carré, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. David Comet, M. Laurent Degallaix, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, Mme Michèle Fournier-Armand, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Patrick Gille, Mme Laure de La Raudière, Mme Isabelle Le Callennec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Véronique Louwagie, M. Gilles Lurton, Mme Véronique Massonneau, M. Jacques Moignard, M. Denys Robiliard, Mme Sophie Rohfritsch, Mme Claudine Schmid, M. Gérard Sebaoun, M. Christophe Sirugue, M. Dominique Tian, M. Philippe Vitel
Les comptes rendus des auditions sont disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, à l’adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-miparitarisme/15-16/
L’ensemble des informations relatives à la mission sont accessibles sur son portail, à l’adresse :
___
Pages
AVANT-PROPOS DE M. ARNAUD RICHARD, PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION 9
INTRODUCTION 15
PREMIÈRE PARTIE – LE PARITARISME : UN MODE DE GOUVERNANCE ORIGINAL GÉRANT UN QUART DE LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE 21
I. LA NOTION DE PARITARISME EN FRANCE : UNE DÉFINITION COMPOSITE ISSUE D’UNE HISTOIRE SINGULIÈRE 21
A. LE PARITARISME : UNE RÉALITÉ INSTITUTIONNELLE SANS VÉRITABLE DOCTRINE 22
1. Les fondements intellectuels du paritarisme 22
a. Le paritarisme s’appuie sur une certaine conception des corps intermédiaires 22
b. Le fondement juridique du paritarisme est le droit contractuel 23
2. Le paritarisme français : d’une pluralité de définitions à une définition plurielle 23
3. Le paritarisme français est sans équivalent en Europe 26
B. LE PARITARISME : UNE HISTOIRE SINGULIÈRE, REFLET DES RAPPORTS TOURMENTÉS ENTRE L’ÉTAT ET LES CORPS INTERMÉDIAIRES 30
II. LE PARITARISME AUJOURD’HUI : LES CHAMPS DE L’ENTREPRISE, DE LA NÉGOCIATION ET DE LA GESTION 54
1. 1945-1967 : la gestion par les intéressés 60
a. Un contexte politique défavorable à une gestion étatique 60
b. Une organisation affirmant la prépondérance des salariés dans les conseils d’administration 62
c. Le poids déjà très important de l’État dans la gestion de la sécurité sociale 63
d. Une gouvernance délicate dans un contexte de hausse des dépenses 64
2. 1967-1982 : le retour très temporaire au paritarisme dans un contexte financier difficile 64
a. Les ordonnances « Jeanneney » : une réforme profonde de la gouvernance dans un contexte favorable au paritarisme 64
b. Une gouvernance renouvelée et renforcée, chargée de redresser les comptes de la sécurité sociale 65
3. 1982-1995 : le retour partiel à la gestion par les intéressés 66
4. De 1995 à aujourd’hui : une place difficile à trouver au milieu de l’étatisation 67
a. La réforme de 1995 67
b. La réforme de l’assurance-maladie du 13 août 2004 : une étatisation assumée 69
c. Un paysage étatisé dans lequel les partenaires sociaux jouent un rôle limité 69
i. Des conseils d’administration qui ne relèvent plus du paritarisme pur… 69
ii. … laissant l’essentiel de la gestion aux directeurs 72
iii. Le tripartisme asymétrique : un aboutissement inévitable 73
C. LE PARITARISME D’ENTREPRISE ET DE NÉGOCIATION 75
1. L’état des lieux de la négociation collective 76
a. Un paritarisme d’entreprise inégalement développé 78
i. Les délégués du personnel 78
ii. Les comités d’entreprise et de groupe 80
iii. Les comités d’entreprise européens et les comités de sociétés européennes 85
iv. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 89
v. Les délégués syndicaux 91
vi. Les obligations de négocier 92
vii. La représentation des salariés dans les organes de gestion des sociétés 94
viii. La faible représentation du personnel dans les petites entreprises 98
b. Un paritarisme d’entreprise et de négociation fragilisé par un renouvellement insuffisant de ses acteurs 100
c. Un paritarisme de négociation parfois tributaire de l’intervention de l’État 104
2. L’articulation des normes issues de la négociation collective 107
D. LE PARITARISME DE GESTION INTÉGRAL 115
1. Les retraites complémentaires représentent une masse financière considérable gérée par des instances paritaires quasiment pures 116
a. Les retraites complémentaires sont le premier espace de reconquête du paritarisme après 1945 116
i. La création de l’AGIRC : une victoire en demi-teinte pour un régime autonome des cadres (1945-1947) 117
ii. La création de l’ARRCO : l’extension progressive au plus grand nombre (1947-1961) 120
iii. Un demi-siècle de paritarisme dans les retraites complémentaires : un système original qui a montré ses capacités de gestion et de réforme (de 1961 à aujourd’hui) 121
b. L’AGIRC-ARRCO aujourd’hui : un modèle de paritarisme pur dans un contexte d’étatisation croissante des enjeux de la protection sociale 126
i. Un processus de négociation juridiquement autonome mais dont l’État n’est pas complètement absent 126
ii. Une gestion autonome et globalement performante en cours de transformation 132
c. Les retraites complémentaires constituent le champ le plus important du paritarisme 137
2. Le paritarisme de prévoyance 138
a. Les conventions collectives et leurs caisses paritaires de branche ne séparaient pas la prévoyance de la retraite complémentaire avant 1996 138
i. Les institutions de prévoyance sont créées entre 1937 et 1947 par les conventions paritaires de retraite et de prévoyance pour les cadres 138
ii. La prévoyance est incluse dans les conventions collectives de retraite complémentaires jusqu’aux années 1990 141
b. Les institutions de prévoyance ont dû séparer leurs caisses de retraite complémentaire de celles de prévoyance et d’assurance maladie 144
i. Le droit et la jurisprudence communautaires ont imposé la libre concurrence dans un champ, largement défini, de l’assurance vie 144
ii. La fin des clauses de désignation affaiblit les institutions de prévoyance 153
E. LE « TRIPARTISME ASYMÉTRIQUE MASQUÉ » 164
1. Action Logement (anciennement « 1 % logement ») 165
2. L’assurance paritaire du chômage 173
a. À l’indemnisation légale du chômage s’est ajoutée, en 1959, une assurance conventionnelle paritaire 173
i. Avant 1959, le chômage est indemnisé par les bureaux de bienfaisance des communes 173
ii. En 1959, l’État agrée une convention d’assurance chômage, interprofessionnelle et paritaire, qui complète l’indemnisation publique 177
iii. Les dépenses d’indemnisation du chômage restent cependant partagées entre l’État et les partenaires sociaux 179
b. Les partenaires sociaux tentent, depuis 2001, de limiter le coût de l’assurance chômage par une prévention personnalisée du risque 183
i. L’assurance chômage personnalisée, négociée par les partenaires sociaux en 2001, a été déléguée par l’État au service public de l’emploi 183
ii. Après la crise de 2008, le régime d’assurance redevient déficitaire 186
iii. Le service public de l’emploi doit désormais concilier la prévention du chômage et du paupérisme avec le service d’une assurance contributive 192
3. La santé et la sécurité au travail 206
a. Le paritarisme « encadré » de la branche AT-MP de la CNAMTS 208
b. La gouvernance tripartite des agences intervenant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 215
c. Un exemple d’organisme de branche intervenant dans le champ de la santé au travail : l’OPPBTP 218
d. Les services de santé au travail 221
4. Le handicap : un paritarisme légal associant des tiers 226
a. Un paritarisme d’origine légale : la loi du 10 juillet 1987 226
b. Un conseil d’administration original 228
c. Une grande autonomie de fait, sous le regard attentif de l’État 229
d. Une organisation « tête de réseau » 231
e. Des ressources modestes et variables 232
5. La justice prud’homale : un paritarisme historique isolé dans un ordre juridique étatique 233
a. Le plus ancien des paritarismes 233
i. 1806-1848 : l’esquisse 233
ii. 1848-1979 : l’extension 234
iii. 1979 à aujourd’hui : l’institutionnalisation 235
b. Un paritarisme juridictionnel constamment réinterrogé 237
i. La France est le seul pays à avoir fait le choix du paritarisme 237
ii. Le fonctionnement des conseils de prud’hommes 237
iii. Le fonctionnement du paritarisme prud’homal fait l’objet de critiques récurrentes 240
iv. D’importantes réformes sont en cours pour préserver le paritarisme 241
F. L’ÉMERGENCE D’UNE FORME DE QUADRIPARTISME DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. 244
a. L’instrument étatique d’intervention en matière de formation professionnelle : la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 247
b. Les instances quadripartites pilotant les dispositifs de formation professionnelles au niveau national : le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 248
c. Les instances quadripartites pilotant les dispositifs de formation professionnelle au niveau régional : les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation et les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 252
d. Un exemple de gestion paritaire au sein des OPCA et des OPACIF : Uniformation 255
e. Un exemple de gestion paritaire au sein des FONGECIF : le FONGECIF Île-de-France 257
f. La prochaine mise sous tutelle étatique de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 261
DEUXIÈME PARTIE – LE PARITARISME : UN SYSTÈME À REFONDER POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE NOTRE SIÈCLE 265
I. L’ARCHITECTURE DE LA NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE ET DU PARITARISME DOIT ÊTRE REPENSÉE 267
II. L’INSTITUTION, À TERME, D’UNE SÉCURITÉ SOCIALE PROFESSIONNELLE DOTÉE D’UNE GESTION UNIFIÉE 272
A. LA COMPLEXITÉ DU DISPOSITIF DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ILLUSTRE LA NÉCESSITÉ DE CRÉER, ASSEZ RAPIDEMENT, UN RÉGIME D’ASSURANCE-FORMATION GÉRÉ PAR UNE AGENCE NATIONALE POUR L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE… 273
1. La complexité et les insuffisances du dispositif du conseil en évolution professionnelle 273
2. La nécessité de créer, à terme, un régime d’assurance-formation géré par une Agence nationale pour l’évolution professionnelle 275
B. …QUI POURRAIT AMORCER LA CRÉATION, À TERME, D’UNE AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE PROFESSIONNELLE FAVORISANT UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE DE LA PERSONNE, DANS LE PROLONGEMENT DE LA LOGIQUE QUI ANIME LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ 276
1. L’amorce d’une prise en compte globale de la personne à travers la création d’un compte personnel d’activité 278
a. Le développement d’une logique de fongibilité et de portabilité des droits avec la création des comptes personnels de formation et de prévention de la pénibilité. 279
b. La consécration de l’universalité des droits avec la création du compte personnel d’activité 285
2. La nécessité de créer, à terme, un régime unifié de sécurité sociale professionnelle géré par une agence unique 293
a. Le modèle paritaire de gouvernance de la sécurité sociale professionnelle. 295
b. Le modèle tripartite (voire quadripartite) de gouvernance de la sécurité sociale professionnelle. 297
i. La tentation d’institutionnaliser le tripartisme 298
ii. La pertinence du contrôle par voie d’agrément ou de la contractualisation 300
III. LE DÉFI DE L’UBÉRISATION DE L’ÉCONOMIE 303
A. LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI BOULEVERSENT LA CONCEPTION DU TRAVAIL QUI INSPIRAIT LE PARITARISME 303
1. Le développement des nouvelles formes d’emploi dans un cadre indépendant tend à réduire le caractère normatif du salariat 303
a. Les « nouvelles formes d’emploi » : un travail indépendant d’un type nouveau 303
i. Une sémantique incertaine : « ubérisation », disruption et nouvelles formes d’emploi 303
ii. Des situations juridiquement difficiles à qualifier : « salariat déguisé » et subordination économique 307
b. Vers une remise en cause quantitative de la prédominance du salariat ? 310
i. Le poids des nouveaux travailleurs indépendants est très important dans certains pays 311
ii. Ces nouveaux travailleurs restent encore minoritaires en France 311
2. L’augmentation des effectifs des nouveaux travailleurs du numérique fait peser un risque d’ampleur inconnue sur le financement de la protection sociale 312
a. Le statut des indépendants implique par construction une diminution des recettes des régimes de protection sociale 312
b. Les pertes de recettes ne sont pas suffisamment documentées 312
B. LES ENJEUX DES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI LIÉES À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ÉCHAPPENT AU CHAMP ACTUEL DU PARITARISME 314
1. L’économie numérique est caractérisée par des nouvelles relations de travail qui ne laissent pas de place pour le dialogue et la représentation habituels 314
2. Ces néo-travailleurs, juridiquement indépendants mais dépendants économiquement, ne peuvent être privés de protection sociale 315
C. UN NOUVEAU PARITARISME ADAPTÉ À LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE INVENTÉ POUR COMPLÉTER L’EXISTANT ET ASSURER UNE PROTECTION À TOUS LES TRAVAILLEURS 316
1. Ce nouveau système doit être fondé sur le souci d’assurer une protection suffisante aux travailleurs sans remettre en cause leur activité 316
2. Le paritarisme numérique devra s’appuyer sur différents instruments pour assurer une représentation à la fois solide et souple des intérêts des travailleurs du numérique 318
a. Un préalable : la représentation des acteurs du secteur 318
b. Le constat : un besoin de dialogue et de régulation 319
c. Confier aux partenaires sociaux le soin de co-construire progressivement cette régulation avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les acteurs du secteur 319
i. Un horizon : la sécurité professionnelle pour tous 319
ii. Une méthode : la négociation 321
PROPOSITIONS 323
EXAMEN DU RAPPORT 327
CONTRIBUTION DE Mme ISABELLE LE CALLENNEC AU NOM DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS 343
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 345
GLOSSAIRE 353
AVANT-PROPOS DE M. ARNAUD RICHARD,
PRÉSIDENT DE LA MISSION D’INFORMATION
Le paritarisme est l’un des piliers de la démocratie française, que la tectonique de notre vie collective nous invitait à réexaminer. C’est aussi un espace stratégique de modernisation de notre pays qui s’ouvre à l’issue des travaux de cette mission d’information. Ce travail à venir me paraît extraordinairement passionnant et refondateur…
Expression profonde d’un choix de société, dans sa conception comme dans ses modalités de fonctionnement, cet outil de l’Intérêt Général porte aujourd’hui tout autant la nécessité de stabilité que l’impératif d’intégration de nouvelles perspectives à l’œuvre.
Voilà pourquoi le groupe de l’Union des démocrates et indépendants a émis le souhait d’une mission d’information sur ce sujet, dont la création a été décidée par la Conférence des présidents du 23 juin 2015.
L’honneur qui m’est revenu de présider cette mission s’est doublé du plaisir de l’émulation intellectuelle, suscitée par la vigueur et l’exigence constantes du Rapporteur, Jean-Marc Germain. Fin connaisseur des problématiques sociales, notre Rapporteur a fait la preuve de sa volonté d’aller au-delà de certaines opinions, pour que nous nous orientions vers des chemins nouveaux. Je tiens à le remercier très chaleureusement et très vivement de ce véritable cheminement, de cet acte de liberté qui constitue pour moi la première qualité requise pour un Parlementaire et qui a permis d’animer nos travaux avec l’ensemble de nos collègues. Je salue aussi les choix retenus, avec l’aide très éclairée des administrateurs de l’Assemblée, de témoins.
Je me félicite également de l’implication de nombreux membres de la mission, qui ont su nourrir nos réflexions collectives par leurs interventions appuyées sur de véritables recherches.
Les travaux de cette mission constituent désormais la référence incontournable à partir de laquelle toute réflexion sur l’évolution de notre modèle paritaire devient possible.
La démocratie sociale est un impératif et un objectif vers lesquels doivent tendre les politiques publiques en matière de dialogue social, d’emploi, de formation, de retraites, de logement, mais aussi de développement économique.
Elle se nourrit d’une tension constante visant à concilier efficacité économique et protection des travailleurs. Elle suppose les bons outils de régulation sociale et de gouvernance. Voilà l’enjeu fondamental qui a présidé à notre travail.
Le paritarisme est un instrument au service des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Il suppose pour être efficace l’union de deux facteurs : la co-construction de règles essentielles et la légitimité de leurs concepteurs.
Les maillons de la chaîne sont constitués des processus électifs, de l’état de droit, du pluralisme et de la transparence. Et ils sont tous nécessairement reliés par une double exigence d’éthique et de bonne foi.
Tout ne se résume pas, en effet, à des données objectives, qui aboutissent le plus souvent à une « architecture en tuyau d’orgues » – correspondant à chacun des pans de notre vie sociale – à l’opposé de l’esprit du paritarisme. C’est, par exemple, tout l’enjeu de la création du compte personnel d’activité (CPA), qui dessine un mode de régulation axé sur la personne, initiant ainsi une ouverture des droits sur le temps long qu’est le parcours de vie. D’évidence, cette idée doit être structurée et prendre une nouvelle dimension.
Que s’est-il donc passé pour que l’on soit amené finalement à se demander si le temps n’était pas venu de rebattre les cartes ?
Comment pourrait-il en être autrement quand le paritarisme s’impose à nous comme une mosaïque, avec 767 000 mandats de représentation en cours, exercés par environ 600 000 personnes, représentant 6 % des salariés, un nombre effarant de branches professionnelles, 40 000 à 45 000 accords d’entreprises en vigueur, 950 accords de branche conclus par an et une petite dizaine d’accords nationaux interprofessionnels (ANI) ?
Mais ce grouillement paritaire posé sur une tête d’épingle – avec un taux de syndicalisation de 7 % – aboutit au résultat remarquable d’un taux de couverture conventionnelle de près de 94 %, l’un des plus élevés des pays occidentaux.
Autrement dit, le système paritaire français n’est pas improductif, mais il est nébuleux. Et pour qu’il ne devienne finalement illisible, le Parlement s’invite dans le jeu de l’élaboration collective.
Gardons à l’esprit que le paritarisme est un moyen pas une fin en soi ! Ce n’est pas un monde à part, comme pourrait le laisser penser la doctrine interne du régime AGIRC-ARRCO, selon laquelle les régimes doivent être coopératifs, mais non alignés avec les régimes de base de la sécurité sociale, afin de se soustraire à toute reprise en main par l’État…
Le bon chemin passe donc entre la simplification et la collaboration !
Le fait de savoir si l’on évolue vers un système dirigé par l’État, ou si, au contraire, on revient à l’esprit de départ des organismes paritaires, c’est-à-dire à une plus grande liberté de gestion et de décision des partenaires sociaux, n’est plus le fond du débat. Mais cela pose la question, fondamentale, de la méthode.
Paraphrasant Winston Churchill pour la démocratie, il me semble que le paritarisme est le pire système, à l’exception de tous les autres parce qu’il permet d’élaborer de subtils compromis et de piloter les régulations sociales.
Mais il est nécessairement porté par la souveraineté nationale, qui n’encadre pas mais qui projette la négociation sociale, évitant ainsi le risque d’un conservatisme de compromis des partenaires sociaux. Si, en effet, ce système permet de trouver des aménagements parfois subtils, il ne doit pas aboutir à l’immobilisme de postures syndicales. C’est d’autant plus nécessaire que le tour de table exclut aujourd’hui trop de partenaires indispensables à l’avènement d’un débat parfaitement transversal et constructif.
Ce subtil équilibre est une belle occasion pour la loi de retrouver toute sa légitimité, là où elle est si nécessaire : l’État c’est l’impulsion, le cap, le changement ; les partenaires sociaux les moteurs des avancées sociales.
Le pivot de l’élaboration collective dans une démocratie, c’est le Parlement. Et compte-tenu des sommes considérables, aussi bien sous forme de prélèvements que sous forme de prestations, des droits du quotidien, de la diversité des situations individuelles concernées, de la crise qui frappe nos concitoyens, il ne peut plus détourner aujourd’hui son regard de l’ensemble du champ paritaire.
Le contrôle légitime du Parlement n’est en rien un acte de méfiance mais bien une volonté de rendre le système paritaire plus lisible à nos concitoyens et plus efficient dans l’intérêt général.
Sans remettre en cause le paritarisme – socle de notre système de protection sociale – il convient de réaménager l’équilibre entre le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux, véritable « cinquième pouvoir » dans notre pays.
Concrètement, je pense que l’on pourrait compléter les dispositions de l’article 34 de la Constitution en prévoyant que le Parlement soit saisi chaque année d’un projet de loi sur les finances sociales portant approbation d’un rapport sur les comptes prévisionnels de l’ensemble des régimes paritaires. Une réforme d’une telle ampleur suppose une consultation sans précédent, qui pourrait prendre la forme d’« états généraux du paritarisme », conduits par le CESE pour aboutir à la création d’une LOLF du Paritarisme.
Y a-t-il en vérité une « crise du paritarisme » ? Je ne le crois pas. Il y a, au contraire, des opportunités de ré-enchantement du paritarisme.
Il existe une posture un peu anxiogène et très déterministe, selon laquelle les nouvelles formes de travail se substitueraient dans un délai rapide au travail salarié. Or, ce n’est pas la réalité mais un « bruit faible » bruyant ! Mais on ne peut pas non plus nier que la transformation numérique s’accompagne de nouvelles formes d’emploi, qui recouvrent des formes très diverses. Vivre avec ces nouveaux types d’emplois, c’est une chose. En faire le prétexte d’un bouleversement de notre socle social en est une autre.
L’objectif est de se rapprocher des situations réelles, celles au sein des petites entreprises, celles individuelles, ici et là, dans de nouveaux cadres. Attacher des droits aux personnes plutôt qu’aux statuts. En cela, le rôle de la branche est majeur. Pour autant, pour se rapprocher encore, ni la branche ni le code du travail ne « voient » d’assez près.
Initialement, la gouvernance des institutions sociales reposait sur des cotisations assises sur la masse salariale, ce que la fin du plein emploi, les parcours professionnels séquencés – parfois syncopés –, l’économie relationnelle, de plateformes, l’ubérisation, la situation des demandeurs d’emplois et des retraités hors système, ont fortement fragilisé.
Mais prendre ce raccourci reviendrait néanmoins à faire fausse route. Je suis convaincu que la diversité impose la proximité et la complexité, la vue de près. Le paritarisme est la bonne méthode pour y parvenir, à condition qu’il fasse par lui-même sa révolution copernicienne.
Il ne me semble pas scandaleux d’étendre le champ de la négociation collective obligatoire aux orientations de formation et aux restructurations, de rationaliser les incitations publiques à la négociation, de favoriser le regroupement des thèmes connexes pour s’adapter à la diversité des contextes.
Et il m’apparaît nécessaire que la gouvernance de l’entreprise et des administrations donne une voix délibérative et non plus seulement consultative aux représentants du personnel au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance.
L’administration est un cas particulier, qui me semble devoir être traité avec une exigence singulière pour éviter toute confusion possible entre les intérêts de carrière et l’activité représentative.
C’est bien l’organisation en silos de la régulation sociale qu’il faut réformer et c’est bien la fongibilité des droits qui dessine un mode de régulation axé sur la personne et sur son parcours qu’il faut viser.
Enfin, il faut lancer plus loin les filets de ce paritarisme repensé, parce qu’aujourd’hui pour une même activité, on peut être employeur, employé, autoentrepreneur ou salarié ; parce que le travail bouge, de l’autoentrepreneur au franchisé, du portage salarial aux plateformes collaboratives, des « faux indépendants » à la multi-activité.
Jusque-là en France, il n’y avait que quatre activités possibles : fonctionnaire, salarié, indépendant ou demandeur d’emploi. Vient maintenant s’ajouter une cinquième catégorie, l’ensemble plus ou moins défini des « free lancers », les emplois aujourd’hui les moins protégés. S’agit-il là des « trous dans la raquette », évoqués par notre Rapporteur ou du format de la raquette elle-même ?
La seule question qui vaille n’est pas de savoir comment taxer ces activités économiques et commerciales, mais bien de savoir intégrer ces formes d’emplois au financement de notre protection sociale et donc au sein du paritarisme. Cela signifie une obligation incontournable pour ces plateformes de s’engager dans un certain nombre de domaines : formation, protection des travailleurs dans les cas de rupture de la relation contractuelle avec la plateforme, logement, VAE, CPA. Complément indispensable de cet engagement, un contrôle effectif nécessaire devrait pouvoir être instauré lorsque ces services transitent par des plateformes uniques de gestion.
Cette obligation doit être nécessairement calibrée pour garantir un niveau de revenu que l’on pressent très inférieur au revenu salarié moyen. Il faut donc imaginer pour ces régimes un socle de droits universels, garanti par les systèmes mutualisés, en priorisant le besoin de formation et de santé.
Est-ce que, dans le fond, la solution n’est pas à chercher dans l’idée d’un socle minimal de droits humains, devant être garantis ici comme ailleurs par les donneurs d’ordres ? Et cela pose la question de l’efficacité de la loi face à des situations extrêmement diverses. Il faut bien qu’elle se recentre sur des droits universels et sur la reconnaissance de nouvelles fonctions économiques. Là, nous reviendrions à la vocation fondamentale de la loi, grâce à des évolutions modernes non moins fondamentales du travail.
Voilà pour moi les pistes d’une nouvelle légitimité du paritarisme par une révolution copernicienne, face à une société française devenue plus complexe : un État pivot, un Parlement porteur de sens, un champ social élargi, un espace transversal de négociation, une intransigeance de l’évaluation par la représentation nationale et un socle de droits humains minimaux.
Remettons l’homme au centre de notre projet de démocratie sociale, bien avant les statuts et les représentations statutaires… et parfois statufiées.
Notre modèle social est en train de se transformer. Mais il est pas à bout de souffle. Le Parlement doit anticiper ces mutations, conformément aux compétences que lui reconnaît la Constitution. Il est indispensable que le pays se fixe des objectifs de long terme, avec une vision d’ensemble, parce que de grands horizons doivent s’ouvrir à un paritarisme attaché aux personnes.
Ce travail doit être engagé.
Mal connu des Français, souvent critiqué injustement, difficile à définir pour les universitaires spécialistes des questions sociales, le paritarisme méritait que la représentation nationale s’intéresse à cette forme de gouvernance à la fois si spécifique et si importante.
Le fait que des représentants des salariés et des employeurs, comptés en nombre égal, se réunissent pour créer de la norme, pour l’interpréter et pour gérer les institutions et les droits qui en sont issus est un procédé aussi simple à comprendre que difficile à mettre en œuvre. Fort naturellement, il suscite aussi beaucoup de questions : ces acteurs sont-ils vraiment légitimes pour prendre en charge une partie des politiques publiques ? Quelle autonomie l’État peut-il leur laisser dès lors que les enjeux financiers dépassent les seuls intérêts des entreprises et des salariés et concernent la nation tout entière ? Comment s’assurer que les systèmes paritaires sont gérés dans l’intérêt de tous et conservent la capacité de se réformer ?
Le paritarisme est d’autant plus difficile à appréhender qu’il échappe en grande partie à toute doctrine et à toute conceptualisation. La meilleure façon d’analyser le paritarisme reste alors de le prendre tel qu’il est, à savoir une réalité politique, sociale et institutionnelle construite de façon pragmatique tout au long du XXe siècle.
Le paritarisme résiste aussi à toute approche simplificatrice du modèle social français. Alors que la France est parfois hâtivement dépeinte comme le lieu du conflit social permanent et d’une étatisation excessive – quand ce n’est pas prédatrice –, il s’avère que notre pays a confié près d’un quart de sa protection sociale, 150 milliards d’euros, aux représentants des salariés et des employeurs parce qu’ils semblaient les mieux à même de s’occuper de certains sujets touchant à la vie de tous les jours, pour le salarié et sa famille : les retraites complémentaires, le chômage, la prévoyance, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou l’insertion des personnes handicapées sont aujourd’hui l’affaire des partenaires sociaux au moins autant que de l’État.
Le vocable d’« organismes paritaires » renvoie à un nuancier très riche qui va d’institutions indépendantes et autonomes, créées et gérées sans l’État, regroupant près de 100 000 salariés, jusqu’à des systèmes légaux très encadrés. Tous ont cependant en commun de faire une place importante, dans leur gouvernance, à des mandataires volontaires et compétents issus des organisations professionnelles. Ce sont eux qui font vivre la démocratie sociale tous les jours dans les négociations d’entreprise, de branche ou interprofessionnelles ainsi que dans les conseils d’administration.
La mission a pu constater que, partout où les partenaires sociaux se sont vus confier ou se sont saisis de véritables responsabilités, cette confiance dans des corps intermédiaires pourtant très critiqués s’est traduite par une gestion consensuelle et sérieuse des cotisations des salariés et des employeurs.
Le paritarisme ne mérite donc pas les critiques injustes et caricaturales dont il est souvent l’objet. Pour autant, il est vulnérable à certaines faiblesses structurelles dont rend compte le panorama qu’a dressé la mission. Produit de circonstances historiques, le système paritaire est un ensemble hétérogène qui doit affronter les défis nouveaux posés par les transformations structurelles que connaissent les économies des pays industrialisés. Or, aujourd’hui, chaque acteur remplit très correctement la mission qui lui est confiée, mais aucun ne s’interroge suffisamment sur la cohérence de l’ensemble.
Le risque est alors de voir délégitimé un système qui a néanmoins fait ses preuves et qui reste un pilier de notre système national de protection sociale. Ce risque est bien plus inquiétant que ne le sont les débats récurrents sur la qualité de la gestion paritaire, mais sa réalisation n’a rien d’inéluctable à condition de se donner les instances qui permettront de décloisonner les politiques publiques gérées paritairement.
De même, il n’y a pas de fatalité dans la difficulté pour le paritarisme à prendre à bras le corps les questions liées à l’économie numérique alors que l’émergence de celle-ci – qui bouscule tout à la fois les modèles de l’entreprise, du salariat, et des relations sociales qui se sont construites sur ces prémisses – soulève des questions auxquelles le paritarisme peut apporter des réponses. Il faut en effet construire une régulation qui fasse échapper le « travailleur des plates-formes » au face-à-face individuel avec un donneur d’ordres algorithmique déshumanisé, sans pour autant brider un secteur naissant dont on apprécie encore mal le potentiel créateur d’emplois mais dont on perçoit déjà la capacité à répondre aux aspirations d’autonomie qui animent nombre de nos concitoyens.
Le présent rapport a donc cherché à présenter le paritarisme sous toutes ses formes et dans toute sa complexité, à brosser un panorama inédit dans son exhaustivité et dans sa précision, en attendant les documents plus complets et plus réguliers que pourraient réaliser les services de l’État dans les années à venir, documents qui pourraient être joints au projet de loi de finances annuel sous la forme d’un « jaune budgétaire », à l’instar de ce qui existe déjà par exemple en matière de formation professionnelle.
Puisqu’on ne comprend bien le paritarisme qu’à la lumière de sa dimension historique, le rapporteur a consacré des développements nourris à celle-ci : l’un d’eux, au début du rapport, présente une histoire globale qui conduit jusqu’aux années 1945-1947, les autres, intégrés aux développements thématiques, peuvent faire référence à des faits remontant au début du XXe siècle ; les recouvrements qui s’ensuivent ont paru au rapporteur moins gênants que ce qu’aurait été la fracture artificielle résultant d’un découpage chronologique strict.
Le présent rapport appelle à donner au paritarisme – dont l’objet même a toujours été de rapprocher, autour d’une discussion commune et par une gestion commune, des acteurs aux intérêts antagonistes – de nouvelles instances et une nouvelle architecture visant à inscrire les partenaires sociaux dans un projet d’ensemble et à favoriser les conditions de la négociation en lui donnant un cadre permanent, cohérent et transparent.
1) Le rapport propose, en premier lieu, de créer, comme clé de voûte de cette nouvelle architecture, un Haut Conseil de la Négociation Collective et du Paritarisme.
Ce Haut Conseil comprendrait quatre commissions permanentes :
– protection sociale et vie quotidienne (retraites complémentaires, prévoyance, logement, etc.),
– sécurité sociale professionnelle (emploi, chômage, formation, santé et qualité de vie au travail, etc.),
– nouvelle économie (numérique, plateformes collaboratives, écologie, etc.),
– contrôle et évaluation (contrôle, évaluation, recherche, formation des acteurs, financement du paritarisme, etc.)
Véritable Chambre Haute sociale, ce Haut Conseil serait le lieu des négociations interprofessionnelles sur saisine de l’État, du Parlement ou auto-saisine. Les projets et propositions de loi concernant le droit du travail feraient l’objet d’une concertation étroite entre les deux chambres du Parlement et le Haut conseil, tout au long de la procédure parlementaire, qui pourrait prendre la forme d’auditions réciproques entre les commissions concernées du Haut conseil et les commissions du Parlement saisies de ces projets ou propositions.
2) Le rapport préconise également la création d’un Institut des Hautes études du dialogue social (IHEDS).
Conçu sur le modèle de l’Institut des Hautes études de défense nationale (IHEDN), il aurait pour mission de diffuser la culture de la négociation dans le monde économique, administratif, associatif ou politique. Il pourrait être rattaché au Haut Conseil de la Négociation Collective et du Paritarisme.
3) Le rapport appelle ensuite les acteurs du paritarisme et les pouvoirs publics à se saisir sans délai d’une profonde réforme du paritarisme dans les domaines liés à l’emploi et la formation.
Il s’agirait d’adapter le système pour le faire passer d’une logique de statut (salarié, chômeur, indépendant, etc.) à une logique de parcours. La création par les partenaires sociaux du droit individuel à la formation (DIF) ou du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) a été un premier pas en ce sens.
Un objectif prometteur pourrait être la création, à terme, d’une Agence Nationale de Sécurité Sociale Professionnelle, régime unique de sécurité sociale professionnelle accessible aux salariés aussi bien qu’aux chômeurs et autres actifs, qui serait chargée de gérer et d’adapter les droits – en commençant par ceux attachés au compte personnel d’activité (CPA) –, comme d’accompagner la progression professionnelle de chacun.
Gérée paritairement, territorialisée, elle articulerait son rôle avec celui de l’État – et des régions, dans les domaines qui leur sont propres – par un système de conventions d’objectifs et de gestion.
4) Le rapport préconise en outre la création d’une Banque paritaire du Temps, qui serait naturellement l’un des champs d’extension du paritarisme.
La gestion des temps tout au long de la vie est l’un des enjeux importants de nos sociétés, marquées par une double aspiration à des libertés individuelles dans le cadre de garanties collectives. Le compte épargne temps comme les journées de RTT ont constitué des avancées en ce sens. Elles méritent d’être prolongées en permettant leur portabilité d’une entreprise à l’autre. Les syndicats de salariés ont défendu l’intégration du compte épargne temps au CPA, les organisations d’employeurs se sont inquiétées des conséquences pour les entreprises, notamment les plus petites ; la mutualisation via cette Banque paritaire du Temps pourrait être le chaînon manquant qui satisferait les attentes des uns et apaiserait les inquiétudes des autres.
5) Dans le domaine de la prévoyance et des complémentaires santé, le rapport appelle les pouvoirs publics et les partenaires sociaux à la constitution progressive, à partir des branches professionnelles, d’un Régime Paritaire de Sécurité Sociale Complémentaire comparable au régime de retraites complémentaires.
Il s’agirait, dans un premier temps, de trouver une voie juridiquement viable au regard du droit constitutionnel et du droit européen pour éviter que la suppression des clauses de désignation ne se traduise par une montée des inégalités en matière de couverture complémentaire, couverture qui prend de plus en plus de place dans notre pays. Une piste serait d’introduire, en droit national, comme proposé par plusieurs spécialistes, un nouvel instrument juridique, la convention collective de sécurité sociale complémentaire, qui permettrait aux branches professionnelles, au motif de la solidarité, d’établir un régime de prévoyance étendu à toutes les entreprises de leur secteur.
6) Dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, le rapport propose la présence d’au moins un tiers de représentants des salariés dans les conseils d’administration dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés
La participation des salariés aux décisions de gestion des entreprises est fondamentale. La loi de sécurisation de l’emploi a constitué un progrès en prévoyant la présence obligatoire d’un salarié dans les entreprises de plus de 5000 salariés. Il convient de généraliser cette pratique. Le conseil d’administration pourrait également, dans les entreprises de plus de 5000 salariés, comprendre un administrateur issu de la branche professionnelle comme c’est le cas chez nos voisins allemands.
7) Enfin, le rapporteur appelle à l’organisation sans délai d’une « COP 21 du numérique ».
Les acteurs de paritarisme, comme l’ensemble des décideurs publics, doivent se saisir davantage des questions posées par l’émergence des nouvelles formes de travail liées au numérique.
Chacun constate des évolutions majeures, parfois extrêmement rapides, aux conséquences potentiellement lourdes pour les ressources des systèmes sociaux comme pour les droits des travailleurs, et, en face, la réaction plutôt lente des acteurs – à commencer par la connaissance même du phénomène, que la statistique publique n’est toujours pas en mesure d’appréhender correctement.
Afin de mobiliser le pays autour de cet enjeu, le rapport invite les pouvoirs publics à organiser une « COP 21 du numérique », conférence permanente dans un processus impliquant étroitement l’ensemble des acteurs concernés à l’image de ce qui se pratique désormais en matière d’environnement.
*
* *
À l’heure où s’est constituée la mission d’information sur le paritarisme, ses membres étaient loin d’imaginer qu’ils auraient à conduire leurs réflexions dans une France secouée par d’importants mouvements sociaux et que ceux-ci seraient toujours en cours au moment d’en dresser les conclusions.
L’objectif était à la fois descriptif et prospectif : dresser un état des lieux le plus complet possible du paritarisme, qui n’existait pas jusqu’ici, pour comprendre ; et, partant, tracer des perspectives d’évolution pour mieux répondre aux enjeux de notre époque. Le climat social n’a en rien modifié notre feuille de route mais a renforcé notre double conviction : le paritarisme est plus que jamais nécessaire ; le paritarisme doit plus que jamais se réformer.
Il n’est pas raisonnable de vouloir remettre en cause le paritarisme alors qu’il constitue, comme corps intermédiaire légitimement organisé, l’un des ciments de la société française et qu’il a globalement, comme mode de gestion, atteint sa maturité institutionnelle dans tous les domaines qu’il a progressivement investis.
Mais penser le paritarisme comme perpétuation d’un système figé, morcelé, sans vision ni pilotage global, au risque de rester inerte face aux mutations du travail et sans prise sur l’avenir, serait le condamner sans merci.
C’est le sens des propositions qui sont faites ici, et qui se veulent un hommage au paritarisme et un acte de confiance envers ceux, syndicats de salariés, organisations d’employeurs, qui le font vivre et qui sont si nécessaires à notre vie démocratique.
PREMIÈRE PARTIE
–
LE PARITARISME : UN MODE DE GOUVERNANCE ORIGINAL GÉRANT UN QUART DE LA PROTECTION SOCIALE EN FRANCE
À la question : « Qu’est-ce que le paritarisme ? », M. Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail (2), a répondu, lors de son audition, que « dans le sens que nous lui attribuons, le mot n’apparaît pas avant 1961. Avant cela, le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse le définit comme un “système qui consiste à traiter tous les cultes sur un pied d’égalité”. […] C’est le 19 avril 1961 qu’André Bergeron, qui venait de créer l’Unédic, écrit dans le journal de la CGT-FO que l’assurance chômage est “un succès qu’il faut porter au compte du paritarisme”. Le mot “paritarisme” est donc lancé, mais, comme souvent, il n’est pas défini. » (3)
Les travaux de la mission ont effectivement conduit à un constat plutôt surprenant : bien que le paritarisme soit le mode de gouvernance de près d’un quart de la protection sociale en France, il reste complexe à cerner.
Il est vrai que le paritarisme, qui s’est développé dans les domaines du logement, de l’assurance-chômage, de la protection sociale ou encore de la formation professionnelle relève largement d’une construction empirique. Comme l’a expliqué M. Laurent Duclos, sociologue, lors de son audition, la fragilité théorique de l’édifice n’a pas empêché « la multiplication des formes de gouvernement paritaire » (4).
I. LA NOTION DE PARITARISME EN FRANCE : UNE DÉFINITION COMPOSITE ISSUE D’UNE HISTOIRE SINGULIÈRE
Construction juridique relativement récente et largement empirique, le paritarisme, tel qu’il existe aujourd’hui en France, semble résister à toute tentative de conceptualisation. Les raisons sont à rechercher dans l’histoire de notre système de négociation et de protection sociales avant 1945, marquée par les rapports tourmentés entre l’État et les corps intermédiaires.
A. LE PARITARISME : UNE RÉALITÉ INSTITUTIONNELLE SANS VÉRITABLE DOCTRINE
M. Laurent Duclos écrit dans sa thèse consacrée au paritarisme d’institution que « la doctrine sociale ou le système politique auxquels le mot “paritarisme” paraissait faire référence […] ne formaient pas un plan d’énonciation suffisamment robuste pour procurer au procédé paritaire un fondement unitaire, étayer et normaliser, de ce fait, l’ensemble des pratiques sociales » (5). Les travaux de la mission ont confirmé qu’il n’existe pas de définition précise et partagée de ce que recouvre le paritarisme.
Aussi, si l’on peut trouver des sources intellectuelles communes, le paritarisme français est employé pour qualifier des réalités institutionnelles très hétérogènes et ne trouve pas véritablement d’équivalent ailleurs dans le monde.
1. Les fondements intellectuels du paritarisme
La notion du paritarisme est difficile à délimiter, au-delà du fait que son étymologie renvoie au latin « pars » qui signifie « en nombre égal ». M. Laurent Duclos esquisse cependant, dans sa thèse, une définition éclairante, qui le présente comme « un procédé visant à structurer, par l’agencement d’intérêts distincts et organisés, le rapport capital/travail pour en associer la représentation à la production de biens collectifs ou de règles établies dans l’intérêt général ». Discutable comme le sont les nombreuses tentatives de définition qui ont été proposées à la mission, celle-ci a le mérite de tracer des contours nets : le paritarisme a pour objectif de confier une partie de l’action publique aux partenaires sociaux, conçus comme les corps intermédiaires les plus adéquats pour gérer certains enjeux d’intérêt général. Il ne s’agit cependant pas dans son esprit d’une doctrine mais bien d’un « procédé » juridique.
a. Le paritarisme s’appuie sur une certaine conception des corps intermédiaires
Entrer en paritarisme suppose en effet de reconnaître l’existence d’intérêts privés à la fois antagonistes et légitimes à dépasser eux-mêmes leur antagonisme pour produire de la norme. Ce présupposé explique d’ailleurs largement les rapports distants qu’a longtemps entretenus l’État à ce mode de gestion, dont la partie B qui suit présente le contexte et les évolutions. Cette conception repose en effet sur l’idée que les représentants des intérêts du capital et les représentants des intérêts du travail, associés à parité, sont susceptibles de se substituer efficacement à la puissance publique pour produire des « biens collectifs » ou mettre au point des « règles établies dans l’intérêt général », selon les termes de M. Laurent Duclos. Lors de son audition, M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière (FO), a ainsi estimé que le paritarisme assurait « une indépendance des champs concernés, que ce soit l’assurance chômage, les retraites complémentaires ou d’autres, par rapport au domaine législatif. C’est un outil de responsabilisation des syndicats qu’ils soient de salariés ou patronaux » (6).
Le paritarisme repose une conception de l’intérêt général très différente de la pensée classique française issue de la Révolution. Ses sources doivent être davantage recherchées dans le principe de subsidiarité ou dans une sorte de corporatisme (7). D’ailleurs, les partenaires sociaux auditionnés ont souvent justifié leur intervention en matière de négociation et de gestion par une connaissance du monde du travail supérieure à celle de l’État, valorisée dans le cadre d’un « circuit court » plus efficace que les structures et les procédures de l’État dans les domaines concernés.
b. Le fondement juridique du paritarisme est le droit contractuel
Le paritarisme est un procédé juridique reposant sur le droit privé, et plus précisément le droit des conventions. Comme l’ont rappelé nombre de représentants des organisations professionnelles auditionnées, un régime paritaire est en principe issu d’un accord collectif. M. Jean-Claude Mailly a ainsi posé le principe selon lequel « d’un côté, il y a ce qui relève de l’État ; de l’autre, il y a le contrat sur lequel nous avons un pouvoir de négociation et de gestion dans le cadre d’un système paritaire ». C’est d’ailleurs ce qui fait dire à certains que la négociation qui précède l’accord fait partie intégrante du paritarisme.
Il s’agit cependant très souvent, en pratique, notamment en France, d’un droit privé aménagé pour tenir compte à la fois d’enjeux sociaux et économiques considérables, qui dépassent le seul champ des intérêts des partenaires engagés dans une démarche paritaire, et du fait que ces partenaires interviennent parfois dans un champ où ils sont délégataires de l’État.
2. Le paritarisme français : d’une pluralité de définitions à une définition plurielle
Le mot « paritarisme » est plutôt récent puisqu’il a été forgé et popularisé par M. André Bergeron en 1961 pour qualifier le mode de gouvernance créé pour l’Unédic. Le patronat semble quant à lui avoir dans un premier temps préféré l’expression « dispositif paritaire » (8). Initialement utilisé pour qualifier les systèmes de protection sociale négociés et gérés par les partenaires sociaux, il est parfois devenu un synonyme ou une actualisation des expressions « démocratie sociale » (9) ou « dialogue social » (10). Il doit néanmoins se distinguer de ces conceptions qui seraient plus larges et moins arithmétiques du rôle des syndicats, de sorte qu’il faudrait plutôt considérer que le paritarisme en est une déclinaison particulière : comme l’a indiqué M. Éric Aubin, membre de la commission exécutive confédérale de la Confédération générale du travail (CGT), « le paritarisme fait partie du dialogue social, comme le dialogue social fait partie de la démocratie sociale » (11).
M. Olivier Mériaux, directeur général adjoint et directeur scientifique et technique de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), a opéré une distinction entre le « paritarisme au sens strict » et le « paritarisme au sens large ». Selon lui, le « paritarisme au sens strict », dans sa forme « chimiquement pure », « est une technique de gestion des garanties collectives, qui s’opère dans des instances où employeurs et salariés sont représentés à parité » et qui « se retrouve dans la gestion des retraites complémentaires » (12).
En revanche, « dans un sens plus large, le paritarisme englobe toutes les formes de gestion où participent employeurs et salariés, travaillant ensemble à la production de normes et à la gestion des garanties collectives. Cela inclut la concertation, […] la négociation collective, les relations collectives de travail et les instances de représentation paritaire ».
S’il est opportun de distinguer le paritarisme d’autres notions voisines, cela ne permet pas pour autant de lui donner un contenu précis. Technique institutionnelle plutôt que concept politique, le paritarisme ne fait pas l’objet d’une élaboration doctrinale particulière au sein des organisations syndicales. Certaines organisations lui proclament un fort attachement, comme la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et Force Ouvrière – M. Jean-Claude Mailly a ainsi rappelé que son organisation était « quasiment génétiquement attachée à ce mode de gestion » tandis que M. Philippe Louis, président de la CFTC, a indiqué que son organisation pouvait légitimement « revendiquer d’être à l’origine » (13). La plupart des autres organisations de salariés ont une approche similaire.
Pour sa part, la CGT estime que « le paritarisme de gestion au sens propre du terme peut se justifier lorsque les fonds à gérer sont issus du travail et qu'ils financent des prestations à destination des salariés dont les intérêts sont partagés entre employeurs et salariés », ce qui est le cas de la formation professionnelle. Cependant, « la question doit se poser différemment pour des fonds issus du fruit du travail et finançant des prestations au seul bénéfice des salariés. Dans ce cadre, le collège représentant les bénéficiaires devrait bénéficier d'un poids prépondérant dans les décisions de gestion » (14).
Du côté des organisations patronales, le rapporteur relève que M. Michel Guilbaud, directeur général du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), déclarait à propos de son organisation : « Il existe bien sûr des débats internes au MEDEF. Nos doutes peuvent venir du sentiment que les partenaires ne vont pas réussir à s’entendre. […] Saurons-nous être à la hauteur de nos responsabilités sur certains enjeux structurels ? […] Ce débat existe donc chez nous comme il existe au sein de la société, et il peut donc y avoir des tendances sceptiques à l’égard du paritarisme au sein du MEDEF comme au sein de toutes les organisations. Il n’y pas d’attachement idéologique viscéral au paritarisme, cela n’aurait pas de sens. Le paritarisme a du sens s’il est légitime. » (15)
Ces positions sont donc à la fois un héritage historique et le reflet d’une conception des rapports sociaux, mais aucune organisation n’a engagé de réflexion majeure sur le sujet ces dernières années. Les auditions conduites par la mission ont montré qu’elles ne partagent pas une acception unique de la notion de paritarisme et par conséquent, du champ de celui-ci. Des désaccords existent en effet sur la présence ou non de la négociation dans le paritarisme, sur le rattachement du paritarisme aux seules questions relevant du contrat de travail, sur la différence à faire entre un vrai paritarisme et un « paritarisme de figuration », selon les mots de M. Claude Tendil, président de la commission Protection sociale du MEDEF lors de l’audition du 3 décembre 2015, etc.
Aux dires des spécialistes consultés, la recherche s’est également assez peu intéressée à ce sujet spécifique, notamment sur la période récente, avec ces quelques exceptions notables que sont les travaux de science politique de MM. Renard et Pollet dans les années 1990, et de sociologie de M. Laurent Duclos dans les années 1990 et 2000.
Souvent évoqué dans les médias à l’occasion de problèmes ponctuels liés à la gestion ou à l’équilibre financier d’instance paritaires, le paritarisme a fini par se donner des définitions officielles dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme, qui visait précisément à mettre fin à ces difficultés :
« La notion de paritarisme peut recouvrir plusieurs acceptions :
« – la négociation collective, dont l’objet est de fixer entre partenaires sociaux (représentants des salariés et des employeurs) les normes applicables aux salariés et aux entreprises, liées à l’existence d’un contrat de travail ;
« – la gestion paritaire des normes issues de la négociation collective ;
« – l’interprétation de ces normes »
Cette pluralité de définitions, assumée par la mission pour conduire ses travaux, a le mérite de n’exclure aucune forme de paritarisme et de mettre en relief les différents rôles qu’assurent les organes paritaires. La typologie « paritarisme de gestion / paritarisme de négociation » a d’ailleurs été utilisée par la plupart des personnes auditionnées et semble largement admise. Le rapporteur rappelle cependant que d’autres modes d’action peuvent relever du système paritaire : pour rendre compte de l’organisation et des activités de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et du réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), M. Hervé Lanouzière, directeur général de l’ANACT, mettait en exergue la notion de « paritarisme de projet » (16).
3. Le paritarisme français est sans équivalent en Europe
Le mot de « paritarisme » ne connaît pas véritablement d’équivalent dans le monde. On trouve des termes proches comme codetermination en anglais ou Mitbestimmung en allemand, mais ils correspondent plutôt à ce que nous appellerions « cogestion ». Cette singularité n’est pas uniquement terminologique : il n’existe pas à l’étranger de système véritablement similaire en termes de « partage de l’action publique », même si certains éléments s’en rapprochent. S’il est difficile de présenter exhaustivement tous les systèmes qui ont des points communs avec le paritarisme français, il est possible de faire un tour d’horizon sommaire de quelques partenaires européens pour en montrer les similarités mais surtout les différences, notamment grâce aux éléments transmis par l’Association Travail Emploi Europe Société (ASTREES) (17).
Au Royaume-Uni et dans tous les pays d’Europe centrale (18), c’est l’État qui gère les systèmes de protection sociale. Il existe cependant dans ces pays souvent libéraux des fonds de pension gérés par les partenaires sociaux.
Dans de nombreux pays, les partenaires sociaux gèrent certains risques comme les accidents du travail en Espagne (Mutuas), l’assurance chômage de base en Suède, le conseil et la protection juridique des chambres du travail en Autriche, les mutuelles ouvrières en Belgique. On peut noter qu’il ne s’agit pas de paritarisme à proprement parler puisque ces systèmes sont gérés par les syndicats. En Finlande, en revanche, les 32 fonds d’assurance-chômage créés en 1998 sont paritaires.
De nombreux régimes de retraite – souvent complémentaire – sont issus de la négociation collective et prennent la forme de fonds de pension, comme aux Pays-Bas.
Traditionnellement, la santé et la sécurité au travail sont des terrains d’élection des associations professionnelles, comme les Berufsgenossenschaften en Allemagne qui sont strictement paritaires (19). En Finlande, le centre de sécurité au travail est géré par les partenaires sociaux et les assureurs.
Enfin, le modèle italien se rapproche du modèle français en matière de formation (notamment au regard de la collecte) et il existe au niveau régional des institutions « bilatérales » créées par les partenaires sociaux du secteur de l’artisanat pour rendre des services à la fois aux entreprises (emploi et maintien dans l’emploi, formation, accès au crédit) et aux salariés (soutien en période de chômage, prestations financières complémentaires en matière de congé parental).
Le modèle suédois de protection sociale :
un recul de l’État compensé par des syndicats puissants
La mission a eu l’occasion de se rendre en Suède. Le rapporteur a pu constater que le modèle suédois laisse une véritable autonomie à des grands syndicats historiques dans le domaine du chômage et des prestations complémentaires. Cette bonne couverture des Suédois a permis d’absorber le recul de l’État sur les régimes de base.
La construction d’un syndicalisme puissant…
La Suède a connu à la fin du XIXe siècle un développement très important de son industrie qui s’est traduit sur le plan social par des conflits extrêmements difficiles dans un pays qui était alors très inégalitaire. Patronat et ouvriers se sont rapidement organisés pour créer au début du XXe siècle des organisations puissantes capables de négocier. Après plusieurs décennies de tentatives plus ou moins fructueuses pour mettre fin aux cycles de grèves suivies de mises à pied, les Suédois ont conclu un accord sur lequel repose encore leur modèle social : l’accord de Saltjösbaden du 20 décembre 1938, qui prévoit que les syndicats renoncent à leur droit de grève tant qu’un accord négocié sur les salaires et les conditions de travail est en vigueur.
Cette transaction historique a permis au patronat d’obtenir une paix sociale largement préservée en échange d’une amélioration progressive du niveau de vie des salariés. Le syndicalisme suédois a pu utiliser les fonds considérables constitués en vue de rémunérer les salariés grévistes pour développer une offre de services importante : accès à des fonds d’assurance chômage, accès à des prestations complémentaires, conseil juridique et accompagnement dans l’emploi.
Le paysage syndical suédois se caractérise donc par la présence de trois confédérations puissantes : LO pour les « cols bleus », SACO et TCO pour les « cols blancs ». Ces organisations possèdent des moyens très importants issus quasi-exclusivement des cotisations de leurs adhérents. Le taux de syndicalisation est le plus élevé d’Europe, même s’il tend à diminuer. Le patronat est représenté principalement par une organisation : SN.
… qui a absorbé le recul de l’État
La plupart des systèmes de protection sociale en Suède reposent sur trois piliers (20) : le premier pilier est formé par les prestations de base versées par l’État, qui sont généralement assez modestes. Le second pilier représente les prestations qui ont été négociées collectivement et qui constituent une part importante, voire très importante, des aides ; on estime que 90 % de la population bénéficie de cette couverture collective. Enfin, le troisième pilier correspond à l’assurance privée individuelle.
Depuis les années 1990, le système suédois a évolué vers une réduction des prestations de base versées par l’État, celle-ci étant cependant compensée par le développement du deuxième et du troisième pilier. Ainsi, le système d’assurance-chômage de base (21) est moins généreux qu’en France mais les assurances complémentaires dont bénéficie une large majorité de la population sont très avantageuses, y compris au regard des règles de l’Unédic.
De même, la grande réforme des retraites conduite entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000 – qui s’est accompagnée d’une amélioration sensible de la qualité du service rendu (22) – a conduit à une baisse effective des retraites de base, cependant compensée par des retraites complémentaires négociées. Les syndicats rencontrés ont indiqué regretter que les gouvernements successifs aient réduit les avantages liés aux régimes de base mais il faut constater que leur rôle en a été renforcé puisqu’un bon niveau de couverture dépend désormais très largement de leur capacité à négocier et des services qu’ils rendent aux salariés.
La Suède illustre ainsi l’absence de lien entre la puissance des syndicats et l’existence d’un paritarisme « à la française ». En effet, il n’y existe pas ce « partage de l’action publique » qui caractérise le modèle français mais une distinction entre deux espaces de solidarité bien distincts : un espace étatique de protection obligatoire de base et un espace privé de prestations complémentaires négociées par les partenaires sociaux mais gérées par des assurances, banques, mutuelles, etc. partenaires ou propriété des grands syndicats.
Trois conclusions peuvent être tirées de ce bref éclairage européen :
– Il n’y a pas de lien entre l’intensité de la négociation collective et le fait de confier des régimes de protection sociale aux partenaires sociaux.
– Les partenaires sociaux des autres pays européens gèrent souvent des systèmes purement privés (mutuelles, fonds de pension, services divers), rarement paritaires – c’est-à-dire avec un nombre égal de représentants patronaux et syndicaux –, là où en France il s’agit de services privés mais investis d’une mission d’intérêt général.
– Même dans les pays où existe une forme de paritarisme, il n’est pas aussi étendu qu’en France en termes de risques pris en compte et de montants gérés.
Cette comparaison donne également du relief à une faiblesse structurelle du paritarisme français : l’ampleur des responsabilités confiées aux partenaires sociaux se heurte à la faiblesse du taux de syndicalisation, utilisée pour mettre en question leur légitimité à assurer ces importantes fonctions de gestion. Dans la mesure où le rapporteur souhaite voir le paritarisme se renforcer, avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles perspectives, il estime qu’il est urgent d’accompagner cette évolution des responsabilités exercées d’une action tendant à renforcer l’adhésion. De ce point de vue :
– Le syndicalisme de service, qui relève d’une dimension « utilitariste » de l’adhésion, a fait ses preuves dans les pays scandinaves ou en Belgique mais il a le défaut d’ériger une nouvelle frontière entre ceux qui sont syndiqués et ceux qui ne le sont pas, frontière jugée contraire à l’idéal égalitaire de la République dès les origines du syndicalisme.
– Le chèque syndical, qui permet de financer l’organisation de son choix à partir de fonds dédiés par l’entreprise à cet usage, est une piste souvent évoquée. Il fait l’objet de critiques du patronat. Une variante existe avec la prime syndicale en Belgique, grâce à laquelle le salarié récupère une partie des fonds alloués par l’entreprise au syndicat choisi.
– Le vote obligatoire aux élections syndicales, privilégié par le rapporteur, pourrait donner davantage de force à cette mesure d’audience très importante.
La place singulière qui, en France, est reconnue au paritarisme – tant au regard de son étendue financière que de sa fréquente institution en « puissance publique déléguée » – est en partie éclairée par l’histoire de sa construction, reflet des rapports souvent tourmentés entre l’État et les corps intermédiaires.
B. LE PARITARISME : UNE HISTOIRE SINGULIÈRE, REFLET DES RAPPORTS TOURMENTÉS ENTRE L’ÉTAT ET LES CORPS INTERMÉDIAIRES
Pour soutenir son autorité contre celle des seigneuries féodales et ecclésiales, l’État royal s’était associé, en leur déléguant son autorité juridictionnelle, aux conventions collectives entre professionnels qui suppléaient, en ville, depuis le XIIe siècle, l’entraide familiale dans le partage du travail et la charité paroissiale dans la réparation des malheurs.
En réglant, par métier, les formations d’apprentis, les embauches d’aides ainsi que la nature et le tarif des prestations d’art, les corporations établissaient la nomenclature des professionnels, aucun métier ne pouvant empiéter sur un autre. Par ailleurs, leurs confréries partageaient tacitement les marchés locaux entre leurs membres et assuraient leurs familles contre les pertes de revenu accidentelles.
Par la suite, de la Révolution jusqu’au milieu du XXe siècle, l’État reste réservé à l’égard des solidarités professionnelles, préférant le mutualisme et le patronage au syndicalisme.
a. À la Révolution française, l’État-nation interdit les corporations
S’étant uni à la Nation en 1789 au nom d’un contrat social putatif qui interdit les corps intermédiaires susceptibles de s’interposer entre le citoyen et la Nation, l’État abolit les corporations, se déclare seul responsable du secours aux indigents et, mettant fin à la délégation de son autorité juridictionnelle, s’érige en juge unique de contrats qui ne peuvent plus être associatifs mais transactionnels.
L’article 16 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire supprime le privilège de juridiction des corporations. L’article 10 du titre III renvoie au juge de paix et à ses deux prud’hommes assesseurs le contentieux du paiement des salaires et de l’exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
L’année suivante, la loi dite « d’Allarde » des 2 et 17 mars 1791 abolit les qualifications professionnelles par lesquelles les corporations limitaient le nombre de leurs membres. L’article premier de cette loi dit qu’il sera libre « à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ». Le même article libère les engagements pris entre maître et employés des obligations collectives imposées par leurs corporations en déclarant que « chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés. »
Pour inciter employeurs et employés à se faire individuellement concurrence au lieu de se répartir collectivement les commandes ou le marché local, la loi des 14 et 17 juin 1791 relative aux assemblées d’ouvriers et artisans de même état et profession, dite « Le Chapelier », prohibe la discipline syndicale. Elle déclare que « l’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. »
En vertu de l’article 2, « les citoyens d’un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. »
L’article 4 prive de tout effet ce que l’on appellerait aujourd’hui une entente : « si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme, et de nul effet ; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. »
Les corporations supprimées, la loi confie la police des arts et des manufactures qu’elles assuraient à l’État, qui l’assure par l’enregistrement individuel des travailleurs indépendants en contrepartie du paiement annuel d’une patente.
La loi ne prévoit pas de sanction pénale contre les accords passés entre travailleurs indépendants pour limiter leur concurrence. Elle prive seulement de commandes publiques ceux qui s’abandonnent à des ententes illicites. La libéralisation des arts, celle des installations et des échanges commerciaux devaient suffire pour intéresser le plus grand nombre à la concurrence plutôt qu’aux anciennes solidarités.
En revanche, pour empêcher les ouvriers qui se présentent à l’embauche de se coaliser et de négocier en corps leur emploi, la loi interdit explicitement que les contrats de travail puissent être collectifs ou faire l’objet d’une négociation collective préalable. Elle réprime pénalement les coalitions syndicales ouvrières qui seraient découvertes, dénoncées ou manifestées par des attroupements séditieux ou des violences collectives. Les articles 19 et 20 de la loi sur la police rurale des 28 septembre et 6 octobre 1791 établissent une répression analogue des coalitions d’ouvriers de la campagne.
Cette répression est relevée par les articles 414 et 415 du code pénal de 1810, qui soumettent à l’agrément du Gouvernement toute association de plus de vingt personnes et punissent les coalitions non agréées par des peines d’emprisonnement. Pour sa part, l’article 416 sanctionne la discipline syndicale ouvrière en punissant « les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres. »
b. L’État-nation n’admet d’arbitrage paritaire que des contentieux individuels de travail et de commerce
La loi d’organisation judiciaire de 1790 avait conservé à des juges-consuls, élus par leurs pairs, le contentieux des contrats de commerce. Après avoir affranchi le contrat de travail individuel des conventions collectives, en apparentant les fabricants aux négociants et les arts au commerce, l’État rend aux intéressés l’arbitrage des différends provoqués par ces contrats.
Une loi du 18 mars 1806 accorde un premier privilège de juridiction à un conseil de prud’hommes élus de Lyon pour « terminer, par la voie de conciliation, les petits différens qui s’élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d’atelier et des compagnons ou apprentis » et assurer la police de leurs métiers. Elle autorise la création de conseils analogues, par décret, dans d’autres villes et pour d’autres professions industrielles. Ils se généraliseront promptement. Elle veille cependant à ce que ces conseils ne puissent poser insidieusement des règlements jurisprudentiels supérieurs aux contrats de travail personnels, en ne permettant pas aux parties de renoncer par avance à faire appel de l’arbitrage au tribunal civil, suivant l’usage admis devant les tribunaux de commerce.
Les conseils de prud’hommes, ouverts dans 75 villes en 1848, deviennent paritaires par deux décrets des 27 mai et 6 juin 1848, amendés par une loi du 1er juin 1853. Ce paritarisme, de justice et non de charité ou de solidarité, reste toutefois une exception au sein du droit du travail français.
c. L’État-nation autorise la reconversion des confréries en sociétés de secours mutuel, à condition que leurs activités n’entravent pas la libre concurrence
Hostile aux corporations qui limitent la concurrence, l’État-nation l’est moins aux sociétés commerciales qui l’exacerbent et aux confréries qui en réparent les dégâts. Les textes qui empêchent la reconstitution d’instances conventionnelles de solidarités professionnelles, nanties d’un privilège juridictionnel ou arbitral, n’interdisent pas celles qui ne procurent qu’une indemnisation des malheurs personnels par la mise en commun d’une épargne.
L’État permet aux confréries de se reconstituer en sociétés philanthropiques, confessionnelles ou de secours mutuel, à condition qu’elles n’aient ni but lucratif, ni rôle arbitral, qu’elles ne promettent que des secours et de l’entraide à leurs membres, lorsqu’ils sont victimes d’un malheur et non de leurs faiblesses concurrentielles – ces deux risques économiques étant, à l’époque, jugés moralement exclusifs –, qu’elles n’indemnisent pas le chômage, tenu pour paresse, et qu’elles ne dissimulent pas sous un objet caritatif des entraides d’incidence politique.
Ces sociétés connaissent un vif succès à la Restauration, du fait d’un moindre contrôle policier sur les associations urbaines. En délicatesse avec la Monarchie de Juillet, qu’elles ont pourtant contribué à porter au pouvoir, elles sont reconnues à part des autres associations agréées après la révolte des Canuts lyonnais, par l’article 6 de la loi du 5 juin 1835 sur les caisses d’épargne, auprès desquelles elles ont été invitées à déposer leurs fonds.
Cet article admet, sans en tirer immédiatement de conséquences, une distinction entre les sociétés de secours mutuel formées d’ouvriers et celles composées d’autres individus, alors que les villes, transformées par l’exode rural et la pauvreté qui l’accompagne, connaissent deux nouvelles révolutions politiques, en février et juin 1848.
Les sociétés de secours mutuel, dont bon nombre ont été compromises dans ces événements, sont replacées sous la tutelle de l’autorité publique. Par une loi du 15 juillet 1850 puis un décret du 26 mars 1852, leur administration est soustraite aux élus des sociétaires pour être confiée à des notables, désignés parmi leurs membres honoraires. Une commission supérieure d’encouragement et de surveillance fait régulièrement rapport de leurs activités aux autorités.
Ce contrôle s’accompagne d’encouragements à réduire une indigence urbaine que les bureaux de bienfaisance confessionnels ou municipaux ne peuvent plus juguler. Les autorités publiques, confrontées à l’agitation politique des villes ouvrières, souhaitent réduire cette indigence sans donner suite aux revendications d’un droit au travail incompatible avec les libertés d’entreprendre, de circuler et de commercer.
Elles estiment que l’activité des sociétés de secours mutuel peut les aider à départir individuellement bons et mauvais ouvriers, en encourageant les premiers à faire preuve de prévoyance collective et en renvoyant les seconds, placés sous une surveillance policière permanente, aux soins des bureaux de bienfaisance.
Elles soutiennent alors, par des subventions, celles dont elles reconnaissent l’utilité publique à compenser le salaire des jours de travail perdus pendant une maladie. D’autres sont admises à verser des pensions en cas de vie, de décès ou d’infirmité, en constituant des caisses de retraite par capitalisation. L’activité de celles-ci est toutefois limitée par avance par la loi du 18 juin 1850 qui a ouvert, à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse de retraites des fonctionnaires depuis 1816, une caisse concurrente des retraites par rentes viagères, alimentée par les revenus de l’épargne individuelle capitalisée de 110 000 déposants en 1860, dont 60 % d’ouvriers (23).
Ces encouragements institutionnels, mesurés, sont bientôt accompagnés d’une reconnaissance légale des solidarités professionnelles. Après l’amnistie des proscrits du coup d’État de 1851, le Gouvernement transige sur les droits de coalition et de grève. La loi du 25 mai 1864, dite « Ollivier », limite les peines prévues par le code pénal de 1810 pour des faits de coalitions ouvrières aux seuls cas de violence, sans autoriser pour autant la conclusion de conventions collectives.
Les encouragements deviennent plus nets après la chute du Second Empire, quand les sociétés de secours mutuel s’engagent en faveur du nouveau régime républicain. Celui-ci leur rend, par un décret du 27 octobre 1870, le droit d’élire le président de leur conseil d’administration. Elles sont même épargnées par la répression de l’insurrection parisienne de 1871, à laquelle certains de leurs membres ont pourtant pris part.
d. Les sociétés de secours mutuel n’affilient pas les ouvriers d’usine des bassins ruraux
En dépit du soutien et des encouragements des autorités publiques, les sociétés de secours mutuel ne sont pas parvenues à attirer tous les ouvriers. Comme l’explique Henri Hatzfeld dans son essai sur l’origine de la sécurité sociale en France (24), ces sociétés répondent par une prévoyance individuelle et volontaire à l’indigence à laquelle sont exposés les travailleurs indépendants et les ouvriers qualifiés en cas d’accident ou de maladie.
Parmi ces derniers, elles ne recrutent que les plus âgés, lorsqu’ils renoncent à se mettre à leur compte, tandis que les plus jeunes, qu’elles n’indemnisent pas en cas de chômage, se convainquent d’échapper aux autres risques couverts et sont peu désireux d’abandonner une part de leur épargne tant qu’ils espèrent quitter le salariat.
Ces ouvriers qualifiés, prompts aux séditions et sensibles aux thèses anarchistes, travaillent dans des manufactures urbaines qui échappent, jusqu’au milieu du XXe siècle, à la concentration industrielle qui les a rapidement résorbées au Royaume Uni mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Suède, tous pays dont la production d’acier et la productivité par actif dépassent celle de la France de 1913.
Hors des manufactures urbaines, quatre secteurs de production seulement se sont industrialisés rapidement en France, avec le concours de l’État : les chemins de fer, les mines, les forges et les filatures, le premier près des grandes gares, les trois autres dans des bassins miniers ruraux. Or, alors que la population active est, encore en 1914, occupée à 40 % aux travaux des champs, les sociétés de secours mutuel, peu implantées dans les campagnes, ne comptent guère d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles.
Les caisses de secours auxquels ceux-ci adhèrent sont des caisses d’assurances créées par deux associations de propriétaires terriens rivales, la Société des Agriculteurs de France et la Société Nationale d’encouragement à l’agriculture, qui obtiennent du Gouvernement, par une loi du 4 juillet 1900, que leurs caisses, qui ne font pas de bénéfices, soient retranchées du registre des sociétés commerciales et assimilées à des caisses patronales. Ces caisses se partageront le monopole de l’affiliation des ouvriers agricoles – rendue obligatoire par un décret du 30 octobre 1935 – avant de s’unir dans une mutualité sociale agricole en 1940.
Ignorées par les populations rurales, les sociétés de secours mutuel ne peuvent prévenir le risque de paupérisme, imputable aux faibles salaires des ouvriers spécialisés par l’industrie, auquel est exposée la main d’œuvre d’origine paysanne, qu’une courte espérance de vie invite moins encore que les ouvriers qualifiés à mutualiser – autrement dit perdre presque certainement – leur peu d’épargne de précaution.
e. Les syndicats ouvriers, légalisés en 1884, restent à l’écart du syndicalisme de services qui procure des assurances sociales aux ouvriers des pays plus rapidement industrialisés
Après la répression de la révolution parisienne de mai 1871, qui décime le mouvement ouvrier, l’installation d’un régime républicain libère l’expression politique des revendications professionnelles. L’État tente de les contenir en autorisant, par la loi du 21 mars 1884, dite « Waldeck-Rousseau », la libre constitution de syndicats professionnels ayant exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
La loi Waldeck-Rousseau abroge la loi Le Chapelier et l’article 416 du code pénal. Elle autorise les syndicats professionnels d’employeurs et d’employés à constituer des caisses spéciales de secours mutuel et de retraite alimentées par les cotisations de leurs membres, en dehors des règles imposées aux sociétés de secours mutuel par le décret de 1852.
Les syndicats ouvriers qui se créent ne saisissent pas l’occasion offerte de concurrencer ces sociétés par une offre d’assurances sociales, alors même qu’ils leurs disputent les ouvriers qualifiés des compagnies et manufactures urbaines, plutôt que les ouvriers spécialisés des usines rurales auxquelles ils n’ont pas accès. Ils s’investissent dans les débats politiques qui animent les bourses du travail et dans la constitution de caisses de grèves révolutionnaires. Ils se fédèrent dans l’espoir, entretenu par le souvenir des révolutions du siècle, d’une grève générale qui confisquerait le capital industriel et financier et permettrait une planification syndicale de la production.
La loi Waldeck-Rousseau n’a donc pas répondu aux espoirs de ses promoteurs. Elle n’a pas détaché les syndicats ouvriers de la lutte politique avant la création d’une Section française de l’Internationale ouvrière en 1905. Elle n’a pas fait naître un syndicalisme de services comparable à celui suscité par les partis sociaux-démocrates des pays d’Europe du nord, plus vite industrialisés, pour consolider leur assise électorale après l’adoption du suffrage universel.
La raison tient à la faible industrialisation de l’économie française et à l’installation des usines hors des villes, ce qui provoque une divergence d’intérêts entre un syndicalisme urbain politisé, essentiellement révolutionnaire, et un prolétariat industriel rural moins enclin aux séditions.
L’autre explication vient du refus de l’État d’accorder aux syndicats, en sus du droit de conduire une grève, celui de la conclure par une convention collective et plus encore – sauf pour les dockers et les ouvriers du livre –, par le transfert au syndicat ouvrier du monopole d’embauche de l’employeur. Ces clauses conventionnelles, admises par le droit de common law, permettent aux syndicats d’entreprise et de branche de cogérer avec les propriétaires du capital industriel leurs intérêts communs. Elles ont permis aux syndicats ouvriers anglais, américains, scandinaves, allemands ou belges d’affilier en grand nombre des salariés à leurs caisses syndicales à la suite d’une grève réussie, tout en procurant aux employeurs une main d’œuvre qualifiée.
En France, les syndicats ouvriers, privés de ces droits conventionnels, n’ont pas eu intérêt à concurrencer les caisses de secours mutuel avant 1936 et à constituer, à la manière des Trade Unions anglais et américains, des fonds de pensions de retraite dont les revenus, convertis en capitaux industriels, leur eussent procuré une indépendance économique et permis de financer des partis politiques défendant leurs vues au Parlement.
f. À la place des syndicats ouvriers et des sociétés de secours mutuel, ce sont les propriétaires d’entreprises qui procurent à leurs ouvriers spécialisés les premières assurances sociales
Rebuté par les revendications révolutionnaires des syndicats ouvriers, l’État se détourne des intentions de la loi de 1884 et revient vers les sociétés de secours mutuel, qui revendiquent leur indépendance à l’égard des syndicats ouvriers et leur attachement aux principes de la propriété privée et de l’individualisme juridique.
Il leur restitue, par une loi du 1er avril 1898, dite « Charte de la mutualité », l’autonomie que le décret de 1852 avait supprimée et les incite à concurrencer les caisses ouvrières de grève et les bourses du travail en gagnant les ouvriers à la prévoyance volontaire par des cours professionnels, des offices gratuits de placement et des allocations de chômage.
Les effectifs des sociétés de secours mutuel progressent : de 271 000 adhérents en 1852, elles parviennent à réunir 1,7 million de sociétaires en 1895 et entre 2,5 et 3 millions en 1914. Mais leurs sociétaires, souvent membres de plusieurs associations en dépit des restrictions posées aux indemnisations multiples, sont, pour un tiers d’entre eux, des ouvriers qualifiés âgés, ayant des possibilités d’épargne, pour un autre tiers des fonctionnaires, militaires ou employés de grandes compagnies de banque ou de chemin de fer et, pour le dernier tiers, les petits patrons, artisans, commerçants et professions libérales (25) d’une France qui, en 1914, ne compte encore que 46 % de salariés contre 90 % au Royaume Uni et 3 patrons pour 7 salariés dans l’industrie.
À leur place, ce sont les propriétaires des industries qui entreprennent de loger, de scolariser les enfants ou d’affilier gratuitement leur personnel et leur famille à des caisses de secours aux frais de l’entreprise, afin de fidéliser une main d’œuvre peu qualifiée et peu payée. D’une part, ils ont intérêt à détourner leurs ouvriers des demandes inconditionnelles et immédiates d’augmentation générale et indifférenciée de salaire, réclamées lors des grèves, par une assurance individuelle contre les pertes de salaires et des avantages en nature. D’autre part, ils considèrent qu’il est de leur devoir de reprendre les œuvres de charité dont ils avaient recueilli les dépouilles à la Révolution, afin de soustraire leur main d’œuvre au paupérisme.
Des caisses patronales d’indemnisation des journées de travail perdues pendant une maladie sont ouvertes dans les mines dès le Premier Empire, puis dans les usines textiles et sidérurgiques attenantes aux bassins miniers, en complément des dispensaires qui distribuent des soins aux ouvriers et à leurs familles, logés gratuitement sur place.
Pour les compagnies de chemin de fer, dont la direction est en ville et le personnel dispersé sur le territoire, le moyen le plus efficace et le plus avantageux de discipliner et de fidéliser sa nombreuse main d’œuvre s’avère la constitution d’une caisse de retraite financée paritairement. Les compagnies promettent à leurs agents, en contrepartie d’une carrière longue, des pensions analogues à celles que l’État verse à ses fonctionnaires. Après avoir d’abord sous-traité l’assurance retraite de leurs employés à la caisse publique des retraites pour la vieillesse, ouverte dans les comptes de la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 18 juin 1850, elles préfèrent ensuite les reprendre en gestion dans l’entreprise.
Comme celle de l’État, ces caisses d’entreprise n’immobilisaient aucune provision et ne garantissaient aucune créance en contrepartie des cotisations des employés licenciés avant la liquidation de leur pension. La jurisprudence le confirmera par deux jugements, en 1889 et 1890. Cependant, la loi du 27 décembre 1895 sur les caisses de retraite des employés et ouvriers renverse cette jurisprudence en soumettant les caisses patronales (d’entreprise ou syndicales) à un agrément qui exige la séparation de leur actif social de celui de l’entreprise, afin d’accorder aux salariés une créance sur les cotisations versées et les intérêts produits et d’obliger les gestionnaires à investir leurs fonds en titres garantis par l’État.
Cette première loi sur les assurances sociales interprofessionnelles est mal accueillie par le patronat, qui tient à conserver la trésorerie des caisses à la disposition de l’entreprise, sans capitaliser de fonds. Il n’entend pas que ses caisses de retraite soient soumises au contrôle de l’État ni que leur conseil d’administration soit désigné au scrutin secret des sociétaires, comme l’impose le droit des sociétés de secours mutuel.
C’est ce qui l’incitera, au milieu du XXe siècle, à explorer la voie d’un paritarisme de gestion, associatif et conventionnel, pour conserver la direction des caisses et négocier avec les syndicats professionnels la nature et le coût des prestations versées, plutôt qu’avec les confédérations ouvrières qui considèrent les assurances mutualisées comme un moyen de baisser les salaires directs en échange de promesses collectives et qui refusent de les financer par des cotisations ouvrières.
g. L’État répond aux revendications des grèves de mineurs en généralisant ce patronage
Ces confédérations, sans relais dans les usines, ne parviennent cependant pas à organiser la grève générale expropriatrice qu’elles espéraient. Les seules grèves préoccupantes pour les gouvernements de la Troisième République sont le plus souvent spontanées, à la suite d’un accident de mine ou en raison du phylloxera qui ruine des régions viticoles.
L’État répond aux revendications des mineurs en favorisant les initiatives patronales d’assurances. Il impose par la loi l’affiliation des ouvriers aux employeurs qui s’en dispensaient pour conserver un avantage concurrentiel. Après les grèves de 1891 et 1892, la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs pose plusieurs principes qui seront par la suite étendus aux autres secteurs industriels.
La loi n’affilie les mineurs qu’à concurrence d’un plafond salarial. Elle détaille les prestations qui s’imposent à l’administration des caisses. Elle leur impose un financement paritaire, par le versement de cotisations salariales et patronales égales.
La loi laisse aux employeurs le choix de leur caisse de secours. Ceux qui en ont une peuvent la conserver sans changement de statut, avec l’accord du ministère. Ceux qui se sont dérobés à cette contrainte peuvent créer leur propre caisse ou adhérer à une caisse syndicale dont le ressort comme les statuts doivent alors être approuvés par l’État.
La loi laisse aussi aux employeurs le choix de la caisse de retraite qui affilie leur personnel. Ce peut être une caisse patronale, d’entreprise ou syndicale, ou bien la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, réformée par une loi du 20 juillet 1886 ; l’article 10 de la loi de 1894 impose aux caisses patronales nouvellement créées un conseil d’administration composé d’un tiers de représentants de l’employeur et de deux tiers d’élus des salariés.
L’article 5 autorise même les exploitants de mines et leurs ouvriers ou employés à conclure des conventions spéciales, quel que soit le statut de la caisse de retraite d’affiliation, en vue de constituer des retraites complémentaires par capitalisation. Ces premières conventions collectives spéciales précèdent de quarante ans celles qui accorderont paritairement une pension de retraite aux salariés exonérés des cotisations obligatoires aux assurances sociales.
L’État parvient à imposer ces contraintes d’assurance sociale au patronat des mines parce qu’il est propriétaire du sous-sol qu’elles exploitent et maître des droits d’exploitation qu’il concède à bail aux compagnies privées. Également proche des compagnies de chemin de fer, par l’expropriation des terres que les voies ferrées occupent, il ne dispose pas des mêmes atouts à l’égard de l’industrie textile et de la sidérurgie, même si ses armées sont l’un de leurs principaux clients.
Quand de nouvelles grèves ouvrières touchent à la fois l’industrie et l’agriculture entre 1905 et 1907, les cabinets Clemenceau et Briand parviennent néanmoins à imposer un encadrement légal du patronage à l’ensemble des secteurs industriels et manufacturiers. D’anciens membres de la Section française de l’Internationale ouvrière, proche des syndicats ouvriers, apportent au Gouvernement les soutiens parlementaires que la mutualité lui refusait. L’un d’eux, René Viviani, ministre du travail et de la prévoyance sociale, répond aux revendications des grévistes par une codification des lois salariales. Il fait voter une extension de l’assurance retraite.
La loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général rend l’assurance obligatoire par cotisation salariale et patronale. Elle fixe les taux de cotisation, la durée d’affiliation, l’âge de liquidation ainsi que les minima et maxima des pensions versées selon le grade professionnel, mais elle laisse la responsabilité de la gestion des caisses de retraite aux compagnies, sous le contrôle du ministère des travaux publics qui vérifie l’équilibre de leurs comptes.
La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes entreprend, pour la première fois, d’accorder les mêmes droits à pension, sur financement paritaire, aux salariés des manufactures urbaines, du commerce et des professions libérales, et même à l’agriculture.
Le choix par affinité d’une caisse d’assurances est cette fois laissé au salarié, qui peut ouvrir un livret d’épargne retraite auprès de la caisse nationale des retraites, des caisses d’épargne, des sociétés de secours mutuel, des caisses syndicales autorisées par décret et des sociétés d’assurances. La loi leur offre aussi la possibilité de s’affilier à de nouvelles caisses départementales ou régionales de retraite, crées par décret et administrées par des comités tripartites associant en nombre égal des représentants de l’État, des élus des assurés et des élus des employeurs.
Dans leur article sur les genèses et usages de l’idée paritaire dans le système de protection sociale français entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, MM. Gilles Pollet et Didier Renard rappellent que le régime d’administration des caisses est alors l’enjeu d’un débat politique :
« La gestion ouvrière est défendue par les socialistes dont le projet politique ne peut cependant s’imposer dans un jeu parlementaire où leur mouvement demeure divisé et minoritaire. Le modèle paternaliste est investi par les conservateurs et plus généralement par les catholiques, ralliés ou non à la République, mais leur faiblesse politique ne permet pas qu’il s’impose comme un élément structurant des législations sociales en discussion. Le modèle mutualiste de liberté subsidiée est, pour sa part, mis en avant par les républicains modérés ou libéraux. Il devient l’un des creusets du solidarisme républicain.
« Mais l’échec, de plus en plus patent, de la constitution d’une protection sociale fondée sur le principe de la liberté d’affiliation amène les parlementaires à se retourner, non sans d’âpres débats, vers le principe d’obligation qui correspond mieux par ailleurs aux principes philosophiques de républicains plus radicaux…
« Le principe d’obligation est, dans la législation de protection sociale votée à partir de la fin du 19e siècle, la marque de l’intervention de l’État, au double sens de l’édiction par le législateur d’une règle qui s’impose à tous, mais aussi de la participation au financement qui l’accompagne et en constitue la contrepartie. Il a pour corollaire, à ses débuts, un mode spécifique d’administration des institutions de protection sociale obligatoire, le tripartisme.
« L’administration conjointe, par les bénéficiaires, leurs employeurs et les représentants de l’État, va peu à peu apparaître dans les institutions de protection sociale obligatoire comme une contrepartie à l’obligation. Elle est présentée comme la conséquence normale de la triple source du financement de ces institutions, ceux qui supportent la charge financière de la protection l’administrant. Elle peut apparaître comme une tentative de restreindre le principe de liberté de choix des caisses par les assurés, qui laisse pour sa part subsister les modèles de gestion antérieurs. » (26)
La gestion tripartite des caisses de retraite territoriales est contestée par la mutualité, les syndicats ouvriers et le patronat. Ce dernier, auquel la loi a imposé l’affiliation obligatoire de ses ouvriers et un régime de prestations et de cotisations d’assurance retraite, obtient de la Cour de cassation d’être exonéré de toute responsabilité pénale lorsque le salarié ne présente pas son livret pour que l’employeur y appose les timbres postaux obtenus en contrepartie des cotisations payées.
Le patronat parvient en outre, avec l’accord des ministères de tutelle, à sauver 68 des 74 caisses de retraite d’entreprise ou syndicales qu’il contrôlait et que les caisses territoriales devaient remplacer. Seules les caisses de retraite des mines sont contraintes, par une loi du 25 février 1914, à s’unir dans une caisse autonome, d’adhésion obligatoire pour les employeurs comme pour les salariés, dont le conseil d’administration est composé de six membres élus par les ouvriers, six élus par les exploitants des mines et six représentants des ministères de tutelle.
h. Après la Première guerre mondiale, les syndicats ouvriers obtiennent de l’État, dans un élan international, l’affiliation obligatoire aux assurances sociales mais toujours pas la gestion des caisses
La guerre modifie la répartition territoriale de l’industrie puisque les bassins miniers et textiles sont occupés. Elle n’a pas résorbé la manufacture urbaine mais la principale, celle de Paris, cesse de croître. La guerre amène aussi les syndicats ouvriers à penser qu’ils peuvent prendre le contrôle de la production industrielle en s’emparant de l’appareil d’État au lieu de le renverser, puisque cet appareil a lui-même pris le contrôle de la main d’œuvre, de la production et de l’approvisionnement dans une économie administrée pour les besoins de la guerre.
L’expérience révolutionnaire russe de 1917 le confirme. Pour éviter une répression comparable à celle qui met en échec, l’année suivante, les révolutions ouvrières allemande et hongroise, l’État obtient le ralliement de la mutualité et de la majorité des confédérations syndicales ouvrières à sa politique d’assurances sociales légales et obligatoires. Tous espèrent détacher les ouvriers des syndicats révolutionnaires, désormais minoritaires mais adossés à un parti politique qui emporte une majorité de l’ancienne SFIO au congrès de Tours de 1920.
Les confédérations ouvrières dites réformistes rejoignent la Fédération nationale de la mutualité française dans un comité général d’entente pour soutenir le projet de loi sur les assurances sociales, déposés sur le bureau de la Chambre des députés le 22 mars 1921 par le cabinet Briand, alors que la chambre débat de l’extension aux salariés français des assurances sociales maintenues dans les départements d’Alsace et de Moselle repris à l’empire allemand défait.
Le projet de loi propose d’assujettir à un régime légal d’assurances sociales, financées par des cotisations salariales et patronales obligatoires et égales, les travailleurs dont les revenus, inférieurs à un plafond, sont estimés insuffisants pour promettre une prévoyance individuelle spontanée ou une épargne de précaution substantielle.
Cette initiative est recommandée par la XIIIe partie du traité de Versailles de 1919 : elle fonde la paix sur une justice sociale qui doit, entre autres, garantir un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, et des pensions de vieillesse et d’invalidité.
Le traité ne laisse pas les États parties libres du choix des instruments pour atteindre les objectifs de justice sociale convenus. Il invente un droit international fait de conventions collectives qui réglementent la condition des travailleurs et le régime du travail. Nonobstant leur source de droit international, ces conventions ne sont pas conclues entre États mais entre États et représentations paritaires des organisations nationales d’employeurs et de salariés que les États auront désignées comme les plus représentatives. Ces contrats collectifs, mêlant les droits régalien et conventionnel, auraient pu généraliser les assurances sociales.
Mais le Parlement français a anticipé l’entré en vigueur du traité, dont, à l’époque, les stipulations ne s’imposent pas directement en droit interne, en adoptant une loi sur les conventions collectives de travail, promulguée le 25 mars 1919, trois mois avant la signature du traité.
Cette loi rompt avec les principes légaux et jurisprudentiels de l’individualisme contractuel, maintenus depuis 1791. Elle limite cependant le champ des conventions collectives aux conditions de travail, excluant tacitement
– sûre de la jurisprudence de la Cour de cassation – les autres domaines de la justice sociale énumérés par le traité de Versailles.
La loi déclare inchangées les lois relatives aux sociétés de secours mutuel et aux syndicats, ce qui exclut explicitement leur objet des conventions collectives, en dépit de l’exemple des conventions collectives d’assurances complémentaires des mineurs, autorisées par la loi de 1894 précitée. Elle introduit dans le titre II du livre 1er du code du travail de 1910 un chapitre V, appelé à de nombreuses modifications. Celui-ci est ouvert par un article 31 selon lequel « La convention collective de travail est un contrat relatif aux conditions du travail, conclu entre, d’une part, les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d’employés et, d’autre part, les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d’employeur, ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel ou même un seul employeur. »
Cet article ne réserve aucun privilège conventionnel aux organisations les plus représentatives, mentionnées dans le traité. Il ne règle pas les rapports entre ces conventions et le droit du commerce, ni l’opposabilité des clauses convenues à l’intérêt des tiers, notamment aux concurrents des parties ou aux organisations professionnelles exclues de la négociation ou défavorables à l’accord conclu.
Pour garantir aux travailleurs les assurances sociales préconisées par le traité de Versailles et que l’État était prêt à leur concéder, les syndicats ouvriers réformistes n’ont donc pu emprunter la voie des conventions collectives. Ils ont dû s’en remettre au législateur. Mais tant que l’industrie française n’a pas employé plus de salariés que le travail indépendant ou l’agriculture, le soutien du Parlement aux projets d’assurances ouvrières est resté limité.
L’exposé des motifs du projet de loi sur les assurances sociales déposé en 1921 était pourtant ambitieux, affirmant « opportun d’englober, dans une seule et même assurance, les risques découlant de la maladie, de l’invalidité, de la vieillesse, du décès et d’y prévoir même ceux qui résultent de la maternité, car, en réalité, ils constituent pour les intéressés une seule et même menace sous des formes successives et diverses. »
Le texte concède ensuite que l’assurance sociale est un acte de prévoyance individuel mais ajoute que l’État doit y apporter sa large contribution parce que « l’individu n’a pas le droit, dans une société bien organisée, de se retrancher dans une imprévoyance qui le laisse à la charge de ses semblables… Ce principe a été encore récemment proclamé au congrès de la Mutualité à Angers. Les mutualistes qui se réclamaient jadis du dogme de la liberté absolue se sont ralliés, presque sans réserve, à une conception que l’intérêt général impose. » (27)
Il est immédiatement précisé que cette intervention de l’État « n’est pas synonyme d’étatisme. Le projet bannit toute centralisation administrative et institue des organismes autonomes, où les représentants des divers intérêts, et principalement les mandataires des assurés, participent à la gestion commune. » (28)
« S’il y a le plus grand intérêt social à ce que l’assurance soit unique pour les salariés comme pour les employeurs, rien ne s’oppose à ce que les opérations qu’elle comporte soient divisées et, par suite, effectuées par des organismes différents. L’assurance maladie peut être réalisée simultanément par des caisses multiples et de diverses sortes. » (29)
Le dispositif du projet de loi rend obligatoire l’affiliation des salariés à des assurances sociales couvrant les principaux risques professionnels, lorsque leurs revenus ne dépassent pas un plafond fixé par la loi, au-delà duquel ils auraient
– estime-t-on – une capacité d’épargne suffisante pour adhérer volontairement à une société de secours mutuel.
Ces assurances obligatoires seraient dispensées par des caisses régionales administrées par un conseil de 36 membres, 18 élus par l’assemblée générale des assurés, 9 élus par leurs employeurs et 9 désignés par décret des ministres du travail et des finances pour représenter les intérêts généraux. Ces caisses seraient à la tête d’un réseau de succursales dans chaque canton ou commune de plus de 10 000 habitants.
Cette unité d’organisation posée, le texte offrait aux sociétés de secours mutuel, aux entreprises et aux syndicats la possibilité d’ouvrir une section locale du réseau, dite de remplacement, à condition que son conseil d’administration assure une représentation des assurés analogue à celle prévue dans les caisses régionales.
L’article 103 impose même aux sections patronales de remplacement « un comité mixte composé de délégués du syndic patronal, de l’union de syndicats patronaux ou de l’établissement employeur d’une part, et de délégués élus par le personnel assuré d’autre part. Ce comité doit comprendre la moitié au moins de représentants du personnel. »
Ces concessions n’ont pas suffi à donner au projet de loi une majorité parlementaire. La mutualité s’est opposée à l’affiliation obligatoire des travailleurs, les sociétés agricoles à leur dépossession et le patronat à la confiscation de ses caisses par des syndicalistes ouvriers qui ne pourraient plus en être exclus par un licenciement.
Tous obtiennent que le projet soit reporté puis repris en janvier 1923 par le docteur en médecine Édouard Grinda et le professeur de droit et d’économie Étienne Antonelli, afin d’être entièrement réécrit par la commission selon les termes de leur rapport, plus favorable au principe d’affinité. Le texte est adopté par la chambre du Cartel des gauches mais retenu par le Sénat. Il ne peut être promulgué, le 5 avril 1928, qu’en échange de la promesse présidentielle d’y revenir après les élections législatives de juin.
Selon Henri Hatzfeld, « le premier rectificatif à la loi de 1928, présenté par Loucheur en 1929 imposait la formule paritaire dans toutes les caisses. Le Gouvernement avait renoncé à ce rectificatif, laissant les mutuelles, créées à l’initiative des assurés sociaux, libres d’adopter ce mode de gestion.
« Par la suite, le thème de la gestion paritaire est demeuré l’un des thèmes habituels du patronat lorsqu’il ne peut espérer obtenir une solution plus satisfaisante. D’autant plus que la division syndicale donne évidemment dans les assemblées paritaires un pouvoir plus que proportionnel à son nombre à la représentation patronale. » (30)
Le deuxième rapport d’Étienne Antonelli et d’Édouard Grinda sur le projet de loi modificatif de 1930 reprend l’idée d’un paritarisme de gestion des caisses : « Les industriels et les commerçants payant la moitié de l’assurance devraient participer pour moitié à sa gestion, ce serait juste et d’intérêt général car par leurs fonctions mêmes ils ont la pratique de la gestion et de la bonne administration.
« Sans vous accorder ce droit, la loi vous permet pourtant d’arriver à une réalisation de ce genre. Il suffit que votre personnel soit inscrit six mois avant l’application dans des mutuelles à gestion paritaire, c’est-à-dire administrées à parité par les salariés et les employeurs. » (31)
Il n’en est plus guère question dans la loi promulguée le 30 avril 1930 et moins encore dans les décrets d’application qui, de 1930 à 1935, retirent aux caisses territoriales, devenues départementales, l’affiliation des assurés, la perception des cotisations et leur conseil d’administration élu. Celui-ci est remplacé provisoirement par un conseil de direction composé de représentants de l’union départementale des sociétés de secours mutuel, des mutuelles agricoles et des syndicats professionnels ouvriers, dans l’attente d’élections en assemblée générale, à la proportionnelle, qui ne seront jamais organisées.
L’affiliation passe aux services ministériels départementaux, puis régionaux, de l’assurance sociale. Les cotisations, acquittées, comme en 1910, sous forme de timbres achetés par l’employeur dans les bureaux de postes, sont versées à la Caisse des dépôts qui en distribue les recettes au réseau des caisses départementales et de remplacement, sous le contrôle des services du ministère.
Une caisse de garantie est créée sous forme d’établissement public administré par un directeur général nommé par décret et un conseil présidé par un conseiller d’État, composé d’une majorité de représentants des ministères. Elle devait initialement gérer un fonds budgétaire de majoration des assurances sociales et un fonds de garantie de la trésorerie du réseau mais s’impose en intermédiaire obligé entre la Caisse des dépôts, qui reçoit les cotisations, et l’administration du ministère, qui les distribue aux caisses primaires d’affinité.
Les assurances sont divisées par risques et partagées entre les caisses primaires, à l’avantage des caisses de remplacement ouvertes par les sociétés de secours mutuel ou les syndicats, dispensés de leur donner un conseil tripartite.
Le comité des forges, qui a conservé son ascendant sur les autres branches économiques capitalisées et l’a imposé aux nouvelles industries, aéronautiques, automobiles, chimiques, électriques et gazières, pourtant très contrôlées par l’État, obtient que les caisses patronales, d’entreprise ou syndicales, acquièrent également le statut de caisse de remplacement.
Il l’obtient d’autant plus aisément qu’il accepte, en contrepartie, la loi du 11 mars 1932 qui rend obligatoire, par le code du travail et non par les assurances sociales, la distribution d’allocations pour charges de famille, commencée à leur initiative par MM. Émile Marcesche et Émile Romanet. Ces allocations familiales, réglées en 1938 sur la politique nataliste de l’État, sont versées par des caisses de compensation associatives auxquelles l’adhésion des employeurs est obligatoire de par la loi.
i. Sous la pression des grèves, le gouvernement du Front populaire reprend, avec quelques inflexions, la politique des lois sociales d’avant-guerre
Confronté à des grèves qui paralysent la production en mai 1936, l’État reprend la politique des gouvernements Clemenceau et Briand du début du siècle. La majorité de Front populaire, élue à la Chambre des députés en juin, obtient la neutralité bienveillante des syndicats et des partis révolutionnaires, qui ne participent pas au ministère. Elle accède à leurs revendications immédiates sur les congés payés, la liberté syndicale dans l’enceinte des usines et l’élection de délégués du personnel en entreprise. Elle accepte surtout de transposer les principes conventionnels du traité de Versailles dans le code du travail.
Une loi du 24 juin 1936 maintient le droit commun des conventions collectives de travail, introduit en 1919 dans le code du travail. Elle leur ajoute des conventions collectives conclues par des commissions mixtes régionales de branche, convoquées à la demande d’un syndicat ou du ministre et composées, comme le préconisait le traité de Versailles, des représentants des organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d’industrie ou de commerce pour la région considérée ou pour l’ensemble du territoire.
L’article 31vd de cette loi ajoute que ces conventions spéciales « peuvent, par arrêté du ministre du travail, être rendues obligatoires pour tous les employeurs et employés des professions et régions comprises dans le champ d’application de la convention. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. »
En échange, la loi impose à ces conventions collectives administrées des clauses obligatoires en matière de liberté syndicale, d’élection de délégués représentant les intérêts individuels du personnel, de salaires et de congés. Mais elle ne dit mot ni du monopole d’embauche, ni des assurances sociales. L’article 31vc précise seulement que « les conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables. »
Ce principe, dit de faveur, aurait pu favoriser les offres d’assurance retraite faites par les deux principales confédérations, qui passent de 750 000 à 4 millions d’adhérents et créent chacune leur union syndicale de caisses d’assurances, l’une appelée Le Travail, l’autre La Famille.
Ces dernières ne comptent cependant que 500 000 affiliés en 1938, alors que les effectifs des sociétés de secours mutuel, principales bénéficiaires des lois sur les assurances sociales, passent de 5,6 millions d’adhérents en 1926 à 8,2 millions en 1930, soit la quasi-totalité des assurés pour le risque maladie.
j. Les caisses patronales tirent avantage des garanties complémentaires des assurances sociales obligatoires accordées par les conventions collectives administrées
Le principe de faveur favorise surtout l’initiative du comité des forges, présidé par François de Wendel. Au début des années 1930, il a entrepris d’affilier collectivement à une caisse de retraite patronale les collaborateurs d’entreprise, bientôt appelés cadres, dont les revenus dépassent le plafond d’affiliation obligatoire aux assurances sociales.
Un acte notarié du 30 mai 1932 signé par le seul patronat de la métallurgie, des houillères et des mines, déclare la Caisse mutuelle d’assurances sur la vie de la Métallurgie des Houilles et des Mines, constituée des employeurs et agents d’entreprises industrielles et de leurs ayants droits adhérents. Cette caisse est créée non pas sous le régime des lois de 1884, 1898 ou 1928 mais sous celui de la loi du 17 mars 1905 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d’assurance sur la vie. L’employeur peut y affilier collectivement ses salariés. Ces derniers peuvent également souscrire individuellement un contrat. Ce sont les statuts de la caisse, annexés à l’acte, qui fixent les cotisations et prestations. Ces statuts placent la société mutuelle sous l’administration d’un conseil nommé par l’assemblée générale, une moitié des administrateurs étant prise parmi les employeurs adhérents et l’autre moitié parmi les assurés et les pensionnés qui cotisent ou reçoivent le plus. Si cette administration est paritaire, elle est cependant censitaire et non pas syndicale.
Après la loi du 24 juin 1936, le comité des forges convainc la plupart des branches industrielles de conclure des conventions collectives avec les syndicats d’ingénieurs et de techniciens, incluant des clauses d’affiliation à l’assurance retraite des employés, techniciens et ingénieurs exclus des assurances sociales qui les laissent libre du choix de leur caisse d’assurance mais leur recommandent celles d’un bureau commun des assurances de groupe créé en 1938.
Puisque les collaborateurs sont susceptibles d’être obligatoirement assujettis aux assurances sociales en début de carrière et de ne plus l’être par la suite, compte tenu de l’augmentation de leur salaire, le Gouvernement accorde, sous condition, à leur caisse de retraite un statut de caisse de remplacement pour l’ensemble de leurs assurances sociales.
Pour faire place aux syndicats de cadres, signataires des conventions, qui leur procurent des adhérents solvables et obligés, ces caisses mutuelles adoptent les formes juridiques du paritarisme de gestion, en répartissant les postes de leur conseil d’administration par collèges catégoriels d’assurés sans considération de cens.
k. Du fait de la guerre, l’État reprend le contrôle administratif de l’économie, interrompt l’extension des assurances sociales et envisage de les confier aux corporations qu’il rétablirait
En 1935, les lois sur les assurances sociales ne couvrent que 5,5 millions de cotisants, 7 millions de salariés et 8,8 millions d’assurés et d’ayant droits – sur une population de 40 millions. Leur application est affectée par la préemption de la trésorerie disponible, pour indemniser, par un fonds spécial, les chômeurs.
La caisse de garantie reçoit, par le décret-loi du 25 juillet 1930, la charge d’affilier aux assurances sociales puis, par le décret du 15 mai 1934, celle d’indemniser, par un fonds commun de travail alimenté par l’État et la trésorerie du réseau, les nombreux chômeurs inscrits dans les offices publics de placement quand la crise économique finit par atteindre une France moins industrialisée que les pays américains et européens les premiers touchés par ses effets.
Manquant de trésorerie, les assurances sociales sont aussi affectées par les décisions du Gouvernement qui réglementent les prix et les salaires. Le Gouvernement suspend certaines prestations pour installer une économie de guerre. Les assurances sociales sont encore diminuées par les clauses de la convention d’armistice de 1940 : elles maintiennent en captivité les prisonniers de guerre et exigent des réparations en nature et en or qui imposent un rationnement de la part de la production industrielle, manufacturière et agricole laissée à la population.
René Belin, secrétaire général adjoint de la CGT, est nommé secrétaire d’État au travail en juillet 1940. Il fait interdire les confédérations interprofessionnelles par une loi du 16 août 1940 qui place la production industrielle sous le contrôle administratif de comités d’organisation. Il prépare en même temps une loi d’organisation sociale des professions, appelée Charte du travail, qui rétablirait des corporations professionnelles et confierait la gestion des assurances sociales à leurs comités mixtes sociaux.
Cette loi, promulguée le 4 octobre 1941, n’est appliquée qu’au secteur agricole, les assurances sociales des exploitants et des salariés passant à une mutualité sociale unifiée. Dans les autres secteurs de production, les syndicats professionnels entrent en sommeil, privés de leurs confédérations et subordonnés aux comités d’organisation qui négocient directement avec les chefs d’entreprise. Les sociétés de secours mutuel, en revanche, dont la fédération nationale a fait bon accueil à la Charte du Travail, poursuivent leurs activités et obtiennent l’abandon, en 1943, d’un second projet de réforme des assurances sociales.
À la Libération, la Mutualité et le patronat sont marginalisés par les confédérations syndicales ouvrières, réunies par une déclaration des Principes du syndicalisme français du 15 novembre 1940 (32) qui renonce à absorber l’État et affirme qu’il n’y a pas à choisir entre le syndicalisme et le corporatisme, les deux étant également nécessaires. Rétablies dans leurs droits par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), ces confédérations obtiennent des engagements de sa part sur la réorganisation, à leur profit, de la vie économique et sociale et sur la gestion syndicale de la sécurité sociale qui doit, selon le programme du Conseil national de la Résistance du 15 mars 1944, se substituer aux assurances sociales d’avant-guerre.
l. L’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoit de réserver l’administration des caisses de sécurité sociale aux syndicats ouvriers et patronaux
Lorsque le ministre du Travail, Alexandre Parodi, présente le plan de cette sécurité sociale, préparé par Pierre Laroque, à l’Assemblée consultative provisoire, en juillet 1945, il annonce que, cette fois, « la relève de la mutualité par le syndicalisme » assurera « à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés ».
Le plan instauré par l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, publiée au Journal Officiel sans le rapport du ministre du Travail et de la sécurité sociale qui l’accompagnait, remplace le principe d’affinité par une affiliation obligatoire à une caisse territoriale, sans considération de plafond salarial ni caisse de remplacement. Il remplace également l’élection des conseils d’administration des caisses par leur désignation par les confédérations syndicales ouvrières et patronales les plus représentatives.
Le rapport du ministre (33) reprend, pour justifier l’abandon des principes d’assurances sociales, l’argument d’une gestion par les bénéficiaires, déjà avancé par le projet de loi de 1921 sur les assurances sociales et la Charte du Travail, pour constater que « Le premier principe qui doit donc dominer cette organisation est celui de la gestion des institutions de sécurité sociale par les bénéficiaires eux-mêmes. Pour y parvenir, l’on pouvait envisager la désignation de dirigeants des différentes organisations par voie d’élection. Ce procédé a paru, en l’état actuel des choses, mal adapté au caractère propre de ces institutions.
« Au surplus, les bénéficiaires des institutions de sécurité sociale sont aujourd’hui légalement représentés par leurs groupements syndicaux qui sont qualifiés pour désigner les dirigeants des institutions nouvelles, de même que pour faire l’éducation des intéressés dans le domaine social. »
Dans l’article premier de l’ordonnance, il ne s’agit plus toutefois d’assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, comme l’annonçait Alexandre Parodi en juillet, mais de « garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs capacités de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. »
L’administration syndicale des caisses est considérée comme démocratique et représentative des assurés parce que les travailleurs, chefs de famille, sont les premiers bénéficiaires et les intermédiaires obligés de l’ouverture des droits d’indemnisation et parce que le coût des prestations de sécurité sociale est couvert, comme celui des assurances sociales, par des cotisations obligatoires dont, selon l’article 32 de l’ordonnance, la moitié est à leur charge, l’autre moitié à celle de leur employeur.
m. Le patronat, qui perd l’administration des caisses nationalisées et des caisses d’allocations familiales, s’allie à des syndicats minoritaires et à la mutualité pour faire échec au plan Laroque
Avec les nationalisations décidées par le Gouvernement du Front populaire puis le GPRF, les principales caisses patronales d’assurances sociales, d’entreprise ou syndicales, sont passées sous administration publique. Leur régime déjà très encadré par des lois devient entièrement statutaire. Les anciennes caisses de secours mutuel et de retraite des banques, des mines, des chemins de fer et du métropolitain, de l’industrie électrique et gazière, de la chimie, des marins et des ouvriers d’État conservent une personnalité juridique distincte de l’entreprise publique qui les porte.
Le conseil d’administration de certaines caisses, comme celui des assurances des agents de la SNCF, devient paritaire, une moitié des administrateurs étant élus par les assurés et pensionnés, l’autre désignée par la direction. D’autres conseils, comme celui de la caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents de la RATP, sont entièrement élus par les assurés.
Perdant ses caisses d’entreprise, le patronat industriel perd aussi ses caisses de compensation des allocations familiales, que le plan de sécurité sociale prévoit d’absorber.
Selon Henri Hatzfeld, « Le patronat regrette les institutions patronales qu’il gérait lui-même. Au moment des discussions sur les Assurances sociales il n’a pas renoncé à imposer, dans certains cas, de telles institutions. Par la suite, le patronat renoncera sans doute à un impossible retour en arrière. Mais il ne se rallie jamais à l’idée d’une grande institution sociale coiffée si l’on peut dire par l’État et reposant à la base sur une démocratie de conseils élus avant tout par les travailleurs. Faute de mieux, il préfèrera des institutions séparées, spécialisées à gestion paritaire et où l’intervention de l’État se fera moins directe. » (34)
Le patronat reçoit le concours de la Confédération générale des cadres, créée en 1944, qui craint pour les régimes d’assurance mutuelle paritaire négociés avant-guerre, puisque les cadres sont assujettis au régime général de sécurité sociale quels que soient leurs revenus. Il reçoit aussi l’appui de la CFTC, dont la représentativité, reconnue par le ministère en février 1945, est contestée par le syndicat majoritaire jusque devant le Conseil d’État. Tous redoutent d’être mis en minorité par la CGT dans les conseils d’administration des nouvelles caisses.
n. La mutualité conserve l’assurance sociale des fonctionnaires et obtient le retour au principe d’affinité et à l’élection des administrateurs de caisses
Dans le plan de sécurité sociale mis en œuvre par l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 précitée et l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, les sociétés de secours mutuel, qui géraient auparavant l’assurance maladie hors des grandes industries et celle des fonctionnaires qui n’étaient pas assujettis aux lois sur les assurances sociales de 1928 et 1930, se voient privées de leurs assurés, de leurs réserves et de leurs biens-fonds.
L’ordonnance du 4 octobre peut bien paraître sans le rapport du ministre, placer les caisses de sécurité sociale sous le régime de la loi de 1898 et ménager aux sociétés de secours mutuel des sections locales de caisses primaires ou des places pour ses anciens administrateurs et membres honoraires dans les conseils provisoires, la Fédération nationale de la mutualité française s’est opposée au plan Laroque dès son assemblée générale du 5 mai 1945.
Comme le patronat, elle conteste l’étatisation des assurances sociales, la constitution de caisses territoriales uniques et leur gestion par des représentants nommés par les confédérations syndicales d’employeurs et d’employés et non plus élus par les sociétaires.
Elle n’accepte pas d’être confondue avec l’assurance mutuelle à gestion paritaire du patronat, dans le rôle subalterne d’assureur de complément que lui assigne l’article 18 de l’ordonnance du 4 octobre, qui n’autorise le service d’assurances sociales aux salariés, hors le régime général, que sur autorisation du ministre.
Elle accepte encore moins l’exposé des motifs de l’ordonnance du 19 octobre, qui abroge la loi de 1898 en ne laissant aucun doute sur l’intention du Gouvernement : « La généralisation du système d’assurance obligatoire enlève une très large part de leur raison d’être aux institutions de prévoyance volontaire » et il serait « peu conforme à l’intérêt bien entendu de la mutualité que celle-ci voie son activité, ses forces vives s’absorber de plus en plus dans le fonctionnement des assurances sociales. La vitalité, l’élan de la mutualité, étroitement liés à un effort volontaire et libre, risquent en effet, à la longue, de se trouver affaiblis et de perdre leur efficacité dans le cadre d’une organisation essentiellement obligatoire. »
L’article 1er de cette ordonnance confie à de nouvelles sociétés mutualistes la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ; mais elles n’obtiendront pas la gestion des services médicaux du travail rendus obligatoires par la loi du 11 octobre 1946.
Le même article leur recommande d’encourager la maternité et la protection de l’enfance et de la famille ; mais elles ne distribueront pas les allocations familiales, pourtant retranchées du régime général de sécurité sociale par la loi du 30 octobre 1946.
Enfin le même article les invite au développement moral, intellectuel et physique de leurs membres et les incite pour cela à assurer les œuvres sociales des comités d’entreprise, créés par la loi du 22 février 1945, en leur permettant d’avoir des représentants au conseil d’administration et au comité d’entreprise ; mais œuvres, postes et mutuelles d’entreprise seront préemptés par les syndicats, avec l’accord des directions.
Menacée de disparition, la mutualité est résolue à faire échec au plan Laroque. Avec ses alliés syndicaux et le soutien du Mouvement républicain populaire, elle organise, après la chute du gouvernement du général de Gaulle, une grève générale, le 25 mars 1946, pour faire échec au projet de loi d’affiliation obligatoire de tous les travailleurs, indépendants et salariés, à la sécurité sociale.
Les opposants au projet obtiennent du premier gouvernement de la IVe République la réduction de la liste des affiliés obligatoires à la sécurité sociale, jusqu’à la limiter aux salariés du secteur privé industriel et commercial. Les régimes spéciaux deviennent indépendants de la sécurité sociale. Les artisans, les professions industrielles et commerciales et les professions libérales qui devaient lui être affiliés, y échappent par une loi du 17 janvier 1948.
La loi n° 46-2425 du 30 octobre 1946 revient au principe de l’élection des administrateurs des caisses et recompose le conseil d’administration des caisses primaires, pour les trois quarts, de représentants élus des travailleurs et, pour un quart, de représentants élus des employeurs, auxquels s’ajoutent deux représentants élus du personnel de la caisse, deux médecins élus par leurs pairs, deux personnes nommées par le ministre et un élu de l’union départementale des associations familiales.
Cette même loi sépare les caisses d’allocations familiales des caisses primaires et les dote d’un conseil d’administration élu pour moitié par les travailleurs salariés du ressort territorial de la caisse, pour un quart par leurs employeurs, désormais en minorité, et pour un quart par les travailleurs indépendants affiliés.
Les mutuelles réservées aux fonctionnaires se fédèrent en 1945 en unions d’instituteurs, de postiers, de militaires pour négocier avec le Gouvernement un statut de caisse de substitution qui leur est accordé par décret en décembre 1946.
Ce décret est complété par une loi dite « Morice », du 9 avril 1947 qui accorde à ces mutuelles un statut de section professionnelle de caisse primaire de sécurité sociale. Ceci leur permet de récupérer la part patronale des cotisations et de précompter la part salariale sur les traitements. Un décret du 28 février 1950 soumet leur conseil d’administration à une élection au scrutin proportionnel par les assurés et pensionnés.
De la même façon, la loi du 23 septembre 1948 affilie les étudiants aux caisses primaires de sécurité sociale mais impose le recours obligatoire à des sections mutualistes dans les établissements d’enseignement ou les villes universitaires pour le service des prestations.
o. Le patronat et les syndicats minoritaires s’unissent contre la CGT pour se partager l’administration des caisses territoriales
L’élection nationale des administrateurs est organisée en 1947. 75 % des électeurs inscrits votent. Comme espéré par les opposants à la désignation des administrateurs par les confédérations représentatives, les résultats des élections ne reproduisent pas leurs rapports d’effectifs. Dans le collège des salariés, les listes CGT obtiennent 59,2 % des suffrages, les listes CFTC 26,4 % et les listes mutualistes 9,1 %, alors que la CGT revendiquait 5,5 millions d’adhérents et la CFTC, reconnue représentative par le Gouvernement et le Conseil d’État, moins d’un million.
Le patronat profite, l’année suivante, de la scission du syndicat majoritaire pour négocier avec les confédérations réformistes des alliances en leurs élus afin de mettre en minorité les représentants de la CGT dans les conseils d’administration des caisses territoriales de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Ils utilisent ensuite la possibilité ouverte par l’ordonnance du 4 octobre de regrouper des caisses pour créer, dans les départements de la Seine, des Alpes-Maritimes et d’Ille-et-Vilaine, des services communs d’affiliation et de calcul, qui remplacent l’ancienne administration ministérielle des assurances sociales, et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF). Cette substitution est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne de l’attribution aux URSSAF de privilèges de puissance publique, pour l’exercice desquels les agents des caisses doivent être assermentés, puisque les cotisations en retard sont légalement passibles d’une majoration et garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Les URSSAF sont légalisées par la loi de finances pour 1953 qui leur donne la même personnalité juridique que les institutions de sécurité sociale. Elles seront imposées au réseau des caisses d’allocations familiales, qui ont longtemps défendu leur propre encaissement des cotisations, par un décret du 12 mai 1960 mais resteront tenues à l’écart par les mutuelles de fonctionnaires et les mutuelles paritaires de retraite.
L’alliance des confédérations patronales et des confédérations salariales minoritaires pour empêcher la CGT de s’emparer des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale ouvre la voie à l’extension du paritarisme de gestion, expérimenté avant-guerre avec les syndicats de collaborateurs.
Des solidarités confédérales paritaires s’instaurent alors dans plusieurs domaines hors des instances de la sécurité sociale, tantôt par la voie législative, tantôt par la voie conventionnelle administrée des conventions collectives étendues ou agrées par arrêté ministériel.
*
* *
Ainsi, le développement du paritarisme ne paraît pas pouvoir être porté au crédit de ses fondements théoriques – en fait ténus – ou de sa profondeur historique – en fait limitée. Il semble venir de deux éléments pragmatiques :
– Le paritarisme est une solution institutionnelle difficilement remplaçable, comme l’indiquait M. Laurent Duclos lors de son audition : « le paritarisme constitue une doctrine assez faible qui a fondé une pragmatique institutionnelle : aujourd’hui, il s’impose à défaut de technologie politique alternative, ce qui le rapproche de l’expression anglaise “ready-made solution”. Lorsque l’on a quelque chose à instituer entre la société civile organisée et l’État, on fait appel au paritarisme ».
– La légitimité de la gestion par les partenaires sociaux dans les domaines où des institutions ad hoc ont été créées, y compris dans des contextes économiques difficiles et face à des enjeux financiers considérables, n’est pas sérieusement contestable.
Il est en tout cas incontestable que, depuis des décennies, le paritarisme irrigue une grande partie des rapports sociaux dans notre pays. C’est pourquoi la mission s’est attachée à dresser un panorama aussi exhaustif que possible de ses différentes manifestations, tant pour le paritarisme d’entreprise et de négociation que pour le paritarisme de gestion.
II. LE PARITARISME AUJOURD’HUI : LES CHAMPS DE L’ENTREPRISE, DE LA NÉGOCIATION ET DE LA GESTION
Comme rappelé plus haut, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme précise que la notion de paritarisme peut recouvrir plusieurs acceptions : la négociation collective, la gestion paritaire et l’interprétation de ces normes. Parmi ces acceptions, les signataires de l’ANI ont choisi de « s’attacher au seul paritarisme de gestion » qui, selon eux, « facilite la négociation collective par la plus grande proximité qu’il permet entre partenaires sociaux ».
Les partenaires sociaux signataires de l’ANI font donc une distinction entre, d’une part, un « paritarisme de gestion » qui consiste à gérer en commun, de façon paritaire, des organismes sociaux créés par les organisations patronales et syndicales pour la mise en œuvre des règles collectivement négociées, et, d’autre part, un « paritarisme de négociation » qui consiste, lui, à négocier les accords collectifs de façon paritaire entre représentants des salariés et des employeurs.
Pour ce qui concerne le « paritarisme de gestion », le Dictionnaire des instances d’exercice des mandats élaboré en 2010 par l’association Réalités du dialogue social (35) dénombre 58 instances paritaires : 24 dans le domaine de la protection sociale et de la santé, 20 dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, 8 dans différents domaines ayant trait à la vie des salariés (logement, etc.). Trois autres sont dotées de fonctions juridictionnelles et le reste intervient dans le champ du dialogue social. (36)
Si M. Olivier Mériaux a estimé que les « différentes modalités d’organisation de la démocratie sociale » n’étaient « pas du paritarisme », le rapporteur a néanmoins jugé utile de ne pas limiter le champ des travaux de la mission au seul « paritarisme de gestion » et d’aborder les enjeux liés au « paritarisme de négociation », qui s’incarne notamment dans une forme de « cogestion à la française » que l’on pourrait qualifier de « paritarisme d’entreprise ».
En effet, « au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, n’avons-nous pas aussi affaire à une forme de paritarisme ? Certes, l’employeur est “seul” face à la diversité des organisations syndicales reconnues comme représentatives, mais les représentants du capital, des entreprises en tant qu’employeurs, et des représentants de la communauté de travail se mettent bien d’accord pour produire de la norme » (37).
Les travaux de la mission ont permis de réaliser un bilan aussi large que possible des organismes de gestion paritaire, qui se fonde sur l’annexe de l’accord national interprofessionnel du 17 février 2012. Ce bilan permet de prendre la mesure du fait que le paritarisme n’est pas un mode de gestion anodin : les partenaires sociaux se sont ainsi vu confier la gestion d’à peine moins de 150 milliards d’euros de dépenses en 2014, soit près d’un quart des 689 millions d’euros de dépenses de protection sociale en France. On peut également comparer ces montants aux 346 milliards d’euros de dépense de la Sécurité sociale pour la même année ou aux 474 milliards de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces montants confirment l’idée que le paritarisme français se distingue très nettement par l’ampleur des politiques sociales gérées et par la couverture de l’ensemble des terrains traditionnels de la gestion paritaire (chômage, prestations complémentaires, santé au travail, formation professionnelle).
LES DÉPENSES DE PROTECTION SOCIALE EN 2014
(en millions d’euros)

La collecte des données entreprise pour réaliser ce panorama a montré qu’il manque une vision d’ensemble du paritarisme, qui gère pourtant une part considérable des dépenses de protection sociale. Ni la direction générale du travail ni le ministère des affaires sociales ne disposent d’un document correspondant à celui qu’a construit la mission.
Le rapporteur estime qu’il est souhaitable, sans porter atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux, que l’État établisse chaque année un document permettant de retracer l’ensemble des dépenses, des coûts de fonctionnement et des effectifs relevant d’organismes paritaires. Un tel document favoriserait la connaissance de ce mode de gouvernance, qui est souvent la cible de clichés infondés, et permettrait au législateur de nourrir une réflexion d’ensemble sur le champ du paritarisme. Il pourrait prendre la forme d’un « jaune » joint au projet de loi de finances.
Proposition : Faire établir par les services de l’État, en coopération avec les organismes paritaires, un document général annuel retraçant les données financières des systèmes paritaires.
Ces politiques sont très variables dans leurs enjeux financiers mais aussi quant au degré d’autonomie de gestion dont disposent les partenaires sociaux. La mission n’a conservé que des champs dans lesquels les syndicats jouent un rôle significatif dans la négociation et dans la gestion.
Le paritarisme « pur » comprend les secteurs de la prévoyance et des retraites complémentaires. Cela représente une part très importante des dépenses gérées paritairement puisqu’il s’agit de 86 milliards d’euros, soit un peu plus de la moitié des sommes gérées paritairement.
Le « tripartisme de fait », conçu comme les systèmes dans lesquels l’État joue un rôle de tiers essentiel dans la construction de la norme ou dans la gestion, représente 54 milliards d’euros. Le quadripartisme correspond à la formation professionnelle soit près de 9 milliards d’euros.
RÉPARTITION DES DÉPENSES SOCIALES PAR TYPE DE GOUVERNANCE
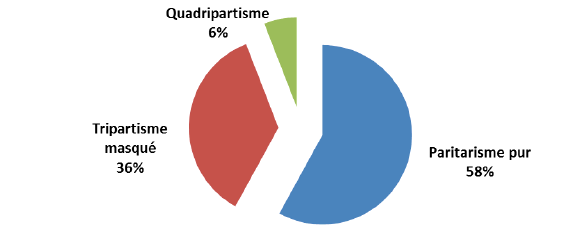
Au total, le bilan éclaire l’activité des partenaires sociaux dans des secteurs aussi différents que la prévoyance, les retraites complémentaires, l’emploi et le chômage, la santé au travail, la formation professionnelle, le logement ou le handicap. À ces secteurs, il faut ajouter le paritarisme juridictionnel des conseils de prud’hommes, qui est l’un des terrains historiques du procédé paritaire.
RÉPARTITION PAR SECTEUR DES DÉPENSES SOCIALES GÉRÉES PARITAIREMENT
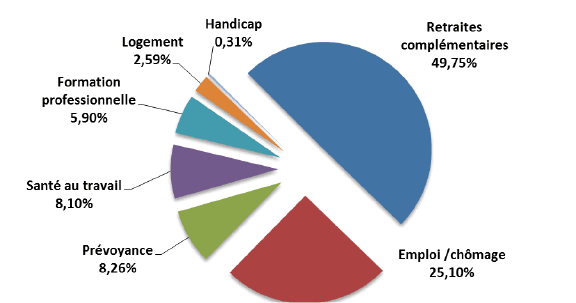
Le paritarisme se décline également dans le champ de l’entreprise dans la négociation et dans des organes aussi essentiels que les comités d’entreprise ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La mission a considéré qu’il était peu pertinent – et peu praticable, en l’espèce – d’essayer de cerner les dépenses et les effectifs concernés.
La mission a également considéré que la sécurité sociale ne relève pas à proprement parler du paritarisme dans la mesure où, d’une part, son histoire se caractérise par une succession de modes de gouvernance qui n’ont pas toujours été paritaires et, d’autre part, l’État est devenu l’acteur prédominant de la politique et de la gestion de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne l’approche financière de ce domaine, les documents annexés aux projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les travaux conduits, chaque année, par la Cour des comptes et par le Parlement offrent un panorama précis et sans cesse renouvelé.
LES ORGANISMES DE GESTION PARITAIRE EN 2014
Organisme |
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) | ||
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) | |||
Effectifs (en équivalent temps plein) | |||
Retraites complémentaires |
|||
AGIRC |
23 246 |
359 |
2 633 |
ARRCO |
44 125 |
1 388 |
10 562 |
AGFF |
6 764 |
– |
– |
Sous-total |
74 135 |
1 747 |
13 195 |
Emploi-Chômage |
|||
Pôle Emploi |
3 200 |
NC |
49 422 |
Unédic |
34 100 |
109 |
344 |
APEC |
111 |
NC |
751 |
Sous-Total |
37 411 |
NC |
50 817 |
Prévoyance |
|||
Instituts de prévoyance |
12 300 |
1 000 |
10 100 |
Centre technique des instituts de prévoyance |
3 |
6 |
24 |
Sous-total |
12 303 |
1006 |
10 124 |
Santé au travail |
|||
Branche « accidents du travail – maladies professionnelles » (ATMP) de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) |
10 757 |
896 |
– |
FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) |
521 |
8 |
84 |
FCAATA (Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) |
779 |
10 |
– |
ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) |
15 |
15 |
85 |
INRS (Institut national de recherche et de sécurité) |
– |
86 |
590 |
EUROGIP |
– |
1,5 |
12 |
Sous-total |
12 072 |
1017 |
NC |
Formation professionnelle |
|||
FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) |
1 100 |
11 |
48 |
OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) |
6 024 |
611 |
5 375 |
OPACIF (organismes paritaires collecteurs agréés pour le financement du congé individuel de formation) |
781 |
70 |
423 |
AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) |
887 |
788 |
8 275 |
Sous-total |
8 792 |
1 480 |
14 121 |
Logement |
|||
UESL (Union des entreprises et des salariés pour le logement) + CIL (Comités interprofessionnels du logement) |
3 662 |
305 |
2 966 |
AFL (Association Foncière logement) |
144 |
12 |
37 |
APAGL (Association pour l’accès aux garanties locatives) |
47 |
6 |
38 |
ANPEEC (Agence nationale pour la PEEC) fusionnée depuis le 1er janvier 2015 avec la mission interministérielle d’inspection du logement social au sein de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) |
0,5 |
8 |
43 |
Sous-total |
3 854 |
331 |
3 084 |
Handicap |
|||
AGEFIPH |
462,6 |
47,5 |
384 |
Sous-total |
463 |
48 |
384 |
TOTAL |
149 029 |
– |
– |
B. LE CAS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : LE PARITARISME COMME PARENTHÈSE
La Sécurité sociale constitue un cas à part dans la mesure où le paritarisme – souvent évoqué dans les médias ou par les partenaires sociaux – n’y a en réalité existé que pendant une très brève période – et encore, sous une forme toujours édulcorée. Un rappel historique permettra d’illustrer ce qu’est le paritarisme et de qualifier la situation originale des partenaires sociaux au sein de la Sécurité sociale aujourd’hui, souvent considérée – à tort – comme relevant du paritarisme de gestion (38).
Les partenaires sociaux participent historiquement à la direction des organismes de sécurité sociale, avec l’État et la direction salariée. Cette participation reposait sur leur rôle fondateur dans la création de la Sécurité Sociale, mais aussi sur l’idée que, le financement étant assuré par les cotisations sociales des salariés et des employeurs, la participation de leurs représentants à la gestion des sommes collectées était légitime.
L’importance des partenaires sociaux a sensiblement diminué dans la gouvernance des organismes de sécurité sociale. De 1947 à 1967, des élections permettaient de désigner les administrateurs de la Sécurité sociale. De 1967 à 1996, la gestion quotidienne a été confiée aux partenaires sociaux qui désignent directement les administrateurs. À partir de 1996, l’importance des partenaires sociaux a diminué avec le renforcement du contrôle du Parlement sur les finances sociales, avec un partenariat plus étroit avec l’État en matière de gestion (convention d’objectifs et de gestion) et avec un renforcement de la direction salariée.
1. 1945-1967 : la gestion par les intéressés
a. Un contexte politique défavorable à une gestion étatique
Comme le rappellent MM. Gilles Pollet et Didier Renard dans leurs travaux, le choix du mode de gouvernance de la sécurité sociale a fait l’objet de débats importants avec les organisations de salariés et d’employeurs, les organismes mutualistes (39) et les hauts fonctionnaires. Tous avaient en commun de ne pas vouloir confier directement le système à l’État, conformément à l’état d’esprit qui prévalait à l’époque (40) et que reflète bien l’exposé des motifs du projet d’organisation de la Sécurité sociale (41) déposé devant l’Assemblée constituante provisoire : « l’organisation nouvelle doit éviter le risque bureaucratique. Elle doit être faite d’institutions vivantes, se renouvelant par une création continue, par l’effort des intéressés eux-mêmes chargés par leurs représentants d’en assurer directement la gestion ». La gestion de la Sécurité sociale a donc été finalement confiée aux intéressés dès le départ pour plusieurs raisons dont il est difficile aujourd’hui de savoir laquelle a eu l’impact le plus décisif mais qui, comme on l’a vu précédemment, ont toutes été revendiquées par les syndicats et assumées par le pouvoir politique :
– les droits étaient créés en faveur des travailleurs ;
– le financement était assuré par des cotisations sociales ;
– les prestations étaient contributives, c’est-à-dire assises sur le montant des cotisations individuelles ;
Cette « gestion par les intéressés » est parfois appelée « démocratie sociale » ou « gestion ouvrière » par certains acteurs. Elle repose sur la volonté de tenir à distance un État devenu synonyme de difficultés mais aussi sur le souhait, très proche de celui qui donne naissance au paritarisme, de favoriser ce qu’on appelle alors la « collaboration de classes ». La dureté des relations sociales est en effet jugée contraire au besoin de développement de la protection sociale dans le pays. Elle correspond aussi au programme du Conseil national de la Résistance qui appelle à « une véritable démocratie économique et sociale » et à « la participation des travailleurs à la direction de l’économie ». Le mode de gestion est d’ailleurs considéré comme émancipateur par les fondateurs comme Pierre Laroque qui écrit en 1948 : « Nous voulons que les travailleurs considèrent que les institutions de la sécurité sociale sont des institutions à eux, gérées par eux et où ils sont chez eux » (42).
Ce choix est vécu par la CGT comme une véritable conquête ouvrière (43) tant pour les prestations qu’elle crée que pour le mode de gestion retenu qui met fin aux caisses patronales et à l’assurance privée. Le projet de sécurité sociale obtient également des soutiens politiques appuyés des principaux partis de l’époque que sont la Section française de l’Internationale ouvrière, le Mouvement républicain populaire et le Parti communiste (44). Il est d’ailleurs défendu avec véhémence par le conseil d’administration contre les tentatives d’immixtion de l’État qui se soldent par un échec parfois retentissant pour le gouvernement (45).
b. Une organisation affirmant la prépondérance des salariés dans les conseils d’administration
Le choix de l’autonomie par rapport à l’État implique la création des caisses autonomes de sécurité sociale avec trois niveaux : local, régional et national, les caisses régionales et nationale ayant la charge de piloter le réseau à leur échelon respectif.
Juridiquement, la caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public alors que les caisses locales et régionales sont des personnes privées. Les compétences respectives de chaque échelon sont bien délimitées : les caisses primaires (locales) assurent le recouvrement des cotisations et le versement des prestations ; les caisses régionales arrêtent la politique sanitaire et la tarification des cotisations d’accident du travail ; la caisse nationale assure la compensation entre les différentes caisses et gère les fonds nationaux d’action sanitaire et sociale et le fonds de prévention des accidents du travail. Le choix de la déconcentration repose sur la volonté de conserver les avantages des caisses antérieures, l’implication de leurs membres paraissant être gage de leur efficacité.
Pour autant, la gouvernance connaît deux phases.
En 1945, il est prévu, d’une part, que le conseil d’administration de chaque caisse soit composé pour les deux tiers des représentants des salariés et pour un tiers des représentants des employeurs (46) et, d’autre part, que les membres de conseils d’administration soient désignés par leurs organisations professionnelles respectives. Ce choix résulte notamment de la crainte de l’abstention aux élections et de la volonté d’assurer une représentation claire de toutes les organisations.
Une exception est consentie, à titre temporaire, pour les caisses d’allocations familiales, héritières des caisses patronales et où s’applique, de ce fait, un paritarisme strict en raison du rôle historique du patronat dans la mise en place de cette catégorie de prestations.
Les élections pour la présidence des conseils d’administration des caisses, le 1er juillet 1946, donnent 80 % des présidences à la CGT. Celle-ci acquiert donc une position dominante dans la gouvernance de la sécurité sociale, renforcée par la mise en place de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale (FNOSS) (47) qui a vocation à défendre les intérêts des organismes de sécurité sociale face aux pouvoirs publics.
La situation ne dure pas. Avec la loi n° 46-2425 du 30 octobre 1946, le principe de l’élection des administrateurs est rétabli, car jugé plus à même d’assurer un lien direct avec les bénéficiaires. L’élection, qui intervient en 1947, est beaucoup moins favorable à la CGT, qui recule scrutin après scrutin au profit de la CFTC et de petites listes mutualistes jusqu’à passer en dessous des 50 % des voix à partir de 1950. Cette érosion, suivie de la scission avec la CGT-FO, se traduit par la perte de majorité de la centrale dominante dans beaucoup de conseils d’administration des caisses. Par ailleurs, l’équilibre des forces au sein des conseils d’administration des caisses est déplacé au profit des organisations de salariés, leurs représentants et ceux des organisations d’employeurs étant désormais dans un rapport de 3 pour 1.
Le conseil d’administration de la caisse nationale a la particularité de compter 6 membres représentant l’État, dont le président, issu du Conseil d’État, un représentant de la Caisse des dépôts et consignations, 15 administrateurs élus par les caisses régionales et 6 administrateurs élus par les caisses d’allocations familiales. Les représentants des organismes de sécurité sociale sont donc majoritaires mais les décisions peuvent être annulées par les autorités de tutelle, qui nomment par décret le directeur de la caisse.
c. Le poids déjà très important de l’État dans la gestion de la sécurité sociale
L’État assure donc sur l’ensemble une tutelle – conçue comme légère au départ –, à l’aide de la direction générale de la Sécurité sociale et de ses déclinaisons régionales, qui est alors rattachée au ministère du Travail. Le contrôle est assuré par le ministère des Finances, notamment par la direction du budget. Le Parlement a également un rôle important puisque l’organisation et le financement sont de compétence législative jusqu’à la Constitution de 1958 qui renvoie ces matières dans le champ du pouvoir règlementaire. Aussi, la décision d’augmenter ou de diminuer les cotisations ou les prestations revient au Parlement, puis au Gouvernement, sans que les partenaires sociaux n’aient leur mot à dire, ce qui fait dire au spécialiste de la protection sociale, M. Bruno Pallier, que « dès les premières années de fonctionnement, le mode d’organisation de la Sécurité sociale, qui se traduit peu à peu par un tripartisme de fait, a engendré des conflits de compétences entre l’État et les partenaires sociaux au sein des caisses de Sécurité sociale » (48). L’historien Bruno Valat le confirme : « l’intervention de l’État dans la vie des caisses, si elle a pu prendre une place accrue au fur et à mesure de l’évolution du régime général et de la banalisation du projet fondateur, était déjà très importante dès le départ. » (49).
d. Une gouvernance délicate dans un contexte de hausse des dépenses
Lors de la mise en place de la sécurité sociale, le principe de la gestion par les intéressés a été d’autant mieux accepté par le gouvernement et l’administration que le pilotage financier avait été conçu comme assez simple, les cotisations ayant été calculées ab initio comme suffisantes pour couvrir les dépenses pendant de nombreuses années. La réalité économique se révèle néanmoins rapidement très différente. Les dépenses d’assurance-maladie sont difficilement maîtrisées en raison du conventionnement médical et de la modernisation de l’équipement hospitalier, ce qui oblige les pouvoirs publics à intervenir en 1961 pour relever les taux de cotisations patronales. Les divergences de vues entre partenaires sociaux d’une part, et avec la tutelle de l’État, d’autre part, rendent difficiles toutes les décisions. M. Bruno Valat rappelle qu’en 1960, l’État a annulé chaque jour huit décisions de caisse et confié par décret davantage de prérogatives aux directeurs des caisses.
La première Sécurité sociale échappe donc au champ du paritarisme à double titre : en premier lieu, elle est fondée sur une « gestion ouvrière » et non sur un modèle « paritaire », considéré comme une réminiscence des caisses patronales ; en second lieu, elle est déjà marquée par une tutelle très active de l’État alors qu’elle connaît ses premières difficultés financières.
2. 1967-1982 : le retour très temporaire au paritarisme dans un contexte financier difficile
a. Les ordonnances « Jeanneney » : une réforme profonde de la gouvernance dans un contexte favorable au paritarisme
La réforme de 1967 est d’abord le produit d’un contexte financier difficile. L’augmentation croissante des dépenses sociales a conduit à des ajustements chaotiques dans les années 1960 qui ont rendu nécessaire une réflexion sur l’évolution du régime. Le Premier ministre Georges Pompidou annonce la réforme au printemps 1967, sous la forme d’ordonnances.
Les principales mesures intéressant la gouvernance de la sécurité sociale sont l’éclatement de la caisse nationale de sécurité sociale, remplacée par la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), gérant également les accidents du travail, la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en vue de séparer les risques et d’éviter des compensations jugées contraires à la responsabilisation des partenaires sociaux. La forme juridique de ces caisses reste celle d’établissements publics sous tutelle de l’État. La présidence est assurée par un membre élu issu du conseil d’administration.
Les conseils d’administration sont réduits à dix-huit membres au lieu de trente et un. Le nombre de représentants de l’État est drastiquement réduit. Enfin, le paritarisme est introduit dans les caisses d’assurance-maladie à raison de 9 représentants des salariés et de 9 représentants des employeurs (50).
Cette transformation s’accompagne de la fin des élections au profit de la désignation par les organisations représentatives. La répartition paritaire est alors immédiatement décriée par les syndicats qui y voient un renforcement inopportun du rôle du patronat ; elle laissera des traces, comme le montrent les propos de M. Jean-François Naton, vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (commission AT-MP) : « Le paritarisme, imposé par les ordonnances de 1967, a été en partie mis en œuvre pour évincer la CGT des présidences des caisses de sécurité sociale. Les conseils d’administration étant composés pour deux tiers de représentants de salariés et pour un tiers de représentants d’organisations patronales, cela permettait au camp salarié de présider la majorité, si ce n’est la totalité des caisses de sécurité sociale. Le rééquilibrage opéré à l’époque par le paritarisme s’est fait au détriment de la CGT » (51).
Cette analyse est convaincante dans la mesure où, d’une part, il est très directement mis fin à la « gestion ouvrière » qui prévalait jusque-là, et, d’autre part, le patronat uni dans le conseil d’administration en devient la force centrale face à un syndicalisme éclaté. Le gouvernement d’alors accuse la « gestion ouvrière » d’une forme de surenchère en termes de remboursements. Il estime que la confusion du rôle de l’État et de celui des partenaires sociaux a joué un rôle dans les difficultés financières des années 1950-1960. Par ailleurs, les régimes complémentaires paritaires sont, à l’époque, en meilleure santé financière, fait valoir très tôt le Conseil national du patronat français (CNPF) auprès du gouvernement (52), alors même que la démographie y est pour beaucoup. Le paritarisme correspond donc avant tout, du point de vue des décideurs publics, à une réalité financière, d’autant que les conseils ont gagné dans la réforme le droit d’augmenter les cotisations.
b. Une gouvernance renouvelée et renforcée, chargée de redresser les comptes de la sécurité sociale
La période qui suit la mise en place des ordonnances voit un renforcement des caisses nationales : le décret du 24 septembre 1973 les autorise à annuler les décisions d’une caisse locale qui compromettent l’équilibre financier. Dans les conseils d’administration, les collèges patronaux, susceptibles d’avoir facilement une majorité, pèsent pour confier aux directeurs davantage de responsabilités que ne le faisaient les syndicats. La CGT et la CFDT se situent dans l’opposition à cette gestion pour protester contre l’importance du patronat. Les présidences des caisses nationales reviennent alors à Force Ouvrière (CNAMTS), à la CFTC (CNAF) et au CNPF (CNAV).
3. 1982-1995 : le retour partiel à la gestion par les intéressés
Le changement de majorité se traduit dès 1982 par la volonté de revenir aux principes de l’élection et de la gestion par les intéressés, les représentants des salariés obtenant désormais trois cinquièmes des sièges des conseils d’administration. Cependant, les cinq organisations de salariés représentatives au plan national se voient octroyer un monopole de présentation des candidats (53) et les représentants des employeurs restent désignés par leurs organisations respectives. Quelques sièges complémentaires sont attribués aux mutualistes et aux associations familiales.
Les élections du 19 octobre 1983 sont marquées par une forte abstention et par la dispersion des forces syndicales (54). De cet échec démocratique résulte la prolongation, jusqu’à la réforme de 1996, des mandats des administrateurs, qui couraient jusqu’en octobre 1989. Après le changement de majorité aux élections législatives de 1993, le nouveau gouvernement rétablit le paritarisme à l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS) dès 1994 (55).
La loi du 25 juillet 1994 semble s’inscrire dans le sillage des ordonnances de 1967 en confirmant le principe de la séparation en quatre branches distinctes
– maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et famille –, chacune émargeant cependant à une trésorerie commune gérée par l’ACOSS (56). Les caisses nationales obtiennent le pouvoir de donner leur avis, de proposer des réformes ou des mesures aux caisses de base, la volonté de l’État étant de voir les caisses nationales se substituer à lui dans le contrôle du réseau des caisses locales.
Prélude aux réformes de 1995, le Parlement vote également la remise d’un rapport annuel du gouvernement présentant la politique de sécurité sociale ainsi que d’un rapport annuel de la Cour des comptes.
4. De 1995 à aujourd’hui : une place difficile à trouver au milieu de l’étatisation
Si certaines évolutions étaient déjà perceptibles dans la loi de 1994, le « plan Juppé » présenté à l’Assemblée nationale le 15 novembre 1995 marque véritablement le début d’une évolution qui conduira à affirmer – ce qui existait déjà de manière plus ou moins masquée – la centralité de l’État dans la gestion des organismes de sécurité sociale.
Si les préoccupations qui ont conduit à mettre en place une « gestion ouvrière » en 1945 ou le paritarisme en 1967 étaient de nature politique, celles qui sous-tendent la réforme de 1995 sont, aux dires de leurs promoteurs, largement financières : la situation de la Sécurité sociale était très difficile après la récession de 1993. La réforme s’inscrit également dans un contexte européen contraint par les critères financiers à respecter pour faire entrer la France dans la monnaie unique. Enfin, la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991, qualifiée par le Conseil constitutionnel d’imposition de toute nature, donnait à l’État une légitimité de financeur de la Sécurité sociale, qui explique d’ailleurs que FO et la CGT se soient opposés à cette réforme.
Les mesures adoptées importent donc moins par l’évolution du conseil d’administration que par les nouveaux outils que se donnent les pouvoirs publics pour orienter et contrôler la gestion des caisses de sécurité sociale. La clarification des responsabilités qui s’était faite en faveur des partenaires sociaux, et plus particulièrement des représentants patronaux, en 1967, se fait désormais au détriment des administrateurs des caisses.
Peut-être faut-il mentionner ici les propos de M. Raymond Soubie, président du groupe d’information professionnelle AEF, président des sociétés de conseil Alixio et Taddeo, et conseiller du Président de la République de 2007 à 2010. Soulignant que « les régimes paritaires sont de nature très différente », et que « si les partenaires sociaux ont un véritable pouvoir de décision dans certains d’entre eux – retraite complémentaire, assurance chômage, prévoyance, formation –, d’autres régimes, tout en demeurant paritaires, ont été vidés de leur substance, en particulier celui de l’assurance maladie », M. Soubie a rappelé que « les ordonnances de 1967 avaient prévu que le conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie pouvait décider des augmentations de cotisation. Les partenaires sociaux disposaient, au moins en droit, de ce pouvoir financier, mais ils ne l’ont jamais utilisé, estimant qu’il était préférable de laisser l’État prendre les mesures impopulaires lorsqu’elles étaient nécessaires. […] On affirme généralement que la protection sociale est confiée à des régimes paritaires, mais, selon moi, on ne peut pas dire qu’ils soient véritablement paritaires lorsque l’État est seul maître des financements et des prestations » (57).
Pour M. Éric Aubry, le « plan Juppé » de 1995, puis la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, ont « eu le mérite de la clarification : il a été reconnu que le système n’est pas paritaire, et que c’est bien le Parlement qui adopte le PLFSS [projet de loi de financement de la sécurité sociale] et l’État qui prend les décisions » (58).
Ainsi, l’État fixe désormais le cadre financier général dans lequel s’inscrit la gestion des caisses à travers deux outils : les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) et les conventions d’objectifs et de gestion (COG).
Les premières, prévues par la loi constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996, fixent les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale qui conditionnent l’équilibre financier. La loi organique du 2 août 2005 complète cette démarche en inscrivant les dépenses sociales dans le cadre des dépenses publiques qui sont soumises au même travail de prévisions financières que le budget de l’État.
Le second aspect de cet encadrement n’est pas unilatéral mais contractuel : il s’agit de créer un partenariat avec les caisses dans une logique d’efficacité. Les conventions d’objectifs et de gestion, instrument alors plutôt novateur dans la sphère publique, fixent pour au moins trois ans les objectifs de gestion et les moyens de fonctionnement des branches. La gestion des caisses est donc soumise à des objectifs et évaluée à leur aune, ce qui n’est pas complètement nouveau mais affirme le rôle de l’État à un degré qui n’avait jamais été aussi élevé. Les COG joue un rôle essentiel dans le nouveau pilotage financier puisqu’elles impliquent à la fois à la direction technique et le président du conseil d’administration. M. Thomas Fatome, directeur de la Sécurité sociale, les a effectivement présentées comme un outil « technique » mais aussi comme un outil « politique entre les mains de l’État, des caisses et de leur gouvernance même si les points d’accord sont parfois difficiles à atteindre » (59).
La réforme de la gouvernance revient, quant à elle, aux principes de la réforme de 1967, à savoir le « paritarisme sur désignation » et augmente même l’effectif des conseils alors que le sens des réformes avait jusqu’ici été inverse. Cela s’explique par l’introduction de personnalités qualifiées qui viennent s’ajouter aux représentants désignés de l’État, sans voix délibérative. La durée du mandat passe de six à cinq ans, celui-ci étant renouvelable une fois, avec un âge maximal de nomination à 65 ans. Le paritarisme d’administration reste toutefois encadré puisque des conseils de surveillance sont créés auprès de chaque caisse nationale avec des représentants du Parlement, des collectivités locales, de personnalités qualifiées et de représentants de la société civile (retraités, familles, associations) (60).
b. La réforme de l’assurance-maladie du 13 août 2004 : une étatisation assumée
La réforme de 2004 est le prolongement des réformes de 1994 et de 1996 : en effet, il s’agit à la fois de donner à la caisse nationale un rôle de pilotage du réseau très important et de donner au directeur nommé par décret la conduite opérationnelle.
Le renforcement de la CNAMTS passe par la création de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) placée sous la houlette du directeur général de la CNAMTS, qui devient responsable de la négociation et de la signature des conventions avec les professions de santé à la place du conseil de la caisse. Ce directeur est nommé pour cinq ans en conseil des ministres et ne peut être démis de ses fonctions que sur un vote défavorable des deux tiers des membres du conseil. Le conseil d’administration devient d’ailleurs un simple « conseil », ce qui marque son recentrage vers l’orientation stratégique et son éloignement de la gestion opérationnelle. Il pilote un réseau hiérarchisé de caisses régionales et locales.
c. Un paysage étatisé dans lequel les partenaires sociaux jouent un rôle limité
Il en ressort un affaiblissement des caisses de base, reflet du très net éloignement avec le choix fait en 1945 de confier un système d’inspiration mutualiste à une « gestion ouvrière » locale, et, au-delà, d’organiser le pilotage de la sécurité sociale autour des partenaires sociaux. Les réformes de la sécurité sociale ont en effet conduit à une véritable étatisation, dans laquelle il faut distinguer ce qui relève du renforcement des caisses nationales, dans le cadre d’une logique de réseau, et ce qui relève d’un encadrement très fort de l’État, associé à la place souvent prépondérante donnée au directeur dans le pilotage opérationnel.
i. Des conseils d’administration qui ne relèvent plus du paritarisme pur…
Les conseils des caisses de sécurité sociale ne relèvent plus véritablement du paritarisme de gestion au sens où on l’entend dans d’autres champs comme les retraites complémentaires ou l’assurance-chômage. En effet, la composition comprend des mandataires qui ne font partie ni du collège des salariés ni de celui des employeurs et les prérogatives des conseils sont limitées.
• Des conseils où les partenaires sociaux cohabitent avec d’autres mandataires
Ainsi que l’indiquait M. Gérard Rivière, président de la CNAV, « Le paritarisme a une forme tout à fait atypique dans les organismes de Sécurité sociale, bien qu’il associe étroitement les partenaires sociaux. » (61).
Les administrateurs, élus pour cinq ans, voient leur nombre de siège réparti comme suit pour les caisses nationales :
CNAMTS (conseil) |
CNAF (conseil d’administration) |
CNAVTS (conseil d’administration) |
ACOSS (conseil d’administration) | |
Représentants des partenaires sociaux | ||||
Représentants des assurés sociaux (13 sur désignation) |
3 CGT 3 CGT-FO 3 CFDT |
2 CFTC 2 CGC | ||
Représentants des employeurs (désignation) |
7 MEDEF 3 CGPME 2 UPA |
6 MEDEF 2 CGPME 2 UPA |
7 MEDEF 3 CGPME 3 UPA |
6 MEDEF 2 CGPME 2 UPA |
Indépendants (désignation) |
1 UNAPL |
1 UPA 1 CGPME 1 UNAPL/CNPL |
– |
1 UPA 1 CGPME 1 UNAPL/CNPL |
Sous-total |
26 |
26 |
26 |
26 |
Autres représentants | ||||
Représentants des associations (désignation) |
1 UNAF 1 FNATH 1 CISS |
5 UNAF |
– |
– |
Personnalités qualifiées (désignation par le ministre chargé de la sécurité sociale) |
2 |
4 |
4 |
4 |
Autres |
3 FNMF |
– |
– |
– |
Sous-total |
8 |
9 |
4 |
4 |
Total |
34 |
35 |
30 |
30 |
Mandat |
5 ans | |||
La répartition est un peu différente pour les caisses locales, même si les règles de mandat sont les mêmes :
Catégories |
Instance compétente |
CPAM |
CAF |
URSSAF |
CARSAT |
Membres avec voix délibérative | |||||
Assurés sociaux |
Organisations syndicales nationales représentatives des salariés (a) |
8 |
8 |
8 |
8 |
Employeurs et travailleurs indépendants |
Organisations nationales représentatives (b) |
8 |
8 |
8 |
8 |
Mutualistes |
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) |
2 |
– |
– |
1 |
Familles |
Unions d'associations familiales |
– |
4 |
– |
– |
Institutions intervenant dans le domaine concerné |
Préfet de région |
4 |
4 |
4 |
4 |
Personnalité qualifiée |
Ministre chargé de la sécurité sociale |
1 |
– |
– |
– |
Sous-total |
23 |
24 |
20 |
21 | |
Membres avec voix consultative | |||||
Élus du personnel |
3 |
3 |
3 |
3 | |
Associations familiales |
1 |
– |
– |
1 | |
a) CGT (2) – FO (2) – CFDT (2) – CFTC (1) – CGC (1)
b) 5 représentants des employeurs et trois des travailleurs indépendants.
Source : Dominique Ceccaldi et Jean-Philippe Lhernould, Fascicule 201 : Généralités- Organisation et gouvernance de la sécurité sociale, Jurisclasseur Protection sociale. Traité, 1er janvier 2015.
La clef de répartition des mandataires issus des organisations syndicales est fixée par le pouvoir règlementaire (62) qui tient compte du poids de chaque organisation sans que l’on puisse parler de représentation parfaitement proportionnelle. S’agissant des organisations d’employeurs, le principe était initialement un accord entre les trois organisations patronales jusqu’à ce qu’en 2001, le MEDEF et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) refusent de désigner des représentants pour protester contre la loi sur les 35 heures. L’Union professionnelle artisanale (UPA) a obtenu du gouvernement un décret fixant une répartition des sièges (63).
L’État est présent au travers de personnalités qualifiées qui n’ont pas de voix délibérative. Enfin, les conseils comprennent des représentants de tiers comme les associations familiales (64) ou de la mutualité (65) dans des proportions qui ne sont pas négligeables. Ces administrateurs ont une voix délibérative. Cette immixtion n’est pas toujours appréciée des partenaires sociaux comme le rappelle M. Jean-François Naton : « À la CNAMTS, on peut dire qu’on est aussi dans une fonction paritaire. Mais, de réforme en réforme, de loi en loi, on a rajouté des organismes. Le paritarisme n’est donc plus dans sa forme originelle. Ce n’est plus du paritarisme quand on est avec des personnes qualifiées, la mutualité, les associations… » (66).
Les fonctions d’administrateur sont assumées à titre bénévole, les dépenses exposées du fait de leur activité relevant de défraiements pour déplacements, repas et hébergement (article L. 231-12 al. 3 du code de la sécurité sociale).
Les administrateurs sont soumis au secret professionnel et à une obligation de réserve. En cas de manquement, ils peuvent être révoqués par le ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d’administration.
• Des prérogatives réelles mais limitées
Les administrateurs bénéficient de prérogatives significatives, comme le droit d’obtenir tous les moyens nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, la participation à l’élection du président de la caisse nationale, la détermination d’objectifs de résultats et de performance, dans le cadre par exemple des contrats pluriannuels de gestion (CPG) conclus avec les caisses du réseau.
Le conseil d’administration approuve le budget de gestion et d’intervention qui peut être rejeté à la majorité qualifiée. Enfin, il délibère sur les grandes orientations de certaines politiques comme la politique d’action sanitaire et sociale au sein des caisses primaires d’assurance maladie ou la politique de relations avec les usagers. Il approuve les comptes de la caisse. Le conseil d’administration est saisi pour avis de tout projet de mesure législative ou règlementaire qui concerne la caisse. Les caisses nationales sont notamment saisies pour la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui les concerne. Toutefois, les conditions dans lesquelles le texte est transmis et la motivation de l’avis – qui prend la forme d’une juxtaposition des opinions émises par chaque organisation – affadissent l’impact de cet avis et font que cette prérogative n’a pas la portée qu’elle mérite.
M. Dominique Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale, a d’ailleurs estimé qu’« On pourrait s’interroger sur la façon d’améliorer ce processus de consultation, de concertation. S’agissant de la loi de financement de la sécurité sociale, les caisses disposent sans doute de délais trop courts pour pouvoir émettre un avis très motivé. En outre, les conseils et les caisses font une addition d’avis de chaque partenaire social alors qu’un avis commun motivé aurait plus d’impact, surtout si sa publicité était bien assurée » (67).
Les conseils de la branche assurance-maladie ont perdu toutes leurs prérogatives de gestion pour se concentrer sur des missions d’orientation de la politique de gestion du risque.
ii. … laissant l’essentiel de la gestion aux directeurs
L’évolution du statut des directeurs de caisse a été directement inverse de celle des conseils d’administration.
La gestion mutualiste qui a beaucoup inspiré les fondateurs de la sécurité sociale laissait peu de place au directeur, ce qui explique que celui-ci n’avait aucun statut en 1945. Le décret du 12 mai 1960 (68) a comblé ce vide en précisant qu’il était élu par le conseil d’administration et agréé par le ministre compétent. L’ordonnance du 24 avril 1996 a donné son indépendance au directeur vis-à-vis du conseil d’administration en le faisant nommer, pour les caisses nationales, par le ministre, et pour les caisses locales, par le directeur national sur proposition du conseil d’administration. La même ordonnance lui a aussi donné des pouvoirs propres : le directeur nomme ses collaborateurs et a seul autorité sur le personnel ; il ordonne les dépenses, décide des actions en justice et représente la caisse à cette occasion ; il préside le comité d’entreprise ; il prépare le budget et les rapports d’activité avec ses services.
iii. Le tripartisme asymétrique : un aboutissement inévitable
La gouvernance de la sécurité sociale est donc marquée par un tripartisme asymétrique apparu dès les premières difficultés de gestion et qui s’est progressivement accentué, même si la tutelle a pu être temporairement allégée à certains moments où le gouvernement mettait l’accent sur la responsabilisation des partenaires sociaux.
Malgré la prédominance de l’État, la plupart des personnalités auditionnées sont convaincues de maintenir une forte présence des partenaires sociaux dans la gouvernance. Il en est ainsi des deux derniers directeurs de la Sécurité sociale, entendus dans le cadre de la mission.
M. Dominique Libault a estimé que « les partenaires sociaux ont un rôle à jouer dans le pilotage dans le cadre de la solidarité nationale » mais que l’État ne peut pas leur laisser une très grande autonomie dans un domaine qu’il a investi pleinement par la technicité de la gestion et par la fiscalité : « Asymétrique, cette relation doit le rester : il ne s’agit certainement pas de donner un tiers des voix à l’État dans un domaine donné » (69).
M. Thomas Fatome développe une analyse très intéressante dans laquelle la complexité institutionnelle n’est pas un frein au bon fonctionnement des caisses :
« Il est de bon ton de dire qu’il est complexe, peu transparent, etc. Au risque de passer pour conservateur, ou de sembler faire un plaidoyer pro domo, je considère que ce système un peu original de gouvernance a de nombreux d’atouts, qui se démontrent au quotidien. Les caisses absorbent des transformations très significatives ; par exemple, la branche famille est en train d’absorber la prime d’activité dans des délais resserrés et dans d’assez bonnes conditions, même si la situation peut parfois se tendre dans certaines caisses. La sécurité sociale s’est profondément transformée ces dernières années, dans son organisation comme dans son offre de services, significativement élargie. Nous sommes en train de réussir la déclaration sociale nominative, qui est aussi une œuvre collective de l’État et des caisses. Inutile de revenir sur la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), sur le chèque emploi service universel (CESU) ou sur la carte Vitale. Et aujourd’hui, vous pouvez obtenir, sur internet, un rendez-vous en moins de sept jours dans une caisse d’allocations familiales (CAF).
« Je pense donc que le système fonctionne et qu’il est agile, précisément en raison de la répartition des rôles que je vous ai décrite. Nous n’avons pas en face de nous 90 000 opérateurs, une entreprise unique côté CNAM, et 30 000 personnes côté famille. Nous avons des têtes de réseau et des organismes locaux responsables et autonomes, des conseils d’administration au niveau local, des directeurs. Ce n’est pas forcément toujours simple, le système peut se gripper
– c’est rare – mais il permet de concilier souplesse et réactivité et il assure une capacité de transformation qui est intéressante dans l’univers public que nous connaissons. » (70)
Le constat de M. Gérard Rivière est très proche : « J’en viens au rôle du conseil d’administration de la CNAV. Il diffère en fonction du champ et de nos métiers. Il convient de distinguer notre rôle en fonction de la nature des prestations servies, c’est-à-dire si l’on s’adresse à des prestations légales ou extralégales.
« Si l’on s’adresse à des prestations légales, c’est-à-dire les prestations d’assurance vieillesse, le paiement des pensions, notre responsabilité est essentiellement de veiller à la politique de proximité, à la relation client si l’on peut dire, au maillage territorial, par exemple assurer le développement des nouvelles technologies pour fournir à la fois un service public moderne adapté à son temps, ce qui permet concomitamment de réduire les coûts de fonctionnement, et assurer la présence territoriale physique pour accueillir les personnes les plus fragiles et les plus éloignées des nouvelles technologies. La qualité de service est assurée en co-responsabilité, c’est-à-dire par le conseil d’administration et la direction.
« Si l’on s’adresse à des prestations extralégales, c’est-à-dire notamment l’action sociale en faveur des personnes âgées, le conseil d’administration joue un rôle beaucoup plus étendu puisqu’il définit les orientations qui seront ensuite validées par l’État puis reprises dans la convention d’objectifs et de gestion. » (71)
Les partenaires sociaux maintiennent un lien étroit avec le terrain, ce qui était leur vocation principale, pour les fondateurs de la sécurité sociale. M. Jean-Louis Deroussen, président de la CNAF, l’a rappelé pour le champ qui le concerne : « Ce niveau local s’incarne dans les conseils d’administration des CAF, composés chacun de 24 membres, soit près de 2 500 administrateurs sur l’ensemble du territoire. Autant d’hommes et de femmes en lien direct avec les allocataires, les familles, les associations, les élus, les partenaires, autant d’hommes et de femmes en prise directe avec la réalité du territoire et des besoins qui s’y expriment, ce qui leur permet de faire remonter les propositions. De surcroît, ces administrateurs sont déjà engagés dans un milieu associatif, ou comme élus dans un conseil municipal, ou bien dans leur entreprise ou leur branche professionnelle en tant que délégués syndicaux, ou encore auprès des partenaires comme acteurs de centres sociaux. De cette richesse dans chaque CAF découle la capacité à mettre en place des dispositifs. » (72)
Il a également insisté sur l’action sociale menée à travers les caisses : « Si, demain, les 5 milliards d’euros de notre action sociale devenaient une forme de prestation aux contours définis par l’État, les partenaires sociaux n’auraient plus la possibilité d’adapter les orientations nationales aux réalités locales. Ce serait là pour le coup un paritarisme de figuration. Le réseau des CAF resterait, certes, réactif et productif – les personnes toucheraient leurs prestations –, mais il deviendrait incapable de conduire des diagnostics de terrain, de mener des expérimentations et d’apporter des solutions adaptées aux attentes des Français. Autrement dit, si demain les budgets qui sont aux mains de nos administrateurs locaux étaient cadrés et fléchés, nos commissions, qui travaillent dossier par dossier, allocataire par allocataire, ne pourraient plus apporter l’aide spécifique dont ont besoin certains allocataires notamment pour surmonter des caps difficiles. Cette politique menée par nos CAF ne peut pas être conduite de Paris. Pour ne pas en arriver à un tel paritarisme de figuration, il faut résister aux tentations de confisquer les marges de manœuvre des partenaires sociaux. » (73)
En définitive, le paysage de la Sécurité sociale a évolué depuis trente ans, principalement sous la contrainte financière, dans le sens d’un renforcement du rôle de l’État. D’autres choix étaient possibles, mais la mission a pu constater que ce mouvement est peu remis en cause aujourd’hui – compte tenu de la nature des prestations gérées par la Sécurité sociale, considérée comme devant relever de la solidarité nationale –, tout comme le maintien d’une forte présence syndicale et patronale dans la gouvernance.
C. LE PARITARISME D’ENTREPRISE ET DE NÉGOCIATION
Afin de clarifier les notions de paritarisme « d’entreprise » et de « négociation », il est utile de préciser d’abord celles de « démocratie sociale », de « dialogue social » et de « négociation collective ».
Lors de son audition, M. Henri Rouilleault, ancien conseiller du Premier ministre Michel Rocard et ancien directeur général de l’ANACT, a défini la « démocratie sociale » comme « le système d’acteurs permettant de définir et de mettre en œuvre les règles relatives aux relations professionnelles, ce qui renvoie non seulement aux acteurs de la démocratie politique – Gouvernement et Parlement – mais également aux organisations professionnelles d’employeurs et aux syndicats de salariés » (74).
Cette notion ne doit pas être assimilée à celle de « dialogue social » qui, d’après M. Henri Rouilleault désigne toutes les formes de dialogue entre les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés, qu’il s’agisse du partage ou de l’échange d’informations, de la consultation, de la concertation ou de la négociation, et cela à tous les niveaux (comités d’entreprise, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel, etc.).
Quant à la négociation collective, elle est, selon M. Henri Rouilleault, « la forme privilégiée du dialogue social, dans la mesure où elle matérialise la recherche d’un équilibre des intérêts par la négociation et la signature d’un accord entre les représentants des employeurs et des salariés » (75).
Le « paritarisme de négociation » correspond à la notion de « négociation collective » – négociation dont un état des lieux a pu être dressé au gré des travaux de la mission et a conduit le rapporteur à formuler des propositions destinées à en améliorer la méthode.
1. L’état des lieux de la négociation collective
Depuis le début du XXe siècle, s’est progressivement créée, entre la loi et le contrat de travail, une source de droit spécifique, liée à la faculté reconnue aux syndicats de salariés et aux organisations d’employeurs de négocier des accords collectifs susceptibles de créer des normes applicables aux entreprises et à leurs salariés, par délégation de la loi (76) .
Contrairement aux idées reçues, et comme l’a rappelé M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’État, « le code du travail français est l’un de ceux qui, en Europe, renvoient le plus à la négociation collective » (77).
D’après le rapport sur La négociation collective en 2014 élaboré par le ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, une dizaine d’accords nationaux interprofessionnels sont signés chaque année, dans les domaines correspondant au paritarisme dit « de gestion » : la prévoyance, les retraites complémentaires ou encore l’assurance-chômage
– domaines clés dans lesquels les partenaires sociaux jouent un rôle moteur, l’État étant « en seconde ligne ».
Entre 950 et 1 500 accords de branche sont conclus chaque année. M. Jean-Henri Pyronnet, sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail à la direction générale du travail (DGT), a indiqué que l’on observait « ces deux dernières années une baisse du nombre d’accords de branche sur les salaires, qui représentaient jusqu’à présent la moitié des accords – en 2014, sur les 951 accords signés, entre 400 et 450 portent sur les salaires. Cette évolution ne tient pas à un refus de la négociation par les partenaires sociaux mais à la situation économique » (78).
Par ailleurs, si elles sont aujourd’hui au nombre de 750 (dont 200 à 300 branches départementales ou régionales dans le secteur agricole), toutes les branches ne négocient pas : les accords sont le fait d’à peine 150 branches chaque année, certaines négociant très peu – ce qui a motivé le lancement d’un processus de restructuration.
Pour ce qui concerne les accords d’entreprise, on en dénombre chaque année entre 35 000 et 40 000 (79), contre quelques centaines par an dans les années 1970. D’après M. Jean-Henri Pyronnet, les salaires sont le « thème central, consubstantiel » de ces accords, « indépendamment de l’obligation légale de négociation qui s’y rattache (80) […] Le deuxième thème prépondérant de ces accords est la méthode et les conditions de la négociation. Enfin, le troisième thème est lié au paritarisme de gestion – la formation professionnelle, les retraites complémentaires et la prévoyance » (81).
Il faut noter qu’en outre, l’intervention du législateur « contribue à la prospérité de la négociation collective » : les accords enregistrés en 2012, 2013 et 2014 correspondent, selon M. Jean-Henri Pyronnet, à un « cycle de trois ans de négociations dites administrées, c’est-à-dire impulsées par les pouvoirs publics et assorties d’incitations financières ou de pénalités. Les négociations de cette nature ont porté sur le contrat de génération mais aussi sur l’égalité entre les hommes et les femmes ou encore la pénibilité » (82).
Si plusieurs dizaines de milliers d’accords d’entreprise sont signés chaque année dans notre pays, c’est aussi et surtout parce qu’il s’est développé au sein des entreprises une forme de « paritarisme d’entreprise » associant employeurs et représentants des salariés au sein de diverses instances, au premier rang desquelles les institutions représentatives du personnel (IRP).
a. Un paritarisme d’entreprise inégalement développé
Les salariés peuvent être représentés au sein d’une entreprise :
– par des représentants élus directement ou indirectement par les salariés, sur liste syndicale ou pas : délégués du personnel, élus au comité d’entreprise ou d’établissement, au comité de groupe, au comité d’entreprise européen ou de la société européenne, représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
– par des délégués syndicaux qui agissent au nom des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise ;
– au sein des organes de gestion de l’entreprise : conseil d’administration ou conseil de surveillance.
Les délégués du personnel constituent la forme la plus ancienne de représentation collective des salariés : ils trouvent leur origine dans la loi du 8 juillet 1890 qui a mis en place des délégués à la sécurité dans les mines. La création par le ministre de la guerre, Albert Thomas, en 1917, des « délégués d’ateliers » dans les établissements de plus de 50 ouvriers travaillant pour la défense nationale a marqué une étape vers la généralisation de ces représentants du personnel.
Celle-ci est intervenue avec les accords de Matignon des 7 et 8 juin 1936, qui ont prévu l’implantation de délégués ouvriers, sur la base d’accords conventionnels, dans tout établissement occupant plus de 10 salariés.
La loi du 24 juin 1936 a ensuite rendu obligatoire, dans les conventions collectives conclues par les organisations syndicales les plus représentatives, l’insertion d’une disposition relative à l’élection de délégués élus par le personnel dans les établissements occupant plus de 10 personnes.
La nature conventionnelle de l’institution des délégués du personnel s’est effacée lorsque le décret-loi du 12 novembre 1938 a rendu obligatoire l’institution de délégués du personnel dans tous les établissements industriels et commerciaux occupant plus de 10 salariés, même si l’établissement n’était pas régi par une convention collective. Les délégués ont alors reçu qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles relatives aux salaires et à l’application du code du travail et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l’hygiène et la sécurité.
L’institution des délégués du personnel a été mise en sommeil pendant la Seconde guerre mondiale : un décret-loi du 10 novembre 1939 a mis fin au mandat des délégués élus et confié aux organisations syndicales ouvrières les plus représentatives le soin de désigner des délégués dans les établissements comptant plus de 100 salariés.
La loi du 16 avril 1946 a rétabli le principe de l’élection de délégués du personnel dans les entreprises occupant plus de 10 salariés – principe qui a, depuis lors, fait l’objet de nombreux aménagements.
Le fait que les délégués du personnel constituent le plus souvent la seule forme de représentation collective du personnel au sein de l’entreprise a conduit le législateur à leur attribuer de nombreuses missions supplétives, en complément de leurs missions propres.
Les délégués du personnel sont avant tout « un vecteur permettant aux salariés d’entretenir des liens avec l’employeur, l’inspection du travail et les autres instances de représentation du personnel ». Ils peuvent en effet :
– présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés, sans se substituer pour autant aux délégués syndicaux : les délégués du personnel réclament uniquement l’application du droit existant tandis que les délégués syndicaux portent des revendications propres à les faire évoluer ;
– exercer un droit d’alerte à propos de toute atteinte au droit des personnes (droit au respect de la vie privée, à l’égalité de traitement, à la liberté d’expression, etc.), à la santé (physique et mentale) des salariés et aux libertés individuelles, lorsque cette atteinte n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ;
– saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle chargée d’assurer le contrôle (au même titre que les délégués syndicaux, les membres du comité d’entreprise et l’ensemble des salariés) ;
– collaborer avec le comité d’entreprise en lui communiquant les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité (contrôle de la gestion économique de l’entreprise, gestion des activités sociales et culturelles, suivi des questions collectives relatives à l’emploi et aux conditions de travail, etc.) ;
– saisir le CHSCT de toutes suggestions et observations entrant dans le champ de ses compétences.
Afin d’exercer leurs missions, les délégués du personnel ont le droit :
– d’avoir un local qui soit mis à leur disposition pour leur permettre de se réunir, de circuler librement dans l’entreprise et d’y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (à condition de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés) ;
– d’obtenir un certain nombre d’informations et de documents (exemplaire des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise, attestations et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail, etc.) ;
– d’être consultés sur un certain nombre de décisions, et notamment sur les postes de reclassement susceptibles d’être proposés aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et devenus inaptes à la reprise de leur emploi antérieur, ou encore sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, notamment lorsqu’elles bénéficient d’une aide publique ;
– d’être consultés, dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur les projets de licenciement collectif pour motif économique, sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ou encore sur les dérogations aux règles légales relatives à l’organisation du temps de travail (en l’absence d’accord collectif à ce sujet).
L’employeur qui refuserait de transmettre ces informations ou documents ou de procéder à ces consultations s’exposerait au délit d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel.
Les délégués du personnel peuvent par ailleurs être appelés à se substituer au comité d’entreprise, au CHSCT et aux délégués syndicaux dans les entreprises où ces IRP ne sont pas présentes. Mais dans les entreprises de moins de 50 salariés, aucun moyen supplémentaire ne leur est attribué pour l’exercice effectif de ces attributions supplémentaires.
Ainsi, en cas de carence de comité d’entreprise constatée par un procès-verbal, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions du comité d’entreprise en matière économique (droit d’alerte économique) ou encore en matière de formation professionnelle.
ii. Les comités d’entreprise et de groupe
L’institution des comités d’entreprise est tardive : longtemps les employeurs ont redouté qu’une telle institution affaiblisse leur autorité, tandis que les syndicats de salariés craignaient qu’elle ne conduise à remettre en cause leur monopole de représentation des travailleurs. Jusqu’en 1945, la France a donc été plutôt réticente au principe d’une représentation élue du personnel.
Pourtant, dès 1883, un industriel de la région de Reims, Léon Harmel, a institué des « conseils professionnels », devenus en 1893 des « conseils d’usine » dont les membres sont élus par le personnel à partir de 1903 (ils étaient auparavant nommés). Inspiré par les thèses du catholicisme social, Léon Harmel croyait à la participation des salariés à l’intérêt de l’entreprise et souhaitait que cette participation soit effective, sans pour autant porter atteinte à l’autorité du chef d’entreprise.
À l’étranger, l’idée d’une présence ouvrière dans des comités directeurs d’usine est apparue bien plus tôt. En Allemagne, le principe des « conseils de fabrique » a été débattu dès 1848.
Dès le début du XXe siècle, des conseils d’entreprise sont mis en place en en Norvège, au Luxembourg et dans l’empire austro-hongrois, tandis qu’en France, la représentation du personnel se limite alors à la mise en place de délégués ouvriers à la sécurité dans les mines et, plus tard, dans l’aviation civile et la marine marchande.
Alors que les délégués du personnel ne sont obligatoires en France qu’entre 1936 et 1939, dans les entreprises soumises à une convention collective, différentes institutions, comme des comités mixtes à la production, émergent au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis entre 1940 et 1944.
Alors que le contrôle ouvrier était jusqu’ici conçu comme devant être exercé par des représentants syndicaux mandatés par l’organisation et ne rendant compte qu’à celle-ci, la CGT et la CFTC acceptèrent en 1945 l’idée que des membres de comités soient élus par les salariés.
L’ordonnance n° 45-289 du 22 février 1945 a donc institué des comités d’entreprise dont les attributions ont été élargies dès l’année suivante, par la loi n° 46-1065 du 16 mai 1946. Le comité d’entreprise a alors été chargé d’examiner les questions relatives à l’amélioration des conditions d’emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel.
L’originalité du droit français, par rapport au droit allemand qui ne prévoit pas la présence de l’employeur au sein du comité d’entreprise, tient à ce qu’il a conçu ce comité comme un organe de collaboration : l’article 2 de l’ordonnance du 22 février 1945 dispose ainsi que « le comité d’entreprise coopère avec la direction à l’amélioration des conditions collectives d’emploi et de travail ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l’entreprise ».
Le rôle du comité d’entreprise a pris plus d’ampleur avec l’affirmation, à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946, du principe « particulièrement nécessaire à notre temps » selon lequel « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
Par la suite, l’institution du comité d’entreprise a fait l’objet de nombreuses réformes, en 1982 (loi dite « Auroux » n° 82-915 du 28 octobre 1982), en 2001 (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques), en 2002 (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) et en 2008 (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail).
La loi « Auroux » du 28 octobre 1982 a quelque peu modifié l’esprit de l’institution en lui confiant le soin d’assurer une « expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » (article L. 2323-1 du code du travail).
Alors qu’initialement, l’ordonnance du 22 février 1945 prescrivait à l’employeur de présenter un rapport annuel sur l’activité de l’entreprise et ses possibilités de développement, le législateur a peu à peu augmenté les initiatives de communication et de consultation obligatoire ainsi que la périodicité de certaines d’entre elles. À cette communication périodique se sont ajoutées des informations non périodiques dans l’hypothèse de mesures particulières prises par le chef d’entreprise.
Aujourd’hui, la mise en place de comités d’entreprise s’impose à l’employeur dès lors que son effectif salarial atteint 50 personnes – étant précisé que, dans les entreprises comportant des établissements distincts, des comités d’établissement et un comité central d’entreprise sont constitués.
En deçà du seuil de 50 salariés, un comité d’entreprise peut être institué par voie conventionnelle ou par usage, mais cette possibilité n’est guère utilisée. Ce sont alors souvent les délégués du personnel qui suppléent le comité d’entreprise.
Doté de la personnalité civile (et donc du droit d’agir en justice), le comité d’entreprise comprend le chef d’entreprise ou son représentant (qui le préside) et une délégation du personnel comportant un nombre de membres (titulaires et suppléants) déterminé par décret en Conseil d’État, compte tenu du nombre de salariés.
Élue par les salariés et répartie en deux ou trois collèges électoraux, la délégation du personnel comprend entre 6 membres (3 titulaires et 3 suppléants) dans les entreprises qui comptent entre 50 et 74 salariés, et 30 membres (15 titulaires et 15 suppléants) dans les entreprises occupant plus de 10 000 salariés.
Sans être à proprement parler membres du comité d’entreprise, les représentants syndicaux en sont des invités permanents et peuvent participer aux réunions de ses commissions (à l’exception de la commission économique).
Le comité d’entreprise doit en effet comporter un certain nombre de commissions en fonction de la taille de l’entreprise :
– dans les entreprises occupant au moins 200 personnes, une commission de la formation professionnelle qui est consultée sur l’ensemble des problèmes relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et qui est notamment chargée « d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine » ainsi que « d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés » (article L. 2325-26 du code du travail) ;
– dans les mêmes entreprises, une commission de l’égalité professionnelle, qui est chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise concernant le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise ;
– dans les entreprises occupant au moins 300 personnes, une commission d’information et d’aide au logement des salariés qui est notamment chargée de « facilite[r] le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation », en recherchant les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en lien avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et en assistant les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
– dans les entreprises occupant au moins 1 000 personnes, une commission économique, qui a pour objectif de renforcer la participation du personnel au contrôle de la gestion économique et financière de l’entreprise.
Lorsque des entreprises sont contrôlées par une entreprise « dominante », l’article L. 2331-1 du code du travail impose la constitution d’un comité de groupe qui est mis en place au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la configuration du groupe est définie – le défaut de constitution de ce comité étant constitutive d’un délit d’entrave pénalement sanctionné.
C’est la loi « Auroux » du 28 octobre 1982 qui a créé le comité de groupe et consacré ainsi une pratique qui organisait par voie conventionnelle des structures de représentation dépassant le périmètre des diverses entités formant un groupe.
Doté de la personnalité civile (et donc du droit d’agir en justice), ce comité est composé d’une part du chef de l’entreprise dominante, qui le préside et peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, et, d’autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe – étant précisé que le nombre maximal de représentants du personnel est fixé à 30.
Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, ce qui suppose que les parties définissent, pour l’ensemble du groupe, le nombre de collèges entre lesquels s’effectuera la répartition des sièges. Le plus souvent, deux ou trois collèges sont déterminés pour regrouper, en un ensemble homogène, les différents collèges des entreprises du groupe (ouvriers-employés, agents de maîtrise, cadres).
Une fois que chaque collège s’est vu attribuer un certain nombre de sièges, ces derniers sont répartis entre les organisations syndicales auxquelles il revient de désigner les membres du comité de groupe, proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans chacun des collèges.
Les membres du comité de groupe qui représentent le personnel ne sont donc pas des représentants des différentes entreprises du groupe, mais plutôt des représentants d’organisations syndicales élus au sein des entreprises du groupe. Ils sont à la fois des représentants du personnel, élus d’un comité d’entreprise, et des représentants syndicaux, désignés par leur organisation syndicale.
Le comité de groupe a des attributions relativement réduites : il s’agit davantage d’un organe de réflexion que d’action ou de négociation. À la différence du comité d’entreprise, il ne joue en principe aucun rôle de consultation – sauf si un accord de groupe prévoit qu’il peut être consulté annuellement sur les orientations stratégiques du groupe.
Pour exercer ses missions, le comité de groupe reçoit un certain nombre d’informations lors de sa réunion annuelle. Il peut se faire assister par un expert-comptable.
Le comité de groupe complète la représentation du personnel mise en place dans les entreprises : il n’a pas vocation à se substituer aux IRP des entreprises membres du groupe, dont il ne restreint nullement les prérogatives. Le comité de groupe n’est qu’un échelon supplémentaire de représentation du personnel qui s’ajoute aux comités d’entreprises et d’établissements, voire aux comités centraux d’entreprises. La coexistence d’un comité de groupe et d’un comité d’entreprise européen est même admise lorsque le groupe et les entreprises de dimension communautaire forment des ensembles partiellement superposés. Mais il est également possible d’aménager les conditions de fonctionnement du comité de groupe, voire de le supprimer pour qu’il fusionne avec le comité d’entreprise européen.
iii. Les comités d’entreprise européens et les comités de sociétés européennes
Le droit européen ne pouvait ignorer l’information et la consultation des travailleurs sur les questions touchant les structures économiques et sociales de l’entreprise.
La Charte sociale européenne prévoit, en son article 21, le droit des travailleurs à l’information et à la consultation, et, en son article 22, le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail.
La directive n° 94-45 du 22 septembre 1994 a institué un comité d’entreprise européen ou, à défaut, une procédure dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs. La logique qui anime ce texte est similaire à celle qui a justifié la création, en France, du comité de groupe : l’éclatement d’une entreprise en plusieurs établissements et l’existence d’un groupe formé de multiples sociétés juridiquement distinctes imposaient de créer une instance fédérative de représentation du personnel susceptible de donner aux délégués des salariés une perception globale de la vie du groupe.
La directive n° 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 a établi un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’Union européenne.
La directive n° 2009/38/CE du 6 mai 2009 a succédé à la directive du 22 septembre 1994 et été transposée par l’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011. Aux termes de la directive du 6 mai 2009, une entreprise est réputée de dimension communautaire dès lors :
– qu’elle possède des établissements sur le territoire d’au moins deux des États destinataires de ce texte ;
– qu’elle emploie au total au moins 1 000 employés sur le territoire de ces États ;
– qu’elle emploie au moins 150 salariés dans au moins deux de ces États.
Si l’on se tient aux prescriptions subsidiaires annexées à la directive du 6 mai 2009, seuls peuvent être membres du comité d’entreprise européen des représentants des salariés.
Toutefois, la faculté a été reconnue aux États destinataires de la directive de fixer des règles concernant la présidence des réunions d’information et de consultation du comité.
En conséquence, le législateur français a imposé la présence du chef d’entreprise (ou, dans un groupe, du chef de l’entreprise dominante) au sein du comité d’entreprise européen.
Le nombre de membres du comité d’entreprise européen dépend d’une clé de répartition, entre les États destinataires de la directive du 6 mai 2009, des salariés employés dans les établissements de l’entreprise ou dans les sociétés du groupe. Est alloué un siège par tranche de 10 % des effectifs employés dans l’ensemble des États de l’Espace économique européen (EEE) – étant précisé que toute tranche commencée justifie l’attribution d’un siège.
Pour la désignation des représentants des salariés au comité d’entreprise européen, la loi française distingue selon que des organisations syndicales sont, ou non, présentes dans les implantations de l’entreprise ou du groupe situées en France – l’élection ou la nomination des représentants des salariés désignés au titre des établissements ou sociétés implantés dans des États étrangers intervenant selon les règles en vigueur dans chacun d’entre eux.
En présence d’organisations syndicales, les salariés appelés à siéger au sein du comité d’entreprise européen sont issus d’un processus de nomination. Celle-ci est opérée par les organisations syndicales ayant obtenu des élus aux comités d’entreprise ou d’établissement créés dans les installations françaises du groupe ou de l’entreprise de dimension communautaire lors des dernières élections organisées en vue de constituer ou de renouveler ces instances.
Lorsqu’aucune organisation syndicale n’est présente dans les établissements de l’entreprise ou dans les sociétés du groupe de dimension communautaire implantés en France, une distinction est opérée selon qu’au total, y sont, ou non, occupés au moins 50 salariés.
Si les implantations françaises de l’entreprise ou du groupe occupent ensemble au moins 50 salariés, les représentants des salariés au comité d’entreprise européen sont élus par ces derniers.
Si ces implantations occupent ensemble moins de 50 salariés, de deux choses l’une : soit la direction centrale de l’entreprise ou du groupe dont dépendent ces établissements ou sociétés est située à l’étranger – dans quel cas les salariés de l’entreprise ou du groupe travaillant en France n’auront pas de représentant au sein du comité d’entreprise européen ; soit cette direction centrale est située en France – dans quel cas les salariés employés sur le territoire français désignent par voie d’élection directe un ou plusieurs représentants au comité d’entreprise européen.
Doté de la personnalité civile, le comité d’entreprise européen est créancier d’informations qui ne se confondent pas nécessairement avec celles fournies au comité d’entreprise. Il ne peut toutefois exiger que des informations à caractère transnational, intéressant donc au minimum deux établissement de l’entreprise ou deux sociétés du groupe situés dans différents États de l’Espace économique européen.
Le comité d’entreprise européen est appelé à être consulté :
– une fois par an sur l’évolution des activités et les perspectives de l’entreprise ou du groupe, qui sont retracées dans un rapport examiné lors de la réunion annuelle du comité ;
– chaque fois qu’est envisagée une mesure affectant la situation et l’évolution probable de l’emploi, un investissement ou l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux modes de production ;
– occasionnellement – et à sa demande – sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
Par ailleurs, chaque État destinataire de la directive est en droit de décider que, dans des cas spécifiques, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des informations dont la nature serait telle que leur communication entraverait gravement le fonctionnement de l’entreprise ou du groupe ou lui porterait préjudice.
L’entreprise de dimension communautaire ou l’entreprise dominante du groupe de dimension communautaire est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen (frais d’organisation des réunions, de traduction, de déplacement, de séjour, etc.).
Le comité d’entreprise européen ne doit pas être confondu avec le comité susceptible d’être mis en place dans la société européenne qui a été instituée par le règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001.
Lorsqu’une société européenne est une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, les dispositions relatives au comité d’entreprise européen ne lui sont pas applicables, pas plus qu’à ses filiales.
Les modalités de l’implication des salariés dans une société européenne sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés. Ces modalités recouvrent :
– l’information : à la fois sur les questions concernant la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, et sur celles qui excèdent les pouvoirs des instances de décision situées dans un État membre ;
– la consultation (qui suppose un dialogue et un échange de vues entre l’organe représentant les salariés ou leurs représentants et l’organe compétent de la société européenne) ;
– la participation (qui suppose que les représentants des salariés puissent exercer une influence sur les affaires d’une société soit en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société, soit en exerçant leur droit de recommander la désignation de tout ou partie de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ou de s’y opposer).
L’accord fixant les modalités d’implication des salariés dans une société européenne est conclu par un groupe spécial de négociation (GSN) qui est composé de représentants des salariés dont les membres sont désignés en fonction de l’effectif total de la société et de la répartition géographique des sociétés qui la composent. Les salariés travaillant dans chaque État se voient attribuer un siège dès lors que leur nombre représente une tranche de 10 % de l’effectif total de la société européenne.
Une fois les sièges répartis entre les salariés de chaque État, les représentants des salariés appelés à les occuper sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs délégués syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
En l’absence d’organisation syndicale dans la société européenne dont le siège se situe en France, les représentants des salariés au GSN sont élus directement selon les règles applicables au comité d’entreprise.
Une fois le GSN constitué, la négociation peut durer jusqu’à six mois. À défaut d’accord, différentes dispositions légales ont vocation à s’appliquer de manière supplétive, qui prévoient notamment l’institution d’un comité de la société européenne ainsi qu’un mécanisme de participation des travailleurs.
Composé selon des règles identiques à celles qui président à la constitution du GSN, le comité de la société européenne comprend le dirigeant de la société européenne (ou son représentant) et des représentants du personnel des sociétés participantes (filiales ou établissements). Il se réunit au moins une fois par an pour examiner notamment :
– la situation économique et financière de la société européenne, ainsi que de ses filiales et établissements ;
– les changements substantiels intervenus concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
– la réduction de taille ou la fermeture d’entreprises ou de parties de celles-ci ;
– les licenciements collectifs.
Par ailleurs, lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprise ou d’établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne est réuni de plein droit, s’il en fait la demande, par le dirigeant de ladite société afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant les intérêts des salariés.
Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société, ou, à défaut, l’ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité, dans le respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion.
Les représentants du personnel au sein du comité de la société européenne bénéficient d’un certain nombre de moyens pour s’acquitter de leurs missions (prise en charge des frais de séjour et de déplacement, congé de formation, etc.).
iv. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Si tous les représentants du personnel ont dans leurs attributions la santé et la sécurité (83), celles-ci constituent, non pas une préoccupation parmi d’autres, mais le seul centre d’intérêt du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les CHSCT résultent de la fusion, par la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, du comité d’hygiène et de sécurité et de la commission pour l’amélioration des conditions de travail.
Leur constitution est obligatoire dans les entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés. Toute méconnaissance des règles relatives à leur constitution et à leur fonctionnement est passible de sanctions civiles et pénales (au titre du délit d’entrave).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés qui sont dépourvus de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui sont investis des missions normalement confiées au CHSCT, sans qu’ils disposent pour autant d’autres moyens que ceux qui leur sont ordinairement reconnus (hormis le droit à la formation prévue au profit des membres du personnel siégeant au CHSCT).
Doté de la personnalité civile (et donc du droit d’agir en justice), le CHSCT comprend le chef d’entreprise ou d’établissement (qui le préside de plein droit) et des représentants du personnel dont le nombre varie selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. La délégation du personnel peut ainsi compter de trois représentants des salariés (dans les entreprises ou établissements occupant moins de 200 personnes) à neuf représentants des salariés (dans les entreprises ou établissements occupant plus de 1 500 personnes) – étant précisé que certains des représentants du personnel appelés à siéger au CHSCT doivent appartenir à la catégorie des agents de maîtrise ou des cadres.
Néanmoins, le collège désignant les membres du CHSCT est en principe unique : il ne peut être scindé en deux pour la désignation des représentants des agents de maîtrise et des cadres, d’une part, et pour celle des représentants des autres salariés, d’autre part.
Les représentants du personnel au CHSCT sont élus au scrutin de liste, pour une durée de deux ans, par les membres du comité d’entreprise ou d’établissement ou les délégués du personnel – étant précisé qu’aucun monopole n’est accordé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou dans l’établissement pour la présentation de listes de candidats.
Il faut toutefois noter que l’ANI du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail autorise chaque syndicat représentatif à désigner, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 300 salariés, parmi le personnel de l’entreprise ou de l’établissement concerné, un représentant syndical auprès du CHSCT habilité à assister aux réunions de ce comité avec voix consultative.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé (physique et mentale) et à la sécurité des salariés dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel il a été constitué, sa compétence ne s’exerçant toutefois qu’à l’égard de ces salariés.
Il a l’obligation de vérifier que sont respectées les prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et notamment d’analyser les risques professionnels.
Il a la faculté :
– de réaliser des inspections (une véritable enquête devant être menée lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) ;
– de formuler des propositions pour promouvoir la prévention des risques professionnels, du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, ainsi que de susciter toute initiative utile en la matière ;
– d’exercer un droit d’alerte en raison d’un danger grave et imminent, et, d’une manière plus générale, en matière de santé et d’environnement.
Le CHSCT doit par ailleurs être consulté en de nombreuses circonstances, et notamment :
– sur le règlement intérieur ;
– sur toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail – les juges pouvant suspendre des opérations, tel un transfert d’activité, jusqu’à information et consultation du CHSCT ;
– sur tout problème relevant de sa compétence dont il serait saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, le comité d’entreprise ou d’établissement ou les délégués du personnel.
S’il n’est pas doté d’un budget propre, le législateur a néanmoins exigé que les moyens nécessaires à l’exercice des missions du CHSCT soient mis à la disposition de ses membres. Ainsi, en vue de ses réunions qui doivent se tenir au moins tous les trois mois, le CHSCT bénéficie d’un certain nombre d’informations, mais aussi du droit de faire appel à un expert agréé, étranger à l’entreprise, et, le cas échéant, spécialisé en risques technologiques, les frais d’expertise étant à la charge de l’employeur.
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation spécifique nécessaire à l’exercice de leurs missions (et d’un congé de formation) dont la charge financière incombe à l’employeur.
Enfin, il convient de préciser que, lorsqu’une entreprise compte moins de 300 salariés, il est possible de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP), dont les élus exercent à la fois les attributions du CHSCT, du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
On notera en outre qu’une expérimentation permet que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord majoritaire prévoie le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT ou de deux de ces institutions représentatives du personnel au sein d’une unique instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.
En revanche, cette possibilité de regroupement ne concerne pas les délégués syndicaux.
En instaurant la section syndicale et le délégué syndical, la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical dans les entreprises a mis fin au paradoxe juridique qui, depuis 1884, reconnaissait à l’organisation syndicale des moyens d’action à tous les niveaux de la vie économique et sociale sauf à celui, pourtant fondamental, de l’entreprise.
L’action syndicale a ainsi pu être directe, sans avoir à passer par les institutions élues du personnel, car jusqu’alors, c’est par l’intermédiaire des institutions représentatives élues que le syndicat pouvait peser sur le jeu des relations internes à l’entreprise, à l’occasion de la mise en place des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
Aujourd’hui, dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise a la possibilité de désigner des délégués syndicaux ainsi qu’un représentant syndical auprès du comité d’entreprise (84). Ces délégués syndicaux prennent part aux négociations menées avec l’employeur.
Lorsque l’entreprise compte moins de 50 salariés, les délégués du personnel peuvent être désignés délégués syndicaux.
En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, un accord peut être conclu par les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, sous certaines conditions (indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur, élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche).
En l’absence de représentants élus du personnel, ou lorsqu’aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Enfin, en l’absence de salarié mandaté par une organisation syndicale, les délégués du personnel non mandatés par une telle organisation peuvent négocier et conclure des accords collectifs.
Comme l’a rappelé M. Henri Rouilleault, « alors qu’en Allemagne et en Angleterre, les syndicats sont reconnus avant l’instauration du suffrage universel, la reconnaissance des syndicats en France ne date que de 1884, soit près de quarante ans après l’instauration du suffrage universel. L’évolution ensuite sera lente : il faut attendre 1968 pour que soient reconnus les délégués syndicaux dans les entreprises, puis celle des trois niveaux – interprofessionnel, branche, entreprise – de la négociation collective. Enfin, il a fallu, avec les lois Auroux de 1982, inventer l’obligation de négocier, preuve que la négociation sociale n’était pas vraiment rentrée dans les mœurs de notre pays… » (85).
vi. Les obligations de négocier
C’est en effet la loi « Auroux » n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail qui a introduit une obligation de négocier, tant au niveau de la branche que de l’entreprise, dans certains domaines et selon une périodicité définie par la loi.
Depuis, les obligations de négociation et d’information-consultation des institutions représentatives du personnel se sont accumulées au fur et à mesure du renforcement du rôle du comité d’entreprise et du CHSCT.
Face à cette accumulation qui saturait l’agenda social des entreprises et nuisait à la qualité du dialogue entre employeurs et salariés, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a regroupé les 12 obligations de négociation et les 17 obligations d’information-consultation récurrentes du comité d’entreprise au sein de 3 consultations et de 3 négociations.
Depuis le 1er janvier dernier, trois grandes consultations sont prévues :
– sur les orientations stratégiques et leurs conséquences – et notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur les orientations de la formation professionnelle ;
– sur la situation économique et financière de l’entreprise – ce qui inclut la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du CICE ;
– sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi – ce qui inclut l’apprentissage, l’accueil des stagiaires, la durée du travail, l’égalité professionnelle, et, dans les entreprises de plus de 300 salariés, le bilan social.
Un projet de décret a été transmis aux partenaires sociaux en mai dernier, qui précise les modalités de consultation des IRP, et notamment les délais de consultation ainsi que le contenu des informations transmises.
Pour ce qui est des obligations de négociation, elles ont été regroupées en trois ensembles :
– une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, mise en place du travail à temps partiel, réduction du temps de travail, intéressement, participation, épargne salariale, etc.) ;
– une négociation annuelle sur la qualité de vie au travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ; mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ; mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, etc.) ;
– dans les entreprises d’au moins 300 salariés et dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France, une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut également porter sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l’entreprise, sur le contrat de génération et sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Cette périodicité peut toutefois être modifiée, sous certaines conditions, par un accord d’entreprise, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.
En outre, il faut rappeler qu’en dehors de ces négociations obligatoires, les employeurs et les délégués syndicaux (ou, à défaut, les élus du personnel) ont toute liberté pour négocier sur les thèmes de leur choix – la seule condition de la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement tenant à ce qu’il doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou des délégués du personnel et qu’il ne doit pas faire l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Enfin, il faut garder à l’esprit que la négociation collective n’est qu’une des modalités de participation des salariés à la « détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » qui est proclamée par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 : cette participation peut également prendre la forme de la représentation des salariés au sein des organes de gestion des entreprises.
vii. La représentation des salariés dans les organes de gestion des sociétés
Alors qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne et en Belgique, aucune participation des salariés aux organes dirigeants des entreprises n’est imposée, et que l’implication des salariés dans la marche des entreprises prend essentiellement la forme d’une participation financière (stock-options, etc.), la participation des salariés à la gestion des entreprises sous la forme de leur représentation dans les conseils de surveillance est ancienne en Allemagne. Dans les sociétés de capitaux les plus importantes, les salariés sont représentés – dans une proportion qui varie selon la taille des entreprises – au sein du conseil de surveillance qui choisit les membres du directoire et contrôle son activité. Dans les entreprises allemandes qui occupent entre 500 et 2 000 salariés, les représentants des salariés doivent constituer un tiers des membres du conseil de surveillance. Dans celles qui occupent plus de 2 000 salariés, la composition du conseil de surveillance est numériquement paritaire.
En France, la question de la représentation des salariés dans les organes de gestion des entreprises est apparue dès le XIXe siècle, en réponse aux contradictions de l’économie capitaliste naissante.
Un courant « utopiste » proposait alors de dépasser l’opposition entre capital et travail par une nouvelle organisation salariale fondée sur l’association. Un courant « humaniste », inspiré par la doctrine sociale de l’Église, considérait que la participation des salariés à la gestion des entreprises permettait d’assurer la dignité de l’homme au travail. Enfin, un courant « productiviste » estimait que la participation des salariés au capital pouvait être un facteur d’amélioration quantitative et qualitative des résultats de l’entreprise en favorisant la motivation des salariés.
L’idée de la participation des salariés à la gestion de l’entreprise a donc fini par trouver ses premières traductions législatives au début du XXe siècle : la loi du 18 décembre 1915 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production a ainsi associé les salariés, apporteurs de capitaux, au pouvoir de gestion.
Plus tard, le programme du Conseil national de la Résistance a préconisé une cogestion des sociétés anonymes par des conseils d’administration composés de représentants des actionnaires et des salariés.
Cependant, le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l’entreprise (86). En effet, à l’issue de la Seconde guerre mondiale, la participation des salariés à la gestion des entreprises a été conçue comme devant passer par l’intermédiaire d’institutions représentatives élues : l’ordonnance n° 45-289 du 22 février 1945 a institué des comités d’entreprise qui avaient le droit d’être écoutés sans pour autant pouvoir imposer à l’employeur de suivre leur avis. Si la loi n° 46-1065 du 16 mai 1946 a autorisé la désignation de deux membres du comité d’entreprise au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes, ces derniers n’y avaient toutefois qu’une voix consultative.
Si la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 a autorisé le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social – ouvrant ainsi la voie à l’entrée des salariés au conseil d’administration –, il n’en demeurait pas moins que les salariés étaient élus au conseil d’administration par les actionnaires, et non par leurs pairs.
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a marqué une étape importante en imposant la présence, avec voix délibérative, des représentants du personnel au sein des organes d’administration et de surveillance des entreprises du secteur public et de leurs filiales. La participation des salariés à ces organes a été maintenue lors de la privatisation de ces entreprises.
Par la suite, l’ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986 a modifié la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin d’offrir aux sociétés anonymes la faculté d’introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel salarié siègeraient avec voix délibérative au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Cette faculté n’a toutefois guère été utilisée – pas plus que n’ont été appliquées les dispositions de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, qui permettaient de désigner des membres du conseil d’administration ou de surveillance pour représenter les intérêts des salariés.
Faute de décret d’application, les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui imposaient la représentation, dans les organes dirigeants, des salariés actionnaires détenant plus de 3 % du capital de l’entreprise n’ont jamais été appliquées.
Il a fallu attendre la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social pour que l’obligation d’assurer la représentation des salariés actionnaires détenant au moins 3 % du capital soit effective dans les seules sociétés cotées dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Et il a fallu attendre encore plusieurs années pour que, dans le prolongement de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi impose la présence de représentants des salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés permanents – étant précisé que ce seuil peut être atteint dans les groupes par l’addition des effectifs de la société mère et de ses filiales, directes ou indirectes, et que, quand bien même ce seuil n’est pas atteint, une entreprise demeure tenue d’assurer la représentation des salariés dans ses organes de gestion lorsqu’elle appartient à un groupe employant au moins 5 000 salariés permanents dans la société mère et ses filiales, peu important que leur siège social soit situé en France ou à l’étranger (87).
Au sujet de ce dispositif, M. Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha, a estimé que, sans « rêver à une codétermination sur le modèle allemand, avec une représentation paritaire dans les conseils de surveillance, […] on a été un peu frileux en n’accordant qu’un ou deux administrateurs salariés selon la taille de l’entreprise » (88).
C’est aussi le point de vue du rapporteur qui, avec plusieurs de ses collègues, a déposé, lors de l’examen du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, un amendement visant à augmenter le nombre d’administrateurs salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions susmentionnées.
Aujourd’hui, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à douze et au moins égal à un dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est égal ou inférieur à douze (89) ; l’amendement déposé proposait que le nombre d’administrateurs représentant les salariés soit égal à un tiers au moins du nombre total d’administrateurs, sans pouvoir être inférieur à deux – sauf dans l’hypothèse où le conseil d’administration ou de surveillance ne compterait que trois membres, afin d’éviter une surreprésentation des administrateurs représentant les salariés. Si cet amendement avait pu être discuté et adopté, le nombre d’administrateurs représentant les salariés au sein d’un conseil d’administration ou de surveillance comptant douze membres aurait donc été de quatre au moins (alors qu’il est aujourd’hui de un seulement).
En outre, un autre amendement du rapporteur proposait de prévoir que chacun des comités spécialisés du conseil d’administration ou de surveillance (comités d’audit, des nominations, des rémunérations, des risques, etc.) comprenne au moins un administrateur représentant les salariés afin que les salariés, par l’intermédiaire de leurs représentants, puissent prendre part à l’ensemble des débats concernant l’entreprise et se prononcer sur la politique de rémunération des dirigeants.
Proposition : Améliorer la représentation des salariés dans les organes dirigeants des entreprises de plus de 300 salariés :
– en prévoyant que les conseils d’administration ou de surveillance doivent compter au moins un tiers de représentants des salariés ;
– en prévoyant la présence d’au moins un représentant des salariés dans chaque comité d’un conseil d’administration ou de surveillance.
Telle qu’elle est aujourd’hui conçue, l’obligation de représentation des salariés au sein des organes dirigeants a aujourd’hui un champ d’application particulièrement limité, alors que, comme l’a fort justement expliqué M. Pierre Ferracci, « écouter la voix des administrateurs salariés ou des représentants des syndicats n’enlèverait rien au pouvoir de l’employeur. Cela modifierait seulement un peu l’angle d’attaque. […] Cela permettrait de parvenir à un équilibre que, de mon point de vue, on n’a pas réussi à trouver avec les IRP telles qu’elles fonctionnent aujourd’hui » (90).
Il est vrai que ces IRP souffrent aujourd’hui d’un inégal développement selon la taille des entreprises.
viii. La faible représentation du personnel dans les petites entreprises
L’enquête REPONSE menée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, permet d’approcher les discussions qui ont lieu dans les entreprises de façon plus informelle que ne l’autorise le bilan annuel de la négociation collective, qui ne recense que les accords conclus.
Or, comme l’indiquait Mme Françoise Bouygard, directrice de la DARES, il ressort de l’enquête REPONSE réalisée en 2011 auprès de 4 000 établissements relevant du secteur privé non agricole et employant au moins 11 salariés que « parmi les établissements de onze salariés et plus, six sur dix comptent au moins une forme de représentation du personnel. […] La présence d’institutions représentatives du personnel augmente très significativement avec la taille des établissements : si 63 % des établissements de onze à dix-neuf salariés n’en ont pas, ce n’est le cas que de 6 % de ceux employant cinquante salariés ou plus. […] L’implantation de ces instances se stabilise aujourd’hui dans les établissements de vingt salariés ou plus, après avoir fortement progressé entre la fin des années 1990 et le milieu des années 2000, dans un contexte de négociation sur la réduction du temps de travail » (91).
Cette enquête a par ailleurs révélé « la fréquente absence de toute représentation du personnel dans les petites entreprises […] et la relative modestie de leur activité de négociation » (92).
Par conséquent, « les règles qui s’appliquent aux salariés relèvent le plus souvent, dans ces entreprises, de décisions unilatérales de l’employeur ou prises dans le cadre d’échanges individuels », comme l’a confirmé une enquête sur les relations sociales dans les très petites entreprises employant d’un à neuf salariés citée par Mme Françoise Bouygard.
En revanche, d’après l’enquête REPONSE précitée, « entre 2008 et 2010, 90 % des établissements de onze salariés et plus ont “négocié ou discuté” au moins une fois avec des représentants ou d’autres salariés sur au moins un des thèmes étudiés – salaires, temps de travail, conditions de travail… Dans un tiers des cas, ces négociations ou discussions ont impliqué la participation de délégués syndicaux. […] Si, dans les établissements de moins de cinquante salariés, les discussions informelles sont très majoritaires, la négociation formalisée est surtout le fait des établissements plus grands, notamment ceux où la négociation est obligatoire chaque année du fait de la présence de délégués syndicaux » (93).
Afin de dynamiser la négociation collective dans les très petites et moyennes entreprises (TPE et PME) dépourvues de structures représentant formellement les salariés et d’éviter qu’elle ne se résume à des décisions unilatérales de l’employeur, M. Hervé Lanouzière a proposé d’inventer « de nouveaux espaces de régulation » (94), sur le modèle des espaces d’expression créés à la suite de l’ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail, qui a défini des règles procédurales sur la manière d’aborder des sujets tels que l’articulation entre vie privée et vie professionnelle. M. Lanouzière a indiqué qu’« aujourd’hui, dans les entreprises, on voit naître spontanément des espaces de discussion [qui] se mettent en place, avec les organisations syndicales ou sans elles. Car elles se rendent compte qu’elles ne peuvent tout réguler » (95).
La création de ces espaces de discussion supposerait de dépasser le système binaire actuel qui repose sur la consultation – dans quel cas on attend la délivrance d’un avis favorable ou défavorable – et la négociation – qui suppose que soit, ou non, signé un accord. Selon M. Lanouzière, « cette forme binaire de discussion contraint ou accule les parties à adopter des postures, souvent surprenantes » (96). Au rebours de ce modèle, il a fait la promotion « d’un espace de concertation régulé », propice à un « dialogue professionnel loyal dans l’entreprise ».
Outre le problème des insuffisances (voire de l’absence) de la négociation collective dans les TPE et PME, le rapporteur a pu constater, avec M. Pierre Ferracci, que, même dans les entreprises dotées d’institutions représentatives du personnel, le fonctionnement de ces dernières pouvait être optimisé car aujourd’hui, « les IRP ont beaucoup de mal à jouer un rôle d’anticipation » (97).
Cela peut s’expliquer en partie par les lacunes en matière de renouvellement des représentants du personnel, car, comme l’a fait remarquer M. Olivier Mériaux, la « pyramide des âges ne permet pas toujours que les interlocuteurs soient ancrés dans les réalités des intérêts qu’ils sont censés défendre. Comme [les organisations syndicales et patronales] ont des difficultés à trouver suffisamment d’actifs pour exercer ces mandats, elles se reposent en effet soit sur des retraités, dont il faut saluer l’engagement militant, soit sur des experts » (98).
b. Un paritarisme d’entreprise et de négociation fragilisé par un renouvellement insuffisant de ses acteurs
Lors de son audition, M. Éric Aubin a prévenu : « le jour où il n’y aura plus de représentants syndicaux, il n’y aura plus de paritarisme. [Or] il est de plus en plus difficile de renouveler les troupes, tant pour les représentants des salariés que pour ceux du patronat » (99).
Partageant le même constat, M. Jean-François Herlem, membre de l’association Réalités du dialogue social, a ajouté que « si rien n’est fait, le paritarisme aura de plus en plus recours soit aux retraités soit aux techniciens des structures patronales ou salariales, avec le risque, dans ce dernier cas, d’une “fonctionnarisation” du système fatalement génératrice de blocages et remettant en cause la nature même du paritarisme » (100).
D’après l’enquête REPONSE précitée, il apparaît qu’« aujourd’hui, 6 % des salariés interrogés disent détenir au moins un mandat de représentation, ce qui permet d’estimer qu’environ 600 000 salariés du champ considéré, c’est-à-dire du secteur marchand non agricole, sont des représentants du personnel, élus titulaires ou suppléants, ou délégués syndicaux et représentants de la section syndicale. Le nombre de mandats est quant à lui estimé à 767 000 en 2011, un salarié pouvant disposer de plusieurs mandats. Ces salariés qui représentent leurs collègues de travail sont en moyenne un peu plus âgés qu’eux, ont une plus forte ancienneté, et sont un peu plus souvent ouvriers qualifiés, techniciens ou agents de maîtrise. Ils sont aussi nettement plus souvent syndiqués – à 56 %, contre 8 % pour les salariés ne disposant d’aucun mandat » (101).
Cette même enquête a fait ressortir que « dans 38 % des établissements dotés d’un représentant, il n’y a pas assez de candidats pour occuper les fonctions de représentant du personnel » (102).
Or le nombre de mandats à pourvoir est considérable. L’association Réalités du dialogue social a élaboré, avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national, un Dictionnaire des instances d’exercice des mandats (DIEM) et un Mandascop qui regroupe en sept familles 31 mandats types validés par l’ensemble des partenaires. D’après les représentants de cette association, « hors institutions représentatives du personnel (IRP) qui, à elles seules, représentent plus de sept cent mille mandats, le nombre de mandats se situe vraisemblablement entre cent et deux cent mille, sachant, d’une part, que, dans une instance, siègent plusieurs personnes ayant des mandats identiques puisque chaque organisation peut y disposer de plusieurs représentants, et que, d’autre part, les mandataires ont en général plusieurs mandats dans différentes instances » (103).
M. Martial Brun, directeur général du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), a en effet relevé que « certaines personnes physiques siègent à la fois dans un conseil d’administration de service de santé, au COCT [conseil d’orientation des conditions de travail], au COREOCT [comités régionaux d’orientation des conditions de travail], dans le conseil d’administration de l’INRS [Institut national de recherche et de sécurité], et dans celui de l’ANACT. Ces situations existent et témoignent peut-être de la difficulté que rencontrent les partenaires sociaux pour mobiliser les ressources humaines nécessaires pour occuper tous les sièges de ces nombreuses instances » (104).
Il est vrai que « dans les syndicats de salariés et d’employeurs, il est difficile de trouver des personnes prêtes à s’engager pour des mandats de cette nature, qui sont en fin de compte très exigeants » (105), comme l’a expliqué M. Jean-François Pilliard, vice-président de l’Unédic.
Selon le professeur Jacques Freyssinet, professeur émérite à l’Université Paris I et président du conseil scientifique du Centre d’études sur l’emploi, cela tient notamment au fait que « les salariés associent certes les institutions paritaires au dispositif de protection sociale dans son ensemble, mais n’y voient ni une conquête syndicale ni un service fourni. Les organisations syndicales ne parviennent pas à présenter les institutions paritaires comme le produit d’une conquête syndicale et, du même coup, à faire la preuve de leur utilité » (106).
Cela tient aussi au fait que, pour assumer des mandats de plus en plus techniques et chronophages, la formation des mandataires gagnerait sans doute à être améliorée. Comme l’a noté le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), M. Patrick Bernasconi, « un effort de professionnalisation doit concerner tous les acteurs de la négociation » (107).
Certes, les mandataires bénéficient d’une formation, dont le financement a été rendu plus transparent grâce à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a créé un fonds paritaire destiné, entre autres, à apporter une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés.
La formation économique et sociale syndicale bénéficie d’une subvention de l’État de 29,6 millions d’euros. 12 millions d’euros supplémentaires provenant des entreprises étaient attendus pour l’année 2015. Par ailleurs, 3 millions d’euros supplémentaires sont versés par l’État à la fois aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CFTC, CGT, FO, CFE-CGC, MEDEF, CGPME et UPA) et à d’autres partenaires sociaux (UNSA, Solidaires et organisations patronales dans les secteurs des professions libérales, agricoles et de l’économie sociale et solidaire).
La récente rénovation du financement du paritarisme
À la suite de l’ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation du paritarisme, qui a notamment posé des exigences de transparence, en matière de gestion financière comme de gouvernance, par exemple en fixant des règles d’audit interne et en limitant à trois le nombre des mandats susceptibles d’être simultanément exercés par un mandataire à un même niveau (par exemple interprofessionnel), la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a mis en place un fonds paritaire de financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs dont les modalités de fonctionnement ont été précisées par le décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015.
Auparavant, ces organisations étaient financées sur les fonds de la formation professionnelle par le biais d’un prélèvement pour frais de gestion des OPCA et des OPACIF exprimé en pourcentage de leur collecte à hauteur de 1,5 % au maximum des sommes recueillies par les organismes collecteurs. Cela représentait une somme d’environ 40 millions d’euros, gérée par l’association FONGEFOR.
Désormais, les articles L. 2135-9 et suivants du code du travail prévoient qu’un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et soumis à l’agrément du ministre chargé du travail crée « un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au développement et à l’exercice des missions » suivantes :
– la conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
– la participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par l’animation et la gestion d’organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation ;
– la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation et l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales.
Ce fonds paritaire est habilité à attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs les ressources qu’il reçoit au titre :
– d’une contribution des employeurs dont le décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 a fixé le taux à 0,016 % de leur masse salariale brute (article D. 2135-34 du code du travail) ;
– le cas échéant, d’une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;
– d’une subvention de l’État ;
– le cas échéant, de toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
Ce fonds paritaire est géré par une association paritaire (AGFPN), administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel – la présidence de l’association étant assurée alternativement par un représentant de ces organisations syndicales de salariés et un représentant de ces organisations professionnelles d’employeurs.
Tout en reconnaissant globalement que ce fonds paritaire constituait « une véritable avancée en matière de transparence, de légitimité et donc de viabilité du paritarisme » (108), certaines des personnes entendues se sont inquiétées de l’extension de ses missions : Mme Marie-Françoise Leflon, secrétaire générale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), a notamment déploré que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ait ajouté aux missions du fonds paritaire le financement de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) et du dialogue social territorial sans avoir modifié l’assiette du financement (109).
En complément d’une amélioration de la formation des mandataires, M. Philippe Hourcade, président de l’association Dialogues, qui permet à des syndicalistes et à des directeurs des ressources humaines d’échanger leurs analyses et leurs points de vue sur le paritarisme ainsi que de sur nombreux autres sujets, a suggéré « d’inciter au renouvellement des militants investis dans l’exercice de responsabilités syndicales, par exemple en instaurant une limitation du nombre de mandats syndicaux – limitation qui n’existe aujourd’hui que dans très peu de fonctions puisque, au sein de la sécurité sociale, seuls les présidents d’organisme se voient imposer de telles limites ».
Le rapporteur considère que cette réflexion doit relever avant tout des partenaires sociaux eux-mêmes. Limitation du nombre de mandats syndicaux ou pas, il revient aux pouvoirs publics de veiller à ce que les mandats exercés soient mieux valorisés, notamment grâce au dispositif de validation des acquis de l’expérience. Car, « si l’on veut, demain, attirer des jeunes vers le syndicalisme, il faut […] faire en sorte que les salariés qui quittent leur mandat n’aient pas le sentiment d’avoir perdu du temps dans leur carrière professionnelle, comme c’est malheureusement le cas aujourd’hui » (110).
c. Un paritarisme de négociation parfois tributaire de l’intervention de l’État
Si le paritarisme de négociation suppose qu’en principe, les accords collectifs sont négociés par les seuls représentants des salariés et des employeurs, il arrive régulièrement que la puissance publique soit sollicitée pour tenter de mettre fin à des blocages que les partenaires sociaux ne parviennent pas à surmonter seuls.
C’est particulièrement le cas dans le cadre de la négociation d’accords de branche, où l’État est amené à intervenir dans le cadre de commissions mixtes paritaires qui constituent, « une sorte d’aide de l’État », pour reprendre la formule de M. Bernard Maurin, ancien président de plusieurs de ces commissions (111).
Ce dernier a expliqué que « l’objet d’une commission mixte paritaire [était] d’aider à la négociation de textes conventionnels de branche susceptibles d’extension, un tiers apportant une compétence technique et juridique pour mettre fin à des situations de blocage parfois passagères » (112).
Ce tiers, représentant de l’État, assume les fonctions de président de la commission mixte paritaire et joue le rôle de « facilitateur » pour aider à l’établissement ou au rétablissement du dialogue social et, le cas échéant, apporter aux partenaires sociaux un appui technique ou une expertise juridique.
Les présidents des commissions mixtes paritaires, qui ne sont pas rémunérés pour exercer ces fonctions, forment un réseau d’une centaine de personnes appartenant aux différentes directions du ministère du travail, et notamment à l’inspection (générale) du travail.
Selon M. Bernard Maurin, on peut distinguer quatre types de commissions mixtes :
– celles qui regroupent des partenaires sociaux n’ayant que peu ou pas d’expérience de la négociation au niveau d’une branche ;
– celles qui sont mises en place par la direction générale du travail, comme l’y autorise l’article L. 2261-20 du code du travail, à la suite d’une carence ou d’un blocage considéré comme grave au regard des sujets de négociation devant être abordés par les partenaires sociaux d’une branche ;
– celles qui, malgré de longues années de négociation en formation mixte, et sans trop de difficultés particulières, n’arrivent pas ou ne souhaitent pas fonctionner autrement qu’en commission mixte alors que ce type de fonctionnement n’est pas censé être pérennisé ;
– enfin, celles dont les organisations représentatives au sein d’un même collège – celui des employeurs ou celui des salariés – n’arrivent pas à s’entendre pour élaborer une position commune vis-à-vis de l’autre collège.
Les commissions mixtes paritaires sont, dans la plupart des cas, sollicitées par les organisations syndicales de salariés qui, à divers titres, ne sont pas satisfaites de l’état des négociations de la branche.
Dans certaines branches, il est même systématiquement recouru aux commissions mixtes paritaires depuis des décennies. C’est le cas de la branche des transports routiers, en raison de ses « difficultés tant historiques que culturelles à se rendre autonome dans la négociation collective et la construction du droit conventionnel » (113). C’en est au point que la convention collective du transport routier prévoit même que les organisations représentatives ne négocieraient jamais en l’absence d’un représentant de l’État.
Parfois, c’est le législateur lui-même qui impose que la négociation, dans certaines branches, ait lieu en commission mixte paritaire. Ainsi, l’article 35 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire dispose que « la convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports [à savoir la convention collective de branche applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités] est négociée et conclue dans le cadre d’une commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application du même article ».
Selon M. Bernard Maurin, « les organisations d’employeurs n’apprécient guère a priori la mise en place d’une commission mixte. D’une part, parce qu’à de rares exceptions près, elles ne partagent pas l’avis des organisations représentatives des salariés quant à l’état des négociations de leur branche. D’autre part, parce qu’elles sont a priori hostiles à l’incursion d’un tiers, notamment d’un représentant de l’État, au sein de leurs négociations paritaires de branche » (114).
Mme Laurence Rivoal, présidente des commissions mixtes paritaires des branches des hôtels-restaurants, des cafétérias, de l’esthétique, de la parfumerie et de la coiffure, a précisé qu’en 2015, étaient en commission mixte paritaire « quatre-vingt-quatorze des 300 branches nationales que l’on qualifiera de branches “vivantes” au sens où elles négocient régulièrement (115). Parmi celles-ci, quarante-sept relèvent du secteur des services, trente-huit du secteur du commerce et seulement sept du secteur de l’industrie. Toujours en 2015, les commissions mixtes ont tenu 647 réunions et signé plus de 200 textes, le premier thème de ces négociations ayant été les salaires, qui doivent faire l’objet de négociations annuelles. Ces quatre-vingt-quatorze commissions sont animées par soixante-huit présidents de commission mixte – certains ont donc le plaisir d’en présider plusieurs. Et 40 % des présidents sont des femmes » (116).
Quant aux principaux thèmes des négociations des branches en commissions mixtes paritaires, il s’agit :
– des négociations salariales (car il est possible de placer d’office en commission mixte paritaire une branche qui applique des grilles de salaire dont les coefficients sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance - SMIC) ;
– et du pacte de responsabilité (car toutes les branches ont l’obligation de négocier sur ce thème).
L’intervention de l’État dans la négociation de branche à travers les commissions mixtes paritaires est révélatrice de l’ambiguïté du paritarisme de négociation dans notre pays. Comme l’a reconnu M. Jean-François Pilliard, « on fustige le rôle de l’État, mais en même temps, on le sollicite constamment » (117), au point que ce dernier finit par jouer « le rôle de “bison futé” en ce qu’il contribue directement ou indirectement à assurer, accompagner, inciter, faciliter et soutenir la négociation » (118).
Une fois négocié, avec ou sans l’aide de l’État, l’accord de branche s’insère dans un ensemble de normes dont la hiérarchisation fait l’objet de débats récurrents.
2. L’articulation des normes issues de la négociation collective
Le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle sur La négociation collective, le travail et l’emploi et l’examen de l’article 1er du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, qui propose une « refondation du droit du travail », ont été l’occasion de débats aussi vifs que nourris sur la hiérarchie des normes votées par le Parlement et collectivement négociées par les partenaires sociaux.
La loi du 24 juin 1936 issue des « accords de Matignon » a préservé le caractère contractuel de la convention collective tout en la transformant en véritable « loi professionnelle », en introduisant une procédure d’extension qui permet de rendre applicable à l’ensemble d’une profession la convention conclue par les organisations syndicales les plus représentatives (119) et en imposant que la convention comporte un certain nombre de clauses obligatoires.
Cette loi a en revanche permis que la convention collective traite librement des questions qui n’ont pas à être abordées à titre obligatoire, à la condition qu’elles soient plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur. C’est l’origine du principe « de faveur » en vertu duquel, dans la hiérarchie des normes (loi – accord interprofessionnel – accord de branche – accord d’entreprise – contrat de travail), chaque source inférieure peut déroger à la norme supérieure à la condition impérative d’être plus favorable pour le salarié (articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail) (120).
Selon M. Henri Rouilleault, le principe de faveur a fonctionné « pendant les Trente Glorieuses, époque où la croissance et l’emploi se sont formidablement développés », mais il aurait « commencé à montrer ses limites à partir de 1974, lorsque nous sommes entrés dans une crise économique dont, quarante ans plus tard, nous ne sommes toujours pas sortis » (121).
Ainsi, au cours des années 1970-1980, après que la loi n° 71-561 du 13 juillet 1971 a consacré l’existence d’un « droit des travailleurs à la négociation collective », facilité la procédure d’extension des accords de branche et créé les accords d’entreprise et d’établissement (122), la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail (dite « loi Auroux ») a ouvert la possibilité de conclure, dans certains domaines et dans des conditions définies par la loi, des conventions et accords collectifs dérogeant à des dispositions législatives et réglementaires – sous réserve du droit d’opposition des organisations syndicales non signataires, s’agissant des accords d’entreprise et d’établissement.
Mais, a souligné M. Henri Rouilleault, le principe des accords dérogatoires instauré en 1982 n’est applicable que s’il est « accompagné d’une double garantie : d’une part, le respect de l’ordre public social, ce qui englobe les normes internationales, européennes et françaises ; d’autre part, des conditions de validité renforcées, telles que définies par la loi du 20 août 2008 (123) [à savoir que] pour être valable, un accord devra désormais avoir été signé par des organisations représentatives ayant totalisé au moins 30 % d’audience aux dernières élections professionnelles et ne pas avoir été contesté par des organisations ayant recueilli une majorité des voix » (124).
Jusqu’en 2004, l’articulation des normes législatives et réglementaires et des normes issues de la négociation collective et individuelle était relativement simple : la loi fixait une règle, l’accord de branche pouvait y déroger dans un sens favorable aux salariés, l’accord d’entreprise pouvait déroger à l’accord de branche dans un sens favorable aux salariés et le contrat de travail pouvait déroger à l’accord d’entreprise à la même condition.
Mais la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a ouvert la possibilité pour l’accord d’entreprise de contenir des clauses moins favorables que l’accord de branche en fixant deux limites :
– d’une part, quatre domaines sont exclus : les classifications, les salaires minimaux, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle et celle de la protection sociale complémentaire (article L. 2253-3 du code du travail) ;
– d’autre part, l’accord de branche ne doit pas s’y opposer en interdisant à l’accord d’entreprise de contenir des dispositions différentes.
Puis, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a défini six domaines relatifs à l’aménagement du temps de travail – contingent d’heures supplémentaires, forfait jour, forfait heure, compte épargne-temps, aménagement du temps de travail, journée de solidarité – dans lesquels l’accord d’entreprise peut établir des règles particulières sans que l’accord de branche ne puisse l’interdire. Dans ces six domaines, l’accord de branche ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise, et le code du travail qu’en l’absence d’un accord collectif. La loi du 20 août 2008 a ainsi procédé à une inversion de la hiérarchie des normes au profit de l’accord d’entreprise.
Le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle sur La négociation collective, le travail et l’emploi (125) dresse cependant un constat mitigé des réformes de 2004 et 2008 : à la suite de la loi du 4 mai 2004, « les partenaires sociaux ont eu plutôt tendance à “verrouiller” la faculté de déroger des entreprises, dans les accords de branche, comme les y autorisait la loi » (126) et les dispositions de la loi du 20 août 2008 inversant la hiérarchie des normes au profit de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail « semblent avoir été peu utilisées » (127).
Ce rapport propose d’établir un principe selon lequel, dans le champ des accords relatifs aux conditions de travail, au temps de travail, à l’emploi et aux salaires (ACTES), l’accord d’entreprise pourrait déroger aux dispositions plus favorables de l’accord de branche, à condition toutefois que ce dernier ne s’y oppose pas.
En d’autres termes, une fois la distinction opérée entre les dispositions du code du travail qui relèveraient de l’ordre public, celles qui procèderaient à un renvoi à la négociation collective en raison de la spécificité de leur objet, et celles qui seraient supplétives, en l’absence d’accord collectif, la primauté serait donnée à l’accord d’entreprise en matière de conditions de travail, de temps de travail, d’emploi et de salaires, sous réserve des ordres publics législatif et conventionnel. Il reviendrait aux accords de branche de déterminer le contenu de l’ordre public conventionnel (notamment en matière de qualifications, de salaires minima, de prévoyance, de formation professionnelle et de pénibilité) et de préciser les missions de prestation de services que les branches pourraient assurer auprès des très petites entreprises (production d’accords d’entreprise types, etc.).
Plusieurs dispositions du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » se revendiquent de cette analyse :
– l’article 1er confie à une commission d’experts et de praticiens des relations sociales le soin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail en « attribu[ant] une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action » ;
– l’article 2 « applique aux dispositions […] du code du travail relati[ves] à la durée du travail, aux repos et aux congés, la nouvelle architecture préconisée par le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle » de façon à « privilégier autant que faire se peut l’accord d’entreprise » (128).
Devant la mission, M. Jean-Denis Combrexelle a défendu cette nouvelle organisation de la hiérarchie des normes applicable en droit du travail en expliquant que « dans une société d’évolution rapide, il n’est pas possible d’imposer la même règle à tous, grands principes mis à part. Des sujets qui concernent la vie concrète des salariés, tels l’organisation collective du temps de travail, la mise en œuvre de la journée de solidarité ou la taille des vestiaires, méritent d’être l’objet d’une régulation au plus près de la situation de travail » (129).
Déjà, en 2011, le rapport Reconstruire le dialogue social, publié par l’Institut Montaigne, avait proposé « de faire de l’accord d’entreprise le socle de la négociation collective, de préférence à la négociation de branche ou interprofessionnelle » (130) : des accords d’entreprise majoritaires pourraient fixer un certain nombre de dispositions applicables dans les entreprises, concernant notamment le temps de travail, l’organisation des institutions représentatives du personnel ou les motifs de licenciement économique.
Cette prééminence de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et la loi est récusée par beaucoup.
Dans le contexte d’une économie nouvelle où les modes de production connaissent des transformations considérables et où se multiplient les petites entreprises aux statuts juridiques incertains, les changements de métier, d’entreprise et de branche professionnelle tout au long de la vie deviennent courants. Une telle situation incite à déterminer les normes à l’échelon national ou au niveau des branches, plutôt qu’au sein des entreprises.
Du reste, tout en martelant qu’« il faut privilégier l’accord d’entreprise partout où cela est possible », M. Éric Aubry, membre du groupe de travail de l’Institut Montaigne sur le dialogue social, a concédé que « pour les PME, l’accord de branche demeure évidemment le cadre de référence » et « que, pour les très petites entreprises ou les secteurs économiquement et socialement très éclatés, l’accord de branche conserve toute sa légitimité » (131).
Nombre des personnes entendues par la mission ont d’ailleurs loué les vertus de l’accord de branche. M. Pierre Ferracci a ainsi expliqué que « pour qu’une négociation soit réussie, il faut que le rapport de forces soit équilibré dans l’entreprise, ce qui est loin d’être garanti compte tenu de la faiblesse et de la division du syndicalisme français. Dans notre pays, le taux de syndicalisation est l’un des plus faibles d’Europe. […] Si le fait de se syndiquer n’ouvre pas de droits supplémentaires, on éprouve un peu moins le besoin de se syndiquer. Dans certains pays, en Europe du nord et en Belgique, où l’adhésion à un syndicat donne accès à certaines prestations, le taux de syndicalisation est forcément très élevé » (132). Compte tenu de la faiblesse du taux de syndicalisation en France, M. Ferracci a « défendu l’idée que le passage de cette situation à un système de relations du travail fondé sur la négociation d’entreprise devait se faire par un sas important : la négociation de branche. […] Le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle […] insiste beaucoup sur les conditions qui permettront de développer la négociation en entreprise. Parmi les conditions préalables, il évoque le renforcement de l’équilibre du rapport de forces, particulièrement dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME). En essayant de développer la négociation en entreprise, il ne faut pas que nous développions surtout la liberté du dirigeant de faire ce qu’il veut. […] À ce stade, un basculement trop rapide serait dangereux, et pas seulement dans les TPE et les PME. Même en Allemagne, la négociation de branche structure encore beaucoup de choses, y compris dans les grandes entreprises et y compris en termes de politique salariale, malgré les effets des lois Hartz. Il faut trouver cet équilibre » (133).
M. Olivier Mériaux, a lancé la même mise en garde : de son point de vue, compte tenu du niveau peu élevé du taux de syndicalisation qui est l’une des « faiblesses congénitales » du paritarisme en France, « à vouloir des négociations autonomes au sein de chaque entreprise, on risque d’aboutir à une réglementation unilatérale » (134).
Une renonciation au « principe de faveur » qui a été instauré par le Front populaire, il y a 80 ans, et qui a constitué le socle de l’histoire sociale de notre pays ne serait donc pas sans risques. Compte tenu de la réalité du marché du travail, l’ambition d’une négociation au plus près du terrain pourrait se révéler n’être qu’un miroir aux alouettes.
Le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Denis Combrexelle l’a d’ailleurs signalé : dans les pays d’Europe particulièrement touchés par la crise économique et financière, les dernières années ont été marquées par une transformation accélérée de leur système de négociation collective qui s’est notamment traduite par une primauté donnée à l’accord d’entreprise (notamment en Irlande). Or, d’après ce rapport, « la négociation d’entreprise n’a pas forcément occupé le terrain abandonné par les branches mais s’est accompagnée de la diminution tendancielle du taux de couverture des salariés par des accords collectifs » (135).
Tout en rappelant que « plus de 95 % des salariés sont couverts par un accord de branche en France, chiffre qui a peu d’équivalent dans les autres pays », ce même rapport indique que « la plupart des organisations syndicales voient dans l’accord de branche un échelon de négociation plus mature et plus sûr. Mais aussi le moyen de limiter les risques d’une concurrence entre les entreprises d’un même secteur qui se ferait par du “dumping social” » (136).
La mission a pu le constater par elle-même. M. Pierre Burban, secrétaire national de l’UPA, a ainsi souligné que « sans interdire évidemment le développement de la négociation d’entreprise, l’UPA est plutôt favorable à la négociation de branche […] Lors les débats sur le temps de travail, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, les discussions ont porté sur le temps d’habillage et de déshabillage. Or cette question se pose dans certaines branches mais pas dans d’autres. Ne peut-on pas renvoyer de tels sujets à la négociation ? » (137)
Pour M. Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), il est « indispensable de renforcer les branches plutôt que l’interprofession en tant que telle [car] l’avenir est davantage à la mutualisation au niveau de la branche qu’à une solution qui reviendrait à laisser ces dernières gérer seules des aspects essentiels de leur vie quotidienne » (138).
Et M. Philippe Louis, président de la CFTC, d’ajouter : « nous tenons au rôle pivot de la branche […] Nous ne voulons pas de décision unilatérale » (139).
Du côté des « experts », Mme Françoise Bouygard a rappelé que « dans bien des cas, l’accord d’entreprise n’est pas possible faute de négociateur dans l’entreprise [de sorte que] l’accord de branche retrouve alors tout son intérêt », qui tient notamment à ce qu’il aboutit à ce « les termes de la concurrence soient identiques pour tous les établissements et les entreprises dans un secteur d’activité » (140). D’une manière plus générale, Mme Bouygard a fait valoir « le rôle structurant des conventions collectives de branche dans les négociations. Elles sont particulièrement utilisées dans le cadre des discussions ou négociations sur le temps de travail : 79 % des établissements de onze salariés et plus déclarent “utiliser” la convention collective de branche sur le temps de travail, qu’ils négocient sur ce thème ou pas ».
Pour sa part, M. Bernard Vivier a expliqué que les salariés « des entreprises de moins de cinquante salariés, où le droit de négociation n’existe pas et où, de toute façon, il ne peut pas être effectif […] sont souvent parmi les moins favorisés au regard de la protection sociale et des avantages sociaux. Ils ont donc un grand besoin d’être protégés ; c’est la branche qui leur assurera cette protection. Au demeurant, la négociation de branche est avantageuse non seulement pour les salariés, auxquels elle assure une protection minimale, […] mais aussi pour les entreprises, dans la mesure où elle permet d’organiser la concurrence sur des bases communes : les règles applicables en matière de salaires, de durée et de conditions de travail ou de sécurité sont les mêmes pour toutes les entreprises rattachées à la branche » (141).
S’agissant précisément du niveau de régulation à privilégier en matière de santé et de sécurité au travail, M. Hervé Lanouzière a indiqué que « la branche a un rôle essentiel et décisif à jouer dans l’amélioration des conditions de travail, non pas nécessairement en ouvrant de nouveaux droits liés à la santé et à la sécurité au travail, mais plutôt en offrant des services méthodologiques aux entreprises, notamment à celles qui n’ont pas de représentant du personnel. […] Une branche aurait au contraire tout intérêt à offrir aujourd’hui à ses adhérents une offre de services mutualisée, pour qu’une entreprise de douze salariés puisse faire appel à un réseau de consultants. Grâce à leur aide, une PME ou TPE pourrait établir un diagnostic, un plan d’action et en organiser le suivi. L’acceptabilité sociale en sera garantie par la gestion paritaire, au niveau de la branche, de la qualité des prestations servies aux adhérents comme du cahier des charges imposé aux consultants. […] Ainsi, la branche constitue un échelon essentiel, non dans l’ouverture des droits, mais dans la définition de lignes directrices de méthodologie » (142).
M. Jean-Denis Combrexelle s’est lui aussi demandé si, « plutôt que de trouver des modes dérogatoires à la négociation, certaines branches ne pourraient [pas] jouer le rôle de prestataires de services et fournir des accords “clé en main” » (143).
Aux yeux du rapporteur, le renversement de la hiérarchie des normes serait finalement peu utile pour les entreprises et risquerait de fragiliser les salariés, particulièrement dans les PME. Si l’entreprise doit avoir la faculté de trouver des adaptations locales qui lui permettent de mieux fonctionner, elle doit le faire dans le cadre de règles définies par les branches professionnelles, qui évitent le dumping social, et dans le respect du principe de faveur, selon lequel les accords d’entreprise doivent être plus favorables aux salariés que les stipulations de branches, qui elles-mêmes doivent être plus favorables que les dispositions légales et réglementaires.
Le renforcement de la négociation d’entreprise pourrait en revanche s’obtenir en soumettant étendant le champ de la négociation collective obligatoire à de nouveaux domaines.
Le rapporteur considère qu’il serait particulièrement opportun d’envisager cette extension de la négociation annuelle obligatoire en priorité dans deux domaines :
– le plan de formation, qui est aujourd’hui élaboré par l’employeur et ne fait l’objet que d’un avis du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) (144) ;
– l’attribution de certaines aides comme le CICE.
Conforter les branches professionnelles en maintenant leurs prérogatives, donc, mais aussi en menant à bien l’important travail de restructuration engagé depuis plusieurs années.
Tout en concédant que « la branche est un lieu très intéressant pour traiter de sujets très complexes », M. Dominique Libault a prévenu que c’était « sous réserve d’une réduction du nombre de ces branches et d’une amélioration de leur gouvernance » (145).
En 2013, il est apparu que le ministère du travail n’avait pris aucun arrêté de représentativité dans 179 branches inscrites à l’inventaire des branches – et représentant moins de 100 000 salariés, d’après M. Jean-Henri Pyronnet – ou qu’aucun accord n’avait été signé depuis vingt ans. Or, les branches qui disparaissent n’envoient pas d’avis de décès.
En avril 2014, le ministre du travail a annoncé devant la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) son intention de resserrer le paysage conventionnel en partant de ces 179 branches.
En septembre 2015, le groupe de travail présidé par M. Jean-Denis Combrexelle a préconisé dans son rapport l’instauration d’un mécanisme de restructuration des branches reposant sur la fusion obligatoire des branches représentant moins de 5 000 salariés, avec des conventions collectives d’accueil, pour un délai de 3 ans dans un premier temps. L’objectif serait que notre pays ne compte plus qu’une centaine de branches au début des années 2020.
En octobre 2015, la DGT était en mesure de dresser un constat de décès effectif pour 37 branches.
Lors de son audition, M. Jean-Denis Combrexelle a suggéré d’« aller plus loin encore […] en déclarant d’office caduques les branches qui n’atteignent pas une taille critique » (146) sur le modèle de la loi qui a supprimé les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dont la collecte était inférieure à un seuil relevé à 100 millions d’euros.
Pour le rapporteur, il convient toutefois de mener à bien ce travail, tout en préservant, au sein de ces branches regroupées, les organisations collectives d’employeurs et de salariés, si petites soient-elles, dès lors qu’elles manifestent le besoin et l’utilité de s’organiser. Comme l’a noté Me Franck Morel, avocat associé du cabinet Barthélémy et membre du groupe de travail de l’Institut Montaigne sur le dialogue social, « ce n’est pas le nombre d’acteurs d’une branche professionnelle qui doit constituer le critère de justification des regroupements, mais la vitalité de la négociation collective » (147).
D. LE PARITARISME DE GESTION INTÉGRAL
Tout en choisissant de limiter le champ d’application de leur accord aux seuls « organismes paritaires nationaux interprofessionnels de gestion dans lesquels les partenaires sociaux ont une capacité de gestion autonome », les partenaires sociaux signataires de l’ANI du 17 février 2012 ont admis qu’il existait « deux formes de paritarisme (issu des accords, issu d’une délégation de l’État) et trois modes d’intervention des partenaires sociaux : gestion par les partenaires sociaux seuls, gestion tripartite avec l’État, gestion partagée avec d’autres acteurs ».
Comme les signataires de cet ANI, la mission a pu constater la « grande disparité » qui caractérise ce « paritarisme de gestion », tant en termes de modes de gouvernance que de modes de financement.
La notion de « paritarisme de gestion » étant polymorphe, plusieurs experts entendus par la mission ont appelé à faire la distinction entre le « vrai paritarisme » et le « faux paritarisme » ou « certaines formes de pseudo-paritarisme ». C’est notamment le cas du professeur Jacques Freyssinet, pour qui « on ne peut parler de paritarisme au sens fort que s’agissant des institutions créées par la négociation collective », à savoir les régimes de retraites complémentaires, dits AGIRC et ARCCO. Selon lui, « tout cela diffère profondément d’une autre acception du paritarisme qui couvre les instances de gestion de la sécurité sociale, par exemple, où le nombre de représentants des organisations patronales est égal à celui des représentants d’organisations syndicales. Ces instances, qui comportent parfois d’autres représentants, sont créées par l’État et leurs compétences de gestion sont étroitement contraintes par le fait qu’il revient à l’État de fixer le régime de financement et celui des prestations » (148).
De son côté, après avoir rappelé que le paritarisme était « une construction historique qui va trouver son plein développement en même temps que l’État-providence, avec les “Trente Glorieuses” » et que « la gouvernance de ces institutions construites avec les partenaires sociaux s’explique, entre autres, par le fait que leur financement reposait sur des cotisations sociales assises sur la masse salariale », Mme Annette Jobert, directrice de recherche au CNRS, a souligné que « ces institutions [étaient] très diverses » et que « l’on [était] amené à introduire des clivages, notamment entre le “faux paritarisme” où l’intervention de l’État est majeure – et cela renvoie évidemment à la sécurité sociale – et le “vrai paritarisme”, où l’autonomie des partenaires sociaux est plus grande – et cela renvoie aux retraites complémentaires et à l’assurance-chômage » (149).
Selon M. Gérard Adam, président du groupe de travail de l’Institut Montaigne qui a publié, en 2011, un rapport intitulé Reconstruire le dialogue social, « trois critères peuvent être pris en compte pour définir le paritarisme. Le premier est l’origine contractuelle du système, ce qui est le cas pour l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), l’Unédic, la formation et aussi l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), mais sans doute pas pour l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph). […] Le deuxième critère est celui de l’origine des ressources
– proviennent-elles de cotisations et contributions pesant sur les entreprises et les salariés ou de subventions publiques ? Le troisième est celui de la liberté d’utilisation de ces ressources ». Et M. Adam d’en conclure : « si l’on cumulait ces trois critères, on pourrait être conduit à considérer que le paritarisme n’existe plus aujourd’hui. La question serait alors plutôt de savoir où placer le curseur entre ce que l’on appelle le paritarisme de gestion et ce qui relèverait d’autres systèmes de concertation sociale » (150).
À défaut d’être vraiment « chimiquement pur », le paritarisme existe de manière relativement aboutie dans les domaines des retraites complémentaires et de la prévoyance.
1. Les retraites complémentaires représentent une masse financière considérable gérée par des instances paritaires quasiment pures
a. Les retraites complémentaires sont le premier espace de reconquête du paritarisme après 1945
L’histoire des retraites complémentaires depuis 1945 illustre parfaitement celle du paritarisme en général : né, après la mise en place de la Sécurité sociale, de la volonté de maintenir les systèmes spécifiques d’avant-guerre, il tend à se généraliser jusqu’à devenir trop important pour que l’État lui laisse une totale autonomie.
i. La création de l’AGIRC : une victoire en demi-teinte pour un régime autonome des cadres (1945-1947)
• La mise en place de la Sécurité sociale remettait en cause la situation des cadres qui avaient acquis des retraites spécifiques plutôt avantageuses
La mise en place du système de retraites complémentaires pour les cadres se révèle être une position de repli des partenaires sociaux après avoir échoué à convaincre le législateur de permettre le maintien, au moins optionnel, du système spécifique des cadres.
Dans le contexte de réflexion sur les retraites de l’après-guerre, ce sont les systèmes de solidarité par répartition qui ont été favorisés à la fois par les politiques et la CGT (151) pour des raisons à la fois structurelles et conjoncturelles :
– une volonté de rupture avec les systèmes par capitalisation ;
– une meilleure prise en compte de la situation économique et notamment de la dépréciation de la monnaie ;
– l’irréversibilité du système par répartition ;
– le souci d’universalisation, conçu alors comme émancipateur par rapport à une capitalisation d’entreprise jugée paternaliste.
C’est de cet état d’esprit que résulte le choix de l’inscription obligatoire de l’ensemble des salariés du secteur privé non agricole au régime de la Sécurité sociale. La situation des cadres, alors 200 000 sur 40 millions de Français, devient problématique car ils ne souhaitent pas abandonner les systèmes de retraite privés créés dans les années 1930 au profit d’un système jugé moins favorable. Les représentants des cadres, dont la Confédération générale des cadres naissante (152), se mobilisent contre l’« immatriculation obligatoire » dès la publication des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. La loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale constitue donc un échec pour les cadres, qui constatent alors que leurs retraites seront bien inférieures à celles dont ils auraient pu bénéficier avec le système antérieur. La tentative législative de reporter la généralisation au 1er janvier 1947 échoue dans un premier temps en août 1946 mais l’Assemblée finit par admettre l’idée du report à cette date en raison de difficultés techniques. Une « commission paritaire nationale », en réalité tripartite, est mise en place, sous la surveillance de l’État pour réfléchir aux conditions de transformation de la retraite des cadres.
• La mise en place d’un nouveau système de retraites complémentaires pour les cadres
Ce délai est mis à profit par les syndicats pour négocier et conclure deux conventions collectives nationales le 14 mars 1947, signées par le CNPF, la CGT, la CFTC et la CGC, et entérinant le principe d’une retraite spécifique pour les cadres. La population couverte par ces conventions est déjà assez large puisqu’il s’agit non seulement des ingénieurs et cadres mentionnés par le décret-loi du 28 octobre 1935 mais aussi des employés, techniciens ou agents touchant un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale. En faisant le choix d’un système par répartition, par points et géré par des conventions collectives, les partenaires sociaux ont tranché trois problèmes essentiels à la fondation d’un nouveau système :
– le choix d’un système par répartition est conforme à l’esprit qui prévalait à l’époque, mais le système étant à cotisations définies et à prestations variables, il est exactement inverse du système d’assurance-vieillesse de la sécurité sociale ;
– le choix d’un système par points permet d’éviter d’avoir à équilibrer ressources et prestations chaque année, ce qui aurait conduit à des variations excessives d’une année à l’autre ; un délai de dix ans est fixé pour atteindre l’équilibre. Le point de retraite est inventé pour servir d’intermédiaire entre les cotisations et la liquidation, afin d’immuniser le montant de la pension contre l’érosion monétaire ;
– enfin, le véhicule juridique qui portera le système est la convention collective nationale définie par la loi du 23 décembre 1946 (153), afin de ne pas reproduire le désordre des systèmes privés d’entre-deux-guerres et de permettre la création d’un régime unique. Ce choix est loin d’être évident à l’époque puisque la création d’un système de retraite interprofessionnel par répartition, donc irréversible, reposait dès lors sur une convention aux effets limités dans le temps, renégociable, et à laquelle il était possible de déroger par une autre convention. Malgré ces obstacles juridiques, le gouvernement prend un arrêté d’agrément dès le 31 mars 1947.
Le système créé repose alors sur trois instances :
– une commission paritaire nationale comprenant les signataires (CNPF, CGT, CFTC, CGC puis CGT-FO à partir de 1948) et qui peut seule interpréter et modifier les conventions collectives du 14 mars 1947. On peut noter qu’elle était présidée de 1949 à 1964 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
– l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) qui agrée les institutions de retraite, garantit un minimum d’allocations aux bénéficiaires et assure une compensation des charges entre les institutions. Son conseil d’administration est strictement paritaire ;
– les institutions, forme juridique originale, admises de manière libérale par l’État (154), qui manient directement les capitaux. Leur conseil d’administration doit comprendre au moins la moitié de salariés ou de retraités, sans plus d’exigence.
Les années qui suivent la mise en place de ce système réinterrogent la question du fondement juridique du régime. La nécessité de modifier ou de compléter la convention initiale, trop brève ou trop évasive pour un régime aussi complexe, par des avenants remet en cause l’idée que les retraites complémentaires peuvent reposer sur une convention qui ferait l’objet d’un accord d’extension à chaque modification. L’État intervient donc en 1959, par ordonnance, pour permettre que les « accords ayant pour objet exclusif » les régimes de retraite complémentaire soient automatiquement étendus dès lors qu’ils sont agréés par arrêté ministériel, créant ainsi une nouvelle catégorie d’accord collectif.
Les années 1950 puis 1960 permettent également à l’AGIRC de prendre toute sa place par rapport aux autres instances que sont la commission paritaire nationale et les institutions : si des représentants de l’association assistent aux travaux de la commission paritaire nationale depuis 1947, l’AGIRC obtient en 1955 de récupérer de nombreuses attributions qui relevaient jusqu’ici de la commission (155). Le besoin d’asseoir un contrôle sur des institutions de retraite, trop nombreuses, trop atomisées et sur lesquelles l’État assure une surveillance minimale, incite les dirigeants du régime à fixer, en 1966, un nombre minimum d’adhérents pour constituer une institution et, en 1967, des clauses à inscrire obligatoirement dans leur statut (156).
Aussi, la création de l’AGIRC et les premières années qui suivent sont marquées par une forme d’originalité juridique, à laquelle l’État ne s’est pas opposé et dont il a même accompagné la construction, permettant aux partenaires sociaux de s’approprier ce nouveau régime harmonisé. Cette mise en place plutôt réussie doit beaucoup à plusieurs facteurs :
– la relative discrétion du processus, qui ne concerne à l’époque que très peu de salariés ;
– la place relativement peu importante que représente la construction d’un régime complémentaire par rapport au grand œuvre que constitue le régime de sécurité sociale ;
– la relative indifférence des Français sur le sujet des retraites, plutôt mineur dans un contexte économique favorable (157), alors que d’autres évènements historiques accaparent l’attention des médias.
La « révolution discrète » que constitue la création de l’AGIRC joue cependant le rôle de modèle pour ce que M. François Charpentier appelle le « tsunami » de la création de l’ARRCO (158).
ii. La création de l’ARRCO : l’extension progressive au plus grand nombre (1947-1961)
La situation des salariés non-cadres est marquée au sortir de la guerre par le nombre pléthorique des régimes complémentaires de retraite auxquels ils pouvaient s’affilier. Il en résulte des inégalités considérables en fonction de la région, de la profession et de la branche, les secteurs économiques les plus dynamiques étant, à l’époque, en capacité d’offrir une rentabilité des cotisations quatre fois plus élevée que les secteurs les moins dynamiques, à salaire égal. En outre, les spécialistes des systèmes de solidarité ont déjà établi depuis des années que l’efficacité d’une assurance vieillesse est proportionnée à l’étendue de sa base.
Renault fait alors figure de laboratoire en signant, en 1955, un accord qui crée une véritable de caisse de retraite complémentaire dont la singularité est d’être complètement autonome de l’entreprise. Cette expérience est suivie par de nombreuses autres entreprises du secteur industriel. Modernes lorsqu’elles sont considérées individuellement dans leurs modalités de fonctionnement, ces « caisses de retraite interentreprises » continuent cependant à participer du morcellement du système (159). C’est pourquoi le législateur intervient en 1956 pour imposer la portabilité des droits à la retraite entre caisses, ce qu’elles ne parviendront pas réellement à appliquer.
Soucieux d’éviter une reprise en main complète par un État de plus en plus entreprenant, les partenaires sociaux signent le 15 mai 1957 un accord créant l’Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), chargée d’organiser la compensation entre les régimes et d’harmoniser les taux de cotisations entre entreprises adhérentes. La gestion de cette union est confiée à un conseil d’administration paritaire dont les dirigeants sont un président issu de la CFTC et un vice-président issu de l’UIMM, au nom du CNPF. Préfigurant par bien des aspects le régime unique paritaire, l’UNIRS s’en distingue néanmoins par son caractère facultatif. Les résultats de l’opération sont donc mitigés puisque n’y adhèrent que les plus petites institutions à la recherche de mutualisation (160). Toutefois, même à petite échelle, l’UNIRS fait la démonstration pour les adhérents et les bénéficiaires de l’efficacité d’un régime normalisé.
L’ordonnance du 4 février 1959 donne une nouvelle impulsion au développement des retraites complémentaires et vise à remettre de l’ordre au sein d’un univers encore dispersé, malgré l’UNIRS. Comme le rapporteur l’a indiqué précédemment, le texte donne à l’arrêté d’agrément les effets d’un arrêté d’extension si l’accord ne concerne que la retraite, permettant ainsi à des secteurs ou des entreprises dans lesquels la négociation collective est trop faible d’accéder aux retraites complémentaires. C’est dans ce cadre juridique plus favorable qu’est signé l’accord du 8 décembre 1961 entre le CNPF, FO et la CFTC. Il prévoit la généralisation partielle des régimes de retraite complémentaire et oblige les institutions existantes à se coordonner au sein d’associations. Plus ambitieux que celui qui a fondé l’UNIRS, mais sans prétendre toutefois créer un régime unique, l’accord de 1961 se distingue de celui de 1957 par son caractère obligatoire pour toutes les entreprises adhérentes au CNPF et l’adhésion tout aussi obligatoire à une association gérée par un conseil d’administration paritaire (161), l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO). Comme à l’AGIRC, une commission paritaire est chargée d’interpréter l’accord. Certains secteurs obtiennent une dérogation mais une étape décisive vers l’intégration des retraites complémentaires est franchie, saluée par l’ensemble des partenaires sociaux (162) et par la presse spécialisée comme un progrès considérable (163) réalisé sans l’intervention de l’État.
iii. Un demi-siècle de paritarisme dans les retraites complémentaires : un système original qui a montré ses capacités de gestion et de réforme (de 1961 à aujourd’hui)
Les années 1960 et 1970 se traduisent par une augmentation considérable du nombre de cotisants tant pour l’AGIRC que pour l’ARRCO. Alors qu’en 1964, on compte un peu moins d’un million de cotisants pour 1 900 000 allocataires, il y a, en 1972, 13 millions de cotisants et 4,5 millions d’allocataires. Les explications à cette évolution quantitative mais aussi qualitative sont à rechercher du côté de facteurs externes (rattachement des rapatriés des colonies et d’Afrique du nord (164), des mineurs (165) et enfin les chômeurs (166) qui constituent des populations plus déséquilibrées quant au rapport cotisations/prestations) mais aussi à un réel dynamisme du dialogue social sur le plan des retraites complémentaires.
En 1972, une loi de généralisation, sollicitée par les partenaires sociaux eux-mêmes et acceptée par le gouvernement qui recherchait alors à afficher des mesures sociales visibles, est votée en faveur du million de salariés qui étaient encore privés de retraite complémentaire. Voulue par les organisations professionnelles gestionnaires et largement conforme à leurs recommandations (167), cette loi ne donnera pas l’impression de remettre en cause le paritarisme.
L’objectif ayant été atteint, les partenaires sociaux s’emparent d’un autre sujet – toujours d’actualité : le rapprochement entre les deux régimes de retraite complémentaire. L’accord du 6 juin 1973 affirme la solidarité entre cadres et non-cadres à travers plusieurs mesures dont l’une consiste pour les cotisants à l’AGIRC à verser une cotisation nouvelle en faveur de l’ARRCO.
Sur le plan financer, la situation demeurait très satisfaisante notamment au regard des excédents accumulés, contrairement au régime de base sur lequel pesaient les déficits récurrents de l’assurance-maladie. Ce sont donc les systèmes de retraite complémentaire généralisés et moins contraints financièrement qui ont permis une amélioration continue des pensions de retraite jusqu’au milieu des années 1970. S’ajoutent au système des retraites des fonds d’action sociale financés par un prélèvement sur le compte des régimes pour financer des aides individuelles ou collectives, ainsi que les centres d’information et de coordination de l’action sociale (CICAS) pour assister les personnes âgées dans l’utilisation de leurs droits. Des difficultés apparaissent cependant au niveau de l’ARRCO – qui perdurent jusqu’au début des années 1980 – pour parvenir à faire respecter par les institutions le principe de compensation, certaines n’ayant pas accepté l’accord de 1961.
Sur le plan administratif, les régimes favorisent la « reconstitution des carrières » quelles que soient les entreprises dans lesquelles le salarié a pu travailler. L’AGIRC transmet ainsi à la dernière institution de cotisation une « déclaration générale de carrière ». L’ARCCO connaît davantage de difficultés, notamment vis-à-vis de l’UNIRS qui impose son corps de règles à l’exécutif de l’association. Ces difficultés tiennent au caractère beaucoup plus hétérogène du paritarisme au sein des non-cadres et à un attachement parfois très fort de certaines professions à leur institution de retraite complémentaire. Elles seront progressivement dépassées par la fédération qui acquiert certaines prérogatives en matière de contrôle avec l’accord du 17 juin 1975, de coordination informatique puis d’harmonisation du rendement entre les institutions avec le protocole d’accord de janvier 1980.
Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, la crise économique crée pour les régimes de retraite complémentaire deux contraintes majeures : d’une part, le chômage renforce les revendications des syndicats qui demandent depuis longtemps un abaissement de l’âge de la retraite. Les femmes obtiennent en 1977 le droit de partir à la retraite à 60 ans et un accord national interprofessionnel de la même année permet à tous les salariés de partir à 60 ans avec 70 % de leur salaire brut. D’autre part, les pertes de recettes pour la sécurité sociale incitent le gouvernement à relever les plafonds, ce qui amène l’AGIRC et l’ARRCO à perdre les salariés qui touchent des salaires inférieurs à ces plafonds. La mise en place de la retraite à 60 ans, en 1982, constitue un réel défi pour les régimes, relevé avec efficacité par les deux exécutifs.
Dès l’élection présidentielle de mai 1981, les services de l’AGIRC et de l’ARRCO (168) avaient commencé à travailler sur plusieurs hypothèses techniques. La solution finalement retenue par l’accord du 4 février 1983 est la création d’une Association pour la gestion de la structure financière (ASF) (169), instance paritaire chargée d’assurer la transition et financée par une contribution sur les salaires, une contribution de l’État et le produit de deux emprunts garantis par l’État.
Le législateur se montre également moins soucieux de respecter l’autonomie contractuelle des partenaires sociaux : en 1978, il crée des pensions de réversion pour le conjoint divorcé non remarié et cette mesure est applicable en matière de retraite complémentaire ; en 1979, il soumet à une cotisation en faveur de l’assurance-maladie les avantages liés à la retraite. L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) critique le système des retraites complémentaires, jugé trop complexe par le nombre d’institutions mais aussi par la coexistence de deux régimes indépendants. M. Raymond Barre, Premier ministre, évoque en 1978 la possibilité pour les retraites complémentaires d’abandonner le principe de la répartition au regard des défis démographiques.
La réponse des régimes est à la fois politique et technique : les partenaires sociaux, par la voie de l’exécutif de l’AGIRC et de l’ARRCO, réaffirment leur attachement au système et rappellent le gouvernement au respect de la volonté des signataires, tandis que les services de l’AGIRC, notamment, répondent point par point pour démontrer que la répartition reste le système le plus pertinent (170). M. Jacques Barrot, ministre de la Santé, donne raison aux gestionnaires en 1980, en estimant que le régime de base et les régimes complémentaires doivent rester par répartition tandis qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que le sur-complémentaire (ou prévoyance individuelle) relève de la capitalisation.
Après avoir passé cette zone de turbulences avec une certaine réussite, les deux régimes se voient contraints de gérer la croissance faible et une démographie moins favorable au moyen de solutions standards : ne pouvant recourir à l’emprunt, ils augmentent le taux d’appel des cotisations et diminuent le taux de rendement afin de maintenir un équilibre consubstantiel au système par points (171). Le régime des cadres intègre peu à peu d’autres systèmes pour élargir sa base (172).
Ils doivent également affronter les critiques, devenues récurrentes dans le débat public, sur le système par répartition. Une stratégie de communication plus offensive est adoptée à partir de 1985 : publication de revues trimestrielles (173), interventions dans les colloques, forums, création en 1990 d’un Observatoire des retraites qui préfigurera le Conseil d’orientation des retraites (COR).
La fin des années 1980 et le début des années 1990 voient les premiers déficits techniques des régimes de retraite complémentaire, et ce malgré les ajustements paramétriques. Avant les réformes du régime de base, en 1993, les partenaires sociaux prennent en toute autonomie la décision de réformer tant l’AGIRC que l’ARRCO. Sont signés tour à tour un accord ARRCO du 10 février 1993, qui prévoit une augmentation de la cotisation obligatoire, un accord commun du 30 décembre 1993 pour une prolongation de trois ans de l’ASF (174) et un accord AGIRC du 6 février 1994 qui permet de retrouver l’équilibre moyennant un effort partagé entre actifs et retraités (175).
En 1996, les partenaires sociaux décident de négocier pour la première fois une réforme de fond des deux grands systèmes, ce qui aboutit à l’accord du 25 avril 1996. Cet accord prévoit de nombreuses mesures techniques (176) mais aussi des modifications plus profondes : l’harmonisation des conditions d’attribution de points entre les deux régimes, la création d’un véritable régime unique pour l’ARRCO (177) et la solidarité financière avec l’AGIRC. Ces accords permettent aux régimes de retraite complémentaire d’arriver aux années 2000 dans une bonne santé financière, avec en perspective un rapprochement entre les deux régimes, rendu possible par la création d’un véritable régime unique pour les non-cadres le 1er janvier 1999.
La première étape de cette convergence se concrétise par la création d’un groupement d’intérêt économique, le 1er juillet 2002, qui réunit les services des deux associations. L’accord de 2001 avait également précisé les conditions dans lesquelles des institutions pouvaient former des groupes de protection sociale (GPS). La notion de groupe permet d’obliger les entreprises nouvelles à adhérer à l’un d’entre eux, limitant la dispersion qui caractérisait le paysage des institutions, et s’inscrit dans le processus de convergence puisqu’elle permet d’affilier à un groupe unique des salariés cadres et non-cadres.
Les années 2000 et le début des années 2010 se traduisent par des évolutions plus modestes, destinées à la fois à tenir compte des réformes des retraites de base (lois du 21 août 2003, du 9 novembre 2010, du 20 janvier 2014) et des effets de la crise financière de 2008 (178). Bien que rien ne les y contraigne juridiquement, les partenaires sociaux choisissent d’aligner systématiquement le système complémentaire sur le régime de base tant en terme de durée de cotisation que d’âge légal. Sur le plan administratif, la rationalisation en cours à travers le regroupement des institutions et des groupes, d’une part, et le rapprochement entre AGIRC et ARRCO, d’autre part, connaît une période difficile sur le plan budgétaire avec des dépenses importantes dues à la consolidation des systèmes informatiques.
Tirer un bilan de ces cinquante années de paritarisme pour les retraites complémentaires suppose de bien comprendre les enjeux spécifiques de ce mode de gouvernance : les retraites complémentaires étaient avant 1945 un aspect spécifique de la prévoyance et relevaient déjà très largement du paritarisme. Les partenaires sociaux se sont en revanche trouvés face à un enjeu d’une tout autre ampleur en se saisissant d’une problématique autrement plus difficile : la création de régimes obligatoires de retraite sinon uniques, du moins harmonisés. Or, de ce point de vue, l’œuvre du paritarisme est importante : la gestion financière a su s’adapter à des conjonctures difficiles en créant des réserves importantes et surtout en modifiant par accord, aussi souvent que nécessaire, les paramètres du régime. La gouvernance paritaire a su transformer les régimes pour créer de l’ordre dans un univers particulièrement fragmenté et organiser la solidarité, puis la convergence, de deux systèmes qui avaient été initialement conçus comme parfaitement indépendants. Enfin, les mandataires gestionnaires ont pris toute leur part dans la défense d’un modèle par répartition souvent attaqué. Dans un rapport pourtant sévère, la Cour des comptes faisait le bilan du paritarisme dans les retraites complémentaires ces cinquante dernières années en ces termes : « les partenaires sociaux ont su assumer pleinement depuis leur création leurs responsabilités, et, mieux que les pouvoirs publics pour le régime général, définir à chaque période de crise une démarche volontaire, méthodique, rigoureuse et attentive à la juste répartition des efforts entre tous les acteurs » (179).
Ce parcours plutôt réussi sur le plan de la gestion et de la capacité d’évolution et d’adaptation – qui n’a effectivement rien n’à envier à celui d’organismes à gestion plus étatique –, explique largement que les retraites complémentaires constituent, avec la prévoyance, des modèles du paritarisme.
b. L’AGIRC-ARRCO aujourd’hui : un modèle de paritarisme pur dans un contexte d’étatisation croissante des enjeux de la protection sociale
« Seul vrai champ du paritarisme » pour M. Claude Tendil (180), les retraites complémentaires sont directement associées au paritarisme dont elles semblent être à la fois le champ privilégié et la vitrine. La presse se montre cependant très critique à l’égard de ce mode de gestion, comme l’a encore montré la couverture des dernières négociations ayant conduit à l’accord du 30 octobre 2015181, le présentant parfois comme inutilement complexe ou intéressé. L’histoire du paritarisme dans les régimes obligatoires, tout comme une description précise du fonctionnement de ce mode de gouvernance, semblent cependant indiquer le contraire. Pour bien comprendre le paritarisme tel qu’il se pratique aujourd’hui à l’AGIRC et à l’ARRCO, il faut recourir à la distinction classique entre paritarisme de négociation et paritarisme de gestion.
i. Un processus de négociation juridiquement autonome mais dont l’État n’est pas complètement absent
Le principe de la négociation AGIRC-ARRCO est celui de l’autonomie, miroir de l’autonomie de gestion dont jouissent les partenaires sociaux. Cette autonomie est assez importante, même si la négociation ne peut se faire sans l’intervention informelle de l’État.
• Les négociateurs : un patronat uni et cinq syndicats représentatifs
La négociation réunit les trois organisations patronales et les cinq organisations syndicales représentatives au plan national. Lors de la dernière négociation, les organisations patronales ont choisi de conduire une délégation unique menée par le négociateur du MEDEF, M. Claude Tendil.
Le choix des négociateurs est souvent celui de la continuité. Ainsi, lors de la dernière négociation, deux négociateurs seulement sur six n’avaient encore pas conduit de négociation AGIRC-ARRCO auparavant.
• L’appui à la négociation : une objectivation des données par les services de l’AGIRC-ARRCO et une équipe de permanents techniques
La négociation est préparée par chaque délégation avec l’aide des services de l’AGIRC et de l’ARRCO qui fournissent ainsi un « diagnostic partagé » (182). Les services des deux fédérations ont indiqué mettre à disposition 5 membres (sur 12) de la direction technique afin de réaliser des simulations. Chaque syndicat mobilise également un groupe technique qui suit le dossier des retraites. Ainsi à la CFDT, il y a une équipe légère autour de deux secrétaires nationaux, dont le négociateur, et de la responsable du dossier des retraites au sein du service « Protection sociale » ; un groupe Bureau national est « composé d’une quinzaine ou d’une vingtaine de personnes – techniciens, représentants du bureau national et représentants des régimes –, il se réunit tous les mois et suit le dossier des retraites » (183). La CFTC dispose « d’une technicienne très compétente sur le sujet, d’un groupe de travail de six personnes en lien avec le bureau confédéral, auquel je faisais un rapport tous les mois sur la négociation, et d’une commission exécutive avec laquelle je faisais le point tous les lundis matin sur l’état d’avancement de cette négociation » (184). Les hypothèses retenues pour construire les prévisions sont celles du Conseil d’orientation des retraites.
• Les modalités de la négociation : l’initiative au patronat
L’organisation professionnelle, en général son bureau national, donne un mandat à son négociateur qui prend une forme suffisamment vague pour permettre la négociation : « le mandat du bureau national n’est pas précis au sens technique et arithmétique, car donner des chiffres avant une négociation est très compliqué. Pour simplifier, je dirai qu’il fixe des orientations, des limites basses et hautes » (185). C’est également le bureau national qui donne son accord pour la signature. Ainsi, la CFDT avait annoncé à M. Jean-Louis Malys « qu’il y aurait un compromis ».
Mme Pascale Coton, négociatrice pour la CFTC, souligne l’importance des rencontres informelles qui ont lieu pendant la discussion : « ce que la CFTC a apprécié, et moi plus particulièrement, ce sont les intersyndicales entre les uns et les autres. Les réunions bilatérales ont également été positives et permis parfois de faire baisser un peu la tension » (186). Ce sentiment a été confirmé par M. Éric Aubin, négociateur pour la CGT : « des réunions bilatérales ont eu lieu pendant les séances plénières, ce qui est important » (187).
La discussion a lieu dans les locaux du MEDEF, sous la présidence du MEDEF, autour de la proposition du patronat, qui arrive souvent mieux que les syndicats à avoir une position nette sur tous les sujets. Certains syndicats peuvent alors faire une contre-proposition chiffrée avec l’appui des services administratifs des régimes. Cet aspect de la négociation, qui n’est d’ailleurs pas spécifique aux retraites complémentaires, a été très sévèrement critiqué par certaines personnes auditionnées comme M. Éric Aubin, qui a expliqué : « quand on se retrouve dans une négociation au siège du MEDEF, sous présidence du MEDEF et sur la base d’un texte du MEDEF, les propositions des autres organisations sont trop souvent écartées d’un revers de main au motif qu’elles relèvent d’une autre négociation. »
• La place ambiguë de l’État dans les négociations
Si l’État n’intervient évidemment pas directement dans les négociations, il ne s’en désintéresse pas complètement. D’abord, si les accords sur les retraites complémentaires ont souvent tenu compte des évolutions législatives sur les retraites de base, une évolution des régimes complémentaires peut aussi avoir des conséquences assez directes sur le régime de base. Ainsi, le système de malus mis en place par l’accord d’octobre 2015 pour les départs avant 63 ans, s’il ne remet pas en cause l’âge légal de la retraite, peut conduire à un report de fait de l’âge de départ à la retraite. Ensuite, les comptes des régimes de retraite complémentaire, régis par le droit privé mais gérant des cotisations obligatoires pour un régime de solidarité, relèvent des dépenses publiques au sens des critères européens. Cet aspect était longtemps indifférent à l’État car les régimes étaient excédentaires. Cependant, depuis la crise financière de 2009, l’AGIRC et l’ARRCO sont dans une situation de déficit technique à laquelle le gouvernement ne peut plus être indifférent en raison de ses engagements européens, renforcés par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
Ces considérations expliquent probablement certaines interventions du gouvernement, directes ou indirectes, dénoncées par des représentants syndicaux auditionnés, signataires et non-signataires du dernier accord. Ainsi, M. Philippe Pihet, négociateur pour Force Ouvrière, a indiqué que l’État avait pesé très fortement sur la négociation pour des raisons budgétaires : « Lorsque, il y a environ dix-huit mois, le Gouvernement a remis sa copie à Bruxelles, il y était indiqué que 2 milliards d’euros d’économies seraient réalisés sur les régimes complémentaires. La Cour des comptes, alors en mission à l’ARRCO a souhaité savoir comment avaient été chiffrés ces 2 milliards : il a fallu la renvoyer à Bercy, car l’ARRCO n’avait pas même été consultée ! » (188).
M. Pierre Roger, délégué national à la protection sociale de la CFE-CGC, a, pour sa part, fait état d’un avis du comité de suivi des retraites (189) au cours des négociations : « Nous avons ainsi été très surpris de découvrir que figuraient parmi les recommandations contenues dans l’avis du comité de suivi des retraites publié cet été des idées en cours de négociation entre les partenaires sociaux, ce qui pouvait malencontreusement apparaître comme une incitation à s’y conformer » (190). Mme Pascale Coton a davantage insisté sur les commentaires du gouvernement pendant les négociations : « L’État n’est pas intervenu directement dans les dernières négociations, mais le fait que plusieurs membres du Gouvernement aient indiqué par voie de presse que les discussions étaient en bonne voie et qu’ils en validaient les premiers résultats – alors que la CFTC récusait pour sa part les premiers chiffrages – a évidemment pesé sur l’élaboration de l’accord sans qu’il soit possible ensuite de rectifier le tir » (191).
Il est d’autant plus difficile de déterminer les effets qu’ont pu avoir ces interventions sur la négociation – tant son aboutissement que le contenu de l’accord – que les partenaires sociaux affirment souvent qu’ils souhaitent obtenir un accord non seulement pour sauver le régime, mais aussi pour préserver le paritarisme. M. Claude Tendil a posé ainsi le problème : « Dans le cas des régimes de retraite complémentaire, nous avons à la fois la responsabilité de la décision et celle de sa mise en œuvre et de sa gestion. Si, compte tenu de cette caractéristique du paritarisme en matière de gestion des retraites complémentaires, cette négociation avait échoué, c’est le concept même de paritarisme qui aurait été fragilisé car, faute de décision, il aurait fallu que l’État reprenne la main pour fixer le taux d’appel, le niveau des pensions, donc qu’il se substitue aux partenaires sociaux, mettant ainsi fin à ce qui est aujourd’hui le cœur du vrai paritarisme, et qui relève de la seule responsabilité des partenaires sociaux. » (192). Mme Pascale Coton a partagé ce sentiment : « Si nous n’étions pas parvenus à un accord, nous aurions pu craindre de voir sombrer le paritarisme dans son ensemble, mais il fallait mener cette négociation sans avoir à chaque instant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. » (193)
Ainsi, plus que le principe d’un regard attentif de l’État, qui semble inévitable, ce sont les modalités de son intervention, plus ou moins respectueuse sur le plan formel du paritarisme, qu’il convient de revoir afin d’articuler au mieux les règles du régime général et les impératifs financiers sans remettre réellement en cause la capacité des partenaires sociaux à prendre leurs décisions en toute autonomie dès lors qu’ils ont conscience de la nécessité de trouver un accord. Cette bonne articulation pourrait être l’une des fonctions du Haut Conseil de la Négociation Collective et du Paritarisme dont la création est proposée dans la deuxième partie du présent rapport.
• La forme juridique de l’accord : un accord national interprofessionnel particulier
Les premiers pas de l’AGIRC et de l’ARRCO ont montré que la nature juridique de l’accord collectif sur lequel se fondent les régimes de retraite complémentaire n’a pas toujours été facile à identifier.
L’article L.921-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Ils sont mis en œuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. »
L’articulation entre la loi du 29 décembre 1972 (194) et les conventions collectives nationales de 1947 et 1961 présente d’ailleurs une certaine originalité juridique puisque, comme le rappelait Me Jacques Barthélémy, sur le plan du droit, on peut considérer que « les acteurs sociaux se substituent au pouvoir réglementaire. L’ANI est alors un “quasi-règlement” » (195). En effet, même si ces accords sont antérieurs à la loi de généralisation des retraites complémentaires, ils en définissent les modalités d’application si bien que celle-ci peut se passer de décret d’application. Le champ d’application de l’accord étant le même que celui de la loi – il concerne tous les employeurs, syndiqués ou non –, un arrêté d’extension et d’élargissement (196) pris par les ministres chargé de la sécurité sociale et du budget conditionne son applicabilité.
En pratique, l’accord fraîchement conclu est déposé auprès de la direction de la Sécurité sociale (DSS) qui instruit la demande d’extension et d’élargissement faite par l’une des organisations signataires. Le contrôle exercé sur l’ANI est de légalité et non d’opportunité. L’arrêté est pris par les ministres compétents après consultation de la Commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) (197), qui respecte toujours la position des signataires, tout en assurant un contrôle des clauses qui pourraient poser un problème juridique.
Cette technique contractuelle, simplifiée par rapport au droit commun de la négociation collective, n’est pas de nature à remettre en cause le paritarisme dans la mesure où le contenu de l’accord est exclusivement décidé par les partenaires sociaux, sous réserve de sa légalité.
• Un processus de négociation qui s’améliore malgré des difficultés persistantes
La négociation sur les retraites complémentaires montre cependant certaines insuffisances.
La première tient à sa fréquence, très élevée ces dernières années en raison d’un contexte économique qui s’est considérablement dégradé et de l’adaptation nécessaire à un cycle de réformes des retraites de base.
M. Frédéric Agenet (MEDEF), vice-président de l’AGIRC, a souligné son insatisfaction à cet égard : « Le problème majeur auquel nous sommes confrontés est celui de la crédibilité de nos régimes de retraite complémentaire par répartition. Le fait de devoir, à intervalles réguliers, entrer à nouveau en négociation, en donnant à chaque fois le sentiment que l’avenir des régimes de retraite complémentaire se joue dans ces négociations, est particulièrement anxiogène. » (198) M. Pierre Roger a exprimé un sentiment similaire tout en expliquant cette situation : « Si, dans un passé récent, des négociations ont eu lieu régulièrement – même si je considère qu’il y en a eu trop –, c’est malheureusement parce que la situation économique et sociale en France le réclamait » (199). Une réponse a été apportée avec l’ANI du 30 octobre 2015 qui prévoit une clause de revoyure tous les deux ans.
La seconde tient aux conditions dans lesquelles se déroulent les négociations, avec une prépondérance du MEDEF qui semble favoriser une certaine conflictualité, comme l’a montré la dernière négociation. Un schéma devenu classique veut que les syndicats fassent front commun contre la proposition patronale jusqu’au dernier moment, où un accord doit être trouvé. Toutefois, cette problématique qui touche l’ensemble de la négociation appelle une réponse globale qui dépasse la responsabilité des seuls négociateurs sur les retraites complémentaires.
ii. Une gestion autonome et globalement performante en cours de transformation
• Les mérites du « circuit court » entre paritarisme de négociation et paritarisme de gestion
La gestion des deux régimes de retraite complémentaire atteint les deux objectifs qui la sous-tendent : l’autonomie des partenaires sociaux est quasiment totale et la qualité du service rendu est très satisfaisante. Il semble que le paritarisme explique en partie cette réussite qualitative de la gouvernance.
M. François-Xavier Selleret, directeur général du GIE AGIRC-ARRCO (200), s’est fait l’écho d’une interaction particulièrement efficace entre paritarisme de négociation et paritarisme de gestion : « La force du paritarisme, c’est précisément le circuit court entre négociation et gestion […]. Le circuit court permet d’aller de la négociation, donc de la conception d’éléments de pilotage et de réforme, à leur mise en œuvre. Pouvoir garantir cet élément réduit le risque d’écart entre l’objectif du négociateur et la capacité à atteindre cet objectif… Dans un système fonctionnant par cycles, le fait que les acteurs soient associés à la fois à la conception et à la mise en œuvre et que la négociation intègre dès le départ les conditions de cette mise en œuvre permet, par rapport aux objectifs que se sont fixés les partenaires sociaux dans la négociation, de donner le maximum de garanties quant à l’atteinte de ces objectifs. Pour avoir travaillé dans d’autres environnements où, parfois, l’on distingue strictement le champ de la négociation ou de la conception d’une réforme et le champ de sa mise en œuvre, je peux témoigner que le circuit court, au contraire, permet de relier de manière très forte l’intention politique au sens large et les conditions de la mise en œuvre.» (201)
• L’institutionnalisation permet de distinguer nettement négociateurs et gestionnaires
Si la gestion d’un système paritaire procède de la négociation, elle s’en distingue nettement par deux éléments au moins.
En premier lieu, il est fait abstraction de la distinction entre signataire et non-signataire puisque la gouvernance de l’AGIRC et de l’ARRCO au sein du conseil d’administration est assurée par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce caractère institutionnel du paritarisme est intéressant puisqu’il permet d’associer ultérieurement des syndicats qui ne signent pas les accords conduisant à la création du système.
En second lieu, les partenaires sociaux ont mis en place, sans qu’aucun texte ne les y oblige, une règle de non-cumul des fonctions de négociation et des fonctions exécutives qui a été expliquée en audition par les président et vice-président de l’AGIRC. M. Jean-Paul Bouchet (CFDT), président, l’a présentée ainsi : « J’ai moi-même fait partie de la délégation des négociateurs, mais je n’aurais pu en être le chef de file. Il y a cinq ans, à la CFDT, la règle était même plus stricte encore : dès lors que l’on était président ou vice-président et que l’on faisait partie de la gouvernance, on ne pouvait pas être négociateur. Nos règles ont un peu évolué, mais mon organisation ne m’aurait en aucun cas désigné comme chef de file. Nous considérons en effet que cela revient à exposer une personne de façon excessive et à la mettre dans une situation qui peut être extrêmement compliquée en cas d’inversion de majorité pour ou contre la signature d’un accord. » (202)
Il a été rejoint dans son analyse par M. Frédéric Agenet : « En ce qui concerne le cumul des fonctions de négociateur et de président ou de vice-président, j’ai moi-même participé, comme Jean-Paul Bouchet, à la négociation patronale, et je le rejoins dans son analyse. Il me paraîtrait dommageable et quelque peu académique de considérer que le président, qui connaît bien la vie des régimes, ne soit pas associé à une négociation et ne puisse pas faire bénéficier sa délégation de l’expérience qu’il a acquise au quotidien dans le fonctionnement des régimes. Pour autant, j’estime que ce n’est pas compatible avec le fait de diriger une délégation, car cela vous place dans un rôle de premier plan et vous amène à prendre des positions éventuellement très tranchées. Or, lorsque vous reprenez ensuite, en tant que président, votre travail au niveau des fédérations ou, demain, au niveau du régime unique, vous devez être le garant de la cohésion de l’ensemble et vous exprimer au nom de tous. » (203)
L’ANI du 17 février 2012 a posé le principe de l’incompatibilité entre les rôles de chef de file et de président, principe jusqu’ici coutumier. Cette conception conforte l’idée que le paritarisme de gestion relève d’une autre logique que le paritarisme de négociation : il s’agit d’une mécanique de compromis au regard de l’intérêt supérieur de l’institution et de ses bénéficiaires alors que la négociation procède de la confrontation parfois tendue des positions de partenaires sociaux qui représentent l’ensemble des intérêts de la société. Le rapporteur a d’ailleurs pu constater qu’une grande courtoisie et convergence de vues réunissait les dirigeants auditionnés.
• Une répartition des rôles efficace entre plusieurs instances
Mieux équilibrées que dans le régime général de sécurité sociale, les fonctions de gestion sont réparties entre plusieurs instances dans chaque régime.
Instances communes aux deux régimes :
Le président, élu pour deux ans au sein du conseil d’administration, a statutairement la responsabilité de l’organisation des instances de la fédération. Les régimes fonctionnent en pratique selon une logique de « présidence globale », président et vice-président étant pris au sein de chaque collège, avec alternance employeur/salarié tous les deux ans. Les statuts précisent que « les modalités de prise de parole publique des président et vice-président de la fédération doivent respecter le principe du paritarisme lorsqu’ils s’expriment au nom du conseil d’administration de [la fédération] ».
Le directeur général est nommé par les conseils d’administration. Il leur rend compte régulièrement des missions qui lui sont confiées et de ses activités ainsi que celles des équipes ; le directeur général a la responsabilité du management.
Afin d’assurer un bon suivi des activités, des réunions se tiennent régulièrement entre les présidences paritaires et le directeur général ; il s’agit d’une gouvernance informelle qui permet de préparer les réunions d’instance et de bien préciser la déclinaison des grands sujets stratégiques.
Instances propres à chaque régime :
Au regard de l’article 18 des statuts (204), le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer la fédération. Outre les fonctions classiques (nomination du directeur général, délégations de pouvoirs, vote du budget et suivi des comptes, etc.), il prend, dans le cadre des statuts et règlements du régime, les mesures nécessaires à l’application de l’accord de 1961 ou de la convention de 1947 et des délibérations des commissions paritaires des régimes. Il peut fixer les paramètres de fonctionnement du régime en application des accords paritaires en vigueur (notamment la valeur du point et le salaire de référence), met en œuvre la compensation financière et exerce les pouvoirs liés à la création, au fonctionnement et au contrôle des institutions. Il dispose, le cas échéant, d’un pouvoir de sanction à l’égard des institutions.
Le bureau prépare les réunions du conseil d’administration. Il a délégation de pouvoir sur un certain nombre de sujets (rapprochement des GPS, agrément des directeurs généraux, etc.).
Une commission de contrôle « vérifie chaque année les comptes de la fédération. Elle prend connaissance des travaux des commissaires aux comptes de la fédération, de la réalisation du budget, du rapport de contrôle interne, de la cartographie des risques. Elle propose à la commission paritaire élargie la nomination des commissaires aux comptes. Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport dont il est rendu compte au conseil d’administration et à la commission paritaire élargie en vue de l’approbation des comptes » (205).Cette commission de contrôle est composée de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants désignés paritairement et n’appartenant pas au conseil d’administration des fédérations.
Des commissions sociale, administrative, technique et financière assistent le conseil d’administration, sur le fondement de l’article 18 des statuts qui prévoit que « le conseil d’administration se dote de commissions qui préparent ses décisions, sans jamais le dessaisir de ses pouvoirs, le conseil d’administration ayant seul pouvoir de décision. Les membres de ces commissions, composées paritairement, sont choisis parmi les administrateurs. Chaque commission doit transmettre au conseil d’administration un compte rendu détaillé de ses activités pour permettre à ce dernier de prendre ses décisions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d’administration. La composition des commissions dont la présidence est paritaire, leurs missions et la fréquence de leurs réunions sont fixées par le conseil d’administration. Des membres extérieurs au conseil peuvent faire partie de ces commissions avec voix consultative (206) »
Ce cadre de gestion est en profonde transformation puisque le dernier accord national interprofessionnel prévoit une fusion entre les deux fédérations en 2019, qui devrait favoriser l’apparition de synergies.
Cette organisation complexe est cependant un gage de qualité de la gestion de ces deux fédérations qui ont constitué une véritable administration pour mettre en œuvre des orientations fixées par les négociateurs et déclinées par les gestionnaires.
• Un paritarisme plus efficace et plus transparent après l’ANI du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme
L’enjeu de la formation, essentiel pour des administrateurs qui gèrent plusieurs milliards d’euros, a été pris au sérieux puisque chaque nouvel administrateur AGIRC ou ARRCO a la possibilité de suivre une formation initiale qui dure deux jours. Cette formation lui permet de découvrir l’ensemble des sujets relatifs à la retraite complémentaire. Le principe qu’un administrateur de groupe de protection sociale doit suivre dans l’année qui suit sa nomination une formation proposée par l’AGIRC, l’ARRCO ou le CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance) a été inscrit dans les statuts des associations sommitales.
En 2015, on dénombre 258 participations à l’un des sept séminaires proposés :
- Formation initiale AGIRC-ARRCO (2 jours),
- Action sociale AGIRC-ARRCO,
- Gestion financière et les mécanismes de compensation,
- Retraite complémentaire et enjeux européens,
- Outils de pilotage et qualité de gestion
- Informatique et gestion des activités,
- Informatique et enjeux stratégiques.
Une nouvelle formation vient d’être mise en place pour sensibiliser les administrateurs aux enjeux de qualité de service rendu : le plan de transformation du produit retraite et de la relation client.
Cependant, le rapporteur insiste sur le fait que si les administrateurs sont généralement des personnalités qui connaissent très bien les sujets, avec souvent une importante ancienneté, cette situation n’a pas vocation à perdurer. Le renouvellement des mandataires, souhaité par les partenaires sociaux, doit être accompagné – voire précédé – d’un renforcement des obligations de formation pour les nouveaux administrateurs des fédérations quelle que soit leur organisation professionnelle. Le développement des compétences doit en effet se faire sur une base égalitaire et commune afin de faciliter le dialogue et de garantir l’équilibre au sein du paritarisme. La maîtrise des enjeux techniques demeure en effet la condition d’une gestion effectivement paritaire.
L’ANI du 17 février 2012 a été très largement mis en place : les statuts ont été adaptés pour les fédérations AGIRC et ARRCO et pour les institutions de retraite complémentaire. En particulier, les statuts intègrent les stipulations de l’accord sur la composition du conseil d’administration, sur sa représentation paritaire et sur l’interdiction de cumuler plus de trois mandats de même niveau. Une limite d’âge a été fixée à 70 ans pour la désignation. Un devoir d’assiduité est sanctionné par une perte du mandat après 3 absences injustifiées dans l’année. L’élection du président se fait au vote par tête et non plus par collège. Le secret professionnel a été renforcé.
En termes de transparence, des mesures ont été prises comme la création d’une direction de l’audit, des risques et des contrôles à la fois pour les fédérations et pour les groupes de protection sociale. Un comité de nomination et un comité de rémunération ont été mis en place.
Aujourd’hui, les fédérations prennent en charge financièrement les conseillers techniques des organisations professionnelles à hauteur d’un million d’euros par an, des participations à des insertions dans des revues syndicales à hauteur de 100 000 euros et des participations aux congrès des organisations syndicales du même ordre de grandeur.
Les frais de déplacement et de séjour des mandataires des fédérations AGIRC et ARRCO sont en baisse : ils s’établissaient à 283 748 euros en 2011 mais ne représentaient plus que 171 596 euros en 2014.
c. Les retraites complémentaires constituent le champ le plus important du paritarisme
Le champ des retraites complémentaires comprend donc l’AGIRC, l’ARRCO et l’AGFF pour des dépenses totales dépassant 74 milliards d’euros en 2014. En 2013, les dépenses vieillesse représentaient 297 milliards d’euros. Les régimes de retraite complémentaire représentent alors 25 % de ces dépenses, dont 16,3 % pour l’ARRCO et 8,5 % pour l’AGIRC. À titre de comparaison, le régime de base des salariés représentait 38 % des dépenses vieillesse, les régimes des fonctionnaires et les régimes spéciaux 28 %. Les retraites complémentaires des salariés correspondent à environ 6% du PIB (207). Au-delà des dépenses annuelles, il faut considérer les réserves techniques gérées par les deux régimes qui atteignent environ 75 milliards d’euros, soit plus d’une année de cotisations.
En 2014, l’AGIRC comptait 4 130 000 cotisants pour 2 873 000 retraités tandis que l’ARRCO comptait 18 140 000 cotisants pour 12 202 000 retraités.
Au niveau des bénéficiaires, la pension complémentaire représente un quart de la pension globale pour un salarié rémunéré au salaire médian, la moitié de la retraite d’un cadre rémunéré au niveau moyen de cette catégorie et les deux tiers de la retraite d’un cadre rémunéré à 10 000 euros par mois (208). La retraite moyenne ARRCO est de 3 856 euros par an et la retraite moyenne AGIRC est de 8 803 euros par an.
Montant des dépenses gérées (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
AGIRC |
2011 : 20 205 2012 : 21 441 2013 : 22 364 2014 : 23 246 2015 : 23 823 |
2011 : 365 2012 : 384 2013 : 373 2014 : 359 2015 : 343 |
2011 : 2 931 2012 : 2 946 2013 : 2 852 2014 : 2 633 2015 : 2 536 |
ARRCO |
2011 : 37 870 2012 : 40 312 2013 : 42 321 2014 : 44 125 2015 : 45 417 |
2011 : 1 373 2012 : 1 422 2013 : 1 425 2014 : 1 388 2015 : 1 286 |
2011 : 11 367 2012 : 11 254 2013 : 10 886 2014 : 10 562 2015 : 10 028 |
AGFF |
2011 : 9 913 2012 : 8 727 2013 : 7 915 2014 : 6 764 2015 : 6 189 |
Sans objet (les opérations de l’AGFF sont réalisées par les fédérations et ses coûts de fonctionnement sont donc inclus dans ceux de l’AGIRC et de l’ARRCO) | |
Total pour 2014 |
74 135 |
1 747 |
13 195 |
Source : GIE AGIRC ARRCO
Les coûts de fonctionnement représentent un peu moins de deux milliards d’euros soit environ 2,7% de la masse des cotisations, un niveau relativement constant par rapport aux années précédentes. Des plans d’économie sont déjà engagés pour réduire ces coûts de 300 millions d’euros entre 2013 et 2017. Ces coûts ne sont pas le fait des fédérations mais très largement de la gestion au niveau des institutions de retraite complémentaire. Les coûts informatiques ont beaucoup augmenté en raison de la mise en place d’un nombre réduit de plateformes au profit d’un nouveau système commun (Usine Retraite). Les effectifs ont fortement diminué ces dernières années, notamment avec le départ d’effectifs importants de baby-boomers.
Il faut enfin noter que les retraites complémentaires représentent plus de la moitié des dépenses gérées de manière paritaire.
2. Le paritarisme de prévoyance
a. Les conventions collectives et leurs caisses paritaires de branche ne séparaient pas la prévoyance de la retraite complémentaire avant 1996
i. Les institutions de prévoyance sont créées entre 1937 et 1947 par les conventions paritaires de retraite et de prévoyance pour les cadres
Les caisses patronales de secours et de retraite créées au cours du XIXe siècle et jusqu’aux années 1930 étaient, pour la plupart, des caisses d’entreprise ou syndicales ; elles ont donc été soumises aux lois sur les assurances sociales de 1928 et 1930 puis aux lois de nationalisation de la IIIe République. N’ont pu s’y soustraire que celles qui assuraient collectivement des salariés de l’industrie et du commerce exclus des régimes spéciaux et de l’obligation d’affiliation posée en 1928.
• Les institutions de prévoyance sont héritières de la caisse mutuelle d’assurance inventée par le patronat industriel en 1932
L’article 44 des dispositions transitoires de la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales, qui modifie et complète celle de 1928, autorisait les caisses de retraite par capitalisation et les institutions de prévoyance par répartition, qui servaient des prestations d’assurance en application de conventions collectives de travail, à poursuivre leur activité sur la part des salaires excédant le plafond d’affiliation obligatoire.
La loi leur impose toutefois une procédure administrative d’agrément qui vérifie que les prestations versées sont au moins équivalentes à celles du régime légal. Puisque la mutualisation des risques couverts – vieillesse, invalidité, maternité et maladie – n’était rentable qu’en réunissant suffisamment d’assurés, seules les grandes industries et les banques, qui rémunéraient en grand nombre des cadres, pouvaient conserver ces caisses conventionnelles, dites de substitution.
L’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) souhaitait constituer, pour fidéliser les salariés, une caisse de retraite qui échapperait à l’obligation de soumettre la désignation des administrateurs des caisses d’assurances sociales à une élection ouverte à l’ensemble des assurés et pensionnés, afin de conserver la direction de la caisse, celle du conseil d’administration et la gestion des cotisations encaissées et des réserves capitalisées en valeurs garanties par l’État.
Il fallait, pour cela, concilier le régime juridique des sociétés d’assurances commerciales, qui sépare assureur et assuré, et ceux des caisses de secours mutuel ou des caisses syndicales de secours et de retraite, qui les confondent. Ces caisses, en effet, conditionnaient la vente de contrats d’assurance à l’adhésion à la société et prévoyaient l’élection de leurs administrateurs au scrutin secret par l’assemblée générale des adhérents.
Cette conciliation avait été opérée par les caisses mutuelles d’assurances créées à la fin du XIXe siècle par les propriétaires terriens, au bénéfice de leurs métayers et de leurs salariés agricoles. La loi dite Vigier du 4 juillet 1900 les avait assimilées à des caisses syndicales en raison de leur gestion désintéressée ou de leur but non lucratif déclaré.
Cette conciliation avait également été opérée par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, qui maintenait les modes d’administration propres aux différentes caisses, tout en ouvrant la voie à leur réglementation par convention collective, puisque son article 31 disposait que, lorsque les caisses auront été organisées avec le concours des ouvriers et employés, les intéressés seront amenés à se prononcer sur les engagements et sur les ressources nécessaires pour les couvrir.
Suivant ces exemples, l’UIMM a créé, par acte notarié du 30 mai 1932, une caisse mutuelle d’assurance sous le régime général de la loi du 17 mars 1905 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés d’assurance sur la vie, en la séparant de sa caisse syndicale d’assurance mutuelle contre les accidents du travail, ouverte en 1891, et de sa caisse syndicale de retraite, ouverte sur le fondement de la loi du 5 avril 1910.
La loi sur les assurances sociales de 1930 prévoyait que les caisses mutuelles, syndicales et patronales d’assurance devraient à terme faire élire leur conseil d’administration par les assurés et pensionnés. Si cette disposition n’a pas été appliquée, c’était néanmoins un risque que le droit des sociétés mutuelles d’assurance permettait d’éviter, puisque leurs administrateurs devaient être élus parmi les plus forts assurés ou parmi les sociétaires ayant le service des valeurs assurées minimal nécessaire pour être admis à l’assemblée générale.
Ce mode de désignation composait le conseil d’administration autour de deux collèges censitaires, l’un pour les assureurs, l’autre pour les assurés. Il pouvait être interprété selon les dispositions, très imprécises, relatives aux caisses syndicales de secours et de retraite dans la loi du 21 mars 1884 sur la création des syndicats professionnels.
Le statut notarié de la Caisse mutuelle d’assurances sur la vie de la Métallurgie, des Houilles et des Mines put ainsi réserver ses prestations de rente viagère et d’assurance vie et invalidité aux salariés d’une entreprise appartenant aux secteurs professionnels visés, assurés par souscription de leur employeur, sans que ce dernier soit contraint d’adhérer au syndicat patronal pour adhérer à la caisse, ou par souscription individuelle d’un employé de ces secteurs.
Le statut prévoyait que les administrateurs, qui exercent à titre gratuit sans engager leur responsabilité personnelle, étaient pris par moitié dans deux collèges, l’un formé des sociétés ou employeurs adhérents, l’autre des salariés adhérents individuels et des pensionnés, distingués par le montant de leur cotisation ou pension annuelle.
En soumettant le statut de cette caisse à une convention collective de travail, susceptible, après la réforme du code du travail en juin 1936, d’être étendue aux branches désignées, l’UIMM a pu inventer un modèle de caisse paritaire de retraite et de prévoyance, offrant des garanties collectives d’assurance vieillesse, invalidité, décès et maladie, qui évitait l’élection du conseil d’administration par les bénéficiaires et remplaçait son élection collégiale censitaire par une désignation syndicale paritaire.
• Des conventions collectives, applicables aux concurrents après 1936, garantissent la retraite et la prévoyance des cadres
Les conventions collectives admises par la loi en 1919 ne pouvaient être étendues aux tiers. À la suite des accords de Matignon, la loi du 24 juin 1936 introduit dans le code du travail de 1910, en sus de ces conventions collectives de droit commun, des conventions conclues par des commissions mixtes régionales de branche. Le point i du B du I de la présente partie en a présenté l’économie générale.
L’UIMM conclut avec la Fédération nationale des syndicats d’ingénieurs, le 14 mai 1937, un accord applicable à ses salariés, ingénieurs et collaborateurs, exclus des assurances sociales légales, qui leur accorde une pension de retraite, une assurance vie et une assurance invalidité en contrepartie d’une cotisation paritaire de 10 %. L’accord ne désigne pas la Caisse constituée en 1932 comme assureur : il le laisse au choix de l’assuré. Ce peut être la Caisse nationale des retraites, la Caisse nationale d’assurance vie, une compagnie d’assurance commerciale, une société de secours mutuel. Mais ce peut être aussi la caisse patronale.
Les syndicats patronaux des autres secteurs industriels, de la chimie, de l’énergie électrique, de l’aéronautique et des travaux publics, mais aussi des soieries lyonnaises, prennent cet accord pour modèle de ceux qu’ils concluent dans les mois suivants. L’extension réglementaire de ces accords les rend obligatoires dans les branches concernées.
Un grand nombre de caisses professionnelles d’assurance mutuelle des cadres se créent pour garantir à la fois la retraite et la prévoyance, voire une assurance maladie. Ce succès conduit le Gouvernement à distinguer, par un décret du 31 décembre 1938, les sociétés mutuelles d’assurance, d’administration égalitaire, des sociétés d’assurance à forme mutuelle, d’administration censitaire, que le décret précédent du 8 mars 1922 confondait.
Échappant au choix d’une gestion par répartition des cotisations, sans provision de réserves obligatoires – choix fait par le Gouvernement en 1941 pour financer les pensions de retraite versées par l’assurance vieillesse légale –, ces caisses d’assurance collective des cadres échappent aussi à l’intégration dans la sécurité sociale de 1945.
Elles ne deviennent paritaires qu’après l’adoption des deux conventions collectives nationales du 14 mars 1947, la convention de retraite et de prévoyance des cadres et la convention sur le maintien des avantages antérieurs à l’affiliation des cadres à la sécurité sociale.
ii. La prévoyance est incluse dans les conventions collectives de retraite complémentaires jusqu’aux années 1990
• Les conventions collectives nationales du 14 mars 1947 lient la prévoyance à une retraite complémentaire par répartition
L’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale remplace le plafond d’affiliation obligatoire des salariés par un plafonnement du salaire garanti soumis à cotisations. Les cadres ne sont plus les salariés qui sont soustraits à l’obligation d’affiliation mais ceux dont le salaire excède la garantie de sécurité sociale.
Les clauses de leurs conventions collectives sont revues pour attribuer à leur garantie le caractère complémentaire reconnu par l’article 18 aux prestations des institutions de prévoyance. Selon cet article : « Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuel, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale. »
Le décret d’application du 8 juin 1946 permet aux institutions de prévoyance groupant tout ou partie du personnel d’une ou plusieurs entreprises de constituer « soit en vertu d’une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s’ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale notamment sous forme d’épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraite de vieillesse, de pensions d’invalidité ou de rentes à l’occasion d’accidents du travail, de pensions de veuves ou d’orphelins. »
La possibilité de créer des avantages par convention collective sépare plus nettement encore que ne le faisait le décret du 31 décembre 1938 ces institutions de prévoyance – détachées du droit des assurances commerciales, par action, mutuelles ou tontinières – des sociétés mutuelles d’assurance qui relèvent de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.
Les deux conventions collectives nationales du 14 mars 1947 établissent une cotisation supplémentaire de 1,5 % pour financer une garantie de prévoyance, dont au moins la moitié doit être affectée à une assurance décès, qui, dans un régime de retraite par répartition, préserve les ayants droits qui ne peuvent prétendre à une pension de réversion en cas de décès de l’assuré.
Déclinant les principes de ces conventions nationales, les conventions collectives de branche, d’entreprise ou de profession modulent les clauses de prévoyance, leur ajoutent des options facultatives et maintiennent, pour les plus favorables, des garanties de salaire en cas d’arrêt maladie qui s’ajoutent aux indemnités journalières de sécurité sociale.
La croissance économique maintenue jusqu’aux années 1970 permet aux partenaires sociaux d’utiliser librement l’autre moitié de cette sur-cotisation et de la compléter pour financer des retraites supplémentaires par répartition ou de généreuses indemnités d’assurance décès ou invalidité. Les conventions collectives de retraite et de prévoyance offrent en outre à leurs bénéficiaires des options facultatives individuelles, avantageusement négociées, de rentes viagères par capitalisation qui deviendront par la suite des plans d’épargne d’entreprise.
Aux prestations convenues collectivement, les conseils d’administration des institutions de prévoyance ajoutent des prestations non contributives, financées par les recettes tirées du placement des réserves, comparables à celles des comités d’entreprise, telles que des aides individuelles ou des investissements immobiliers dans des résidences de retraite ou de vacances.
• Les conventions collectives garantissent le remboursement des soins de santé en plus du complément des indemnités journalières
Dans les années 1970, les accords collectifs de mensualisation des salaires qui sont appelés par l’accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977, étendu par la loi du 19 janvier 1978, prévoient que l’employeur garantit le maintien des salaires en cas de maladie ou d’accident en complétant l’indemnité journalière de sécurité sociale.
Ces clauses ne bénéficiaient auparavant qu’aux cadres de l’industrie, pour la partie de leur salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale, qui n’était pas compensée par les indemnités journalières légales. Étendues à l’ensemble des salariés couverts par les conventions collectives, elles sont complétées par des garanties de remboursement des dépenses de soins laissées à la charge de l’assuré par la sécurité sociale.
Toutefois, alors que les cotisations collectives de retraite complémentaire et de prévoyance étaient réservées, par des clauses conventionnelles de désignation de l’assureur, aux institutions de prévoyance, les assurances maladie complémentaires, dites complémentaires santé ou couverture de frais de santé, ont été souscrites par les entreprises auprès des mutuelles et des sociétés d’assurances comme auprès des institutions de prévoyance, les trois catégories d’assureurs se partageant un marché qui n’a cessé de croître depuis lors.
• Les conventions collectives désignent comme assureur des institutions de prévoyance, agréées par l’AGIRC
Après 1947, les conventions collectives de retraite et de prévoyance des cadres, de branche, d’entreprise ou de profession, ne laissent plus l’assuré aussi libre qu’avant-guerre du choix de son assureur en raison du financement des pensions par la répartition, qui ne permet pas d’en changer sans perdre les droits constitués.
Ces conventions incluent des clauses de désignation qui confient les garanties collectives à une institution de prévoyance, en contrepartie de la collecte des cotisations. Cette institution doit être agréée par l’AGIRC et préalablement autorisée à compléter les prestations de sécurité sociale.
L’agrément par l’AGIRC suppose que le conseil d’administration de l’institution de prévoyance soit composé pour moitié de représentants des salariés et des retraités – ce qui garantit aux syndicats patronaux, signataires des conventions qui créent ces institutions, l’autre moitié du conseil –, sans imposer toutefois le mode de désignation ou d’élection de ces représentants.
Échappant à l’élection obligatoire des conseils d’administration par les assurés, imposée aux organismes de sécurité sociale et aux mutuelles, les institutions de prévoyance agréées ne sont pas plus astreintes au contrôle par l’État des sociétés d’assurance mutuelle ni au provisionnement de leurs engagements ; elles ne réapparaîtront dans la législation des sociétés d’assurances qu’en 1994.
Les conventions collectives leur imposent progressivement un conseil d’administration composé paritairement de représentants désignés par les confédérations syndicales de salariés et d’employeurs négociatrices ou signataires de la convention, répartis en deux collèges, quand ce paritarisme s’imposera dans les organismes de sécurité sociale avec les ordonnances Jeanneney de 1967.
La généralisation de la prévoyance à l’ensemble des salariés, par voie de conventions collectives de retraite complémentaire, porte le nombre d’institutions paritaires d’une soixantaine à plus d’un millier dans les années 1960.
Au terme de cette généralisation, la loi du 29 décembre 1972 qui oblige les employeurs à affilier leurs salariés à un régime de retraite complémentaire, même en l’absence de convention collective, conduit au regroupement fédératif des caisses. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales remis en 1975 en dénombre encore 531 en 1974.
b. Les institutions de prévoyance ont dû séparer leurs caisses de retraite complémentaire de celles de prévoyance et d’assurance maladie
i. Le droit et la jurisprudence communautaires ont imposé la libre concurrence dans un champ, largement défini, de l’assurance vie
• Le droit européen a réservé la répartition de cotisations obligatoires aux régimes publics et coordonnés d’assurance
Alors que la sécurité sociale était de la compétence exclusive des États, le principe de libre circulation des travailleurs dans le marché intérieur a invité la Cour de justice des Communautés européennes à séparer les régimes de solidarité professionnelle par répartition de cotisations obligatoires et les régimes de prévoyance concurrentielle par capitalisation de primes d’assurance.
La Cour avait écarté l’argument de la compétence juridique exclusive des États en matière de sécurité sociale dès avant l’acte unique de février 1986 : l’arrêt du 20 octobre 1981 soumet les régimes obligatoires de retraite complémentaire français à l’obligation de coordination imposée par le règlement n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
Elle a ensuite défini précisément, par l’arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993, les caisses de gestion et les prestations relevant de ces régimes obligatoires pour les opposer aux prestataires d’assurances facultatives, renvoyés aux règles de la libre concurrence sur le marché de l’assurance instaurées séparément pour l’assurance vie et pour les autres risques par deux directives de 1992.
L’arrêt se fonde sur la directive 92/96, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie. Cette directive interdit les monopoles d’assurance vie, au motif qu’il serait dans l’intérêt du preneur d’assurance, qu’il en prenne ou non l’initiative lui-même, d’avoir accès à la plus large gamme de produits d’assurances offerts dans la Communauté par des entreprises faisant appel à l’épargne en vue de sa capitalisation.
L’arrêt écarte les arguments du lien nécessaire entre assurance vie et pension de retraite, quand cette dernière est financée par répartition. Il introduit une division, auparavant ignorée par les conventions collectives de retraite et de prévoyance, entre une retraite complémentaire légale et des prestations de prévoyance soumises aux règles de la concurrence au motif qu’elles sont conventionnelles et facultatives, alors que le lien entre les deux permettait de distinguer l’ayant droit conventionnel de l’assurance vie de l’ayant droit légal à une pension de réversion.
Cet arrêt, qui visait la CANAM et la CANCAVA, atteint par ricochet les institutions de prévoyance qui mêlent indistinctement pensions obligatoires, indemnités d’assurance vie et assurances maladie complémentaires.
Par un arrêt Coreva du 16 novembre 1995, le juge communautaire a ensuite exigé que la mutualité sociale agricole scinde ses activités pour que l’assurance retraite facultative qu’elle proposait en sus des prestations de son régime obligatoire ne puisse plus bénéficier des avantages fiscaux dont les offres concurrentes des assurances commerciales étaient privées.
Ces jurisprudences ont été suivies par la Cour de cassation et le Conseil d’État, saisis par la Fédération française de sociétés d’assurances, alors que ces juridictions supérieures venaient tout juste de reconnaître la supériorité du droit dérivé européen sur les lois françaises, mêmes postérieures.
Plusieurs arrêts dits « Albany », rendus les deux années suivantes à propos de fonds de pensions conventionnels néerlandais rendus obligatoires dans trois branches par agrément ministériel au profit d’un gestionnaire désigné, ont néanmoins accepté qu’une convention collective de travail accorde un monopole de retraite complémentaire en raison d’une mutualisation des risques individuels entre travailleurs favorable à la libre concurrence entre eux.
Mais la directive européenne du 4 juin 1997, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, a utilisé cette reconnaissance de l’intérêt économique général des conventions collectives de retraite complémentaire pour leur imposer les contraintes juridiques du principe de coordination entre régimes de sécurité sociale.
Pour la Commission européenne, cette stratégie avait deux avantages. Elle favorisait la libre circulation des travailleurs par une compensation, coordonnée entre les régimes, des droits à pensions des travailleurs migrants. Elle permettait d’imposer des conditions financières de compensation interdisant toute équivalence entre les droits constitués par répartition et ceux constitués par capitalisation.
De ce fait, les prestations conventionnelles facultatives de retraite collective supplémentaire et d’assurance vie ne pouvaient plus être assurées par répartition et leur financement par cotisations ne pouvait être rendu obligatoire par l’extension des conventions. Elles n’étaient liquidables qu’à proportion des primes capitalisées et des intérêts perçus.
Pour les institutions de prévoyance, la jurisprudence européenne Coreva, reprise par l’arrêt du Conseil d’État en dépit d’une loi du 30 décembre 1988, et la directive de 1997 imposaient une division de toutes leurs caisses et une recomposition de leurs instances paritaires que le législateur accompagne encore.
• La loi Évin a transposé en droit français dès 1990 les principes communautaires de la prévoyance collective
Le droit européen emportait la modification des codes français des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale et du code rural pour exiger des mutuelles, des caisses de sécurité sociale des non-salariés et des institutions de prévoyance qu’elles séparent les garanties légales des prestations facultatives concurrentielles.
Tirant les conséquences de l’arrêt de la CJCE d’octobre 1981, deux groupes de travail interministériels sur la protection sociale complémentaire, l’un réuni en 1985 sous la présidence de M. Pierre Gisserot, l’autre sous celle de Mme Colette Même, tracent le chemin menant à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin ».
Cette loi installe hors des codes les nouveaux principes du droit concurrentiel de l’assurance et de la protection conventionnelle des salariés par des dispositions d’ordre public.
Sans modifier directement les codes, elle ouvre à la concurrence la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, des risques liés à la maternité et des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou de chômage. Sont admises à concourir sur les marchés de l’assurance vie, maladie et chômage, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance complétant la sécurité sociale des salariés, la mutualité sociale agricole et les mutuelles.
La loi Évin impose aux garanties collectives des salariés des clauses de négociation, de résiliation, d’information du personnel couvert et de prolongation de l’assurance pendant la première année de retraite d’un ancien assuré.
Contradictoirement avec l’affiliation collective des salariés par une décision unilatérale de leur employeur prévue par l’article 2, l’article 11 précise, afin de confirmer la nature facultative des prestations, qu’aucun salarié déjà présent dans l’entreprise ne peut être contraint à cotiser, sans préciser toutefois si son refus rompt son contrat de travail ou entame le contrat collectif.
La loi impose enfin aux assureurs collectifs des salariés de provisionner les rentes viagères et les indemnités en capital garanties et de constituer des réserves de sécurité pour les risques de maladie couverts par répartition de cotisations afin de permettre aux assurés de changer d’assureur sans perdre le bénéfice des réserves en capital de leurs primes.
La loi du 31 décembre 1989 a ouvert de deux décennies de chantiers juridiques sur la nature des conventions collectives de protection sociale, le mode de financement de cette protection, la mutualisation des risques et la portabilité des droits.
Les institutions de prévoyance, d’abord contraintes de se regrouper pour consolider le financement par répartition des retraites complémentaires, n’ont adopté ces nouveaux principes concurrentiels qu’à mesure de leur traduction dans les accords collectifs de protection sociale des salariés et dans le détail des codes.
• Le législateur a séparé les prestations légales et facultatives des institutions de prévoyance en préservant leur gestion paritaire
La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social a ensuite exigé la séparation comptable des organismes qui garantissent leurs contrats d’assurance par des provisions techniques de ceux qui ne pratiquent que la technique de répartition, contraignant les institutions de prévoyance à scinder les activités par répartition de retraite complémentaire obligatoire et leurs activités de prévoyance, dans lesquelles figurent cependant les garanties de santé, au titre des prestations facultatives d’assurance concurrentielle.
La loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances soumet l’assurance vie et la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie au régime juridique commun à l’assurance par des réserves capitalisées, à l’assistance et à la réassurance.
La loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives du Conseil n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 sépare, dans le code de la sécurité sociale, les institutions de retraite et de prévoyance complémentaire des salariés en trois catégories : les institutions de retraite complémentaire, les institutions de prévoyance et les institutions de retraite supplémentaire. Elle met en extinction ces dernières au motif qu’en finançant une rente viagère conventionnelle par répartition collective de cotisations, elles exonèrent les entreprises d’en provisionner le coût.
La loi définit les institutions de prévoyance, sans plus faire référence à la sécurité sociale – bien qu’elles soient encore sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales et non sous celle du ministère des finances –, comme des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants. Elle confirme qu’elles prennent des engagements assurantiels qui doivent être couverts par des provisions.
Elle limite leur activité à la couverture des risques concurrentiels cités par la loi Évin mais autorise des accords professionnels ou interprofessionnels à mutualiser la couverture de ces risques par l’adhésion obligatoire, à l’assureur désigné, des entreprises relevant du champ d’application des accords. Autrement dit, la loi autorise l’extension administrative d’accords qui attribuent un monopole. Ce monopole profite à l’un quelconque des assureurs concurrents cités par la loi.
En incluant au passage le risque de chômage, la loi Évin et celle de 1994 emportent implicitement l’Unédic, bien que cette institution paritaire d’assurance collective des salariés n’ait pas de réserves provisionnées mais plutôt une dette accumulée. Cette contradiction entre le code de la sécurité sociale et celui du travail ne sera pas entièrement levée par la réforme de 2008.
La séparation exigée des caisses de répartition et de capitalisation des institutions de prévoyance est entérinée par un accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, qui est signé par 7 des 8 confédérations syndicales représentatives.
L’article 2 de l’accord invente des groupements ayant pour objet la mise en commun de moyens de gestion et comprenant des institutions de retraite complémentaire, des institutions de prévoyance, des institutions de retraite supplémentaire, des mutuelles et des structures assurant la gestion de l’épargne salariale. Il prévoit que ces groupements seront constitués sous forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et que leur assemblée générale sera composée paritairement de membres des conseils d’administration de chacun des organismes adhérents et désignés par eux, en réservant une minorité de blocage aux institutions de retraite complémentaire.
L’accord exige que les activités des adhérents restent juridiquement et comptablement séparées. La séparation des caisses s’opère sur près de dix ans, à partir de 1996. Un nouveau plan comptable est mis en œuvre en 2000 par les institutions paritaires.
L’accord paritaire sur les retraites complémentaires du 10 février 2001 confirme le rapprochement des caisses par répartition de l’AGIRC et de l’ARRCO pour une couverture coordonnée de la retraite complémentaire légale, tout en les autorisant à appartenir à des groupes paritaires de protection sociale concurrents.
À la différence des régimes légaux coordonnés, ces groupes étant inconnus du droit européen de l’assurance et n’étant pas cités dans les listes légales d’assureurs ou de réassureurs, les liens qu’ils établissent entre leurs membres restaient susceptibles de recours juridictionnel pour entente illicite ou abus de position dominante. Ils pouvaient néanmoins justifier leur constitution par les exigences des directives européennes et des lois françaises visant à assurer la couverture des engagements concurrentiels de leurs membres par des réserves suffisantes et par la nécessité de renforcer les services de gestion des risques, d’actuariat et d’audit des caisses de répartition et de capitalisation.
• La prévoyance ne peut plus être assurée que par capitalisation, selon des règles prudentielles qui renchérissent son coût financier
La directive 2003/41 du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle reprend la séparation faite par la jurisprudence entre les retraites professionnelles obligatoires et la prévoyance facultative.
Afin d’assurer leur solvabilité et la possibilité de changer l’assureur des garanties facultatives, elle exige également que ces garanties soient réservées aux caisses par capitalisation, les caisses par répartition ne pouvant servir que des retraites légales coordonnées par le règlement européen.
Ainsi, sont renvoyées à la capitalisation concurrentielle de primes facultatives, non seulement la prévoyance – et, plus généralement, l’assurance vie – mais aussi les retraites supplémentaires et les assurances conventionnelles contre la maladie et le chômage qui, comme elles, doivent provisionner leurs engagements.
Ces dispositions ont été transposées en droit français par les articles 107 et 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sous la forme de l’épargne retraite collective en entreprise.
Une ordonnance du 22 mars 2006 précise les conditions dans lesquelles les institutions de retraite complémentaire et les institutions de prévoyance peuvent constituer un groupement assurantiel de protection sociale, c’est-à-dire une holding paritaire sans but lucratif et néanmoins concurrente, pour la protection collective conventionnelle et le placement de l’épargne salariale collective, des conglomérats financiers à but lucratif.
• Pour constituer des réserves suffisantes, les institutions paritaires ont dû se regrouper
La consolidation de ces groupes se poursuit, sous la coordination du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), constitué par elles en 1986 pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et qui est, dans les années 2000, la principe source d’informations sur ces institutions (209).
Cette consolidation est précipitée par une directive-cadre européenne du 25 novembre 2009, dite « Solvabilité II », qui précise le droit européen de l’assurance et de la réassurance établi par les directives précédentes en mentionnant explicitement l’assurance maladie substituée à la couverture fournie par les régimes de sécurité sociale.
Rédigée pour relever les garanties prudentielles imposées aux sociétés d’assurances après la crise des subprimes de 2008, la directive « Solvabilité II » augmente les ratios de fonds propres et les provisions et réserves exigées de ces entreprises et exige que la base technique de la couverture de l’assurance maladie soit analogue à celle de l’assurance vie.
Elle autorise les entreprises, notamment les mutuelles et les associations de type mutuel, à constituer « des regroupements ou groupes, non par des liens en capital mais par des relations institutionnalisées fortes et durables, fondées sur une reconnaissance contractuelle, ou une autre forme matérielle de reconnaissance, qui soit garante de la solidarité financière entre ces entreprises. » Mais elle impose à ces groupes, « lorsqu’une influence dominante y est exercée par l’intermédiaire d’une coordination centralisée », d’être contrôlés « en suivant les mêmes règles que celles prévues pour les groupes constitués sur la base de liens en capital, afin de garantir un niveau de protection adéquat des preneurs et des conditions équitables de concurrence entre les groupes. »
Un rapport commandé par les partenaires sociaux aux avocats Philippe Laigre et Philippe Langlois, remis le 16 mars 2009, recommande de poursuivre la concentration des groupes paritaires de protection sociale sur le modèle des sociétés de groupe d’assurance mutuelles. Il propose de transformer leurs associations sommitales, établies comme instances de coordination en 1996, en instances de gouvernance liées aux membres du groupe par des conventions d’affiliation concernant l’ensemble de leurs activités.
Les conclusions de ce rapport ont été reprises par un accord du 8 juillet 2009, signé par les huit confédérations syndicales, sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale. L’accord redéfinit le groupe de protection sociale comme un ensemble structuré de personnes morales ayant entre elles des liens étroits et durables, créé, piloté et contrôlé par les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre des régimes obligatoires et généralisés de retraite complémentaire ainsi que des couvertures de protection sociale complémentaire collectives ou individuelles.
L’accord installe à la tête du groupe une association sommitale gérée paritairement, qui doit comporter au moins une institution de retraite AGIRC, une institution de retraite ARRCO et une institution de prévoyance mais peut aussi inclure des mutuelles et des sociétés d’assurance mutuelles.
L’accord précise que l’association n’est pas une holding de réassurance du groupe mais une instance de gouvernance, paritaire et bénévole, sans activité de gestion ni moyens propres. Il indique toutefois que les décisions du directeur général rémunéré du groupe, nommé par l’association, s’imposent aux adhérents et que le groupe consolide leurs budgets. L’accord prévoit enfin un renforcement du contrôle national conjoint des institutions de prévoyance par le CTIP et les fédérations AGIRC et ARRCO.
Une ordonnance du 21 janvier 2010 réunit peu après le Comité des entreprises d’assurance, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans une Autorité de contrôle prudentiel, devenue en 2013 « de contrôle prudentiel et de résolution ».
Les activités concurrentielles des groupes paritaires et des institutions de prévoyance sont soumises à son contrôle. Elle vérifie que les institutions de prévoyance disposent de provisions suffisantes pour couvrir leurs engagements, en incluant une marge de prudence, qu’elles disposent d’actifs suffisamment liquides et rentables et d’un montant minimal de fonds propres en cas de pertes imprévues.
Pour mettre en œuvre les décisions de l’accord et les recommandations de l’autorité de contrôle tout en préservant la gestion paritaire des institutions et leurs parts du marché de la protection sociale conventionnelle, les confédérations syndicales coordonnent la négociation des conventions collectives de prévoyance et d’épargne retraite, de branche ou d’entreprise et l’administration paritaire des institutions de prévoyance et des groupes de protection sociale.
Cette coordination repose toutefois sur une forme juridique de groupe qui reste fragile, parce qu’elle suggère que les réserves des caisses de répartition pourraient garantir les engagements des caisses de prévoyance et d’assurance par capitalisation du groupe, en dispensant ces dernières de concurrencer les compagnies d’assurance à but lucratif sur le marché financier des fonds propres, alors même que le ratio de couverture, par ces fonds, des engagements d’assurance vie et maladie est supérieur à celui exigé des assurances habitation ou automobile.
La Commission européenne, interprétant la directive « Solvabilité II », exige d’ailleurs de ces groupes paritaires français qu’ils optent plus clairement, avant le 1er janvier 2018, entre la forme juridique d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, qui lie financièrement ses affiliées en exerçant une influence dominante sur celles-ci, et celle d’un groupement assurantiel de protection sociale, sans solidarité financière ni influence dominante.
La coordination paritaire des institutions repose aussi sur les parts du marché de l’assurance collective garanties par les clauses conventionnelles de désignation et de recommandation de l’assureur collectif d’une branche.
Néanmoins, après deux décennies de divisions, de fusions capitalistiques et de regroupements institutionnels entre les caisses, il ne reste du millier d’institutions de prévoyance des années 1960 que 36 GPS adhérents au CTIP, comprenant 15 institutions de prévoyance professionnelles, 15 institutions de prévoyance interprofessionnelles, 6 institutions de prévoyance d’entreprise et une union, dont les activités, hors retraite complémentaire légale, sont retracées dans le tableau suivant :
ACTIVITÉ DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Total IP |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Cotisations |
11,8 mds€ |
12,1 mds€ |
12,8 mds€ |
13,3 mds€ |
13,1 mds€ |
Charges de prestations |
11 mds€ |
11,1 mds€ |
11,9 mds€ |
12,3 mds€ |
12,4 mds€ |
Nombre de salariés couverts (en millions) |
13 m |
13 m |
13,2 m |
13,2 m |
13 m |
Nombre de bénéficiaires (avec ayant-droits en santé) |
25 millions de personnes | ||||
Effectifs salariés des IP |
9 900 |
10 000 |
10 000 |
10 100 |
10 300 |
Couverture de la marge de solvabilité 1 |
460% |
430% |
500% |
600 % |
620% |
Source : Centre technique des institutions de prévoyance
Sur les 13 milliards d’euros de cotisations collectées par les institutions de prévoyance, 6,2 milliards d’euros financent des garanties complémentaires de soins et d’indemnités journalières, soit le cinquième d’un marché des complémentaires santé qui atteint 34 milliards d’euros de primes collectées en 2014, répartis comme suit :
ASSIETTE DE LA TAXE DE SOLIDARITÉ ADDITIONNELLE PERÇUE AU PROFIT DU FONDS CMU ENTRE 2001 ET 2014 ET PARTS DE MARCHÉ
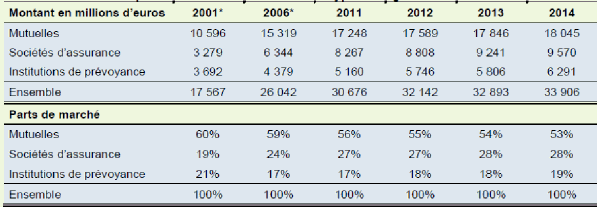 Source : Rapport de la DREES pour 2015 sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 2015, p.8, citant le fonds CMU
Source : Rapport de la DREES pour 2015 sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé 2015, p.8, citant le fonds CMU
Champ : organismes assujettis à la taxe de solidarité additionnelle perçue au profit du fonds CMU au cours de l’année. L’assiette du fonds CMU correspond aux primes collectées par les organismes au titre d’une activité de complémentaire santé. Elle sert de base au calcul de la taxe CMU.
* En 2011 la taxe CMU a remplacé la contribution CMU. Les primes collectées pour les années 2001 et 2006 incluent donc la contribution, tandis que celles collectées à partir de 2011 excluent la taxe.
5,7 milliards d’euros assurent des garanties collectives de prévoyance. Ce montant de collecte est à comparer avec les 9,2 milliards d’euros de primes d’assurance vie collectés, en 2014, par l’échantillon des principaux assureurs sur la vie suivi par l’APCR, alors que les provisions des institutions de prévoyance ne représentent, selon la même étude, que deux centièmes de celles des assureurs de l’échantillon et celles des mutuelles, un centième (210).
ii. La fin des clauses de désignation affaiblit les institutions de prévoyance
• La désignation conventionnelle de l’assureur d’une branche mutualise les risques, étend la couverture et réduit les provisions
Les avantages économiques d’une mutualisation des risques assurantiels financée par l’affiliation obligatoire des assurés à une caisse unique sont bien connus. Outre qu’elle permet à cette caisse de fonctionner par répartition des cotisations, sans constituer de réserves importantes, la mutualisation ouvre la possibilité de répartir les cotisations de manière homogène.
Des assureurs concurrents doivent nécessairement sélectionner les risques pour maximiser leur profit ou minimiser le coût de leurs contrats. Si les assurés peuvent choisir individuellement leur assureur sur un marché concurrentiel, ceux qui présentent les moindres risques auront accès à des garanties moins onéreuses que les autres, sans pour autant que le coût moyen de l’assurance diminue parce que chaque assureur doit provisionner le transfert des réserves capitalisées pour une clientèle qui en est propriétaire.
La division d’une collectivité d’assurés entre plusieurs assureurs aboutit en outre à exclure de l’assurance, faute de rentabilité suffisante, les plus pauvres des plus exposés au risque, qui ne peuvent payer les primes exigées d’eux.
En revanche, si des cotisations homogènes versées à un assureur unique ne permettent plus à celui-ci d’influer sur la prévention individuelle des risques volontaires, en contrepartie, l’assurance qu’il procure peut être étendue à des risques marginaux qui seraient, sans cela, inassurables : la mutualisation des risques accroît la solidarité d’indemnisation entre assurés.
Un contrat de prévoyance contenant simultanément des assurances maladie, invalidité et décès oblige à provisionner le coût des indemnités en capital versées à la suite d’une maladie déclarée pendant l’exercice du contrat, même si ces suites surviennent après l’échéance de versement des primes. Cette obligation de constituer des provisions est celle dont s’est servie la CJCE pour contraindre les assureurs à limiter la couverture des risques par répartition et imposer une capitalisation aux opérations de prévoyance négociées sur un marché concurrentiel.
Les provisions exigées sont d’autant plus élevées que le législateur impose des clauses de transfert ou de prolongation des garanties hors de la période d’exécution du contrat et donc de perception des primes, ce qui exige d’anticiper leur coût et de relever substantiellement ces primes.
Ces clauses légales de prolongation concernent les interruptions entre deux contrats de travail successifs mais aussi la première année de retraite. Selon M. Jean-Paul Lacam, directeur général du CTIP : « Quant à la question de la transition avec la retraite, le ministère des affaires sociales et la direction de la sécurité sociale sont en train de se pencher sur l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, qui concerne le maintien de la couverture des anciens salariés, ainsi que sur les contrats labellisés destinés aux personnes de plus de 65 ans.
« Nous serons attentifs à la forme définitive que prendront ces dispositifs, qui ne doivent pas léser les intérêts de nos adhérents, lesquels peuvent être conduits à constituer des provisions ou à ne plus maîtriser la sinistralité, ce qui les mettrait en difficulté avec la directive “Solvabilité 2” et les obligerait à répercuter le poids des cotisations manquantes sur les entreprises et les salariés. » (211)
Même au cours de l’exécution d’un contrat collectif d’assurance lié à un contrat de travail, la couverture des salariés employés à temps partiel et leurs garanties d’indemnisation ne sont pas réduites au prorata alors que les recettes de cotisations le sont. Si un salarié a plusieurs employeurs, chacun d’eux pourrait choisir un assureur différent et le salarié pourrait refuser ceux de ses employeurs sauf le plus avantageux, ou devoir changer d’assureur aussi souvent que d’employeur, ce qui est préjudiciable pour lui mais aussi pour ses ayants droits.
Pour éviter cela, la mutualisation des risques couverts par les contrats collectifs de prévoyance était, jusqu’en 2015, obtenue par les clauses de désignation des assureurs d’une branche professionnelle, incluses par les partenaires sociaux dans les conventions collectives de prévoyance, souvent au bénéfice des institutions paritaires que leurs confédérations administrent. Ces clauses, admises par la jurisprudence européenne, ont été privées de force obligatoire par la décision 2013-672 DC du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 portant sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
• Les clauses de désignation étaient admises en droit européen sous la condition d’une sélection concurrentielle du bénéficiaire
La jurisprudence européenne reconnaît l’intérêt social d’une mutualisation des risques couverts par une assurance vie et celui d’une négociation collective de cette mutualisation par les partenaires sociaux, dans un cadre professionnel établissant un haut degré de solidarité entre les assurés.
Elle exige cependant qu’une convention collective de protection sociale n’accorde pas de monopole permanent à un assureur et que le bénéficiaire de ce monopole ou d’une position dominante soit régulièrement sélectionné par une procédure transparente et loyale d’appel au marché concurrentiel.
Elle prétend même que cette procédure s’impose aussi à la sélection de l’assureur de prestations légales de sécurité sociale mais estime que sa désignation à l’issue d’une procédure publique, par exemple parlementaire, suffit à remplir les conditions posées.
Pour l’attribution d’un monopole conventionnel d’assurance professionnelle facultative, cette jurisprudence admet de faire exception à l’interdiction des cartels et des ententes, prohibés par le droit de la concurrence.
Une convention collective de branche peut désigner ou recommander des assureurs après être convenue avec eux des prestations et des tarifs, à condition toutefois d’avoir procédé au préalable à leur mise en concurrence et d’avoir sélectionné la meilleure offre, de manière transparente et impartiale, selon une procédure analogue à celle des marchés publics.
Dans deux arrêts rendus le 17 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie de questions préjudicielles par le Conseil d’État, a étendu ces obligations procédurales aux mesures de publicité préalables à l’extension réglementaire d’une convention collective, afin de permettre à l’autorité publique de vérifier que l’offre de l’assureur désigné est bien la plus avantageuse.
Un décret du 8 janvier 2015 définit l’impartialité attendue des négociateurs de ces clauses en prohibant les conflits d’intérêts entre eux et les représentants de leurs organisations syndicales qui administrent les institutions paritaires recommandées. En l’espèce, un conflit d’intérêts est caractérisé lorsqu’un membre de la commission paritaire exerce ou a exercé, au cours des cinq années précédentes, une activité salariée ou des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein des organismes candidats à l’assurance ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.
• Le Conseil constitutionnel a privé ces clauses de force obligatoire à l’égard des employeurs qui assurent leurs salariés
À ces obligations jurisprudentielles, l’ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme avait répondu par l’exemplarité de la gestion paritaire tout en défendant ses attributions légale et conventionnelle.
Cette exemplarité devait permettre aux institutions paritaires de conserver leurs parts de marché de la couverture, par branches, des remboursements complémentaires de frais de santé rendue obligatoire pour toutes les entreprises par l’ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels.
L’article 1er de cet accord prévoyait que les branches professionnelles ouvriraient des négociations avant le 1er avril 2013, « en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture. »
Il laissait aux entreprises, responsables de l’affiliation de leurs salariés, la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, en substituant à la désignation d’un assureur unique, et de ce fait obligatoire, la recommandation de plusieurs assureurs, « après mise en œuvre d’une procédure transparente de mise en concurrence. » Les signataires de l’accord avaient prévu de constituer « un groupe de travail paritaire, dont l’objet sera de définir, dans le délai de trois mois, les conditions et les modalités d’une procédure transparente de mise en concurrence. »
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, qui a repris les dispositions de cet accord pour donner à la complémentaire santé la force légale requise par le droit européen, a cependant autorisé les clauses de désignation des assureurs en sus des clauses de recommandation.
Saisi du texte adopté par le Parlement, le Conseil constitutionnel a privé ces clauses de désignation de force obligatoire en considérant, dans sa décision du 13 juin 2013, qu’elles portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques, qu’il estime par ailleurs légitime : « si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini »
Ce n’est donc pas en considération du droit de libre concurrence entre entreprises d’assurances qu’il a interdit les clauses de désignation, mais en considération du pouvoir de direction de l’entreprise que le principe de la liberté d’entreprendre impose de respecter.
Il a ensuite fait valoir le principe de l’égalité devant la loi fiscale pour rejeter le compromis avancé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui remplaçait la clause de désignation litigieuse par une majoration de la taxation des entreprises qui ne choisissaient pas un assureur recommandé. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce désavantage fiscal instituait « des différences de traitement qui entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », une différenciation de taxation pour faire respecter une recommandation conventionnelle n’étant admissible que « dans une mesure très limitée » (212).
Les clauses conventionnelles de désignation des assureurs n’ont donc plus de force obligatoire à l’égard des employeurs en droit français, qu’ils soient ou non membres des confédérations signataires des conventions dans lesquelles elles figurent, en dépit de l’intérêt reconnu de la mutualisation des risques assurés qu’elles garantissaient, ce qui ne laisse guère de moyen juridique pour assurer cette mutualisation en dehors d’une caisse unique de sécurité sociale légale.
Interrogé par la mission sur la discordance des jurisprudences de la CJCE et du Conseil constitutionnel en matière de convention collective de prévoyance et d’assurance maladie, Me Jacques Barthélémy les a commentées lors de son audition du jeudi 7 avril 2016 :
« Il est donc important de souligner que pour la Cour de justice de l’Union européenne, les monopoles confiés dans le cadre de garanties sociales organisées au niveau de la branche ne peuvent pas être considérés comme des ententes prohibées entre entreprises – ceci vaut pour tous les accords collectifs – pas plus qu’ils ne peuvent se traduire par une position dominante abusive. En d’autres termes, l’objectif de solidarité confère une mission d’intérêt général à celui qui le met en œuvre dans le cadre d’une institution.
« Le Conseil constitutionnel n’a pas critiqué cela dans sa décision du 13 juin 2013. Il s’est simplement posé sur le terrain de la liberté contractuelle, en invoquant l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, en le sortant un peu de son contexte. Rappelons que lorsque la Convention européenne des droits de l’homme évoque la liberté et la capacité à négocier les contrats, il est surtout question de la liberté individuelle, pas collective.
« Mais laissons là cette question ; le Conseil constitutionnel considère, dans cette décision, que l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale, qui permet de mutualiser les cotisations de toutes les entreprises afin de mettre en place un régime de protection sociale fondé sur la solidarité, porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, celle de l’employeur, s’entend.
« Première critique qui peut être faite à cette décision : s’il y a manifestement atteinte à la liberté contractuelle, toute convention collective porte atteinte à la liberté contractuelle du chef d’entreprise ! Le problème est de savoir si cette atteinte répond à un but légitime, auquel cas elle est proportionnée. Or il est évident que l’objectif de solidarité, d’autant plus qu’il s’agit d’un droit fondamental, donne un but légitime à cette atteinte, qui est par conséquent proportionnée.
« C’est ce que la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 12 avril 2012 concernant les Banques populaires. La Cour ne s’est pas appuyée sur le droit interne mais sur la Convention européenne des droits de l’homme, dans laquelle on retrouve les mêmes exigences de liberté contractuelle et de liberté d’association. Dans l’affaire à l’origine de cet arrêt, un salarié ne voulait pas se voir imposer l’affiliation à un régime de prévoyance déterminé par accord entre l’employeur et les salariés.
« Le Conseil constitutionnel a donc uniquement sanctionné l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale, qui ne permettait que la mutualisation. Or la mutualisation n’est pas une fin en soi, c’est un moyen au service de la solidarité. Si l’on avait posé le problème autrement, en invoquant la solidarité, je pense que la solution aurait été différente. Du reste, le même Conseil constitutionnel, dans une décision ultérieure, du 26 mars 2015 concernant le statut des frontaliers suisses, a considéré qu’un degré élevé de solidarité conférait une mission d’intérêt général et permettait de porter une atteinte, de ce fait proportionnée, à la liberté contractuelle.
« Un deuxième problème était posé : lorsque l’on met en place des garanties sociales par un accord collectif, cela crée des droits au profit des salariés, pas simplement des obligations à la charge de l’employeur. Le Conseil constitutionnel ne s’est absolument pas préoccupé de la liberté contractuelle du salarié. Je pense donc que la décision du 13 juin n’est qu’une étape, et qu’elle évoluera. » Comme le suggère Me Jacques Barthélémy, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel pourrait être fondée sur une prémisse implicite, touchant à la délégation syndicale du pouvoir de direction de l’entreprise. Le Conseil aurait pu estimer que les critères de représentativité des représentants syndicaux des employeurs étaient insuffisants pour justifier que les clauses qu’ils négocient en matière de prévoyance puissent être étendues.
Son appréciation pourrait être modifiée par la révision des critères de représentativité des syndicats patronaux, opérée par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Saisi de cette révision par une question prioritaire de constitutionalité, le Conseil n’a toutefois fait d’objection ni aux nouveaux critères posés, ni aux précédents.
Cependant, le critère d’audience posé par la loi a fait l’objet, le 19 janvier 2016, d’une position commune entre le MEDEF et la CGPME, dont les stipulations ont été reprises par l’article 19 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. La révision de ces critères pourrait inviter le Conseil constitutionnel à modifier sa jurisprudence sur la force obligatoire des clauses convenues, pour une branche professionnelle, par ses organisations syndicales représentatives.
Si cette jurisprudence était cependant maintenue, elle serait préjudiciable à l’extension des garanties de santé des salariés et, plus encore, à la prévoyance professionnelle collective, si l’on ajoute aux obligations conventionnelles de l’assureur désigné l’obligation légale de reprendre les risques en cours en provisionnant la durée probable des arrêts de travail et les risques d’invalidité, voire de décès.
En septembre 2015, M. Dominique Libault, en sa qualité de directeur général de l’École nationale supérieure de la sécurité sociale, a remis à Mme Marisol Touraine, alors ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, un rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective (213) qui revient sur cette jurisprudence et constate que le double mouvement de généralisation de la couverture et de concurrence accrue entre opérateurs pourrait fragiliser la protection sociale complémentaire, en matière de prévoyance comme de complémentaire santé, et priver d’assurance certains publics.
Il estime que l’on ne peut exclure le dessin d’un « nouveau paysage de la protection sociale complémentaire qui combinerait les “inconvénients” d’un système obligatoire (notamment l’absence de liberté individuelle quant au contenu de l’assurance) sans en présenter les avantages (notamment la solidarité), et les défauts d’un système volontaire et assurantiel, caractérisé par des différences tarifaires fortes selon le profil de risque et la faiblesse, voire l’absence d’éléments de solidarité. »
Les représentants du CTIP ont réservé leur analyse des conséquences de cette décision, dans l’attente d’études détaillées des affiliations, à l’échéance des contrats collectifs en cours lors de la décision du Conseil. M. Jean-Paul Lacam a notamment déclaré : « Selon les statistiques, à la mi-février, 121 branches professionnelles avaient signé un accord, dont 50 qui “recommandent”, suite à la décision du Conseil constitutionnel, un ou plusieurs organismes assureurs, tous ces accords ayant été signés postérieurement au décret du 7 janvier 2015, qui organise la procédure de mise en concurrence ; 38 accords signés avant la décision du Conseil constitutionnel contiennent une clause de désignation en vigueur jusqu’à leur extinction, au bout de cinq ans ; 33 accords laissent aux entreprises de la branche le choix de leur organisme assureur. La répartition se fait peu ou prou à parts égales entre les IP et les mutuelles, seules trois à quatre compagnies d’assurances ayant été recommandées. Il n’y a donc pas de déperdition réelle pour les IP à ce jour, mais il faut encore attendre que la généralisation soit achevée et que les clauses de désignation encore en vigueur se soient éteintes pour avoir une vue plus précise des choses. » (214)
Pour M. Bernard Daeschler, président du CTIP :
« Quand l’ANI sur la complémentaire santé pour tous a été signé, on a dansé dans les chaumières, et chacun s’est réjoui devant cette belle idée. Les groupes de protection sociale et les IP [institutions de prévoyance], qui étaient organisés et équipés pour cela, ont considéré qu’il s’agissait d’une chance. Très rapidement cependant, l’enthousiasme est retombé, surtout après la décision du Conseil constitutionnel de supprimer les clauses de désignation au nom de la liberté d’entreprendre.
« Il a été d’autant plus compliqué de s’organiser que les pouvoirs publics ont voulu introduire dans le dispositif des “contrats responsables” des plafonds, des planchers, qui l’ont rendu très difficilement lisible non seulement aux yeux des salariés mais également aux yeux des spécialistes.
« Les IP ont pensé qu’elles allaient pouvoir proposer des garanties sur-complémentaires, avec un système d’options, mais, finalement, l’évolution du système n’est pas allée dans le bon sens : les cotisations avaient tendance à augmenter pour des prestations identiques, voire inférieures, à moins de souscrire une garantie sur-complémentaire, ce dont tout le monde n’a pas les moyens. Du coup, le taux de résiliation constaté s’est révélé plus important que les années précédentes. » (215)
M. Pierre Mie, vice-président du CTIP, a pour sa part rappelé l’intérêt qui s’attache à la mutualisation la plus large possible : « la prévoyance concerne des risques lourds, et une petite entreprise qui a parmi ses effectifs des salariés en arrêt de travail de longue durée, en incapacité voire en situation d’invalidité, sans parler de décès, peut très vite se révéler inassurable sur un marché concurrentiel, ou à un taux de cotisation très élevé.
« De ce point de vue, la mutualisation au niveau de la branche était une solution intéressante qui permettait d’éviter les “trous dans la raquette” que nous redoutons, sachant que certaines sociétés d’assurances peuvent vouloir faire la course aux “bons risques” » (216).
L’affiliation à un contrat collectif dit « responsable » d’assurance maladie complémentaire de la sécurité sociale est devenue obligatoire pour tous les employeurs de droit privé depuis le 1er janvier 2016. Alors que 96 % de la population est déjà couverte par une assurance maladie complémentaire, l’obligation d’affiliation des salariés va transférer le coût de plusieurs millions de contrats individuels vers l’assurance collective professionnelle.
Le marché, déjà très partagé entre compagnies à but lucratif, mutuelles et institutions de prévoyance, en sera d’autant plus disputé que le partage entre elles du marché de l’assurance individuelle est différent de celui du marché de l’assurance collective, de beaucoup plus favorable aux institutions de prévoyance, qui comptent désormais sur des frais de gestion inférieurs pour résister à leurs concurrents.
Les clauses de recommandation pourraient suffire à désigner aux entreprises les assureurs collectifs les plus avantageux, en dispensant les premières des coûts de négociation des contrats et en offrant aux seconds une publicité gratuite et une clientèle captive, au risque de soulever la question d’un éventuel conflit d’intérêts pour les confédérations syndicales qui négocient ces clauses et administrent les institutions de prévoyance qui en bénéficient.
Seules les entreprises ayant un profil de risques identifié comme faible auront intérêt à négocier des contrats particuliers échappant aux négociations paritaires confédérales, en escomptant que les assureurs recommandés, qui ne peuvent pas refuser les entreprises ayant un mauvais profil de risque, auront dû relever leurs primes moyennes pour le couvrir.
Or, à la différence du contrat collectif négocié par les assureurs recommandés, qui, en vertu du code de la sécurité sociale, est soumis au contrôle des ministères du budget et de la sécurité sociale par la procédure d’extension de la convention qui le recommande, les contrats particuliers concurrents échappent à ce contrôle administratif.
Au conflit d’intérêts des négociations paritaire du contrat recommandé répond celui de distorsion de concurrence entre les assureurs paritaires, invités à une gestion solidaire par branche par leur statut et les accords nationaux interprofessionnels qui s’imposent à eux, et les mutuelles ou sociétés d’assurance à but lucratif qui ne négocieraient qu’avec les grandes entreprises.
Cette distorsion de concurrence est d’autant plus accusée que le profil de risque apprécié par l’assureur collectif du personnel d’une entreprise dépend des caractéristiques sociales et démographiques de ce personnel, plus ou moins exposé aux maladies et plus ou moins attentif à les prévenir, mais aussi du risque d’un défaut de paiement, par l’employeur, des primes convenues.
L’appréciation, entreprise par entreprise, de ce double risque deviendrait un instrument d’évaluation de leur capital social, comparable à l’évaluation, par les créanciers, du capital immobilisé qui garantit les autres dettes d’exploitation de l’entreprise.
Or, dans le passif de cette dernière, le Conseil constitutionnel admet que les dettes salariales fassent l’objet d’une garantie collective obligatoire, par l’intermédiaire de cotisations obligatoires versées à l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).
Il serait donc légitime que les assureurs de branche désignés ou recommandés soient seuls bénéficiaires d’une réassurance similaire des garanties collectives de couverture santé prolongées, même en cas d’une liquidation de l’entreprise entraînant un défaut de paiement des primes dues, puisque ces garanties collectives sont des dettes salariales.
La réassurance conventionnelle par les partenaires sociaux de la couverture santé collective serait une contrepartie légitime du haut de degré de solidarité accepté par les employeurs qui respectent les clauses de désignation ou de recommandation des conventions collectives.
Proposition : Dans l’attente d’une révision de la jurisprudence constitutionnelle sur la force obligatoire des clauses conventionnelles de désignation d’un assureur collectif de branche, motivée par la révision des critères de représentativité des syndicats d’employeurs, ou d’une révision constitutionnelle le permettant, les assureurs désignés ou recommandés par les partenaires sociaux devraient bénéficier d’une réassurance privilégiée des complémentaires santé.
Au-delà, le rapporteur invite les pouvoirs publics à rechercher une voie juridiquement viable au regard du droit constitutionnel et du droit européen pour la constitution progressive, à partir des branches professionnelles, d’un régime paritaire de sécurité sociale complémentaire comparable au régime actuel de retraite complémentaire.
Proposition : Introduire dans le droit national, le cas échéant en levant les éventuels obstacles constitutionnels, un nouveau vecteur juridique, la « convention collective de sécurité sociale complémentaire», qui permettrait aux branches professionnelles, au motif de la solidarité, d’établir un régime de prévoyance étendu à toutes les entreprises d’un secteur d’activité déterminé.
• Les institutions de prévoyance espèrent que leurs coûts de gestion protègeront leurs parts des marchés d’assurance collective
M. Pierre Mie a insisté devant la mission sur le fait que les institutions de prévoyance auraient une gestion efficace : « Les institutions de prévoyance sont des organismes à gouvernance paritaire, qui agissent dans un cadre à la fois concurrentiel et réglementé, dans l’intérêt des entreprises et des salariés, en promouvant le dialogue social, la non-lucrativité, la mutualisation et la solidarité sous toutes ses formes.[…] Selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) paru en 2014, la gestion des IP est globalement efficace. Sur 100 euros de cotisations, tous risques confondus, 87 euros financent les prestations, soit un taux meilleur que celui des autres acteurs.
« Nous évoluons dans un environnement en constante évolution, notamment au plan réglementaire où il nous faut nous adapter à la directive européenne “Solvabilité 2”. Cela nous conduit à avoir la gestion la plus efficace possible. Dans le cadre de cette gestion efficace, la moyenne de solvabilité de nos IP est de 250 %, ce qui en fait des acteurs solides. Nous privilégions le long terme sur le court terme, conscients que, du fait des cycles que connaît le marché assurantiel, certaines années sont plus difficiles que d’autres. » (217)
Cette opinion a été confortée par le tableau comparatif que M. Jean-Paul Lacam a dressé sur les frais de gestion : « Malgré la concurrence et le déferlement de publicité auquel vous faisiez référence, les comparaisons effectuées par la DREES font ressortir les avantages comparatifs des IP, dont les frais de gestion sont les plus bas du marché : 13 à 14 % contre 17 à 19 % pour les mutuelles et 25 % pour les compagnies d’assurances. Elles peuvent donc gagner des parts de marché mais doivent se faire connaître sur le marché. » (218)
Le rapport que la DREES a consacré en 2015 à La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé (219) indique que les mutuelles se caractérisent par des frais d’administration moyens plus élevés que les autres types d’organismes : 9 % des cotisations collectées, contre 6% pour les sociétés d’assurance et 5 % pour les institutions de prévoyance. Les sociétés d’assurance se distinguent quant à elles par des frais d’acquisition moyens plus importants : 13 % des cotisations, contre 6% pour les mutuelles et 5 % pour les institutions de prévoyance.
Mais les frais de gestion plus faibles des institutions de prévoyance tiennent pour partie à un moindre recours au marché financier pour constituer les provisions en fonds propres et assurer la couverture à terme de leurs engagements. Cela résulte de ce qu’elles fonctionnent encore implicitement comme des caisses par répartition, en utilisant les ressources partagées avec les institutions de retraite complémentaire.
En outre, elles bénéficient de la trésorerie procurée par les réserves constituées au sein des branches, dont la propriété est juridiquement indéterminée puisque les branches n’ont pas de personnalité morale, que les contrats collectifs d’assurance sont souscrits par les entreprises mais qu’ils sont attachés au contrat de travail du salarié assuré. Les réserves constituées pour celui-ci devraient le suivre dans ses transitions professionnelles. La portabilité des réserves jointe à celle des droits conduirait, selon les mécanismes de marché, à augmenter le coût des contrats d’assurance, rendant plus économique une sécurité sociale unique.
En outre, selon le rapport de M. Dominique Libault, « le sort des réserves globales est des plus incertains : il n’existe aucun cadre légal qui précise leur affectation en cas de changement d’organisme. C’est la négociation qui doit fixer les principes en la matière. Or, la grande majorité des accords ne contient aucune stipulation sur les réserves.
« En définitive, dans de nombreux cas, les réserves pourraient s’avérer intransférables, ce qui introduirait nécessairement un biais dans le dispositif de recommandation : quel serait le devenir d’une recommandation d’un nouvel entrant au prix du risque face à un ancien tenant désigné disposant des fichiers des entreprises et des ressources financières pour le concurrencer ? […]
« Si les questionnaires médicaux ont pratiquement disparu pour les contrats de complémentaire santé, d’autres instruments permettent de pratiquer la sélection des risques : lieu de résidence, niveau socioprofessionnel, secteur d’activité, mais également toutes les perspectives offertes par l’exploitation des données numériques liées au “big data” ».
Le risque couvert n’est pas seulement lié aux dépenses d’indemnisation des salariés mais aussi à l’insolvabilité de l’entreprise qui les assure au cours de l’exécution du contrat alors que les contrats de branche prévoient que les salariés sont indemnisés même en cas de cessation de paiement de leur employeur. En 2014, plus de 63 000 faillites auraient affecté la perception des primes d’assurance collective de 270 000 salariés et ayant-droits.
Les assurances maladie complémentaires se sont généralisées au point de couvrir 96 % de la population, les plus démunis ayant bénéficié de la création de la couverture maladie universelle en 1999. Le remboursement conventionnel du reste à charge, qui excède les tarifs de responsabilité fixés par la sécurité sociale, pour un panier de soins, a été rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2016 par l’article premier de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Ces primes étaient, avant l’entrée en vigueur de l’obligation d’assurance collective pour le panier de soins, majoritairement collectées par contrat individuel, les contrats collectifs n’en représentant que 44%. M. Dominique Libault estime, dans son rapport, que la loi fera basculer 4 millions d’assurés individuels en contrat collectif.
E. LE « TRIPARTISME ASYMÉTRIQUE MASQUÉ »
Un certain nombre de pans du champ social que l’on a coutume de présenter un peu rapidement comme relevant du « paritarisme » font en réalité l’objet d’une gestion tripartite associant les représentants des employeurs, les représentants des salariés et, selon les cas, l’État ou d’autres acteurs, notamment associatifs. C’en est au point que l’on peut parler, comme le professeur Jacques Freyssinet, de « tripartisme asymétrique masqué » (220), voire, comme M. Claude Tendil de « paritarisme de figuration » (221).
C’est le cas dans les domaines du logement, de l’assurance-chômage, de la santé au travail ou encore du handicap.
1. Action Logement (anciennement « 1 % logement »)
L’intervention des partenaires sociaux dans le domaine du logement remonte à la Seconde guerre mondiale. En 1943, à l’initiative d’Albert Prouvost, patron de la Lainière de Roubaix, les employeurs des industries textiles du Nord créèrent le premier « comité interprofessionnel du logement » (CIL) afin de collecter les cotisations volontairement versées par des entreprises locales pour financer la construction de logements au bénéfice de leurs salariés, sans pour autant que cet avantage ne découle directement du contrat de travail. Dès l’origine, les représentants de ces derniers ont été associés au sein des CIL à la gestion des fonds versés par les entreprises.
Il s’agissait alors, pour le patronat chrétien, de promouvoir une réponse à la crise du logement en empruntant une voie intermédiaire entre le laisser-faire libéral et une forme de collectivisation (illustrée notamment par le projet de « service public du logement » qui sera évoqué à la Libération). Cette « troisième voie » était la démonstration de la capacité de la société à élaborer par elle-même des solutions servant l’intérêt général. Qui plus est, l’association des représentants des employeurs et des salariés au sein des CIL avait la vertu non seulement d’optimiser l’utilisation des fonds grâce à une connaissance précise des besoins en logement (à la faveur du lien de proximité qu’entretenaient les syndicats avec les ouvriers), mais aussi de renforcer la cohésion sociale en confortant l’intégration des ouvriers.
Mais après que les CIL se sont multipliés au cours de l’après-guerre, sur une base essentiellement géographique, tout en se rattachant aussi à une entreprise, à une branche ou à un métier, la puissance publique, confrontée à la pénurie de logements, s’est immiscée dans ces programmes de construction de logements initialement gérés de manière exclusivement paritaire par les partenaires sociaux.
En application de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, qui l’habilitait à prendre des mesures en la matière, le Gouvernement a édicté le décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) qui a substitué à la cotisation interprofessionnelle volontaire une contribution obligatoire des employeurs correspondant à « 1 % des salaires payés au cours de l’exercice écoulé » (dans les entreprises de plus de 10 salariés). Les sommes correspondant à 1 % de la masse salariale devaient être soit versées aux salariés sous forme de prêts ou de subventions, soit versées à des CIL, soit investies dans la construction directe de logements économiques et familiaux ou de logements répondant aux normes prévues pour les habitations à loyer modéré (HLM), ou dans des opérations effectuées par des organismes d’HLM ou par des « sociétés immobilières à caractère désintéressé ».
S’il est vrai que l’État a alors fait le choix de laisser aux CIL le soin de collecter et de distribuer les fonds issus de la PEEC, il n’en demeure pas moins que, comme l’explique M. Jules-Mathieu Meunier, auteur d’une thèse de doctorat sur le « 1% logement » (222), cette institution est depuis lors tiraillée entre, d’une part, la volonté des partenaires sociaux de préserver l’objectif de facilitation et de développement du logement des salariés qui était initialement celui de cette initiative volontaire privée et, d’autre part, la tentation de la puissance publique d’en faire l’instrument d’une politique du logement voire d’en budgétiser les ressources.
Ce lien étroit que l’État a très tôt établi entre la PEEC et la politique du logement figure en germe dans le décret du 9 août 1953 qui prévoyait que, sauf exception, la PEEC ne pourrait être investie dans des opérations de construction autres que celles qui bénéficiaient déjà d’une aide publique. Les fonds versés par les entreprises avaient alors vocation à compléter les aides à la pierre.
Des années 1950 aux années 1970, les fonds issus de la PEEC sont massivement investis dans les opérations aidées par l’État, et en particulier dans les opérations d’HLM, et jouent le rôle de complément des aides publiques. M. Jules-Mathieu Meunier constate alors une « convergence d’intérêts entre l’État, le patronat et les syndicats représentant les salariés » (223) : tandis que l’État trouve dans la PEEC une ressource d’appoint pour financer sa politique du logement, les partenaires sociaux y voient un moyen d’assurer aux salariés des gains de pouvoir d’achat et de bien-être en leur permettant d’accéder à un logement locatif disposant des éléments du confort moderne à un niveau de loyer inférieur aux prix du marché ou de bénéficier de prêts complémentaires à taux réduits pour accéder à la propriété.
Mais avec la crise économique des années 1970, outre que la question du logement perdit de son acuité au regard d’autres motifs de préoccupation comme le chômage, la puissance publique a été tentée d’adopter une approche plus libérale consistant à transférer au marché la responsabilité de satisfaire l’essentiel des besoins en logements et de réserver le bénéfice de l’aide au logement aux plus défavorisés. Comme le note justement M. Jules-Mathieu Meunier, « la PEEC sera conçue comme une forme de cagnotte extra-budgétaire à laquelle l’État sera enclin à recourir au gré des rapports de force interministériels, afin de contenir le niveau de la dépense publique et de transférer au 1 % logement une partie du coût de la politique du logement » (224).
À cela s’ajoute, au tournant des années 1970-1980, une crise de légitimité de l’institution aux yeux des partenaires sociaux eux-mêmes. Cette légitimité est en effet écornée dans les années 1980 par différents scandales, à la suite desquels l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC) est créée en 1987 pour contrôler le respect des conditions d’agrément des CIL et le respect, par les CIL, des règles de bon emploi des fonds.
Par ailleurs, tandis que certains, issus notamment du secteur du bâtiment, défendent le 1 % logement, d’autres souhaitent la suppression de la PEEC au nom d’une réduction des charges pesant sur les entreprises. En 1992, le taux de la PEEC est ainsi ramené de 1 % à 0,45 % de la masse salariale de l’exercice écoulé (225).
Depuis les années 1990, l’État a hésité entre la tentation de laisser libre cours aux initiatives des partenaires sociaux et celle de reprendre en main le programme du « 1 % logement ».
M. Jules-Mathieu Meunier analyse la création, en 1996, d’une tête de réseau chargée d’assurer le pilotage national du programme (l’Union économique et sociale pour le logement, devenue Union des entreprises et des salariés pour le logement – UESL (226)), comme ayant eu « pour effet d’élargir considérablement les responsabilités des partenaires sociaux. […] Plusieurs conventions ont été conclues [à la fin des années 1990] qui témoignaient toutes d’une propension commune des partenaires sociaux et du ministère du Logement à s’entendre pour restaurer la légitimité de l’institution et préserver ainsi l’inscription de la PEEC dans les champs du paritarisme et de l’aide à la pierre, contre l’hypothèse rampante d’une budgétisation des fonds » (227).
Si la création de l’UESL peut être analysée comme un « réinvestissement » du dispositif du « 1 % logement » par les partenaires sociaux, il faut toutefois noter que leur marge d’initiative a été dans le même temps encadrée par l’État. En 1995, le « 1% logement » a ainsi financé le nouveau prêt à taux zéro, dans le prolongement d’une logique qui, initiée en 1977, a conduit l’État à effectuer des prélèvements successifs sur la PEEC pour financer sa politique du logement soit par une affectation directe ou un reversement au budget, soit par une orientation des ressources des CIL vers des emplois prédéterminés. En 1997 puis en 1998, l’État a prélevé 1,1 milliard d’euros sur la PEEC au titre du prêt à taux zéro, soit l’équivalent d’une collecte annuelle.
Qui plus est, le 3 août 1998, une convention quinquennale a été signée entre les ministères du budget et du logement, d’une part, et l’UESL, d’autre part, qui, en contrepartie de l’arrêt des prélèvements étatiques sur les ressources de la PEEC à l’horizon de 2002, a imposé aux partenaires sociaux de contribuer au financement de la rénovation urbaine.
En effet, en échange du développement d’un espace d’intervention autonome au sein de la politique du logement et d’une « sanctuarisation » des fonds issus de la PEEC (contre les tentations de prélèvement du ministère des Finances), les partenaires sociaux ont dû prendre en charge une partie du coût de la politique du logement et ont concédé une contribution spécifique du « 1 % logement » à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui a été créée en 2003 et dont la quasi-totalité du financement repose aujourd’hui sur cette contribution (900 millions d’euros en 2014). Lors de son audition, M. Bruno Arbouet, directeur général de l’UESL, a en effet indiqué qu’« un quart de la ressource [d’Action Logement] est consacré à la rénovation urbaine et [que] cet effort finance 95 % du budget de l’ANRU » (228).
Par ailleurs, il faut souligner que l’État s’est imposé au sein des conseils d’administration de l’UESL, de l’Association Foncière Logement (AFL) et de l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL), conseils qui comptent chacun trois commissaires du Gouvernement qui représentent respectivement les ministères du Logement, du Budget et de l’Économie et qui ont un pouvoir de veto portant notamment sur les décisions compromettant l’équilibre financier de l’organisme concerné – ce qui témoigne une fois de plus de ce que la gouvernance du « 1 % logement » est plus tripartite que strictement paritaire.
La première de ces associations, l’AFL, a été créée en 2002 pour mettre en œuvre l’action de « 1 % logement » en matière de mixité sociale et pour produire des logements locatifs à destination des salariés pour diversifier l’habitat dans les secteurs en réhabilitation ainsi que dans les quartiers où l’offre est la plus tendue.
La seconde (l’APAGL) a été créée en 2005 pour faciliter l’accès au logement des personnes en situation de précarité en pilotant au niveau national le dispositif de garantie des risques locatifs (appelé à être remplacé par un nouveau dispositif « Visale » de sécurisation du parc locatif privé en application de la convention signée le 23 décembre dernier entre l’État et l’UESL).
Cette même année 2005, le seuil d’assujettissement à la PEEC est passé de 10 à 20 salariés : seules en sont désormais redevables les entreprises du secteur privé non agricole employant au moins 20 salariés lors de l’exercice précédent. Et en 2007, une participation des employeurs agricoles à l’effort de construction (PEAC) a été instaurée : seules en sont toutefois redevables les entreprises du secteur privé agricole employant au moins 50 salariés au cours de l’année civile écoulée (229). Au total, Action Logement est aujourd’hui financée par les cotisations de plus de 220 000 entreprises employant 14 millions de salariés potentiellement bénéficiaires.
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a marqué une véritable « mise sous tutelle » du programme du « 1 % logement », à la suite d’une série de dysfonctionnements pointés par la Cour des comptes qui a par ailleurs dénoncé les coûts de gestion exagérés dudit programme. À la suite de cette réforme, le nombre de CIL est passé de plus d’une centaine à une vingtaine.
Désormais baptisé « Action Logement », ce programme est investi de deux missions :
– construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones de forte tension immobilière, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale et en développant une offre locative intermédiaire (logements en colocation et autres résidences collectives) destinée aux salariés en mobilité, notamment les jeunes actifs ;
– accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en proposant des services et des aides financières qui facilitent l’accès des salariés au logement, et donc à l’emploi, qu’ils soient jeunes actifs, en mobilité ou en difficulté (230).
M. Jules-Mathieu Meunier voit dans la loi du 25 mars 2009 précitée l’aboutissement d’une « reprise en main du 1 % logement qui procède de trois dynamiques interdépendantes : la concentration du pouvoir de décision en matière d’orientation des fonds au profit des acteurs nationaux de l’institution, le transfert d’une partie du coût de la politique du logement vers la PEEC et le renforcement du rôle de l’État dans la définition des emplois du 1 % logement » (231), notamment au profit de la rénovation urbaine et de l’amélioration de l’habitat (232). Le fait qu’à compter de 2011, le conseil d’administration de l’ANPEEC cesse d’être paritaire pour ne plus comporter que des représentants de l’État et des personnalités qualifiées illustre cette reprise en main qui a conduit M. Michel Guilbaud à conclure que « dans le domaine du logement, l’État légifère largement. La loi définit tous les paramètres et la gouvernance des outils de ce qui était auparavant le “1 % logement”, maintenant appelé “Action Logement” » (233).
Au rebours de ce mouvement, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») a marqué un « retour de balancier » favorable aux partenaires sociaux puisqu’« en réinscrivant la définition des emplois du 1 % logement dans un espace de négociation entre l’État et les partenaires sociaux, cette réforme tranche avec la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 qui avait transféré au pouvoir législatif et réglementaire la responsabilité d’élaborer la politique nationale d’emploi des fonds du 1 % logement » (234).
La réforme de 2014 a par ailleurs conforté la logique de transfert du pouvoir de décision vers les échelons centraux de l’institution en renforçant l’autorité de l’UESL sur les CIL, afin d’harmoniser les interventions du programme et de juguler ses dysfonctionnements. Dans le prolongement de cette réforme et de la convention signée avec l’État le 2 décembre 2014 pour la période 2015-2019, qui prévoit notamment une diminution de 10 % du coût de gestion d’Action Logement, l’opérateur s’est engagé, depuis le printemps 2015, dans une refonte complète de son organisation.
Partant du constat que « la concentration des collecteurs a abouti à la constitution de vingt groupes extrêmement puissants qui se livrent à une concurrence stérile » (235), l’architecture autour d’une tête de réseau (l’UESL) et d’une vingtaine de collecteurs (CIL) sera supprimée au profit d’une seule entité : Action Logement. Aux côtés de cette structure faîtière chargée de piloter l’ensemble du groupe et de conclure avec l’État des conventions quinquennales existeront un pôle unique de services chargé de la collecte et de la distribution des aides aux entreprises – pôle auquel sera rattachée l’APAGL – et un pôle immobilier chargé de mettre en œuvre la politique immobilière du groupe – pôle auquel sera rattachée l’AFL. Des délégations régionales garantiront la déclinaison des politiques nationales au niveau des territoires.
Afin de permettre cette réforme, l’Assemblée nationale a adopté, le 17 mars dernier, en première lecture, un projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation. L’article 1er de ce texte propose d’autoriser le Gouvernement à :
– créer un organisme paritaire chargé de définir, dans le cadre de la loi, les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;
– substituer aux organismes collecteurs agréés associés de l’UESL un organisme unique chargé de collecter la PEEC et de distribuer les emplois de cette participation ;
– créer un organisme unique qui recueillera l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs agréés associés de l’UESL émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées ;
– définir la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes créés.
Pour ce qui est du montant des dépenses gérées par les différents organismes qui sont recensés par l’annexe à l’ANI du 17 février 2012 comme étant « paritaires », de leurs effectifs et de leur coût de fonctionnement, le ministère du logement et de l’habitat durable a fourni au rapporteur les données rassemblées dans le tableau ci-dessous.
D’après M. Bruno Arbouet, « les montants collectés au titre de la participation des entreprises à l’effort de construction s’élèvent à 1,8 milliard d’euros par an » (236).
Les chiffres fournis par le ministère du logement et de l’habitat durable indiquent que :
– le nombre d’aides distribuées aux personnes physiques était de 365 775 en 2014 (contre 378 990 en 2013, 388 211 en 2012 et 441 230 en 2011) ;
– le nombre de personnes physiques potentiellement bénéficiaires de cette participation, en tant que salariés du secteur assujetti, était de 14,9 millions en 2013 (contre 15,3 millions en 2011 et 15,1 millions en 2012) ;
– le nombre de personnes morales bénéficiaires était quant à lui de 4969 en 2014 (contre 4815 en 2013, 4822 en 2012 et 4831 en 2011) ;
– l’AFL avait livré 33 programmes et 771 logements en 2014 (contre 3812 logements et 161 programmes en 2011) ;
– l’APAGL garantissait 145 452 baux en 2014 (contre 176 773 en 2011).
Ces chiffres confirment que « l’UESL est ainsi devenu un acteur majeur des politiques publiques en France, du fait du retrait progressif de l’État de l’aide à la pierre » même si, pour reprendre la formule du M. Bruno Arbouet, la puissance publique reste habitée par la « tentation permanente de mettre la main sur cette ressource » (237).
CHIFFRES RELATIFS AU « PARITARISME » DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
UESL (Union des entreprises et des salariés pour le logement) et CIL |
2011 : 3621 2012 : 3288 2013 : 3172 2014 : 3662 |
2011 : 318 2012 : 310 2013 : 308 2014 : 305 |
2011 : NC 2012 : 3246 2013 : 3035 2014 : 2966 |
AFL |
2011 : 13 2012 : 80 2013 : 69 2014 : 144 |
2011 : 18 2012 : 12 2013 : 12 2014 : 12 |
2011 : 23 2012 : 35 2013 : 35 2014 : 37 |
APAGL |
2011 : 46 2012 : 55 2013 : 64 2014 : 47 |
2011 : 9 2012 : 7 2013 : 6 2014 : 6 |
2011 : 63 2012 : 53 2013 : 44 2014 : 38 |
ANPEEC |
2011 : 0,2 2012 : 0,1 2013 : 0,03 2014 : 0,5 |
2011 : 7 2012 : 8 2013 : 7 2014 : 8 |
2011 : 42 2012 : 45 2013 : 43 2014 : 43 |
Total pour l’année 2014 |
3 853,5 |
331 |
3 084 |
L’ANPEEC est fusionnée depuis le 1er janvier 2015 avec la Mission interministérielle d’inspection du logement social au sein de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
Source : Ministère du logement et de l’habitat durable.
En somme, comme le note M. Jules-Mathieu Meunier, « quand on s’intéresse à l’histoire du 1 % logement, on se rend compte que le paritarisme n’a jamais véritablement fonctionné comme prévu » (238). Déficit de portage politique du dispositif par les partenaires sociaux, déficit démocratique de sa gouvernance, relative inertie à l’œuvre dans l’offre de prestations, inégalités dans l’accès des salariés aux aides attribuées par les CIL (avec le reproche parfois fait aux modalités de gestion de la PEEC de conduire à traiter prioritairement les besoins en logement des salariés des grandes entreprises au détriment d’autres composantes du salariat comme les salariés des PME, les travailleurs migrants, les jeunes en insertion professionnelle et les demandeurs d’emploi)… toutes ces raisons ont pu expliquer que l’État ait été tenté de prendre une place croissante dans la gouvernance du « 1 % logement », au point que, aux yeux du rapporteur, il faille qualifier celle-ci de « tripartite » plutôt que de véritablement paritaire, même si ce « tripartisme » est un peu moins marqué qu’en matière d’assurance-chômage.
2. L’assurance paritaire du chômage
a. À l’indemnisation légale du chômage s’est ajoutée, en 1959, une assurance conventionnelle paritaire
i. Avant 1959, le chômage est indemnisé par les bureaux de bienfaisance des communes
• Les associations ouvrières ont défense d’assurer le chômage entre 1852 et 1884
L’indemnisation des périodes de chômage devait être l’une des principales raisons d’être des sociétés de secours mutuel, légalisées après la révolte des Canuts lyonnais. Mais les autorités publiques, qui doutaient de l’existence d’un chômage involontaire, l’assimilaient à l’indigence ou à la mendicité vagabonde (239), voire à des grèves séditieuses que des caisses de chômage eussent financées.
En 1852, les associations ouvrières qui financent des caisses de chômage sont dissoutes. Un décret interdit à celles qui subsistent d’assurer leurs membres contre le risque de chômage involontaire. Placées sous le contrôle de l’administration publique et de notables, ces sociétés ne comptent plus guère d’ouvriers à livret mais des ouvriers et des artisans patentés, moins exposés à ce risque, et des fonctionnaires qui ne le sont pas.
• L’interdit levé, les syndicats ouvriers et la mutualité ne s’aventurent guère dans l’assurance collective du chômage
À la place de ces sociétés, les syndicats professionnels, autorisés depuis la fin du Second Empire, puis légalisés en 1884 et réunis en confédérations interprofessionnelles dans les bourses du travail municipales, auraient pu proposer une assurance chômage pour augmenter leurs effectifs, comme l’ont fait les chambres syndicales anglaises.
La principale confédération syndicale française refusait le principe d’un financement salarial et mutualisé de cette assurance, en rappelant que l’État s’était engagé, en février 1848, à garantir un droit au travail et une rémunération aux ouvriers, même en l’absence de chantier. Seules quelques fédérations professionnelles comme celles des ouvriers du livre et des dockers, qui obtiennent un partage tacite du droit d’embauche, offrent cette assurance à leurs adhérents.
Les confédérations syndicales concurrentes n’ont pas eu plus d’intérêt à se lancer dans l’assurance collective d’un chômage ouvrier que les crises de surproduction, jusqu’alors inconnues, rendaient financièrement hasardeuse.
Une étude de l’Office du travail (240) de 1895 indique que, l’année précédente, seuls 66 des 2 178 syndicats ouvriers déclarés, regroupant 14 600 cotisants, ont accordé des indemnités chômages à leurs membres, le plus souvent hors des secteurs d’activité les plus menacés.
Lorsque l’État finit, avec le siècle, par reconnaître l’existence d’un chômage involontaire, ce sont les sociétés de secours mutuel et non les syndicats qu’il invite à proposer une assurance aux ouvriers menacés, en levant, par la loi de 1898, l’interdit posé en 1852. Elles ne s’y risquent pas plus que les syndicats. En 1926, sept ans après la légalisation des conventions collectives et deux ans avant que l’assurance chômage ne soit intégrée dans les assurances sociales obligatoires, seuls 100 000 salariés sur 12 millions cotisent à une caisse syndicale ou mutuelle de chômage.
• Ce sont des bureaux municipaux de bienfaisance, financés par une taxe sur les spectacles, qui secourent les chômeurs
Les premières assemblées nationales appelaient l’État à donner du travail ou des subsides aux nécessiteux, mais c’est aux municipalités que le Directoire les confie. À partir de 1796, une législation « charitable » – selon les termes de l’époque (241) –, leur enjoint de secourir les indigents, qu’ils soient invalides ou au chômage.
Sous le Consulat, des bureaux de bienfaisance sont installés par décret, à l’initiative du préfet, sur délibération du conseil municipal, dans les communes qui abritent des chômeurs et qui ont les fonds nécessaires pour leur allouer des subsides, en sus des dépenses occasionnées par les hospices et hôpitaux publics. Du début du XIXe siècle jusqu’aux années 1960, ces bureaux seront financés par le produit d’un impôt sur les entrées des spectacles et concerts.
Avant 1914, un tiers des communes tient un bureau de bienfaisance. Ces bureaux secourent à domicile les incapables de travail, vieillards, orphelins ou infirmes, plutôt que les chômeurs. Les municipalités emploient ceux qui ont charge de famille aux tâches occasionnelles de voirie ou de terrassement plutôt qu’elles ne les indemnisent. En outre, les changements de domicile qu’implique une recherche active d’emploi privent les chômeurs des secours qui sont réservés aux résidents permanents.
Ceux que les communes n’aident pas s’en remettent aux associations charitables, privées et confessionnelles, dont l’activité est retracée, entre 1910 et 1963, par les bulletins de l’Office central des œuvres de bienfaisance.
• Après 1914, l’État subventionne les bureaux municipaux et leur adjoint des commissions paritaires d’indemnisation
Entre 1914 et 1945, tandis qu’elle s’industrialise, l’économie française connaît trois périodes de chômage de masse – à l’automne 1914, entre 1932 et 1938 puis de 1940 à 1942 –, en dépit de faiblesses démographiques qui provoquent plutôt des pénuries de main d’œuvre.
En 1914, l’exode des populations des régions occupées et l’implication de l’État dans l’organisation de la production et l’affectation de la main d’œuvre, pour les besoins de la guerre, contraignent René Viviani, président du Conseil, à instituer, par décret, un fonds national d’indemnisation du chômage pour couvrir les dépenses supplémentaires des bureaux de bienfaisance municipaux qui accueillent les réfugiés, en les subordonnant à des offices départementaux.
Les disparités d’indemnisation sont réduites par un décret d’avril 1918. Il prévoit que l’admission des secours sera prononcée par une commission paritaire, nommée par le préfet ou le maire, « comprenant parmi ses membres des patrons et des ouvriers en nombre égal ». Il admet que cette commission puisse être celle qui administre les bureaux municipaux de placement de la main d’œuvre, instaurés par une loi du 14 mars 1904, généralisés au cours de la guerre et placés sous la tutelle d’offices départementaux et d’un office central de placement des réfugiés et chômeurs.
Cette administration paritaire et centralisée de la main d’œuvre est confirmée par la loi du 2 février 1925 qui l’inscrit dans l’article 85 c du code du travail. Selon cet article, les commissions « doivent comprendre un nombre égal d’ouvriers ou d’employés et de patrons appartenant, autant que possible, aux professions qui font le plus souvent appel au placement » plutôt qu’aux confédérations reconnues représentatives, visées par le traité de Versailles de 1919, dont aucune liste n’est publiée avant la circulaire Parodi du 28 mai 1945.
• Les premières cotisations obligatoires d’assurance chômage, votées en 1928, sont retenues par l’État entre 1932 et 1945
Alors que la plupart des pays industrialisés d’Europe instaurent, après la Première guerre mondiale, une indemnisation collective du chômage – elle existe depuis 1911 au Royaume Uni –, les pouvoirs publics français hésitent à suivre leur exemple. L’indemnisation collective du risque de chômage est rejetée par la Chambre des députés en 1921. Adoptée par celle du Cartel des gauches en 1924, elle est intégrée dans la loi de 1928 sur les assurances sociales, rendues obligatoires en dessous d’un montant de salaire, mais elle n’entre en application que lentement.
Une loi modificative de 1930 impose aux assurés mis au chômage de s’inscrire à l’office public de placement de leur lieu de résidence pour toucher leurs allocations. La même année, seuls 16 000 chômeurs avaient été secourus par 21 caisses départementales, 192 caisses municipales de chômage et 214 institutions privées de bienfaisance.
La crise économique des années 1930 affecte moins l’économie française que celle des pays plus industrialisés. Elle oblige néanmoins le Gouvernement à retenir sur le compte du fonds national de chômage, confié à la Caisse générale de garantie des assurances sociales, à partir de 1932, la part des cotisations couvrant l’assurance chômage qui devait revenir aux caisses primaires.
Ces cotisations s’avèrent insuffisantes puisqu’elles ne sont payées que par une faible minorité de salariés, le défaut de leur paiement n’étant pas plus sanctionné que celui d’affiliation aux assurances sociales obligatoires. L’État doit abonder le fonds de chômage par des crédits budgétaires jusqu’en 1942, pour que les sommes réunies puissent couvrir le surcroît d’indemnisations versées par les bureaux de bienfaisance.
En droit, l’indemnisation du chômage est séparée des autres assurances sociales par la loi du 11 octobre 1940 pour être rattachée à l’administration de la main d’œuvre, rétablie par le Gouvernement en 1938 et maintenue après la convention d’armistice. En nombre, 805 400 chômeurs sont secourus sur les fonds publics à partir de novembre 1940 alors même que 1 800 000 soldats sont retenus captifs en Allemagne.
Le contrôle administratif de la main d’œuvre perdure après 1942 pour satisfaire les exigences du service du travail obligatoire et du service civique rural, bien que le chômage soit devenu résiduel. Délégué à des commissariats successifs qui supervisent les bureaux municipaux et les offices départementaux, il est conservé à la Libération en vue de planifier la reconstruction.
Les ordonnances du 3 juillet 1944, du 24 mai et du 4 octobre 1945 rendent le placement des travailleurs et le contrôle de l’emploi au ministère du travail. En raison du plein emploi de la main d’œuvre, l’indemnisation du chômage n’est pas intégrée au plan de sécurité sociale de 1945 et reste à l’initiative des bureaux de bienfaisance, dans les conditions fixées par le code du travail.
Ces bureaux, devenus d’aide sociale en 1953 n’ont à indemniser que 25 000 chômeurs en 1959 quand, avant l’arrivée sur le marché du travail des générations nombreuses du baby-boom et en dépit de l’allongement du service militaire, la fin de la reconstruction provoque une hausse du chômage qui décide l’État à intervenir de nouveau en complétant l’indemnisation publique par une assurance paritaire.
ii. En 1959, l’État agrée une convention d’assurance chômage, interprofessionnelle et paritaire, qui complète l’indemnisation publique
• Une assurance chômage, collective et conventionnelle, hors sécurité sociale est agréée en 1959 par l’État
Lors d’une allocution télévisée prononcée le 1er août 1958, le président du Conseil, Charles de Gaulle, invite les partenaires sociaux, c’est-à-dire les confédérations reconnues représentatives par la circulaire Parodi, à créer, par voie conventionnelle, un fonds de garantie des salaires qui maintienne la rémunération des salariés momentanément privés d’emploi et facilite leur reclassement professionnel.
Cette invitation, motivée par l’entrée de la France dans le marché commun européen, répond aux vœux du CNPF et de la CGT-FO, auxquels souscrivent, lors des négociations, la CFE-CGC et la CFTC puis, pour ne pas en être exclue, la CGT, plus réticente puisqu’elle plaidait pour une intégration de l’assurance chômage dans la sécurité sociale, que l’État refuse.
Sans contester qu’il s’agisse d’une assurance collective, garantissant les revenus du travail salarié contre un aléa, analogue aux indemnités journalières pour maladie, l’État préfère qu’elle soit administrée séparément : soit de façon paritaire, par les partenaires sociaux, à la manière de la retraite complémentaire des cadres, soit par les services du ministère du travail.
• Cette convention d’assurance chômage est soustraite, par ordonnance, au régime juridique des conventions collectives
La négociation paritaire de l’assurance chômage dure tout l’automne 1958 en raison de désaccords sur le partage des cotisations. Supervisée par le ministre du travail, elle n’est conclue que le 31 décembre 1958, au terme du délai accordé. Elle n’est pas soumise au régime juridique des commissions paritaires prévues par l’article 31 f du code du travail de 1910, réécrit par la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits du travail, car l’assurance contre le chômage n’entre ni dans le domaine obligatoire, ni dans le domaine facultatif des conventions collectives que peuvent conclure ces commissions paritaires.
L’ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959 relative à l’action en faveur des travailleurs sans emploi rétablit les subventions aux bureaux municipaux par un fonds national d’assurance chômage tout en autorisant subsidiairement les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, au sens de la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives, à conclure un accord ayant pour objet exclusif le service d’allocations aux chômeurs.
Un agrément est indispensable pour « rendre obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ professionnel et territorial de la convention » les dispositions de telles conventions. Cet agrément n’est accordé qu’à l’issue d’un contrôle des clauses convenues qui, selon l’explication donnée à la mission par M. Hervé Léost, sous-directeur chargé des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi à la DGEFP, ne se limite pas à vérifier leur légalité : « Le pouvoir d’appréciation du ministre est plus large. Il peut aussi s’opposer à l’agrément sollicité pour des motifs d’intérêt général, tels que la nécessité de préserver l’équilibre financier du régime ou la protection des droits des travailleurs privés d’emploi. Si l’agrément est refusé, les règles d’indemnisation sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. C’est ce qu’il est advenu de la convention de juillet 2000 : un décret a prorogé la convention précédente de 1997 jusqu’à ce qu’un nouvel accord ait été conclu au début de l’année 2001. » (242)
• La convention d’assurance chômage réserve aux institutions paritaires qu’elle crée la collecte des cotisations et la liquidation des allocations
La première convention d’assurance chômage, agréée par un arrêté du 12 mai 1959, établit un régime national interprofessionnel d’allocations aux travailleurs sans emploi de l’industrie et du commerce. Elle prévoit qu’une commission paritaire nationale, dans laquelle chaque confédération est représentée par deux délégués, interprète le règlement de l’assurance collective qui lui est annexé.
Ce règlement finance l’assurance par des cotisations obligatoires, partagées entre les employeurs, pour 80 %, et les salariés, versées à des caisses territoriales gérées par les associations interprofessionnelles désignées par la convention. Ces associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, nommées Assédic, sont déclarées sous le régime de la loi de 1901. Elles affilient les employeurs à l’assurance et liquident les allocations dues à leurs anciens salariés mais ni les uns ni les autres n’en sont membres.
Leur conseil d’administration et leur bureau sont paritaires. Ils sont composés de bénévoles, désignés et non pas élus, tous les deux ans, dans deux collèges, par les syndicats de salariés et d’employeurs signataires de la convention, qui sont les membres de l’association. Ces deux collèges en obtiennent alternativement du bureau la présidence.
Les Assédic recrutent leur personnel, administrent leur caisse de chômage et nomment leur directeur. Elles doivent cependant être agréées par une Union pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, appelée Unédic, qui les fédère et garantit l’équilibre de leur trésorerie. Cette Union, prévue par la convention, est composée et administrée par un conseil et un bureau paritaires comme celui des associations.
• L’État étend l’assurance chômage au-delà de l’industrie et du commerce puis ouvre les négociations à la CGPME et à l’UPA
La convention, conclue pour les salariés des entreprises de l’industrie et du commerce adhérentes au CNPF, est rendue applicable à leurs concurrentes par l’agrément. Des protocoles annexés soumettent à l’assurance chômage des professions salariées par intermittence ou payées à l’unité.
Un arrêt du Conseil d’État du 2 mars 1962 l’impose aux entreprises artisanales en rejetant le recours déposé par leur confédération nationale, qui ne participait pas aux négociations. Les ordonnances Jeanneney du 13 juillet 1967 l’étendent à toutes les entreprises employant des salariés.
Les banques, les assurances et les coopératives agricoles sont affiliées à l’Unédic après la dissolution des caisses d’assurance chômage séparées qu’elles finançaient. L’assurance est étendue en 1979 aux gens de maison et aux assistantes maternelles puis, à titre facultatif, aux contractuels de droit public des collectivités et établissements en 1987, puis de l’enseignement supérieur en 1999.
Ces extensions modifient peu les instances paritaires de négociation de la convention collective. La CGPME, séparée du CNPF depuis 1969, adhère à la convention en 1979 (243). L’UPA, créée en 1975 et reconnue représentative en 1983, rejoint la négociation en 1988 et adhère à la convention en 1994.
iii. Les dépenses d’indemnisation du chômage restent cependant partagées entre l’État et les partenaires sociaux
• Dans les années 1960, l’État réforme l’administration de la main d’œuvre et rétablit un fonds d’indemnisation du chômage
L’ordonnance de 1959 prévoyait que l’indemnisation du chômage par l’État et l’assurance paritaire se complètent. Les bureaux d’aide sociale versent aux chômeurs une indemnité forfaitaire sans limitation de durée, financée par l’impôt. Les allocations d’assurance complètent, pour une durée limitée, l’indemnité des chômeurs assurés. Elles la remplacent lorsqu’ils ne satisfont pas les conditions de résidence et d’inscription sur les registres de main d’œuvre vérifiées par les bureaux municipaux.
Les mutations démographiques et économiques que connaît le pays dans les années 1960 augmentent la population active et réduisent les emplois du secteur primaire de la production au profit d’emplois dans l’industrie et le commerce. Elles ne provoquent qu’un chômage frictionnel, de courte durée, indemnisé de manière généreuse par l’assurance et le fonds national de l’emploi (FNE) créé par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 pour subventionner les bureaux municipaux d’aide sociale qui ne reçoivent plus de taxe locale affectée.
Les indemnités financées par le FNE se composent d’allocations de conversion, des primes de transfert et de transports ainsi que d’allocations de préretraite réservées aux chômeurs de plus de 60 ans, licenciés par des entreprises de secteurs reconnus en restructuration et conventionnées à ce titre par l’État.
Trois ordonnances du 13 juillet 1967 (n° 67-579, n° 67-580 et n° 67-581) confirment qu’en complément des allocations de reclassement ou de conversions, tout salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement et, lorsqu’il reste au chômage, à un revenu de remplacement, composé d’une allocation d’aide publique et d’une allocation d’assurance.
Pour diminuer cette période de chômage indemnisé, une quatrième ordonnance (n° 67-578 du 13 juillet 1967) réaffecte le personnel des bureaux municipaux et les offices départementaux de placement de la main d’œuvre dans les antennes locales d’une Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créée pour administrer une bourse nationale de l’emploi et pour former les chômeurs. Les organismes paritaires, les associations reconnues d’utilité publique et les associations d’anciens élèves qui proposent des placements gratuits doivent être agréés et établir une convention avec elle.
• La hausse du chômage impose un nouveau partage de son indemnisation entre l’État et l’Unédic
L’augmentation du chômage après les deux crises pétrolières des années 1970 entraîne un allongement des durées d’indemnisation et une nouvelle répartition des allocations entre l’assurance et l’aide d’État, convenue par l’ANI du 27 mars 1972 et confirmée par la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l’aide aux travailleurs privés d’emploi.
La loi rend exclusives l’allocation de base financée par l’État, l’indemnité d’assurance d’un an et la garantie de ressource des préretraités financée par le FNE ou bien par l’Unédic, selon les termes de l’accord du 27 mars 1972.
Elle soumet leur versement, coordonné par les Assédic, à une exigence de recherche d’emploi vérifiée par l’ANPE, même pour les chômeurs qui n’étaient pas salariés. L’Unédic reçoit en contrepartie une subvention de l’État et la loi lui impose d’ajuster ses recettes à ses dépenses par une hausse des cotisations, complétée pour moitié par un relèvement de sa subvention.
Ce régime d’indemnisation unifié est remis en cause dans les années 1980, en raison de l’allongement des durées d’indemnisation et des réformes engagées par le gouvernement de M. Pierre Mauroy. L’échec des négociations interprofessionnelles de 1982 contraignent le Gouvernement à modifier par ordonnances et décret la répartition du revenu de remplacement.
Les allocations de solidarité versées par l’État prennent désormais le relais des indemnités contributives d’assurance quand les droits à indemnisation des assurés sont épuisés, afin d’étendre la durée des indemnisations.
Pour couvrir des dépenses d’assurance en forte hausse, le Gouvernement relève les cotisations, baisse le taux de remplacement, subventionne l’Unédic et garantit l’emprunt obligataire qu’elle contracte sur le marché financier.
Les chômeurs non indemnisés sont repris en charge par les bureaux d’aide sociale des communes, auxquelles les lois de décentralisation délèguent la liquidation d’aides sociales indépendantes de l’emploi.
• Le départ en retraite à 60 ans provoque des transferts de cotisations entre assurance chômage et retraite complémentaire
Les chômeurs de plus de 50 ans étant rarement réembauchés, des durées d’indemnisation plus longues leur avaient été accordées dans les années 1960 puis un double régime instauré pour les indemniser jusqu’à ce qu’ils obtiennent, à 65 ans, une pension de retraite.
L’ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, qui abaisse à 60 ans l’âge minimal de liquidation des pensions versées par la sécurité sociale et permet aux chômeurs de plus de 60 ans d’obtenir une pension s’ils ont cotisés plus de dix ans, transfère sur l’assurance vieillesse des dépenses incombant auparavant à l’assurance chômage et au FNE.
Le rapport introductif de l’ordonnance invitait les partenaires sociaux à adapter les régimes conventionnels complémentaires à cet abaissement de l’âge légal de liquidation. En réponse, un accord national interprofessionnel du 4 février 1983, agréé par arrêté du 21 mars suivant et renouvelé entre 1983 et 2001, partage entre l’Unédic, l’AGIRC et l’ARRCO le produit de cotisations qui atteignent 2 % de l’assiette de l’assurance chômage, augmenté d’une subvention de l’État d’un milliard et demi de francs (soit 229 millions d’euros).
Ces fonds devaient financer les retraites complémentaires versées entre 60 et 65 ans aux salariés et chômeurs autorisés à liquider par anticipation leurs droits à pension. L’accord charge l’Association pour la gestion de la structure financière (ASF), paritaire et administrée par l’Unédic, de procéder à leur partage par des conventions financières bilatérales.
En 2001, l’ASF est remplacée par une Association pour la gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO, également paritaire mais administrée par les deux régimes bénéficiaires, qui leur reverse entièrement le produit de la cotisation de 2 %.
Une modification, au profit de l’Unédic, de la répartition de ces cotisations supplémentaires a été évoquée devant la mission en raison du relèvement de l’âge de liquidation à taux plein des retraites, des exigences de durée de cotisations plus longue, et de la hausse du taux d’activité mais aussi du taux de chômage des salariés âgés de 60 à 65 ans.
Lors de la table ronde qui a réuni des négociateurs de la convention Unédic, le 10 décembre 2015, M. Éric Aubin a expliqué que : « L’assurance chômage subit les conséquences de décisions prises par ailleurs. Dès lors, saucissonner les négociations sur l’assurance chômage en l’isolant de son contexte pose problème. Ainsi, lorsqu’un gouvernement antérieur a décidé de porter l’âge légal de la retraite de soixante à soixante-deux ans, cela a eu des répercussions sur l’assurance chômage puisque les employeurs se séparent de leurs seniors et que 56 % des salariés ne sont plus en activité au moment où ils font valoir leur droit à la retraite. Ce phénomène n’est jamais abordé dans le cadre de la convention sur l’assurance chômage. »
Au cours de la table ronde du 3 décembre 2015, qui a réuni des négociateurs des conventions AGIRC-ARRCO, il précisait : « Je mesure en particulier les conséquences sur l’assurance chômage d’un accord relatif aux retraites complémentaires : elles ne sont pas négligeables, puisque nous les avons évaluées à plus de 3 milliards d’euros, qui viennent s’ajouter aux 20 milliards d’euros de déficit cumulé, qui s’accroît par ailleurs chaque année de 4 milliards environ. Or, quand nous avons soulevé ces questions, notamment celle de l’emploi des seniors, dans le cadre de la négociation, on nous a renvoyés à une autre négociation. Je considère au contraire que l’on aurait dû pouvoir discuter de l’emploi des seniors dans le cadre de l’accord sur les retraites complémentaires, d’autant que 56 % des salariés ne sont plus en activité au moment où ils font valoir leurs droits à la retraite.
« En effet, les décisions prises dans le cadre de cet accord ne concernent que les 44 % qui sont encore en activité, et qui ont effectivement le choix de partir à l’âge où elles peuvent faire valoir leurs droits à la retraite sans abattement ou de rester un an supplémentaire pour échapper à l’abattement. Les 56 % qui ne sont plus en activité, eux, n’ont pas le choix. »
M. Jean-Louis Malys estimait pour sa part que : « Décaler de façon uniforme l’âge de départ à la retraite à 63 ans serait profondément injuste et porterait un très mauvais coup à la situation des seniors, qui sont aujourd’hui largement victimes du chômage. L’accord ne s’appliquant pas avant 2019 en ce qui concerne la question de l’abattement, nous avons un travail spécifique à faire, en lien avec les négociations UNEDIC qui vont s’ouvrir. Nous devons exiger
– l’accord le prévoit – une contribution des employeurs qui se débarrassent des salariés de façon anticipée, et veiller à ce que ceux qui ne sont pas en emploi aujourd’hui ne subissent pas pleinement l’abattement envisagé. »
b. Les partenaires sociaux tentent, depuis 2001, de limiter le coût de l’assurance chômage par une prévention personnalisée du risque
i. L’assurance chômage personnalisée, négociée par les partenaires sociaux en 2001, a été déléguée par l’État au service public de l’emploi
• Les « 35 heures » ont permis d’équilibrer les comptes de l’Unédic et de résorber sa dette tout en autorisant une baisse des cotisations
Comme l’a rappelé, il y a deux ans, le rapport de la commission d’enquête sur l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail, entre 1997 et 2001, les créations d’emploi ont atteint un niveau sans précédent depuis les années 1950, alors que la population en âge de travailler augmentait.
En cinq ans, la France a créé 2 millions d’emplois salariés dans le secteur marchand. 600 000 chômeurs ont retrouvé un emploi. Le taux de chômage calculé par l’INSEE selon les règles du Bureau international du travail est passé de 11,8 % de la population active en mars 1998 à 8,8 % en mars 2001, les rôles des demandeurs d’emploi tenus par l’ANPE confirmant cette baisse.
NOMBRE DE CHÔMEURS AU SENS DU BIT
(en milliers)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2 549 |
2 710 |
2 745 |
2 652 |
2 594 |
2 239 |
2 046 |
2 107 |
Source : Site Internet de l’INSEE
NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A
(en milliers, en décembre)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
3 188 |
3 251 |
3 207 |
3 145 |
2 884 |
2 496 |
2 536 |
2 650 |
Source : Site Internet de Pôle Emploi
Le retour au travail de chômeurs de longue durée a même bénéficié à des personnes de 50 à 64 ans dont le taux d’emploi est remonté de 7 points entre 1998 et 2003. Ces créations d’emplois ont augmenté les recettes de cotisation et provoqué une baisse des dépenses d’indemnisation.
Elles ont permis aux partenaires sociaux de modifier l’indemnisation des chômeurs âgés en mettant fin à l’allocation de remplacement pour l’emploi. Elles ont permis à l’Unédic de rétablir ses comptes et de résorber sa dette tout en diminuant les taux de cotisation de 4,5 points, partagés entre les parts salariale, patronale et celle du fonds de garantie.
• En 2001, les partenaires sociaux subordonnent l’indemnisation à une prévention contractuelle personnalisée du risque
Alors que le régime d’assurance chômage est revenu à l’équilibre, les partenaires sociaux décident d’en changer les règles d’indemnisation. Lors de son assemblée générale du 18 janvier 2000, la principale confédération syndicale d’employeurs, le MEDEF, qui a succédé au CNPF deux ans plus tôt, propose à ses partenaires une refondation du paritarisme.
Cette refondation devait, en matière d’assurance chômage, subordonner l’indemnisation à des obligations contractuelles personnalisées, négociées lors de la liquidation des créances d’assurance. Auparavant, les règles d’indemnisation applicables à la plupart des assurés ne tenaient compte que de critères impersonnels, comme la durée de cotisation et le montant des salaires assurés, ou bien d’un critère d’âge favorable aux personnes visées.
Les chômeurs indemnisés n’avaient ensuite à satisfaire que des obligations générales : rechercher activement un emploi et accepter tout emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et normalement rétribué. L’obligation d’accepter un emploi tenait compte de la région de résidence du chômeur, pour apprécier le salaire normalement pratiqué dans sa profession, et de sa situation personnelle et familiale, pour apprécier ses possibilités de mobilité géographique.
Cette obligation n’était, en outre, guère sanctionnée, puisque seul l’État était admis par la loi et la jurisprudence à contrôler les demandeurs d’emploi indemnisés. Ses services du contrôle de la recherche d’emploi n’instruisaient guère plus de 2 000 contentieux par an, tandis que l’ANPE ne sanctionnait que les manquements aux obligations administratives d’inscription sur ses rôles.
Les obligations personnalisées, souhaitées par le MEDEF, devaient être prescrites lors d’un examen de situation personnelle et familiale, afin de diminuer l’exposition de chaque chômeur indemnisé au risque couvert.
Le principe assurantiel et contributif de l’indemnisation n’était cependant pas remis en cause. Elle demeurait proportionnelle aux cotisations acquittées individuellement et indépendantes des revenus non salariaux ou des charges de famille de l’assuré.
Ce nouveau régime d’assurance, accepté par les partenaires sociaux en contrepartie de la suppression de la dégressivité des allocations, instaurée en 1992, donne lieu à un protocole d’accord signé le 14 juin 2000. Il lui fallait encore l’agrément de l’État pour entrer en vigueur.
• D’accord sur le nouveau principe d’assurance, l’État obtient que l’ANPE soit associée aux Assédic pour exécuter la convention
L’État a d’abord refusé d’agréer la convention du 1er juillet 2000 qui détaillait cet accord, bien qu’il en partageât l’intention de remplacer l’indemnisation d’un risque fortuit par une prévention active, et a prolongé par décret la convention de 1997, assortie d’un mécanisme de carence.
Il l’a refusé parce que la convention attribuait aux Assédic des pouvoirs de sanction en cas d’inexécution du contrat personnel, sans garantie d’impartialité ni voies de recours contradictoires. En effet, la division juridique de l’assurance chômage entre une convention collective paritaire et un contrat synallagmatique personnel suppose que l’agent payeur de l’assurance chômage, qui négocie le contrat d’indemnisation, soit intégré à l’agence de placement du chômeur et puisse contrôler l’exécution des obligations convenues et les sanctionner par la liquidation des indemnités.
La convention est renégociée pour établir entre l’ANPE et l’Unédic un partage des tâches de négociation des contrats, de contrôle des obligations, des systèmes d’information conservant les données de situation des chômeurs et des guichets des deux réseaux. En contrepartie de sa participation à l’exécution de la convention, l’ANPE obtient une subvention de l’Unédic.
Agréée par un arrêté du 4 décembre 2000, la convention de 2001 définit un dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage qui lie l’indemnisation à la conclusion d’un contrat personnel de retour à l’emploi par lequel le chômeur et son assureur s’engagent à l’évaluation des capacités professionnelles du premier, la tenue d’entretiens réguliers avec le second et des actions définies en commun dans un projet d’action personnalisé, comprenant des formations et des actes positifs de recherche d’emploi.
• L’État adapte la législation au nouveau régime d’assurance
Alors que les conventions suivantes confirment le choix d’une contractualisation personnalisée de l’assurance chômage, le code du travail est modifié pour tenir compte des engagements souscrits et du contrôle des obligations convenues.
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale intègre les organismes d’assurance chômage dans le service public de l’emploi. Elle modifie la procédure de réduction des allocations en cas de manquement aux obligations convenues. Des garanties juridictionnelles sont posées au contrôle des agents de l’assurance chômage. La faculté de suspendre les allocations est soumise à l’avis d’une commission administrative et au principe du contradictoire.
La loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux punit d’une amende le mensonge en vue d’obtenir le bénéfice d’allocations chômage.
La loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi intègre dans le code du travail les deux obligations convenues pour les demandeurs d’emploi, à savoir participer à la définition de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi qui leur seraient proposées.
• L’État décide de fusionner les Assédic et l’ANPE en 2008
Les échanges d’informations entre les Assédic et l’ANPE et la mise en commun des guichets d’accueil des chômeurs préparaient une fusion des institutions d’indemnisation du chômage et d’administration du placement de la main d’œuvre, envisagée au profit des Assédic quand la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle leur avait transféré l’inscription au chômage, mais écartée par un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 1994.
L’État impose cette fusion par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, en ôtant aux partenaires sociaux le choix de l’opérateur de collecte des cotisations et celui de l’agent d’exécution de la convention qui négocie les contrats personnels et liquide les indemnités d’assurance mais en leur conservant le règlement conventionnel de l’assurance chômage, le contrôle de son exécution et la gestion de sa trésorerie.
La loi attribue la collecte des cotisations aux URSSAF et désigne l’établissement public responsable de la politique nationale de l’emploi, appelé par la suite Pôle Emploi, pour exécuter la convention. Elle réunit dans cet établissement les 14 837 anciens salariés des Assédic et les 29 838 anciens agents de l’ANPE, ainsi que les biens des deux institutions et lui attribue le dixième des cotisations d’assurance perçues deux ans auparavant.
ii. Après la crise de 2008, le régime d’assurance redevient déficitaire
• La crise de 2008 interrompt la baisse du chômage
Le succès du nouveau principe d’indemnisation reposait sur une remise en cause implicite de la nature involontaire du chômage. Le renforcement des obligations imposées au chômeur devait aboutir à faire baisser le nombre de ceux qui se déclaraient sans aucune activité.
Dans les cinq premières années d’exercice de l’assurance personnalisée, le chômage ne baisse pas, l’Unédic connaît des déficits récurrents et s’endette. En revanche, entre 2005 et 2007, une baisse rapide du chômage permet de rétablir la situation comme l’indique le graphique suivant.
SITUATION FINANCIÈRE DE L’ASSURANCE CHÔMAGE ENTRE 1990 ET 2014
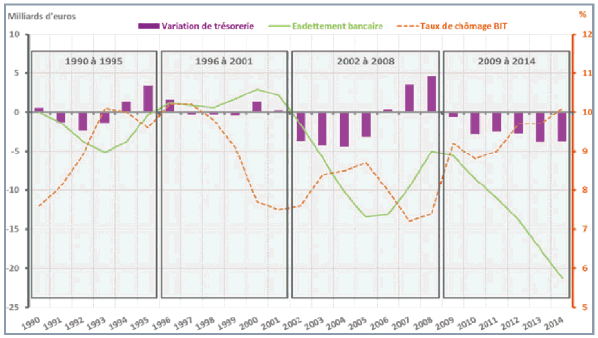
Sources : Unédic et Insee, situation au 31 décembre de chaque année
Après 2008 et la création de Pôle Emploi, la crise économique dégrade, pour une décennie, les comptes de l’assurance chômage, en dépit du relèvement des taux de cotisation. Le chômage ne cesse d’augmenter.
NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A
(en milliers, en décembre)
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2 536 |
2 650 |
2 781 |
2 762 |
2 616 |
2 305 |
2 053 |
2 257 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
2 681 |
2 748 |
2 898 |
3 193 |
3 303 |
3 496 |
3 590 |
Source : Site Internet de Pôle Emploi
À la hausse des dépenses d’indemnisation du chômage s’ajoute celle des dépenses d’accompagnement des chômeurs par les services de Pôle Emploi. Ces services sont financés par l’Unédic qui verse à Pôle Emploi 10 % des recettes de cotisations perçues deux ans plus tôt, soit 3,2 milliards d’euros en 2014.
M. Jean-François Pilliard indiquait qu’un taux de chômage d’environ 9 % permet de ne pas compromettre l’équilibre financier du nouveau régime d’assurance chômage : « Jusqu’à 2008, nous avions plutôt à gérer l’accompagnement de la croissance, le taux de chômage étant alors beaucoup moins important qu’aujourd’hui, même si, de temps en temps, nous avions à faire face à une phase de bas de cycle plus difficile. La pression qui pesait sur les gestionnaires était beaucoup moins forte. Depuis 2008, l’exigence est devenue beaucoup plus grande et, ainsi que vous l’avez relevé, nous sommes confrontés à un dilemme, difficile pour les équipes comme pour moi-même : nous devons faire des arbitrages constants entre notre mission de solidarité – permettre à des personnes qui ont perdu leur travail de vivre décemment et de revenir vers l’emploi – et la nécessité de prendre en compte les contraintes financières. » (244)
• L’apparition d’un chômage intermittent modifie l’équilibre convenu en en 2001 entre prévention et indemnisation
Le premier système paritaire d’assurance chômage avait été conçu pour une économie industrialisée proche du plein emploi, dans laquelle une carrière se déroulait au sein de la même entreprise, de l’âge de seize ans à celui de la retraite. Il était alors possible de gérer l’assurance chômage comme une caisse indemnisant un accident peu coûteux, puisqu’un chômeur de moins de 50 ans pouvait retrouver rapidement du travail.
D’une indemnisation subsidiaire aux aides de l’État dans les années 1960, l’assurance chômage est devenue, au fil des crises économiques des décennies suivantes, l’une des principales garanties collectives des revenus des foyers frappés par des périodes de chômage longues ou fréquentes.
Si le nombre de chômeurs indemnisés au 31 décembre de chaque année a connu des baisses conjoncturelles, entre 1993 et 2000 puis entre 2004 et 2007, il reste en hausse tendancielle soutenue depuis 1973.
Avant les années 2000, l’effectif de 2 millions de personnes indemnisées au 31 décembre n’avait été atteint qu’une fois, en 1993. Entre 2002 et 2006, les effectifs indemnisés ont été continûment supérieurs à 2 millions. Après la forte hausse du chômage de la décennie passée, ils dépassent 2,6 millions.
Les transformations économiques qui maintiennent les effectifs du chômage indemnisé par l’assurance à un tel niveau ne sont plus seulement les restructurations de l’appareil industriel et les délocalisations, accompagnées auparavant par des préretraites. Elles affectent désormais la stabilité et le niveau de rémunération des emplois de services, en provoquant l’apparition d’un emploi peu qualifié et faiblement rémunéré, intermittent en France, à temps partiel dans le reste de l’Europe, dont les salaires ne suffisent plus à garantir les revenus d’un foyer et maintiennent les familles dans la pauvreté et la dépendance aux aides sociales.
Lors de son audition en qualité de vice-président de l’Unédic, M. Jean-François Pilliard relevait que les chômeurs indemnisés sur de courtes périodes devenaient des travailleurs intermittents pour lesquels l’indemnisation est un complément nécessaire de leurs revenus d’activité et non la réparation d’un préjudice fortuit : « Nous sommes dans une situation nouvelle : aujourd’hui, près de la moitié des personnes indemnisées par l’assurance chômage sont en activité. Cela présente à l’évidence un avantage : une personne en activité, même partielle, a de meilleures chances de conserver ses compétences et ses liens sociaux qu’une personne durablement éloignée de l’emploi, qui finira par perdre ses compétences et, pire encore, par se désocialiser. Nous avons donc certainement eu raison de nous engager dans cette direction, notamment avec les droits rechargeables.
« Cependant, les partenaires sociaux doivent s’interroger sur au moins deux points. D’une part, on nous interpelle sur le fait que cette activité fait souvent l’objet de contrats de très courte durée. Nous devons étudier la question, car l’assurance chômage n’a pas vocation à créer et à financer de nouveaux business models – modèles économiques – pour telle ou telle profession.
« D’autre part, si la proportion de personnes en activité parmi les allocataires continue à augmenter, cela soulèvera, à terme, la question de nos missions : le rôle de l’assurance chômage est-il d’indemniser en grande partie des personnes en activité ? Nous entendons alimenter la réflexion sur ces sujets. Le succès d’aujourd’hui doit être accompagné d’éventuels aménagements ou correctifs si nécessaire. » (245)
Un premier correctif a été apporté par la convention du 14 mai 2014 sous le nom de droits rechargeables. L’indemnisation est suspendue si les chômeurs retrouvent du travail et reprise si ce travail n’est que temporaire, afin d’inciter à accepter un emploi même court et moins bien rémunéré que le précédent. D’autres modifications des règles d’indemnisation sont envisagées en 2016 alors que l’Unédic anticipe, selon le graphique suivant, d’autres exercices déficitaires.
VARIATION DE TRÉSORERIE ANTICIPÉE EN JUIN 2015

Source : Unédic, dossier de référence de la négociation, février 2016
• La dette de l’Unédic augmente celle de l’État qui la garantit…
Le déficit comptable de l’assurance chômage grève depuis 2008 le patrimoine de l’Unédic d’une dette croissante. Socialement nécessaire, cette dette est aussi économiquement utile puisqu’elle joue un rôle contra-cyclique de stabilisation de la consommation des ménages en période de récession ou de faible croissance, alors que les 38,5 milliards d’euros de dépenses de l’Unédic représentent désormais plus de 1,7 % du PIB contre 1,5 % en 1996 et de 0,02 % en 1960.
L’endettement auprès des marchés financiers repose toutefois sur le caractère obligatoire de l’affiliation et des cotisations ainsi que sur la garantie apportée par l’État. Il s’ajoute de ce fait à l’endettement déclaré aux autorités européennes pour vérifier le respect des engagements souscrits lors de la signature du traité sur l’Union européenne.
Interrogé au sujet de l’endettement prévisionnel retracé dans le graphique ci-dessous, M. Vincent Destival, directeur général de l’Unédic, a expliqué que : « À réglementation constante, 2016 devrait permettre d’engager une réduction du déficit de l’assurance chômage. Le déficit atteindrait un plafond en 2015 autour de 4,4 milliards d’euros et baisserait à 3,6 milliards en 2016. Nos prévisions pluriannuelles montrent que cette baisse du déficit se poursuivra au cours des années suivantes.
« Dans ces conditions, notre dette pourrait atteindre un peu plus de 29 milliards d’euros à la fin de l’année prochaine, soit l’équivalent de dix mois de recettes de l’assurance chômage. Cette dette est financée par appel aux marchés financiers, et notamment par l’émission d’obligations. Nous avons veillé, avec l’augmentation de la dette, à allonger la maturité de nos moyens de financement. Leur maturité moyenne est aujourd’hui supérieure à cinq ans, ce qui nous met à l’abri d’un risque de remontée des taux.
« Le coût de notre dette ne représente, aujourd’hui, qu’environ 1 % des recettes de l’assurance chômage. Il est relativement bien maîtrisé, même si nous sommes conscients que nous bénéficions de taux d’intérêt particulièrement bas, compte tenu du contexte conjoncturel et de l’intervention de la Banque centrale européenne, et que cette situation ne se maintiendra pas indéfiniment. » (246)
SITUATION FINANCIÈRE DE FIN D’ANNÉE DE L’UNÉDIC, ANTICIPÉE EN JUIN 2015
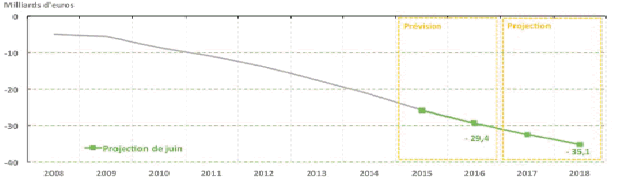
Source : Unédic, dossier de référence de la négociation, février 2016
Cette dette croissante pèse sur les négociations paritaires de la convention d’assurance chômage. Lors de la table ronde qui a réuni des négociateurs de l’Unédic, M. Franck Mikula, secrétaire national chargé de l’emploi et de la formation à la CFE-CGC, a reconnu que : « Dans la mesure où l’endettement de l’Unédic s’inscrit dans la dette au sens de Maastricht, l’État fait peser sur les négociateurs un certain nombre de contraintes, visant par là un retour à l’équilibre des comptes. » (247)
Selon M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral « emploi-chômage-formation » de CGT-FO : « On dit aux partenaires sociaux qu’ils sont libres de leur gestion et qu’il leur revient de déterminer collectivement, à travers un accord, les paramètres de l’indemnisation. Mais lorsque l’endettement cumulé menace d’atteindre 27 milliards d’euros, on comprend que l’exécutif, quel qu’il soit, ait intérêt à ce qu’un accord soit trouvé, plutôt que de “reprendre le bébé”. À cet égard, je rappelle qu’en 2008, l’assurance chômage était sur le point de revenir à l’excédent et qu’un courrier de François Fillon, alors Premier ministre, nous a enjoints de verser une partie des cotisations du régime à la caisse de retraite. Le système paritaire est ainsi constamment confronté à des demandes qu’il n’est pas en mesure de supporter. » (248)
Pour M. Éric Aubin, entendu lors de la table ronde des négociateurs des conventions AGIRC-ARRCO : « La question de l’endettement de l’Unédic et de Pôle emploi doit être remise en perspective dans le cadre d’une réflexion sur le service public de l’emploi. La France lui consacre deux fois moins de part de son produit intérieur brut (PIB) que nos partenaires nordiques notamment. » (249)
• … alors que l’assurance chômage est entrée dans le champ concurrentiel de la libre prestation d’assurance
La réforme de 2008 devait attribuer l’indemnisation du chômage au service public de l’emploi pour prévenir la contestation du monopole juridique d’assurance confié par les partenaires sociaux à une institution paritaire alors que ces institutions relèvent du champ concurrentiel de l’assurance, défini par la directive européenne 92-49 du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.
Mutuelles, institutions paritaires et sociétés commerciales d’assurance seraient fondées à proposer des contrats d’assurance chômage individuels et collectifs concurrents si le titre II du livre IV du code du travail n’avait substitué à l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi un droit légal à un revenu de remplacement à l’assurance collective contre le chômage.
Le code pouvait ensuite étendre ce droit aux salariés dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement alors que leur chômage ne peut être qualifié d’involontaire.
L’article L.5421-2 du code du travail précise toutefois que ce revenu prend trois formes : celle d’une allocation d’assurance, celle d’allocations de solidarité et celle d’allocations et d’indemnités régies par des régimes particuliers.
La première, attribuée par une convention collective étendue, devait être attribuée, selon la jurisprudence de la CJUE, à un opérateur désigné selon une procédure publique, équivalente à une passation de marché public, ou de nature législative, comme celle par laquelle l’article L.5312-1 du code du travail a confié la négociation et la liquidation personnelle des demandes d’indemnisation à Pôle Emploi.
iii. Le service public de l’emploi doit désormais concilier la prévention du chômage et du paupérisme avec le service d’une assurance contributive
• Le partage des garanties de revenu du travail entre une assurance contributive et une aide publique aux plus démunis reste débattu
Alors que la prévention obligatoire et personnalisée du risque, instaurée en 2001 et la segmentation des indemnisations par les droits rechargeables, depuis 2014, n’ont pas rétabli l’équilibre des finances de l’Unédic, l’augmentation du nombre de salariés pauvres, provoquée soit par un chômage intermittent, soit par un travail à temps partiel, remet en débat le partage des garanties collectives de leurs revenus d’activité entre les trois formes d’indemnités définies par l’article L.5421-2 du code du travail et les aides fiscales telles que la prime d’activité.
Les disparités sectorielles concernant tant le niveau de salaire direct que la stabilité de l’emploi mettent à l’épreuve les solidarités interprofessionnelles, mais celles-ci sont jusqu’à présent préservées par les confédérations négociatrices alors qu’une situation inverse aurait pu prévaloir si l’attribution des indemnités de chômage avait été l’apanage de syndicats catégoriels. L’indemnisation du chômage de longue durée a pu ainsi être rendue dégressive pour les chômeurs assurés sans distinction de secteurs d’activité et de motif de licenciement.
Une modulation par branche des taux de cotisation, selon l’usage retenu pour la prévention des accidents du travail, pourrait néanmoins être négociée au même titre que les obligations personnelles imposées depuis 2001 aux chômeurs indemnisés. Même dans les secteurs qui pourraient financer sans déficit permanent une assurance chômage collective, l’étude économétrique des facteurs de risque, à des fins de prévention du risque et de réduction des coûts d’indemnisation, pourrait être faite par employeur comme elle l’est par salarié ou par poste de travail.
À rebours, l’allocation d’un revenu universel est évoquée puisque le service public de l’emploi peine à concilier le caractère contributif de l’assurance chômage avec la compensation publique des bas salaires, sans réserver l’indemnisation aux chômeurs par intermittence les plus qualifiés et les obligations coûteuses d’accompagnement ou de formation aux chômeurs de longue durée.
Dans ce cadre, M. Michel Guilbaud a souhaité que l’assurance chômage personnalisée et contributive soit davantage distinguée de la redistribution publique des revenus du travail : « Dans le cadre de la réflexion qui est en cours sur la légitimité des partenaires sociaux à définir les règles et sur l’origine du financement – fiscalité ou cotisation sociale –, nous pensons que la distinction entre des droits contributifs, sur le modèle assurantiel, et des droits universels financés par l’impôt doit être prise en compte. C’est ce qui s’est passé dans les régimes de protection sociale d’autres pays, et la plupart des rapports semblent aller en ce sens […]
« Sur l’assurance-chômage, nous sommes très préoccupés de voir que les problèmes financiers deviennent de plus en plus structurels. Nous pouvons réfléchir au fait que l’assurance-chômage est un régime plus ou moins universel selon ce que nous lui demandons de faire. Vu les responsabilités qui sont les nôtres, le rendez-vous est devant nous, mais nous ne pensons pas du tout que le tripartisme va nous rendre plus responsables. Ce n’est pas ce que nous avons constaté dans le passé : quand l’État intervient, c’est plutôt déresponsabilisant et notre expérience n’a pas montré que cela aboutissait à des décisions plus fortes et plus courageuses pour répondre aux problèmes structurels. L’intervention de l’État ajoute une dimension politique liée au contexte de la négociation en cours, mais n’améliore pas l’efficience de la gestion et ni la définition des grands paramètres des régimes dont nous sommes responsables. » (250)
Pour Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, « L’assurance chômage devra évidemment être mise en cohérence avec les minima sociaux. Le métier de l’assurance chômage aujourd’hui consiste à indemniser la perte de revenus et non à procurer un revenu minimum en toutes circonstances. J’excepte les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d’assurance chômage, dont les règles sortent de la logique de l’assurance chômage pour garantir un revenu minimal à tous les bénéficiaires, […] quelle que soit la quantité d’heures travaillées. Cela a abouti à déresponsabiliser les entreprises en les exonérant de leurs obligations en matière d’emploi ou de formation, évolution que, depuis des années, personne ne parvient à endiguer. C’est précisément ce modèle que nous refusons. » (251)
M. Philippe Louis a cependant rappelé que l’indemnisation du chômage concernait la part de la population active la plus exposée à la précarité des emplois : « Aujourd’hui, nous avons 10 % de demandeurs d’emploi et 24 millions de salariés. Sur ces 24 millions, 12 millions ne connaîtront jamais le chômage parce qu’ils sont fonctionnaires ou salariés dans de grandes entreprises.
« Sur les 12 millions restants, 6 millions travaillent dans des entreprises où, même si ce ne sont pas de grandes entreprises, les CDI sont relativement solides. Ce sont des PME qui marchent bien et qui investissent. Si ces salariés connaissent un jour le chômage, ils retrouveront facilement du travail au bout de six mois, un an maximum, parce qu’ils auront été formés tout au long de leur carrière.
« Restent 6 millions de personnes pour lesquelles il n’existe plus d’emplois, et qui se retrouvent à supporter les 10 % de chômage que nous connaissons aujourd’hui, ou les 5 % en période de plein-emploi. Quel espoir peut-on donner à ces gens-là ? Si l’on part du principe que l’on doit travailler quarante-trois ans, qu’il y a 10 % de chômeurs et 24 millions de salariés, cela veut dire que, sur une carrière de quarante-trois ans, chacun va passer 10 % de son temps au chômage, soit quatre ans.
« Quatre ans, cela pourrait être une période permettant de se former, garder ses enfants ou travailler pour une association, mais il faudrait que ce soit réparti sur les 24 millions de salariés. Or ce n’est pas le cas puisque 12 millions d’entre eux ne seront jamais au chômage – ce qui veut dire qu’il ne s’agit plus pour ces 6 millions de personnes de passer 10 %, mais 20 % de son temps au chômage, soit huit années.
« Mais en fait, ce sont les 6 millions les plus défavorisés, c’est-à-dire les “mal formés”, les “mal accompagnés”, qui supportent à eux seuls le volume correspondant à un taux global de 10 % du chômage, soit pratiquement douze années de leur carrière. Douze ans sur quarante-trois ! Je vous laisse imaginer la perspective pour ces 6 millions de personnes… Cela n’est plus admissible. » (252)
• L’intervention de l’État dans la négociation paritaire de l’assurance chômage est apparue aussi fréquente que disputée
Loin de stabiliser le régime d’assurance chômage, la refondation du paritarisme et l’activation des dépenses d’indemnisation, engagées depuis 2001, rendent permanentes les négociations tripartites d’une convention d’assurance chômage qui doit prévenir et indemniser un risque de moins en moins aléatoire.
Tant que l’assurance chômage est indifférente aux disparités interprofessionnelles comme aux facteurs personnels de risque, les partenaires sociaux ont toute légitimité à la régler. La négociation paritaire des transferts indemnitaires entre entreprises concurrentes, entre secteurs d’activité comme entre catégories sociales de salariés appelle en revanche des interventions de l’État.
Les représentants syndicaux des assurés, qu’ils soient ou non parties à la négociation, sollicitent d’ailleurs ces interventions lorsque l’arbitrage paritaire annoncé leur paraît défavorable. Et si l’État ne répond pas à leurs instances et agrée la convention négociée, ils peuvent ensuite saisir la juridiction administrative d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté d’agrément de la convention d’assurance conclue.
Le Conseil d’État, réserve faite des prérogatives de la juridiction judiciaire en matière de droit du travail, s’autorise d’ailleurs à statuer sur la forme mais aussi sur le fond des dispositions conventionnelles. Il a annulé cinq arrêtés d’agrément depuis 2000, entrant davantage dans le détail des dispositions agréées pour en apprécier la légalité à l’égard des compétences déléguées aux partenaires sociaux mais aussi l’équité assurantielle à l’égard du droit européen des assurés à réparation du préjudice subi.
M. Jean-Claude Mailly estimait cependant, lors de son audition, que l’assurance chômage était tout autant victime d’une politique économique rigide que des interventions des syndicats catégoriels et des pouvoirs publics qui traversent les négociations : « Ces derniers jouent un rôle à travers Pôle emploi, donnent une délégation aux interlocuteurs sociaux, et ils ne facilitent pas toujours les choses, comme nous le voyons dans le cas des intermittents du spectacle. Les négociations interprofessionnelles qui se tiennent en ce moment doivent aboutir à la fixation d’une enveloppe et d’une trajectoire financières.
« Fidèles à notre conception du paritarisme, nous n’avons pas signé la lettre de cadrage financier lors de la négociation interprofessionnelle. Suite à l’accord intervenu à l’issue du dernier conflit, le Gouvernement a décidé de financer le différé d’indemnisation à hauteur de 85 millions d’euros.
« À juste titre, l’État indique qu’il veut mettre cet argent dans un fonds dédié à l’emploi des intermittents. Ce système me paraît bon. Nous étions donc prêts à assumer l’économie équivalente pendant deux ans dans le régime des intermittents, pour un montant estimé à une centaine de millions d’euros.
« Mais la lettre de cadrage fait état de 185 millions d’euros d’économies, 85 millions d’euros étant réclamés à l’État. Il faudrait que nos interlocuteurs du patronat sachent ce qu’est le paritarisme : dans un tel système, on assume ses responsabilités et on ne va pas chercher l’argent des pouvoirs publics. Nous ne voulons pas réclamer 85 millions d’euros à l’État pour le financement du régime d’assurance chômage des intermittents. C’est à nous de gérer le problème. » (253)
Au cours de la table ronde syndicale des négociateurs de l’Unédic, M. Stéphane Lardy a reconnu que « Le chômage de masse influe sur nos relations avec l’État et le Parlement. Dès lors, les négociations sont rendues très difficiles, et les prochaines discussions relatives à l’assurance chômage ne pourront qu’être encore plus complexes que les précédentes. De fait, le régime de l’assurance chômage est particulièrement sensible à la conjoncture économique en entrées – soit en cotisations – et en sorties – soit en indemnisations –, et son déficit ne peut aujourd’hui que s’aggraver. Cela n’est pas le cas pour le régime des retraites complémentaires, qui n’est très sensible qu’aux entrées. » (254)
M. Éric Aubin a ajouté que « Pour ce qui est de la place de l’État dans le paritarisme, nous sommes confrontés à un vrai problème. Dans le cadre de la négociation de la convention Unédic, notamment, c’est l’État qui détermine les objectifs budgétaires à atteindre avant même que les discussions aient commencé. La dernière fois, il nous a été demandé de réaliser 800 millions d’euros d’économies, et nous les avons atteints. Cette fois, la demande sera la même ; à nous de répartir les restrictions entre l’indemnisation et d’autres postes. Il ne peut y avoir pires conditions pour commencer les négociations. J’entends bien que le budget de la nation est voté par le Parlement, mais comment faire pour que la négociation ne soit pas contrainte par ces décisions ? » (255)
Pour Mme Véronique Descacq, « L’État intervient dans le cadre de la négociation collective à deux niveaux différents, soit directement, soit à des fins d’articulation. Cette deuxième possibilité est tout à fait légitime s’agissant de la négociation de l’assurance chômage, puisque la convention doit faire l’objet d’un agrément. Ce mécanisme juridique n’est contesté par personne. D’autres articulations existent : le contrôle de légalité au moment de l’agrément, la vérification de la faisabilité pour Pôle emploi, entre autres […]
« L’État n’a pas à intervenir sur le fond des accords politiques, et nous sommes attachés à cette autonomie. Il est vrai que certaines déclarations de ministres pourraient passer pour de l’intervention. Pour ma part, je considère qu’elles ont un caractère de communication plutôt qu’un réel poids sur la négociation. Elles participent tellement de la communication qu’elles se contredisent parfois. Ce peut être Bercy qui fait état de contraintes financières majeures à respecter, évoquant parfois des engagements pris auprès de Bruxelles qui ne sauraient lier les négociateurs ; mais ce peut aussi être le ministère de la Culture qui nous demande, au contraire, de préserver certains champs de l’assurance chômage, ou encore le ministère du Travail, susceptible d’intervenir sur d’autres sujets. » (256)
Pour la DGEFP, M. Hervé Léost a précisé que la procédure d’agrément des conventions de chômage « emporte plusieurs interventions de l’État, en aval ou en amont de la négociation, mais aussi un suivi précis de la progression de celle-ci.
« En amont de la négociation, et cela a été évoqué ce matin, le ministre peut faire des déclarations publiques ; il peut aussi communiquer des documents d’orientation. En 2013, la négociation de l’accord national interprofessionnel, qui portait sur l’emploi de façon plus générale, avait été précédée par un tel document, lequel concernait des sujets relatifs à l’assurance chômage, notamment la modulation des contributions en fonction de la nature des contrats. Ce document avait été pris en compte dans la négociation de l’ANI, qui avait abouti à la loi de sécurisation de l’emploi ainsi que dans la convention qui a suivi.
« Des réunions officielles ou de grandes conférences peuvent aussi être convoquées, ce qui fut le cas en 2007 avec la grande conférence relative à l’emploi et au pouvoir d’achat, dont certains thèmes touchaient à l’assurance chômage. Toujours dans le cadre de l’amont de la négociation, l’État doit remettre à la fois aux partenaires sociaux et au Parlement, un rapport sur la situation de l’assurance chômage, établi sur la base d’un document élaboré par l’Unédic.
« La négociation fait l’objet d’un suivi le plus précis possible, l’objectif étant d’anticiper sur l’agrément à venir. Lors de la conclusion de l’ANI – qui, une fois conclu, devait être traduit dans la convention –, des échanges ont eu lieu entre la DGEFP et l’Unédic afin de préparer l’agrément et détecter des risques potentiels portant sur la légalité de la future convention.
« Les échanges sont très nombreux en aval de la négociation, tant avec l’Unédic qu’avec Pôle emploi, au sujet de difficultés opérationnelles susceptibles de se présenter. Celles-ci peuvent conduire à la conclusion d’avenants à la convention ou alimenter la préparation de la négociation à venir. Des échanges techniques très nourris permettent aussi de repérer des problèmes de nature à gêner la mise en œuvre de la convention. » (257)
• Les conditions matérielles de la négociation paritaire et le rôle dévolu à l’Unédic dans cette négociation sont aussi discutés
Une convention privilégie les parties qui l’adoptent au détriment des tiers, fussent-ils parties aux négociations, et lorsque celles-ci portent sur des budgets élevés et affectent des catégories nombreuses d’assurés, elles peuvent susciter des tensions entre les confédérations qui les conduisent comme, en leur sein, entre les négociateurs et les gestionnaires. L’ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme n’a pas fixé de règles générales sur les conditions matérielles de ces négociations.
En revanche, dans un arrêt du 11 mai 2004, le Conseil d’État avait rappelé que les partenaires sociaux ne pouvaient pas renvoyer à la commission paritaire nationale, composée de représentants des seules organisations signataires de la convention, le soin de définir des règles complétant la convention.
Le rôle de l’Unédic dans les négociations a été abordé à plusieurs reprises. Depuis la réforme de 2008, cette association n’est plus l’instance d’agrément d’un réseau territorial de caisses d’assurances mais le syndic des signataires de la convention, leur conseil, leur actuaire et la chambre de garantie de la trésorerie de l’assurance chômage. Au cours de son audition, Mme Patricia Ferrand, présidente de l’Unédic, avait expliqué le rôle dévolu à l’institution paritaire dans les négociations de la convention : « L’accord national interprofessionnel sur la modernisation du paritarisme du 17 février 2012 a été l’occasion pour les partenaires sociaux de rappeler les objectifs fixés à l’organisme paritaire. Il s’agit en particulier de faciliter la négociation, d’assurer la transparence de la gouvernance et de la gestion, de garantir la qualité du service rendu en procédant notamment à une évaluation régulière, et de développer les compétences des mandataires.
« S’agissant du premier objectif que j’ai cité, faciliter la négociation, l’Unédic intervient en amont, pendant et après la négociation, aussi bien dans la mise en œuvre que dans l’évaluation. Nous avons souhaité, dès 2012, renforcer le rôle et l’action de l’Unédic auprès des partenaires sociaux. La qualité de la négociation nécessite en particulier que ceux-ci disposent d’un diagnostic sur les questions qu’ils ont à résoudre et la mise en œuvre des décisions qu’ils souhaitent prendre. Cette mission a été confiée à l’Unédic.
« Le bureau est amené très régulièrement à partager les analyses que réalisent les services de l’Unédic sur le fonctionnement du marché du travail, la perception des dispositifs d’assurance chômage par les bénéficiaires et les difficultés opérationnelles que peuvent poser certaines décisions. Ces analyses opérationnelles sont généralement conduites en lien avec Pôle emploi et les organisations de recouvrement, et l’ensemble des travaux sont portés à la connaissance des négociateurs, le plus souvent par le biais d’un organe appelé le groupe paritaire politique.
« L’Unédic intervient également en appui de chacune des organisations qui la composent et prennent part à la négociation. Chacune d’elles peut demander à ses services d’évaluer les conséquences juridiques, opérationnelles ou financières de nouvelles dispositions qu’elles envisagent. Il revient à chacune des organisations de porter les résultats de ces travaux à la connaissance des autres organisations dans le cadre de la négociation.
« La négociation elle-même comporte deux temps. Dans un premier temps, les négociateurs s’entendent sur un accord politique, qui prend la forme d’un accord national interprofessionnel. Le dernier en date est l’accord du 21 mars 2014. Cet accord politique doit être ensuite transcrit dans un texte juridique. C’est le rôle de l’Unédic de rédiger ce texte, mais cela donne lieu à une nouvelle négociation, dans la mesure où les dispositions politiques générales ne sont pas toujours très précises. C’est ce qui a eu lieu lors de la dernière négociation, notamment sur la condition de mise en œuvre des droits rechargeables pour les anciens « alternés ». La sécurisation des textes passe également par des échanges avec l’État et Pôle emploi. » (258)
Lors de la table ronde des négociateurs Unédic, M. Stéphane Lardy avait cependant estimé que : « Lors de la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC, l’Unédic a perdu beaucoup d’expertise. Elle en a recouvré une grande partie et cela est sensible dans le suivi des conventions. Elle a reconstitué un service de l’évaluation et de la statistique qui travaille en bonne intelligence avec les services de l’État et Pôle emploi. Il nous est d’une aide précieuse dans les négociations. » (259)
S’agissant de la désignation des négociateurs par les confédérations qu’ils représentent, Mme Patricia Ferrand soulignait que « Un des points clés de la réussite de l’Unédic s’agissant du paritarisme, tient à la très grande proximité entre les gestionnaires et les négociateurs qui, forts de leur légitimité et de leur connaissance des réalités du terrain, sont les décideurs politiques. Cela nous permet d’être très réactifs, c’est-à-dire à la fois de transmettre le sens des décisions prises sans le dénaturer – tel est notre objectif premier – et, si des difficultés opérationnelles émergent, de réajuster les décisions, toujours en coordination avec les négociateurs. » (260)
Mme Véronique Descacq rappelait toutefois, lors de la table ronde des négociateurs de l’Unédic, la nécessité de maintenir une séparation entre les négociateurs des gestionnaires qui évite de confondre les intérêts : « Il importe que ce ne soit pas les mêmes personnes qui interviennent dans ces deux activités. L’idée nous est souvent opposée que la compétence de gestion prédispose à la compétence de négociation. Nous considérons cependant que ce que nous défendons dans la négociation, ce sont les aspirations des salariés et des entreprises. Autant des gestionnaires peuvent faire partie de la délégation qui négocie, autant ils ne peuvent pas en être les chefs de file. Nous avions demandé que cette distinction soit inscrite dans l’accord de 2012. L’histoire a montré, hélas ! que les impératifs de la gestion peuvent parfois l’emporter sur les objectifs politiques de la négociation. » (261)
L’accès des négociateurs à la documentation des scénarios actuariels d’indemnisation établie par les services de l’Unédic a été évoqué par les confédérations qui ne sont pas signataires de la convention d’assurance : elles estiment que les signataires ont un accès privilégié à l’information prospective. Plus largement, M. Éric Aubin a dénoncé le fait que, « Au fil du temps, nous constatons que les organisations refusant de signer tel ou tel accord sont frappées d’ostracisme. Nous revendiquons le droit d’être signataires ou non et de ne pas, à ce titre, être tenus écartés des négociations. Si le phénomène n’est pas nouveau, il est de plus en plus fréquent, ce qui est incompatible avec l’esprit de la démocratie sociale. » (262)
Me Michel Henry est revenu sur les conditions dans lesquelles la négociation paritaire se déroule et a souhaité que la méthode de négociation soit précisée et clarifiée : « Quand on signe, on gère ensuite. C’est le mécanisme binaire actuel. Et ceux qui gèrent organisent la négociation suivante. Par conséquent, le système a tendance à se pérenniser : le projet suivant est préparé entre les deux partenaires qui gèrent, et l’on aboutit à la situation que nous avons connue. Les deux partenaires sont d’accord sur un texte et ne souhaitent pas le négocier, ils disparaissent toute une après-midi dans les étages parce qu’il y a quelques points résiduels de désaccord avant de réapparaître à minuit moins dix avec le texte définitif, dont il n’est pas question de modifier un mot.
« Force Ouvrière a dit : “Plus jamais ça !” La CGT a intenté un procès, qui a abouti à la décision du Conseil d’État que vous connaissez. Lors de la précédente négociation de l’assurance-chômage, la question centrale de la loyauté de la négociation avait déjà été soulevée. Quand on concède autant de pouvoirs, dans un monde syndical tel que nous le connaissons, il faut fixer des règles, soit par un accord de méthode, comme le propose Jacques Barthélémy, soit par une réglementation très stricte des conditions de la négociation […]
« Il est très difficile d’imposer un comportement aux partenaires sociaux dans la négociation. Mais on peut prévoir que les partenaires sociaux qui ont des propositions alternatives à formuler disposent des mêmes moyens pour examiner le coût de ces mesures, afin de permettre de les comparer au coût de celles qui figurent dans le projet qui leur est présenté et qui a fait l’objet d’un préconsensus entre certaines organisations syndicales et patronales.
« C’est ce qui a beaucoup fait défaut à la CGT et à FO : à aucun moment ils n’ont pu avoir accès aux ordinateurs de l’Unedic pour faire des états comparés, profession par profession, catégorie par catégorie, problème par problème, avantage par avantage, et savoir en quoi les options proposées changeraient les équilibres respectifs.
« Il y a là la matière d’un vrai travail. Il pourrait s’inspirer des lois les plus récentes sur la négociation collective, en particulier les négociations annuelles obligatoires, ainsi que de la jurisprudence assez précise de la Cour de cassation, afin de fixer des règles du jeu. Compte tenu des enjeux et de l’importance de ce que l’État délègue aux partenaires sociaux, et des fonds colossaux qui sont en cause, nous sommes en droit d’exiger que les textes soient élaborés dans des conditions normales de transparence et de loyauté. » (263)
• Une seconde négociation, pour l’application de la convention par le service public de l’emploi réunit l’Unédic, l’État et Pôle Emploi
La convention conclue par les partenaires sociaux n’est qu’une des pièces de l’écheveau juridique, régalien et conventionnel, qui lie désormais l’assurance paritaire au service public de l’emploi.
Lors de son audition par la mission d’information, M. Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, a souligné l’incidence sur le service public de l’emploi de la convention tripartite conclue entre son établissement, sa tutelle et l’Unédic pour l’exécution de la convention d’assurance chômage, en expliquant qu’elle justifiait l’implication de Pôle Emploi dans la phase préparatoire des négociations de l’assurance chômage : « Nous nous sommes permis d’aller au-delà des quelques mesures de simplification pour développer quelques sujets de fond. L’évolution est nette : il y a quelques années, c’est à peine si nous avions le droit de prononcer le mot « assurance chômage » ; aujourd’hui, on nous accepte pour faire valoir notre point de vue en matière de simplification et de mise en œuvre de la réglementation. » (264)
M. Jean-Michel Pottier, vice-président, chargé des affaires sociales, de la CGPME, s’est montré réservé quant à cet aspect, préférant sans doute que Pôle emploi se consacre à améliorer la qualité des services délivrés dans le cadre de son cœur de métier : « Le regroupement de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et de l’Unédic, auquel nous nous sommes toujours opposés, a accouché d’un monstre. Étant moi-même administrateur de Pôle Emploi, je mesure mes propos et pourrais vous citer les propositions concrètes qu’a modestement formulées la CGPME par mon intermédiaire en vue d’améliorer la gestion de l’établissement et de faire en sorte qu’il s’adapte aux réalités du terrain […]
« Je me suis battu pendant quatre ans pour expliquer au conseil d’administration de Pôle Emploi que c’est dans les TPE et PME que se crée l’emploi. Il y a trois ans, lorsqu’on s’est enfin décidé à lancer une phase de tests pour vérifier la véracité de mon propos, on s’est aperçu que 51 % des déclarations préalables à l’embauche étaient faites par des entreprises de moins de dix salariés – secteur dont Pôle Emploi ignorait jusqu’à l’existence […]
« Pôle Emploi est une instance hybride ne fonctionnant pas de manière concertée puisqu’elle regroupe quatre parties prenantes : l’État, cinq organisations représentatives des salariés, cinq organisations représentatives du patronat, des personnalités qualifiées et des représentants des territoires régionaux et départementaux.
« Les marges de manœuvre de l’organisme sont limitées dans la mesure où celui-ci est sous le contrôle non seulement de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) mais aussi de Bercy : le ministère des finances cherche toujours à mettre l’organisme “au ras des pâquerettes” et serait fort satisfait si la trésorerie de ce dernier pouvait être négative.
« La dotation de l’État, qui représente moins d’un tiers du budget de Pôle Emploi, a très peu évolué ; les partenaires sociaux, avec une fraction des cotisations d’assurance-chômage, assurent le fonctionnement de la structure. La marge d’ajustement disponible est minime, car les frais de fonctionnement sont incompressibles, Pôle Emploi recourant à 50 000 collaborateurs et devant garantir une indispensable présence territoriale. Le service de l’indemnisation est très bien rendu, mais cette marge d’ajustement porte sur l’accompagnement et, surtout, la formation des demandeurs d’emploi. » (265)
Lors de la table ronde des syndicats d’employeurs, M. Jean-François Pilliard a également estimé que l’Unédic était légitime à formaliser quelques exigences quant au fonctionnement de Pôle emploi : « L’Unédic finance Pôle emploi pour deux tiers ; autrement dit les partenaires sociaux apportent 3,5 milliards d’euros dans le fonctionnement de Pôle emploi à travers les cotisations des salariés et des employeurs. Aujourd’hui, la façon dont le système fonctionne aboutit cependant à une sorte de déséquilibre : alors que nous sommes les principaux “actionnaires”, c’est l’État qui joue un rôle prédominant dans le pilotage. » (266)
Le 22 octobre, il avait estimé que l’Unédic était « en droit d’être exigeants sur les résultats, d’une part, parce qu’il s’agit de rendre un service aux chômeurs et, d’autre part, parce que la fusion a entraîné pour la collectivité nationale, c’est-à-dire pour le contribuable, un coût annuel supplémentaire d’environ 400 millions d’euros par rapport à la situation antérieure. Car, au moment de la fusion, rappelons-le, les statuts ont été harmonisés par le haut. C’était un choix politique, mais il n’est pas anecdotique. Lorsque l’on paie un tel prix en amont, on est en droit d’attendre, en retour, une efficacité accrue. »
Comme en réponse à cette interpellation, M. Jean Bassères a souligné devant la mission l’ampleur des évolutions engagées à Pôle emploi pour en faire un opérateur des partenaires sociaux au même titre qu’il est opérateur de l’État : « J’aimerais insister sur le fait que Pôle emploi fait un peu figure de chauve-souris au regard du paritarisme. Nous ne sommes pas un organisme paritaire au sens où peuvent l’être l’Unédic ou les organismes de gestion des retraites complémentaires, mais les partenaires sociaux jouent un rôle important dans notre organisation puisqu’ils sont majoritaires au conseil d’administration. […] La place majoritaire des partenaires sociaux est d’autant plus prégnante que certaines décisions, notamment le budget, doivent être adoptées à une majorité des deux tiers. Ils sont donc directement impliqués dans la détermination des orientations stratégiques et dans leur exécution. D’un point de vue juridique, Pôle emploi est un opérateur de l’État et sans doute l’État considère-t-il Pôle emploi comme son opérateur à part entière. Il nous appartient de faire comprendre que Pôle emploi est aussi l’opérateur des partenaires sociaux. Des évolutions fortes se sont produites : il n’y a plus de délibérations dont la validité serait strictement conditionnée à leur approbation par le Gouvernement, comme du temps de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). Le conseil d’administration a la capacité d’intervenir, il peut même mettre fin aux fonctions du directeur général à une majorité des deux tiers – des projets en ce sens sont peut-être en cours, mais je ne suis pas au courant…
« Le livre que mon prédécesseur, M. Christian Charpy, a consacré à son expérience comporte un chapitre intitulé “Dans l’arène du conseil d’administration”. Cela témoigne du fait que Pôle emploi avait été construit sans soutien des partenaires sociaux présents au conseil d’administration, lequel était davantage un lieu d’affrontements que de convergences. Grâce au talent de l’actuel président du conseil d’administration, M. François Nogué, nous avons réussi à bâtir un conseil de nature complètement différente en lui imprimant deux évolutions décisives.
« La loi prévoit l’existence de deux comités : un comité d’audit et un comité d’évaluation. Nous avons créé un comité stratégique qui a fusionné avec le comité d’évaluation. Dans cette instance extrêmement vivante, présidée par un membre du conseil d’administration – en l’occurrence Mme Patricia Ferrand, de la CFDT –, nous discutons de tous les projets importants avant qu’ils ne soient soumis à la délibération du conseil d’administration.
« Par ailleurs, nous organisons avec tous les membres du conseil d’administration des séminaires qui contribuent à créer un sentiment d’appartenance. Depuis la création de Pôle emploi, trois se sont tenus : le premier avait pour thème le premier plan stratégique “Pôle emploi 2015” ; le deuxième était consacré à Pôle emploi à un horizon de dix ans ; le troisième préparait la discussion de la dernière convention tripartite avec l’État et l’Unédic. Un quatrième est prévu au mois de mai. » (267)
• La place prise par les régions dans le service public de l’emploi ajoute à la complexité des « tutelles »
« Dès lors que vous avez autour de la table les organisations syndicales, les organisations patronales, les régions et l’État, il devient difficile de faire vivre la gouvernance de façon active. » À entendre le diagnostic formulé par M. Jean-François Pilliard sur la base de son expérience de huit années passées à la présidence de l’AFPA, il semble que la multiplication des acteurs – qui portent chacun des intérêts et points de vue légitimes – ne favorise guère l’efficacité du service public de l’emploi.
Pourtant, pour concilier les politiques publiques et paritaire de l’emploi, nationale et régionales, la loi du 5 mars 2014, reprenant les dispositions sur la gouvernance d’un accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, a inséré dans le code du travail un chapitre de coordination.
Ce chapitre double le comité national et les comités régionaux d’emploi et de formation, installés auprès des exécutifs politiques, d’un comité paritaire interprofessionnel national (COPANEF) et de comités paritaires régionaux (COPAREF) pour l’emploi et la formation, qui remplacent des commissions paritaires interprofessionnelles pour l’emploi. Mais il ne s’agit encore que d’instances consultatives ou de contrôle et non des instances permanentes de négociation des conventions d’emploi et de formation, comparables aux commissions paritaires mixtes qui négocient les conventions collectives du droit du travail.
Cette évolution n’a pas suffi pour convaincre M. Pierre Ferracci de revenir sur l’opinion tranchée – mais argumentée – dont il a fait part à la mission, quant à la confusion caractérisant la gouvernance du service public de l’emploi, qui pèse sur son efficacité : « Le fonctionnement du paritarisme aujourd’hui montre qu’une confusion similaire existe dans les organismes paritaires, quant aux compétences respectives de l’État et des partenaires sociaux et quant aux nouveaux équilibres entre l’État et les régions associés aux enjeux de la décentralisation. L’Unédic, la formation professionnelle et Pôle emploi en sont de bons exemples. L’Unédic est un organisme paritaire. Pôle emploi est un service public, dont le directeur général est nommé par l’État en conseil des ministres, mais les partenaires sociaux sont majoritaires au sein de son conseil d’administration […]. Résultat : la gouvernance est compliquée et confuse. D’abord, le conseil d’administration – en tout cas sa majorité – ne désigne pas le directeur général. Ensuite, sur des enjeux comme celui de la formation professionnelle, il y a un débat de fond sur le rôle respectif de l’État, des régions et des partenaires sociaux au travers de Pôle emploi pour les uns ou de l’Unédic pour les autres.
« Cette confusion nuit à l’efficacité, ce qui est dommage en période de crise et de chômage élevé. Les régions jouent un rôle prépondérant dans le domaine de la formation professionnelle – en tout cas celle des jeunes et des demandeurs d’emploi – et de l’orientation depuis le développement des services régionaux d’orientation. En revanche, l’accompagnement dans la recherche d’emploi est un service public national qui n’a d’ailleurs pas toujours été aussi déconcentré qu’il l’aurait fallu. Du coup, les partenaires sociaux contestent. Lors de l’annonce du plan de formation de 500 000 chômeurs, la CFDT a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que Pôle emploi soit régionalisé. Est-ce que ça veut dire déconcentré ou décentralisé ? À mon avis, la CFDT voulait dire qu’elle ne souhaitait pas que les régions prennent la main. Dans le même temps, elle rappelait que les partenaires sociaux, par l’intermédiaire de l’Unédic, financent l’essentiel du budget de Pôle emploi […]
« Actuellement, les régions jouent un rôle, donnent un avis, sont entendues. Pour autant, et c’est à mon avis assez symptomatique, nous ne parvenons pas à trouver la gouvernance qui mette chacun à la bonne place. Le dispositif concernant les demandeurs d’emploi est sans doute trop complexe : les partenaires sociaux s’occupent de l’indemnisation au travers de l’Unédic ; l’État s’occupe de l’accompagnement via Pôle emploi, et les régions s’occupent de l’orientation et de la formation. La coordination est une bonne chose, et je trouve que beaucoup d’efforts ont été faits dans ce domaine ces derniers temps, mais peut-être faudrait-il aller un peu plus loin. » (268)
D’ailleurs, interrogé par M. Pascal Demarthe, député, sur l’initiative « Proch’emploi » lancée par le président de la région des Hauts de France, destinée à rapprocher les chômeurs d’offres d’emploi non pourvues, M. Jean Bassères a fait valoir les considérations suivantes : « S’agissant de Proch’emploi, j’ai dit, depuis le début, que je ne comprenais pas la logique de ce dispositif. C’est, ni plus ni moins, un Pôle emploi bis. S’il s’agit de doublonner, alors il faut assumer le fait qu’il y ait des doublons. Une chose me gêne tout particulièrement : les rendez-vous avec les demandeurs d’emploi seront assurés par le personnel de la région ; or, selon moi, on ne peut s’improviser conseiller à l’emploi du jour au lendemain : c’est un véritable métier.
« Cela étant, qu’une personne trouve un emploi grâce à Proch’emploi ou à Pôle emploi, cela me fera toujours plaisir. Nous jugerons des dispositifs à leur efficacité respective – à moyens identiques car la clef de l’accompagnement est le temps consacré aux individus. Nous devons travailler avec Proch’emploi : il y a des articulations à trouver avec Pôle emploi et il serait sans doute bon de mettre l’accent sur la formation. » (269)
En contrepoint, M. Henri Rouilleau a néanmoins relevé l’intérêt d’une gouvernance multipartite, tout en évoquant discrètement les inconvénients d’un foisonnement certain : « Ces structures se développent de plus en plus – je pense aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour l’emploi (COPIRE), puis aux comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation professionnelle (COPAREF). Certaines sont redondantes et justifient une simplification du système, mais le quadripartisme est indispensable sur certains sujets. » (270)
En définitive, dès lors qu’il s’agit de la situation des salariés, le jeu (de l’emploi) vaut bien la chandelle (de la complexité), a estimé M. Michel Guilbaud : « Le compte personnel de formation permet aujourd’hui aux partenaires d’entrer dans le jeu, aux côtés des collectivités locales. Nous avons réclamé d’exercer une coresponsabilité, qui s’est traduite par le COPANEF (comité interprofessionnel pour l’emploi et la formation) et les COPAREF (comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation professionnelle). Cela peut sembler de la tuyauterie, mais c’est là que se joue l’enjeu du devenir des salariés, de leur transition professionnelle, et si l’on veut bouger sur le marché du travail, c’est par là que nous y arriverons. » (271)
Une gouvernance coordonnée suppose aussi que la division catégorielle du service public de l’emploi reste limitée ; c’est le cas aujourd’hui puisqu’il ne compte pour l’heure que deux institutions paritaires catégorielles de placement : l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
• Deux institutions paritaires, l’Agefiph et l’APEC, conduisent des stratégies paritaires de placement autonomes
L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) est une association paritaire relevant de la loi du 1er juillet 1901, créée en 1954 et réformée en 1966 pour offrir, avec l’agrément de l’État, une bourse de placement aux cadres, financée par plus de 100 millions d’euros de cotisations obligatoires collectées par l’AGIRC. Intégrée dans le service public de l’emploi, l’APEC dispose de son propre réseau de comités paritaires régionaux et de délégations territoriales liées à Pôle Emploi par des conventions.
L’Agefiph est présentée dans les pages 226 à 233 du présent rapport.
3. La santé et la sécurité au travail
En matière de santé au travail, l’État a très tôt été associé aux initiatives des partenaires sociaux de sorte qu’il est difficile de parler de paritarisme « pur » dans ce domaine.
Une quinzaine d’années après la création, en juillet 1868, de deux caisses d’assurance sur la vie et contre les accidents du travail, la puissance publique est intervenue dès le 27 juin 1884, date à laquelle a été adoptée une loi sur l’assurance contre les accidents du travail complétée, quelques années plus tard, par la célèbre loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, qui a établi le principe de la responsabilité patronale en matière d’accidents du travail.
Bien plus tard, la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 portant organisation des services médicaux du travail a généralisé la médecine du travail à la majeure partie des salariés, mis sa gestion et les frais y afférant à la charge des employeurs et prévu le contrôle du service médical par le comité d’entreprise, tandis que la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a intégré la gestion du risque « AT/MP » à la Sécurité sociale.
Lors de son audition, le 28 janvier dernier, Mme Bénédicte Legrand-Jung, sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail au ministère du travail, a expliqué qu’« historiquement, la sécurité sociale s’est largement construite autour des questions d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; de fait, la branche AT-MP (accidents du travail – maladies professionnelles) de la CNAMTS s’appuie sur un paritarisme beaucoup plus poussé que celui des autres caisses de sécurité sociale, dont témoigne le rôle plus important dévolu en matière de prévention et de réparation des risques professionnels à l’instance de gouvernance qu’est la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et, à l’échelle régionale, aux caisses régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles. De même, l’Institut national de recherche et de sécurité, l’INRS, qui relève de la branche AT-MP, est un organisme très important en matière de prévention et d’expertise des risques professionnels. Le conseil d’administration de cette structure associative est strictement paritaire, et l’État y siège avec une voix uniquement consultative. Quant aux services de santé au travail, leur fonctionnement est désormais paritaire – même si la présidence demeure exclusivement patronale – depuis la réforme de 2011-2012 qui a renforcé le paritarisme de gestion dans ce réseau important, sachant qu’ils sont soumis au régime particulier de l’agrément de l’État. Ce fonctionnement paritaire se retrouve également dans d’autres organismes tels que l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, l’ANACT, et le réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail, les ARACT ».
S’il est vrai qu’en matière de santé et de sécurité au travail, le paritarisme est plus marqué que dans d’autres branches de la Sécurité sociale, on ne peut néanmoins que constater que ce paritarisme est à tout le moins « encadré », voire qu’il confine souvent au tripartisme.
Comme l’a expliqué M. Dominique Libault, « en matière de protection sociale, […le paritarisme…] est vu comme un instrument de pilotage des solidarités professionnelles, alors que l’État et la représentation nationale possèdent la légitimité en matière de solidarité nationale ». Toutefois, « il ne faut pas voir ces solidarités professionnelles comme des territoires. Il n’y a pas, d’un côté, la solidarité nationale et, de l’autre, le territoire des solidarités professionnelles et du paritarisme. Là encore, une bonne articulation est nécessaire. Le paritarisme s’incarne naturellement là où les risques sont plutôt de nature professionnelle, où le dialogue social permet d’améliorer les protections : revenu de remplacement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, etc. […] Il faudrait absolument éviter que l’un et l’autre soient gérés comme des territoires car il y a des interactions entre ces phénomènes. […] Il existe des liens avec la protection sociale obligatoire, notamment en matière de financement : on fait appel à des ressources, or il existe une politique globale des ressources issues des prélèvements obligatoires. Rappelons que l’État est comptable vis-à-vis de l’Union européenne de l’ensemble des finances publiques, et qu’il doit donc indiquer des orientations en matière de prélèvements obligatoires » (272).
a. Le paritarisme « encadré » de la branche AT-MP de la CNAMTS
Soulignant qu’« historiquement la sécurité sociale n’a jamais été paritaire » et que « l’étatisation était en germe dans les fonts baptismaux de la sécurité sociale », M. Éric Aubry a expliqué qu’à compter du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, qui a conféré à l’État le pouvoir d’agréer la nomination des directeurs de caisse de sécurité sociale, et de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale (dite « ordonnance Jeanneney », il ne fait plus de doute que « dans notre système de sécurité sociale, le paritarisme a toujours occupé un strapontin et l’État a toujours joué un rôle majeur » (273).
S’il est vrai que la gestion du risque professionnel a été intégrée à la Sécurité sociale depuis la loi du 30 octobre 1946 et s’il est vrai que le conseil de la CNAMTS est loin d’être purement paritaire (comme en témoigne la présence, en son sein, de commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget), il n’en demeure pas moins que les orientations de la branche AT-MP sont définies dans un cadre strictement paritaire au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (commission AT/MP) de la CNAMTS.
Il s’agit là de ce que M. Hervé Lanouzière a appelé « l’un des paradoxes français » : « d’une part, le droit de la santé et de la sécurité au travail est un droit régalien à l’extrême, puisque les règles imposées par le code du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ne se négocient pas (274) […] ; d’autre part, par tradition, la branche des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la caisse nationale d’assurance maladie qui pilote ces questions définit, de manière paritaire, les grandes orientations en matière de santé et de sécurité au travail » (275).
La commission AT/MP est en effet composée de dix membres titulaires et dix suppléants, qui représentent à parité employeurs et salariés et dont le mandat est de cinq ans renouvelable.
La commission AT/MP exerce les compétences du conseil de la CNAMTS en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sans avoir pour autant les fonctions d’un conseil d’administration. Elle a en charge l’équilibre financier de la branche AT/MP ainsi que la tarification, la réparation et la prévention des AT/MP. Elle se réunit tous les mois en séance ordinaire et travaille en séminaire sur les sujets clés de la prévention, de la tarification et de l’indemnisation. Dans ce cadre, elle détermine les orientations de la convention d’objectifs et de gestion de la branche AT-MP. Elle approuve par ailleurs les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNPATMP).
La commission AT/MP est assistée dans sa mission de prévention des risques professionnels par neuf comités techniques nationaux (CTN) représentant les différentes branches d’activité : métallurgie (CTN A), bâtiment et travaux publics (CTN B), industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication (CTN C), alimentation (CTN D), industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), industries du bois, de l’ameublement, du papier et du textile (CTN F), commerce non alimentaire (CTN G), activités de services (CTN H et I).
À la demande de la commission AT/MP, ces CTN identifient les cibles prioritaires en matière de prévention dans les branches qu’ils représentent. Ils élaborent notamment des études sur les risques des professions qu’ils regroupent et sur les moyens de les prévenir, ainsi que des recommandations nationales qui constituent pour ainsi dire les « règles de l’art » proposées aux professionnels pour prévenir les risques liés à leurs activités. Selon M. Hervé Lanouzière, ces recommandations « n’ont pas force légalement contraignante, mais sont le résultat de longues négociations entre partenaires sociaux. Ces règles de l’art, propositions très concrètes, produisent des effets, car la règle négociée paritairement est aussi mieux acceptée socialement au sein des entreprises » (276).
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a conforté le fonctionnement paritaire de la branche AT-MP de l’assurance maladie en région en imposant que le conseil d’administration de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) siège en formation strictement paritaire quand les affaires accidents du travail/maladies professionnelles sont évoquées.
Cette loi a également créé une commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles (CRAT/MP) auprès du conseil d’administration de la CARSAT. Comme la commission nationale, chaque commission régionale est composée de dix membres titulaires et dix suppléants, représentant à parité employeurs et salariés. Les CRAT/MP donnent leur avis au conseil d’administration de la CARSAT sur toutes les affaires relevant du domaine des risques professionnels dans lequel les caisses régionales interviennent, et notamment la prévention et la tarification des risques professionnels. Le conseil d’administration de la CARSAT peut déléguer une partie de ses pouvoirs à la CRAT/MP dans les conditions qu’il détermine.
Les CRAT/MP assurent la coordination des comités techniques régionaux (CTR) en impulsant et évaluant les plans d’actions visant à promouvoir la prévention des risques professionnels dans les entreprises de leur région. Un échange régulier entre la CRAT/MP et les CTR doit permettre de prendre en compte à la fois les attentes des représentants des organisations interprofessionnelles et celles des représentants des différentes branches professionnelles.
En 2014, la branche AT-MP a perçu 12,3 milliards d’euros de produits nets (dont 12 milliards d’euros au titre des cotisations sociales). Ses charges nettes s’élevaient à 11,6 milliards d’euros (dont 8,8 milliards d’euros au titre des prestations sociales et 892 millions d’euros au titre des charges de gestion courante : personnel, etc.).
Couvrant « 2 millions d’établissements [dont 85 à 90 % de TPE-PME] et à peu près 18 millions de personnes » (277), la branche AT/MP a ainsi dégagé en 2014 un excédent de près de 700 millions d’euros qui, pour M. Jean-François Naton, vice-président de la commission AT/MP, traduit le fait que, bien que ses acteurs puissent apparaître « un peu comme des dinosaures », « le paritarisme a porté et continue de porter une dynamique positive » (278) au sein de cette branche.
La branche AT-MP gère par ailleurs le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Doté d’un conseil d’administration associant 5 représentants des syndicats de salariés (à raison d’un par organisation représentative au niveau national et interprofessionnel), 3 représentants des employeurs (à raison d’un par organisation représentative au niveau national et interprofessionnel), 4 représentants de l’État, 4 représentants de la CNAMTS, 4 représentants de la Mutualité sociale agricole (MSA) et 3 personnalités qualifiées, ce fonds gérait en 2014 des dépenses atteignant 779 millions d’euros, pour un coût de fonctionnement de 10 millions d’euros.
Le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 1999, 2000 et 2001 ont mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales. Le dispositif a été étendu successivement aux dockers professionnels (en 2000), aux personnels portuaires de manutention (en 2002) et aux salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l’amiante (en 2003).
Les allocations de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) sont prises en charge par le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), dépourvu de personnalité morale et intégré dans les comptes de la branche AT-MP. Ce fonds prend également à sa charge les cotisations au régime de l’assurance volontaire vieillesse ainsi que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire dues par les bénéficiaires des allocations versées par le fonds.
Le fonds est financé essentiellement par une contribution de la branche AT-MP du régime général fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que par une fraction du produit des droits de consommation sur le tabac et une contribution de la branche AT-MP du régime des salariés agricoles.
Le fonds est géré pour une partie de ses opérations (allocations, cotisations volontaires vieillesse et frais de gestion) par la branche AT-MP de la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAMTS) et, pour l’autre partie (cotisations complémentaires vieillesse) par la Caisse des dépôts et consignations.
Quant au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), que l’annexe à l’accord national interprofessionnel du 17 février 2012 recense parmi les organismes de gestion paritaire, il s’agit d’un établissement public à caractère administratif qui a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour prendre en charge l’indemnisation (en réparation intégrale de leurs préjudices) des personnes atteintes de maladies liées à l’amiante (contractées ou non dans un cadre professionnel). Placé sous la double tutelle des ministères chargés de la sécurité sociale et du budget, le FIVA est doté d’un conseil d’administration multipartite associant 5 représentants des syndicats de salariés (à raison d’un par organisation représentative au niveau national et interprofessionnel), 3 représentants des employeurs (à raison d’un par organisation représentative au niveau national et interprofessionnel), 5 représentants de l’État, 4 représentants des organisations nationales d’aide aux victimes de l’amiante et 4 personnalités qualifiées.
Le fonds prend en charge les maladies d’origine professionnelle occasionnées par l’amiante reconnues par la sécurité sociale, les maladies spécifiques figurant dans l’arrêté du 5 mai 2002 (pour lesquelles le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante) et enfin toute maladie pour laquelle le lien avec une exposition à l’amiante est reconnu par le FIVA après examen par la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante.
Le fonds instruit les dossiers et verse les indemnisations selon un barème qui se décompose en deux parties : l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.
Enfin, c’est sous l’égide de la branche AT/MP de la CNAMTS que l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et Eurogip, tous deux dotés de conseils d’administration paritaires, déploient leurs activités.
L’INRS et Eurogip
Créé à l’initiative des partenaires sociaux en 1947, dans un contexte où la notion de prévention devient incontournable dans la mise en place d’actions de santé, notamment au travail, l’Institut national de sécurité (INS) a été conçu comme l’instrument de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en France. Cet organisme avait vocation à apporter son soutien à la Sécurité sociale, encore jeune, afin de développer l’esprit de sécurité, de recueillir et de diffuser l’information dans ce domaine, et d’assister et former les acteurs de la prévention.
Dès 1950, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a lancé un projet de grand laboratoire de recherche axé sur « l’homme au travail », qui a abouti, dans les années 1960, à la création du centre d’étude et de recherche pour la prévention des accidents du travail (CERPAT). Ce laboratoire exerçait des activités de recherche dont les résultats étaient ensuite diffusés par l’INS.
Compte tenu de la complémentarité de leurs activités, le CERPAT et l’INS ont été fusionnés en 1968 en un unique organisme : l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Cette association est gérée par un conseil d’administration paritaire qui est constitué de représentants des organisations d’employeurs et de salariés et dont les orientations sont mises en œuvre par une direction générale selon un programme d’activités établi chaque année pour toutes les actions de l’INRS (études et recherche, formation, information ou assistance).
Aux activités de formation, de recueil et de diffusion de l’information qui étaient celles de l’INS se sont donc ajoutées des activités de recherche (dans des domaines aussi variés que la mécanique, l’ergonomie ou la toxicologie) ainsi que de valorisation et de diffusion des résultats de ces travaux.
Depuis les années 1980, les activités de recherche de l’INRS ont considérablement évolué, avec le souci permanent de diffuser leurs résultats auprès des employeurs, des salariés et des acteurs de la prévention (services de santé au travail, CHSCT, inspection du travail, etc.) et de leur proposer des outils de prévention des risques professionnels répondant mieux aux besoins du monde du travail.
L’offre de services de l’INRS est orientée vers la diffusion des bonnes pratiques et comprend des études et recherches, une offre de formation et d’assistance aux entreprises ainsi que des publications techniques et bases de données. L’INRS s’attache à adapter son savoir-faire pour que les acteurs et relais de la prévention mettent en place des actions efficaces s’inscrivant le plus en amont possible, dès la conception des locaux ou des équipements de travail.
Compte tenu de l’évolution du contexte réglementaire dans les années 1990 (obligation pour l’employeur de préserver la santé physique et mentale et la sécurité de ses salariés, nécessité d’évaluer régulièrement les risques dans l’entreprise et de mettre en place des actions de prévention adaptées, etc.), des outils ont été développés pour notamment mieux planifier la prévention et prendre en compte tous les risques (y compris les risques psychosociaux).
Développant une approche pluridisciplinaire (épidémiologie, métrologie, ingénierie…), l’INRS s’efforce de répondre aux enjeux de la santé et de la sécurité du travail en permanente évolution : multi-expositions des salariés, origine multifactorielle des risques, latence de survenue de certaines pathologies, prédominance des nouvelles technologies, nouvelles formes d’organisation du travail, vieillissement de la population salariée, prise en compte de la pénibilité au travail, etc.
Regroupant environ 635 personnes aux compétences variées (ingénieurs, médecins, chercheurs, formateurs, juristes et spécialistes de l’information, etc.), l’INRS intervient en lien avec les autres acteurs institutionnels de la prévention des risques professionnels (direction des risques professionnels de la CNAMTS, réseau régional des CARSAT, ANACT, OPPBTP, etc.). Des conventions de partenariat ont par exemple été conclues entre l’INRS et la direction générale du travail, pour les années 2008-2011 et 2012-2015. Sur la base d’un programme défini annuellement, la DGT peut solliciter l’INRS pour l’exécution d’interventions comme l’appui technique à l’élaboration de textes réglementaires, l’exécution de missions d’information, de sensibilisation et de communication, et des études spécifiques sur le champ de la prévention des risques professionnels.
Soumis au contrôle financier de l’État, le budget de l’INRS est aujourd’hui de l’ordre de 85 millions d’euros. Ses ressources proviennent du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnels qui est alimenté par les cotisations AT/MP des entreprises cotisant au régime général de la Sécurité sociale.
Quant à Eurogip, il s’agit d’un groupement d’intérêt public créé en 1991 par la CNAMTS et l’INRS pour analyser les évolutions dans le domaine des risques professionnels au plan européen et international ainsi que pour faire valoir le point de vue de la branche AT-MP française auprès des organismes communautaires et des pays de l’Union européenne. Dans ce cadre, Eurogip réalise des études et enquêtes comparatives sur les risques professionnels en Europe et à l’international (en particulier sur les conditions de reconnaissance et d’indemnisation des victimes de maladies professionnelles comme les cancers professionnels ou les maladies liées à l’amiante, ainsi que sur les incitations à la prévention, notamment dans les PME). Eurogip assure également une veille sur les dispositifs étrangers, coordonne l’activité de normalisation de la branche AT-MP, anime un réseau d’experts participant à l’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, et participe à des projets d’intérêt européen financés par l’Union européenne et relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Eurogip assure enfin, par délégation des ministères du travail et de l’agriculture, le secrétariat de la coordination des organismes notifiés pour la certification des équipements de protection individuelle des machines.
Doté d’un conseil paritaire constitué de représentants des organisations d’employeurs et de salariés, Eurogip emploie 12 personnes et dispose de ressources qui proviennent à 75 % d’une subvention attribuée par le FNPATMP et à 25 % de contrats signés avec les pouvoirs publics français et les autorités européennes.
Le lancement, en 2005, des plans de santé au travail, puis la création, en 2009, du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), ont achevé de faire de la santé au travail une politique publique impulsée par l’État plutôt que par les partenaires sociaux, qui y demeurent néanmoins étroitement associés.
Depuis 2005, la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail font en effet l’objet d’un pilotage qui résulte en bonne part des plans de santé au travail arrêtés par le Gouvernement, après concertation avec les partenaires sociaux. Ces plans ont l’ambition de structurer le dispositif de prévention et de fédérer l’ensemble des acteurs, aux niveaux national et local, pour encourager la diffusion de la prévention dans les entreprises.
Afin de définir les orientations et priorités de ces plans de santé au travail, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a évolué, en 2009, pour devenir le COCT.
Cette instance nationale de concertation entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics participe à l’élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels, notamment en donnant son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail. Elle contribue aussi à la définition de la position française sur les orientations stratégiques dans ce domaine au niveau européen et international.
Présidé par le ministre chargé du travail, le COCT est composé de :
– 11 membres issus de départements ministériels (travail, santé, sécurité sociale, fonction publique, collectivités locales, entreprises, agriculture, hospitalisation et organisation des soins, inspection générale des affaires sociales, transports, environnement) et des organismes de prévention (ANSES, INRS, ANACT, OPPBTP, etc.) ;
– 8 représentants de salariés (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC) ;
– 8 représentants d’employeurs (MEDEF, CGPME, UPA, entreprises publiques, UNAPL, FNSEA/CNMCCA) ;
– 15 personnes qualifiées désignées en raison de leurs compétences médicales, techniques ou organisationnelles.
Le groupe permanent d’orientation des conditions de travail est quant à lui présidé par le vice-président du COCT et composé de représentants des organisations syndicales et patronales, de l’État (ministères du Travail et de l’Agriculture) et de la direction des risques professionnels de la CNAMTS.
Il a fallu attendre le troisième plan Santé au travail (« PST 3 »), couvrant la période 2016-2020, pour que la définition des orientations d’un tel plan soit confiée aux partenaires sociaux. Comme l’indique ce document, « pour la première fois, le ministre chargé du travail a confié aux partenaires sociaux au sein du groupe permanent d’orientation du COCT l’élaboration des orientations pour le PST 3 ». Une fois adoptées par consensus entre les cinq confédérations syndicales et les cinq organisations patronales membres du COCT, les lignes directrices et structures du plan ont fait l’objet d’une « validation » par le ministre chargé du travail, lors du comité permanent du COCT qui s’est tenu le 27 janvier 2015, puis d’une concertation associant l’ensemble des acteurs de la prévention, au cours du premier semestre 2015, avant d’être définitivement adopté par le COCT, sous la présidence du ministre chargé du travail, le 8 décembre dernier.
Le processus d’élaboration du « PST 3 » montre que, si les partenaires sociaux ont, cette fois, été à l’initiative des grandes orientations de ce plan, la déclinaison de celles-ci et la rédaction du plan lui-même restent largement pilotées par la puissance publique, et notamment par la DGT.
À la question de savoir pourquoi l’État avait tenu à préserver l’association des partenaires sociaux dans les instances compétentes en matière de santé au travail, Mme Bénédicte Legrand-Jung a répondu que « ces questions recouvrent des enjeux importants pour les salariés, mais aussi pour les employeurs, qui sont directement responsables et sont tenus par une obligation de sécurité et de résultats en matière de santé au travail – domaine dans lequel ils sont en quelque sorte les gestionnaires du risque. En outre, le ministère du travail est très attaché à ce que les acteurs du paritarisme s’approprient ces enjeux de prévention des risques, non seulement pour conforter le paritarisme de gestion dans les instances et organismes concernés mais aussi au regard de la politique plus globale de prévention et de santé au travail. La direction générale du travail a [ainsi] mené une réforme importante du conseil d’orientation des conditions de travail afin de renforcer la gouvernance tripartite permettant de définir l’orientation donnée à la politique de santé et de sécurité au travail » (279).
b. La gouvernance tripartite des agences intervenant dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail
La gouvernance tripartite des diverses agences qui jouent un rôle majeur dans le domaine de la santé au travail contribue aussi à convaincre que ce domaine ne relève pas d’un paritarisme « chimiquement pur ».
Alors que M. Hervé Lanouzière a parlé de « paritarisme de projet » (280), M. Henri Rouilleault a retenu la formule de « paritarisme d’incitation » pour décrire les activités de l’ANACT et de son réseau en faveur de la promotion du « changement concerté de l’organisation du travail dans les entreprises et les administrations » (281).
Créée par la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l’amélioration des conditions de travail, l’ANACT est dotée d’un conseil d’administration tripartite comprenant trois représentants des organisations d’employeurs, neuf représentants des organisations de salariés, six représentants de l’État et trois personnalités qualifiées en matière de conditions de travail, dont l’une est désignée sur proposition de l’Association des régions de France (ARF).
Le conseil d’administration délibère sur les objectifs stratégiques pluriannuels, le programme de travail, le budget, les conditions générales d’emploi, etc.
Dirigée par un directeur général, l’ANACT dispose également d’un conseil scientifique composé de personnalités du monde de la recherche en sciences humaines et sociales, d’experts des questions d’organisation du travail et de responsables scientifiques d’institutions partenaires. Il donne un avis sur le programme de travail de l’ANACT, contribue au suivi et à l’évaluation des actions conduites et assiste l’ANACT dans ses missions d’anticipation de l’évolution des conditions de travail et dans l’élaboration de projets.
Basée à Lyon, l’ANACT pilote un réseau de 26 associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), présentes sur l’ensemble du territoire et gérées de façon strictement paritaire. Chaque association décline, en région, les missions permanentes et les priorités d’intervention définies par la gouvernance de l’ANACT. Chaque association conclut avec l’ANACT une convention annuelle fixant ses actions ainsi que les financements correspondants et est dotée d’un comité d’orientation composé de représentants des organisations d’employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d’administration de l’association, de représentants des institutions publiques, qui participent au financement de l’association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l’association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l’affectation des ressources correspondantes.
L’ANACT se voit allouer une subvention pour charges de service public qui constitue environ 80 % de son budget, les 20 % restants relevant essentiellement de conventions de partenariat. L’agence est donc essentiellement financée par le ministère chargé du travail : elle disposait en 2014 d’un budget d’environ 15 millions d’euros qui couvrait des dépenses de fonctionnement et de personnel (85 ETP). Outre les co-financements apportés par de nombreux partenaires pour réaliser des projets pilotes d’intérêt commun, elle bénéficie aussi de ressources propres (formations, vente d’ouvrages).
Les missions de l’ANACT
Aux termes du décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015 relatif aux missions et au fonctionnement de l’ANACT, cet établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé du travail a vocation à conduire « des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l’organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration ».
Ses champs d’intervention couvrent notamment :
– la promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;
– la prévention des risques professionnels dans le cadre de l’organisation du travail ;
– l’amélioration de l’environnement de travail par l’adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.
L’ANACT met à disposition son expertise pour faciliter l’expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
Pour mener à bien ses missions, l’ANACT :
– conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;
– développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d’être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
– assure l’information, la diffusion et la formation nécessaires à l’utilisation de ces outils et méthodes ;
– conduit une activité de veille, d’étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;
– développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.
Les actions de l’ANACT, conduites au besoin par l’intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux PME.
Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la conclusion d’une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l’intervention.
L’agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité vis-à-vis des acteurs de l’entreprise, de l’association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.
Outre l’ANACT, d’autres agences peuvent être amenées à intervenir dans le domaine de la santé au travail, sans que cela constitue pour autant leur seul champ d’intervention. C’est notamment le cas de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui, aux termes de l’ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010, a notamment pour mission de mettre en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste contribuant à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine du travail, à développer la connaissance et l’évaluation des risques professionnels émergents et à fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques.
Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, du travail et de la consommation, l’ANSES est, elle aussi, dotée d’une gouvernance multipartite comprenant un conseil scientifique et un conseil d’administration composé, outre son président et les représentants du personnel, de cinq collèges associant des représentants de l’État, des élus et des acteurs du monde professionnel, syndical et associatif.
Ce conseil vote les orientations générales de l’ANSES, notamment sa stratégie pluriannuelle, son programme de travail annuel et son contrat de performance conclu avec l’État. En 2014, les dépenses de fonctionnement de l’ANSES s’élevaient à 128,9 millions d’euros et ses effectifs à 1 255 ETP.
Outre les actions menées au niveau national ou régional au sein de la branche AT/MP de la CNAMTS et d’agences comme l’ANACT et son réseau d’ARACT, les enjeux de santé et de sécurité au travail sont aussi traités au niveau de certaines branches, par des organismes au caractère paritaire plus marqué.
c. Un exemple d’organisme de branche intervenant dans le champ de la santé au travail : l’OPPBTP
Né d’une initiative professionnelle du secteur du bâtiment et des travaux publics, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) est le seul organisme « paritaire » de branche qui exerce dans le champ de la santé et de la sécurité au travail.
Créée dès 1859, la caisse de prévention de la chambre syndicale de la maçonnerie versait aux ouvriers blessés une indemnisation pendant leur période d’indisponibilité. Au cours de la première moitié du XXe siècle, de nombreux organismes techniques et sociaux du BTP ont vu le jour avec le souci croissant d’améliorer les conditions de travail.
Créé par un arrêté du 9 août 1947, l’OPPBTP est l’aboutissement de la conviction de M. Pierre Caloni qu’il était indispensable, compte tenu de la particularité des métiers du secteur du BTP, d’instituer un organisme spécialisé de prévention dont la gestion reposerait sur l’association immédiate des employeurs et des salariés, afin de représenter au mieux les intérêts de ces derniers et de permettre aux entreprises d’améliorer les conditions de travail et, partant, leur performance.
Deux dates importantes jalonnent l’histoire de l’OPPBTP : 1982 et 2007. En 1982, alors que l’OPPBTP était considéré comme le comité d’hygiène et de sécurité de la profession, les lois dites « Auroux » ont imposé la mise en place de CHSCT dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, y compris dans le secteur du BTP.
Le décret n° 2007-1284 du 28 août 2007 modifiant le décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 relatif à l’OPPBTP a confié la fonction exécutive de l’Organisme au seul conseil du comité national tout en rassemblant la responsabilité de gestion sous l’autorité du secrétaire général. Ce décret a également étendu la mission de l’Organisme à l’ensemble des acteurs de la profession en l’ouvrant à l’espace européen.
Ainsi, l’OPPBTP est doté d’une gouvernance paritaire s’appuyant sur un conseil du comité national, qui tient le rôle d’organe exécutif suprême, et sur onze conseils des comités régionaux qui jouent un rôle d’appui et de relais. Chacun de ces conseils se compose de dix membres titulaires et de dix membres suppléants à raison de cinq par collège, d’un représentant de l’État – DGT ou directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) – ainsi que d’un représentant de la CNAMTS ou des CARSAT, qui ont une voix consultative.
Conformément au décret de 2007, l’OPPBTP exerce des missions de conseil, d’information et de formation. Il a en effet pour mission de sensibiliser les professionnels du bâtiment et des travaux publics à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail, à travers :
– des actions de conseil (collectives mais aussi individuelles, sur le terrain, et en particulier sous forme d’accompagnement personnalisé pour les grands groupes, comme Vinci Construction, Eiffage, Fayat ou Colas), si possible en amont des chantiers ;
– des actions de formation (privilégiant une offre sur mesure et le développement d’une culture de prévention pérenne, dès la formation initiale des jeunes en filières professionnelle et supérieure) ;
– la mise à disposition d’informations, notamment via La Lettre de Prévention du BTP (dont la diffusion touche quelque 210 000 PME) et un site de services de prévention en ligne (www.preventionbtp.fr) qui permet aux professionnels de chaque métier d’identifier les formations spécifiques à leur activité et qui permet à chaque entreprise d’établir et de mettre à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels (espace personnel e-prevention).
L’OPPBTP met notamment en œuvre :
– des campagnes nationales de sensibilisation sur différents risques (chutes de hauteur, risque routier, amiante, pénibilité) ;
– des plans régionaux de prévention annuels qui déclinent les mobilisations nationales sur les risques majeurs et dont les priorités sont fondées sur un diagnostic local (risque chimique, risque électrique).
Par ailleurs l’OPPBTP, qui siège dans les instances du COCT, contribue, souvent au moyen de conventions, à la formulation et à la mise en œuvre d’actions par les organisations professionnelles syndicales. L’OPPBTP a ainsi conclu des conventions et partenariats avec la DGT (notamment sur l’amiante), la CNAMTS, l’INRS, la délégation interministérielle à la sécurité routière (charte pour la prévention du risque routier), des organisations professionnelles d’employeurs comme la FFB, la CAPEB, la FNTP ou encore SCOP-BTP (étant précisé que 7 conventions nationales ont été signées avec ces organisations entre 2012 et 2014, assorties de déclinaisons locales et d’une trentaine de conventions régionales spécifiques), ou encore des entreprises privées comme Razel-Bec, Bouygues ou Eiffage.
Ce sont les actions de conseil, de formation et d’information qui mobilisent la majorité des ressources de l’organisme. Celles-ci reposent pour l’essentiel sur le versement des cotisations obligatoires des 231 867 entreprises adhérentes – son budget annuel étant de l’ordre de 40 millions d’euros.
En 2014, l’OPPBTP comptait 25 agences et bureaux et 341 collaborateurs, dont 152 conseillers et ingénieurs en prévention sur le terrain – parmi lesquels 60 ont été mobilisés pour sensibiliser quelque 150 000 jeunes apprentis et professionnels à la prévention.
La même année, l’OPPBTP a réalisé 13 088 actions d’accompagnement et diagnostics de conseil auprès de 7 985 entreprises (soit une hausse de 20 % par rapport à 2013), assuré la formation de 24 000 professionnels avec 60 stages spécialement conçus pour les entreprises du BTP et organisé 1 757 réunions de sensibilisation à la prévention des risques auxquelles ont participé plus de 28 000 personnes.
De 2010 à 2014, l’OPPBTP a observé une progression tant du nombre de stages proposés que des stagiaires formés (+ 27 %), malgré une baisse de 10 % du nombre de salariés dans la branche depuis 2009. Les stages les plus fréquentés concernent, entre autres, l’amiante et la pénibilité.
L’État, représenté par la DGT, siège au conseil d’administration de l’organisme avec une voix consultative ; il ne dispose d’un pouvoir de veto qu’en matière budgétaire. En cas de désaccord au sein du conseil du comité national, l’État peut endosser le rôle de départiteur.
Mme Bénédicte Legrand-Jung a expliqué qu’« en pratique, il ne se trouve que très rarement en position d’arbitre, sans doute parce que les parties prenantes sont soucieuses d’éviter qu’il n’ait à utiliser ses pouvoirs de départage en préférant le consensus. Dans ces conditions, le rôle de l’État consiste davantage à veiller à la convergence de l’action de l’OPPBTP avec les priorités publiques en matière de santé et de sécurité au travail qui sont notamment définies dans le plan Santé au travail » (282).
M. Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP, a conclu que « le fonctionnement actuel est déjà tripartite de facto. Certes, l’État ne prend pas part au vote sur les orientations. Cependant, c’est lui qui a fixé par décret le cadre de fonctionnement de l’OPPBTP, à qui il incombe donc une mission clairement impartie par l’État. D’autre part, [on veille] avec la plus grande attention à la bonne coordination entre les actions de l’OPPBTP et l’État. Ainsi le conseil de l’OPPBTP a délibérément décidé dès 2009 de caler le rythme d’application de ses plans stratégiques sur celui du plan Santé au travail. […] L’intérêt du tripartisme de fait qui régit la prévention des risques professionnels est évident. Dans son récent rapport, M. Jean-Denis Combrexelle a clairement indiqué que les questions de santé et de sécurité au travail relèvent de l’ordre public et à ce titre, n’a pas envisagé qu’elles soient confiées à la seule responsabilité de l’entreprise et des partenaires sociaux. »
Et Mme Bénédicte Legrand-Jung d’ajouter : « Il va de soi qu’en matière de santé et de sécurité au travail, la responsabilité de l’État demeure fondamentale. Le rôle que doivent jouer les partenaires sociaux ne remet aucunement en question celui de l’État. […] Le concept de tripartisme est sans doute adapté à ces questions, sachant qu’il appartient à l’État de fixer les normes et les règles en s’appuyant sur les données scientifiques et en veillant à ce qu’il existe une capacité d’expertise – c’est par exemple l’objet de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. Les partenaires sociaux, quant à eux, sont les acteurs de la santé au travail dans les entreprises et dans les branches professionnelles. […] Le tripartisme permet de croiser l’approche de l’expertise scientifique avec le dialogue social. »
d. Les services de santé au travail
Soixante-dix ans avant que le comité présidé par M. Robert Badinter et chargé de définir les principes essentiels du droit du travail ne suggère d’inscrire les principes essentiels en matière de santé et de sécurité au travail aux articles 39 à 43 de ce qui serait un chapitre préliminaire du code du travail (283), la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 portant organisation des services médicaux du travail a imposé aux employeurs la responsabilité de veiller à la santé et à la sécurité de leurs salariés, en prévenant, aux frais de l’entreprise, les maladies professionnelles et les accidents du travail par la consultation d’un service de médecine du travail.
Ce service, devenu service de santé au travail en 2004, est régi par le titre II du livre VI de la 4e partie du code du travail. Aux termes de l’article L. 4622-2 de ce code, « les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :
« 1° conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
« 2° conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
« 3° assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ».
Le rôle du médecin du travail est donc exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers (284).
En application de l’article L. 4622-5 du code du travail, « selon l’importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ».
En conséquence, l’article D. 4622-1 du code du travail précise que « le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° soit d’un service autonome, qui peut être un service de groupe, […] d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; 2° soit d’un service de santé au travail interentreprises » qui est constitué sous la forme d’un organisme à but non lucratif (association), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière (article D. 4622-15).
Ces services de santé au travail sont agréés par l’État, par l’intermédiaire de la DIRECCTE, généralement pour cinq ans.
L’article D. 4622-2 du même code ajoute que « lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622-1, ce choix est fait par l’employeur » et que « le comité d’entreprise préalablement consulté peut s’opposer à cette décision » de façon motivée, dans quel cas l’employeur « saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail » (article D. 4622-3).
Comme l’a expliqué M. Martial Brun, directeur général du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), « en 1946, le conseil d’administration d’un service de santé au travail pouvait prendre deux formes. Il pouvait n’être composé que de représentants des employeurs. Dans ce cas, lui était adjoint une commission de contrôle composée aux deux tiers de représentants des salariés, dont la présidence était assurée par un employeur. Le conseil d’administration pouvait également être composé à parité d’employeurs et de salariés, son président et son trésorier restant des employeurs. Dans ce cas, il n’y avait pas de commission de contrôle. Une nouvelle formule [a été] introduite, en 2004, avec un conseil d’administration composé pour les deux tiers de représentants des employeurs, et pour le tiers restant des représentants des salariés, ce qui permettait d’associer davantage ces derniers aux décisions prises. Une commission de contrôle, dans la même composition que celle qui existait déjà, était adjointe à ce conseil d’administration » (285).
Depuis la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail, le service de santé au travail, qu’il soit autonome ou interentreprises, est, en vertu de l’article L. 4622-11 du code du travail, « administré paritairement par un conseil composé : 1° de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ; 2° de représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ». Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage, est élu parmi les représentants des employeurs – en raison du lien de responsabilité qu’il convient de préserver avec les employeurs adhérents et de la difficulté juridique qu’il y aurait à confier la présidence d’une association à des salariés qui n’en sont pas adhérents – tandis que, dans un souci de transparence financière, le trésorier est élu parmi les représentants des salariés.
Le caractère paritaire des services de santé au travail a été affirmé par la loi du 20 juillet 2011 alors que le protocole d’accord interprofessionnel du 11 septembre 2009 qui a inspiré cette loi mais qui n’a pas été accepté, en raison de divergences entre syndicats sur la composition du conseil d’administration des associations et sur le contrôle que peuvent exercer sur celles-ci les entreprises qui les rémunèrent, retenait, dans un premier temps, une gouvernance tripartite.
L’organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés, soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés et son secrétaire l’est parmi les représentants des employeurs (286).
Par ailleurs, dans les services interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres (287), car, comme l’a souligné M. Martial Brun, « le paritarisme à l’œuvre dans les conseils d’administration ne vise pas seulement à gérer des fonds, mais bien à exécuter une mission et à agir. Cette mission est formalisée dans un projet de service qui détermine les priorités d’action du service de santé au travail » (288).
Le pays compte aujourd’hui quelque 270 services de santé au travail interentreprises qui emploient 15 000 personnes pour veiller sur la santé au travail de 15 millions de salariés du secteur privé. Les prestations de services et les cotisations des entreprises qui les financent, dont le total atteint environ 1,2 milliard d’euros, sont négociées au cas par cas.
Ces services, personnes morales, sont fédérés au sein d’une association : le centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME). Employant une dizaine de personnes, cette association représente les services auprès des pouvoirs publics, réalise des études et négocie, pour le compte des employeurs, la convention collective de la branche. Son conseil d’administration est composé de présidents de conseils d’administration des associations adhérentes et de directeurs de services de santé de grandes entreprises.
Le directeur général de cette association, M. Martial Brun, a souligné que « le paritarisme s’exerce au niveau local, dans chaque service de santé, mais également aux niveaux régional et national », de sorte que, si les services de santé au travail sont administrés de façon purement paritaire, il n’en demeure pas moins que « le plan Santé travail (PST) se présente comme une commande de la collectivité nationale dont les services de santé au travail doivent tenir compte » (289).
Ces services doivent également tenir compte de la déclinaison, au niveau régional, de la politique conçue au niveau national. En effet, comme l’a expliqué M. Martial Brun, la DIRECCTE « exécute cette politique de santé au travail débattue au niveau local au sein du conseil régional d’orientation des conditions de travail (COREOCT) – l’ancien comité régional de prévention des risques professionnels (CRPRP). Ce conseil élabore une déclinaison du plan national : le plan régional de santé au travail (PRST), qui tient compte des spécificités de la région ».
Afin de favoriser la cohérence entre l’action des services de santé au travail et les plans nationaux et régionaux de santé au travail, le législateur a prévu la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), généralement renouvelable tous les cinq ans, qui permet de faire signer par un président de service de santé, au nom de ses adhérents employeurs, un document qui met en avant un objectif commun à tous les acteurs et qui permet de préserver la responsabilité de chaque employeur.
Car c’est toute la particularité des dispositifs de santé et de sécurité au travail que de faire coexister la responsabilité de chaque employeur et la responsabilité de l’État.
Peut-on encore parler de « paritarisme chimiquement pur » quand, de l’aveu de M. Martial Brun, il arrive que « des priorités d’action adoptées de façon unanime par un conseil d’administration paritaire soient modifiées par l’agrément [délivré par l’État] – par exemple parce que les partenaires sociaux s’étaient accordés sur une mesure dérogatoire au droit » (290) ?
Cela conforte le choix fait par le rapporteur de qualifier de tripartite la gouvernance des dispositifs de santé et de sécurité au travail. M. Martial Brun a même admis que l’« on pourrait imaginer que l’État pilote directement les services de santé au travail », même si « cela finirait par poser la question de la responsabilité de chaque employeur ».
CHIFFRES RELATIFS AU « PARITARISME »
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
Branche AT-MP de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) |
2011 : 10 682 2012 : 10 787 2013 : 10 408 2014 : 10 757 2015 (p) : 10 933 |
2011 : 878 2012 : 911 2013 : 925 2014 : 896 2015 (p) : 909 |
2011 : 11 412* 2012 : 11 719* 2013 : 11 548* 2014 : 11 177* 2015 : 11 067* |
FIVA |
2011 : 400 2012 : 481 2013 : 556 2014 : 521 2015 (p) : 525 |
2011 : 7 2012 : 7 2013 : 8 2014 : 8 2015 : NC |
2011 : 75 2012 : 76 2013 : 84 2014 : 84 2015 : NC |
FCAATA |
2011 : 874 2012 : 858 2013 : 819 2014 : 779 2015 (p) : 717 |
2011 : 12 2012 : 11 2013 : 11 2014 : 10 2015 (p) : 9 |
2011 : sans objet** 2012 : sans objet** 2013 : sans objet** 2014 : sans objet** 2015 : sans objet** |
ANACT |
2011 : 16 2012 : 15 2013 : 15 2014 : 15 2015 : 16 |
2011 : 16 2012 : 15 2013 : 15 2014 : 15 2015 : 16 |
2011 : 82 2012 : 86 2013 : 85 2014 : 85 2015 : 86 |
INRS |
2011 : sans objet 2012 : sans objet 2013 : sans objet 2014 : sans objet 2015 : sans objet |
2011 : 87 2012 : 85 2013 : 85 2014 : 86 2015 : NC |
2011 : 634 2012 : 632 2013 : 607 2014 : 595 2015 : 586 |
Eurogip |
2011 : sans objet 2012 : sans objet 2013 : sans objet 2014 : sans objet 2015 : sans objet |
2011 : 1,4 2012 : 1,5 2013 : 1,5 2014 : 1,5 2015 : 1,6 |
2011 : 12 2012 : 12 2013 : 12 2014 : 11 2015 : 11 |
Total pour l’année 2014 |
12 072 |
1 016,5 |
11 952 |
Sources : Commission des comptes de la Sécurité sociale, Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), Direction de la Sécurité sociale (DSS), Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
* Ces chiffres correspondent aux ETP affectés, directement ou indirectement, à la gestion des dispositifs AT-MP au sein de la CNAMTS, des caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM), des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), des Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des directions régionales du service médical (DRSM).
** Les effectifs des CARSAT affectés à la gestion de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA) – accueil physique et téléphonique relatif à cette allocation, instruction des demandes, calcul et notification, etc. – étaient de 106 ETP en 2011 et 102 ETP en 2012. Les difficultés de mise en place du nouveau module de comptabilité analytique au sein de la CRAMIF depuis 2013 ne permettent d’avoir qu’une estimation de ces effectifs depuis cette date (autour de 100 ETP chaque année).
*
* *
En somme, on peut parler, en matière de santé au travail, de « tripartisme assumé ». Comme l’a expliqué M. Philippe Hourcade, président de l’association Dialogues, « si la faculté pour les acteurs de participer à la gestion de ces régimes obligatoires a été maintenue, force est de constater que leur capacité autonome de gestion est aujourd’hui fort réduite : ils ne sont malheureusement que consultés au préalable sur la stratégie de santé. Il est évident que la définition de cette stratégie relève de l’État » (291). Et l’on peut en dire autant en matière de handicap.
4. Le handicap : un paritarisme légal associant des tiers
Organisme jeune au regard de l’histoire du paritarisme, l’Association de gestion du fonds d’insertion des personnes handicapées (Agefiph) en est une déclinaison originale qui se distingue nettement par son origine légale, la présence significative d’associations à son conseil d’administration et une autonomie opérationnelle dans la gestion d’un réseau important.
a. Un paritarisme d’origine légale : la loi du 10 juillet 1987
La politique publique d’insertion en matière de handicap est née avec la loi d’orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975, qui faisait de la formation, de l’orientation et de l’emploi des personnes handicapées une « obligation nationale ». Cette politique a notamment donné naissance au secteur du travail protégé à travers les centres d’aide par le travail (CAT). Or, au milieu des années 1980, cette politique est jugée à la fois insuffisante et insatisfaisante, car elle cantonne les personnes handicapées à un milieu adapté sans leur permettre d’intégrer le milieu ordinaire. C’est dans ce contexte que la loi du 10 juillet 1987 se fixe pour objectif d’insérer les handicapés en milieu ordinaire de travail.
Pour ce faire, elle fixe aux entreprises de plus de 20 salariés une obligation d’emploi à hauteur de 6 % de leur effectif. Cette mesure n’est pas complètement nouvelle en droit français. Déjà, la loi du 26 avril 1924 sur les mutilés de guerre et son décret d’application du 16 juillet 1925 obligeaient les entreprises de plus de 10 salariés à réserver 10 % de leurs emplois à des anciens militaires invalides, des veuves et orphelins de guerres, et des femmes d’invalides. La loi du 23 novembre 1957 prétendait offrir aux travailleurs handicapés un accès prioritaire portant sur 3 % des emplois dans toutes les entreprises et les administrations publiques. Mais cette législation est restée largement inefficace : les quotas étaient peu appliqués et, lorsqu’ils l’étaient, une part importante des personnes handicapées n’étaient pas concernées.
La loi du 10 juillet 1987 impose donc une obligation de résultat aux employeurs, qui peuvent s’en acquitter en versant une cotisation au fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés, en mettant en œuvre un programme d’embauche, d’insertion, de formation, d’adaptation ou de maintien de l’emploi par la voie d’un accord collectif, ou en donnant du travail au secteur protégé.
Le fonds est donc alimenté par une contribution dont le montant est assis sur l’« effectif manquant », c’est-à-dire l’écart entre le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de l’obligation d’emploi (6 % de l’effectif) et le nombre de personnes handicapées effectivement employées. Le législateur a décidé de confier la gestion du fonds, dont la vocation entre au moins partiellement dans le champ de la formation professionnelle, à une association privée « où se retrouvent les représentants des salariés, des employeurs, des handicapés et des personnalités qualifiées » (292). En effet, « l’action du fonds doit compléter celle de l’État mais en aucun cas se substituer à elle » (293). L’État est néanmoins représenté au conseil d’administration de l’Agefiph en raison du caractère public des deniers gérés et pour assurer une meilleure coordination avec les autres actions publiques.
Le terme de « paritarisme » n’est cependant pas utilisé par le législateur de l’époque, probablement parce que la configuration du conseil d’administration ne répond pas aux critères stricts du paritarisme.
b. Un conseil d’administration original
Le conseil d’administration est chargé de définir la stratégie et les axes d’intervention de l’association. Il s’appuie sur des commissions techniques : commission financière, commission Politique d’intervention, commission Études et évaluations, commission Études des conventions nationales, commission de la communication et commission Innovations / expérimentations.
Le conseil d’administration comprend en effet non pas deux, mais trois collèges :
– un collège des employeurs avec le MEDEF (3 représentants), la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) (un représentant) et la CGPME (un représentant) ;
– un collège des salariés avec les cinq organisations représentatives au plan national (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC), qui désignent chacune un représentant ;
– un collège des associations comprenant cinq associations qui désignent 5 représentants : trois sont présentes à titre permanent et deux sont régulièrement renouvelées en fonction des priorités que souhaite porter le monde associatif. C’est ainsi que, depuis septembre 2015, l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et / ou handicapés psychiques (UNAFAM) fait partie du conseil d’administration.
Le conseil compte également trois personnalités qualifiées nommées par chacun des collèges et deux personnalités qualifiées nommées par l’État.
Cette composition, qui va de soi pour ce qui concerne l’État, est plus surprenante s’agissant des associations : celles-ci se trouvent représentées en nombre égal avec les salariés et les employeurs. On ne trouve pas d’équivalent ailleurs, y compris pour les associations familiales ou mutualistes aux conseils ou conseils d’administration des caisses de sécurité sociale, puisque celles-ci y ont un nombre de sièges sensiblement inférieur à celui dévolu aux partenaires sociaux.
De ce point de vue, comme l’a fait remarquer Mme Anne Baltazar, présidente de l’Agefiph, « l’Agefiph a été précurseur du mouvement général tendant à associer les parties prenantes à la gouvernance des structures chargées de la gestion de fonds ». Elle a indiqué à la mission trouver cette configuration intéressante en raison de la complémentarité des collèges : « Les représentants patronaux et syndicaux sont particulièrement impliqués dans les aspects collectifs et l’interaction des problématiques liées au handicap avec le champ de l’entreprise, de l’emploi et du chômage ; les représentants des associations font davantage valoir les besoins individuels des personnes en situation de handicap. »
Interrogée sur les rapports entre les associations et les organisations professionnelles, elle a néanmoins précisé que « la présence des associations ajoute un peu de complexité, car leurs représentants font état de besoins qui ne sont pas de même nature que ceux des partenaires sociaux et n’ont pas la même façon d’agir. N’étant pas nécessairement présentes dans d’autres organismes, les associations concentrent leurs revendications au conseil d’administration de l’Agefiph : elles ont des exigences fortes mais parfois contradictoires. Celles qui n’interviennent pas dans les entreprises n’ont parfois pas une connaissance aussi poussée de leur fonctionnement que les autres interlocuteurs. Le mécanisme paritaire peut être lourd, long et compliqué, mais le consensus qui s’en dégage est plutôt fructueux. » (294)
Les représentants de l’État n’ont pas de pouvoir de veto, sauf en matière budgétaire puisque le budget doit être approuvé par l’État. Lors de son audition, la délégation de l’Agefiph n’a d’ailleurs pas fait état de situations où l’État se serait immiscé dans la gestion des fonds de l’Agefiph, ce qui lui a permis de développer une action diversifiée et autonome.
c. Une grande autonomie de fait, sous le regard attentif de l’État
L’Agefiph n’est pas un opérateur de l’État : celui-ci n’exerce pas de tutelle et a une présence modeste à son conseil d’administration.
Les ressources de l’association proviennent exclusivement des contributions versées par les établissements d’au moins 20 salariés au titre de l’obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés. Toutefois, le budget de l’Agefiph ne peut être exécuté sans l’approbation du ministre chargé de l’emploi. Il reste que l’État peut, comme en 2009, ponctionner 50 millions d’euros sur le budget de l’association alors que le conseil d’administration avait unanimement voté contre. Il peut aussi confier à l’association de nouvelles missions sans prévoir de réajustement de ses moyens : ce fut le cas en 2011, avec comme tâches nouvelles l’instruction des demandes faites par les entreprises pour bénéficier de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, le financement de la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle qualifiante et certifiante, ou le versement de la prime de reclassement aux personnes sortant de centre de rééducation professionnelle.
Mme Anne Baltazar a également témoigné des contours changeants de l’autonomie de l’Agfefiph vis-à-vis de l’État, qui se reflètent dans l’extension de ses missions au fil du temps : « On peut dire des relations de l’Agefiph avec l’État qu’elles ont sensiblement évolué. À l’origine, l’Agefiph était perçue comme le simple gestionnaire d’un fonds constitué à partir des contributions des entreprises, les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés ayant manifesté leur volonté de bien gérer ce fonds. Aujourd’hui, l’État lui transfère de plus en plus de tâches, comme la gestion des déclarations obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés et de la lourdeur du handicap, et même des missions de puissance publique comme la gestion du rescrit, le tout sans moyens supplémentaires – mais c’est peut-être un autre sujet. L’Agefiph assume ses missions et s’interroge sur les façons d’améliorer son partenariat avec l’État. Le conseil d’administration s’approprie davantage la mission d’intérêt général qui lui est confiée par l’État, tout en restant libre au regard de la gestion du fonds. Il se montre en fait de plus en plus perméable aux injonctions de politiques publiques en matière de handicap. ».
L’Agefiph a donc vu sa mission évoluer sans que soient modifiés ses textes constitutifs. Mme Baltazar voit l’association comme un exemple de la capacité d’un organisme à sortir de la mission de gestion qui lui est assignée par la loi pour innover : « l’Agefiph est un exemple de ce décloisonnement : elle est passée d’un paritarisme de gestion avec une mission bien définie consistant à gérer le fonds, à un positionnement global par rapport à d’autres acteurs. Au départ, nous fonctionnions sur la base de deux principes : la recherche du retour des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et la « récupération » par les entreprises de leurs contributions. Aujourd’hui, nous assumons de nouvelles missions, qui sont mieux acceptées : le développement de l’interaction, la prise en compte de besoins et des injonctions politiques ».
Aujourd’hui, l’Agefiph exerce des fonctions très variées au service des entreprises et des personnes handicapées :
- financement de l’adaptation ou de l’acquisition d’un matériel en vue de maintenir un poste occupé par une personne handicapée ou d’en recruter une ;
- aide aux personnes handicapées pour créer une entreprise ;
- contribution au financement des Cap Emploi (295), qui aident les personnes handicapées dans leurs recherches ;
- financement d’une prime pour un contrat d’apprentissage conclu avec une personne handicapée ;
- versement d’une aide financière à l’embauche ;
- financement des formations.
Pour ce faire, elle travaille avec 102 organismes de placement spécialisés Cap Emploi, 99 services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), près de 70 prestataires labellisés « Alther » – syndicats, associations, etc. – qui conseillent et accompagnent les entreprises pour les aider à satisfaire à leur obligation d’emploi, 73 prestataires « Vie au Travail » qui accompagnent les entreprises dans la gestion de carrière de leurs collaborateurs handicapés, des opérateurs spécialisés dans la prise en charge des déficiences physiques, des ergonomes et des prestataires d’appui à la création d’entreprise.
d. Une organisation « tête de réseau »
L’Agefiph est à la tête d’une organisation déconcentrée autour de 20 délégations régionales dont deux en outre-mer mais n’a pas de comités déconcentrés sur le modèle de son conseil d’administration.
Pour autant, comme l’a signalé M. Hugues Defoy, directeur Pôle Métier de l’Agefiph, l’association s’est retrouvée, pour répondre au mieux à ses missions diverses, en situation de gérer un véritable réseau lui permettant de réaliser une grande variété de prestations financées par le fonds : « L’Agefiph a mis au point, en plusieurs années, un ensemble d’interventions qui composent une offre organisée en trois composantes. Notre offre comprend tout d’abord des services, dont ceux de Cap Emploi, qui sont bien connus. Elle comprend des prestations qui viennent en complément de ces services, parmi lesquelles une politique de formation professionnelle par achat de formations, celle-ci étant en lien direct avec le paritarisme puisque les partenaires sociaux sont à la manœuvre pour nous aider à décliner notre politique sur les territoires. Notre offre comprend enfin des aides financières, qui ont vocation à être versées aux entreprises et aux personnes en situation de handicap ; il y avait historiquement, parmi ces aides, la prime à l’insertion. Notre offre d’interventions a une particularité importante : elle est très intermédiée. Nous nous appuyons sur réseau de partenaires, d’opérateurs et de prestataires et hormis les financements alloués par Cap emploi, tout ce que nous mettons en place fait l’objet de procédures d’achats par appels d’offres puisque nous sommes considérés comme un pouvoir adjudicateur. » (296)
Les effectifs de l’association comprennent des conseillers en prestations en contact direct avec les personnes handicapées, des chargés d’études et de développement qui analysent les besoins et répondent aux demandes, des assistants de délégation qui assurent l’information administrative au niveau de la délégation régionale et des délégués régionaux qui encadrent les équipes à cet échelon. 15 % des salariés sont des personnes handicapées.
M. Hugues Defoy a rappelé que l’Agefiph doit coopérer, au nom de son réseau, avec les organismes chargés de la formation professionnelle ainsi qu’avec ceux compétents en matière de santé au travail : « Notre action vient s’articuler avec celles d’autres acteurs compétents en matière de formation professionnelle, en vue de mobiliser en faveur des personnes handicapées les dispositifs de droit commun. Ainsi, l’Agefiph achète des formations spécifiques mais négocie aussi des partenariats avec les exécutifs régionaux. L’Agefiph est également présente dans les instances quadripartites de gouvernance des cinq commissions du conseil national sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CNEFOP) et dans les conseils régionaux sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP). Cette politique de formation territoriale s’exerce aussi en relation avec les partenaires sociaux présents dans nos instances et avec Pôle emploi. Depuis 2006, nous avons mis en place un programme de formation professionnelle nommé HANDI COMPÉTENCES qui doit accueillir le maximum de bénéficiaires. Il faut pour cela qu’il soit accessible le plus facilement possible auprès de nos partenaires.
« Un tiers de notre budget est consacré à la formation professionnelle. Nous avons la possibilité d’abonder le compte personnalisé d’activité (CPA) au titre du compte personnel de formation (CPF). Des membres de notre conseil d’administration sont très au fait de ce projet puisqu’ils sont aussi signataires de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 dont est issue la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui a mis en place ce CPF. La politique de maintien dans l’emploi est l’autre composante de l’activité de l’Agefiph, en lien avec les politiques de santé au travail, dont certains acteurs sont membres de notre conseil d’administration. Nous informons les employeurs des services, des dispositifs, de l’expertise et des aides destinés à favoriser le maintien des personnes handicapées dans l’emploi. Cette information est relayée dans les entreprises par les élus des organisations syndicales. » (297)
e. Des ressources modestes et variables
Les déterminants des ressources de l’Agefiph sont assez particuliers puisque celles-ci sont inversement proportionnelles aux résultats des entreprises en matière d’intégration professionnelle de personnes handicapées. Les ressources diminuent régulièrement depuis 10 ans en raison de la mise en place d’un grand nombre d’accords d’entreprises ou du recours aux possibilités offertes par la loi de s’acquitter de l’obligation légale en confiant du travail à des ESAT.
LE PARITARISME DANS LE DOMAINE DU HANDICAP
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
AGEFIPH |
2011 : 435,7 2012 : 403,9 2013 : 443,2 2014 : 462,6 2015 : 431,6 |
2011 : 43,6 2012 : 45,7 2013 : 46,2 2014 : 47,5 2015 : 47,1 |
2011 : 352 2012 : 356 2013 : 366 2014 : 384 2015 : 363 |
Total pour l’année 2014 |
462,2 |
47,5 |
384 |
On estime en effet qu’aujourd’hui 50 % des entreprises respectent leur obligation d’emploi, l’autre moitié étant donc amenée à contribuer au fonds géré par l’Agefiph : un peu moins de 10 % des entreprises ne mènent aucune action en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et, par conséquent, près de 40 % ont une action insuffisante pour être exonérée complètement de la cotisation.
5. La justice prud’homale : un paritarisme historique isolé dans un ordre juridique étatique
Si elle n’appartient pas au champ de la protection sociale, qui constitue le terrain de prédilection du paritarisme, la justice prud’homale constitue la plus ancienne forme de paritarisme institutionnel puisque ses origines remontent au Premier Empire. L’étude de ce paritarisme juridictionnel est d’autant plus intéressante qu’il connaît, dans des fonctions très différentes, des problématiques similaires à celles d’autres systèmes paritaires : sa capacité à favoriser le dialogue social, les questions de compétence et de formation des représentants des salariés et des employeurs ou encore la capacité de réforme du système.
a. Le plus ancien des paritarismes
L’histoire de la prud’homie, parfaitement résumée par le sociologue Alain Cottereau en 1987, donne à voir l’émergence de ses principales caractéristiques : « Comparée aux autres systèmes occidentaux de justice industrielle, [la prud’homie] constitue une expérience unique dès son départ, en 1806. Son originalité s’affirme encore plus tout au long des cent quatre-vingt années de son histoire ». L’histoire longue des juridictions prud’homales fait l’objet de travaux encore limités, dont il ressort cependant une explication à l’essor de cette singularité judiciaire : une faible conflictualité collective – que l’on peut associer à la non reconnaissance des syndicats pendant une longue partie du XIXe siècle – a été assortie d’une forte conflictualité individuelle devant les juridictions prud’homales (298). Cette réalité se traduit par une transformation d’une instance professionnelle de conciliation en une véritable juridiction.
Les conseils de prud’hommes sont parfois comparés aux magistrats corporatifs d’Ancien régime en raison du principe de l’élection corporative et du principe de conciliation entre organisations professionnelles. Des historiens comme Marcel David affirment cependant qu’il y a des différences significatives entre les deux systèmes (299) comme en témoigne la création des prud’hommes par l’Empire, qui se veut en rupture avec les syndics et juges-gardes de l’Ancien régime.
L’origine des prud’hommes se trouve en effet à Lyon dans une industrie de la soie épuisée et désorganisée après la fin des règlements corporatifs. Des représentants influents du secteur réclament de l’Empereur le retour à ces normes qui permettaient de réguler le marché et de faire la police des différends entre négociants, d’une part, chefs d’atelier et maîtres-ouvriers, d’autre part. Ils ne peuvent obtenir satisfaction en raison du principe de la séparation des pouvoirs qui s’oppose à ce qu’une corporation administre et juge en même temps, mais le Corps législatif et Napoléon sont sensibles à la dimension juridictionnelle de la demande. La loi du 18 mars 1806 confie ainsi à ces conseils de prud’hommes (300) le soin de « terminer, par la voie de conciliation, les petits différens qui s’élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, soit entre des chefs d’atelier et des compagnons ou apprentis ». Ils sont composés de cinq négociants et de quatre chefs d’atelier et maîtres-ouvriers élus. La mission des prud’hommes est alors de concilier plus que de juger dans des litiges liés à l’exécution du travail qui nécessitent des connaissances techniques. Les historiens estiment que, de 1811 à 1840, les affaires font l’objet d’une conciliation à 97 %.
La loi de 1806 permet d’appliquer le système lyonnais à toute ville dont la chambre de commerce en ferait la demande. Le système connaît rapidement un certain succès (en 1848, 75 villes françaises en ont un, dont Rouen depuis 1807 et Paris depuis 1845), mais il est aussi très critiqué comme étant une institution patronale, ce que confirme la composition des conseils (301).
Le paritarisme strict est obtenu avec la IIe République, qui répond à une demande ouvrière formulée dès les années 1830, par la loi du 27 mai 1848. Le bureau de conciliation, le bureau de jugement, la formation de référé et les chambres comptent alors autant de représentants ouvriers et que de représentants patronaux. Le principe de l’élection des conseillers est retenu, tout patron, chef d’atelier, contremaître, ouvrier ou compagnon âgé de 21 ans pouvant voter. En cas d’égalité des voix, le président du conseil a une voix prépondérante pour trois mois avec une alternance entre patron et ouvrier.
La fibre sociale de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, le conduit à consolider le système. La loi du 7 août 1850 met à la charge des communes les élections prud’homales et dispense l’ouvrier d’avancer le montant des frais de procédure. Mais l’Empereur est soucieux de contrôler ces tribunaux professionnels et fait voter la loi du 1er juin 1853 qui prévoit que le président du conseil est nommé par l’État.
La IIIe République rétablit rapidement, en 1880, le principe de l’élection des présidents et vice-présidents, mais le système impérial perdure globalement jusqu’au début du XXe siècle. La loi du 27 mars 1907 est une étape importante de construction du système prud’homal tel qu’il existe aujourd’hui. En effet, elle consacre les principes républicains de 1848, comme l’alternance de la présidence entre patrons et employés, et elle crée des sections « modernes », là où les chambres se répartissaient par profession, qui ont vocation à connaître des litiges de publics larges comme les salariés du commerce ou les ouvriers de l’industrie. Aussi, le conseil de prud’hommes est, dans la première moitié du XXe siècle, une juridiction professionnelle, paritaire, conforme aux standards juridiques de l’époque sans pour autant que la loi n’impose sa généralisation sur le territoire ni sa compétence de droit commun, laquelle appartient encore au juge de paix puis, à partir de 1958, au tribunal d’instance.
La procédure devant les prud’hommes connaît un essor constant tout au long de la période 1850-1950 : les procédures de conciliation se révèlent rapides (moins d’une semaine), simples et peu coûteuses. Les auteurs de l’époque évoquent souvent ces juridictions comme des « tribunaux de famille ».
iii. 1979 à aujourd’hui : l’institutionnalisation
Considérablement transformés au tout début du siècle, les conseils de prud’hommes présentent, dans les années 1970, une organisation territoriale très inégale qui ne correspond pas à son statut de juridiction prépondérante des litiges individuels de droit du travail. Conscient du décalage entre cette inégale répartition des conseils et le fait que la juridiction donne satisfaction partout où elle existe, l’État entreprend d’aligner les conseils de prud’hommes sur des standards juridictionnels plus classiques en vue de leur confier une compétence de droit commun.
• La grande réforme de 1979
Les années 1970-1980 constituent un moment de « débats passionnés » (302) autour des prud’hommes : leur organisation d’ensemble est jugée déficiente et amène une réforme de grande ampleur, qui suscite à son tour des réactions très vives.
Dans les années 1960-1970, les conseils de prud’hommes présentent des « conditions de dispersion étranges » (303). En effet, il n’existe pas de conseils de prud’hommes dans six départements, en raison des charges financières qu’ils constituent pour les communes, lesquelles doivent émettre un avis favorable avant que le gouvernement ne puisse prendre un décret d’institution. On estime qu’à l’époque 8 millions de salariés relèvent des conseils de prud’hommes et 6 millions des tribunaux d’instance. L’organisation des conseils se caractérise également par la lourdeur des procédures visant à créer de nouvelles sections, qui étaient alors très spécialisées, en vue d’étendre leur compétence à de nouveaux métiers, car cela nécessite un décret d’extension. Enfin, les conseils sont très inégalement répartis sur le territoire.
La loi du 18 janvier 1979 vise à rationaliser l’ensemble de l’organisation prud’homale, appelée à s’homogénéiser sur tout le territoire. La réforme crée une carte prud’homale à raison d’un conseil par ressort de tribunal de grande instance (TGI).
Les suppressions qu’implique la réforme sont vivement critiquées par les acteurs de la vie locale, qui voient dans le conseil de prud’hommes une juridiction de proximité ; elles font l’objet d’âpres négociations avec la Chancellerie.
La loi du 18 janvier 1979 prévoit également une profonde réorganisation de la structure des conseils, désormais appelés à traiter de tous les litiges individuels du travail et non des seules affaires concernant des salariés du commerce, de l’industrie et de l’agriculture (304). Elle prévoit donc l’uniformisation de l’organisation autour de cinq sections : industrie, commerce, agriculture, activités diverses et encadrement. La conséquence juridique est l’unicité du contentieux, chaque salarié relevant d’un conseil en fonction de la localisation de l’activité principale de l’entreprise. Les prud’hommes deviennent la juridiction de droit commun des litiges individuels de droit du travail.
La réforme conçue par le gouvernement envisageait de supprimer les sections, au motif que leur maintien était peu compatible avec le souci de rationalisation qui l’inspirait ; mais l’Assemblée nationale, attachée au principe d’être jugé par des pairs, choisit finalement de les maintenir.
Cette période d’institutionnalisation correspond à une accélération de la juridictionnalisation des litiges : entre 1973 et 1980, le pourcentage d’affaires conciliées diminue de 20 à 11%.
• Les suites de la réforme : extension, professionnalisation et étatisation
La loi du 6 mai 1982 apporte la touche finale à la généralisation en étendant le paritarisme aux juridictions d’Alsace-Moselle, qui avaient conservé le modèle allemand échevinal, malgré l’opposition des élus locaux et des syndicats les plus importants dans les départements concernés (CFTC, CGC, FO).
En 1985, le législateur généralise le principe de la mise en état de l’affaire en adoptant le « contrat de procédure » qui consacre le passage d’une procédure orale à une procédure écrite. Les salariés, notamment les cadres, font de plus en plus appel à des avocats, au détriment des défenseurs syndicaux, devant le bureau de jugement. Cette présence de professionnels du droit, indispensable en raison de la technicité croissante de la matière, rend plus difficile la conciliation, qui n’est pas dans l’intérêt des avocats.
La loi du 30 décembre 1986 supprime 101 sections de l’agriculture en raison de la faiblesse du contentieux (305) pour confier celui-ci au tribunal de grande instance. Elle crée également une chambre compétente pour juger en urgence les litiges relatifs aux licenciements pour motifs économiques. Enfin, pour accompagner la suppression de l’autorisation administrative de licenciement, elle confie aux juges prud’homaux la responsabilité nouvelle d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs.
b. Un paritarisme juridictionnel constamment réinterrogé
i. La France est le seul pays à avoir fait le choix du paritarisme
L’originalité de la juridiction prud’homale est à rechercher dans sa longue histoire mais aussi dans une conception très individualiste du droit à partir de la Révolution française. Celle-ci est en effet très singulière à la France, qui a la particularité d’ériger une nette distinction entre les conflits individuels et les conflits collectifs de travail, les premiers étant privilégiés par rapport aux seconds.
Il n’existe par conséquent pas de véritable équivalent au paritarisme prud’homal dans le monde. Le Premier Empire a participé à l’exportation du modèle hors des frontières, en Allemagne, en Italie et en Belgique, mais la forme paritaire n’y a pas été maintenue par la suite. Le bureau du droit comparé du Service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice rappelle ainsi qu’il n’existe en Europe que des juridictions ordinaires (Espagne, Italie, Pays-Bas) ou spécialisée (Allemane, Belgique, Royaume-Uni), la forme échevinale (306) étant la plus répandue.
ii. Le fonctionnement des conseils de prud’hommes
• Une juridiction paritaire
Chaque juridiction a un président et un vice-président, élus par les conseillers prud’hommes. Cette structure bicéphale permet une représentation équilibrée des employeurs et des salariés : d’une part, lorsque le président est employeur, le vice-président est salarié, et inversement ; d’autre part, chaque collège occupe alternativement la présidence et la vice-présidence. Les présidents jouent un rôle important dans la rédaction des décisions.
Chaque conseil de prud’hommes possède cinq sections autonomes, qui sont l’héritage du caractère professionnel de l’institution et qui la distinguent des chambres dans une juridiction ordinaire :
– la section de l’encadrement ;
– la section de l’industrie ;
– la section du commerce et des services commerciaux ;
– la section de l’agriculture ;
– la section des activités diverses.
Chaque section est composée en nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés à raison d’au moins six conseillers par section. Cette composition paritaire a été jugée par la Cour de cassation comme un gage de l’impartialité de la juridiction, notamment au regard des standards européens (307). Dans les conseils importants, des sections peuvent être subdivisées en chambres ; chaque chambre doit alors compter au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
Les membres sont élus pour cinq ans par scrutin de liste lors des élections prud’homales, qui sont ouvertes à tous les salariés, employeurs et demandeurs d’emploi âgés de plus de 16 ans. L’élection a lieu par section.
Ces conseillers sont des magistrats à part entière même s’ils disposent d’un statut particulier. Ils prêtent serment, notamment de garder le secret des délibérations. En cas de manquement grave à leurs devoirs, ils encourent la censure, la suspension pour une durée inférieure à 6 mois ou la déchéance. Les conseillers ne sont pas rémunérés mais indemnisés.
• Des organes qui reflètent la double fonction de conciliation et de jugement
Le conseil des prud’hommes comprend quatre formations :
– le bureau de conciliation, composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur, qui recherche à régler le litige en amont ;
– le bureau de jugement, composé en principe de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs, qui instruit l’affaire en vue de son règlement juridictionnel ;
– la formation de référé, composée d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur, qui peut prendre une décision d’urgence.
– la formation de départage, qui est présidée par un juge du tribunal d’instance nommé par le premier président de la cour d’appel en plus des membres du bureau de jugement, dans l’hypothèse où il y aurait égalité des voix.
• Une compétence large mais partagée avec d’autres juridictions
Les conseils de prud’hommes disposent d’une compétence d’attribution déterminée par la loi. Ainsi le premier alinéa de l’article L.1411-1 du code du travail prévoit que : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ». Il s’agit donc d’une compétence de droit commun pour les litiges individuels entre employeur et salarié sur l’application du contrat de travail.
M. Alain Lacabarats, ancien président de la chambre sociale de la Cour de Cassation, rappelait lors de son audition que le contentieux de droit du travail demeurait cependant très dispersé entre différentes juridictions : « En l’état actuel, sans compter le Conseil constitutionnel, qui a un rôle à jouer en toute matière, sept juridictions sont compétentes en droit du travail : les juridictions administratives, les juridictions judiciaires avec le conseil prud’homal, le tribunal de grande instance pour les litiges collectifs, le tribunal d’instance pour les élections et le départage – compétences transférées au tribunal de grande instance par la loi du 6 août 2015 – ainsi que le contrat de travail des marins, le tribunal de commerce pour ce qui concerne les procédures collectives. » (308)
Il insistait aussi sur les difficultés liées aux règles de compétence territoriale : « Par ailleurs, la multiplicité des compétences territoriales pour une même affaire pose un problème, sur lequel j’avais été entendu lors des travaux relatifs à la loi de juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi. En matière de licenciement économique, lorsqu’il y a un litige sur la cause économique, plusieurs juridictions peuvent se prononcer sur une même question concernant la même entreprise, selon le nombre d’établissements qu’elle compte sur le territoire national. Je cite toujours l’exemple de la série d’arrêts que la Cour de cassation a rendus le 14 décembre 2011 : cinq cours d’appel s’étaient prononcées sur la situation d’une même entreprise, avec des jugements divergents sur l’existence d’une cause économique. De multiples conseils de prud’hommes peuvent être saisis de la même question – concernant par exemple la compensation pour heures supplémentaires ou la rémunération du temps de pause – qui relève d’un seul et même accord d’entreprise s’appliquant à plusieurs établissements. Il faut savoir en effet que le conseil de prud’hommes normalement compétent pour le salarié est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’établissement dans lequel il travaille. »
Il est vrai que les règles en la matière renvoient à une notion parfois difficile à identifier : le lieu d’établissement dans lequel le travail est effectué. Dans certains cas, il peut s’agir également du domicile du salarié ou du lieu de son engagement. L’ensemble demeure assez peu lisible pour les justiciables et parfois pour le juge.
iii. Le fonctionnement du paritarisme prud’homal fait l’objet de critiques récurrentes
• Une procédure trop longue
Le succès des prud’hommes a longtemps tenu à la simplicité et la rapidité de la procédure, mais le fonctionnement actuel des juridictions pose plutôt le problème inverse. Le constat n’est pas nouveau et faisait déjà l’objet de critiques dans les années 1970. On peut l’expliquer par plusieurs facteurs :
– la complexification des règles de fond a profondément transformé la nature de ces juridictions ;
– le gouvernement et le législateur ont fait également le choix, dans les années 1970-1980, de ne plus favoriser la conciliation en dispensant dans certains cas le bureau de conciliation de la rechercher (309).
• Des juges parfois guidés par un intérêt catégoriel plutôt que par l’intérêt général
Les juges peuvent apparaître parfois comme des mandataires défendant les intérêts de leurs mandants. La plupart d’entre eux font prévaloir leur mission sur le militantisme – comme en témoigne le taux de départage, qui reste de 20 % alors qu’il serait de 100 % si les conseillers pensaient avoir un mandat impératif –, mais des problèmes persistent ponctuellement.
• Un manque de formation juridique
En 1987, M. Jean-Pierre Bonaffé-Schmitt, sociologue, spécialiste de la médiation, rapporte les propos d’un représentant patronal responsable du secteur prud’homal : « 75 % des conseillers n’avaient jamais vu un code ou ne savaient pas se servir d’un code […] les conseillers sont demandeurs de stages car beaucoup ignorent le fonctionnement même de la juridiction prud’homale, le paritarisme, les règles du contradictoire. » (310).
Si ces propos ne sont pas représentatifs de l’ensemble des prud’hommes, ni à l’époque ni aujourd’hui, ils rendent compte d’une réalité qu’a également évoquée M. Alain Lacabarats et qui a amené celui-ci à formuler un jugement sévère : « La formation des conseillers est assurée par les organisations professionnelles. Parfois, elle est déléguée à des instituts universitaires du travail. Or, j’ai appris qu’ils ne formaient que les conseillers salariés, le plus souvent syndicat par syndicat. Il n’est pas question de former conjointement conseillers issus du collège des salariés et conseillers issus du collège des employeurs. Comment voulez-vous qu’il y ait un minimum de culture de juridiction si à aucun moment de la formation les divers conseillers ne sont pas mis en présence les uns des autres ? S’il y a un terrain sur lequel cela me paraît indispensable, c’est tout ce qui concerne le statut des juges, l’organisation des juridictions, la procédure, la rédaction des jugements. Je suis désolé, mais ce ne sont pas les organisations professionnelles qui peuvent former à la rédaction des jugements. C’est un travail qui suppose l’intervention de l’autorité publique, en l’espèce l’École nationale de la magistrature pour la formation aux règles de procédure et à la technique de rédaction ainsi que l’École nationale des greffes car les conseillers prud’homaux ont souvent quelque difficulté à comprendre le rôle des greffes dans leur juridiction […] Rappelons qu’auparavant, il n’y avait guère plus de 30 % des conseils prud’homaux qui suivaient régulièrement une formation, ce qui est proprement effrayant. » (311)
iv. D’importantes réformes sont en cours pour préserver le paritarisme
Des travaux récents ont été conduits dans la perspective d’une réforme de la juridiction prud’homale.
Le rapport remis à la garde des sceaux en décembre 2013 par M. Didier Marshall sur Les juridictions du XXIe siècle proposait que le conseil de prud’hommes soit refondu dans un tribunal de première instance spécialisé, le tribunal social (312), qui regrouperait le tribunal du travail et le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans une composition échevinale. Cette proposition n’a pas été retenue par le gouvernement.
Le rapport sur L’avenir des juridictions du travail : vers un tribunal prud’homal du XXIe siècle, remis par M. Alain Lacabarats à Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, en juillet 2014, fait un constat similaire à celui du rapport Marshall (la justice prud’homale « ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences de standards européens et connaît de graves carences ») mais développe ses propositions dans une autre logique : rechercher une amélioration des juridictions prud’homales sans remettre en cause leur existence et le paritarisme qui préside à leur constitution.
Cette démarche a été explicitée par M. Lacabarats lors de son audition : « Lorsqu’en 2014, Mme la garde des sceaux m’a demandé de travailler sur les conseils prud’homaux, la commande était claire : comment améliorer le fonctionnement des juridictions du travail en l’état actuel du système ? Autrement dit, il ne fallait pas envisager d’évolution vers l’échevinage, réforme compliquée à maints égards : ce type d’organisation rencontre de multiples oppositions, les juges professionnels n’y sont sans doute pas favorables et nous n’avons pas les moyens de la mener à bien. Les travaux préliminaires d’auditions m’avaient plutôt porté au pessimisme, mais celui-ci a été fort heureusement tempéré par l’optimisme des jeunes rapporteurs qui m’assistaient. Et, de fait, il est apparu qu’il était possible de trouver des voies d’amélioration du système actuel, à condition toutefois que les acteurs acceptent certaines réformes. » (313)
Le rapport dépeint plusieurs difficultés majeures : un taux de conciliation en baisse (5,5 % en 2013), un départage représentant 20 % des affaires, un taux d’appel supérieur à 60 % (314), des procédures dont la durée dépasse 15 mois.
Comme l’a fait remarquer M. André Lacabarats, ces difficultés peuvent aboutir à remettre en cause la réalité du paritarisme. En effet, une minorité d’affaires sont désormais jugées de façon paritaire : « elles finissent pour la plupart devant les juridictions composées de juges professionnels. Le taux de départage est relativement important, se situant autour de 20 % en moyenne, et comme le montre la lettre Infostat du ministère de la Justice publiée en août 2015, le taux moyen d’appel est de 67 %. » (315)
Sauver le paritarisme prud’homal supposait donc de prendre des mesures radicales. Elles figurent pour la plupart dans l’article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
• La réforme de la procédure
La loi du 6 août 2015 a entendu renforcer la phase de conciliation en créant un bureau de conciliation et d’orientation (BCO) chargé de l’orientation et de la mise en état des affaires.
Une formation restreinte paritaire comprenant un conseiller de chaque collège peut se voir renvoyer l’affaire dans certaines matières.
La loi a ainsi maintenu le paritarisme dans tous les organes qu’elle a modifiés ou créés, alors que le projet envisageait initialement d’introduire l’échevinage au sein du BCO.
• La déontologie et la formation des conseillers prud’hommes
Le nouvel article L.1421-2 du code du travail prévoit en effet que « les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. »
Les conseillers doivent également suivre une formation initiale d’au moins six mois qu’il appartient à l’État d’organiser et de financer. D’après les informations obtenues auprès de la ministre du Travail par la mission d'information commune sur l’application de la loi du 6 août 2015, cette formation devrait être assurée par l’École Nationale de la Magistrature (ENM), conformément aux recommandations du rapport de M. Alain Lacabarats.
Le non-respect des obligations déontologiques et de formation est sanctionné par une nouvelle instance, la « commission nationale de discipline ».
L’attachement très fort des partenaires sociaux et des Français à l’institution prud’homale lui a permis de survivre aux critiques récurrentes, dont certaines tiennent d’ailleurs davantage au fonctionnement de la juridiction qu’au principe même du paritarisme. Cette « juridiction plurielle » semble donc avoir réussi à faire valoir l’intérêt de sa composition originale malgré l’évolution du contentieux.
Aussi, on peut voir une certaine continuité des arguments des défendeurs du paritarisme prud’homal. M. Jean Auroux déclarait en 1982 : « La prud’homie, c’est la prise en charge par les intéressés de leur propre sort. Reconnus comme citoyens à part entière de l’entreprise, les salariés sont ainsi reconnus capables de rendre la justice. Ils règlent avec les employeurs les conflits qui peuvent les opposer et assurent le respect et l’interprétation dynamique d’un droit du travail de progrès social » (316). Cette conception a été exprimée d’une autre manière par M. Jean-François Merle, président du conseil supérieur de la prud’homie, qui a insisté sur la pertinence inchangée du modèle : « L’institution prud’homale permet que la résolution des litiges entre employeurs et salariés se déroule non pas en face-à-face, mais dans une représentation collective de leur relation, grâce au paritarisme et à des juges qui sont extérieurs au litige, mais pas étrangers à l’entreprise » (317).
Toutefois, cette préservation du paritarisme depuis 1848 ne peut masquer ni les évolutions très profondes qu’a connues l’institution prud’homale, ni la place spécifique qu’elle occupe aujourd’hui dans le système judiciaire. Le conseil des prud’hommes était devenu une simple étape des litiges relatifs au contrat de travail engagés devant les juridictions du travail. Les réformes en cours permettront vraisemblablement, en donnant à la première instance les moyens d’améliorer son fonctionnement et d’accélérer ses décisions, d’éviter l’appel et le départage massifs qui contribuent à minorer la place de ce paritarisme judiciaire.
F. L’ÉMERGENCE D’UNE FORME DE QUADRIPARTISME DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Bien avant que le comité présidé par M. Robert Badinter ne suggère d’inscrire à l’article 20 d’un « préambule » au code du travail que « chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle et en bénéficier tout au long de sa vie », les principes de l’organisation des dispositifs de formation professionnelle dans notre pays ont été établis par l’ANI du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels. Cet accord a notamment posé les principes du droit à la formation des jeunes (formation générale et apprentissage), des salariés et des travailleurs menacés de licenciement. Il a par ailleurs prévu le droit à un congé individuel de formation (CIF) et le rôle consultatif du comité d’entreprise en matière de formation.
Mais la puissance publique s’est très vite impliquée dans la gouvernance des dispositifs de formation professionnelle, comme l’y invite l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « la Nation garantit l’égal accès […] de l’adulte […] à la formation professionnelle ».
La loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente a repris une bonne partie des dispositions de l’ANI conclu l’année précédente et a généralisé le principe du CIF, réaffirmé le rôle du comité d’entreprise et perfectionné le mécanisme des conventions de formation entre l’État et les offreurs de formation ainsi que celui des rémunérations des stagiaires.
Depuis lors, les principales initiatives des partenaires sociaux en matière de formation professionnelle n’ont cessé d’être suivies du vote de lois reprenant le contenu des accords interprofessionnels conclus auparavant.
L’ANI relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, signé le 20 septembre 2003 par l’ensemble des organisations représentatives au niveau national (MEDEF, CGPME, UPA, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO), a introduit un droit individuel à la formation pour chaque salarié, transférable d’une entreprise à l’autre sous certaines conditions (licenciement sauf pour faute grave ou faute lourde, licenciement économique, fermeture d’entreprise ou restructuration). Ce mécanisme d’« assurance-formation » permettait à chaque salarié de bénéficier de 20 heures de formation par an, cumulables sur six années et pouvant se dérouler pendant le temps de travail ou en dehors.
Cet accord a également créé les contrats de professionnalisation qui visent à l’acquisition d’une qualification reconnue afin de favoriser le recrutement des jeunes et la réinsertion d’adultes, dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI comprenant obligatoirement une partie « formation » et une partie « production » en entreprise.
Enfin, cet accord a imposé aux entreprises employant au moins 10 salariés de consacrer chaque année à la formation professionnelle, à compter du 1er janvier 2004, au moins 1,60 % des rémunérations versées pendant l’année de référence. Le taux de cette contribution obligatoire a été fixé, pour les entreprises employant moins de 10 salariés, à 0,40 % de la masse salariale pour l’année 2004, et à 0,55 % de cette même salariale à compter du 1er janvier 2005. Le contenu de cet accord a été repris par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
De la même façon, le contenu de l’ANI du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, qui a créé le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), a été repris par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Toujours selon la même méthode, le contenu de l’ANI du 11 janvier 2013, qui a, entre autres, prévu la création d’un compte personnel de formation (CPF) attaché au salarié tout au long de sa vie professionnelle, abondé d’un crédit de 20 heures par an (pour un contrat de travail à temps complet) et plafonné à 120 heures, a été repris par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Mme Françoise Bouygard a relevé « cette particularité française qui consiste à reprendre dans la loi les accords nationaux interprofessionnels (ANI), si bien que, dans l’esprit de nos concitoyens, l’ANI s’efface souvent derrière la loi. Ainsi, on parle de la loi de 1971 sur la formation professionnelle, en oubliant l’ANI de 1970 » (318). M. Bernard Vivier a estimé, pour sa part, que cette méthode est la bonne car la négociation permet de mieux préparer la loi (319).
Toujours est-il que cette méthode a conduit l’État à occuper une place primordiale en matière de formation professionnelle, à tel point qu’après qu’il s’est arrogé le contrôle des organismes de formation, en application de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 relative au contrôle du financement des actions de formation professionnelle continue, la question du rapprochement entre le service public de l’emploi et les organismes de formation a même été évoquée en 1985, par M. Michel Delebarre, alors ministre du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Mais, depuis le début des années 1980, l’État a fait émerger, aux côtés des partenaires sociaux, un acteur public concurrent : la région. En effet, les régions ont été impliquées de façon croissante dans la gouvernance du dispositif de formation professionnelle depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État (dite « loi Defferre ») qui a transféré aux régions la mise en œuvre des actions d’apprentissage et de formation professionnelle continue.
À partir de la fin des années 1980, il est revenu au préfet de région de fixer les programmes de formation. Par la suite, le rapport « Cambon », remis en juillet 1993 au ministre du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, a recommandé d’accorder un rôle accru aux régions dans la formation professionnelle.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a chargé les régions de définir un plan régional de développement des formations professionnelles, qui, pour son volet adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi des actifs, notamment les actions organisées par le conseil régional, les formations destinées aux demandeurs d’emploi dans le cadre de conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels, et les actions relevant des programmes prioritaires de l’État pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier celles organisées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). À cette fin, la région a été chargée d’arrêter un schéma régional des formations de l’AFPA.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a posé le principe selon lequel les régions ont l’entière responsabilité de l’apprentissage et de la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi, dès lors que ces formations ne relèvent pas de l’entreprise ou de l’assurance-chômage.
En application de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, « la région définit en lien avec l’État et met en œuvre le service public régional de l’orientation tout au long de la vie professionnelle […] Elle est chargée de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. […Et] elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ».
Il revient depuis aux conseils régionaux de définir et mettre en œuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle. En outre, ils se voient confier l’organisation du réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience (VAE). Qui plus est, ils se voient imposer l’obligation d’assurer l’accueil en formation qualifiante de la population résidant sur leur territoire, ou d’assurer cet accueil dans une autre région si la formation désirée n’est pas accessible sur leur territoire. Enfin, les régions se voient transférer les crédits consacrés aux stages AFPA (traditionnellement à la charge de l’État) et deviennent ainsi les donneurs d’ordres exclusifs de l’AFPA au titre de la commande publique.
C’est ce que Mme Annette Jobert, directrice de recherche au CNRS, a appelé le « dialogue social territorial » (320). Celui-ci « va au-delà du face-à-face entre employeurs et salariés, et qui permet de prendre en compte les bassins d’emplois et les lieux où s’exercent les compétences des collectivités territoriales », en particulier dans le domaine de la formation professionnelle.
Si, d’après le « jaune budgétaire » de la formation professionnelle joint au projet de loi de finances pour 2016, 31,4 milliards d’euros ont été investis en 2013 dans ce domaine (soit environ 1,5 % du produit intérieur brut) (321), il faut savoir qu’après les entreprises (qui ont engagé 13,8 milliards d’euros pour la formation continue des salariés et l’apprentissage) (322), ce sont les régions qui ont assumé ces dépenses (à hauteur de 4,6 milliards d’euros pour la formation des demandeurs d’emploi et l’apprentissage) (323). De son côté, l’État a investi 4 milliards d’euros pour des programmes spécifiques et l’apprentissage (324). Quant à Pôle Emploi et à l’Unédic, ils ont consacré 1,6 milliard d’euros à la formation des demandeurs d’emploi (325).
a. L’instrument étatique d’intervention en matière de formation professionnelle : la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) conçoit et met en œuvre les orientations du Gouvernement en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle conçues par la DGEFP sont mises en œuvre dans les territoires par le service public de l’emploi (SPE). Cette action est conduite par le préfet de région avec l’appui des services déconcentrés – les DIRECCTE – et fait appel à un ensemble d’opérateurs, notamment Pôle emploi et les missions locales intervenant dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans, ainsi que de partenaires, dont l’Unédic et l’Agefiph. Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent également à cette action, notamment du fait de leurs compétences en matière d’insertion et de formation professionnelle.
La DGEFP est investie de trois missions :
– construire et ajuster le cadre juridique et financier des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle avec les autres départements ministériels et les partenaires sociaux ;
– piloter la mise en œuvre des dispositifs en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et en évaluer les résultats ;
– assurer la gestion des programmes soutenus par le Fonds social européen (FSE) en France.
Forte de 255 agents, la DGEFP dispose en 2016 d’un budget de 11 milliards d’euros. Les crédits au titre du FSE s’élèvent, pour la programmation 2014-2020, à 3,1 milliards d’euros.
b. Les instances quadripartites pilotant les dispositifs de formation professionnelles au niveau national : le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est une association constituée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la suite de l’ANI du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle et de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
En application de l’article L. 6332-21 du code du travail, le FPSPP est habilité par la loi à recevoir un certain nombre de ressources (326) pour :
– contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par une convention-cadre signée entre l’État et le FPSPP – cette convention-cadre biennale pouvant prévoir une participation de l’État au financement de ces actions et devant déterminer le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le FPSPP et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou Pôle Emploi ;
– assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) pour collecter les contributions de 1 % et 0,55 % de la masse salariale, pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation, à condition que ces OPCA affectent au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis, ou que les fonds recueillis par les OPCA et destinés au financement d’actions de professionnalisation soient insuffisants pour assurer la prise en charge de ces actions ;
– contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ;
– financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation lorsque ce dispositif est actionné par un salarié à l’occasion d’un congé individuel de formation ou par un demandeur d’emploi ;
– contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de onze salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux OPCA, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;
– contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de onze à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux OPCA d’une part des sommes versées au fonds ;
– procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation entre les fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) qui existent dans chaque région (à raison d’un par région).
Par ailleurs, le FPSPP anime le réseau des OPCA, des organismes paritaires collecteurs agréés pour le financement du congé individuel de formation (OPACIF) et des FONGECIF.
Piloté et géré par les partenaires sociaux, le FPSPP, qui emploie près d’une cinquantaine de collaborateurs, dispose d’un conseil d’administration paritaire dont la présidence et la vice-présidence alternent tous les 18 mois entre le collège des employeurs et le collège des syndicats représentant les salariés.
Trois commissions statutaires ont été créées au sein du conseil d’administration du FPSPP : la première dédiée à la sécurisation des parcours professionnels, la deuxième à la professionnalisation et à la troisième au CIF.
L’État est représenté au conseil d’administration du FPSPP par un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi que par un contrôleur désigné par l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’État.
Comme l’a expliqué Mme Annette Jobert, la création du FPSPP a été motivée par le souci « d’instituer une certaine perméabilité entre les circuits de formation des salariés, qui sont gérés paritairement, et ceux qui sont destinés aux demandeurs d’emplois, qui sont gérés par l’État, en faisant en sorte qu’une partie des fonds des entreprises aille aux demandeurs d’emploi. C’[était] important, mais difficile à accepter pour les partenaires sociaux, en raison de l’aspect assurantiel des fonds destinés aux salariés. En outre, cela [a] impos[é] à l’État de rentrer dans le dispositif » (327).
Sur les 13,8 milliards d’euros consacrés par les entreprises à la formation professionnelle en 2014, 6,9 milliards d’euros ont été investis dans des plans de formation directement gérés par les entreprises et 6,9 milliards d’euros ont été versés, sous forme de contributions, aux OPCA, au titre de la formation continue, et aux OPACIF, au titre du financement du congé individuel de formation.
Sur les 6,9 milliards d’euros versés par les entreprises aux OPCA, 940 millions d’euros ont été versés au FPSPP qui en investi une part conséquente (740 millions d’euros) dans des projets de formation et dans le mécanisme de péréquation entre les différents fonds et qui en a reversé une moindre part à Pôle Emploi et aux régions (200 millions d’euros).
En 2014, le FPSPP a disposé d’un budget de 1,1 milliard d’euros (dont 70 millions d’euros reçus de l’État au titre du FSE). L’essentiel de ces ressources a été affecté à l’accès à l’emploi des jeunes (499,5 millions d’euros) et à la sécurisation des salariés et demandeurs d’emploi confrontés à des mutations économiques, dans le cadre de transitions et de reconversions professionnelles (500,9 millions d’euros).
26,9 millions d’euros ont été consacrés à des mesures d’accompagnement à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, et 3 millions d’euros au suivi et à l’évaluation des actions menées.
Une autre analyse des dépenses du FPSPP en 2014 montre que :
– 521 millions d’euros ont été investis dans des projets de formation (soit 47 % du budget du FPSPP) ;
– 400 millions d’euros ont été versés aux OPCA au titre du mécanisme de péréquation pour financer des formations organisées dans le cadre du contrat de professionnalisation (soit 36% du budget du FPSPP) ;
– 188 millions d’euros ont été investis dans des conventionnements (soit 17 % du budget du FPSPP), comme celui qui lie chaque année le FPSPP à Pôle Emploi afin d’assurer le paiement de la rémunération de fin de formation des demandeurs d’emploi.
Au total, en 2014, 247 477 personnes ont été formées avec le soutien financier du FPSPP, dont 53,3 % étaient des salariés (131 958 personnes) et 46,7 % des demandeurs d’emploi (115 519 personnes).
Pour ce qui concerne les contrats de professionnalisation, 70 % de ces contrats ont bénéficié en 2014 aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, 20 % aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, et 10 % à certains publics prioritaires bénéficiaires de minima sociaux.
En 2014, 70 millions d’euros de subventions au titre du FSE ont été investis par le FPSPP dans les contrats de sécurisation professionnelle destinés aux salariés d’entreprises de moins de mille salariés qui procèdent à des licenciements économiques. Près de 110 millions d’euros l’ont été par les OPCA.
M. Philippe Dole, directeur général du FPSPP, a indiqué lors de son audition, que le FPSPP travaillait « avec les régions depuis 2015, dans le cadre de la dotation pour les demandeurs d’emploi au titre du compte personnel formation » et que le FPSPP leur avait « alloué 89 millions d’euros en 2015, dans le cadre de conventions bilatérales signées par la présidence du fonds paritaire avec la plupart des régions de France. Seules quatre régions n’ont pas souhaité en bénéficier, ou ont manifesté leur intention trop tard » (328)
Pôle emploi fait aussi partie des opérateurs qui reçoivent des financements du fonds paritaire. Il a bénéficié d’une dotation de 78 millions d’euros en 2015, au titre du CPF pour les demandeurs d’emploi.
Les orientations financières du FPSPP sont arrêtées par le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF) qui est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations d’employeurs au niveau national et interprofessionnel et qui a pour mission de définir les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi, d’assurer le suivi et la coordination avec les autres acteurs et de constituer les listes de formation éligibles au CPF pour les salariés et les demandeurs d’emploi.
Alors que le FPSPP relève plutôt du paritarisme de gestion, le COPANEF relève plutôt du paritarisme de négociation. Compte tenu de la « lourdeur de cette gouvernance bicéphale » (329), leur fusion a cependant été évoquée lors des travaux de la mission, ce qui n’est pas sans poser la question des positionnements respectifs de l’État et des partenaires sociaux dans l’« architecture politique » de la formation professionnelle. En effet, si l’État est représenté au sein du conseil d’administration du FPSPP, il ne l’est pas au sein du COPANEF, qui monte en puissance.
Faut-il, comme l’ont suggéré les députés Jean-Patrick Gille et Gérard Cherpion dans leur rapport d’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, privilégier un rapprochement entre le FPSPP et le Conseil national, de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) ? (330)
Le CNEFOP a en effet été conçu par la loi du 5 mars 2014 comme l’institution chargée d’organiser la concertation nationale et régionale quadripartite entre l’État, les régions, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.
Les politiques en matière de formation, d’orientation et d’emploi relevant d’autorités et d’organismes distincts, le CNEFOP s’est vu confier la responsabilité de définir des priorités triennales et d’élaborer la stratégie partagée pour les mettre en œuvre. Il élabore un programme triennal d’évaluation et assure le suivi du déploiement des principaux outils, notamment ceux issus de la réforme de mars 2014 : liste nationale des formations éligibles au CPF, service public régional de l’orientation, conseil en évolution professionnelle (CEP).
Le CNEFOP a vu ses missions s’enrichir en matière d’orientation professionnelle, de systèmes d’information, de suivi de l’engagement des principaux financeurs de la formation et de l’apprentissage, par rapport aux missions qui étaient celles du Conseil national de la formation tout au long de la vie auquel il a succédé.
Le CNEFOP est composé, autour d’un noyau quadripartite d’acteurs qui forme son bureau (État, régions et partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel), des principaux décideurs et opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle.
c. Les instances quadripartites pilotant les dispositifs de formation professionnelle au niveau régional : les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation et les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
Devançant en partie les souhaits de M. Henri Rouilleault, qui a expliqué devant la mission qu’« en matière de formation professionnelle continue, voire de formation initiale, où il faut penser de manière cohérente à l’échelle d’un territoire l’articulation entre lycées professionnels, apprentissage et contrats de professionnalisation, il serait pertinent de passer par une négociation et des accords quadripartites qui impliquent la région » (331), la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a réaffirmé le rôle central de la région en matière de formation professionnelle et d’apprentissage.
En application de l’article L. 6121-1 du code du travail, elle est « chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ».
La région a donc la responsabilité de la politique de formation professionnelle de tous les publics à l’exception de la formation professionnelle initiale, compétence de l’État, et de celle des salariés dont la responsabilité relève des partenaires sociaux. À cette fin, elle élabore un contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et une carte régionale des formations professionnelles.
Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) est consulté sur cette carte, mais il a principalement pour mission d’animer en région le déploiement territorial des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation professionnelle et d’emploi, d’élaborer le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle et d’en assurer le suivi.
Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, la région peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d’actions de formation au bénéfice des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.
La région conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d’insertion, une convention qui détermine l’objet, le montant et les modalités de ce financement.
Elle organise l’accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi qui sont candidats à la VAE et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d’assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature.
Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP). Issus de la fusion des comités régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle et des conseils régionaux de l’emploi, les CREFOP ont principalement pour mission, en cohérence avec les orientations du CNEFOP, d’accorder les partenaires sociaux, l’État et la région sur la désignation des opérateurs régionaux chargés du conseil en évolution professionnelle, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises et sur les listes des formations éligibles au CPF.
Enfin, la région contribue à l’évaluation, au niveau régional, des politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi.
Pour reprendre la formule de M. Hugues de Balathier-Lantage, chef de service, adjoint à la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, « au fil des différentes étapes de la décentralisation, les régions se sont vues transférer l’essentiel des compétences. […] Les outils de l’État sont désormais moins financiers – l’essentiel des dispositifs ayant été décentralisé et une part croissante des financements provenant des partenaires sociaux – que législatifs et réglementaires » (332).
D’après l’observatoire de l’Association des régions de France (ARF), en 2014, les régions ont financé la formation professionnelle et l’apprentissage à hauteur de 5,104 milliards d’euros. En 2014, plus de 360 000 des quelques 600 000 demandeurs d’emplois entrés en formation ont été soutenus grâce à l’action des régions. Plus de 60 % des formations des demandeurs d’emploi ont été financées par les régions, pour un effort de 1,12 milliard d’euros. Les régions ont financé 66 545 formations au titre des « compétences clés » et de l’illettrisme, 31 440 formations pour la préqualification de jeunes sortis du système scolaire avant la 3e année de collège et 84 629 formations pour des élèves du niveau CAP/BEP.
En 2014, les régions ont consacré 586,9 millions d’euros à l’amélioration des conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle. Cela va de la rémunération des stagiaires, au transport, à l’hébergement, à la restauration ou au petit équipement.
En février 2016, l’ARF a proposé un plan de mobilisation État-régions pour l’emploi afin d’apporter une « clarification des rôles respectifs de l’État, des régions et des partenaires sociaux ». Ce plan formule plusieurs propositions : unification du processus de commande de formation pour les demandeurs d’emploi sous le pilotage des régions, décentralisation complète du service public d’accompagnement vers l’emploi, facilitation d’expérimentations au niveau régional en matière d’apprentissage, etc.
Du point de vue du rapporteur, s’il ne fait pas de doute que les rôles des différents acteurs doivent être clarifiés et que le rôle majeur des instances régionales doit être conforté et affirmé non seulement en matière de définition de l’orientation des formations au regard des débouchés économiques sur leur territoire mais aussi en matière de détermination des formations éligibles au CPF, il n’en demeure pas moins que l’accompagnement des personnes n’a pas à relever des régions, contrairement au postulat qui anime l’initiative « Proch’Emploi », développée par la région des Hauts de France.
À cet égard, le rapporteur partage le point de vue de M. Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi, qui, lors de son audition, le 31 mars dernier, a expliqué que « la région doit non pas assurer elle-même le suivi des demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise mais s’assurer que les actions des divers organismes sont bien articulées ».
Si l’intervention croissante de l’État et des régions a conduit la gouvernance des dispositifs de formation professionnelle à évoluer vers un quadripartisme de plus en plus marqué, il ne faut pas perdre de vue que bon nombre d’organismes intervenant dans ce domaine restent gérés de façon purement paritaire : c’est le cas de la quasi-totalité des OPCA et OPACIF.
d. Un exemple de gestion paritaire au sein des OPCA et des OPACIF : Uniformation
Certes, les plans de formation professionnelle relèvent du seul pouvoir de gestion des employeurs et, « jusqu’en 1982, la mutualisation était quasiment inexistante », comme l’a rappelé le professeur Jacques Freyssinet lors de son audition, le 22 octobre 2015. Il n’en demeure pas moins que « grâce à la conclusion – souvent sous la forte pression de l’État – des accords nationaux interprofessionnels de 1982 et 1984, les ressources mutualisées ont augmenté », de sorte que, pour sa fraction mutualisée, la formation professionnelle continue relève du paritarisme.
À l’origine, en 1972, on dénombrait environ 400 organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation continue (OPCA) ; aujourd’hui, on n’en compte plus qu’une vingtaine, à la suite du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue qui a conditionné l’octroi de l’agrément des OPCA à un seuil de collecte annuelle de 100 millions d’euros (alors que ce seuil était auparavant de 15 millions d’euros).
Le rapporteur estime que ce processus de regroupement des OPCA et de réduction progressive de leur nombre doit être encouragé et poursuivi.
Parmi la vingtaine d’OPCA que le pays compte aujourd’hui et qui, en 2014, géraient près de 7 milliards d’euros de cotisations (333) et employaient 5 375 ETP, pour un coût de fonctionnement estimé à 611 millions d’euros, deux sont interprofessionnels (Agefos-PME et Opcalia) (334). Les autres sont des OPCA dits « de branche », comme Constructys pour le secteur du BTP ou Uniformation pour le secteur de l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale.
La mission a choisi d’entendre ce dernier OPCA, dit « hors champ », c’est-à-dire hors accords interprofessionnels, qui est à la fois un OPCA, un OPACIF et un organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA), qui rassemble aujourd’hui plus de 49 000 entreprises adhérentes issues de 21 branches professionnelles et employant au total plus d’un million de salariés, et qui collecte chaque année près de 350 millions d’euros (335).
M. Robert Baron, trésorier-adjoint d’Uniformation, a précisé que la spécificité de cette organisation, tenant à ce que la représentation patronale (336) n’est pas issue de l’interprofession, avait pour conséquence qu’il fallait l’intervention du législateur pour rendre les accords interprofessionnels applicables au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Uniformation met à la disposition de ses adhérents une offre de formation (catalogue national transversal et catalogues de branches) qui est systématiquement évaluée par un prestataire externe.
Uniformation conseille et accompagne ses adhérents dans la définition de leurs besoins en formation ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets et plans de formation, en les aidant notamment dans la recherche de financements complémentaires au niveau régional, national ou européen, qui se sont élevés à 30 millions d’euros en 2014.
Uniformation a financé plus de 22 millions d’heures de formation en 2014, qui ont bénéficié à plus de 450 000 stagiaires. La même année, Uniformation a répondu à de nombreux appels à projets lancés par le FPSPP, notamment en ce qui concerne l’illettrisme et les emplois d’avenir.
La gouvernance d’Uniformation s’organise autour :
– d’un conseil d’administration paritaire (48 administrateurs, dont 24 appartenant au collège employeurs et 24 au collège salariés) ;
– d’un bureau paritaire (12 administrateurs, dont 6 appartenant au collège employeurs et 6 au collège salariés) ;
– de six sections professionnelles paritaires (solidarité et aide à domicile ; loisir, sport, tourisme ; habitat et lien social ; cohésion sociale ; protection sociale ; emploi et insertion) qui accueillent toutes les branches professionnelles ayant désigné Uniformation comme organisme collecteur, qui suivent et consolident les besoins en formation des branches qui les composent et qui agrègent les priorités des branches pour proposer des projets de formation communs à l’ensemble des branches.
La présidente d’Uniformation, Mme Nadine Goret, a fait valoir lors de son audition, que « la gestion paritaire n’[était] absolument pas une contrainte, au contraire », car elle permettait « d’assurer dans la gestion d’Uniformation une réelle continuité par rapport aux volontés exprimées par les branches » (337).
Les mêmes vertus de la gestion strictement paritaire ont été mises en exergue par les représentants du FONGECIF Île-de-France, et notamment par sa vice-présidente, Mme Myriam Blanchot-Pesic, qui estime que « la richesse du paritarisme tient à la connaissance qu’apporte chacun des métiers, de l’employabilité, ainsi que de l’émergence ou de la disparition de certains métiers » (338).
e. Un exemple de gestion paritaire au sein des FONGECIF : le FONGECIF Île-de-France
Les fonds de gestion des congés individuels de formation ont été créés en 1983 pour promouvoir et gérer les congés individuels de formation, qui ont d’abord bénéficié aux seuls salariés en CDI, avant d’être étendus en 1990 aux salariés en CDD. Le CIF permet à toute personne qui travaille de suivre, au cours de sa vie professionnelle, des actions de formation pour se qualifier, évoluer, se reconvertir, ou préparer et passer un examen. Il est à l’initiative du salarié et s’effectue indépendamment des actions de formation prévues par le plan de formation de l’entreprise.
Présents dans chaque région, les 26 (et bientôt 13) FONGECIF assurent l’accueil et l’accompagnement des salariés dans l’élaboration de leur stratégie individuelle d’évolution professionnelle et de leur projet de formation, ainsi que la gestion administrative et financière de plusieurs dispositifs – dont le CIF, mais aussi, depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la VAE, et, depuis la loi du 5 mars 2014, le conseil en évolution professionnelle (CEP).
L’ambition des FONGECIF est de favoriser des évolutions (voire des reconversions) professionnelles qui s’inscrivent dans les dynamiques économiques régionales. Gérés de manière exclusivement paritaire par les représentants des employeurs (MEDEF, CGPME, UPA) et des salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), et soumis au contrôle de la Cour des comptes, les FONGECIF décident de l’attribution des financements aux projets de formation qui leur sont présentés mais ne dispensent pas eux-mêmes les formations qu’ils acceptent de prendre en charge. Comme l’a expliqué M. Patrick Frange, président du FONGECIF Île-de-France, « le paritarisme s’applique jusque dans la gestion des dossiers individuels. Les demandes de financement sont [en effet] instruites par des commissions paritaires dans lesquelles sont représentés les différents secteurs professionnels ainsi que l’ensemble des composantes syndicales et patronales » (339).
Les ressources des FONGECIF proviennent presqu’exclusivement des entreprises. Jusqu’en 2015, les FONGECIF assuraient eux-mêmes la collecte auprès des entreprises de la région. Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises versent leur contribution aux OPCA et le FPSPP reverse ensuite à chaque FONGECIF sa quote-part régionale.
La mission a entendu les dirigeants du FONGECIF Île-de-France qui, comme tout FONGECIF, est un organisme paritaire chargé d’accompagner, d’informer et d’orienter les salariés, ainsi que de financer les projets de formation professionnelle qu’il sélectionne, notamment au regard de leur cohérence, de leur crédibilité et de leur opportunité.
Il est doté d’un conseil d’administration qui est composé à parité de dix représentants des employeurs (unions régionales du MEDEF, de la CGPME et de l’UPA) et de dix représentants des salariés (unions régionales de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de CGT-FO), auxquels il faut ajouter 10 suppléants. Le conseil est renouvelé tous les deux ans – sa présidence étant attribuée, tous les deux ans, par alternance, à un représentant des employeurs ou des salariés. Le conseil d’administration définit la stratégie du FONGECIF Île-de-France (choix des priorités par âge et niveau de formation, etc.) et vote le budget. Émanation du conseil d’administration (cinq représentants du collège patronal et cinq représentants du collège salariés), le bureau s’occupe du suivi des affaires courantes et s’assure de la bonne exécution des décisions dudit conseil.
Le conseil d’administration a créé des commissions paritaires interprofessionnelles afin d’assurer le bon fonctionnement du FONGECIF. Une commission de la qualité de l’offre contrôle la qualité de l’offre de formation et de l’accompagnement des salariés ainsi que de l’instruction des demandes d’habilitation des centres de bilan de compétences. Une commission de coordination harmonise et coordonne les pratiques des cinq commissions opérationnelles qui étudient les demandes de prise en charge et sélectionnent les projets qui seront financés (3 commissions de première instance pour le CIF-CDI, 1 commission de première instance pour le CIF-CDD et le bilan de compétences, 1 commission de recours chargée d’instruire les recours présentés par les salariés à la suite d’une décision de refus de financement).
En 2014, le FONGECIF Île-de-France a bénéficié d’un budget de plus de 260 millions d’euros, dont 238,2 millions d’euros – soit 90 % des ressources du FONGECIF – issus de la collecte des contributions obligatoires versées par les entreprises d’Île-de-France (les entreprises de plus de 200 salariés représentant environ les deux tiers de cette collecte). 26 millions d’euros proviennent de cofinancements (4,5 millions d’euros provenant du FSE). 1,4 million d’euros ont été attribués par le FPSPP au titre de la péréquation. Enfin, le conseil régional d’Île de France a versé 1,2 million d’euros et l’Agefiph quelque 600 000 euros.
241 millions d’euros ont été engagés pour la prise en charge de l’ensemble des dispositifs. 7 194 salariés (dont 83,5 % d’employés ou ouvriers) ont bénéficié d’un CIF-CDI, 1 178 (dont 85,5 % d’employés ou ouvriers) d’un CIF-CDD, 1 053 (dont 69 % d’employés ou ouvriers) d’une VAE, 4 531 (dont 46 % d’employés ou ouvriers) d’un bilan de compétences, et 699 bénéficiaires (dont 51,5 % d’employés ou ouvriers) d’une formation hors temps de travail.
D’après une enquête réalisée en 2014, le coût du fonctionnement paritaire du FONGECIF Île-de-France a représenté en 2013 4,2 millions d’euros (soit 1,7 % de la collecte). Les comptes annuels, consultables en ligne, chiffrent les « charges liées au paritarisme » à environ 3,4 millions d’euros en 2013 (et 3,5 millions d’euros en 2014). À ces charges s’ajoutent des charges de fonctionnement (17,6 millions d’euros en 2013 et 16,8 millions d’euros en 2014). Les effectifs de ce FONGECIF (en ETP) en 2014 ne sont pas indiqués dans le rapport d’activité disponible en ligne (340).
Plus globalement, on estimait à 600 le nombre de collaborateurs employés par l’ensemble des 26 FONGECIF du pays en 2012 (341).
Cependant, il est difficile de connaître les effectifs précis des FONGECIF – et parfois le montant de leurs ressources et de leurs charges de fonctionnement – à la seule lecture des informations réglementaires qui sont disponibles en ligne.
Le rapporteur note que, même dans le « jaune budgétaire » consacré à la formation professionnelle et joint au projet de loi de finances pour 2016, « en l’absence d’informations, les données statistiques et financières nationales sont [présentées] hors Fongecif Guyane, Guadeloupe, Martinique et Franche Comté » (342).
Le rapporteur s’est néanmoins efforcé de rassembler dans le tableau ci-dessous s’efforce les données disponibles en ligne sur les ressources, charges de fonctionnement et effectifs des 26 FONGECIF du pays pour l’année 2014 (ou 2013, s’agissant des FONGECIF de Basse-Normandie et de Corse).
Toutefois, il serait souhaitable à l’avenir de disposer d’informations exhaustives pour l’ensemble des FONGECIF dans le « jaune budgétaire » qu’il est proposé d’établir pour regrouper toutes les données chiffrées relatives aux dispositifs gérés par les partenaires sociaux, en collaboration avec l’État ou avec d’autres acteurs.
BUDGET, COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET EFFECTIFS DES FONGECIF EN 2014
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
FONGECIF Alsace |
19,9 |
NC |
NC (8 conseillers) |
FONGECIF Aquitaine |
34,4 |
NC |
NC |
FONGECIF Auvergne |
14,7 |
0,9 (soit 6 % des ressources) |
NC (10 collaborateurs) |
FONGECIF Basse-Normandie* |
16,9 |
NC |
NC |
FONGECIF Bourgogne |
16,9 |
NC |
NC |
FONGECIF Bretagne |
31,7 |
NC |
NC |
FONGECIF Centre |
27,1 |
2,2 |
NC |
FONGECIF Champagne-Ardenne |
12,3 |
1,1 |
NC |
FONGECIF Corse* |
3,6 |
NC |
NC |
FONGECIF Franche-Comté |
11,4 |
1,2 |
NC |
FONGECIF Guadeloupe |
NC |
NC |
NC |
FONGECIF Guyane |
NC |
NC |
NC |
FONGECIF Haute-Normandie |
21,8 |
2,2 |
NC |
FONGECIF Île-de-France |
269,8 |
17,7 |
NC |
FONGECIF La Réunion & Mayotte |
5,2 |
0,7 |
NC (10 collaborateurs) |
FONGECIF Languedoc-Roussillon |
25,4 |
2,2 |
NC |
FONGECIF Limousin |
6,3 |
0,5 |
NC |
FONGECIF Lorraine |
21,4 |
1,8 |
NC |
FONGECIF Martinique |
NC |
NC |
NC |
FONGECIF Midi-Pyrénées |
35,6 |
2,8 |
NC (7 conseillers) |
FONGECIF Nord-Pas-de-Calais |
50,4 |
3,6 |
NC (13 conseillers) |
FONGECIF |
47,5 |
3,3 |
NC |
FONGECIF Picardie |
16,8 |
1 |
NC |
FONGECIF |
17,6 |
1,2 |
NC |
FONGECIF Provence-Alpes-Côte d’Azur |
63 |
4,9 |
NC |
FONGECIF Rhône-Alpes |
94,2 |
6,9 |
NC (73 collaborateurs, dont 23 conseillers) |
TOTAL (hors Guadeloupe, Guyane et Martinique) |
863,9 |
NC |
NC |
Sources : Rapports d’activité et/ou comptes annuels 2014 des 26 FONGECIF.
* Pour ces FONGECIF, les chiffres fournis sont dans leurs rapports d’activité ou comptes annuels de l’année 2013.
S’il est vrai que les FONGECIF et la quasi-totalité des OPCA pourraient être regardés comme relevant d’un paritarisme « chimiquement pur », dans la mesure où, sauf rares exceptions, ni l’État ni les régions ne sont représentés au sein de leurs conseils d’administration, il faut garder à l’esprit que, comme l’a fait remarquer M. Hugues de Balathier-Lantage, « même lorsque l’État n’est pas présent au sein du conseil d’administration d’un organisme, il arrive qu’il exerce un mandat de service public par le biais d’un comité de suivi […] ou d’un comité d’orientation, comme au sein de l’Association nationale pour la formation des adultes (AFPA) » (343).
f. La prochaine mise sous tutelle étatique de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Créée en 1946 pour répondre aux besoins de la France en pleine reconstruction, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante.
D’abord connue sous le nom d’Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main d’œuvre (ANIFRMO), son rôle consistait initialement à former rapidement des adultes pour les amener à un premier niveau de qualification dans les secteurs du bâtiment et de la métallurgie.
Aujourd’hui, l’AFPA accompagne tous les actifs, demandeurs d’emploi et salariés, sans distinction, à toutes les périodes de leur vie professionnelle, vers l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi, notamment :
– en participant à la mise en œuvre des politiques publiques de qualification des demandeurs d’emploi au côté de Pôle emploi, des services déconcentrés de l’État et des régions ;
– en délivrant une ingénierie de certification pour le compte de l’État et des titres professionnels du ministère du Travail ;
– en concevant et en mettant en œuvre des programmes et dispositifs pour les organismes paritaires.
Employant 8 000 salariés (dont 3 700 formateurs), l’AFPA propose 235 formations qualifiantes, qui concernent prioritairement les métiers en tension et les personnes les plus éloignées de l’emploi. Plus de 140 000 stagiaires sont formés chaque année, dont 60 000 salariés et 80 000 demandeurs d’emploi (parmi lesquels 61 % trouvent un emploi dans les six mois).
L’AFPA est dotée d’une gouvernance quadripartite. Ses conseils d'orientation et d’administration, chargés respectivement de définir les orientations stratégiques et d’assurer le suivi de la gestion, regroupent des représentants de l’État, des régions et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.
Toutefois, comme l’a expliqué M. Pierre Ferracci, « l’évolution récente de l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) [en a fait] une structure, où les régions sont présentes, [mais] dont la gouvernance est un peu impossible. […] À un moment donné, à l’AFPA, on a demandé à tous les partenaires de poids – les partenaires sociaux, les régions et l’État – de sortir du conseil d’administration et de siéger dans un conseil d’orientation stratégique. On a alors nommé au conseil d’administration des personnalités qualifiées. […] Dans ces conditions, dès que l’AFPA a rencontré des difficultés financières lourdes, le conseil d’administration s’est trouvé démuni, et on a fait appel à l’État. Selon moi, cet épisode est symptomatique des déshérences de la gouvernance et de la difficulté à trouver un bon équilibre entre les partenaires sociaux, les régions et l’État » (344).
Pour cette raison, la place de l’État au sein de l’AFPA est appelée à évoluer avec la transformation prochaine de cet organisme en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en application d’une ordonnance prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
L’article 39 de ce texte habilite en effet le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour procéder à la création d’un EPIC chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’AFPA et préciser les missions exercées par cet établissement.
CHIFFRES RELATIFS AU « PARITARISME »
DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Montant des dépenses gérées par la structure ou des investissements effectués par elle (en millions d’euros) |
Coûts de fonctionnement (en millions d’euros) |
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP) | |
FPSPP |
2011 : 1306 2012 : 1674 2013 : 1043 2014 : 1100 2015 : NC |
2011 : 7 2012 : 7 2013 : 10 2014 : 11 2015 : NC |
2011 : 44 2012 : 44 2013 : 48 2014 : 48 2015 : NC |
OPCA |
2011 : 5059 2012 : 5295 2013 : 5836 2014 : 6024 2015 : NC |
2011 : 509 2012 : 537 2013 : 584 2014 : 611 2015 : NC |
2011 : 5018 2012 : 5119 2013 : 5002 2014 : 5375 2015 : NC |
OPACIF |
2011 : 727 2012 : 757 2013 : 701 2014 : 781 2015 : NC |
2011 : 61 2012 : 63 2013 : 63 2014 : 70 2015 : NC |
2011 : 551 2012 : 408 2013 : 414 2014 : 423 2015 : NC |
AFPA |
2011 : 909 2012 : 891 2013 : 889 2014 : 887 2015 : NC |
2011 : 849 2012 : 826 2013 : 788 2014 : 788 2015 : NC |
2011 : 9150 2012 : 8970 2013 : 8624 2014 : 8275 2015 : NC |
Total pour l’année 2014 |
8 792 |
1 480 |
14 121 |
Source : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).
*
* *
Comme le notait lui-même le vice-président de l’Unédic, M. Jean-François Pilliard, « en définitive, le seul domaine de “paritarisme pur”, ce sont les retraites complémentaires. […] Dans les domaines de l’assurance chômage et de la formation professionnelle, la dose de paritarisme est importante, mais les partenaires sociaux agissent par délégation dans le premier domaine, et l’intervention de l’État s’est accrue dans le second avec la mise en place du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » (345).
À cet égard, le rapporteur partage les analyses du professeur Jacques Freyssinet qui a expliqué que « le phénomène du paritarisme, tout au long de son histoire, s’est trouvé pris en tenaille entre la négociation collective et l’intervention de l’État. […] Les institutions paritaires reposant sur des financements obligatoires, elles supposent une approbation par l’État sous une forme ou sous une autre – loi de transposition en matière de formation professionnelle continue, agrément pour l’assurance chômage et arrêté d’extension ou d’élargissement pour les retraites complémentaires. Dans tous les cas, l’intervention de l’État est indispensable et n’est pas toujours passive, loin s’en faut. Ouvertes ou officieuses, les tractations entre l’État et les partenaires sociaux, signataires et non signataires, peuvent être intenses, à l’image de la bataille livrée pour aboutir à l’agrément de l’accord du 1er janvier 2001 relatif au régime d’assurance chômage, qui dura plus de six mois » (346).
Et M. Gérard Adam concluait lui aussi qu’il fallait « reconnaître d’emblée que nous connaissons un système de tripartisme larvé ou occulte n’osant pas s’avouer comme tel.[…] Les modalités d’intervention de l’État sont multiples, les unes étant très claires, les autres plus subreptices, tels des prélèvements effectués sur des organismes comme l’Agefiph ou l’ancien 1 % logement, au motif, soit que la gestion était déficiente, soit qu’ils devaient contribuer à des objectifs d’intérêt général » (347).
DEUXIÈME PARTIE – LE PARITARISME : UN SYSTÈME À REFONDER POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE NOTRE SIÈCLE
Le panorama du paritarisme qui a été brossé dans la première partie de ce rapport conduit au constat du morcellement des dispositifs et organismes prenant en charge les différents risques auxquels on peut être exposé.
Il faut reconnaître que le paritarisme fonctionne plutôt bien quand, comme en matière de retraites complémentaires, les partenaires sociaux maîtrisent les cotisations et les paramètres des dépenses et qu’il n’y a pas d’intervention de tiers dans les négociations : les problèmes sont analysés et traités ; les décisions sont prises ; les caisses sont en excédent ; les déficits prévisibles sont anticipés. Une gestion paritaire vraiment autonome peut donc être sérieuse et efficace.
Toutefois, si les structures paritaires sont plutôt bien gérées et qu’elles font montre d’une capacité d’innovation, elles sont souvent très cloisonnées. Comme l’a fort bien résumé Mme Marie-Françoise Leflon, secrétaire générale de la CFE-CGC : « la légitimité du paritarisme n’est pas contestée, mais son application souffre de la dispersion de la prise de décision » (348).
En effet, les grandes lignes de l’architecture des dispositifs de protection sociale n’ont guère évolué depuis l’après-guerre, alors que le modèle économique s’est transformé et que le monde d’aujourd’hui est très différent du monde dans lequel ces dispositifs ont été conçus.
De l’après-guerre au milieu des années 1970, pendant les « Trente Glorieuses », il était courant qu’une carrière se déroule intégralement au sein d’une même entreprise, de l’âge de seize ans à celui de la retraite. À l’époque, il était donc possible de gérer l’assurance-chômage comme une caisse indemnisant un « accident de parcours » peu coûteux, car les salariés avaient la perspective de retrouver rapidement du travail. Les différents risques – santé, chômage, retraite, famille, etc. – ont été traités de manière cloisonnée.
Dans ces conditions, la négociation collective et la gestion (plus ou moins) paritaire des dispositifs mis en place par les normes négociées fonctionnaient sans trop de difficultés. On était dans une logique que certains ont qualifiée de « gagnant-gagnant », parce qu’il y avait des richesses à redistribuer. Dans ce contexte, il semblait logique, sain et utile à la démocratie que les partenaires sociaux, au sein de l’entreprise et de la branche comme au niveau interprofessionnel, œuvrent ensemble à la répartition des fruits de la croissance. Et le relatif retrait de l’État était légitime, car il n’était pas besoin de faire valoir d’autres intérêts que ceux des employeurs et des salariés.
Depuis la fin du XXe siècle, la croissance a ralenti, les revenus à partager ont diminué, l’exacerbation de la mondialisation et de la concurrence et l’apparition du chômage de masse – que le rapporteur lie à la mondialisation – ont marqué la fin d’une période de progrès social. Les accords collectifs ont cessé d’être « gagnant-gagnant », tant pour les salariés que pour les employeurs. Comme le note M. Jean-Denis Combrexelle, dans le rapport sur La négociation collective, le travail et l’emploi qu’il a remis au Premier ministre en septembre 2015, on est passé d’une « négociation de distribution » à une « négociation d’accompagnement de la crise et de gestion des conséquences sociales des mutations économiques » (349).
Dans ce contexte, la puissance publique a été amenée à intervenir dans des dispositifs qui étaient jusqu’alors gérés par les partenaires sociaux. La réforme dite « Juppé » de 1995, qui a conduit à l’« étatisation » de la Sécurité sociale, en est une bonne illustration.
Depuis, on observe une forme de stabilisation : l’architecture des dispositifs « paritaires » a été conservée.
Si, comme l’a expliqué M. Raymond Soubie, « la vie a été relativement facile pour les régimes paritaires tant que la vie en général a elle-même été facile » et si « au cours des périodes de croissance, ces régimes évoluaient dans le sens d’une amélioration continue en faveur des salariés […] - ce qu’André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, appelait “le grain à moudre” », on remarque que « depuis quelque temps – mais depuis peu au regard de leur histoire –, les régimes paritaires sont confrontés à un problème considérable : le ralentissement de la croissance et, partant, celui de leurs recettes. […] Les régimes paritaires fonctionnent bien par beau temps et à peu près correctement par temps maussade, mais leur mode de gouvernance ne peut pas fonctionner lorsque soufflent des vents contraires violents » (350).
Quelle est encore la place du paritarisme à l’heure où salariés et employeurs sont tentés de faire cause commune pour survivre dans le contexte de la mondialisation ?
Dans le domaine professionnel, tout est lié aujourd’hui : les règles relatives à l’âge légal de départ à la retraite ont des incidences sur l’assurance-chômage (351). Pourtant, alors qu’il paraîtrait logique que les chômeurs puissent bénéficier d’une formation dès leur premier jour de chômage, on se heurte au fait que les dispositifs d’assurance-chômage ne sont pas gérés par ceux qui pourraient prendre une telle décision.
Face à ces évolutions, ni les pouvoirs publics, ni les différents organismes paritaires ne semblent avoir défini de stratégie d’évolution et d’adaptation des dispositifs qu’ils gèrent, au-delà d’utiles et constantes améliorations soulignées dans la première partie du présent rapport. Or, aujourd’hui, c’est l’architecture d’ensemble qu’il faut repenser.
I. L’ARCHITECTURE DE LA NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE ET DU PARITARISME DOIT ÊTRE REPENSÉE
Évoquant le processus de négociation de l’accord obtenu le 16 octobre 2015 sur la réforme des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, M. Philippe Pihet, secrétaire confédéral de Force ouvrière, a fait remarquer qu’à la suite de cet accord, « le “patron des patrons”, comme on disait autrefois, a pris la peine de remercier le Gouvernement pour avoir facilité la négociation et l’obtention d’un accord » (352).
Il est vrai que « ce qu’il est convenu d’appeler “document d’orientation” constitue un euphémisme pour dire que le Gouvernement tient la main des partenaires sociaux en les invitant à négocier librement, mais selon des modalités et un calendrier qu’il a lui-même fixés », comme l’a expliqué M. Gérard Adam, président du groupe de travail de l’Institut Montaigne qui a publié, en 2011, un rapport intitulé Reconstruire le dialogue social (353) .
Mais si le Gouvernement peut être amené à prendre les partenaires sociaux « par la main », c’est parfois à leur demande.
Or, si « un besoin d’État s’exprime y compris chez ceux qui critiquent son intervention » (354), c’est que le paritarisme de négociation est arrivé à bout de souffle et que ses méthodes méritent d’être renouvelées, en particulier au niveau interprofessionnel.
Ainsi, appelant de ses vœux une nouvelle pratique de la négociation collective, qui permettrait qu’elle se déroule dans un lieu neutre, comme le Conseil économique, social et environnemental – contrairement à la pratique actuelle qui veut qu’elle ait lieu dans les locaux du MEDEF et sous la présidence de cette organisation –, M. Éric Aubin a suggéré que la négociation des accords interprofessionnels soit présidée « par une personne neutre, par exemple un représentant de l’État » (355).
Au-delà de la question de la présidence des négociations, la question se pose en effet de l’utilité d’un lieu neutre et du « partage du stylo » pour la rédaction du projet d’accord soumis aux débats.
En effet, si l’on veut éviter que l’État soit régulièrement sollicité pour intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations, et si l’on veut favoriser une forme d’organisation équilibrée entre les partenaires sociaux pour faciliter la conclusion d’accords dans un cadre purement paritaire, alors il ne faut plus que les organisations syndicales de salariés, qui manquent souvent de moyens pour négocier, soient systématiquement amenées à réagir (parfois dans l’urgence) sur des textes d’origine patronale. Il y a quelque chose d’« inéquitable », pour reprendre la formule de M. David Dugué, administrateur de la CGT (356).
Comme l’a souligné Me Michel Henry, avocat, « la Cour de cassation a défini une règle du jeu [de la négociation] il y a quelques années. En quelques arrêts, […] la Cour a édicté les règles qu’il faut appliquer dans une négociation collective : être sur un pied d’égalité au regard de l’information ; se retrouver ensemble ; sans que les apartés soient interdits, il faut néanmoins, lors de discussions communes, pouvoir participer à la discussion d’un texte dont on a pu prendre connaissance ; et il faut que le texte soumis définitivement à la signature des partenaires ait été préalablement soumis à la discussion de l’ensemble des partenaires sociaux réunis tous ensemble. [Mais] à la lumière de ce qui s’est passé lors de la négociation de la dernière convention Unédic, on pourrait encore perfectionner cette jurisprudence, peut-être par voie législative » (357).
Dans le prolongement des suggestions faites par M. Éric Aubin, les représentants de la CFTC ont préconisé, lors de leur audition, le 28 avril dernier, la création d’un « comité paritaire permanent du dialogue social » qui siégerait au CESE et qui permettrait d’établir, en amont, et sans lien direct avec l’actualité brûlante, la liste de tous les sujets du ressort des partenaires sociaux susceptibles de faire l’objet de discussions, concertations ou négociations (sans obligation systématique de résultat), afin de bâtir un agenda partagé de réforme.
Dans l’esprit des représentants de la CFTC, ce comité paritaire permanent pourrait être consulté par le Parlement et le Gouvernement sur les questions socio-économiques et l’emploi. Une fois un accord conclu, il pourrait notamment « devenir l’interlocuteur privilégié des parlementaires afin de faciliter si nécessaire sa transposition dans la loi », et « cette logique de fonctionnement s’appliquerait également au suivi de l’accord, de la loi et des décrets d’application » (358).
Par ailleurs, la CFTC a proposé que ce dispositif soit décliné dans les branches sous forme de commissions du dialogue social qui faciliteraient l’élaboration des agendas sociaux des branches, encadreraient la négociation d’entreprise et permettraient aussi d’opérer des regroupements de négociations entre plusieurs branches.
Le rapporteur est convaincu des vertus de ce « dialogue social new look » (359), de ce que « le modèle culturel de la négociation, on serait tenté de dire sa “liturgie”, est dépassé » (360) et de ce qu’il faut aller plus loin, dans la formalisation de la négociation, que ce qui est aujourd’hui prévu par l’article L. 1 du code du travail (361).
Il a donc a déposé, lors de l’examen du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (dont l’article 13 prévoit la création de commissions paritaires permanentes de négociation au niveau des branches) un amendement proposant la création d’une commission paritaire permanente interprofessionnelle de négociation, ou plus exactement d’un « Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme » qui serait composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et qui se réunirait dans des locaux n’appartenant à aucune de ces organisations (pourquoi pas le CESE, comme le préconise la CFE-CGC depuis plusieurs années ? (362)) pour :
– établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte ;
– établir, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste, un calendrier prévisionnel de négociation.
Le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme serait le lieu des négociations interprofessionnelles sur saisine de l’État, du Parlement ou auto-saisine, qui seraient organisées autour de quatre commissions permanentes :
– protection sociale et vie quotidienne (retraites complémentaires, prévoyance, logement, etc.),
– sécurité sociale professionnelle (emploi, chômage, formation, santé et qualité de vie au travail, etc.),
– nouvelle économie (numérique, plateformes collaboratives, écologie, etc.),
– contrôle et évaluation (contrôle, évaluation, recherche, formation des acteurs, financement du paritarisme, etc.)
Ces commissions se prononceraient sur l’opportunité d’ouvrir une négociation nationale et interprofessionnelle lorsque le Gouvernement formulerait une demande en ce sens. Toute saisine formelle de la part de l’exécutif exigerait une réponse formelle de la part des commissions du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme, sur le modèle des avis que les caisses de sécurité sociale émettent chaque année sur le PLFSS dont elles sont saisies parallèlement à sa transmission au Conseil d’État.
Au sein du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme, les méthodes de négociation devraient être définies pour favoriser un meilleur équilibre entre les partenaires sociaux que celui que l’on constate aujourd’hui. Par exemple, les discussions devraient s’engager sur un projet de texte élaboré conjointement par les organisations patronales et syndicales.
Véritable « parlement des partenaires sociaux et de la négociation », le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme aurait vocation à collaborer avec les assemblées parlementaires. On pourrait notamment imaginer que ses représentants puissent être entendus par les différents groupes parlementaires et que, réciproquement, les représentants des groupes parlementaires puissent être entendus par le Haut conseil.
Ce dernier entretiendrait des liens non seulement avec les élus, mais aussi avec les citoyens eux-mêmes. Il serait en effet utile que ce Haut conseil soit accompagné dans ses travaux par un jury citoyen, sur le modèle de celui qui a été placé auprès du comité de suivi des retraites par l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale (363).
Proposition : Créer un « Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme », véritable « clef de voûte » de l’architecture du dialogue social interprofessionnel, qui serait chargé :
– d’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte et de définir un calendrier prévisionnel de négociation, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste ;
– de se prononcer formellement sur l’opportunité d’ouvrir une négociation nationale et interprofessionnelle lorsque le Gouvernement formulerait une demande en ce sens ;
– d’entretenir avec le Parlement une « navette » consultative pour l’analyse des textes (projets ou propositions de loi) concernant le droit du travail.
Pour l’exercice de ses attributions, le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme serait organisé autour de quatre commissions permanentes : protection sociale et vie quotidienne, sécurité sociale professionnelle, nouvelle économie, contrôle et évaluation.
Afin de favoriser la qualité des négociations au sein du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme, on pourrait imaginer la création d’une structure permettant à l’ensemble des acteurs du paritarisme d’avoir une vision partagée des enjeux économiques et sociaux.
En effet, il semble qu’il manque aujourd’hui dans notre pays une sorte d’« Institut des hautes études du dialogue social », pour reprendre le parallèle avec l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) qui a été établi par M. Jean-Denis Combrexelle, lors de son audition, le 18 novembre 2015 (364).
Selon M. Philippe Hourcade, président de l’association Dialogues, « il manque actuellement un dispositif de formation globale de l’ensemble des acteurs, quel que soit le lieu où ils exercent leurs responsabilités, qui leur permette d’avoir une vision partagée des enjeux économiques et sociaux » (365). De son point de vue, il est « essentiel d’instaurer des mécanismes, aujourd’hui encore inexistants, de formation des acteurs sociaux, qui soient coercitifs ou plus incitatifs ».
Proposition : Créer un « Institut des hautes études du dialogue social » permettant à l’ensemble des acteurs du paritarisme d’avoir une vision partagée des enjeux économiques et sociaux.
Dans le cadre du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme et de l’Institut des hautes études du dialogue social, les partenaires sociaux pourraient réfléchir à l’institution, à l’horizon d’une dizaine d’années, d’une sécurité sociale professionnelle.
II. L’INSTITUTION, À TERME, D’UNE SÉCURITÉ SOCIALE PROFESSIONNELLE DOTÉE D’UNE GESTION UNIFIÉE
Tout en louant la bonne qualité de la gestion de ces organismes, M. Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha, a ainsi regretté « un manque d’innovation sur le plan stratégique : ces organismes éprouvent souvent des difficultés à prendre des décisions, ce qui peut conduire à rester dans un consensus mou ». Selon lui, « l’absence d’innovation stratégique est liée à la diversité des acteurs présents autour de la table, qui sont souvent en désaccord. […] La gouvernance à plusieurs, avec l’État et les régions, n’a pas été suffisamment pensée. À un moment donné, il faut avoir le courage de remettre chacun à sa place. On peut être nombreux autour de la table pour élaborer la stratégie et pour en évaluer les résultats. […] Pour le reste, et notamment quand il s’agit de prendre des décisions un peu fortes, il faut un pilote dans l’avion. Les partenaires sociaux ont tendance à considérer qu’ils doivent être au gouvernail à chaque fois qu’ils financent quelque chose. […] Eh bien non, ce ne doit pas forcément être le cas. […] Prenons l’exemple de la formation des demandeurs d’emploi. […] Les partenaires sociaux ont toujours voulu se mêler de la formation des demandeurs d’emploi qu’ils financent notamment au travers du fonds paritaire. […] Sur le terrain, se sont bâtis des fonds paritaires régionaux. […] L’ennui est que le processus a pris beaucoup de temps et que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est resté, pendant très longtemps, éloigné des régions. […] Nous ne parvenons pas à trouver la gouvernance qui mette chacun à la bonne place. Le dispositif concernant les demandeurs d’emploi est sans doute trop complexe : les partenaires sociaux s’occupent de l’indemnisation au travers de l’Unédic ; l’État s’occupe de l’accompagnement via Pôle emploi, et les régions s’occupent de l’orientation et de la formation » (366).
Le même constat du foisonnement des acteurs et de la complexité des dispositifs peut être dressé en matière de santé au travail. Dressant le bilan de l’efficacité du « paritarisme de projet » qui prévaut dans ce domaine, M. Hervé Lanouzière a jugé que « beaucoup de temps et d’énergie y sont dépensés. La question est sans cesse posée de savoir qui est autonome, qui est le chef, qui pilote… ». Il a ajouté que « si le fonctionnement paritaire est passionnant, il n’en est pas moins coûteux » car « passer autant de temps à élaborer les conditions des compromis est particulièrement coûteux en énergie […] Plutôt que vingt-six chapelles [correspondant aux 26 ARACT], nous préférerions une grande cathédrale » (367).
L’une des meilleures illustrations de cette organisation en « chapelles » et de « l’étanchéité entre ces institutions, qualifiée d’architecture en tuyaux d’orgue » (368) est sans doute le dispositif retenu pour la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP), qui a été confiée à cinq acteurs majeurs (Pôle Emploi, Cap Emploi, les missions locales, l’APEC ainsi que les OPACIF et les FONGECIF), alors qu’il s’agit d’apporter une réponse à un même besoin.
A. LA COMPLEXITÉ DU DISPOSITIF DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ILLUSTRE LA NÉCESSITÉ DE CRÉER, ASSEZ RAPIDEMENT, UN RÉGIME D’ASSURANCE-FORMATION GÉRÉ PAR UNE AGENCE NATIONALE POUR L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE…
1. La complexité et les insuffisances du dispositif du conseil en évolution professionnelle
Créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et rénové par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service de conseil gratuit mis en place dans le cadre du service public régional de l’emploi et destiné à favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel en permettant :
– d’une part, l’accompagnement dans les projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles des territoires ;
– d’autre part, la simplification de l’accès à la formation, en identifiant les qualifications répondant aux besoins de la personne et la mobilisation des financements disponibles et en facilitant le recours au compte personnel de formation (CPF).
Délivré en dehors de l’entreprise, ce conseil est aujourd’hui susceptible d’être assuré par cinq institutions définies à l’article L. 6111-6 du code du travail, à savoir :
– les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi) ;
– Pôle emploi ;
– les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
– les OPACIF et les opérateurs régionaux désignés par la région après concertation au sein du bureau du CREFOP ;
– l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
Pour ce qui concerne les FONGECIF, M. Patrick Frange, président du FONGECIF Île-de-France, a expliqué que la mise en œuvre du CEP constituait « une petite révolution ». Alors que « jusqu’en 2015, il[s] finançai[en]t des prestations, la plus importante étant le congé individuel de formation (CIF) […], depuis la dernière réforme, le[s] FONGECIF exerce[nt] une nouvelle mission [où il] ne s’agit plus seulement de construire un projet avec le salarié, mais de l’accompagner même si son projet n’est pas défini ou s’il ne demande pas de financement » (369).
M. Patrick Frange a également jugé « judicieux » le choix fait par le législateur de confier la mise en œuvre du CEP à cinq catégories d’acteurs, car, selon lui, « chacun d’eux a sa “clientèle” […] : historiquement, les FONGECIF s’adressent aux salariés en activité qui souhaitent une évolution, voire une réorientation professionnelle » tandis que « Pôle emploi travaille sur la recherche d’une employabilité pour les personnes privées d’emploi » (370).
Du point de vue du rapporteur, ce cloisonnement est gênant, d’autant qu’il ne semble pas que les différents acteurs se rencontrent au sein d’un comité de coordination pour faire le point tous les mois sur le dispositif.
Le législateur ayant décidé de confier des responsabilités élargies à ceux qui étaient les plus proches de ce métier de conseil, on aboutit à un paysage extrêmement complexe, puisque le dispositif du CEP implique cinq acteurs différents en fonction de la situation de la personne concernée et qu’il est en outre décliné dans vingt-six (et bientôt treize) régions. Dans ces conditions, il est difficile pour les bénéficiaires du dispositif de savoir à quel organisme s’adresser.
Il est certes avantageux de partir de l’existant et de ne pas tout bouleverser, mais cela conduit à un système à l’efficacité incertaine.
Preuve en est que le premier rapport sur la mise en œuvre du CEP qui a été publié par le CNEFOP en avril dernier (371) indique que la mise en œuvre de ce dispositif ne pouvait qu’être lente et progressive, car si 732 000 personnes ont bénéficié du dispositif en 2015 (372), le déploiement de celui-ci est inégal, selon les institutions qui le délivrent. Si les FONGECIF, les OPACIF ou l’APEC ont restructuré leur offre de services, il semblerait que les opérateurs historiques de l’accompagnement – Pôle emploi et missions locales – n’aient pas encore procédé à l’articulation avec leur offre de services préexistante.
Constatant lui aussi la mise en œuvre inégale du CEP par les cinq institutions chargées de le délivrer, M. Christophe Sirugue, député, a souligné dans son rapport sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, que « le CEP ne dispos[ait] pas de moyens propres » et qu’il était nécessaire de « renforcer les moyens du CEP et de lui assurer la pleine capacité de remplir sa mission pour 40 millions d’actifs » (373).
La mise en œuvre du CEP est l’exemple même d’une réforme où des organismes existants se sont vus confier des missions supplémentaires sans que soient déployés des moyens supplémentaires et sans que soit repensée l’architecture globale du dispositif au profit de potentielles synergies. Après tout, le métier des FONGECIF n’est pas fondamentalement différent de celui de Pôle emploi en matière de conseil en évolution professionnelle.
2. La nécessité de créer, à terme, un régime d’assurance-formation géré par une Agence nationale pour l’évolution professionnelle
Tout en se déclarant « dubitatif sur l’idée d’une structure unique couvrant la totalité du spectre [puisqu’] on s’adresse à 28 millions de salariés, auxquels s’ajoutent les demandeurs d’emploi », M. Laurent Nahon, directeur général du FONGECIF Île-de-France, a concédé que « l’acteur unique de référence peut être une deuxième phase dans la mise en œuvre des dispositifs » (374).
Le processus de mise en œuvre du CEP pose en effet la question de savoir de qui relève fondamentalement de l’accompagnement des projets d’évolution professionnelle : s’agit-il d’une mission régalienne, auquel cas il reviendrait à l’État et aux régions de le gérer, éventuellement dans le cadre d’un établissement public ? Ou doit-on mettre en place, à l’instar de l’assurance-chômage gérée par les partenaires sociaux, une assurance-formation gérée par un acteur unique, éventuellement paritaire, qui suivrait l’individu dans tous les moments de sa vie ?
Le rapporteur plaide pour la création, à terme, d’un régime d’assurance-formation susceptible d’être géré par une Agence nationale pour l’évolution professionnelle qui favoriserait une meilleure intégration entre le FPSPP, les OPCA, les OPACIF et les FONGECIF, soit en les fusionnant au sein d’un opérateur unique, géré paritairement, soit en conservant leur identité spécifique tout en mettant en place un « front office » unique, car, comme l’a dit M. Pierre Burban, « dès lors que les organismes travaillent ensemble, ce qui compte, du point de vue de l’assuré, c’est la qualité du service rendu, c’est-à-dire le front office davantage que le back office » (375).
Proposition : Créer, assez vite, comme aboutissement de la réforme de 2014, un régime d’assurance-formation géré par une Agence nationale pour l’évolution professionnelle.
Le rapporteur ne conçoit toutefois la création de ce régime unifié d’assurance-formation que comme une étape vers la mise en place, à terme, d’un véritable « service public de l’emploi » propre à assurer une prise en compte globale des parcours professionnels qui soit moins morcelée qu’elle ne l’est aujourd’hui dans les dispositifs gérés par l’Unédic, Pôle Emploi et les innombrables acteurs de la formation professionnelle.
B. …QUI POURRAIT AMORCER LA CRÉATION, À TERME, D’UNE AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE PROFESSIONNELLE FAVORISANT UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE DE LA PERSONNE, DANS LE PROLONGEMENT DE LA LOGIQUE QUI ANIME LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
L’éclatement des différents régimes de protection sociale des travailleurs qui sont gérés paritairement est particulièrement problématique en matière de d’assurance-chômage et de formation professionnelle : avant que le chômage ne survienne, il n’y a pas assez d’anticipation par la formation.
Lors de son audition, M. Pierre Ferracci a déclaré avoir été jadis « partisan de réunir l’ANPE et l’AFPA pour former un grand service de l’accompagnement, de la formation et de l’orientation », ajoutant que « cette réforme a été faite en Belgique, de façon plutôt efficace » (376).
Après avoir rappelé que ce projet a été contrarié par le fait que « les régions ont acquis des prérogatives en matière de formation des demandeurs d’emploi » et que « la gouvernance de l’AFPA a été un peu improbable pendant quelques années et l’est encore aujourd’hui – l’État s’est désengagé, sans que les régions prennent le relais », M. Ferracci a expliqué qu’il fallait s’orienter vers un système confiant à Pôle Emploi le soin de s’occuper aussi de la formation des actifs, car « la force des pays scandinaves, c’est précisément de s’occuper par anticipation de la formation des actifs potentiellement menacés par des restructurations ou des mutations importantes » (377).
Au-delà du CEP, c’est l’ensemble du dispositif de formation professionnelle qui est caractérisé par une complexité telle qu’il est difficile de savoir vers qui se tourner : vers le directeur des ressources humaines de son entreprise ? Vers un OPCA, un OPACIF, un FONGECIF ? Vers Pôle emploi, Cap emploi ou la mission locale ?
S’il ne fait pas de doute qu’il faille encourager et améliorer les coopérations entre ces différents acteurs, on peut légitimement se demander si cela suffira à permettre à un demandeur d’emploi de trouver, le jour même où il se retrouve au chômage, une formation lui offrant la possibilité de « rebondir ».
Dès lors que l’on traite des questions de formation et d’évolution professionnelle, cela n’a pas de sens de considérer le temps du chômage de manière isolée. Un chômeur est autant un ancien salarié qu’un futur salarié.
Rien n’interdit de se demander en conséquence si l’Unédic ne devrait pas traiter des questions de formation, se rapprocher du FPSPP et devenir l’« Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi, la formation et la gestion des temps de la vie dans l’industrie et le commerce » – organisme unifié qui accompagnerait à la fois des salariés et des chômeurs dans leur parcours professionnel et, plus généralement, dans la gestion des temps de la vie, notamment en cas de congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant, d’adoption, d’« engagement citoyen » ou de proche aidant.
Du côté des opérateurs, on pourrait imaginer, dans un souci de rationalisation du système, qu’un même opérateur gère à la fois l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des salariés. Pôle Emploi pourrait alors devenir dans un premier temps un « Pôle emploi-formation », puis une « Agence nationale de sécurité sociale professionnelle », qui gérerait à la fois les situations de chômage et de formation en entreprise, donc la progression du salarié tout au long de son parcours professionnel.
Interrogé au sujet de la création, à terme, d’un « Pôle emploi-formation », M. Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi, a jugé lors de son audition, le 31 mars dernier, que cela « supposerait de recalibrer Pôle emploi en profondeur, alors que [ses agents sont] déjà confrontés à des difficultés objectives dans le traitement des demandeurs d’emploi » et que cela « impliquerait de remettre en cause des évolutions institutionnelles assez lourdes ».
Toutefois, le rapporteur estime qu’une telle évolution serait positive non seulement pour les demandeurs d’emploi mais aussi pour les agents de Pôle Emploi, qui seraient ainsi amenés à gérer des carrières, avec des temps de chômage mais aussi des temps d’emploi et de formation. Ils auraient la possibilité à la fois d’aider des demandeurs d’emploi et de monter des projets de formation pour des salariés.
Le métier des agents de Pôle Emploi – dont le rapporteur sait qu’il est très difficile – deviendrait complètement différent : ils seraient très fortement ancrés dans l’entreprise et prendraient en compte les stratégies déployées par les salariés tout au long de leur carrière. Ce serait sans doute plus gratifiant pour eux… et plus efficace pour le système.
Au-delà de la valorisation des tâches des agents de Pôle Emploi, la création de l’Agence nationale de sécurité sociale professionnelle répondrait à l’exigence, constatée par M. Philippe Hourcade, de ne « plus raisonner en distinguant les branches les unes des autres » et d’examiner, par exemple, « si les fonds de la formation professionnelle ne pourraient pas être mobilisés de façon plus importante pour aider à la formation des jeunes et des chômeurs » (378).
C’est, dans une certaine mesure, la logique qui a inspiré la création du FPSPP. Ce dernier tend, en effet, à favoriser une certaine perméabilité entre les circuits de formation des salariés et des demandeurs d’emploi.
À cet égard, le rapporteur tient à souligner que si les fonds disponibles pour la formation des salariés ne doivent pas être « cannibalisés » par la formation des demandeurs d’emploi, il n’en demeure pas moins que les ressources dédiées à la formation de ces derniers doivent être pleinement utilisées.
Plus encore qu’un dispositif de péréquation entre les fonds dédiés à la formation des salariés et ceux dédiés à la formation des demandeurs d’emploi, le FPSPP constitue, du point de vue du rapporteur, un embryon de prise en compte globale de la personne, permettant de financer différents types d’action en prenant pour point de départ les difficultés constatées.
Cette prise en compte globale de la personne a commencé de s’affirmer plus nettement encore à travers le projet tendant à mettre en place, à compter du 1er janvier 2017, un compte personnel d’activité (CPA).
1. L’amorce d’une prise en compte globale de la personne à travers la création d’un compte personnel d’activité
L’article 38 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a posé le principe de la création, à compter du 1er janvier 2017, d’un compte personnel d’activité (CPA) qui rassemblerait pour chaque personne, « dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel ».
Aux termes de l’article 21 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, le CPA a vocation à regrouper plusieurs comptes rattachés à la personne et aujourd’hui distincts, parmi lesquels le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et le compte personnel de formation (CPF), qui reposent eux-mêmes sur une logique de fongibilité et de portabilité des droits.
a. Le développement d’une logique de fongibilité et de portabilité des droits avec la création des comptes personnels de formation et de prévention de la pénibilité.
Créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le C3P permet en effet d’acquérir des points au titre de l’exposition à la pénibilité et de convertir les points acquis afin de financer des heures de formation, un complément de rémunération en cas de réduction de la durée de travail ou une majoration de durée d’assurance vieillesse. Ce compte a ainsi initié un principe de fongibilité des droits.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)
Les principes du compte de prévention de la pénibilité ont été définis au sein des articles 6 à 17 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
L’idée du compte est que chaque salarié exposé à des conditions de travail pénibles, c’est-à-dire réputées réduire l’espérance de vie en bonne santé, peut cumuler des points au long de sa carrière. Le compte concerne tous les salariés des entreprises du secteur privé ainsi que tous les personnels employés par des personnes publiques sous contrat de droit privé.
Chaque trimestre d’exposition donne lieu à un point, voire deux en cas d’exposition à plusieurs facteurs, le total des points cumulables par an étant fixé à huit par le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014. Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte tout au long de la carrière est plafonné à 100, ce qui correspond à deux années et demie de départ anticipé à la retraite.
Les points enregistrés sur le compte peuvent être utilisés par les salariés exposés à des facteurs de pénibilité pour :
– suivre une formation, en vue d’une réorientation professionnelle dans un secteur moins exposé à la pénibilité. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à cette formation ;
– financer une réduction du temps de travail (dix points permettant de compenser une réduction du temps de travail de 50 % pendant un trimestre) ;
– majorer la durée d’assurance vieillesse (dix points correspondant à un trimestre d’assurance).
Le financement du compte est assuré par les cotisations versées par les employeurs, conformément aux dispositions de l’article L.4162-19 du code du travail. L’ensemble des entreprises verse en effet une cotisation minimale, au titre de la solidarité interprofessionnelle. Les entreprises exposant leurs salariés à l’un des facteurs de pénibilité retenus, ou à plusieurs d’entre eux, sont quant à elles soumises à une cotisation additionnelle, l’objet de cette dernière étant de les inciter à réduire le niveau d’exposition de leurs salariés par des protections adaptées ou une moindre exposition dans la durée aux facteurs de pénibilité.
Le produit de ces cotisations est affecté au Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, créé par le décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014.
Dix facteurs de pénibilité ont été retenus : le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, le risque chimique, les activités exercées en milieu hyperbare, l’exposition à des températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes ainsi que le travail répétitif.
Pour chacun de ces facteurs, un seuil d’exposition minimale a été déterminé, ainsi qu’une intensité d’exposition et une durée ou une fréquence à compter desquelles la pénibilité est prise en compte.
Afin de tenir compte des difficultés de mise en place du compte personnel de pénibilité dans certains secteurs d’activité, la mise en œuvre du dispositif a été partiellement différée. Ainsi seuls quatre facteurs de pénibilité, choisis en raison de leur caractère facilement identifiable et quantifiable, sont entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : les activités en milieu hyperbare, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif.
Les six autres critères devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2016, afin de laisser le temps aux entreprises concernées de prendre leurs dispositions.
Chaque employeur doit déclarer, pour chacun de ses salariés, l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité tels que définis plus haut. Pour faciliter ses démarches, cette déclaration s’effectue dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) prévue à l’article L.133-5-4 du code de la sécurité sociale, qui est transmise par l’employeur à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) avant le 31 janvier de chaque année.
Initialement, chaque salarié devait par ailleurs être informé, par voie électronique ou par courrier, de la disponibilité des informations affectées à son compte sur un site dédié.
Le dispositif initial a fait l’objet de plusieurs modifications dans le cadre de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a notamment confié l’élaboration de référentiels aux branches professionnelles et révisé les fourchettes de taux de la cotisation additionnelle à la charge des employeurs pour financer le fonds pénibilité.
Quant au compte personnel de formation (CPF), il combine à la fois la fongibilité des droits (puisque le CPF peut être abondé au titre de l’utilisation du C3P) et leur portabilité (puisqu’il prévoit un mécanisme de transférabilité des droits à la formation permettant aux salariés de ne plus les perdre quand ils changent d’emploi ou connaissent une période de chômage).
Le rapporteur rappelle que ce principe de transférabilité des droits, qui concourt à la sécurisation des parcours professionnels consacrée par l’ANI du 11 janvier 2013 (379), est également au cœur de dispositifs tels que :
– la portabilité des garanties de couverture santé et prévoyance ;
– la création des droits rechargeables à l’assurance-chômage, qui permettent aux demandeurs d’emploi reprenant un emploi de conserver tout ou partie de leurs droits aux allocations d’indemnisation chômage non utilisés ;
– la création du compte épargne-temps (CET), qui permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, et qui, en cas de changement d’employeur, autorise le salarié à conserver ses droits, lorsqu’un accord collectif le prévoit, ou, à défaut de dispositions conventionnelles, à demander la conversion monétaire de ses droits et la consignation des unités monétaires correspondantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le compte personnel de formation (CPF),
levier de la sécurisation des parcours professionnels
Consacré comme un droit depuis l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, l’accès à la formation est longtemps demeuré virtuel, en décalage avec les attentes des salariés et des employeurs en matière de qualification. Le droit individuel à la formation (DIF) n’a en effet pas atteint les objectifs qui lui étaient dévolus, qu’il s’agisse de l’égal accès à la formation, de la sécurisation des parcours professionnels ou de l’acquisition de niveaux supplémentaires de qualification.
Le DIF n’étant pas suffisamment mobilisé, au terme d’une longue réflexion menée à la fois par les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et la société civile, la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi a posé les grands principes du CPF. Ces principes ont ensuite été enrichis et ajustés par la loi du 5 mars 2014 qui a repris des dispositions adoptées par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI du 14 décembre 2013.
Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le CPF est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans lors de son entrée sur le marché du travail, qu’elle occupe un emploi, en recherche un ou soit accompagnée dans un projet d’orientation ou d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail. Une exception est toutefois prévue pour tout jeune âgé d’au moins quinze ans, dès lors qu’il signe un contrat d’apprentissage, à condition d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
S’agissant des modalités d’utilisation des heures de formation, le titulaire du compte peut les mobiliser afin de financer les formations au moment voulu, en particulier lors des transitions professionnelles. Ces formations doivent garantir la progression d’au moins un niveau de qualification au cours de la vie professionnelle.
Le CPF offre trois garanties d’appropriation par les actifs de leurs droits : la portabilité des droits, une mobilisation simplifiée des heures de formation disponibles et une information accrue sur les droits acquis.
La portabilité des droits est garantie par le maintien des heures de formation inscrites sur le compte en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
Consacré dès la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, le principe de pleine transférabilité des heures acquises rompt ainsi avec l’espérance de vie limitée des droits accumulés au titre du DIF. Les mécanismes de portabilité du DIF étaient en effet conditionnés à une utilisation des droits durant la période de chômage consécutive ou aux deux années suivant la prise de fonctions dans une nouvelle entreprise. À ces restrictions s’ajoutaient la nécessité pour l’employeur d’avoir inscrit sur le certificat de travail du salarié le montant des droits acquis au titre du DIF dans cette entreprise. Certaines ruptures du contrat de travail, telles que la démission ou le licenciement pour faute lourde, étaient en outre exclues du dispositif de portabilité.
La portabilité s’applique aussi aux droits accumulés au titre du DIF jusqu’au 31 décembre 2014. Ces heures de formation sont ainsi inscrites sur le CPF et pourront être mobilisées par leur titulaire jusqu’au 1er janvier 2021. Ces heures ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte.
L’effectivité de l’accès à la formation repose aussi sur une mobilisation simplifiée des heures de formation. Tout salarié peut mobiliser les heures créditées sur son compte sans accord de son employeur dès lors que la formation est suivie en dehors du temps de travail. Lorsque cette formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l’accord préalable de l’employeur doit être demandé par le salarié concernant le contenu et le calendrier de la formation.
Des exceptions à l’obligation d’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation sont toutefois prévues, notamment lorsqu’il s’agit d’heures de formation financées au titre des heures créditées sur le CPF pour manquement à l’obligation d’organiser un entretien professionnel ou dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe. La mobilisation du CPF au titre de l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ou de l’acquisition du socle de connaissances et de compétences ne nécessite pas non plus d’accord préalable de l’employeur.
Dans le cas d’un demandeur d’emploi, son projet de formation est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi dès lors qu’il bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son CPF suffisant pour suivre une formation. Dans le cas contraire, Pôle emploi ou toute autre institution chargée du conseil en évolution professionnelle étudie le projet de formation et peut mobiliser les financements complémentaires en conséquence.
Il faut cependant noter que le CPF n’est utilisable que pour des formations éligibles figurant sur des listes arrêtées par le COPANEF ou les COPAREF. Si cette formation est inscrite, c’est qu’elle est certifiante.
L’effectivité de l’accès à la formation repose enfin sur les outils d’information relatifs aux CPF. Tout titulaire d’un CPF peut consulter son nombre d’heures créditées en accédant à un service en ligne gratuit : le système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF), géré par la Caisse des dépôts et consignations. L’accès à l’information est aussi facilité par la création d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, accessible par son titulaire et recensant les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue et les acquis de l’expérience professionnelle.
Le CPF est alimenté en heures de formation, conformément au principe posé par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Pour un travail à temps complet, le compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Au-delà, et jusqu’à un plafond de 150 heures, le compte est alimenté de 12 heures par année de travail. Le CPF étant d’abord alimenté par les droits accumulés au titre du DIF, un salarié peut donc déjà disposer de 120 heures. En y ajoutant les heures acquises en 2015, on peut ainsi atteindre 144 heures. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant un financement spécifique à cet effet.
Les périodes d’absence pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de soutien familial, pour un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail, sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures créditées sur le CPF.
Le seuil de 150 heures est moins un « plafond » au-delà duquel le CPF ne serait plus abondé qu’un « socle » au-delà duquel plusieurs abondements peuvent être effectués. Ces abondements n’entrent en compte ni dans le mode de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année ni dans celui du plafond.
Le CPF peut tout d’abord être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel.
Le CPF est également alimenté au titre d’un « abondement correctif » (200 heures) en cas de non-respect par une entreprise d’au moins cinquante salariés de l’obligation qui lui est faite de procéder à un entretien professionnel tous les deux ans et à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les six ans.
Le CPF peut aussi être abondé au titre de l’utilisation du C3P : un point inscrit sur le C3P ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé.
Enfin, lorsque la durée de la formation recherchée est supérieure au nombre d’heures inscrits sur le CPF, des « abondements complémentaires » peuvent être effectués afin d’assurer le financement de la formation concernée. Ces abondements sont liés à un projet de formation et ne figurent sur le compte que lors de leur utilisation, sans y être inscrits. Leur mobilisation entraîne alors le débit de tous les droits inscrits sur le compte, avec l’accord exprès du titulaire. Les heures complémentaires peuvent être financées par l’employeur, le titulaire du compte, un OPCA, un OPACIF, la CNAVTS, l’État, les régions, Pôle Emploi ou l’Agefiph. Si le CPF est mobilisé dans le cadre d’un CIF, le financement repose alors sur le FPSPP.
Selon M. Thierry Dez, directeur général d’Uniformation, « le CPF marche, quoi qu’on en dise, il monte en charge, […] il fonctionne, et ce dans ses différentes modalités » (380).
Le rapport publié par le CNEFOP en avril dernier a cependant constaté que son déploiement n’était pas encore achevé. Si le CPF a été activé par 2,5 millions d’actifs depuis sa mise en œuvre, le 1er janvier 2015, la complexité du système de listes de formations éligibles au CPF justifie, d’après le CNEFOP, plusieurs mesures de simplification, notamment pour ce qui concerne la méthodologie d’élaboration de ces listes ainsi que leur articulation.
D’après les données transmises par la DGEFP à MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, députés, qui ont publié, en mars dernier, un rapport sur la mise en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, « 286 000 formations ont été validées [en 2015, et] parmi ces formations, plus des trois quarts – 79 % – ont été suivies par des demandeurs d’emploi » (381).
Compte tenu du bilan plutôt positif de la première année de mise en œuvre du CPF, l’article 21 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s suggère de compléter le dispositif pour encourager la formation des jeunes et des salariés sans qualification – ce que le rapporteur ne peut qu’approuver. Cet article 21 prévoit le financement d’une durée complémentaire de formation qualifiante pour les jeunes sans qualification ainsi qu’un renforcement de l’abondement du CPF des salariés sans qualification qui serait alimenté à hauteur de 48 heures par an, le plafond étant quant à lui porté à 400 heures – le rapporteur estimant, pour sa part, que le CPF des salariés sans qualification devrait être immédiatement abondé à hauteur de 400 heures.
Qui plus est, le CPF étant aujourd’hui limité aux salariés et aux demandeurs d’emploi, alors qu’il a une vocation universelle, l’article 21 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s propose d’en étendre le bénéfice aux travailleurs indépendants, aux membres des professions libérales ou des professions non salariées et à leurs conjoints collaborateurs. Les modalités d’abondement du compte des travailleurs non-salariés seraient identiques à celles du CPF en vigueur. En revanche, les formations de ces travailleurs feraient l’objet d’un financement spécifique, et les formations éligibles à leur CPF seraient aménagées : certaines pourraient être communes au CPF des salariés, d’autres pourraient être propres aux travailleurs non-salariés.
S’agissant des formations susceptibles de bénéficier aux titulaires d’un CPF, elles seraient étendues aux actions permettant de bénéficier de prestations de bilan de compétences et à celles dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise.
Dans un contexte où le travail indépendant se développe et où les trajectoires professionnelles sont de moins en moins linéaires, le rapporteur juge positives les dispositions de l’article 21 précité qui vont dans le sens de l’universalisation du droit à la formation et de la préservation des droits en cas de changement de statut.
Il accueille donc favorablement les dispositions de ce même article 21 qui définissent les contours du compte personnel d’activité dont le principe a été posé par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
b. La consécration de l’universalité des droits avec la création du compte personnel d’activité
L’article 38 de cette loi a prévu qu’« afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité ».
Cette concertation, menée à l’échelle nationale et interprofessionnelle, a abouti en février 2016 à un projet de position commune aux termes duquel le CPA, ouvert de l’âge de 16 ans à la retraite, regrouperait deux comptes existants : le compte personnel de formation, d’une part ; le compte personnel de prévention de la pénibilité, d’autre part.
En parallèle de cette concertation, une réflexion a été animée par France Stratégie à la demande du Premier ministre afin d’examiner les options envisageables pour la mise en place du CPA. Présidée par Mme Selma Mahfouz, la commission « Compte personnel d’activité » a rendu ses travaux en octobre 2015, identifiant plusieurs scénarios de mise en œuvre du CPA.
Les différentes formes de CPA conçues par France Stratégie
Dans son rapport remis en octobre 2015 (382), France Stratégie a identifié plusieurs principes sur lesquels le CPA devrait reposer, quel que soit le scénario envisagé. Afin d’être universel, le CPA devrait être ouvert à tous les résidents à partir de 16 ans, être fermé au décès, utiliser le point comme unité de mesure des droits et s’appuyer sur des dotations correctrices pour les personnes éloignées de l’emploi.
Une fois ces principes communs identifiés, France Stratégie a élaboré trois scénarios de mise en œuvre du CPA répondant chacun à une logique distincte :
– « un compte orienté vers la capacité d’évolution professionnelle », visant en premier lieu la sécurisation des trajectoires professionnelles et reposant en conséquence sur les droits à la formation. Les droits accumulés sur d’autres comptes, tels que le compte personnel de prévention de la pénibilité, le compte épargne-temps ou l’épargne salariale, seraient fongibles pour financer les actions de formation. Les droits à l’assurance chômage pourraient également être partiellement intégrés ;
– « un compte ciblé sur la liberté de l’usage des temps au long de la vie », reposant sur une meilleure articulation entre les temps professionnel, personnel, familial et social et la reconnaissance des activités, qu’elles soient marchandes ou non. Le CPA rassemblerait alors les droits du premier scénario et les droits à congés tels que les jours de réduction du temps de travail (RTT). Certaines activités d’utilité collective, telles que le service civique, pourraient donner lieu à des dotations complémentaires ;
– « un compte ciblé sur l’accès aux droits et la sécurité des transitions », destiné à assurer la continuité des droits sociaux au-delà de l’emploi. Aux côtés des droits contenus dans les scénarios précédents, le CPA constituerait un point d’accès aux droits couvrant les principaux risques sociaux – maladie, accidents du travail, retraite… Assimilé à un « compte-ressources », le CPA permettrait de faciliter l’accès aux droits
– aujourd’hui gérés par des organismes différents – ainsi que la mobilité entre statuts.
Tel que conçu par le Gouvernement dans le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, le CPA se situe à mi-chemin entre le premier et le second scénario. En effet, géré par la Caisse des dépôts et consignations, le CPA intégrerait à la fois le C3P et le CPF, mais permettrait aussi la reconnaissance de l’engagement citoyen, qu’il prenne la forme du bénévolat associatif, de l’accomplissement du service civique, de l’activité de maître d’apprentissage ou encore de l’appartenance à la réserve militaire, à la réserve communale de sécurité civile ou à la réserve sanitaire. Toutes ces activités citoyennes alimenteraient un compte d’engagement citoyen dont les points permettraient d’acquérir des heures inscrites sur le CPF à raison de l’exercice de ces activités ou, sous réserve de l’accord de l’employeur, des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
Les contours du CPA dans le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s
L’article 21 du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s propose de compléter le code du travail pour prévoir que le CPA aura pour objectifs de :
– renforcer l’autonomie et la liberté d’action du titulaire du compte et sécuriser son parcours professionnel, en supprimant les obstacles à la mobilité ;
– contribuer au droit à la qualification professionnelle, en facilitant l’acquisition par tout actif d’au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière professionnelle ;
– permettre la reconnaissance de l’engagement citoyen.
Le CPA serait ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans occupant un emploi, ayant un statut de conjoint collaborateur, à la recherche d’un emploi, accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (ESAT). Reprenant une dérogation applicable au CPF, le CPA pourrait être ouvert dès 15 ans pour tout jeune qui signe un contrat d’apprentissage.
Universel, le CPA concernerait donc aussi bien les demandeurs d’emploi et les travailleurs salariés (à compter du 1er janvier 2017) que les travailleurs non-salariés (à compter du 1er janvier 2018).
L’article 22 du projet de loi précité propose même d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en œuvre, pour chaque agent public, un CPA ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à la formation et de ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits. Les mesures prises par le Gouvernement définiraient notamment les règles de portabilité des droits lorsqu’un agent public change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et lorsque le titulaire d’un CPA acquiert la qualité d’agent public.
Le CPA serait fermé à la date du décès de la personne. Toutefois, à compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à retraite, le CPF cesserait d’être alimenté, sauf au titre des activités de bénévolat ou de volontariat qui permettraient aux bénévoles et volontaires en service civique d’utiliser les points correspondants pour financer des formations destinées à leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Ce régime d’ouverture et de fermeture du compte doit permettre d’accompagner son titulaire tout au long de son activité et ainsi lui permettre de préserver ses droits accumulés quel que soit le stade de son parcours professionnel. Afin de garantir cette préservation des droits, il est prévu que les droits inscrits sur le compte demeureraient acquis par leur titulaire, y compris en cas de départ à l’étranger, jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. Le CPA garantirait ainsi la portabilité des droits.
Il assurerait aussi leur fongibilité puisque le compte d’engagement citoyen pourrait, par exemple, permettre de financer l’inscription d’heures sur le CPF.
Obéissant à un principe général de liberté d’utilisation, le CPA ne pourrait être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire dont l’éventuel refus ne constituerait pas une faute.
Afin de favoriser cette mobilisation, un système d’information performant, clair et facilement utilisable serait mis en place, sous la forme d’un service en ligne gratuit qui permettrait à chaque titulaire de connaître et d’utiliser ses droits et qui serait géré par la Caisse des dépôts et consignations, déjà chargé du système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF), sans préjudice de la gestion du C3P par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Comme le fait le rapporteur du projet de loi, M. Christophe Sirugue, le rapporteur « souligne l’avancée fondamentale que constitue la mise en place du compte personnel d’activité pour 40 millions d’actifs », compte qui « permettra de faciliter les transitions entre métiers et entre statuts, de garantir la préservation des droits acquis tout au long d’une carrière et de réduire les inégalités en facilitant l’accès aux droits » (383).
La mise en œuvre du CPA, qui place la personne au cœur des différents dispositifs, apporte une première réponse à la modification en profondeur des formes de travail et au caractère de plus en plus discontinu des trajectoires professionnelles.
Dès 1999, certains auteurs, comme M. Alain Supiot, avaient préconisé l’adaptation du modèle social français – et, plus largement, européen – aux nouvelles réalités du marché du travail et aux nouvelles formes d’emploi (384). M. Supiot avait notamment mis en exergue la tension entre, d’une part, un droit du travail et un système de protection sociale restés attachés au métier ou au statut et, d’autre part, des carrières professionnelles et des formes d’emploi peu adaptées à ce cadre juridique.
Le système français de protection sociale s’est en effet construit sur une logique de statut, à une époque de généralisation du salariat et du recul du travail indépendant. Suivant des trajectoires individuelles souvent linéaires, les salariés conservaient leur métier – donc les droits associés – tout au long de leur carrière. Mais les formes et le contenu des parcours professionnels se sont modifiés en profondeur depuis une trentaine d’années. Le monde du travail est aujourd’hui marqué par le changement de statut au cours d’une même carrière, un marché du travail dual et le déclin du modèle salarial connu jusqu’alors.
Ces changements ne se sont pas accompagnés d’évolutions juridiques conduisant à remettre en cause le caractère indissociable des droits sociaux et du métier ou du statut. Un écart croissant existe dès lors entre le cadre juridique de la protection sociale – rattachée au métier – et la nouvelle réalité des parcours professionnels.
Selon M. Pascal Terrasse, député, auteur d’un rapport sur l’économie collaborative remis au Premier ministre le 8 février 2016, « nous allons vers une “économie du chasseur”, où l’on alternera activité à temps partiel et activité à temps plein, où l’on sera indépendant deux jours et salarié trois jours. Nos modes de pensée et d’organisation sont en plein bouleversement. S’il n’y a pas, face à cette instabilité ou à ce nomadisme professionnel, une prise en charge cohérente au titre de la protection sociale et un accompagnement en matière de formation, nous nous exposons à de nombreuses déconvenues » (385).
Le CPA est de nature à répondre à ces défis, car, ainsi que l’a expliqué le commissaire général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie), M. Jean Pisani-Ferry, « les dispositifs existants examinent la situation des individus à un instant donné, en fonction de leur situation et d’un risque donné [alors qu’] avec un instrument comme le CPA, vous gérez aussi la profondeur historique de la personne » (386).
Le rapporteur partage ce point de vue, ainsi que celui de Mme Selma Mahfouz, directrice adjointe de France Stratégie, qui a fait valoir la nécessité d’un « décloisonnement d’un système de protection sociale conçu en silos » car « l’enjeu est bien de faciliter le passage du statut de salarié d’une grande entreprise, avec une bonne complémentaire santé et des avantages de tous ordres, à celui d’indépendant, par exemple » (387).
Le rapporteur note que certaines organisations syndicales de salariés ont réservé un accueil favorable au dispositif du CPA. Le secrétaire général de Force ouvrière (FO), M. Jean-Claude Mailly, a jugé que « le CPA est une bonne idée dont la mise en œuvre doit être progressive » (388). De son côté, Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT, a estimé que « l’universalité du CPA revient à sécuriser les travailleurs dans tous les allers et retours [de leur parcours professionnel] » (389), car « personne ne sera toute sa vie entrepreneur individuel, ni même sans doute salarié en CDI dans une grande entreprise » de sorte qu’« il convient donc de sécuriser les passages d’un statut à l’autre » (390).
L’accueil a été tout aussi favorable de la part de gestionnaires d’organismes paritaires : le directeur général de l’OPCA Uniformation, M. Thierry Dez, a ainsi déclaré : « nous n’avons rien à redire à ce que le CPA vienne s’ajouter à ces deux dispositifs [CEP et CPF] ou qu’il devienne une sécurité sociale professionnelle, avec une plateforme d’information pilotée par la caisse des dépôts et consignations » (391).
M. Pierre Ferracci a toutefois signalé qu’il fallait, selon lui, éviter « un écueil qui a tué le droit individuel à la formation (DIF) et pourrait tuer le CPA si on n’y prend garde : donner les mêmes droits à tout le monde, du président-directeur général salarié à l’ouvrier le moins qualifié. […] Il faudra donc faire l’effort de définir des priorités pour le CPA, comme on l’a fait pour le CPF. À défaut, les entreprises ne pourront pas le financer et le dispositif ne sera pas juste » (392).
Par ailleurs, le rapporteur tient à souligner que le dispositif du CPA, tel qu’il résulte du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, ne saurait être l’alpha et l’oméga de la sécurisation des parcours professionnels.
Comme le fait M. Christophe Sirugue, député, le rapporteur juge essentiel « de réfléchir dès à présent à l’extension future du CPA en engageant une réflexion relative aux différents comptes pouvant y être intégrés à l’avenir » (393).
Il semblerait que le Gouvernement conçoive le périmètre du CPA
– concentré autour d’un « noyau dur » de trois comptes personnels (C3P, CPF et compte d’engagement citoyen) – comme la première étape d’une construction progressive qui mènerait vers la création d’un compte regroupant tous les droits professionnels.
C’est en ce sens qu’il faut tendre car, comme l’a noté M. Jean-Denis Combrexelle, « lorsque plus de 80 % des embauches prennent la forme non seulement de contrats à durée déterminée, mais de contrats à durée déterminée très courte, un écart se fait jour entre les générations. Si le droit n’est plus lié au contrat de travail, il faut reconstruire le code du travail pour que les périodes interstitielles entre les contrats ne constituent pas autant de vides juridiques. Le compte pénibilité, le compte personnel de formation et le compte épargne temps ont tenté de répondre à cette situation. Mais une évolution est sans doute nécessaire pour qu’un compte unique gère tous ces droits » (394).
Ce compte unique devrait notamment intégrer le compte épargne-temps dont la portabilité est aujourd’hui limitée puisqu’en cas de changement d’employeur, si un accord collectif ne prévoit pas de modalités de transfert des droits à congé rémunéré acquis, le salarié est contraint de demander la conversion monétaire de ces droits, puis leur versement sous forme d’indemnité ou leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
Par ailleurs, les droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel ne peuvent être monétisés que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours et, au-delà d’un certain seuil, les droits correspondant à l’abondement en temps ou argent versé par l’employeur sont assujettis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Quant aux droits qui ne sont pas issus d’un tel abondement, ils sont fiscalisés au-delà de 10 jours par an.
Afin d’optimiser la portabilité des droits inscrits sur les comptes épargne-temps, le rapporteur propose de ne plus imposer à leurs titulaires de procéder à la liquidation de leurs droits en cas de changement d’employeur, lorsque les modalités de transfert des droits ne sont pas prévues par un accord collectif.
Afin d’assurer le transfert des droits à congé rémunéré acquis en cas de changement d’employeur, on pourrait imaginer la création d’une « Banque paritaire du temps » qui, dotée d’une gouvernance paritaire, assurerait la gestion et le transfert de ces droits. Grâce à un tel organisme, le problème de la gestion du temps serait mieux traité qu’il ne l’est à travers le projet de CPA tel qu’il est conçu par le Gouvernement.
Proposition : Créer une « Banque paritaire du temps » qui assurerait la gestion et le transfert, d’une entreprise à l’autre, des droits à congé rémunéré dont la portabilité n’est aujourd’hui qu’imparfaitement garantie par le dispositif du compte épargne-temps.
Le compte unique pourrait notamment intégrer les droits à indemnisation au titre de l’assurance-chômage, car, comme l’a fait remarquer M. Philippe Louis, président confédéral de la CFTC, au sujet des indépendants, « quand l’activité n’est plus suffisante, n’ayant pas droit à une allocation-chômage, leur situation devient dramatique. Pourquoi ne leur permet-on pas de cotiser et d’avoir eux aussi accès aux allocations-chômage ? […] En France, il n’y a que quatre activités possibles : vous pouvez être fonctionnaire, salarié, indépendant ou demandeur d’emploi. Aujourd’hui, vient s’ajouter une cinquième catégorie qui n’entre dans aucune case. Il y a deux solutions : créer une cinquième case, qu’on ne sait pas comment traiter, ou supprimer toutes les cases, c’est-à-dire qu’on en reste au travailleur, ce qui est l’esprit du CPA. On donne alors les mêmes droits à tout le monde en matière de formation, de droit social, de chômage, et l’on passe d’une catégorie à l’autre sans se poser de questions. Je pense que c’est ce à quoi aspirent les Français » (395).
C’est aussi le point de vue du rapporteur, qui s’est interrogé sur la pertinence qu’il y aurait à pousser la logique du CPA dans le sens de la constitution, à terme, d’un « socle » de droits communs à tous les actifs dans tous les domaines de risque, qui seraient déterminés et gérés par l’État, financés par des contributions générales non assises sur les salaires et susceptibles d’être complétés par des avantages complémentaires négociés, octroyés et gérés par les partenaires sociaux, dans une logique plutôt assurantielle, un peu sur le modèle du système de retraite des salariés du secteur privé qui associe une retraite de base du régime général, versée par la CNAVTS, et des retraites complémentaires, versées notamment par l’AGIRC-ARRCO.
Cette réflexion mérite d’être conduite, car, comme l’a souligné Mme Selma Mahfouz, « la question du financement du CPA se pose : un cadre collectif et solidaire, cela veut dire à la fois mutualisation du financement entre entreprises et abondement par l’État au titre de la solidarité » (396).
À cet égard, Mme Véronique Descacq a indiqué que la CFDT réfléchissait à « l’idée d’un socle de droits communs à tous les travailleurs, qu’ils soient salariés ou dans la zone grise à la frontière du salariat, dans un lien de dépendance non pas juridique avec un employeur mais économique avec un donneur d’ordres » (397).
Pour sa part, M. Bruno Mettling, directeur des ressources humaines d’Orange et auteur du rapport Transformation numérique et vie au travail (398), a estimé que « l’idée d’un socle minimal de “droits humains”, devant être garantis ici comme ailleurs par les donneurs d’ordre, [serait] une voie intéressante » (399) , à la différence de celle qui consisterait à appliquer aux nouvelles formes de travail l’ensemble des obligations pesant sur les formes de travail plus anciennes.
En revanche, Mme Brigitte Dormont, économiste et co-auteure de la note du Conseil d’analyse économique « Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité », a expliqué qu’« il faut unifier et ne pas faire d’étages, bas et complémentaire, pour les risques » et qu’« il faut donc un pilotage coordonné de tout ce qui est couvert par ces prélèvements obligatoires, risque par risque, pour avoir un système efficient en termes de couverture » (400).
Le rapporteur craint en effet que la généralisation, à tous les risques, d’un système « à étages », associant régime de base garanti par la solidarité nationale et régimes complémentaires à la charge des partenaires sociaux, ne risque, à terme, de faire peser sur ces derniers régimes une charge excessive en cas de baisse des prestations versées au titre du régime de base.
En revanche, rien n’interdit, comme l’a rappelé M. Dominique Libault, de « construire un compte personnel d’activité qui donne à la personne un accès à l’ensemble de ses droits, en faisant travailler ensemble des régimes à la création d’une interface » (401).
Car, au-delà du financement, le CPA pose aussi une question d’organisation et de gouvernance des dispositifs de protection sociale : comme l’a justement fait remarquer M. Olivier Mériaux, le paritarisme « doit évoluer à partir du moment où les droits ne sont plus attachés à l’emploi, mais à la personne du salarié, en poste ou non » (402).
Les partenaires sociaux semblent en avoir pris conscience. Regrettant que l’on travaille trop « en silos », M. Pierre Burban a fait valoir la nécessité « de coopérer et de faire en sorte que les gens travaillent ensemble » (403).
De son côté, le vice-président de l’AGIRC, M. Frédéric Agenet, a déclaré devant la mission que « le paritarisme va devoir évoluer dans son mode de fonctionnement et dans sa gouvernance, en premier lieu parce que nous vivons des cycles économiques de plus en plus courts, de plus en plus rapprochés, qui nécessitent que nous nous adaptions de plus en plus vite. Or le mode de fonctionnement actuel du paritarisme est assez lourd. Il va falloir réfléchir à le simplifier et à le rendre plus efficace de telle sorte qu’il soit possible de s’adapter à des environnements qui évoluent très rapidement » (404).
2. La nécessité de créer, à terme, un régime unifié de sécurité sociale professionnelle géré par une agence unique
Si les travaux de la mission ont fait ressortir que chaque organisme paritaire est plutôt correctement géré, il n’en demeure pas moins que le système dans son ensemble peine à prendre en compte les individus dans la diversité de leurs problèmes et dans les spécificités de leur parcours professionnel.
Les divers aspects de la vie professionnelle – chômage, formation, complémentaire-santé, retraite – sont gérés par une multitude d’organismes qui, au lieu d’appréhender l’individu dans sa globalité, le « tronçonnent » en une juxtaposition de risques : les personnes sont traitées à un moment particulier de leur vie sans que leur parcours professionnel soit jamais mis en perspective
Dans le même temps, des dispositifs sont mis en place, comme le CPF et le CPA, qui tendent à l’universalisation, à la portabilité et à la fongibilité des droits, sans pour autant que cela se traduise par une évolution des structures chargées de gérer ces droits. Or le passage de droits attachés au statut à des droits attachés à la personne, c’est aussi le passage d’un système centré sur une offre de protection à un système centré sur le demandeur et son parcours.
Pour mettre fin à ce hiatus, ne faut-il pas, comme objectif de long terme, repenser totalement le système autour des personnes et non plus autour des risques ? Ne faudrait-il pas réfléchir à une unification du système autour d’une sécurité sociale professionnelle, dont il faudrait définir les modalités de gouvernance et de gestion ?
Cette sécurité sociale professionnelle, dont le CPA pourrait être le support, permettrait une gestion unifiée des parcours tout au long de la vie en partant des individus qui seraient ainsi appréhendés dans leur globalité.
Elle supposerait toutefois un décloisonnement de notre système de protection sociale, qui a été conçu pour gérer des protections individuelles déconnectées les unes des autres.
Ce régime d’assurance professionnelle permettrait de faire face à la crise à laquelle la France est confrontée, comme l’ensemble des pays développés. En effet, puisque l’on ne peut pas empêcher certaines fermetures d’entreprise, il faut faire en sorte que les salariés confrontés aux licenciements économiques puissent rebondir vers un autre emploi, donc les accompagner, en maintenant leurs droits (à des congés, à la formation, à des complémentaires santé) quand ils passent d’un emploi à l’autre – transition que le CPA pourrait commencer à favoriser.
Les transformations du monde du travail, notamment la forte accélération des mobilités professionnelles et l’importance du chômage, obligent à mener une réflexion sur la direction à donner à des dispositifs qui gèrent aujourd’hui des risques de manière segmentée au lieu d’appréhender le parcours des individus dans son ensemble.
Le rapporteur invite donc les partenaires sociaux à réfléchir (notamment dans le cadre du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme dont la création a été préconisée) à l’institution, à l’horizon d’une dizaine d’années, d’une sécurité sociale professionnelle qui pourrait prendre la forme d’un régime unifié d’assurance professionnelle pour lequel deux modèles alternatifs de gouvernance sont concevables.
Car, si les partenaires sociaux devaient entreprendre des négociations en ce sens, « la question se pose [pour reprendre la formule de M. Gérard Adam] de savoir si l’on évolue vers un système dirigé par l’État ou si, au contraire, il ne serait pas souhaitable de revenir à l’esprit de départ des organismes paritaires, c’est-à-dire à une plus grande liberté de gestion et de décision des partenaires sociaux » (405).
En effet, l’institution d’une sécurité sociale professionnelle unifiée n’implique pas nécessairement de renoncer au paritarisme, qui pourrait favoriser les compromis nécessaires. Comme le rappelle l’ANI du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme, « l’apport spécifique de la gestion paritaire » et sa « contribution significative à la cohésion sociale et au progrès social » découlent :
– « de la proximité des partenaires sociaux avec les bénéficiaires finaux des services rendus, à savoir les salariés et les entreprises » ;
– de « la capacité des gestionnaires à mettre en œuvre les réformes issues de la négociation collective et donc, pour le paritarisme de gestion, à les comprendre et les décliner correctement et rapidement, au mieux des intérêts des salariés et des entreprises » ;
– de « la connaissance pratique qu’ils [les gestionnaires] ont du monde du travail » ;
– et de « la provenance des fonds gérés, puisqu’il s’agit de cotisations salariales et/ou patronales ».
Mais comme l’ont noté, au sujet du CPA, MM. Jean-Patrick Gille et Gérard Cherpion, députés, dans leur rapport d’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la question peut se poser « de la légitimité des partenaires sociaux à gérer seuls des droits universels » (406). Il est vrai que l’orientation et la gestion de dispositifs concernant potentiellement 40 millions d’actifs – parmi lesquels des agents des trois fonctions publiques – conduit à s’interroger sur l’association, à leur gouvernance, de l’État voire des collectivités territoriales (comme les régions).
a. Le modèle paritaire de gouvernance de la sécurité sociale professionnelle.
Le panorama du paritarisme qui a été brossé dans la première partie du présent rapport montre que les organismes strictement paritaires sont plutôt bien gérés et qu’ils sont capables de prendre à bras le corps leurs difficultés : le paritarisme « chimiquement pur » peut aller de pair avec une gestion efficace.
Il n’y a donc pas de raison d’exclure a priori le modèle strictement paritaire pour esquisser les contours de la gouvernance de la sécurité sociale professionnelle qui pourrait être mise en place à terme.
Le premier atout de ce modèle tient à la culture de compromis que favorise le choix de confier aux partenaires sociaux le soin de construire et de gérer des dispositifs de protection sociale. Pour reprendre la formule de M. Franck Mikula, secrétaire national chargé de l’emploi et de la formation à la CFE-CGC, le paritarisme est « une voie autonome de régulation sociale, qui trouve sa place entre le tout-marché et le tout-État, en faisant jouer les solidarités professionnelles » et qui favorise la « conciliation d’intérêts divergents et le dépassement des conflits afin de rendre possible la construction d’un bien commun au service des salariés et des entreprises » (407).
Quand elle est le fruit de leur compromis, la norme est aussi mieux acceptée et mieux appliquée par les partenaires sociaux. Il est vrai que, pour reprendre la formule de M. François-Xavier Selleret, directeur général de l’AGIRC, de l’ARRCO et du GIE AGIRC-ARRCO, « la force du paritarisme, c’est précisément le circuit court entre négociation et gestion » (408) : le fait que ceux qui prennent des décisions en assument ensuite la gestion constitue en effet « un levier extrêmement utile » (409) pour responsabiliser les partenaires sociaux. C’est aussi l’un des ressorts du « succès de la négociation collective », selon M. Jean-Henri Pyronnet (410).
Définissant le paritarisme comme « une belle école de l’engagement collectif », M. Bernard Vivier a expliqué devant la mission que c’était « une construction naturelle qui permet[tait] à la société de respirer et de s’organiser, puisqu’il s’agit de confier aux acteurs directement concernés le soin de définir les règles qu’ils s’appliqueront. Or on est souvent beaucoup plus enclin à respecter un contrat que l’on a négocié et qui définit des règles que l’on s’est données, qu’à obéir à une loi dont on se méfie des décrets d’application » (411).
Ce faisant, le paritarisme participe d’une forme de démocratie sociale essentielle à toute démocratie politique. À cet égard, le rapporteur fait siens les propos de M. Gérard Adam qui, à la question de savoir s’il fallait ou non réformer en profondeur le système paritaire, a répondu que « deux atouts subsist[ai]ent en sa faveur : l’un est cette cogestion étrange incluant même ceux qui n’ont pas signé les accords, qui constitue un facteur non négligeable de réduction des tensions et des divergences ; l’autre est que, quelles que soient les majorités politiques, le système paritaire demeure un utile contre-pouvoir social, tant il est vrai que garantir l’autonomie des partenaires sociaux importe beaucoup dans un régime démocratique » (412).
M. Bernard Vivier a justement fait remarquer que « si l’on ne veut pas laisser les forces du marché s’organiser par elles-mêmes – c’est-à-dire s’en remettre à la loi du plus fort – ou laisser l’État tout régenter – c’est-à-dire donner libre cours à la bureaucratie –, il est nécessaire d’organiser la vie collective, de fixer des règles communes, d’échanger et de dialoguer. […] Aussi opposés soient les intérêts, le besoin de travailler ensemble s’impose, pour rapprocher les points de vue, sans effacer les divergences. On ne sort pas indemne d’une institution paritaire dans laquelle on a siégé pendant longtemps. […] Le paritarisme n’est donc pas une anecdote historique » (413).
Aussi faut-il résister à la tentation de tout « rationaliser » en confiant à l’État la majeure partie (voire la totalité) de la gouvernance et de la gestion de la sécurité sociale professionnelle. M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral « emploi-chômage-formation » de CGT-FO, a jugé que « la pire des tentations serait de recourir à la complète étatisation de l’assurance chômage et de la formation professionnelle, même si, quelque part, cela pourrait nous faciliter la tâche ». Et d’ajouter : « je ne crois pas à l’autonomie des partenaires sociaux en matière de gestion paritaire, nous ne sommes pas dans un monde à part. Toute la question est d’articuler les dispositifs qui émanent de l’État, des régions et des départements. Je ne pense pas non plus que ce serait plus simple si l’État faisait tout » (414).
Mettant en garde contre cette « tendance de fond à l’étatisation de la protection sociale, que l’on observe depuis quarante ans, par-delà les alternances », M. Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternatives économiques, a lui aussi estimé que cela « ne [lui] parai[ssai]t pas la meilleure solution » (415). Il a fait valoir, à juste titre, qu’« un niveau élevé de dépenses publiques est logique, voire inévitable, et bon, mais [que] la gestion des différents volets de ces dépenses doit pouvoir répondre à différentes orientations politiques et permettre l’expression diversifiée des intérêts de ceux qui sont concernés par ces politiques » (416).
La logique voudrait donc que la gouvernance de la sécurité sociale professionnelle ne soit pas confiée aux seuls partenaires sociaux ou à l’État seul, mais associe l’ensemble des parties prenantes. En effet, quand « le système tend vers l’universalisation des prestations sociales, alors que l’organisation des organismes paritaires repose sur une vision étroite de la société, comme si elle se limitait à la représentation des salariés, d’un côté, et celle des employeurs, de l’autre » (417), l’hypothèse d’une gouvernance tripartite voire quadripartite peut légitimement être étudiée.
b. Le modèle tripartite (voire quadripartite) de gouvernance de la sécurité sociale professionnelle.
De l’aveu même du directeur général du MEDEF, M. Michel Guilbaud, « les partenaires sociaux ont moins de légitimité à gérer la protection sociale si elle a une vocation universelle » (418). Et, tout en soulignant que la CGT défendait depuis longtemps l’idée d’une sécurité sociale professionnelle et d’un service public de l’emploi, M. Jean-Philippe Maréchal, conseiller à l’espace revendicatif confédéral de cette organisation syndicale, a même ajouté : « la présence de l’État ne nous effraie pas » (419).
De son côté, en réponse à une question sur la forme de gouvernance du CPA, Mme Selma Mahfouz a répondu que « le bon cadre, aujourd’hui, c’est sans doute un tripartisme ou un quadripartisme » (420).
Reste à savoir quelle forme pourrait prendre ce tripartisme ou ce quadripartisme : impliquent-ils nécessairement la présence de représentants de l’État ou des régions au sein des instances de gouvernance de la future sécurité sociale professionnelle ? Faut-il plutôt confier cette gouvernance à un conseil d’administration purement paritaire dont les initiatives seraient soumises à un contrôle de l’État (ou des régions) dans le cadre d’agréments (sur le modèle de l’assurance-chômage) ou de conventions d’objectifs et de moyens (sur le modèle des dispositifs de santé au travail) ?
i. La tentation d’institutionnaliser le tripartisme
À la question de savoir si le paritarisme est plus efficace que le tripartisme ou le quadripartisme, M. Henri Rouilleault a répondu que « cela dépend[ait] des sujets. En ce qui concerne par exemple le pacte de compétitivité et le CICE, si le diagnostic posé par le Gouvernement était bon au sujet du manque de compétitivité de notre économie […] il aurait été plus pertinent et plus efficace d’avoir recours à la négociation pour mettre en œuvre les importants dispositifs d’aides aux entreprises – 40 milliards d’euros. Comme cela se pratique en Irlande ou en Italie, il aurait fallu que le Gouvernement signe avec le patronat et les syndicats un accord tripartite conditionnant l’octroi des aides à la signature d’accords d’entreprise, lesquels auraient permis la négociation de contreparties claires, en termes de plan de charge, d’investissement, de formation et d’emploi, adaptées à la situation de chaque entreprise. Cela aurait renforcé l’efficacité du dispositif car, lorsque les aides sont conditionnées à des accords, les employeurs jouent le jeu – les lois Aubry en sont un bon exemple » (421).
Nombre d’experts entendus par la mission ont invité à institutionnaliser le tripartisme « masqué » – ce qu’un consensus tacite se refuse à faire aujourd’hui. Pourtant, pour reprendre les mots du professeur Jacques Freyssinet, « la réalité est celle-ci : le jeu à trois est la règle. […] L’accord national interprofessionnel n’est que l’un des éléments d’un processus à trois […et] la gestion paritaire des institutions dont nous avons parlé repose sur trois acteurs, puisqu’elles ne reçoivent de financement qu’après approbation de l’État. […] Nous avons inventé un système extrêmement compliqué et en partie opaque qui permet de trouver des solutions tripartites sans avoir à accepter un tripartisme officiel » (422).
Confortant M. Dominique Libault qui a fait valoir la nécessité « d’affirmer les règles de ce tripartisme asymétrique » (423), M. Jean-Paul Guillot, président de l’association Réalités du dialogue social, a lui aussi appelé à « assumer notre histoire », car « si l’État n’est jamais très loin, c’est un héritage de la loi Le Chapelier, qui considérait les corps intermédiaires comme inutiles et a longtemps irrigué notre culture sociale, ce qui fait que le rôle des partenaires sociaux dans la construction de la norme s’est développé beaucoup plus tard en France que dans d’autres pays d’Europe » (424).
De son côté, M. Jean Pisani-Ferry a vanté les mérites du « paritarisme d’élaboration » (425) à l’œuvre dans le cadre du comité d’évaluation du CICE, qui est composé de quatre parlementaires, mais aussi, à parité, de représentants des administrations, d’une part, des organisations représentatives des salariés et des employeurs, d’autre part.
Certains partenaires sociaux appellent d’ailleurs de leurs vœux l’institutionnalisation de système tripartite : Mme Sylvie Durand, responsable du secteur retraite à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT (UGICT-CGT), a ainsi expliqué que, de son point de vue, « le paritarisme doit changer. Une évolution vers un tripartisme n’est pas à exclure : elle permettrait de redonner un ancrage démocratique aux discussions et améliorerait la représentation des salariés ». Par exemple, « la mise en commun des régimes de retraite se ferait sous l’égide d’un organisme de pilotage, avec une représentation des salariés, élue sur liste syndicale, une présence de la représentation nationale, et des représentants des employeurs respectant la diversité des entreprises » (426).
Pour répondre à la question posée par M. Éric Aubry, membre du groupe de travail de l’Institut Montaigne sur le dialogue social, qui se demandait « comment sortir de cette hypocrisie dans laquelle on prétend que le paritarisme est le fait des seuls partenaires sociaux, alors qu’il est notoire qu’il s’agit d’un “ménage à trois” au sein duquel l’État est constamment présent » (427), le rapporteur estime que la représentation de l’État au sein du conseil d’administration du futur régime d’assurance professionnelle n’est pas nécessairement la seule et la meilleure solution. Le professeur Jacques Freyssinet a même estimé qu’une telle institutionnalisation du tripartisme « sembl[ait] aller à contresens de l’histoire » (428).
Il est vrai qu’il est difficile de prendre des décisions et d’en établir la légitimité quand on est trois ou quatre (ou davantage encore) autour d’une table. Le principe du paritarisme, c’est que deux parties dont les intérêts divergent parviennent à se mettre d’accord sur ce que l’on peut dès lors considérer comme l’intérêt général. La présence de l’État et des régions autour de la table introduit une forme de hiérarchie entre les parties. Cela complique les décisions et ce mode de gouvernance pourrait vite se transformer en « usine à gaz ».
Aussi convient-il d’examiner les autres voies possibles pour associer l’État (voire les régions) à la gouvernance de la future sécurité sociale professionnelle.
ii. La pertinence du contrôle par voie d’agrément ou de la contractualisation
M. Bernard Vivier a expliqué devant la mission que « c’est la négociation sociale qui construit les édifices paritaires, mais [que], si on lui donne trop de place, sans l’encadrer par la loi, on risque d’être confronté au conservatisme des partenaires sociaux qui, syndicats comme patronats, préfèrent que rien ne change » (429).
Dans le même esprit, tout en affirmant ne pas douter « qu’il soit utile d’associer organisations syndicales et patronales pour négocier la norme dans des domaines qu’elles sont censées mieux connaître que l’administration », Mme Françoise Bouygard s’est interrogée « sur les effets que peut avoir sur les négociations la gestion financière d’un certain nombre de fonds » (430).
Constatant que « le paritarisme a toujours besoin pour fonctionner de l’intervention modulée et pertinente de la puissance publique », notamment parce que « les acteurs jouent parfois un jeu consistant à ne pas trouver d’accord parce qu’ils savent que l’État interviendra et qu’il subira ultérieurement toutes les critiques », M. Yves Struillou, directeur général du travail, a rappelé que « selon les institutions concernées, le paritarisme s’accompagne toujours d’une présence modulée de la puissance publique [qui] peut intervenir en amont, pour définir la règle du jeu, ou en aval » (431).
Outre la représentation de l’État, au sein du conseil d’administration de l’opérateur unique de la sécurité sociale professionnelle, par des personnes ayant voix consultative et droit de veto sur le seul vote du budget, on pourrait imaginer, afin de permettre à la puissance publique d’exercer un contrôle sur les normes négociées et la gestion des dispositifs qui en résultent, une sorte de « valse à trois temps » qui rythmerait la gouvernance de la sécurité sociale professionnelle :
– dans un premier temps, une orientation politique serait donnée ;
– dans un deuxième temps, les partenaires sociaux négocieraient sans subir la moindre intervention des pouvoirs publics car, s’« il est évident que l’État a un rôle à jouer en matière de dialogue social, ne serait-ce que pour vérifier la légalité des accords signés, notamment par rapport à la réglementation européenne, mais aussi pour contrôler la gestion des organismes, ce que font l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et la Cour des comptes, [il n’en demeure pas moins que] le temps de la négociation est celui du paritarisme, et [qu’]il ne saurait y être question d’interventions directes de l’État » (432) ;
– dans un troisième temps, le législateur reprendrait, en l’aménageant si nécessaire, le contenu de l’accord négocié par les partenaires sociaux, en posant un certain nombre de règles d’intérêt général, car, a expliqué M. Raymond Soubie, « quel que soit le système d’adoption de ces accords, qu’il y ait un référendum ou non, le dernier mot doit appartenir au Parlement » (433), rejoignant en cela l’avis de M. Philippe Louis : « Nous estimons que les accords interprofessionnels doivent être retranscrits dans la loi. Doivent-ils être retranscrits tels quels ? Pour notre part, nous pensons que c’est le législateur qui doit avoir le dernier mot » (434).
On peut aussi imaginer que ce « troisième temps » de la valse prenne la forme d’un agrément de l’État (sur le modèle de ce qui prévaut aujourd’hui en matière d’assurance-chômage), voire des régions. En effet, après avoir assuré que « la participation systématique de l’État au sein du conseil d’administration des organismes paritaires […] n’est pas une revendication de la DGEFP », M. Hugues de Balathier-Lantage a fort justement souligné que « l’État dispose d’autres outils d’intervention : dans le domaine de l’assurance chômage par exemple, il n’est pas présent à la table des négociations, mais dispose d’un pouvoir d’agrément. Historiquement, il lui est déjà arrivé, au début des années 2000, de refuser d’accorder un agrément. Cet outil juridique est aussi un outil politique permettant, en amont, au Gouvernement de peser – publiquement ou officieusement – sur les négociations, même lorsqu’il n’est pas autour de la table » (435).
Cet agrément étatique serait parfaitement légitime, car, comme l’a rappelé M. Olivier Mériaux, « dans les instances paritaires, des représentants d’intérêts particuliers se voient déléguer la définition et l’administration de services établis dans l’intérêt général. Cela procède d’une délégation par l’État de certaines de ses prérogatives » (436).
Du point de vue du rapporteur, cette « valse à trois temps » permettrait de concilier efficacité et légitimité : tout en restant paritaire, le processus de décision serait soumis, via un agrément, au contrôle de l’État ou des régions.
Par ailleurs, on pourrait imaginer que ce contrôle de l’État ou des régions en aval de la négociation se double de leur intervention en amont : le contrôle de la puissance publique sur l’élaboration et la gestion paritaires des normes régissant la sécurité sociale professionnelle pourrait prendre la forme de conventions d’objectifs et de moyens ou de gestion, sur le modèle de ce qui se pratique en matière de santé au travail ou de formation professionnelle. De telles conventions permettraient de mieux articuler l’action des partenaires sociaux avec celle de l’État.
*
* *
Pour tenter de répondre aux innombrables interrogations que suscite la création, à court terme, du CPA et, à plus long terme, de la sécurité sociale professionnelle, le rapporteur a déposé, lors des débats sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, un amendement demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 décembre prochain, après consultation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, un rapport sur la création d’un régime unique de sécurité sociale professionnelle qui serait susceptible de prendre la forme d’un organisme paritaire régionalisé accessible aux salariés aussi bien qu’aux chômeurs, travailleurs de l’économie des plateformes numériques et autres actifs, et qui serait à la fois gestionnaire des droits associés au CPA et opérateur unifié et territorialisé des parcours professionnels.
Ce régime d’assurance professionnelle pourrait être une réponse aux défis que constitue, pour le paritarisme, l’émergence de nouvelles formes de travail à la faveur du développement de l’économie collaborative et de l’uberisation de la société, car, comme l’a dit M. Éric Aubry au sujet du CPA, la logique de cette sécurité sociale professionnelle constituerait « l’un des moyens d’adaptation à la nouvelle économie » (437).
Proposition : Créer, à terme, une Agence nationale de sécurité sociale professionnelle, régime unique accessible tant aux salariés qu’aux autres actifs et aux demandeurs d’emploi qui, prenant la relève notamment de l’Agence nationale pour l’évolution professionnelle et de la Banque paritaire du temps, serait chargé à la fois :
– de gérer et d’adapter leurs droits – à commencer par ceux attachés au compte personnel d’activité (CPA) ;
– et d’accompagner l’accès à l’emploi et la progression professionnelle de chacun.
III. LE DÉFI DE L’UBÉRISATION DE L’ÉCONOMIE
Penser l’avenir du paritarisme suppose de s’interroger sur sa capacité d’adaptation à des bouleversements susceptibles de remettre en cause le modèle sur lequel repose cette forme de gouvernance. Il s’agit de faire porter le regard sur le développement des plateformes et du travail numérique, envisagé sous l’angle de sa régulation sociale.
Dans la mesure où elles semblent a priori étrangères aux rapports entre employeurs et salariés sur lesquels repose le procédé paritaire, les nouvelles formes d’emploi n’entrent pas dans le cadre classique de la régulation sociale par les partenaires sociaux. Or, si le paritarisme ne constitue pas davantage que l’intervention de l’État une réponse totale et définitive aux défis qu’amène cette révolution du travail, il doit prendre sa part à la construction d’un cadre juridique protecteur et donc se saisir de ces enjeux qui le concernent directement.
A. LES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI BOULEVERSENT LA CONCEPTION DU TRAVAIL QUI INSPIRAIT LE PARITARISME
Si l’on regarde le paritarisme comme un mode de production de normes et de gestion d’un système de protection sociale, on constate que les nouvelles formes de travail viennent percuter deux de ses fondements les plus essentiels : le salariat comme modèle de base du statut du travailleur et de la relation de travail, et les cotisations comme mode de financement des systèmes d’assurance sociale.
1. Le développement des nouvelles formes d’emploi dans un cadre indépendant tend à réduire le caractère normatif du salariat
Le paritarisme est intrinsèquement lié, comme une très large partie du modèle social français, à un rapport employeur/salarié qui constitue la matrice des protections mises en place au fil des décennies écoulées. En effet, les « nouvelles formes d’emploi » renvoient à une forme complètement nouvelle de travail indépendant appelée à croître considérablement avec l’économie numérique.
a. Les « nouvelles formes d’emploi » : un travail indépendant d’un type nouveau
i. Une sémantique incertaine : « ubérisation », disruption et nouvelles formes d’emploi
La première manifestation du caractère novateur des évolutions qui traversent l’économie est la floraison des termes visant à qualifier les « nouvelles formes d’emploi », qui restent cependant imperméables à toute définition précise. Les travaux de la mission ont néanmoins permis d’éclaircir certaines notions.
• L’économie collaborative ou économie du partage : un modèle de partage de frais
L’économie collaborative est une expression assez souvent utilisée comme synonyme de l’économie numérique ou de l’économie des plateformes, mais ces notions ne se recoupent pas parfaitement : beaucoup contestent que l’activité d’une société comme Uber puisse être qualifiée de « collaborative ».
Ainsi, M. Arthur De Grave, rédacteur en chef du magazine OuiShare spécialisé dans l’économie collaborative, a expliqué comment l’économie collaborative est devenue progressivement un refuge lexical pour un grand nombre de pratiques qui n’en relève pas : « En fait, l’économie collaborative, en tant que secteur, n’existe pas. Cela a été durant très longtemps un concept un peu “fourre-tout”, qui nous a permis de mettre “dans le même bain”, des Uber et des mouvements sociaux comme Occupy. Le fait qu’il s’agissait toujours d’organisations en réseau, assez éclatées, distribuées, donnait l’impression qu’il y avait un rapport, une espèce d’affinité profonde entre Occupy et Uber, même si ce rapprochement est en réalité assez héroïque. Aujourd’hui, je pense que ce concept d’économie collaborative est travaillé par des tensions, il est en miettes. En fait, ce n’est pas un secteur, c’est juste une façon différente d’organiser le travail. En regardant les choses avec un peu de cynisme, on pourrait le définir comme un mode de production de valeur qui ne passe pas par l’organisation du travail salariée ; ce qui peut être bien ou mal. » (438)
L’expression « économie collaborative », comme sa variante « économie du partage », semble finalement la plus appropriée pour désigner les activités de partage de frais. En effet, comme le rappelle M. Pascal Terrasse, député, dans le rapport remis au Premier ministre le 8 février 2016, l’économie collaborative est inspirée par la mouvance du libre et de la fonctionnalité ou encore par l’économie du don (439), ce qui exclut de son champ des plateformes comme Uber. Elle ne se limite d’ailleurs pas à des usages numériques, mais elle en intègre certains comme les sites de partage de frais – c’est-à-dire la participation à un service adossé à un actif personnel (appartement, voiture, etc.).
L’entrée dans cette économie n’est pas nécessairement motivée par l’altruisme : selon une étude du Pôle Interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques, 65 % des Français utilisent l’économie collaborative pour améliorer leur pouvoir d’achat (440).
• L’ubérisation : une remise en cause concurrentielle de l’économie traditionnelle par des plateformes numériques
L’« ubérisation » est un terme popularisé par la presse et dont l’origine est à rechercher dans une interview de M. Maurice Lévy, président-directeur-général de la société Publicis, dans laquelle il estime qu’aujourd’hui « tout le monde a peur de se faire ubériser ».
Pour MM. Bruno Teboul et Thierry Picard, auteurs de Ubérisation = économie déchirée ? (441), il s’agit d’un modèle d’innovation « servicielle » qui consiste à améliorer l’offre existante plutôt que d’une vraie rupture technologique. Les auteurs estiment ainsi que ces modèles d’ubérisation correspondent à de « l’innovation frugale », ou jugaad en hindi, c’est-à-dire qu’ils nécessitent une dépense minime, voire nulle, en recherche et développement et qu’ils correspondent davantage à des procédés ingénieux de mise en réseau, de meilleure régulation de l’offre et de la demande, de plus grande proximité ou d’optimisation règlementaire ou fiscale. Uber a ainsi réussi à mieux mettre en contact les utilisateurs et les conducteurs grâce à la géolocalisation et a développé par la suite, grâce à sa plateforme, d’autres services (notamment de partage).
La capacité à se passer d’argent liquide, à répondre à l’impatience du consommateur et à optimiser l’effet de réseau grâce à la plateforme constituent les clefs du succès des sociétés comme Uber. Ces évolutions résultent directement de l’usage massif d’internet et de l’amélioration des téléphones mobiles qui permettent un effet de masse dans des secteurs où le numérique n’était pas jugé essentiel.
Lors de son audition, M. Bruno Teboul a insisté sur le caractère national de ce phénomène essentiellement américain : « ce phénomène, né du processus de numérisation de la société à l’œuvre depuis une vingtaine d’années, met en jeu des start-up essentiellement américaines ayant créé des écosystèmes numériques fondés sur la désintermédiation totale, des plateformes prenant appui sur le web ou le téléphone portable, qui mettent en relation prestataires de services et consommateurs. » (442). Il a également questionné la pérennité de ce modèle : « Extrêmement performantes du point de vue des services, elles ont des chiffres d’affaires peu élevés et sont très peu rentables – Uber a ainsi enregistré cette année des pertes abyssales de l’ordre d’un milliard de dollars. Dans le même temps, elles sont à même d’opérer des levées de fonds avoisinant le milliard de dollars – ce qui leur vaut de surnom de “licornes” et même de “décacornes” au-delà de dix milliards. Par ailleurs, elles sont caractérisées par une très faible intensité capitalistique […] La question de la rentabilité et de la solvabilité de l’économie des plateformes reste entière. Rappelons qu’Amazon, qui enregistre plus de 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires, est aujourd’hui à peine rentable. Est-ce un modèle que nous devons importer en Europe ? Je pense que non. »
Les effets de l’ubérisation sur l’emploi sont présentés par MM. Bruno Teboul et Thierry Picard comme très ambivalents.
Les tâches dématérialisées semblent favoriser un travail à l’unité pour des travailleurs souhaitant avoir une rémunération complémentaire, moduler leur temps de travail ou travailler depuis chez eux. Les machines et les algorithmes n’étant pas toujours plus performants que l’intelligence humaine, il est souvent fait appel à des travailleurs humains. Ainsi, l’application CAMFIND, qui permet d’identifier un objet ou un paysage pris en photo avec un téléphone mobile, passe par un opérateur humain. Il en va de même de nombreuses tâches sur le site Amazon. L’intelligence humaine est même mise à profit gratuitement par certaines entreprises comme Google qui utilisent le captcha (test destiné à distinguer en ligne la machine et l’humain) pour améliorer leurs ordinateurs. Aussi, ces entreprises issues de l’innovation numérique sont profondément duales, associant des salariés ultra-qualifiés occupant des emplois à forte valeur ajoutée et des emplois cognitifs faiblement rémunérés pour réaliser des tâches répétitives.
Par ailleurs, l’ubérisation remet en cause l’emploi dans les secteurs historiques comme par exemple le taxi. Les auteurs citent le cabinet de conseil Roland Berger qui estime que 42 % des emplois français présentent une probabilité d’automatisation forte. Selon la même source, 3 millions d’emplois pourraient être détruits d’ici 2025. En revanche, les auteurs ne quantifient pas le nombre d’emplois que le surcroît de concurrence et d’activité généré par l’ubérisation pourrait créer.
• Les nouvelles formes de travail : une catégorie très générique
Le développement des nouvelles formes de travail reflète des évolutions de l’économie qu’on peut appréhender selon deux axes.
Le premier est une transformation de la façon de travailler caractérisée par l’usage des techniques numériques, qui se traduit concrètement par la présence d’une plateforme d’échanges. Il s’agit en général d’une « place de marché » où clients et prestataires peuvent se rencontrer. Les nouveaux travailleurs sont donc des travailleurs des plateformes mais pas des employés de celles-ci. En effet, le rôle de la plateforme est d’éviter au travailleur d’avoir à rechercher un client puisque c’est celui-ci qui recherche un prestataire grâce à la plate-forme. Les travailleurs du numérique travaillent donc à la tâche. On peut aussi bien intégrer à cette analyse le digital labour, c’est-à-dire l’ensemble des tâches effectuées sur internet – parfois gratuitement – au profit des sites de recherche ou des grandes plateformes commerciales (443).
Le second axe est un transfert du salariat en contrat à durée indéterminée vers d’autres formes de travail (contrat à durée déterminée et travail indépendant). Les nouvelles formes de travail incluraient donc toutes les formes de travail indépendant qui n’existaient pas auparavant ou qui relevaient du salariat. Ces deux aspects sont importants car si le premier tend à recouper la problématique des travailleurs des plateformes, le second comprend une économie de travailleurs free-lances qui n’est pas directement liée au numérique et qui correspond à d’autres impératifs économiques.
Ainsi, M. Bruno Mettling indiquait lors de son audition qu’il existait dans les entreprises un besoin accru du travail indépendant en raison de l’accélération des cycles économiques et de la nécessité pour les grandes entreprises d’aller chercher ponctuellement des talents rares. L’évolution des nouvelles formes d’emploi sous cette seconde acception n’est pas récente, comme l’a indiqué Mme Véronique Descacq : « les formes d’emploi avaient beaucoup évolué dès avant l’apparition du numérique… Je me souviens que dans les années quatre-vingts, dans le secteur des métiers de la communication et du conseil, on incitait les salariés à devenir travailleurs indépendants. L’idée était de reporter l’aléa économique sur les individus plutôt que de les maintenir à la charge de l’entreprise. » (444)
Ces trois grandes évolutions (développement de l’économie partagée, concurrence par les plateformes numériques, développement d’une nouvelle catégorie d’indépendants), bien que distinctes sur le plan des concepts, brouillent certaines frontières qui étaient assez claires jusque-là : frontière entre activité professionnelle et activité non-professionnelle ; frontière entre salariat et travail indépendant. La remise en cause de cette dernière pose un problème très direct au paritarisme, qui risque de voir contournées les protections juridiques patiemment construites au fil de la négociation autour du contrat de travail, ainsi que les recettes finançant les régimes de protection sociale qu’il gère.
ii. Des situations juridiquement difficiles à qualifier : « salariat déguisé » et subordination économique
Lors des auditions consacrées aux nouveaux travailleurs du numérique, la question de la subordination a été posée à de nombreuses reprises. Elle est en effet essentielle puisque c’est la subordination juridique qui fonde l’état de salariat. L’enjeu est donc de déterminer si ce critère est encore valide et son activation peut constituer une première réponse aux défis de la nouvelle économie.
• La subordination juridique, fondement du salariat
La subordination juridique demeure le critère principal de définition du contrat de travail salarié. Il est bien cerné par une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le salariat est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui donne des ordres et des directives, en contrôle l’exécution et en sanctionne les manquements (445).
La capacité de ces critères à rendre compte de la relation entre une plateforme et un travailleur fait débat. Nombre de personnes auditionnées ont semblé penser qu’il existait un salariat déguisé, dans les entreprises de transport notamment. Toutefois, le débat juridique est loin d’être simple, comme le rappelait le professeur de droit et avocat Laurent Gamet à l’occasion de la fermeture de la plateforme Uberpop : « les relations entre chauffeur et UberPop se cantonnaient au versement du prix de la course grevé de la commission de l’intermédiaire. Sauf à travestir le sens des mots, ou à faire évoluer au prétexte incertain de la révolution numérique les critères d’appréciation de la subordination juridique, l’on serait bien en peine de caractériser les critères d’appréciation de la subordination juridique, l’on serait bien en peine de caractériser un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements… Uberpop n’est qu’un intermédiaire opérant la relation entre une demande et une offre de services au public comme la radio met en relation les clients qui l’appellent avec des taxis. » (446) Il semble en effet délicat, en droit, de qualifier de salarié de la plateforme un prestataire libre de ses horaires et propriétaire de son outil de travail. En tout état de cause, cette question n’a pas encore été tranchée nettement par le juge.
D’autres personnes auditionnées ont fait remarquer que si le lien de subordination n’est pas à proprement parler juridique comme on l’entend dans le droit positif, il existe une subordination économique socialement inacceptable qui impose de légiférer pour la prendre en compte dans l’appréciation de l’état de salariat. Mme Véronique Descacq a ainsi affirmé : « Je suis persuadée qu’il faut dépasser ces notions de subordination juridique et économique. Il y a un lien de subordination lorsque quelqu’un fournit du travail, surveille l’exécution de ce travail, le contrôle et en fixe plus ou moins le prix. Cela montre que la frontière entre la subordination juridique et économique est artificielle. Sans qu’il y ait un lien de subordination juridique, les plateformes fournissent le travail et en surveillent l’exécution – on ne peut pas prétendre que les travailleurs concernés sont complètement autonomes dans l’organisation de leur travail. En outre, les plateformes contrôlent l’exécution de leur travail
– puisqu’elles peuvent les écarter – et en fixent le prix. Pour moi, c’est un lien de subordination qui justifie d’imposer les règles du code du travail […] Je pense que les formes d’exercice de certaines plateformes méritent d’être requalifiées comme de l’emploi salarié. Cela ne vaut pas pour toutes les plateformes collaboratives, notamment celles qui se trouvent à la frontière du bénévolat et du prêt d’appartement. En revanche, cela vaut pour celles qui présentent toutes les caractéristiques d’un lien de subordination que l’on qualifiait jusqu’ici de subordination juridique, et que je qualifierai, pour ma part, de lien simplement de subordination, comme pour le secteur des transports. » (447)
Cette prise de position est intéressante car elle renvoie à la réalité de certaines plateformes monopolistiques ou oligopolistiques qui, par exemple, sont en situation d’imposer sans concertation une baisse drastique des tarifs à leurs utilisateurs. Dans bien des cas, la plateforme est l’interlocuteur unique du travailleur, qui ne peut trouver de clients sans son intermédiaire. Cependant, au-delà même des embûches que l’on rencontrerait à tenter de définir la substance de cette dépendance économique, ladite prise de position ouvre une alternative qui rend la solution impraticable.
Soit le nouveau critère a vocation à remplacer celui de la subordination juridique, et le risque est d’attraire vers le salariat des travailleurs indépendants qui ne le souhaiteraient pas (448). Soit il a vocation à devenir le critère d’un troisième statut, intermédiaire entre travail indépendant et salariat, auquel le rapporteur n’est pas favorable. En effet, comme l’a fort justement exposé M. Pascal Terrasse, cette hypothèse emporte le risque de voir le statut intermédiaire supplanter le contrat de travail et, en définitive, le dégrader : « Lorsque nous avons commencé nos travaux, j’étais plutôt d’avis qu’il fallait créer un troisième statut. Mais, si l’idée paraît assez moderne, elle est source de risques que je n’avais pas mesurés au début : un tel système hybride permettrait à des employeurs d’exclure un certain nombre de salariés du bénéfice de conventions collectives relativement protectrices. » (449)
Il n’est donc pas simple de dépasser le critère actuel de la subordination juridique. Peut-être le juge – dont on peut penser qu’il sera amené à se prononcer bientôt – affinera-t-il la notion et éclaircira-t-il la façon dont elle pourrait être adaptée à l’économie des plates-formes.
• La requalification, une solution à certaines situations
Lors de son audition, M. Philippe Barbezieux, inspecteur général des affaires sociales et co-rapporteur du rapport remis par M. Pascal Terrasse au Premier ministre, expliquait que les administrations sociales (450) se tenaient prêtes à requalifier toute situation qui le justifierait et se montrait confiant en leur capacité à identifier les difficultés : « Nous avons rencontré à ce sujet la cellule internet de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France. Elle instruit actuellement un certain nombre de dossiers visant précisément à requalifier en activités salariées des activités exercées sous le statut d’autoentrepreneur.
« L’économie collaborative facilite les contrôles du fait de la traçabilité des transactions qui passent par les plateformes. Dès lors que le législateur a prévu la communication obligatoire de certaines informations à l’administration fiscale, ainsi qu’il l’a fait dans la dernière loi de finances, l’administration peut
– sous réserve des moyens qu’elle est en mesure de consacrer à cette tâche – contrôler plus facilement l’activité sur les plateformes collaboratives que dans les secteurs plus classiques de l’économie. Car il n’est pas aisé de détecter une activité non déclarée ou du travail au noir lorsque les intéressés ont offert leurs services via une petite annonce où figure un simple numéro de téléphone, laissée dans une boulangerie ou sur un poteau télégraphique.
« Il y a donc un potentiel de contrôle. Il appartient aux services de s’adapter, ainsi que le fait l’URSSAF d’Île-de-France. Certes, la cellule dédiée ne compte que trois agents, mais ceux-ci ont acquis un certain savoir-faire, qui leur permet de repérer sur les sites des activités susceptibles de relever du salariat plutôt que du statut d’indépendant. » (451)
Le rapporteur ne peut qu’inciter les services de l’État et des administrations sociales à la vigilance en ce domaine. Il insiste pour que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour requalifier les situations qui le nécessiteraient. Des procédures ont été lancées en mai dernier par l’URSSAF d’Ile de France devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et auprès du procureur de la République de Paris en vue de faire confirmer la requalification qu’elle a opérée pour des chauffeurs de la société Uber. Elles permettront probablement à la Cour de Cassation de se prononcer définitivement sur le sujet. Une procédure similaire avait été lancée aux États-Unis – dans un cadre juridique très différent.
Ces procédures pourraient se multiplier mais, en toute hypothèse, elles ne pourront suffire à réguler le système qui ne présente pas cette seule difficulté, surtout si le modèle des nouveaux travailleurs indépendants tend à se généraliser.
b. Vers une remise en cause quantitative de la prédominance du salariat ?
Les travaux de la mission ont confirmé que le problème changerait de dimension si le développement d’un nouveau travail indépendant avait vocation à remplacer la norme du salariat. En l’état de nos connaissances, la situation dans certains pays peut alimenter certaines préoccupations, même si la France n’est pas le pays le plus touché.
i. Le poids des nouveaux travailleurs indépendants est très important dans certains pays
L’emploi indépendant (452) est très important dans certains pays comme l’Espagne (17,7% en 2014) et l’Italie (24,9% en 2014), ou très dynamique comme au Royaume-Uni (14,4%) ou aux Pays-Bas (16%).
Le cas des États-Unis semble plus ambivalent puisque le taux d’emploi non salarié est faible (453) mais les indépendants sont très organisés et ont des perspectives de croissance importantes, comme l’ont indiqué à la mission les représentants du collectif Ouishare.
Ainsi M. Arthur de Grave dressait des perspectives de moyen terme assez spectaculaires : « Vient ensuite, dans le prolongement, le phénomène de “freelancisation” de l’économie. Il peut susciter des débats infinis, mais il est bien réel : selon certaines études, les États-Unis compteraient 54 millions de travailleurs indépendants, selon d’autres, ils représenteraient le tiers de la main-d’œuvre. Des études affirment qu’à l’horizon 2020, 47 % de la main-d’œuvre seront free-lance aux États-Unis. »
Mme Diana Filippova rappelait, quant à elle, l’existence de l’organisation « Freelancers Union, un des premiers syndicats d’indépendants dans le monde, avec plus de 400 000 adhérents, [qui] organise des campagnes, prend beaucoup la parole et agit aussi en tant que représentation politique, donnant voix à cette espèce de masse inexistante, sans visage, des travailleurs à la demande » (454).
ii. Ces nouveaux travailleurs restent encore minoritaires en France
En France, d’après l’INSEE, le travail indépendant représente 10,3 % de la population active, soit 2,3 millions d’indépendants, ce nombre incluant des professions libérales, des exploitants agricoles, des patrons de l’industrie ou des dirigeants de société, avec une progression faible depuis 15 ans. On compte parmi eux 982 000 autoentrepreneurs en 2014, mais beaucoup exercent également une activité salariée.
D’après une étude récente de France Stratégie (455), les transformations de l’économie « n’apparaissent pas de nature à induire une déformation significative de la structure de l’emploi par statut : ni la part des contrats à durée limitée ni celle de l’emploi non salarié ne sont appelées à croître mécaniquement ».
Si le nombre de travailleurs des plateformes n’est pas connu avec précision, il est encore plus inquiétant qu’il n’existe aucune donnée sur les pertes qu’occasionnent ces nouvelles formes de travail pour les systèmes de protection sociale.
2. L’augmentation des effectifs des nouveaux travailleurs du numérique fait peser un risque d’ampleur inconnue sur le financement de la protection sociale
Le rapporteur a pu constater l’absence de données précises sur l’impact de ces nouvelles formes de travail, qui, par construction, provoquent un manque à gagner pour les régimes de salariés dont certains parmi les plus importants sont gérés paritairement : retraites complémentaires, assurance-chômage, etc.
a. Le statut des indépendants implique par construction une diminution des recettes des régimes de protection sociale
S’il est parfois adopté en vue d’une plus grande autonomie, le statut d’indépendant a aussi des conséquences en termes de fiscalité et de cotisations sociales dont on imagine mal qu’elles n’aient aucun impact sur les systèmes de protection sociale. Deux mécanismes se conjuguent, l’un relatif aux taux de cotisation, l’autre à l’assiette globale des cotisations.
Il faut noter, en premier lieu, que les travailleurs des plateformes sont des travailleurs indépendants, le plus souvent sous la forme du micro-entrepreneur, qui a remplacé le régime d’autoentrepreneur. Le plafond de chiffre d’affaires, fixé à 82 200 euros HT pour la fabrication de produits et à 32 900 euros HT pour la prestation de services commerciaux et artisanaux ou l’exercice libéral, convient tout particulièrement à des activités partielles ou faiblement rémunératrices (456). Les cotisations sociales du régime du microsocial (entre 13,4 et 22,9%) sont en moyenne deux fois moins élevées que celles payées sur les salaires (cotisations patronales et salariales ajoutées). Les prestations sont évidemment en rapport avec ce niveau de cotisations.
D’autre part, si certaines activités salariées disparaissent au profit d’activités indépendantes, cela se traduit par une réduction de l’assiette des cotisations exigibles au titre des régimes de salariés que sont la Sécurité sociale, l’AGIRC-ARRCO ou l’Unédic.
b. Les pertes de recettes ne sont pas suffisamment documentées
Malgré d’évidents risques pour l’équilibre des régimes de protection sociale, aucun travail approfondi n’a à ce jour été mené pour quantifier les pertes de recettes sociales qu’entraîne le développement du travail indépendant.
Le Haut conseil pour le financement de la protection sociale doit conduire cette année des travaux sur ce thème, mais ceux-ci n’aboutiront pas avant l’automne 2016 ; de son côté, le Conseil national de l’information statistique (CNIS) conduit un groupe de travail sur la diversité des formes d’emploi dont le mandat confié à l’INSEE et à la DARES en décembre 2014. Un rapport a été présenté au ministère de l’Économie en mars 2016, avec d’intéressantes propositions méthodologiques.
Pour le rapporteur, il n’est pas normal que les pouvoirs publics n’aient pas à leur disposition toutes les données nécessaires pour évaluer quantitativement et sur des bases sérieuses les mutations profondes que connaît le monde du travail. Les travaux engagés doivent être menés à leur terme, approfondis et actualisés régulièrement pour éclairer la décision publique.
Proposition : S’assurer que le Gouvernement et le Parlement disposent d’une information fiable sur les conséquences du développement du travail indépendant sur les comptes de la protection sociale
Au vu de cette trop faible documentation, il est difficile de parler avec certitude d’explosion des nouvelles formes d’emploi. En revanche, l’économie des plateformes conduit à une profonde remise en cause de l’entreprise comme lieu du dialogue et de la protection, qui nécessite d’anticiper les évolutions et de trouver une solution pour ces travailleurs des plateformes. Cette analyse a été développée par plusieurs personnes auditionnées.
Ainsi, M. Arthur de Grave a insisté sur le fait que les plateformes deviennent des places de marché monopolistiques : « En gros, sa taille résulte directement d’un arbitrage entre les coûts de transaction internes et les coûts de transaction externes. À une époque lointaine, les contremaîtres négociaient tous les jours la paie avec les ouvriers. C’étaient des coûts de transaction trop élevés, cela s’est arrêté avec l’entreprise fordienne. En fait, l’entreprise elle-même n’est pas un marché : en interne, elle en est tout le contraire, c’est une organisation de la production dont le fonctionnement ne repose pas sur le jeu quotidien de l’offre et de la demande. Le problème, c’est qu’à mesure que les coûts de transaction externes baissent, grâce aux révolutions des technologies de l’information, le périmètre de l’entreprise elle-même évolue. Les entreprises plateformes n’ont pas besoin de beaucoup de personnels – ils sont peut-être 400 chez BlaBlaCar, pour 25 millions d’utilisateurs et 2 millions de personnes transportées par mois. Et ce ne sont pas des salariés qui réalisent ces prestations de transport : le coût de transaction externe a suffisamment baissé pour que l’arbitrage se fasse en faveur des non-salariés. Je ne pense pas que l’on puisse revenir sur cette évolution ; c’est quelque chose de plus profond qu’un problème de partage de la valeur entre le capital et le travail. » (457)
M. Jean Pisani-Ferry est convenu qu’il s’agit d’une remise en cause très profonde : « On a raison de s’interroger sur les conséquences qu’ont ces plateformes sur le travail ; mais en amont, il faut aussi s’interroger sur la destruction, et donc la réinvention, de l’entreprise. Celle-ci s’organise sur une base hiérarchique, se mettant ainsi hors marché. Ces plateformes organisent, pour leur part, par la technologie, la coexistence de différents offreurs – de travail, d’activité, de produits – sans qu’ils aient besoin de passer par une relation hiérarchique pour les coordonner. C’est donc d’abord le modèle de l’entreprise traditionnelle qui est attaqué, et la supériorité du modèle de l’entreprise sur le petit producteur, qui a fait la révolution industrielle. Ces plateformes, auxquelles chacun peut avoir accès, organisent la standardisation et la mesure de la qualité grâce à la notation des utilisateurs. On vend ainsi son travail à la tâche : Amazon a ainsi lancé un service nommé Mechanical Turk qui vous permet de gagner quelques centimes en regardant par exemple une vidéo pendant dix minutes, en notant certaines choses. Cela me paraît très disruptif, et bien difficile à remettre dans les cases existantes que sont le salariat et le travail indépendant. » (458)
Il apparaît donc un besoin de régulation auquel le paritarisme n’apporte malheureusement aucune réponse en l’état actuel des choses.
B. LES ENJEUX DES NOUVELLES FORMES D’EMPLOI LIÉES À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ÉCHAPPENT AU CHAMP ACTUEL DU PARITARISME
Les travaux de la mission ont permis d’identifier deux manques dans la construction de cette nouvelle économie : un manque de régulation, en raison de l’absence de partenaires sociaux pour se saisir de cette situation, et un manque de protection pour ces néo-travailleurs.
1. L’économie numérique est caractérisée par des nouvelles relations de travail qui ne laissent pas de place pour le dialogue et la représentation habituels
Les travaux de la mission ont mis au jour un certain malaise des organisations syndicales quant à la représentation de ces travailleurs du numérique, malaise qui tient largement à leur statut d’indépendant.
L’ambiguïté de la situation a été exposée avec beaucoup de clarté et de franchise par le président de la CFTC, M. Philippe Louis : « En ce qui concerne la représentation des catégories, des choix sont à faire : on peut considérer que les autoentrepreneurs seraient mieux représentés par une organisation patronale que par une organisation salariale, mais je vois mal comment on pourrait négocier socialement. Imaginons que les autoentrepreneurs adhèrent au MEDEF… Sachant qu’Uber est adhérent du MEDEF et qu’il s’agit d’un rapport de sous-traitance. […] Si les autoentrepreneurs sont pour moitié adhérents au MEDEF et pour moitié adhérents à des organisations syndicales, cela va poser des problèmes… » (459)
Deux problèmes font sérieusement obstacle à une représentation de ces travailleurs.
Plusieurs personnes auditionnées ont fait état d’une réticence de certains syndicats à admettre des travailleurs des plateformes au sein de leur syndicat de salariés. Mme Véronique Descacq évoque ainsi la difficulté à trouver des interlocuteurs pour traiter de ces sujets : « Y a-t-il des travaux en cours dans le cadre du dialogue social interprofessionnel ? Non, il n’y en a pas, ne serait-ce que parce qu’un certain nombre d’organisations syndicales ne considèrent pas devoir représenter ces travailleurs. Les chambres patronales sont dubitatives. J’observe que c’est aussi le cas du Gouvernement qui n’aborde la question du CPA des travailleurs indépendants qu’avec l’Union nationale des professions libérales (UNAPL). Comme s’il fallait replacer des frontières… » (460) Aucune organisation auditionnée n’a cependant assumé cette réticence à représenter ces nouveaux travailleurs indépendants.
D’autre part, les statuts de certains syndicats créeraient pour eux une impossibilité juridique d’accepter les travailleurs indépendants. Certaines organisations partent du principe que le droit du travail l’interdit, à l’image de ce qu’expliquait M. Philippe Louis : « Un salarié d’Uber ou un autoentrepreneur peuvent-ils adhérer à la CFTC ? Le code du travail prévoit que ce sont les salariés qui peuvent le faire. Il se trouve que nous avons vocation à rassembler les salariés. J’ai envie de vous retourner la question : qu’en pense le législateur ? » (461)
Ces travailleurs se trouvent ainsi dans un vide représentatif préjudiciable à la défense de leurs intérêts.
2. Ces néo-travailleurs, juridiquement indépendants mais dépendants économiquement, ne peuvent être privés de protection sociale
Le fait qu’aujourd’hui, nombre de travailleurs indépendants se satisfont de leur situation – parce qu’elle répond à leur envie d’autonomie – n’interdit pas de réfléchir aux moyens d’assurer mieux leur représentation, premier élément de la défense collective de leurs intérêts.
La situation monopolistique ou oligopolistique de nombreuses plateformes impose de donner aux prestataires la capacité de faire valoir leurs revendications en termes de tarif, de conditions de la désaffiliation de la plateforme, de conditions de travail, voire de conditions d’accès à une formation professionnelle.
Il s’agit aussi de donner à ces travailleurs des perspectives en termes de sécurisation professionnelle dès lors que nombre de ces micro-entrepreneurs se retrouvent dans une situation qui n’est pas toujours durable et qui peut conduire à une perte d’activité.
Mme Véronique Descacq a résumé cette tension entre besoin d’autonomie et besoin de protection, pour ces travailleurs : « Ils aspirent à l’autonomie, tout en se rendant compte que parfois leur rêve d’autonomie se fracasse contre le mur de l’organisation économique d’un certain nombre d’activités. Mais ils aspirent aussi à plus de protection, à une formation et à une carrière professionnelle qui n'est pas toujours possible quand on est entrepreneur indépendant. » (462)
C. UN NOUVEAU PARITARISME ADAPTÉ À LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE INVENTÉ POUR COMPLÉTER L’EXISTANT ET ASSURER UNE PROTECTION À TOUS LES TRAVAILLEURS
Alors que la nouvelle économie cherche encore ses marques, il faut se garder de lui imposer des normes inadaptées ou des standards trop exigeants : un nouveau modèle d’activité économique apparaît, dont on apprécie encore mal les risques, mais aussi les potentialités. Il serait irresponsable de tuer dans l’œuf l’innovation au prétexte qu’elle n’entre pas dans les cadres existants.
Il revient cependant aux acteurs de la régulation sociale – parlementaires, partenaires sociaux, etc. – de tracer des orientations claires en vue d’une meilleure régulation du système ainsi émergent.
1. Ce nouveau système doit être fondé sur le souci d’assurer une protection suffisante aux travailleurs sans remettre en cause leur activité
De nombreuses personnes auditionnées ont fait état de leur préoccupation quant aux tentatives de régulation de ces nouvelles plateformes qui, si on fait exception de quelques cas très visibles, sont souvent jeunes et très fragiles.
Ainsi, M. Jean-Michel Petit, fondateur et président de VizEat (463), a insisté sur les risques d’une régulation trop rapide ou excessive : « Nous pensons que notre secteur va se développer. Ma grande expérience dans la “tech”, à la fois comme entrepreneur, comme cadre dans de grandes entreprises de technologie, et comme investisseur, me permet de constater que, parfois, pour encourager une activité, il faut aussi savoir ne rien faire, surtout lorsqu’un secteur de taille limitée est en cours d’émergence. Il faut le laisser se développer avant de voir ce qu’il advient et de légiférer. L’exemple de l’internet et du e-commerce est parlant de ce point de vue : parce que des législations se sont rapidement mises en place dans toute l’Europe, aucun acteur majeur n’a pu émerger dans ces secteurs, et les GAFA – les géants que sont Google, Apple, Facebook et Amazon – ne sont pas européens. » (464)
M. Jean Pisani-Ferry a également insisté sur la prudence dont il ne faudrait pas se départir : « Au départ, on ne savait pas si Airbnb avait du potentiel, mais ce modèle s’est développé très rapidement. Il permet de fournir un service en économisant énormément de capital, tout en posant différents problèmes, notamment de distorsion de concurrence avec l’hôtellerie, qui n’est pas fiscalisée de la même manière, et d’évasion fiscale.
« Il faudra donc ramener ce modèle vers le droit commun. L’attitude opposée aurait consisté à interdire ce service dès le premier jour, en obligeant tout service d’hébergement à appliquer la législation de l’hôtellerie. Il est vrai que ce service s’est développé d’autant plus vite qu’il profitait d’une distorsion fiscale, mais ce développement repose surtout sur l’offre d’un service qui n’existait pas, et dont les atouts demeureront même si l’on applique le droit commun de la fiscalité […]
« À quel moment faut-il ramener un modèle au droit commun ? C’est une question qui n’est pas facile. Il faut arbitrer. Il me semble qu’une période d’observation est nécessaire. Faut-il interdire les sites qui proposent d’apprendre le code sur internet, parce qu’ils n’ont pas de salle à proposer aux élèves ? C’était pourtant bien la réglementation des auto-écoles. Il faut donc accepter l’évolution, et le caractère disruptif de certaines innovations. » (465)
Il faut également tenir compte du fait que les travailleurs du numérique
– dont bon nombre sont fortement diplômés – ont parfois fait délibérément le choix d’un statut plus souple et qu’il ne s’agit pas de remettre en cause ce choix. Comme le rappelait M. Arthur de Grave, « Les dernières études publiées par la Freelancers Union [aux États-Unis], syndicat de free-lancers, tendent à montrer que les free-lancers d’aujourd’hui sont de plus en plus qualifiés. C’est toute l’ambiguïté du développement de ce précariat. Auparavant, ceux qui n’étaient pas salariés subissaient leur condition ; aujourd’hui, de plus en plus nombreux sont ceux, qualifiés, qui la choisissent, car ils peuvent se débrouiller ainsi. » (466)
Le rapporteur partage donc l’idée que les évolutions que connaît l’économie n’en sont qu’à leurs débuts et qu’il existe à la fois de grandes opportunités et de grands risques pour les travailleurs du numérique. Alors qu’il est encore temps de prendre du recul sur ces transformations, il convient de fixer l’horizon vers lequel doit tendre ce secteur sans vouloir imposer une législation, une règlementation ou une fiscalité qui brideraient a priori son essor.
2. Le paritarisme numérique devra s’appuyer sur différents instruments pour assurer une représentation à la fois solide et souple des intérêts des travailleurs du numérique
C’est donc la négociation qui doit permettre d’édifier les bases d’un paritarisme numérique susceptible de faire émerger des solutions souples dans le cadre de la sécurité sociale professionnelle qui se dessine.
a. Un préalable : la représentation des acteurs du secteur
Le droit syndical est reconnu à l’ensemble des travailleurs au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, sans distinction catégorielle. Ainsi, l’article 2 de la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la France en 1951, stipule que « les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières ». On trouve des droits similaires dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950), la Charte sociale européenne (1961 et 1996) ou encore le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Les dispositions du code du travail relatives à la définition des syndicats ne font pas de distinction entre catégories de travailleurs : comme le prévoit l’article L. 2131 de ce code, les syndicats doivent avoir « exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Un syndicat n’est donc pas une forme juridique figée et limitée qui n’admettrait que la représentation traditionnelle des salariés ou des employeurs. C’est d’ailleurs cette liberté qui a permis à certains chauffeurs de VTC de créer leur propre organisation – SCP/VTC – qui a ensuite été affiliée à l’UNSA (467).
L’article 27 bis du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, en instance au Sénat, confirme donc le droit pour les travailleurs des plateformes de constituer une organisation syndicale pour défendre leurs intérêts collectifs.
Ainsi, il n’y a pas d’obstacle légal à une représentation syndicale des travailleurs des plateformes ; seuls peuvent éventuellement faire obstacle à une affiliation sur le modèle de l’UNSA-SCP/VTC les statuts des syndicats existants. Il appartient donc aux organisations intéressées par la représentation de ces travailleurs économiquement dépendants de lever les ambiguïtés que pourraient contenir leurs statuts et de favoriser la création de ces nouveaux syndicats. À cet égard, le rapporteur rappelle l’existence de fédérations fondées expressément sur la communauté des intérêts professionnels des travailleurs et non sur leur statut juridique, comme la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC-CGT), qui accueille sans distinction salariés permanents, intermittents du spectacle et non-salariés parce que, dans le champ professionnel concerné, ces statuts ont vocation à se succéder au cours de la vie active.
b. Le constat : un besoin de dialogue et de régulation
Le rapporteur partage la philosophie du rapport remis au Premier ministre par M. Pascal Terrasse : il revient aux pouvoirs publics de clarifier le cadre juridique existant plutôt que de créer un troisième statut. Le statut de « travailleur autonome économiquement dépendant » créé en Espagne et en Italie risque, en l’absence d’une véritable convergence des droits et des obligations fiscales et sociales entre les statuts, d’aboutir aux abus qu’a connus l’Espagne à la mise en place du dispositif. L’importance de la couverture conventionnelle des salariés, plus large en France que dans ces deux pays, risque également de provoquer une forme d’éviction du statut de salarié dans les entreprises au profit de celui de « travailleur économique dépendant ».
Aussi, plutôt que de créer par la loi un statut nouveau qui viendrait affaiblir les accords collectifs, on doit tendre plutôt à instaurer un dialogue social permanent sur les questions soulevées par le numérique, autour d’acteurs légitimes.
c. Confier aux partenaires sociaux le soin de co-construire progressivement cette régulation avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les acteurs du secteur
i. Un horizon : la sécurité professionnelle pour tous
En tant qu’elle permet de favoriser les transitions entre emplois mais aussi entre statuts, la sécurité professionnelle ne peut pas rester l’apanage du salariat. Or, les travailleurs indépendants du numérique n’ont pas vocation à rester tels toute leur vie ; ils n’ont d’ailleurs pas toujours travaillé dans ce champ. Il convient donc de leur donner toute leur place au sein des mécanismes qui sont en train de se construire pour sécuriser les parcours professionnels.
Toutes les organisations syndicales auditionnées ont dit être intéressées par une démarche autour du CPA qui doit, à terme, pouvoir bénéficier aux indépendants. Le CPA peut être un bon outil pour assurer un socle de protection sociale à ces travailleurs en matière d’accompagnement ou de formation professionnelle.
Cette évolution passe par une convergence au moins partielle des statuts entre indépendants et salariés sur les droits mais aussi sur les obligations, notamment en termes de cotisations sociales. Il ne serait pas envisageable de donner des droits équivalents pour des cotisations plus faibles, comme le relevait Mme Véronique Descacq dans le cas des indépendants : « Évidemment, qui dit protection dit contribution au financement. Or la formation professionnelle est extrêmement contributive. Avant d’imaginer – ce qui sera peut-être le cas, à terme – une solidarité interprofessionnelle en matière de formation professionnelle, il faut que les indépendants soient, au moins dans un premier stade, à même de financer et de mutualiser le financement de leur formation. » (468)
Ce rapprochement entre les statuts doit aussi passer par l’application de standards minimaux en termes de protection des travailleurs des plateformes. L’article 27 bis précité prévoit des droits nouveaux pour ces travailleurs, comme la souscription à une assurance volontaire en matière d’accidents du travail par la plateforme, le bénéfice de la formation professionnelle continue ou le droit de grève. le droit de constituer une organisation syndicale pour défendre leurs intérêts collectifs.
Ces progrès doivent être prolongés par une adaptation aux travailleurs indépendants des principes issus du rapport au Premier ministre du comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail, dit « rapport Badinter », qui est très attendue par certains syndicats. Ainsi, Mme Véronique Descacq a indiqué souhaiter « que lesdits principes [soient] aussi […] appréciés au regard des nouvelles modalités d’exercice de ces professions […] ces principes ne doivent pas être envisagés à droit constant » mais « appliqués de façon universelle à toutes les formes de travail – employabilité, protection de la santé, voire besoin d’intermédiation et d’échange sur les pratiques professionnelles » (469). Pour M. Philippe Louis, « Le récent rapport de M. Robert Badinter esquisse des pistes : il y a de grands principes qui peuvent être appliqués à tous, et d’autres qui pourraient être appliqués suivant le mode de salariat. Encore faut-il admettre qu’il puisse exister plusieurs modes de salariat. » (470)
Pour autant, de tels principes ne sauraient être intégrés au code du travail sous peine de fragiliser l’édifice des droits sociaux et des protections conquis par les travailleurs, au fil des décennies, pour compenser l’inégalité de fait de la relation de travail qu’ils entretiennent avec l’employeur. Même si le code du travail n’est pas le « code du salariat », il faut se garder de ce que l’affirmation de droits applicables à l’ensemble des actifs n’emporte, par ricochet, dégradation de l’état des salariés.
Proposition : Formaliser les grands principes protecteurs applicables à l’ensemble des travailleurs économiquement dépendants, complémentaires au code du travail, comme par exemple ceux qui doivent régir le référencement et le déréférencement, ainsi que les systèmes de notation, par les plateformes collaboratives.
ii. Une méthode : la négociation
Toutes ces évolutions doivent reposer non seulement sur des dispositifs légaux et règlementaires mais aussi sur une négociation permanente sur ces sujets. Cette négociation permanente aurait le mérite d’être suffisamment souple pour prendre en compte les évolutions très rapides de cette économie et de tenir compte d’un besoin de représentation de ces travailleurs. Comme souvent en droit du travail, elle pourrait constituer le guide du cadre normatif décidé ensuite par les pouvoirs publics.
Le rapporteur estime que le conseil national du numérique n’est pas une instance appropriée pour accueillir cette négociation sociale, dès lors que sa compétence est strictement limitée au champ économique.
La négociation pourrait plus utilement se tenir dans le cadre du Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme proposé précédemment, au sein de la commission « Nouvelle économie », dans une section qui serait plus spécialement consacrée au travail indépendant, ce qui permettrait d’associer à ses travaux la grande diversité des acteurs concernés : les organisations syndicales et patronales représentatives, des acteurs syndicaux comme l’UNSA – qui semble vouloir jouer un rôle important dans la représentation des indépendants (471) – et les autres centrales syndicales, ainsi que les autres organisations professionnelles qui se créeront sur le fondement de l’article 27 bis précité, ou la fédération des autoentrepreneurs, mais aussi des représentants des acteurs qui ne se retrouvent aujourd’hui dans aucun cadre.
Proposition : Inviter les partenaires sociaux à engager une négociation de long terme sur les droits et obligations des travailleurs des plateformes – notamment pour leur accès à la sécurité sociale professionnelle – dans le cadre interprofessionnel habituel ainsi qu’au sein d’un comité qui comprendrait les autres représentants de ces travailleurs. Identifier dans ce but les organisations syndicales et patronales représentatives des travailleurs des plateformes numériques, desdites plateformes et de leurs donneurs d’ordres qui devraient être associées à la négociation.
Ainsi, si l’on considère le paritarisme comme ce « procédé » qui amène des acteurs aux intérêts divergents à se structurer pour contribuer à l’intérêt général, il ne peut pas rester indifférent à ces défis nouveaux. Historiquement, le paritarisme reposait sur les syndicats et le patronat pour représenter des salariés et des employeurs. Aujourd’hui, des modes de régulation nouveaux doivent être inventés, qui doivent combiner des notions aussi diverses que liberté, autonomie, responsabilité, mutualisation, etc. C’est là, pour les partenaires sociaux, une occasion inédite de construire une croissance qui nourrira le progrès social.
1. Paritarisme d’entreprise et de négociation
• Améliorer la représentation des salariés dans les organes dirigeants des entreprises de plus de 300 salariés :
– en prévoyant que les conseils d’administration ou de surveillance doivent compter au moins un tiers de représentants des salariés ;
– en prévoyant la présence d’au moins un représentant des salariés dans chaque comité d’un conseil d’administration ou de surveillance.
• Créer un « Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme », véritable « clef de voûte » de l’architecture du dialogue social interprofessionnel, qui serait chargé :
– d’établir la liste de tous les thèmes relevant du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle pour lesquels une telle négociation pourrait être ouverte et de définir un calendrier prévisionnel de négociation, lorsqu’un thème a été inscrit sur la liste ;
– de se prononcer formellement sur l’opportunité d’ouvrir une négociation nationale et interprofessionnelle lorsque le Gouvernement formulerait une demande en ce sens ;
– d’entretenir avec le Parlement une « navette » consultative pour l’analyse des textes (projets ou propositions de loi) concernant le droit du travail.
Pour l’exercice de ses attributions, le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme serait organisé autour de quatre commissions permanentes : protection sociale et vie quotidienne, sécurité sociale professionnelle, nouvelle économie, contrôle et évaluation.
• Créer un « Institut des hautes études du dialogue social » permettant à l’ensemble des acteurs du paritarisme d’avoir une vision partagée des enjeux économiques et sociaux.
2. Sécurité sociale professionnelle
• Créer, assez vite, comme aboutissement de la réforme de 2014, un régime d’assurance-formation géré par une Agence nationale pour l’évolution professionnelle.
• Créer une « Banque paritaire du temps » qui assurerait la gestion et le transfert, d’une entreprise à l’autre, des droits à congé rémunéré dont la portabilité n’est aujourd’hui qu’imparfaitement garantie par le dispositif du compte épargne-temps.
• Créer, à terme, une Agence nationale de sécurité sociale professionnelle, régime unique accessible tant aux salariés qu’aux autres actifs et aux demandeurs d’emploi qui, prenant la relève notamment de l’Agence nationale pour l’évolution professionnelle et de la Banque paritaire du temps, serait chargé à la fois :
– de gérer et d’adapter leurs droits – à commencer par ceux attachés au compte personnel d’activité (CPA) ;
– et d’accompagner l’accès à l’emploi et la progression professionnelle de chacun.
• Dans l’attente d’une révision de la jurisprudence constitutionnelle sur la force obligatoire des clauses conventionnelles de désignation d’un assureur collectif de branche, motivée par la révision des critères de représentativité des syndicats d’employeurs, ou d’une révision constitutionnelle le permettant, les assureurs désignés ou recommandés par les partenaires sociaux devraient bénéficier d’une réassurance privilégiée des complémentaires santé.
• Introduire dans le droit national, le cas échéant en levant les éventuels obstacles constitutionnels, un nouveau vecteur juridique, la « convention collective de sécurité sociale complémentaire », qui permettrait aux branches professionnelles, au motif de la solidarité, d’établir un régime de prévoyance étendu à toutes les entreprises d’un secteur d’activité déterminé.
3. Économie numérique, travailleurs des plates-formes
• S’assurer que le Gouvernement et le Parlement disposent d’une information fiable sur les conséquences du développement du travail indépendant sur les comptes de la protection sociale.
• Formaliser les grands principes protecteurs applicables à l’ensemble des travailleurs économiquement dépendants, complémentaires au code du travail, comme par exemple ceux qui doivent régir le référencement et le déréférencement, ainsi que les systèmes de notation, par les plateformes collaboratives.
• Inviter les partenaires sociaux à engager une négociation de long terme sur les droits et obligations des travailleurs des plateformes – notamment pour leur accès à la sécurité sociale professionnelle – dans le cadre interprofessionnel habituel ainsi qu’au sein d’un comité qui comprendrait les autres représentants de ces travailleurs. Identifier dans ce but les organisations syndicales et patronales représentatives des travailleurs des plateformes numériques, desdites plateformes et de leurs donneurs d’ordres qui devraient être associées à la négociation.
4. Connaissance du paritarisme
• Faire établir par les services de l’État, en coopération avec les organismes paritaires, un document général annuel retraçant les données financières des systèmes paritaires.
La mission d’information examine le rapport présenté par M. Jean-Marc Germain au cours de sa réunion du mercredi 8 juin 2016.
M. Arnaud Richard, président. Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner et approuver le rapport établi par Jean-Marc Germain. Si l’on en juge par l’état d’esprit qui a animé nos auditions, auxquelles les participants ont été beaucoup plus nombreux que ce que l’on voit habituellement dans le cadre des missions d’information, et par la durée de nos travaux, cette séance ne devrait pas poser de problème.
Nous avons beaucoup travaillé : nous nous sommes réunis vingt-trois fois pour effectuer soixante-et-une auditions et entendre plus de cent cinquante personnes ; cela représente près de soixante-dix heures d’auditions.
Je vous précise que le délai accordé pour déposer des contributions au nom des groupes politiques a été repoussé à lundi, 17 heures, au lieu de vendredi comme prévu précédemment. Vous voudrez bien faire parvenir ces contributions directement au secrétariat, qui les intégrera au rapport définitif.
Enfin, je vous informe qu’il est prévu que la mission remette officiellement son rapport à M. le président de l’Assemblée nationale la semaine prochaine, à une date qui reste à fixer – jeudi, certainement. Afin de ne pas dénaturer le caractère officiel de cette remise et la conférence de presse qui suivra, je vous demande de ne pas diffuser le projet de rapport dont vous disposez.
C’est le groupe de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) qui a souhaité la création de cette mission d’information. L’honneur de la présider qui m’a été donné s’est doublé du plaisir de l’émulation intellectuelle suscitée par la vigueur et l’exigence constantes de notre rapporteur, Jean-Marc Germain. Je tiens à le remercier très chaleureusement pour ce véritable cheminement, cet acte de liberté. Je veux lui témoigner toute ma gratitude quant au résultat obtenu, qui constitue à partir d’aujourd’hui une véritable référence, à partir de laquelle toute réflexion sur l’éventuelle évolution de notre modèle paritaire devient possible.
M. Jean-Marc Germain, rapporteur. Je salue à mon tour, monsieur le président, la façon dont nous avons conduit ces travaux, la liberté que nous nous sommes respectivement accordée et l’ampleur du travail accompli. Je remercie votre groupe d’avoir initié cette mission, nécessaire et utile, mais aussi les administrateurs et fonctionnaires de l’Assemblée nationale qui, comme toujours, ont fait un travail extraordinaire, fidèle aux personnes que nous avons auditionnées. C’est ce qui fait sa force, au-delà des propositions que nous pourrons en tirer : ce rapport constitue une somme d’informations et d’expression des acteurs tout à fait importante. Enfin, je voudrais vous remercier, chers collègues, d’avoir pris de votre temps pour participer à ces travaux, malgré un agenda parlementaire chargé.
J’en viens aux propositions du rapport. Celui-ci aura pour première vertu d’offrir un panorama du paritarisme – qui n’existait pas jusqu’alors. Ce panorama, sans être totalement exhaustif, permet d’appréhender de manière à la fois synthétique et complète, avec une profondeur historique, l’originalité de ce modèle. Très peu de pays ont en effet confié à la cogestion des employeurs et des salariés une part aussi importante de la protection sociale. Nous avons aussi fait une tentative de quantification : la somme des moyens gérés par les organismes paritaires s’élève à 150 milliards d’euros, soit un quart de la protection sociale. Ces organismes regroupent environ 100 000 salariés, ce qui représente autant que l’ensemble des effectifs de police et de gendarmerie. Soulignons aussi la diversité des domaines traités : beaucoup d’éléments de la vie quotidienne sont gérés de façon paritaire.
Le président de la mission et moi-même partageons une double conviction, explicitement exprimée en introduction de notre rapport. Nous croyons aux corps intermédiaires. Nous pensons que le paritarisme est un lieu de confrontation des intérêts et des visions des organisations d’employeurs et de salariés. Nous sommes donc des défenseurs de cette gestion paritaire. D’autre part, nous avons constaté qu’au fil du temps, un tri naturel s’était opéré entre ce qui relevait de l’État et de la solidarité nationale et ce qui relevait plutôt de droits liés à des salaires différés
– droits gérés dans la plupart des domaines par les partenaires sociaux. L’histoire de la sécurité sociale est à cet égard emblématique puisqu’au terme d’une phase au cours de laquelle les partenaires sociaux ont eu beaucoup de responsabilités – y compris la capacité de fixer le montant des cotisations –, nous sommes revenus à un système où ils sont très présents dans la gouvernance des caisses de sécurité sociale mais où la décision relève essentiellement de l’État. Pour autant, nous ne remettons pas en cause leur présence dans les conseils d’administration des caisses, bien au contraire. Les auditions nous ont montré que les partenaires sociaux y sont tout à fait utiles, même sans réel pouvoir de décision sur les montants des prestations et des cotisations.
Si le paritarisme est plus que jamais nécessaire, il est aussi plus que jamais nécessaire de le réformer. Nous avons rencontré, chez les femmes et les hommes qui gèrent les différents organismes de protection sociale complémentaire, une capacité à innover et à se moderniser. Ces organismes n’ont à cet égard rien à envier au fonctionnement de l’État ou des collectivités locales. Mais nous avons le sentiment que, si chaque élément pris isolément fonctionne plutôt correctement, le système dans son ensemble est dans l’incapacité de se réformer et d’évoluer pour prendre en compte les transformations des modes de production, la mondialisation, les enjeux écologiques et numériques et les problèmes financiers issus des déséquilibres démographiques ou du chômage de masse.
Sur le fondement de ce constat, nous formulons plusieurs propositions : j’évoquerai simplement celles qui sont présentées dans l’introduction du rapport.
S’il fallait ne retenir qu’une seule de ces propositions, je souhaiterais que ce soit la première. Cette proposition – que j’espère la plus consensuelle possible – n’est pas simplement un élément d’un puzzle d’ensemble : elle a vocation à constituer la clef de voûte du paritarisme. Elle vise à la création d’un Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme. Il nous semble qu’il manque un lieu permettant de formaliser les négociations interprofessionnelles et la mise en cohérence des différents domaines gérés par le paritarisme. Ce Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme serait une sorte de chambre haute sociale ou de parlement du dialogue social. Dans mon esprit, ce Haut conseil n’aurait pas la décision finale, qui resterait bien sûr au Parlement, mais on pourrait aller jusqu’à un système de « navette » entre le Parlement et cet organisme. Celui-ci serait une forme d’aboutissement de la réforme Larcher prévoyant la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier avant que le législateur ne se prononce dans le domaine social. On a bien vu, avec le projet de loi El Khomri, que l’absence de structuration de ce dialogue avait permis à l’État, sur une partie du projet – notamment sur le rapport de M. Jean-Denis Combrexelle –, de solliciter les partenaires sociaux sans que ceux-ci ne rendent une réponse formelle. Les uns ont alors affirmé qu’on leur avait demandé de négocier et qu’ils avaient refusé de le faire, tandis que d’autres nous ont dit qu’ils avaient accepté mais qu’il leur aurait fallu des années pour arriver à un résultat – ce qui n’était pas possible dans le temps imparti par le processus législatif. Il nous semble donc indispensable de structurer la négociation collective et le paritarisme.
J’ai proposé que le Haut conseil comprenne quatre commissions. La première serait consacrée à la prévoyance et à la vie quotidienne. La deuxième, à la sécurité sociale professionnelle – chargée de l’emploi, de la formation, du chômage et peut-être de la santé et de la qualité de vie au travail et s’adressant donc essentiellement à des actifs. La troisième, à l’innovation, à la nouvelle économie, au numérique, aux questions écologiques et aux plateformes collaboratives. Nous avons en effet constaté que si les acteurs étaient très conscients des conséquences de l’ubérisation de la société, en termes de ressources des régimes de protection sociale et de défense des droits des travailleurs, aucun d’eux ne s’était vraiment saisi de la question de manière opérationnelle – à l’exception peut-être d’une organisation syndicale ayant récemment organisé un congrès sur le sujet. L’administration ne l’a pas fait non plus, à l’exception de l’URSSAF qui a récemment souhaité imposer un redressement à Uber. Enfin, il nous semble essentiel que le système se dote de moyens de contrôle et d’évaluation. Cette mission pourrait être confiée à ce Haut conseil mais aussi à la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) ou encore à des corps de contrôle de l’État. Cela étant, si l’on veut adresser un signe de confiance aux partenaires sociaux dans un rapport qui, quoi qu’il en soit, les bousculera, il nous semble opportun de leur confier cette responsabilité. Car si l’idée de créer une commission de contrôle est fortement défendue par la CFTC et la CGT, les autres organisations n’y ont certes pas été opposées mais l’on a bien senti que leurs habitudes en seraient chamboulées. Ce que le président de la mission et moi-même recherchons, c’est une rigueur de gestion mais pas la remise en cause de la place des acteurs sociaux dans le pays.
Le Haut conseil aura une double fonction : la négociation collective dans le cadre de l’article L. 1 du code du travail et la structuration du paritarisme par grands domaines d’activité. Il ne s’agira pas d’un conseil de plus mais de la clef de voûte d’une nouvelle architecture.
La deuxième proposition vise à développer la culture du dialogue social. Il faut que les acteurs apprennent à se parler, à se connaître et à comprendre la valeur du dialogue et du compromis. Nous suggérons donc la création d’un Institut des hautes études du dialogue social. C’est une proposition du président que j’ai reprise bien volontiers, car cela me paraît tout à fait essentiel. Certains ont participé à ce type de formations, que ce soit à l’Institut des hautes études de défense nationale ou dans le cadre du dialogue social – puisque l’Institut national du travail (INT) organise déjà des séquences de formation annuelles au profit des syndicalistes, des dirigeants d’entreprise et des fonctionnaires.
Troisième proposition, nous invitons les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à une réforme importante de la formation professionnelle et de l’emploi, domaines dans lesquels on a besoin de passer d’une logique d’assurance du risque à une logique d’ingénierie des parcours. L’objectif est de prendre les individus en considération tout au long de leur vie et pas simplement à un moment donné. Il nous semble à cet égard que l’on pourrait procéder par étapes. J’ai eu à ce sujet des discussions avec le président et certains d’entre vous : je suis le tenant, à terme, d’un régime unique de sécurité sociale professionnelle chapeauté par un organisme unique de type Unédic gérant l’ensemble des questions liées au parcours professionnel. Paritaire, cet organisme serait agréé ou bien soumis à une convention d’objectifs et de gestion – outil qui nous a paru très utile au fil de nos auditions. Alors qu’un agrément fonctionne selon une logique du tout ou rien, une convention d’objectifs permet de planifier dans une perspective pluriannuelle. Quelles que soient les modalités juridiques retenues, cet organisme unique gèrerait à la fois la formation professionnelle, les parcours professionnels, l’emploi et le chômage grâce à un opérateur intégré – idée qui, aux yeux du directeur général de Pôle Emploi, a paru pertinente mais difficilement envisageable à court terme. Cette solution permettrait d’aider au mieux les individus tout au long de leur vie. Les travailleurs pourraient ainsi, lorsqu’ils sont salariés, anticiper le moment où ils risqueraient d’être au chômage. Et lorsqu’ils seraient au chômage, ils pourraient suivre les formations dont ils rêvaient lorsqu’ils étaient salariés – formations qui, au fond, dédramatisent le passage au chômage. Dans un système parfaitement cohérent, la période de chômage peut devenir une opportunité pour rebondir ailleurs au lieu d’un moment où l’on tombe au fond du trou.
Nous demandons donc aux partenaires sociaux de construire, par étapes, un système permettant d’y parvenir. Une étape pourrait consister à poursuivre la réforme de 2014 et à aboutir à un système d’assurance-formation. Une Agence nationale de l’évolution professionnelle gèrerait l’ensemble des conseils en évolution professionnelle. Nous demandons aussi aux partenaires sociaux de se saisir de la question de la transférabilité des droits relatifs à la gestion du temps. Une « banque du temps », interprofessionnelle, gèrerait de façon paritaire la possibilité de transférer les comptes épargne temps d’une entreprise à l’autre, cela n’étant possible aujourd’hui que partiellement et dans des conditions limitées. On peut, par exemple, consigner des jours de congé à la Caisse des dépôts et consignations mais cela est plafonné, notamment en termes fiscaux. Nous demandons aux partenaires sociaux d’aller au bout de cette logique et d’intégrer cette transférabilité dans le compte personnel d’activité. Il nous faut une organisation qui permette de passer d’une logique d’assurance du risque à une logique de suivi des parcours, en mobilisant toutes les capacités de formation, d’assurance-chômage, de transfert de droits liés à la pénibilité et au temps.
Le rapport consacre un long développement à la prévoyance et aux complémentaires santé – point essentiel à côté duquel nous ne pouvions passer. C’est l’un des sujets sur lesquels nos positions diffèrent. Je propose pour ma part, a minima, de réfléchir à un système permettant de gérer de manière collective des éléments de solidarité au sein d’une branche professionnelle. Pourquoi d’ailleurs ne pas créer, à partir des branches, un système de retraite complémentaire obligatoire ? Un tel système est un objectif de long terme qui ne sera sans doute pas partagé. En revanche, la remise en cause des clauses de désignation a conduit à une situation très délicate, porteuse d’un risque d’inégalité au regard de la possibilité d’être couvert par des assurances complémentaires. Il faut donc agir. J’ai envisagé, d’une part, un système de garantie, par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), des organismes désignés par les branches professionnelles et, d’autre part, la création d’un statut juridique de convention collective de sécurité sociale. Je précise d’ailleurs, par rapport au texte que vous avez sous les yeux, que ce sont pour moi des conventions collectives de sécurité sociale complémentaire : il ne s’agit pas de remettre en cause la sécurité sociale pour en faire un outil conventionnel. D’après les juristes qui ont travaillé sur la question, Maître Jacques Barthélémy ou M. Dominique Libault, des régimes de prévoyance de branche semblent compatibles avec les règles européennes, même si la constitutionnalité d’un tel dispositif reste incertaine. J’ai souhaité que le rapport soulève cette question, sachant que la prévoyance complémentaire représente 12 milliards d’euros, les retraites complémentaires, 75 milliards, et l’Unédic, 35 milliards. La capacité des branches professionnelles à définir des régimes complémentaires me semble essentielle.
Nous évoquons aussi le paritarisme d’entreprise et préconisons la présence d’un tiers de salariés dans les conseils d’administration, dans les entreprises de 300 salariés et plus, ainsi que la présence des salariés dans l’ensemble des comités du conseil d’administration, notamment au comité des rémunérations, et
– pourquoi pas, comme en Allemagne – la présence de représentants désignés par les branches professionnelles dans les entreprises de plus de 5 000 salariés. L’objectif est de répondre à un besoin complémentaire de celui de la négociation collective : l’employeur et les salariés pourraient discuter, chacun avec leurs propres intérêts, de la stratégie de l’entreprise. Il me paraît fondamental que les salariés soient au cœur des conseils d’administration et que les branches professionnelles, dans les très grandes entreprises de notre pays, soient associées à la stratégie de ces dernières.
Enfin, nous nous sommes intéressés à la question du numérique, comme d’autres l’ont fait ces derniers temps. Nous avons constaté que les acteurs
– organismes paritaires et État – se saisissaient insuffisamment rapidement du sujet et qu’il n’existait que très peu de données relatives à l’emploi et aux pertes de cotisations, pour la Sécurité sociale comme pour les régimes paritaires, occasionnées par l’économie numérique et l’ubérisation de la société. Nous demandons donc aux pouvoirs publics de se saisir de toute urgence de cette mission de production d’informations. D’autre part, nous reprenons la conclusion du rapport de notre collègue Pascal Terrasse, considérant qu’il n’y a pas urgence à créer un troisième statut, ce qui ferait courir le risque évident de créer un salariat dégradé. Il convient d’abord d’essayer de rattacher ces différentes activités aux statuts existants – auto-entrepreneuriat et salariat – et de faire en sorte qu’elles restent compatibles avec l’idée d’une économie de partage de frais, ce qui nous paraît acceptable en cette période d’activité naissante. En revanche, il nous semble extrêmement important que des négociations soient organisées sur ces questions dans chaque secteur d’activité et qu’au niveau interprofessionnel, les partenaires sociaux puissent discuter du type d’activités autorisées, de la notion de partage de frais ou de ce qui peut être considéré comme de l’autoentreprise. Il me semble dangereux que le législateur fixe des critères avant que n’ait eu lieu une consultation approfondie organisée par les pouvoirs publics. Nous proposons donc la tenue de ce que j’ai appelé une « COP 21 du numérique », c’est-à-dire un processus de discussion associant tous les acteurs concernés. Nous appelons aussi l’État et les partenaires sociaux à réfléchir aux principes fondamentaux de droit du travail qui pourraient s’appliquer à l’ensemble des travailleurs économiquement dépendants, à l’exclusion bien sûr des salariés qui sont couverts par le code du travail. Ces principes pourraient notamment s’appliquer aux travailleurs de l’économie collaborative. Le rapport soulève plusieurs questions, comme savoir à quelles conditions une plateforme collaborative peut décider de déréférencer un collaborateur, quelles possibilités a ce dernier de se défendre et de contester cette décision et auprès de qui. Nous évoquons aussi les systèmes de notation, pour lesquels il faut poser des règles de transparence et ouvrir des moyens de défense puisque ce sont les rémunérations des travailleurs concernés qui sont en cause, derrière ces systèmes.
Voilà, monsieur le président, chers collègues, un résumé très schématique des propositions de ce rapport.
M. le président Arnaud Richard. Je salue ces propositions aussi sages qu’ambitieuses. Manifestement, le système est à bout de souffle ou, du moins, il est à refonder. Pour autant, il est issu de l’histoire de notre pays. Le Parlement ne s’était, je crois, jamais vraiment penché sur le sujet, le dernier rapport sur la démocratie sociale datant de 2000 et ne faisant qu’une vingtaine de pages. Dans une France en démembrement, le rôle du Parlement est bien de fixer des objectifs. L’indépendance des partenaires sociaux, que l’on pourrait qualifier de cinquième pouvoir, n’empêche pas à mon sens que leurs missions soient contrôlées. D’où l’intérêt de la première proposition. Il ne s’agira pas d’un haut conseil de plus. L’idée est d’avoir, pour chacun des « tuyaux d’orgue », des objectifs et une cabine de pilotage. Et, à mon avis, il est nécessaire que ce Haut conseil rende des comptes tous les ans aux représentants de la nation. J’aurai peut-être des détracteurs sur ce point. Mais le contrôle n’est pas la méfiance. Il est temps que le paritarisme sorte de l’entre soi. Ce geste de confiance est un moyen pour la représentation nationale de dire l’importance qu’elle accorde aux partenaires sociaux. Mais il est aussi nécessaire que le Parlement joue son rôle.
M. Jean-Patrick Gille. Comme l’ont souligné le président et le rapporteur, ce rapport est en quelque sorte une somme sur le sujet – travail à la fois diachronique et synchronique qui, bizarrement, n’avait jamais été fait. Il pourrait être intéressant que ce document fasse l’objet d’une restitution en présence des partenaires sociaux.
Ce matin, le rapport sur les minima sociaux de notre collègue Christophe Sirugue a été présenté en commission des Affaires sociales. Ce n’est apparemment pas le même sujet mais, en fait, si. Je me demande de plus en plus si l’on ne devrait pas opter pour un système comportant un socle forfaitaire commun à l’ensemble des publics, assorti d’assurances complémentaires liées aux différents risques et gérées par les partenaires sociaux avec une plus grande souplesse.
Je suis plus nuancé quant à la création d’un grand opérateur intégrateur qui organiserait tout. Il me semble préférable d’envisager la reconnaissance d’un droit opposable à l’accompagnement. Il conviendrait, au contraire de ce que vous proposez, que cet accompagnement soit relativement décentralisé tout en ayant un cadre national. Il existe déjà un grand opérateur chargé de la formation et du chômage : il a de nombreuses qualités mais il est lourd à gérer et bureaucratique.
Quoi qu’il en soit, je félicite les auteurs de ce rapport, qui mérite d’être valorisé.
Mme Isabelle Le Callennec. Je ne suis pas certaine que ce rapport sera de nature à faire évoluer la situation actuelle de notre pays. Je salue votre travail mais vos propositions me laissent sur ma faim. Comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, il est nécessaire de réformer le système – même si ce sera difficile. Mais avec la création d’agences, je ne vois pas ce que vos propositions ont de révolutionnaire. Vous ne proposez rien concernant la représentativité de ceux qui négocient et de ceux qui gèrent, et rien concernant les financements – qui sont le nerf de la guerre. Vous n’évoquez pas la nécessité d’un diagnostic partagé comparable à celui qui avait été établi par le Conseil d’orientation des retraites (COR) avant la réforme de ces dernières. Le COR ayant associé tous les acteurs, la réforme a fini par aboutir, alors qu’elle était difficile.
Il est vrai que notre système de gestion paritaire est original – il n’y en a de comparable nulle part en Europe. Mais à l’Assemblée nationale, on se pose régulièrement la question de la démocratie sociale lorsque le Gouvernement enjoint aux partenaires sociaux de négocier, le pistolet sur la tempe – comme par exemple pour la convention d’assurance-chômage. Aujourd’hui, le problème est que, dans notre pays, la culture de la négociation est tout à fait inadaptée aux défis économiques et sociaux qui sont les nôtres.
Ce rapport sera utile. Vous avez effectué un travail d’audition considérable et passionnant. Mais j’ai envie de vous dire : tout ça pour ça ! Je ne suis pas certaine qu’un tel rapport nous permettra de relever les défis actuels de notre pays et de faire évoluer tous les blocages et les corporatismes qui demeurent. Ce rapport est publié dans le contexte précis que nous connaissons aujourd’hui et au moment où nous n’avons pas été capables de voter en première lecture à l’Assemblée nationale un texte pourtant très important sur le dialogue social. N’est pas non plus mentionnée dans ce rapport la nécessité de s’interroger sur les rôles respectifs du Parlement, du Gouvernement et des partenaires sociaux.
M. le rapporteur. Dans tous les pays, il existe des systèmes de base gérés par l’État – qu’il s’agisse de systèmes de « charité » très limités ou de systèmes beaucoup plus généreux comme en Europe. La question porte sur les systèmes complémentaires : doivent-ils être gérés par des assurances privées ou parapubliques – comparables à nos complémentaires santé, rendues obligatoires par la loi mais placées dans un contexte concurrentiel de marché – ou bien de façon collective par les acteurs de l’entreprise eux-mêmes ? Cette gestion peut être déléguée aux syndicats de salariés, comme en Suède, ou assurée de manière conjointe par les employeurs et les salariés, comme chez nous. En réalité, les employeurs sont devenus prépondérants dans cette gestion quand on a commencé à leur demander plus d’argent. Le choix est entre ces deux systèmes. En Suède, lorsque les niveaux d’indemnisation du chômage ont été réduits, des systèmes d’assurance complémentaire ont été créés – assortis de tarifs moins élevés pour qui adhère à un syndicat. Si bien que lorsqu’on empile le système général, le système complémentaire géré par les syndicats et les assurances privées, l’indemnisation des cadres est plus élevée qu’avant – environ 95 % de leur salaire est garanti – et celle des plus modestes est, au contraire, plus faible.
Quant à la représentativité, depuis la réforme de 2008, elle ne me semble pas un sujet déterminant pour ce qui concerne la négociation collective – même si nous avons rediscuté de la représentativité patronale. Concernant la présence de représentants des cinq organisations syndicales et des organisations patronales au sein des organismes paritaires, on peut faire évoluer les choses mais ce n’est pas l’essentiel. Le fait que ces organisations soient toutes présentes est important dans un système où il y a encore cinq organisations syndicales, mais je ne suis pas opposé intellectuellement à ce que les votes puissent être pondérés en fonction de l’audience des différentes organisations. Encore une fois, c’est une question importante mais qui, dans la pratique, ne me semble pas déterminante.
L’ampleur de la réforme proposée a été minimisée. Au-delà de la question de savoir si l’on continue à confier la gestion des organismes aux partenaires sociaux ou pas, nous proposons quand même une évolution très profonde – qui n’apparaît pas de manière très explicite dans le rapport car il s’agit d’un travail de fourmi auquel les partenaires sociaux devront s’atteler. D’abord, le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme n’est pas un conseil de plus : il a vocation à se substituer à dix, vingt, trente conseils : le COPANEF (comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation), les COPAREF (comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation), les comités de négociation paritaire existant dans les différents domaines, etc. Je le précise car cela n’est pas indiqué dans le rapport. La création du Haut conseil aurait vocation à faire converger tous les systèmes vers trois grandes fonctions : la sécurité sociale complémentaire, la retraite complémentaire, et tout ce qui concerne l’emploi, la formation et la sécurité sociale professionnelle.
S’agissant du diagnostic partagé, j’ai indiqué que le Haut conseil devrait avoir quatre commissions permanentes et que serait créée une fonction de contrôle et d’évaluation – qui sera assurée par l’État ou les partenaires sociaux. Le rapport aborde aussi le financement du paritarisme. Nous avions évoqué avec le président l’idée de demander aux partenaires sociaux d’aller au bout de la réforme du financement du paritarisme, qui a été engagée avec le fonds paritaire et qui mériterait d’être approfondie. Le Haut conseil comprendra une commission permanente de la sécurité sociale professionnelle qui sera chargée de toutes les discussions et négociations stratégiques sur les parcours professionnels. Une autre commission permanente sera consacrée à la prévoyance et aux complémentaires santé. Enfin, une commission sera consacrée à l’innovation, à l’économie numérique et à l’écologie – questions dont ne se saisissent pas du tout les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Ce Haut conseil sera donc le lieu du diagnostic, de la définition d’une stratégie et ensuite du regroupement des différents organismes. Il est vrai que nous aurions pu proposer un big bang et décider qu’il n’y aurait plus que trois organismes au 1er janvier 2017. Nous avons fait le choix d’inviter à la discussion avec les partenaires sociaux. Mais plus cette discussion ira vite, mieux ce sera.
M. Denys Robiliard. Je vous remercie tout d’abord du travail effectué, extrêmement important en termes tant quantitatifs que qualitatifs.
J’exprimerai tout d’abord une demande. Nous avons eu la chance, au cours de cette mission, que nos auditions fassent systématiquement l’objet de comptes rendus – ce qui est loin d’être le cas dans toutes les missions d’information. Si ces comptes rendus ne sont pas regroupés en annexe au rapport, nous les perdrons. Or, certaines auditions furent très riches, voire drôles, comme celle de M. Raymond Soubie. Ce matériau très dense mérite d’être conservé, d’autant que le travail est fait. Cela pose peut-être un problème matériel mais qui ne me paraît pas insurmontable.
Ensuite, j’ignore s’il est encore possible de modifier le texte du rapport à ce stade, mais je formulerai quelques propositions.
Un point de détail : lorsque vous proposez que le Haut conseil de la négociation collective et du paritarisme entretienne avec l’Assemblée nationale une navette consultative, vous me semblez anticiper la réforme des institutions et postuler que le Sénat aurait disparu. Mieux vaudrait viser le Parlement. Je le précise car la question de l’existence du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental se pose véritablement.
J’entendais Isabelle Le Callennec dire que ce rapport n’est pas révolutionnaire, mais les membres de la Commission nationale de la négociation collective ne seront pas forcément très heureux de voir ce Haut conseil reprendre les fonctions de celle-ci. Par ailleurs, il est proposé d’institutionnaliser un jury citoyen, ce qui ne correspond pas vraiment au fondement de nos institutions.
Je suis favorable à l’institution d’une banque interprofessionnelle du temps. Mais la portabilité du compte épargne temps pose une vraie difficulté : les salariés auront des créances opposables à des employeurs chez lesquels les droits n’auront pas été accumulés. J’ignore si cette question est traitée dans le rapport mais elle peut avoir un impact sur l’embauche, un employeur étant susceptible de vouloir savoir quels sont les droits accumulés par un individu avant de le recruter. Comment gérer cette portabilité ? Faudra-t-il distinguer entre différentes tailles d’entreprises ? Là est la question, la banque du temps relevant plutôt de la gestion que de la politique.
Je suis parfaitement d’accord avec vous quant à la nécessité d’une « révision » – si je puis dire – de la jurisprudence constitutionnelle sur la force obligatoire des clauses conventionnelles de désignation. Le Conseil constitutionnel a annulé une disposition du code de la sécurité sociale en se saisissant d’une des mesures de la loi Sapin qui transposait l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, mettant à terre un dispositif qui avait fait ses preuves et qui était fondé sur une forme de solidarité. Toutes les institutions de prévoyance sont ainsi remises en cause – et elles ne sont pas les seules. Il est nécessaire de revenir sur cette annulation. Le Conseil constitutionnel n’était pas obligé de faire cette analyse. Il l’a faite et nous n’arrivons pas à trouver de dispositif alternatif. Ce qui est en jeu ici est la possibilité d’avoir des tarifs accessibles et acceptables pour les petites entreprises.
J’ai du mal à apprécier la réforme consistant à prévoir que l’AGS soit le réassureur des assureurs désignés ou recommandés par les partenaires sociaux. Notamment parce que les limites de garantie de l’AGS vis-à-vis des créances salariales en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’une entreprise ont été très sévèrement diminuées par un décret qui a dû être publié un 14 août
– est-ce un hasard ? Je ne suis pas sûr que l’AGS doive être le réassureur en cette matière.
Vous proposez d’introduire dans le droit national, le cas échéant en levant les éventuels obstacles constitutionnels, un nouveau vecteur juridique. Cela me paraît extrêmement intéressant mais il me semble que l’obstacle n’est pas de nature constitutionnelle mais bien communautaire. Vous l’expliquez parfaitement aux pages 140 à 149 du rapport. La question est de savoir si nous avons la capacité de faire modifier les directives applicables en la matière, bien plus que de modifier la Constitution qui, de mon point de vue, n’a pas du tout empêché, avant les arrêts Albany, d’adopter des conventions collectives de sécurité sociale. Les institutions de prévoyance – les fameuses institutions « L. 63 », en référence à l’ancien article L. 63 du code de la sécurité sociale – existaient et la Constitution n’a jamais empêché leur développement. C’est clairement le droit communautaire qui a limité leur essor. L’obstacle n’est constitutionnel que parce que le Conseil constitutionnel s’est cru bien inspiré en censurant la loi Sapin. Le jour où le droit communautaire nous permettra de faire ce que nous voulons, le Conseil constitutionnel pourrait revenir sur sa jurisprudence.
S’agissant de l’économie numérique, je ne suggèrerai pas, comme vous le faites, d’« engager une réflexion en vue de formaliser » les grands principes protecteurs applicables à l’ensemble des travailleurs économiquement dépendants, mais bien de « formaliser » directement ces principes. Autrement, on n’est pas près de le faire. Si nous sommes d’accord sur la nécessité d’édicter des principes protecteurs, affirmons-le plus nettement.
Vous proposez aussi d’« inviter les partenaires sociaux à engager une négociation de long terme sur les droits et obligations des travailleurs des plateformes ». L’un des apports de votre rapport est précisément de montrer la nécessité de reconnaître, en ce qui concerne les plateformes numériques, d’autres partenaires sociaux que ceux qui sont classiquement identifiés à ce jour. Vous dites que l’UNSA et la CGT Spectacles s’intéressent à ces questions. En outre, la CFDT n’est pas citée mais il me semble que Mme Véronique Descacq avait affirmé que ce syndicat incitait à l’adhésion des travailleurs du numérique. Mais, formellement, il peut y avoir des syndicats complètement indépendants des grandes confédérations – la difficulté étant que ces travailleurs ne sont pas reconnus comme salariés. Je suggère donc de conserver votre proposition mais de la compléter en évoquant la nécessité d’identifier des organisations syndicales ou professionnelles représentatives de ces travailleurs. Ces organisations pourraient être associées ou consultées à l’occasion des négociations. J’ai ici une rédaction que je peux vous transmettre pour mettre en valeur, dans vos propositions, cet aspect important du rapport. Pour savoir qui sont les partenaires sociaux dans l’économie dite numérique, nous avons besoin d’identifier les travailleurs des plateformes numériques, les donneurs d’ordres et les plateformes elles-mêmes.
Mme Claudine Schmid. Je vous remercie ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce rapport. Mon intervention portera sur la lecture du rapport et de ses conclusions, bien que le rapporteur nous ait informé tout à l’heure qu’il n’avait pas tout indiqué dans ce document.
Tout d’abord, vous prônez la création de plusieurs agences, conseils ou comités, ce qui va à l’encontre de la volonté d’en réduire le nombre. Vous avez certes précisé entre-temps que ces nouvelles instances viendraient en remplacer d’autres mais cela n’est pas explicité dans le rapport. Ne faudrait-il pas plutôt faire confiance aux partenaires sociaux ? À mon sens, la création d’un Haut conseil compliquerait encore davantage le fonctionnement du paritarisme. Et pourquoi confier les missions que vous avez citées à cette instance plutôt qu’au Conseil économique, social et environnemental (CESE) ? Sauf erreur de ma part, lors de l’audition du président du CESE, cette question avait été posée.
Vous évoquez aussi la représentation des salariés dans les conseils d’administration. Or, le dialogue social est en général satisfaisant dans les grandes entreprises mais plus compliqué dans les TPE-PME. Il n’est pas nécessaire d’imposer à celles-ci de nouvelles contraintes alors que les chefs d’entreprise doivent déjà supporter le poids de nombreuses réglementations.
Vous préconisez la présence d’un tiers de représentants des salariés dans les organes dirigeants des entreprises. Je considère pareille représentation comme inadaptée, voire trop importante. Ne vaudrait-il pas mieux favoriser l’actionnariat salarié et assurer une formation économique des représentants de salariés afin de leur transmettre une vision plus large de la concurrence et des contraintes auxquelles les entreprises doivent faire face ?
L’Agence nationale de sécurité sociale professionnelle et la Banque interprofessionnelle du temps auraient, à mon sens, dû faire l’objet d’une réflexion lors du débat – si débat il y avait eu – sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs.
Dans vos conclusions, vous souhaitez, monsieur le rapporteur, que des modes de régulation nouveaux soient inventés. Cette formule est très vague. Que proposez-vous plus précisément ?
Bref, comme ma collègue Isabelle Le Callennec, je reste assez sceptique quant aux résultats de vos recommandations : je ne suis pas sûre que celles-ci soient favorables à l’intérêt général.
Mme Fanélie Carrey-Conte. Je remercie à mon tour le président et le rapporteur pour la qualité de nos échanges, la richesse des auditions et le travail produit. Je n’ai pas assisté à toutes les réunions de la mission mais celles auxquelles j’ai participé font partie des moments stimulants de la vie parlementaire – moments qui ne sont guère fréquents actuellement.
Au contraire de ce qui a pu être dit tout à l’heure, je pense que certaines propositions, si elles étaient appliquées rapidement, bouleverseraient de façon positive la situation démocratique et économique de notre pays. Je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, Mme Schmid, quant à la présence des représentants des salariés dans les conseils d’administration. Je considère que cette réforme est absolument indispensable à la qualité de la négociation et à la bonne santé économique et démocratique de notre pays. Je serais assez favorable à titre personnel à un système de cogestion à l’allemande – avec près de 50 % de représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises de plus de 2 000 salariés. On peut néanmoins considérer votre proposition comme un premier pas, monsieur le rapporteur.
Je suis tout à fait favorable à vos propositions relatives au régime unifié de sécurité sociale professionnelle. J’ai néanmoins du mal à saisir l’articulation entre l’Agence nationale pour la formation professionnelle, la Banque interprofessionnelle du temps et l’Agence nationale de sécurité sociale professionnelle. L’idée est-elle bien, à terme, que la dernière intègre les deux dispositifs précédents ? Si oui, peut-être faudrait-il le préciser. Je m’interroge également sur la gouvernance de l’Agence nationale de sécurité sociale professionnelle : quelle y sera la place des partenaires sociaux ?
Enfin, s’agissant de l’économie numérique, je suis tout à fait d’accord pour dire que créer un statut intermédiaire pour les nouvelles formes d’emploi est une fausse bonne idée. On risque de dégrader les conditions d’emploi de nombreux travailleurs. Il faut surtout faire en sorte que les nouvelles formes d’emploi des travailleurs non-salariés soient pleinement intégrées à la sécurité sociale professionnelle que l’on mettra en place demain. Les systèmes existants sont pensés pour les salariés classiques. Au-delà de la question des travailleurs non-salariés se pose celle des autoentrepreneurs, des intermittents et des travailleurs de l’économie sociale. Il conviendrait donc de faire apparaître plus distinctement le lien entre les deuxième et troisième volets de vos propositions.
M. le président Arnaud Richard. Paraphrasant Winston Churchill, je dirai à ceux de nos collègues qui restent sur leur faim que, pour moi, le paritarisme est le plus mauvais des systèmes, à l’exception de tous les autres, pour élaborer de subtils compromis et piloter des régulations. C’est peut-être la raison pour laquelle le rapporteur a souhaité formuler des propositions peu nombreuses mais extrêmement fortes – et qui le sont beaucoup plus qu’elles n’en ont l’air. Ce Haut conseil sera vraiment une cabine de pilotage à la main des partenaires sociaux, compte tenu de l’importance de leur rôle. Le Parlement connaissant mal le paritarisme – d’où l’intérêt d’en faire un panorama –, il est bien qu’il prenne sa place dans ce dispositif au regard des évolutions et des réalités du monde du travail. Le rôle du Parlement consiste aussi à évaluer et à se trouver en amont et en aval des négociations, le Gouvernement donnant le cap de celles-ci. Si j’ai qualifié le paritarisme de cinquième pouvoir, il me semble bénéfique que tous les pouvoirs de notre pays travaillent de concert.
M. le rapporteur. Partageant la plupart des remarques de Denys Robiliard, je les intégrerai sans difficulté au rapport. Il me semble utile de conserver l’idée d’une réassurance privilégiée pour les complémentaires santé à court terme, mais pas de nous prononcer sur l’instance qui doit s’en charger. Si ce devait être l’AGS, elle le ferait au détriment d’autres instances ou bien les cotisations devraient augmenter. Cet aspect ne change rien au fait qu’il faille trouver des solutions à court terme pour aider à faire de la mutualisation et, à plus long terme, des solutions juridiques, que ce soit sur le plan européen ou constitutionnel. Je ne fais pas la même analyse que vous, mais je crois qu’il faut agir aux deux niveaux. Je suis prêt à défendre une réforme constitutionnelle disposant que pour créer un régime de conventions collectives de sécurité sociale, on peut restreindre la liberté d’entreprendre. On ne l’écrira pas ainsi mais c’est l’idée. On peut également agir au niveau européen. Mais j’ai cru comprendre que c’est parce que nous nous y étions mal pris, en abordant les choses à partir des clauses de désignation et non des régimes de protection sociale, que de telles conclusions avaient été tirées au niveau européen.
La gestion du temps est précisément l’objet de la Banque interprofessionnelle du temps. Quel que soit le nom retenu, le dispositif a vocation à n’être qu’une étape. Si l’on n’introduit pas aujourd’hui la notion de temps dans le compte personnel d’activité (CPA), c’est parce que la question de sa transférabilité n’est pas réglée. J’ai donc voulu traiter ce sujet de façon spécifique. Nous avons réglé le problème de la transférabilité des droits à formation via le compte personnel de formation. Reste à décider comment transférer des jours d’une entreprise à une autre et à décider qui les paie. Dans mon esprit, l’idée est lorsque vous transférez des jours, ils soient payés par l’entreprise à cette banque du temps – qui serait naturellement la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu des choix qui ont été faits pour le CPA. Lorsque le salarié prendrait des jours de congé acquis dans les entreprises où il a travaillé antérieurement, ces jours seraient donc payés par celles-ci. Il faut néanmoins que les entreprises apprennent à remplacer les salariés qui prendront un « congé CPA » tout comme elles remplacent les femmes qui prennent un congé maternité. Bref, la création d’une banque du temps permettra de régler la question du financement – celui-ci étant aujourd’hui incomplet en raison de certains plafonnements et de règles de fiscalisation qui limitent la possibilité de transférer des jours. Reste effectivement à traiter la façon de concilier cette liberté avec un bon fonctionnement de l’entreprise, question dont, à nos yeux, les partenaires sociaux doivent se saisir.
S’agissant de la navette entre le Haut conseil et le Parlement, nous corrigerons évidemment la rédaction de la proposition de façon à la faire coïncider avec ce qui est écrit dans le corps du texte.
Eu égard à la simplification, j’ai voulu éviter l’écueil d’un raisonnement manichéen consistant à vouloir faire entrer cinquante-huit organismes dans trois cases. J’ai préféré montrer la direction et laisser les partenaires sociaux faire le travail. Nous indiquons clairement dans le rapport que le Haut conseil de la négociation collective doit être hébergé par le Conseil économique et social et que sa création ne saurait se substituer à une nécessaire réflexion sur le CESE et le Sénat ainsi que sur l’articulation entre ces instances.
Mme Fanélie Carrey-Conte a elle-même répondu à sa question concernant l’Agence nationale de sécurité sociale professionnelle : le système se construira évidemment par étapes. Il faut déjà achever la réforme de la formation professionnelle : le nombre d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) a été réduit mais le système n’est pas encore unifié. Nous avons vu au cours de nos auditions que, lorsqu’il s’agit par exemple d’octroyer un congé individuel de formation, pour une formation longue, c’est un parcours du combattant : les organismes doivent aller chercher de l’argent sur le compte personnel de formation, sur le congé individuel de formation (CIF), dans les OPCA de la branche, et lorsqu’aucune branche n’est concernée, dans le FPSPP. La première étape consistera donc à achever cette réforme pour que l’on ait un conseil en évolution professionnelle, c’est-à-dire un accompagnement et un système de financement, unifié. La deuxième étape consistera à créer la banque du temps. La troisième étape sera celle de la fusion de toutes ces instances en un seul organisme.
Nous avons vu au cours de nos auditions de nombreux modèles paritaires. Ce n’est pas celui où le conseil d’administration comprendrait quatre parties
– salariés, employeurs, État, régions – que je privilégie. Car je ne sais pas comment décider combien pèsera l’État par rapport aux partenaires sociaux, ni combien pèseront les régions par rapport à l’État. Je penche pour un système dont les partenaires sociaux soient co-gestionnaires et qui soit régulé – que ce soit par un droit de veto, une procédure d’agrément ou des conventions d’objectifs et de gestion. L’organisme pourrait signer une convention avec l’État et une autre avec les régions. Cela me paraîtrait plus clair ainsi, mais le fait de savoir si l’on opte pour le quadripartisme ou un paritarisme assorti de relations bilatérales avec l’État d’une part, et les régions d’autre part, n’est pas déterminant.
Enfin, je n’ai pas compris la remarque de Mme Claudine Schmid sur les nouveaux modes de régulation. À quel passage du rapport faites-vous référence ?
Mme Claudine Schmid. À la page 318, on peut lire la phrase suivante : « aujourd’hui, des modes de régulation nouveaux doivent être inventés, qui doivent combiner des notions aussi diverses que liberté, autonomie, responsabilité, mutualisation, etc. ». Qu’entendez-vous par là ?
M. le rapporteur. Cette phrase est un résumé de ce qui précède. Nous pensons que l’économie numérique apporte des services nouveaux que nous ne voulons pas « tuer » en considérant ces activités comme du salariat. Il faut donc trouver le moyen de créer des protections au profit des travailleurs exerçant leur activité dans ce cadre sans remettre en question l’existence de ces services. Cela correspond à un champ nouveau de la protection sociale. Il convient de déterminer les cotisations qui devront être versées par ces travailleurs aux régimes de protection sociale et quelles règles de protection leur seront applicables.
J’ai oublié de dire que je suis tout à fait d’accord avec la remarque de Denys Robiliard concernant le numérique. Je l’intègrerai dans le rapport.
M. le président Arnaud Richard. Je salue la capacité du rapporteur à embrasser tous nos travaux. Nous avions comme mission de trouver des pistes afin de conférer une nouvelle légitimité au paritarisme, dans une société française de plus en plus complexe. Jean-Patrick Gille a qualifié ce rapport de « somme ». Je crois que celle-ci sera très utile à la réforme du modèle social français.
À présent, il revient à notre mission, en application de l’article 145 du Règlement, de voter sur le rapport qui vous est soumis.
La mission d’information adopte le rapport, autorisant ainsi sa publication conformément aux dispositions de l’article 145 du Règlement de l’Assemblée nationale.
CONTRIBUTION DE Mme ISABELLE LE CALLENNEC AU NOM DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS
L’histoire retiendra que ce rapport de la mission d’information sur le paritarisme dont les travaux ont démarré en novembre 2015, a été remis au Président de l’Assemblée nationale au moment où plusieurs organisations syndicales tentaient à force de grèves, manifestations, et autres déclarations hostiles, de faire échouer le vote d’une loi portée par une majorité dont ils avaient pourtant soutenu l’élection en 2012.
Á leur décharge, le contenu de plusieurs articles contenus dans la loi "visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s", était parfaitement contraire aux principes qu’ils avaient défendus depuis l’après-guerre. Le Président Hollande, « l’ennemi de la finance » pour lequel ils avaient appelé à voter à l’élection présidentielle, n’avait absolument pas annoncé pareille évolution du droit du travail.
Le climat actuel prouve, s’il en était encore besoin, que le paritarisme est à bout de souffle dans notre pays.
Ce rapport arrivait donc à point nommé, pour faire l’analyse du paritarisme en France : ses forces, ses faiblesses, et tracer des perspectives. L’idéal aurait été de raisonner en termes « opportunités/menaces» afin de dresser un diagnostic partagé qui aurait permis de construire les fondements d'une réforme utile.
Si nous rendons hommage au Président et au rapporteur de cette mission d'information pour leur implication personnelle dans la conduite des travaux (23 réunions de la commission, 151 personnes auditionnées, des tables rondes ouvertes à la presse, les 70 heures d'auditions), si nous entendons remercier les administrateurs pour la qualité du travail fourni, nous sommes en revanche extrêmement déçus par les 12 propositions du rapporteur.
Quel était l’objectif de ce rapport, il y a 6 mois ?
Dans quel contexte est-il aujourd’hui rendu public ?
Est-il à la mesure des défis qui sont devant nous ?
Ce sont les questions auxquelles le groupe les Républicains s’est attaché à répondre afin de décider de son vote.
Selon l’expression du Président Arnaud Richard lors de l’audition de Jean Denis Combrexelle le 18 novembre 2015, la commission entendait s’interroger sur l’état du paritarisme, sur son efficacité, sur sa pertinence et sur ses évolutions possibles ou souhaitables, compte tenu notamment du développement de nouvelles formes de travail.
La réponse apportée en conclusion du rapport ? "L’architecture de la négociation interprofessionnelle et du paritarisme devrait être repensée, une sécurité sociale professionnelle dotée d’une gestion unifiée mise en place et, enfin, l’invention d’un nouveau paritarisme adapté à la société numérique, à la fameuse « ubérisation » de la société".
Pour y parvenir, quelles propositions ? Création d’un «Haut-Conseil de la négociation collective et du paritarisme », création d’un « institut des hautes études du dialogue social », création d’une « banque paritaire du temps », création d’une « Agence nationale de Sécurité sociale professionnelle »… Dès lors, une question méritait d'être posée : la création d'un institut, d'un haut conseil et d'une agence, est-elle la meilleure réponse aux "blocages" observés à la faveur des événements qui se produisent en ce moment même dans notre pays ? Allusion aux manifestations d’opposition à la loi travail, à la difficulté pour les partenaires sociaux à négocier la nouvelle convention d’assurance chômage ou aux discussions en cours entre le gouvernement pour tenter de sauver la face en cédant aux corporatismes.
On peut aussi s’étonner qu’il n’y ait aucune proposition sur le financement du paritarisme ou sur la représentativité des organisations patronales et syndicales de salariés alors que chacun sait que les réformes relatives au "dialogue social" bloquent précisément sur ces deux questions fondamentales, encore tabous.
Dans un pays où le chômage est de masse et dont l’économie est en profonde mutation, nous ne pouvons faire l’économie d’un changement radical de nature du paritarisme. D’autres pays européens tels que la Suède ou l’Allemagne ont, en effet, prouvé qu’un paritarisme moderne pouvait être la source de création de richesses et de bien-être au travail.
Pouvons-nous continuer à confier la responsabilité de la gestion d’organismes sociaux à des organisations patronales et syndicales de salariés aussi peu représentatives et pour certaines d’entre elles, dont le moteur continue de participer de la lutte des classes ?
Peut-on encore confier la responsabilité de tels organismes, la négociation des Accords Nationaux Interprofessionnels qui s’appliquent à tous, à des organisations qui ne représentent que 6 % des salariés ?
Á défaut d’une prise en compte, par les partenaires sociaux, des réalités économiques et sociales et si la défense des intérêts particuliers, voire corporatistes, l’État ne devrait-il envisager de revoir les modalités de gestion de la protection sociale ?
Á défaut d'une réponse définitive, la question aurait au moins due être posée dans ce rapport.
En conclusion, le paritarisme né après-guerre a vécu et mérite une réforme pour lui redonner une légitimité.
Le paritarisme qui élabore des règles, avec par exemple les accords nationaux interprofessionnels et gère la protection sociale (Unédic, agirc-arco, caf…) a prouvé ses limites.
Le dialogue social, absolument nécessaire pour concilier compétitivité économique et cohésion sociale doit être radicalement repensé avec, au cœur, l’entreprise et les salariés : plus de dialogue, plus de représentativité.
Cela passe nécessairement par une révision du calcul de leur représentativité et des modes de financements de leurs activités, mais aussi peut-être par une révision des modes d’exercice du syndicalisme.
Finalement, ce rapport, malgré sa densité et quelques recommandations pertinentes, passe à côté de l’objectif qui aurait dû être le sien : rendre le paritarisme plus efficace et mieux adapté aux défis économiques et sociaux. Force est malheureusement de constater que les recommandations ne sont pas de nature à simplifier le dispositif actuel ni à faire avancer le sujet.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Ø Direction générale du travail : M. Jean-Henri Pyronnet, sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail, et Mme Anne Thauvin, chef de bureau des relations individuelles du travail ;
Ø Réalités du dialogue social (RDS) : M. Jean-Paul Guillot, président, Mme Lydia Zumelli-Brovelli, vice-présidente de l’Amicale du CESE, co-auteure d’un rapport sur la réalité du dialogue social, et M. Jean François Herlem, « contributeurs RDS » qui ont mené les travaux du groupe « Efficience des mandats » qui a produit le DIEM et le Mandascop ;
Ø UNEDIC : Mme Patricia Ferrand, présidente, M. Jean-François Pilliard, vice-président, et M. Vincent Destival, directeur général ;
Ø M. Henri Rouilleault ancien conseiller du Premier ministre (M. Michel Rocard), ancien directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, auteur de Où va la démocratie sociale ? ;
Ø M. Jacques Freyssinet, professeur émérite à l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, président du conseil scientifique du Centre d’études de l’emploi ;
Ø M. Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d’État ;
Ø Table ronde des négociateurs des conventions AGIRC-ARRCO représentant les organisations d’employeurs et de salariés) :
– Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : Mme Pascale Coton, secrétaire générale
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Claude Tendil, président de la commission Protection sociale, Mme Valérie Corman, conseillère pour la protection sociale, et Mme Marine Binckli, chargée de mission à la direction des affaires publiques
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) : M. Jean-Louis Malys, secrétaire national, et Mme Virginie Aubin, secrétaire confédérale
– Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Philippe Pihet, secrétaire confédéral chargé des secteurs Retraites, Prévoyance sociale et UCR
– Confédération générale du travail (CGT) : M. Éric Aubin, chargé du dossier Retraite et membre de la commission exécutive confédérale, et Mme Sylvie Durand, responsable secteur Retraite UGICT CGT
– Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : M. Pierre Roger, délégué national secteur Protection sociale, et Mme Leslie Robillard, chargée d’études à la protection sociale
Ø Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) : Mme Françoise Bouygard, directrice, et M. Patrick Pommier, chef du département Relations professionnelles et temps de travail ;
Ø M. Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail ;
Ø Table ronde des négociateurs de la convention Unédic au titre des représentants des salariés :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) : Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe, et Mme Lucie Lourdelle, secrétaire confédérale
– Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : M. Franck Mikula, secrétaire national chargé de l’emploi et de la formation, et M. Franck Boissart, conseiller technique
– Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Stéphane Lardy, secrétaire confédéral Emploi-chômage-formation
– Confédération générale du travail (CGT) : M. Éric Aubin, chargé du dossier Retraite et membre de la commission exécutive confédérale, et M. Denis Gravouil, secrétaire général de la Fédération nationale CGT des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (FNSAC), membre du bureau de l’Unédic
– Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : M. Yves Razzoli, président de la fédération Protection sociale et emploi
– Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : M. Hervé Léost, sous-directeur des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi, et Mme Marie Marcena, adjointe au chef de la mission Indemnisation du chômage de la sous-direction des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi
Ø Table ronde des négociateurs de la convention Unédic au titre des représentants des employeurs :
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Jean-François Pilliard, délégué général de l’UIMM, vice-président de l’Unédic, et M. Antoine Foucher, directeur général adjoint du MEDEF
– Union professionnelle artisanale (UPA) : M. Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Caroline Duc, conseillère technique
– Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : M. Hervé Léost, sous-directeur des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi, et Mme Marie Marcena, adjointe au chef de la mission Indemnisation du chômage de la sous-direction des mutations économiques et de la sécurisation de l’emploi
Ø M. Jean-Pisani Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie), et Mme Selma Mahfouz, directrice adjointe ;
Ø Table ronde de l’exécutif de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) :
– M. Jean-Paul Bouchet (CFDT Cadres), président de l’AGIRC, et M. Frédéric Agenet (MEDEF), vice-président
– M. François-Xavier Selleret, directeur général de l’AGIRC-ARRCO et du groupement d’intérêt public AGIRC-ARRCO ;
Ø M. Philippe Hourcade, président, et M. Jean-Dominique Simonpoli, directeur général de Dialogues ;
Ø M. Dominique Libault, ancien directeur de la sécurité sociale (2002-2012), vice-président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, directeur général de l’École nationale supérieure de Sécurité sociale ;
Ø Mme Annette Jobert, directrice de recherche au CNRS, directeur de recherche émérite de l'IDHE ;
Ø M. Bruno Mettling, directeur des ressources humaines d’Orange, auteur du rapport Transformation numérique et vie au travail ;
Ø M. Bruno Teboul, vice-président de Keyrus, membre de la chaire Data Scientist de l’École polytechnique, auteur de Ubérisation, économie déchirée ;
Ø M. Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternatives économiques ;
Ø Fédération Française du Bâtiment : M. Jacques Chanut, président, M. Bertrand Sablier, directeur général, Mme Laetitia Assali, directrice des affaires sociales, et M. Benoît Vanstavel, direction des relations institutionnelles ;
Ø CAPEB : M. Albert Quenet, premier vice-président, Mme Cécile Sauveur, directrice du Pôle juridique et social, M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et européennes, Mme Valérie Guillotin, chargée de mission ;
Ø BTP-Prévoyance :
– représentants des salariés : Mme Caroline Tykoczinsky, présidente du conseil (CFTC)
– représentant de la FNTP : M. Christian Lavedrine, secrétaire adjoint du conseil ;
– M. Stephan Reuge, directeur général délégué
Ø Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) :
– représentants des employeurs : M. Jean-Claude Guyard, président FNPTP,
– représentants des salariés : Mme Véronique Deleville, vice-présidente (FO),
– secrétaire général : M. Paul Duphil,
– pour le ministère du Travail (DGT) : Mme Bénédicte Legrand-Jung, sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, Mme Marie-Laurence Guillaume, chef du bureau Équipement et lieux de travail, représentante titulaire de la DGT au conseil du comité national de l’OPPBTP, et M. Bernard Lancery, chargé de prévention BTP, représentant suppléant au même conseil
Ø M. Raymond Soubie, président du groupe d’information professionnelle AEF, président des sociétés de conseil Alixio et Taddeo, ancien conseiller du président de la République, M. Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2010 ;
Ø CFDT : Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe, et Mme Patricia Ferrand, secrétaire confédérale ;
Ø Mme Brigitte Dormont et M. Antoine Bozio, économistes ;
Ø CFTC : M. Philippe Louis, président confédéral, et M. Richard Bonne, directeur de cabinet
Ø Mme Diana Filippova et M. Arthur De Grave, représentants du collectif OuiShare
Ø Institut Montaigne : M. Gérard Adam, président du groupe de travail sur le dialogue social (rapport de 2011), M. Éric Aubry, membre du groupe de travail sur le dialogue social, Me Franck Morel, avocat associé au cabinet Barthélémy et membre du groupe de travail, et M. Marc-Antoine Authier, chargé d’études ;
Ø Table ronde de présidents de commissions mixtes paritaires de négociations de branche :
– Commission transports ferroviaires : M. Jean Bessière
– Commission transports routiers de marchandises : M. Didier Caroff
– Commissions hôtels-restaurant, cafétérias, esthétique, parfumerie, coiffure : Mme Laurence Rivoal
– M. Bernard Maurin ;
Ø Table ronde Économie numérique – Économie des plates-formes :
– Koolicar : M. Alexandre Bol, cofondateur
– Vizeat : M. Jean-Michel Petit, fondateur et président
– Blablacar : Mme Fabienne Weibel, directrice des affaires institutionnelles
Ø M. Pascal Terrasse, député de l’Ardèche et auteur du rapport sur l’économie collaborative, remis au Premier ministre le 8 février 2016, accompagné de M. Philippe Barbezieux, inspecteur général des affaires sociales, et de Mme Camille Herody, inspectrice des finances
Ø Uniformation : Mme Nadine Goret, présidente (collège salariés), M. Robert Baron, trésorier adjoint (collège employeurs), et M. Thierry Dez, directeur général ;
Ø Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) : M. Pierre Possémé, président, M. Dominique Schott, vice-président, et M. Philippe Dole, directeur général ;
Ø M. Alain Lacabarats, membre du Conseil supérieur de la Magistrature, ancien président de chambre à la Cour de cassation ;
Ø Conseil supérieur de la prud’homie : M. Jean-François Merle, président, membre du Conseil d’État ;
Ø Centre interservices de Santé et de Médecine du travail en Entreprise (CISME) : M. Serge Lesimple, président, et M. Martial Brun, directeur général ;
Ø Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) :
– collège des salariés : M. Bernard Daeschler, président (CGT, Malakoff-Mederic-Prévoyance)
– collège des employeurs : M. Pierre Mie, vice-président (MEDEF, Humanis-Prévoyance)
– M. Jean Paul Lacam, délégué général
– Mme Miriana Clerc, directrice Communication et relations extérieures, et Mme Stéphanie Maringe, chargée de mission relations institutionnelles ;
Ø M. Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha ;
Ø Fongecif Île-de-France : M. Patrick Frange, président (MEDEF), Mme Myriam Blanchot-Pesic, vice-présidente (CFTC), et M. Laurent Nahon, directeur général ;
Ø Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) : M. Hervé Lanouzière, directeur général, et M. Olivier Mériaux, directeur général adjoint, directeur technique et scientifique ;
Ø Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) : M. Hugues de Balathier-Lantage, chef de service, adjoint à la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, et M. Guillaume Fournié, chef adjoint de la mission Droit et financement de la formation ;
Ø Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) : Mme Anne Baltazar, présidente, et M. Hugues Defoy, directeur du Pôle Métier ;
Ø Pôle emploi : M. Jean Bassères, directeur général, et M. Damien Ranger, chargé de mission à la direction de la stratégie ;
Ø Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL) : M. Bruno Arbouet, directeur général, et M. Jean-René Poillot, chargé de mission auprès de la direction générale ;
Ø Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) : MM. Ronald Schouller et Jean-François Naton, vice-présidents de la commission AT/MP, et M. Franck Gambelli, membre de la commission AT/MP ;
Ø Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) : M. Jean-Louis Deroussen, président du conseil d’administration, et Mme Patricia Chantin, responsable des relations parlementaires et institutionnelles ;
Ø Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) : M. Gérard Rivière, président du conseil d’administration, et M. Renaud Villard, directeur ;
Ø Direction générale du travail : M. Yves Struillou, directeur général, Mme Florence Renon, chef de bureau, M. Frédéric Teze, adjoint à la sous-directrice des conditions de travail, Mme Claire Scotton, adjointe au sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail, et M. Aymeric Morin, chef de bureau ;
Ø M. Laurent Duclos, docteur en sociologie, associé à l’IDHES (Institutions et Dynamiques historiques de l’Économie et de la Société), département de la synthèse de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère (DGEFP) ;
Ø Me Jacques Barthélémy, avocat, et Me Michel Henry, avocat ;
Ø Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général, et M. Philippe Pihet, secrétaire confédéral
Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Michel Guilbaud, directeur général, M. Antoine Foucher, directeur général adjoint chargé des affaires sociales, Mme Valérie Corman, conseillère pour la protection sociale, et Mme Ophélie Dujarric, directrice adjointe chargée de la direction des affaires publiques ;
Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : M. Philippe Louis, président, et M. Michel Charbonnier, conseiller politique ;
Ø Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : Mme Marie-Françoise Leflon, secrétaire générale, et Mme Laurence Matthys, responsable du service Travail – Emploi ;
Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : M. Jean-Michel Pottier, vice-président chargé des affaires sociales, Mme Sandrine Bourgogne, secrétaire générale adjointe, et M. Georges Tissié, directeur des affaires sociales ;
Ø Union professionnelle artisanale (UPA) : M. Pierre Burban, secrétaire général, et M. Christian Pineau, chef du service Relations du travail et protection sociale ;
Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) : Mme Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe, Mme Sonia Buscarini, responsable du service Protection sociale, et M. Philippe Couteux, responsable du service Emploi et sécurisation des parcours professionnels ;
Ø Conseil économique, social et environnemental : M. Patrick Bernasconi, président, M. Vincent Le Roux, directeur de cabinet du président, et Mme Catherine Lopez, conseillère chargée des relations institutionnelles ;
Ø Direction de la sécurité sociale : M. Thomas Fatome, directeur, et Mme Élodie Viscontini, chef adjoint du bureau de l’organisation administrative et des ressources humaines ;
Ø Confédération générale du travail (CGT) : M. David Dugué, administrateur, et M. Jean-Philippe Maréchal, conseiller à l’Espace revendicatif confédéral.
Les comptes rendus des auditions sont disponibles sur le site Internet de l’Assemblée nationale, à l’adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-miparitarisme/15-16/
L’ensemble des informations relatives à la mission sont accessibles sur son portail, à l’adresse :
ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale
ACTES accord relatif aux conditions de travail, au temps de travail, à l’emploi et aux salaires
AFL Association Foncière Logement
AFPA Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Agefiph Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
AGFF Agence française de gestion du fonds de financement
AGFPN Association de gestion du fonds paritaire national
AGIRC Association générale des institutions de retraite des cadres
ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
ANCOLS Agence nationale de contrôle du logement social
ANI accord national interprofessionnel
ANPE Agence nationale pour l’emploi
ANPEEC Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction
ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
APAGL Association pour l’accès aux garanties locatives
APEC Association pour l’emploi des cadres
ARACT association régionale pour l’amélioration des conditions de travail
ARF Association des régions de France
ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ASF Association pour la gestion de la structure financière
AT/MP Accidents du travail / maladies professionnelles
BCO bureau de conciliation et d’orientation
BEP brevet d'études professionnelles
CAF caisse d’allocations familiales
CANAM Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes
CANCAVA Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale
CAP certificat d'aptitude professionnelle
CARSAT caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CAT centre d’aide par le travail
CDD contrat à durée déterminée
CDI contrat à durée indéterminée
CEP conseil en évolution professionnelle
CESE Conseil économique, social et environnemental
CET compte épargne-temps
CFDT Confédération française démocratique du travail
CFE-CGC Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres
CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens
CGPME Confédération générale des petites et moyennes entreprises
CGT Confédération générale du travail
CGT-FO Confédération générale du travail – Force ouvrière
CHSCT comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CICAS centre d’information et de coordination de l’action sociale
CICE crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
CIF congé individuel de formation
CIL comité interprofessionnel du logement
CISME Centre interservices de santé et de médecine du travail
CISS Collectif interassociatif sur la santé
CJCE Cour de justice des Communautés européennes
CJUE Cour de justice de l’Union européenne
CNAF Caisse nationale des allocations familiales
CNAMTS Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
CNEFOP Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
CNIS Conseil national de l’information statistique
CNNC Commission nationale de la négociation collective
CNPF Conseil national du patronat français
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale
COCT Conseil d’orientation des conditions de travail
COG convention d’objectifs et de gestion
COMAREP Commission des accords de retraite et de prévoyance
COPANEF Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
COPAREF Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation
COR Conseil d’orientation des retraites
COREOCT comité régional d’orientation des conditions de travail
CPA compte personnel d’activité
CPAM caisse primaire d’assurance maladie
CPF compte personnel de formation
CPG contrat pluriannuel de gestion
CPOM contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CPRDFOP contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
CRAT/MP commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles
CREFOP comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
CSG contribution sociale généralisée
CTIP Centre technique des institutions de prévoyance
CTN comité technique national
DADS déclaration annuelle des données sociales
DARES direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques
DGEFP direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle
DGT direction générale du travail
DIF droit individuel à la formation
DIRECCTE direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DSS direction de la sécurité sociale
DUP délégation unique du personnel
EEE Espace économique européen
ENM École nationale de la magistrature
EPIC établissement public industriel et commercial
ESAT établissement et service d’aide par le travail
ETP équivalent temps plein
FCAATA Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
FFB Fédération française du bâtiment
FIVA Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
FNAL Fonds national d’aide au logement
FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés
FNE Fonds national de l’emploi
FNMF Fédération nationale de la Mutualité française
FNOSS Fédération nationale des organismes de sécurité sociale
FNPATMP Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
FNTP Fédération nationale des travaux publics
FONGECIF Fonds de gestion des congés individuels de formation
FPSPP Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
FSE Fonds social européen
FSU Fédération syndicale unitaire
GIE groupement d’intérêt économique
GPEC gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
GPRF Gouvernement provisoire de la République française
GPS groupe de protection sociale
GSN groupe spécial de négociation
HCFPS Haut conseil du financement de la protection sociale
HLM habitation à loyer modéré
IGAS Inspection générale des affaires sociales
IHEDN Institut des hautes études de défense nationale
INRS Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
IRES Institut de recherches économiques et sociales
IRP institution représentative du personnel
LFSS loi de financement de la sécurité sociale
MEDEF Mouvement des entreprises de France
MSA Mutualité sociale agricole
OCTA organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
ONDAM Objectif national des dépenses d’assurance maladie
OPACIF organisme paritaire collecteur agréé pour le financement du congé individuel de formation
OPCA organisme paritaire collecteur agréé
OPPBTP Office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
PEAC participation des employeurs agricoles à l’effort de construction
PEEC participation des employeurs à l’effort de construction
PLFSS projet de loi de financement de la sécurité sociale
PME petite et moyenne entreprise
PST Plan Santé au travail
RSI Régime social des indépendants
RTT réduction du temps de travail
SAMETH service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance
SPE service public de l’emploi
SPRO service public régional de l’orientation
TGI tribunal de grande instance
TPE très petite entreprise
UCANSS Union des caisses nationales de sécurité sociale
UDES Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire
UESL Union des entreprises et des salariés pour le logement (antérieurement Union économique et sociale pour le logement)
UIMM Union des industries métallurgiques et minières
UNAF Union nationale des associations familiales
UNAPL Union nationale des professions libérales
UNCAM Union nationale des caisses d’assurance maladie
UNIRS Union nationale des institutions de retraite des salariés
UNSA Union nationale des syndicats autonomes
UPA Union professionnelle artisanale
URSSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
USH Union sociale pour l’habitat
VAE validation des acquis de l’expérience
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page
2 () Depuis 1969, l’Institut supérieur du travail (IST) développe une expertise dans le domaine des relations sociales et syndicales, à laquelle plus de 300 entreprises, de toute taille et de tous secteurs, font appel chaque année. L’IST prépare les responsables d’entreprise et les représentants du personnel à l’exercice des relations sociales et syndicales en leur proposant :
– une large gamme de formations auxquelles participent chaque année, quelque 6 500 personnes (pour les deux tiers, des responsables d’entreprise et membres de l’encadrement, et pour un tiers des représentants du personnel) ;
– des missions d’expertise et de conseil auprès des entreprises pour les aider à améliorer leur gestion des problématiques sociales (interprétation des stratégies syndicales, clarification des rôles des acteurs sociaux, prévention des conflits…) ;
– des études sur tous les sujets d’actualité sociale et syndicale, qui sont accessibles en ligne gratuitement.
3 () Audition du 3 décembre 2015.
4 () Audition du 7 avril 2016.
5 () Laurent Duclos, Paritarisme(s) et institution(s). La représentation du rapport Capital-Travail dans la gestion de services établis dans l’intérêt général : les cas de l’électricité et des allocations familiales, Thèse pour le doctorat de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Fondation nationale des sciences politiques, mars 2006.
6 () Audition du 27 avril 2016.
7 () Le terme « corporatiste » ou « néo-corporatiste », qui a acquis aujourd’hui une connotation péjorative, est couramment utilisé en sociologie des institutions.
8 () Ces éléments historiques ont été évoqués à la fois par Mme Annette Jobert et M. Bernard Vivier. Voir par exemple l’article de M. André Bergeron du 19 avril 1961 dans le journal de Force Ouvrière : « La bonne gestion des ASSEDIC est un succès qu’il faut porter au compte du paritarisme ».
9 () La démocratie sociale est une exigence constitutionnelle générique correspondant à la volonté des politiques et des partenaires sociaux d’après-guerre de compléter la démocratie politique par une autre forme de démocratie. Voir Pierre Laroque, Au service de l’homme et du droit, 1993.
10 () Le dialogue social est défini par l’Organisation internationale du travail (OIT) comme incluant « tout type de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun ».
11 () Audition du 3 décembre 2015.
12 () Audition du 24 mars 2016.
13 () Audition du 28 avril 2016.
14 () Audition du 24 mai 2016.
15 () Audition du 27 avril 2016.
16 () Audition du 24 mars 2016.
17 () ASTREES se définit comme un « think tank, laboratoire et opérateur d’expérimentations concrètes », qui est basé à Paris ; ses travaux avaient été recommandés à la mission par les représentants de l’association Réalités du dialogue social.
18 () À l’exception de la Slovénie.
19 () On pourrait les rapprocher des CARSAT si elles n’étaient pas réparties par branche plutôt que par région. Elles sont financées exclusivement par les cotisations des employeurs.
20 () Ceci n’est pas une spécificité suédoise : on retrouve ce genre de construction en « piliers » dans les autres pays nordiques et aux Pays-Bas.
21 () Le système d’assurance-chômage est assez complexe au plan institutionnel : il repose sur 28 caisses gérées par des administrateurs élus mais qui se révèlent être souvent des membres des syndicats du secteur concerné. Il semble que l’affiliation au syndicat confère certains avantages au bénéficiaire et que cette adhésion soit souvent concomitante. Les caisses assurent le versement de la prestation de base financée par l’État et d’une prestation contributive. Une caisse d’État a été créée pour les travailleurs qui ne souhaitaient pas adhérer à une caisse proche des syndicats (travailleurs indépendants notamment) mais elle ne verse que l’allocation de base. Ces caisses sont financées très largement par l’État.
22 () Le rapporteur a pu constater l’efficacité du système informatique qui gère les droits à l’assurance retraite, mis en œuvre par une agence d’État, l’Office suédois des pensions : il permet de calculer le montant total de sa retraite, complémentaire comprise, selon plusieurs hypothèses. Le droit à l’information est également assuré par un relevé annuel orange adressé dès leurs 26 ans à tous les Suédois.
23 () Michel Dreyfus, Liberté, égalité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme. 1852-1967, Paris, éd. de l’Atelier, 2001, p. 34. Transformée en caisse nationale des retraites pour la vieillesse par la loi du 20 juillet 1886, elle n’a, en 1890, que 800 000 déposants sur 10 millions de salariés, en dépit d’une baisse des minima de versement.
24 () Henri Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale. 1850-1940, Presses universitaires de Nancy, 1971, 1989, 2004.
25 () Michel Dreyfus, op. cit., p. 98.
26 () Gilles Pollet et Didier Renard, « Genèses et usages de l’idée paritaire dans le système de protection sociale français. Fin 19e – milieu du 20e siècle », Revue Française de Science Politique, 45e année, n° 4, 1995, p. 550-551. Accessible sur http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1995_num_45_4_403558.
27 () Projet de loi sur les assurances sociales, n° 2369 de la douzième législature, renvoyé à la commission d’assurance et de prévoyance sociale, annexé au procès-verbal de la 2e séance du 22 mars 1921, pp. 12 et 13.
28 () Id., p. 15.
29 () Id., p. 46.
30 () Hatzfeld, op. cit., p. 168.
31 () Rapport n° 3187 présenté au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociale sous le n° 3187 en 1930, page 541.
32 () Ce texte est aussi connu sous le nom de Manifeste des douze.
33 () Le texte du rapport a été publié par la revue Prévenir, en mars 1982 (p. 121). Il est accessible sur http://www.e.ternel.com/spip.php?article3400
34 () Henri Hatzfeld, op. cit., p. 161.
35 () Cette association réunit des personnes morales – entreprises publiques ou privées – adhérant à l’ensemble des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national, auxquelles s’ajoutent la FSU et l’UNSA pour le secteur public, ainsi que Sud-Solidaires, qui participe à ses activités lorsqu’elles concernent ce dernier secteur.
36 () Ce dénombrement a été exposé par M. Jean François Herlem, rédacteur du DIEM, lors de l’audition du 8 octobre 2015.
37 () M. Yves Struillou, directeur général du travail (audition du 7 avril 2016).
38 () Pour autant, les conseils de sécurité sociale font partie du champ de l’ANI du 17 février 2012 sur la modernisation du paritarisme mais, comme l’a indiqué M. Jean-Louis Deroussen, président de la CNAF, « Nous ne nous sommes pas sentis totalement concernés par les recommandations de l’ANI 2012, car beaucoup d’entre elles étaient déjà appliquées par notre conseil d’administration. » (audition du 6 avril 2016).
39 () Les critiques très vives des représentants de la mutualité ont perdu beaucoup de crédit dans l’immédiat après-guerre en raison du passif vichyste de la Fédération nationale de la mutualité française qui avait pu tenir deux assemblées générales pendant la guerre et avait adhéré à la Charte du Travail.
40 () Le rapport Beveridge au Royaume-Uni privilégie en revanche la gestion par l’État.
41 () Rédigé par les auteurs du plan français de sécurité sociale dont beaucoup avaient été sensibilisés à ces questions au Conseil national économique.
42 () Pierre Laroque, « De l’assurance à la Sécurité sociale, l’expérience française », Revue internationale de droit du travail, 1948.
43 () Il s’agit en revanche d’un véritable recul pour le patronat, affaibli par sa position sous le régime de Vichy, qui ne cessera de réclamer le paritarisme strict jusqu’à l’obtenir en 1967 et l’appliquera dans des régimes conventionnels (AGIRC en 1947, Unédic en 1958, ARRCO en 1961).
44 () Représentés à la commission du Travail et des Affaires sociales de l’Assemblée constituante par des personnalités comme M. André Croizat pour le Parti communiste, M. Georges Buisson pour la SFIO et M. Robert Prigent pour le MRP, qui avaient tous milité avant-guerre pour les assurances sociales.
45 () C’est ainsi que le gouvernement Pinay tombe en 1952 sur la question de l’étatisation du recouvrement.
46 () Il n’y a de paritarisme syndical que dans les comités techniques de branche adjoints aux caisses régionales pour la gestion des risques d’accident du travail et de la maladie professionnelle.
47 () Le bureau de la FNOSS, élu par les caisses, comprend alors 9 membres dont 7 appartiennent à la CGT.
48 () Bruno Pallier, Gouverner la sécurité sociale, PUF, 2005.
49 () Bruno Valat, Histoire de la Sécurité sociale, Economica, 2001.
50 () Trois administrateurs pour la CGT, deux administrateurs pour FO et la CFDT, un administrateur pour la CFTC et la CGC dans le collège des salariés. Neuf administrateurs pour le collège des employeurs.
51 () Audition du 6 avril 2016.
52 () M. Bruno Valat, dans l’ouvrage précité, remarque que la campagne en faveur du paritarisme démarre en 1961, au moment de la mise en place d’un régime paritaire de retraites complémentaires pour les salariés non-cadres (l’ARRCO).
53 () Ce qui aboutit à exclure de la compétition électorale les listes mutualistes et celles des associations familiales, qui représentaient de 10 à 15 % des voix dans les années 1950.
54 () CFDT : 18,38 % ; CFTC : 12,29 % ; CGC : 15,9 % ; CGT : 28,17 %.
55 () L’Union des caisses nationales de sécurité sociale est issue de la fusion entre la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale (FNOSS) et l’Union nationale des caisses d’allocations familiales (UNCAF) prévue par la loi n°68-698 du 31 juillet 1968. Elle comprenait au départ un nombre égal de représentants de chacune des trois caisses de sécurité sociale. C’est la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 a prévu une structure paritaire.
56 () L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a été créée par les ordonnances Jeanneney du 21 août 1967 pour assurer la gestion de la trésorerie de l’ensemble du régime général. Elle dirige le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) créées par le décret du 12 mai 1960.
57 () Audition du 28 janvier 2016.
58 () Audition du 11 février 2016.
59 () Audition du 12 mai 2016.
60 () Dans la branche maladie, ce conseil comprend des professionnels de santé.
61 () Audition du 6 avril 2016.
62 () Article D.231-1 du code de la sécurité sociale.
63 () Décret n° 2001-889 du 28 septembre 2001, codifié à l’article D.231-3 du code de la sécurité sociale.
64 () L’Union nationale des associations familiales bénéficie d’une mission légale de représentation codifiée à l’article L.211-1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie son monopole.
65 () La Fédération nationale de la Mutualité française bénéficie d’un monopole de représentation.
66 () Audition du 6 avril 2016.
67 () Audition du 17 décembre 2015.
68 () C’est ce décret qui a créé le Centre national d’études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS), devenu en 2004 École nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S).
69 () Audition du 17 décembre 2015.
70 () Audition du 12 mai 2016.
71 () Audition du 6 avril 2016.
72 () Audition du 6 avril 2016.
73 () Ibid.
74 () Audition du 22 octobre 2015.
75 () Idem.
76 () Dans sa décision n° 77-79 DC du 5 juillet 1977, le Conseil constitutionnel a consacré le rôle de la négociation collective sur le fondement du 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le juge constitutionnel reconnaît en effet au législateur la faculté, « après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités d’application concrètes des normes qu’il édicte » (décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004). Par ailleurs, la liberté contractuelle, qui a valeur de principe constitutionnel, concerne les accords collectifs du travail (décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008).
Quant à la Cour de cassation, sa chambre sociale a reconnu la spécificité de l’accord collectif par rapport à l’acte unilatéral de l’employeur en conférant aux accords collectifs une présomption de légalité au regard du principe d’égalité (Cass. soc., 27 janvier 2015, pourvoi n° 13-22.179).
77 () Audition du 18 novembre 2015.
78 () Audition du 8 octobre 2015.
79 () 36 500 en 2014.
80 () L’article L. 2242-5 du code du travail dispose que « la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : 1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. […] ; 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ».
81 () Audition du 8 octobre 2015.
82 () Audition du 8 octobre 2015.
83 () Le comité d’entreprise connaît de ces questions à de multiples occasions, notamment au sujet de la réinsertion des accidentés du travail et des handicapés, tandis que les délégués du personnel ont mission de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles et collectives concernant, entre autres, la santé et la sécurité au travail.
84 () Dans les entreprises qui occupent au moins 100 salariés et qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés chacun, un délégué syndical central peut être désigné. Et dans les entreprises qui occupent plus de 500 salariés, les syndicats qui ont obtenu aux élections du comité d’entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire.
85 () Audition du 22 octobre 2015.
86 () Conseil constitutionnel, décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013, considérant n° 5.
87 () Seuls sont susceptibles d’être élus ou désignés les salariés de la société mère ou de l’une de ses filiales, directes ou indirectes, ayant une ancienneté d’au moins deux ans au jour de la nomination – le titulaire et le suppléant devant être de sexe différent.
Par ailleurs, afin d’améliorer leur capacité à exercer leurs prérogatives, les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance élus par les salariés bénéficient d’un stage de formation économique, financière et juridique d’une durée maximale de cinq jours.
88 () Audition du 23 mars 2016.
89 () Article L. 225-27-1, II, du code de commerce.
90 () Audition du 23 mars 2016.
91 () Audition du 3 décembre 2015.
92 () Ibid.
93 () Ibid.
94 () Audition du 24 mars 2016.
95 () Ibid.
96 () Ibid.
97 () Audition du 23 mars 2016.
98 () Audition du 24 mars 2016.
99 () Audition du 10 décembre 2015.
100 () Audition du 8 octobre 2015.
101 () Mme Françoise Bouygard, audition du 3 décembre 2015.
102 () Ibid.
103 () Audition du 8 octobre 2015.
104 () Audition du 23 mars 2016.
105 () Audition du 22 octobre 2015.
106 () Audition du 22 octobre 2015.
107 () Audition du 11 mai 2016.
108 () M. Yves Struillou, directeur général du travail, audition du 7 avril 2016.
109 () Audition du 28 avril 2016.
110 () M. Jean-Dominique Simonpoli, directeur général de l’association Dialogues (audition du 17 décembre 2015).
111 () Audition du 11 février 2016.
112 () Idem.
113 () M. Didier Caroff, président de la commission mixte paritaire de la branche des transports routiers (audition du 11 février 2016).
114 () Audition du 11 février 2016.
115 () En 2014, trois branches étaient « entrées » en commission mixte paritaire (commerces de quincaillerie et de fourniture industrielle, industries céramiques, géomètres experts) et six en étaient « sorties » (commerce de gros, habillement, mercerie ; mareyage ; industries de la cimenterie ; transformation de la volaille ; agences de voyages ; organismes de formation).
116 () Audition du 11 février 2016.
Le rapport sur La négociation collective, le travail et l’emploi que M. Jean-Denis Combrexelle a remis au Premier ministre en septembre 2015 indique par ailleurs que « dans le cadre de la restructuration des branches du spectacle menée par la DGT depuis 2006, plus de 500 séances ont été nécessaires » (p. 26).
117 () Audition du 10 décembre 2015.
118 () La négociation collective, le travail et l’emploi, rapport remis au Premier ministre par M. Jean-Denis Combrexelle, septembre 2015, p. 25.
119 () L’État assure en effet le contrôle de la légalité des accords de branche par le biais des arrêtés d’extension pris par le ministre du Travail après avis de la Commission nationale de la négociation collective composée des partenaires sociaux représentatifs. Son contrôle n’est pas exclusivement juridique et intègre des considérations d’opportunité sur l’intérêt que présente l’accord pour la branche concernée.
120 () On retrouve ce principe en filigrane à l’article 57 du projet de chapitre préliminaire au code du travail élaboré par le comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail. Cet article 57 prévoirait en effet que « les clauses d’une convention ou d’un accord collectif s’appliquent aux contrats de travail » et que « les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi n’en dispose pas autrement ».
121 () Audition du 22 octobre 2015.
122 () Les accords d’entreprise font l’objet d’un dépôt dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), mais cette procédure n’autorise pas les services à opérer un contrôle de la légalité de l’accord, à l’instar de ce que fait l’État en matière d’extension des accords de branche. En cas de contentieux, seul le juge judiciaire contrôle la validité des accords d’entreprise.
123 () La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a réformé les règles de la représentativité syndicale – condition nécessaire pour que les parties prenantes soient plus légitimes pour négocier – tandis que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a modifié celles de la représentativité patronale.
124 () Audition du 22 octobre 2015.
125 () Ce rapport est consultable au lien suivant :
126 () Rapport précité, p. 29.
127 () Ibid.
128 () Rapport n° 3675 fait, au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, M. Christophe Sirugue, député, p. 190.
129 () Audition du 18 novembre 2015.
130 () M. Éric Aubry, membre du groupe de travail de l’Institut Montaigne sur le dialogue social, audition du 11 février 2016.
131 () Audition du 11 février 2016.
132 () Audition du 23 mars 2016.
133 () Audition du 23 mars 2016. Quant à « l’idée de valider par référendum des accords d’entreprise signés par des syndicats représentant au moins 30 % des salariés », M. Pierre Ferracci a estimé que cet outil pouvait « être utilisé par les dirigeants d’entreprise pour contourner les syndicats lorsque le rapport de forces est déséquilibré ».
134 () Audition du 24 mars 2016.
135 () Rapport précité, p. 44.
136 () Rapport précité, pp. 19-20.
137 () Audition du 10 décembre 2015.
138 () Audition du 28 janvier 2016.
139 () Audition du 28 avril 2016.
140 () Audition du 3 décembre 2015.
141 () Audition du 3 décembre 2015.
142 () Audition du 24 mars 2016.
143 () Audition du 18 novembre 2015.
144 () M. Pierre Ferracci a estimé que « la négociation du plan de formation dans l’entreprise aurait été un signal fort » lors de son audition du 23 mars 2016.
145 () Audition du 17 décembre 2015.
146 () Audition du 18 novembre 2015.
147 () Audition du 11 février 2016.
148 () Audition du 22 octobre 2015.
149 () Audition du 14 janvier 2016.
150 () Audition du 11 février 2016.
151 () La CGT, auréolée de sa participation très importante aux réseaux de la Résistance, comptait alors 5,5 millions d’adhérents et constituait de loin le plus grand syndicat de France.
152 () La Confédération générale des cadres a été créée le 15 octobre 1944, à côté d’associations qui promouvaient déjà le statut spécifique des cadres. Elle est devenue en 1980 la CFE-CGC.
153 () Cette loi rouvrait la possibilité de négociation, retirée pendant la Seconde guerre mondiale, la convention n’étant alors applicable qu’après agrément ministériel.
154 () Il suffit en effet que l’institution adhérente à l’AGIRC respecte la convention de 1947 pour que le ministère du Travail lui accorde un agrément.
155 () Il s’agissait de compétences techniques sur des cas individuels ou restreints comme la délivrance des pénalités de retard, la décision sur les années à valider, mais aussi d’éléments plus essentiels comme la mise en œuvre de la procédure d’extension ou le contrôle des institutions qui n’avait pas été clairement attribué dans l’accord de 1947.
156 () L’AGIRC prévoit également des clauses facultatives afin d’harmoniser les statuts des différentes institutions de retraite complémentaire.
157 () À cette époque, tous les régimes de retraite, y compris celui de la Sécurité sociale, s’équilibrent facilement et connaissent même des excédents importants. Le régime dispose dans les années 1960 de réserves représentant environ une année de cotisations.
158 () François Charpentier est journaliste, spécialiste de la question des retraites. Il a publié en 2015 un ouvrage de référence intitulé Retraites complémentaires : histoire et place des régimes Arrco et Agirc dans le système français. 75 ans de paritarisme, Economica.
159 () On estime qu’il existait à l’époque au moins 500 institutions différentes.
160 () Sont en revanche absentes les institutions les plus importantes qu’étaient à l’époque le secteur du bâtiment, l’AGRR – institution très importante sur les plans national et local, qui espérait encore absorber une bonne partie de ses concurrentes – et une fédération, la FNIRR.
161 () Qui comprend à l’époque les représentants du CNPF et les organisations syndicales représentatives.
162 () La CGT, pourtant non signataire et très critique à l’égard de l’accord, en demande l’extension aux entreprises non adhérentes au CNPF.
163 () Le système couvre 7 millions de salariés sur les 13 millions que compte la France d’alors.
164 () 1,4 million de personnes sont concernées dont 900 000 venant d’Afrique du Nord.
165 () Initialement exclus, leurs caisses connaissent d’importants problèmes d’équilibre qui les conduisent à se fondre dans le dispositif de l’AGIRC ou celui de l’ARRCO.
166 () Un protocole d’accord est signé par les partenaires sociaux le 10 mai 1967, dans un contexte où la France ne compte que 100 000 chômeurs relevant de l’Unédic.
167 () Les partenaires sociaux étaient particulièrement sensibles à ce que les nouveaux affiliés ne constituent pas une charge trop déséquilibrante pour les régimes.
168 () Les syndicats étaient alors dans une situation délicate puisque, favorables sur le fond à l’abaissement de l’âge légal de la retraite, ils en voyaient les conséquences sur l’équilibre des comptes.
169 () Prévue initialement pour 7 ans, l’ASF fera l’objet d’un âpre débat avec le gouvernement entre 1989 et 1990, celui-ci acceptant finalement de prolonger sa contribution jusqu’en 1993. Prolongée en 1993, puis en 1996 dans des conditions plus favorables, l’ASF devient l’AGFF (Agence française de gestion du fonds de financement).
170 () Les régimes complémentaires font également condamner l’Union des Assurances de Paris pour une publicité mensongère indiquant qu’il sera impossible de financer les retraites complémentaires avec le principe de la répartition.
171 () En 1982, 1986 et 1989.
172 () Le régime de retraite des chefs d’atelier et des contremaîtres des métaux en 1982, les régimes des cadres supérieurs en 1988.
173 () POINT sur la retraite des cadres pour l’AGIRC dès 1985 ; Retraite complémentaire pour l’ARRCO en 1989.
174 () Justifié par le fait qu’à cette date, l’ASF n’avait perçu que 58 % des sommes qui lui étaient dues pour financer le passage à la retraite à 60 ans.
175 () Pour les recettes : relèvement du taux d’appel des cotisations progressif et du taux minimum de cotisation
– qui doit doubler en dix ans – ; pour les charges : gel de la valeur du point, relèvement de l’âge d’obtention de la pension de réversion, diminution des majorations familiales.
176 () Diminution du rendement, des frais de gestion, des dépenses d’action sociale, accélération de la hausse des cotisations, limitation de la revalorisation des pensions.
177 () Un véritable régime unique supposait une seule valeur du point, une seule règlementation, un seul paiement et un seul interlocuteur, résultat auquel n’était pas parvenu l’ARRCO jusque-là malgré des avancées considérables en matière de gouvernance.
178 () Les experts de l’AGIRC-ARRCO constatent dès janvier 2009 que les régimes auront des problèmes d’équilibre très importants à court terme.
179 () Cour des Comptes, Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (AGIRC et ARRCO). Rapport public thématique, décembre 2014. Les magistrats financiers ont également pointé des perspectives financières difficiles avec des mesures urgentes à prendre ainsi que des progrès de gestion à effectuer. Beaucoup de ces constats ont trouvé des réponses dans l’accord du 30 octobre 2015.
180 () Audition du 3 décembre 2015.
181 () Cet accord, obtenu après des négociations difficiles qui ont démarré en janvier 2015, comprend plusieurs mesures destinées à équilibrer les comptes des deux régimes (économies de gestion et système de bonus-malus pour les départs à la retraite) et prévoit la création d’un régime unifié d’ici le 1er janvier 2019.
182 () M. Jean-Louis Malys (CFDT), audition du 3 décembre 2015.
183 () Ibid.
184 () Mme Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, audition du 3 décembre 2015.
185 () M. Jean-Louis Malys, audition du 3 décembre 2015.
186 () Audition du 3 décembre 2015.
187 () Ibid.
188 () Audition du 3 décembre 2015.
189 () Issu d’une proposition du rapport Moreau de 2013, le comité de suivi des retraites a été créé par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite. Il intervient, par un avis public s’appuyant sur un rapport, pour constater si le système des retraites s’éloigne des objectifs qu’il s’est donné au regard des hypothèses du COR. Il est dirigé par Mme Yannick Moreau, conseillère d’État, et comprend cinq membres assistés d’un jury citoyen.
190 () Audition du 3 décembre 2015.
191 () Ibid.
192 () Ibid.
193 () Ibid.
194 () Codifiée à l’article L.921-1 du code de la sécurité sociale.
195 () Audition du 7 avril 2016.
196 () Il ne s’agit pas d’un arrêté d’agrément comme pour l’Unédic car les accords de 1947 et de 1961 ne concernaient pas tous les établissements des banques et les personnels de la sécurité sociale. On parle dès lors d’extension et d’élargissement pour que le champ d’application des accords soit le même que celui de la loi. Il s’agit là d’une procédure originale en droit du travail puisqu’un tel accord devrait en principe nécessiter deux arrêtés : un pour étendre l’ANI aux employeurs non-signataires et un pour l’étendre aux professions qui n’entrent pas dans le champ de l’AGIRC-ARRCO. En matière de retraites complémentaires, les ministres n’ont à prendre qu’un seul arrêté.
197 () La COMAREP est prévue à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. Elle doit être consultée avant tout arrêt d’extension et d’élargissent d’un accord de protection sociale complémentaire. Présidée par un représentant du ministre du travail, elle est composée de manière paritaire.
198 () Audition du 17 décembre 2015.
199 () Audition du 3 décembre 2015.
200 () La mise en place du groupement d’intérêt économique, en 2002 a impliqué une fusion des services et une direction générale partagée entre les deux régimes.
201 () Audition du 17 décembre 2015.
202 () Audition du 17 décembre 2015.
203 () Ibid.
204 () Les statuts des fédérations de l’AGIRC et de l’ARRCO ont été harmonisés en 2013 en suite de l’intégration des dispositions de l’accord du 17 février 2012.
205 () Articles 32 des statuts de l’AGIRC et de l’ARRCO.
206 () Cette faculté est notamment utilisée à la commission financière.
207 () Données issues du GIE AGIRC-ARRCO.
208 () Source : Cour des Comptes, Garantir l’avenir des retraites complémentaires, décembre 2014.
209 () Lucy apRoberts, Emmanuel Reynaud, Un panorama de la protection sociale complémentaire. Rapport réalisé pour la Mission interministérielle Recherche expérimentation, Institut de recherches économiques et sociales, février 1998.
210 () https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/2015072-AS52-La-situation-des-principaux-organismes-dassurance-en-2014.pdf
211 () Audition du 23 mars 2016.
212 () Décision 2013-682 DC du 19 décembre 2013.
213 () voir : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000668.pdf
214 () Audition du 23 mars 2016.
215 () Ibid.
216 () Ibid.
217 () Audition du 23 mars 2016.
218 () Ibid.
219 () voir : http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_2015_situation_financiere_organismes_complementaires.pdf
voir aussi : http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/oc2016.pdf
220 () Audition du 22 octobre 2015.
221 () Audition du 3 décembre 2015.
222 () J.-M. Meunier, Le 1 % logement : la participation d'une institution paritaire à la production de l’action publique. Genèse, perte de légitimité et reprise en main par l’État, thèse de doctorat soutenue le 26 novembre 2013 à l’Université de Paris Est.
223 () J.-M. Meunier, « Le paritarisme du 1 % logement n’a pas fait le poids face à la logique gestionnaire », Alternatives économiques, 8 mai 2010.
224 () Ibid.
225 () Article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation.
226 () L’UESL est une société anonyme dont les associés sont :
- à titre obligatoire : chaque CIL agréé aux fins de collecter et d’utiliser les fonds de la PEEC ;
- à titre volontaire : toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d’entreprises assujetties au versement de la PEEC.
L’assemblée générale de l’UESL compte 40 associés, dont 2 organisations patronales (MEDEF, CGPME), 5 organisations syndicales de salariés (CDFT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) et les 20 CIL.
227 () J.-M. Meunier, « Le paritarisme du 1 % logement n’a pas fait le poids face à la logique gestionnaire », Alternatives économiques, 8 mai 2010.
228 () Audition du 31 mars 2016.
229 () Article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.
230 () Pour mémoire, en 2014, Action Logement dédiait :
- 1,3 milliard d’euros au financement du logement social et intermédiaire ;
- 1,2 milliard d’euros au financement de politiques publiques en matière de logement social (dont 900 millions d’euros versés à l’ANRU) ;
- 890 millions d’euros d’aides aux salariés (dont 46 % d’aides accordées aux jeunes de moins de 30 ans) ;
- 619 millions d’euros de prêts finançant des projets d’accession à la propriété ou de travaux.
231 () J.M. Meunier, « Les crises du 1 % logement », Metis Europe – correspondances européennes du travail, 29 juin 2015.
232 () En 2012, une contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) a été mise à la charge d’Action Logement, en sus de sa contribution à l’ANRU.
233 () Audition du 27 avril 2016.
234 () J.-M. Meunier, « Les crises du 1 % logement », Metis Europe – correspondances européennes du travail, 29 juin 2015.
235 () M. Bruno Arbouet, audition du 31 mars 2016.
236 () Audition du 31 mars 2016.
237 () Ibid.
238 () J.-M. Meunier, « Les crises du 1 % logement », Metis Europe – correspondances européennes du travail, 29 juin 2015.
239 () Christian Topalov, Naissance du chômeur, Albin Michel, 1994.
240 () Jean Luciani (dir.), Histoire de l’Office du travail, Syros, 1992 ; Isabelle Lespinet-Moret, L’Office du Travail, 1891-1914, PUR, 2007.
241 () Ces bureaux, substitués aux œuvres de charité de l’Église après la confiscation de ses biens et sa séparation d’avec l’État sous le Directoire, sont établis par les lois des 7 frimaire et 16 vendémiaire an V, modifiées par celles des 28 pluviôse an VIII, 4 ventôse et 9 fructidor an XI, 12 juillet 1807, par des ordonnances du 2 juillet 1816, du 31 octobre 1821, du 24 décembre 1826, du 6 juin 1830, du 31 mai 1838, un décret du 25 mars 1852, la loi du 24 juillet 1867 puis par la jurisprudence tirée de la loi du 5 avril 1884 qui abroge celle de 1867 et par la loi du 15 juillet 1893.
242 () Audition du 10 décembre 2015.
243 () Marion Rabier, « Revue de littérature : Organisations patronales en France et en Europe », in Documents d’études de la DARES, n° 130, décembre 2007, pp 36ss.
244 () Audition du 22 octobre 2015.
245 () Audition du 22 octobre 2015.
246 () Audition du 22 octobre 2015.
247 () Audition du 10 décembre 2015.
248 () Ibid.
249 () Audition du 3 décembre 2015.
250 () Audition du 27 avril 2016.
251 () Audition du 11 mai 2016.
252 () Audition du 4 février 2016.
253 () Audition du 27 avril 2016.
254 () Audition du 10 décembre 2015.
255 () Ibid.
256 () Audition du 10 décembre 2015.
257 () Ibid.
258 () Audition du 22 octobre 2015.
259 () Audition du 10 décembre 2015.
260 () Audition du 22 octobre 2015.
261 () Audition du 10 décembre 2015.
262 () Audition du 10 décembre 2015.
263 () Audition du 7 avril 2016.
264 () Audition du 31 mars 2016.
265 () Audition du 28 avril 2016.
266 () Audition du 10 décembre 2015.
267 () Audition du 31 mars 2016.
268 () Audition du 23 mars 2016.
269 () Audition du 31 mars 2016.
270 () Audition du 22 octobre 2015.
271 () Audition du 27 avril 2016.
272 () Audition du 17 décembre 2015.
273 () Audition du 11 février 2016.
274 () Il faut toutefois souligner que, comme l’a rappelé M. Hervé Lanouzière, « 90 % des normes applicables dans le domaine sont d’origine européenne », et notamment issues de la directive-cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui a été transposée par la loi n° 91-1414 du 7 janvier 1992. Cette loi a modifié en conséquence les codes du travail et de la santé publique pour favoriser la prévention des risques professionnels et imposé que soit définie une politique de prévention propre à chaque établissement. Comme l’a rappelé le directeur général du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), M. Martial Brun, lors de son audition, le 23 mars 2016, cette directive-cadre « rappelle le principe de la responsabilité individuelle de chaque employeur : la signature d’un contrat de travail l’oblige à agir en faveur de la sécurité et de la santé de son salarié » et cette « obligation née de la directive de 1989 a été considérablement renforcée par la jurisprudence française, celle-ci ayant notamment dégagé un principe d’obligation de résultat qui s’applique à chaque employeur ».
275 () Audition du 24 mars 2016.
276 () Audition du 24 mars 2016.
277 () M. Franck Gambelli, membre de la commission AT/MP, audition du 6 avril 2016.
278 () Audition du 6 avril 2016.
279 () Audition du 28 janvier 2016.
280 () Audition du 24 mars 2016.
281 () Audition du 22 octobre 2015.
282 () Audition du 28 janvier 2016.
283 () L’article 39 prévoirait notamment que « l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail » et l’article 43 ajouterait que « tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie de garanties spécifiques ».
284 () Article L. 4622-3 du code du travail.
285 () Audition du 23 mars 2016.
286 () Article L. 4622-12 du code du travail.
287 () Article L. 4622-13 du code du travail.
288 () Audition du 23 mars 2016.
289 () Audition du 23 mars 2016.
290 () Idem.
291 () Audition du 17 décembre 2015.
292 () Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, M. Henri Collard, sénateur, 27 mai 1987.
293 () Ibid.
294 () Audition du 31 mars 2016.
295 () Le réseau des Cap Emploi est co-financé par Pôle Emploi.
296 () Audition du 31 mars 2016.
297 () Ibid.
298 () Par exemple : Paul Delsalle, La brouette et la navette, 1985, qui brosse l’histoire des prud’hommes à Roubaix et Tourcoing au début du XIXe siècle.
299 () Marcel David, « L’évolution historique des conseils de prud’hommes en France », Droit social, février 1974.
300 () Il semble que le terme « prud’hommes » ait été choisi en raison de son origine médiévale qui laissait penser que l’Empereur avait octroyé aux négociants de la soie ce qu’ils voulaient, alors qu’il créait en réalité un système nouveau.
301 () La régulation par le conseil lyonnais n’empêche pas les révoltes des Canuts, les ouvriers de la soierie, en 1831-1834.
302 () Alain Cottereau, « Cent quatre-vingts années d’activité prud’homale », Le Mouvement social, n° 141, octobre-décembre 1987.
303 () Gérard Lyon-Caen, « À propos de la réorganisation des juridictions sociales », Recueil Dalloz, 1969.
304 () On estime qu’avant 1979, 100 % des conseils avaient une section industrie, 75 % une section commerce et 18 % une section agriculture.
305 () Moins de 3 % des affaires examinées par les conseils à l’époque. Certaines juridictions n’ont aucun contentieux agricole.
306 () L’échevinage est un système d’organisation judiciaire qui associe des juges professionnels et non-professionnels, alors que le paritarisme exclut la présence d’un juge professionnel. Dans les pays qui ne pratiquent pas l’échevinage, c’est un juge professionnel, le plus souvent spécialisé, qui traite l’affaire.
307 () Cass. Soc. 16 mai 2013, n°11-23-246.
308 () Audition du 3 mars 2016.
309 () En matière de congé parental par exemple.
310 () Jean-Pierre Bonaffé-Schmitt, « Les prud’hommes : du conseil de discipline à la juridiction de droit commun du travail », Le mouvement social, 1987, p. 133.
311 () Audition du 3 mars 2016.
312 () Il reprend ainsi une idée formulée par Pierre Laroque dès 1954, selon laquelle le droit social aurait une unité qui impliquerait la création d’un ordre juridictionnel spécifique.
313 () Audition du 3 mars 2016.
314 () Alors qu’il est de 12,5 % dans les tribunaux de grande instance, 5,3 % dans les tribunaux d’instance et 14,4 % dans les tribunaux de commerce.
315 () Audition du 3 mars 2016.
316 () Déclaration de 1982 devant la presse.
317 () Audition du 3 mars 2016.
318 () Audition du 3 décembre 2015.
319 () Audition du 3 décembre 2015.
320 () Audition du 14 janvier 2016.
321 () Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2016, p. 22.
322 () Ibidem, p. 24.
323 () Ibidem, p. 26.
324 () Ibidem, p. 27.
325 () Ibidem, p. 30.
326 () Les ressources que le FPSPP est habilité par les articles L. 6332-18 et suivants du code du travail à recevoir sont :
- un pourcentage de la contribution obligatoire de 1 % de la masse salariale que les employeurs d’au moins 11 salariés doivent verser à l’OPCA désigné par l’accord de branche dont ils relèvent ou, à défaut, à l’OPCA au niveau interprofessionnel ;
- les sommes issues de la collecte de cette contribution et de celle de la contribution obligatoire de 0,55 % de la masse salariale que les employeurs de moins de 11 salariés doivent verser à l’OPCA désigné par l’accord de branche dont ils relèvent ou, à défaut, à l’OPCA au niveau interprofessionnel, en tant qu’elles excèdent : pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation (CPF), un quart des charges comptabilisées par les OPCA au cours du dernier exercice clos, et, pour les autres sommes, un tiers de ces charges.
Outre ces ressources prévues par la loi, qui constituent l’essentiel de son financement (avec, en 2014, 1,4 million d’entreprises versantes employant 17 millions de salariés), le FPSPP reçoit et gère des sommes d’origine conventionnelle ou contractuelle, notamment une partie des fonds européens destinés à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.
327 () Audition du 14 janvier 2016.
328 () Audition du 3 mars 2016.
329 () M. Philippe Couteux, responsable du service « Emploi et sécurisation des parcours professionnels » à la CFDT, audition du 11 mai 2016.
330 () Rapport d’information n° 3558 sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, députés, mars 2016, p. 58.
331 () Audition du 22 octobre 2015.
332 () Audition du 24 mars 2016. M. Hugues de Balathier-Lantage a ajouté qu’au-delà des outils législatifs et réglementaires, « l’État recourt de plus en plus aux outils contractuels, tels que la convention-cadre qui le lie au FPSPP, les conventions d’objectifs et de moyens (COM) conclues avec les OPCA ou l’implication [des] services déconcentrés dans la discussion avec les conseils régionaux sur les contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP). Enfin, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, […] l’État joue un rôle croissant dans la régulation du marché de la formation ».
333 () D’après le « jaune » consacré à la formation professionnelle joint au projet de loi de finances pour 2016, « les OPCA ont comptabilisé, en 2014, une collecte globale de près de 6 992 millions d’euros » (p. 53).
334 () Au sujet de ces deux OPCA interprofessionnels M. Pierre Burban, secrétaire national de l’UPA, a estimé, , que « s’il n’y en avait plus qu’un, le système serait sans doute plus efficace » (audition du 11 mai 2016).
335 () Les sommes engagées dans des actions de formation, parfois pluriannuelles, dépassent aujourd’hui 550 millions d’euros, d’après M. Robert Baron, trésorier-adjoint d’Uniformation.
336 () Les organisations patronales présentes au conseil d’administration d’Uniformation sont en effet :
- l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS) ;
- l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES – anciennement USGERES) ;
- l’Union sociale pour l’habitat (USH).
337 () Audition du 3 mars 2016.
338 () Audition du 24 mars 2016.
339 () Audition du 24 mars 2016.
340 () Voir : http://www.fongecif-idf.fr/fileadmin/user_upload/docs_enligne/ra/2014/ra-fongecif/index.php
341 () Voir le site dédié au compte personnel de formation : http://www.cpformation.com/fongecif/
342 () Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances pour 2016, p. 53.
343 () Audition du 24 mars 2016.
344 () Audition du 23 mars 2016.
345 () Audition du 22 octobre 2015.
346 () Audition du 22 octobre 2015.
347 () Audition du 11 février 2016.
348 () Audition du 28 avril 2016.
349 () Rapport précité, p. 51. M. Jean-Denis Combrexelle fait de ce changement de paradigme l’un des quatre facteurs d’affaiblissement de la négociation collective avec :
- le défaut de négociateurs, compte tenu de la faible attractivité de l’activité syndicale pour les jeunes ;
- la complexité des sujets de négociation, qui impliquerait une formation des négociateurs, voire leur « professionnalisation » ;
- l’absence de confiance entre partenaires sociaux.
350 () Audition du 28 janvier 2016.
351 () Comme l’a fait remarquer M. Éric Aubin lors de son audition le 10 décembre 2015, « lorsqu’un gouvernement antérieur a décidé de porter l’âge légal de la retraite de soixante à soixante-deux ans, cela a eu des répercussions sur l’assurance chômage puisque les employeurs se séparent de leurs seniors et que 56 % des salariés ne sont plus en activité au moment où ils font valoir leur droit à la retraite. Ce phénomène n’est jamais abordé dans le cadre de la convention sur l’assurance chômage ».
352 () Audition du 3 décembre 2015.
353 () Audition du 11 février 2016.
354 () M. Jean-Denis Combrexelle, audition du 18 novembre 2015.
355 () Audition du 3 décembre 2015.
356 () Audition du 24 mai 2016.
357 () Audition du 7 avril 2016.
358 () Contribution écrite fournie à la mission par la CFTC.
359 () Contribution écrite fournie à la mission par la CFTC.
360 () La négociation collective, le travail et l’emploi », rapport remis au Premier ministre par M. Jean-Denis Combrexelle, septembre 2015, p. 58.
361 () Il est rappelé que la loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social a rendu obligatoire une phase de concertation avec les partenaires sociaux avant tout projet gouvernemental de réforme dans les domaines des relations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle (article L. 1 du code du travail).
Ce principe a été repris par le comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail et présidé par M. Robert Badinter, qui propose d’inscrire, dans le chapitre préliminaire qu’il suggère d’insérer dans le code du travail, un article 51 prévoyant que « tout projet de réforme de la législation du travail envisagé par le Gouvernement qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation ».
Pour sa part, le groupe de travail sur « La négociation collective, le travail et l’emploi », présidé par M. Jean-Denis Combrexelle, avait préconisé d’inscrire dans le préambule de la Constitution de 1946 les grands principes énoncés par les articles L. 1 à L. 3 du code du travail (proposition n° 29).
362 () Audition de Mme Marie-Françoise Leflon, 28 avril 2016. Lors de son audition, le 11 mai dernier, le président du CESE, M. Patrick Bernasconi, ne s’est pas opposé à ce qu’une telle commission se réunisse dans les locaux du CESE.
363 () Les modalités de fonctionnement de ce jury citoyen sont précisées aux articles D. 114-4-0-7 à D. 114-4-0-14 du code de la sécurité sociale.
364 () Dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre en septembre 2015, M. Jean-Denis Combrexelle a d’ailleurs préconisé la « mise en place de formations communes syndicats/entreprises sur la négociation, à l’instar de ce qui se fait au Québec, où la négociation collective est enseignée comme une technique et une méthode, chacun restant ensuite libre de ses options syndicales » (proposition n° 12).
365 () Audition du 17 décembre 2015.
366 () Audition du 24 mars 2016.
367 () Audition du 24 mars 2016.
368 () M. Laurent Duclos, docteur en sociologie, adjoint au chef du département de la synthèse de DGEFP (audition du 7 avril 2016).
369 () Audition du 24 mars 2016.
370 () Ibid.
371 () Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-et-avis/rapports/cnefop-premier-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-du-compte-personnel-de.html
372 () Dont « une très forte majorité de demandeurs d’emploi », d’après M. Hugues de Balathier-Lantage, chef de service, adjoint à la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle (audition du 24 mars 2016).
373 () Rapport n° 3675 fait, au nom de la commission des Affaires sociales, sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, M. Christophe Sirugue, député, p. 508.
374 () Audition du 24 mars 2016.
375 () Audition du 11 mai 2016.
376 () Audition du 23 mars 2016.
377 () Ibid.
378 () Audition du 17 décembre 2015.
379 () Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.
380 () Audition du 3 mars 2016.
381 () Rapport n° 3558 fait, au nom de la commission des Affaires sociales, sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, par MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, députés, p. 33.
D’après le directeur général du FONGECIF Île-de-France, M. Laurent Nahon, les deux tiers des quelque 300 000 CPF activés dans la région francilienne l’ont été par des demandeurs d’emploi (audition du 24 mars 2016). Selon lui, seuls 300 CPF activés dans la région en 2015 ne correspondaient pas à des dispositifs de formation antérieurs du FONGECIF. D’après lui, ce chiffre est relativement faible parce que « la montée en puissance du CPF, l’établissement des listes de formation éligibles, le système d’information piloté par la Caisse des dépôts, l’information des salariés ainsi que la mise en œuvre par les OPCA ont pris du temps » (audition du 24 mars 2016).
382 () Ce rapport est consultable au lien suivant :
383 () Rapport n° 3675 fait, au nom de la commission des Affaires sociales, sur le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, par M. Christophe Sirugue, député, p. 511.
384 () A. Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, 1999. Adde : A. Supiot, Au-delà de l’emploi, les voies d’une vraie réforme du droit du travail, 2016.
385 () Audition du 18 février 2016.
386 () Audition du 10 décembre 2015.
387 () Audition du 10 décembre 2015.
388 () Audition du 27 avril 2016.
389 () Audition du 10 décembre 2015.
390 () Audition du 4 février 2016.
391 () Audition du 3 mars 2016.
392 () Audition du 23 mars 2016.
393 () Ibid.
394 () Audition du 18 novembre 2015.
395 () Audition du 4 février 2016.
396 () Audition du 10 décembre 2015.
397 () Audition du 4 février 2016.
398 () Ce rapport est consultable au lien suivant : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf
399 () Audition du 14 janvier 2016.
400 () Audition du 4 février 2016.
401 () Audition du 17 décembre 2015.
402 () Audition du 24 mars 2016.
403 () Audition du 10 décembre 2015.
404 () Audition du 17 décembre 2015.
405 () Audition du 11 février 2016.
406 () Rapport d’information n° 3558 sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, présenté par MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, députés, p. 58.
407 () Audition du 10 décembre 2015.
408 () Audition du 17 décembre 2015.
409 () M. Jean-François Pilliard, vice-président de l’Unédic (audition du 10 décembre 2015).
410 () Audition du 8 octobre 2015.
411 () Audition du 3 décembre 2015.
412 () Audition du 11 février 2016.
413 () Audition du 3 décembre 2015.
414 () Audition du 10 décembre 2015.
415 () Audition du 14 janvier 2016.
416 () Audition du 14 janvier 2016.
417 () M. Gérard Adam (audition du 11 février 2016).
418 () Audition du 27 avril 2016.
419 () Audition du 24 mai 2016.
420 () Audition du 10 décembre 2015.
421 () Audition du 22 octobre 2015.
422 () Audition du 22 octobre 2015.
423 () Audition du 17 décembre 2015.
424 () Audition du 8 octobre 2015.
425 () Audition du 10 décembre 2015.
426 () Audition du 3 décembre 2015.
427 () Audition du 11 février 2016.
428 () Audition du 3 décembre 2015.
429 () Audition du 3 décembre 2015.
430 () Audition du 3 décembre 2015.
431 () Audition du 7 avril 2016.
432 () M. Pierre Roger, délégué national de la CFE-CGC pour le secteur protection sociale (audition du 3 décembre 2015).
433 () Audition du 28 janvier 2016.
434 () Audition du 28 avril 2016.
435 () Audition du 24 mars 2016.
436 () Audition du 24 mars 2016.
437 () Audition du 11 février 2016.
438 () Audition du 4 février 2016.
439 () La mouvance du libre repose sur l’idée d’un accès libre, gratuit et ouvert à des logiciels et à des produits. L’économie de la fonctionnalité vise à une optimisation de l’usage des objets plutôt qu’à valoriser la propriété en tant que telle. L’économie du don s’oppose à l’idée que tous les individus prennent des décisions sur une base utilitariste et valorise la reconnaissance sociale que procure l’échange. Voir Damien Massé, Simon Borel et Damien Demailly, « Comprendre l’économie collaborative et des promesses à travers ses fondements théoriques », Working Paper, IDDRI-Sciences Po, Nouvelle prospérité, juillet 2015.
440 () Pôle Interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques, Enjeux et perspectives de la consommation collaborative, juin 2015.
441 () M. Bruno Teboul est directeur scientifique du groupe Keyrus et membre de la gouvernance de la chaire Data Scientist de l’École Polytechnique. Il est l’auteur, en collaboration avec M. Thierry Picard, ingénieur et entrepreneur, de Ubérisation = économie déchirée ? (juin 2015), ouvrage qui tente de cerner le sens et les contours de l’évolution de l’économie sous l’effet du numérique.
442 () Audition du 14 janvier 2016.
443 () Ainsi aux États-Unis, Amazon a créé une plateforme dénommée « Amazon Mechanical Turk » qui permet de recruter les services de travailleurs pour assurer des tâches difficiles ou répétitives comme la traduction.
444 () Audition du 4 février 2016.
445 () Cass. Soc. 13 novembre 1996.
446 () Laurent Gamet, « UberPop (+) », Droit Social, p. 929, 2015. M. Laurent Gamet est directeur de l’Institut d’Études Judiciaires et du master de droit social de l’université Paris XIII-Sorbonne, et avocat associé au cabinet Flichy Grangé.
447 () Audition du 4 février 2016.
448 () L’administration peut en effet engager d’elle-même les démarches tendant à la requalification, indépendamment de toute demande du travailleur concerné.
449 () Audition du 18 février 2016.
450 () Les URSSAF jouent un rôle essentiel dans la requalification des autoentrepreneurs depuis 2009.
451 () Audition du 18 février 2016.
452 () Il n’est pas possible d’isoler les données relatives aux travailleurs du numérique ; la comparaison ne peut donc porter que sur des bases communes comme le taux d’emploi non salarié.
453 () La conception du salariat étant différente, certains freelances sont considérés comme des salariés, ce qui rend la comparaison difficile. Ainsi, pour l’OCDE, il n’y a que 6,6 % de travail non salarié aux États-Unis mais l’institut Roosevelt indique que 34 % de la force de travail, soit 53 millions de personnes, repose sur le travail indépendant.
454 () Ibid.
455 () France Stratégie, Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs, mars 2016.
456 () Il revient aux services des URSSAF et de l’inspection du travail de contrôler le respect de ces plafonds.
457 () Audition du 4 février 2016.
458 () Audition du 10 décembre 2015.
459 () Audition du 4 février 2016.
460 () Audition du 4 février 2016.
461 () Audition du 4 février 2016.
462 () Audition du 4 février 2016.
463 () Vizeat est une plateforme française permettant de partager des repas chez l’habitant, fondée en 2014.
464 () Audition du 18 février 2016.
465 () Audition du 10 décembre 2016.
466 () Audition du 4 février 2016.
467 () Il existait auparavant des associations comme Capa VTC ou VTC de France, ou des syndicats plus anciens comme la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT), qui représentent l’ensemble des TPE/PME dans le transport routiers de voyageurs.
468 () Audition du 4 février 2016.
469 () Audition du 4 février 2016.
470 () Audition du 4 février 2016.
471 () Le premier syndicat de chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) s’est affilié à cette centrale syndicale.
© Assemblée nationale