

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE, AMÉLIORER NOTRE COMPÉTITIVITÉ GRÂCE À LA RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE
Compte rendu de l’audition publique du 3 juillet 2014
et de la présentation des conclusions du 28 janvier 2015
par
M. Jean-Yves LE DÉAUT et Mme Anne-Yvonne LE DAIN, députés, et M. Bruno SIDO, sénateur
par M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président de l'Office |
par M. Bruno SIDO, Premier vice-président de l’Office |
Composition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques
Président
M. Jean-Yves LE DÉAUT, député
Premier vice-président
M. Bruno SIDO, sénateur
Vice-présidents
M. Christian BATAILLE, député M. Roland COURTEAU, sénateur
Mme Anne-Yvonne LE DAIN, députée M. Christian NAMY, sénateur
M. Jean-Sébastien VIALATTE, député Mme Catherine PROCACCIA, sénatrice
|
DÉputés |
SÉnateurs |
M. Gérard BAPT M. Christian BATAILLE M. Denis BAUPIN M. Alain CLAEYS M. Claude de GANAY Mme Françoise GUÉGOT M. Patrick HETZEL M. Laurent KALINOWSKI M. Jacques LAMBLIN Mme Anne-Yvonne LE DAIN M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Alain MARTY M. Philippe NAUCHE Mme Maud OLIVIER Mme Dominique ORLIAC M. Bertrand PANCHER M. Jean-Louis TOURAINE M. Jean-Sébastien VIALATTE |
M. Patrick ABATE M. Gilbert BARBIER Mme Delphine BATAILLE M. Michel BERSON Mme Marie-Christine BLANDIN M. François COMMEINHES M. Roland COURTEAU Mme Dominique GILLOT M. Alain HOUPERT Mme Fabienne KELLER M. Jean-Pierre LELEUX M. Gérard LONGUET M. Jean-Pierre MASSERET M. Pierre MÉDEVIELLE M. Christian NAMY Mme Catherine PROCACCIA M. Daniel RAOUL M. Bruno SIDO |
SOMMAIRE
___
Pages
PREMIÈRE PARTIE : L’IMPACT DE LA RECHERCHE ENVIRON-NEMENTALE SUR LA SOCIÉTÉ 11
PROPOS INTRODUCTIFS 11
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l'OPECST 11
M. François Houllier, président de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement (AllEnvi), président directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 13
PREMIÈRE TABLE RONDE : BIEN-ÊTRE, SANTÉ, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 19
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 19
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : LE MICROBIOTE INTESTINAL 20
M. Dusko Ehrlich, directeur de recherche à l’unité de recherche de génétique microbienne de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)… 20
M. Pierre Bélichard, président-directeur général d’Enterome 21
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : BIOCONTRÔLE DES PRODUCTIONS AGRICOLES 22
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 22
M. Antoine Coutant, directeur général d’Agrauxine 22
M. Didier Andrivon, chef de département adjoint au département santé des plantes et environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 24
C. TROISIÈME ILLUSTRATION : MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 26
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 26
M. Yves Bigay, président-directeur général d’Ethera 26
Mme Thu-Hoa Tran-Thi, directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire Francis Perrin du CEA de Saclay 27
D. MISE EN PERSPECTIVE 29
M. Éric Quemeneur, directeur des programmes de recherche et des partenariats industriels du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 29
E. DÉBAT 31
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l'OPECST 31
M. Antoine Coutant, directeur général d’Agrauxine 32
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 32
Mme Frédérique Clusel, directrice générale de Lesaffre Feed Additives 32
M. Yves Bigay, président directeur général d’Ethera 33
M. François Démarcq, directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 33
M. François Houllier, président de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement (Allenvi), président directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 33
M. Dusko Ehrlich, directeur de recherche à l’unité de recherche de génétique microbienne de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 34
M. Didier Andrivon, chef de département adjoint au département santé des plantes et environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 34
M. Pierre Bélichard, président directeur général d’Enterome 34
SECONDE TABLE RONDE : CONFLITS D’USAGE, RISQUES ET VULNÉRABILITÉ 37
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : LA GESTION DE L’EAU À TRAVERS LA CARACTÉRI-SATION D’UN HYDROSYSTÈME SOUTERRAIN 37
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 37
M. Patrick Lachassagne, responsable environnement et ressources en eau de Danone Eaux France 37
M. Jean-Christophe Maréchal, responsable de l’unité Nouvelles Ressources en eau et Économie du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 38
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : GESTION DU RISQUE INONDATION, CHAÎNE D’INFORMATION SUR CRUES ÉCLAIRS RHYTMME 41
M. Patrice Mériaux, ingénieur-chercheur à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) 41
M. Hervé Champion, chargé de mission au service des risques naturels majeurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 42
C. MISE EN PERSPECTIVE 44
M. Patrick Vincent, directeur général délégué de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) 44
D. DÉBAT 46
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 46
M. François Démarcq 47
M. Jean-Marc Bournigal, président de l’IRSTEA 47
M. Patrick Lachassagne, responsable environnement et ressources en eau de Danone Eaux France 48
DEUXIÈME PARTIE : LA CONTRIBUTION À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 51
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : RESTAURATION DES POPULATIONS D’ESTURGEONS 53
M. Thierry Mazet, directeur de l’agriculture de la région Aquitaine 53
M. Éric Rochard, directeur de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) 54
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : EXTRACTION DES PRINCIPES ACTIFS DES VÉGÉTAUX, PLANTES À TRAIRE 56
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 56
M. Jean-Paul Fèvre, président-directeur général de Plant Advanced Technologies (PAT) 57
M. Frédéric Bourgaud, professeur à l’Université de Lorraine 58
C. MISE EN PERSPECTIVE 60
Mme Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS-INEE) et vice-présidente d’AllEnvi pour la programmation scientifique 60
D. DÉBAT 61
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l'OPECST 61
Mme Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS-INEE) et vice-présidente d’AllEnvi pour la programmation scientifique 62
Mme Frédérique Clusel. 63
M. Paul Indelicato, vice-président « Recherche et innovation » de l’université Pierre-et-Marie-Curie 63
Mme Katia Barral, membre de la direction de l’innovation du CNRS 64
M. Benoît Fauconneau, chercheur à l’INRA. 65
SECONDE TABLE RONDE : DÉVELOPPEMENT DURABLE 67
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : VALORISATION DES RESSOURCES ET MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS 67
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 67
M. Emmanuel Maille, directeur corporate and business development de Carbios 67
M. Alain Marty, professeur à l’Institut national de sciences appliquées de Toulouse (INSA) 69
M. Patrick Hetzel, député, membre de l’OPECST 72
B. SECONDE ILLUSTRATION : VALORISATION DES DÉCHETS, BIOTECHNOLOGIES BLANCHES ET MÉTHANISATION 74
M. Michel Torrijos, ingénieur de recherche au laboratoire de biotechnologie de l’environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) 74
M. Aurélien Lugardon, président directeur-général de Naskeo 75
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 79
M. François Moisan, directeur exécutif de la stratégie, de la recherche et de l’international à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME) 80
C. MISE EN PERSPECTIVE 80
M. Gilles Trystam, directeur général de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) 80
D. DÉBAT 84
Mme Dorothée Browaeys, rédactrice en chef bio-innovation du magazine Up’ 84
M. Gilles Trystam, directeur général de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) 84
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. 84
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 85
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UNE RECHERCHE TRANS-VERSALE 89
Mme Véronique Bellon-Maurel, directrice du département Écotechnologies de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) 89
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 90
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 91
M. François Moisan, directeur exécutif de la stratégie, de la recherche et de l’international à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 91
CONCLUSION 97
M. Jean-Marc Bournigal, vice-président de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), président de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) 97
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST 98
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST 99
EXTRAIT DE LA RÉUNION DE L’OPECST DU 28 JANVIER 2015 PRÉSENTANT LES CONCLUSIONS DE L’AUDITION PUBLIQUE 101
L’audition publique du 3 juillet 2014 sur
« Construire une société nouvelle, améliorer notre compétitivité grâce à la recherche environnementale »
a été organisée en collaboration avec AllEnvi
PREMIÈRE PARTIE :
L’IMPACT DE LA RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE
SUR LA SOCIÉTÉ
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a le plaisir d’accueillir aujourd’hui les représentants de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), ainsi qu’un certain nombre d’industriels avec lesquels l’Alliance a établi des partenariats, afin de développer les applications positives directement issues de leurs recherches. L’organisation de cette audition s’inscrit dans le droit fil des précédents travaux de l’OPECST, qui manifeste un intérêt constant pour la recherche et l’innovation, en mettant, notamment, régulièrement l’accent sur la nécessité de la valorisation de la recherche, condition indispensable pour que celle-ci se traduise par des progrès significatifs pour la société et l’économie.
L’OPECST a suivi dès leur origine les alliances thématiques de recherche. Celles-ci ont été constituées entre mars 2009 et juin 2010, afin de favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche et d’innovation définie en mars 2009. Ces alliances sont aujourd’hui au nombre de cinq : AVIESAN pour la santé, ANCRE pour l’énergie, ALLISTENE pour le numérique, ALLEnvi pour l’environnement et ATHENA pour les sciences humaines et sociales.
L’OPECST avait organisé, dès novembre 2010, une audition publique consacrée aux alliances de recherche, afin de faire une présentation détaillée de chaque alliance, ainsi que des principaux organismes de financement de la recherche, l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et Oséo. Le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche y avait précisé de quelle manière leur action s’inscrivait dans la stratégie nationale de recherche et d’innovation. Cette audition avait déjà permis de mettre en lumière l’enthousiasme indéniable des membres des alliances et l’important travail de coordination et de programmation qu’elles entreprenaient. La mission confiée aux alliances consistait principalement à élaborer une programmation suivant les priorités définies par la stratégie nationale de recherche et de nouer des partenariats avec les entreprises des secteurs économiques concernés, dont l’alliance AllEnvi va nous apporter aujourd’hui de nombreuses illustrations concrètes dans le domaine de l’environnement. Ce dispositif se prolonge aujourd’hui par la contribution du travail programmatique des alliances à la définition du cadre annuel d’action de l’ANR, et à l’élaboration – en cours – des choix qui vont être entérinés par la stratégie nationale de recherche instituée par la loi du 22 juillet 2013. Vous savez que je représente l’Assemblée nationale au Conseil stratégique de la recherche. Un représentant du Sénat, Michel Berson, et un représentant de l’Association des régions françaises, Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie, y siègent également.
Depuis la mise en place des alliances, l’expérience apparaît très concluante. On a pu constater une forte implication des grands organismes de recherche publique, qui trouvent dans les alliances une instance de dialogue et de concertation, assurant une collaboration étroite, laquelle dynamise indéniablement la recherche française. Ce dispositif innovant se révèle donc très positif, en regroupant les initiatives dans les domaines où les acteurs étaient nombreux et dispersés – comme celui des sciences du vivant – et en concentrant les moyens.
Les alliances de recherche ont déjà accompli un important travail de réflexion et constitué des groupes programmatiques par thématique. Ces initiatives méritent d’autant plus d’être saluées que les différents acteurs concernés prennent sur leur temps et leurs moyens, dans la mesure où le principe même des alliances est de fonctionner sur des structures légères, avec des ressources qui sont mobilisées uniquement en cas de besoin. Il est essentiel que cet enthousiasme et cette mobilisation des grands organismes publics de recherche à l’égard du dispositif des alliances débouchent sur des réalisations concrètes, comme l’alliance AllEnvi va nous en faire aujourd’hui la vivante démonstration.
Pour y parvenir, le travail réalisé au sein des groupes programmatiques doit être pris en compte dans les différents circuits de financement de la recherche. Dans la mesure où les alliances font jouer les synergies entre organismes publics de recherche et évitent le saupoudrage, les empilements, les chevauchements, et concentrent les moyens financiers, elles permettent de faire émerger plus facilement les partenariats public-privé, qui sont indispensables pour que la recherche se traduise en innovation et permette davantage de croissance et d’emploi. Il ne pourra en effet être remédié efficacement à l’insuffisance chronique de la recherche privée française qu’à la condition que la recherche publique donne une impulsion forte en faisant effet de levier, l’une des vocations de la recherche publique étant d’ouvrir la voie pour inciter les industriels à concentrer des moyens supplémentaires sur les objectifs poursuivis. Les alliances, désormais au cœur du dispositif de la recherche française, sont appelées à jouer un rôle moteur dans la constitution de véritables clusters associant entreprises, centres de recherche et universités autour de projets innovants.
L’OPECST est une sorte de passerelle entre le monde du Parlement, dont les priorités sont multiples, et le monde de la science. On peut dire que les priorités scientifiques ne sont peut- être pas au cœur de l’actualité politique de tous les jours. Néanmoins, les relations établies depuis trente ans – l’OPECST a été créé en 1983 – avec les grands organismes de recherche, avec la Conférence des présidents d’université, avec les académies (Académie des sciences morales et politiques, Académie des technologies, Académie d’agriculture) sont indéniables. Ce rôle de passerelle est important, dans la mesure où l’OPECST essaie de transmettre au plus haut niveau politique les messages du monde scientifique.
L’OPECST est associé dans le processus de valorisation de la recherche, comme en témoigne sa participation à l’élaboration de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Nous avons joué un rôle d’intermédiaire entre la communauté scientifique et les parlementaires en organisant l’audition : « Quelles conclusions législatives tirer des Assises ? ». Celle-ci a rencontré un vif succès. En effet, c’est ici, dans cette même salle, avec 180 prises de parole dans la journée, que nous avons réussi à procéder à la traduction législative des Assises de la recherche, c’est-à-dire tisser le lien entre les Assises et le projet de loi qui allait suivre. J’ai été moi-même nommé parlementaire en mission, avec la charge d’assurer, à l’époque, le lien entre les Assises et le Parlement, et j’ai remis un rapport préparatoire à la loi sur l’enseignement supérieur.
Mais nous nous voyons à chaque fois qu’un sujet d’actualité apparaît sur le devant de la scène. Il y a quelque temps, à l’occasion de « l’affaire Séralini », des auditions publiques ont été organisées dans cette même salle entre ceux qui critiquaient les publications du type de celle de M. Georges-Éric Séralini (avant qu’elle ne soit retirée) et ceux qui considéraient comme normal de pouvoir tout publier.
Je vous souhaite donc la bienvenue, en vous précisant que cette réunion avec une alliance constitue une première. La communauté scientifique et les grands organismes publics de recherche sont assurés de trouver auprès de l’OPECST et des parlementaires qui le composent une écoute attentive et un soutien actif. Je vous remercie de votre mobilisation et passe la parole à M. François Houllier.
M. François Houllier, président de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement (AllEnvi), président directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Monsieur le premier vice-président, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens tout d’abord à remercier l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de nous accueillir dans cette belle salle, pour ce qui constitue donc une première. Cette initiative a été suscitée par M. Jean-Marc Bournigal, vice-président d’AllEnvi, qui est en charge des questions de valorisation, d’innovation, de transfert et d’appui aux politiques publiques.
Dans mon propos liminaire, je souhaiterais vous dire quelques mots de l’alliance AllEnvi. Je vous parlerai ensuite d’un dispositif particulier qui est au cœur de cette journée : le Consortium de valorisation thématique. L’objectif est de montrer que la recherche environnementale est susceptible de déboucher sur des applications, des innovations, des transferts, de l’appui à la compétitivité. Je terminerai sur un projet particulier de l’organisme que je préside, l’INRA. Ce projet me semble en phase avec les propos que nous allons tenir aujourd’hui, dans la mesure où il porte sur les impacts de la recherche publique et la manière dont on peut les analyser et les quantifier.
L’alliance AllEnvi a été créée le 12 février 2010. Elle rassemble douze membres fondateurs qui sont des organismes de recherche et la Conférence des présidents d’université. Ils sont tous compétents dans le champ de la recherche environnementale entendue au sens large : celle qui traite de l’alimentation, de l’eau, du climat, de la biodiversité et des territoires. Elle rassemble également seize membres associés, le dernier étant le Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Notre alliance rassemble de fait l’ensemble des organismes qui, à un titre ou à un autre, organismes, universités ou écoles, sont concernés par ce vaste champ de la recherche environnementale. Elle se situe à la confluence d’un certain nombre de défis scientifiques majeurs : nourrir plus de neuf milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 ; garantir l’accès à l’eau et aux ressources naturelles au plan mondial ; faire face aux changements climatiques et à l’érosion de la biodiversité ; respecter l’impératif de qualité environnementale de nos territoires.
Nous travaillons évidemment dans une perspective de développement durable et équitable, avec une double ambition : comprendre, diagnostiquer et analyser, c’est-à-dire, plus simplement, faire de la science ; et simultanément, apporter un éclairage aux politiques publiques et une contribution à l’innovation. Il est vrai qu’aujourd’hui nous allons plutôt nous focaliser sur cette seconde dimension : la contribution à l’innovation, au transfert et à la valorisation des recherches. L’Alliance est également très attentive à la qualité de la science qui peut être produite et aux mécanismes qui peuvent être compris, étudiés et analysés.
Aux quatre défis que je viens d’identifier, s’ajoutent deux missions complémentaires qui sont communes à l’ensemble des alliances et se situent à l’articulation entre « national », « européen » et « international ».
Avec l’Agence nationale de recherche (ANR), nous contribuons à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche, actuellement en cours de discussion, et nous essayons à ce titre de mener des travaux de programmation en amont des dispositifs de financement.
Nous sommes un dispositif de coordination nationale : nous réfléchissons, par exemple, aux questions relatives à la feuille de route des infrastructures de recherche – chantier qui est en train de redémarrer à l’initiative du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, nous essayons de créer des coopérations entre recherche publique et privée.
Enfin, comme l’a remarqué tout à l’heure le président Jean-Yves Le Déaut, nous tenons à conserver un dispositif souple et léger.
Cette alliance porte sur les écosystèmes, sur le vivant, sur la mer, sur les eaux continentales, sur les territoires. Elle est organisée en un certain nombre de groupes thématiques – que vous retrouverez dans notre plaquette – sur les différents segments de l’eau, de la ressource et de ses usages, jusqu’à la mer en passant par les aliments et l’alimentation.
Elle dispose par ailleurs de cinq groupes transversaux, qui portent sur les prospectives, sur l’Europe, sur l’international. Il existe notamment un groupe qui s’intéresse aux questions de valorisation, de transfert, d’innovation et d’appui aux politiques publiques. Ce groupe a notamment contribué à préparer la réunion d’aujourd’hui : il s’agit du Comité de valorisation, CoVallEnvi, dont je vais dire un mot.
La mobilisation du partenariat et des transferts pour l’innovation est importante pour l’ensemble des membres de l’alliance. CoVallEnvi est finalement l’alliance des services de valorisation. Ce n’est pas le service de valorisation de l’alliance puisque nous n’avons pas de personnalité morale et que nous ne souhaitons pas en avoir une. Nous souhaitons être un dispositif de coordination.
C’est un groupe qui rassemble les directeurs de la valorisation des différents membres de l’alliance, et essaie de mettre en place un réseau de partage des bonnes pratiques, de réflexion en faveur du partenariat et du transfert, à l’image de ce qui a été fait dans d’autres alliances. Nous avons ainsi été amenés à mettre en place un cadre bilatéral pour favoriser les interactions entre recherche publique et secteur privé. L’idée est de partager des expériences, des analyses et d’avoir ainsi une manière de travailler plus efficace entre nous et avec nos partenaires du secteur public ou privé qui sont intéressés par l’usage et la valorisation de nos recherches.
Le CoVallEnvi se trouve doté d’un outil particulier : le Consortium de valorisation thématique, ou CVT AllEnvi, qui est un instrument du Programme Investissements d’Avenir et qui a vocation à devenir un centre de ressources et d’expertise en intelligence économique, au service à la fois des membres de l’alliance et des communautés scientifiques qui relèvent de ce périmètre. Il est opérationnel depuis un peu plus d’un an. Il est dirigé par M. Marc Chaussade, sous le regard du dispositif de valorisation CoVallEnvi que je viens d’évoquer, et notamment du vice-président en charge des questions de valorisation et d’appui aux politiques publiques, M. Jean-Marc Bournigal.
Venons-en aux objectifs principaux du CVT Allenvi, qui est un instrument particulier. L’idée est d’avoir la capacité de construire une stratégie nationale de valorisation entre les différents membres de l’alliance dans les domaines de valorisation stratégiques (DVS), potentiellement créateurs de valeur économique et sociétale.
Nous avons identifié quatre grandes priorités qui nous paraissaient porteuses d’avenir : la bio-économie, l’économie circulaire, les usages énergétiques, chimiques pour l’alimentation animale ou humaine de la biomasse ; les écotechnologies et la remédiation des écosystèmes ; l’adaptation aux risques naturels et au changement climatique ; les services environnementaux, la biodiversité et les territoires.
Il s’agit, dans ces quatre très grands domaines, de mutualiser et de renforcer les potentiels d’analyse stratégique des différents membres de l’alliance, en concentrant les investissements sur un certain nombre de sujets particuliers, en faisant des analyses stratégiques collectives et en valorisant les résultats au service de la croissance des entreprises.
L’idée est de repérer un certain nombre de sujets particuliers – que je vais illustrer dans un instant – sur lesquels faire des études permettant de réfléchir à l’opportunité de lancer des recherches ou d’avoir des actions particulières de valorisation dans le futur. Cela nous amène à interagir avec les acteurs économiques.
Six analyses stratégiques collectives de ce type sont en cours : l’une porte sur la biologie de synthèse pour les applications chimiques et énergétiques et en environnement ; une autre, qui vient de démarrer, porte sur le recyclage des métaux critiques ; une autre sur la remédiation des sols pollués ; une autre sur les services d’adaptation au changement climatique, sujet particulièrement important ; une autre sur l’observation environnementale pour l’agriculture et la gestion des risques naturels ; et la dernière sur un sujet essentiel pour l’autonomie protéique de la France : les protéines végétales pour l’alimentation. Ces études, d’une durée d’environ une année, visent à identifier des domaines porteurs intéressants à la fois pour la recherche publique et pour les acteurs industriels.
Je vais prendre comme exemple l’étude sur les protéines végétales et ses résultats. Les chercheurs, en interaction avec les chargés d’études, ont identifié onze axes stratégiques. Leur interaction avec les industriels a permis d’en identifier quatre parmi les plus importants. Ainsi, les priorités que l’on pourrait qualifier de scientifiques ont été mises en relation avec les attentes du secteur industriel et du secteur économique : d’où ces quatre priorités qui, en outre, ont été hiérarchisées.
Quatre analyses stratégiques collectives sont aujourd’hui au stade de pré-études : l’une portera sur les bio ressources marines pour les biotechnologies (marines) ; une autre sur les services environnementaux pour la préservation et la restauration de la quantité et de la qualité des eaux ; une autre sur l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la production et la consommation d’énergie (sujet qui pourrait être à l’interface avec l’alliance ANCRE, qui porte sur l’énergie) ; une autre enfin sur l’ADN environnemental et la gestion des écosystèmes, domaine dans lequel des services sont susceptibles de se développer.
Je précise que les premiers résultats de ce dispositif de valorisation thématique qui est en train de se déployer seront bientôt disponibles.
Je voudrais terminer sur un travail particulier réalisé par l’INRA, qui peut intéresser l’ensemble de l’alliance AllEnvi. Nous avons, en effet, essayé de caractériser la diversité des impacts que la recherche agronomique pouvait avoir, sur le long cours, dans le domaine de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement. On nous avait en effet fait remarquer, il y a quelques années, que nous savions décrire et documenter nos productions scientifiques – et je crois que c’est vrai pour tous les organismes membres de l’alliance – mais que nous avions du mal à documenter nos impacts. D’une certaine manière, une partie de la journée portera sur la manière dont nous arrivons à traduire en impacts économiques, sociétaux, politiques, sanitaires, les recherches que nous conduisons.
Ce travail nous a amenés à mettre en place trois outils analytiques particuliers, sur la base d’études de cas ayant donné lieu à des impacts avérés : la chronologie permettant de passer de la recherche la plus en amont jusqu’à l’impact sociétal ou économique le plus avéré ; les trajectoires d’impact et, notamment, les rôles relatifs des différents acteurs et l’importance de l’investissement des uns et des autres ; enfin, la diversité des impacts potentiels, qui ne sont pas uniquement de nature économique, mais qui peuvent être de nature environnementale, sociale, politique, territoriale ou sanitaire.
Nous avons observé – et ce qui est valable pour le champ de l’agriculture-alimentation-environnement l’est tout autant dans les domaines de recherche du BRGM, du CNRS, de l’IRD, du CIRAD, de l’IRSTEA qui sont membre de l’alliance AllEnvi – que les chemins de l’innovation sont généralement longs : dix, quinze, vingt, vingt-cinq ans, entre la recherche séminale et le marché ou la politique publique. Ils impliquent des partenaires multiples et variés : jamais un seul organisme de recherche, mais en général un tissu d’interactants : entreprises, acteurs publics, instituts techniques, centres. L’innovation est souvent technologique, mais elle peut être aussi systémique et sociale. Elle ne se résume pas à de l’innovation de rupture technologique. Il faut pouvoir regarder ces différentes facettes de l’innovation.
Prenons le cas d’une start-up particulière qui s’intéresse à la méthanisation à partir de déchets solides, dont les résultats séminaux datent de 1995. Celle-ci emploie aujourd’hui une quarantaine de personnes, mais sa montée en puissance remonte à quelques années. Il a donc fallu attendre assez longtemps pour assister aux réalisations particulières à ce procédé de méthanisation qui avait été découvert et mis en place à Narbonne. Les chemins de l’impact eux-mêmes peuvent paraître compliqués, mais c’est parce qu’ils mettent en jeu toute une série de partenaires et d’éléments, y compris des normes et des régulations.
Au-delà de cet exemple particulier sur la méthanisation des déchets, il y a une vraie diversité des impacts. Je crois que c’est le sens de ce que, avec M. Jean-Marc Bournigal et les autres organisateurs de cette réunion, nous avons voulu vous montrer aujourd’hui. Certaines innovations n’ont qu’un impact purement économique ; certaines ont des impacts environnementaux ; d’autres ont des impacts de nature sanitaire, ou de nature territoriale. Il est important, notamment pour la recherche environnementale que nous représentons, d’avoir en tête cette diversité d’impacts. Il ne faut pas réduire les sorties positives de nos recherches à la seule efficacité économique. Selon les sujets, selon les projets, les impacts sont différents.
En conclusion, monsieur le vice-président, nous avons construit cette audition autour de cinq grands domaines : bien-être, santé et sécurité alimentaire ; conflits d’usage, risques et vulnérabilité ; biodiversité et écosystèmes ; développement durable ; évaluation environnementale, qui est une question très transversale. Dans chacun de ces domaines, nous avons mis en avant plusieurs cas de succès avérés, nous permettant de présenter de manière positive les recherches que nous conduisons dans nos différents organismes. Nous avons adopté le point de vue d’un acteur socioéconomique, public ou privé, sur l’intérêt de la recherche. Et puis, de façon un peu rétrospective, nous sommes revenus vers les recherches qui ont mené à l’impact. Nous avons enfin ménagé des temps de discussion.
PREMIÈRE TABLE RONDE :
BIEN-ÊTRE, SANTÉ, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Merci, monsieur Houllier, de ces propos et de la dynamique explicite donnée à l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), connue du monde scientifique et des médias, mais dont on ne perçoit pas toujours l’ambition sur tous les champs de la question alimentaire, environnementale et climatique, qui compte désormais parmi les préoccupations des Français. On discerne ainsi une inquiétude larvée sur ce que fait, ou ne fait pas, la recherche, alors même que les scientifiques travaillent, que les entreprises trouvent le chemin des laboratoires et que les choses ne vont finalement pas si mal, ce qui est mieux que rien dans ce monde constamment inquiet. Merci donc de dire les choses avec autant de précision – c’est-à-dire avec beaucoup de science – et de simplicité.
Vous avez évoqué les impacts, qui sont le grand enjeu économique, mais aussi la principale source d’inquiétude. La science, et notamment celle qui touche à la vie et à l’environnement, est aujourd’hui vécue comme une altération du monde dans lequel nous vivons : altération par rapport à la santé, avec de plus en plus de parents qui ne font pas vacciner leurs enfants, inquiétude par rapport à notre environnement. Dans le même temps, la déprise agricole conduit à un développement de la biomasse sur pied, les paysages changent.
En France, la situation n’est pas si dégradée. À l’échelle mondiale, en revanche, les concentrations urbaines comportent de gros enjeux en termes de développement comme en termes économiques, mais aussi au regard de la dégradation des modes de vie et de l’inquiétude pour l’environnement ainsi que pour la qualité et l’accessibilité de l’alimentation. Et je pense aussi aux pays du Sud.
Le sujet de notre première table ronde, intitulée « Bien-être, santé, sécurité alimentaire », est donc tout à fait stratégique et résume bien les enjeux de notre société. Le bien-être n’est pas seulement le confort, mais aussi le fait de ne pas être inquiet. Ce sont deux notions différentes : nos sociétés n’ont pas encore établi la relation entre inquiétude collective et confort individuel. Il est important de reconstruire le dialogue sur ces deux concepts de bien-être et de santé. Quant à la sécurité alimentaire, elle est bien sûr nécessaire, et semble avoir été explicitée par les débats qui ont eu lieu, il y a une dizaine d’années, sur la sûreté et la sécurité.
Avant de laisser la parole à chacun des intervenants, je précise que l’audition est publique et enregistrée ; vous pourrez donc retrouver sur le site Internet de l’OPECST la totalité de vos interventions et même vous en servir, qu’il s’agisse des vôtres ou de celles des autres.
Venons-en à la première illustration de cette table ronde : le microbiote intestinal.
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : LE MICROBIOTE INTESTINAL
M. Dusko Ehrlich, directeur de recherche à l’unité de recherche de génétique microbienne de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). C’est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole devant l’OPECST pour vous entretenir d’un organe négligé, qui impacte la santé. Pensez donc que 100 milliards de micro-organismes, soit dix fois plus que de cellules dans notre corps, habitent notre intestin. La masse correspondante peut représenter jusqu’à deux kilos – plus que le cerveau. Cet organe est une interface entre l’aliment qui nous permet de vivre et notre corps, en contact avec le premier réservoir de cellules immunitaires, qui nous protège des maladies, et le deuxième ensemble de cellules neurales – il y a suffisamment de neurones dans l’intestin pour constituer le cerveau d’un chat. On en viendrait presque à se demander quel est le premier et quel est le deuxième cerveau de notre corps…
C’est sur le rôle majeur de cet organe négligé pour la santé que je focaliserai mon intervention. Si cet organe a longtemps été négligé, c’est parce que les médecins n’avaient pas de méthode, de scanner ; ils ne savaient pas le palper pour évaluer son état, et donc déterminer s’il était altéré. Nous avons élaboré cette méthode nouvelle, que nous appelons la métagénomique quantitative ; elle a été développée au sein du grand consortium européen MetaHIT, coordonné par l’INRA, et implémentée dans MetaGenoPolis, qui est soutenu par les investissements d’avenir.
Le temps me manque pour vous décrire dans le détail comment fonctionne cette méthode. Retenons simplement qu’elle est fondée sur des technologies de pointe, le séquençage à très haut débit, couplé à un programme informatique très puissant, pour convertir l’information contenue dans les selles, substance qui peut être obtenue de manière très simple et non invasive, avec un protocole standardisé développé avec le concours d’Enterome. Cette approche s’apparente à un microscope surpuissant, qui permet de scanner cet organe jusque-là négligé.
Qu’avons-nous appris ? Une personne sur quatre a perdu la richesse de cet organe qu’est l’intestin. Les conséquences en sont la perte de 40 % des espèces microbiennes, un microbiote moins sain, pro-inflammatoire, qui produit moins des substances nécessaires pour la santé de l’intestin, et expose les sujets concernés au risque de développer des maladies chroniques graves telles que le diabète, des complications hépatiques ou cardiovasculaires. Nous savons détecter cette perte de richesse par un test simple, élaboré par Enterome, et nous savons qu’elle peut être corrigée – au moins en partie – par une intervention nutritionnelle.
Les maladies chroniques sont très fréquentes et coûtent très cher : 4,4 % de la population française souffre de diabète de type 2 – et ailleurs, c’est pire ; le coût des traitements est évalué à 12 milliards d’euros par an ; le déficit annuel de la branche maladie de la sécurité sociale atteint régulièrement ces 12 milliards. Par la seule prévention, alliant détection du risque, grâce au test, et sa réduction par une intervention, on pourrait retarder le diabète d’un an – voire davantage. Imaginez les ressources considérables que cela permettrait d’économiser !
La recherche en microbiome humain sur la santé pourrait donc aider à réorienter la médecine curative d’aujourd’hui vers la médecine préventive de demain, à économiser des ressources et à diminuer la souffrance des malades.
La France est leader en métagénomique humaine, en témoignent nos publications dans les meilleures revues mondiales, qui assoient les bases de nos découvertes. Au-delà de cet aspect, nous sommes intégrés dans les milieux internationaux, et nous déposons des brevets qui sont le fondement d’une activité économique future.
M. Pierre Bélichard, président-directeur général d’Enterome. Pharmacien, je suis un pur produit de l’industrie pharmaceutique. Je vais essayer de vous décrire le cercle vertueux qui a conduit à la création d’Enterome, à partir de la science développée à l’INRA par l’équipe de Dusko Ehrlich.
En deux ans d’existence, Enterome a créé vingt emplois et réussi à lever 20 millions d’euros auprès du capital-risque international – nous avons des investisseurs danois, suédois, américains et français. Nous développons des outils de diagnostic afin de mieux comprendre comment des maladies liées à l’altération de la flore intestinale découverte par l’équipe de Dusko Ehrlich, ou anomalies du microbiote, peuvent se transformer en outils de diagnostic ou de pronostic, mais aussi, dans un deuxième temps, être utilisées comme outils de découverte de nouveaux médicaments. Il s’agit de la plupart des maladies auto-immunes, aujourd’hui très mal soignées ou soignées seulement au niveau des symptômes : la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde, voire demain la dépression. Il existe un « réservoir » de maladies non traitées et non soignées, dont il semble – les travaux de Dusko Ehrlich l’ont démontré – que la relation de cause à effet avec les anomalies du microbiote soit très forte.
Faisons un détour par le passé. L’INRA, adossé à la banque française Natixis et son fonds d’investissement de capital-risque Seventure, a créé l’entreprise Agro Biotech Accélérateur (ABA) dont l’objet était d’être un observatoire des découvertes faites au sein de l’INRA et pouvant être valorisées par le capital-risque ; tout se passait alors en France. Enterome est issue de cette démarche ; elle peut donc être considérée comme l’une des pépites nées de l’INRA. A suivi le démarrage de l’implémentation de MetaGenoPolis, plateforme de métagénomique quantitative, qui est en train de devenir industrielle sous l’impulsion d’Enterome et qui est notre outil de recherche et développement (R&D) et de travaux. Comme vous le voyez, il y a eu tout un parcours, très valorisant et très sain, préalable à la création d’Enterome.
La deuxième partie a consisté à faire savoir au capital-risque international que nous avions un projet et la volonté de créer, non pas une petite entreprise, mais une nouvelle industrie, basée en France. Au-delà du fait que je suis un professionnel de la création d’entreprise et que Dusko Ehrlich est un vrai créateur de valeur, cette innovation a été adoubée par l’ensemble des capitaux-risqueurs du monde entier, en témoignent les 20 millions d’euros que nous avons levés par ce moyen.
La suite logique est maintenant de développer des produits. Avoir levé des capitaux aussi importants nous permettra d’arriver sur le marché américain avec le test d’évaluation de la richesse de la flore intestinale à la fin de l’année 2015. Nous sommes sur des périodes beaucoup plus courtes, qui s’expliquent par notre capacité à embaucher des équipes et à lever des produits. Rappelons que nous sommes des professionnels du développement de produits.
J’ai travaillé ici même, en 2009, avec des parlementaires, sur l’aide à apporter aux entreprises françaises de biotechnologie qui se développaient pour passer le cap des deux premiers tours de table, la fameuse « vallée de la mort ». Nous voulions comprendre pourquoi ces entreprises, qui avaient besoin de 50 millions d’euros pour continuer à se développer, se retrouvaient systématiquement vendues à des fonds d’investissement ou à des sociétés pharmaceutiques américaines. Ce travail a été effectué par le Gouvernement : Bpifrance s’est dotée d’un outil, Large Venture, qui peut être un relais de financement tardif après les phases d’investissement que je viens de citer.
Le futur se présente sous les meilleurs auspices. Nous discutons avec Bpifrance pour essayer de créer un nouveau pôle d’innovation et de développement, et surtout un pôle industriel de développement de produits de diagnostic et pharmaceutiques, qui nous permette, au lieu d’être contraints de vendre l’entreprise, d’assurer sa pérennité, et donc des emplois en France, pour les années qui viennent.
M. Dusko Ehrlich. Nous avons un dernier message à vous faire passer : merci beaucoup, et prenez soin de votre microbiome, pour qu’il soit aussi riche et beau qu’un jardin japonais !
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : BIOCONTRÔLE DES PRODUCTIONS AGRICOLES
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Nous en venons à la deuxième illustration de cette table ronde : le biocontrôle des productions agricoles.
M. Antoine Coutant, directeur général d’Agrauxine. Nous sommes heureux de vous présenter un secteur du biocontrôle émergent et générateur d’emplois pour une agriculture moderne, compétitive et durable.
Parmi les différents facteurs qui contribuent à l’émergence et à l’accélération de ce secteur, il y a, bien sûr, la pression en faveur d’une agriculture moins impactante pour l’environnement, qui produise avec moins de résidus, et qui présente toutes les conditions de sécurité pour les agriculteurs et pour les différents acteurs de la chaîne. Mais je citerai surtout le plan Ecophyto 2018, qui a été un vrai facteur d’impulsion pour le secteur. Lancé au cours du premier Grenelle de l’environnement en 2008, il a été maintenu par les équipes gouvernementales successives – et c’est une bonne chose. L’objectif est de réduire de 50 % les produits chimiques pour la protection des plantes.
Le biocontrôle peut se définir comme des solutions « biosourcées », c’est-à-dire issues du monde du vivant, souvent de la nature. Il peut s’agir de micro-organismes, de macroorganismes, c’est-à-dire d’insectes utiles, d’extraits de plantes ou de phéromones. J’insiste sur le fait que ces technologies viennent en substitution partielle ou totale de technologies conventionnelles, c’est-à-dire de pesticides chimiques. Nous ne sommes pas dans une logique de « tout-bio », mais dans une logique d’agriculture performante, moderne et de rendement, sans les risques historiques associés à un usage excessif des produits chimiques.
Agrauxine aussi peut témoigner d’une collaboration réussie avec l’INRA, qui a conduit à la création de produits industriels et commerciaux. Le premier est la souche I-1237, Trichoderma atroviride, qui avait été sélectionnée à l’origine par des équipes de l’INRA dans les années 1990, et que nous avons rachetée, avec les brevets, au début des années 2000. Nous venons d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour ce produit, Esquive WP, premier produit de biocontrôle en France pour lutter contre les maladies du bois de la vigne, véritable fléau contre lequel il n’existait plus de solution depuis l’interdiction, en 2001, de l’arsenite de sodium, un dérivé de l’arsenic.
Nous avons d’autres produits, qui ne relèvent pas du biocontrôle stricto sensu, et qui sont, par exemple, destinés à apporter aux plantes les moyens d’utiliser moins d’eau et moins d’engrais, ce qui est aussi une priorité pour l’agriculture. Nous poursuivons également une collaboration avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur les bactéries, qui ne relève pas non plus du domaine du biocontrôle stricto sensu.
Les maladies ciblées sont des maladies d’origine microbienne. Nous pouvons en toucher un grand nombre avec nos solutions de biocontrôle. Vous trouverez une illustration plus large de ces solutions et du domaine du biocontrôle dans le Livre blanc du biocontrôle, édité par l’International biocontrol manufacturer’s Association (IBMA), une association professionnelle qui a son siège en France.
Contrairement à l’approche totalement chimique, le biocontrôle n’intervient pas seul mais par croisement avec d’autres technologies : le « biodelivery », qui recouvre les nouvelles méthodes d’apports aux plantes, par exemple l’encapsulation, ces produits étant en général plus fragiles que les produits chimiques ; les pratiques culturales qui doivent elles-mêmes évoluer ; les pesticides avec lesquels nous travaillons souvent en association ou en synergie.
Nous allons créer beaucoup d’emplois avec ce secteur du biocontrôle, car celui-ci va être associé à une agriculture de précision. Il ne s’agit pas de traiter tous les champs, mais de diagnostiquer plus précisément les maladies et d’utiliser davantage les technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est un nouveau secteur pour les équipementiers, puisqu’il va falloir produire, ce qui exige de nouvelles usines. Le biocontrôle va également nécessiter des activités de service, telles que la fourniture d’analyses et d’expérimentations, notamment en plein champ où nous avons de nombreux sous-traitants.
Les mouvements d’acquisition qui ont eu lieu depuis deux ans dans le secteur du biocontrôle représentent un montant de près de deux milliards d’euros. Beaucoup de « grands » de l’agrochimie mondiale rachètent des acteurs du biocontrôle, ce qui est un signe de l’émergence du secteur. Certes, le contexte réglementaire joue, mais les « grands » de l’agrochimie se sont aussi rendu compte qu’il existait des synergies de performance entre les produits de biocontrôle et les produits de la chimie, permettant une nouvelle approche du traitement des plantes. Enfin, il y a des succès sur le terrain – beaucoup plus aux États-Unis qu’en Europe. Les Américains excellent à créer de nouvelles industries rapidement. Nombreuses sont les acquisitions en Amérique du Nord ; il faut maintenant que l’Europe suive et accélère.
Il nous a fallu dix ans pour mettre Esquive WP sur le marché. Autrement dit, le biocontrôle requiert des temps de développement longs. C’est donc un défi difficile pour les entreprises. Pour dynamiser le biocontrôle, quatre points nous semblent importants. Il faut développer des moyens de financement adaptés à des temps de cycles longs ; nous nous sommes rapprochés de Bpifrance, mais il faudrait que le biocontrôle soit davantage connu des organes de financement. Ensuite, il faut accélérer les processus d’homologation, en donnant plus de moyens à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à la Direction générale de l’alimentation (DGAL), et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et en simplifiant et priorisant les processus. Il faut développer une vision stratégique de ce domaine, et enfin renforcer les collaborations entre la recherche publique et le secteur privé.
M. Didier Andrivon, chef de département adjoint au département santé des plantes et environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Je vais maintenant vous montrer, à partir de quelques exemples, quelles sont les questions de recherche posées par le biocontrôle et comment nous essayons d’interfacer les activités de recherche d’amont à l’INRA avec les besoins des industriels.
Premier exemple : la lutte biologique. M. Coutant a évoqué les macroorganismes, domaine historique du biocontrôle. Il s’agit de trouver des agents biologiques invasifs, mais pas trop : peu invasifs, ils ne peuvent pas se développer dans la population de parasites ; trop invasifs, ils deviennent nuisibles. L’enjeu sera donc le choix et l’acclimatation d’espèces exotiques, avec des conséquences sur la législation des introductions. Nous en avons plusieurs exemples. Derrière cela, il y a des enjeux en termes de biodiversité, de maîtrise de la biodiversité, d’identification et de suivi des agents de biocontrôle. Un des exemples est Microdochium, en cours de développement par Agrauxine : nous avons besoin, d’une part, d’être sûrs qu’il s’agit bien d’un Microdochium, et, d’autre part, d’avoir des marqueurs spécifiques permettant de suivre cette souche.
Un autre enjeu touche à l’élevage et aux collections. C’est en effet un prérequis pour des développements industriels en termes de production de ces agents.
Plus en amont, la biologie des invasions constitue aussi un grand enjeu de la recherche à l’INRA, car elle s’intéresse à de potentiels agents de biocontrôle, comme la coccinelle exotique.
Deuxième exemple : les stimulateurs de défense des plantes (SDP). Toute la question est de savoir si cette stimulation est suffisante pour être efficace. Derrière cela, il y a de nouveaux enjeux et de nouvelles cibles pour les acteurs de la création variétale.
Il nous faut nous doter d’outils de suivi d’expression de gènes pour caractériser les états de stimulation des plantes. La qPFD est un dispositif que nous avons breveté, qui est actuellement transféré au pôle de compétitivité Vegepolys et que nous développons aujourd’hui sur un ensemble de plantes pour suivre les états de stimulation vis-à-vis de stress biotiques et abiotiques.
Troisième exemple : l’utilisation des phéromones dans la confusion sexuelle. L’enjeu est ici la sélectivité et l’efficacité, avec des conséquences industrielles évidentes pour la production de ces phéromones, c’est-à-dire de ces molécules, par la chimie, mais aussi pour le développement de nouveaux types de diffuseurs permettant une application ciblée de ces molécules, au plus près des sources de ravageurs.
Pour nous, la problématique clé est de gérer des interactions durables dans les écosystèmes, ce qui est compliqué. Comme l’a dit M. Antoine Coutant, l’utilisation du biocontrôle ne consiste pas en une transposition pure et simple des méthodes actuelles de phyto-protection. Alors que l’utilisation du pulvérisateur de pesticide face à un problème n’est que tactique, il faut raisonner l’application de ces produits dans une stratégie complète, que j’ai appelée IPM 2.0. Lors du forum biocontrôle, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a parlé d’une agriculture intensive non pas en intrants, mais en connaissances, qui fait appel à notre capacité à combiner un certain nombre de méthodes pour une efficacité optimale.
Cela a des conséquences évidentes sur la mesure de l’efficacité de ces produits, cette dernière étant partielle par rapport aux pesticides classiques de synthèse, et sur les procédures d’homologation. Nous en avons parlé tout à l’heure à propos de la mesure du potentiel invasif. Pour un organisme comme le nôtre, savoir organiser le transfert de technologies est un enjeu important, depuis la recherche amont dans nos laboratoires jusqu’à des industriels, comme Agrauxine, qui mettront ces produits sur le marché. Nous essayons de le faire à travers des conventions cadres et des relations de partenariat, ainsi qu’en développant des plateformes technologiques dédiées, comme la plateforme qPFD à Angers sur laquelle l’INRA a investi en soutien humain et en environnement scientifique. Cette plateforme va être ouverte, via le pôle de compétitivité Vegepolys, à l’ensemble des acteurs dans la filière des productions végétales.
J’espère vous avoir convaincus que les technologies du biocontrôle sont un creuset d’avenir.
C. TROISIÈME ILLUSTRATION : MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Nous abordons maintenant la troisième illustration de cette table ronde : la mesure de la qualité de l’air intérieur. Nous nous en réjouissons particulièrement, car nous présenterons ici même, mardi prochain, un rapport sur les freins réglementaires à l’innovation dans la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons beaucoup travaillé sur la réglementation thermique 2012, et nous ignorions qu’AllEnvi travaillait aussi sur ce sujet. Pour tout vous dire, nous avons écrit aux organismes de recherche pour recruter les membres du comité de pilotage !
La réglementation thermique 2012 porte à la fois sur la performance énergétique, sur la circulation de l’air et la ventilation et sur le confort d’été. On débouche ainsi sur la qualité de l’air intérieur. C’est un sujet majeur, voire, comme je l’ai écrit dans mon rapport, une bombe à retardement – peut-être tempérerez-vous cette appréciation. Nous avons bien isolé les logements, nous savons conserver la chaleur et les calories, mais nous ne nous sommes sans doute pas suffisamment préoccupés de l’air intérieur.
M. Yves Bigay, président-directeur général d’Ethera. Je vais vous présenter une technologie née de cette problématique de la qualité de l’air intérieur qui participe à plusieurs enjeux sociétaux. Aujourd’hui, la qualité de l’air intérieur est responsable de 30 000 décès par an en France et de la perte de huit mois d’espérance de vie. Elle est à l’origine de problèmes de stérilité et de nombreuses journées de travail perdues. Le ministère de l’écologie a récemment chiffré son coût à 19 milliards d’euros par an. Autant dire que, là aussi, la sécurité sociale pourrait faire des économies !
La prise de conscience de l’importance de la qualité de l’air varie d’un continent à l’autre. Elle est surtout forte en Asie. Mais grâce à la législation et à la réglementation, la France est en train de rattraper son retard.
Nous avons une bonne connaissance de la qualité de l’air extérieur, qui a entraîné récemment l’application d’une mesure de circulation alternée des voitures à Paris. Or le graphique que je vous présente montre que l’air intérieur est bien plus pollué – environ dix fois plus – que l’air extérieur, et cela alors même que nous vivons 90 % de notre temps à l’intérieur.
Cette pollution de l’air intérieur vient des matériaux qui font notre habitat. L’habitat français médian est ancien ; on y trouve encore beaucoup de formaldéhyde : alors que l’ANSES recommande de ne pas dépasser 10 microgrammes par mètre cube, 50 % des logements français en recèlent plus de 20 microgrammes par mètre cube, et les trois quarts sont au-delà de cette limite. Et il n’y a pas que le formaldéhyde.
La qualité de l’air intérieur est donc un marché, dont le montant est estimé à une dizaine de milliards de dollars aux États-Unis. Il se vend un million d’épurateurs Philips par an en Chine. Bref, alors qu’il y avait ce marché, il s’est trouvé qu’une technologie existait au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et au CNRS. Je laisse la parole à son inventrice.
Mme Thu-Hoa Tran-Thi, directrice de recherche CNRS au sein du laboratoire Francis Perrin du CEA de Saclay. Cette technologie est issue d’un laboratoire du CEA associé au CNRS et de la recherche très fondamentale. Il y a quinze ans, j’ai eu l’idée de concevoir un capteur de polluants de l’air, utilisable par les particuliers, qui se colore en présence de polluants. Cette technologie est basée sur le principe de la réaction chimique, qui est une collision de molécules. J’ai longtemps étudié ces réactions en solution, en me demandant comment les exalter sans apporter de catalyseur, mais en les plaçant dans un milieu solide. C’est cette idée que j’ai reprise pour concevoir ces capteurs.
Pour donner une image d’une réaction chimique en solution, imaginons que tous les membres de cette assemblée se trouvent dans une piscine les yeux bandés, et qu’Yves Bigay et moi devions nous retrouver dans la piscine et nous donner la main pour provoquer la réaction chimique. Vous comprenez sans peine la difficulté. Imaginons maintenant que nous soyons dans une cage d’ascenseur, et avec moins de monde : il nous sera très facile de nous retrouver et de nous donner la main. C’est cette idée que j’ai exploitée, avec des matériaux poreux, dans lesquels peut être insérée une molécule sonde qui va attirer le polluant cible ; la réaction se fera alors aisément.
Les matériaux utilisés sont de vraies éponges qui ont une surface spécifique d’absorption, c’est-à-dire une surface développée de 600 mètres carrés, soit l’équivalent d’un court de tennis. Notre capteur est un monolithe de 2 millimètres sur 5 millimètres sur 8 millimètres. À l’échelle humaine, si vous êtes une molécule, cela représente un building de 1 300 kilomètres de largeur, 3 250 kilomètres de longueur et 5 200 kilomètres de hauteur, comprenant des chambres de 15 à 50 mètres cubes, dans lesquelles se trouvent des molécules sondes. En pénétrant dans une chambre, le polluant va entrer en collision avec ces molécules et former le composé coloré. En effet, la matrice que nous fabriquons est transparente au départ et se colore lorsqu’elle capte le polluant.
Cette technologie est utilisée pour mesurer la pollution dans l’air, mais aussi, grâce à sa forte capacité de captage, pour dépolluer. Elle offre aussi la possibilité de mesurer toutes sortes de composants organiques volatils. Mon rêve serait de concevoir des capteurs qui permettent de diagnostiquer des maladies. Dans l’haleine que nous exhalons se trouvent, en effet, des marqueurs volatils qui sont des marqueurs de maladies. Nous utilisons d’ailleurs déjà la technologie pour des bactéries qui émettent également des composés volatils. C’est ainsi que nous pouvons distinguer Escherichia coli d’un autre pathogène.
M. Yves Bigay. Le secret de cette technologie se trouve dans les nanomatériaux, à partir desquels nous avons développé deux catégories de produits. Les premiers sont des appareils de mesure, qui permettent de répondre au décret obligeant à mesurer la présence de polluants dans les crèches et les écoles. Les seconds sont des appareils de dépollution, qui utilisent les capacités absorbantes des matériaux placés à l’intérieur des filtres dans les épurateurs.
Ethera s’est développée avec l’aide des pouvoirs publics – services de valorisation du CEA et du CNRS, fonds d’amorçage. Notre chance a été que les industriels s’intéressent à nous. Pour la partie épuration, c’est le groupe SEB, bien implanté en Chine avec 700 magasins, qui nous apporte son soutien. Grâce à ce partenariat, nous sommes en train de construire à Crolles, près de Grenoble, l’unité de production de ces matériaux ; les machines démarrent ces jours-ci. Le premier marché visé, grâce à notre partenariat avec SEB, qui est à la fois notre investisseur et notre client, est le marché chinois. Nous produisons en France, avec une technologie brevetée – il y a sept familles de brevets protégées à l’international derrière cette technologie.
Ethera emploie vingt personnes et réalise un million d’euros de chiffre d’affaires. Si nous continuons sur notre lancée, nous en serons à trente ou quarante personnes et à quelques millions d’euros de chiffre d’affaires à la fin de l’année. C’est déjà une réussite, mais nous pouvons aller bien plus loin. À travers le CEA, le CNRS, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), nous avons une recherche académique de premier plan. Nous disposons d’un réseau de PME non négligeable dans ce secteur de la qualité de l’air – un représentant de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique (FIMEA) se trouve d’ailleurs dans la salle. Des outils et des associations se sont créés ; Ethera, le CEA et le CNRS ont créé un laboratoire commun sur cette technologie, ce qui double notre effort de R&D.
Un autre acteur important pour notre développement est Bpifrance. Nous montons actuellement un programme très ambitieux, SMARTY, qui regroupe cinq centres de recherche, le tissu de PME dont j’ai parlé, de grands industriels – SEB, Suez Environnement, Schneider – et bien entendu la plateforme de Crolles, pour continuer à développer ces capteurs. C’est en nous constituant en filière que nous pourrons nous dépasser. Sans SEB, jamais Ethera n’aurait pu aller en Chine. C’est la filière, qui va de la recherche amont aux PME, soutenues par les grands groupes industriels français qui s’intéressent à la qualité de l’air, qui nous permettra de réaliser à terme des centaines de millions d’euros de chiffres d’affaires à l’international et de créer des milliers d’emplois en France. Le mouvement est déjà engagé.
La recherche fondamentale en France est de grande qualité ; le dispositif d’aides également. Il faut bâtir cette filière. Enfin, la législation et la réglementation sont une aide importante pour les entreprises françaises. Si Ethera est née, c’est parce qu’il y a eu cette impulsion des politiques ; il ne faut pas s’arrêter là. Étendre les décrets à des technologies plus innovantes permettrait d’ailleurs à des start-up françaises de gagner des parts de marché en France et d’aller à l’international.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Les petits cubes dont vous avez parlé, sont-ils réversibles ?
M. Yves Bigay. Non, ils sont intégrés dans un épurateur composé de divers filtres qui doivent être changés régulièrement. Outre le filtre Ethera qui absorbe le formaldéhyde, il y a notamment du charbon actif contre les mauvaises odeurs et le filtre HEPA qui absorbe les bactéries. Cet ensemble doit être changé tous les six mois ou tous les ans. En tout état de cause, une bonne qualité de l’air repose sur une ventilation efficace, un appareil de mesures adéquat et un dispositif d’épuration, le tout devant être bien entretenu.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La vente de l’appareil n’est donc pas un acte sans lendemain ; elle ouvre, au contraire, un marché susceptible de se développer.
M. Jean-Yves Le Déaut. Place, maintenant, à la mise en perspective de cette première table ronde par M. Éric Quemeneur, directeur des programmes de recherche et des partenariats industriels du CEA.
M. Éric Quemeneur, directeur des programmes de recherche et des partenariats industriels du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Les trois exemples évoqués au cours de la table ronde illustrent des secteurs vastes et diversifiés. J’en tirerai une synthèse en dégageant les éléments communs pour tenter de définir des facteurs de succès de l’innovation sur le plan socio-économique.
De toute évidence, une conjonction de facteurs est nécessaire pour qu’une synergie entre l’industrie et la recherche conduise à l’explosion, ou du moins au développement rapide et intense, d’un marché. Il faut qu’elle intervienne au bon moment du temps scientifique – lorsque l’innovation est reconnue sur le plan scientifique, jouit d’un consensus international et peut trouver des applications – et lorsque la technologie qui la porte a gagné en maturité. C’est toute la question du technology readiness level et du manufacturing readiness level.
Mais l’innovation ne perce que si le marché, éventuellement stimulé par un récent changement normatif ou législatif, était déjà prêt à un changement d’attitude. Les usages et les comportements sont donc également un facteur à prendre en compte.
Une dynamique d’investissement doit enfin exister. La question des apports financiers et des retombées obtenues se pose avec une acuité particulière dans un secteur où le temps d’incubation est prolongé et la prise de risque particulièrement élevée. La réactivité est primordiale.
Les exemples l’ont montré, la rencontre d’une méthode scientifique, d’une technologie, d’une dynamique financière et d’un changement d’attitude des consommateurs se révèle fort opportune dans la réussite.
Le microbiote a bénéficié de la maturité de l’hologénomique, qui est devenue une discipline consensuelle. On comprend maintenant que la connaissance du génome humain n’a pas beaucoup de sens prédictif et médical si elle ne sert pas à raisonner sur l’hologénome d’un individu, de populations et d’écosystèmes. En sont issues la connaissance que la régulation de l’homéostasie microbienne est possible par la nutrition, la technologie de la métagénomique devenue relativement accessible à tous, et des perspectives pour la médecine préventive. Le biocontrôle a, pour sa part, bénéficié des travaux de recherche sur l’immunité végétale, avec des débouchés sur une microbiologie maîtrisée et une agriculture de précision grâce à la géolocalisation ou l’analyse chimique aux champs. Quant au capteur de polluants, il devra son développement à la maturité du champ des recherches sur les agents qui conditionnent l’évolution de la qualité de vie, et à la coordination de l’environnement réglementaire.
D’une manière générale, AllEnvi a identifié, à destination de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et des agences de financement, quatre ou cinq champs de recherche intégrés et transversaux.
D’abord, la recherche moléculaire doit s’ouvrir sur une perspective à la fois quantitative, holistique et intégrative. Il convient de marier l’expérimentation et la modélisation dès la conception des programmes de recherche. Les outils publics – observatoires, bioinformatique, investissements en calcul intensif, logiciels multi-échelles – puiseront un nouvel élan dans une telle approche.
L’interface entre la recherche et la réglementation doit également alimenter une recherche prénormative qui anticipe le changement de législation. La sociologie et l’économie savent, en outre, s’unir aux sciences dures pour dégager les évolutions clefs qui permettront d’envisager l’émergence d’un marché. Dans ces deux disciplines aussi, la recherche doit donc être préservée, pour vaincre la résistance au changement et favoriser la prise de risque dans les nouvelles technologies. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a tout son rôle à jouer ici.
Il faut aller au-delà d’une recherche centrée sur la précaution pour la connecter à la réalité technique et économique. Du dialogue renforcé entre recherche scientifique et établissements de conseil et d’évaluation, émergeront plus rapidement de nouvelles filières plus sûres, dans des domaines aussi divers que les matériaux de construction ou les pratiques médicales. À plus long terme, les initiatives seront issues de la prise de conscience du lien indissoluble entre la santé humaine, la santé animale et l’équilibre des écosystèmes. Finalement, ce que nous avons vu aujourd’hui est l’extrapolation des réflexions conduites il y a cinq ou six ans en matière d’antropo-zoonoses, lorsque s’imposait la formule « un monde, une santé ».
Au demeurant, autant l’intégration disciplinaire est facile à concevoir, autant sa mise en œuvre est difficile. Dans ces modèles intégrés, tout l’enjeu technique est de mesurer l’interdépendance entre les différentes couches pour en tirer des données productives.
Il faut que le monde de la recherche développe une vision opérationnelle de son activité. En analysant les effets qu’elle peut produire, il pourra s’orienter plus rapidement vers l’action. Ainsi, là où une dizaine d’années était nécessaire pour un développement complet quand un nouveau champ de recherche était découvert, les exemples de ce matin ont montré qu’un dialogue rapproché pouvait réduire ce délai à quelques années seulement.
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. J’apprécie que vous vous soyez efforcés de venir à deux pour assurer la parité dans la représentation de vos établissements. À l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, nous devons, quant à nous, composer avec les exigences d’une triple parité, entre les hommes et les femmes, entre l’Assemblée nationale et le Sénat et entre la droite et la gauche.
Pouvez-vous nous dire quels sont les freins que vous rencontrez dans le développement de votre activité ? Par exemple, ne serait-il pas possible d’accélérer le processus d’homologation ? Il me semble que le poids de l’administration le ralentit. J’entendais tout à l’heure qu’une autorisation de mise sur le marché peut prendre dix ans !
Dans le nouvel « écosystème » qui se met en place avec Bpifrance et d’autres organismes qui vous apportent de l’aide, n’hésitez pas à nous indiquer ce qui fonctionne bien et aussi, là encore, les freins que vous avez identifiés. C’est là où nous pouvons avoir une valeur ajoutée. Vous avez notamment évoqué le sujet de l’innovation ; sachez que l’OPECST a organisé, il y a un mois, une audition avec plusieurs personnalités pour réfléchir aux moyens de l’accélérer. Puisque vous avez choisi d’intervenir en binômes, dites-nous si le couple recherche/transfert de technologie fonctionne bien et s’il y a des améliorations à apporter. En tout cas, les disciplines qui ont été présentées ce matin étaient trois bonnes illustrations des sujets que nous avons abordés au niveau parlementaire.
M. Antoine Coutant, directeur général d’Agrauxine. Les dix ans nécessaires pour la mise sur le marché que vous évoquez incluent la constitution préalable du dossier. Son instruction a pris tout de même moins de temps. Il n’en reste pas moins que c’est un processus long, qui est plus rapide d’un ou deux ans aux États-Unis, ce qui constitue un avantage commercial non négligeable et un facteur de compétitivité important. Rien d’étonnant à ce que leur marché intérieur représente non moins de 60 % du marché mondial du biocontrôle.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Dans beaucoup des cas présentés ce matin, il n’est pas forcément besoin de norme nouvelle pour aller sur le marché. Les normes forment un cadre où le marché peut se développer ; elles n’interdisent pas d’y accéder. La question pour l’innovation en France est de trouver un marché, d’aller chercher des fonds pour passer à la commercialisation. Comme présidente directrice générale d’une petite société d’investissement pendant cinq années, j’ai constaté qu’il faut six commerciaux pour un technicien pour trouver sa place dans cette étape. Certes, la Banque publique d’investissement est une innovation formidable, mais le secteur bancaire privé pourrait également remplir ce rôle, s’il n’était aussi frileux.
Trop souvent, quand la norme existe, l’expérimentation dans certaines régions du territoire se heurte à des résistances, tant en France qu’en Europe, de manière générale. Aux États-Unis, il est possible de procéder du moins à des tests.
Mme Frédérique Clusel, directrice générale de Lesaffre Feed Additives. Œuvrant dans le secteur de la nutrition animale, je partage le point de vue selon lequel les entreprises ne peuvent pérenniser leur activité qu’en s’internationalisant d’elles-mêmes pour éviter le rachat par des firmes étrangères. Encore faudrait-il pourtant, dans mon secteur, que l’homologation soit plus facile à obtenir.
Se lancer ? C’est bien difficile dans le domaine de la santé animale où aucun test n’est possible sans autorisation préalable. Les administrations adoptent une approche trop normative. Chaque molécule doit être enregistrée. Même lorsqu’il s’agit de limiter les effets des antibiotiques grâce à de nouveaux extraits de levure, ces derniers doivent eux-mêmes être enregistrés. Sans conteste, les règles administratives constituent ici un frein.
M. Jean-Yves Le Déaut. Voulez-vous dire qu’on pourrait aller plus vite pour les autoriser ?
Mme Frédérique Clusel. Oui, si les administrations étaient plus à l’écoute en matière d’innovation. À cause de ce maudit principe de précaution, des produits plus sûrs que ceux qui existent déjà ne peuvent être lancés faute de réglementation les concernant. Le consortium de valorisation thématique (CVT) a-t-il un équivalent au niveau européen, qui pourrait accélérer l’enregistrement des produits pour favoriser l’innovation ?
M. Yves Bigay, président directeur général d’Ethera. Les décrets n’ont malheureusement qu’une portée unique. Ils ne désignent qu’une seule technologie, sans laisser la porte ouverte à de nouvelles technologies, même si elles sont plus efficaces et moins chères.
M. Jean-Yves Le Déaut. Il s’agit notamment d’un problème de méthode. Les commissions chargées de l’évaluation sont endogames. Des spécialistes de réglementation qui ont en commun le même cursus y travaillent entre eux. La commission en charge de votre secteur n’inclut aucun universitaire. Nous pâtissons de cette culture unique et avons besoin, au contraire, d’un métissage des cultures de travail pour évoluer.
Quant au principe de précaution, j’y ai consacré un rapport avec mon collègue Claude Birraux. Nous y réclamions que son champ et son périmètre fussent clairement définis.
Mais il existe aussi des blocages d’ordre culturel. L’innovation implique le changement, qui comporte lui-même une part de risque. Or l’aversion naturelle à ce dernier fige les comportements dans notre pays.
M. François Démarcq, directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Il existe deux natures différentes de réglementation. Répondant à un besoin de protection des populations, elle peut d’abord limiter l’activité ou lui imposer des garde-fous. Mais elle peut aussi susciter l’émergence de nouveaux produits. Si les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires n’avaient pas dû mesurer la qualité de l’air à l’intérieur de leurs locaux, le marché des appareils de mesure ne se serait pas développé.
Il faut réfléchir au moyen de faire évoluer la lettre de la réglementation de telle sorte qu’elle puisse prendre en compte l’innovation. La légistique doit ouvrir la porte aux innovations, en permettant à l’administration d’admettre qu’elles soient prises en compte quand elle interprète les textes.
M. François Houllier, président de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement (Allenvi), président directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Le Consortium de valorisation thématique a pour fonction de conduire des analyses stratégiques dans le domaine des produits et besoins émergents. Il évalue si l’investissement de la recherche publique est susceptible de rencontrer l’intérêt des industriels. Il n’est donc pas tourné vers la réglementation, quoiqu’il puisse en identifier par anticipation les lacunes. Sans apporter d’appui direct, il peut donc mettre en lumière des verrous potentiels.
M. Dusko Ehrlich, directeur de recherche à l’unité de recherche de génétique microbienne de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). La France s’affirme comme chef de file dans le développement de technologies environnementales. Mais comment transformer l’essai sur le plan industriel ? Les travaux sur les maladies chroniques pourraient être les piliers d’une nouvelle industrie, mais il faut des fonds publics pour qu’elle se développe. Aux États-Unis, le projet à l’origine de Human Longevity Inc. a bénéficié de millions de dollars.
M. Didier Andrivon, chef de département adjoint au département santé des plantes et environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Comme chercheur, je dirais que l’un des freins est sans doute le manque de sensibilisation. Certes, beaucoup de chercheurs font des découvertes qui ne perceront jamais comme des innovations, car il n’y aura pas de transfert vers un marché. Mais jusqu’où doit aller un institut public de recherche pour faire le lien avec l’industrie ? Les chercheurs ont souvent le sentiment d’être allés très en aval dans le développement des applications, alors que les partenaires industriels ont souvent l’impression qu’ils sont au contraire demeurés très en amont. Il faut trouver le moyen de faire se rencontrer plus facilement les mondes de la recherche et du développement, ce qui doit être, me semble-t-il, un des objectifs du CVT.
De même, un dialogue s’avère nécessaire entre les porteurs d’innovation et ceux qui édictent la réglementation. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ces derniers veulent brider l’innovation, qu’ils travaillent au niveau français, européen ou international. Simplement, ils doivent échanger avec le monde de la recherche. Des rencontres plus régulières entre industriels de l’innovation et rédacteurs de règlements sont nécessaires. Cela dit, sans le plan Ecophyto 2018, jamais le biocontrôle n’aurait vu le jour.
M. Pierre Bélichard, président directeur général d’Enterome. À quel moment industriels et chercheurs doivent-ils se rencontrer ? L’exemple du procédé breveté par Dusko Ehrlich est intéressant. Alors qu’il permet de détecter dans les selles du patient cinq espèces bactériennes l’identifiant comme obèse, ce procédé aurait pu devenir un outil de qPCR utilisé dans n’importe quel laboratoire. Or une simple balance remplit déjà la même fonction. En revanche, ces travaux ont pu servir à développer un test pour une compagnie d’assurance médicale américaine dont 60 % des clients sont obèses. Grâce aux résultats obtenus sur leur flore intestinale, elle peut définir ceux d’entre eux qui peuvent tirer profit d’un régime alimentaire médicalisé et ceux qui souffrent d’une pathologie génétique.
Quant aux instances réglementaires, je veux me faire l’écho de quelques récriminations contre l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Alors que c’est une pratique courante aux États-Unis, elle n’autorise pas le remboursement de compléments alimentaires. Dans la grille de lecture de la Food and Drug Administration, c’est, au contraire, une possibilité intégrée dès le départ.
Je ne veux pas, en revanche, m’attaquer à la réglementation. Les laboratoires Servier ont passé des années à essayer de s’y soustraire. Cela explique les mesures drastiques actuelles.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Dans les années 1990, la valorisation de la science pariait sur les royalties : un chercheur vendait son invention à des investisseurs en espérant un retour sous cette forme. Cela n’était pas toujours satisfaisant. Je me souviens ainsi du ministre de la recherche, Hubert Curien, particulièrement irrité parce que l’invention des cristaux liquides avait été vendue à une entreprise japonaise, faute d’entreprise française ou européenne intéressée. Aujourd’hui, la démarche est différente : le chercheur reste détenteur de son invention grâce à un brevet et à des licences d’exploitations ponctuelles. La concurrence met cependant à profit les trois années qui sont en moyenne nécessaires pour les obtenir.
Une rupture est nécessaire dans l’approche de l’innovation ; il faut la concevoir de manière innovante. Nous sommes à un tournant, face aux défis du XXIe siècle : vivre mieux, plus longtemps, en meilleure santé, en mangeant mieux et en étant plus heureux, le tout en faisant de l’argent. Reste à savoir comment il sera réparti. Je le dis de manière délibérément humoristique, mais il n’en reste pas moins que nous vivons un changement de sens.
SECONDE TABLE RONDE :
CONFLITS D’USAGE, RISQUES ET VULNÉRABILITÉ
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : LA GESTION DE L’EAU À TRAVERS LA CARACTÉRISATION D’UN HYDROSYSTÈME SOUTERRAIN
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Pour la géologue que je suis, ce sera un plaisir que d’écouter la première illustration de notre seconde table ronde : la gestion de l’eau et la caractérisation d’un hydro-système souterrain.
M. Patrick Lachassagne, responsable environnement et ressources en eau de Danone Eaux France. J’appartiens à la division Eaux du groupe Danone. Au risque de vous surprendre, ce que nous allons vous présenter avec M. Jean-Christophe Maréchal relève presque de l’artisanat par rapport aux précédentes interventions. C’est peut-être parce que nous n’avons pas vocation à vendre directement au consommateur les produits que nous développons ensemble, mais plutôt à utiliser des méthodologies servant à l’industriel ; le nombre de clients potentiels est donc plus limité.
En France, Danone gère, protège et embouteille les eaux provenant des quatre sources Évian, Volvic, Badoit et la Salvetat. Notre pays est le premier exportateur mondial d’eau minérale naturelle (EMN), avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 milliards d’euros, soit 2 % à 3 % du chiffre d’affaires de son industrie agro-alimentaire. L’EMN représente environ 10 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects, sans compter l’activité thermale. Surtout, elle participe au dynamisme et à l’activité de régions peu dotées du point de vue de l’emploi et de l’industrie, étant généralement exploitée dans des régions de montagne ou rurales, où cette exploitation constitue souvent la seule activité industrielle. Enfin, il faut noter que la ressource est non délocalisable.
Pour autant, le groupe Danone est présent dans le monde entier. En effet, nous avons non seulement un business model d’eaux produites en France, qui sont largement exportées dans le monde, mais aussi un modèle d’eaux produites dans les pays, notamment les pays émergents, destinée à l’alimentation en eau de qualité de ces pays.
Nous exploitons une ressource en eau naturelle, qui fait partie intégrante du cycle de l’eau. Contrairement à un gisement d’hydrocarbures ou à un gisement minier qu’il s’agirait d’exploiter jusqu’à épuisement, cette ressource en eau doit être exploitée selon les règles du développement durable. Certes, l’eau met du temps à s’infiltrer, à descendre dans le réservoir souterrain, à remonter vers la surface et à être captée ; si on la gère de manière inconsidérée, on risque de « surexploiter » la ressource et de rendre notre business non durable. Nous avons donc besoin d’évaluer avec précision cette ressource en eau, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif – il faut s’assurer de la préservation de la qualité de la ressource à long terme.
Nous avons évoqué tout à l’heure une agriculture de précision ; nous devons ici entrer dans une gestion de précision d’une ressource naturelle. Cela va être utile à l’industriel pour la gestion « au quotidien » de l’eau disponible pour l’embouteillage, qui permet d’adapter l’outil industriel et l’emploi à la ressource dans une optique de rationalisation des coûts. Cela répond aussi à un objectif de gestion de la croissance – il faut continuer à montrer à nos actionnaires que nous allons gagner de l’argent, ce qui suppose de garantir la ressource qui nous permettra d’assurer cette croissance à moyen ou long terme. Nous parlons généralement de trois ou cinq ans, car c’est l’échéance de nos plans stratégiques ; mais en tant qu’hydrogéologue, je m’emploie à convaincre mes collègues qu’il faut raisonner et investir à plus long terme.
Notre activité étant très encadrée sur le plan réglementaire, nous avons aussi une tâche d’information de l’administration, pour lui montrer que nous faisons bien notre travail.
Nous avons besoin d’outils adaptés à la complexité des réservoirs souterrains d’eau minérale. Ces outils doivent avoir des fonctionnalités similaires à celles développées pour les ressources en eau « classique », en termes de quantité comme en termes de qualité. Néanmoins, les hydrosystèmes dont il s’agit sont beaucoup plus complexes, et nous peinons à trouver ce type d’outils « sur étagère » dans les bureaux d’études classiques. Nous nous adressons donc à des instituts de recherche, tant en France qu’à l’international, sachant que nous n’avons pas seulement besoin de l’outil, mais aussi du savoir-faire qui permet de s’assurer que celui-ci est bien « calé » ou adapté au système. Cela requiert une approche multidisciplinaire, qui nécessite de faire appel, au sein même des sciences du sol et du sous-sol, à des spécialistes de disciplines très variées afin de pouvoir disposer d’outils à la pointe du développement académique. C’est ce qui nous conduit à ces interactions entre industriels et chercheurs.
M. Jean-Christophe Maréchal, responsable de l’unité Nouvelles Ressources en eau et Économie du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Le BRGM a cherché à améliorer la prévision qui peut être faite dans la gestion d’un gisement d’eau minérale naturelle. Il s’agit de passer d’une conceptualisation mentale du gisement, schématisée par une boule de cristal, dans laquelle l’exploitant a une vision assez empirique du gisement – il constate que lorsqu’il pompe plus dans une partie de celui-ci pour augmenter la production, le niveau de l’eau baisse –, à un modèle numérique capable de simuler le cycle de l’eau, et plus précisément ce gisement d’eau minérale naturelle.
Pour cela, nous allons mettre en œuvre trois étapes fondamentales : la compréhension des processus naturels au sein du gisement, l’élaboration d’un modèle conceptuel de son fonctionnement et de ses réactions aux sollicitations extérieures – pompages, pluie – et, enfin, le développement du modèle numérique, qui est la principale attente de l’industriel pour optimiser la gestion de son réservoir.
La première étape consiste à acquérir et à traiter des données. L’exploitant s’intéresse essentiellement à deux aspects. L’un est la qualité de l’eau, qui figure ici sur l’étiquette de la Salvetat – teneur en sels minéraux, en sodium, en potassium, en calcium ou en bicarbonates. Il s’agit d’une eau carbogazeuse naturelle, dont la composition fait toute la spécificité et la richesse. Pour comprendre d’où provient cette minéralisation, différentes techniques sont mises en œuvre, par exemple le forage, pour identifier le type de roche, la fracturation et la circulation de l’eau au sein du réservoir. Des analyses au microscope permettent ensuite d’identifier les minéraux qui interagissent avec l’eau et lui donnent ses caractéristiques spécifiques.
La seconde préoccupation de l’industriel concerne la quantité, c’est-à-dire le nombre de bouteilles qu’il peut produire. Environ 20 mètres cubes par heure correspondent à 20 000 bouteilles par heure ; si on arrive à augmenter ce débit, les gains seront plus importants, mais il faut veiller à préserver le gisement sur le long terme, en termes de quantité comme de qualité.
Pour mieux comprendre le fonctionnement du gisement, des pompages d’essai sont effectués dans le forage à différents niveaux de débit afin d’observer sa réaction. De nombreuses informations sont ainsi recueillies sur la capacité du gisement. Des techniques d’interprétation issues de l’industrie pétrolière fournissent également des informations sur la géométrie de ce gisement et sur son extension, ce qui est très important du point de vue de sa vulnérabilité et de sa protection. Je vous ai schématisé seulement deux techniques, mais nous utilisons également d’autres méthodes comme le traitement du signal pour faire la part des différentes composantes qui peuvent impacter le comportement du gisement en termes de quantité et de qualité.
La deuxième étape consiste à confronter les résultats de cette approche pluridisciplinaire. L’adjectif est important, car c’est l’une des raisons pour lesquelles Danone Eaux France fait appel à un établissement public de recherche tel que le BRGM : nous pouvons mobiliser les compétences de géologues, de géophysiciens, d’hydro-chimistes, d’hydrogéologues et de modélisateurs, bref l’ensemble des disciplines nécessaires à l’élaboration de l’outil de gestion final.
Sur une coupe verticale du gisement de la Salvetat, se trouve, au Nord, le lac de la Raviège, lac de barrage d’EDF, qui influe indirectement sur le gisement à travers la gestion du niveau d’eau par EDF. Deux zones de fracture représentent les vecteurs de remontée du gaz carbonique qui vient de la profondeur et se mélange avec l’eau, laquelle est ensuite captée par les forages. Une partie des eaux de ruissellement atteint le lac de la Raviège, tandis que l’autre partie s’infiltre très lentement et « recharge » régulièrement le gisement. C’est au sein de ces roches que l’eau minérale acquiert sa minéralisation finale, qui est extrêmement intéressante.
La troisième et dernière étape consiste à caler et à tester le modèle numérique pour s’assurer qu’il est fidèle à la réalité. Nous l’intégrons dans l’ordinateur en simulant toutes les équations de la physique, des écoulements souterrains, mais aussi de la chimie et de l’interaction entre l’eau et les roches, pour les résoudre à chaque étape de la gestion du système. Nous allons ensuite le caler, c’est-à-dire nous assurer qu’il représente correctement la réalité. Je vous présente ici les mesures de niveau d’eau dans un forage comparées à celles simulées par le modèle : on constate que celui-ci représente la réalité de façon relativement satisfaisante. La difficulté majeure est que la nature est souvent compliquée, alors que nos modèles sont très simples, voire simplistes. Mais une fois calibré, le modèle peut être utilisé pour tester des scénarios de pompage, voire de changement climatique, ce qui permettra à Danone d’optimiser la gestion de son gisement.
Pour l’industriel, cette démarche est un moyen d’accroître sa compétitivité, tant en France qu’à l’international. Le dernier forage réalisé pour la Salvetat va ainsi permettre d’augmenter la production. En termes de communication et de publications scientifiques, ces résultats sont valorisés dans des revues internationales.
Pour nous, c’est l’opportunité de constituer, en complément des systèmes d’observation et d’expérimentation pour la recherche en environnement (SOERE), des jeux de données exceptionnels. L’eau souterraine est mal connue ; il faut procéder à des forages coûteux pour avoir de l’information. Nous pouvons ici tester et développer de nouveaux outils en vraie grandeur sur des sites exceptionnels. En outre, le BRGM est un établissement public industriel et commercial (EPIC) : la recherche sous contrat avec des industriels fait partie de ses missions. La bonne entente avec l’industriel est évidemment un prérequis. Dans le cas présent, elle a été facilitée par le fait que M. Patrick Lachassagne est un spécialiste de notre domaine.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Élue de Montpellier, je connais bien la Salvetat et le lac de la Raviège. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous féliciter pour la qualité de la publicité pour la Salvetat. L’accent est un tantinet parisien, mais elle est très réussie !
M. Patrick Lachassagne. Je le dis tous les jours à mes collègues du marketing.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Nous en venons à la seconde illustration de cette table ronde : la gestion du risque inondation et la chaîne d’information sur les crues éclairs RHYTMME.
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : GESTION DU RISQUE INONDATION, CHAÎNE D’INFORMATION SUR CRUES ÉCLAIRS RHYTMME
M. Patrice Mériaux, ingénieur-chercheur à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). Avant de commencer mon intervention, je tiens à préciser que M. Frédéric Atger, de Météo France Aix-en- Provence, pilote du projet, est présent dans la salle.
En tant que chercheur, je contribue au projet RHYTMME – Risques Hydrométéorologiques en Territoires de Montagnes et Méditerranéens – depuis sept ans. Ce projet ne traite pas seulement du risque inondation, mais c’est sur celui-ci que nous concentrerons notre propos, puisque la vocation de RHYTMME est d’anticiper ce type de risque. L’objectif du projet est de permettre aux collectivités territoriales et aux services de l’État de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de mieux anticiper les risques liés aux précipitations, ou risques hydrométéorologiques.
Ce projet comporte deux volets. Un volet équipement, d’abord, qui vise à améliorer la mesure des pluies en tout point du territoire, notamment en montagne, c’est-à-dire dans les Alpes du Sud pour ce qui concerne notre région. Ce volet s’est concrétisé par le déploiement de trois radars hydrométéorologiques de nouvelle technologie dans les Alpes du Sud. Un volet recherche et développement, ensuite, qui a débouché sur la création d’une plateforme web de services et de cartes d’avertissement en temps réel des risques. La R&D a porté sur le traitement du signal radar, tâche dont se sont acquittées les équipes de Météo France, et sur la modélisation dynamique et cartographique à haute résolution des aléas, réalisée par l’IRSTEA. Ce projet de R&D relève du contrat de projet État-région (CPER) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2007-2013, qui se poursuivra en fait jusqu’en 2015. Il est porté par Météo France et l’IRSTEA et cofinancé par le conseil régional, représenté ici par M. Hervé Champion, l’Union européenne et le ministère en charge de l’écologie.
Les aléas que RHYTMME vise à anticiper sont ceux liés aux précipitations, que ce soit en excès ou en défaut, sous forme liquide comme la pluie ou sous forme solide comme la neige. Mon propos ne s’intéressera qu’aux crues éclairs, mais la plateforme traite aussi des aléas spécifiques à la montagne que sont les crues torrentielles, glissements de terrain ou chutes de blocs. Les quelque mille communes de la région sont toutes concernées par au moins un de ces aléas, et une centaine, en zone de montagne, le sont par tous.
J’en viens à l’état d’avancement du volet équipements radar. Les cartes que je vous présente montrent l’état de la couverture radar – il s’agit d’une modélisation de la visibilité radar, donc de la capacité à mesurer la pluie avec ces technologies – dans le quart sud-est de la France avant le projet et depuis l’installation des trois radars. Vous constatez que nous avons désormais une bonne couverture sur l’ensemble de la région.
L’illustration vous montre le principe du radar : ce sont les gouttes de pluie qui sont visées. Il existe une difficulté dans le traitement du signal, puisque c’est la pluie arrivée au sol qui nous intéresse : nous avons un gros travail à faire entre le retour du radar sur une goutte de pluie et l’estimation de la pluie arrivée au sol.
Vous pouvez voir sur les copies d’écran de la plateforme RHYTMME que nous mettons à la disposition des utilisateurs des informations sur les niveaux d’aléas en temps réel, avec un renouvellement tous les quarts d’heure et à l’échelle du kilomètre carré – ici, une illustration des quantités de pluie mesurées sur l’agglomération de Nice lors d’un événement pluviométrique de type orageux survenu le 15 septembre dernier. Nous fournissons à la fois une qualification en termes de quantités, c’est-à-dire en millimètres d’eau sur six heures, et une qualification en termes de durée de retour, qui exprime l’intensité, cinquante ans correspondant à l’intensité la plus forte.
Nous produisons le même type de cartes pour plus de 1 700 cours d’eau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui sont « surveillés » en temps réel, avec une information renouvelée tous les quarts d’heure : nos modèles numériques estiment en temps réel le débit sur chacun de ces cours d’eau à partir de la mesure de la pluie, et traduisent ce débit en durée de retour. La plateforme RHYTMME est donc un outil d’anticipation des crues éclairs pour la gestion de crise et de post-crise. Elle nous permet de remonter de quatre à cinq jours dans le temps. Après un événement, il peut être intéressant – notamment pour les gestionnaires d’infrastructures – d’identifier les endroits où des dégâts sont à déplorer.
Enfin, RHYTMME a son « fan-club » d’expérimentateurs, qui nous a permis de raccourcir le chemin de l’innovation. Nous avons intégré les expérimentateurs au projet de recherche dès novembre 2011, à trois ans du démarrage du projet ; les résultats valorisables ont été mis à la disposition d’un groupe d’expérimentateurs qui compte une quarantaine de structures – collectivités locales de montagne, syndicats de rivière – et dont les missions sont de tester « en situation » les services de la plateforme, de participer aux retours d’expérience et de contribuer à la démarche d’amélioration continue de l’outil. Originalité du projet RHYTMME, ce club permet de l’ancrer dans l’opérationnel.
M. Hervé Champion, chargé de mission au service des risques naturels majeurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Les organisateurs de cette journée m’ont demandé de témoigner de l’utilité économique et sociale du projet RHYTMME. Mon intervention tournera autour de la décision publique en matière de risque. Je commencerai donc par cette image d’arbres couchés par une avalanche dans une très haute vallée, la vallée du Queyras, que j’ai intitulée « Faut-il agir ? ». En l’absence d’enjeu visible, il n’y a, a priori, pas de raison d’agir, en tout cas d’intervenir avec de l’argent public. Bien entendu, ce n’est pas le cas : les arbres couchés par l’avalanche se retrouvent au fond d’un torrent et menacent un village en aval à cause du risque d’embâcle, qui verrait les arbres boucher le torrent lors d’une crue puis relâcher l’eau d’un coup.
La décision d’agir a donc été prise. Reste à savoir à quel prix. La question n’est pas que financière : agir exige aussi de mobiliser des compétences importantes là où les ressources sont rares, puisque nous sommes en zone de montagne, ainsi que des financeurs. Dans ce cas précis, le coût de l’intervention s’élève à 400 000 euros.
Ce que je souhaitais montrer, c’est que cet événement découle en fait d’une succession de décisions publiques. Le village de Ristolas est installé sur un cône torrentiel. Des travaux ont été réalisés à la fin du XIXe siècle dans le cadre de la politique dite de restauration des terrains de montagne, devenue un service de l’Office national des forêts (ONF), pour éviter de trop grandes érosions dans ces zones de montagne à une époque marquée par la surpopulation et le surpâturage. En 1956, une grande crue s’est produite dans le Queyras ; de gros investissements publics ont alors été consentis pour canaliser le Guil et protéger le village des crues – d’où le site où a eu lieu l’avalanche en 2008 et la nécessité d’enlever ces arbres.
En matière de décisions publiques sur les risques, les retours en arrière ne sont pas toujours possibles. Voyez cette courbe établie par la Direction départementale des territoires (DDT), qui a cherché à dénombrer les constructions d’habitations en zone rouge dans les Hautes-Alpes. Vous constatez que nous sommes face à un stock d’enjeux en zone de danger, qu’il va falloir gérer. C’est en ce sens que le projet RHYTMME s’insère dans cette problématique de la décision publique. En effet, la tendance est aujourd’hui à envisager la question des risques naturels sur toute la chaîne de responsabilité, de l’information du public jusqu’à la prévision, qui est l’objet de RHYTMME, en passant par les ouvrages et l’intervention post-crise.
RHYTMME s’est révélé être un projet créateur d’opportunités. Il y a, bien sûr, le club d’expérimentateurs, qui a d’abord été rejoint par la direction de l’ingénierie de la SNCF, dont le propre projet est venu tout naturellement s’intégrer à RHYTMME et qui travaille à l’horizon 2050. Il faut savoir que tous les acteurs qui investissent à plus de cinquante ans travaillent sur le changement climatique. Ce n’est pas seulement l’alerte qui intéresse la SNCF dans le projet RHYTMME, mais la perspective de pouvoir mieux préparer les visites de maintenance et de ne pas sur-dimensionner les ouvrages – pratique courante en raison du peu d’informations dont nous disposions jusqu’ici sur les zones de montagne.
D’autres acteurs plus petits, comme le syndicat mixte d’aménagement de la Bléone, rivière des Alpes de Haute-Provence, ont aussi rejoint le club d’expérimentateurs, leurs compétences dans le domaine du risque inondation ayant considérablement évolué sur la durée du projet. Il faut y ajouter ceux qui visent l’amélioration continue des dispositions réglementaires. Je pense à la gestion de l’alerte « crue » sur les campings des Hautes-Alpes, souvent implantés en bord de rivière.
Enfin, des décisions publiques ont exploité le projet RHYTMME. Suite à la tempête Xynthia et aux inondations du Var en 2010, le ministère a décidé de mettre en place pour les collectivités une « information pluie intense ». Cela n’aurait pas été possible sans les radars dont nous avons parlé.
J’en viens aux perspectives et aux développements possibles aujourd’hui. La dynamique de RHYTMME rejoint celle impulsée dans les orientations de la stratégie régionale de l’innovation portée par la région, en réponse aux demandes de la Commission européenne, pour pouvoir bénéficier de crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER). La région a identifié un domaine d’activité stratégique – risques, sécurité, sûreté – dans lequel s’intègre parfaitement le projet RHYTMME. Nous avons, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, un pôle de compétitivité « gestion des risques et vulnérabilité des territoires », auquel s’ajoutent les pôles régionaux d’innovation et de développement économique solidaire (PRIDES).
À certains établissements publics, je veux dire que, parmi les perspectives possibles, il y a une Agence nationale pour le patrimoine immatériel de l’État. Il est tout de même étonnant que les brevets et les recherches qu’ils effectuent ne soient pas toujours portés dans leurs actifs immatériels.
Les régions ont une obsession, le maintien des compétences de recherche sur le territoire, et un objectif, territorialiser la recherche. À plus long terme, notre objectif politique est le maintien de la solidarité régionale et nationale envers les zones de montagne. Nous ne pouvons plus continuer à investir sur des ouvrages. À titre d’exemple, le coût d’un kilomètre de route exposé est de 640 000 euros. Parmi les perspectives, il y a aussi ce que nous appelons « monitorer » le territoire. Enfin, ce projet nous permettra peut-être d’identifier les signaux faibles du changement climatique. La vulnérabilité a tellement augmenté que le problème est moins le changement climatique que la construction et le stock d’habitations en zone rouge. Nous ne verrons pas venir les effets du changement climatique, car ils sont masqués par le reste.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vice-présidente du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, je tiens à saluer la technicité des services des régions. On pense souvent qu’il y a une certaine distance intellectuelle entre les services de l’État et ceux des régions ; vous venez de nous prouver qu’elle n’est pas si grande.
Il revient maintenant à M. Patrick Vincent de mettre en perspective les illustrations présentées au cours de ce tour de table.
M. Patrick Vincent, directeur général délégué de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). Je résumerai les enjeux du débat sur les conflits d’usage, le risque et la vulnérabilité en signalant d’abord qu’il s’agit d’identifier les potentiels de recherche et de transfert dans ce domaine. Puisque celui-ci recoupe les quatre défis sociétaux évoqués par François Houllier, il faut, à l’instar d’AllEnvi, l’aborder de manière transversale, en s’appuyant sur une méthodologie articulée autour de trois axes : observation, modélisation et prévision.
L’étude du littoral constitue, dans cette optique, un point de départ pertinent pour définir les notions d’aléa, d’enjeu, de risque et de vulnérabilité. En effet, se concentrent dans ce type de zone l’ensemble des problématiques qui nous intéressent : villes et population, bassins versants et pollution, industrialisation, conflits d’usage, zones portuaires. La population et les biens présents sur le littoral sont exposés non seulement aux aléas technologiques mais à des aléas naturels très spécifiques, comme l’érosion marine, ce qui explique que les arrêtés de catastrophe naturelle y soient plus nombreux que dans la moyenne des communes continentales, et ce qui fait du littoral une zone où il est possible d’appréhender dans sa globalité la question des risques naturels et industriels.
Une fois le constat dressé, il convient d’élaborer un agenda stratégique de recherche dans le domaine des risques et de la vulnérabilité, qui implique les acteurs à la fois de la recherche, du monde économique et de la société civile.
La transversalité s’applique au climat et à la question des interactions entre le changement climatique et les risques naturels. Les programmes européens comme Copernicus développent déjà des services climatiques, dit services de base, voués à être déclinés en aval en services plus ponctuels et plus pointus à destination des industries.
Elle s’applique également dans le domaine de la biodiversité, à l’étude des effets anthropiques, et enfin dans le domaine de l’eau, où l’on a vu précédemment quels processus de valorisation des connaissances étaient à l’œuvre et comment pouvait s’opérer leur transfert vers les entreprises ou les acteurs publics. J’insiste ici sur le rôle des instituts Carnot qui permettent au BRGM ou à l’IFREMER de développer, en lien avec l’industrie, toute une série d’innovations environnementales.
Cette articulation entre le développement technologique et les services concerne d’autres domaines comme celui des risques liés aux substances toxiques, où l’approche moléculaire va permettre de développer des nouvelles méthodes d’analyse dont pourront se saisir les développeurs industriels puis les laboratoires d’analyse. Citons enfin le domaine des risques biologiques et des maladies infectieuses émergentes, des risques sanitaires et des risques liés aux agents physiques non ionisants, des risques enfin liés à l’exploitation des ressources naturelles continentales et marines. Dans ce dernier cas, il est primordial que les filières assises sur cette exploitation – qu’il s’agisse des énergies marines renouvelables ou des ressources minérales profondes – aient un caractère durable pour l’environnement et la biodiversité. C’est la raison pour laquelle le CNRS et l’IFREMER ont développé, pour le compte du ministère de l’écologie, une expertise conjointe qui devrait servir de base à une réglementation future.
La mise en place d’un agenda stratégique de recherche doit permettre de mobiliser en faveur de l’innovation, non seulement les équipes de recherche, mais également des équipes d’industriels. C’est dans cette perspective que se développent des start up comme Altamira Information, qui œuvre dans le domaine de l’imagerie radar afin d’assurer le suivi et la prévention des risques géologiques.
Dans un domaine plus inattendu, celui de la protection du patrimoine culturel, l’innovation permet également de mitiger les risques qui menacent les monuments historiques ; c’est moins l’usage économique que l’usage sociétal de la recherche qui est ici mis en valeur. Cela m’amène à souligner combien il est primordial d’appréhender la dimension sociétale du risque, ce qui implique de développer l’expertise pour une meilleure gestion des risques dans des disciplines aussi diverses que la science de la décision et le management du risque, la communication et le droit.
J’évoquerai, pour conclure, un ultime domaine dans lequel nous disposons d’un potentiel de recherche et d’innovation majeur pour la prévention des risques et de la vulnérabilité : il s’agit de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et de toutes les techniques d’ingénierie écologique qui y sont liées. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, gardons à l’esprit les trois axes que j’évoquais au début de mon propos : l’observation, susceptible de se traduire en termes de développements technologiques, puis la modélisation et la prévision, que l’on valorisera sous la forme de services.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Nous sommes un drôle de pays : conscients des enjeux, disposant des connaissances nécessaires et d’un potentiel énorme, nous sommes pourtant incapables de traduire ces atouts en valeur économique ou d’en tirer une réglementation adaptée. La région PACA a beau avoir mis en place des radars pour mieux appréhender les crues et les inondations, Danone a beau avoir accompli avec le BRGM un travail remarquable pour qualifier sa ressource, la sécuriser et l’exploiter au mieux dans le respect de l’environnement, ces prémices exigeantes n’aboutissent souvent qu’au renoncement.
Sans doute est-ce qu’en amont des conflits d’usage se jouent des conflits sur la validité des connaissances des uns et des autres et sur la légitimité de leur opposabilité au tiers. Car toute la question est là : qui est responsable in fine ? Qui paiera in fine ? Et les subtilités du droit sont sans limite lorsqu’il s’agit d’identifier celui qui n’a pas dit, celui qui n’a pas fait, celui qui n’a pas averti, celui qui n’a pas prédit, celui qui a informé mais n’a pas été écouté…
Dans les années 1980, on parlait déjà des modèles numériques de terrain, et les collectivités disposaient déjà de cartes topographiques et de données hydrographiques concernant les VRD, les sources et les points d’eau. L’accélération de la numérisation et le développement d’Internet qui les rend accessibles au plus grand nombre n’ont guère modifié l’utilisation que l’on fait de ces outils. Les maires des petites communes restent seuls face à leurs responsabilités, contraints de choisir entre le développement économique et l’exode rural. On a appréhendé l’espace naturel comme un nouvel espace récréatif où développer une nouvelle économie du tourisme, puissante et performante, mais cela s’est fait sans que s’organise pertinemment l’imbrication entre les différents niveaux de la puissance publique ; et notre pays souffre, depuis trente ans, de l’absence d’un tissu intermédiaire entre, au sommet, les décideurs et, à la base, les petits opérateurs locaux.
M. François Démarcq. Il faut évidemment intégrer les aspects économiques dans les stratégies de gestion des risques, mais il faut distinguer économie et innovation. L’économie du tourisme en montagne n’est pas nécessairement très innovante et, en la matière, la question de la gestion du risque se traduit, assez classiquement, en termes de prise de responsabilité des uns et des autres. Certes, nous sommes un pays assez « sécuritaire », mais je ne pense pas que nous ayons à nous en plaindre, car les catastrophes coûtent très cher.
La vraie question est de savoir en quoi le besoin social de sécurité peut, au-delà des réglementations qu’il engendre, produire de l’innovation, faire progresser la métrologie et les techniques de simulations, déboucher sur une offre nouvelle de services. En d’autres termes, comment faire d’une contrainte un atout ?
M. Jean-Marc Bournigal, président de l’IRSTEA. On peut, en effet, s’étonner du décalage qui existe entre les connaissances acquises et les principes d’action retenus. Cette question sous-tend toute la réflexion sur les priorités que se donnent aujourd’hui les établissements de recherche, qui s’interrogent sur la manière d’aller au-delà des connaissances acquises sur les aléas, leurs impacts et les mesures de gestion opérationnelle vers la notion de vulnérabilité des systèmes intégrant les dimensions socio-économiques.
En matière de risques naturels, les recherches menées ont permis la mise en place de systèmes de prévision et d’alerte relativement performants, qui améliorent la gestion des aléas et ont permis de sauver des vies. L’objectif maintenant est de passer de la gestion des aléas à une vision plus intégrée de vulnérabilité qui devrait permettre d’en tirer les conséquences en termes de gouvernance et de décision impactant le développement des territoires. C’est un exercice rendu possible aujourd’hui grâce aux avancées en matière de gestion de systèmes complexes, qui mobilisent un faisceau de technologies et de connaissances, mettant clairement en lumière le fait que la recherche environnementale est aujourd’hui caractérisée par une forte pluridisciplinarité qui intègre les sciences humaines et sociales : ce sont elles qui permettent , au-delà des capacités de modélisation des impacts physiques liés aux risques naturels, de prendre en compte, notamment les impacts socio-économiques, l’acceptabilité sociale qui sont déterminant pour le choix et la mise en œuvre effective des principes d’action dans les territoires. En montagne, par exemple, la reconversion des petites stations de ski qui s’étaient développées sur un modèle unitaire concurrentiel oblige à repenser les modèles économiques dans une vision territoriale large – on parle désormais de parcs naturels, de massif – remettant en question non seulement les modalités d’investissement, d’évolutions des activités mais aussi les systèmes de gouvernance.
Anne-Yvonne Le Dain. Je m’étonne qu’il n’existe pas, en France, de grands bureaux d’études qui aient l’envergure d’opérateurs nationaux ou mondiaux. Les chercheurs transmettent leur savoir à des étudiants qui, pour certains, resteront dans le domaine de la recherche mais qui, pour la plupart, deviendront des acteurs économiques. Il est essentiel de ne pas perdre de vue, dans ce circuit de la connaissance, que la création de valeur ajoutée doit profiter à l’économie de notre pays.
M. François Démarcq. Il ne faut pas oublier les pouvoirs publics, qui sont un acteur important de ce circuit. Le risque est, en effet, au cœur d’un certain nombre de politiques publiques. Il est donc essentiel de disposer d’acteurs bien formés si l’on veut assurer la protection des populations dans les meilleures conditions économiques possibles.
L’idéal serait d’exporter notre expertise et nos bonnes pratiques, ainsi que s’y efforce le BRGM, mais les politiques publiques ont souvent une forte dimension nationale et, par ailleurs, les crédits sont aussi rares à l’étranger que chez nous. Je précise néanmoins que certains grands bureaux d’études français ont une bonne implantation internationale et qu’ils pourraient aider les organismes publics de recherche à diffuser et à faire rayonner notre expertise sur ces thématiques à l’échelle internationale.
M. Patrick Lachassagne, responsable environnement et ressources en eau de Danone Eaux France. L’industriel d’envergure mondiale que je représente est sensible à ce qui vient d’être dit. Contraints de travailler de manière assez artisanale avec des interlocuteurs locaux ou nationaux, nous serions preneurs de toute solution nous permettant d’étendre un certain nombre de bonnes pratiques à l’ensemble de nos sources dans le monde, et nous ne manquerions pas d’être intéressés par une offre de services alliant l’expertise fournie par les laboratoires de recherche à l’opérationnalité d’un bureau d’études.
M. Jean-Marc Bournigal. Si je suis d’accord sur la nécessité de renforcer les synergies entre organismes publics et bureaux d’études, je rappelle que nous parlons ici d’un domaine dans lequel le poids de l’ingénierie publique est extrêmement important. Or les réformes récentes ont bouleversé les processus de transfert traditionnels ; l’ingénierie publique a subi de fortes restructurations sans que ni les collectivités territoriales, d’une part, ni les bureaux d’études, d’autre part, disposent de toutes les compétences pour se substituer aux anciens acteurs.
Restaurer ces processus de transfert est l’un des défis que nous avons à relever. C’est également un enjeu économique car nous avons, en France, de grandes entreprises de dimension internationale, comme Danone, Veolia ou Suez et des grands bureaux d’études, qui, dans le domaine de l’eau, valorisent à l’étranger le modèle de développement français fondé sur un savoir-faire collectif. Face au changement climatique et à la nécessité de mettre en place des plans d’adaptation, nous devons travailler sur le glissement de perspective de la gestion des aléas à la vulnérabilité : c’est un champ où nous devrions pouvoir capitaliser davantage qu’on ne le fait aujourd’hui.
M. Patrick Lachassagne. Vous venez d’évoquer les majors de l’eau et la manière dont elles ont su accomplir leur transition. C’est vrai pour ce qui concerne la partie « émergée » du processus. En ce qui concerne l’acheminement des ressources souterraines vers la surface, le transfert des savoirs et des compétences de haut niveau entre chercheurs et acteurs opérationnels est loin d’être abouti.
DEUXIÈME PARTIE :
LA CONTRIBUTION À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Nous reprenons nos travaux après une matinée particulièrement riche, durant laquelle nous avons été dans l’interaction, ce qui n’est pas si courant. N’hésitez pas à être proactifs, voire décapants ! Cela peut aider le législateur…
Ce matin, nous avons réfléchi à l’impact de la recherche environnementale sur la société : l’impact potentiel, l’impact souhaité, et la manière dont cette recherche peut s’articuler avec le monde de l’entreprise afin que les étudiants, de la licence au doctorat, puissent trouver leur voie – car il existe dans ce secteur un fort potentiel d’emplois.
Cet après-midi, nous allons examiner comment la recherche peut contribuer à la préservation de l’environnement. J’aurai pour ma part toujours le souci qu’au bout du compte, il y ait non seulement des transformations, mais des créations nettes d’emplois. La préservation de l’environnement et de la biodiversité, de la molécule à l’écosystème, sont potentiellement des sources de développement économique : on le voit bien avec le débat sur la transition énergétique. Mais si c’est bien de le dire, ce serait mieux de le faire !
La première table ronde portera sur : « Biodiversité et écosystèmes » – sujet difficile, et stratégique. La semaine dernière, à la Commission du développement durable, nous avons examiné en première lecture le projet de loi relatif à la biodiversité. Il a été décidé de créer un Comité national de la biodiversité et un Conseil national de protection de la nature ; eh bien, pour l’instant, il est prévu que les institutions soient représentées dans le premier et les scientifiques dans le second ! On sent sourdre de la population française, et surtout de ses élites, qu’elles soient politiques, institutionnelles ou médiatiques, une inquiétude sur les questions environnementales, scientifiques et sanitaires. Pourtant, avec l’énergie, l’environnement, l’eau, la biodiversité, avec la perspective d’utiliser de nouvelles techniques, de nouveaux procédés, de nouvelles molécules, de nouveaux indicateurs, s’ouvre un vaste champ de développement économique, et donc d’emplois pour le XXIe siècle – mais si c’était pour demain, ce serait encore mieux. Car nos jeunes sont là : ils attendent, ils espèrent et ils combattent – beaucoup créent des start-up.
J’espère que ce propos un peu piquant permettra de lancer le débat. En attendant, je donne la parole aux intervenants de la première table ronde, en rappelant que le thème comprendra deux illustrations, chacune faisant l’objet de deux témoignages, l’un provenant du monde de la recherche, l’autre du monde des opérateurs – entreprises ou administrations.
PREMIÈRE TABLE RONDE :
BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : RESTAURATION DES POPULATIONS D’ESTURGEONS
M. Thierry Mazet, directeur de l’agriculture de la région Aquitaine. Je vais vous présenter les incidences environnementales, mais également socio-économiques du programme de restauration des populations d’esturgeon dans le bassin d’Aquitaine, laissant à M. Éric Rochard le soin d’aborder les aspects scientifiques.
Les premières traces de pêche à l’esturgeon dans l’estuaire de la Gironde remontent au Moyen Âge, mais la filière s’est développée surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle, entre 1840 et 1870, avec la modernisation des ports et des bateaux de pêche ; l’activité faisait alors vivre une dizaine de familles. Mais à l’époque, seule la chair du poisson était valorisée : on ne s’intéressait pas aux œufs.
Ensuite survint la révolution du caviar. La première étape eut lieu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsqu’un marchand allemand apprit aux pêcheurs locaux à produire du caviar – avec un succès tout relatif : la production était de faible qualité et a périclité après la première guerre mondiale. Deuxième étape, dans les années 1920, quand la petite histoire rencontra la grande : la révolution russe ayant anéanti la commercialisation du caviar, un restaurateur parisien eut l’idée de relancer la production française dans l’estuaire de la Gironde en faisant appel à des savoir-faire russes. Ce fut le début de la richesse pour certains pêcheurs : avant la seconde guerre mondiale, le caviar de Gironde jouissait d’une certaine renommée. Cela a si bien marché que la pêche s’est intensifiée et que le poisson s’est raréfié. La situation est devenue dramatique : de 4 000 prises d’esturgeon dans l’estuaire en 1947, on est passé à 193 en 1963 et à 12 en 1980 !
À compter des années 1980, un programme de recherche ambitieux a été mis en œuvre par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (CEMAGREF), auquel ont participé l’ensemble des pouvoirs publics – les régions de Poitou-Charentes et d’Aquitaine, les départements concernés, l’agence de l’eau du bassin Adour-Garonne – et qui a bénéficié d’un financement européen. Son objectif principal était de restaurer la biodiversité et de préserver l’espèce ; s’y ajoutait pour nous, collectivités territoriales, un enjeu économique : créer de la valeur ajoutée dans le territoire.
Sur le plan économique, le programme du CEMAGREF a abouti à la création d’une filière d’élevage, avec l’introduction d’une espèce d’esturgeon d’origine russe, Acipenser baerii, et le transfert aux pisciculteurs de la technique de production mise au point par les chercheurs. La filière, qui regroupe une quinzaine d’entreprises et représente une centaine d’emplois, est solide : elle a produit quelque 300 tonnes d’esturgeons et 23 tonnes de caviar en 2013 – ce qui place la France parmi les premiers pays producteurs –, généré 14 millions d’euros de chiffre d’affaires et créé de la valeur ajoutée. Elle continue à se développer, et cherche aujourd’hui à se structurer autour d’un label de qualité : une demande de reconnaissance d’indication géographique protégée (IGP) vient d’être déposée sur la dénomination « caviar d’Aquitaine ».
Sur le plan environnemental, il s’agit d’un travail de plus longue haleine. Une étape cruciale a néanmoins été franchie à l’été 2012 avec la réimplantation de 700 000 juvéniles de l’espèce sauvage Acipenser sturio dans la Gironde et dans la Dordogne, qui ouvre la perspective d’un repeuplement des fleuves d’Europe de l’Ouest, après la très forte régression observée entre 1850 et 2008. L’enjeu est de taille, car l’estuaire de la Gironde est le dernier territoire connu de reproduction et de croissance de l’esturgeon européen.

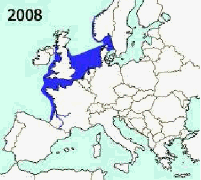
Pour nous, collectivités territoriales, la mise en œuvre de ce programme constitue un parfait exemple d’une politique de préservation de l’environnement concrète et accessible à nos concitoyens. Elle permet de valoriser notre image, de générer de la valeur ajoutée et de conforter la filière aquacole, avec des retombées prometteuses sur le plan environnemental et concrètes sur le plan économique. Nous allons tâcher de continuer à structurer la filière, en évitant qu’elle ne connaisse une dérive similaire à celle de l’élevage de saumon.
M. Éric Rochard, directeur de recherche à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). L’esturgeon est le plus grand des poissons migrateurs européens : on a recensé des spécimens atteignant cinq mètres de long. Il naît en rivière, grandit en fleuve, puis en mer, avant de revenir en rivière pour se reproduire. On en trouvait dans une vingtaine de bassins versants européens, de l’Elbe jusqu’au Pô. Cette espèce a la particularité d’avoir une maturité sexuelle tardive, vers l’âge de dix ans pour les mâles et de quinze pour les femelles, ce qui explique que la restauration des populations soit un travail de longue haleine. Heureusement, un même individu peut se reproduire plusieurs fois, ce qui ouvre d’autres opportunités.
L’exploitation de l’esturgeon remonte à l’époque romaine ; on l’a d’abord pêché pour sa chair, puis pour le caviar. L’espèce est strictement protégée depuis 1982, la législation française ayant été complétée par tout un ensemble de textes européens.
La première étape du programme de recherche a consisté à identifier les facteurs, outre la pêche, qui ont conduit à la raréfaction de l’espèce. Nous avons collecté des données anciennes pour analyser l’état des zones de frayères et mis en œuvre un suivi de la population dans l’estuaire, avec des campagnes d’échantillonnage régulières. Grâce à ce monitoring, nous avons appris que la dernière reproduction sauvage de l’espèce avait eu lieu en 1994 – on était par conséquent à la veille de l’extinction totale – et nous avons recueilli les informations de base sur l’écologie de l’espèce : croissance, habitats, alimentation. L’étude a été complétée par un suivi des captures accidentelles en mer, grâce à des partenariats, notamment avec la filière pêche ; en été, les poissons migrent jusqu’à la mer du Nord, puis reviennent passer l’hiver dans le golfe de Gascogne : on ne peut pas s’en tenir à une approche locale. Nous avons notamment analysé la sensibilité de l’espèce aux différentes pratiques de pêche – sa « capturabilité » –, ce qui nous a permis de mieux connaître ses habitats.
Les travaux se sont ensuite focalisés sur la maîtrise de la reproduction de l’espèce. Une technique a été mise au point sur une espèce modèle, l’esturgeon sibérien, Acipenser baerii – qui est une espèce d’eau douce –, puis appliquée à l’esturgeon européen, Acipenser sturio. On a d’abord essayé sur des poissons capturés accidentellement, sans succès ; puis, au début des années 1990, on a décidé de constituer un « stock captif » : de jeunes poissons ont été mis en captivité pour une dizaine d’années. Ce choix tactique a payé, puisqu’à partir de 2007, nous avons eu des reproductions régulières. Ces juvéniles ont permis de soutenir la population de Gironde – plus de 1,5 million d’alevins ont été déversés dans l’estuaire –, d’arrêter un plan de réintroduction dans l’Elbe, de lancer une expérimentation dans le Rhin et de renforcer le stock captif par des poissons de classes d’âge différentes. Le programme de recherche a finalement abouti au développement d’une nouvelle filière de production aquacole, particulièrement dynamique.
Un plan national d’action a également été lancé, qui est en bonne voie. Les effets en sont déjà visibles, comme le montre l’augmentation des captures accidentelles en mer – qui, si l’on considère que le comportement du pêcheur ne varie pas, est un bon indicateur de l’évolution d’une population de poissons.


Nous attendons le retour des premiers géniteurs pour passer à l’étape suivante : vérifier que les poissons que nous avons lâchés vivent bien en mer et qu’ils reviennent en rivière pour se reproduire ; cela permettra de relancer la dynamique de la population.
Une réintroduction est en cours dans l’Elbe et les recherches continuent, notamment sur l’évolution de la population soutenue. Quels seront ses habitats de reproduction ? Dans quel état se trouvent les zones de frayère ? Les embryons pourront-ils se développer ? Les poissons relâchés réussiront-ils à s’adapter à la population indigène ?
Le plan prévoit aussi le transfert de savoir-faire en matière de conservation et de reproduction de l’espèce, ainsi que le développement de bonnes pratiques pour assurer le soutien des populations, non seulement d’esturgeons, mais aussi d’autres espèces de poissons migrateurs sur lesquelles nous travaillons.
Pour résumer, il s’agit d’une « success story » au long cours, du fait de la lenteur du cycle de vie de l’animal, qui a été permise par le soutien et la collaboration de nombreux partenaires.
B. DEUXIÈME ILLUSTRATION : EXTRACTION DES PRINCIPES ACTIFS DES VÉGÉTAUX, PLANTES À TRAIRE
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Nous en venons à la seconde illustration : l’extraction de principes actifs des végétaux grâce au procédé dit des plantes à traire.
Lorsque j’étais premier vice-président de la région Lorraine, nous avions soutenu, dans le cadre de l’Agence de mobilisation économique que nous venions de créer, le projet Bioprolor, qui visait à regrouper de petites entreprises et start-up travaillant dans le domaine de la conception ou de la production de substances actives d’origine végétale. On en est aujourd’hui au dixième programme de ce type, dans tous les secteurs : il en existe ainsi sur l’ingénierie des langues, comme Ortolang, ou sur la dépollution des sols.
L’entreprise PAT est intéressante, car elle est issue de travaux de l’Institut national de la recherche agronomique ; la conjonction des efforts d’un universitaire et d’un chef d’entreprise a permis au projet de prendre forme. Si vous passez dans le Lunévillois, je vous invite à venir visiter ses serres, notamment au moment de la traite des plantes. Où en est-on aujourd’hui ?
M. Jean-Paul Fèvre, président-directeur général de Plant Advanced Technologies (PAT). Avec Frédéric Bourgaud, nous avons toujours parlé entre nous du procédé en le désignant par le sigle « PAT ». Mais pour attaquer les marchés des produits pharmaceutiques et cosmétiques, il nous fallait un autre nom que « plantes à traire » ! Nous avons donc conservé le sigle, et appelé la société « Plant Advanced Technologies » – ce qui fait un peu plus sérieux.
La technologie provient d’une unité mixte de recherche de l’INRA et de l’École nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA), qui fait partie de l’université de Lorraine. Elle est presque devenue un nom générique : on commence à en parler dans les colloques comme d’une nouvelle façon de produire des substances actives.
Notre société a été lauréate du concours national d’aide à la création d'entreprises de technologies innovantes en 2005 ; elle a obtenu le prix Pierre Potier en 2006, le trophée de l’innovation de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en 2010 et a été classée l’année dernière par le palmarès Technology Fast 50 au premier rang des entreprises du nord-est de la France, au deuxième rang des entreprises du secteur des sciences de la vie et au vingt-sixième rang au niveau national. L’entreprise est entrée en Bourse, sur le marché libre, en 2009, où elle a levé deux millions d’euros de fonds. Son chiffre d’affaires était de 1,2 million d’euros en 2013 et devrait être de 1,5 million cette année. Nous avons acquis une serre de trois hectares l’an passé. La société comprend une trentaine de personnes : c’est beaucoup trop eu égard à notre chiffre d’affaires, mais nous bénéficions de soutiens et organisons des levées de fonds – nous avons encore recueilli un million d’euros la semaine dernière ; nous comptons plus de 2 500 actionnaires, notamment au titre des investissements entrant dans le dispositif de défiscalisation de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Plantes à traire » est une solution de sourcing permettant la production de substances actives directement à partir de la racine des plantes. Je vais vous projeter un film qui présente le procédé. (L’intervenant projette le film tout en le commentant.)
À partir d’une plante tropicale sud-américaine, on produit un actif pour un grand groupe cosmétique mondial. Les plantes sont cultivées en aéroponie – c’est-à-dire que les racines pendent dans le vide et que l’on vaporise sur elle de l’eau et des sels minéraux – et elles sont stimulées de manière à développer des voies de biosynthèse. Frédéric Bourgaud reviendra tout à l’heure sur la technique qui a été mise au point au sein de son laboratoire pour activer la production de métabolites secondaires.
Nous sommes les seuls au monde à posséder un champ sur roulettes… Les plantes sont déplacées et leurs racines plongées pendant une demi-heure dans un bac contenant un solvant non toxique, de sorte qu’elles exsudent leurs molécules, que nous pouvons alors récupérer. L’intérêt est que l’on procède à une extraction ex vivo sans tuer la plante ; ses racines seront ensuite lavées, voire coupées pour repousser, et trois semaines à un mois plus tard, le cycle recommence. C’est comme pour les vaches : on n’a pas besoin de les tuer à chaque fois qu’on les trait…
L’autre intérêt du procédé, c’est que la concentration en actif est bien supérieure. Dans cet exemple, la teneur naturelle de la plante en actif est extrêmement faible ; la culture hors sol et la stimulation permettent de la multiplier par cinquante. À raison de six récoltes par an, on produit trois cents fois plus qu’en plein champ, et sans difficultés pour récupérer les racines fines. Une serre de mille mètres carrés produirait ainsi l’équivalent d’un champ de 30 hectares, sans amenuiser la ressource végétale : on conserve les plantes durant l’hiver ou l’on reprend la production à partir de pieds mère.
M. Frédéric Bourgaud, professeur à l’Université de Lorraine. La société Plant Advanced Technologies a été créée en 2005, mais la recherche sur la technologie des plantes à traire avait démarré en 1996 en laboratoire et, en 1999, nous avions déposé un brevet, propriété conjointe de l’université de Lorraine et de l’INRA. À l’époque, les services de valorisation de la recherche étaient balbutiants, et mes collègues m’avaient déconseillé de le faire : « Ce n’est pas ton boulot et, de toute façon, ça ne sert à rien ! », m’assuraient-ils. Heureusement, avant d’être universitaire, j’avais travaillé pour un laboratoire pharmaceutique et je connaissais les grands principes de la propriété intellectuelle ; en outre, des collaborations avec des groupes industriels m’avaient fait comprendre que, sans brevet, il était difficile pour l’institution publique de faire valoir ses droits d’inventeur. C’est donc nous, les chercheurs de base, qui avions mis au point la technologie, qui avons décidé de déposer un brevet.
Dès le début de ma carrière, dans les années 1990, j’avais travaillé sur les molécules discrètes – sujet qui, à l’époque, n’était pas en vogue. Les molécules que nous produisons par la technologie des plantes à traire sont bien souvent des molécules de défense que les végétaux élaborent en réponse à des agressions du milieu – on peut établir un parallèle avec le système immunitaire des vertébrés. Par exemple, une plante soumise à des UV va élaborer des molécules qui vont filtrer ces derniers : les plantes ont inventé la crème solaire avant nous ! Une plante agressée par des insectes produira quant à elle des molécules insecticides, parfois très puissantes.
Il s’agit d’un cas typique de sérendipité, puisque tout est parti d’observations fortuites. Dans les dispositifs de recherche en agronomie ou en biologie végétale, on travaille souvent sur des plantes cultivées dans des conditions dites « hors sol », les racines étant placées dans un milieu de culture. En travaillant sur des plantes connues pour fabriquer des substances naturelles actives, nous avons observé que l’on retrouvait ces composés actifs dans la solution nutritive dans laquelle les racines baignaient. Par exemple, la garance – célèbre pour le pantalon « rouge garance » des Poilus de 1914 – produit un colorant à partir de ses racines ; eh bien, nous avons réussi à fabriquer en laboratoire ce colorant avec la technologie des plantes à traire, en faisant sortir les molécules directement des racines ! L’observation ayant été réitérée à plusieurs reprises, nous nous sommes rendu compte que, d’une manière générale, les plantes étaient capables d’excréter les substances actives présentes dans leurs racines, ce qui nous a incités à systématiser le procédé – d’autant qu’en raison de mon passé dans l’industrie pharmaceutique, j’étais informé de la valeur intrinsèque de ces molécules.
Nous avons donc élaboré un système de culture hors sol nous inspirant de la méthode des serristes. Il faut pour commencer choisir des plantes richement dotées en molécules ; nous sommes par conséquent de fervents défenseurs de la biodiversité végétale, richesse dont la France est particulièrement bien pourvue du fait de ses territoires et départements d’outre-mer. Les plantes sont cultivées en aéroponie et soumises à un certain nombre de traitements, qui vont avoir pour effet de leur faire croire qu’elles sont attaquées – c’est un peu l’histoire de Jean qui criait « Au loup ! » –, afin qu’elles élaborent des systèmes de défense ; les concentrations en substance active augmentent alors fortement et la technologie des plantes à traire va consister à aller chercher les molécules présentes dans les racines et à les en faire sortir de manière non destructrice. Il s’agit donc d’une technologie de préservation de la ressource végétale – certes, nous avons au départ besoin d’une ressource, mais que nous allons en général chercher auprès des conservatoires et jardins botaniques de métropole ou d’outre-mer. À l’issue du processus, nous disposons d’extraits actifs que nous amenons ensuite au niveau de qualité et de pureté requis par nos clients. Nous réalisons entre trois et huit récoltes par an, compte tenu du climat lorrain.
Pour conclure, je présenterai une synthèse des éléments favorables et défavorables que nous avons rencontrés au cours de la phase amont du projet.
D’abord, il vaut mieux faire appel à des chercheurs qui connaissent un tant soit peu les principes de base qui régissent la propriété intellectuelle si l’on veut protéger les inventions du service public. Il est également utile de disposer de services de valorisation de la recherche professionnalisés. En 1999, l’INRA possédait déjà un certain savoir-faire en la matière, contrairement à l’université ; entre-temps, celle-ci a rattrapé son retard et les choses sont aujourd’hui bien plus faciles qu’il y a quinze ans. Les directeurs de laboratoire doivent laisser leurs chercheurs travailler sur des thèmes « à signaux faibles » : il ne faut pas investir uniquement sur ce qui marche à un moment donné. Enfin, nous avons eu la chance de bénéficier relativement facilement d’aides aux transferts de technologie de la part de l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) – il faudrait aujourd’hui s’adresser à Oséo ou à l’Agence nationale de la recherche (ANR).
S’agissant des éléments défavorables, je peux témoigner du manque de reconnaissance académique pour le travail de transfert de technologies ! Les commissions d’évaluation des laboratoires ont une attitude au mieux neutre, assez souvent négative ; dans ces conditions, la seule motivation des porteurs de projets est d’aller jusqu’au bout de leur idée. À plusieurs reprises, le projet a manqué d’être abandonné à cause d’une personne qui détenait un pouvoir de vie et de mort sur lui. Enfin, nous avons eu la chance de trouver un business angel et un chef d’entreprise, mais ce n’est pas toujours facile !
Mme Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS-INEE) et vice-présidente d’AllEnvi pour la programmation scientifique. La confrontation de ces illustrations ayant trait, pour l’une à une espèce animale, pour l’autre à une espèce végétale, était particulièrement intéressante. Je crierai pour ma part « Au loup ! » s’agissant de la biodiversité et de la connaissance des écosystèmes.
Le contexte actuel des changements climatiques planétaires conduit un nombre croissant d’États à adopter une politique environnementale extrêmement volontariste. Ces politiques s’accompagnent d’un effort de synthèse au plan scientifique pour inscrire la problématique dite de la « biodiversité » dans un contexte global intégrant le fonctionnement des écosystèmes, l’économie et, plus largement, les sociétés humaines : c’est l’un des grands défis de ce début de siècle.
Je veux faire un plaidoyer pour la recherche. Les scientifiques ont aujourd’hui à fournir la description des systèmes écologiques tout en construisant en parallèle des concepts qui permettront d’en comprendre les propriétés ainsi que des modèles prédictifs susceptibles d’anticiper leur devenir dans un environnement changeant. C’est avec une recherche fondée sur l’observation, l’expérimentation, la modélisation et la valorisation que nous aurons peut-être une chance de croire encore dans le progrès. Un tel effort suppose la collaboration entre différentes disciplines – l’écologie, les sciences de l’évolution, les mathématiques, la physique, la chimie, la climatologie, l’économie, la sociologie, l’anthropologie et d’autres encore –, ainsi que l’acquisition et l’analyse d’une quantité de données sans précédent. Il nécessite aussi le développement d’une recherche de qualité en écologie fondamentale, le développement d’indicateurs biologiques pertinents et la mise en place de méthodes de scénarisation et d’évaluation à différentes échelles spatiales et temporelles. Il implique enfin et surtout que l’on considère l’homme, non plus comme un simple observateur, mais comme un acteur majeur du devenir des écosystèmes.
Nous sommes très influencés par la pensée philosophique d’Aristote, selon laquelle la théorie doit rendre compte de ce qui est observé, et non pas l’inverse. Cette approche naturaliste a longtemps cloisonné l’écologie, en la menaçant d’être une science du cas particulier, chaque famille d’organisme et de milieu donnant naissance à sa propre écologie : terrestre, marine, vertébrée, végétale, microbienne, des communautés, etc. Mais l’écologie a aussi cherché des lois générales et déterministes gouvernant les relations entre les organismes et leur environnement : telle est la théorie développée récemment par Hubbell.
La biodiversité est un concept récent. Le terme a été créé dans les années 1990 ; il y a trente ans, il n’existait pas : en 1995, on n’en relevait que cinquante occurrences dans le monde entier. Moins de vingt ans plus tard, il est entré dans le langage courant et va faire l’objet d’une loi : quel chemin parcouru !
La biodiversité est un drôle d’oiseau. Dès qu’une discipline tente de la capturer pour en produire une définition et en déterminer les règles, elle s’échappe et s’envole vers d’autres cieux disciplinaires. Le droit y rencontre l’écologie, la génétique y dialogue avec l’anthropologie, les sciences de l’évolution y rejoignent la philosophie. Pourtant, aujourd’hui, on ne la connaît pas – et c’est pourquoi je crie : « Au loup ! ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la connaissance du vivant n’est pas encore acquise ; on connaît mieux l’espace que les grands fonds marins. Il y a des pans entiers du vivant dont nous ignorons soit l’existence, soit les fonctions – on vient de le voir avec la garance. Un immense champ de recherche est à explorer, qui comprend les modes d’existence de la biodiversité, mais aussi sa place dans les écosystèmes et les relations entre ces derniers – on l’a vu avec l’esturgeon.
Nous autres chercheurs avons parfois l’impression que l’on oublie l’importance des écosystèmes pour notre vie, et pour la survie des populations. Tout ce que l’on mange est végétal ou animal : alors, faisons-y attention ! Il est primordial de savoir comment cette chaîne fonctionne. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que les résultats de la recherche fondamentale sont susceptibles d’être valorisées et que, en retour, cela nous apportera de nouvelles connaissances sur les espèces, la biodiversité et les écosystèmes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Que de gravité dans vos propos, Madame Thiébault ! Vous avez eu l’acuité de souligner que les notions dont nous parlons aujourd’hui sont entrées récemment dans le paysage public. Le mot « écologie » est apparu à la fin des années 1960 ; à l’époque, quelques laboratoires se qualifiaient d’« écologiques », mais c’était rare. Trente ans plus tard, le mot « biodiversité » est arrivé. Aujourd’hui, ces termes ne relèvent plus de la seule sphère scientifique, mais ils se sont diffusés dans le discours politique, et surtout médiatique, car la société actuelle est ainsi faite.
La place des scientifiques est dans la cité. Or, depuis quelques décennies, ils sont de plus en plus en dehors. Vous avez, monsieur Bourgaud, souligné l’énergie et la volonté que vous avez dû déployer pour faire « malgré » – à défaut de faire « avec ». On vous a laissé faire, et c’est tant mieux. Il y a d’autres scientifiques que l’on laisse faire, soit parce qu’ils n’intéressent personne – et l’on découvre vingt ans après qu’ils avaient raison –, soit parce qu’ils intéressent tout le monde – et l’on commence à les formater. La question qui se pose à travers celle de la biodiversité et des écosystèmes, et elle n’est pas simple, c’est celle de la diversité scientifique et de l’écosystème science dans l’écosystème France. Dans ce dernier, il y a aussi le monde de l’entreprise et celui de l’administration publique, ainsi que les représentations mentales : projections sur l’avenir, inquiétudes du passé, angoisses envers les enfants ou les voisins. Le fait est que la société française est un peu à l’arrêt – alors qu’il y a de l’énergie et de la vaillance partout.
Comment les scientifiques peuvent-ils reprendre place dans la cité et redevenir audibles ? Pourquoi la science est-elle aujourd’hui source d’inquiétude, alors qu’elle recèle un tel potentiel ? La cité, ce sont aussi les entreprises et l’on peut, par cet intermédiaire, reconquérir l’estime de nos concitoyens ; pour autant, ne pas faire preuve de prudence serait une bêtise, y compris sur le plan scientifique. Il faut réussir à se situer dans cet entre-deux – ce qui est passionnant. Les scientifiques doivent réinvestir le vocabulaire et l’espace publics ; ils ne peuvent se contenter d’être uniquement des scientifiques. Surtout, qu’ils évitent autant que possible de terminer toutes leurs phrases par : « …en l’état actuel des connaissances », ce qui est mortifère ! Car la réponse sera toujours la même : « Continuez de chercher dans vos laboratoires avec vos blouses blanches, et prévenez-nous lorsque vous aurez trouvé : on verra alors ce que l’on peut faire de concret ». On sait bien que le principe même d’une recherche scientifique est de rajouter toujours plus d’epsilon à la fin de l’équation – sinon, ce sont des maths, c’est-à-dire un langage, mais pas du concret. Par pitié, chers amis scientifiques, ne terminez pas vos interventions en précisant que vous manquez d’argent ou que vos travaux ne sont pas terminés – même si c’est vrai. Songez aux phases intermédiaires, qui permettront à certains de créer des entreprises, de la valeur, des normes, et de solliciter l’administration pour donner du punch à tout cela !
Mme Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS-INEE) et vice-présidente d’AllEnvi pour la programmation scientifique. Si mes propos vous ont paru graves, madame la présidente, c’est que je tenais à souligner que ce n’est pas parce que nous avons quelques success story à présenter qu’il faut croire que nous connaissons déjà tout : il y a autant à découvrir.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Et ce que nous ne connaissons pas doit être une source d’espoir, et non d’inquiétude. C’est pourquoi il est important que les scientifiques prennent la parole.
Mme Frédérique Clusel. Dans Peste & Choléra, Patrick Deville raconte la vie d’Alexandre Yersin, disciple de Pasteur et découvreur du bacille de la peste. Il rappelle que Pasteur ne voulait pas recevoir d’argent extérieur, notamment de la part des entreprises, parce qu’il était convaincu que si tel était le cas, sa recherche ne serait plus objective et qu’il perdrait son âme. J’ai l’impression que, en France, on reste inconsciemment très attaché à ce principe. Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion de travailler dans des laboratoires américains et avec des institutions anglo-saxonnes : la valorisation de la recherche y est plus simple et plus rapide, et l’interface entre le monde universitaire et le monde économique mieux assurée. Je suis plutôt chauvine et fière de nos fleurons économiques, mais il est difficile pour nous, industriels, de savoir à quelle porte frapper quand on veut travailler avec des Français – même si je reconnais que INRA Transfert fait du bon travail. Il est bien plus facile d’aller voir un Anglais ou un Américain qui saura vous vendre sa recherche – éventuellement au prix fort : pour un même travail, le Royal Veterinary College nous a demandé 30 000 livres sterling et le centre INRA de Tours 800 euros et quelques… Il faut que les chercheurs français valorisent mieux leurs recherches !
Cela ne tiendrait-il pas au mode éducatif ? En France, on ne veut pas prendre de risques, parce qu’on a toujours peur de se tromper ; en cas de difficulté, on cherche un coupable et on lui tape sur les doigts ; du coup, on préfère ne rien faire. Les Anglo-Saxons, eux, s’en moquent : ils font, ils tombent et ils se relèvent.
Peut-être faudrait-il également que les chercheurs français acquièrent le réflexe du dépôt de brevets ?
M. Paul Indelicato, vice-président « Recherche et innovation » de l’université Pierre-et-Marie-Curie. Je représente la Conférence des présidents d’université au bureau d’AllEnvi.
Peut-être serait-il temps de modifier l’idée que l’on se fait de la recherche en université et de ses rapports avec l’innovation. Nous disposons maintenant de nombreux outils pour valoriser les recherches menées dans nos laboratoires, qui, dans notre université, sont tous des unités mixtes constituées avec les organismes de recherche : les sociétés d’accélération du transfert de technologie assurent le développement des projets en phase de pré-industrialisation, un fonds d’investissement a été créé dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et on trouve des start-up dans les universités – parfois intégrées aux laboratoires, parfois accueillies dans des pépinières.
En outre, une réflexion est en cours au ministère pour apprendre aux chercheurs à calculer des coûts, et ne plus fixer les sommes au hasard.
L’état d’esprit des chercheurs évolue. Beaucoup de jeunes partent en post-doc aux États-Unis. Là-bas, une bonne publication peut être le point de départ pour déposer un brevet, alors qu’en Europe, cela marche plutôt dans l’autre sens : il faut garder sa recherche secrète jusqu’au dépôt du brevet. Le problème, c’est que cela a des conséquences directes sur l’évaluation ; il faudrait que pour la carrière, tout ce qui concerne la valorisation de la recherche soit mieux pris en compte.
Mais vous avez raison : aux États-Unis, on peut faire des erreurs et recommencer. Notre mode d’éducation est très différent. Nous nous efforçons toutefois de sensibiliser les étudiants au monde de l’entreprise et à l’insertion professionnelle : espérons que cela portera ses fruits ! Le plus long, ce sont les changements culturels.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Lyautey qui, à la fin de sa vie, avait acheté une propriété dans le Val-de-Loire, s’y promenait en donnant des instructions à son jardinier : « Ici, nous allons planter des chênes et des pins. Là, on pourrait mettre des rosiers… – Ce sera long et difficile, lui fit remarquer le jardinier. – Alors, commençons tout de suite !, rétorqua Lyautey ». En France, on a du mal à « commencer tout de suite » : on en reste à « ce sera long et difficile ». Notre rapport à la vie est un peu souffrant…
Cependant, je crois que l’état d’esprit change. La plupart des enseignants du supérieur ont le souci de leurs étudiants : ils savent qu’il ne faut pas les orienter uniquement vers l’administration ou l’enseignement supérieur et la recherche, mais qu’il existe un espace disponible dans le monde de l’entreprise. C’est une petite révolution ! Il y a une trentaine d’années, la culture universitaire était bien différente : on cherchait le meilleur élève de maîtrise pour l’inscrire en doctorat, et l’on mettait en compétition les filières de doctorat avec des systèmes de tri remarquablement efficaces… Aujourd’hui, les mentalités ont évolué, et la profession est soucieuse de son impact – c’est d’ailleurs le thème de notre journée.
La recherche environnementale est porteuse d’avenir ; l’usage, la préservation, la protection, l’extraction, la culture sont autant d’enjeux considérables. L’agriculture et l’agroalimentaire ne s’opposent pas à une nature qui serait par essence formidablement belle et généreuse. Elle est belle et généreuse, certes, mais lorsqu’elle est cultivée et utilisée.
Mme Katia Barral, membre de la direction de l’innovation du CNRS. On note en France une tendance à considérer que la recherche publique est gratuite, et certaines entreprises privées rechignent à apporter des financements car elles estiment que c’est un dû – ce qui n’est pas le cas. Si l’on veut fonctionner sur le mode anglo-saxon, un changement de culture est nécessaire aussi bien de la part des industriels que des chercheurs.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, présidente. Je partage votre opinion. En France, on estime que ce qui est public doit être gratuit. Pourtant, il faut bien que la recherche soit payée par quelqu’un, et l’impôt seul ne saurait y suffire ! Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, les entreprises paient des impôts tout en contribuant par ailleurs à l’effort de recherche. Il existe aux États-Unis un système intéressant : le pay per view ; tous les deux ou trois ans, les entreprises vont dans les laboratoires sélectionner des projets, et les subventionnent ensuite fortement, par des grants : si ça marche, tant mieux, sinon, le financement s’arrête. C’est assez stimulant !
Il faut que la France change de culture, ce qui n’est pas facile – mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Il est d’ailleurs remarquable que nous en venions à discuter du problème des coûts alors que nous traitons, non de la santé, du nucléaire ou du numérique, mais de la recherche environnementale !
M. Benoît Fauconneau, chercheur à l’INRA. Je suis secrétaire exécutif d’Allenvi et, à ce titre, sensibilisé à l’accès aux ressources pour les recherches sur la biodiversité.
La biodiversité et les écosystèmes sont un enjeu non seulement pour la recherche, mais aussi pour le progrès social. Par exemple, pour reprendre un sujet évoqué ce matin, les découvertes faites sur le microbiote ont eu des répercussions sur la santé et la connaissance de l’homme. Imaginez ce que ce serait à l’échelle de la biodiversité et des écosystèmes !
Ce qui importe, c’est de rendre possible la recherche sur la biodiversité – même si un encadrement est nécessaire. Les chercheurs sont des gens responsables, conscients des inquiétudes actuelles, et il faut qu’ils puissent découvrir ce qu’il y a à découvrir. Des chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement m’expliquaient hier qu’il existait en Indonésie des hotspots de biodiversité extraordinairement riches.
Ces recherches relèvent en partie de la description, mais elles peuvent aussi mettre au jour des processus écologiques qui sont potentiellement des sources d’innovations. Les services écosystémiques en sont un exemple, mais nous venons de voir que les débouchés peuvent aussi être économiques. Encore faut-il que la recherche puisse se faire et disposer d’une certaine marge de manœuvre face à toutes les connaissances qu’il lui faut acquérir dans ce domaine de la biodiversité et des écosystèmes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. La question de l’accès à la biodiversité pose des problèmes juridiques, sur lesquels nous travaillons dans le cadre de la discussion du projet de loi. La France dispose du deuxième patrimoine maritime mondial ; pour autant, nous ne sommes pas propriétaires du globe. La notion de partage est donc fondamentale ; mais que doit-on partager, avec qui, dans quelles conditions et durant combien de temps ?
Ce sont des questions délicates. Exploiter ne signifie pas nécessairement abîmer, de même que respecter ne doit pas conduire à enfermer. C’est une dialectique qu’il nous faut construire, car elle fournira la base à l’économie du XXIe siècle. Nous voulons conserver nos paysages – mais cela implique-t-il que ceux-ci ne doivent pas évoluer ? Le paysage, par nature et par fonction, évolue ; sinon, il ne serait pas vivant.
SECONDE TABLE RONDE :
DÉVELOPPEMENT DURABLE
A. PREMIÈRE ILLUSTRATION : VALORISATION DES RESSOURCES ET MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Nous en venons à la seconde table ronde, consacrée au développement durable ; l’expression est furieusement politique et médiatique, mais que signifie-t-elle du point de vue scientifique ? Pour répondre à cette question, nous en passerons par deux illustrations. La première porte sur la valorisation des ressources et les matériaux bio-sourcés.
M. Emmanuel Maille, directeur corporate and business development de Carbios. Merci à AllEnvi de nous fournir l’occasion, trop rare, de discuter avec des parlementaires de l’innovation que nous développons : c’est essentiel pour élaborer les futures dispositions législatives, et cela évite de devoir réagir après coup à des mesures qui contraindraient l’innovation.
Créée en avril 2011, Carbios est une jeune société un peu atypique dans le domaine de l’innovation : alors que les jeunes sociétés innovantes sont généralement fondées sur une technologie, un chercheur, un laboratoire, Carbios est née à l’initiative d’un fonds d’investissement, Truffle Capital, dans le but de développer une innovation de rupture dans le domaine de la chimie verte. Basée en Auvergne, Carbios emploie aujourd’hui huit personnes et fait travailler plus de soixante chercheurs académiques. Depuis notre création, nous avons levé près de 26 millions d’euros, dont 14 millions d’euros grâce à l’introduction en Bourse fin 2013 et près de 7 millions apportés par BPI France.
La mission de Carbios est d’inventer des concepts industriels et de développer des procédés biologiques permettant de repenser le cycle de vie des polymères en général et plus particulièrement des matières plastiques. Peu après la création de la société, en 2012, nous avons décidé de lancer un projet appelé Thanaplast™, projet ISI (innovation stratégique industrielle), avec des partenaires académiques – l’INRA, le CNRS et l’université de Poitiers – et industriels – Limagrain, Barbier et Deinove. Son budget global atteint 22 millions d’euros, dont 15 millions apportés en propre par Carbios. Il repose en effet sur une recherche académique poussée dont le coût est élevé. Nous sommes ravis des résultats que nous avons déjà pu obtenir. Carbios détient aujourd’hui huit brevets, dont deux en licence, fruits de résultats obtenus notamment par le CNRS et l’université de Poitiers. Thanaplast™ s’appuie sur plus de dix ans de R&D des différents partenaires actuels du projet.
Carbios est née d’un constat : la demande de matières plastiques est de plus en plus importante, avec un taux de croissance de plus de 5 %, supérieur à celui du PIB mondial. Elle est partout présente dans nos sociétés modernes, car les matériaux plastiques sont dotés de propriétés exceptionnelles, devenues incontournables avec le remplacement des matériaux nobles. 280 millions de tonnes sont produites chaque année. Mais elle génère aussi plus de 100 millions de tonnes de déchets plastiques peu ou mal valorisés, voire pas du tout. En France, pourtant bonne élève en la matière, seuls 20 % des déchets sont aujourd’hui retraités et valorisés à des conditions intéressantes ; près de 30 % sont incinérés et 50 % partent à la décharge. Cette dernière possibilité ayant vocation à être interdite, l’importance de ce volume va obliger à trouver d’autres solutions.
À nos yeux, la nature a plus d’imagination que nos rêves industriels. C’est donc en explorant la biodiversité que nous trouverons les outils industriels de demain. Voilà pourquoi nous développons des procédés biologiques fondés sur ce que la nature fait de mieux en matière de dégradation ou de synthèse de matériaux.
La filière du plastique fabrique à partir du pétrole ce que l’on appelle des monomères, c’est-à-dire des unités comparables à des perles que l’on enchaîne pour composer des colliers de perles : les polymères, ensuite fondus et transformés pour donner des plastiques, ou tissés pour donner des textiles. Les procédés biologiques que nous avons conçus afin de repenser leur cycle de vie sont au nombre de trois. Le premier concerne les plastiques à courte durée de vie et à usage unique : celui des sacs, des films de paillage, films agricoles déjà en contact avec la terre, ou des emballages alimentaires. Nous avons développé une technologie qui permet de produire une nouvelle génération de plastiques biodégradables dans lesquels on inclut, au cœur de la matière, des enzymes capables de dégrader celle-ci au moment où on l’a décidé. C’est le principe de Mission impossible : le plastique s’autodétruira au moment voulu. La biodégradation du matériau s’opère alors jusqu’à la complète bio-assimilation par l’environnement. Ce procédé concerne les matériaux à courte durée de vie et dont on maîtrise la durée d’usage.
Pour les plastiques à usage plus long ou multiple, par exemple celui des bouteilles, nous avons imaginé un autre procédé utilisant la spécificité des enzymes : leur capacité à dépolymériser et à restituer la perle initiale. Pour recycler ces matières plastiques, en particulier les polyesters et les polyamides, on « détricote » le polymère pour revenir au monomère, on le purifie et on le replace en début de chaîne, avec une qualité identique au monomère produit à partir de pétrole. Il s’agit véritablement d’un recyclage de la matière à l’infini, qui offre des perspectives très intéressantes dans la mesure où il permet de dépasser les limites actuelles du recyclage.
Le troisième procédé concerne la bioproduction. On parle aujourd’hui beaucoup des biopolymères, ou polymères biosourcés. Leur inconvénient majeur est leur prix : deux à cinq fois plus élevé que celui des matières fossiles, il freine considérablement leur pénétration sur le marché. Nous avons développé des procédés qui permettent de ramener le prix du PLA (acide polylactique), l’un de ces polymères, à celui du PET. Or ses propriétés en font un bon substitut à celui-ci, dont pas moins de 56 millions de tonnes sont produites chaque année.
À travers le projet Thanaplast™, nous avons développé un réseau d’excellence qui réunit des acteurs financiers, essentiels car l’innovation est une prise de risque qui nécessite de gros moyens, des acteurs industriels, capables de s’impliquer très en amont, et des chercheurs académiques. À cet égard, je souligne particulièrement notre partenariat avec l’INRA, qui représente 7 millions d’euros sur cinq ans. Un tel partenariat est très difficile à mettre en place du point de vue juridique, surtout dans des unités relevant de différentes tutelles. La précieuse plateforme TWB (Toulouse White Biotechnology) simplifie considérablement les procédures juridiques de conclusion des accords, grâce à des principes de valorisation convenus à l’avance entre industriels et universitaires. Cette démarche est suffisamment rare pour être soulignée.
Au total, je l’ai dit, nous faisons travailler plus de soixante chercheurs académiques. La France est un magnifique terrain de jeu pour pratiquer une innovation de rupture, une innovation ambitieuse. La difficulté consiste à estimer la valeur finale de cette innovation. Pour des activités comme les nôtres, les dispositifs d’accompagnement et de soutien sont beaucoup moins développés dans les étapes de pilotage et de pré-industrialisation que lors de la commercialisation. En d’autres termes, entre la phase de recherche et celle de commercialisation, les financements font défaut.
M. Alain Marty, professeur à l’Institut national de sciences appliquées de Toulouse (INSA). Le laboratoire d’ingénierie des systèmes biologiques et des procédés, auquel j’appartiens, compte trois cent cinquante personnes environ, qui travaillent sur ce que l’on appelle communément les biotechnologies. Notre cœur de métier est le développement d’enzymes et de micro-organismes. Grâce à ses fondateurs, en particulier Gérard Goma, notre laboratoire a l’habitude depuis trente ou quarante ans de collaborer avec le monde industriel – ce qui ne veut pas dire que nous ne menons pas des recherches de qualité ! Affilié au CNRS, à l’INRA et à l’INSA, le LISBP est maintenant adossé à TWB, démonstrateur pré-industriel qui développe des biotechnologies dites blanches, dites également biotechnologies industrielles. Il est exact que ces recherches sont coûteuses : les industriels ne trouvent jamais que nous ne sommes pas assez chers ! Ainsi, 7 millions d’euros ont été affectés à TWB dans le cadre du projet Thanaplast™, pour une recherche qui implique de nombreux acteurs et se caractérise par la pluridisciplinarité.
Revenons brièvement sur les procédés décrits à l’instant par M. Emmanuel Maille. Le biorecyclage des plastiques consiste à collecter différents plastiques puis à développer des réacteurs enzymatiques afin de les dépolymériser de manière sélective, les uns après les autres, de manière à revenir au monomère de chacun, avant de les repolymériser pour produire à nouveau du plastique.
Un autre procédé permet de rendre biodégradables des plastiques tels que les plastiques de paillage utilisés en agriculture et de contrôler leur durée de vie en y incluant des enzymes. Indispensable à la société, il représente un vrai défi scientifique. Pour le relever, il faut d’abord explorer la biodiversité microbienne afin de trouver des enzymes de dépolymérisation efficaces dans des environnements soit pollués par le plastique, soit enrichis en plastique par nos soins. Il faut ensuite mettre en œuvre des techniques permettant d’accéder à des enzymes de souche non cultivable – c’est ce que l’on appelle la métagénomique –, puis produire efficacement ces enzymes, les purifier, accéder à leur structure, ce qui demande des compétences en modélisation moléculaire. La nature qui a produit le PET ou le PLA n’ayant généralement pas inventé d’enzymes pour dégrader ces polymères, les enzymes que l’on trouve n’ont pas nécessairement les spécificités et les activités recherchées, ni les thermostabilités qui leur permettraient de résister au processus de fabrication des plastiques. Nous devons donc les faire évoluer de manière à aboutir à l’enzyme optimale, utilisable dans un réacteur industriel. Pour y parvenir, nous nous appuyons en particulier sur la plateforme de l’INRA dédiée à l’évolution des enzymes à l’INSA de Toulouse.
Nous avons obtenu un premier succès en découvrant une enzyme capable de dépolymériser des plastiques en quelques heures avec un rendement supérieur à 80 %. Nous parvenons alors à récupérer un monomère identique à celui qui a initialement servi à la fabrication du plastique. On peut dégrader ainsi des films, des gobelets, des fourchettes, par exemple.
Une dernière voie est la production de bioplastiques, en particulier de PLA, polymère biosourcé, fabriqué à partir d’acide lactique. L’idée est ici de réduire les coûts, de développer des procédés biologiques économiquement pertinents, en partant de biomasse végétale pour développer des bactéries lactiques : on produit ainsi de l’acide lactique à partir non plus du glucose mais d’une biomasse qui est plus compliquée à dégrader. On fait ensuite évoluer des levures pour leur intégrer les voies métaboliques permettant de produire le plastique.
Cela suppose de faire de la génétique, de l’ingénierie métabolique, de pouvoir reprogrammer une souche afin qu’elle fabrique ce bioplastique, améliorer les enzymes que l’on va inclure dans ce micro-organisme pour leur apporter la sélectivité voulue, enfin extraire efficacement le polymère de l’intérieur du micro-organisme. Bref, les défis sont nombreux.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Étymologiquement, Thanaplast, c’est bien la mort du plastique ?
M. Emmanuel Maille. Le terme fait référence à la fin de vie des plastiques.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vous avez suggéré que nous, Français, n’étions pas mauvais en recyclage des plastiques, mais que l’on pouvait faire encore mieux, d’où votre projet.
M. Emmanuel Maille. Tout à fait. En matière de recyclage et de valorisation des matières plastiques en fin de vie, les procédés employés ont leurs limites. Certains matériaux plastiques sont très complexes, multiplient les polymères. Or, pour bien recycler, il faut des matières très homogènes. Cela explique que la fraction véritablement recyclable, qui correspond à une matière plastique de très bonne qualité, reste assez limitée. La voie royale consiste à refaire du textile, mais elle ne donne au plastique qu’une deuxième vie, non une troisième et encore moins une quatrième. Quant à l’incinération, elle entraîne une perte de valeur complète. Les procédés que nous développons permettent en revanche de recouvrer la qualité initiale et de reprendre le processus en début de chaîne pour refaire des plastiques, soit le même, soit un autre qui utilise ces polymères.
Notre cas montre qu’il existe dans notre pays des dispositifs permettant même à une petite société de développer une innovation de qualité et d’obtenir assez vite des résultats : nous sommes en mesure d’envisager les premières applications de nos recherches d’ici à deux ou trois ans. La qualité de la recherche au sein de nos universités est indéniable ; il faut savoir la mobiliser. Dans ce domaine, nous avons bénéficié d’outils très pertinents.
Par ailleurs, sur ces sujets sensibles, nous aimerions pouvoir contribuer plus activement à la définition des axes réglementaires, car il faut prendre en considération certaines innovations afin de veiller à l’efficacité et à la viabilité industrielles.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Par exemple ?
M. Emmanuel Maille. Je songe à l’amendement qu’a fait adopter la ministre de l’écologie à propos des sacs en plastique, dans le but de valoriser les plastiques biodégradables et bio-sourcés. L’intention environnementale est louable, mais ces plastiques ne représentent aujourd’hui que 0,3 % des 280 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde. La mesure risque donc d’engendrer des tensions, faute de mettre à profit des matériaux existants qui ne sont pas nécessairement bio-sourcés et n’en permettent pas moins une biodégradation efficace.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Ces 0,3 % ne vous font pas vraiment concurrence.
M. Emmanuel Maille. Ils nous intéressent, mais ils risquent de ne pas suffire pour répondre aux besoins du marché.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Monsieur Marty, si je vous ai bien suivi, l’alimentation et la production de matériaux vont se disputer les espaces cultivés.
M. Alain Marty. Non, car, comme pour l’éthanol de deuxième génération, la biomasse que nous utilisons n’est pas exploitée par l’agro-alimentaire. Il n’y a donc pas de concurrence.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. L’objectif est donc d’aller vers le zéro déchet agricole.
M. Alain Marty. Exactement.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Soit on nourrit les vaches, soit on fabrique des plastiques destinés à notre bien-être ?
M. Alain Marty. Pas tout à fait.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est une question de choix. Peut-on tout concilier ou faut-il choisir ? Personnellement, je pense que l’on peut parvenir à tout faire.
M. Emmanuel Maille. En effet : les matières dont nous parlons sont des déchets verts, des déchets agricoles, des déchets de l’industrie agro-alimentaire dont nous essayons d’utiliser les propriétés pour être performants en termes de coûts. Le point de départ des biopolymères, ce sont des sucres qui servent au marché agro-alimentaire, ainsi qu’à la fabrication des biocarburants, à un prix indexé sur celui du pétrole. On ne peut pas trouver de glucose à moins de 350 euros la tonne. Le rendement des souches qui permettent de produire des monomères est d’environ 40 %. Du coup, le prix de la matière atteint 800 à 900 euros la tonne, sachant que la tonne de PET, le matériau fossile concurrent, est vendue 1 200 euros. Un problème de coût se pose donc. Ces matériaux ne pourront jamais pénétrer sur le marché si l’on ne part pas d’une matière plus brute pour produire un polymère revenant au prix d’un matériau fossile.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le pétrole est dans la terre. Certes, il faut tenir compte du coût d’extraction. Mais les matériaux bio-sourcés, s’il s’agit de plantes, requièrent un arrosage, qui implique un coût et un prélèvement sur l’environnement immédiat.
M. Emmanuel Maille. Les matières dont nous parlons sont très peu valorisées : elles représentent davantage un coût de traitement qu’une valeur. Nous essayons précisément de leur apporter cette valeur. Leur volume est considérable, alors que les matériaux plastiques ne représentent que 4 % de la consommation annuelle de pétrole dans le monde. Ces matières sont donc largement suffisantes pour répondre aux besoins.
M. Patrick Hetzel, député, membre de l’OPECST. Dans la belle aventure de coopération entre industrie et recherche publique que vous venez de nous décrire, avez-vous été gênés, à un moment ou à un autre, par le principe de précaution ?
M. Emmanuel Maille. À vrai dire, nous n’avons pas pris ce soin car, comme le dit Oscar Wilde, le progrès n’est que l’accomplissement des utopies. Nous nous sommes donc autorisés à rêver des procédés industriels de demain, et la faisabilité dont attestent les premiers résultats nous offre des perspectives d’industrialisation tout à fait prometteuses, nous permettant d’envisager des alternatives à l’existant.
M. Patrick Hetzel. Lors des colloques que nous organisons, nous entendons souvent dire que le microclimat français n’est pas toujours propice aux coopérations entre industrie et recherche. Avez-vous identifié des obstacles à cette coopération dans votre cas et, si oui, comment les avez-vous levés ? Comment les législateurs que nous sommes pourraient-ils accélérer le processus de transfert technologique ?
M. Emmanuel Maille. Nous avons eu beaucoup de chance. D’abord, le fonds d’investissement à l’origine du projet était mû par l’esprit entrepreneurial, ce qui n’est pas toujours le cas. Cela nous a permis de nous focaliser sur le projet plutôt que sur les moyens à investir au départ, qui sont cruciaux dans le cas de l’innovation. Ensuite, nous avons réussi à attirer des partenaires comme l’INRA et le CNRS, riches de savoir-faire exceptionnels, et à trouver avec eux des formes de coopération adaptées. Enfin et surtout, nous avons eu la chance de bénéficier de l’accompagnement offert par BPIfrance et tous les autres opérateurs du domaine.
La difficulté consiste à faire ensuite de l’innovation une réalité industrielle et un succès. Une centrale de démonstration de quelques milliers de tonnes suppose 30 à 40 millions d’euros d’investissement : une petite entreprise qui n’est pas une société industrielle ne trouve pas toujours sur le territoire les soutiens nécessaires à cet investissement. Nombre de sociétés vont donc voir ailleurs, notamment aux États-Unis, où l’on est beaucoup moins aidé en amont mais beaucoup plus en aval. Dans ce domaine, nous pourrions faire beaucoup mieux ; cela permettrait de pérenniser une recherche, d’en entamer d’autres et surtout de réaliser l’innovation pour en tirer bénéfice en France.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Quels sont la structure et le montant de votre capital ?
M. Emmanuel Maille. Nous avons levé 26 millions d’euros, dont 19 en capital, et notre capital social est un peu supérieur à 2 millions d’euros.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vous dites qu’il faudrait 40 millions d’euros de plus. C’est un vrai problème économique : est-ce à la puissance publique de payer ?
M. Emmanuel Maille. Le problème, c’est plutôt la capacité à mobiliser cet argent. Le pilote a pour seul objectif de démontrer à l’industriel que le procédé est praticable dans des conditions industrielles. L’entreprise a besoin de défendre son innovation pour être véritablement impliquée dans cette étape, mais elle n’est pas toujours en mesure de lever une telle somme. Elle peut être accompagnée par des banques qui croient au projet depuis le début, parfois sous la forme d’une garantie, ce qui lui évite de chercher à l’étranger. Mais les outils financiers peuvent être difficiles d’accès pour des sociétés innovantes de cette taille.
M. Patrick Hetzel. Ce devrait être le job des capital-risqueurs. Ceux qui interviennent en France vous réclament-ils des garanties ? Ce serait contraire à l’esprit même du capital-risque.
M. Emmanuel Maille. Il arrive que l’on trouve davantage d’opportunités hors de France, y compris en matière de capital-risque.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Et plus généralement hors d’Europe.
D’une manière générale, on semble considérer en France que, lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas un million d’euros, c’est à la puissance publique – Oséo puis BPIfrance, et les collectivités, notamment régionales – d’y investir. Le monde capitalistique n’intervient qu’au-delà de ce montant, souvent, d’ailleurs, pour « écraser » le capital en écartant ceux qui ont créé l’entreprise et innové, ou en ne leur donnant plus qu’une place réduite. Mais c’est la vie… Quoi qu’il en soit, ces ordres de grandeur n’ont rien à voir avec ceux que vous évoquez. Nous devrons reparler de cette question fondamentale, celle du financement non de l’innovation, mais de sa transformation en puissance économique.
Qui doit prendre en charge ce financement ? Il y a de quoi s’interroger à l’heure où une banque française va devoir payer 7 milliards d’euros d’amende. Je félicite d’ailleurs l’actuel patron de la BNP de survivre à ce qu’ont fait ses prédécesseurs ! Mais c’est l’une des plus grandes banques européennes, et un bel outil.
B. SECONDE ILLUSTRATION : VALORISATION DES DÉCHETS, BIOTECHNOLOGIES BLANCHES ET MÉTHANISATION
M. Michel Torrijos, ingénieur de recherche au laboratoire de biotechnologie de l’environnement de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Aurélien Lugardon, qui représente le partenaire industriel de notre laboratoire, et moi-même allons retracer à titre d’exemple la création de la start-up Naskeo, spécialisée dans la méthanisation, c’est-à-dire le traitement des effluents, essentiellement industriels, mais aussi des résidus solides en vue de produire de l’énergie. Nous exposerons ensuite les principales conclusions tirées de l’étude de ce cas dans le cadre du programme ASIRPA (analyse des impacts de la recherche publique agronomique) de l’INRA.
Les partenaires du projet sont le laboratoire de biotechnologie de l’environnement (LBE) de l’INRA de Narbonne et la société Naskeo Environnement, start-up créée en 2005 par des étudiants de l’École centrale de Paris à partir d’un transfert de technologie classique, tel qu’il se pratiquait dans les années 1990 : le procédé Provéo, développé au sein de l’INRA, a ensuite été licencié à la société Naskeo. Très vite, un second procédé a été développé : Ergenium, procédé bi-étape de valorisation des déchets solides par méthanisation, élaboré quant à lui en collaboration étroite avec Naskeo, jusqu’au brevet en codépôt.
Le procédé Provéo utilise une cuve contenant des supports. Il s’agit d’un procédé biologique, avec des micro-organismes à l’intérieur de la cuve ; les supports servent à les fixer et à augmenter leur quantité dans le système. Cela permet de créer un procédé trois fois plus intensif. Ces supports s’agglomèrent en paquets et forment un filtre qui, au bout d’un certain temps, se colmate. Le procédé se caractérise par la possibilité de le décolmater régulièrement, à la demande.
L’historique de sa création a été étudié dans le cadre d’ASIRPA. De 1996 à 2004, le procédé a été développé sur fonds propres par l’INRA, au niveau laboratoire puis au niveau pilote, en vue de la validation préindustrielle. Naskeo s’y est intéressée au moment où il est arrivé à maturité. 2005 fut une année cruciale : création de Naskeo, dépôt par l’INRA du brevet Provéo et signature d’une licence exclusive entre l’INRA et Naskeo. Dès 2006, le traitement des déchets solides s’est diversifié : Naskeo s’est associée avec un constructeur allemand et des activités de recherche ont été développées au sein du LBE, avec une thèse CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche) portant sur le procédé Ergenium, un codépôt de brevet et la signature d’une licence exclusive.
M. Aurélien Lugardon, président directeur-général de Naskeo. Naskeo, c’est, à l’origine, quatre étudiants en sortie d’école. Nous ne savions pas grand-chose et n’avions aucune idée de la société que nous voulions créer ; à ce stade, on ne connaît pas son marché et on ignore ce qui se fait à la pointe de la technologie. Nous avons donc commencé par rencontrer le plus grand nombre d’acteurs possible – institutionnels, laboratoires de recherche, représentants de l’industrie agro-alimentaire, prescripteurs, concurrents. Nous avons étudié cet écosystème avec la volonté de nous lancer, mais sans savoir vraiment dans quoi.
C’est au cours de cette sorte d’étude de marché que nous avons connu le laboratoire de biotechnologie de l’environnement et Michel Torrijos, et découvert qu’un grand nombre de technologies y avaient été développées, dont certaines faisaient l’objet de publications ou de brevets, mais sans la moindre volonté de les valoriser : en somme, nous avons découvert des projets sans porteurs de projet.
Parce que nous étions jeunes et avions envie de nous lancer, nous avons très vite monté un partenariat avec l’INRA. L’institut disposait de la technologie Provéo qui permettait, en conditions de laboratoire, de traiter trois fois plus d’effluents dans un volume de cuve réduit, ce qui pouvait représenter un différentiateur concurrentiel important si nous parvenions à industrialiser le procédé. Nous avons commencé à travailler ensemble ; nous nous sommes installés pour un an ou deux à Narbonne, et nous nous sommes présentés au concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes organisé par le ministère de la recherche, que nous avons remporté.
Nous avons décidé de créer notre entreprise en 2005, après un an et demi de discussions avec l’INRA sur la possibilité de licencier la technologie Provéo et sur l’industrialisation, à laquelle nous devions déjà penser. En parallèle, nous cherchions des clients. En mai 2005, nous avons à la fois signé la licence avec l’INRA, signé notre premier contrat avec une entreprise pharmaceutique, et créé la société.
Assez rapidement, nous avons rencontré un certain succès avec Provéo, grâce au caractère très intensif du procédé, marqué par l’importance des charges organiques appliquées, c’est-à-dire des quantités de matière que l’on peut traiter par mètre cube de réacteur et par jour. Nous avons donc été sollicités par des industriels. Il n’est pas évident de vendre de l’innovation dans le monde industriel, mais le fait que l’INRA ait travaillé pendant sept ans sur cette technologie avant notre entrée en scène, accumulant de nombreux résultats expérimentaux, nous a rendus crédibles.
Peu après, nous sommes parvenus à convaincre des capital-risqueurs, en l’occurrence des FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation), d’investir 2,6 millions d’euros dans notre société, ce qui lui a donné les moyens financiers de prendre les garanties attendues par ces industriels.
En 2006, nous nous sommes aperçus que le marché de traitement des effluents liquides par la méthode Provéo était intéressant, mais assez restreint – un marché de niche, puisqu’il ne se construit que quatre ou cinq centrales de ce type par an, à un ou deux millions d’euros l’unité. Nous avons donc décidé d’évoluer vers un marché plus vaste et plus prometteur. C’est alors que nous avons commencé, avec l’INRA, à développer une seconde technologie : Ergenium. Il nous a fallu sept ans avant de pouvoir en proposer une version industrielle : trois ans et demi de thèse CIFRE, suivis de trois ans de contrat de recherche avec une équipe de l’INRA et un postdoctorant dédié.
L’objectif était de développer un procédé produisant 5 à 10 % de plus de biogaz que les procédés concurrents. Contrairement à la première illustration qui nous a été présentée, il ne s’agit pas d’innovation de rupture, mais bien plutôt d’innovation incrémentale. 5 à 10 % de biogaz en plus par tonne de fumier, cela peut ne pas paraître énorme, mais pour un agriculteur, la perspective de produire, avec son exploitation de deux cents unités gros bétail, 220 kilowatts au lieu de 200 modifie assez significativement son compte d’exploitation en fin d’année pour le convaincre de préférer Naskeo à son concurrent allemand.
Le commissaire général à la stratégie et à la prospective déclarait la semaine dernière dans un entretien que « nos ingénieurs sont formés à la culture de l’innovation radicale plus qu’à celle du progrès incrémental qui fait la fortune des Allemands ». De fait, on ne peut pas révolutionner la méthanisation, qui existe depuis cinquante ans et fait l’objet de nombreux brevets. Pour être concurrentiels sur ce marché, nous devons nous appuyer sur ce que nous a apporté l’INRA et sur nos propres réflexions pour proposer des améliorations légères qui font progresser peu à peu la filière et nous permettent de nous différencier et, au final, d’être rentables.
C’est exactement ce que nous avons cherché à faire avec Ergenium, et nous avons assez bien réussi. Nous avons déposé un brevet en copropriété qui s’est révélé difficile à exploiter au niveau industriel, mais nos six ans de résultats expérimentaux nous ont permis d’élaborer un produit industriel qui plaît beaucoup et qui fait de Naskeo le constructeur leader de la méthanisation, du moins sur le marché agricole, avec 20 % de parts de marché.
Notre collaboration avec l’INRA est donc un succès. Le savoir-faire qui en est né nous a permis de prendre une position dominante sur un marché où ce n’était pas gagné d’avance, puisque l’on y trouve aussi des entreprises allemandes fortes de dix ans d’expérience. L’enseignement que nous pouvons en tirer est que les différentiateurs ne résultent pas nécessairement d’une innovation de rupture, mais peuvent être le fruit d’une expérience accumulée pendant plusieurs années grâce à un savoir-faire et beaucoup d’essais et de pilotes, en laboratoire, dans des fermes, dans des entreprises agro-alimentaires.
Nous poursuivons aujourd’hui cette collaboration selon de nombreux axes de recherche différents. Nous nous intéressons à l’extraction de fertilisants
– principalement l’azote et le phosphore – des digestats, c’est-à-dire des résidus de la méthanisation, qui sortent de la cuve après la fermentation. Nous collaborons avec l’INRA, mais aussi avec le CNRS et l’IFREMER, à propos du couplage de la méthanisation et de l’algoculture. Bref, nous préparons aujourd’hui les produits que nous espérons lancer d’ici un à cinq ans.
Du point de vue économique, nous sommes considérés comme l’un des leaders du marché, dont deux ou trois sociétés se partagent plus de 50 %. Nous avons construit quinze unités, nous avons une dizaine de chantiers en cours. Nous sommes profitables depuis quatre ans. Notre chiffre d’affaires est d’environ 12 millions d’euros en 2014, contre 9 en 2013, et 20 l’année prochaine. Nous employons 45 salariés en CDI. Bref, nous avons bâti une PME industrielle à partir de savoir-faire de recherche.
M. Michel Torrijos. L’une des principales raisons du succès du programme ASIRPA est le contexte favorable au transfert de technologies qu’offre le laboratoire de biotechnologie de l’environnement : le LBE a poursuivi une stratégie de transfert s’appuyant sur une équipe dédiée et favorisant l’hébergement d’industriels ainsi qu’une étroite collaboration avec l’INRA Transfert et le Parc méditerranéen de l’innovation de Narbonne. Il s’est doté de deux halles technologiques équipées de pilotes. La première, de 950 m2, est adossée au LBE. La seconde, de 650 m2, situe à cinq kilomètres, regroupe un hôtel d’entreprise et un IUT. Ces deux halles pilotes visent à nous permettre de passer du laboratoire à l’échelle pilote, c’est-à-dire de la production de quelques litres à celle d’un mètre cube de méthane, avant d’en venir à la valorisation économique et à l’application du procédé à l’échelle industrielle, comme l’a fait Naskeo pour le procédé Proveo.
Le succès du projet s’explique aussi par l’existence d’un dispositif d’accueil d’industriels : nos partenaires ont ainsi accès à un équipement complet au sein du laboratoire et sont encadrés par des scientifiques et des techniciens du LBE. Nos chercheurs peuvent ainsi entretenir des relations étroites avec Naskeo dont l’équipe de recherche-développement est hébergée au LBE depuis 2005. Fortement impliqué dans le projet, l’INRA a mis à disposition une technologie mature, le procédé Provéo, a favorisé le co-développement du procédé Ergénium, et a permis à Naskeo d’intégrer un réseau de partenaires scientifiques et de participer à des accords de consortium. Enfin, en matière de protection et de propriété intellectuelle, l’INRA a déposé des brevets et signé des licences exclusives avec Naskeo : cette politique d’exclusivité favorise la pérennité des relations industrielles. Le dépôt de ces brevets a apporté une caution scientifique à Naskeo et l’a révélée en tant qu’entreprise innovante et dynamique, ce qui a beaucoup rassuré les actionnaires et a facilité la levée de fonds. Enfin, le co-dépôt d’un brevet a permis à la start-up Naskeo de partager la renommée scientifique de l’INRA.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le LBE est un projet de longue haleine qui remonte aux années 1990 avec le déménagement du laboratoire de Narbonne. Ce projet a posé des problèmes complexes de propriété du sol et s’est heurté aux dispositions de la loi littoral.
M. Michel Torrijos. C’est pour cette raison que notre deuxième halle se situe à cinq kilomètres de la première.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. À l’autre bout de la France… J’ai le souvenir d’avoir été en conflit avec un préfet de département qui ne voyait aucun inconvénient à construire un laboratoire dans la bande des cent mètres – c’est-à-dire dans une zone inondable interdite à la construction sur tout le territoire national, sauf en zone déjà urbanisée – au motif que l’INRA, c’était de l’environnement ! Ce à quoi j’ai répondu, soutenue par le préfet de région, qu’il s’agissait de construire une halle de technologie. Et de son côté, l’INRA considérait qu’il pouvait faire ce qu’il voulait sur son terrain… L’anecdote est amusante, mais lourde de conséquences : vingt ans plus tard, l’extension de ce laboratoire se situe à cinq kilomètres de la première halle, ce qui est loin d’être anodin…
M. Michel Torrijos. Cela nous a effectivement posé beaucoup de problèmes.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. … en termes de collaboration scientifique et de convivialité. Il n’empêche que ce laboratoire fonctionne très bien. Et pourtant, cette affaire avait démarré à partir d’une idée qui n’avait rien de moderne, mais qui était terriblement innovante. Naskeo dispose-t-il d’unités hors de France ? Quel est votre projet d’entreprise ? Comptez-vous investir aux États-Unis et en Allemagne ?
M. Aurélien Lugardon. Mieux vaut ne pas investir dans les énergies renouvelables en Allemagne en ce moment, compte tenu de la loi allemande transposant la directive européenne sur les énergies renouvelables, dite « EEG ». Les énergies renouvelables n’ont guère le vent en poupe en Europe à l’heure actuelle, à l’exception de la France qui reste relativement préservée à cet égard. Les déclarations prononcées hier par la ministre de l’écologie nous ont d’ailleurs rassurés pour ce qui concerne la bioénergie.
Nous développons plusieurs grands projets.
À l’export, nous nous intéressons plutôt aux pays dans lesquels l’électricité est structurellement chère à produire. Las de devoir dépendre de tarifs conventionnés arrêtés par l’État et susceptibles de changer du jour au lendemain – ce qui n’est heureusement pas le cas pour la méthanisation – nous cherchons à exporter dans des pays produisant leur électricité à partir du fioul, c’est-à-dire en Afrique de l’Ouest, dans certains pays d’Amérique du Sud tels que le Chili et en Australie.
Deuxième axe, maintenant que notre ingénierie a construit plusieurs centrales de méthanisation pour le compte de tiers – groupements d’agriculteurs, coopératives ou industriels –, nous souhaiterions prendre davantage de parts de capital dans ces sociétés de projet et les exploiter progressivement.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Vous souhaiteriez donc devenir exploitant ?
M. Aurélien Lugardon. Nous voudrions devenir investisseurs en méthanisation, et peut-être exploitants dans un second temps.
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Auriez-vous des recommandations à formuler en matière fiscale ? On m’a indiqué que les entreprises de méthanisation paient la contribution climat-énergie.
M. Aurélien Lugardon. Ce n’est pas tant la fiscalité qui bloque les projets de méthanisation que l’instabilité réglementaire, notamment dans le domaine sanitaire. Si le règlement européen applicable ne change pas, l’interprétation qu’en fait la Direction générale de l’alimentation fluctue au gré des mois, tant et si bien qu’une fois que l’on a commencé la construction d’une centrale, on s’aperçoit qu’elle n’est plus aux normes et que l’on ne peut plus l’exploiter. Il nous faut quatre ans pour développer un projet.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. C’est très clair. Et cela me va très bien !
M. François Moisan, directeur exécutif de la stratégie, de la recherche et de l’international à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME). Quelles sont vos perspectives en matière de production d’électricité et d’injection au réseau ?
M. Aurélien Lugardon. Nos perspectives sont excellentes, puisque les réseaux de transport et de distribution de gaz irriguent le territoire. Nos capacités sur ces réseaux sont importantes car le gaz naturel est une énergie fortement développée en France. Reste un problème, dont on parle peu, au niveau du financement bancaire des projets d’injection de bio-méthane au réseau : faute d’être assurées que les unités de méthanisation pourront injecter systématiquement leur biométhane dans le réseau quel que soit l’état de la consommation, les banques rechignent à financer les projets. Ce verrou ralentit fortement la progression de la filière. Nous explorons la possibilité d’interconnecter les réseaux et celle consistant à faire remonter le gaz injecté dans les réseaux de distribution jusque dans les réseaux de transport – ce que l’on appelle le rebours. Mais en attendant que ces solutions se concrétisent, la filière reste bloquée.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Quid de l’Allemagne ?
M. Aurélien Lugardon. L’Allemagne a opté pour une voie de développement de la méthanisation fort différente de la nôtre : les Allemands cultivent du maïs de façon intensive, en tant que culture principale, pour alimenter des méthaniseurs. Un tel conflit d’usage conduit de nombreuses personnes à se poser des questions d’ordre éthique sur la filière du biogaz allemand. De plus, le cours de maïs ayant fortement grimpé ces dernières années, de nombreuses unités de méthanisation ont fait faillite. L’Allemagne a connu une telle crise du biogaz en 2012-2013 que les Allemands reviennent progressivement, comme en France, à la méthanisation des déchets agricoles et agroalimentaires. L’Allemagne ne constitue donc pas pour nous un pays où il fait bon exporter.
M. Gilles Trystam, directeur général de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech). Je vais vous présenter les différents usages que l’on peut faire de la ressource agricole et les voies technologiques qui permettent de la transformer, afin, d’une part, de chasser l’idée reçue selon laquelle seule la valorisation alimentaire de cette ressource serait intéressante et, d’autre part, de comparer la valeur économique de ces différentes voies technologiques, représentée en rouge sur le schéma ci-dessous. Vous constaterez notamment que ces voies sont en concurrence entre elles et que c’est la voie pharmaceutique qui a la valeur économique la plus forte.
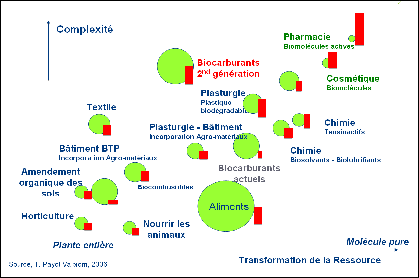
Les enjeux de la transformation de la ressource agricole sont très divers : outre celui des énergies renouvelables dont nous venons de parler, citons la sécurité alimentaire, le changement climatique, les matériaux bio-sourcés, les nouveaux synthons, la sécurité sanitaire, l’eau et la biodiversité. Si l’on exclut le secteur des transports, il semblerait que l’on dispose de suffisamment de carbones bio-sourcés pour pouvoir les substituer totalement au pétrole. Mais un tel consensus pose question.
Jusqu’ici, la plupart des exemples qui ont été présentés partaient de la recherche pour aller vers la mise en application. Or, si l’on constate depuis longtemps que la valeur économique de l’optimisation énergétique et des bilans d’eau augmente très fortement, les questions soulevées ne proviennent pas tant des laboratoires de recherche mêmes que des praticiens de terrain qui les interrogent directement et les conduisent à une re-conception. Il n’est plus alors seulement question de valeurs économiques mais aussi d’éco-socio-conception, de position sur le territoire et d’ « ego-conception » – cette dernière renvoyant à la dimension sensorielle de l’alimentation.
Après l’étape de la re-conception, limitée à un industriel individuel raisonnant sur son propre progrès, vient celle de l’innovation des procédés industriels, lorsque plusieurs usines codéveloppent un ensemble de valeurs et de produits. La question environnementale devient alors plus prégnante et favorise l’écoconception et l’éco-innovation – ce qui induit un changement complet dans le processus de production.
Ces trois premières étapes ont peu à peu saturé l’approche incrémentale, au point que l’on se retrouve dans l’incapacité d’évoluer ; du coup, on se trouve obligé de changer radicalement sa manière de produire des matériaux. Dans nombre de filières, ce cheminement arrive à maturité et s’impose progressivement dans les consciences.
Prenons l’exemple des aliments. Dans le schéma ci-dessous, les flèches rouges symbolisent les valeurs économiques comparées – à la hausse ou à la baisse selon le sens de la flèche. La notion de fractionnement, que l’on retrouve ici, illustre un changement de dialectique dans le monde de l’industrie alimentaire : la notion de coproduit commence à prendre le pas sur celle de déchets, dont on a parlé dans les deux exemples présentés précédemment, alors qu’il y a quelques années, peu d’industries alimentaires l’utilisaient. Cela s’explique par le fait qu’elle permet une valorisation importante. Dans certaines filières, la valorisation du produit alimentaire est en concurrence avec la valorisation des coproduits.
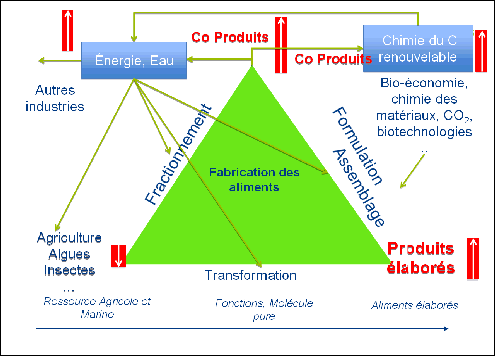
On recense deux voies principales dans cette approche cyclique. Première possibilité : les coproduits servent à produire de l’énergie, ou bien l’eau est retraitée et réutilisée dans certaines étapes du process. Seconde possibilité : les coproduits sont utilisés pour la chimie des matériaux, le gaz carbonique et les biotechnologies, qui permettent de produire des matériaux pour l’industrie chimique, cosmétique et pharmaceutique. On notera que cette approche se voit affecter une flèche rouge montante, qui symbolise sa dimension économique. C’est le grand défi des années à venir : Ce que l’on est capable de faire aujourd’hui n’est peut-être pas pour l’heure économiquement intéressant dans la mesure où il est encore possible de fabriquer des produits similaires à des coûts moindres par la voie pétrochimique. Peut-être la voie des coproduits que l’on commence à élaborer dans les laboratoires de recherche ne sera-t-elle véritablement opérationnelle que dans quelques années, lorsque les rapports économiques auront changé : la gestion des échelles de temps est un élément, difficile, à appréhender dans les choix de valorisation.
Ce processus s’inscrit dans ce que l’on appelle l’économie circulaire, ce qui me conduit à formuler plusieurs remarques. Premièrement, le fonctionnement de cette chaîne de valeur, qui allie l’alimentaire et le non-alimentaire, soulève la question des conflits d’usage des sols. Deuxièmement, elle fait appel à une notion de cycle alors que l’on raisonnait auparavant de façon linéaire, en considérant des filières qui partaient d’un intrant pour arriver un produit final. Troisièmement, l’écoconception pouvant se calculer à condition que l’on dispose de toutes les données nécessaires, encore faut-il avoir les bons outils, parmi lesquels la modélisation tient à l’évidence une place importante.
Je conclurai en insistant sur quelques points à mes yeux essentiels. Pour commencer, nous avons besoin de bases de données pour pouvoir connaître les propriétés d’une matière et les données environnementales à prendre en compte. Parallèlement à l’approche « big data » plusieurs fois soulignée, il nous faut développer une approche prenant en compte l’incomplétude, l’incertitude de données, qui en elle-même constitue un véritable champ de recherches : si nous ne savons pas progresser dans ce domaine, nous ne saurons pas construire les décisions qui en seront la conséquence.
Nous avons également un réel besoin de bio-indicateurs qu’il nous faut choisir au cas par cas. Si la modélisation est elle aussi nécessaire compte tenu de la complexité des enjeux à traiter, il convient toutefois de faire en sorte que les acteurs des différentes filières concernées puissent se réapproprier les modèles élaborés en laboratoire ; encore faut-il déterminer le « grain », l’échelle de modélisation afin de rendre le modèle appropriable.
Il faut mettre au point des méthodes d’aide à la décision qui prennent mieux en compte la question de l’acceptabilité sociale de la science, mais également prendre en compte les aspects de logistique, souvent négligés même lorsque les distances sont importantes comme dans les pays africains, et de finalité alimentaire et non-alimentaire : pour nombre de productions concurrentes des voies fossiles, nous aurons besoin de filières agricoles spécifiques, ce qui amène à traiter la question de la compétition dans l’usage des terres. Enfin, si nous voulons dépasser l’approche incrémentale, nous devrons être capables de remettre en cause nos façons de faire et d’adopter une vision holistique et systémique. Lorsqu’il n’existe pas de meilleur choix de conception, l’adaptation au contexte, et donc l’éco-exploitation, importe beaucoup : on peut abîmer la conception si l’exploitation n’a pas été pensée dans le même sens.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Le problème des données manquantes est-il strictement d’ordre scientifique ou est-il dû au fait que les interactions avec le monde économique sont plus rapides et plus fréquentes ?
M. Gilles Trystam. Plusieurs instituts et laboratoires de recherche scientifique s’interrogent effectivement sur la manière de traiter les bases de données. La diversité des produits et des matériaux est telle qu’il est utopique de croire que l’on pourra en connaître toutes les données, d’autant que cela coûte cher. Par ailleurs, de plus en plus de travaux proposent des méthodes permettant de trier les données publiées dans la littérature scientifique et de ne retenir que les plus fiables comme paramètres des modèles à appliquer.
Mme Dorothée Browaeys, rédactrice en chef bio-innovation du magazine Up’. La bioéconomie a été peu évoquée ici alors qu’elle représente des investissements importants au niveau européen, que l’Allemagne a défini une stratégie en la matière et que l’Unesco y a consacré des assises en présence de Jacques Weber. Afin de mieux arbitrer entre la production agricole alimentaire et non-alimentaire, et compte tenu de la méfiance des Français à l’encontre des biotechnologies, une réflexion politique est-elle en cours sur ce thème dans l’hexagone ?
M. Gilles Trystam, directeur général de l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech). Je sais que plusieurs groupes de recherche réfléchissent à ces questions. Sur le plan politique en revanche, je ne saurais vous répondre.
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Si l’OPECST a traité du sujet des biotechnologies vertes, blanches et sanitaires dans de nombreux rapports, l’affaire des OGM a globalement orienté les recherches de nos établissements publics de recherche français et européens. Les États membres de l’Union européenne ont d’ailleurs des positions convergentes sur le sujet, à l’exception de l’Espagne, du Portugal et, dans une moindre mesure, de la Roumanie.
Je suis pour ma part l’auteur du premier rapport sur les OGM qu’ait publié l’Assemblée nationale, en 1998. C’est lors de la première conférence française de citoyens, qui a eu lieu dans cette salle il y a seize ans, qu’un divorce est apparu entre le monde de la recherche et les citoyens. Jusqu’alors, la position des citoyens était claire : ils étaient pour la recherche. En 2002, le Conseil économique et social a confié à MM. Didier Sicard, Jacques Testart, Christian Babusiaux ainsi qu’à moi-même, qui présidais alors l’Office parlementaire, le soin de réfléchir à la recherche en plein champ. En 2006, l’Assemblée nationale a publié sur le sujet un rapport préparatoire à la loi adoptée en 2008. C’était une loi équilibrée, mais elle n’a pas été appliquée en raison d’une incompréhension. Quant au procès de Colmar à la suite de la destruction des recherches sur le virus du court-noué, il a récemment donné lieu à une décision que tous les directeurs d’organismes publics de recherche français ont jugée incompréhensible, au point que le procureur de la République s’est pourvu en cassation. Tout cela montre que l’incompréhension demeure.
La question des OGM aurait été réglée si nous l’avions mieux traitée. Pour commencer, elle a fait l’objet de marchandages politiques lors de grandes étapes de notre vie démocratique telles que le Grenelle de l’environnement. J’ai moi-même écrit, ce qui m’a valu de vives critiques, que les OGM avaient été la victime expiatoire du Grenelle de l’environnement, où ils ont fait l’objet d’un traitement séparé, avec un Haut conseil des biotechnologies et un comité de préfiguration, à qui l’on a fait dire des choses qui n’avaient pas exactement été dites ainsi. Le sujet aurait dû être abordé politiquement sous l’angle de la propriété intellectuelle ; or il l’a été sous l’angle de la santé et on a continué à l’aborder ainsi, avec notamment ce montage médiatique de l’affaire des rats et la première page du Nouvel Observateur dans l’affaire dite Séralini. Et la recherche et les expérimentations, qui se poursuivent aujourd’hui et qui portent non plus sur la transgénèse mais sur d’autres technologies comme la cisgénèse, sont elles aussi remises en cause : la semaine dernière encore, des locaux de l’École normale supérieure de Lyon ont été occupés.
Le divorce entre les chercheurs et les citoyens sur les biotechnologies ayant débordé le cadre initial des OGM, il conviendrait de relancer le dialogue. Car les chercheurs ne doivent plus se contenter de faire de la recherche : ils doivent aussi l’expliquer à la société, ce qui n’est pas simple.
Le deuxième point que je souhaitais aborder concerne les conflits d’usage dans l’agriculture. La production d’huile de palme, du maïs allemand ou encore de la canne à sucre brésilienne à des fins industrielles et non agricoles – notamment pour produire des biocarburants – est très critiquée, nombre de gens y voyant un dévoiement. Heureusement, les plantes à traire, cultivées in vitro et hors sol, échappent à cette critique.
Autant de grands sujets qui doivent être traités en amont de l’élaboration de la loi car une fois un problème arrivé, les avis se cristallisent : chacun a sa vérité, mais certains entendent bien imposer la leur aux autres, et n’hésitent pas à déclarer péremptoirement quelles recherches sont bonnes ou mauvaises, à l’opposé de toute démarche de recherche : un chercheur doit chercher, dans un cadre éthique déterminé certes, mais il est impensable de dire que les recherches dans le domaine de la biologie et des biotechnologies ne sont pas bonne a priori. Une telle dérive ne peut que nous inquiéter.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Il est ennuyeux qu’une société en arrive à s’interdire de faire de la recherche sur certains sujets. Dans le sixième programme-cadre de recherche et développement technologique (PCRDT), il ne pouvait être présenté de travaux à la Commission européenne portant sur les phanérogames supérieures. Pourtant, il n’est pas une bière ni un vin qui n’ait été fermenté à l’aide d’OGM ! On pourrait aussi étudier la question des synténies et des transferts de gènes au sein d’une même espèce. Mais l’omerta sur le vocabulaire nous conduit à cette situation terrifiante, terriblement complexe, voire douloureuse dans la mesure où nous nous interdisons de gagner des points de croissance. En conséquence, les scientifiques contournent la difficulté ou passent à autre chose.
Quant à savoir si les politiques réfléchissent à la question de la bio-économie, c’est précisément ce que font le Sénat et l’Assemblée nationale à l’OPECST en organisant des tables rondes pour bâtir un discours de raison, bien en amont de l’élaboration de la loi. Nous nous attachons à construire un discours de raison, à l’opposé d’un discours de passion : construire la loi sur la passion, ce n’est pas forcément une bonne idée… Lors de la conférence mondiale sur la biodiversité qui s’est tenue en Afrique du Sud en présence du regretté Jacques Weber, nous avons évoqué de grands objectifs, comme « nourrir la planète ». Le problème est de les décliner localement. Or, parce que les Français sont tout à la fois universalistes et individualistes, ils ne parviennent pas à construire les outils intermédiaires, ce que les Américains et les Allemands savent faire sans problème – ce qui ne veut pas dire sans difficulté. À l’OPECST, le monde de la loi, celui de la science et celui de l’entreprise tentent de débattre des enjeux en cause au lieu de les escamoter, de se comprendre, de dire ce que l’on fait, et de trouver les mots pour cela. Et de ce point de vue, la notion de bio-économie est tellement large que je ne sais sous quel angle l’approcher sinon en des termes vagues et à horizon de dix ans. Or c’est au jour le jour que vivent les entreprises.
Mme Dorothée Browaeys. Le terme de bio-économie permettrait précisément de traiter de la question du vivant de façon non conflictuelle, sans la restreindre à celle des biotechnologies, dans la mesure où elle comprend le bio-mimétisme et l’éco-agriculture. En mettant en évidence les contradictions qui existent, elle permettrait d’ouvrir le dialogue entre les parties prenantes, autrement dit de mettre les pieds dans le plat, et de mieux organiser les finalités alimentaires et non-alimentaires de l’agriculture.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. S’il est vrai que la bio-économie ne renvoie pas du tout à celle de biotechnologies, les agriculteurs se retrouveront-ils dans une notion aussi vaste ? On ne peut se contenter de fabriquer un masque, aussi plaisant soit-il, en utilisant des termes trop englobants. Le fait est qu’avec le mot bio-économie, on a enlevé le « agro ». Or l’agriculture est bien là, comme l’environnement, les paysages, les problèmes de déchets, d’épuration, d’inondations et bien d’autres questions, qui sont autant de réalités : par exemple, la réintroduction de l’ours ou du débordement du loup dans les alpages, est-ce de la bio-économie ou non ?
Mme Dorothée Browaeys. Le problème, c’est qu’au niveau international, le sujet dont nous discutons depuis ce matin relève directement de la « boîte » bio-économie – tant dans le programme Obama que pour l’Union européenne qui a créé un observatoire sur ce thème. Nous serons donc bien obligés de nous en servir.
M. Jean-Yves Le Déaut. Il me semble que le terme de bio-économie a été cité tout à l’heure par M. Trystam. Il ne s’agit certes pas d’un sujet tabou mais le préfixe « bio- » sert souvent de camouflage. La preuve, c’est que l’on se demande aussi s’il est préférable de parler d’agro-carburants ou de biocarburants.
En vérité, le vrai problème est celui de la propriété intellectuelle, et particulièrement de la propriété intellectuelle du vivant. C’est parce que cette vraie question a été mal étudiée qu’elle a abouti à une confusion : certains en ont conclu que les OGM étaient dangereux alors que le danger était celui de l’appropriation du vivant. Alors qu’Allenvi et les organismes de recherche s’interrogent sur l’épuisement des ressources et de la biodiversité, les risques environnementaux et l’atteinte portée aux écosystèmes, thématiques majeures, notre société a des préoccupations tout autres : elle accepte de prendre des risques pour se soigner, mais pas pour se nourrir. Quant aux politiques, quel qu’ait été le gouvernement, ils se sont refilé la patate chaude sans aborder le débat, si bien que ce n’est qu’en 2008 que la France a transposé la directive européenne de 2001 sur les OGM. Dans de telles conditions, comment voulez-vous que l’on inspire confiance aux citoyens sur des sujets aussi complexes, surtout lorsqu’ils sont résumés en quelques minutes au JT du vingt heures ?
Mme Anne-Yvonne Le Dain. Cela dit, j’invite tous les scientifiques, tous les laboratoires de France et de Navarre à se précipiter vers l’appel d’offres
bio-économie et à utiliser tous les mots possibles. Mais vous avez raison, Madame Browaeys, les Français sont frileux en la matière : la réécriture des appels d’offres est une grande tradition française… Reste que cela me pose un problème déontologique. Si la science de très haut niveau en est réduite à passer par des biais en utilisant des mots dans l’air du temps – et d’un temps qui file à toute allure – pendant que les pays du Sud cavalent et que les Américains ne s’embarrassent pas trop non plus, on est en droit de s’inquiéter de voir l’Europe manifester ces pudeurs de vierge !
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UNE RECHERCHE TRANSVERSALE
Mme Véronique Bellon-Maurel, directrice du département Écotechnologies de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). En quoi l’évaluation environnementale peut-elle nous faire progresser ? Selon un physicien de la fin du XIXe siècle du nom de William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin –qui a donné son nom a l’échelle des températures-, il n’y a pas d’amélioration sans mesure. De même pourrait-on dire aujourd’hui qu’il n’y aura pas de transition écologique réussie sans mesure. L’évaluation constitue la mesure de notre performance environnementale dès lors que l’on souhaite éco-concevoir de nouveaux produits, tels que la brique Tetrapak, par exemple, ou de nouveaux modes de production ou encore que l’on souhaite éclairer des choix de constitution de filières ou d’aménagement. Nous disposons pour ce faire de différents « thermomètres » tels que le bilan carbone ou l’empreinte environnementale, qui ont permis au grand public de s’interroger sur certains indicateurs environnementaux, mais aussi l’analyse du cycle de vie (ACV), outil aujourd’hui plébiscité par de nombreux acteurs.
Je vous expliquerai en quoi consiste cette analyse, à la suite de quoi M. François Moisan vous présentera les enjeux de son utilisation.
Reconnue par l’Integrated Product Policy de l’Union européenne, l’analyse du cycle de vie est une méthode permettant de rendre les marchés plus transparents et d’accroître la confiance du public envers l’éco-innovation. Lorsque l’on souhaite fabriquer un produit nouveau, on calcule la quantité de matières premières et la consommation d’énergie nécessaires au processus et l’on observe la manière dont ce produit termine sa vie. Ainsi, un produit pourra-t-il être jugé « environnementalement » performant s’il peut être démonté et recyclé en fin de cycle de vie. Quant aux ressources nécessaires à sa fabrication, elles sont issues de la transformation de ressources naturelles et minières. On peut ainsi construire un arbre des procédés, un modèle cyclique nous permettant d’aller de la conception de ce produit depuis le berceau – l’extraction des matières premières – jusqu’à la tombe. En travaillant à partir d’«unités fonctionnelles » ou de « service rendu »
– qu’il s’agisse d’un litre de bière, d’une chaise, de « mille essuyages de mains » ou de « dix mille kilomètres parcourus entre deux villes » – plutôt qu’à partir de produits, on élargit le champ des solutions possibles. Ainsi, sur certains marchés, Michelin ne vend plus aujourd’hui des pneus, mais des kilomètres de roulage. Dans cette économie de la fonctionnalité, on fabrique des services et non plus des objets. Une fois construit cet arbre, on évalue, à chacune des étapes de fabrication du produit ou de mise en place du service concerné, les ressources consommées
– matières premières, ressources énergétiques – et les polluants émis. Cette méthode d’analyse est normalisée et reproductible. La prise en compte des multiples impacts induits par ce processus de fabrication nous permet d’éviter les transferts d’impacts entre catégories et entre les différentes phases du cycle de vie. Enfin, on rapporte ces impacts au service rendu.
Une fois un problème posé – par exemple « quel scénario pour produire un litre de bière ? » –, on établit un inventaire des consommations et des pollutions nécessaires, dont on exprime le résultat en flux. On convertit ensuite ces flux en impacts tels que les effets cancérigènes, les radiations ionisantes ou la destruction de la couche d’ozone, par exemple. Il existe dix-huit catégories d’impact intermédiaires, ayant des effets sur trois aires de protection : la santé humaine, la qualité de l’écosystème et le changement climatique. Dans cette deuxième partie de l’analyse, on utilise des bases de données. Enfin, la dernière phase est celle de l’interprétation. À chaque phase de cette analyse, on se retrouve confronté à des problèmes car lorsque l’on cherche à modéliser non plus la production d’un litre de bière, mais des systèmes plurifonctionnels, dynamiques et en interaction économique, l’arbre des processus se complique énormément. Enfin, compte tenu du manque de données sur les impacts, on doit être capable de produire soi-même des données valides. On doit comprendre les chaînes allant d’une émission à son impact, en intégrant des particularités régionales.
Une fois que l’on a réalisé une analyse de cycle de vie, on dispose au mieux de trois indicateurs (liés aux trois aires de protection) pour fournir aux acteurs concernés des résultats lisibles et dont l’incertitude est qualifiée.
En Languedoc-Roussillon a été effectuée une expérience intéressante d’analyse des différentes filières de traitement de l’eau : nous avons formé les acteurs à utiliser un logiciel du nom d’ACV4E, qui permet d’analyser différentes solutions de traitement. Ces acteurs ont la possibilité de mettre en balance les valeurs obtenues sur chaque indicateur environnemental. L’utilisation de cette méthode dans la sphère publique permet d’avoir une vision globale de l’impact d’une activité pour la planète : dans le cas du traitement de l’eau, la méthode a permis de mettre en évidence que l’on visait de la « sur-qualité », ce qui avait un impact très négatif sur d’autres catégories d’impact (par exemple l’énergie).
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. On comprend mieux ces méthodes aujourd’hui que lorsque les premiers pionniers ont commencé à travailler sur ces sujets il y a quelques années. Dans le cas précis de l’eau, il serait bon que les trois pôles de compétitivité qui ont été créés travaillent davantage ensemble.
Mme Véronique Bellon-Maurel. Nous n’avons pas fait travailler ensemble les trois pôles, mais bien deux d’entre eux. L’an dernier, nous avons présenté un projet de chaire industrielle ELSA-PACT portant sur les méthodologies d’évaluation environnementale et sociale. Ce projet a été co-labellisé par les pôles Durabilité de la ressource en eau associée aux milieux (DREAM) et EAU.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. J’apprécie beaucoup que vous ayez employé la notion d’« incertitude qualifiée », qui nous libère de l’idée qu’il nous faudrait tout savoir pour commencer à avancer. En revanche, je constate que vous ne nous avez présenté que les impacts négatifs d’un cycle de vie, autrement dit tous les ennuis possibles, sans jamais parler des bénéfices.
Mme Véronique Bellon-Maurel. Toute activité humaine a un impact négatif sur l’environnement, à quelques exceptions près, l’intérêt de cette méthode étant de rapporter cet impact à un service rendu. Nous cherchons à évaluer le moyen de minimiser cet impact par rapport au service rendu. Lorsque l’on produit du plastique à partir du recyclage, l’objectif est que l’impact soit moindre que lorsque l’on recourt à une production classique à base de pétrole.
Mme Anne-Yvonne Le Dain. On pourrait alors élaborer non pas des normes mais des préconisations afin de minimiser les impacts environnementaux d’une activité, la qualification de l’incertitude nous permettant de ne pas nous retrouver embourbés dans un marécage d’inquiétudes.
M. François Moisan, directeur exécutif de la stratégie, de la recherche et de l’international à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Je vais vous présenter quelques exemples de la façon dont l’ADEME utilise l’évaluation environnementale. L’ADEME n’est pas un organisme de recherche, mais une agence qui intervient en aval de la recherche, et qui soutient des programmes de recherche.
Pour l’agence, l’évaluation environnementale vise à éclairer les choix par une approche systémique afin de réduire les impacts environnementaux, à assurer une cohérence entre différentes politiques ou mesures de politique publique et enfin, à évaluer les projets de recherche et développement. Ainsi, dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir, nous demandons à tous les candidats d’établir une analyse de cycle de vie de l’impact attendu de leur projet.
Parmi les domaines d’application de l’évaluation environnementale qui relèvent du strict champ des politiques publiques, je citerai l’exemple des plans d’élimination des déchets, obligatoires dans tous les départements. Cette évaluation peut aussi porter sur différentes options technologiques, comme lorsque l’on compare le véhicule électrique au véhicule thermique. L’évaluation environnementale nous permet de dégager le domaine de pertinence du véhicule électrique et des pistes pour l’améliorer. Enfin, cette évaluation peut porter sur des produits : ainsi l’analyse du cycle de vie d’un jean permet-elle de déterminer des pistes d’écoconception et de formuler des conseils à destination des utilisateurs et des professionnels.

Dans l’exemple illustré dans le schéma ci-dessus, l’unité fonctionnelle est un jean de 600 grammes, avec une doublure en polyester. Les cercles qui entourent le jean correspondent aux différentes étapes de sa fabrication, de son usage et de sa fin de vie. Quant aux ronds colorés, ils correspondent aux différents impacts de cette production sur l’eau, sur le réchauffement climatique, etc. On constate ainsi que les deux stades du cycle de vie du jean qui ont l’impact le plus important sur l’environnement sont la culture du coton, en haut à gauche, et l’utilisation et la fin de vie du jean, en bas à gauche. Globalement, 41 % des impacts environnementaux sont provoqués par l’usage et la fin de vie du jean, contre 51 % dans l’ensemble des autres étapes. Cela illustre l’importance des conseils d’achat à fournir aux particuliers quant à la matière première et la culture du coton, ainsi que celle des conseils d’usage, puisque le lavage du jean a un impact sur l’environnement.
Le programme de recherche de l’ADEME sur les analyses de cycle de vie vise à améliorer les méthodologies d’évaluation environnementale, notamment en prenant en compte le changement d’affectation des sols dans l’évaluation des biocarburants ; à développer des méthodes de calcul des impacts et des dommages potentiels qui supposent de définir et de caractériser des indicateurs d’impact intermédiaires (mid point), tels que l’épuisement de ressources, et finaux (end point), tels que la perte de biodiversité ; enfin, à construire des données d’inventaires de cycles de vie en partenariat avec les professionnels concernés. Pour les produits agricoles, nous développons ainsi avec les organismes de recherche une base Agribalyse sur les produits agroalimentaires et une base Acyvia sur les substances chimiques.
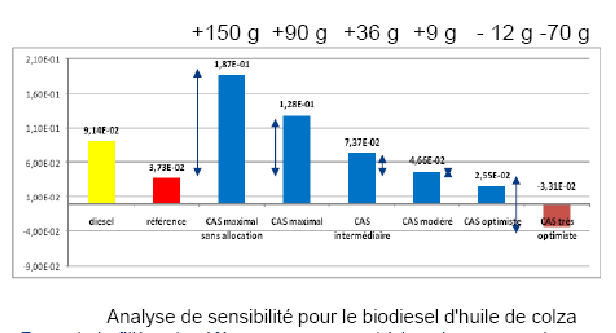
La question du changement d’affectation des sols pour les biocarburants a constitué un enjeu important pour leur qualification, compte tenu de la directive européenne sur les biocarburants.
Le graphique ci-dessus illustre l’impact, en grammes de CO2, de la production de biodiesel issu d’huile de colza. Le deuxième rectangle correspond à la solution de référence, qui ne prend pas en compte le changement d’affectation des sols lié à la fabrication de ce biodiesel. À droite de ce rectangle, nous présentons différentes hypothèses prenant en compte un changement d’affectation des sols, la pire des situations étant celle d’une forêt primaire coupée pour cultiver de l’huile de palme. Le biocarburant produit dans ce cas des émissions beaucoup plus élevées que le diesel fossile. Cette étude de cas a permis de montrer l’importance de la prise en compte du changement d’affectation des sols pour la production de biocarburants, par comparaison avec l’importation de carburants.
Quant aux modalités de soutien à la recherche, l’ADEME finance des bourses de thèse, ayant notamment pour objet l’évaluation des risques toxiques des nanomatériaux manufacturés ou encore la combinaison d’analyses de cycles de vie et de modèles économiques pour l’évaluation de systèmes de production agricole, avec l’INRA de Rennes. Nous soutenons également des programmes d’études et de recherche, comme par exemple le programme de construction de données d’inventaires Agribalyse ou encore un appel à projet de recherche d’écoconception dirigé vers les entreprises. Enfin, nous soutenons des initiatives collectives d’évaluation environnementale telles que le réseau SCORE-LCA.
L’appel à projet de recherche d’écoconception est renouvelé tous les deux ou trois ans. Dans le cadre de la troisième édition, qui a débuté en 2013, sept lauréats ont été désignés dans les domaines des produits d’emballage, de l’écoconception de logiciels, de l’économie de la fonctionnalité pour les meubles et l’aménagement de locaux commerciaux, de la location d’appareils culinaires, des sièges auto pour enfants et de l’écoconception de t-shirts en fibres de chanvre. Une étude réalisée en 2013 auprès de 119 entreprises situées en Europe et au Québec montre que l’écoconception contribue à augmenter les ventes, à réduire les coûts et à valoriser l’image des entreprises. Elle constitue donc une solution positive tant du point de vue économique qu’environnemental. 45 % des entreprises estiment que l’écoconception a un effet positif sur leurs profits. L’étude révèle que cette démarche a favorisé l’innovation.
Quant au réseau SCORE LCA, il correspond à une association d’études et de recherche créée en 2012 et dédiée aux travaux sur les analyses de cycle de vie et à la quantification environnementale. Regroupant plusieurs industriels, elle promeut et organise la collaboration entre entreprises, institutionnels et scientifiques en vue de la mise en pratique de la méthodologie des ACV. Les membres de ce réseau sont engagés dans une recherche dont les résultats sont appliqués à des problématiques concrètes dans les entreprises concernées. Ces actions de recherche hors champ de la concurrence peuvent être mutualisées. L’implication des membres de ce réseau dans le domaine de l’environnement est reconnue et valorisée au niveau international. Enfin, un directoire scientifique assure la qualité du programme.
S’agissant de l’affichage environnemental des produits et la base de données IMPACTS, les lois dites Grenelle I et II d’août 2009 et de juillet 2010 énonçaient un objectif d’accroissement de la transparence de l’information sur les caractéristiques des produits par l’évaluation environnementale des produits finis par grandes catégories, telles que l’habillement, le mobilier, l’alimentation, l’équipement, la détergence et la cosmétique. L’ADEME a donc créé des référentiels méthodologiques qui définissent les règles d’évaluation et de calcul des impacts environnementaux de chaque famille de produits. L’Agence a également créé la base de données IMPACTS qui rassemble les données génériques de référence nécessaires à l’analyse des cycles de vie : cette base garantit l’homogénéité des données utilisées par les entreprises et par conséquent la comparabilité des résultats d’analyse. Pour constituer cette base, nous avons acheté des bases existantes mais aussi coproduit des données avec des organismes de recherche. Enfin, nous développons des outils de calcul, connectés à la base IMPACTS et permettant à ces entreprises d’évaluer les impacts de leurs produits à partir de données génériques et de données spécifiques liées au processus de production : 73 % des entreprises ayant procédé à ces analyses s’en sont déclarées satisfaites en 2011-2012.
Pour l’ADEME, les enjeux de la recherche en évaluation environnementale consistent à disposer de méthodes et d’outils robustes, reproductibles et consensuels, compte tenu de leur impact sur les politiques publiques et les marchés ; à positionner les différentes approches entre elles ; à mobiliser des équipes de recherche pluridisciplinaires, étant donné les aspects économiques et sociologiques en cause ; et enfin, à articuler les évaluations environnementales et les risques sanitaires.
M. Jean-Marc Bournigal, vice-président de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), président de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA). Je remercie l’OPECST d’avoir organisé cette réunion. Au-delà d’un ton qui a pu être grave par instants, nous avons voulu mettre en évidence le travail collectif à l’œuvre dans la recherche environnementale. Depuis ses membres fondateurs jusqu’à ses membres associés, l’Alliance constitue en effet, M. François Houllier l’a rappelé, une collectivité fort nombreuse. Il peut sembler paradoxal de se placer sous la bannière de la recherche environnementale à l’heure où, de l’Agence nationale de la recherche et du programme « Horizon 2020 » jusqu’aux stratégies nationales en matière de recherche, on privilégie une entrée et un affichage par les enjeux sociétaux et que le mot environnement n’apparaît plus; mais, plutôt que de me ranger du côté des pessimistes qui y verraient un recul, j’y vois le signe que l’environnement est aujourd’hui partout.
Cette journée, en tout cas, aura fait ressortir la dynamique positive de la recherche environnementale et les enjeux stratégiques qu’elle recèle, en termes de valorisation économique mais aussi sociétale. Les présentations ont montré que cette dynamique repose, certes, sur une recherche fondamentale de haut niveau, mais aussi au vu de la complexité croissante des problèmes, sur la pluridisciplinarité et les partenariats. Ceux-ci associent non seulement le public et le privé, mais aussi les citoyens, qui ont un rôle de vigilance et peuvent contribuer à la collecte de données.
La recherche environnementale exige du temps, des investissements et une volonté tenace. Nous surveillons ainsi des bassins versants depuis plus de cinquante ans, et la collection de données sur la biodiversité représente une somme d’efforts considérable et un véritable patrimoine. Observer, décrire, comprendre, expérimenter et modéliser : c’est l’ensemble de ce processus qui permet in fine des valorisations et des innovations, en matière d’ appui aux politiques publiques, d’études, d’expertises ou de débouchés technologiques et d’activités de service.
La recherche environnementale a aussi comme spécificité de reposer sur des bases de données dont le partage, à l’échelle de la France, de l’Europe et même du monde, est un enjeu fondamental pour accélérer les progrès de la recherche. Le partage de ces donnée ne doit pas faire oublier que la collecte de ces données repose notamment sur des systèmes d’observation sur de très longue durée, qui sont des infrastructures de recherche, pour la majorité mutualisées au sein des membres de l’Alliance, dont le maintien du financement dans le temps nécessite d’être pris en compte.
L’art inquiète et la science rassure, disait en substance Georges Braque ; mais la science génère aussi des craintes, à travers les dangers supposés de ses innovations, les spoliations qu’elle opérerait aux dépens de la biodiversité et des traditions des peuples ou encore le caractère partisan des choix qu’elle imposerait en matière de réglementation. Cette dernière, par définition, fait toujours des mécontents, qui se plaignent, ou de sa lourdeur, ou de son insuffisance. S’il appartient au politique de faire des choix, il appartient à la science de faire avancer les connaissances mais aussi de contribuer à en évaluer les conséquences pour accompagner le progrès, tâche qui place souvent les chercheurs dans une situation inconfortable dans le débat sociétal actuel qui pourrait aboutir si l’on ni prend pas garde, à une remise en cause du rôle de la recherche et de la liberté des chercheurs. Le rôle de la recherche dans la société est aussi, d’ailleurs, une question épineuse pour les politiques, le président Le Déaut le rappelait.
En ce qui concerne la contribution de la recherche au développement économique, de nombreux outils ont été créés, et les mentalités évoluent : une vision humaniste de la recherche fait place, en ces temps difficiles, au souci de sa valorisation économique. Les investissements d’avenir ont fait émerger les consortiums de valorisation des Alliances de recherche, les sociétés d’accélération du transfert de technologies, les Instituts Carnot, les structures existantes de valorisation et de transfert des organismes de recherches, sans oublier les pôles de compétitivité et les grappes d’entreprise, sont autant de structures d’accompagnement pour les chercheurs, pour qui le rapprochement avec le monde économique ne va pas toujours de soi. Beaucoup de ces instruments étant en cours de développement, il est difficile d’en tirer des enseignements à ce stade ; nous devons en tout cas éviter les dérives bureaucratiques, la multiplication des structures favorisant leur indépendance, sans parler du surcroît de complexité.
Ces évolutions traduisent un engagement fort des pouvoirs publics dans l’accompagnement de la valorisation de la recherche et de l’innovation, à travers des investissements dont il est légitime d’attendre des valorisations, qu’elles soient économiques ou sociétales. La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a fait du transfert l’une des missions de la recherche – ce qu’il était déjà, mais pas en des termes aussi explicites.
Mes remerciements vont au président Bruno Sido, à madame Anne-Yvonne Le Dain et à monsieur Jean-Yves Le Déaut, mais aussi à monsieur Benoît Fauconneau, secrétaire exécutif d’AllEnvi, à monsieur Gérard Jacquin, animateur du groupe CovAllEnvi et président d’INRA Transfert, à madame Nathalie
Le Bars, de l’OPECST, qui nous a beaucoup aidés dans l’organisation de ce colloque, et à madame Aliette Maillard, directrice de la communication à l’IRSTEA.
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l’OPECST. Merci pour cette synthèse, qui dessine des pistes pour l’avenir. La vraie démarcation ne me semble pas être entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, mais entre la recherche – bonne ou mauvaise – et les applications qu’on peut en tirer. Cette vision ouvre des perspectives et donne de la liberté, sans exclure le contrôle.
M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST. Je remercie l’ensemble des participants, qui ont su faire preuve de pédagogie – y compris par le moyen de métaphores – et l’équipe de l’OPECST. Cette journée, qui aura réuni des entrepreneurs et des chercheurs de l’Alliance, aura été placée sous le signe fort de la parité ; elle nous aura aussi donné une vision plus claire de la recherche environnementale. Il y a une vingtaine d’années, nous nous efforcions de détecter, au sein des organismes de recherche, des unités spécialisées dans l’environnement – le CNRS, l’INRA ou le CEA eux-mêmes n’en possédaient pas. Nous avions alors réussi à fédérer des équipes issues de départements différents, cependant que l’IRSTEA et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) restaient cantonnés dans une spécialisation marquée.
L’alliance sert à fédérer, à coordonner et à mettre en réseau, avec pour objectif de relever des défis environnementaux à l’échelle nationale et mondiale, qu’il s’agisse de l’alimentation, de l’eau, du climat ou des territoires. Le thème de la qualité de l’air, abordé ce matin, montre la pertinence de regroupements, par exemple entre l’environnement et la santé.
L’enjeu est de relever ces défis à travers la stratégie nationale de recherche, qu’aux termes de la loi, je le rappelle, l’OPECST doit évaluer tous les deux ans – pour ma part, je participe à sa définition tout en m’occupant de son évaluation pour le Parlement.
Le lien entre la recherche fondamentale et ses applications est un sujet majeur, de même que le développement de cette recherche au niveau mondial. L’un des interlocuteurs soulignait que, dans son secteur, 60 % des innovations se font aux États-Unis. Nous avons donc des parts de marché à conquérir : il serait dommage de ne pas engranger comme fruits de notre effort de recherche des dividendes pour l’industrie, la compétitivité de nos entreprises et l’emploi.
L’OPECST continuera de suivre l’action des alliances au service de la collectivité, notamment dans le domaine de l’environnement, qui intéresse beaucoup nos concitoyens et le Parlement. Il faut en tout cas, cette journée nous en aura convaincus, poursuivre la réflexion sur une démarche dont les débuts apparaissent prometteurs. Je vous remercie donc d’avoir pris l’initiative de cette rencontre, que nous sommes heureux d’avoir pu concrétiser.
EXTRAIT DE LA RÉUNION DE L’OPECST DU 28 JANVIER 2015 PRÉSENTANT LES CONCLUSIONS DE L’AUDITION PUBLIQUE
Mme Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente. – Cette audition constituait une première puisque l’Alliance nationale de la recherche pour l’environnement (AllEnvi) a souhaité présenter une partie des résultats de ses travaux devant l’OPECST. La démarche est apparue particulièrement intéressante car elle met en lumière les retombées positives de la recherche et la nécessité de soutenir celle-ci sur le long terme, afin qu’elle puisse se traduire en progrès sociétaux et économiques.
Le domaine de l’environnement a semblé parfaitement adapté pour cette démonstration car il recouvre des enjeux cruciaux pour l’avenir et se trouve au cœur des politiques publiques et des préoccupations de nos concitoyens. Parmi les différents groupes thématiques que comporte l’alliance, l’audition a mis l’accent, en matière de valorisation, de transfert et d’innovation, sur la place fondamentale du comité de valorisation de l’alliance : CoVallEnvi qui coordonne les différents services de valorisation des membres de l’alliance. La question de la propriété intellectuelle (dépôt de brevets, signature de licences, …) constitue notamment un enjeu important si l’on veut protéger les innovations issues de la recherche publique.
L’audition a présenté un certain nombre de réalisations significatives choisies dans les domaines très diversifiés que recouvre la recherche environnementale qui peuvent aller de la mesure de la qualité de l’air intérieur jusqu’au plantes à traire, en passant par la restauration des populations d’esturgeons, pour ne citer que quelques exemples. Ces exemples concrets de partenariats d’entreprises ou de collectivités publiques avec des organismes de recherche illustrent les différents types d’impacts que la recherche environnementale peut avoir sur la société et sont l’occasion de prendre conscience de l’utilité de celle-ci. La recherche environnementale repose actuellement sur une forte pluridisciplinarité et un travail collectif qui intègre les sciences humaines et les sciences sociales pour mieux appréhender les retombées économiques et sociétales de celle-ci. Elle est appelée à jouer un rôle déterminant en matière de prévention et de débouchés technologiques, en s’appuyant notamment sur les bases de données et la modélisation.
L’audition a souligné les temps de développement longs de la recherche environnementale et des applications industrielles qui peuvent en découler. Il est donc essentiel de développer des moyens de financement adaptés à ces temps de cycles longs. À cet égard, Bpifrance est susceptible de jouer un rôle d’impulsion décisif.
Il apparaît également important d’accélérer les processus d’homologation. L’interface entre la recherche et la réglementation constitue un préalable indispensable : des évolutions réglementaires sont souvent nécessaires pour permettre l’émergence d’un marché. Cela implique une réflexion sur le principe de précaution qui prenne en compte les évolutions technologiques et économiques. Ainsi, il serait souhaitable de revoir la composition des commissions d’évaluation et d’y introduire plus de diversité, en y faisant figurer davantage d’universitaires, à côté des spécialistes de la réglementation. D’une manière générale, l’innovation devrait être mieux prise en compte dans l’évaluation des chercheurs et des laboratoires, dans le domaine des sciences de l’environnement comme dans les autres.
Il est indispensable de constituer des filières qui partent de la recherche fondamentale pour aller jusqu’aux PME, en bénéficiant du soutien de grands groupes industriels français. Les dispositifs financiers d’accompagnement et de soutien, qu’ils soient publics ou privés, sont essentiels aussi bien aux étapes de pilotage et de pré-industrialisation, qu’au moment de la mise sur le marché. C’est ainsi qu’on pourra gagner des parts de marché, y compris à l’international et créer un nombre significatif d’emplois, permettant à la recherche environnementale d’être porteuse d’avenir et facteur de progrès social.
Cette première audition publique appelle une poursuite des contacts entre l’OPECST et l’alliance AllEnvi, notamment à travers des visites sur place qui sont déjà envisagées.
© Assemblée nationale