Document mis en distribution le 21 février 2001 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000. RAPPORT D'INFORMATION déposé en application de l'article 145 du Règlement PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE SUR LES OBSTACLES AU CONTRÔLE ET À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE ET DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN EUROPE (1) PRÉSIDENT M. Vincent PEILLON, RAPPORTEUR M. Arnaud MONTEBOURG, Députés. -- TOME I Monographies Volume 3 - La Suisse (1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. Banques et établissements financiers. La Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe est composée de : M. Vincent Peillon, Président ; MM. Michel Hunault, Jean-Claude Lefort, Vice-Présidents ; MM. Charles de Courson, Philippe Houillon, Secrétaires ; M. Arnaud Montebourg, Rapporteur ; MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Alain Barrau, Jean-Louis Bianco, Jérôme Cahuzac, Jacky Darne, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Jean-Jacques Jegou, Gilbert Le Bris, François Loncle, Mmes Jacqueline Mathieu-Obadia, Chantal Robin-Rodrigo. S O M M A I R E _____ Pages AVANT-PROPOS 9 I.- LA SUISSE, UN PRÉDATEUR DE LA FINANCE MONDIALE 12 A.- LA RÉPUBLIQUE DES BANQUIERS 12 1.- Une alliance entre cantons souverains 12 2.- Le berceau des banquiers 14 3.- Une neutralité rentable 17 a) La Suisse, banquier du Reich 18 b) La question des avoirs juifs 20 B.- LA SUISSE S'EXPOSE À L'AFFLUX DE CAPITAUX D'ORIGINE DOUTEUSE 22 1.- Le caractère attractif de la place bancaire suisse 23 a) L'attachement de la Suisse à son secret bancaire 23 b) Une fiscalité préférentielle pour les non-résidents 29 c) La Suisse répond à la définition du centre offshore 34 2.- Une place financière en pleine expansion 37 a) Les banques en Suisse : un secteur en pleine croissance 37 b) Un secteur financier aussi puissant que discret 39 3.- La Suisse associée à la délinquance financière internationale 42 C.- LA SUISSE NE RÉAGIT QUE SOUS LA PRESSION INTERNATIONALE 44 1.- Les règles conventionnelles 46 a) La convention de diligence des banques 46 b) Les circulaires de la Commission fédérale des banques 47 2.- Les dispositions du code pénal 48 3.- La suppression des comptes anonymes 53 4.- La loi-cadre sur le blanchiment des capitaux du 10 octobre 1997 (loi L.B.A.) 54 II.- DES BANQUES SUISSES PEU IMPLIQUÉES DANS LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 59 A.- UN NOMBRE DÉRISOIRE DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS 62 1.- Une réticence de principe 62 2.- Une interprétation restrictive des recommandations du GAFI 66 3.- La contrainte du blocage des fonds 70 4.- Des obligations de déclarer les soupçons fondés sur l'exclusive bonne volonté des banquiers 72 B.- DES OBLIGATIONS DE DILIGENCE À RENFORCER 75 1.- Les limites à l'identification de l'ayant droit économique 75 a) Le titulaire du compte bancaire est présumé en être le bénéficiaire 75 b) Un principe qui souffre d'un trop grand nombre d'exceptions 80 c) Le problème des comptes de sociétés domiciliées offshore 84 2.- Des procédures de clarification qui n'empêchent pas le dépôt de fonds d'origine douteuse 90 a) Des obligations théoriquement contraignantes 90 b) Les avoirs des « personnes politiquement exposées » 95 c) Le cas des fonds Abacha 96 C.- LA CONCURRENCE DES AUTRES CENTRES OFFSHORE 106 1.- La recherche de la confidentialité 106 2.- La proximité du Liechtenstein 109 III.- DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ABSENTS DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 113 A.- UNE AUTORÉGULATION DIFFICILE À METTRE EN _UVRE 114 1.- Un champ d'application mal délimité 115 2.- Des intermédiaires financiers en nombre pléthorique 121 B.- DES PREMIERS RÉSULTATS PEU CONCLUANTS 123 1.- Une Autorité de contrôle contestée 123 2.- Des intermédiaires financiers qui ont du mal à jouer le jeu 130 a) Les intermédiaires financiers peinent à apurer le passé 132 b) Les intermédiaires financiers ne font pas de déclarations de soupçons 133 C.- LES AFFAIRES CONTINUENT 136 1.- L'utilisation des fiduciaires 136 a) Des mécanismes bien connus 136 b) L'atonie de la Chambre fiduciaire 139 2.- Le cas de la BCGE 141 IV.- UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE À GÉOMÉTRIE VARIABLE 145 A.- LA SUISSE COOPÈRE 148 1.- Fondements de la coopération suisse 148 2.- L'exception fiscale et sa dérogation, l'escroquerie fiscale 153 B.- D'UN CANTON À L'AUTRE LA COOPÉRATION VARIE 160 C.- LE MAINTIEN DES VOIES DE RECOURS 168 V.- DES MOYENS NOTOIREMENT INSUFFISANTS ALLOUÉS À LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT 176 A.- LA PAUVRETÉ DES MOYENS ACCORDÉS AUX AUTORITÉS ANTI-BLANCHIMENT 176 1.- Les effectifs réduits du Bureau de communication 176 2.- La faiblesse des moyens attribués à l'Autorité de contrôle 178 B.- LE PROJET DE LOI SUR L'EFFICACITÉ 184 1.- Présentation de la réforme 186 a) La compétence de la Police judiciaire fédérale en matière de blanchiment 186 b) La compétence du Service d'analyse et de prévention pour procéder à l'analyse stratégique des cas de blanchiment 187 2.- Un pari très audacieux 188 3.- Le choix d'une approche intégrée 191 a) L'intégration du blanchiment dans l'ensemble de la criminalité organisée 191 b) L'intégration du blanchiment dans l'ensemble des activités de surveillance 192 CONCLUSION 195 EXAMEN DU RAPPORT 205 EXPLICATIONS DE VOTE 209 EXPLICATIONS DE VOTE DU COMMISSAIRE APPARTENANT AU GROUPE DÉMOCRATIE LIBÉRALE 210 EXPLICATIONS DE VOTE DU COMMISSAIRE APPARTENANT AU GROUPE COMMUNISTE 211 AUDITIONS 213 ANNEXES 405 SOMMAIRE DES AUDITIONS Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des entretiens de la Mission
Les auditions suivantes tenues par le Rapporteur sont présentées dans l'ordre chronologique
La Mission anti-blanchiment a poursuivi son travail de diagnostic et d'investigation à travers l'Europe. Après la Principauté du Liechtenstein, après la Principauté de Monaco, les députés se sont penchés sur les conditions de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Confédération helvétique. Ce travail s'achève à un moment où les exigences à l'égard de la lutte contre le blanchiment sont devenues une priorité de l'action des gouvernements de l'Union européenne. Un an après le sommet de Tampere, en octobre 1999, le Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l'Union qui s'est tenu le 17 octobre 2000 à Luxembourg, a accru la pression politique, juridique, économique et financière à l'encontre des territoires non coopératifs et centres offshore du reste du monde. Pour sa part, le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), après avoir établi en juin 1999, une liste de quinze territoires et pays non coopératifs, vient de publier un premier rapport d'étape concernant les premières mesures prises par sept de ces Etats et procédera prochainement à l'évaluation des progrès accomplis dans lesdits pays. Le GAFI se réserve la possibilité de prendre en juin 2001 des décisions plus contraignantes telles que le prononcé de restrictions ou d'interdiction des transactions financières avec l'ensemble des juridictions non coopératives qui n'auraient pas fait de « progrès adéquats ». Par ailleurs, dans son dernier rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux portant sur la période 2000-2001, paru le 4 février 2001, le GAFI s'inquiète de l'utilisation des fiducies - « Bien qu'elles aient de nombreuses utilisations légitimes... les fiducies, ainsi que d'autres formes de sociétés, sont de plus en plus perçues comme un dispositif-clé des mécanismes de blanchiment à grande échelle ou complexes... Ce qui préoccupe les autorités chargées de la lutte anti-blanchiment, c'est l'anonymat apparemment inviolable qu'une fiducie peut offrir à son propriétaire ou bénéficiaire réel. » (point 83) - et propose des solutions juridiques plus contraignantes pour lutter contre le détournement de tels mécanismes juridiques à des fins criminelles. C'est dans ce contexte de renforcement des contraintes et des pressions internationales que la Mission anti-blanchiment a décidé de publier l'ensemble des informations qu'elle a recueillies au cours de ses deux voyages en Confédération helvétique. Sur le plan strictement méthodologique, le lecteur s'apercevra que la Mission, dans son travail d'investigation et de recoupement des données collectées, ne s'est appuyée que sur des informations, des déclarations ou des appréciations en provenance des institutions et des autorités suisses. Le rapport a délibérément voulu entrer dans le détail technique, mais impérieusement nécessaire, des mécanismes mis en place par les autorités politiques de la Confédération helvétique pour lutter contre le blanchiment. L'un de nos interlocuteurs, Bernard Bertossa, Procureur Général près la République du canton de Genève, a parfaitement résumé la situation de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment : « L'existence de la loi est une chose, sa mise en _uvre en est une autre » Ce rapport s'attache en matière bancaire, financière ou judiciaire, à ne pas se contenter des apparences, à regarder les actes plutôt que les intentions, à mesurer les résultats plutôt que la bonne volonté. A cette aune, si la Suisse donne l'impression de lutter ardemment contre le blanchiment, les résultats obtenus et les moyens engagés par les autorités fédérales font apparaître un retard considérable sur ses voisins de l'Union européenne. La lenteur de réaction des institutions financières suisses, la culture du secret attachée à une tradition économique et une véritable stratégie de développement financier profondément implantée dans son histoire, le refus des autorités politiques et administratives de faire preuve de volontarisme en la matière, le découragement des combattants suisses de la lutte anti-blanchiment auquel nombre d'entre eux cèdent, nous ont amenés à décrire par le menu les lourdes défaillances du système suisse qui se révèlent de façon éclatante. Nous regrettons que les autorités fédérales suisses n'aient pas accepté de nous laisser publier intégralement des déclarations du directeur de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment, du directeur de la Délégation aux questions monétaires et financières internationales, du directeur-adjoint de l'Office fédéral de la police, du chef du service juridique du ministère public de la Confédération, du chef suppléant de la section des marchés et services financiers, ou du chef du service économique et financier au département fédéral des Affaires étrangères recueillies au cours du voyage du rapporteur, Arnaud Montebourg, à Berne, le 28 septembre 2000. Nous regrettons également que les autorités judiciaires et policières du canton de Zürich nous aient adressé une fin de non-recevoir aux questions précises que nous leur avons posées pour compléter et préciser le contenu de l'entretien qu'elles ont accordé au rapporteur lors de sa venue à Zürich, en septembre 2000. Ces complications qui nous ont ainsi été faites nous ont amenés à rechercher des informations par d'autres voies que celles officielles que nous avons toujours souhaité emprunter. La Mission a, par ailleurs, fait des découvertes qui ont amené le rapporteur à dénoncer aux autorités judiciaires françaises des faits délictueux de blanchiment survenus sur le territoire de la République française en liaison avec des intervenants suisses. Cette dénonciation aux parquets compétents a découlé de l'article 40 du Code de procédure pénale qui fait obligation à « toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat, tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Parmi les dénonciations faites à ce titre, l'une concerne le comportement sur notre territoire d'une filiale de la Banque Cantonale de Genève. Il reste dès lors à espérer que, de la même façon que la pression internationale a eu raison du système bancaire suisse sur la question des avoirs juifs en déshérence, les autorités helvétiques reprendront sans délai ce dossier de la lutte anti-blanchiment des capitaux qui mérite davantage d'énergie, de volonté politique, de moyens humains et budgétaires. Si tel n'était pas le cas dans un proche avenir, nul ne sera étonné que la critique européenne et internationale s'intensifie gravement et se dramatise à l'égard de la Suisse. I.- LA SUISSE, UN PRÉDATEUR DE LA FINANCE MONDIALE A.- LA RÉPUBLIQUE DES BANQUIERS 1.- Une alliance entre cantons souverains Petit Etat de 7,1 millions d'habitants (1997) pour une superficie de 41 000 km², la Suisse occupe une situation géographique enviable. Sa situation de carrefour des routes nord-sud - entre l'Italie et l'Europe hanséatique - et est-ouest - entre la France et l'Europe orientale - la place au c_ur des flux d'échanges économiques et humains. Mais sa géographie montagneuse oppose à ces mêmes échanges des reliefs élevés et un climat parfois rigoureux. Les historiens font du Pacte fédéral de 1291 le véritable acte de naissance de ce qui deviendra la Confédération helvétique. Par cette charte, signée sans limitation de durée, des représentants d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald concluent une alliance pour lutter contre la puissance de leurs suzerains - les Habsbourg - qui cherchent à étendre leur influence. La période 1291-1513 est celle de la constitution de la Confédération des huit cantons, par adjonctions progressives à partir du socle originel de 1291. Cédant progressivement à la tentation d'accéder au rang de grande puissance, les Confédérés tentent de s'étendre dans toutes les directions, jusqu'à ce que la victoire française à Marignan marque le terme de ces velléités. La Suisse de l'époque moderne n'est donc pas un Etat, mais un ensemble de souverainetés locales. La Diète, qui réunit les députés de chaque canton, n'a pas de véritable pouvoir : il manque un gouvernement central, un pacte unique liant tous les cantons et une armée commune. La Confédération est juridiquement reconnue par les parties signataires du Traité de Westphalie (1648), mais il faut attendre 1798 et l'occupation des Etats de la Confédération par Bonaparte pour que celle-ci soit dotée d'une véritable Constitution, qui en fait un État unitaire et une République « une et indivisible ». Après la défaite de Napoléon et le Congrès de Vienne, les Alliés restaurent les Etats et les gouvernements sur le modèle existant avant la Révolution (pacte fédéral de 1815). La Confédération est constituée par l'alliance de 22 cantons souverains. Une seule liberté est garantie par le pacte, la liberté de commerce. Une Diète, assemblée de délégués des cantons, forme le gouvernement central. Par ailleurs, la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'inviolabilité de son territoire sont reconnues et garanties. En 1848, le pays devient un Etat fédératif. Les 22 cantons perdent une partie de leur souveraineté au profit de l'État suisse (armée, affaires étrangères, douanes, postes et monnaie). Les autorités fédérales se mettent en place : sept conseillers fédéraux responsables de l'exécutif, un parlement bicaméral et un tribunal fédéral. Sa constitution sera révisée en 1874 et 1999, afin d'en accentuer le caractère démocratique. Aujourd'hui, la Suisse - toutes proportions gardées - présente une structure analogue à celle des Etats-Unis : c'est une réunion de cantons comme les Etats-Unis sont une réunion d'Etats. Tous les cantons ont leur propre constitution, pour laquelle ils jouissent d'une très grande liberté dès lors qu'ils respectent la forme républicaine et assurent l'exercice des droits politiques. Chacun envoie une députation de deux membres au Conseil des Etats. Les cantons disposent de compétences étendues en matière d'éducation, de fiscalité, de santé publique, de police du commerce, d'aménagement du territoire, de maintien de l'ordre public et d'organisation judiciaire. En revanche, ils sont soumis à la Confédération en matière de droit civil et pénal. Le Parlement comprend deux chambres. Le Conseil national compte 200 membres, répartis entre les cantons en proportion de leur population et élus pour une période de quatre ans à la représentation proportionnelle. Le Conseil des Etats compte 46 membres, soit deux par cantons et un par demi-canton. Ces députés sont élus selon le droit cantonal, pour une période de quatre ans. Le Conseil fédéral constitue le pouvoir exécutif. Les conseillers fédéraux sont élus, tous les quatre ans, par l'Assemblée fédérale (les deux chambres réunies). Depuis 1959, les groupes principaux de l'Assemblée fédérale ont conclu un accord au terme duquel est formée une coalition comprenant des socialistes, des radicaux, des démocrates-chrétiens et des centristes ; cette combinaison étant établie, la seule inconnue réside dans la personnalité des élus. Le Conseil est responsable de l'activité gouvernementale. Il lui appartient donc de fixer les objectifs fondamentaux et les moyens d'action de l'État, de planifier et coordonner la politique gouvernementale et d'assurer sa mise en _uvre et de représenter la Confédération à l'étranger. Dans les cas litigieux, il approuve les actes législatifs des cantons, dans la mesure où un acte normatif fédéral, soumis au référendum, le prévoit. Le président de la Confédération, qui change chaque année, a pour principale tâche de présider les séances du Conseil et de départager en cas d'égalité des voix. Dans cette démocratie si particulière, le gouvernement ne démissionne pas lorsqu'il est mis en minorité par le Parlement. Le vote de la motion de censure n'y est d'ailleurs pas possible, comme c'est le cas dans d'autres systèmes parlementaires. Inversement, le Parlement n'a pas le pouvoir de destituer le gouvernement ni de démettre un conseiller en cours de législature. La principale caractéristique du système politique suisse est donc sa stabilité. La physionomie politique du Parlement n'a guère varié depuis 1919 - introduction de la proportionnelle -, dominée par quatre grands partis représentés par une quarantaine de députés au Conseil national. S'agissant du gouvernement, sa composition politique est la même depuis 1960, fait unique dans les Etats démocratiques et qui donne à la diplomatie suisse une immobilité - que d'aucuns qualifieront de pragmatisme - proverbiale. La Suisse bénéficie d'un poids économique et financier que la modestie de sa population et de sa géographie ne semble pas autoriser. Il est vrai qu'au-delà des images d'Epinal d'une Suisse paisible, terre du chocolat, du Matterhorn et du lait frais, se dissimule un véritable prédateur de la finance mondiale. Le renom de la place financière suisse ne date pas d'hier. Il s'appuie sur une tradition séculaire, qui débute au Moyen-Age avec l'établissement des premières banques privées dans certains cantons. Pendant la Réforme au XVIème siècle et l'émergence du calvinisme, des protestants persécutés affluèrent de toute l'Europe - principalement de France et d'Italie - et trouvèrent refuge en Suisse, notamment à Genève. Parmi ceux-ci, quelques banquiers qui ne manquèrent pas d'y développer leurs talents. Les banquiers suisses ne tardèrent pas à s'établir dans les grands pays voisins, où ils profitèrent de l'appui et de l'expérience des maisons de commerce et banques huguenotes déjà existantes. Les banquiers genevois furent ainsi particulièrement attirés par les affaires françaises - c'est-à-dire des opérations pour le compte d'un Etat royal dont l'impécuniosité a été un travers récurrent. La guerre de succession d'Espagne (1701-1714) fournit l'occasion d'interventions rémunératrices et aux noms célèbres de Thellusson, Vernet, Necker et Mallet, viennent s'ajouter ceux des vaudois Panchaud et Delessert - créateurs à Paris de la Caisse d'escompte - et des neuchâtelois Rougemont et Perregaux ; ce dernier fut d'ailleurs, avec Le Couteulx de Canteleu, l'un des cofondateurs de la Banque de France. On trouve à la même époque à Paris Jean-Conrad Hottinger, de Zürich - futur banquier de Napoléon. Le destin de Jacques Necker apparaît à tous égards exceptionnel. 1 Un destin exceptionnel dans la banque : Jacques Necker Le père, Jacques Necker, protestant genevois né en 1732 et monté jeune à Paris, entra dans la banque et y fit une fulgurante carrière. Membre du conseil d'administration de la Compagnie des Indes dès 1764, il sauva la vénérable institution de la faillite. En 1768, il fut ministre de la République de Genève auprès du roi de France. En 1770, il acheta le château de Saint-Ouen et, deux ans plus tard, se retira précocement des affaires - à trente-huit ans... - avec une fortune de sept à huit millions de livres. Il avait épousé en 1764 Suzanne Curchod, née en 1737 dans le pays de Vaud. Cette fille de pasteur tint, pour servir la carrière de son mari, un des plus brillants salons de Paris. Ses réceptions du vendredi accueillirent l'abbé Morellet, Galiani, Diderot, Grimm, Marmontel, d'Alembert ou Buffon. Femme de grande culture, protestante convaincue et adepte de la bienfaisance, elle fonda l'hôpital qui porte son nom. Une nouvelle carrière, politique et littéraire, commença alors pour les Necker. Le financier se fait écrivain. En 1773, ce fut l'Eloge de Jean-Baptiste Colbert, couronné par l'Académie française ; en 1775, le Traité sur la législation et le commerce des grains. Surtout, après la disgrâce de Turgot en novembre 1776, Necker - pourtant étranger et protestant - fut nommé directeur du Trésor royal. Il supprima les intendants des finances et, l'année suivante, prit le titre de directeur général des finances. Ministre prudent et habile, le Genevois se distingua par son souci de l'opinion publique: en 1780, il publia le Compte rendu au roi de sa gestion, dont le succès public fut prodigieux (trente mille exemplaires vendus en deux semaines). Victime d'intrigues de cour, comme tant de ses prédécesseurs, il fut congédié en 1781. Dans sa retraite, il composa son Traité sur les finances de la France (1784). En 1788, Necker fut rappelé aux affaires. Il fut à nouveau directeur général des finances, mais aussi ministre d'Etat et premier ministre de fait. Pour résoudre la crise financière, il décida le roi à convoquer les Etats généraux. Mais le brillant ministre ne tarda pas à être emporté par le souffle de la Révolution naissante. Son discours inaugural aux Etats généraux ne remporta qu'un médiocre succès. Peu après, pendant les journées de juin et juillet 1789, il fut davantage le jouet des événements que leur instigateur et n'eut guère de prise sur son nouveau renvoi, son rappel et le triomphe qui s'ensuivit. Cette apothéose ne dura d'ailleurs qu'un instant. Premier des monarchistes, partisan d'une constitution à l'anglaise, il se sentit vite dépassé par le cours de l'histoire. Son immense popularité s'étiola rapidement, et c'est dans l'indifférence générale qu'en septembre 1790, il remit sa démission - pour la troisième et dernière fois. Il mourut en 1804. Paris n'est pas la seule ville où les banquiers suisses se distinguent. A Londres, on voit à la fin du XVIIème siècle un groupe de genevois, de vaudois et de bernois participer aux affaires financières de la place : ils sont très actifs à la bourse, où ils placent des sommes importantes pour le compte de leurs correspondants et clients du continent - notamment de Berne et de Zürich. De ce milieu, sortiront les banques londoniennes Thellusson et Haldimand, qui donneront des gouverneurs et des directeurs de la Banque d'Angleterre. A Vienne, les bâlois Ochs et Geymüller accèdent au rang de banquiers de la cour, alors que Hippenmeyer crée et dirige la Banque d'émission autrichienne (1816). Les De La Rüe s'imposent à Gênes, Jean-Gabriel Eynard à Florence, Isaac Iselin et Albert Gallatin aux Etats-Unis. Le XIXème siècle voit le système bancaire suisse se renforcer et se segmenter en fonction des demandes de sa clientèle. Une séparation se marque entre les banques de famille - dans lesquelles les associés, peu nombreux, sont indéfiniment responsables à titre personnel des engagements de leur maison - et les institutions bancaires spécialisées comme les caisses d'épargne, les caisses d'escompte, les crédits fonciers et les banques d'émission. C'est surtout l'apparition des grandes banques qui donnera à l'armature bancaire suisse sa configuration actuelle. En 1856, le Crédit suisse est fondé par le notable zurichois Alfred Escher (1819-1882), qui fut longtemps conseiller national et que son activité dans le domaine ferroviaire avait fait surnommer « le roi des chemins de fer ». En 1862, est créée la Banque de Winterthour qui, après sa fusion avec la banque du Toggenbourg, deviendra l'Union de banques suisses. A la même époque, Jakob Stämpfli (1820-1879), personnalité influente de la vie politique bernoise, crée la Banque fédérale tandis qu'apparaissent la Banque commerciale de Bâle et la Banque populaire de Berne. Enfin, en 1872, est créée la Société de banques suisses (Basler Bankverein), par l'union de cinq anciennes banques privées. Cette vague de créations bancaires s'inscrit dans le grand mouvement qui voit se constituer, à la même époque, les principaux établissements de crédit en France, en Allemagne et en Angleterre : c'est le début de la mobilisation des épargnes nationales pour financer les investissements considérables requis par l'industrie, les transports, les mines et le commerce. Marquées, à leur début, par le modèle qu'offrait les grandes banques allemandes et françaises, les banques commerciales suisses n'ont pas voulu devenir concomitamment des banques d'affaires - c'est-à-dire des organismes qui, à côté des opérations courantes d'une grande banque, entendent jouer un rôle dans la promotion et la prise de participations dans des affaires autres que bancaires (par exemple, des affaires industrielles). Ce n'est qu'à l'époque contemporaine que ces rapprochements entre banques commerciales et banques d'affaires s'effectueront, sur le modèle des stratégies adoptées par les grands établissements anglo-saxons. Sa neutralité permet à la Suisse de traverser sans grands dommages la guerre de 1914-1918. Il est vrai que les sympathies y étaient partagées entre les belligérants : alors que les Empires centraux jouissaient, dans les cantons alémaniques, d'un courant d'opinion favorable, la Suisse romande soutenait au contraire vigoureusement la cause des Alliés. Dès lors, les difficultés liées aux aléas du cours de la guerre, les problèmes d'approvisionnement rendus plus complexes par l'entrée en guerre de l'Italie et des Etats-Unis et l'intensification de la guerre sous-marine, purent être limités. En 1913, les importations en provenance des Alliés et des Empires centraux sont égales ; au cours de la guerre, l'équilibre se rompt fort opportunément en faveur des Alliés, qui contrôlent la fourniture de tous les produits d'Outre-mer. Le Traité de Versailles confirma la neutralité helvétique. De cette époque, date l'Union douanière, monétaire et postale de la Principauté du Liechtenstein avec la Suisse. Durant les années trente, la Suisse sait faire de son repli sur elle-même un argument pour attirer les avoirs de ceux que l'évolution du monde inquiète - qu'il s'agisse de la haute bourgeoisie française, qui n'a pas accepté l'arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, ou de ceux des capitalistes allemands que la montée du parti nazi condamnait à l'effacement, voire à la destruction. a) La Suisse, banquier du Reich Dès le début du second conflit mondial, soit deux mois après la défaite française, la Suisse mène des négociations commerciales actives avec l'Allemagne alors que la Confédération se trouve désormais encerclée par les puissances de l'Axe. En 1941-1942, on estime ainsi que 60 % de l'industrie d'armement, 50 % de l'industrie optique et 40 % des industries d'équipement travaillaient pour le Reich2. L'Allemagne et ses alliés deviennent alors des partenaires commerciaux auxquels rien ne saurait être refusé : les exportations suisses ne trouvant pas leur entière contrepartie dans des livraisons allemandes, la Confédération fournit des avances sous forme de crédits (crédits de compensation). L'Etat national-socialiste, en faisant peser constamment la menace d'une rupture des approvisionnements, obtint que ce crédit de compensation s'accroisse sans cesse - pour atteindre, à la fin de la guerre, 1,1 milliard de francs suisses. Surtout, la Suisse, en raison de son rôle sur le marché de l'or, revêtait une importance cruciale pour l'Allemagne. Celle-ci avait en effet besoin de devises pour se procurer des marchandises d'importance stratégique auprès de ses alliés. La plupart des pays neutres - comme la Suède et le Portugal - a refusé d'accepter l'or allemand, notamment et probablement saisi dans toute l'Europe sur les victimes des camps de concentration. La Suisse n'eut pas de telles délicatesses et accepta cet échange d'or allemand contre devises. L'utilité de cette conversion pour l'Allemagne était telle que le ministre du Reich et président de la Reichsbank, Walter Funk, estimait que son pays ne pouvait pas renoncer plus de deux mois à cette prestation de la Suisse. Dans l'ensemble, 1,6 milliard de francs d'or fut échangé contre des devises libres - le tout, sous le contrôle de la Banque nationale suisse et avec l'autorisation politique au plus haut niveau du Conseil fédéral.
« Il y a quelques années encore, on considérait que la résistance armée du pays avait été déterminante pour éviter à la Suisse d'être envahie. Aujourd'hui, on peut affirmer que nos relations économiques avec l'Allemagne, en particulier en ce qui concerne les transactions en or effectuées avec la Banque Nationale, ont largement contribué à la préservation de notre intégrité territoriale [...] La Banque Nationale Suisse (BNS) achète pour 1,7 milliard de francs-or (souvent pillé aux pays victimes du Reich) d'or à la Reichsbank allemande. Selon le rapport de la commission Bergier, la BNS savait en 1941 déjà que la Reichsbank lui fournissait de l'or volé. Là aussi, l'esprit « business as usual » prédomine. Les francs suisses, principal moyen de paiement international dès 1940, ainsi obtenus permettent à l'Allemagne d'acheter des matières premières indispensables à la poursuite de la guerre. Plus grave encore, des dents ou des bagues saisies aux victimes des camps de concentration sont fondues en lingots qui figurent parmi ceux achetés par la BNS. 120 kilos d'or provenant des victimes des camps de concentration ont atterri à la BNS. Mais selon la commission Bergier, rien n'indique qu'on ait eu la connaissance de la provenance de cet or. Il est aussi admis que de nombreux cadres nazis placent de l'or, des bijoux, des titres boursiers et d'autres valeurs dans des banques en Suisse, protégées par le secret bancaire. In Textes sur la Suisse pendant la 2ème guerre mondiale, par Albert Chevalley La Suisse fut donc le banquier prospère du Reich et en tira un large profit, comme l'atteste l'évolution des réserves monétaires de la Banque nationale - qui progressent de 88,4 % entre 1939 et 19453. Evolution des réserves monétaires suisses, 1939-1945
Plusieurs banques suisses ont, par ailleurs, fait des prêts aux plus hauts dirigeants nazis. Ainsi, en 1997, des documents attestant que le Crédit Suisse a accordé des crédits à des responsables SS jusqu'en février 1945, auraient été retrouvés dans les archives de l'ancienne R.D.A. b) La question des avoirs juifs Espérant échapper aux persécutions nazies, 15 à 20 000 juifs placent leurs avoirs en Suisse par l'intermédiaire de ressortissants helvétiques. Lorsque leurs héritiers, après la guerre, viennent réclamer ces fonds, les banques suisses font la sourde oreille, allant jusqu'à exiger la production d'un certificat de décès dans les camps, du titulaire du compte ! Le problème des avoirs juifs détenus par les banques suisses émerge au cours de l'été 1995 : cinquante ans après la fin de la guerre, l'ouverture de certaines archives fait naître une série d'interrogations sur le rôle de la place financière helvétique pendant la période nazie. Le 12 septembre, Edgar Bronfman, président du Congrès juif mondial (CJM), demande ainsi à l'Association suisse des banquiers (ASB) d'enquêter sur les comptes de victimes de l'Holocauste restés en déshérence. Le 7 février 1996, l'ASB évalue le montant des avoirs en déshérence depuis 1945 à 38,7 millions de francs suisses - soit environ 32 millions de dollars. Ce chiffre suscite la colère du CJM, qui estime le montant de la spoliation à plusieurs centaines de millions de dollars et obtient le 2 mai 1996 la constitution d'une commission d'enquête mixte dirigée par Paul Volcker, ancien président de la banque centrale américaine (Federal Reserve). Dès le début, le manque de coopération des institutions financières et des autorités suisses apparaît manifeste. Les critiques s'amplifient à la fois sur les avoirs en déshérence et sur l'achat massif par la banque centrale suisse de l'or pillé par les armées d'Hitler en Europe. Le président de la Confédération, Jean-Pascal Delamuraz, ne s'embarrasse pas de précautions oratoires et parle alors de « chantage » - voire de « rançon » - de la part des organisations juives. En janvier 1997, un garde de nuit découvre à l'UBS des documents d'archives voués à la destruction. Il les transmet aux représentants de la Communauté israélite. Les banques suisses, menacées dans leur réputation et dont l'image se ternit sérieusement, se savent sous le coup d'une plainte déposée à New-York qui pourrait leur coûter extrêmement cher. En février 1997, les banques suisses proposent la création d'un Fonds Spécial financé par les banques et l'industrie, destiné à venir en aide aux victimes de l'Holocauste dans le besoin. Il est doté d'environ 100 millions de francs suisses. L'UBS, la SBS et le Crédit Suisse restent néanmoins visés par la « Class Action Suit », plainte collective par laquelle les survivants de l'Holocauste leur réclament 10 à 20 millions de dollars. Le 7 mai 1997, un rapport du sous-secrétaire d'Etat américain Stuart Eizenstat publié à Washington accuse la Suisse d'avoir soutenu l'effort de guerre allemand en blanchissant l'or confisqué par les nazis, soit quelque 580 millions de dollars de l'époque. Le 23 juillet, les banques suisses publient une liste de 1 872 noms d'ayants droit de comptes non réclamés depuis 1945. Une nouvelle liste de plus de 14 000 noms est publiée fin octobre. Les sommes totalisent alors près de 80 millions de FS, soit un peu plus de 320 millions de FF, c'est-à-dire plus du double du chiffre donné en 1996. Cet épisode fera dire à un journaliste du New York Times : « Les Suisses sont pires, non pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre - ils étaient encerclés - mais pour ce qu'ils ont fait après. Ils ont trouvé des excuses pour garder une grande part du butin nazi. »4 En décembre 1997, se tient à Londres une conférence internationale sur l'or pillé par les nazis, qui conduit plusieurs villes et États américains, excédés par la mauvaise volonté suisse, à donner trois mois aux banques pour fournir des informations fiables avant d'imposer des sanctions économiques. En définitive, les banques suisses s'engagent le 13 août 1998 à verser 1,25 milliard de dollars sur trois ans pour solde de tout compte - soit près de quarante fois le montant qu'elles ont initialement proposé. B.- LA SUISSE S'EXPOSE À L'AFFLUX DE CAPITAUX D'ORIGINE DOUTEUSE La Suisse a continué de connaître la prospérité pendant la période faste des Trente Glorieuses. Les économies occidentales en pleine expansion ont été séduites par la solidité et la stabilité du franc suisse, librement convertible par ce pays où les impôts sont très faibles. Le conflit israélo-arabe, les crises monétaires de 1967 et les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont renforcé le sentiment que la Suisse constituait un espace financier abrité. Depuis, si le monde financier et bancaire anglo-saxon a progressivement affirmé sa suprématie - à Londres puis à New-York -, la Suisse a su conserver une place qui, pour n'être pas première, n'en est pas moins essentielle. Sa situation géographique, sa réputation de place financière refuge et surtout son attachement à défendre le secret bancaire et à refuser toute coopération en matière d'évasion fiscale font de la Suisse, encore aujourd'hui, un lieu particulièrement attractif pour les capitaux. En cela, et comme tous les Etats qui ont développé une économie financière fondée sur des dispositifs fiscaux, juridiques ou commerciaux particulièrement avantageux, la Suisse s'expose plus largement à l'arrivée de capitaux d'origine criminelle. Le deuxième rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse par les experts du GAFI établissait en mai 1998 le constat suivant :
« La situation géographique centrale de la Suisse, sa relative stabilité politique, sociale et monétaire, le contexte de libéralisation et de secret professionnel qui caractérise le système financier du pays, constituent autant d'attraits pour tout investisseur de capitaux d'origine légale ou illégale. Le haut niveau du développement des techniques et la grande diversité des établissements de la place financière facilitent également et indéniablement l'utilisation de la Suisse dans les circuits internationaux de blanchiment. » Point 5 du deuxième rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI en mai 1998. Il lui faut donc témoigner de ses intentions de lutter contre le fléau du blanchiment qui met à mal sa réputation de place financière, tout en maintenant les avantages, qu'elle entend bien conserver, qui lui ont permis d'attirer en masse les capitaux. 1.- Le caractère attractif de la place bancaire suisse a) L'attachement de la Suisse à son secret bancaire Les pratiques suisses en matière bancaire et fiscale permettent à la Confédération de présenter un visage avenant aux capitaux en quête de rentabilité, de sécurité et de discrétion. La Suisse reste indéfectiblement attachée à son secret bancaire, quasiment érigé en principe juridique supérieur, véritable institution nationale, qualifiée par certains de « magnifique aimant attrape-capitaux... qui n'a pas son pareil »5. Le secret bancaire découle de la loi bancaire suisse de 1934. Ce texte fut adopté par la Confédération alors qu'était intervenu deux ans auparavant à la tribune de l'Assemblée nationale le 10 novembre 1932, le député socialiste Fabien Albertin, dénonçant l'évasion fiscale organisée vers la Suisse par d'éminentes personnalités françaises (hommes politiques, magistrats, patrons d'industrie, dignitaires du clergé, directeurs de journaux, etc.). « La Suisse redoute les retraits massifs des sommes déposées M. Fabien Albertin, député socialiste : Si l'on lit ce matin les journaux suisses, on voit que l'opinion publique, en Suisse, est extrêmement émue, qu'on y redoute les retraits massifs des sommes qui ont été déposées dans ses banques, dont c'est le profit principal, je pourrais dire le profit exclusif. L'opinion publique redoute que, à la suite de ces retraits massifs de fonds, une véritable chute du franc suisse ne se produise. M. le ministre des finances sait très bien que, depuis dix ans, la préoccupation de tous ses prédécesseurs a été de dépister cette fraude, qui est connue. Pour la réprimer, il faut la saisir. Or jusqu'ici, les renseignements qu'on avait pu obtenir étaient extrêmement vagues. Quand des documents parvenaient aux mains de la justice, c'étaient des carnets informes, sur lesquels les titulaires des comptes ne figuraient que sous un simple numéro d'ordre. Les employés des banques intéressées ne connaissaient pas les noms des titulaires des comptes. Ces noms sont connus du seul directeur de la banque, auquel les clients font défense absolue de correspondre avec eux, tellement ils sont soucieux de conserver l'anonymat. [...] Il y a eu dans les journaux un récit, que je crois fidèle, des circonstances dans lesquelles, un juge d'instruction a été désigné par le parquet à la suite de la plainte de M. le ministre des finances. Le juge d'instruction a donné une commission rogatoire à la sûreté générale. Un commissaire du contrôle des recherches s'est présenté dans un hôtel de la rue de la Trémoille, située dans l'aristocratique quartier des Champs-Elysées. Le commissaire savait que les dirigeants de la banque suisse occupaient un appartement de cinq pièces. Il a trouvé dans le salon d'attente une foule de clients impatients de faire régler leurs coupons. Il a pénétré directement dans les bureaux. Il a pu dresser procès-verbal et opérer la saisie d'un certain nombre de documents. Il est regrettable que cette opération de police n'ait pas eu lieu plus tôt. C'est le 26 octobre, à seize heures dix, très exactement, que M. Barthelet, commissaire au contrôle des recherches, s'est présenté rue de la Trémoille. Mais il faut qu'on sache que les employés, que le directeur même - car l'opération était à ce point importante que le directeur de Bâle s'était dérangé et était présent - il faut qu'on sache que ces paiements avaient commencé dix jours avant et s'étaient poursuivis sans aucune interruption. A l'heure où le commissaire de police s'est présenté, il ne restait plus que quelques clients, car l'opération allait prendre fin vers six heures. Cependant - voici des chiffres qui nous fixent sur l'importance des opérations qui avaient été accomplies - le commissaire de police a pu saisir sur les employés de la banque une somme de 245 000 francs en argent français et 2 000 francs en argent suisse, sommes qui devaient permettre de faire face aux besoins de cette fin de journée. Si l'on n'avait trouvé que cela, ce ne serait pas grand chose. Fort heureusement, on a saisi un répertoire, un livre de caisse, un fichier, et - retenez cette précision - dix carnets d'assez grandes dimensions. Ces dix carnets contenaient environ 2 000 noms. On a dit 1 400. Un membre du Gouvernement disait 1 400 ou 1 500. Ne chicanons pas sur ces chiffres. Disons qu'il y a dans ces carnets un nombre considérable de noms. A l'extrême gauche : Nous voulons les connaître. [...] M. Fabien Albertin : Je disais, messieurs, que ces carnets sont tenus avec un soin tellement minutieux, qu'il a suffi à un secrétaire de la sûreté générale de quatre ou cinq heures pour dresser la liste complète des 2 000 noms, liste qui a dû être portée immédiatement au Gouvernement, en tout cas, au chef responsable de cet important service. Cette liste est connue. Le ministre la connaît... M. le ministre des finances : Ah ! non ! Monsieur Albertin, j'affirme que je ne connais pas du tout cette liste. M. Xavier Vallat : Puisque le ministre ne connaît pas la liste, c'est le moment de la lui lire. M. Fabien Albertin : Je vais satisfaire votre curiosité. [...] On nous dira : « Ah ! comme vous êtes heureux, socialistes, de faire ces constatations, de déshonorer des adversaires politiques et de montrer qu'il y a des classes dans la société ! » Oui, il y a des classes. Et les classes dirigeantes, l'élite de la société, viennent, à l'occasion de ce scandale, de montrer en même temps que leur égoïsme, la volonté qu'elles ont de ne pas se soumettre à la loi française. Il y a des personnages dont le rôle est de faire les lois : trois sénateurs - leurs noms ont été donnés - des personnages dont le rôle est d'appliquer les lois, des magistrats, de l'ordre administratif et judiciaire. Il y a des hommes qui sont d'un patriotisme particulièrement chatouilleux et qui, sans doute, ignore que l'argent qu'ils constituent en dépôt à l'étranger est prêté par la Suisse à l'Allemagne. Nous trouvons sur cette liste une douzaine de généraux ! [...] Sur ces listes figurent, outre des généraux, un contrôleur général de l'armée. M. Renaud Jean : Lequel ? M. Fabien Albertin : Vous serez bien avancé, quand j'aurai dit qu'il s'appelle Delalande. [...] Il en est un que je peux prononcer sans hésitation, parce qu'on ne le trouve pas seulement dans le répertoire. Le titulaire de ce nom, si j'ose dire, a pris contact avec le commissaire de police. Il s'est présenté de lui-même rue de la Trémoille pour toucher ses coupons. C'est M. Viellard, sénateur de Belfort. M. Lionel de Tastes : Il y en a d'autres. M. Fabien Albertin : C'est exact. M. de Tastes sera heureux d'apprendre qu'il y a M. le sénateur Jourdain. Il y en a un troisième, c'est M. le sénateur Schrameck. [...] M. Gustave Guérin : Y a-t-il des députés sur cette liste, monsieur Albertin ? M. Fabien Albertin : Monsieur de Tastes et monsieur Vallat, qui m'avez interrompu tout à l'heure, voulez-vous que je vous dise aussi qu'il y a des évêques, en particulier l'évêque d'Orléans ? M. le Président : Le règlement ne me permet pas de vous laissez la parole, monsieur Albertin. M. Fabien Albertin : Il n'y a pas de règlement qui puisse empêcher un député de remplir son devoir au regard du pays. [...] Je disais, puisqu'on m'a obligé à donner cette précision, qu'en effet, il y a de hauts dignitaires de l'Eglise, deux évêques dont, évidemment, le royaume n'est pas de ce monde mais qui, certainement, grâce à d'habiles restrictions mentales, ont pu concilier à la fois la nécessité du serment fiscal, qui doit être sincère, avec le juste souci de mettre à l'abri leur fortune Il y a de grands chefs d'une industrie automobile, dont le siège est à Valentigney ; il y a un fabricant de meubles... A droite : Les noms ! [...] M. Fabien Albertin : On y trouve surtout des chefs de la grande industrie automobile, les frères Peugeot, puisque vous voulez leur nom. On trouve aussi un fabricant de meubles dont la T.S.F. nous proclame assidûment la pérennité de la fabrication ; je crois qu'il se nomme Lévitan. Jamais, messieurs, une liste de noms n'a fait un pareil emprunt à l'armorial français. Je vais, messieurs, montrer que je ne recule devant aucun des risques que peut comporter mon attitude. La presse est une grande puissance. Je ne sais pas quel lien de droit unit au directeur de l'Ami du peuple Mme Henriette François Coty, je ne sais pas s'il s'agit d'un compte qui appartient en propre à Mme Coty ou si cette dernière n'est ici qu'une personne interposée. Je ne sais pas si le nom de M. Sapètre s'applique bien au directeur du Matin. Ce que je sais, messieurs, c'est qu'il n'y a rien de plus douloureux, de plus attristant et de plus tragique, rien qui puisse décourager plus profondément la masse des travailleurs français que de voir, chaque jour, des hommes qui dirigent et qui inspirent l'opinion française faire, du haut des colonnes de leurs grands quotidiens, appel au patriotisme fiscal du pays, faire prévoir de nouveaux sacrifices que l'on demandera nécessairement aux petits fonctionnaires, aux victimes de la guerre, ou, par l'établissement de nouveaux impôts indirects, à la masse énorme des consommateurs et frauder pour leur part. En face de semblables constatations, nous avons le droit d'être profondément attristés. Source : Journal Officiel des Débats de la Chambre des députés, 10 novembre 1932, p. 2997 et suiv. A cette date, le secret bancaire n'existe pas et les banquiers suisses s'inquiètent à l'idée de voir disparaître ces capitaux issus de l'évasion fiscale dont elles tirent un large profit. La Confédération décide de réagir pour protéger son fonds de commerce en modifiant sa législation : la loi de 1934, sanctionne pénalement le banquier suisse qui transgresse ce secret mais, surtout, étend le bénéfice du secret bancaire aux non-résidents. Hypocritement invoqué pour soi-disant protéger les avoirs juifs déposés en Suisse pendant la guerre, le secret bancaire est à l'origine lié à l'évasion fiscale à laquelle il doit sa vitalité, mais il représente aussi un atout juridique de poids pour les délinquants économiques friands de discrétion. Le secret bancaire est actuellement réglementé par diverses dispositions du droit suisse. Il découle essentiellement du droit civil - notamment, de l'engagement pris par le banquier envers son client de garder le secret sur la situation personnelle de ce dernier : la relation contractuelle existant entre le client et la banque engendre un devoir de discrétion du banquier, qui constitue le corollaire de la confiance témoignée par le client. La sphère personnelle du client est également protégée par les dispositions générales du code civil suisse relatives à la protection de la personnalité (art. 27 et suiv.), ainsi que par la législation sur la protection des données. Le droit bancaire considère la discrétion du banquier, tel qu'elle découle du droit civil, comme un devoir professionnel dont la violation est sanctionnée. Il rend en effet punissable d'emprisonnement ou d'une amende le banquier qui divulgue des secrets de ses clients ou de tiers (art. 47 de la loi sur les banques et les caisses d'épargne). Ce secret n'est pour autant pas absolu. Si, en principe, seul le bénéficiaire de ce secret - c'est-à-dire le client - peut délier la banque de son obligation de discrétion, des dispositions de droit pénal6, de droit des faillites7 et d'entraide judiciaire en matière pénale8 prévoient des dérogations - notamment, sur demande de l'autorité judiciaire. Périodiquement, des voix s'élèvent pour mettre un terme à ce principe, mais les démarches entreprises en ce sens se sont, jusqu'à présent, soldées par des échecs comme ce fut le cas en 1984. Les électeurs se sont prononcés comme prévu Les électeurs suisses se sont prononcés comme prévu massivement dimanche par 73 % contre 27 % des voix pour le maintien du secret bancaire sous sa forme actuelle. [...] Tous les cantons ont ainsi rejeté l'initiative populaire lancée par le parti socialiste qui souhaitait modifier la loi en vue d'assurer une plus grande perméabilité sur les réserves des banques et les comptes numérotés. Les socialistes estimaient par ailleurs que deux milliards de francs suisses (un milliard de dollars) échappaient chaque année au fisc sous la couverture de ce secret. Ainsi, les milieux économiques, qui avaient fait une campagne vigoureuse contre ce projet de loi, ont-ils remporté un succès qui risque de légitimer désormais pour longtemps l'imperméabilité du secret bancaire au sein des banques suisses, relèvent les observateurs. Les partis conservateurs, ainsi que le Gouvernement fédéral, qui n'avait même pas pris le soin de rédiger un contre-projet à l'initiative socialiste, seront également soulagés par l'issue du scrutin. Lancée en 1979, l'initiative contre les banques apparaissait dans un climat plus propice qu'aujourd'hui. Plusieurs scandales avaient éclaboussé des établissements bancaires suisses durant les deux années précédentes. Aujourd'hui, les électeurs suisses ont apparemment préféré éviter tout bouleversement en cette période de ralentissement économique. Dépêche de l'AFP, 20 mai 1984. Aujourd'hui encore, la Suisse tient à son secret bancaire et le fait savoir : un sondage de l'institut de recherche GFS pour le compte de l'Association suisse des banquiers (ASB)9 indique que 77 % des Suisses soutiennent « la conception actuelle du devoir de discrétion du banquier ». Toujours selon ce sondage, 66 % des personnes interrogées considèrent comme « positif » - voire « très positif » - le rapport qu'elles entretiennent avec la place financière suisse. b) Une fiscalité préférentielle pour les non-résidents Si la fiscalité appliquée par la Suisse à ses nationaux n'apparaît pas particulièrement avantageuse, la Confédération sait en revanche se montrer accueillante aux étrangers qui souhaiteraient y domicilier leur fortune. Le système fiscal suisse - en matière d'impôts directs - se présente comme un dispositif à trois échelons10 : tout contribuable paie un impôt fédéral direct, un impôt cantonal prélevé par le canton dans lequel il réside et un impôt communal. Toutefois, les personnes domiciliées ou en séjour en Suisse, qui n'ont pas la nationalité suisse et qui n'exercent et n'ont exercé en Suisse aucune activité lucrative - voire aucune activité au cours des vingt dernières années - peuvent demander à payer un impôt d'après la dépense en lieu et place des impôts sur le revenu et sur la fortune, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct : c'est le système de l'imposition « à forfait », que connaissent par exemple les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. L'impôt spécial cantonal et communal est calculé sur la base de la dépense correspondant au train de vie du contribuable. Le revenu ainsi déterminé doit s'élever au moins à cinq fois la valeur locative du logement ou à une fois et demie le prix de la pension pour les personnes demeurant à l'hôtel ou en pension. En ce qui concerne l'impôt fédéral, il est également calculé d'après la dépense du contribuable - ou d'après certains éléments bruts du revenu, si ces derniers sont plus élevés que la dépense. La dépense des contribuables vivant à l'hôtel ou en pension doit s'élever au moins à deux fois le prix de la pension. L'impôt fédéral direct est calculé sur le tarif de l'impôt ordinaire sur le revenu, le taux maximum étant de 11,5 % pour un revenu imposable de 659 000 FS (personne mariée). Sur le plan cantonal et communal, des différences existent, compte tenu du fédéralisme suisse : en conséquence, la situation varie si l'étranger s'établit dans le canton de Genève, dans le canton de Vaud ou dans le canton du Valais11. Ce système de l'imposition à forfait permet donc de ne pas déclarer l'ensemble de ses revenus. C'est ce qui en fait tout l'intérêt. En matière de successions, la situation apparaît également très favorable dans sa diversité, puisque chaque canton a sa propre législation en matière d'assujettissement et de perception des droits de succession et qu'il n'existe ni droits de donation, ni droits de succession sur le plan fédéral. Dans le canton de Genève, les successions d'étrangers ouvertes dans le canton connaissent les mêmes principes applicables que ceux en vigueur pour les personnes « ordinaires ». En conséquence, le taux des droits de succession en ligne directe est de 6 % au maximum - taux atteint pour des sommes supérieures à 500 000 FS -, de 23,1 % au maximum pour les frères et s_urs, 27,3 % pour les oncles, neveux, nièces, grands-oncles et petits-neveux et 54,6 % lorsqu'il n'existe aucun lien de parenté entre le défunt et les bénéficiaires de la succession (sommes supérieures à 100 000 FS). Les taux sont les mêmes en matière de droits de donation. Dans le canton de Vaud, l'impôt sur les successions d'étrangers ouvertes dans le canton bénéficie d'une réduction de 50 %. Tout dépend ensuite du montant de l'impôt cantonal que la commune de domicile du défunt prélève 12 Sous cette réserve et pour des sommes supérieures à 1 300 000 FS, l'impôt sur les successions s'élève au maximum en ligne directe à 3,5 % - et peut être réduit à 1,75 % si la commune ne prélève aucun impôt sur les successions. Sur le plan des droits de donation, les taux sont les mêmes qu'en matière de droits de succession. Quant au canton du Valais, il ne connaît purement et simplement pas de droit de succession et de donation pour la « première parentèle » Il faut également rappeler qu'en Suisse (à l'exception du canton des Grisons), les particuliers ne sont pas imposés sur le gain en capital réalisé Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, les étrangers doivent obtenir des autorités une autorisation de séjour. Cinq conditions sont requises pour la délivrance de cette autorisation, dite « permis B » : être âgé de plus de soixante ans, avoir des attaches étroites avec la Suisse, ne pas y exercer d'activité lucrative, transférer en Suisse l'ensemble de ses intérêts et disposer des moyens financiers nécessaires. Les autorités savent néanmoins se montrer très accommodantes lorsque certaines catégories - artistes, sportifs, investisseurs, etc. - entendent s'établir en Suisse alors même qu'elles n'ont pas encore l'âge requis. Toutefois, à défaut de détenir le fameux permis B, il est toujours possible de se rendre en Suisse pour y ouvrir un compte, parfois avec l'aide de dynamiques professionnels des affaires. Profession : chasseur de riches Ils font la nique aux avocats d'affaires et aux banquiers privés. Leurs bureaux perchés au dernier étage de la maison Mercier - l'opulente demeure du célèbre industriel du même nom devenue entre-temps le repaire des médecins et des avocats les plus huppés de Lausanne, offrent une vue imprenable (...). Rien n'est assez beau, rien n'est assez cher pour leurs clients: des riches du monde entier qui souhaitent s'installer en Suisse. François Micheloud, 26 ans, s'excuse presque : « Nous faisons un travail de vieux, ce qui nous oblige à compenser notre jeunesse » (...). Depuis 1998, les deux associés proposent leurs services à de riches étrangers. Via leur site Internet switzerland.isyours.com, ils promettent de leur trouver un logement et de leur décrocher un permis d'établissement. Moyennant, bien sûr, des honoraires rondelets. Dans la branche, cette prestation s'échelonne de dix à cinquante mille francs. (...). Leur société - pompeusement appelée Micheloud & Cie - propose également à des étrangers d'ouvrir un compte en Suisse. (...) Clément Bucher, qui supervise ce secteur, aide ainsi à placer environ deux millions de francs suisses par mois dans les grandes banques de la place. (...) Leur affaire roule. Elle roule même si bien [qu'ils comptent] développer leur entreprise en proposant les mêmes services aux Bahamas et en Grande-Bretagne. Source : Titus Platner, L'Hebdo, 13 avril 2000. Généralement, l'ouverture d'un compte est motivée par des raisons fiscales. Selon les milieux bancaires, 90 % des fonds d'origine étrangère déposés par les banques suisses ne sont pas déclarés dans leur pays. Lorsqu'on s'adresse en revanche à un banquier en particulier, il préférera mettre en avant d'autres motivations plus présentables, de discrétion ou d'exigences de qualité. La Suisse offre à cette clientèle aisée un système bancaire et financier performant, susceptible de mettre en place une « gestion patrimoniale optimisée » - et surtout discrète, comme le confirme le directeur général de Paribas Suisse.
M. le président : Votre banque d'origine française a de nombreuses succursales à l'étranger. Qu'est-ce qui peut attirer des clients à Paribas Genève ? Quels services offrez-vous ici qu'ils ne trouveraient pas à Paribas Paris ? M. François de RANCOURT : Pourquoi venir à Paribas Suisse ? Comme pour la place financière de Londres, pour une raison de gestion de patrimoine. Le marché de l'euro s'est développé à Londres parce que tous les experts - fiscaux, juridiques, conseil, etc. - sont venus assister les banques. De même, les gens viennent chercher ici une expertise. Il ne s'agit pas seulement pour eux de venir ouvrir un compte et d'éviter de payer des impôts. Rencontrant souvent différents problèmes familiaux, ils viennent chercher ici une structure à même de gérer leur fortune. Ils trouvent une expertise dans la banque, dans la gestion de leurs actifs, en matière juridique, qui n'existe pas nécessairement ailleurs. C'est coûteux. Nous le faisons payer. M. Burnand, juriste connu et expert en matière de trusts et autres, en sait quelque chose. Nous avons des clients mondiaux, pas seulement français mais aussi d'Europe du nord, d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient. Au cours de ses 125 ans de présence en Suisse, Paribas s'est construit une réputation d'expertise. Si nous avons les montants de fonds sous gestion que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons cette compétence de haut niveau qui d'ailleurs coûte cher. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. François de Rancourt, Directeur général de Paribas Suisse S.A., septembre 1999 c) La Suisse répond à la définition du centre offshore La Suisse figure sur la liste des paradis fiscaux publiée le 26 mai dernier par le Forum de stabilité financière (1er groupe).
Le Forum de stabilité financière (FSF) a été créé en 1999 par le G7 pour trouver des parades aux dangers que font courir les paradis fiscaux, les fonds spéculatifs et certaines transactions à court terme au système financier international. Le FSF a dressé une liste de 42 Etats ou entités qualifiés de « paradis fiscaux », classés selon leur degré de coopération avec les autorités de régulation financière au titre de la surveillance prudentielle. Cette liste - qui distingue entre les pays qui coopèrent avec ces autorités, ceux qui sont « moyennement » coopératifs et ceux qui ne coopèrent pas - ne tient pas compte du degré de coopération judiciaire ou policière de ces territoires, où il est très facile de placer discrètement son argent. Cet aspect est pourtant fondamental dans la lutte contre le blanchiment de l'argent sale et rétrograderait probablement certains pays européens bien classés dans la liste du Forum. Le premier groupe, dont le niveau de coopération est jugé satisfaisant, est composé de Hongkong, Luxembourg, Singapour, la Suisse, la ville de Dublin (Irlande), les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey et l'île de Man. Les pays faisant partie de ce groupe disposent, selon le Forum, d'un système de réglementation de « bonne qualité » et supérieur à celui des autres paradis fiscaux. Le deuxième groupe, dont la coopération est « moyenne », est composé d'Andorre, du Bahreïn, des Barbades, des Bermudes, de Gibraltar, de Lubuan (Malaisie), de Macau, de Malte et de Monaco. Enfin le troisième groupe, le plus déficient sur le plan de la réglementation et de la surveillance financière, est composé des îles Anguille, d'Antigua et Barbuda, d'Aruba, de Belize, des îles Vierges, des îles Cayman, des îles Cook, du Costa-Rica, de Chypre, du Liban, du Liechtenstein, des îles Marshall, de l'île Maurice, de Nauru, des Antilles néerlandaises, de Niue, de Panama, de Saint-Kitt et Nevis, de Sainte Lucie, de Saint-Vincent, des îles Grenadines, de Samoa, des Seychelles, des Bahamas, Turquoise et Caicos et du Vanuatu. Si l'on considère l'origine des avoirs déposés dans les banques suisses, il apparaît que la Confédération gère majoritairement des avoirs appartenant à des non-résidents. En 1998, la Banque nationale suisse a recensé le montant des fortunes gérées en Suisse - 3 000 milliards de francs suisses soit plus de 12 000 milliards de francs français - et a estimé à 1 400 milliards les avoirs de la clientèle suisse et à 1 600 milliards ceux de la clientèle étrangère. Cette répartition ne doit pas faire oublier qu'une très large majorité des avoirs réputés appartenir à la clientèle suisse, ne le sont qu'en raison du simple fait qu'ils sont déposés ou gérés par des fonds établissements ou des structures de nationalité suisse. En conséquence, au regard de ce critère, il n'y a rien de surprenant à ce que la Suisse soit qualifiée de « centre offshore ». La Suisse a néanmoins refusé d'admettre la qualification de « centre offshore » qui lui a été décernée par le Forum de stabilité financière, estimant qu'elle ne répondait pas aux autres critères retenus pour mériter ce qualificatif. La Commission fédérale des banques et la Banque nationale suisse ont officiellement protesté et qualifié « d'incompréhensible » l'inclusion de la Suisse parmi les centres offshore, même si elle figure à ce titre parmi les Etats les mieux réglementés. Les autorités suisses ont vu dans ce classement, transmis au FMI pour évaluation des pays concernés, un moyen de pression consistant à faire figurer la Confédération parmi un groupe de pays peu recommandables afin de ternir la réputation de sa place financière. Le Président de la Commission fédérale des banques (C.F.B.), M. Kurt Hauri, et le Président de la Banque nationale suisse (B.N.S.), M. Hans Meyer, ont notamment réfuté l'amalgame opéré par le FSF entre la définition d'une place financière internationale et celle d'un territoire offshore. Ils ont rappelé que la Suisse appliquait les standards internationaux en matière de réglementation et de surveillance du secteur financier sans distinction entre activité des non-résidents et des résidents et entre activité offshore et onshore. Ils ont également fait valoir que le secteur financier n'était pas prépondérant dans l'économie suisse puisqu'il ne représentait que 11 % du P.N.B., et que le volume des transactions réalisées par les non-résidents n'excédait pas substantiellement celui des transactions faites par les résidents. Cette observation doit être tempérée par le fait que, parmi les transactions faites par les résidents, figurent les opérations réalisées par des Suisses, mais aussi celles réalisées par les particuliers résidents en Suisse de nationalité étrangère et surtout par les sociétés qui sont enregistrées dans la Confédération helvétique. En réalité, le volume des transactions qui sont le fait d'ayants droit non suisses est donc très nettement supérieur au volume des opérations financières réalisées par la clientèle suisse. Si l'on applique par ailleurs les différents critères permettant de qualifier un territoire ou un Etat de centre offshore, à la Suisse, celle-ci semble bien répondre à cette définition. Un centre offshore gère dans de fortes proportions une masse d'avoirs qui appartiennent à des non-résidents. A cet égard, la Suisse qui, actuellement, gère à hauteur de 3 500 milliards de francs suisses, environ un tiers de la fortune privée mondiale déposée majoritairement par des non suisses, répond incontestablement à ce critère. Si l'on se réfère aux autres critères retenus, on s'aperçoit que la Confédération helvétique n'y déroge pas davantage. La Suisse applique ainsi un taux d'imposition sur le revenu nettement plus favorable pour les entreprises ou les particuliers étrangers. Or l'existence d'une fiscalité préférentielle figure parmi les éléments traditionnels de définition d'un centre offshore. On trouve également parmi les éléments distinctifs, un secret bancaire et professionnel renforcé - même si le secret bancaire suisse n'est pas absolu, il reste malgré tout un des atouts majeurs de la place suisse. On estime également qu'une faible réglementation, voire une absence de réglementation du secteur financier, peut constituer aussi un indice qualifiant. Or si la Suisse a soumis les banques, la bourse ou les assurances à une législation spécifique de surveillance et de conditions d'exercice, il existe encore des pans entiers de l'économie financière qui échappent à une telle réglementation, au point qu'une commission d'experts présidée par le professeur Zufferey a été chargée par les autorités suisses de réfléchir à une éventuelle surveillance de ces marchés financiers qui ne font actuellement l'objet d'aucune réglementation prudentielle ou d'autorisation d'exercer. Il s'agit notamment des négociants en devises et des gestionnaires de fortune indépendants. 13 Ainsi, au regard des différents critères retenus, la Suisse se définit tout à la fois comme une place financière internationale et comme un centre offshore, même si la coopération judiciaire et policière qu'elle accorde ne peut être comparée avec l'absence ou la faiblesse de coopération offerte par d'autres territoires offshore. 2.- Une place financière en pleine expansion a) Les banques en Suisse : un secteur en pleine croissance Au 31 décembre 1999, la Banque nationale suisse dénombrait 372 banques implantées en Suisse soumises à son contrôle, qu'il s'agisse d'établissements bancaires ayant leur siège social en Suisse ou des filiales et succursales de banques étrangères se trouvant en Suisse. Parmi ces banques, 24 étaient des établissements cantonaux, 106 des banques régionales et caisses d'épargne, 54 des « banques boursières » et 123 des banques « en mains étrangères ». Il est intéressant d'observer que la part relative de ces différentes catégories d'établissements a évolué au cours des années récentes, en lien avec le mouvement de concentration accéléré qu'a connu le secteur : en 1990, les banques régionales étaient encore au nombre de 204. Par ailleurs, les sociétés financières, en mains suisses ou en mains étrangères, disparaissent des statistiques officielles à partir de 1995 : celles-ci ont en effet été invitées à se transformer en banques stricto sensu - ce qui les soumet au contrôle de la banque centrale - ou en sociétés non soumises à la loi sur les banques - et les fait donc échapper audit contrôle... Selon la même source et à la même date, les banques suisses détenaient 1 259,9 milliards de francs suisses d'avoirs sur l'étranger, un portefeuille de titres destinés au négoce de 248,1 milliards de francs et dégageaient une position nette de 130,9 milliards de francs. Sur le plan international, la banque d'affaires américaine Goldman-Sachs a récemment dressé la liste des principaux opérateurs bancaires, une « global superleague » où seules sont admis les établissements affichant une capitalisation boursière supérieure à 50 milliards de dollars (55,5 milliards d'euros, 364 milliards de francs). Ce seuil de 50 milliards correspond à une taille critique au-delà duquel l'établissement devient de fait, selon la banque d'affaires, invulnérable à toute OPA. Ce cercle ne comprend que seize élus. Aux côtés des groupes américains (Citigroup, Bank America, J.P.Morgan-Chase Manhattan), britanniques (HSBC, Lloyds TSB et Royal Bank of Scotland), japonais (Mizuho Financials et Tokyo Mitsubishi) et espagnols (BBVA et BSCH), on ne compte qu'une banque française (BNP-Paribas) et une banque allemande (Deutsche Bank) mais deux établissements suisses (UBS et Crédit Suisse). Avec 1 746 milliards de francs suisses d'actifs gérés, UBS est la première banque helvétique. Sa stratégie de diversification est révélatrice de ses ambitions mondiales : elle a ainsi racheté récemment son compatriote Fondvest SA, un grossiste zürichois en fonds de placement créé en 199314, après avoir acquis peu auparavant la banque américaine Paine Webber pour 11,8 milliards de dollars. Cette dernière, qui apporte dans l'opération 2,7 millions de clients et des actifs gérés totalisant 865 milliards de francs suisses (485 milliards de dollars) n'est elle-même qu'un maillon d'UBS Warburg, la branche « banque d'affaires » de l'UBS, qui forme ainsi un groupe employant 39 000 personnes dont 28 000 aux seuls Etats-Unis... Deuxième banque helvétique, Crédit Suisse Group gérait fin septembre 2000, environ 1 269 milliards de FS d'actifs (746 milliards de dollars), en hausse de 7,4 % par rapport au 31 décembre 199915. Comme UBS, la banque poursuit une stratégie d'achats tous azimuts. Elle vient de reprendre la banque d'affaires américaine DLJ (Donaldson, Lufkin and Jenrette) à l'assureur français Axa, spécialisée sur le marché très risqué des obligations à haut rendement (junk bonds). Parallèlement, Crédit Suisse Private Banking - la branche gestion de fortune du Crédit Suisse - vient de reprendre le gérant de fortune britannique JO Hambro Investment Management (Johim), spécialisé dans la clientèle très fortunée (1,5 milliard de livres sterling d'actifs gérés, soit quelque seize milliards de francs). Il n'est donc guère surprenant que la Suisse attire les fortunes de la nouvelle économie. La filiale suisse de la banque d'affaires J.-P. Morgan ainsi relevé une importante augmentation du nombre de comptes appartenant à des personnalités ayant fait fortune dans la nouvelle économie : elle aurait enregistré cette année plus de 400 millions de dollars de dépôts émanant de nouveaux clients liés à ce secteur16. b) Un secteur financier aussi puissant que discret Nul n'ignore la renommée des banques suisses, mais la Suisse n'est pas seulement une puissance bancaire, elle est aussi une puissance financière et les banques ne sont pas les seules à intervenir sur ce marché financier. On y trouve des sociétés de fonds de placement, des négociants en valeurs mobilières, des agents fiduciaires, des sociétés d'assurance-vie , des bureaux de change, des gérants de fortunes, des intermédiaires de crédit, des avocats, des notaires... etc. Certains de ces intermédiaires financiers sont soumis à une réglementation et une surveillance de leurs activités sur la base d'une législation spécifique - loi sur les fonds de placement, loi sur les Bourses, loi sur la surveillance des assurances -, d'autres ne relèvent que de la seule législation sur le blanchiment des capitaux. Dans cette sphère économique fort peu réglementée, l'activité de gestion de fortunes ou de patrimoine occupe une place de choix. Elle n'est pas toujours exercée par les banques, elle est aussi le fait d'avocats, d'agents fiduciaires, de gérants de fortune indépendants ou qui opèrent en relation avec une banque. Ainsi l'UBS et le Crédit suisse ne sont que la partie émergée d'un secteur financier en pleine croissance, qui permet aux établissements les plus importants de s'adosser à des centaines d'opérateurs spécialisés. Selon une récente étude de la banque Pictet entièrement consacrée aux gestionnaires privés helvétiques17, celle-ci estime qu'en droite ligne d'une année 1999 déjà « remarquable », les gestionnaires indépendants devraient connaître des performances exceptionnelles cette année et même surpasser les filiales de gestion des principaux poids lourds bancaires. A titre d'illustration, les nouveaux capitaux confiés au gestionnaire Julius Baer - 128,4 milliards de francs suisses d'encours globaux - ont été supérieurs à ceux obtenus par UBS Private Banking et Crédit Suisse Private Banking. Effectivement les gestionnaires de patrimoine n'ont fait que croître et embellir et dans ce domaine les banquiers privés ont eux aussi largement bénéficié de la conjoncture favorable. Les banquiers privés sont des entrepreneurs individuels ou associés, responsables sur leur patrimoine, qui exercent des activités bancaires- la loi bancaire leur est applicable- principalement consacrées aux activités de conseil en placement, de gestion de titres et de gestion de fortune de leur clientèle en majorité étrangère. L'implantation des filiales et des bureaux de représentation, à l'étranger, des banquiers privés est assez significative de l'attention portée à certaines places alors que, par tradition, « les maisons » n'ont qu'un réseau limité à l'étranger. Ainsi huit des seize maisons bancaires privées suisses ont un établissement dans un ou plusieurs centres offshore tels que les Bahamas, les Bermudes, les Caïmans, Gibraltar et Guernesey. La banque Darier, évoquée dans l'actualité récente, est ainsi représentée aux Bahamas et aux Caïmans mais aussi à Hong Kong et Monaco. Les banquiers privés n'étaient guère représentés non plus en Suisse en raison du fait que les services offerts ne nécessitaient pas des contacts très fréquents avec la clientèle. La conjoncture récente a changé la donne comme l'indique le rapport annuel pour 1999 de l'Association des banquiers suisses : « la période sous revue - qui s'étend du 1er avril.1999 au 31 mars 2000 - a été marquée par une excellente marche des affaires des banques suisses spécialisées dans la gestion de fortune... On peut affirmer que l'importance de la place financière pour la prospérité du pays a rarement été aussi manifeste qu'aujourd'hui. » La reprise de la croissance, la constitution récente d'énormes fortunes dans le secteur de la net économie, ont fait que de nouvelles masses de capitaux privés ont cherché à s'investir discrètement en échappant au fisc. Les propriétaires de ces fonds ont trouvé en Suisse des interlocuteurs financiers prêts à les conseiller et à gérer ces patrimoines que la Suisse cherche à capter. Plus que jamais, la Suisse demeure le pays du « private banking » et de la fiducie, la place financière de référence pour les professionnels de la gestion de fonds pour le compte d'autrui. « Toutes les fortunes sont bonnes à prendre » « Pour les banquiers privés, le Valais est devenu en quelques mois un véritable eldorado. Selon des estimations, son marché de la gestion de patrimoine se chiffre à 18 milliards de francs. Un gâteau qui suscite un appétit gargantuesque. Au cours de ces vingt derniers mois, Ferrier Lullin, Edouard Constant, Darier Hentsch, von Graffenried ainsi que la banque étrangère Bruxelles Lambert ont ouvert des succursales à Sion, Crans Montana, Verbier, Martigny et Brigue. Leur réussite est prodigieuse. (...) Leur succès est tel que toutes ces banques cherchent à engager de nouveaux gestionnaires de fortune. L'arrivée de ces établissements coïncide avec la fusion entre l'Union de Banques Suisses et la Société de Banque Suisse. Tous les banquiers privés reconnaissent avoir ainsi largement bénéficié des restructurations de la place financière helvétique «Pour les étrangers, l'image des banques helvétiques a changé. Avec de tels mariages, la discrétion n'est plus forcément assurée. Nous en avons profité », insiste Alexandre Borgeat [fondé de pouvoir à la Banque Bruxelles Lambert à Crans]. Aujourd'hui, l'ensemble des instituts installés en Valais part à la conquête de nouveaux sommets. «Par exemple, à Verbier, le développement de la station est fantastique. Y vient en vacances une nouvelle génération de riches âgés de 30 à 40 ans dont la fortune provient en partie des gains réalisés à la Bourse. Il y a des affaires à prendre », constate le patron d'Edouard Constant. Pour les banquiers, l'absence d'impôts sur les successions et l'impôt forfaitaire sont deux atouts non négligeables pour convaincre des clients. « C'est à nous de vendre ces deux prestations. Elles peuvent nous faciliter la tâche dans notre politique de démarchage », indique Pascal Masserey, directeur de Ferrier Lullin. Les mauvaises langues affirment que si les banquiers privés ont décidé de s'implanter en Valais, ce n'est pas seulement pour réaliser de bonnes affaires mais aussi pour échapper à la trop grande curiosité du procureur genevois Bernard Bertossa. « C'est ridicule, rétorque Pascal Masserey. La loi est la même dans tout le pays. ». « Nous ne voulons pas piquer des millionnaires aux Vaudois ou aux Genevois, mais aux pays étrangers, notamment à la France et à l'Italie », lance Alfred Rey, délégué aux questions financières de l'Etat du Valais. « Nous allons élaborer une véritable stratégie afin d'attirer non seulement des entreprises mais aussi des étrangers fortunés », poursuit cette éminence grise de la politique régionale. La nouvelle législation sur la promotion économique, dont l'ordonnance d'application sera soumise prochainement au Grand Conseil, est une véritable machine de guerre. Avec la possibilité de pouvoir confier des mandats à des prestataires de services, le gouvernement cherchera « à engager ceux qui possèdent les meilleurs contacts », affirme Wilhelm Schnyder. Ainsi, le gouvernement pourra demander à des avocats d'affaires, des fiduciaires ou à d'autres spécialistes de partir à la chasse aux riches. Source : L'Hebdo, 23 avril 2000. 3.- La Suisse associée à la délinquance financière internationale Sous l'effet conjugué du secret bancaire, d'une fiscalité préférentielle accordée aux non-résidents, de la multiplicité des structures et des services financiers échappant à toute forme de contrôle ou de surveillance, la Suisse, inévitablement, attire sur son sol non seulement ceux qui cherchent à fuir une imposition nationale mais aussi tous les criminels désireux de placer leurs avoirs et de les respectabiliser. La lecture de l'actualité de ces quinze dernières années montre que la Suisse reste pour les délinquants des différents pays de la planète une destination de choix. En novembre 1984, une commission d'enquête parlementaire italienne attend avec intérêt la décision des responsables suisses autorisant ou non la justice italienne à enquêter sur des comptes bancaires où seraient déposés d'importants « pots de vins » versés par le patron italien de l'office national des hydrocarbures (ENI) à l'occasion d'un gros contrat pétrolier avec l'Arabie Saoudite (dépêche AFP du 14 novembre 1984). En janvier 1985, c'est au tour d'une commission parlementaire argentine d'enquêter sur un scandale économique relatif au rachat, par l'Etat argentin, à un prix dix fois supérieur aux estimations, de la compagnie d'électricité Italo, compagnie à capitaux suisses. L'enquête parlementaire révèle que l'Union des banques suisses avait « exercé des pressions » sur l'Etat argentin pour procéder à ce rachat, avalisé par des membres de la junte militaire au pouvoir (les Généraux Videla et Graffigna) (dépêches AFP des 28 janvier 1985 et 13 mars 1985). En février 1985, l'Espagne est secouée par un scandale qui révèle une des plus grosses affaires d'évasion de capitaux opérée par les plus hauts représentants de l'aristocratie espagnole, de la diplomatie ou des affaires. L'ancien consul d'Espagne à Genève révèle à cette occasion qu'il avait reçu de ce « groupe d'amis » 2,7 millions de dollars pour les investir en Suisse en sa qualité d'administrateur de la société financière « Equitas », filiale de la banque Rothschild, la société « Equitas » déclarant ignorer cet « administrateur » (dépêche AFP du 8 février 1985). En novembre 1986, le Président américain Ronald Reagan reconnaît qu'il n'a pas été pleinement informé de ce qui deviendra le scandale de l'Irangate qui fait apparaître que les bénéfices des armes vendues par les Etats-Unis à l'Iran via Israël - en dépit de l'embargo officiel - étaient déposés sur des comptes bancaires en Suisse au profit de rebelles au Nicaragua (dépêche AFP du 29 novembre 1986). La Suisse transmettra aux enquêteurs américains le nom des titulaires des comptes et le détail des transactions. Elle bloquera également les avoirs de « l'Irangate », ce qui donnera lieu à un rebondissement inattendu mais hautement révélateur des pratiques et des comportements existant en Suisse à cette époque. A la suite d'une erreur d'écriture, les 10 millions de dollars que le Sultan de Brunei destinait également à la Contra nicaraguayenne ont abouti au Crédit Suisse sur le compte d'un homme d'affaires genevois qui les a immédiatement transférés à la Caisse d'épargne de Genève. Le Crédit Suisse porte plainte et l'homme d'affaire rétorque de bonne foi qu'il ne s'était pas soucié de la provenance des fonds car il attendait un important virement à cette date (sic) (dépêche AFP du 11 juin 1987). A la fin de l'année 1986, les autorités suisses, outre le blocage des avoirs de l'Irangate, avaient décidé le gel des comptes bancaires des dictateurs Marcos (décision exceptionnelle du Conseil fédéral du 25 mars 1986) et Duvalier (décision du 15 avril 1986). Cette triple décision fut considérée par les observateurs de l'époque comme un revirement très net d'attitude destiné à redorer l'image de marque de la Suisse, secouée par les scandales à répétition. Las, trois années plus tard en 1989, les ramifications en Suisse de la « peseta connection » indiquent que plus d'un milliard de francs auraient été blanchis en deux ans. Dans cette affaire, l'argent récolté au terme d'un trafic de cigarettes américaines était convoyé par voiture puis déposé à Bâle sur un compte de l'UBS avant d'être changé en dollars sur un compte d'une filiale de cette banque à Zürich et ensuite transféré sur le compte d'une société domiciliée au Liechtenstein. Un million de dollars aurait été ainsi blanchi chaque semaine (Le Monde du jeudi 6 juillet 1989). La Grèce est, quant à elle, secouée par le scandale « Koskotas » en cette fin d'été 1989. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails de cette affaire politico-financière, il suffit de rappeler qu'à cette occasion l'ancien ministre grec de la Justice, M. Koutsogiorgas, était accusé d'avoir touché un pot de vin de 2 millions de dollars destiné à le « récompenser » pour avoir fait adopter en 1988 une loi sur le secret bancaire qui arrangeait les affaires du banquier Koskotas. Pour sa défense, l'ancien ministre de la Justice avait déclaré que le montant de ce pot de vin avait été « déposé à son insu sur un compte suisse et... retiré par le banquier une fois que le scandale eût éclaté. » (Le Monde du 29 septembre 1989). Toutefois, en cette année 1989, c'est le scandale dit de la « filière libanaise » qui va contraindre la Suisse à modifier sa législation. De façon plus générale, qu'il s'agisse de l'initiative des banquiers ou de celle du législateur, chaque intervention qui a eu pour but de prévenir ou de sanctionner en Suisse le phénomène du blanchiment s'est réalisée, soit sous la pression du scandale, soit sous celle de la communauté internationale. C.- LA SUISSE NE RÉAGIT QUE SOUS LA PRESSION INTERNATIONALE La réaction des autorités helvétiques a toujours été et reste encore motivée par l'impératif économique de maintenir intacte la réputation de la place bancaire et financière suisse. Récemment, la ministre de la Justice suisse, Mme Ruth Metzler, s'exprimait en ces termes devant un parterre de banquiers18 : « Il est dans la logique des choses que, de par son climat favorable à l'économie et sa société relativement ouverte, la Suisse exerce une attirance sur des organisations criminelles. Bien que, dans la grande majorité des cas, ni l'Etat, ni les citoyennes et les citoyens ne soient menacés, la une des journaux peut signifier des dommages considérables pour la place financière. » Cette intervention est particulièrement significative de la conception suisse qui considère avant tout l'activité criminelle organisée telle que le blanchiment de capitaux, non pas comme une menace pour les démocraties, mais comme un risque pour l'image des banques qui, si elle se dégradait aux yeux du monde, conduirait la Suisse à la catastrophe. Sous la pression des scandales à répétition, la Suisse s'est donc progressivement dotée d'un ensemble de normes anti-blanchiment très complet. Les mesures anti-blanchiment prises par la Suisse sont, d'une part contenues dans le code pénal suisse et la loi fédérale cadre du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent - dite loi LBA, d'autre part dans un ensemble de règles édictées par les banquiers - Convention de diligence des banques, directives et circulaires de la Commission fédérale des banques - qui ont, selon les cas, précédé ou complété l'intervention du législateur. L'infraction spécifique de blanchiment se réfère au produit de toute activité criminelle et les professions ou activités soumises à l'obligation d'annonce - l'équivalent de la déclaration de soupçon - sont très nombreuses. Outre les acteurs économiques habituellement concernés, banques, bureaux de change, etc., la Suisse a soumis à l'obligation de déclaration de soupçon les avocats et les notaires et, d'une façon générale, l'ensemble des intermédiaires financiers non bancaires, tels que les gérants de fortune, les négociateurs en valeurs mobilières, mais aussi les hôteliers ou les chemins de fer fédéraux qui ont une activité de change. Le Bureau de communication, ou MROS - l'équivalent de TRACFIN - reçoit les déclarations de soupçons qu'il transmet, le cas échéant, à la justice. Une des caractéristiques du système suisse vient de ce que la Confédération helvétique a mis en place un système fondé sur le principe de l'autorégulation des intermédiaires financiers qui relèvent d'organismes d'autorégulation (OAR) créés sur la base de critères professionnels - OAR des avocats et notaires, OAR des fiduciaires, etc. Ces organismes sont chargés de surveiller le respect par leurs affiliés des dispositions anti-blanchiment dont ils définissent la mise en application. In fine, les intermédiaires financiers relèvent donc, au regard de la législation anti-blanchiment, soit d'autorités de surveillance spécifique - c'est le cas des banques ou des assurances -, soit indirectement ou directement de l'Autorité de contrôle créée par la loi-cadre de 1997. 1.- Les règles conventionnelles a) La convention de diligence des banques Une convention de droit privé, la Convention de diligence des banques (CDB), a été conclue pour la première fois en 1977 entre l'Association suisse des banquiers19, la Banque nationale suisse - qui s'en est retirée en 1987 - et toutes les banques établies en Suisse. Elle a ensuite été révisée et renouvelée à échéances régulières. Cette Convention relative aux obligations de diligence des banques (CDB) n'est nullement issue d'une volonté délibérée des banquiers suisses de mettre fin à d'éventuelles pratiques douteuses, mais a été imposée par la Banque nationale suisse aux banquiers de la place au lendemain du scandale de « l'affaire Chiasso ». Rappelons que cette affaire, qui domina l'actualité helvétique pendant le printemps 1977 et coûta plus de 1,2 milliard de FS au Crédit suisse, a permis de confirmer les soupçons de ceux qui affirmaient que les banques contribuaient activement à la fuite de capitaux étrangers vers la Suisse20 : il est en effet apparu que les responsables de la filiale à Chiasso de cette grande banque se rendaient régulièrement à Milan pour recueillir l'argent d'Italiens fortunés, faisaient franchir clandestinement la frontière à ces capitaux afin de les faire bénéficier du secret bancaire et les investissaient après les avoir fait transiter par une société établie au Liechtenstein. La partie principale de la CDB est constituée par les règles relatives à la vérification de l'identité du cocontractant (art. 2, § 4 à 21) et à l'identification de l'ayant droit économique (art. 3, § 22 à 33). La convention en outre prohibe toute assistance active à la fuite de capitaux (art. 7, § 44 à 48), à la fraude fiscale et aux actes analogues (art. 8, § 49 à 52). Un dispositif de contrôle et de sanction est prévu (art. 10 à 12). Le contrôle repose sur la diligence des auditeurs, dans le cadre de leur mission de révision ordinaire des comptes, mais surtout sur une Commission de surveillance spécialement instituée à cette fin. En cas de violation de la Convention, la banque peut se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 millions de FS... mais il est « dûment tenu compte » de la gravité de la violation (art. 11, § 1) et du « degré de culpabilité... de la banque ». On comprend donc que les velléités répressives de l'instance ordinale, dont la vigueur n'apparaît que rarement comme le travers principal, doivent savoir composer avec certaines réalités... Le dernier rapport de la Commission de surveillance de la Convention de diligence auquel la Mission d'information a eu accès, porte sur la période qui s'étend du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; le rapport couvrant les dernières années (1998-2000) ne sera en effet publié que dans le courant 2001. Il ressort de ce document que la Commission a été conduite à trancher 46 cas en trente-six mois : dans 16 des cas examinés, la procédure a été suspendue ; dans les 30 restants, une sanction a été prononcée. La Commission n'a pas rendu public le détail des sanctions infligées : il apparaît seulement qu'un blâme a été infligé en trois ans et que seules 13 amendes conventionnelles dépassent un montant de 10 000 FS, soit environ 40 000 FF. C'est donc dire que, dans la plupart des cas, les violations étant commises par de « petits » établissements, la Commission a su faire preuve d'un certain réalisme et que les sanctions prononcées ne présentent aucun caractère dissuasif. b) Les circulaires de la Commission fédérale des banques La Commission fédérale des banques exerce une influence notable sur le contenu de la Convention de diligence des banques et la considère comme une norme de référence sur laquelle elle s'appuie dans le cadre de ses missions de surveillance et de contrôle. La Commission fédérale des banques (CFB) intervient également par voie de circulaire pour accompagner et préciser la législation. Elle a ainsi tout d'abord édicté une circulaire CFB n° 31/3 du 18 décembre 1991, adressée à toutes les banques et organes de révision agréés et qui contient des directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces dernières sont entrées en vigueur le 1er mai 1992. Elles ont pour objectif premier de codifier la pratique suivie par la CFB quant à la garantie d'une « activité irréprochable » et à l'organisation interne adéquate des banques. Le principe de l'activité irréprochable a été posé par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. Il est interprété comme impliquant, en particulier, l'interdiction d'accepter des avoirs d'origine criminelle. La circulaire de la CFB contient des principes généraux et des règles de comportement pratique concernant : - l'identification du client et, au besoin, de l'ayant droit économique : la circulaire renvoie assez largement sur ce point à la CDB et concentre ses prescriptions sur le comportement à tenir lors de transactions inhabituelles ; - l'examen de l'arrière-plan économique et de la finalité des transactions : si des doutes existent sur la légalité de la transaction ou la provenance des avoirs du client, la banque doit décliner ou rompre la relation d'affaires ; - la collaboration avec les autorités de poursuite pénale ; - l'adoption de directives internes et d'un programme de formation dans les banques. Le contenu de la circulaire du 18 décembre 1991, qui a été abrogée, a été repris et complété par la circulaire 98-1 du 26 mars 1998, prise en application de la loi LBA du 10 octobre 1997. 2.- Les dispositions du code pénal Tout comme l'élaboration de la convention de diligence des banques, l'introduction dans le code pénal suisse de l'infraction de blanchiment est une des conséquences directe de l'actualité du scandale, en l'occurrence l'affaire des narcodollars - connue aussi sous le nom de « filière libanaise » ou « d'affaire Kopp » qui a achevé d'entamer plus que sérieusement la respectabilité de la place financière suisse en cette fin d'année 1989. Jusqu'à la survenance de ce scandale, les avertissements n'avaient pourtant pas manqué mais en dehors de la décision de geler les avoirs des dictateurs Marcos et Duvalier, les autorités suisses, comme les banquiers de la place, avaient choisi de faire profil bas devant les scandales qui s'étaient succédés tout au long des années 1980. « cette suisse trop accueillante pour les tricheurs et les malfrats de tout poil» Le scandale des narcodollars, qui a déjà coûté son poste au ministre de la Justice, Mme Elisabeth Kopp, continue de susciter de nombreux remous en Suisse. Il remet en question bien des certitudes sur la respectabilité helvétique. La révélation de l'affaire de la connexion libanaise, le plus important réseau de recyclage de narcodollars jamais découvert en Suisse, a écorné les certitudes helvétiques. Dans un pays préservé des remous, où l'opinion se complaît candidement dans l'illusion que « ça n'arrive qu'aux autres », le choc a été brutal. La connexion libanaise a provoqué la chute de Mme Elisabeth Kopp, ministre de la Justice, et révélé un monde d'affairisme insoupçonné derrière la façade respectable des institutions. Comme s'il suffisait de tirer un fil, c'est une vraie pelote qui commence à se dévider : la connexion libanaise révèle dans son sillage des combines plus anciennes, de sombres histoires d'argent blanchi par millions dans la pénombre discrète des grandes banques, des relations qui ressemblent, à s'y méprendre, à des trafics d'influence, et même un étrange dossier de meurtre précipitamment enterré. Bref, une kyrielle de turpitudes soigneusement occultées. De mémoire d'Helvète, on n'avait jamais vu cela. Pour parvenir à cet étonnant résultat, il aura fallu la ténacité d'un juge du canton du Tessin et l'obstination de la presse. Pourtant les avertissements n'avaient pas manqué. Les banques helvétiques avaient été mises sur la sellette à propos de fonds déposés dans leurs coffres par des dictateurs déchus comme Marcos ou Duvalier. Et on ne comptait plus les affaires de blanchiment d'argent sale ayant des ramifications dans la Confédération. Depuis plusieurs années, un ancien procureur de Suisse italienne, M. Paolo Bernasconi, qui avait enquêté sur la « pizza connection », n'avait cessé de réclamer la confiscation de l'argent de la drogue, « véritable talon d'Achille des trafiquants ». Ses mises en garde n'avaient cependant servi à rien, pas plus que les critiques adressées aux lacunes de la législation helvétique par un juge d'instruction de Mulhouse, M. Germain Sengelin. « Des lois faites pour des paysans jouant du cor des Alpes le samedi soir », avait-il déclaré. La saisie, en février 1987, à Bellinzone, d'une cargaison de 100 kilos de morphine base et d'héroïne dans un camion en provenance de Turquie devait faire l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière. Menée en collaboration avec les services de lutte antidrogue des Etats-Unis l'opération aboutissait à l'arrestation de deux personnages centraux de la future connexion libanaise, les frères Jean et Barghev Magharian qui viennent d'être placés jeudi 23 mars sous écrou extraditionnel à la demande des Etats-Unis. En deux ans, ces agents de change libanais établis à Zürich, sans permis de travail ni autorisation de séjour, avaient blanchi plus d'un milliard de narcodollars par l'intermédiaire de banques ou de sociétés financières ayant pignon sur rue en Suisse. Révélée début novembre par la presse, la connexion libanaise deviendra, non seulement la plus retentissante affaire de recyclage d'argent sale découverte dans la Confédération, mais aussi un scandale politique sans précédent. [...] En quelques semaines, tout a basculé. Naguère encore portée au pinacle, Mme Elisabeth Kopp, la première femme élue au Conseil fédéral, austère ministre de la Justice et de la police, se retrouve subitement au banc des accusés. C'est elle qui a averti son mari, M. Hans Kopp, un avocat d'affaires à la vie tumultueuse et au passé controversé, d'avoir à quitter le conseil d'administration de la Sharkaçai Trading de Zürich, une des sociétés impliquées dans le blanchiment des narcodollars. A la suite d'un rapport accablant du procureur extraordinaire chargé d'enquêter sur les fuites de son ministère, Mme Kopp est contrainte de partir sans plus attendre, le 12 janvier. Dans un pays instinctivement attaché à ses institutions, le « Koppgate » aura semé les germes du doute. Le ver semble bel et bien dans le fruit, dans la pomme pour être précis et fidèle à la légende de Guillaume Tell. « Le vrai problème est dans cette Suisse trop accueillante pour les tricheurs et les malfrats de tout poil. Il est dans cette morale que notre pays a perdue à force d'aimer l'argent », écrivait le quotidien 24 heures, de Lausanne. Reste à savoir dans quelle mesure les autorités fédérales se montreront maintenant capables de redorer leur blason et surtout de restaurer une confiance soumise, depuis quelques semaines, à rude épreuve. Le Monde du 27 mars 1989, Extraits de l'article de M. Jean-Claude Buhrer Contraints par les événements, les élus du Conseil national réagissaient en adoptant le 28 novembre 1989, un projet de loi portant révision du code pénal et visant à réprimer plus sévèrement le blanchiment de l'argent sale. Le Conseil national refusait cependant, lors de ce même débat, par 124 voix contre 66, d'adopter la proposition socialiste visant à inclure, comme le prévoyait l'avant-projet, la notion d'infraction par négligence. Cette loi a abouti à l'introduction de l'infraction de blanchiment dans le code pénal suisse. À l'origine de cet article se trouve la législation américaine qui l'a très directement inspiré comme cela est expressément reconnu dans l'un des considérants de l'arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour de cassation pénale suisse « il s'agit d'une infraction inspirée du droit des Etats-Unis d'Amérique, qu'il a fallu insérer dans notre droit pénal ». Le dispositif de répression du blanchiment repose aujourd'hui, pour l'essentiel, sur l'article 305 bis du code pénal en vigueur depuis le 1er août 1990. Son premier alinéa dispose ainsi que « celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ». Cette rédaction très large considère toute infraction grave - tout « crime », c'est-à-dire, selon le droit suisse, une infraction passible d'une peine privative de liberté d'une année au moins - comme infraction préalable et prend en compte le fait que les fonds blanchis ne proviennent pas uniquement du trafic de stupéfiants, mais également d'autres activités criminelles. L'argent sale, dans la conception suisse, est donc l'argent provenant d'un crime, c'est-à-dire d'une infraction passible d'emprisonnement. A contrario, l'argent provenant d'activités qui ne sont pas juridiquement qualifiées de crime bénéficie de « l'impunité du blanchiment d'argent ». De ce point de vue, le fait de n'avoir pas défini en amont les infractions préalables au blanchiment constitue une lacune. Interrogé sur cet aspect par la Mission, le professeur Paolo Bernasconi a suggéré d'admettre le critère de « commerce armé » pour définir un commerce criminel relevant des dispositions pénales punissant le blanchiment : « Il faut se poser la question suivante. Le commerce armé, qui est pratiqué sur les territoires étrangers, lorsqu'il a des conséquences sur le territoire suisse, est punissable puisqu'il est armé. L'argent qui provient des produits de ce commerce armé peut-il faire l'objet de blanchiment punissable ? Oui, parce que c'est du commerce armé qualifié comme crime (art. 260 ter du code pénal suisse), qui par conséquent, constitue une infraction concernant le blanchiment (art. 305 du code pénal suisse). Mais si vous travaillez avec l'idée de contrebande, personne ne parvient à ce résultat. Cela ne marche pas. » Ainsi, en droit suisse, entre par exemple dans la catégorie des simples délits, la contrebande de cigarettes, activité dans laquelle la Suisse semble jouer un rôle central en Europe. Tous les revenus criminels ne sont pas punissables « Les revenus de la contrebande [de cigarettes], récoltés par des courriers, sont ensuite rapatriés en cash ou par transaction virtuelle vers des fiduciaires suisses. L'argent n'a même pas besoin d'y être blanchi puisqu'il est le fruit d'une activité pénalement non punissable aux yeux de la loi helvétique. Nicolas Giannakopoulos estime à entre 5 et 20 les personnes prépondérantes dirigeant actuellement leurs trafics depuis notre pays. Considérés comme des hommes d'affaires en Suisse, ces individus sont souvent recherchés ou condamnés à l'étranger. 80% de ces acteurs auraient des liens directs avec les grandes organisations mafieuses italiennes. La récente décision d'extrader Gerardo Cuomo « en sa qualité de membre d'une organisation criminelle » pourrait donner un coup de frein à des « activités commerciales » jusqu'ici tolérées. Mais la Suisse, légalement, marche sur des braises. » Extrait du dossier spécial de l'Hebdo du 14 décembre 2000 En mai 2000, la Suisse a criminalisé la corruption de fonctionnaires, ce qui en conséquence, a ajouté les actes de corruption parmi les infractions préalables au blanchiment, que ces actes se soient produits en Suisse ou à l'étranger. Dans le cadre des procédures de révision de son code pénal, la Suisse réfléchit également à la possibilité d'établir une responsabilité subsidiaire de l'entreprise qui pourrait également être sanctionnée, et non plus seulement l'employé indélicat qui aurait blanchi de l'argent ou corrompu un fonctionnaire, lorsque cette dernière tolère de telles pratiques. Constituent des circonstances aggravantes - et justifient une répression alourdie (cinq ans d'emprisonnement et un million de francs d'amende) - le fait d'agir comme membre d'une organisation criminelle, d'agir comme membre d'une bande formée aux fins de se livrer « de manière systématique » au blanchiment d'argent ou de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent. Le blanchiment est également punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (article 305 bis, alinéa 2). Cette exigence de réciprocité limite les possibilités pour la Suisse de punir le blanchiment, même si, en pratique, les infractions principales sous-jacentes au blanchiment punissables en Suisse le sont aussi généralement dans les pays étrangers. L'article 305 bis du code pénal suisse peut s'appliquer à celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-même commis dans le cas notamment où l'auteur du crime qui a produit les fonds ne peut plus être poursuivi de ce chef pour des raisons de procédure. Enfin, même en l'absence de la réalisation de l'infraction principale, le juge suisse considère que la tentative de blanchissage peut relever de l'article 305 bis du code pénal suisse (Cour de Cassation pénale du 21 septembre 1994). L'article 305 ter du code pénal également en vigueur depuis le 1er août 1990, complète la disposition précédente en introduisant une obligation générale d'identification du client ainsi que de tout ayant droit économique éventuel. Ainsi, « celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances » est susceptible de se voir infliger une amende ou une peine privative de liberté. Cet article 305 ter a été complété et permet, depuis le 1er août 1994, aux personnes visées à l'alinéa 1er de cet article d'user d'un droit de communication, aux autorités de poursuite pénales, des indices fondant le soupçon que ces valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. 3.- La suppression des comptes anonymes En mai 1991, la Commission fédérale des banques publie une décision par laquelle elle oblige les intermédiaires financiers - avocat, notaire, gérant de fortune - à communiquer le nom de leurs mandants aux banques. Jusqu'à cette date, les banquiers qui devaient connaître le nom de leurs clients, en application de la convention de diligence, pouvaient se dispenser de cette formalité lorsque le client était lui-même représenté par un avocat, un notaire, une fiduciaire ou un gérant de fortune. L'intermédiaire financier attestait que l'identité de l'ayant droit lui était connue. Pour répondre aux exigences du GAFI - dont la Suisse fait partie - exprimées en juillet 1989, la CFB a décidé de ne plus accepter l'ouverture de comptes anonymes. Rappelons que la note interprétative à la recommandation 11 du GAFI précise qu'« une banque ou une autre institution financière devrait connaître l'identité de ses propres clients, même s'ils sont représentés par des avocats afin de détecter et d'empêcher les transactions suspectes... ». Les comptes numérotés dont l'identité des titulaires n'est connue que d'un nombre très limité de hauts responsables des banques, sont en revanche, toujours autorisés en Suisse et existent en très grand nombre. A proprement parler, ce type de comptes ne constitue pas un obstacle à la lutte anti-blanchiment puisque leur existence n'entrave pas les procédures judiciaires. Néanmoins, il reste toujours possible pour un avocat ou un notaire soumis au secret professionnel de ne pas dévoiler l'identité de l'ayant droit qu'il représente lorsque ces derniers effectuent un certain nombre d'opérations précisément définies dans ce que la Convention de diligence des banques appelle le formulaire R. Il s'agit par exemple du dépôt de sommes en paiement d'avances ou de frais de procédure, ou du dépôt de valeurs patrimoniales affectées à la réalisation d'opérations précises telles que partage successoral ou liquidation de régime matrimonial. La gestion de fortune est exclue de cette possibilité de représentation. 4.- La loi-cadre sur le blanchiment des capitaux du 10 octobre 1997 (loi L.B.A.) En prévoyant la pénalisation du blanchiment assortie de peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et un million de francs suisses d'amende, la Suisse estimait s'être dotée d'un dispositif « mordant » incitant banquiers et financiers à la vigilance. En pratique, cette législation n'a pas apporté de changements notables. Les autorités pénales n'ont reçu, en application du droit de communiquer, que quelques dizaines de déclarations de soupçons et la Suisse a continué, au cours des années 1990, d'accueillir en masse les capitaux douteux et notamment l'argent sale des pays de l'Est mais aussi des pays de l'Union européenne. Genève, haut lieu du blanchiment des capitaux Genève est un des cantons suisses les plus touchés par les affaires de blanchiment d'argent et de corruption, puisque pas moins de treize gros dossiers touchant les pouvoirs économiques, financiers ou politiques en Europe y transitent actuellement. Le procureur général Bernard Bertossa a noté vendredi, à l'issue d'une réunion à Genève de 35 magistrats italiens, suisses, espagnols et français qui ont demandé des moyens légaux renforcés pour lutter contre la corruption internationale, que même si la corruption ne frappe « pas, ou pas encore » les milieux politiques et économiques helvétiques, « des fonds ayant servi à corrompre, ou provenant de la corruption, sont souvent passés par la Suisse ou y restent ». M. Bertossa et le procureur Laurent Kasper-Ansermet sont saisis de plus d'une dizaine de commissions rogatoires internationales, le seul canton de Genève ayant eu à connaître depuis le début de l'année de 127 demandes d'aide pénale. La France arrive en tête, surtout avec 53 affaires, dont certaines cependant souvent minimes « liées à des délits transfrontaliers », selon le greffier-en-chef de l'instruction pénale à Genève. L'Italie a fait 21 demandes, les Etats-Unis 10, l'Allemagne 9, la Belgique et l'Espagne 7, suivis de l'Autriche 4 et du Portugal 3. Concernant la France, le Crédit Lyonnais, notamment, est concerné par la faillite de la holding genevoise Sasea, animée par l'italien Florio Fiorini. Sur demande du juge français Philippe Courroye, on examine aussi sur les bords du lac Léman le dossier qui oppose le maire de Lyon, Michel Noir, à son gendre Pierre Botton. Des sociétés proches de ce dernier ont ouvert des comptes à la filiale genevoise de la Banque de l'Union européenne. Sur demande du juge marseillais Pierre Philippon, six actes d'enquête concernant les finances du club de football Olympique de Marseille se sont déroulés en Suisse, rappelait cet été une enquête du quotidien « Tribune de Genève ». Poursuivi par la justice espagnole, l'ancien chef de la Guardia Civil, Luis Roldan, qui aurait empoché des commissions illégales, a ouvert, par des intermédiaires helvétiques, plusieurs comptes en Suisse. Dans le cadre de l'instruction ouverte contre un ancien gouverneur de la banque d'Espagne, Mariano Rubio, dont le nom est cité dans un délit d'initié concernant la banque Ibercop, la justice helvétique se penche sur plusieurs comptes ouverts à Genève par sa femme et un associé. Genève est également saisi dans le cadre de l'affaire de la Société belge d'Assurances Mutuelles des administrations publiques (SMAP). Le récent scandale de l'affaire du promoteur allemand Juergen Schneider et celui de la privatisation de la cimenterie grecque Aget Herakles, dans laquelle un ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir reçu des pots de vins versés en Suisse, occupent également la justice. Enfin, plusieurs demandes italiennes sont traitées à Genève, toutes peu ou prou en rapport avec l'opération « Mani Pulite » (mains propres). Malgré les récentes restrictions à la pratique du secret bancaire en Suisse, Genève reste une terre d'accueil privilégiée pour le blanchiment ou la dissimulation de capitaux, grâce à un tissu très dense et croisé de fiduciaires et de sociétés financières. Dépêche de l'AFP, du 9 septembre 1994 Le dispositif pénal et réglementaire de la Suisse révélant son insuffisance et son incapacité à endiguer le flot des affaires de délinquance financières qui aboutissement principalement dans les cantons de Zürich, Lugano et Genève, certains magistrats suisses fortement engagés dans ce combat font comprendre qu'il est grand temps de faire évoluer les choses, considérant la démocratie suisse désormais menacée. L'Union européenne a, de son côté, adopté depuis 1991 une directive anti-blanchiment directement inspirée des principes du GAFI. Dans les différents pays de l'Union européenne, une unité de renseignement financier est chargée de recueillir, d'exploiter et de transmettre à la justice les déclarations de soupçons des banquiers ou des professionnels exposés au risque de blanchiment. La Suisse manque à l'appel ; elle ne peut s'isoler davantage et décide alors de modifier sa législation. Les travaux préparatoires commencent en 1995 et s'achèvent sur l'adoption, le 10 octobre 1997, d'une loi fédérale cadre contre le blanchiment des capitaux, dite loi L.B.A. Encore une fois, la Suisse donne le sentiment d'avoir évolué sous la pression, certains estimant que « les pressions américaines ont joué un rôle-clef dans la genèse de cette législation », d'autres allant même jusqu'à affirmer : « La loi helvétique sur le blanchiment d'argent a été dictée par les Américains. Elle rompt la présomption d'innocence, car elle permet à un dénonciateur de bloquer de l'argent sans preuves. » 21 Ce texte instaure une obligation de communiquer les soupçons à un Bureau de communication, également appelé MROS, et soumet l'ensemble des intermédiaires financiers - bancaires et non bancaires - à ce dispositif. La loi repose par ailleurs sur le principe spécifique à la Suisse de l'autorégulation. Les intermédiaires financiers adhèrent à des organismes d'autorégulation (OAR) et relèvent, soit d'une autorité de surveillance spécifique comme, par exemple, la Commission fédérale des banques, soit de l'Autorité de contrôle créée par la LBA. Celle-ci surveille les différents OAR ainsi que les intermédiaires financiers qui lui sont directement rattachés. En conséquence, il faut distinguer au sein de l'ensemble générique des intermédiaires financiers : - les intermédiaires financiers soumis à une surveillance définie par une loi spéciale. C'est le cas des assurances, des bourses ou des banques qui relèvent d'autorités de surveillance spécifiques. Ces intermédiaires peuvent par ailleurs s'affilier à un organisme d'autorégulation (ex. : Association suisse des banquiers). Dans ce cas, l'affiliation à un OAR ne résulte pas de la loi LBA mais de la pratique de l'autorégulation acceptée par les Autorités de surveillance. - les intermédiaires financiers non réglementés sur le plan prudentiel qui s'affilient à un organisme d'autorégulation (OAR) et qui sont sous la surveillance de ce dernier au regard des dispositions anti-blanchiment de la LBA, c'est le cas par exemple des gestionnaires de fortune indépendants. L'Autorité de contrôle surveille à son tour les OAR qu'elle agrée ou refuse. - les intermédiaires financiers non affiliés à un OAR qui dépendent directement de la surveillance de l'Autorité de contrôle qui leur délivre une autorisation d'exercer. Par convention, on désignera sous le terme d'intermédiaires financiers, les intermédiaires financiers qui relèvent, en application de la L.B.A., d'un O.A.R. ou de l'Autorité de contrôle, les intermédiaires financiers bancaires répondant, quant à eux, à la terminologie d'intermédiaires bancaires ou plus simplement de banques. La loi instaure une série d'obligations de diligence, conformes aux Quarante Recommandations du GAFI : vérification de l'identité du cocontractant (art. 3), identification de l'ayant droit économique (art. 4) Toutefois, l'apport essentiel de la LBA repose sur la création d'une obligation de communiquer au lieu d'un simple droit de communication des soupçons prévu par le code pénal. En cas de soupçon de blanchiment, les obligations des intermédiaires financiers sont les suivantes : - information du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ; - blocage des avoirs ayant un lien avec les informations communiquées, jusqu'à réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente - au maximum, durant cinq jours ouvrables à compter de l'information du Bureau de communication - en s'abstenant d'informer les personnes concernées ou des tiers. Le banquier ou l'intermédiaire financier qui procède à une telle communication et au blocage des fonds ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel ou être rendu responsable de violation de contrat, s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances. En conséquence de l'adoption de la loi sur le blanchiment d'argent, la Commission fédérale des banques a adopté une nouvelle circulaire 98-1 sur le blanchiment des capitaux, qui abroge la circulaire précédente. Ce nouveau texte a apporté quelques modifications aux directives antérieures - d'ampleur modeste, selon la CFB, car la LBA se serait précisément alignée sur les principaux devoirs fondamentaux en matière d'organisation, de comportement et de documentation qu'elle avait dégagés. Les adaptations concernent essentiellement l'élargissement du champ d'application du dispositif de lutte au-delà du domaine bancaire - dans la limite de la compétence de la CFB (fonds de placement et négociants en valeurs mobilières) -, l'instauration du devoir d'annonce des soupçons et la formalisation des règles applicables aux avoirs de personnalités politiques importantes. De même, une nouvelle version de la Convention de diligence des banques révisée (CDB) qui tient compte de la LBA a pris effet le 1er juillet 1998. Elle comprend des dispositions plus strictes que la CDB antérieure sur différents points - notamment, celui de l'acception de mandats de gestion de fortune sur des avoirs déposés auprès de tiers, de même que celui de l'exécution d'opérations de négoce sans relation avec des comptes existants auprès de la banque. II.- DES BANQUES SUISSES PEU IMPLIQUÉES DANS LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT L'Association suisse des banquiers (ASB) manifeste une volonté apparente de faire de la Suisse une des places financières les plus irréprochables. Elle s'est engagée dans cette voie il y a plus de vingt ans en élaborant la Convention de diligence des banques, qui connaît aujourd'hui sa cinquième édition et qui constitue le texte de référence des banquiers suisses. L'ASB a publié de multiples recommandations interprétatives concernant notamment l'application de la loi-cadre LBA de 1997, telles que la recommandation concernant le blocage des comptes et l'interdiction d'informer ou la recommandation concernant la gestion des valeurs patrimoniales faisant l'objet d'un tel blocage. La Commission fédérale des banques (CFB) fait preuve, de son côté, du souci de lutter contre le blanchiment. Une centaine de personnes travaillent à la CFB qui n'en comptait que trois ou quatre il y a une vingtaine d'années. La CFB est l'auteur de la circulaire n° 98-1, véritable vade-mecum du banquier en matière de lutte anti-blanchiment. La Commission a dernièrement décidé de jouer la transparence en publiant par exemple sur son site Internet le rapport d'enquête sur les fonds de l'ex-dictateur nigérian Sani Abacha et de sa famille, qui ont été acceptés par certaines banques en Suisse, en violation manifeste de leurs obligations. L'enquête a révélé des comportements individuels lourdement contestables.
Depuis le mois de novembre 1999, la CFB examine si dix-neuf banques en Suisse ont respecté les obligations de diligence qui découlent de la loi sur les banques et d'autres lois applicables lors de l'acceptation et de la gestion de fonds provenant de l'entourage de l'ancien président du Nigeria, Sani Abacha. [...] La CFB a déployé une énergie considérable dans cette procédure administrative. D'importants volumes de documents devaient être analysés. Des discussions avec les directions de plusieurs banques concernées ont eu lieu. Dans le cas d'un établissement, toutes les personnes effectivement ou potentiellement concernées ont été formellement entendues. Les ressources investies par la CFB sont en relation avec ces efforts puisque jusqu'à 12 personnes, soit 14 % de l'effectif global de la CFB, ont été impliquées dans les procédures et les vérifications annexes. [...] Chaque état de fait se distingue des autres de façon importante. Les banques examinées ont eu des comportements radicalement différents. L'appréciation de leurs comportements s'avère par conséquent différenciée. Il est possible de former trois groupes. Banques ayant eu un comportement irréprochable : Cinq banques ont pleinement respecté leurs obligations de diligence : Banca del Gottardo, Citibank N.A., Goldman Sachs & Co. Bank, Merrill Lynch et UBS AG. Ces banques se sont comportées de manière correcte parce qu'elles ont procédé à des clarifications approfondies relatives à la situation personnelle et économique de leurs clients et lorsqu'elles ont eu connaissance de faits nouveaux ou en cas de doutes persistants, pris en temps utile les mesures qui s'imposaient telles que la rupture de la relation d'affaires ou l'annonce aux autorités compétentes. [...] Banques ayant montré des points faibles : Dans le cas de diverses banques, la CFB a constaté des points faibles ou des défaillances qui n'atteignaient pas un degré de gravité tel que des mesures contraignantes se seraient avérées nécessaires. Ce groupe se compose des banques Banque Edouard Constant SA, Banque Nationale de Paris (Suisse) SA, Banque Barings Brothers (Suisse) SA, J. Henry Schroder Bank, Pictet & Cie et SG Rüegg Bank AG. Dans le cas de la plupart de ces banques, il s'est avéré nécessaire de critiquer la clarification insuffisante ou tardive de l'arrière-plan économique. Dans certains cas, des manquements au plan de l'organisation telles que l'application traînante de décisions internes ou, dans un cas, l'absence de directives internes relatives à la politique commerciale avec des personnalités politiques exposées, ont été critiquées. Banques ayant montré des défaillances plus graves : Dans le cas du troisième groupe de banques, l'enquête a établi des défaillances en partie graves et des défaillances ou des comportements erronés individuels crasses. Il faut citer dans ce groupe trois banques du Crédit Suisse Group (Crédit Suisse, Bank Hofmann et Bank Leu), Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA, UBP Union Bancaire Privée et MM. Warburg Bank (Schweitz) AG. Extraits du rapport de la Commission fédérale des banques « Fonds Abacha » auprès des banques suisses, 30 août 2000. Est-il possible pour autant de délivrer un satisfecit général au système bancaire suisse lorsque l'on sait que le Bureau de communication, pour sa deuxième année d'activité, n'a enregistré que 313 communications venant des banques alors que le volume des sommes gérées par la place bancaire suisse est actuellement estimé à 4 000 milliards de dollars. A.- UN NOMBRE DÉRISOIRE DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS L'obligation de communiquer prévue par la LBA a fait l'objet de vives discussions et de profondes réticences lors de la discussion de ce projet. Les travaux préparatoires, en 1995, montrent que l'une des principales questions en débat était de savoir s'il fallait imposer cette obligation ou se satisfaire d'une demande de blocage des avoirs par les intermédiaires financiers. A l'exception des autorités pénales et des postes suisses, les représentants consultés - Association suisse des banquiers, Fédération suisse des avocats, Fédération suisse des notaires, Chambre fiduciaire, Banque nationale suisse, Union suisse des assureurs privés - s'étaient prononcés contre l'obligation de communiquer. « Une avalanche de communications Les milieux consultés étaient, dans l'ensemble, d'avis qu'il était fondamentalement souhaitable de créer une loi sur le blanchissage d'argent. [...] Etant donné la participation active de la Suisse au Groupe d'action financière (GAFI) et les efforts du Conseil fédéral pour lutter contre le blanchissage, il était d'ailleurs exclu, pour des raisons politiques, de renoncer à poursuivre l'élaboration d'une telle loi. [...] Il s'agissait de savoir si, en cas de soupçon fondé de blanchissage, il faudrait imposer aux intermédiaires une obligation de communiquer, ou si l'on se contenterait de leur demander de bloquer les avoirs incriminés. [...] A l'exception des représentants des autorités pénales et des PTT, les participants à l'audition rejettent l'obligation de communiquer, estimant que cette obligation reviendrait à confier aux intermédiaires financiers des tâches de police, ce qui serait inadmissible. Toujours selon eux, elle aboutirait aussi forcément à une quantité de dénonciations injustifiées, que le Bureau de communication en matière de blanchissage ne serait guère en mesure de traiter. Enfin, cette avalanche de communications compromettrait le secret bancaire, atout majeur de notre place financière. Quant au simple blocage des avoirs, les participants y voient un moyen efficace d'arriver au but recherché. Extraits du message fédéral n° 96-055 du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier. Malgré cette opposition, les membres du groupe de travail de l'administration ont approuvé, à l'exception de la CFB, l'obligation de communiquer en se fondant sur le fait que le GAFI attachait beaucoup d'importance à ce principe et qu'en y dérogeant, la Suisse s'exposerait à des pressions extérieures.
« Le simple blocage des avoirs compromettrait le but même de la loi : les valeurs patrimoniales suspectes seraient certes bloquées, mais il deviendrait plus difficile d'en identifier les ayants droit économiques. D'autre part, [...] il ne faut pas surestimer l'afflux de dénonciations injustifiées, le seuil d'application de l'obligation de communiquer étant placé très haut en Suisse, par rapport à d'autres pays. Enfin, en abandonnant l'obligation de communiquer, la Suisse s'exposerait rapidement à des pressions extérieures, la majorité des Etats du GAFI la connaissant en effet, notamment ceux de l'Union européenne. Dans la lutte contre le blanchissage d'argent, la présidence du GAFI paraît elle aussi attacher beaucoup d'importance à l'obligation de communiquer. Au début de 1996, le GAFI a en effet ouvert le débat pour décider si l'obligation de communiquer imposée aux intermédiaires financiers serait inscrite dans ses recommandations en tant qu'instrument obligatoire du dispositif de prévention. » Extraits du message fédéral n° 96-055 du 17 juin 1996 relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier. En effet, le fait pour la Suisse d'être membre fondateur du GAFI, dont elle avait assuré la présidence en 1992 et dont elle avait reconnu les 40 Recommandations, la conduisait inexorablement à transposer ces principes dans son droit interne. Le message fédéral précité y fait d'ailleurs explicitement référence. « La présente loi tient compte des engagements internationaux de notre pays. Pour cette raison, il est souhaitable qu'elle entre en vigueur rapidement, d'autant plus que la Suisse sera soumise [...] à une deuxième évaluation du pays de la part du GAFI [...] » (Point 51). Les défenseurs de l'obligation de communiquer ne manquèrent d'ailleurs pas de rappeler que la majorité des Etats du GAFI et les pays de l'Union européenne avaient posé cette obligation et, qu'à l'époque, parmi les 27 membres du GAFI, seuls le Canada - qui envisageait de l'introduire - la Suisse et la Turquie ignoraient l'obligation d'informer imposée aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral suisse a donc tranché en faveur de l'obligation de communiquer, estimant que le seul blocage des avoirs ne permettrait pas de lutter efficacement contre le blanchiment en laissant aux personnes soupçonnées une trop grande facilité pour quitter le pays et brouiller les pistes. L'obligation de communiquer a ainsi été instaurée contre la volonté des intermédiaires financiers et des banques. Il n'est donc pas surprenant que ceux-ci aient quelques réticences à l'appliquer et que le système finalement adopté par la Suisse n'aboutisse qu'à un nombre très faible de déclarations de soupçons. Le Bureau de communication ou MROS destinataire des déclarations de soupçons, a publié depuis sa création deux rapports d'activités portant respectivement sur les périodes 1er avril 1998 - 31 mars 1999 et 1er avril 1999 - 31 mars 2000 dont on peut retenir les éléments suivants : Jusqu'au 1er avril 1998 date d'entrée en vigueur de la loi fédérale relative au blanchiment, les autorités de poursuites pénales enregistrent chaque année, sur la base de l'article 305 ter du code pénal suisse prévoyant un droit de communication, environ 30 à 40 communications, en provenance des intermédiaires financiers. Au terme de sa première année d'activité (1998-1999) le Bureau a reçu 160 communications représentant 333,7 millions de francs suisses - soit 1,34 milliard de francs français - soit 6 milliards de francs français. Pour la période suivante (1999-2000), le MROS a enregistré 370 communications correspondant à un montant de 1,5 milliard de francs suisses, 85 %de ces annonces provenant des banques. Il est mathématiquement indéniable, comme certains interlocuteurs l'ont souligné devant la Mission, que l'on a assisté en un an à une progression de 231 % du nombre des communications et à une augmentation de 448 % du montant des sommes concernées par ces mêmes communications. Cette argumentation purement quantitative n'est destinée qu'à masquer la réalité. En effet, ces pourcentages ne peuvent pas faire oublier l'extrême modestie de ces résultats en valeur absolue, compte tenu de l'importance et du poids de la place financière suisse. Rappelons qu'il y avait 372 établissements bancaires dénombrés au 31 décembre 1999 et que le Bureau de communication a reçu 313 déclarations venant des banques soit, en moyenne théorique, moins d'une déclaration par banque et par an. Comment les banques suisses peuvent-elles, dans ces conditions, convaincre de leur réelle volonté de faire de la lutte anti-blanchiment une de leur priorité essentielle ? Les autorités suisses invoquent la logique de l'autorégulation pour expliquer et se satisfaire de la faiblesse du nombre des déclarations de soupçon. Selon elles, par le jeu d'une autodiscipline préventive mise en place au sein des professions concernées, il s'opère un filtrage préalable ne laissant parvenir au Bureau de communication que les seuls cas sur lesquels pèsent de sérieux soupçons de blanchiment.
« M. Ricardo SANSONETTI : S'agissant de l'efficacité des systèmes d'annonce de soupçons, nous avons toujours considéré qu'il n'était pas essentiel d'avoir une myriade d'annonces mais qu'il importait que les annonces correspondent vraiment à un état de fait devant être annoncé et surtout qu'il y ait un suivi. L'efficacité d'un système d'annonce se mesure moins au nombre d'annonces qu'au rapport entre le nombre d'annonces et le suivi qui leur est donné. Sur le plan national, il est clair que les systèmes qui aboutissent au plus grand nombre d'annonces ne sont pas les plus efficaces. Le système britannique qui en produit environ dix mille par an est assorti d'un ratio de suivi extrêmement faible. Dans le système néerlandais, dépourvu d'une définition claire des soupçons, qui prévoit l'annonce des « unusual transactions », le suivi est également difficile à mesurer. » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Ricardo Sansonetti, Chef suppléant de la section marchés financiers, septembre 1999. La Suisse n'a pas souhaité opter pour un système de déclaration systématique de toute transaction inhabituelle, il convient donc d'apprécier l'efficacité de son dispositif non pas par rapport aux pays qui ont fait ce choix mais par rapport aux autres dispositifs de déclarations plus subjectifs qui font appel à la notion de soupçon et laissent aux personnes déclarantes la possibilité d'apprécier s'il convient ou non de faire une telle déclaration. Mais même dans ce cadre, la Suisse se situe encore à un niveau particulièrement faible compte tenu de l'importance de sa place financière. Il apparaît plutôt que la pénurie de déclarations de soupçons dont le Bureau de communication se trouve victime vient essentiellement de deux facteurs : la contrainte du blocage des fonds et la définition relativement floue de la notion de relation d'affaires et de soupçon fondé. 2.- Une interprétation restrictive des recommandations du GAFI L'obligation de communiquer en cas de soupçon de blanchiment d'argent résulte de l'article 9 de la LBA qui prévoit que « l'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'article 305 bis du code pénal... doit en informer sans délai le Bureau de communication... ». A la lecture de la loi, l'obligation de communiquer n'existe pas en dehors de la relation d'affaires, ce que confirment les travaux préparatoires de la LBA. « Cette obligation [de communiquer] n'existe pas si, lors du premier contact établi sans engagement avec un client, l'intermédiaire renonce à engager une relation d'affaires qui le mènerait plus loin. Ainsi, dans des cas manifestement douteux, il est libre de décider s'il veut véritablement instaurer une telle relation. S'il décide d'y renoncer, son activité n'aura créé aucun risque de blanchissage d'argent, raison pour laquelle il n'y a aucun motif de lui imposer des obligations plus étendues ». 22 En somme, soit il n'existe pas de relation d'affaires et seul s'applique alors un simple droit de communication aux autorités pénales prévu à l'article 305 ter du code pénal, soit il existe une relation d'affaires et, dans ce cas seulement, il y a une obligation de communiquer au Bureau de communication. La Commission fédérale des banques a adopté une autre position. Pour autant, existe-t-il véritablement une obligation de communiquer en dehors de la relation d'affaires ? Interrogé par la Mission en septembre 1999 sur ce sujet, le juge d'instruction genevois Paul Perraudin a apporté les précisions suivantes :
« M. le président : Je me demande si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire quant à la définition de la notion de relation d'affaires. Vous nous avez dit que le principe de l'autorégulation ou de l'autocontrôle était une bonne chose. Toutefois, j'ai relevé d'une part l'imprécision de la notion du soupçon fondé et la difficulté pour les établissements concernés d'établir eux-mêmes cette déclaration ou annonce, d'autre part, le flou que revêt la notion de relation d'affaires tel que cela ressort du rapport du Bureau de communication au paragraphe 50. Avez-vous un point de vue sur cette notion de relation d'affaires ? Cela nous éclairerait. M. Paul PERRAUDIN : En Suisse, la relation d'affaires, c'est essentiellement la relation de compte. M. le président : Compte ouvert ? M. Paul PERRAUDIN : Compte ouvert alors même qu'il ne serait pas encore opérationnel. Il peut y avoir un décalage entre l'ouverture du compte et son utilisation. La circulaire 98-1 de la Commission fédérale des banques, qui s'adresse uniquement aux banques et non pas aux autres intermédiaires financiers, prévoit que l'obligation d'annonce est également applicable hors relation d'affaires, hors relation de compte. Imaginez que quelqu'un se présente dans une banque avec de faux titres, repérés comme tels, la banque doit en informer le Bureau de communication alors même qu'elle aurait décliné d'emblée la relation d'affaires. Pour les intermédiaires financiers bancaires, la circulaire sur le blanchiment a en effet introduit une obligation d'annonce, même hors relation d'affaires, lorsqu'il y a soupçons fondés manifestes que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle. » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Paul Perraudin, juge d'instruction à Genève, en septembre 1999 La Commission fédérale des banques, en tant qu'autorité de surveillance de ce secteur, a, dans sa circulaire 98-1 du 26 mars 1998, rassemblé un certain nombre de directives relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce faisant, la CFB a effectivement donné une interprétation extensive de l'obligation de communiquer. Au titre des procédures de clarification à effectuer par le banquier, la circulaire 98/1 de la CFB précise qu'il « n'appartient pas aux intermédiaires financiers (...) de rechercher systématiquement lors de chaque transaction un éventuel acte délictueux » (point 21) avant de distinguer « les obligations dans les relations d'affaires » (point 23) des « obligations hors relation d'affaires » (point 22). Dans le cadre de la relation d'affaires le banquier, outre l'obligation de communiquer, doit procéder à un certain nombre de clarifications des transactions ou opérations qui paraissent inhabituelles. Hors de la relation d'affaires, le banquier n'est pas tenu de procéder à ces clarifications mais il doit néanmoins se soumettre à l'obligation d'informer. Ainsi « s'il a des soupçons fondés manifestes que des valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle, il en informe les autorités pénales compétentes et le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ». (point 22 de la circulaire n° 98-1) Cette prise de position de la CFB subordonne donc l'obligation de communiquer, en dehors de la relation d'affaires, à la condition qu'il y ait des soupçons fondés manifestes, alors que les seuls soupçons fondés sont retenus pour entraîner l'obligation de communiquer dans le cadre de la relation d'affaires. Rappelons que, selon le Message précité des autorités fédérales, « des soupçons sont considérés comme fondés lorsqu'il existe un signe concret ou plusieurs indices qui font craindre une origine criminelle des valeurs patrimoniales. » De fait, la situation où existeraient des soupçons fondés manifestes, se présente rarement en dehors de la relation d'affaires. Il ne s'agirait que d'une hypothèse d'école selon certains banquiers.
M. le président : Il semblerait que le Bureau de communication ait lui-même une certaine difficulté à donner un contenu très précis à la notion de relation d'affaires. Dans le cas où vous refuseriez, en fonction de vos critères, d'accepter l'ouverture d'un compte, pour des raisons liées au doute ou au soupçon que vous pourriez avoir sur l'origine des fonds, vous sentiriez-vous néanmoins dans l'obligation de faire une déclaration ou bien vous en tiendriez-vous là ? M. Claude-Alain BURNAND : La réponse est contenue dans la loi et dans les directives de la Commission fédérale des banques. En principe, lorsque nous déclinons une relation d'affaires, nous n'avons pas l'obligation d'annonce, sauf en cas de soupçons manifestement fondés, ce qui est très rare, voire inexistant. Lorsque dans une conversation, nous avons l'impression qu'une personne qui veut entrer en relation de compte n'est pas quelqu'un de sérieux, nous n'avons pas d'éléments concrets qui nous permettent de considérer que les fonds qu'il nous propose sont en relation avec un délit. On pourrait imaginer que vienne nous voir une personne dont nous aurions lu le nom dans un journal qui nous aurait été envoyé par un de nos correspondants étrangers. En ce cas, nous aurions la faculté, voire l'obligation, de dénoncer, mais c'est une situation théorique. » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Claude-Alain Burnand, Secrétaire général de Paribas Suisse SA, en septembre 1999 L'ancien responsable du Bureau de communication, M. Daniel Thelesklaf, dans le premier rapport d'activité du MROS, constatait cette réalité : « La LBA contribuera à une amélioration sensible de ce dispositif en introduisant notamment une obligation de déclaration de soupçons dont il faut relever le caractère incomplet en raison du fait que l'obligation ne naît qu'au moment de la relation d'affaires et la lecture restrictive qu'en font les institutions financières. Le secteur financier suisse tend plutôt à se prémunir contre les blanchisseurs en étant scrupuleux lors du début des relations d'affaires et en privilégiant ainsi le refus d'engager des relations d'affaires avec les clients douteux. » (point 50) La Suisse a ainsi adopté une interprétation « restrictive » des recommandations du GAFI. Surtout, la distinction ainsi opérée par les autorités suisses et la restriction du devoir d'information hors relations d'affaires aux seules situations où naissent des soupçons « fondés » et « manifestes » ne répondent aucunement aux demandes du GAFI. Les termes généraux de sa Recommandation 15 sont en effet sans ambiguïté et ignorent une telle distinction : « Si les institutions financières suspectent que des fonds proviennent d'une activité criminelle, elles devraient être obligées à déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes. » Le législateur français en a d'ailleurs tiré toutes les conséquences, puisqu'il avait imposé dès 1990 (art. 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, modifié par l'article 72 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) que les organismes financiers déclarent non seulement « les sommes inscrites dans leurs livres » mais également « les opérations qui portent sur des sommes » - c'est-à-dire, qu'une relation d'affaires soit établie ou pas - lorsque celles-ci leur paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Il en est de même de la quasi-totalité des législations des pays européens. Sur ce point, la législation suisse apparaît donc pour le moins en retrait - voire totalement défaillante - alors même que c'est au moment de son intégration au système financier officiel que l'argent sale apparaît le plus vulnérable. 3.- La contrainte du blocage des fonds Les banquiers réalisent des opérations commerciales et sont, par définition, contraints de forcer leur nature pour effectuer tout acte qui irait à l'encontre de cet objectif marchand. En Suisse, comme ailleurs, la démarche consistant à faire une déclaration de soupçons auprès d'une structure ad hoc n'est jamais facile pour une banque. En Suisse, elle s'accompagne de l'obligation qui, commercialement, est loin d'être neutre, de bloquer les avoirs concernés par la déclaration de soupçons pendant un délai de cinq jours maximum sans pouvoir informer les personnes concernées ou les tiers (article 10 de la LBA). Avant même l'adoption de la loi LBA, l'Association suisse des banquiers (ASB) était déjà intervenue, dans le cadre du simple droit de communication, par la voie d'une Recommandation, pour éviter « d'éventuels malentendus entre les banques et les autorités de poursuite pénale face au conflit d'intérêt qui peut exister entre la nécessité de ne pas entraver l'enquête pénale (...) et le devoir de loyauté de la banque ». L'A.S.B a, par ailleurs, publié le 26 mars 1999, une recommandation n° 1429 D qui complète la recommandation précitée, et qui concerne la gestion des valeurs patrimoniales faisant l'objet d'une mesure de blocage. En application de cette recommandation, les instructions de placement données par le client ou son représentant ne peuvent être exécutées qu'avec l'accord de l'autorité pénale. S'agissant des mandats de gestion de fortune ceux-ci continuent en revanche d'être exécutés jusqu'à leur révocation ou leur modification par le juge. En ce qui concerne les valeurs patrimoniales pour lesquelles il n'existe pas d'instructions de placement, l'autorité pénale donne des instructions concrètes de placement et peut accorder à la banque un mandat de gestion de fortune dont l'autorité pénale fixe le contenu. Il apparaît donc clairement que l'annonce faite au Bureau de communication qui déclenche le blocage des avoirs représente une entrave des relations commerciales et peut constituer un frein pour le banquier qui hésitera à altérer aussi profondément ses relations avec un client qui lui aura fait une entière confiance. Ce système très rigoureux qui entraîne le blocage immédiat des avoirs travaille précisément à l'encontre du but recherché, puisqu'il retient plus qu'il n'encourage la déclaration de soupçons. 4.- Des obligations de déclarer les soupçons fondés sur l'exclusive bonne volonté des banquiers Les banquiers, dans la conception suisse de l'autorégulation, étant considérés comme les mieux placés professionnellement pour identifier ou percevoir la provenance douteuse des avoirs déposés ou qui transitent sur un compte, l'efficacité du système repose donc in fine sur le bon vouloir et la diligence des établissements bancaires comme le soulignait devant la Mission le procureur Bernard Bertossa en septembre 1999. Dans les affaires sensibles, nous découvrons M. Bernard BERTOSSA : Je pense que l'efficacité est extrêmement limitée dans la mesure où le signalement dépend de la diligence et de la bonne volonté de l'intermédiaire financier lui-même. Dans les affaires sensibles, nous n'avons pas de signalement avant que nous ne découvrions par d'autres sources des opérations concernant des établissements bancaires suisses, à quelques exceptions près, comme l'affaire dite de la Bank of New-York qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Nous avons reçu treize signalements de banques suisses relatives à des phénomènes relativement périphériques par rapport à l'enquête américaine dont la presse s'est fait l'écho ». Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Bernard Bertossa, Procureur Général du canton de Genève, en septembre 1999 Dans ce contexte, compte tenu des conséquences commercialement contraignantes de l'obligation d'informer (blocage des fonds, non-information du client...), des possibilités de l'éviter en refusant la relation de compte et des marges importantes d'appréciation laissées à l'intermédiaire financier sur la base d'une notion assez floue de soupçon fondé (moins qu'une certitude, plus qu'un sentiment...), il n'est pas surprenant que le nombre d'annonces reçues, de la part des banquiers, par le Bureau de communication soit aussi peu élevé. Si l'on examine, par ailleurs, l'origine des éléments qui ont conduit les banquiers à informer le Bureau de communication, on s'aperçoit que, dans une proportion considérable, cette déclaration est généralement motivée par la lecture des informations livrées par la presse qui alerte ainsi les responsables des banques. Le deuxième rapport d'activité du Bureau de communication (31 mars 1999-1er avril 2000) montre que les révélations contenues dans les médias arrivent en tête des motifs qui ont entraîné la communication. Principaux motifs des communications
Source : deuxième rapport d'activité du MROS Ce tableau est ainsi commenté par le MROS : « Cette année encore, les intermédiaires financiers ont mentionné le plus souvent comme motif de communication les informations diffusées dans les médias, par lesquelles ils ont appris que leurs clients pouvaient être impliqués dans des actes criminels. » A ce stade, le client du banquier fait en principe déjà l'objet d'une procédure judiciaire et les inconvénients ou risques commerciaux que fait encourir le blocage des avoirs lié à la déclaration de soupçons, s'atténuent considérablement. Les affaires de blanchiment, d'autre part, concernent souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, plusieurs banques de la place. Dès lors, si le fait déclencheur se trouve dans la presse, plusieurs banques vont alors faire des déclarations en chaîne portant sur la même affaire. La progression du nombre de déclarations n'est donc pas nécessairement significative de l'augmentation du nombre d'affaires dénoncées. L'existence d'un arrière-plan économique peu clair de la transaction ne constitue que le deuxième motif de déclaration de soupçons au Bureau de communication, alors même que les banquiers sont soumis à l'obligation de clarifier les transactions (article 6 de la LBA). Il ressort du deuxième rapport du MROS que les banquiers qui procèdent à des déclarations de soupçons les effectuent majoritairement sur la base d'informations qu'ils reçoivent de l'extérieur, puisque les éléments fournis par les médias et les informations transmises par les autorités de pouvoir motivent 57 % de ces déclarations. En se fondant sur les principes de l'autorégulation et de la prévention, la Suisse considère qu'elle s'est engagée dans une voie qui aboutit nécessairement à un nombre d'annonces peu élevé et que le critère d'efficacité se mesure avant tout par rapport au nombre de cas transmis à la justice. Les autorités fédérales suisses avancent un taux de transmission à la justice de 69 % des communications reçues par le MROS, soit 256 affaires, pour considérer que leur système est suffisamment performant. Il faut cependant faire observer que dans la mesure où le Bureau de communication reçoit 35 % d'annonces déclenchées par des informations relatées dans la presse, il est logique dans cette hypothèse que le MROS transmette à la justice les éléments dont il dispose sur des affaires qui sont déjà très vraisemblablement entre les mains des juges et qui constitueront dès lors pour ces derniers des informations complémentaires. Enfin, la faiblesse des sanctions ou le faible risque qu'elles soient prononcées ne saurait constituer une menace incitative pour les banques. La violation de l'obligation de communiquer est assortie d'une amende maximum de 200 000 FS soit environ 800 000 francs français (article 37 de la LBA) ; il est douteux que ce soit là un montant réellement dissuasif pour une banque en Suisse. Par ailleurs l'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales d'origine criminelle n'est pas punissable. Cette attitude peut néanmoins contrevenir aux dispositions de la législation relative aux banques qui exige une activité irréprochable. B.- DES OBLIGATIONS DE DILIGENCE À RENFORCER Les obligations de diligence applicables aux intermédiaires financiers qui sont contenues dans la loi LBA de 1997 sont concrétisées par la convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) passée entre l'Association suisse des banquiers (ASB) et les banques membres, dont la dernière version date du 28 janvier 1998. Cette convention rappelle que les banques s'obligent envers l'ASB, chargée de la sauvegarde des intérêts et de la réputation de la banque en Suisse, et s'engagent à vérifier l'identité de leurs cocontractants et à se faire remettre, en cas de doute, une déclaration du cocontractant relative à l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales confiées à la banque (article 1). Les procédures de vérification de l'identité du cocontractant n'appellent pas d'observations particulières si ce n'est le fait que le seuil à partir duquel une opération de caisse rend obligatoire les procédures de diligence reste très élevé puisqu'il est fixé à 25 000 francs suisses, soit environ 100 000 francs français. La CDB a mis en place un mécanisme fondé sur la présomption que le cocontractant est l'ayant droit économique en précisant que cette présomption « est détruite » en cas de « constatations insolites ». La Convention prévoit par ailleurs un certain nombre d'exceptions à la nécessité de procéder à l'identification des ayants droit économiques. 1.- Les limites à l'identification de l'ayant droit économique a) Le titulaire du compte bancaire est présumé en être le bénéficiaire La convention des banques (CDB) traite de la vérification de l'identité du cocontractant (article 2) et de l'identification de l'ayant droit économique (article 3), effectuée par le cocontractant qui « s'engage à communiquer spontanément les modifications à la banque ». A la différence de la vérification de l'identité du cocontractant qui repose sur la production d'un document officiel (passeport, permis de conduire ou d'un extrait du registre du commerce, lorsque le cocontractant est une personne morale), l'identification de l'ayant droit économique se fonde sur le principe de la déclaration faite par le cocontractant. Il s'agit alors pour le banquier de s'assurer de la plausibilité des dires du cocontractant. La banque peut présumer que le cocontractant est également l'ayant droit économique (article 3, point 22 de la CDB). Mais cette présomption est détruite « lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si le cocontractant est lui-même l'ayant droit économique ». Dans ce cas, il y a pour le banquier obligation d'identifier l'ayant droit économique. Ainsi, il y a doute : - lors de la remise d'une procuration à une personne qui, manifestement, n'a pas de liens étroits avec le cocontractant ; - lorsqu'il y a une disproportion entre l'opération demandée et le montant des avoirs figurant sur le compte, - de façon plus générale, il y a doute « lorsque, dans le cadre de ses relations avec le client, la banque est amenée à faire d'autres constatations insolites ». Plutôt que de s'interroger sur l'insolite et l'existence d'un doute, notions très subjectives, il paraîtrait raisonnable d'adopter un système plus rationnel et de s'engager dans la voie de l'identification systématique de l'ayant droit dès lors que serait constaté par le banquier l'existence d'un ou plusieurs éléments objectifs préalablement définis tels que la présence d'une structure garantissant l'anonymat ou la domiciliation de l'ayant droit dans un territoire non coopératif. Réunis à Luxembourg, le 17 octobre 2000, en Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures (JAI), les ministres des quinze pays membres de l'Union européenne ont réaffirmé leur volonté politique de faire de la lutte anti-blanchiment une priorité absolue. Les pressions à l'encontre des territoires non coopératifs et la lutte contre tous les mécanismes juridiques garantissant l'anonymat des détenteurs de fonds ont fait l'objet d'engagements précis.
Le Conseil considère qu'un an après la publication de la première liste du GAFI sur les pays et territoires non coopératifs, il conviendra d'apprécier, au sein du GAFI, les contre-mesures appropriées à prendre au cas où un pays ou un territoire non coopératif ne réagirait pas de façon adéquate en procédant aux réformes nécessaires. Les Etats membres, réunis au sein du Conseil, s'engagent à mettre en _uvre de concert, concomitamment et sans délai les contre-mesures qui auront été décidées par le GAFI et à l'adoption desquelles l'Union européenne contribuera de manière active. Il s'agit de l'obligation pour les institutions financières de rendre compte systématiquement à l'Unité de renseignement compétente de leurs opérations financières avec le pays ou territoire concerné ; l'interdiction aux personnes physiques et morales établies ou enregistrées dans ce pays ou territoire non coopératif d'ouvrir un compte dans un organisme financier de l'Union, si elles ne fournissent pas de document valable permettant l'identification du titulaire ou bénéficiaire du compte ; enfin, dans les cas les plus graves, la mise sous conditions ou restriction des transactions financières avec ce pays ou territoire non coopératif. A cet effet, les Etats membres adapteront, le cas échéant, leurs législations internes. Les Etats membres se concerteront entre eux et avec la Commission dans le cadre de ses compétences, pour assurer le suivi de la mise en _uvre de ces mesures. Le Conseil a pris note avec un grand intérêt du document présenté par la Commission sur l'état des législations nationales applicables dans l'Union en matière de structures à vocation économique ou patrimoniale. Conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, il invite la Commission à approfondir ses travaux à ce sujet en vue d'identifier, avant juin 2001, les mesures susceptibles de résoudre les difficultés, largement reconnues à l'échelle internationale, posées par les sociétés - écrans et autres entités juridiques opaques dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Conseil invite la Commission à lui présenter un rapport complémentaire, dans lequel serait plus particulièrement examinée l'éventualité d'établir des critères minimaux de transparence des divers types d'entités juridiques (notamment les fiducies, trusts et fondations), afin de se donner les moyens de mieux identifier les ayants droit économiques. Extraits des conclusions du Conseil européen justice affaires intérieures (JAI) du 17 octobre 2000. L'identification, lorsqu'elle est effectuée, doit être « établie avec le soin approprié aux circonstances » (article 3, point 22 de la CDB). Cette formulation laisse la porte ouverte à de très larges interprétations, notamment lorsqu'il s'agira d'apprécier s'il y a eu ou non manquement de la part de la banque ou si elle a correctement procédé à ses obligations de diligence. Aucune précision n'est apportée par la convention sur les cas dans lesquels cette identification devrait s'effectuer de manière plus approfondie. L'obligation d'identification de l'ayant droit s'applique notamment à l'ouverture du compte, à l'ouverture de dépôts, à la conclusion d'opérations fiduciaires ou à l'acceptation de mandats de gestion de fortune sur les avoirs déposés auprès de tiers. L'article 15, point 3, de la CDB précise que les nouvelles règles relatives à la vérification de l'identification de l'ayant droit économique doivent être appliquées « aux nouvelles relations d'affaires établies après l'entrée en vigueur de la présente convention - soit le 1° juillet 1998 - ou lorsque la procédure d'identification de l'ayant droit économique doit être répétée... Les nouvelles dispositions s'appliquent aux relations d'affaires déjà existantes lorsqu'elles constituent un allégement par rapport aux anciennes règles ». Il est précisé que la procédure de l'identification de l'ayant droit économique doit être renouvelée lorsque « dans le courant de la relation d'affaires un doute survient : - au sujet de l'exactitude des indications données sur l'identité du cocontractant, - sur le point de savoir si le cocontractant est lui-même l'ayant droit ; - sur le point de savoir si la déclaration remise au sujet de l'ayant droit économique est conforme à la réalité ; - lorsque des indices de modifications survenues a posteriori existent » (article 6 de la CDB) En dépit de l'énoncé de ces différents cas qui exigent de procéder à l'identification de l'ayant droit, l'article 15 précité de la CDB pose le problème de la régularisation, et de la mise à niveau des dossiers documentaires des comptes bancaires ouverts avant le 1° juillet 1998. Rien n'est prévu pour que soit systématiquement entreprise la mise en conformité à une échéance relativement rapprochée de deux ou trois ans, de tous les comptes ouverts en Suisse avant cette date. Ce n'est qu'à l'occasion de la survenance d'un doute que la procédure de l'identification de l'ayant droit économique devra être engagée pour les relations d'affaires intervenues antérieurement au 1° juillet 1998. En conséquence, à l'heure actuelle l'écrasante majorité des milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse peuvent avoir des ayants droits économiques non identifiés par les banquiers, et ce en toute légalité. Peut-on, dans ces conditions, estimer que les banquiers suisses répondent pleinement à l'obligation qui leur est faite de connaître leurs clients ? Il est permis d'en douter lourdement. Quelles que soient les circonstances, qu'il s'agisse de l'entrée en relation d'affaires ou de l'exécution de cette relation, c'est toujours au cocontractant qu'il appartient de faire une déclaration identifiant l'ayant droit à partir d'un formulaire type appelé formulaire A. Tout repose donc, toujours in fine, sur la qualité du cocontractant. Ledit formulaire A se présente sous la forme d'une fiche des plus ordinaires. Le cocontractant déclare s'il est ou non l'ayant droit économique. S'il ne l'est pas, il se borne à indiquer le nom, prénom ou raison sociale économique ainsi que l'adresse - celle du siège pour les personnes morales - de l'ayant droit. Aucun renseignement n'est exigé permettant d'identifier plus précisément les sociétés ayants droit tel qu'un numéro d'enregistrement au registre des sociétés ou le nom des administrateurs et de ses dirigeants. Enfin, la mention figurant au bas de ce formulaire par laquelle « le cocontractant s'engage à communiquer spontanément les modifications à la banque » apparaît comme une simple clause de style. Le banquier est toutefois tenu « si des doutes sérieux persistent quant à l'exactitude de la déclaration écrite du cocontractant » de refuser d'entrer en relations d'affaires ou de s'abstenir d'exécuter l'opération demandée. Cette conséquence apparaît totalement inappropriée. En effet, à ce stade de la procédure, que la relation d'affaires ait ou non été engagée, il existe par définition un doute sérieux portant sur des éléments essentiels - sincérité des informations, caractère insolite des opérations demandées, etc. - le banquier devrait alors faire automatiquement une annonce au Bureau de communication. Le seul fait de refuser la relation d'affaires ou l'exécution de l'opération demandée paraît notoirement insuffisant. Il faudrait en effet considérer que, dans une telle circonstance, le doute sérieux est très proche du soupçon fondé de l'origine criminelle des fonds qui sont ou seront déposés sur le compte bancaire. Se contenter de refuser la relation d'affaires revient à reporter la difficulté sur un autre établissement bancaire, au risque éventuellement de faire craquer la chaîne et de permettre l'introduction dans le circuit de fonds criminels. b) Un principe qui souffre d'un trop grand nombre d'exceptions L'identification de l'ayant droit économique n'est de surcroît pas systématiquement exigée. Cette obligation connaît de multiples exceptions. Elle n'est ainsi pas nécessaire dans certains types d'opérations de placement. « Dans les formes de placement collectif à l'étranger qui regroupent plus de 20 ayants droit économiques en qualité d'investisseurs, les indications prescrites... [identification] ne sont exigées que pour les ayants droit économiques qui, seuls ou de concert, détiennent au moins 5 % de valeurs patrimoniales déposées ». Cette disposition fait référence à la souscription de valeurs de placement de type SICAV. Ce genre d'opération peut être faite en Suisse directement au guichet de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un compte. Lorsque l'achat ne dépasse pas le pourcentage indiqué, l'identification n'est pas exigée. Pour se prémunir contre le risque de blanchiment par l'utilisation de cette disposition, il faudrait, dans ce cas, obliger l'acheteur à ouvrir un compte, ce qui déclencherait les diligences prévues par la convention de diligence des banques et la LBA. De plus, cette disposition peut aisément permettre à des membres de réseaux criminels organisés, au moyen de ce fractionnement, d'échapper légalement à toute identification. Par ailleurs, aucune déclaration sur l'identification de l'ayant droit économique n'est exigée des personnes morales et des sociétés dont le siège est en Suisse, qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres par une action commune ou qui poursuivent essentiellement des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques ou de bienfaisance. Cette exception ne s'applique pas lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si les buts statutaires sont effectivement poursuivis (article 3, point 31 de la CDB). On retrouve ici l'application du raisonnement général consistant à dire que la société est présumée agir conformément à ses buts déclarés et qu'il n'y a pas lieu d'identifier l'ayant droit à moins qu'il n'y ait un doute. Cette disposition pose à l'évidence le problème des sectes ou de toute autre organisation criminelle qui dissimulerait ses activités véritables sous couvert d'actions philanthropiques. En effet, le mécanisme permet ici de fonctionner dans une opacité totale puisque toutes les opérations effectuées, par exemple sur le compte d'une société religieuse ou de bienfaisance, ne feront l'objet d'aucune procédure d'identification de l'ayant droit tant que les opérations paraissent respecter les buts statutaires déclarés. Lorsqu'une fondation déclare _uvrer pour le bien-être de l'humanité ou la paix dans le monde, il lui est facile d'entreprendre toutes sortes d'opérations financières sans que l'on puisse s'assurer que l'on reste bien dans le cadre des statuts et des objectifs poursuivis. Cette question des fondations pose de sérieuses difficultés si l'on veut réussir à identifier l'ayant droit économique réel. L'obligation d'identification des ayants droit d'une société dont le siège est en Suisse devrait en conséquence s'appliquer sans exception et sans considération de l'objet social. Les banques doivent pouvoir identifier le premier bénéficiaire M. Paul PERRAUDIN : Vous parlez des fondations. M. le président : Dans vos enquêtes, est-ce un véritable souci ? M. Paul PERRAUDIN : C'est un véritable souci. Dans certaines structures juridiques, on voit que les propriétaires économiques des fonds sont complètement déconnectés de la structure juridique mise en place. On doit considérer que suivant l'exigence d'identification, le bénéficiaire économique, tel que l'on comprend cette notion, est celui qui a la maîtrise effective des fonds, le propriétaire des fonds. Dans nos investigations en Suisse, en visant les structures juridiques du genre fondation, on comprend que les banques, dans l'exigence d'identification suisse, doivent pouvoir identifier le premier bénéficiaire, que l'on considère comme l'ayant droit. Quelle que soit la structure juridique mise en place, l'obligation d'identification est réelle et non pas formelle. Cela procède d'une notion économique de la maîtrise des fonds. On doit pouvoir se dire que quelle que soit la structure juridique mise en place pour dissimuler l'ayant droit à l'égard de tiers, l'exigence d'identification doit être suffisamment forte pour que l'on ait trace de cette personne. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Paul Perraudin Juge d'instruction à Genève, en septembre 1999 Enfin, aucune déclaration relative à l'ayant droit économique n'est exigée des banques (article 3, point 30.1 de la CDB), c'est-à-dire des établissements financiers agréés désignés comme tels. Cette dispense est de type classique. En application du principe d'équivalence, une banque considère qu'elle dispose d'un « interlocuteur fiable » qui a correctement procédé aux identifications nécessaires, lorsqu'elle traite avec une autre banque à moins que la Commission fédérale des banques n'ait fait connaître ses doutes sur certains établissements venant de pays déterminés. Cette approche a été confirmée à la Mission par les représentants des autorités fédérales suisses : elles reconnaissent les défaillances du système.
M. Ricardo SANSONETTI : « Notre approche, comme celle de la plupart des législations anti-blanchiment, tend à prévoir une identification à l'entrée dans le système financier. Dans le cadre des transactions internationales, la question pratique la plus importante est de savoir si tel pays possède une réglementation d'un niveau suffisant. Nous considérons dans nos textes que les pays de l'espace GAFI, c'est-à-dire ceux dont la réglementation a été testée concrètement par cet organisme, sont dotés d'une réglementation à niveau. Par conséquent, si une institution financière surveillée en France entre en contact avec une institution surveillée en Suisse, on peut se reposer sur son identification. En revanche, comment réagir si l'institution financière est basée à Gibraltar ou aux Seychelles ? » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Ricardo Sansonetti, Chef suppléant de la section marchés financiers, septembre 1999. Les banquiers, eux aussi, admettent implicitement ces défaillances. Connaissez-vous votre client ? M. Michel Y. DEROBERT : Un article paru dans The Economist m'a beaucoup choqué. Il relate l'histoire d'un client russe, apparemment très connu, qui voulait ouvrir un compte en Angleterre. Comme le banquier anglais était réticent, le client russe a menacé de lui jeter en cendrier dans la figure. Celui-ci a avoué : « Comme cela devenait dangereux, je lui ai trouvé une banque en Suisse ; Cette phrase témoigne d'un cynisme inouï car selon nos règles une banque qui prend un client s'appuie sur les recommandations des gens respectables. Or il n'a pas dit : « Je suis avec le plus grand filou de toutes les Russies, est-ce que vous voudriez bien le prendre" » mais il a dû dire : « Je vous recommande un très bon ami ». Si l'histoire est vraie, c'est scandaleux, si elle est fausse, c'est de la calomnie... M. Jacky DARNE : Quand on a défini des normes, quand on a mis en place des procédures, on peut réussir à les respecter dans une, deux, voire cinq banques. Comment être assuré d'une qualité identique de mise en _uvre des procédures dans une quinzaine d'établissements très divers ? N'y a-t-il pas des maillons faibles dans la chaîne ? Cela ne justifie-t-il pas qu'un magazine puisse écrire que l'on peut trouver en Suisse une petite banque dont la façon de travailler fera accepter un tel client? M. Michel Y. DEROBERT : Ce qu'il y a de scandaleux, c'est qu'un banquier respectable ait recommandé un client dont il ne voulait pas à un autre banquier respectable. M. le président : Sous la pression d'un cendrier ! Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Michel Y. Dérobert, Secrétaire général de l'Association des banquiers suisses, septembre 1999 Ce même principe d'équivalence est également applicable aux intermédiaires financiers suisses ou étrangers « qui sont assujettis à une surveillance appropriée ainsi qu'à une réglementation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent » (article 3, point 30.2 de la CDB). c) Le problème des comptes de sociétés domiciliées offshore L'identification de l'ayant droit économique constitue à l'évidence pour les banques un travail fondamental de vigilance et de suivi. Cette tâche qui découle du principe traditionnel de la connaissance de ses clients par le banquier est devenue plus complexe à réaliser dès lors que se sont multipliés les mécanismes d'intermédiation et de gestion des comptes par des tiers. Progressivement, les banquiers ont accepté de se couper de leurs clients bénéficiaires réels du compte en se satisfaisant des dires du représentant dudit client. Ainsi, le système aboutit à rendre les banques dépendantes de la déclaration du cocontractant. Les ayants droit économiques sont identifiés mais ne sont pas directement connus des institutions financières. Ce point est particulièrement préoccupant pour les comptes de sociétés domiciliées dans ce qu'il est convenu d'appeler les paradis fiscaux ou les centres offshore. Sur ce point, les réflexions et les constatations du professeur Paolo Bernasconi sont tout à fait significatives et illustrent parfaitement l'usage criminel détourné qui peut être fait de ces mécanismes juridiques. Je n'ai jamais connu un seul cas important de blanchiment Professeur Paolo BERNASCONI : Le dernier point sur lequel la Commission s'est interrogée est le suivant : quelle est l'attitude que l'intermédiaire financier bancaire et non bancaire doit avoir à l'égard des sociétés de siège offshore ? Le degré de diligence à l'égard de l'argent déposé sur le compte ouvert au nom d'une société offshore doit-il être plus élevé du fait que le pays offshore concerné figure sur la liste noire ? C'est un pas très important à franchir. Ce terrain est actuellement sondé. Dans le cadre des cours obligatoires donnés aux intermédiaires financiers ou des séminaires pour les banquiers, je pose cette question que je ne posais pas il y a dix ans : le fait d'ouvrir un compte au nom d'une société offshore est-il suspect ? Non car 90 % des sociétés offshore qui ouvrent des comptes en Suisse le font pour des raisons de fraude fiscale, les 5 ou 10 % (qui sait ?) restants pour des raisons criminelles. Toutefois, sur la base de mon expérience judiciaire en trente ans d'activités en tant que magistrat et, après, comme avocat, je n'ai jamais connu un seul cas important de blanchiment, d'escroquerie ou de criminalité économique organisée dans lequel n'intervenait pas une société de siège offshore. Il y en a toujours une, c'est le mécanisme typique. Néanmoins, on ne peut pas en conclure qu'il faut criminaliser toutes les sociétés offshore. C'est bien là la difficulté. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. le Professeur Paolo Bernasconi, en septembre 2000 L'actualité récente ne fait que confirmer cet usage fort commode et à des fins détournées de blanchiment, des sociétés offshore représentées par des intermédiaires financiers auxquels les banques suisses continuent d'accorder leur confiance. Le géant de l'armement russe alimentait les comptes du Qui alimentait les caisses noires suisses du maître espion péruvien Vladimiro Montesinos, dit « El Doc » ou « Raspoutine », âme damnée désormais en fuite de l'ancien président Alberto Fujimori ? Et comment ont été ouverts ses comptes en banque à Zürich et Lugano, qui contenaient 70 millions de dollars (près de 120 millions de francs suisses), lors de leur blocage en octobre dernier ? Selon les informations très détaillées publiées il y a quelques jours par le journal El Comercio et le magazine Caretas, deux intermédiaires, Rony L. et Ilan L., un Péruvien d'origine israélienne qui serait actif dans le trafic d'armes, auraient ouvert deux comptes de transit dans des banques israéliennes de Zürich, la Leumi et la Fibi. Plus de 17 millions de dollars seraient ensuite parvenus sur un compte de la banque Leumi appartenant à Maria Trinidad Becerra, la femme de Vladimiro Montesinos. Ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés offshore des Bahamas, Ruggel Trading, Hawkeye Management ou encore Lenwick Trading. Une partie de l'argent a ensuite été transférée dans d'autres banques, notamment Adamas à Lugano et Leu à Zürich. Selon El Comercio, les établissements qui ont alimenté ce système sophistiqué de comptes secrets sont notamment la Novaya Moskva Bank, la Bank for Foreign Economic Affairs de Moscou et les filiales de UBS à Luxembourg, Lugano et Zürich. Avocat zürichois : « Vladimiro Montesinos, qui a réussi à s'attacher les services d'un avocat zurichois malgré sa cavale, prétend que l'argent déposé en Suisse vient des sociétés de pêche appartenant à sa famille. Mais les versements découverts par la justice helvétique au cours de son enquête racontent une autre histoire. Certains émanent d'une entreprise parfaitement connue des marchands d'armes du monde entier : la Rosvooruzhenie, qui exporte quelque 90 % des armes fabriquées en Russie. Cette société d'Etat a déboursé les 17 millions de dollars retrouvés sur les comptes de Maria Trinidad Becerra. Ce versement serait lié à la livraison, en 1998, de trois intercepteurs MIG-29 à l'armée de l'air péruvienne, pour un montant total de 117 millions de dollars. A la suite de cette commande très contestée, le gouvernement russe avait affirmé que la transaction s'était déroulée de façon parfaitement transparente et légale ». Du côté suisse, les informations très précises dévoilées par la presse péruvienne provoquent de sérieux grincements de dents. Selon une source proche du dossier, la juge d'instruction zurichoise Cornelia Cova - qui n'a pas souhaité faire de commentaire sur le déroulement de ses recherches - serait furieuse de voir que le résultat de ses investigations a été livré au public. « Ces révélations, estime notre interlocuteur, ne sont pas dans l'intérêt de l'enquête. » Un secret reste cependant bien gardé, l'identité de l'avocat zurichois qui a aidé la femme de Vladimiro Montesinos et les deux intermédiaires péruviens à constituer leur galaxie de sociétés écrans et à ouvrir leurs comptes en banque. Source :Le Temps du 13 décembre 2000, article de M. Sylvain Besson. Ces sociétés domiciliées offshore dans des territoires tels que les Iles Caïmans, les Iles Vierges britanniques ou les Bahamas, etc., délèguent à un tiers ayant la qualité d'intermédiaire financier (mandataire de fortune, avocat, notaire, société fiduciaire, etc.) et qui se trouve en Suisse, le pouvoir de représenter ladite société offshore et d'accomplir toute opération commerciale ou industrielle de type classique. Pour ce faire, ce représentant de la société offshore ouvre des comptes en banques et bénéficie des services habituellement offerts par la banque à ses clients. En tant que cocontractant de la banque, il doit théoriquement être en mesure de fournir les éléments d'identification de l'ayant droit économique qu'il représente, c'est-à-dire la société offshore. En tant qu'intermédiaire financier, la loi LBA lui est applicable et il devra en principe effectuer les procédures de diligence pour connaître son client. La banque peut-elle, dans ce contexte juridique complexe, considérer que l'identification de l'ayant droit a été entreprise de manière fiable par l'intermédiaire financier ? La banque s'en remet à l'intermédiaire financier mais ce dernier aura-t-il toujours rempli ses obligations ? Un avocat suisse accepte-t-il un poste d'administrateur Me Didier de MONTMOLLIN : Vous me direz qu'il y a des administrateurs de sociétés offshore. Toutefois, un avocat qui accomplit son travail avec diligence et discernement, n'accepte pas, sans auparavant avoir acquis une certitude suffisante quant à la qualité de la relation, un poste d'administrateur dans une société étrangère offshore. Ce serait aller vite en besogne que de dire que le seul fait d'accepter un tel poste suffit à dénoter un comportement manquant d'éthique ou pire que cela de la part de l'administrateur. [...] Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'a priori négatif quant à la participation d'un citoyen suisse, français ou autrichien à un tel conseil. Extrait de l'entretien de la Mission avec Me Didier de Montmollin, avocat au Barreau de Genève, en septembre 2000 Il ne serait cependant pas inutile pour un banquier de s'enquérir systématiquement auprès de chacun de ses clients administrateurs de sociétés offshore du nombre total de mandats d'administrateurs détenus par chacun d'eux. Au-delà d'un certain nombre de mandats, que la banque pourrait définir, on peut raisonnablement estimer qu'un administrateur de sociétés n'est pas en mesure d'assumer convenablement sa responsabilité d'administrateur de sociétés et ne saurait constituer pour la banque un cocontractant fiable et acceptable. « L'existence de la loi est une chose, M. le président : Comme nous ne sommes pas des spécialistes du droit des affaires, pourriez-vous nous décrire les montages juridiques qui peuvent être opérés. Si j'ai bien compris, il s'agit de sociétés offshore ? M. Bernard BERTOSSA : Il y a des sociétés offshore qui, comme leur nom l'indique, sont actives en dehors du rivage. Ce sont des sociétés panaméennes, des îles Caïmans, des îles Vierges britanniques, etc., qui ont une existence purement formelle dans un registre tout aussi formel du paradis fiscal considéré. Leur administration est composée de professionnels sur place qui délèguent le pouvoir de représenter la société ici à un tiers : avocat, fiduciaire ou autre. M. le président : Ressortissant suisse ? M. Bernard BERTOSSA : Pas nécessairement, ce peut être un ressortissant français, allemand ou anglais. L'exercice n'est pas contrôlé à ce jour. Il pourra donc, au nom de la société, accomplir tous les actes de la vie commerciale et industrielle habituelle. Aussi longtemps qu'il n'aura pas besoin d'une autorisation spécifique pour développer telle ou telle activité, il pourra la développer librement. Il pourra donc notamment ouvrir des comptes en banque, faire passer des ordres en Bourse, obtenir toutes les prestations qu'une banque peut fournir à ses clients. Il pourra investir dans des sociétés suisses par l'intermédiaire de fiduciaires ou par le rachat d'actions à des actionnaires existants, ces opérations n'étant pas soumises à contrôle, etc. M. le président : Les avocats que nous avons rencontrés disent que cela n'est pas possible. Ils disent que se trouvant dans le champ de la LBA, ils ont le devoir de connaître non seulement leurs cocontractants mais aussi les ayants droit économiques. Et s'ils ne connaissent pas les ayants droit économiques, disent-ils, dans le cas où il y aurait infractions et poursuites, ils sont responsables. Ils disent qu'ils n'agissent plus ainsi car ils peuvent être pénalement attaqués. Cela voudrait dire qu'il y a la loi et d'autres pratiques. M. Bernard BERTOSSA : Si la loi était respectée, vous ne seriez sans doute pas ici et moi non plus. Le problème, c'est que dans un processus de blanchiment, à un certain moment, il doit bien y avoir une complicité de la part d'un intermédiaire financier en place. C'est d'ailleurs le point vulnérable des organisations criminelles. C'est le moment où elles doivent entrer leurs profits criminels dans le réseau d'apparence honnête. Ce passage-là peut être plus ou moins subtil, plus ou moins camouflé, mais il y aura toujours un moment où quelqu'un aurait dû se poser des questions et ne se les est pas posées. L'existence de la loi est une chose, sa mise en _uvre en est une autre. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Bernard Bertossa, Procureur Général du canton de Genève, en septembre 1999 L'identification de l'ayant droit économique constitue une étape essentielle de la lutte anti-blanchiment. En Suisse, cette procédure s'accompagne de trop d'exceptions. Elle repose par ailleurs sur la déclaration du cocontractant, ce qui en fait son point faible. Ce principe permet encore trop facilement aux blanchisseurs d'opérer sans craindre d'être inquiétés. La proposition à la fois simple et radicale suggérée par le professeur Paolo Bernasconi mérite d'être considérée avec attention. Il s'agit d'exiger à l'ouverture du compte la présence de l'ayant droit aux côtés du cocontractant : Après dix ans, le système d'identification de l'ayant droit ne fonctionne pas en Suisse et dans les pays du GAFI M. Paolo BERNASCONI : « Il faut maintenant accepter de sauter le pas suivant. La banque ne peut accepter la déclaration du client concernant l'identité de l'ayant droit économique que seulement en présence de l'ayant droit économique. C'est très lourd sur le plan bureaucratique et organisationnel. Sans vouloir suggérer qu'en Suisse et dans les pays du GAFI, le système ne fonctionne pas après dix ans, il n'en demeure pas moins que trop de personnes encore peuvent profiter de cette lacune qui doit être comblée. Il suffirait d'étendre à la signature de l'ayant droit économique le système en vigueur pour la récolte de la signature des procureurs du titulaire du compte bancaire avec enregistrement centralisé comme en Suisse d'après la circulaire de l'ASB en vigueur depuis le 1er juillet 2000 » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. le Professeur Paolo Bernasconi, en septembre 2000 L'Association suisse des banquiers est en effet intervenue par une Recommandation n° 1421 D du 4 février 1999. Ce texte rappelle que la Commission fédérale des banques attend des intermédiaires financiers qu'ils soient en mesure de déterminer, dans un délai raisonnable, si une personne est ayant droit économique. Par ailleurs, la Recommandation précise l'obligation de déterminer si une personne est ou non bénéficiaire d'une procuration. Pour cela, il est prévu la création d'un registre central des autorisations de signer et des procurations. Par analogie, on pourrait donc prévoir la création d'un registre central des signatures des ayants droit économiques. En présence de l'ayant droit produisant des documents officiels et d'une personnalité qualifiée de la banque, la signature serait enregistrée. Le registre central des signatures des ayants droit économiques contiendrait toutes les données d'identification de ces derniers et les documents attestant de leur réalité (nom, adresse, au besoin statuts de la société, composition du conseil d'administration, etc.) En s'inspirant des règles établies pour le registre central des procurations, on pourrait considérer que les informations du registre des ayants droit économiques continueraient de figurer au registre central dix ans après la perte de la qualité d'ayant droit économique qui devrait, elle aussi, être enregistrée. La gestion de ce registre pourrait relever, dans les structures des banques, de leur « secrétariat-client » chargé déjà de tenir la documentation juridique relative aux cocontractants. 2.- Des procédures de clarification qui n'empêchent pas le dépôt de fonds d'origine douteuse a) Des obligations théoriquement contraignantes Le moment délicat pour un banquier se situe à l'ouverture du compte lorsqu'il va créer avec son client cette fameuse relation d'affaires et exercer ses obligations de diligence. A ce stade, outre les éléments d'identification qui sont exigés, le banquier va s'enquérir du profil du compte c'est-à-dire de l'usage que le client lui déclare vouloir en faire et des sommes qui sont amenées à s'y trouver (gestion de fortune, placements à risques, compte commercial, etc.). Ces informations doivent alimenter la documentation bancaire et permettre par la suite au banquier de s'assurer que les mouvements observés sur ce compte sont conformes à l'usage qui a été déclaré. Dans ce cadre, la LBA prévoit notamment l'obligation pour la banque de « clarifier l'arrière-plan économique » lorsque la transaction lui paraît inhabituelle ou lorsque des indices laissent supposer que les fonds proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce sur eux un pouvoir de disposition. La banque doit notamment procéder à une clarification lorsque le montant de la transaction ou le nombre des transactions apparaissent anormalement élevées par rapport à l'activité ou aux revenus déclarés du client. Il appartient dans ce cas à chaque banque de fixer elle-même les normes à partir desquelles cette clarification est entreprise. La clarification devient obligatoire lorsque le banquier constate l'existence d'indices de blanchiment des capitaux. La présence d'un seul indice appartenant à la catégorie des indices qualifiés suffit à déclencher la procédure de clarification. La liste de ces indices est établie par la circulaire n° 98-1 de la Commission fédérale des banques. Chaque banque est tenue, au regard de la LBA, de se doter d'une structure interne spécifique qui édicte des instructions en vue de la prévention et de la lutte anti-blanchiment. Il appartient par conséquent à chaque établissement d'organiser sa propre surveillance interne sur les mouvements des comptes bancaires de ses clients. La surveillance des comptes, pour être efficace, doit s'effectuer avec l'aide d'outils informatiques qui permettent de repérer tout mouvement excessif ou inhabituel sur un compte. Les dirigeants de la banque Paribas Suisse rencontrés par la Mission ont apporté les précisions suivantes sur cet aspect : Nous avons développé des procédures informatiques M. Pierre-Yves DESPLAND : Il existe d'autres opérations sensibles : transferts internationaux sans indication complète de l'expéditeur ou du bénéficiaire, opérations en suspens et comptes dont le fonctionnement est différent de celui prévu à l'origine. De nombreuses entrées et sorties sur un compte en gestion patrimoniale est inhabituel sur ce genre de compte. Il est alors soumis à une analyse particulière et à une appréciation pour connaître les tenants et les aboutissants des opérations réalisées, déterminer la finalité du compte, le profil du client ordonnateur, la justification des opérations, et décider s'il est souhaitable de maintenir la relation. M. François de RANCOURT : On peut aussi effectuer des contrôles a posteriori par informatique pour examiner les mouvements. M. Pierre-Yves DESPLAND : Autant la procédure d'ouverture d'un compte se déroule entre personnes bien pensantes, autant toutes les analyses relatives aux mouvements de comptes doivent faire appel à l'utilisation exhaustive des outils informatiques permettant de faire des rapprochements. Nous avons développé, là aussi, des procédures informatiques pour détecter les comportements anormaux, les opérations particulières et d'autres éléments. Il s'agit, sur une masse de transactions très importante, de faire ressortir celles qui ont un comportement particulier ou anormal et de procéder à des analyses permettant de comprendre ces opérations, de déterminer dans quelle mesure elles sont justifiées, de les mettre en relation avec le client concerné, etc. [...] M. le Rapporteur : [...] La directive publiée par la Commission fédérale des banques dresse une liste d'indices de blanchiment de capitaux. L'un d'entre eux, le dix-septième - « retraits fréquents de gros montants en espèces sans que l'activité du client ne justifie de telles opérations » - m'est venu à l'esprit en vous écoutant. Comment interprétez-vous cet indice ? A partir de quand considérez-vous que l'activité du client ne justifie plus de telles opérations ? Pouvez-vous nous donner des illustrations concrètes ? Vous êtes-vous vous-mêmes fixé une ligne interprétative pour chacun de ces indices ? Avez-vous discuté de la pertinence de ces interprétations avec la Commission fédérale des banques ? [...] M. Pierre-Yves DESPLAND : Nous avons mentionné plusieurs éléments, dont la connaissance intime du client. Sur ce point, je vous rassure : nous nous remettons toujours en question, nous ne sommes pas dans un système figé, car les blanchisseurs évoluent et inventent de nouvelles techniques. Nous avons évolué dans le détail de l'information que nous exigeons sur le client, notamment son environnement familial et professionnel. Nous l'avons consigné assez précisément. Lorsque nous relevons une transaction importante pouvant révéler un comportement anormal, nous la mettons en relation avec les informations dont nous disposons sur l'activité du client, son contexte professionnel, afin de déterminer sa plausibilité avec la motivation qui est donnée. Si nous avons encore des doutes, nous engageons la conversation avec le gestionnaire responsable du compte en lui disant : connaissez-vous vraiment bien votre client ? Avant de procéder à une déclaration, nous devons avoir acquis le sentiment que ces opérations constituent un indice fondé. De nombreuses analyses préalables et opérations de détections sont effectuées au fil des jours. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Pierre-Yves Despland, Directeur de la déontologie à Paribas Suisse S.A., en septembre 1999 La procédure de clarification d'une transaction inhabituelle, en raison de son montant, de sa provenance géographique ou de sa nature (versement en cash) n'entraînera pas automatiquement une annonce au Bureau de communication qui reste liée à l'existence d'un soupçon fondé. La procédure de clarification ne permet pas non plus, lorsqu'une opération est réalisée par une personne bénéficiant du secret professionnel, de s'assurer que toutes les obligations de diligence ont été correctement effectuées. Le problème se pose notamment en matière commerciale dans le cadre d'opérations d'augmentation de capital comme l'ont très clairement exposé à la Mission M. Niklaus Huber, Chef de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et Mme Dina Balleyguier, responsable du service juridique de la Commission fédérale des banques.
M. Niklaus HUBER, Chef de l'Autorité de contrôle : (...) Le vrai problème aujourd'hui dans l'industrie du monde occidental réside dans ce domaine, car personne ne demande d'où vient cet argent. De nombreuses sociétés confrontées à des problèmes financiers augmentent leur capital. On met en avant un homme de paille puissant alors que l'argent vient d'ailleurs. C'est un réel danger car ensuite, les sociétés industrielles sont infiltrées, on ne sait plus qui les dirige. Des sommes énormes en provenance de ce pays du tiers-monde sont ainsi investies dans des sociétés en Europe et aux Etats-Unis sans que personne ne sachent qui se cachent derrière les hommes de paille ou les écrans. M. le président : Quels moyens relevant du droit peut-on utiliser pour lutter contre ces pratiques ? M. Niklaus HUBER : Pour des raisons commerciales, de compétition ou de concurrence, la plupart des pays d'Europe ont exclu l'identification dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Si vous déposez dans une banque de l'argent destiné à réaliser une augmentation de capital, aucune vérification n'est effectuée. Cela tient à des raisons commerciales. Comme on veut attirer les sociétés industrielles et les capitaux, on ne pose pas de questions [...]. Les notaires disent toujours que c'est aux banques de vérifier, mais celles-ci ne vérifient pas la provenance des capitaux déposés dans le cadre de la fondation d'une société. Si j'ouvre un compte dans une banque et si l'on m'y verse deux millions de francs suisses, à moins qu'il n'y ait des indices de blanchiment, on ne me demandera pas qui est l'auteur du paiement et s'il a le pouvoir économique d'effectuer un tel versement. Cela irait beaucoup trop loin. Lorsque quelqu'un dépose de l'argent sur le compte d'une société industrielle afin d'augmenter son capital, dans 99,9 % des cas, aucune vérification n'est effectuée. M. le président : Monsieur Huber, vous nous dites des choses passionnantes, je partage totalement votre analyse et vous répondez ainsi pour partie à ma première question. Selon vous, c'est donc à travers les sociétés industrielles, dont certaines ont des hommes de pailles mais qui ont pignon sur rue, que s'opèrent aujourd'hui les grandes activités de blanchiment ? M. Niklaus HUBER : Je le soupçonne. (...) M. Jacky DARNE : Un de vos propos antérieurs m'a semblé un peu contradictoire avec les ordonnances d'application de la loi contre le blanchiment. Je pensais que les banques devaient contrôler les arrivées de fonds destinées à l'augmentation des capitaux propres des sociétés au même titre que d'autres opérations. Cela entre-t-il ou non dans le champ de la loi ? Mme Dina BALLEYGUIER, Chef du service juridique de la Commission fédérale des banques : A partir du moment où cet argent est versé dans une banque par un particulier, il existe, à l'évidence, une obligation de contrôle. En revanche, cette obligation de contrôle n'existe pas si cet argent est versé par un notaire. Dans son activité de notaire - et non dans celle d'intermédiaire financier -, celui-ci bénéficie du secret. Pour la banque, il n'y a pas obligation d'identification mais le notaire est censé la faire. Toutefois, personne ne va contrôler puisque cela ne fait pas partie de son activité d'intermédiaire financier mais de son activité de notaire. M. Jacky DARNE : Autrement dit, si vous êtes russe et si vous voulez blanchir de l'argent en participant à une augmentation de capital, il vous suffit de passer par un notaire qui déposera l'argent à la banque, laquelle ne contrôlera pas, alors que si un Russe dépose de l'argent à la banque, on entre dans la procédure de blanchiment. Mme Dina BALLEYGUIER : Tout à fait ! Extrait de l'entretien de la Mission avec les représentants des Autorités fédérales suisses, en septembre 1999 Cette situation, décrite par les responsables des instances fédérales, est des plus préoccupantes et constitue une béance du système économico-financier dans laquelle peuvent s'engouffrer sans difficulté tous les représentants de la délinquance financière. La logique et la cohérence devraient conduire le législateur à imposer la vérification systématique de la provenance des fonds destinés à des augmentations de capital, en posant comme principe que tout apport de ce type ne peut se faire par virement et nécessite d'abord l'ouverture d'un compte dans la banque du compte à alimenter. b) Les avoirs des « personnes politiquement exposées » Dans son premier rapport d'activité, le Bureau de communication, au titre des opérations sujettes à communication, a précisé que « l'obligation de communiquer ne doit pas être appliquée non plus lorsqu'il s'agit de la fortune de dictateurs, à moins qu'il y ait un soupçon fondé qu'elle provient d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce sur elle un pouvoir de disposition. » La Mission s'est étonnée de cette interprétation nuancée du Bureau de communication. En exigeant l'existence d'un soupçon fondé concernant de tels avoirs, le MROS semble considérer que certaines de ces fortunes de dictateurs pourraient avoir été acquises légalement et qu'il convient dans ce cas de ne pas procéder systématiquement à une annonce. Cette interprétation ferait donc des avoirs des dictateurs des avoirs comme les autres, alors que, par principe, les fonds accumulés par un dictateur sur ses comptes bancaires en Suisse devraient faire systématiquement l'objet d'une suspicion de provenance criminelle. Fonds des dictateurs ou fonds criminels, il y a là comme une tautologie. Toutefois, comment, dans ce cas, déterminer les titulaires de compte que l'on peut qualifier de dictateur, de potentat ou, plus largement, de personne politiquement exposée ou P.E.P. (Politically Exposed Persons) ? C'est toute la question que le journaliste Paul Coudret expose en ces termes : On ne dit plus dictateur, on dit « PEP » On ne dit plus dictateur. On ne dit plus potentat. On dit « Politically Exposed Persons ». Ou PEP, si vous préférez. Bref, dans les banques, les « personnes politiquement exposées » sont comme les patates brûlantes :on aimerait bien les lancer au voisin mais il n'y a aucun volontaire... Alors, comme ont essayé de l'expliquer lundi à quelques journalistes économiques les responsables des banques, on essaie de gérer le dégagement de chaleur... Le problème n'est pas tant les anciens PEP. Les Marcos, Mobutu et autres Abacha sont des dossiers qu'on a pris en pleine figure. Ils ont fait mal, très mal même. En termes de réputation bien sûr. Mais aussi, parce qu'ils ont coûté très cher par rapport aux montants qu'ils représentent en rapport avec les sommes totales gérées par les banques suisses. Cependant, pour pénible qu'il soit, le problème n'est pas dans les dossiers du passé. Il est dans ceux de demain. Dans les politiciens au pouvoir aujourd'hui et qui, demain, deviendront des PEP. Il n'y a, paraît-il pas de listes noires de ces hommes de pouvoir. Pas question, par exemple, d'y déclarer indésirable le chef d'une nouvelle démocratie d'Asie centrale sur le territoire de laquelle on a installé une filiale active dans le négoce de matières premières mais qui a pris la détestable habitude de dilapider les versements du FMI. Les banquiers aimeraient bien avoir une telle liste. Mais pourraient-ils lui accorder la moindre parcelle de confiance sans savoir qui l'a établie ? Chaque établissement a donc ses propres critères d'appréciations basés, par exemple, sur la liste des pays exposés à la corruption établie par l'ONG Transparency International. Ou sur ses contacts discrets avec telle ou telle agence de renseignement. Pourtant, savoir quel politicien sera demain aussi « pourri » dans son portefeuille que dans la presse internationale, alors qu'il est aujourd'hui « bien sous tous les rapports », admis dans les cercles de l'ONU et en cour à la Maison-Blanche, est un exercice de haute voltige. D'autant que ces PEP, surtout s'ils sont dans un gouvernement, sont en général au bénéfice de l'immunité que leur accorde le droit international. Et que leurs besoins de placement sont souvent compatibles avec le réalisme politique des pays où ils aimeraient voir leur argent être géré. Les écarter de l'antichambre d'un conseiller à la clientèle au prétexte qu'ils sont des politiciens est donc tout aussi délicat que les accepter. C'est même une question insoluble sauf s'ils sont assez malins pour s'intéresser à ce que les spécialistes appellent les « Special Purpose Vehicles », des outils financiers offshore très très discrets... Source :Le Temps du 22 août 2000, article de M. Paul Coudret. L'actualité montre que les potentats ont encore pour la Suisse une attirance particulière et qu'ils continuent de vouloir y déposer leurs avoirs, espérant y trouver la discrétion requise et bénéficier de l'expérience et du professionnalisme des banquiers, comme le confirment quelques affaires récentes. La Commission fédérale des banques a envisagé, dans sa circulaire n° 98-1 sur le blanchiment des capitaux, la question de ces avoirs de personnalités politiques étrangères. Le point 9 de la circulaire précise que « les intermédiaires financiers ne doivent pas accepter des fonds dont ils savent ou doivent présumer qu'ils proviennent de la corruption ou de détournements de fonds publics. Malgré l'existence de cette disposition, certaines banques ne respectent pas leurs obligations de diligence. L'affaire Abacha, du nom de l'ex-dictateur nigérian, est parfaitement significative de certaines pratiques bancaires et a fait l'objet, de la part de la Commission fédérale des banques (CFB), d'un rapport d'enquête rendu public le 4 septembre 2000 sur le site Internet de la CFB sous le titre Fonds « Abacha » auprès des banques suisses.
Le Nigeria essaye depuis 1999 de récupérer environ 3 milliards de dollars détournés et placés à l'étranger par son ancien dirigeant-dictateur Sani Abacha, décédé en 1998. Voici une chronologie des faits : - novembre 1993 à juin 1998 : le général Sani Abacha dirige de manière dictatoriale le Nigeria, avec de multiples violations des droits de l'homme. En 1995, Mohamed, le fils d'Abacha, ouvre sous un faux nom un compte auprès du Crédit Suisse. La banque trouve sa véritable identité en mars 1999 et signale le cas aux autorités. - 8 juin 1998 : Sani Abacha meurt à 54 ans des suites d'un infarctus. Son successeur est le général Abdusalam Abubakar. - automne 1998 : la presse nigériane fait état de la corruption du régime Abacha et parle de détournement de 4,3 milliards de dollars, dont 3 milliards ont été placés à l'étranger. - 28 février 1999 : l'ex-général Obasanjo gagne les premières élections présidentielles démocratiques du Nigeria. 14 octobre 1999 : la Suisse bloque 5 comptes de l'ex-dictateur, suite à une demande provisoire d'entraide du Nigeria. - 29 octobre 1999 : le juge d'instruction genevois Bernard Bertossa ouvre une enquête sur les comptes d'Abacha -- novembre 1999 : la Commission fédérale des banques ouvre une enquête auprès de 19 banques où des fonds ont été placés. - décembre 1999 : 660 millions de dollars ont été bloqués dans ces banques. - 11 janvier 2000 : le Nigeria adresse à la Suisse une demande officielle d'entraide judiciaire, qui lui est accordée 10 jours plus tard. - 6 mai 2000 : après la Suisse, le Luxembourg bloque aussi des fonds pour un montant d'un milliard de FS (580 millions USD). - 6 juin 2000 : la justice suisse poursuit Mohamed Abacha pour corruption et blanchiment d'argent. Mohamed Abacha est incarcéré au Nigeria. - 21 juillet 2000 : la Suisse rend au Nigeria 66 millions de dollars, provenant des fonds bloqués. - 24 juillet 2000 : la justice suisse condamne un homme d'affaires nigérian, impliqué dans cette affaire, à payer une amende d'un million de FS (580 000 USD). - 11 août 2000 : le Nigeria adresse une demande d'entraide judiciaire au Liechtenstein, pour récupérer les fonds placés dans cette principauté. Trois comptes sont bloqués. Selon le Nigeria, 100 millions de dollars ont été placés sur ces comptes. - 4 septembre 2000 : l'enquête de la Commission fédérale des banques montre que 6 des banques incriminées ont violé leurs obligations de diligence. Source : dépêche AFP du lundi 4 septembre 2000 La CFB a notamment critiqué le Crédit Agricole Indosuez (Suisse) S.A. en estimant que « la banque n'a pas agi avec la diligence nécessaire. La banque a ouvert les comptes alors qu'elle savait que les titulaires ou les ayants droit économiques étaient des proches de l'ancien président du Nigeria et en omettant de procéder aux clarifications complémentaires nécessaires. » La CFB a constaté d'autre part que cette banque ne disposait pas d'une organisation interne apte à faire appliquer correctement les dispositions anti-blanchiment « en particulier en raison du cloisonnement de l'information entre les succursales. » A propos de l'Union bancaire privée UBP, la CFB a estimé que « lors de l'ouverture de cinq autres relations d'affaires par un proche de Sani Abacha identifié comme tel, la banque n'a en outre pas agi avec la diligence nécessaire en omettant de procéder aux clarifications complémentaires nécessaires relatives à l'arrière-plan économique des transactions. » Dans le cas de la Warburg Bank (Schwartz) AG, celle-ci a accepté le versement de 300 millions de deutschmarks sur un compte dont deux fils de Sani Abacha étaient les ayants droit. Ces sommes ont ensuite été transférées en grande partie à la banque du groupe au Luxembourg. Les personnes dirigeantes impliquées ont quitté la banque après l'intervention de la CFB. Quant au Crédit Suisse Group qui avait accepté des avoirs d'un montant de 214 millions de dollars de deux fils de Sani Abacha, la CFB a conclu que cet établissement n'avait pas détecté la qualité de ces deux clients « politiquement exposés » en dépit d'éléments qui auraient dû alerter les responsables de la banque : âge, pays d'origine, montant des fonds déposés. La CFB a critiqué notamment le fait que le Crédit Suisse « a accordé trop de crédit aux indications et aux informations d'un client de longue date qui avait introduit les nouveaux clients à la banque. » Le cas des avoirs de l'ex-dictateur Abacha n'est pas isolé. Avant cela, la question des fonds détournés et déposés sur des comptes en Suisse par l'ancien dictateur Marcos ou le Maréchal Mobutu avaient également fait l'objet de blocage sur décision de la justice suisse. Tout récemment, en octobre 2000, dans le cadre de l'enquête ouverte à Zürich contre Vladimiro Montesinos, ancien chef des services secrets et ex bras droit de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, cinq comptes bancaires ouverts auprès de trois banques ont été bloqués après que ces établissements eurent fait une déclaration de soupçons au Bureau de communication. Selon le ministre de la Justice péruvien, M. Alberto Bustamante, Montesinos avait déposé 48 millions de dollars « d'argent sale » dans les banques suisses. A ces 48 millions de dollars qui ont été gelés début octobre 2000, se sont ajoutés 22 millions de dollars qui ont subi le même sort en novembre 2000. Selon la justice suisse, ces sommes se trouvant sur cinq nouveaux comptes bancaires proviendraient de commissions liées à des ventes d'armement. Ces exemples montrent à quel point, en dépit des efforts très importants entrepris notamment par la Commission fédérale des banques, le système bancaire suisse reste encore vulnérable aux opérations de blanchiment. La CFB a d'ailleurs décidé, au terme de l'enquête sur les fonds Abacha, d'entreprendre la révision des directives blanchiment contenues dans sa circulaire n° 98-1 et de prévoir des modifications sur les points suivants qu'elle expose dans son rapport : L'affaire des fonds Abacha a mis en évidence les faiblesses de la réglementation relative aux procédures d'identification des ayants droit et de clarification de l'arrière plan économique des transactions effectuées sur certains comptes bancaires. La Commission fédérale reconnaît très expressément ces lacunes et propose des modifications de la circulaire 98.1 qu'elle expose dans le rapport d'enquête qu'elle a menée sur lesdits fonds Abacha. On ne peut que souscrire aux propositions de la CFB.
La CFB va adapter la circulaire CFM « Blanchiment » du 26 mars 1998 en tenant compte de l'évolution du droit qui a eu lieu depuis cette date ainsi que des conclusions de l'enquête relative aux fonds « Abacha » auprès des banques suisses. Les points suivants devront être discutés. · Adaptation au droit de la corruption révisé Les directives de lutte contre le blanchiment doivent être adaptées au droit pénal de la corruption entré en vigueur le 1er mai de cette année. Ce droit introduit entre autres la pénalisation de la corruption active de fonctionnaires étrangers. Avec l'introduction de cette norme pénale, les employés de banque se rendent nouvellement coupables de blanchiment lorsqu'ils acceptent des fonds de fonctionnaires étrangers dont ils savent ou doivent présumer qu'ils proviennent de la corruption. Le nouveau droit pénal de la corruption introduit en outre une obligation d'annonce lorsque la banque sait ou a des soupçons fondés que des fonds proviennent de la corruption étrangère. Selon les directives actuelles de lutte contre le blanchiment de la CFB, les intermédiaires financiers ne doivent pas accepter de fonds dont ils savent ou doivent présumer qu'ils proviennent de la corruption ou du détournement de fonds publics, faute de quoi leur garantie d'une activité irréprochable sera mise en cause. Mais depuis l'entrée en vigueur du droit pénal révisé de la corruption, il manque la mention du caractère punissable d'un tel comportement ainsi que l'obligation d'annonce. · Obligation de la direction générale de connaître les clients les plus importants Dans plusieurs des cas examinés par la CFB, il s'est avéré que les échelons supérieurs de la hiérarchie de la banque n'étaient pas informés de relations contractuelles même s'il s'agissait de montants et de relations d'affaires comparativement importants. Cette situation doit être évitée à l'avenir. La CFB examine par conséquent l'introduction d'une obligation qui exige de manière générale que les membres de la direction des banques actives dans la gestion de fortune connaissent leurs clients les plus grands et les plus importants de leur banque. Chaque banque devrait définir elle-même la limite entre les clients grands/importants et les autres et prévoir dans des directives internes des seuils échelonnés en fonction du pays d'origine et du potentiel de risque. · Clarification des raisons qui motivent un changement de relation bancaire Ainsi que cela vient d'être exposé, le fait que des fonds d'un client proviennent d'une banque suisse ou étrangère renommée ne dispense pas les banques de l'obligation de procéder aux clarifications nécessaires lors de l'ouverture d'une relation d'affaires. Il peut s'agir, dans ce contexte, d'interroger le client sur les raisons qui motivent son désir de changer de relation bancaire et de contrôler, le cas échéant, ces indications en contactant la banque précédente. Le pendant de cette obligation pourrait consister en une obligation de la banque qui rompt une relation d'affaires de prévenir d'autres banques de manière proactive ou sur requête. En règle générale, dans de tels cas, les indications des clients ne correspondent pas à celles de leurs anciennes banques et il peut s'avérer ardu de clarifier quelle version correspond à la réalité des faits. La CFB examinera par conséquent si une telle obligation doit être ancrée expressément dans les directives de lutte contre le blanchiment. Source : rapport de la commission fédérale des banques sur les fonds Abacha, Août 2000. Cette décision de la CFB d'imposer encore davantage de rigueur aux banquiers tire les leçons de ce scandale et démontre a contrario que le dispositif existant n'était sans doute pas aussi parfait que certains se plaisaient à le dire. La CFB n'a pas manqué enfin de souligner que les actions de blocage menées par la Suisse ne prennent leur pleine efficacité que si les autres pays concernés par le transfert ou la détention de tels fonds appliquent eux aussi le gel de ces avoirs. Dans le cas des « fonds Abacha », la CFB a notamment informé ses homologues en Grande-Bretagne, au Luxembourg et en France. La Mission a souhaité obtenir des précisions sur les informations qui avaient pu être transmises par la Commission fédérale des banques suisses à la Commission bancaire française et a adressé à son Président la lettre suivante : « Monsieur le Président, Dans le cadre des travaux de la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, dont je suis le rapporteur, je viens d'effectuer un déplacement en Suisse. [...] A cette occasion, il m'a été indiqué que la Commission fédérale des banques suisses, aurait, dans ce qu'il est convenu d'appeler « l'affaire Abacha », informé officiellement la Commission bancaire de divers mouvements financiers, concernant les fonds de l'ancien dictateur nigérian, qui auraient eu lieu sur des comptes bancaires français. Je souhaiterais que vous puissiez me confirmer et me préciser les formes dans lesquelles la Commission bancaire française s'est trouvée, avant la parution le 4 septembre par la Commission des banques suisses du rapport sur les fonds Abacha, destinataire de cette information qui visait, semble-t-il, à permettre le blocage de ces avoirs douteux. Dans cette hypothèse, vous serait-il possible de m'informer des mesures qui auraient été prises par les banques en France concernant les dits comptes bancaires de la famille Abacha. [...] » En réponse, la Mission a obtenu les éléments suivants : « Monsieur le Député, Par une lettre en date du 3 octobre 2000, vous avez souhaité obtenir des précisions sur les formes dans lesquelles la Commission bancaire s'est trouvée, avant la publication le 4 septembre par la Commission fédérale des banques suisse du rapport sur les fonds Abacha, officiellement destinataire d'informations relatives à divers mouvements financiers sur les comptes bancaires français de l'ancien président du Nigéria. En réponse à votre demande, je peux vous faire connaître que la Commission fédérale des banques suisse a bien porté, à l'attention de la Commission bancaire, dans le courant du mois de juillet 2000, certains éléments de l'enquête diligentée par elle sur les établissements bancaires suisses détenant des fonds ayant un lien avec l'ancien président du Nigéria. Cette lettre évoquait notamment l'existence de comptes ouverts dans des établissements de crédit établis en Suisse au nom de la famille Abacha, y compris dans certaines filiales suisses d'un établissement de crédit français. La Commission fédérale des banques suisse est seule compétente pour les agissements d'établissements de crédit situés en Suisse ; la Commission bancaire française n'a pas de pouvoirs de contrôle direct sur ces établissements, même s'il s'agit de filiales de droit suisse d'un établissement de crédit français. En ce qui concerne les établissements de crédit français relevant de sa supervision, je puis vous indiquer que la Commission bancaire a mené toutes les actions et diligences utiles dans l'affaire sur laquelle vous attirez mon attention. S'agissant du blocage de fonds portés au crédit de comptes, comme vous le savez, c'est l'autorité judiciaire qui est seule compétente en ce domaine et la Commission bancaire ne manque pas de donner suite à toute demande qui lui serait présentée et qui entre dans le cadre de ses attributions. La Commission bancaire, par ailleurs, poursuit toutes diligences appropriées au vu de l'ensemble des éléments en sa possession à l'effet de s'assurer du respect, par les établissements de crédit situés en France, de la réglementation en vigueur, notamment relative à la lutte contre le blanchiment. Si vous le souhaitez, M. Fort, Secrétaire Général de la Commission bancaire, se tient à votre disposition pour un entretien sur ces questions dont je mesure, comme vous, l'importance. » Il aurait été agréable à la Mission de bénéficier d'informations plus précises concernant « toutes les actions et diligences utiles » entreprises par la Commission bancaire relativement à cette affaire des fonds Abacha, dont la provenance criminelle est avérée. La City n'a pas été non plus épargnée par le scandale. Des banquiers londoniens ont accepté sans sourciller d'ouvrir des comptes aux deux fils Abacha sans vérifier la validité des deux passeports établis sous deux faux noms « Kaiser » et « Soze » se référant au personnage Keyser Soze du film préféré de leur père (Usual Suspects). Selon un professionnel de la banque privée, « les comptes Abacha illustrent la mentalité coloniale sous-jacente qui veut que les classes dirigeantes de la grande famille anglophone d'outre-mer ne soient pas inquiétées » 23 Le cas des fonds Abacha est emblématique du décalage existant entre les normes adoptées par les autorités fédérales et les banquiers suisses pour lutter contre le blanchiment et la réalité. La CFB, dans sa circulaire 98-1, a eu beau rappeler les grands principes, les banquiers n'y sont pas encore suffisamment sensibles.
L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales d'origine criminelle n'est pas punissable, mais peut contrevenir aux dispositions des lois sur les banques et sur les bourses relatives à la garantie d'une activité irréprochable ou à la disposition de la loi sur les fonds de placement concernant la jouissance d'une bonne réputation. C'est pourquoi les intermédiaires financiers doivent faire preuve de la vigilance requise par les circonstances même dans les affaires qui ne présentent pas pour eux de risques financiers apparents (risque de solvabilité). Les intermédiaires financiers ne doivent pas accepter des fonds dont ils savent ou doivent présumer qu'ils proviennent de la corruption ou de détournements de fonds publics. Ils doivent dès lors examiner avec une attention particulière s'ils veulent entrer en relation d'affaires, accepter et garder des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des personnes exerçant des fonctions publiques importantes pour un Etat étranger ou à des personnes et sociétés qui, de manière reconnaissable, leur sont proches. Extrait de la circulaire de la Commission fédérale des banques n° 98-1 du 26 mars 1998 L'affaire Abacha, outre qu'elle a révélé les faiblesses des dispositifs de contrôle et de surveillance internes de certaines banques, est intéressante également à un double titre. Elle a, d'une part, révélé l'absence de tout système d'inspection préventif envisagé au niveau fédéral, qui permettrait, à travers des séries de contrôle inopinés, de s'assurer que les banques ont bien mis en place des procédures adaptées et unifiées. La CFB, en effet, en application de la philosophie de l'autorégulation, laisse aux institutions de révision privées reconnues par elle, le soin de contrôler régulièrement les établissements bancaires et dépend, comme elle le reconnaît elle-même « dans une très grande mesure des informations que lui fournissent les institutions de révisions agréées » Ces dernières, si elles ont effectué des révisions, semblent avoir été plus sensibles aux aspects prudentiels, que concernées par le problème du blanchiment si l'on en juge par l'affaire Abacha. Cette affaire a, d'autre part, constitué l'occasion de rappeler qu'en ce qui concerne les filiales ou succursales de banques étrangères, implantées en Suisse, la responsabilité de la supervision relève aussi des autorités de surveillance du pays du siège social de ladite banque en « mains étrangères ». Si de tels établissements doivent respecter la législation suisse, rien ni personne n'interdit et surtout pas les autorités fédérales suisses, qu'une réglementation interne plus rigoureuse, du pays d'origine de la banque, soit applicable dans la filiale ou la succursale implantée suisse. C.- LA CONCURRENCE DES AUTRES CENTRES OFFSHORE 1.- La recherche de la confidentialité Même si la législation suisse anti-blanchiment souffre d'imperfections, il n'en demeure pas moins que la Suisse n'est plus ce qu'elle était, un sanctuaire totalement inviolable où l'on rêvait d'investir les capitaux pour lesquels on souhaitait la plus extrême discrétion et la garantie d'une sécurité totale. Concurrence oblige, la Suisse a besoin de conserver à sa clientèle un certain nombre de prestations et la création de filiales ou succursales dans divers paradis bancaires, juridiques ou fiscaux s'est largement développée ces derniers temps pour répondre à ce besoin. Il y a des gens qui n'ont pas envie M. le président : [...] On cite souvent le Liechtenstein. Les banques que vous connaissez ont-elles des succursales ? Observez-vous ce phénomène ? Est-ce une préoccupation pour vous ? Le fait d'imposer des normes plus rigoureuses entraîne-t-il la fuite de clients vers des contrées moins normatives ? M. Michel Y. DEROBERT : La possibilité existe. Il y a effectivement une certaine compétition, non seulement dans les normes applicables mais également dans la façon de les appliquer, ce qui, nous, suisses, nous préoccupe presque davantage car nous n'avons pas de tradition normative mais une conception assez rigoureuse de l'application des lois [...] Face à une telle situation, la réaction du banquier est toujours pragmatique. Celui-ci se demande : dois-je suivre mes clients qui ne veulent plus travailler ici ou bien dois-je les laisser partir ? M. le Rapporteur : [...] Il est possible que l'on se dise : puisqu'il y a des choses que l'on ne peut plus faire ici en raison de l'apparition de normes qui placent la Suisse en première ligne de la lutte contre le blanchiment, sauf peut-être dans quelques cantons de l'est faiblement accessibles, peut-être faut-il les faire faire par nos filiales ou nos succursales dans ces endroits-là ? Ma réaction est la même que la vôtre. Je me demande si des grands établissements soit instrumentent eux-mêmes des mouvements financiers qui font l'objet de poursuites et qui n'ont pas fait l'objet des dénonciations conformément à l'arsenal juridique aujourd'hui en vigueur en Suisse, soit le font faire par leurs succursales dans des centres offshore, avec des sociétés aux noms les plus folkloriques que l'on trouve dans toutes les affaires de financement politique, de trafic d'armes, de corruption de fonctionnaires, etc. M. Edouard CUENDET : Juridiquement, les règles suisses interdisent aux banques d'utiliser leurs filiales à l'étranger pour détourner les lois suisses. M. le Rapporteur : La preuve que non. M. Denis MATHIEU : Ce n'est pas parce que vous ouvrez une filiale à Nassau que vous y commettez forcément des turpitudes. M. Edouard CUENDET : Il est des clients honnêtes qui tiennent à la confidentialité, même s'ils n'ont rien à cacher. M. le Rapporteur : S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi cherchent-ils à se dissimuler ? M. Edouard CUENDET : C'est la thèse de M. Bertossa qui dit : si vous n'avez rien à cacher, quel est le problème ? M. le Rapporteur : Où est le problème ? M. Edouard CUENDET : Il y a des gens qui n'ont pas envie que M. Bertossa vienne regarder. M. le Rapporteur : [...] Je crois qu'en Suisse, comme en France et comme dans tous les pays où il est permis de s'enrichir honnêtement, le secret bancaire existe et peut être utilisé par quiconque agit dans le respect des lois. Quelle est donc l'utilité, pour quelqu'un qui est honnête, de rechercher la délocalisation de fonds dans un endroit où l'on sait que sont garanties l'opacité sur le plan bancaire et l'impunité judiciaire. [...] Nous sommes donc obligés de considérer que tous ceux qui vont chercher autre chose que ce qu'ils peuvent trouver sur le pas de leur porte, dans n'importe quelle banque honorable, pour des activités honorables, recherchent l'impunité. Que répondez-vous à cela ? M. Michel Y. DEROBERT : Vous allez mettre à l'Index la totalité de la profession financière de la planète. M. le Rapporteur : Cela nous fera enfin des ennemis, car nous ne trouvons que des amis qui pensent comme nous. [...] Que vont chercher ces gens aux îles Vierges britanniques ? Chaque fois que nous avons une transaction avec les îles Vierges britanniques, elle est toujours suivie, deux ans plus tard, d'une commission rogatoire. M. Michel Y. DEROBERT : Je ne répondrai pas à cette question, car nous sommes en train de remonter la pente avec une certaine difficulté contre ce genre d'accusations très générales et très globales. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Michel Y. Dérobert, Secrétaire général de l'Association des banquiers suisses, en septembre 1999 La création de succursales et de filiales dans les paradis bancaires et fiscaux permet malgré tout la réalisation d'opérations qui n'auraient pu se faire en restant sur le sol suisse, comme le montre ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Lazarenko, du nom de l'ancien Premier ministre d'Ukraine.
M. le président : Avez-vous le sentiment que les banques suisses ouvrent de plus en plus de filiales dans ces paradis bancaires, fiscaux et judiciaires que vous évoquez, mais garantissent que ces filiales ouvertes dans des centres offshore répondent aux mêmes règles prudentielles, déontologiques que les règles admirables qui sont respectées ici ? Avez-vous pu observer que ces sociétés offshore, qui existent pour tous les grands groupes, y compris français - nous avons rencontré ce matin les dirigeants de Paribas - servent malheureusement maintenant beaucoup plus facilement aux transactions concernant l'argent sale ? M. Bernard BERTOSSA : Il s'est effectivement produit une évolution due au fait que la Suisse n'a plus la réputation de coffre-fort inviolable de l'argent sale, grâce à l'activité de certaines autorités judiciaires, grâce à celle du législateur qui nous a dotés d'une panoplie de normes qui répond à un standard convenable, grâce aussi, reconnaissons-le, à des efforts déontologiques importants de la part de la majorité des établissements bancaires suisses. Même commercialement, ils n'ont pas intérêt à cultiver cette image. La tentation était donc, pour ne pas perdre la clientèle des capitaux qui avait pour vocation de rester dissimulée, d'ouvrir des succursales ou des filiales dans des Etats où la confidentialité est mieux garantie. Concrètement, nous avons une affaire liée à l'ancien Premier ministre d'Ukraine, M. Lazarenko. Je ne trahirai pas de secret puisque tous les noms que je citerai ont fait l'objet de publication. Dans ce contexte, une banque genevoise avait reçu des fonds qu'elle a immédiatement elle-même fait transférer à sa succursale de Nassau. Il s'agissait tout de même d'environ 50 millions de francs suisses, ce qui n'est pas tout à fait innocent. Lorsque nous sommes allés dans cette banque, il nous fut répondu que l'on pouvait nous remettre la documentation mais pas bloquer les fonds. Dans ces cas-là, les normes suisses auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure font obligation à l'établissement bancaire suisse de prendre les mesures nécessaires pour que, dans sa filiale, les fonds ne disparaissent pas dans un délai raisonnable, dans la mesure où l'autorité judiciaire envisage de saisir ces fonds. Le juge genevois a immédiatement envoyé une commission rogatoire à Nassau, avec le succès que vous pouvez imaginer. Neuf mois plus tard, la banque nous a dit qu'elle n'avait toujours pas d'ordre de saisie du juge de Nassau et qu'elle était obligée de libérer les fonds. Et les fonds sont partis. Même si, sous l'angle de la transparence, on peut admettre, et encore, avec quelques réserves, que les normes suisses sont appliquées à l'étranger, sous l'angle de l'efficacité de la saisie, ce n'est certainement pas le cas. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Bernard Bertossa, Procureur Général du canton de Genève, en septembre 1999 Concernant l'affaire Lazarenko, la Suisse a restitué, début novembre 2000, à l'Ukraine les 6,6 millions de dollars détournés par l'ex-Premier ministre reconnu coupable de blanchiment et actuellement détenu aux Etats-Unis. Par ailleurs, la circulaire n° 98-1 de la CFB précise que les intermédiaires financiers ne doivent pas utiliser leurs succursales étrangères, ni les sociétés du groupe à l'étranger actives dans le domaine bancaire ou financier pour contourner les directives anti-blanchiment. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'utilité qu'il y a pour un établissement bancaire suisse de s'installer dans un territoire non coopératif. En mai 1999, lors d'un colloque sur le secret bancaire, des banquiers suisses, inquiets pour leur avenir, réagissaient aux menaces européennes d'harmonisation fiscale en indiquant qu'ils avaient procédé à des délocalisations bancaires dans des zones offshore. Ainsi, le porte-parole de la Banque de Patrimoines Privés (BPP) a annoncé le rachat par son établissement « d'une petite banque à Nassau aux Bahamas ». Un représentant de la banque Piguet d'Yverdon, qui dépend de la banque cantonale vaudoise a également indiqué à cette occasion qu'une implantation de sa banque était envisagée aux îles Caïmans. 2.- La proximité du Liechtenstein Sur le plan bancaire, mutatis mutandis, le Liechtenstein est à la Suisse ce que Monaco est à la France. Les banques suisses présentes dans la Principauté du Prince Hans Adam II sont nombreuses. Il est vrai que tout s'y prête, la proximité géographique, la pratique de la langue allemande, la tradition d'une économie financière et surtout l'existence, au lendemain de la première guerre mondiale, d'une Union douanière et monétaire entre le Liechtenstein et la Suisse venue se substituer à l'Empire austro-hongrois défunt. Les banques du Liechtenstein bénéficient de la réputation de professionnalisme des banquiers suisses. Inversement, les banques suisses trouvent au Liechtenstein des commodités législatives qui finissent par leur manquer en territoire helvétique. L'attrait du Liechtenstein n'est pas nouveau ; le scandale « Chiasso » avait déjà, à son époque, montré que les personnes mises en cause faisaient transiter par une société établie dans cette Principauté les capitaux italiens blanchis. Les observateurs avertis soulignaient également que la Banque nationale suisse constatait, dans son rapport annuel de 1979, un fort accroissement de capitaux en provenance du Liechtenstein. Toutefois, la Suisse a fini par être gênée par ce voisin peu fréquentable, refusant systématiquement l'entraide judiciaire en matière pénale sur les affaires de blanchiment, mais dont elle veut espérer malgré tout qu'il rentrera dans le droit chemin. Le ministre suisse des Finances, M. Kaspar Villiger a en effet récemment salué les améliorations introduites par le Liechtenstein dans sa législation anti-blanchiment, ainsi que l'augmentation des effectifs des magistrats et a souhaité en conséquence que cette Principauté soit « loyalement traitée » par le GAFI. Néanmoins, tant que le Liechtenstein n'aura pas donné davantage de garanties, cette place financière continuera de demeurer le lieu de toutes les turpitudes les plus criminelles. Le témoignage recueilli par la Mission d'une ancienne avocate qui a choisi de dénoncer de telles pratiques montre que certaines relations des banques suisses avec le Liechtenstein méritent, elles aussi, qu'on y mette un terme définitif.
M. Arnaud MONTEBOURG : Vous avez pris le « taureau par les cornes », si j'ose dire, et vous avez procédé à un certain nombre de dénonciations auprès des autorités du Liechtenstein, comme la loi vous en fait obligation en tant qu'avocate. Que vous est-il arrivé en 1996, dès lors que vous avez fait votre devoir en alertant les autorités du Liechtenstein de ce que vous aviez vu ? Mme Z, ancienne avocate : J'ai procédé la même année à des dénonciations et donné ma démission. Rien ne s'est passé pendant treize mois, mais beaucoup de choses se sont produites quand mon chef a appris que j'avais fait des dénonciations. Il a commencé à déposer des plaintes en justice. Il en a déposé au total 18, même s'il a toujours perdu et si la cour d'appel - j'ai le jugement ici - m'a exonérée concernant l'affaire des organes et du sang. A chaque fois que je gagne, il dépose une autre plainte, ce qui me prend toute mon énergie et tout mon temps. J'ai témoigné au Liechtenstein une semaine après avoir été nommée fondée de pouvoir à Zürich et j'ai été ce jour-là licenciée par KPMG sans raison officielle. Ils m'ont payé les quatre mois qu'ils me devaient et m'ont indiqué qu'ils avaient fait l'objet de pression de la part de la banque X., leur client le plus important. J'ai appris par ailleurs que le client d'un Directeur de la banque X. - qui a une fiduciaire au Liechtenstein -, qui est aussi avocat, faisait l'objet d'une instruction et était mêlé à l'affaire de la vente du sang. Comme toutes les grandes organisations, la banque X. a fait appel à un agent fiduciaire connu, en l'occurrence le président du parti noir, le porte-parole du parti rouge en étant le P.D.G. Le jour où ce Directeur de la banque X. a appris que je témoignais contre son client dans une affaire dans le cadre de laquelle il avait été agent fiduciaire et avait touché de l'argent sale, il a téléphoné à mon supérieur hiérarchique et lui a dit que je devais être licenciée. Cela a été la fin de ma carrière. Mon supérieur hiérarchique m'a dit que c'était dommage parce que j'avais bien travaillé - il m'a remis une lettre de recommandation -, mais a ajouté que je ne travaillerai plus jamais comme avocate et que ma carrière était terminée en Suisse et au Liechtenstein parce que j'avais parlé aux autorités. Il a ajouté que, même s'il s'agissait de la vie humaine et d'un trafic d'organes et de sang, ce n'était pas une justification pour la banque X. et certains cabinets d'avocats, et que j'avais brisé l'omerta. Extrait de l'entretien de Mme Z, ancienne avocate, avec le rapporteur, le 25 mai 2000 Le Liechtenstein semble constituer également la porte de service utilisée par les capitaux criminels des dictateurs pour s'échapper de Suisse où la présence de tels avoirs se fait de plus en plus indésirable.
M. Arnaud MONTEBOURG : Vous voulez dire que l'oncle du Prince du Liechtenstein, Constantin, est à la tête d'une fiduciaire qui a reçu les fonds de Marcos : sont-ils toujours au Liechtenstein aujourd'hui ? Mme Z, ancienne avocate : C'était le cas quand j'ai quitté la banque, qui m'a fait licencier car cette banque a appris que je savais où se trouvait l'argent de Marcos, comme beaucoup de salariés chez KPMG et à la banque X. On a su, au moment où la Suisse a voulu séquestrer les fonds de Marcos, que la banque X. les avait transférés dans une petite agence fiduciaire liechtensteinoise. Cependant, c'était un peu difficile sur le plan politique au Liechtenstein à cette époque, la banque X. ayant acheté l'oncle du Prince. M. Arnaud MONTEBOURG : C'est-à-dire ? Mme Z : Quelques mois après l'arrivée de l'argent de Marcos, l'oncle du Prince a été nommé président du Conseil d'Administration de cette fiduciaire de Vaduz, qui appartient au Groupe de la banque X. Il occupe toujours cette position, même si c'est un homme très âgé, et gagne beaucoup d'argent. Tout le monde est acheté au Liechtenstein ; c'est un vrai problème. Extrait de l'entretien de Mme Z, ancienne avocate, avec le rapporteur, le 25 mai 2000 III.- DES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ABSENTS DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT La loi sur le blanchiment de l'argent sale du 10 octobre 1997 qui a soumis l'ensemble des intermédiaires financiers aux obligations de diligence jusque là applicables aux seules banques est une loi-cadre fondée sur le principe de l'autorégulation issu de la pratique bancaire. Ce processus tout helvétique a pour objectif d'éviter autant que possible une surveillance directe par les autorités fédérales au profit d'une surveillance des intermédiaires financiers par leurs pairs. « La LBA est une loi-cadre qui repose sur le principe de l'autorégulation. L'autorégulation a été choisie pour plusieurs raisons : d'une part, parce que nous avions déjà l'expérience de l'application de la loi sur les bourses, qui s'est révélée plutôt efficace, et d'autre part, en raison de l'intérêt d'avoir des organismes qui surveilleraient les intermédiaires financiers qui en auraient une bonne connaissance, qui seraient des spécialistes des diverses activités des intermédiaires financiers. » (Mme Natacha Polli, ex-directrice-adjointe de l'Autorité de contrôle, 29 septembre 1999). Les intermédiaires financiers s'affilient à des organismes d'autorégulation (OAR) créés sur une base professionnelle. La LBA a créé une Autorité de contrôle qui s'assure du respect, par les OAR, qu'elle autorise, des dispositifs anti-blanchiment. L'Autorité de contrôle surveille directement les intermédiaires financiers qui ne dépendent pas d'un OAR. La Suisse s'est engagée avec l'autorégulation dans une expérience longue et qui suppose un travail très lourd.
M. Paolo BERNASCONI : Je ne suis pas partisan d'un système totalement fondé sur l'autorégulation, mais plutôt d'un système mixte, c'est-à-dire un cadre réglementaire avec les autorités de surveillance et, à l'intérieur, certains secteurs laissés à l'autorégulation. C'est l'expérience que nous avons eue avec la Commission fédérale des banques et que nous avons aujourd'hui avec les organismes d'autorégulation de la LBA. D'ailleurs cette dernière expérience démontre que ce mot « autorégulation » entraîne un travail très lourd. Je suis moi-même conseiller de plusieurs organismes d'autorégulation. L'autorégulation comporte plusieurs phases. La première est celle de l'autorisation qui demande beaucoup de temps. Un organisme d'autorégulation, qui compte cinq cents affiliés, doit tous les vérifier sur le plan documentaire. C'est un travail bureaucratique très important. La deuxième phase est une phase de formation de base que nous devons renouveler chaque année. L'autorité fédérale de surveillance, au Département des Finances, prévoit par an un minimum d'une journée et demie de formation. Mais c'est un travail très important car après avoir approché les cinq cents banques en Suisse, on approche maintenant le secteur non bancaire qui reste un secteur presque inconnu. Au Tessin, seul canton à disposer d'un « financial services act », on en a autorisé mille [...] La Suisse a choisi pour l'instant ce système d'autorégulation, mais cela peut changer. Après cette première phase d'autorisation, puis cette seconde phase de formation - avec la préparation de matériel à disposition de tous et l'organisation de sites Internet et autres - on arrive à la phase la plus difficile, celle de la surveillance, car elle implique des visites, des inspections, des rapports, voire des sanctions. Une inspection est un processus qui demande du temps. Effectuer une seule inspection rigoureuse, simplement sous l'angle anti-blanchiment, peut prendre une heure, voire deux, avec deux réviseurs expérimentés. C'est une tâche colossale si elle est prise au sérieux. Je continue de croire à l'auto-surveillance, mais nous n'en verrons les résultats que d'ici cinq ou dix ans [...] Extrait de l'entretien de la Mission avec M. le Professeur Paolo Bernasconi, en septembre 2000 A.- UNE AUTORÉGULATION DIFFICILE À METTRE EN _UVRE A la différence de l'autorégulation issue de la pratique (cas des banques), l'autorégulation des intermédiaires financiers résulte ici de la loi. Sa mise en _uvre rencontre des difficultés liées au nombre des professionnels concernés, à la définition des activités visées, enfin à la résistance de certains milieux à ce principe. Actuellement, la Suisse ne parvient pas à mettre en place, dans les délais prévus, ce mécanisme très sophistiqué, fondé sur l'autodiscipline supposée des acteurs économiques, mais qui laisse finalement les autorités fédérales dans une position de retrait. Alors que la loi fixait au 31 mars 2000 la date limite à laquelle tout intermédiaire financier, pour exercer son activité, devait avoir déposé une demande d'autorisation à l'Autorité de contrôle ou d'affiliation à un OAR, des milliers d'intermédiaires ne respectaient pas cette condition dans le délai prévu et se trouvent théoriquement passibles de sanctions allant de 200 000 FS - 800 000 francs français - d'amende à la liquidation de leur société. 1.- Un champ d'application mal délimité La loi sur le blanchiment d'argent étend le dispositif de répression aux intermédiaires financiers, c'est-à-dire aux personnes qui, à titre professionnel, « acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers ». (article 2, al. 3) Le législateur a ainsi entendu soumettre aux dispositions de la loi : - les gestionnaires de fortune et conseillers en matière de placement ; - toutes les personnes proposant des opérations de crédit - crédits à la consommation, crédits hypothécaires, affacturages, financements de transactions commerciales, leasings, etc. et de manière générale toutes les personnes proposant le financement de transactions commerciales. - les fournisseurs de services dans le domaine du « trafic des paiements » - virements électroniques pour le compte de tiers, émissions ou gestion de moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage, etc. ; - les offreurs ou distributeurs de parts de fonds de placement suisse ou étranger ; - tous ceux qui font commerce, pour leur propre compte ou celui de tiers, de billets de banque, de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières. Cette liste n'est pas limitative et d'autres personnes ou activités pourraient tomber sous le coup de la LBA. La Suisse a voulu étendre très largement à l'ensemble du secteur financier les dispositions anti-blanchiment, considérant qu'une personne qui n'est pas habituellement active dans le secteur financier peut être d'autant plus facilement manipulée à des fins de blanchiment étant donné son manque d'expérience ou d'informations. Pour cette raison, sont aussi bien concernés ceux qui « interviennent dans le secteur financier, soit de façon habituelle, soit de manière occasionnelle, du moment que l'activité est exercée à titre professionnel ». Il est fait appel à des critères multiples permettant de conclure si ladite activité se fait ou non à titre professionnel. On considère par exemple que le nombre de clients, le montant de la transaction ou celui de la rémunération ne constituent pas des critères décisifs. Une transaction unique peut être considérée comme une activité exercée à titre professionnel. Le tableau ci-après montre que de nombreuses professions ne sont soumises à la LBA que pour certaines de leurs activités et fait apparaître la complexité du système. Liste non exhaustive d'activités soumises ou non soumises à la LBA
Source : Questions relatives à la mise en _uvre de la LBA par M. Niklaus Huber, Chef de l'Autorité de contrôle. La mise en place de la législation anti-blanchiment a eu pour effet de déplacer les blanchisseurs vers d'autres domaines d'intervention, notamment les secteurs industriels et commerciaux qui ne sont pas concernés par ce dispositif, comme l'a souligné Mme Natacha Polli, ex-directrice adjointe de l'Autorité de contrôle. En somme, le champ d'application extrêmement large de la LBA laisse malgré tout subsister des lacunes et certains professionnels qui pourraient se révéler actifs en contribuant à réaliser du blanchiment peuvent passer entre les mailles du filet.
Mme Natacha POLLI : C'est une définition extrêmement large qui comprend non seulement les intermédiaires financiers particuliers déjà cités, mais aussi tout gérant de fortune, les bureaux de change dans les gares, voire les stations-service qui fournissent des prestations de change, la poste avec ses services financiers, les chemins de fer fédéraux qui ont ouvert des bureaux de change et qui fournissent des services en matière de transfert d'argent, notamment par l'intermédiaire de Western Union. C'est donc un champ extrêmement large qui peut aussi, sous certaines conditions, s'appliquer aux avocats et notaires qui, à côté de leurs activités soumises à monopole, développent des activités d'intermédiation financières. D'un autre côté, paradoxalement, nous ressentons le besoin d'élargir le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent non pas quant aux personnes mais quant aux secteurs auxquels il s'applique. Il est clair qu'aujourd'hui, le secteur financier étant beaucoup moins attractif pour les blanchisseurs, une grande part de leur activité s'est déplacée, notamment dans le domaine industriel et dans le domaine immobilier, qui était expressément exclu par la loi. Extrait de l'entretien de la Mission avec Mme Natacha Polli, ex-directrice adjointe de l'Autorité de contrôle, en septembre 1999 L'Autorité de contrôle s'est employée à donner une interprétation extensive du champ d'application de la L.B.A. Estimant que la L.B.A. vise à transmettre aux autorités de poursuites pénales toutes les informations ou documents nécessaires à leur mission, le chef de l'Autorité de contrôle considère qu'il est important que toute personne active dans le secteur financier soit soumise à la L.B.A. pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. Cette interprétation a été, par certains, qualifiée de rigide ou de rigoriste. Or, ce n'est pas sans doute sans raison que le chef de l'Autorité de contrôle continue de faire preuve d'intransigeance en exigeant par exemple des négociants en matières premières qu'ils se soumettent à la L.B.A., si l'on en juge par les relations qui semblent exister entre certaines sociétés de négoce et des trafiquants d'armes. D'autre part, les professions réglementées soumises au secret professionnel sont, pour certaines de leurs activités, soumises à la LBA. Tel est le cas des avocats et des notaires qui se sont constitués en OAR afin de pouvoir continuer d'offrir des services financiers à compter du 1er avril 2000. Le problème qui se pose dans ce cas est celui de l'articulation des activités judiciaires des avocats qui sont protégées par le secret professionnel auquel on ne saurait porter atteinte sans danger et leurs activités financières exercées à titre professionnel. Autrement dit, dans quelles circonstances un avocat ou un notaire acquiert-il la qualité d'intermédiaire financier ? Le Tribunal fédéral distingue entre l'activité spécifique de l'avocat et son activité commerciale pour déterminer l'étendue du droit de refuser de témoigner en application du secret professionnel et estime qu'il faut raisonner au cas par cas en fonction des circonstances concrètes. La justice fédérale a ainsi considéré que « lorsqu'un avocat est en même temps membre du conseil d'administration d'une société et est, en cette dernière qualité, sommé de produire, dans la faillite de la société, tous les documents d'affaire, il y a lieu de distinguer entre la correspondance d'affaire de la société et les documents internes de l'avocat. Seule doit être produite la correspondance de celle-ci avec l'avocat. Lorsque l'avocat détient à la fois certains documents pour lui-même et pour la société, il doit compléter et produire les documents d'affaire de la société de manière appropriée. » (Arrêt du Tribunal fédéral, Recueil III, 114ème volume (1988), page 105.) Le Tribunal fédéral classe toutefois au rang des activités non spécifiques de l'avocat la gestion de fortune ou le placement d'argent, opérations qui sont en général effectuées par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banques. En revanche, il n'y a pas d'activité d'intermédiaire financier lorsque les avocats ou les notaires acceptent, gardent en dépôt, placent ou transfèrent des valeurs patrimoniales dans le cadre d'un mandat relevant de leur activité spécifique d'avocat pour laquelle ils remplissent auprès des banques le formulaire R (exemple : partage successoral, liquidation d'un régime matrimonial). Cette distinction donne lieu à des situations alambiquées. Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une vente immobilière, le notaire qui reçoit une somme d'argent de son mandant et la dépose à la banque pour acquitter le prix de la vente et les frais de mutation n'est pas un intermédiaire financier. Non soumis à la L.B.A., il n'a pas à effectuer les procédures de diligences prévues par ce texte, mais peut en revanche opposer le secret professionnel sur l'identité de la personne propriétaire des fonds qu'il représente. D'un côté, l'avocat ou le notaire estime qu'il appartient à la banque de vérifier l'origine de l'argent déposé sur le compte pour acheter l'immeuble et, de façon générale, de procéder à toutes les diligences. De son point de vue, la banque peut considérer que les procédures ont été effectuées par le notaire ou l'avocat qui connaissent leurs clients. Dans un tel cas, le mécanisme est semblable à celui précédemment décrit concernant une augmentation de capital. Si l'argent destiné à acheter un immeuble est déposé directement à la banque, celle-ci procédera aux vérifications d'usage ; en revanche, si ces fonds sont déposés par un notaire ou un avocat, ces procédures peuvent ne pas être appliquées. Les agents immobiliers ne sont pas considérés non plus comme des intermédiaires financiers lorsqu'ils se contentent de mettre en relation vendeurs et acheteurs, lorsqu'ils indiquent un avocat, un notaire ou un banquier, ou lorsqu'ils donnent un conseil pour le financement d'opérations. Dans ce cas, aucune vigilance, aucune des obligations posées par la L.B.A. n'est exigée de ces professionnels. De façon générale, l'Autorité de contrôle applique le critère de la gestion active des fonds pour déterminer si une personne agit ou non en tant qu'intermédiaire financier. Ainsi, l'Autorité de contrôle considère que le notaire qui reçoit des valeurs dans le cadre d'une succession n'est pas un intermédiaire financier si son activité est limitée à l'exécution du partage ; en revanche, si ce notaire est titulaire d'un mandat de gestion, accordé par les héritiers d'une succession indivise, il devient intermédiaire financier. Une fois encore, la L.B.A. qui se borne à définir le cercle des personnes visées, leurs devoirs fondamentaux et les mesures d'organisation de la surveillance à leur endroit 24, a laissé à l'appréciation de l'Autorité de contrôle le soin de préciser la notion d'intermédiaire financier, ce qui a conduit à établir des distinctions innombrables, source de nombreuses incertitude juridiques. 2.- Des intermédiaires financiers en nombre pléthorique L'autorégulation entraîne une lourdeur de gestion résultant, à l'opposé, de la prise en compte d'une multitude d'intermédiaires financiers, de petite dimension et de faible niveau d'activité, qui désormais relèvent de la LBA. La LBA ne prévoyant pas de seuil minimum à partir duquel les intermédiaires financiers doivent s'affilier, l'Autorité de contrôle est tenue d'examiner tous les cas qui se présentent à elle et ceux-ci sont en réalité beaucoup plus nombreux que ce qui avait pu être initialement envisagé. L'évaluation qui a pu être entreprise du nombre d'intermédiaires financiers s'est heurtée au fait qu'en dehors du canton du Tessin qui dispose d'un registre des gestionnaires de fortune, les autres cantons ne disposent pas d'un tel outil de surveillance administrative. Combien y a-t-il en Suisse de gérants de fortune, d'avocats d'affaires, de gestionnaires de sociétés offshore, etc. ? Personne ne le sait véritablement. La Fédération suisse des avocats compte 7 700 membres, celle des notaires 1 500, mais ces chiffres ne représentent pas la totalité des membres de ces deux professions. Les gestionnaires de fortune indépendants constituent une catégorie d'intermédiaires financiers très disparate ; on y trouve des sociétés, des particuliers, des avocats ou des notaires... Les sociétés elles-mêmes sont de taille variable ; elles peuvent compter des dizaines d'employés comme deux ou trois personnes. Ces situations aboutissent à des résultats très divers. Certains dénombrent 450 sociétés gestionnaires de fortune, d'autres estiment qu'il y aurait 1 000 intermédiaires gérants de fortune en incluant les fiduciaires et les gestionnaires individuels, tels que les anciens employés de banque. Si l'on ajoute à cela les notaires et les avocats, d'autres avancent le chiffre de 10 000 gérants de fortune. Les grandes banques évaluent à environ 1 500 le nombre de gestionnaires de fortune agissant à titre professionnel. C'est ce chiffre qu'a retenu pour ses travaux la commission Zufferey dans son rapport sur la surveillance des marchés financiers. Selon ce même rapport, les gestionnaires de fortune indépendants en Suisse auraient 100 milliards de francs suisses - 400 milliards de francs français - sous gestion « en retenant les chiffres les plus prudents. » Les négociants en valeurs mobilières non bancaires sont évalués à 120 selon le rapport de la commission Zufferey. Il existe parallèlement des négociants en valeurs mobilières bancaire puisque pratiquement toutes les banques autorisées en Suisse ont demandé à pouvoir exercer cette activité ; il y a donc environ 400 négociants en valeurs mobilières bancaires qui relèvent de la CFB et de la loi fédérale sur les bourses. Les « autres prestataires de services financiers » regroupent quantité de métiers dont les experts de la commission Zufferey reconnaissent qu'il est « impossible pour les autorités d'avoir en l'état une vision précise » et que « les organismes professionnels ne sont pas à même de fournir des renseignements plus décisifs. » Au total, l'Autorité de contrôle estime à l'heure actuelle qu'il y a plus de 4 500 intermédiaires financiers affiliés aux OAR et environ 3 000 autres intermédiaires qui ne se sont pas fait connaître. Actuellement, l'Autorité de contrôle doit encore examiner 550 cas « d'adhérents directs » en attente d'autorisation et ce chiffre des dossiers en souffrance va encore augmenter. Cette situation a alarmé les parlementaires suisses membres des Commissions de gestion et a mis en évidence l'insuffisance notoire des moyens accordés à l'Autorité de contrôle, face à l'ampleur de la tâche qui a été grandement sous-évaluée. B.- DES PREMIERS RÉSULTATS PEU CONCLUANTS Au départ, le choix de l'autorégulation n'était pas apparu comme la meilleure solution, puisque l'avant-projet de loi de la LBA renonçait au système d'autorégulation et laissait aux seules Autorités de surveillance définies par la loi le pouvoir de faire respecter les obligations de diligence du secteur financier. L'autorégulation a finalement prévalu. 1.- Une Autorité de contrôle contestée Les intermédiaires financiers doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation (OAR) ou, à défaut, demander une autorisation d'exercer à l'Autorité de contrôle, organe administratif faisant partie intégrante de l'Administration fédérale des finances. L'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation : « Les buts généraux de l'Autorité de contrôle sont de garantir que tout intermédiaire financier actif en Suisse soit soumis à une surveillance, soit d'une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale, comme la Commission fédérale des banques, par exemple, soit parce qu'il s'est affilié à un organisme d'autorégulation, soit parce qu'il nous est soumis. » (Mme Natacha Polli, ex-directrice-adjointe de l'Autorité de contrôle, 29 septembre 1999). Si l'Autorité de contrôle retire la reconnaissance à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de l'Autorité de contrôle, à laquelle ils doivent demander l'autorisation d'exercer leur activité s'ils ne se rattachent pas à un autre organisme d'affiliation dans les deux mois. Actuellement, douze organismes d'autorégulation ont été reconnus par l'Autorité de contrôle, parmi lesquels on peut citer la Poste ou les chemins de fer fédéraux, l'Association suisse des gérants de fortune (ASG), la Fédération suisse des avocats et des notaires, l'organisme d'autodiscipline des fiduciaires du canton du Tessin, l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF), l'Union suisse des fiduciaires, l'Association suisse des sociétés de leasing ou l'Organisme d'autorégulation du Groupement suisse des conseils en gestion indépendants et du Groupement patronal des gérants de fortune de Genève. Les OAR se constituent donc à partir d'un critère professionnel et/ou géographique. A ce jour, deux OAR ont vu leur demande d'agrément refusée par l'Autorité de contrôle. Il faut rappeler que les tâches attribuées à chaque OAR sont lourdes et qu'il convient par conséquent de s'entourer de toutes les garanties avant d'autoriser un OAR. Chaque OAR doit s'assurer que les intermédiaires financiers affiliés respectent les obligations de diligence posées par la LBA - ce qui suppose que son indépendance soit garantie et qu'il dispose d'un mécanisme de contrôle efficace et de procédures de sanctions éprouvées. Par ailleurs, la LBA n'étant qu'une loi-cadre, elle se borne à énumérer les obligations de diligence. Ce sont donc les OAR qui devront préciser ces devoirs dans leurs règlements, en tenant compte des besoins des intermédiaires financiers qui leur sont rattachés. Le règlement des OAR est lui-même approuvé par l'Autorité de contrôle. La mise en place d'un tel mécanisme est donc longue et difficile, comme l'indiquait l'ex-directrice adjointe de l'Autorité de contrôle.
Mme Natacha POLLI : « La plupart ne sont pas adossés à une association professionnelle préexistante ou ont des problèmes d'indépendance. Certains sont animés par des personnes, qui pensent qu'il y a là un marché à trouver et qui ont de la peine à comprendre qu'elles doivent avoir un nombre minimum d'intermédiaires financiers affiliés. Il est exclu de reconnaître un organisme d'autorégulation avec un potentiel de quarante à cinquante membres, par exemple, car garantir l'indépendance des structures vis-à-vis des affiliés est absolument impossible. Tous ces organismes d'autorégulation, y compris ceux qui reposent sur une organisation professionnelle préexistante, rencontrent des problèmes financiers. Bien souvent, une ou deux personnes physiques, voire une société, ont dû avancer de l'argent pour mettre en place l'organisme d'autorégulation. [...] Alors que les intermédiaires financiers sont en train de déposer leurs demandes d'autorisation, notre gros problème est que les organismes d'autorégulation ne sont toujours pas indépendants, même ceux qui ont été reconnus. Ils ont toujours besoin d'une aide énorme de l'Autorité de contrôle afin de s'organiser. Ils ont beaucoup de peine à se mettre en place et à proposer un projet terminé. Les organismes d'autorégulation ont encore grand besoin de notre aide pour pouvoir travailler de façon efficace. Le temps passé avec les organismes d'autorégulation est tout bénéfice pour nous dans la mesure où cela s'appliquera à des centaines d'intermédiaires financiers si cela fonctionne, mais tout le temps consacré encore aux organismes d'autorégulation nous empêche de nous consacrer pleinement aux demandes d'autorisation des intermédiaires financiers. » Extrait de l'entretien de la Mission avec Mme Natacha Polli, ex-directrice adjointe de l'Autorité de contrôle, en septembre 1999 Ce système apparaît donc dans toute sa lourdeur, qui en compromet l'efficacité, d'autant que les responsabilités de l'Autorité de contrôle ne se bornent pas à octroyer ou retirer la reconnaissance aux organismes d'autorégulation. Aux termes de l'article 18, al. 1er de la LBA, il lui appartient aussi : - de surveiller les OAR et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis - par le moyen, notamment, de contrôles sur place (al ; 2) ; - d'approuver les règlements édictés par les OAR et les modifications qui y sont apportées ; - de veiller à ce que les OAR fassent appliquer ces règlements ; - de préciser, à l'intention des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, les obligations de diligence auxquelles ils sont astreints et d'en régler les modalités d'application. Très rapidement pourtant, l'Autorité de contrôle a exercé son pouvoir de surveillance et n'a pas hésité à dénoncer plusieurs dizaines d'intermédiaires financiers dont elle estimait qu'ils ne respectaient pas les obligations de la LBA. Ces décisions, de nature administrative, ont pour certaines fait l'objet d'un recours devant les autorités fédérales du ministère des Finances dont dépend l'Autorité de contrôle. A ce jour, l'Autorité de contrôle n'a pas été suivie par sa hiérarchie. Le département de M. Kasper Villiger a notamment qualifié de non fondées les dénonciations pénales effectuées par l'Autorité de contrôle à l'encontre de deux intermédiaires financiers exerçant sans les autorisations nécessaires. Dans un tel cas, ces derniers se seraient trouvés passibles d'une amende pouvant atteindre 200 000 FS - 800 000 francs français -, le défaut d'affiliation pouvant également conduire à l'interdiction d'exercice d'activité. L'Autorité de contrôle, loin d'être encouragée dans son action, est parfois vivement critiquée dans la presse, certains allant jusqu'à l'accuser d'être « une véritable copie du maccarthysme » et de pénaliser les petites structures.
L'Autorité suisse de contrôle contre le blanchiment d'argent dans le secteur non bancaire commence à inquiéter la place financière par sa dureté et son manque de dialogue. [...] Le retour du maccarthysme : il faut savoir que la lutte contre le blanchiment, qui touche de nombreux membres de la place financière helvétique, est perçue par beaucoup comme une tâche utile et nécessaire partagée par les OAR et dont les contraintes sont jugées acceptables. Pour d'autres, cette tâche devient pourtant un véritable cauchemar du fait de l'attitude de l'Autorité de contrôle. Des témoignages recueillis par l'Agefi tendent en effet à démontrer que l'Autorité de contrôle exagère étrangement sa chasse aux « sorcières ». « Une véritable copie du maccarthysme », selon les termes d'un financier très remonté. Retour sur les origines d'un conflit qui pourrait rapidement tourner à la confrontation. Des plaintes pénales humiliantes et évitables : les intermédiaires financiers cherchant à s'affilier à un OAR après la date du 1er avril 2000 ont l'obligation d'adresser leur demande directement à l'Autorité de contrôle basée à Berne. Beaucoup d'entre eux ont récemment eu la désagréable surprise de recevoir une plainte pénale administrative émanant de l'administration des finances à la suite de leur demande d'affiliation. Une procédure pénale humiliante basée uniquement sur l'énoncé des activités de sociétés ne cherchant qu'à régulariser leur situation. [...] Une lutte qui pénalise encore plus les petites structures : on imagine facilement le désarroi de nombreux intermédiaires financiers qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps ou de l'argent dans ce qui s'apparente fort à des futilités administratives. Sans oublier les coûts supplémentaires pour les fiduciaires qui ont dû engager ou former des spécialistes LBA. A tel point que la chasse au blanchiment d'argent semble aujourd'hui plus pénalisante pour les petits professionnels que pour les grands établissements rompus aux démarches fédérales. Il faut rappeler qu'un intermédiaire financier n'est pas forcément doté d'une structure puissante. Il peut être actif dans les milieux du négoce, de l'hôtellerie, des fiduciaires, des agences de voyages ou même du change de stations de service. Les coûts d'inscription aux OAR ainsi que les pesanteurs administratives liées aux demandes d'affiliation ne sont pas toujours à la portée des petites sociétés. Extraits de l'article de M. Edouard Bolleter dans l'AGEFI du 5 octobre 2000. La réalité est qu'il y a aussi de très nombreux récalcitrants qui n'acceptent pas de se soumettre à une législation jugée lourde et coûteuse. Parmi les plus opposés à l'application de la LBA, figureraient les négociants en matières premières, les maisons de négoce, les agences de voyage ou les hôteliers. Le problème s'est concrètement posé pour l'hôtellerie, le responsable de l'Autorité de contrôle, M. Niklaus Hubert, considérant que les hôteliers, dans le cadre de leurs activités de change, devaient se soumettre aux obligations de la LBA et s'affilier. Puisque les activités de change réalisées dans les bureaux ouverts par les chemins de fer fédéraux sont soumises à la LBA, la cohérence voudrait qu'il en soit de même lorsque le change est effectué dans les hôtels. Cette décision a provoqué de vives réactions de la profession qui s'est considérée comme persécutée par la bureaucratie. Le directeur du Montreux Palace a notamment déclaré à la presse : « Je refuse de m'affilier à un quelconque OAR. Les montants qui font l'objet d'une opération de change dans mon hôtel sont en effet ridicules. Je ne suis pas contre la lutte anti-blanchiment, mais j'estime simplement que les frais à consentir sont beaucoup trop élevés. » (Extrait d'un article de la Tribune de Genève du 30 novembre 2000). On ne peut toutefois pas exclure que les blanchisseurs préféreront s'adresser aux hôtels pour blanchir en une ou plusieurs fois leur argent liquide si cette opération n'est pas contrôlée. C'est pourquoi l'Autorité de contrôle a estimé qu'en l'absence de seuil fixé par la loi, les activités de change effectuées par les hôtels, quels qu'en soient les montants, restent soumises à la LBA et que les hôteliers doivent s'affilier. Le cas des négociants en matières premières est également préoccupant, ces derniers ne s'estimant pas concernés par la L.B.A. alors que leurs activités les exposent indéniablement à des réseaux d'activités criminelles ou de blanchiment. Pour l'Autorité de contrôle : « Dès l'instant où il y a une relation contractuelle préalable entre un négociant et le client à qui il destine les matières premières, il devient un intermédiaire financier au sens de la L.B.A. » 25 A cela, les intéressés rétorquent que personne n'est en mesure de définir une matière première et soulignent les contraintes excessives posées par ce texte : un coût d'affiliation d'environ 2 500 FS la première année puis de 1 500 FS les autres années - soit environ 10 000 et 6 000 francs français - la nécessité pour le négociant de s'assurer que le client n'a rien à se reprocher, etc. Le recours de M. Marc Rich, prêt à aller jusqu'au Tribunal fédéral, est devenu significatif de ce vif mécontentement. Le porte-parole de ce riche négociant en matières premières installé à Zoug affirmait : « Nous faisons des affaires pour notre propre compte, nous ne sommes en aucun cas un intermédiaire financier [...] La L.B.A. est la seule loi au monde à être aussi restrictive pour les négociants. Vous n'imaginez pas le travail que cela représente de devoir s'y conformer. » La récente affaire de trafic d'armes avec l'Angola impliquant deux trafiquants notoires et dans le cadre de laquelle la justice française a entendu un certain nombre de personnalités politiques, fait apparaître que la plupart des contrats d'armement signés par l'Angola auraient été financés grâce aux revenus du pétrole et que les transactions auraient été organisées par l'entreprise Glencore basée en Suisse à Zoug, société dans laquelle M. Marc Rich détiendrait des intérêts. Il n'est donc pas excessif d'exiger de ces professionnels qu'ils relèvent de la L.B.A.
L'affaire n'est pas banale, même selon les normes particulières de la politique française. Dans les dernières semaines, des personnalités allant du fils de François Mitterrand, Jean-Christophe, à l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, en passant par Jacques Attali, ancien président de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), ont été l'objet de perquisitions menées par la justice française. Celle-ci s'intéresse aux relations entre ces figures de la classe politique et un duo bien connu dans le monde des marchands d'armes, le Français Pierre F., incarcéré préventivement pour « commerce illicite d'armes » et fraude fiscale, et l'Israélo-Russe Arkadi G., recherché internationalement. Ces deux hommes, qui furent longtemps les principaux fournisseurs d'armes du gouvernement angolais, ont entretenu d'étroites relations d'affaires avec certaines entreprises suisses. [...] La plupart des contrats d'armement signés par l'Angola sont financés grâce aux revenus du pétrole, dont le pays est un important producteur. D'un montant de 553 millions de dollars (environ 940 millions de francs), la transaction avec ZTS-Osos a été organisée par Arkadi G. et l'entreprise suisse Glencore, basée à Zoug et spécialiste du négoce de matières premières. Selon une source bien informée, Arkadi G., qui s'est rendu à plusieurs reprises en Suisse, entretenait de bonnes relations avec Glencore, mais aussi avec l'ancienne UBS, qui possédait à l'époque une division active dans le financement de l'exploration pétrolière en Angola. Le Temps du 16 décembre 2000, article de M. Sylvain Besson Cette actualité récente illustre à point l'enjeu représenté par l'entrée en vigueur de la L.B.A. considérée comme inutile par certains et indispensable par d'autres. Certains représentants d'OAR comme l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) font pour leur part une analyse positive de la LBA.
Inapplicable, la loi sur le blanchiment d'argent ? « Pas du tout », affirme sans peur Irina Perret, de l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF). [...] « Certaines sociétés vont être liquidées ? Nous sommes obligés de passer par-là. Il fallait s'attendre à ce genre de restrictions. La place financière n'en sera que mieux assainie », poursuit-elle. A l'ARIF, la mise en place de la LBA est perçue plutôt comme une bonne chose. La loi comble un vide. « Auparavant, le secteur parabancaire vivait sans aucune réglementation. L'arrivée de la LBA chamboule bien sûr pas mal d'entreprises, mais nous sommes là pour les aider à se conformer à la loi ». Aux petites sociétés qui s'inquiètent pour leur avenir, Irina Perret répond d'ailleurs qu'elles sont loin d'avoir tout vu. « Bientôt, tous les types d'activités financières requéreront une licence. Les procédures seront longues avant de pouvoir démarrer une société. » Et l'experte d'ajouter que la LBA n'est, après tout, pas si restrictive que cela. « J'ai vu des sociétés étrangères venir récemment s'installer en Suisse parce que les normes en la matière sont encore plus sévères dans leur pays. La Suisse s'est dotée d'une loi sur le blanchiment certes dure au début, mais qui, à terme, portera ses fruits et contribuera à la préservation des intérêts de la place financière helvétique. » La Tribune de Genève du 19 décembre 2000, article de Mme Florence Noël. Dans ce contexte tendu, l'Autorité de contrôle subit énormément de pressions dues à la quantité de travail mais aussi des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, des politiciens qui défendent les intérêts du secteur privé et surveillé. A ce jour, la participation des intermédiaires financiers à la lutte anti-blanchiment reste encore notoirement insuffisante. 2.- Des intermédiaires financiers qui ont du mal à jouer le jeu En raison de la lourdeur du processus, l'application de la LBA aux intermédiaires financiers s'est déroulée en deux phases. L'obligation de communiquer et sa conséquence, le blocage des avoirs, sont applicables depuis le 1er avril 1998, date de l'entrée en vigueur de la LBA. S'agissant des obligations de diligence (vérification de l'identité du cocontractant, identification de l'ayant droit, obligation de clarification...), le non-respect de ces obligations n'a pu être sanctionné qu'à compter du 1er avril 2000. En conséquence, pour respecter cette date butoir fixée par la L.B.A., chaque intermédiaire financier a dû s'organiser pour mettre à niveau au 31 mars 2000 au plus tard, l'ensemble de sa documentation afin de satisfaire aux obligations de diligence 26. Monsieur Didier de Montmollin, membre du comité exécutif de l'OAR des avocats et des notaires, a ainsi récapitulé le calendrier d'application de la LBA aux intermédiaires financiers. « S'agissant de l'obligation de communiquer les soupçons, nous n'aurons pas la compétence pour sanctionner lorsqu'il s'agit d'une situation antérieure au 1er avril 1998 puisqu'une telle obligation n'existait pas antérieurement à cette date. Quant au principe « Know your customers », que le dossier ait été ouvert avant ou après le 1er avril 1998 ne fera aucune différence, dans la mesure où le dossier est toujours en cours à la date cruciale du 1er avril 2000. Pour la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 1er avril 2000, nous vérifierons la conformité avec l'article 9 LBA relatif à l'obligation de communiquer. Ensuite nous élargirons notre champ d'investigation en l'étendant à l'ensemble de la LBA et de la réglementation de l'OAR, à compter du 1er avril 2000. C'est ainsi que cela devrait fonctionner. » En conséquence, les intermédiaires financiers doivent mettre à niveau le contenu de leurs anciens dossiers qui doivent désormais contenir les informations concernant l'identité du cocontractant ou l'identification de l'ayant droit économique. En pratique, les choses se révèlent beaucoup plus malaisées. S'agissant du respect des obligations de diligence, la question fondamentale reste celle du règlement des affaires en cours. Concernant l'obligation de communiquer, on ne peut que constater, non sans une réelle inquiétude, les résultats dérisoires enregistrés par le Bureau de communication, s'agissant du nombre de déclarations effectuées par les intermédiaires financiers non bancaires. a) Les intermédiaires financiers peinent à apurer le passé Depuis le 1er avril 2000, les intermédiaires financiers doivent procéder aux obligations de diligence, dans le cadre des nouveaux contrats, mais aussi s'agissant des dossiers ouverts antérieurement et qui sont toujours en cours. C'est ce qu'ont confirmé deux responsables d'OAR à la Mission. Depuis le 1er juillet, l'OAR de la Chambre fiduciaire a entrepris une première série de contrôles opérés par des réviseurs externes auprès de ses affiliés, pour s'assurer du respect des dispositions légales. Un premier bilan devait être établi en janvier 2001 au vu des premiers rapports des réviseurs externes. Maître Didier de Montmollin, responsable de l'OAR des avocats, a précisé que les contrôles des affiliés commencés à l'automne 2000 permettraient d'avoir examiné la situation d'un tiers des adhérents en mars 2001. Concrètement, cela signifie donc, au rythme d'un tiers des adhérents contrôlés chaque année, que la fin du processus de vérification des membres de l'OAR des avocats s'achèvera au printemps 2003. De l'avis même du chef de l'Autorité de contrôle, cette mise en conformité des dossiers est lourde à réaliser et demandera encore du temps et, surtout, elle est pour l'instant très difficile à vérifier pour l'Autorité de contrôle elle-même, qui doit, pour le moment, achever les premières phases du processus de l'autorégulation, à savoir l'agrément et la formation des affiliés et des OAR. Les responsables de différents OAR, sur ce sujet de l'apurement du passé, se sont d'ailleurs contentés de réponses convenues. De fait, l'Autorité de contrôle ne semble pas avoir encore eu le temps matériel de procéder à des contrôles systématiques. Même s'il y a eu des contrôles et des dénonciations concernant des cas ponctuels de violations de la LBA, cette Autorité n'a toutefois rien lancé sur une grande échelle. Tant que les intermédiaires financiers affiliés à des OAR n'ont pas reçu la formation adéquate, ils ne sont pas à même de faire des communications, car ils ne savent pas ce qu'est un soupçon et ne connaissent pas leurs obligations. Il y a là un réel problème. Les chiffres témoignent en effet du fait que les intermédiaires financiers sont encore très loin de remplir leurs obligations et notamment l'obligation de communiquer au Bureau de communication tout soupçon fondé de blanchiment. b) Les intermédiaires financiers ne font pas de déclarations de soupçons Le Bureau de communication a reçu au total 370 communications pour l'année 1999-2000. Seules, 57 d'entre elles sont le fait d'intermédiaires financiers non bancaires. Ce résultat dérisoire témoigne, de fait, de la non-entrée en application de la L.B.A. dans les habitudes des acteurs économiques du secteur parabancaire. La ventilation des 57 annonces faites par les intermédiaires financiers se décompose comme suit :
- Gestionnaires de fortune 19 - Prestataires de services en trafic des paiements 14 - Fiduciaires 9 - Avocats 6 - Assurances 4 - Entreprises de cartes de crédit 3 - Négociants en valeurs mobilières 2 Total 57 Source : 2ème rapport d'activité du MROS, 1999-2000, p. 25 Face à ces résultats quasi-invisibles, on ne peut que souscrire aux sobres propos de l'ancien responsable du Bureau de communication, M. Daniel Thelesklaf : « La participation du secteur non bancaire est encore bien en dessous des attentes. » Les intermédiaires financiers éprouvent une certaine répugnance à procéder à de telles déclarations qui sont ressenties comme des opérations qui entachent la réputation de leurs établissements et non pas comme l'expression d'une vigilance et d'un comportement vertueux.
M. le Rapporteur : Combien y a-t-il eu de communications au Bureau depuis deux ans ? Me Didier de MONTMOLLIN ; Je n'ai pas de chiffres spécifiques aux avocats. D'après mes souvenirs, il y a eu environ 370 communications. M. le Rapporteur : Combien en provenance des avocats de votre OAR ? Me Didier de MONTMOLLIN : En l'occurrence, encore aucune. Par chance, nous n'avons pas eu de cas qui ont dû être rapportés. Mais cette mise en place est encore très récente [...] M. le Rapporteur : Alors qu'ils fonctionnent depuis plus d'une année, tous les OAR que nous rencontrons ne communiquent aucune information au Bureau de communication et n'ont jamais sanctionné aucun de leurs membres. Au même moment, la France est confrontée à des situations dans lesquelles on retrouve des fiduciaires et des avocats suisses qui blanchissent de l'argent dont la provenance s'est révélée illégale. Me Didier de MONTMOLLIN : Il y a là une question de temps. La loi n'est entrée en vigueur de manière partielle que le 1er avril 1998 et dans sa totalité, le 1er avril 2000. S'il y avait eu manquement à l'obligation de communiquer un soupçon avant l'entrée en vigueur de ces OAR, M. Huber aurait eu le pouvoir de proposer qu'une sanction soit prononcée par la section compétente de l'administration fédérale. Vous devez vous informer auprès de lui pour savoir s'il a eu ou non à utiliser ce pouvoir. Un intermédiaire financier qui viole l'article 9 ou 10 de la LBA est sanctionnable par le biais de M. Huber dès le 1er avril 1998. Toutefois, les OAR ne sont opérationnels que depuis le 1er avril 2000. Pour le moment, il serait prématuré de tirer des conclusions. Les statistiques, publiées par le bureau de M. Thelesklaf, démontrent que la plupart des annonces émanent encore principalement des banques. Cependant les banques, avant l'entrée en vigueur de la LBA, avaient déjà, depuis1997, une convention de diligence. D'où une sensibilisation plus grande qui a eu le temps de s'instaurer. Extrait de l'entretien de la Mission avec Me Didier de Montmollin, avocat au Barreau de Genève, en septembre 2000 A entendre de nombreux intervenants, tout ne serait qu'une simple affaire de temps et l'avenir de l'autorégulation semble se présenter pour le mieux du point de vue des OAR et ce processus devrait, à lui seul, permettre de lutter efficacement contre les risques de blanchiment des capitaux. Or ici ou là, des réflexions laissent à penser qu'il faudrait réagir plus largement en adoptant des législations complémentaires. Ainsi, le 21 août 2000, Mme Salika Wenger, parlementaire membre de l'Alliance de Gauche, a déposé à Genève au Grand Conseil, un projet de loi visant à empêcher les avocats inscrits au Barreau genevois de faire partie des conseils d'administration, sauf s'il s'agit d'une entité publique. Mme Wenger estime notamment que « trop d'avocats sont impliqués dans des affaires financières et qu'il faut empêcher la confusion des tâches » et que trop d'avocats « ont tendance à aider les entreprises à contourner les lois. » 27
Article 1 : La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est modifiée comme suit : Article 7, alinéa 2 (nouveau) : Un avocat inscrit au tableau des avocats ne peut être administrateur, associé, gérant ou représentant d'une personne morale à but lucratif, sauf s'il s'agit d'une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public, ou lorsqu'il assume la gestion de son patrimoine privé. [...] Extrait du Projet de loi déposé au Parlement du canton de Genève, le 21 août 2000 La question de la surveillance et d'une réglementation de la profession des gestionnaires de fortune indépendants, qui ne sont actuellement contrôlés que sous l'angle du respect de la législation anti-blanchiment, a été par ailleurs clairement posée par la commission Zufferey chargée de réfléchir à la surveillance des marchés financiers. S'agissant des gestionnaires de fortune indépendants qui font régulièrement l'objet de plaintes ou de réclamations de la part de leur clientèle, la commission a estimé que « l'absence actuelle de réglementation pour les gestionnaires de fortune indépendants en Suisse ou à partir de la Suisse ne correspond donc plus au standard en matière de gestion » et a conclu à la nécessité d'une réglementation des gestionnaires de fortune indépendants prévoyant notamment une autorisation fédérale de pratiquer, des garanties de solidité financière, l'existence de règles claires en matière de rémunération des gestionnaires, etc. Le rapport Zufferey souligne toutefois que cette nouvelle réglementation « exigera de la Confédération qu'elle mette à disposition les ressources administratives nécessaires et procède dans ce contexte à une comparaison des coûts et bénéfices qui en résulteront, faute de quoi il serait préférable de s'abstenir de toute nouvelle réglementation... » Il n'est donc pas interdit de s'inquiéter lorsque la presse fait régulièrement état d'affaires de blanchiment de capitaux où finissent par se retrouver en Suisse, fiduciaires, gérants de fortune ou avocats. Face à cela, l'atonie des OAR n'en est que plus préoccupante. 1.- L'utilisation des fiduciaires En juin 1997, le procureur général du canton de Genève, Bernard Bertossa, estimait qu'en l'an 2000, la majorité des Etats d'Europe et d'Amérique du Nord serait dotée de normes juridiques théoriquement destinées à lutter contre le blanchiment, mais que le combat des policiers et des magistrats n'était pas pour autant gagné. A l'appui de sa déclaration, le procureur de Genève citait deux exemples de circulation de l'argent du crime inspirés d'enquêtes qui avaient été menées à Genève.
1. X fait partie d'une bande de trafiquants spécialisée dans l'importation de cocaïne aux Etats-Unis. Les profits considérables qu'il retire de cette activité parviennent finalement en Suisse après avoir transité par des banques bahaméennes. Les comptes ouverts en Suisse le sont aux noms de sociétés « off shore » gérées par des fiduciaires. Ces comptes sont vidés au profit d'hommes de paille, qui font transporter les fonds dans un autre pays européen, d'où ils reviennent en Suisse, sur d'autres comptes bancaires ouverts aux noms d'autres sociétés exotiques. 2. La multinationale Y, basée dans le pays A, souhaite obtenir un important marché public dans le pays B. Au moyen de la « caisse noire » qu'elle a constituée, elle alimente le compte d'un avocat suisse, qui alimente à son tour le compte mis à sa disposition par un confrère. Tous ces transferts sont effectués au moyen de chèques bancaires au porteur. C'est également ce procédé qui est utilisé pour remettre les fonds, à la faveur de plusieurs centaines d'opérations, à des intermédiaires ressortissants du pays B, qui font créditer les chèques au profit d'autres ressortissants du même pays, auprès d'autres banques suisses. Les « décideurs » du pays B, ou leurs représentants, reçoivent les fonds à la faveur d'opérations de compensation. Ces exemples illustrent bien les obstacles auxquels les autorités judiciaires sont confrontées. La Tribune du 3 juin1997, article de M. le Procureur Bernard Bertossa - Blanchiment de l'argent : la justice impuissante Des comptes bancaires accueillants, des sociétés off shore qui en sont titulaires, des fiduciaires qui gèrent ces structures, des avocats qui interviennent et procèdent à des transactions diverses. Tous les acteurs sont là. Une rapide lecture de la presse française depuis ces cinq dernières années fait apparaître très régulièrement le rôle joué par des fiduciaires, se trouvant en Suisse, pour faire transiter ou recevoir des fonds douteux et confirme que les mécanismes décrits ci-dessus n'ont pas disparu. On peut ainsi citer pêle-mêle : - A propos de l'affaire Schuller, le juge d'instruction s'est rendu en compagnie d'une magistrate genevoise au siège de la fiduciaire Veripol dont plusieurs hommes politiques français avaient utilisé les services pour effectuer des transferts de fonds à Genève (Libération du lundi 20 mars 1995). - Dans l'affaire Sointra concernant la surfacturation du prix du blé dans un contrat avec le Yémen, les factures en cause ont été rédigées en Suisse par deux sociétés off shore au siège d'une fiduciaire genevoise. Les contrats ont donné lieu au versement de commissions suspectes de l'ordre de 3,6 millions de francs versés sur des comptes ouverts à la Société de Banques Suisses de Genève (SBS) (Libération du 1er juillet 1996). - Une avocate est radiée du barreau de Paris à la suite d'un détournement de fonds de clients de 16 millions de francs en 1992. Elle avait créé une société fiduciaire suisse et mis au point des « contrats de fiducie » pour lesquels elle proposait des placements à rendement mirobolant (dépêche AFP du mardi 3 mars 1998). - Concernant l'affaire Dumas, les enquêteurs retrouvent la trace d'un fax adressé par Mme Christine Deviers-Joncour au gestionnaire suisse de ses comptes bancaires, le financier Carlo Pagani, dirigeant d'un cabinet fiduciaire à Lugano, par lequel elle demande le retrait de 6 millions de francs (Le Monde du samedi 28 novembre 1998). - Dans le cadre des escroqueries réalisées aux dépens de l'Association pour la recherche sur le cancer (l'ARC) et estimées entre 200 et 300 millions de francs, en 1998, le juge d'instruction a recueilli le témoignage d'une dirigeante suisse de sociétés fiduciaires ayant participé au blanchiment de quelque 100 millions de francs entre 1983 et1996, détournés par l'ARC (dépêche AFP du samedi 6 février 1999). - Dans l'affaire de la MNEF, M. Pelletier a récupéré fin 1991, à Lyon, par les soins d'une fiduciaire suisse, 1,2 million de francs en espèces qu'il avait déposé quatre ans plus tôt sur un compte en banque à Zürich (Le Monde du jeudi 1er avril 1999). - Le CDS avait un compte en Suisse au nom de deux fiduciaires, Jacques et Sun Investissement, alimentées par un bureau d'études qui collectait les fonds auprès des entreprises (Libération du 6 décembre 1999). - Les commissions versées à Jean-Claude Méry par les entreprises attributaires de marchés publics parisiens étaient placées sur un compte ouvert à l'Union des Banques Suisses (UBS) au nom de la société panaméenne Farco Entreprise, elle-même administrée par une société fiduciaire genevoise Gestoval (Le Monde du 23 septembre 2000). - Le détournement de plusieurs dizaines de millions de francs depuis 1997 des comptes d'associations d'aide aux handicapés vers la société fiduciaire suisse Dominator qui avait fait à nouveau transiter ces fonds vers une autre fiduciaire avant qu'ils ne disparaissent ainsi que les dirigeants de la société (Le Monde du 6 octobre 2000). Au risque de lasser le lecteur, nous cesserons là cette énumération mais cette liste ne constitue qu'un aperçu et n'épuise pas la réalité. Certaines des affaires évoquées se sont déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi LBA mais à une époque où s'appliquait déjà la Convention de diligence des banques que certaines fiduciaires, faisant de la gestion de fortune, avaient elles aussi décidé de respecter. b) L'atonie de la Chambre fiduciaire Aujourd'hui, de tels mécanismes sont toujours utilisés et devraient désormais déclencher des réactions de la part des OAR ou de l'Autorité de contrôle chargée de surveiller les sociétés fiduciaires dans leur activité de gestion de fortune ou de gestion de sociétés. Or il ne semble pas que de telles informations aient suscité des réactions particulières de la part des intermédiaires financiers non bancaires qui sont pourtant, depuis le 1er avril 1998, assujettis aux dispositions de la LBA concernant l'obligation de communiquer. Entendu par la Mission, le président de l'OAR de la Chambre fiduciaire, a indiqué que son organisme avait reçu l'agrément de l'Autorité de contrôle dès avril 1999, qu'il s'était doté d'un règlement propre et qu'il était prêt à fonctionner avant même la date d'entrée en application du volet de la LBA concernant les intermédiaires financiers. Néanmoins, fin septembre 2000, comme M. André Cuendet l'a confirmé à la Mission, « aucun cas n'est passé par l'OAR de la Chambre Fiduciaire ». Selon le président Cuendet, cette situation s'explique par des critères exigeants d'affiliation à cette OAR et le fait que la très bonne réputation de ses membres se répercute au niveau global de l'OAR. Ainsi, sur les 350 « membres - entreprises » inscrits à l'OAR de la Chambre fiduciaire qui est la principale des deux associations patronales, aucun ne s'est trouvé impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Rappelons que l'OAR compte également, parmi ses membres, des « membres - personnes physiques », qui sont plusieurs milliers. En septembre 2000, le Bureau de communication n'avait donc reçu aucune annonce en provenance d'un membre de cette OAR, qu'il s'agisse d'une affaire postérieure au 1er avril 2000 ou d'un cas ayant pris naissance avant cette date. Interrogé sur la résolution de ces cas antérieurs au 1er avril 2000, le président Cuendet a précisé ainsi la situation :
« M. le Rapporteur : Dans ces sociétés fiduciaires affiliées, comment le règlement de votre OAR va-t-il s'appliquer sur les dispositifs et dossiers en cours ? M. André CUENDET : Sur la base de notre règlement, nos membres ont eu l'obligation de créer des dossiers de surveillance s'agissant de toutes leurs relations d'affaires sensibles au sens de la LBA effectives à la date d'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les relations pouvant remonter à plusieurs décennies. Ils ont dû créer des dossiers dans la mesure où ils n'existaient pas. Les fiduciaires qui font de la gestion de fortune devaient déjà, avant l'entrée en vigueur de la LBA, appliquer l'esprit de diligence, de la même manière que les banques. D'une manière générale, ce sont plutôt les petits bureaux qui ont quelques difficultés à s'adapter. Sur la base des contrôles commencés dès le 1er juillet, nous ferons un bilan. Nous sommes dans une période de transition car la loi vient d'entrer en vigueur. » Extrait de l'entretien de la Mission avec M. André Cuendet, président de l'OAR de la Chambre fiduciaire, septembre 2000 La Mission en est arrivée à la conclusion que toutes les fiduciaires évoquées dans les articles de presse précités n'appartenaient pas à l'OAR de la Chambre fiduciaire et doivent être membres d'une autre OAR, qui néglige ses obligations d'annonce et de diligence. Un cas cependant mérite une attention particulière, celui de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) ou, plus exactement, de sa filiale française. Selon les propos tenus à votre rapporteur par l'ancien mandataire social de la Banque Cantonale de Genève à Lyon, M. Bernard Monnot, la BCGE réalisait des opérations de blanchiment en recourant au mécanisme de la fiduciaire.
« M. Arnaud MONTEBOURG : Vous allez nous expliquer en quoi, à vos yeux, les bilans de la Banque cantonale de Genève, pour les exercices 1996 et 1998, apportent la démonstration qu'il y aurait des activités de blanchiment au sein de cette banque. M. Bernard MONNOT : Le mécanisme utilisé peut difficilement être plus simple. Un chef d'entreprise dépose une somme - et c'est son affaire - par exemple un million, à la Banque cantonale de Genève à Genève. A ma connaissance, jamais personne à Lyon n'a imaginé que la filiale française prêtait la main à cet aspect-là, c'est-à-dire que les Lyonnais ou les Savoyards font leur affaire de déposer une somme X au guichet de la Banque cantonale de Genève en Suisse. La Banque cantonale de Genève, faisant du blanchiment en bande organisée et à échelle industrielle, a créé - ce dont je tiens confirmation de M. Subra lui-même - une fiduciaire censée regrouper juridiquement, probablement à leur insu, car cela ne leur plairait pas de savoir qu'ils sont dans une seule société, les déposants français qui ont mis cet argent à Genève. M. Arnaud MONTEBOURG : Vous voulez dire que la Banque cantonale de Genève maison mère contrôle les ayants droit économiques d'une société fiduciaire en Suisse... M. Bernard MONNOT : Oui. Le banquier dépositaire étant la Banque cantonale de Genève à Genève, mais la structure juridique une société fiduciaire, cet argent permettait aux déposants d'obtenir un crédit de même montant en France. Les Suisses étant particulièrement précis, tout indique que c'est au centime près le montant qui est dans la fiduciaire qui a été reprêté à court terme à la filiale française pour faire rigoureusement le même montant de crédit en France à des entreprises françaises. » Extrait de l'entretien avec le rapporteur de M. Bernard Monnot, ancien mandataire social de la BCGE de Lyon, le 21 octobre 1999 Entendu à son tour, M. Etienne Subra, ancien responsable de la Banque de France pour la région lyonnaise a fait les déclarations suivantes :
« M. Arnaud MONTEBOURG : [...] Vous confirmez l'existence d'une fiduciaire et vous expliquez qu'il n'est pas démontré que ce sont les clients de la Banque cantonale de Genève à Lyon qui entreposeraient leur argent pour obtenir une contrepartie sous forme de crédits à Lyon. M. Etienne SUBRA : Je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre première conclusion. M. Arnaud MONTEBOURG : Je vous en prie, vous pouvez la rectifier. M. Etienne SUBRA : Quand vous dites que je confirme l'existence d'une fiduciaire, non, je suis désolé ; je n'ai pas connaissance d'une fiduciaire ; je l'apprends aujourd'hui. M. Arnaud MONTEBOURG : Je crois que dans ce que vous avez dit précédemment, vous avez indiqué que vous connaissiez l'existence d'une fiduciaire et qu'à vos yeux elle n'était pas interdite. M. Etienne SUBRA : Non, pas exactement. [...] Je crois qu'il faut préciser les choses. Bernard Monnot m'avait dit en effet que la Banque cantonale de Genève utilisait la fiducie dans ses relations avec certains de ses clients ; pardonnez-moi, il faut rectifier en effet, je n'ai jamais eu connaissance, ni par lui ni par d'autres voies, de l'existence d'une société fiduciaire à proprement parler, c'est-à-dire d'un mécanisme monté par la Banque cantonale de Genève à Genève pour participer à tout l'échafaudage que Bernard Monnot vous a décrit ; je rectifie en effet ce qui est une erreur de ma part ou un malentendu. Bernard Monnot m'a parlé effectivement de l'existence de fiducie au sens juridique du terme, mais dans l'environnement de la Banque cantonale de Genève, il ne m'en a jamais parlé, ou je l'ai oublié ; il ne m'a jamais parlé, je serai très clair là-dessus, d'une véritable société ; c'est la seule contradiction que je me permets d'apporter à votre conclusion. » Extrait de l'entretien avec le rapporteur de M. Etienne Subra, ancien responsable de la Banque de France pour la région lyonnaise, le 12 novembre 1999 Malgré l'existence d'éléments troublants dont elle a eu connaissance, il semble que la Commission bancaire française ait fait preuve à l'égard de la filiale lyonnaise d'une certaine mansuétude et qu'elle ait choisi de se placer prioritairement sur un plan strictement prudentiel, plutôt que d'envisager la situation de cet établissement au regard du risque de blanchiment des capitaux. La Mission a, pour sa part, estimé qu'il convenait au contraire de porter à la connaissance des autorités judiciaires les éléments d'information qu'elle a pu recueillir dans le cadre de ses travaux. Aujourd'hui, la Banque cantonale de Genève est dans une situation difficile. A la fin des années 90, ses dirigeants se sont lancés dans une politique aventureuse d'octroi de crédits à des spéculateurs immobiliers et, fin 1999, les fonds propres de la BCGE ont atteint un ratio de 3 % par rapport aux « positions pondérées en fonction du risque » au lieu des 8 % exigés par l'ordonnance fédérale. Soutenue par la puissance publique, une Fondation de valorisation des actifs a été instituée par une loi du 19 mai 2000, afin d'y transférer 5 milliards de crédits à risque gagés par des biens immobiliers. Plusieurs plaintes ont été déposées contre les organes de la BCGE, notamment pour « faux dans les titres », « gestion déloyale » de la part de l'audit externe, « omission de transmission de renseignements » à la Commission fédérale des banques, « blanchiment d'argent » via sa succursale française. Plus généralement, le cas de la BCGE illustre l'utilisation détournée des mécanismes classiques de la fiducie. Le dernier rapport du GAFI sur les typologies du blanchiment de capitaux 28 consacre un large développement à l'utilisation des fiducies et autres formations juridiques, telles que les établissements (Anstalts), fondations (Stifting ou Stichting) ou trusts, comme mécanismes actifs du blanchiment permettant de masquer l'identité du bénéficiaire ou du propriétaire de fonds d'origine criminelle. Les experts du GAFI insistent sur le fait que « les fiducies peuvent être exploitées pour brouiller un peu plus les liens entre le produit et l'activité illégale qui l'a généré et qu'elles servent notamment à occulter les divers aspects de mouvements de fonds liés à des mécanismes de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale. » Il convient par conséquent d'anéantir l'anonymat protecteur détourné à des fins criminelles, rendu possible par ces procédés juridiques de type fiducie, et de réglementer plus que sévèrement la constitution de telles structures juridiques. A l'initiative de la Mission, l'Assemblée nationale vient d'adopter, dans le cadre de la législation sur les nouvelles régulations économiques une disposition visant à contrôler plus sévèrement toutes les opérations financières faisant intervenir des structures juridiques opaques. La Mission approuve donc pleinement les propositions émises par le GAFI visant à faciliter les enquêtes relatives aux affaires de blanchiment de capitaux impliquant des fiducies.
· Etablir une réglementation relative à la constitution des fiducies et à l'agrément des professionnels intervenant dans ces opérations. La création d'un tel dispositif supposerait nécessairement d'imposer à ces professionnels d'appliquer les mêmes mesures préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux que celles qu'emploient les institutions financières (à savoir, l'identification des clients, la conservation d'enregistrements, la déclaration d'opérations suspectes) et de recourir à des procédures convenables d'inspection afin de veiller au respect de ces dispositions. · Réglementer la forme des fiducies. Etablir des normes dans ce domaine pourrait passer par l'imposition d'une documentation normalisée aux fiducies qui pourrait varier en fonction des types de fiducies et pourrait prévoir l'abolition ou l'interdiction de certains types de fiducies (par exemple, « fiducies en aveugle » ou « fiducies à trou noir », etc.) ou encore de certains aspects dommageables comme les « clauses de fuite » ou la possibilité pour le fiduciant de conserver le contrôle des actifs (à savoir les fiducies de protection d'actifs). · Imposer une obligation d'immatriculation aux fiducies. Instaurer une obligation d'immatriculation des fiducies garantirait une certaine transparence de ces montages juridiques ; toutefois, cela risque de se heurter à une forte résistance dans certaines juridictions pour des raisons à la fois pratiques et éthiques. Quelques juridictions imposent déjà l'immatriculation des fiducies auprès d'un registre central, principalement à des fins fiscales. En revanche, la plupart des juridictions dans lesquelles les fiducies existent n'ont pas de procédure d'immatriculation de ces structures. Une solution de compromis pourrait consister à inscrire les fiducies dans des registres auxquels seules les institutions financières et les autorités d'enquête et de tutelle publiques auraient accès. Une autre solution consisterait à n'imposer l'immatriculation qu'aux fiducies présentant certaines caractéristiques (couvrant des actifs d'une valeur supérieure à un certain seuil ou lorsque la fiducie est établie à des fins spécifiquement commerciales, par exemple). Point 30 du rapport du GAFI du 1er février 2001 sur les typologies du blanchiment de capitaux (2000-2001). IV.- UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE À GÉOMÉTRIE VARIABLE En 1996, une poignée de magistrats européens lancent « l'Appel de Genève » pour faire connaître aux opinions publiques la difficulté de leur combat contre l'Europe du crime organisé et de la délinquance financière, cette « Europe de l'ombre » qui gangrène et menace l'Europe des citoyens. Ils dénoncent la partie inégale qui se joue entre les criminels dont les capitaux circulent à grande vitesse et les magistrats auxquels des années sont nécessaires « pour retrouver la trace de cet argent, quand cela ne s'avérera pas impossible », en raison du refus de coopérer de nombreux territoires offshore. La coopération judiciaire à l'échelle du continent européen reste la seule chance pour lutter efficacement contre cette criminalité astucieuse. En septembre 1998, plusieurs parlementaires de la nouvelle Assemblée élue en 1997 ont pris l'initiative d'inviter les magistrats européens premiers signataires de « l'Appel de Genève » pour les assurer d'un soutien politique et ont décidé, à l'issue de cette rencontre, de créer une Mission d'information chargée d'identifier les obstacles à la lutte contre le blanchiment de l'argent dans les différents pays d'Europe.
Conseil de l'Europe, traité de Rome, accords de Schengen, traité de Maastricht : à l'ombre de cette Europe en construction visible, officielle et respectable, se cache une autre Europe, plus discrète, moins avouable. C'est l'Europe des paradis fiscaux qui prospère sans vergogne grâce aux capitaux auxquels elle prête un refuge complaisant. C'est aussi l'Europe des places financières et des établissements bancaires, où le secret est trop souvent un alibi et un paravent. Cette Europe des comptes à numéro et des lessiveuses à billets est utilisée pour recycler l'argent de la drogue, du terrorisme, des sectes, de la corruption et des activités mafieuses. Les circuits occultes empruntés par les organisations délinquantes, voire dans de nombreux cas criminelles, se développent en même temps qu'explosent les échanges financiers internationaux et que les entreprises multiplient leurs activités, ou transfèrent leurs sièges au-delà des frontières nationales. Certaines personnalités et certains partis politiques ont eux-mêmes, à diverses occasions, profité de ces circuits. Par ailleurs, les autorités politiques, tous pays confondus, se révèlent aujourd'hui incapables de s'attaquer, clairement et efficacement, à cette Europe de l'ombre. A l'heure des réseaux informatiques d'Internet, du modem et du fax, l'argent d'origine frauduleuse peut circuler à grande vitesse d'un compte à l'autre, d'un paradis fiscal à l'autre, sous couvert de sociétés offshore, anonymes, contrôlées par de respectables fiduciaires généreusement appointées. Cet argent est ensuite placé ou investi hors de tout contrôle. L'impunité est aujourd'hui quasi assurée aux fraudeurs. Des années seront en effet nécessaires à la justice de chacun des pays européens pour retrouver la trace de cet argent, quand cela ne s'avérera pas impossible dans le cadre légal actuel hérité d'une époque où les frontières avaient encore un sens pour les personnes, les biens et les capitaux. Pour avoir une chance de lutter contre une criminalité qui profite largement des réglementations en vigueur dans les différents pays européens, il est urgent d'abolir les protectionnismes dépassés en matière policière et judiciaire. Il devient nécessaire d'instaurer un véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront, sans entraves autres que celles de l'Etat de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours. Nous demandons la mise en application effective des accords de Schengen prévoyant la transmission directe de commissions rogatoires internationales et du résultat des investigations entre juges, sans interférence du pouvoir exécutif et sans recours à la voie diplomatique. Nous souhaitons, au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la signature de conventions internationales entre pays européens : · garantissant la levée du secret bancaire lors de demandes d'entraide internationale en matière pénale émanant des autorités judiciaires des différents pays signataires, là où ce secret pourrait encore être invoqué ; · permettant à tout juge européen de s'adresser directement à tout autre juge européen ; · prévoyant la transmission immédiate et directe du résultat des investigations demandées par commissions rogatoires internationales, nonobstant tout recours interne au sein de l'Etat requis ; · incluant le renforcement de l'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. A ce propos, dans les pays qui ne le connaissent pas, nous proposons la création d'une nouvelle incrimination d' « escroquerie fiscale » pour les cas où la fraude porte sur un montant significatif et a été commise par l'emploi de man_uvres frauduleuses tendant à dissimuler la réalité. A cette fin, nous appelons les parlements et gouvernements nationaux concernés : · à ratifier la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990* relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ; · à réviser la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 ; · à prendre les mesures utiles à la mise en _uvre effective des dispositions du titre VI du traité de l'Union européenne du 7 février 1992 et de l'article 209 A du même traité ; · à conclure une convention prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement les nationaux coupables d'actes de corruptions à l'égard d'autorités étrangères. Par cet appel, nous désirons contribuer à construire, dans l'intérêt même de notre communauté, une Europe plus juste et plus sûre, où la fraude et le crime ne bénéficient plus d'une large impunité et d'où la corruption sera réellement éradiquée. Il en va de l'avenir de la démocratie en Europe et la véritable garantie des droits du citoyen est à ce prix. * Bernard Bertossa, Edmondo Bruti Liberati, Gherardo Colombo, Benoît Dejemeppe, Baltasar Garzon Real, Carlos Jimenez Villarejo, Renaud Van Ruymbeke. C'est depuis la Suisse que ce combat a été lancé et la Mission tenait à rendre à nouveau un hommage appuyé à tous ceux des magistrats ou anciens magistrats suisses qui, comme MM. Bernard Bertossa, Paul Perraudin, Jacques Ducry, Paolo Bernasconi, Kaspar Ansermet ou Luca Marcellini, mettent toute leur énergie dans ce travail contre la criminalité économique. Ces magistrats ont fait de la coopération judiciaire internationale un élément-clé de cette lutte. Toutefois, la nature fédérale de la Suisse aboutit à faire coexister des réalités fort différentes d'un canton à l'autre, puisque ces derniers disposent d'une très large autonomie en matière judiciaire. De façon générale, la Suisse a développé sa coopération judiciaire sur la base de multiples conventions bilatérales qu'elle accorde sous la double réserve importante de l'exception fiscale et de l'existence de voies de recours qui entrave encore l'efficacité de l'entraide. 1.- Fondements de la coopération suisse La coopération judiciaire suisse se fonde sur une série de textes internationaux ou bilatéraux, complétés par des dispositions de droit interne. La Convention européenne d'entraide judiciaire internationale en matière pénale du 20 avril 1959 (ceej) a été ratifiée par la Suisse, où elle est applicable depuis le 20 mars 1967. Des accords visant à la compléter et à faciliter son application ont, par la suite, été conclus avec la République fédérale d'Allemagne (13 novembre 1969), l'Autriche (13 juin 1972) et la France (28 octobre 1996)29. La Suisse et la France ont signé un traité additionnel, en vigueur depuis le 1er mai 2000, qui vise à simplifier et accélérer l'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux pays. Les autorités judiciaires peuvent désormais s'adresser directement des demandes d'entraide sans passer par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police ou du ministère français de la justice. La CEEJ régit la procédure probatoire, mais ne contient aucune disposition relative à la saisie ou à la confiscation des valeurs. Ces questions sont réglées par la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, en vigueur en Suisse depuis le 1er septembre 1993. Les relations d'entraide avec les Etats-Unis sont régies par un traité spécial sur l'entraide judiciaire en matière pénale (25 mai 1973), qui a été complété par diverses notes - en matière, notamment, d'entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires à des requêtes portant sur des délits d'initiés - et un mémorandum d'interprétation (Memorandum of understanding, 10 novembre 1987). En outre, un certain nombre d'accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels la Suisse est partie, contiennent des dispositions sur l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale : il s'agit, par exemple, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, de la Convention internationale contre la prise d'otages, des conventions relatives à la répression de la traite des êtres humains, de l'esclavage, du faux monnayage ou du trafic de stupéfiants. Le droit interne est constitué par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (eimp) du 20 mai 1981, qui réglemente de manière globale cette entraide. Cette loi n'est applicable que si les traités en vigueur ne prévoient pas expressément ou implicitement une autre solution (art. 1er, al. 1er). Comme il est cependant rare que les traités internationaux se prononcent sur le mode d'exécution d'une requête d'entraide judiciaire et qu'ils se contentent fréquemment de renvoyer cette question aux dispositions du droit interne de l'Etat requis, la loi eimp conserve une grande importance pratique : elle décrit en effet le détail de la procédure d'entraide et détermine notamment les moyens juridiques dont disposent les personnes visées par une telle requête. En outre, elle trouve à s'appliquer dans le silence des traités - par exemple, en matière de remise du produit de l'infraction (art. 74, al. 2) - voire, en l'absence de tout traité, pour déterminer les conditions auxquelles l'entraide peut être accordée (art. 1 à 6, 27 à 29, 63 à 67 et 76). La loi EIMP est complétée par une ordonnance du Conseil fédéral du 24 février 1982, qui contient les dispositions réglementaires d'exécution de la loi (O-EIMP). L'entraide pénale suisse est accordée sous réserve de l'ouverture préalable d'une procédure pénale par l'Etat requérant. Ce principe connaît cependant des assouplissements. La justice suisse a notamment admis, dans une décision de la Cour de droit public du 21 décembre 1990, relative à l'affaire Marcos, que « bien que l'Etat requérant n'ait pas encore ouvert de véritable poursuite pénale, les renseignements demandés peuvent néanmoins lui être transmis, étant destinés à lui servir de moyens de preuve dans la procédure qu'il s'est clairement engagé à introduire à bref délai... ». Le tribunal fédéral a donc autorisé, en l'espèce, la transmission des pièces bancaires détenues par la Société de Banque suisse. L'entraide pénale suisse répond par ailleurs au principe de spécialité et n'est par conséquent accordée que si les autorités requérantes utilisent les éléments de la demande aux fins d'investigation ou comme moyen de preuve dans une procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est octroyée. En application de ce principe, l'utilisation c'est à dire la communication aux autorités douanières et fiscales, des résultats de l'entraide judiciaire est exclue. Quant aux requêtes d'entraide provenant des Etats-Unis, elles sont exécutées conformément à la loi du 3 octobre 1975 relative au traité d'entraide de 1973, dont la principale différence avec l'EIMP réside dans le fait que les demandes d'entraide présentées par les Etats-Unis relèvent systématiquement de la compétence de l'Office fédéral de justice. L'entraide judiciaire suisse en matière pénale est à géométrie variable selon l'Etat requérant. Le régime particulier accordé aux Etats-Unis et à eux seuls par le traité du 25 mai 1973 et la loi fédérale du 3 octobre 1975 prise sur son fondement, l'attestent. Les Etats-Unis bénéficient ainsi d'un périmètre d'entraide judiciaire bilatérale étendu, à leur profit, à la lutte contre le crime organisé (art. 6 du traité). Par cette expression, « il faut entendre une association ou un groupe de personnes constitué pour une période relativement longue ou indéterminée, afin de se procurer ou de procurer à autrui des revenus ou d'autres avantages financiers ou économiques par des moyens partiellement ou totalement illégaux et de mettre ses activités illicites à l'abri de poursuites pénales, et qui, systématiquement et méthodiquement, cherche à parvenir à ses fins (...) en commettant ou en menaçant de commettre, pour une partie de son activité tout au moins, des actes de violence ou d'intimidation punissables dans les deux Etats ou [s'efforce] d'exercer une influence sur la politique ou l'économie, notamment sur les institutions ou les organisations politiques, les administrations publiques, la justice, les entreprises commerciales, les syndicats patronaux ou ouvriers ou d'autres associations d'employés » (id., al. 3). Les Etats-Unis bénéficient aussi d'une centralisation de la procédure au niveau de l'Office central de justice : c'est ainsi que « si l'exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons (...), l'office central peut charger une seule autorité de l'exécution » (loi du 3 octobre 1975, art. 3, § 2) et que l'office « peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. » (id., § 3). L'Office central peut ordonner, sur requête de l'Office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques ou de préserver des moyens de preuve. A la différence du droit commun de la procédure d'entraide, les l'opposition et le recours formés contre ces décisions n'ont pas d'effet suspensif (art. 8, § 4). Dans ce pays qui se dit si attaché aux droits de l'homme, les Etats-Unis ont même obtenu que l'accès des ayant droits au dossier puissent être limité si « l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis l'exige » (art. 9, § 2, a) ! Surtout, les recours introduits contre la procédure au moment de sa clôture n'ont pas, en principe, d'effet suspensif (art. 19a, § 1). Par ailleurs, les Etats-Unis ont obtenu une extraterritorialisation de leur droit processuel : c'est ainsi que l'interrogatoire des personnes intéressées « peut être effectué conformément au droit de procédure américain » (art. 21 a,, § 1) si l'objet de cet interrogatoire « semble essentiel pour l'issue de la procédure américaine » (id., § 2, a). Cette formulation est si générale que seuls des actes mineurs apparaissent pouvoir y échapper... Une part essentielle de la coopération internationale de la Suisse s'effectue au sein de l'Union européenne, avec des pays appartenant à l'espace Schengen. Dans une intervention devant l'Association suisse des banquiers à Saint-Gall, Mme Ruth Metzler-Arnold, conseillère fédérale pour la Justice, remarquait le 1er septembre dernier que cette coopération se heurtait à des difficultés non négligeables : « Pour des raisons évidentes, il serait important, côté suisse, d'être partie au Système d'information Schengen. Celui-ci est aujourd'hui en fonctionnement dans presque tous les Etats membres de l'Union européenne. Il permet de rechercher, au plan international, des personnes et des objets à l'aide d'une banque électronique de données. « Malgré les divers efforts que nous avons consentis, nous n'avons pas encore réussi à nous relier à ce système. L'Accord de Schengen ayant été entre-temps incorporé au droit communautaire, il nous est pratiquement impossible d'en être partie, à part entière, vu que nous ne sommes pas membre de l'Union européenne. [...] Du fait de la ratification des accords bilatéraux avec l'Union européenne et leur mise en _uvre, un changement de paradigmes s'impose dans la politique européenne de la Suisse. Alors que jusqu'à présent, les considérations économiques primaient, la sécurité intérieure et la migration seraient, en premier lieu, concernées lors de nouvelles négociations avec l'Union européenne. » La Suisse a compensé cette difficulté avec la signature de multiples accords de coopération policière avec ses voisins et notamment avec la France. L'accord relatif à la coopération en matière policière et douanière signé entre la Suisse et la France en mai 1998 est finalement entré en vigueur le 1er octobre 2000. En pratique, cette coopération repose depuis cette date sur des procédures simplifiées et la possibilité d'exercer, en cas de délits graves, un droit de poursuite. Lorsque les policiers français pénétreront en Suisse, ils aviseront le centre de coopération police-douane (C.C.P.D.) et, inversement, celui-ci transmettra aux autorités nationales compétentes. Cet accord doit permettre la transmission d'informations sans requête formelle ainsi que l'échange de données relatives aux recherches de personnes et d'objets. La Suisse a conclu des accords bilatéraux du même type avec ses pays limitrophes et entend, par ce biais, éviter de devenir une plaque tournante de la criminalité transfrontalière et de la migration illégale. 2.- L'exception fiscale et sa dérogation, l'escroquerie fiscale En matière de coopération judiciaire internationale, la Suisse refuse son assistance dans une série de cas d'exceptions classiques : · Violation des articles 5 - irrégularité de la détention, non-communication à l'intéressé des motifs de son arrestation, absence de contrôle du juge, etc. - et 6 - respect des droits de la défense, droit à être jugé par un tribunal ordinaire, respect de la présomption d'innocence - de la Convention européenne des droits de l'homme ; · Poursuites engagées sur le fondement des opinions politiques, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou à une ethnie, de la religion ou de la nationalité, etc. ; · Violation du principe du Non bis in idem - c'est-à-dire, lorsqu'une autorité étrangère sollicite une assistance dans une affaire qui a déjà fait l'objet d'une procédure pénale menée par les autorités suisses ; · Atteinte aux intérêts essentiels de la Suisse. Mais, outre ces hypothèses de type classique, la Suisse refuse également d'accorder l'entraide judiciaire en matière fiscale : « La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique » (art. 3, al. 3, eimp). La Suisse n'a pas ratifié le protocole additionnel n° 99 du 17 mars 1978 à la ceej du 20 avril 195930. Ce choix apparaît comme l'ultime expression de la stratégie suisse de captation des capitaux étrangers, sans considération de leur origine. Dans ce but, la Confédération a décidé d'adopter une conception large de l'infraction fiscale, puisqu'il s'agit de « tout acte destiné à réduire une contribution fiscale, c'est-à-dire qui a pour but la soustraction d'impôts, de droits de douane ou d'autres contributions publiques »31. Au principe du refus de l'entraide en matière fiscale, la Suisse admet néanmoins trois exceptions pour lesquelles elle accepte d'accorder l'entraide : · d'une part, lorsque cette procédure vise à décharger la personne poursuivie (art. 63, al. 5 eimp) · d'autre part, dans le cadre de la convention passée avec les Etats-Unis, lorsque la demande concerne la poursuite pénale de membres dirigeants du crime organisé aux Etats-Unis. · enfin lorsqu'il s'agit non plus d'évasion fiscale, mais d'escroquerie fiscale, situation qui mélange délit fiscal et délit pénal. Le principe semble simple. Lorsque la procédure étrangère vise une infraction qui, en Suisse, peut être qualifiée d'escroquerie en matière fiscale, l'entraide judiciaire peut être accordée (art. 3, al. 3 eimp), son application ne l'est guère. L'article 24, al. 1er O-EIMP définit l'escroquerie en matière fiscale comme une « escroquerie en matière de contributions au sens de l'article 14, al. 2 » de la loi fédérale sur le droit pénal administratif c'est-à-dire par exemple la soustraction frauduleuse de redevances commise au moyen d'indications fausses, falsifiées ou matériellement inexactes32. Les surfacturations33 ou le recours à des intermédiaires fictifs ont ainsi été considérés comme des escroqueries en matière de contributions. Pour que l'entraide judiciaire soit alors accordée, il faut qu'il résulte de façon évidente de l'exposé des faits que les éléments constitutifs de l'escroquerie en matière fiscale sont réunis d'après le droit suisse. En la matière, le Tribunal fédéral a défini une jurisprudence particulièrement rigoureuse : l'Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants quant à l'existence de l'escroquerie et, à cet effet, joindre à sa demande copie des documents prétendument falsifiés. A ce degré d'exigence, il ne s'agit plus de soupçons, mais presque déjà de preuves. Il existe donc, en théorie, une possibilité pour les Etats requérants d'obtenir de la Suisse une entraide en matière fiscale lorsque celle-ci admet l'escroquerie fiscale. Pour la Suisse il y a escroquerie fiscale ou plus exactement « escroquerie en matière de prestations ou de contributions » « lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l'emprisonnement pour un an au plus ou l'amende jusqu'à concurrence de 30 000F » En cas de doute sur le point de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas d'escroquerie fiscale, l'Office fédéral de la justice requiert l'avis de l'administration fédérale des contributions. Différents interlocuteurs rencontrés par la Mission ont confirmé cette procédure et reconnu qu'actuellement le nombre de demandes d'entraide sur cette base restait encore faible, de l'ordre d'une trentaine par an, contre une quinzaine dans les années 1980. Pourtant, selon le professeur Paolo Bernasconi, cette disposition pourrait être beaucoup plus largement utilisée qu'elle ne l'est, dans la mesure où toute entreprise qui soustrait une partie de ses résultats au fisc le fait en procédant à une falsification de documents et se trouve, de ce fait, punissable pour fraude ou escroquerie fiscale.
M. Paolo BERNASCONI : Au point de vue fiscal, vous connaissez la législation suisse et son fameux article 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Le principe traditionnel et historique veut que la Suisse ne donne aucune coopération en matière fiscale. Il y a des exceptions dans les conventions contre la double imposition, mais cela n'est pas déterminant car la convention est mise en application seulement sur demande du contribuable. Puis il y a l'exception de ce principe, la plus importante étant depuis 1983 celle de l'article 3. Vous avez trois types d'entraide, l'extradition des personnes, l'extradition des moyens de preuve et l'extradition des produits des infractions. En matière fiscale, il n'y a pas d'extradition de personnes, mais cela pourrait venir, il suffirait de ratifier le protocole de la Convention européenne d'extradition. Il n'y a pas non plus d'extradition du produit de la fraude fiscale, mais il y a la remise de moyens de preuve concernant la fraude fiscale. C'est une exception colossale. En effet, une entreprise inscrite au registre du commerce a l'obligation de tenir une comptabilité, un bilan, etc. Par conséquent, si l'entreprise commet une soustraction fiscale, elle le fait moyennant une falsification de documents, soit une facture, le bilan... Potentiellement, cette exception est colossale car toute entreprise qui commet une soustraction fiscale est, par définition, punissable de fraude fiscale. Il est très facile de commettre une soustraction fiscale qualifiée comme fraude fiscale, mais quelle est la réalité ? L'Office fédéral de la police a reçu, depuis 1983, en moyenne une dizaine ou une quinzaine de demandes d'entraide en matière de fraude fiscale. Une moitié a été acceptée, l'autre refusée. Pendant les années 90, cela a augmenté à peut-être trente demandes d'entraide par an. Pourquoi si peu de demandes d'entraide ? En fait, les pays d'origine sont les pays scandinaves, l'Angleterre et l'Allemagne mais dans les länders proches de la frontière. Quant à l'Italie, elle n'avait jamais fait de demande d'entraide en matière fiscale jusqu'à cette année. Le ministère public de Milan a fait une demande d'entraide dans le cadre d'une très grosse affaire impliquant cinq cents entreprises italiennes. Cette demande va certainement fausser les statistiques. En fait, cette demande a été faite par un seul magistrat et ne concerne qu'une seule affaire. L'Italie n'avait jamais jusqu'alors présenté une seule demande d'entraide pour fraude fiscale, alors qu'ils en connaissent la possibilité. Lorsque la norme est entrée en vigueur en 1983, je me rappelle que le journal interne de la Guardia di Finanza portait à sa une « Fini le secret bancaire suisse ». Il est clair que le Tribunal fédéral suisse est très généreux en matière d'entraide pénale, mais moins généreux en matière fiscale. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. le Professeur Paolo Bernasconi, en septembre 2000 En pratique, les magistrats tessinois ont indiqué qu'ils recherchaient autant que possible, avec leurs collègues des Etats requérants, à faire évoluer le dossier faisant apparaître un délit fiscal mais qu'en cas de fraude fiscale caractérisée avec falsification de documents, l'assistance du Tessin est parfois plus facile à obtenir qu'en se fondant sur d'autres motifs.
M. Luca MARCELLINI : Pour le reste, nous observons que les pays de l'Union européenne qualifient parfois différemment le même genre de faits. On le voit très bien par rapport à la fraude fiscale. Par exemple, pour le même genre d'activités délictueuses, l'Italie préfère invoquer l'infraction de contrebande, ce qui n'est pas suffisant pour nous pour agir et n'utilise pratiquement jamais la fraude fiscale pour demander l'assistance, ce qui pourrait être plus simple pour nous, tandis que l'Allemagne le fait fréquemment. M. le Rapporteur : Combien de fois par an opposez-vous l'excuse fiscale ? M. Luca MARCELLINI : C'est très rare. En général, on prend contact avec l'autorité requérante et on essaie de faire évoluer le dossier. M. Jacques DUCRY : Chaque demande, sauf celles envoyées directement selon l'article 15 chiffre 2 de la CEAJ, arrive à Berne qui fait un examen préliminaire avant de nous transmettre pour un examen plus approfondi, la décision d'entrée en matière et l'exécution. M. le Rapporteur : Nous avons rencontré à l'Office fédéral de la police, l'année dernière, la personne chargée de faire ce filtrage. En France, au ministère de la Justice, nous recevons beaucoup de rejets pour irrecevabilité sur la base de l'excuse fiscale directement invoquée par Berne. Quand un juge français fait apparaître un délit fiscal, celui-ci est en quelque sorte absorbant des autres délits connexes qui peuvent être graves et suffit à lui seul pour justifier l'irrecevabilité de la commission rogatoire par la Confédération helvétique. Il est intéressant de signaler aux pays qui cherchent la collaboration du Tessin qu'ils peuvent vous contacter par téléphone avant de lancer leur commission rogatoire. [...] M. Luca MARCELLINI : Lorsqu'ici nous recevons une commission rogatoire à caractère fiscal, si nous-mêmes avons des doutes quant à la recevabilité de la demande pour fraude fiscale, nous transmettons généralement le cas à l'administration fédérale des contributions, laquelle contrôle si, selon le droit suisse, ladite infraction fiscale pourrait être qualifiée de fraude fiscale. Pour ma part, j'ai toujours reçu des confirmations. Mme Maria GALLIANI : Moi aussi. Depuis cinq ou six mois, on reçoit de Berne des commissions rogatoires déjà assorties de l'accord de l'administration fédérale des contributions. M. le Rapporteur : Nous interrogerons Berne sur cette question. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Luca Marcellini, Procureur général du canton du Tessin, en septembre 2000 Considérant qu'il y avait là la preuve d'une attitude positive de la part des autorités fédérales suisses acceptant plus largement l'entraide judiciaire dans des dossiers contenant des éléments de caractère fiscal, la Mission a souhaité obtenir à ce sujet des précisions complémentaires et a adressé aux autorités suisses, le 17 octobre 2000, le questionnaire suivant : 1. L'Office fédéral de la police reçoit chaque année un certain nombre de demandes d'entraide pour fraude fiscale. Pourriez-vous nous indiquer, depuis une dizaine d'années, le nombre annuel de ces demandes qui vous parviennent et si possible nous préciser quels en sont les pays d'origine. 2. La Suisse ne reconnaît pas en matière fiscale l'extradition des personnes, ni celle du produit de la fraude fiscale, elle admet en revanche l'extradition de moyens de preuve concernant la fraude fiscale. Pourriez-vous nous préciser en la matière quelle est actuellement la doctrine tant de l'administration fiscale fédérale que des autorités judiciaires chargées d'examiner les demandes internationales d'entraide concernant cette distinction entre évasion fiscale et fraude fiscale. 3. Pourriez-vous nous dire combien d'affaires sont actuellement traitées par la justice suisse sur la base de cette infraction pour fraude fiscale. En réponse à ce courrier, les autorités suisses ont simplement indiqué que la Division de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la Justice recevait en moyenne 1500 demandes d'entraide chaque année et qu'environ 50 d'entre elles concernaient des cas de fraude fiscale et douanière.
M. Beat FREY, chef de la section de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police : C'est un domaine assez complexe. La Suisse a de bonnes raisons d'avoir choisi le système actuel, mais c'est assez difficile à comprendre lorsque l'on ne connaît pas toutes les idées qui le sous-tendent. Les juges d'instruction à l'étranger ne savent pas toujours suffisamment que la Suisse ne refuse pas l'entraide judiciaire en matière pénale pour des raisons d'ordre fiscal. La Suisse peut l'accorder pour des cas d'escroquerie en matière fiscale. Le problème est d'établir la distinction entre une escroquerie en matière fiscale et le simple non-paiement des impôts. L'explication est difficile. Quand je dois l'expliquer à un collègue suisse, cela me prend une demi-heure, quand je dois l'expliquer à un collègue étranger, je lui demande de m'adresser sa demande en lui indiquant qu'après examen de l'état de fait, je lui dirai si cela relève ou non d'un tel cas. Il m'arrive même de transmettre la demande à l'administration fédérale des impôts afin de connaître sa position. Sur le principe, cela n'est pas très difficile à comprendre. L'escroquerie en matière fiscale, c'est le délit grave. Le délit grave, dans l'esprit de la loi, est commis par quelqu'un qui fait plus qu'une fausse déclaration. Oublier, omettre des chiffres dans sa déclaration d'impôt est un délit simple. Le délit grave commence lorsque quelqu'un fait plus que mentir à l'administration, par exemple, en falsifiant des documents. Nous avons eu à connaître de cas simples de gens habitant en Allemagne et travaillant en Suisse, qui ont modifié des chiffres sur les relevés annuels de salaires, pour lesquels nous avons accordé l'entraide judiciaire. Cela ne concerne pas uniquement des cas très importants. Il existe des cas plus compliqués de constructions de mensonges avec falsification de documents qui ne peuvent plus être contrôlés par l'administration. Si des documents sont falsifiés, il s'agit, selon la loi suisse, d'une escroquerie en matière fiscale et là aussi, l'entraide judiciaire est possible. Nous sommes toujours surpris de voir très peu de demandes étrangères. Je pense que cela est dû au fait que la distinction est difficile à expliquer. Les autorités étrangères ont tendance à considérer, de façon simpliste, qu'avec la Suisse, cela ne fonctionne pas et qu'il est inutile de prendre la peine d'envoyer des demandes. La Suisse a conclu avec l'Italie un traité complémentaire prévoyant notamment l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie fiscale. En fait, nous n'allions pas plus loin que ce qui existait déjà dans notre loi, mais pour les Italiens, l'ouverture de la Suisse a été saluée comme un grand succès. Nous avons alors réalisé qu'ils ignoraient qu'ils auraient pu demander cette coopération depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'entraide judiciaire en 1983. Avec la France, la situation est comparable. Nous recevons assez peu de demandes pour des cas d'escroquerie, nous commençons à en recevoir davantage dans le domaine douanier. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Beat Frey, chef de la section de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police, en septembre 1999 En dépit de l'absence de précisions pratiques de la part des autorités suisses, la Mission tient à faire savoir largement aux magistrats français qu'ils peuvent obtenir de la Suisse une entraide judiciaire dans des affaires de fraude fiscale en les incitant notamment, lorsque les autorités pénales compétentes sont celles du Tessin, à prendre préalablement contact avec ces dernières avant que de définir les termes de la commission rogatoire internationale. B.- D'UN CANTON À L'AUTRE LA COOPÉRATION VARIE La structure fédérale de la Suisse donne à chacun des vingt-six cantons une autonomie très importante en matière judiciaire. Il est donc difficile de porter une appréciation générale sur la qualité de la coopération judiciaire en matière pénale puisque la situation est fort différente selon le canton auquel s'adresse l'Etat requérant. C'est ce que confirment les propos du procureur adjoint de Paris, M. Jean-Claude Marin, entendu par la Mission.
M. Jean-Claude MARIN : Concernant la Suisse, il y a effectivement une situation extrêmement différenciée entre deux cantons actifs, ceux de Genève et du Tessin, et les autres. A Genève, l'action de juges tels que MM. Perraudin, Kasper Ansermet à une certaine époque, ainsi que l'action du procureur général du canton, ont permis de faire évoluer la situation. La réforme législative sur la limitation des recours a également permis de gagner du temps. La modification de la procédure s'est appuyée sur une volonté de bien faire. En outre, Genève et le Tessin sont les seuls à appliquer de façon dynamique la procédure dite du canton leader, qui permet à un juge étranger souhaitant des investigations dans plusieurs cantons, de demander au juge du canton dans lequel elles sont les plus nombreuses, de déclencher une procédure l'autorisant à investiguer dans les autres cantons pour son compte. Cela évite d'avoir à envoyer des commissions rogatoires à chacun des cantons concernés. Genève le fait volontiers ; à Zürich, c'est extrêmement aléatoire. Il y avait un juge très actif ; M. Peter Cossandey, qui remuait les montagnes pour que l'on puisse obtenir le renseignement voulu: telle fiduciaire genevoise a ouvert un compte au nom de telle société panaméenne, quel est le bénéficiaire économique final du compte... Il a pu, dans un dossier Péchiney, nous répondre dans un délai qui était considéré comme raisonnable pour Zürich, soit vingt-six mois. Mais tout cela repose sur une volonté personnelle. Nous savons par les juges genevois que les cantons alémaniques n'aiment guère que le canton de Genève soit juge leader dans des commissions rogatoire pluricantonales et qu'ils préféreraient que ce soit Zürich, pour des raisons que l'on comprend bien. Il est vrai que les cantons alémaniques n'ont pas les mêmes règles de procédure, ni parfois le même contour de secret bancaire ; ce sont autant d'obstacles qui rendent la coopération plus difficile. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Jean-Claude Marin, Procureur adjoint, Chef de la division économique et financière, en octobre 1999 Cette collaboration entre les différents cantons suisses est prévue par le Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale du 5 novembre 1992.Ce Concordat permet aux autorités judiciaires d'un canton saisies d'une affaire pénale, d'ordonner et d'accomplir des actes de procédure directement dans un autre canton (article 3). La procédure applicable est celle du canton de l'autorité judiciaire saisie (article 24). En application de ce Concordat, l'autorité judiciaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit qui tombe sous la juridiction d'un autre canton est tenue d'informer l'autorité compétente de ce canton (article 11). La collaboration intercantonale s'effectue cependant dans des conditions fort différentes selon les cantons impliqués, à l'instar de ce qui peut se produire entre Etats. Si la collaboration entre le Tessin et Genève ne semble pas poser de difficultés particulières, les choses apparaissent plus délicates lorsqu'il s'agit de demander la collaboration du canton de Zürich.
M. Jacques DUCRY : Zürich n'est pas très active. J'avais essayé sans résultat, en 1996, de transmettre à Zürich un dossier qui concernait une grosse affaire russe. Genève a la volonté et les moyens de la faire. Genève a une réalité russe bancaire sur son territoire, il y avait aussi les comptes au Tessin des Russes qui sont aussi propriétaires immobiliers. M. Luca MARCELLINI : Avec Genève, nous avons une bonne assistance. M. le Rapporteur : Pourquoi ne se passe-t-il rien à Zürich ? M. Luca MARCELLINI : Je n'ai pas d'éléments pour faire l'analyse. M. le Rapporteur : Pourquoi sur ce dossier russe le canton de Zürich n'a-t-il rien fait ? M. Jacques DUCRY : Sur ce dossier, ils devaient mettre des écoutes téléphoniques et ils ne les ont pas faites. Il y avait tous les éléments, mais ils nous ont dit que leur procédure était différente et qu'il leur fallait des preuves pour faire les écoutes téléphoniques. Je leur ai dit que si on a les preuves, il n'est plus nécessaire de faire des écoutes téléphoniques. M. Luca MARCELLINI : Ils sont plus formels dans l'évaluation des commissions rotatoires. Lorsqu'arrivent les commissions rogatoires de l'étranger, qui touchent les différents cantons, lorsque Zürich est désigné comme canton directeur, qui doit décider l'admissibilité, on voit parfois des décisions négatives assez formelles. Mme Maria GALLIANI : Ils ne sont pas flexibles. C'est peut-être une question de mentalité. M. Luca MARCELLINI : Si la commission rogatoire n'est pas en ordre, peut-être chez nous l'approche est de prendre contact et de la modifier tandis qu'à Zürich, ils sont plus formels. Extrait de l'entretien de la Mission avec les magistrats du canton du Tessin, en septembre 2000 Ce contraste a frappé également votre rapporteur lorsqu'il s'est rendu successivement à Zürich puis à Lugano. Alors que ces deux cantons figurent parmi les plus concernés par les affaires de blanchiment et de criminalité économique, la différence d'approche et de sensibilisation à ces questions est apparue très nettement. Si les magistrats de Genève et Lugano ont fait de la lutte anti-blanchiment une de leurs priorités et se montrent particulièrement actifs, ceux de Zürich font preuve de formalisme et de retenue. La Mission n'a ainsi pu obtenir aucune précision d'ordre méthodologique ou quantitatif concernant l'activité d'entraide judiciaire en matière pénale menée par le canton de Zürich. Le questionnaire complémentaire adressé au procureur de Zürich a fait l'objet d'une réponse s'apparentant à une fin de non-recevoir.
Questionnaire de la Mission au Procureur de Zürich : 1. Les informations contenues dans le deuxième rapport du MROS indiquent que les autorités de poursuite pénale de Zürich ont reçu de ce Bureau, pour la période mars 1999-mars 2000, 65 communications. Pourriez-vous nous préciser s'agissant de cet ensemble : - le montant financier représenté par ces 65 cas, - le nombre d'entre eux qui ont fait l'objet d'une exploitation par la justice et pour ces derniers : · le montant financier total · l'état actuel de la procédure · la description des différentes mesures qui ont pu être prises (gel des avoirs, confiscation, condamnation définitive, etc.). - S'agissant des cas qui n'ont pas été exploités par la justice pourriez-vous nous indiquer les raisons principales de ce choix (faiblesses des sommes concernées, manque de qualification juridique, insuffisance des éléments fournis...). 2. Dans le cadre de procédures préalables, les services de police ou les procureurs peuvent procéder à des mesures contraignantes sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du juge d'instruction. Cette autorisation est elle-même délivrée s'il existe des preuves ou des soupçons suffisants. Pourriez-vous nous indiquer concernant la criminalité financière et le blanchiment, depuis les cinq dernières années, le nombre d'autorisations qui n'ont pas été accordées aux demandes formulées par les procureurs suisses en nous précisant quelles étaient les mesures envisagées (levée du secret bancaire, écoutes téléphoniques, saisie de documentation...) et en nous indiquant les motifs principaux qui ont fondé ces rejets. Pouvez-vous nous confirmer que sur cette même période, dans les domaines précités, aucune autorisation n'a été accordée aux autorités de police de procéder à des mesures contraignantes dans le cadre de procédures préalables ? 3. S'agissant des commissions rogatoires venant de l'étranger et pour lesquelles Zürich a été désigné comme canton directeur, pouvez-vous nous indiquer les critères utilisés pour décider de la recevabilité ou non des demandes de commissions rogatoires internationales. Vous serait-il possible, en respectant l'anonymat des affaires, de nous indiquer depuis les trois dernières années, combien de demandes ont ainsi été rejetées et pour quels motifs ? 4. L'exécution de commissions rogatoires en présence des autorités étrangères qui les ont demandées ouvre, en application du droit fédéral suisse, des possibilités de recours. Pouvez-vous nous indiquer si cette demande de présence vous est fréquemment adressée. Dans ce cas, vous arrive-t-il de rechercher avec les autorités étrangères une autre solution ou répondez-vous systématiquement à cette demande ? 5. Pourriez-vous nous préciser enfin combien de procureurs spécialisés traitent dans le canton de Zürich l'assistance internationale et combien de commissions rogatoires internationales concernent en moyenne chaque année la criminalité financière et le blanchiment des capitaux ? De façon générale, combien de procureurs et juges d'instruction sont compétents dans le canton de Zürich en ces matières ? Réponse de M. le Procureur René Ramer : « Monsieur, L'entretien d'information du 27 septembre 2000 étant une rencontre informelle, il ne nous semble pas indiqué de formuler un quelconque avis sur un procès-verbal rédigé par vos soins. De plus, je dois malheureusement vous informer que répondre à votre liste de questions signifierait d'accomplir un travail démesuré, c'est pourquoi nous ne nous voyons pas en mesure de le faire, en particulier dans un délai aussi court. Je regrette de ne pas pouvoir vous fournir d'autre renseignement mais notre administration fédérale pourra peut-être encore vous aider, au moins partiellement. J'espère vous avoir été utile en vous donnant ces indications et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » Cette attitude réservée contraste avec le volontarisme des magistrats de Genève et le souci des magistrats tessinois de faciliter la coopération judiciaire. Ainsi le procureur Bernard Bertossa s'est depuis longtemps prononcé en faveur de la constitution d'un véritable parquet européen et pour la suppression des voies de recours et la transmission des demandes de commissions rogatoires directement de juge à juge dans l'ensemble des pays européens, de même que le procureur Luca Marcellini. Ces derniers temps, les juges du Tessin ont néanmoins fait l'objet de critiques leur reprochant leur passivité dans le traitement des affaires de contrebande avec l'Italie ou de criminalité impliquant la mafia russe. En 1985, sur réquisition du Procureur du Tessin, M. Paolo Bernasconi, la Suisse tenait à Lugano son premier grand procès pour blanchiment de l'argent de la drogue dans l'affaire de la « Pizza Connection ». Aujourd'hui, les magistrats tessinois entendent honorer cette tradition mais doivent actuellement faire face à un retard impressionnant de 2 500 dossiers en attente. Le Grand Conseil vient de décider d'augmenter de 12 à 15 le nombre de ses procureurs. Parmi ces derniers, six s'occupent de la criminalité financière et de l'entraide internationale. Ils reçoivent à ce titre environ 500 demandes d'entraide judiciaire par an dont 95 % sont déclarées recevables. Malgré cet effort supplémentaire, le Tessin qui se trouve à l'un des carrefours du recyclage de l'argent de la mafia reste sous-dimensionné par rapport à d'autres cantons et il lui faudrait pouvoir disposer de 25 procureurs pour répondre aux exigences des enquêtes, d'après les estimations du magistrat Jacques Ducry. La ville de Bâle avec 100 000 habitants en moins et qui ne constitue pas une place financière de même ampleur disposerait du double de procureurs par rapport au Tessin. Le Tessin, en raison de sa situation géographique, reste particulièrement exposé à la criminalité organisée et se remet difficilement des critiques qui sont adressées à ses magistrats. On subit des critiques qu'il faudrait adresser M. Jacques DUCRY : J'ai lu dans la presse que votre collègue François d'Aubert avait critiqué violemment le Tessin quant à sa présumée inaction face à la mafia russe. Il n'est pas venu, car nous aurions pu lui expliquer les problèmes que nous rencontrons avec notre parquet. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse il y a vingt-six cantons et que Genève enquête aussi sur le Tessin pour ce qui concerne ces affaires que M. d'Aubert évoquait. Nous avons pris des accords pour savoir qui fera quoi dans ce contexte. Nous voulons dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Genève a fait un travail énorme sur les Russes, qu'on aurait peut-être fait moins bien et en tout cas dans un laps de temps bien plus long, avec un magistrat à plein temps, plus quelques collaborateurs. Expliquez à vos collègues que ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou de paresse, mais de structure, et que cela ne dépend pas de nous. Nous sommes passés de 12 à 15 procureurs, mais pour nos exigences d'enquête, nous devrions être vingt-cinq. Nous avons été douze enquêteurs pendant les vingt dernières années. En vingt ans, nous avons pu assister à une évolution négative épouvantable. On subit des critiques, qu'il faut adresser au pouvoir politique, législatif ou exécutif, et aux structures qui ne dépendent pas de nous. Ce ne sont pas seulement les lois ou les recours, mais aussi le nombre de personnes et cette structure qui nous empêchent de faire mieux. M. Luca MARCELLINI : Les politiciens estimaient peut-être qu'une justice pénale trop forte aurait pu être dangereuse pour l'économie, ce qui a freiné dans le passé l'aide à la magistrature. Dans les dernières années, le point de vue politique a quand même, mais assez timidement, changé par rapport à la justice pénale. Depuis deux ou trois ans, nous récupérons les retards accumulés et une certaine évolution se fait sentir avec l'adoption de procédures plus favorables depuis une année, et les augmentations d'effectifs. Une autre réforme est en vue, dans un an ou deux, pour la création de la fonction de substitut du Procureur, ce qui pourrait augmenter le nombre de magistrats en mesure de prendre des décisions. De la part du pouvoir politique, on voit qu'il y a une volonté. Mais avant il faudra reprendre les milliers de dossiers qu'on a accumulés pendant ces années. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Jacques Ducry, procureur du canton du Tessin, en septembre 2000 C.- LE MAINTIEN DES VOIES DE RECOURS Le dispositif suisse d'entraide en matière pénale apparaît particulièrement complexe. Le tableau ci-après en atteste, qui résume l'architecture découlant de la loi eimp du 20 mars 1981 ; depuis la révision du 4 octobre 1996, le déroulement de cette procédure est uniforme sur l'ensemble du territoire fédéral. 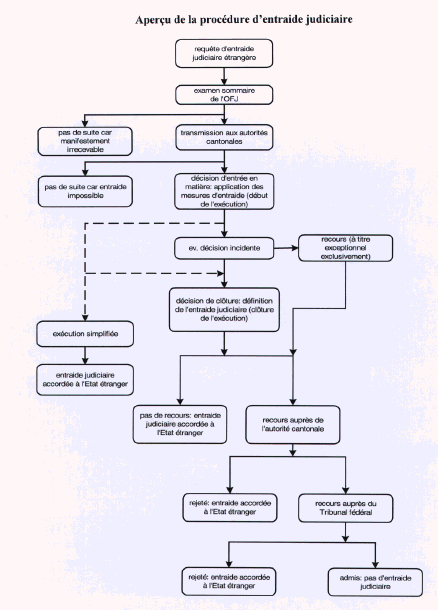 On constate que la simplicité et la clarté ne sont pas les vertus dominantes de la procédure d'octroi par la Suisse de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Surtout, celle-ci apparaît constamment sous la menace de recours dilatoires introduits par les avocats des parties, aux fins de la ralentir - ou de la bloquer. La partie droite du tableau ne présente pas moins de trois possibilités de recours qui peuvent surgir à tous les stades de la procédure d'entraide qui s'apparente au parcours du combattant. La première phase de la procédure porte classiquement sur l'examen de la recevabilité de la demande d'entraide, mais en Suisse cet examen se déroule en deux temps, au niveau fédéral puis au niveau cantonal. L'Office fédéral de la justice (OFJ) est le premier destinataire des demandes d'entraide émanant de l'étranger (art. 78, EIMP). Il lui revient d'examiner sommairement la recevabilité formelle de la demande et de veiller à ce qu'elle ne contienne pas de dispositions manifestement irrecevables, sans statuer pour autant sur la recevabilité matérielle de la demande. Dans les cas urgents, l'Office fédéral peut ordonner des mesures provisionnelles dès qu'une requête est annoncée (art. 18, al. 2,EIMP). L'Office fédéral de la justice transmet ensuite la demande à l'autorité d'exécution compétente - généralement, une autorité cantonale -, qui examine si toutes les conditions juridiques nécessaires à l'octroi de l'entraide judiciaire sont réunies. Lorsque l'examen préliminaire est positif, l'autorité d'exécution rend une décision motivée d'entrée en matière, où elle constate que les conditions matérielles nécessaires à l'octroi de l'entraide sont remplies. Simultanément, elle ordonne les mesures requises et recevables en droit suisse. Il existe donc un double filtrage aux demandes d'entraide internationales, aux niveaux fédéral et cantonal. On peut légitimement s'interroger sur la nécessité de maintenir ce double examen. En effet si l'Office de la justice se borne à effectuer un examen sommaire, pourquoi ne pas alors admettre par principe une transmission directe aux autorités judiciaires qui procèdent quant à elles à un examen approfondi de la recevabilité de la demande d'entraide ? On pourrait inversement admettre que l'Office de la justice se prononce définitivement sur la question de la recevabilité de la demande mais il lui faudrait dans cette hypothèse disposer de moyens dont il apparaît qu'il est loin d'en disposer. La deuxième phase est constituée par l'exécution matérielle de la demande d'entraide. A ce stade, un premier type de recours est déjà possible, contre une décision incidente, dans deux cas. Il s'agit d'une part de la décision de saisie de valeurs ou d'objets, d'autre part de la présence de fonctionnaires étrangers à l'occasion des actes d'exécution. En principe, ces décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours. Il en va différemment si les parties estiment que les mesures envisagées occasionnent « un préjudice immédiat et irréparable » (art. 80 l, al. 2, EIMP). Afin de préserver les droits de la défense, la décision incidente doit d'ailleurs mentionner les voies de recours, être formellement notifiée et l'autorité de recours peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre la décision incidente. Ces mécanismes de contestation - dont la Suisse s'enorgueillit autant que de l'attention extrême qu'elle porte aux droits de l'homme, qui ne sont pourtant pas ignorés par les Etats de l'Union européenne parties à la Convention européenne des droits de l'homme, aboutissent en pratique à paralyser l'action judiciaire : non pas que les tribunaux supérieurs fassent nécessairement droit aux prétentions des parties, mais parce que l'action du juge saisi de la demande d'entraide est entravée par l'attente des décisions rendues à propos des questions incidentes. Présentées comme exceptionnelles par les Autorités fédérales suisses, ces voies de recours sont au contraire dénoncées par certains magistrats suisses, comme constitutives d'obstacles sérieux au bon déroulement de l'entraide. Vient ensuite la troisième phase, celle de la clôture, qui fait espérer une réponse à la partie requérante. Or c'est justement à ce stade que peuvent intervenir deux voies de recours supplémentaires auprès de l'Autorité cantonale puis auprès du Tribunal fédéral, qui vont représenter en moyenne deux à trois ans d'attente pour les autorités judiciaires requérantes. Lorsque l'exécution de la demande est terminée - c'est-à-dire lorsque tous les moyens de preuve requis ont été recueillis -, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture, dans laquelle elle se prononce sur la recevabilité matérielle de la demande et l'étendue de l'entraide. Le droit suisse autorise les ayants droit à requérir contre cette décision qui clôt la procédure et, conjointement avec celle-ci, contre les décisions incidentes rendues précédemment. Cette intervention bloque de nouveau la procédure, puisque seule l'entrée en vigueur de la décision de clôture permet la remise des documents recueillis et des moyens de preuve à l'Etat requérant... d'autant que la décision de l'autorité cantonale de dernière instance est susceptible de faire l'objet d'un recours administratif contentieux devant le Tribunal fédéral. Surtout, l'article 80 l, al. 1er, EIMP dispose que les recours contre la décision de clôture - ou toute autre décision autorisant la transmission à l'étranger d'objets ou de valeurs - ont de droit un effet suspensif. Dans cette perspective, le manque d'intérêt suisse pour la question des voies de recours - que déplorait le procureur général Bernard Bertossa - apparaît des plus préoccupant. Suppression des voies de recours : M. le Rapporteur : Nous avons eu hier une discussion avec quelques parlementaires du Conseil des Etats et du Conseil national sur les voies de recours internes en Suisse. Nous avons aussi donné à voir concrètement les conséquences de l'abus de ces voies de recours dans les affaires les plus importantes. L'ex-procureur du Tessin, M. Marty, devenu conseiller des Etats, nous a indiqué qu'un élément de progrès avait été accompli par la Suisse, puisque la compétence en matière de délinquance financière, de lutte contre le blanchiment et d'infractions attachées à ces questions était devenue fédérale, ce qui va supprimer la voie de recours passant par la justice cantonale. Un parlementaire socialiste nous a indiqué qu'il considérait que la Suisse n'avait aucun argument pour s'opposer à la suppression du maintien de voies de recours internes sur des saisies et perquisitions bancaires, dans la mesure où l'entraide était réclamée par des pays ayant adhéré à la Convention européenne des droits l'homme. En revanche, les réponses que nous avons obtenues de la part d'un certain nombre d'autres hommes politiques suisses ne nous ont pas donné satisfaction, dans la mesure où certains considèrent que le recours doit continuer d'appartenir à la culture juridique suisse du recours. Le débat sur la suppression des voies de recours vous paraît-il pouvoir devenir une priorité dans la Confédération helvétique ? M. Bernard BERTOSSA : Je crains que non. Nos ministres de la justice successifs n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt pour ces thèmes. Lorsque la loi suisse a été remise en question il y a trois ans, le problème a été soulevé. La réaction a été ambiguë. Le Parlement a adopté une norme qui supprimait l'un des recours possibles mais qui allongeait le délai de recours, le faisant passer de dix à trente jours. Il ne peut donc rien se passer pendant trente jours, même s'il n'y a pas de recours. Tant que la décision n'est pas en force, la documentation ne peut pas être envoyée. Imaginez ce que représente un mois dans la remise à disposition du magistrat étranger d'une documentation qui lui est indispensable. L'existence même de ce recours, même s'il n'est pas utilisé, est perverse. Il est exact que la Confédération sera dorénavant compétente pour poursuivre le blanchiment et l'appartenance à une organisation criminelle. C'est une compétence pour poursuivre en Suisse mais pas nécessairement pour exécuter un acte d'entraide. Si un juge français a besoin d'une documentation dans une banque genevoise, que la Confédération soit ou non compétente pour poursuivre en Suisse la délinquance liée à l'organisation criminelle, l'Office fédéral de la police pourra continuer à envoyer à Genève la demande d'entraide pour exécution ici. Il y a donc un double recours et cette réponse n'est pas satisfaisante. Nous avons quotidiennement l'expérience de ces problèmes lancinants, qui ont des effets non seulement sur l'efficacité de la poursuite conduite à l'étranger, ce qui est déjà important compte tenu de la prescription et du risque d'évasion des personnes mises en cause et des fonds, mais aussi sur le travail qui nous est demandé. On oublie parfois que nous avons aussi nos propres infractions à poursuivre. Le formalisme auquel est soumise l'entraide, la nécessité de rédiger des décisions parfaitement motivées, de répondre à des recours, de plaider devant les autorités de recours, tout cela impose au personnel judiciaire suisse un effort très important. Sans compter d'autres effets pervers comme celui qui consiste à faire pratiquement interdiction aux juges étrangers de venir entendre des témoins ici. Si, dans une affaire délicate, Mme Joly souhaite venir elle-même entendre ici des témoins sur commission rogatoire, ce qui paraît être la moindre des choses puisque c'est elle qui connaît le dossier, et si le juge suisse est d'accord, il doit prendre une décision, la notifier. Or cette décision peut faire l'objet d'un recours, qui est toujours utilisé dans les cas délicats. A tel point que nous en sommes à conseiller aux juges étrangers de ne pas venir car ils risquent de perdre six mois. Ces problèmes restent d'actualité. Je ne suis pas optimiste quant à la faculté du Parlement helvétique de modifier, de lui seul, cette situation. Des pressions extérieures sur la Suisse seront nécessaires. Comme on n'a pas hésité à en exercer pour qu'elle laisse passer des camions, on devrait en faire pour qu'elle laisse passer les informations judiciaires. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Bernard Bertossa, Procureur Général du canton de Genève en septembre 1999 Les magistrats du Tessin ont, eux aussi, admis que cette question des voies de recours leur créait des difficultés et donnait l'impression aux autorités requérantes d'une mauvaise volonté de la part des juges tessinois d'accorder l'entraide judiciaire. Les magistrats tessinois se sont donc très clairement prononcés pour une simplification de la procédure d'entraide et une accélération de son exécution par la suppression des voies de recours lorsque l'Etat requérant offre des garanties de procédure et de protection comparables. La réforme qui accorde aux autorités judiciaires fédérales une compétence nouvelle en matière d'enquêtes dans les affaires de criminalité économique et de blanchiment a pour conséquence la suppression d'un niveau de recours en retirant cette compétence aux autorités cantonales. Selon certains magistrats, cette réforme engagée par Mme Carla Del Ponte, ex-procureur général de la Confédération, a pour effet de faire gagner au moins une année aux Etats requérants. Ce résultat encourageant laisse toutefois subsister des procédures de recours qui altèrent encore considérablement la qualité de l'entraide judiciaire avec la Suisse. Ainsi, il existe des voies de recours au niveau cantonal et fédéral lorsqu'il y a une demande de perquisition bancaire, ce qui signifie deux ou trois années supplémentaires d'attente. Si des mesures provisoires comme la saisie des biens sont demandées, le fait que cela cause un préjudice immédiat irréparable entraîne une double voie de recours. Enfin, la procédure fédérale prévoyant que la demande des autorités requérantes d'être présentes lors de la perquisition peut donner lieu à une voie de recours, les magistrats du Tessin, comme ceux de Genève, s'efforcent de contourner cet obstacle.
M. Luca MARCELLINI : Un autre problème pratique se rencontre assez souvent, lorsque l'autorité étrangère demande à être présente lors de la perquisition. Si la demande est assez claire et que nous pensons être sûrs d'atteindre les mêmes résultats sans cette présence des autorités étrangères, nous préférons généralement suivre cette solution. En effet, leur présence donne lieu à une autre voie de recours, ce qui va généralement compliquer la procédure. M. le Rapporteur : Est-ce propre au Tessin ? M. Luca MARCELLINI : Non, c'est une procédure fédérale. Parfois les autorités étrangères viennent ici quelques jours avant notre intervention, pour clarifier leurs demandes de perquisition. Mais, dans la majorité des cas, on agit directement sans leur présence, ce qui parfois peut susciter des réactions de la part des autorités étrangères qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on ne souhaite pas les laisser participer, alors que c'est pour éviter les voies de recours. Extrait de l'entretien de la Mission avec M. Luca Marcellini, procureur général du canton du Tessin, en septembre 2000 Interrogées également sur ce point, les autorités judiciaire du canton de Zürich n'ont pas davantage répondu à la Mission sur leur pratique en cas d'une demande des autorités requérantes d'être présentes. L'ensemble des voies de recours est, comme au Luxembourg ou au Liechtenstein, un instrument procédural utilisé à des fins purement dilatoires. Le Luxembourg vient d'évoluer très fortement sur cette question et a finalement adopté, après de longues années de discussions, le 8 août 2000, une législation sur l'entraide judiciaire pénale internationale, qui encadre les recours dans un délai de dix jours. La Suisse doit-elle disputer au Liechtenstein la capacité d'obstruction à faire exécuter les commissions rogatoires ? Cette question des voies de recours hypothèque grandement la qualité du travail de nombreux magistrats suisses engagés dans la lutte anti-blanchiment et mériterait, pour ce seul fait, d'être réexaminée. Alors que les autorités suisses acceptent le principe d'équivalence lorsqu'il s'agit de s'assurer de la qualité des procédures de diligence ou des législations de surveillance applicables à des banques, pourquoi n'admettraient-elles pas le même raisonnement s'agissant du niveau de protection accordé par des procédures judiciaires ? Pourquoi faire davantage confiance aux 40 Recommandations du GAFI qu'aux codes de procédure pénale des Etats de l'Union européenne ou à la Convention européenne des droits de l'homme ? La mission a adressé le 17 octobre 2000 à M. Roland Hauenstein, chef du service juridique du ministère public de la Confédération, les demandes d'information suivantes : « La Conférence des autorités pénales suisses a récemment entrepris une démarche visant à modifier la loi fédérale sur l'entraide judiciaire internationale afin notamment d'obtenir la suppression des voies de recours lorsque le pays requérant dispose de procédures judiciaires accordant aux personnes concernées une protection juridique équivalente à celle de la Suisse. Pourriez-vous nous préciser si, à l'heure actuelle, cette proposition a fait l'objet d'une procédure d'examen et quel serait l'équilibre du projet. Les pays avec lesquels la Suisse a passé des accords bilatéraux seraient-ils automatiquement bénéficiaires de cette suppression des voies de recours ? » Il n'a pas été répondu à ce courrier. Faute d'évolution notable sur cette question, les magistrats français sont contraints eux aussi de contourner l'obstacle des voies de recours et de recourir à des artifices de procédure. Dans une affaire actuellement en cours, le Juge Philippe Courroye plutôt que d'engager dans les formes une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, concernant un dirigeant d'une banque genevoise, semble avoir préféré une autre voie, celle de la convocation de témoin. La justice française met sous pression C'est une guerre psychologique d'un nouveau type que livre le juge parisien Philippe Courroye au directeur de banque M., figure en vue de la banque privée genevoise. Comme l'a appris Le Temps, ce magistrat réputé inflexible a convoqué à trois reprises le financier suisse, qui occupe un poste de directeur à la banque HSBC Republic, l'ancienne Republic National Bank (RNB) d'Edmond Safra, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent et de transfert de fonds entre la France et la Suisse. Selon différents témoignages qui sont parvenus à la justice, le financier genevois, non content de gérer les comptes suisses de O., aurait en outre joué un rôle actif dans le système de compensation qui permettait à une riche clientèle franco-marocaine de déplacer sans laisser de traces d'importantes sommes d'argent de France en Suisse et vice versa. Cela explique l'intérêt manifesté par la justice française pour le témoignage de M. Cinq cents millions de dollars évaporés Selon le défenseur de O., Marc Bonnant, le banquier est tout à fait prêt à être entendu, à condition que les juges parisiens respectent les formes de l'entraide judiciaire internationale. «M. a été convoqué par téléphone, par fax, par courrier recommandé. Or, c'est la voie diplomatique qui doit être utilisée dans un cas de ce genre. Genève n'est pas encore une province française», s'indigne l'avocat. Mais selon une source proche du dossier, c'est à dessein que Philippe Courroye a renoncé à faire une demande en bonne et due forme: «Il est très intelligent. En ne respectant pas les règles de l'entraide, il évite des recours et envoie un signal clair au financier qu'il convoque comme témoin: si vous ne vous présentez pas, c'est à vos risques et périls. » Source : Le Temps du 23 janvier 2001, article de M. Sylvain Besson. En somme la législation suisse aboutit en pratique, à paralyser l'exécution des demandes d'entraide judiciaire internationales en maintenant des voies de recours totalement superfétatoires qui entravent l'action des magistrats helvétiques, - certains déploient actuellement toute leur science pour échapper aux contraintes de leur législation - et à accorder une protection judiciaire excessive à tous ceux qui ont décidé de placer en Suisse des fonds d'origine douteuse. V.- DES MOYENS NOTOIREMENT INSUFFISANTS ALLOUÉS À LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT La logique de l'autorégulation qui, par construction, place les autorités fédérales dans un champ d'intervention subsidiaire, d'une part, le principe du fédéralisme qui accorde aux cantons une large autonomie en matière pénale, d'autre part, ont abouti à ce que l'Etat fédéral suisse ne s'engage qu'indirectement dans la lutte anti-blanchiment et n'y consacre que des moyens extrêmement limités. A.- LA PAUVRETÉ DES MOYENS ACCORDÉS AUX AUTORITÉS ANTI-BLANCHIMENT 1.- Les effectifs réduits du Bureau de communication Depuis sa création le Bureau de communication compte quatre personnes et devait en janvier 2001 être renforcé par deux personnes supplémentaires. Cet effectif ne peut manquer d'étonner si on le compare aux structures homologues qui existent dans les autres pays.
Au regard des 4 000 milliards de dollars gérés par la place bancaire suisse, les quatre personnes du Bureau de communication ne peuvent malheureusement pas faire grand chose de plus que de se contenter d'enregistrer et d'examiner les quelques déclarations de soupçons que voudront bien lui faire parvenir les banques ou autres intermédiaires financiers les plus vertueux. Les autorités suisses interrogées sur ce point considèrent pourtant que cet ordre de grandeur est suffisant. Tout en reconnaissant que le Bureau de communication est encore sous-dimensionné, les représentants de l'Office fédéral de la police estiment qu'il ne faut pas apprécier la situation du MROS de façon isolée et qu'il convient de considérer cette structure replacée dans l'ensemble du dispositif de lutte anti-blanchiment qui repose sur le principe de l'autorégulation et l'existence de différentes autorités de surveillance. Dans cette logique, le Bureau de communication se trouve être un des maillons de la chaîne et il est important de s'assurer qu'il n'y aura pas d'encombrement à l'une ou l'autre des étapes du traitement des affaires de blanchiment. Autrement dit, les autorités suisses admettent implicitement qu'à l'heure actuelle tous les acteurs soumis à l'obligation d'annonce ne sont pas encore pleinement sensibilisés à ce problème du blanchiment - notamment les intermédiaires financiers non bancaires qui sont en sous-régime notoire de déclarations de soupçons - et qu'en conséquence, la question des effectifs adéquats du Bureau de communication ne se pose pas prioritairement. L'un des responsables fédéraux a d'ailleurs déclaré que ce n'est que lorsque les intermédiaires financiers auront été sensibilisés à ce problème et rempliront leurs obligations d'annonce que se posera alors la question de l'effectif nécessaire au Bureau de communication qui intervient comme un organe de tri distinguant le bon grain de l'ivraie. Inversement, certains représentants des autorités fédérales se sont demandés à quoi servirait d'avoir un Bureau de communication doté de cinquante personnes si, dans les cantons, pour des raisons d'effectifs mais aussi de complexité des affaires, les dossiers continuent de s'accumuler. Les autorités suisses reconnaissent par-là même qu'une activité plus importante du Bureau de communication risquerait d'aboutir, en l'état, à un engorgement du traitement judiciaire des affaires de blanchiment par les autorités pénales cantonales. Quoiqu'il en soit les quatre personnes de l'équipe du Bureau de communication ont du procéder à l'examen et au tri, en vue d'une transmission aux autorités pénales cantonales, de 370 communications représentant en masse 1,5 milliard de francs suisses qui leur sont parvenues entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000. A cette tâche, s'ajoutent la gestion du système de traitement des données consacrées à la lutte contre le blanchiment, dit système GEWA, et le développement des relations institutionnelles avec les unités de renseignement financier des autres pays, en vue d'établir des accords de collaboration, et la participation ou l'organisation de séminaires d'information (une quarantaine par an). Il n'est pas possible, dans ces conditions, de considérer comme suffisant un effectif de quatre personnes, même porté à six, compte tenu de ce que devrait être le niveau d'activité d'une cellule de renseignement financier d'un pays comme la Suisse. 2.- La faiblesse des moyens attribués à l'Autorité de contrôle En 1998, lors de son entrée en activité, deux personnes constituaient la « force de frappe » de cette nouvelle autorité chargée d'agréer les organismes d'autorégulation des intermédiaires financiers non bancaires et de surveiller l'ensemble de ce secteur soumis à l'application de la loi sur le blanchiment d'argent. En 1999, l'effectif est passé à six personnes et devrait atteindre prochainement douze personnes, selon la préconisation faite par une société d'audit externe, la Novo Business Consultants. Huit personnes travaillaient à l'Autorité de contrôle, quatre d'entre elles ont aujourd'hui démissionné. Dès le départ, l'Autorité de contrôle, conçue pour intervenir à titre subsidiaire, autorégulation oblige, n'a eu à sa disposition que des moyens et des effectifs très réduits. Il y a eu là un choix délibéré Mme Natacha POLLI : Au départ nous étions deux personnes, nous sommes aujourd'hui six et il est prévu que l'autorité de contrôle compte dix personnes. Ce chiffre assez faible est justifié par le choix opéré du recours à l'autorégulation. L'Autorité de contrôle, qui doit aussi surveiller les organismes d'autorégulation, dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers, peut faire appel à des forces extérieures, notamment en confiant les contrôles sur place des intermédiaires financiers à des sociétés de révision externes. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle se contenterait de vérifier la façon dont est attribué le mandat à ces sociétés de révision et de contrôler le résultat de leur travail. Cela n'exigera donc pas de notre part d'aller vérifier personnellement des centaines, voire des milliers d'intermédiaires financiers. Nous avons en effet développé une banque de données performante destinée à pallier le fait que nous ne serons probablement à terme que dix personnes. Il est évident que la gestion des données qui nous sont confiées par les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers, et celle des documents que nous recevons, sous forme électronique ou papier, ne peut être réalisée sans une banque de données efficace. Nous l'avons développée durant la première année, afin de permettre une gestion dynamique de ces données, qui nous permette de faire des recherches en plein texte et de contrôler l'activité de l'Autorité de contrôle. Cet outil est indispensable dans la mesure où une autorité cantonale peut nous demander si telle personne ou tel intermédiaire financier est enregistrée chez nous. Avec une gestion des documents sur papier uniquement, une telle recherche pourrait prendre plusieurs jours. Avec la banque de données, la recherche concernera à la fois les intermédiaires financiers, leurs employés qui ont le droit de signature et les membres du conseil d'administration ou les personnes exerçant des fonctions au sein des organismes d'autorégulation. Extrait de l'entretien de la Mission avec Mme Natacha Polli, ex-directrice adjointe de l'Autorité de contrôle, en septembre 1999 En réalité, la tâche est écrasante, hors de proportion avec les moyens mis en _uvre, au point que les commissions de gestion du Parlement suisse se sont inquiétées de la situation et qu'il y aurait actuellement 600 dossiers en souffrance, correspondant à l'examen de la situation d'intermédiaires financiers non bancaires, qui relèvent directement de l'Autorité de contrôle et ne dépendent pas d'un organisme d'autorégulation (OAR). Pour sortir de cet engorgement, le chef de l'administration fédérale des finances, M. Peter Siegenthaler, a présenté le 29 novembre 2000, devant les parlementaires de la Commission de gestion du Conseil national, qui les a accueillies favorablement, une série de mesures pour résoudre la situation, après le départ de quatre collaborateurs s'estimant aussi mal payés que mal compris. Il est prévu d'ici 2002 une revalorisation des salaires de ces personnels, la création d'une unité spéciale de six personnes ayant pour mission d'écluser les 5 à 600 dossiers « d'adhérents directs » à l'Autorité de contrôle qui sont en attente d'agrément, ainsi que la possibilité de confier la réalisation de certaines tâches à des réviseurs extérieurs à l'administration. Train de mesures pour appuyer l'Autorité de contrôle Ces mesures doivent permettre de résorber les difficultés rencontrées au cours des premiers mois de mise en _uvre de la nouvelle loi sur le blanchiment d'argent [...] Peter Siegenthaler, directeur de l'Administration fédérale des finances, a présenté une série de mesures afin de renforcer l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de mieux encadrer ses activités. · L'Autorité de contrôle sera réévaluée hiérarchiquement et renforcée en personnel : une nouvelle organisation structurée en fonction des processus est envisagée. · Une Task Force sera mise sur pied pour traiter les 550 demandes d'autorisation en suspens d'intermédiaires financiers demandant à être affiliés à l'Autorité de contrôle. · Des modèles d'externalisation (outsourcing) seront examinés pour assurer la révision des intermédiaires financiers directement subordonnés à l'Autorité de contrôle. · Différentes questions d'interprétation de la loi en rapport avec sa mise en _uvre feront l'objet d'éclaircissements, de même que l'éventualité de l'introduction de seuils limites pour les activités entrant dans le champ d'application de la loi. · Une stratégie claire sera définie pour guider les activités de l'Autorité de contrôle, et celle-ci sera désormais soutenue par un conseil consultatif permanent, à titre d'organe de conseil indépendant. · Les relations entre l'Autorité de contrôle et les organismes d'autorégulation (OAR) seront intensifiées, et un plan directeur élaboré en commun permettra de définir une unité de doctrine sur la manière de concevoir et de mettre en _uvre l'autorégulation. · Un concept de communication sera élaboré pour l'Autorité de contrôle vis-à-vis de ses différents partenaires (OAR, intermédiaires financiers, médias et autres cercles intéressés par la mise en _uvre de la loi). [...] Peter Siegenthaler a saisi l'occasion de cette rencontre avec les représentants des médias pour réaffirmer la volonté du Département fédéral des finances de lutter avec détermination contre le blanchiment d'argent. La LBA sera mise en _uvre conformément à la volonté du législateur, en se fondant sur le principe de l'autorégulation. Extrait du communiqué de presse du département fédéral des finances du 29 novembre 2000 Malgré ces promesses, le dernier collaborateur du chef de l'Autorité de contrôle a donné sa démission début décembre 2000. M. Raoul Schidler a invoqué, d'une part le déséquilibre criant entre la charge de travail et la faiblesse des effectifs, d'autre part l'absence de soutien de l'Administration fédérale des Finances qui, par deux fois, a désavoué les sanctions demandées par l'Autorité de contrôle à l'encontre d'intermédiaires financiers.
En outre, Raoul Schidler revient sur un épisode à propos duquel, mercredi encore, les différents représentants du DFF présents à la conférence de presse se montraient particulièrement peu loquaces. Il y a quelques mois, le département de Kaspar Villiger a désavoué l'Autorité de contrôle, qui lui est subordonnée, en qualifiant de non fondées des dénonciations pénales déposées par les services de Niklaus Huber contre deux intermédiaires financiers exerçant sans les autorisations nécessaires prévues par la loi sur le blanchiment. Ce revers est resté en travers de la gorge des membres de l'Autorité de contrôle, qui l'ont considéré comme totalement inconciliable avec les dispositions claires de la loi. « Les décisions du Département concernant ces deux dénonciations sont aussi une cause de mon départ », indique aujourd'hui Raoul Sidler. L'équipe de Niklaus Huber attendait bien autre chose de l'arbitrage du DFF. La mise en _uvre de la loi sur le blanchiment (LBA) s'est en effet avérée beaucoup plus difficile que prévu, la charge de travail incombant à l'Autorité de contrôle a été largement sous-estimée. Des attaques personnelles ont commencé à viser Niklaus Huber, relayées par le secteur parabancaire, d'autant plus enclin à utiliser ce genre de méthodes que ses professionnels sont, dans l'ensemble, considérés comme le point faible de la lutte contre le blanchiment en Suisse, et qu'ils peinent sérieusement à s'imposer une autodiscipline conforme aux exigences légales. Journal Le Temps, article de M. Denis Masmejan, du 1er décembre 2000. On reste frappé par la vive résistance de certains milieux économiques peu enclins à se soumettre aux exigences de la législation anti-blanchiment. Face à une telle attitude de résistance, on reste tout aussi étonné de la position des autorités hiérarchiques et des hautes autorités politiques à l'encontre de l'Autorité de contrôle. Sous une volonté affichée de faire de l'application de la LBA « un modèle du genre » de la lutte anti-blanchiment, se cache une réalité quelque peu différente.
Nombre de traders en matières premières sont hors d'eux : « Rendez-vous compte ! Nous devons demander les casiers judiciaires de tous nos clients, pour les faire parvenir aux autorités suisses », confie l'un d'eux à Genève. La pagaille est telle que l'Autorité fédérale de contrôle n'arrive plus à suivre et que Kaspar Villiger a interdit de parole le directeur de cet organisme, Niklaus Huber. Pire : la commission de recours a déjà refusé que l'on condamne deux des 24 contrevenants à la loi, poursuivis parce qu'ils refusaient de s'affilier à un organisme d'autorégulation. Cette décision a été un premier camouflet pour le Département des finances et son administration qui voulait faire du respect de cette loi « un modèle du genre », selon Kaspar Villiger. La Tribune de Genève, article de Mme Elisabeth Eckert, 30 novembre 2000. En application des engagements précités, l'Autorité de contrôle a été promue hiérarchiquement, le 1er janvier 2001, par le Département fédéral des finances (DFF), au rang de division que dirigera M. Niklaus Huber, seul rescapé de l'équipe précédente démissionnaire. Selon le communiqué de presse officiel du Département fédéral des finances, publié le 31 janvier 2001, « cette réévaluation hiérarchique sert à élargir la marge de man_uvre permettant d'offrir aux collaborateurs et collaboratrices des possibilités de développement à long terme. D'autre part, elle démontre l'importance que la Confédération accorde à la question de la lutte contre le blanchiment d'argent. » S'agissant des effectifs, 11,5 postes seront affectés à l'Autorité de contrôle pour traiter des affaires courantes. Cinq juristes ont été engagés pour remplacer les cinq départs enregistrés et huit personnes sont au total actuellement employées par l'Autorité de contrôle. Enfin, le 29 janvier 2001, le Département des finances a mis en place une commission d'experts chargée de conseiller l'Administration fédérale des finances dans l'application de la L.B.A. « Ce conseil consultatif permanent, qui fonctionnera à titre d'organe de conseil indépendant, guidera et soutiendra l'Autorité de contrôle dans ses activités. La présidence de ce conseil sera assurée par le professeur Peter Nobel, de Zürich, qui faisait partie de la Commission fédérale des banques jusqu'à la fin de l'an 2000. Le professeur Paolo Bernasconi, avocat à Lugano, a été nommé vice-président. Les autres membres de la commission d'experts sont Jean-Marc Futterknecht, docteur en droit, de Zürich, Peter R. Isler, docteur en droit et avocat, de Zürich, Paul Perraudin, avocat et juge d'instruction, de Genève, Mark Pieth, professeur de droit pénal à l'Université de Bâle, et René Schwarzenbach, docteur en droit et avocat, de Zürich. Par la rapide mise en _uvre des mesures présentées en novembre 2000, le Département fédéral des finances entend réaffirmer sa volonté de lutter avec détermination contre le blanchiment d'argent. » B.- LE PROJET DE LOI SUR L'EFFICACITÉ En mai 2000, la ministre de la justice suisse Mme Ruth Metzler a présenté au Conseil fédéral un important projet de réorganisation des services de police judiciaire afin de recentrer l'Office fédéral de la police sur ses missions traditionnelles de police et de lui accorder ainsi qu'au ministère public de la Confédération de nouvelles compétences en matière de crime organisé et de criminalité économique. Actuellement, le ministère public de la Confédération helvétique est compétent pour intervenir dans un certain nombre de cas limitativement énumérés, tels que le faux monnayage, la falsification de titres fédéraux, les infractions à la loi sur les jeux, les délits contre l'Etat ou les délits contre le pouvoir fédéral. En dehors de ces situations expressément prévues, la compétence en matière pénale revient aux cantons, même s'il peut arriver que des affaires revêtant une importance particulière fassent l'objet d'un jugement devant le tribunal fédéral. Le projet de loi dit « projet sur l'efficacité » a donc une double ambition, développer une stratégie globale de lutte contre la criminalité organisée et transférer les compétences en ce domaine au niveau fédéral pour parvenir à une harmonisation des décisions. « Nos autorités de poursuite judiciaire « En effet, le blanchiment d'argent n'est pas seulement un état de fait en soi. Il ne peut être dissocié des différents avatars que connaît la criminalité organisée ; c'est un moyen dont elle se sert. (...) « Il faut disposer d'une stratégie globale. D'une stratégie qui vise à combattre la criminalité organisée dans son ensemble, y compris le blanchiment d'argent ; d'une stratégie qui a recours à tous les moyens disponibles, qu'il s'agisse de la prévention, de la répression, de l'entraide judiciaire accordée à d'autres Etats, de la coopération policière internationale et de l'information (...) « Pour faire obstacle efficacement et durablement au blanchiment d'argent et au crime organisé, nos autorités de poursuite judiciaire doivent être dotées de moyens supplémentaires, donc de moyens dont nous savons avoir besoin, mais qui nous font encore défaut, et de moyens indispensables pour mettre en _uvre ce que l'on appelle le projet sur l'efficacité que le Parlement a approuvé peu avant Noël, l'an passé. » Extrait de l'exposé de Mme Ruth Metzler, Ministre de la justice, lors de la réunion de l'Association suisse des banquiers, le 1er septembre 2000 à Saint-Gall. Le risque d'une trop forte disparité de traitement des infractions criminelles en matière économique avait été souligné lors des évaluations auxquelles a procédé le GAFI. L'équipe des experts chargés d'examiner la situation de la Suisse s'était interrogée sur les mesures de politique criminelle fédérale prises par la Confédération pour limiter les distorsions importantes entre cantons dans l'application des articles 305 bis et 305 ter du code pénal et avait notamment conclu dans son rapport établi en mai 1998 : Les petits cantons ne disposent pas de spécialistes « La compétence des cantons pour la législation en matière de procédure pénale ainsi que pour les autorités judiciaires est un traditionnel principe constitutionnel de la Suisse. Cependant, la situation actuelle peut être un obstacle à des poursuites efficaces surtout dans les plus petits cantons qui ne disposent pas d'unités spécialisées dans les questions de criminalité économique et de blanchiment d'argent au niveau policier et/ou judiciaire (point 112). « Une étape encore plus importante serait l'attribution d'une compétence au Ministère public fédéral de conduire des enquêtes en matière de blanchiment et de crime organisé. Même s'il serait souhaitable que les limites de cette proposition (actes commis à l'étranger ou dans plusieurs cantons) soient écartées, cette disposition devrait s'appliquer le plus tôt possible. Finalement, les examinateurs soutiennent les efforts des autorités fédérales visant à créer, à l'occasion d'une révision de la constitution fédérale, une compétence de la Confédération à légiférer en matière de procédure pénale. La modification de la constitution sur ce point présente un caractère d'urgence particulier » (point 115). GAFI, deuxième rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse, 20 mai 1998, p. 21 et 22. La réforme engagée par la Suisse répond donc dans le principe aux observations du GAFI, même si la compétence attribuée à la Confédération en matière de blanchiment, de crime organisé ou de criminalité économique reste soumise à la condition que l'infraction ait un caractère international ou transcantonal. 1.- Présentation de la réforme Sur le plan structurel cette réforme a abouti au transfert, à l'Office fédéral de la justice, depuis le 1er juillet 2000, de toutes les questions relatives à l'entraide judiciaire internationale. Par ailleurs, l'Office fédéral de la police sera organisé, à compter du 1er janvier 2001, autour de deux entités principales : la Police judiciaire fédérale et le Service d'analyse et de prévention. a) La compétence de la Police judiciaire fédérale en matière de blanchiment La Police judiciaire fédérale interviendra désormais sous la direction du Procureur général de la Confédération, pour effectuer toutes les investigations préliminaires et les procédures d'enquêtes de police judiciaire dans les matières qui relèvent de la compétence fédérale. Le nouvel article 340 bis du code pénal suisse, modifié le 22 décembre 1999, prévoit que le traitement des infractions en matière de crime organisé et de criminalité économique sera traité au niveau fédéral lorsque ces affaires auront un caractère international ou intercantonal. A l'heure actuelle et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 340 bis du code pénal, les cantons demeurent compétents sur ces questions, le transfert de compétence à la Confédération étant théoriquement prévu au 1er janvier 2002. En application de ces principes, le blanchiment d'argent qui constitue un des aspects de la criminalité économique et de la criminalité organisée et dont le caractère transnational ou transcantonal se trouve très fortement marqué, relèvera de la compétence de la Confédération. En conséquence, le Bureau de communication devra transmettre, non plus aux autorités cantonales, mais à la police judiciaire fédérale via le ministère public de la Confédération, les cas qui lui paraissent mériter des suites judiciaires. En application de la nouvelle loi, la procédure en matière de blanchiment d'argent conduite par la Confédération se déroulera de la façon suivante. Le Procureur général de la Confédération, en sa qualité de chef de la police judiciaire, ouvrira et mènera la procédure d'investigation en collaboration avec la police judiciaire fédérale. Cette enquête pourra déboucher sur une requête auprès du juge d'instruction fédéral pour qu'il ouvre une instruction préparatoire. Ce dernier procédera aux constatations nécessaires afin que, le cas échéant, le procureur général puisse prononcer la mise en accusation devant le tribunal fédéral. b) La compétence du Service d'analyse et de prévention pour procéder à l'analyse stratégique des cas de blanchiment Chargé de rassembler l'ensemble des missions d'analyse et de prévention effectuées dans tous les domaines qui relèvent de la protection de l'Etat, ce nouveau service regroupera les activités des différents Offices centraux de police criminelle. Il recueillera les informations relatives au terrorisme, au transfert illégal de technologie, au trafic d'armes et de substances radioactives. Parallèlement à cette activité de renseignement, le service d'analyse et de prévention analysera tous les éléments relatifs à la criminalité organisée et à la criminalité économique qui relèvent de la compétence fédérale. Actuellement le Bureau de communication procède, à partir de la collecte des informations qu'il reçoit, à un travail d'analyse et de statistiques destiné à améliorer la connaissance du phénomène de blanchiment et de ses évolutions. En conséquence, dans le cadre de la réforme, le Bureau de communication connaîtra une « diminutio capitis » puisque c'est à ce nouveau service d'analyse et de prévention qu'il appartiendra à terme de procéder aux analyses opérationnelles des affaires de blanchiment qui seront envisagées dans leur contexte général au regard des infractions sous-jacentes qui les ont précédées (trafic de drogue, prostitution, trafic de main d'_uvre...). Ce nouveau service sera également chargé d'élaborer, à l'intention des autorités politiques, des propositions en matière de politique criminelle. Selon les représentants des autorités fédérales suisses rencontrés par votre rapporteur en septembre 2000, ce projet de réorganisation visant à étendre les compétences des autorités fédérales dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique organisée, répond à un double objectif. Il s'agit d'une part d'introduire davantage de flexibilité et de souplesse de gestion par la mise en commun de moyens, répartis pour l'instant entre divers services de police judiciaire, au sein d'un seul office, l'Office fédéral de la police. Sur le plan opérationnel, cette nouvelle organisation devrait permettre d'intervenir plus rapidement et de façon plus ciblée, en mobilisant plus facilement les moyens d'enquête. Sur le plan des principes, cette réforme devrait permettre une coordination et une unification de la politique criminelle menée par les autorités fédérales suisses en matière économique et financière. Elle s'accompagne d'un renforcement considérable des moyens à engager et passe notamment par un recrutement massif de fonctionnaires. Envisagée du point de vue de sa mise en _uvre, cette réforme implique une politique de recrutement massif dans un contexte où les fonctionnaires suisses semblent de plus en plus difficiles à fidéliser. A l'heure actuelle, l'Office fédéral de police compte un peu moins de 400 collaborateurs et il est prévu de recruter 300 à 400 personnes, soit environ un doublement des effectifs, d'ici 2004 ou 2005 pour faire face à ce nouveau domaine de compétence fédérale qu'est la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé. Il s'agit pour cela de faire appel à des personnels très qualifiés et spécialisés et d'entreprendre un programme ambitieux de formation en tenant compte de surcroît de l'exigence du multilinguisme. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, les autorités fédérales ont d'ores et déjà mis en place une formation spéciale en liaison avec les directeurs de justice et de police cantonaux. Une estimation permettant de calculer le nombre de cas à traiter par les autorités fédérales dès la mise en _uvre de la réforme au 1er janvier 2002 a été établie mais elle n'a pas fait à ce jour l'objet d'une approbation par le Conseil fédéral. Le Parlement n'a pas encore décidé non plus d'accorder les financements nécessaires correspondants à cette restructuration. Au terme d'une étude réalisée auprès des autorités de poursuite pénale les plus concernées par la délinquance économique, le ministère public de la Confédération devrait, en application de la réforme, être confronté chaque année à au moins 34 nouveaux cas complexes de criminalité organisée économique à grande échelle. Actuellement les effectifs du ministère public de la Confédération s'élèvent à une vingtaine de personnes dont la moitié seulement sont des juristes. Il y a dix ans une trentaine de cas par an allaient jusqu'au tribunal fédéral contre 141 cas en 1998. En application de la réforme, l'augmentation du nombre d'affaires qui vont relever de l'échelon fédéral ne peut donc plus se satisfaire de moyens humains aussi réduits. En conséquence, le ministère public de la Confédération mais aussi l'Office fédéral de la police judiciaire, ainsi que l'Office des juges d'instruction fédéraux devront recruter massivement des procureurs, des experts financiers, des fonctionnaires de police, etc. Les seuls cantons de Genève, du Tessin, de Zürich et de Bâle Ville affectent actuellement, dans le secteur policier, 600 personnes à la lutte contre cette catégorie de délinquance. Selon le ministre de la Justice suisse, Mme Ruth Metzler, il est prévu de recruter entre 2002 et 2004, 80 personnes au ministère public de la Confédération, 320 à la police judiciaire fédérale et 25 juges d'instruction fédéraux. Au total, c'est plus de 400 personnes qui viendront augmenter cet ensemble où travaillent aujourd'hui 125 personnes. Cet aspect très concret est loin de constituer un point de détail car il ne suffit pas de recruter 400 spécialistes encore faut-il les rémunérer dans des proportions acceptables par rapport aux niveaux de salaires proposés dans le secteur privé. Comme le soulignait un des interlocuteurs rencontrés par la Mission, comment le secteur public suisse peut-il être encore concurrentiel lorsqu'il propose 140 000 francs suisses annuels alors que le secteur bancaire offre 200 000 francs suisses. Avant même l'adoption de cette réforme, reposant sur le recrutement de 400 fonctionnaires, un des représentants de l'Administration fédérale des finances avait admis qu'il serait extrêmement difficile de recruter des gens qui connaissent la matière et qu'il y avait là un grand risque de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il a fait observer que la mafia pouvait proposer n'importe quel salaire pour recruter les meilleurs, tandis que le Gouvernement se trouvait toujours en butte à des difficultés budgétaires. A la question de la rémunération s'ajoute celle du statut. La différence de traitement, plus faible dans le secteur public, peut se justifier en contrepartie par la situation plus protectrice dont bénéficie le fonctionnaire par rapport à son homologue du secteur privé. Or cet aspect est largement remis en cause par la récente loi votée en mars dernier par le Parlement sur le personnel de la Confédération (Loi L. Pers) qui rapproche les conditions de travail du secteur public de celles qui prévalent dans le secteur privé et sur laquelle le peuple suisse s'est prononcé favorablement lors de la votation du 26 novembre 2000. Il faut néanmoins préciser que les policiers ne sont pas concernés par ce texte qui visera en revanche les experts techniques susceptibles d'être recrutés au titre de la lutte anti-blanchiment. Dans ce contexte, il n'est donc pas exagéré de considérer que le succès de la réforme ainsi engagée par les autorités suisses repose sur un pari très audacieux, celui du recrutement massif de fonctionnaires fédéraux qualifiés et spécialisés dans un Etat où par tradition on a préféré privilégier la responsabilisation des acteurs privés (autorégulation) et une décentralisation très poussée (fédéralisme), deux caractéristiques qui, a priori, ne vont pas dans le sens d'une Confédération aux pouvoirs renforcés. 3.- Le choix d'une approche intégrée a) L'intégration du blanchiment dans l'ensemble de la criminalité organisée On peut tout d'abord se demander si l'intégration du problème du blanchiment des capitaux dans l'ensemble plus large de la criminalité économique et du crime organisé dont il constituerait un des aspects sera réellement de nature à améliorer l'efficacité de la lutte contre ce fléau ou ne risquera pas, au contraire, de faire disparaître la spécificité de cette criminalité si particulière ou d'en faire un élément moins prioritaire de la politique criminelle par rapport à d'autres types de délinquance (trafic de drogue, contrebande, prostitution, etc.). Les démissions, au cours de l'été 2000, du Chef du Bureau de communication en matière de blanchiment M. Daniel Thelesklaf et de son adjoint M. Mark Van Thiel, suivies au moins d'octobre par celles de deux autres collaborateurs a mis en lumière cette problématique. Ces responsables ont estimé qu'il aurait été plus adapté de développer au sein du Bureau de communication un service chargé de l'analyse et des typologies du blanchiment alors qu'il a été décidé au contraire de transférer cette compétence au Service d'analyse et prévention, au motif qu'une affaire de blanchiment dérive par définition d'une infraction préalable et s'intègre au sein d'un réseau d'affaires criminelles par rapport auquel elle doit être analysée. Au total les quatre spécialistes qui formaient l'équipe d'origine du Bureau de communication et dont la compétence était unanimement reconnue, ont tous démissionné à la fin de l'année 2000, deux ans après la création de ce Bureau. Ces départs qui traduisent un désaccord profond sur le rôle désormais dévolu au Bureau de communication à l'issue de cette vaste réorganisation et par voie de conséquence sur le mode de traitement du blanchiment des capitaux, fragilisent, quoiqu'elles s'en défendent, la position des autorités fédérales suisses. Ainsi M. Jean-Luc Vez, Directeur de l'OFP, a considéré que ces départs, au Bureau de communication comme d'ailleurs au sein de l'Autorité de Surveillance, ne signifie pas que la Suisse refuse de s'attaquer avec la vigueur nécessaire à la lutte contre le blanchiment d'argent et qu'il serait « franchement réducteur de faire passer l'idée que la Confédération rechigne à lutter contre le blanchiment parce que de jeunes collaborateurs partent » 34. La tonalité est quelque peu différente du côté de ceux qui ont choisi de partir, ainsi un ancien collaborateur de M. Daniel Thelesklaf a pu déclarer « Je connais les obstacles que l'esprit technocratique met à une lutte efficace contre la criminalité organisée et le blanchiment (...). Il faut créer des réseaux et faire preuve d'initiative (...). Mais pour agir ainsi, il faut une marge de man_uvre qui manque à Berne. Résultat : on y fait de beaux organigrammes (...) » 35. Création d'une unité étoffée chargée de traiter du phénomène du blanchiment sous tous ses aspects ou intégration dans un ensemble plus large de l'analyse de ce phénomène, il y a là un choix politique opéré par les autorités suisses. En même temps qu'elle s'est engagée à porter à l'échelon fédéral la lutte contre la criminalité organisée, la Suisse a décidé d'une réforme de ses services fédéraux de police qui globalise la lutte contre ce phénomène dont le blanchiment n'est qu'un des composants. On retrouve cette même démarche lorsqu'on se place sous l'angle de la surveillance. b) L'intégration du blanchiment dans l'ensemble des activités de surveillance Les autorités bancaires suisses ont développé une approche économique et prudentielle de la lutte contre le blanchiment des capitaux qui ne constitue qu'un des aspects de l'activité de la Commission fédérale des banques (CFB) comme l'a indiqué très clairement à la Mission, Mme Dina Balleyguier, responsable du service juridique de la CFB. « La Commission fédérale des banques est une autorité de surveillance globale. La lutte contre le blanchiment, n'est qu'un des aspects de notre activité. Notre tâche principale consiste en la surveillance des établissements qui nous sont assujettis, principalement quant à leur solvabilité et au contrôle du caractère irréprochable de leur activité globale. » Dans cette conception, le blanchiment des capitaux qui, par définition, ne présente guère de risque pour la solvabilité des établissements bancaires, ne sera considéré qu'en ce qu'il peut altérer le caractère irréprochable de la place financière suisse. Du point de vue des banquiers, le blanchiment est considéré avant tout comme un risque de réputation, alors que le blanchiment constitue un enjeu plus large d'ordre macro-économique et politique. Comme le rappelait récemment M. Niklaus Huber, le chef de l'Autorité de contrôle : « Du point de vue économique, le blanchiment d'argent est l'épiphénomène le plus important du crime organisé. Dans certains pays, les organisations criminelles qui opèrent au niveau international ont acquis un tel pouvoir qu'elles sont en mesure d'ébranler des gouvernements élus démocratiquement et de manipuler les processus de décision politiques. » 36 Dans la mesure où les autorités suisses ont actuellement engagé à la fois une restructuration de leurs services de police en vue d'assurer une meilleure efficacité de la lutte contre la criminalité organisée (projet de loi sur l'efficacité) et une réflexion générale sur la surveillance des marchés financiers (Commission Zufferey), la question pouvait donc se poser à cette occasion de procéder éventuellement à la création d'une unité ad hoc chargée de s'assurer du respect de la loi anti-blanchiment et de l'ensemble des obligations de diligence applicables à tous les acteurs économiques exposés à ce risque. Cette voie n'a pas été retenue, puisqu'un pas supplémentaire dans l'intégration des autorités de surveillance vient d'être suggéré. La commission d'experts, présidée par le professeur Jean-Baptiste Zufferey, chargée de réfléchir à la réglementation et la surveillance des marchés financiers en Suisse 37 a préconisé la création d'une Autorité de surveillance intégrée regroupant les compétences actuellement attribuées à la Commission fédérale des banques et à l'Office fédéral des assurances privées (Recommandation 36) en précisant que cette autorité intégrée « aura également la tâche de veiller à ce que les prestataires de services financiers qu'elle surveille prudentiellement respectent la loi sur le blanchiment d'argent » et que « les organismes d'autorégulation qui existent aujourd'hui sur la base de cette loi seront associés à la formulation des réglementations, mais n'assumeront pas de tâches de surveillance » (Recommandation 38). En effet, le rapport Zufferey, dans son point 625, suggère, si la nouvelle Autorité de contrôle des marchés financiers était créée, de lui accorder la compétence de veiller à ce que tous les nouveaux intermédiaires financiers placés sous son contrôle respectent leurs obligations découlant de la loi anti-blanchiment. Estimant que la plupart des intermédiaires financiers sont désormais autorégulés et qu'ils sont donc affiliés à un OAR, la commission des experts considère que les OAR, dans ce nouveau contexte, n'auraient plus à contrôler l'application de la LBA, mais resteraient associés, en tant qu'organes consultatifs, à la formulation et à l'élaboration des réglementations. Cette solution, si elle était retenue par les autorités fédérales, aboutirait de fait à un affaiblissement considérable de l'Autorité de contrôle instituée par la LBA. S'il était adopté, ce point 625 pourrait apparaître en contradiction avec les engagements récents pris par les autorités fédérales de renforcer les moyens accordés à l'Autorité de contrôle. En somme, la question du blanchiment des capitaux en même temps qu'elle est considérée comme un enjeu d'ordre public qu'il convient d'évoquer au niveau fédéral, devient un élément d'ensembles de plus en plus larges. En amont le blanchiment serait intégré dans le champ général de la fonction de surveillance des institutions financières, traité comme une application particulière de la surveillance prudentielle. En aval le blanchiment est englobé dans le cadre général de l'analyse de la criminalité économique organisée au sein du service d'analyse et de prévention. Cette approche globale est-elle de nature à mieux prendre en compte et à lutter plus efficacement contre le phénomène du blanchiment des capitaux. Rien ne permet pour l'instant de l'affirmer. Depuis plus de vingt ans, les banquiers suisses ont acquis la conviction que le blanchiment d'argent, auquel ils se trouvaient exposés, finirait par être fatal à la réputation d'excellence de la place financière suisse si cette dernière ne réagissait pas. En adoptant, en octobre 1977, une loi fédérale-cadre sur le blanchiment de l'argent sale, dite loi LBA, la Suisse a manifesté sa volonté de faire de la lutte anti-blanchiment un objectif qui concerne l'ensemble des acteurs économiques qui exercent une activité d'intermédiaire financier. Voilà bientôt trois ans que la loi LBA est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Si l'on s'interroge sur les changements concrets apportés par cette récente législation, on ne peut qu'être frappé d'une part, par l'utilisation encore très timorée de l'obligation de communiquer posée par la loi, d'autre part, par la persistance, dans les affaires de blanchiment, du mécanisme classique de l'ouverture de comptes par un représentant d'une société offshore, enfin par la difficulté à transposer à l'ensemble des intermédiaires financiers le principe d'autorégulation régissant les banques. 1) Élargir l'obligation de communiquer L'obligation de communiquer les soupçons fondés au Bureau de communication, entrée en vigueur depuis le 1er avril 1998, ne connaît aujourd'hui qu'un embryon d'application (370 communications pour l'année 1999-2000) et reste essentiellement - à 85 % - le fait des banques, les autres intermédiaires financiers étant pour ainsi dire absents de cette procédure avec 57 annonces enregistrées par le Bureau de communication alors que plusieurs milliers d'acteurs économiques sont concernés par cette disposition. Actuellement, l'obligation de communiquer reste limitée, en pratique, par l'engagement d'une relation d'affaire et il n'existe pas de cas d'annonces systématiques au Bureau de communication dans certaines circonstances préalablement définies. Pour les banquiers, cette obligation d'annonce qui représente une dérogation sérieuse au principe du secret bancaire, reste encore un acte difficile à accomplir même si leur situation n'est pas comparable à celle des intermédiaires non financiers dont la contribution est quasi nulle. Par conséquent, il leur sera toujours plus facile de refuser purement et simplement la relation d'affaires que d'avoir à effectuer une déclaration de soupçons si la relation de compte est acceptée. Si l'obligation de communiquer a notamment pour objectif de permettre à la justice de disposer du maximum d'éléments d'information pour lutter avec davantage d'efficacité contre le blanchiment, la Suisse ne devrait-elle pas dès lors harmoniser la situation ? À l'heure actuelle les intermédiaires financiers non bancaires sont strictement soumis à la L.B.A. qui lie l'obligation de communiquer à l'existence d'une relation d'affaires alors que les banquiers ont apparemment renforcé cette obligation en la faisant jouer également en dehors de la relation d'affaires. Mais dans ce dernier cas, les conditions posées par la circulaire de la Commission fédérale des banques sont telles - existence de soupçons fondés manifestes - que cette extension de l'obligation de communiquer n'est que théorique. En pratique, les banques, comme les autres intermédiaires financiers, n'appliquent pas l'obligation de communiquer en dehors de la relation d'affaires. La législation suisse gagnerait en efficacité à poser le principe d'une obligation de communiquer en cas de simple soupçon, que l'on soit ou non dans le cadre de la relation d'affaires, applicable à tout intermédiaire financier bancaire ou non bancaire et à renoncer en conséquence au blocage systématique des fonds accompagnant la déclaration de soupçon. La Suisse, d'autre part, ne s'est pas engagée, pour l'instant, dans la voie consistant à définir un certain nombre de cas qui entraîneraient automatiquement une annonce au Bureau de communication. Il n'existe pas de dispositions similaires à celles que le législateur français vient d'adopter, dans le cadre des « nouvelles régulations économiques », instaurant une déclaration de soupçon systématique dès lors que l'opération envisagée fait intervenir un fonds fiduciaire ou un territoire offshore non coopératif tels que ceux définis par le GAFI. Si la Suisse entend réellement démanteler un des mécanismes de base du blanchiment, à savoir l'utilisation de sociétés domiciliées offshore dans des territoires non coopératifs, il lui faudra renforcer sa législation et prévoir des obligations plus contraignantes que l'incitation des banquiers à une vigilance renforcée. Cette seule réponse apparaît désormais comme tout à fait insuffisante et très en retrait dans le contexte européen, chaque Etat membre de l'Union s'étant engagé à l'issue du Conseil du 17 octobre 2000, à mettre en place le principe d'une déclaration systématique de toute transaction financière avec les territoires non coopératifs. 2) Identifier systématiquement les ayants droit économiques Le principal sujet de préoccupation concerne le champ d'application de l'obligation d'identification des ayants droit économiques des comptes bancaires qui ne s'applique que pour les comptes ouverts depuis juillet 1998 et laisse sans solution satisfaisante la situation des comptes ouverts antérieurement qui ne seront pris en considération qu'au cas par cas si un doute survient. Alors que les intermédiaires financiers non bancaires doivent, en application de la LBA, avoir mis à jour depuis le 1er avril 2000, en les renseignant correctement, l'ensemble de leurs dossiers quel que soit leur date de création, les banques ont échappé à un tel butoir. Cette situation est surprenante et réclamerait sans doute une égalité de traitement, qui soumettrait les banques comme les autres intermédiaires financiers, à moyen terme, à une mise à jour documentaire et à une identification des ayants droit de tous les comptes de leurs clients. Par ailleurs, la procédure d'identification prévue par la Suisse connaît trop d'exceptions concernant notamment les fondations. Enfin, il serait souhaitable que l'identification de l'ayant droit soit systématiquement entreprise par la banque chaque fois que le cocontractant se trouve être un représentant d'une profession à secret (avocat, notaire etc.) qui n'agit pas en qualité d'intermédiaire financier En effet, cette situation est constitutive de failles et aboutit à laisser sans contrôle l'apport de fonds pratiqué lors d'opérations commerciales telle que l'augmentation de capital d'une société. Le GAFI a abordé cette question dans son dernier rapport sur les typologies du blanchiment de février 2001 en estimant que « les avocats, notaires, comptables et autres professionnels proposant des conseils financiers constituent désormais une composante commune dans les mécanismes complexes de blanchiment de capitaux » (point31) et qu' «en conséquence, les professionnels du droit et de la comptabilité sont en quelque sorte des « ouvreurs de porte » puisqu'ils ont la possibilité d'ouvrir l'accès (sciemment ou à leur insu) aux diverses fonctions susceptibles d'aider des criminels ayant des fonds à déplacer ou à dissimuler » (point 32). 3) Lutter contre l'utilisation de sociétés de domicile offshore La troisième question sensible est celle de l'application de procédures de diligence renforcées ou de la création d'une obligation de communication systématique dans certaines circonstances objectivement définies. En juin 2000, le GAFI a publié une liste de territoires qualifiés de non coopératifs au regard d'une liste de vingt-cinq critères préalablement définis. Ces territoires constituent non seulement ce qu'il est convenu d'appeler des paradis fiscaux, mais aussi des paradis judiciaires dans lesquels la réglementation est aussi inexistante que la coopération judiciaire. Par conséquent, pour une société, s'installer dans de tels lieux représente bien des avantages de discrétion et de garantie d'impunité. Mais que penser de surcroît lorsqu'une telle société offshore domiciliée dans un de ces territoires non coopératifs ouvre un compte en Suisse géré sur place par un intermédiaire financier exerçant lui-même une profession non réglementée - cas du gestionnaire de fortune indépendant - ou constitué sous la forme d'une société fiduciaire ? Si toutes les sociétés de domicile offshore ne masquent pas des opérations de blanchiment, en revanche, les affaires de blanchiment qui ont eu lieu en Suisse font intervenir quasi systématiquement une société domiciliée dans un territoire non coopératif détentrice d'un compte bancaire géré par un tiers opérant sur le territoire helvétique. Dans ces conditions, la Suisse ne pourrait-elle pas considérer dans ce cas que toute relation d'affaires qui fait apparaître l'intervention d'une société offshore domiciliée dans un des territoires non coopératifs identifiés par le GAFI devrait faire l'objet d'une annonce systématique au Bureau de communication et de procédures d'identification et de clarification renforcées ? Si l'identification de l'ayant droit économique est effectuée « avec le soin approprié aux circonstances », c'est en application de ce principe qu'il faudrait exiger, lorsqu'intervient dans la relation d'affaires une société offshore installée dans un territoire jugé non coopératif, la présence physique de l'ayant droit économique au côté du cocontractant au moment où se noue ladite relation. Rappelons que cette solution exigeante a été proposée par le professeur Paolo Bernasconi, un des plus éminents spécialistes des questions de criminalité financière et de blanchiment, qui parle d'expérience. Sur cette question des territoires offshore, la Commission fédérale des banques a déjà apporté un premier élément de réponse en appelant les banques suisses à une vigilance particulière dans l'application des procédures d'identification lorsque la relation d'affaires fait intervenir un établissement bancaire situé dans un territoire figurant sur la liste noire du GAFI. Mais cette précaution semble bien faible au regard des potentialités de blanchiment qu'offre la domiciliation de sociétés offshore dans de tels lieux. De façon plus générale, cette situation est dénoncée régulièrement par les magistrats suisses qui se sont lancés avec courage et détermination dans la lutte anti-blanchiment. Elle appelle une réponse politique et une intervention - non pas des banques ou des acteurs financiers - mais du législateur lui-même, même si elle ne concerne pas exclusivement le législateur suisse. On ne peut, dans ces conditions, qu'approuver sans réserve les déclarations du procureur Bertossa38 : « Cela ne coûterait rien à la communauté internationale de constater que les prétendues sociétés panaméennes, celles des îles Vierges, des îles anglo-normandes ou des Anstalts du Liechtenstein n'existent pas. Ce serait tout simple. Ce serait la vérité. Et pourtant, on ne le fait pas, tout en sachant que ces instruments sont largement utilisés par les fraudeurs fiscaux d'une part, et par les blanchisseurs d'argent d'autre part. » 4) Réglementer l'ensemble des services financiers La Suisse pourra-t-elle continuer à accepter indéfiniment que certaines professions financières restent en dehors de toute réglementation générale, alors que les Etats membres de l'Union européenne sont tenus, depuis l'entrée en vigueur de la directive sur les services financiers du 10 mai 1993, de soumettre à des conditions d'exercice et à une surveillance minimale les intermédiaires actifs dans la gestion de patrimoine de tiers ? S'agissant des prestataires de services financiers actuellement non réglementés en Suisse, la Commission Zufferey a notamment estimé : - « La non-réglementation actuelle des introducing brokers apparaît comme une lacune, le législateur devrait la combler. » (Recommandation 29) Les introducing brokers sont des intermédiaires financiers, en Suisse, qui interviennent dans des opérations de négoce pour le compte de négociants étrangers. Dans leur fonctionnement, leurs activités sont semblables à celles des gérants de fortune, en ce sens qu'ils agissent à partir des comptes de leurs clients sur lesquels ils ont souvent une procuration. - « Les négociants en devises devraient faire l'objet d'une réglementation. » (Recommandation 30) - « [...] une réglementation et une surveillance des gestionnaires de fortune indépendants se justifient [...] » (Recommandation 31) La qualité professionnelle des gérants de fortune indépendants qui gèrent au bas mot 300 milliards de francs suisses n'est, à la différence de la gestion de fortune effectuée par les établissements bancaires, en rien garantie à l'heure actuelle et peut, de plus, représenter un risque pour les banquiers qui travaillent avec certains d'entre eux. Ainsi, le rapport de gestion de la Cour Suprême de Berne constate « l'augmentation des délits au préjudice des banques et des investisseurs, de même que les délits commis par des gérants de fortune malhonnêtes, est frappante. »39 La commission Zufferey s'est prononcée en faveur de la réglementation de cette profession tout en s'interrogeant sur le bilan coût/avantage d'une telle solution. La décision qui sera prise à ce sujet par les autorités suisses de soumettre cette profession à une réglementation générale sera significative de la volonté politique de mettre fin à une situation que l'on retrouve fréquemment exploitée dans les affaires de blanchiment auxquelles la Suisse est confrontée. Enfin, la double qualité de gestionnaire de fortune indépendant et celle d'avocat ou de notaire tenu au secret professionnel constitue une source de confusion sur l'étendue de ces deux activités et des législations qui en relèvent respectivement. L'enchaînement de ces différents mécanismes que sont la domiciliation d'une société offshore dans un territoire non coopératif, le recours à un tiers gérant exerçant sa profession dans un contexte non surveillé ou dans une situation où la confusion des qualités est permise - le cocontractant agit-il en tant qu'intermédiaire financier soumis à la L.B.A. ou en tant que notaire ou avocat relevant du secret professionnel ? - fragilise l'ensemble du système. 5) Enregistrer l'ensemble des intermédiaires financiers Il convient également de s'interroger sur l'efficacité de la transposition du principe d'autorégulation à l'ensemble des intermédiaires financiers soumis à la L.B.A. En opérant un tel choix, les autorités suisses ont délibérément fait de l'Autorité de contrôle une autorité administrative à compétence subsidiaire dotée par conséquent de moyens fort limités qui sont apparus en totale disproportion par rapport au nombre d'intermédiaires financiers qui relèvent en réalité de sa tutelle directe. La lourdeur du processus et le temps qui sera nécessaire pour mettre en place les OAR et une surveillance efficace de leurs affiliés demandera très vraisemblablement de longues années avant de pouvoir apprécier si, réellement, l'autorégulation a atteint son but. D'ici là, les mécanismes utilisés par les blanchisseurs risquent fort d'être encore largement exploités sans grand risque pour ces derniers. Avant que la LBA n'ait atteint sa pleine application avec la mise en place de l'autorégulation, le législateur fédéral ne devrait-il pas au moins envisager l'extension à l'ensemble des cantons du principe de l'enregistrement obligatoire des intermédiaires financiers tel que le pratique le Tessin ? Pour l'instant, la vive résistance de certaines professions aux décisions prises par l'Autorité de contrôle, soucieuse de faire appliquer strictement la législation, témoigne encore de l'insuffisante sensibilisation au risque de blanchiment et laisse présager des difficultés dans l'application des obligations de diligence et de communication par des professions qui sont pourtant fort exposées au risque de blanchiment - hôteliers qui procèdent à des activités de change, ou négociants en matières premières et métaux précieux. 6) Supprimer les voies de recours Les possibilités de recours admis par la Suisse constituent actuellement une entrave au bon fonctionnement de l'entraide judiciaire entre la Confédération et ses partenaires européens. Ces recours ne font qu'allonger de plusieurs années la procédure d'entraide et ne satisfont qu'un objectif apparent- la protection des droits de la défense -, derrière lequel se dissimule une volonté de protection des détenteurs de capitaux. Les droits de la défense et les libertés individuelles sont garantis de manière équivalente en Suisse et dans les pays de l'Union européenne. Il n'est donc pas nécessaire de répéter des procédures de recours qu'offre déjà l'Etat requérant. Encore une fois si la Suisse sait reconnaître aux pays membres du GAFI une qualité de législation anti-blanchiment d'un niveau équivalent à celui de la législation suisse, elle doit pouvoir admettre par le même raisonnement l'équivalence du degré de protection des libertés individuelles accordé par les pays de l'Union européenne et par la Confédération helvétique. 7) Elargir la levée du secret bancaire Désireuse de réaffirmer sa volonté de lutter efficacement contre le blanchiment et la criminalité organisée, la Suisse devra aussi évoluer sur sa conception de la défense du secret bancaire, compte tenu de la récente décision intervenue entre les Etats membres de l'Union européenne d'harmoniser la fiscalité de l'épargne. Cette décision, prise de 27 novembre 2000, a pour corollaire l'échange d'informations et, par voie de conséquence, la suppression du secret qui pourrait leur être opposable. Face à cette initiative qui va conduire l'Union européenne à engager les négociations avec les pays tiers dont la Suisse, le porte-parole du ministère suisse des Finances et le porte-parole de l'Association suisse des banquiers ont réagi à l'unisson40 : « Nous sommes prêts à aider l'Union européenne dans la question de l'harmonisation fiscale, mais pas question de toucher à notre secret bancaire garanti par la loi. Le secret bancaire n'est pas discutable ; nous espérons et croyons qu'une solution pourra être trouvée dans ce cadre de travail. » La Suisse souhaite faire accepter le principe d'une imposition à la source qui, en contrepartie, la dispenserait de sa participation à un système de communication de renseignements entre les différents fiscs nationaux, principe considéré comme inacceptable car en violation flagrante du secret bancaire. La Suisse n'a cependant aucun intérêt objectif à attirer des capitaux en masse au seul motif de les soustraire à la législation de l'Union européenne. En se marginalisant de la sorte, la Suisse ne ferait que rendre plus difficile la réalisation de ses ambitions internationales - adhérer à l'ONU d'ici 2003 et à l'Union européenne d'ici 2008 - et la conclusion des accords bilatéraux engagés avec chacun des pays de l'Union européenne. De son côté, l'Union européenne verrait difficilement le fait d'être traitée de façon plus inconfortable que les Etats-Unis qui ont signé avec la Suisse une convention de double imposition et ont décidé d'appliquer leur loi fiscale de façon « extra-territoriale ». De façon générale, si la Suisse veut témoigner de sa réelle volonté de lutter avec détermination contre le blanchiment des capitaux, il lui sera difficile de défendre en même temps la pérennité de son secret bancaire dans un contexte européen où cette particularité ne fera qu'attirer davantage les capitaux d'origine douteuse en quête de discrétion. Les autorités fédérales suisses auront-elles suffisamment de pouvoir pour faire évoluer les banquiers ? La partie s'annonce difficile et l'on constate que le débat engagé autour de la suppression ou de l'assouplissement du secret bancaire il y a une vingtaine d'années est toujours d'actualité. La lutte contre la criminalité économique et le blanchiment des capitaux ne peut reposer sur la seule responsabilité des acteurs économiques et, avant tout, celle des banques. Il appartient désormais à l'Etat suisse de démontrer politiquement sa volonté de placer ce combat au centre de ses préoccupations en mettant la Confédération au même niveau que ses voisins européens qui ont adopté le principe de la réglementation des services financiers (directive de 1993), exprimé un accord politique déclarant la non-opposabilité du secret bancaire et fiscal dans les enquêtes en matière de criminalité organisée ou de blanchiment et reconnaissant la nécessité de centraliser les données relatives aux comptes bancaires d'une même personne (Conseil « justice affaires intérieures »du 17 octobre 2000), et enfin accepté, avec l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne des non-résidents, la suppression à terme du secret bancaire (Conseil de Feira du 27 novembre 2000). C'est à ce prix que se construira l'Europe que les juges de l'Appel de Genève ont appelée de leurs v_ux : « Une Europe plus juste et plus sûre, où la fraude et le crime ne bénéficient plus d'une large impunité et d'où la corruption sera réellement éradiquée. Il en va de l'avenir de la démocratie en Europe et la véritable garantie des droits du citoyen est à ce prix. » La Mission d'information a procédé à l'examen du rapport de M. Arnaud Montebourg au cours de sa séance du 7 février 2001. M. Vincent Peillon, président, a indiqué qu'après s'être intéressé à la situation des principautés du Liechtenstein et de Monaco, la Mission d'information a préparé un rapport sur la Suisse, où elle s'est rendue à deux reprises - la première fois, afin d'étudier le système existant et la seconde, pour approfondir son analyse et préciser les évolutions constatées depuis la première visite. La lutte contre le blanchiment en Suisse a donné lieu à l'adoption de très nombreux textes, dont la loi cadre sur le blanchiment d'argent (LBA) votée en 1997 constitue l'aboutissement. Le législateur suisse, en application du principe de l'autorégulation, ayant laissé aux intermédiaires financiers la responsabilité de mettre en place les mécanismes de surveillance et de respect des règles anti-blanchiment, la question de l'efficacité de cette politique fait actuellement l'objet d'un débat dans la Confédération helvétique. Perçue comme un pays offensif dans le combat anti-blanchiment, la Suisse n'en reste pas moins confrontée à la succession de scandales financiers qui fournissent ensuite autant d'occasions de constater que la coopération judiciaire n'est pas toujours exempte de lenteurs et de formalisme. Par ailleurs, la Suisse reste encore trop ouverte à l'utilisation de mécanismes trop systématiquement empruntés par la criminalité financière. Il en va ainsi de l'utilisation des fiduciaires, qui permettent de déjouer les procédures d'identification des bénéficiaires réels des fonds et qui de ce fait, constituent une zone d'ombre préoccupante au sein des dispositifs de contrôle. Le travail mené par la Mission sur la Suisse met davantage l'accent sur la place centrale qu'occupe le système bancaire et financier au regard du phénomène du blanchiment et pose ainsi indirectement la question de l'engagement de l'ensemble des acteurs du système financier international dans la lutte contre la délinquance financière. M. Arnaud Montebourg, rapporteur, a rappelé que les travaux de la Mission d'information reposent sur l'étude des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux dans des pays dont certaines caractéristiques posent problème. Ces travaux ont d'ores et déjà débouché sur des évolutions positives à Monaco ou au Liechtenstein, ce dont on ne peut que se réjouir. En effet, le langage tenu par les parlementaires de la Mission exprime la volonté politique de tous les démocrates européens, de combattre efficacement, en s'affranchissant des frontières nationales, la délinquance financière. Au regard des normes anti-blanchiment, la Suisse apparaît dans une position de retrait vis-à-vis de l'Union européenne et des réglementations élaborées au niveau mondial, tout en ayant développé une stratégie habile de captation des capitaux privés venant alimenter le marché rémunérateur de la gestion de patrimoine. Avec 7 millions d'habitants, la Suisse peut s'enorgueillir de gérer 14 000 milliards de francs de fortunes privées. Un travail de relations publiques aussi discret qu'efficace, lui permet aujourd'hui de se présenter comme un Etat vigoureux dans ses efforts de lutte contre le blanchiment, alors que la réalité est bien plus subtile. Les banquiers, inquiets malgré tout du regard international, restent avant tout préoccupés par la défense de l'image de la place financière suisse. On ne peut en effet que s'étonner de la faiblesse du nombre de déclarations de soupçons reçues par le Bureau de communication - moins de 400 - dont 313 proviennent des établissements bancaires, qui ne font souvent qu'intervenir à la suite d'informations publiées dans la presse. De même, la Suisse ne s'est dotée d'un instrument législatif plus coercitif qu'en 1998, soit près de dix ans après les conclusions du sommet de l'Arche et l'intervention du législateur français. Au cours des dernières années, toutes les affaires financières criminelles ont, à un moment donné, fait intervenir des comptes bancaires ou des fiduciaires situés en Suisse. Ces dernières constituent un véritable « trou noir » dans le système financier mondial, que le dernier rapport du GAFI vient de dénoncer vigoureusement. En conséquence, l'absence de toute déclaration de soupçon par l'organisme autorégulateur des fiduciaires n'en apparaît, dès lors, que plus surprenant. Le fonctionnement de l'appareil judiciaire suisse apparaît contrasté. Certains magistrats des cantons de Genève et du Tessin notamment, auxquels il convient de rendre publiquement hommage, ont su engager des actions très fermes contre le blanchiment ; d'autres en revanche, dans les cantons alémaniques, font plus souvent preuve de formalisme et de réserve. Enfin, l'existence de voies de recours dans les procédures d'entraide judiciaire contribue à ralentir considérablement cette coopération - puisque les actes du juge sont susceptibles de se voir contestés jusque devant le tribunal fédéral. Par ailleurs, le refus des autorités d'accorder l'entraide judiciaire dès lors que l'infraction revêt un caractère d'évasion fiscale, constitue un obstacle de taille pour les juges étrangers qui auraient à solliciter l'aide de la Suisse. Il est enfin remarquable que, sur la question douloureuse des avoirs juifs en déshérence, seule une pression internationale continue ait permis de faire plier les réticences d'un monde bancaire particulièrement peu enclin à coopérer. Les investigations de la Mission l'ont, d'autre part, conduite à s'interroger très fortement sur la nature réelle des activités de la filiale française d'une banque suisse, ayant pignon sur rue et elle-même sous le coup d'une plainte judiciaire. Par ailleurs, la Mission a recueilli les dépositions d'une avocate sur la connivence d'intermédiaires financiers complices de crimes graves. En conséquence, la Mission a approuvé la proposition du rapporteur de transmettre, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations ainsi recueillies, aux autorités judiciaires pénales compétentes. Mme Chantal Robin-Rodrigo a salué le travail effectué par la Mission et le courage d'une démarche novatrice et ambitieuse. Les conclusions du rapport apparaissent en effet bien sévères vis-à-vis du système bancaire suisse, dont on pouvait attendre davantage de participation dans la lutte anti-blanchiment et surtout accablantes pour les autres intermédiaires financiers quasiment absents de ce combat. M. Jean-Claude Lefort a estimé que la Suisse constitue l'exemple d'un modèle de développement économique et financier intrinsèquement pervers. Les travaux de la Mission d'information prennent le relais des propos courageux que M. Jean Ziegler avait su tenir il y a quelques années. Ce rapport fera vraisemblablement l'objet de critiques abondantes en Suisse, mais il est probable qu'il y est aussi attendu par tous ceux qui _uvrent contre le blanchiment. Il convient donc que la plus large publicité possible puisse lui être donnée. M. Vincent Peillon, président, a également admis que seule la pression internationale avait pu faire évoluer la Suisse sur le problème des avoirs juifs, comme en atteste la publication récente d'une liste de 21 000 noms supplémentaires. Les réticences des intermédiaires financiers y apparaissent patentes, qu'il s'agisse de la facilité avec laquelle les avoirs de divers potentats africains ou de mafias de l'Est sont accueillis par la place financière helvétique ou du constat que plus de la moitié des déclarations de soupçons bancaires sont motivées par des signalements provenant de sources extérieures aux banques. Le problème des fiduciaires, particulièrement préoccupant, révèle une certaine hypocrisie des autorités, qui savent à la fois présenter une vitrine législative avenante et se montrer peu regardantes sur la réalité des pratiques. La Mission s'est prononcée en faveur de la publication de ce rapport. EXPLICATIONS DE VOTE DU COMMISSAIRE APPARTENANT Le groupe Démocratie Libérale approuve les conclusions de la Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe concernant plus particulièrement la Suisse. Le groupe Démocratie Libérale rappelle que la lutte contre le blanchiment d'argent sale doit constituer une priorité pour les Etats, notamment pour ceux qui fournissent actuellement un cadre juridique, financier, fiscal et bancaire exceptionnellement favorable à la circulation et au placement de capitaux provenant directement ou indirectement de la criminalité organisée. EXPLICATIONS DE VOTE DU COMMISSAIRE APPARTENANT La criminalité financière prospère dans un contexte de mondialisation libérale, de concurrence fiscale entre les Etats, de lenteur de la coopération internationale. Les « paradis fiscaux » sont les grands recycleurs de cet argent sale. Après les monographies sur le Liechtenstein et Monaco, ce rapport sur la timidité de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Suisse contribue à sensibiliser l'opinion et le gouvernement sur l'ampleur du dispositif judiciaire à mettre en _uvre sur notre propre continent. Il ne s'agit pas de s'ériger en donneurs de leçons, ni de stigmatiser un pays étranger, mais de soutenir le courage de nombreux avocats, magistrats et personnalités suisses qui, comme Jean Ziegler, se sont élevés depuis longtemps contre les pratiques bancaires dans leur propre pays. L'expérience a montré, d'autre part, que les banques suisses étaient très sensibles à la pression internationale même si leurs réponses ne s'avèrent pas toujours à la hauteur. En témoigne ainsi la longue réticence des banques suisses à reconnaître la rétention des avoirs juifs confiés par près de 30 000 victimes de l'Holocauste durant la seconde guerre mondiale, puis leur mauvaise volonté à communiquer une liste précise. Malgré une loi-cadre contre le blanchiment des capitaux appliquée depuis 1998, les travaux de la Mission montrent bien la timidité des avancées dans ce « centre offshore » qui gère un tiers de la fortune mondiale placée par des non résidents. Les directives du GAFI sont interprétées de manière restrictive. En pratique, l'unité de renseignement financier suisse dispose de faibles moyens humains et le nombre de déclarations de soupçon recensé est dérisoire. L'identification des ayants droit économiques, les conditions de levée du secret bancaire sont très insuffisantes. Le rapport pointe également la difficulté d'octroi de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale qui obéit à une procédure très complexe et se heurte à des pratiques différentes selon les cantons. Alors que la Suisse envisage tôt ou tard une adhésion à l'Union européenne, la représentation nationale française ne pouvait se désintéresser des pratiques bancaires de ce pays qui entravent une bonne harmonisation fiscale européenne. Le groupe communiste soutient donc les mesures préconisées en conclusion des travaux de la Mission et se prononce favorablement sur le rapport. Entretien avec les représentants des autorités fédérales suisses : (soit par ordre d'intervention...) M. Niklaus HUBER, Mme Natacha POLLI, Mme Dina BALLEYGUIER, M. Riccardo SANSONETTI, M. Alexander HARTMANN, M. Beat FREY, (compte-rendu de l'entretien du 29 septembre 1999 en Suisse) Présidence de M. Vincent PEILLON, président M. Niklaus HUBER : Messieurs les députés, c'est pour nous un honneur de recevoir une délégation de l'Assemblée nationale française. Nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez aussi bien pour notre législation que pour les efforts déployés concrètement par la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Permettez-moi de me présenter brièvement, ainsi que les personnes qui se trouvent à mes côtés. Je m'appelle Niklaus Huber, je suis le chef de l'autorité de contrôle au sein de l'administration fédérale des finances. Mme Natacha Polli, avocate genevoise, est responsable du service juridique de l'autorité de contrôle, chef suppléante de l'autorité de contrôle. Mme Dina Balleyguier, membre du service juridique de la Commission fédérale des banques, est en charge en particulier de l'application de la loi sur la bourse et le commerce des valeurs mobilières. M. Riccardo Sansonetti est présent en sa qualité de membre de la délégation suisse auprès du GAFI. M. Alexander Hartmann est membre du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. M. Beat Frey, que j'ai le plaisir de rencontrer pour la première fois, est le chef de la section de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police. Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte à la lecture de la documentation qui a été mise à votre disposition par les soins de l'ambassade de France à Berne, notre pays dispose aujourd'hui d'une législation moderne et complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier en ce qui concerne le secteur parabancaire. Les recommandations du GAFI sont ainsi pleinement mises en _uvre. Aucun autre pays n'a, à notre connaissance, de législation comparable, de sorte que la Suisse se situe sans conteste dans le groupe de tête des nations engagées dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Les Etats-Unis ont reconnu, dans un rapport du State Departement de novembre 1998, que la Suisse avait une législation très progressiste en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous pouvons ainsi être fiers des efforts déployés à ce jour. Il faut toutefois se garder de suffisance, car le combat contre le crime organisé est loin d'être terminé. Un aspect important de ce combat est, bien entendu, la coopération internationale. A ce titre, le GAFI constitue un forum de discussion important mais il ne saurait remplacer les discussions bilatérales. La rencontre de ce jour en est, du reste, une démonstration. Il est en effet important, à nos yeux, de renforcer encore la coopération traditionnellement mise sur pieds entre États voisins comme la Suisse et la France. Les présentations qui vont suivre sont destinées à vous offrir un premier survol de l'état actuel de la mise en _uvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse. Une courte documentation vous sera remise afin de compléter vos dossiers. Nous avons par ailleurs réservé quarante-cinq minutes à l'issue des diverses présentations afin que vous puissiez poser des questions aux différents intervenants. La parole est à Mme Polli. Mme Natacha POLLI : Je reviendrai sur un certain nombre de points développés dans la loi sur le blanchiment d'argent, puis je décrirai l'activité déployée par l'autorité de contrôle depuis son entrée en fonction en 1998. En tant que membre du GAFI, la Suisse, pour satisfaire à ses obligations, a adopté le 10 octobre 1997 sa loi sur le blanchiment d'argent - la LBA. Elle complétait, en fait, un certain nombre de dispositions qui avaient déjà été introduites dans le code pénal en 1990 et 1994. En 1990, une disposition pénalisait le blanchiment d'argent et le défaut de vigilance des intermédiaires financiers. En Suisse, est considérée comme infraction préalable au blanchiment d'argent toute infraction qualifiée de crime et donc passible de réclusion. Cela concerne à la fois les infractions liées au trafic de stupéfiants, bon nombre des infractions contre le patrimoine et l'encouragement à la prostitution. La définition est donc extrêmement large. En 1994, le code pénal avait déjà accordé un droit de communication aux intermédiaires financiers qui pouvaient ainsi informer les juges des cas où ils soupçonnaient du blanchiment d'argent. Comme vous l'avez probablement constaté à la lecture de son texte, la LBA est une loi-cadre qui repose sur le principe de l'autorégulation. L'autorégulation a été choisie pour plusieurs raisons : d'une part, parce que nous avions déjà l'expérience de l'application de la loi sur les bourses, qui s'est révélée plutôt efficace et, d'autre part, en raison de l'intérêt d'avoir des organismes qui seraient des spécialistes des diverses activités des intermédiaires financiers qu'ils surveillent. La LBA définit les conditions personnelles et matérielles qui doivent être remplies par un intermédiaire financier qui, renonçant à la possibilité de l'autorégulation La LBA dresse la liste d'un certain nombre d'obligations de diligence très classiques : identification du cocontractant et obligation de documentation. Enfin, la LBA a introduit l'obligation de communiquer et de bloquer les avoirs en cas de soupçons fondés de blanchiment d'argent. Suite à l'introduction de la loi sur le blanchiment d'argent, deux nouvelles autorités ont été créées, qui sont représentées ici : l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sera l'autorité de surveillance des intermédiaires financiers, rattachée à l'administration fédérale des finances, et le Bureau de communication, rattaché à l'Office fédéral de la police, qui est chargé de recueillir les différentes communications. Mais ce ne sont pas les seules autorités chargées de mettre en application la loi sur le blanchiment d'argent, puisque d'autres autorités ont été introduites par des lois spéciales, telles que la Commission fédérale des banques, qui surveille les banques, les directions de fonds de placement et les négociants en valeurs mobilières. Une nouvelle autorité, la Commission des maisons de jeux, est en cours d'installation. En effet, dès le printemps 2000, l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeux entraînera une modification du périmètre de la loi sur le blanchiment d'argent, puisqu'elle prévoit expressément que les maisons de jeux sont soumises à la LBA. S'agissant du champ d'application, la LBA s'applique à toute personne physique ou morale agissant à titre professionnel, c'est-à-dire contre rémunération, acceptant en garde ou en dépôt, ou aidant à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales de tiers. C'est une définition extrêmement large, qui comprend non seulement les intermédiaires financiers particuliers déjà cités, mais aussi tout gérant de fortune, les bureaux de change dans les gares, voire les stations-service qui fournissent des prestations de change, la poste avec ses services financiers, les chemins de fer fédéraux qui ont ouvert des bureaux de change et qui fournissent des services en matière de transfert d'argent, notamment par l'intermédiaire de Western Union. C'est donc un champ extrêmement large qui peut aussi, sous certaines conditions, s'appliquer aux avocats et notaires qui, à côté de leurs activités soumises à monopole, développent des activités d'intermédiation financière. La loi sur le blanchiment d'argent est entrée en application progressivement. Les organismes d'autorégulation ont eu jusqu'au 31 mars 1999 pour se déclarer auprès de l'autorité de contrôle, lui soumettre leurs statuts et leur règlement. Le but de ce délai n'était pas d'avoir un numerus clausus d'organismes d'autorégulation puisque des organismes d'autorégulation peuvent également s'annoncer aujourd'hui. Il s'agissait de faire en sorte qu'ils soient prêts pour que les intermédiaires financiers qui ont, eux, jusqu'au 31 mars 2000 pour se mettre en conformité avec la loi, soit en s'affiliant à un organisme d'autorégulation, soit en demandant une autorisation à l'autorité de contrôle, aient le temps de faire les démarches nécessaires. Au 1er avril 1999, nous avions reçu douze dossiers de candidatures d'organismes d'autorégulation. Il est possible que quelques autres déposent leur dossier d'ici à la fin de cette année. En revanche, il n'est pas du tout garanti que ceux-ci soient reconnus avant fin mars 2000. M. le Président : Vous avez reçu douze demandes de reconnaissance. Leur avez-vous déjà accordé l'agrément ? Mme Natacha POLLI : Tout à fait, à l'heure actuelle 7 organismes d'autorégulation ont été agréés et cinq sont en cours d'agrément. Je reviendrai tout à l'heure en détail sur les qualités des différents organismes d'autorégulation. Les buts généraux de l'autorité de contrôle sont de garantir que tout intermédiaire financier actif en Suisse soit soumis à une surveillance, soit d'une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale, comme la Commission fédérale des banques, soit parce qu'il s'est affilié à un organisme d'autorégulation, soit parce qu'il nous est soumis. Nous devons ensuite assurer le bon fonctionnement de l'autorégulation. Les tâches de l'autorité de contrôle sont ainsi diverses. Dans une première phase, nous nous sommes principalement consacrés à l'octroi de reconnaissance à des organismes d'autorégulation. Nous sommes déjà entrés dans la deuxième phase, puisque certains intermédiaires financiers ont déjà déposé leur demande d'autorisation. Viendra ensuite la surveillance des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui nous sont directement soumis. La LBA consacre ses chapitres les plus longs aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle n'entre pourtant pas dans le détail. Elle énonce les différentes obligations de diligence qui sont maintenant imposées aux intermédiaires financiers : vérification de l'identité du cocontractant, identification de l'ayant droit économique, obligation particulière de planification pour des opérations inhabituelles laissant apparaître un indice de blanchiment d'argent - c'est probablement une des obligations les plus difficiles à mettre en _uvre et à surveiller -, obligation d'établir et de conserver les documents afférents à l'exécution de ces obligations de diligence. De plus, de par la loi, les intermédiaires financiers doivent, de façon interne, prendre des mesures organisationnelles particulières afin de mettre en _uvre la loi sur le blanchiment d'argent. Enfin, au chapitre des sanctions, des infractions pénales ont été introduites, pouvant aller jusqu'à une amende de 200 000 FS pour une personne qui exercerait en Suisse sans avoir d'autorisation ou sans être affiliée à un organisme d'autorégulation. La violation de l'obligation de communiquer est également sanctionnée par une amende de 200 000 FS. Dans le domaine de l'intermédiation financière, 200 000 FS peuvent paraître une amende assez faible. La mesure la plus efficace est la possibilité pour l'autorité de contrôle d'ordonner la dissolution de la société d'un intermédiaire financier qui ne se serait pas conformé à la loi ou de demander la radiation du registre du commerce d'une personne physique qui ne se serait pas conformée à la loi. Je vais maintenant vous exposer ce qui s'est passé au sein de l'autorité de contrôle depuis 1998. Au départ nous étions deux personnes, nous sommes aujourd'hui six et il est prévu que l'Autorité de contrôle compte dix personnes. Ce chiffre, assez faible, est justifié par le choix opéré du recours à l'autorégulation. L'Autorité de contrôle, qui doit aussi surveiller les organismes d'autorégulation, dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers, peut faire appel à des forces extérieures, notamment en confiant les contrôles sur place des intermédiaires financiers à des sociétés de révision externes. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle se contenterait de vérifier la façon dont est attribué le mandat à ces sociétés de révision et de contrôler le résultat de leur travail. Cela n'exigera donc pas de notre part d'aller vérifier personnellement des centaines, voire des milliers d'intermédiaires financiers. Dans la mesure où la LBA est une loi-cadre, l'autorité de contrôle a dû éditer un certain nombre de textes complémentaires à valeur normative, notamment des ordonnances, dont une purement technique sur les émoluments de l'autorité de contrôle et une autre, plus importante, relative au registre de l'autorité de contrôle. Nous avons en effet développé une banque de données performante destinée à pallier le fait que nous ne serons probablement à terme que dix personnes. Il est évident que la gestion des données qui nous sont confiées par les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers, et celle des documents que nous recevons, sous forme électronique ou papier, ne peut être réalisée sans une banque de données efficace. Nous l'avons développée durant la première année, afin de permettre une gestion dynamique de ces données, qui nous permette de faire des recherches en plein texte et de contrôler l'activité de l'Autorité de contrôle. Cet outil est indispensable dans la mesure où une autorité cantonale peut nous demander si telle personne ou tel intermédiaire financier est enregistré chez nous. Avec une gestion des documents sur papier uniquement, une telle recherche pourrait prendre plusieurs jours. Avec la banque de données, la recherche concernera à la fois les intermédiaires financiers, leurs employés qui ont le droit de signature et les membres du conseil d'administration ou les personnes exerçant des fonctions au sein des organismes d'autorégulation. Malgré l'existence d'une loi sur la protection des données, des abus se sont produits par le passé mais pas au sein de l'autorité de contrôle. Aussi, désormais, une ordonnance est nécessaire pour pouvoir disposer d'une telle banque de données. Nous avons édicté une autre ordonnance sur les obligations de diligence. Elle concerne les intermédiaires financiers qui n'ont pas pu, ou pas voulu, s'affilier à un organisme d'autorégulation. Cette ordonnance était indispensable afin de concrétiser les obligations de diligence elles-mêmes, en expliquer les modalités et fixer un standard minimum quant à l'organisation que doivent connaître les intermédiaires financiers. Cette ordonnance est souvent plus sévère que les règlements que nous avons acceptés de la part des organismes d'autorégulation, précisément parce que les intermédiaires financiers qui viendront chez nous seront d'une nature assez hétérogène : du kiosque qui vend du chocolat et qui fait du change à la très grosse fiduciaire employant plusieurs dizaines de personnes, qui aurait décidé de ne pas s'affilier à une organisation professionnelle pour des raisons X ou Y. Cette ordonnance est très sévère et il est possible qu'elle ne soit pas toujours adaptée, dans ses détails, à toutes les professions. Il est impossible de faire autrement. La situation restera en l'état pour un certain temps. A côté de ces textes normatifs, nous avons émis un règlement type à l'usage des organismes d'autorégulation pour les soutenir dans la création de leurs structures. Nous avons pu établir que les organismes d'autorégulation, même ceux qui reposaient sur une association professionnelle préexistante, ce qui était l'idée de base de la LBA, avaient beaucoup de peine à s'organiser. Nous avons prévu ce règlement afin de prévoir un standard minimum et pour que le travail avance plus vite. Nous avons aussi établi des check-lists pour indiquer aux organismes d'autorégulation les documents dont nous avons besoin pour élaborer leurs dossiers. Sur douze candidatures, sept organismes d'autorégulation ont été reconnus à ce jour, un est en voie de l'être, quatre nous causent quelques soucis. La plupart ne sont pas adossés à une association professionnelle préexistante ou ont des problèmes d'indépendance. Certains sont animés par des personnes, qui pensent qu'il y a là un marché à trouver et qui ont de la peine à comprendre qu'elles doivent avoir un nombre minimum d'intermédiaires financiers affiliés. Il est exclu de reconnaître un organisme d'autorégulation avec un potentiel de quarante à cinquante membres, par exemple, car garantir l'indépendance des structures vis-à-vis des affiliés est absolument impossible. Tous ces organismes d'autorégulation, y compris ceux qui reposent sur une organisation professionnelle préexistante, rencontrent des problèmes financiers. Bien souvent, une ou deux personnes physiques, voire une société, ont dû avancer de l'argent pour mettre en place l'organisme d'autorégulation. Au stade de la reconnaissance, l'organisme n'existe guère que sur le papier, mais très rapidement, dès qu'arrivent les intermédiaires affiliés et qu'il faut exercer les activités de surveillance, les difficultés financières commencent. Il est exclu, par exemple, qu'un affilié ait financé son propre organisme d'autorégulation, car l'indépendance ne serait absolument pas garantie. Quelques voies sont explorées afin de permettre une aide des pouvoirs publics, mais rien n'est encore décidé. Certains organismes d'autorégulation qui peinent à se constituer utilisent la pression politique pour faire avancer plus vite leur dossier, mais ce n'est pas une solution. Durant ses premiers mois d'existence, l'autorité de contrôle a déjà rencontré un certain nombre de problèmes. La définition de l'intermédiaire financier étant très large, nous saisissons également de « petits poissons », des cas insignifiants. Il est exclu pour l'instant de songer à une révision de la loi afin d'exclure ces bagatelles. Il va nous falloir résoudre le problème du trop grand nombre de soumissions directes à l'autorité de contrôle. D'un autre côté, paradoxalement, nous ressentons le besoin d'élargir le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent, non pas quant aux personnes mais quant aux secteurs auxquels il s'applique. Il est clair qu'aujourd'hui, le secteur financier étant beaucoup moins attractif pour les blanchisseurs, une grande part de leur activité s'est déplacée, notamment dans le domaine industriel et dans le domaine immobilier, qui était expressément exclu par la loi. Un autre problème résulte de la grande diversité des structures, des intermédiaires financiers et des organismes d'autorégulation. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de standardiser au maximum les structures et les procédures mais cela n'est possible que jusqu'à un certain point, compte tenu des diverses activités professionnelles déployées. Alors que les intermédiaires financiers sont en train de déposer leurs demandes d'autorisation, notre gros problème est que les organismes d'autorégulation ne sont toujours pas indépendants, même ceux qui ont été reconnus. Ils ont toujours besoin d'une aide énorme de l'autorité de contrôle afin de s'organiser. Ils ont beaucoup de peine à se mettre en place et à proposer un projet terminé. Les organismes d'autorégulation ont encore grand besoin de notre aide pour pouvoir travailler de façon efficace. Le temps passé avec les organismes d'autorégulation est tout bénéfice pour nous, dans la mesure où cela s'appliquera à des centaines d'intermédiaires financiers si cela fonctionne, mais tout le temps consacré encore aux organismes d'autorégulation nous empêche de nous consacrer pleinement aux demandes d'autorisation des intermédiaires financiers. Tels sont nos soucis actuels. Mme Dina BALLEYGUIER : La Commission fédérale des banques est une autorité de surveillance globale. La lutte contre le blanchiment, n'est qu'un des aspects de notre activité. Notre tâche principale consiste en la surveillance des établissements qui nous sont assujettis, principalement quant à leur solvabilité et au contrôle du caractère irréprochable de leur activité globale. Cela dit, la Suisse et la Commission des banques ont une longue histoire en matière de lutte anti-blanchiment. La structure des services existant aujourd'hui a été mise en place en 1977. A la suite de plusieurs scandales, la Commission des banques a vivement invité l'association des banques à mettre en place une structure d'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique. Cela a été fait sur une base privée conventionnelle - la convention de diligence - qui a été, par la suite, régulièrement renouvelée, améliorée, et dont les grandes lignes ont servi de base à la réglementation existant actuellement à la fois dans les recommandations du GAFI et dans la loi de lutte contre le blanchiment d'argent entrée en vigueur en 1998. Tandis que le GAFI naissait et que les recommandations prenaient forme, la Commission des banques a ressenti le besoin de ne pas se limiter à la convention de diligence de droit privé. En 1993, la Commission des banques a édicté une circulaire qui étendait cette convention de droit privé aux établissements qui ne l'avaient pas signée et qui en faisait un standard minimal que tout établissement soumis à la surveillance de la Commission des banques devait respecter. Elle contenait en outre un certain nombre de règles relatives à la conservation des documents et à la possibilité de communiquer des soupçons. Cette circulaire de droit administratif ne liait ni le juge civil ni le juge pénal mais pouvait néanmoins aider un établissement bancaire qui avait communiqué des soupçons à se défendre contre une éventuelle action en responsabilité contractuelle d'un intermédiaire mécontent. Cette circulaire a été entièrement révisée au début de l'année 1998 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment. Cette circulaire, comme tous nos textes, se trouve sur notre site Internet www.cfb.admin.ch.. Elle concrétise ce qui est décrit dans la loi. Elle étend le champ d'application de la convention de diligence actuelle non seulement aux banques qui l'ont signée mais aussi aux autres établissements bancaires et à tous les autres établissements surveillés par la Commission des banques. En effet, parallèlement à la loi sur le blanchiment, est entrée en vigueur la loi sur les bourses qui rend obligatoire une autorisation pour les négociants en valeurs mobilières et les assujettit à la surveillance de la Commission des banques. Avec cette circulaire sur le blanchiment, nous avons donc étendu l'application des règles strictes en vigueur en matière bancaire à tous les établissements que nous surveillons. Cette circulaire a également formalisé les règles que nous appliquions de manière informelle depuis une dizaine d'années en matière d'acceptation de fonds provenant de personnalités politiques exposées, appelées vulgairement « potentats ». Nous avons ressenti le besoin des milieux bancaires de formaliser ces règles que nous exprimions auparavant dans des décisions au cas par cas, afin qu'ils aient certaines lignes directrices pour être moins exposés aux conséquences des scandales. Cela fonctionne assez bien. Nous avons essayé de clarifier ce qu'est une personnalité politique exposée, dans quelles conditions l'on pouvait accepter les comptes de ces personnes ou les inviter à retirer leurs fonds et dans quelles conditions il convenait de les bloquer. En ce qui concerne les règles introduites par la LBA, nous n'avons pas rencontré de difficultés dans les milieux bancaires, ni quant à l'introduction de la loi, ni quant à son application, puisque celle-ci ne fait que légaliser quelque chose qui existait déjà. En revanche, nous en avons rencontré dans le milieu des négociants, qui n'est pas accoutumé à la surveillance prudentielle, puisque jusqu'à présent celle-ci ne concernait pas ces intermédiaires. Ces établissements manquent totalement de culture de la surveillance. Ils ne savent pas ce qu'est une autorité de surveillance, ils ignorent les pouvoirs dont elle dispose, ils ne savent pas lire et appliquer une loi. Il y a là un travail à faire. Celui-ci va beaucoup plus loin que la lutte anti-blanchiment, car certains de ces négociants sont choqués quand on leur dit que l'on va exiger d'eux qu'ils se dotent d'un organe d'adhésion agréé pour la surveillance en matière boursière. Ils répondent qu'ils travaillent depuis vingt ans avec le même réviseur. Ils ne comprennent pas. Ils ont aussi de la peine à comprendre quand on leur dit qu'il leur faut identifier leurs cocontractants et les ayants droit économiques. En ce qui nous concerne et en ce qui concerne les organes de révision, il nous faudra, dans les années qui viennent, mettre l'accent sur le respect des règles établies. Puisque nous y sommes parvenus avec les banques, nous y parviendrons bien avec les négociants. Quant à la coopération internationale, là aussi, nous avons une longue histoire avec les autorités de surveillance des milieux bancaires. Nous échangeons des informations avec nos homologues des pays voisins et outre-Atlantique. Il va de soi que nous pouvons aussi échanger ces informations en matière de lutte anti-blanchiment. Nous répondons aussi à des demandes d'information concernant ce type de renseignements. La loi sur le blanchiment, mais surtout la loi sur les bourses et la loi sur les banques, ont formalisé un peu la procédure, ce qui est une bonne chose parce que l'on crée au moins une obligation d'informer. Cela complique dans certains cas l'échange d'information, lorsque des clients d'établissements assujettis sont concernés. Cela ne concerne pas la lutte anti-blanchiment parce que l'entraide en matière pénale entre en jeu, laquelle peut passer outre les barrières de l'entraide administrative. M. Niklaus HUBER : Les deux autorités de surveillance ont mis récemment beaucoup d'informations sur Internet. Cela nous évite d'avoir à répondre à mille questions par téléphone. Cela n'empêche pas les gens qui ne sont pas habitués à avoir une surveillance, de nous appeler sans avoir consulté les informations disponibles sur Internet... y compris nos chers confrères avocats, qui nous posent tous les jours des questions de base sur l'entrée en vigueur de la loi. M. Riccardo SANSONETTI : En ce qui concerne le GAFI, je me suis posé la question de savoir si, pendant toutes ces dernières années, la France et la Suisse avaient eu sur certains points des approches fondamentalement différentes. J'ai eu beaucoup de peine à en trouver. Le fait que la France et la Suisse comptent parmi les piliers fondateurs du Groupe d'action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux explique sans doute cette entente. Après l'impulsion initiale donnée par le G7 au sommet de l'Arche en 1989, la France a présidé les deux premiers exercices, puis la Suisse a pris le relais. Lors des deux premières présidences françaises, ont été élaborées les quarante recommandations, c'est-à-dire le fondement de l'action du GAFI. Sous la présidence suisse a été lancé le processus d'évaluation mutuelle. Dix ans après, la troisième phase de l'action du GAFI a tendu à élargir l'action au plan mondial. On commence à distinguer une quatrième phase sur laquelle nous avons avec la France des vues convergentes, qui est de s'attaquer à la question des juridictions non coopératives. Je dirai quelques mots sur l'évaluation du blanchiment. Il s'agit certes d'un problème récurrent, dont on parle beaucoup mais dont la quantification est difficile. Lundi dernier, dans un communiqué de presse français, on indiquait : « Les études réalisées au niveau international estiment que le blanchiment d'argent représente chaque année entre 2 et 5 % du PIB mondial ». A ma connaissance, ce chiffre vient exclusivement d'une déclaration faite par M. Camdessus en juin 1998, à Paris, lors d'une réunion plénière du GAFI. En fait, on sait peu de chose quant à la méthodologie qui a conduit à l'annoncer. Au sein du GAFI, on a tenté, depuis deux ans, de faire avancer les travaux pour réaliser une estimation la plus fondée possible du blanchiment. Nous nous sommes retrouvés assez seuls avec la France pour défendre une méthodologie qui soit la plus sérieuse possible. En ce qui concerne les Etats et territoires non coopératifs, comme cela a été annoncé par un communiqué des ministres des finances du G7, le 25 septembre, le GAFI a achevé la première phase de son travail qui était d'établir des critères pour définir ces territoires. Il s'agit maintenant d'établir une liste. En fonction de la réaction obtenue par ces États et territoires après être entrés en contact avec eux, nous élaborerons éventuellement des contre-mesures. Dans cette phase, la transparence de la procédure et l'égalité de traitement des territoires auxquels nous nous adresserons sont essentiels afin d'assurer la crédibilité de l'exercice et d'avoir les mêmes paramètres fondamentaux que dans les autres enceintes internationales qui traitent actuellement le même thème, notamment le Forum de l'OCDE, l'initiative Offshore de l'ONU et le Forum de stabilité financière. Du côté du GAFI, de toute façon, même avant d'en arriver à ces travaux, il y a toujours eu un instrument de pression non négligeable : la politique relative aux membres ne respectant pas les recommandations, qui permet, lorsqu'un pays n'est pas suffisamment en conformité, de faire une déclaration publique. Le dernier pays visé était, en janvier dernier, l'Autriche, à cause des comptes anonymes. La prise d'une telle mesure n'est que l'une des cinq étapes de l'approche du GAFI, lorsqu'il s'agit de s'attaquer à un problème très sérieux dans le système d'un pays. Des étapes préalables permettent d'exercer une pression graduelle tout en fournissant l'occasion au pays d'expliquer et de développer une solution. Le but est toujours d'apporter un progrès et non uniquement de sanctionner. Là aussi, dans les discussions, nous avons toujours eu une approche comparable à celle de la France, pour favoriser le progrès plus que la sanction sans suite. J'évoquerai maintenant la commission d'experts qui a été nommée par notre ministre, à Noël dernier, avec pour mission de procéder à une évaluation critique de la situation en matière de surveillance des marchés financiers. Il s'agit d'une étude à réaliser en dix-huit mois, jusqu'à la moitié de l'an 2000, sur l'ensemble des questions qui peuvent se poser dans la réglementation du marché financier. Plutôt que d'essayer de pronostiquer ce qu'il en sortira, je tenterai d'indiquer les raisons de la mise en place d'une telle commission. Il s'agit tout d'abord de conserver une vue d'ensemble de toutes les évolutions qui se produisent dans la réglementation des marchés financiers. Ces dernières années, avec l'introduction de la loi sur le blanchiment et la loi sur les bourses, les révisions d'ordonnances et de règlements, le développement de l'autorégulation, il devenait un peu difficile d'avoir une vision globale. Des travaux approfondis pour lesquels on dispose de dix-huit mois et non de quelques semaines peuvent permettre d'acquérir cette vision d'ensemble. Un deuxième objectif est d'examiner les risques et tendances des nouvelles évolutions dans le secteur financier. Un exemple type est celui de la bancassurance, c'est-à-dire des concentrations entre la banque et l'assurance. Trois cas se sont produits ces dernières années, dont la reprise de Winthertur par le Crédit Suisse Group en 1997 et la création d'une banque par la société Zurich Assurances, en 1998. Il s'agit d'une évolution internationale. L'idée est de voir, par exemple, si l'instrumentaire et les structures de la réglementation sont adaptés ou s'il convient de recentrer les ressources de surveillance. Un troisième point important consiste dans l'étude des standards internationaux. Celle-ci comporte deux voies : d'une part, l'examen des règles émanant des organismes de réglementation internationaux - les concepts sont-ils similaires ? - et, d'autre part, l'établissement d'une comparaison avec les structures nationales existant à l'étranger. Par exemple, est-il approprié de concentrer la surveillance ? Le modèle doit-il être de type britannique, où l'on contrôle à la fois la surveillance des banques, les négociants en valeurs mobilières, des bourses et des assurances, ou bien de type américain, c'est-à-dire éclaté, avec la SEC et la CFTC pour les valeurs mobilières et les produits de base et plus de trois autorités dans le domaine bancaire ? Tout est possible. Il convient aussi de prendre en compte la dimension des marchés et leur tendance à long terme. Il ne s'agit pas uniquement de faire des suggestions événementielles, mais de prévoir l'avenir des structures. En définitive, il y a au moins trois soucis derrière ces réflexions : celui de la compétitivité, celui de l'efficacité du système de réglementation, c'est-à-dire son rapport coût/bénéfice, et celui de l'identification des lacunes. Une raison supplémentaire, d'origine ancienne, motive la mise en place de cette commission. Après le krach de 1987, le ministre d'alors avait demandé un rapport sur les structures de réglementation. On avait conclu à la nécessité d'une loi sur la bourse et le commerce des valeurs mobilières et de l'examen des besoins de réglementation restants. On pensait en particulier aux activités de négoce de valeurs mobilières qui n'auraient pas été concernées par la réglementation sur la bourse. Dans l'intervalle, la loi sur les bourses a été élaborée. Il s'agissait essentiellement de reprendre les diverses réglementations cantonales et de créer la première réglementation fédérale, car cela coïncidait avec la création de la bourse électronique. Puis nous avons édicté la loi sur le blanchiment. Elle couvre toutes les activités financières, mais uniquement sous l'angle anti-blanchiment. Pour les activités de gestion de fortune, par exemple, la loi sur les bourses s'applique aussi car elle assujettit un bon nombre de gérants, mais pas tous. Il convient de savoir si l'arsenal législatif doit être complété et, si oui, de quelle manière. M. Alexander HARTMANN : Les tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent sont les suivantes : - d'abord, exploiter les déclarations fournies par les intermédiaires financiers, enquêter sur les antécédents annoncés et déceler les éléments suspects ; - ensuite, gérer le système de traitement des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent - GEWA - ; - enfin, saisir les communications dans une statistique de façon à être constamment capable de fournir des informations sur le nombre des communications, leur contenu, leur type et leur provenance, sur les cas suspects, leur fréquence, les types de délit et la manière dont ils sont traités. Ces données doivent être rendues anonymes. Le Bureau de communication a une fonction de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les instances pénales. Lors de la vérification des déclarations qui lui parviennent, le Bureau de communication doit éliminer les cas dans lesquels toute origine criminelle des biens, toute contravention à l'article 305 bis ou 305 ter du code pénal ou toute relation des biens avec le crime organisé peut être exclue. Les cas restants sont transmis aux autorités pénales compétentes. En tant que bureau spécialisé, le Bureau de communication sera en mesure de faire la distinction entre les cas pouvant relever du blanchiment d'argent et les cas moins fondés, assurant ainsi un contrôle préalable efficace pour les autorités pénales. En tant qu'autorité centralisée, le Bureau de communication aura en outre la possibilité de faire des recoupements et des rapprochements entre diverses déclarations. Enfin, il doit être en mesure d'avoir une vue d'ensemble des méthodes et des évolutions observables dans le domaine du blanchiment d'argent, d'analyser les risques et d'informer de manière compétente les intermédiaires financiers, les instances de contrôle et les autorités pénales. Les Cassandre qui prédisent que le Bureau de communication croulera sous une avalanche de déclarations et se trouvera incapable de remplir sa mission, n'ont pas de raisons de le faire. L'enjeu est de mettre en pratique les nouvelles dispositions légales et de veiller à ce que la justice soit rendue par le biais d'une concertation étroite avec les autorités pénales et les intermédiaires financiers. Les conditions préalables sont les suivantes. Les biens doivent provenir d'une relation d'affaires et être impliqués dans la relation d'affaires. L'obligation de déclaration ne naît qu'au moment où les parties s'engagent dans la relation d'affaires. Le moment où l'on s'engage dans une relation d'affaires diffère selon les cas. On peut tout au plus décrire des moments caractéristiques pour une branche donnée. En règle générale, ce moment sera celui où le contrat est conclu. Pour une banque, l'engagement dans la relation d'affaires sera réalisé au plus tard quand ladite banque manifestera sa volonté d'ouvrir un compte ou un dépôt, par exemple en communiquant un numéro de compte ou de dépôt. Dans le cas de l'assurance-vie, la compagnie s'engage dans une relation d'affaires au plus tard au moment où elle accepte la demande. Par exemple, en envoyant la police. En outre, les biens doivent être impliqués dans la relation d'affaires. Si l'intermédiaire financier sait que son client a acquis des biens provenant d'un crime, mais s'il peut exclure que les biens qui lui ont été confiés aient quelque chose à voir avec un crime, il n'est pas tenu de faire une déclaration. Toutefois, cette distinction entre biens acquis en toute honnêteté et biens acquis par délit est difficile à établir. En cas de doute, l'intermédiaire financier fera bien d'opter pour la déclaration. Les biens considérés doivent provenir d'un crime, ou être en rapport avec une infraction au sens de l'article 305 bis du code pénal, relatif au blanchiment d'argent, ou faire l'objet du pouvoir de disposition d'une organisation criminelle (article 260 ter du code pénal). Selon l'article 9-1 du code pénal, les crimes sont des actes passibles d'une sanction de réclusion. Ainsi, des biens acquis par le biais d'un délit - par exemple, des manipulations sur les cours visées à l'article 161 bis du code pénal - n'entraînent pas l'obligation de déclaration. Dans cette mesure, l'article 9 de la loi sur le blanchiment d'argent correspond aux faits constitutifs du délit de blanchiment d'argent défini à l'article 305 bis du code pénal. Selon la loi, les biens peuvent également être en relation directe avec les faits constitutifs du blanchiment d'argent, en vertu de l'article 305 bis du code pénal. Il était nécessaire de mentionner cela spécialement, car l'article 305 bis, alinéa 1 du code pénal ne fait pas état de crimes. Cet ajout couvre ainsi le cas où le blanchisseur de capitaux ferait directement face à l'intermédiaire financier. La dernière possibilité énumérée - « Les biens doivent faire l'objet du pouvoir de disposition d'une organisation criminelle » - est destinée à couvrir les cas où l'intermédiaire financier ne peut pas établir la relation entre lesdits biens et un crime ou un cas de blanchiment d'argent. On peut penser en particulier aux biens issus d'un premier processus de blanchiment. Il faut tenir compte du fait qu'il est difficile pour l'intermédiaire financier de reconnaître l'organisation criminelle en cause, d'autant plus que l'on ne dispose pas de longues années d'expérience en ce qui concerne l'application de l'article 260 ter du code pénal. L'intermédiaire financier doit avoir connaissance ou un soupçon fondé de l'origine criminelle des biens considérés. Par exemple, l'intermédiaire financier peut avoir connaissance de l'origine criminelle des biens par la lecture de la presse ou par une information émanant d'une autorité pénale. Il est plus difficile de définir le concept de « soupçon fondé ». Le soupçon ne doit pas être absolument proche de la certitude. Par conséquent, un soupçon sera fondé s'il repose sur une indication concrète ou sur plusieurs indices. Il est fait référence à la circulaire de la Commission fédérale des banques intitulée « Blanchiment d'argent », qui contient en annexe un catalogue d'indices pour les banques. A notre sens, cette approche est correcte. La loi sur le blanchiment, en tant que loi-cadre applicable à l'ensemble du secteur financier, doit tenir compte des aspects spécifiques des secteurs concernés pour la concrétisation d'un soupçon fondé. Les faits constituant des indices révélateurs du blanchiment peuvent différer d'un secteur à l'autre. Les organismes d'autorégulation qui se mettent en place sont priés de définir les indices correspondants et d'adapter ces définitions en permanence. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire que l'intermédiaire financier sache de quel délit ou de quels faits répréhensibles les biens proviennent. Par conséquent, il serait faux de dire qu'il doit y avoir un soupçon parfaitement établi plutôt qu'un soupçon fondé. Si le soupçon est parfaitement établi, il s'agit déjà d'une connaissance. Les conditions requises pour la communication étant réunies, celle-ci doit être effectuée auprès de l'administration compétente, à savoir le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, relevant de l'Office fédéral de la police (article 23 de la LBA). La communication aux seules autorités judiciaires en charge des poursuites ne suffit pas. Celle-ci peut exceptionnellement et dans certains cas particuliers se révéler utile, parallèlement à la communication au Bureau de communication. Dans ce cas, l'intermédiaire financier devra par conséquent, au titre de la coordination de la procédure, effectuer une double communication. Jusqu'à présent, nous avons reçu 312 communications, pour une valeur totale de 737 millions de FS. 60 % d'entre elles ont été transmises aux autorités de poursuites pénales, représentant 188 millions de FS. 258 communications viennent du secteur bancaire. Seules 23 communications sont venues des fiduciaires, ce qui est révélateur d'un problème. La valeur moyenne des communications est de 2,4 millions de FS. M. Niklaus HUBER : Avant de passer aux questions, je reviendrai brièvement sur deux points importants évoqués par Mme Polli dans son intervention. Le premier concerne l'article 6 de la LBA. Dans une circulaire du 24 décembre, l'autorité de contrôle a demandé aux intermédiaires financiers d'établir des profils de clients. Ils nous semblent nécessaires pour satisfaire à l'obligation de diligence selon l'article 6. Comment pouvez-vous reconnaître des opérations inhabituelles si vous ne connaissez pas les opérations habituelles de vos clients ? On nous a répondu à plusieurs reprises que l'on ne savait pas comment pratiquer, que l'on ne l'avait jamais fait, que l'on n'a pas d'informations sur les clients et que l'on ne peut, de toute façon, en recueillir. Je considère que ce sont de fausses réponses puisque toute société qui souhaite vendre un produit établit un profil de clients. Pour vendre, il faut connaître les besoins des clients. Le profil établi dans un but de marketing est déjà un très beau profil de clients. Les profils de clients ne sont pas mis à disposition de l'autorité de contrôle. Nous ne recueillons pas d'informations sur les clients des intermédiaires financiers. Nous recueillons des informations sur les intermédiaires financiers eux-mêmes. En cas de besoin, les autorités pénales peuvent demander la présentation de ces dossiers de clients. Elles auront ainsi les informations dont elles ont besoin pour poursuivre leurs enquêtes. Le but principal de l'autorité de contrôle est d'assurer que les intermédiaires financiers recueillent les informations dont les autorités pénales pourraient avoir besoin dans les procédures d'enquête. Le second point important est relatif aux négociants en matières premières que la LBA soumet à une surveillance. La définition du négociant en matière première est assez complexe. Si vous le souhaitez, je laisserai le soin à Mme Polli de vous expliquer de quoi il s'agit. André, à Lausanne (Vaud), ou Glencore à Baar (Zoug) sont des sociétés de négoce aux dimensions énormes qui constituent en elles-mêmes des organismes d'autorégulation. D'un côté, l'autorité de contrôle devrait surveiller les organismes d'autorégulation, et, de l'autre côté, des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis constituent eux-mêmes des organismes d'autorégulation. Une telle tâche ne saurait être menée à bien sans les moyens nécessaires, c'est-à-dire avec du personnel. Je me demande si dix personnes au sein de l'autorité de contrôle suffisent, sans compter le niveau de salaire des personnes engagées. Tant que nous resterons dans le cadre étroit de la Fédération, nous ne pourrons pas recruter les spécialistes dont nous avons besoin, car les salaires proposés sont inférieurs à ceux du secteur privé. La Commission fédérale des banques rencontre les mêmes problèmes. Il est extrêmement difficile de recruter des gens qui connaissent la matière. C'est là un grand risque pour la lutte contre le blanchiment d'argent. La mafia peut proposer n'importe quel salaire pour recruter les meilleurs, tandis que le Gouvernement est toujours en butte à des difficultés budgétaires. Mme Polli a également fait allusion aux « cas bagatelles ». Les Français passant par Genève qui doivent faire le plein d'essence et qui n'ont pas assez de francs suisses paient en francs français. Les stations-service font alors office de bureau de change. Ces commerces étant soumis à la loi, nous sommes obligés de surveiller cinq à six cents bureaux de change de très petite taille, au risque d'être débordés. Il faudrait donc limiter le champ d'application de la LBA ou exclure ces cas en fixant un critère de volume de transactions par mois ou par an. Une solution acceptable serait de limiter le champ d'application aux intermédiaires financiers ayant un volume de transaction supérieur, par exemple, à 1 000 FS par mois. L'introduction d'un tel critère nous permettrait de réduire considérablement le nombre des intermédiaires financiers directement soumis à l'autorité de contrôle. Dans le domaine du change et du transfert, on trouve peu de gens peu capables d'interpréter les textes de loi et de gérer des dossiers. Ils sont très professionnels dans le métier du change mais ils sont totalement ignorants du nouveau cadre de loi. Mais comme ils ne se sont pas organisés au sein d'une association professionnelle, ils nous sont directement soumis. M. le Président : Merci beaucoup pour votre accueil, la concision et la précision de vos interventions. Nous nous félicitons de la très bonne coopération franco-suisse. Il est évident que la législation que vous avez mise en place est reconnue. Les évaluations du GAFI en ont encore récemment porté témoignage. Nous souhaitons nous renseigner sur le fonctionnement des dispositions que vous avez mises en place, sachant qu'en la matière, la coopération internationale est une dimension essentielle. Vous avez les qualités et les défauts des spécialistes que nous ne sommes pas. Vous êtes dans les difficultés d'application de lois récemment édictées sur lesquelles vous avez insisté avec honnêteté, mais avant d'entrer dans le détail de la mise en place de la LBA, pourriez-vous nous fournir une estimation du blanchiment réalisé en Suisse, de la masse de capitaux qui en est issu ? Pourriez-vous également nous apporter des éléments sur le mécanisme du blanchiment ? Cela nous aiderait à mesurer l'enjeu du problème que nous traitons. M. Alexander HARTMANN : En ce qui concerne les mécanismes, vous trouverez dans notre rapport d'activité des typologies et des exemples de blanchiment d'argent, de la simple escroquerie à des systèmes plus compliqués. Il est très difficile d'avancer une estimation sur le blanchiment d'argent en Suisse. Je ne peux pas répondre à la question mais je sais que le GAFI a un projet d'estimation pour le monde entier. M. le Président : Nous avons rencontré le secrétaire général du GAFI. Nous avons eu communication de toutes les informations dont il dispose. Ma question porte sur la Suisse. M. Alexander HARTMANN : Nous n'avons pas d'estimations. M. le Président : Je poserai une autre question concernant plus directement l'autorité de contrôle. Je vous remercie de la sincérité avec laquelle vous vous êtes exprimés. A vous écouter, il semble que vous ayez fait le choix très moderne et sans doute très efficace de l'autorégulation. Eu égard aux difficultés habituelles liées à la mise en place d'un processus, considérez-vous toujours que c'est le bon choix ? C'est une question philosophique qui intéresse les autres pays, puisque certains ont à mettre en place ce que vous avez déjà fait. Par ailleurs, pouvez-vous nous apporter des précisions sur les mécanismes de contrôle car nous, Français, sommes moins enclins à utiliser ce genre de système ? De quels moyens réels disposez-vous ensuite pour contrôler les obligations ? M. Niklaus HUBER : Pensons-nous avoir fait le bon choix ? La réponse est délicate dans la mesure où la qualité des OAR est très diverse. J'en distinguerai quatre catégories: les OAR coopératives, les OAR suffisantes, les OAR ignorantes et les OAR non coopératives. M. le Président : Les banques sont-elles suffisantes ou coopératives ? M. Niklaus HUBER : C'est une autre question à laquelle Mme Balleyguier pourra répondre. Je parlerai uniquement du secteur non bancaire. Dans le secteur non bancaire, on trouve sept organismes d'autorégulation suffisante et coopérative, qui sont des associations professionnelles préexistantes comme la chambre fiduciaire, qui existe depuis une centaine d'années et qui a une très grande expérience en matière de surveillance, de révision et d'organisation d'une entreprise. C'est leur métier. Ces gens-là n'ont pas de problème. Dans ce cas, l'autorégulation est un bon choix. Ils nous ont soumis un dossier complet sans aide de notre part. Pour quatre autres, nous pouvons considérer que cela pourrait fonctionner. Des sept organismes que nous avons reconnus jusqu'à présent, deux sont de bonne volonté mais rencontrent quelques difficultés car ils n'ont pas d'expérience en ce qui concerne la gestion d'une telle association. Ils manquent parfois un peu de connaissances légales. Ce sont des gens du métier qui n'ont pas nécessairement la formation de base nécessaire pour gérer un tel organisme qui peut avoir huit cents à mille affiliés. Ensuite deux organisations plus ou moins professionnelles n'ont pas envie de suivre. M. le Président : Pouvez-vous nous les citer ? M. Niklaus HUBER : C'est assez délicat. En les citant, je créerais des classes et je fermerais la porte à une coopération future. Pour le moment, je préfère laisser la question ouverte. Avec un organisme reconnu comme la Chambre fiduciaire, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez imaginer quels sont les organismes qui fonctionnent et quels sont ceux qui font des problèmes. Pour répondre à votre question, pour la moitié d'entre eux, c'était le bon choix, pour l'autre moitié, ce n'était pas le bon choix. Nous avons tous dû les accompagner, en sorte que je ne sais pas si l'on peut réellement parler d'une autorégulation car c'était plus ou moins le diktat de l'autorité de contrôle. Ils n'ont pas su profiter de l'espace vide qui existait initialement. Personne ne savait comment aborder ce nouveau défi. Ils nous ont donc demandé de leur faire des propositions. Nous avons commencé avec l'un, nous avons continué avec d'autres et tout à coup, nous nous sommes retrouvés dans le diktat. Comme ils ne faisaient rien, nous avons dû avancer car nous ne pouvions pas attendre. Si nous n'avions pas exercé de pression, nous n'aurions pas aujourd'hui d'OAR reconnues. Entre le dépôt du dossier et la reconnaissance, il s'écoule neuf à douze mois. Désormais, cela devrait aller un peu plus vite, car les candidats copient les OAR reconnues. Il y a des contacts. Mais une structure qui existe sur le papier et non dans la réalité n'est pas suffisante. Cela doit fonctionner le 1er avril de l'année prochaine. Au début, nous avons pu reconnaître des organismes d'autorégulation qui existaient uniquement sur le papier parce qu'ils avaient une année pour mettre en place une infrastructure, mais il reste aujourd'hui moins de temps pour concrétiser. Ils doivent donc nous soumettre une structure sur papier et démontrer qu'ils disposent d'une infrastructure qui fonctionne. Cela est assez coûteux. Nous avons maintenant des structures parallèles, ce qui peut coûter assez cher. Mme Polli s'est penchée sur les problèmes financiers de certaines OAR. Du point de vue économique, c'était peut-être un mauvais choix. On doit créer huit ou douze structures parallèles presque identiques pour laquelle chaque OAR doit engager son personnel de gestion, alors qu'avec une structure électronique, il est possible de gérer la question sur ordinateur. En Grande-Bretagne, le rachat des organismes d'autorégulation a permis de profiter d'une synthèse. C'est ce que toutes les sociétés commerciales font aujourd'hui dans le secteur privé avec les fusions. Ma réponse est un peu complexe mais il n'y a pas de réponse facile. M. le Président : Si vous reconnaissez que des professions sont récalcitrantes mais si vous estimez qu'elles vont s'auto-organiser sous la pression de l'autorité de contrôle, quelles garanties avez-vous que les autorités d'autorégulation feront bien leur travail, que les sanctions et le contrôle seront efficaces ? Mme Natacha POLLI : S'agissant des exigences que nous avons fixées, chaque organisme d'autorégulation a dû nous livrer son propre concept de contrôle sur des affiliés. Nous avons accepté deux types de systèmes de contrôle différents des OAR sur leurs propres affiliés. Le premier est l'autodéclaration, qui n'a été adopté que par un organisme. Dans ce système, les affiliés devront une fois par an rédiger eux-mêmes un rapport concernant la mise en application de la loi sur le blanchiment d'argent, faisant état de tout fait en rapport avec l'application de la loi s'étant produit au sein de l'entreprise. Cela contraint l'organisme d'autorégulation à prendre connaissance de tous ces rapports et à aller contrôler sur place l'ensemble des intermédiaires financiers dans un délai de trois ans. Il s'agit d'aller examiner un certain pourcentage de ces dossiers pour voir comment la documentation est gérée, si un responsable chargé du blanchiment d'argent est bien nommé, si des directives internes prévoient pour les dossiers difficiles ou pour l'acceptation d'un nouveau client qu'il faut toujours passer par un membre de la direction ou par telle personne ayant des connaissances particulières. De plus, l'organisme d'autorégulation doit aller effectuer des contrôles dès qu'il est en possession d'indices d'un problème chez un intermédiaire financier, tels qu'une procédure pénale pendante, un rapport annuel rigoureusement identique au précédent ou des renseignements fournis par un concurrent. L'autre solution adoptée par tous les autres organismes d'autorégulation reconnus, est le système de la régulation par des tiers dans lequel l'organisme d'autorégulation demande, de la même façon que l'autorité de contrôle peut faire réaliser des contrôles par des tiers, que l'intermédiaire financier s'adresse à une société de révision remplissant un certain nombre de conditions en ce qui concerne les connaissances professionnelles, son indépendance vis-à-vis de l'intermédiaire financier à contrôler, la bonne réputation et la garantie d'une activité irréprochable. On confie à cette société de révision le contrôle chez l'intermédiaire financier. De la sorte, les intermédiaires financiers seront révisés par une société qui a les connaissances nécessaires pour le faire, qui a un regard critique et qui est indépendante. M. Niklaus HUBER : Ce peut être une société de révision ordinaire, c'est-à-dire un organe de contrôle selon le droit des sociétés anonymes. M. Jacky DARNE : Est-ce un contrôle qu'ils font en plus ou qui s'intègre dans leur contrôle ? Mme Natacha POLLI : C'est un contrôle qui s'intègre dans la mission de contrôle. Les organismes d'autorégulation doivent concentrer leur énergie pour leur propre contrôle sur les éventuels indices de problème chez un intermédiaire financier, dans la mesure où ils ont fait appel à des personnes particulièrement qualifiées pour effectuer les contrôles. Il y a ensuite le contrôle de l'autorité de contrôle sur l'organisme d'autorégulation pour savoir dans quelle catégorie il figure. Par exemple, si la Chambre fiduciaire - je peux la citer car c'est un « bon élève » - nous dit que 99 % de ses intermédiaires financiers ont été contrôlés et que le 1 % restant a été vérifié, nous sommes tranquilles. Elle sait ce qu'est un travail de révision. Elle ne peut pas se permettre de ne pas être allée faire les contrôles là où il le fallait. M. le Président : Vous avez beaucoup d'admiration pour la Chambre fiduciaire, ce qui est sans doute fondé. Mme Natacha POLLI : Non pas de l'admiration mais c'est un bon élève ! M. le Président : Dans le schéma que vous nous avez présenté, 80 % des déclarations viennent des banques mais nous en avons vu un très faible nombre venant des fiducies. Cela signifie-t-il qu'elles contrôlent extrêmement bien ? Mme Natacha POLLI : Nous sommes encore dans une phase transitoire. La loi l'avait prévue. Il y avait les deux fameux délais : fin mars 1999 pour les organismes de régulation et fin mars 2000 pour les intermédiaires financiers. En fait, les obligations de diligence sont pleinement applicables aux intermédiaires le 1er avril 2000. Ce n'est qu'à partir de cette date que nous pourrons aller vérifier s'ils ont rempli leurs obligations. Mais la LBA précise que l'obligation de communiquer est en fait applicable depuis le 1er avril 1998. Il y a un problème d'information des intermédiaires financiers. Les fiduciaires ne s'intéressent pas particulièrement à la lecture des lois. Les associations professionnelles et nous-mêmes avons organisé des séminaires d'information, mais les gens ont du mal à le comprendre. De plus, une bonne application de l'obligation de communiquer implique que l'on ait préalablement rempli toutes ses autres obligations de diligence. Si l'on n'a pas rempli l'obligation d'identifier son cocontractant, de vérifier son identité, d'identifier l'ayant droit économique, il est fort probable que l'on n'arrive jamais à trouver l'indice qui aurait justifié une communication. On se trouve donc dans une phase où il y a très peu de communication des intermédiaires financiers lesquels n'ont pas une longue tradition d'application des obligations de diligence. M. Niklaus HUBER : On pense qu'après la mise en place de la loi et son entrée en vigueur vis-à-vis des intermédiaires financiers, les chiffres des communications vont augmenter. C'est une question de formation. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire. Si des avocats nous appellent pour nous demander quand la loi est entrée en vigueur, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens communiquent, puisqu'ils ne savent même pas qu'ils sont soumis à cette obligation. L'audit par un tiers se fait dans le cadre de l'audit annuel ordinaire de la société. M. Jacky DARNE : C'est un chapitre particulier de l'audit général. Mme Natacha POLLI : Tout à fait. M. Jacky DARNE : J'ai lu dans le document que vous nous avez remis que vous organisiez des séminaires. Est-ce dans ce cadre que vous formez les réviseurs extérieurs ? Dans les sociétés d'audit, on peut considérer que le blanchiment n'est pas leur préoccupation immédiate. On peut penser que l'incompétence que vous signaliez chez certains avocats existe aussi chez certains auditeurs. Réalisez-vous un travail de formation des auditeurs ? M. Niklaus HUBER : Le travail de formation devrait être fait par l'organisme d'autorégulation qui est accoutumé de ce genre d'affaires. Nous sommes en contact avec certains représentants de la Chambre fiduciaire et nous avons publié des articles dont quelques-uns sont reproduits dans la documentation publiée sur Internet. Nous leur avons indiqué quelle est la base de leur activité. L'information existe. La question est de savoir si les gens l'assimilent ou non. Nous ne pouvons pas les contraindre. Nous faisons tout notre possible pour que l'information soit diffusée. M. le Président : La question des sanctions est importante. Nous en avons eu un exemple en France avec les notaires. Après une bonne sanction, on constate que les gens s'informent mieux. Mme Natacha POLLI : Nous avons quelques idées pour les premiers exemples ! Mme Dina BALLEYGUIER : Dans le milieu bancaire, l'autoréglementation et l'autorégulation ne s'appliquent qu'à titre subsidiaire. Nous assurons une surveillance directe sur tous les établissements qui nous sont soumis. Bien entendu, nous collaborons avec l'Association suisse des banquiers mais ce n'est pas elle qui contrôle les banques, c'est nous ou les organes de révision que nous désignons à cet effet. C'est un régime totalement différent de celui de la LBA. M. Jacky DARNE : Peut-on avoir une idée du guide de procédure ou de la méthodologie de contrôle que vous utilisez ? Mme Dina BALLEYGUIER : Il existe un gros manuel, « Le manuel suisse de révision », qui est le guide de contrôle qu'utilisent les organismes d'audit qui font ce travail pour nous. M. Jacky DARNE : Porte-t-il exclusivement sur le blanchiment ? Mme Dina BALLEYGUIER : Non, sur tout, mais un chapitre est consacré au blanchiment. M. Jacky DARNE : Il comporte un chapitre spécial sur le blanchiment ? Mme Dina BALLEYGUIER : Je ne pourrai pas l'affirmer car je n'ai jamais utilisé ce guide. Je ne fais pas de révision directe. Je travaille au service juridique. M. Jacky DARNE : Pourriez-vous nous communiquer le chapitre du manuel des méthodes de contrôle consacré au blanchiment ? Mme Dina BALLEYGUIER : Nous vous remettons volontiers ce chapitre. Il s'agit des pages 118 à 124 du Manuel suisse d'audit 1998, tome 3, en particulier p. 118 et suivantes. M. Jacky DARNE : Il s'agit de passer de l'obligation générale à la capacité de mise en _uvre aux différents échelons. L'application de la loi passe par des procédures, par des choix d'organismes d'autorégulation mais elle passe ensuite, pour les réviseurs, soit auprès des banques, soit auprès des autres intermédiaires, par la qualité des procédures. Je pose la question parce que je constate que le nombre de communications est assez faible en comparaison de ce que j'imagine être le total des opérations financières en Suisse. Mme Dina BALLEYGUIER : Je pense que votre impression est erronée. Dans certains pays, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers, de communications qui n'aboutissent à rien. Il est intéressant de noter que 60 % des communications sont transmises au juge pénal, ce qui montre que nombre de soupçons sont fondés. M. le Rapporteur : C'est pour nous une particularité que de faire confiance à des professionnels et à l'autodiscipline, notamment pour les professions soumises au secret. Je crois avoir relevé dans certaines de vos communications publiques sur Internet, que nous lisons avec assiduité, que vous aviez agréé des OAR chez les notaires et les avocats. Comment l'autocontrôle fonctionne-t-il concrètement ? Qui sont ces OAR ? Quels sont les résultats de ce mécanisme ? Sur ce terrain, la France paraît avoir un peu de retard sur la Suisse. Mme Natacha POLLI : La Fédération suisse des avocats et la Fédération suisse des notaires ont créé conjointement un organisme d'autorégulation. Elles devaient le faire puisque la loi a prévu un régime spécial pour les professions soumises au secret, ainsi que vous les qualifiez. En droit suisse, le secret professionnel de l'avocat et du notaire et le secret de fonction ne répondent pas tout à fait aux mêmes règles. Le secret de fonction peut être levé beaucoup plus facilement et lorsqu'il est levé, le fonctionnaire doit témoigner, ce qui n'est pas le cas pour les avocats et les notaires. C'est la raison pour laquelle la LBA, afin de préserver le secret professionnel des avocats et des notaires, a prévu que ceux-ci sont obligés de s'affilier à un organisme d'autorégulation. Toutes les personnes chargées des contrôles sur place chez les intermédiaires financiers doivent être elles-mêmes soumises au même secret professionnel. Pour l'instant, en tout cas, l'OAR des avocats et des notaires n'a que des avocats et des notaires dans sa structure. On pourrait envisager que des personnels administratifs n'y soient pas soumis mais ces personnes ne devraient jamais se trouver en possession du dossier d'un client. Si un avocat venu effectuer un contrôle chez un de ses confrères constate que, dans un dossier, celui-ci aurait dû communiquer et ne l'a pas fait, l'organisme d'autorégulation doit communiquer à sa place. M. le Rapporteur : Est-ce déjà arrivé ? Mme Natacha POLLI : Cela n'est pas arrivé dans la mesure où c'est en train de se mettre en place. Les premiers contrôles effectifs auront lieu à partir du 1er avril 2000. Nous sommes encore dans une phase d'organisation. La première date butoir est le 1er avril 2000. Nous avons reconnu un premier groupe d'OAR, quelques-uns sont un peu à la traîne. Une première visite a été effectuée chez ces organismes d'autorégulation pour savoir comment cela se mettait en place. Une première conférence réunissant tous les organismes d'autorégulation reconnus aura lieu au début de l'année prochaine pour connaître les difficultés qu'ils auront rencontrées afin de déterminer si certains points nécessitent une réglementation commune ou s'il convient d'adapter la réglementation choisie. M. le Rapporteur : Vous orientez-vous, dans les statuts de cette OAR pour les avocats et les notaires, vers un autocontrôle d'initiative ? Avez-vous trouvé, dans la Fédération des avocats suisses, des avocats qui iront contrôler d'initiative, sur la base d'éléments peut-être hasardeux ou de dénonciations, dans d'autres cabinets d'avocats pour y dénoncer leurs clients ? M. Niklaus HUBER : Nous avons essayé de recruter des auditeurs pour les avocats et les notaires. Par définition, ils doivent être avocats ou notaires, pour des raisons de secret professionnel et de connaissances particulières dans ce domaine. Ce ne peut être qu'un avocat qui n'est pas intermédiaire financier, sinon il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Nous avons essayé de recruter des avocats qui ont travaillé ou qui travaillent pour l'Association suisse des banquiers. Malheureusement, ils ont tous préféré travailler uniquement avec l'Association suisse des banquiers. J'ignore pourquoi. Dès le mois d'octobre, nous chercherons activement des représentants de la profession capables d'assumer cette fonction. Pour le moment, nous n'en avons pas, mais je suis certain que nous trouverons des gens qualifiés pour assumer ce rôle. Mme Natacha POLLI : Il s'agit là des contrôles sur l'OAR elle-même. L'OAR a des contrôleurs qui iront faire des vérifications chez leurs confrères. M. le Rapporteur : Vous avez déjà des noms ? Mme Natacha POLLI : Nous avons déjà des noms. Mais ils ne veulent pas effectuer des contrôles dans le barreau où ils sont eux-mêmes actifs. M. le Rapporteur : Je me tourne maintenant vers le responsable de la Commission fédérale des banques. J'ai votre directive de l'année dernière avec l'énumération des indices de blanchiment de capitaux, qui est en fait le manuel du banquier qui voit arriver chez lui quelqu'un avec un camion de la Brinks chargé d'espèces ! Mme Dina BALLEYGUIER : Vous plaisantez, mais ce genre de cas se produit ! M. le Rapporteur : Je vous pose la question parce que nous avons eu connaissance de cas précis. L'indice A 25 fait allusion à un critère géographique. C'est, à ma connaissance, le seul cas d'apparition du critère géographique : « Virements importants et fréquents en direction ou en provenance ce pays producteur de drogue ». Comment définissez-vous ce pays producteur de drogue ? Les banquiers sont-ils au fait de l'ensemble des pays producteurs de drogue ? Considérez-vous qu'il serait utile d'appliquer ce critère géographique à tout virement important et fréquent en direction ou en provenance de centres offshore ? La Suisse aujourd'hui est-elle bien aussi en avant dans la réflexion politique et donc juridique - ce qui est politique prend une concrétisation juridique - au point, un jour ou un autre, de ne plus accepter de l'argent qui, en lui-même, par sa provenance ou sa direction, est susceptible de soupçons ? J'ai envie d'ajouter à ce critère géographique un autre critère, peut-être un peu plus farfelu mais qui correspond aussi à des dossiers que nous voyons passer en Suisse, en France ou ailleurs, à savoir la qualité de l'auteur du virement ; par exemple, sa qualité politique, quel que soit le signalement de l'intéressé, qu'il soit dictateur ou président de conseil général en France. Mme Dina BALLEYGUIER : De ce point de vue, dans le milieu de la Commission fédérale des banques et des établissements que nous surveillons, nous sommes déjà un pas plus loin. Non contents de lutter contre le blanchiment de l'argent provenant de crimes ou du trafic de drogue, nous réglementons et interdisons jusqu'à un certain point l'acceptation de fonds provenant de potentats, pour ne pas utiliser le terme de « dictateur » car il est un peu réducteur. Quant à savoir jusqu'où les banques doivent participer à la lutte contre l'évasion fiscale, c'est une vaste question qui se discute en ce moment. Je n'ai pas qualité pour émettre une opinion. C'est une question qui se situe à un autre niveau. C'est un problème général, ce n'est pas un problème bancaire. C'est un problème qui doit se régler au plan international et pas au plan suisse. M. Riccardo SANSONETTI : Notre approche, comme celle de la plupart des législations anti-blanchiment, tend à prévoir une identification à l'entrée dans le système financier. Dans le cadre des transactions internationales, la question pratique la plus importante est de savoir si tel pays possède une réglementation d'un niveau suffisant. Nous considérons dans nos textes que les pays de l'espace GAFI, c'est-à-dire ceux dont la réglementation a été testée concrètement par cet organisme, sont dotés d'une réglementation à niveau. Par conséquent, si une institution financière surveillée en France entre en contact avec une institution surveillée en Suisse, on peut se reposer sur son identification. En revanche, comment réagir si l'institution financière est basée à Gibraltar ou aux Seychelles ? On s'est également interrogé sur les cas où l'on trouve parallèlement des éléments qui font penser que l'on est en présence du produit d'une infraction grave et un autre élément, fiscal ou autre. Nous avons négocié une solution assez intéressante dans une note interprétative à la recommandation n° 15 du GAFI qui a été adoptée en juin dernier, à Tokyo. Il y est indiqué que la présence d'éléments autres que des traces d'infraction préalable ne peut pas être une excuse pour ne pas annoncer. Du côté suisse, nous étions d'avis qu'il convenait de prendre en compte n'importe quel élément, et pas seulement fiscal, par exemple les infractions politiques et la corruption. Il n'y a aucune raison de faire de ségrégation pour le fiscal mais je ne suis pas sûr que nous soyons tous sur la même ligne au plan international. Cette approche est assez difficile à faire admettre, non seulement en matière de communication de soupçons mais aussi et surtout en matière de coopération internationale. La discussion que nous avons eue à Porto, la semaine dernière, pour fixer les critères permettant de déterminer les juridictions non coopératives a buté sur ce point. Du côté suisse, nous soutenions une approche très large mais, étrangement, nous avons été un peu isolés. Si l'on prétend vraiment vouloir lutter efficacement contre le blanchiment, il n'y a pour nous aucune raison d'établir de distinctions. Soit l'on prend en compte toutes les infractions graves, soit on se limite à des approches historiquement originaires. S'agissant de l'efficacité des systèmes d'annonce de soupçons, nous avons toujours considéré qu'il n'était pas essentiel d'avoir une myriade d'annonces mais qu'il importait que les annonces correspondent vraiment à un état de fait devant être annoncé et surtout qu'il y ait un suivi. L'efficacité d'un système d'annonce se mesure moins au nombre d'annonces qu'au rapport entre le nombre d'annonces et le suivi qui leur est donné. Sur le plan national, il est clair que les systèmes qui aboutissent au plus grand nombre d'annonces ne sont pas les plus efficaces. Le système britannique qui en produit environ dix mille par an est assorti d'un ratio de suivi extrêmement faible. Dans le système néerlandais, dépourvu d'une définition claire des soupçons, qui prévoit l'annonce des « unusual transactions », le suivi est également difficile à mesurer. M. le Président : Il est amusant de découvrir à la lecture des graphiques figurant dans votre rapport, que 20 % des déclarations sont dues au fait que les banquiers ont lu dans la presse que leurs clients étaient déjà mis en difficulté, soit un bien plus grand nombre que celles résultant de l'application des règles prudentielles. On voit avec quelle énergie vous vous êtes lancés dans cette lutte contre le blanchiment. Et on lit dans les rapports du GAFI que plus vous contrôlez le système, plus le système a tendance à se délocaliser. Il est écrit en toutes lettres que de nombreuses banques suisses vont au Liechtenstein. Est-ce pour vous un important sujet de préoccupation ? D'autant que j'ai lu dans un autre texte que, dans le même temps, la réglementation sur les filiales des banques suisses à l'étranger s'était plutôt assouplie. Parallèlement, on voit que les cocontractants se trouvent dans des pays comme les îles Vierges mais que les ayants droit économiques ne s'y trouvent pas. Cela montre qu'en matière de blanchiment, il existe une difficulté avec les centres offshore et un certain nombre de paradis fiscaux. Cette difficulté se rencontre partout. La réponse ne peut donc être que coordonnée. Quelle attitude la Suisse entend-elle faire valoir dans les discussions internationales ? Mme Dina BALLEYGUIER : Assiste-t-on à des créations de filiales de banques suisses à l'étranger, notamment dans certains centres offshore ? C'est possible. Je n'en sais rien. Je sais, en revanche, que si cela était exact, elles ne sauraient utiliser ces filiales pour contourner les règles sur la lutte contre le blanchiment. Notre circulaire est très claire à ce sujet : les intermédiaires financiers ne doivent pas utiliser leurs succursales étrangères ni les sociétés du groupe à l'étranger, actives dans le domaine bancaire ou financier, pour contourner ces directives. Si elles le font, elles en subissent les conséquences ici. Nous prononçons les sanctions contre la maison mère, ici. M. le Président : Pouvez-vous nous donner un exemple de sanction que vous avez prise dans la dernière année ? Mme Dina BALLEYGUIER : Nous n'avons pas pu prendre de sanctions puisqu'il n'y a pas eu d'infractions ! Je ne dis pas qu'il n'y a pas délocalisation de certaines activités, mais certainement pas dans le but d'éviter la lutte contre le blanchiment. Il y a d'autres motifs. Le jour où ces motifs seront répréhensibles, punissables et condamnables, il est clair que nous interviendrons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous n'avons donc aucune raison d'intervenir tant que les maisons mères respectent les directives en matière de blanchiment. Elles sont responsables et doivent nous rendre compte de ce qui se passe dans les filiales. Dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, il nous arrive d'envoyer des réviseurs de la maison mère dans une succursale ou une filiale à l'étranger. Je ne peux pas vous citer de cas, car cela relève du secret professionnel, mais il y en a eu. Ce n'était pas en matière de blanchiment. Si nous avions des indices qu'il y a un problème de blanchiment dans la filiale d'une banque suisse dans un centre offshore, nous n'hésiterions pas à faire de même. M. le Président : Une note interprétative examinée lors de la réunion du GAFI à Tokyo indiquait que la question de l'excuse fiscale devait être sérieusement abordée si on voulait traiter sérieusement la question du blanchiment. Quelle est votre position à ce sujet ? Vous entretenez les meilleurs termes avec le GAFI. Le suivez-vous encore sur cette question ou cela vous paraît-il être une approche partiale ? M. Riccardo SANSONETTI : Il est clair que nous avons été tout à fait favorables à la précision de la recommandation. Il s'agissait d'une note interprétative à la recommandation 15. Cette recommandation fait obligation d'annoncer les soupçons. La difficulté est qu'il n'existe pas de définition réellement univoque du blanchiment au plan international. En effet, la recommandation 4 du GAFI, qui est le standard reproduit partout, y compris désormais dans les textes de l'ONU, indique que c'est le produit de toute infraction grave, chaque Etat devant établir la liste des infractions graves. Notre code pénal établit une division tripartite des infractions, les infractions graves étant les crimes, lesquels sont au nombre d'environ quatre-vingt. Pour nous, il s'agit donc de toutes ces infractions sans exception. Dans d'autres pays, il y a une liste ad hoc, ou c'est parfois moins clair, ou la liste est très restrictive. En tout cas, à la base, il est fait obligation d'annoncer ces soupçons-là. Cela dit, on a constaté dans certaines juridictions que certains intermédiaires se prévalaient d'une gêne liée au fait que dans un cas particulier, ils avaient à la fois un élément de soupçon et un autre élément d'information qui n'avait rien à voir - par exemple, un élément prétendument fiscal ou prétendument lié à une infraction politique - et qui ne faisait pas l'objet d'annonce, pour ne rien annoncer du tout. On a voulu vraiment clarifier ce point. Si nous étions tous d'accord sur l'intérêt de le clarifier, la question était de savoir comment le faire. La proposition initiale visait à se cantonner à l'excuse fiscale. Du point de vue de la philosophie du système, nous ne voulions pas une approche trop restrictive. C'est pourquoi nous avons voulu faire figurer dans le libellé les mots « inter alia ». Sinon, on aurait pu l'interpréter de bonne foi comme n'étant applicable qu'en présence également d'un élément fiscal, sans qu'il y ait, dans les autres cas, d'annonce à faire. Cela aurait donc été contraire au but poursuivi. M. le Président : Merci pour cette précision. M. le Rapporteur : Ma question s'adresse au chef de section de l'entraide judiciaire internationale de l'Office fédéral de la police. La Suisse n'étant pas partie à la convention européenne de l'entraide judiciaire en matière pénale de 1978 qui exclut la possibilité de refuser l'entraide au motif que l'infraction est pénale, chaque fois qu'un juge d'instruction français écrit à l'autorité chargée de l'entraide, à charge pour lui de transmettre dans les cantons compétents, celui-ci reçoit le texte de la réserve de spécialité. Or ce texte est utilisé par les délinquants français. Par exemple, lorsque l'un demande à un faux facturier d'un parti politique confondu pourquoi l'argent est en Suisse, il répond qu'il fait de la fraude fiscale. Ils se sont donnés le mot. Telle est la conséquence concrète sur le terrain judiciaire de l'évolution politique lente de la Suisse par rapport aux recommandations et à la pression du GAFI, qui refuse de plus en plus l'excuse fiscale en matière d'entraide judiciaire. L'immunité en matière de la fraude fiscale est un point très important pour notre appréciation et pour améliorer la coopération judiciaire. C'est l'une des causes des atteintes gravissimes aux libertés publiques dans notre pays. Pendant que l'on refuse la coopération, les individus restent en prison, on les place sous contrôle judiciaire, on confisque leurs avoirs mais ils ne sont pas jugés parce que l'on ne peut pas les relâcher. Cela a des effets pervers considérables. Pouvez-vous nous donner l'état du droit, la façon dont vous l'interprétez et la manière dont on peut le faire évoluer, si vous considérez, comme nous, qu'il doit être aménagé ? M. Beat FREY : C'est un domaine assez complexe. La Suisse a de bonnes raisons d'avoir choisi le système actuel, mais c'est assez difficile à comprendre lorsque l'on ne connaît pas toutes les idées qui le sous-tendent. Les juges d'instruction à l'étranger ne savent pas toujours suffisamment que la Suisse ne refuse pas l'entraide judiciaire en matière pénale pour des raisons d'ordre fiscal. La Suisse peut l'accorder pour des cas d'escroquerie en matière fiscale. Le problème est d'établir la distinction entre une escroquerie en matière fiscale et le simple non-paiement des impôts. L'explication est difficile. Quand je dois l'expliquer à un collègue suisse, cela me prend une demi-heure ; quand je dois l'expliquer à un collègue étranger, je lui demande de m'adresser sa demande en lui indiquant qu'après examen de l'état de fait, je lui dirai si cela relève ou non d'un tel cas... Il m'arrive même de transmettre la demande à l'administration fédérale des impôts afin de connaître sa position. Sur le principe, cela n'est pas très difficile à comprendre. L'escroquerie en matière fiscale, c'est le délit grave. Le délit grave, dans l'esprit de la loi, est commis par quelqu'un qui fait plus qu'une fausse déclaration. Oublier, omettre des chiffres dans sa déclaration d'impôt est un délit simple. Le délit grave commence lorsque quelqu'un fait plus que mentir à l'administration : par exemple, en falsifiant des documents. Nous avons eu à connaître de cas simples de gens habitant en Allemagne et travaillant en Suisse, qui ont modifié des chiffres sur les relevés annuels de salaires, pour lesquels nous avons accordé l'entraide judiciaire. Cela ne concerne pas uniquement des cas très importants. Il existe des cas plus compliqués de constructions de mensonges avec falsification de documents qui ne peuvent plus être contrôlés par l'administration. Si des documents sont falsifiés, il s'agit, selon la loi suisse, d'une escroquerie en matière fiscale et là aussi, l'entraide judiciaire est possible. Nous sommes toujours surpris de voir très peu de demandes étrangères. Je pense que cela est dû au fait que la distinction est difficile à expliquer. Les autorités étrangères ont tendance à considérer, de façon simpliste, qu'avec la Suisse, cela ne fonctionne pas et qu'il est inutile de prendre la peine d'envoyer des demandes. La Suisse a conclu avec l'Italie un traité complémentaire prévoyant notamment l'entraide judiciaire en matière d'escroquerie fiscale. En fait, nous n'allions pas plus loin que ce qui existait déjà dans notre loi, mais pour les Italiens, l'ouverture de la Suisse a été saluée comme un grand succès. Nous avons alors réalisé qu'ils ignoraient qu'ils auraient pu demander cette coopération depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'entraide judiciaire en 1983. Avec la France, la situation est comparable. Nous recevons assez peu de demandes pour des cas d'escroquerie, nous commençons à en recevoir davantage dans le domaine douanier. Pour les autres cas, nous avons prévu le formulaire du principe de spécialité. Le coupable d'une escroquerie est mis en prison. On ne devrait pas avoir à se demander s'il a payé tous ses impôts. Si cette solution existe en Suisse, c'est parce que nous avons eu de très longs débats au Parlement. Or c'est le Parlement qui a la maîtrise de cette réglementation et non l'administration ou le gouvernement. M. le Président : Nous avons vu qu'il avait eu des débats très sérieux. M. Beat FREY : Des parlementaires étaient partisans de la coopération en matière fiscale, d'autres y étaient hostiles. On a trouvé un compromis typiquement suisse, dans la mesure où il ne convient pas entièrement à quelqu'un mais repose sur de très bons fondements juridiques. L'administration fiscale suisse ne peut pas avoir accès aux comptes bancaires en cas de simple non-paiement mais uniquement lorsqu'il s'agit d'une escroquerie en matière fiscale. L'affaire est alors soumise à un juge d'instruction qui, seul, peut lever le secret bancaire. Nous proposons la même solution à l'égard de l'étranger mais elle est très difficile à comprendre de l'extérieur. Si la Suisse devait changer d'attitude, elle ne le ferait pas seulement en fonction de l'étranger. M. Jacky DARNE : Ce que vous venez de dire nous ouvre des pistes de travail et des possibilités de réflexion bilatérales non négligeables, car il me semble qu'il existe une confusion dans l'approche du problème. D'un côté, toutes les administrations fiscales sont soucieuses d'établir ce type de distinction parce qu'elles sont soucieuses de lutter contre une évasion fiscale due aux difficultés d'application de textes souvent complexes. Le choix d'un taux de TVA, d'une déductibilité entraîne une application du redressement différente selon les cas. En France, par exemple, quelqu'un qui triche peut faire l'objet d'un redressement avec des droits simples ou, s'il est de mauvaise foi, à 200 %. En matière de contrôle fiscal, le concept de mauvaise foi se rapproche donc de ce que vous qualifiez d'escroquerie. On évoquera la mauvaise foi si l'on a cherché à justifier des sorties de fonds par de fausses factures ou d'autres procédés. En ce cas, on ne pourra pas parler simplement d'erreur. Mais d'un autre côté, c'est le résultat de l'investigation. On ne peut dire qu'après coup s'il y a eu escroquerie ou bonne foi. En censurant le travail au départ, en disant : démontrez l'escroquerie pour que je puisse investiguer et disposer des éléments, vous introduisez une quasi-impossibilité de trouver la faute. Il serait préférable de dire : nous avons démontré que vous avez mis de l'argent de côté en ouvrant un compte en Suisse et en y déposant de l'argent, donc votre vente sans facture et votre mauvaise foi sont démontrés, parce que l'on n'ouvre pas un compte à l'extérieur de son pays ou ailleurs que dans un environnement normalement connu. La diligence normale d'un chef d'entreprise avisé est de gérer en bonne conformité. En prenant la peine d'aller ouvrir un compte ailleurs, dans des conditions un peu floues, il révèle sa volonté d'escroquerie. En demandant la preuve avant, vous interdisez quasiment de la démontrer. Instruisons plutôt ensemble pour savoir s'il s'agit ou non d'une escroquerie. Je considère qu'une évolution est nécessaire de part et d'autre sur ce sujet. M. Beat FREY : Je ne peux pas tout à fait suivre votre argumentation. C'est la même chose pour les escroqueries simples et pour toutes sortes de crimes. Une demande d'entraide judiciaire est toujours formulée sur la base du soupçon d'une autorité. Il n'est pas nécessaire de prouver. On se base sur un soupçon contenu dans une commission rogatoire. On ne contrôle pas si le contenu de la commission rogatoire est juste ou non. M. Jacky DARNE : Vous voulez dire que, dans son énoncé, la commission rogatoire n'énumère pas suffisamment les soupçons. M. Beat FREY : Le soupçon doit être présent. Bien entendu, il faut déjà avoir certains éléments pour ouvrir une enquête. M. Jacky DARNE : On a dit tout à l'heure que le nombre des procédures comptait davantage que le nombre des dénonciations. En prolongeant votre appréciation qualitative, on peut estimer que vous avez réalisé un important travail de tri et que n'arrive que ce qui est largement fondé. Pourtant, les documents que vous nous avez fournis ne font état que de 25 jugements, dont un acquittement et 30 ordonnances de non-lieu. Alors que les fautes sont qualifiées de crimes, la moitié des décisions sont très légères puisqu'elles se limitent à des amendes et à quelques mois d'emprisonnement. Que pensez-vous de l'efficacité du juge ? M. Alexander HARTMANN : Notre service n'existe que depuis le 1er avril. Nous n'avons eu communication que des sanctions prises dans les cantons. Nous n'avons pas eu communication de celles des juges d'instruction. Il n'est pas significatif de comparer ces condamnations avec les chiffres évoqués. M. Jacky DARNE : Il y a tout de même eu 30 non-lieux ! M. Alexander HARTMANN : Laissez-nous un ou deux ans pour travailler. M. le Rapporteur : Nous sommes venus trop tôt ! M. Beat FREY : A la section de l'entraide judiciaire internationale, nous voyons les cas les plus importants. Cela nous permet de constater que la Suisse intervient rarement au début d'un blanchiment mais plutôt vers la fin. Bien souvent, on retrouve l'argent déposé en Suisse, on le bloque, on le confisque, on le rapatrie, on pratique du sharing - la presse s'est fait l'écho de cas avec les Etats-Unis. Dans ces conditions, le rôle du juge suisse pour condamner les coupables ne s'impose pas. Nous essayons plutôt d'obtenir une coopération de la part des banques ou des fiduciaires concernées, afin de pouvoir confisquer les avoirs et de condamner les gens qui sont à l'origine du blanchiment, c'est-à-dire les trafiquants de stupéfiants, les escrocs, les vrais criminels. Lorsque des fonds résultant de la vente de stupéfiants aux Etats-Unis sont passés par les îles anglo-normandes, Gibraltar ou les Bahamas avant d'arriver en Suisse, il reste assez peu de matière à condamnation ici. La coopération vise plutôt à condamner les auteurs initiaux. Le juge d'instruction doit ouvrir une enquête pénale s'il veut bloquer l'argent, quand il n'y a pas encore d'entraide, mais il se dessaisira de l'affaire s'il sait qu'un juge à l'étranger est mieux placé pour la résoudre. M. le Président : D'abord, dans le rapport annuel, vous dites que vous avez été saisis d'une centaine de demandes d'information par les autorités d'autres pays et que vous n'avez répondu à aucune. Si vous le dites avec une telle simplicité, cela est sans doute dû aux problèmes matériels auxquels a fait allusion le représentant de l'autorité de contrôle et qui existent dans tous les pays. Est-ce bien le cas ? Sinon, pourquoi n'y a-t-il pas eu transmission de ces demandes ? Ensuite, vous dites qu'une difficulté dans l'obligation de déclaration est liée à la relation d'affaires. Il faudrait revenir sur ce qu'est vraiment une relation d'affaires et en quoi certaines interprétations de ceux qui sont en relations d'affaires et qui doivent déclarer vous posent problème. Dans votre brillant exposé, vous n'êtes pas revenu sur les difficultés mentionnées dans votre rapport. Enfin, vous dites que le blanchiment passe des banques vers d'autres acteurs, notamment des entreprises et des industries. N'est-il pas possible que soient créées ici des sociétés à but commercial ou industriel dont on aurait du mal à identifier les actionnaires et l'état des comptes ? Dans cette perspective, comment appréhendez-vous le droit des sociétés, sachant que nous rencontrons aussi ce problème ? M. Alexander HARTMANN : En tant que Bureau de communication, nous avons un réseau particulier. Nous parlons avec les quarante et un autres pays ayant créé un Bureau de communication. C'est un réseau spécial et informel. Concernant la France, nous travaillons avec TRACFIN. M. le Président : Nous avons reçu des responsables de TRACFIN qui nous ont dit que tout allait bien avec la Suisse, sauf sur ce cas précis évoqué dans votre rapport : sur cent demandes adressées, aucune réponse n'a été obtenue. Je pensais que c'était dû à un problème matériel mais vous nous avez dit que vous étiez assez nombreux à trois pour régler tous les problèmes du blanchiment. Si tel n'est pas le cas, dites-nous de quoi il s'agit. M. Alexander HARTMANN : Vous avez obtenu cette réponse directement de TRACFIN ? M. le Président : Directement. On nous a dit que cela allait s'arranger car des négociations étaient en cours, mais que jusqu'alors, la situation était telle. M. Alexander HARTMANN : J'ai une toute autre information à vous donner. Notre coopération avec TRACFIN est très bonne. Nous répondons aux demandes de renseignements de façon informelle. J'aimerais savoir d'où vous tenez cette information. M. le Président : Elle provient de deux sources : d'une part, votre rapport, où vous écrivez que vous n'avez pas pu répondre à une centaine de demandes adressées entre 1998 et 1999 ; d'autre part, le secrétaire général de TRACFIN que nous avons reçu la semaine dernière, lequel nous a précisé qu'il entamait avec la Suisse des négociations bilatérales à la suite de demandes d'informations sans retour. Il ne s'agit pas de ma part d'une accusation. Je m'attendais à ce que vous disiez que vous manquez de moyens, mais ce n'est peut-être pas le cas. M. Alexander HARTMANN : Nous discutons maintenant officiellement avec TRACFIN mais je ne peux pas répondre de façon plus détaillée à cette question. M. le Président : Vous disposez d'un système d'information baptisé GEWA. En dehors de TRACFIN, vous dites que vous n'avez pas répondu à un certain nombre de demandes qui vous étaient faites. M. Alexander HARTMANN : Seules les communications figurent dans ce système et non les demandes. M. le Président : Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de problème avec la relation d'affaires, mais vous écrivez le contraire dans le rapport. Mme Natacha POLLI : La définition de la relation d'affaires est claire. Elle apparaît dès l'établissement d'une relation contractuelle. Cela ne nécessite pas un contrat écrit. Par exemple, si quelqu'un se présente dans une gare pour changer de l'argent, dès l'instant où il pose les coupures sur le guichet et où l'employé les prend, la relation d'affaires est engagée. La seule issue que nous laissons aux intermédiaires financiers, du moins à ceux qui nous sont soumis, est le droit pour l'employé de refuser la transaction, donc la relation d'affaires. Dans ce cas, il n'a pas l'obligation de communiquer. M. le Président : Je vous demande de me préciser ce que vous dites par ailleurs. Au paragraphe 50 du rapport de cette année, il est écrit : « (...) une obligation de déclaration de soupçon dont il faut relever le caractère incomplet en raison du fait que l'obligation ne naît qu'au moment de la relation d'affaires, et la lecture restrictive qu'en font les institutions financières. » Cette interrogation était la vôtre, puisque vous estimiez que la notion de relation d'affaires donnait lieu à des lectures restrictives. M. Alexander HARTMANN : L'obligation d'annoncer les soupçons est définie à l'article 9 de la LBA, dont le non-respect est assorti par la loi d'une sanction. Selon cette disposition, toute personne qui sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées proviennent d'une infraction préalable au blanchiment d'argent doit l'annoncer sans délai au Bureau de communication. L'obligation d'annoncer s'applique même en l'absence de relations d'affaires établies, ainsi que le souligne par exemple la circulaire de la Commission fédérale des banques. Mme Dina BALLEYGUIER : Cette obligation s'applique à tous les établissements soumis à notre surveillance. Même s'ils n'entrent pas en relation d'affaires, même s'ils la refusent, mais qu'ils ont des soupçons manifestes, ils doivent communiquer. Cela est prévu au paragraphe 22 de la circulaire. M. le Président : Pouvez-vous nous parler du rôle des entreprises ? M. Niklaus HUBER : J'en ai déjà parlé à mes supérieurs. Il s'agit d'une extension du champ d'application de la LBA. Quand je compare notre législation à celle de nos pays voisins et des Etats-Unis, je constate que notre champ d'application est très vaste. Nous avons du mal à consolider la surveillance. Je doute que, dans les deux à trois ans à venir, nous procédions à une révision de la LBA pour élargir son champ d'application. Nous voyons déjà une certaine fuite dans le secteur immobilier. Nous savons que des restaurants augmentent leur chiffre d'affaires sans développer leur clientèle. Les hôtels et les agences de voyages qui effectuent des opérations de change sont déjà soumis à la loi. S'agissant du commerce d'objets de luxe - voitures, montres, tableaux, bijoux, etc. -, les négociants en matières premières, y compris en diamants, sont soumis à la loi. Le problème qui se pose actuellement avec la mafia russe concerne le commerce d'objets de luxe et le secteur industriel, non soumis à la loi aujourd'hui Dans le secteur industriel, il y a deux problèmes, Le premier a trait aux contrats de consultant. Comme j'ai travaillé auparavant dans le secteur industriel comme conseiller juridique, je connais le sujet. Des contrats de consultant, qui ne sont pas de réels contrats car aucun service n'est jamais rendu, servent de camouflage pour la corruption des fonctionnaires. Le second problème est lié aux augmentations de capital. Le vrai problème aujourd'hui dans l'industrie du monde occidental réside dans ce domaine, car personne ne demande d'où vient cet argent. De nombreuses sociétés confrontées à des problèmes financiers augmentent leur capital. On met en avant un homme de paille puissant alors que l'argent vient d'ailleurs. C'est un réel danger car ensuite, les sociétés industrielles sont infiltrées, on ne sait plus qui les dirige. Des sommes énormes en provenance de pays du tiers-monde sont ainsi investies dans des sociétés en Europe et aux Etats-Unis, sans que personne sache qui se cache derrière les hommes de paille ou les écrans. M. le Président : Quels moyens relevant du droit peut-on utiliser pour lutter contre ces pratiques ? M. Niklaus HUBER : Pour des raisons commerciales, de compétition ou de concurrence, la plupart des pays d'Europe ont exclu l'identification dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Si vous déposez dans une banque de l'argent destiné à réaliser une augmentation de capital, aucune vérification n'est effectuée. Cela tient à des raisons commerciales. Comme on veut attirer les sociétés industrielles et les capitaux, on ne pose pas de questions. Ce matin, un avocat m'a demandé par téléphone si les notaires qui acceptent des capitaux pour fonder une société devaient identifier leurs clients. Si cela entre dans le cadre de leur activité traditionnelle, la réponse est non car, dans ce domaine, ils ne sont pas soumis à la LBA. Les notaires disent toujours que c'est aux banques de vérifier, mais celles-ci ne vérifient pas la provenance des capitaux déposés dans le cadre de la fondation d'une société. Si j'ouvre un compte dans une banque et si l'on m'y verse deux millions de francs suisses, à moins qu'il n'y ait des indices de blanchiment, on ne me demandera pas qui est l'auteur du paiement et s'il a le pouvoir économique d'effectuer un tel versement. Cela irait beaucoup trop loin. Lorsque quelqu'un dépose de l'argent sur le compte d'une société industrielle afin d'augmenter son capital, dans 99,9 % des cas, aucune vérification n'est effectuée. M. le Président : M. Huber, vous nous dites des choses passionnantes, je partage totalement votre analyse et vous répondez ainsi pour partie à ma première question. Selon vous, c'est donc à travers les sociétés industrielles, dont certaines ont des hommes de paille mais qui ont pignon sur rue, que s'opèrent aujourd'hui les grandes activités de blanchiment ? M. Niklaus HUBER : Je le soupçonne. M. le Rapporteur : Dans le premier rapport du Bureau de communication, il est explicitement indiqué que « l'obligation de communiquer ne doit pas être appliquée non plus lorsqu'il s'agit de fortune de dictateurs, à moins qu'il n'y ait un soupçon fondé qu'elle provient d'un crime ou d'une organisation criminelle. ». Or toute fortune accumulée par un homme politique est forcément soupçonnable, à plus forte raison pour un dictateur. Permettez-moi d'avoir là une réaction forte. Nous ne comprenons pas. Nous avons des statistiques de la chancellerie sur les demandes d'entraide et sur l'exécution des commissions rogatoires entre la France et la Suisse et entre la Suisse et la France, car il est normal que l'évaluation soit bilatérale. Concernant les demandes de la France envers la Suisse, pour 1996, 82 sont terminées, 33 ne le sont pas, soit 30 % ; pour 1998, 49 le sont ; pour 1997, 93 sont terminées, 36 ne sont toujours pas revenues, pour 1998, le rapport est de 88 pour 80. Nous n'avons pas de problème sur l'exécution des commissions rogatoires par la Suisse, nous savons qu'elles seront un jour exécutées, mais considérez-vous que les recours internes que les ressortissants peuvent effectuer - ce qui n'est pas le cas en France - devant les juridictions cantonales, puis devant le tribunal fédéral, soient la première cause du fait qu'environ 40 % des commissions rogatoires ne sont pas exécutées en trois ans ? Nous avons même trouvé, dans le canton de Zürich, un cas où la chancellerie attend depuis dix ans, dans une affaire célèbre, pour des sommes importantes et des délits graves, un retour d'exécution de commission rogatoire internationale. C'est à l'évidence un cas pathologique mais nous interrogerons les autorités compétentes. M. le Président : Mais qui va se résoudre. M. le Rapporteur : Je préfère l'approche statistique sur la question du délai. M. Beat FREY : La durée de la procédure d'entraide judiciaire en Suisse a posé un problème durant de longues années. La loi a été révisée. Le système a été modifié. Ces dispositions commencent à donner leurs effets mais d'après nos statistiques, la Suisse reçoit chaque année 2 000 à 2 500 requêtes étrangères, dont 500 à 600 concernent des cas graves. Le reste a trait à des cas assez simples : cambriolages, accidents de voiture. Pour les cas exécutés avec les Etats-Unis - une centaine par an -, l'Office décide directement. Ils peuvent être résolus en moins d'une année. Les cas concernant de très fortes sommes sont les plus longs à résoudre, car les gens n'hésitent pas à payer des avocats très cher. Alors que la loi a été simplifiée, d'autres complications apparaissent. M. le Rapporteur : En tant qu'homme de terrain, estimez-vous que les voies de recours sont un obstacle à la lutte contre la délinquance financière internationale ? M. Beat FREY : La procédure suisse a ses raisons. Elle présente des avantages. Elle va beaucoup plus loin que dans les autres pays. L'an dernier, nous avons rendu aux Philippines 580 millions de dollars des fonds Marcos. Nous sommes le seul pays du monde à avoir rendu de l'argent aux Philippines, alors que la famille Marcos possède des fonds ailleurs. Je reconnais que cela a duré douze ans, mais nous avons pu rendre des sommes considérables. Obtenir des auditions de témoins demande des années. Ma tâche est de chercher à raccourcir les délais. Lorsque j'ai pris mon poste, il y a dix ans, une trentaine de cas par an allaient jusqu'au tribunal fédéral. L'an dernier, il y en a eu 141. L'affaire Marcos a donné lieu à 64 décisions de notre cour suprême. Cela révèle des complications pas uniquement dues à la loi, mais aussi aux actions de la défense. M. Niklaus HUBER : Vous nous avez interrogés sur l'existence d'un manuel de révision et sur le point de savoir s'il comporte un chapitre sur le blanchiment. Je crois savoir que les grandes sociétés de révision ou d'audit sont en train d'établir un manuel qui va dans cette direction. Au sein de l'autorité de contrôle, nous avons défini un concept d'audit dont je ne peux vous communiquer copie car il est confidentiel. Si la Commission fédérale des banques n'a pas un concept comparable, c'est tout ce qui existe actuellement. Mais dans les douze mois à venir, toutes les sociétés de révision auront un instrument comparable. M. Jacky DARNE : Nous nous rejoignons sur ce point. Je souhaite que nous disposions d'outils qui nous permettent d'être efficaces. Un de vos propos antérieurs m'a semblé un peu contradictoire avec les ordonnances d'application de la loi contre le blanchiment. Je pensais que les banques devaient contrôler les arrivées de fonds destinées à l'augmentation des capitaux propres des sociétés au même titre que d'autres opérations. Cela entre-t-il ou non dans le champ de la loi ? Mme Dina BALLEYGUIER : A partir du moment où cet argent est versé dans une banque par un particulier, il existe, à l'évidence, une obligation de contrôle. En revanche, cette obligation de contrôle n'existe pas si cet argent est versé par un notaire. Dans son activité de notaire - et non dans celle d'intermédiaire financier -, celui-ci bénéficie du secret. Pour la banque, il n'y a pas obligation d'identification mais le notaire est censé la faire. Toutefois, personne ne va contrôler puisque cela ne fait pas partie de son activité d'intermédiaire financier mais de son activité de notaire. M. Jacky DARNE : Autrement dit, si vous êtes russe et si vous voulez blanchir de l'argent en participant à une augmentation de capital, il vous suffit de passer par un notaire qui déposera l'argent à la banque, laquelle ne contrôlera pas, alors que si un Russe dépose de l'argent à la banque, on entre dans la procédure de blanchiment. Mme Dina BALLEYGUIER : Tout à fait ! M. Jacky DARNE : D'où l'importance de prévoir pour le notaire des procédures identiques aux autres Mme Dina BALLEYGUIER : En l'occurrence, même avec la LBA, une procédure pour le notaire ne servirait à rien puisque le notaire n'est pas intermédiaire financier, il est notaire. Mme Natacha POLLI : Il faut que ce soit dans son activité typique de notaire, c'est-à-dire pour l'achat d'un immeuble ou pour l'augmentation de capital d'une société. Mme Dina BALLEYGUIER : L'augmentation de capital d'une société est une activité typique de notaire et personne n'ira contrôler si le notaire a identifié. M. Jacky DARNE : Il faut tout de même tenter d'élargir le champ. Les trous de la passoire sont trop gros. J'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur le système GEWA de traitement des données. Il est accessible à un certain nombre de personnes qui ont donné toutes garanties quant à la discrétion qui convient à un tel fichier. Huit cents personnes y ont accès, dont quatre-vingts à l'international. Quelle pertinence trouvez-vous à cet outil ? Comment l'utilisez-vous ? Comment l'étranger l'utilise-t-il ? De votre côté, quels fichiers extérieurs utilisez-vous ? Existe-t-il un système de centralisation des fichiers ? Un des problèmes principaux est de suivre les individus, quels qu'ils soient. M. Alexander HARTMANN : Seules trois personnes du Bureau de communication ont accès au système GEWA. L'ordonnance prévoit la possibilité d'accès d'autres autorités mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous sommes les trois seuls à pouvoir l'utiliser. M. Jacky DARNE : Dans l'immédiat, TRACFIN n'y a donc pas accès ? M. Alexander HARTMANN : Non. M. Jacky DARNE : Ils passent par vous. M. Alexander HARTMANN : C'est uniquement une base de données regroupant les communications. Nous avons d'autres bases de données policières sur la drogue et le crime organisé. Les informations que nous communiquons à TRACFIN proviennent des bases de données policières. Le système GEWA n'existe que depuis le 1er avril 1998 et ne contient pas encore beaucoup d'informations. M. le Président : Au nom de la mission d'information, je tiens à vous remercier très chaleureusement de l'accueil que vous nous avez réservé ainsi que de la qualité et de la liberté de vos réponses. Vous êtes des fonctionnaires, des praticiens, nous sommes des parlementaires. Notre but est de vous aider dans votre tâche. Pour faire avancer les choses, il est nécessaire que les opinions publiques et les responsables politiques se saisissent davantage du problème. La grande qualité du dispositif que vous avez mis en place ne permet pas de dire aujourd'hui que tous les problèmes sont résolus. C'est pourquoi nous voulions vous laisser pointer les difficultés rencontrées. M. Niklaus HUBER : Ce fut un plaisir de vous répondre. Vos questions nous aideront à orienter nos recherches. De telles discussions sont porteuses d'enseignements. Merci beaucoup. Audition de M. Bernard BERTOSSA, (compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 1999 en Suisse) Présidence de M. Vincent PEILLON, président M. le Président : M. Bertossa, je vous rappelle que notre Mission d'information s'intéresse aux obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux. En effet, en rencontrant des interlocuteurs : responsables politiques, responsables administratifs ou praticiens - avocats, banquiers ou autres -, nous avons le sentiment que les dispositifs législatifs et, s'agissant de la Suisse, la LBA, donnent tous les moyens d'agir et que le phénomène du blanchiment - ou plus largement, de la délinquance financière - ne pose plus réellement problème. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour porter la discussion sur le terrain des obstacles. On parle beaucoup de la délinquance financière, du blanchiment, de l'argent des mafias, de l'argent russe. Mais est-on capable d'estimer l'importance de ce phénomène de l'argent sale et de son blanchiment, c'est-à-dire de son introduction dans les circuits normaux et, par conséquent, est-on bien conscient de l'urgence qu'il y a à lutter contre ce phénomène ? M. Bernard BERTOSSA : Je ne me risquerai pas à donner des chiffres. Par définition, nous avons affaire à des phénomènes occultes et il est hasardeux de vouloir circonscrire ce que l'on ne connaît pas. Je dirai simplement que les enquêtes judiciaires - notre seul point d'observation de ces phénomènes - en cours à Genève dans le domaine du blanchiment représentent plusieurs centaines de millions de francs suisses, soit plus d'un milliard de francs français. Quant à apprécier la gravité du phénomène, cela relève plus du politique que du juge. Un grand nombre d'organisations internationales, aussi bien dans le domaine économique que politique, sont maintenant conscientes de la nécessité de réagir avant qu'il soit trop tard. M. le Président : Le procureur du Tessin nous disait hier que sur les treize déclarations de soupçon qui lui avaient été transmises dans l'année par le Bureau de communication, aucune ne lui avait appris quelque chose dans la mesure où elles visaient toutes des affaires déjà ouvertes et traitées par la justice. Avez-vous le sentiment que ce mécanisme instauré par la loi est efficace et que les professions qui sont tenues à ces déclarations le respectent parfaitement ? M. Bernard BERTOSSA : Je pense que l'efficacité est extrêmement limitée, dans la mesure où le signalement dépend de la diligence et de la bonne volonté de l'intermédiaire financier lui-même. Dans les affaires sensibles, nous n'avons pas de signalement avant que nous ne découvrions par d'autres sources des opérations concernant des établissements bancaires suisses - à quelques exceptions près, comme l'affaire dite « de la Bank of New York » qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Nous avons reçu treize signalements de banques suisses, relatifs à des phénomènes relativement périphériques par rapport à l'enquête américaine dont la presse s'est fait l'écho. A mon sens, l'efficacité dépend trop de la bonne volonté ou de la diligence de l'intermédiaire financier. On ne peut pas exclure que des employés ou une partie des cadres, mais pas nécessairement des membres du conseil d'administration ou du corporate, sachent un certain nombre de choses mais ne le signalent pas au système de compliance de la banque. Ce que nous avons pu apprendre par des dénonciations ou des signalements dans toutes les affaires délicates que nous avons eu à traiter, n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y aurait lieu de découvrir. M. le Président : On a le sentiment que, dans un certain nombre de cas, pour des petites sommes, des personnages sont, par leur existence ou par leur origine nationale, assez facilement désignables, mais que des sommes plus importantes, qui ne sont généralement connues a posteriori que par l'ouverture d'informations judiciaires, arrivent à pénétrer dans les banques sous le couvert d'une certaine respectabilité. Comme vous avez l'expérience des affaires en cours, quels vous semblent être aujourd'hui les moyens les plus pratiqués pour le blanchiment et l'introduction dans le système bancaire de sommes venant des capitaux illicites ? M. Bernard BERTOSSA : Il s'agit du recours systématique à des sociétés offshore, sociétés économiquement fictives mais juridiquement reconnues par l'ordre international, sous le couvert desquelles circule l'écrasante majorité de ces capitaux. Il s'agit aussi de la création de caisses noires par de grandes entreprises multinationales, qui ont recours à des entités qui ne sont pas nécessairement juridiquement liées à elles pour constituer des fonds destinés à la corruption. Il s'agit également du recours à des intermédiaires financiers suisses peu scrupuleux, tels que des officines d'avocat. Les professions financières ne sont pas encore réglementées en Suisse. La respectabilité de certains fonds est très souvent assurée par l'intermédiaire de personnes bien établies en Suisse, non seulement des avocats mais aussi des gérants d'affaires, des gérants de fortune, des fiduciaires qui se portent garantes de la qualité de leurs clients auprès des établissements bancaires. Il n'en demeure pas moins que l'on découvre aujourd'hui un certain nombre de situations qui ne devraient pas se produire. Par exemple, l'existence de comptes de sociétés de domicile offshore, dont les ayants droit économiques sont des personnes qui exercent une partie du pouvoir à l'étranger ou sont proches du pouvoir à l'étranger, devrait suffire à inciter les intermédiaires financiers à se méfier. Si une personne proche du pouvoir russe reçoit sur son compte, sans justification particulière, des montants qui permettraient à la population moscovite de vivre pendant une semaine, cela devrait apparaître, a priori, curieux. Pourtant, ça ne l'est pas pour tout le monde. M. le Président : Avez-vous le sentiment que les banques suisses ouvrent de plus en plus de filiales dans ces paradis bancaires, fiscaux et judiciaires que vous évoquez, mais garantissent que ces filiales répondent aux mêmes règles prudentielles et déontologiques que les règles qui sont respectées ici ? Avez-vous pu observer que ces sociétés offshore, qui existent pour tous les grands groupes, y compris français - nous avons rencontré ce matin les dirigeants de Paribas - servent malheureusement maintenant beaucoup plus facilement aux transactions concernant l'argent sale ? M. Bernard BERTOSSA : Il s'est effectivement produit une évolution due au fait que la Suisse n'a plus la réputation de coffre-fort inviolable de l'argent sale, grâce à l'activité de certaines autorités judiciaires ; grâce à celle du législateur, qui nous a dotés d'une panoplie de normes qui répond à un standard convenable ; grâce aussi, reconnaissons-le, à des efforts déontologiques importants de la part de la majorité des établissements bancaires suisses. Même commercialement, ils n'ont pas intérêt à cultiver cette image. La tentation était donc, pour ne pas perdre la clientèle des capitaux qui avaient pour vocation de rester dissimulés, d'ouvrir des succursales ou des filiales dans des Etats où la confidentialité est mieux garantie. Concrètement, nous avons une affaire liée à l'ancien Premier ministre d'Ukraine, M. Lazarenko. Je ne trahirai pas de secret puisque tous les noms que je citerai ont fait l'objet de publication. M. le Président : Nous avons la même pratique que vous. M. Bernard BERTOSSA : Dans ce contexte, une banque genevoise avait reçu des fonds qu'elle a immédiatement fait transférer à sa succursale de Nassau. Il s'agissait tout de même d'environ 50 millions de FS ce qui n'est pas tout à fait innocent. Lorsque nous sommes allés dans cette banque, il nous fut répondu que l'on pouvait nous remettre la documentation mais pas bloquer les fonds. Dans ces cas-là, les normes suisses auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure font obligation à l'établissement bancaire suisse de prendre les mesures nécessaires pour que, dans sa filiale, les fonds ne disparaissent pas dans un délai raisonnable, dans la mesure où l'autorité judiciaire envisage de saisir ces fonds. Le juge genevois a immédiatement envoyé une commission rogatoire à Nassau, avec le succès que vous pouvez imaginer. Neuf mois plus tard, la banque nous a dit qu'elle n'avait toujours pas d'ordre de saisie du juge de Nassau et qu'elle était obligée de libérer les fonds. Et les fonds sont partis. Même si sous l'angle de la transparence, on peut admettre - et encore, avec quelques réserves - que les normes suisses sont appliquées à l'étranger, sous l'angle de l'efficacité de la saisie, ce n'est certainement pas le cas. M. le Président : On a le sentiment que l'excuse fiscale peut servir à protéger les capitaux venus de l'argent sale. Quel est votre point de vue à ce sujet ? M. Bernard BERTOSSA : Il revêt deux aspects. Le premier a trait à l'intermédiaire financier lui-même. Dès lors qu'il est appelé à contribuer à des opérations financières sans justification économique bien claire ou qui, sous l'angle des contrats, du droit de la famille, des activités commerciales usuelles lui paraissent incorrectes, l'intermédiaire peut être conduit à se prêter néanmoins à ces opérations, son client lui expliquant que leur caractère relativement insolite n'est dû qu'à la volonté d'éluder le fisc de son pays. Le second, c'est qu'au moment où nous tenterons de poursuivre ce même intermédiaire financier ici pour fait de blanchiment, nous devrons démontrer, selon la loi suisse non seulement qu'il s'est prêté à la dissimulation de fonds provenant d'un crime mais qu'en plus, il le savait ou devait le savoir. C'est sous cet angle subjectif, puisque le blanchiment est une infraction intentionnelle, que nous nous heurtons très souvent à la même objection exprimée en ces termes : « Je me rendais bien compte que je participais à une opération qui n'était pas économiquement fondée mais je croyais qu'il ne s'agissait que d'évasion fiscale ». Tel est l'aspect essentiel de la collusion entre le fiscal et le pénal, du point de vue du magistrat chargé d'appliquer la loi suisse. Vu sous l'angle du ministre des finances, c'est évidemment un tout autre problème ! Il existe un autre problème dans l'entraide internationale. La Suisse assortit toujours la remise de documents à l'étranger de la réserve dite de la spécialité. C'est-à-dire que nous faisons interdiction aux magistrats étrangers, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour l'administration fiscale locale, d'utiliser la documentation reçue pour des poursuites fiscales, ce qui est très généralement respecté, à quelques exceptions près. Cela nous conduit à des situations d'une injustice flagrante. Il est incroyable de penser qu'alors même que les autorités d'un pays, quel qu'il soit - la France ou un autre - possède la preuve de la fraude fiscale d'un de ses contribuables, il ne puisse pas agir, sous prétexte que la documentation leur a été remise sous la condition de la spécialité. M. le Président : En regardant un certain nombre d'affaires déjà traitées judiciairement qui mettent en liaison la France et la Suisse, en m'informant sur un certain nombre de commissions rogatoires liées à des affaires célèbres - l'une concernait un délit d'initié, d'autres portant sur du blanchiment d'argent - j'ai acquis le sentiment, en dehors de la difficulté liée au temps perdu à chaque fois que l'argent se déplace d'un compte à un autre, qu'il était plus facile d'obtenir des réponses rapides sur des mouvements de comptes auprès de petites officines qu'auprès d'institutions bancaires ayant pignon sur rue et dont la réputation n'est d'ailleurs pas entachée. Partagez-vous cette analyse ? M. Bernard BERTOSSA : Oui et non. La remise de la documentation par les établissements bancaires aux juges d'instruction se déroule généralement assez bien, aussi bien en termes de délai que de qualité. Il y a des exceptions qui ne tiennent pas à la dimension ou à la notoriété de l'établissement bancaire, mais au caractère plus ou moins délicat de l'enquête et à l'implication plus ou moins grande de la banque concernée dans les actes qui font l'objet de la poursuite. Par exemple, une banque qui a elle-même donné des conseils à un client étranger, le cas échéant public, pour faire transiter des fonds sales par son établissement, a évidemment moins envie de répondre rapidement au juge que lorsqu'elle se sent parfaitement innocente dans le contexte de l'opération en cause. Cela n'a donc pas à voir avec la taille, mais avec l'implication de la banque dans les processus délictueux mis au jour. En revanche, il est vrai que lorsque des établissements bancaires importants ou des personnes politiques importantes sont concernés, on se heurte à de plus grandes réticences que lorsqu'il s'agit d'une affaire de criminalité ordinaire. Puisque vous parlez de la Suisse et de la France, cela vaut d'ailleurs dans les deux sens, cela me permet de dire que la diligence de l'administration - la chancellerie, chez vous -, et des magistrats, est aussi en cause. Pour parler de Genève, la fameuse affaire de la Société générale, la première commission rogatoire française est arrivée, il y sept ans... M. le Président : En 1991 ! M. Bernard BERTOSSA : ...et je crois que le juge d'instruction genevois vient de terminer les derniers actes qui lui étaient demandés. Outre les complications procédurales dues à la loi suisse qui conduisent à perdre beaucoup de temps, on a affaire à un magistrat non diligent, et en France à un ou à des magistrats qui ne le sont pas plus dans l'instruction du même dossier. M. le Président : Cela fait beaucoup ! M. Bernard BERTOSSA : Prenons l'exemple du Crédit lyonnais. A l'inverse, le juge d'instruction genevois est allé perquisitionner à Paris en juin 1993. Nous n'avons reçu qu'en octobre 1996, soit plus de trois ans après, les documents un peu chauds que nous attendions, ce qui est exceptionnel pour la France. Mais l'affaire du Crédit lyonnais n'est pas exceptionnelle. M. le Président : Il a fallu le temps d'allumer un incendie ! M. le Rapporteur : Puisque nous évoquons la coopération judiciaire, êtes-vous satisfait, en tant qu'autorité de poursuite suisse du canton de Genève, de votre coopération avec l'autorité judiciaire française ? Si vous ne l'êtes qu'à moitié, quelles sont les améliorations possibles ? Comment pourrions-nous vous aider à obtenir un perfectionnement du système ? M. Bernard BERTOSSA : Ainsi posée, la question appelle une réponse plutôt positive. Nous sommes généralement satisfaits de l'assistance accordée par les autorités françaises, avec cette précision d'importance par rapport au sujet traité, que nous sommes rarement demandeurs d'informations chaudes. Dans la coopération de tous les jours avec la France, nous avons assez systématiquement de gros retards, de l'ordre de plusieurs mois qui sont dus, je pense - car je n'ai pas de raison de chercher une autre explication - à l'encombrement des services à Paris. La moindre affaire prend plusieurs mois. Et nous avons ponctuellement des couacs dans des affaires qui ne méritent pas d'être mentionnées parce qu'elles ne correspondent pas à la définition de votre mission. Dans une affaire, nous en sommes au septième rappel depuis 1994, sans jamais la moindre réponse de la France. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une affaire chaude. Avec ces quelques bémols, compte tenu du système actuel, cela ne va pas trop mal. Le président du collège des juges d'instruction de Paris, à qui nous avions demandé d'accomplir un acte nous répondait, il y a quelques semaines encore, que cela ne lui paraissait pas urgent et qu'en conséquence, il nous renvoyait à Mme la garde des sceaux. Il nous écrivait cela en mars pour une demande simple que nous avions faite en janvier. Cela a finalement été exécuté en juin. C'est la cuisine quotidienne qui a parfois quelques dérapages. Sur le plan général, cette satisfaction relative s'inscrit dans un contexte qui, lui, n'est pas satisfaisant du tout mais qui ne concerne pas la France, mais l'entraide internationale qui doit passer par des arcanes totalement désuets et pratiquement garantes de leur inefficacité. M. le Rapporteur : Nous avons eu hier une discussion avec quelques parlementaires du Conseil des Etats et du Conseil national, sur les voies de recours internes en Suisse. Nous avons aussi donné à voir concrètement les conséquences de l'abus de ces voies de recours dans les affaires les plus importantes. L'ex-procureur du Tessin, M. Marti, devenu conseiller des Etats, nous a indiqué qu'un élément de progrès avait été accompli par la Suisse, puisque la compétence en matière de délinquance financière, de lutte contre le blanchiment et d'infractions attachées à ces questions était devenue fédérale, ce qui va supprimer la voie de recours passant par la justice cantonale. Un parlementaire socialiste nous a indiqué qu'il considérait que la Suisse n'avait aucun argument pour s'opposer à la suppression des voies de recours internes contre des saisies et perquisitions bancaires, dans la mesure où l'entraide était réclamée par des pays ayant adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, les réponses que nous avons obtenues de la part d'autres responsables politiques ne nous ont pas donné satisfaction, dans la mesure où certains considèrent que cela doit continuer d'appartenir à la culture suisse du recours. Le débat sur la suppression des voies de recours vous paraît-il pouvoir devenir une priorité dans la Confédération helvétique ? M. Bernard BERTOSSA : Je crains que non. Nos ministres de la justice successifs n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt pour ces thèmes. Lorsque la loi suisse a été remise en question il y a trois ans, le problème a été soulevé. La réaction a été ambiguë. Le Parlement a adopté une norme qui supprimait l'un des recours possibles mais qui allongeait le délai de recours, le faisant passer de dix à trente jours. Il ne peut donc rien se passer pendant trente jours, même s'il n'y a pas de recours. Tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée, la documentation ne peut pas être envoyée. Imaginez ce que représente un mois dans la mise à disposition du magistrat étranger d'une documentation qui lui est indispensable ! L'existence même de ce recours, même s'il n'est pas utilisé, est perverse. Il est exact que la Confédération sera dorénavant compétente pour poursuivre le blanchiment et l'appartenance à une organisation criminelle. C'est une compétence pour poursuivre en Suisse, mais pas nécessairement pour exécuter un acte d'entraide. Si un juge français a besoin d'une documentation dans une banque genevoise - que la Confédération soit ou non compétente pour poursuivre en Suisse la délinquance liée à l'organisation criminelle - l'Office fédéral de la police pourra continuer à envoyer à Genève la demande d'entraide pour exécution ici. Il y a donc un double recours et cette réponse n'est pas satisfaisante. Nous avons quotidiennement l'expérience de ces problèmes lancinants, qui ont des effets non seulement sur l'efficacité de la poursuite conduite à l'étranger - ce qui est déjà important compte tenu de la prescription et du risque d'évasion des personnes mises en cause et des fonds - mais aussi sur le travail qui nous est demandé. On oublie parfois que nous avons aussi nos propres infractions à poursuivre. Le formalisme auquel est soumise l'entraide, la nécessité de rédiger des décisions parfaitement motivées, de répondre à des recours, de plaider devant les autorités de recours, tout cela impose au personnel judiciaire suisse un effort très important. Sans compter d'autres effets pervers, comme celui qui consiste à faire pratiquement interdiction aux juges étrangers de venir entendre des témoins ici. Si, dans une affaire délicate, Mme Joly souhaite venir entendre ici des témoins sur commission rogatoire, ce qui paraît être logique puisque c'est elle qui connaît le dossier, et si le juge suisse est d'accord, il doit prendre une décision et la notifier. Or cette décision peut faire l'objet d'un recours, qui est toujours utilisé dans les cas délicats. A tel point que nous en sommes à conseiller aux juges étrangers de ne pas venir, car ils risquent de perdre six mois. Ces problèmes restent d'actualité. Je ne suis pas optimiste quant à la faculté du Parlement helvétique de modifier, de lui seul, cette situation. Des pressions extérieures sur la Suisse seront nécessaires. Comme on n'a pas hésité à en exercer pour qu'elle laisse passer des camions, on devrait en faire pour qu'elle laisse passer les informations judiciaires. M. le Rapporteur : Nous ne connaissons pas la jurisprudence du tribunal fédéral en la matière. Quel est le taux de validation d'assistances judiciaires lorsqu'il y a un recours sur les deux bases que vous venez d'indiquer ? M. Bernard BERTOSSA : Le taux de succès des recours en matière d'entraide doit être de l'ordre de 2 à 3 % au grand maximum. Il y a un effet pervers pour l'Etat de droit à vouloir trop formaliser les prétendus droits. Il faut se mettre dans la situation du policier ou du juge qui est assis sur un tas de documents qui sont absolument indispensables à son voisin immédiat, un homme ou une femme dans un autre Etat de droit qui, comme lui, est respectueux du droit, soumis à des autorités de recours élues ou désignées. Par découragement, par dépit, on risque de voir la loi finalement violée par des indiscrétions, des transmissions plus ou moins clandestines, des combines. Pour ne pas violer la loi, on peut utiliser des procédés légaux qui relèvent de la combine. C'est un effet pervers qui ne devrait pas être sous-estimé. M. le Rapporteur : Je vous poserai une question peut-être un peu plus difficile car elle requiert une analyse en fonction de critères non encore stabilisés. Nous réfléchissons, au fur et à mesure de nos investigations, à la définition d'un territoire non coopératif. Notre ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Strauss-Kahn, a employé une expression plus violente, il a parlé de « territoires délinquants ». Il n'a classé aucun territoire européen dans cette catégorie. Notre problématique, nous qui enquêtons sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière sur le territoire européen, consiste à analyser en quoi un territoire peut ne pas être coopératif. Il peut ne pas l'être sur le plan administratif : les bureaux de communication ne communiquent pas entre eux. Il peut ne pas l'être sur le plan judiciaire. Considérez-vous que certains des cantons en Suisse alémanique ou en Suisse du Tessin n'ont pas les mêmes caractéristiques que celles que les Genevois ou, d'une façon générale, les Suisses romans, ont développées dans leurs cantons, à la fois sur le plan administratif et sur le plan judiciaire ? M. Bernard BERTOSSA : Je pense que l'on peut raccorder ma réponse à celle que je vous faisais tout à l'heure sur la responsabilité que les magistrats doivent eux-mêmes reconnaître dans une certaine part. Il est vrai que tous les cantons n'ont pas la même volonté que celle que nous essayons d'avoir à Genève, mais je vous ai cité un exemple contraire tout à l'heure. Le parquet n'a pas d'autorité sur les juges d'instruction en matière d'entraide. Il est vrai que dans certains cantons, souvent en Suisse alémanique, les autorités ne se sont pas dotées des moyens nécessaires pour exécuter les demandes d'entraide dans des délais raisonnables. La magistrature de ces cantons n'est pas aussi motivée, que nous essayons de l'être, pour apporter sa coopération. L'esprit de clocher reste assez répandu dans la magistrature ; pas seulement en Suisse, d'ailleurs. Depuis que la justice existe, ou presque, nous sommes un pouvoir qui est resté à l'intérieur des frontières nationales. Le pacte suisse fondateur de la Confédération prévoit que nous ne devons pas être jugés par des juges étrangers. Ce n'est pas très grave dans des cantons qui n'ont que peu à faire avec des demandes d'entraide importantes ; ça l'est un peu plus dans des places financières importantes comme Zurich, qui reste la place financière la plus importante de Suisse. M. Jacky DARNE : Les statistiques montrent que le pourcentage de déclarations de soupçon transmises à l'autorité pénale est important mais qu'ensuite, le nombre de non-lieux est très élevé. Bien que ces chiffres portent sur une courte période et sur le début de mise en _uvre de cette procédure, ils sont néanmoins révélateurs de difficultés d'investigation et de recueil des éléments constitutifs du crime. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté ? Qu'est-ce qui rend difficile la recherche de la preuve ? De quels moyens disposez-vous non seulement en termes de police nationale et internationale, mais aussi d'expertise ? Quelle est votre capacité d'expertise d'une déclaration de soupçon ? Il ne suffit pas de déceler des soupçons ; s'il n'y a pas de suite ou si les peines sont dérisoires, l'effet dissuasif est réduit. M. Bernard BERTOSSA : S'agissant de la sanction en matière de criminalité économique, il ne faudrait pas oublier la saisie puis la confiscation des produits d'infraction. Elles sont souvent sous-estimées, notamment dans le sud de l'Europe, y compris dans une partie de la France ; contrairement aux Etats-Unis, qui mettent l'accent sur ce point. Cela fait partie de la sanction. A Genève, les confiscations sont assez importantes. La Suisse est souvent le lieu où l'argent se trouve ou par lequel il est passé. Nous ne sommes donc généralement pas compétents pour poursuivre le crime d'origine. La difficulté majeure pour pouvoir condamner en Suisse des gens pour blanchiment est d'apporter la preuve, d'une part, du crime commis à l'étranger et, d'autre part, du lien entre ce crime et des fonds trouvés et manipulés en Suisse. Apporter la preuve du crime commis à l'étranger est souvent un obstacle insurmontable faute de coopération de l'autorité étrangère concernée. Nous sommes partis gaiement avec nos affaires russes en sachant très bien qu'il y a peu d'espoir que nous puissions obtenir une coopération de la part des Russes, qui seuls détiennent ces preuves de la réalisation du crime de corruption par telle ou telle personne. Paradoxalement, nous rencontrons la même difficulté avec les Américains, non en raison de la corruption des autorités mais à cause du système pénal américain, qui conduit à ce que 95 % des affaires aboutissent à un plea agreement, c'est-à-dire à une sorte de décision consensuelle entre l'accusation et la défense, laquelle a notamment pour conséquence que la documentation ou les preuves n'ont plus à être administrées et n'existent plus. Concernant la preuve du paper trail, si les fonds passent par des Etats ou des places financières dont les autorités n'accordent pas l'assistance, une coupure nous empêche de faire la preuve du lien entre le crime et les fonds retrouvés ici. Quant aux moyens mis à la disposition de l'ensemble de la justice civile, pénale et administrative, ils représentent 1 % du budget de fonctionnement de l'Etat. Quinze juges d'instruction doivent traiter 2 500 dossiers. Neuf personnes au parquet doivent traiter 15 000 à 20 000 dossiers par an, y compris ceux auxquels j'ai fait allusion. Sachez que le magistrat qui s'occupe de l'affaire Elf, que vous entendrez tout à l'heure, a trente-six autres dossiers dans son cabinet et que les magistrats en charge des affaires russes ont aussi plusieurs dizaines d'autres dossiers dans leur cabinet. Ce sont des magistrats spécialisés pour les affaires complexes. Nous souffrons donc d'un manque de temps. La Suisse est traditionnellement sous-dotée en matière de police financière. Nous avons une brigade financière qui est composée de policiers dont la qualité principale est la bonne volonté. Ils n'ont pas de formation à l'égal des brigades financières françaises. Il n'y pas de spécialistes dans la police, sauf un, enfin, depuis trois ans. La collaboration policière internationale dans ce domaine est mauvaise. Interpol ne fonctionne pas. C'est une boîte aux lettres lente. Ce n'est pas DHL ! Si j'ai besoin d'une assistance policière à Madrid, je téléphone à l'inspecteur ici, parce que je sais qu'il connaît un collègue qui travaille là-bas. Mais si je passe par Interpol, je dois attendre six mois... et encore ! L'entraide policière ne fonctionne que parce que les flics se connaissent. Nous avons la chance à Genève d'avoir des policiers que nous faisons voyager. Les juges les emmènent souvent avec eux, de sorte qu'ils connaissent d'autres gens et peuvent établir des relations. Nous avons enfin trois analystes financiers à l'instruction, qui sont d'une aide considérable dans ces dossiers. M. Jacky DARNE : Quelles sont leurs caractéristiques ? M. Bernard BERTOSSA : Ces analystes financiers sont des employés du pouvoir judiciaire. Ils n'ont pas un statut de policier. Ce ne sont pas non plus des experts privés. Ils sont salariés du pouvoir judiciaire et affectés aux besoins du juge d'instruction. M. le Président : On peut acheter des produits de luxe avec de l'argent liquide, sans limitation de montant. Cela vous paraît-il poser problème ? M. Bernard BERTOSSA : Vous me prenez un peu au dépourvu. Je n'ai jamais considéré que le recyclage d'argent dans des voitures de luxe soit un vrai gros problème. Il est évident que les Russes qui viennent ici font vivre un certain nombre de boutiques de luxe. 85 % des effectifs de certaines écoles privées sont constitués d'enfants russes. Ces institutions devraient sans doute disparaître si on ne pouvait pas utiliser des dollars américains, mais je ne pense pas que cela soit économiquement significatif. Plus dangereuses sont les acquisitions immobilières et l'entrée de fonds d'origine criminelle sur les marchés boursiers. M. le Président : L'autorité de contrôle, M. Huber, nous a fait part hier de ses préoccupations quant à un mécanisme que la LBA n'avait pas pris en compte consistant, lors d'augmentations de capital, à faire souscrire des actions auprès des banques par l'intermédiaire de notaires. La profession de notaire semble poser problème lorsqu'elle se livre à ce genre d'exercice. Confirmez-vous cette analyse ? M. Bernard BERTOSSA : Je pense qu'elle est juste. Nous avons un exemple concret de ce type de recyclage. Plus fréquent est le recours à des sociétés offshore établies en Suisse et qui sont libres d'exercer toutes les activités financières qu'elles souhaitent, sauf les fonds de placement et les activités de type bancaire pures qui sont soumises à la loi fédérale sur les banques. Par l'intermédiaire de ces officines, on peut investir son argent quelle que soit son origine dans n'importe quelle activité commerciale. M. Jacky DARNE : Elles ne sont donc soumises à aucune autorité de contrôle ? L'implantation de ce type d'entreprises est libre ? M. Bernard BERTOSSA : Tout à fait. Tout dépend du genre de société. Si vous constituez une société anonyme, vous devez indiquer l'actionnariat d'origine. Si vous avez des actionnaires fiduciaires, leurs noms apparaîtront mais pas ceux des véritables détenteurs économiques des actions. De plus, si la société est suffisamment importante, ses actions peuvent être cotées en Bourse. Or le marché boursier permet l'anonymat presque total des transactions. M. le Président : Comme nous ne sommes pas des spécialistes du droit des affaires, pourriez-vous nous décrire les montages juridiques qui peuvent être opérés ? Si j'ai bien compris, il s'agit de sociétés offshore ? M. Bernard BERTOSSA : Il y a des sociétés offshore qui, comme leur nom l'indique, sont actives en dehors du rivage. Ce sont des sociétés panaméennes, des îles Caïmans, des îles Vierges britanniques, etc., qui ont une existence purement formelle dans un registre tout aussi formel du paradis fiscal considéré. Leur administration est composée de professionnels sur place qui délèguent le pouvoir de représenter la société ici à un tiers: avocat, fiduciaire ou autre. M. le Président : Ressortissant suisse ? M. Bernard BERTOSSA : Pas nécessairement, ce peut être un ressortissant français, allemand ou anglais. L'exercice n'est pas contrôlé à ce jour. Il pourra donc, au nom de la société, accomplir tous les actes de la vie commerciale et industrielle habituelle. Aussi longtemps qu'il n'aura pas besoin d'une autorisation spécifique pour développer telle ou telle activité, il pourra la développer librement. Il pourra donc notamment ouvrir des comptes en banque, faire passer des ordres en Bourse, obtenir toutes les prestations qu'une banque peut fournir à ses clients. Il pourra investir dans des sociétés suisses, par l'intermédiaire de fiduciaires ou par le rachat d'actions à des actionnaires existants, ces opérations n'étant pas soumises à contrôle, etc. M. le Président : Les avocats que nous avons rencontrés disent que cela n'est pas possible. Ils disent que se trouvant dans le champ de la LBA, ils ont le devoir de connaître non seulement leurs cocontractants mais aussi les ayants droit économiques. Et s'ils ne connaissent pas les ayants droit économiques, disent-ils, dans le cas où il y aurait infractions et poursuites, ils sont responsables. Ils disent qu'ils n'agissent plus ainsi car ils peuvent être pénalement attaqués. Cela voudrait dire qu'il y a la loi et d'autres pratiques. M. Bernard BERTOSSA : Si la loi était respectée, vous ne seriez sans doute pas ici et moi non plus. Le problème, c'est que dans un processus de blanchiment, à un certain moment, il doit bien y avoir une complicité de la part d'un intermédiaire financier en place. C'est d'ailleurs le point vulnérable des organisations criminelles. C'est le moment où elles doivent entrer leurs profits criminels dans le réseau d'apparence honnête. Ce passage-là peut être plus ou moins subtil, plus ou moins camouflé, mais il y aura toujours un moment où quelqu'un aurait dû se poser des questions et ne se les est pas posées. L'existence de la loi est une chose, sa mise en _uvre en est une autre. M. Jacky DARNE : L'application de la législation repose en grande partie sur les organismes d'autorégulation. Que pensez-vous de l'efficacité de cette mise en _uvre qui est encore partielle, puisque des homologations restent à venir ? Considérez-vous qu'il s'agit d'une organisation pertinente ? M. Bernard BERTOSSA : Je suis convaincu que l'on n'arrivera pas à bout de ces phénomènes sans une collaboration des intermédiaires financiers eux-mêmes. Faute de quoi, nos Etats de droit dériveront vers des Etats policiers, et je ne pense pas que c'est ce que nous souhaitons. Le jour où il y aura trop de gens pour contrôler, il faudra contrôler les contrôleurs. D'une manière ou d'une autre, il faudra bien, si l'on veut espérer tordre le cou à cette hydre dangereuse, que les intermédiaires financiers honnêtes y mettent du leur. Cette conviction étant exprimée, le système que vous venez d'évoquer me paraît en soi relativement bon. Le problème, c'est son efficacité par rapport à ceux qui ne sont pas prêts à s'y soumettre. On a vu des établissements bancaires genevois dotés de tous ces instruments d'autorégulation, de compliance, se prêter, après l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment, à des opérations dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles ne respectaient pas les engagements de diligence qu'ils avaient pris. M. Jacky DARNE : Des sanctions ont-elles été prises ? M. Bernard BERTOSSA : Il est un peu trop tôt pour parler de sanctions. C'est pourquoi la statistique que vous évoquiez tout à l'heure n'est pas très significative. Ces procédures prennent du temps et la loi n'a qu'un an et demi d'existence. M. le Rapporteur : Concernant les sociétés offshore, vous avez employé une formulation qui synthétise bien le problème. Vous avez dit : ce sont des fictions économiques mais la communauté internationale reconnaît juridiquement leurs opérations. Croyez-vous possible qu'à un moment, ladite communauté internationale ou un certain nombre de pays pionniers décident de ne plus reconnaître les transactions interdites sur leurs territoires en provenance de sociétés offshore ? Cela vous paraît-il réaliste pour traiter le problème courageusement ? Le courage, personne autour de cette table n'en manque, il nous reste à être efficaces. M. Bernard BERTOSSA : Le phénomène que nous évoquons ensemble aujourd'hui est un phénomène mondial, à l'image des problèmes de protection de l'environnement. Les initiatives individuelles peuvent avoir des effets d'annonce, des conséquences psychologiques - c'est pourquoi je ne dis pas clairement « non » à l'idée que vous évoquez -, mais son efficacité concrète sera sans doute limitée. Si la France prenait cette initiative, ses voisins en recueilleraient les fruits. Il conviendrait de prendre une initiative collective à un niveau économiquement lourd. La Suisse, par exemple, ne pourrait pas s'engager seule dans une opération de ce genre, d'autant que les objections politiques seraient considérables. On ne manquerait pas d'observer que le seul résultat serait le renforcement de la puissance de nos concurrents. M. le Président : Je vous poserai une dernière question, relative à l'excuse fiscale. On nous a fait valoir l'argument, qui semble très juste, selon lequel ce qui marche à l'international se justifie parce que c'est aussi la pratique nationale. N'est-il pas possible de procéder à un découplage et de faire en sorte que la possibilité d'invoquer l'excuse fiscale ne vaille pas pour les ressortissants nationaux suisses ? M. Bernard BERTOSSA : Ce serait tout à fait possible juridiquement. Je ne vois pas quelle serait l'obligation pour la Suisse d'appliquer à ses propres ressortissants des engagements qu'elle aurait pris internationalement à l'égard des ressortissants d'autres Etats. M. le Président : Autrement dit, cet argument ne vous semble pas valide ? M. Bernard BERTOSSA : Il n'est pas suffisant pour justifier la position suisse actuelle. Cela dit, pour l'évasion fiscale, comme pour la corruption : il faut être deux. Il y a peu de corrompus sans corrupteurs. Il y a peu de gens qui reçoivent de l'argent évadé sans qu'il y ait une volonté active d'éluder son propre fisc. M. le Président : Merci beaucoup. Audition de M. Paul PERRAUDIN, (compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 1999 en Suisse) Présidence de M. Vincent PEILLON, président M. le Président : La démarche des juges, souvent courageuse, parfois un peu isolée, nous importe beaucoup. Cette mission d'information commune à la commission des affaires étrangères et à la commission des lois de l'Assemblée nationale a pour origine « l'appel de Genève », relatif au travail des procureurs et aux difficultés que rencontrent les juges à traquer l'argent sale. Nous avons donc souhaité achever notre déplacement en Suisse en rencontrant les praticiens du monde judiciaire. En rencontrant les responsables du Bureau de communication et votre collègue du canton du Tessin, nous avons été surpris de découvrir que la plupart des signalements faits à partir des déclarations de soupçon n'apprenaient strictement rien aux autorités judiciaires parce qu'il s'agissait de cas déjà déclarés. Cela est de nature à mettre en doute l'efficacité du mécanisme de la LBA et de la déclaration de soupçon. D'autant que les banquiers que nous avons rencontrés nous ont déclaré, avec une honnêteté qui les honore, que lorsqu'un client leur posait difficulté, ils préféraient fermer son compte et ne pas déclarer afin d'éviter toute mauvaise publicité. Quel jugement portez-vous sur ce mécanisme mis en place par la loi ? Quelle confiance accordez-vous à l'efficacité de ces déclarations de soupçon ? M. Paul PERRAUDIN : La question est difficile car ce système fonctionne depuis relativement peu de temps. Les statistiques qui ont dû vous être présentées montrent que les enquêtes internes bancaires à l'origine d'une déclaration de soupçon proviennent davantage de la presse que de sources internes relevant de l'analyse liée à l'exercice des obligations de diligence. C'est ainsi que les banques apprennent l'existence d'opérations suspectes et, partant, annoncent les cas au Bureau de communication. Il faudrait passer à la phase suivante où les intermédiaires financiers exerçant leurs obligations de diligence, notamment celles de clarifier les relations douteuses et de vérifier la plausibilité des explications fournies sur la base d'un cas insolite, annonceraient l'existence de relations d'affaires suspectes. Ces annonces, à source interne, ne sont guère le fait des intermédiaires financiers, sauf peut-être celui des grandes banques qui, par leur organisation, se trouvent en mesure d'identifier les comptes ou les opérations douteux. En revanche, l'expérience et l'organisation des autres intermédiaires financiers ne correspondent pas encore à ce que l'on est en droit d'attendre. Le seuil d'obligation d'annonce est relativement élevé. L'obligation ne naît que dans la relation d'affaires, donc la relation de compte. On a fait confiance aux intermédiaires financiers pour décider à partir de quand doit naître un soupçon fondé d'opération douteuse. Le parlement a opté pour ce seuil qualitatif parce que l'on s'est engagé sur le chemin de l'autorégulation. En Suisse, on croit de très longue date aux vertus de l'autorégulation dans le domaine financier. Celle-ci n'a de sens que si, parallèlement, elle s'inscrit dans le cadre de dispositions de droit public contraignantes émanant notamment de la Commission fédérale des banques, autorité de surveillance. Nous avons constaté que les cas annoncés étaient de nature à nous permettre d'étendre les investigations à des indices qui n'avaient pas été perçus au départ. En outre, plusieurs affaires annoncées étaient déjà connues de certaines autorités judiciaires cantonales. Un certain nombre d'informations nous sont tout de même parvenues par le truchement du Bureau de communication qui, apprenant l'existence d'une enquête d'importance, nous a annoncé des comptes ou des relations d'affaires douteux, connexes, dont nous n'avions pas connaissance. L'efficacité du système est encore difficile à appréhender mais il convient de l'intégrer dans la conception suisse de l'autorégulation avec un seuil d'annonce qualitatif. Nous partons du principe que les intermédiaires financiers doivent identifier eux-mêmes les opérations douteuses car ils sont professionnellement mieux à même de les percevoir. Ce système, je le répète, ne peut pas exister sans qu'existent parallèlement des règles contraignantes préventives et répressives émanant notamment des autorités de contrôle bancaires et financières. M. le Président : On entend dire et on lit que la place de Genève recèlerait en quantité importante des capitaux issus de la mafia russe. Certains se hasardent à les chiffrer, d'autres sont plus réticents. Quand on interroge les banquiers, ils répondent que cet argent n'est pas chez eux. En suivant le travail des juges, on s'aperçoit que cet argent se trouve dans les banques suisses, pas seulement dans les petites banques véreuses, mal connues, mal famées, mais dans des institutions parfaitement dotées d'un système d'inspection et disposant d'un code de déontologie, lesquels ont même inspiré la LBA. Comment cet argent entre-t-il dans les banques et avez-vous une idée de la masse qu'il peut représenter ? M. Paul PERRAUDIN : L'argent n'entre pas ou peu directement en Suisse par le système bancaire traditionnel. Quand il y entre, c'est souvent par des intermédiaires financiers autres que bancaires. C'est d'ailleurs en raison de ce constat que les obligations de diligence ont été étendues à tout le secteur non bancaire. On s'est rendu compte qu'il y avait là une faille. Le GAFI a exercé une forte pression sur la Suisse pour que les obligations de diligence s'étendent aux intermédiaires non bancaires. On peut penser, sans en avoir la certitude, que l'argent entre dans des places financières où les obligations de diligence sont nettement moins fortes, en particulier où les obligations d'identification des ayants droit n'existent pas ou quasiment pas. On peut penser que des pays de l'Est, comme la Pologne et autres, où ces obligations de diligence n'existent pas et où les normes sont beaucoup plus permissives, permettent l'entrée du capital sale dans les circuits financiers. Ce n'est que dans une deuxième phase, après introduction de l'argent sale dans un circuit financier où la législation est moins stricte, que l'on voit arriver l'argent en Europe occidentale. Lorsque l'on examine la provenance des fonds arrivés en Suisse, on est amené très souvent à constater que le parcours de ces fonds passe par des places financières où les obligations de diligence n'existent quasiment pas. Les intermédiaires financiers suisses, même bancaires, se disent tributaires du pays d'où provient l'argent. Certains pays, connus du GAFI, où la réglementation existe très peu, devraient faire l'objet d'une obligation de diligence renforcée. Dans d'autres pays « médians », la réglementation existe mais laisse subsister des failles considérables. Or les intermédiaires financiers qui acceptent l'argent dans une phase de lavage ont souvent recours à l'alibi consistant à dire que ce n'était pas à eux de revérifier ce qui aurait dû l'être dans un pays qui ne figurerait au demeurant pas sur la liste noire du GAFI. S'il vient d'un pays connu par le GAFI pour son absence de législation bancaire, l'intermédiaire doit faire preuve d'une vigilance accrue. M. le Président : Des responsables de Paribas nous ont dit que par le système swift de transmission quasi instantanée, ils pouvaient recevoir un ordre de virement émis d'un paradis fiscal mais passant par un intermédiaire, très souvent aux Etats-Unis, sans avoir nécessairement l'identification de celui qui était à l'origine de la chaîne. M. Paul PERRAUDIN : Ils partent vraisemblablement du principe que l'intermédiaire américain a rempli ses obligations de diligence. Ils s'exonèrent à tort de leurs propres responsabilités en disant que les obligations de diligence ont déjà été remplies par un pays agréé ou acceptable aux yeux du GAFI. On dit : si la banque précédente n'a pas vu, comment voulez-vous que nous puissions voir ? C'est souvent un alibi pour ne pas avoir à refaire un travail de diligence sérieux. M. le Président : De même, s'il est fait appel à un notaire considéré comme ayant dû lui-même respecter un certain nombre d'obligations, la banque considère qu'il a fait son travail. M. Paul PERRAUDIN : Le notaire ou l'avocat. Pour ce type d'intermédiaires financiers, la réglementation suisse pose un problème particulier. Si le secret de l'avocat est une institution utile, il ne peut cependant pas être invoqué par des avocats dont l'activité est celle d'intermédiaire financier, puisqu'ils ont les mêmes obligations de diligence que les autres intermédiaires. M. le Président : Ils appliquent un mécanisme d'autorégulation, mais nous avons eu deux échos contradictoires. Aujourd'hui, un avocat qui conseille des banquiers nous a dit que la situation était clarifiée. Hier, des représentants de l'autorité de contrôle nous ont dit qu'avec les avocats, on était encore loin du compte. M. Paul PERRAUDIN : De ce point de vue, ils ont raison de dire que rien n'est encore fait parce que l'organisme d'autorégulation n'est pas encore opérationnel. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral établit déjà la distinction entre l'activité usuelle de l'avocat et son activité d'intermédiaire financier. Pour l'instant, on a résolu le problème ainsi, même s'il n'est pas définitivement réglé. Les avocats peuvent ouvrir dans les banques des comptes d'étude par lesquels ne peuvent transiter que des avoirs directement liés à leur activité traditionnelle : successions, cautions, régime matrimonial, etc. Ces comptes doivent être annoncés comme tels auprès des intermédiaires dépositaires. Dans ce cas, les banques dépositaires des fonds n'ont pas une obligation d'identification des ayants droit puisque ces opérations sont couvertes par le secret de l'avocat. Un avocat qui exerce une activité financière à titre professionnel et qui ouvre des comptes en son nom a l'obligation de révéler l'identité exacte de son client. Un avocat qui ouvre un compte en son nom doit indiquer qui est l'ayant droit économique des sommes déposées. Dans ce cadre-là, il a les mêmes obligations de diligence - notamment identification de l'ayant droit - que tout intermédiaire financier. Cette distinction est fondamentale pour trouver une voie médiane entre la protection du secret de l'avocat qui est justifiée dans son activité traditionnelle et les règles qui doivent lui être appliquées dans son activité d'intermédiaire financier. On a constaté que certains comptes d'étude avaient été abusivement utilisés. Ces dernières années, nous sommes, à plusieurs reprises, intervenus afin que ces règles soient respectées. Le sont-elles aujourd'hui ? Probablement mieux que jadis. Reste à savoir si c'est encore suffisant ! M. le Président : Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les notaires ? M. Paul PERRAUDIN : Les notaires sont aussi considérés comme des intermédiaires financiers lorsqu'ils acceptent des fonds à titre professionnel. Ils sont donc soumis aux même obligations de diligence. Je ne suis pas très familier de leurs activités. Lorsqu'en Italie, les choses se faisaient difficiles en raison de la chute de la lire, on a vu passer en Suisse d'importantes quantités de fonds en liquide qui ont permis, par exemple, à des Italiens de venir acheter en Suisse des immeubles sans avoir besoin de crédit bancaire. Un notaire qui accepte des fonds dans le cadre de transactions de cette nature a des obligations de diligence. S'il a un soupçon sur l'origine criminelle des fonds, il doit l'annoncer. En tout cas, il doit procéder à ses obligations de diligence, clarifier la relation avec son client et, le cas échéant, si les soupçons persistent, il est fondé à l'annoncer. M. le Président : Connaît-on des exemples de sanctions à l'égard des notaires ou des avocats ? En France, les notaires ont réagi à la suite de la condamnation pénale sévère de l'un de leurs confrères. Je vous pose la question parce que l'autorité de contrôle semble considérer que la mobilisation des avocats ou des notaires, est encore très insuffisante. M. Paul PERRAUDIN : L'article 305 ter du code pénal oblige les intermédiaires financiers à identifier les ayants droit. La simple violation de cette obligation permet une condamnation pénale. Quand l'avocat ou le notaire est entré dans le processus de blanchiment, intentionnellement ou non, ce n'est plus cette disposition qui s'applique mais celle relative au blanchiment d'argent, art. 305 bis du code pénal, alors que dans la phase antérieure, s'il viole ses obligations d'identification, il commet une infraction objective, spécifique, qui n'a rien à voir avec le blanchiment lui-même. Pour répondre directement à votre question, on vous a sans doute présenté la formule A de la convention de diligence des banques par laquelle le titulaire, physique ou moral, d'un compte désigne à la banque le nom de l'ayant droit économique. Une jurisprudence suisse relativement récente considère que ce document est un titre et que s'il comprend des indications fausses, on est en présence d'un faux dans les titres. L'avocat ou tout autre intermédiaire financier qui déclarerait que l'ayant droit économique est M. X alors qu'il s'agit de M. Z peut être poursuivi pour faux dans les titres. Outre quelques condamnations pour violation de l'article 305 ter du code pénal relatif au défaut de vigilance en matière d'opérations financières, des condamnations pour faux dans les titres ont également été prononcées par des juges en raison de la fausse identification de l'ayant droit économique d'une relation de compte. M. le Président : Il serait intéressant de savoir à quoi ont été condamnés ceux qui ont commis des faux dans les titres. M. Paul PERRAUDIN : Les cas ne sont pas très nombreux. Les statistiques dans le domaine du blanchiment comprennent les condamnations pour blanchiment et celles dont les qualifications juridiques retenues sont connexes ou dérivées, telles que le faux dans les titres pour une fausse désignation d'ayant droit. Dans ce domaine, en Suisse comme dans les autres pays, la statistique est donc assez difficile à tenir alors même qu'elle est un instrument indispensable au contrôle de l'efficacité opérationnelle de la lutte contre le blanchiment. En Suisse, place financière, on rencontre sans doute un problème particulier en raison du fait que les infractions primaires génératrices des fonds criminels sont généralement commises à l'étranger. Toutefois, une jurisprudence fédérale permet de poursuivre également pour acte de blanchiment l'auteur des infractions primaires. L'auteur d'actes de corruption peut également blanchir le produit de sa propre activité criminelle, de telle sorte qu'il peut être poursuivi en concours avec le blanchiment d'argent. C'est sur cette jurisprudence que l'on s'est fondé pour condamner également pour blanchiment d'argent les auteurs de l'infraction primaire commise à l'étranger. Il est resté du ressort de la justice étrangère de poursuivre les auteurs des infractions primaires. Cela fut le cas, par exemple, dans les affaires de corruption espagnoles. Plusieurs jugements rendus pour blanchiment ont touché aussi les auteurs de la corruption. M. le Président : On dit qu'au moins 50 % de l'argent « sale » vient de la drogue. Votre collègue le procureur du Tessin nous a cité hier cette proportion. Dans les cas dont vous avez à connaître à Genève, estimez-vous que le délit à la base de l'argent « sale » est principalement le trafic de drogue ? M. Paul PERRAUDIN : Je suis incapable d'indiquer des proportions. J'ai tout de même le sentiment que la corruption, ce qui est lié à la corruption ou plus généralement au crime organisé jusqu'au détournement de fonds publics, est aujourd'hui devenu une source prépondérante d'argent sale. M. le Président : Quand on entend le mot de corruption, on a tendance à penser à de lointains pays africains ou asiatiques. Pour votre part, entendez-vous corruption d'Etat, corruption de grandes sociétés, corruption politique ? M. Paul PERRAUDIN : J'entends plutôt corruption publique. M. le Président : Qui concerne aussi de grandes démocraties. M. Paul PERRAUDIN : A l'évidence, oui. M. le Rapporteur : Tout à l'heure, M. Bertossa nous a livré un début d'analyse sur les différences entre les cantons de la Confédération helvétique. Nous avons eu le sentiment qu'il se produisait un réveil des appareils judiciaires du Tessin et des cantons de la Suisse romande. Quel est votre sentiment sur les cantons de la Suisse alémanique ? Comment, avec les mêmes lois fédérales, les systèmes cantonaux peuvent-ils produire des conséquences aussi disparates ? M. Paul PERRAUDIN : Difficile question. Sans opposer Genève au Tessin ou à Zurich, on peut faire un constat général. Genève est une place financière, Zurich aussi, la comparaison est donc possible. Pourquoi une magistrature est-elle plus faible dans un canton qu'elle ne l'est dans un autre ? C'est aussi une question d'état d'esprit. En Suisse, notre arsenal juridique couvre largement la problématique du crime organisé ou de la corruption. Après, cela dépend beaucoup de la détermination des magistrats. On dépend toujours de sa propre motivation. Certains attendent d'avoir tous les instruments en main pour essayer d'en faire quelque chose. D'autres se contentent du peu dont ils disposent pour essayer de construire et de remplir le rôle qui est le leur. M. le Président : Se sentent-ils soutenus par l'opinion publique ? En France, cela devient un vrai sujet. Nous avons une garde des sceaux qui avance résolument dans ce domaine. Depuis deux jours que nous sommes ici, nous avons le sentiment que l'opinion publique et même les politiques sont assez loin de considérer cela comme une priorité. M. Paul PERRAUDIN : Le crime organisé est une notion relativement abstraite ; il est multiforme. Il est donc assez difficile de faire comprendre ce concept. Un effort pédagogique doit être réalisé car pour que ce concept soit concrètement perçu, il faut savoir s'exprimer simplement et avec conviction. Cela étant, ce que nous voyons dans nos procédures est assez terrifiant - je pèse mes mots - car on s'aperçoit, dans la réalité, que cette gangrène ne s'étend pas seulement aux pays traditionnellement touchés par les phénomènes de corruption mais atteint aussi largement les pays européens. Nous en avons une telle perception parce que nous en examinons les circuits financiers qui sont très révélateurs. Les chiffres ne trompent personne. Les déclarations peuvent faire illusion - on peut tricher ou mentir - mais la réalité chiffrée ne trompe pas, elle indique clairement qui ont été les bénéficiaires des processus de corruption ou de criminalité organisée. A partir de ce constat, ceux qui travaillent sur ce genre d'affaires peuvent exprimer un sentiment de grande préoccupation. Cette situation résulte des insuffisances de moyens mais aussi de notre incapacité à expliquer ces phénomènes et à faire mesurer le poids des enjeux au monde politique. Notre perception des circuits financiers criminels fait que nous sommes plusieurs à dire aujourd'hui, de façon fondée, que ces phénomènes de corruption sont beaucoup plus étendus qu'on ne le pense. M. le Président : Pensez-vous qu'ils s'amplifient ou qu'on les voit mieux ? M. Paul PERRAUDIN : Il est probable qu'on les voit aussi mieux. Dès lors, on mesure les insuffisances de l'entraide judiciaire et de la coordination internationales. Dans le domaine des stupéfiants, par exemple, une coordination se fait avant que les enquêtes ne démarrent. Les pays se concertent souvent. Dans le domaine de la criminalité financière y compris la corruption, les pays ne se concertent pas avant mais après... et encore, quand ils se concertent ! Les règles de l'entraide judiciaire sont suffisamment difficiles pour entraver les processus d'enquête, en tout cas momentanément. On mesure donc la difficulté de l'entraide judiciaire : problème de coordination, mais également expérience et formation des magistrats et enquêteurs insuffisantes. Tout cela est une nécessité qui se fait de plus en plus sentir. On ne s'improvise plus dans l'examen des circuits financiers criminels. Il y faut une certaine expérience qui doit s'acquérir. Souvent les magistrats ne restent pas en poste assez longtemps pour donner le meilleur de leur efficacité. M. le Président : Ces inquiétudes que vous exprimez, liées à un facteur important qu'est la corruption publique, nous préoccupent aussi beaucoup puisqu'elles concernent les grandes démocraties avancées. N'avez-vous pas le sentiment qu'en travaillant sur ce sujet, on s'attaque presque à une évidence et que là réside la difficulté ? Les grandes entreprises du monde occidental fonctionnent presque de façon institutionnelle, connue de tous les praticiens, avec une partie liée à ce que l'on appelle la corruption. On s'attaque là à un système général plutôt qu'à des exceptions, ce qui peut sembler un peu décourageant. M. Paul PERRAUDIN : Cela dépend de vos motivations et de vos priorités. Les normes existantes ne doivent pas être des alibis. Les magistrats sont là pour les faire respecter. A partir d'un certain moment, jouer son rôle jusqu'au bout en dépit des découragements est une affaire d'état d'esprit, de détermination et de motivation. Je vous le dis tel que je le ressens. Le phénomène est généralisé. On dira peut-être que pour une procédure, telle société est dans le collimateur de la justice alors que l'on sait que des dizaines d'autres ont des comportements répréhensibles similaires. Faut-il s'arrêter pour ce motif ? Je ne le crois pas. De la même façon, pour la criminalité financière traditionnelle qui ne relèverait pas de la corruption, on constate que le comportement de sociétés transnationales devient inquiétant. On peut penser qu'elles travaillent presque toutes avec d'importants fonds De sérieux problèmes nous attendent. Sans parler des aspects liés à la fiscalité - je n'aborde que la criminalité financière - l'ampleur de ces pratiques illégales et l'importance des avoirs sociaux détournés avec des méthodes que l'on connaît devient intolérable. Ces comptes sont utilisés à des fins multiples, même à des fins licites, mais la volonté est d'occulter les opérations. Les caisses noires des sociétés transnationales sont un sujet qui mériterait d'être examiné pour lui-même car il fait partie des processus de blanchiment, comme mériterait d'être examiné aussi, dans ce contexte, le phénomène des grandes concentrations d'entreprises et leur financement. Les opérations de compensation sont un autre sujet de préoccupation, puisqu'elles permettent de mobiliser dans n'importe quelle partie du monde des sommes considérables hors circuits financiers traditionnels. Elles ne laissent ainsi pratiquement aucune trace repérable. La contre-valeur de n'importe quelle somme collectée dans un pays peut être remise à des intermédiaires à l'étranger, sans que cet argent sorte physiquement du pays et donc sans laisser une trace de transfert. Ce sont donc autant de sujets d'inquiétude. Depuis sa création, en 1989, le GAFI tente de proposer des débuts de solution. Même les centres offshore ont commencé à être un peu chahutés afin de les contraindre à une coopération judiciaire minimale. M. le Président : Une des raisons de la création de notre mission d'information est une réelle inquiétude sur deux points. D'une part, dans cette forme de délinquance concernant un certain nombre de grandes sociétés que vous avez évoquée, on a l'impression de se heurter rapidement à la raison d'Etat ou aux intérêts géostratégiques, les deux étant liés. Le développement des travaux du GAFI à l'intérieur de grands organismes internationaux tout à fait respectables et utiles tels que l'OCDE, le G7 ou le FMI, le fait que le droit produise de la norme, n'empêchent pas les mauvaises pratiques de se perpétuer, de sorte que l'on peut penser que le droit et la norme juridique assurent essentiellement une fonction idéologique au sens marxiste d'autrefois, c'est-à-dire génère un système d'illusions pour mieux masquer des pratiques douteuses. Avez-vous le sentiment que les trois ou quatre grands colloques internationaux sur la question du blanchiment organisés cette année ont réellement fait avancer les pratiques ? M. Paul PERRAUDIN : J'ai été entendu récemment à l'OCDE avec plusieurs collègues européens. La rencontre s'adressait à des praticiens et à des fonctionnaires des pays concernés par les effets de la corruption. Ce fut là une occasion de leur faire partager nos préoccupations et de recourir à la pédagogie nécessaire pour les sensibiliser à cette problématique. Quand on dit qu'en Suisse on croit aux vertus de l'autorégulation, c'est aussi une manière didactique de rendre responsables ceux qui sont au front. La meilleure façon d'intégrer les règles et de les faire respecter, c'est de permettre aux intermédiaires financiers d'édicter eux-mêmes des règles de comportement propres à leur profession dans un système financier soumis à une autorité publique de surveillance. Un très grand effort de pédagogie est nécessaire pour une sensibilisation optimale. Ces colloques en sont l'occasion. Cela étant, il faut s'armer de patience pour faire avancer les choses. En matière de coopération internationale, les législateurs prévoient toujours des dispositions tendant à protéger les intérêts stratégiques nationaux ou les intérêts économiques prépondérants. La loi d'entraide suisse, par exemple, prévoit une sauvegarde de cette nature. On constate aussi que les pays qui ne veulent pas remplir leurs obligations internationales de coopération, notamment dans le domaine de la corruption publique, masquent leur absence de volonté sous des dispositions de cette nature. Il convient de se mobiliser pour que de telles règles ne puissent pas être invoquées dans n'importe quelle situation pour refuser la coopération internationale en matière pénale. Un sujet de préoccupation du même ordre tient au problème des immunités abusives. M. le Rapporteur : Pourriez-vous, comme votre collègue Bertossa, procéder à une évaluation de la coopération, non seulement franco-suisse, mais aussi avec l'ensemble des Etats européens ou non européens qui vous requièrent sur un certain nombre de questions ou, à l'inverse, que vous requérez ? Je pense notamment au Chili, à l'Argentine, à la Russie. Quels sont les points sur lesquels il vous paraît utile d'agir politiquement ? M. Paul PERRAUDIN : Il convient d'établir une distinction entre l'entraide traditionnelle, qui concerne les informations et les preuves (documents bancaires et financiers) et la grande entraide, qui concerne le problème de l'extradition. Je pense que l'on a sous-estimé tous les problèmes liés à l'extradition et plus spécifiquement à la non-extradition des nationaux. En ce qui concerne l'entraide traditionnelle, l'idéal serait que les frontières nationales ne puissent pas retarder les processus de communication d'informations et que, par exemple, un juge de Paris puisse agir à l'étranger, de la même manière qu'un juge suisse qui irait faire une enquête à Zurich et obtiendrait l'information quasiment en direct. Les canaux de l'entraide entraînent des retards, parfois normaux, mais souvent inacceptables car constitutifs de préjudices considérables dans les procédures pénales engagées à l'étranger. Il se produit ainsi un délai inacceptable entre la requête de coopération et la transmission de l'information requise. Il n'est plus acceptable que de nombreux mois s'écoulent avant que l'autorité requérante puisse poursuivre son enquête, au motif qu'une autorité requise n'aurait pas rempli ses obligations avec la diligence nécessaire. On constate ainsi que certaines règles d'entraide judiciaire internationale sont critiquables et devraient être supprimées. Par exemple, pour la Suisse, on ne comprend pas qu'un inculpé dans une procédure étrangère ait accès à la documentation et à l'information requise avant le magistrat étranger. Une telle règle n'est pas adéquate. On ne comprend pas non plus que le magistrat requis de l'entraide soit limité par la mission du juge étranger, alors qu'il serait en mesure de collecter lui-même d'importantes informations susceptibles de faire progresser l'enquête étrangère. Toutes ces sortes de complications ou de réserves sont de nature à freiner l'entraide judiciaire, insuffisamment fluide pour répondre aux exigences d'efficacité et de célérité de la justice. Certains pays considérés comme de bons élèves par le GAFI ne le sont pas. D'autres qui passent pour de très mauvais élèves ont réalisé des progrès. Et puis il y a ceux qui se confondent dans la masse, dont on n'entend jamais parler mais qui mériteraient la mention : « Peut faire mieux ». Parmi les pays qui passent pour de bons élèves et qui ne le sont objectivement pas, je citerai l'Angleterre qui nous pose un problème très sérieux, aussi bien en matière d'entraide traditionnelle qu'en matière d'extradition. D'autres pays, tels que le Luxembourg, ont amélioré leur système, ce qui ne signifie pas encore qu'ils répondent aux attentes légitimes. M. le Rapporteur : Quelle amélioration a-t-il apportée ? M. Paul PERRAUDIN : J'ai constaté une certaine détermination des magistrats. C'est aussi lié à cela. Dans le domaine de la coopération internationale, des instruments sont sous-utilisés et sont même ignorés par les magistrats. Je pense par exemple à la convention du Conseil de l'Europe sur le blanchiment, que la France a également ratifiée. C'est un instrument efficace s'il est utilisé. A mon sens, la collaboration avec le Luxembourg s'est améliorée en raison, sauf erreur, de l'adoption de nouvelles normes rendant la procédure plus fluide et depuis la mise en place d'une brigade financière comportant des analystes financiers. Le Liechtenstein est un des pays où la coopération internationale est extrêmement difficile. Avec d'autres pays, la collaboration demeure peu efficace voire inexistante. Lorsque la collaboration n'a pas lieu, le juge qui requiert l'entraide doit se manifester et montrer sa détermination. Si aucune progression ne se fait dans un dossier et que le juge requérant ne réagit pas, il peut être suspecté de s'accommoder de la passivité de l'autorité requise, alors qu'en montrant sa détermination, il a une chance de faire progresser la procédure. Outre les problèmes d'entraide traditionnelle, reste celui de l'extradition et de la non-extradition des nationaux. Cet instrument de procédure, qui ne doit être utilisé que dans des cas graves - il s'agit de décerner des mandats d'arrêt en vue d'extradition -, est à la disposition des juges et devrait être utilisé plus souvent. Il conviendrait aussi que les pays en viennent à extrader leurs nationaux, en tout cas dans ceux où les standards minimums relatifs aux droits de la défense sont concrètement et suffisamment élevés pour que l'on puisse faire confiance aux autorités judiciaires amenées à juger. Je n'ai évoqué que quelques pays proches s'agissant de l'entraide judiciaire internationale. Il faudrait parler aussi de tous les centres offshore où la coopération internationale est quasi inexistante. M. le Rapporteur : Que se passe-t-il concrètement lorsque vous envoyez une commission rogatoire à Tortola, par exemple ? M. Paul PERRAUDIN : Il n'y a pas de réponse. Une relation commence à s'établir lorsque le juge requérant se déplace. M. le Rapporteur : Y êtes-vous déjà allé ? M. Paul PERRAUDIN : Non. Aux Bahamas, l'entraide s'est effectuée avec l'aide des Américains qui ont des moyens de pousser la coopération. C'est extraordinaire. Pour se faire ouvrir certaines places offshore, il faut utiliser les Américains. On obtient alors certains résultats. En revanche, le processus judiciaire ordinaire, c'est-à-dire la voie directe, est beaucoup trop lent quand il aboutit. On ne peut pas attendre cinq ou six ans pour une extradition ou pour une transmission d'informations. M. le Rapporteur : Qu'avez-vous pu obtenir concrètement, dans une de vos procédures, grâce au soutien du drapeau étoilé ? M. Paul PERRAUDIN : Des informations sur des circuits financiers. Les fonds passent généralement par un de ces paradis offshore. Le circuit est utile lorsqu'il est continu. Il faut l'établir complètement, de l'origine criminelle à sa destination finale - soit l'enrichissement de personnes ou son intégration dans l'économie légale. Quand il manque un maillon de la chaîne, il faut chercher à l'obtenir. Il faut déterminer comment des fonds entrés aux Bahamas en sont sortis. Si vous connaissez l'entrée et pas la sortie, la chaîne est coupée. Un paradis offshore comme Singapour est imperméable. Par des contacts personnels, on arrive à mobiliser un peu les acteurs mais on devrait pouvoir faire sans cela. On obtient plus en se déplaçant. Il est en effet difficile d'intéresser une autorité étrangère à des investigations portant sur une enquête qu'elle ne maîtrise pas. Il faudrait ainsi que des règles soient instituées pour que des magistrats puissent se déplacer beaucoup plus facilement et surtout appliquer leurs propres règles de procédure dans la mesure où, par définition, elles seraient compatibles avec l'ordre juridique local. Il conviendrait d'accepter que s'applique non plus la procédure du lieu d'exécution des actes mais la procédure du lieu de l'autorité requérante. Il y a évidemment quelques problèmes avec les pays anglo-saxons, qui ont une procédure et un droit matériel qui ne correspondent pas aux nôtres. Il est temps de fixer des règles où le magistrat étranger puisse se déplacer et effectuer les actes lui-même, parce qu'il a la maîtrise de la procédure ou d'accepter qu'il participe de façon active à l'exécution des actes qu'il a lui-même requis dans le contexte de sa propre procédure. Ce sont des questions qui devraient être examinées pour garantir l'efficacité des procédures. Aujourd'hui un juge d'instruction, en particulier financier, doit raisonner en termes d'efficacité et non seulement agir formellement. Nous sommes obligés d'intégrer, de façon pondérée, dans le respect des règles de procédure, des notions d'efficacité. Cela ne signifie pas que l'on puisse se passer des règles de procédure qui constituent des garde-fous nécessaires. Il est difficile de réaliser un bon dosage entre les règles de procédure pénale nécessaires et l'intégration de critères d'efficacité. L'efficacité passe par des stratégies d'investigation. Aujourd'hui elles ont changé. Elles doivent probablement faire appel à des services de renseignements (intelligence service) destinés à permettre aux magistrats de comprendre les réseaux, les filières - ce que les juges d'instruction ne sont pas vraiment capables d'appréhender au regard notamment de l'internationalisation du crime. Quand on parlait de stratégie il y a 10 ans, les juges étaient suspectés d'utiliser des méthodes déloyales. Il n'en est rien. La stratégie est une méthode totalement loyale qui respecte les règles. Il faut cependant en avoir une au risque d'être inefficace. La confiscation des gains illicites est un autre problème. Il faut des règles qui permettent de confisquer les valeurs illicites sans trop d'obstacles. Le crime ne doit pas pouvoir payer. En Suisse, dans le domaine du crime organisé, on a introduit le renversement de la charge de la preuve, ce qui constitue une petite révolution dans la tradition juridique. Lorsque quelqu'un est inculpé d'une infraction relevant de l'organisation criminelle, on présume que les fonds qu'il a sous sa maîtrise sont d'origine illicite. C'est à lui de prouver la provenance licite de ses fonds mais il appartient à l'accusation de prouver l'organisation criminelle. Ces règles de procédure permettent de renforcer l'efficacité de la politique criminelle par la confiscation des biens illicites. Si l'on compare le montant de ce qui est saisi et finalement confisqué par rapport à l'évaluation des gains illicites établie par l'ONU ou par d'autres institutions, il faut bien convenir que le résultat est extrêmement faible. Pendant très longtemps la confiscation des biens illicites n'a pas constitué un des objectifs de la politique criminelle mais cela doit en être un. Les règles de confiscation doivent être adaptées pour le permettre. M. le Président : Je me demande si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire quant à la définition de la notion de relations d'affaires. Vous nous avez dit que le principe de l'autorégulation ou de l'autocontrôle était une bonne chose. Toutefois, j'ai relevé d'une part l'imprécision de la notion de soupçon fondé et la difficulté pour les établissements concernés d'établir eux-mêmes cette déclaration ou annonce ; d'autre part, le flou que revêt la notion de relation d'affaires tel que cela ressort du rapport du Bureau de communication au paragraphe 50. Avez-vous un point de vue sur cette notion de relation d'affaires ? Cela nous éclairerait. M. Paul PERRAUDIN : En Suisse, la relation d'affaires, c'est essentiellement la relation de compte. M. le Président : Compte ouvert ? M. Paul PERRAUDIN : Compte ouvert alors même qu'il ne serait pas encore opérationnel. Il peut y avoir un décalage entre l'ouverture du compte et son utilisation. La circulaire 98-1 de la Commission fédérale des banques, qui s'adresse uniquement aux banques et non pas aux autres intermédiaires financiers, prévoit que l'obligation d'annonce est également applicable hors relation d'affaires, hors relation de compte. Imaginez que quelqu'un se présente dans une banque avec de faux titres, repérés comme tels : la banque doit en informer le Bureau de communication, alors même qu'elle aurait décliné d'emblée la relation d'affaires. Pour les intermédiaires financiers bancaires, la circulaire sur le blanchiment a en effet introduit une obligation d'annonce, même hors relation d'affaires, lorsqu'il y a soupçons fondés manifestes que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle. Il existe une tradition suisse d'auto-réglementation. La convention de diligence des banques existe depuis de très longues années. Elle a été grandement améliorée en 1992 par des obligations d'identification formelles. En effet, l'obligation des intermédiaires financiers d'identifier l'ayant droit est un point névralgique dans la lutte contre le blanchiment. Quand un Juge est à la recherche de fonds criminels, il connaît peut-être M. Dupont, mais M. Dupont n'est peut-être pas le titulaire du compte ; il peut n'être que l'ayant droit d'une société qu'il a lui-même constituée. Cette obligation d'identification permettra de retrouver les fonds incriminés, M. Dupont ayant pu être repéré, non pas comme titulaire d'un compte mais comme ayant droit d'une société ayant ouvert le compte. On pourra aussi identifier Dupont non pas comme ayant droit ou comme titulaire, mais comme fondé de procuration, car la circulaire contre le blanchiment n° 98-1 oblige aussi les intermédiaires financiers à constituer des registres de fondés de procuration. C'est un autre moyen d'identifier et de retrouver des fonds suspectés d'être d'origine criminelle alors que l'on ne sait pas sous quelle relation de compte se trouvent ces fonds. J'insiste sur ces points car ils font partie des plus importantes recommandations du GAFI. M. le Président : Quand on remonte à des sociétés offshore, aux îles Vierges ou ailleurs, on ne retrouve pas le véritable ayant droit économique. M. Paul PERRAUDIN : Vous ne savez pas où les comptes sont ouverts, mais avec le système d'identification, si un compte est ouvert en Suisse au nom d'une société offshore, l'ayant droit doit être désigné. Peut-être aura-t-on donné une fausse identité de l'ayant droit mais cela est un autre problème. Le titulaire devra désigner l'ayant droit du compte. Par cette identification, l'ayant droit est repéré et les fonds criminels peuvent être retracés. Je peux donc demander aux intermédiaires financiers suisses : M. Dupont est-il titulaire d'un compte ? Est-il l'ayant droit d'une relation de compte ouverte ou/et le fondé de procuration ? A-t-il fait des opérations de caisse ? Les opérations de caisse sont des opérations sans relation de compte. Il existe en Suisse l'obligation de répertorier les opérations de caisse à partir de 25 000 FS. On va même plus loin, parce que l'on s'est rendu compte qu'il était possible à partir d'un pays de gérer d'importants avoirs à l'étranger. Il existe ainsi une relation juridique de mandat entre le client et la banque pour des avoirs déposés à l'étranger. On peut ainsi identifier des avoirs criminels déposés à l'étranger par l'existence de mandats de gestion confiés à des intermédiaires financiers suisses. Par ce biais, on peut repérer certains systèmes mis en place où l'argent est déposé à l'étranger et géré d'une place financière avec les services bancaires usuels. M. le Président : Je formulerai différemment ma question. J'ai compris que l'on parvenait à identifier des prête-nom, des intermédiaires financiers, mais en remontant vers les sociétés offshore, il me semble que l'on finit par aboutir à un écran total derrière lequel la personne au début de la chaîne peut parfaitement se dissimuler. M. Paul PERRAUDIN : Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Bien entendu, la société est constituée. Elle comprend des organes, par exemple panaméens et elle va délivrer un mandat à une tierce personne qui peut être un intermédiaire de l'ayant droit. Ce mandataire de la société va pouvoir ouvrir des comptes dans n'importe quel pays du monde puisqu'il est autorisé par les organes de la société. Dans les pays où l'identification est exigée, en Suisse par exemple, le mandataire sera obligé de désigner l'ayant droit économique de ce compte. Dans les pays où il n'y a pas d'exigence d'identification, la société _uvrera par l'intermédiaire de ce mandataire qui n'est pas forcément le véritable propriétaire des fonds. Si vous ouvrez un compte à Varsovie, vous pouvez dire : « Je m'appelle Mickey et je veux ouvrir un compte au nom de Mickey ». On ne vous demandera pas qui est Mickey, ni s'il est le véritable propriétaire économique des fonds. Il n'y a pas d'exigence d'identification et on ne saura jamais qui est derrière Mickey. M. le Président : J'avais le sentiment que des pays comme le Liechtenstein avaient des formules de droit des sociétés permettant de désigner comme l'ayant droit économique quelqu'un qui n'était pas le réel. M. Paul PERRAUDIN : Vous parlez des fondations. M. le Président : Dans vos enquêtes, est-ce un véritable souci ? M. Paul PERRAUDIN : C'est un véritable souci. Dans certaines structures juridiques, on voit que les propriétaires économiques des fonds sont complètement déconnectés de la structure juridique mise en place. On doit considérer que suivant l'exigence d'identification, le bénéficiaire économique, tel que l'on comprend cette notion, est celui qui a la maîtrise effective des fonds, le propriétaire des fonds. Dans nos investigations en Suisse, en visant les structures juridiques du genre fondation, on comprend que les banques, dans l'exigence d'identification suisse, doivent pouvoir identifier le premier bénéficiaire, que l'on considère comme l'ayant droit. Quelle que soit la structure juridique mise en place, l'obligation d'identification est réelle et non pas formelle. Cela procède d'une notion économique de la maîtrise des fonds. On doit pouvoir se dire que, quelle que soit la structure juridique mise en place pour dissimuler l'ayant droit à l'égard de tiers, l'exigence d'identification doit être suffisamment forte pour que l'on ait trace de cette personne. M. le Président : Les pays où l'identification n'est pas obligatoire sont-ils nombreux ? M. Paul PERRAUDIN : C'est le cas de nombreux pays européens. L'Espagne, par exemple, où l'on ne distingue pas toujours l'ayant droit du fondé de procuration. C'est, en tout cas, ce que me disait récemment un banquier espagnol. Sans cette obligation, il nous est difficile d'agir dans le domaine du blanchiment. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'en Suisse, nous avons érigé l'omission d'identification en infraction pénale objective. L'intermédiaire qui n'identifie pas est passible d'une peine d'emprisonnement. M. le Président : On peut donc être membre de l'Union européenne et n'avoir pas cette obligation d'identification ? M. Paul PERRAUDIN : Tout à fait. M. le Président : Pourtant, ces pays sont membres du GAFI ! M. Paul PERRAUDIN : Vous pouvez être membre du GAFI et ne pas suivre entièrement ses recommandations. Par exemple, si vous êtes Canadien, avec une législation anti-blanchiment très faible, et si votre ami américain vous soutient au GAFI, vous ressortez tout de même avec un rapport d'évaluation satisfaisant. (Sourires.) M. le Président : Cela méritait d'être dit. C'est aussi l'impression que nous avions mais c'est rarement dit. Monsieur le juge, nous vous remercions. Audition de M. Michel Y. DÉROBERT, accompagné de MM. Edouard CUENDET, Premier Secrétaire et Denis MATHIEU, Secrétaire (compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 1999 en Suisse) Présidence de M. Vincent PEILLON, président M. le Président : Monsieur Dérobert, nous avons assez bien travaillé hier sur la LBA. Compte tenu du temps limité dont nous disposons pour cet entretien, je vous propose qu'après vos quelques mots de présentation, nous procédions à un échange très libre sur des points précis. M. Michel Y. DÉROBERT : Nous n'avons pas la prétention de représenter l'ensemble de la profession bancaire suisse. Nous nous occupons de deux associations : l'Association des banquiers privés suisses et le Groupement des banquiers privés genevois, qui sont les organisations les plus fortes par les liens qui unissent leurs membres. Créées au début des années trente, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur d'une loi sur les banques au niveau fédéral, elles défendent les intérêts des banquiers privés qui ont une forme juridique un peu spéciale, puisque ce sont des sociétés de personnes avec des associés à responsabilité illimitée. Parce qu'il n'est pas responsable de s'engager dans des affaires commerciales risquées quand on engage son patrimoine personnel, ces banques se sont spécialisées depuis très longtemps dans les opérations hors bilan de gestion de fortune. Elles ont très fortement profité du processus de désintermédiation qui s'est produit, ces quinze à vingt dernières années et ont bénéficié de l'évolution des marchés financiers. Les cinq banques genevoises les plus anciennes font partie du Groupement. La plus grande, Pictet & Cie, gère environ 120 milliards de FS ; Lombard, Odier & Cie, un peu moins ; Darier, Hentsch & Cie, plus de 30 milliards de FS ; enfin, Mirabaud & Cie et Bordier & Cie sont plus petites. Le Groupement les aide pour toutes les questions réglementaires et de formation. Nous faisons également de la publicité générique pour la fonction de banquier privé. Vous pouvez en voir à l'aéroport de Genève et dans la presse anglo-saxonne. Le Groupement intervient aussi sur le marché des capitaux de façon collégiale, c'est-à-dire qu'une seule maison fait le travail des cinq, ce qui simplifie les choses. L'Association des banquiers privés suisses regroupe plus largement tous les banquiers privés suisses qui ont cette forme juridique. Elle est venue se greffer sur l'organisation du Groupement que nous avions renforcée. L'ancien secrétaire général de l'Association des banquiers privés suisses est aujourd'hui président de la BNP Suisse. Nos membres ont beaucoup développé leurs activités dans le domaine de la gestion institutionnelle. Il existe en Suisse un système de prévoyance professionnelle qui repose sur trois piliers : le système redistributif de solidarité entre les générations ; le système accumulatif, avec des caisses de pension qui sont responsables de la gestion de fonds importants et la prévoyance, que chacun fait avec ce qui lui reste après avoir payé ses impôts. La place genevoise, internationale depuis des temps immémoriaux, avec une tradition d'investissement dans tous les marchés, a bien profité de la mondialisation dans le domaine financier. Nous avons aussi l'avantage de trouver facilement des gens qui ont plusieurs cultures. C'est un des atouts sur lesquels nous avons pu compter par le passé. Les maisons les plus anciennes, celles qui datent du début du XVIIIème siècle, se trouvent en Suisse allemande, car la Révolution française a aussi eu des conséquences à Genève. La plupart des anciennes banques privées genevoises ont été créées juste après cette date, à une période où Genève était sous dépendance française. Pour ces maisons restées dans des mains familiales, la lutte anti-blanchiment est importante car lorsque vous avez passé deux siècles à bâtir une réputation, ce n'est pas pour la remettre en cause avec un client qui vient apporter un million de dollars. Cela n'est pas dans l'intérêt de la maison. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire très attention. On ne sait jamais à qui l'on parle. Les gens sont pleins de ressources. Voilà qui nous sommes. Je vous invite maintenant à nous interroger sur notre système et sur notre législation. M. le Président : Merci beaucoup de nous accueillir. Il était très important pour nous de vous rencontrer, car nous savons que vous partagez notre préoccupation pour des raisons liées à vos activités et à votre intégrité. Nous rencontrons les responsables de grandes institutions financières, comme ceux de Paribas, qui, suite à la loi mais souvent même avant, ont mis en place des règles destinées à éviter que l'argent sale, issu du crime, ne transite par leurs banques. Dans le même temps, vous le savez, un grand nombre de rapports d'organismes internationaux - FMI, ONU, OCDE -, que ni vous, ni nous n'avons de raison de mettre en doute, indiquent qu'il y a actuellement des fonds issus des mafias russes en stock à Genève, qui se chiffrent en milliards de dollars. Si tel est le cas, où peuvent à votre avis se trouver ces fonds et comment sont-ils entrés ? M. Michel Y. DÉROBERT : C'est une question à laquelle je suis assez peu confronté, parce que je ne suis pas en relation avec la clientèle dans le cadre de mes activités. Je sais que circulent dans les rues de Genève des Russes qui achètent des montres fort cher. Ils acquièrent parfois des immeubles coûteux à Lugano. J'imagine qu'ils vont aussi sur la Côte d'Azur, en Italie ou aux Etats-Unis. Le problème se pose à l'ouverture d'un compte. Sur ce point, la Suisse est particulièrement rigoureuse puisque nous sommes censés, à ce stade, connaître l'ayant droit économique, et nous devons savoir s'il s'agit d'un Russe. Quelques banques font savoir, en en faisant presque un argument publicitaire, qu'elles refusent tous les Russes, en tout cas directement. D'autres disent qu'elles prennent avec les Russes des soins particuliers. Les grandes banques ont interdit à toute succursale en Suisse d'ouvrir des comptes à des Russes, en réservant cette faculté à la maison mère ou à la succursale de Genève, qui sont équipées en conséquence. Chez les banquiers privés, l'ouverture d'un compte est une décision majeure. Dans la plupart des maisons, mais j'ignore si elles ont toutes exactement les mêmes procédures, on n'ouvre pas de compte sans l'accord du collège des associés. Il peut arriver, par exemple, qu'un associé propose l'ouverture d'un compte pour telle personne et que le collège s'y refuse. C'est une décision collective et nous prenons toutes sortes de renseignements jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme satisfaisants. M. le Président : Qui ouvre donc ces comptes ? M. Michel Y. DÉROBERT : Je ne suis pas certain que toutes les banques aient autant de retenue. M. le Président : C'est tout de même préoccupant pour vous ! Vous représentez 200 milliards de FS, vous êtes des institutions anciennes, à la compétence reconnue par tous. Mais, en même temps, les rumeurs concernant les fonds mafieux vous nuisent. Puisque ce ne sont pas les grandes institutions, vous devez savoir mieux que nous qui sont ceux qui accueillent ces masses de milliards de dollars issues du crime. Cela permettrait de prendre des mesures ou de trouver des pistes de travail qui, plutôt que de surcharger les banques qui font bien leur travail, viseraient directement les moutons noirs. Bien entendu, ceux-ci n'acceptent pas de nous rencontrer et tous ceux que nous rencontrons nous disent qu'ils font parfaitement bien leur travail. M. Michel Y. DÉROBERT : En France, comment réagissez-vous à la question de la mafia russe ? Vous avez peut-être une solution pour empêcher que les Russes n'investissent en France, notamment sur la Côte d'Azur ? M. Jacky DARNE : La mafia russe est présente en France comme ailleurs. Nous devons donc mettre en place des outils ensemble. Une des pistes est de travailler davantage avec les intermédiaires immobiliers, qui n'ont souvent pas les mêmes pratiques professionnelles que les banquiers et qui sont des voies d'entrée. M. Michel Y. DÉROBERT : Il existe des voies d'entrée. Le procureur Bertossa que vous allez rencontrer vous en parlera certainement mieux que moi car il a une vision plus globale, mais je pense que le secteur bancaire n'est pas le moyen le plus simple d'entrer dans le système. M. Jacky DARNE : Cela passe tout de même souvent, à un moment ou à un autre, par des banques. Cela se traduit fréquemment par un mouvement sur un compte. M. le Rapporteur : En France, le TRACFIN, qui est l'équivalent du Bureau de communication, reçoit environ 1 500 dénonciations ou déclarations de soupçon par an, contre 120 pour votre bureau. En France, le recours à la banque est terminé. Notre problème, c'est les notaires et les avocats dont les pratiques ne sont toujours pas vraiment réglementées. Nous avons vu hier que c'est également le cas en Suisse. M. Edouard CUENDET : La LBA s'applique très clairement. Pour avoir quitté le barreau il y a très peu de temps, je sais que le devoir de diligence pour les avocats qui font des affaires au niveau international est extrêmement sérieux. Il y a eu des cas dans le passé où des avocats ont fini derrière les barreaux et les gens sont devenus extrêmement prudents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, comme partout, des moutons noirs, mais il y a eu une prise de conscience. La Fédération suisse des avocats sera bientôt considérée comme une autorité de surveillance d'autorégulation reconnue au niveau fédéral. La structure se met en place. M. le Rapporteur : Nous considérons, nous Français, au regard des lacunes de nos propres législations sur les avocats, que la Suisse n'a qu'une avance théorique sur la France dans la mesure où il n'existe actuellement aucune obligation de dénonciation. M. Edouard CUENDET : Si, c'est pleinement en vigueur ! M. le Rapporteur : Il nous a été confirmé hier par le Bureau de communication que les avocats ne pourraient commencer qu'à partir de 2000. M. Edouard CUENDET : C'est déjà en place. M. le Rapporteur : Il nous a été indiqué que les organismes d'autorégulation ne fonctionnaient pas encore. M. Michel Y. DÉROBERT : Lorsque l'on met en place une nouvelle législation, il y a un moment où tout n'est pas encore absolument rodé. On ne peut guère l'éviter. Je puis difficilement m'exprimer au nom des avocats et des notaires. Mon ami Cuendet qui exerçait encore tout récemment cette honorable profession est mieux à même de le faire. Lorsque l'on vient de mettre en place une loi, on ne peut pas la réviser immédiatement. M. le Président : Pour en revenir à ce que vous connaissez mieux, avez-vous une idée du nombre de comptes ou de fortunes qui sont gérées par les cinq membres de votre Groupement ? M. Michel Y. DÉROBERT : Je n'en ai aucune idée. M. le Président : Vous n'avez pas de statistiques à ce sujet ? M. Michel Y. DÉROBERT : Non. M. le Président : Avez-vous une idée du pourcentage de comptes ouverts dans ces institutions par des personnes résidant à l'étranger ? M. Michel Y. DÉROBERT : Je n'ai pas cette information. Des évaluations ont été faites pour l'ensemble de la Suisse. On estime que les comptes suisses étrangers en gestion représentent environ 50 % du total, dont plus de la moitié appartient à la clientèle privée et un peu moins de la moitié à la clientèle institutionnelle. Cela s'explique par le fait que le système fiscal suisse, notamment le droit de timbre, a tendance à ne pas attirer, autant qu'il le devrait, la clientèle étrangère institutionnelle. Des clients institutionnels sont gérés par des banques suisses, mais depuis Londres. M. le Président : Qu'est-ce qui attire les clients privés ? Pourquoi des Belges, des Allemands, des Français, etc., viennent-ils faire gérer leurs avoirs chez vous ? Quelles sont vos plus-values ? M. Michel Y. DÉROBERT : Une bonne partie de la clientèle est très ancienne. Ce n'est pas forcément celle reconnue comme étant la plus intéressante. Il est d'ailleurs de tradition dans les banques privées de garder le contact sur des générations. Les plus-values se situent à des niveaux variés. La Suisse a bénéficié d'une extraordinaire plus-value pendant un certain nombre d'années, quand les monnaies étrangères, notamment le franc, la lire et la livre, se dévaluaient fortement. Je l'ai vécu, car il se trouve que je suis président d'une institution de handicapés mentaux dont j'étais auparavant le trésorier. Un certain nombre de parents français qui, à l'époque, ne disposaient pas d'institutions équivalentes en France, nous ont déposé de l'argent. C'était là notre accord : ils nous faisaient un prêt à intérêt négatif de 2 % par an. Or ceux qui ont retiré leurs enfants ou dont les enfants sont morts et qui ont donc récupéré leur dépôt, se sont retrouvés avec plus d'argent qu'ils n'avaient déposé en francs français parce que, en toute légalité, ce dépôt devait être effectué en francs suisses. L'inflation a donc joué un rôle important. D'une manière générale, la Suisse en a beaucoup profité, mais cet atout a eu tendance à se dévaluer. Il y a aussi l'attrait du secret bancaire, qui est un mythe, à bien des égards. On a l'impression qu'il existe dans ce pays une culture de la confidentialité que l'on n'a pas dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis. Une autre plus-value est la capacité de trouver des gens qui ont l'habitude de gérer de l'argent à l'échelle internationale. De plus, la concurrence est très forte. Quand une banque étrangère vient s'installer dans le quartier, on me demande parfois si je suis inquiet. Je réponds invariablement qu'au contraire, je m'en félicite. Elle vient avec ses clients que l'on va pouvoir leur prendre. Si vous êtes antiquaire, vous n'auriez pas l'idée d'installer votre boutique dans un secteur où il n'y a que des marchands de voitures d'occasion, mais plutôt à proximité d'autres magasins d'antiquités. C'est d'ailleurs une préoccupation que nous avons en voyant le développement de la place de Londres dans certains métiers. Nous ne voudrions pas que ces métiers soient systématiquement transférés à Londres parce que nous pourrions perdre un savoir-faire. La clientèle internationale est attirée par les organisations internationales importantes. Dans le métier financier, nous avons acquis une réputation qui tient à différents facteurs. Il importe que ces facteurs soient préservés en sachant qu'il convient de respecter des critères universellement reconnus, notamment en matière de lutte contre la criminalité. Pris individuellement, un banquier à qui l'on impose de nouvelles normes n'est pas forcément satisfait d'avoir à engager le personnel qu'il faut pour les faire respecter. C'est pourtant le rôle des organismes d'autorégulation (pour les banques suisses : l'Association suisse des banquiers). M. Jacky DARNE : M. Dérobert, je vous ai entendu dire à peu près ceci : « Nous avions déjà des normes et des procédures et nous ne faisions pas mal, la loi et les circulaires viennent consolider ce que nous faisions. C'était presque inutile. On nous impose une bureaucratie excessive ». Votre expérience et votre fonction à la tête de l'Association des banques privées de Genève et au sein de votre association générale regroupant l'ensemble des banques privées suisses vous donnent une capacité d'analyse tout à fait privilégiée. Que pensez-vous de la façon de traiter aujourd'hui, en Suisse et dans le monde, les problèmes de blanchiment d'argent sale ? Le GAFI et les structures de contrôle mises en place dans chaque pays - TRACFIN chez nous, les deux organismes suisses, etc. - conduisent à des réglementations qui ont pour objectifs de définir des normes sur l'ouverture des comptes et sur l'observation des transactions, d'obliger à faire des déclarations de soupçon, à favoriser l'entraide judiciaire internationale et à harmoniser les services administratifs et de police afin de les rendre plus efficaces et de pouvoir suivre les gens. Pensez-vous que cela soit efficace ? Est-on sur la bonne voie ? Chaque pays doit-il poursuivre ces pistes ou bien trouvez-vous des faiblesses à ces démarches ? Quelle serait votre démarche si vous étiez responsable de l'univers en ce domaine ? Faut-il laisser chaque banquier face à ses responsabilités en disant : après tout, si cela fonctionne mal, il en résultera une image négative ? J'ai retenu qu'il n'était pas très facile de demander à des banquiers de faire des déclarations de soupçon sur leur clientèle. J'ai eu cette impression en écoutant ce matin le responsable de la banque Paribas. Si on dénonce un de ses clients, même s'il le mérite, cela peut effrayer les autres. M. Michel Y. DÉROBERT : C'est tout à fait exact. M. Jacky DARNE : C'est peut-être pour cela qu'il y a aussi peu de déclarations de soupçons. Vous parliez tout à l'heure de la confidentialité. Est-ce une bonne solution ? Ma question est générale mais j'aimerais connaître votre état d'esprit. M. Michel Y. DÉROBERT : Je ne suis pas certain que cela fonctionne tellement bien, ici ou ailleurs. Je sais que les Américains ont voulu mettre en place un dispositif sophistiqué sur lequel ils sont d'ailleurs en train de revenir. Ils ont refusé une nouvelle norme sur la connaissance des clients. Cela ne marche pas formidablement bien. En tant qu'organisation de banque, nous n'avons jamais instauré toutes ces normes de gaieté de c_ur, même si nous en avons inventé certaines. On met généralement en place une nouvelle directive ou une nouvelle convention pour répondre à une difficulté. Il y a peut-être aussi une évolution des mentalités. Ce qui était toléré, il y a cinquante ans ne l'est plus aujourd'hui. On court probablement après un objectif mouvant. Il ne serait peut-être pas venu à l'esprit à vos prédécesseurs, il y a vingt ans, de se poser ce type de questions. Que ferais-je si j'étais le maître de l'univers ? Je ne sais pas si je dois vous dire ce que je pense. C'est un ensemble de problèmes qui se pose. Est-ce que la lutte contre les stupéfiants donne le moindre résultat ? Interviennent des problèmes de santé publique, des problèmes sociaux. Qui sommes-nous pour en juger ? J'observe que ces politiques ne fonctionnent pas. Il y a dix ans, le magazine The Economist, que je lis régulièrement, proposait une libéralisation générale des stupéfiants afin de décriminaliser ces pratiques. C'est un point de vue difficile à défendre mais on a tout de même le droit d'y penser. Ce n'est pas non plus la solution. M. Denis MATHIEU : Cela a tout de même une influence certaine sur la structure des banques. Presque toutes les banques connaissent le compliance officer. Même si vous trouvez qu'il y a peu de dénonciations, il y a une prise de conscience au niveau interne. Un effort très important est consacré à la formation des employés. Le compliance officer entraîne une responsabilité de formation. Les employés des banques suisses et des banques étrangères en Suisse ont pris conscience de ces problèmes et suivent attentivement les évolutions législatives. Des règlements internes et des procédures très stricts sont appliqués. M. Jacky DARNE : Vous défendez donc ce qui a été fait. M. Denis MATHIEU : A mon sens, toutes les procédures internes sont assez efficaces. Il y a une prise de conscience tout à fait bénéfique. M. Michel Y. DÉROBERT : Chez les banquiers privés traditionnels, toutes ces obligations ont toujours été remplies et c'est normal ; mais lorsque l'on a affaire à un établissement financier de 1 000, 1 200, 10 000, 15 000 ou 30 000 employés en Suisse, on est obligé d'édicter des lois, des règles et des règlements parce que le contrôle devient très difficile. Parmi la masse, des employés seraient peut-être prêts à prendre un client qui n'est pas tout à fait correct pour augmenter leur volume d'affaires. M. le Président : On lit aussi que le secret bancaire est plus un mythe qu'une réalité et que l'évolution de la législation depuis 1983 conduit certains clients des banques suisses à les quitter au profit de places moins respectueuses des normes internationales. On cite souvent le Liechtenstein. Les banques que vous connaissez ont-elles des succursales ? Observez-vous ce phénomène ? Est-ce une préoccupation pour vous ? Le fait d'imposer des normes plus rigoureuses entraîne-t-il la fuite de clients vers des contrées moins normatives ? M. Michel Y. DÉROBERT : La possibilité existe. Il y a effectivement une certaine compétition non seulement dans les normes applicables mais également dans la façon de les appliquer - ce qui nous préoccupe presque davantage, car nous n'avons pas de tradition normative, mais une conception assez rigoureuse de l'application des lois. A l'inverse, dans le monde anglo-saxon - je ne parle même pas des Etats-Unis où cela est poussé jusqu'à l'absurde, les lois sont devenues tellement compliquées que plus personne ne peut les comprendre - l'application n'est pas toujours rigoureuse. Il peut donc exister, dans ce domaine, une certaine compétition. Face à une telle situation, la réaction du banquier est toujours pragmatique. Celui-ci se demande : dois-je suivre mes clients qui ne veulent plus travailler ici ou bien dois-je les laisser partir ? Un article paru dans The Economist m'a beaucoup choqué, à tel point que j'ai demandé à l'Association des banquiers suisses privés d'écrire au magazine, mais nous n'avons toujours pas obtenu de réponse. Il relate l'histoire d'un client russe, personnage dont le nom n'est pas cité mais apparemment très connu, qui voulait ouvrir un compte en Angleterre. Comme le banquier anglais était réticent, le client russe a menacé de lui jeter un cendrier dans la figure. Celui-ci a avoué : « Comme cela devenait dangereux, je lui ai trouvé une banque en Suisse ». Cette phrase témoigne d'un cynisme inouï car selon nos règles, une banque qui prend un client s'appuie sur les recommandations des gens respectables. Or il n'a pas dit : « Je suis avec le plus grand filou de toutes les Russies, est-ce que vous voudriez bien le prendre ? », mais il a dû dire : « Je vous recommande un très bon ami ». Si l'histoire est vraie, c'est scandaleux ; si elle est fausse, c'est de la calomnie. M. Jacky DARNE : Vous regroupez l'ensemble des banques privées suisses. J'ignore combien d'adhérents cela représente. M. Michel Y. DÉROBERT : Une quinzaine, soit les banques organisées sous la forme de sociétés de personnes. M. Jacky DARNE : Quand on a défini des normes, quand on a mis en place des procédures, on peut réussir à les respecter dans une, deux, voire cinq banques. Comment être assuré d'une qualité identique de mise en _uvre des procédures dans une quinzaine d'établissements très divers ? N'y a-t-il pas des maillons faibles dans la chaîne ? Cela ne justifie-t-il pas qu'un magazine puisse écrire que l'on peut trouver en Suisse une petite banque dont la façon de travailler fera accepter un tel client ? M. Michel Y. DÉROBERT : Ce qu'il y a de scandaleux, c'est qu'un banquier respectable ait recommandé un client dont il ne voulait pas à un autre banquier respectable. M. le Président : Sous la pression d'un cendrier ! M. Michel Y. DÉROBERT : En 1989, est paru dans la revue Euromoney le reportage fort intéressant d'une journaliste, qui s'était mise dans la peau d'une Américaine qui affirmait détenir de l'argent qu'elle ne pouvait pas déclarer. Elle était allée dans plusieurs banques à Genève. Elle citait les noms des gens qui l'avaient reçue et expliquait comment on l'avait reçue. On y apprenait que le « téléphone arabe » avait fonctionné, puisqu'elle avait été reçue avec la plus grande réserve par les banquiers privés genevois auxquels elle s'était adressée. En revanche, dans certaines autres banques, elle avait été reçue à bras ouverts. C'était avant la directive de la Commission fédérale des banques. Cela prouve que la question aurait déjà dû être réglée. M. le Rapporteur : Je vais vous poser une question plus précise. La Suisse a fait un énorme effort sur le plan juridique et l'on peut considérer, comme le note d'ailleurs le GAFI, qu'elle a effectué un rattrapage par rapport aux autres pays européens. C'est la raison pour laquelle nous essayons de nous parler et de faire avancer les choses ensemble. En France, s'il reste aujourd'hui possible de trouver un notaire indélicat, les blanchisseurs n'ont plus aucune chance auprès des banques françaises. L'essentiel des capitaux soupçonnés, à partir d'infractions détectées en France, se réfugie dans les banques suisses. L'essentiel des demandes d'entraide judiciaire répressive est destiné au Luxembourg et à la Suisse. C'est intéressant, car on tombe sur des établissements qui ont pignon sur rue. Une commission rogatoire internationale de 1998 relative à des personnalités françaises, suspecte des mouvements à l'UBP de Genève et au Crédit suisse, lequel a par ailleurs créé dans des centres offshore une société dont le nom est connu de la justice française. J'ajoute que la Banque de patrimoine privé a annoncé le rachat d'une petite banque à Nassau, aux Bahamas, et que la banque Piguet d'Yverdon, qui appartient à la Banque cantonale vaudoise, a annoncé son implantation aux îles Caïmans. Il est possible que l'on se dise : puisqu'il y a des choses que l'on ne peut plus faire ici en raison de l'apparition de normes qui placent la Suisse en première ligne de la lutte contre le blanchiment, sauf peut-être dans quelques cantons de l'est faiblement accessibles, peut-être faut-il les faire faire par nos filiales ou nos succursales dans ces endroits-là ? Ma réaction est la même que la vôtre. Je me demande si des grands établissements, soit instrumentent eux-mêmes des mouvements financiers qui font l'objet de poursuites et qui n'ont pas fait l'objet des dénonciations conformément à l'arsenal juridique aujourd'hui en vigueur en Suisse ; soit le font faire par leurs succursales dans des centres offshore, avec des sociétés aux noms folkloriques que l'on trouve dans toutes les affaires de financement politique, de trafic d'armes, de corruption de fonctionnaires, etc. Nous allons devoir dire des choses sur ce que nous aurons vu ici et ailleurs. C'est un jugement que nous nous forgeons au fur et à mesure de nos rencontres. Pour l'instant, autant la franchise des procureurs nous a étonnés, car nous n'y sommes pas habitués dans notre pays, autant notre dialogue avec les représentants de la banque est plus retenu et pudique. Nous ne pouvons pas avoir des pudeurs-là. M. Edouard CUENDET : Juridiquement, les règles suisses interdisent aux banques d'utiliser leurs filiales à l'étranger pour détourner les lois suisses. M. le Rapporteur : La preuve que non. M. Denis MATHIEU : Ce n'est pas parce que vous ouvrez une filiale à Nassau que vous y commettez forcément des turpitudes. M. Edouard CUENDET : Il est des clients honnêtes qui tiennent à la confidentialité, même s'ils n'ont rien à cacher. M. le Rapporteur : S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi cherchent-ils à se dissimuler ? M. Edouard CUENDET : C'est la thèse de M. Bertossa qui dit : si vous n'avez rien à cacher, quel est le problème ? M. le Rapporteur : Où est le problème ? M. Edouard CUENDET : Il y a des gens qui n'ont pas envie que M. Bertossa vienne regarder. M. le Rapporteur : Pourquoi ? M. Michel Y. DÉROBERT : Je vais vous raconter une histoire amusante qui n'a rien à avoir avec la banque, mais beaucoup avec la montagne et avec le canton un peu éloigné du Valais. M. le Président : A l'est ! M. Michel Y. DÉROBERT : Il y a une vingtaine d'années, un guide de montagne prénommé René, que je connaissais, était allé accueillir un client belge qui n'était pas arrivé. En rentrant chez lui, vers quatre heures du matin, il se fait arrêter par le garde-chasse qui l'accuse d'être allé braconner. René lui répond : « Pas du tout, je suis allé chercher un client belge qui n'est pas venu ». Soupçonneux, le garde-chasse lui ordonne d'ouvrir son coffre. René lui dit : « Si j'ouvre mon coffre et qu'il est vide, je t'envoie dans le précipice ; s'il contient quelque chose, tu pourras me mettre une amende ». Il n'a pas ouvert son coffre. Ce n'est peut-être pas transposable au premier degré en langage de procureur mais c'était lui faire un procès d'intention ; tout comme se serait faire un procès d'intention à la nation russe que d'interdire à toutes les banques et à tous les agents immobiliers d'entrer en relation d'affaires avec un Russe. Ce serait une solution mais ce serait proche du racisme. M. le Rapporteur : M. Dérobert, n'employons pas des mots excessifs. Je crois qu'en Suisse, comme en France et comme dans tous les pays où il est permis de s'enrichir honnêtement, le secret bancaire existe et peut-être utilisé par quiconque agit dans le respect des lois. Quelle est donc l'utilité, pour quelqu'un qui est honnête, de rechercher la délocalisation de fonds dans un endroit où l'on sait que sont garanties l'opacité sur le plan bancaire et l'impunité judiciaire ? Voilà pourquoi nous sommes en train de qualifier ces pays de délinquants, car ce sont des pays qui prêtent à des délinquants non seulement le secret bancaire, mais aussi leur inertie et leur refus de coopération judiciaires. Nous sommes donc obligés de considérer que tous ceux qui vont chercher autre chose que ce qu'ils peuvent trouver sur le pas de leur porte, dans n'importe quelle banque honorable, pour des activités honorables, recherchent l'impunité. Que répondez-vous à cela ? M. Michel Y. DÉROBERT : Vous allez mettre à l'Index la totalité de la profession financière de la planète. M. le Rapporteur : Cela nous fera enfin des ennemis, car nous ne trouvons que des amis qui pensent comme nous. M. Edouard CUENDET : Vous faites une présomption ! M. le Rapporteur : Nous faisons ce que nous devons faire. Nous sommes les représentants de la Nation française, c'est-à-dire des députés de base, aux pieds crottés, élus par les paysans et les ouvriers ! Nous avons des préjugés comme les Suisses en ont d'une autre nature. Nous cherchons à faire prévaloir certains points de vue et nous sommes heureux de constater que les Suisses pensent comme nous. Vous ne voulez pas de cela. Que vont chercher ces gens aux îles Vierges britanniques ? Chaque fois que nous avons une transaction avec les îles Vierges britanniques, elle est toujours suivie, deux ans plus tard, d'une commission rogatoire. M. Michel Y. DÉROBERT : Je ne répondrai pas à cette question, car nous sommes en train de remonter la pente avec une certaine difficulté contre ce genre d'accusations très générales et très globales. M. le Rapporteur : Les miennes sont précises, M. Dérobert. Je vous ai donné des noms, qui figureront d'ailleurs dans le procès-verbal ! M. Michel Y. DÉROBERT : Tout à fait. Mais vous partez de l'idée qu'à partir du moment où l'on va faire une opération à tel endroit, on le fait pour de mauvaises causes. M. Edouard CUENDET : C'est une présomption ! M. le Rapporteur : Apportez la preuve. M. Edouard CUENDET : Il y a un problème de charge de la preuve. Vous violez largement la présomption d'innocence ! M. le Rapporteur : En matière de blanchiment, la France vient d'introduire le renversement de la charge de la preuve. C'est un des points sur lesquels nous aurons à travailler avec la Suisse à un moment ou à un autre. M. Michel Y. DÉROBERT : Prouvez que ce n'est pas du blanchiment ! M. le Rapporteur : Voilà les indices qui apparaissent : tant de millions en espèces, vous avez des relations avec un trafiquant de drogue. La loi française dit : « Prouvez que ce n'est pas du blanchiment ». C'est ce qui se passe pour la drogue. M. Denis MATHIEU : La Suisse le fait déjà pour la drogue. M. le Rapporteur : Voyez que nous n'apportons pas un arsenal de monstruosités juridiques sur la table des débats. M. Michel Y. DÉROBERT : Dans le domaine du blanchiment, un élément a été perçu par les banquiers d'une manière un peu étonnante. Quand on a parlé de blanchiment, au départ, il s'agissait de drogue, de prostitution, de trafic d'armes, de la grande criminalité, du crime organisé. Le premier cas de blanchiment traité en Suisse... M. Edouard CUENDET : ...concernait quelqu'un qui avait caché 120 000 francs suisses dans un pot de fleurs sur son balcon. C'était un petit dealer local. Le but n'était pas atteint. M. le Rapporteur : Il ne les avait pas déposés dans une filiale offshore du Crédit suisse ? M. Edouard CUENDET : Pas du tout, dans un pot de fleurs ! M. Michel Y. DÉROBERT : C'était « off-flat », pas offshore. Depuis l'entrée en application de la législation anti-blanchiment, nous avons donné une définition assez large, qui est en train d'entrer en vigueur dans la plupart des pays. Le Japon ne l'a pas encore appliquée. Au Japon, on ne blanchit que l'argent de la drogue. M. Edouard CUENDET : Vous avez parlé de rattrapage. Je ne pense pas que l'on puisse parler de rattrapage, car nous n'avons jamais été vraiment en retard en matière de lutte contre le blanchiment. Déjà, dans les années soixante-dix, l'Association suisse des banques privées a édicté des directives extrêmement strictes. Il y a des pays européens qui étaient beaucoup plus en retard que la Suisse. Le terme de « rattrapage » ne me paraît pas tout à fait adéquat. M. le Président : Parmi la quinzaine d'adhérents de votre Groupement, des déclarations de soupçon ont-elles été émises dans les dix-huit derniers mois ? Puisque l'on peut saisir directement l'autorité judiciaire sans passer par l'autorité administrative, êtes-vous au courant de signalements de ce genre ? M. Michel Y. DÉROBERT : Oui. Je ne vous fournirai pas d'indications. Le vrai problème que vous allez avoir à résoudre avec tous les banquiers de la planète, c'est que lorsqu'ils dénoncent un de leurs clients, ils ne le font vraiment pas de gaieté de c_ur. Il vous a peut-être abusé, il vous a peut-être donné, comme c'est arrivé dans un cas, un vrai-faux passeport. Il était une autre personne qui avait d'autres recommandations. Vous vous apercevez tout d'un coup que ce vrai-faux passeport est vraiment faux, même s'il a été émis par l'autorité nationale. Vous êtes alors pris de doute, vous téléphonez discrètement à l'autorité en prenant bien soin que les autres clients ne le sachent pas, car même s'ils n'ont strictement rien à se reprocher, ils n'aiment pas l'idée que leur banquier a une double allégeance. M. le Président : Nous avons une grosse affaire de blanchiment en France, où les fonds sont arrivés en Suisse. Comme l'affaire est en cours, je ne vous donnerai pas les noms. On a envoyé une commission rogatoire, qui est revenue. L'argent qui était dans la première banque est parti vers trois autres banques, parmi les plus prestigieuses de la place de Genève. Cela ne porte pas sur 100 000 francs mais sur des sommes comprises entre 1 et 2 millions de dollars. Il n'y a jamais eu de signalement. Compte tenu de l'origine des fonds, en fonction des normes élémentaires du code de déontologie ou des règles normatives, ces comptes n'auraient pas dû être ouverts. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas eu de signalement ? M. Edouard CUENDET : D'une part, on juge a posteriori. D'autre part, comme l'a dit M. Dérobert, cela peut être lié à l'introduction des gens. Ils ont pu avoir des références. Toutes les due diligences ont pu être exécutées sans que l'on puisse rien faire. M. le Président : Une fois que l'on s'en rend compte, ne serait-ce qu'à la lecture d'un journal, plutôt que de faire une déclaration de soupçon, n'a-t-on pas tendance à vouloir fermer le compte et à se débarrasser du client, comme l'a fait votre ami anglais ? M. Michel Y. DÉROBERT : Cela n'est pas conforme à la loi. M. le Rapporteur : Cela se produit-il souvent ? M. Michel Y. DÉROBERT : A mon avis, depuis que ce n'est plus conforme à la loi, cela n'arrive plus souvent. M. Denis MATHIEU : Toute la difficulté de la loi est de définir le soupçon fondé. C'est là où se situe la frontière entre l'obligation et le droit de dénoncer. Il n'existe aucune définition du soupçon fondé. M. Jacky DARNE : Il y a des indices. M. Denis MATHIEU : Il y a des indices, mais il y a toute une zone grise. Entre la page blanche et la page noire, vous trouvez toutes les nuances de gris. M. Jacky DARNE : C'est le problème général de la déontologie. C'est l'art de la chose et sa mise en _uvre. M. Denis MATHIEU : Cela vient avec la pratique. M. Jacky DARNE : La convention relative à l'obligation de diligence des banques est conclue entre l'Association suisse des banquiers, d'une part, et les banquiers signataires, d'autre part. Existe-t-il des banquiers non-signataires ? M. Michel Y. DÉROBERT : Non, ils sont tenus par cette convention. M. Edouard CUENDET : Ce texte est considéré comme la référence en la matière. Si on tombe dans une affaire de blanchiment pénal, les problèmes de soupçon et de diligence, seront précisément jugés à l'aune de cette convention, devenue le standard minimum de la profession. Cela reste une convention de droit privé mais elle est considérée comme l'usage dans toutes les banques. M. Denis MATHIEU : Elle est négociée avec la Commission fédérale des banques. M. Michel Y. DÉROBERT : Si vous ne respectez pas cette convention, la Commission fédérale des banques sera fondée à estimer que vous ne respectez pas l'article 3 de la loi sur les banques, sur les garanties d'une gestion irréprochable. M. Jacky DARNE : Depuis qu'elle existe, avez-vous utilisé la commission de surveillance ? M. Edouard CUENDET : Oui, elle est très active. M. Jacky DARNE : A quel rythme ? M. Edouard CUENDET : Un rapport est publié à ce sujet. M. Michel Y. DÉROBERT : Le rapport de la commission de surveillance est un document que vous devriez avoir. M. Edouard CUENDET : La commission de surveillance est dirigée par un ancien juge du tribunal fédéral. M. Denis MATHIEU : Les amendes peuvent atteindre dix millions de francs suisses. M. Edouard CUENDET : Il y a une jurisprudence. M. le Président : Merci de votre accueil et merci d'avoir répondu à nos questions. Audition de M. François de RANCOURT, accompagné de MM. Pierre-Yves DESPLAND, Claude-Alain BURNAND, Secrétaire général et de Marcel NAEF, Directeur des affaires juridiques (compte-rendu de l'entretien du 30 septembre 1999 en Suisse) Présidence de M. Vincent PEILLON, président M. François de RANCOURT : Je voudrais, tout d'abord, vous présenter la banque Paribas Suisse, une des plus rentables banques étrangères de ce pays qui réalise un résultat net d'environ 600 millions de francs. Installée depuis 125 ans, c'est la plus ancienne et aussi la plus capitalisée des banques étrangères en Suisse. Elle occupe une position dominante et emploie quelque 700 personnes, avec des implantations à Bâle, Zurich, Lugano. Je vous suggère que vous nous indiquiez tout d'abord quels sont les renseignements obtenus par la mission d'information, afin que M. Burnand puisse vous expliquer comment nous traitons ces sujets dans la réalité. M. le Président : Votre activité principale est-elle la banque d'affaires ou la gestion de fortune ? M. François de RANCOURT : Notre activité s'exerce à 55 % dans le domaine de l'investissement et à 45 % dans celui de la gestion. Nous avons ici notre centre de financement du négoce avec les pays de l'Est et une importante activité « grandes entreprises ». Nous avons à Zurich une activité de marché, c'est-à-dire d'émission d'obligations pour des sociétés étrangères. Nous exerçons enfin une très importante activité de trésorerie et de change. Pour nous, en Suisse, la banque d'investissement est plus importante que la banque de gestion, même si cette dernière représente quelque 20 milliards de FS. M. le Président : Après avoir rencontré les responsables des autorités de contrôle, nous voudrions savoir quels mécanismes d'alerte vous avez concrètement mis en place afin de détecter les clients pouvant poser problème, soit avant, soit depuis l'instauration de la LBA. M. Claude-Alain BURNAND : Vous le savez, la Suisse a été, en 1991, l'un des premiers pays à se doter d'une législation anti-blanchiment. Son champ est d'ailleurs extrêmement large car si, dans de nombreux pays, elle s'applique uniquement à l'argent de la drogue, en Suisse, elle englobe les activités criminelles, c'est-à-dire tout délit mentionné dans le code pénal qui est passible d'une peine de réclusion criminelle, c'est-à-dire aussi bien le brigandage, l'enlèvement, l'escroquerie, la corruption que le trafic de drogue auquel on pense toujours. Vous avez raison de noter que notre souci n'est né, ni de l'introduction dans le code pénal des articles 305 bis et 305 ter qui répriment à la fois le blanchiment proprement dit et le défaut de vigilance dans les opérations financières, ni de la LBA, puisque ces législations se sont, dans une large mesure, inspirées de la pratique. Je rappelle que la Suisse a introduit dès 1977 un code de conduite - ou plutôt, comme disent les anglais, un code d'autoconduite - qui est la fameuse Convention de diligence, laquelle ne faisait que codifier une pratique antérieure. Depuis son introduction en 1934, le secret bancaire n'a jamais été absolu. Il a toujours pu être levé par un juge pénal suisse dans des cas de délinquance de droit commun. Cette introduction historique était destinée à vous montrer que pour nous, secteur bancaire, cette préoccupation n'est pas vraiment une nouveauté. Au quotidien, il convient de distinguer deux étapes : l'acceptation d'un client et la vie d'un compte. Pour l'acceptation d'une nouvelle relation, nous ne déléguons aucune autorité à un gestionnaire, quel que soit son statut hiérarchique. Toute nouvelle relation, toute ouverture de compte passe par un comité d'acceptation qui se réunit presque quotidiennement et qui comprend à la fois des spécialistes du métier concerné - gestion privée pour les comptes en gestion, crédit négoce pour les comptes commerciaux - de la déontologie et des affaires juridiques. M. le Président : Quel que soit le montant ? M. Claude-Alain BURNAND : Nous n'avons pas de limite. M. le Président : Vous vous réunissez même pour l'ouverture d'un compte pour deux mille dollars ? M. François de RANCOURT : Nous n'acceptons l'ouverture d'un compte qu'à partir de 500 000 FS, soit environ 2 millions de francs français. M. Claude-Alain BURNAND : Il y a toujours des exceptions dans la mesure où un petit compte est susceptible de grandir ou parce qu'il est l'accessoire d'un plus grand compte. Il arrive fréquemment que, pour des raisons liées à nos relations avec nos clients, nous ne puissions pas refuser l'ouverture d'un compte, même s'il ne s'annonce pas aussi rentable que nous le souhaiterions. Ce comité examinera l'identification de la personne, les raisons fournies de son entrée en relation avec nous, les personnes rencontrées, les références. Soit il l'acceptera ; soit il demandera un complément d'information ; soit il la refusera, ce qui se produit d'ailleurs assez rarement, pour deux raisons principales. D'une part, les gestionnaires réalisent un travail préalable et ne décident de la présentation d'un compte que lorsqu'ils pensent qu'il sera accepté. Dans le cas contraire, dans leur conversation avec le client potentiel, ils lui font comprendre avec diplomatie que nous ne souhaitons pas une entrée en relation. D'autre part, depuis une dizaine d'années, l'image de la Suisse s'est modifiée. Comme le disait le représentant d'une autorité régulatrice américaine, aujourd'hui, les blanchisseurs savent qu'il faut éviter la Suisse. Par la suite, il peut arriver que la vie d'un compte nous amène à revoir notre relation, soit parce que des événements nous paraissent curieux, soit parce que le fonctionnement ne correspond pas à ce que l'on nous avait indiqué au départ. Le cas typique est celui d'une personne qui nous a dit vouloir une gestion patrimoniale et qui reçoit et effectue de nombreux virements. Nous devons alors nous demander si de telles opérations sont compatibles avec une gestion patrimoniale. Des cas peuvent être portés à notre connaissance par les gestionnaires ou par des missions d'inspection ou de contrôle de nature déontologique. M. Despland va maintenant vous dire quelques mots sur cette déontologie qui, bien qu'entrant dans le cadre spécifique de la législation suisse, est la déontologie du groupe Paribas, telle qu'elle s'applique en France, en Suisse, en Angleterre ou aux Etats-Unis. M. Pierre-Yves DESPLAND : Chaque établissement bancaire a développé, ces dernières années, une fonction déontologique ou assimilée, car toutes les réglementations incitent à le faire. Toutefois, au sein du groupe Paribas, la reconnaissance d'une fonction déontologie existe depuis de très nombreuses années. A Paribas Suisse, j'ai exercé deux fonctions parallèles : la fonction d'audit et la fonction de déontologie, que nous avons pris la décision stratégique de séparer, il y a deux ans, pour donner plus d'importance encore à la déontologie. M. François de RANCOURT : Lorsque vous parlez d'audit, il s'agit d'inspectorat général. M. Pierre-Yves DESPLAND : La fonction de déontologie se veut une fonction d'accompagnement et de prévention. Le groupe Paribas entend adopter une unité de comportement dans la conduite de ses affaires, que se soit en Italie, aux Etats-Unis, en Suisse ou à Hong-Kong. C'est un élément très important. Cette fonction est pleinement intégrée et reconnue dans l'état-major du groupe en France. Nous avons développé des codes de déontologie qui s'inspirent du code de déontologie du groupe. Il existe un code international et pour chaque territoire : français, suisse, américain, anglais, italien et autres. Nous avons défini un code de déontologie qui intègre à la fois la philosophie du groupe et les spécificités des législations locales. Je le souligne car mes contacts avec d'autres banques m'ont appris que la fonction déontologie était différente d'un établissement à l'autre. Sur le plan pratique, nous avons des consignes pour ne pas avoir affaire à certains types d'activités et de clientèles. Ces raisonnements sont affinés par des considérations particulières propres à chaque territoire. Par exemple, pour notre activité de gestion privée, à l'égard des intermédiaires financiers suisses, nous avons défini nos propres critères afin de sélectionner les personnes avec lesquelles nous souhaitons avoir des relations d'affaires. M. François de RANCOURT : Pour la clientèle de négoce, puisque nous sommes un grand financier des pétroles russes, tout mouvement de plus de 100 000 FS en caisse fait l'objet d'un suivi sur les comptes. M. Pierre-Yves DESPLAND : Parmi les opérations sensibles, figurent les opérations en cash. Beaucoup de mouvements d'apport ou de retrait se traitent au guichet par des opérations de caisse. Notre dispositif prévoit un système de déclaration. M. Burnand l'a mentionné mais je le souligne : chaque relation de compte a un responsable et un répondant dans la banque. Comme les législations anti-blanchiment font porter la responsabilité aussi bien sur le chargé de relations que sur la banque elle-même, chacun est hautement sensibilisé à ne pas prendre des risques indus à son niveau. Le gestionnaire responsable d'un client qui veut effectuer une importante transaction en espèces doit, sous sa signature, faire une déclaration aux responsables de la déontologie avec la motivation de la transaction. Il revient à ce service d'apprécier, dans le contexte, l'importance du patrimoine du client et la finalité de l'opération. Il existe d'autres opérations sensibles : transferts internationaux sans indication complète de l'expéditeur ou du bénéficiaire, opérations en suspens et comptes dont le fonctionnement est différent de celui prévu à l'origine. De nombreuses entrées et sorties sur un compte en gestion patrimoniale est un phénomène inhabituel sur ce genre de compte. Il est alors soumis à une analyse particulière et à une appréciation pour connaître les tenants et les aboutissants des opérations réalisées, déterminer la finalité du compte, le profil du client ordonnateur, la justification des opérations, et décider s'il est souhaitable de maintenir la relation. M. François de RANCOURT : On peut aussi effectuer des contrôles a posteriori par informatique pour examiner les mouvements. M. Pierre-Yves DESPLAND : Autant la procédure d'ouverture d'un compte se déroule entre personnes bien pensantes, autant toutes les analyses relatives aux mouvements de comptes doivent faire appel à l'utilisation exhaustive des outils informatiques permettant de faire des rapprochements. Nous avons développé, là aussi, des procédures informatiques pour détecter les comportements anormaux, les opérations particulières et d'autres éléments. Il s'agit, sur une masse de transactions très importante, de faire ressortir celles qui ont un comportement particulier ou anormal et de procéder à des analyses permettant de comprendre ces opérations, de déterminer dans quelle mesure elles sont justifiées, de les mettre en relation avec le client concerné, etc. M. le Président : Avez-vous eu déjà l'occasion de faire des déclarations de soupçon au sens de la LBA ? Avant la mise en _uvre de la LBA, avez-vous saisi les parquets ou les juges d'opérations qui vous semblaient difficiles ou bien gérez-vous cela à votre propre niveau ? Avez-vous un exemple concret de déclaration de soupçon dans l'année qui vient de s'écouler ? M. Pierre-Yves DESPLAND : La codification d'une annonce au système judiciaire ou au Bureau de communication est très bien établie. On sait très bien à quel moment on doit la faire. Le Bureau de communication est de formation récente. Depuis qu'il existe, nous n'avons pas eu de déclaration à lui faire. Il est très bien qu'il en soit ainsi. C'est peut-être une preuve de l'efficacité de notre dispositif, qui n'est pas tout à fait nouveau non plus. M. Jacky DARNE : Peut-on avoir une idée du nombre d'opérations difficiles dont vous êtes saisi, en tant que responsable de la déontologie, par les gestionnaires de comptes ? De telles interrogations sont-elles quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, ou de l'ordre de quelques-unes par an ? M. Pierre-Yves DESPLAND : J'ai chaque semaine plusieurs questions des gestionnaires sur des transactions. J'essaie de leur inculquer que les discussions doivent intervenir avant qu'une opération ait lieu. On me dit souvent : « Un client me demande de faire telle opération, qu'en pensez-vous ? ». On examine les modalités relatives à cette opération et on essaie d'intervenir avant d'être placé devant une situation déjà engagée. M. le Président : Il semblerait que le Bureau de communication ait lui-même une certaine difficulté à donner un contenu très précis à la notion de relation d'affaires. Dans le cas où vous refuseriez, en fonction de vos critères, d'accepter l'ouverture d'un compte, pour des raisons liées au doute ou au soupçon que vous pourriez avoir sur l'origine des fonds, vous sentiriez-vous néanmoins l'obligation de faire une déclaration ou bien vous en tiendriez-vous là ? M. Claude-Alain BURNAND : La réponse est contenue dans la loi et dans les directives de la Commission fédérale des banques. En principe, lorsque nous déclinons une relation d'affaires, nous n'avons pas l'obligation d'annonce, sauf en cas de soupçons manifestement fondés, ce qui est très rare, voire inexistant. Lorsque dans une conversation, nous avons l'impression qu'une personne qui veut entrer en relation de compte n'est pas quelqu'un de sérieux, nous n'avons pas d'éléments concrets qui nous permettent de considérer que les fonds qu'il nous propose sont en relation avec un délit. On pourrait imaginer que vienne nous voir une personne dont nous aurions lu le nom dans un journal, qui nous aurait été envoyée par un de nos correspondants étrangers. En ce cas, nous aurions la faculté, voire l'obligation, de dénoncer, mais c'est une situation théorique. Un des prédécesseurs de M. Despland qui s'occupait de la déontologie à Paris nous disait : la très grande difficulté vient de ce que les transactions illégales des criminels et les blanchisseurs ont pour caractéristique d'être rigoureusement identiques à celles, légitimes, des clients honnêtes : à savoir, des apports et des retraits de caisse, des transferts vers le compte ou en dehors du compte, des achats et des ventes de titres. Pour fonder des soupçons d'illégalité ou de blanchiment, il faut, comme l'indique également la circulaire de la Commission fédérale des banques, non pas un élément mais un faisceau d'éléments. Il est très rare, voire inexistant, que nous les ayons lors d'une demande d'opération refusée. M. le Président : Votre banque d'origine française a de nombreuses succursales à l'étranger. Qu'est-ce qui peut attirer des clients à Paribas Genève ? Quels services offrez-vous ici qu'ils ne trouveraient pas à Paribas Paris ? M. François de RANCOURT : Avant de vous répondre, j'insisterai sur l'importance du personnel en ce qui concerne les relations de compte. Nous sommes très attentifs aux personnels que nous recrutons, parce que c'est par-là que peuvent arriver des incidents. Cela implique des entretiens, des tests, des analyses graphologiques, etc. Tout membre de la direction, tout cadre passe par un système de sélection strict. De plus, dans notre banque - j'étais contrôleur général du groupe avant de venir ici - ont été mis en place des systèmes de contrôle, aussi bien sur le plan de l'inspectorat et du contrôle interne que de la déontologie. Nous avons des systèmes de contrôle qui portent sur le fonctionnement, les recrutements et les clients que nous acceptons. Ce n'est peut-être pas pareil partout. Pourquoi venir à Paribas Suisse ? Comme pour la place financière de Londres, pour une raison de gestion de patrimoine. Le marché de l'euro s'est développé à Londres parce que toutes les experts - fiscal, juridique, conseil, etc. - sont venus assister les banques. De même, les gens viennent chercher ici une expertise. Il ne s'agit pas seulement pour eux de venir ouvrir un compte et d'éviter de payer des impôts. Rencontrant souvent différents problèmes familiaux, ils viennent chercher ici une structure à même de gérer leur fortune. Ils trouvent une expertise dans la banque, dans la gestion de leurs actifs, en matière juridique, qui n'existe pas nécessairement ailleurs. C'est coûteux. Nous le faisons payer. M. Burnand, juriste connu et expert en matière de trusts et autres, en sait quelque chose. Nous avons des clients mondiaux, pas seulement français mais aussi d'Europe du nord, d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient. Au cours de ses 125 ans de présence en Suisse, Paribas s'est construit une réputation d'expertise. Si nous avons les montants de fonds sous gestion que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons cette compétence de haut niveau, qui d'ailleurs coûte cher. M. le Président : A l'heure du TGV et de l'Internet, cette expertise présente à Genève ne pourrait pas s'exercer à Paris ? M. François de RANCOURT : Non, il faut le contexte. M. le Président : Vous avez évoqué rapidement la question fiscale. Vous dites qu'elle est mineure, que sur les 20 milliards de FS que vous avez évoqués, la question fiscale est tout à fait secondaire. M. François de RANCOURT : J'essaie de faire comprendre à certains de nos visiteurs qui pensent que la Suisse est une sorte de paradis fiscal, que pour ceux qui y vivent, c'est loin d'être le cas. A Genève, l'impôt sur la fortune est peut-être plus lourd qu'en France, à tel point que certains Suisses partent vivre à Londres, à Monaco ou ailleurs. M. Claude-Alain BURNAND : Il est exact que l'impôt sur la fortune existe en Suisse depuis une cinquantaine d'années. Il commence à 100 000 FS pour un couple - soit 400 000 francs français - ce qui est beaucoup plus strict que les 4,7 millions de francs français. M. François de RANCOURT : Tout y passe, votre voiture et même les bijoux de votre épouse ! M. Claude-Alain BURNAND : M. de Rancourt a raison d'insister sur notre tradition. Je vous rappelle que les banquiers genevois étaient traditionnellement les banquiers des rois de France et que Necker a inventé, en 1770-1780, la bancassurance avec des emprunts assis sur les têtes de trente jeunes filles de Genève en bonne santé. Le bénéficiaire empruntait un capital pour pouvoir faire ce placement. Certains banquiers privés genevois actifs aujourd'hui ont commencé leurs activités avant 1800. Il y a donc une longue tradition. A l'époque où, malheureusement, l'Europe subissait des carcans, les Suisses n'ont jamais eu, sauf pendant la période 1939-1945, de véritable contrôle des changes. Pour un banquier suisse, traiter dans trente-six monnaies, passer d'une action japonaise à une obligation hollandaise ne présente aucune difficulté. C'est extrêmement important parce que les clients privés veulent pouvoir diversifier leurs investissements. C'est un rôle qu'historiquement nous avons partagé avec Londres. Actuellement, Londres et la Suisse détiennent probablement la majorité du marché de la gestion privée. Avec l'ouverture des marchés et une internationalisation plus grande nous essayons de faire en sorte que le service soit aussi bon à Singapour qu'à Genève. Un client viendra à Genève plutôt qu'à Singapour pour des raisons géographiques, de préférence, de « sympathie » ; il se sentira plus à l'aise ici. Il y a aussi une caractéristique assez remarquable, de nombreuses langues sont parlées dans cette banque : français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, suédois, arabe, grec, japonais... M. François de RANCOURT : Russe ! M. Claude-Alain BURNAND : Oui, certainement. Si cela est courant chez nos concurrents de Genève et de Zurich, si cela commence d'être le cas à Londres, en revanche, aux Bahamas, le client qui ne parle pas anglais est mal à l'aise. Pour une relation patrimoniale familiale destinée à s'inscrire dans la durée, il est très important de pouvoir s'exprimer dans sa langue. M. Jacky DARNE : Je ne doute pas de l'excellence de votre banque et de vos conseils, ni que cela explique votre réussite et le bénéfice que vous tirez de l'exploitation ici. En réponse à une question voisine, M. Marti, conseiller d'Etat du Tessin, nous disait hier : « Si j'avais à conseiller des personnes qui veulent blanchir de l'argent, je les inciterais à choisir les établissements les plus honorables, car cela permettrait une utilisation du capital incontestable et dans les meilleures conditions ». On peut donc imaginer qu'un certain nombre de criminels du monde cherchent à placer de l'argent chez vous. Estimez-vous que vos procédures permettent d'exclure ce risque ou bien que, malgré vos procédures, compte tenu de l'origine des clients qui sont les vôtres, de l'argent peut être blanchi et que, d'une façon ou d'une autre, la corruption, le marché de la drogue, les marchés illégaux existent par ces mécanismes ? Puisque vous avez une expérience, une pratique, des outils qui ne datent pas de la loi contre le blanchiment, estimez-vous que l'on peut faire mieux ou au contraire que les outils actuels suffisent amplement ? M. Claude-Alain BURNAND : Ce sont les statistiques de l'ONU ou du GAFI qui rappellent la fameuse statistique des délits non recensés. Si ces statistiques sont à peu près exactes, alors il y a de l'argent sale dans tout le système bancaire : à Paris, à Londres, à Amsterdam, à Tokyo, à New York... et à Genève. Il est bien entendu impossible de vous garantir que nous n'aurons jamais chez nous un mouton noir. Nous avons essentiellement une clientèle d'origine étrangère. Si une personne arrive à tromper pendant des années les autorités de son pays, à faire croire qu'elle est un commerçant honorable alors que ce n'est qu'une couverture et qu'elle exerce d'autres activités, il nous est évidemment difficile d'être plus forts que le FBI et Scotland Yard réunis. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, c'est la meilleure réponse que je puisse vous fournir. M. le Président : Il existe aujourd'hui de nombreuses règles et lois contre le blanchiment, mais croyez-vous qu'elles soient suffisantes ? En tant que praticien, pensez-vous qu'il existe encore des espaces d'insécurité juridique et que des améliorations pourraient être apportées ? M. Claude-Alain BURNAND : Nos concepts de légalité et d'illégalité s'appliquent à un système juridique donné, d'inspiration occidentale, anglo-saxonne et latine, et certains pays ne criminalisent pas certains comportements. Concernant les marchés publics, il est de notoriété publique que les pays du Moyen-Orient n'établissent pas de distinction entre argent privé et argent public de la même manière que nous le faisons en Suisse, en France ou en Angleterre. Dans ces monarchies, d'une certaine façon, le système de la cassette royale en vigueur sous Philippe le Bel est resté en vigueur. Certains virements, certains versements à des personnages de ces pays sont parfaitement légaux dans les pays en question. Le seraient-ils demain s'il se produisait une révolution islamique ? Il est permis d'en douter. Le concept de légalité évolue. Notre système n'est pas parfait car la perfection n'est pas de ce monde, mais il est très solide. De plus, ce n'est pas un système en circuit fermé, au centre d'une cage de Faraday. Vos interlocuteurs vous ont certainement dit que la Suisse accorde l'entraide judiciaire aux Etats étrangers, avec un libéralisme qui contraste avec la retenue dont fait preuve le Royaume-Uni. Des membres de la magistrature et de la police judiciaire me disaient récemment : « Nous jouons le jeu mais nos collègues anglo-saxons nous répondent rarement ». Le secret bancaire a toujours été levé en cas de soupçon de crime ou de délit, y compris dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale. M. François de RANCOURT : La Suisse, avec ses lois, avec sa responsabilité des individus, se sent un peu persécutée. Nous pensons que c'est totalement injustifié eu égard aux lois en vigueur, aux actions judiciaires d'entraide entreprises, à la responsabilité que chacun d'entre nous a et aux peines que nous encourons individuellement en tant que membres de la direction de banques. M. Claude-Alain BURNAND : La sanction pénale en Suisse est uniquement applicable à des individus. Il n'existe pas encore de délits et de peines applicables aux sociétés. L'article du code pénal sur le défaut de vigilance dans les opérations financières est intéressant dans la mesure où, contrairement à la plupart des lois, il ne s'applique pas à l'ensemble de la population mais uniquement aux professionnels de la finance. Il a encore plus sensibilisé les employés, les cadres et les dirigeants de banque, parce qu'ils savent, et on le leur redit dans les séminaires de formation, que s'ils acceptent de l'argent d'origine criminelle, s'ils n'ont pas fait leurs diligences ou si, les ayant faites, ils passent outre, ils sont personnellement responsables et peuvent être emprisonnés. M. le Président : Pour tempérer votre optimisme, je rappellerai que dans une affaire très importante de délit d'initié concernant une grande banque française, deux commissions rogatoires relatives à des comptes ouverts dans de grands établissements financiers de cette place que vous connaissez bien, impliquant des personnalités importantes et de grands groupes français, émises par les juges en 1991 et 1992, n'ont jamais eu de suite. En juin, la chancellerie française a été obligée de déléguer une mission spéciale afin d'éviter la prescription de l'affaire, puisqu'il n'y avait jamais eu de retour de la commission rogatoire. J'entends bien ce que vous dites sur les commissions rogatoires ; mais dans quelques cas, on se dit qu'il y a tout de même comme une petite résistance. Cela peut être dû tout simplement à l'inefficacité du juge, mais on peut se demander s'il n'y a pas d'autres blocages que l'on comprendrait par ailleurs. Je citerai une autre affaire concernant une banque installée en France qui se livrait à des malversations directement liées au blanchiment de l'argent de la drogue. Le responsable de cette banque a été emprisonné, un autre responsable a été placé sous contrôle judiciaire. Une commission rogatoire a été envoyée en Suisse. Il y a eu un premier retour concernant des dépôts effectués dans une petite banque, mais ce compte conduisait à de grandes institutions financières suisses. Or la commission rogatoire concernant ces grandes institutions financières suisses ne revient pas très rapidement. Ce sont de très grandes institutions qui sont soumises aux mêmes règles que vous. On découvre là des comptes de petits truands d'un ou deux millions de dollars. Ce sont des petites sommes mais aucune des obligations n'a été respectée et l'entraide judiciaire fonctionne mal. En tant que praticien, vous avez dû avoir connaissance de telles affaires, en plus grand nombre que moi. Est-ce dû à un facteur humain, à des juges qui font mal leur travail ? Ou bien est-ce tout à fait marginal ? M. Claude-Alain BURNAND : Je ne connais pas les cas dont vous parlez mais je sais que mes collègues du barreau de Genève se plaignent souvent de ce que les juges délaissent les affaires locales pour pouvoir mieux se consacrer aux affaires internationales. La loi sur l'entraide pénale a été révisée récemment afin de réduire les possibilités de recours. Il existe des possibilités de recours qui sont tout à fait justifiées. Si un truand achète une voiture à un garagiste, celui-ci n'est pas son complice. Si on découvre que du compte du truand sont partis 100 000 FS destinés à l'achat d'une Mercédès, l'opération est tout à fait légitime. Il est normal que les tiers de bonne foi non impliqués aient des possibilités de protection. Cela dit, la jurisprudence est extrêmement limitative dans ce domaine, puisqu'elle que ce n'est pas à la Suisse, Etat requis, de se substituer à l'Etat requérant pour savoir si une personne est ou non membre d'une organisation. Je collecte les informations et tout ce que je trouve, je décide, par une ordonnance de clôture, de le communiquer à mon confrère étranger. Contre cette ordonnance-là, c'est actuellement la seule possibilité de recours. M. François de RANCOURT : Monsieur Naef, vous devriez dire que vous êtes bombardé de demandes. M. Marcel NAEF : Effectivement nous recevons régulièrement depuis des années, au rythme de deux à trois par semaine, des ordonnances de juges d'instruction, du procureur local ou du procureur de la Confédération, adressées à des établissements bancaires d'une certaine taille. Cela entraîne des recherches importantes afin de déterminer si une, dix ou trente personnes ou sociétés qui se trouvent sur une liste ont été un jour titulaires d'un compte dans notre établissement, si telle personne bénéficiait d'une procuration ou si telle autre personne était ayant droit économique. Ces recherches doivent toujours être effectuées séance tenante, car si nous devions avoir le compte d'une des personnes inquiétées, nous devrions immédiatement le bloquer puis remettre dans un délai de deux à trois semaines l'ensemble de la documentation de compte au juge d'instruction. Je ne sais pas dans quelle proportion nous sommes touchés mais il nous arrive d'avoir des blocages, d'avoir eu des clients inquiétés... M. François de RANCOURT : Oui. M. Marcel NAEF : ...auquel cas, nous bloquons le compte et nous transmettons les documents. Il ne me souvient pas que nous ayons fait un jour de l'obstruction à la remise. Cela n'est pas notre rôle. M. François de RANCOURT : Par contre, il est anormal qu'une information donnée automatiquement apparaisse in extenso trois mois plus tard dans Le Monde. M. le Président : C'est paradoxal, puisque le premier motif qui justifie les déclarations des banquiers à l'autorité de contrôle sont les informations qu'ils ont lues dans la presse. Il n'est pas bien de lire les informations dans la presse mais c'est tout de même utile, y compris pour les banquiers, afin de se prémunir contre les délinquants. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, en indiquant que des confrères vous envoyaient des articles de journaux. Nous sommes évidemment dans un jeu compliqué. M. François de RANCOURT : En l'occurrence, cela me paraît anormal. M. Claude-Alain BURNAND : M. de Rancourt veut dire qu'il est anormal que les extraits d'un rapport d'un juge d'instruction genevois à son collège parisien soient publiés dans Le Figaro avec un chapeau tout à fait charmant disant : le juge Perraudin a fait un travail remarquable, il a rendu son rapport et Le Figaro a pu le consulter. M. le Rapporteur : Je propose que nous revenions à des questions plus concrètes, car il serait difficile d'engager un débat sur le sens et l'utilité du secret de l'instruction. La directive publiée par la Commission fédérale des banques dresse une liste d'indices de blanchiment de capitaux. L'un d'entre eux, le dix-septième - « retraits fréquents de gros montants en espèces sans que l'activité du client ne justifie de telles opérations » - m'est venu à l'esprit en vous écoutant. Comment interprétez-vous cet indice ? A partir de quand considérez-vous que l'activité du client ne justifie plus de telles opérations ? Pouvez-vous nous donner des illustrations concrètes ? Vous êtes-vous vous-mêmes fixés une ligne interprétative pour chacun de ces indices ? Avez-vous discuté de la pertinence de ces interprétations avec la Commission fédérale des banques ? M. François de RANCOURT : Vous quittez le particulier pour entrer dans le commercial. Rares - hélas ! - sont les particuliers qui effectuent des mouvements de millions de dollars ou francs suisses. M. Pierre-Yves DESPLAND : Nous avons mentionné plusieurs éléments, dont la connaissance intime du client. Sur ce point, je vous rassure : nous nous remettons toujours en question, nous ne sommes pas dans un système figé, car les blanchisseurs évoluent et inventent de nouvelles techniques. Nous avons évolué dans le détail de l'information que nous exigeons sur le client, notamment son environnement familial et professionnel. Nous l'avons consigné assez précisément. Lorsque nous relevons une transaction importante pouvant révéler un comportement anormal, nous la mettons en relation avec les informations dont nous disposons sur l'activité du client, son contexte professionnel, afin de déterminer sa plausibilité avec la motivation qui est donnée. Si nous avons encore des doutes, nous engageons la conversation avec le gestionnaire responsable du compte en lui disant : connaissez-vous vraiment bien votre client ? Avant de procéder à une déclaration, nous devons avoir acquis le sentiment que ces opérations constituent un indice fondé. De nombreuses analyses préalables et opérations de détection sont effectuées au fil des jours. Nos clients italiens travaillent beaucoup en cash, d'autres pays travaillent beaucoup avec les montants en espèces. Une fois leur activité, leurs volumes, leurs chiffres d'affaires cernés et s'ils font un dépôt mensuel qui peut correspondre, on arrive à des éléments plausibles. S'il y a une disproportion, nous faisons une recherche plus approfondie. Oui, nous faisons des interprétations personnelles de ce genre. Nous les appliquons dans nos réflexes et nos analyses. M. Claude-Alain BURNAND : Dans des pays de l'ex-U.R.S.S., notamment les républiques d'Asie centrale, les gens ont une confiance limitée dans le système bancaire local. On sait que des transactions sur des matières premières doivent être réglées en cash, sinon le train ne part pas. Vous allez nous dire que cela ouvre la porte à des abus. Mais si l'on nous demande de l'argent pour régler, par exemple, un bateau chargé d'acier, il faut d'abord que le client soit un trader d'acier. Si c'est le boucher du coin, cela n'est évidemment pas plausible. Si un trader d'acier a revendu cette marchandise à une aciérie européenne et que l'on voit arriver le paiement d'une grande société allemande, nous n'avons aucune raison de mettre en doute ces affirmations. L'expérience du métier, la connaissance de nos clients nous conduisent à juger qu'une transaction est tout à fait plausible. Qu'une fois ce ne soit pas le cas, c'est le risque. M. Jacky DARNE : Si cela n'est pas plausible, vous faites votre investigation. Si vous vous apercevez alors que ce n'est pas un trader d'acier et qu'il fait autre chose, vous arrive-t-il alors de décider de fermer le compte et de ne plus travailler avec ce client ? A quelle fréquence cela se produit-il ? M. François de RANCOURT : En matière de comptes commerciaux, chaque transaction, par exemple, dans le négoce, doit être approuvée. Nous savons exactement à qui nous avons affaire. Ces gens-là empruntent contre des marchandises. Chaque transaction, qu'elle soit sur l'aluminium, l'acier, le coton ou le pétrole, est suivie. Un comité se réunit ici quotidiennement, étudie les transactions et les approuve. Pour moi, il est exclu que des mouvements en millions de dollars puissent avoir lieu sans que la transaction concernée soit étudiée. M. le Président : Il y a eu des fermetures de comptes ? M. François de RANCOURT : Des comptes ont été fermés, remis à zéro, mais tout ce qui atteint des montants comme ceux dont vous avez parlé est suivi attentivement. M. le Président : Nous croyons profondément à votre professionnalisme et nous connaissons à peu près le système. Mais lorsque des soupçons vous conduisent à fermer un compte, et j'ai entendu des banquiers très respectables dire qu'ils y avaient procédé, y a-t-il information de l'autorité judiciaire ? M. Pierre-Yves DESPLAND : On n'a pas nécessairement de soupçon fondé, il se peut qu'il s'agisse d'un type d'activité avec lequel la banque n'est plus en phase. On peut considérer qu'il ne vaut mieux ne pas persévérer, sans avoir pour autant les éléments qui conduiraient à une déclaration de soupçon. Nous avons beaucoup d'éléments dans une stratégie ou une politique de comportement de la banque et dans le choix des relations que nous devons entretenir. M. François de RANCOURT : Il se trouve que je m'occupe du métier bancaire, ici. Il y a, premièrement, l'ouverture de compte ; deuxièmement, les relations peuvent évoluer. C'est là où l'on tombe sur les opérations qui sont effectuées et là, nous ne traitons pas. Tout commence par le choix des clients. Oui, nous refusons des clients ; oui, nous refusons de traiter avec certaines personnes. Il en est peut-être d'autres qui traitent avec elles. Nous avons parlé du contexte juridique, nous avons parlé de la responsabilité personnelle, mais nous avons peut-être oublié de vous dire que chaque employé signe un code de déontologie. Les comptes commerciaux sont différents des comptes privés - nous n'avons pas tellement de comptes commerciaux - mais chaque compte est suivi de façon continuelle. Je pense que cela doit être le cas dans la plupart des banques. M. le Rapporteur : Vous dites que vous rapprochez de nombreuses informations et que votre relation avec vos clients est évolutive en fonction des besoins économiques à financer. Vous dites aussi que le cash était un moyen culturel d'organiser des transactions dans de nombreux pays, surtout lorsque les acteurs économiques n'ont pas confiance dans le système bancaire, ce qui est le cas dans des Républiques assez lointaines. Ma question sera assez brutale. S'il paraît normal que des Caucasiens ou des Tchétchènes viennent à Genève, en revanche, il paraît plus curieux que des Français ou des Italiens prennent le risque de passer la frontière avec du cash, même s'ils sont marchands de pizzas. Recevez-vous beaucoup d'Européens frontaliers qui viennent déposer de l'argent en cash, sachant que l'on peut faire confiance au système bancaire en France et en Italie ? La Carte bleue, la monnaie électronique, le chèque ont remplacé partout, même en Italie, les transactions en espèces. M. Pierre-Yves DESPLAND : Il y a beaucoup de mythes autour de votre question. Il y a eu des périodes historiques où les mouvements en cash, l'apport de valises et autres existaient. Il y a de nombreuses années que l'on ne voit plus ce genre de chose de cette façon-là. Certes, il y a toujours des opérations en cash, même pour des montants qui peuvent paraître importants, d'où la recherche de justifications. Les chèques ne s'utilisent plus. On n'a pas l'habitude de travailler avec des systèmes de chèques, on utilise soit les transferts bancaires, soit les transferts en espèces. D'où notre vigilance sur des transactions en espèces importantes, sur leur justification et leur contexte. M. François de RANCOURT : Si quelqu'un se présente en bas avec de l'argent plein les poches, nous voulons savoir d'où viennent ces fonds. Il n'est absolument pas question de les accepter si nous n'en savons pas la provenance. Les banques sérieuses, ici, ne se livrent pas à ce genre d'activité. Cela ne présente d'ailleurs aucun intérêt. M. le Rapporteur : Je suis ignorant de votre métier. C'est la raison pour laquelle je cherche à comprendre. Ma surprise vient de ce que vous considériez normal que l'on passe des frontières avec de grosses quantités d'argent, non pas pour ouvrir un compte, puisque c'est le cas de certains de vos clients habituels. Cela pose le problème de l'interpénétration entre les circuits de financements légaux, naturels, économiquement justifiés et la dilution d'argent illégal et sale dans l'économie. Les magistrats nous ont d'ailleurs expliqué hier que le primo-blanchiment n'avait pas lieu ici, mais ailleurs et que l'on était plutôt en phase deux ou trois du recyclage. Vous paraît-il normal qu'au vu des justifications que vous donne un client qui travaille habituellement avec des espèces, vous acceptiez - puisque votre activité est essentiellement tournée vers le financement de non-résidents - que celui-ci puisse passer les frontières avec du cash, avec les problèmes de traçabilité et de justification de l'origine des fonds que cela pose ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Nous avons à remplir un devoir de due diligence sur la provenance des fonds. Nous sommes très sévères sur ce point, mais il n'est pas totalement anormal que l'on puisse effectuer des transactions en espèces. Tout ne se fait pas par transfert bancaire. M. Claude-Alain BURNAND : Une loi sur la monnaie est en préparation en Suisse, puisque le franc suisse a été déconnecté de l'or. La lecture du projet de loi m'a beaucoup amusé car il prévoit l'obligation d'accepter les billets de banque en cours, sans limitation de montant. Dans notre métier, on a, d'un côté, une obligation d'accepter et, de l'autre côté, une obligation de refuser. M. le Président : Peut-on avoir une idée des montants de ces transactions en espèces ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Nous travaillons avec un système de déclaration à partir de 100 000 FS. Toutes les transactions sont analysées et passées au peigne fin. Pour des montants inférieurs, nous appliquons des routines à même de détecter des opérations répétitives. M. Jacky DARNE : M. de Rancourt, vous avez dit que vos collaborateurs signaient un code de déontologie. Auparavant, vous avez indiqué que vous établissiez une distinction entre l'audit et la déontologie. J'aimerais que vous m'éclairiez davantage sur la mise en _uvre des procédures pour l'ouverture d'un compte et pour les opérations. Vos collaborateurs ont-ils un guide de procédure écrite ? La documentation qui est fournie au comité chargé de statuer sur les ouvertures de comptes est-elle élaborée suivant des règles précises, en fonction de fiches et de commentaires argumentés de l'agent ? Nous avons parlé des transactions en espèces mais quelle est la procédure pour toute transaction ? Doit-elle être justifiée par une note écrite de l'agent, par la fourniture des éléments ou cela fait-il simplement l'objet d'un travail en direct, sans trace ? Indépendamment de la vérification du code de déontologie, quels sont les outils internes et externes de réviseurs qui permettent de s'assurer que les procédures sont respectées ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Il existe trois niveaux de contrôle successifs. Comme nos activités sont organisées en métiers, chaque métier a ses procédures, ses directives codifiées et ses manuels d'opérations. Un ensemble de procédures et de réglementations internes régit à la fois le comportement des gens et les opérations. L'autorité hiérarchique a une première responsabilité de contrôle et de surveillance sur les opérations et chaque métier a, dans son organisation, une unité de contrôle interne qui réalise des programmes de contrôle spécifiques, destinés à veiller au respect des procédures et des situations sensibles. Le niveau suivant est celui de l'inspection générale, qui n'intervient pas dans la routine opérationnelle journalière mais dans l'appréciation des risques. Elle planifie des interventions dans un secteur ou dans un autre, pour vérifier l'adéquation des conditions de prise de risques aux opérations. Ce niveau d'inspection générale, présent au niveau local suisse, est doublé par les interventions de l'inspection générale du groupe. M. Jacky DARNE : Quel est le résultat des rapports d'inspection, que ce soit au niveau du contrôle interne, à l'échelon opérationnel, à celui de l'inspection générale ou à celui de l'inspection du groupe ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Toutes ces missions de contrôle se concrétisent en recommandations d'amélioration des systèmes ou en résolutions de points en suspens. Il existe un système bien codifié et organisé de recommandations, avec identification de personnes qui doivent présider à la résolution de ces points et fixation d'un délai de réalisation. Un suivi est organisé pour voir les corrections qui sont apportées. M. François de RANCOURT : J'ajouterai que l'inspectorat ne rend pas compte à la direction générale en Suisse, il rapporte directement au conseil d'administration et au comité d'audit. Il est donc indépendant de la direction générale. M. Jacky DARNE : Dans la dernière année, ces contrôles ont-ils fait apparaître des défaillances sérieuses ? M. François de RANCOURT : Pas dans le sujet qui nous concerne. Je voudrais corriger un point. Je n'ai pas connaissance d'une opération de négoce qui s'est réglée en cash, en tout cas chez nous. Cela peut se faire dans d'autres pays, mais pas en ce qui nous concerne. M. Pierre-Yves DESPLAND : M. Burnand parlait des frais de transport. Il est arrivé que pour des frais annexes à une transaction commerciale, il y ait eu un besoin de cash. M. François de RANCOURT : Pour de tels montants ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Non, cela tournait autour de 100 000 dollars qui devaient couvrir tels ou tels frais et pour lesquels nous avons demandé des justificatifs, mais la transaction elle-même n'est jamais financée de la sorte. M. François de RANCOURT : Avec un baril à 20 dollars ! M. Pierre-Yves DESPLAND : Pour être tout à fait complet, j'indiquerai que l'on trouve ensuite le niveau d'intervention des auditeurs externes. Dans le système suisse, la Commission fédérale des banques n'a pas de pouvoir de contrôle à l'intérieur des établissements, mais elle le fait au travers des auditeurs externes agréés. Leurs audits vont bien au-delà de l'intervention des commissaires aux comptes que vous connaissez en France. Ils doivent produire des rapports exhaustifs et détaillés sur le respect des réglementations, sur l'application des directives et demandes formulées par la Commission fédérale des banques et de la Convention de diligence. Ils produisent chaque année un rapport fort détaillé qui est porté à la connaissance de l'autorité de surveillance et des administrateurs de la banque. M. Jacky DARNE : Nous avons parlé surtout de la gestion patrimoniale et des opérations commerciales. Or vous nous avez dit en introduction qu'une bonne part de votre activité était la banque d'investissement. Vous avez indiqué que vous placiez des obligations pour des clients étrangers. Au cours de ces derniers jours, nous est apparue la difficulté de connaître l'origine des fonds en cas de souscription d'actions ou d'obligations par l'intermédiaire d'un notaire. Etes-vous concernés par ce type d'intermédiaires ? Sinon, lorsque des fonds sont virés de l'étranger pour souscrire des augmentations de capital ou des emprunts obligataires, vos procédures sur leur origine sont-elles comparables à celles que vous avez mentionnées pour des opérations commerciales ? M. François de RANCOURT : Nous plaçons surtout des obligations pour des emprunteurs japonais institutionnels. Nous ne sommes pas concernés par votre souci. Quand des particuliers veulent acheter des obligations, on revient toujours à l'application des procédures évoquées. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de traiter du cash sans que l'on ait un point de contrôle. M. Pierre-Yves DESPLAND : Cela peut être des titres physiques. M. François de RANCOURT : Celui qui veut tenter de sortir plus de 50 000 francs de France ou de traverser la frontière italienne à Lugano avec des lires en prend le risque... mais entre nous, c'est vraiment du pipeau ! Tout est dans le système de contrôle d'origine des fraudes. A mon avis, dans le contexte suisse actuel, c'est difficile. En ce qui concerne cette banque, c'est plus que difficile. Au mois de mars, nous avons remercié un monsieur venu avec de l'argent plein les poches. M. Pierre-Yves DESPLAND : Comme nous ne sommes pas une banque de détail, les sollicitations spontanées de clients qui viennent pour ouvrir un compte sont l'exception. Il en vient deux chaque année et ils sont tous deux retoqués. M. François de RANCOURT : Nous contrôlons le nombre d'opérations par jour, parce qu'un caissier coûte cher, ici. Dans environ 80 % des cas, les retraits d'argent sont le fait du personnel. M. Claude-Alain BURNAND : L'activité d'émission est essentiellement une activité obligataire. Dans le système du marché des capitaux suisses, le syndicat d'émission comprend uniquement des professionnels, d'autres banques ou des courtiers en titres, donc des gens soumis aux mêmes règles sur le blanchiment et qui doivent connaître leurs clients. M. Jacky DARNE : Parce que le contrôle sur les souscriptions d'actions semble moins rigoureux que sur les opérations commerciales, l'idée circule que des augmentations de capital ont permis l'entrée dans le capital de ces sociétés de détenteurs de fonds d'origine frauduleuse, ce qui semble poser un véritable problème. Percevez-vous ce type de difficulté ? Y a-t-il une porte d'entrée qui n'est pas bien cernée aujourd'hui ? M. François de RANCOURT : Je ne vois pas très bien comment on peut acheter des actions sans passer par un institutionnel. M. Claude-Alain BURNAND : Vous devez faire allusion au fait que l'un des moyens des blanchisseurs est de repérer une entreprise en difficulté, une petite manufacture d'horlogerie, par exemple, et de suggérer à l'actionnaire qui est généralement une personne unique ou une famille, de procéder à une augmentation de capital. On lui propose d'ouvrir un compte de souscription de capital dans lequel est versé, par transfert bancaire ou postal, un montant de 500 000 francs qui est l'augmentation du capital de la société. J'ai lu cela, mais nous n'avons pas constaté de telles opérations chez nous. Ce sont plutôt des banques régionales, cantonales ou des caisses d'épargne qui sont visées. M. le Président : Dans quelle mesure êtes-vous en relation avec les paradis offshore ? Dans votre système de vigilance, le fait que des fonds viennent des îles Vierges, par exemple, est-il pour vous un signal particulier ? Avez-vous des succursales ou des correspondants privilégiés dans ces territoires, que l'on est en train de considérer au niveau international comme des territoires délinquants ? M. Claude-Alain BURNAND : En tant que Paribas Suisse, nous avons deux filiales : l'une à Monaco, l'autre à Guernesey, auxquelles nous appliquons le même régime de déontologie dont parlait Pierre-Yves Despland. En ce qui concerne le groupe Paribas, je n'ai pas l'impression que nous soyons implantés dans des pays que vous qualifiez de « territoires délinquants ». J'en ignore d'ailleurs la liste. M. Strauss-Kahn a parlé d'Aruba et des îles Caïmans. Nous n'y sommes pas. M. le Rapporteur : Guernesey en fait partie. M. François de RANCOURT : Nous avons quatre personnes à Guernesey. Pour nous, c'est surtout un centre de trésorerie. Il y a quelques trusts. C'est une autre filiale. M. Claude-Alain BURNAND : Une activité de constitution de trusts. C'est une activité parabancaire. Je suis étonné que Guernesey soit montré du doigt sous l'angle du blanchiment, car ils ont un système de communication avec l'autorité locale redoutablement efficace. S'il apparaît un soupçon de blanchiment, le gouvernement local demandera très rapidement un tracing order ou un freezing order pour bloquer les fonds. Ils coopèrent très bien avec les autorités en matière de lutte contre le blanchiment. M. le Président : Cela fait partie des indices de vigilance ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Tout à fait. Nous soumettons les comptes dans ces filiales aux procédures que l'on applique dans le réseau suisse. M. le Rapporteur : Je ne parle pas des procédures intra-groupe ou à l'intérieur de vos établissements, mais n'infligez-vous pas un traitement particulier à un compte qui recevrait de l'argent de Vaduz, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des Bahamas. Est-ce pour vous un indice particulier d'avoir à approfondir la vigilance ou bien est-ce quelque chose d'assez naturel, comme semble le considérer la Commission fédérale des banques, à laquelle nous en avons fait la remarque, hier ? M. Marcel NAEF : Je ne crois pas qu'il faille interpréter ainsi cette directive. Cela fait partie du jugement et des indices de risque. Si des fonds viennent d'endroits tels que ceux-là, ils seront soumis à notre approbation. On cherchera la motivation d'utiliser une banque à Aruba pour s'approvisionner en fonds chez nous, quelle est l'activité du client, quelle est sa relation. Nous reviendrons toujours à la connaissance intime du client, de son activité, de l'utilisation du compte, etc. M. François de RANCOURT : Il convient de faire une distinction entre ces territoires et des centres comme celui de Guernesey, où le contrôleur est un cadre détaché de la Banque d'Angleterre. Je sais que les autorités sont très vigilantes. Ce n'est peut être pas le cas partout. M. Claude-Alain BURNAND : Une banque d'Aruba ou d'Antigua ne pourrait pas nous transférer des dollars sans passer par son correspondant de clearing, à New York, qui peut être le même que le nôtre mais qui est généralement différent, lequel doit ensuite transférer les fonds à notre correspondant de clearing bancaire, qui nous les créditera. Nous ne recevrons donc pas les fonds de la banque d'Antigua, mais de notre correspondant de clearing. On mentionnera peut-être l'ordre de telle banque à Aruba ou Antigua ou bien l'ordre de telle société, de sorte que nous ne saurons même pas qu'il y avait une banque d'Antigua. Seul son correspondant à New York le saura. Avec le système de clearing, ou compensations électroniques swift, les virements sont pratiquement instantanés. La connaissance ne peut donc avoir lieu qu'a posteriori ; et encore, on n'aura pas nécessairement une visibilité de la chaîne. En revanche, nous pourrons analyser la transaction à l'entrée chez nous : qu'est-ce que ce virement ? Pour quel compte ? De quoi s'agit-il ? M. Jacky DARNE : L'analyse causale existe toujours. Ce que vous nous dites donne presque l'impression qu'il y a une rupture dans la chaîne. Mais pour toute opération, en recette ou en dépense, vous avez toujours la possibilité d'en comprendre le contexte et la cause ? M. Claude-Alain BURNAND : Bien sûr ! M. Jacky DARNE : Les transactions électroniques par Internet apportent-elles une difficulté supplémentaire dans l'exercice de votre métier ou l'effet est-il neutre ? M. Pierre-Yves DESPLAND : C'est une difficulté supplémentaire pour assurer la sécurité et la confidentialité des transactions. M. Jacky DARNE : Vous faites allusion au risque de perte en réseau... M. Pierre-Yves DESPLAND : Tout à fait. M. Jacky DARNE : ... mais cela vous crée-t-il une difficulté particulière pour la compréhension de l'opération proprement dite ? M. Pierre-Yves DESPLAND : Non. M. Claude-Alain BURNAND : C'est un nouveau moyen de transmission d'informations ou d'ordres. Il n'est pas question de proposer l'ouverture de comptes par Internet. M. Jacky DARNE : D'autres le font. M. le Rapporteur : Quelle est votre attitude si vous voyez arriver une personnalité politique qui ne soit pas d'une monarchie persique mais d'un pays démocratique ? Avez-vous un petit signalement ? Nous avons en effet découvert, grâce à une presse attachée à mettre au jour certaines vérités qui fâchent, que de nombreux partis politiques utilisent la Suisse pour entreposer leur magot. M. Pierre-Yves DESPLAND : On en revient à des questions de stratégie. Paribas a certaines règles internes. Elle ne veut pas, entre autres, faire de financement de partis politiques. Si un ministre souhaite ouvrir un compte, nous appliquons une procédure particulière qui prévoit une autorisation d'ouverture de compte supplémentaire par rapport à un client normal, eu égard au risque politique que cela représente. M. François de RANCOURT : En principe, la réponse est « non ». On n'en veut pas. M. Pierre-Yves DESPLAND : En principe, la réponse est « non ». La seule exception est celle de personnalités issues de pays tout à fait honorables, des gens très fortunés, qui ont acquis leur fortune par héritage... M. le Président : ... ou même par leur travail ! M. François de RANCOURT : S'ils ne sont pas trop imposés ! M. Pierre-Yves DESPLAND : La règle de la Commission fédérale des banques est très claire. Elle prévoit que les hommes politiques ne peuvent être acceptés qu'au plus haut niveau hiérarchique de la banque et lorsqu'il y a une garantie qu'il ne s'agit pas de fonds provenant de corruption. M. François de RANCOURT : J'ai d'ailleurs été intéressé de voir, à un moment donné, des diplomates suisses conseiller vivement de ne pas avoir de comptes à un moment donné de représentants d'un certain pays. Ils avaient tout à fait raison. Des responsables suisses ont conseillé à la Commission fédérale des banques de décourager toute banque d'ouvrir de tels comptes. M. le Président : Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de nous avoir apporté ces nombreux éléments d'information. Audition de M. René RAMER, Procureur du canton de Zürich, MM. Peter HUNIG et Marcel STRASSBURGER, Juges d'instruction et Max MUISSEL des forces de police (compte-rendu de l'entretien du 27 septembre 2000 à Zürich) Présidence de M. Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur M. René RAMER : Compte tenu de votre connaissance du sujet, il me semble que nous pouvons évoquer directement les points qui vous intéressent, à savoir les mesures que nous avons prises pour lutter contre le blanchiment d'argent. Il y a deux niveaux : la police et le juge d'instruction. C'est le procureur qui formule les accusations apportées devant le juge d'instruction du district. Le procureur du canton est l'autorité de surveillance de l'office du procureur du district. Il représente l'intérêt de l'Etat devant la cour supérieure du canton, la cour de cassation et le tribunal fédéral à Lausanne. Nous avons, au sein de l'office du procureur du district, des spécialistes pour le blanchiment d'argent et la criminalité économique. Auprès de la police cantonale, il existe un service spécialisé pour les crimes économiques à l'intérieur duquel on trouve des spécialistes pour le blanchiment d'argent. J'ai prié les représentants de ces deux autorités de se joindre à nous. En ma qualité de procureur du canton, je suis responsable des juges d'instruction du district ainsi que des services chargés des commissions rogatoires et de la lutte anti-blanchiment. J'ai la responsabilité de la présentation de ces cas devant le tribunal supérieur du canton, le tribunal de cassation ainsi que le tribunal fédéral à Lausanne. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions, dans la mesure de nos connaissances. M. le Rapporteur : Merci de votre accueil amical. Notre séjour à Zürich s'explique par le fait que nous ne pouvions porter d'appréciations sur la Confédération helvétique sans rencontrer les responsables du ministère public et de la police à Zürich et au Tessin, qui sont avec Genève où la mission s'est rendue l'an dernier, les cantons les plus concernés par la lutte anti-blanchiment. A la suite des différents entretiens que nous avons eus à Genève et à Berne, nous avons pu mesurer à quel point l'appareil judiciaire de ces cantons paraissait extraordinairement réveillé par rapport aux exigences, non seulement internationales, mais également fédérales et locales, de lutte contre l'argent sale. Nous avions fait quantité d'éloges à la suite de nos entretiens avec vos collègues Perraudin et Bertossa. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous rencontrer, afin de poursuivre cette discussion avec vous ici à Zürich. Nous souhaiterions tout d'abord des informations sur votre système d'administration de la preuve de la culpabilité en matière de blanchiment. Tous les pays européens sont confrontés aux limites des systèmes probatoires classiques, lesquels ne semblent pas bien adaptés à cette forme de délinquance dite astucieuse. Les Italiens, les premiers à en avoir fait le constat, ont procédé à des renversements de charge de la preuve. La France, sous notre impulsion, vient de s'engager dans cette voie, dans certains cas bien définis, de manière à protéger les libertés publiques. Ma question s'adresse à des techniciens, des policiers, des magistrats qui luttent au quotidien contre ce type de délinquance. Avez-vous un système probatoire propre dans le canton de Zürich ? Quelles difficultés rencontrez-vous pour administrer la preuve dans des affaires de blanchiment ? Combien de procédures avez-vous réussi jusqu'à présent à mener jusqu'à leur terme, c'est-à-dire combien avez-vous prononcé de condamnation définitive ? M. René RAMER : Nous avons une procédure limitée avec prise de preuves directes. On juge sur les documents tout en étant en mesure néanmoins d'enregistrer des preuves dans ces procédures. Nous ne connaissons pas le renversement de la charge de la preuve, sauf dans un seul cas, prévu par l'article 59 du code pénal suisse, lorsqu'une organisation criminelle est à la tête d'une fortune. Il est difficile de prouver l'origine criminelle de ces fonds car ils proviennent souvent d'un pays étranger, où les actes ont été perpétrés, auquel cas le pays concerné doit nous fournir les preuves. M. le Rapporteur : S'agissant de la coopération judiciaire, nous posons par principe la question de savoir si vous avez des appréciations négatives à porter sur certains pays y compris la France. Lors de notre tour d'Europe, nous avons fait le constat que tous les magistrats établissent un tableau comparatif des pays coopératifs qui ressemble fort à celui de leurs voisins. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour obtenir les preuves de l'origine criminelle des fonds à partir de systèmes judiciaires défaillants ? M. René RAMER : S'agissant de l'entraide judiciaire internationale, elle incombe à l'Office fédéral de justice de la Confédération qui a une fonction de charnière entre la Suisse et les autres pays. C'est une organisation qui a fait ses preuves, grâce aux liens personnels qui se sont établis entre les responsables dans les divers pays. Il est essentiel que les fonctionnaires responsables aient établi un lien de confiance entre eux et entretiennent des relations personnelles. Cela permet de résoudre les difficultés. Nous avons à Zürich un Office de procureurs spécialisés chargés de l'aide judiciaire internationale. Je vais maintenant passer la parole aux juges d'instruction et au représentant de la police qui vont vous fournir des compléments d'information, concernant notamment la collaboration entre la France et la Suisse. M. Marcel STRASSBURGER : J'aimerais tout d'abord répondre à votre question quant aux difficultés concernant la collecte de preuves, étape étroitement liée à la collaboration avec les autorités compétentes des autres pays avec lesquelles, comme cela a été mentionné, il est primordial d'avoir instauré un lien personnel. Nous rencontrons en Suisse en matière de coopération judiciaire un problème qui tient au fait que, pour pouvoir poursuivre un crime, il doit correspondre à la définition qu'en donne notre code pénal, c'est-à-dire un délit puni de la réclusion criminelle. La majorité des crimes sont des infractions à la loi sur les stupéfiants et des fraudes en matière de placements d'argent. Nous ne rencontrons quasiment aucune difficulté de coopération avec les pays dont le système judiciaire est comparable au nôtre, comme la France. Le fait que la plupart des pays européens ont signé l'accord sur l'entraide judiciaire et, depuis 1999, l'accord sur le blanchiment d'argent, nous facilite grandement la collecte de preuves. En revanche, nous rencontrons de grandes difficultés avec les pays dont le système judiciaire est de type anglo-saxon. Sans entrer dans le détail des difficultés avec ces pays, il est toutefois nécessaire de souligner que nous avons commencé à recueillir des preuves qui ne rentrent pas systématiquement dans le cadre de la procédure judiciaire formelle. Nous les communiquons ensuite à la police qui, à son tour, se met en contact avec Interpol pour échanger les informations. Avec des pays comme l'Allemagne et l'Autriche avec lesquels nous avons signé un accord complémentaire à la convention européenne, la tâche nous est facilitée grandement. L'accord signé avec la France n'étant entré en vigueur qu'au 1er mai 2000, nous manquons d'expérience pour en faire le bilan. Un accord est également en cours de préparation avec l'Italie et devrait être ratifié sous peu. En ce qui concerne les difficultés dans l'administration des preuves, il me semble que les demandes de commissions rogatoires se ressemblent un peu partout en Europe. La grande difficulté, c'est de prouver que les accusés ont eu connaissance du fait qu'il s'agissait d'argent sale. S'agissant du renversement de la charge de la preuve, l'article 59 du code pénal ne fait que déplacer la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut prouver que les accusés sont membres d'une organisation criminelle. Mon collègue, M. Hünig, interviendra pour vous donner le nombre de cas ayant abouti à des condamnations. M. René RAMER : Je donne la parole au représentant de la police qui va vous faire part de ses expériences. M. Max MUISSEL : J'aimerais souligner que l'échange d'informations entre les autorités de police se fait beaucoup plus facilement qu'entre les autorités judiciaires. Quand nous avons affaire à des Etats de droit, nous ne rencontrons pratiquement aucune difficulté. Les difficultés surgissent avec des pays tels que les anciens pays communistes du bloc de l'Est. On peut même parfois obtenir des informations utiles de la Bolivie ou du Chili, sans toutefois avoir la certitude qu'elles ne nous sont pas fournies, à l'autre du fil, par un baron de la drogue. Je suis heureux de pouvoir dire que la collaboration avec nos collègues français est excellente, et j'espère qu'il en est de même pour eux. La France nous adresse chaque année une soixantaine de commissions rogatoires dont un tiers concerne le blanchiment d'argent. M. le Rapporteur : Nous avons des témoignages, douloureux pour le système bancaire suisse, qui montrent que de nombreuses banques zürichoises utilisent le Liechtenstein en première phase pour blanchir une partie de l'argent, avant de le réintroduire dans le système européen. Quelles constatations avez-vous fait de ces pratiques qui consistent à passer par des filiales implantées à l'étranger, tout en sélectionnant la nature de l'argent ? Quelle est votre analyse en votre qualité de policier ? M. Max MUISSEL : Même si nous n'avons pas eu l'occasion de faire de telles constatations, nous ne sommes pas naïfs. Si on peut le prouver, le blanchiment d'argent entame gravement l'image de marque des banques concernées. Par conséquent, elles se gardent bien d'y arriver. Chaque grande banque suisse a une succursale au Liechtenstein, toutefois nous n'avons fait aucune constatation de ce type. Notre gouvernement a négocié ce point avec celui du Liechtenstein. En effet, pendant un certain temps, il était plus facile d'obtenir des informations des Bermudes que du Liechtenstein. Pour ma part, je veille au bon fonctionnement de l'aide judiciaire et à ce qu'une commission rogatoire ne reste pas sans réponse pendant plus de deux mois. M. René RAMER : Vu l'importance de la place financière de Zürich, il est compréhensible que des individus enfreignent la loi. Mais lors de nos investigations, il ne nous a pas semblé que les banques avaient une politique systématique visant à contourner la loi. Au contraire, elles ont reconnu qu'il était de leur propre intérêt de soigner leur image de marque et de ne pas nuire à l'image de marque de la Suisse comme place financière. A l'occasion de délits ou de crimes commis par des employés de banque, nous avons pu constater que les banques coopéraient avec nous pour les punir. M. le Rapporteur : Qu'en est-il du nombre de condamnations ? M. René RAMER : Ce problème du blanchiment se retrouve plus particulièrement dans le secteur parabancaire, à savoir des intermédiaires financiers qui se rendent coupables d'affaires louches. Cette lacune vient d'être comblée avec la création d'une Autorité de contrôle anti-blanchiment d'argent qui permettra aux autorités judiciaires de renforcer leur action. De plus, il semblerait que la loi en cours de discussion sur la surveillance des marchés financiers aille au-delà des mesures déjà en place. M. Peter HÜNIG : S'agissant du nombre de condamnations et de communications ayant trait au blanchiment d'argent, lors de la période 1999/2000 comparée à celle de 1998/1999, le Bureau de communication a enregistré une augmentation de 230 % de telles dénonciations. A Zürich, toujours en comparant les mêmes périodes, les dénonciations ont plus que doublé. Ce chiffre ne concerne que les communications toutes provenances confondues. M. le Rapporteur : Je souhaiterais que vous nous distinguiez la dénonciation de l'enquête. M. Peter HÜNIG : 63 % de ces dénonciations ont conduit à des procédures pénales, ce qui, en comparaison avec le reste de l'Europe, peut être considéré comme un bon résultat. M. le Rapporteur : En chiffres absolus, combien y a-t-il eu de procédures ? M. Peter HÜNIG : Selon les résultats fournis par le Bureau de communication pour la période 1999/2000, il y a eu trois cent soixante-dix dénonciations. Deux tiers de ces dénonciations ont été transmis aux cantons aux fins de poursuites pénales, dont un tiers des cas n'a pas abouti par manque de preuves. M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous donner les chiffres en valeur absolue ? M. Peter HÜNIG : Deux cinquante-six cas ont été transmis aux cantons tous confondus. M. le Rapporteur : Selon nos informations, soixante-cinq cas ont été transmis aux autorités pénales du canton de Zürich. Sur ce chiffre, combien avez-vous ouvert de procédures pénales ? M. Peter HÜNIG : Jusqu'à une période récente, il était nécessaire à Zürich de procéder à des enquêtes préalables afin de vérifier la véracité de ces accusations. Toutefois, lors de ces enquêtes préalables, on ne pouvait imposer des mesures contraignantes telles que la saisie ou le blocage des comptes. Toutefois, dans 60 % des cas, des mesures contraignantes ont été prises, puis transmises aux autorités judiciaires. M. le Rapporteur : Pour vous, les mesures contraignantes sont le blocage ou le gel des avoirs. S'agissant des perquisitions bancaires, c'est-à-dire l'obtention de façon contraignante de la documentation sur un compte bancaire, pouvez-vous les obtenir dans le cadre de l'enquête préalable de police ou devez-vous aller jusqu'au tribunal ? M. René RAMER : Auparavant, on ne pouvait pas prendre de mesures contraignantes car elles n'étaient pas fixées dans la procédure pénale. Nous avons eu recours à cette procédure car le besoin s'en est fait sentir. Lors de la mise en application de la loi sur le blanchiment d'argent, a subsisté un certain flou car nous n'avions pas encore l'expérience de l'application de cette loi. Or depuis mars 2000, lorsque le Bureau de communication contre le blanchiment d'argent transmet une dénonciation au canton de Zürich, nous entamons une procédure pénale sans enquête préalable, car les difficultés avec l'application de la loi ont été résolues. Chaque cas donne lieu à une procédure pénale. M. le Rapporteur : Dans le cadre de la procédure d'enquête policière préalable, la police a-t-elle autorité pour vérifier les mouvements bancaires sur un compte ou considérez-vous que c'est une mesure contraignante ? M. René RAMER : Selon la jurisprudence suisse et le tribunal fédéral, une enquête sur les mouvements de comptes constitue une mesure contraignante. M. le Rapporteur : Il faut donc demander l'autorisation au tribunal... Tous : Non, au juge d'instruction. M. le Rapporteur : Sur quels critères acceptez-vous que la police procède à ces mesures contraignantes ? M. René RAMER : Il y a une différence entre la levée du secret bancaire et l'arrestation. Selon le tribunal fédéral, il faut avoir suffisamment de soupçons de délit ou de crime pour lever le secret bancaire tandis que, pour une arrestation, il faut un soupçon urgent. M. le Rapporteur : C'est un système très anglo-saxon. Dans certains cas, rejetez-vous une demande de perquisition bancaire au motif que des soupçons ne seraient pas suffisamment avérés ? Par exemple, le procureur ou l'autorité policière ne sont pas parvenus pas à vous convaincre qu'il y avait des soupçons suffisants car ils n'ont pu obtenir la preuve de ces mouvements d'argent, du fait que vous êtes l'autorité chargée de les y autoriser. M. René RAMER : En règle générale, le procureur peut toujours convaincre le juge d'instruction de la nécessité des mesures contraignantes car il est habilité à lui donner des instructions. Il convient toutefois de distinguer entre les commissions rogatoires et les investigations en Suisse. Lorsque le pays requérant soumet ses demandes, le juge d'instruction peut uniquement vérifier la présence d'erreurs quant à la présentation des faits, il ne peut juger des soupçons concernant un crime, puis il procède automatiquement aux mesures contraignantes. La situation se présente différemment lorsque le procureur agit sur sa propre initiative, mais selon mon expérience, il n'est pratiquement jamais arrivé que des mesures contraignantes aient été décidées à la demande de la police. M. Marcel STRASSBURGER : Dans le cadre des commissions rogatoires internationales, il faut s'assurer que les faits sont punissables selon la loi du pays requérant ainsi que par le code pénal suisse. Comme il est parfois difficile de vérifier rapidement ces points et qu'il est nécessaire d'agir immédiatement, nous procédons alors à des mesures provisoires, telles que la saisie ou le gel d'un compte, dans l'attente d'un complément d'informations. Pour ma part, je ne connais aucun cas où on aurait procédé à des mesures contraignantes, sur les indications de la police. Toutefois, lorsque le délit ou le crime a été commis à l'étranger, des problèmes peuvent se poser, lorsque, par exemple, une partie civile peut essayer d'obtenir gain de cause en ayant recours au code criminel. M. le Rapporteur : Monsieur le procureur, êtes-vous nommé par le gouvernement ? M. René RAMER : Oui. M. le Rapporteur : Pouvez-vous recevoir des instructions positives ou négatives de poursuites ou de non-poursuites du gouvernement ? M. René RAMER : Le conseil d'Etat, c'est-à-dire le conseil exécutif du canton, peut théoriquement commander une enquête judiciaire, mais depuis vingt ans que je suis juge d'instruction et procureur du canton, je n'ai jamais connu cette situation. Par ailleurs, le conseil d'Etat ne peut empêcher un procureur d'ouvrir une enquête pénale. Je ne peux arguer de ma qualité d'autorité de surveillance des juges d'instruction pour leur demander d'arrêter une enquête criminelle. Si le juge d'instruction ouvre une procédure judiciaire, je ne peux l'en empêcher, c'est au tribunal de décider. Il n'y a pas non plus de recours contre l'action du juge d'instruction. M. le Rapporteur : Merci beaucoup de votre accueil et de ces précisions. Audition de M. André CUENDET, (compte-rendu de l'entretien du 27 septembre 2000 à Zurich) Présidence de M. Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur M. André CUENDET : A titre préliminaire, je souhaiterais vous remettre quelques documents d'information sur notre organisme d'autorégulation (OAR) de la Chambre Fiduciaire et notamment le règlement d'autorégulation et le rapport annuel 1999-2000. En tant qu'association, nous sommes soumis à la production d'un rapport tous les deux ans et non tous les ans, comme les entreprises. Tout d'abord, je voudrais dissiper un certain flou quant au terme de fiduciaire. Ce terme n'a pas de signification consacrée. Selon le droit suisse, ce n'est pas un terme légal. Par ailleurs, lorsque vous évoquez des problèmes que le parquet zürichois rencontrerait notamment avec les « fiduciaires », il faut le relativiser. Peut-être rencontrent-ils des problèmes avec le monde parabancaire, mais alors la notions d'« intermédiaire financier » selon la LBA inclut notamment aussi les avocats, les notaires, les gestionnaires de fonds, de devises et les brokers. En fait, ce qu'on entend à l'origine par société fiduciaire en Suisse, ce sont des sociétés qui traitent de tout ce qui tourne autour du contrôle et de la gestion d'une entreprise (tenue de comptabilité, audits, conseil fiscal, juridique...). La plupart de ces activités n'exposent pas au risque de blanchiment d'argent et ne sont même pas assujetties à la LBA. Les principales activités, en ce qui nous concerne, assujetties à la LBA, sont la gestion de fortune et la gestion de sociétés. La Chambre Fiduciaire est la principale des deux associations patronales. Elle est la plus ancienne, et elle rassemble toutes les grandes fiduciaires du pays ; ainsi que beaucoup de moyennes et petites sociétés, la deuxième association ne regroupant que des petites fiduciaires. Nous avons créé un OAR car quelques-uns de nos membres exercent des activités assujetties à la LBA. A ce jour, sur nos trois cent cinquante membres inscrits à notre OAR, aucun ne s'est trouvé impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Je voudrais que ces définitions soient bien ancrées dans les esprits pour que l'on sache de quoi on parle. M. le Rapporteur : Nous allons lire avec beaucoup d'attention votre règlement d'autorégulation. Le Bureau de communication a évoqué le domaine parabancaire Il est vrai que c'est un mécanisme récent et que les OAR n'ont pas tous leur règlement d'autorégulation. M. André CUENDET : Des litiges sont encore en cours avec l'Autorité de contrôle concernant des OAR, mais, pour les autres, leurs règlements sont en vigueur. La loi est entrée en vigueur au 1er avril 2000, mais notre OAR était prêt depuis longtemps. Il a même reçu l'agrément en avril 1999. Nous avons anticipé le mouvement en appelant nos membres qui sont des intermédiaires financiers à adhérer avant la date limite du 31 mars 2000. De plus, nous sommes allés très loin car la Chambre Fiduciaire a décidé que les premiers contrôles seraient effectués par des auditeurs externes ou internes, dès le 1er juillet 2000, soit moins de six mois après l'entrée en vigueur de la législation. M. le Rapporteur : S'agissant de ces contrôles externes, ceux qui les effectuent sont-ils adhérents de votre Chambre ? Ne craignez-vous pas de rencontrer des conflits d'intérêt lorsqu'il y a ces contrôles externes ? M. André CUENDET : Je ne vois pas pourquoi. Nous n'acceptons comme membres que ceux qui répondent à certains critères de qualité. Ces conditions ne sont pas toutes remplies par les intermédiaires financiers et certains ne pourraient pas être membre chez nous. Par ailleurs, nos membres doivent être révisés par des réviseurs externes. Ils ne peuvent pas faire de mesures de complaisance. Les contrôles croisés sont interdits. Un intermédiaire financier ne put pas être contrôlé par un réviseur, et vice versa. M. le Rapporteur : La question de vérification de l'identité des personnes étrangères qui seraient les ayants droit économiques est une question primordiale. C'est un mécanisme essentiel dans les fiduciaires. Pour une personne de nationalité étrangère, quels sont les critères que vous demandez ? M. André CUENDET : Si on se réfère au règlement de diligence, vous trouvez une mention faite quant à l'identité du cocontractant présumé être l'ayant droit économique. La nature des contrôles est différente entre l'identification de l'ayant droit économique et la vérification de l'identité du cocontractant. Cette dernière vérification est vraiment un contrôle formel, mais intelligent et qui doit être fait avec du bon sens. On demande une pièce d'identité et la nature des papiers reconnus comme tels est limitée. Il est dit, dans ce document, qu'on accepte les passeports mais pas les permis de conduire et autres pièces. M. le Rapporteur : S'agissant de l'ayant droit économique... M. André CUENDET : S'agissant de l'ayant droit économique, ce n'est pas une vérification formelle car la loi ne l'exige pas non plus. Selon les règles du GAFI, qui sont une copie conforme de nos règles suisses concernant l'ayant droit économique, il n'est pas nécessaire de fournir des pièces d'identité, mais il faut arriver à s'assurer que l'identité de ladite personne est crédible. C'est un contrôle de plausibilité. L'Autorité de contrôle a remis la liste établie par la Commission fédérale des banques, des indices qui doivent déclencher des signaux d'alerte quant au blanchiment. M. le Rapporteur : Depuis combien de temps votre règlement existe-t-il ? M. André CUENDET : Il n'existe que depuis avril 1999. M. le Rapporteur : Y a-t-il eu application du règlement par des fiduciaires de votre OAR sur l'obligation de communiquer au Bureau de communication ? M. André CUENDET : Jusqu'à ce jour, aucun cas n'est passé par l'OAR de la Chambre Fiduciaire. Nos critères élevés d'affiliation en sont la raison principale. Nos membres ont une très bonne réputation qui se répercute au niveau global de l'OAR de la Chambre Fiduciaire. M. le Rapporteur : Comment vont-ils faire pour solder le passé ? M. André CUENDET : Je ne comprends pas la question. M. le Rapporteur : Dans ces sociétés fiduciaires affiliées, comment le règlement de votre OAR va-t-il s'appliquer sur les dispositifs et dossiers en cours ? M. André CUENDET : Sur la base de notre règlement, nos membres ont eu l'obligation de créer des dossiers de surveillance s'agissant de toutes leurs relations d'affaires sensibles au sens de la LBA effectives à la date d'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les relations pouvant remonter à plusieurs décennies. Ils ont dû créer des dossiers dans la mesure où ils n'existaient pas. Les fiduciaires qui font de la gestion de fortune devaient déjà avant l'entrée en vigueur de la LBA appliquer l'esprit de diligence, de la même manière que les banques. D'une manière générale, ce sont plutôt les petits bureaux qui ont quelques difficultés à s'adapter. Sur la base des contrôles commencés dès le 1er juillet, nous ferons un bilan. Nous sommes dans une période de transition car la loi vient d'entrer en vigueur. M. le Rapporteur : Quelle est la situation s'agissant des dossiers qui ne satisfont pas les nouvelles obligations légales et votre règlement ? M. André CUENDET : Nous exigeons toujours un contrôle par les réviseurs externes qui ont un cahier des charges. Ces points figurent dans les documents que je viens de vous transmettre. Une fois reçus les rapports des réviseurs dans un délai de six mois, nous pourrons voir quelles sont les lacunes. M. le Rapporteur : Combien avez-vous de membres ? M. André CUENDET : Nous avons deux catégories, les membres entreprises et les membres personnes physiques. Les membres entreprises qui ont adhéré à l'OAR ont au nombre de trois cent cinquante. Les membres personnes physiques sont plusieurs milliers. M. le Rapporteur : Qui choisit les réviseurs externes ? M. André CUENDET : L'intermédiaire financier membre de notre OAR. Mais vous verrez que l'OAR de la chambre a le droit de designer un réviseur interne lorsque nous avons des soupçons de blanchiment d'argent. Nous pouvons désigner, aux frais de l'intéressé, un réviseur pour aller faire des contrôles dans cette société. M. le Rapporteur : Avez-vous reçu les rapports des réviseurs externes ? M. André CUENDET : A la prochaine séance du Comité OAR début octobre, nous en aurons déjà un certain nombre. M. le Rapporteur : Le Bureau de communication dispose-t-il du pouvoir de nommer un réviseur interne ? M. André CUENDET : Non. M. le Rapporteur : C'est donc votre monopole. M. André CUENDET : Le Bureau de communication n'a pas de pouvoir sur les OAR. M. le Rapporteur : Dans de nombreuses affaires de corruption, apparaissent régulièrement les noms de fiduciaires suisses, lieux d'entrepôt de produits issus de délits perpétrés sur le territoire français. Si nous avons connaissance du nom de l'une de ces fiduciaires suisses, pourriez-vous passer à la phase d'autorégulation ? M. André CUENDET : La plupart du temps, les médias déclenchent les affaires de blanchiment. Si nous entendons quelque chose sur un membre de notre OAR, nous ferons des investigations. Ce sera notre devoir d'intervenir pour voir ce qui se passe. Nous voulons que nos membres respectent notre règlement pour que le discrédit ne retombe pas sur notre OAR. M. le Rapporteur : Je vous remercie de ces précisions. Audition de M. Luca MARCELLINI, Mme Maria GALLIANI, M. Jacques DUCRY et M. Emmanuele STAUFFER, Procureurs tessinois (compte-rendu de l'entretien du 27 septembre 2000 à Lugano) Présidence de M. Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur M. le Rapporteur : Merci de venir à notre rencontre. Notre mission s'est déjà rendue une première fois en Suisse, puis en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, dans les Iles anglo-normandes, à Gibraltar, à Chypre, en Italie, en Espagne, à Monaco, en Autriche, au Liechtenstein et au Luxembourg. Nous ne voulions pas parler de la Suisse, sans avoir eu la possibilité de nuancer la situation selon les cantons. Nous, Français, ne sommes pas habitués au fédéralisme, surtout dans des matières aussi importantes que l'action publique et judiciaire. La diversité de la législation, des pratiques, des cultures dans chacun des cantons suisses nous a incités à revenir car nous ne voulions pas nous exprimer sur votre pays sans avoir rencontré tous ceux qui se battent contre le blanchiment, dont les magistrats, les policiers, les fonctionnaires chargés du renseignement économique. Nous observons que beaucoup de magistrats, en France mais aussi dans d'autres pays se plaignent des conditions dans lesquelles leurs Etats respectifs ne mettent pas suffisamment de moyens, soit matériels soit humains, voire juridiques, entre leurs mains. En France, le débat sur cette question s'est beaucoup intensifié avec la multiplication des dossiers, mais aussi avec l'arrivée d'une nouvelle génération au Parlement et dans les ministères. Cette question n'est plus interdite. C'est la raison pour laquelle un volet législatif a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, qui tend à renforcer très nettement l'arsenal juridique entre les mains des magistrats pour lutter contre le blanchiment. Nous n'aurions pas remporté cette victoire sans ce qui s'est passé à Monaco ou au Liechtenstein et si le soutien que nous avons rencontré dans tous les pays européens, membres ou non de l'Union européenne, ne s'était pas manifesté aussi clairement. Nous pouvons chacun, dans nos compétences et avec nos moyens, accomplir quelque chose. C'est pourquoi il me semblait utile de vous rencontrer pour débattre librement de la façon dont vous voyez ces questions. Ensuite j'aimerais sur divers sujets engager le débat avec vous. M. Luca MARCELLINI : Je pense que l'essentiel sera abordé au travers de problèmes concrets. En termes généraux, il est important de garder en tête la position géographique du Tessin. Notre situation particulière de petit canton aux ressources limitées qui se trouve être, en même temps, une place financière importante, amène des problèmes. Il y a les affaires propres et les affaires moins propres. Le fait d'être géographiquement très proche de Milan et du nord de l'Italie où, il y a encore quelques années, existait un manque de structures pour faire des opérations financières internationales même légitimes, a permis au Tessin de réaliser ces activités. Cela a fini par créer une situation qui nous place au centre de beaucoup d'affaires internationales. Nous avons plusieurs affaires de différents types, dans lesquelles nous nous heurtons à des difficultés de relations avec les autres Etats, et où l'échange d'information ne fonctionne pas toujours au mieux. D'autre part, nous devons faire face à ce genre de problème avec des ressources limitées. Je trouve que l'approche que vous avez choisie de visiter plusieurs cantons et de vous rendre compte des différentes situations qui peuvent se poser en Suisse est très mesurée. Même si la loi fédérale s'applique dans tout le pays, les situations sont très différentes selon les différents cantons, de même que les ressources mises à disposition, ce qui peut provoquer, dans certaines situations, des réactions diverses de la part des appareils judiciaires cantonaux. Mais nous pouvons néanmoins vous assurer de la ferme volonté du parquet tessinois de faire face à ses devoirs au plan national et international et de notre désir d'obtenir déjà de la part de nos politiciens locaux les moyens nécessaires pour mener cette lutte contre le blanchiment et la criminalité financière. M. le Rapporteur : Peut-être pourrions-nous évoquer les problèmes de coopération internationale ainsi que les relations que vous avez avec le Bureau de communication, si l'information qu'il vous apporte est de bonne qualité, comment l'exploiter ; j'aimerais aussi aborder les problèmes probatoires, comment construire un dossier, ce que permet le droit et ce qu'autorise la pratique, jusqu'où pouvez-vous sortir des dossiers et comment s'opère le renversement de la charge de la preuve. Sur la coopération judiciaire, comment d'une part êtes-vous organisés pour traiter des demandes qui vous viennent de l'extérieur ? Jugez-vous les moyens suffisants ? Nous n'avons pas, dans la Mission, entendu d'éléments négatifs sur la justice tessinoise, au contraire. A l'inverse, comment appréciez-vous la coopération judiciaire accordée par certains territoires ? J'avais interrogé M. Jacques Ducry sur Monaco et sa réponse avait été relativement positive. Je m'apprêtais d'ailleurs, dans le rapport, à écrire quelque chose de positif quand, en Espagne, le parquet anti-corruption du juge Balthazar Garzon nous a signalé que M. Daniel Serdet coopérait sans doute avec Lugano mais très peu avec Madrid. Cela doit être du à des intérêts différents en cause. La justice princière est animée par une main invisible. M. Luca MARCELLINI : S'agissant de l'entraide internationale au Tessin, c'est le parquet qui est compétent pour le traitement des demandes de coopération judiciaire. Mon bureau comprend le Procureur général et onze procureurs, six d'entre eux s'occupant des crimes financiers et de l'entraide internationale. Nous recevons environ par an cinq cents demandes d'entraide. Il s'agit principalement de perquisitions bancaires. On donne suite à 95 % des demandes. Il est très rare que des demandes ne soient pas admissibles. Normalement cela fonctionne. Très souvent la procédure est assez lente, déjà en raison de nos problèmes de personnel. Nous avons des retards importants sur nos dossiers intérieurs et il nous faut équilibrer l'activité entre le traitement des requêtes internationales et celui des dossiers intérieurs. Nous avons des cas avec des personnes en détention, ces situations doivent être traitées au plus vite, ce qui amène des retards dans d'autres affaires. Par ailleurs, il y a le problème des voies de recours, notamment dans les perquisitions bancaires. Elles sont au niveau cantonal et fédéral. Cela peut entraîner des retards de deux ou trois ans. Un autre problème pratique se rencontre assez souvent, lorsque l'autorité étrangère demande à être présente lors de la perquisition. Si la demande est assez claire et que nous pensons être sûrs d'atteindre les mêmes résultats sans cette présence des autorités étrangères, nous préférons généralement suivre cette solution. En effet, leur présence donne lieu à une autre voie de recours, ce qui va généralement compliquer la procédure. M. le Rapporteur : Est-ce propre au Tessin ? M. Luca MARCELLINI : Non, c'est une procédure fédérale. Parfois les autorités étrangères viennent ici quelques jours avant notre intervention, pour clarifier leurs demandes de perquisition. Mais, dans la majorité des cas, on agit directement sans leur présence, ce qui parfois peut susciter des réactions de la part des autorités étrangères qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on ne souhaite pas les laisser participer, alors que c'est pour éviter les voies de recours. Pour le reste, nous observons que les pays de l'Union européenne qualifient parfois différemment le même genre de faits. On le voit très bien par rapport à la fraude fiscale. Par exemple, pour le même genre d'activités délictueuses, l'Italie, préfère invoquer l'infraction de contrebande, ce qui n'est pas suffisant pour nous pour agir et n'utilise pratiquement jamais la fraude fiscale pour demander l'assistance, ce qui pourrait être plus simple pour nous, tandis que l'Allemagne le fait fréquemment. M. le Rapporteur : Combien de fois par an opposez-vous l'excuse fiscale ? M. Luca MARCELLINI : C'est très rare. En général, on prend contact avec l'autorité requérante et on essaie de faire évoluer le dossier. M. Jacques DUCRY : Chaque demande, sauf celles envoyées directement selon l'article 15 chiffre 2 de la CEAJ, arrive à Berne qui fait un examen préliminaire avant de nous la transmettre pour un examen plus approfondi, la décision d'entrée en matière et l'exécution. M. le Rapporteur : Nous avons rencontré à l'Office fédéral de la police, l'année dernière, la personne chargée de faire ce filtrage. En France, au ministère de la Justice, nous recevons beaucoup de rejets pour irrecevabilité sur la base de l'excuse fiscale directement invoquée par Berne. Quand un juge français fait apparaître un délit fiscal, celui-ci est en quelque sorte absorbant des autres délits connexes qui peuvent être graves et suffit à lui seul pour justifier l'irrecevabilité de la commission rogatoire par la Confédération helvétique. Il est intéressant de signaler aux pays qui cherchent la collaboration du Tessin qu'ils peuvent vous contacter par téléphone avant de lancer leur commission rogatoire. M. Jacques DUCRY : Souvent, quand nous connaissons nos collègues, en particulier italiens, nous leur demandons de nous envoyer directement la commission rogatoire et de l'envoyer, dans le même temps, à Berne par la voie diplomatique. Il faut tenir compte de ce passage par Berne avant de pouvoir faire une évaluation du nombre de cas que le Tessin refuse. Ceci est conforme à la loi fédérale qui régit l'entraide internationale, y compris celle prévue par les conventions. M. Luca MARCELLINI : Lorsqu'ici nous recevons une commission rogatoire à caractère fiscal, si nous-mêmes avons des doutes quant à la recevabilité de la demande pour fraude fiscale, nous transmettons généralement le cas à l'administration fédérale des contributions, laquelle contrôle si, selon le droit suisse, ladite infraction fiscale pourrait être qualifiée de fraude fiscale. Pour ma part, j'ai toujours reçu des confirmations. Mme Maria GALLIANI : Moi aussi. Depuis cinq ou six mois, on reçoit de Berne des commissions rogatoires déjà assorties de l'accord de l'administration fédérale des contributions. M. le Rapporteur : Nous interrogerons Berne sur cette question. Je reviens aux voies de recours qui ont été un des motifs de discorde lors de notre dernier voyage. Je sais qu'une réforme est intervenue et qu'un des niveaux de recours a disparu. Comment appréciez-vous cette évolution législative et procédurale ? M. Luca MARCELLINI : C'est un bon résultat. M. le Rapporteur : C'est Mme Carla Del Ponte qui a fait passer cette réforme. M. Luca MARCELLINI : C'est une amélioration. Cela n'a pas été évident parce qu'auparavant, on avait pratiquement quatre voies de recours tout au long de la procédure. M. le Rapporteur : Combien de temps estimez-vous que les Etats requérants ont gagné, grâce à cette réforme, sur les commissions rogatoires non exécutées ? M. Luca MARCELLINI : Au moins une année. M. le Rapporteur : C'est appréciable, mais pas suffisant. M. Emmanuele STAUFFER : Si des mesures provisoires comme la saisie de biens sont demandées, et ceci a pour conséquence un préjudice immédiat et irréparable, il y a une double voie de recours. M. Luca MARCELLINI : La conférence des autorités de poursuite pénale suisse a présenté, il y a déjà un an, une requête au Conseil Fédéral pour qu'on puisse modifier à nouveau la loi fédérale relative à l'entraide, de façon à prévoir que lorsque l'Etat requérant est en mesure d'offrir certaines garanties de procédure, on puisse éviter les voies de recours. M. le Rapporteur : Nous avons eu ce débat avec les Luxembourgeois qui sont, avec les Britanniques et vous les Suisses, les seuls à nous poser ce problème. En France, il n'y a pas de voie de recours. Sur une décision de saisie de pièces et d'enquête à la demande d'un Etat étranger, c'est auprès de la juridiction de l'Etat requérant que celui qui a fait l'objet des mesures contraignantes doit se plaindre et exercer ses droits de la défense. Nous considérons que ce n'est pas à nous de le faire. Nous avons eu, sur ce thème, un débat très orageux avec les banquiers, les parlementaires et le ministre de la Justice luxembourgeois qui de cette manière indirecte protègent leur système bancaire et financier contre l'intrusion du regard répressif en invoquant le respect de la vie privée et les droits de la défense. Les Luxembourgeois viennent de modifier leur loi sur l'entraide en aménageant les possibilités de voies de recours soumises désormais à des délais stricts. C'est un des points qui conduit les membres de notre Mission à maintenir une certaine pression sur la Suisse. Si cette question de voies de recours venait à être résolue, nous pourrions considérer que le reste relève davantage des problèmes interne à la Confédération. M. Luca MARCELLINI : Pour nous, au Tessin, où l'autorité de poursuite pénale est la même que celle qui exécute les demandes d'entraide, on se trouve parfois avec les autres pays dans des situations un peu absurdes. On demande des perquisitions bancaires en Italie, les confrères de Milan demandent les mêmes perquisitions bancaires chez nous : quand nous recevons des Milanais la réponse un mois plus tard, eux ne la reçoivent que deux ans après. Cela nous pose des problèmes dans l'exercice de nos fonctions et dans nos rapports avec les collègues des autres pays. C'est pourquoi nous avons en tant que Conférence des autorités de poursuite pénale suisse pris cette position. A mon avis, une hypothèse qu'on pourrait suivre serait de prévoir une voie simplifiée pour les pays avec lesquels la Suisse est liée par un accord bilatéral ou multilatéral. Cela pourrait être une solution. M. le Rapporteur : Egalement pour les pays adhérant à la convention européenne des droits de l'homme. Quel est le statut de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse ? M. Luca MARCELLINI : C'est une association de tous les procureurs et juges d'instruction de tous les cantons. M. le Rapporteur : Quelles sont les chances de voir la législation évoluer dans le contexte politique actuel fédéral ? M. Jacques DUCRY : Il faut rappeler qu'il y a un projet de code de procédure pénale fédéral. Dans le cadre de l'assistance internationale, le ministère public de la Confédération pourrait éventuellement s'occuper des commissions rogatoires. C'est dans cette direction qu'il faudrait aller pour alléger les cantons de ces tâches. Le Tessin manque de personnes et de structures techniques pour enquêter. Il faudrait une structure fédérale qui s'occupe intégralement de ces requêtes. M. le Rapporteur : Un pays fédéral est plus complexe à faire évoluer qu'un Etat centralisé. Je voulais faire un tour d'horizon des pays qui vous ont posé des problèmes de coopération judiciaire, je pense, notamment à des pays comme le Luxembourg. Avez-vous des difficultés à obtenir leur assistance si vous la demandez ? Avec Monaco, votre expérience a été plutôt positive. Mme Maria GALLIANI : J'ai eu des expériences très positives avec Monaco depuis l'arrivée du Procureur M. Daniel Serdet. M. Luca MARCELLINI : Avant c'était une situation particulière. Une fois il a fallu aller au consulat suisse à Nice pour envoyer par fax à Monaco une demande de commission rogatoire parce que les autorités monégasques n'acceptaient pas une remise brevi manu de l'acte. M. le Rapporteur : Je voudrais qu'on parle du Liechtenstein. M. Luca MARCELLINI : Nous rencontrons des problèmes avec eux. M. le Rapporteur : Comment avez-vous fait pour faire exécuter vos commissions rogatoires ? M. Jacques DUCRY : J'ai eu un seul cas en 1991. J'ai appelé M. Koller, l'ancien ministre de la Justice, et la réponse est arrivée. Après je n'ai plus rien eu avec le Liechtenstein. M. Luca MARCELLINI : J'ai eu deux expériences. Une dans une affaire mineure, il y a cinq ou six années. Cela concernait des perquisitions bancaires, mais pas de saisie de comptes, car c'était encore impossible selon la loi du Liechtenstein. La deuxième commission rogatoire, il y a deux ou trois ans, qui n'a absolument rien donné, était une affaire assez importante avec plusieurs comptes et recherches bancaires. C'était impossible d'obtenir des résultats. Les autorités du Liechtenstein ont continué à me demander des preuves quant à la culpabilité des personnes. M. le Rapporteur : Nous pouvons aller jusqu'à la guerre pour que la situation évolue. Aucun pays européen n'y parvient, et nous n'avons pas la clef, il ne reste plus que la sanction. M. Jacques DUCRY : Il y a cette enquête au Liechtenstein de ce Procureur spécial qui va peut-être faire bouger les choses. M. le Rapporteur : Il a rendu un rapport très nuancé sur la situation de cette Principauté en disant qu'il y avait du vrai et du faux dans le rapport des services secrets allemands du BND, mais ce Procureur est loué par le Prince, donc pas tout à fait indépendant. En réalité, rien n'a changé au Liechtenstein puisque le seul moyen de vérifier que ce que dit le Procureur Spitzer, prétendument indépendant, est vrai ou faux, serait précisément l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les demandes des autorités étrangères qui s'accumulent chez M. Marxer, chef du service juridique du Gouvernement. Cette personne, dont le Prince dit qu'il est incapable de faire autre chose que de laisser les choses s'accumuler - d'ailleurs il n'envoie pas de réponses aux lettres qu'il reçoit, sauf des lettres type à des fins dilatoires - est chargée par le Gouvernement de ne pas répondre pour protéger la place bancaire du Liechtenstein. Nous devons trouver une solution. Il nous faudra vérifier la force des appréciations de M. Spitzer lorsque le Liechtenstein aura changé sa loi et décidé d'avoir une autre attitude en répondant aux demandes de commissions rogatoires internationales venant des nombreux pays qui demandent l'assistance. Nous nous apercevrons alors que le Liechtenstein est une place tournante de l'argent criminel. J'aimerais également recueillir votre expérience sur le Luxembourg. M. Jacques DUCRY : Nous avions un dossier commun Genève, Zürich et le Tessin avec le Luxembourg et la Belgique, dans une affaire de blanchiment en rapport avec des pierres précieuses, dans le cadre également d'une enquête américaine sur un trafic de stupéfiants. Une somme d'argent est passée au Luxembourg où elle a été saisie par nos collègues luxembourgeois, mais finalement l'argent a été débloqué et ses détenteurs sont partis sans problème. Les pierres précieuses, saisies par la Belgique sur commission rogatoire, sont encore à Zürich. Par ailleurs dans cette affaire, toutes les présomptions existaient pour confisquer cet argent et punir les personnes qui étaient en prison au Luxembourg, mais elles ont été relâchées. Ce n'était pas un problème d'entraide judiciaire, mais d'enquêtes communes de la Belgique et du Luxembourg. L'argent est reparti; les Belges ont saisi au Luxembourg l'argent et en Suisse les pierres. M. le Rapporteur : Qu'en est-il de Chypre ? M. Luca MARCELLINI : Cela se passe très bien. M. le Rapporteur : L'attorney général de Chypre vous a répondu dans un délai très bref. Avez-vous eu à identifier un ayant droit économique se dissimulant derrière un trust ? M. Luca MARCELLINI : Il s'agissait de perquisitions de bureaux, pas de comptes bancaires. Les autorités chypriotes ont fait les perquisitions, saisi tous les documents, et envoyé le tout dans un bon délai. M. Jacques DUCRY : J'ai une expérience avec Chypre, mais sans collègue magistrat. Il y a eu une grosse escroquerie en Suisse dont environ la moitié, soit 30 millions de francs suisses, est partie sur un compte bancaire à Chypre. Nous avons invité la banque suisse, qui avait reçu l'argent, produit de l'escroquerie, à faire rentrer ces 30 millions de francs suisses à la partie civile suisse. Il y avait un titulaire de compte bancaire inconnu, dans une banque de Chypre, l'argent était rentré tout de suite, sans commission rogatoire ou saisie officielle, sur le compte de la partie civile. M. le Rapporteur : Nous sommes allés à Chypre. Chypre est un pays très sensible, la moindre histoire y prend des proportions incroyables. Avez-vous d'autres éléments sur les pays non coopératifs ? Mme Maria GALLIANI : J'en ai deux. J'ai d'énormes problèmes avec la Tunisie où je ne sais même pas si ma commission rogatoire est arrivée. Les autorités de Berne ont envoyé sept sollicitations pour avoir une réponse et personne ne donne suite à nos lettres. Les ponts sont totalement coupés. M. le Rapporteur : Quel est le montant de la demande ? Mme Maria GALLIANI : Il s'agit d'une affaire pour blanchiment de 7 millions de dollars, soit 10 millions et demi de francs suisses. J'ai demandé des perquisitions et des documentations bancaires. M. le Rapporteur : De quelle nationalité sont les ressortissants poursuivis par la justice du Tessin ? Mme Maria GALLIANI : Tous les deux sont de nationalité anglaise. M. le Rapporteur : Y a-t-il des Tunisiens en cause ? Mme Maria GALLIANI : Non, même pas. M. le Rapporteur : Alors peut-être la Tunisie se lance-t-elle dans le offshore. Pouvez-vous nous faire passer les courriers, en masquant les identités des personnes concernées, par lesquels vous demandez des informations ? Comme la France entretient des relations assez suivies avec la Tunisie et à l'occasion d'un prochain voyage, nous pourrons peut-être poser la question. Mme Maria GALLIANI : Cela fait déjà un an et demi que j'ai présenté cette demande, sans avoir encore reçu une seule réponse. Je rencontre le même problème avec l'Irlande. J'ai reçu deux lettres dans lesquelles on me demande des informations complémentaires et, dans la deuxième lettre, on me dit que je dois encore apporter des preuves supplémentaires pour démontrer la culpabilité des personnes citées. C'est toujours la même affaire et avec l'Irlande, je n'obtiens rien du tout. M. le Rapporteur : Avez-vous testé le système britannique ? Mme Maria GALLIANI : Oui, j'ai obtenu ce que je voulais, mais avec difficulté. M. le Rapporteur : Avez-vous utilisé le « Serious Fraud Office » ? Mme Maria GALLIANI : Oui. M. le Rapporteur : C'est le meilleur système en Grande-Bretagne. Si vous allez à la police de la City, vous êtes perdu. Mais le « Serious Fraud Office », c'est la contribution du Gouvernement Blair à la lutte contre le blanchiment. Je crois en leur sincérité. Par ailleurs, ils sont en train d'assouplir leur système qui comporte des critères trop contraignants. Avez-vous des expériences avec les îles anglo-normandes ? Mme Maria GALLIANI : J'ai eu une expérience très positive avec l'Ile de Man. J'ai même parlé personnellement avec le Procureur là-bas qui s'est donné beaucoup de peine pour m'aider. J'ai reçu l'exécution de ma demande sans problème. Mais dans tous les cas, j'ai constaté qu'il faut avoir un rapport personnel. Si on envoie une commission rogatoire sans en avoir préalablement parlé avec la personne responsable, on n'obtient pas de résultat. M. le Rapporteur : Avez-vous eu des expériences avec Jersey et Guernesey ? Mme Maria GALLIANI : Non. M. Emmanuele STAUFFER : Avec la Belgique, j'ai eu une expérience négative avec de gros intérêts financiers en cause. Cette affaire remonte à 1994 dans laquelle nous avions demandé l'entraide judiciaire pour blanchiment. Nous avions trouvé, sur un compte suisse, 2,5 millions de dollars. Le ministère public du Tessin a ouvert une procédure pénale pour blanchiment, ensuite le dossier a été bloqué pendant quelques années. Maintenant il s'agit de savoir si le blanchiment sera poursuivi en Belgique ou en Suisse. Nous ne savons pas quoi faire de ces fonds qui sont encore déposés en Suisse. Cela fait maintenant deux ans et demi que j'essaie d'obtenir une réponse de la Belgique sur cette affaire qui concerne deux Allemands, mais absolument rien ne nous parvient. Nous avons demandé la levée de séquestre, mais nous n'avons aucun résultat. M. le Rapporteur : La Belgique a adhéré à la convention de Schengen qui permet, par son article 53, une communication directe de juge à juge. Par exemple, un juge d'instruction espagnol et un juge d'instruction belge se mettent eux-mêmes d'accord avec information au parquet, sans passer par la voie diplomatique, sur les modalités de l'enquête. On peut presque considérer qu'il y a là comme un parquet européen supranational. Votre cas est très isolé car, quand nous avons rencontré vos collègues belges, nous avons trouvé des magistrats très engagés dans la lutte anti-blanchiment. M. Emmanuele STAUFFER : C'est probablement un cas particulier. M. Luca MARCELLINI : J'ai eu de bonnes expériences avec Curaçao. M. le Rapporteur : Quel type d'information avez-vous pu obtenir ? M. Luca MARCELLINI : C'étaient des perquisitions bancaires et de bureaux. L'expérience, en revanche, a été mauvaise avec les îles Caymans où nous n'avons rien pu obtenir. Il a été répondu à notre lettre que la situation ne pouvait pas donner lieu à des perquisitions, selon leurs lois de procédure. Mme Maria GALLIANI : Ils m'ont répondu, mais pour me donner des conseils pour réécrire ma commission rogatoire et l'expédier chez eux. Ce qu'ils me demandent n'est pas très compliqué. Ils font peut-être une différence entre le juge qui va ordonner une perquisition et le magistrat Procureur public. Je dois faire une sorte de déclaration indiquant qu'ici, selon le droit suisse, je suis celle qui peut prendre cette décision et que je n'ai pas besoin de l'autorisation d'un juge. C'est un peu ce qui est également demandé par les autorités anglaises. Ils me demandent aussi ce qu'ils appellent « probable causes », c'est-à-dire que je dois donner encore plus d'indices pour démontrer le bon fondement de ma question. Comme ce n'est pas trop difficile, je vais remettre l'affaire en route. M. Luca MARCELLINI : Dans mon cas, l'entraide avait été refusée parce qu'on était dans la phase des informations préliminaires Mme Maria GALLIANI : Ils me demandent également si les deux personnes en détention ont déjà été condamnées ou pas, et si nous avons une inculpation formelle. M. le Rapporteur : Quelle est la configuration de ce que vous cherchez à découvrir ou à mettre à jour, et pourquoi êtes-vous concernée par de l'argent qui se trouverait aux Iles Caymans ? Mme Maria GALLIANI : Le blanchiment, qui s'est produit en Suisse, a été un blanchiment très rapide. L'argent est arrivé ici avant de repartir tout de suite vers diverses destinations sur des comptes bancaires aux îles Caymans et en Tunisie. C'est toujours la même affaire. Douze pays sont concernés pour une somme de 10,5 millions de francs suisses. Cette somme, qui est arrivée ici, a été divisée en petits morceaux. M. le Rapporteur : Avez-vous identifié qui se cache derrière la société qui sert de véhicule ? Mme Maria GALLIANI : En Suisse, j'ai seize personnes physiques et morales, mais je sais en Suisse qui se cache derrière les personnes morales. Mon problème a été de découvrir où allait l'argent et qui l'a reçu. Sur les douze pays concernés, j'ai pu résoudre cette question dans huit ou neuf pays, mais pas en Irlande, aux îles Caymans et en Tunisie. Les autres pays concernés étaient l'Espagne, où nous n'avons eu aucun problème, de même que dans quatre Länder en Allemagne et en Italie à Palerme. J'ai eu une très bonne collaboration avec Monaco ainsi qu'à l'Ile de Man. J'ai obtenu des réponses, avec quelques problèmes en Angleterre et en Colombie. Aux Etats-Unis dans l'Etat de Floride et de New York, où je suis allée personnellement pour obtenir la documentation et mener des interrogatoires, je n'ai eu aucune difficulté. M. le Rapporteur : Vous avez donc pu identifier, dans tous ces pays, sans grande difficulté, les destinataires de l'argent. Mme Maria GALLIANI : Tout à fait. J'ai même pu, dans deux cas, les interroger car ils étaient en détention. L'argent provenait d'Italie, d'Angleterre et des Etats-Unis et résultait d'un trafic de cocaïne qui venait de la Colombie et qui avait circulé en Italie, aux Etats-Unis et en Angleterre. L'argent était entreposé partout en Suisse, en particulier dans les cantons de Zürich, du Tessin et de Genève. Vingt-quatre ou vingt-cinq banques étaient concernées. L'argent est reparti tout de suite sur des comptes de personnes physiques et morales ainsi que sur des comptes de sociétés d'assurance pour payer des assurances. C'est un moyen de blanchiment. Vous avez une description de ce système dans le rapport du GAFI de février 1999. C'est exactement la méthode qui a été utilisée. L'argent en dollars a été utilisé, en Suisse ou aux Etats-Unis, pour payer des fournisseurs de biens de consommation en Colombie ou payer des assurances sur la vie. J'ai eu quelques problèmes avec l'Angleterre, mais c'était le problème le plus grave car la cocaïne y a été vendue. Dès que les Anglais ont découvert que j'avais beaucoup d'informations à leur donner, ils ont collaboré activement. M. le Rapporteur : Je constate que l'Irlande ne veut pas que vous découvriez qui se cache derrière ces affaires de blanchiment de l'argent de la drogue. Mme Maria GALLIANI : Tout à fait. Une des personnes en détention est un citoyen anglais qui habitait à Dublin, où il avait sa profession comme fiduciaire. M. le Rapporteur : Merci pour tous ces points. Je voudrais maintenant aborder le système probatoire. Comment fonctionne-t-il au Tessin et quel serait selon vous le système d'administration de la preuve idéal pour lutter contre le blanchiment ? Comment l'améliorer ? M. Luca MARCELLINI : En réalité, pour nous, dans notre situation particulière, le problème principal est celui de l'obtention dans les autres pays des informations utiles. C'est là le problème. Nous avons très souvent de l'argent sous séquestre, on voit des situations étranges qui ne peuvent pas s'expliquer, sauf avec des délits derrière cet argent, mais on se trouve dans une grande difficulté pour obtenir de l'étranger des informations utiles. Pour nous, le problème se pose particulièrement par rapport à l'Italie : ils poursuivent l'association de malfaiteurs, ce qui leur évite souvent de prouver le crime spécifique. Pour nous, il y a quand même la nécessité de démontrer que l'argent est le résultat d'un crime. Très souvent, nous avons des dossiers qui nous arrivent d'Italie dans lesquels nous voyons que la personne liée à une autre dans une association criminelle, a commis des crimes, mais nous n'avons aucun lien entre l'argent et le crime. C'est notre problème principal. M. le Rapporteur : Comment y remédier ? M. Jacques DUCRY : La condition de l'application de notre article 305 bis nécessite l'existence d'une infraction criminelle préalable. M. le Rapporteur : Et la connaissance par celui qui manie l'argent, qu'il utilise le produit de ce crime. M. Jacques DUCRY : Si on n'a pas cette information, nous sommes démunis. J'aimerais évoquer les problèmes avec la Russie avec laquelle Genève rencontre de nombreuses difficultés, ces jours-ci. On avait une bonne collaboration à Moscou avec des magistrats qui ont tous été limogés. Sans crime on ne peut rien faire. Ensuite il y a un problème de confiscation. M. Luca MARCELLINI : En vertu de la législation suisse, la confiscation est possible par exemple s'il y a une organisation criminelle mafieuse, mais dans les autres cas, lorsqu'il s'agit, comme la loi italienne le prévoit, de simples associations de malfaiteurs, ce n'est pas suffisant. Comment y remédier ? Il est difficile de trouver une solution. C'est vrai qu'on pourrait songer à un élargissement des cas de renversement de la charge de la preuve à certaines conditions. M. le Rapporteur : C'est ce qu'ont fait les Italiens avec des résultats contrastés. En France, cette situation n'a pas passé l'obstacle du Conseil constitutionnel, mais nous avons cette volonté politique. M. Luca MARCELLINI : Pour nous, le renversement de la charge de la preuve existe dans le cas d'organisations criminelles mafieuses. On pourrait étendre cette solution à d'autres situations, par exemple lorsqu'une personne a déjà été condamnée pour certains crimes et se trouve en possession de sommes d'argent qu'elle ne peut pas justifier. M. Jacques DUCRY : Nous avons le cas de Mikhaïlov à Genève. M. le Rapporteur : Quelle est votre analyse de cette affaire ? M. Jacques DUCRY : Les Russes avaient donné des éléments, en avril 1998, à Interpol qui les avaient transmis au substitut du Procureur Bernard Bertossa. Mais la décision de la Cour genevoise ne les a pas considérés suffisants pour démontrer que Mikhaïlov appartenait à la mafia russe et que l'argent était d'origine criminelle. A Genève il y a une décision récente qui a accueilli le recours de M. Stolpovshikh, qui a cassé la décision de notre collègue le juge Devaud. Ce dernier a refait la saisie. Il a des arguments nouveaux qu'il n'avait pas développés. Dans ce dossier, il y avait toutes les phases d'un blanchiment, une documentation partielle mais suffisante à nos yeux pour justifier le crime. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles la Chambre d'accusation a cassé la décision. Le cas de ce Russe touche le Tessin car les Russes ont des activités ici et de l'argent, nous sommes très concernés. Nos moyens ne sont pas suffisants pour mener ce type d'enquête d'une telle envergure. Nous travaillons donc avec Genève. M. le Rapporteur : Pourrions-nous parler du Bureau de communication et de ses performances ? Mme Maria GALLIANI : J'ai eu de bonnes relations avec le Bureau de communication. Ses responsables nous ont envoyé en une année environ une cinquantaine de cas depuis septembre 1999. Pour ma part, mes relations avec eux ont été bonnes. L'affaire, que je viens d'évoquer, a commencé avec une communication de Berne. J'ai reçu, il y a environ un mois, une autre communication de Berne qui m'a permis de bloquer environ 20 millions de francs suisses. Toutefois il me faut maintenant rechercher le crime spécifique à l'origine de ces mouvements de fonds. Pour ce faire, je dois aller en Italie où je vais avoir des problèmes avec des procédures qui ne sont pas encore terminées en Italie et qui sont très longues avec plus de cent personnes poursuivies. Je vais garder l'argent sous séquestre et je ne sais pas encore si je vais arriver à un résultat. Néanmoins, avec le Bureau de communication, j'ai une très bonne expérience car, quand je reçois une communication, je m'aperçois qu'il y a quelque chose à faire. M. Emmanuele STAUFFER : Je ne pense pas qu'il faille exiger de ce Bureau de communication que toutes les choses soient utilisables et soient le point de départ d'une grosse enquête de blanchiment. Si de temps en temps, certaines opérations sont encore le fruit de la méconnaissance des mécanismes de la loi, des cas intéressants nous sont quand même transmis. D'autres ont été inutiles dans la mesure où ils ne nous ont pas permis de commencer quelque chose, mais il est toujours mieux de les recevoir. Mme Maria GALLIANI : On en a connaissance, par principe, c'est toujours mieux. M. le Rapporteur : Le nombre de communications a-t-il augmenté d'une année sur l'autre? Combien en avez-vous reçu l'année dernière et cette année en comparaison ? M. Emmanuele STAUFFER : Il y a eu une certaine diminution cette année. Le motif n'est pas connu. Contrairement aux commissions rogatoires, le Bureau de communication fait un filtrage assez poussé et sélectionne vraiment les cas avant de nous les envoyer. M. le Rapporteur : Connaissez-vous les raisons pour lesquelles M. Thelesklaf a démissionné ? Tous : On ne sait pas. M. le Rapporteur : Etes-vous élus ? M. Luca MARCELLINI : Nous sommes désignés par le Parlement. A Genève, c'est le suffrage universel qui désigne le Procureur général et les juges d'instruction, tandis que les substituts du Procureur général sont nommés par le Gouvernement. M. le Rapporteur : Le canton de Genève est-il le seul canton où le Procureur général est élu au suffrage universel ? M. Jacques DUCRY : Parfois c'est le tribunal qui désigne le Procureur. Parfois c'est le Parlement. Cela dépend des lois cantonales. M. le Rapporteur : Au Tessin, en tant que Procureur, êtes-vous, sur le plan statutaire, protégé contre toute atteinte à votre indépendance ? Pouvez-vous être révoqué ? M. Luca MARCELLINI : Non. Notre mandat est de durée déterminée mais il est renouvelable. Jusqu'à présent, il est de cinq ans, et dès le 1er janvier 2003, il sera de six ans. Nous pouvons toutefois être révoqués par le conseil de la magistrature pour des raisons disciplinaires. M. le Rapporteur : Nous avons pris connaissance de ce que la presse appelle le « Ticinogate ». Pouvez-vous nous donner votre opinion sur cette affaire ? Dans tous les pays européens, les juges sont régulièrement attaqués, quels que soient leurs statuts, qu'ils soient nommés par les gouvernements ou le Parlement, ou élus par le peuple. M. Luca MARCELLINI : Au Tessin, il ne s'agissait pas d'une attaque envers la magistrature. C'était une chose tout à fait différente, malheureusement beaucoup plus concrète et liée à des faits qui semblent être bien précis. Il s'agissait tout simplement du fait que, selon une enquête conduite par la magistrature italienne de Bari sur la base d'écoutes téléphoniques, il apparaissait que quelqu'un, dans la magistrature tessinoise, avait été probablement payé pour libérer une partie des fonds dans une procédure de confiscation. Il s'agissait d'un cas de criminalité organisée lié à la contrebande. La justice de Bari a transmis ce dossier au ministère public de la Confédération helvétique, lequel a pris contact avec le Gouvernement tessinois et a proposé de nommer un Procureur extraordinaire pour instruire cette affaire. Dans une des écoutes téléphoniques, une personne disait à une autre de ne pas poursuivre ladite affaire et de payer la moitié de la somme libérée à « un ami ». Malheureusement, dans la première de ces conversations, un des deux interlocuteurs, probablement parce qu'il ne voulait pas nommer son ami, semble avoir donné mon nom. Je pouvais donc être la personne destinée à toucher la moitié de cette somme. Il faut préciser que chargé de cette affaire, j'avais demandé la confiscation de cette somme. Le Gouvernement a donc estimé que c'était une bonne solution de charger pour cette affaire un Procureur extraordinaire. En dehors de moi-même, qui avait demandé la saisie et la confiscation, le président du tribunal pénal qui devait se prononcer sur cette confiscation était aussi concerné par ce dossier. Je dirai, heureusement pour ce qui me concerne, qu'en une semaine d'enquête, on a pu établir facilement que l'ami de l'interlocuteur était, malheureusement pour notre justice, le président du tribunal qui avait des liens très forts avec cette personne. Cela ressortait très bien dans les autres conversations téléphoniques qui suivaient et c'est lui qui a fait l'objet de l'enquête extraordinaire. On a lu, dans les journaux, qu'il y aurait bien eu un lien important entre ces deux personnes s'expliquant par les difficultés financières de la femme du président du tribunal qui a provoqué cette situation. Pour un Procureur général, ce n'est pas agréable de se trouver dans une telle situation. Pour ma part, il a été préférable d'avoir un Procureur spécial, tout à fait extérieur, pour qu'il puisse vérifier que tout était en ordre pour les collègues, la population. A la suite de cette affaire, on a quand même découvert beaucoup de liens étranges entre cette personne, amie du juge, et des avocats, des politiciens, ou des fonctionnaires de l'administration. Cette personne qui est ici, fait formellement du commerce international de cigarettes et parait avoir des liens avec des groupes criminels. De l'autre côté, vous trouvez une personne aisée qui fait du commerce, mène une vie normale dans le luxe et a accès grâce à ses relations à beaucoup de personnes. C'est un danger de se lier avec ce genre de personnes actives dans la contrebande. Nous avions déjà dénoncé ce danger il y a quelques années. On sait que ce genre de personne a forcément des liens avec les organisations criminelles. On peut toujours parler d'un commerçant international de cigarettes, mais celles-ci doivent être vendues quelque part. La vente au détail est quand même dans les mains des organisations criminelles. Le problème qui se pose pour nous, c'est que le pur et simple commerce de cigarettes fait en Suisse ne peut pas être un délit ou un crime. Si quelqu'un achète des tonnes de cigarettes en Hollande et les revend à une société panaméenne, c'est dans le pays où se déroule la vraie activité illicite qu'il faudrait recueillir les preuves utiles démontrant que cette personne est liée à des organisations criminelles. S'il s'agit d'une organisation criminelle mafieuse, on peut agir ici. On peut collaborer avec les autorités étrangères, faire des écoutes téléphoniques, des contrôles bancaires, des interrogatoires. M. Jacques DUCRY : Depuis la fin des années 80 et début 90, nous avons des dossiers au Tessin sur ces gens dont on connaît le nom. Si l'Italie ne nous donne pas les moyens pour intervenir, on ne peut rien faire. Le problème, c'est l'Italie. Nous recevons ces personnes, qui travaillent avec des banques, des avocats, des fonctionnaires pour leur permis de séjour. Dans une enquête que mène actuellement le Procureur général, on a trouvé presque 12 millions de francs suisses en espèce dans le bureau d'un avocat. On peut avoir des défauts, mais les magistrats du Tessin ne veulent pas subir les conséquences de l'inactivité étrangère. Si on ne nous donne pas les éléments pour agir, on ne peut rien faire. Le ministre des Finances italien critique la Suisse car chez lui, il y a les morts et chez nous l'argent. Mais les Italiens savent qu'ils doivent nous donner les moyens de preuve pour poursuivre les ressortissants qui résident chez nous. M. Luca MARCELLINI : On le voyait très bien dans cette affaire de confiscation. J'avais trouvé un membre de la Sacra Corona Unita qui avait ouvert un bureau à Lugano dans lequel il faisait des activités de contrebande. On a contrôlé, séquestré l'argent qui était ici dans des sociétés à son nom personnel et dans des sociétés sous les noms de sa famille, soit 3 millions de francs suisses. L'Italie n'a pas fait arriver l'ordre d'arrestation internationale. Ensuite, j'ai su que cette personne était déjà en procès en Italie pour organisation de genre mafieux. Les débats étaient déjà en cours. Nous avons attendu pendant des années la décision de la cour italienne. En 1999, la décision de premier degré de la cour italienne n'était pas encore rendue. J'avais alors de réelles difficultés à conserver cet argent sous séquestre pendant plusieurs années au motif que j'attendais la décision de la cour italienne. J'avais eu trois recours. Au troisième, notre juge d'instruction, dans sa décision, m'a dit qu'il confirmait, pour la dernière fois, le séquestre, mais pas pour longtemps car il fallait trouver une solution. J'étais allé à Lecce où j'avais obtenu la remise de documents contenant les dépositions de repentis. Dans ces déclarations, on disait que cette personne que je poursuivais avait été admise dans la Sacra Corona Unita et il a juré en tant que membre de cette organisation. Cet élément suffisait à mon avis, pour demander la confiscation. Dans la réalité, on arrive très souvent dans les procédures de confiscation à un accord judiciaire proposé par le président du tribunal qui est compétent pour ce genre de décision. Probablement à cause de la surcharge et aussi de la forme de procédure car la procédure de confiscation est une procédure civile. Dans le contexte de procédure civile, le juge plutôt que de faire une instruction civile qui va durer longtemps, propose des transactions. C'est ce qui a été envisagé dans ce cas, mais le problème c'est que derrière la proposition de transaction, il y avait quelque chose d'autre. Heureusement que j'avais refusé la première proposition de transaction. Pour finir, le résultat auquel on est arrivé était juste, le corrompu n'a pas probablement été payé. M. le Rapporteur : Je vous remercie de toute cette narration qui est édifiante. Je ne vois pas d'autres questions. Nous avons approfondi les choses. Avez-vous d'autres points que vous souhaiteriez évoquer avec nous ? M. Régis de BÉLENET : J'imagine que vous avez suivi les travaux sur la convention sur la criminalité transnationale organisée qui se sont déroulés à Vienne. Ils ont abouti à un texte, le 29 juillet, qui doit être présenté aux Nations unies et faire l'objet d'une signature à Palerme avant la fin cette année. Comment voyez-vous l'apport que peut constituer ce texte à vos activités ? M. Jacques DUCRY : Nous n'avons pas encore pris connaissance de ce texte. Il peut y avoir tous les accords internationaux, mais tout dépend ensuite de leur mise en _uvre. La volonté des magistrats y est, mais si les moyens ne suivent pas, c'est l'éternel problème. M. Luca MARCELLINI : Nous voulions encore signaler que des cas individuels d'entraide ne fonctionnent pas. J'ai un cas avec l'Espagne de requête de perquisition bancaire et de séquestre d'immeubles à Tenerife. Je n'ai aucune réponse depuis 1993 alors que nous les sollicitions chaque année. M. le Rapporteur : Gibraltar ? M. Luca MARCELLINI : Non, rien à signaler. Mais même avec la France, où j'ai envoyé des commissions rogatoires pour des perquisitions d'appartements et des saisies de logement à Paris, j'ai connu des difficultés. C'était une opération coordonnée dans une vingtaine de pays il y a deux ou trois ans. Je dois dire que cela a fonctionné dans peut-être dix-sept ou dix-huit pays sur les vingt, mais à Paris et Nice, aucune réponse. Six ou huit mois après, quelqu'un m'a téléphoné pour me demander si ces perquisitions et saisies étaient toujours nécessaires. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous transmettre les documents liés à cet échange ? En effet, il est toujours intéressant d'éduquer ses propres juges. M. Luca MARCELLINI : Mais ce sont des cas individuels. Il arrive chez nous aussi qu'une requête, pour une raison ou une autre, reste quelque part ou qu'on n'a pas le temps d'y répondre. M. Jacques DUCRY : J'ai une affaire qui date d'il y a trois ans. M. Luca MARCELLINI : J'ai simplement fait deux ou trois demandes d'entraide en France. Mme Maria GALLIANI : La France ne demande pas de compléments d'informations. J'en ai fait deux ou trois sans problème. M. Luca MARCELLINI : J'ai eu une fois un problème avec la Corse dans le cadre d'une affaire complexe. On m'a envoyé un exposé des faits en me demandant comment préparer la commission rogatoire. Je trouve que c'est une bonne façon de procéder. J'ai préparé un texte avec les formalités qu'une commission rogatoire doit avoir selon les critères de notre loi. Je l'ai envoyé par fax en Corse et peut-être six mois après, j'ai reçu la même demande. On avait complètement ignoré le travail qui avait été fait. J'ai répondu qu'elle n'était pas conforme à notre législation et j'ai indiqué à nouveau certains critères nécessaires pour nous. En tout cas, il est important d'avoir des contacts personnels, de se déplacer quand on peut le faire, pour l'efficacité de l'entraide. Si on reçoit ensuite un projet par fax, en général cela fonctionne assez bien. M. Jacques DUCRY : J'ai lu dans la presse que votre collègue François d'Aubert avait critiqué violemment le Tessin quant à sa présumée inaction face à la mafia russe. Il n'est pas venu, car nous aurions pu lui expliquer les problèmes que nous rencontrons avec notre parquet. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse il y a vingt-six cantons et que Genève enquête aussi sur le Tessin pour ce qui concerne ces affaires que M. d'Aubert évoquait. Nous avons pris des accords pour savoir qui fera quoi dans ce contexte. Nous voulons dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Genève a fait un travail énorme sur les Russes, qu'on aurait peut-être fait moins bien et en tout cas dans un laps de temps bien plus long, avec un magistrat à plein temps, plus quelques collaborateurs. Expliquez à vos collègues que ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou de paresse, mais de structure, et que cela ne dépend pas de nous. Nous sommes passés de 12 à 15 procureurs, mais pour nos exigences d'enquête, nous devrions être vingt-cinq. Nous avons été douze enquêteurs pendant les vingt dernières années. En vingt ans, nous avons pu assister à une évolution négative épouvantable. On subit des critiques, qu'il faut adresser au pouvoir politique, législatif ou exécutif, et aux structures qui ne dépendent pas de nous. Ce ne sont pas seulement les lois ou les recours, mais aussi le nombre de personnes et cette structure qui nous empêchent de faire mieux. M. Luca MARCELLINI : Les politiciens estimaient peut-être qu'une justice pénale trop forte aurait pu être dangereuse pour l'économie, ce qui a freiné dans le passé l'aide à la magistrature. Dans les dernières années, le point de vue politique a quand même, mais assez timidement, changé par rapport à la justice pénale. Depuis deux ou trois ans, nous récupérons les retards accumulés et une certaine évolution se fait sentir avec l'adoption de procédures plus favorables depuis une année, et les augmentations d'effectifs. Une autre réforme est en vue, dans un an ou deux, pour la création de la fonction de substitut du Procureur, ce qui pourrait augmenter le nombre de magistrats en mesure de prendre des décisions. De la part du pouvoir politique, on voit qu'il y a une volonté. Mais avant il faudra reprendre les milliers de dossiers qu'on a accumulés pendant ces années. M. Jacques DUCRY : On ne s'occupe pas uniquement des grosses enquêtes, mais aussi des délits de moindre importance. Ce sont aussi les petits cas qui nous empêchent de travailler. M. le Rapporteur : Que dois-je dire à mon collègue François d'Aubert ? M. Jacques DUCRY : D'avoir confiance. Qu'il appelle le Procureur Général ou moi-même pour qu'on lui explique ! M. le Rapporteur : Ce que j'ai compris, sur les questions russes, c'est que vous avez délégué le travail de rattrapage de lutte contre la délinquance et le blanchiment de l'argent sale russe à Genève afin que ce canton prenne en charge une partie de ce que vous n'avez pas pu faire. M. Jacques DUCRY : Zürich n'est pas très active. J'avais essayé sans résultat, en 1996, de transmettre à Zürich un dossier qui concernait une grosse affaire russe. Genève a la volonté et les moyens de le faire. Genève a une réalité russe bancaire sur son territoire, il y avait aussi les comptes au Tessin des Russes qui sont aussi propriétaires immobiliers. M. Luca MARCELLINI : Avec Genève, nous avons une bonne assistance. M. le Rapporteur : Pourquoi ne se passe-t-il rien à Zürich ? M. Luca MARCELLINI : Je n'ai pas d'éléments pour faire l'analyse. M. le Rapporteur : Pourquoi sur ce dossier russe le canton de Zürich n'a-t-il rien fait ? M. Jacques DUCRY : Sur ce dossier, ils devaient mettre des écoutes téléphoniques et ils ne les ont pas faites. Il y avait tous les éléments, mais ils nous ont dit que leur procédure était différente et qu'il leur fallait des preuves pour faire les écoutes téléphoniques. Je leur ai dit que si on a les preuves, il n'est plus nécessaire de faire des écoutes téléphoniques. M. Luca MARCELLINI : Ils sont plus formels dans l'évaluation des commissions rogatoires. Lorsqu'arrivent les commissions rogatoires de l'étranger, qui touchent les différents cantons, lorsque Zürich est désigné comme canton directeur, qui doit décider l'admissibilité, on voit parfois des décisions négatives assez formelles. Mme Maria GALLIANI : Ils ne sont pas flexibles. C'est peut-être une question de mentalité. M. Luca MARCELLINI : Si la commission rogatoire n'est pas en ordre, peut-être chez nous l'approche est de prendre contact et de la modifier, tandis qu'à Zürich, ils sont plus formels. M. le Rapporteur : Merci d'avoir collaboré à ce travail difficile. Je vous renouvelle mes remerciements les plus appuyés en vous souhaitant bon courage comme à tous vos collègues magistrats qui méritent le soutien de toutes les représentations nationales. M. Luca MARCELLINI : Il est toujours intéressant pour le magistrat de voir que le pouvoir politique s'intéresse à sa situation, même si ce n'est pas toujours évident. Audition de M. le Professeur Paolo BERNASCONI, Avocat, Professeur des universités de Zürich et Saint Gall, (compte-rendu de l'entretien du 27 septembre 2000 à Lugano - Suisse) Présidence de M. Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur M. le Rapporteur : Merci de vous être déplacé. Peut-être devrais-je dire un mot sur la façon dont nous travaillons depuis un an et demi. La Mission, dont je suis rapporteur, est née de la rencontre à l'Assemblée nationale, en 1998,entre des parlementaires nouvellement élus et les magistrats signataires de l'appel de Genève. Nous avons alors décidé de mettre en place une action de soutien à tous ces magistrats européens qui travaillent par-delà les frontières. Nous nous étions également engagés à faire une évaluation précise de chacun des dispositifs juridiques des pays européens afin d'avancer dans la levée des obstacles à la coopération et à la lutte contre le blanchiment. Nous sommes allés en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg en Angleterre, à Gibraltar et dans les Iles anglo-normandes, en Espagne, en Italie, au Liechtenstein, en Autriche, à Monaco, à Chypre et en Suisse. Nous avons voulu revenir en Suisse car il nous a semblé qu'il fallait y analyser la situation canton par canton, plutôt que d'en avoir une vision globale. M. Paolo BERNASCONI : Le volume des sommes gérées par la place bancaire suisse est estimé à 4 000 milliards de dollars. M. le Rapporteur : C'est également une des raisons de ce second déplacement. M. Paolo BERNASCONI : Avez-vous rédigé un rapport sur la Suisse ? M. le Rapporteur : Non, puisque nous attendons de terminer ce voyage pour nuancer nos appréciations selon les cantons, les cultures, les systèmes juridiques locaux et que nous souhaitions voir fonctionner avec davantage de recul le système de déclarations de soupçons. Demain, nous rencontrons de nouveau les fonctionnaires à Berne car il ne suffit pas de lire les rapports. D'ailleurs le rapport du MROS exige que nous nous posions quelques questions sur le fonctionnement de ce Bureau de communication, au vu des résultats, après quelques mois d'activité. Le système bancaire, parabancaire, financier, juridique, soumis selon la loi LBA au principe de l'autorégulation avec la création d'organismes d'autorégulation, mérite qu'on s'y attarde car c'est un système original. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce thème. Que pensez-vous de ce mécanisme d'autorégulation et comment appréciez-vous son évolution ? L'autre point qui m'intéresse concerne les difficultés que rencontrent les magistrats pour faire la preuve du lien entre l'argent qu'ils découvrent sans justification et l'existence d'un crime ou d'un délit en amont, en particulier commis à l'étranger. Tous les pays européens que nous avons visités ont attiré notre attention sur les difficultés d'administration de la preuve. Les nombreux échecs de l'accusation publique sont souvent liés aux défaillances de ce système probatoire. Plusieurs pays, dont l'Italie, l'Espagne, la France, organisent actuellement des mécanismes d'allégement du renversement de la charge de la preuve. En votre qualité d'émérite juriste, pourriez-vous nous donner votre avis sur ce sujet ? Comment améliorer l'efficacité et progresser dans la lutte contre la criminalité ? Comment la législation dans cette guerre doit-elle évoluer et comment la faire évoluer ? Je sais que les réponses toutes faites existent. Le parquet européen en fait partie. Toutefois, nous considérons que des solutions qui seraient radicales, donc impossibles à mettre en _uvre immédiatement, ne peuvent être une réponse politique viable. Nous recherchons l'amélioration concrète, pas à pas, efficace, pragmatique, qui permettra à tous les combattants de la lutte anti-blanchiment de trouver du soutien. Il serait intéressant également que vous nous donniez votre sentiment sur les liens entre le blanchiment et la fraude fiscale, puis sur l'exception fiscale en vigueur en Suisse contre laquelle nous nous élevons et la manière dont elle a été opposée, utilisée. M. Paolo BERNASCONI : J'ai trouvé l'initiative des magistrats de l'appel de Genève et de l'appel de Bruxelles très bonne. Il serait intéressant de procéder en faisant une analyse séparée entre les moyens de prévention et de répression. Je commencerai par la prévention. Je ne suis pas partisan d'un système totalement fondé sur l'autorégulation, mais plutôt d'un système mixte, c'est-à-dire un cadre réglementaire avec les autorités de surveillance et, à l'intérieur, certains secteurs laissés à l'autorégulation. C'est l'expérience que nous avons eue avec la Commission fédérale des banques et que nous avons aujourd'hui avec les organismes d'autorégulation de la LBA. D'ailleurs cette dernière expérience démontre que ce mot « autorégulation » entraîne un travail très lourd. Je suis moi-même conseiller de plusieurs organismes d'autorégulation. L'autorégulation comporte plusieurs phases. La première est celle de l'autorisation qui demande beaucoup de temps. Un organisme d'autorégulation, qui compte cinq cents affiliés, doit tous les vérifier sur le plan documentaire. C'est un travail bureaucratique très important. La deuxième phase est une phase de formation de base que nous devons renouveler chaque année. L'Autorité fédérale de surveillance, au Département des Finances, prévoit par an un minimum d'une journée et demie de formation. Mais c'est un travail très important car après avoir approché les cinq cents banques en Suisse, on approche maintenant le secteur non bancaire qui reste un secteur presque inconnu. Au Tessin, seul canton à disposer d'un « financial services act », on en a autorisé mille. Dans une quinzaine de jours, M. Villiger, Chef du Département fédéral des Finances tiendra une conférence de presse sur les résultats des travaux de la commission d'experts qui a travaillé sur cette idée de « financial services act ». Cela a été relaté dans la presse le 16 novembre 2000. Ma première interrogation est la suivante : on parle d'améliorer la surveillance, mais on ne sait pas qui est le destinataire. On sait qu'il y a environ mille opérateurs et intermédiaires financiers au Tessin, mais combien sont-ils à Genève, deuxième place financière, ou Zürich, première place financière ? On se retrouve avec peut-être dix ou vingt mille professionnels très différents. Je suis toujours curieux de savoir comment les pays étrangers font avec leur « financial services act » pour contrôler la masse d'opérateurs et d'intermédiaires financiers de Londres, de Paris... Si on le fait sérieusement, c'est horriblement difficile. La Suisse a choisi pour l'instant ce système d'autorégulation, mais cela peut changer. Après cette première phase d'autorisation, puis cette seconde phase de formation Une inspection est un processus qui demande du temps. Effectuer une seule inspection rigoureuse, simplement sous l'angle anti-blanchiment, peut prendre une heure, voire deux, avec deux réviseurs expérimentés. C'est une tâche colossale si elle est prise au sérieux. Je continue de croire à l'auto-surveillance, mais nous n'en verrons les résultats que d'ici cinq ou dix ans. J'estime qu'une loi votée au Parlement nécessite un minimum de cinq ans avant de faire ressentir réellement ses effets. L'obligation de notification à l'autorité fédérale commence à jouer, mais seulement après cinq ans, on pourra tirer un premier bilan. Je crois à la prévention au sens où, par ce système d'autorégulation, on réussit à diffuser, d'une façon capillaire, un système d'auto-surveillance. J'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années. Les changements que j'ai vus se mettre en place en Suisse sont colossaux. Il y a eu un revirement général de comportement sur le secret total, avec des initiatives imposées aux détenteurs de secrets professionnels et d'affaires. Cela a pris beaucoup de temps. Peut-être est-ce grâce au fait qu'il y a des sanctions, que les organisations internationales - publiques et privées - soulignent de plus en plus la qualité des institutions dans le secteur tertiaire, leur fiabilité. Il y a toute une constellation qui a aidé en ce sens et qui continuera à le faire. Par ailleurs, s'ouvre là, pour les réviseurs et les auditeurs, un marché énorme. Les consultants en tout genre offrent des services nouveaux aux banques et aux intermédiaires financiers qui ont besoin de spécialistes. Les auditeurs se réunissent et proposent du conseil. Lorsque l'on réussit à intéresser le marché et ses différents intervenants, les jeux sont faits car ce sont eux qui vont promouvoir l'activité. Il faut faire des expériences. Celle de l'obligation de l'identification de l'ayant droit économique est positive, mais aujourd'hui elle arrive à son terme. Je me pose alors la question suivante. L'ensemble du système de l'identification et de l'enregistrement de l'ayant droit économique repose sur la déclaration faite par le client. Celui-ci dit s'appeler M. Untel, il ouvre un compte au nom d'une société du Panama dont Mme Untel est l'ayant droit économique. Pour justifier l'identité de cette dame, il donne sa signature, parfois authentifiée, et son passeport : tout se fait sans que la banque n'ait jamais ni vu ni interpellé Mme Untel. Il y a un mois, un banquier m'a indiqué que certains clients étaient rayés hors de Suisse. A Monaco, un individu, pour 200 000 francs, se déclare comme étant l'ayant droit économique de qui veut bien le rémunérer. Ainsi, par exemple, je donne sa signature et son passeport à la banque, et du coup ce Monsieur devient l'ayant droit économique. Payez-le et il accepte le risque. Il faut maintenant accepter de sauter le pas suivant. La banque ne peut accepter la déclaration du client concernant l'identité de l'ayant droit économique seulement qu'en présence de l'ayant droit économique. C'est très lourd sur le plan bureaucratique et organisationnel. Sans vouloir suggérer qu'en Suisse et dans les pays du GAFI le système ne fonctionne pas après dix ans, il n'en demeure pas moins que trop de personnes encore peuvent profiter de cette lacune qui doit être comblée. Il suffirait d'étendre à la signature de l'ayant droit économique le système en vigueur pour la récolte de la signature des procureurs du titulaire du compte bancaire avec enregistrement centralisé comme en Suisse d'après la circulaire de l'ASB en vigueur depuis le 1er juillet 2000. M. le Rapporteur : C'est ce que l'on nous a rapporté dans plusieurs pays que nous avons visités. Un procureur m'a dit qu'à Monaco, c'est le trou noir du système, et le GAFI n'a jamais voulu aller au-delà. M. Paolo BERNASCONI : Le GAFI continue à faire beaucoup, mais il doit garder le dynamisme qu'il avait à ses débuts. M. le Rapporteur : Vous pensez qu'il l'a perdu... M. Paolo BERNASCONI : Non. De façon objective, quand vous partez de zéro, vous faites automatiquement un bond, mais ensuite cela devient plus difficile. Il faut informer sur toutes les choses positives que le GAFI accomplit. Il faut le proclamer car à une époque, certains disaient qu'il fallait renoncer au GAFI. Pour en revenir à l'ayant droit économique, c'est souvent une société dont le siège se trouve dans un pays offshore. Aujourd'hui, il est de bon ton, pour toute organisation internationale, d'avoir son groupe de travail sur l'offshore. Je trouve qu'il y a dans cette démarche encore beaucoup de naïveté. Par exemple, comme critère, on examine si le pays en question dispose d'une norme qui punit le blanchiment d'argent. Or le premier pays qui a eu une telle norme était le Panama. Il conviendrait déjà de savoir quel est le nombre des sociétés au Panama. Le GAFI devrait demander au Liechtenstein ou au Panama combien ils ont de sociétés, mais il ne le fait pas. M. le Rapporteur : Les instances de certains pays ne sont déjà pas d'accord sur les chiffres du nombre de sociétés dans le pays, comme c'est le cas à Chypre. M. Paolo BERNASCONI : A Chypre, la question majeure serait de s'assurer du nombre de filiales de banques russes, qui sont au nombre de quarante-six. Lors d'un séminaire anti-corruption à Chypre, je leur ai posé la question de cette présence si nombreuse. Leur réponse a été qu'ils ont une convention de non double imposition. On peut faire tout ce que l'on veut à Chypre, il n'y a aucun contrôle possible sur la masse de clients de ces banques russes et sur l'origine d'une masse d'argent provenant d'un pays avec un taux très élevé de criminalité et de corruption. Ce n'est pas une affaire de personnes, mais de tradition. Il n'y a pas de tradition à Chypre. J'explique à mes clients que s'ils vont à Chypre pour profiter du fait que c'est un territoire non coopératif et que, si leurs fonds sont détournés dans le cadre de la banque, s'ils vont à la police, la procédure prendra des années et encore pire, d'après le code civil, la banque ne couvrira pas le dommage. C'est une question de tradition, d'organisation de la justice, de responsabilité civile des banques. Je reviens sur la législation anti-blanchiment, déjà mise en place par le Panama. Le Liechtenstein va se doter, à compter de l'année prochaine, d'une législation anti-blanchiment copiée sur celle de la Suisse. Ils auront une belle loi anti-blanchiment, mais le Liechtenstein n'en demeurera pas moins responsable de la production de milliers de mécanismes anti-blanchiment (sur lesquels leurs administrateurs ne peuvent exercer aucun contrôle) qui ne sont pas utilisés qu'au Liechtenstein, mais partout dans le monde. Ils ouvrent des comptes à Vaduz, à Zürich et même aux Etats-Unis. A New York, vous pouvez ouvrir un compte sans que l'on vous pose la moindre question sur l'ayant droit économique d'une société offshore. L'efficacité de votre Mission sera mesurée aussi sur la base de vos résultats également aux U.S.A. Vous voyez la difficulté. Le Liechtenstein comme le Panama ont une législation anti-blanchiment, mais ils continuent d'avoir la production d'instruments de blanchiment qui sont éparpillés partout dans le monde. Ont-ils un système de droit civil qui institue une responsabilité personnelle des administrateurs des sociétés qui aurait un effet dissuasif à l'égard des investisseurs ? La bonne question à poser aux administrateurs au Liechtenstein et au Panama est la suivante : de combien de sociétés êtes-vous administrateur et êtes-vous à même d'en contrôler effectivement toute l'activité ? Mais ils n'en veulent rien savoir. Le pays qui accepte le principe selon lequel l'administrateur est une personne qui ne veut aucune information sur les sociétés qu'il administre est un pays qui fabrique des instruments pour le blanchiment. Par conséquent, il doit figurer sur la liste noire des pays non coopératifs. S'agissant non pas de paradis fiscal mais pénal, je trouve l'expression « pays non coopératif » bien choisie. En effet, si l'on s'en tient aux mots, les pays aujourd'hui sont tous coopératifs. Il faut aller voir derrière. Un système dans lequel un administrateur peut avoir deux ou trois cents sociétés en administration ne peut pas fonctionner, il n'y exerce aucun contrôle. Le premier élément de contrôle serait que toute personne qui assume une charge soit à même de contrôler. En fait, les administrateurs de centaines de sociétés n'en ont aucune idée et, de plus, ils ne peuvent pas savoir. Ils donnent la procuration générale à une personne inconnue sans savoir ce qu'elle va faire, trafic d'armes ou autres. C'est l'attitude typique de l'administrateur de sociétés des pays offshore. Je dirais que, en Suisse, nous sommes à mi-chemin dans le sens que la révision du droit sur les sociétés anonymes, en 1992, a partiellement travaillé en cette direction. Les responsabilités de l'administrateur et de la révision externe et interne ont été renforcées. Plus de moyens ont été donnés aux actionnaires pour entamer des actions en responsabilité civile. Là c'est le marché, vous avez la contrainte financière. Si l'administrateur d'une société anonyme en Suisse ne respecte pas ses devoirs de diligence, il a à craindre des réviseurs. C'est un procédé très dissuasif. La Suisse compte un grand nombre de sociétés de siège, mais pour des raisons fiscales. En général, l'administrateur d'une société de siège est un comptable et tient beaucoup à sa profession. De ce fait, il tâche de respecter toutes les obligations de droit des actions, fiscales, etc. A ce propos, une note très importante a été publiée sur le site Internet de la Commission fédérale des banques. J'ai connu l'époque où la Commission comptait trois ou quatre personnes, aujourd'hui elles sont deux cents et vous disent qu'en Hollande, elles sont trois cents : ces effectifs de la Commission suisse sont-ils suffisants ? Le dernier point sur lequel la Commission s'est interrogée est le suivant : quelle est l'attitude que l'intermédiaire financier bancaire et non bancaire doit avoir à l'égard des sociétés de siège offshore ? Le degré de diligence à l'égard de l'argent déposé sur le compte ouvert au nom d'une société offshore doit-il être plus élevé du fait que le pays offshore concerné figure sur la liste noire ? C'est un pas très important à franchir. Ce terrain est actuellement sondé. Dans le cadre des cours obligatoires donnés aux intermédiaires financiers ou des séminaires pour les banquiers, je pose cette question que je ne posais pas il y a dix ans : le fait d'ouvrir un compte au nom d'une société offshore est-il suspect ? Non car 90 % des sociétés offshore qui ouvrent des comptes en Suisse le font pour des raisons de fraude fiscale, les 5 ou 10 % (qui sait ?) restants pour des raisons criminelles. Toutefois, sur la base de mon expérience judiciaire en trente ans d'activités en tant que magistrat et, après, comme avocat, je n'ai jamais connu un seul cas important de blanchiment, d'escroquerie ou de criminalité économique organisée dans lequel n'intervenait pas une société de siège offshore. Il y en a toujours une, c'est le mécanisme typique. Néanmoins on ne peut pas en conclure qu'il faut criminaliser toutes les sociétés offshore. C'est bien là la difficulté, du moins, c'est la raison pour laquelle je renvoie aux listes de critères que j'ai publiées ces dernières années et que je vous communiquerai. M. le Rapporteur : D'où la sélection de la liste noire. M. Paolo BERNASCONI : Là encore, c'est la contrainte financière qui joue. Le GAFI l'avait indiqué dans les recommandations 20 et 21 de 1990 et 1996, mais d'une façon très nuancée. Le Forum de Stabilité Financière peut prendre une décision en spécifiant que cette liste noire implique des mesures de diligence accrues de la part de tous les intermédiaires financiers. Si le client requiert une opération urgente de devises à terme sur son compte au profit d'un compte ouvert au nom d'une société offshore ayant son siège dans un pays sur la liste noire, une telle opération prendra trois ou quatre jours avant d'être complétée. Par la suite, la clientèle ne voudra plus travailler avec une société de ce pays, car cela lui fait perdre de l'argent. M. le Rapporteur : A votre connaissance, des réactions juridiques de type législatif, réglementaire ou dans le cadre des cahiers des charges d'autorégulation, secteur par secteur, se préparent-elles au regard de la liste noire et grise du GAFI ? Des changements se préparent-ils en Suisse à ce sujet comme ils s'en préparent au Canada, aux Etats-Unis et en France ? M. Paolo BERNASCONI : En général, il est facile de dire que la vague régulatrice ne s'arrêtera plus. On a une bonne constellation. Prenez l'exemple de la corruption. Pendant vingt ans, j'ai abordé avec virulence ce sujet maintes et maintes fois sans succès et, tout à coup, en deux ou trois ans, le Japon, les Etats-Unis et d'autres ont ratifié la Convention. Les Etats-Unis l'ont même ratifiée de facto vingt ans avant la signature de la convention OCDE. C'est un changement incroyable et inattendu. Nous sommes à mi-chemin. La corruption est un cas intéressant. Pour le blanchiment, cela suit le même cheminement. Tout à coup, le sujet a surgi sur la scène, mais cela a pris dix ans pour mettre en place les instruments anti-blanchiment. Même en Suisse, pour le offshore, la prise de conscience a enfin démarré. Pour ma part, la globalisation des marchés signifie la globalisation des règles, donc la globalisation de la surveillance et donc la globalisation de la transparence. Les systèmes se tiennent. Il nous faut tous suivre les mêmes règles. Si le Canada et d'autres pays commencent en ce sens, ce sera aux organisations internationales de se mettre autour de la table, ce qui ne saurait tarder. Il convient toutefois de faire en sorte que ces listes noires ou grises ne soient pas naïves. Il me semble indispensable que les spécialistes considèrent non seulement le droit pénal, l'entraide, etc. mais aussi le droit civil et commercial : les listes noires actuelles ne sont encore que des cartes géographiques moyenâgeuses, avec trop de « terrae incognitae ». Il est aujourd'hui plus facile d'agir au niveau international qu'au niveau national. Je l'ai vécu en Suisse où on ne réussissait pas à faire passer certaines propositions qui, en fait, ont été parachutées de l'OCDE, de Strasbourg, etc. C'est un moyen peu démocratique car il n'y a pas de contrôle parlementaire, mais très efficace, étant soustrait aux pressions des forces proches des zones grises et noires. La liste noire de la Banque mondiale pour les faits de corruption est très intéressante. Vous avez évoqué le ministère public européen, mais la Banque mondiale est une institution au niveau international. Les chemins qui se dessinent sont très intéressants. Aujourd'hui, un thème brûlant est celui de la contrebande. J'ai lu avec attention la déclaration de M. Barren, membre de la Commission de l'Union européenne le jour suivant le vote suisse sur les sept traités bilatéraux à Bruxelles. Ce représentant indiquait que maintenant nous sommes prêts pour le huitième traité qui concernera la coopération contre la criminalité internationale organisée, y compris la fraude contre les intérêts de l'Union européenne. Cela prendra du temps, mais la Suisse l'acceptera d'ici cinq ans. Il est difficile de mobiliser l'opposition par un vote populaire sur ce thème car c'est un secteur qui ne touche pas tout le monde. De toute façon, on ne peut se déclarer contre la coopération contre la criminalité organisée. Cela ne change pas beaucoup pour l'économie suisse, même si cela obligera à couper certaines branches comme le transport de cigarettes destiné à l'Italie. Une bonne définition pour agir contre la contrebande est celle de « commerce armé ». Aujourd'hui, les commerces armés qui nécessitent une protection armée par des mitraillettes, etc... définissent ce qu'on appelle la criminalité organisée. Naturellement cela reste difficile à prouver. S'agissant des millions de francs suisses qui arrivent sur le compte d'une banque en Suisse au nom de sociétés qui font le produit du commerce de cigarettes avec l'Italie, il s'agit alors de savoir si ce commerce de cigarettes en Italie se fait avec des armes, ce qui est presque toujours le cas. Ceux qui participent à ce type de commerce sont traqués, nuit et jour, par la Police et par la Guardia di Finanza. Les policiers sont armés, de même que les criminels. La traite des femmes et des mineurs, la contrebande d'or et de devises, etc. sont également des commerces armés parce que ce sont des commerces clandestins. Pour ma part, il me semble que c'est la bonne solution. Dès lors que c'est un commerce protégé avec des armes, on considère qu'il s'agit d'un commerce criminel à qualifier sous la définition de « crime organisé » punissable. Je pense qu'il y a là des chemins ouverts, dans le sens où il y aura des changements. On s'en approche. Mme Jacqueline MILLER : Le commerce de cigarettes en Suisse est punissable. M. Paolo BERNASCONI : Mais la législation française punit-elle la contrebande faite en direction de la Suisse ? Le fait d'importer des produits sans payer la douane suisse est punissable d'après le droit suisse. Ce n'est pas punissable par la législation française, car la contrebande est punie dès lors qu'elle est faite au préjudice du fisc national. C'est évident. La question est tout autre. Il faut se poser la question suivante. Le commerce armé, qui est pratiqué sur les territoires étrangers lorsqu'il a des conséquences sur le territoire suisse, est punissable puisque qu'il est armé. L'argent qui provient des produits de ce commerce armé peut-il faire l'objet de blanchiment punissable ? Oui, parce que c'est du commerce armé qualifié comme crime (art. 260 ter du code pénal suisse), qui par conséquent, constitue une infraction concernant le blanchiment (art. 305 du code pénal suisse). Mais si vous travaillez avec l'idée de contrebande, personne ne parvient à ce résultat. Cela ne marche pas. Une grande lacune est la définition des infractions principales en amont du blanchiment d'argent. C'est une lacune très importante dans le droit suisse, mais aussi du GAFI et de la Convention 141 anti-blanchiment de la convention européenne, instrument très important mais mal connu et mal appliqué. Par exemple, même le commerce d'armes non autorisées n'est pas puni comme un crime mais seulement comme un délit. Par conséquent, le produit du commerce d'armes non autorisées n'est pas l'objet du blanchiment d'argent et n'est pas punissable. M. le Rapporteur : Comment sortir de cela ? M. Paolo BERNASCONI : Il faut faire la liste des infractions en amont du blanchiment d'argent, même si les juristes n'aiment pas cela. La norme qui régit l'escroquerie est différente dans tous les pays d'Europe. mais les éléments essentiels restent les mêmes. M. le Rapporteur : Y a-t-il un pays qui a fait la liste ? M. Paolo BERNASCONI : Certains pays ont fait une liste minimaliste qui vise seulement le trafic de stupéfiants, la traite des femmes et des mineurs. M. le Rapporteur : Sur ce sujet en France, nous avons eu un débat avec la Garde des Sceaux lorsque nous avons voulu sortir de l'idée d'organisations criminelles, qui est indémontrable. Lorsque j'ai proposé un amendement « activités en réseau criminel ou activités délictueuses », il m'a été répondu que c'était trop large, que l'on peut commettre des délits bénins. Nous ne sommes pas sortis de cette histoire. M. Paolo BERNASCONI : Faites la liste. Mais il faut la faire à Bruxelles et à Strasbourg car ce sont eux (O.C.D.E., Conseil de l'Europe, Union européenne) qui changent la définition de l'article du blanchiment dans la Convention et dans les Directives. Le système des listes n'est pas aimé par les juristes. Mais s'agissant des traités d'extradition bilatéraux prévus entre tel et tel pays, les Américains notamment, ont fait une liste. M. le Rapporteur : Qu'est-ce qu'ont fait les Italiens ? M. Paolo BERNASCONI : Ils ont commencé avec une liste minimaliste en invoquant le trafic de stupéfiants. Puis ils ont changé trois fois et ont fait une liste élargie avec l'endettement, le brigandage... Dans l'actuelle Résolution (648 bis du code pénal italien), ils ont visé, comme les Américains et les Belges, toute infraction délictueuse. Si vous demandez à un magistrat italien si la fraude fiscale est une infraction en amont du blanchiment, il vous répondra que non avec toute une série d'explications. Tout ceci pour vous dire qu'une définition générale est très difficile. Certains groupes de magistrats travaillent dans cette direction. Pour la Suisse, c'est aussi très difficile. Dans le cadre des cours que je donne aux banquiers, jusqu'à il y a encore deux ans dans la liste des infractions en amont du blanchiment, je disais : l'escroquerie oui, mais l'abus de confiance, non. Ensuite le Parlement a heureusement transformé l'abus de confiance en crime c'est à dire infraction en amont du blanchiment. Mais le trafic d'armes est puni comme un délit. Dans deux ans, il y aura en Suisse une nouvelle définition d'infractions dans le nouveau code pénal. Il y aura encore les catégories crimes, délits et contraventions, mais d'après le projet, cela va devenir compliqué, la différence se faisant sur la base de la mesure de la peine prévue pour chaque infraction. L'infraction grave en amont est une question qu'il faut régler au niveau international, mais on n'y parvient pas. L'ONU va tenir, en décembre à Palerme, une conférence sur la criminalité transnationale, mais cela reste très vague. Pour ma part, je leur suggère d'établir une liste de vingt infractions en amont même pour le crime organisé. On peut se chamailler pour savoir si l'abus de biens sociaux se trouvera dedans ou pas. Mais on peut être généreux pourvu qu'il y ait une liste de vingt infractions. M. le Rapporteur : On ne peut pas attendre que la communauté internationale, même restreinte, se mette d'accord, car nos policiers crient famine. Il y a urgence. Ce ne sont pas les institutions internationales qui doivent débattre de cela, quitte à l'envoyer à une harmonisation extérieure. M. Paolo BERNASCONI : La Convention européenne n° 141 a introduit à l'article 10 le principe de l'entraide spontanée. Les autorités des pays qui l'ont ratifié peuvent renseigner spontanément, de leur propre chef, les autorités d'un autre pays en leur indiquant que, lors de la conduite d'une enquête sur des brigandages en Suisse, ils ont découvert qu'un brigandage avait été commis à Paris. Le fait de transmettre spontanément des informations sur une affaire en cours dans un autre pays est très important car cela change le mécanisme traditionnel. Si les parties qui ont signé la Convention l'appliquent, cet article aura une utilité. Mais il y a là encore une lacune. Après dix ans de cette Convention, les parties qui l'ont ratifiée devraient avoir l'obligation d'appliquer l'article 10 au niveau national. Lorsque vous tombez sur un moyen de preuve qui concerne une infraction importante, commise sur le territoire d'un autre pays, il est indispensable de le signaler. M. le Rapporteur : Quelle est votre analyse sur le renversement de la charge de la preuve ? M. Paolo BERNASCONI : Là aussi la Convention n° 141 contient cette possibilité. Après dix ans, on pourrait tenter de faire un pas en avant, mais le pénaliste traditionnel est contre. Pour lui, nous sommes des hérétiques à cause du principe in dubio pro res. A l'Université, nous avons enseigné que c'est un mécanisme fondamental pour notre système démocratique mais qui fonctionne exclusivement au moment du procès et pas pendant la procédure. En outre, ce n'est un principe applicable que dans la procédure qui concerne la personne. Les questions de confiscation ne concernent que les biens, les objets. On ne touche pas à ce principe fondamental parce qu'on ne parle pas de personnes, mais de choses. Lorsqu'on se pose la question de savoir si ce million de dollars ou ce paquet de diamants est d'origine licite ou pas, la présomption d'innocence ne joue pas. Dans le système suisse, on a introduit un renversement de la charge de la preuve dans certains cas décrits de façon stricte et déterminée (article 59 chiffre 3 du code pénal suisse). Si la Convention européenne n° 141 prévoyait obligatoirement une telle norme, j'en serais ravi. M. le Rapporteur : Les Italiens ont essayé de le faire, et il me semble que la cour constitutionnelle a sanctionné. M. Paolo BERNASCONI : Mais les Italiens n'ont même pas la loi d'application de la Convention 141 : le Conseil de l'Europe doit établir un rapport concernant les progrès ou les paralysies dans la mise en _uvre de la Convention n° 141. Je suggère les mesures suisses en place par les circulaires de l'ASB en 1997 et en 1999. M. le Rapporteur : Que dites-vous de la coopération judiciaire... M. Paolo BERNASCONI : En Suisse, elle fonctionne mieux que dans beaucoup d'autres pays. Par exemple, le principe « nec est index ultra petita » a été aboli par le tribunal fédéral : une petite révolution ! On peut dire qu'elle est lente, qu'il existe encore trop de voies de recours. Une proposition, examinée par le Parlement, a été rejetée. La voilà : le ministère public ou le juge d'instruction en première instance prend la première décision. Puis on peut recourir au tribunal cantonal. Une des propositions au Parlement a été de supprimer l'instance cantonale en ne laissant qu'une seule instance, le tribunal fédéral. C'est une porte entrouverte. Pour l'extradition, on n'a qu'une seule instance. Le bon argument a été que, pour bloquer et transférer un million de dollars, le Parlement demande deux degrés et pour transférer une personne, ne demande qu'un degré. J'accepterais l'inverse. Pour l'entraide administrative comme la commission fédérale des banques, secteur colossal qui s'ouvre, il n'y a qu'une instance, le tribunal fédéral. Lorsque le ministère public de la confédération, donc autorité judiciaire, prend cette décision en matière d'entraide judiciaire ou pénale, il n'y a qu'une seule instance. La décision des autorités fédérales ne peut pas être attaquée au niveau cantonal. Voilà démontré qu'il existe toute une série de décisions importantes en matière d'entraide pénale et administrative qui déjà aujourd'hui ne sont attaquables qu'au niveau du tribunal fédéral. Au Liechtenstein, il y a quatre degrés de juridiction. J'ai vu dans un jugement en cour de cassation, une demande d'entraide, venant d'Italie, refusée dans un cas très important de corruption. Le magistrat italien demandait l'interrogatoire de l'administrateur d'une société du Liechtenstein afin de savoir qui était son client, c'est à dire l'ayant droit économique. Cet administrateur s'y est opposé. L'affaire est allée jusqu'à la cour de cassation de Vaduz qui a tranché. Sa décision a été que la demande d'entraide n'était pas acceptable car il convenait de faire la balance entre d'une part les intérêts de la justice, d'autre part le « goodwill » du témoin, lequel serait détruit si la Cour de Cassation de Vaduz l'avait obligé à donner le nom de son client. M. le Rapporteur : J'aimerais beaucoup lire cette décision. M. Paolo BERNASCONI : C'est vrai qu'en Suisse, l'entraide en matière pénale est lente. On pourrait prendre cette solution, qui fonctionne bien et qui est beaucoup pratiquée à Genève, un peu au Tessin, peu à Zurich. Lorsqu'une demande d'entraide concerne des infractions qui portent sur le patrimoine ou des trafics, on ouvre d'office la procédure pour blanchiment d'argent sur le territoire suisse où se trouve le produit de l'infraction commise à l'étranger. Ce serait un bon point à mettre dans la liste des pays coopératifs ou non coopératifs. S'agissant de l'application du principe de la légalité de la poursuite pénale, à l'Office fédéral de justice, dès qu'une demande d'entraide arrive portant sur des avoirs patrimoniaux qui ont été transférés sur le territoire suisse, une série de mesures provisionnelles sont prises immédiatement. Même si l'enquête piétine, les mesures ont déjà été adoptées dans l'intérêt de la poursuite. M. le Rapporteur : Vous parliez des perspectives de la coopération administrative entre les organes de vigilance du marché bancaire. Comment voyez-vous l'avenir sur ce sujet ? M. Paolo BERNASCONI : Cela aura un développement colossal en Suisse comme dans tous les pays. Tout d'abord, ce sont des spécialistes qui ont un orgueil professionnel formidable. De plus, il faut considérer le pas politique qu'implique cette réunion des représentants des autorités de surveillance nationale qui se tient tous les deux ans. M. le Rapporteur : Quel type d'information pourraient-ils échanger ? M. Paolo BERNASCONI : Toutes les informations qui touchent à leurs fonctions de vigilance sur les marchés financiers. Les plus importants sont les renseignements qui touchent à la solidité de la banque. C'est indispensable, c'est le cordon sanitaire. En revanche, je vais vous citer un exemple franco-monégasque dans lequel cela ne fonctionne pas. Il s'agit de l'affaire Hobbs, escroquerie lors de laquelle plusieurs millions se sont envolés. Je vous résume l'affaire. Lorsque le client, victime de malversations, téléphone à son avocat, il sait vaguement à qui il avait remis son argent. Lorsque vous réussissez à savoir que cet argent allait à Genève, vous découvrez alors qu'une société à Genève, où Hobbs avait un compte, prend en consigne l'argent des clients, lequel est ensuite envoyé par ce compte on ne sait plus où. Après renseignements, vous découvrez que Hobbs a des sociétés à Monaco, en France, aux Etats-Unis, aux Antilles néerlandaises, à Genève. J'ai alors fait le travail comme un étudiant de première année d'université et écrit aux autorités de surveillance en leur demandant si c'étaient elles qui surveillaient et ce qu'elles faisaient pour la protection des victimes. Je n'ai reçu à ce jour que des réponses évasives. Durant cette même période, lorsque les responsables de ces sociétés ont compris qu'ils ne pourraient pas payer, ils se sont envolés et ont fermé boutique. Qu'ont-ils fait de l'argent des clients ? En France ou en Suisse, ce n'est que lorsque c'est un cas national que la commission fédérale des banques nomme un liquidateur qui bloque les comptes. Mais lorsque c'est une multinationale, on ne sait pas où ils font partir l'argent. L'organisation d'un système d'alarme général grâce auquel on pourrait intervenir tout de suite et bloquer l'argent des client, dans toutes les filiales d'un groupe multinational en déconfiture serait un thème pour le Comité de Bâle. L'argent est parti, mais il s'agit de la protection des créanciers qui ne sont pas du tout protégés. Si vous voulez faire une enquête pénale, il faut en lancer une dans plusieurs pays du monde. Le coût sera énorme, sans compter les honoraires des avocats et autres frais. Car il n'y a plus d'argent pour les clients, on ne peut rien faire. Vous pouvez mettre sur pied une telle organisation, récolter dans une année 500 millions de francs et disparaître. Cela arrive encore et on ne fait rien. Quand je dis « on », ce n'est plus entre les mains d'un Parlement ou des autorités de surveillance, mais du comité de Bâle. C'est à cette instance de faire quelque chose. C'est vrai qu'elle a accompli un certain nombre de choses, mais elle doit tirer des leçons de ces scandales. M. le Rapporteur : J'ai trois ou quatre exemples de ce type avec Monaco ou la Suisse. Nous sommes allés ce matin à Zürich et nous n'avons pas compris pour quelles raisons les organismes d'autorégulation - celui de la Chambre fiduciaire par exemple - n'avaient jamais fait une seule communication au Bureau de communication. De plus, parmi les communications obtenues du bureau de communication par le parquet de Zürich, il n'y avait aucune décision de condamnation. M. Paolo BERNASCONI : Les organismes d'autorégulation n'ont commencé leur travail que le 1er avril 2000. M. le Rapporteur : Mais le président de la chambre fiduciaire nous a indiqué qu'ils étaient en conformité avec la loi depuis le 1er avril 1999. M. Paolo BERNASCONI : Leurs obligations, en qualité d'organisme d'autorégulation d'après la LBA, s'appliquent depuis le 1er avril 2000. Mais pour les intermédiaires financiers non bancaires, l'obligation de communication s'applique depuis le 1er avril 1998. Selon le rapport de M. Thelesklaf, 80 % des communications sont faites par des banques. Pour moi, c'est nécessaire d'interpréter. Cela a un rapport avec le volume d'argent géré par les banques qui est beaucoup plus important que celui géré par les intermédiaires non bancaires. Il est vrai que la banque a beaucoup plus à protéger, notamment sa renommée, que l'intermédiaire financier. De plus, elle est soumise à la surveillance de la Commission fédérale des banques qui fonctionne et qui est très respectée. La Commission fait peur tandis qu'on n'a pas encore eu le temps d'avoir peur des organismes d'autorégulation car ils n'en sont qu'à leurs débuts. M. le Rapporteur : Ce matin, nous avons dit à M. Cuendet, président de la chambre des fiduciaires suisses, qu'en France, il s'écoule rarement une semaine sans qu'on découvre une nouvelle affaire de corruption dans laquelle apparaît une fiduciaire suisse. La semaine dernière, c'étaient 400 millions issus de commissions occultes et de marchés truqués qui ont servi à financer le RPR et que le financier occulte a entreposé dans des fiduciaires dont les noms sont connus. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il avait prévu pour solder le passé car l'argent est encore là, sa réponse a été inexistante. M. Paolo BERNASCONI : J'ai toujours été très pressé. Dès que j'ai une idée, il faudrait que deux jours après, elle soit déjà en boite. Or parfois il a fallu dix ou quinze ans. Lorsqu'une loi est votée, il faut laisser passer un certain temps avant que les résultats de son application soient visibles, ce n'est jamais à court terme. En voilà encore un exemple : le 1er mai 2000, le Code pénal suisse a été révisé et on a introduit la punissabilité de la corruption des fonctionnaires étrangers. C'est la révolution. Traditionnellement, pour les Suisses (de même que pour tous les pays du monde), il convenait déjà de s'occuper de l'honnêteté et de la loyauté de l'administration de notre pays. Une liste de vingt séminaires publics, non publics, internes sur cette affaire ont déjà eu lieu ou vont avoir lieu en Suisse. Les entrepreneurs doivent comprendre le risque nouveau. Les industries d'importation ou d'exportation, les commerces, les financiers et les banquiers ont un risque nouveau, mais beaucoup ne le savent pas encore. Déjà depuis le 1er juillet 1998, donc deux ans avant la ratification de la Convention anti-corruption de l'OCDE, la Commission fédérale des banques, dans les directives anti-blanchiment, a sérié quatre ou cinq normes concernant non seulement la corruption, mais aussi les personnalités qui ont des tâches politiques importantes. Ce sont des normes pour les banques. Je prêche pour que ces normes soient valables pour tous les intermédiaires financiers, mais cela prend du temps. Il faut changer la mentalité des gens. En tant qu'avocat, vous rencontrez des entreprises suisses ou étrangères qui viennent ici, qui voient un risque et qui ne veulent plus payer des commissions en partant de la Suisse. On va perdre des marchés : tant mieux s'agissant de marchés criminels. Mais que faire avec un contrat signé il y a deux ans, qui est encore en cours et qui impose de continuer. On ne peut pas appliquer des normes transitoires mais dans cinq ans, ce sera fini. Vous avez certainement vu le rapport Abacha. Il m'a surpris car le Crédit suisse a été une des premières banques qui a mis en _uvre un règlement interne. Je connais très bien ceux qui l'ont mis sur pied il y a des années. C'était très bien fait, pionnier. Pourquoi sont-ils tombés ? Il est très important d'avoir la norme légale, de l'avoir transférée à l'intérieur de l'économie privée et mise en _uvre. Cela prend du temps. La lutte contre la corruption est une grande tâche historique, qui ne sera jamais achevée mais qui peut et doit être constamment perfectionnée. M. le Rapporteur : Zürich nous a beaucoup intrigué, peut-être parce que nous nous comprenons plus facilement avec le Tessin. Nous avons évoqué, ce matin à Zürich, les filiales de banques suisses installées au Liechtenstein dans les mécanismes d'adossement des prêts. J'ai demandé au chef de la police du canton de Zürich et à deux juges d'instruction s'ils avaient entendu parler de cette pratique. Ils nous ont répondu n'en avoir jamais entendu parler. Or, nous avons des témoignages douloureux pour la réputation des banques suisses que nous allons leur communiquer. M. Paolo BERNASCONI : Dans tous les pays, le choix et la nomination des magistrats est un grave problème. Je préconise un système mixte pour l'élection des magistrats. Pour devenir membre de la police de sûreté, il faut suivre des cours et puis passer des examens. Pour devenir juge d'instruction au pénal, on ne vous demande pas si vous avez déjà mené un interrogatoire. Il conviendrait que ces magistrats passent un examen. M. le Rapporteur : Comment sont recrutés les juges à Zürich ? M. Paolo BERNASCONI : En partie par carrière, en partie par élection, d'après le type et le niveau de la juridiction. Il me semble que le système mixte est bon. Hier un directeur de banque m'a raconté qu'il avait dû passer, pour être admis dans les cadres de direction, des tests psychotechniques très poussés sur ses capacités et sa résistance au stress, mais rien de tout cela pour les magistrats. Il serait bon que les magistrats passent les mêmes examens que pour devenir cadre de banque. M. le Rapporteur : Vous signalez un problème de compétence. M. Paolo BERNASCONI : Comme j'enseigne dans beaucoup d'écoles de magistrats aussi hors de Suisse, j'ai constaté que c'était un problème général. C'est un métier très difficile, on demande énormément aux juges. Peut-être êtes-vous mal tombé. Il y a, au ministère public à Zürich, un groupe spécialisé dans la criminalité économique qui est très compétent. Nous avons un gros problème, car l'Office fédéral de la police en Suisse cherche à recruter soixante personnes qu'il faudra former et puis mettre à niveau en permanence. C'est une tâche très difficile, mais commune à tous les pays. M. le Rapporteur : Mais vous ne mettez pas en cause l'indépendance de ces magistrats... M. Paolo BERNASCONI : Non, mais les tâches des magistrats sont très difficiles et peuvent suivre des tendances. Pourquoi une vague contre la corruption a-t-elle démarré dans les années 90, puis contre la pédophilie ? Ces deux problèmes ne sont pas nés d'aujourd'hui. Il est très difficile de déterminer pourquoi des magistrats s'en préoccupent tout à coup. S'agissant du blanchiment d'argent, il y avait le recel qui est une norme depuis le droit romain et le droit germanique. Elle était appliquée aux voitures, mais jamais au système bancaire. Pourquoi ? C'est le fait de constellations favorables. Vous posez la question de l'indépendance des juges. Il y a une difficulté d'une autre nature qui est l'atmosphère, l'environnement. C'est terrible car du juge on s'attend qu'il applique immédiatement la loi et le code pénal. Je me souviens du canton de Genève il y a vingt ans, il y avait très peu de procès en criminalité économique. Puis lors du changement de procureur il y a sept ou huit ans, tout a radicalement changé. Au point de vue fiscal, vous connaissez la législation suisse et son fameux article 3 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale. Le principe traditionnel et historique veut que la Suisse ne donne aucune coopération en matière fiscale. Il y a des exceptions dans les conventions contre la double imposition, mais cela n'est pas déterminant car la convention est mise en application seulement sur demande du contribuable. Puis il y a l'exception de ce principe, la plus importante étant depuis 1983 celle de l'article 3. Vous avez trois types d'entraide, l'extradition des personnes, l'extradition des moyens de preuve et l'extradition des produits des infractions. En matière fiscale, il n'y a pas d'extradition de personnes, mais cela pourrait venir, il suffirait de ratifier le protocole de la Convention européenne d'extradition. Il n'y a pas non plus d'extradition du produit de la fraude fiscale, mais il y a la remise de moyens de preuve concernant la fraude fiscale. C'est une exception colossale. En effet, une entreprise inscrite au registre du commerce a l'obligation de tenir une comptabilité, un bilan, etc... Par conséquent, si l'entreprise commet une soustraction fiscale, elle le fait moyennant une falsification de documents, soit une facture, le bilan... Potentiellement, cette exception est colossale car toute entreprise qui commet une soustraction fiscale est, par définition, punissable de fraude fiscale. Il est très facile de commettre une soustraction fiscale qualifiée comme fraude fiscale, mais quelle est la réalité ? L'Office fédéral de la police a reçu, depuis 1983, en moyenne une dizaine ou une quinzaine de demandes d'entraide en matière de fraude fiscale. Une moitié a été acceptée, l'autre refusée. Pendant les années 90, cela a augmenté à peut-être trente demandes d'entraide par an. Pourquoi si peu de demandes d'entraide ? En fait, les pays d'origine sont les pays scandinaves, l'Angleterre et l'Allemagne mais dans les länders proches de la frontière. Quant à l'Italie, elle n'avait jamais fait de demande d'entraide en matière fiscale jusqu'à cette année. Le ministère public de Milan a fait une demande d'entraide dans le cadre d'une très grosse affaire impliquant cinq cents entreprises italiennes. Cette demande va certainement fausser les statistiques. En fait, cette demande a été faite par un seul magistrat et ne concerne qu'une seule affaire. L'Italie n'avait jamais jusqu'alors présenté une seule demande d'entraide pour fraude fiscale, alors qu'ils en connaissent la possibilité. Lorsque la norme est entrée en vigueur en 1983, je me rappelle que le journal interne de la Guardia di Finanza portait à sa une « Fini le secret bancaire suisse ». Il est clair que le Tribunal fédéral suisse est très généreux en matière d'entraide pénale, mais moins généreux en matière fiscale. M. le Rapporteur : Nous n'avons pas souhaité nous placer sur le terrain de la fraude fiscale. Notre Mission est composée de plusieurs groupes politiques et rassemble l'ensemble des opinions sur la lutte contre l'argent sale. Si nous introduisons la fraude fiscale, nous perdons l'opposition. Nous avons fait ce choix et nous y sommes tenus. M. Paolo BERNASCONI : Il faut poser la question « qu'est-ce que l'argent sale ? » Selon la définition suisse, c'est l'argent qui provient du crime. M. le Rapporteur : Mais il faut faire la liste, comme vous le disiez vous-même. M. Paolo BERNASCONI : Il y a un grand problème juridique qui est la détermination du produit de la fraude fiscale. En Belgique, en Italie, aux Etats-Unis, ils ont une définition large de l'infraction principale en amont. Ils se sont interrogés et ont beaucoup débattu sur le produit de la fraude fiscale. Si on définit un produit, on peut dire que ce million de francs a été blanchi, par conséquent on peut séquestrer, confisquer. C'est difficile à déterminer. En effet, par exemple dans le domaine des infractions contre les intérêts de l'Etat, si une personne obtient des subsides de l'Etat grâce à l'utilisation de faux bilans, c'est clairement une escroquerie, et le produit de l'infraction sera représenté par les subsides reçus pour la construction de bâtiments ou autres. Toutefois, dans le cadre de la fraude fiscale, c'est plus difficile à déterminer car il n'y a pas ce transfert du patrimoine de l'Etat, qui est la victime, au patrimoine de l'auteur. C'est le contraire. Il n'y a pas eu de mouvement du patrimoine de l'auteur au patrimoine de l'Etat. Il n'a pas déclaré un million de dollars comme revenus, donc il a soustrait 350 000 francs qui sont le produit de l'escroquerie fiscale. C'est un problème ardu qui fait actuellement l'objet de débats en Suisse. Dans le cadre d'une demande d'entraide qui vient d'arriver, peut-on demander de bloquer le produit de l'escroquerie, et non seulement des moyens de preuve ? M. le Rapporteur : On l'obtient facilement dans les pays du Nord ou en Belgique. Cela fonctionne et la Suisse y viendra. M. Paolo BERNASCONI : C'est un sujet très débattu, on verra. M. le Rapporteur : Il n'y a pas de jurisprudence... M. Paolo BERNASCONI : Non. Il existe un cas allemand de ce printemps. Les Allemands l'ont demandé et l'office fédéral de justice a bloqué. M. le Rapporteur : Merci pour ces développements passionnants. Audition de Me Didier de MONTMOLLIN, (compte-rendu de l'entretien du 28 septembre 2000 à Berne) Présidence de M. Arnaud MONTEBOURG, Rapporteur Me Didier de MONTMOLLIN : Je suis avocat de profession. Je vous ai fait constituer un dossier spécifique comportant certains documents auxquels on pourra se référer dans la discussion et qui concernent l'Organisme d'autorégulation des avocats. Je suis un des 6 200 membres de la Fédération suisse des avocats. Notre organisme d'autorégulation est également celui de la Fédération suisse des notaires qui compte un peu plus de 1 500 membres. Ces deux fédérations regroupent donc environ 7 700 membres auxquels il faut ajouter, comme membres potentiels de l'OAR, des avocats et des notaires qui ne seraient pas membres d'une organisation privée. Ces derniers sont les bienvenus dans l'OAR des avocats et des notaires, même s'ils ne sont pas membres de l'une ou l'autre des deux fédérations précitées. Douze organismes d'autorégulation ont été reconnus à ce jour par l'Autorité de contrôle, dont M. Huber est le directeur. L'agrément nous a été délivré le 16 juin 1999, conformément à l'article 24 de la LBA. On peut s'interroger, les avocats et les notaires n'étant pas en premier lieu des financiers, sur les raisons de la création d'un organisme particulier pour cette profession. De plus, il existe déjà en Suisse des organismes généralistes tels l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF). Néanmoins, les avocats et les notaires ont souhaité avoir un organisme d'autorégulation pour leur profession. Cet organisme a permis de prendre en compte, de façon adéquate et rigoureuse, d'une part, les exigences posées par la LBA et, d'autre part, la disposition claire dans son libellé et son application qui règle, dans le code pénal suisse, la sanction de la violation du secret professionnel de l'avocat et du notaire. C'est autour de cette action que s'est décidée la création d'au moins un organisme d'autorégulation spécifique aux deux professions précitées. Un avocat peut toujours rejoindre un autre organisme d'autorégulation, sans être considéré comme dissident ou contestataire. Nous sommes une profession de gens libres. La seule difficulté sera, pour les responsables de cet autre organisme, de séparer les activités juridiques d'avocat et de notaire de celles de gérant de fortune ou autre intermédiaire financier. A tort ou à raison, nous estimions justifié d'avoir un organisme pour la profession. Chaque canton aurait pu avoir le sien, mais, pour assurer une unité de doctrine, il n'était pas opportun, face à un domaine aussi international que la lutte contre le blanchiment, de multiplier à l'intérieur d'une même profession le nombre des OAR même si la création d'un OAR n'est pas soumise à un numerus clausus. Toutefois si un autre OAR des avocats se constituait, il devrait regrouper un nombre important de membres car sinon il pourrait être refusé par l'Autorité de contrôle. Pour tenter de trouver une solution à ce difficile aménagement - les obligations de l'intermédiaire financier selon la LBA et l'obligation du secret professionnel de l'avocat - la profession dispose de quelques outils dont un arrêt du tribunal fédéral du 29 décembre 1986. Cette décision est intervenue le cadre d'une affaire où un avocat a été tenté de se prévaloir du secret professionnel pour refuser de témoigner dans une procédure, alors qu'il s'agissait de ses activités en tant qu'administrateur d'une fondation liechtensteinoise. L'avocat, en brandissant le code pénal, n'a pas voulu témoigner à propos de renseignements confidentiels dont il était dépositaire. A cela, le tribunal a répondu qu'en l'occurrence, cet avocat n'était absolument pas protégé par le secret professionnel s'agissant d'une activité d'administrateur d'une société de ce type, alors même que l'activité de cet avocat était celle de gérant de fortunes. Cela a été le point de départ d'une remise en perspective du secret professionnel de l'avocat. Ensuite, il y a eu le message, texte explicatif à l'appui d'un projet de loi, rendu par le Conseil fédéral, au regard de l'article 305 ter du code pénal en vigueur depuis 1990 et introduisant le devoir de vigilance en matière d'opérations financières dans la loi pénale, alors qu'il était seulement jusqu'à maintenant dans la convention de diligence des banques. Les notions d'intermédiation financière et de champ d'application se recoupent assez complètement avec la LBA adoptée quelques années plus tard. En 1994, a été rajouté, à l'article 30 ter du code pénal, le droit de communiquer les soupçons de blanchiment Puis la LBA est entrée en vigueur par étape le 1er avril 1998 - puis le 1er avril 2000 pour certaines professions en raison de la période transitoire prévue pour ces dernières, sauf en matière d'obligation de communiquer les soupçons fondés de blanchiment, applicable dès le 1er avril 1998 à tous les intermédiaires financiers. Les deux messages du Conseil fédéral, à l'appui des articles 305 bis et ter du code pénal et à l'appui de la LBA, ont repris très largement, s'agissant des avocats et des notaires, la distinction qu'avait faite le tribunal fédéral en 1986. Pour les avocats et les notaires, la question n'est donc pas aussi nouvelle qu'il pourrait le sembler. Ce n'est pas depuis le 1er avril 2000, ni même depuis le 1er avril 1998, mais déjà depuis le 1er août 1990, date de l'entrée en vigueur de l'article 305 ter, que les avocats et les notaires ont dû intégrer le fait qu'ils ne pouvaient ignorer les tenants et les aboutissants des opérations auxquelles ils pouvaient être mêlés en tant qu'intermédiaires financiers. La jurisprudence devrait plus encore préciser cette délimitation, mais pour le moment, nous n'avons pas de textes nouveaux sur la jurisprudence quant à cette délimitation. Par contre, lorsque les avocats et les notaires interviennent, d'une manière ou d'une autre, dans des opérations financières, et si cette intervention se fait dans le cadre d'un mandat de nature juridique, il n'y a pas soumission aux devoirs prévus par la LBA. En revanche, il y a pleine sanction en cas de violation du secret professionnel, en vertu de l'article 321 du code pénal. M. le Rapporteur : Y a-t-il eu des sanctions d'un avocat pour non-communication ? Me Didier de MONTMOLLIN : A ma connaissance, je n'ai pas le souvenir qu'une telle sanction ait été prononcée. Néanmoins il convient de rappeler que l'obligation ne date que du 1er avril 1998. M. le Rapporteur : Y a-t-il des procédures en cours ? Me Didier de MONTMOLLIN : Aucune à ma connaissance, mais c'est sous toute réserve. En effet, les procédures ne sont pas systématiquement connues. M. le Rapporteur : Y a-t-il eu des sanctions pour violation abusive du secret professionnel ? Me Didier de MONTMOLLIN : Oui, mais je doute qu'il y en ait eu en relation avec des éléments que nous évoquons... Je peux demander à un collaborateur de me faire une recherche sur tous les arrêts parus. M. le Rapporteur : Si jamais vous en trouvez un, faites-le nous parvenir. Me Didier de MONTMOLLIN : Je ferai donc une recherche sur la jurisprudence relative à l'application de l'article 321 CPS. Il ne faut pas non plus s'imaginer que, dans les cas où l'avocat ou le notaire ne tombe pas sous le coup de la LBA car il est suffisamment ancré dans une activité juridique, cela lui permet de jouir d'une immunité totale. Comme tout citoyen et résident de ce pays, il reste astreint à toutes les obligations du droit pénal, telles que notamment celles prévues à l'article 305 bis sur le blanchiment. Il serait tout à fait déconseillé à un avocat ou un notaire dans son activité d'homme de loi, de se désintéresser de savoir pour qui il agit et dans quel contexte. Il ne pourra sans doute pas être sanctionné dans le cadre de l'article 305 ter ou de la LBA, mais il pourra l'être en tant que blanchisseur d'argent ou complice d'autres infractions. M. le Rapporteur : Y en a-t-il beaucoup ? Me Didier de MONTMOLLIN : Non. Toutefois malheureusement certains avocats peuvent se retrouver impliqués dans une affaire de blanchiment ou autre infraction de caractère économique. L'ordre des avocats de Genève- l n'y a pas d'Ordre des avocats au sens français - association privée regroupant la grande majorité des avocats genevois, a dû prendre, de temps à autre ces dernières années, des mesures à l'égard de quelques-uns uns de ses membres. Cette sanction est importante car elle peut être non seulement l'exclusion de l'ordre, mais dans les cas graves, doublée d'un retrait de l'autorisation de pratiquer prise par une commission publique. Cette situation n'est pas fréquente, mais elle arrive de temps à autre. En fait, outre une éventuelle sanction pénale, il y a un cumul de sanctions possibles. Tout d'abord, il y a les sanctions de l'ordre des avocats en tant qu'association de droit privé, mais très représentative de la profession. Par ailleurs, cette procédure est doublée - dans le canton de Genève comme dans les autres cantons suisses - d'un système d'évaluation et de sanctions administratives disciplinaires publiques, qui visent également les non-membres de l'ordre. Ainsi on arrive à saisir l'ensemble des acteurs de la profession. S'agissant des avocats et des notaires qui ont des activités financières qui ne peuvent être considérées comme intrinsèquement liées à une activité juridique, ils sont alors considérés comme intermédiaires financiers selon la LBA. De ce fait, comme tous les intermédiaires financiers, ils ne peuvent commencer ou continuer d'opérer de la sorte qu'en rejoignant au préalable l'OAR des avocats et des notaires ou un autre OAR. Selon l'ARIF, il existerait un système qui garantirait, d'une manière ou d'une autre, le secret professionnel, mais je ne sais pas exactement par quels mécanismes. De plus, nos membres sont rendus attentifs au fait que, dans le doute, il leur faut s'affilier même dans le cas d'activité professionnelle financière occasionnelle, voire très accessoire. Par exemple, il serait très imprudent pour un avocat de dire qu'il effectue cette activité sans rémunération spécifique, alors qu'il se fait rémunérer pour d'autres services rendus. Du fait qu'un service pourrait être gratuit donc ne représentant pas une activité professionnelle, et un autre pas, cette situation pourrait s'avérer dangereuse car incertaine quant à son assujettissement à la LBA. Toutefois, ce service dans le domaine financier peut être exceptionnel et dénué de toute connotation matérielle, et n'impliquer aucune intermédiation financière. Néanmoins une affaire, même unique, peut suffire à faire considérer l'avocat ou le notaire comme un intermédiaire financier. La sensibilisation des membres a commencé bien avant 1998. Par exemple, une circulaire du 27 mai 1991 de l'ordre des avocats de Genève a introduit le sujet de l'obligation de vigilance en matière d'opérations financières, de manière expresse, à l'adresse de ses membres. Puis dans la perspective de l'entrée en vigueur de la LBA, d'autres actions que vous trouverez décrites dans le dossier qui vous a été remis, ont été entreprises. Par exemple, vous trouverez à la section 5, une lettre d'information en date de mars 1998 du conseil de l'ordre des avocats de Genève qui reproduit une lettre d'information de la Fédération suisse des avocats. Par conséquent, déjà au printemps 1998, les obligations de la LBA ont été détaillées, afin de susciter une prise de conscience de la profession quant à leur contenu. Vous trouverez également dans ce dossier la circulaire qui a été émise en septembre 1999 par la FSA et la FSN, avec un bref descriptif de l'OAR incitant les avocats à s'affilier ainsi que les statuts et le règlement. M. le Rapporteur : Tout cela a-t-il été approuvé par l'Autorité de contrôle ? Me Didier de MONTMOLLIN : Absolument. Il y a peu de différence entre les divers OAR. M. le Rapporteur : Combien y a-t-il eu de communications au Bureau de communication depuis deux ans ? Me Didier de MONTMOLLIN : Je n'ai pas de chiffres spécifiques aux avocats. D'après mes souvenirs, il y a eu environ 370 communications. M. le Rapporteur : Combien en provenance des avocats de votre OAR ? Me Didier de MONTMOLLIN : En l'occurrence, encore aucune. Par chance, nous n'avons pas eu de cas qui ont dû être rapportés. Mais cette mise en place est encore très récente. M. le Rapporteur : Depuis combien de temps fonctionne votre OAR ? Me Didier de MONTMOLLIN : L'OAR en tant que tel a été approuvé en juin 1999. Les membres du comité exécutif ont été nommés en mai 1998. Jusqu'au 1er avril 2000, nous avons travaillé à la mise au point de tous les mécanismes de fonctionnement et des programmes de formation et d'information. A compter de cette date, nous avons constaté que les affiliations avaient été très importantes. A cet égard, il est intéressant de noter que le Conseil fédéral, dans les messages précités, évaluait à environ cinq cents les avocats et notaires qui travaillaient en Suisse dans des affaires financières, c'est-à-dire ceux susceptibles d'être assujettis à la LBA. Nous avons près de trois fois plus d'affiliations, soit environ 1 400. En fait, ce nombre est encore plus important si on considère qu'en général, ce sont les seuls chefs d'étude ou les associés de l'étude qui s'affilient et qui communiquent ensuite la liste de leurs collaborateurs actifs dans le domaine de l'intermédiation financière au sein de l'étude. Si on estime, par hypothèse, qu'un chef d'étude sur deux travaille avec un collaborateur, on atteint un chiffre encore supérieur. Nous menons un programme de contrôle sur trois ans, agréé par M. Huber à Berne. L'ensemble des membres de l'OAR doivent avoir été contrôlés par l'un ou l'autre des membres du comité, dont je fais partie, dans les trois ans. M. le Rapporteur : Pouvez-vous me donner un exemple de ces contrôles ? Me Didier de MONTMOLLIN : Il convient de distinguer le contrôle régulier, qui se fait tous les trois ans, du contrôle exceptionnel. Ce dernier dépendra d'un cas de blanchiment dont se ferait l'écho la presse, avec l'implication d'un homme de loi. M. le Rapporteur : Nous avons, dans le cadre de nos procédures en France, les noms d'avocats genevois qui blanchissent de l'argent. Si je vous donne ces noms, votre organisme va-t-il procéder à un contrôle ? Me Didier de MONTMOLLIN : Nous ne sommes pas limités quant à la source des informations qui peuvent mener à l'ouverture d'une enquête. Si l'information transmise nous semble a priori plausible, nous ouvrons une enquête spéciale. L'enquête spéciale est lancée lorsqu'un fait rapporté peut susciter des doutes quant au comportement de l'avocat en matière d'opérations financières. Selon les cas, l'enquête se déroulera soit par écrit - le plus courant - soit sous la forme d'une visite surprise, pour les cas les plus dramatiques. M. le Rapporteur : Peut-on vous refuser cette visite surprise domiciliaire ? Me Didier de MONTMOLLIN : Non, selon les statuts et le règlement, on ne peut nous opposer un quelconque secret des affaires ou professionnel. M. le Rapporteur : Dans quelles dispositions est-il écrit que vous pouvez perquisitionner chez vos membres ? Me Didier de MONTMOLLIN : Il est clair que nous ne sommes pas appuyés par la force publique, à la différence du juge qui peut venir accompagné de policiers. Nous n'avons pas ce pouvoir de force publique. En revanche, si un intermédiaire financier, membre de notre organisme d'autorégulation, refuse d'ouvrir ses dossiers, il s'expose à des sanctions de l'OAR qui ne sont pas négligeables, car elles vont jusqu'à une amende de 100 000 francs suisses, sans compter les possibilités d'exclusion de l'organisme. Dans cette hypothèse, ce ne serait pas les seuls éléments de sanctions que pourrait encourir la personne concernée car il pourrait, pour le moins, y avoir ouverture d'une enquête pénale du chef des articles 305 bis et ter du code pénal et/ou d'autres dispositions pénales. Selon la gravité des faits, nous avons des sanctions administratives en relation avec le maintien ou non de l'autorisation de pratiquer, en plus des procédures pénales. M. le Rapporteur : Je n'ai pas vu, dans la loi LBA, que l'amende de 200 000 francs suisses concernait le refus par un de vos membres d'ouvrir ses dossiers lors d'un contrôle de l'OAR. Un tribunal qui aurait à juger l'application de cette loi donnerait raison à votre victime. Me Didier de MONTMOLLIN : L'amende prévue par la LBA de 200 000 francs suisses ne concerne pas ce cas. Seul M. Huber, ou plus exactement la section compétente au sein du ministère fédéral des finances, a le pouvoir de sanctionner l'avocat qui ne s'est pas affilié, alors qu'il le devait, et qui se trouve ensuite impliqué dans une affaire. M. le Rapporteur : Si l'avocat ne s'est pas affilié, vous n'avez aucune autorité sur lui ! Me Didier de MONTMOLLIN : C'est exact, mais c'est alors l'Autorité de contrôle qui intervient. La sanction pour non-affiliation frappe l'intermédiaire financier. En revanche, s'il est affilié, c'est l'OAR qui a la responsabilité essentielle des sanctions sous réserve de l'obligation de communiquer dont la violation peut être sanctionnée tant par l'OAR que par le ministère fédéral des finances. M. le Rapporteur : Alors qu'ils fonctionnent depuis plus d'une année, tous les OAR que nous rencontrons ne communiquent aucune information au Bureau de communication et n'ont jamais sanctionné aucun de leurs membres. Au même moment, la France est confrontée à des situations dans lesquelles on retrouve des fiduciaires et des avocats suisses qui blanchissent de l'argent dont la provenance s'est révélée illégale. Me Didier de MONTMOLLIN : Il y a là une question de temps. La loi n'est entrée en vigueur de manière partielle que le 1er avril 1998 et dans sa totalité, le 1er avril 2000. S'il y avait eu un manquement à l'obligation de communiquer un soupçon avant l'entrée en vigueur de ces OAR, l'Autorité de contrôle aurait eu le pouvoir de proposer qu'une sanction soit prononcée par la section compétente de l'administration fédérale. Vous devez vous informer auprès de lui pour savoir s'il a eu ou non à utiliser ce pouvoir. Un intermédiaire financier qui viole l'article 9 ou 10 de la LBA est sanctionnable par le biais de M. Huber dès le 1er avril 1998. Toutefois les OAR ne sont opérationnels que depuis le 1er avril 2000. Pour le moment, il serait prématuré de tirer des conclusions. Les statistiques, publiées par le Bureau de communication, démontrent que la plupart des annonces émanent encore principalement des banques. Cependant les banques, avant l'entrée en vigueur de la LBA, avaient déjà, depuis 1977, une convention de diligence. D'où une sensibilisation plus grande qui a eu le temps de s'instaurer. M. le Rapporteur : Les banquiers sont des commerçants, mais les avocats sont des hommes de loi et sont soumis comme tels à une déontologie, c'est-à-dire la science des devoirs. Ils sont beaucoup plus sensibles que les banquiers et pourtant ils ne font aucune communication. Pendant ce temps, on continue de voir des avocats suisses mener leurs affaires en France. Peut-être serait-il plus judicieux que je transmette le nom de ces avocats au juge plutôt qu'à votre OAR. Le juge peut procéder à une visite surprise tandis que votre OAR parlementera avec l'avocat concerné. Me Didier de MONTMOLLIN : Rien ne vous empêche de transmettre le nom de ces avocats au juge et à l'OAR. Mon expérience dans ce domaine est modeste mais réelle puisque, depuis 1989, je travaille comme chargé d'enquête de la convention de diligence. Je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu d'affaires qui auraient été mises sous le tapis par la commission de surveillance de la convention de diligence, sous prétexte qu'il valait mieux ne pas investiguer. S'il est mentionné qu'une banque est partie à une affaire où se pose le problème du non-respect du principe du « Know your customers », il y a ouverture d'une enquête. Maintenant savoir si cela fonctionnera dans le secteur parabancaire ou pas, je ne serai pas optimiste ou naïf au point de vous répondre oui immédiatement. M. le Rapporteur : Néanmoins, dans le même temps, je note un contraste important avec la relative faiblesse des effectifs à l'échelon du gouvernement. C'est une tradition suisse. Alors que la Suisse est l'une des principales places financières au monde, la Commission fédérale des banques fonctionne avec un nombre de personnes incroyablement inférieur, comparé à celui d'autres places financières dans le monde. Me Didier de MONTMOLLIN : Néanmoins, si l'on se réfère par exemple à l'affaire Abacha, ce sont les Suisses qui ont demandé aux banques de bloquer les fonds et d'annoncer les relations d'affaires concernées à l'autorité de surveillance bancaire. C'est la Suisse qui publié des communiqués de presse à ce sujet et qui sanctionne, alors que l'argent venait essentiellement du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'Autriche, avec un tout petit pourcentage du Nigeria. Des banques anglaises, américaines et autrichiennes ont transmis l'argent en Suisse, sans le bloquer. L'importance de l'effectif de l'autorité de surveillance n'est donc pas toujours garante d'efficacité. Cet OAR fonctionne avec un comité de douze personnes, deux chargées d'information et de formation plus des aides extérieures, le cas échéant. Si vous comptez douze OAR comme celui-ci, fonctionnant chacun avec un minimum de dix personnes, cela représente déjà cent vingt personnes qui travaillent sur cette problématique du blanchiment, organisent des séminaires de formation et vérifient le degré de participation à ces séminaires. En effet les attestations ne sont fournies qu'aux intermédiaires financiers qui suivent ces séminaires de formation. Même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, un travail important est en cours au niveau de la prévention. M. le Rapporteur : Malgré tout cela, je ne vois aucun résultat, que ce soit chez les fiduciaires ou les avocats. J'ai là un article de presse qui relate les déclarations de Mme Wenger, députée de l'Alliance de gauche. Elle a déposé un projet de loi visant à empêcher les avocats inscrits au barreau genevois de faire partie de conseils d'administration. Selon ses termes, « trop d'avocats sont impliqués dans des affaires financières. Il faut empêcher la confusion des tâches. » Si les parlementaires suisses reconnaissent eux-mêmes l'implication des avocats, d'autant que 10 % sur les mille deux cents inscrits au barreau de Genève sont en même temps administrateur de société et « ont tendance à aider les entreprises à contourner les lois », je suis inquiet sur l'utilité de votre OAR. Me Didier de MONTMOLLIN : Il s'agit d'une déclaration qui émane d'un parti situé fondamentalement à la gauche de la gauche. Je ne crois pas que cette déclaration soit représentative d'une opinion politique importante en Suisse. L'administrateur d'une société suisse est soumis à de nombreuses responsabilités. Peut-être certains administrateurs continuent-ils de prendre cela à la légère, mais cela semble dangereux du seul point de vue du droit des sociétés anonymes suisses et de la responsabilité de l'administrateur, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Vous me direz qu'il y a des administrateurs de sociétés offshore. Toutefois un avocat, qui accomplit son travail avec diligence et discernement, n'accepte pas, sans auparavant avoir acquis une certitude suffisante quant à la qualité de la relation, un poste d'administrateur dans une société étrangère offshore. Ce serait aller vite en besogne que de dire que le seul fait d'accepter un tel poste suffit à dénoter un comportement manquant d'éthique ou pire que cela de la part de l'administrateur. Dans le système anglais, par exemple, il existe une quantité de « charity organizations » qui ne sont pas des organisations de façade. Elles gèrent des fonds très importants au bénéfice d'un certain nombre de personnes en Angleterre et à travers le monde. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'a priori négatif quant à la participation d'un citoyen suisse, français ou autrichien à un tel conseil. M. le Rapporteur : Qu'en est-il des contrôles de routine triennaux ? Me Didier de MONTMOLLIN : Les contrôles démarrent cet automne, comme pour tous les OAR. Nous devons jusqu'au 31 mars 2001 contrôler le tiers de nos affiliés, soit environ 450 adhérents. Ce n'est pas du tout une opération virtuelle, cela a été organisé, planifié, distribué. Dès avril 2001, nous pourrons évaluer ce que les contrôles ont apporté. M. le Rapporteur : Quand serez-vous en mesure de me transmettre des informations sur les contrôles ? Me Didier de MONTMOLLIN : Mon collègue responsable des contrôles et des chargés d'enquête va planifier définitivement la distribution du travail. Le premier état des lieux pourra être dressé dès avril ou mai 2001, pour ce qui est des enquêtes ordinaires. Dans le cadre des enquêtes ordinaires, on vérifie de façon serrée les éléments d'organisation de l'étude. Tout avocat ou notaire doit pouvoir présenter, sans réticence ou difficulté, sous forme informatique ou écrite, la liste des dossiers dans lesquels il agit comme intermédiaire financier. C'est un facteur très important qui permet déjà d'apprécier la durée de la révision. Une grande étude, qui compte deux ou trois cents dossiers d'intermédiation financière, n'aura pas la même organisation qu'une petite étude. Nous devons constater l'existence de directives internes et évaluer dans quelle mesure elles ne sont pas mises au placard et jamais appliquées. De même que nous devons constater qu'une formation a été suivie et que l'étude compte en son sein un responsable de l'application de la LBA, de manière à vérifier que l'encadrement pour la prévention du blanchiment est bien en place. Ensuite lors de contrôles plus spécifiques qui doivent concerner 10 % des dossiers, mais au minimum dix dossiers, nous vérifierons tous les points usuels de base, prévus dans l'ensemble des systèmes compatibles avec le GAFI, c'est-à-dire l'identité du contractant, de l'ayant droit économique et la documentation. Nous devons être également en mesure d'évaluer si l'arrière-plan économique a été suffisamment étayé, ce qui dépendra du type d'activité. Plus l'activité d'intermédiation financière concernera des montants importants et se fera selon des modes qui pourraient donner lieu à certains soupçons, en raison de leur caractère peu commun, plus cela poussera le contrôleur à vérifier que la justification de cette activité se trouve dans le dossier au niveau de l'arrière-plan économique. Si, dans le cadre d'un dossier, le contrôleur constatait l'existence de soupçons fondés qui n'aurait donné lieu à aucune communication, il reviendra à l'OAR d'en prendre note, de sanctionner et d'en informer le Bureau de communication à Berne. M. le Rapporteur : Qu'allez-vous faire lorsque vous découvrirez que des activités antérieures à la loi n'auront pas été régularisées et sont encore en cours ? Me Didier de MONTMOLLIN : Il convient de faire la différence entre deux situations. Il est évident que l'on ne pourra pas accepter, s'agissant du principe du « Know your customers », l'explication que cette relation date du grand-père de l'avocat, chef d'étude actuel et, qu'en conséquence, il n'a jamais été jugé utile de la documenter. De ce point de vue, depuis le 1er avril 2000, les dossiers doivent être conformes à la loi. S'agissant de l'obligation de communiquer les soupçons, nous n'aurons pas la compétence pour sanctionner lorsqu'il s'agit d'une situation antérieure au 1er avril 1998 puisqu'une telle obligation n'existait pas antérieurement à cette date. Quant au principe « Know your customers », que le dossier ait été ouvert avant ou après le 1er avril 1998 ne fera aucune différence, dans la mesure où le dossier est toujours en cours à la date cruciale du 1er avril 2000. Pour la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 1er avril 2000, nous vérifierons la conformité avec l'article 9 LBA relatif à l'obligation de communiquer. Ensuite nous élargirons notre champ d'investigation en l'étendant à l'ensemble de la LBA et de la réglementation de l'OAR, à compter du 1er avril 2000. C'est ainsi que cela devrait fonctionner. M. le Rapporteur : Suite à mes enquêtes dans le Sud, quelques noms me reviennent à l'esprit, notamment ceux d'avocats lyonnais. Certains utilisent tous les véhicules du blanchiment de la région - Liechtenstein, etc. - et sont inscrits aux barreaux les plus honorables tels que celui de Genève. Me Didier de MONTMOLLIN : Vous pouvez malheureusement toujours trouver des exceptions, mais il me semble que la profession... M. le Rapporteur : Ce n'est plus un problème d'exception ou de profession. Dès lors qu'il n'y a aucune communication de soupçons, nous considérons que l'OAR ne fait pas son travail et que, par conséquent, l'ensemble de la profession est soupçonnable. Me Didier de MONTMOLLIN : Il convient de rappeler que les OAR ne sont opérationnels que depuis le 1er avril 2000. Ce serait faire un procès d'intention aux OAR que de prétendre qu'ils ne font pas leur travail. M. le Rapporteur : Depuis avril 2000, il n'y a eu aucune communication provenant des fiduciaires ou des avocats. Pourtant tous ces noms apparaissent dans les journaux. Cela nous fait sourire. De plus, des fonctionnaires suisses, qui n'ont aucun rôle politique comme tout fonctionnaire, se sont exprimés dans la presse en ces termes : « Je ne voudrais pas que les parlementaires de tous les pays fassent des enquêtes sur la place financière suisse... » Si votre souhait est que l'on assimile la Suisse au Liechtenstein, continuez ainsi, et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. D'ailleurs, dans un an, nous vous poserons de nouveau les mêmes questions et nous ferons le bilan. Me Didier de MONTMOLLIN : D'ici là, les OAR auront eu le temps de fonctionner. M. le Rapporteur : En deux ans, les intermédiaires financiers n'ont fait quasiment aucune déclaration de soupçons, nous sommes quelque peu inquiets. Ce n'est pas à nous, étrangers, d'aller dénoncer des avocats qui viennent faire ici leurs opérations hautement suspectes. Que faites-vous contre ces avocats qui ont pignon sur rue à Genève et qui font l'objet de poursuites en France ? Me Didier de MONTMOLLIN : Des actions sont prises au niveau de la justice pénale. Vous connaissez d'ailleurs la politique de notre procureur Bertossa à Genève. Lorsqu'il apprend qu'un avocat ou un notaire aurait trempé dans une affaire de blanchiment, il ouvre une enquête. Je ne crois pas qu'il y ait négligence ou laxisme. M. le Rapporteur : L'avenir nous le dira. C'est à vous de jouer maintenant. Me Didier de MONTMOLLIN : Nous avons fait un pari avec l'extension du système d'autorégulation au secteur para-bancaire et nous verrons si cela fonctionne ou pas. De manière générale, je suis toutefois de l'avis que la situation en Suisse n'a plus rien de comparable à celle qui existait par le passé. Comme partout ailleurs, on trouvera toujours des gens qui ne suivront pas les règles du jeu, il faudra alors les sanctionner. Mais on ne peut ignorer la très sérieuse prise de conscience au niveau de la prévention du blanchiment en Suisse avec des instruments qui se sont développés et qui sont appliqués. M. le Rapporteur : Si je vous adresse des renseignements, vous engagez-vous à les contrôler ? Me Didier de MONTMOLLIN : Je n'aurai même pas à choisir entre ouvrir une enquête ou pas, dès lors que l'OAR considère que les faits rapportés font état d'un manquement possible à l'application de la LBA. M. le Rapporteur : Quelle position allez-vous prendre par rapport à la liste des territoires non coopératifs publiée par le GAFI ? Me Didier de MONTMOLLIN : Cette question a fait l'objet d'une récente communication de l'Autorité de contrôle. Nous examinerons si l'intermédiation financière de l'avocat ou du notaire avec l'un de ces pays est conforme aux exigences légales. Nous serons particulièrement attentifs au sujet de la question de la clarification de l'arrière-plan économique. M. le Rapporteur : Comment procéderez-vous avec par exemple KPMG Zurich qui possède une filiale ou un bureau de représentation à Vaduz ? Me Didier de MONTMOLLIN : Nous n'aurions pas la compétence de faire quoi que ce soit, car cette institution dépend de l'OAR des fiduciaires, présidée par M. Cuendet. M. le Rapporteur : Qu'en est-il alors pour KPMG juridique ? Me Didier de MONTMOLLIN : Ils ne sont pas membres de la fédération suisse des avocats puisque ne pratiquant pas en tant qu'avocats indépendants. M. le Rapporteur : Je vous remercie de toutes ces informations. Entretien du Rapporteur avec M. Bernard MONNOT, ancien mandataire social de la Banque cantonale de Genève à Lyon (compte-rendu de l'entretien du 21 octobre 1999) M. Arnaud MONTEBOURG : Pouvez-vous nous donner votre identité ? M. Bernard MONNOT : Bernard Monnot, né le 1er mai 1944 à Auxerre (Yonne). M. Arnaud MONTEBOURG : Quelle est votre profession actuelle ? M. Bernard MONNOT : Consultant. J'habite 74, rue Vendôme à Lyon (VIe). M. Arnaud MONTEBOURG : Vous avez fait parvenir au rapporteur de la mission d'information qui vous interroge, un certain nombre de documents relatifs à une banque lyonnaise dont le siège social est à Lyon. Il s'agit de la Banque cantonale de Genève, dont vous avez été directeur général. M. Bernard MONNOT : Tout à fait. M. Arnaud MONTEBOURG : De quelle date à quelle date ? M. Bernard MONNOT : Du 1er juillet 1993 au 31 janvier 1996. M. Arnaud MONTEBOURG : Dans quelles conditions avez-vous été nommé à la tête de cette banque ? M. Bernard MONNOT : Un chasseur de tête genevois m'a présenté tout d'abord au Crédit suisse qui cherchait à restructurer sa bancassurance. A la suite de dissensions entre Genève et Zurich à l'intérieur de cette banque, il m'a ensuite présenté à ce qui était à l'époque la Caisse d'épargne de Genève, avant qu'elle ne fusionne avec la Banque hypothécaire pour devenir la Banque cantonale de Genève. Il y avait deux banques cantonales à Genève et il n'y en a plus qu'une. J'ai été recruté comme mandataire social et non pas comme salarié, alors que je venais de la Société générale où j'étais sous-directeur, pour monter ex nihilo une banque, qui n'existait pas en 1993, au moment de mon embauche. Jusqu'à plus amples informations, beaucoup de banques étrangères voulant venir en France avaient à payer une sorte de ticket d'entrée consistant à racheter une banque en difficulté. Dès lors que les Suisses me faisaient confiance et que je leur faisais confiance, j'ai choisi d'aller voir la banque de France, avec une création ex nihilo d'une société financière au capital de 15 millions, transformée en banque dix-huit mois plus tard avec un capital de 50 millions, puis une augmentation de capital pour l'amener à 100 millions. M. Arnaud MONTEBOURG : A quelle date l'exercice de l'activité bancaire a-t-il été attribué à la banque que vous avez fondée à Lyon ? M. Bernard MONNOT : Immédiatement, puisqu'il n'y a eu aucun changement d'activité entre la société financière et la banque. Nous sommes d'ailleurs restés avec les mêmes interlocuteurs à la Commission bancaire pour bien montrer que nous ne changions pas d'activité, que nous ne faisions que du crédit moyen et long terme et de l'assurance vie. M. Arnaud MONTEBOURG : Pouvez-vous expliquer quel était l'objectif économique de cette création en termes de marché ? M. Bernard MONNOT : L'objectif économique procédait de l'analyse suivante. Pour ne pas être la nouvelle banque sur une place telle que Lyon où tout le monde se connaît, à qui on donne systématiquement les mauvais dossiers, j'ai préféré me mettre sur un créneau complémentaire des banques existantes. Ces dernières conservaient, vis-à-vis de leurs clients, les mouvements, les crédits court terme et les relations personnelles tandis que nous nous placions en complément, en offrant des crédits d'investissement, souvent en accord avec la banque principale. Un certain nombre de banques locales nous ont d'ailleurs purement et simplement apporté des dossiers. Ceci montre que cela ne s'est pas fait en conflit. Ce n'était pas une banque qui venait avec d'énormes moyens prendre une part de marché, mais remplir un vide, celui des banques d'investissement telles qu'ont pu l'être à une époque le Crédit national, les SDR et autres. M. Arnaud MONTEBOURG : Pour quelles raisons sont-ce les Suisses, et non pas les établissements bancaires français spécialisés dans ce type d'opération, ont-ils investi dans cette niche à Lyon ? M. Bernard MONNOT : Le mécanisme même de la bancassurance, qui consiste à s'adresser presque exclusivement à des dirigeants de PME et à leur dire qu'ils ont une stratégie d'investissement dans ce qui est leur outil et leur propriété ou celle de leur famille, et une stratégie d'épargne, sous forme d'assurance vie, pose aux banques le problème suivant : lorsqu'un particulier souscrit un contrat d'assurance vie, c'est au détriment des placements qu'il fait dans la banque, à qui il va demander ce produit. Cela ne signifie pas que cela ne s'est pas fait, au contraire. La Société générale, le Crédit lyonnais, la BNP, le Crédit agricole, l'UCB ont suivi cette démarche, mais l'ont limitée volontairement pour ne pas toucher leurs dépôts et leur ratio déjà bien fragile en France. Dès lors que nous n'étions pas contraints de prendre dans l'épargne déjà dans nos caisses ou dans nos lignes, les Suisses avaient alors intérêt à faire cette opération d'entrée de jeu saine et rentable, même faiblement. En effet, la marge sur les crédits, qui est d'environ 1,5 à 2 %, laisse normalement un déchet. Comme dans toute banque, il y a des impayés et des dossiers litigieux. La commission versée au titre de la souscription de contrat par l'assureur, que l'on a choisi externe car on n'a pas créé une compagnie d'assurance en même temps, permettait de disposer des 1,5 à 2 % supplémentaires servant à faire face aux impayés et aux risques. Les risques étaient donc payés par les commissions d'assurance et on disposait de la marge normale, ce qui permettait, au moment même où toutes les banques avaient des marges très faibles, de démarrer avec une marge nette de près de 2 %. Les Suisses disposaient ainsi d'une banque spécialisée, avec un investissement relativement faible. M. Arnaud MONTEBOURG : Dans quelles conditions avez-vous quitté, en 1996, cette banque dont vous étiez mandataire social ? M. Bernard MONNOT : J'en étais le directeur général et mandataire social, et non salarié, avec responsabilité pénale, totale et au fond un agrément de la banque de France, que j'ai reçu en novembre 1993, c'est-à-dire quelques mois après la création. Au départ, lorsque j'ai quitté la banque, c'était clairement en raison d'une divergence de stratégie. La réussite ayant été beaucoup plus rapide et forte que prévu, la Banque cantonale de Genève à Genève et le président en France ont voulu aller à tout prix dans l'immobilier. Ayant près de vingt-cinq ans de banque, je n'étais pas du tout intéressé par l'immobilier. Nous nous sommes donc séparés sur une divergence de stratégie. Mais il faut aller un peu plus loin, dès ce moment-là. Un des administrateurs, présent lors de la séance au cours de laquelle a été prononcée ma révocation, m'a alerté sur le fait que les opérations immobilières, non seulement n'étaient pas dans la stratégie prévue à l'origine, mais qu'elles étaient probablement soit douteuses soit même frauduleuses. Une fois mon attention attirée sur ce point, à l'aide d'un Minitel et de la consultation des documents disponibles dans les greffes de tribunaux de commerce, je me suis aperçu qu'au-delà des crédits immobiliers pour lesquels il y avait des garanties normales et une prise de risque normale, à l'insu de la banque, une cascade de transmission de parts des sociétés aboutissait à enrichir des personnes de la banque. On sait maintenant, puisque le procureur de la République adjoint, M. Mondonneix, m'a récemment fait interroger sans prendre de gants sur la formulation, qu'il s'agit plus d'une escroquerie que d'un abus de bien social. C'est qualifié. M. Arnaud MONTEBOURG : Cela a-t-il donné lieu à des poursuites pénales de Lyon ? M. Bernard MONNOT : Il semblerait qu'il y ait poursuites pénales, mais je n'en sais pas plus. M. Arnaud MONTEBOURG : Avez-vous été interrogé par le procureur de la République, un juge d'instruction ou la police sur cette affaire ? M. Bernard MONNOT : Par la police. A la suite d'un détournement de courriers, un ami qui m'avait envoyé du courrier a porté plainte. J'ai donc été entendu, dans ce cadre, par la police à qui j'ai dit qu'à ma connaissance, je n'avais d'ennemis que les dirigeants de la Banque cantonale de Genève à Genève. En effet, au fil des mois, il y avait non seulement escroquerie dans l'immobilier, mais également blanchiment. J'étais en travers de leur route, c'est aussi simple que cela. Déposition sous serment a été faite devant le commissaire de mon quartier à Lyon. M. Arnaud MONTEBOURG : Vous indiquez, au travers des activités de la banque postérieures à votre départ, que seraient apparues des activités de blanchiment au sein de la Banque cantonale de Genève. Pouvez-vous l'expliquer ? M. Bernard MONNOT : Il manque un épisode. J'ai donc quitté la banque le 1er février 1996 et alerté par écrit l'actionnaire majoritaire ainsi que l'actionnaire minoritaire, la compagnie d'assurance GPA du groupe Worms. Début juillet 1996, j'ai rendu visite à M. Etienne Subra, directeur régional de la banque de France, à qui j'ai remis en mains propres, avec une lettre d'accompagnement, la totalité des preuves que l'on peut trouver librement - j'insiste sur ce point, il n'y a aucun document interne de la banque - relatives à l'escroquerie immobilière. M. Arnaud MONTEBOURG : A quelle date ? M. Bernard MONNOT : Début juillet 1996. J'ai d'ailleurs eu droit à ses remerciements. Le temps a passé, puis le bilan 1996 a été disponible au greffe du tribunal de commerce, pendant l'été 1997. J'ai eu le bilan de cette banque que je connaissais à fond pour l'avoir créée et dont je suis resté volontairement actionnaire sur les conseils de mes avocats, pour éviter que, lors d'une quelconque délibération d'assemblée générale, ils n'aient la tentation - qu'ils ont eu - de mettre sur mon compte des choses que je n'avais ni commises ni même connues. Lorsque j'ai eu en mains ce bilan, accompagné de mes deux avocats, le bâtonnier de l'Ordre, Me Chanon, et Me Simon Wesley, je suis retourné volontairement voir M. Etienne Subra. La deuxième visite à M. Etienne Subra s'est passée d'une façon relativement différente par rapport à la première, où j'avais été accueilli à bras ouverts. Enfin, je lui donnais l'opportunité de lancer des inspections et autres, comme s'il avait dû attendre que j'amène les dossiers pour lancer des inspections. Lors de cette deuxième visite, M. Subra était au fond, quand même, bien embarrassé de ce dossier qui donnait lieu à des rumeurs insistantes à Lyon sur l'escroquerie immobilière et déjà sur le blanchiment d'argent. Que je vienne lui demander si c'était exact, en tant qu'ancien mandataire social et toujours actionnaire, l'embarrassait beaucoup. Poussé dans ses derniers retranchements et un peu énervé, M. Subra, lorsque je lui ai démontré, à partir de documents officiels, qu'il y avait blanchiment d'argent, n'a absolument pas tergiversé, mais m'a dit - et ce sont des points très importants pour la suite : 1) Oui, il y a blanchiment, je vous confirme que vous avez vu juste, mais sachez que nous étions au courant. Il était vexé que j'ose venir lui montrer qu'il y avait blanchiment. 2) Il y a inspection sur inspection sur le sujet. 3) Près de la moitié de ce blanchiment - il s'agit de plus de 300 millions - a été faite dans la région d'Annecy (où nous avions un bureau). 4) Ce point m'a le plus intrigué : les neuf personnages les plus importants du système bancaire se sont réunis sur ce dossier, m'a-t-il dit. Dès lors que la maison mère assure à tout moment la trésorerie de la filiale française, en ce qui nous concerne, nous estimons que nous n'avons rien d'autre à faire et à dire, a-t-il ajouté. M. Arnaud MONTEBOURG : Vous allez nous expliquer en quoi, à vos yeux, les bilans de la Banque cantonale de Genève, pour les exercices 1996 et 1998, apportent la démonstration qu'il y aurait des activités de blanchiment au sein de cette banque. M. Bernard MONNOT : Le mécanisme utilisé peut difficilement être plus simple. Un chef d'entreprise dépose une somme - et c'est son affaire - par exemple 1 million, à la Banque cantonale de Genève à Genève. A ma connaissance, jamais personne à Lyon n'a imaginé que la filiale française prêtait la main à cet aspect-là, c'est-à-dire que les Lyonnais ou les Savoyards font leur affaire de déposer une somme X au guichet de la Banque cantonale de Genève en Suisse. La Banque cantonale de Genève, faisant du blanchiment en bande organisée et à échelle industrielle, a créé - ce dont je tiens confirmation de M. Subra lui-même - une fiduciaire censée regrouper juridiquement, probablement à leur insu, car cela ne leur plairait pas de savoir qu'ils sont dans une seule société, les déposants français qui ont mis cet argent à Genève. M. Arnaud MONTEBOURG : Vous voulez dire que la Banque cantonale de Genève maison mère contrôle les ayant droits économiques d'une société fiduciaire en Suisse... M. Bernard MONNOT : Oui. Le banquier dépositaire étant la Banque cantonale de Genève à Genève, mais la structure juridique une société fiduciaire, cet argent permettait aux déposants d'obtenir un crédit de même montant en France. Les Suisses étant particulièrement précis, tout indique que c'est au centime près le montant qui est dans la fiduciaire qui a été reprêté à court terme à la filiale française pour faire rigoureusement le même montant de crédit en France à des entreprises françaises. M. Arnaud MONTEBOURG : Tout cela est assez clair, mais cela n'apparaît pas dans le bilan en tant que tel. M. Bernard MONNOT : Si. J'admets volontiers que la pratique de la banque permet de le comprendre, mais cela s'explique assez facilement. Il faut examiner à la fois le bilan et le compte d'exploitation. Si on prend l'exemple du 31 décembre 1996, ce sont 313 millions. M. Arnaud MONTEBOURG : Il apparaît en effet qu'au passif du bilan 1996, les dettes à court terme envers des établissements de crédit s'élèvent à 313,254 millions. Ces dettes à moins de trois mois, inscrites au passif du bilan, sont contractées envers des établissements de crédit. Comment interprétez-vous ce chiffre ? M. Bernard MONNOT : Dès lors que cette banque s'était engagée, dans le dossier de 1993 de création, à ne faire que du crédit à moyen et long terme, elle devait, de par les règles prudentielles, rechercher des refinancements - or, les 313 millions font bien partie d'un ensemble de refinancement de 573 millions - de même nature et même durée. Ce n'est pas le cas puisqu'à l'intérieur des 573 millions, 313 millions sont à moins de trois mois et sont les sommes prêtées par la fiduciaire. M. Arnaud MONTEBOURG : Je note, à ce stade de vos explications, qu'il est exact qu'à l'actif, la somme de 390 millions environ a été attribuée, sous forme de prêts à long terme plus de cinq ans, par la Banque cantonale de Genève de Lyon et que son refinancement est, à moins de trois mois, pour près des deux tiers de ces encours. M. Bernard MONNOT : Tout à fait. On arrive au deuxième volet qui permet de verrouiller le premier. Cela se traduit au compte d'exploitation. En effet, si la banque avait eu à payer un refinancement normal, moyen et long terme, même avec la baisse des taux que l'on a connue à cette époque, il n'y aurait pas un coût de refinancement aussi faible. M. Arnaud MONTEBOURG : De combien est-il ? M. Bernard MONNOT : De mémoire, on doit trouver 26 millions de coût de refinancement, qui est le coût global sur le compte d'exploitation. On le trouve dans « intérêts et charges affiliés ». Ces 26 millions ne correspondent pas au prix de 573 millions. A l'intérieur des 573 millions, 313 millions sont rémunérés à 0 %. M. Arnaud MONTEBOURG : C'est votre déduction. M. Bernard MONNOT : Confirmée par M. Subra, directeur régional de la Banque de France. M. Arnaud MONTEBOURG : Voulez-vous dire que le directeur régional de la Banque de France de Lyon, chargé de dénoncer auprès de la Commission bancaire non seulement les anomalies au regard des règles prudentielles, mais également les anomalies qui devraient mettre en évidence des infractions pénales, connaissait ces informations et les avait lui-même notées ? M. Bernard MONNOT : Je suis très affirmatif, mais je ne le formulerai pas ainsi. A ma connaissance, il a eu le courage de le transmettre à la Commission bancaire. Etant le représentant local de la Commission bancaire, l'infraction de non-communication ou vis-à-vis de l'article 40 du code pénal ne doit pas être à son niveau. C'est un monsieur que je connais bien, tout à fait droit et honnête, et à ma connaissance, il a transmis ces informations à la Commission bancaire. M. Arnaud MONTEBOURG : Cette activité de blanchiment, selon vous, a-t-elle continué après 1996 ? M. Bernard MONNOT : Il semble. J'ai obtenu les bilans 1997 et 1998. Si l'on reconstitue le même mécanisme - mais je ne suis pas allé voir M. Subra qui entre-temps a pris sa retraite -, les Genevois ayant été pris la main dans le sac à hauteur de 313 millions, se sont calmés sur l'année 1997, puisque l'encours n'est passé du 31 décembre 1996 au 31 décembre 1997 que de 313 millions à environ 360 et quelques millions. Cela signifie que, sur l'année 1997, ils n'ont fait comme blanchiment qu'une cinquantaine de millions de plus. Voyant que la banque de France, la Commission bancaire et autres ne bougeaient pas d'un cil, semble-t-il, ils ont redémarré sur 1998 où on atteint la glorieuse somme de 573 millions. M. Arnaud MONTEBOURG : C'est-à-dire plus d'un demi-milliard de francs lourds. M. Bernard MONNOT : Oui. Il y a une démonstration tout à fait amusante du fait que c'est une continuation. Le compte d'exploitation n'a pas augmenté alors même que le volume des crédits, d'une part, et du refinancement, d'autre part, a presque doublé. M. Arnaud MONTEBOURG : Quelle est la clientèle de la Banque cantonale de Genève qui se livre, à votre avis, à ce type d'activités de blanchiment ? M. Bernard MONNOT : Il y a deux réponses à cette question. Tout d'abord, la région Rhône-Alpes a toujours eu de longue date, une tradition de placements en Suisse, mais c'était la première fois qu'un outil permettait, à partir d'un dépôt qui se faisait et mal rémunéré en Suisse, d'obtenir du crédit en France, le crédit étant avec des intérêts déductibles au compte d'exploitation de la PME. Le type de clientèle est essentiellement, non pas les PME de l'industrie qui ont d'énormes difficultés à sortir de l'argent noir, mais probablement de l'hôtellerie, des boîtes de nuit dont certains cas sont connus à Lyon. Ce sont les outils habituels de l'argent noir. Pour une fois, cet argent noir donne un deuxième produit. Non seulement on peut le mettre à l'abri, mais également le faire directement produire de l'endettement fictif en France. M. Arnaud MONTEBOURG : Les clients de la Banque cantonale de Genève sont-ils exclusivement des hôteliers ou des gérants de boites de nuit, ou des clients plus importants ont-ils utilisé ce mécanisme ? M. Bernard MONNOT : Le positionnement même de la banque, par rapport à ses confrères à Lyon, ne permettait pas, à mon sens, de faire des opérations unitaires importantes, des grandes opérations et des grandes entreprises. Ce n'était vraiment que des PME. M. Arnaud MONTEBOURG : Avez-vous engagé une procédure contre la Banque cantonale de Genève en ce qui vous concerne et sur quels fondements, puisque vous étiez mandataire social ? M. Bernard MONNOT : Tout à fait. Le bâtonnier Chanon et Me Wesley ont dû, ce qui me semble normal, laisser passer un certain laps de temps pour être sûrs que ce que j'avançais était exact. Il a fallu que les Suisses refusent toute discussion concernant les atteintes à ma réputation, parce que même si cela s'est passé après mon départ, il est certain que, sur la place de Lyon et dans le monde bancaire, j'apparais comme lié à une banque qui fait des escroqueries immobilières et du blanchiment. La réputation de la banque, sur la place de Lyon, est parfaitement établie ainsi. En tant que professionnel, cela me porte un préjudice. Nous venons de déposer des conclusions au tribunal de commerce, puisque ce sont, d'une part, les sociétés et la Banque cantonale de Genève France et, d'autre part, la Banque cantonale de Genève à Genève que nous attaquons, d'abord pour le préjudice et essentiellement, pour le fait que ce qui est arrivé et ce qui s'est passé ensuite ne me permet pas de retrouver du travail dans la banque, alors même qu'il y a eu réussite. J'insiste sur ce point, au fond ils ont profité d'une réussite. Il y a en effet une procédure en cours. M. Arnaud MONTEBOURG : Je souhaiterais que vous nous fassiez parvenir vos conclusions faisant état de l'ensemble de vos revendications devant le tribunal de commerce de Lyon. M. Bernard MONNOT : Tout à fait. J'ai indiqué au bâtonnier que nous allions nous rencontrer aujourd'hui et il m'a demandé de lui indiquer quelle était la nature de ma déposition et quelles en étaient les conséquences, mais sur le principe, je suis d'accord. M. Arnaud MONTEBOURG : Avez-vous d'autres éléments à ajouter ? M. Bernard MONNOT : Oui. Ayant rejoint récemment l'Association Attac, je considère en tant que citoyen être en mesure de témoigner devant qui que ce soit : la Commission bancaire, et les autorités judiciaires ou policières. Je sais parfaitement où est la limite. Je ne dois utiliser que des documents disponibles. Je dois faire très attention de ne jamais utiliser des documents dont je pourrais avoir eu connaissance par ailleurs. M. Arnaud MONTEBOURG : Connaissez-vous le nom de cette fiduciaire ? M. Bernard MONNOT : Je ne connais pas le nom de cette fiduciaire. M. Arnaud MONTEBOURG : Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de cette fiduciaire suisse ? M. Bernard MONNOT : Par M. Subra, le directeur régional de la banque de France, aussi surprenant que cela puisse paraître. J'ignorais que c'était une fiduciaire. M. Arnaud MONTEBOURG : Je vous remercie. Pour le procès-verbal, j'ajoute que l'ensemble des déclarations que vous venez de faire engageront votre responsabilité, qu'elles sont faites sous votre responsabilité, que la mission procédera à un certain nombre de vérifications dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés. N'étant pas une autorité judiciaire, nous n'avons pas les pouvoirs dont celle-ci dispose dans le code de procédure pénal. Nous tâcherons de faire la lumière dans ce cadre restreint qui est le nôtre et nous déciderons, souverainement, de l'opportunité de porter publiques vos déclarations, le moment voulu. Entretien du Rapporteur avec M. Etienne SUBRA, (compte-rendu de l'entretien du 12 novembre 1999) M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je vous remercie d'avoir accepté de témoigner devant la Mission d'information anti-blanchiment. Je rappelle que nous avons les mêmes exigences de vérité qu'une commission d'enquête, à l'égard de ceux qui ont la gentillesse de venir s'exprimer devant nous. Nous essayons d'approcher la vérité, ce phénomène trop méconnu et sur lequel nous sommes engagés, comme de nombreux fonctionnaires, de nombreux magistrats, policiers, sur la question délicate du blanchiment de l'argent sale. Je crois que vous avez été directeur la délégation régionale de la Banque de France pour la région Rhône Alpes ; c'est à ce titre que je souhaitais que vous me donniez quelques précisions sur le fonctionnement concret de votre travail de surveillance à l'égard des établissements bancaires dans le ressort qui est le vôtre. Nous souhaiterions connaître le rôle que joue une délégation de la Banque de France, dans le contrôle des établissements bancaires qui ont leurs sièges sociaux dans son ressort et la façon dont s'exerce ce contrôle lorsqu'il y a des soupçons sur le non-respect des normes prudentielles et des soupçons sur le blanchiment. Concrètement, comment cela marche ? M. Etienne SUBRA : Merci M. le rapporteur. Je partage bien sûr votre exigence de clarté et de vérité, dans la mesure où je peux apporter quelque chose, évidemment, à vos sujets de préoccupation, sachant que malgré tout, mes souvenirs commencent à s'estomper un petit peu, puisqu'il y a onze mois maintenant que j'ai pris ma retraite de la Banque de France. Ceci étant, en effet, j'ai dirigé la direction régionale de la Banque de France à Lyon pour l'ensemble des 8 départements de Rhône Alpes pendant 9 ans, de 1989 à 1998 ; c'est donc sur ce terrain que je répondrai à vos questions. Tout d'abord sur le contrôle prudentiel exercé sur les banques dont le siège social était dans la Région et plus spécialement sur la place de Lyon : il existe de tout temps et en tout cas jusqu'à mon départ en retraite, je ne dirais pas tout à fait une cloison étanche, mais une séparation claire, nette et tout à fait officielle, réglementaire, en matière de contrôle prudentiel, exercé d'une part par la commission de contrôle des banques, la commission bancaire, présidée par M. Jean-Louis Fort et les antennes locales, ou les organes du siège de la Banque de France, ceci parce que la loi l'imposait ; la Commission bancaire est une institution d'Etat à laquelle la Banque de France prête, sous convention, le concours de ses agents, de ses moyens, mais il n'y a pas confusion des genres, ni confusion des fonctions et des responsabilités. Ceci se retrouve donc sur le terrain, sauf cas tout à fait particulier, par exemple dans le cas récent, je parle des trois dernières années, des préoccupations exprimées par le Gouverneur sur le niveau très bas de certains taux d'opérations actives des banques ; nous avons dans le cadre d'une convention un peu de gré à gré, été amenés (quand je dis « nous », ce sont les directeurs régionaux de la Banque de France) à collaborer avec la Commission bancaire pour rechercher sur nos places un meilleur fonctionnement des établissements de crédit en matière de taux. C'est tout à fait différent des problèmes qui vous préoccupent, mais je voulais vous donner cet exemple pour vous dire que c'est le seul, dans les fonctions que j'exerçais, où j'ai été amené, en effet, à être en quelque sorte le représentant non écrit, non officiel, mais avec la couverture quand même des plus hautes autorités de la Maison, de la Commission bancaire sur la place. Cela étant, il est tout aussi évident qu'un directeur de la Banque de France, qu'il soit au niveau départemental ou régional ne peut pas ne pas s'intéresser de près au fonctionnement des banques locales ou régionales ; mais cela se fait au plan local dans ce que nous appelons « un rôle de place », c'est-à-dire que le directeur de la Banque de France est inséré dans le tissu bancaire local ou régional, et cherche donc à s'informer au jour le jour, sur l'évolution des établissements de crédit qui sont domiciliés sur cette place. S'informer pour nous-mêmes mais aussi bien entendu pour nos autorités, en l'espèce les services centraux à Paris et le gouvernement de la Banque. C'est un rôle qui n'est pas défini à proprement parler par les textes, c'est un rôle qui est né de l'histoire, 200 ans d'histoire maintenant. La Banque de France n'ayant, de surcroît, depuis la loi de 1993, aucune activité qui aille en concurrence directe des établissements commerciaux, nous sommes donc un établissement neutre sur une place et cela nous donne beaucoup plus de liberté pour entretenir avec les responsables des banques locales le maximum d'informations, de liens, etc. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Par quoi cela se traduit-il ? M. Etienne SUBRA : Par des réunions périodiques que je présidais à Lyon, comme mon successeur le fait maintenant, non pas des 61 banquiers présents, mais des 12 ou 15 principaux banquiers, réunions au cours desquelles nous partagions les sujets de préoccupation communs, mais je pouvais également ès qualité, faire passer des messages qui soient, soit de nature monétaire (car c'est le c_ur du métier), soit tout autre sujet, y compris celui du blanchiment, lors de l'installation des antennes TRACFIN, etc. Nous en avons parlé dans cette enceinte. Bien évidemment aussi, les renseignements que je pouvais obtenir, de toutes sortes, par toutes sortes de canaux, y compris ces réunions, mais aussi des entretiens individuels, mais aussi l'examen des comptes annuels de chaque établissement de crédit local, tout cela donnait lieu à un rapport que je transmettais aux services centraux à Paris, mais de la Banque de France, pas de la Commission bancaire en tant que telle. J'ai peut-être un peu résumé, mais je suis prêt à répondre à vos questions plus précises, sur le rôle d'un directeur de la Banque de France, car je ne pense pas que depuis dix mois les choses aient beaucoup évolué, par rapport aux banquiers locaux. Encore une fois, ce n'est pas un rôle de superviseur direct ; je ne suis pas, je n'étais pas l'inspecteur de la Commission bancaire, j'ai fait ce métier mais en des temps beaucoup plus éloignés, j'étais là pour être à l'écoute de la place, lui passer des messages, si vous permettez l'expression familière, de nature monétaire, voire prudentielle, exemple les taux bas, et rendre compte, pas plus ; je n'avais donc pas de pouvoir sur la place. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je vous remercie de ces cadrages tout à fait précis. Nous avons interrogé M. Jean-Louis Fort et nous lui avons demandé si les implantations locales de la Banque de France menaient des enquêtes ; il nous a répondu que non, mais qu'elles pouvaient en effet participer aux travaux de la Commission bancaire en faisant passer un certain nombre d'informations. M. Etienne SUBRA : C'est cela. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je suis amené évidemment à vous demander si, dans le cadre de vos fonctions à Lyon, vous avez eu à connaître d'irrégularités dans le fonctionnement, normal pourrait-on dire, d'un établissement de crédit, et si vous avez eu précisément à transmettre dans ce cadre un certain nombre d'informations qui vous paraissaient de nature à justifier une attention particulière de la Commission bancaire, dans les neuf ans qui ont occupé votre carrière à ce poste à Lyon. M. Etienne SUBRA : La question que vous posez là a trait essentiellement à votre Mission, ou est-ce plus large ? M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : C'est à la fois une question large et particulière, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de savoir si à Lyon, où nous avons eu des informations qui montrent qu'il y a eu des difficultés, la Banque de France a été alertée et si elle l'a été, y a-t-il eu des anomalies à vos yeux qui ont justifié des alertes au niveau de la Commission bancaire ? M. Etienne SUBRA : La réponse est « oui », bien entendu ; je ne vais pas me faire plus fort que je ne suis, autrement dit, en terme de précocité d'information, je ne prétends pas que la Banque de France en général et votre serviteur en particulier, aient toujours été les premiers informés sur la place. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Certainement. M. Etienne SUBRA : Ceci étant, il est clair également que dans les neuf ans auxquels vous faites allusion, j'ai été informé, je me suis informé et j'ai rendu compte d'anomalies pour ne pas dire pis, mais certaines de ces anomalies sont passées devant les tribunaux, de nature financière. Je fais allusion notamment à mes débuts à Lyon, à la défaillance d'un agent de change, une opération financière qui a été traitée avant de connaître une issue définitive sur le plan judiciaire, tout est clos maintenant, c'est l'affaire Girardet. Sur le plan strictement bancaire, de mémoire car je n'ai plus mes dossiers, le cas le plus récent d'anomalies graves dont j'ai eu à connaître, et dont j'ai suivi le déroulement, dans le cadre de la COB, dont j'étais délégué régional, et aussi de la Commission bancaire, avec les limites des explications que je vous ai données, c'était le cas de la banque Clément, mais nous sommes tout à fait dans un cadre qui, dans les informations dont j'ai souvenir, ne touchait pas à des problèmes de blanchiment de l'argent sale, etc. Pour la Banque Clément, il s'agissait essentiellement d'opérations sur les marchés d'options, des marchés dérivés, qui avaient été menées essentiellement par un des opérateurs, un des gérants de cette banque, qui est un tout petit établissement d'ailleurs, je ne dirai pas forcément frauduleusement, mais en tout cas, vraisemblablement au-delà des mandats reçus par cet établissement de la part de ses clients. La banque a été mise en administration provisoire par la Commission bancaire en 1998-1999 ; je ne sais pas où en est maintenant l'opération de cession ; elle était engagée en tout cas à l'automne 1998 quand j'ai pris ma retraite. Ce sont des exemples où j'ai suivi de près le travail entrepris par l'administrateur provisoire nommé par la Commission bancaire, j'ai rendu compte régulièrement, aussi bien au secrétaire général de la Commission à Paris, qu'à mes autorités de la Banque de France, de l'état de mes informations, à titre de suivi ; je n'avais pas encore une fois, de pouvoir particulier d'investigation, l'administrateur provisoire me rendait compte quand même très régulièrement de l'état d'évolution de ses travaux. Voilà deux exemples ; y en aurait-il d'autres ? Très franchement, je n'en vois pas qui soit de lourde importance, mais ma mémoire peut me faire défaut. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Précisément, M. Subra, nous avons reçu le témoignage, qui a été recueilli dans des conditions solennelles ici, d'un ancien directeur général d'une banque de Lyon qui s'appelait « La Banque cantonale de Genève ». M. Etienne SUBRA : Ah ! En effet. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je pense que c'est un dossier qui vous rappelle peut-être quelque chose ? M. Etienne SUBRA : Oui, tout à fait ; j'y pensais d'ailleurs ; ce n'est pas du tout par dissimulation croyez-moi, franchement, je n'ai aucune intention de la sorte, mais je me demandais si c'était un cas que l'on pouvait évoquer dans le cadre de vos interrogations. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Tout dépend de votre analyse. M. Etienne SUBRA : Je pense que si vous en avez parlé à la Commission bancaire, elle est beaucoup mieux outillée que moi pour vous répondre là-dessus. Mon analyse aujourd'hui, serait tout à fait neutre ; je pense que l'établissement en question, au moment où j'ai quitté mes fonctions, ne présentait plus - encore une fois sous bénéfice d'inventaire et l'inventaire a été fait par la commission bancaire depuis lors par une mission spéciale - de risque grave au sens prudentiel ; car je suis là dans mon rôle de représentant de la Banque de France, en résonance avec ce que pourrait penser la Commission bancaire. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Bien sûr. M. Etienne SUBRA : Que s'est-il passé à ce moment à Lyon à la Banque Cantonale de Genève ? Je rassemble un peu mes souvenirs, pardonnez-moi. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Prenez votre temps. M. Etienne SUBRA : Encore une fois, je n'ai plus de dossier. De mémoire, lorsque cette banque s'est créée à Lyon, elle était l'émanation d'un établissement genevois qui à l'époque n'était d'ailleurs pas aussi puissant qu'il l'est devenu depuis ; la Banque Cantonale de Genève était l'émanation d'une caisse d'épargne de Genève relativement importante, qui a fusionné, je ne vous donne pas de date là aussi, car je me tromperai, avec une banque hypothécaire de Genève, pour devenir un établissement de poids à Genève, mais dans un secteur qui n'est pas le plus représentatif de la banque genevoise, qui est une banque généralement, vous le savez comme moi, et suivant vos investigations, je pense, une banque plutôt internationale tournée vers la gestion de patrimoine. La Banque Cantonale, quant à elle, était une banque hypothécaire, issue d'une caisse d'épargne, donc, avec une clientèle commerciale, courante, une banque de détail je dirais. Elle a cherché à s'établir à Lyon, d'après les dire à l'époque de ses dirigeants qui étaient venus me voir, pour étendre son fonds de commerce, en direction des PME Rhône-Alpines qui sont effectivement une cible tout à fait convenable pour une banque d'affaires, une banque plus commerciale ; le tissu de PME et PMI en Rhône-Alpes est très important, tend à se développer, à s'enrichir, à grandir, donc il me paraissait assez naturel qu'une banque étrangère, pas seulement française, vienne s'intéresser à cette clientèle ; d'autant plus qu'ils apportaient à l'époque un produit assez intéressant, qui combinait un contrat d'assurance sur la tête du client, montée par le dirigeant d'entreprise, de la PME, qui était adossé à un crédit d'équipement, à moyen terme, ou à un crédit bail de moyen terme ou de long terme ; c'était un produit relativement original, le crédit bail n'était pas très répandu en 1989-1990 et même en 1995 en Rhône-Alpes, donc, pourquoi ne pas le proposer ? M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : De quoi a pâti cette maison ? M. Etienne SUBRA : Dans les deux ou trois premières années de fonctionnement de la Banque Cantonale de Genève à Lyon, celle ci a pâti, me semble-t-il, d'après mes souvenirs, d'une politique de distribution de crédits aventureuse. J'ai cité 61 établissements de crédit à Lyon, par conséquent en arrivant comme 62ème sur la place, la clientèle qui restait à prendre n'était, bien évidemment pas la meilleure. Le directeur général de l'époque, ancien banquier français, a eu une politique assez aventureuse, c'est-à-dire a distribué du crédit sur des signatures qui étaient pour le moins fragiles ; cela a coûté fort cher, en terme de pertes à cette banque et cela a donné lieu à une éviction du directeur général en question dans les deux ans ou trois ans de sa prise de fonctions et à la reprise en main de la filiale française par la Banque Cantonale de Genève elle-même. Le directeur général qui a été nommé en 1996 ou 1997 (je ne saurais plus vous dire) était un des cadres supérieurs membre du comité de direction de Genève, avocat de formation et directeur juridique pendant un temps, c'est vous dire que semble-t-il, ils voulaient reprendre les choses en main. Les responsables de la Banque Cantonale de Genève ont, à ma connaissance, donné aux autorités françaises, notamment à la Commission bancaire, l'assurance que les choses tourneraient correctement. Lorsque j'ai pris ma retraite, je n'avais plus de souci particulier avec cet établissement lyonnais, dans la mesure où on avait fait le ménage sur les crédits, les provisions avaient été passées, largement, et en ce qui concerne les ressources, l'objectif prudentiel qui est de protéger les déposants, était largement assuré là aussi, car le financement des opérations actives était très largement assuré par la maison mère genevoise. Cela étant, je ne pouvais pas aller plus loin et je ne sais pas si la Commission bancaire qui a je crois mandaté au moins deux missions directes concernant la banque cantonale à Lyon a pu elle-même aller plus loin. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Vous vous souvenez des dates d'inspection de la Commission bancaire ? M. Etienne SUBRA : De mémoire, il me semble qu'une mission a dû avoir lieu fin 1998 ou début 1999 mais je n'en suis absolument pas certain. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Vous vous souvenez de la personne qui la dirigeait ? M. Etienne SUBRA : Absolument pas ; je quittais mes fonctions ou je les avais quittées, je n'ai donc pas pu avoir de renseignement là-dessus ; j'étais beaucoup plus occupé par la banque Clément en 1998 que par la Banque Cantonale de Genève, les propos que je tiens là doivent plutôt se référer à une période qui serait en gros 1996-1997 à peu près, ou 1995-1997, sur trois ans. Ceci étant, je comprends votre interrogation également dans la mesure où vous parliez de fiducie tout à l'heure et d'un avocat, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il semble bien qu'une partie des fonds qui étaient employés au financement de la filiale lyonnaise venait de Genève, la Banque Cantonale de Genève, laquelle pouvait très bien les obtenir sous forme de dépôts de fiducie. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : C'est précisément ce que nous explique l'ancien directeur général qui d'ailleurs nous a expliqué l'historique de ses relations avec cette banque ; il assume parfaitement d'ailleurs sa part de responsabilité. M. Etienne SUBRA : Elle est lourde. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : ... non pas dans ce qu'il considère comme étant une activité postérieure, mais il est resté actionnaire, car il était mandataire social, et il a participé ensuite à la surveillance de l'activité de la banque dont il était le mandataire social. Celui-ci nous explique, c'est au procès-verbal, que la Banque Cantonale de Genève avait installé en Suisse une société fiduciaire qui permettait de refinancer à court terme à Lyon des activités de long terme pratiquées par l'établissement lyonnais ; est-ce que cela vous paraît conforme à votre analyse, ne serait-ce que sur le terrain prudentiel ? M. Etienne SUBRA : Oui, sur le terrain prudentiel ; mais encore une fois, là, c'est moins cet ancien directeur général qui pourrait vous renseigner que mes amis de la Commission bancaire. Personnellement, c'est mon avis tout à fait personnel, je n'engage vraiment que moi, oui, je crois que dans la mesure où les autorités, les mandataires sociaux de la maison mère de Genève avaient donné oralement et par écrit des assurances de refinancement de leur établissement lyonnais, sachant aussi comme je l'ai dit tout à l'heure que cet établissement n'avait collecté que très peu de dépôts, sur le plan prudentiel, je ne vois pas ce qui pouvait nous pousser à douter de la pérennité de l'établissement lyonnais ; il y avait des lettres d'engagement de refinancement (qu'il soit à long terme ou à court terme, peu importe) ; dans la mesure où le président d'une banque étrangère donne l'engagement formel devant le secrétaire général de la Commission bancaire en France, voire devant le président, le Gouverneur de la Banque de France, de soutenir financièrement son établissement local, on n'a pas de raison d'aller mettre en doute un tel engagement, qui sur le plan de l'honorabilité de la personne qui le donne l'engage fortement quand même. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : J'ai compris votre raisonnement. M. Etienne SUBRA : Ce n'est pas une échappatoire. Je me place sur le plan sur lequel je suis. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je tiens à dire que vous n'êtes mis en cause par quiconque. M. Etienne SUBRA : Non, je sais bien. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Votre honnêteté, votre droiture n'ont fait l'objet de discussion de la part de personne. M. Etienne SUBRA : Je n'ai aucun soupçon. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Tout le monde vous tient pour un fonctionnaire absolument droit et ayant accompli les devoirs et responsabilités de sa charge. Vous pouvez être tranquille sur ce terrain. M. Etienne SUBRA : Absolument, je le suis tout à fait. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je le sais. Je veux simplement vous donner le raisonnement qui était tenu par l'ancien directeur général qui est digne d'intérêt, qui figure d'ailleurs dans des documents portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, commerciale d'ailleurs, nous avons le devoir de nous pencher ensemble, avec la Commission bancaire, mais comme vous étiez la tête sur le pont, avancé sur le terrain de l'autorité bancaire, j'ai le devoir de vous interroger très précisément sur cette question ; voilà ce qu'explique ce Monsieur ; si vous voulez bien être attentif à chacun des éléments ainsi recueillis par la Mission d'information parlementaire. Lecture du compte-rendu de l'entretien avec M. Monnot M. Bernard MONNOT : Le mécanisme utilisé peut difficilement être plus simple. Un chef d'entreprise dépose une somme - et c'est son affaire - par exemple 1 million, à la Banque Cantonale de Genève à Genève. A ma connaissance, jamais personne à Lyon n'a imaginé que la filiale française prêtait la main à cet aspect-là, c'est-à-dire que les Lyonnais ou les Savoyards font leur affaire de déposer une somme X au guichet de la Banque cantonale de Genève en Suisse. La Banque Cantonale de Genève, faisant du blanchiment en bande organisée et à échelle industrielle, a créé - ce dont je tiens confirmation de M. Subra lui-même - une fiduciaire censée regrouper juridiquement, probablement à leur insu, car cela ne leur plairait pas de savoir qu'ils sont dans une seule société, les déposants français qui ont mis cet argent à Genève. M. Arnaud MONTEBOURG : Vous voulez dire que la Banque Cantonale de Genève maison mère contrôle les ayant droits économiques d'une société fiduciaire en Suisse... M. Bernard MONNOT : Oui. Le banquier dépositaire étant la Banque Cantonale de Genève à Genève, mais la structure juridique une société fiduciaire, cet argent permettait aux déposants d'obtenir un crédit de même montant en France. Les Suisses étant particulièrement précis, tout indique que c'est au centime près le montant qui est dans la fiduciaire qui a été reprêté à court terme à la filiale française pour faire rigoureusement le même montant de crédit en France à des entreprises françaises. (...) (...) M. Arnaud MONTEBOURG : Je note, à ce stade de vos explications, qu'il est exact qu'à l'actif, la somme de 390 millions environ a été attribuée, sous forme de prêts à long terme - plus de cinq ans -, par la Banque Cantonale de Genève de Lyon et que son refinancement est, à moins de trois mois, pour près des deux tiers de ces encours. M. Bernard MONNOT : Tout à fait. On arrive au deuxième volet qui permet de verrouiller le premier. Cela se traduit au compte d'exploitation. En effet, si la banque avait eu à payer un refinancement normal, moyen et long terme, même avec la baisse des taux que l'on a connue à cette époque, il n'y aurait pas un coût de refinancement aussi faible. M. Arnaud MONTEBOURG : De combien est-il ? M. Bernard MONNOT : De mémoire, on doit trouver 26 millions de coût de refinancement, qui est le coût global sur le compte d'exploitation. On le trouve dans « intérêts et charges affiliés ». Ces 26 millions ne correspondent pas au prix de 573 millions. A l'intérieur des 573 millions, 313 millions sont rémunérés à 0 %. M. Arnaud MONTEBOURG : C'est votre déduction. M. Bernard MONNOT : Confirmée par M. Subra, directeur régional de la Banque de France. M. Arnaud MONTEBOURG : Voulez-vous dire que le directeur régional de la Banque de France de Lyon, chargé de dénoncer auprès de la Commission bancaire non seulement les anomalies au regard des règles prudentielles, mais également les anomalies qui devraient mettre en évidence des infractions pénales, connaissait ces informations et les avait lui-même notées ? M. Bernard MONNOT : Je suis très affirmatif, mais je ne le formulerai pas ainsi. A ma connaissance, il a eu le courage de le transmettre à la Commission bancaire. Etant le représentant local de la Commission bancaire, l'infraction de non-communication ou vis-à-vis de l'article 40 du code pénal ne doit pas être à son niveau. C'est un monsieur que je connais bien, tout à fait droit et honnête, et à ma connaissance, il a transmis ces informations à la Commission bancaire. M. Arnaud MONTEBOURG : Cette activité de blanchiment, selon vous, a-t-elle continué après 1996 ? M. Bernard MONNOT : Il semble. (...) (...) M. Arnaud MONTEBOURG : Quelle est la clientèle de la Banque Cantonale de Genève qui se livre, à votre avis, à ce type d'activités de blanchiment ? M. Bernard MONNOT : Il y a deux réponses à cette question. Tout d'abord, la région Rhône-Alpes a toujours eu de longue date, une tradition de placements en Suisse, mais c'était la première fois qu'un outil permettait, à partir d'un dépôt qui se faisait et mal rémunéré en Suisse, d'obtenir du crédit en France, le crédit étant avec des intérêts déductibles au compte d'exploitation de la PME. Le type de clientèle est essentiellement, non pas les PME de l'industrie qui ont d'énormes difficultés à sortir de l'argent noir, mais probablement de l'hôtellerie, des boîtes de nuit dont certains cas sont connus à Lyon. Ce sont les outils habituels de l'argent noir. Pour une fois, cet argent noir donne un deuxième produit. Non seulement on peut le mettre à l'abri, mais également le faire directement produire de l'endettement fictif en France. M. Etienne SUBRA : Quelle charge ! C'est du roman. C'est du roman noir. Je passe sur les qualificatifs qu'il m'attribue. Peu importe. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : « Droit et honnête ». M. Etienne SUBRA : C'est déjà cela ! Mais bon ... Derrière tout cela, il y a deux choses que je peux et que je dois dire en toute franchise. M. Bernard Monnot a été un des responsables, sinon le responsable numéro un, les deuxièmes responsables sont les services de contrôle de la Banque Cantonale de Genève qui auraient dû mettre le holà beaucoup plus tôt à ces activités, le responsable de la quasi-faillite de cet établissement au sens objectif du terme, par la masse de pertes accumulées sur de mauvais crédits accordés à de mauvaises entreprises ; il faut s'en souvenir ! Il a été aussi, comme mandataire social, forcément très impliqué dans le montage de la société elle-même et de la banque elle-même à Lyon ; il a été donc ulcéré de l'issue de sa mission, puisque contraint de démissionner dans des conditions évidemment assez outrageantes pour lui. Mes relations avec lui ont été en effet tout à fait ce qu'il a dit, très clairement ; au moment où le conflit entre lui-même d'une part, et ses patrons genevois s'est noué, il est venu me dire, sinon exactement ce qui vous est dit là, car il est venu bien plus tôt, il est déjà venu me dire « cela ne va pas, cette banque tourne mal », et d'autre part, « voilà des documents qui attesteraient toutes les malversations qu'il lui attribuait » ; ces documents sont cités là, en effet, je les ai reçus, je n'avais aucune raison de les mettre au panier, ou les lui laisser, et je les ai transmis, en effet ; c'est pourquoi je vous disais « voyez la Commission bancaire », elle est quand même dépositaire de ces documents, de ces déclarations, elle a entendu aussi M. Bernard Monnot ; elle a entendu également M. Ducret, je crois, président de la Banque Cantonale à Genève même ; là, j'ai été non pas une tête de pont, mais une boîte à lettres, guère plus dans cette affaire ; mais j'ai été très attentif, encore une fois, à ce que la défaillance éventuelle de cet établissement ne lèse pas la place de Lyon ; quand je parlais de la banque Clément tout à l'heure, c'était cela aussi mon objectif, c'est que lorsqu'une affaire financière tourne mal, pour des raisons que je ne juge pas d'ailleurs, sur une place, essayer de voir comment les répercussions peuvent être contenues ou limitées pour le bien de la place et de ses acteurs. Encore une fois, j'estime que sur la connaissance que j'avais du dossier, la quasi-défaillance de l'établissement dont M. Bernard Monnot était le responsable a été due avant tout à une politique de crédits aventureuse et dangereuse. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Ensuite, qu'a fait ce Monsieur ? M. Etienne SUBRA : Il a essayé effectivement de se défendre, ce qui était son droit, avec une vindicte assez forte, vous le sentez dans ses termes, et s'il a gardé, effectivement, il me l'avait dit, lors d'une dernière rencontre qui s'est passée au printemps 1998 de mémoire, à peu près, une action nominative, c'est pour pouvoir, effectivement, et c'était son droit, et en même temps tactiquement, c'était bien joué, être informé des assemblées générales et des documents de la banque. C'est clair. Je ne parle là et ne peux parler là (je ne peux, au sens physique, objectif) que de l'établissement de la Banque Cantonale de Genève à Lyon. Tout ce que dit M. Monnot sur la fiducie à Genève, sur le fonctionnement, sur la structure, sur les objectifs, sur les orientations de cet établissement genevois, je n'en sais strictement rien et je ne pouvais rien en savoir. Moi qui n'avais que très peu de moyens d'investigation réglementaires sur ma place, je vous ai dit le rôle et place de directeur de la Banque de France, a fortiori, je n'avais (on peut le regretter, mais c'est ainsi et la Commission bancaire a les mêmes difficultés comme d'ailleurs les magistrats, on le sait bien) et nous n'avions aucun pouvoir, ni moi ni la Commission bancaire, d'aller voir directement à Genève les comptes de la Banque Cantonale de Genève et de sonder les reins et les c_urs de son président et de ses directeurs généraux, pour savoir exactement ce qu'ils faisaient. A partir du moment où une fiducie a été montée, M. Bernard Monnot a lancé et vous le dit à longueur de page, l'accusation de blanchiment d'argent ; c'est son affaire ; l'a-t-il démontré ? Je n'en sais rien. Je rajouterai simplement, là aussi à titre personnel, un peu en technicien financier et bancaire et non pas en qualité de représentant de la Banque de France, que le fait que des chefs d'entreprise, des individus, de nationalité française, Rhône-Alpins de surcroît, placent de l'argent en Suisse, en France ou ailleurs, est parfaitement normal aujourd'hui. Vous le savez comme moi, c'est bien tout le problème, les marchés financiers sont mondiaux ; tout est ouvert ; réglementairement, ni la Banque de France, ni la Commission bancaire - en auraient-elles le pouvoir d'ailleurs ? ne peuvent s'opposer à cela ; d'où vient l'argent qui est déposé sur des comptes en Suisse, au Luxembourg, à Londres, à Paris ou à Lyon ? Il vient de l'activité de ces messieurs et de ces établissements. Grâce à Dieu, depuis deux ans, nous avons une activité économique qui marche bien, les entreprises Rhône-Alpines (je suis quand même les enquêtes de conjoncture encore, pour mon information personnelle, sont bonnes) l'argent, les profits se développent et c'est une bonne chose pour nos entreprises. Qu'une partie se place en Suisse, sur une place comme Genève qui est une place internationale, peut paraître peut-être un peu surprenant, mais dans certains cas relève sans doute aussi de l'activité internationale des entreprises de Rhône Alpes ; et cela, je l'ai constaté. Entre ma prise de fonctions en octobre 1989 et mon départ en 1998, le taux d'exportation des industriels Rhône-Alpins est passé de 28 ou 29 % à 35 % ; même dans les années noires, en 1993-1994, ce taux d'exportation a augmenté ; cela veut dire, lorsque l'économie française était plutôt terne, en 1993-1994, que l'activité de nos entreprises (et c'était très bien en terme d'emploi) était soutenue par l'étranger. Sur dix ans, j'ai vu se développer l'activité internationale de nos entreprises industrielles et je n'y voyais rien d'anormal, au contraire ; c'était tout bénéfice pour la France ; cela correspondait finalement à un compte créditeur de nos comptes extérieurs, cela correspondait à de l'emploi maintenu grâce à cette activité, etc. Il est clair aussi que le financement de ces opérations a entraîné la nécessité d'avoir affaire à des moyens qui pouvaient être externalisés également. Il me semble, c'est peut-être un jugement à cette lecture, que M. Monnot n'a jamais pu démontrer, et je ne vois pas par quel moyen il pouvait le faire (il serait intéressant de le faire, mais qui pourrait le faire et par quel moyen ?) que les fonds déposés dans la société fiduciaire en Suisse étaient des fonds d'origine française et Rhône-Alpine en particulier ; je serai curieux de savoir comment il peut remonter cette filière. Il a peut-être raison, je ne dis pas qu'il a tort sur ce plan, je dis qu'à mon sens ce n'est pas démontré et ensuite que ni la Banque de France, ni la Commission bancaire, ni votre serviteur, n'étaient à même d'avoir le pouvoir de remonter ces filières ; nous sommes dans un domaine qui relève de la police internationale. Je ne plaide pas coupable, je cantonne les choses ; c'est ce que je peux dire sur ces déclarations. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je vous remercie de ces précisions tout à fait intéressantes que je résume d'une certaine manière et sous votre contrôle. Vous confirmez l'existence d'une fiduciaire et vous expliquez qu'il n'est pas démontré que ce sont les clients de la Banque Cantonale de Genève à Lyon qui entreposeraient leur argent pour obtenir une contrepartie sous forme de crédits à Lyon. Et comment expliquer, c'est cela le raisonnement qui nous a intrigués au fil de nombreuses lettres ... M. Etienne SUBRA : Je ne suis pas tout à fait d'accord sur votre première conclusion, pardonnez-moi. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je vous en prie, vous pouvez la rectifier. M. Etienne SUBRA : Quand vous dites que je confirme l'existence d'une fiduciaire, non, je suis désolé ; je n'ai pas connaissance d'une fiduciaire ; je l'apprends aujourd'hui. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je crois que dans ce que vous avez dit précédemment, vous avez indiqué que vous connaissiez l'existence d'une fiduciaire et qu'à vos yeux elle n'était pas interdite. M. Etienne SUBRA : Non, pas exactement. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : C'est ce que vous avez dit à deux reprises, dans le procès-verbal. M. Etienne SUBRA : Je crois qu'il faut préciser les choses. Bernard Monnot m'avait dit en effet que la Banque cantonale de Genève utilisait la fiducie dans ses relations avec certains de ses clients ; pardonnez-moi, il faut rectifier en effet, je n'ai jamais eu connaissance, ni par lui ni par d'autres voies, de l'existence d'une société fiduciaire à proprement parler, c'est-à-dire d'un mécanisme monté par la Banque Cantonale de Genève à Genève pour participer à tout l'échafaudage que M. Bernard Monnot vous a décrit ; je rectifie en effet ce qui est une erreur de ma part ou un malentendu. Bernard Monnot m'a parlé effectivement de l'existence de fiducie au sens juridique du terme, mais dans l'environnement de la Banque Cantonale de Genève, il ne m'en a jamais parlé, ou je l'ai oublié ; il ne m'a jamais parlé, je serai très clair là-dessus, d'une véritable société ; c'est la seule contradiction que je me permets d'apporter à votre conclusion. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Ce qui reste dans les déclarations de celui qui est le mieux placé - qu'il ait fait faillite, il peut être un mauvais banquier et ne pas approuver un redressement par des procédés illégaux - est intrigant ; car si je fais la synthèse entre ses déclarations et les vôtres, vous êtes en train de nous dire que la Banque Cantonale de Genève avait un mauvais banquier qui était M. Monnot ... M. Etienne SUBRA : C'est vrai. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : ... qui a fait faillite ; je n'ai même pas l'impression que lui-même refuserait cette analyse. Nous ne le lui avons pas demandé, mais c'est quelque chose que nous pourrions lui demander. Si j'ajoute vos déclarations aux siennes, je constate que sur le plan prudentiel, vous avez quitté vos fonctions plutôt rassuré sur le fonctionnement, redevenu normal, de la Banque Cantonale de Genève grâce à des mécanismes qui aujourd'hui sont qualifiés par l'ancien directeur général comme étant du refinancement blanchiment. Ce qui m'intrigue dans vos déclarations, à partir des siennes, c'est que vous ne donnez pas d'explication et ne vous prononcez pas sur l'allégation, faite par un ancien dirigeant de banque, resté actionnaire, selon laquelle le coût de refinancement de crédits à long terme par du crédit à court terme en provenance de la maison mère (c'est acquis je crois) paraît très faible ; et s'il est faible, ce coût de refinancement, nous nous permettons de déduire que ceux qui placent (c'est ce qu'il explique et vous ne vous prononcez pas là-dessus) de l'argent en Suisse le placent à taux zéro, c'est-à-dire qu'ils ne font pas travailler cet argent ; voilà ce qu'il affirme ; s'ils ne font pas travailler cet argent, c'est donc de l'argent qui est en sécurité, parce que c'est de l'argent illégitime (je ne dis pas qu'il est illégal) ; lorsque vous placez de l'argent en Suisse, c'est précisément bien sûr pour profiter de la défiscalisation, mais aussi pour profiter d'une rémunération supérieure ; si une société fiduciaire refinance après avoir collecté de l'argent qu'elle ne rémunère pas, une activité de crédit à long terme, on ne peut pas déduire autre chose que ce que déduit M. Monnot. Mon problème est celui-là ; mon problème, comprenez-vous, n'est pas que les banques fassent faillite ou pas. M. Etienne SUBRA : C'était le mien. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : De grandes banques ont blanchi de l'argent pendant des années et ont fait faillite, il y a de très beaux établissements bancaires qui ont pignon sur rue aux Etats Unis qui aujourd'hui sont accusés d'avoir blanchi des milliards d'argent sale, tous les paradis fiscaux utilisent le même langage que vous en expliquant : nous avons besoin de prospérité, nous ne sommes pas toujours obligés de regarder la couleur de l'argent ; c'est un raisonnement que l'on peut transposer ; c'est un raisonnement que précisément de nombreux paradis fiscaux, bancaires et judiciaires aujourd'hui utilisent pour leur prospérité en faisant fi de toute la moralité et de l'éthique des affaires, finalement ; notre préoccupation est plutôt celle-là que celle dont vous étiez en charge à la tête de votre délégation. M. Etienne SUBRA : C'est peut-être de là que vient la confusion. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je voudrais vous faire une remarque avant que vous ne répondiez. Vous dites que M. Bernard Monnot n'apporte pas les preuves ; à partir du moment où un ancien directeur général de banque affirme des éléments tout à fait convaincants, et dans ce que j'entends, je n'entends pas que vous m'ayez convaincu du contraire, ce n'est pas à lui d'apporter les preuves, c'est à vous d'aller les rechercher ; quand je dis vous, c'est la Commission bancaire, que nous interrogerons d'ailleurs sans tarder ; nous allons nous expliquer sur ce dossier. M. Etienne SUBRA : Le raisonnement de M. Bernard Monnot repose sur quelque chose dont encore une fois je n'avais aucune preuve et sur quoi je n'avais aucun moyen d'investigation ; à ce sujet, c'est l'existence de la fameuse société fiduciaire d'où viendrait tout l'argent. Je ne suis favorable ni aux paradis fiscaux, ni au blanchiment de l'argent sale, que ce soit clair entre nous. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : C'est pourtant le cas de la Suisse ; c'est un paradis fiscal ; c'est un lieu où les banques les plus honorables blanchissent de l'argent sale. Donc, cela vous touche. M. Etienne SUBRA : Reconnaissez que je n'avais aucune compétence, ni aucun pouvoir, pour aller mettre de l'ordre dans les paradis fiscaux suisses ou des Îles Caïman, je ne suis que ce que je suis, je n'étais qu'un fonctionnaire, directeur de la Banque de France ; à partir de là, si je ne réponds pas directement à l'échafaudage monté par M. Monnot, c'est parce qu'encore une fois, cette société fiduciaire, c'est lui qui l'affirme, je n'en ai eu aucune preuve, je n'ai aucun papier, si d'autres l'ont en France, vous le trouverez certainement. Le premier étage, l'étage fondamental, de l'échafaudage de M. Monnot, celui-ci, je ne l'ai jamais connu et je ne le connais pas ; je ne peux pas vous dire que je suis d'accord, puisque je ne le connais pas et je ne défends personne, même pas moi dans cette affaire. Deuxièmement, le mécanisme, que je connaissais et que connaissait la Commission bancaire, de refinancement de la filiale française mettait en cause la Banque Cantonale de Genève à Genève et sa filiale française, deux banques entre elles. A partir du moment où d'une part, je vous l'ai déjà dit, la maison mère suisse affirmait, sous sa responsabilité, qu'elle maintenait les moyens de financer sa filiale française sur le plan prudentiel encore une fois, nous étions couverts. Je ne pense pas que la Commission bancaire puisse vous dire autre chose. Deuxièmement : l'origine des fonds du refinancement de la filiale française était l'affaire de la maison mère ; nous sommes là dans un mécanisme bancaire, pas dans un mécanisme de recherche du blanchiment d'argent j'en suis d'accord, mais dans une relation de maison-mère à filiale, même avec une frontière au milieu, ce sont des relations tout à fait normales. Sur le plan des techniques bancaires d'aujourd'hui, à partir du moment où nous avions un engagement de longue durée de refinancement de la société mère à Genève, à la limite, même si les fonds qui étaient apportés étaient théoriquement à court terme, dans la mesure où ils étaient revolving, ce sont des financements classiques qui se font, le mélange des genres paraît effectivement, théoriquement, très critiquable, mais il est courant ; même si la filiale française faisait des crédits à moyen terme, elle pouvait très bien se refinancer, et vous le voyez même dans l'immobilier aujourd'hui avec des financements à taux variables, vous avez des financements qui sont révisables, même sur une longue durée ; dans la technique bancaire, les relations de refinancement entre la Banque Cantonale de Genève à Genève et la Banque Cantonale de Genève à Lyon, ne prêtaient pas à critique dans l'état actuel des techniques bancaires, françaises, mondiales, suisses, etc. Sur le plan des taux d'intérêt, cela a été une critique effectivement, permanente, après ses déboires internes, que M. Bernard Monnot a relevée contre la Banque Cantonale de Genève en Suisse ; il n'en avait rien dit au départ ; car au départ, que s'est-il passé ? Comme dans toute affaire de ce genre, la maison mère a consenti des frais d'établissement importants, qui sont venus se doubler ensuite des pertes qu'il a fallu éponger ; mais au départ, et pour couvrir ces frais d'établissement, la Banque Cantonale de Genève à Genève, avait admis effectivement des conditions financières privilégiées à sa filiale, pour qu'elle puisse s'établir, pour qu'elle puisse investir, louer ses locaux, payer son personnel, etc. Car avant tout, dans un investissement, on investit d'abord, on met de l'argent sur la table, on le dépense, et le retour sur investissement se fait plus tard. Ce sont des relations de banques commerciales privées ; mais M. Monnot les connaissait, il ne les a pas critiquées au départ, il a commencé à les critiquer quand, au bout de deux à trois ans, les pertes accumulées de son fait ont amené la maison mère suisse à se dire « cela commence à suffire comme cela, on « vire » le directeur général, on met des gens un peu plus rigoureux à la tête de la filiale française, on éponge les pertes ; mais la Commission bancaire y veillait aussi rigoureusement ; quand une inspection de la Commission bancaire vérifie sur place un établissement bancaire, le c_ur de sa mission va être « d'éplucher », pardonnez-moi le terme, les crédits octroyés par l'établissement de voir s'ils ont quelque chose à se rembourser ; à partir de cette analyse précise, au cas par cas, de ces crédits, la Commission bancaire détermine les provisions à constituer ; si elles ont déjà été constituées par l'établissement ces commissions, pas de problème, sinon, il faut « rajouter au pot ». C'est ce qui a été demandé certainement à la Banque Cantonale de Genève. Donc, les relations financières réciproques entre la filiale et la maison mère ont été bâties de cette façon : au départ pour faciliter le financement de l'investissement, taux bas, et ensuite, il a fallu éponger les pertes et rapatrier quand même un minimum d'argent. Voilà où nous en sommes ; quand j'ai dit que c'était « du roman », le terme est peut-être un peu excessif et n'engage que moi, mais si on rentre effectivement dans la problématique et dans l'échafaudage de M. Bernard Monnot, une société fiduciaire, qui pompe de l'argent sale, qui par l'habillage d'une société qui s'appelle « La Banque cantonale de Genève » à Genève fait transiter cet argent sur la France, etc., c'est logique ; je dis simplement qu'à mon niveau, le premier élément de l'échafaudage, de l'édifice, je ne l'ai jamais connu, il ne m'a jamais été démontré ; en revanche, les relations entre l'étage numéro deux de M. Monnot, c'est-à-dire la société mère à Genève, et l'étage numéro 3, c'est-à-dire la filiale française, cet étage et ses relations financières s'expliquent très clairement sur le plan tout à fait naturel des techniques bancaires de l'époque et d'aujourd'hui, y compris au niveau du taux d'intérêt ; car il s'agit avant tout d'une implantation de long terme. Là aussi la Banque cantonale de Genève a affirmé publiquement, à Lyon, à plusieurs reprises, dans mon bureau aussi, en privé, et je pense aussi devant le Gouverneur et devant M. Fort, qu'elle soutiendrait son établissement lyonnais sur le long terme ; un investissement de long terme suppose des frais, suppose des conditions préférentielles pour pouvoir faire tourner encore une fois un établissement qui arrivait sur un marché surbancarisé, difficile, qui avait commencé ensuite, par la faute de M. Bernard Monnot, par essuyer des pertes considérables. Voilà tout ce que je peux vous dire en toute franchise ; il faudrait pour que je rentre tout à fait dans le jeu de M. Monnot, que j'aie la certitude, qu'il semble avoir lui, de l'existence de cette fiduciaire en tête de l'édifice, du financement de cette fiduciaire par des fonds Rhône-Alpins ; je n'en ai aucune idée, et aucune possibilité d'en avoir quand je vois les deux étages qui étaient de mon ressort. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Il donne pourtant des précisions : des hôteliers, des boîtes de nuit, il a été directeur de cette banque. M. Etienne SUBRA : Il ne cite aucun hôtelier, aucune boîte de nuit, etc. Je n'en sais rien ; moi, il ne m'a jamais dit cela ; il ne m'a jamais dit que tel hôtelier de Lyon, tel restaurateur, telle boîte de nuit, avait déposé tant d'argent sur telle société fiduciaire en Suisse, lequel argent transitait ensuite par les deux banques cantonales pour se retrouver à financer des crédits bancaires ; cela, il ne me l'a jamais dit ; demandez-lui, vous verrez. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Est-ce que vous avez transmis à la Commission bancaire les allégations de l'ancien directeur général ? M. Etienne SUBRA : Pas celles-là, car je les ignorais ; la société fiduciaire, dont il a parlé devant vous, il ne m'en a jamais parlé. Ce qu'il m'a transmis, mais au début de son débat, c'est-à-dire au moment où il a été « flanqué à la porte » de la Banque Cantonale à Lyon, je l'ai effectivement transmis. Il s'agissait de documents qui devaient porter sur des crédits, ou des choses de ce genre ; je n'en ai pas le souvenir précis, pardonnez-moi, cette affaire date de trois ans ; mais si vous interrogez la Commission bancaire, de toute façon, et s'ils vous ouvrent leurs dossiers, vous trouverez tout cela chez eux, sans aucun problème. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : M. Monnot dit une chose un peu différente de ce que vous venez d'affirmer, puisqu'il parle d'une visite qu'il vous a rendu, en présence du Bâtonnier de l'Ordre, Maître Chanon et Maître Vesselet; donc, il n'était pas seul. M. Etienne SUBRA : Tout à fait, je m'en souviens fort bien. Mais que dit-il de cette visite ? M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Je vais vous le lire : « La deuxième visite à M. Etienne Subra s'est passée d'une façon relativement différente par rapport à la première, où j'avais été accueilli à bras ouverts. Enfin, je lui donnais l'opportunité de lancer des inspections et autres, comme s'il avait dû attendre que j'amène les dossiers pour lancer des inspections. Lors de cette deuxième visite, M. Subra était au fond, quand même, bien embarrassé de ce dossier qui donnait lieu à des rumeurs insistantes à Lyon sur l'escroquerie immobilière et déjà sur le blanchiment d'argent. Que je vienne lui demander si c'était exact, en tant qu'ancien mandataire social et toujours actionnaire, l'embarrassait beaucoup. Poussé dans ses derniers retranchements et un peu énervé, M. Subra, lorsque je lui ai démontré, à partir de documents officiels, qu'il y avait blanchiment d'argent, n'a absolument pas tergiversé, mais m'a dit - et ce sont des points très importants pour la suite : 1) Oui, il y a blanchiment, je vous confirme que vous avez vu juste, mais sachez que nous étions au courant. Il était vexé que j'ose venir lui montrer qu'il y avait blanchiment. 2) Il y a inspection sur inspection sur le sujet. 3) Près de la moitié de ce blanchiment - il s'agit de plus de 300 millions - a été faite dans la région d'Annecy (où nous avions un bureau). 4) Ce point m'a le plus intrigué : les neuf personnages les plus importants du système bancaire se sont réunis sur ce dossier, m'a-t-il dit. Dès lors que la maison mère assure à tout moment la trésorerie de la filiale française, en ce qui nous concerne, nous estimons que nous n'avons rien d'autre à faire et à dire, a-t-il ajouté. ». M. Etienne SUBRA : Ecoutez, c'est parole contre parole ; je déments totalement ces allégations, totalement ! Je me souviens fort bien de cette visite, d'autant plus que je me souviens très bien du Bâtonnier Chanon ; effectivement, M. Monnot a lancé à ce moment des allégations sur le blanchiment de l'argent sale, etc. Je lui ai dit que de toute façon, il y avait des autorités pour cela, je n'en étais pas, il y avait des tribunaux ; le point que nous avons surtout débattu, car j'étais surpris de la présence des deux avocats, a été de savoir quelle était son attitude sur le plan judiciaire, autrement dit, si étant remercié par ses patrons genevois, il entendait pousser l'affaire plus loin sur le plan judiciaire ; c'est de cela que nous avons parlé ; mais je déments totalement les quatre allégations que vous avez énumérées et notamment la dernière qui est totalement farfelue. Je suis désolé ; étais-je énervé à ce moment ? C'est possible, il m'arrive de l'être. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Ce n'était pas un point important. M. Etienne SUBRA : Non, mais cela peut expliquer que M. Monnot s'en soit souvenu, je n'en sais rien. Vous avez la date de cette réunion ? Il a dû vous la donner. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : En juillet 1996 ? C'est cela ? En 1996. M. Etienne SUBRA : A ce moment, j'étais informé des risques de déconfiture de cette filiale, notamment du fait de la politique de crédits de M. Monnot ; je ne pouvais pas l'accueillir à bras ouverts, comme il le dit, je crois. L'expression « bras ouverts » est d'ailleurs assez curieuse ; lorsque les dirigeants de la banque genevoise sont venus me voir, à titre préliminaire, avant même de créer leur société, ils ont d'abord été une société financière avant d'être une banque, mais le titre de banque est intervenu très vite, au bout d'un an, un an et demi, par les autorités parisiennes, Banque de France, comité d'établissement de crédit, lorsque ce président et ce directeur général genevois sont venus me voir, j'avais reçu avant eux des banquiers italiens, des banquiers britanniques, etc., voire coréens ou japonais, qui voulaient s'installer à Lyon, je ne leur ai pas fait un accueil d'une froideur extrême ; il n'y a aucune raison, au contraire, que sur une place qui se voulait internationale et une région qui elle-même est très ouverte sur l'étranger pour que l'on reçoive froidement ceux qui avaient des velléités d'installation d'établissements étrangers. Je sais bien que ce faisant, la concurrence devenait plus féroce pour nos établissements aussi, mais enfin, ils portent cette concurrence à l'étranger ; il est donc vrai qu'au début, quel que soit le banquier étranger, à condition qu'il ait une certaine surface et renom, qui soit venu me voir, il n'a jamais trouvé porte close chez moi. Ceci étant, la preuve étant faite ensuite du mauvais fonctionnement de l'établissement, je n'avais pas les mêmes préoccupations devant ses dirigeants, et aussi bien devant le directeur général suisse, que j'ai rencontré à ce moment aussi, que devant M. Monnot, je n'ai pas caché que je n'étais pas satisfait de la façon dont la banque avait été gérée, c'est tout ; voilà pourquoi mes bras ont été moins ouverts ce jour-là que les fois précédentes. Encore une fois, c'est bien aimable de me traiter d'honnête homme et de faire appel à ma droiture, mais là, c'est pousser un peu loin le bouchon que de mettre dans ma bouche des choses que je n'ai jamais prononcées et qui sont totalement ridicules, surtout la dernière. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Il va falloir que l'on tire au clair tous ces points ; je crois que nous allons nous revoir, les uns et les autres ; nous sommes là dans une situation un peu curieuse. M. Etienne SUBRA : Si vous me le permettez, M. le Rapporteur, vous l'avez peut-être déjà fait et en ce cas, je m'arrête vite, il y a un moyen de tirer les choses au clair ; vous avez, sur place, à Paris, le secrétaire général de la Commission bancaire. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Nous allons l'appeler tout de suite. M. Etienne SUBRA : Il était le réceptacle de toutes les informations qu'il pouvait obtenir ; je pense que M. Monnot a été reçu aussi à la Commission bancaire, plusieurs fois certainement également, à partir de là, je crois que c'est là que vous aurez le maximum d'informations ; ce sont eux, je l'ai dit au départ, encore une fois, qui ont les pouvoirs d'investigation, beaucoup plus que moi. Quant à m'inscrire en faux ou en vrai devant les allégations de quelqu'un, je vous ai dit franchement ce que j'ai en tête, mon souvenir de ce qui s'est passé, c'est tout. M. Arnaud MONTEBOURG, rapporteur : Nous vous remercions. M. Etienne SUBRA : Désolé si je n'ai pas répondu à votre attente. Entretien du Rapporteur avec M. Alain BOCHET, (compte-rendu de l'entretien du 20 avril 2000) M. Alain Bochet est introduit. M. le Rapporteur : Je vous remercie d'avoir répondu à notre demande d'entretien. La Mission d'information dont je suis le Rapporteur travaille sur les obstacles, français, européens et internationaux, de toute nature, à la répression de la délinquance économique et financière et à la lutte contre le blanchiment. Il se trouve que nous avons, dans ce cadre, reçu un certain nombre d'informations concernant les pratiques extranationales de plusieurs établissements bancaires de diverses nationalités. Parmi ces informations figure le témoignage de M. Bernard Monnot, ancien directeur général de la Banque cantonale de Genève et, par ailleurs, mandataire social, qui, je crois, a été votre prédécesseur... M. Alain BOCHET : Pas directement ! M. le Rapporteur : M. Monnot nous a donné un certain nombre d'éléments que nous avons jugés suffisamment sérieux pour poursuivre notre enquête. Je dois vous dire que nous ne sommes pas responsables de la diffusion dans la presse d'un certain nombre d'informations. M. Monnot s'est excusé auprès de nous d'avoir, lui-même, rendu public le compte rendu de nos échanges, que conformément aux usages, nous lui avions transmis pour observation éventuelle. Par conséquent, ni les parlementaires, ni les fonctionnaires de cette Mission ne sont en cause dans cette diffusion partielle que nous regrettons ainsi que nous l'avons fait savoir dans un communiqué. Nous avons exposé l'ensemble de ces éléments à vos avocats qui ont, je crois, déposé un certain nombre de demandes auprès du Président de la mission. Pas plus qu'il ne s'agit d'une enquête judiciaire, il ne saurait être question d'une attaque quelconque de la Mission à l'encontre d'un établissement bancaire particulier... M. Alain BOCHET : Nous ne le considérons pas comme tel ! M. le Rapporteur : Il s'agit pour nous d'identifier des pratiques, au demeurant, assez répandues, relatives à la manière dont fonctionnent les établissements bancaires et la circulation de l'argent privé. Voilà, pour vous mettre à l'aise, quel est le cadre de notre travail. Je n'ai pas estimé utile que le Président de la Banque Cantonale de Genève, M. Fues participe à cet entretien car la question qui nous est aujourd'hui posée concerne la banque française proprement dite, selon les règles françaises. Si nous avons des questions à poser aux dirigeants suisses, nous le ferons. Nous nous sommes d'ailleurs rendus à Genève où nous avons rencontré les représentants de l'Association des banquiers genevois. C'est ainsi que la Mission s'est entretenue avec M. Dérobert et avec les dirigeants de Paribas. M. Alain BOCHET : J'avais proposé que M. Fues participe à cet entretien, parce que vous lui aviez demandé un rendez-vous qu'il n'avait pu honorer ce qui vous avait amené à lui proposer de reprendre contact ultérieurement... M. le Rapporteur : Oui, mais je pensais l'entendre séparément ! Peut-être pourriez-vous commencer par nous exposer les conditions de votre venue à la banque, dans quel état économique et financier vous avez trouvé cet établissement que vous dirigez, après quoi nous poursuivrons notre entretien. M. Alain BOCHET : Je suis arrivé à la Banque Cantonale de Genève à Lyon en septembre 1999, mon prédécesseur avait été chargé d'établir certaines structures que M. Monnot n'avait pas mises en place. Dès sa prise de fonction, il avait été prévu qu'il serait remplacé à terme et j'ai été désigné pour lui succéder. A l'exception des problèmes essentiellement dus au manque de structures administratives des premières années d'existence, la banque, lorsque je suis arrivé, possédait, je crois que les rapports de la Commission bancaire en attestent, tous les éléments pour fonctionner normalement et répondre aux exigences des autorités de tutelle. Quant au portefeuille de la banque, j'estime qu'il est sain et normalement provisionné. Pour ce qui est des opérations que nous avons actuellement en cours elles ne m'inspirent pas, en tant que banquier, d'inquiétudes particulières. M. le Rapporteur : Je vous remercie de ces précisions mais j'ai maintenant plusieurs questions à vous poser. La première concerne les conditions du refinancement exposées de façon assez circonstanciée par M. Monnot auxquelles se livrent d'ailleurs toutes les banques, d'un certain nombre d'activités de crédit, auprès de la maison mère suisse. En effet, la faiblesse de la rémunération de ce refinancement apporte, selon lui, la démonstration qu'en vérité les déposants français placent en Suisse - c'est en tout cas sa thèse - des fonds dans des conditions à ses yeux suspectes, de manière à refinancer des crédits, à moyen ou à long terme, accordés par la filiale Banque cantonale de Genève à Lyon. Il prétend que la maison mère a reçu ces dépôts, dans des conditions de non-respect des ratios prudentiels habituels. M. Alain BOCHET : J'ai très bien compris ! J'aimerais savoir si vous vous êtes interrogé sur la raison pour laquelle M. Monnot est venu vous voir et pourquoi il s'est empressé, dès sa sortie, et dès qu'il en a eu possession, de faire publier dans la presse, le compte rendu de votre entretien... M. le Rapporteur : Comme vous l'aurez remarqué c'est le Rapporteur et rarement celui qui doit répondre, qui pose les questions. J'ai évidemment une idée sur ce point mais j'aimerais d'abord obtenir votre réponse. M. Alain BOCHET : C'est là un point essentiel ! En ce qui concerne la Banque Cantonale de Genève France SA, elle se refinance comme toute banque dans les premières années de son existence et je dirais, malheureusement pour sa maison mère, auprès de cette dernière pour la raison évidente et bien normale qu'avant d'avoir atteint son niveau d'équilibre, toute banque génère des pertes et qu'aucune autre banque sur le marché ne souhaite la refinancer avant qu'elle ait récupéré ses pertes de départ, ce qui est bien compréhensible. En conséquence, la banque se refinance auprès de sa maison mère ; c'est évident ! Cette dernière se refinance sur l'euromarché n'ayant pas accès elle-même à des déposants en francs français, elle se refinance à des taux flottants auprès de n'importe quelle banque française sur le marché. Nous ne prenons pas de dépôts à Lyon et la banque suisse n'ayant pas, elle-même de déposants en francs français, le refinancement s'opère donc sur le marché. La Commission bancaire tout comme nos réviseurs aux comptes ont une parfaite maîtrise de nos refinancements et savent très clairement d'où proviennent ces fonds. Une partie de ces refinancements de l'ordre de 25 %, jusqu'à un passé très récent, a été le fait de dépôts fiduciaires dont je vous rappelle que la Caisse des Dépôts en France, fait un usage intensif. La Commission bancaire nous a demandé de ne plus avoir recours à ces pratiques ce que nous avons fait. Mais nous avons également rappelé à cet organisme que la Caisse des Dépôts en faisait usage ce à quoi il nous a été répondu que cet organisme n'était pas une banque. Ce qui revient à dire que, si vous êtes non banque, vous pouvez avoir accès à cette pratique, et que, si vous l'êtes, elle vous est interdite. Pour couper court à toute polémique, nous avons abandonné ce type de refinancement. M. le Rapporteur : Comment fonctionnaient ces dépôts fiduciaires - je parle à l'imparfait puisque vous m'expliquez que tout cela est révolu ? M. Alain BOCHET : Tout cela est révolu et la Commission bancaire en a d'ailleurs la preuve... N'étant pas banquier suisse, il m'est difficile de répondre précisément à votre question. Je sais néanmoins que les dépôts fiduciaires sont une forme de dépôts qui, en Suisse, autorise la banque suisse qui les accepte, sous la responsabilité du déposant - c'est ce qui est important - de les replacer ailleurs. Ce système évite à ce déposant de s'acquitter d'un impôt à la source élevé qui frappe les dépôts classiques en Suisse. C'est là ma vision globale du fonctionnement des dépôts fiduciaires. M. le Rapporteur : Quelle est l'utilité de ce dépôt fiduciaire pour le déposant, hormis l'économie fiscale qui reste d'ailleurs à démontrer ? M. Alain BOCHET : Qui reste à démontrer en Suisse ? M. Arnaud MONTEBOURG. Oui vous ne l'avez pas démontrée. Quelle est l'utilité fiscale pour le déposant ? M. Alain BOCHET : Ce n'est pas une question que vous m'avez posée ! Il est évident que le déposant, en Suisse, utilise le dépôt fiduciaire afin d'être exonéré de l'impôt à la source sur ses intérêts en prenant un risque supérieur. Dans le cas d'un dépôt classique, il prend le risque de la banque auprès de laquelle il dépose et paie un impôt à la source. Le risque n'est pas le même ; la rémunération n'est pas la même ! C'est une pratique extrêmement courante. Je crois que la Caisse des Dépôts refinance de cette manière pour plusieurs centaines de millions de francs. M. le Rapporteur : Vos concurrents, à savoir les banques de dépôt classiques, font-ils de même ? M. Alain BOCHET : Je n'en ai pas la moindre idée pour la bonne raison que l'accès à ce type de financement, demande d'avoir des relations avec une banque suisse. Certaines le font très probablement puisqu'il y a un marché ! Les banques suisses qui acceptent ces dépôts les replacent forcément ailleurs sur le marché et très probablement auprès de banques françaises... M. le Rapporteur : Quelles étaient les objections que vous opposait la Commission bancaire ? M. Alain BOCHET : Elle faisait valoir que nous ne pouvions pas, clairement identifier, pour des raisons évidentes, le déposant. M. le Rapporteur : Donc que vous ne respectiez pas la loi du 12 juillet 1990 ? M. Alain BOCHET : Lorsque nous en avons discuté avec la Commission bancaire, je crois qu'elle était consciente d'être en train de traiter un phénomène nouveau et que nous n'étions pas les seuls à rencontrer ce genre de problèmes. Nous avons donc accédé à sa demande et mis un terme à ces pratiques ce qui n'est pas sans répercussion pour nous dans la mesure où ces dépôts qui n'ont jamais représenté des sommes très importantes, constituaient néanmoins une partie de notre financement et qu'ils étaient de par leur nature à des taux plus intéressants... M. le Rapporteur : Vous dégagiez donc un avantage de compétitivité sur la place lyonnaise ? M. Alain BOCHET : Voilà ! Sur la place lyonnaise, parisienne et sur d'autres marchés : si vous empruntez, par exemple, à dix points de base de moins - ce qui n'est pas énorme - vous êtes plus compétitifs, voire bénéficiaires. M. le Rapporteur : N'avez-vous pas cherché à parer les arguments de la Commission bancaire en vous assurant de l'identité des déposants ? M. Alain BOCHET : Non, ce n'est pas possible ! M. le Rapporteur : Pour quelles raisons ? M. Alain BOCHET : Cela tient à la nature même du dépôt fiduciaire. D'ailleurs, le point a été longuement discuté avec la Commission bancaire qui, dans un premier temps, nous a conseillé de réfléchir et de faire preuve de prudence et dans un second temps, nous a demandé de ne plus utiliser de dépôts fiduciaires, ce que nous avons fait. C'est notre organisme de tutelle et, pour être franc, je dirai que nous n'avions pas vraiment le choix. M. le Rapporteur : A-t-elle engagé une procédure disciplinaire contre la Banque cantonale de Genève de Lyon ? M. Alain BOCHET : Non ! M. le Rapporteur : Elle considère que c'est une pratique courante ? M. Alain BOCHET : Je l'ignore mais, pour répondre à votre question, elle n'a pas engagé de procédure. Elle nous a demandé d'arrêter et nous avons arrêté. M. le Rapporteur : Vous avez dit, tout à l'heure, que vous aviez argumenté en faisant valoir qu'il s'agissait d'une pratique courante à laquelle la Caisse des dépôts elle-même avait recours. Disposez-vous d'informations précises à ce sujet ? M. Alain BOCHET : Je sais que la Caisse des Dépôts est preneur de manière tout à fait officielle de plusieurs centaines de millions par an de dépôts fiduciaires. Je sais d'ailleurs que d'autres banques ont également recours à cette pratique. M. le Rapporteur : Lesquelles ? M. Alain BOCHET : Je ne suis pas un délateur... M. le Rapporteur : Puisque ce n'est pas une infraction et que la Commission bancaire n'a pas engagé de procédures disciplinaires, vous ne dénoncez personne... M. Alain BOCHET : La Commission bancaire le sait pertinemment ! M. le Rapporteur : La Commission bancaire sait pertinemment le nom des autres établissements bancaires ? M. Alain BOCHET : Je le suppose ! M. le Rapporteur : Vous le supposez ? M. Alain BOCHET : Je le suppose ! M. le Rapporteur : Mais vous ne le savez pas ? M. Alain BOCHET : Je ne le sais pas... M. le Rapporteur : Nous avons deux solutions : soit c'est une pratique courante, auquel cas il n'y a aucune raison que la Banque cantonale de Genève fasse l'objet de reproches... M. Alain BOCHET : Elle n'a pas été l'objet de reproches : on lui a demandé d'arrêter et elle l'a fait... M. le Rapporteur : Il a quand même fallu un peu de temps pour vous convaincre que c'était une pratique contestable... M. Alain BOCHET : Cela a fait l'objet de discussions ! M. le Rapporteur : Il a fallu plusieurs années ? M. Alain BOCHET : Si vous le dites... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis là que depuis un peu plus de six mois mais, à ma connaissance, la décision n'a pas pris des années. La discussion a été entamée par mon prédécesseur, peu de temps avant mon arrivée donc tout cela n'a pas pu prendre des années... M. le Rapporteur : Quand vous expliquez que vous n'êtes pas en mesure d'identifier le déposant, vous voulez dire que vous n'êtes pas certain que c'est à votre client que vous prêtez des fonds ? M. Alain BOCHET : Il n'y a aucun lien possible entre l'organisme prêteur, qui peut être n'importe quelle banque suisse prenant des dépôts fiduciaires, et le déposant. Ces fonds sont replacés sur le marché... Au même titre - et c'est une réflexion que nous avons eue avec la Commission bancaire - si Chase Manhattan Bank accepte un dépôt fiduciaire et le reprête, nous ne savons pas qui lui a prêté. Si Chase Manhattan Bank accepte un dépôt classique et le reprête, lorsqu'elle nous fait une ligne de crédits, nous ignorons également qui lui a prêté. Sur l'euromarché, vous ne connaissez jamais le déposant, vous ne connaissez que la banque qui vous accorde une ligne de crédit sur des fonds qui lui sont propres ou qu'elle a elle-même empruntés sur l'euromarché. Vous ne connaissez jamais le déposant quand vous êtes banquier. M. le Rapporteur : La position de M. Monnot va un peu plus loin. Elle consiste à dire que la Banque cantonale de Genève, à Genève, capte un certain nombre de dépôts que la Banque cantonale de Genève de Lyon ne peut pas capter dans la mesure où elle n'est pas une banque de dépôt et que ce sont les mêmes qui vont déposer à la BCGE Genève et qui obtiennent du crédit à Lyon. Cela vous paraît farfelu ? M. Alain BOCHET : Complètement ! M. le Rapporteur : Vous êtes sûr, vous êtes formel ? M. Alain BOCHET : Complètement ! M. le Rapporteur : Il faut être formel ! M. Alain BOCHET : Je suis formel ! M. le Rapporteur : Comment se fait-il, alors, que M. Monnot cite, non pas des noms de clients - on ne le lui demandait d'ailleurs pas - mais des catégories socioprofessionnelles de clients identifiés comme ayant de l'argent à placer, incités à aller en Suisse dans les fiduciaires de la BCGE Genève afin d'obtenir, en contrepartie, des crédits à Lyon ? M. Alain BOCHET : C'est un mythe pur et simple. Vous connaissez les conditions dans lesquelles M. Monnot nous a quittés... N'ayant pas retrouvé d'emploi, il cherche manifestement à nous nuire, la preuve évidente en étant qu'il a fait publier dans la presse Vous avez entendu son témoignage et vous pouvez mener une enquête sur le personnage dont la réputation n'est plus à faire ! C'est une erreur qui a été commise que de le recruter ! Cela étant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes soumis sur chaque dossier au contrôle de nos commissaires aux comptes et de la Commission bancaire. Ces dossiers sont étayés et ne s'appuient pas sur des dépôts mythiques reprêtés sous forme de dépôts fiduciaires par notre maison mère. A supposer que cela ait été le cas, nous nous trouverions alors dans une situation extrêmement difficile de par la suppression de ces dépôts fiduciaires, ce qui n'est pas le cas. M. le Rapporteur : Comment avez-vous géré la transition ? M. Alain BOCHET : Tout simplement en ayant dix points de base de moins, soit dans nos revenus, soit en termes de négociation par rapport à nos concurrents : c'est tout ! Sur le plan pratique cela a été simple : à partir du moment où la Commission Bancaire nous a enjoint d'abandonner les dépôts fiduciaires nous l'avons fait au fur et à mesure de leurs échéances, les derniers ayant été rompus en cours de contrat ! C'est aussi simple que cela ! Les répercussions, comme en attestent les documents internes de la banque, ont été un manque à gagner, une baisse de compétitivité mais ce n'est pas terrible et nous nous en remettrons. M. le Rapporteur : Dans le compte d'exploitation des années 1997-1998, le coût du refinancement n'était pas tellement élevé... M. Alain BOCHET : Ce n'était pas tout à fait l'avis de nos actionnaires. Normalement, une banque qui se refinance sur le marché, lorsqu'elle a des structures plus solides que les nôtres, c'est-à-dire quelques années d'antériorité, doit le faire à bien meilleur marché que nous ne le faisions à l'époque. M. le Rapporteur : C'est que l'affaire était vraiment mal gérée. M. Alain BOCHET : C'est vrai ! C'est une déduction tout à fait logique d'où le départ de certaines personnes... (Rires.) M. le Rapporteur : Avant de vous libérer et de vous remercier de cette entrevue bien franche, avez quelque chose à ajouter ? M. Alain BOCHET : Je peux vous dire que, compte tenu des contrôles dont nous sommes l'objet et auxquels M. Monnot n'est d'ailleurs pas étranger, nous sommes allés très loin, puisqu'un audit confié à deux organismes extérieurs est en cours pour attester et prouver que ce genre de pratiques n'a jamais existé. M. le Rapporteur : Vous n'en êtes pas certains vous-même ? M. Alain BOCHET : J'en suis certain mais il faut en attester puisque les journaux, suite aux déclarations de M. Monnot, font état de montants astronomiques équivalant pratiquement à l'encours de la banque ce qui est complètement aberrant ! Qui ne dit mot consent et donc après avoir traité la question par le mépris pendant un certain temps, nous avons été contraints de prendre des mesures pour répondre et aux journalistes - des assignations ont été délivrées - et à M. Monnot. M. le Rapporteur : Dans ce cadre, accepteriez-vous de nous remettre le dossier de la Commission bancaire et la correspondance suivie que vous avez entretenue avec elle ? M. Alain BOCHET : Il convient de demander à la Commission bancaire si elle le souhaite : personnellement, je n'y vois aucune objection. Mais vous savez qu'en France comme ailleurs, le secret bancaire existe. Si la Commission bancaire qui est notre organisme de tutelle souhaite vous remettre des documents, je n'y vois aucun inconvénient. M. le Rapporteur : La Commission bancaire n'est pas, juridiquement, en position de le faire. En revanche, je vous demande, dans la mesure où vous recevez des informations, des lettres, une correspondance, si vous accepteriez de nous les transmettre pour que la Mission d'information puisse se faire une idée absolument nette de l'étendue du dialogue existant entre vous et la Commission bancaire sur ce sujet. M. Alain BOCHET : Je ne le pense pas et pour une raison bien simple : ces études sont des études extrêmement approfondies qui durent plusieurs mois, qui font l'objet de rapports substantiels, où des noms de clients sont cités avec des garanties, des états de fortune, des hypothèques et tout ce qui peut asseoir un crédit en France, certains clients pourraient donc nous reprocher de les avoir publiés. Cela étant, encore une fois, si vous vous adressez à la Commission bancaire qui est notre organisme de tutelle et qu'elle nous demande notre accord pour vous les communiquer, nous le lui donnerons mais je dois dire que c'est quand même assez délicat...` M. le Rapporteur : Nous ne recherchons pas d'informations nominatives... M. Alain BOCHET : Oui mais elles sont là ! M. le Rapporteur : ...et il y a toute possibilité d'effacer ces informations nominatives. L'intérêt, pour nous, est de suivre le raisonnement de la Commission car, voyez-vous, le Parlement s'attache également à contrôler la manière dont les autorités de contrôle contrôlent : c'est la problématique de qui gardera les gardiens ! Cela fait partie du champ de nos investigations et nous sommes en mesure de demander ces documents auxquels nous souhaiterions avoir accès après effacement de ces informations nominatives... M. Alain BOCHET : Mais ces informations représentent la plus grande partie du rapport ! M. le Rapporteur : Cela relève de votre décision et de votre responsabilité. Nous n'avons pas le pouvoir de vous contraindre. Seule la justice peut le faire... M. Alain BOCHET : Tout à fait ! J'espère que notre entretien ainsi que la suite des événements vous apportera certains éclaircissements mais, à ce stade, j'aimerais que les rapports ne vous soient pas remis à moins que ce ne soit par les soins de la Commission bancaire... M. le Rapporteur : Finalement, à ma question, vous avez répondu par oui et non. Est-ce que les rapports d'audit, même s'ils sont établis par vos soins... M. Alain BOCHET : Ils ne sont pas établis par nos soins... M. le Rapporteur : C'est bien vous qui payez ces organismes de contrôle ? Ce sont vos prestataires de service ? M. Alain BOCHET : Pourquoi se faire auditer à ce moment-là ? Tous les auditeurs de ce bas monde étant payés par les clients, quelle est la valeur de leurs rapports ? M. le Rapporteur : C'est un véritable problème qui est d'ailleurs assez général et que nous retrouvons avec les commissaires aux comptes. M. Alain BOCHET : C'est un peu comme la Cour des comptes ? M. le Rapporteur : Non, la Cour des comptes a construit une réputation. Actuellement, nous avons des problèmes avec les commissaires aux comptes. M. Alain BOCHET : Vous n'en avez tout de même pas qu'avec eux ? M. le Rapporteur : Non, nous en avons avec eux, entre autres, et avec les réviseurs. La question que je vous pose est donc la suivante : accepteriez-vous de nous remettre le rapport d'audit quand il sera achevé, de manière à rassurer la mission puisqu'il est fait pour cela ? M. Alain BOCHET : Comme il est commandé par la maison mère, je peux lui poser la question mais, là encore, apparaîtront des noms puisqu'ils traitent de 750 cas de clients. Si vous posiez cette question à la B.N.P., pensez-vous qu'elle accéderait à votre demande ? M. le Rapporteur : Je ne sais pas mais vous n'êtes pas la B.N.P. et la B.N.P. à d'autres soucis que la Banque cantonale de Genève : chacun les siens... M. Alain BOCHET : Je crois même, sans en être certain, que, ce faisant, j'enfreindrais ce que je suis autorisé à faire en qualité de banquier. M. le Rapporteur : Je ne vous demande rien qui soit hors de votre portée. Je vous ai demandé tout à l'heure des choses qui sont dans l'ordre du possible : vous ne voulez pas, c'est votre choix ! Par ailleurs, j'ignorais l'existence de ces audits, commandés par la maison mère, destinés à rassurer évidemment la maison mère et à vérifier, ainsi que vous le disiez vous-même, que ces pratiques « n'ont jamais existé » et nous serions heureux de pouvoir profiter de ces informations. M. Alain BOCHET : Je répète que ces pratiques n'ont jamais existé ! M. le Rapporteur : Heureusement que la maison mère qui en doute, demande à des auditeurs extérieurs de le vérifier. M. Alain BOCHET : Non, la maison mère n'en doute pas : cela c'est votre version des choses ! La maison mère a été contrainte de le faire afin de répondre à une presse alertée par M. Monnot qui a officialisé ses dires en publiant un texte sur un papier à en-tête de l'Assemblée nationale... M. le Rapporteur : Je vous ai donné au préalable toutes les explications sur ce sujet ! Si la maison mère veut se défendre d'accusations dans la presse il serait peut-être utile qu'elle informe la représentation nationale qui, actuellement, enquête sur sa filiale lyonnaise. M. Alain BOCHET : La presse relatera tout cela probablement très largement et elle se fera également l'écho des procès qui suivront les assignations en cours auprès des diverses personnes intéressées... M. le Rapporteur : Je voulais vous lire un attendu de jugement du 2 octobre 1998, du tribunal correctionnel de Lyon. M. Alain BOCHET : Je le connais ! M. le Rapporteur : Le président qui jugeait l'affaire était M. Müller et le représentant du procureur de la République, M. Mondonneix. A propos de la Banque Cantonale de Genève, il est dit : « Cet établissement bancaire a ainsi, en toute connaissance de cause, mis en place un mécanisme permettant de faire travailler de l'argent de provenance douteuse, en connaissant la provenance - vous aviez connaissance de la provenance de l'argent donc des déposants fiduciaires... Ses responsables se sont efforcés, durant l'enquête, de dissimuler par le mensonge leur complicité objective avec des réseaux criminels qui peuvent ainsi, profitant de l'opacité des frontières, donner aux revenus de leurs activités occultes une apparence de légalité. » Comment voulez-vous, avec un attendu de ce genre, que nous n'ayons pas quelques doutes sur vos déclarations lénifiantes ? M. Alain BOCHET : Comment interprétez-vous, alors que, dans cette opération... M. le Rapporteur : Là, ce n'est pas M. Monnot mais le tribunal de Lyon ! M. Alain BOCHET : Oui et le tribunal de Lyon n'a pas condamné ni même mis en examen la Banque Cantonale donc je pense qu'il doit y avoir collusion entre le tribunal de Lyon et ladite Banque Cantonale... Comment l'expliquez-vous ? C'est quand même un peu fort : le client en question fait l'objet de comptes auprès de pratiquement toutes les banques lyonnaises qui ont eu les mêmes problèmes que nous. Si ce que vous venez de me dire était vrai pensez-vous que nous aurions aujourd'hui une « ardoise » - parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom - de 2,5 millions de francs sur cette opération ? Si nous avions été couverts, il me semble que les fonds auraient été récupérés ou alors nous sommes encore plus mauvais qu'on ne veut bien le dire ! M. le Rapporteur : Donc, selon vous, le tribunal s'est trompé ? M. Alain BOCHET : Je ne sais pas. Le tribunal dit certaines choses mais ne nous condamne pas : pourquoi ? Vous avez lu l'attendu jusqu'au bout y compris la condamnation... Nous n'avons même pas été mis en examen donc l'accusation est tout à fait gratuite et a fortiori pas condamnable... M. le Rapporteur : Je peux vous lire ce qui se passe dans cette affaire dite « Minguez ». « L'attention des enquêteurs était attirée sur un prêt de 5 millions de francs consenti à Minguez par la BCGE de Lyon. Lorsque ceux-ci ont constaté que Patrick Minguez, qui avait lui-même prêté cette somme à la SA, avait tenu à rembourser celui-ci avant de prendre la fuite, les investigations accomplies sur commission rogatoire internationale, ont permis de constater que ce prêt, consenti sans garanties apparentes réelles, s'adossait en réalité sur le dépôt, en février 1995, d'une somme de 5 millions de francs, sur un compte ouvert en Suisse au nom de Patrick Minguez. Cette somme était versée en espèces... » Nous sommes donc en pleine contradiction de vos dénégations concernant les déclarations de M. Monnot. Voilà un exemple constaté et inscrit sur le marbre des décisions de justice qui fait la démonstration contraire de ce que vous venez de me dire à l'instant. M. Alain BOCHET : Ce n'est pas une décision de justice ! M. le Rapporteur : C'est un jugement ! M. Alain BOCHET : Le jugement nous condamne-t-il ? M. le Rapporteur : C'est un jugement qui poursuit et condamne l'intéressé. M. Alain BOCHET : Il y a deux erreurs dans cette déclaration : premièrement, si nous avions été remboursés, je le saurais, de même que nos commissaires aux comptes et la Commission bancaire... M. le Rapporteur : On parle « d'adossement »! M. Alain BOCHET : Mais également de remboursement ! On prétend que l'intéressé « a tenu à rembourser » ce qui n'a pas du tout été le cas. Deuxièmement, si un tribunal se permet ce genre de fantaisies - et vous conviendrez que, pour une banque, alors qu'elle n'est pas condamnée, il est difficile d'attaquer les auteurs de semblables déclarations -, comment expliquez-vous que nous n'ayons pas été condamnés, si le tribunal nous avait jugé coupables ? M. le Rapporteur : Vous savez, le fait que le parquet ne poursuive pas certaines personnes dans une affaire et qu'il ait une conception sélective de l'action publique, n'est jamais, et surtout à mes yeux, un brevet d'innocence ! M. Alain BOCHET : Ce qui revient à dire : « vous êtes coupables mais comme on est gentils avec vous, on vous laisse en paix... » ? M. le Rapporteur : Je crois que nous avons fait le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu prêter main forte à l'_uvre de vérité parlementaire. Je vous remercie. SOMMAIRE DES ANNEXES Annexe 1 : Liste des indices de blanchiment des capitaux établie par la circulaire de la Confédération fédérale des banques n° 98-1. Annexe 2 : Formulaires d'identification de l'ayant droit économique (extrait de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) du 28 janvier 1998. Annexe 3 : Echange de lettres entre la Mission et la Commission bancaire au sujet des fonds Abacha. Annexe 4 : Echange de lettres entre la Mission et la Commission fédérale des banques suisses concernant les territoires non coopératifs. Annexe 5 : Echange de lettres entre la Mission et les autorités judiciaires du canton de Zürich. Annexe 6 : Echange de lettres entre la Mission et le Directeur de la délégation aux questions monétaires et financières internationales à l'Administration fédérale des finances à Berne. Annexe 7 : Echange de lettres entre la Mission et le Chef du service juridique du Ministère public de la Confédération helvétique à Berne. Annexe 8 : Echange de lettres entre la Mission et le Procureur général du Tessin. 1 A ce sujet, Cf. Jean-Denis Bredin (Une singulière famille - Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël), Fayard, 1999 2 Source : Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, Payot, Lausanne, 2ème éd., 1986, p. 753. 3 Source : Nouvelle histoire..., op. cit. 4 Source : New York Times, 11 mai 1997, cité dans le dossier spécial consacré à l'or nazi par le journal l'Hebdo à consulter sur Internet à l'adresse suivante : 5 Claude Torracinta - « Les banques suisses en question » Editions de l'Aire, 1981, p. 110. 6 L'article 305 ter, al. 2 du code pénal suisse accorde aux intermédiaires financiers le droit de communiquer aux autorités des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. Ce droit est devenu obligation dans le cadre de la loi fédérale du 10 octobre 1997. 7 La loi de 1987 sur le droit international privé prévoit qu'un jugement de faillite prononcé à l'étranger et reconnu en Suisse, permet de lever le secret bancaire lorsque les droits des créanciers sont dûment établis. 8 La Suisse est en effet partie aux conventions du Conseil de l'Europe sur le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime et sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle n'a toutefois pas ratifié le protocole additionnel à ce dernier texte, qui permet d'accorder l'entraide judiciaire à un pays tiers pour des actes qu'il considère comme des infractions fiscales, alors même qu'ils ne sont pas punissables dans l'Etat qui reçoit la demande d'entraide. 9 Source : AFP Economie, 14 septembre 2000. 10 Source : site internet de l'Association française des financiers indépendants. 11 Le canton de Vaud semble le plus intéressant pour les personnes étrangères désirant s'établir en Suisse. L'impôt spécial cantonal et communal d'après la dépense y est calculé au taux ordinaire, avec toutefois un arrêt de la progression au taux de base de 10 % - en lieu et place du taux maximum de 14 % possible. Par ailleurs, l'impôt sur les revenus étrangers soumis à l'impôt spécial est calculé au taux de base unique de 3 %. En revanche, le canton de Genève ne connaît pas de barème spécial pour les personnes imposées à forfait. 12 Dans certaines communes le taux d'impôt communal est ainsi inexistant, alors qu'il représente dans d'autres 100 % de l'impôt cantonal. 13 Commission Zufferey sur la surveillance des marchés financiers. Rapport final, novembre 2000. 14 Selon les informations disponibles (AFP, 7 novembre 2000), Fondvest s'adresse essentiellement aux banques, compagnies d'assurance et sociétés de gestion de fortune qui veulent présenter sous un même toit à leurs clients une gamme complète de fonds de placement. Elle offrirait ainsi plus de 1 600 fonds de placement provenant de soixante émetteurs suisses et étrangers. 15 Source : Crédit Suisse Group (AFP, 15 novembre 2000). 16 Source : Nice-Matin, 24 août 2000. 17 Source : L'Agefi, 2 novembre 2000. 18 « De concert contre le crime organisé » - Exposé de la conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold à l'occasion de la réunion de l'Association suisse des banquiers le 1er septembre 2000 à Saint-Gall. 19 L'Association suisse des banquiers (ASB) a été fondée à Bâle en 1912. Selon le site internet de l'ASB), elle regroupe pratiquement toutes les banques et sociétés de révision, ainsi que la plupart des négociants en valeurs mobilières en Suisse. En revanche, les fonds de placement, qui ont constitué leur propre association, n'en sont pas membres. 20 Source : C. Torracinta, Les banques suisses en question, Lausanne, Ed. de l'Aire, 1981, p. 9 et suiv. 21 in Banque-Assurance, novembre/Décembre 2000, dossier spécial : Des milliers d'intermédiaires financiers en situation illégale. 22 Message fédéral précité du 17 juin 1996 23 Article de Marc Roche du Monde daté du 25 octobre 2000 24 Message fédéral précité du 17 juin 1996 25 Article de Florence Noël dans La Tribune de Genève du 19 décembre 2000. 26 Questions en relation avec la mise en _uvre de la loi sur le blanchiment d'argent dans le secteur non bancaire (état au 1er janvier 2000). Article de M. Niklaus Huber, Chef de l'Autorité de contrôle 27 La Tribune de Genève du 13 septembre 2000 - « La Gauche veut contrer les avocats d'affaires », article de Mme Danièle Chaussas 28 Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) - rapport sur les typologies du blanchiment des capitaux 2000-2001, 1er février 2001. 29 Cf. aussi la loi n° 99-984 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation dudit accord, publié par le décret n° 2000-452 du 22 mai 2000. 30 Le Conseil fédéral avait bien proposé cette ratification (message du 31 août 1983), mais les Chambres ont décidé le 4 octobre 1985 d'exclure les questions fiscales du domaine couvert par l'entraide judiciaire 31 Source : Office fédéral de la justice, L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, 8ème éd., 1998, p. 9. 34 Le Temps, article de Denis Masmejan du 17 octobre 2000. 35 Le Temps, article de Sylvie Arsever du 30 août 2000. 36 Banque Assurance - novembre/décembre 2000, p. 25 37 La Réglementation et la Surveillance des marchés financiers en Suisse, Rapport final, novembre 2000. 38 Denis Robert, « La justice ou le chaos », p. 123. 39 Rapport de gestion de la Cour Suprême de Berne pour 1999, p. 11. 40 Dépêche AFP International du mardi 28 novembre 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

