Document
mis en distribution
le 11 avril 2002
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000.
RAPPORT D'INFORMATION
déposé en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE
SUR LES OBSTACLES AU CONTRÔLE ET À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE ET DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX EN EUROPE (1)
Président
M. Vincent PEILLON,
Rapporteur
M. Arnaud MONTEBOURG,
Députés.
--
TOME II
La lutte contre le blanchiment des capitaux en France :
un combat à poursuivre
Volume 1 - Rapport et annexes
Accès au volume 2 -
Auditions
|
Pour en faciliter la consultation en ligne, ce premier volume est scindé en deux parties :
|
La Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe est composée de : M. Vincent Peillon, Président ; MM. Michel Hunault, Jean-Claude Lefort, Vice-Présidents ; MM. Charles de Courson, Philippe Houillon, Secrétaires ; M. Arnaud Montebourg, Rapporteur ; MM. Philippe Auberger, François d'Aubert, Alain Barrau, Jean-Louis Bianco, Jérôme Cahuzac, Jacky Darne, Arthur Dehaine, Jean-Jacques Jegou, Gilbert Le Bris, François Loncle, Mmes Jacqueline Mathieu-Obadia, Chantal Robin-Rodrigo.
S O M M A I R E
_____
Première partie
[Accès à la deuxième partie]
Pages
AVANT-PROPOS 7
I.- LA MOBILISATION PROGRESSIVE DES PROFESSIONS FINANCIÈRES 11
A.- DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE RIGOUREUSES 12
1.- L'identification du client 12
2.- L'examen particulier des opérations importantes 13
3.- La déclaration de « soupçon » 13
B.- UNE APPLICATION INÉGALE 14
1.- L'extension progressive du champ d'application 14
2.- Le coeur du dispositif : les établissements de crédit 17
3.- Les mauvais élèves 22
a) Le silence des marchés financiers face à l'utilisation dévoyée des produits dérivés 22
b) L'aveuglement durable des assurances 30
C.- UNE ACCEPTATION DIFFICILE 38
1.- Le traumatisme de la levée du secret professionnel 38
2.- L'exigence de définition précise des obligations de vigilance 42
D.- DES SANCTIONS INSUFFISANTES 45
1.- Les carences des sanctions administratives 45
2.- Les nécessaires sanctions pénales 47
II.- LA DIFFICILE RECONSTITUTION DES FLUX FINANCIERS 52
A.- LES LIMITES DE L'INVESTIGATION FINANCIÈRE À LA FRANÇAISE 53
1.- Un foisonnement institutionnel qui impose un travail en réseau 53
2.- La difficile articulation du renseignement financier et de l'enquête judiciaire 60
3.- La surcharge de la police économique et financière 72
B.- CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET PROCÉDURE PÉNALE 81
1.- La criminalité organisée au coeur du blanchiment 81
2.- La nécessaire consolidation juridique des opérations sous couverture et des livraisons surveillées 83
C.- MONDIALISATION DES ÉCHANGES FINANCIERS ET TRAÇABILITÉ : LA FRANCE FAVORABLE À LA RÉGULATION 91
1.- Les Etats et territoires non coopératifs 94
a) Identification et sanctions 95
b) Les banques françaises implantées dans les centres offshore : l'exemple des îles Caïman 101
c) Le piège des banques correspondantes 108
2.- Les « instruments » garantissant l'anonymat du bénéficiaire 113
3.- Faut-il plaider en faveur d'une régulation transnationale ? 117
a) Une autorité mondiale de régulation des registres du commerce 118
b) Les intermédiaires des échanges financiers : le problème SWIFT 118
D.- LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, POLICIÈRE ET JUDICIAIRE : LA FRANCE EN PHASE AVEC LES PROGRÈS EUROPÉENS 127
1.- Les acquis de la coopération opérationnelle 127
a) Les échanges entre services de renseignement 127
b) La coopération policière 130
2.- Les lenteurs de la coopération judiciaire malgré des efforts récents 136
a) Le Sommet de Tampere et la création d'Eurojust 136
b) Le mandat d'arrêt européen 139
c) La multiplication des conventions internationales 142
III.- UN BILAN RÉPRESSIF EN DEMI-TEINTE 144
A.- DES STATISTIQUES EN HAUSSE 144
B.- LA FRANCE : UN PAYS DE TRANSIT ET D'EMPILAGE 148
C.- L'EXTENSION DES INCRIMINATIONS 151
1.- La généralisation des délits sous-jacents 152
2.- Le renversement de la charge de la preuve de l'origine des capitaux 155
3.- L'intentionnalité des délits et l'éventuelle pénalisation de la négligence 159
|
Accès
à la deuxième partie de ce volume IV.- LA SITUATION DANS LE SUD-EST A.- LE SUD-EST, TERRE D'ACCUEIL DE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE 1.- Une économie infiltrée par les capitaux suspects 2.- Des professionnels encore trop peu concernés a) Les agents immobiliers b) Les notaires 3.- Des mécanismes juridiques pleinement exploités a) La représentation fiscale b) Le recours aux sociétés civiles immobilières B.- DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES AFFAIBLIES 1.- La pénétration du sud-est par les organisations criminelles 2.- L'inamovibilité pernicieuse des magistrats dans le sud-est 3.- Une délinquance financière impunie a) L'absence de priorité accordée à la lutte contre la délinquance financière b) Des moyens insuffisants 4.- Une situation judiciaire très dégradée a) Les dossiers s'enlisent b) Les dossiers se perdent c) Des dessaisissements inhabituels PROPOSITIONS DE LA MISSION POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT CONCLUSION GÉNÉRALE EXAMEN DU RAPPORT EXPLICATIONS DE VOTE EXPLICATIONS DE VOTE DU GROUPE U.D.F. ANNEXES |
En décidant, en juin 1999, la création d'une Mission parlementaire d'information commune chargée d'étudier les obstacles à la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux en Europe, les commissions des lois et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale ignoraient qu'elles venaient d'entreprendre une démarche sans précédent.
Cette Mission d'information, exceptionnelle dans sa durée (juin 1999 - avril 2002), la plus longue de l'histoire parlementaire de la Vème République, se distingue également par son champ d'investigation étendu à l'ensemble de l'Europe.
La Mission, pendant ses trois années d'existence, s'est rendue dans 14 pays ou destinations différents pour rencontrer l'ensemble des acteurs de la lutte anti-blanchiment, qu'il s'agisse des responsables politiques ou administratifs, des représentants des institutions financières ou des magistrats.
Ces entretiens ont pu parfois décontenancer nos interlocuteurs, surpris par la nouveauté et le caractère inhabituel de la démarche de la Mission.
Chaque déplacement de la Mission à l'étranger a été conçu dans le but de s'informer, au-delà du stade des généralités, sur la mise en application concrète des mécanismes de lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux.
Très rapidement, deux types de situations se sont dessinés avec, d'une part, un ensemble de pays avec lesquels la coopération judiciaire ou policière ne pose pas de problèmes particuliers et, d'autre part, différents Etats qui, de façon concordante, font régulièrement l'objet d'observations ou de critiques et dont il est toujours plus difficile, voire parfois même impossible, d'obtenir la collaboration judiciaire en matière pénale sur des dossiers financiers.
Il est apparu, dans le même temps, que ces pays qui posent des problèmes en matière d'entraide judiciaire sont également ceux dont les dispositifs juridiques présentent les plus graves lacunes au regard de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux.
Ces Etats ont maintenu un secret bancaire qui limite la coopération judiciaire et empêche toute forme de coopération administrative. Ces pays, par ailleurs, reconnaissent et facilitent l'utilisation de mécanismes juridiques (trust, fiducie, Anstalt) très faciles à créer et qui permettent de conserver l'anonymat des ayants droit économiques des fonds placés ou circulant dans de telles structures.
C'est sur la base de ce constat que la Mission a décidé de consacrer une série de monographies critiques relatives au Liechtenstein, à Monaco, à la Suisse, au Royaume-Uni et au Luxembourg.
Il a été régulièrement reproché à la Mission, par les autorités des pays concernés, d'avoir porté l'attention sur les faiblesses des systèmes anti-blanchiment des pays voisins et de n'avoir pas entrepris un semblable travail critique d'évaluation du dispositif français de lutte anti-blanchiment.
C'est maintenant chose faite et la Mission s'est employée à analyser, avec les mêmes méthodes d'investigation, les différentes étapes, allant de la prévention à la répression, qui caractérisent le système français.
Il ressort, au terme de ce travail, que la France est très représentative et que les faiblesses ou les obstacles qu'elle rencontre pour lutter efficacement contre la délinquance financière et le blanchiment des capitaux reflètent la situation de la majorité des pays européens.
La lutte contre le blanchiment repose encore trop largement sur la contribution du monde bancaire qui, bien qu'étant la profession la mieux placée pour déclencher l'alerte à partir d'un soupçon ou d'une situation objectivement qualifiée, ne saurait à lui seul assumer cette veille qui doit être à l'avenir plus largement partagée avec les autres professions exposées (notaires, avocats, agents immobiliers, assureurs, etc.).
L'enquête sur les mouvements de fonds suspects pose d'une part, le problème des interventions respectives des autorités financières, policières et judiciaires et des moyens qui leur sont alloués et, d'autre part, soulève la question plus générale de la traçabilité des fonds.
Enfin, la répression reste en France, comme ailleurs, un grand point faible puisque les condamnations pour blanchiment font toujours figure d'exception.
La spécificité française vient essentiellement de la situation qui s'est développée dans le sud-est où la Riviera ne se contente plus, depuis quelques décennies, d'attirer les retraités fortunés qui ont choisi de placer leur épargne dans une banque ensoleillée.
Le sud-est, terre d'élection d'investissements immobiliers dont les propriétaires camouflent leur identité derrière des sociétés civiles, souffre aussi d'un fonctionnement anormal des institutions judiciaires.
La Mission a donc estimé de son devoir d'examiner plus attentivement la situation prévalant dans le midi de la France au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
I.- la mobilisation progressive des professions financières
A la suite du sommet des pays industrialisés de l'Arche de juillet 1989, le monde occidental a mis en place un dispositif conséquent de lutte contre le blanchiment. La France, pays hôte du sommet et à l'initiative de la création du Groupe d'action financière (GAFI), a joué un rôle important dans cette évolution.
Le début des années 1990 a été décisif, comme le montrent les dates suivantes :
- mai 1990 : publication des 40 Recommandations du GAFI ;
- 12 juillet 1990 : promulgation de la loi française relative à « la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux » ;
- 10 juin 1991 : adoption de la directive européenne relative à « la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment.
Ce dispositif novateur reposait à la fois sur la création d'une nouvelle entité administrative, un service de renseignement financier nommé TRACFIN, pour « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins », et sur la participation des professions financières via l'imposition d'obligations spécifiques de vigilance.
La différence d'appellation de la loi française et de la directive européenne souligne bien l'ambiguïté qui est apparue d'emblée dans ce partenariat inédit entre les professions financières et les services répressifs de l'Etat.
S'agissait-il uniquement de prévention de l'utilisation du système financier par la criminalité organisée, auquel cas un simple refus de la relation commerciale suffirait à remplir ces obligations, ou bien de participation à la lutte contre cette criminalité, ce qui sous-tendait une démarche plus coopérative des organismes financiers, en rupture avec des normes et des coutumes profondément ancrées dans ces milieux professionnels ?
La lettre et presque douze années d'application de la loi française ont tranché : c'est bien une coopération active qui est désormais exigée des professions financières. Dans le lent et complexe processus de démantèlement d'une filière de blanchiment, leur rôle est essentiel : il s'agit de la détection et de l'alerte.
Les organismes financiers se trouvent au point de passage privilégié de l'entreprise de blanchiment, à l'étape la plus délicate qui consiste à transformer de l'argent mal acquis en actif respectable. C'est cette position clé qui a légitimé la création d'un dispositif très novateur d'association aux pouvoirs publics, dont la philosophie est encore contestée, notamment par les professions qui y sont récemment soumises. Si leur mobilisation reste inégale bien qu'en progrès, la question des sanctions pour manquement aux obligations de vigilance reste posée.
A.- des obligations de vigilance rigoureuses
La loi du 12 juillet 1990 précitée a établi des obligations de vigilance étendues pour les professions qui y sont soumises et dont la rédaction laisse parfois place à une marge d'interprétation substantielle. Ce dispositif étant initialement largement focalisé sur les établissements de crédit, on ne s'étonnera pas que les obligations de vigilance soient particulièrement adaptées à l'exercice concret de l'activité bancaire.
1.- L'identification du client
Le devoir d'identification du client est un principe désormais universellement admis dans l'exercice du métier de banquier, même si sa déclinaison pratique varie fortement d'un pays à l'autre. Les pays anglo-saxons en font l'élément clé de la déontologie financière.
La France a adopté une conception très rigoureuse de cette obligation puisque la loi de 1990 (désormais articles L. 563-1 et L. 563-2 du code monétaire et financier) l'a définie comme suit :
- vérifier l'identité de tout client qui demande l'ouverture d'un compte par la présentation de tout document écrit probant, et en garder la preuve pendant cinq ans ;
- vérifier l'identité de tout client occasionnel qui demande à louer un coffre ou à réaliser une opération supérieure à 8 000 euros (50 000 francs) et en garder les traces dans les mêmes conditions ;
- s'il apparaît que la personne pourrait ne pas agir pour son compte, se renseigner sur l'identité véritable de celui pour le compte duquel elle agit ;
- pour les bons et titres anonymes et les opérations sur l'or : création d'un registre spécial dans lequel est conservée l'identité des personnes qui effectuent ces opérations, lorsqu'elles excèdent certains montants.
Outre les documents relatifs à l'identité des clients, les organismes financiers doivent conserver, pendant la même durée de cinq ans, les documents relatifs aux transactions qu'ils ont effectuées, ce qui facilite grandement la reconstitution des opérations (article L. 563-4 du code monétaire et financier).
La France dispose aussi d'un fichier centralisé des comptes bancaires (FICOBA), géré par la Banque de France, qui est un instrument particulièrement utile aux enquêteurs puisqu'il permet, sous réserve d'une réquisition judiciaire, d'identifier immédiatement l'ensemble des comptes bancaires détenus en France par une même personne physique ou morale.
2.- L'examen particulier des opérations importantes
Aux termes de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, les organismes financiers doivent procéder à un examen particulier de toute opération importante (notamment supérieure à un million de francs) se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité, et ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. L'établissement a l'obligation de se renseigner sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et sur l'identité de la personne qui en bénéficie.
3.- La déclaration de « soupçon »
L'expression déclaration de « soupçon », passée dans l'usage courant, désigne l'obligation précisée à l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, instituée dès 1990 et légèrement modifiée dans sa rédaction par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Cet article impose aux organismes financiers et aux professions spécialisées en relation avec des placements financiers dont la liste s'est progressivement allongée, de déclarer à TRACFIN les opérations « portant sur des sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. »
C'est cette obligation, en raison de son aspect subjectif incontestable, qui a cristallisé les critiques des professionnels progressivement assujettis.
La loi relative aux nouvelles régulations économiques précitée a enfin ajouté des obligations de déclaration systématique dans les cas suivants :
- les opérations pour lesquelles l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse en dépit des diligences effectuées, en particulier lors de l'ouverture des comptes ;
- les opérations réalisées avec des fonds fiduciaires ou tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation, dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
Cette dernière obligation a été instituée à l'initiative de la Mission d'information en vue de contribuer à l'amélioration de la traçabilité des opérations.
1.- L'extension progressive du champ d'application
La liste des professions soumises aux obligations de vigilance contre le blanchiment s'est progressivement allongée.
Professions soumises aux obligations de vigilance contre le blanchiment
Etablissements de crédit Sociétés de bourse Changeurs manuels |
Loi du 12 juillet 1990 |
Sociétés d'assurance Entreprises d'investissement Agents de compensation Membres des marchés réglementés d'instruments financiers |
|
Professionnels de l'immobilier Notaires |
|
Directeurs de casinos Commissaires priseurs Acteurs des marchés de pierres précieuses, des antiquités et d'_uvres d'art |
Loi du 15 mai 2001 |
La tendance observée en France, comme à l'étranger, est donc l'élargissement progressif de la liste des professions concernées. Il faut toutefois remarquer que cette extension est modulée selon le type de métier. Ainsi, seules les professions financières (banques, assurance, marchés financiers, changeurs manuels) sont assujetties à l'ensemble des obligations, alors que les autres professions ne sont soumises qu'à la seule déclaration de soupçon.
Le législateur s'est progressivement efforcé de citer les principales professions au contact d'importants placements financiers. Avant la promulgation de ces textes, ces professions n'étaient soumises, comme l'ensemble des commerçants, qu'à l'interdiction, sous peine d'amende, d'accepter des paiements en liquide par des particuliers pour des montants supérieurs à 3 000 euros (article 1649 quater B du Code général des impôts) ou à la déclaration, comme toute personne physique, des transferts vers l'étranger de sommes supérieures à 8 000 euros (article 1649 quater A du Code général des impôts).
La loi française n'a pas encore traité de la question complexe des professionnels du droit et du chiffre, dont le rôle d'« ouvreurs de portes » a été régulièrement dénoncé par le GAFI.
Les professionnels du droit et du chiffre,
« ouvreurs de porte » pour le compte
de la criminalité organisée
Une autre tendance particulièrement manifeste des mécanismes de blanchiment de capitaux décrits par les experts du GAFI réside dans le rôle croissant joué par les prestataires de services professionnels. Les comptables, avocats et agents de création de société apparaissent toujours plus souvent dans les enquêtes anti-blanchiment. En créant et administrant des entités étrangères ayant la personnalité morale qui recèlent des mécanismes de blanchiment, ce sont ces prestataires qui apportent de plus en plus le perfectionnement apparent et la couche supplémentaire de vernis de respectabilité de certaines opérations de blanchiment. Ces services sont proposés non seulement dans des zones extra-territoriales, mais aussi dans les pays membres du GAFI. Une délégation a ainsi décrit un mécanisme de blanchiment dans lequel un groupe criminel avait choisi un cabinet d'avocats chargé d'agir en son nom pour l'achat d'une société. Les fonds destinés à cette acquisition ont été remis aux avocats et placés sur un compte-client. Lorsque l'achat a par la suite échoué, les fonds ont été retournés - après déduction des commissions - au groupe criminel par chèque. En réalité, le groupe possédait déjà la société qu'il était censé vouloir « acheter » et avait organisé l'échec de la vente puisqu'il souhaitait simplement convertir ses fonds d'origine délictueuse en chèque tiré sur un cabinet juridique respectable. Ce mécanisme a été révélé dans une déclaration d'opération suspecte par le cabinet concerné. Mais trop souvent, les prestataires de services professionnels ne sont pas encore assujettis à des obligations de déclaration des transactions suspectes dans les pays membres du GAFI. De plus, même lorsqu'ils y sont soumis, le nombre de déclarations déposées auprès des autorités est fréquemment décevant.
GAFI, rapport sur les typologies 1998-1999 - 10 février 1999, p. 13.
La Mission a très rapidement pris conscience de la nécessité de l'assujettissement progressif de ces professions à l'obligation de soupçon. Elle a toutefois aussi perçu la difficulté de bien identifier les différentes professions concernées, et parfois, de distinguer selon la nature des activités exercées au sein d'une même profession, notamment pour ce qui concerne les avocats. Elle n'a pas souhaité prendre d'initiatives lors de la discussion de la loi sur les nouvelles régulations économiques puisque les instances communautaires s'efforçaient, au même moment, de traiter la question au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive de 1991.
L'arbitrage opéré par ces instances satisfait la Mission puisqu'il permet d'affirmer le principe de l'assujettissement à la déclaration de soupçon, tout en préservant les droits de la défense et le secret professionnel des avocats lorsqu'ils exercent leur rôle de conseil dans une procédure pénale.
La directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la directive de 1991, au terme d'un débat vif et approfondi, a ainsi tranché en faveur de l'assujettissement à la déclaration de soupçon des commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, ainsi que des autres membres de professions juridiques indépendantes, dans le cadre de certaines de leurs activités limitativement énumérées à l'article 2 bis-5, et essentiellement relatives à la réalisation de transactions commerciales, financières ou immobilières.
Pour ce qui concerne les informations obtenues par des avocats dans le cadre de leur activité de conseil juridique, l'obligation de déclaration n'est imposée que dans le cas où la consultation juridique est fournie ou demandée aux fins de blanchiment (considérant 17).
Les informations obtenues à l'occasion d'une procédure judiciaire sont ainsi exonérées de l'obligation de déclaration.
Ce texte, que la France devra désormais rapidement transposer, permet ainsi de viser l'avocat, conseiller et acteur de montages juridiques et financiers, tout en excluant l'avocat pénaliste qui n'est informé de comportements illégaux que dans l'exercice de son activité de défenseur, parfois du fait même des personnes mises en cause qu'il a pour mission de défendre face aux services répressifs de l'Etat, et non pas de trahir en collaborant avec ces mêmes services.
2.- Le coeur du dispositif : les établissements de crédit
De par la nature de leur activité, la densité de leurs réseaux sur le territoire et la structure hiérarchique de leurs organigrammes, les établissements bancaires sont au coeur du dispositif de vigilance.
Evolution du nombre de déclarations de soupçon
reçues par TRACFIN
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 | |
Nombre |
900 |
1 202 |
1 244 |
1 655 |
2 537 |
3 761 |
Evolution |
+ 33 % |
+ 3,5 % |
+ 33 % |
+ 53 % |
+ 48 % |
Source : TRACFIN.
En 2001, les banques ont été à l'origine de 67 % des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN. Cette proportion est constante, alors même que le volume total des déclarations est lui-même en forte progression, puisqu'il a plus que doublé entre 1999 et 2001. Le nombre des déclarations de soupçon (de l'ordre de 2 400) doit toutefois être rapproché des 67 millions de comptes bancaires ouverts en France, ainsi que des 10,7 milliards d'opérations qui transitent chaque année dans les systèmes interbancaires.
Sur la période 1996-2000, les banques ont ainsi totalisé en moyenne les deux tiers des déclarations, auxquels il faut ajouter 14 % en provenance des établissements financiers publics (Caisse des dépôts, La Poste, Trésor public).
Conseillée par son organisme professionnel, la Fédération bancaire, qui a publié plusieurs circulaires sur le sujet, et par TRACFIN qui a périodiquement animé des réunions de travail au sein même des établissements, la profession a progressivement assumé ses obligations. Les établissements les plus lents ou les plus rétifs, souvent étrangers et de petite taille, ont été identifiés et désignés comme tels par TRACFIN à la Commission bancaire qui s'est efforcée d'intégrer cet aspect dans ses activités de contrôle et de régulation, sans toutefois excessivement sévir (voir infra). La désignation d'un correspondant TRACFIN au sein de chaque réseau, la mise au point des procédures, la formation des personnels se sont peu à peu généralisées.
Le rapport d'activité 2000 de TRACFIN donne aussi un satisfecit aux bureaux de change (12 % des déclarations) et aux intermédiaires immobiliers (à peine 2 %), au regard de leur champ économique d'intervention ou du caractère récent de leur assujettissement.
On peut ainsi relever l'exemple des notaires dont les déclarations ont presque doublé entre 1999 et 2000 (de 35 à 60), alors que leur assujettissement date de 1998. Il est vraisemblable que la condamnation pénale pour blanchiment d'un notaire de Grasse a eu un effet pédagogique salutaire.
Plus le degré d'organisation d'une profession est élevé (organe disciplinaire, organisme professionnel représentatif et structuré) et plus sa contribution à la lutte contre le blanchiment est homogène et cohérente. A ce titre, les agences immobilières fournissent le contre-exemple des notaires. Sans organe disciplinaire ou de régulation, constituées de différents réseaux commerciaux ou d'officines indépendantes, les agences immobilières, dont la culture dominante est celle du commerçant méfiant vis-à-vis des pouvoirs publics qu'il assimile rapidement au fisc, ne font pas preuve d'un grand zèle en faveur de la déclaration de soupçon, dont elles ignorent parfois l'existence, malgré les efforts pédagogiques de TRACFIN.
Les notaires : une profession très surveillée
M. Jean-Paul DECORPS, Président du Conseil supérieur du Notariat : Au départ nous avons fait auprès de TRACFIN quelques déclarations de blanchiment, fondées sur des certitudes ; nous avons ensuite travaillé sur l'extension de l'obligation de déclaration à toutes les opérations, y compris immobilières ; enfin, le législateur a créé l'obligation de déclaration de soupçon, récemment étendue aux professionnels de l'immobilier. C'est donc bien notre rôle d'observateur qui nous a amenés à alerter les pouvoirs publics.
Ces déclarations de soupçon font l'objet de procédures mises en place - notamment dans le midi et à Paris - avec l'aide des parquets généraux et des parquets départementaux et en relation avec TRACFIN.
Nous avons adressé à l'ensemble des notaires de France une circulaire qui, d'une part, leur demande d'être très attentifs à un certain nombre d'éléments tel que le montage de dossiers de grosse importance pour des clients qu'ils ne connaissent pas, et dans lesquels il y a un élément d'extranéité, d'autre part, précise la procédure de signalement de soupçon. Celle-ci est tout à fait informelle - un coup de téléphone, un rendez-vous, la visite du parquet dans l'étude, etc. - mais s'effectue toujours sous la surveillance du président de la chambre des notaires, autorité de discipline dans ce domaine. [...]
La circulaire que j'ai adressée à tous les notaires de France, a valeur d'obligation ; sa non-application peut entraîner des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la destitution, et qui sont prises par le président de la chambre des notaires et, éventuellement, par le tribunal.
Les notaires sont contrôlés tous les ans par le biais d'inspections, dont le but est de veiller au respect de ces circulaires. Ces derniers, dans leur écrasante majorité, ont conscience de leurs engagements. [...]
M. le Président : Avez-vous déjà eu l'occasion, sur le sujet qui nous occupe, de mettre en _uvre une procédure disciplinaire ?
M. Jean-Paul DECORPS : Oui, il y a eu une procédure disciplinaire dans les Alpes-Maritimes, à la demande de la profession et relayée par le parquet. Elle a eu lieu à l'époque de la déclaration non pas de soupçon, mais de blanchiment.
Ce notaire avait reçu un compromis d'une personne paraissant bien sous tous rapports, mais qui, entre le compromis et la vente, a été arrêtée et emprisonnée pour blanchiment. Or le notaire - sans doute ne lisait-il pas la presse - a tout de même passé l'acte de vente avec la concubine de ce truand. Lorsque la brigade financière a effectué ses contrôles, elle s'est aperçue de l'opération, une sanction disciplinaire a été prise et le notaire destitué.
M. le Président : Très souvent, les professions préfèrent régler leurs problèmes de façon interne. Ce corps de contrôle des notaires fait-il remonter un certain nombre de cas dans lesquels vous intervenez avant que la justice ne soit saisie ?
M. Jean-Paul DECORPS : Les inspections annuelles font l'objet de rapports circonstanciés, transmis systématiquement au président de la chambre des notaires et au parquet. L'un ou l'autre - et souvent les deux - demandent, lorsqu'une dérive ou un manquement est constaté, des sanctions disciplinaires.
M. le Président : Pouvez-vous nous donner une estimation annuelle de ces sanctions ?
M. Jean-Paul DECORPS : Je dirai en moyenne deux ou trois sanctions par an et par chambre, soit au total entre cent et cent cinquante. Lorsque je parle de sanctions disciplinaires, je parle de sanctions internes, telles que l'avertissement ou la défense de récidiver. S'agissant des poursuites, il y en a peut-être eu une trentaine par an.
Extrait de l'audition de M. Jean-Paul Decorps, président du Conseil supérieur du notariat, devant la Mission, le 27 octobre 1999.
La contribution des notaires à TRACFIN, souvent bien ciblée, comme le montre l'exemple ci-après, doit être encouragée.
Le notaire français et la mafia italienne
Une société française se propose d'acquérir un bien immobilier de 3,4 millions d'euros situé en France. Un notaire est chargé d'établir l'acte de vente entre le représentant du vendeur et la société de droit français. Le financement de l'opération est réalisé sans mouvement de fonds, mais dans le cadre d'une opération de cession d'une créance en dollars réputée détenue sur le vendeur par une société sise dans un paradis fiscal.
Les informations sont transmises à TRACFIN.
Le service constate que ce procédé de transfert apparent de propriété d'un bien immobilier ne permet pas de déterminer réellement les ayants droit économiques, dans la mesure où l'essentiel des actes de constitution de la société et d'établissement de la créance est réalisé dans des paradis fiscaux. La construction juridique du financement rend, par ailleurs, possible le règlement de la transaction en dehors de la vue du notaire.
L'enquête de TRACFIN conduit cependant à établir que la société sise dans un paradis fiscal, représentée chez le notaire par un simple mandataire, appartient à une personne physique déjà impliquée dans une procédure de blanchiment d'argent, ouverte dans un pays membre de l'Union européenne.
La société française est, quant à elle, détenue par un holding immatriculé en Suisse. Ce holding est contrôlé par une personne physique également en cause dans la même procédure de blanchiment.
Le vendeur du bien immobilier de nationalité russe est lié à la mafia russe, tandis que le représentant de la société française entretient des relations avec la mafia italienne.
Indices :
- paiement en dehors de la vue du notaire ;
- société sise dans un paradis fiscal.
Source : TRACFIN.
Certaines professions se distinguent par un nombre de déclarations très faible, alors même que leur secteur d'activité est très exposé à des opérations de blanchiment.
a) Le silence des marchés financiers face à l'utilisation dévoyée des produits dérivés
Alors que ces professionnels sont soumis depuis longtemps aux obligations de vigilance (1990 pour les anciennes sociétés de bourse, 1996 pour les autres professions), leurs déclarations de soupçon restent excessivement faibles (à peine plus de 1 % du total pour les entreprises d'investissement, en moyenne, entre 1996 et 2000).
Ce constat est d'autant plus inquiétant qu'il est avéré que les marchés financiers fournissent des possibilités de blanchiment variées et difficilement détectables pour les autorités de place.
Si le GAFI avait attiré l'attention sur cette technique sophistiquée de blanchiment dans son rapport sur les typologies dès février 1999, les investigations de la Mission n'ont pu que confirmer ces appréhensions.
Les produits financiers dérivés :
une possibilité de blanchiment de premier ordre
A l'occasion de réunions récentes du GAFI, on s'est interrogé sur la vulnérabilité apparente des marchés des instruments dérivés et des valeurs mobilières au blanchiment de capitaux. Dans le cadre de la contribution écrite d'un membre, un document a été établi sur la question et diffusé aux experts. D'après ce document, il y a de bonnes raisons de soupçonner le blanchiment de capitaux de constituer une menace substantielle sur ces marchés. Par rapport aux banques, les marchés dérivés et les produits associés offrent peut-être de meilleures perspectives de blanchiment en raison de la facilité de brouillage du contrôle et du suivi des opérations. En effet, tout produit soumis à des décisions commerciales rapides, des transferts à grande vitesse, une difficulté de contrôle ou une complexité du contrôle et suivi des opérations, présente des risques. Les opérateurs sur ces marchés tendent à être moins sensibilisés à la lutte anti-blanchiment que le personnel des banques. On dispose aussi d'éléments - le cas de la BCCI en est un bon exemple - qui montrent la disposition des criminels à faire appel aux produits financiers pour leurs opérations de blanchiment.
Par sa complexité, le marché dérivé présente une possibilité de blanchiment de premier ordre. Les instruments dérivés sont des titres dont la valeur est déterminée par un autre instrument financier ou actif lui servant de support ; ils n'ont pas en soi de valeur intrinsèque. Il y a trois grands types de contrats dérivés : les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme normalisés et les options. En termes simples, tous ces instruments sont des contrats vendus à titre de couverture contre des risques futurs de fluctuations des prix de marchandises, de décalages dans le temps, de taux d'intérêt, de taux d'imposition, de cours de change, etc. Par la souplesse de ces produits, le marché dérivé est particulièrement intéressant pour des opérateurs prêts à subir de lourdes pertes. L'ampleur du volume de l'activité sur le marché est essentielle pour assurer la liquidité qui fait la réputation de ces marchés. Les modalités de négociation des instruments dérivés et le nombre d'opérateurs sur le marché font qu'il est possible de brouiller le lien entre chaque nouvel intervenant et l'échange initial. Aucun maillon de la série de transactions n'est certain de connaître l'identité de la personne intervenant au-delà de celle avec laquelle il traite directement.
Les marchés dérivés n'ont jamais été soumis à une surveillance stricte de la part des autorités de tutelle, car on considérait que leurs opérateurs, en tant qu'investisseurs à haut risque, n'ont pas besoin de la même protection que des petits épargnants. L'introduction de mesures de contrôle plus rigoureuses pousserait nécessairement les investisseurs à se reporter sur de tels marchés dans d'autres juridictions. Par crainte d'effrayer les investisseurs, rien n'est donc prévu pour inciter les opérateurs de ce marché à se poser trop de questions. L'absence de contrôle rigoureux par les pouvoirs publics rend ces marchés dérivés d'autant plus intéressants pour les blanchisseurs de capitaux. »
GAFI, rapport sur les typologies 1998-1999 - 10 février 1999, p. 14.
A cet égard, la séance de travail organisée pour la Mission par l'Inspection de la Commission des opérations de bourse (COB) le 23 février 2000, sur l'utilisation des produits dérivés aux fins de blanchiment, fut particulièrement édifiante.
Pour une opération de recyclage d'argent sale, déjà introduit dans le système bancaire via un établissement offshore peu scrupuleux, les produits dérivés présentent de nombreux avantages :
- la rapidité et la multiplication des opérations rendent difficile la reconstruction logique du processus ;
- l'ampleur des volumes financiers traités permet de dissimuler plus facilement des pertes ou des gains de grande envergure ;
- les modalités de négociation permettent de cloisonner les différentes étapes de la procédure et de compliquer l'identification des donneurs d'ordre ;
- la surveillance des autorités de tutelle est moindre que sur les autres marchés financiers, au motif que les opérateurs de produits dérivés n'ont pas besoin de la même protection que les petits épargnants.
Dans une note technique remise à la Mission et explicitée lors de cette séance de travail, M. Ould Amar Yahya, ancien responsable de la surveillance des marchés de la COB, principal concepteur de ses programmes informatiques de détection d'anomalies et lui-même mis en examen récemment pour « manipulation de cours, délit d'initié et blanchiment aggravé en bande organisée », a fait la démonstration qu'un réseau d'opérateurs avisés pouvait, en toute impunité, blanchir jusqu'à 150 millions d'euros (1 milliard de francs) grâce aux produits dérivés.
L'impossible détection des opérations de blanchiment
utilisant les stratégies d'aller et retour
M. Ould Amar YAHYA, responsable de la surveillance des marchés à la Commission des opérations de bourse (COB) : L'aller-retour est une technique connue sur les marchés financiers qui peut être renouvelée de nombreuses fois dans la journée.
A titre d'exemple, un gestionnaire domicilié dans un pays X et gérant les comptes de deux clients, l'un dans un pays Y, l'autre dans un centre offshore non coopératif (OFC), veut blanchir les fonds qui sont sur le compte du client de l'OFC en le transférant via la chambre de compensation au client domicilié dans le pays Y.
Le gestionnaire demande à une société de bourse de lui passer deux ordres successifs d'aller-retour. Il achète et revend en l'espace d'une à deux minutes, par exemple 50 contrats et quelques instants plus tard (15 minutes), il refait le même acheté/vendu de 50 contrats. Au total, le gestionnaire a effectué quatre opérations sur le marché : un achat de 50 contrats, suivi une minute après d'une vente de 50 contrats et 15 minutes plus tard d'un achat de 50 contrats, suivi une minute après d'une vente de 50 contrats.
Entre ces deux opérations d'acheté/vendu, le contrat CAC 40 a évolué dans un sens, soit à la hausse, soit à la baisse. L'opération perdante sera toujours allouée au client de l'OFC, tandis que l'opération gagnante sera affectée au client domicilié dans le pays Y.
Cette technique peut facilement être renouvelée jusqu'à 25 fois dans la journée. Vu de l'extérieur, les deux clients, dont les comptes sont en fait gérés par le même gestionnaire, sont indépendants l'un de l'autre. L'un spécule sur la hausse de l'indice, l'autre sur la baisse.
Le client du pays Y a gagné face à la chambre de compensation la somme à blanchir, sans qu'à aucun moment, n'apparaisse de lien entre lui et le client de l'OFC. Il recevra son paiement de la chambre de compensation. Le dépôt de garantie est également blanchi.
M. Hervé DALLERAC, Chef de l'Inspection de la COB : Cela signifie que le gestionnaire de compte a une déontologie plus que moyenne puisqu'il y a une affectation a posteriori, alors que cela doit être affecté a priori.
M. Charles de COURSON, Député : Pouvez-vous détecter ce type d'opération ?
M. Hervé DALLERAC : Il est impossible de le faire au quotidien, pour chaque intermédiaire. Cela peut se faire dans le cadre de contrôles spécialisés ou d'enquêtes particulières de la Commission bancaire ou du Conseil des marchés financiers. Plusieurs institutions sur la place sont en mesure de le détecter, mais il faut effectuer un contrôle sur place.
M. Charles de COURSON : Les gestionnaires de portefeuille qui affectent, a posteriori de façon à faire perdre de l'argent à un client qui veut blanchir, sont des pratiques courantes.
M. Ould Amar YAHYA : Ce cas est celui d'un gestionnaire de fortune qui réside aux Iles Caïman. On le détecte parce que l'on constate, dans la journée, qu'il n'a rien gagné ni rien perdu. Il a passé sa journée à faire des aller-retour. A l'époque, l'intermédiaire nous a répondu qu'il ne faisait que recevoir des ordres et les exécuter sur le marché. Il n'exerce aucun contrôle et ne peut passer son temps à éplucher la cohérence des ordres qu'il reçoit.
Même si le contrôleur interne a constaté ce manège pour chaque opération, l'intermédiaire peut lui répondre que tel client lui amène beaucoup de courtages. Le contrôleur interne va-t-il dénoncer le client parce qu'il ne gagne pas d'argent ou qu'il en perd ?
M. Hervé DALLERAC : Les systèmes de contrôle interne sont à même de détecter ce genre de pratiques systématiques et de s'interroger. En soi, ce n'est pas irrégulier. Si un établissement commercial a un client qui lui passe beaucoup d'opérations et lui apporte un chiffre d'affaires, il peut soit s'étonner de l'activité de son client et en rester là, soit en aviser l'autorité. [...]
M. Ould Amar YAHYA : Il ne faut pas non plus oublier la position du chef d'établissement. Vous avez, d'une part, celui qui rapporte de l'argent et, d'autre part, le contrôleur interne. C'est une situation difficile pour la hiérarchie. Le dilemme est là.
De plus, le contrôleur interne ne reçoit pas souvent de la banque quantité de moyens pour déceler les différentes transactions anormales. Chez certaines banques, le volume de transactions est énorme. Si un contrôleur interne ne dispose pas des audits adéquats ou de critères intelligents, il passe à côté de beaucoup de choses.
M. Hervé DALLERAC : Pour avoir une vue d'ensemble intéressante, il faudrait que le contrôleur interne puisse faire une analyse précise des intermédiaires avec lesquels travaillent ses traders. Souvent les contrôleurs internes vérifient que les opérations restent dans les limites et avec des intermédiaires autorisés, mais ils ne connaîtront pas le nom du client.
Il faudrait qu'il puisse constater que c'est toujours le même client qui est derrière toutes les opérations d'aller-retour. Dans de grands établissements de crédit très spécialisés sur les opérations de marché, comme par exemple la Société générale, il est extrêmement difficile de détecter quotidiennement les opérations récurrentes.
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Au cours de cette même séance, M. Yahya a détaillé une simulation de blanchiment, d'un montant de 150 millions d'euros ou 1 milliard de francs, reposant sur la stratégie « en delta neutre ».
Cette stratégie apparaît comme étant la plus efficace dans la mesure où elle supprime tout risque de pertes, où les limites de volume d'échange sont les moins contraignantes et où les possibilités de détection du caractère frauduleux de l'opération semblent négligeables, du fait même de l'intervention simultanée sur plusieurs marchés (contrats Futures, options sur Indices, paniers d'actions).
Blanchir jusqu'à 150 millions d'euros en une journée
M. Ould Amar YAHYA : Abordons maintenant la stratégie la plus intéressante qui permet de blanchir un milliard de francs par jour, sans que cela soit détecté. Cette stratégie, appelée stratégie en delta neutre, rentre dans la normalité du marché. Elle consiste à prendre position sur différents instruments financiers qui peuvent évoluer en sens contraire, de telle sorte que, quelle que soit la configuration, on ne gagne rien et on ne perde rien.
M. le Président : Tenez-vous compte de vos seuils d'alerte quand vous évoquez la somme d'un milliard ?
M. Hervé DALLERAC : Un milliard ne se détecte pas, eu égard au volume des opérations du jour.
Analyse technique d'une opération reposant sur des interventions combinées sur les trois marchés d'options (CAC 40 - Futures CAC 40 - Règlement mensuel) par M. Yahya.
M. le Président : Les opérations que vous nous décrivez, sont relativement techniques. Quelles sont les organisations criminelles qui, aujourd'hui, ont l'expertise suffisante pour procéder à ce genre d'opération et où trouvent-elles cette expertise ?
M. Ould Amar YAHYA : Lorsque les organisations criminelles s'intéressent à un marché, ce n'est pas pour faire du gain honnête, mais pour truquer son fonctionnement. Quand elles s'intéressent à la finance, elles vont acheter des banques ou avoir des représentants dans ces banques. C'est la porte d'accès à ce milieu.
M. Hervé DALLERAC : En l'occurrence, les organisations criminelles qui font ces opérations passent par des opérateurs de marché qui ont appris leur métier de trader, comme tout trader. Mais, par appât du gain, manque de déontologie personnelle, ils vont commencer à travailler avec des gens qui ont une moralité douteuse et s'intégrer à ces organisations.
M. le Président : Le point d'entrée des organisations criminelles dans le système se situe donc au niveau des traders. Quel contrôle peut-on avoir sur cette profession ?
M. Hervé DALLERAC : Beaucoup de jeunes arrivent sur le marché et deviennent des traders. Dans le métier de trader, le problème est que, très jeune, on gagne beaucoup d'argent. La mentalité de trader est très particulière. Certains traders veulent gagner encore plus d'argent et vont travailler dans les maisons qui les paient beaucoup et qui les paieront encore plus, peut-être parce qu'ils ne font pas preuve d'une déontologie à toute épreuve.
M. Charles de COURSON : Quel est le risque pour le trader ?
M. Hervé DALLERAC : Il y a le gestionnaire qui prend les positions et qui connaît son métier. Le trader de la société de bourse reçoit les ordres et les exécute. A la limite, l'ordre vient de n'importe quelle banque et le trader de la banque lui-même peut vouloir décrocher une affaire. Mais quelqu'un d'autre, encore en amont, a prévu les opérations et sait de quelle banque cela va venir et où cela va aller. C'est à ce niveau que l'on peut trouver la personne à la moralité douteuse, mais ce sont des opérations qui viennent du marché.
M. le Président : C'est un constat terrible de ne pas pouvoir détecter un milliard par jour. Peut-être faut-il être fataliste et considérer que c'est un épiphénomène dans un système financier qui a d'autres qualités par ailleurs. Comment éviter cela ?
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Clairement évoquée par ces deux éminents spécialistes, l'infiltration des marchés financiers par des organisations criminelles n'est plus à exclure. Cet état de fait ne peut que souligner la gravité des carences des marchés en matière de déclaration de soupçon et renforcer la volonté du législateur de faire respecter la loi, si nécessaire en pénalisant le manquement manifeste aux obligations de vigilance.
La « discrétion » des sociétés de bourse
M. le Rapporteur : J'ai, sous les yeux, la loi de 1990, qui dispose que tous ceux qui conseillent ou procèdent à un mouvement de capitaux sont soumis à la déclaration de soupçon. Comment les sociétés de bourse et les autres intermédiaires financiers non bancaires appliquent-ils cette obligation légale ?
M. Hervé DALLERAC : Lorsque j'étais chef de l'Inspection de la Bourse de Paris nous tenions régulièrement, avec les responsables du contrôle interne, des réunions auxquelles nous avons invité, à deux reprises au moins, des représentants de TRACFIN pour exposer l'obligation des sociétés de bourse à l'égard de TRACFIN.
Pour autant, je sais que les sociétés de bourse font très peu de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN. TRACFIN, de son côté, déplore beaucoup ce manque de réactivité des sociétés de bourse. Tout ceci est difficile à analyser. Je n'ai pas une idée parfaitement précise des raisons pour lesquelles les sociétés de bourse n'envoient pas de déclarations de soupçon à TRACFIN.
Il me semble que la première raison est un défaut culturel. Elles sont issues de sociétés d'agents de change qui avaient une culture de la discrétion.
Tout ce que l'on vous a exposé démontre aussi une relative banalisation des opérations qui n'amène pas les sociétés de bourse à être nécessairement les plus vigilantes et les mieux à même d'observer les grands mouvements financiers. En effet, le blanchisseur va répartir ses opérations de façon à ne pas être détecté. Je crains que beaucoup d'opérations ne puissent être détectées par les sociétés de bourse. [...]
M. Ould Amar YAHYA : Il est très difficile de demander à un établissement de pratiquer l'auto-surveillance ou auto-contrôle. Cela ne fonctionne pas.
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
b) L'aveuglement durable des assurances
Avec moins de 4% de déclarations de soupçon sur la période 1996-2000, le taux de participation des compagnies d'assurance peut encore être considéré comme « inférieur à son potentiel », ainsi que l'écrit élégamment TRACFIN dans son rapport d'activité 2000.
Dans son rapport annuel portant sur l'année 1999, la Commission de contrôle des assurances a aussi souligné l'insuffisante prise de conscience des assureurs de la vulnérabilité de leurs produits au blanchiment.
La Commission a ainsi évoqué des « anomalies » détectées lors de contrôles sur place dans ce domaine (absence d'identification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, vérifications lacunaires lors du paiement par chèque de gros montants, absence de désignation d'un correspondant TRACFIN). Elle a aussi relevé l'insuffisante application concrète du mécanisme de la déclaration de soupçon, faute d'implication des dirigeants de certains grands groupes.
Les représentants des sociétés d'assurance ont ainsi fait preuve d'une sérénité inébranlable devant la Mission. Aux yeux des professionnels de l'assurance en effet, les obligations de vigilance contre le blanchiment relèvent d'abord des autres professions financières.
Le blanchiment, c'est les autres
M. Claude FATH, Président du Groupement Assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : Le fonctionnement même de l'assurance vie en fait sans doute l'un des vecteurs les moins intéressants pour blanchir des capitaux. Si vous aviez à blanchir de l'argent d'origine douteuse, je ne pense pas que vous choisiriez le système de l'assurance vie. En effet, les sociétés d'assurance vie déclarent, à la fin de chaque année, de façon nominative, toutes les sommes sorties de leurs caisses. C'est une obligation qui incombe aux sociétés d'assurance et pas aux autres intervenants du marché financier. Nous établissons un imprimé fiscal unique sur lequel nous déclarons toutes les sommes et les plus-values attachées à ces sommes, versées au cours de l'année à un assuré quelconque. Enfin, tous les contrats d'assurance sont nominatifs. [...]
Regardons le fonctionnement pratique de la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie. Pour qu'il y ait un contrat d'assurance vie, il faut un souscripteur, un assuré, ce n'est pas nécessairement la même personne, et il faut un paiement. Tout est nominatif ; l'identité du souscripteur et de l'assuré (date de naissance, lieu de naissance, etc.) est précisée. Il faut un paiement. Aujourd'hui, ce paiement ne peut pas être fait en espèces, sauf dans la limite de droit commun du paiement en espèces de 20 000 F.
En matière de contrôle et de déclaration de soupçon, il y a en amont l'établissement bancaire ou l'établissement financier. Si le paiement est effectué par chèque, c'est à l'établissement bancaire qu'il appartient de faire les vérifications sur l'origine des fonds, et non pas à la compagnie d'assurance. [...]
Le rapport de TRACFIN constate qu'il y a peu de déclarations de soupçon en provenance des sociétés d'assurance et sous-entend qu'elles ont donc manqué de vigilance. Si c'est le cas, il devrait alors être facile, sur tout ce que nous aurions laissé échapper, de nous citer quelques exemples.
Nos relations avec TRACFIN sont peu fréquentes. On peut rencontrer des gens, mais ce n'est pas organisé. Je n'ai pas d'opinion sur l'activité de TRACFIN, mais si TRACFIN en a une sur la mienne, je serais tout à fait prêt pour qu'au niveau institutionnel, c'est-à-dire entre nos organisations, il y ait des échanges approfondis et que l'on passe du concept intellectuel du montage que l'on pourrait utiliser pour faire quelque chose de frauduleux, au cas pratique. Je ne demande pas mieux que l'on me mette en face des réalités, s'il y en a.
Extrait de l'audition de M. Claude Fath, Président du groupement assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), devant la Mission, le 8 décembre 1999.
Depuis cette date, la profession a quelque peu rompu avec cette présentation optimiste du problème. Outre le rapport portant sur l'année 1999 de la Commission de contrôle déjà cité, certaines enquêtes internes ont fait remonter la réalité des choses. Quelques mises en examen de personnalités emblématiques de l'assurance française, dont les dirigeants du groupe Axa, MM. Claude Bébéar et Henri de Castries, le 13 juin 2001, dans le cadre de l'affaire Paneurolife, filiale d'assurance-vie luxembourgeoise, ont permis de parachever la prise de conscience.
Quant à TRACFIN, il répondait aux souhaits du Président Fath, dès son rapport d'activité 2000, en évoquant les cas pratiques suivants :
L'utilisation concrète de l'assurance-vie
aux fins de blanchiment
Conversion d'espèces en contrat d'assurance-vie
Une personne souscrit un contrat d'assurance-vie et paie la prime en espèces, en déposant celles-ci sur le compte de la filiale bancaire de la compagnie d'assurance. Lors de la souscription, l'intéressé déclare être gérant de société et que les fonds proviennent de commissions versées en dessous de table. Le bénéficiaire du contrat est inconnu, une clause testamentaire qui l'identifie ayant été déposée chez un notaire.
L'enquête de TRACFIN révèle que la seule société, dont l'individu en cause était le gérant, a été dissoute pour insuffisance d'actif dix ans auparavant et que, de surcroît, il ne dispose pas de revenus suffisants permettant de justifier la possession des capitaux investis. Cette personne est en outre sous le coup d'un mandat d'arrêt pour divers délits, commis en bande organisée.
Cette affaire met en évidence l'utilisation des produits d'assurance-vie comme vecteurs potentiels de blanchiment d'argent. Une telle opération pouvait, en l'occurrence, être détectée à la fois par la banque filiale de la société d'assurance, mais aussi par cette dernière, du fait notamment de l'opacité de l'identité du bénéficiaire.
Immobilier et assurance-vie
Le compte courant d'une personne, agissant comme prête-nom pour un tiers, est alimenté par des chèques en sommes rondes et des versements en espèces, ainsi que par des virements en provenance d'une société établie à l'étranger. Ces fonds sont ensuite investis en produits d'assurance-vie et dans l'immobilier. L'enquête démontre, par différents indices tangibles, que l'individu concerné agit pour le compte d'un réseau de proxénétisme, lequel fait l'objet d'une information judiciaire. En outre, toutes les personnes apparaissant dans le dossier sont déjà connues pour diverses infractions financières. Les procédés de blanchiment utilisés sont des classiques du genre.
Extrait du rapport d'activité 2000 de TRACFIN (p. 31).
On mentionnera aussi la survivance des bons de capitalisation anonymes qui peuvent être souscrits sans divulgation de l'identité du souscripteur ou du porteur, ce qui facilite le blanchiment comme le montre l'exemple ci-après.
Les bons de capitalisation anonymes recyclaient
le produit du trafic de stupéfiants
Des mouvements inexpliqués sont apparus sur les comptes bancaires des membres d'une même famille. En effet, les comptes épargne de cette famille ont tous été soldés le même jour, soit par des retraits espèces, soit par des chèques de banque destinés à des notaires. Parallèlement, l'établissement bancaire concerné a reçu une réquisition judiciaire visant les comptes du père dans le cadre d'une procédure pour trafic de stupéfiants.
La banque a signalé à TRACFIN les mouvements opérés sur les comptes de la famille en cause, dont la police n'avait pas connaissance (les comptes considérés étaient restés en sommeil quelques années).
Un autre établissement de crédit a émis une nouvelle déclaration de soupçon, son attention ayant été appelée sur des mouvements anormaux affectant un compte ouvert par le père de la famille.
L'analyse dudit compte a mis en évidence l'émission de deux chèques au bénéfice d'une compagnie d'assurance. Les renseignements fournis par cette dernière ont révélé l'existence d'un vaste réseau de blanchiment.
D'importants placements en espèces sur des bons de capitalisation et autres produits d'assurance-vie avaient été réalisés au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire pour trafic de stupéfiants quelques années auparavant. Ces placements avaient été réalisés par l'intermédiaire d'autres membres de la famille ou de l'entourage des personnes connues pour trafic de stupéfiants.
Ces éléments ont permis de présumer du recyclage direct des espèces issues du trafic de stupéfiants par le biais de bons anonymes.
Indices :
- mouvements bancaires concomitants à une procédure judiciaire ;
- utilisation de comptes de proches pour écouler des espèces ;
- placement sur des produits anonymes (bons de capitalisation) et d'assurance par l'intermédiaire de prête-noms.
Source : TRACFIN.
Poussée dans ses derniers retranchements, la Fédération française des sociétés d'assurances s'est décidée à mener une enquête approfondie et à proposer des recommandations à ses mandants, adoptées lors de son Assemblée générale du 17 décembre 2001.
Les sept résolutions vertueuses des sociétés d'assurances
1) « Les sociétés membres de la Fédération s'engagent à être particulièrement vigilantes :
- lors de la souscription de contrats donnant lieu à des versements en espèces ou quasi-espèces (chèques de banque, chèques de notaire, chèques endossés...) ;
- lors de la souscription de contrats ou bons de capitalisation placés sous le régime fiscal de l'anonymat. »
2) « Les sociétés membres de la Fédération conviennent de s'assurer que les courtiers d'assurances avec lesquels elles sont en relations s'engagent par écrit auprès d'elles qu'ils respectent strictement les obligations en matière de lutte contre le blanchiment. »
3) « Les sociétés membres de la Fédération s'engagent à veiller avec une particulière attention au respect de l'application des dispositions des articles L. 563-3 et L. 563-4 du code monétaire et financier et notamment à la constitution d'un dossier justifiant la non-déclaration à TRACFIN de l'opération par l'entreprise concernée. »
Exposé des motifs :
L'article L. 563-3 du code monétaire et financier prévoit que toute opération importante dont le montant est supérieur à 150 000 euros (1 million de francs) et qui, sans entrer dans le champ des obligations de déclaration à TRACFIN, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'entreprise d'assurance d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'entreprise d'assurances dans les conditions prévues à l'article L. 563-4 du code monétaire et financier.
4) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la Fédération s'engagent à tenir formellement le registre visé à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier afin de conserver les informations que les entreprises d'assurances ont l'obligation de collecter sur l'identité de leurs clients lors de la souscription et lors du remboursement de bons de capitalisation anonymes. »
5) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent, lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, à vérifier l'identité du souscripteur dès le premier franc en relevant le numéro d'une pièce d'identité. »
Observation :
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification (article A. 310-6 du code des assurances).
6) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent à vérifier systématiquement l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lors du paiement de la prestation, sauf lorsque le paiement est effectué sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. »
7) « Les sociétés d'assurance-vie et de capitalisation membres de la FFSA s'engagent à examiner systématiquement les renonciations et rachats qui interviennent rapidement après la souscription lorsque, notamment, les clients ne se préoccupent pas des conséquences financières ou fiscales de ces opérations. »
Extrait de l'Assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA), du 17 décembre 2001.
Ces résolutions, certes tardives, vont dans le bon sens, d'autant qu'elles semblent s'accompagner d'un regain d'intérêt des sociétés d'assurances pour la déclaration de soupçon. Ces dernières sont ainsi passées de 54 en 2000 à 161 en 2001, soit un triplement.
Elles doivent toutefois véritablement rentrer dans les m_urs des sociétés d'assurances et des courtiers, ce qui pose la question de l'autorité de l'organisme professionnel sur ses mandants.
Les limites de la « confraternité vigilante »
M. le Président : Merci beaucoup pour ces propos introductifs qui sont rassurants. Vous avez évoqué ces recommandations. Les professionnels de l'assurance ne disposent pas, comme les experts-comptables ou comme les avocats, d'un ordre. Quels sont les moyens que vous avez de contrôler le suivi de vos recommandations ? Quelles sont les éventuelles sanctions dont vous disposez ?
M. Claude FATH : Nous ne disposons pas d'un ordre, c'est vrai. Il existe des ordres d'experts-comptables, d'avocats, de médecins, dentistes, etc. Tout professionnel qui contrevient aux règles de son ordre peut faire l'objet de sanction. On peut radier un avocat, exclure un médecin. Mais ce sont des mesures extrêmes. Il faut déjà qu'il ait commis bien des choses peu convenables pour en arriver là.
La Fédération a quand même des moyens à sa disposition. Nous pouvons rappeler une société adhérente qui ne respecterait pas nos recommandations à son devoir de respect. Nous pouvons aller jusqu'à l'exclusion de la Fédération - c'est prévu dans nos statuts - d'une entreprise d'assurance qui ne respecterait pas nos recommandations. Tout comme nous pouvons ne pas admettre une société d'assurance à la Fédération, quand nous considérons que ses dirigeants, sa solvabilité, ou sa politique ne nous inspirent pas confiance.
Vous avez connu un exemple qui vous a amenés à légiférer cette année, puisque la loi sur la sécurité financière et la protection de l'épargne est directement la conséquence de la défaillance d'une société d'assurance vie que nous avions refusé d'admettre dans notre Fédération.
La Fédération est très active et les compagnies participent à son organisation - assemblée générale, comité directeur -, à tout un ensemble d'instances, et nous nous connaissons. Si quelqu'un s'écarte des normes, on s'en explique.
M. le Président : Précisément sur cette question des mécanismes de contrôle, quels sont les moyens dont vous disposez pour assurer le suivi des recommandations ?
M. Gilles COSSIC : Les recommandations existent pour le blanchiment, mais aussi dans d'autres domaines. Il y a tout d'abord une confraternité vigilante qui amène éventuellement certains assureurs à dénoncer les pratiques d'autres assureurs. Ils savent qu'en s'adressant à l'organisme professionnel, la confidentialité de la diffusion de l'information au niveau de la profession est garantie. Simplement, on intervient auprès des sociétés concernées. Le degré extrême est celui de l'exclusion. Depuis que je suis dans cette profession, cela n'est arrivé qu'une fois. En effet, une société, à maintes reprises, n'avait pas respecté les recommandations.
C'est surtout par le biais des assureurs eux-mêmes que nous sommes informés de choses qui relèvent du respect de la déontologie. A ce moment-là, on intervient auprès de la société, au niveau de la direction générale, et cela redescend assez vite. Une observation de la profession a une vraie valeur parce que nous parlons de la même chose. Parfois c'est plus rapide et plus efficace qu'un texte théorique qu'il faudrait un jour appliquer. Une société mise en cause fait l'objet d'une intervention de la profession et, généralement, la situation est redressée très rapidement.
Extrait des auditions de M. Claude Fath, Président du groupement assurances de personnes à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et de M. Gilles Cossic, adjoint du directeur, devant la Mission, le 8 décembre 1999.
On le voit, cette culture de « l'entre-soi » n'est guère propice à la mise en place de sanctions adaptées et dissuasives qui réprimeraient efficacement tout manquement aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon.
La lenteur avec laquelle les professions financières ont commencé à remplir convenablement leurs obligations de vigilance contre le blanchiment, malgré les précautions prises par le législateur en 1990, le fait que certaines d'entre elles y demeurent encore étrangères, témoignent d'une application difficile de la loi.
Ces obligations ne sont toujours pas acceptées aisément par la communauté financière qui saisit toute occasion pour les remettre en cause ou en atténuer la portée. Il faut reconnaître que l'institution d'une coopération obligatoire et systématique des professions financières avec les services d'enquête de l'Etat constituait une véritable révolution culturelle pour ces corporations et que la conception élargie des obligations de vigilance adoptée par le législateur français a encore accentué la portée du choc ressenti.
1.- Le traumatisme de la levée du secret professionnel
Toutes les professions progressivement assujetties aux obligations de vigilance exercent leur activité dans la discrétion. Cette confidentialité est un fondement de leur déontologie et de leur compétitivité.
Pour nombre d'entre elles, la loi protégeait même ce secret professionnel en punissant de peines correctionnelles sa violation. Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »
Le législateur accorde une importance telle à ce secret professionnel qu'il prévaut sur l'obligation de dénoncer un crime ou un délit en préparation, prévue à l'article 434-1 du code pénal.
Cette position forte du secret professionnel reflète une volonté de protection des informations détenues par certaines professions et qui relèvent, pour la plupart, de la vie privée, de l'intimité de la personne et, finalement, de la liberté individuelle.
Pour prendre l'exemple de la profession bancaire, la loi bancaire ne tolère que de rares dérogations à la protection du secret professionnel.
Seules l'administration fiscale, les Douanes, la Banque de France, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, et l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, bénéficient de ces dérogations.
Le fait que cette nouvelle inopposabilité instituée au profit de TRACFIN s'accompagne d'une obligation d'initiative et de participation active aux enquêtes menées par les services de l'Etat, a donc créé un traumatisme.
Eriger les professions financières en auxiliaires de justice constituait une sérieuse gageure, surtout dans un pays qui a toujours allègrement pratiqué la dénonciation anonyme, tout en rejetant massivement l'institution de procédures officielles de coopération avec les services répressifs.
Transformer certains citoyens en auxiliaires temporaires de la justice à raison de leurs fonctions n'était toutefois pas une idée radicalement nouvelle. L'ensemble des fonctionnaires est ainsi théoriquement soumis à l'obligation de déclarer au procureur de la République des faits pénalement qualifiables (article 40 du code de procédure pénale), de même que les commissaires aux comptes depuis un décret-loi de 1935. Faute de sanctions, ces dispositions demeurent toutefois peu appliquées.
Il faut bien avouer que la mentalité française n'est pas spontanément favorable à cette forme de civisme et qu'il faut déployer beaucoup de pédagogie et s'entourer de beaucoup de précautions pour convaincre du bien-fondé de cette politique. Les réactions épidermiques à l'expression « déclaration de soupçon », souvent fondées sur un rapprochement hâtif, scandaleux et indécent avec la période de l'Occupation et l'appel à la délation des ennemis du IIIème Reich, en témoignent.
Les avocats hostiles à la « délation »
Mme Dominique de LA GARANDERIE : Et c'est bien là qu'est le danger. C'est prendre un risque considérable que de vouloir imposer à un avocat, dont le métier est précisément d'avoir un rapport de confiance, de se défier et de rechercher tous les éléments de défiance, or telle est la logique du soupçon.
Puis vient la dénonciation, que nous considérons comme de la délation. Si nous acceptons la délation sur le seul fondement d'un soupçon, il n'y a plus de limite. Le blanchiment ne justifie pas à lui seul qu'on puisse franchir ces deux étapes. La délation ne peut être admise.
Certes, nous pourrions faire comme nos confrères chinois qui expliquent qu'ils ne trahiront jamais leur secret professionnel en leur qualité d'avocat, mais qu'ils iront, en tant que citoyens, dire à la police ce qu'ils ont entendu...
Cette culture n'est pas la nôtre. Nous savons aussi, sans vouloir agiter des moments pénibles de notre histoire, ce qu'ont représenté les périodes de délation.
Il y a un point qui ne peut pas être atteint pour nous, c'est celui de la dénonciation. Il n'en est pas question. Ceux qui voudraient l'imposer prendraient un très gros risque pour notre démocratie.
Extrait de l'audition de Mme Dominique de La Garanderie, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, devant la Mission, le 17 novembre 1999.
Au-delà de la rhétorique parfois convenue, il faut prendre en compte la réalité psychologique de la rupture imposée à ces professions. La réaction purement affective de Mme de la Garanderie à la question précise du Président de la Mission lui demandant les raisons qui justifieraient le maintien absolu du secret professionnel de l'avocat, illustre pleinement la difficulté à faire évoluer les mentalités de certains professionnels.
Le maintien du secret professionnel de l'avocat
pour des raisons affectives
M. le Président : Nous sommes très sensibles à la défense que vous faites de votre secret professionnel, notamment lorsque vous évoquez, à travers sa remise en cause, une remise en cause des principes mêmes de la démocratie. Cela ne peut pas nous laisser insensibles, vous vous en doutez bien. [...]
Vous avez parlé de délation et évoqué des périodes sombres de l'histoire. Je m'étonne ! Prenons les notaires : on peut considérer que la confiance est également nécessaire dans la relation du notaire avec son client et qu'ils seraient fondés, de ce point de vue, à avoir des réticences. Les banquiers peuvent aussi invoquer cette notion de confiance. [...]
Ces professions ne peuvent être accusées - ce que vous faites indirectement -d'entamer un processus de remise en cause des principes démocratiques, en se laissant aller à des attitudes profondément négatives.
Je voudrais donc, plutôt que d'être négatifs à l'égard de la déclaration de soupçon, que vous soyez plus positifs par rapport à la nature particulière de votre secret et que vous soyez capables de nous dire pourquoi il y aurait un glissement préjudiciable, si on distinguait la défense et le conseil. [...]
Je voudrais que vous nous disiez pourquoi la nature de votre exercice professionnel, y compris dans une activité exclusive de conseil, suppose de maintenir ce secret - autrement qu'en invoquant ce seul élément qu'est la notion de confiance -, car la confiance n'existe pas que dans votre profession.
Mme Dominique de LA GARANDERIE : Poser ce genre de question, c'est comme demander à quelqu'un pourquoi il veut avoir un enfant. Y a-t-il une réponse ?
Cela peut vous paraître surprenant, mais il est vrai que l'avocat est à ce point impliqué dans sa relation d'intimité avec son client, qu'il ne se pose plus la question.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de Mme de La Garanderie, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, le 17 novembre 1999
Cette rupture peut aussi porter sur le sens même du métier exercé.
S'agissant de la banque, la vigilance s'est toujours exercée à l'endroit des clients économiquement douteux, à la solvabilité déficiente, mais plus rarement à l'encontre de déposants fortunés ou d'opérations fructueuses en commissions diverses.
Si la logique traditionnelle du métier bancaire a pu conduire à s'interroger sur l'origine des actifs confiés afin d'évaluer leur solidité et leur pérennité, elle a rarement entraîné des refus de clientèle pour ce seul motif. Les professions financières doivent donc acquérir de nouveaux réflexes dans l'exercice quotidien de leur métier, ce qui passe par des programmes approfondis et systématiques de formation continue.
2.- L'exigence de définition précise des obligations de vigilance
Même lorsqu'elles acceptent le principe des nouvelles obligations qui leur sont imposées, les professions financières ont tendance à déplorer l'insuffisante précision de leur définition.
Elles demandent périodiquement une redéfinition de ces obligations, fondée exclusivement sur des critères objectifs et incontestables.
Une telle exigence, dont on peut comprendre la justification, ne saurait être pleinement exaucée puisqu'elle prend le contre-pied de la volonté même du législateur qui, en adoptant une définition élargie des obligations de vigilance, notamment via la déclaration de « soupçon », a souhaité susciter une démarche active des professions financières dans ce combat, en leur laissant une marge importante d'appréciation et d'évaluation des situations.
Même si la loi ne l'utilise pas, puisqu'elle évoque des « sommes qui pourraient provenir d'activités criminelles organisées ou du trafic de stupéfiants », le terme de « soupçon » cristallise ainsi les oppositions.
Outre son voisinage avec la délation, on reproche au soupçon son caractère subjectif ou la tournure d'esprit qu'il impose constamment dans les relations avec la clientèle.
Pour Mme de La Garanderie par exemple, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, le « soupçon » est une démarche purement intellectuelle.
« Si nous refusons absolument que l'avocat participe d'une façon quelconque, de près ou de loin, à une opération de blanchiment, faut-il pour autant que celui-ci, dans sa relation avec son client, puisse le soupçonner et transmettre un éventuel soupçon à son égard ? On passe cette fois-ci à une démarche qui est purement intellectuelle. Je ne vous renverrai pas aux définitions du dictionnaire sur le soupçon, mais on y parle de « conjectures » : on est donc très loin d'un élément objectif ou même seulement d'un début d'élément quelconque. » (Extrait de l'audition, devant la Mission, de Mme de La Garanderie, le 17 novembre 1999).
Il est avéré que la France a choisi de laisser aux professions financières une marge d'interprétation dans la définition de leurs obligations de déclaration, afin de les mobiliser davantage et de les impliquer dans un combat qui les concerne autant que les pouvoirs publics.
Cette interprétation ne conduit pas à l'arbitraire puisqu'elle est progressivement normalisée par les conseils de TRACFIN et de ses correspondants dans les différents établissements financiers ; elle présente de nombreux avantages par rapport à un simple système de déclaration automatique fondé sur des paramètres mécaniques.
La Mission souscrit donc au jugement globalement favorable porté sur ce mécanisme par MM. Dominique Garabiol et Bernard Gravet dans leur rapport au ministre de l'Intérieur de juin 2000 et qui avait aussi le mérite d'en souligner les limites en ces termes :
Quelle réponse apporter à la prise de contrôle
de certains établissements
par la criminalité organisée ?
« La déclaration discrétionnaire a l'avantage de conduire uniquement à des informations à valeur ajoutée. Il y en a donc beaucoup moins et les services sont susceptibles de procéder à leur analyse. L'inconvénient est que ce système repose beaucoup sur l'efficacité, voire parfois simplement la bonne volonté, des établissements. Il est évident qu'un établissement fortement impliqué dans des opérations suspectes aura tendance à ne pas faire montre d'une grande vigilance. Tel est aujourd'hui parfois le cas en France d'établissements détenus par des capitaux originaires de territoires jugés non coopératifs par le GAFI.
L'élément le plus important tient surtout au biais qu'introduit la déclaration discrétionnaire. En effet, pour l'effectuer, l'établissement doit avoir réuni par ses propres moyens les éléments d'un soupçon. Le dispositif a été efficace sans aucun doute pour détecter les méthodes de blanchiment laissant apparaître, à un moment donné, beaucoup de signes suspects. Les opérations de placement en numéraire sont bien suivies par un tel mécanisme et il est vraisemblable que le succès constaté dans la détection de tels dépôts et la lutte contre le pré-blanchiment y trouve une raison majeure. En revanche, le système s'est montré sans efficacité pour la détection d'empilage ou d'intégration d'argent pré-blanchi et ne constitue en rien un rempart à la prise de contrôle d'intérêts économiques licites à des fins criminelles. »
Extrait du rapport Gravet/Garabiol au ministre de l'Intérieur - « La lutte contre le recyclage de l'argent du crime organisé » - juin 2000.
Enfin, certaines professions mettent en doute le caractère concrètement applicable des obligations de vigilance et refusent absolument d'être soumises à une obligation de résultat. On pourra ainsi mettre en avant le nombre de chèques traités quotidiennement en France ou le nombre d'opérations financières (achat de titres, virements interbancaires) pour placer le débat sur le terrain concret et logistique.
Il va sans dire qu'une réponse équitable doit être apportée à ces observations, parfois légitimes, par les pouvoirs publics et notamment les organes de régulation qui doivent définir les méthodes et les procédures les plus aptes à satisfaire aux obligations de vigilance et veiller à leur application dans les établissements soumis à leur surveillance.
Afin de créer les conditions institutionnelles de cette concertation qui doit être constante entre les pouvoirs publics et les professions assujetties aux obligations de vigilance, la Mission a été à l'origine, lors de la discussion de la loi sur les nouvelles régulations économiques, de l'institution d'un comité de liaison (article L. 562-10 du code monétaire et financier), animé par TRACFIN et qui tiendra ses premières réunions dans les mois à venir.
Ce comité permettra à TRACFIN d'exposer ses attentes aux représentants des professions concernées, de les inciter à s'inspirer des bonnes pratiques constatées dans tel ou tel secteur et de les informer des suites données aux déclarations de soupçon qu'il a reçues.
D.- des sanctions insuffisantes
Il ressort des analyses précédentes que les obligations de vigilance contre le blanchiment ne sont pas encore respectées de manière satisfaisante en France, ou bien parce que certaines professions s'en sont collectivement dispensées jusqu'à présent (marchés financiers, sociétés d'assurances), ou bien parce que certains établissements, notamment parmi les moins respectables, passent à travers les mailles du filet.
La question qui se pose désormais est celle des sanctions.
1.- Les carences des sanctions administratives
La totalité des professions soumises aux obligations de vigilance plaident pour l'autorégulation et l'autodiscipline en évoquant la rigueur implacable des sanctions disciplinaires qu'elles appliquent à l'encontre des moutons noirs ou des contrevenants.
La Mission ne peut qu'exprimer son scepticisme sur l'efficacité de ce type de règlement des crises ou des cas douteux. S'en remettre exclusivement à cette solution n'est pas envisageable.
Tout d'abord, certaines professions ne font pas l'objet d'une organisation disciplinaire (ordre, organisation professionnelle) et ne seraient donc pas surveillées. Par ailleurs, on peut s'interroger sur les moyens d'investigation des ordres professionnels existants et sur leur capacité à établir la preuve de comportements déviants, même dans l'hypothèse où la volonté d'être inflexible existe, ce qui reste à établir.
Le deuxième niveau d'intervention relève des organes de régulation et des sanctions administratives. Le dispositif français de régulation, éclaté entre plusieurs organismes, couvre l'essentiel des professions financières mais pas l'intégralité des professions désormais assujetties aux obligations de vigilance (professionnels de l'immobilier, antiquaires, directeurs de casinos, etc.). De plus, ces organismes n'ont intégré qu'avec une extrême lenteur leurs obligations de surveillance des dispositifs anti-blanchiment au titre du contrôle interne des établissements et ont fait preuve d'un laxisme coupable en matière de sanctions.
Il en va notamment ainsi de la Commission bancaire à qui a été confiée la surveillance des établissements de crédit (1 150) mais aussi des succursales d'établissements communautaires (50), des entreprises d'investissement (500) et des changeurs manuels (900), en matière de lutte contre le blanchiment.
Sur un total de 2 600 organismes soumis à son contrôle, la Commission bancaire n'avait prononcé, fin 1999, que 25 sanctions dont 21 à l'encontre des changeurs manuels, 4 à l'encontre des établissements de crédit et aucune à l'encontre des entreprises d'investissement. Ces sanctions se répartissaient en 3 avertissements, 13 blâmes, 2 interdictions d'exercer et 7 sanctions pécuniaires (300 000 francs pour un établissement de crédit, alors que la sanction peut atteindre le montant du capital et 100 000 francs en moyenne pour 6 changeurs, alors que le maximum est de 250 000 francs).
La Commission bancaire n'avait transmis que 4 dossiers (portant tous sur des établissements de crédit) au Parquet.
Pour justifier ce très maigre bilan, la Commission bancaire a mis en avant la difficulté d'établir le manquement aux obligations de vigilance du fait de la complexité de leur définition législative.
Cette situation semblait plutôt relever d'une insuffisante motivation à agir de la Commission bancaire, très marquée, comme les établissements de crédit, par sa vocation d'autorité prudentielle qui venait d'être gravement mise en cause par la succession des faillites ou quasi-faillites de grands établissements bancaires du début des années 1990. Cette vocation l'incitait davantage à contrôler les risques des engagements plutôt que l'honorabilité des dépôts ou des commissions.
Au cours de ses investigations, la Mission a eu à connaître du cas de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève (BCGE). Cet établissement a fait l'objet d'une inspection de la Commission bancaire qui n'a envisagé la situation de cette banque que sous l'angle purement prudentiel, alors que l'alerte avait clairement été donnée concernant des pratiques suspectes d'octroi de prêts adossés laissant supposer l'existence possible de circuits de blanchiment.
La plainte suisse déposée pour blanchiment, en mai 2000, contre la BCGE et classée sans suite par le procureur Bertossa en novembre 2001, fait actuellement l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation. Les plaignants s'appuient notamment sur la pratique répandue du prêt adossé (dépôt de la valeur à Genève contre octroi d'un prêt de même montant à Lyon) et sur le contenu de rapports de police d'avril 2001, faisant état de renseignements défavorables concernant certains clients «transfrontaliers».
L'attitude initiale et durable de la Commission bancaire résultait davantage d'un manque de volonté que de la complexité législative. La meilleure preuve en est qu'à législation inchangée, la Commission bancaire a légèrement augmenté le nombre des sanctions en 2000 et 2001, ainsi que le nombre de dossiers transmis au Parquet (5 dossiers transmis en 2000 et 9 dossiers transmis pour la seule année 2001).
Le laxisme prolongé de la Commission bancaire (jusqu'en 2000) était d'autant moins excusable qu'elle est guidée dans ses investigations par TRACFIN qui lui fait un rapport annuel détaillé sur la façon dont les différents établissements financiers s'acquittent de leurs obligations de vigilance et qui lui signale les établissements particulièrement défaillants.
L'attitude frileuse de la Commission bancaire devrait inciter le législateur à se pencher sur la composition de son collège, qui, s'il reflète fidèlement les différents pouvoirs qui régulent la place financière dans une connivence de bon aloi, laisse peu de place à l'expression de la société réelle qui peut parfois pâtir des arbitrages rendus par cette autorité désuète. Cette réflexion accompagnera nécessairement les débats qui se tiendront prochainement sur la réforme de nos autorités de régulation financière, dont l'éclatement actuel n'est pas satisfaisant.
2.- Les nécessaires sanctions pénales
Les carences des sanctions administratives justifient l'institution de sanctions pénales.
Il s'agit d'abord, en agitant le spectre de sanctions lourdes, de manière dissuasive, de faire appliquer par l'ensemble des professions qui y sont assujetties leurs obligations de vigilance. Mais il s'agit aussi et surtout d'incriminer les établissements, acteurs ou complices de blanchiment qui, actuellement, se dispensent méthodiquement de procéder aux contrôles nécessaires pour ne pas tomber sous le coup d'une incrimination existante en prétendant ignorer l'origine illicite des actifs qui leur sont confiés.
C'est l'organisation raisonnée de la négligence crédible qui doit prioritairement faire l'objet d'une répression pénale.
De nombreux pays (notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni) se sont engagés, à des degrés divers, dans la pénalisation du manquement aux obligations de vigilance, avec des peines d'emprisonnement de 5 et 2 ans.
La Mission en a aussi reconnu la nécessité et a fait des propositions dans ce sens, tant à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, que lors de la Conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, qui s'est tenue à Paris les 7 et 8 février 2002. Si, lors de cette Conférence, la Mission a obtenu gain de cause grâce au soutien de plusieurs délégations européennes qui connaissent ce mécanisme, il n'en a pas été de même en France puisque l'Assemblée nationale, à une voix près, a refusé de suivre sa Mission sur ce point.
Lorsque la Mission ne convainc pas le Gouvernement
Mme la Présidente : Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth GUIGOU, Garde des Sceaux : Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui a pour objet de sanctionner pénalement le manquement manifeste à l'obligation de dénoncer à TRACFIN les opérations suspectes.
Je crois qu'une telle incrimination serait inutile, et d'ailleurs peu conforme à la tradition pénale française. En effet, dans l'hypothèse où ce manquement aux obligations déclaratives dissimule la participation des assujettis à une opération de blanchiment, en qualité d'auteurs ou de complices, des poursuites pénales pourront bien évidemment être engagées. [...]
Dans le cas contraire, lorsqu'une infraction pénale ne pourra être relevée, la méconnaissance par l'assujetti de ses obligations déclaratives, par suite d'un grave défaut de vigilance ou d'une carence dans l'organisation de ses procédures de contrôle, ne demeurera pas impunie, puisque, aux termes même de la présente loi, des poursuites disciplinaires pourront être engagées. Il n'y aura donc pas d'impunité en cas de négligence grave, lorsque des soupçons n'auront pas donné lieu à une déclaration.
Par ailleurs, sur un plan plus général, je rappelle que la dénonciation des crimes et délits revêt traditionnellement, dans notre droit pénal, un caractère facultatif. Seule est sanctionnée pénalement la non-dénonciation des crimes et délits portant gravement atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, en l'espèce, les obligations déclaratives ne portent que sur de simples soupçons, et non sur des infractions caractérisées.
J'observe enfin que l'obligation générale de dénonciation des crimes et délits à laquelle sont assujettis les fonctionnaires et agents publics, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, n'est pas sanctionnée non plus pénalement. Il serait pour le moins paradoxal de sanctionner pénalement les organismes financiers et assimilés, simples représentants de la société civile, pour manquement à leurs obligations, alors même que les fonctionnaires qui participent à l'exercice de l'autorité publique n'encourraient aucune sanction pénale. [...]
Mme la Présidente : La parole est à M. Arnaud Montebourg.
M. Arnaud MONTEBOURG : Je suis, avec Vincent Peillon et Jacky Darne, coauteur de cet amendement. Pour quelle raison avons-nous eu l'idée...[...] de définir une nouvelle infraction pénale ?
D'abord, parce que nous faisons le constat, et, je crois, avec l'ensemble des collègues ici rassemblés, que l'organisme de contrôle disciplinaire n'a jamais fonctionné en dix ans. Voici un apport statistique assez intéressant pour notre discussion : pendant toute cette période, la Commission bancaire a prononcé trois sanctions pour 1 150 établissements de crédit soumis à son contrôle !
Je me félicite que nous ayons organisé le renforcement des fondements juridiques, d'une part, des mécanismes de contrôle de l'autorité chargée de la discipline des établissements de crédit, d'autre part. Mais j'attire tout de même l'attention de l'Assemblée nationale sur le fait que de nombreuses professions assujetties à la déclaration de soupçon et à la loi de 1990 ne sont pas contrôlées par un organisme disciplinaire. [...]
Quid des agents immobiliers ? Est-ce que ces professions, qui ne font presque aucune déclaration de soupçon, sont soumises à un contrôle disciplinaire, à des sanctions disciplinaires au titre de la loi de 1990 ? La réponse est non.
C'est la raison pour laquelle, comme huit Etats de l'Union européenne l'ont déjà fait, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg - même l'Irlande et le Luxembourg, quelle ironie ! - l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, s'il vous plaît, ont déjà prévu des sanctions pénales en cas d'absence de signalement d'une transaction suspecte. Je ne vois pas pourquoi nous nous refuserions à engager la répression sur le terrain pénal lorsque, à l'évidence, la loi est contournée, en cas de volonté de ne pas l'appliquer, de désir manifeste, répété, délibéré de contourner des dispositions dont nous venons précisément d'accroître la vigueur, la force et la portée.
Extrait du Journal Officiel, débats Assemblée nationale, séance du 27 avril 2000, p. 3423 et 3424.
Cohérente avec elle-même, la Mission réitère cette proposition dans son rapport final, même si le contexte de ce débat important au regard des principes du droit pénal est actuellement perturbé par une remise en cause de la définition française de l'incrimination de blanchiment.
Cette contestation, souvent menée dans des termes plus ou moins volontairement confus et directement reliée à une procédure judiciaire en cours (affaire dite du Sentier II), n'a pas modifié les positions de la Mission sur la pénalisation de la négligence, dans le respect des grands principes du droit pénal et, notamment, de l'intentionnalité des délits et des crimes.
La Mission a ainsi assisté, avec une grande sérénité, à une tentative d'instrumentalisation des mises en examen de certains éminents banquiers français, dont les dirigeants de la Société Générale, afin d'obtenir une modification de la définition légale du délit de blanchiment, qui répondait à d'autres finalités que le simple soutien à certaines personnalités emblématiques de la place de Paris.
Après quelques hésitations initiales, vraisemblablement inspirées par le souci de témoigner sa solidarité à ces personnalités plongées dans l'épreuve, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, M. Laurent Fabius, a convenu devant la Mission que l'affaire de la Société Générale ne légitimait pas de modification législative.
L'affaire de la Société Générale :
une clarification législative ne s'impose pas
M. Laurent FABIUS : S'agissant de la Société générale, je ne ferai aucun commentaire sur une affaire en cours de jugement. Je dirais simplement qu'il existe une imbrication de textes qui rend les obligations des uns et des autres pas très claires : les textes relatifs aux chèques fixent les obligations de vérification des banquiers avec une vocation purement civile et commerciale ; les textes relatifs à la prévention du blanchiment fixent les obligations des banquiers pour se mettre en situation de déceler les fonds d'origine criminelle ; le code pénal qualifie de blanchiment, depuis 1996, différents faits, etc. Il me paraît donc nécessaire, effectivement, de clarifier les obligations de chacun.
C'est dans cet état d'esprit que j'ai créé ce groupe de travail interministériel qui a pour objectif d'aboutir à plus d'efficacité dans la lutte contre le blanchiment. Je n'ai pas d'a priori, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire, pour procéder à cette clarification, de passer par la loi ; attendons la conclusion de ce groupe.
Avec quatre milliards de chèques émis par an, il n'est évidemment pas possible de tous les vérifier. L'objectif est de mettre en place des procédures d'alerte qui permettent aux banquiers de s'intéresser à un cas précis. Je suis certain que les dirigeants et le personnel de nos banques sont des personnes très consciencieuses, honnêtes. Nous ne devons pas transposer au domaine financier la psychologie du Dr Knock : un bien-portant est un malade qui s'ignore ; un chèque normal est un chèque frauduleux qui s'ignore ! [...]
M. le Président, Vincent PEILLON : Je voudrais revenir sur l'affaire de la Société générale, pour distinguer la question de l'application de la loi de 1996 et le problème lié aux modalités de contrôle des chèques. Certaines personnes ont demandé une révision de la loi de 1996, au motif que l'intentionnalité du délit de blanchiment n'étant pas spécifiée, cette intentionnalité n'était pas exigée. Or tel n'est pas le cas, puisqu'en application, dans notre droit, du principe général de l'intentionnalité des délits, le délit de blanchiment suppose le caractère intentionnel.
Nous n'avons pas accès au dossier de l'affaire de la Société Générale, et nous n'avons pas à contester la décision du juge ; je rappellerai simplement que ce dernier est censé connaître et appliquer le droit et donc le principe d'intentionnalité.
Enfin, en ce qui concerne le traitement des chèques, il existe, sans doute, pour nos banques, une difficulté particulière à exercer leur obligation de vigilance et la création du groupe de travail interministériel devrait permettre de clarifier ce point.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. Laurent Fabius, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le 13 février 2002.
De fait, le groupe de travail a conclu à une modification réglementaire portant sur les modalités de contrôle des chèques et à l'affirmation renouvelée de la nécessité de bien connaître les banques partenaires et correspondantes, conformément aux recommandations du GAFI, suggestions que la Mission soutient pleinement.
II.- la difficile reconstitution des flux financiers
Exiger de la société civile, via les professions soumises aux obligations de vigilance, une coopération sans faille dans la détection des anomalies financières, impose encore davantage à l'Etat une efficacité satisfaisante dans le traitement et l'exploitation de ces informations.
Bien que des avancées notables aient été constatées sur ce plan depuis l'origine du système, c'est-à-dire une petite décennie, notre dispositif national d'enquête en matière de blanchiment a encore devant lui d'importantes marges de progrès.
Dans le même temps, la France a joué un rôle moteur dans la promotion de la régulation et de la coopération internationales, notamment européennes, ce qui constitue une condition indispensable à l'efficacité de la traçabilité des opérations financières illicites et à l'identification des réseaux qui les conçoivent et les exécutent.
A.- les limites de l'investigation financière à la française
L'investigation financière se heurte, sur un plan national, à deux obstacles de poids qu'elle s'efforce de contourner, parfois difficilement :
- notre sociologie administrative qui peine à promouvoir une action interministérielle efficace et sans arrière-pensée ;
- les grands principes de notre procédure pénale qui sont peu adaptés à une action d'envergure contre les puissants réseaux de la criminalité organisée.
L'analyse de la situation actuelle montre que les différents services de l'Etat impliqués dans l'enquête financière ont peu à peu trouvé un modus vivendi en faisant preuve de pragmatisme, mais que certains points de blocage subsistent, auxquels il conviendra d'apporter une réponse rapide, sous peine de démobiliser des équipes dont les résultats globaux sont en progrès.
1.- Un foisonnement institutionnel qui impose un travail en réseau
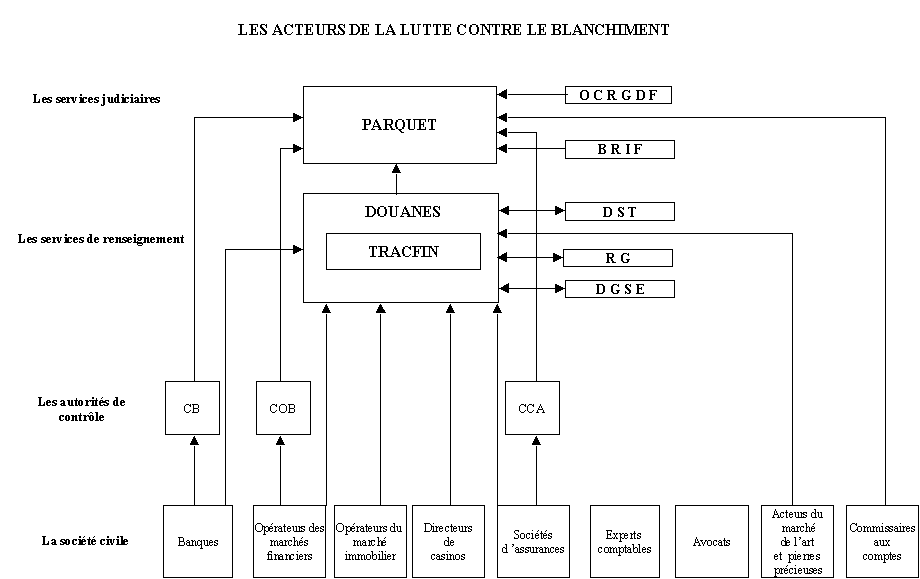
La diversité des intervenants appelle un bref résumé de leur rôle respectif dans la chaîne des pouvoirs publics qui conduit à la procédure judiciaire.
Les autorités de régulation (Commission bancaire, Commission des opérations de bourse, Commission de contrôle des assurances, Conseil des marchés financiers) vérifient que les professions qui sont soumises à leur contrôle appliquent la loi, les conseillent sur les règles de bonne conduite et les sanctionnent en cas de violation de leurs obligations.
TRACFIN est un service de renseignement financier destinataire des déclarations de soupçon. Il a pour mission de les étudier, de les filtrer, de les enrichir et de transmettre au Parquet les dossiers qu'il estime susceptibles de donner prise à une qualification pénale.
Le Parquet est le destinataire des dossiers de TRACFIN, mais aussi de l'ensemble des autres intervenants. Il définit la suite procédurale qu'il convient de donner à ces dossiers : classement sans suite, enquête préliminaire ou information judiciaire.
Les services de police judiciaire procèdent à l'enquête judiciaire.
Devant la Mission, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a précisé les compétences et les complémentarités des services administratifs et policiers de la manière suivante :
« Les services des Douanes ont une bonne perception de ce qui se passe aux frontières, la Gendarmerie nationale et la sécurité publique de ce qui se passe au niveau local, les services fiscaux de ce qui se passe en matière de fiscalité, de déclaration d'impôts. La police judiciaire, pour sa part, gère les plates-formes internationales que sont Interpol à Lyon, Europol à La Haye, Schengen à Strasbourg, mais aussi l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), qui a une vision globale de la criminalité organisée transnationale et de son fonctionnement, nous en donnant une image plus précise. Les Renseignements généraux ont également un pôle « Criminalité organisée, blanchiment » à la division « analyse et recherche financière », renforcé par des correspondants financiers installés dans chaque département, qui mènent des enquêtes d'initiative et parfois des investigations poussées. Les services de la DST disposent aussi de moyens d'analyse et opérationnels contre la menace que constituent ces flux et l'implantation sur notre sol d'organisations criminelles transnationales. Disons qu'il y a une veille, une vigilance.
Tous ces services concourent à la lutte contre la grande délinquance financière transnationale, avec des approches différentes. La multiplication des services au ministère de l'Intérieur n'est pas un inconvénient parce que des mises en commun peuvent se faire, mais néanmoins cette multiplication de services compétents peut brouiller les sources d'informations et faire perdre du temps. Il faut donc aller vers une meilleure cohésion. » (Extrait de l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, devant la Mission, le 28 octobre 1999).
Le paysage institutionnel actuel est issu des arbitrages de 1989/1990, au moment de la création de TRACFIN. Il a été décidé, à l'époque, de confier le traitement des déclarations de soupçon à un service nouveau, confié à la direction générale des Douanes du ministère de l'Economie et des Finances plutôt qu'à l'Office central de répression de la grande délinquance financière, théoriquement interministériel mais relevant clairement de l'orbite du ministère de l'Intérieur.
L'argument officiel principalement évoqué pour justifier cette décision consistait à dire qu'il ne fallait pas effrayer les professions financières en les exposant au contact direct des services répressifs et que le filtre de leur ministère de tutelle permettrait d'optimiser le rendement des déclarations de soupçon. On ne peut exclure non plus que les pouvoirs publics aient souhaité relancer le plan de charge des Douanes, ébranlées par la disparition des frontières intra-communautaires et du contrôle des changes.
En contrepartie, en refusant la « judiciarisation » de TRACFIN, les pouvoirs publics l'ont cantonné à une activité de renseignement et non d'enquête judiciaire débouchant directement sur une qualification pénale. Cet arbitrage s'est traduit par un cloisonnement qui n'a pas contribué à optimiser le « rendement » judiciaire des déclarations de soupçon et qui commence seulement actuellement à s'estomper, sous l'impulsion des responsables actuels de TRACFIN et de l'OCRGDF, comme en témoignent les propos suivants tenus devant la Mission.
La rivalité congénitale de TRACFIN et de l'OCRGDF
a mis 10 ans à s'estomper
M. Jean-Claude MARIN, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris : Il faut bien voir que TRACFIN pâtit encore de ses origines et de la lutte extrêmement forte qui y a eu lieu un temps entre le ministère de l'intérieur et celui des finances pour savoir qui hébergerait ce réceptacle de l'information financière. Les arbitrages ont été rendus au profit du ministère de l'économie et des finances. A l'époque, on a eu le bon goût de dire que c'était pour ne pas effrayer les banques, mais j'ai pourtant entendu dire que certaines étaient des indicateurs de la police.
Si TRACFIN n'a pas de pouvoir d'enquête, c'est bien parce qu'il est placé là où il est. On vit aujourd'hui une situation, que vous démentira vraisemblablement le secrétaire général si vous l'entendez, en vertu de laquelle TRACFIN effectue des para-enquêtes. Nous craignons toujours que TRACFIN aille un pont trop loin et que son renseignement soit un jour invalidé par une jurisprudence qui dira : « Pas d'enquêtes, cela veut dire pas d'enquêtes ! »
* *
*
M. le Président : Votre collaboration avec TRACFIN est-elle satisfaisante ?
M. Yves GODIVEAU, chef de l'OCRGDF : Elle est devenue satisfaisante. Il faut dire que l'on a créé deux jumeaux et ce n'était sans doute pas la meilleure chose à faire. Cela a conduit à une émulation qui n'est pas toujours très saine.
J'ai connu de l'extérieur la première période de délation permanente entre l'OCRGDF et TRACFIN, puis le calme s'est instauré et depuis mon arrivée, sans faire de plaidoyer pro domo, nous sommes arrivés, avec le secrétaire général de TRACFIN à un modus vivendi tout à fait satisfaisant.
Nous échangeons les informations de manière utile, au travers de réunions formelles ou informelles. Lorsque des dénonciations partent de TRACFIN par l'intermédiaire du magistrat détaché à TRACFIN, nous en avons systématiquement une copie. Nous nous représentons mutuellement dans les réunions internationales.
Vous me direz que cela est peu de choses, mais cela permet de faire fonctionner deux outils au profit de la collectivité. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Je pense que l'arrivée des douaniers à l'Office central n'est plus qu'une question de mois, de même que celle d'un officier de police à TRACFIN.
* *
*
M. Jean-Bernard PEYROU, Secrétaire général adjoint du TRACFIN : Quant au troisième point, traitant de la collaboration avec les autres services de l'Etat, il concerne une question que vous aviez évoquée, à savoir le manque d'organisation ou d'étroitesse des liens entre TRACFIN et les services de police ou de justice. Nous avons mis sur pied une information immédiate de l'Office central pour la grande délinquance économique et financière (OCRGDF). Dès que nous recevons une déclaration de soupçon, l'un des premiers actes de l'agent de TRACFIN est de consulter les fichiers de l'Office. En principe, l'Office peut réagir lorsqu'il constate que TRACFIN s'intéresse plus particulièrement à une personne physique ou morale.
Parallèlement, j'envoie systématiquement au chef de l'Office un double des dossiers transmis aux différents parquets afin qu'il puisse en tant qu'Office situer l'affaire dans tel ou tel parquet, même si elle ne lui sera pas obligatoirement cotée, les parquets étant libres de confier nos dossiers soit au SRPJ local, soit aux services de police judiciaire de la région parisienne. D'ailleurs, une grande partie de nos dossiers sont suivis par la brigade de recherche et d'investigation financière, la BRIF, avec laquelle cela fonctionne bien.
Extrait des auditions, devant la Mission, de M. Jean-Claude Marin, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris, le 6 octobre 1999, de M Yves Godiveau, chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), le 6 octobre 1999, et de M. Jean-Bernard Peyrou, Secrétaire général adjoint de TRACFIN, le 30 mai 2001.
Monsieur Godiveau faisait là preuve d'optimisme puisque, plus de deux années après son audition, le détachement d'un officier de police judiciaire n'est pas encore réalisé.
Le principe du travail en réseau, sous forme d'échange croisé d'officiers de liaison et d'accès aux informations en temps réel, a donc mis une petite dizaine d'années à s'imposer entre TRACFIN et l'OCRGDF, mais, en raison de pesanteurs administratives inacceptables, il n'est pas encore rentré dans les faits.
Il apparaît à la Mission que cette formule, complétée par une plus grande multidisciplinarité des équipes de TRACFIN, est la meilleure dans le contexte institutionnel actuel, comme le montrent les exemples suivants d'une coopération réussie.
Un coup de filet réussi
grâce à la coopération entre TRACFIN
et la police judiciaire
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT : Le dispositif mis en oeuvre sur le plan national est de haut niveau mais, il faut le dire, dans ce cadre, le policier est trop isolé, trop coupé de la source de renseignement la plus riche, celle du système bancaire et financier.
Ainsi, par exemple, en juin 1998, la brigade de recherche et d'investigation de la préfecture de police de Paris a arrêté en flagrance une équipe de malfaiteurs chevronnés qui s'apprêtait à négocier près de 700 000 francs en faux billets de 20 dinars du Bahreïn. L'origine de cette affaire est la suivante. Des policiers se trouvaient, dans le cadre d'une enquête, dans les locaux de TRACFIN, lorsqu'ils ont assisté en direct à la communication de l'information donnée téléphoniquement par un agent de change sur une transaction suspecte en cours : un homme porteur d'une grande quantité de dinars en cash en demandait l'échange contre 700 000 F en espèces, ce qui en France est possible. Si les policiers, avec leur savoir-faire, n'avaient pas été présents et n'avaient pas immédiatement réagi pour organiser immédiatement, dans l'urgence, un dispositif qui n'éveille pas l'attention de l'individu et qui permette d'opérer des vérifications puis des filatures, les malfaiteurs courraient toujours et l'agent de change aurait perdu 700 000 F. J'ajoute que cela nous a permis de découvrir bien d'autres choses ensuite.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. Jean-Pierre Chevènement, le 28 octobre 1999.
« Judiciariser » TRACFIN en le rattachant à l'OCRGDF déstabiliserait l'équilibre actuel sans gain assuré. La police judiciaire, par ailleurs accablée sous la tâche, ne pourrait effectuer le travail de filtre et d'enrichissement effectué par TRACFIN.
Comme le relève le rapport Gravet-Garabiol précité, l'intégration de la cellule de renseignement financier au sein de la police judiciaire, parfois pratiquée à l'étranger, n'aboutirait pas à un taux de procédures judiciaires très supérieur, au contraire d'une bonne coopération entre deux partenaires disposant chacun de son savoir-faire :
« La seconde approche est au contraire fondée sur une relation étroite des services de renseignement financier et d'enquêtes policières. Dans ce cas, les renseignements financiers sont reçus par les services de police soit en direct, comme au Royaume-Uni, soit en y ayant un accès totalement ouvert, comme pour le FBI aux Etats-Unis ou la DIA en Italie, soit encore en étant le destinataire désigné du service de renseignement financier, comme aux Pays-Bas.
Il n'est pas certain à ce jour que cette approche donne des résultats plus probants en termes de détection des réseaux de blanchiment à partir des seuls renseignements financiers. Dans tous les pays, il est estimé que le nombre d'affaires judiciaires ouvertes à partir d'une détection du réseau financier ne dépasse pas 15 à 20 % du total. En revanche, lorsque la collaboration est autorisée ou prescrite, les renseignements financiers sont alors sollicités dans le cadre des enquêtes criminelles et facilitent la détection connexe des réseaux de blanchiment. A titre d'exemple, le service américain de renseignement financier rattaché au Trésor, FINCEN, a produit en 1999, plus de 8 000 rapports d'analyse demandés par les services d'enquêtes policières fédérales ou locales. » (Rapport au ministre de l'Intérieur - juin 2000, p. 39).
Le renseignement financier et l'enquête judiciaire constituent bien en effet deux approches différentes dont l'articulation conditionne l'efficacité du traitement des déclarations de soupçon.
2.- La difficile articulation du renseignement financier et de l'enquête judiciaire
L'évaluation du traitement des déclarations de soupçon par les services de l'Etat repose sur deux critères : la proportion de déclarations enrichies par TRACFIN et transmises au Parquet, et la proportion des dossiers donnant lieu à une procédure judiciaire ou à une condamnation.
Si le premier ratio relève exclusivement de TRACFIN, le second dépend à la fois de TRACFIN et des services judiciaires.
Les services judiciaires (police et Parquet) ont toujours tendance à déplorer le faible nombre de dossiers qui leur sont soumis au regard de la masse des déclarations de soupçon dont TRACFIN est le destinataire exclusif.
Transmissions de dossiers au Parquet par TRACFIN
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 | |
Nombre de déclarations de soupçon reçues par TRACFIN |
|
|
|
|
|
|
Nombre de dossiers transmis par TRACFIN au Parquet |
|
|
|
|
|
|
Proportion |
5,2 % |
6,4 % |
8,4 % |
7,8% |
6,1% |
6 % |
TRACFIN conteste cette méthode brute de détermination du ratio en faisant observer qu'elle ne prend pas en compte la dimension chronologique de son activité. En d'autres termes, les dossiers transmis en 2001 ne correspondent pas automatiquement aux déclarations reçues cette même année et peuvent remonter à des années antérieures.
TRACFIN utilise une méthode différente, consistant à rapporter le nombre de dossiers transmis au Parquet au nombre de dossiers dont l'étude est achevée, ce qui lui semble plus refléter la réalité de son activité. Accessoirement, cette méthode permet aussi d'afficher des taux de transmission au Parquet de 20 à 25 %, donc très supérieurs à ceux qui figurent dans le tableau ci-joint.
TRACFIN observe aussi à juste titre que le traitement de plusieurs déclarations de soupçon peut déboucher sur une seule transmission, dès lors qu'il apparaît que les faits visés par celles-ci sont connexes : à titre d'exemple, une transmission en justice de 2001 résultait de plus de 20 déclarations de soupçon distinctes.
Sur un simple plan quantitatif, on constate que si TRACFIN a plus que doublé le nombre de ses transmissions en valeur absolue entre 1998 et 2001, son ratio a tendance à décroître, principalement du fait de la progression exponentielle du nombre de déclarations qu'il reçoit. Cette tendance étant vraisemblablement appelée à se poursuivre, ne serait-ce qu'en raison des nouveaux dispositifs de déclarations automatiques, la question des moyens informatiques et humains de TRACFIN se pose désormais clairement.
Les moyens de TRACFIN (500 000 euros de budget, une trentaine de personnes dont une vingtaine d'opérationnels, dont une douzaine d'enquêteurs financiers) sont relativement légers et constants depuis quelques années.
La Mission ne peut que cautionner le développement annoncé des moyens de TRACFIN début 2002, à la suite d'un arbitrage favorable du ministre de l'Economie et des Finances, (création de 15 emplois dont 8 enquêteurs et 3 agents de traitement automatisé des données, doublement de la surface des locaux et du budget de fonctionnement, qui permettra notamment à TRACFIN d'adhérer au réseau électronique pour l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier européennes), à condition de placer cette croissance sous le signe de l'interdisciplinarité puisque, malgré des efforts en ce sens, la division opérationnelle de TRACFIN reste marquée par une monoculture douanière de contrôle des changes.
TRACFIN interpellé par la Mission
« M. Jacky DARNE, Député : S'il y a une augmentation quantitative et qualitative des déclarations de soupçon, il me semble que la productivité de votre service et des juges demeure modeste. Si les 2 500 déclarations de soupçon sont considérées comme de bonne qualité, cela signifie qu'il y a un doute sérieux sur l'opération. Or sur 2 500 déclarations, seules cent cinquante ont fait l'objet d'une transmission au parquet. Pourquoi n'en transmettez-vous pas plus ?
M. Jean-Bernard PEYROU, Secrétaire général adjoint de TRACFIN : Les déclarations peuvent avoir un contenu fiscal. Nous les classons. Ensuite, nous devons faire des recoupements pour les autres. Les faits déclarés ne concernent pas automatiquement de grosses sommes, parfois cela concerne de très petites sommes, ou des personnes qui n'ont pas un environnement mafieux ou un passé judiciaire. Il faut apprécier en permanence. [...]
Il faut bien saisir que les déclarations de soupçon concernent des faits de différentes natures provenant, tant de banques importantes que d'un bureau de poste d'un petit village. »
* *
*
« M. Dominique GAILLARDOT, Magistrat de liaison à TRACFIN : Le travail de TRACFIN consiste à comprendre les opérations qui nous sont dénoncées afin de voir si l'on peut passer du soupçon à une présomption, à faire ce basculement pour passer d'un contexte financier à un contexte pénal.
Globalement, deux critères nous amènent à transmettre les dossiers au procureur de la République. Le premier est celui où nous avons réussi à replacer la transaction dans un contexte criminel, même lointain. Notre rôle n'est pas d'établir que telle somme découle de telle infraction, mais que l'auteur de la transaction est lui-même connu pour une participation à des activités criminelles et qu'il est en contact direct avec un ensemble de personnes liées à la criminalité organisée. Cela nous suffit à caractériser, de notre point de vue, un contexte criminel éventuel qui justifie à lui seul que la police et la justice prennent le relais pour mener des investigations avec les moyens qui sont les leurs. C'est le meilleur des cas.
Les autres cas, dont le dossier fait l'objet d'une transmission aux autorités judiciaires, sont ceux dans lesquels même si l'on n'a pu caractériser le contexte criminel, l'opération nous parait être tellement significative et « typologique » du blanchiment qu'il nous semble essentiel que soient menées des investigations complémentaires pour lesquelles nous ne disposons pas des moyens juridiques.
Dans cette seconde catégorie de cas, j'ai parfois dû convaincre mes collègues de déclencher des investigations en raison du manque d'infractions évidentes. A la lecture d'une affaire, l'opération parait anormale, suspecte, mais sans que l'on puisse définir a priori le moindre lien avec une infraction déterminée. Si les moyens ne sont pas engagés pour essayer de déterminer quelle est la source de l'information, on n'a aucune chance d'établir, un jour, un blanchiment éventuel.
Ces moyens vont au-delà de ceux de TRACFIN, il faut mettre des moyens judiciaires et policiers traditionnels. Ce sont les deux critères qui nous amènent à transmettre des dossiers à l'autorité judiciaire.
On peut s'interroger sur ces critères, voir s'ils sont suffisants ou si d'autres critères devraient permettre de transmettre ces informations à l'autorité judiciaire. Nous réfléchissons en permanence à ces questions car notre finalité et notre objectif restent la transmission de dossiers à l'autorité judiciaire. Si la totalité du travail de renseignement est faite, nous avons alors établi ce contexte criminel, et le dossier est transmis à l'autorité judiciaire. Dans le cas contraire, nous avons un soupçon brut, un fait que l'on n'a pas réussi à étayer. Hormis les cas typologiques du blanchiment, l'exploitation de ces derniers cas n'est pas facile.
Néanmoins, l'information recueillie et non transmise immédiatement à l'autorité judiciaire reste disponible aux services de police ou à la justice. A priori, nous avons déjà cherché à faire le maximum de recoupements. Toutefois, si des services de police, des juges d'instruction ou des collègues, saisis d'une affaire, veulent voir s'il n'y pas de conséquences en termes de blanchiment, ils ont tout loisir de nous interroger. »
Extrait des auditions de M. Jean-Bernard Peyrou, Secrétaire général adjoint de TRACFIN, devant la Mission, le 30 mai 2001, et de M. Dominique Gaillardot, Magistrat de liaison, dans les locaux de TRACFIN à Paris, le 20 janvier 2000.
Les services judiciaires mettent aussi en cause le contenu des dossiers qui leur sont soumis par TRACFIN, en déplorant leur faible utilité en vue d'une qualification pénale des faits décrits, ce qui pose la question du deuxième ratio, celui des procédures judiciaires déclenchées sur le fondement des dossiers transmis par TRACFIN.
La mise en accusation de TRACFIN
par les services judiciaires
M. Yves CHARPENEL, directeur des affaires criminelles et des grâces : S'agissant du rôle d'un certain nombre d'institutions publiques, et plus particulièrement de TRACFIN, je souhaiterais, en ma qualité de magistrat et directeur des affaires criminelles, voir cette institution évoluer vers une sphère plus judiciaire que financière, tout en conservant ses compétences fort intéressantes.
Toutefois, entre les informations que TRACFIN récupèrent et celles que nous pouvons traiter, il y a un très grand fossé qui n'est que rarement franchi. Il y a là un frein réel à l'efficacité du travail des juges d'instruction et des procureurs que je tenais à signaler à votre Mission. [...]
A priori on ne peut pas ouvrir une enquête préliminaire sur la seule base d'une déclaration de soupçon classique. C'est pourquoi le taux est si faible. Lorsqu'un procureur reçoit des dénonciations de TRACFIN, il saisit de façon quasi automatique les services compétents de la chancellerie pour une analyse. Si le procureur requiert une analyse, c'est précisément parce qu'il ne sait pas la faire. En effet, ce ne sont pas des actes répréhensibles ou soupçonnés comme tels qui sont désignés, mais une démonstration financière mettant en lumière une anomalie financière qui n'est jamais qualifiée d'infraction.
Lorsque la Commission bancaire, par exemple, intervient sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, il y a tout un argumentaire financier qui se termine par une tentative de raisonnement pénaliste. En revanche, que peut faire un procureur face à une déclaration de soupçon classique ? Soit entendre les personnes qui ont fait la dénonciation, c'est-à-dire TRACFIN qui se retranchera derrière son statut et qui ne pourra pas en dire plus que le document qu'elle a écrit, soit déclencher, ce qui a été fait parfois, une enquête préliminaire et prendre le risque de partir en aveugle.
En fait, nous souhaitons pouvoir connaître toutes les dénonciations afin de procéder à des recoupements avec d'autres enquêtes en cours.
M. Jean-Pierre DINTILHAC, Procureur de la République : Nous avons beaucoup de déchets sur les informations de TRACFIN, rarement pour des raisons de droit mais le plus souvent des raisons de fait, notamment lorsque des identités se révèlent fausses et ne nous permettent pas d'établir la traçabilité des opérations et de retrouver les auteurs réels de l'infraction.
Mme Anne-Josée FULGERAS, chef de la section financière : Les agents de TRACFIN reçoivent des informations, généralement de bonne qualité, mais qui, la plupart du temps, ne livrent pas la vraie nature des fonds et nécessitent des investigations. Or aujourd'hui, TRACFIN n'a aucun pouvoir d'enquête et ne dispose que d'un droit de communication qui lui permet parfois, grâce à des informations transmises par les douanes et les services de police, de s'assurer que la matière est sérieuse et que les fonds sont bien d'origine illicite. On sent parfois que les agents de TRACFIN souhaiteraient pouvoir en faire un peu plus pour s'assurer du sérieux de la matière première et pouvoir la transmettre avec plus de sécurité.
La solution actuellement retenue est un contact plus étroit avec les services de police spécialisés de façon à ce que les renseignements puissent donner lieu à une intervention de la police lorsque les transferts de fonds sont encore exploitables.
Il me semble que l'on pourrait peut-être envisager de faire de TRACFIN un organisme plus performant sur le terrain de l'intelligence financière ; l'exploitation de renseignements, notamment avec des moyens informatiques plus poussés, permettrait sans doute d'obtenir véritablement de l'information. Aujourd'hui, et c'est un des problèmes de la lutte contre la grande délinquance financière, nous ne bénéficions pas vraiment de renseignements à vocation judiciaire. Cela nous fait très largement défaut, surtout en matière de blanchiment où la connaissance des organisations est nécessaire. En effet, si l'on veut s'intéresser à des réseaux criminels, il faut connaître ce qu'il y a de plus pérenne, c'est-à-dire les hommes et les circuits financiers puisque les activités sont de plus en plus fluctuantes. Si TRACFIN était doté de davantage de moyens, peut-être pourrait-il développer ce type de mission.
Extrait des auditions, devant la Mission, de M. Yves Charpenel, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, le 15 septembre 1999, de M. Jean-Pierre Dintilhac, Procureur de la République, et de Mme Anne-Josée Fulgeras, chef de la section financière, le 6 octobre 1999.
Suites judiciaires données aux dossiers transmis par TRACFIN au Parquet
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 | |
Dossiers transmis au Parquet |
104 |
129 |
156 |
226 |
37 * |
Enquêtes préliminaires Informations judiciaires |
- 34 |
40 37 |
49 37 |
60 * 14 * |
3 * |
* Chiffres provisoires - Source : TRACFIN.
Ces chiffres sont des minima puisqu'ils proviennent des retours d'information du Parquet vers TRACFIN, reposant, jusqu'à présent, sur la seule bonne volonté des parquetiers (la loi sur les nouvelles régulations économiques a opportunément rendu obligatoire la transmission par le Parquet des décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon) ; ils relativisent quelque peu les affirmations critiques des magistrats sur l'utilisation qu'ils font des dossiers transmis par TRACFIN. On constate ainsi qu'en 1999 et 2000, presque 60 % des dossiers transmis ont donné lieu à une suite judiciaire.
TRACFIN apparaît bien comme un « apporteur d'affaires » incontournable pour la justice économique et financière. Le service est ainsi à l'origine de trois quarts des procédures de blanchiment dont la section financière du Parquet de Paris a été saisie, depuis 1989 (236 sur un total de 314).
Il faudrait aussi compléter ces statistiques par des éléments plus qualitatifs (montant des sommes, sophistication des montages, opacité des réseaux) pour mesurer pleinement l'apport de TRACFIN au Parquet.
Le tableau de chasse 1999 de TRACFIN
transmis au Parquet
- Opérations injustifiées en espèces sur les comptes d'une fédération de sport : 18 millions de francs.
- Opérations en espèces sur les comptes d'une association travaillant dans le secteur sanitaire ou social : 72 millions de francs.
- Achat d'un complexe immobilier touristique par des personnes connues pour leurs liens avec des organisations criminelles : plus d'un milliard.
- Opération sur les comptes de la famille d'un ancien dirigeant africain, poursuivi dans son pays : 350 millions de francs.
- Achat de plus de mille lingots d'or par une personne sans revenus connus.
- Achat d'un hôtel par des Russes connus à l'étranger et usant d'identités falsifiées : moins de 2 millions de francs.
- Virements vers l'étranger d'une personne recherchée par les services de police : 2,4 millions de francs.
- Opérations de change par personnes recherchées pour trafic de stupéfiants en Grande-Bretagne.
- Opérations irrégulières sur les comptes d'un courtier en assurance. Le courtier en assurance peut être un outil de blanchiment s'il a joué avec des comptes taxi, escroquerie bien connue en matière d'abus de confiance.
- Revente à perte d'un appartement et transfert vers un paradis fiscal. L'argent, qui venait d'un paradis fiscal, repart vers un paradis fiscal.
Pour 1999, vingt-deux transmissions sont supérieures à 10 millions de francs et vingt-deux se situent entre 3 et 10 millions de francs.
Extrait de l'audition, par la Mission, de représentants de TRACFIN dans les locaux de TRACFIN à Paris, le 20 janvier 2000.
Plus fondamentalement, les critiques des magistrats portent davantage sur le positionnement institutionnel de TRACFIN que sur sa productivité intrinsèque. TRACFIN est un service de renseignement qui expertise et étoffe une déclaration de soupçon, sans procéder à une enquête judiciaire qui relève de la police financière.
On passe ainsi du soupçon à la présomption en vue d'une qualification pénale.
Le coeur de son métier consiste à caractériser le contexte d'une opération financière ponctuelle qui a attiré l'attention des professionnels soumis à la déclaration de soupçon. Pour ce faire, TRACFIN cherche de l'information sur :
- l'insertion de cette opération dans un montage et la mise en évidence de sa signification économique et financière ;
- l'identité et l'environnement humain des auteurs de cette opération.
Ses moyens sont ceux d'un service de renseignement qui, sans être négligeables, ne sont pas ceux de la police judiciaire.
Directement ou indirectement, souvent officieusement, par un travail fondé sur l'entretien des sources et la densité des relations personnelles, au sein des services de l'Etat ou en dehors, en France et à l'étranger, TRACFIN s'efforce de reconstituer le puzzle et monte son dossier.
Ce travail reste discret et ne prend jamais la forme des procédures officielles de la police judiciaire : filatures, saisies, perquisitions, convocations pour auditions, gardes à vue, etc. De ce fait, il débouche sur des indices mais rarement sur des preuves dont la recherche et l'établissement continuent de relever des services judiciaires, d'autant que l'infraction de blanchiment est une infraction complexe qui se rattache à une infraction principale, comme le relevait M. Gaillardot, ancien magistrat de liaison à TRACFIN :
Les procureurs n'ouvrent des informations judiciaires
qu'avec parcimonie
« La deuxième question est de savoir quelle est l'utilité de ces renseignements que l'on transmet. Il convient de repartir de la conception et de la définition même du blanchiment. Le blanchiment concerne des transactions financières liées à une infraction principale qui existe, qu'elle soit connue ou pas. Dans le meilleur des cas, cette infraction principale est connue et elle peut l'être déjà de services de police ou de la justice. C'est l'essence même du service que d'apporter alors le volet financier à des autorités policières et judiciaires déjà en charge d'investigations sur l'infraction principale.
Ces informations financières, qui compléteront l'ensemble du dossier, seront parfois le catalyseur. C'est grâce à ces informations financières qu'on aura un autre angle d'attaque pour aborder l'infraction principale. Dans d'autres cas, les autorités judiciaires ou policières sont en totale ignorance de l'infraction principale. Nous nous trouvons face à la difficulté habituelle qui est de faire le lien entre les mouvements financiers et cette infraction principale, d'autant plus quand cette infraction principale est située à l'étranger.
Pour connaître, de façon objective, le degré d'utilité de cette information, il existe quelques indicateurs simples, au-delà de ce que la police ou la justice peuvent en dire. A partir de 1996, un palier significatif dans le nombre de transmissions aux autorités judiciaires a été franchi. Nous tournons, globalement depuis trois ans, entre 100 et 120 dossiers par an. Pour la seule année 1998, actuellement plus de trente cas d'informations judiciaires sont ouverts sur des dossiers transmis par TRACFIN.
Quand on connaît la prudence et le souci des procureurs de la République de ne pas encombrer les cabinets des juges d'instruction, de n'ouvrir qu'avec parcimonie des informations, ce chiffre est significatif. Au-delà de ces 34 dossiers en cours d'instruction chez mes collègues juges d'instruction, il faut également prendre en compte tous les dossiers directement transmis à l'Office central, à la BRIF ou aux différents services d'enquêtes. »
(Extrait de l'audition de M. Dominique Gaillardot, magistrat de liaison, par la Mission, dans les locaux de TRACFIN à Paris, le 20 janvier 2000).
La condition déterminante du succès, c'est effectivement la réalité du travail en réseau, c'est-à-dire la bonne insertion de TRACFIN dans le dispositif global de l'investigation financière et l'étroitesse des liens entretenus avec la police judiciaire.
Ceci passe par l'interdisciplinarité interne de TRACFIN et, à cet égard, la vacance de poste du magistrat de liaison pendant neuf mois en 2001, et la lenteur avec laquelle un policier et un gendarme ont été mis en détachement, sont inacceptables.
La nécessaire coopération de TRACFIN
et de la police judiciaire
M. Dominique GAILLARDOT, Magistrat de liaison à TRACFIN : Le texte, initialement, nous désigne comme partenaire privilégié de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF). Nous transmettons également de l'information aux services désignés. En pratique, nous avons vite compris qu'au-delà de tel ou tel service, il convenait d'interroger directement le service susceptible d'avoir l'information qui nous intéresse.
Quand nous avons un mouvement financier ciblé sur la Côte d'Azur, nous prenons des renseignements auprès de la police judiciaire locale, pour savoir s'ils connaissent ou non cette personne. Si oui, cela nous donne une information précieuse, car cela signifie qu'il y a un contexte éventuellement criminel. Dans le cas contraire, c'est aussi une information précieuse pour nous, pour tenter de comprendre cette opération.
Nous avons maintenant développé des relations avec la plupart des services de police judiciaire. Tant que ces services n'avaient jamais eu l'occasion de travailler sur un de nos dossiers, ils ne comprenaient pas toujours ce qu'était TRACFIN, un soupçon ou la procédure. Dès lors qu'ils ont appris à travailler sur nos dossiers, ce qui est le cas de tous les parquets et les services de polices de la Côte d'Azur, ils constituent naturellement pour les enquêteurs des interlocuteurs privilégiés.
M. Jean-Bernard PEYROU, Secrétaire général adjoint de TRACFIN : On observe même certains phénomènes relativement nouveaux. Lorsqu'une affaire est transmise en justice sur la base d'un dossier de TRACFIN et qu'il y a une instruction donnée à un service policier, sous l'autorité du procureur, on peut nous demander d'être associés à certaines opérations en tant qu'experts. Dans plusieurs cas, nous avons contribué activement à la suite donnée aux dossiers.
M. Jean-Paul GARCIA, responsable de la branche opérationnelle de TRACFIN : Il convient d'insister sur la réciprocité. Si un service de police ou un magistrat veut nous interroger pour savoir si nous avons des déclarations de soupçon sur telle ou telle personne, cette information est disponible pour eux. [...]
Nous avons entrepris, il y a trois ans, d'intéresser à notre travail des services de police et des parquets, en amont de la transmission, par le biais d'une participation à notre réflexion et à nos enquêtes pour l'OCRGDF, les SRPJ, la BRIF et la gendarmerie. Cette démarche a débuté par des opérations communes de formation ou d'information lors desquelles nous avons pu nouer des contacts personnels. Ainsi nous avons pu associer des services. Lorsqu'un service de police ou de gendarmerie est associé à une affaire TRACFIN avant la transmission, ils sont davantage intéressés. Cette démarche de sensibilisation à notre travail a donné satisfaction.
Extrait des auditions, par la Mission, de M. Dominique Gaillardot, magistrat de liaison, de M. Jean-Bernard Peyrou, Secrétaire général adjoint de TRACFIN, et de M. Jean-Paul Garcia, responsable de la branche opérationnelle, dans les locaux de TRACFIN à Paris, le 20 janvier 2000.
Tout autant que cette insertion optimale de TRACFIN dans l'appareil de l'Etat, ce sont les conditions de travail de la police économique et financière qui doivent attirer l'attention des pouvoirs publics dans l'optique d'une lutte efficace contre le blanchiment.
3.- La surcharge de la police économique et financière
La police économique et financière est surchargée, comme l'a reconnu le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, devant la Mission.
« Durant ces deux dernières années, l'activité des unités financières de la police judiciaire a représenté 43 % des dossiers traités pour un effectif représentant 28 % des personnels actifs en charge du traitement des enquêtes judiciaires. Ces unités ont traité chaque année plus de 5 000 dossiers. Parmi ceux-ci, plus de 200 procédures de blanchiment sont en cours.
Compte tenu du nombre important de départs à la retraite, il faut poursuivre l'effort que j'ai engagé pour combler le déficit et amorcer durablement l'augmentation des fonctionnaires spécialisés. Ils étaient 987 en 1998, 958 au 1er janvier 2000, ils sont aujourd'hui 966. Il y a un effort à faire, l'Etat doit le poursuivre. » (Audition de M. Daniel Vaillant, devant la Mission, le 30 janvier 2002).
Cette situation conduit à l'allongement des délais d'exécution des commissions rogatoires et à une certaine forme de démobilisation des magistrats financiers.
Quand la justice s'efforce de séduire
la police judiciaire
Mme Marylise LEBRANCHU, Garde des Sceaux : Notre difficulté est la suivante : comment améliorer la coordination entre les procureurs et les OPJ en particulier, afin que la circulation de l'information se fasse dans les meilleures conditions ? Vous savez que les effectifs ne sont pas suffisants, mais nous avons également des problèmes quant au niveau de recrutement des enquêteurs ; il est difficile, pour une personne qui est entrée dans la police comme gardien de la paix, de mener des enquêtes relatives au blanchiment qui sont des affaires complexes et difficiles.
Je suis gênée de le dire, mais il est incontestable que les effectifs policiers destinés à lutter contre le blanchiment baissent. A force de mettre le projecteur sur l'insécurité quotidienne, on en oublie d'autres problèmes. Les médias, et certains responsables, affirment régulièrement que ce qui intéresse les citoyens c'est, non pas la délinquance financière, mais la délinquance au quotidien. [...]
Le malaise vient surtout des services d'enquêtes, des OPJ ; les enquêtes sont très longues car ils ne sont pas assez nombreux - beaucoup sont partis en retraite.
C'est à Paris que l'on trouve, au niveau des effectifs de police, les personnes les plus efficaces, les mieux formées, en particulier parmi les enquêteurs de la brigade financière et la brigade de recherche d'investissements financiers. Nous avons là de grands spécialistes qui doivent faire école.
* *
*
M. Jean-Claude MARIN, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris : Il existe d'autres obstacles, plus prosaïques, comme l'extraordinaire pauvreté des services de police spécialisés dans cette matière. De fait, le travail du magistrat qui souhaite une enquête devient un véritable travail de marketing : « Regardez mon affaire ! Elle est belle, elle est bonne ! Prenez-là ! ». [...]
M. Jean-Pierre DINTILHAC, Procureur de la République : Néanmoins, la première difficulté provient de ce qu'il manque globalement des effectifs. De plus, la situation parisienne n'est pas très attractive pour les fonctionnaires en majorité d'origine provinciale et qui dès qu'ils le peuvent cherchent à partir. Le taux de rotation des personnels aggrave la situation.
M. Jacky DARNE, Député : Chez les magistrats aussi ?
M. Jean-Pierre DINTILHAC : C'est également un problème chez les magistrats.
Extrait des auditions, devant la Mission, de Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, le 9 janvier 2002, de M. Jean-Claude Marin, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris, et de M. Jean-Pierre Dintilhac, Procureur de la République, le 6 octobre 1999
Interrogé par la Mission sur cette pénurie relative d'officiers de police judiciaire, M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, n'a pas dissimulé la difficulté qu'il rencontrait pour maintenir les effectifs de la police économique et financière devant les flux de départs à la retraite et les arbitrages internes à la police judiciaire :
Quelles priorités pour la répartition des effectifs
de la police judiciaire ?
« M. Jean-Pierre CHEVENEMENT, ministre de l'Intérieur : La réponse est à la fois très simple est très difficile.
Très simple parce que les moyens de la police judiciaire ne sont pas indéfiniment extensibles, et que la déflation du nombre des commissaires et des officiers de police engagée depuis 1995, fait que nous disposons de moins en moins de moyens en personnels hautement spécialisés, de sorte qu'il y a de plus en plus de trous dans le dispositif, y compris dans le dispositif de la sécurité publique.
Nous sommes confrontés à des demandes de très nombreux juges qu'il nous faut satisfaire simultanément. Toutes ces demandes sont très hétérogènes. Certaines intéressent de grandes affaires, comme ELF, dont chacun connaît la lisibilité et encouragent des comportements que vous avez qualifiés « de marketing ». Est-ce compatible d'ailleurs avec une saine justice ? Je me garderai bien de trancher la question. Par ailleurs, j'ai pu observer certaines enquêtes très mobilisatrices, très consommatrices de moyens, dont la base était pour le moins fragile, qui durent depuis des années.
Je m'interroge donc aussi sur la manière dont on peut trouver une cohérence entre des demandes qui prolifèrent, et dont certaines ne sont pas toujours pleinement justifiées, et une police judiciaire dont les effectifs sont ce qu'ils sont et dont je ne vois pas comment j'arriverais à les augmenter beaucoup, à moins que des dispositions qui relèvent du Parlement élargissent quelque peu mes marges de man_uvre.
Mais je tiens à vous faire également observer que la police judiciaire doit aussi s'intéresser à la petite et moyenne délinquance, au démantèlement de réseaux de trafics locaux, que la police de proximité impliquera une dimension de police judiciaire et que le Français moyen est plus préoccupé par les dégradations faites à sa voiture, les vols d'autoradios, de portables, les vols à l'arraché, qui contribuent au sentiment d'insécurité, sans parler des injures, des boîtes aux lettres cassées, etc. Par ailleurs, nous avons affaire au grand banditisme, au trafic de stupéfiants, à la criminalité financière, à une menace terroriste permanente, venant de plusieurs horizons.
La police doit faire front tous azimuts avec des moyens qui sont très fortement limités. Je rappelle que les effectifs de la police judiciaire représentent dans leur ensemble 4 000 personnes, auxquelles s'ajoutent 1 900 fonctionnaires de la police judiciaire de la préfecture de Paris. Nous sommes donc en dessous de 6 000, et ce ne sont pas tous des officiers de police judiciaire, sont comptés dans ce nombre des secrétaires, des agents administratifs, des chauffeurs, etc. »
Extrait de l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, devant la Mission, le 28 octobre 1999.
En revanche, les dirigeants de la police judiciaire ont contesté les affirmations des magistrats dénonçant de véritables carences policières, soit devant la Mission, soit dans un article retentissant du journal Le Monde (« Juges et officiers s'alarment de l'état de la police financière » - 19 décembre 2001) :
« Les pôles financiers » n'arrivent pas à suivre
« M. Patrick RIOU, directeur central de la police judiciaire : Quelques mots pour modérer une appréciation qui me semble quelque peu caricaturale. Je parle en tant que directeur central de la police judiciaire, ancien directeur de la police judiciaire parisienne et ancien sous-directeur des affaires économiques et financières parisiennes. Je dresse donc un état de fait sur une situation que je connais bien. Je répondrai que plusieurs autres paramètres sont à prendre en compte.
Premièrement, avant de parler plus précisément des effectifs, je rappelle que la police nationale a un monopole de fait dans le traitement de ces affaires. La gendarmerie nationale ne traite qu'un volume très réduit d'affaires économiques et financières.
Deuxièmement, vous le savez bien, les cabinets d'instruction sont envahis et débordés de constitutions de partie civile qui, très souvent, sont abusives. Pour deux tiers, le portefeuille des affaires économiques et financières est alimenté par des constitutions de partie civiles.
Troisièmement, l'autorité judiciaire ne fait pas toujours le tri qu'elle devrait en amont, c'est-à-dire que des dossiers parfois volumineux nous sont transmis alors qu'ils n'ont aucune qualification pénale, venant encombrer aussi les services de police judiciaire. On considère que 15 à 20 % des dossiers que nous recevons sont des dossiers non pénaux.
Quatrièmement, contrairement aux affirmations lapidaires de M. Marin, jamais aucun officier de police judiciaire n'a refusé de traiter un dossier, jamais aucun officier de police judiciaire n'a retardé le traitement d'un dossier, a fortiori s'il s'agit d'un dossier signalé, tout simplement parce que l'organisation centralisée de la police judiciaire permet de déplacer les effectifs là où l'urgence se fait sentir. Il existe au sein de la direction centrale de la police judiciaire une unité composée de policiers spécialisés en affaires économiques et financières, volontaires et mobilisables pour traiter des affaires d'importance.
Donc, jamais aucun magistrat n'a pu dire qu'une affaire n'était pas traitée faute de moyens. Je m'insurge totalement contre de telles affirmations.
En revanche, il est vrai que des affaires secondaires, de moindre importance telles que des constitutions de partie civile abusives, des dossiers non pénaux ou des litiges civils traités abusivement au pénal, sont parfois prises en compte avec un peu de retard. Mais tout est relatif. La situation, en tout état de cause, ne va certainement pas en s'aggravant.
L'état des effectifs, M. le ministre l'a précisé, est parfaitement stable en termes d'OPJ. Quand bien même nous aurions davantage d'OPJ, je suis convaincu que l'autorité judiciaire ne pourrait pas suivre.
Mais, en aucun cas, un OPJ n'a refusé de traiter un dossier faute de moyens.
M. le Rapporteur : Que voulez-vous dire lorsque vous dites qu'ils ne pourraient pas suivre, monsieur le directeur ?
M. Patrick RIOU : Si, pure hypothèse, nous étions considérablement renforcés, les parquets et les cabinets d'instruction ne pourraient pas suivre. Ils ne pourraient pas digérer notre production.
M. le Rapporteur : C'est un argument !
M. Patrick RIOU : Ce n'est pas un argument, c'est le constat que je fais. Parfois, certains pôles financiers - et j'assume ce que je dis - font porter à la police une responsabilité tout simplement parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à suivre. Je sais que mes propos figureront au procès-verbal et je maintiens qu'aucun magistrat ne peut affirmer qu'un dossier n'a pas été traité faute de moyens. Ce n'est pas vrai. »
Extrait de l'audition de M. Patrick Riou, directeur central de la Police judiciaire, le 30 janvier 2002
Face à la rareté relative des moyens, la question de leur répartition réapparaît avec une acuité redoublée. La formule de l'Office central, théoriquement interministériel, mais en réalité intégré au seul ministère de l'Intérieur, est-elle la plus performante ? Au vu des arbitrages budgétaires successivement rendus sur l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), la réponse n'est pas évidente.
L'OCRGDF, le mal aimé des arbitrages budgétaires
M. René WACK, ancien chef de l'Office central, au sujet de l'affaire « Margarita » : J'ai dû accélérer le mouvement parce qu'à la fin, j'avais soixante-dix suspects alors que l'Office comptait soixante personnes. Actuellement, ils ne sont plus que vingt, pour des raisons que j'ignore.
* *
*
M. Yves GODIVEAU, chef de l'Office central : L'Office central représente vingt-cinq personnes chargées de lutter contre le blanchiment d'argent mais aussi contre les fraudes communautaires. Même si nous pouvons nous appuyer sur les vingt SRPJ et les 500 fonctionnaires spécialisés en matière économique et financière, nos moyens restent limités. Globalement nous sommes à un niveau intéressant par rapport à nos homologues : pour l'ensemble de la Russie, ils ne sont qu'une centaine d'enquêteurs pour lutter contre la criminalité issue de la privatisation. En revanche, il est vrai qu'il y a les grosses machines américaines. On se demande comment il est possible de mettre en _uvre une politique cohérente de lutte contre la criminalité organisée, comment nous, qui sommes complètement désorganisés, pouvons avoir la prétention de lutter contre des organisations criminelles qui ont des hommes, des moyens financiers et des structures adaptées pour lutter contre les organisations étatiques, les mettre à mal, les investir et les déstabiliser. En France, nous tenons le choc, mais je ne sais pas combien de temps encore. L'exemple italien, qui est assez récent, peut faire froid dans le dos car je crois que cela n'arrive pas qu'aux autres.
Je pense que l'on devrait se doter de moyens supplémentaires pour lutter efficacement contre ce véritable fléau, en y associant des forces publiques qui sont peut-être mal utilisées. Nous avons une loi qui est bien faite, peut-être un peu trop générale, nous avons le personnel qualifié, mais ce qui manque, c'est le nombre de personnes capables de traiter ce genre de dossier. J'ai actuellement trois affaires difficiles en cours et s'il en arrive une quatrième, je ne sais pas comment je ferai pour la traiter.
M. le Rapporteur : Combien de postes supplémentaires seraient nécessaires pour atténuer les inconvénients de la situation que vous décrivez, sachant que les magistrats nous indiquent que les délais de retour des commissions rogatoires sont maintenant de dix-huit mois ?
M. Yves GODIVEAU : Dans le meilleur des cas...
M. le Rapporteur : Que peut faire le Parlement pour améliorer significativement le travail de votre office et des magistrats ?
M. Yves GODIVEAU : Comparativement à d'autres structures en Europe, ce n'est pas la peine d'aller outre-Atlantique car ce ne sont pas tout à fait les mêmes ressorts, une division qui compte moins d'une centaine de personnes ne peut raisonnablement envisager de travailler sérieusement parce qu'il faut tenir une documentation opérationnelle à jour, à base d'informations nationales mais aussi internationales. Or, je n'ai pas les moyens de le faire.
* *
*
M. Daniel VAILLANT, ministre de l'Intérieur : J'ai voulu tout d'abord améliorer la collecte et l'analyse des renseignements. L'Office a ainsi professionnalisé sa section de documentation opérationnelle avec du matériel nouveau d'archivage électronique. Cela lui permet d'assurer toutes ses missions, particulièrement, celle d'être le point de contact national pour Interpol et Europol.
Ensuite, j'ai renforcé les effectifs, qui sont passés de 20 à 50 fonctionnaires en deux ans. Ce sont des effectifs jamais atteints, même du temps de l'ancien responsable, M. Wack, qui comptait parmi les effectifs de l'Office le personnel de la sous-direction. C'est un effort très important, y compris en heures de formation.
* *
*
Mme Marylise LEBRANCHU, Garde des Sceaux : Une des questions qui doivent être débattues avec le ministre de l'Intérieur, c'est peut-être l'articulation entre ces services, la préfecture de Paris et l'Office central, les services de la préfecture de Paris étant plus efficients que l'Office central. Nous devrions pouvoir essaimer une culture, une formation et un savoir-faire par l'Office, or ce n'est aujourd'hui pas possible. Tel est le souci premier que nous remontent les magistrats instructeurs. [...]
L'Office central de répression de la grande délinquance financière vient de voir ses effectifs renforcés par des gardiens de la paix qui n'ont pas encore suivi la formation relative à la lutte contre le blanchiment, organisée par la sous-direction des affaires économiques et financières, où un magistrat présente le cadre juridique et parle de la loi NRE.
Extrait des auditions, devant la Mission, de M. René Wack, ancien chef de l'OCRGDF, le 13 octobre 1999, de M. Yves Godiveau, chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), le 6 octobre 1999, de M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, le 30 janvier 2002 et de Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, le 9 janvier 2002.
Outre le nécessaire renforcement des effectifs et de la formation de la police économique et financière que la Mission continue d'appeler de ses v_ux, deux dispositifs évoqués par M. Jean-Pierre Dintilhac, procureur de la République, permettraient peut-être, en amont, de filtrer davantage les saisines de la police judiciaire grâce à une aide à la décision des magistrats : le renforcement des assistants spécialisés des pôles financiers et la mise à disposition d'officiers de police judiciaire.
La question épineuse du contrôle
de la police judiciaire
M. Jean-Pierre DINTILHAC, procureur de la République : L'assistant spécialisé, par sa compétence et son expérience, peut apporter de manière continue une collaboration, une réflexion et une aide au magistrat. Il peut le guider dans les administrations que beaucoup de magistrats connaissent mal, car on ne peut pas leur demander de connaître toutes les administrations fiscales, douanières et autres. Il peut indiquer quand il est possible et souhaitable de désigner un expert ou de saisir la police judiciaire, aussi bien au niveau de l'instruction que de l'enquête préliminaire. Là encore, c'est un progrès parce que si l'on saisit à tort la police judiciaire qui possède déjà des moyens extrêmement limités, on la noie sous des commissions rogatoires qui reviennent actuellement rarement avant un an. [...]
M. le Président : Le rattachement d'officiers de police judiciaire au pôle financier vous semblerait-il intéressant ?
M. Jean-Pierre DINTILHAC : Oui, parce que les officiers de police judiciaire sont saisis à la fois par les juges d'instruction, les parquets de Paris et ceux de la petite couronne - Nanterre, Bobigny et Créteil - si bien qu'il faut les solliciter, négocier et les convaincre de donner priorité à un dossier, sachant que nos collègues mènent d'autres négociations comparables. Si l'on pouvait affecter des officiers de police judiciaire, j'y serais favorable, mais c'est un terrain extrêmement complexe car derrière se pose la question épineuse du contrôle et de la direction de la police judiciaire.
Une option plus facile serait d'avoir quelques officiers de police judiciaire affectés au pôle financier, non pas comme policiers dotés de compétences de police judiciaire, mais en tant qu'assistants de justice spécialisés. De même, quand nous envoyons un magistrat en Grande-Bretagne, il ne devient pas magistrat anglais, mais magistrat de liaison. Nous pourrions ainsi avoir des officiers de police judiciaire de liaison qui pourraient assurer le lien avec leurs collègues de la police judiciaire. »
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. Jean-Pierre Dintilhac, procureur de la République, le 6 octobre 1999.
B.- criminalité organisée et procédure pénale
La lutte contre le blanchiment passe aussi et surtout par la lutte contre la criminalité organisée.
Il est apparu à la Mission que notre code de procédure pénale ne conférait pas aux services d'enquête des moyens pleinement adaptés à l'ampleur et aux difficultés de leur tâche lorsqu'ils sont confrontés à la criminalité organisée, à la différence de nombreux pays placés dans la même situation.
L'absence de réforme dans ce domaine, au cours de cette législature, constitue un regret pour la Mission.
1.- La criminalité organisée au coeur du blanchiment
Même si l'incrimination de blanchiment a été généralisée à l'ensemble des infractions pénales sous-jacentes, il n'en demeure pas moins que la criminalité organisée reste au coeur du blanchiment. TRACFIN évalue ainsi la part de la criminalité organisée dans l'ensemble des dossiers qu'il a transmis au Parquet en 2001, à un chiffre de l'ordre de 40 %.
Corrélativement, l'incrimination de blanchiment permet de « faire tomber » certains membres d'organisations criminelles dont les infractions principales sont difficiles à prouver.
Encore faut-il s'entendre sur le sens de l'expression « criminalité organisée » qui est devenue très courante pour désigner de manière pseudo-technique des phénomènes inquiétants et mal connus, de délinquance en réseau, aux ramifications souvent internationales. Elle renvoie au terme plus journalistique de « mafia ».
Les experts du groupe de travail multidisciplinaire de l'Union européenne sur la criminalité organisée ont identifié onze critères pour décrire l'objet de leur étude, qui sont les suivants :
- collaboration entre plus de deux personnes ;
- spécialisation des tâches au sein du groupe ;
- durée de la collaboration ;
- existence d'une discipline et d'un degré de contrôle du groupe ;
- suspicion d'infractions pénales graves ;
- action internationale ;
- recours à la violence ou autres moyens d'intimidation ;
- utilisation de structures commerciales ;
- activité de blanchiment ;
- influence sur les milieux politiques, de l'administration ou des médias ;
- motivation par le profit et le pouvoir.
Il n'est pas surprenant de voir le blanchiment figurer au nombre des critères permettant d'identifier la criminalité organisée. Quels que soient la ou les « spécialités » criminelles d'un groupe et son champ géographique d'action, il arrivera toujours un moment où le réseau devra entrer en relation avec l'économie officielle, soit pour investir ses profits illicites et décupler son pouvoir, soit pour en jouir par l'achat de biens et de services que la seule économie clandestine ne peut suffire à fournir.
On peut donc affirmer que l'activité de blanchiment est le point de rencontre obligé de toutes les délinquances organisées.
Mais cette activité entraîne aussi, par elle-même, un degré minimal d'organisation. Il est difficile de blanchir soi-même et seul le produit de ses turpitudes.
Chacun connaît la chaîne des opérations qui caractérise le blanchiment, à travers ses trois phases souvent décrites :
- le placement ou prélavage qui consiste à faire entrer l'argent, le plus souvent en espèces, dans le système économique ;
- l'empilage ou le lavage qui consiste à multiplier les étapes ou les écrans pour masquer l'origine du financement ;
- l'intégration ou recyclage qui consiste à réaliser des investissements ou des dépenses d'apparence classique, au terme du processus.
La succession de ces étapes entraîne une diversification des rôles et donc une organisation. Le blanchiment est donc lui-même une forme de délinquance organisée.
Cette activité fait appel à des expertises financières ou juridiques spécifiques et, donc, à des métiers (avocats conseil, comptables, banquiers, traders) particuliers.
Le blanchiment requiert des qualités professionnelles différentes de celles d'un chef de gang, trafiquant de stupéfiants ou proxénète. On retrouve donc une spécialisation et une division des tâches, caractéristiques de la criminalité organisée.
Pour identifier et démanteler de tels réseaux via leur activité de blanchiment, il faut consolider et élargir l'utilisation de techniques d'enquête actuellement cantonnées à la lutte contre le trafic de stupéfiants.
2.- La nécessaire consolidation juridique des opérations sous couverture et des livraisons surveillées
En 1994, une opération de police judiciaire de grande envergure a permis le démantèlement d'un réseau important de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de cocaïne, organisé depuis la Colombie et l'interpellation de plus de 50 personnes. Cette opération constitue encore le plus gros succès obtenu à ce jour en France en matière de lutte contre le blanchiment.
Devant la Mission, l'un de ses concepteurs, M. René Wack, alors chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière, a souligné le grand professionnalisme de ce type de réseau et la nécessité d'avoir recours à des techniques d'enquête inhabituelles, notamment l'infiltration et les livraisons surveillées.
Quand la police judiciaire blanchit pour le compte
du cartel de Cali
M. René WACK, ancien chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière : De mon expérience de six ans à la tête de l'Office, je n'ai trouvé qu'une seule technique d'enquête qui permette vraiment d'attaquer le crime organisé sous l'angle financier, c'est la technique de l'infiltration. [...]
Plutôt que de parler de façon théorique, je peux évoquer l'affaire « Margarita » et vous montrer comment, dans une opération d'infiltration, nous avons réalisé, en partant de l'angle financier, la plus belle affaire de démantèlement de trafic de stupéfiants de ces dernières années. Nous n'avons pas saisi énormément de marchandises, mais le résultat s'est soldé par 150 ans de prison, ce qui me semble plus efficace que de saisir une tonne de cocaïne et d'arrêter un petit intermédiaire, qui est un demi-sel. Dans cette affaire, nous avons identifié les vrais maîtres d'_uvre colombiens, les blanchisseurs et les patrons des cartels. [...]
Je reviens sur l'opération « Margarita ». C'est un dossier qui a démarré de la façon suivante : lorsque j'étais le patron de l'Office, un jour, les douaniers américains viennent me voir pour me dire qu'ils avaient une opération très importante en cours à Atlanta, en Géorgie, avec un de leurs agents infiltré et qu'ils étaient en train de blanchir de l'argent du cartel de Cali. Ils avaient identifié le financier à Bogota qui récupérait une partie de l'argent venant du trafic de cocaïne aux Etats-Unis, grâce au réseau qu'ils avaient mis en place. Ce financier avait contacté leur agent sous couverture, lui disant qu'il y avait des problèmes pour rapatrier le cash qui se trouvait en Europe. Il leur manquait un homme à Paris, un à Madrid et un à Rome.
Les Américains nous ont demandé si nous pouvions présenter quelqu'un aux Colombiens. Le Colombien responsable du rapatriement de l'argent du trafic de cocaïne pour la France se prénommait Mario. Nous n'avions au départ aucun autre renseignement.
J'avais déjà un collaborateur qui travaillait pour moi, qui n'apparaissait jamais dans le service, que l'on a converti du jour au lendemain en homme d'affaires, et nous avons monté une filiale d'une société américaine d'import-export. Nous avons contacté des Colombiens et commencé à accepter des dollars issus du trafic.
Parallèlement, j'avais une équipe qui faisait un travail de terrain, surveillances, téléphone, etc. Mais l'opération la plus importante était le blanchiment, que nous réalisions avec l'aide d'une banque amie, qui était au courant.
Jusqu'alors, nous pensions que les cartels étaient organisés dans la branche distribution et la branche financière. Je me suis en fait aperçu qu'il y avait une troisième branche, la plus importante, la branche logistique. L'argent venant du trafic de stupéfiants n'est pas entièrement rapatrié vers le pays auteur du trafic, une grande partie reste en France pour financer la logistique. C'est ainsi que nous avons découvert des appartements loués à Paris pour le passage des Colombiens. Le lieu de stockage des tonnes de cocaïne en transit en France était Saint-Pardoux Morterolles dans la Creuse, haut lieu du crime s'il en est.
Nous avons découvert l'endroit où ils achetaient des catamarans qu'ils faisaient construire spécialement avec une trappe en dessous avec accès à la mer, si jamais le catamaran se retournait ! Détail très intéressant : ces catamarans étaient payés par de l'argent provenant de bureaux de change de Houston au Texas.
Nous avons pu identifier toutes les personnes, y compris le responsable pour l'Europe, en poste à Madrid et Barcelone, qui était le neveu du patron colombien.
Tout cela grâce à l'analyse des flux financiers et à une enquête de police classique qui a permis, pour la première fois, de démanteler un réseau entier, avec les skippers, les bateaux, les lieux de stockage, l'argent, etc.
M. le Président : Combien cela vous a-t-il demandé de temps ?
M. René WACK : Une année intensive.
M. le Président : C'est rapide.
M. René WACK : Le problème était que nous avions même trop d'informations et j'ai dû accélérer le mouvement parce qu'à la fin, j'avais soixante-dix suspects alors que l'Office comptait soixante personnes. [...]
Cette opération d'infiltration s'est faite en étroite coopération avec M. Marin et Mme Fulgeras du parquet de Paris. Il y avait des comptes-rendus, nous nous voyions au moins une fois par mois, parfois même une fois par semaine parce que la situation évolue parfois très vite et qu'il faut prendre des décisions, d'autant que se posent des problèmes juridiques énormes parce que les opérations d'infiltrations ne sont permises en France qu'en matière de trafic de stupéfiants. Si nous avions découvert qu'il s'agissait d'argent provenant d'un trafic d'armes, nous aurions été dans l'illégalité. [...]
Je ne fais pas là d'élitisme, mais il faut des gens bien formés car on ne peut pas faire d'opérations d'infiltration, se faire passer pour un financier véreux, si l'on ne connaît rien au monde bancaire ou à celui de la finance. Par exemple, au début de cette opération, notre crédibilité a été jugée sur le pourcentage que nous demandions : il fallait que nous connaissions le coût de ce service à Paris. Je peux vous le dire, c'est 14 %. Nous aurions pu négocier à 15 ou 13 %, mais cela a un coût. Si on le fait pour rien, cela n'existe pas ; si on demande 25 %, on n'est pas crédible.
Il faut vraiment avoir une bonne connaissance du monde criminel pour être crédible dans ce genre d'opération. Je puis vous assurer que ce que nous avons appris sur les cartels colombiens montre bien que nous sommes en présence d'une criminalité ultra organisée, utilisant des techniques de services de renseignement. C'est ainsi qu'un Colombien qui se déplace dans Paris pour aller d'un point A à un point B change au moins cinq fois de taxi, qu'il appelle chaque fois à partir de bornes, jamais d'un téléphone. Lorsqu'un Colombien de Paris a besoin d'en appeler un autre à Marseille, il appelle un numéro de téléphone au Mexique en laissant un message à une boîte vocale, le message disant : « Si Pedro appelle, qu'il me rappelle tel jour à telle heure à tel numéro », le numéro étant celui d'une cabine publique. Si Pedro appelle, il recevra le message. S'ils ne peuvent se contacter, l'opération est annulée et on reprend un nouveau rendez-vous. Voilà le genre d'individus auxquels on a affaire.
Pourquoi ont-ils choisi comme lieu de stockage Saint-Pardoux Morterolles ? Ce village se situe en bout de réseau téléphonique, il était donc impossible de se brancher pour faire des écoutes car, techniquement, nous aurions pris une telle puissance sur la ligne qu'ils s'en seraient rendu compte. Le seul moyen d'écouter était donc de grimper sur les poteaux téléphoniques, comme dans certains films, mais on ne peut laisser quelqu'un au sommet d'un poteau télégraphique jour et nuit. Il s'agissait de grands professionnels qui ne laissent rien au hasard.
Impossible de faire la moindre filature, c'était un cul-de-sac. Tout était calculé. On a vraiment là affaire à des criminels organisés, spécialistes de la filature, de la contre-filature, etc. Mais nous savons tout cela parce que nous avons blanchi plusieurs centaines de milliers de dollars sur la place de Paris.
A cette occasion, j'ai aussi appris que j'ai blanchi à Paris non pas l'argent du trafic de cocaïne français, mais celui d'Espagne, d'Italie du Nord et de Londres, afin que je ne puisse pas faire de lien entre le trafic et l'argent.
Sur un transfert, nous avons interpellé les gens dont nous pensions qu'ils allaient chercher de la drogue à Madrid. En fait, ils faisaient des transferts physiques d'argent pour le ramener à Paris afin qu'il soit blanchi. Cet argent était même « prélavé », puisque je n'ai vu que des dollars, pas un franc ni une peseta ni une livre sterling. Ils utilisaient les services de n'importe qui, parfois d'étudiants, pour reconvertir des pesetas en dollars.
Toutes ces observations expliquent pourquoi l'infiltration est la seule technique que j'estime efficace pour lutter contre ce type de délinquance.
Lorsque je vois le battage médiatique qui est fait à propos des Russes, quelle erreur ! J'ai lu dans un article que l'on faisait du harcèlement administratif pour les empêcher de venir sur le territoire national. Moi, j'avais une autre méthode : je les laissais venir, je savais quel hôtel ils fréquentaient et je m'occupais de savoir ce qu'ils se disaient. Ce ne sont pas les mêmes techniques, mais c'est déjà du judiciaire proche du renseignement. Ensuite, on exploite des informations et on essaie de créer un organigramme.
Si aujourd'hui on me demandait ce qu'il faut faire en France pour lutter contre le crime organisé, je ne conseillerais pas de grands offices calqués sur le code pénal - office du trafic de stupéfiants, office de répression du banditisme, office du proxénétisme, du vol d'_uvres d'art, traite des êtres humains, grande délinquance financière, etc. Le vrai crime organisé, ce sont de véritables holdings : un jour, ils font du jeu clandestin, le lendemain du trafic de cigarettes et ils ont des activités multiples. Dès lors, tous les renseignements qui les concernent sont éparpillés entre tous les services opérationnels. Dans ces conditions, je conseillerais de créer une unité qui ne travaille que sur les Russes, quelle que soit la nature des infractions, une entité qui travaille sur les Colombiens, avec des gens qui parlent couramment l'espagnol, et une entité qui travaille sur les Chinois. Il se passe énormément de choses dans le Chinatown de Paris et la police française ne le sait pas car nous n'avons aucun collaborateur qui parle chinois.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. René Wack, ancien chef de l'OCRGDF, le 13 octobre 1999.
Cet exemple démontre à l'évidence le haut niveau de professionnalisme requis pour mener à bien ce type d'opération.
L'infiltration ou l'opération sous couverture ne peut s'improviser. Parce qu'elle impose une connaissance parfaite des rouages et des méthodes de la criminalité qu'elle combat, elle doit être précédée d'une formation spécifique des policiers qui l'exercent ainsi que d'une action durable de renseignement (écoutes, filatures, etc.) sur le réseau qu'elle se propose de pénétrer. La moindre erreur ou imprudence mettant en jeu la vie des agents impliqués dans l'action, la coordination des services répressifs doit être sans faille et la divulgation de l'identité réelle des policiers infiltrés minimale, même devant les tribunaux lors des procès des réseaux démantelés.
L'utilisation de ces techniques reste assez artisanale en France, puisqu'elles restent cantonnées au trafic de stupéfiants, souvent déclenchées sur demande d'un pays qui travaille sur un réseau international, et exercées dans des conditions juridiques mal sécurisées.
Comme l'a souligné devant la Mission le chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière, M. Yves Godiveau :
En matière d'infiltration, la France fait pâle figure
M. Yves GODIVEAU, Chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) : Lutter contre la grande délinquance financière et contre le blanchiment d'argent nécessite des moyens financiers, ne serait-ce que parce qu'il faut mettre en _uvre de temps en temps des dispositifs extraordinaires pour rémunérer des actions précises. Il ne s'agit pas de payer des indics : les indics on ne les paie pas car tout repose sur un échange de bons procédés, j'en fais un principe.
En revanche, nous pratiquons légalement des techniques d'infiltration des filières. La mission d'un agent sous couverture est de recueillir le maximum de renseignements de façon à ce que, le moment venu, une opération d'interpellation puissent être menée de manière efficace. Quand on est fonctionnaire sous couverture dans le milieu des « stups », des jeans et un vieux polo peuvent suffire ; lorsqu'on le devient dans les milieux financiers, en ayant comme interlocuteurs des banquiers ou tout autre personne représentant le pouvoir de l'argent, il faut acheter ou louer une voiture, avoir un appartement, pouvoir disposer d'un certain train de vie.
M. le Président : Utilisez-vous souvent cette pratique ?
M. Yves GODIVEAU : Malheureusement non, et c'est un des obstacles que je tenais à souligner, car la loi ne nous permet pas de le faire de manière cohérente. Toutefois, l'Assemblée devrait débattre d'un texte prochainement, et nous espérons que la France rattrapera son retard en ce domaine.
De nombreux pays pratiquent cette technique, notamment en matière économique et financière et de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le concert européen, la France fait pâle figure puisque nos collègues belges, allemands, anglais, espagnol ou italiens pratiquent depuis très longtemps ce type d'enquête qui donne de bons résultats, sans même parler des Américains qui y recourent à une toute autre échelle.
Extrait de l'audition de M Yves Godiveau, chef de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), le 6 octobre 1999.
Monsieur Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, a détaillé ces carences devant la Mission en regrettant notamment l'absence de statut de l'agent sous couverture et de règles garantissant son anonymat tout au long de la procédure.
Pour un statut de l'agent sous couverture
M. Jean-Pierre CHEVENEMENT : Vous le savez, actuellement, les dispositions du Code de procédure pénale et du Code des douanes, mentionnées comme opérations des livraisons contrôlées, s'appliquent strictement à la répression des trafics de stupéfiants et du blanchiment d'argent qui en résulte.
Cette opération de livraison contrôlée est subordonnée à l'autorisation préalable du magistrat compétent. En conséquence, ces policiers infiltrés agissent dans le cadre d'un scénario qu'ils ont proposé. Naturellement, ces actions ne doivent pas déterminer la commission de l'infraction. Elles doivent simplement permettre la révélation de ces infractions. Les fonctionnaires engagés bénéficient donc du fait justificatif qu'instaurent les textes, quand les opérations qu'ils mènent s'inscrivent dans les conditions relatives à l'enquête initiale, aux infractions autorisées et lorsque cette opération s'inscrit également dans le cadre de l'information préalable donnée au magistrat compétent.
Les dispositions actuelles sont parcellaires. Aucune mesure ne garantit l'intégrité physique et juridique des agents en opération. Les textes sont muets, par exemple, sur le fait que ces agents doivent disposer de papiers d'identité qui leur permettent de rester, en fait, anonymes. Mais l'anonymat n'est pas clairement autorisé pour les agents appelés à témoigner devant les tribunaux, ce qui pose problème. Pourtant, c'est une arme moderne de lutte contre les entreprises criminelles qui justifierait une extension de ce dispositif aux formes les plus graves de la criminalité organisée.
Tout cela plaide pour une reconnaissance légale des opérations d'infiltration et la création d'un véritable statut de l'agent sous couverture. Il serait utile d'ailleurs d'harmoniser également les pratiques européennes.
Extrait de l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, devant la Mission, le 28 octobre 1999.
La Mission appelle donc de ses v_ux une réforme du code de procédure pénale afin, d'une part, de permettre l'utilisation de ces moyens d'enquête pour lutter contre les organisations criminelles dans leur globalité et non contre le seul trafic de stupéfiants et, d'autre part, d'améliorer la protection de l'agent infiltré.
Propositions de réforme du code de procédure pénale
en vue de développer l'utilisation de l'infiltration
1) Extension du champ d'application de l'infiltration, au-delà du trafic de stupéfiants, aux infractions suivantes : enlèvement et séquestration, proxénétisme, diffusion d'images pornographiques de mineurs, vol en bande organisée, extorsion de fonds, recel en bande organisée, blanchiment, trafic d'armes en relation avec une entreprise terroriste, faux-monnayage, association de malfaiteurs (possibilité de rapprochement avec la liste des crimes et délits à la base du mandat d'arrêt européen).
2) Irresponsabilité pénale des agents étrangers autorisés à procéder aux opérations sous couverture sur le territoire national pour les actes nécessaires à l'exécution de leur mission et commis dans le cadre de l'autorisation de l'autorité judiciaire.
3) Autoriser l'usage d'une identité d'emprunt pour les agents infiltrés.
4) Possibilité, pour l'agent infiltré, de refuser son audition par l'autorité judiciaire lorsque sa sécurité est menacée, au profit de l'audition de l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête.
5) Coordination, au niveau national, des opérations d'infiltration par l'intermédiaire des offices centraux.
6) Création d'un titre spécifique du code de procédure pénale, consacré aux règles dérogatoires en matière de poursuite et d'instruction des infractions relevant de la criminalité organisée, qui aura vocation à devenir le réceptacle des dispositions législatives ultérieures dans ce domaine.
C.- mondialisation des échanges financiers et traçabilité : la France favorable à la régulation
Chacun connaît désormais les termes du débat relatif aux effets de la mondialisation financière, à travers ses bienfaits (allocation optimale des ressources, rationalité économique des choix d'investissement, financement des économies émergentes) mais aussi ses excès ou ses déviances (spéculation effrénée, comportements cumulatifs des marchés, etc.).
Sous le prisme de la lutte contre le blanchiment, il est indéniable que la globalisation financière, du fait de l'ampleur et de la rapidité des échanges qu'elle permet, a singulièrement compliqué la tâche des enquêteurs, comme l'ont souligné devant la Mission les responsables de l'Inspection de la Commission des opérations de bourse, et notamment M. Ould Amar Yahya, ancien responsable de la surveillance des marchés de la COB, principal concepteur de ses programmes informatiques de détection d'anomalies et lui-même mis en examen pour « manipulation de cours, délit d'initié et blanchiment aggravé en bande organisée. »
La globalisation financière facilite le blanchiment
M. Ould Amar YAHYA, responsable de la surveillance des marchés à la Commission des opérations de bourse (COB) : La globalisation fait qu'à partir de 15 heures 30, à Paris, les capitaux commencent à basculer sur les Etats-Unis et puis, à partir de 23 heures 30, vers l'Asie. Cela continue à tourner. Le matin, quand j'appelle Indosuez sur la salle de marché de Singapour, on me dit d'attendre trente minutes car le standard va basculer. Les traders, dans les différentes places, reçoivent des capitaux qu'ils gèrent pendant un laps de temps et cela continue à tourner.
Aujourd'hui, il s'échange deux mille milliards de dollars par jour sur le marché des devises, alors que les besoins de l'humanité, pour l'économie réelle, sont de dix milliards de dollars par jour. La différence entre les deux est énorme. Je n'ai pas cité le marché des contrats à terme, des valeurs mobilières, des matières premières... Les échanges sont donc colossaux.
Les stratégies utilisées sur ces marchés sont globales. Quand nous avons cité le chiffre d'un milliard, c'est le résultat d'une stratégie classique d'arbitrage que l'on voit tous les jours. On ne peut mettre un filtre sur cela, sinon on doit interroger toute la place.
M. Hervé DALLERAC, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse (COB) : Dans cette gigantesque masse de capitaux, une énorme part résulte de la simple spéculation pour gagner de l'argent, mais le blanchiment y trouve sa place.
M. le Président : Faut-il admettre l'idée qu'une des conséquences de la globalisation financière est que l'on ne puisse détecter un milliard potentiel de blanchiment par jour ?
M. Hervé DALLERAC : Indéniablement, cela facilite l'anonymat et la discrétion des opérations de blanchiment. »
Extrait des auditions de M. Ould Amar Yahya, responsable de la surveillance des marchés, et de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse, dans les locaux de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
La dimension internationale, voire mondiale, est désormais systématiquement présente dès lors que l'on traite des questions de régulation financière.
C'est pourquoi le gouvernement de M. Lionel Jospin a systématiquement mis l'accent, dans les enceintes de la diplomatie économique et financière, sur la nécessité de mieux réguler le système financier international, afin d'en accroître la transparence.
Le rôle pionnier joué par la France
dans la régulation internationale
M. Laurent FABIUS, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : Le rôle pionnier joué par la France dans les enceintes internationales est connu. Le GAFI en est une illustration, et nous y jouons un rôle moteur : pays et territoires non-coopératifs, révision des 40 Recommandations, extension de son mandat initial à la traque des sources de financement du terrorisme, rôle des institutions financières internationales. Les résultats parlent d'eux-mêmes, comme en ont témoigné les discussions à Ottawa ces derniers jours sur la lutte contre le financement du terrorisme.
La lutte contre le blanchiment et le rôle du GAFI ne sont qu'un élément de l'arsenal mobilisé par notre pays en faveur d'une régulation renforcée. Au-delà des dangers engendrés par les bulles financières, la faillite d'Enron confirme que la maîtrise des abus de la globalisation reste à consolider et qu'une trop grande confiance dans les seuls mécanismes du marché est périlleuse. Les travaux du Forum de stabilité financière, notamment ceux qui ont été menés avec le FMI sur les centres offshore mal régulés, et les initiatives de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables sont essentiels. S'agissant de l'OCDE, je suis attaché au respect de l'échéance du 28 février, étape déterminante dans l'identification des « paradis fiscaux non coopératifs ». Je souhaite aussi que soient accomplies des avancées en matière de levée du secret bancaire dans le domaine fiscal ou encore des échanges d'informations. Sur ces enjeux, la France fait valoir une vision globale et durable comme j'ai eu l'occasion de le rappeler au G7 samedi dernier.
Les discussions internationales sur ces sujets sont souvent difficiles et longues. Il faut tenir un langage de vérité : nous ne devons pas dissimuler ou minimiser les divergences qui peuvent exister entre les Etats. Nos positions « en avance » sur ces questions nous ont parfois isolés, rendant indispensable une forte détermination de la part des pouvoirs publics. Au total, au cours de cette législature, nous avons fait progresser les idées françaises en faveur d'une meilleure régulation de la globalisation, fondée sur la coopération internationale.
Au niveau européen, au cours du deuxième semestre 2000, la présidence française de l'Union européenne a permis de mettre la lutte contre le blanchiment au coeur des priorités des Quinze. La traduction la plus importante est l'élaboration de la position commune du Conseil sur la révision de la directive anti-blanchiment, qui a été finalement approuvée à l'issue du processus de codécision à l'automne 2001. Vous connaissez son contenu. Nous allons désormais engager le processus de transposition en droit français. Je suis certain qu'il s'agira d'un chantier prioritaire du prochain gouvernement.
La France a également milité et agi pour le développement d'une action européenne multidisciplinaire en matière de lutte contre le blanchiment par le conseil conjoint JAI/ECOFIN. Nous avons ici aussi fait _uvre de pionniers. Seule une action résolue et concertée entre les sphères financière, policière et judiciaire permet d'obtenir des résultats concrets durables dans la lutte contre le blanchiment.
Les travaux sur la fiscalité de l'épargne sont déterminants dans l'agenda européen. La France plaide pour une approche volontariste. En ce domaine, les décisions se prennent à l'unanimité et certains de nos partenaires - l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg - ont soulevé des réserves sur ce texte. Le principal point d'achoppement est l'adoption de mesures équivalentes à l'échange automatique d'informations par six pays tiers dont les Etats-Unis, la Suisse, le Liechtenstein ou Monaco. Un accord a pu finalement être trouvé et l'adoption définitive de cette directive devrait, je l'espère, intervenir d'ici à la fin de cette année, selon les résultats des négociations avec les pays tiers. Parallèlement, la France a été très active dans la lutte contre la concurrence fiscale dommageable au sein de l'Union, avec le code de conduite sur la fiscalité des entreprises. Autant de fronts sur lesquels la finalisation du paquet fiscal en 2002 sera déterminante.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. Laurent Fabius, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, le 13 février 2002.
Ce combat, mené successivement par MM. Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, au niveau gouvernemental, et anticipé, sur un plan parlementaire, par la Mission, a contribué à la prise de conscience internationale du phénomène et a permis d'obtenir des avancées significatives qui ne peuvent pas encore être qualifiées de décisives, ce qui pose notamment la question des limites de la régulation interétatique et de l'opportunité de la création d'une supervision transnationale.
1.- Les Etats et territoires non coopératifs
La lutte contre les Etats et territoires non coopératifs a fait d'importants progrès ces dernières années, dans la mesure où elle a contraint les Etats déviants à adopter une posture défensive, consistant à réfuter les accusations publiquement portées à leur encontre.
L'exercice d'identification mené par le GAFI, quoiqu'imparfait, a été utile mais il doit être accompagné par une action vigoureuse de ses Etats membres, qui font encore trop souvent preuve, dans ce domaine, d'une hypocrisie condamnable.
a) Identification et sanctions
L'identification des Etats non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment relève du GAFI. Celui-ci a défini 25 critères permettant de caractériser cette notion qui se différencie de celles de centre offshore ou de paradis fiscal qui reposent davantage sur l'attribution d'un régime dérogatoire (fiscal et/ou réglementaire) aux entités ayant leur siège sur le territoire, mais exerçant leur activité ailleurs.
Tous les territoires non coopératifs ne sont pas des centres offshore, comme le montre le simple exemple de la Russie et, inversement, les centres offshore ne sont pas tous non coopératifs même si la discrétion qu'ils entretiennent sur les activités qu'ils abritent est une dimension essentielle de leur compétitivité.
On peut légitimement s'interroger sur l'absolue neutralité du GAFI et sur la bienveillance relative avec laquelle il traite les territoires plus ou moins coopératifs qui appartiennent à la sphère d'influence d'un Etat membre particulièrement puissant.
De même, ce n'est pas parce qu'un territoire n'est pas ou n'est plus inscrit dans la liste du GAFI qu'il est irréprochable sur le plan de la lutte contre le blanchiment. Les territoires figurant sur cette liste sont particulièrement négligents, ce qui ne signifie pas que ceux qui n'y figurent pas soient vertueux. Pour mémoire, on signalera, par exemple, que les Bahamas, les îles Caïman, le Liechtenstein et Panama ont été retirés de la liste en juin 2001, alors que les Iles Vierges britanniques, Jersey ou Guernesey, n'y ont jamais figuré.
Comment déterminer la proportion d'argent sale
dans la masse des actifs transitant
par les centres offshore ?
L'ensemble des paradis financiers draine plus de la moitié (54,2 %) des avoirs détenus hors-frontières, pour un total de plus de 5 000 milliards de dollars. Plus de 4 000 banques offshore y sont installées, et on y compte également plus de 2,4 millions de sociétés-écrans ! [...]
Aucune étude scientifique sérieuse n'a été menée à ce jour pour déterminer quelle proportion de ces avoirs est d'origine criminelle. S'agissant d'une économie grise, il est évidemment difficile de mettre en avant des données fiables, d'autant qu'une grande partie de ces capitaux criminels sont investis dans les centres offshore déjà pré-blanchis et ne sont pas « étiquetables » en tant que tels.
De plus, l'acception de la notion de capitaux criminels est plus ou moins large selon que l'on n'y recense que les produits des activités des organisations criminelles stricto sensu, si l'on tient compte de l'ensemble des biens dérivés d'une infraction pénale, ou si l'on y ajoute également le produit des infractions fiscales. Si l'on se base sur l'acception la plus large, et en tenant compte du fait que l'attrait principal de ces paradis financiers est la possibilité de cacher l'identité du propriétaire des biens et de mettre ceux-ci à l'abri de la confiscation, on peut, sans se tromper, estimer la part des biens d'origine illicite dans les avoirs offshore entre 10 et 20 % de la totalité des capitaux. La plus grande partie des avoirs détenus offshore reste, en effet, des capitaux d'origine licite, représentés notamment par des fonds de retraite ou d'investissement, et qui vont chercher offshore une « optimisation fiscale » qui reste dans les limites de la légalité de leur pays d'origine. Ces 10 à 20 % de capitaux sales représentent tout de même une fourchette entre 500 et 1 000 milliards de dollars. [...]
A vouloir tout embrasser, le risque existe de perdre de vue l'objectif initial de la machine de guerre anti-blanchiment qui a été mise en place depuis quinze ans, et qui est de s'attaquer au crime organisé et au terrorisme. Les véritables menaces pour les institutions des Etats sont celles-là. Pour mieux cibler, il faut donc mesurer de manière plus stricte ce que représente l'argent du crime organisé et la finance terroriste. Que pèsent-ils dans la masse des avoirs offshore ? Vraisemblablement des chiffres beaucoup plus raisonnables, qui ne dépassent sans doute pas les 50 milliards de dollars : de quoi faire frémir malgré tout.
Extrait de la contribution de M. Jean-François Thony - « La problématique « offshore » in rapport moral sur l'argent dans le monde en 2001, p. 302 et 303.
Pour sa part, la Mission de l'Assemblée nationale a considéré qu'il convenait d'examiner sans complaisance le comportement des Etats de l'Europe afin de s'assurer de leur exemplarité avant de se permettre de donner des leçons au reste du monde.
Elle a donc consacré une partie importante de ses travaux à l'analyse de certains Etats ou territoires européens régulièrement cités comme des obstacles à la reconstitution des flux financiers douteux et elle a publié une série de monographies successivement consacrées au Liechtenstein, à Monaco, à la Suisse, à la place de Londres et aux Dépendances de la Couronne, et au Luxembourg. Ces monographies ont permis d'accélérer la prise de conscience de certains de ces territoires et ont parfois débouché sur des réformes importantes.
Certains enquêteurs français ou européens ont fait part à la Mission de l'évolution favorable de leurs commissions rogatoires internationales, à la suite de son passage dans tel ou tel sanctuaire de l'argent douteux, mais il convient de rester vigilant à plus long terme.
Au-delà de la mise en accusation publique, s'est rapidement posée la question des sanctions, ou, pour parler comme le GAFI, de contre-mesures.
Dans ce domaine aussi, la France a assumé un rôle de pionnier puisqu'elle a, tant au niveau national que communautaire, particulièrement soutenu les suggestions émises par le GAFI.
Les contre-mesures proposées par le GAFI
Recommandation 21. Les institutions financières devraient porter une attention particulière à leurs relations d'affaires et à leurs transactions avec les personnes physiques et morales, y compris les sociétés ou les institutions financières, résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou trop peu les présentes recommandations. Lorsque ces transactions n'ont pas de cause économique ou licite apparente, leur arrière-plan et leur objet devraient être examinés dans la mesure du possible ; les résultats de cet examen devraient être établis par écrit, et être disponibles pour aider les autorités de contrôle, de détection et de répression, les commissaires aux comptes et les contrôleurs internes ou externes.
Outre l'application de la Recommandation 21, le GAFI recommande l'application d'autres contre-mesures qui doivent être graduelles, proportionnées et flexibles quant aux moyens mis en _uvre et qui doivent être prises dans le cadre d'une démarche concertée en vue d'atteindre un objectif commun. Le Groupe pense qu'un renforcement de la surveillance et de la déclaration des opérations financières ainsi que d'autres initiatives pertinentes concernant ces pays ou territoires doivent être désormais mis en _uvre, avec notamment la possibilité de :
- imposer des prescriptions rigoureuses pour l'identification des clients et renforcer les conseils, notamment les conseils financiers spécifiques à chacun de ces pays ou territoires, à l'intention des institutions financières pour l'identification des propriétaires réels avant d'établir des relations commerciales avec des particuliers ou des sociétés de ces pays ou territoires ;
- renforcer les mécanismes de déclaration appropriés ou procéder à la déclaration systématique des opérations financières avec ces pays ou territoires en considérant que des opérations financières avec de tels pays sont plus susceptibles d'être suspectes ;
- tenir compte, lors de l'examen des demandes d'autorisation en vue de l'établissement dans des pays membres du GAFI de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de banques, du fait que la banque concernée est établie dans un PTNC ;
- mettre en garde les entreprises du secteur non financier contre les risques de blanchiment de capitaux liés aux opérations avec des entités établies dans les PTNC.
GAFI - Rapport visant à identifier les pays ou territoires non coopératifs - 22 juin 2001, p. 3 et 4.
La France s'est donné les moyens juridiques d'appliquer ces sanctions au cours de la discussion de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, qui a permis l'adoption de l'article L. 563-1.1 du code monétaire et financier, ainsi rédigé :
« Art. L. 563-1.1.- Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du même article. »
Parallèlement, au niveau communautaire, elle a soutenu l'adoption des conclusions du conseil conjoint ECOFIN/JAI du 16 octobre 2001, au terme desquelles « Les Etats membres ont décidé d'appliquer, de concert et concomitamment, les contre-mesures précitées aux Philippines et à Nauru, si nécessaire, avec effet immédiat. Si l'adoption de textes législatifs s'avère nécessaire pour permettre la mise en _uvre des contre-mesures, les Etats membres, réunis au sein du Conseil, s'engagent à veiller à ce que leur législation leur permette d'appliquer les contre-mesures à compter du 1er janvier 2002. » (conclusion 8 d).
Le 5 décembre 2001, le GAFI décidait l'imposition de contre-mesures à Nauru, alors que, le 18 décembre 2001, il en exemptait, jusqu'à nouvel ordre, les Philippines.
Dès le 7 février 2002, le Gouvernement français prenait un décret imposant aux organismes financiers la déclaration systématique à TRACFIN des opérations avec Nauru d'un montant supérieur à 8 000 euros.
Même si l'Etat de Nauru peut, a priori, sembler un adversaire modeste, son rôle dans les circuits mondiaux de blanchiment n'est pas négligeable, si l'on en croit certains experts, comme M. Jean-François Thony :
« Nauru - qui compte désormais 400 banques offshore -, Niue et Palau sont parmi les plus récents et les plus opaques des paradis financiers établis dans le Pacifique. Ils sont directement liés au blanchiment de l'argent du crime organisé russe. C'est ainsi que Nauru a été impliqué dans le scandale de la Bank of New York, par le biais d'une banque offshore d'origine russe, la Sinex Bank, qui a été le donneur d'ordre du virement de plus de 3 milliards de dollars vers des comptes de correspondants ouverts à la Bank of New York. » (M. Jean-François Thony, op. cité p. 302).
Quoi qu'il en soit, le signal politique ainsi lancé par le GAFI et l'Union européenne est sans ambiguïté et les contre-mesures évoquées représentent une réelle force de dissuasion sur certains Etats déviants.
Pour sa part, le Gouvernement français n'a pas exclu d'aller plus loin que les sanctions proposées par le GAFI. Tout en replaçant l'utilisation de la sanction dans un contexte global de coopération, M. Lionel Jospin a clairement évoqué la suspension de l'aide publique française au développement, pour les pays qui persisteraient dans une attitude non coopérative :
La conception française de la sanction
M. Lionel JOSPIN, Premier ministre : Ce combat doit être mondial, en outre, parce que les effets déstabilisateurs et pervers de la criminalité financière sont universels. Ils frappent plus durement encore les pays en développement. C'est pourquoi il faut rappeler que la lutte contre la délinquance financière n'est pas un combat des riches contre les pauvres, mais le combat du droit contre le crime. Parce qu'ils ont une vision commune des solidarités entre le Nord et le Sud, les Européens doivent veiller ensemble à ce que la lutte contre les flux financiers clandestins soit pleinement intégrée aux politiques de développement.
Je souhaite que l'Europe propose aux pays du Sud les stratégies « gagnant/gagnant ». D'abord en les associant aux réflexions internationales sur les normes de sécurité contre le blanchiment. Les disciplines collectives sont toujours mieux acceptées lorsqu'elles ont été collectivement débattues. Par ailleurs, l'Europe doit offrir son soutien aux pays qui s'engagent dans la voie de la conformité aux règles internationales, notamment en leur apportant l'assistance technique dont ils ont besoin.
En retour, les Européens devront décider s'ils maintiennent une aide publique au développement pour les pays ou territoires qui, après avoir reçu les avertissements nécessaires, continueraient délibérément d'enfreindre la discipline commune. C'est une question de cohérence. Pour sa part, le Gouvernement français entend suspendre les financements accordés à des pays en développement qui se seraient placés dans cette situation, à l'exception des projets bénéficiant directement aux populations.
Extrait de l'allocution de M. Lionel Jospin, Premier ministre, devant la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment - Paris, 8 février 2002.
b) Les banques françaises implantées dans les centres offshore : l'exemple des îles Caïman
Les pays industriels occidentaux qui animent le GAFI font preuve d'une hypocrisie coupable en tolérant, au-delà des condamnations vertueuses des centres offshore et des territoires non coopératifs, des implantations massives de leurs agents économiques dans ce type d'Etats.
Certains d'entre eux, comme les Etats-Unis, les y encouragent même en autorisant explicitement des montages d'évasion fiscale destinés à garantir leur compétitivité commerciale internationale. La loi américaine sur les sociétés de vente à l'étranger officialise ainsi l'exonération fiscale des sociétés qui domicilient, de façon tout à fait artificielle, les profits générés par des contrats internationaux, dans leurs filiales implantées dans les centres offshore.
Ces pratiques, qui facilitent aussi le versement de pots-de-vin aux « élites » des pays acheteurs, sont très fréquentes dans des secteurs comme l'aviation commerciale, l'armement ou le bâtiment et les travaux publics. Leur consécration officielle par les Etats-Unis leur a toutefois voulu d'être, à la suite d'une plainte de la Commission européenne, condamnés par l'Organisation mondiale du commerce pour concurrence déloyale.
Les agents économiques des pays occidentaux utilisent donc largement la « souplesse » et les « facilités » procurées par les centres offshore et en tirent un grand profit. Les banques françaises ne font pas exception à la règle et la Mission a pu aisément le vérifier en approfondissant le cas des îles Caïman qui constituent, avec les Bahamas, une implantation privilégiée de la finance internationale dans la zone caraïbe.
Les îles Caïman (259 km², 35 000 habitants) constituent une dépendance de la Couronne britannique, dotée d'une certaine autonomie. Leur proximité avec la côte de Floride (600 kilomètres de Miami) les place dans l'orbite économique des Etats-Unis.
Les îles Caïman présentent toutes les caractéristiques du centre offshore (secret bancaire à toute épreuve, extrême souplesse pour la création de sociétés, supervision financière minimale, fiscalité allégée, etc.). Leur poids financier est considérable et représente une bonne partie de celui de la zone caraïbe dans son ensemble. En 2000, la Banque des règlements internationaux avait évalué les actifs gérés dans cette zone à 900 milliards de dollars. Les banques immatriculées aux îles Caïman gèrent des dépôts d'un montant de l'ordre de 500 milliards de dollars, ce qui en ferait la cinquième place financière mondiale.
Etiquetées comme territoire non coopératif dès juin 2000 par le GAFI et classées, en avril 2000, par le Forum de stabilité financière dans le groupe présentant les plus grands dangers pour la stabilité financière internationale en raison des carences constatées en matière de supervision bancaire, les îles Caïman ont adopté une stratégie ingénieuse qui leur a permis de sortir de la liste « noire » du GAFI en juin 2001.
Cette stratégie a consisté à promulguer une série de lois qui témoignaient d'une prise de conscience politique du risque encouru et qui affichaient une meilleure volonté, tout au moins au niveau des intentions, comme le relève le GAFI dans son rapport de juin 2001 :
Les îles Caïman placées sous la surveillance du GAFI
Les îles Caïman ont accompli des progrès importants dans la mise en _uvre de leur nouveau régime de lutte contre le blanchiment. Elles ont sensiblement renforcé les ressources humaines et financières affectées à la surveillance financière et à leur service de renseignement financier. Elles ont entrepris un ambitieux programme d'inspection des institutions financières, imposé l'identification des clients des comptes préexistants d'ici le 31 décembre 2002, et imposé à toutes les banques agréées dans les îles Caïman d'établir une présence physique sur leur territoire.
A l'avenir, le GAFI accordera une attention plus particulière au maintien de la capacité du SRF et des autres autorités des îles Caïman à coopérer avec leurs homologues étrangers, à la capacité des autorités de tutelle financière d'atteindre leurs objectifs ambitieux en matière d'inspection, à l'identification des bénéficiaires des fiducies ainsi qu'aux progrès de l'application des prescriptions sur l'identification des clients aux comptes préexistants, ainsi qu'à la poursuite des efforts pour renforcer le respect par le secteur financier des nouvelles dispositions anti-blanchiment.
GAFI - Rapport visant à identifier les pays ou territoires non coopératifs - 22 juin 2001, P. 9.
Ces déclarations d'intention ont suffi au GAFI pour sortir les îles Caïman de sa liste noire, tout en les laissant sous contrôle renforcé ; d'autres observateurs, comme M. Yves Charpenel, ont dévoilé à la Mission la subtilité de la politique adoptée par les îles Caïman :
« M. Yves CHARPENEL : Pour ma part, j'insisterai sur la vigilance que doivent exercer les Etats de l'Union européenne, en raison de notre participation au GAFI, sur les dispositifs légaux qu'adoptent les pays sensibles. L'exemple le plus caractéristique de la réaction des petits pays est celui des Iles Caïman. Premier pays de la Caraïbe à se doter d'une législation anti-blanchiment sous la pression du G8, des Américains et des Français, il a réussi à créer le premier paradis juridique pour le blanchiment puisqu'il a réprimé avec une grande sévérité le blanchiment des capitaux émanant de trafics intérieurs, laissant la voie libre au blanchiment des capitaux venant des pays étrangers.
Dans un pays comme les Iles Caïman, il est évident que c'était un appel à faire venir les capitaux. Il faut donc être très attentif au fait que l'adoption de normes présumées protectrices n'est parfois pas protectrice des intérêts auxquels on pense. Dans le cas présent, la communauté internationale pourrait utilement dénoncer ces paradoxes criants qui expliquent qu'il y ait aujourd'hui encore plus efficace que les paradis offshore « classiques », c'est-à-dire les paradis juridiques. En effet, c'est en toute apparence de légalité que ces pays se mettent à l'abri des investigations conduites par d'autres Etats. » (Audition par la Mission de M. Yves Charpenel, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, le 15 septembre 1999).
La réglementation applicable à l'exercice de l'activité bancaire illustre à merveille la duplicité des îles Caïman.
Il existe en effet deux catégories de licences (A et B) qui sont délivrées en fonction des catégories de contreparties avec lesquelles l'établissement est habilité à traiter. La plupart des établissements optent pour la seconde catégorie, pour laquelle les contraintes d'agrément et de fonctionnement sont des plus souples, au motif que ces banques ne peuvent effectuer leurs opérations qu'avec des non-résidents des îles Caïman.
Il faut ajouter que, jusqu'à présent, les îles Caïman avaient organisé le développement des banques-coquilles puisqu'il n'existait aucune obligation de présence physique sur le territoire, au-delà de la désignation d'un représentant local, incarné par des cabinets juridiques qui ne comptaient pour rien dans la gestion effective de la banque.
Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si les îles Caïman comptent pas loin de six cents banques dont seulement une trentaine de banques locales, le reste étant essentiellement constitué de filiales ou succursales de banques occidentales, parmi lesquelles onze établissements français appartenant à huit groupes différents.
Ces entités ne sont, pour la plupart, que des « boîtes aux lettres » de structures logées à New York et leur surface financière propre est extrêmement limitée.
Les banques françaises implantées dans les îles Caïman
à la date du 31 décembre 2001
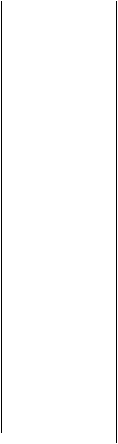 |
N° Licence |
type de licence |
- Banque nationale de Paris - Banque Sudameris - BNP Paribas Private Bank and - Crédit agricole Indosuez - Crédit industriel et commercial - Crédit Lyonnais - Inchauspe Bank corporation - Indosuez Trust Company (Cayman)Ltd - Natexis Banques populaires - Paribas - Société Générale |
79012 88012
79011 91067 74012 89016 93009 77005 78010 79033 |
Banque et trust Banque et trust
Banque Banque Banque Banque Trust Banque Banque Banque |
Les banques françaises sont très pudiques sur ce type d'implantations et ont tendance à les dissimuler aux pouvoirs publics. Il est ainsi révélateur de constater que l'enquête annuelle diligentée par le ministère de l'Economie et des Finances auprès des établissements sur leurs implantations (filiales et succursales) à l'étranger à la fin 1999, et publiée dans les Notes bleues avec deux ans de retard, ne mentionne que trois implantations aux îles Caïman, autant aux Bahamas et une seule aux îles Vierges britanniques (les Notes bleues de Bercy, n° 222 - du 16 au 31 janvier 2002).
De même, la Mission s'étonne que certains grands établissements, précisément questionnés par écrit sur ce type d'implantations, aient « oublié » de mentionner leurs établissements aux îles Caïman.
La Commission bancaire a adressé un questionnaire aux banques françaises sur leurs activités aux îles Caïman ; le moins que l'on puisse dire, à la lecture de la note de synthèse qui en découle, c'est que les réponses ont dû rester assez évasives...
Les activités des banques françaises aux îles Caïman :
« répondre aux besoins de certains clients »
En matière bancaire, la quasi-totalité des succursales à Cayman des banques françaises interrogées sont ainsi placées sous le contrôle direct des succursales ouvertes à New York, qui semblent plutôt délocaliser une partie de leurs activités à Cayman pour des raisons d'allégement tant des coûts que des contraintes administratives. [...]
D'une façon générale, les banques interrogées mettent principalement l'accent sur le fait que la délocalisation d'une partie des activités de New York sur Cayman permet de ne pas avoir à payer aux Etats-Unis une taxe dont l'assiette est le total des actifs, de réduire le risque d'avoir à constituer des réserves obligatoires sur les eurodollars collectés et de répondre aux besoins de certains clients. [...]
Les réponses fournies au questionnaire montrent que les activités logées à Cayman par certains des huit groupes bancaires qui y opèrent sont parfois de montants significatifs.
Il apparaît que la plupart des grands établissements sont présents sous la forme de succursales de type « B », qui dépendent de New York. Elles ont pour la plupart été fondées entre 1979 et 1980, à une époque où les autorités américaines imposaient 3 % (ce taux est actuellement de 0 %) de réserve sur les dépôts en eurodollars. Certains des groupes qui ont une succursale détiennent des participations dans des filiales spécialisées, notamment en matière d'opérations de marché, ou constituées avec des objectifs plus ou moins spécifiques.
Les succursales de Cayman sont fréquemment utilisées pour réaliser des échanges de trésorerie internes aux groupes, pour des montants parfois non négligeables. En net, la position des succursales est emprunteuse auprès du reste du groupe, pour des montants pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars. L'activité de crédit à la clientèle, largement constituée d'encours libellés en dollars au profit d'une clientèle de sociétés américaines, dépasse pour certains établissements 1 milliard de dollars.
Les dépôts issus de la clientèle contribuent en général de façon assez marginale au refinancement des succursales, à certaines exceptions près. L'ensemble des succursales sont plutôt équilibrées ou emprunteuses nettes auprès du système bancaire hors groupe. Le solde emprunteur est cependant limité.
Certaines banques délocalisent également une partie de leurs activités de marché. En outre, certains établissements ont constitué il y a quelques années à Cayman des filiales non agréées en qualité d'établissements de crédit et spécialisées dans les émissions de warrants.
Parmi les activités développées, on note en particulier des financements de projets, notamment de leasing aéronautiques, logés dans des sociétés enregistrées à Cayman. D'une façon générale, ces concours sont soit logés dans des filiales directes intégrées globalement, soit dans des « Special Purpose Vehicles » (SPV) ad hoc. Dans ce cas, la part du risque de crédit est enregistrée dans les comptes de la maison-mère. Il s'agit en général de projets suivis par la ligne de métier en charge du financement des grands projets, et donc conduits à être examinés lors de contrôles sur place habituels à Paris.
Source : Secrétariat général de la Commission bancaire - « Implantation des banques françaises aux îles Cayman ».
Ce qui apparaît en revanche clairement à la Mission, c'est que ces activités ne sont pas contrôlées et que ces implantations créent les conditions des montages les plus condamnables, tant au regard de l'évasion fiscale que de la lutte contre la délinquance financière.
Des activités peu contrôlées
M. Jean-François THONY, responsable du programme des Nations unies pour la lutte contre le blanchiment : Douze banques françaises, qui ont pignon sur rue en France, ont des filiales aux Iles Caïman. Je ne porte le blâme sur aucune de ces banques. Mais lorsque la législation française sur le blanchiment impose d'être très pointilleux sur l'origine des fonds, il est évident qu'on préfère passer par les filiales de ces banques dans ces pays-là pour faire les transactions.
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Jean-François Thony, responsable du programme des Nations unies pour la lutte contre le blanchiment, le 10 novembre 1999.
* *
*
Au total, la description ci-dessus montre que l'existence et le développement d'entités de ce type pose un problème de fond pour les superviseurs bancaires, notamment pour les pays de l'Union européenne, dans la mesure où la délocalisation qui en résulte amoindrit les bases du contrôle consolidé, qui échoit au pays d'origine en vertu de la seconde directive de coordination bancaire. En effet, un tel contrôle, qui repose prioritairement sur la vérification de l'existence de procédures rigoureuses de contrôle interne au sein des groupes bancaires, ne peut faire abstraction des conditions particulières de surveillance individuelle des activités par les autorités du pays d'accueil.
Source : Secrétariat général de la Commission bancaire - « Implantation des banques françaises aux îles Cayman ».
La Mission considère que la Commission bancaire devrait avoir le pouvoir d'interdire aux banques françaises l'ouverture de filiales ou de succursales dans un certain nombre de territoires offshore, dont le caractère artificiel et suspect des avantages compétitifs est évident.
c) Le piège des banques correspondantes
La capacité de nuisance de certains centres offshore et des entités plus ou moins fictives qui y sont immatriculées est démultipliée par les modes de fonctionnement traditionnels des échanges interbancaires et, notamment, par le système des comptes de correspondants entre les établissements bancaires.
Une banque correspondante délivre à une autre banque des services bancaires afin de lui permettre de réaliser des transactions financières internationales pour son compte et celui de ses clients, dans des Etats où elle n'a pas d'implantation physique. C'est ainsi que les grandes banques internationales dotées d'un réseau très ramifié peuvent assurer des fonctions de correspondants pour des milliers de banques partenaires dans le monde.
L'utilisation dévoyée des comptes de correspondants
M. René WACK, ancien chef de l'OCRGDF : A New York, en transferts internationaux, rien que pour le Crédit Lyonnais - et nous sommes une petite banque sur la place de New York -, nous avons entre huit et quinze milliards de dollars par jour. La City Bank, me semble-t-il, en effectue 500 milliards par jour. Pour toute l'Amérique du nord, ce sont 2 000 milliards de dollars par jour qui passent par les opérations de clearing. Dans ces opérations de compensation, seules les grandes banques se parlent ; les petites ne sont pas autour de la table. Nous, nous serons en contact avec la City Bank ou Barclays, lesquelles interviendront pour le compte d'autrui.
Pour vous donner un exemple, vous avez certainement lu dans la presse les mésaventures qui sont arrivées au président d'American Express France après l'affaire du Sentier, dans laquelle le Crédit Lyonnais avait également quelques chèques.
Que s'est-il passé ? Les chèques émis par le Crédit Lyonnais ou par les clients du Crédit Lyonnais étaient encaissés par un bureau de change en Israël, qui les donnait à une banque israélienne. La banque correspondante de la banque israélienne était Americain Express et la banque correspondante d'American Express France sont les Banques Populaires, qui sont le correspondant du Crédit Lyonnais. En définitive, nous recevions un chèque Banque Populaire. Le reste, nous nous le voyions pas.
Lorsque je suis arrivé au Crédit Lyonnais, j'ai demandé un audit de nos petites banques correspondantes. Nous avons fait le ménage car certaines étaient à risque. Mais le problème, c'est que nous sommes sans cesse démarchés. Je me souviens d'une demande faite par une banque finlandaise, qui souhaitait un accord de correspondant avec le groupe Crédit Lyonnais. A l'examen, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une banque finlandaise située juste à côté de la frontière russe, qui acceptait les dépôts en espèces des Russes qui ne voulaient pas aller plus loin. Ma réponse a donc été négative. Mais, si on ne fait pas l'appréciation du risque à ce moment-là, une fois l'accord conclu, c'est trop tard : les autres banques auront en face d'elles non pas cette banque finlandaise, mais le Crédit Lyonnais. C'est, en fait, toute l'organisation des finances mondiales qu'il faut repenser.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de M. René Wack, ancien chef de l'OCRGDF, le 13 octobre 1999.
Plusieurs affaires retentissantes de blanchiment ont récemment impliqué des grandes banques, en raison de l'insuffisant contrôle qu'elles exerçaient sur leurs banques partenaires. Aux Etats-Unis, le Sénat a même intitulé un rapport de commission d'enquête, datant de février 2001 : « Les comptes de correspondants : la porte ouverte au blanchiment. »
En France, ce système est une des raisons de l'implication de grands établissements dans l'affaire dite du Sentier II.
Il est évident que le fonctionnement en chaîne des comptes de correspondants atténue singulièrement la portée des dispositifs anti-blanchiment mis en place dans une banque donnée et la connaissance de son client ultime.
Comme le relève toutefois le GAFI dans son rapport sur les typologies de 2001-2002, la vigilance des grandes banques correspondantes sur leurs banques partenaires est à géométrie variable :
« Il est important de noter, comme le fait observer un expert, que le degré de diligence de certaines banques correspondantes semble souvent être déterminé par l'octroi ou non d'un crédit. L'octroi de facilités de crédit oblige le correspondant à évaluer la manière dont est gérée la banque étrangère, sa situation financière, ses activités commerciales, sa réputation, son environnement réglementaire et ses modes d'exploitation. Toutefois, lorsqu'il s'agit de services rémunérés par des commissions (virements électroniques de fonds, compensations de chèque), ces mêmes banques ne procèdent pas à des vérifications aussi pointues. Pourtant, les banques étrangères les plus risquées se voient rarement octroyer des crédits et ne sont donc effectivement pas surveillées de la même manière que des institutions qui demandent des crédits. » (GAFI, rapport sur les typologies 2001-2002 - 1er février 2002, p. 9).
Certains organismes professionnels bancaires ont proposé à la Mission des mesures drastiques pour lutter contre l'utilisation dévoyée des comptes de correspondants, dans la lignée des premières réactions américaines au rapport du Sénat.
« Premièrement, il faut renforcer très fortement la discipline à l'égard des centres offshore.
C'est un sujet qui progresse. Je crois comprendre que le Forum de stabilité publiera probablement dans les trois mois qui viennent une liste de pays ne répondant pas à un certain nombre de critères objectifs permettant de les qualifier de fiables sur le plan bancaire. Nous soutenons cette démarche. Nous souhaitons que les pays déviants sur le plan du comportement bancaire ou du droit des sociétés soient sanctionnés. Nous souhaitons que ces sanctions soient identiques et appliquées de la même façon dans tous les pays du G10, à la fois pour des raisons de concurrence et pour des raisons d'efficacité car la moindre faille dans le système fait perdre toute son efficacité à l'ensemble du dispositif.
Nous sommes prêts à aller très loin, je pense notamment à l'interdiction de transaction ou à l'identification individuelle de transactions entre comptes de correspondants, qui est une idée originale des Etats-Unis. Ce serait, en réalité, la fin du fonctionnement des comptes de correspondants, mais il serait sans doute utile de soutenir cette idée. Dans ce cadre, il faut aller aussi loin que nécessaire dans le renforcement de la discipline. » (Audition par la Mission, de M. Jean-Pierre Landau, Directeur général de l'Association française des banques (AFB), le 29 février 2000).
Sans aller aussi loin dans un premier temps, la Mission estime que les banques correspondantes doivent connaître leurs banques partenaires, afin de chasser du système interbancaire les banques fictives immatriculées dans les centres offshore ou les établissements douteux. Cette exigence minimale n'est qu'une application particulière du principe général de connaissance de son client et ne doit pas tolérer d'exceptions. Les propositions énoncées par le GAFI paraissent pouvoir satisfaire cette exigence minimale.
Les banques doivent connaître leurs partenaires
- Mettre en place des procédures rigoureuses pour avoir une meilleure connaissance des activités légitimes de chaque partenaire. Dans le cadre de ces procédures, il conviendrait d'inclure les facteurs suivants :
a) des informations sur la direction de la banque partenaire, le type d'agrément bancaire dont cette banque dispose, et ses principales activités commerciales ;
b) des informations sur le lieu géographique où la banque partenaire est située, en vérifiant notamment que ce partenaire a une présence physique réelle au sein de la juridiction ayant accordé l'agrément ;
c) le volume et la nature des transactions qui sont supposées transiter par le compte de correspondant ;
d) l'identité de toute tierce partie ayant un accès direct à ce compte de correspondant (l'utilisant donc comme un compte de transit). Les banques partenaires devraient être fermement invitées à fournir des listes, tenues à jour, des établissements auxquels elles accordent elles-mêmes des facilités de correspondant bancaire ;
e) le degré de rigueur des contrôles bancaires en vigueur dans le pays d'origine de la banque partenaire ; et
f) la qualité des dispositifs anti-blanchiment et des efforts de détection dans la banque partenaire.
- Faire preuve d'une « diligence » accrue vis-à-vis des relations de correspondants bancaires et, s'il est impossible d'exercer un contrôle efficace, fermer les comptes des banques partenaires dont les procédures d'identification et de « connaissance des clients » sont insuffisantes ou qui ne font pas l'objet de contrôles assez rigoureux.
- Refuser de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec un partenaire dans une juridiction où il n'a pas de présence physique (banque fictive), qui n'est pas affilié à un groupe financier réglementé ou qui est situé dans une juridiction non coopérative et n'est pas autorisé à réaliser des transactions avec des ressortissants de cette juridiction. Les banques devraient également se garder de nouer des relations avec des banques étrangères « partenaires » qui autorisent l'utilisation de leurs comptes par des banques fictives.
- Former le personnel chargé des comptes de correspondants à repérer les situations à risque ou les activités inhabituelles, qu'il s'agisse de transactions isolées ou de tendances, et inciter les chargés de compte à faire des déclarations de transactions suspectes ou inhabituelles le cas échéant.
- Procéder à des examens périodiques de toutes les relations de correspondants bancaires établies avec des banques étrangères, afin de détecter les partenaires à haut risque et de fermer les comptes ouverts avec des banques qui posent des problèmes.
- Notifier l'autorité de tutelle et l'unité de renseignement financier de tout problème rencontré avec des banques étrangères partenaires, notamment lorsque ces problèmes conduisent ces banques à cesser toute relation avec ces dernières.
Sur ce dernier point, certains experts estiment aussi qu'il faudrait peut-être créer un dispositif visant à informer systématiquement les unités de renseignement financier et/ou les autorités financières chargées de la réglementation des autres pays. Ce dispositif permettrait d'empêcher qu'une banque partenaire étrangère qui a déjà posé des problèmes, puisse s'adresser successivement à plusieurs autres correspondants de la même juridiction, après avoir été déboutée par un premier correspondant. Les échanges de renseignements entre les autorités concernées permettraient d'accroître l'efficacité des mesures internationales ; les autorités nationales pourraient également envisager de mettre en place un dispositif de communication systématique à leurs établissements financiers nationaux des informations relatives aux banques partenaires étrangères qui posent des problèmes.
GAFI, rapport sur les typologies 2001-2002 - 1er février 2002, p. 11.
2.- Les « instruments » garantissant l'anonymat du bénéficiaire
L'identification de l'ayant droit économique se heurte aussi à l'existence de certaines entités juridiques, sociétés ou fiducies, qui ne sont pas utilisées que dans les centres offshore, loin s'en faut. Une action communautaire est engagée dans ce secteur, mais l'ampleur des intérêts et le poids des traditions qui sont en cause dans certains Etats membres compliquent singulièrement l'exercice.
Le Gouvernement français en faveur
d'une plus grande transparence du droit des sociétés
M. Lionel JOSPIN, Premier ministre : L'Europe ne peut tolérer l'existence d'entités opaques ou anonymes, par lesquelles transitent des flux financiers considérables et sans rapport avec des échanges économiques réels. Trusts, fiducies, fondations anonymes, sociétés pour non-résidents, quelles que soient leurs caractéristiques juridiques précises et leurs noms dans les différents pays qui les acceptent, ces entités n'ont d'autre but que d'empêcher l'identification de leurs ayants droit économiques. Or, elles constituent fréquemment, chacun le sait, un vecteur très efficace des opérations de blanchiment. Elles sont également - je le rappelle même si ce n'est pas le sujet de nos travaux - propices aux manipulations comptables, comme on a pu le constater à l'occasion de la débâcle d'Enron. Cette entreprise excellait dans l'affichage d'une rentabilité d'autant plus élevée que ses pertes étaient cachées dans des « véhicules spécialisés », comme les désignent les spécialistes de la finance, c'est-à-dire dans des filiales le plus souvent localisées dans des centres financiers offshore.
Aujourd'hui encore, dans certains territoires du monde, il faut moins de 100 dollars et quinze minutes pour créer une « boîte à lettres », ce qui permet à certains d'abriter les activités financières les plus répréhensibles derrière l'écran de l'anonymat, du secret bancaire ou de l'absence de coopération administrative ou judiciaire. Il faut mettre fin à ces facilités qui autorisent toutes les dérives.
Il faut d'abord agir chez nous, en Europe. La création d'une norme minimale de transparence a été identifiée par le Conseil européen de Tampere comme prioritaire. La Commission doit fournir un rapport sur cette question et proposer un dispositif précis. Mais les progrès sont encore faibles, comme l'a constaté le dernier Conseil JAI/ECOFIN. La France sera très attentive à ce que de nouveaux retards n'affectent pas l'avancement de ces travaux de toute première importance, dont le Groupe d'Action Financière (GAFI) est également saisi.
Extrait de l'allocution de M. Lionel Jospin, Premier ministre, devant la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment - Paris, 8 février 2002.
De même, M. Jean Lemierre, directeur du Trésor, a mis l'accent, devant la Mission, sur les facilités offertes par le droit anglo-saxon des sociétés :
« Le droit anglo-saxon des sociétés offre une multitude de formules juridiques souples qui ont été largement utilisées par des financiers et qui constituent de formidables vecteurs et canaux aux capitaux à blanchir. Pour faire des progrès, il faudra s'attaquer très clairement aux sociétés-écrans, parfois liées aux centres offshore. La transparence des sociétés ou la capacité à accéder à un certain nombre d'informations est un sujet tout à fait fondamental.
J'opposerai les approches française et anglo-saxonne. Le dispositif français, certes trop lourd pour les créateurs d'entreprise, a tout de même la vertu de la transparence. On sait qui dépose les actes, qui est derrière, si bien que l'on peut retrouver des traces. Dans le droit anglo-saxon, notamment de certains Etats des Etats-Unis, une société est déclarée en une journée, sans vérification d'identité, sans dépôts d'actes, ce qui conduit à l'opacité totale. Des choses graves peuvent se passer sans que l'on soit capable de procéder à des identifications.
Sans opposer un modèle à un autre, ce qui serait quelque peu primaire, les formes juridiques, particulièrement souples et surtout caractérisées par un aspect très éphémère, sont extrêmement dangereuses. Il en existe beaucoup en droit anglo-saxon et dans certains pays de l'Union européenne, tels que l'Irlande, le Luxembourg et, bien entendu, le Royaume-Uni et les territoires qui lui sont liés. Il peut également en exister dans un système juridique plus proche du droit français. J'insiste sur cet aspect tout à fait fondamental de la réflexion qui devrait être engagée sur le droit des sociétés. » (Audition, devant la Mission, de M. Jean Lemierre, Directeur du Trésor, le 22 septembre 1999).
De fait, les travaux de la Commission européenne de Bruxelles ont tendance à s'étirer en longueur dans ce domaine.
La conclusion n° 58 du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 l'invitait à « établir un rapport recensant les dispositions des législations nationales dans le domaine de la banque, de la finance et des sociétés qui font obstacle à la coopération internationale. »
Sur la base d'une étude passée au Transcrime Institute de l'université de Trente en Italie, la Commission a établi un document de travail en date du 16 octobre 2001.
L'étude a identifié trois groupes de structures de société pour lesquelles les risques d'abus à des fins de blanchiment semblent élevés : les sociétés à responsabilité limitée, publiques et privées, les fiducies et la société de droit civil. Si l'étude propose un certain nombre de recommandations, la Commission ne les a pas encore reprises à son compte dans un projet officiel de Directive.
S'agissant des fiducies, cette étude ne constitue pas une découverte. La Mission les a identifiées comme instrument potentiel de blanchiment, à de nombreuses reprises. Dans son rapport sur les typologies de 2000-2001, le GAFI les décrivait ainsi :
L'anonymat inviolable des fiducies
Bien qu'elles aient de nombreuses utilisations légitimes et qu'elles existent depuis très longtemps dans de nombreuses juridictions, les fiducies, ainsi que d'autres formes de sociétés, sont de plus en plus perçues comme un dispositif-clé des mécanismes de blanchiment à grande échelle ou complexes. Les experts du GAFI ont examiné cette question, en se penchant brièvement sur la nature des fiducies en tant que relations juridiques, sur les usages qui peuvent en être faits et sur la diversité des formes qu'elles peuvent prendre. Cet examen a montré que ce qui préoccupe les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment, c'est l'anonymat apparemment inviolable qu'une fiducie peut offrir à son propriétaire ou bénéficiaire réel. Cet anonymat est renforcé par le fait que les documents relatifs à la fiducie ne sont pas considérés comme des informations publiques. Par ailleurs, certains types de fiducies sont plus souvent détournés que d'autres (par exemple les fiducies aveugles ou fiducies de protection d'actifs) et mériteraient donc que des mesures spécifiques soient prises pour interdire leur utilisation. D'autres solutions possibles ont été évoquées, allant de l'établissement d'un régime de réglementation stricte des agents chargés de constituer les fiducies (par exemple les soumettre à des obligations d'autorisation, d'identification de la clientèle, de tenue de livres et de déclaration) à l'imposition d'une sorte d'obligation d'enregistrement public ou semi-public.
GAFI, rapport sur les typologies 2001-2002 - 1er février 2001, p. 30.
A l'initiative de la Mission, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a institué la déclaration systématique à TRACFIN des opérations menées avec des fonds fiduciaires ou assimilés (article L. 562-2 du code monétaire et financier).
Dès que son texte d'application sera publié, cette mesure permettra à TRACFIN d'être systématiquement informé de l'utilisation de toutes ces structures a priori suspectes en France.
Au niveau européen, la Conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment a adopté, le 8 février 2002, plusieurs propositions destinées à encadrer l'utilisation des fiducies :
Des propositions novatrices pour encadrer les fiducies
- déclaration systématique auprès de l'unité du renseignement financier des opérations menées avec des fonds fiduciaires ou assimilés, en cas d'impossibilité d'identifier l'ayant droit économique (proposition n° 15) ;
- réglementation de la forme des fiducies (documentation normalisée, interdiction de clauses « suspectes ») (proposition n° 16) ;
- obligation d'inscription des fiducies sur un registre central ainsi que l'identification des bénéficiaires (proposition n° 17) ;
- agrément obligatoire auprès de l'autorité de régulation des services financiers des agents de création de sociétés (proposition n° 49).
Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment - Déclaration finale du 8 février 2002.
Le suivi de l'application de ces propositions, notamment au Luxembourg et au Royaume-Uni, qui utilisent massivement les fiducies dans leur droit civil, devra faire l'objet d'un examen attentif dans les prochaines années.
Ces propositions novatrices constituent l'un des points forts de la déclaration finale de la Conférence des Parlements de l'Union européenne.
A l'invitation du Président de l'Assemblée nationale, cette Conférence a réuni, pendant deux journées, des représentants de la quasi-totalité des Parlements de l'Union ainsi que des observateurs de pays candidats à l'adhésion. Précédés de deux réunions de son comité de pilotage, les travaux de la Conférence ont permis d'aboutir à une déclaration finale, dite de Paris, comportant trente propositions pour lutter contre le blanchiment.
Chacun des parlementaires présents s'est engagé à soutenir ce texte dans son pays et la Conférence a convenu de se réunir périodiquement pour faire le point sur l'application et l'actualisation de ces propositions.
Tant sur le contenu de la déclaration de Paris que sur sa procédure de suivi, la Mission considère que la Conférence a constitué un succès qui a démontré l'esprit de responsabilité des parlementaires de l'Europe dans la lutte contre le blanchiment.
3.- Faut-il plaider en faveur d'une régulation transnationale ?
La régulation des échanges financiers globalisés appelle, pour être pleinement efficace, une large réponse internationale, regroupant au moins l'ensemble des pays économiquement développés et des grandes places financières. Cette idée, largement reprise par les organismes financiers français et européens pour limiter les tentations de régulation des pouvoirs publics nationaux ou communautaires, au nom de la compétitivité, a un certain fondement, même si elle ne dispense pas les Européens, au nom de l'exemplarité, de commencer à corriger leurs déviances ou leurs vulnérabilités les plus flagrantes.
a) Une autorité mondiale de régulation des registres du commerce
Elle est notamment pertinente pour la régulation des sociétés offshore à vocation commerciale internationale (International business Companies ou IBC). On conçoit mal une action efficace dans ce domaine sans l'institution, à terme, d'une autorité mondiale de régulation des registres du commerce, dont l'action consisterait à définir et à faire appliquer les normes minimales de transparence des sociétés par les registres du commerce locaux implantés dans les centres offshore, dont elle attribuerait ou retirerait les agréments.
L'agrément par cette autorité permettrait notamment de garantir :
- le dépôt et la conservation des actes constitutifs de la société ;
- leur actualisation régulière ;
- la mention de l'ayant droit économique de la société ;
- la libération effective du capital social par les actionnaires ;
- l'accès public à ces informations.
b) Les intermédiaires des échanges financiers : le problème SWIFT
S'agissant des échanges financiers proprement dits, la Mission a pleinement mesuré l'importance des intermédiaires qui permettent la réalisation effective de la mondialisation financière et qui ne sont pas ou peu régulés, alors que leur positionnement stratégique en fait de véritables boîtes noires des transactions.
Les sociétés internationales de compensation et de règlement-livraison de fonds et de titres ont ainsi choisi de s'établir dans des petits pays (Luxembourg, Belgique), dont les autorités de régulation ne peuvent être à la hauteur de leur activité (Cf. analyse du contrôle de Clearstream par l'autorité de régulation du Luxembourg dans le rapport de la Mission n° 2311 en date du 22 janvier 2002).
L'autre grande catégorie d'intermédiaire, que la Mission a identifiée comme échappant à toute forme de régulation, traite les virements internationaux. Elle est incarnée par la société SWIFT ou société de télécommunication mondiale pour les transactions financières interbancaires. SWIFT présente la double caractéristique d'échapper à toute forme de régulation et de refuser de mettre en place des outils garantissant la traçabilité immédiate des messages qu'elle diffuse, alors qu'elle est au coeur des échanges.
SWIFT, une entité non régulée au coeur
des échanges financiers mondiaux
M. le Président : Votre système de quatre-vingt-douze critères ne vous a jamais conduit à détecter une affaire de blanchiment ?
M. Hervé DALLERAC, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse (COB) : Non.
M. Charles de COURSON, Député : De toute façon, ce n'est pas votre mission. Grâce à vos quatre-vingt-douze critères d'analyse des opérations sur le marché, vous pouvez identifier des délits d'initiés.
M. Hervé DALLERAC : Vous avez raison. Nous nous consacrons à la recherche des délits d'initiés et de la manipulation de cours. La technique du bon blanchisseur est de rester le plus anonyme possible. Dès lors, notre système a peu de chance de découvrir quelque chose. Cela dit, si nous avions à connaître une telle opération, nous alerterions immédiatement TRACFIN et le parquet.
Une fois l'argent blanchi, on ne contrôle pas les virements interbancaires vers les centres offshore. Mais si on arrive à agréger ces grands virements internationaux et à démontrer qu'ils ont une communauté soit de provenance, soit de destination, il existe peut-être alors une possibilité d'analyse intéressante. C'est au niveau de SWIFT que se situe la clef.
M. Ould Amar YAHYA, responsable de la surveillance des marchés à la COB : Si la personne, qui détient, à la banque de France, la liste et les montants des virements, les croise avec toutes les transactions sur le marché, elle peut avoir une certaine visibilité sur ce qui se passe. [...]
M. Hervé DALLERAC : Les marchés réglementés ont une capacité de blanchiment, compte tenu de l'existence de cette chambre de compensation qui permet de rendre honnête un argent qui ne l'était pas. Mais il y a aussi des possibilités de blanchiment sur les marchés de gré à gré.
Le rôle de la COB est de surveiller les marchés réglementés et les produits qui font appel à l'épargne. Mais les autres marchés nous échappent complètement. Il y a là des masses considérables de capitaux traités hors de toute réglementation. Dans ce domaine, le seul point de détection est encore l'analyse des flux de capitaux.
Un des points-clés de l'analyse du blanchiment, au moins du très grand blanchiment, est qu'il passe par des flux financiers qui sont nécessairement, à un moment ou à un autre, interbancaires. Si on connaissait leur provenance et s'il y avait un croisement de plusieurs sources d'informations sur ces mouvements de capitaux, il y aurait peut-être possibilité d'un observatoire.
M. le Président : Le problème qui nous préoccupe est celui de l'identification des ayants droit économiques dans les virements bancaires, c'est-à-dire dans le système SWIFT. Ne pourrait-on pas renforcer les obligations d'identification des ayants droit à l'origine de la transaction ?
M. Ould Amar YAHYA : Il faut, au départ, une autorité qui contrôle tous ces virements, qui sont très nombreux.
M. Hervé DALLERAC : Oui, mais l'essentiel est que, dans le grand blanchiment ayant sans doute une provenance de sociétés offshore, la première étape va être une banque plus ou moins complice, plus ou moins regardante. Si ce premier maillon ne recherche pas la provenance des capitaux, toute la suite de la chaîne se trouve dans l'incapacité de le faire.
Quand bien même la première banque ne serait aucunement liée au blanchisseur, l'absence de coopération des centres offshore est telle, en matière de fournitures d'informations sur le bénéficiaire économique, qu'elle ne connaîtra jamais que le nom de la banque qui lui envoie l'argent et non celui du client final émetteur du virement. [...]
L'interconnexion, entre systèmes d'information, peut améliorer la connaissance de l'origine des fonds et de leur destination.
Beaucoup d'éléments nous échappent dans les flux interbancaires qui vont être générés par les déplacements de fonds. Il nous est déjà difficile de faire ressortir l'opération anormale. L'agrégation de ces opérations est faite au niveau du transfert final des fonds. Le point crucial est l'observation des flux interbancaires internationaux (SWIFT).
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Hervé Dallérac, Chef du service de l'inspection de la Commission des opérations de bourse (COB), le 23 février 2000.
Comme le relèvent MM. Gravet et Garabiol :
« Une des particularités du réseau SWIFT, de par sa vocation internationale, est d'échapper au contrôle de toute autorité publique alors même que les réseaux nationaux équivalents sont sous le contrôle des banques centrales. Une évolution dans ce domaine nécessiterait un accord international et permettrait de rechercher les circuits suspects à l'aide de systèmes automatisés. Dans aucun des pays rencontrés au cours de la mission, une telle préoccupation ne s'est fait jour parmi les autorités concernées. Or, le principe d'un contrôle des réseaux interbancaires est d'application générale et est strictement appliqué tant que le cadre reste national. Le GAFI devrait être sollicité pour faire avancer le principe de transparence des flux financiers internationaux.
Cette situation mérite aussi d'être examinée lucidement. Les informations maintenant publiques sur les performances de certains systèmes de renseignement, comme ECHELON, indiquent que les messages traités par SWIFT sont accessibles à certains services. Un principe de transparence ou de contrôle mutuel réduirait leur avance comparative en matière de renseignement. » (Rapport annuel de MM. Gravet et Garabiol au ministre de l'Intérieur, juin 2000, p. 61 et 62).
Malgré les demandes répétées du GAFI, les messages SWIFT sont techniquement recevables, alors même qu'ils occultent l'identité du donneur d'ordre. Les banques peuvent ne remplir la case « donneur d'ordre » que par la formule « un de nos clients » ou par un numéro de compte parfaitement anonyme. Le message SWIFT, tel qu'il est mis en _uvre par certaines banques, contribue donc à dissimuler l'identité du donneur d'ordre et facilite le blanchiment, ce que regrette le GAFI :
« Dans certaines opérations de blanchiment, des virements sont effectués en lien étroit avec des dépôts d'espèces. Toutefois, comme les virements interviennent souvent au stade de l'empilement, on ne dispose guère d'éléments pour distinguer une transaction suspecte d'une autre. Les enquêteurs doivent s'en remettre à des liens avec d'autres facteurs comme les DOS, les déclarations de passage aux frontières ou les renseignements figurant dans les messages SWIFT de virements interbancaires. Les experts ont donc exprimé leurs préoccupations devant l'absence persistante d'uniformité quant à l'identification de l'initiateur d'un virement (par le système de messages SWIFT). Bien que depuis un certain nombre d'années, ces messages prévoient un champ permettant d'indiquer l'initiateur des fonds, il n'est pas obligatoire de remplir ce champ. » (Extrait du rapport du GAFI sur les typologies 2000-2001 - 1er février 2001, p. 19 et 20.)
Changer une norme qui s'applique à des
milliards d'opérations internationales
M. le Président : Parmi les préoccupations plus générales concernant le blanchiment, un certain nombre d'observateurs nous signalent que dans le réseau SWIFT, les donneurs d'ordres des mouvements de fonds, ne sont pas toujours identifiés ; il y a là un véritable problème de régulation. Quelle est votre analyse sur cette absence d'identification et quelle proposition de régulation pourrions-nous faire ?
M. Edouard FERNANDEZ-BOLLO, chef du service juridique de la Commission bancaire : Cette question a donné lieu à des travaux au sein du GAFI ; et en effet, dans un certain nombre de cas le système SWIFT donne la possibilité d'inscrire la mention « notre client » dans la partie du message concernant le donneur d'ordre, ce qui ne permet pas l'identification. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'identification possible puisque SWIFT transmet des messages ; si l'on recherche la banque qui a émis les messages, elle saura identifier le donneur d'ordre. L'autorité nationale compétente sur cette banque peut donc connaître l'identité du donneur d'ordre. Le problème est que cela implique parfois une coopération internationale étroite, notamment au niveau judiciaire. Tous les juges sont confrontés à cette réalité et savent que cette coopération, juridiquement possible, n'est cependant pas toujours facile.
SWIFT avançait comme argument qu'il n'appartenait pas à une entreprise coopérative privée de payer le prix des lenteurs de la coopération judiciaire internationale. Il n'était donc pas décidé à changer ses règles, à imposer une modification du format pour les milliards de messages échangés.
Il est clair qu'au niveau national, dès lors que se définissent des normes nationales, nous encourageons la mise en place de possibilités d'identification ou de traçabilité. Dans les travaux retracés dans le livre Blanc, pour tout ce qui concerne la monnaie électronique et Internet, nous insistons pour que ce type de problème n'existe pas. Mais il n'est pas facile de changer une norme qui s'applique à des milliards d'opérations internationales depuis de nombreuses années.
M. Jean-Claude TRICHET, Président de la Commission bancaire : La Banque de France et le gouvernement français, lorsqu'ils négocient dans le cadre du GAFI, prônent qu'un consensus international puisse conduire le système SWIFT à appliquer certaines règles d'identification.
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Edouard Fernandez-Bollo, chef du service judiciaire de la Commission bancaire, et de M. Jean-Claude Trichet, Président de la Commission bancaire, le 30 mai 2001.
Les raisons d'instituer des mécanismes de régulation transnationaux ne manquent donc pas, sous le seul prisme de la lutte contre le blanchiment. D'autres motifs peuvent bien évidemment justifier une telle démarche, davantage liés à la stabilité des échanges financiers qu'à leur moralisation, comme le relève M. Jean Peyrelevade.
Plaidoyer pour la régulation internationale
M. le Président : Je voudrais revenir à la question des chambres de compensation et au système SWIFT. Vous nous avez dit que, d'après vos analyses, le fonctionnement de Clearstream ne posait pas de problème majeur. Nous avons reçu certaines personnes - dont un ancien administrateur de Cedel-Clearstream - qui nous ont dit que le transfert d'argent liquide pouvait s'effectuer au travers de ces chambres de compensation, et que les titres pouvaient être échangés à des cours très différents de ceux du marché. De la même façon, il est reconnu que le système SWIFT permet des transactions sans connaissance de l'identité du donneur d'ordres.
Ces différents systèmes - chambres internationales de compensation, système SWIFT - relèvent, au mieux, du contrôle des autorités nationales du pays dans lequel ils ont leur siège, alors qu'il s'agit d'organismes internationaux. Ne serait-il pas nécessaire de proposer une régulation externe, au moins au niveau européen de ces organismes, afin d'être mieux assurés du contrôle de ce qui s'y passe ?
M. Jean PEYRELEVADE, Président du Crédit Lyonnais : Je n'y vois aucune objection. Simplement, je ne pense pas que le motif serait essentiellement la lutte contre le blanchiment ; en effet, ce n'est pas le dérapage principal que l'on peut avoir dans ce type de système.
En ce qui concerne les transactions de convenance, les autorités boursières présentes sur chaque marché sont en principe chargées de vérifier les prix. Quant au système SWIFT, je suis étonné par vos propos. Je suis d'accord sur le fait que l'on ne connaît pas nécessairement le client primaire ou le destinataire final, mais il s'agit d'un moyen de transmission d'ordres de paiement entre banquiers ; je ne vois donc pas comment l'on peut exécuter un ordre SWIFT si l'on ne connaît pas le banquier qui est à son origine. Les problèmes de détournement ou de fraude sur le système SWIFT sont donc des problèmes que nous retrouvons sur tous nos systèmes de paiement : ce sont des problèmes de captation d'un code de transmission par une personne qui n'est pas habilitée à l'avoir. Cela peut être lié à une opération de blanchiment, mais l'opération en elle-même n'en est pas une.
Je vous ferai la même remarque que pour le régulateur international : il s'agit d'une bonne idée, mais il y a beaucoup d'organismes financiers qui, aujourd'hui, ne sont pas régulés ; les dommages potentiels à la stabilité financière internationale me paraissent au moins aussi grands sinon plus grands que ceux que peuvent apporter les chambres de compensation, le groupement Carte bleue ou le système SWIFT.
A ma connaissance par exemple, l'industrie de la réassurance n'est pas du tout régulée. Et là, avec le réchauffement de la terre et l'effet de serre, c'est quelque chose à laquelle les autorités publiques devraient être sensibles, les dommages potentiels sont gigantesques. Que se passera-t-il le jour où il y aura un typhon sur la Nouvelle Orléans ou un tremblement de terre à Tokyo ? Autre exemple : les hedge funds ne sont pas régulés. Ce qui me paraît également plus important que les chambres de compensation.
J'ai une grande estime pour vos efforts de réflexion, mais si l'on commence à cibler les organismes qui devraient être régulés et qui ne le sont pas aujourd'hui, il faut faire une liste exhaustive et hiérarchiser.
Je citerai un autre exemple, volontairement provocateur : je ne suis pas sûr que de très grandes institutions industrielles, qui ont leur propre salle de marché, qui ont leur propre activité en matière de produits financiers, n'aient pas potentiellement des risques importants ; on a d'ailleurs connu par le passé un certain nombre d'incidents de ce type sur des acteurs industriels. Et ce mouvement va s'accroître. Nous avons aujourd'hui des négociants en électricité ; quelle est la régulation sur ces négociants : nulle. Or nous savons que qui dit négoce dit risque.
La liste d'exemples est très longue. Alors qu'il faille une régulation, oui, mais je vous incite à ne pas vous limiter uniquement aux banques et à leurs émanations. D'autres éléments sont potentiellement aussi déstabilisants que le système bancaire aujourd'hui.
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Jean Peyrelevade, Président du Crédit Lyonnais, le 2 mai 2001.
Si la Mission est convaincue que l'amélioration de la lutte contre le blanchiment passe par le développement de la régulation internationale, voire par l'institution d'autorités transnationales, elle est aussi consciente de la réticence viscérale que ces notions inspirent à certains partenaires indispensables à la crédibilité d'une telle démarche, au premier rang desquels les anglo-saxons et, notamment, les Etats-Unis, comme l'a relevé, avec un réalisme éprouvé, M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères.
Il faudra faire preuve d'une grande force de conviction
M. le Président : Après le 11 septembre, on a pu penser que les Etats-Unis allaient changer d'attitude sur ces questions de lutte contre la délinquance financière, le blanchiment ou le financement du terrorisme.
Même si, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué, le blanchiment et l'argent du terrorisme, sont des processus différents. Dans un cas, il s'agit de noircir, dans l'autre, de blanchir. Ma question est la suivante. Avez-vous le sentiment qu'il y a, de la part des Etats-Unis, un réel changement d'appréciation sur ce que l'on peut appeler la régulation ou qu'il ne s'agit que d'une attitude conjoncturelle ?
M. Hubert VEDRINE, ministre des Affaires étrangères : Je ne pense pas qu'il ait changement. Nous sommes les seuls, avec l'Union européenne et quelques autres pays autour, quoique à un degré variable, à être porteurs de cette idée de régulation telle que nous l'exprimons. C'est une ligne très européenne et liée à un certain nombre d'éléments, ligne avec laquelle les Etats-Unis ne sont pas du tout en phase.
Certes un grand nombre d'autres pays du monde ne le sont d'ailleurs pas non plus, mais pour de toutes autres raisons. En effet, ils considèrent que ce sont des contraintes injustes et iniques qui les empêchent de se développer comme nous l'avons fait. Mais l'influence de ces pays est moindre que celle des Etats-Unis.
Concernant les Etats-Unis, je n'ai jamais partagé un seul instant l'idée que le choc du 11 septembre allait les faire changer de position. Pour des raisons de mentalité et de poids que chacun connaît et qui ne fait que se renforcer, c'est un pays qui reste fondamentalement unilatéraliste, qui ne voit pas pourquoi il aurait à négocier quoi que ce soit avec l'ensemble des autres par rapport à ses intérêts fondamentaux. [...]
M. Hubert VEDRINE : En France, il est d'usage de faire des propositions de régulation sur tel ou tel sujet, alors qu'on n'aime pas s'interroger sur les obstacles à la régulation. Au stade où nous sommes actuellement, nous avons le devoir de nous interroger et d'analyser les obstacles à la régulation, et non pas simplement de nous impressionner favorablement par la force de nos propositions ou l'intransigeance de nos déclarations.
Il faut aussi comprendre les raisons pour lesquelles les Etats-Unis veulent y échapper, pourquoi des forces aussi colossales dans le monde s'organisent très intelligemment pour échapper à la régulation et quelles sont les forces qui profitent de la non-régulation. Il faut chercher des points sur lesquels on peut s'appuyer. C'est exactement le contraire du défaitisme. Cela consiste à avoir une vision exacte des choses.
Ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur les petits pays n'était pas forcément l'annonce que cela ne fonctionnait pas. Je crois simplement que si nous parvenons à établir entre les Etats-Unis et l'Europe, une alliance sur la forme que doit prendre la régulation dans ses grands principes, nous aurons une force extraordinaire à laquelle aucun de ces petits pays marginaux ne résistera, car ils sont tous sous l'influence ou parrainés par des pays plus importants.
Toutefois, en l'absence d'accord véritable entre Européens et un désaccord presque conceptuel avec les Etats-Unis, il est certain que l'on se heurte à des difficultés considérables. Nous progresserions beaucoup plus rapidement s'il y avait un accord entre les grandes puissances économiques du monde, au sein d'un G7 ou d'un G8 par exemple.
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, le 9 janvier 2002.
D.- la coopération administrative, policière et judiciaire : la France en phase avec les progrès européens
« Pour avoir une chance de lutter contre une criminalité qui profite largement des réglementations en vigueur dans les différents pays européens, il est urgent d'abolir les protectionnismes dépassés en matière policière et judiciaire. Il devient nécessaire d'instaurer un véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront, sans entraves autres que celles de l'Etat de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours. » (Appel de Genève - 1er octobre 1996).
Devant, pour une bonne part, sa création à cet Appel de Genève des magistrats européens en pointe dans le combat contre la délinquance financière, la Mission n'a eu de cesse de dénoncer, partout où elle les a rencontrés, y compris en France, les obstacles à la création de cet espace judiciaire européen.
D'importants progrès ont été notés dans ce domaine, en l'espace de quelques années, comme la création d'Eurojust au Sommet de Tampere (16 octobre 1999), la signature de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 et son protocole du 16 octobre 2001, ou encore l'accord politique sur le mandat d'arrêt européen au Sommet de Laeken (14 décembre 2001).
Toutefois, l'Europe judiciaire quotidienne est encore bien poussive, comme en témoigne la lenteur avec laquelle les commissions rogatoires internationales sont exécutées entre certains Etats européens.
1.- Les acquis de la coopération opérationnelle
a) Les échanges entre services de renseignement
Les services de renseignement financier, qu'ils soient de nature administrative ou policière, tissent des liens de plus en plus étroits dans un cadre géographique très élargi.
Le Groupe Egmont : l'internationale
du renseignement financier
En application des recommandations du GAFI, des unités de renseignement financier (URF) chargées de recueillir et de traiter les déclarations de soupçon des institutions financières et de certaines professions ont été constituées dans la plupart des pays dotés d'une législation en ce domaine.
Tandis que l'activité de ces services prenait de l'essor, leurs responsables ont rapidement pris conscience de la nécessité de pouvoir disposer d'un cadre international pour résoudre les problèmes concrets de coopération que pose au quotidien la lutte contre le blanchiment.
Le Groupe Egmont est né en juin 1995 à Bruxelles au palais d'Egmont, de cette volonté des URF de disposer d'un forum de rencontre et d'échange d'informations dans un cadre spécifique, indépendant des dispositifs policiers, judiciaires ou diplomatiques en vigueur.
Les dirigeants des URF à l'initiative du système, tous marqués par leur participation au GAFI, ont entendu mettre en place un dispositif fondé sur les principes prévalant dans le monde des affaires : confiance, rapidité, absence de formalisme. Les relations entre membres du Groupe sont donc établies sur une base novatrice pour des administrations : pas de protocole, affranchissement des structures et des procédures diplomatiques, petite taille et indépendance, ou du moins grande liberté d'action, des unités, personnalisation maximale des rapports.
Le Groupe, qui compte désormais 58 URF membres, concentre ses travaux sur les moyens concrets d'améliorer la coopération internationale dans la lutte anti-blanchiment et notamment l'échange de renseignements opérationnels entre services anti-blanchiment.
En sept années, le Groupe compte à son actif de nombreuses réalisations, dont :
- l'élaboration d'un accord-type de coopération bilatérale, pour surmonter les entraves à la communication opérationnelle lors des recherches entre services de nature juridique différente ;
- l'adoption de la définition de la notion d'unité de renseignement financier, reprise depuis par l'Union européenne ;
- la mise en place d'un système sécurisé d'échanges par l'Internet ;
- l'organisation régulière par les URF d'ateliers régionaux de formation permettant à leurs analystes financiers d'échanger leur expérience et des renseignements sur des cas concrets. TRACFIN a ainsi tenu deux ateliers, l'un sur le thème du blanchiment au travers des produits d'assurance (en octobre 1998), l'autre sur celui du blanchiment et du passage à l'euro fiduciaire (septembre 2000) ;
- l'échange régulier de personnel entre URF ;
- l'organisation d'un séminaire de formation à Vienne, conjointement avec le Programme mondial contre le blanchiment d'argent des Nations unies, ouvert aux agents des URF et aux responsables anti-blanchiment de pays non encore dotés de tels services.
Dans une matière nouvelle, dont la quasi-totalité des principes et des règles provenaient de sources internationales, le Groupe Egmont a contribué à structurer un système autour de concepts et de stratégies progressivement reconnus par les Etats, puis par les organisations internationales.
Le Groupe Egmont poursuit actuellement une réflexion en profondeur sur son évolution structurelle, entamée lors de sa réunion plénière de juin 2001. Elle devrait se traduire par la création d'un Conseil du Groupe Egmont, auquel TRACFIN sera candidat.
Enfin, la coopération entre les URF européennes devrait se développer autour du réseau télématique sécurisé d'échange d'informations financières, dénommé FIU Net, reliant déjà cinq d'entre elles, dont TRACFIN.
Source : TRACFIN.
Parallèlement, TRACFIN a multiplié les accords bilatéraux avec d'autres URF, à finalité plus directement opérationnelle pour l'échange concret de renseignement. Depuis 1990, le service a signé 21 accords de ce type. Il est actuellement en discussion avec le Japon ainsi qu'avec la Suisse et Jersey ; s'agissant de ces deux derniers pays, les négociations traînent en longueur, ce qui n'est pas pour étonner la Mission.
Indépendamment de ces accords formels, il a la faculté d'échanger des informations financières avec les services analogues d'autres pays, sur le seul fondement des articles L. 563-4 et L. 564-2 du code monétaire et financier.
Au cours de ses déplacements en Europe, la Mission a pu constater que l'échange d'informations entre URF fonctionnait convenablement, en raison de relations personnelles confiantes. La coopération policière présente souvent les mêmes caractéristiques tant que l'on reste sur un plan informel d'échange d'informations (certaines URF relèvent d'ailleurs de la police, notamment au Royaume-Uni), mais se complique singulièrement dès lors que l'on aborde une phase véritablement opérationnelle, entraînant des actes de procédure encadrés par l'autorité judiciaire.
La coopération policière opérationnelle la plus efficace repose sur l'échange d'officiers de liaison, comme l'ont relevé MM. Garabiol et Gravet, dans leur rapport précité :
« A l'échelle internationale, la coopération étroite entre les forces de police est évidemment un pré-requis pour éviter que les frontières ne constituent les remparts de protection des organisations criminelles. Des officiers de liaison ont été mis en place entre les principaux pays développés et veillent à la bonne transmission d'informations opérationnelles entre les services. Des enquêtes sont menées en très étroites relations et donnent des résultats significatifs comme en témoigne l'affaire « Margarita » dans laquelle furent associés les services américains et français. Cet esprit opérationnel doit demeurer et être développé.
Les relations multilatérales, comme avec l'OICP-Interpol, sont éminemment utiles en matière d'échange d'informations sur les procédures formellement engagées. Mais les informations d'investigation sont, par nature, trop sensibles pour donner lieu à des échanges multilatéraux.
L'enquête requiert que les échanges d'informations soient à finalité opérationnelle, ce qui repose sur des relations bilatérales ou, à tout le moins, en groupe restreint à l'instar du dispositif mis en place entre les Etats-Unis et la France par un accord intergouvernemental de février 1971 contre le trafic de stupéfiants et ensuite ouvert au Canada et à l'Italie. Cet accord permet des liens directs par échange de policiers et par échange de renseignements opérationnels. Une extension de cet accord à l'ensemble des affaires de criminalité organisée, en y incluant le blanchiment, serait bienvenue.
Cette nécessité de conduire l'enquête sur une base très opérationnelle et étroite rend en revanche très difficile l'implication d'une structure comme Europol à ce stade des enquêtes, ce à quoi ne prétend pas l'OICP-Interpol. »
Cette analyse rejoint celle de la Mission, au vu des témoignages qu'elle a recueillis.
Interpol : le mandat d'arrêt international
et la base de données
M. le Président : Dans quel cas les Etats ont-ils recours à Interpol ? Ils n'ont pas l'obligation de recourir à vos services et peuvent également faire appel aux mécanismes de coopération policière traditionnels.
M. Damien HENDRICKX, Officier d'Interpol : Il s'agit tout de même du canal légitime, puisque nous fonctionnons depuis 1923. Bien entendu, la coopération bilatérale, étroite, est toujours possible - comme en matière de terrorisme. Mais je crois que le canal Interpol reste utile aux Etats, et qu'ils doivent y adhérer davantage. Nous avons actuellement un projet, dans le cadre du G8, le projet Millenium, qui consiste à un partage d'informations, une mise en commun des données informatiques sur les criminels, afin de rendre plus fiables les services concourant à la lutte contre le blanchiment.
M. le Président : Je ne remets pas en question l'intérêt du recours à Interpol, même si des policiers ont déclaré devant cette mission que les délais étaient trop longs. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'aimerais savoir si vous avez le sentiment que les Etats ont suffisamment recours à vos services. En outre, pouvez-vous déterminer à quel moment ces Etats font appel à Interpol ?
M. Damien HENDRICKX : Je pense que tous les Etats ont intérêt à recourir au canal Interpol, qui est un excellent réseau de communication sécurisé. C'est le meilleur moyen de réunir de nombreuses informations, même si les Etats non coopératifs, dont je vous parlais tout à l'heure, n'alimentent pas suffisamment notre base de données. J'encourage vivement, lors de mes déplacements, mes différents interlocuteurs à utiliser Interpol. C'est en effet par un échange d'informations que nous pourrons lutter efficacement contre le blanchiment, dans le cadre judiciaire.
M. le Président : Vous nous dites que vous encouragez les Etats à faire appel à vos services, mais vous ne nous dites pas si, selon vous, ils le font suffisamment, ni dans quel cas ils le font. Quelle plus-value apporte Interpol par rapport aux enquêtes traditionnelles ?
M. Damien HENDRICKX : Les Etats ont systématiquement recours à Interpol lorsqu'il s'agit d'émettre un mandat d'arrêt international. Ce qui veut dire que dans la fonction première qui est la nôtre et qui est de favoriser l'entraide judiciaire en vue de l'extradition des criminels, nous sommes le canal indispensable. [...]
M. Jacky DARNE, Député : Quelle est la nature exacte de votre travail ? Délivrez-vous simplement des informations - qui vous sont communiquées par les différents pays - ou êtes-vous également un organisme d'investigation en mesure de diligenter une enquête ?
Un membre d'un parquet étranger nous a révélé que s'il connaissait un policier dans le pays où il doit mener une enquête, il a plus vite fait de le contacter que de faire appel à Interpol. Les services que vous proposez sont-ils de première ou de seconde main ?
M. Damien HENDRICKX : Nous disposons effectivement d'une base de données importante : 125 000 individus y sont répertoriés. L'information vient des différents pays qui nous alimentent. Nous sommes normalement destinataires de tous les échanges de télégrammes portant sur les investigations en cours. Notre service spécialisé informatique peut mener, lorsque les affaires sont complexes, des analyses très poussées que nous fournissons aux pays membres. Nous avons donc un rôle de centralisation des analyses dans le but de dégager les grandes tendances.
Nous développons le projet Asiewash, qui est une étude sur le blanchiment en Asie, ainsi que le projet Eastwash qui porte sur l'Europe de l'Est. Cependant, nous ne sommes pas un super FBI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'intervenir directement dans les Etats pour des raisons évidentes de souveraineté.
Nous avons également une importante activité de formation des polices, de sensibilisation des cadres supérieurs qui sont susceptibles d'intervenir dans leur pays, ainsi qu'une action de lobbying puisque nous essayons de faire avancer les thèses que nous préconisons, notamment en matière de blanchiment, auprès des instances internationales.
Je ne diligente pas une enquête de A à Z, je ne dispose pas de pouvoirs d'investigation, je ne procède pas aux recherches fichiers, ni à l'audition des mis en cause. Je n'ai pas un travail de police opérationnelle au sens classique du terme. Nous avons simplement une approche globale des choses qui nous permet de dégager de grandes tendances, et nous raisonnons à l'échelle mondiale.
Extrait de l'audition, par la Mission, de M. Damien Hendrickx, Officier d'Interpol, le 10 novembre 1999.
De même, la vocation opérationnelle d'Europol est des plus ténues, malgré les conclusions du Sommet de Tampere qui s'orientaient dans cette direction :
- participation d'Europol, à titre de soutien, aux équipes communes d'enquête prévues à l'article 30 du traité d'Amsterdam (conclusion 43) ;
- réception par Europol de données opérationnelles des Etats membres et habilitation d'Europol à demander aux Etats membres d'engager, de mener ou de coordonner des enquêtes ou de créer des équipes communes d'enquête, en respectant les systèmes de contrôle par les tribunaux dans les Etats membres (conclusion 45).
Pour être effectives, ces conclusions devraient passer par la modification de la convention en date du 26 juillet 1995 qui a créé Europol et qui en détermine les compétences.
Europol : une plateforme d'officiers de liaison
M. Willy BRUGGEMANN, Directeur adjoint d'Europol : Bien que nous nous concentrions sur des sites opérationnels, nous n'avons pas de rôle exécutif, c'est-à-dire le droit d'aller sur le terrain procéder à des arrestations.
M. le Président : Vous venez en appui...
M. Willy BRUGGEMAN : Tout à fait, nous apportons de l'information et nous aidons à cet échange d'information entre les Etats membres, nous intervenons pour analyser les formes de criminalité, fixer les priorités, faciliter la coordination en matière d'information sur le trafic de drogue et autres. Voilà notre rôle, qui n'est pas d'aller dans la rue arrêter des gens.
Nous avons développé la fonction Activel, troisième pilier du traité d'Amsterdam (article 30), c'est-à-dire que nous avons la faculté de prendre des initiatives, d'initier des enquêtes avec des équipes conjointes, ce qui est une nouveauté. Cet article fait encore l'objet de discussions. [...]
M. le Rapporteur : Ma question, d'ordre opérationnel, s'adresse à M. Tjalkens, chargé de la lutte contre le blanchiment. Un juge d'instruction peut-il vous confier directement, en vous écrivant, du travail d'ordre technique, d'expertise ou de renseignement ? S'il vous délivre une commission rogatoire dans laquelle il vous demande diverses informations et recoupements, considérez-vous la demande comme recevable, dès lors qu'il s'agit d'une infraction commise à l'évidence sur plusieurs territoires de la Communauté européenne ?
M. Robert TJALKENS, chargé des questions de criminalité financière : Je ne suis pas concerné par un tel problème, dans la mesure où il s'agit d'un dossier opérationnel, traité soit par les officiers de liaison, soit par nos analystes.
M. GOUJARD, Commissaire divisionnaire, chef de la délégation française à Europol : Il convient de vous donner quelques informations quant au fonctionnement des demandes des pays entre les unités nationales Europol et Interpol. Dans chaque pays, a été créée une unité nationale, composée de membres des différentes forces de sécurité opérant dans ce pays.
L'unité nationale française est constituée de représentants de la police, de la douane, de la gendarmerie et, depuis peu, d'un magistrat. Quant au bureau de liaison à La Haye, il comprend des officiers de liaison issus de la police, des douanes et de la gendarmerie. Quand un enquêteur français d'un de ces trois services, qui travaille dans le cadre d'une enquête préliminaire, de flagrant délit ou d'une délégation d'un magistrat instructeur, a besoin de renseignements, il adresse sa demande à l'unité nationale Europol qui se trouve actuellement auprès de la division nationale de la DCPJ.
Ce service nous transmet la demande qui est d'abord traduite en anglais. Ainsi aucun problème linguistique ne se pose entre les officiers de liaison. Elle est ensuite transmise aux officiers de liaison du ou des pays concernés par cette demande.
Lorsque la réponse nous revient, nous la retransmettons à l'unité nationale en France qui la renvoie au service demandeur. Dans le cadre des questions posées à la France, on suit le système inverse, c'est-à-dire que l'officier de liaison français ici reçoit la question en anglais. Cette question peut arriver de n'importe quel pays, de la Grèce, de l'Autriche ou de la Finlande. Nous la renvoyons vers l'unité nationale qui, elle, la transmet au service concerné.
L'avantage est que les quinze représentations sont présentes sur place. Cela peut donc se faire dans des délais extrêmement courts. Imaginez le problème pour un Français du commissariat de Carpentras qui doit obtenir un renseignement en Finlande. Ce serait quasiment impossible de l'avoir autrement que par cette unité. On n'a pas à se préoccuper de la barrière linguistique, du contact à qui adresser la demande. Il suffit de l'envoyer à l'unité nationale et ensuite, on reçoit son produit fini.
M. Gilles LECLAIR, Directeur adjoint d'Europol : S'agissant des commissions rogatoires, nous ne pouvons actuellement être saisis directement par un magistrat instructeur. Nous n'avons pas le pouvoir de recevoir des commissions rogatoires, et aucun échange de commission rogatoire ne peut se faire entre les bureaux de liaison. En revanche, il est possible de déguiser le phénomène.
Un Etat qui voudrait mener une enquête commune, ce qui est important dans les affaires de blanchiment, entre les différents bureaux de liaison, peut fort bien le faire par le biais du bureau français. Par exemple, si un juge d'instruction de Lille veut faire une enquête approfondie, il peut passer par l'unité nationale et soumettre le dossier. Une réunion a lieu ici avec les pays concernés, et la tête de l'enquête est prise par le bureau français. Ainsi chaque pays concerné et sollicité poursuit ou non dans la demande qui est faite.
On peut envisager, actuellement, de mener des enquêtes au niveau de la plate-forme des officiers de liaison, laquelle peut avoir des développements concrets.
M. le Rapporteur : Pour le moment, on doit interpréter le traité d'Amsterdam comme créant une plate-forme d'officiers de liaison, sans aller au-delà.
M. Gilles LECLAIR : On peut associer à ces équipes d'enquête dirigées par un pays, des experts comme ceux du blanchiment, si le pays le souhaite.
Extrait de l'entretien avec MM. Willy Bruggeman et Gilles Leclair, Directeurs adjoints d'Europol, Goujard, Commissaire divisionnaire chef de la Délégation française à Europol, et Robert Tjalkens, chargé des questions de criminalité financière, le 8 février 2000 à La Haye.
2.- Les lenteurs de la coopération judiciaire malgré des efforts récents
Au cours de ses déplacements, la Mission a pu mesurer la pesanteur des traditions et des organisations judiciaires nationales en Europe. L'opposition tranchée entre les pays de droit latin et ceux de « common law » en est un exemple connu.
Les débats récurrents sur l'institution d'un éventuel Parquet européen ont souligné l'ampleur des difficultés techniques et politiques qui demeurent.
Néanmoins, la coopération judiciaire a récemment progressé, en mettant en place des instruments qui permettront d'accélérer l'avènement de cette Europe judiciaire que de nombreux européens appellent désormais de leurs v_ux, pour des raisons qui dépassent largement les seules exigences de la lutte contre la délinquance financière.
La France a joué un rôle majeur dans ce processus, notamment en raison de sa forte implication dans le réseau judiciaire européen illustrée par sa dizaine de magistrats de liaison en poste dans des capitales étrangères.
a) Le Sommet de Tampere et la création d'Eurojust
Le Sommet de Tampere a défini la mission d'Eurojust comme suit :
« Afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée, le Conseil européen a décidé la création d'une unité (Eurojust) composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes détachés par chaque Etat membre conformément à son système juridique. Eurojust devrait avoir pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité organisée, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol ; cette unité devrait aussi coopérer étroitement avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de simplifier l'exécution des commissions rogatoires. Le Conseil européen demande au Conseil d'adopter l'instrument juridique nécessaire avant la fin de l'année 2001. » (Conclusion 46).
La mise en place d'Eurojust a été précédée par la création, à titre de préfiguration, d'une unité provisoire Eurojust, instituée par la décision du 14 décembre 2000.
Les négociations pour la constitution d'Eurojust lui-même ont abouti, au cours de l'automne dernier, à un accord politique au sein du Conseil. Le projet de décision institutive est en voie d'adoption définitive.
Ce projet confirme la fonction opérationnelle d'Eurojust, comme l'a relevé notre collègue, M. Pierre Brana, dans un rapport d'information adopté par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.
« Eurojust : une fonction opérationnelle affirmée »
Les objectifs d'Eurojust, tels qu'ils sont décrits dans le projet de décision, visent directement la coordination des enquêtes et des poursuites pénales menées, dans des affaires de criminalité grave, par les autorités compétentes dans au moins deux Etats membres, ainsi que la coopération entre ces autorités pour la mise en _uvre de l'entraide judiciaire et de l'extradition.
En pratique, Eurojust, agissant soit en collège, soit par l'intermédiaire d'un ou « de manière motivée » plusieurs membres nationaux, a notamment la faculté de demander aux autorités compétentes en matière pénale « d'envisager d'entreprendre » (s'il s'agit d'un membre national) « ou d'entreprendre » (s'il s'agit du collège) une enquête ou des poursuites sur des faits précis », de mettre en place des équipes d'enquête communes, d'assurer l'information réciproque de ces autorités sur les enquêtes et poursuites en cours qui concernent des Etats membres.
Lorsque la demande d'enquête ou de poursuite est formulée par Eurojust agissant en collège, les autorités de l'Etat membre destinataire sont tenues, en règle générale, de lui notifier et de motiver leur décision de refus éventuelle.
La décision Eurojust préserve donc la liberté de décision des parquets et autres autorités nationales de poursuites qui ne sont pas tenues d'accepter le concours que leur offre l'unité. Mais, dans la mesure où le collège Eurojust présente une demande d'ouverture d'enquête 1°) à l'initiative d'un ou plusieurs membres nationaux, 2°) lorsque les procédures envisagées ont une incidence au niveau de l'Union européenne, 3°) lorsqu'« une question générale relative à la réalisation de ses objectifs se pose » (article 5 § 1), on imagine mal que les motivations du refus ne puissent être inspirées par des considérations d'intérêt supérieur.
Les interventions et demandes d'Eurojust ont des effets juridiques immédiats sur les décisions prises par les autorités nationales pour l'ouverture d'enquêtes judiciaires ou pour l'ouverture de l'action publique. Les équipes d'enquête communes, dont le principe est posé par la décision, sont appelées à accomplir des actes de poursuite s'intégrant dans une procédure judiciaire.
Pierre Brana - « Pour une Europe de sécurité et de justice » - n° 3609, 13 février 2002.
Cette décision rencontre l'adhésion de la Mission ; elle est conforme à la volonté des représentants des Parlements de l'Union européenne qui ont adopté, lors de la Conférence de Paris du 8 février 2002, la proposition suivante :
« Consolider le caractère opérationnel d'Eurojust en lui permettant, au-delà de l'échange d'informations, de demander aux autorités nationales compétentes de déclencher et d'exercer des poursuites, de les assister dans ce cadre et de coordonner les enquêtes. » (proposition 43).
La brève existence d'Eurojust provisoire semble encourageante, comme l'a relevé, devant la Mission, la Garde des Sceaux, Mme Marylise Lebranchu.
Eurojust : des débuts encourageants
Mme Marylise LEBRANCHU, Garde des Sceaux : S'agissant d'Eurojust, un magistrat - parfois un policier - est affecté par pays ; et il s'agit essentiellement de croisement d'informations. Je suis allée à Eurojust, où les magistrats travaillent encore un peu au cas par cas, à la demande de magistrats d'autres pays.
Je me demande si Eurojust ne pourrait pas tenir, au niveau européen, les statistiques des commissions rogatoires, afin de nous donner une idée sur les pays qui traînent un peu les pieds. Nous aurons ainsi une vision du comportement de chaque pays. Voilà une mission qu'il nous faut demander à Eurojust lors de son installation définitive.
Toutefois, en ce qui concerne Eurojust, nous avons déjà un acquis d'expérience depuis mars dernier de l'unité provisoire, avec nos représentants nationaux. Nous sommes là dans un outil de la coopération judiciaire et sur un sujet qui est transnational avec le blanchiment par rapport aux différents trafics existants. Or l'un des gros atouts de la coopération judiciaire, c'est le rapprochement des hommes. Nos magistrats ont des résultats lorsqu'ils se rendent dans le pays qui pose problème. Avec Eurojust, nous avons la possibilité d'avoir un réseau.
Sur les 180 dossiers qui ont été traités par Eurojust, un bon nombre concerne des affaires de blanchiment. Notre représentant national d'Eurojust n'a pas hésité à demander à son homologue luxembourgeois de venir faire un tour au pôle économique et financier de Paris afin d'évoquer certains problèmes ; tous les juges d'instruction ont sorti leur dossier et ont pu solliciter le représentant luxembourgeois pour obtenir des réponses ou la levée d'obstacles qu'ils avaient rencontrés.
Extrait de l'audition, devant la Mission, de Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, le 9 janvier 2002.
La Mission approuve tout à fait l'idée de la Garde des Sceaux consistant à confier à Eurojust la tenue des statistiques relatives à l'exécution des commissions rogatoires internationales. Ceci permettrait de garantir l'objectivité de cet exercice et d'identifier de manière incontestable les systèmes judiciaires les plus récalcitrants aux demandes étrangères.
La finalisation de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen au Sommet de Laeken du 16 novembre 2001 est une avancée considérable pour l'Europe judiciaire.
Illustration du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, le mandat d'arrêt européen met un terme définitif, dans les limites de son champ d'application, à la procédure de l'extradition entre Etats membres de l'Union. Cette procédure porte aussi un coup sérieux à la position traditionnelle de certains Etats, dont la France, qui refusent d'extrader leurs nationaux.
Ce succès, porté par le nouveau contexte issu des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, est le fruit d'un compromis dont les termes permettent d'affirmer qu'un pas important a été franchi sur la voie de la coopération judiciaire contre la délinquance financière.
Ainsi, malgré l'opposition constante du gouvernement italien de M. Berlusconi qui a dû finalement céder sous la pression de l'ensemble des autres Etats membres de l'Union, la délinquance financière est bien intégrée au champ d'application du mandat d'arrêt européen puisque, parmi les 32 infractions qui constituent la liste dite positive, on retrouve :
- la corruption ;
- la fraude ;
- le blanchiment ;
- le racket et l'extorsion de fonds ;
- la participation à une organisation criminelle ;
- l'escroquerie ;
- la falsification de documents administratifs et le trafic de faux.
Par ailleurs, la plupart des infractions traditionnellement sous-jacentes au blanchiment appartiennent aussi à la liste.
Toutefois, demeurent soumis au contrôle de double incrimination, les faits relevant des mêmes comportements et punis dans la législation de l'Etat d'émission d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans. Autrement dit, le juge ne vérifiera pas que les faits reprochés soient punissables dans son propre pays s'ils relèvent de la liste et qu'ils sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement dans le pays demandeur.
La décision-cadre prendra effet le 1er janvier 2004 et rendra inapplicable entre les Etats membres le droit d'extradition. Le mandat d'arrêt européen s'applique aux faits commis avant cette date et qui n'ont pas antérieurement fait l'objet d'une demande d'extradition. Les Etats membres ont cependant la faculté de limiter la rétroactivité aux faits commis après l'entrée en vigueur de la décision-cadre (vingt jours après sa publication au Journal officiel), c'est-à-dire en février 2002.
Cette rétroactivité à géométrie variable est une importante concession faite au Gouvernement italien qui semblait craindre l'application du mandat d'arrêt européen à des faits antérieurs à 2002...
Le gouvernement de M. Berlusconi contre la
coopération judiciaire européenne
Le gouvernement de M. Berlusconi est engagé dans une épreuve de force avec la magistrature italienne pour des raisons politiques et idéologiques qui recoupent largement les intérêts du justiciable Berlusconi, dont le groupe doit affronter de nombreuses procédures relevant de la délinquance financière (fraude fiscale, abus de biens sociaux, conflits d'intérêt, etc.).
Ce combat a eu des conséquences directes sur la position italienne dans les instances communautaires. Après le vote de la loi italienne sur les commissions rogatoires internationales qui en a considérablement compliqué l'exécution en matière financière, on peut ainsi citer les exemples suivants :
- refus prolongé de nommer des représentants italiens à l'Office de lutte antifraude (OLAF) ;
- veto italien, finalement levé devant les pressions de l'ensemble des membres de l'Union, sur 26 des 32 délits à la base du mandat d'arrêt européen, dont l'ensemble des délits financiers ;
- volonté de reculer l'application du mandat d'arrêt européen jusqu'à 2007-2008.
Il conviendra donc d'être particulièrement vigilant sur le rythme d'adoption des réformes constitutionnelles et législatives qui conditionnent l'application effective du mandat d'arrêt européen avec l'Italie.
c) La multiplication des conventions internationales
L'entraide judiciaire est un domaine qui a vu se multiplier les conventions internationales. Si cette profusion peut présenter certains inconvénients pour les opérationnels qui risquent de s'y perdre, elle témoigne cependant d'une volonté politique positive. La France n'est pas étrangère à cette mobilisation internationale même si le refus traditionnel d'extrader ses nationaux explique l'absence de ratification par notre pays du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'extradition du 17 mars 1978 et de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996.
Parmi les textes les plus importants pour la lutte contre la délinquance financière, on notera :
- la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ratifiée par tous les Etats membres).
Il s'agit d'un instrument général pour l'entraide judiciaire en matière pénale qui participe de la lutte contre la criminalité financière dans la mesure où, dans le cadre de cet instrument, les Etats membres se sont engagés à « s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante ».
Cet instrument permet une large coopération mais celle-ci peut être limitée, particulièrement si des mesures coercitives sont demandées, la plupart des Etats ayant fait des déclarations pour se prévaloir des conditions prévues à l'article 5. A noter par ailleurs que, par le biais de déclaration faite à l'article 2, la coopération peut être soumise à la double incrimination ou exclue en matière d'infractions fiscales, ce que ne permet plus le protocole additionnel du 17 mars 1978.
- la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000.
Cette convention ne prévoit aucune disposition particulière pour le renforcement de la lutte contre la criminalité financière. Toutefois, dans la mesure où elle renforce de manière générale la coopération en matière d'entraide judiciaire en simplifiant et en complétant les instruments existants, elle y participe. Cette convention n'est pas encore en vigueur, elle n'a pour le moment été ratifiée que par un seul Etat membre (le Portugal).
- le protocole du 16 octobre 2001 à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000.
Cet instrument, récemment signé, constitue un renforcement du dispositif global de lutte contre la délinquance économique et financière. Cet instrument ne s'applique pas uniquement aux infractions financières et au blanchiment mais la nature des dispositions prévues devraient faciliter considérablement la coopération sur les points suivants :
· demande d'information sur des comptes et transactions bancaires ;
· opposabilité du secret bancaire ;
· poursuite des infractions fiscales ;
· saisine d'Eurojust.
- la convention européenne du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ratifiée par tous les Etats membres).
Cet instrument, élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe, ne concerne pas exclusivement la criminalité financière mais vise à « faciliter la coopération internationale en ce qui concerne l'entraide aux fins d'investigation, de dépistage, de saisie et de confiscation du produit de tout type de criminalité, notamment les crimes graves et, en particulier, les infractions en matière de stupéfiants, de trafic d'armes, les infractions terroristes, le trafic d'enfants et de jeunes femmes et d'autres infractions rapportant des profits importants » (extrait du rapport explicatif).
- la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 12 décembre 2000.
Il s'agit d'un instrument extrêmement important pour la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre les infractions financières. En effet, outre les dispositifs de coopération judiciaire et policière prévue en matière de criminalité organisée, cet instrument oblige les Parties à incriminer le blanchiment et la corruption. Il prévoit en outre des mesures de lutte contre le blanchiment. Les infractions prévues sont des infractions dites « autonomes », c'est-à-dire que la commission par une organisation criminelle et le caractère transnational de l'infraction ne font pas partie des éléments constitutifs de ces infractions.
III.- un bilan répressif en demi-teinte
L'enquête en matière de blanchiment se heurte à une série d'obstacles d'autant plus difficiles à surmonter que l'incrimination de blanchiment est elle-même délicate à établir, puisqu'elle repose sur trois éléments successifs :
- le caractère suspect d'une opération financière ou commerciale ;
- le lien entre l'argent blanchi et un délit préalable ;
- l'élément intentionnel du délit de blanchiment, c'est-à-dire la preuve que la personne connaissait l'origine condamnable des fonds.
Ces éléments éclairent sans doute la médiocrité relative du bilan répressif en France. Ils justifient et expliquent aussi les efforts récents tendant à étendre la définition de l'incrimination de blanchiment, efforts auxquels la Mission n'est pas totalement étrangère.
A.- des statistiques en hausse
En France, la statistique judiciaire semble tout, sauf scientifique. Sa qualité dépend beaucoup des conventions appliquées (rattachement des condamnations à telle ou telle incrimination, prise en compte des condamnations non définitives, etc.) par les différents Parquets.
C'est d'autant plus vrai pour le blanchiment que certaines affaires sont souvent rattachées aux infractions principales sous-jacentes plus faciles à prouver ou à l'infraction de recel dont la définition est très proche et que notre droit pénal compte trois incriminations différentes du blanchiment : un délit général (article 324-1 du code pénal) et deux délits de blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants, dont l'un est inséré dans le code pénal (article 222-38 du code pénal) et l'autre dans le code des douanes (article 415 du code des douanes).
Condamnations pour blanchiment
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Total | |
Blanchiment de fonds du trafic de stupéfiants |
|
|
|
|
|
|
Blanchiment de fonds provenant d'autres délits |
|
|
|
|
|
|
Total blanchiment |
8 |
7 |
22 |
28 |
28 |
93 |
Source : ministère de la Justice.
Ces chiffres doivent être analysés en tenant compte des précisions suivantes :
- les procédures douanières, notamment pour violation des obligations déclaratives à l'occasion d'un transfert de sommes supérieures à 50 000 francs entre la France et l'étranger, qui s'avèrent parfois plus efficaces, ne sont pas prises en compte ;
- du fait de la longueur des procédures, les effets des modifications de la législation pénale sont décalés ; sur 307 procédures pour blanchiment ouvertes en 1999 et 2000, 200 sont encore en cours de traitement et auront un impact sur les statistiques de 2001 et 2002 ;
- ces condamnations ne concernent que des personnes physiques à l'exception d'une seule personne morale (une société implantée à Cayenne blanchissant du trafic d'opium).
Le casier judiciaire montre une relative sévérité des peines puisque 90 % des condamnations comportent des peines de prison et que les durées moyennes de prison ferme s'élèvent à trois ans.
Les 28 condamnations pour blanchiment de 2000 ont compté 22 peines de prison dont 17 ferme et 5 avec sursis. Une peine de 8 ans d'emprisonnement a été prononcée (blanchiment de trafic de stupéfiants) et deux de 5 ans dont un dirigeant d'une société soupçonné d'entretenir des relations avec la mafia italienne.
On constate que le nombre de condamnations a franchi un palier en 1998, mais qu'il progresse très légèrement depuis, et principalement en raison de l'application de la nouvelle incrimination de blanchiment généralisée à l'ensemble des délits.
Cette faible progression des condamnations est inférieure à l'augmentation constatée du nombre d'ouvertures de procédures judiciaires depuis 1996 (de 21 en 1996 à 71 en 2001 pour la seule section financière du Parquet de Paris), ce qui reflète, soit la durée des procédures, soit leur faible taux de succès.
Même s'il est encore un peu tôt pour formuler un jugement consolidé, ce bilan place encore la France dans un rang médiocre par rapport aux pays comparables.
La justice n'aurait saisi que 0,5 % de l'argent
de la criminalité organisée investi en France
Hormis les difficultés à cerner les chiffres d'activités occultes, la diversité des activités donnant lieu à blanchiment explique aussi l'amplitude des évaluations produites en matière de blanchiment. Sans que les fondements statistiques de l'information soient établis, le FMI a indiqué en 1998 que l'argent blanchi représentait 2 à 5 % du PIB mondial, alors que les produits du seul trafic de stupéfiants en sont estimés à 1 %. Le GAFI a une estimation plus modeste de ce dernier chiffre, à un peu moins de 0,5 % du PIB mondial. Les exemples montrent que les montants en jeu sont rapidement très élevés. Les candidats à l'utilisation de la filière de travail clandestin organisée par les Triades asiatiques à l'origine du drame récent de Douvres payaient 150 000 francs le passage. La capacité de ce circuit était évaluée à environ 1 000 passages par an, ce qui conduit à un chiffre d'affaires de 150 millions de francs par an pour ce seul canal d'immigration clandestine.
Le trafic de stupéfiants étant estimé représenter la moitié environ des activités des organisations criminelles, l'évaluation réelle des montants en jeu est clairement dans le bas de la fourchette du FMI. [...]
Nettement moins de 1 % du PIB mondial peut donc être estimé comme le montant blanchi au profit de la criminalité organisée. Ceci est corroboré par le « trou noir » des balances de paiement, écart entre les flux sortants et les flux entrants déclarés dans chaque pays, écart sans aucun doute en lien étroit avec les flux de blanchiment, et qui atteint 120 milliards de dollars, soit environ 0,4 % du PIB mondial. [...]
S'il ne faut donc pas confondre les flux liés à l'économie informelle, souterraine ou illicite avec les flux liés aux organisations criminelles, bien plus limités, les montants accumulés par ces dernières n'en sont pas moins impressionnants puisqu'ils dépassent, selon les données du FMI, et compte tenu des taux de rendement financier, 1 200 milliards de dollars. Au taux de rendement actuel, le placement de ce patrimoine produit plus de 70 milliards de dollars, soit environ 500 milliards de francs, d'intérêts annuels. [...]
Jean-Luc Hérail et Patrick Ramael (« Blanchiment d'argent et crime organisé » - PUF - 1996, p. 107), reprennent une estimation d'environ 10 % de l'argent des organisations criminelles investi en France, soit autant qu'en Suisse bien que ce pays soit plus exposé à des opérations de pré-blanchiment. Ceci est assez cohérent avec des critères de gestion financière répondant aux objectifs précités. Ce serait donc, en fonction des précédentes évaluations, au moins 120 milliards de dollars, soit 800 milliards de francs, qui seraient en réalité sous l'influence d'organisations criminelles. [...]
Le résultat quantitatif global de ce dispositif n'est évidemment pas très probant. Depuis 1987, 160 affaires de blanchiment auraient donné lieu à instruction et 50 jugements auraient été prononcés en France Environ 3 milliards de francs auraient été saisis, soit environ 0,5 % de l'argent de la criminalité organisée investi en France, selon l'estimation précédemment développée.
Dans le même temps, le Royaume-Uni ouvrait 257 instructions pour faits de blanchiment, l'Italie 538 et les Etats-Unis 2 034. Rapporté à la taille du pays, le chiffre américain correspond environ à 400 instructions pour la France. Au Royaume-Uni, 136 condamnations ont été prononcées, mais seulement 12 pour chacune des deux dernières années, contre 43 en 1997. Les procédures avaient abouti, en 1996, à la saisie d'une contre-valeur de 26,4 millions de dollars au Royaume-Uni contre 25 millions aux Pays-Bas et 760 millions aux Etats-Unis.
La France se distingue donc par le faible nombre de ses enquêtes judiciaires et de ses condamnations, sachant que tous ces chiffres sont réellement sujets à caution en raison de la redondance de l'incrimination de blanchiment avec celle de recel dont l'application effective est bien plus large. En revanche, en termes de saisies, les insuffisances relevées en France et dans les autres pays sont comparables.
Extrait du rapport Gravet/Garabiol au ministre de l'Intérieur - « La lutte contre le recyclage de l'argent du crime organisé » - juin 2000.
B.- La France : un pays de transit et d'empilage
L'analyse des condamnations pourrait laisser penser que le blanchiment en France est encore très dépendant du seul trafic de stupéfiants. La réalité, telle que l'on peut la retracer à l'aide de l'activité de TRACFIN et des services de police judiciaire, est plus diverse. Elle reflète la diversification des grands réseaux criminels agissant sur le territoire français, puisque l'on observe une montée en puissance du blanchiment des fonds résultant de l'activité des filières d'immigration clandestine ou des mafias contrôlant le proxénétisme dans les grandes villes, mais aussi de la délinquance financière à travers notamment les fraudes à la TVA intra-communautaire.
De manière plus insidieuse, la France sert aussi, soit de base arrière, soit de pays de transit pour l'intégration des produits d'activités criminelles commises à l'étranger, ce qui complique singulièrement l'activité des services judiciaires.
La France, pays de transit
Dans ce contexte, la France paraît relativement épargnée par les opérations de blanchiment de premier niveau, c'est-à-dire de placement d'argent directement issu d'activités criminelles. Les mesures de prévention y ont sans doute concouru. Mais elle a toutes les caractéristiques d'un pays attrayant pour de l'argent pré-blanchi. Le blanchisseur est, en effet, supposé attiré par la sécurité de son placement puis par sa valorisation, sachant que l'anonymat doit avoir été assuré par la première opération de placement. La solidité du système financier et la force de sa monnaie depuis une décennie ont offert l'environnement souhaité. La France est donc essentiellement exposée à des opérations d'intégration d'argent criminel dans son économie licite.
* *
*
M. Jean-Bernard PEYROU, Secrétaire général adjoint de TRACFIN : La France, en fait, sert beaucoup de pays de transit. Dans de nombreux circuits financiers, on voit que l'argent passe par la France, mais ne reste pas ici. Par exemple, s'agissant de la provenance des capitaux pour l'année 2000, les fonds provenaient d'un grand nombre de pays, dont la Lettonie, la Russie, les îles anglo-normandes, Monaco, la Suisse, l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne.... Ensuite les fonds repartent vers Hongkong, le Bénin, la Roumanie, la Russie, les îles Caïman, l'Italie, l'île de Man, la Turquie, la Suisse, le Luxembourg.... La France, selon moi, est surtout concernée par la phase d'empilage pour multiplier l'opacité.
Mais il est vrai qu'on constate, notamment en matière immobilière, des opérations très typées, centrées essentiellement sur la région parisienne ou la Côte d'Azur. Dans ces opérations, on peut réellement considérer que cet argent est intégré dans l'achat d'un complexe sportif ou un achat immobilier quelconque.
Extrait du rapport Gravet/Garabiol au ministre de l'Intérieur - « La lutte contre le recyclage de l'argent du crime organisé » - juin 2000, et de l'audition, devant la Mission, de M. Jean-Bernard Peyrou, Secrétaire général adjoint de TRACFIN, le 30 mai 2001.
Des tendances inattendues se manifestent, comme un recours accru à l'association humanitaire en tant que vecteur de blanchiment.
«Selon des statistiques sur les infractions susceptibles d'être à l'origine des capitaux ou leur mise en évidence au travers d'opérations financières, les trafics de stupéfiants se situent au même niveau que les escroqueries, soit autour de 30 %, 9 % pour les abus de biens sociaux, 5 % pour la corruption.... Nous avons aussi beaucoup de détournements de fonds d'association. A cet égard, de belles affaires devraient sortir sur un certain nombre d'associations humanitaires où l'argent sert à bien d'autres choses. Au-delà du blanchiment stricto sensu, nous travaillons de plus en plus dans le cadre de la lutte contre la corruption. » (Audition de M. Jean-Bernard Peyrou, devant la Mission, le 30 mai 2001).
L'aide humanitaire, paravent du blanchiment
Une association caritative présente une situation financière atypique : plus de 12 millions d'euros transitent par ses comptes et par ceux d'entités liées, en vue de mettre en place une structure d'aide dans un pays du tiers monde. L'origine de certains apports (fonds en provenance de l'étranger et, notamment, de juridictions non-coopératives), l'utilisation manifeste d'écrans, la tension inhabituelle du client et la volonté de transférer le sommes vers un autre pays de l'Union européenne, ont incité le banquier à adresser une déclaration de soupçon à TRAFIN.
L'enquête du service a mis en évidence des éléments négatifs concernant certaines personnes impliquées (déjà connues pour escroquerie, abus de biens sociaux, appartenance à une organisation criminelle), l'origine des fonds à l'étranger, l'aspect douteux des capitaux provenant d'autres associations (sommes disproportionnées au regard de leur situation). Ces éléments ont conduit à une transmission rapide des faits au Parquet, qui a saisi quelques mois plus tard un service de police.
Suite à une rencontre entre ce dernier et TRACFIN, des liens nouveaux ont été mis au jour et de nouvelles informations transmises au Parquet. Une cellule de renseignement financier (CRF) européenne a, par la suit, informé TRACFIN qu'une partie des fonds, objet de la première transmission, et arrivés dans ce pays, avait fait l'objet d'une tentative de transfert vers le Liechtenstein.
Plus d'un an après la première saisine judiciaire, TRACFIN a reçu une nouvelle déclaration d'un autre intermédiaire financier, impliquant la même association et laissant présumer d'un abus de confiance portant sur près de 2 millions d'euros : les fonds étaient passés de l'association vers une autre structure, avant une demande de transfert sur un compte à l'étranger. Interrogée par TRACFIN, la CRF étrangère a informé que ce compte était celui d'un diamantaire.
Les informations ont alors été communiquées au Parquet et TRACFIN a été tenu informé un mois plus tard de l'arrestation de plusieurs personnes et de la saisie de fonds.
Source : TRACFIN.
Devant des activités d'empilage ou d'intégration sur le territoire français, les services répressifs éprouvent de grandes difficultés à prouver le blanchiment, surtout si les services du pays où se sont commis les délits ne coopèrent pas, comme l'a reconnu M. Patrick Riou, directeur central de la police judiciaire :
« La première catégorie, générée par les déclarations de soupçon et TRACFIN, concerne des crimes ou des délits commis en France sur lesquels nous sommes arrivés ces derniers temps à résoudre de très belles affaires et des affaires de grande envergure.
La deuxième catégorie concerne des affaires générées par ces mêmes déclarations de soupçon, liés à des crimes ou des délits commis à l'origine à l'étranger - je pense notamment aux investissements de la mafia russe dont tout le monde me rebat les oreilles et sur lesquels les enquêtes sont extrêmement difficiles, voire impossibles.
Une troisième catégorie obéit à un raisonnement inverse et concerne des affaires de crimes ou de délits, le plus souvent des affaires de trafic de stupéfiants, à l'occasion desquelles nous débouchons, secondairement, sur des affaires de blanchiment. » (Audition de M. Patrick Riou, directeur central de la Police judiciaire, le 30 janvier 2002).
Ce bilan en demi-teinte devrait s'améliorer du fait de l'élargissement progressif des incriminations de blanchiment.
C.- L'extension des incriminations
Afin de mieux cerner l'activité de blanchiment dans ses différents aspects et de faciliter la qualification pénale des faits, la France s'est progressivement engagée, depuis une décennie, dans un processus d'extension des incriminations. Même s'il présente encore quelques imperfections qui mériteraient d'être corrigées, ce processus devrait peu à peu permettre aux services répressifs de disposer de plus de moyens pour incriminer la diversité des comportements qui relèvent du blanchiment.
1.- La généralisation des délits sous-jacents
L'apparition de l'incrimination de blanchiment dans le droit pénal français remonte à 1987. Elle est, à l'époque, exclusivement destinée à lutter contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants et fait partie d'un plan global ciblé sur cette délinquance. A l'usage, les services répressifs ont souligné la difficulté que leur posait cette incrimination qui les obligeait à apporter la preuve que la personne en cause, non seulement connaissait l'origine illicite des fonds qu'elle manipulait, mais savait précisément qu'il s'agissait du produit d'un trafic de stupéfiants.
Parallèlement à cette utilisation délicate d'une incrimination aussi précisément définie, le blanchiment, illustration emblématique de la délinquance en col blanc, est apparu comme une problématique autonome, un comportement condamnable quelle que soit la nature précise de la criminalité à la source de l'argent blanchi. Cette prise de conscience est issue d'un mouvement international (création du GAFI, adoption de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe et dite convention de Strasbourg), qui date de 1989-1990.
Ce n'est qu'à l'occasion de la transposition de la Convention de Strasbourg que la France, en 1996, a considérablement élargi sa définition du blanchiment, puisqu'elle l'a généralisée à l'ensemble des crimes et délits sous-jacents. Entre autres effets, cette généralisation a eu le mérite d'esquiver le débat sur la notion de criminalité organisée.
La plupart des autres pays ont adopté des définitions moins extensives :
- liste de crimes fédéraux excluant la fraude fiscale pour les Etats-Unis ;
- infraction relevant de la procédure pénale lourde pour le Royaume-Uni ;
- crimes, à l'exclusion des délits, pour la Suisse ;
- infraction passible d'au moins trois ans de prison pour l'Espagne ;
- criminalité organisée pour l'Italie.
La conception française du blanchiment s'apparente fortement à celle du recel, comme le montrent les définitions des incriminations.
Les trois définitions du code pénal français sont aujourd'hui les suivantes :
Article 121-7 : complicité
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 321-1 : recel
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Article 324-1 : blanchiment
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
La dissimulation porte sur le produit lui-même dans les deux cas mais ne porte de façon distincte sur la seule origine des fonds que dans le cas du blanchiment. Ainsi, une personne ne dissimulant pas un produit mais dissimulant son origine réelle sera qualifiée de blanchisseur et non de receleur. Toutefois, il est peu vraisemblable que les fonds ne soient jamais transférés ou utilisés. S'ils le sont, l'incrimination de complicité de recel, qui vise la préparation d'une infraction, peut être appliquée au blanchisseur. La dissimulation de l'origine des fonds requiert, en outre, souvent une action directement qualifiée pénalement (le faux en écriture par exemple).
Ensuite, la personne impliquée doit être « intermédiaire » dans le cas du recel et « apporter son concours » dans le cas du blanchiment. La définition du blanchiment est donc plus large et touche notamment le simple conseil ou l'assistance apportée au blanchiment.
Cette proximité du blanchiment et du recel constitue l'une des explications de la faiblesse apparente du nombre d'affaires ou de décisions de justice rattachables au blanchiment. Dans bien des cas, le juge retient finalement une incrimination de recel, mieux établie dans notre droit.
En fonction de la circulaire d'application de la Garde des Sceaux, le blanchiment tend à être plutôt retenu pour les affaires relatives à la criminalité organisée internationale et le recel pour les affaires de proximité, mais sans que ceci ne soit une règle rigoureuse.
Par ailleurs, la création de ce nouveau délit de blanchiment général n'a pas supprimé l'ancien délit spécifique de blanchiment des fonds issus du trafic de stupéfiants qui reste prévu à l'article 222-38 du code pénal.
La persistance de deux délits de blanchiment
gêne les services répressifs
M. Jean-Claude MARIN, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris : De fait, nous pouvons poursuivre sur la base de deux textes différents. L'un, qui traite du blanchiment de sommes provenant du trafic des stupéfiants, engendre des peines de dix ans et autorise une garde à vue de quatre jours. L'autre, issu de la loi de mai 1996, concerne le blanchiment dit de droit commun, pour lequel tous ces moyens extraordinaires de procédure n'existent pas et dont le mauvais usage peut d'ailleurs être sanctionné par la Cour de cassation, au motif que l'on a délibérément choisi un blanchiment de stupéfiants pour utiliser un cadre procédural exorbitant du droit commun, alors que l'on savait que c'était un autre type de blanchiment. Par ailleurs, si nous voulons faire une opération sous couverture, l'article 706-32 du code de procédure pénale n'est applicable qu'au blanchiment du produit provenant du trafic de stupéfiants et non de crime organisé. [...]
Mme Anne-Josée FULGERAS, chef de la section financière : Il est vrai que cette distorsion entre les moyens procéduraux selon les caractéristiques de l'opération de blanchiment est pénalisante.
Aujourd'hui, lorsque l'on travaille sur le réseau d'une organisation criminelle extrêmement puissante, si l'on n'arrive pas à apporter la preuve que le trafic de stupéfiants est au nombre de ses activités, sachant que les activités des organisations criminelles sont très évolutives, nous ne pouvons juridiquement pas recourir à ces instruments, qu'il s'agisse de la garde à vue, de la perquisition, du délai de prescription ou d'un moyen aussi essentiel pour atteindre certaines étapes du blanchiment que sont les opérations sous couverture.
Extrait des auditions, devant la Mission, de M. Jean-Claude Marin, chef de la division économique et financière du Parquet de Paris, et de Mme Anne-Josée Fulgeras, chef de la section financière, le 6 octobre 1999.
Aux yeux de la Mission, la solution de cette difficulté passe par l'extension du champ d'application des moyens spécifiques de procédure, actuellement cantonnés au trafic de stupéfiants, à l'ensemble des activités de la criminalité organisée (voir supra, liste des infractions proposées).
2.- Le renversement de la charge de la preuve de l'origine des capitaux
Pour les raisons déjà longuement évoquées, la demande d'aménagement de la charge de la preuve dans les affaires de blanchiment a été une constante dans les rencontres de la Mission avec les opérationnels, aussi bien en France qu'à l'étranger.
L'idée qui est à la base de tous les dispositifs de ce type est de considérer comme légitime qu'un individu qui, d'une part, jouit d'un train de vie sans commune mesure avec les ressources légales dont il dispose, et qui, d'autre part, est en relation habituelle avec un groupe de personnes impliquées dans la commission de délits ou de crimes, doive fournir des explications sur l'origine de son train de vie et de son patrimoine.
Il ne s'agit donc pas d'un renversement total de la charge de la preuve mais d'un partage, l'accusation devant établir l'appartenance à un réseau délinquant et la déconnexion entre le train de vie et les ressources connues, et la personne mise en cause devant justifier l'origine de ses biens.
Convaincue du bien-fondé et des potentialités répressives de cette mesure pour lutter contre les réseaux de la criminalité organisée et leurs mentors, la Mission n'a pas épargné ses efforts pour faire adopter ce dispositif dans le droit français et dans la déclaration finale des Parlements de l'Union européenne réunis à Paris le 8 février 2002.
Il lui a paru en revanche possible de créer une nouvelle incrimination fondée sur la notion bien connue en droit français de l'association de malfaiteurs et comparable à ce qui a été fait en 1996 pour le trafic de stupéfiants (article 222-39.1 du code pénal dit du « proxénétisme de la drogue »).
C'est ainsi qu'elle est à l'origine de l'adoption par le Parlement de l'article 46 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui crée un nouvel article 450-2.1 du code pénal ainsi rédigé :
« Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes appartenant à une association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. »
Parallèlement, l'article 45 de la même loi a modifié le seuil de définition de l'association de malfaiteurs en abaissant de 10 à 5 ans la peine de prison de l'infraction principale, ce qui permettra de qualifier d'association de malfaiteurs des organisations se livrant à des actes de délinquance financière ou fiscale.
La combinaison des deux mesures est donc potentiellement très intéressante, si les services de l'Etat, et pas seulement la police, se mobilisent pour agir de concert afin d'identifier l'environnement économique et financier des réseaux délinquants.
Frapper la délinquance organisée au portefeuille
Mme Marylise LEBRANCHU, Garde des Sceaux : S'agissant du travail policier d'initiative, notamment en lien avec les services fiscaux et TRACFIN, nous devons affecter des moyens de façon plus précise, plus fine. Le nouvel article 450.2.1 du code pénal qui introduit un allégement de la charge de la preuve mérite d'être mis en _uvre rapidement pour donner des résultats.
S'agissant des points positifs, nous pouvons signaler les parquets les plus performants : Grasse, Rouen, Brest, Pontoise, Toulon, Metz et Grenoble qui ont mis en place des cellules de coordination avec des services fiscaux, la DGCCRF. Le croisement des informations est réalisé par ces services ; le recueil systématique des éléments de train de vie, par exemple, pour toute personne mise en cause, est effectué, ce qui est rarement le cas. Nous devons valoriser ce type d'expérience et montrer que l'on obtient des résultats. Il s'agit d'une nouvelle façon de travailler, notamment pour la France dont les services publics oublient trop souvent qu'ils peuvent avoir des objectifs communs. [...]
Ensuite, en ce qui concerne la mise en _uvre de l'article 222-39-1 du code pénal concernant le « proxénétisme de la drogue », je voudrais préciser que dix condamnations ont été prononcées il y a deux ans et sept l'année dernière. Nous avons demandé à l'ensemble des procureurs généraux de nous communiquer les jugements et les motivations de ces dix condamnations définitives. Nous les avons analysées et nous sommes en train de préparer une méthodologie d'enquête qui sera diffusée également aux policiers sous l'égide de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Ce guide méthodologique aura évidemment une répercussion sur l'application du mécanisme de renversement de la charge de la preuve prévu par l'article 450.2.1. car il s'agit de la même démarche.
Enfin, le fait de donner aux agents de la direction générale des impôts, en modifiant l'article 10 B dans la loi sécurité au quotidien, la possibilité de concourir à l'établissement de ces infractions, nous permet de les associer dans les comités de liaison et de lutte contre la criminalité organisée, dont il a été question tout à l'heure.
* *
*
Mme Mireille BALLESTRAZZI, sous-directrice chargée des affaires économiques et financières à la direction centrale de la Police judiciaire : Nous n'avons pas, à notre connaissance, d'exemple d'emploi de cet article pour la principale raison - qui ne tient pas à un manque de volonté ou de sensibilisation des magistrats ou des policiers - que, d'une manière générale, l'association de malfaiteurs est une infraction extrêmement difficile à mettre en _uvre, qui n'est donc pas si courante que cela.
Cela étant, je pense qu'il faut se laisser du temps car cette infraction était difficile à mettre en _uvre parce que, justement, elle ne concernait que des infractions criminelles. Elle le sera bien plus facilement maintenant que le seuil est abaissé à cinq ans, en ce qui concerne les délits.
C'est bien plus intéressant mais nous n'en avons pas encore d'exemple, peut-être tout simplement parce que personne n'a eu l'idée de l'appliquer. Il est vrai qu'à un moment donné, il faut une volonté d'innovation sur le terrain des enquêteurs ou des magistrats. C'est une hypothèse d'analyse.
Je peux proposer de sensibiliser à nouveau. Cela peut servir d'en reparler. Il est sans doute bon que les directeurs centraux sensibilisent une nouvelle fois les sections financières et criminelles à cet article. On peut le suggérer également au bureau de police judiciaire de la Chancellerie pour qu'il le suggère à leur ministre. Il y a diverses pistes que l'on peut emprunter pour sensibiliser. Mais je n'ai pas d'exemple précis à vous donner aujourd'hui.
Cependant, on s'aperçoit qu'il a fallu énormément de temps pour que l'article 222.39-1, qui instaure le renversement de la charge de la preuve pour les stupéfiants, soit mis en _uvre. Cela commence depuis deux ou trois ans. Il y a donc des décalages. Il faut laisser du temps.
Mais c'est une excellente mesure. Nous l'avons vu sur une affaire récente du SRPJ de Strasbourg en coopération avec la sécurité publique et le fisc. Il s'agissait d'une très belle affaire de démantèlement d'une équipe de délinquants dans une banlieue, où l'on a démontré qu'il y avait trafic de stupéfiants et recyclage de l'argent issu de ce trafic par le biais de cet article 222.39-1. Tout le monde a suivi, y compris la justice. Et, fait important, la population est satisfaite.
Ce renversement de la charge de la preuve, on le voit, nous facilite la tâche et facilite la répression.
Extrait des auditions, devant la Mission, de Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, le 9 janvier 2002, et de Mme Mireille Ballestrazzi, sous-directrice chargée des affaires économiques et financières à la direction centrale de la Police judiciaire, le 30 janvier 2002.
Au niveau européen, cinq membres de l'Union européenne (Danemark, Grèce, Irlande, Italie et Royaume-Uni) disposent déjà d'un mécanisme de renversement de charge de la preuve en matière de blanchiment et de lutte contre la criminalité organisée.
La majorité de ces dispositifs s'appliquent à des confiscations des produits du crime une fois la condamnation définitive prononcée.
Ce type de dispositions peut susciter des débats constitutionnels au nom du respect de la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
En Italie, la Cour constitutionnelle a ainsi annulé, en 1992, une disposition comparable, tout en validant la confiscation des biens après une condamnation (article 12 sexies de la loi du 7 août 1992), si la personne en cause ne peut justifier de leur origine.
Lors de la Conférence des Parlements de l'Union européenne des 7 et 8 février 2002, la Mission s'est efforcée de convaincre certaines délégations, notamment les délégations allemande, autrichienne et espagnole, du bien-fondé de ces dispositifs et de leur compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle a été appuyée en cela par les délégations des pays utilisant déjà ces mécanismes, et notamment par la Grèce, la Belgique et l'Italie où ils sont les plus développés.
Ces efforts n'ont pas été vains, puisque la déclaration finale compte une proposition n° 39, ainsi rédigée :
« Instituer un partage de la charge de la preuve de l'origine criminelle des capitaux, dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Au-delà de la pénalisation du seul blanchiment, il est apparu à la Mission que la meilleure façon de lutter contre la criminalité organisée dans ses différents rouages, notamment logistiques, consisterait à créer une nouvelle incrimination d'appartenance à une organisation criminelle comme il en existe dans le droit italien (association mafieuse), suisse ou luxembourgeois, ou dans la jurisprudence britannique avec la notion de « conspiration ».
3.- L'intentionnalité des délits et l'éventuelle pénalisation de la négligence
L'intentionnalité des délits est un des grands principes de notre droit pénal établi par l'alinéa premier de l'article 121-3 du code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
Ce principe s'applique au délit de blanchiment : l'accusation doit établir que la personne savait que les actifs qu'elle gérait provenaient d'une infraction, quelle que soit celle-ci.
De la même façon, l'accusation devra établir, dans le contexte du nouvel article 450-2.1 du code pénal, que la personne connaissait les actes délictueux des individus avec lesquels elle était en relation habituelle.
Le fait que la rédaction actuelle du délit de blanchiment ne précise pas ce point, à la différence de celle du recel qui requiert que son auteur ait agi « en connaissance de cause » ou de la complicité, qui suppose que la personne ait agit « sciemment », ne suffit pas à exclure l'application du principe général de l'intentionnalité des délits.
La jurisprudence en matière de blanchiment confirme cette interprétation classique du texte pénal. L'éventuelle pénalisation de la négligence au regard des obligations de vigilance, que la Mission souhaite instaurer, conduirait, en revanche, à une application plus limitée du principe d'intentionnalité.
Cette pénalisation relèverait davantage des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal, issus de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, ainsi rédigés :
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Ce sont bien ces manquements aux « diligences normales » ou ces violations « manifestement délibérées » des obligations de vigilance que la Mission entend réprimer sans obliger l'accusation à prouver que le professionnel ayant organisé de manière crédible sa négligence connaissait l'origine illicite des fonds qu'il manipulait.
En tout état de cause, il resterait à l'accusation à faire la preuve de l'intentionnalité du manquement aux obligations de vigilance, en établissant, par exemple, la continuité d'un tel comportement malgré des observations répétées des autorités de régulation ou des corps de contrôle internes.
Si la Mission a échoué à instituer une telle pénalisation en France, lors de la discussion de la loi sur les nouvelles régulations économiques, elle a contribué, avec le soutien de délégations de pays qui connaissent déjà un tel dispositif, à l'inscrire au nombre des propositions actées par la Conférence des Parlements de l'Union européenne contre le blanchiment, le 8 février 2002.
La proposition 53 est ainsi rédigée :
« Assortir de sanctions pénales le manquement manifeste à leurs obligations de vigilance des professions qui y sont soumises. »
Au vu des éléments portés à la connaissance de la Mission, on peut donc affirmer que, globalement, le dispositif français commence à prendre la mesure de l'importance de la lutte contre le blanchiment et la délinquance financière. Il est encore freiné dans son efficacité répressive par quelques dysfonctionnements qui relèvent parfois de problèmes budgétaires (effectifs de la police économique et financière), mais aussi organisationnels (articulation entre le renseignement financier et l'enquête judiciaire).
La France devrait aussi renforcer l'adaptation de son code de procédure pénale aux exigences du combat contre la criminalité organisée.
Il faut enfin évoquer les inquiétudes que suscitent, à côté de ce constat global nuancé, les faiblesses du système judiciaire dans une région pourtant particulièrement exposée au blanchiment, c'est-à-dire le sud-est de la France.
_________________________
2311 - Rapport d'information de M. Arnaud Montebourg. Tome II : La lutte contre le blanchiment des capitaux en France : un combat à poursuivre Volume 1 - Rapport et annexes (1ère partie).