N° 3413 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 novembre 2001. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA MISSION D'INFORMATION COMMUNE (1) SUR LES ÉVÉNEMENTS DE SREBRENICA Président M. François LONCLE, Rapporteurs MM. René ANDRÉ et François LAMY, Députés -- Tome I RAPPORT Relations internationales La mission d'information commune sur les événements de Srebrenica est composée de : M. François Loncle, Président ; Mme Marie-Hélène Aubert, Vice-présidente ; MM. René André et François Lamy, Rapporteurs ; MM. Roland Blum, Pierre Brana, René Galy-Dejean, Jean-Noël Kerdraon, François Léotard, François Liberti. SOMMAIRE - Pages INTRODUCTION 9 I. - SREBRENICA MARS 1993 - JUILLET 1995 : D'UNE ZONE DE SÉCURITÉ A - Srebrenica protégée 13 1) Aux origines de la zone de sécurité 13 a) Le contexte général dans l'ex-Yougoslavie à la fin de l'hiver 1992-1993 13 b) La situation dramatique de Srebrenica 16 c) Le coup de force du général Morillon 17 2) L'extension des zones de sécurité 20 a) La naissance des zones de sécurité : b) Les autres zones de sécurité 21 3) Une enclave singulière 22 a) Srebrenica, un enjeu stratégique pour les Serbes 22 b) Le lourd passif entre Serbes et Musulmans à Srebrenica 23 B - Srebrenica coupée du monde 25 1) L'ONU à Srebrenica 25 a) Un sous-effectif constant 26 b) Des moyens matériels insuffisants 27 2) Vivre à Srebrenica 29 a) Des conditions de vie dramatiques 29 b) Le rôle du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) 31 3) Les organisations non gouvernementales (ONG) à Srebrenica 32 C - Srebrenica abandonnée 33 1) 6/11 juillet 1995 : l'attaque serbe 33 a) Les prémices de l'attaque : la concentration des troupes au mois de juin 33 b) 6/7 juillet : première offensive, première demande d'appui aérien et répit 35 c) 8 juillet : la remontée des Serbes vers le Sud et la d) 9 juillet : la pression croissante des Serbes et la réaction de Zagreb 41 e) 10 juillet : les Serbes aux portes de la ville et les hésitations du général Janvier 44 f) 11 juillet : la chute de l'enclave et l'intervention tardive de l'OTAN 46 2) 11/17 juillet : « le grand massacre » 48 II. POURQUOI SREBRENICA ? ANALYSER L'INACCEPTABLE 59 A - Srebrenica ou l'échec tragique d'une politique internationale 60 1) L'ONU dans la guerre, un outil inadapté 60 a) Culture de paix contre « nettoyage ethnique » : un décalage dramatique b) Un fonctionnement lourd et non réactif 64 c) Une force aveugle : les lacunes du dispositif de renseignement 72 2) Des missions impossibles ? La faillite de la politique des zones de sécurité 73 a) L'intervention internationale en ex-Yougoslavie ou le b) Une illusion tragique : la politique des zones de sécurité 77 B - De la responsabilité collective des Etats aux responsabilités particulières des acteurs : 1) Un constat troublant : des carences et des erreurs multiples 82 a) En amont, aveuglement et négligences en série 82 b) La gestion de la crise : erreurs et fautes sur fond de passivité internationale 92 2) Le rôle des acteurs étatiques : un bilan accablant 102 a) La réaction des Etats : divisions et atermoiements 103 b) Srebrenica, victime de la raison d'Etat ? 110 c) Un massacre en direct ? 115 C - La France et les événements de Srebrenica 117 1) Un engagement continu de la France en ex-Yougoslavie desservi par a) Grandeurs de la politique de la France en ex-Yougoslavie : b) Faiblesse de la politique de la France en ex-Yougoslavie : une politique c) Les zones de sécurité, un concept français 122 d) 1995, changement de style ou changement de politique ? 124 2) Les carences du renseignement français en Bosnie 125 a) Une focalisation excessive sur Sarajevo 125 b) Du recueil au traitement de l'information : des lacunes tragiques 128 3) La France et l'arme aérienne : des rumeurs aux réalités 130 a) La thèse du marchandage : une hypothèse peu crédible 132 b) Une doctrine française sur le recours à l'arme aérienne ? 136 c) L'erreur d'un homme ? 140 III. SREBRENICA : PLUS JAMAIS - LES LEÇONS D'UN MASSACRE 145 A. Un accélérateur du changement de logique en ex-Yougoslavie 145 1) Une connaissance officielle des massacres étrangement tardive aux Nations unies 147 a) Des révélations progressives 148 b) L'absence d'information des Nations unies sur la situation des 2) Une logique de coercition efficace 152 a) La conférence de Londres du 21 juillet 1995 : l'impossible protection des enclaves 153 b) L'opération « Force délibérée » ou le passage à l'acte 154 c) L'accord de Dayton : Pax Americana ou conséquence B - Le recours à la justice pénale internationale : lutter contre l'oubli et l'impunité 161 1) Une obligation morale et une étape nécessaire à la construction a) L'interrogation obsédante des victimes sur les responsabilités 162 b) La recherche des disparus 163 c) Le difficile retour des réfugiés 164 2) Des résultats limités : la nécessaire arrestation de Ratko Mladic et Radovan Karadzic 164 a) La première condamnation pour génocide en Europe b) Arrêter Radovan Karadzic et le général Ratko Mladic : un devoir 165 C - Quel rôle pour l'ONU dans les interventions extérieures ? 169 1) Des lacunes majeures à combler 170 a) Du rapport de Kofi Annan au rapport Brahimi 170 b) Les propositions présentées dans le rapport du groupe d'étude c) Des difficultés de mise en oeuvre 175 2) L'ONU peut-elle faire la guerre pour imposer la paix ? 176 a) Les limites de la culture de paix 176 b) Les interventions des organisations régionales : le Kosovo ou l'anti Bosnie 177 c) Le développement des organisations régionales dans la D - La France et les interventions extérieures 179 1) La nécessaire cohérence des objectifs, des mandats et des moyens 179 2) Pour une politique du renseignement à la hauteur des engagements CONCLUSION 183 EXAMEN EN COMMISSION 193 LETTRES
COMPLEMENTAIRES DE MM. FRANCOIS LEOTARD ET RENE ANDRE ANNEXES La plupart des annexes sont proposées au format PDF. Pour les visualiser, vous devez disposer d'Acrobat Reader, que vous pouvez télécharger en cliquant ici. ANNEXE I : COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EN DATE DU
24 JANVIER 2001 DEMANDANT LE HUIS CLOS POUR LES AUDITIONS DES
GÉNÉRAUX BERNARD JANVIER ET PHILIPPE MORILLON ANNEXE II : CARTES POLITIQUES DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE
CORRESPONDANT AUX DIFFÉRENTS PLANS DE PAIX ANNEXE III : PHOTOGRAPHIES PROUVANT LES MASSACRES
(JUILLET À OCTOBRE 1995) FOURNIES PAR LES ETATS-UNIS ANNEXE IV : DOCUMENTS ÉCRITS Rapport de la mission du Conseil de sécurité À Srebrenica le 30 avril 1993 Mémorandum de la France du 19 mai 1993 sur les zones de sécurité Rapport du Secrétaire général des Nations unies du 9 mai 1994 sur les zones de sécurité Note de la Délégation aux Affaires stratégiques du 25 mai 1994 sur la crise de Gorazde Rapport du Secrétaire général des Nations unies du 30 mai 1995 sur
la situation en Bosnie-Herzégovine Compte rendu d'une discussion entre M. Yasushi Akashi, le général
Bernard Janvier et le général Rupert Smith, le 9 juin 1995 Compte rendu du 15 juin 1995 de la rencontre entre le général Bernard
Janvier et le général Ratko Mladic à Zvornik le 4 juin 1995 Note de la Délégation aux Affaires stratégiques du 27 juin 1995 sur
les réactions possibles face aux bombardements serbes Note interne du ministère de la Défense du 11 juillet 1995
sur la situation en ex-Yougoslavie Déclaration de M. Yasushi Akashi le 11 juillet 1995 Compte rendu des entretiens entre le colonel Thomas Karremans
et le général Ratko Mladic des 11 et 12 juillet 1995 Note du ministère de la Défense du 12 juillet 1995 sur les options à adopter en Bosnie Compte rendu Z-1154 de M. Yasushi Akashi à M. Kofi Annan sur la situation
à Srebrenica le 13 juillet 1995 Compte rendu sur la situation à Tuzla fait par le secteur Nord Est de la
FORPRONU le 15 juillet 1995 Compte rendu de l'entretien entre les généraux Rupert Smith et
Ratko Mladic le 19 juillet 1995 à Han-Kram ANNEXE V :
COPIES DE CERTAINES LETTRES CONCERNANT
L'AUDITION
DE PERSONNALITÉS OU LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ANNEXE VI : PROGRAMME DU DÉPLACEMENT EN BOSNIE-HERZÉGOVINE _______________________________________________________ Mesdames, Messieurs, « Srebrenica - un nom de ville que chacun associe au conflit qui a ravagé l'ex-Yougoslavie. Un nom qui évoque immédiatement des milliers de personnes assiégées, affamées, privées de tout, même d'eau ou de temps pour respirer... Le nom d'une enclave que les Nations unies déclarent zone protégée et qui tombe quasiment sans combat. « Srebrenica, c'est aussi des images comme on ne veut pas en voir : des femmes, des enfants, des vieillards que l'on fait monter dans des autobus pour une destination inconnue ; des hommes séparés de leur famille, dépouillés de leur bien ; des hommes qui fuient ; des hommes qui sont faits prisonniers ; des hommes que l'on ne reverra jamais ; des hommes que l'on retrouvera, parfois, mais pas toujours, morts, cadavres entassés dans des fosses communes ; cadavres aux mains liées ou cadavres aux yeux bandés, souvent ; cadavres démembrés, aussi ; cadavres sans identité... cadavres... « Srebrenica est, encore, un nom de syndrome post-traumatique, celui que subissent les femmes, les enfants et les vieillards, qui ne sont pas morts et qui sont, depuis juillet 1995, depuis six ans, sans nouvelles de leur mari, de leurs fils, de leur père, de leur frère, de leur oncle, de leur grand-père. Des milliers de vies amputées, depuis six ans, de l'amour et de l'affection de leurs proches, ces fantômes qui viennent les hanter, jour après jour, nuit après nuit. » Ces mots du Président de la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, prononcés le 2 août 2001 lors de la condamnation pour génocide du général Krstic, tentent de dire l'indicible. Le jugement qui les accompagne est une première lueur d'espoir pour les survivants de Srebrenica, comme il rend hommage à ses morts. Tel est également l'objectif auquel tente de contribuer le présent rapport, qui porte sur le rôle - et les éventuelles responsabilités - de la France dans le drame de Srebrenica. A la suite de cette tragédie survenue en juillet 1995, des accusations, graves, ont en effet été lancées contre la France, mettant notamment en doute la volonté réelle de notre pays de protéger la zone de sécurité de la menace serbe. Il est du devoir de la représentation nationale d'en examiner le bien-fondé ou la fausseté, comme elle a, sans préjugé ni souci d'auto-justification, examiné il y a trois ans le rôle qu'avait effectivement joué la France dans les dramatiques événements du Rwanda en 1994. Les victimes le méritent, leurs familles l'attendent et aucun citoyen français ne peut vivre avec l'idée que la patrie des droits de l'Homme aurait commis des fautes ayant conduit au massacre de plus de 7 000 personnes. * Chacun comprendra qu'il y a, dans ces accusations, un paradoxe inconfortable, voire infamant, pour la France. Quel autre pays a, en effet, apporté une contribution humaine, politique et diplomatique à la solution au conflit yougoslave aussi importante que la France ? Comment accepter l'idée que 56 de nos soldats y ont laissé la vie, quand nous aurions, dans le même temps, laissé faire ou accepté le massacre d'au moins 7 000 personnes et la déportation de plusieurs milliers d'autres à Srebrenica en juillet 1995 ? C'est afin de lever ce paradoxe que l'Assemblée nationale a décidé, en décembre 2000, la création d'une Mission d'information chargée de faire la lumière sur le rôle de la France dans les événements de Srebrenica, poursuivant en cela sa réflexion de fond sur les opérations militaires extérieures de la France. La Mission d'information, représentant, bien entendu, tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, s'est assignée deux objectifs. En premier lieu, elle s'est efforcée de comprendre comment et pourquoi une zone de sécurité défendue par l'ONU a pu tomber, malgré la présence sur place de troupes de l'ONU, et surtout comment le plus grand massacre commis en Europe depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a pu se dérouler quand 35 000 soldats de la paix étaient présents en ex-Yougoslavie. En deuxième lieu, elle s'est attachée à étudier plus particulièrement le rôle de la France dans cette tragédie, que ce soit au titre de membre du Conseil de sécurité particulièrement impliqué dans ce dossier tout au long du conflit, de membre du Groupe de contact ou de premier contributeur de troupes. Comment oublier enfin que le chef de la force de paix des Nations unies est, à l'époque des événements, un général français ? * Les travaux de la Mission d'information s'inscrivent dans un processus de réflexion engagé de longue date au sein des différents Etats ou organisations particulièrement impliqués dans le drame de Srebrenica. Ainsi, les Pays-Bas mènent depuis plusieurs années un patient travail de recherche (peut-être un peu long), par l'intermédiaire d'un institut historique indépendant, avec lequel la Mission d'information a bien entendu établi de fructueux contacts. Les Nations unies ont pour leur part publié sous la plume de l'actuel Secrétaire général un très intéressant et très objectif rapport en novembre 1999. Au-delà de ces deux sources précieuses, la Mission d'information a également procédé à une importante série d'auditions de responsables, civils et militaires, français et étrangers. Elle aurait souhaité que l'ensemble des auditions qu'elle a menées soit public. Toutefois, dans un souci d'efficacité et dans un esprit de responsabilité, elle a accepté, à la demande du ministère de la Défense, que certains des militaires français ayant servi en ex-Yougoslavie soient entendus à huis clos. La Mission regrette que ces hommes, parfois violemment mis en cause, n'aient pu témoigner au grand jour, plus encore dans la mesure où leurs homologues étrangers ont pu s'exprimer en toute publicité. Elle doit également dire à nouveau son regret de n'avoir pu entendre certains témoins étrangers, dont les informations eussent été précieuses pour l'élaboration du rapport, qu'il s'agisse du général Rupert Smith, ancien responsable de la FORPRONU, ou de Madame Ogata, qui dirigeait alors le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. De même, le refus de certains responsables militaires bosniaques de rencontrer la Mission en Bosnie n'est pas de nature à dissiper certaines rumeurs. En outre, la Mission d'information a également travaillé à partir de documents déclassifiés fournis par les ministères de la Défense et des Affaires étrangères. Elle aurait, là encore, aimé s'appuyer sur une collaboration plus active, notamment de la part de l'organisation des Nations unies qui, en l'occurrence, n'a pas été la « maison de verre » que certains décrivent. Enfin, la Mission n'a pas manqué de se rendre en Bosnie pour rencontrer notamment les survivants, les témoins et les acteurs de cette époque et prendre, sur le terrain, la mesure du drame. * Au terme de cette enquête méthodique, la Mission d'information ne prétend nullement livrer la clé de toutes les interrogations que les événements de Srebrenica continuent de susciter, ni faire oeuvre d'exhaustivité sur un sujet aussi complexe. Les questions sont en effet nombreuses, plus de six ans après les faits : comment expliquer que la zone de sécurité de Srebrenica n'ait pas été défendue par la FORPRONU ? Faut-il chercher des responsabilités au sein des structures et des procédures ou se tourner vers les hommes, avec leurs faiblesses et leurs préjugés ? Existe-t-il des responsabilités actives en la matière ou « seulement » une responsabilité passive d'acteurs, étatiques ou non, qui n'ont pas su ou pas voulu s'opposer à la chute de Srebrenica ? Etait-il possible, d'ailleurs de prévoir les événements, et de les prévenir ? I. - SREBRENICA MARS 1993 - JUILLET 1995 : Personne ne peut mettre en doute l'objectif humanitaire et désintéressé qui a prévalu lors de la création des zones de sécurité en 1993. Personne non plus ne peut contester le caractère tragique de la fin des zones de sécurité durant l'été 1995. Comment donc une idée a priori généreuse et finalement consensuelle, même si de nombreuses réserves se sont exprimées à l'origine, comment donc une telle idée a-t-elle pu conduire à une issue aussi tragique ? Trois phases se sont succédé qui auraient pu alerter la communauté internationale, les autorités bosniaques, comme les populations concernées. On n'est pas en fait passé d'un seul coup d'une ville protégée à une ville abandonnée : une phase intermédiaire assez longue pendant laquelle Srebrenica a été coupée du monde, aurait peut-être permis d'éviter le pire, si la réaction avait été adéquate. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons en quelques pages rappeler comment se sont enchaînés les événements qui ont conduit à la tragédie de juillet 1995. Au départ, il y a l'intuition d'un général français, qui se fait le porte-parole de tous les hommes de bonne volonté qui refusent le renouvellement de Vukovar et qui va permettre à Srebrenica d'être protégée par les Nations unies. Ensuite, l'apparente réussite de cette opération va conduire à son extension au point qu'on peut se demander si les zones de sécurité ne constitueront pas alors l'expression même de la politique de la communauté internationale en Bosnie-Herzégovine... 1) Aux origines de la zone de sécurité Aux origines de la création des zones de sécurité, il y a d'abord un contexte : une guerre sanglante sévit en Bosnie-Herzégovine, à la suite du refus par les Serbes de l'indépendance proclamée de cette république. Il y a ensuite un phénomène propre à Srebrenica, sorte « d'épine » musulmane - mais le terme est trop faible - dans une région où les Serbes sont majoritaires et qu'ils entendent dominer, éventuellement en obligeant ces Musulmans à la quitter. Il y a enfin « l'intuition brillante » du général Morillon. a) Le contexte général dans l'ex-Yougoslavie à la fin de l'hiver 1992-1993 Pour comprendre la genèse et le développement du conflit ou des conflits en ex-Yougoslavie, il faut remonter à l'architecture retenue par Tito dans la constitution qu'il fit adopter en 1946. Celle-ci distingue des peuples et des minorités : l'ex-Yougoslavie est alors composée de six peuples et de douze minorités : à chacun des « peuples » correspond une république mais chaque république peut « englober » plusieurs peuples, d'où les problèmes de frontières et d'enclaves que contient en germes cette architecture ; les douze « minorités », quant à elles, ne sont pas constituées en structures territoriales autonomes, mais leurs membres disposent d'une certaine autonomie notamment culturelle. La mosaïque yougoslave comprend en outre trois religions (catholique, musulmane et orthodoxe). L'éclatement de la Fédération yougoslave résulte principalement de la conjonction de trois phénomènes simultanés : l'aspiration à l'indépendance de plusieurs groupes (les « peuples » croate et slovène et la « minorité » albanaise, notamment au Kosovo) ; la volonté hégémonique des Serbes et de la Serbie qui s'est incarnée dans la personne du Président Milosevic. Enfin, bien entendu la dissolution du parti unique communiste qui a suivi, comme dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, la chute du mur de Berlin. La disparition de la Ligue communiste yougoslave au début de 1990 enclenche le processus de dislocation de la Fédération yougoslave : la Slovénie et la Croatie entament leur marche vers l'indépendance. Mais la situation des deux républiques est très différente : autant la Slovénie est d'une composition ethnique très homogène, autant celle de la Croatie l'est peu, la présence de nombreux Serbes, notamment dans la Krajina, constituant un élément de difficulté important. Par ailleurs les contentieux hérités de l'histoire entre les peuples croates et serbes sont très lourds dans la Krajina comme ailleurs, notamment en Slavonie. Reste que même la proclamation de son indépendance par la Slovénie ne sera pas acceptée par les Serbes : mais la guerre de Slovénie ne durera que trois semaines environ et les accords de Brioni, conclus le 8 juillet 1991 à l'initiative de la Communauté européenne, y mettront fin. En Croatie, les choses se présentent très différemment. Les Accords de Brioni n'y seront pas appliqués. La minorité serbe proclamera son autonomie et s'armera très vite grâce à la complicité de l'armée yougoslave, armée au sein de laquelle la place des Serbes est très supérieure à leur poids dans la Fédération yougoslave. La guerre en Croatie commence sur des succès serbes rapides : l'armée serbe contrôle dès l'automne 1991 l'essentiel de la Krajina. La « purification ethnique » commence, l'objectif étant de chasser par tous les moyens les populations non serbes. C'est au cours de cette progression de l'armée serbe que Vukovar sera détruite : le siège de la ville qui comptait 45 000 habitants avant la guerre commence en août 1991 ; il durera 84 jours et se terminera le 18 novembre. La ville, lorsque les Serbes y entreront, sera en cendres après des bombardements massifs de plusieurs semaines. Les populations non serbes seront déportées. Au mépris des règles les plus élémentaires du droit humanitaire, des centaines de personnes seront exécutées, en particulier les blessés et les malades de l'hôpital. Tous seront ensevelis dans des fosses communes après avoir été abattus. Certains ont pu dire que Vukovar était la première ville rasée en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Quelques semaines plus tôt, le 25 septembre 1991, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 713, qui généralisait l'embargo sur les armes à destination des protagonistes du conflit, embargo déjà décidé par les Douze de la Communauté européenne le 5 juillet 1991. Le 27 novembre 1991, le Conseil de sécurité adopte la résolution 721 qui prend acte de l'accord des Croates et des Serbes pour une opération dite de maintien de la paix mais qui se limite à une action humanitaire, les Nations unies inaugurant ainsi une politique de petits pas, qui sera le plus souvent en retard par rapport à la situation sur le terrain. La résolution 743 du 21 février 1992 crée la Force de protection des Nations unies (FORPRONU) qui est donc positionnée en Croatie dans un contexte de « maintien de la paix » c'est-à-dire après que les armes s'y sont tues. A ce moment commence le conflit en Bosnie-Herzégovine : la Commission Badinter avait recommandé un réferendum sur l'autodétermination, lequel est organisé les 29 février et 1er mars 1992. L'indépendance suit début avril et la guerre est immédiate. On sait qu'au sein de l'ancienne Fédération yougoslave, cette république était celle où la répartition entre les « peuples » était la plus délicate dans la mesure où aucun de ceux-ci ne représentait la moitié de la population. Les chiffres varient selon les sources, mais on peut dire que les Musulmans représentaient un peu plus de 40 % de la population, les Serbes, un tiers environ et les Croates à peine 20 %. Dès l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, les peuples serbe et croate s'y proclament chacun de leur côté autonomes. Des opérations militaires ont lieu autour des villes où se concentrent des populations appartenant à plusieurs peuples, en particulier dans celles qui deviendront les enclaves de l'Est et à Bihac à l'Ouest. Sur le plan militaire, l'embargo décidé par la Communauté européenne puis l'ONU se révèle très inégalitaire dans la mesure où les entités croate et serbe de Bosnie qui ont proclamé leur autonomie sont soutenues par les Etats croate et serbe , tandis que la Bosnie-Herzégovine, elle, est dans une situation plus délicate, même si l'approvisionnement en armes, du moins en armes légères n'a jamais été un réel problème dans l'ex-Yougoslavie. L'objectif des Serbes est immédiatement celui qui demeurera le leur jusqu'à la fin du conflit, c'est-à-dire réaliser la grande Serbie en assurant la continuité territoriale entre les différentes régions où sont installés des Serbes. Au milieu de l'année 1992, les Croates s'allient aux Bosniaques pour faire front contre les Serbes. Malgré tout, la progression serbe est rapide. Le siège de Sarajevo commence. C'est un accord sur la réouverture de l'aéroport de Sarajevo en juin 1992 qui donne l'occasion d'élargir le mandat de la FORPRONU à sa sécurisation : les Nations unies arrivent en Bosnie-Herzégovine ; elles y resteront plus de trois ans. Au même moment, on découvre les premiers camps de détention de prisonniers avec leur cortège d'horreurs qui évoquent (même si elles ne les atteignent pas) les plus mauvais souvenirs de la seconde guerre mondiale. On reviendra plus loin sur la réaction de la France (et de ses partenaires) : disons tout de suite que d'une manière générale, à ce moment là comme du reste plus tard, l'action ne fut pas à la hauteur de l'indignation. Le Conseil de sécurité décide que la FORPRONU devra assurer l'acheminement de l'aide humanitaire (Résolution 770 du 13 août 1992). On organise la situation où les soldats de la FORPRONU laisseront se réaliser les horreurs et essaieront ensuite de soigner ceux qui auront eu la chance de survivre, la Force n'ayant évidemment pas à rétablir la paix, ni même à la « maintenir ». Quelle est alors la situation générale sur le plan militaire ? Le front, si l'on peut dire, est stabilisé en Croatie. En Bosnie-Herzégovine, la progression serbe a été très importante : les Serbes ont réussi à sécuriser le corridor au Nord de la Bosnie-Herzégovine, leur assurant par Brsko une continuité territoriale entre la région de Pale à l'Est et celle de Banja Luka à l'Ouest. Ils contrôlent près des deux tiers du territoire et assiègent Sarajevo qu'ils espèrent bien voir tomber un jour. Si l'on nous permet cette formule, on peut dire que la « purification ethnique » bat son plein dans les zones qu'ils ont conquises. S'agissant de la FORPRONU, après un premier déploiement autour de Sarajevo, elle voit son mandat s'élargir à toute la Bosnie-Herzégovine sans que les effectifs suivent pour autant. Parallèlement, le général Morillon y devient commandant de la Force. Restent quatre enclaves à l'Est dont trois autour des villes de Srebrenica, Zepa et Gorazde. b) La situation dramatique de Srebrenica Comme on vient de le dire, l'offensive serbe avait eu comme première priorité la création d'une continuité territoriale au Nord et l'accroissement de la pression sur Sarajevo. On peut penser que, si la priorité n'avait pas porté sur les enclaves de l'Est, ce n'est pas parce qu'on n'y attachait pas la même importance, mais plutôt parce qu'on pensait qu'elles tomberaient ultérieurement comme un « fruit mûr », si l'on peut dire, tant il semblait évident qu'elles ne pourraient survivre dans le contexte euphorique qui avait suivi les succès militaires serbes. Au début du conflit, les Musulmans avaient conquis la ville, qui était devenue un bastion militaire avec à la tête des forces militaires bosniaques le colonel Naser Oric, dont on dit qu'il a été le garde du corps personnel du Président Slobodan Milosevic. Les accrochages s'étaient multipliés entre les forces serbes et bosniaques. En outre la « purification ethnique » et la « contre-purification ethnique », si l'on ose ce terme, étaient très systématisées. Le général Wahlgren, qui commande la FORPRONU, indique alors à une mission du Conseil de sécurité que « si toutes les parties commettent des atrocités à tous les niveaux... seuls les Serbes s'emparent de territoires ». Srebrenica compte alors de 20 000 à 28 000 habitants, contre 8 000 à 10 000 avant la guerre ; l'ensemble de l'enclave atteint 70 000 habitants : les nouveaux « habitants » sont en fait des réfugiés des villages voisins chassés par la « purification ethnique » qui ensanglante la Bosnie-Herzégovine. Après la jonction qui a été opérée avec Zepa et Cerska, l'enclave atteint 900 km², mais la jonction ne sera jamais faite avec la Bosnie centrale. On peut se référer à cet égard au film Warriors réalisé par Leigh Jackson : il se passe à Vitez, c'est-à-dire dans une zone où s'opposent Bosniaques et Croates, un contingent britannique de la FORPRONU tentant d'assurer au mieux sa mission ; mais les faits rapportés auraient pu se passer aussi bien dans l'Est de la Bosnie-Herzégovine, dans une région où c'est aux Serbes que s'opposaient les Bosniaques. Le 7 janvier 1993, jour du Noël orthodoxe, des Bosniaques partis de Srebrenica ont dévasté des fermes dans des villages de la région. Les Serbes feront état de plusieurs dizaines de morts. Dans les semaines qui suivent, la pression de l'armée serbe autour de la ville s'accentue. Comme le raconte le général Morillon, les rumeurs les plus alarmantes parviennent à la FORPRONU par les radioamateurs, seul moyen de communication entre la région et Sarajevo. Les Serbes ont miné toutes les routes et détruit les ponts empêchant les convois du HCR et des organisations non gouvernementales d'accéder à Srebrenica. Cerska est tombée, et les Serbes bombardent Koljevic Polje sous les yeux des Casques bleus présents. Il apparaît clairement que les Serbes conduisent une offensive d'envergure qui vise à réduire les poches de l'Est de la Bosnie et en premier lieu Srebrenica. La situation dans la ville est épouvantable : des dizaines de milliers de réfugiés, parmi lesquels des femmes et des enfants, s'y pressent, ainsi que dans les environs. Ils vivent dans la rue, sans abri et sont pris dans une nasse dont ils ne peuvent s'échapper. Une mission du Conseil de sécurité résumera ainsi la situation : « Les conditions actuelles, caractérisées par une population en surnombre, par la coupure de l'approvisionnement en eau potable [les Serbes avaient coupé l'alimentation en eau] et de l'électricité, par l'insalubrité publique et par l'absence de services médicaux essentiels, constituent pour les habitants de Srebrenica, dont beaucoup dorment dans les rues, une épreuve particulièrement cruelle et tragique. Les gens font leurs besoins sur la voie publique. La destruction totale ou partielle de 50 % des habitations et des infrastructures pose aussi des problèmes majeurs de santé et crée des conditions sanitaires dangereuses qui risquent de causer des épidémies ». Un nouveau Vukovar se prépare, dira alors le général Morillon, si les Serbes attaquent et prennent la ville. c) Le coup de force du général Morillon Le général Morillon, doit-on le rappeler, commande depuis quelques mois la FORPRONU en Bosnie après avoir commandé en second la Force déployée alors en Croatie. Confronté à une situation qu'il juge catastrophique, il a alors une intuition - aller lui-même à Srebrenica -, qui sera fortement médiatisée, et qui se révélera ensuite une erreur politique, dans la mesure où le général se trouvera contraint de prendre, au nom de la communauté internationale, un engagement que celle-ci ne pourra pas tenir, trompant ainsi les populations civiles et conduisant peut-être à amplifier la catastrophe de 1995. L'idée est intéressante : les Serbes n'oseront pas empêcher la venue personnelle du commandant de la FORPRONU, pense celui-ci. Il est vrai qu'il en sera ainsi. Apprenant l'objectif du général, ils rendront inutilisable la route directe menant à Srebrenica, notamment en faisant sauter un pont ; mais ils n'empêcheront pas le passage par une piste de montagne enneigée de l'engin blindé avec à son bord le général. Les Serbes croyaient que la colonne, composée d'un blindé, d'une jeep et d'un camion transportant dix tonnes de ravitaillement et réunissant cinq Canadiens et deux Américains chargés de l'engin blindé et des parachutages, une équipe de deux hommes et d'une femme de MSF, du représentant du HCR et de quatre observateurs des Nations unies, n'arriverait jamais à Srebrenica. Cependant, après avoir prévenu son supérieur hiérarchique, le général Wahlgren, le général Morillon mène l'entreprise à bien. Ce groupe va réussir à passer là où les Serbes ne pensaient pas qu'il pourrait passer et va arriver à Srebrenica : il y retrouve deux journalistes qui confirment que Srebrenica est un enfer. L'objectif est double : obtenir de Naser Oric et des Bosniaques qu'ils arrêtent leurs provocations contre les Serbes et laisser à Srebrenica des observateurs canadiens. Au moment de repartir, les femmes et les enfants empêchent le véhicule du général de quitter la ville, tant ils ont peur des Serbes ; en fait c'est volontairement que le général restera, comme il l'a écrit lui-même. Avant de repartir, il fera une déclaration qui sera reprise par tous les médias et assurera sa réputation : « Vous êtes maintenant sous la protection de l'ONU... Je ne vous abandonnerai jamais ». Au-delà du caractère un peu médiatique et mégalomane de la formule, le « je » limite la portée de l'engagement pris ; il traduit sans doute la conviction (erronée) que le siège de Srebrenica ne durera pas. Le problème est que les populations civiles de Srebrenica ont pu, à juste titre, ne pas prendre la mesure exacte des limites de l'engagement pris. David Owen dans son livre Balkan Odyssey, est sensible à la « démarche » du général Morillon et lui reconnaît du « panache ». Mais reprenant (en français) le mot du Maréchal Pierre Bosquet sur la charge de la Brigade légère à Balaklava, conduite par Lord Cardigan le 25 octobre 1854 pendant la Guerre de Crimée, il a cette phrase assez dure : « C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre ». Quoi qu'il en soit, cette « intuition brillante » va se révéler une erreur politique : elle va en effet constituer le socle de la politique suivie concernant les zones de sécurité. Fait plus grave encore, elle sera à elle seule presque toute la politique des zones de sécurité, ne se contentant pas de n'être que le socle sur lequel on construit quelque chose de cohérent. Faute de construction d'un ensemble cohérent, on va se trouver dans la situation où certains se sentent protégés alors que leurs « protecteurs » ne se donneront jamais les moyens militaires d'assurer cette protection ; pire ils ne s'en donneront même jamais les instruments juridiques. Car, tout autant que les moyens, c'est la volonté politique qui va faire défaut. Aller au-delà de son mandat était sans aucun doute nécessaire, ne pas avoir dit ultérieurement que les promesses faites ne pouvaient être tenues a constitué une faute aux conséquences catastrophiques. Dans l'immédiat ce fut un succès : une négociation s'engagea avec Milosevic et celui-ci fit pression sur les Bosno-Serbes - Karadzic et Mladic - afin qu'ils renoncent à prendre la ville et mieux, qu'ils autorisent l'accès de celle-ci aux convois humanitaires. En contrepartie, les forces bosniaques devaient être désarmées dans l'enclave. L'accord est signé le 17 avril 1993 entre les généraux Mladic et Halilovic, en présence du général Wahlgren qui représente la FORPRONU et fait office de médiateur. Il est nécessaire d'en rappeler les termes exacts car sa non-application sera à l'origine des difficultés à venir. Il fut en effet difficile à accepter pour les Bosniaques. Les bombardements de la ville amenèrent en apparence les Bosniaques à l'accepter : mais, tout autant que les bombardements, c'est la pression du commandant de la FORPRONU sur les autorités bosniaques, pression qui avait été très forte, celui-ci indiquant que faute d'une signature, on risquait 25 000 morts, qui conduisit les Bosniaques à signer. L'accord prévoit d'abord un cessez-le-feu total dans la zone de Srebrenica et le déploiement de la FORPRONU dans l'enclave. Il prévoit aussi l'évacuation aérienne pendant deux jours des blessés graves et des grands malades, qui seraient au nombre de 500, et ceci après identification et vérification de leur état de santé par les deux parties. Il prévoit surtout la démilitarisation de Srebrenica dans un délai de 72 heures, précisant que « toutes les armes, munitions, mines, explosifs et fournitures de combat (à l'exception des médicaments) se trouvant à Srebrenica seront présentés/remis à la FORPRONU sous la supervision de trois officiers de chacune des parties, le contrôle étant effectué par la FORPRONU. Aucune personne ni unité armée, à l'exception des éléments de la FORPRONU, ne restera dans la ville une fois le processus de démilitarisation achevé. La responsabilité du processus de démilitarisation incombe à la FORPRONU ». L'accord prévoit encore le déminage par chaque partie des zones qu'elle a minées et surtout le libre accès de l'aide humanitaire à l'enclave. La mission du Conseil de sécurité qui se rend dans la région du 22 au 27 avril rend compte de l'accord dans des termes qui laissent un peu perplexe l'observateur : elle souligne d'une part que « la population a été sauvée manifestement sous l'imposition de conditions extrêmes qui sont décrites plus haut et qu'il importera de changer », mais que l'arrangement trouvé « devrait cependant dicter au Conseil de sécurité la ligne à suivre pour empêcher la chute d'autres enclaves et territoires comme Gorazde, Zepa et Tuzla... ». On a un peu de mal à comprendre que les conditions imposées par l'accord doivent être « changées » à Srebrenica, mais cependant servir de modèle dans les autres enclaves... 2) L'extension des zones de sécurité De manière curieuse, et somme toute inquiétante pour le fonctionnement de la communauté internationale, voici comment une « intuition brillante » mais à l'objectif limité va être systématisée et devenir l'expression même d'une politique. a) La naissance des zones de sécurité : concept juridique ou situation de fait politique ? La promesse du général Morillon et la négociation qui suivit avec Milosevic conduisirent le Conseil de sécurité à créer une zone de sécurité à Srebrenica. L'idée était ancienne : le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait, en août 1992, demandé qu'un « refuge » soit institué pour toutes les personnes déplacées en ex-Yougoslavie. Le CICR avait réitéré sa demande en octobre 1992 en soulignant que « la situation actuelle exige la création de zones qui ont besoin de la protection internationale ». Comme l'observe le Secrétaire général des Nations unies dans son rapport sur la chute de Srebrenica, si « certains représentants de l'ONU étaient au début favorables à cette solution... dans l'ensemble, les membres permanents du Conseil de sécurité n'étaient pas favorables à cette idée ». Reste que malgré tout, le Conseil de sécurité confie le 16 novembre 1992 au Secrétaire général le soin « d'étudier, en consultation avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autres organismes internationaux à vocation humanitaire concernés, les possibilités et les besoins touchant la création de zones de sécurité à des fins humanitaires ». Outre les obstacles évidents pour tous (accord des parties, démilitarisation et moyens militaires nécessaires pour en assurer la protection), plusieurs responsables, en particulier les co-Présidents de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, Cyrus Vance et David Owen, ainsi que Mme Sadako Ogata, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, ont exprimé des réserves assez fortes sur l'idée de zones protégées internationalement. Dans l'ensemble, il leur semblait, à juste titre du reste, que la création de telles zones accélérerait le processus de la « purification ethnique » ; il semblait en outre à Mme Ogata que de telles zones constitueraient en fait des camps de réfugiés dès lors que la paix n'était pas instituée. Mme Ogata a cependant changé d'avis au vu de l'évolution de la situation, dans une lettre qui date du 2 avril 1993, c'est-à-dire entre le déplacement du général Morillon à Srebrenica qui a eu lieu deux semaines plus tôt et l'accord entre les généraux Mladic et Halilovic du 18 avril : elle indique que la situation à Srebrenica est telle qu'elle impose une évacuation des populations bosniaques de la ville et que celles-ci la souhaitent, mais que le Président Izetbegovic s'y oppose car le départ des femmes et des enfants faciliterait une attaque massive contre l'enclave. Dès lors, il semble à Mme Ogata que « deux options s'offrent à nous si nous voulons sauver la vie des personnes bloquées dans Srebrenica... La première consisterait à renforcer immédiatement la présence internationale, y compris celle de la FORPRONU, afin de transformer l'enclave en une zone protégée par les Nations unies, à laquelle serait apportée une assistance à la survie à une échelle bien supérieure à celle qui est actuellement permise...A défaut, la seule option serait d'organiser une évacuation massive de la population menacée de Srebrenica ». La situation militaire s'est dégradée gravement dans les jours suivants : les Serbes ont adressé un véritable ultimatum aux forces bosniaques le 13 avril : l'assaut allait commencer, si la ville ne se rendait pas et si la population musulmane n'était pas évacuée. Finalement le Conseil de sécurité, en faisant référence au chapitre VII de la Charte, adoptait le 16 avril la résolution 819, proposée par les non-alignés, en particulier le Venezuela et le Pakistan : cette résolution exigeait « la cessation immédiate des attaques armées contre Srebrenica par les unités paramilitaires serbes » et demandait que « toutes les parties et autres intéressés traitent Srebrenica comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée et de tout autre acte d'hostilité ». Parallèlement les négociations se poursuivaient : le général Morillon rencontrait longuement Milosevic et lui indiquait que la chute de Srebrenica entraînerait des massacres épouvantables, compte tenu des lourds contentieux entre les deux communautés dans la région. Milosevic semblait le savoir puisque David Owen raconte que celui-ci lui a dit au cours d'une conversation téléphonique tenue le 16 avril 1993 qu'il ne fallait pas que Srebrenica tombe car les massacres y seraient épouvantables, ceci soulignant le caractère spécifique de la situation dans cette région. Finalement l'accord est signé le 17 avril entre les généraux Mladic et Halilovic, le cessez-le-feu entrant en vigueur le 18 avril. Désormais Srebrenica sera une zone de sécurité. b) Les autres zones de sécurité Comme on l'a dit, la mission du Conseil de sécurité soulignait l'inadéquation de la solution retenue à Srebrenica. Elle « ne peut pas servir de modèle ; (elle) devrait cependant dicter (sic) au Conseil de sécurité la ligne à suivre pour empêcher la chute d'autres enclaves et territoires comme Gorazde, Zepa et Tuzla ». Le même rapport souligne le caractère vulnérable de Gorazde et Zepa, observant que « l'issue en ce qui les concerne pourrait être analogue à Srebrenica si l'on ne prend pas immédiatement des mesures énergiques ». S'il n'y avait pas le caractère tragique de la situation, on pourrait sourire au terme « énergique » retenu par la mission (au sein de laquelle M. Hervé Ladsous représentait la France), terme si éloigné de la pratique des membres du Conseil de sécurité dans cette affaire. La solution « énergique » proposée était de « déclarer » ces deux villes zones de sécurité. La mission du Conseil de sécurité proposait la même solution pour Tuzla, dont la situation était cependant différente en raison des 200 000 personnes déplacées qui s'y trouvaient et qui « diminuent sa capacité de résistance », précise curieusement la mission dans son rapport. Cette mission, qui semble un peu relever de la gesticulation, se situait alors que le Plan Vance-Owen était soumis aux parties intéressées. L'espoir était réel d'un retour à la paix. Mais le 6 mai 1993, à la surprise générale, l'assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine réunie à Pale rejetait le Plan Vance-Owen, repoussant à plus loin les perspectives de paix. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 824, fit alors preuve « d'énergie » en faisant de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde et Bihac des zones de sécurité. Dans celles-ci devait être respecté un cessez-le-feu et l'aide humanitaire devait y parvenir librement. Dans les faits, le Conseil de sécurité avait agi a minima, rejetant toutes les suggestions présentées qui auraient permis de prendre des mesures de nature à rendre effective la mise en oeuvre de la résolution. Une partie importante des protagonistes de la tragédie a tendance à nier le caractère singulier de Srebrenica : il s'agit à l'évidence d'une réaction destinée à justifier leur inaction par le caractère dès lors imprévisible de la tragédie qui s'y est déroulée, et dont le caractère spécifique lui n'est pas contestable. Vos Rapporteurs ne sont pas totalement convaincus, car le caractère singulier de Srebrenica était évident pour tous. a) Srebrenica, un enjeu stratégique pour les Serbes Srebrenica revêtait à un double titre un caractère stratégique, elle était au centre d'une région stratégique et elle-même une ville stratégique. Srebrenica est au centre de la Podrinje centrale : cette région mitoyenne de la Serbie revêtait selon le général Radovan Radinovic, un expert militaire auprès du Tribunal pénal international, un caractère stratégique certain : en réalité les Serbes, qu'ils résident en Serbie ou en Bosnie-Herzégovine, entendaient vivre dans le même Etat. Dès lors le contrôle de la Podrinje centrale avait comme l'a dit le général Radinovic durant le procès du général Krstic « une importance stratégique énorme » pour eux. Sans la Podrinje centrale, il n'y aurait pas eu de Republika Srpska ; il n'y aurait pas eu d'intégrité territoriale des territoires ethniquement serbes. Celle-ci aurait été coupée en deux et des territoires peuplés à 100 % de Serbes auraient été séparés. Le général Halilovic, qui a commandé l'état-major général des forces bosniaques de juin à novembre 1993, a confirmé ce point de vue en soulignant que l'objectif des Serbes était de supprimer la Drina, comme frontière entre les Etats serbes. Il suffit de regarder la carte pour reconnaître que Srebrenica revêtait aussi un caractère stratégique pour les Bosniaques à l'instar, du reste, des autres enclaves de l'Est. En effet, celles-ci constituaient des bastions militaires essentiels à l'armée bosniaque, laquelle pouvait exercer en permanence une pression sur les arrières de l'armée serbe et de ce fait atténuer la pression serbe sur Sarajevo, objectif qui restera prioritaire durant tout le conflit, tant la différence était importante entre cette ville et les autres villes de Bosnie-Herzégovine, en particulier de l'Est de la République. C'est la raison pour laquelle le Président Izetbegovic conduisit une politique qui, tout en faisant prendre des risques importants à la population bosniaque de l'enclave, peut se comprendre : militairement, le fait de tenir Srebrenica constituait un avantage certain par l'épine que cela représentait au sein du dispositif serbe. Ce n'est que lorsque la prise de la ville sera de nature à entraîner une réaction de la communauté internationale et dès lors à changer l'équilibre des forces en présence que l'intérêt stratégique de Srebrenica baissera aux yeux des Bosniaques. Reste que très tardivement autant les Serbes auront intérêt à la réduction de la taille de l'enclave de telle sorte qu'elle perde toute autonomie économique et ne survive que grâce à l'aide internationale, autant ils n'auront pas intérêt à sa prise totale. En effet, comme on le constatera bien en 1995, les Casques bleus se trouvant dans les enclaves constitueront aux yeux des Serbes autant d'otages ouvrant la perspective de négociations « juteuses » pour les troupes serbes. C'est ainsi que l'aide internationale comme le ravitaillement des Casques bleus seront soumis à une « dîme » (souvent supérieure à 10%) sur les convois devant se rendre dans les enclaves en traversant les Check Points serbes. C'est une des raisons pour lesquelles, malgré des informations alarmistes, jusque tard en juillet 1995, les généraux de la FORPRONU estimeront (ou disent avoir estimé) que l'objectif de Mladic sera de resserrer la taille de l'enclave pour la rendre encore plus invivable et inciter les civils à la quitter, mais non de la prendre. b) Le lourd passif entre Serbes et Musulmans à Srebrenica On a déjà évoqué le lourd passif entre les forces serbes et bosniaques à Srebrenica. On doit cependant y revenir, dans la mesure où cela peut expliquer certains comportements, même si cela ne les justifie évidemment pas et même du reste si cela n'atténue en rien la responsabilité de ceux qui ont eu ces comportements. En fait, dès le début du conflit en Bosnie-Herzégovine, Srebrenica a été l'objet de combats acharnés. A la suite de la proclamation par le Président Izetbegovic de l'indépendance bosniaque le 6 mars 1992, la campagne serbe commence le 27 mars. Comme on l'a dit, la priorité durant les premières semaines a été de créer un corridor entre la région de Banja Luka et l'Est de la Bosnie-Herzégovine, par le Nord. Dans le même temps, les milices serbes dévastaient Bratunac et les Serbes lançaient un ultimatum aux habitants de Srebrenica, exigeant d'eux qu'ils rendent leurs armes avant le 18 avril à 10 heures ; la ville serait sinon attaquée. Sachant ce qui s'était passé à Bratunac et Zvornik, les hommes avaient quitté la ville et s'étaient réfugiés dans les montagnes avoisinantes d'autant plus facilement que celles-ci sont très boisées. Des milices serbes - la présence d'Arkan a été évoquée - occupèrent la ville à l'issue de l'ultimatum et commencèrent à maltraiter et à tuer les hommes valides qui étaient demeurés dans la ville. Des montagnes environnantes, plusieurs groupes de Musulmans armés préparaient une contre-attaque, l'un de ces groupes étant dirigé par Naser Oric qui avait alors 25 ans. Né en 1967 à Potocari (c'est le lieu où sera implanté le quartier général de la FORPRONU à Srebrenica), il a rejoint les forces spéciales à Belgrade, mais est revenu en Bosnie au moment de l'indépendance. Le 20 avril, soit deux jours après l'entrée des Serbes dans Srebrenica, la contre-attaque eut lieu ; la ville fut reprise. Plusieurs miliciens serbes furent tués et Naser Oric devint commandant de la défense locale. Début mai, des milices serbes attaquèrent de nouveau la ville, mais leur chef Goran Zekic fut tué le 8 mai. On assista alors à un départ en masse des Serbes de Srebrenica vers Bratunac : Srebrenica était désormais aux mains des Bosniaques. Mais le ressentiment des Serbes s'en trouvait accru par les deux défaites militaires qu'ils avaient subies et dont ils aspiraient à se venger. Srebrenica devint alors le bastion militaire le plus efficace des forces bosniaques et les attaques se multiplièrent contre les villages serbes, en particulier vers le Sud afin de ramener des armes et du ravitaillement. Ces attaques furent au total meurtrières puisqu'on a pu évoquer le chiffre de 1 300 morts au cours des huit derniers mois de 1992. Les villages de Brezani, Zalazje, Rakovici, Fakovici et Glogova furent l'objet d'attaques dévastatrices. Cette opération de « nettoyage ethnique » ne suffisait pas à Naser Oric, car celui-ci était convaincu que Srebrenica ne pourrait tenir si elle demeurait enclavée : son objectif était donc de réussir à relier l'enclave à la Bosnie centrale. Il faut souligner à cet égard le fait que les conflits en ex-Yougolavie conjuguent souvent un objectif stratégique territorial avec une pratique tendant à obtenir le déplacement des populations une fois les territoires conquis. Comme on l'a dit, le 7 janvier 1993, jour du Noël orthodoxe, les troupes bosniaques attaquèrent en conséquence des villages et des fermes serbes. Il s'agissait d'opérations militaires destinées à assurer la liaison entre Srebrenica, Cerska et Konjevic Polje. L'objectif était clairement de relier l'enclave de Srebrenica à la Bosnie centrale contrôlée par le Gouvernement bosniaque. Difficile de dire exactement ce qui s'est passé ce jour de Noël orthodoxe. Les Serbes indiquèrent dans les jours qui suivirent que 70 civils serbes avaient été tués et les villages brûlés. Sans doute ce bilan est-il exagéré. Ce qui est cependant certain, c'est que des exactions avaient été commises, et qu'elles étaient directement imputées aux hommes de Srebrenica. Il n'est pas douteux qu'elles alourdissaient chaque fois le ressentiment serbe à l'endroit des Bosniaques de Srebrenica, même si dans l'ensemble les opérations avaient des objectifs militaires. C'est du reste cet impératif militaire qui rendit l'accord des autorités bosniaques pour une démilitarisation de l'enclave si difficile à obtenir en avril 1993 lorsque celle-ci fut exigée par les Serbes. C'est la raison aussi pour laquelle David Owen estime qu'en fait Naser Oric n'appliqua jamais ce volet de l'accord. B - SREBRENICA COUPÉE DU MONDE Le site de l'enclave de Srebrenica se prête parfaitement à l'isolement ; entourée de montagnes, la ville, toute en longueur, s'étend le long d'une route d'accès étroite. Déjà durement éprouvée par l'afflux de réfugiés, l'enclave, qui comptait entre 20 000 et 30 000 habitants, verra sa population atteindre 70 000 personnes. « Srebrenica est comparable aujourd'hui à une prison ouverte dont la population peut aller ici et là mais étant contrôlée et terrorisée par la présence croissante, tout autour d'elle, des forces serbes possédant des chars et des armes lourdes. » Si bien que la ville, selon les termes du représentant du HCR, ressemble « à un mauvais camp de réfugiés ».1 De mauvais camp de réfugiés, Srebrenica deviendra progressivement un ghetto, selon les termes employés par M. Pierre Salignon, Directeur des opérations de Médecins sans frontières lors de son audition. « Des gens se sont retrouvés otages, dans un ghetto. Je n'ai pas connu la deuxième guerre mondiale mais, quand je suis rentré à Srebrenica la première fois, j'ai revu les images du ghetto de Varsovie (...) J'ai vu une situation où les gens étaient parqués et où j'avais l'impression qu'à l'extérieur, il y avait, d'une part, des miliciens serbes, avec une bonhomie et une joie de vivre, qui étaient là avec un camp retranché, et d'autre part, des gardiens de la population bosniaque qui étaient les Casques bleus ». L'histoire de l'ONU à Srebrenica est une suite d'échecs due à des demi-mesures que le rapport sur la chute de Srebrenica, présenté par le Secrétaire général des Nations unies en novembre 1999, décrit abondamment. Srebrenica a été la première zone de sécurité déclarée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 819 du 16 avril 1993. Cette résolution fut de peu d'effet sur le terrain, car les forces serbes continuaient de harceler la ville malgré la signature d'un premier accord de démilitarisation, le 18 avril 1993. Le rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 819, le 30 avril 1993, constate que la ville est pratiquement en état de siège et que les forces serbes en contrôlent l'accès. « A court terme, les perspectives concernant la ville sont les suivantes : « - des conditions inhumaines règnent dans la ville et risquent d'avoir des conséquences catastrophiques ; « - les forces paramilitaires serbes ne semblent pas prêtes à se retirer. Au contraire, elles sont aujourd'hui plus nombreuses qu'elles ne l'étaient lorsque la résolution a été adoptée. » Un nouvel accord de démilitarisation est alors signé le 8 mai 1993 entre le général Sefer Halilovic et le général Ratko Mladic, qui prévoit, lui aussi, que les forces de l'armée bosniaque remettent leurs armes, munitions et mines à la FORPRONU, à la suite de quoi les armes lourdes et les unités serbes constituant une menace pour les zones démilitarisées seraient retirées. Cet accord confère à Srebrenica le statut de zone démilitarisée au sens de l'article 60 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève. Il ne sera appliqué que partiellement par la seule armée bosniaque qui remettra quelques armes. Les Bosno-Serbes continueront à encercler la ville, qui subira comme les autres enclaves les conséquences d'un blocus inhumain, que décrivent Eric Stover et Gilles Peress : « Après la résolution 819 de l'ONU, des troupes canadiennes puis hollandaises furent déployées à Srebrenica. Les soldats de maintien de la paix - au nombre de 750 le 1er mai 1994 - furent chargés d'une grande mission, bien que peu réaliste, qui consistait à désarmer les résistants musulmans et à empêcher les attaques bosno-serbes sur la ville. Les forces de Naser Oric, pour le geste plus que pour toute autre raison, rendirent deux tanks, plusieurs pièces d'artillerie et quelque 260 armes de petit calibre aux soldats de la paix. Mais il se gardèrent de donner leurs meilleures armes. « Pendant ce temps, sur les collines entourant l'enclave, les chefs serbes attendaient patiemment le bon moment pour attaquer (...) Attendre n'était de toutes façons pas un problème : ils contrôlaient déjà presque tous les accès de la ville et pouvaient bloquer l'entrée des convois d'aide et même les mouvements des troupes hollandaises si le c_ur leur en disait. Srebrenica leur appartiendrait un jour ou l'autre, de cela ils étaient certains. Il ne s'agissait plus que d'une question de temps ».2 Après le rejet du plan de paix Vance-Owen par les Serbes de Bosnie, le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 824 visant à renforcer la FORPRONU par des observateurs militaires non armés des Nations unies, qui se révélera tout aussi inopérante, ce qui a amené le Conseil à adopter, en vertu du chapitre VII, la résolution 836 du 4 juin 1993, dont l'ambiguïté a suscité les divergences d'interprétations exposées ci-après et a contribué à la paralysie de la FORPRONU sur le terrain, ce qui s'est traduit à Srebrenica par un sous-effectif constant de la force, des moyens matériels dérisoires, paralysant l'action du HCR. Les auditions, comme les différents rapports présentés au Conseil de sécurité font état de sous-effectifs constants de la FORPRONU à Srebrenica. Le dernier rapport présenté par le Secrétaire général avant la chute de l'enclave, le 30 mai 1995, en témoigne dans son paragraphe 33 : « Dans mon rapport du 14 juin 1993, j'ai informé le Conseil qu'environ 14 000 hommes supplémentaires seraient nécessaires pour pouvoir assurer la dissuasion par la force, tout en déclarant qu'il serait possible de commencer à appliquer la résolution 836 (1993) au moyen d'une "option légère" faisant appel à environ 7 600 hommes, en tant qu'approche initiale dont les objectifs étaient limités et qui supposait l'assentiment et la coopération des parties. Dans sa résolution 844 (1993), le Conseil a retenu l'option légère. » Mais, en réalité, même cette option légère n'est pas réellement appliquée. Dès son installation dans l'enclave, la FORPRONU connaît des déboires liés à l'insuffisance de ses effectifs. Voici comment le général Jean Cot décrit la FORPRONU à Srebrenica à l'automne 1993. « Je découvre dans cette première visite une présence de l'ONU symbolique puisqu'il s'agissait d'une compagnie canadienne de 200 hommes, complètement sur les genoux.(...) Cela veut dire qu'ils disposaient en moyenne d'un poste d'observation à peu près tous les dix kilomètres, ce qui n'avait évidemment strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ce qu'on peut appeler la défense d'une enclave. » Bien pis, la relève de ce maigre effectif est, dès 1993, problématique. Aucun contingent ne souhaite relever rapidement les Casques bleus canadiens de Srebrenica. Le général Cot évoque un épisode révélateur de l'état d'esprit qui règne au sein de la FORPRONU s'agissant de Srebrenica : « (...) je me suis efforcé de trouver une solution avec le général Briquemont qui commandait en Bosnie-Herzégovine. Pour assurer le plus vite possible la relève de cette compagnie canadienne (...) nous avions imaginé, la nécessité faisant loi, de demander au gros bataillon nordique, qui était installé à Tuzla depuis quelques mois, de fournir au minimum une grosse compagnie pour cette enclave. Là s'est enclenché une véritable saga puisque le général Briquemont a donné l'ordre au chef du bataillon nordique de Tuzla d'envoyer un gros détachement à Srebrenica. « Ce colonel (c'était un Danois ou un Suédois) a refusé. Je l'ai convoqué à Zagreb pour qu'il exprime devant moi son refus d'obéissance. J'ai vu un homme qui est tombé en larmes en me disant : je suis honteux en tant qu'officier mais mon Gouvernement m'interdit d'exécuter votre ordre. (...) Cet incident est relaté par le menu par le général Cot dans son audition devant la Mission d'information. Dès 1993-1994, l'enclave n'est pas une priorité pour la FORPRONU qui répugne visiblement à y envoyer un contingent trop nombreux. Aussi, le bataillon néerlandais qui succède aux Canadiens sera-t-il toujours en sous-effectifs, comme l'a expliqué le colonel Karremans : « Ce n'est que deux mois après ma prise de commandement, en janvier 1995, que mon bataillon a atteint sa composition finale. J'ai demandé des soldats qui venaient d'environ 80 unités (...). A Srebrenica, j'ai commencé avec 600 hommes pour n'en avoir ensuite plus que 450, 150 personnes n'ayant jamais pu revenir de leurs vacances ». Le blocus de la route n'est jamais réellement brisé. Les Bosno-Serbes ne relâcheront jamais la pression. b) Des moyens matériels insuffisants Il est très habituel qu'en raison du blocus des routes imposé par les forces bosno-serbes, la FORPRONU ne soit pas ravitaillée. Au printemps 1995, les Casques bleus n'étaient ravitaillés qu'au compte-gouttes, l'essence, les médicaments, les produits frais leur faisaient défaut. Il ressort des télégrammes diplomatiques comme des auditions que ce problème fut lancinant, contribuant au découragement des soldats. D'ailleurs, l'armée bosniaque n'était pas dupe de l'insuffisance des moyens de la FORPRONU. Le général Jovan Divjak se souvient : « Au vu de la situation en 1995 à Srebrenica, j'avais compris que les Nations unies n'auraient pas les moyens de remplir l'accord qu'elles avaient signé. « Dès le début, s'est posé le problème de l'effectif des troupes à placer dans l'ensemble des zones de Bihac, Sarajevo et Srebrenica. (...) Il y a eu tout d'abord le bataillon canadien, très vite remplacé par le bataillon hollandais, mais jamais au nombre prévu par la résolution des Nations unies. En tant que militaire, il me semble que, d'un point de vue stratégique, les structures militaires des Nations unies n'avaient pas réellement analysé l'ensemble des éléments importants pour l'enclave de Srebrenica ». Quant à la préparation des soldats de la FORPRONU, il s'étonne de la manière dont la situation leur est présentée. « A l'époque, en tant que citoyen de Bosnie-Herzégovine et membre de l'armée bosniaque, je m'étais senti blessé dans mon amour-propre, quand j'avais su que l'on avait distribué aux troupes qui se préparaient à venir de Lyon à Bihac une brochure présentant la Bosnie-Herzégovine comme un pays où les tribus s'entre-tuaient, des choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Dans son journal, l'un des soldats de la FORPRONU à Bihac raconte que la situation qui a été présentée aux soldats au moment de leur préparation n'avait rien à voir avec la réalité quand ils sont arrivés à Bihac. On a la même situation à Srebrenica. » Les difficultés d'accès à l'enclave étaient « permanentes et extrêmement contraignantes » selon les termes employés par le général Bertrand de La Presle qui s'y est rendu début 1995. « Si je suis allé à Srebrenica en hélicoptère, malgré les difficultés météo du mois de février, c'est notamment parce qu'un déplacement par la route, outre le fait qu'il aurait été très long compte tenu de la disposition du terrain et de l'état des voies de communication, aurait été très aléatoire, plus encore que la météo. (...) Les difficultés d'accès étaient donc une préoccupation permanente du commandement de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo et bien sûr du patron de Srebrenica. » L'état d'esprit des soldats et leur moral sont aussi analysés par M. Daniel O'Brien, directeur de l'antenne médicale de Médecins sans frontières : « Les militaires qui étaient partis en congé n'avaient pas eu l'autorisation de revenir. Ils étaient donc en sous-effectifs. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'avaient pas forcément toujours de quoi manger à leur faim et ils devaient se contenter de rations de survie. « L'hygiène était mauvaise : il n'y avait pas de douches, par exemple, et ils me disaient qu'ils ne savaient pas ce qu'on attendait d'eux. Ils étaient conscients de l'angoisse au sein de la population locale, mais également de l'hostilité dans l'esprit des Serbes. Donc le moral était détestable. » Toutes les personnalités auditionnées qui se sont rendues à Srebrenica alors que l'enclave était zone protégée ont insisté sur les difficultés de ravitaillement et de relève du contingent de Casques bleus qui y était basé. Dans de telles conditions, la vie de la population civile ne pouvait qu'être d'une extrême dureté qui évoque la deuxième guerre mondiale. « Située dans une vallée étroite, Srebrenica, ou "la ville d'argent", s'étend sur trois kilomètres de long et huit cents mètres de large. Des collines sombres et inquiétantes s'élèvent au-dessus de la ville, conférant un sentiment de claustrophobie les jours de mauvais temps. ». Cette description de la ville elle-même avant la guerre révèle parfaitement la sensation immédiate de claustrophobie qui saisit, même sans menace, le visiteur, et que la Mission d'information a ressentie sur place. On peut donc imaginer aisément quel pouvait être l'état d'esprit d'une population comptant nombre de réfugiés démunis, ayant déjà vécu des situations tragiques. a) Des conditions de vie dramatiques Voici les descriptions que la Mission d'information a entendues lors de son déplacement et lors des auditions à Paris, elles parlent d'elles-mêmes. M. Sadik Ahmetovic, Vice-président de l'assemblée municipale de Srebrenica, explique : « En 1991, Srebrenica comptait 36 000 personnes, soit 27 000 Bosniaques et 9 000 Serbes. La zone protégée ne comprenait pas toute la région de Srebrenica durant cette période. Elle ne comportait que la ville et deux petites zones autour. « Entre 1992 et 1995, j'étais dans cet enfer qu'on appelait la zone protégée de Srebrenica. « (...) il n'y avait ni pain, ni eau, ni électricité, ni médicaments. Les gens mouraient de faim et de manque de médicaments. Les enfants mouraient de maladies infectieuses et, presque chaque jour, des civils étaient tués dans cette zone. » M. Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'Homme, fait état d'incidents violents dans les zones protégées et dénonce la situation des populations déplacées3. M. Sead Avdic, Président de la Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine, se souvient : « Pendant la guerre, j'étais le Président du Gouvernement de la ville de Tuzla où des milliers de réfugiés sont venus de Srebrenica. En 1993 et 1995, j'ai participé à l'accueil de ces gens et à l'organisation de leur hébergement. Quand vous rencontrez un enfant qui n'a jamais vu une ampoule électrique, que vous affrontez les traumatismes et le malheur des gens, d'une mère qui a perdu trois fils, trois belles-filles, deux petits-enfants, son mari, son frère, etc., ce sont vraiment des choses qu'on n'avait plus vues depuis la Deuxième Guerre mondiale. » M. Smaïl Cekic, Directeur de l'Institut de recherche sur les crimes contre l'humanité et le droit international à l'Université de Sarajevo a, lui aussi, évoqué la manière dont « les gens vivaient - ou survivaient pour être plus précis - à Srebrenica. La ville, lorsqu'elle était sous la protection de la communauté internationale en tant que zone protégée, fut le plus grand camp de concentration. C'était un véritable camp. La situation était extrêmement difficile. Il faut commencer par la faim. La communauté internationale qui devait assurer le ravitaillement en nourriture et le reste n'a pas rempli sa mission. L'aide humanitaire pour Srebrenica arrivait par convois de Belgrade et, chaque fois, ils étaient arrêtés au moment de la traversée de la Drina. A Srebrenica, il n'y avait pas de sel. Ce manque de sel dans la nourriture a provoqué entre autres de nombreuses maladies thyroïdiennes. La situation sanitaire qui régnait à Srebrenica était extrêmement difficile. Dans un endroit relativement restreint, il y avait entre 40 000 et 45 000 personnes. Les moins nombreux étaient les habitants de Srebrenica, les plus nombreux, les réfugiés venus d'autres villes de la Bosnie de l'Est, de Visegrad, de Vlasenica, de Zvornik, de Bratunac, qui, dans la première partie de 1992, avaient dû quitter la Bosnie et s'installer là. » Les habitants de l'enclave que la Mission d'information a entendus expriment tous la même détresse et la même terreur : Mme Schehida Abdurahmanovic, membre de l'association « Femmes de Srebrenica » : « Je vous raconte mon histoire. Je suis de Srebrenica. Dès le début de la guerre, en 1992, les troupes d'Arkan ont commencé à tuer. Nous savions que cela se passait à Zvornik et à Bratunac donc tout près de Srebrenica où je suis restée en me disant qu'on ne me tuerait pas. Nous savions ce qui se passait autour de nous, mais nous n'avions pas vraiment conscience de ce qui pouvait nous arriver. Ce n'est que lorsque les troupes d'Arkan sont rentrées chez moi le 8 mai 1992 et qu'elles ont tué mon mari sous les yeux de mes enfants, que j'ai vraiment pris conscience du danger. A ce moment-là, je suis restée enfermée, je ne pouvais plus partir. J'ai lutté pour sauvegarder les enfants et leur trouver à manger. Nous avons quand même réussi à survivre. » Les témoignages sur les conditions de vie à Srebrenica décrivent les mêmes maux : une population de personnes déplacées, souvent éprouvées par la perte d'un proche dans le conflit, qui se retrouvent parquées sans pouvoir sortir de l'enclave, souffrant de la faim et en très mauvaise santé. Les conditions sanitaires précaires provoquées par le ravitaillement aléatoire en médicaments, la sous-alimentation, le déficit en iode (il n'y avait pas de sel) provoquaient des maladies graves et des décès. D'après certaines informations, les combattants de l'armée bosniaque souffraient des mêmes maux. Les difficultés constantes d'acheminement des vivres et des médicaments à Srebrenica, par l'unique route d'accès, sont évoquées tant par les victimes que par les diplomates en poste et les militaires de la FORPRONU. Elle suscitent périodiquement des interventions du HCR qui négocie avec les Bosno-Serbes le passage de ses convois. Or, ceux-ci refusaient de manière récurrente l'entrée des convois humanitaires dans l'enclave, ce qui aggravait les conditions de vie des populations. b) Le rôle du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) Dès le début des conflits en ex-Yougoslavie, le HCR avait attiré l'attention sur l'ambiguïté de son rôle. A plusieurs reprises, Mme Sadako Ogata avait mis sa démission en balance, estimant que le HCR était dans une situation impossible. Secourir les déplacés, voire les déportés, ce qui est sa mission, revenait à cautionner le système de « nettoyage ethnique » que les Serbes avaient initié, et contre lequel, à juste titre, la communauté internationale s'insurgeait, la lutte contre le « nettoyage ethnique » étant l'un des objectifs de l'intervention de l'ONU. Les autorités bosniaques ne manquaient d'ailleurs pas de le rappeler dès que des déplacements de populations civiles en vue de leur protection étaient envisagés. Aussi, très rapidement, le HCR s'est-il trouvé pris dans une logique perverse, dont il avait conscience, mais contre laquelle il ne pouvait lutter sans trahir son mandat. Lorsqu'une guerre a comme but ultime d'exclure et de vider une partie de la population, l'action humanitaire sur le terrain est prise dans un dilemme insoluble, soit elle aide à évacuer les habitants pour les protéger et contribue à l'objectif même de la purification, soit elle s'y refuse et expose directement les personnes à des exactions encore plus graves. Le problème principal n'est plus l'assistance matérielle des personnes mais leur protection que les agences humanitaires sont incapables d'assurer et qui n'entre pas dans le mandat des Casques bleus. L'action humanitaire est alors réduite soit à l'impuissance soit à alimenter elle-même le flot des réfugiés. Il est regrettable que la Mission d'information n'ait pu entendre Mme Sadako Ogata, alors Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Elle aurait pu exposer comment le HCR avait conçu son action dans l'enclave avant sa chute. Il ressort des télégrammes diplomatiques, des témoignages des survivants du drame, et des membres de MSF, que le HCR était en permanence obligé de négocier le passage de l'aide humanitaire à travers les barrages mis en place sur la route qui menait à l'enclave. Négocier avec l'armée, voire les milices bosno-serbes, les passages de l'aide aux réfugiés, essayer de s'informer, semble avoir été la principale occupation du HCR dans l'enclave. Périodiquement les autorités bosniaques contestaient au HCR le droit de négocier avec les Serbes de Pale, qui par ailleurs, ne tenaient pas leur engagement. Le HCR, comme la FORPRONU, pâtissait très fortement de l'ambiguité des résolutions de l'ONU. Son impuissance liée à la situation géographique de l'enclave comme à la volonté des Bosno-Serbes de l'isoler transparaît dans tous les documents. Il apparaît qu'avant la chute de l'enclave la protection des populations civiles réfugiées soit passée au second plan par rapport à celle des Casques bleus. Dès lors le HCR n'était plus à même de jouer son rôle. Les difficultés qu'il rencontrera au moment et après la chute pour porter secours aux déportés en sont la conséquence. 3) Les organisations non gouvernementales (ONG) à Srebrenica Dans l'enclave de Srebrenica comme dans toute l'ex-Yougoslavie pendant le conflit, l'humanitaire a souvent servi d'alibi à l'impuissance politique. Aussi la Mission d'information comprend-elle l'indignation de M. Pierre Salignon, directeur des opérations de Médecins sans frontières (MSF), chargé du programme Balkans, quand il déclare : « Permettez-moi de vous rappeler que, tout au long de la guerre en ex-Yougoslavie, les organisations humanitaires comme MSF ont critiqué l'opération militaro-humanitaire de l'ONU en Bosnie. « Je pense que cette "observation militaro-humanitaire" de la purification ethnique a contribué à créer les conditions du massacre des habitants de Srebrenica. Pourquoi ? Parce que confier un mandat humanitaire à des militaires en situation de conflit ouvert dans lequel des crimes de masse sont perpétrés revient ni plus ni moins à les désarmer. En d'autres termes, cette pseudo-politique humanitaire de la France en Bosnie a finalement été menée au détriment de la protection réelle de la population civile. II est inquiétant de voir que le travail d'enquête que vous menez sur la tragédie de Srebrenica n'a conduit pour l'instant à aucun commentaire critique sur ce type d'opérations de l'armée française à l'étranger. L'ambition humanitaire ou de protection des civils continue à être affichée pour légitimer le déploiement de troupes françaises à l'étranger, sans que cette ambition ne supporte l'épreuve des faits. » La présence de MSF à Srebrenica pendant le siège et au moment de la chute de l'enclave est à l'honneur de cette ONG. D'après le Dr. Eliaz Pilav, qui travailla jusqu'à la chute de l'enclave dans l'hôpital de la ville avec l'équipe de MSF : « MSF et la Croix-Rouge sont arrivés à Srebrenica après que l'enclave eut été déclarée zone protégée (...) les représentants du HCR ont quitté la ville quelques mois avant sa chute. Seul un employé local est resté, c'est-à-dire un Musulman de Srebrenica. Les représentants de la Croix-Rouge ont également quitté Srebrenica quelques mois avant la chute et seuls quelques employés locaux sont restés. Quelques mois avant la chute, la mission MSF a aussi été réduite à Srebrenica. Au moment de l'attaque et de la chute de Srebrenica, il n'y avait comme représentants de MSF qu'une infirmière allemande, Christina Schmitz, et un médecin australien, Daniel O'Brien... ». Comme le HCR, le CICR et MSF sont eux aussi contraints de négocier l'arrivée des convois humanitaires avec les milices ou l'armée bosno-serbe qui les empêche périodiquement d'arriver. Avec peu de moyens, MSF a pu porter secours à la population de l'enclave. Les victimes que la Mission d'information a entendues ont rendu un vibrant hommage à l'action de cette ONG à Srebrenica. Dans cette enclave la situation humanitaire a toujours été désespérée même quand la pression internationale était plus forte. Srebrenica fut une enclave spécifique plus isolée que les autres, plus difficile d'accès, contraignant les ONG qui avaient décidé d'y rester à assumer un rôle qui n'était pas le leur au départ, celui de témoin engagé de l'impuissance de la communauté internationale - c'est-à-dire des Etats membres de l'ONU et particulièrement du Conseil de sécurité - à enrayer la « purification ethnique » et à empêcher les massacres de civils. On reviendra plus loin sur les moyens militaires dont disposait l'enclave en juillet 1995. D'une manière générale les forces bosniaques ne sont pas négligeables. Naser Oric dispose de plusieurs milliers d'hommes. Certes lui-même n'est pas là, mais ses forces demeurent une réalité. Leur armement léger est correct mais ils manquent cruellement d'armements lourds, une partie d'entre eux ayant été regroupée par la FORPRONU. La FORPRONU dispose d'un bataillon néerlandais, dénommé le Dutchbat 3, car c'est le troisième bataillon néerlandais qui est présent à Srebrenica. En dehors de quelques membres des services spéciaux britanniques, il ne semble pas y avoir d'autres militaires à Srebrenica. Le Dutchbat devrait disposer de 500 hommes mais les Serbes depuis plusieurs mois n'autorisent plus le retour de permission des Casques bleus qui sont rentrés dans leurs familles ; dès lors l'effectif est ramené à 350. Cela pourrait constituer un élément dissuasif réel, mais pour tout dire « le moral n'est pas bon », ce qui aura une importance décisive lors de l'attaque. 1) 6/11 juillet 1995 : l'attaque serbe Tous les militaires rencontrés par la Mission d'information se sont déclarés surpris par l'attaque de Srebrenica : pourtant celle-ci avait été précédée d'événements qui auraient dû susciter l'inquiétude des responsables. a) Les prémices de l'attaque : la concentration des troupes au mois de juin Il est toujours difficile de savoir quelles étaient les informations dont disposaient les protagonistes avant le début de l'offensive. On peut cependant indiquer les points suivants. En mars 1995, Radovan Karadzic, Président de la Republika Sprska, édicte la directive 7 adressée à l'armée bosno-serbe (VRS). Celle-ci doit « réaliser la séparation complète de Zepa et Srebrenica aussi vite que possible, en empêchant même les communications entre les individus des deux enclaves ». La VRS doit aussi « par des opérations militaires planifiées et bien pensées, créer une situation insupportable de totale insécurité avec aucun espoir futur de survie ou de vie pour les habitants de Srebrenica ». Ces extraits, cités par le TPI dans le jugement du général Krstic sur la mission confiée par Karadzic aux forces bosno-serbes, sont donc parfaitement clairs : il s'agit de rendre la vie des Musulmans à Srebrenica impossible. Le 31 mars, le général Mladic, qui commandait alors la VRS lui donne l'ordre (c'est la directive 7.1) « de conduire des opérations de combat autour des enclaves ». Les incidents se multiplient à la frontière des enclaves. Le 3 juin 1995, les Bosno-Serbes prennent le poste d'observation Echo au Sud de l'enclave après que la Force de protection des Nations unies eut refusé de déplacer sa position conformément à ce qu'avaient demandé les Serbes, le 1er juin. On notera qu'un appui aérien a été demandé à cette occasion, mais qu'il n'a pas été, selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies, transmis au quartier général de la FORPRONU à Zagreb. Le Secrétaire général précise qu' « elle [la demande] semble avoir été découragée plus bas dans la chaîne de commandement, du fait que des centaines de membres de la FORPRONU étaient toujours tenus en otage ». On notera à cet égard que cette décision de ne pas recourir aux frappes aériennes, dont il est avéré qu'elle n'a pas été prise par le commandement de la FORPRONU à Zagreb, c'est-à-dire par le général Janvier ou un membre de son état-major, est antérieure à la fameuse rencontre de Zvornik entre ce dernier et le général Mladic : à l'évidence, il n'y avait pas besoin de prendre quelqu'engagement que ce soit vis-à-vis de Mladic pour ne pas recourir aux frappes aériennes ; la seule réaction aux frappes de la fin mai suffisait amplement à dissuader tous les échelons de la FORPRONU d'y recourir. Quoi qu'il en soit, les Bosniaques répondent le 26 juin 1995 à la prise du poste d'observation de la FORPRONU en faisant un raid sur le village serbe de Visnjica : des maisons sont brûlées et il y a plusieurs morts. Par ailleurs, le contingent des Nations unies rétablit, au cours du mois de juin, deux postes d'observation à proximité du poste Echo qui avait été détruit par les Bosno-Serbes. Selon plusieurs témoins, le contingent néerlandais semble alors être devenu plus tolérant envers les Bosniaques en acceptant plus facilement qu'ils portent des armes dans l'enclave. Le général Milenko Zivanovic qui commande alors le corps de la Drina signe les ordres pour le déclenchement de l'attaque de l'enclave, dont le nom de code est Krivija 95. On notera que contrairement à ce qu'ont dit les Serbes à l'époque, il ne s'agit pas de répondre aux attaques bosniaques en provenance de Srebrenica, mais de créer une situation sur le terrain favorable en cas de négociations de paix. Au reste le commandant Karremans, lorsqu'il est venu devant la Mission d'information, a déclaré qu'il récusait « le prétexte avancé par les Serbes pour justifier leur attaque, selon lequel les forces bosniaques menaient des opérations contre les Serbes à partir de l'enclave. » Peut-être, cependant, ne faut-il pas prendre à la lettre les propos suivants tenus là encore par le commandant Karremans devant la Mission d'information : « Il n'y avait pas de combats avec les troupes serbes. Mais, comme je l'ai appris, de nuit, le bruit va très loin sur ce type de terrain et il y a eu, à plusieurs reprises et pendant notre présence là-bas, des attaques non pas contre les forces serbes, mais des escarmouches ici et là, car il fallait trouver de la nourriture. Pendant des mois, il n'y a pas eu de ravitaillement ; or, il fallait bien que ces gens, et notamment tous ces réfugiés, se nourrissent. C'était peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu des opérations de nuit. Je me souviens de discussions que j'ai eues avec les représentants des Serbes, Nicolic et Vukovic, qui critiquaient ces opérations de nuit et nous critiquaient de ne rien faire. ». S'agissant de l'information dont a bénéficié la FORPRONU, quelques éléments peuvent être fournis. Répondant à une question, le général Nicolai a indiqué devant la Mission d'information « qu'il y avait eu des indications préalables quant à une attaque éventuelle sur Srebrenica... Au début de juin, le colonel Karremans avait envoyé un rapport de situation aux instances supérieures de l'ONU ainsi qu'aux Pays-Bas. Il y mentionnait que le ravitaillement était stagnant et que sa préparation opérationnelle ne pouvait pas être assurée de manière satisfaisante. Dans ce même rapport, il indiquait qu'il y avait des concentrations de troupes des forces serbes près de l'enclave de Srebrenica. Il en concluait qu'il se pouvait qu'une attaque se prépare ». Et le général Nicolai ajoute : « L'interprétation de cette information au niveau de la FORPRONU à Sarajevo fut que, certes, il pouvait avoir raison, mais qu'il s'agirait d'une attaque ayant un objectif assez limité, c'est-à-dire la conquête du point Sud de l'enclave ou la réduction de la dimension de l'enclave ». Puis il précise que « les informations [en provenance de l'OTAN] devinrent très sommaires pendant la période de juin et juillet... à la suite de l'attaque de l'avion américain par un missile serbe... ». Sur place, cependant, les informations commençaient à se diffuser. Mme Christina Schmitz, de MSF, en a témoigné devant la Mission d'information : « Le mardi 4 juillet, nous avons été informés d'une concentration importante d'hommes de troupes bosno-serbes, mais également de matériel lourd, d'artillerie et de chars autour de l'enclave. C'est un membre du HCR, entré ce jour là avec un convoi de nourriture, qui nous a avertis. Le 5 juillet, lors du point de sécurité quotidien, ces informations ont été confirmées et une nouvelle équipe médicale de la FORPRONU a été autorisée à rentrer. » b) 6/7 juillet : première offensive, première demande d'appui aérien et répit La batterie serbe installée le 5 juillet lance ses premières roquettes le 6 juillet à 3 heures 15. Plusieurs d'entre elles tombent à proximité immédiate du quartier général du bataillon néerlandais installé à Potocari. L'attaque concerne plusieurs points de l'enclave. Durant les deux heures suivantes, il apparaît clairement qu'il s'agit d'une opération concertée, sinon de grande envergure : plusieurs points d'appui bosniaques sont bombardés. Plus grave, dès 5 heures, un poste d'observation néerlandais PO Hotel, indique que des obus de char sont tombés à une centaine de mètres du poste. Le commandant du Dutchbat, à qui la demande avait été présentée par Ramiz Becirovic, commandant par intérim des forces bosniaques, refuse de rendre les armes détenues par la FORPRONU. Jusque là on peut avoir des doutes sur les objectifs de l'armée serbe : mais à plusieurs reprises à partir de 12 heures le poste d'observation néerlandais PO Foxtrot est touché par un obus de char. Dès lors le commandant Karremans a jugé nécessaire de présenter une demande d'appui aérien au quartier général de la FORPRONU du secteur Nord-Est installé à Tuzla dont dépendait Srebrenica, lequel quartier général dépendait lui même du quartier général de la FORPRONU pour la Bosnie à Sarajevo, lui même dépendant du quartier général pour l'ensemble de l'ex-Yougoslavie implanté à Zagreb. Tuzla ayant accédé à la demande du commandant Karremans, la demande a été soumise à Sarajevo : le général Rupert Smith, qui commandait la FORPRONU en Bosnie, un Britannique, était alors en congé, et l'Acting Commandant était le général Gobilliard, un Français, chargé normalement du seul secteur de Sarajevo, et dont le quartier général était éloigné de celui de la FORPRONU pour l'ensemble de la Bosnie : dès lors ce n'est pas à lui que s'est adressé Tuzla, mais au général Nicolai, un Néerlandais, qui était chef d'état-major du quartier général pour la Bosnie et donc le collaborateur direct du général Rupert Smith. Le général Nicolai a longuement expliqué devant la Mission d'information les raisons qui l'avaient amené à ne pas accepter la demande d'appui aérien : d'une manière générale, il estimait que les conditions d'emploi de l'arme aérienne, telles qu'elles avaient été redéfinies à la suite de la prise d'otages qui avait suivi son usage le 24 mai 1995, n'étaient pas remplies. Ceci est tout à fait discutable, dans la mesure où les postes d'observation de la FORPRONU avaient été touchés, mettant en danger la vie des Casques bleus néerlandais. Le quartier général de la FORPRONU à Zagreb a cependant été informé de la demande et le chef des opérations terrestres comme le chef d'état-major du général Janvier, tous deux aussi Néerlandais, qui ont été consultés par le général Nicolai ont, semble-t-il, approuvé sa décision. Il est évident que ce manque de réaction dès l'attaque serbe a constitué une erreur : le manque de détermination qu'il traduisait à ne pas défendre la FORPRONU était très inquiétant. M. Akashi a comparé devant la Mission d'information la FORPRONU à une vitrine de magasin, expliquant que ce n'est pas sa force qui protège le magasin mais le respect que voue la société à la vitrine. Si l'on suit le raisonnement de M. Akashi, il fallait réagir immédiatement à l'attaque, comme le fait un commerçant dès qu'on s'attaque à sa vitrine. Si la FORPRONU ne constituait qu'un symbole, sa mise en cause par des obus tirés par des chars devait entraîner une riposte symbolique immédiate. Peut-être que le fait que Carl Bildt, le médiateur de la Communauté européenne, ait dû rencontrer le lendemain 7 juillet à Belgrade Milosevic et Mladic, n'a pas poussé à une réaction trop forte. On notera à cet égard que - mauvaise appréciation des choses ou mauvaise transmission de l'information - il ne semble pas que Carl Bildt ait évoqué la situation à Srebrenica lors de ses entretiens avec les deux leaders serbes. Quoi qu'il en soit, après quelques tirs de char, dont certains visaient des postes de la FORPRONU, les bombardements serbes ont cessé en milieu d'après-midi. Le 7 juillet, on a assisté à ce que les Nations unies appellent une « pause », due au mauvais temps. Quelques tirs sporadiques ont eu lieu, certains visant la FORPRONU. On retiendra de cette journée l'évaluation de la situation faite par le commandant Karremans : celui-ci estime dans son rapport journalier que les Serbes ne sont pas en mesure de conquérir l'enclave à court terme, faute d'effectifs en nombre suffisant. Il observe cependant qu'à long terme, ils sont en mesure de la neutraliser. Une telle évaluation, dont on ne sait si elle provient du manque de renseignements, de l'autosuggestion ou de l'illusion sur la détermination des forces bosniaques et néerlandaises à accomplir leur devoir, était assez grave, car de nature à conforter les états-majors dans leur attentisme naturel. c) 8 juillet : la remontée des Serbes vers le Sud et la deuxième demande d'appui aérien Comme le souligne le Secrétaire général des Nations unies dans son rapport sur la chute de Srebrenica, « les Serbes ont considérablement progressé à l'intérieur de la zone de sécurité de Srebrenica le 8 juillet », contredisant l'évaluation faite la veille par le commandant Karremans. Cette journée va en effet se révéler cruciale : si la pause du 7 juillet peut expliquer - même si elle ne la justifie pas - l'inaction des Nations unies, celle du 8 juillet ne laisse plus planer aucun doute sur la détermination des Serbes. Observons, dès à présent, que ce jour là, ni le commandant en ex-Yougoslavie, ni celui en Bosnie ne sont sur le terrain : tous deux sont à Genève pour rencontrer le Secrétaire général des Nations unies et le Haut Commissaire aux réfugiés : on notera à cet égard que, pour cette rencontre, le général Rupert Smith est rentré de ses vacances en Dalmatie, ce qu'il ne fera à aucun autre moment durant la chute de Srebrenica : manque de clairvoyance, ou système de valeurs spécifique ? On ne peut juger, les autorités britanniques ayant refusé son audition par la Mission d'information. Quoi qu'il en soit, les Serbes attaquent en fin de matinée : ce sont d'abord des tirs de char sur les positions bosniaques à proximité immédiate du poste d'observation Foxtrot du contingent néerlandais des Nations unies ; puis, le poste d'observation est lui-même touché vers 14 heures. Parallèlement, les Serbes bombardent, mais pas de manière systématique, le reste de l'enclave, plusieurs obus tombant, là aussi, à proximité immédiate de postes d'observation ou de commandement des Nations unies. A ce moment, il semble que le commandant Karremans ait appelé le général Nicolai pour lui faire part de la situation et lui demander un appui aérien, comme il l'avait déjà fait le 6 juillet. Tous deux se sont expliqués devant la Mission sur ces entretiens dont la conclusion traduit clairement que la tendance, au-delà des personnes, n'était pas à l'usage de l'arme aérienne. Mais laissons la parole aux témoins. Devant la Mission d'information le commandant Karremans a indiqué : « S'agissant du document relatif au Post Air Strike Guidance, aux conséquences de déploiement de l'arme aérienne, après qu'il en a été fait utilisation au mois de mai, j'étais au courant de ce document qui m'avait été envoyé par fax. Le premier jour de l'attaque, le 6 juillet, j'en ai discuté amplement avec le général Nicolai. A la suite de la non-autorisation du déploiement de l'appui aérien, je pouvais m'attendre à ce que les commandants de niveau supérieur fassent quelque chose, un appui au sol par exemple. Nous avons discuté du Post Air Strike Guidance. Mon avis était qu'il fallait un appui aérien rapproché indépendamment des instructions. Je pense qu'au vu des circonstances dans lesquelles je me trouvais avec le bataillon et la population, l'appui aérien aurait été un moyen ultime permettant de renverser la situation. Le général Nicolai a parlé de troupes au sol. Je crois davantage en une présence accrue de troupes terrestres beaucoup mieux armées, avec plus de sources de renseignement, ce qui s'est d'ailleurs produit à un stade ultérieur, mais ce qui n'était pas le cas en juillet... « De temps en temps, la fin justifie les moyens ; de temps en temps, il faut prendre une décision et s'écarter des instructions. L'arme aérienne est peut-être l'arme ultime, mais il n'est pas facile de déployer cette arme aérienne en tant que telle : il faut prendre en compte les discussions entre le pilote et les troupes au sol, il faut également penser au territoire concerné, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Quant à l'avis des politiques et des militaires sur le déploiement de l'arme aérienne, il se situe à un niveau beaucoup plus abstrait. J'étais sur place. Il y a eu des prisonniers. Nous attendions un appui aérien et je recommencerais s'il le fallait. » A l'évidence, ce n'était pas l'avis de la hiérarchie des Nations unies : le général Nicolai a été de ce point de vue tout à fait clair devant la Mission d'information : « Les conclusions décevantes des frappes aériennes exécutées les 25 et 26 mai 1995, entraînant la prise d'otages de plus de 300 collaborateurs des Nations unies, amenèrent le général Rupert Smith, commandant de la FORPRONU, à publier le 29 mai 1995 un Post Air Strike Guidance (instructions consécutives aux frappes aériennes) qui définissait l'appui aérien rapproché et les frappes aériennes comme des outils de dernier recours. Il fallait éviter de mettre en danger les vies des militaires de l'ONU ou de courir le risque qu'ils soient pris en otage, particulièrement pour maintenir une position indéfendable. Dans ce cas précis, le commandant local pouvait juger que ces positions pouvaient être abandonnées ». Vos Rapporteurs souhaitent observer à cet égard que les dates des ordres de restriction de l'usage de l'arme aérienne, si elles ont un lien direct avec la prise en otages des Casques bleus à la fin du mois de mai 1995, n'en ont, à l'inverse, aucun avec les entretiens de juin entre les généraux Janvier et Mladic. Mais redonnons la parole au général Nicolai : « Les directives ont été confirmées et reconfirmées par le commandant en chef de la FORPRONU, le général Janvier, le 2 juin et le 27 juin. Même si cette donnée ne ressort pas des instructions ou des directives écrites dont j'ai eu connaissance, les compétences permettant l'approbation de l'appui aérien ont été reportées à un niveau supérieur. L'approbation des frappes aériennes fut dès lors réservée au Secrétaire général des Nations unies, alors qu'elle revenait auparavant à son représentant spécial à Zagreb, M. Akashi. L'approbation de l'appui aérien rapproché revint quant à elle à M. Akashi, alors qu'elle revenait jusqu'à cette date au commandant de la FORPRONU. « J'en viens maintenant de manière plus détaillée aux demandes d'appui aérien rapproché à Srebrenica, au mois de juillet 1995. « Dans la période du 6 au 11 juillet 1995, le colonel Karremans, commandant du Dutchbat stationné à Srebrenica, a demandé un CAS à plusieurs reprises, soit personnellement, soit par délégation. Ces demandes ont été faites soit oralement, soit par écrit par la voie hiérarchique, c'est-à-dire au commandement du secteur Nord-Est de la FORPRONU, à Tuzla, qui transmettait au QG FORPRONU à Sarajevo, ce dernier les envoyant, le cas échéant, au QG à Zagreb. « C'est le 6 juillet 1995, entre 1 heure et 2 heures de l'après-midi, que, pour la première fois, le commandant du Dutchbat a demandé un appui aérien rapproché, à la suite de tirs sur le poste d'observation Foxtrot et de tirs d'artillerie intenses dans la partie Sud de l'enclave de Srebrenica. Cette demande a été envoyée par le commandant en charge du secteur Nord-Est à Tuzla, le colonel Brantz, Néerlandais, à Sarajevo. L'état-major de la FORPRONU à Sarajevo estima que cette demande ne satisfaisait pas au critère de dernier recours mentionné dans le Post Air Strike Guidance et que, par conséquent, cette demande devait être rejetée, tout comme une telle demande fut rejetée au début du mois de juin dans des situations similaires à Gorazde. Le commandant en charge de la FORPRONU, le général Gobilliard, a adhéré à ce jugement. Je ne me souviens pas à 100 % si cela était avant ou après la décision. Bien que cette demande n'ait pas été transférée au QG à Zagreb, l'état-major de Zagreb a été informé qu'une telle demande avait été formulée et des motifs du rejet de cette demande. Il a également approuvé cette décision. Le rejet de cette demande m'a conduit à appeler personnellement le colonel Karremans afin de lui en exposer les motifs et de lui rappeler également les lignes directrices du Post Air Strike Guidance qu'il connaissait personnellement d'ailleurs. Dans la discussion qui s'en est suivie, le commandant du Dutchbat a suggéré une Air Presence, c'est-à-dire une présence aérienne sans attaque aérienne. J'ai également refusé cette suggestion. « La deuxième demande d'appui aérien qui est parvenue au QG FORPRONU a été formulée le 8 juillet par le commandant du Dutchbat, après un tir direct sur le poste d'observation Foxtrot par les forces serbes. Comme il était encore possible de quitter ce poste d'observation afin de mettre en sécurité le personnel, l'état-major de la FORPRONU a recommandé cette option, mais, cette fois-ci, il a été proposé une présence aérienne de l'OTAN. Après approbation par le général Gobilliard et conformément à cet avis, il a été décidé de demander une présence aérienne à 13 heures 15 environ. « A la fin de cette journée, on pensait à tous les niveaux de l'ONU que l'attaque par les forces serbes ne concernait ou ne visait pas la prise de toute l'enclave, mais seulement la maîtrise du point Sud de cette enclave, étant donné qu'il y avait là une route très importante pour le ravitaillement. » C'est le point de vue que retient le Secrétaire général des Nations unies dans son rapport, lequel indique qu'il semble que l'analyse faite à ce moment à Sarajevo et Zagreb est que l'objectif des Serbes n'est pas de conquérir l'enclave mais seulement d'occuper un point stratégique dans la zone Sud. Mais revenons à la situation de Srebrenica : les combats ont eu lieu à proximité immédiate du poste d'observation Foxtrot. Le commandant néerlandais de la compagnie, bien qu'il en ait eu la possibilité, a estimé ne pas devoir utiliser de roquettes contre le char serbe : il s'agissait d'éviter une action susceptible d'aggraver la situation et de mettre en danger la vie des soldats néerlandais. On est un peu étonné d'une telle attitude : le commandant Karremans veut d'une part un appui aérien pour impressionner les Serbes, mais n'utilise pas les armes dont il dispose pour ne pas aggraver la situation... Là encore, on voit la double préoccupation qui va être celle de la communauté internationale tout au long de la crise : protéger les Casques bleus et éviter tout acte qui soit de nature à aggraver la situation sur le terrain : en un mot, ne rien faire. Finalement, le commandant de la compagnie a opté pour évacuer le poste d'observation qui, immédiatement, a été occupé par les Serbes, lesquels ont obtenu que les Néerlandais, avant de partir, laissent leurs armes. Quittant le poste d'observation dans un véhicule en choisissant de rejoindre la ville de Srebrenica, l'un des soldats néerlandais a alors été touché mortellement par un soldat bosniaque à un barrage. Après la prise de Foxtrot, l'objectif des Serbes a été constitué des postes d'observation Sierra et Uniform, toujours au Sud de l'enclave, postes qui ont été rapidement l'objet d'attaques. Des tirs serbes à proximité du poste d'observation Uniform ont conduit à ce que les Néerlandais se retirent de là comme à Foxtrot quelques heures plus tôt. De 20 à 30 Serbes ont alors occupé le poste d'observation et comme à Foxtrot, les Néerlandais ont pu partir, mais sans leurs armes et matériels. A Foxtrot, ils avaient quitté le poste d'observation pour se rendre à Srebrenica. Mais afin d'éviter d'avoir à franchir les lignes tenues par les Bosniaques qui avaient tué un des leurs à Foxtrot, les Néerlandais ont choisi au poste d'observation Uniform, de partir du côté des lignes serbes. Ils se sont donc rendus à Bratunac. S'agissant du poste d'observation Sierra, il n'était pas tombé mais était encerclé. Comment expliquer qu'il n'y ait eu aucune réaction ni des Néerlandais, ni de la communauté internationale, ce jour là ? Difficile de l'expliquer totalement. On peut cependant indiquer quelques points ; d'une part les Néerlandais étaient à l'évidence une « force de paix » et n'entendaient pas faire la guerre. Le fait qu'ils aient eu un mort sous les balles bosniaques à Foxtrot, ne les a pas incités à résister réellement dans les autres postes. Leur choix de partir du côté des lignes serbes plutôt que des lignes bosniaques est à cet égard révélateur. L'absence des généraux Bernard Janvier et Rupert Smith, tous deux à Genève, le fait que l'Acting Commandant en Bosnie ait été un général français qui ne connaissait pas la région de Srebrenica, la tendance réelle du général Nicolai à respecter strictement le principe que l'usage des armes ou de l'arme aérienne n'est « qu'un dernier recours », peuvent expliquer l'absence de réaction en ce jour fatidique du 8 juillet. En effet, si le 6 juillet les Serbes ont pu croire que l'absence de réaction était due à l'effet de surprise, ou à une mauvaise estimation de la détermination serbe, au soir du 8 juillet, ils peuvent avoir la quasi-conviction qu'ils prendront l'enclave sans coup férir, ce qui va être le cas. Il est vrai aussi que les Serbes exerçaient en même temps une pression sur les autres enclaves de l'Est à Zepa (et dans une moindre mesure à Gorazde). Les rapports journaliers du ministère français de la Défense sont à cet égard tout à fait révélateurs : la situation à Srebrenica, tout en étant jugée préoccupante, ne l'est guère plus que celle dans les autres enclaves. Cela explique que dans aucune des notes journalières concernant cette journée qui ont été communiquées à la Mission d'information, il n'ait été envisagé d'opération terrestre de soutien vers l'une ou l'autre des enclaves dont Srebrenica. On notera enfin, et cela est souligné tant dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies, que dans les auditions faites par la Mission d'information, que les responsables présents à Genève ce 8 juillet - les généraux Janvier et Rupert Smith et le représentant spécial M. Akashi notamment - n'ont pas été avertis de la forte détérioration de la situation à Srebrenica : les Serbes avaient déjà pris plusieurs postes d'observation et détenaient en fait des Néerlandais comme otages et les responsables n'en avaient pas été avertis. Comment expliquer une telle attitude ? Difficile de le dire, mais on peut penser que l'impuissance des Nations unies avait gagné tous les échelons ; à quoi donc servait-on ? A ce moment on discutait de la question de savoir s'il n'était pas urgent de quitter la Bosnie ; l'ambiance était plutôt au retrait qu'à l'action. A supposer que ce choix ait été fait, il aurait fallu en avertir à l'avance les populations civiles afin de ne pas les entretenir dans une illusion de protection qu'on envisageait sérieusement de ne pas assurer. d) 9 juillet : la pression croissante des Serbes et la réaction de Zagreb Le 9 juillet, la journée commence dans le droit fil de celle du 8 ; l'absence de réaction des forces des Nations unies pousse les Serbes à poursuivre leur offensive. Vos Rapporteurs ont acquis la conviction qu'il n'y a pas eu de planification de la prise de Srebrenica avant le 9 juillet, même si la ville était à l'évidence un objectif stratégique pour les Serbes, et que c'est l'absence de réaction de la communauté internationale à cette date - et notamment l'absence de frappes aériennes - qui explique la décision prise le 9 de prendre l'enclave. Le commissaire Ruez, qui a enquêté pour le compte du procureur du TPI est à cet égard très clair : « Non, il n'y a pas d'éléments concernant une planification antérieure. En fait, la prise de l'enclave n'était pas planifiée. Le plan d'opération pour cette offensive est daté du 5 juillet. Je crois que la composante défense antiaérienne de cette opération date du 6 ou du 7 juillet, la date peut être précisée. Mais, en fait, la décision de s'emparer de l'enclave n'est pas prise avant le 9 juillet au moment où le général Mladic s'est rendu compte que la défense de l'enclave ne se ferait pas. Le but initial était de réduire l'enclave à la limite de la ville de Srebrenica même et de la transformer en un gigantesque camp de réfugiés à ciel ouvert, afin de forcer les Nations unies à procéder à l'évacuation de la zone. » Interrogé alors sur la question de savoir si des documents existaient de nature à confirmer ce sentiment, M. Ruez a précisé : « Oui, tout à fait. On a en notre possession les plans d'opération. L'élément composante aérienne est important. Le général Mladic a prévu et anticipé le fait qu'il y aurait des frappes aériennes, ce qui paraît assez antinomique avec tout accord préalable sur le fait qu'elles n'aient pas lieu. Il a prévu les moyens antiaériens qu'il estimait nécessaires pour abattre les avions de l'OTAN qui viendraient effectuer des frappes aériennes sur ce secteur ». On peut déduire clairement de ces propos fondés sur l'enquête du TPI que le général Mladic s'attendait à une résistance et à des réactions dans les premiers jours de l'attaque et que son objectif était la réduction de la superficie de l'enclave, en particulier dans la zone Sud. L'absence de réactions entre les 6 et 8 juillet l'a conduit à choisir, le 9 juillet, de poursuivre l'offensive afin de faire tomber l'enclave. C'est donc ce qui se passe le 9 juillet. Les troupes bosno-serbes continuent d'attaquer les postes d'observation et les forces de la FORPRONU, les soldats néerlandais étant, selon une analyse faite ce jour-là, directement pris pour cibles. Pour la première fois semble-t-il, un rapport fait état du risque que courent la population et l'armée de Bosnie-Herzégovine, puisqu'il indique que ceux-ci sont « à la merci de l'armée des Serbes de Bosnie ». On a tout de même un peu de difficulté à comprendre comment on est passé en deux jours d'une évaluation du commandant Karremans indiquant qu'il n'y avait pas de risque à moyen terme, à une évaluation telle que celle qui est faite le 9 juillet. Sans doute l'absence de réactions des forces bosniaques et des Nations unies y est-elle pour quelque chose, et explique que le rapport journalier se conclut sur ces terribles mots : « Devant la quasi-absence de réaction des Nations unies, elle [l'armée bosno-serbe] pourrait même multiplier ses objectifs et elle est désormais en mesure d'envahir l'enclave si elle le souhaite. » Il est vrai que la journée aura été difficile pour les troupes des Nations unies. Dès 9 heures du matin, des soldats bosno-serbes ont occupé le poste d'observation PO Uniform, en obligeant les soldats néerlandais à rejoindre le poste d'observation PO Echo et à devenir ainsi des otages potentiels des Serbes. Dans un contexte « normal », une telle perspective pour les forces des Nations unies aurait dû conduire à une réponse appropriée. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque où il était presque devenu banal que des Casques bleus soient retenus en otages. Quelques heures plus tard, ce sont plusieurs autres Néerlandais qui seront pris comme otages par les Serbes au Sud de l'enclave, après qu'ils eurent été désarmés et que leur véhicule leur eut été pris. Ils seront emmenés par les Serbes à Bratunac. Au début de l'après-midi, d'autres postes d'observation ont été l'objet d'une attaque serbe, bien entendu au Sud de l'enclave, comme le poste PO Kilo, mais aussi au Nord comme le PO Mike, montrant à l'évidence que l'attaque serbe prenait une envergure qui laissait de moins en moins de place à l'incertitude sur les objectifs qu'avait désormais le général Mladic. Le général Nicolai a alors téléphoné au général Tolimir de l'état-major serbe pour lui indiquer que la « zone de sécurité serait défendue par les Nations unies ». Le général Tolimir a, semble-t-il, fait des réponses de nature dilatoire. On notera que les informations qu'envoyait le commandant Karremans à ses supérieurs pouvait encore les induire en erreur sur l'évolution de la situation et les risques à court terme. Il semble en effet qu'à midi ce 9 juillet le commandant Karremans ait encore indiqué au poste de commandement de Tuzla dont il dépendait que la prise de l'enclave était certes possible, « mais pas à court terme... » Quoi qu'il en soit, les Bosno-Serbes poursuivaient leur offensive en prenant le PO Delta : une fois de plus les soldats néerlandais optèrent pour partir du côté serbe devenant de nouveaux otages potentiels. On note là combien a pesé lourd le soldat néerlandais tué par les Bosniaques au début de l'offensive : il a en fait potentiellement transformé de nombreux Casques bleus néerlandais en otages, lesquels, deux jours plus tard, se révéleront un obstacle considérable à une réaction d'envergure au moment de la prise de l'enclave. Le général Janvier, enfin informé, a alors décidé de réagir. Devant la Mission d'information il a expliqué son action. « C'est le 9 juillet à 8 heures 40 que les responsables des Nations unies, réunis à Genève, ont pleinement conscience de ce qui se passe à Srebrenica... La demande d'appui et d'engagement de l'arme aérienne que je reçois est du 9 juillet. » A ce moment il décide d'ordonner aux Néerlandais de créer une « position d'arrêt » sur la route qui mène du Sud de l'enclave à la ville. Cet ordre, parfaitement clair, ne sera que très partiellement exécuté, et il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que les troupes néerlandaises en sont responsables. Peut-être l'ordre était-il inapplicable, peut-être aurait-il entraîné la mort de soldats ? Quoi qu'il en soit, le fait que les Casques bleus ne l'aient en définitive pas exécuté oblige l'ONU, comme elle s'y est d'ailleurs livrée, à revoir ses procédures. Les soldats néerlandais ont avancé des arguments indiquant qu'ils ne savaient pas d'où venaient les attaques, ou bien que les obus qu'ils recevaient pourraient ne pas leur être initialement destinés. Dans les faits, ils ne souhaitaient pas se battre et ne se sont pas battus. On a d'ailleurs quelque difficulté à comprendre ce qui a amené Mme Madeleine Albright à saluer le courage et l'efficacité du contingent néerlandais devant le Conseil de Sécurité le 12 juillet 1995. Parallèlement, une nouvelle demande d'appui aérien rapproché était émise qui, celle-là, recevait l'appui du commandement de la FORPRONU à Sarajevo, c'est-à-dire d'abord du général Nicolai, chef d'état-major de cette force, et du général Gobilliard, qui en assurait l'intérim en l'absence du général Rupert Smith. On notera que ce dernier, rentré de Genève où il avait assisté avec le général Janvier aux entretiens avec le Secrétaire général des Nations unies et le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés, était retourné sur le lieu de villégiature où il passait ses congés depuis le 1er juillet. Durant toute la période de l'attaque de Srebrenica, il sera tenu au courant de l'évolution de la situation par son aide de camp à Sarajevo, comme l'a souligné le général Nicolai devant la Mission d'information, mais refusera de prendre le général Janvier, son supérieur, au téléphone : curieux sens des responsabilités... Au demeurant, la situation évoluait rapidement : ce fut clairement une journée où les choses basculèrent. Les plans de Mladic ont changé ; d'une pression sur l'enclave, on s'achemine vers une prise de la ville. C'est pourquoi le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Akashi, et le général Janvier, ont adressé aux Serbes un avertissement qui ressemblait tout à fait à un ultimatum : ils exigeaient l'arrêt de l'offensive, le retour des Serbes au-delà des limites de la zone de sécurité et la libération des Néerlandais qui sans bien s'en rendre compte au début étaient devenus des otages des Serbes. Cet ultimatum a été communiqué par oral et par écrit aux Bosno-Serbes. Dans la version écrite, il était précisé que toute attaque de la position d'arrêt qu'avait décidée le général Janvier sur la route Sud entraînerait une riposte aérienne. Une fois de plus on constate que ce n'était ni la défense de la zone de sécurité, ni même celle des populations civiles, qui pouvait conduire à une réaction militaire des Nations unies, mais seulement une attaque sur les forces des Nations unies elles-mêmes. En fin de journée, tout était prêt pour un appui aérien dès le 10 juillet à 6 heures du matin. e) 10 juillet : les Serbes aux portes de la ville et les hésitations du général Janvier Le matin du 10 juillet, on peut dire que l'histoire balbutie. Quelles qu'avaient été les évaluations faites jusque là par le commandant Karremans, et on a vu qu'elles étaient parfois un peu fantaisistes, il est clair que le 9 juillet les perspectives d'une prise de l'enclave se font plus pressantes. A l'inverse, le 10 juillet, on va avoir le sentiment que les choses sont susceptibles de s'arranger : sans doute s'agit-il d'une réaction des Serbes à l'ultimatum du 9, Serbes passés maîtres dans l'art de la manipulation. Par ailleurs, pour la seule fois durant toute l'attaque de l'enclave, on va constater une réaction des forces bosniaques. Même si cette réaction sera en fait l'occasion de malentendus supplémentaires, on ne doit pas passer sous silence le fait qu'elle a eu lieu. Le 10 juillet au matin, malgré les réserves clairement exprimées alors par le commandant Karremans et que celui-ci a réitérées devant la Mission d'information, les Néerlandais installent la position d'arrêt sur la route Sud. Il s'agit en fait de placer des véhicules blindés sur chacune des routes conduisant à la ville. A l'une des implantations prévues, des incidents opposent le forces des Nations unies aux Bosniaques. Plus tard, à proximité, des tirs auront lieu en direction de la position néerlandaise, tirs qui seront imputés à tort aux Bosniaques. Cette erreur ne sera pas sans conséquences, car l'information erronée ayant été transmise par les Néerlandais à Tuzla, Sarajevo et Zagreb sans, semble-t-il, être démentie avant le briefing du matin à Zagreb autour du Représentant spécial, M. Akashi, et du commandant de la force, le général Janvier, elle expliquera largement l'absence de réaction des Nations unies durant cette journée du 10 juillet. Quoi qu'il en soit, en début d'après-midi de nouveaux tirs ont lieu contre l'une des positions d'arrêt installées par les Néerlandais. Ces tirs étaient sans conteste d'origine serbe. D'après le rapport du Secrétaire général des Nations unies, certains Néerlandais se rappellent avoir alors demandé un nouvel appui aérien rapproché, mais il n'a été trouvé trace de cette demande à aucun stade de la hiérarchie, ni à Tuzla, ni à Sarajevo, ni à Zagreb. On peut donc douter du fait que la demande ait été faite en bonne et due forme, même si on peut penser qu'une telle demande a été envisagée et peut-être même discutée avec certains officiers, néerlandais probablement, aux différents quartiers généraux des Nations unies. Ce même 10 juillet à New York, M. Gharekan, représentant du Secrétaire général, exposait devant le Conseil de sécurité l'état de la situation. Il y indiquait que les tirs contre les véhicules de la FORPRONU provenaient des forces bosniaques, ce qui, compte tenu du décalage horaire, avait déjà été démenti depuis plusieurs heures. L'objectif d'obtenir une réaction ferme des Nations unies ne risquait pas d'être atteint. Il est difficile de savoir si certaines délégations ont souhaité une réponse ferme ; ce qui est vrai c'est que les instructions données par le ministère français des Affaires étrangères (télégramme du 10 juillet à 13 heures 30 envoyé à notre représentation permanente auprès des Nations unies), ne témoignaient pas d'une forte détermination, se contentant de demander de la retenue aux parties. C'est à peu près ce que jugera nécessaire de faire le Conseil de sécurité. Compte tenu du décalage horaire, ce sera à quelques heures de la chute de la ville et personne n'en saura rien. Entre-temps, les tirs serbes continuaient sur l'enclave. En fin d'après-midi, les premiers éléments significatifs de l'infanterie serbe sont arrivés en vue des Néerlandais et ceux-ci ont tiré sur eux mais en visant délibérément au-dessus de la tête des Serbes. Le commandant Karremans a alors demandé de nouveau un support aérien rapproché qui a été appuyé aux quartiers généraux de Tuzla et de Sarajevo et est donc parvenu en début de soirée au quartier général de la Force à Zagreb. On peut penser que le support aérien était dans l'esprit des Néerlandais plus « anonyme » que la réplique terrestre aux attaques serbes. En engageant l'arme aérienne, c'est toute la communauté internationale qui s'engageait, avec moins de risques pour les troupes néerlandaises que l'utilisation de leurs propres armes. Au cours de cette soirée qui a fait couler beaucoup d'encre, de nombreux appels ont eu lieu entre le quartier général de la Force des Nations unies à Zagreb et les autres protagonistes de l'affaire, le Gouvernement néerlandais, le général Tolimir, à l'état-major serbe, et le général Gobilliard commandant de la FORPRONU à Sarajevo, ainsi qu'avec le Représentant spécial, M. Akashi, qui était à Dubrovnik. Après de multiples discussions qui sont bien retracées dans le rapport du Secrétaire général des Nations unies (paragraphes 287 à 293), le général Janvier a décidé ... de ne rien décider, estimant notamment que la nuit tombée à 20 heures 30 et la concentration des réfugiés que venait de souligner l'envoyé spécial du HCR rendaient dangereuse toute action aérienne. Le général Janvier avait pourtant pour la première fois estimé qu'à ne rien faire on ouvrait la voie aux Serbes qui étaient alors en mesure de contourner les positions d'arrêt installées depuis le matin par les Néerlandais, mais le commandant Karremans indiquait lui que la position d'arrêt lui semblait alors tenable. On entre alors dans un de ces mystères que seuls les historiens pourront peut-être élucider. En fin de soirée, deux prévisions contradictoires sur l'action des Nations unies sont présentées, simultanément (ou presque) pour le 11 juillet au matin ; la première par le quartier général des Nations unies à Zagreb, la seconde par le commandant Karremans. Le quartier général des Nations unies indique clairement qu'un appui aérien rapproché pourra avoir lieu dès 6 heures le lendemain matin à condition qu'une nouvelle demande en ce sens soit présentée fixant en particulier les cibles à atteindre ; au même moment, le commandant Karremans explique de bonne foi aux autorités locales bosniaques que des frappes aériennes massives auront lieu à la même heure sans qu'aucune demande nouvelle soit nécessaire. Malgré les demandes qu'elle a présentées aux différents protagonistes auditionnés, la Mission d'information n'est pas plus en mesure de dire pourquoi un tel « malentendu » a pu ainsi exister au sein de la FORPRONU. Quoi qu'il en soit ce malentendu pèsera fort lourd le lendemain matin car aucune demande ne sera présentée pour l'intervention de l'aviation. f) 11 juillet : la chute de l'enclave et l'intervention tardive de l'OTAN Chacun comprend, au vu de ce qui vient d'être dit, que la journée du 11 commence sur ce que le Secrétaire général des Nations unies appelle la « confusion initiale au sujet de l'appui aérien rapproché ». Pour des raisons qui demeurent obscures, le QG de Tuzla, dont dépend Srebrenica, confirme au contingent néerlandais que des avions de l'OTAN atteindront leurs cibles pour des « frappes aériennes » au petit matin ; dès lors les militaires de la FORPRONU se mettent dans des abris et deviennent indisponibles pour d'autres missions en attendant que les frappes interviennent. Celles-ci n'intervenant pas, le même quartier général indiquera alors à Srebrenica qu'aucune demande n'a été présentée pour des frappes aériennes. Comme le dit le Secrétaire général dans son rapport, « le bataillon néerlandais sur le terrain attendait des frappes aériennes et le haut commandement, de son côté, attendait qu'on l'informe que l'attaque serbe avait repris et qu'un appui aérien rapproché était nécessaire ». Malgré sa grande compréhension des difficultés de l'action de la FORPRONU, la Mission d'information reste confondue devant de tels désordres, d'autant qu'en l'espèce ces dysfonctionnements pèseront très lourds dans les heures qui vont suivre. L'enquête des Nations unies montre que c'est entre Sarajevo, Tuzla et Srebrenica que s'est opéré le malentendu : Sarajevo et Zagreb disposaient de la même information ; Srebrenica d'une autre et Tuzla semble avoir été au centre du dysfonctionnement même si ce ne sont pas nécessairement des militaires de Tuzla qui sont responsables du malentendu. Quoi qu'il en soit, on est entré dans une période de grande incertitude : quand le malentendu a été levé de nouvelles demandes d'appui aérien ont semble-t-il été rapidement présentées par oral ; mais, à supposer qu'il en ait été ainsi, ce qui n'est pas acquis, celles-ci n'ont pas été transmises à Zagreb, les militaires présents à Sarajevo ne se rappelant pas les avoir reçues... On comprend que, vu ce qui se passera dans les jours qui vont suivre, chacun, à quelque niveau qu'il soit, cherche à s'exonérer de toute responsabilité dans ce drame. Reste que toute cette matinée suscite un réel malaise ; le malentendu perdure jusqu'à 10 heures. A ce moment les avions de l'OTAN, qui sont en vol depuis 6 heures du matin, doivent revenir à leur base et ne seront de nouveau disponibles qu'à 14 heures environ. Entre-temps, vers 11 heures, les Serbes ont repris leur attaque en tirant directement sur les Néerlandais et le général Janvier a recommandé un appui aérien, que M. Akashi a accepté à 12 heures 17. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies observe que c'est le formulaire du 9 juillet qui a été utilisé le 11 juillet ; reste que le malentendu du 10 juillet au soir et du 11 juillet au matin a conduit à retarder d'autant l'utilisation de l'arme aérienne. Etait-ce parce que ces cibles n'étaient pas identifiables, comme l'a laissé supposer le général Janvier ? Pourtant, M. Daniel O'Brien, directeur de l'antenne médicale de Médecins sans frontières à Srebrenica, indique que, le 11 juillet au matin, « trois soldats britanniques se trouvaient devant le bâtiment des PTT, en face de l'hôpital, et lorsqu'ils sont sortis, les gens ont commencé à courir en craignant que les attaques aériennes ne commencent. » Vos Rapporteurs considèrent que ces soldats britanniques pouvaient être des guideurs au sol. Ils semblent d'ailleurs avoir été identifiés comme tels par les populations qui fuyaient. L'audition du général Rupert Smith aurait probablement permis d'éclairer ce point. Les forces serbes ont continué leur avancée et, comme le dit le Secrétaire général, le drapeau serbe flottait sur la ville à 14 heures 07, « le bataillon néerlandais, pour sa part, n'avait pas tiré un seul coup de feu contre les forces serbes qui progressaient ». Quelques minutes plus tard, des avions de l'OTAN ont survolé l'enclave, et deux d'entre eux ont tiré sur des chars serbes. A ce stade on peut considérer que la composante militaire de la prise de Srebrenica est achevée. Certes, comme on le verra dans la partie sur l'action de la France, des projets ont été élaborés tendant à reprendre l'enclave ; par ailleurs les Nations unies ont, comme à l'accoutumée, condamné et exigé... Mais tout cela était sans conséquence... Le Ministre de la Défense néerlandais, M. Voorhoeve, avait dit le 10 juillet que son Gouvernement s'en remettait aux autorités de la FORPRONU pour décider s'il fallait utiliser l'arme aérienne. Mais dans l'après-midi du 11, le changement de ton à La Haye était manifeste. Le Ministre des Affaires étrangères, M. Van Mierlo, faisait part à M. Klaus Kinkel, alors Ministre allemand des Affaires étrangères, et à M. Akashi que le Gouvernement néerlandais avait changé d'avis et souhaitait la suspension de toute contre-attaque de quelque nature que ce soit. D'après une source interne au cabinet du Premier ministre néerlandais de l'époque, il semble que la position prise la veille par M. Voorhoeve n'avait le soutien ni du reste du Gouvernement ni du Parlement néerlandais. Les Serbes avaient pris Srebrenica et entendaient désormais « régler » le sort des autres enclaves de Zepa et Gorazde. Mais surtout ils entendaient éliminer les populations musulmanes afin que ces enclaves n'en soient plus, et ceci définitivement. En conclusion, vos Rapporteurs souhaitent souligner qu'il leur paraît assez vain, et somme toute injuste, d'imputer la chute de l'enclave à telle ou telle décision particulière ou à telle ou telle erreur ou défaillance. Il est hautement vraisemblable qu'une réaction ferme soit au sol soit par l'arme aérienne, à un moment quelconque de l'attaque entre le 6 juillet et le 11 juillet dans la matinée, voire même dans l'après-midi, aurait suffi à endiguer, voire à stopper, l'attaque serbe et ainsi à éviter la tragédie qui allait suivre. Mais c'est un enchaînement d'erreurs et d'insuffisances qu'on ne peut que constater tout au long de ces journées : de l'absence des uns à la non-réaction des autres, tout a concouru à l'échec des Nations unies. Dans ce contexte, et sauf à considérer que les supérieurs hiérarchiques ne sont responsables que des victoires, on doit admettre que le responsable civil sur place de l'opération et le général qui commandait en chef n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. On aimerait connaître le sentiment de ceux qui les ont choisis pour exercer ces fonctions. Quant à l'autorité civile à New York, elle a été inexistante. 2) 11/17 juillet : « le grand massacre » Cet intitulé, repris de la traduction française du livre de David Rohde sur le massacre de Srebrenica, dit bien l'horreur qui a suivi la prise de l'enclave. En quelques jours - les massacres se concentrent du 13 au 17 - ce sont de 7 000 à 8 000 personnes qui vont trouver la mort. Plus de la moitié des victimes seront exécutées alors qu'elles étaient désarmées, prisonnières des Serbes : leur exécution sera souvent accompagnée d'actes traduisant un sadisme de la part des bourreaux - le terme n'est pas trop fort - qu'on croyait ne pas devoir revoir en Europe : des hommes contraints de creuser leur propre tombe, par exemple... Vos Rapporteurs resteront volontairement silencieux dans cette description des horreurs, car il ne souhaitent pas faire part de l'émotion qui a été la leur à l'audition de certains témoignages. Dès lors, le plus souvent, ils se contenteront de laisser la parole aux témoins et de renvoyer pour le surplus le lecteur aux actes d'accusation et aux jugements du Tribunal pénal international concernant le massacre de Srebrenica, notamment dans l'affaire Krstic. Mme Christina Schmitz, infirmière allemande à l'antenne MSF, a raconté devant la Mission d'information comment elle avait vécu les premières heures de l'occupation serbe : Le 12 juillet, en fin de matinée, « je me déplaçais constamment et je faisais des allers-retours entre l'hôpital improvisé de MSF et la population qui se trouvait à l'extérieur pour essayer de m'occuper des gens, des blessés. Les conditions étaient abominables. Les gens n'avaient aucun abri, n'avaient pas de quoi manger, n'avaient pas de quoi boire et gisaient dans leurs excréments. « Nous avons alors été informés que Mladic allait commencer la déportation de la population à Tuzla et l'évacuation des blessés au stade de football de Bratunac. Je suis allée le trouver pour contester cette intention, mais il m'a dit de faire mon boulot et il m'a tourné le dos pour partir. « Ensuite, on nous a annoncé que les plans avaient été changés, et la déportation a commencé, mais il s'agissait uniquement des gens qui avaient été déplacés par les forces bosno-serbes. Tout cela était tellement bien organisé que nous étions convaincus que c'était prévu et qu'il y avait un plan. « Devant le secteur des Nations unies, les hommes devaient se signaler et donner leurs coordonnées dans une maison où 35 hommes ont été retenus. J'ai exprimé mes vives préoccupations au commandant Franken ; il m'a assuré qu'ils étaient bien traités. J'en ai parlé également au commandant Karremans qui s'est dit sûr qu'aucun de ces hommes ne serait tué. Malgré tout, peu de temps après, j'ai entendu le bruit d'armes légères autour de cette maison ». Vers 19 heures, l'évacuation des malades, qui attendaient à la base de la FORPRONU depuis deux jours, a commencé dans des véhicules conduits par des Casques bleus. C'était le chaos. Tout le monde voulait faire partie du convoi puisque tout le monde y voyait une possibilité de salut. Il est difficile de faire comprendre le désespoir, mais les gens sautaient sur les camions et d'autres ont demandé qu'on évacue leurs parents ou leurs malades. Neuf infirmières bosniaques et un technicien médical ont pu accompagner ce convoi. « A 7 heures du matin, jeudi 13 juillet, la déportation des civils a repris. Les Casques bleus essayaient de maintenir un bon ordre en formant une chaîne humaine. Tous ceux qui auraient pu arrêter cet exode de masse ou qui pensaient qu'il était possible de stopper cet exode devraient être forcés de constater de visu le climat de panique et de désespoir de cette population. On poussait les gens comme des animaux. Il y avait des enfants qui hurlaient dans les bras de leurs mères qui fuyaient, désespérées. « L'après-midi, un père qui portait dans ses bras un bébé d'un an est venu me trouver. Il pleurait et il était accompagné d'un soldat bosno-serbe en arme. J'ai compris qu'ils devaient être séparés. Il m'a remis son bébé. C'est une scène horrible que je ne pourrai jamais oublier. J'ai dû écrire le nom de l'enfant et j'ai su que ce père n'allait plus jamais revoir sa petite fille. « Plus tard, j'ai été informée par la FORPRONU que des cadavres gisaient derrière l'usine. Un soldat de l'armée bosno-serbe m'a dit que si je voulais y aller pour en avoir la confirmation, avec un militaire des Nations unies, libre à moi, mais qu'il ne pourrait garantir ma sécurité. Je n'y suis pas allée. « Vers 16 heures, la partie extérieure du camp était vide et la déportation des personnes déplacées a commencé à l'intérieur de l'enceinte de la FORPRONU. Les Casques bleus ont aidé les personnes déplacées à se rendre jusqu'à la porte extérieure et on nous a dit qu'à l'extérieur de l'enceinte, les gens étaient pris par des militaires qui séparaient les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, et que les gens étaient mis sur des véhicules distincts. 25 000 personnes ont ainsi été évacuées en l'espace de deux jours. » La Mission d'information s'est rendue en Bosnie-Herzégovine, notamment à Srebrenica. Elle a pu alors avoir une conversation avec des victimes de Srebrenica, en fait des femmes qui ont perdu leur mari et leurs fils durant la tragédie. Les témoignages se ressemblent malheureusement tous. Vos Rapporteurs veulent citer celui de Mme Mirsada Bosnjakovic qui les a particulièrement touchés : « Je vais vous raconter mon histoire. Le 12 juillet à midi, Mladic est venu avec ses Tchetniks tous fortement armés avec des mitraillettes et des sabres. Ces militaires serbes sont rentrés parmi nous, les mères, qui n'étions pas armées. Il y avait un bébé qui pleurait. Le Tchetnik a dit à la mère de faire taire son bébé, mais elle n'a pas réussi. Il a alors attrapé le bébé par le bras, a pris le couteau, l'a égorgé et a jeté la tête d'un côté et le corps de l'autre. Nous sommes toutes restées muettes, impuissantes. A ce moment-là, un millier de nos proches avait déjà été emmené. Il y avait du sang partout. Pendant que certaines personnes étaient égorgées, d'autres étaient violées, d'autres encore se pendaient, tandis qu'au même moment, des femmes accouchaient. Nous n'avions que deux pierres pour couper le cordon ombilical. C'était l'horreur. On ne peut pas l'expliquer. « C'est à ce moment-là qu'on a emmené mon fils. Lorsque j'ai crié, Mladic m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que j'avais peur. Il m'a demandé si j'avais de la famille, je lui ai dit que j'avais un fils, et ils m'ont pris mon fils. » La plupart des interlocuteurs de la Mission d'information ont indiqué que les massacres qui ont suivi la prise de Srebrenica n'étaient pas prévisibles, au motif que les Serbes avaient arrêté les massacres massifs depuis 1992 : l'argument a notamment été donné par le Président Izetbegovic lors de l'entretien qu'il a eu avec la Mission d'information à Sarajevo. L'affirmation selon laquelle les massacres étaient imprévisibles laisse cependant perplexe : d'une part, comme on l'a dit, la spécificité de Srebrenica avait été soulignée dès 1993, notamment par le Président Milosevic auprès du général Morillon et de Lord David Owen. D'autre part, les massacres ne s'étaient pas véritablement arrêtés : on en voudra pour seule preuve le témoignage apporté par le commissaire Ruez, qui a enquêté pour le compte du procureur du TPI sur les massacres en Bosnie-Herzégovine. Celui-ci a rappelé qu'au mois d'avril 1995, c'est-à-dire trois mois seulement avant le massacre de Srebrenica, les personnes habitant des villages environnant Bratunac ont été « invitées » à se regrouper dans cette ville et que « celles qui ne l'ont pas fait ont vu leurs villages encerclés, et certaines ont été massacrées ». M. Ruez a ensuite précisé que « lors de ce rassemblement de populations dans Bratunac, un premier massacre a eu lieu et a concerné entre 150 et 300 personnes qui enfermées dans l'école Vuk Karadzic ont été massacrées à l'aide d'objets contondants et d'autres choses. La fosse commune rattachée à ce massacre a été découverte en décembre 2000, donc, très récemment. Elle se trouve à proximité de la ville de Bratunac et devra être exhumée ». Sans doute tous les massacres antérieurs à juillet 1995 n'étaient-ils pas connus. On peut cependant douter du fait qu'une partie de l'information n'ait filtrée. Dès lors, arguer, en particulier du côté des autorités bosniaques, de l'absence de prévisibilité des massacres pour justifier la faiblesse de la défense de l'enclave paraît un peu abusif. Du reste pour les populations de l'enclave elles-mêmes, le caractère prévisible des massacres ne faisait aucun doute. Le 11 juillet 1995, quand tous les responsables militaires et civils de l'enclave réalisent qu'elle va tomber, la population est confrontée au dilemme : partir ou rester. Compte tenu des risques encourus, indique le commissaire Ruez, « tous les hommes valides, la majorité d'entre eux, se réunissent dans une zone de l'enclave et, dans la nuit du 11 au 12, commencent à s'exfiltrer de l'enclave en colonne par un pour traverser un champ de mines, dans le but de longer la route Bratunac, Konjevic, Polje, ensuite de remonter la vallée de la Cerska et de s'échapper dans cette direction. « L'armée est en tête, environ un tiers de ces personnes portent des armes et environ deux tiers sont non armés. La majorité d'entre eux ne connaissent pas les lieux étant originaires d'autres régions. « Le 12 juillet, la colonne perce les lignes serbes à hauteur de la vallée de la Cerska et ne rencontre aucune opposition. C'est une force assez massive et le périmètre n'est pas encore complètement saturé par les forces serbes. Une fois que la plus grande masse d'hommes en armes est passée, toute cette zone est bloquée et tout le monde se retrouve piégé dans cette partie du territoire ». Pendant ce temps (le 11 juillet), les femmes et les enfants ainsi que les hommes qui ont choisi de demeurer à Srebrenica « se transfèrent en direction de Potocari où se trouve la base des Nations unies dans l'enclave. La nuit du 11 au 12 juillet se passe dans le calme pour eux ». Mais pour eux, en particulier pour les hommes, va commencer le calvaire. Laissons le commissaire Ruez présenter son rapport. « Dans la nuit du 12 au 13 juillet, les forces serbes qui se trouvent à Srebrenica, donc, essentiellement une brigade de la police spéciale du ministère de l'Intérieur, ainsi que des éléments de la brigade de Bratunac, commencent à séparer les hommes des femmes et des enfants, se rendant sur leur lieu d'habitat provisoire, c'est-à-dire des usines qui se trouvent à cet endroit-là, ainsi que des champs à l'air libre. Tous les hommes sont emmenés dans des lieux de détention, essentiellement une maison qui se trouve juste en face du quartier général des forces onusiennes présentes dans l'enclave. « Le 13 juillet, l'évacuation-déportation de cette population commence. Les hommes sont systématiquement séparés de leur famille et parqués dans une maison. Une fois que la maison est pleine, des autobus arrivent, se chargent de les emmener à Bratunac qui devient donc le premier lieu de détention pour les hommes qui sont séparés de leurs femmes et de leurs enfants. « A l'occasion du transfert de la population en autobus, il y a un certain nombre de points de contrôle militaires où les hommes qui ont réussi à monter à bord sont séparés également. Le dernier lieu de séparation est une petite école en limite de zone de séparation, zone de confrontation à l'époque, l'école de Tisca. Un certain nombre d'exécutions se déroulent à l'occasion de ce processus, au moment où les gens sont débarqués des autobus ». Ces exécutions sont importantes, car ce sont elles qui vont déclencher les premières réactions dans les media : c'est dès le 14 juillet qu'un Ministre néerlandais présent à Tuzla parlera de génocide ; mais la présence d'otages néerlandais aux mains des Serbes conduira d'une manière générale ceux qui étaient le plus au courant à se taire. Revenons avec le commissaire Ruez sur la situation de ceux qui tentent de traverser les lignes serbes pour s'échapper de l'enclave. « La colonne continue son chemin pendant cette période de temps (le 13 juillet). Il y a des combats extrêmement violents avec les forces serbes qui essayent de leur monter des embuscades sur le trajet. A un moment, une partie de la colonne se déroute pour faire croire à une attaque sur Zvornik afin de libérer la pression justement sur le reste de la colonne. C'est dans la journée du 13 juillet que le plus grand nombre de prisonniers est capturé. Au cours d'activités militaires pendant la nuit, infiltration de la colonne et bombardement de la colonne, les gens sont paniqués et ne savent pas où aller. « Les forces serbes le long de la route donnent des garanties de sécurité à l'aide de mégaphones à tous les gens qui sont dans la forêt. Le matériel qui a été volé aux Casques bleus est utilisé. Des promesses de sécurité sont données, du genre : "Rejoignez-nous. Vous allez rejoindre vos femmes et vos enfants. La Croix-Rouge est là. Les Nations unies sont là". Aussi, un certain nombre de personnes décident de se rendre, et cela génère un mouvement massif de redditions. Les lieux sur lesquels les gens sont parqués en attente de transfert sont essentiellement un terrain de football à Nova Kasaba et plusieurs champs à un lieudit Sandic. De là, au cours de la journée du 13 juillet, ils sont systématiquement transférés sur Bratunac par camions ou par autobus et rassemblés dans plusieurs bâtiments publics à Bratunac. Le premier bâtiment utilisé était un hangar, puis une école. Au final, ces lieux sont tellement pleins que les gens restent à bord de convois d'autobus et de camions qui restent parqués en ville. « Le premier massacre a lieu dans l'après-midi du 13 juillet. Un vaste groupe de prisonniers est emmené dans un hangar à Kravica. Une fois que ce hangar est totalement plein de prisonniers, les gardes ouvrent le feu par toutes les ouvertures, jettent des grenades à l'intérieur et massacrent l'intégralité des personnes qui y sont enfermées. J'en évoque également un autre proche de l'intersection de Konjevic-Polje où plusieurs groupes de prisonniers sont exécutés à l'arme automatique. En fait tout un tas de petites exécutions soit individuelles, soit avec quelques petits groupes ont lieu dans cette zone. En fin de journée, lorsqu'il n'y a plus de moyens de transport et s'il reste des prisonniers sur un champ, l'ordre est de les exécuter. « Au final, le 14 juillet au matin, l'intégralité des prisonniers se trouve dans la ville de Bratunac. L'évacuation de ces prisonniers commence. Je passe sur les promesses faites par le général Mladic qui se rend sur pratiquement tous ces lieux de détention. Il tient plus ou moins systématiquement le même discours à la population, lui demandant si elle le reconnaît, et lui fait un petit discours pour expliquer vers quelle misère la politique d'Izetbegovic l'a menée. Il donne aux gens des garanties de sécurité, leur promettant qu'ils vont rejoindre leurs familles, qu'ils vont faire l'objet d'un échange de prisonniers. « Le 14 juillet au matin, on évacue le premier lieu de détention, un hangar, où pendant la nuit une cinquantaine de personnes ont été tuées à l'arme blanche et à coups d'objets contendants. « Les prisonniers sont emmenés dans un convoi d'autobus. Ils prennent la direction de Zvornik, tournent en direction de Tuzla, mais finalement sont orientés sur une école, que nous appelons l'école de Orahovac, (à ne pas confondre avec Orahovac au Kosovo). Ils sont parqués dans un gymnase au fur et à mesure de la journée, convoi après convoi. Ce gymnase est rempli de prisonniers. « Au même moment, d'autres convois évacuent les prisonniers de Bratunac, dépassent Zvornik, puis tournent à gauche et emmènent tous ces gens dans une école qui s'appelle l'école de Petkovci. Même scénario, au fur et à mesure de la journée, l'école est remplie. Il n'y a pas de gymnase. C'est une école à deux étages. Toutes les salles de classe sont pleines. Là, les prisonniers subissent énormément de mauvais traitements. « En milieu d'après-midi, après la visite du général Mladic sur le site d'Orahovac, les prisonniers sont emmenés dans un petit camion, groupe après groupe, vers un champ qui se trouve à 800 m de l'école où un commando d'exécuteurs les attend et systématiquement les exécute petit camion après petit camion. L'exécution dure toute l'après-midi et continue pendant la nuit. Durant l'exécution, un bulldozer est sur place et creuse une fosse commune pour enterrer les gens. L'exécution se termine en fin de soirée. Le scénario est le même à l'école de Petkovci, les prisonniers sont embarqués sur un camion. Ceux-là n'ont pas de bandeau sur la tête. Ils sont emmenés sur le plateau d'un barrage qui se trouve à proximité où là aussi un commando d'exécuteurs les attend et les exécute les uns après les autres leur demandant de choisir un espace libre parmi les cadavres qui jonchent le sol. « Toujours le même jour, il y a eu un détournement d'autobus avec 150 personnes à bord qui ont été emmenées dans la vallée de la Cerska où elles sont exécutées immédiatement et tombent sur le bas côté de la route. Une excavatrice arrive, prend de la terre sur une petite colline juste à côté et enterre ces gens. Le site ici a été exhumé. Les 150 cadavres ont été retrouvés les mains attachées et les pieds également pour certains d'entre eux. « Durant la journée du 15 juillet, l'évacuation continue. Un certain nombre de prisonniers sont mis dans une école et de là emmenés par camions sur un site d'exécution qui se trouve au bord de la vallée de la Drina où environ 500 personnes sont exécutées sur place et enterrées dans une fosse commune qui se trouve sur le site d'exécution. « Pendant la journée du 15 juillet, le transfert de prisonniers de Bratunac en direction de Pilica où se trouve une école avec un gymnase continue. Le gymnase est totalement plein et l'école à deux niveaux l'est aussi. Au cours de la nuit du 15 au 16 juillet, un autobus arrive avec des prisonniers qui sont exécutés sur place car probablement il n'y a plus de place à l'intérieur. « Mais en fait l'exécution ne commence que le lendemain, 16 juillet, autobus après autobus, selon le même scénario, promesse d'être échangés et de rejoindre leurs familles. Les gens sont emmenés de 10 heures du matin à 3 heures de l'après-midi à la ferme de Branjevo où les attend un commando d'exécuteurs qui se conduit d'une façon particulièrement sauvage sur ce site-là et exécute un nombre de personnes évalué par un des membres du commando d'exécution à 1 200. Le chiffre pour l'instant n'est pas confirmé. La confirmation de toutes ces données ne se fera que lorsque l'intégralité des exhumations aura été effectuée. Ce même jour, comme l'école de Pilica était pleine, des prisonniers ont été emmenés à la maison de la culture de Pilica où une fois l'exécution de la ferme de Branjevo terminée, les exécuteurs ont reçu l'instruction d'aller tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur de cette maison de la culture. Cela se passe effectivement pendant la journée du 16 juillet, et tous les gens à l'intérieur sont massacrés » Comment ces massacres ont ils été réalisés ? S'agit-il d'une de ces furies collectives que connaissent parfois certains pays ou cela a-t-il répondu à un plan bien arrêté ? A ces questions, le commissaire Ruez répond de la manière la plus claire. Il n'y aucun doute. « Il faut bien préciser et insister sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une action comme on en a malheureusement trop connu dans la période de conflit entre 1992 et 1995 où l'armée rentrait dans une zone et tuait tout le monde. Là, il s'est agi d'un processus parfaitement organisé avec déplacement systématique de gens. Qu'ils aient été militaires ou civils n'a plus vraiment fait de différence, ce sont tous des prisonniers emmenés d'abord dans des lieux de détention puis transférés à l'écart de cette zone pour des raisons évidentes de discrétion, et emmenés jusqu'à 70 kilomètres de distance dans des écoles, par des officiers de sécurité du Drina Corps ayant la veille repéré les lieux de détention, les sites d'exécution et organisé le transfert d'équipements lourds pour les enterrer. Les exécutions s'étalent sur une durée de trois jours, le 14, le 15 et le 16 juillet. Le 17 juillet, tout est terminé. Les fosses communes sont refermées. » Le commissaire Ruez a clairement démenti les rumeurs ou allégations imputant les massacres à des milices paramilitaires. « J'ai entendu dire que les paramilitaires étaient impliqués dans cette affaire, a-t-il dit. En fait, Arkan n'a pas participé à cette opération. Toutes les exécutions ont été commises par les unités régulières du Drina Corps ou par des unités spéciales rattachées à l'état-major général de l'armée, 10ème groupe de sabotage pour l'exécution de la ferme de Branjevo, 4ème bataillon de la brigade de Zvornik pour l'exécution de Orahovac et le jardin, 6ème bataillon pour les exécutions sur le plateau du barrage Petkovci ». Le commissaire Ruez a conclu en précisant que les autorités militaires serbes se sont rendu compte que des enquêtes pourraient être diligentées ultérieurement. « C'est pourquoi, à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, avant la signature des accords de Dayton, les auteurs de ces atrocités réalisent qu'il y aura certainement une enquête pour essayer de déterminer la véracité des rumeurs qui ont été lancées par la presse en juillet 1995, tout le monde hurlant au massacre certain de ces prisonniers. Une opération aussi massive que l'opération d'extermination est déclenchée visant à effacer les traces du crime en exhumant les corps de toutes les fosses communes, que nous appelons les fosses communes principales, et les répartir dans un certain nombre de fosses communes, que nous appelons les fosses communes secondaires. » Vos rapporteurs ne tiennent pas à aller au-delà : cela relève des tribunaux compétents. Il faut cependant dire que l'on a déjà exhumé 2 028 corps et que compte tenu du nombre de fosses communes déjà identifiées mais non encore fouillées, c'est au moins 4 000 corps d'hommes exécutés de sang-froid par les forces serbes, alors qu'ils étaient leurs prisonniers, qu'on retrouvera. Srebrenica c'est une dizaine d'Oradour en quatre jours. Vos Rapporteurs veulent souligner que cela ne recouvre que les prisonniers exécutés collectivement de sang froid par leurs geôliers. Si l'on y ajoute ceux morts au cours de la fuite, par exemple, Srebrenica c'est environ 8 000 morts, toujours en quatre jours. Les massacres étaient-ils prévisibles ? Revenons à la question essentielle : ces massacres étaient-ils prévisibles et pourquoi ceux qui disent les avoir prévus n'ont-ils pas pris des mesures ? La question a été posée à Mme Christina Schmitz, de MSF ; faut-il rappeler que MSF a vu une partie importante du personnel bosniaque de son antenne disparaître dans la tragédie. Le Président François Loncle lui ayant demandé : « Puisque vous avez indiqué à plusieurs reprises que cette attaque et ces massacres étaient prévisibles, pourquoi MSF n'a-t-il pas évacué ou tenté d'évacuer son personnel bosniaque ? » Mme Christina Schmitz a répondu : « Je dirai tout d'abord que la question reste posée à tout un chacun. Etait-ce prévisible ? Les autres savaient-ils ? Saviez-vous que ces choses se passaient ? Nous ne le savions pas mais, avec le recul, il semblerait que cela ait été prévisible. Pourquoi n'avons-nous pas retiré nos personnels bosniaques ? Nous souhaitions rester avec la population, quoi qu'il arrive. Si nous avions retiré à la fois notre staff international et national pendant la chute de l'enclave, qui serait resté avec la population à l'époque ? Nous ne le savions pas et je tiens à vous l'assurer : j'avais la certitude que j'allais y retourner. Nous ne savions pas que l'enclave allait être prise. « Le 11 juillet, comme je l'ai dit, je pensais que j'allais pouvoir y retourner et que ce serait uniquement un déplacement temporaire des gens ». En conclusion, difficile de se faire une idée précise. Quand a-t-on su ce qui s'était passé ? Vos Rapporteurs ne sont pas des historiens ; mais la question de savoir à quel moment les informations ont circulé sur les massacres est essentielle. En effet, nul ne peut savoir ce qui se serait passé si les massacres avaient été rendus publics entre le 13 et le 17 juillet. On ne peut cependant exclure que la dénonciation par la communauté internationale - par le Conseil de sécurité par exemple - des massacres aurait pu conduire à leur arrêt et ainsi à sauver un certain nombre de victimes. C'est du reste la raison pour laquelle tous les interlocuteurs de la Mission d'information - et plus encore bien entendu ceux qui ont refusé de témoigner - ont été d'une grande discrétion, lorsqu'ils ont eu l'occasion d'être interrogés sur l'état de leurs connaissances des massacres en 1995. On passera sur ce témoin dont la couardise le dispute à la sottise et qui a pu dire qu'il n'avait rien su avant que Mme Madeleine Albright, alors représentante permanente des Etats-Unis au Conseil de sécurité, ne produise des photos satellites en août 1995. Nous n'aurons pas la cruauté de citer son nom mais nul doute qu'il se reconnaîtra lui-même. Plus sérieusement, on sait que des informations ont été diffusées très rapidement ; mais nombre d'entre elles venaient de sources bosniaques et étaient donc sujettes à caution dans la mesure où il s'agissait d'une des parties au conflit. Les informations en provenance des ONG ont été assez limitées. Mais des informations très sérieuses existaient. D'une part les soldats néerlandais ont vu une partie importante des massacres et leur hiérarchie était tout à fait au courant. On en voudra pour seule preuve le témoignage du général Janvier devant la Mission d'information, lequel a notamment indiqué : « Nous avons su qu'il y avait eu... des assassinats parce que les soldats néerlandais les ont vus et en ont parlé. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai envoyé deux officiers, un Russe et un Français, dès le 13 juillet, pour essayer de se rendre sur place, mais ils ne passeront jamais Zvornic. » On peut, sans trahir la pensée du général Janvier, déduire de ce propos que, dès le 13 juillet, c'est-à-dire très tôt dans le processus des massacres, la hiérarchie militaire a été au courant, comme l'étaient, du reste, les responsables néerlandais, comme on l'a indiqué ci-dessus. Reste qu'ils pouvaient ne pas avoir conscience, à ce moment, de l'ampleur des massacres. Il semble que dans les milieux diplomatiques à Belgrade, on a eu très tôt vent des massacres. En effet, l'armée serbe était accompagnée d'au moins un journaliste lors de l'attaque et celui-ci a vu les massacres ; l'information a circulé dans les milieux de la presse serbe, et une diplomate néerlandaise mariée à un journaliste serbe a su très tôt ce qui se passait. Parmi les militaires, il semble que ce sont les Britanniques, et en particulier le général Rupert Smith, qui ont pris connaissance les premiers de l'ampleur des massacres. En effet, M Voorhoeve, alors Ministre de la Défense des Pays-Bas, a indiqué à la Mission d'information qu'au cours de la Conférence de Londres - c'est-à-dire le 21 juillet 1995 - le général Rupert Smith lui avait fait part de ses craintes concernant de 3 000 à 4 000 victimes. Il était au-dessous de la réalité, mais c'est semble-t-il, le premier responsable à avoir évoqué un nombre de victimes relativement proche de la réalité. Interrogé par la Mission d'information sur cette information le général Janvier a indiqué : « Pour ma part, s'il [le général Rupert Smith] le savait, je ne le savais pas. Lorsque nous étions ensemble à la Conférence de Londres, il ne m'a pas donné cette information. Je pense qu'il pouvait le savoir par les Américains, par un accès à des sources qui n'étaient pas les miennes. » Puisque la Mission d'information n'a pu entendre le général Rupert Smith, on souhaiterait que la Chambre des Communes poursuive le travail entrepris afin que progressivement la lumière se fasse sur l'enchaînement des faits. Ce qui est certain, c'est que les Américains - par la voix de Mme Albright - ont, le 10 août, rendu publiques des photos satellites, photos qui dataient du 17 juillet et des jours suivants. Ces photos ne montrent pas les massacres eux-mêmes, mais les déplacements d'engins et de terre, correspondant aux fosses communes dans lesquelles ont été enterrées les victimes, souvent déplacées par les Serbes au cours des mois suivants pour rendre les poursuites plus difficiles. S'agissant du Gouvernement français, la seule chose qu'on puisse dire est qu'il n'a pas fait d'excès de zèle ni pour informer sur ce qui se passait, ni même pour s'informer lui-même. On en voudra pour seule preuve cette déclaration, assez surprenante, d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères le 25 juillet 1995. Interrogé sur les informations concernant des massacres de Musulmans à Srebrenica, le porte-parole répondait avec la langue de bois habituelle : « Nous n'avons pas, pour notre part, confirmation de ces massacres », mais ajoutait montrant par là une grande indifférence vis-à-vis de ces « éventuels » massacres : « C'est à la FORPRONU de l'établir ». Aux yeux du ministère des Affaires étrangères français, il n'appartenait pas au Gouvernement français d'essayer de s'informer... Chacun appréciera. Le 7 août encore, à l'occasion d'un entretien avec le chargé d'Affaires yougoslave à Paris, le représentant du ministère des Affaires étrangères « banalisait » les massacres de Srebrenica en soulignant à son interlocuteur que « la préoccupation de la France était la même pour le sort des réfugiés serbes de Krajina que pour celui des populations musulmanes de Srebrenica et Zepa ». Il faudra attendre l'automne 1995 pour que la France reconnaisse, enfin, le caractère spécifique des massacres de Srebrenica. II. POURQUOI SREBRENICA ? ANALYSER L'INACCEPTABLE Six années ont passé depuis la tragédie de Srebrenica. L'émotion, la douleur, voire la ranc_ur restent intactes chez les survivants, dont la Mission d'information a pu constater le désarroi et la misère, matérielle et morale, lors de son déplacement en Bosnie-Herzégovine. Seule la recherche de la vérité peut favoriser le nécessaire travail de deuil chez ces femmes, ces enfants qui n'ont plus que le souvenir de leurs proches. Le temps est venu de l'analyse rigoureuse, après celui de l'émotion, des accusations et des polémiques. La France a été et reste directement visée par celles-ci, notamment à travers celui qui était alors le commandant des Forces de paix des Nations unies (FPNU) en ex-Yougoslavie, le général Bernard Janvier. Etant donné l'horreur des événements, qui ne peut comprendre la réaction des survivants qui pointent un doigt accusateur sur tel ou tel, surtout quand ils ne connaîtront probablement jamais le visage de l'homme qui a effectivement assassiné leur père, leur mari, leur fils ou leur frère ? La vertu cathartique du bouc émissaire n'est pas nouvelle. La Mission d'information ne prétend nullement poser en a priori l'infaillibilité d'un général français : il est même de son devoir d'examiner en toute objectivité et en toute rigueur, l'ensemble des accusations portées. Ainsi, elle ne sous-estime pas les erreurs commises par le général Janvier, puisqu'il est aujourd'hui le principal visé. Nul doute que les atermoiements du commandant de la force de l'ONU ont joué un rôle dans le drame, tout comme la mentalité pacifiste de l'ONU, incarnée par le Représentant spécial, a eu des effets majeurs. Mais, si l'on montre du doigt quelques individus, il faut être complet et citer les erreurs commises sur le terrain par le bataillon néerlandais (absence totale de tirs sur les Serbes, confusion sur la nature de l'intervention aérienne, démantèlement de la défense bosniaque déjà faible, silence sur les atrocités), l'absence de deux officiers britanniques à un moment-clé, le « cafouillage » au niveau des officiers néerlandais à Tuzla, la scandaleuse attitude des autorités bosniaques qui laissèrent des milliers de réfugiés exposés aux tirs serbes sur l'aéroport de Tuzla, la défaillance des services de renseignement nationaux, l'incroyable carence de Yasushi Akaski dans le compte rendu de situation qu'il fait aux membres du Conseil de sécurité le 10 juillet, ou encore l'inertie des dirigeants du HCR. En bref, aucun des protagonistes n'échappe à la critique. Ceci dit, derrière les hommes, même derrière ceux qui les commandaient, existaient une structure et des Etats ; et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut examiner pour tenter de comprendre ce qui s'est passé en juillet 1995. En définitive, l'analyse des responsabilités dans la tragédie de Srebrenica recouvre trois questions majeures : - la chute de Srebrenica était-elle inscrite dans la logique même de l'action internationale de l'ONU en Bosnie-Herzégovine et plus particulièrement dans la résolution qui la proclame zone de sécurité ? - en dépit d'un statut hybride et fragile, la zone de sécurité de Srebrenica aurait-elle pu être sauvée par les actions adéquates de la FORPRONU et de l'ensemble des responsables militaires et politiques impliqués dans le conflit bosniaque contre l'offensive serbe ? - existe-t-il une responsabilité particulière de la France du fait d'une part, de son rôle moteur dans la politique internationale suivie en Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, du rôle du général Janvier à la tête des FPNU ? Notamment, y a-t-il eu un marchandage entre Serbes et Français sur la libération des otages et l'absence de frappes aériennes ? A - SREBRENICA OU L'ÉCHEC TRAGIQUE D'UNE POLITIQUE INTERNATIONALE L'ensemble des témoins auditionnés par la Mission d'information a mis en cause l'inadéquation de la politique suivie en ex-Yougoslavie par l'ONU. Il est indéniable que cet outil qu'est l'ONU était totalement inadapté pour intervenir dans un pays en guerre. En tant que structure, l'ONU n'en avait ni les moyens, ni surtout la culture. Cette responsabilité de la structure onusienne trouve toutefois rapidement ses limites : l'ONU est un outil actionné par les Etats qui en sont membres. Elle ne fait que mettre en oeuvre ou, en l'occurrence, tenter de le faire, les missions qui lui sont assignées par les Etats, au premier rang d'entre eux les membres du Conseil de sécurité. Comme l'a rappelé Jean-Claude Mallet, à l'époque directeur de la délégation des affaires stratégiques au ministère de la Défense, « il faut prendre garde à ne pas employer un langage qui pourrait très vite stigmatiser les Nations unies. En fait, nous sommes les Nations unies, d'autant que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Cela vaut pour tous les membres permanents du Conseil de sécurité ». N'oublions pas en outre que c'est par défaut que l'ONU a été engagée en ex-Yougoslavie : aucun chef d'Etat européen, ni américain, n'a souhaité faire la guerre aux Serbes, qui furent les agresseurs dans ce conflit. 1) L'ONU dans la guerre, un outil inadapté Même si l'ONU n'est qu'un instrument au service des Etats, il n'en reste pas moins qu'au moment où elle intervient en ex-Yougoslavie, cinquante années d'expérience ont forgé des habitudes, des comportements, en bref, une culture institutionnelle spécifique. Or, celle-ci se heurte de plein fouet aux réalités du théâtre yougoslave : une guerre particulièrement cruelle dans la mesure où elle vise, non seulement la conquête de territoires, mais surtout les populations civiles elles-mêmes. Ces populations, dont l'action de l'ONU, exclusivement humanitaire, vise à soulager la souffrance et les privations liées au conflit, sont en effet l'enjeu profond de cette guerre, comme l'illustre la naissance d'un nouveau concept : le « nettoyage ethnique ». Srebrenica en fut l'exemple patent. Il semble pourtant que personne n'ait compris à l'époque quelle était la nature profonde du conflit yougoslave, avant que le général Mladic, loin de se contenter de la prise du territoire de l'enclave, ne fasse sonner, comme il l'annonça alors, « l'heure de la vengeance contre les Turcs » et n'organise le massacre systématique de plus de 7 000 personnes. a) Culture de paix contre « nettoyage ethnique » : un décalage dramatique entre la mentalité onusienne et la réalité du terrain Si les forces des Nations unies envoyées en ex-Yougoslavie le sont à des fins strictement humanitaires, conformément à la volonté des Etats, il n'en reste pas moins que tous les contingents nationaux sur place ont été frappés par la culture très particulière des structures de l'ONU qui, même dans les cas de légitime défense, même face aux provocations patentes des forces serbes qui bloquaient les convois, étaient obsédées par un impératif : rester neutre, ne pas donner l'impression de s'engager en faveur de l'une ou l'autre partie au conflit. Comme l'a souligné l'amiral Lanxade, « nous avons été dès lors confrontés à la culture de maintien de la paix de l'ONU, culture qui s'était formée durant la guerre froide et qui n'était pas adaptée à la nature du conflit yougoslave ». Tous les interlocuteurs, civils et militaires, de la Mission d'information ont mis en avant cette spécificité : la FORPRONU et, de manière générale, l'ensemble des forces de paix des Nations unies présentes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie vivaient dans une culture de mission de paix qui les conduisait, par exemple, à croire, chaque fois qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu, que c'était le dernier, chaque fois qu'un accord de démilitarisation était signé dans une zone de sécurité, que plus aucune arme ne circulerait dans ledit périmètre. Nul besoin de rappeler les dizaines de cessez-le-feu immédiatement violés, la présence permanente d'armes, à Srebrenica par exemple, même s'il s'agissait essentiellement d'armes légères. Le travail de l'ONU sur le terrain peut se résumer à ces heurts permanents entre une culture de paix et une réalité en total décalage. Comme l'a fait remarquer, non sans ironie, M. Henry Jacolin, alors ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine, « la FORPRONU était en quelque sorte payée par la communauté internationale pour y croire ... ». Cette culture institutionnelle, les responsables civils de l'ONU ne tentèrent à aucun moment de la remettre en cause, en tirant les conséquences d'une situation manifestement inédite qui n'avait rien à voir avec le maintien de la paix traditionnel. Elle fut au contraire constamment revendiquée et rappelée aux responsables militaires qui s'y sont plus ou moins pliés. La manifestation la plus visible en était la tenue des soldats de l'ONU et le caractère visible des véhicules militaires : « Les troupes de maintien de la paix des Nations unies ne sont pas dotées de capacité de combat. Le fait est, comme l'a dit le général Michael Rose, que l'on ne peut pas faire la guerre avec « les véhicules peints en blanc » des Nations unies si voyants», a souligné M. Yasushi Akashi, alors Représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie. C'est d'ailleurs parce que les soldats n'étaient pas là pour combattre que certains pays purent se permettre d'envoyer des contingents qui n'avaient de soldats que le nom, sans armes, voire sans uniformes. Pour d'autres, les actions de corruption, voire les activités délictuelles auxquelles ils se livraient, heurtaient de plein fouet la notion de discipline militaire. Autre manifestation de cette culture spécifique, l'instauration d'une dyarchie, civile et militaire, à la tête des forces déployées sur le terrain. Tel n'avait pas toujours été le cas, cependant, puisque ce n'est qu'à l'issue du mandat du général Morillon qu'un délégué civil permanent, M. Stoltenberg, fut nommé aux côtés du responsable militaire. Le général Morillon s'est félicité de la marge d'initiative que lui offrait cette double casquette, marge qui lui permit d'ailleurs de « forcer la main » aux responsables politiques en promettant la protection aux habitants de Srebrenica ... et valut à son successeur de se voir adjoindre un responsable civil. Si la culture pacifiste de l'ONU fut si prégnante en ex-Yougoslavie, c'est aussi parce que tant le contexte historique, l'évolution du conflit yougoslave que le caractère des hommes présents aux postes de responsabilité vinrent la renforcer. S'agissant tout d'abord du contexte, il faut rappeler que l'on se situe, en 1995, après l'intervention catastrophique des Nations unies en Somalie. M. Yasuhi Akashi l'a rappelé : « Rétrospectivement, les forces des Nations unies de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine avaient peut-être retenu une leçon de trop de l'amère expérience de l'usage de la force, celle qu'avaient subi leurs collègues en Somalie et qui avait abouti à de lourdes pertes et au retrait définitif des Nations unies. " Ne jamais dépasser la ligne de Mogadiscio " devint une devise dans la FORPRONU, ce qui signifiait qu'il ne fallait jamais éveiller l'hostilité d'une des parties en guerre, au point d'en faire un ennemi mortel des Nations unies ». Au-delà de ce contexte historique général, l'évolution même du conflit yougoslave a contribué à conforter l'obsession onusienne de la neutralité, à rebours de la réalité même qui désignait clairement les agresseurs. Par nature hostiles à l'usage de la force même dans le cadre du mandat, les représentants de l'ONU ont interprété les conséquences malheureuses de certaines frappes aériennes, notamment la prise en otage de 300 Casques bleus suite au bombardement d'objectifs limités à Pale par l'OTAN les 25 et 26 mai 1995, comme la démonstration de l'inutilité du recours à la force. Ainsi, dans son rapport du 30 mai 1995, à deux mois de la chute de Srebrenica, le Secrétaire général des Nations unies réitère la nécessité, pratique et juridique, de ne recourir à la force aérienne qu'en cas de légitime défense de la seule FORPRONU, à l'exclusion de toute riposte à des attaques contre les enclaves. La référence au Chapitre VII de la Charte ne porte, rappelle-t-il, que sur la sécurité de la Force. Selon M. François Léotard, « Nous sommes passés à ce moment là de l'ambiguïté à l'aveuglement et de l'impunité à la lâcheté ». Et M. Léotard de relever : « Il n'est pas inintéressant de remarquer que ce rapport a été examiné par le Conseil de sécurité le 16 juin 1995, un mois exactement avant les atrocités de Srebrenica, mais qu'apparemment il n'a pas été approuvé ». Si l'on parle de lâcheté et d'aveuglement en mai, comment qualifier, dès lors, l'intervention du Secrétaire général des Nations unies au moment même où Srebrenica est attaquée, que M. Kofi Annan rappelle dans son rapport : « Le jour même où l'attaque de Srebrenica a commencé, le Secrétaire général a de nouveau rencontré les pays contributeurs des Forces et a réaffirmé que la Force de réaction rapide ne serait pas utilisée pour imposer la paix ». Dans le même ordre d'idées, nous pouvons également lire sous la plume de l'actuel Secrétaire général des Nations unies que « le Représentant spécial [M. Yasushi Akashi] était opposé à l'emploi du nom même de Force de réaction rapide qui était, à son avis, trop provocateur » ! Quant au Secrétaire général, il s'est prononcé « contre " la culture de mort " faisant valoir qu'il ne fallait poursuivre la paix que par des moyens militaires et qu'il ne fallait pas utiliser la Force de réaction rapide trop vigoureusement pour exécuter notre mandat ». En fait, comme le rappelle également M. Kofi Annan, c'est toute la haute hiérarchie onusienne qui était profondément hostile au recours à la force aérienne contre les Serbes. Obsession de la neutralité, peur d'être débordée par les événements, vision limitée à l'humanitaire, crainte des représailles serbes : toutes ces causes avancées par M. Kofi Annan ont joué, venant renforcer une culture préexistante. Par conséquent, à la veille des événements de Srebrenica, le divorce est consommé entre l'ONU et l'OTAN, son bras armé. L'Alliance, mise en cause à la suite de l'affaire des otages, se place délibérément en retrait, en sorte que la double clé réciproque, qui permet à l'une ou l'autre des organisations de proposer des frappes, devient une clé simple : l'OTAN se met à la disposition de l'ONU si celle-ci le lui propose et ne fait plus aucune pression en faveur de l'intervention de l'arme aérienne. Comme l'a souligné M. Jean-Claude Mallet devant la Mission d'information, « compte tenu à la fois des concepts et des mécanismes alors à l'oeuvre entre les Nations unies et l'OTAN, personne ne songe à déclencher sur Srebrenica des frappes aériennes du type de celles que l'on utilisera autour de Sarajevo le 30 août 1995. A ma connaissance, personne n'a prononcé un veto sur l'emploi de la force aérienne. C'est un mythe. En revanche, il y eut un réflexe de prudence inévitable et des précautions prises par les commandants en place, après la crise très grave qu'a traversée la FORPRONU dans la période fin mai jusqu'au 18 juin ». D'une certaine manière, Srebrenica est la conséquence directe de cette divergence d'approche entre deux organisations pourtant supposées travailler ensemble. L'accroc entre deux cultures, deux logiques a conduit à une paralysie collective dont avaient conscience les principaux protagonistes, et notamment les Serbes qui ont parfaitement su saisir cette opportunité pour lancer leur attaque. A travers les lignes qui précèdent, se dessine également l'importance du rôle joué par la psychologie des hommes aux postes de commande à l'époque. Il est de notoriété publique que le Représentant spécial du Secrétaire général était totalement imprégné de cet état d'esprit. M. Alain Juppé l'a rappelé devant la Mission d'information, de même que M. François Léotard : « S'agissant de l'ONU, je confirme que le Représentant spécial du Secrétaire général a joué un rôle décisif dans le non emploi de la force aérienne. C'était sa culture. Je l'avais rencontré au Cambodge auparavant. C'était un homme parfaitement courtois qui n'était ouvert ni aux techniques ni aux comportements militaires, c'est le moins que l'on puisse dire ». Seul le général de La Presle a contesté ce point : de son point de vue il s'agissait d'une question de pédagogie, M. Yasushi Akashi n'étant pas familier des outils et des procédures militaires notamment ceux liés à la mise en oeuvre de l'appui aérien. S'il est vrai que le Représentant spécial ne s'est pas systématiquement opposé à l'usage de la force contre les Serbes, deux exemples confirment plutôt l'analyse la plus souvent entendue faisant état d'une répugnance profonde de sa part à s'écarter du paradigme classique du maintien de la paix. Le premier exemple se situe en mars 1994, alors que Bihac, zone de sécurité, est sous le feu serbe. La FORPRONU présente à Bihac demande un appui aérien rapproché. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1994, le commandant, américain, de la zone Sud de l'OTAN met en l'air 50 avions, tandis que le général Cot, qui commande alors la FORPRONU, demande à son alter ego civil d'autoriser, conformément au principe de la double clé, le déclenchement de la force aérienne. Quatre heures durant, le Représentant spécial tergiverse, demandant au commandant militaire toujours plus de détails complémentaires. Fidèle à son tempérament, le général Cot fait alors savoir à M. Akashi que, s'il ne lui donne pas le feu vert, il tient, dès le lendemain matin, une conférence de presse pour dire sa pusillanimité. C'est au bout de cinq heures de palabre, et par l'intermédiaire de son adjoint, M. Sergio Viera de Mello, qu'il donne son accord. Le ciel s'étant couvert entre-temps, il n'était cependant plus possible d'attaquer. On rappellera que c'était la « première mise à l'épreuve »4 de la procédure d'approbation de l'appui aérien rapproché : la suite des événements en a montré la tragique exemplarité. Il est intéressant de noter que le général Cot a été rappelé avant la date d'échéance normale de son mandat de façon prématurée. Le deuxième exemple se situe au moment des événements de Srebrenica. Dès que le Représentant spécial a eu connaissance de l'attaque sur Srebrenica - soit le 9 juillet, à 8 heures 40, selon le rapport de M. Kofi Annan -, il a délégué ses pouvoirs concernant le recours au soutien aérien rapproché au commandant de la Force, en l'occurrence le général Janvier. Nous reviendrons ultérieurement sur les autres causes de la passivité du général Janvier ; notons seulement que, pour des motivations différentes, sans qu'intervienne dans son comportement un quelconque réflexe de culture de paix, le général Janvier a totalement épousé les vues du Représentant spécial. Ainsi, selon le Ministre de la Défense néerlandais de l'époque, M. Joris Voorhoeve, le 2 juillet 1995, le général Janvier écrit dans une directive : « Nous devons absolument éviter toute action qui pourrait dégénérer et entraîner une confrontation, une escalade et une tension et l'utilisation potentielle de l'arme aérienne. C'est la raison pour laquelle j'estime que votre suggestion - il fait allusion à sa discussion avec le général Rupert Smith - pour utiliser la route du mont Igman, même après notification aux Serbes, n'est pas appropriée dans les circonstances actuelles. Deuxièmement, la sécurité de toutes nos forces armées - il fait allusion aux forces armées des Nations unies - est ma priorité absolue ». La Mission d'information peut comprendre qu'après la crise traumatisante des otages - français dans leur grande majorité -, après le décès de deux soldats français lors de l'épisode du pont de Vrbanja, un général français soit particulièrement sensible aux risques de pertes humaines. Le fait est toutefois qu'au moment où une crise majeure se produit, dont les conséquences sur l'avenir de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine sont évidentes, le système est paralysé du fait des préjugés très forts partagés par les deux têtes, civile et militaire, des FPNU à l'encontre de l'usage de la force. b) Un fonctionnement lourd et non réactif A première vue, le dispositif des Nations unies en ex-Yougoslavie paraît simple et rationnel. L'économie générale de la chaîne de commandement est claire : le politique ayant toujours le dernier mot contre le militaire dans le système onusien, le responsable du volet militaire des FPNU est subordonné à un chef politique qui exerce également son autorité sur les volets civils de la mission et qui relève lui-même d'une structure unique à New York, rendant compte directement au Secrétaire général des Nations unies. Si l'on descend la chaîne de commandement vers le bas, on trouve, dans le dispositif mis en place en Bosnie-Herzégovine, trois niveaux hiérarchiques en-dessous du commandant des forces de paix des Nations unies, basé à Zagreb : - le responsable de la FORPRONU pour la Bosnie-Herzégovine, basé à Sarajevo ; - le responsable de secteur ; - le commandant du bataillon, présent sur le terrain. L'enclave de Srebrenica relève pour sa part du secteur Nord-Est. L'ONU ne disposant pas de moyens aériens propres, elle peut avoir recours à l'OTAN, en sorte qu'outre la chaîne verticale interne à l'ONU, existe, en parallèle, une chaîne OTAN spécifique pour procéder à des missions aériennes en ex-Yougoslavie. Les deux chaînes sont reliées horizontalement au niveau du commandant des forces de paix des Nations unies (appelé Force commander ou FC dans le schéma suivant) et de l'amiral commandant la zone Sud de l'OTAN (CINCSOUTH). L'économie globale des procédures de recours à l'arme aérienne, certes complexe, semble, en théorie, relativement claire. C'est en application des résolutions 781, 816, 836, 908 et 958 du Conseil de sécurité que le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) a délégué, sous certaines conditions, au CINCSOUTH le droit d'utiliser les moyens aériens de l'OTAN pour effectuer des frappes sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Ces décisions du NAC ont été suivies de mémorandums du Comité militaire les traduisant en termes opérationnels, à l'intention des autorités militaires chargées de les mettre en oeuvre. Un ordre d'opération (OPLAN 40101 Deny Flight) a alors été élaboré par le CINCSOUTH à destination des échelons subordonnés, fixant, entre autres, les règles de comportement et d'engagement à observer. L'ordre d'opération initial, ainsi que les différentes modifications rendues nécessaires par l'évolution des mandats ou du cadre tactique, ont été soumis à l'agrément du Comité militaire de l'OTAN ou du NAC, en fonction du niveau des changements effectués. Au moment des événements de Srebrenica, les opérations aériennes qu'est autorisé à conduire le CINCSOUTH se situent dans deux domaines : - l'interdiction de survol du territoire bosniaque et le droit de poursuite en Croatie (domaine air-air) ; - l'appui au sol des FPNU, dans l'exécution de leurs mandats (domaine air-sol). Le domaine air-sol recouvre trois catégories d'intervention aérienne : - l'appui aérien défensif des troupes des FPNU (Close Air Support ou appui aérien rapproché). Le CINCSOUTH est autorisé, sur demande du commandant des FPNU et avec l'accord du Représentant spécial, à faire effectuer des missions d'appui aérien au sol au profit des troupes au sol, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine (application de la résolution 836) et sur celui de la Croatie (résolution 908) ; - les frappes aériennes (Air Strike). En application de la résolution 836 et sur demande du Secrétaire général des Nations unies, le NAC a autorisé le CINCSOUTH à conduire des frappes aériennes, pour protéger la zone de sécurité de Sarajevo (décision du 9 février 1994) et les 5 autres zones (décision du 22 avril 1994). Ces résolutions, ainsi que le mémorandum afférent qui définit les procédures d'application (en particulier les objectifs et le système de double clé), limitent l'action du CINCSOUTH puisque, géographiquement, seuls peuvent être attaqués les armes lourdes et les systèmes associés situés dans les zones d'exclusion entourant Sarajevo et Gorazde et puisque, opérationnellement, sont susceptibles de frappe aérienne, les armes et leurs moyens de support associés (y compris ceux situés en dehors de la zone d'exclusion) qui tireraient sur une zone de sécurité. Le mémorandum prévoit qu'en cas de désaccord entre le commandant des FPNU et le CINCSOUTH sur la décision d'une frappe aérienne, le problème est porté à l'échelon hiérarchique immédiatement supérieur qui tranchera. En dehors des cas énoncés ci-dessus, la décision d'effectuer une frappe aérienne sur le théâtre de l'ex-Yougoslavie est du ressort du Secrétaire général des Nations unies qui en fait, la demande auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ; - la suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD). Le CINCSOUTH est autorisé à faire effectuer des missions de destruction contre des sites de systèmes sol-air dans deux cas : contre des sites menaçant la sécurité des appareils de l'opération Deny Flight dans l'exécution de missions d'appui aérien rapproché ou des frappes aériennes, auquel cas la décision est prise en coopération et avec l'accord du commandant des FPNU ; contre des sites situés sur le territoire bosniaque ou les zones de protection des Nations unies (ZPNU) de Croatie, dans des conditions particulières et avec l'accord du commandant des FPNU. Le schéma ci-après résume le dispositif. Théoriquement valides, les chaînes de commandement et les procédures qui viennent d'être décrites correspondent, en fait, de très loin à la réalité. Le premier élément « perturbateur » de cet état de fait tient au caractère multinational des forces présentes sur le terrain. Contrairement à une organisation telle que l'OTAN, constituée de structures et de nations habituées à travailler ensemble, les forces de maintien de la paix des Nations unies sont constituées d'éléments venus de pays qui n'ont pas nécessairement d'habitudes communes de travail. Elles résultent de l'appel d'offres lancé par le Secrétaire général des Nations unies en application des résolutions prises par le Conseil de sécurité. En bref, ce n'est pas tant le caractère multinational que la nature ad hoc de la force constituée qui peut être source de difficultés et contribuer à rendre des procédures, par avance complexes, extrêmement lourdes. MÉCANISME DE L'APPUI AÉRIEN 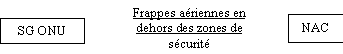 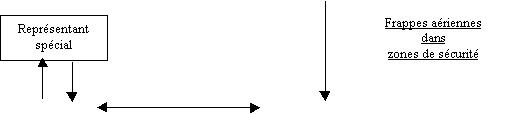 CONCERTATION  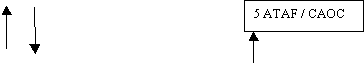 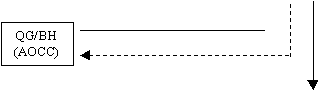 BATAILLON Appui aérien défensif de la FORPRONU  Accord / Refus Acceptation moyens AOCC : Air Operations Coordination Center TACP : Tactical Air Control Party MCC : Monitoring Cas Coordination Center Source : ministère de la Défense, état-major des Armées, note sur les frappes aériennes en ex-Yougoslavie du 23 juin 1995. A cette donnée structurelle, inhérente au principe des opérations de maintien de la paix par les Nations unies, il faut ajouter un élément fondamental : l'existence de chaînes de commandement officieuses entre les contingents nationaux et leur hiérarchie nationale. Certes, en théorie, cette chaîne n'est en aucun cas opérationnelle et vise seulement à donner un droit de regard aux états-majors nationaux sur le respect des conditions prédéfinies de l'emploi des forces de leur pays. C'est ainsi que l'amiral Jacques Lanxade, chef d'état-major des Armées, a rappelé à la Mission d'information que « les instructions opérationnelles sont données par la chaîne de commandement des Nations unies, mais il y a nécessairement des relations directes entre le commandant des forces sur le terrain et le chef d'état-major des Armées parce que nous devons nous assurer que l'emploi qui est fait des forces françaises est bien conforme aux conditions dans lesquelles elles ont été mises à la disposition des Nations unies, et ceci est vrai dans le cas des Nations unies mais aussi dans le cas de l'OTAN, parce que nous transmettons non pas ce que l'on appelle le " commandement opérationnel " mais plutôt, dans le jargon utilisé au sein de l'Alliance et, d'une manière générale, par les militaires, le " contrôle opérationnel ". Cela veut dire que l'autorité qui reçoit des forces sous son contrôle ne peut les employer que ce pour quoi on a trouvé un accord à un niveau supérieur. Il est donc nécessaire de s'assurer en permanence que le mandat est bien respecté ». Tel est en effet le concept de mise en oeuvre des forces françaises en Bosnie-Herzégovine qui ressort des documents produits à l'époque par le ministère de la Défense. Ainsi, une note de l'état-major des Armées en date du 5 novembre 1992 rappelle que les contingents militaires de la force des Nations unies en Bosnie-Herzégovine sont soumis aux règles concernant les opérations de maintien de la paix des Nations unies, en particulier en matière du port et de l'utilisation des armes et qu'ils doivent se conformer à l'aide mémoire des forces de maintien de la paix de l'ONU (Peacekeeper's Handbook). Elle souligne en outre que, dès que le contingent de Casques bleus français affecté aux forces de Bosnie-Herzégovine arrive sur le théâtre de l'ex-Yougoslavie, il y a transfert d'autorité entre la France et l'ONU en matière d'emploi des forces. Ce transfert s'applique en particulier au domaine des règles d'engagement et d'ouverture du feu. Néanmoins, comme l'a indiqué l'amiral Lanxade, la note précise que l'ensemble des éléments français opérant en ex-Yougoslavie dans le cadre des forces des Nations unies est placé sous le commandement organique d'un officier de l'armée de terre qui porte le titre de commandant du contingent français et qui, désigné par le chef d'état-major des Armées, est directement placé sous ses ordres et attributaire à ce titre d'une directive personnelle. Ce dernier est en relation directe avec ses supérieurs hiérarchiques nationaux, dont le tableau ci-dessous résume les fonctions dans le cadre de l'engagement des forces françaises en Bosnie-Herzégovine. CONCEPT DE MISE EN OEUVRE DES FORCES
FRANÇAISES EN BOSNIE-HERZÉGOVINE : · Etat-major des Armées La division Emploi donne les directives de planification et assure la coordination générale de l'ensemble des opérations conduisant à la mise sur pied, au déploiement et à la mise en oeuvre du contingent français dans le cadre de l'ONU. Les autres divisions de l'EMA fixent, chacune pour ce qui les concerne, les directives en matière de : - soutien administratif et logistique (OL) ; - transmission (TEI) ; - gestion des observateurs (RE) ; - mouvement et transport (EMPLOI/BTMAS). · Attributions de la première armée La première armée est chargée : - de planifier les actions et opérations interarmées voire interalliées, selon les directives données par le CEMA ; - de proposer les systèmes de forces susceptibles de concourir à l'obtention des buts recherchés, ainsi que les systèmes de commandement et structures de communication ; - de concourir à la préparation et au maintien en condition des forces, en s'appuyant en particulier sur les enseignements recueillis des mandats précédents ; - de s'assurer, en liaison avec le commandement du contingent français, de la réalité des plans d'évacuation et de sauvegarde des forces qui doivent être normalement élaborés par la FORPRONU. Par délégation du CEMA, le général commandant la première armée peut être chargé de toute mission de contrôle et d'évaluation jugée nécessaire. Il fait part personnellement au CEMA de ses observations et suggestions concernant les conditions d'emploi, de sécurité et de vie des unités françaises en Yougoslavie et les évolutions prévisibles et souhaitables de notre engagement sur ce théâtre. · Etat-major des armées de terre, mer et air Ils sont chargés de la préparation et de l'ensemble du soutien organique des unités françaises affectées à la FORPRONU. A ce titre, ils sont responsables, en étroite coordination avec l'état-major de la première armée : - de la désignation des unités ; - de la préparation de la montée en puissance et du suivi des unités, en particulier de leurs effectifs, durant le séjour sur le théâtre ; - des opérations de mise sur pied, de rassemblement, d'attente et de transit de leurs unités sur le territoire national ; - de l'organisation des stages de cohésion nécessaires ; - de la préparation et de l'exécution des relèves en étroite liaison avec le commandant du contingent français ; - des opérations logistiques concourant au maintien de la disponibilité opérationnelle de leurs unités. Source : ministère de la Défense, note de l'état-major des armées du 5 novembre 1992. Si, globalement, le commandant des forces des Nations unies exerce un commandement opérationnel, il n'en reste pas moins que les Etats ont un droit de regard sur l'emploi de leurs forces d'autant plus important que les événements les mettent dans une posture dangereuse. Tous les responsables militaires de l'ONU ont vécu la situation de se voir refuser l'application d'un ordre parce qu'en réalité, la chaîne de commandement national s'était substituée à la chaîne officielle onusienne. Ainsi, par exemple, dans l'attente de la relève de la campagne canadienne présente à Srebrenica par le bataillon hollandais au début de l'année 1994, le général Cot, soucieux d'alléger les difficultés des Canadiens dont il avait constaté la réalité sur place, ordonne à l'important bataillon nordique installé à Tuzla de fournir, au minimum, une grosse compagnie pour l'enclave de Srebrenica, afin d'assurer la transition. Face au refus du colonel présent sur place, le général Cot le convoque à Zagreb. S'ensuit une scène que l'on peut qualifier sans exagération de surréaliste, au c_ur de laquelle l'officier tombe en larmes et dit au commandant des forces que, bien qu'ayant honte d'obéir en tant qu'officier, il ne peut exécuter un ordre que son Gouvernement lui interdit de prendre en compte. L'élément le plus révélateur de cet épisode tient dans ses conséquences : le général Cot se voit sommé, par le Secrétariat général, de retirer son ordre de relève, tandis qu'une lettre comminatoire lui fait savoir qu'on « espère qu'un incident de ce genre ne se reproduira jamais ». A quoi le général français explique qu'« il ne s'agit pas d'un incident, mais d'une question de principe fondamentale. Je réagirai exactement de la même manière pour tout refus d'obéissance, d'où qu'il vienne. Il ne peut y avoir deux sortes de contingents : ceux sur qui je peux compter pour aller sur le mont Igman ou dans la poche de Medak et ceux qui n'obéissent pas. (...) Cette fermeté a pu paraître excessive. J'espère et je crois qu'elle aura au moins le mérite de faire réfléchir les nations contributrices qui seraient tentées de pratiquer une ingérence aussi inacceptable que celle des pays nordiques dans l'exercice du commandement militaire de l'ONU ». L'épisode de la reprise du pont de Vrbanja représente quant à lui un cas exceptionnel d'intervention directe de la chaîne nationale, la chaîne onusienne étant en réalité implicitement consentante, notamment dans la mesure où elle est dirigée par un général français. Il semble toutefois que, lors de cet épisode, même l'intervention de la chaîne nationale ait été très discrète, le seul ordre reçu alors par le général Hervé Gobilliard, qui commandait alors le secteur de Sarajevo, concernant le rappel des règles de légitime défense. C'est seulement fort de cette orientation que le général Gobilliard aurait donné l'ordre de reprendre le pont. De même, lors des événements de Srebrenica, l'essentiel, avant le 9 juillet, se passe directement entre l'état-major néerlandais présent à Sarajevo, le colonel Brantz, Néerlandais, en charge du secteur Nord-Est et, sur le terrain, le colonel Karremans, avec sans doute, présentes en arrière-plan, les autorités néerlandaises. C'est le général Nicolai qui, jusqu'au 9 juillet, refuse les demandes d'appui aérien émanant du colonel Karremans. Et, lorsque la décision de déclencher l'appui aérien est débattue, le général Janvier s'assure du soutien du Gouvernement néerlandais. Enfin, c'est à la demande du Gouvernement néerlandais que la deuxième frappe a été annulée, le 11 juillet, même si, d'après les témoignages des Néerlandais, le même ordre avait été donné par le général Gobilliard quelques minutes avant. La mise en oeuvre de la chaîne de commandement national n'a généralement pas permis de suppléer les carences et les lourdeurs des procédures propres à l'ONU. Dans le cas de Srebrenica, ni les relations directes entre les officiers néerlandais présents aux différents niveaux de commandement dans la chaîne onusienne ni les liens avec l'état-major national n'ont empêché de tragiques malentendus et dysfonctionnements. A cet égard, il n'est pas incompréhensible, comme l'a souligné M. Thierry Tardy devant la Mission d'information, « compte tenu de la lourdeur de commandement, du système très inadéquat et mal ficelé mis en place par la FORPRONU, qu'un certain nombre de demandes d'appui aérien approché aient pu ne pas aboutir, sans qu'il faille y voir une intention maligne de ne pas les faire aboutir. Compte tenu de la structure de la FORPRONU et des positions respectives des Etats, cela est tout à fait possible ». Ce décalage entre les procédures affichées et la réalité des faits vaut tout autant s'agissant des relations entre l'ONU et l'OTAN, d'autant que, comme on l'a expliqué précédemment, l'ambiance n'était pas précisément favorable à des relations sereines entre les deux organisations. Au total, « si l'on considère les consultations demandées au commandant de la FORPRONU, l'organisation à l'intérieur même de la chaîne des Nations unies entre la partie militaire et la partie civile, les interactions entre la chaîne Nations unies proprement dite et la chaîne OTAN, encore que ce système ait été organisé de façon en principe efficace, le système - très stigmatisé - de double clé, tous ces facteurs expliquent que le mécanisme qui était entre les mains des chefs militaires sur place ne pouvait répondre à la situation à laquelle, sur le terrain, était confronté le bataillon néerlandais ». L'auteur de ces propos tenus devant la Mission d'information, M. Jean-Claude Mallet, écrivait d'ailleurs à l'époque, alors qu'il occupait le poste de Directeur des Affaires stratégiques au ministère de la Défense : « La Chaîne des Nations unies, du Conseil de sécurité aux commandants de la FORPRONU, est à la fois désemparée, impuissante, paralysée par les dissensions entre grandes puissances et inapte à fournir les instruments d'un "coup de reins" politique ». Ce constat d'une lucidité remarquable date du 12 juillet 1995. c) Une force aveugle : les lacunes du dispositif de renseignement « Je préfère m'aventurer dans un champ de mines derrière des démineurs que les yeux bandés et en étant sourd. Je n'ai jamais conçu d'aller quelque part sans m'accompagner de personnels de renseignement ». Ces propos imagés du général Jean Heinrich, à l'époque directeur de la toute nouvelle Direction du renseignement militaire (DRM) créée à la suite de la guerre du Golfe, disent tout de la situation de l'ONU en matière de renseignement. Par définition et par construction, dans la conception du Secrétaire général de l'époque, il ne pouvait y avoir de fonction de renseignement dans l'ONU puisque celle-ci est une « maison de verre ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, le commandant responsable des forces des Nations unies en ex-Yougoslavie n'avait donc ni moyens ni structure officielle de renseignement. Nul besoin de rappeler pourtant la complexité du théâtre d'engagement des troupes, qu'elle soit géographique ou politique.... L'ONU pouvait-elle de toute façon disposer de véritables structures de renseignement ? La question mérite d'être posée, tant il est vrai, comme l'a rappelé avec justesse le général Heinrich, que même l'OTAN ne dispose pas de moyens de renseignement qui lui sont propres : « On compare quelquefois, au plan militaire, l'inefficacité de l'ONU à l'efficacité de l'OTAN. Or, l'OTAN n'a pas de moyens de renseignements ; elle dispose des renseignements que veulent bien lui transmettre les services des différentes pays. Elle a un petit groupe d'analystes mais, très franchement, que fournissent les services ? Ils ne lui transmettent rien ». Toutes les organisations présentes sur place ont naturellement cherché à pallier cette indigence, tant il était impensable d'engager les forces, ne serait-ce pour l'acheminement de convois humanitaires, en terrain inconnu. Ainsi, les Nations unies avaient mis en place des bureaux dits « d'information ». A Zagreb, ce bureau était à l'époque tenu par un journaliste britannique. Son rôle n'était en aucun cas de faire du renseignement militaire, au sens où l'entendent les armées - avec quels moyens aurait-il pu le faire de toute façon ? - mais était plutôt de « prendre la température » sur le terrain, de recueillir des éléments d'ambiance. Il existait également une cellule créée par M. Yasushi Akashi, animée par une chercheuse extrêmement compétente sur les problèmes balkaniques et qui donnait des indications de caractère culturel aux responsables de l'ONU. Ces renseignements pouvaient être riches, comme l'a expliqué à la Mission d'information le général de La Presle : entre les contacts avec les militaires répartis sur une grande partie du territoire, notamment les observateurs militaires des Nations unies, ceux qui existaient continuellement avec la population et les renseignements donnés par la Croix-Rouge ou les organisations non gouvernementales présentes sur le terrain, les responsables pouvaient « avoir le sentiment » - telle est l'expression entendue par la Mission d'information - d'avoir des impressions d'ambiance quotidiennement actualisées « qui auraient pu ou dû nous mettre assez à l'abri de graves surprises ». Impression illusoire, comme les événements l'ont tragiquement prouvé... Nonobstant les qualités de ce bureau d'information, les responsables militaires - notamment parce que, en tant que Français, ils étaient habitués à travailler ainsi - ont mis sur pied des structures ad hoc à l'intérieur de leur état-major, alimentées d'abord par des sources nationales. Par définition, cette structure était restreinte aux ressortissants de pays susceptibles d'avoir du renseignement, peu nombreux, essentiellement français et britanniques. Les structures nationales n'avaient pas nécessairement de lien entre elles. En effet, dès que l'on quittait le cadre national, le partage du renseignement était lié aux relations personnelles que tel commandant pouvait avoir avec ses collègues étrangers. Ainsi, comme en a témoigné à huis clos l'un des généraux français ayant commandé les FPNU, même un général français pouvait, par le biais d'un collègue britannique ou canadien, bénéficier de télégrammes diplomatiques ou militaires. L'un de ses collègues a toutefois nié avoir eu quelque accès que ce soit aux informations OTAN. Peut-on pour autant parler de renseignement ? Le terme est excessif, tant ce système ad hoc dépendait de contacts personnels, par définition aléatoire, et ne reposait sur aucune structure pérenne. Il était, au total, assez difficile d'avoir une vue globale de la situation dans la région. La réalité était celle d'un morcellement du renseignement, essentiellement fondé sur les structures nationales, quand elles existaient et quand elles ont fonctionné correctement, ce qui est loin d'avoir été toujours le cas, y compris pour la France comme nous le verrons par la suite. Dans ce contexte, l'absence de service de renseignement néerlandais dans la zone de Srebrenica, confirmée par M. Van Mierlo aux membres de la Mission d'information, se révélera dramatique, tant en elle-même que par l'absence de chaîne de renseignement qu'elle implique. C'est ainsi que, lorsque les observateurs militaires des Nations unies informent le bataillon hollandais de Srebrenica de concentrations de troupes serbes près de l'enclave, l'information, dont le colonel Karremans assure avoir demandé à son subordonné de la transmettre aux échelons supérieurs, a disparu ou, du moins, ne semble pas avoir été exploitée, si elle est jamais partie. En bref, l'ONU ne savait pas ce qu'elle savait, faute d'une gestion coordonnée de l'information. Et elle en savait très peu. 2) Des missions impossibles ? La faillite de la politique des zones de sécurité Les réflexes et les lourdeurs ataviques de l'ONU ne sauraient être considérés comme les motifs principaux ayant conduit au drame de Srebrenica, dans la mesure où l'ONU est intervenue en ex-Yougoslavie dans le cadre des mandats votés par le Conseil de sécurité. La responsabilité des Etats et de la France étant examinée dans la suite du rapport, l'objet des développements qui suivent est, d'une part, de montrer comment l'action conjuguée des Etats au sein de l'ONU a conduit à forger une action internationale ambiguë et une politique de demi-mesures, d'autre part, d'en analyser les conséquences tragiques à travers l'exemple des zones de sécurité. a) L'intervention internationale en ex-Yougoslavie ou le « fléau des ambiguïtés » (Boutros Boutros-Ghali) « Dès le début de son déploiement en Bosnie-Herzégovine, le mandat de la FORPRONU a été frappé par le fléau des ambiguïtés qui ont affecté la capacité de la force aussi bien que sa crédibilité vis-à-vis des parties, des membres du Conseil de sécurité et de l'opinion publique ». Ce constat du Secrétaire général, établi dans son rapport du 30 mai 1995, est, à bien des égards, prémonitoire du drame de Srebrenica. Dans le même ordre d'idée, le rapport du 16 mars 1994 du Secrétaire général indiquait : « Le Conseil de sécurité a adopté 54 résolutions et 39 déclarations du Président qui ont toutes, à des degrés divers, eu une influence sur le fonctionnement de la force. Cette prolifération de résolutions et de mandats a certainement compliqué son rôle... »5. Comme l'a relevé M. François Léotard lors de son audition devant la Mission d'information, « le mot compliqué est une litote. Je rappelle qu'entre septembre 1991 et octobre 1993, il y a eu 58 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, qu'en la seule année 1994, il y a eu 6 rapports du Secrétaire général et en 1995, 17 rapports du Secrétaire général. Ces résolutions et ces rapports étaient le socle même du mandat et des instructions que devaient appliquer nos soldats sur le terrain ». En réalité, les euphémismes employés par Boutros Boutros-Ghali cachent mal l'absence de cohérence politique des nations impliquées dans le règlement du conflit yougoslave, donc de stratégie globale. La politique des zones de sécurité en est l'illustration patente. Par une cruelle ironie du sort, il faudra l'électrochoc des événements de juillet 1995 pour que soient enfin arrêtées des lignes générales d'action répondant à des buts clairement établis et réalistes, en un mot pour que tous les acteurs du drame bosniaque s'unissent et parviennent, six mois plus tard, à faire accepter les accords de Dayton par les belligérants. Pendant plus de trois ans, les Nations unies se sont en réalité efforcées d'accomplir une mission impossible, qu'a parfaitement résumée l'actuel Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi Annan, dans le rapport en forme de mea culpa qu'il a présenté, le 15 novembre 1999, sur les événements de Srebrenica : « Nous nous efforcions de maintenir la paix et d'appliquer les règles régissant le maintien de la paix alors qu'il n'y avait aucune paix à maintenir ». L'intervention de l'ONU en ex-Yougoslavie fait resurgir le débat ancien sur les opérations de maintien de la paix et leur lien au chapitre VI (« règlement pacifique des différends ») ou VII (qui permet le recours à la force) de la Charte des Nations unies. Sur le plan juridique, la résolution 743 créant la FORPRONU adoptée le 21 février 1992 par le Conseil de sécurité, s'inscrit dans l'esprit du chapitre VI de la Charte, non sans ambiguïté d'ailleurs. Comme l'écrit en effet M. Thierry Tardy, « dans le préambule de la résolution, le Conseil invoque pourtant implicitement l'article 39, lorsqu'il constate "avec inquiétude que la situation en Yougoslavie continue à constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale", ce qui peut laisser penser qu'il souhaite placer le texte dans le cadre du chapitre VII. Le chapitre VI n'est d'autre part pas mentionné, mais l'ensemble du texte se place néanmoins dans ce cadre, compte tenu du contexte prévalant à la constitution de la force (nécessaire consentement des parties, force non coercitive), et en raison de la non-référence explicite au chapitre VII ».6 En bref, l'opération de maintien de la paix de l'ONU en ex-Yougoslavie se situe dans le droit fil des opérations dites de première génération, caractéristiques de l'action limitée de l'ONU pendant la guerre froide, alors même que le contexte d'intervention de l'ONU en Bosnie-Herzégovine était celui d'un conflit d'après-guerre froide. Là réside tout le drame de la FORPRONU : elle « répond à un besoin immédiat, urgent et en principe provisoire, et se déploie après qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu », pour être d'ailleurs immédiatement violé... Tant et si bien d'ailleurs que l'interposition se révèle quasi-immédiatement impossible et que l'opération de maintien de la paix glisse vers une opération strictement humanitaire, dès le mois de juin 1992, comme l'atteste la résolution 758 du 8 juin 1992 par laquelle le Conseil de sécurité décide d'élargir le mandat de la FORPRONU à la Bosnie-Herzégovine. « La composante bosnienne de la FORPRONU n'a donc aucune compétence en matière de maintien de la paix, toutes ses missions étant guidées, tout au moins dans un premier temps, par une finalité humanitaire ». C'est bien cet objectif exclusivement humanitaire qui ressort du concept de mise en oeuvre des forces françaises en Bosnie-Herzégovine (5 novembre 1992) : « Au titre de la résolution 770, les forces des Nations unies assurent l'acheminement de l'aide humanitaire à Sarajevo et aux autres régions de Bosnie-Herzégovine ; au titre de la résolution 776, elles assurent la protection des convois de détenus libérés. La mission initiale du contingent des Nations unies déployé en Bosnie-Herzégovine consiste à garantir la sécurité des dépôts du HCR et, sur demande, à assurer la protection des convois HCR vers les centres de distribution régionaux et vers les points de distribution locaux. Les forces des Nations unies, hormis leur propre sécurité, n'ont pas de mission de contrôle de leur zone de déploiement. A la suite de la résolution 776 la mission des forces des Nations unies en Bosnie-Herzégovine a été étendue à l'escorte, sur réquisition, des convois du CICR. Le secteur FORPRONU de Sarajevo, mis en place en application de la résolution 761 du 30 juin 1992, tout en assurant sa mission spécifique à Sarajevo - à savoir la sécurité de l'aéroport -, participe aux missions impliquées par les résolutions 770 et 776 ». Par conséquent, à aucun moment, l'opération de « maintien de la paix » en ex-Yougoslavie n'a eu pour objectif de s'opposer à l'une des parties ou de stopper le conflit, le seul but étant d'en atténuer les conséquences négatives sur les populations. Comme le souligne très justement Thierry Tardy dans son ouvrage, la FORPRONU est intervenue physiquement, mais jamais militairement. Devant la Mission d'information, cet expert a d'ailleurs porté un jugement extrêmement sévère sur la FORPRONU et, à travers elle, sur les Etats qui l'ont mise en oeuvre, à commencer par la France : dans son optique en effet, si c'est avant tout à l'ONU que revint la gestion de toute l'opération, l'implication française dans la définition et la mise en oeuvre du mandat de la FORPRONU est telle que la France ne peut pas ne pas être associée à son bilan. Le fait est toutefois que l'ensemble des Etats européens ont adhéré, fût-ce par défaut, à cette politique : « Il faut comprendre la FORPRONU comme la réponse des Etats européens aux conflits en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire comme une action intermédiaire entre une action radicale, la guerre ou l'action forte et décisive qu'aucun Etat européen n'a souhaitée, et l'abstention rendue impossible par le contexte de l'après-guerre froide. En cela, la FORPRONU constitue un outil palliatif, un minima ratio de l'action, et traduit ce que les Etats sont prêts à entreprendre pour gérer les conflits yougoslaves, mais également ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Par nature, l'opération onusienne, déployée en Bosnie-Herzégovine à partir de l'été 1992, est une opération ambiguë, sans doute inadaptée au conflit à traiter. Elle bénéficie d'un faible soutien politique et relève d'un mandat mal défini, ce qui se traduit, entre autres, par une structure de commandement mal identifiée, donc susceptible de dysfonctionnements graves ». Nul besoin de souligner combien l'ambiguïté de cette politique a pesé sur le terrain, les militaires devant, en quelque sorte, traduire clairement sur le plan opérationnel des directives pour le moins floues. Où tracer la ligne, en effet, qui permette à la FORPRONU de n'être pas dénaturée et de rester la force minimale voulue par les Etats ? Les documents fournis à la Mission d'information par le ministère de la Défense attestent cette obsession du respect d'un mandat dont le caractère hybride n'échappe à personne. Ainsi, lorsqu'il est question, en juin 1994, d'appliquer strictement les zones d'exclusion de Sarajevo et de Gorazde, jusqu'alors conçues de manière très souple, une note de l'état-major des armées du 27 juin 1994 explique qu'en cas d'utilisation de la menace militaire par la FORPRONU, « il s'agit en fait pour elle de passer du statut de force de maintien de la paix à celui de force d'imposition de la paix (...). Inévitablement ceci amènerait à la faire percevoir comme un belligérant du côté des Bosniaques ». En septembre 1994, c'est à propos des réactions de la FORPRONU aux tentatives serbes de blocus que la Délégation aux affaires stratégiques (DAS) relève que « l'usage de la force est très délicat, la FORPRONU ne pouvant en aucun cas adopter une posture offensive et ayant toujours refusé de considérer que son mandat relevait du chapitre VII de la Charte »7. Les ambiguïtés du mandat deviennent criantes, au fur et à mesure que s'alourdit la pression serbe sur la FORPRONU et que l'armée des Serbes de Bosnie multiplie les provocations, alors que la crise des otages illustre à quel point la logique humanitaire est à bout de souffle, et que toute réaction - en l'occurrence, les frappes des 25 et 26 mai 1995 - de l'ONU conduit à une escalade dans la tension. Dans la directive personnelle adressée par le général Janvier au général Rupert Smith le 28 mai 1995, le général français, soucieux de prévenir toute nouvelle initiative de son subordonné, précise qu'existe « une notion de seuil de tolérance qui ne peut être appréciée que par le chef militaire sur le terrain en fonction de l'enjeu potentiel, du rapport de forces et de la situation locale ». En un mot, on évite de fixer par avance les limites, la ligne rouge au-delà de laquelle la FORPRONU ne peut plus exercer son mandat. N'est-ce pas, en réalité, parce que cette ligne est déjà franchie en mai 1995 et que la FORPRONU est elle-même une source de paralysie de l'action internationale, y compris diplomatique, en ex-Yougoslavie ? Les nouvelles initiatives françaises prises à l'époque, notamment la décision de créer une Force de réaction rapide, sont d'ailleurs révélatrices de cette prise de conscience que la FORPRONU est désormais avant tout un enjeu des combats. Mais, là encore, ce n'est qu'après la chute de Srebrenica que l'alternative est clairement posée : « Dans ces conditions, le temps n'est plus aux demi-mesures. Les termes de l'alternative se simplifient de jour en jour : ou bien nous engageons une épreuve de force, sur un terrain, choisi par nous et nous y infligeons une leçon aux Serbes de Bosnie-Herzégovine qui permettra à la négociation de se renouer sur des bases pour nous plus acceptables ; ou bien nous déclenchons dans les semaines qui viennent la mise en oeuvre de l'opération de retrait et nous engageons une épreuve de vérité qui redistribuera complètement les cartes sur le théâtre de l'ex-Yougoslavie ».8 b) Une illusion tragique : la politique des zones de sécurité Loin d'être le fruit d'une stratégie délibérée et mûrie, la création des zones de sécurité ressort bien davantage d'un choix largement contraint par les événements. C'est dans le contexte du début de l'année 1993 qu'il faut rechercher l'origine des zones de sécurité, sans oublier qu'au début du mois de mai 1993, le plan de paix Vance Owen est rejeté par les Serbes. Comme l'a rappelé M. Thierry Tardy devant la Mission d'information, dans ce contexte de paralysie des initiatives internationales, les Etats-Unis accroissent la pression en faveur de la levée de l'embargo sur les armes à destination de Bosnie-Herzégovine et militent en faveur du recours massif aux frappes aériennes. Autant de solutions auxquelles les Européens s'opposent, au premier rang d'entre eux les Français, « qui s'interrogent sur l'efficacité des frappes, la sécurité de leurs Casques bleus, la chaîne de commandement qui serait activée entre l'ONU et l'OTAN, et la stratégie qui sous-tendrait de telles frappes ». Rappelons en outre que ces zones existent déjà dans les faits, suite à l'intervention du général Morillon à Srebrenica et que les résolutions 819 et 824 leur ont donné une base juridique. Les débats au Conseil de sécurité révèlent les fortes réticences qui existent parmi les Etats-membres sur la pertinence d'un tel concept. Déjà, en 1992, quand l'Autriche avait été le premier Etat à explorer activement la possibilité de créer des zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine, « dans l'ensemble, les membres permanents du Conseil n'étaient pas favorables à cette idée »9. De même, en 1993, c'est dans un contexte d'urgence et de confusion, alors que les combats font rage à Srebrenica, que la zone de sécurité est créée. C'est dans ce contexte que la France propose, dans un mémorandum en date du 19 mai 1993, que les zones de sécurité précédemment créées, soient sanctuarisées, c'est-à-dire que leur protection soit assurée par une FORPRONU dont le mandat serait modifié en conséquence. Dans ce document, deux options sont définies : l'option lourde, qui prévoit de maintenir ouvert un ou plusieurs corridors logistiques à travers les zones serbes, de regrouper les armements lourds ou encore de procéder à leur démilitarisation ; l'option légère, finalement retenue. Au-delà de ce choix, la France semble décidée à franchir un pas vers un engagement plus ferme. Le Ministre des Affaires étrangères précise ainsi, lors d'une conférence de presse du 22 mai 1993 : « Mandat sera donné aux Casques bleus de la FORPRONU dans les zones de sécurité de s'opposer à l'agression. Ce n'est plus la protection des convois humanitaires, mais la protection des populations dans les zones de sécurité ». La résolution 836 adoptée porte toutefois la marque du compromis et apparaît, en dépit de ces engagements et de ce discours, relativement ambiguë. Certes, comme l'a souligné M. Thierry Tardy devant la Mission d'information, « dans les considérants de cette résolution, le Conseil de sécurité est "déterminé à assurer la protection de la population civile dans les zones de sécurité". Mais la suite de la résolution ne fait plus aucune référence à la protection des populations ». Ce n'est pas la première fois, au cours du conflit yougoslave, que les inflexions du discours international laissent croire à un changement de logique de l'action internationale en ex-Yougoslavie et au passage d'une logique de consensus à une logique de coercition. Ainsi, dans le cas de la mise en place des zones de sécurité, certains aspects du discours français pouvaient donner l'impression que la FORPRONU passait d'un statut de spectateur à celui d'acteur à part entière, capable de dissuader les agresseurs et que sa mission passait de la protection des convois à celle de la population. La réalité est beaucoup plus ambiguë : quittant cette option haute, contestée par d'autres membres du Conseil de sécurité, la France se rallie à l'option basse de simple protection des Casques bleus. Le recours à la force ne sort pas des cas de légitime défense. Sur le terrain, l'équivoque ne sera jamais levée et les commandants des différents bataillons de la FORPRONU opérant dans ces zones ne reçoivent aucune instruction précise. Le texte même de la résolution 836 illustre ces ambiguïtés : « Le Conseil de sécurité décide d'étendre le mandat de la FORPRONU afin de lui permettre de dissuader les attaques contre les zones de sécurité. « Le Conseil de sécurité autorise la FORPRONU pour se défendre à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force, en riposte à des bombardements par toute partie contre les zones de sécurité, à des incursions armées ou si des obstacles délibérés étaient mis à l'intérieur de ces zones ou dans leurs environs à la liberté de circulation de la FORPRONU ou de convois humanitaires protégés. « Le Conseil de sécurité décide que les Etats-membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre toute mesure nécessaire, à l'intérieur et dans les environs des zones de sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine, en recourant à la force aérienne pour soutenir la FORPRONU dans l'accomplissement de son mandat ». La première, et principale, ambiguïté tient à la finalité même de l'action de la FORPRONU : s'agit-il ou non de défendre les populations ? Que signifie le choix de l'expression « dissuader les attaques », alors que l'option « s'opposer aux attaques » avait également été proposée ? Le débat entre pays non-alignés et pays occidentaux au sein du Conseil de sécurité est symptomatique de ce qui s'est révélé par la suite comme une tragique ambiguïté, que lève d'ailleurs, à l'époque, l'instigateur du projet. Ainsi, le 8 juin 1993, le Ministre des Affaires étrangères déclare dans une phrase importante et très claire : « Il y a une petite ambiguïté qui peut avoir des conséquences importantes. Certains disent que c'est la protection des troupes elles-mêmes, d'autres disent - et je suis parmi ceux-là - qu'à partir du moment où les troupes de la FORPRONU ont pour mission de défendre les populations si elles sont attaquées, les troupes réagissent et donc sont fondées à réclamer la protection aérienne qui leur a été promise ». Toutefois, comme l'a noté M. Thierry Tardy, « les déclarations françaises ont été, malgré tout, assez contradictoires dans les semaines qui suivent l'adoption de la résolution 836. Il faut également reconnaître que, sur ce point, la France est relativement isolée et que, dans la pratique, elle ne défend qu'assez mollement le principe de défense des populations au sein des zones de sécurité ». Et ce pour une raison très simple : pas plus que les autres Etats, la France n'est disposée à entrer dans une logique militaire d'imposition de la paix et la création des zones de sécurité, comme leur pérennisation, relève bien davantage d'une politique réactive et d'une démarche de gestion à court terme que d'une stratégie visionnaire. Faut-il par ailleurs, avec M. Thierry Tardy, considérer qu'« une lecture possible de la création des zones de sécurité est l'existence d'une nécessité pour les Etats européens, et sans doute pour la France, de faire face à la pression américaine sur les frappes aériennes » ? Sans doute de telles considérations ont pu jouer. De même, la pression de l'opinion publique a pu contribuer à cette décision, en apparence interventionniste, en réalité palliative. Reste à savoir si le concept des zones de sécurité était, en lui-même, voué à l'échec : en bref, la tragédie de Srebrenica est-elle inscrite dans les résolutions de l'ONU ? A l'issue de ses travaux, la Mission d'information estime que c'est, non pas dans le principe lui-même, mais dans l'application qui en a été faite, et notamment dans les moyens qui ont été dévolus aux zones de sécurité qu'il faut chercher une partie des racines du drame de Srebrenica. Il faut en effet rappeler que, suite à l'adoption de la résolution, le Secrétaire général des Nations unies estime à 34 000 hommes le volume des forces nécessaires à la mise en oeuvre des zones de sécurité. A aucun moment, pourtant, les auteurs de la résolution, dont le pays instigateur, n'ont envisagé cette option, se ralliant d'emblée à l'option basse de 7 600 hommes : c'est donc en vertu d'une décision politique, et non en considération de données opérationnelles, que des moyens sont alloués aux zones de sécurité. Lentement d'ailleurs, puisqu'il fallut plus d'un an pour rassembler ces troupes dans la région. Pour prendre le seul exemple de Srebrenica, alors que l'option haute de 3 000 à 4 000 hommes avait été évoquée par le Secrétaire général, 450 sont présents dans l'enclave au moment de l'attaque serbe, dont 200 seulement sont opérationnels. A l'époque, tout le monde préfère croire, comme l'écrit M. Boutros Boutros-Ghali après avoir constaté l'absence de volonté des Etats pour engager les moyens adéquats que, dans ces zones, « la principale capacité de dissuasion de la FORPRONU ne serait pas fonction de sa puissance militaire mais résulterait essentiellement de sa présence dans les zones de sécurité ». Et le Secrétaire général de mentionner « l'exemple positif de Srebrenica où, à son avis, l'efficacité de cette conception avait été démontrée ». Les faits démentent bien vite cette assertion : l'histoire des zones de sécurité devient celle d'une succession de crises, qui posent en arrière-plan la lancinante question des moyens. En février 1993, bombardement de Markale à Sarajevo, premier ultimatum de l'OTAN, desserrement provisoire de l'étau serbe ; en avril 1994, deuxième ultimatum de l'OTAN en raison d'une offensive serbe sur Gorazde ; en novembre et décembre 1994, offensive serbe sur Bihac. En mai 1995, on en arrive même à une sorte de crise de conception des zones de sécurité. Comme l'a souligné M. Jean-Claude Mallet, « plusieurs travaux du secrétariat général des Nations unies et des chefs de la FORPRONU conduisent à mettre en doute l'efficacité du concept mis en oeuvre sur le terrain, en raison notamment de la répétition de ces crises et de la faiblesse chronique des moyens et des capacités de réaction de la FORPRONU. Au début du printemps 1995, la FORPRONU apparaît de plus en plus comme paralysée et comme prise à la gorge par les forces serbes ». Sans nul doute, la crise provoquée par l'ultimatum du général Rupert Smith contribue-t-elle à changer la donne : les initiatives prises alors par la France peuvent laisser penser à un renouveau de la politique des zones de sécurité. La chute de Srebrenica prouve qu'il n'en est rien et que seule une rupture complète avec la philosophie adoptée jusque là, jointe à une véritable volonté politique de faire exister ces enclaves, pouvait changer le cours des événements. Les militaires présents dans ces enclaves en étaient les plus conscients. Comme l'a expliqué à la Mission d'information, M. Joris Voorhoeve, alors Ministre de la Défense des Pays-Bas, qui s'était rendu à Srebrenica en septembre 1994, « l'avis militaire était que cette enclave, étant donné sa position en territoire serbe, entourée de l'artillerie des Serbes, tomberait aussitôt que les Serbes lanceraient une attaque. On espérait donc une solution internationale négociée ». Et lorsque le général Janvier, s'exprimant devant le Conseil de sécurité le 24 mai 1995, se prononce en faveur du retrait des enclaves, il n'est pas le seul à évoquer cette possibilité ; les Britanniques ont obtenu de se retirer de Gorazde. Tous les militaires entendus par la Mission d'information ont d'ailleurs défendu la thèse de l'indéfendabilité des enclaves en l'absence de moyens adéquats. Ainsi, le général Quesnot s'est dit « totalement en accord avec ce que tous les chefs militaires de la FORPRONU successifs ont dit sur ce sujet », ajoutant que « les zones de sécurité n'avaient (...) de sens que si elles disposaient de moyens de se défendre de façon autonome et d'être secourues. A part Sarajevo où il y avait quand même une certaine masse critique, même si les armements n'étaient pas totalement satisfaisants, aucune des autres enclaves ne répondait à ces critères ». Quel bilan tirer, au total, de la politique des zones de sécurité ? Certains interlocuteurs de la Mission d'information ont souligné qu'elles avaient, sous certains aspects, permis de sauvegarder des vies humaines et d'éviter que le territoire de la Bosnie-Herzégovine ne soit totalement mis en pièces. Sans doute la création de ces zones a-t-elle ralenti la progression de l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, après Srebrenica, on ne peut que conclure à la faillite totale de la politique des zones de sécurité. Non seulement ces zones n'ont jamais été considérées que comme la moins mauvaise des solutions, mais, en outre, les Etats-membres du Conseil de sécurité se sont refusés à tirer toutes les conséquences opérationnelles et militaires de leur décision politique, et ce en toute connaissance de causes. L'échec des zones de sécurité n'était pas inscrit dans le concept lui-même mais, dès lors que leur mise en oeuvre a été décidée sans qu'existe de réelle volonté politique de les faire exister, c'est une logique perverse qui s'est enclenchée. Perverse également était l'équation, politiquement séduisante, mais techniquement irréaliste, qui était de croire que le maintien de la paix auquel on adjoindrait l'appui aérien permettrait d'imposer la paix. Quand il apparaît en outre, à la suite de la crise des otages, que l'appui aérien est d'un usage très délicat, le sort des enclaves est en quelque sorte fixé. Les Serbes l'ont parfaitement compris et ont su utiliser tactiquement les incohérences de la FORPRONU pour récupérer ce qu'ils considéraient comme un but de guerre. In fine, au regard de l'ambiguïté des missions dévolues à la FORPRONU et de l'incohérence chronique entre mandat et moyens sur le terrain, la chute de Srebrenica n'est pas totalement surprenante. B - DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE DES ETATS AUX RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES DES ACTEURS : EXISTAIT-IL UNE VOLONTÉ RÉELLE DE PRÉSERVER LA ZONE DE SÉCURITÉ DE SREBRENICA ? L'échec des Nations unies à Srebrenica est avant toute chose l'échec des Etats qui ont pris des engagements, notamment au sein du Conseil de sécurité, qu'ils n'ont pas respectés, faute de s'en donner les moyens. En ce sens, il existe une responsabilité collective des Etats qui se sont impliqués dans la gestion et le règlement du conflit bosniaque. La Mission d'information refuse de s'en tenir à ce constat, certes juste et avéré par l'ensemble des éléments précédemment décrits, mais néanmoins insuffisant. Alors que les oreilles des survivants de Srebrenica résonnent encore du « Je vous protégerai » du général Morillon, ce constat en forme de quitus est insupportable. La Mission d'information n'est pas insensible aux mots du maire de Srebrenica qui, sur place, a rappelé que personne ne pouvait se contenter d'une responsabilité collective : de même que le peuple serbe n'est pas responsable du massacre de Srebrenica, de même, il est trop facile de mettre en accusation l'ONU en tant que telle, par exemple. Il semble par conséquent plus juste de chercher à définir la chaîne des responsabilités. L'action collective des Etats à travers l'ONU invite à examiner les responsabilités éventuelles de chacun des acteurs en particulier, acteurs étatiques certes, mais, au sein même des Etats, le rôle des institutions ou des individus : existe-t-il une responsabilité particulière des Pays-Bas, de la France, du Royaume-Uni, ou des Etats-Unis et, en leur sein, de tels organismes ou individus ? La question se pose également pour les autorités bosniaques, qui ne sont pas exemptes de critiques et de reproches. Car les faits sont là, troublants : certes, la culture onusienne était totalement inadaptée à la réalité du terrain, certes, le mandat était ambigu et portait plus la marque de compromis stériles que d'une vision de long terme clairement définie ; certes, la FORPRONU n'avait pas les moyens de remplir sa mission. Mais aucun de ces éléments n'explique l'incroyable accumulation d'erreurs qui caractérise la gestion de la crise ni les carences fatales observées à tous les niveaux de la chaîne de commandement : avant la crise, une absence totale de prévision et de planification de la défense de l'enclave ; pendant la crise, des erreurs de procédures multiples et des choix tactiques désastreux ; après la crise, des atermoiements sans fin et une politique du fait accompli. N'oublions pas en effet que, deux semaines après Srebrenica, une autre enclave orientale, Zepa, tombe sous les yeux d'une communauté internationale passive et pourtant totalement informée des intentions serbes. Cet élément, qui s'ajoute à l'incroyable série d'erreurs et de défaillances tout au long de la crise de Srebrenica, incite à s'interroger, au-delà de la responsabilité passive des Etats précités, à leur éventuelle responsabilité active. Qui voulait préserver l'intégrité de Srebrenica ? En d'autres termes, Srebrenica serait-elle tombée aux mains des Serbes si l'un des acteurs impliqués dans la gestion du conflit avait vraiment voulu qu'elle ne tombe pas ? Y-a-t-il eu une politique délibérée d'abandon de la zone de sécurité ? 1) Un constat troublant : des carences et des erreurs multiples Tout au long de ses travaux, la Mission d'information a été frappée par l'étonnante accumulation d'erreurs et de carences observées à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit en amont de la crise, pendant celle-ci ou après la chute de Srebrenica. Le fait est qu'à aucun moment, Srebrenica n'a été défendue, à aucun moment n'ont été rationnellement et professionnellement envisagés les moyens de défendre une enclave dont nul n'ignorait la vulnérabilité et l'attrait stratégique qu'elle revêtait aux yeux des Serbes. a) En amont, aveuglement et négligences en série Une partie des causes de la chute de Srebrenica est à rechercher en amont de la crise. A cet égard, la première interrogation porte sur la prévisibilité de l'attaque. La question est d'une redoutable complexité dès lors que l'on s'abstient de toute démarche téléologique, que l'on veut éviter de tomber dans la caricature de ceux qui refont l'histoire. La Mission d'information n'a nullement l'intention de sombrer dans ce travers. Néanmoins, si cette question doit être posée, c'est parce qu'elle recouvre des enjeux majeurs : pouvait-on prévoir l'attaque de Srebrenica ? Plus exactement, était-il possible de prévoir que les Serbes attaqueraient l'enclave à ce moment là ? Si non, est-ce parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens ? Y a-t-il eu une carence technique ou une volonté active de ne pas le faire ? S'est-on désintéressé de Srebrenica ? S'il était possible de prévoir, si des indices existaient, pourquoi n'ont-ils pas été exploités ? La deuxième série de questions concerne l'absence de plans de défense de l'enclave : si la FORPRONU savait qu'à un moment ou l'autre, les Serbes chercheraient à reprendre l'enclave, pourquoi aucun plan de défense n'a-t-il été établi en amont ? A défaut de défense, pourquoi n'a-t-on établi aucun plan d'évacuation de la population ? Les questions sont nombreuses, difficiles et, parfois, les réponses sont davantage des hypothèses que des constats étayés. · La question de savoir si les Serbes attaqueraient l'enclave ne pose guère de difficultés mais elle n'offre, à dire vrai, qu'une valeur démonstrative très relative : l'attaque de Srebrenica était sans nul doute prévisible au sens où, tant pour des raisons tactiques, stratégiques que diplomatiques, politiques ou symboliques, Srebrenica était un but de guerre pour les Serbes. Tactiquement d'abord, Srebrenica représente un double obstacle pour les Serbes : d'une part, l'enclave mobilise une partie de l'équipement et des combattants de l'armée des Serbes de Bosnie et, d'autre part, les Serbes n'admettent pas qu'elle serve de base arrière aux combattants bosniaques qui l'utilisent pour lancer des raids dans les villages des alentours placés sous contrôle serbe. Le 26 juin 1995 par exemple, quelques combattants bosniaques pénètrent à Visnjica, village serbe situé à quelques kilomètres au Nord-Ouest de la ville, qu'ils pillent et incendient. On est certes loin des raids massifs et meurtriers décrits par la propagande serbe, les incursions des Musulmans hors de l'enclave s'apparentant souvent plus, comme l'a expliqué le colonel Karremans, à des tentatives de voler de la nourriture. Gardons-nous d'oublier en effet que l'enclave de Srebrenica subit, notamment depuis le début de l'année 1995, un étouffement lent et progressif, mais parfaitement calculé de la part des Serbes. Le convoi de 64 tonnes de vivres qui parvient enfin à Srebrenica le 27 juin est le premier depuis de longs mois et est bien insuffisant pour soulager la souffrance d'une population qui meurt de faim. Les Serbes s'opposent d'ailleurs à l'entrée de médicaments. Cette politique d'étranglement repose sur des considérations stratégiques : située sur la vallée de la Drina, l'enclave de Srebrenica est essentielle pour permettre la continuité entre la future Republika Srpska et la Serbie. Il s'agit là, dans l'optique serbe, d'un objectif de long terme et d'un élément susceptible de peser dans la balance des négociations diplomatiques, les Serbes voulant en effet s'assurer le maximum d'atouts en vue d'éventuels échanges territoriaux. Les Etats occidentaux ne sont d'ailleurs pas dupes de ce calcul. Dès 1994, la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, commentant la crise de Gorazde qui intervient au printemps 1994, note le 25 mai 1994, qu'« il s'agissait en outre, bien entendu, de poursuivre la politique de construction de la Grande Serbie, donc de réduire voire de supprimer les trois poches musulmanes de Gorazde, Zepa et Srebrenica situées en Bosnie orientale ». Elle concluait : « La première constatation que l'on peut faire au terme de cette crise est que l'un des objectifs stratégiques des Serbes reste la maîtrise totale de la rive droite de la Drina ». Dans son rapport quotidien d'activités du 6 juin 1995, la Mission européenne de contrôle, relatant l'attaque de l'enclave du 4 juin 1995, note que « selon des sources de Pale, cette attaque serait la première d'une vaste offensive serbe contre les enclaves musulmanes, qui une fois conquises, constitueraient une monnaie d'échange contre d'autres territoires entre les Serbes de Bosnie-Herzégovine et le Gouvernement de Sarajevo »10. A la lecture de ce document, transmis au ministère des Affaires étrangères français par un télégramme du 7 juin 1995, la Mission d'information ne peut que se montrer surprise par certaines déclarations entendues lors des auditions selon lesquelles il était impossible de prévoir l'attaque de Srebrenica. En l'occurrence, faut-il même parler de prévisions quand les Serbes montrent clairement que telle est leur intention, joignant l'action au projet en attaquant un premier poste d'observation ? Certes, les alertes sur les enclaves étaient permanentes et les parties au conflit promptes à lancer la FORPRONU sur de fausses pistes. Dans la note précitée relative à la crise de Gorazde, l'auteur notait qu'« analyser au plan militaire et politique les causes de la crise de Gorazde est un exercice difficile. En effet, la stratégie des parties ne s'exprime souvent qu'au travers de déclarations dont nombre procédant de la volonté délibérée de désinformer ». A ce stade du rapport, on peut considérer qu'à tout le moins, cette information eût mérité une attention et une observation accrues de l'enclave, dont nul n'ignorait la valeur symbolique pour les Serbes, ne serait-ce que parce qu'elle avait été le lieu de combats d'une extrême cruauté et que s'y était accumulée une haine qui conférait à cette enclave un poids tout particulier. Au total donc, il est incontestable que chacun savait que les Serbes n'acceptaient pas l'existence de l'enclave et que leur objectif était, à terme, de faire disparaître la zone de sécurité. Sur ce point, le témoignage de l'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine en dit plus que tous les commentaires : en mars 1993, « je me souviens avoir intitulé les télégrammes que j'ai adressés au Quai d'Orsay : "chronique d'un nettoyage ethnique annoncé". Je pense que je ne pouvais être plus clair en utilisant cette formule peut-être un peu littéraire mais qui manifestait bien l'intention que les Serbes avaient de nettoyer cette région ». · Concernant la prévisibilité de l'attaque serbe sur Srebrenica, la vraie question n'est donc pas celle du « si » mais du « quand » : existait-il des signes montrant que les Serbes projetaient une attaque sur Srebrenica au début du mois de juillet ? D'après les témoignages entendus par la Mission d'information et les documents de l'époque transmis par le ministère de la Défense, il est établi que, dès le mois de juin 1995, les signaux d'une attaque sur Srebrenica ont été relevés par les observateurs mais qu'aucun d'entre eux n'a pensé qu'il s'agirait d'une attaque globale visant à prendre l'ensemble de l'enclave. Tel est ce qui ressort du témoignage du général Heinrich, alors directeur du renseignement militaire : « En ce qui concerne l'imminence d'une attaque sur Srebrenica, nous en avions bien été informés, mais il y a quand même une grande différence entre l'imminence d'une attaque et ce qui allait s'ensuivre. Mais les attaques, il y en a eu sur Bihac et sur Gorazde. L'important, ce n'était pas l'imminence d'une attaque, car il y en avait tout le temps, mais son résultat, et c'était de pouvoir dire à l'avance "voilà ce qui risque de se passer". C'était cette analyse qui était importante. Sur les attaques en général, notamment celle de Srebrenica, il est évident que les mieux informés étaient ceux qui étaient sur place, c'est-à-dire les Hollandais, et les Hollandais ont, à ma connaissance, transmis à l'ONU le renseignement dont ils disposaient ». De fait, le compte rendu hebdomadaire de situation générale en ex-Yougoslavie au cours de la semaine du 26 juin au 2 juillet 1995, établi par le commandement du contingent français le 2 juillet 1995, note que « dans les poches orientales, enfin, c'est essentiellement Srebrenica qui retient l'attention. Des incidents inhabituels y ont été signalés ». L'interprétation qui en est donnée n'est pas inintéressante : « Il pourrait s'agir soit d'une attaque serbe, soit d'une opération de simulation d'origine bosniaque ou encore d'une lutte interne pour le pouvoir. Naser Oric, chef historique de la poche, pourrait en effet rencontrer actuellement des opposants ». Sans insister sur le fait que les auteurs du rapport ignorent manifestement que Naser Oric a quitté l'enclave depuis deux mois - élément qu'ignorait également le général Janvier mais qui était connu à Paris ... -, sur lequel nous reviendrons dans la suite du rapport, il apparaît clairement que la piste d'une attaque massive de l'armée des Serbes de Bosnie sur l'enclave de Srebrenica n'est explorée à aucun moment. La remarque du général Heinrich concernant la permanence des tensions sur les zones de sécurité peut expliquer la difficulté, pour l'observateur de l'époque, de sortir des schémas d'attaques continuelles sur les enclaves. La note de la Délégation aux affaires stratégiques sur la crise de Gorazde est à cet égard tout à fait révélatrice puisqu'on y retrouve toutes les problématiques de la crise de Srebrenica : - difficulté de suivre précisément le déroulement de la crise (« Dans ce type de conflit, reconstituer de façon exacte et préciser le déroulement des opérations n'est pas une chose aisée ») ; - débats sur les intentions réelles des Serbes (le général Rose, convaincu que les forces musulmanes possèdent un net avantage sur les Serbes en raison du caractère accidenté et boisé du terrain, déclare, le 3 avril, que « les forces serbes n'ont pas les moyens de prendre Gorazde) ; - méfiance vis-à-vis des autorités bosniaques qui donnent le sentiment de sur-réagir (« la radio bosniaque annonce le 3 avril que la ville de Gorazde est soumise à des bombardements d'une violence "sans précédent", ce qui est, à ce moment là, vraisemblablement exagéré. (...) Les dirigeants bosniaques, tenant absolument à faire réagir la communauté internationale, vont jusqu'à accuser les Nations unies de trahison pour ne pas avoir voulu protéger des populations civiles »). A la différence de Srebrenica toutefois, des frappes aériennes sont déclenchées sur cette zone où ne stationne aucun Casque bleu ... Cette tendance spontanée à sous-estimer l'ampleur de l'attaque correspond, il est vrai, à la réalité des faits. En effet, lorsque les Serbes planifient l'offensive sur Srebrenica, ils visent avant tout la réduction partielle, et non la prise complète de l'enclave : comme l'a expliqué Richard Butler, témoin du procureur au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), lors du procès du général Krstic, l'opération « Krivija 95 » - nom de code de l'offensive sur Srebrenica - a vu son objectif modifié, le 9 juillet, lorsque les unités Serbes ont constaté la faiblesse de la défense bosniaque et des forces de l'ONU, ainsi que l'absence d'intervention de l'arme aérienne. M. Jean-Claude Mallet l'a confirmé aux membres de la Mission d'information : « Nous savons depuis, par différents témoignages, que c'est le dimanche 9 juillet que le général Mladic, à partir du plan qu'il a élaboré et signé le 5 juillet, décide non seulement de poursuivre l'action, mais de prendre la totalité de l'enclave ». Il n'en reste pas moins que la répétition des crises dans les zones de sécurité a façonné un schéma mental, chez l'ensemble des acteurs, de terrain ou non, qui a considérablement atténué leur vigilance face aux signaux de l'attaque et les a menés à commettre de trop nombreuses erreurs. Ainsi, au mois de juin, les observateurs militaires de l'ONU font rapport au bataillon néerlandais d'une concentration de troupes serbes autour de Srebrenica. Selon le colonel Karremans, « le rapport que vous visiez et qui indiquait que, dès juin, il y avait des concentrations de troupes serbes autour de Srebrenica m'est parvenu. Le major Franken et moi-même avons rédigé un message sur son ordinateur portable. Après l'avoir relu, j'ai dit qu'il fallait le transmettre aussi rapidement que possible par voie hiérarchique. J'y ai ajouté d'autres informations. Il a rédigé tout cela mais on n'a plus jamais retrouvé trace de ce message. Je ne suis pas revenu là-dessus, jusqu'à l'année dernière où on a attiré mon attention sur ce message qui constatait qu'il y avait concentration de forces et qu'on pouvait penser que les Bosno-Serbes allaient entreprendre quelque chose ». Le rapport de Kofi Annan confirme l'existence d'une telle information : elle aurait été transmise à un officier de la FORPRONU du secteur Nord-Est par des membres de l'armée bosniaque. Quant au général Nicolai, à Sarajevo, il a témoigné avoir reçu cette information : « Il y avait eu des indications préalables quant à une attaque éventuelle sur Srebrenica. Je me souviens qu'au début du mois de juin, le colonel Karremans avait envoyé un rapport de situation aux instances supérieures de l'ONU ainsi qu'aux Pays-Bas. Il y mentionnait que le ravitaillement était stagnant et que sa préparation opérationnelle ne pouvait pas être assurée de manière satisfaisante. Dans ce même rapport, il indiquait qu'il y avait des concentrations de troupes des forces serbes près de l'enclave de Srebrenica. Il en concluait qu'il se pouvait qu'une attaque se prépare ». Se peut-il, dans ces conditions, qu'elle ne soit pas parvenue jusqu'à Zagreb ? Selon le rapport de l'ONU, il existe un autre indice qui n'aurait, semble-t-il, pas retenu l'attention du bataillon néerlandais. Un agent international d'une organisation humanitaire aurait entendu des rumeurs selon lesquelles les Serbes se préparaient à « rétrécir la poche ». Il aurait alors convenu d'un message codé (« Dis bonjour à Ibrahim ») avec l'un de ses collègues présents à Srebrenica s'il remarquait des indices confirmant cette rumeur. Le 4 juillet, ayant vu des armes lourdes serbes aux alentours de l'enclave et des traces de chars à Bratunac, il transmet le message au bataillon néerlandais11. Des rumeurs, dont la Mission d'information n'a pu vérifier la véracité, font par ailleurs état d'enregistrements qu'auraient interceptés les services de renseignement. La Croix révéla aussi, le 10 juillet 1996 qu'« à l'issue de plusieurs mois d'investigation, les services de renseignement français et américains auraient intercepté, dès le 17 juin 1995, des communications entre le général Perisic, chef d'état-major de l'Armée fédérale yougoslave, et le général Mladic, les deux hommes préparant l'attaque contre Srebrenica ». S'agit-il des « informations » évoquées par le général Heinrich ? Quoi qu'il en soit, même si cette assertion est vraie, la conversation interceptée ne porte pas sur une attaque globale de l'enclave mais, comme il a été prouvé, sur l'intention serbe de « rétrécir la poche ». Il n'en reste pas moins que ces différents indices, dont certains étaient connus, à l'époque, par la plupart des acteurs, auraient dû éveiller l'attention, d'autant que, dès le 1er juin, un poste d'observation de l'ONU tombe, « poste qui permet aux serbes d'utiliser sans restriction une route stratégique juste au Sud de l'enclave »12. Or, le commandant de la FORPRONU, le général Rupert Smith part en permission le 1er juillet et, comme l'a souligné le général Raymond Germanos, « si le général Rupert Smith est parti le 1er juillet, c'est-à-dire à quelques jours de cette chute, c'est qu'il ne pensait en aucun cas qu'il y aurait des attaques aussi massives, à moins de prêter une idée machiavélique, chose que je ne ferai pas, envers un officier général ami. Lui était parti, mais je peux en ajouter un autre, l'adjoint britannique du général Janvier parti aussi à ce moment-là. Cela, c'est uniquement un peu pour alimenter le débat ». A l'instar du général Germanos, d'aucuns ont insisté sur cette absence ou encore sur celle du brigadier britannique correspondant de CINCSOUTH auprès du général Janvier - c'est-à-dire notamment responsable des relations avec le commandement Sud de l'OTAN chargé de l'application de l'arme aérienne, à laquelle tous deux étaient favorables -, qui part en congé du 1er au 11 juillet. Certains pour en conclure qu'on ne pouvait vraiment pas prévoir les événements, puisque même des personnes directement concernées en cas d'attaques sont parties en congé. D'autres pour y voir là une coïncidence troublante. La Mission d'information ne peut donc que poser la question, sans réponse à ce jour : les services de renseignement de certains pays ont-ils eu des données précises sur l'attaque, qu'ils auraient communiquées à leurs ressortissants ou à leurs très proches alliés ? Le débat reste ouvert. · Sans doute la mission de la FORPRONU dans les enclaves était-elle extrêmement ambiguë et n'a jamais explicitement porté sur la défense de l'enclave. La terminologie même utilisée sur le terrain en témoigne : ce sont des postes d'observation, d'ailleurs peints en blanc, qui sont mis en place aux limites de la zone de sécurité, et non de défense. Ceci dit, ces zones ayant été instaurées par le Conseil de sécurité, il n'eût pas été anormal de chercher à en préserver l'intégrité, ne fût-ce que pour des raisons politiques : initiative majeure des Etats occidentaux, et notamment de la France, la politique des zones de sécurité ne pouvait pas se permettre d'échouer, sous peine de décrédibiliser la FORPRONU et l'action de l'ONU tout entière en ex-Yougoslavie. C'est pourtant ce qui s'est passé, d'abord parce qu'aucun plan de défense de l'enclave n'a jamais été élaboré, faisant de Srebrenica une proie d'autant plus tentante pour l'armée des Serbes de Bosnie. Celle-ci suit d'ailleurs avec attention les réactions des Etats de la FORPRONU sur le terrain. Comme l'a expliqué le commissaire Jean-René Ruez aux membres de la Mission d'information, « les officiers de sécurité du Drina Corps qui étaient en rapport avec les observateurs militaires, dans les mois qui ont précédé, ont sans cesse posé des questions sur quelle serait l'attitude de la communauté internationale au cas où l'enclave serait prise ». En réalité, la seule défense dont pouvaient disposer les troupes présentes à Srebrenica était l'arme aérienne dont on a vu précédemment qu'elle était perçue, non seulement comme inefficace, mais plus encore comme dangereuse suite à l'affaire des otages. Dans cette perspective, chacun considérait l'enclave comme indéfendable : les soldats néerlandais l'avaient dit à leur Ministre en 1994 ; tel fut également le message du général Janvier au Conseil de sécurité le 24 mai 1995. Enfin, le constat, brutal, est rappelé par le colonel Karremans le lendemain de la chute de l'enclave, dans un fax relatant ses entretiens avec le général Mladic : « Je suis dans l'incapacité de : a- défendre ces gens ; b- défendre mon propre bataillon... ». Les nombreux signaux relevés auraient pourtant dû conduire à une concertation préalable entre les différents niveaux de la chaîne de commandement sur les scénarios de réaction possibles en cas d'attaque. S'il n'existe pas de plan de défense de l'enclave, c'est parce que, aux yeux des responsables de l'ONU, et même aux yeux des Gouvernements impliqués, la vraie question n'est pas là mais concerne la sécurité des Casques bleus. Ainsi, dans la directive 2/95 du 29 mai 1995, prise suite aux frappes aériennes sur Pale, le général Janvier écrit que : « L'exécution du mandat est secondaire à la sécurité du personnel des Nations unies. L'intention est d'éviter toute perte de vie lorsque des positions sont défendues alors que celles-ci ne sont pas indispensables et pour éviter toute prise d'otage. Les positions qui peuvent être renforcées ou qui peuvent être reprises par une contre-attaque ne doivent pas être abandonnées. Les positions qui sont isolées en territoire serbe et dont le soutien ne peut être assuré, peuvent être abandonnées lorsque les commandements supérieurs en prennent la décision, à la discrétion du commandement supérieur, lorsque ces positions sont menacées et lorsque le commandement supérieur estime que des vies risquent d'être perdues. Les camps ne doivent pas être abandonnés alors que la population peut être transférée vers d'autres lieux. Quoi qu'il en soit, il faut porter le plus grand soin pour éviter de ne pas être surpris par les forces serbes qui pourraient utiliser un équipement appartenant aux Nations unies ». La première phrase est à la fois sans ambiguïté et prémonitoire : entre la préservation des zones de sécurité - le mandat - et la sécurité des Casques bleus, seule compte cette dernière. Non seulement aucun plan de défense de ces zones n'est mis en oeuvre, mais l'application de cette directive conduit purement et simplement à préconiser de ne pas chercher à défendre les enclaves. Ces directives ont été confirmées et reconfirmées les 2 et 27 juin par le général Janvier, commandant des forces de paix des Nations unies pour l'ex-Yougoslavie. A défaut de plan de défense établi par l'ONU, existait-il un dispositif de défense bosniaque ? Sur ce point, la Mission d'information a recueilli des témoignages assez flous, voire contradictoires. Les deux hommes qui auraient pu lui fournir des renseignements précis ne se sont pas présentés aux rendez-vous convenus avec les membres de la Mission d'information lors de son déplacement en Bosnie-Herzégovine : ainsi, le général Rasim Delic, qui commandait l'armée bosniaque pour le secteur de Tuzla dont dépendait Srebrenica, n'est pas venu au rendez-vous prévu le mercredi 27 juin à Sarajevo, sans donner d'explication ; il en est de même de M. Naser Oric, alors responsable de la défense de Srebrenica. Ce dernier, qui avait pourtant confirmé la veille qu'il serait présent au rendez-vous fixé à Tuzla le 29 juin, a même changé de numéro de téléphone dans la nuit... La Mission d'information avait pourtant des questions importantes à leur poser. En premier lieu, combien y avait-il de combattants bosniaques dans l'enclave et quel était leur équipement, dans la mesure où chacun sait que l'accord de démilitarisation signé en 1993, lors de la constitution de la zone de sécurité, n'a jamais été pleinement appliqué, tant s'en faut ? Le rapport de M. Kofi Annan parle de 3 000 à 4 000 hommes de la 28ème division de l'armée bosniaque ; pour sa part, le Ministre de la Défense néerlandais de l'époque, M. Joris Voorhoeve, a évoqué devant la Mission d'information le chiffre de 5 000 militaires et 3 000 miliciens, soulignant la frontière ténue entre combattants « professionnels » et hommes armés occasionnellement, au gré des circonstances. Quant aux documents du ministère de la Défense, ils évoquent le chiffre de 4 000 Musulmans13. Interrogé sur ce point par la Mission d'information, un témoin présent sur place n'a pas souhaité répondre. « Même si je le savais », a-t-il ajouté, « je ne le dirais à personne parce que cela conforterait les mal intentionnés et montrerait que les Serbes avaient eu raison ». A-t-il voulu dire que cela conforterait les affirmations serbes selon lesquelles Srebrenica était une base de repli des combattants bosniaques ? Il a également précisé certains éléments concernant l'armement des Bosniaques dans l'enclave : « Si on arrête le chiffre à 250 fusils par brigade, cela fait au total 8 250. Il y a trois ans, le Président Alija Izetbegovic avait déclaré à la télévision - je l'ai vu moi-même - qu'il avait envoyé à Srebrenica un demi-million de balles. Je ne peux pas croire qu'il a envoyé autant de balles ». Son témoignage confirme par ailleurs les données recueillies par la Mission d'information, à savoir que les Bosniaques n'avaient pas d'armement lourd et étaient mal entraînés : « En fait, les hommes ont perdu leur motivation pour les combats lors des deux années de présence de la FORPRONU. Ils ne suivaient aucun entraînement, toutes les activités militaires étaient interdites. Que pouvait-on espérer de gens qui ont simplement attendu pendant deux ans ? C'est un des facteurs de la faiblesse de la défense ». Le général Nicolai a pour sa part déclaré que, « pour avoir vu les stocks d'armes présents à Srebrenica, je peux témoigner qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un arsenal très dissuasif ». Le rapport de Kofi Annan se situe exactement sur la même ligne : « Les Musulmans de Bosnie-Herzégovine n'avaient pas d'armes lourdes, à l'exception d'un petit nombre de missiles antichars introduits clandestinement dans l'enclave (mais il est apparu par la suite qu'ils ne savaient pas les utiliser) et quelques mortiers légers. Ils étaient mal entraînés (...). Le commandement était fragmenté, la discipline relâchée, le moral bas et la logistique pratiquement inexistante »14. En second lieu, pourquoi les autorités bosniaques de Sarajevo ont-elles ordonné au commandant de l'enclave, M. Naser Oric, et à une vingtaine de ses lieutenants de quitter l'enclave en avril 1995 ? En un mot, pourquoi avoir décapité le « dispositif » bosniaque de défense de l'enclave ? Certes, M. Ramiz Becirovic a pris la relève, que le colonel Karremans a décrit comme un homme tout à fait compétent ; certes, dans aucune armée, le dispositif de défense ne dépend d'un seul homme. Mais, comme l'a expliqué un témoin présent sur place, pour qui l'impact d'une telle décision fut indéniable, « il était une légende. Cela a signifié beaucoup pour le moral de la population ». D'ailleurs, les Serbes eux-mêmes cherchaient à se débarrasser de Naser Oric, ainsi que l'a précisé M. Jean-René Ruez : « Pendant le printemps 1995, les services de sécurité de l'état-major général bosno-serbe ont essayé de monter des opérations d'assassinat contre M. Naser Oric pour l'attirer dans un piège, réunion avec garantie de sécurité, mais en fait dans le but de l'assassiner sur le trajet. Ils n'ont pas eu besoin de se donner cette peine puisque c'est en fait le Gouvernement bosniaque qui a retiré M. Naser Oric et ses meilleurs officiers de l'enclave. Une démarche particulièrement bizarre effectivement dans le mesure où, sans la présence de ce personnage et de ses assistants, il était clair que la volonté de défense de l'enclave était très sévèrement limitée ». Une telle décision paraît donc difficilement compréhensible. Pour M. Van Mierlo, ancien Ministre des Affaires étrangères néerlandais, « nous ne comprenons toujours pas pourquoi le commandant musulman Naser Oric s'était retiré avec une vingtaine de ses meilleurs officiers quelques mois auparavant. » En France, aussi, on s'étonne de cette décision : « Nous sommes nous aussi un peu étonnés d'avoir constaté que Naser Oric a été changé à la tête des unités bosniaques. Lui-même a largement déclaré qu'on l'avait fait quitter Srebrenica car on voulait que Srebrenica tombe. Le « on » c'était Izetbegovic. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Nous avons été étonnés de voir le chef militaire qui était respecté sur place, avec un certain nombre d'unités qui se tenaient relativement bien, quitter avec son état-major Srebrenica. Nous en avons été pour le moins surpris » (général Raymond Germanos). Car, évidemment, au-delà de la question de savoir si le départ de Naser Oric a vraiment eu un impact sur le dispositif défensif bosniaque à Sarajevo, se pose celle du pourquoi. Les autorités bosniaques ont-elles volontairement et en toute connaissance de cause affaibli la défense bosniaque de Srebrenica ? La Mission d'information n'est pas en mesure d'étayer la thèse d'un complot bosniaque, que certains, y compris bosniaques, soutiennent. A ce stade, la meilleure - à dire vrai, la seule - explication fournie sur ce point émane du Président Alija Izetbegovic que la Mission d'information a rencontré à Sarajevo : « Nous avons eu des informations selon lesquelles il y avait des choses pas nettes, des conflits et des disputes entre les autorités militaires et civiles à Srebrenica. Des meurtres ont été commis à Srebrenica et n'ont pas été éclaircis. Nous avons eu des informations de cette sorte pendant plusieurs mois. L'armée a donc convoqué Naser Oric à Tuzla, suite à des plaintes selon lesquelles des choses terribles se passaient à Srebrenica et qui accusaient Naser Oric d'être derrière tout cela. L'armée voulait mener une enquête et voir de quoi il retournait. Naser Oric devait retourner à Srebrenica par l'hélicoptère qui a été abattu au mois de mai. Lui n'est pas monté dans cet hélicoptère ; c'est son adjoint qui est reparti. Depuis cet incident, il ne voulait plus rentrer à Srebrenica, sauf dans un hélicoptère blindé que nous n'avions pas. Peut-être le général Delic pourrait vous en dire plus car c'est l'armée qui s'est chargée de cette enquête. » L'ensemble de ces témoignages et la gravité de l'accusation contre les autorités bosniaques rendent d'autant plus incompréhensible l'attitude de MM. Oric et Delic qui, par leur refus de s'exprimer devant la Mission d'information, ne font que nourrir ce genre de thèses. · Absence totale de plans de défense de l'ONU, une défense bosniaque laminée, en connaissance de cause semble-t-il : dans ces conditions, la logique eût voulu qu'existât au moins un plan d'évacuation de la population dans l'éventualité d'une attaque serbe. Tel n'est pas le cas, notamment et avant tout parce que le Gouvernement bosniaque l'a toujours refusé. Comme l'a rappelé M. Joris Voorhoeve, « la proposition avait été faite également d'évacuer de manière préventive la population de ces enclaves, non seulement par le Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, mais aussi par la France. Mais le Gouvernement bosniaque ne le souhaitait pas, se fondant sur l'idée d'une Bosnie multiethnique. Les enclaves orientales représentaient un symbole de pays multiethnique ». Il est vrai que les autorités bosniaques de Sarajevo ont constamment refusé les évacuations préventives de leurs ressortissants, refusant le fait accompli du « nettoyage ethnique ». Ainsi, à Srebrenica, en avril 1993, elles s'opposent à l'évacuation supplémentaire d'habitants musulmans, 3 000 femmes et enfants ayant déjà quitté l'enclave. A cet égard, le Président Alija Iztbegovic a considéré rétrospectivement que « la politique de son Gouvernement consistant à entraver les évacuations de l'enclave de Srebrenica avait été mal inspirée »15. On pourra considérer toutefois que les organisations humanitaires de l'ONU auraient dû exercer une pression accrue sur le Gouvernement bosniaque en faveur d'évacuations préventives, à tout le moins préparé un plan d'évacuation en cas d'attaque serbe. Leur position dogmatique visant à ne pas se faire les complices du « nettoyage ethnique » les a conduits en l'occurrence à une passivité qui allait à l'encontre de leur mission humanitaire. Ainsi, d'après un télégramme envoyé le 12 juillet 1995 par la représentation diplomatique auprès de l'ONU, c'est-à-dire au c_ur même des événements de Srebrenica, « il est clair que, ni le HCR, ni le CICR ne souhaitent pour des raisons évidentes, être responsables des évacuations »16. Cette application obtuse de la logique traditionnelle de maintien de la paix (consentement des parties), conjuguée à une approche dogmatique de la situation, confine à l'absurde lors de l'attaque serbe sur Zepa, alors que les rumeurs de massacres massifs à Srebrenica se confirment : « Le HCR et le CICR n'entendent pas participer ou organiser l'évacuation de la population qui s'inscrit dans la politique bosno-serbe de « nettoyage ethnique », sauf si le Gouvernement bosniaque leur en fait expressément la demande et à la condition que les civils de Zepa souhaitent quitter les villages de l'enclave »17. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'aucun plan d'évacuation n'ait été préparé au préalable. A posteriori, l'absence de tout plan de défense et, à défaut, d'évacuation de la population civile apparaissent comme des fautes majeures de l'ONU, à savoir le Secrétaire général, le Département des opérations de maintien de la paix, le CICR, le HCR et, sur place, la FORPRONU à Srebrenica, à Tuzla, à Sarajevo et le commandant des FPNU à Zagreb. Car ce qui aurait été une « simple » erreur en cas d'attaque serbe sans conséquence autre que la perte de l'enclave par les Bosniaques est devenue une faute lourde avec le massacre de masse qui a accompagné la chute de la zone de sécurité. · Se pose dès lors l'inévitable question de savoir si les massacres étaient prévisibles. A dire vrai, il est impossible de trancher cette question. La Mission d'information a, pour sa part, la conviction que si nul ne pouvait penser qu'un massacre aussi massif et systématique serait perpétré, il existait une forte probabilité que des exactions soient commises, notamment en raison de ce qu'on pourrait appeler le passif de haine entre Serbes et Musulmans à Srebrenica. Avant l'institution de la zone de sécurité, les deux communautés s'y sont en effet livrées aux pires atrocités. Il n'est pas aisé d'avoir des informations sur les exactions commises par les Bosniaques contre les Serbes. Une source serbe18 évoque l'attaque de plus d'une centaine de localités avant avril 1993, et un bilan de « un millier de civils et de soldats de la RS » tués. Et de détailler certaines de ces attaques, au cours desquelles des habitants des villages environnants auraient été « brûlés, égorgés, décapités, éventrés, tués avec des objets contendants ». La Mission d'information n'a pas les moyens d'évaluer la véracité de ce récit. Reste que, dans l'esprit des Serbes, en 1995, Srebrenica est une base arrière pour les combattants bosniaques dont certains se sont livrés aux pires exactions. Et chaque soldat serbe a en tête les récits, vrais ou faux, de ces « raids ». Sans doute le massacre sans pitié des hommes de Srebrenica relève-t-il partiellement d'une vengeance, au-delà de l'application de l'idéologie folle de « purification ethnique » qui guide Mladic : celui-ci s'est appuyé sur la haine accumulée à Srebrenica et sur des exécuteurs assoiffés de vengeance pour mener à bien son projet de « purification ethnique » de la Republika Srpska. Telle est également la thèse avancée par la plupart des témoins auditionnés par la Mission d'information, qu'il s'agisse du général Christian Quesnot : « J'estimais que cela n'allait pas très bien se passer parce que Mladic... On ne va pas revenir sur ce personnage mais je pense que personne, honnêtement, n'a imaginé ces massacres aussi systématiques », du général Jean Heinrich : « Dire qu'on pouvait prévoir des exactions à la hauteur de ce qui s'est passé est, très sincèrement, douteux ; prévoir l'horreur à ce point me paraît un peu démesuré. Nous avons craint que des exactions puissent être commises car il y avait le contentieux précis que j'ai décrit », ou encore de M. Jean-Claude Mallet : « Nous espérions que la présence internationale à Srebrenica serait un élément qui imposerait une certaine retenue aux Serbes. En revanche, pour ma part, je n'avais aucune illusion sur le fait que des atrocités seraient commises (nous l'avons écrit), sans aller toutefois jusqu'à imaginer les atrocités planifiées telles qu'elles vous ont été décrites ». L'impossibilité de prévoir le massacre de plus de 7 000 personnes à Srebrenica n'excuse en rien l'incurie de l'ONU, bien au contraire : le « contrat » passé en 1993 entre le général Morillon et les habitants de Srebrenica, validé par le Conseil de sécurité, portait sur la protection de toute la population et n'impliquait en rien qu'on accepte consciemment que des « exactions » puissent être commises. b) La gestion de la crise : erreurs et fautes sur fond de passivité internationale Le constat qui ressort des analyses précédentes est simple : rien n'a été fait pour prévenir d'éventuelles attaques contre Srebrenica, ni aucun plan de défense de l'enclave ou d'évacuation des populations civiles étudié. Cela implique-t-il que, le 6 juillet, au moment du déclenchement de l'attaque serbe, le sort de l'enclave est scellé ? Pendant la crise, une action militaire susceptible de repousser les Serbes était-elle possible, sachant que c'est seulement le 9 juillet que les Serbes décident de prendre toute l'enclave, après avoir constaté l'absence de réaction de l'ONU ? A l'issue de ses travaux et du déplacement qu'elle a effectué sur place, la Mission d'information estime qu'il était possible d'intervenir militairement contre les Serbes, aussi bien dans l'enclave elle-même que par une action aérienne. Elle n'approuve donc pas l'analyse, notamment présentée par l'amiral Jacques Lanxade, selon laquelle Srebrenica est perdue dès le 6 juillet : « Votre première question est tout à fait essentielle : cette tragédie aurait-elle pu être évitée ? Il faut savoir à quel moment on se pose cette question. Si on se la pose début juillet, je dis non. Si on se la pose un an avant, je dis oui. En effet, si on avait fait ce qu'on avait prévu de faire à New York, c'est-à-dire mettre en place des moyens pour effectivement donner aux zones de sécurité la protection souhaitée et si, par ailleurs, on avait pu déployer une force de réaction, on aurait pu éviter cela. Malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Pour moi, il est tout à fait clair que, lorsque les événements se précipitent, à partir du 6 ou du 7 juillet, et qu'on en prend conscience, on ne peut militairement plus rien faire ». Nul ne peut dire aujourd'hui si l'enclave aurait pu être préservée par cette intervention ou si la chute aurait été seulement repoussée. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'une action volontaire de l'ONU à Srebrenica aurait permis d'envoyer un message de fermeté aux Serbes et probablement au moins limité les massacres ; en outre, elle aurait fait porter sur eux non seulement la culpabilité mais également l'entière responsabilité de la tragédie. Car Mladic entre dans Srebrenica le 11 juillet, non comme un chef de guerre qui a gagné une bataille contre l'ONU mais comme un idéologue qui interprète la passivité de l'ONU comme un feu vert à l'application de sa politique de « purification ethnique ». Et, avec lui, les exécuteurs serbes se sentent les mains totalement libres. La question se pose dès lors de savoir pourquoi l'ONU n'est pas intervenue pendant la crise. A nouveau, comme dans la période précédant l'attaque, de multiples erreurs d'appréciation et d'utilisation des procédures se succèdent. De bout en bout, la passivité domine, qu'elle soit celle des soldats du Dutchbat pendant l'attaque et après la chute, ou de l'échelon suprême des forces de l'ONU ou des différentes capitales. Et ce, alors que se répandent très rapidement les rumeurs sur des massacres massifs. · La première série d'erreurs porte sur l'appréciation des intentions serbes. Cette incapacité à évaluer les objectifs de l'agresseur pèse sur l'ensemble de la gestion de la crise, d'autant que ce n'est qu'au dernier moment, vraisemblablement le 10 juillet pour certains, le 11 pour d'autres, que les différents échelons de la chaîne de commandement officiel, mais également de la chaîne officieuse française, prennent la mesure de la situation. L'impression pénible qu'ont eu les membres de la Mission d'information, tout au long de leurs investigations, d'un retard permanent des acteurs de la crise sur la réalité des événements tient sans nul doute dans cette erreur initiale. L'incapacité de la FORPRONU à comprendre les intentions serbes est d'abord liée à une erreur dans l'appréciation de leurs moyens. Sans doute, lorsque le colonel Karremans écrit, dans le point de situation qu'il envoie au commandement du secteur Nord-Est le 7 juillet que « l'armée des Serbes de Bosnie ne serait pas en mesure de "conquérir" l'enclave à court terme parce que ses effectifs étaient limités »19, il ne peut pas prévoir ce que les Serbes eux-mêmes n'ont pas encore décidé. Néanmoins, cet élément d'ambiance n'est pas de nature à faire prendre conscience de l'ampleur de l'attaque. Même après que les Serbes ont modifié l'objectif de leur attaque, à savoir non plus seulement le rétrécissement de l'enclave et le contrôle de la route Sud, mais la prise de l'ensemble de la zone de sécurité, après le 9 juillet donc, le bataillon néerlandais n'est pas conscient de l'ampleur de l'attaque. Comme l'a souligné M. Gilles Hertzog lors de son audition, « en ce qui concerne les Néerlandais, il est tout à fait exact qu'ils ont supposé jusqu'à la fin que les Serbes voulaient simplement neutraliser la route Sud de l'enclave, et non pas la prendre ». A la décharge des Néerlandais, il est vrai que les alarmes sur les zones de sécurité étaient permanentes et que beaucoup ont vu cette nouvelle attaque comme une menace supplémentaire, une tension de plus parmi toutes celles qui s'étaient déclenchées. A partir du 10 cependant, le doute n'est plus permis. Même à Paris, où les informations parviennent avec un décalage fatal, c'est le 10 juillet, en début de journée, que l'on comprend que, cette fois, les Serbes sont décidés à aller jusqu'au bout. Comme l'a expliqué M. Jean-Claude Mallet : « Au début de la matinée, les autorités françaises prennent brutalement conscience de la situation sur le terrain. Nous savons que les Serbes se trouvent, le 9 juillet au soir, à moins d'un kilomètre de la ville, qu'ils contrôlent la moitié Sud de l'enclave, que 30 Néerlandais sont entre leurs mains avec, d'après ce qui nous est dit, un statut controversé d'otage ou de prisonnier. L'information qui remonte sur ce dernier point, à ce moment-là dans la capitale, n'est pas claire. Cette prise de conscience brutale aboutit à de fréquentes réunions de crise aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères. (...) En interne, demeurent des interrogations, d'une part, sur les intentions réelles des Serbes et, d'autre part, sur la raison du non-déclenchement du soutien aérien rapproché. Puis, une fois que la gravité de la situation est constatée, nous faisons la comparaison entre ces éléments de base, qui sont ceux de la protection des zones de sécurité, et le fait que le soutien aérien rapproché n'a pas été déclenché. Nous en sommes à ce moment-là au stade des recherches d'explications ». Ce témoignage met l'accent sur ce qui apparaît comme le maillon faible de cette journée du 10 juillet : le commandement des forces de protection des Nations unies à Zagreb. Des documents et auditions recueillis par la Mission d'information, il ressort que le général Janvier, pas plus que M. Yasushi Akashi, ne perçoit la réalité des événements. La conversation téléphonique du général Janvier avec le général Mladic à 21 heures 25, rapportée dans le rapport de M. Kofi Annan, révèle un état d'esprit en total décalage avec les événements. Il déclare en effet au général serbe qui s'occupe déjà de rassembler tous les autocars disponibles dans la région qu'« il ferait tout son possible pour éviter de recourir à la force mais qu'il y avait des limites ». A la fin de la réunion, il a ajouté qu'« il trouvait étrange que les Serbes se soient conduits comme ils l'avaient fait en plein milieu des négociations »20 ! Seule une mésestimation de la situation globale peut expliquer ce qui s'apparente, a posteriori, à un total aveuglement. Celle-ci est patente dans le compte rendu de la réunion entre M. Yasushi Akashi et les généraux Janvier et Rupert Smith du 9 juin 1995, alors que, suite aux bombardements sur Pale décidés par le général Rupert Smith et en pleine crise des otages, les divergences entre les deux officiers sont profondes. Avant d'en citer le contenu, la Mission d'information précise que ce document n'émane d'aucune source officielle, qu'il a vraisemblablement été établi et diffusé par l'un des collaborateurs du général Janvier, alors que les premières accusations de collusion avec le général Mladic sont lancées. Son contenu est donc à prendre avec précaution ; pour autant, il est assez révélateur de l'état d'esprit des deux hommes et peut contribuer à expliquer l'attitude du général Janvier le 10 juillet. Lors de cette réunion, le général Rupert Smith expose qu'il est probable que les Serbes « continuent de tester la communauté internationale pour montrer qu'ils ne sont pas contrôlables : cela va conduire à un resserrement de la pression sur Sarajevo ou à une attaque dans les enclaves orientales, créant une crise à laquelle, faute d'attaque aérienne, nous aurons beaucoup de mal à réagir. (...) Si nous mettons la force de notre côté, il [Mladic] fera des concessions, mais si nous agissons selon ses termes, il réussira à nous neutraliser ». Le général Janvier fait remarquer que « le plus acceptable pour les Serbes serait que nous laissions les enclaves. C'est l'approche la plus réaliste et cela est logique d'un point de vue militaire, mais il est impossible pour la communauté internationale de l'accepter ». Pour sa part, le général britannique, soulignant que son analyse des intentions serbes diffère, se dit convaincu que « les Serbes veulent conclure cette année et ils prendront tous les risques pour accomplir cela ». Le général Janvier poursuit : « Les Serbes veulent deux choses : la reconnaissance internationale et l'adoucissement du blocus sur la Drina. (...) Je ne pense pas qu'ils veuillent aller vers une crise extrême. Au contraire, ils veulent modifier leur comportement, être de bons interlocuteurs. C'est pourquoi nous devons leur parler, non pas négocier, mais leur montrer combien il est important d'avoir une attitude normale (...) à moins d'une provocation majeure des Bosniaques, les Serbes n'agiront pas ». Pour le général Rupert Smith, « nous sommes déjà au-delà de la ligne de Mogadiscio ; les Serbes ne nous voient pas comme des peacekeepers ». Le général Janvier conclut en disant : « Aussi longtemps que les enclaves existeront, nous serons, dans une certaine mesure, neutralisés. A New York j'ai dit que l'armée de Bosnie-Herzégovine devrait défendre les zones de sécurité, ils sont suffisamment forts pour le faire. Cela n'a pas été bien reçu du tout ». Les prises de position du général Janvier le 10 juillet au soir se situent dans l'exacte logique de l'analyse globale de la situation dont il fait état le 9 juin. A cette erreur sur l'appréciation des intentions serbes s'est toutefois ajoutée une incapacité à réagir aux évolutions de la situation sur le terrain et à adapter la ligne de conduite de la FORPRONU en conséquence. Le 10 juillet, le général Janvier a pris la mauvaise décision en n'ordonnant pas au plus vite un appui aérien rapproché parce qu'entre autres éléments, il n'a pas su, ou pas voulu, admettre qu'il s'était trompé sur les intentions serbes. · La deuxième série d'erreurs est d'ordre tactique et opérationnel. Elles émanent, là encore, de tous les niveaux de la chaîne de commandement, de Srebrenica à Zagreb. En premier lieu, l'absence de toute résistance de la part du Dutchbat doit-elle être considérée comme une erreur ou comme le résultat de l'impossibilité dans laquelle le bataillon néerlandais se trouvait de résister à moyen terme à l'attaque de 5 000 Serbes équipés d'armements lourds ? Sur ce point, le rapport de M. Kofi Annan est éminemment prudent : « En dernière analyse », estime-t-il, « on ne peut affirmer avec certitude qu'une intervention plus énergique du bataillon néerlandais aurait sauvé des vies et il se peut même qu'une telle intervention ait fait plus de mal que de bien »21. A dire vrai, on voit difficilement en quoi les événements pouvaient être pires que ce qu'ils ont été. Il note néanmoins que : - « chacun des huit postes d'observation comptait en moyenne 7 soldats, généralement équipés d'un véhicule blindé de transport de troupes (VBTT) sur lequel était montée une mitrailleuse lourde de calibre 0,50. En outre, une arme antichars TOW était généralement montée sur chaque poste qui disposait aussi d'un certain nombre de roquettes antichars AT-4 tirées à l'épaule, et chaque soldat portait des armes de poing et des armes automatiques »22 ; - le 8 juillet, lors de l'attaque du poste d'observation Foxtrot, le missile antichar TOW ne fonctionne pas. « Le personnel du poste d'observation disposait cependant d'une roquette anti-char tiré à l'épaule AT-4 en état de marche, qu'il aurait pu utiliser contre le char de l'Armée des Serbes de Bosnie qui lui faisait face »23. Le commandant de la compagnie B estima toutefois que faire feu risquait d'aggraver la tension ; - lors de l'instauration de la position de blocage, ordre est donné de riposter en cas d'attaque directe sur la position. Quand celle-ci est directement visée le 10, les soldats néerlandais se contenteront de tirer au-dessus de la tête des Serbes ; - lorsque les Serbes entrent dans la ville, « le bataillon néerlandais, pour sa part, n'avait pas tiré un seul coup de feu contre les forces serbes qui progressaient » ; - « comme on lui avait dit que le risque d'affrontement avec les Serbes devait être évité et que la sécurité de ses troupes passait avant l'exécution du mandat de la force, le bataillon néerlandais s'est retiré des postes d'observation directement attaqués. Il est vrai que les troupes de la FORPRONU à Srebrenica n'ont jamais ouvert le feu sur les agresseurs serbes »24. Le fait est là, troublant : à aucun moment, le bataillon néerlandais présent à Srebrenica n'a opposé une quelconque résistance aux Serbes. Ce fait a d'ailleurs été relevé par les Néerlandais eux-mêmes qui, aussitôt après les faits, avaient déclenché une enquête pour comprendre les causes de cette débâcle. Le 31 août 1995, M. Joris Voorhoeve, auditionné pendant plus de cinq heures par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse, avait reconnu que des fautes avaient été commises mais « pas de gaffes monumentales qui auraient mis en danger des vies humaines »25. Il avait rappelé le caractère particulièrement délicat de la mission qui incombait au Dutchbat : « Srebrenica était indéfendable », la tâche du bataillon néerlandais n'était pas de défendre l'enclave mais de faire office de « système d'alarme » pour un appui aérien venu trop tard et de façon trop limitée. Le rapport établi suite à l'enquête ordonnée par le Gouvernement néerlandais exonéra également le Dutchbat, à la fin du mois d'octobre 1995. A la fin du mois de novembre cependant, suite à de nouvelles révélations de certains médecins militaires néerlandais indiquant qu'ils avaient dû, sur instruction, refuser de soigner des Musulmans gravement blessés et de s'en tenir aux Casques bleus néerlandais - à la suite de quoi 3 Musulmans seraient morts -, M. Joris Voorhoeve avait admis que le rapport rédigé en septembre 1995 était « rapide » sur certains points. La Mission d'information n'a pas à se prononcer sur les éventuelles insuffisances des soldats du Dutchbat à Srebrenica, d'autant que, depuis cinq ans, une enquête est en cours aux Pays-Bas sur ce même sujet, dont on peut espérer qu'elle aboutira prochainement. Elle ne reprend pas non plus à son compte les déclarations de certains officiers français qu'elle a auditionnés, pour qui, au-delà du mandat et des règles d'engagement, seule la passivité était infamante, et qui se sont déclarés convaincus que les Français auraient fait Camerone, notamment s'il y avait eu des légionnaires parmi eux, conformément à leur tradition militaire. Officiers pour qui, en un mot, « si nous avions eu 400 Français à Srebrenica, cela aurait été totalement différent car nous nous serions battus. Les Néerlandais ont reçu l'ordre de se battre. Quand on reçoit l'ordre de barrer une direction, on se bat, c'est la mission. Nous nous serions battus et tout aurait changé. Nous aurions man_uvré, replié les dispositifs extérieurs, mis en oeuvre nos armes, comme les mortiers de 81. Chaque engin blindé est équipé d'une mitrailleuse de 50. Nous nous serions battus. Nous aurions réagi et je suis persuadé que nous aurions fait reculer les Serbes. Certes, il nous manquait, dans les forces des Nations unies, des moyens pour annihiler l'artillerie serbe. On l'a bien vu à propos du mont Igman. Lorsque nos mortiers ont été là pour écraser les Serbes, la chose a été différente. Les Néerlandais avaient aussi des missiles anti-chars puissants : ils ne les ont pas utilisés. Ils avaient des lance-roquettes anti-chars : ils ne les ont pas utilisés. Je pense qu'ils auraient dû se battre, quoi qu'en dise le rapport du Secrétaire général des Nations unies ». M. Van Mierlo s'est lui-même posé la question de savoir si d'autres auraient fait mieux : « Pour finir, Monsieur le Président, on pourrait se demander La Mission d'information n'étant pas là pour refaire l'histoire, elle laisse ces déclarations à l'appréciation du lecteur. Elle se doit en revanche de chercher à comprendre : pourquoi les soldats néerlandais ne se sont-ils pas battus ? Nul doute que l'épuisement et la tension nerveuse de jeunes hommes sur le point de regagner leur pays devaient être à leur comble ; à cet égard, le décès tragique de Raviv von Renssen, tué par un combattant bosniaque alors qu'il quittait un poste d'observation attaqué par les Serbes, n'a fait qu'ajouter à la tension déjà extrême. Par ailleurs, il est de notoriété publique que les soldats du Dutchbat entretenaient de mauvaises relations avec les habitants de l'enclave. L'antagonisme et la défiance n'ont fait que croître entre les deux parties, notamment quand les Bosniaques ont constaté que les soldats néerlandais ne se battaient pas. Ce contexte d'ensemble explique sans doute que les soldats du Dutchbat présents dans les postes d'observation tombés aux mains des Serbes préférèrent se rendre à leurs agresseurs plutôt que de regagner l'enclave et d'être éventuellement pris à parti par les Bosniaques. Les soldats néerlandais ont probablement commis une erreur tactique, aux conséquences majeures sur la psychologie des Serbes, en n'opposant absolument aucune résistance ; ils ont sûrement commis une deuxième erreur tactique en devenant des otages potentiels, quand ils avaient véritablement le choix de regagner leurs bases. Sans parler du fait que ces soldats manqueront cruellement quand il s'agira de « contrôler » l'évacuation des réfugiés. La troisième erreur tactique commise par le bataillon néerlandais réside dans leur refus obstiné de laisser les Bosniaques se battre, même alors qu'il apparaissait clairement qu'ils n'opposeraient aucune résistance aux Serbes. Un témoin va même plus loin en exposant que les Néerlandais n'ont pas respecté « l'alliance » conclue entre le colonel Karremans et le chef des combattants bosniaques, Ramiz Becirovic. Certes, une partie des combattants bosniaques était armée ; mais le bataillon néerlandais disposait également d'armes confisquées au titre de l'accord de démilitarisation, qu'il a refusé de remettre aux combattants bosniaques. Là encore, la méfiance a prédominé entre les deux parties. Celle-ci apparaît clairement dans l'incident suivant relaté par M. Kofi Annan. Le 10 juillet, la compagnie B voit son véhicule attaqué, attaque qu'elle attribue immédiatement aux Bosniaques. L'information sera d'ailleurs transmise au Conseil de sécurité via M. Yasushi Akashi. A Zagreb en effet, le général Janvier déclare « qu'à son avis les Bosniens étaient en mesure de se défendre eux-mêmes à Srebrenica, mais qu'au lieu de le faire, ils tiraient sur la position d'arrêt néerlandaise (...). Le Représentant spécial s'est associé à cette évaluation négative du comportement des Bosniens »26. Or, le Dutchbat se rend compte ultérieurement que l'attaque émanait des Serbes, information qui, elle, sera transmise trop tard à Zagreb, et à New York a fortiori... En tout état de cause, l'incident en dit long sur les relations entre les Néerlandais et les Bosniaques. Certes fatiguée, certes désorganisée, certes mal entraînée et mal équipée, l'armée bosniaque présente à Srebrenica aurait néanmoins peut-être choisi de combattre si le Dutchbat lui en avait donné les moyens. Peut-être cela n'aurait-il fait, à données constantes, que retarder une échéance inéluctable mais la Mission d'information ne peut que constater, comme l'a fait M. Kofi Annan, que la décision de la FORPRONU de ne pas redonner leurs armes aux Bosniaques « semble avoir été particulièrement inopportune étant donné que la FORPRONU n'était elle-même pas prête à préconiser systématiquement le recours à la force comme un moyen de décourager l'attaque contre l'enclave »27. Plus encore, en assurant les Bosniaques que des frappes massives auraient lieu dans le Sud de l'enclave, dans la « zone de mort », le 10 juillet au soir, et en leur enjoignant de se retirer de cette partie de la zone de sécurité pour laisser l'OTAN mener à bien sa mission, le colonel Karremans a démantelé le dispositif défensif bosniaque au Sud de l'enclave, c'est-à-dire en une partie stratégique de celle-ci. La quatrième série d'erreurs tactiques commises par le Dutchbat concerne le maniement des procédures prévues en matière de demande d'appui aérien. Comme nous le verrons ci-dessous, l'erreur majeure sur ce point doit être recherchée à Zagreb. Néanmoins, le Dutchbat, notamment son commandant, commet une erreur professionnelle inacceptable en confondant appui aérien rapproché et frappe massive. Alors que, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, il demande un appui aérien rapproché le 9, finalement accepté le 10, il fait savoir à tous, notamment aux Bosniaques, que des frappes massives auraient lieu le 11, à l'aube. Aucune explication satisfaisante de cette erreur grossière n'a pu être fournie à la Mission d'information, y compris par l'intéressé lui-même : « J'ai eu des contacts réguliers avec le colonel Brantz à Tuzla. Le 10, dans la soirée, il m'a assuré que, le lendemain matin, je devais prendre en compte la présence d'un grand nombre d'avions au-dessus de l'enclave et il a ajouté que je n'aurais jamais vu cela de ma vie. Quand on entend "un grand nombre", on peut en déduire qu'il y aura plus de 2 avions ». De son côté, le général Nicolai, l'un des maillons de la chaîne de commandement, n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes : « Quant à savoir pourquoi le colonel Karremans s'attendait à des attaques aériennes massives le 11 juillet, je tiens à préciser que ceci n'a toujours pas été explicité à ce jour, ni même au cours de discussions que nous avons pu avoir par la suite. Plusieurs facteurs ont pu jouer : le très grand nombre d'avions présents au-dessus de Tuzla Pour ajouter à cette erreur incompréhensible, qui empêche l'intervention le 11 puisque, selon la procédure OTAN, le colonel Karremans se devait d'envoyer une liste d'objectifs précis juste avant l'intervention des avions, la nouvelle demande d'appui aérien du 11 au matin doit être envoyée deux fois. La première fois en effet, bien que Sarajevo confirme l'avoir reçue à 8 heures 39, rien ne se passe. Personne ne se souvient aujourd'hui de cette demande ; c'est exactement le même scénario que le 10 où le colonel Karrremans dit avoir envoyé une demande dont toute trace a été perdue. Le rapport de M. Kofi Annan note sur ce point qu'« il n'a pas été possible de vérifier à quel niveau la demande a été rejetée, si elle l'a été, car il n'en existe aucune trace écrite »28. Toujours est-il que la deuxième demande, dûment accompagnée de la mise à jour des cibles, est reçue à Tuzla le 11 juillet, à 10 heures 45 seulement. Cependant, cette confusion ne se serait pas produite si les avions de l'OTAN étaient intervenus le 10 juillet, c'est-à-dire si le général Janvier avait rapidement décidé d'accéder à la demande d'appui aérien qu'il avait reçue le 9 juillet. Toutes les procédures - ultimatum aux Serbes, attaque directe d'une position de la FORPRONU - avaient été respectées : la validité « juridique » de la demande du colonel Karremans était incontestable. L'analyse des prises de position du général Janvier fait l'objet de développements spécifiques dans la suite du rapport. La Mission d'information peut néanmoins d'ores et déjà constater que le 10 juillet, le général Janvier a effectué un choix opérationnel contestable qui n'est rien d'autre qu'une erreur. Ayant vu la topographie de l'enclave lors de leur déplacement en Bosnie-Herzégovine, les membres de la Mission d'information ne comprennent, à dire vrai, pas pourquoi l'OTAN, à la demande de l'ONU, n'a pas procédé à des frappes aériennes, éventuellement accompagnées d'une neutralisation des défenses anti-aériennes serbes. Les spécialistes objecteront que telle n'était pas la procédure, reviendront sur le résultat désastreux des frappes contre Pale en mai et la perte d'un avion américain, abattu par les Serbes. Au-delà des discussions d'experts, il est parfois sain d'en revenir à des réalités de base : un seul axe routier menait à Srebrenica, par le Sud ; les Serbes ne disposaient que de 15 chars et de 45 pièces d'artillerie, selon une note de la Délégation aux affaires stratégiques datée du 11 juillet 1995. Les neutraliser dès les prémisses de l'attaque coupait court aux velléités serbes. Peut être n'était-ce pas une application orthodoxe des procédures et sans doute certains accuseront-ils les membres de la Mission d'information de céder à la trop facile tentation de refaire l'histoire. Mais, pour avoir vu les lieux, les membres de la Mission d'information sont convaincus de la pertinence opérationnelle d'une telle action. Et, pour une fois, l'ambiguïté du mandat de la FORPRONU aurait pu être utilisée à des fins utiles : s'il s'agissait vraiment de préserver l'intégrité territoriale de la zone de Srebrenica, recourir à des frappes massives était un choix politique qu'aucun argument technique ne pouvait invalider. · Enfin, la « gestion » de la crise est marquée par une succession d'erreurs dans la chaîne de transmission du renseignement, voire de rétention volontaire d'informations. Dans les deux cas, la Mission d'information est fondée à penser que ces carences ont pu avoir des conséquences majeures sur le processus de décision politique. La première défaillance en la matière est imputable au Représentant spécial du Secrétaire général. Le 10 juillet, M. Yasushi Akashi transmet 4 informations erronées ou lacunaires aux membres du Conseil de sécurité, si l'on en croit le rapport de M. Kofi Annan qui était alors, rappelons-le, à la tête du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU. En premier lieu, il indique que la progression des Serbes dans l'enclave a cessé. Il semble que l'information soit juste au moment où elle est transmise. Mais, d'une part, la succession des événements depuis le 6 juillet révélait une situation très évolutive ; d'autre part, n'importe quel observateur un peu averti connaissait la tactique de joueur d'échecs de Mladic. A tout le moins par conséquent, M. Yasushi Akashi aurait dû transmettre cette information avec de multiples précautions et préciser que la tendance était bien davantage à une progression continue des Serbes et à un grignotage de l'enclave. La deuxième information, selon laquelle ils ne tirent plus, est également erronée. Quant à la troisième, qui concerne le pseudo-tir bosniaque contre un véhicule de la FORPRONU, disons à la décharge de M. Yasushi Akashi qu'elle émanait du Dutchbat lui-même et qu'il ne semble pas qu'il l'ait démentie, toujours selon le rapport de M. Kofi Annan. Enfin, M. Yasushi Akashi - qui était à Dubrovnik pendant une partie de la crise - se montre incapable de répondre à une question d'un des membres du Conseil de sécurité sur la chronologie des demandes d'appui aérien rapproché. « Pas plus que les autres fonctionnaires du Secrétariat, d'ailleurs, il ne semble avoir été au courant de ces demandes. Il n'a pas indiqué non plus qu'une demande officielle de soutien aérien rapproché avait été soumise au quartier général des FPNU à Zagreb la veille, bien qu'une copie de cette demande ait été transmise au siège de l'ONU à New York ». Encore une fois, nul ne peut dire quelle aurait été la décision du Conseil de sécurité s'il avait été correctement informé. Toujours est-il que de telles erreurs sont incompatibles avec l'importance des responsabilités détenues par M. Yasushi Akashi, co-décisionnaire en matière de recours à l'arme aérienne, même s'il est vrai qu'il avait, à cette occasion, laissé le général Janvier prendre la décision. La seconde erreur observée en matière de transmission des informations sur la situation de terrain tient bien davantage de la faute lourde. Des recherches menées par M. Kofi Annan, confirmées par l'enquête menée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie sur la responsabilité du général Krstic, il ressort que le bataillon néerlandais a été témoin d'atrocités immédiatement après la chute de l'enclave. Pour donner un exemple cité dans le jugement du général Krstic, le 17 juillet, les Serbes demandent au major Franken de signer un document attestant du consentement des populations à quitter l'enclave et de l'absence d'irrégularités dans l'ensemble du processus. Le major Franken sait depuis plusieurs jours que tout cela est faux : notamment, quand les affaires des 1 000 hommes détenus à Potocari et déplacés les 12 et 13 juillet à Bratunac sont brûlées, y compris leurs papiers d'identité que les Serbes n'ont même pas examinés alors qu'ils étaient supposés être arrêtés pour un contrôle d'identité, « les soldats du Dutchbat furent certains que les histoires de vérification des criminels de guerre (Musulmans pour les Serbes) n'étaient pas vraies »29. Et pourtant, le major Franken signe, les Serbes lui ayant indiqué que telle était la condition mise à l'évacuation de 59 blessés par le CICR. Apporter la caution de l'ONU aux agissements des Serbes mécontents de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité le 14 ou prendre le risque de sacrifier 59 blessés, tel fut le « choix » impossible laissé au major Franken. Toujours est-il que ces informations n'ont pas été transmises à l'ONU ou aux Etats de l'OTAN. En outre des preuves auraient été involontairement détruites : photographies de cadavres musulmans ratées au développement, cassettes vidéos effacées. Comme le note le rapport de l'ONU, « il est plus difficile d'expliquer pourquoi le bataillon néerlandais n'a pas rendu compte plus en détail des atrocités qui étaient commises sous ses yeux après la chute de l'enclave. Bien qu'il n'ait pas été directement témoin de massacres, il savait qu'il se passait des choses sinistres. Il se peut que si les membres de ce bataillon en avaient immédiatement pleinement informé la chaîne de commandement des Nations unies, la communauté internationale aurait peut-être été contrainte de réagir plus vigoureusement et plus rapidement et certaines vies auraient pu être sauvées »30. L'explication est en réalité assez simple : tout au long de la crise, la priorité du Gouvernement néerlandais est de garantir la sécurité des soldats du Dutchbat détenus par les Serbes. D'où une discrétion volontaire sur les exactions serbes. Dans le même esprit, les Pays-Bas se montreront très réticents face aux propositions françaises d'intervention militaire après la chute de l'enclave. 2) Le rôle des acteurs étatiques : un bilan accablant Les causes immédiates de la tragédie sont multiples. Elles tiennent à des défaillances majeures de la structure onusienne, à un contexte psychologique défavorable à une riposte suite à l'affaire des otages, à des erreurs complètes d'appréciation sur les intentions et la stratégie des Serbes, à des erreurs humaines beaucoup trop nombreuses, à la présence, enfin, aux postes de décision, de responsables pusillanimes. En un mot, à la structure, au contexte, aux hommes. Ces erreurs, dont certaines, par leurs conséquences, ne sont ni plus ni moins que des fautes, sont si nombreuses, si grossières que leur interprétation a donné lieu à de multiples thèses qui s'articulent autour de la problématique du complot. Il est certes tentant et intellectuellement séduisant de rapporter toutes les erreurs, si nombreuses, trop nombreuses, à un tel complot : si Srebrenica est tombée, ce serait tout simplement parce que quelqu'un l'a voulu. Telle n'est pourtant pas la conviction de la Mission d'information. La raison de fond de la chute de Srebrenica est à rechercher dans l'absence complète de volonté politique d'intervenir à Srebrenica : de la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, des autorités bosniaques de Sarajevo elles-mêmes. Car l'enchaînement complexe des faits ne doit pas occulter cette réalité très simple : seule la volonté politique des acteurs internationaux, au moins des deux grandes puissances militaires directement impliquées dans la gestion du conflit sur le terrain, à savoir la France et le Royaume-Uni, pouvait véritablement faire basculer l'intervention internationale de l'autodéfense de la FORPRONU à la défense des zones de sécurité. Pour ce faire, il aurait fallu lever l'ambiguïté congénitale qui pesait sur les zones de sécurité et qui avait été relevée dès leur création : s'agissait-il de protéger les Casques bleus présents dans les zones de sécurité pour observer que rien ne se passe ou de protéger, en cas d'attaque, la population qui y était prisonnière et y dépérissait ? La vérité brutale est que le maintien de la zone de sécurité de Srebrenica n'était la priorité de personne. Si la chute de l'enclave ne s'était pas accompagnée du plus grand massacre commis sur le sol européen depuis la deuxième guerre mondiale, l'histoire n'y verrait d'ailleurs qu'un épisode supplémentaire de la faillite des Nations unies, du Conseil de sécurité notamment, et plus particulièrement de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, à régler la crise yougoslave. Les quelque 7 000 à 8 000 cadavres que les enquêteurs du Tribunal pénal international s'attachent aujourd'hui à exhumer et identifier nous rappellent que Srebrenica est le symbole même du renoncement des Etats qui n'ont jamais su s'entendre à temps sur les objectifs de leur intervention dans l'ex-Yougoslavie. Srebrenica n'est pas tombée contre la volonté des Gouvernements occidentaux qui, pour autant, n'ont pas voulu la chute de Srebrenica. Mais, peut-être pire encore, ils l'ont regardée passivement, voire même, pour certains, ont peut-être fermé les yeux sur les premières preuves des massacres. a) La réaction des Etats : divisions et atermoiements La première réaction internationale à l'annonce de la chute de Srebrenica est d'une extrême fermeté : elle émane de la France et de l'Allemagne, réunies le 11 juillet à Strasbourg pour un sommet franco-allemand. En accord avec l'Allemagne, le Président de la République fait savoir que les deux pays sont prêts, si le Conseil de sécurité en décidait ainsi, à apporter un concours politique et militaire selon leurs moyens, pour restaurer l'intégrité de la zone de Srebrenica. Dans cette ligne, la France oeuvre activement à l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité, dans laquelle elle souhaite voir figurer quatre points : - condamnation de l'agression serbe contre la zone de sécurité de Srebrenica et exigence du retrait immédiat des troupes serbes ; - exigence du retour à la situation antérieure et réaffirmation de la protection des Nations unies sur cette zone de sécurité, en particulier sur les populations civiles ; - rétablissement de cette protection par les forces des Nations unies ; - avertissement dans les mêmes termes aux Serbes concernant les autres zones de sécurité. Le 12 juillet, dans l'après-midi, la résolution 1004 est adoptée à l'unanimité : le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies exige que « les forces des Serbes de Bosnie-Herzégovine cessent leur offensive et se retirent immédiatement de la zone de sécurité de Srebrenica » et prie le Secrétaire général d'« user de toutes les ressources à sa disposition pour rétablir le statut de la zone de sécurité de Srebrenica, tel qu'il est défini par l'accord du 18 avril 1993, conformément au mandat de la FORPRONU », et demande à toutes les parties de coopérer à cet effet dans son paragraphe 6. Lors du débat, le représentant français explique « qu'un pas nouveau, d'une nature différente des précédents, avait été franchi dans l'escalade avec la volonté délibérée des Serbes de Bosnie-Herzégovine d'occuper par la force une zone de sécurité ». Il ajoute que la France est prête, si les autorités militaires et civiles des forces des Nations unies l'estimaient possible, à mettre ses forces à la disposition de toute opération qu'elles considéreraient utile et réalisable. Parallèlement à cette démarche, le Président de la République, dont tous les interlocuteurs de la Mission d'information ont décrit la colère à l'annonce de la chute de l'enclave, multiplie les efforts pour que soit tentée une opération de reprise de l'enclave. M. Jean-David Levitte, alors conseiller diplomatique du Président de la République, a évoqué devant la Mission d'information une conversation téléphonique entre les Présidents Chirac et Clinton, révélatrice de l'état d'esprit du Président français : « Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Le lendemain, le 13 juillet, (...) A 21 heures 15 , le Président de la République téléphonait au Président Clinton. Le Président de la République était convaincu que nous avions besoin des hélicoptères antichars américains pour ouvrir la voie vers Srebrenica et Gorazde et y débarquer nos troupes. J'ai retrouvé mes notes sur cet entretien qui fut un moment important. Le Président de la République a dit au Président Clinton : "La chute de Srebrenica, celle probable de Zepa, et bientôt peut-être de Gorazde, marqueraient un échec majeur de l'ONU, de l'OTAN et des démocraties. A Srebrenica, les hommes qui risquent d'être égorgés s'ils sont en âge de porter les armes sont séparés des femmes menacées de viol. Les nations civilisées doivent s'opposer au fascisme et mener une action militaire ferme et limitée afin de rétablir la situation dans les enclaves orientales. Nous ne pouvons laisser fouler au pied sans réagir les principes de l'humanisme et de la démocratie. Soit la France, les Etats-Unis, le Royaume Uni et l'Allemagne se mettent d'accord pour une intervention militaire destinée à reprendre Srebrenica et à garantir l'intégrité de Zepa et de Gorazde, ce qui permettrait d'assurer la sécurité de quelques 200 000 Musulmans, soit les grandes démocraties optent pour une politique d'abandon comparable à celle qui a présidé à la seconde guerre mondiale. Alors nous serons conduits à nous retirer, en accord avec nos partenaires, de la FORPRONU. La France est prête à mettre ses moyens à disposition d'une opération militaire, mais elle refuserait d'être complice d'une politique de démission. La question est de savoir si les Etats-Unis sont prêts à contribuer à une telle opération". » Dans la même veine, la France s'efforce de prévenir la chute de Gorazde, autre enclave menacée par les Serbes et tenue par les Britanniques. Comme l'a rappelé le Premier ministre de l'époque, M. Alain Juppé, à l'occasion d'un entretien avec le Premier ministre britannique John Major, le 14 juillet, la France propose le renforcement des troupes terrestres, soit 400 soldats environ, avec des hélicoptères prêtés par les Américains, dans l'enclave de Gorazde. Sur le plan interne, le chef d'état-major particulier du Président de la République, le général Christian Quesnot, se fait l'apôtre d'une opération aéromobile sur Srebrenica. « Aussi bien auprès du Président Mitterrand qu'auprès du Président Chirac, j'ai toujours été partisan d'une action beaucoup plus ferme contre chacune des parties qui franchissait ce que j'appelais la ligne jaune. (...) Cette opération aurait dû être, à mon avis, aéromobile, c'est-à-dire avec des hélicoptères et des parachutages pour pouvoir contrôler les canons qui étaient sur les crêtes. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le risque, c'était de perdre un avion en vol ou peut-être deux hélicoptères, avec des pertes instantanées. Mais c'est une appréciation extrêmement personnelle. Cela aurait pu représenter entre vingt-cinq et une centaine de personnes ». Sur le terrain pourtant, rien ne se passe. Plus encore, l'enclave orientale de Zepa tombe à son tour, le 25 juillet, après deux semaines de combats suivis attentivement par tous les Gouvernements occidentaux qui ont maintenant compris que l'objectif des Serbes était une « purification ethnique » globale de la partie orientale de la Republika Srpska. De même, on suppute à Paris, à Londres, à Washington sur les capacités de Gorazde à résister à l'attaque serbe. Si rien ne se passe, c'est parce que les projets français font l'objet, au mieux d'un intérêt poli, au pire d'un rejet immédiat. En réalité, aucun Gouvernement n'envisage à quelque moment que ce soit de reprendre Srebrenica. Une note de la Délégation aux affaires stratégiques, en date du 11 juillet 1995, fait le point de la situation dans les différentes capitales : - Washington : « (...) réunion de crise en cours à la Maison Blanche ; toutes les options sont envisagées, de l'action unilatérale en soutien des Néerlandais au déclenchement de 4010431 ; la perspective d'une évacuation de Srebrenica est considérée comme le début de la fin » ; - Londres : « Reprendre Srebrenica n'est pas envisageable ; grosses inquiétudes face aux déclarations du Président français ; (...) il faut être honnête vis-à-vis de ce que l'on peut faire pour les zones de sécurité » ; - Quant aux Pays-Bas, le Ministre Van Mierlo a résumé clairement leur position : « Nous ne pensions pas qu'il était utile de reprendre Srebrenica. En fait, tout le monde partageait cet avis : les Américains, les Britanniques, les Allemands et les Français comme l'a confirmé l'amiral Lanxade devant votre Mission d'information. La Force de réaction rapide n'était pas encore prête pour intervenir. Quant à une action de parachutistes, il n'y avait même pas les capacités de transport comme l'a déclaré un officier français devant la Mission d'information ». Effectivement, au cours de la conversation téléphonique qu'il a avec son homologue français, M. Hervé de Charette, le 12 juillet, M. Van Mierlo fait une description sans fard de la situation dans l'enclave : on devait aujourd'hui reconnaître que celle-ci était tombée aux mains des Serbes. Il était exclu, de l'avis même des militaires, de reprendre par la force le contrôle de celle-ci. De bonne source, il apparaît que M. Van Mierlo a défini comme suit les priorités, du point de vue néerlandais : situation humanitaire de la population déplacée à l'intérieur de l'enclave ; sort des 30 à 40 « prisonniers » néerlandais (le Ministre a insisté sur le terme « prisonnier ») ; liberté de mouvement à assurer entre l'enclave et la Bosnie centrale pour la population et le personnel de la FORPRONU. Il ajouta que, quelles que fussent les pressions de l'opinion aux Pays-Bas pour une évacuation sans délai du contingent néerlandais, le Gouvernement comprenait la nécessité de ne pas se prononcer à ce stade publiquement sur ce point, ni sur l'avenir de l'enclave, qui soulevait des questions délicates. Mais il a dit sa préoccupation à propos du projet de résolution du Conseil de sécurité en cours d'examen à New York (dernier alinéa du dispositif, demande au Secrétariat de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application de la résolution) : il était exclu de reprendre la poche par la force. L'administration onusienne est, pour sa part, sur la même ligne. Même si le Secrétaire général demande aux spécialistes militaires de l'ONU quels moyens leur paraissent nécessaires pour délivrer Srebrenica, conformément à la résolution 1004 du 12 juillet, M. Annan, alors responsable du Département des opérations de maintien de la paix, confie au Représentant français auprès du Conseil de sécurité, le 12 juillet, « que le secrétariat n'était pas favorable à une telle action : sa réalisation excéderait très certainement les moyens existants, elle nécessiterait de se maintenir ensuite en territoire hostile et elle serait financièrement très coûteuse »32. La suite de l'entretien est tout à fait révélatrice de l'état d'esprit qui règne alors et de la réalité des faits, au-delà des déclarations diplomatiques, et mérite à cet égard d'être intégralement cité : « Concernant Zepa, le responsable du Département des opérations de maintien de la paix estime que les bombardements actuels constituaient une mesure préemptive. Il m'a donné l'impression que le Secrétariat avait déjà passé la zone de sécurité de Zepa par profits et pertes. A ce sujet, je transmets au Département par télécopie la lettre du chargé d'affaires bosniaque au Président du Conseil de sécurité demandant un renforcement du contingent de la FORPRONU à Zepa pour garantir la protection de cette zone de sécurité des Nations unies et de sa population. « A une question de ma part sur la possibilité de "tenir" Gorazde en renforçant sa garnison, M. Annan a observé 1) que cette zone était beaucoup mieux défendue par les forces bosniaques (10 000 hommes) ; 2) qu'elle était aussi une zone d'exclusion, autrement dit que les frappes aériennes étaient utilisables si l'on en avait la volonté politique ». Très tôt, par conséquent, il semble qu'une partie des responsables ont renoncé à la reprise de l'enclave, unanimement jugée trop coûteuse en moyens humains, matériels et financiers sans parler des risques de pertes de vies humaines. A dire vrai, les autorités françaises elles-mêmes croient-elles dans la reprise de l'enclave ? Le 12 juillet, soit le lendemain même de la réaction de fermeté du Président de la République et au moment même où ce dernier multiplie les contacts diplomatiques pour convaincre ses partenaires, au cours d'une réunion des ambassadeurs américain, français, britannique et allemand auprès du Conseil de sécurité, convoquée par l'ambassadrice américaine, Madeleine Albright, tous les participants reconnaissent que la chute de l'enclave est définitive et que Srebrenica ne serait pas reprise par la force. Pour tous, il convient de se concentrer sur le sort des populations civiles, leur évacuation ordonnée et l'apport de l'aide humanitaire. Chacun constate par ailleurs pragmatiquement que la possibilité que le quartier général des forces des Nations unies monte une opération militaire apparaissait infime. Les ambassadeurs ont été également d'accord pour reconnaître que l'étape suivante pourrait être l'attaque et la prise de la zone de sécurité de Zepa par les Serbes. La question fut donc posée quant à la manière dont il conviendrait de réagir, les participants s'interrogeant notamment sur le fait de savoir si l'on pouvait et si l'on devait chercher à empêcher un tel événement. Sur le premier point, il a semblé à chacun qu'il serait aussi difficile d'éviter la chute de Zepa que celle de Srebrenica, la présence des Nations unies dans l'enclave étant très faible et la distance à parcourir pour envoyer une force de secours étant identique. Enfin, si, selon l'OTAN, 3 brigades étaient nécessaires pour parvenir à Gorazde et en maintenir l'accès, il en fallait davantage pour Zepa. Sur le second point, il fut souligné par l'un des participants qu'il serait dangereux de fixer une limite à ne pas dépasser, spécialement en ce qui concerne les enclaves de l'Est. Proclamer publiquement une telle limite alors que la position ne serait pas défendable, ne pouvait conduire qu'à une humiliation supplémentaire des Nations unies. Le ton du représentant français n'est pas tout à fait le même au sein du Groupe de contact, qui se réunit au niveau des directeurs politiques, le 12 juillet au soir à Londres. Le représentant américain y déclare que la résolution adoptée aux Nations unies lui paraissait inapplicable puisque, sur le terrain, la FORPRONU ne disposait pas des moyens de restaurer sa présence dans la zone protégée. Il valait donc mieux, selon lui, tirer un trait sur Srebrenica, en sachant que Zepa suivrait sans doute le même sort et que la mission de la FORPRONU était maintenant fortement compromise sans parler de la crédibilité même des Nations unies. A l'exception du représentant français, personne ne s'éleva contre ce jugement. Le directeur politique français conclut en effet qu'il ne fallait pas, en tout cas, s'avouer battu d'avance et que l'objectif du rétablissement de l'autorité des Nations unies devait être maintenu, quel que soit le moyen. Le Groupe de contact ne tomba d'accord que pour constater que le Secrétaire général devrait aussi faire face au problème humanitaire posé par la présence de milliers de réfugiés. Tout est dit, ou presque. Les positions exprimées par les représentants français telles qu'elles ressortent des documents ne laissent pas de susciter des interrogations sur la véritable ligne directrice de la politique française à la suite de la chute de Srebrenica. Comment expliquer l'attitude de la France qui, par la voix de son Président, se dit prête, le 11 juillet, à mettre en oeuvre les moyens militaires pour reprendre Srebrenica, avec l'aide d'autres nations, mais dont le Représentant auprès de l'ONU défend tout à tour une résolution qui permet d'envisager éventuellement la reprise de l'enclave puis, en cercle restreint, se range à l'avis général de non-intervention ? S'agit-il d'une manoeuvre de diversion, alors que c'est un général français qui n'a pas été en mesure de sauver l'enclave, d'une démarche solide et étayée ou d'un geste fort d'un Président de la République ulcéré de voir l'ONU humiliée en Bosnie-Herzégovine et désireux de rompre avec une politique trop longtemps conciliante avec l'agresseur serbe ? En bref, les propositions françaises sont-elles d'ordre essentiellement « rhétorique », pour reprendre l'expression du Président de la majorité républicaine du Sénat américain à l'époque, cyniques ou sérieuses ? En réalité, la réaction immédiate du Président de la République est cohérente avec la politique de fermeté adoptée par la France à la suite des otages et symbolisée par la création de la Force de réaction rapide (FRR), initiative française. Ce que l'on comprend immédiatement à Paris, c'est que la chute de Srebrenica met en cause la pertinence et la crédibilité de la FRR, donc de la France, comme l'a rappelé M. Jean-Claude Mallet, lors de son audition : « Globalement, notre analyse de la situation est la suivante : d'une part, la situation est vraiment grave et, d'autre part, si nous ne réagissons pas très fortement, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, notamment depuis le 3 juin avec la Force de réaction rapide, d'origine française et franco-britannique, qui sera mis en péril. Nous considérons également, dans notre analyse, qu'indépendamment des objectifs permanents de l'armée serbe de Bosnie d'éliminer la zone de sécurité de Srebrenica, ce n'est pas par hasard qu'une pression forte s'exerce sur l'un des trois pays ayant choisi de s'engager avec des moyens terrestres, dans la FRR. Nous sommes là devant un test majeur de volonté face au général Mladic. » Cette attitude de fermeté ne va pour autant pas jusqu'à défier nos partenaires par une intervention exclusivement française à Srebrenica. Hormis le général Quesnot, tous les militaires auditionnés par la Mission d'information ont estimé qu'elle n'était pas sérieuse, alors que, sur le terrain, la Force de réaction rapide n'était, semble-t-il, pas opérationnelle notamment du fait des obstacles mis par les Croates et les Bosniaques à son déploiement. En réalité, les conditions techniques d'une telle opération n'ont été sérieusement étudiées à aucun moment, en dépit de la très forte volonté politique exprimée par le Président de la République. Selon l'amiral Jacques Lanxade, alors chef d'état-major des Armées : « Sur les effectifs qui auraient été nécessaires pour Srebrenica, on aurait pu les estimer à 1 500 ou 2 000 hommes mais je pense qu'il aurait fallu les doter de moyens significatifs, c'est-à-dire d'armements de mortier lourd et d'armements antichars plus nombreux que ce qu'ils avaient. Par ailleurs - cela a été une demande constante que l'on n'a jamais pu mettre sur pied -, il fallait l'existence d'une force de réaction. En effet, il fallait que les Serbes qui devaient s'en prendre aux zones de sécurité sachent qu'ils risquaient de voir intervenir une force puissante relativement à leurs propres forces. » De son coté, le général Germanos a brièvement évoqué le « plan Quesnot » : « J'ai entendu le général Quesnot dire lors d'une réunion : "Il faudrait sauter sur Srebrenica. Je prendrai la tête du bataillon". Cela s'est arrêté là comme demande de planification pour ce qui me concerne. Je n'en ai pas reçu d'autre ». Le général Heinrich a confirmé à la Mission d'information qu'aucune demande d'examen sérieuse d'intervention militaire à Srebrenica ne lui avait été adressée, précisant que, si un tel examen avait eu lieu, la Direction du renseignement militaire y aurait évidemment été associée. Au total, ce sont les considérations politiques qui ont primé, disqualifiant d'emblée tout examen technique, y compris, semble-t-il, au sein de l'état-major. Comme l'a expliqué M. Alain Juppé : « J'ai demandé que cette proposition soit étudiée, notre état-major l'a considérée très rapidement comme peu sérieuse. Je dois dire, par ailleurs, qu'elle était également très peu sérieuse sur le plan politique. Je ne vois pas comment la France aurait pu seule sauter sur Srebrenica. Cela n'avait pas de sens. Certes, c'était une proposition très généreuse mais qui me paraît complètement inapplicable ». Les documents internes du ministère de la Défense montrent en réalité que diverses options ont été globalement évoquées, y compris l'option Quesnot, jamais cependant d'un point de vue technique. Ainsi, une note du 12 juillet 1995 présente cinq options militaires, dont l'enjeu est présenté dans les termes suivants : « Accepter ou refuser la situation de fait créée par la prise de contrôle de Srebrenica » : - option 1 : action en force sur la zone de Srebrenica ; - option 2 : action déterminée sur Sarajevo combinée avec une action minimum sur Srebrenica ; - option 3 : action aérienne ; - option 4 : retrait. L'examen de la note révèle en réalité que seules les deux premières options sont privilégiées, l'auteur précisant d'emblée que « notre liberté de choix est en fait dictée au moins partiellement par l'attitude de soutien ou de refus de nos partenaires ; ainsi l'option 2 doit-elle être envisagée si des obstacles à l'option 1 semblent trop importants ». Cette dernière option vise deux objectifs : « Ne pas se laisser enfermer dans la logique serbe, sans pour autant accepter le fait accompli ; pour ce faire, reprendre l'initiative dans la région de Sarajevo, tout en assurant une action humanitaire dans la poche de Srebrenica » et prévoit trois types de moyens : engagement de 1 500 hommes à 2 000 hommes de la FRR en appui de la FORPRONU pour commencer le désenclavement de la zone de Sarajevo ; moyens aériens indispensables en appui de cette intervention ; moyens aériens pour aérolargages humanitaires sur Srebrenica. Au nombre des avantages, l'auteur recense : « - détermination claire de la communauté internationale ; « - gain stratégique majeur si l'on obtient ainsi le désenclavement de la capitale bosniaque ; « - prise en compte du problème immédiat de la population de Srebrenica, même si la réponse n'est que partielle ; « - cohérence des actions engagées suite aux options politiques arrêtées à Cannes ; « - emploi de la FRR dans le cadre prévu lors de sa création (soutien à des éléments ONU dans l'accomplissement de leur mandat) ». Quant aux inconvénients, ils sont résumés ainsi : « - démontrer l'incapacité de la FRR à agir sur les enclaves ; « - action plus symbolique qu'en profondeur face à l'agression serbe sur Srebrenica, puisqu'on ne cherche pas à faire revenir les Serbes sur leurs positions initiales ; « - face à ce qui serait perçu comme une absence de réaction de notre part dans la poche, risque de voir les Serbes poursuivre leurs actions similaires sur les autres enclaves ; « - risque de réaction serbe contre les Casques bleus ; « - une action majeure sur Sarajevo hypothèque lourdement et durablement nos moyens de réaction ; « - risque de voir les Néerlandais rapidement évacuer la poche ; « - perte de Srebrenica, graves difficultés politiques ». En réalité, cette option est rapidement dépassée puisque l'enclave est vidée de sa population en trois jours. Dans les faits, l'option qui sera effectivement « choisie » se résume ainsi : « Action déterminée sur Sarajevo, rien à Srebrenica ». b) Srebrenica, victime de la raison d'Etat ? La volonté politique qui fait défaut à Srebrenica est la même qui fait défaut aux Gouvernements occidentaux tout au long du conflit yougoslave : les Etats européens sont intervenus en Bosnie-Herzégovine parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas intervenir. A quelques heures d'avion de Paris, Londres ou Bonn, ces conflits largement médiatisés « sont perçus par les Européens comme allant à l'encontre d'une certaine conception de l'ordre international, en ce début de la décennie quatre-vingt dix (...). Face à ces conflits, l'abstention n'est pas une option » (Thierry Tardy). Dans le même temps toutefois, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ne heurte en rien les intérêts stratégiques vitaux des Etats européens. D'où cette « intervention », cette « politique de coercition passive » (Boutros Boutros-Ghali) qui n'est rien d'autre que le plus petit dénominateur commun entre des Etats aux intérêts divergents. Srebrenica représente un concentré de cette action a minima : à défaut d'agir avant, de réagir pendant et de s'entendre sur ce qu'il faut faire après, les Etats européens, notamment la France et le Royaume-Uni, se rabattent sur l'option humanitaire. La chute de Srebrenica n'est-elle toutefois que l'aboutissement, tragique certes mais somme toute logique, d'une politique de demi-mesures ? Ne serait-elle pas au contraire le fruit d'un calcul ô combien politique visant à simplifier la négociation diplomatique en clarifiant la carte ethnique de la Bosnie-Herzégovine ? En un mot, Srebrenica est-elle tombée au nom d'une raison d'Etat qui se serait trouvée à Paris, à Londres, à Washington et même à Sarajevo ? La question est choquante mais l'ignorer le serait plus encore. Il n'est qu'à regarder les cartes de la Bosnie-Herzégovine avant et après le mois de juillet 1995, ainsi que la chronologie des faits : quatre mois après Srebrenica, les frères ennemis parviennent à un accord de partage du territoire bosniaque qui correspond grosso modo aux résultats de leurs victoires militaires. Alimente également cette thèse le fait qu'à peine Srebrenica tombée, alors que le « nettoyage ethnique » règne, l'ensemble des chancelleries occidentales fait son deuil de Zepa. Et quand, au cours d'un entretien avec M. Kofi Annan, le 13 juillet, cette question est abordée, le Représentant français à l'ONU note presque avec étonnement que « M. Kofi Annan ne semble pas avoir passé Zepa par pertes et profits » ! En conséquence, l'analyse des raisons pouvant expliquer la chute de Srebrenica ne peut faire abstraction de l'intérêt stratégique que revêtait la chute de la zone de sécurité. « Boulets » en termes opérationnels, car indéfendables selon les militaires, les zones de sécurité représentaient incontestablement des obstacles au plan de paix. Comme l'a noté M. Gilles Hertzog, « en bonne stratégie, on peut admettre d'avoir à sacrifier, en cas d'attaque, une position isolée comme Srebrenica, qui paralyse le dispositif général des forces, où la présence de quelques centaines de défenseurs mal armés, insuffisants en nombre, promis à devenir otages des assaillants, empêche la FORPRONU, partout ailleurs, de s'opposer efficacement aux entreprises serbes. Vouloir être libéré d'un pareil « boulet » est, militairement, légitime, puisque cela permettra d'adopter de nouveau une posture dynamique et de retrouver la liberté d'agir ». A-t-on, par un raisonnement analogue, considéré que le sacrifice de Srebrenica, puis de Zepa, permettrait aux Etats occidentaux de reprendre la main et de relancer le processus diplomatique ? Avec l'amiral Lanxade, « on peut d'ailleurs remarquer que l'arrêt des combats s'est fait pratiquement à la fin du mois de septembre alors qu'on était dans cette situation 49/51. Je n'en tire aucune conséquence. Du moins, je ne veux pas faire de commentaire sur ce point ». En bref, la réalité du terrain - 49 % du territoire sous contrôle serbe, 51 % sous contrôle bosniaque - coïncidait exactement avec le plan de paix depuis longtemps proposé aux parties en sorte qu'en fait de négociations, il s'agissait avant tout de formalisation juridique et politique d'une situation née de l'usage de la force. Ces constats ne suffisent pas à nourrir la thèse d'un complot international contre Srebrenica ; mais elles font peser sur les Etats impliqués - France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Gouvernement bosniaque - le soupçon du cynisme. Certes, aucun d'entre eux n'a activement favorisé la disparition des enclaves mais aucun d'entre eux non plus n'a cherché à empêcher les Serbes d'atteindre ce qu'on savait être des buts de guerre essentiels à leurs yeux. L'analyse de M. Alain Juppé sur ce point est d'ailleurs éclairante : « Sur la chute de Srebrenica et le fait qu'elle ait pu arranger les diplomaties occidentales, je vous paraîtrai peut-être extrêmement naïf, je ne crois pas que les diplomaties soient à ce point cyniques. Je ne crois pas que les responsables politiques ou les Etats envisagent de gaieté de c_ur le massacre de plusieurs milliers de personnes au motif que cela facilitera un règlement politique, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. A aucun moment, je n'ai ressenti cette situation ni chez les responsables français, ni chez nos partenaires. Ensuite, a posteriori, lorsque le drame a été consommé, que certains aient pu considérer qu'effectivement cela pouvait faciliter la redistribution des cartes entre les communautés bosniaques, je ne peux pas l'exclure complètement, mais je suis à peu près sûr que cela n'a jamais été la motivation de l'attitude des responsables avant le 11 juillet ». L'analyse des télégrammes diplomatiques de l'époque révèle qu'en réalité, c'est pendant, voire avant même que le drame soit consommé, que les responsables ont conscience de l'intérêt stratégique de la chute de Srebrenica. Le compte rendu du récit de la réunion provoquée par Madeleine Albright à la suite de l'adoption de la résolution sur Srebrenica le 12 juillet, cité précédemment, contient une phrase tout à fait révélatrice à propos de Zepa : « Pouvait-on et devait-on33 chercher à empêcher un tel événement » ? Ce qui revient en réalité à s'interroger sur l'intérêt des Etats occidentaux à préserver des zones de sécurité qu'ils avaient eux-mêmes décidé d'instaurer deux ans plus tôt... Le ton est le même au cours des entretiens divers avec les responsables américains, par exemple au Conseil de sécurité nationale (NSC) des Etats-Unis, le 12 juillet. Selon les experts de cette enceinte, non seulement du point de vue militaire, l'option d'une reprise de Srebrenica apparaissait très difficile mais on s'y interrogeait même « étant donné la difficulté d'une telle opération, sur son utilité. Srebrenica était dans une situation de « camp de concentration », il semblait également que la majorité des réfugiés souhaitait en partir, comme d'ailleurs les Néerlandais34 ». En un mot, aux yeux des Etats-Unis, c'était au nom de principes humanitaires qu'il fallait laisser tomber Srebrenica, dans l'intérêt même de ses habitants... Selon les experts du NSC, la ligne devait être tracée à Gorazde et à Sarajevo, Gorazde étant militairement plus défendable dans la mesure où il y avait plusieurs centaines de soldats de l'ONU et 10 000 soldats bosniaques. D'autre part, toujours aux yeux du NSC, Gorazde était plus importante et davantage liée au centre de la Bosnie-Herzégovine que Srebrenica et Zepa. A titre personnel, certains des experts du NSC laissent entendre que préserver Gorazde tandis que Zepa et Srebrenica passeraient aux mains des Serbes pouvait « avoir aussi une certaine logique dans la perspective d'un futur arrangement territorial ». Certes, c'est à titre personnel que ces responsables émettent cette opinion ; elle n'en imprègne pas moins l'ensemble des discussions internationales de l'époque. Ainsi, devant le Conseil européen, le 19 juillet 1995, le négociateur américain Richard Holbrooke note « qu'il convenait de considérer d'ores et déjà comme acquis dans le cadre d'une répartition territoriale 51/49 : la perte définitive, pour les Bosniaques, de Zepa et de Srebrenica, la continuité territoriale, aux dépens des Bosno-serbes, entre les vallée de la Livno et de la poche de Bihac, l'élargissement, au détriment des Bosniaques, du corridor de Posavina ». Précisons qu'à cette date, Zepa n'est pas encore tombée - il faut attendre le 25 - mais on travaille déjà sur la carte qui servira de base aux négociations. L'ensemble de ces documents confirme qu'aucun des Etats impliqués dans le règlement du conflit bosniaque n'a voulu sauver Srebrenica, sans qu'existe pour autant de conspiration. Comme l'écrit M. Kofi Annan, « le fait que la tragédie de Srebrenica a facilité dans une certaine mesure la conclusion d'un accord de paix en mobilisant la volonté de la communauté internationale, en distrayant les Serbes de l'offensive que préparaient les Croates, en rendant les membres de la FORPRONU moins vulnérables aux prises d'otages et en facilitant le règlement de certaines questions territoriales, n'est pas un signe de conspiration. C'est une ironie tragique »35. A partir du 12 juillet, le sort des enclaves devient un choix politique : on décide d'abandonner Zepa mais de « tracer la ligne rouge » à Gorazde et Sarajevo, politique que tous les Etats - France, Royaume-Uni et Etats-Unis - ont avalisée. Si l'on comprend sans peine pourquoi Sarajevo est sanctuarisée, la préservation de la zone de Gorazde, un temps débattue, est là pour sauver les apparences : comme l'explique le conseiller américain au NSC, « si en revanche, toutes les enclaves tombaient, il s'agirait d'une défaite majeure et nous perdrions vraisemblablement le contrôle de la crise ». Dans ce contexte, l'attitude des autorités bosniaques suscite quelques questions. Au nombre des multiples interrogations qui entourent la chute de Srebrenica figure celle de savoir si Sarajevo, non seulement n'a pas cherché à aider les combattants de Srebrenica et a, comme les Gouvernements occidentaux, accepté le fait accompli, mais n'a pas également secrètement négocié en amont la chute de l'enclave avec les Serbes. Là encore, la question est détestable, plus encore dans la mesure où les victimes de Srebrenica sont, elles aussi, bosniaques. La Mission d'information se doit néanmoins, à l'instar de M. Kofi Annan d'ailleurs, de la poser, d'autant que cette thèse a été propagée par des Bosniaques eux-mêmes et ne repose pas que sur le triomphant « Alija vous a abandonnés » lancé par Mladic aux habitants apeurés de Srebrenica. Ainsi, lorsque le général de La Presle se rend à Srebrenica à la fin du mois de février 1995, juste avant de passer ses consignes au général Janvier, Naser Oric, le chef des combattants de l'enclave, lui « fait part avec des accents tout à fait dramatiques de son sentiment d'être abandonné par ses autorités de Sarajevo et par le Président Izetbegovic soi-même qu'il a cité à plusieurs reprises. Il craignait à l'évidence que la zone dont il était militairement responsable ne fasse l'objet de décisions auxquelles il n'aurait pas été associé ». Le rapport de M. Kofi Annan confirme que Naser Oric nourrissait des inquiétudes à l'égard des intentions du Gouvernement bosniaque. Il demanda même au commandant de la FORPRONU de le ramener dans son hélicoptère à Sarajevo car il « voulait parler au Président Izetbegovic et aux dirigeants du Gouvernement bosniaque qui, selon lui, se préparaient à retirer aux Bosniens le contrôle de Srebrenica à titre de concession comme de négocier un accord de paix »36. Le fait que le même Naser Oric reçoive l'ordre de Sarajevo de quitter l'enclave deux mois plus tard, de même que vingt de ses meilleurs lieutenants, n'a pas manqué de nourrir l'hypothèse d'un complot de la part du Gouvernement bosniaque qui ne pouvait ignorer que cela revenait à décapiter le commandement des troupes de l'enclave, donc à les affaiblir considérablement. D'autant que Naser Oric était une légende pour les habitants de Sarajevo, que le général Cot lui-même décrit comme « un homme d'un charisme extraordinaire ». La plupart des personnes auditionnées par la Mission d'information se sont elles-mêmes étonnées de la décision des autorités de Sarajevo. Selon la conviction de l'un des officiers entendus à huis clos, « on a éloigné cet homme qui, tel que je l'entrevois, n'aurait sans doute pas accepté la chute de Srebrenica, telle qu'elle s'est produite ». Quel aurait été l'intérêt du Gouvernement bosniaque à abandonner Srebrenica ? Selon les partisans de cette thèse, l'enclave orientale aurait fait l'objet d'un échange contre les faubourgs serbes de Sarajevo. D'autres avancent l'argument selon lequel les autorités bosniaques voulaient provoquer une intervention de l'ensemble des pays occidentaux, y compris des Etats-Unis, à leur côté en Bosnie-Herzégovine, ne fût-ce que sous la forme de la levée de l'embargo sur les armes qui signifiait en réalité un soutien américain actif et un retrait de la FORPRONU. Cette thèse a effectivement pu être alimentée par les propos des responsables bosniaques eux-mêmes. Le 11 juillet au soir, alors que l'enclave vient de tomber, le Premier Ministre bosniaque Haris Silajdzic ne déclare-t-il pas que « après Srebrenica, celui qui est contre la levée d'embargo est coupable de génocide » ? De même, le rapport de M. Kofi Annan évoque une réunion interne aux autorités bosniaques les 28 et 29 septembre 1993, au cours de laquelle le Président Izetbegovic aurait déclaré, aux dires de survivants de Srebrenica présents à cette réunion, « qu'il avait appris qu'une intervention de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine était possible, mais n'aurait lieu que si les Serbes s'introduisaient par la force à Srebrenica et y massacraient au moins 5 000 personnes »37. Enfin, faut-il rappeler l'utilisation médiatique faite des réfugiés de Srebrenica par le Gouvernement bosniaque au lendemain de la chute de l'enclave ? Arguant du fait que l'ONU a failli à sa mission à Srebrenica, les autorités bosniaques laissent les milliers de réfugiés s'entasser sur les pistes de l'aéroport de Tuzla, exposés aux tirs serbes, refusant de mettre à disposition leurs propres structures d'accueil. Le Président Alija Izetbegovic a nié l'ensemble de ces accusations. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, il a expliqué que le départ de Naser Oric avait été décidé suite au développement de rumeurs négatives sur son comportement et que, s'il n'avait pas regagné l'enclave, c'était de son propre chef. Il exigeait en effet de disposer pour son retour d'un hélicoptère blindé, dont ne disposaient pas les forces bosniaques, craignant de subir le même sort que ses compatriotes dont l'hélicoptère avait été abattu par les Serbes au mois de mai, alors qu'ils regagnaient Srebrenica. S'agissant des allégations relatives à un échange avec les Serbes, il a fait valoir que, de toute façon, c'était à la FORPRONU que revenait la défense de l'enclave et qu'il n'était par conséquent pas en son pouvoir de décider du sort de la zone de sécurité. En outre, s'il n'a pas insisté sur Srebrenica et Zepa au moment de la négociation des accords de Dayton, c'est en toute responsabilité et au regard d'une approche globale de la situation : en premier lieu, alors que les Serbes ne voulaient céder ni Srebrenica, ni Zepa, ni Brcko, il a refusé, pour sa part, de renoncer à Brcko ; en deuxième lieu, il ne voulait pas prendre la responsabilité de faire échouer les négociations, alors que se profilait le quatrième hiver de guerre et que les 300 000 habitants de Sarajevo était assiégés, sans électricité, sans eau, sans nourriture, sans armes et sans gaz. La Mission d'information ne dispose pas de preuves permettant d'étayer ou d'infirmer la thèse d'un laisser-faire délibéré, voire d'un accord des autorités bosniaques à la prise de contrôle de Srebrenica par les Serbes. En toute logique, il semble douteux qu'elles aient accepté de lâcher la proie pour l'ombre, de même qu'on voit mal pourquoi elles auraient donné aux Serbes des marges de manoeuvre supplémentaires par la suppression de ce point de fixation qu'était Srebrenica pour les troupes et le matériel lourd de l'armée des Serbes de Bosnie. Ceci dit, comme l'a noté M. Jean-Claude Mallet, « ceci est un raisonnement rationnel, mais il est possible qu'on ait dû faire face à une réalité qui ne l'était pas ». Il est vrai que les Serbes avaient eux-mêmes souligné combien ils tenaient à Srebrenica, tout comme Sarajevo était au centre des préoccupations du Gouvernement bosniaque, pour sa valeur symbolique, politique ou encore économique, autant d'atouts que ne possédait pas Srebrenica, ville pauvre, située dans une région difficile et éloignée de la capitale. Le malaise que suscite dans l'ensemble des pays concernés, plus ou moins directement, la crise de Srebrenica est due à la conjonction entre les considérations de Realpolitik - d'aucuns parleront de cynisme - qui ont présidé au traitement international de la crise et les massacres qui se déroulaient simultanément, ainsi qu'on l'a appris par la suite. D'ailleurs, quand prend-on réellement conscience de ces massacres ? Certains des interlocuteurs de la Mission d'information ont parfois donné l'impression de considérer cette question comme relevant d'un intérêt exclusivement historique. Tel n'est pas du tout le cas : selon le moment à partir duquel certains Gouvernements ou certains responsables prennent conscience de la réalité des massacres, on passe de la passivité irresponsable à la responsabilité passive. Dans la chronologie, les premières preuves des massacres sont apportées par Madeleine Albright, ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, aux membres du Conseil de sécurité le 10 août 1995, au cours de consultations informelles. Il s'agit en l'occurrence de photographies de reconnaissance aérienne prises le 11, puis le 17 juillet 1995 au-dessus de l'enclave, sur lesquelles apparaissent des excavatrices et des endroits où la terre a été manifestement retournée. Ces photographies ont été utilisées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dont les enquêteurs, dépêchés sur place, exhument depuis les cadavres. Avant cette date, s'il n'existe pas de preuves indiscutables des massacres, les nombreux témoignages des réfugiés et l'absence à Tuzla d'un nombre considérable - on oscille à l'époque entre 7 000 et 10 000 personnes - d'hommes présents dans l'enclave nourrissent d'ores et déjà l'inquiétude. Très tôt d'ailleurs, la séparation des hommes et des femmes et l'absence d'hommes parmi les réfugiés arrivant à Tuzla sont relevées par les observateurs, notamment avertis par les responsables bosniaques. Ainsi, par une lettre au Secrétaire général des Nations unies en date du 13 juillet, le chargé d'affaires a. i. de la mission permanente de Bosnie-Herzégovine auprès de l'organisation des Nations unies fait savoir que « notre Gouvernement a eu connaissance d'informations provenant de la région de Srebrenica, selon lesquelles les forces serbes auraient commencé à séparer du reste de la population les hommes et les garçons âgés de plus de treize ans. Ces hommes et ces garçons auraient été forcés à creuser des tranchées et abusivement contraints à oeuvrer d'autres façons à la réalisation des objectifs militaires serbes dans les territoires occupés. Notre Gouvernement a également appris que les femmes de quinze à trente-cinq ans avaient été séparées du reste des réfugiés. Selon des informations en provenance de cette région, un certain nombre de camions transportant des détenus de sexe masculin seraient partis pour des destinations inconnues. On ne connaît pas le sort de ces hommes mais, bien que les informations en question n'aient pas encore été confirmées, il y a de fortes raisons de craindre qu'ils n'aient été exécutés ». C'est en fait autour du 17 juillet que la communauté internationale prend conscience que les hommes, jusqu'alors considérés comme disparus, ont pu être tués, comme l'a indiqué M. Hans Van Mierlo lors de son audition. Les chiffres restent néanmoins incertains. Le 18 juillet 1995, le Secrétaire général des Nations unies écrit à son représentant spécial en Bosnie-Herzégovine : « Vous aurez sans doute lu et entendu les comptes rendus détaillés d'atrocités commises par les Serbes de Bosnie-Herzégovine lors de la récente prise de Srebrenica. Bien que nombre de ces récits viennent des réfugiés, ils sont nombreux et cohérents et sont considérés comme crédibles par divers observateurs internationaux, y compris le HCR »38. Il ne s'agit cependant encore que de rumeurs ou de convictions officieuses. C'est encore à titre confidentiel que, le 21 juillet, à la conférence de Londres, le général Rupert Smith dit à M. Joris Voorhoeve : « Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai l'affreuse suspicion que 3 000 hommes pourraient être disparus. Mais [ajoute-t-il] je n'en ai aucune preuve ». La Mission d'information aurait souhaité savoir sur quels éléments reposaient les suspicions du général Rupert Smith. Sa hiérarchie ayant refusé d'autoriser son audition, elle n'a pu le faire, ce qu'elle regrette vraiment. Officiellement, la prudence est donc de mise avant le 11 août. Interrogé sur ce point par la Commission des Affaires étrangères le 22 juillet 1995, M. Hervé de Charette fait la réponse suivante : « Que s'est-il passé à Srebrenica ? Des choses étranges à vrai dire. S'est-il passé des atrocités ? Qu'en sait-on ? Je suis comme vous car ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dans tout cela, c'est que l'information est très insuffisante et je suppose, en effet, qu'une partie de ce qu'on nous a dit est sans doute vraie ». La Mission d'information a quelques difficultés à comprendre la chronologie exacte de la connaissance des massacres telle qu'elle lui a été présentée par l'ensemble des personnes auditionnées. D'une part, comme les Rapporteurs l'ont expliqué précédemment, dès le 13, les soldats du Dutchbat sont les témoins d'exactions commises par les Serbes dans l'enclave. Sans doute était-il impossible d'y voir les prémisses d'un massacre. Il est néanmoins inexcusable que ces informations n'aient pas été transmises à l'ensemble des Gouvernements concernés par la crise. D'autre part, la Mission d'information est extrêmement troublée par la mention ambiguë, dans le jugement du général Krstic publié le 2 août 2001, de photographies de reconnaissance aérienne prises par des avions américains de l'OTAN. On peut en effet y lire le passage suivant : « Les groupes les plus importants d'hommes bosniaques musulmans de la colonne ont été capturés le 13 juillet 1995 ; plusieurs milliers furent rassemblés sur ou près du pré de Sandia et sur le terrain de football de Nova Kasaba. La Cour l'a entendu d'hommes capturés qui étaient présents sur ces lieux et de témoins qui sont passés devant alors qu'ils roulaient dans des bus vers Kladanj. Des photos de reconnaissance aérienne produites comme preuves par l'Accusation confirment la présence massive de gens sur ces lieux le 13 juillet 1995 »39. Cette phrase ambiguë signifie-t-elle que lesdites photos ont été prises le 13 juillet 1995, c'est-à-dire pendant les massacres, ce qui confirmerait les révélations du Journal La Croix dans un article du 9 juillet 1996, selon lesquelles des avions U2 américains avaient filmé 600 personnes rassemblées à Nova Kasaba, cernées par des hommes armés ? Lors de l'audition du commissaire Jean-René Ruez, enquêteur au TPIY sur Srebrenica, les membres de la Mission d'information s'étaient étonnés de ce que les seules photographies aériennes officiellement évoquées datent du 11 juillet, puis du 17 juillet. Ou bien le texte précité signifie-t-il que c'est à partir des photographies du 17 que l'on a déduit la présence d'hommes le 13, en les recoupant avec les témoignages des survivants ? Quoi qu'il en soit, il semble extrêmement difficile de concevoir qu'un avion de reconnaissance aérienne reçoive la mission d'aller espionner l'enclave de Srebrenica le 11, puis ensuite seulement le 17, alors que l'attention de la communauté internationale toute entière est tournée vers Srebrenica et que, très rapidement, la séparation des hommes et des femmes de Srebrenica est connue. Si de telles photographies ont été prises le 13 juillet, pourquoi n'ont-elles pas été publiées à l'époque ? Y-a-t-il eu une défaillance dans l'exploitation du renseignement qui aurait conduit les responsables américains à n'en avoir connaissance qu'au début du mois d'août, après la chute de Srebrenica et Zepa ? Faute d'avoir pu s'entretenir avec les personnes concernées, la Mission d'information ne peut pas répondre à ces questions. Mais il est clair que si ces photos ont été connues pendant les événements de Srebrenica, celui qui a pris la décision de ne pas les publier est criminel. C - LA FRANCE ET LES ÉVÉNEMENTS DE SREBRENICA Les analyses qui précèdent relatives à la responsabilité collective des Etats à travers l'ONU et aux responsabilités particulières de chacun des acteurs de la crise montrent que la France n'est pas moins que le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou les Pays-Bas responsable de la chute tragique de la zone de sécurité de Srebrenica. L'est-elle plus ? Depuis plusieurs années, un certain nombre d'accusations, de rumeurs visent à établir que la responsabilité de la France est particulièrement engagée dans les événements de Srebrenica. A dire vrai, les premières mises en cause sont quasi-contemporaines du drame. Un homme est particulièrement visé par ces accusations : le général Bernard Janvier, qui commandait l'ensemble des forces de paix des Nations unies en ex-Yougoslavie au moment des faits et détenait à ce titre, conjointement avec la « tête » civile de ces forces, M. Yasushi Akashi, d'importants pouvoirs de décision. Peu à peu toutefois, les rumeurs ont visé les autorités françaises dans leur ensemble, certains avançant que c'est sur instruction de son Gouvernement que le général Janvier, théoriquement responsable à l'époque devant le seul Secrétaire général des Nations unies, a agi comme il l'a fait. La Mission d'information se doit d'examiner ces accusations sans a priori. Il y va de l'honneur d'un homme et surtout de notre pays. Les reproches formulés à l'encontre d'un officier supérieur français ne doivent en effet pas faire oublier qu'in fine, en démocratie, la responsabilité est politique et que les militaires sont au service d'une politique qui est définie par des responsables élus. Au-delà de ces polémiques, le rôle de la France dans les événements de Srebrenica mérite de toute façon un examen spécifique. En effet, dans la mesure où la France a assumé un rôle majeur dans la crise bosniaque, au triple titre de membre du Conseil de sécurité des Nations unies, membre du Groupe de contact et plus gros contributeur de troupes, le bilan global de l'action internationale en ex-Yougoslavie n'est-il pas également celui de la politique française en ce domaine ? Nul doute qu'à ce titre, Srebrenica, qui pèse d'un poids très lourd dans ce bilan, est aussi un échec de la France. Les questions qui doivent être examinées dans ce cadre sont nombreuses, et bien connues : au-delà des motivations et des objectifs officiels, la France et ses soldats ont-ils agi en ex-Yougoslavie en fonction de considérations non avouées, telles qu'un supposé pro-serbisme ? Cette grille de lecture est-elle pertinente pour analyser l'attitude du général Janvier au moment de la crise de Srebrenica ? Quelles raisons peuvent-elles expliquer l'intervention si tardive de l'arme aérienne ? Faut-il les chercher dans la psychologie de l'homme ou dans des instructions qu'il aurait reçu de ses supérieurs hiérarchiques « naturels » et de son Gouvernement d'origine ? Y-a-t-il eu attentisme, inconscience, incompétence ou volonté délibérée ? 1) Un engagement continu de la France en ex-Yougoslavie desservi par une politique aux objectifs confus La France s'est engagée militairement de manière très importante en ex-Yougoslavie ; mais les objectifs politiques qui sous-tendaient cet engagement étaient souvent confus. C'est pourquoi, il serait pour le moins malvenu, d'imputer aux militaires français d'éventuels échecs, qui sont plus la résultante d'un manque d'objectifs clairs. a) Grandeurs de la politique de la France en ex-Yougoslavie : un engagement massif et courageux Il n'est pas douteux que le rôle de la France a été déterminant dans le conflit en ex-Yougoslavie. A cet égard, seul le Royaume-Uni a un rôle comparable au nôtre durant ces années et les remarques qu'on fera sur la politique de la France pourraient être faites par les membres de la Chambre des Communes à l'endroit du Gouvernement britannique dans des termes à peu près équivalents. La France a eu dans cette période un triple rôle majeur : en tant que membre permanent du Conseil de sécurité elle a toujours soutenu la politique conduite pour les Nations unies et elle a le plus souvent été à l'initiative de cette politique. En tant que membre du Groupe de contact, dont la France a été l'un des initiateurs, elle a joué un rôle certain, même si ce Groupe a, d'une manière générale, été très largement « instrumentalisé » par les Etats-Unis, surtout à la fin du conflit. Enfin - faut-il le rappeler - la France a été le premier contributeur de troupes au sein de la FORPRONU et c'est elle qui a perdu le plus d'hommes dans ce conflit, en dehors, bien entendu des protagonistes eux-mêmes. - La France membre du Groupe de contact : La création du Groupe de contact est en fait la résultante de l'échec des Européens à résoudre le problème yougoslave sans une présence effective des Etats-Unis. Dès 1993, la France a tenté d'impliquer les Etats-Unis et la Russie dans le processus de paix en ex-Yougoslavie : après le rejet du Plan Vance-Owen, la pression s'est accentuée (sans tenir compte de ce fait qu'aucune solution n'était envisageable sans une implication réelle et forte des Etats-Unis). La difficulté n'était pas mince. D'une part, il fallait tenir compte de l'action conduite par les Nations unies et l'Union européenne dont les représentants - Cyrus Vance et David Owen - présidaient la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie ; d'autre part, les Etats-Unis ne souhaitaient pas négocier avec les Quinze dans la formation constitutionnelle qui était la leur (présidence tournante, etc.) et ils n'entendaient pas travailler avec David Owen... Dès lors il a semblé nécessaire, malgré les réticences tout à fait normales de certains de nos partenaires au sein de l'Union européenne, d'envisager la création d'une formation ad hoc réunissant les Etats-Unis, la Russie et les trois Etats européens les plus concernés par le conflit en ex-Yougoslavie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La logique qui a présidé à la création du Groupe de contact est retracée de manière très claire dans les propos tenus le 29 mars 1994 par M. Alain Dejammet, alors Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères devant une mission d'information de la Commission des Affaires étrangères que conduisait M. Jean-Bernard Raimond. « On a estimé qu'il était possible d'intervenir sans les Etats-Unis. Dans l'ex-Yougsolavie, les Américains ne sont pas présents à terre. La France a souhaité que les Etats-Unis s'impliquent dans le conflit yougoslave plus pour des raisons politiques qu'opérationnelles... L'ONU dispose aujourd'hui de 30 000 hommes en ex-Yougsolavie, sans les Américains. En cas de mise en oeuvre d'un plan de paix, il en faudrait peut-être 10 000 supplémentaires. D'autres pays que les Etats-Unis peuvent les fournir. Il n'existe donc pas de dépendance opérationnelle vis-à-vis des Etats-Unis ». De ces propos, on retiendra la volonté de rechercher l'appui politique des Etats-Unis à une politique qui n'avait pourtant déjà plus guère de sens à cette période et l'illusion sur les moyens qui sous-tendaient toute cette politique. Enfin doit-on rappeler que l'engagement de la France s'est concrétisé par une présence sur le terrain très importante. Le contingent français a été le plus important au sein de la force des Nations unies et plusieurs généraux français ont occupé des places éminentes au sein de cette force. b) Faiblesse de la politique de la France en ex-Yougoslavie : une politique floue et trop peu réactive à l'évolution de la situation sur le terrain Se demander quelle était la politique de la France en Bosnie-Herzégovine, c'est dans une certaine mesure, y répondre. En effet, il apparaît clairement que l'objectif essentiel était d'être présent sur un théâtre proche de nos frontières, dont nous ne pouvions être absents. Les propos tenus à cet égard par le général Cot, qui a commandé les forces des Nations unies en ex-Yougoslavie sont tout à fait édifiants. Interrogé par M. François Lamy sur la question de savoir quelles instructions il avait reçues avant son départ, le général a d'abord indiqué : « Vous me gênez un peu, Monsieur le Député. » M. François Lamy, ayant observé que c'était la raison pour laquelle il lui posait la question, le général Jean Cot a alors indiqué : « J'ai été désigné de façon assez inattendue. Je devais partir dans les huit jours. On m'a dit qu'il était souhaitable de faire un tour de piste de personnalités dont on m'a donné la liste, avec un cicerone. Je suis donc allé voir M. Léotard, alors Ministre de la Défense, à qui j'ai dit à la fin de l'entretien : "J'aimerais bien, Monsieur le Ministre, que vous me disiez, parce que je ne l'ai pas bien comprise, quelle est exactement la politique de la France dans l'ex-Yougoslavie", et je me souviens très bien que M. Léotard m'a répondu dans un sourire : "Ce n'est pas tellement mon boulot, mais je suis sûr que Juppé va vous le dire". « Je suis allé chez M. Juppé, alors Ministre des Affaires étrangères, mais je ne l'ai pas vu, parce qu'il était très occupé. J'ai donc vu un deuxième ou troisième couteau qui m'a embarqué dans des trucs auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Je n'ai vu personne à Matignon. J'ai été reçu par François Mitterrand, une bonne demi-heure, en tête-à-tête. Il ne m'a pas non plus brossé un tableau géopolitique complet de ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ses derniers mots ont été : "Si j'ai un conseil à vous donner, retirez-vous dans votre chambre jusqu'à votre départ, ce sera sans doute le plus utile". « C'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec ce maigre viatique. Ma réponse est : " Je ne sais toujours pas ce que j'allais faire là-bas". » Le Président François Loncle : « C'est vraiment tout ce qu'il vous a dit ? » Général Jean Cot : « Il a brossé un peu le tableau du théâtre tel qu'il le voyait. Je n'ai pas eu l'impression qu'il me brossait un tableau pro-Serbe de la situation. J'ai plutôt le sentiment qu'il voulait me montrer que, dans le fil de sa vocation, la France devait s'engager en tant que telle dans ce jardin de l'Europe qu'étaient les Balkans, que c'était pour cela qu'il fallait qu'on prenne des risques ; que je pourrais sans doute, en effet, me poser des questions auxquelles on essaierait de répondre au fur et à mesure. « Autrement dit, cela n'avait pas la forme d'une directive carrée et nette, que je n'ai d'ailleurs jamais eue. » Tout en faisant la part des choses et en tenant compte du sens de la formule qu'a le général Cot, il faut bien dire que le sens de notre politique échappe aux meilleurs observateurs et sans doute aussi à ceux qui la conduisaient. On a le sentiment que l'humanitaire a pris alors le pas sur toute autre considération : il convenait d'aider à la survie de communautés dont la vie était mise en danger par les massacres directs et les conséquences indirectes de la guerre, sans pour autant qu'on veuille vraiment s'en prendre à l'agresseur, même lorsque celui-ci était clairement identifié. De ce point de vue, l'amiral Lanxade, qui était alors chef d'état-major des Armées après l'avoir été à la Présidence de la République, a été très clair sur la position de la France, à tout le moins sur celle du Président de la République. Le Président François Loncle l'ayant interrogé sur les objectifs du Président François Mitterrand, l'amiral Lanxade a indiqué à la Mission d'information : « Je crois que le Président considérait qu'il n'était pas question de transformer une opération de maintien de la paix en une opération de guerre et que, même si nous l'avions voulu, nous, Français, la communauté internationale n'était absolument pas prête à nous suivre. « C'était la position du Président Mitterrand, qui consistait à dire : "Essayons autant que nous le pouvons de calmer ou de réduire la tension, empêchons surtout que cette crise sorte des frontières de la Yougoslavie", ce qui aurait été extrêmement dangereux par les enchaînements possibles. Quant à l'expression "Il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre", c'était une sorte de boutade pour dire que nous n'avions pas alors les moyens de passer d'une situation de gestion de crise à une situation de guerre. « C'est au travers de cela qu'on lui aurait reproché d'avoir ménagé les Serbes. En fait, il ne voulait pas ménager les Serbes. Politiquement, au départ de cette crise, au moment où il fallait reconnaître la Slovénie, la Croatie, etc., nous nous sommes retrouvés dans une situation qui était assez préoccupante parce que, d'une certaine façon, nous retrouvions les clivages de l'histoire, voire de la guerre. « C'est pourquoi le Président et la diplomatie française étaient dans une situation délicate de ce point de vue. Naturellement, il n'était pas question de soutenir les Serbes mais, en même temps, il y avait la tentation - c'était le cas notamment de l'Allemagne - d'aller très vite dans la reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie, ce qui posait un problème diplomatique délicat. « Ensuite, effectivement, comme les Serbes étaient les agresseurs ou les plus agressifs, au moins durant la plus grande partie de ce conflit, quand on disait qu'on ne voulait pas faire la guerre, il est évident que c'était aux Serbes qu'on ne voulait pas la faire puisque c'étaient les agresseurs. « Autrement dit, le Président n'a jamais pensé que l'on pouvait passer d'une position qui était celle du départ, c'est-à-dire neutre, à une position qui a été finalement celle de Deliberate Force, à la fin, et qui sera celle du Kosovo plus tard, une position dans laquelle on passe de la crise à la guerre. » Ces explications données par l'amiral Lanxade recoupent, en les nuançant, les impressions qu'ont données de nombreux interlocuteurs du Président Mitterrand sur son sentiment. On devait être présent en Yougoslavie, pour éviter que le conflit ne s'étende et si possible en atténuer les conséquences pour les populations civiles, mais on ne devait pas faire la guerre, même aux agresseurs qui, le plus souvent, étaient les Serbes. c) Les zones de sécurité, un concept français Comme l'observe avec justesse M. Thierry Tardy, la création des zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine est « emblématique » de la politique française en Bosnie-Herzégovine. Elle traduit la volonté de notre diplomatie d'avoir un rôle prépondérant dans la gestion du conflit sans avoir les moyens de mettre en oeuvre ses initiatives. C'est la raison pour laquelle la France a pris l'initiative en 1993 de créer des zones de sécurité et son idée, quoique mal reçue à la fois par les militaires français et les autres membres permanents du Conseil de sécurité, sera reprise par l'ONU en quelques jours. Il nous fallait trouver une parade à l'échec du Plan Vance-Owen et à la nième proposition américaine de frappes aériennes et de levée de l'embargo sur les armes. Il est vrai que les zones de sécurité ouvrent la possibilité d'un recours à la force ; mais la France ne souhaite pas plus à ce moment qu'auparavant être engagée dans un processus qui conduirait à une confrontation armée avec les Serbes. Quoi qu'il en soit et parce qu'il faut proposer quelque chose, puisqu'on ne peut se contenter de s'opposer aux initiatives américaines, nous allons proposer de créer de véritables zones de sécurité. Un exemple de cette démarche peut être trouvé dans le mémorandum français sur les zones de sécurité du 19 mai 1983 (S : 25800). L'ensemble du mémorandum témoigne de la volonté de conserver l'initiative dans l'action humanitaire, en laissant le soin au Conseil de sécurité et au Secrétaire général des Nations unies de voir quelles sont les options qu'ils retiendront en fonction des moyens dont ils disposeront. Ce mémorandum vise, dit-il, à « donner un coup d'arrêt aux conquêtes territoriales des forces serbes de Bosnie-Herzégovine et (...) obtenir une solution négociée entre les parties intéressées ». A cette fin, « une nouvelle résolution devrait... prévoir explicitement la possibilité de recourir à la force », pour contraindre les Serbes à respecter les zones de sécurité qui ont été crées, déjà à l'initiative de la France, par la résolution 824 du 6 mai 1993. Pour faire montre de détermination, la France présente de manière rapide deux options légères et conclut sur une troisième - « l'option lourde » - qui vise à permettre à la FORPRONU de « - s'opposer à toute agression ; « - contrôler le cessez-le-feu ; « - occuper les points essentiels du terrain ; « - participer au soutien de la population ; « - maintenir ouvert un ou plusieurs couloirs logistiques à travers les zones serbes ; « - le cas échéant, regrouper les armements lourds et procéder à la démilitarisation. » L'ensemble est complété par une définition des éléments déclenchant l'usage de la force, qui sont le bombardement ou l'agression contre la zone de sécurité, mais aussi, pour faire bonne mesure, « l'opposition à la libre circulation de l'aide humanitaire et de la FORPRONU. » Tout cela constituerait effectivement une politique traduisant une réelle détermination, s'il y avait une chance que les moyens suivent. Mais cela relève en fait de la « gesticulation » tant on sait aussi bien à Paris, que dans les autres capitales, que les moyens militaires à la mise en oeuvre de tels objectifs ne peuvent, en aucune façon être obtenus. Le mémorandum évoque d'ailleurs les effectifs nécessaires : 15 000 à 20 000 hommes seraient nécessaires à Sarajevo et 5 000 hommes environ pour chacune des quatre autres enclaves. On sait, et la France le sait déjà, qu'en fait l'effectif à Srebrenica n'excédera jamais les 600 hommes. L'objectif de « montrer qu'on fait quelque chose » est particulièrement patent dans la suggestion faite au dernier alinéa du mémorandum, tendant à ce que des participations américaines et russes au sol soient prévues afin de garantir les zones de sécurité, en précisant, non sans humour, que cela permettrait de se cantonner dans une « option légère ». Tout cela relève un peu de la politique « CNN », même si M. Alain Juppé - alors Ministre des Affaires étrangères - a estimé devant la Mission d'information que la création des zones de sécurité traduisait la fermeté de la position française : « Si Srebrenica était une zone de sécurité, ce qui hélas n'a pas évité le massacre, c'est parce que nous l'avions voulu. La création des zones de sécurité a été une demande et une initiative françaises qui remontent à avril-mai 1993, avec les résolutions du Conseil de sécurité. C'est toujours dans ce sens que la France a agi au sein du Groupe de contact, et on n'a pas été nombreux à demander la fermeté. » d) 1995, changement de style ou changement de politique ? Y a-t-il eu un changement en 1995 ? Sans aucun doute en apparence en a-t-il été ainsi, ne serait-ce que parce que la France a fini par s'associer à une conception qui impliquait un engagement massif de l'OTAN face aux forces serbes. Mais on ne peut se contenter de ce seul fait pour affirmer qu'un changement radical a eu lieu lié au changement de Président de la République. Les témoignages présentés devant la Mission d'information ont été à cet égard à la fois divers et nuancés. L'amiral Lanxade a nié tout changement de notre politique dû au seul changement de la personnalité du Chef de l'Etat ; pour lui le changement qu'on a constaté résulte en fait des seules modifications de l'environnement international. « L'actuel Président de la République prend ses fonctions en 1995 », a indiqué l'amiral Lanxade devant la Mission d'information, « il trouve une situation qu'il n'avait suivie que de l'extérieur de l'appareil d'Etat, mais en étant assisté par un Premier ministre, M. Alain Juppé, qui était le Ministre des Affaires étrangères du précédent Gouvernement et qui, par conséquent, avait une connaissance approfondie de la situation et du dossier de la crise. Le Président de la République, au départ, ne change donc pas la politique telle qu'elle se présente. « Ce qui a conduit à changer de politique, c'est la prise d'otages, qui a très clairement marqué que la partie serbe avait franchi un pas de plus dans l'agression contre les forces des Nations unies et, notamment, contre la France. A partir de ce moment-là, il est clair que l'appréciation politique par le Président, par le Premier ministre et par l'ensemble de ceux qui participent à la prise de décisions politico-militaires en France évolue : on entre dans une nouvelle phase. C'est ainsi qu'a pu être décidée très rapidement la mise sur pied de la Force de réaction rapide. » A l'inverse, MM. Juppé et Levitte ont souligné le changement opéré en 1995. Sans vouloir entrer dans une polémique, somme toute assez vaine, vos Rapporteurs voudraient cependant retenir du témoignage de M. Alain Juppé quelques mots qui semblent révélateurs de l'état d'esprit du Président Mitterrand pendant le conflit yougoslave. Alors qu'il évoquait avec le Président de la République la proposition d'étendre le concept des zones de sécurité et indiquant que nombre de nos partenaires, dont les Américains, étaient réticents, le Président Mitterrand lui lâche ces mots : « Vous êtes bien conscient que nous prenons une orientation différente et que nous nous engageons dans une stratégie qui peut conduire à l'affrontement. Cela dit allez-y. » Cette phrase, rapportée par M. Alain Juppé devant la Mission d'information dans une réponse au Président François Loncle, montre d'abord la réticence du Président Mitterrand à toute action de nature à nous entraîner dans un conflit avec les Serbes. Elle montre aussi que le Président Mitterrand, même là dessus, a évolué au cours du conflit. Sans doute le changement de Président en 1995 a-t-il accéléré cette évolution ; mais tout laisse à penser qu'elle aurait eu aussi lieu avec l'ancien Président. 2) Les carences du renseignement français en Bosnie Bien qu'étant le plus gros contributeur de troupes en ex-Yougoslavie, la France ne s'est pas donnée tous les moyens de mener à bien sa mission sur le terrain. Certes, la création de la Force de réaction rapide au printemps 1995 montre que les autorités gouvernementales ont pris la mesure de ces insuffisances. Mais au moment de la crise de Srebrenica, alors que la Force de réaction rapide n'est que partiellement opérationnelle, ce sont les limites du dispositif français de renseignement qui sont apparues. Non seulement la focalisation des moyens sur Sarajevo mais également les lacunes du système en matière de collecte et de transmission du renseignement ont pesé lourd sur le niveau d'information du général Janvier comme des responsables civils et militaires du ministère de la Défense. a) Une focalisation excessive sur Sarajevo Tous les témoins, civils ou militaires, auditionnés par la Mission d'information, l'ont dit : l'obsession des autorités françaises était Sarajevo. Là se trouvait concentrée la majeure partie des forces françaises déployées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ; la ville, assiégée, depuis plus de trois ans, était à nouveau le théâtre de graves tensions alors qu'étaient acheminés les éléments constitutifs de la FRR, essentiellement, voire exclusivement, dédiés, dans l'esprit des responsables, à Sarajevo. Enfin, la Jérusalem du Nord, cette capitale cosmopolite et multiculturelle située au carrefour de civilisations millénaires était, bien davantage qu'un enjeu des combats, le véritable symbole d'une Bosnie multiethnique que la politique d'intervention internationale a tenté de préserver au mieux. Pour résumer, « priorité des priorités » : tel est le qualificatif utilisé par le Premier ministre de l'époque, M. Alain Juppé, en évoquant Sarajevo. « C'est le point capital me semble-t-il pour bien comprendre quelle était la priorité des autorités françaises à cette époque, Sarajevo était étranglée. La FORPRONU, constituée pour l'essentiel de contingents français, était menacée de paralysie et d'épuisement de ses réserves, notamment de ses réserves de carburant, dont on prévoyait qu'elles seraient terminées à la mi-juillet ». Pour M. Alain Juppé, à l'instar de l'ensemble des autorités françaises de l'époque, la crédibilité de la politique française en ex-Yougoslavie allait se jouer sur la levée du siège de Sarajevo. La prégnance de ce thème est d'ailleurs si forte que, lorsque le Premier ministre rencontre le général Janvier le 6 juillet à Paris, la « conversation, qui a duré une dizaine de minutes ou un quart d'heure, a porté quasi exclusivement sur la situation à Sarajevo et sur les conditions de mise en place de la FRR, la FORPRONU étant à cette époque assez préoccupée de l'articulation entre la FRR et son propre dispositif, en particulier de l'organisation des deux chaînes de commandement ». Expliquant pourquoi Srebrenica n'avait pas du tout été évoquée, le Premier ministre a expliqué que « la situation des enclaves orientales, certes difficile, n'apparaissait pas plus préoccupante qu'à l'accoutumée, la pression serbe y étant ce qu'elle était depuis plusieurs mois ». L'approche n'est pas différente dans l'entourage du Président de la République. Le général Christian Quesnot a fait valoir que « Srebrenica, qui était une enclave orientale, n'était pas, en 1995, la préoccupation essentielle des Français, et ce pour deux raisons qui me semblent évidentes : premièrement, ce n'était pas dans leur zone de responsabilité et, d'autre part, nous avions d'énormes soucis à Sarajevo qui était l'implantation principale. Je vous rappelle qu'il y a eu, pendant toute cette période, des attaques serbes violentes, les différentes prises d'otages, les réactions pour reprendre le pont de Vrbanja. En bref, la focalisation aussi bien diplomatique que militaire et politique, c'était, à l'évidence, Sarajevo. Il est évident que Sarajevo était une des clés de l'ensemble ». M. Jean-David Levitte a justifié cette focalisation par une répartition des rôles entre les pays contributeurs. Pour l'ancien conseiller diplomatique du Président de la République, « Chacun avait ses préoccupations. Nous avions l'obsession de Sarajevo et nous avions l'impression de jouer au c_ur du dispositif et du drame bosniaque. Les Néerlandais avaient en charge Srebrenica. Chacun avait son dispositif et sa préoccupation ». Au ministère des Affaires étrangères, Srebrenica n'est évoquée qu'au travers de la question du remplacement du contingent néerlandais qui devait être relevé le 1er juillet, les Pays-Bas ne souhaitant plus assumer la responsabilité de la zone de sécurité. Comme l'a précisé M. Hervé de Charette, « c'est sur Sarajevo qu'était concentré l'essentiel des préoccupations diplomatiques et militaires françaises, parce que, dans cette zone, nous détenions la totalité des responsabilités. Pour ce qui concerne l'enclave de Srebrenica, ce que nous en savions, c'est que les Hollandais voulaient en partir ». L'intervention du Représentant français au Conseil de sécurité le 12 juillet, le jour de l'adoption de la résolution 1004 sur Srebrenica, se conclut d'ailleurs ainsi : « Pour l'instant, mon Gouvernement ne renonce à aucun des objectifs qui sont les miens, parmi lesquels, je le rappelle, figure au premier plan que soient ouverts les accès à Sarajevo dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il prendra toute initiative appropriée en ce sens ». Au ministère de la Défense enfin, la préoccupation essentielle porte sur les conditions d'emploi et le soutien du contingent français. Très logiquement par conséquent, les yeux sont davantage « fixés sur Sarajevo, où le contingent français était stationné, (que) sur Srebrenica, où il y avait le contingent néerlandais » (Charles Millon). Les instructions données à la Direction du renseignement militaire sont évidemment en cohérence avec cette priorité : « Notre objectif était les Français, la zone française, et la fourniture aux responsables politiques et militaires français des éléments qui leur permettraient de prendre en passant par l'ONU des décisions concernant essentiellement le contingent français et sa zone d'influence », ainsi que l'a expliqué le général Jean Heinrich. D'après ce dernier, en outre, il aurait été problématique que la France fasse du renseignement hors de la zone de responsabilité à l'égard de l'ONU, celle-ci ayant, par principe, décidé de ne pas se doter de renseignements militaires. « On risquait aussi de laisser entendre qu'on trahissait sa confiance ». Des arguments techniques expliquent également la focalisation du dispositif français sur Srebrenica : s'agissant des moyens technologiques - en l'occurrence des avions de reconnaissance aérienne -, leur utilisation était rendue délicate par le caractère accidenté et boisé du terrain ; quant au renseignement humain, il émanait de personnels répartis dans le contingent français, qui avait de ce fait très rarement la possibilité de se mouvoir en dehors du cercle d'influence et de responsabilité des Français qui étaient, à ce moment-là, limités à Sarajevo. Au total donc, l'ensemble des moyens de renseignements français était orienté vers la zone de Sarajevo. Il s'agissait en l'occurrence, outre les moyens humains évoqués, de moyens d'écoute, vraisemblablement « très difficiles à mettre en oeuvre puisqu'il fallait les camoufler aux yeux de tout le monde, non seulement des protagonistes mais aussi de l'employeur », d'aéronefs faisant également de l'écoute - dans le cadre de l'opération Deny flight, la France mobilisait en 1995 4 Mirage F1CR chargés d'effectuer des missions de reconnaissance au dessus du territoire bosniaque40 - et de moyens d'imagerie. Sur ce point, le général Jean Heinrich a précisé que, bien qu'encore en phase d'expérimentation, le satellite Hélios 1-A a néanmoins pu être utilisé pour des missions d'essais sur le territoire, « très satisfaisantes mais quand même évidemment très éloignées de ce que les Américains pouvaient obtenir à ce moment-là ». On rappellera à cet égard que ce satellite a été mis en orbite le 7 juillet 1995 et est entré en phase opérationnelle le 11 octobre 1995. A compter de la mise en orbite, il fallait en principe 2 à 3 jours pour que le satellite puisse prendre ses premières photos41. Enfin, le dispositif de renseignement militaire était complété par les informations fournies par la DGSE qui portaient essentiellement sur les influences extérieures qui interféraient sur le terrain. La coopération entre les deux services de renseignement a été, au total, décrite comme satisfaisante par l'ancien chef du renseignement militaire, même si les informations de la DGSE étaient « sans réel intérêt militaire ». C'est en revanche une coopération « plus délicate » (général Heinrich) qui a été décrite avec les services étrangers, notamment avec les deux principaux d'entre eux, la CIA américaine et le MI6 britannique. Au regard du contexte général, caractérisé par l'absence officielle et volontaire de tout dispositif de renseignement, la réticence des services à coopérer apparaît somme toute compréhensible, plus encore dans la mesure où les Etats impliqués dans la gestion du conflit bosniaque poursuivaient chacun des stratégies propres, parfois divergentes. S'agissant des Etats-Unis, ils disposaient exclusivement de moyens techniques - écoute et imagerie -, notamment parce qu'ils n'avaient pas de troupes au sol. M. François Léotard a expliqué que la France n'avait « pas toujours rencontré une collaboration très grande de la part des services américains qui, eux, avaient des satellites ». Le général Heinrich a de toute façon récusé l'idée d'une supériorité écrasante des Etats-Unis dans le domaine du renseignement sur ce théâtre. Même si les moyens américains étaient sans commune mesure avec les moyens français, la réalité du terrain - boisé, accidenté - ne permettait pas aux satellites ou aux avions de reconnaissance aérienne, fussent-ils perfectionnés, de disposer d'un renseignement riche. En matière d'écoute, leur dispositif n'était pas non plus adapté. « Parce que - a expliqué le général Heinrich - Mladic, qui était peut-être un homme de peu de foi, comme Karadzic, avait une certaine formation et communiquait avec Belgrade par fibre optique enterrée. Les Américains ont déployé beaucoup de moyens et n'ont finalement réussi que grâce à nous, et à des moyens dont vous permettrez que je ne parle pas, à se brancher un jour sur ces fibres optiques mais cela s'est fait longtemps après, au moment de l'opération OTAN. Ils n'avaient absolument pas réussi jusque-là à intercepter les communications ni de Mladic, ni de Karadzic ». Au total par conséquent, le niveau de renseignement dont la DRM disposait était nettement supérieur à celui de la CIA. Il est en revanche beaucoup plus regrettable que la coopération franco-britannique dans le domaine du renseignement n'ait pas été meilleure, dans la mesure où le dispositif de renseignement déployé par le Royaume-Uni en Bosnie était, semble-t-il, très performant. On notera cependant qu'officiellement, il n'existait pas de renseignement britannique, ainsi que l'a rappelé le général Heinrich : « C'est vrai, les Britanniques en faisaient d'une manière intensive sans jamais le reconnaître ni vouloir nous le dire, craignant certainement une indiscrétion ». Notamment, ce pays disposait de moyens humains déployés sur des théâtres où la France n'avait pas d'agents. Il est ainsi plus que probable que les membres des commandos spéciaux britanniques (SAS) présents dans l'enclave de Srebrenica, notamment pour faire office de contrôleurs aériens en cas d'intervention de l'OTAN, ont pu fournir des informations essentielles sur la situation dans et autour de l'enclave. Malheureusement, étant donné le tabou posé sur le renseignement, mais également parce que la France ne fait pas partie de la chaîne de commandement OTAN, le général Janvier n'a jamais obtenu de renseignements de la part du général Rupert Smith ou de l'officier britannique chargé à ses côtés des relations avec l'OTAN. A fortiori lorsqu'ils sont tous deux partis en permission le 1er juillet 1995... b) Du recueil au traitement de l'information : des lacunes tragiques Au moment de la crise de Srebrenica, les lacunes du dispositif français de renseignement se révélèrent au grand jour. La première faiblesse du dispositif français tient dans sa rigidité. En dépit de l'intensité de la crise, quasiment aucun moyen n'est redéployé vers Srebrenica, pas même d'ailleurs après la chute de l'enclave, alors que le Président de la République évoque une possible intervention militaire dans la zone. Les limites rencontrées alors sont d'abord techniques, comme l'a expliqué le général Jean Heinrich : « Avons-nous mis à ce moment-là plus de moyens ? Nous n'en avions pas pour mettre des gens à terre. Nous n'avons donc pu que renforcer, avec des résultats limités, nos moyens techniques, c'est-à-dire d'interception, mais cela n'a pas donné de résultats très significatifs. » Rappelons, en outre, qu'aucune « commande » en ce sens n'a été passée à la Direction du renseignement militaire. Cette défaillance dans la réactivité de notre dispositif de renseignement paraît rétrospectivement d'autant plus regrettable que d'autres crises, majeures, s'étaient déroulées sans que nous en tirions les leçons qui s'imposaient : « Comme l'a souligné devant vous le général Heinrich, notre dispositif de renseignement connaît certaines lacunes. Les Français ne disposent pas ou guère d'éléments permettant de les renseigner directement sur la situation dans les zones de sécurité où ils n'ont pas déployé d'unités militaires. Cet état de fait a perduré (...) Peut-être aurions-nous dû tirer des enseignements des précédentes crises, car nous avions déjà été confrontés à ce type de problème et c'est une question qui fut souvent évoquée » (Jean-Claude Mallet). La deuxième défaillance du dispositif français de renseignement en ex-Yougoslavie réside dans la lenteur de la transmission des informations, du théâtre vers Paris, lenteur qui s'est révélée tragique dans le traitement d'une crise aussi rapide que celle de Srebrenica. Sans doute, ce n'était pas à Paris qu'étaient prises les décisions opérationnelles ; on peut néanmoins supposer qu'une crise aussi importante, dont on a souligné précédemment qu'elle mettait en cause ni plus ni moins que la crédibilité de la politique de la France en ex-Yougoslavie, aurait suscité une véritable action politique ou militaire si elle avait été suivie en temps réel. Encore eût-il fallu, il est vrai, interpréter correctement les faits et, à travers eux, les objectifs des uns et des autres. Ce sentiment d'un retard permanent des acteurs sur les faits, la Mission d'information l'a éprouvé tout au long de ses travaux. A Srebrenica même, non seulement le contingent néerlandais n'a jamais su anticiper les actions des Serbes, mais plus encore, faute de comprendre ce qui se passait, il était à la traîne des événements. Ce décalage entre les faits et leur perception s'est répercuté à tous les stades de la chaîne de commandement, en s'amplifiant toujours davantage au fur et à mesure qu'on s'éloignait du théâtre de la crise. Nul besoin de souligner dès lors la médiocrité de l'information reçue à Paris. Le chef d'état-major des Armées de l'époque, l'amiral Lanxade, l'a admis : « Nous n'avons découvert que très tardivement ce qui se passait effectivement à Srebrenica ». Comme l'a expliqué M. Jean-Claude Mallet, c'est seulement le lundi 10 juillet au matin que les autorités françaises prennent conscience de la gravité de la situation : « Jusqu'au lundi 10 juillet au matin, dans les discussions auxquelles je participe, il n'y a quasiment aucune prise de conscience de la gravité de la situation et de l'action en cours. La situation de Srebrenica n'est pas évoquée lors des réunions des vendredi 7 juillet (visioconférence franco-britannique) et samedi 8 juillet (réunion interne avec le cabinet militaire du Ministre de la Défense comme chaque samedi matin). Sur le terrain, l'offensive lancée le 6 juillet a marqué une pause le 7 juillet, puis se développe de nouveau dans l'après-midi du samedi 8 juillet. Pour ma part, il n'y a pas trace dans mes souvenirs d'une information, remontant jusqu'aux chef de cabinet militaire, sous-chef d'opérations, chef d'état-major ou encore leurs équivalents au ministère des Affaires étrangères, directeur des affaires politiques, etc., qui aurait concerné les demandes d'appui aérien des 6 et 8 juillet, enregistrés dans le rapport des Nations unies, encore moins le 9 juillet qui est un dimanche, à supposer qu'il y ait eu, ce jour-là, une demande d'appui aérien, ce qui est controversé ». Et l'ancien délégué aux affaires stratégiques de souligner que c'est le samedi après-midi et le dimanche 9 juillet que se dérouleront les événements les plus graves. Même si la continuité de l'Etat est assurée, la conjonction entre le congé de fin de semaine et l'absence d'alerte sur ce qui se passait à Srebrenica n'a pu qu'amplifier le phénomène de décalage. Ses conséquences sont d'autant plus lourdes que la crise s'accélère. Comme l'a souligné très justement M. Jean-Claude Mallet, « certains décalages sont dus au fait que les informations rassemblées par les services de renseignement datent de la veille, d'où un décalage de 24 heures. Ainsi nous trouvons des informations sur les mouvements serbes du 6 juillet dans les indications qui nous sont fournies le 7. A ces stade de la crise, ce décalage dans la diffusion des informations peut encore être considéré comme acceptable, car nous ne sommes pas au point le plus chaud. En revanche, au moment de l'accélération de la crise, ce type de décalage aura des répercussions de plus en plus graves et préoccupantes ». La comparaison entre le déroulement précis des événements et les données dont disposait le ministère de la Défense à l'époque est révélatrice et, à dire vrai, consternante. Un seul exemple suffit à illustrer ces propos. Le 11 juillet 1995, alors que Srebrenica est sur le point de tomber ou l'est déjà, la Délégation aux affaires stratégiques fait le point sur la situation dans une note sobrement intitulée « Srebrenica ». On peut y lire que : « Les Serbes sont arrêtés à un kilomètre au Sud de la ville et poursuivent leur pression contre l'enclave. Les bombardements intenses auraient fait 10 morts et 50 blessés parmi la population civile, information de source bosniaque mais partiellement recoupée par les déclarations des responsables de MSF présents sur place. Le bataillon néerlandais maintient son dispositif de défense et a toujours instruction d'empêcher la poursuite de l'avancée serbe. (...) L'ultimatum demandant le retrait de la poche, sans arme, des Casques bleus et des Musulmans qui le souhaiteraient, semble émaner d'un responsable serbe local. » Et l'auteur de poursuivre, « Compte tenu du rapport de force sur l'ensemble de la zone (environ 4 000 Musulmans armés avec quelques mortiers contre 5 000 Serbes avec 45 pièces d'artillerie et 15 chars) cet ultimatum n'est guère convaincant. Il est peu vraisemblable en effet qu'ils souhaitent dans ces conditions provoquer le mouvement de la population musulmane de la poche, évaluée à 40 000 personnes ». A posteriori, ce constat pourrait faire sourire, n'eût été l'issue tragique de la crise. L'intention de la Mission d'information n'est nullement de mettre en cause les capacités de ceux qui, à Paris, tentent d'appréhender une situation dont bien des éléments leur échappent. Reste que, du fait de ce tragique décalage, les options présentées à l'autorité politique sont dépassées avant même d'avoir été étudiées et ratifiées par les responsables. L'option privilégiée, en l'occurrence « soutenir les directives et le dispositif arrêté par le général Janvier à Srebrenica, appuyé sur l'avertissement ONU du 9 juillet : ne pas laisser les Serbes progresser plus avant ; et recourir à l'appui aérien rapproché si les Casques bleus sont délibérément attaqués » est sans aucun doute la meilleure à ce stade de la crise. Mais il est déjà trop tard. 3) La France et l'arme aérienne : des rumeurs aux réalités « Voilà, Monsieur le Président, un exposé détaillé quant à cet appui militaire. Cela pourrait susciter l'impression que si l'ordre d'un appui militaire aérien était venu plus tôt, l'enclave ne serait pas tombée. Mais c'est une hypothèse qui ne peut être prouvée. L'histoire ne fait jamais savoir quelles sont les alternatives. Nous ne savons pas non plus comment Mladic aurait réagi à une attaque aérienne. Nous savons qu'il avait plutôt tendance à attaquer la population avec des tirs de mortier. Je n'en dirai pas plus. Ce n'est qu'une hypothèse, importance certes, mais il n'est pas prouvé que la faiblesse de cet appui aérien aurait été déterminante. Ce n'est qu'un aspect de la situation dans ce drame épouvantable et ses conséquences atroces ». Ces paroles de M. Joris Voorhoeve devant la Mission d'information résument parfaitement les termes du débat engagé sur l'arme aérienne à Srebrenica depuis plus de six ans aujourd'hui. Bien qu'il s'agisse seulement de l'une des questions soulevées par le drame, et non de la seule comme l'illustrent suffisamment les pages qui précèdent, les commentaires se sont cristallisés autour de cette question, nonobstant le fait que rien ne permet de dire si le recours à l'appui aérien rapproché aurait eu un impact militaire. La Mission d'information a néanmoins la conviction qu'au-delà d'un effet militaire incertain, le recours à l'arme aérienne aurait certainement eu un effet psychologique, voire politique, non négligeable sur les Serbes, même si, pour reprendre « l'équation perverse » dénoncée par le général de La Presle, il faut être conscient que jamais PK + AS n'égalera PE, à savoir que le soutien aérien (AS pour Air Support) ne transformera jamais une mission de maintien de la paix (Peace Keeping) en une mission d'imposition de la paix (Peace Enforcement). Jamais l'arme aérienne n'a donné à ses utilisateurs en ex-Yougoslavie de capacités d'imposition de la paix, mission qui était incompatible aussi bien avec les résolutions du Conseil de sécurité qu'avec le dispositif sur le terrain ou la volonté politique d'emploi des contingents de la FORPRONU. La probabilité est néanmoins forte que le recours à l'arme aérienne aurait pu faire reculer au moins temporairement les forces serbes et permettre aux Bosniaques de s'organiser ou d'être appuyés par les forces du général Delic à l'extérieur de la zone de sécurité. Ce constat est d'autant plus solide que l'on sait aujourd'hui que c'est seulement le 9 juillet, au vu de l'absence totale de résistance de la FORPRONU, que l'armée serbe de Bosnie a décidé de prendre la totalité de l'enclave. Dans cette perspective, tous les regards se tournent vers ceux qui avaient le pouvoir de déclencher l'appui aérien. Théoriquement, en vertu du principe de double clé, la décision était conjointe à l'ONU (Représentant spécial du Secrétaire général et commandant des forces de paix des Nations unies) et à l'OTAN (commandant de la zone Sud). En réalité, dans le contexte de juillet 1995, c'est-à-dire après les frappes offensives sur Pale et la crise des otages, l'OTAN se contente d'accéder aux éventuelles demandes de l'ONU, la double clé étant en définitive interne à l'ONU. Dans le cas prévu de Srebrenica, M. Yasushi Akashi ayant de facto renoncé à l'exercice de ses responsabilités, un seul homme avait le pouvoir de décider l'appui aérien rapproché défensif, le général Bernard Janvier, commandant des FPNU. Il l'a fait, le 11 juillet 1995, à midi, c'est-à-dire trop tard pour empêcher la chute de la ville de Srebrenica. Si le général Janvier est aujourd'hui mis en cause, c'est en réalité pour deux raisons précises : - tout d'abord, pourquoi ne décide-t-il pas dès le 10 juillet, en fin de journée, de faire procéder à l'appui aérien défensif ? A ce moment, tous les stades de la procédure enclenchée après qu'il a reçu la demande formulée par le commandant du Dutchbat le 9 juillet ont été respectés. Le recours à l'arme aérienne est justifié. Pourquoi cette hésitation jusqu'à la décision, prise à 21 heures 30, de contacter l'amiral Leighton Smith pour lui demander de mettre les avions en l'air à 6 heures du matin le 11 juillet, alors qu'à ce moment, effectivement, la nuit empêche le recours immédiat à l'arme aérienne ? - en second lieu, pourquoi l'appui aérien n'est-il pas déclenché le lendemain matin ? D'un côté, les Néerlandais admettent que le colonel Karremans a commis une erreur en n'envoyant pas, comme l'exigent pourtant les procédures, une liste à jour des cibles, dans la mesure où il croyait - pourquoi ? - à des frappes offensives ? De l'autre côté, le général Janvier explique que, si l'on ne tire pas le 11 au matin, c'est parce que les Serbes semblent hésiter sur le terrain et que les contrôleurs avancés ne sont pas en place, ce qu'a formellement nié le Ministre de la Défense néerlandais. Ce qu'il faut bien appeler un « cafouillage » complet se serait-il produit si, la veille au soir, le général Janvier avait clairement demandé à l'amiral Leighton Smith de frapper les cibles qui avaient elles-mêmes attaqué des positions de la FORPRONU ? On en revient là à la première question. a) La thèse du marchandage : une hypothèse peu crédible Très rapidement, la réponse apportée à ces questions par certains, Bosniaques, Britanniques ou Américains, s'est résumée à un seul mot : marchandage. Ainsi, dès le mois de juin 1995, notamment suite à des fuites émanant des collaborateurs les plus proches du général Janvier, se répand la rumeur que, lors de sa rencontre du 4 juin, à Zvornik, avec le général Mladic, le général Janvier aurait accepté de ne pas recourir à l'arme aérienne contre l'armée des Serbes de Bosnie en échange de la libération des otages détenus par les Serbes suite aux frappes des 25 et 26 mai. Du côté français, on estime que le recours à l'arme aérienne, pour la première fois depuis la crise des otages, est susceptible de déstabiliser les spéculations relayées par certains journaux américains sur les supposés « accords secrets » passés avec le général Mladic, à propos des raids de l'OTAN. Selon cette thèse, l'accord conclu entre les deux hommes à l'issue de la réunion, qui avait été voulue par le général français, serait le suivant : « 1. L'armée de Republika Srpska n'utilisera plus la force ni ne menacera la vie ou la sécurité des membres de la FORPRONU ; « 2. La FORPRONU s'engage à ne plus faire usage de la force qui conduit à l'utilisation de frappes aériennes contre des cibles et le territoire de la Republika Srpska ; « 3. La signature du présent accord conduira à la libération immédiate de tous les prisonniers de guerre ». Ce texte reprend en réalité le compte rendu de l'entretien entre les deux généraux établi par le général Janvier et envoyé à New York le 15 juin 1995. Or, ce compte rendu, sur lequel notamment s'appuient les accusateurs du général Janvier, ne dit en rien qu'un quelconque accord ait été conclu. Ce document montre qu'effectivement Mladic a proposé un texte d'accord « qu'il aurait voulu voir ratifié immédiatement ». A aucun moment de l'entretien cependant, le général Janvier n'accepte cet accord, selon ce compte rendu. Ce document ne saurait donc être considéré comme preuve d'un quelconque accord, sauf par des personnes de mauvaise foi. Faute de preuve écrite, c'est donc vers le récit des témoins qu'il faut se tourner, à commencer par celui qui est mis en accusation. Le général Janvier a toujours vigoureusement nié avoir passé un quelconque accord avec Mladic et il l'a répété devant la Mission d'information. En raison de la gravité des accusations portées, la Mission d'information croit utile de déroger au principe du huis clos en publiant, avec son accord, le récit de la rencontre du 4 juin tel qu'il lui a été fait par le général Bernard Janvier. « Concernant la libération des otages, je rencontre le général Mladic le 4 juin. C'est une rencontre et non une négociation. Pourquoi cette rencontre ? A ce moment, tout est bloqué : le général Rupert Smith ne peut et ne veut avoir aucun rapport avec Mladic, ce qui est de son niveau et non du mien. C'est lui qui commande en Bosnie et non moi. Mladic ne veut pas avoir de rapport avec Rupert Smith car "il a bombardé Pale". Quant à M. Yasushi Akashi, il n'a plus de résonance chez les uns et chez les autres, - c'est un euphémisme, excusez-moi de parler très librement - sauf avec M. Milosevic. « M. Akashi a connu les épreuves de la crise à la suite d'actions aériennes antérieures car les Serbes se sont rodés à la prise d'otages. Ils avaient bien vu que les points de rassemblement d'armes représentaient une ressource extraordinaire pour faciliter leurs manipulations. Ils avaient déjà pris des otages. Même le général Gobilliard a été pris en otage au mois d'août ou en octobre 1994, à la suite d'une action aérienne. Il se trouvait au quartier général serbe et ils l'ont gardé quelques instants. M. Yasushi Akashi me dit : "Il y en a au moins pour trois mois de cette situation. Il faut faire quelque chose." La seule solution, c'est que je rencontre Mladic et que je fasse le point. C'est normal : c'est dans le mandat des Nations unies pour le maintien de la paix d'avoir des échanges avec les parties. Je fais, à partir de cette rencontre, le point de la situation. Encore une fois, je ne vais pas là-bas pour négocier, mais pour le rencontrer et lui dire un certain nombre de choses et recevoir ce qu'il va me dire. « Les otages, j'en parle et je dis à Mladic qu'il s'est mis dans une situation difficile, que, si les Serbes veulent revenir dans le concert de l'action internationale - n'oublions pas que nous développons par ailleurs avec M. Carl Bildt les premières étapes d'une recherche de tentative de paix -, il faut absolument qu'il mette un terme à cet acte scandaleux et qu'il rende les matériels. Lui me rétorque : "Rendez-moi mes 4 Serbes que vous avez fait prisonniers". « Pour être exhaustif, je suis également mandaté par les Américains pour lui poser la question concernant le pilote abattu le 2 juin. Les Serbes me disent qu'ils le tiennent prisonnier. Je demande à repartir avec lui, à le voir. Mladic me répond : "Ne vous occupez plus de cela, je traiterai avec le général Clark. Transmettez au général Clark que je veux traiter avec lui". Avait-il le pilote ? Je n'en sais rien. Voilà la seule "négociation" que j'ai eue avec Mladic. « Les rencontres avec Mladic étaient des rencontres officielles. Si c'est confidentiel, c'est uniquement pour des raisons de sécurité. M. Akashi le sait et les comptes rendus iront à New York. Je dis "les" rencontres car il y a eu le 4 juin, le 17 juin et le 29 juin. « Lorsque je reviens à Zagreb, je fais un compte rendu oral à M. Akashi, aux Nations unies et j'en informe Rupert Smith à qui j'adresserai le compte rendu que j'envoie aux Nations unies. « Dans la discussion avec Mladic, il est établi qu'un convoi pourra s'organiser pour aller vers les enclaves. Ce convoi, en réalité, n'arrive pas à démarrer car les Serbes y mettent des obstacles. Donc, on sollicite à nouveau les Serbes pour leur dire que, maintenant, cela suffit. La réponse des Serbes arrive sur mon fax. Je vous expliquerai après, si vous le voulez, comment on avait la liaison avec Mladic. Ce fax est reçu par un membre de mon cabinet, qui est britannique. Dans ce fax, l'état-major de Mladic dit : "Suite à l'accord du 4 juin, le convoi devra se présenter tel jour à telle heure." A ce moment-là, ce papier est envoyé au chef du Centre d'information civile onusien de Sarajevo et c'est ce jour-là, donc vers le 18 juin, que, publiquement on annonce des "tractations secrètes" entre le général Janvier et Mladic. Ensuite, c'est à New York, à partir des Nations unies, que le document incluant la proposition de Mladic ressort. (...) « Cette proposition de Mladic ne constitue, je le répète avec beaucoup de conviction, qu'un élément d'ambiance que je transmets à New York, rien de plus. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'en parle pas quand je viens à Paris. Pour moi, cela n'a aucune valeur et ne représente rien. (...) le document de Mladic n'a valeur que d'élément d'ambiance, donc je n'y attache pas d'importance. Je n'ai pas envoyé le papier sur demande des Nations unies. Je l'ai envoyé quand il était prêt ». Toutes les personnes auditionnées par la Mission d'information et occupant, à l'époque, des postes de responsabilité, ont également réfuté cette rumeur qui a d'ailleurs progressivement mis en cause les autorités françaises elles-mêmes, certaines personnes n'hésitant pas à avancer que c'est sur instruction de Paris que le général Janvier aurait conclu un tel accord : - pour les personnes de l'entourage du Président de la République, « le Président de la République n'a en rien donné un accord pour qu'il n'y ait pas de bombardement. C'est attenter à l'honneur du Président de la République que de dire le contraire ». L'argument avancé par M. Jean-David Levitte est en revanche assez peu convaincant puisqu'il cite comme étant la meilleure preuve le fait « qu'il y ait eu des avions de l'OTAN au-dessus de la Bosnie et des bombes de l'OTAN ont été déversées par des avions de l'OTAN sur Srebrenica ». Comme nous l'avons vu précédemment en effet, le problème n'est pas tant qu'il n'y ait pas eu d'appui aérien, mais qu'il n'y en ait pas eu à temps pour influer sur le cours des événements ; - quant au Premier ministre de l'époque, M. Alain Juppé, il a qualifié cette thèse de « pure affabulation », s'appuyant sur deux arguments. En premier lieu, il n'y a aucun otage français au moment de Srebrenica puisque la crise de mai s'achève par la libération des derniers otages le 18 juin. On peut ajouter qu'un certain nombre d'entre eux a été libéré le 3 juin, c'est-à-dire avant même la rencontre de Zvornik. En deuxième lieu, une telle démarche était en totale incohérence avec la politique française visant à renverser le rapport de force qui s'était créé en Bosnie. M. Alain Juppé a ajouté, sans donner de détails, que la France, par l'intermédiaire du général de La Presle, avait effectivement négocié la libération des otages, comme l'aurait fait tout Gouvernement normalement constitué, mais qu'à aucun moment, la négociation n'avait porté sur un tel marchandage ; - M. Hervé de Charette, alors Ministre des Affaires étrangères, a confirmé l'analyse de M. Juppé ; - quant à M. Charles Millon, alors Ministre de la Défense, il a également récusé cette thèse. Certes, les Serbes étaient obsédés par l'idée de faire cesser les frappes aériennes et, dans cette perspective, il n'est pas étonnant que le général Mladic ait proposé un tel accord. L'ancien Ministre de la Défense a dit sa conviction que le général Janvier n'avait pas pu accepter cette proposition. Il s'est par ailleurs porté garant de ce « qu'il n'a jamais été question pour le Président de la République, le Premier ministre, les Ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le chef d'état-major général des Armées, d'autoriser directement ou indirectement ou de couvrir directement ou indirectement un général français qui aurait pris cette décision, même s'il relevait de la chaîne de commandement de l'ONU. C'est la parole d'un Ministre. Le général Janvier était sous mes ordres. J'avais des contacts périodiques avec lui. Il n'a jamais reçu, de ma part, l'autorisation de négocier ce type de transaction. Jamais le Président de la République ou le Premier ministre n'auraient accepté ce type de transaction ». L'ancien chef d'état-major des Armées, ainsi que l'ex-chef adjoint opérations, le général Germanos ont également réfuté ces accusations. Hormis ces témoignages unanimes, aucun document probant n'a été communiqué à la Mission d'information, dans un sens ou dans l'autre. La conviction de la majorité des membres de la Mission d'information est néanmoins qu'il n'y a pas eu d'accord secret entre les généraux Janvier et Mladic, a fortiori entre les autorités françaises et serbes. La Mission d'information aurait cependant aimé que le général de La Presle, lors de son audition, en dise plus sur le contenu des entretiens qu'il a eus entre le début juin et le 18 avec Mladic, Karadzic et Koljevic. En effet, comme l'a justement souligné M. Alain Juppé, alors Premier ministre, « il est évident qu'on a négocié la libération des otages. Je ne connais pas de Gouvernement, normalement constitué, dont des ressortissants sont pris en otages, qui ne négocie pas. » Cette conviction repose d'abord sur les faits. 110 otages ont été libérés le 3 juin, soit la veille de la rencontre de Zvornik, alors que le général Janvier se trouve à Paris pour la conférence de mise sur pied de la FRR. Elle s'appuie également sur l'analyse de la personnalité même du général Janvier : même si, comme de très nombreux militaires, pas seulement français, il avait tendance à accorder un certain crédit aux représentants de l'armée régulière qu'était l'armée serbe de Bosnie, le général Janvier, homme si scrupuleux à respecter les procédures, et nommé pour cette raison, n'aurait jamais pris une telle initiative. Dans ce cas, est-il concevable qu'il en ait reçu l'ordre de Paris ? Là encore, cela ne cadre pas avec le durcissement concomitant de l'attitude de la France en Bosnie. Qui plus est, le général Janvier s'est défendu d'avoir jamais reçu de directives françaises pour l'exécution de ses responsabilités opérationnelles, précisant à cet égard que les autorités françaises n'étaient intervenues à aucun moment de la crise de Srebrenica, ce que les documents communiqués à la Mission d'information confirment. La question se pose dès lors de savoir qui a propagé cette thèse et dans quel intérêt. Comme on l'a vu précédemment, si les premières rumeurs émanent, semble-t-il, de certains responsables bosniaques, elles sont propagées essentiellement par la presse internationale, anglo-saxonne notamment. La Mission d'information a d'ailleurs pu constater qu'en Bosnie, les survivants de Srebrenica sont extrêmement virulents à l'égard du général Janvier et que certains politiciens bosniaques s'attachent à entretenir cette focalisation sur l'arme aérienne et le général Janvier. Quel était l'intérêt de ces responsables ? S'agissait-il de faire pression a priori sur la FORPRONU pour la contraindre à agir en cas d'attaque ? Tout au long du conflit d'ailleurs, les responsables de la FORPRONU ont résisté aux tentatives bosniaques de les impliquer dans le conflit, ce qui n'était pas dans leur mandat. Cristalliser le débat autour d'un thème, l'arme aérienne, et d'un homme, le général Janvier, peut aussi être un excellent moyen de détourner le regard de l'opinion publique loin d'autres questions restées sans réponse ; pourquoi les combattants bosniaques de l'enclave qui, avouons-le, n'avaient aucune confiance dans l'ardeur guerrière du Dutchbat, ont-ils totalement remis leur sort entre les mains de la FORPRONU et ont-ils commencé à quitter l'enclave avant même sa chute ? Pourquoi avait-on rappelé Naser Oric ? Pourquoi n'a-t-on mobilisé aucune unité de la 28ème division bosniaque pour secourir Srebrenica ? Certains moyens de renseignement alliés ont-ils observé les événements postérieurs au 11 juillet ? Reste que réfuter la thèse d'un marchandage « frappes contre otages » ne répond pas à la question de savoir pourquoi le général Janvier n'a pas, comme il aurait dû le faire, déclenché le recours à l'appui aérien défensif dès le 10 juillet. Le scénario des événements tel qu'il est rapporté par le rapport de M. Kofi Annan ou par les témoins auditionnés n'apporte pas de réponse satisfaisante à cette question qui, pour n'être pas exclusive, n'en reste pas moins importante. b) Une doctrine française sur le recours à l'arme aérienne ? A défaut de trouver la réponse dans la thèse du complot, il peut être intéressant de se tourner vers des causes « culturelles » : existe-t-il en France, plus particulièrement dans l'armée française, une culture particulière en ce qui concerne le recours à l'arme aérienne ? En bref, le général Janvier a-t-il été l'homme d'une culture, l'homme d'une politique, sans avoir reçu pour autant d'instructions formelles en ce sens ? « Les Américains sont toujours à 12 000 m et nous, on est dans les vallées ». Ce constat quelque peu ironique du Président François Mitterrand, rapporté par M. François Léotard lors de son audition par la Mission d'information, résume bien les termes du débat qui a constamment opposé, à travers l'ONU et l'OTAN, Européens (à tout le moins Britanniques et Français) et Américains pendant le conflit yougoslave. Deux conceptions de l'intervention en Bosnie-Herzégovine se sont affrontées durant toute cette période. D'un côté, les Etats-Unis, comme souvent lorsque les zones en crise ne concernent pas leurs intérêts vitaux, privilégiaient une intervention à la fois indirecte - levée de l'embargo sur les armes pour les Bosniaques - et directe - frappes massives sur les Serbes de Bosnie. De l'autre côté, les Européens avaient choisi d'intervenir directement sur le terrain, mais sans volonté d'identifier explicitement l'agresseur et l'agressé et d'agir en conséquence. Cette divergence s'est accrue avec les difficultés toujours plus nombreuses rencontrées par l'ONU sur le terrain : tandis que les Etats-Unis y voyaient la preuve que la stratégie européenne était sans issue, les pays européens engagés sur le terrain, eux, craignaient de plus en plus un recours intempestif à l'arme aérienne qui eût encore accru leurs difficultés au fur et à mesure que les Casques bleus devenaient eux-mêmes des cibles. « Les militaires américains de l'OTAN, frustrés par l'impuissance de l'organisation, sont chaque fois tentés de jouer avec le feu sans considération pour les unités déployées sur le terrain », lit-on dans une note blanche du ministère de la Défense du 4 juillet 1995. Ce clivage dépassait les solidarités traditionnelles : même le général Michael Rose, qui avait commandé la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine, s'est employé à convaincre son Gouvernement d'utiliser avec parcimonie l'arme aérienne, pensant que ce dernier commençait, « sous la pression des Etats-Unis et de l'OTAN, à vaciller sérieusement sur la question des frappes aériennes »42. Par ailleurs, il est clair que, dans l'esprit des responsables français, le recours accru à l'arme aérienne, donc à l'OTAN, était porteur de risque pour la pérennité du leadership qu'ils partageaient avec les Britanniques dans la gestion du conflit bosniaque. Alors que Srebrenica vient de tomber, le délégué aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, examinant les options possibles, et notamment le retrait des troupes de l'ONU conformément au plan OTAN 40104, écrit que : « Cette option est par nature détestable. On en connaît toutes les conséquences politiques et humaines désastreuses pour l'Europe. Elle implique un changement de cadre institutionnel radical, puisque c'est l'OTAN et la structure de commandement américaine qui seraient amenées à la mettre en oeuvre : notre capacité de contrôle en sera limitée, notre seul atout (qu'il faudra jouer) étant alors le poids de notre contribution en effectifs (qu'il faudra augmenter). Le plan 40104 implique le déploiement d'environ 60 000 hommes (dont 40 000 combattants), dont au moins trois brigades blindées. La participation américaine est évaluée à 25 000 hommes. L'Administration américaine ne pourra refuser d'y participer (sauf à détruire l'Alliance, risque qu'elle ne prendra pas), mais elle fera payer un prix maximum en termes de contrôle de l'opération par l'OTAN, donc par Washington »43. Il serait faux d'en déduire pour autant qu'existait en Europe, à Paris notamment, une doctrine rigide en la matière. La preuve en est que l'arme aérienne a bel et bien été utilisée par l'ONU, que ce soit l'appui aérien défensif ou les frappes massives offensives. Le général de La Presle l'a rappelé lors de son audition : « J'ai utilisé l'arme aérienne à quatre ou cinq reprises en 1994. Je l'ai utilisée soit en soutien rapproché des forces de la FORPRONU menacées, soit en frappes ciblées soigneusement choisies pour démontrer notre détermination à faire cesser telle ou telle violation. J'insiste sur cet aspect car cela souligne que l'effet que je recherchais de cet appui aérien de l'OTAN n'était pas un effet militaire mais plus un effet psychologique pour ne pas dire politique. Je l'ai utilisée également pour obtenir le retrait d'armes lourdes par les Bosno-Serbes des dépôts de la zone d'exclusion de Sarajevo en septembre 1994 de façon fructueuse puisque les Serbes ont ramené des armes lourdes qu'ils avaient récupérées sur ces dépôts. J'ai également utilisé cette arme aérienne sur l'aérodrome d'Udbina qui était utilisé par des avions serbes venant bombarder la zone de sécurité de Bihac en novembre 1994, violant ainsi l'interdiction Deny Flight ». Le même général a reconnu toutefois que le recours à l'arme aérienne devint de plus en plus complexe avec le temps. « L'utilisation de l'appui aérien de l'OTAN s'est tragiquement compliqué quand les Bosno-Serbes ont commencé à l'automne 1999 à déployer de puissants radars et de très performants missiles sol-air. Chaque raid de l'OTAN devait alors commencer par une séquence de suppression des défenses antiaériennes serbes, action de guerre évidemment peu compatible avec notre mission humanitaire au sol, d'autant plus qu'elle se conduisait par vagues de plusieurs dizaines d'avions, dont les avions venant remplir la mission demandée n'étaient que dans les dernières vagues, et était précédée de destruction de radars ou de sites d'éclairage des avions qui n'étaient pas du tout disposés à proximité des objectifs à atteindre, ce qui là encore risquait de brouiller le message ». A Paris, c'est la crise de Gorazde qui marque un tournant décisif dans la conception que l'on se fait de l'arme aérienne : à partir de cette date se forge une sorte de doctrine du cas par cas, qui n'est autre que l'adoption d'une stature de circonspection à l'égard de l'arme aérienne. Dans une note du 25 mai 1994 qui se veut un « essai d'analyse à la crise de Gorazde au plan politique et militaire », la Délégation aux affaires stratégiques note que « pour ce qui concerne les forces de l'OTAN, la faiblesse des actions de rétorsion par voie aérienne a grandement amoindri, du moins pour un certain temps, l'effet dissuasif de l'arme aérienne. Il est certain que si l'on désirait conserver à cette arme un effet dissuasif, il ne fallait l'employer que dans un cas quasi "d'école" et donc procéder, avant tout emploi, à une analyse détaillée de la situation. Le général Rose, subissant une pression considérable de la part des dirigeants bosniaques, a réclamé et obtenu les 10 et 11 avril l'emploi des forces aériennes en appui des éléments de la FORPRONU, alors que les conditions de réussite de l'appui n'étaient absolument pas réunies. A partir de ce moment-là, l'OTAN s'est montrée extrêmement prudente, s'entourant de toutes les précautions avant de donner un feu vert aux demandes de la FORPRONU ». Nul besoin de souligner, dans cette perspective, l'effet produit par les frappes des 25 et 26 mai sur Pale, dont le général Rupert Smith lui-même, qui les avait autorisées, reconnut que « l'objectif n'a pas été atteint ». Cet épisode, et la crise qui s'en suivit, est encore dans tous les esprits au moment où éclate la crise de Srebrenica, et notamment dans celui du général Janvier. Comme le montre sa directive du 2 juillet, son obsession est de préserver des marges de négociation avec les Serbes ; d'ou son souci de considérer chaque crise particulière sous l'angle des conséquences globales qu'elle peut avoir. Michael Rose ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit en 1998 dans son ouvrage Fighting For Peace : « Pour déterminer les objectifs à poursuivre et le niveau de force à employer, je ne pourrais pas, en tant que commandant, ignorer les aspects humanitaires primordiaux de la mission, ni oublier que 2,7 millions de personnes dépendaient toujours de l'aide de l'ONU pour leur survie. Chaque fois que j'ai demandé des frappes aériennes de l'OTAN, la circulation à travers le territoire tenu par les Serbes a été arrêtée et des personnes sont mortes »44. Il est plus que probable que là réside en partie la source des multiples tergiversations du général Janvier lors de la réunion du 10 juillet. Dans le cas de Srebrenica, s'ajoute le fait que c'est un théâtre périphérique, plus encore pour un Français dont l'obsession est Sarajevo. Là réside d'ailleurs tout le drame de la crise de Srebrenica : ville pauvre, excentrée, dont le statut de zone de sécurité était considéré comme un handicap pour la recherche d'une solution par beaucoup, elle fut en même temps, et paradoxalement le symbole de l'échec et de la décrédibilisation totale de l'ONU, beaucoup plus que Sarajevo représente le symbole de la capacité de l'ONU à préserver le multiethnisme dans les Balkans. Cet enjeu échappa à tous les observateurs avant le 11 juillet au soir. C'est d'ailleurs en réaction à cette paralysie de l'arme aérienne que la France proposa la création de la Force de réaction rapide, dont le principe sous-jacent était la nécessité pour la FORPRONU de disposer d'une gradation dans ses moyens de riposte. La logique opérationnelle qui présida à la création de la FRR était donc sans doute bonne. Mais, au moment de Srebrenica, il ne semble pas que la FRR ait pu être efficace, son déploiement étant bloqué à la fois par les Bosniaques, qui y voyaient un frein à leur stratégie de recours accru aux frappes et de levée de l'embargo, et par les Croates. De toute façon, même si elle avait été opérationnelle, y aurait-on eu recours ? Rien n'est moins certain dans le mesure où, dans l'esprit de ses concepteurs, français, elle devait avant tout viser au désenclavement de Sarajevo. Pour sa part, le général Janvier, bien que conscient de la dévaluation de l'arme aérienne sur le théâtre bosniaque, n'en accueillit pas pour autant la création de la FRR avec soulagement, tout au contraire. Il semble qu'il y vit plutôt une initiative perçue comme excessivement offensive par les Serbes, susceptible par conséquent de gêner la FORPRONU dans l'accomplissement de la mission et de l'entraîner dans un conflit ouvert avec les Serbes. Cette réaction incite à se demander si le général Janvier, qui fut sans nul doute en phase avec la conception européenne et onusienne de l'arme aérienne, n'est pas, en juillet 1995, l'homme d'une politique révolue à Paris depuis le mois de mai, en bref si Srebrenica n'est pas aussi le fruit tragique de l'erreur d'un homme. Le 2 juillet 1995, le jour même où le général Janvier rappelle, dans une directive adressée au commandant de la FORPRONU, la nécessité de privilégier autant que faire se peut la négociation contre l'usage de la force, le général commandant le contingent français adresse un courrier au général Germanos. Il y décrit la situation telle qu'elle résulte des frappes des 25 et 26 mai et y évalue « les chances de succès des actions militaires envisagées et les conditions nécessaires à leur succès ». Pour le général Schwerdorfer, « la frappe du 25 mai a fait basculer la situation en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a rien à regretter (...). Les forces de l'ONU à Sarajevo et dans les enclaves sont sous la menace directe d'une faction, qu'il n'est plus possible désormais de désigner autrement que par le terme "ENNEMI" ; (...) la communauté internationale (notamment la France et la Grande-Bretagne) est contrainte à l'action, car soumise au chantage qu'exercent les Bosno-Serbes grâce aux "prisonniers de guerre" qu'ils détiennent ». Si la Mission d'information cite ce courrier, c'est qu'il est représentatif du tournant de l'état d'esprit des militaires et des autorités civiles français au printemps 1995. Une note de juin 1995 évoque également « l'épreuve de force » engagée avec les Serbes. A l'évidence, le général Janvier est en décalage avec cette vision des choses. S'exprimant devant le Conseil de l'Atlantique Nord le 19 juillet - nous sommes après la crise de Srebrenica -, le général Janvier a exactement le même discours que le 24 mai devant le Conseil de sécurité. D'après le compte rendu de la représentation française auprès de l'OTAN, « le général Janvier s'est exprimé dans le même sens que M. Yasushi Akashi, en insistant sur les limites rencontrées par la FORPRONU, mais aussi par l'OTAN. A la situation difficile de la FORPRONU dans un environnement devenu hostile, il s'ajoutait une sorte de "neutralisation" des armes de dissuasion aériennes dont pouvait disposer la FORPRONU avec le soutien et les frappes de l'OTAN. Ceci résultait de l'imbrication des forces mais aussi de l'utilisation d'otages et de "boucliers humains" depuis l'épisode de Srebrenica. Ceci constituait un argument supplémentaire pour éviter toute dérive du maintien de la paix vers le rétablissement de la paix. La FORPRONU n'en aurait pas les moyens et risquait de se trouver acculée à des actions offensives malgré elle. En outre, elle se trouvait au centre du conflit, ce qui pouvait en faire le bouc émissaire des belligérants : une position plus périphérique serait préférable. « Le général Janvier a insisté sur le caractère non offensif de la Force de réaction rapide, faite précisément pour réagir au service de la FORPRONU. Elle ne devait pas, par exemple, être utilisée pour rouvrir par la force un itinéraire. Elle n'était pas faite pour une action de guerre de haute intensité, mais s'inscrivait dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. « (...) Le général Janvier a, pour sa part, fermement défendu la décision prise à Srebrenica : le soutien aérien était venu à point nommé, ni trop tard ni trop peu, et l'amiral Leighton Smith avait donné son plein soutien à cette décision. Il convenait de ne pas confondre crise et guerre et de rester dans le contexte du maintien de la paix. Ceci impliquait la prise en compte des éléments sur le terrain et la décision des comandants locaux devait être respectée. M. Akashi a souligné qu'il se rangeait toujours à l'avis du général Janvier ». A l'évidence, il existe en juillet 1995 un divorce entre le général Janvier et la position des autorités françaises. Le divorce ne porte pas sur l'usage de l'arme aérienne : la doctrine Janvier en la matière est assez semblable à celle de ses pairs à Paris. Plusieurs généraux entendus par la Mission d'information ont ainsi souligné que, dans l'opération Deliberate Force, contrairement à ce qu'en dit Richard Holbrooke, c'est la composante terrestre, et les canons de 155 notamment, qui avaient joué un rôle décisif. En revanche, le divorce est patent s'agissant de la posture de l'ONU. En juillet 1995, Paris tend à une logique d'imposition de la paix, comme l'atteste la FRR. Jusqu'alors, si divorce il y avait eu, c'était plutôt entre les généraux français et les autorités civiles de l'ONU. Ainsi en fut-il du général Morillon qui, sans conséquence fâcheuse immédiate, laissa de côté le mandat à Srebrenica, ce qui fut peu apprécié à New York, et à Paris aussi d'ailleurs. Comme l'expliqua M. Alain Juppé lors de son audition par la Mission d'information, « la réaction aussi bien des Nations unies que de la France a été de saluer le courage et le panache du général Morillon, mais aussi de penser qu'il envisageait la mission de la FORPRONU dans des termes qui n'étaient pas exactement ceux qui avaient été décidés par le Conseil de sécurité. C'est toujours le même problème : étions-nous là pour prendre des initiatives fortes nous permettant de rétablir la paix et de faire cesser les combats ou étions-nous là dans une simple attitude d'interposition, d'observation ? C'est la deuxième thèse qui a constamment prévalu, qui n'était sans doute pas celle du général Morillon ». Avec le général Cot, c'est un conflit ouvert qui se déclencha avec les Nations unies, qui conduisit à son remplacement, à la demande du Secrétaire général de l'ONU, conflit de fond et de forme, le franc-parler et l'énergie du militaire français contrastant singulièrement avec le style feutré et apaisant des responsables de l'ONU. L'amiral Lanxade l'a rappelé, « lorsque le général Cot a pris ses fonctions - je pense qu'il vous le dira mieux que moi -, il a voulu, et il avait raison de le faire, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain, redonner son vrai rôle à la composante militaire de la FORPRONU, c'est-à-dire qu'il a été l'un des acteurs de cette culture du maintien de la paix dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a, dans toutes ces organisations et ces états-majors qui se mettent en place dans les opérations de maintien de la paix, une composante militaire et une composante civile qui sont toutes les deux importantes mais il y avait, de notre point de vue et de celui du général Cot, une dérive qui s'était produite au détriment de la partie militaire. Le général Cot a donc voulu remettre les choses en état et avoir un véritable commandement sur les opérations et les contingents qui étaient en place. Il s'est heurté - c'est très clair - à un certain nombre de responsables des Nations unies. Il s'est probablement heurté indirectement à un certain nombre de responsables de pays qui, eux, n'étaient pas décidés à aller dans son sens ». Les propos suivants, de l'amiral Lanxade, sont extrêmement intéressants : « Si vous voulez, c'était le choc de deux cultures et je crois que ce choc était au fond nécessaire. Ensuite, il a été remplacé par le général de La Presle qui a repris les mêmes objectifs, mais dans une situation qui avait été déjà largement clarifiée par le général Cot ». Ils révèlent en effet qu'au-delà de leurs compétences, c'est également en fonction de leur personnalité et de leur capacité à susciter des électrochocs ou au contraire à épouser les vues des autorités civiles de l'ONU, que les officiers généraux français furent proposés à l'ONU par les autorités françaises. Pour prendre le seul cas du général Cot, citons les propos de M. François Léotard à ce sujet : « Quand on dit l'état-major, c'est un ensemble assez divers, assez pluriel où des personnalités s'affirment. Vous avez entendu le général Cot avec son comportement un peu rude de fantassin. Tous les officiers généraux étaient des fantassins. Le général Cot a contesté dans son intervention le rôle des forces aériennes et même, si j'ai bien compris, le rôle de la Marine ». Les critères de sélection des commandants français en ex-Yougoslavie « Pour le choix des généraux français, le système est toujours le même et n'a pas changé depuis longtemps. Des propositions sont faites par l'état-major au Ministre de la Défense qui ne prend pas de décision seul, il la répercute ensuite dans un accord d'ailleurs total vers le Premier ministre et le Président de la République. Une partie de ces officiers généraux a été reçue par le Président de la République ; en tout cas, je les ai tous reçus. Nous prenions, je dois le dire avec beaucoup de force devant la Mission d'information, les meilleurs de leur génération. J'ai examiné moi-même le curriculum vitae de chacun de ces officiers généraux, je les recevais, je discutais avec eux. Pour ce qui concerne les critères de choix des officiers généraux, j'examinais les curriculum vitae, j'écoutais ce que l'on m'en disait. Je questionnais leurs pairs. Le général Janvier était notamment l'homme du succès de l'opération française de la division Daguet dans la guerre du Golfe. Je l'ai vu, je l'ai reçu. C'était un homme qui m'avait fait une impression extrêmement positive. Je n'avais pas nommé le général Morillon. Il a été nommé avant que je n'arrive, mais tout le monde sait que c'était aussi un homme de grande qualité. Le général Cot, vous l'avez entendu, avait son franc-parler. Le général de La Presle était l'un des meilleurs dans l'armée française. Je faisais confiance au chef d'état-major, l'amiral Lanxade, je regardais et je me faisais ma propre opinion. Je consultais les uns et les autres et ensuite je proposais la nomination au Premier ministre et au Président de la République. Les critères précis sont la qualité militaire, la capacité à observer le mandat de l'ONU. Il faut dire que l'on a mis ces officiers généraux dans des situations extraordinairement difficiles et pas simplement les généraux français. Je me souviens de conversations que j'ai eues à Sarajevo avec le général Rose qui est un ancien commandant des SAS britanniques, ce n'est pas un "pacifiste", mais un homme de guerre. Il était exaspéré par les conditions dans lesquelles on l'avait mis ». (Témoignage de M. François Léotard). Sans doute le général Janvier a-t-il commis une erreur en ne prenant pas une décision rapide le 10 juillet au soir car il s'est refusé à admettre l'évidence : les Serbes voulaient l'enclave, ce n'était pas une attaque de plus contre l'enclave, mais bien l'assaut décisif. Il continue pourtant de considérer l'appui demandé comme n'étant pas raisonnable. Effectivement, peut-être n'est-il plus raisonnable de frapper à 21 heures 30, mais ce n'est pas de nuit que le colonel Karremans demande l'appui ; c'est à 18 heures 30, au mois de juillet, donc quand il fait jour. Il a accordé une confiance - peut-être un peu naïve - aux dénégations rassurantes des généraux Tolimir et Mladic, croyant parler à des hommes d'honneur quand il s'adressait à des manipulateurs, voire à des criminels de guerre. Cela dit, nommer, en février 1995, un brillant général dont les supérieurs connaissent parfaitement le souci scrupuleux à respecter le mandat qui lui est confié, le laisser en place après le 26 mai 1995 quand on connaît sans ambiguïté sa conception de l'action de l'ONU, est un acte politique réfléchi, tout comme l'est celui qui a conduit à nommer, puis à rappeler, un général connu pour son indépendance d'esprit et ses positions carrées. Il s'agissait de compétences de l'ONU - notamment du Secrétaire général et du Département des opérations de maintien de la paix. III. SREBRENICA : PLUS JAMAIS - LES LEÇONS D'UN MASSACRE Si l'on se reporte à la presse, aux dépêches d'agence, aux images insoutenables diffusées par les télévisions, la chute de Srebrenica choque les consciences et l'opinion publique dès qu'elle se produit. Les images de familles séparées, le tri en direct opéré par les troupes de Mladic sous les yeux des Casques bleus, au c_ur de l'Europe, hanteront à jamais les consciences et pèseront sur la perception que les Européens auront du rôle des Nations unies dans les opérations de maintien de la paix. Ce drame intervient au moment où les combats s'intensifient dans toute la Bosnie-Herzégovine, particulièrement à Sarajevo, et où l'armée croate, ayant déjà repris une partie de la Slavonie orientale, intensifie sa pression sur la Krajina. L'humiliation des Casques bleus, à laquelle répond la reprise par les soldats français, le 27 mai 1995, du pont de Vrbanja, en dehors de toute concertation avec la chaîne de commandement des Nations unies, souligne l'échec des forces de la paix. La chute de Srebrenica, le 11 juillet 1995, suivie de celle de Zepa le 25 juillet, symbolise non seulement l'incapacité de la FORPRONU à assurer l'intégrité des zones dites de sécurité, mais également l'apathie des Etats et leur absence de volonté de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité en se dotant de moyens adéquats. M. Jean-David Levitte, alors conseiller diplomatique du Président, a décrit en détail la manière dont le Chancelier Helmut Kohl et le Président Jacques Chirac apprennent, lors du conseil franco-allemand de Strasbourg, la chute de l'enclave et la colère de ce dernier. La chute de Srebrenica dans ce contexte agira comme l'un des accélérateurs du changement de logique en ex-Yougoslavie. Dès lors, il ne s'agira plus de maintenir la paix mais de l'imposer. A. UN ACCÉLÉRATEUR DU CHANGEMENT DE LOGIQUE EN EX-YOUGOSLAVIE Les effets de la chute de Srebrenica sont ainsi perçus par M. Alain Juppé, alors Premier ministre : « Dans la foulée de Srebrenica, juillet 1995, les événements se sont accélérés. C'est là que l'offensive croate s'est produite et a commencé à montrer que la force bosno-serbe n'était pas invincible. Les frappes de l'OTAN sont intervenues et la FRR a disposé des canons, notamment sur le mont Igman. Elle a pu signifier aux Serbes que, s'ils poursuivaient l'encerclement de Sarajevo, on les frapperait. Des tirs sont intervenus. « Après Srebrenica, on est passé à l'utilisation de la force, ce qui a débloqué la situation, a permis au processus diplomatique de s'enclencher à nouveau et d'aboutir aux accords de fin 1995. A partir de ce moment-là la politique de fermeté a commencé à prévaloir et a permis de déboucher sur une solution, hélas encore précaire. Nous sommes toujours sur le terrain et sans doute pour longtemps, parce que le processus de réconciliation entre les communautés sera long, peut-être très long. » Le 12 juillet 1995, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 1004 qui condamne l'attaque de Srebrenica, exige le retrait des Serbes et demande au Secrétaire général « d'utiliser tous les moyens disponibles » afin de « restaurer le statut de zone de sécurité de Srebrenica ». La genèse de cette résolution, d'inspiration française a été rappelée en ces termes par M. Jean-David Levitte : « Le 12 juillet, la France a saisi le Conseil de sécurité en urgence. Nous avons obtenu l'adoption de la résolution 1004, sous le chapitre VII, qui exige le retrait et le respect de la zone de sécurité. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité ». « (...) le 13 juillet, M. Jean-Bernard Mérimée avait un long entretien avec M. Kofi Annan pour examiner très concrètement les modalités possibles de la reprise de Srebrenica, mais aussi de la défense de Zepa et surtout de Gorazde. ... Le Président de la République a dit au Président Clinton : "La chute de Srebrenica, celle probable de Zepa, et bientôt peut-être de Gorazde, marqueraient un échec majeur de l'ONU, de l'OTAN et des démocraties. A Srebrenica, les hommes qui risquent d'être égorgés s'ils sont en âge de porter les armes sont séparés des femmes menacées de viol. Les nations civilisées doivent s'opposer au fascisme et mener une action militaire ferme et limitée afin de rétablir la situation dans les enclaves orientales. La France est prête à mettre ses moyens à disposition d'une opération militaire, mais elle refuserait d'être complice d'une politique de démission. La question est de savoir si les Etats-Unis sont prêts à contribuer à une telle opération" ». Et M. Jean-David Levitte de souligner que l'alternative pour la France était la suivante : « Soit nous intervenions ensemble, rapidement, pour une opération limitée à un coup d'arrêt, soit nous choisissions l'option du retrait et de la levée de l'embargo, et les Etats-Unis se trouveraient rapidement placés devant le choix entre une intervention militaire, massive cette fois, au profit du Gouvernement de Sarajevo, ou une acceptation, difficile à admettre sur le plan moral, de l'écrasement des forces bosniaques. » Cette résolution a été, selon David Rohde, largement critiquée par M. Yasushi Akashi, alors Représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie car elle provoquait « des espoirs irréalistes et brouillait les frontières entre maintien de la paix et imposition de la paix ». A la lumière de l'audition de M. Akashi, cette prise de position paraît tout à fait vraisemblable, tant a transparu son incapacité à définir l'agresseur : « Il était difficile de répartir le blâme, même si les Serbes de Bosnie étaient les plus grands coupables ». Le 13 juillet 1995, le Président Jacques Chirac prend l'un des engagements les plus importants de la gestion du conflit par la France en déclarant « indispensable, par une action ferme et limitée de donner un coup d'arrêt à l'abandon des enclaves » et annonce que « la France est prête à engager ses moyens et en particulier les éléments français de la Force de réaction rapide à cet effet » et en appelle « solennellement à la solidarité occidentale pour mettre en oeuvre une opération de ce type sous l'égide des Nations unies ». Le 14 juillet 1995, il réitère son appel à une action internationale afin, entre autres, de reprendre l'enclave de Srebrenica, et il ajoute : « Seuls, nous ne pouvons pas agir, nous n'avons pas mandat pour le faire et nous n'avons pas non plus les moyens de le faire ». A la demande de l'Elysée, un plan visant à la reprise de l'enclave de Srebrenica a été élaboré par le général Quesnot, qui a affirmé à la Mission d'information que « la reprise de Srebrenica était difficile mais techniquement faisable, à condition d'y mettre les moyens et d'en accepter les risques politiques et militaires [perte d'avions et de 25 à 100 vies humaines] » M. Alain Juppé a d'ailleurs expliqué à la Mission d'information pourquoi ce plan n'avait pas été retenu : il était apparu militairement et stratégiquement irréalisable par manque de moyens sur place et absence de volonté de nos partenaires de s'y engager. Ces réactions sont les premières du changement de logique qui aboutira aux accords de Dayton, évolution que la connaissance progressive des massacres imposera. 1) Une connaissance officielle des massacres étrangement tardive aux Nations unies Entre le 14 juillet 1995, date des premiers soupçons, et le 10 août 1995, lorsque, preuves photographiques à l'appui, Mme Madeleine Albright, alors représentante des Etats-Unis auprès du Conseil de sécurité, fait état d'indications tirées de photographies satellites montrant qu'il y a des charniers, près d'un mois s'est écoulé. Cependant, entre-temps, d'après M. Jean-Bernard Mérimée, les Nations unies seraient restées dans l'ignorance de l'ampleur des massacres. Aveuglement collectif bien difficile à comprendre, et M. Jean-Bernard Mérimée d'expliquer : « Votre dernière question est de savoir si, de juillet à août, on n'a vraiment eu aucune information précise sur les massacres. Je peux dire qu'à mon niveau, non. Pour être totalement exact, j'étais parti en vacances quelque temps, à partir du 5 ou 6 août, mais non, il n'y avait aucune information précise. J'essaie de me rappeler mes conversations avec Madeleine Albright. Il y avait quelques soupçons, bien entendu, parce qu'on voyait qu'étaient arrivés les femmes et les enfants, mais pas les hommes en état de porter les armes. Il devait donc se passer quelque chose. Mais ces hommes étaient-ils dans des camps, prisonniers quelque part, ou étaient-ils tués ? En tout cas, je précise de nouveau, pour ce qui me concerne, je ne le savais pas. » Certes, on peut comprendre la prudence des diplomates, la nécessité de recouper des informations fiables, mais on reste assez confondu devant les conséquences graves de l'absence de réel service de renseignement des Nations unies, abondamment décrites par l'ambassadeur Jean-Bernard Mérimée lors de son audition. Pourtant, pour ceux qui voulaient savoir, l'information était disponible, y compris aux Nations unies... La Mission d'information s'interroge : incompétence de tous les représentants permanents des pays membres du Conseil de sécurité ou apathie du système onusien qui répugnait à réagir. a) Des révélations progressives On sait que les premiers massacres massifs ont commencé dans la nuit du 12 au 13 juillet et que, selon le témoignage du commissaire Ruez, « le 17 juillet, tout était terminé ». Le chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de Bosnie-Herzégovine au Conseil de sécurité, M. Ivan Z. Misic, fait part dès le 13 juillet de ses inquiétudes au Secrétaire général des Nations unies en ces termes : « Notre Gouvernement a eu connaissance d'informations provenant de la région de Srebrenica, selon lesquelles les forces serbes auraient commencé à séparer du reste de la population les hommes et les garçons âgés de plus de treize ans. Ces hommes et ces garçons auraient été forcés à creuser des tranchées et abusivement contraints à oeuvrer d'autres façons à la réalisation des objectifs militaires serbes dans les territoires occupés. Notre Gouvernement a également appris que les femmes de quinze à trente-cinq ans avaient été séparées du reste des réfugiés. Selon des informations en provenance de cette région, un certain nombre de camions transportant des détenus de sexe masculin seraient partis pour des destinations inconnues. On ne connaît pas le sort de ces hommes mais, bien que les informations en question n'aient pas encore été confirmées, il y a de fortes raisons de craindre qu'ils n'aient été exécutés. De tels actes constituent de graves violations des Conventions de Genève et des normes du droit international humanitaire, et ils appellent une réaction des plus énergiques ». Or, dès le 14 juillet à 14 heures 31 GMT, l'AFP publie les déclarations de M. Semsudin Hasanbegovic, responsable gouvernemental de la politique sociale et des réfugiés pour la région de Tuzla. Celui-ci affirme que les forces serbes bosniaques « exécutent les hommes qu'ils ont fait prisonniers à Srebrenica ». Selon lui, des hommes ont été pris par des soldats serbes dans les colonnes de réfugiés et « exécutés sur place. Pour échapper au massacre, beaucoup d'entre eux ont quitté l'enclave à pied par des sentiers de montagne vers des zones de Bosnie contrôlée par l'armée gouvernementale bosniaque ». L'existence des massacres commence à être connue dès le 14 juillet, leur ampleur est en revanche sous-estimée à cette date si l'on en croit M. Hans Van Mierlo, alors Ministre hollandais des Affaires étrangères, et M. Joris Voorhoeve, Ministre hollandais de la Défense à l'époque, interrogés par la Mission d'information sur l'ampleur des massacres et l'existence de photos satellites. Ceux-ci ont expliqué : « On avait des informations au goutte à goutte. Chaque jour, on avait une petite information supplémentaire par rapport à celle que l'on avait eue la veille. Petit à petit s'est créée cette image de massacres. « Le 17 juillet, un journal néerlandais a dit que des milliers de personnes étaient perdues ; le 15 juillet, la commissaire Emma Bonino a parlé de 15 000 disparus. Mais il ne s'agissait que de rumeurs. Ce n'est qu'autour du 17 juillet, après coup, que nous aurons la révélation de ce génocide, que nous connaîtrons l'ampleur de ce désastre. Ce n'est que plus tard que nous déterminerons ce génocide avec plus de certitude. « Dans la matinée du 12 juillet, si mes souvenirs sont bons, des photographies de 9 cadavres auraient été prises par des Néerlandais. On m'avait également informé que le général Mladic avait probablement rassemblé quelques centaines d'hommes autour de Potocari afin de les questionner sur des allégations de crimes de guerre. J'étais très angoissé quant au retour de ces hommes. « Le 14 juillet, M. Silajdzic, Premier ministre bosniaque, donne des informations sur Srebrenica. Là, nous parlons de toute la vallée, des alentours où se déroulent des atrocités massives. Le 15 juillet, 55 militaires qui avaient été pris en otage par les Serbes près de l'enclave sont libérés et l'ambassade des Pays-Bas à Belgrade peut leur parler. Un certain nombre de ces militaires ont vu des cadavres au moment du transport à partir du lieu où ils avaient été emprisonnés. » « Le 21 juillet, je participais à la conférence de Londres. Pendant la pause, j'ai discuté avec le général Smith et je lui ai demandé son avis. Il m'a dit à titre confidentiel : "Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai l'affreuse suspicion que 3 000 hommes pourraient être disparus. Mais - ajoute-t-il - je n'en ai aucune preuve". Après coup, ce sentiment affreux n'était qu'une sous-estimation car la Croix-Rouge a encore une liste de 7 000 noms de personnes disparues. « Pour ce qui est de l'ampleur des massacres, au début, nous ne disposions pas de beaucoup de preuves, mais les suspicions les plus pessimistes se sont avérées exactes. » Ce témoignage recoupe largement celui de M. Pierre Salignon, Directeur des opérations de Médecins sans frontières, chargé du programme Balkans, indiquant que MSF avait exprimé dès le 13 juillet ses inquiétudes sur le sort des réfugiés. « Concernant la date du 13 juillet, des équipes MSF travaillaient à Tuzla depuis le début de la guerre. Vous rencontrerez beaucoup de témoins à Tuzla et à Sarajevo, qui vous raconteront ces éléments-là. Si j'évoque cette date, c'est parce que MSF avait fait un communiqué de presse évoquant ces événements, notamment les marques évidentes de sévices que portaient un certain nombre de femmes et de jeunes filles. C'est donc une réalité qui apparaît très tôt. Je dirai même que, dès le 12 juillet au soir, il y avait déjà des éléments qui apparaissaient à Tuzla, où on peut difficilement dire que les gens ne savaient pas. Ensuite, je suppose qu'il y a eu des informations transmises par le commandant Karremans à sa hiérarchie. » Une série de communiqués de presse transmis par MSF à la Mission d'information témoignent de cette inquiétude grandissante. D'ailleurs à partir du 16 juillet les médias font état d'exactions, de viols, d'exécutions sommaires. D'après le rapport de M. Kofi Annan sur la chute de Srebrenica les informations sur la réalité des massacres ne remontent au siège des Nations unies qu'entre le 20 et le 21 juillet, grâce aux témoignages recueillis dans le cadre de la mission spéciale de l'ONU, de M. Tadeusz Mazowiecki qui en fait état publiquement. Le 24 juillet, celui-ci déclare au Monde : « On est sans la moindre nouvelle de 7 000 habitants de l'enclave. Nous sommes sûrs qu'un certain nombre d'entre eux ont été exécutés par les Serbes. Pour les autres nous pouvons craindre le pire... ». Interrogé sur la fiabilité des témoignages, il ajoute « on peut parler ici en termes de barbarie ». Le 27 juillet, soit deux jours après la chute de Zepa, M. Tadeusz Mazowiecki démissionne. Dans sa lettre de démission adressée au Secrétaire général des Nations unies il lie sa décision à la chute de Srebrenica et de Zepa « qui représente un tournant dans le développement de la situation en Bosnie ». Au-delà des prises de position de tel ou tel ambassadeur et avant même les preuves formelles des massacres, les Nations unies ne peuvent avoir ignorer l'étendue de ces crimes. Ils ont motivé la démission du Rapporteur de la commission des droits de l'Homme sur l'ex-Yougoslavie qui s'étant publiquement exprimé à ce sujet dès le 24 juillet 1995 avait sûrement dû s'entretenir auparavant avec sa hiérarchie. On ne peut que regretter que sur le moment précis où les informations alarmantes remontent à la hiérarchie, le Rapport du Secrétaire général sur la chute de Srebrenica soit resté elliptique et que les Nations unies aient refusé de transmettre à la Mission d'information les documents ayant servi à l'élaboration de ce rapport, notamment les comptes rendus d'audition. A partir des déclarations de M. Tadeusz Mazowiecki, il faut être sourd ou aveugle pour douter de l'existence de massacres à Srebrenica. Aussi, il est étonnant que M. Jean-Bernard Mérimée, alors ambassadeur de France auprès des Nations Unies, attende des preuves photographiques pour se forger une opinion. Ce n'est que le 10 août qu'il se considère informé et qu'il estime que les Nations unies le sont. Voici ses explications sur la manière dont les membres du Conseil de Sécurité prennent connaissance du drame : « La chute de Srebrenica a eu, au Conseil de sécurité, un grand retentissement car c'était la première fois qu'une zone de sécurité était envahie par l'armée serbe, au mépris de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et tombait. L'existence de massacres ne sera connue qu'un certain temps après, le 10 août. Madeleine Albright, alors représentante des Etats-Unis auprès du Conseil de sécurité, fait état, devant le Conseil de sécurité mais en réunion informelle, dans la petite salle, d'indications, tirées notamment de photographies de satellites, montrant qu'il y a des charniers et que quelque chose s'est passé ». Les photographies rendues publiques ont été prises avant et après les massacres et transmises par les Etats-Unis au Tribunal pénal international. Une fois de plus, pendant le conflit, l'absence de circulation de l'information au sein même des Nations unies a affaibli l'institution et discrédité son action en jetant la suspicion sur les services de renseignements de certains membres du Conseil de sécurité qui n'auraient pas divulgué à temps des informations sensibles. b) L'absence d'information des Nations unies sur la situation des déplacés pendant les exécutions La Mission d'information a cherché à savoir si des images aériennes ou satellitaires avaient pu être prises pendant les exécutions, pour vérifier les allégations parues dans la presse, laissant entendre qu'elles auraient eu lieu sous le regard de satellites espions. Mesurant l'importance des photographies, lors de la déposition du commissaire Ruez, la Mission d'information l'a interrogé sur les dates auxquelles elles avaient été prises. Celui-ci a affirmé que le Tribunal pénal international ne disposait d'aucune photographie montrant une exécution en cours. « On a toujours des photographies avant et des photographies après ». La Mission d'information a été frappée par cette curieuse coïncidence qu'elle a analysée plus haut. La Mission d'information a demandé à l'ambassade des Etats-Unis en France s'il était possible d'accéder à des documents photographiques. Elle n'a reçu aucune réponse. Toutefois, le 7 août 2001, la Cour d'appel fédérale de Washington, saisie par une organisation étudiante, Students against genocide, a autorisé le Gouvernement à retenir les images et documents concernant les crimes de guerre commis en Bosnie, même ceux rendus publics. La Mission d'information ne peut qu'exprimer ses regrets à cet égard d'autant que les auditions des généraux français auxquelles elle a procédé n'ont pas permis d'éclaircir ce mystère. Ainsi, l'amiral Jacques Lanxade a-t-il évoqué l'existence de « moyens particuliers des Etats-Unis » sans faire allusion à l'imagerie satellitaire : « Je crois que les Etats-Unis avaient eux-mêmes quelques moyens particuliers qu'ils ont utilisés mais, à l'époque, ils ne les ont pas communiqués ». En revanche, le général Raymond Germanos a douté de l'existence de photographies montrant des exécutions : « Sur l'ampleur des massacres, malheureusement, nous n'avons pas su rapidement ce qui se passait sur Srebrenica. On m'a parlé de photos aériennes soi-disant prises le 13 juillet par les Américains, qui les auraient eues à disposition. C'est quelqu'un que vous avez entendu qui m'en avait parlé il y a un moment, puisque c'était en 1996. Je dois dire avec force d'abord que je n'ai jamais vu ces photos et que si ces photos ont existé et si elles n'ont pas été publiées, celui qui a pris la décision de ne pas les publier est criminel. Il est évident que si l'on publie des photos où l'on voit des massacres ou des débuts de massacres, elles peuvent déclencher au niveau international, en tout cas au sein des nations, des réactions qui en fait n'ont pas eu lieu car personne ne savait ce qui se passait à ce moment-là. Ce n'est que bien plus tard que nous avons eu les premiers témoignages ». Quant au général Jean Heinrich, malgré les questions insistantes des membres de la Mission d'information, il fut impossible de savoir comment et quand il avait pu mesurer l'ampleur des massacres. Il a d'abord déclaré : « J'ignore quelle a été la transmission de l'information au moment des événements les plus graves, mais j'ai déjà expliqué que nous n'avions personne sur place. Nous n'étions pas les témoins de ces événements. Par conséquent, nous n'étions pas en mesure de transmettre l'information en direct comme l'aurait fait un journaliste. Nous n'étions pas présents dans l'enclave. » Puis, à la question du Président François Loncle : « Mais quand avez-vous reçu personnellement les informations provenant de Srebrenica, d'une façon ou d'une autre, et à quel moment avez-vous disposé de renseignements ? Où étiez-vous du 11 au 13 juillet ? », il a répondu : « Je ne peux pas vous dire précisément où j'étais. J'étais à Paris. » A partir du 10 août, l'existence du massacre de grande ampleur à Srebrenica est avérée. La Mission d'information s'est interrogée plus haut sur l'effet qu'aurait produit la publication des photographies plus tôt. Elle ne peut que déplorer l'absence de transmission systématique et efficace des renseignements nationaux vers les Nations unies quand elles sont engagées dans une opération de maintien de la paix. Une transmission plus rapide d'informations fiables et vérifiables sur l'ampleur des massacres aurait peut être obligé les Nations unies à réagir plus vite. Le Conseil de sécurité dépend de ses membres qui maîtres des renseignements qu'ils détiennent, choisissent de les transmettre quand ils le jugent opportun. Si rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu rétention d'information dans le temps, rien ne permet de l'infirmer. 2) Une logique de coercition efficace Dès le début des conflits yougoslaves, plusieurs experts s'étaient étonnés de la mollesse de la réaction de la communauté internationale face à l'intransigeance de Milosevic. De fait, la logique de maintien de la paix qui avait prévalu se révélait inefficace, dramatique pour les populations civiles, humiliante et dangereuse pour les Casques bleus, mis dans des situations périlleuses physiquement et insupportables psychologiquement. Les films Warriors et Srebrenica, une chute sur ordonnance en témoignent. Plusieurs événements qui précèdent la chute de Srebrenica vont contribuer à démontrer que le statu quo ne peut plus durer. Le 24 mai 1995, alors que Sarajevo est toujours assiégée par les forces serbes, la zone d'exclusion des armes lourdes étant violée par les belligérants, le général Smith, commandant de la FORPRONU, après leur avoir lancé un ultimatum qui n'est pas respecté, fait procéder à des frappes aériennes sur un dépôt de munitions serbes de Pale. En représailles, le même jour, les forces serbes bombardent cinq des six zones de sécurité, provoquant le massacre de 76 personnes et plus de 150 blessés à Tuzla, ainsi que l'exode de populations civiles. Puis, les forces serbes, pour répondre à un nouveau raid de l'OTAN, le 26 mai, prennent en otages 200 Casques bleus, dont 100 Français. Afin de prévenir de nouvelles frappes, ils les utilisent comme boucliers humains. Pour la France, la prise d'otages est inacceptable ; c'est un affront qui lui est fait, la Présidence de la République comme l'état-major le ressentent comme tel. La reprise du pont de Vrbanja à Sarajevo par les soldats français est le signe d'un début d'évolution, qu'a retracé M. Jean-David Levitte : « Sur la base d'un accord franco-britannique, le 3 juin 1995, s'est tenue à Paris une réunion des Ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. A ce moment-là, le principe de la création de la FRR a été adopté. C'est allé très vite. Le 8 juin, sans attendre l'arrivée des éléments de la FRR, les mortiers lourds du contingent français de la FORPRONU étaient installés sur le mont Igman, qui domine la ville de Sarajevo. » La création, le 16 juin 1995, de la FRR par la résolution 998 marque la volonté de recourir à la force pour protéger les Casques bleus et réduire le pouvoir de nuisance des Serbes. La logique de coercition ne s'imposera réellement qu'après la chute de Srebrenica et de Zepa. Comme l'a souligné M. Thierry Tardy, « l'épisode de la chute de Srebrenica démontre, de façon tragique, que des opérations de maintien de la paix, inadaptées aux situations qu'elles sont censées gérer, sont productrices de situations inextricables dans lesquelles la probabilité de ne disposer que de mauvaises solutions est proportionnelle au degré d'incohérence de la mission. Il ne faut pas oublier que l'évolution générale de la FORPRONU a échappé à tous les dirigeants politiques européens de même qu'aux dirigeants militaires. » a) La conférence de Londres du 21 juillet 1995 : l'impossible protection des enclaves Dès le 16 juillet, lors d'une réunion à Londres des chefs d'état-major français, américain et britannique, la France propose de créer, à partir de la FRR une force multinationale d'environ 3 000 hommes, capable de venir en aide aux populations assiégées de Gorazde et de Sarajevo. Cette force devrait être appuyée par des avions et des hélicoptères américains. Cependant Américains, Britanniques et Français n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les Français envisagent même le retrait des Casques bleus et se trouvent isolés entre les Britanniques sceptiques et les Américains favorables à des frappes aériennes. Les divergences d'approches font l'objet de télégrammes diplomatiques détaillés. Le 21 juillet, à la conférence de Londres sont réunis les représentants des pays impliqués dans la gestion de la crise. M. Jean-David Levitte a évoqué les négociations en ces termes : « La France a proposé que nous tracions une ligne rouge à Gorazde. Nous avons proposé d'envoyer des troupes françaises à Gorazde, en complément des troupes britanniques qui étaient sur place à condition qu'elles puissent, comme pour Srebrenica, être transportées par les hélicoptères blindés antichars américains. Les Américains et les Anglais ont préféré une autre option qui était celle de la défense de l'ensemble des zones de protection par la menace de frappes massives de l'OTAN. C'est finalement cette stratégie qui a été adoptée à Londres, pendant que la Force de réaction rapide franco-britannique achevait son déploiement, notamment sur les hauteurs de Sarajevo. » Français, Anglais et Américains décident de lancer un ultimatum aux forces bosno-serbes pour leur signifier brutalement selon les termes de M. Jean-David Levitte, « S'il y a de nouvelles attaques sur les zones de protection, il y aura une réaction extrêmement vigoureuse, y compris et notamment par voie aérienne de l'OTAN. » Le 23 juillet trois militaires de haut rang accomplissent cette démarche. Selon le général Germanos qui représentait la France lors de cet ultimatum, « un ultimatum de trois généraux de haut rang américain, britannique et français est lancé le 23 juillet à Mladic après la conférence de Londres le 21 juillet. Je représentais à ce titre la France lors de cet ultimatum. Deux diplomates, un Américain et un Britannique chargés d'établir le compte rendu de la rencontre, nous accompagnaient. Cet ultimatum sera le déclencheur de la campagne aérienne et annoncera les accords de Dayton. » Mais cet ultimatum ne sera pas immédiatement appliqué par l'armée serbe de Bosnie qui lance une offensive sur Zepa, occupe l'enclave le 25 juillet et procède à son évacuation. Au soir du 27 juillet l'évacuation est achevée, mais la prise de l'enclave contribuera à affaiblir la défense de la Krajina par l'armée serbe et provoquera des dissensions entre le général Mladic et Radovan Karadzic. En effet, le 4 août les forces gouvernementales croates lancent l'opération Storm, offensive de grande envergure contre le territoire détenu par les Serbes en Krajina. En trois jours la Krajina de Knin tombe aux mains de l'armée croate. La victoire a dès lors changé de camp et une certaine redistribution de territoire est alors opérée qui n'est pas sans rappeler le plan Vance-Owen. C'est dans ce contexte qu'interviendra le 28 août 1995 le bombardement du marché de Sarajevo provoquant la mort de 37 personnes, et en blessant environ une centaine. Cinq tirs de mortiers avaient touché un quartier central de Sarajevo, l'un était tombé sur la foule du marché de Markale reproduisant l'attaque du 5 février 1994 qui avait soulevé une vive émotion. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la chute de Sarajevo a retracé les différentes étapes ayant mené à l'opération de riposte aérienne et la Mission d'information ne conteste pas cette analyse. b) L'opération « Force délibérée » ou le passage à l'acte Les Serbes de Bosnie n'ont pas compris qu'un nouvel environnement s'était progressivement substitué à l'ancien, que la chute des enclaves, l'entrée des troupes croates en Krajina, la volonté affichée par le Congrès des Etats-Unis de lever unilatéralement l'embargo sur les armes à destination des Bosniaques avaient changé la donne. Ils commettent l'erreur de trop. Conformément à l'ultimatum lancé le 23 juillet, l'OTAN lance le 30 août 1995 une série de frappes aériennes sur les positions serbes en Bosnie orientale. Ces frappes sont accompagnées d'un tir de barrage de plusieurs centaines d'obus de l'artillerie lourde de la FRR. Hommage soit ici rendu au fameux canon de 155 que la France avait fini d'installer sur les hauteurs de Sarajevo et qui se révélera d'une efficacité redoutable comme l'ont répété à l'envi les personnalités auditionnées qui ont toutes regretté son installation trop tardive. L'option aérienne se révélera relativement efficace dans la plus grande opération de guerre entreprise par l'OTAN depuis sa création. Néanmoins il aura fallu dix huit jours de frappes aériennes pour amener les Serbes à résipiscence. Quand les frappes de l'OTAN s'arrêtent le 14 septembre 1995, la défaite serbe est totale, les Serbes obtempèrent et retirent leurs armes lourdes des environs de Sarajevo dont le siège va enfin cesser. Par l'opération « Force délibérée » menée sous le commandement conjoint de l'amiral Leighton Smith, commandant des forces de l'OTAN en Europe du Sud, et du général Janvier, commandant de la FNPU, les Américains s'imposent en Bosnie-Herzégovine reléguant les Européens à l'arrière-plan, même si le Royaume-Uni et la France participent aux frappes. Cette défaite ouvrira la voie à un nouveau processus diplomatique sous l'égide des Américains. On constate qu'à l'arrêt des combats, toutes les enclaves sauf celles de Gorazde et Sarajevo sont aux mains des Bosno-Serbes et que l'armée croate a quasi atteint ses buts de guerre, la reprise de la Slavonie orientale et de la Krajina. Ce qui a fait dire à l'amiral Jacques Lanxade : « Le Groupe de contact s'est mis d'accord sur un plan qui, globalement, prévoyait 49 % pour la partie sous souveraineté serbe et 51 % pour l'autre partie. C'était un accord au sein du Groupe de contact et c'est ce qui a été pris en compte par les négociateurs américains en particulier Richard Holbrooke. « On peut d'ailleurs remarquer que l'arrêt des combats s'est fait pratiquement à la fin du mois de septembre alors qu'on était dans cette résolution 49/51. Je n'en tire aucune conséquence. » Or auparavant, le plan Juppé-Kinkel avait été refusé par les parties, comme l'a rappelé M. Alain Juppé : « Tout le monde a refusé les accords de paix. Je me souviens en particulier qu'à Genève, lors d'une séance de négociations que nous avons à un moment cru pouvoir conclure de manière favorable sur la base du plan Juppé-Kinkel, nous avions en face de nous, Ministres des Affaires étrangères européens, Milosevic, Karadzic, Tudjman, Izetbegovic, et tous ont refusé l'accord. Karadzic par obstination, Milosevic en encourageant Karadzic, Tudjman parce que la solution de force ne lui répugnait pas, et Izetbegovic parce que les Américains - ce n'était pas encore tout à fait M. Holbrooke, mais cela allait le devenir - passaient leur temps à lui expliquer que s'il refusait, il obtiendrait grâce aux Etats-Unis de bien meilleures conditions que celles que lui proposait l'Union européenne. On doit s'en souvenir quand on veut juger du contexte diplomatique général. Cela n'a pas été facile. » c) L'accord de Dayton : Pax Americana ou conséquence de la situation sur le terrain ? D'après M. Jean-David Levitte « le changement de la donne militaire a permis l'accord de paix. » En effet les modifications du rapport de force provoquées par la reprise par les Croates d'une partie de la Slavonie orientale et de la Krajina relativise le mythe de l'invincibilité serbe. Il est temps pour les Bosniaques très durement éprouvés de mettre fin au siège de Sarajevo d'autant qu'ils savent que les Américains mèneront la négociation et espèrent leur appui. L'audition du Président Alija Izetbegovic est éclairante sur l'état d'esprit des Bosniaques. Il a expliqué à la Mission d'information : « Sarajevo a été entièrement encerclée pendant 1 200 jours. Au printemps 1995, c'est-à-dire quelques mois avant la chute de Srebrenica, nous avons, pendant vingt jours, essayé de briser ce siège, mais sans y réussir et en subissant de grandes pertes. Les Serbes ont toujours prétendu que nous nous assiégions et bombardions nous-mêmes. Chaque fois qu'un obus tuait plusieurs personnes, les Serbes disaient que c'étaient les Bosniaques qui se bombardaient eux-mêmes pour attirer l'attention. Pendant le siège de Sarajevo, 10 000 personnes ont perdu la vie, dont 1 300 enfants, et il y a eu 50 000 blessés. « M. François Lamy, rapporteur : Quand vous avez participé aux négociations qui ont débouché sur les accords de Dayton, il y a eu d'entrée de jeu une proposition de mettre, dans la zone de la future Fédération, les enclaves de Zepa et de Srebrenica. Je voudrais savoir dans quelles conditions vous avez été obligé de céder dans la négociation. Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible de récupérer les enclaves au moment des négociations ? « M. Alija Izetbegovic : La délégation serbe disait qu'elle n'accepterait jamais. Les négociations tenaient en permanence à un fil et menaçaient d'être arrêtées à tous moments. Un grand nombre de questions territoriales ont été ouvertes lors de ces négociations (...). « (...) Déjà, depuis le 20 septembre, nous étions seuls dans ce combat contre les forces serbes. En résumé, Tudjman ne voulait plus faire la guerre et l'Europe et les Etats-Unis menaçaient de nous laisser continuer la guerre seuls si nous insistions sur autre chose. « De ce fait, le 21 novembre, les accords de Dayton ont été conclus et signés le matin. Mais, le jour précédent, j'avais signé l'arrêt des négociations à cause de Brcko (...) Quand il (Milosevic) a vu que j'avais signé l'arrêt des négociations, c'est-à-dire le 20 novembre à minuit, et comme il avait besoin de la paix pour éviter les sanctions, il a changé d'avis et proposé le lendemain matin tôt, devant le Secrétaire d'Etat Christopher, l'arbitrage pour Brcko. Nous n'avons pu obtenir que cela. En d'autres termes, nous aurions pu insister sur Srebrenica et Zepa, mais cela signifiait continuer la guerre. Mais, devant nous, se profilait le quatrième hiver de guerre, car nous étions à la fin du mois de novembre. A Sarajevo, 300 000 personnes étaient assiégées. » Pour les Américains, il convient de mettre fin au conflit. En effet la pression exercée sur le Président Clinton par le Congrès est très forte. Le Sénat et la Chambre des Représentants ont voté respectivement le 26 juillet et le 1er août 1995 la levée de l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie. Le 11 août 1995 le Président Clinton a opposé son veto, mais craint que le Congrès comme il en a le droit passe outre par un vote à la majorité des deux tiers dans chaque Chambre dès le début de la session d'automne à la mi septembre 1995. Les Européens qui eux ont déployé des troupes au sol s'opposent à la levée de l'embargo. Ils redoutent une reprise des hostilités conduisant à l'embrasement généralisé. Bien que les divergences entre Américains et Européens persistent, l'évolution de la situation stratégique les amène à travailler en commun à l'obtention d'un règlement de paix. Cependant l'Union européenne se trouvera écartée de la conduite des négociations, les parties préférant recourir aux bons offices de M. Richard Holbrooke, plutôt qu'à ceux du médiateur européen M. Carl Bildt. Pax Americana que, si l'on en croit M. Jean-David Levitte, la France avait en quelque sorte appelé de ses v_ux : « Le Président Jacques Chirac a voulu d'emblée attirer les Américains dans sa démarche. Mais quand les Etats-Unis viennent, en général ils prennent. C'est ce que nous avons vécu à Dayton même si l'Europe et la France étaient très présentes à Dayton. » Cependant il précise : « Je crois véritablement que le Président Jacques Chirac a changé la donne et que si l'on a pu aboutir à la paix, c'est grâce à la création de la FRR, qui a amené les Américains à changer leur regard sur les événements. On est arrivé à l'accord de Dayton qui n'a pas été signé sur la pelouse de la Maison-Blanche mais au palais de l'Elysée à Paris. C'était une façon de rendre hommage à la République française pour le rôle décisif qu'elle a joué dans cette affaire. » En réalité, les négociations seront menées de bout en bout par les Américains. Le 31 août 1995, les Serbes de Bosnie abandonnent au Président Milosevic le droit de négocier en leur nom un accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine. Le 8 septembre 1995, les Ministres des Affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine s'accordent à Genève sur une déclaration sur les principes de base d'un règlement du conflit en Bosnie-Herzégovine, déclaration entérinée le 26 septembre à New York et complétée par des principes sur l'organisation du futur Etat bosniaque. Le 5 octobre, un cessez-le-feu général est accepté par les parties et entre en vigueur le 12 octobre, pour une période de deux mois. La phase finale des négociations se déroule, à huis clos, sur la base aérienne de Wright Patterson à Dayton (Ohio) aux Etats-Unis, entre le 1er et le 21 novembre 1995. L'ONU y est représentée par M. Thorvald Stoltenberg. Les Européens, qui ne parviennent pas à faire valoir leurs vues, se trouvent de plus en plus écartés des discussions. Si l'on en croit le général Bertrand de La Presle, les Européens n'ont pas su parler d'une seule voix lors des négociations de Dayton laissant ainsi le champ libre aux Américains ; en ce sens Dayton fut une Pax americana. « Un des problèmes principaux qui s'est posé à Dayton a été lié au fait que l'on ne pouvait guère parler des Européens. On pouvait parler de Jacques Blot représentant la France. On pouvait parler de Wolfgang Issinger représentant l'Allemagne. On pouvait parler de Pauline Neville-Jones représentant la Grande-Bretagne. On pouvait parler de Carl Bildt censé représenter cette Union européenne dont les trois personnes que je viens de citer démontraient bien qu'elle n'existait pas puisque des différences d'appréciation à l'évidence existaient entre eux. « J'ai été assez frappé à Dayton de constater qu'une partie significative des trois semaines que nous y avons passées a été consacrée à régler des différends entre autorités politiques de la communauté internationale, Américains, Britanniques, Français, Allemands, Russes, avant que l'on ne trouve une sorte de front uni pour discuter avec les belligérants. » Les documents diplomatiques transmis à la Mission d'information confirmeront cette analyse. Ainsi, avec l'offensive aérienne planifiée par l'OTAN, les Américains surgissent comme un deus ex machina et sans avoir basé un seul homme à terre, fait observer Alain Joxe, dans Le Monde du 14 décembre 1995, et il ajoute : « Mais le Gouvernement français n'a pas pu empêcher que les accords de Dayton soient dans leur fondement diamétralement opposés aux principes d'une Bosnie réunifiée que la France a commencé à défendre activement. » En effet, la France préconisait de régler préalablement la question de la constitution unitaire pour que les solutions territoriales et militaires de transition ne s'imposent pas comme structure de paix. C'est l'inverse qui s'est produit. Le point de vue américain l'a emporté, bousculant les Bosniaques. Dayton découpe la Bosnie-Herzégovine en zones militaires ethniques ce qui perdure. L'accord de paix pour la Bosnie-Herzégovine paraphé à Dayton le 21 novembre 1995 par les Présidents croate, serbe et bosniaque, est un accord dont la responsabilité revient très largement aux Etats-Unis. Toutefois, la France obtient que l'accord soit officiellement signé à Paris le 14 décembre 1995. Malgré cette concession, d'après M. Thierry Tardy, « la diplomatie française n'a pas joué le rôle que sa contribution politique et militaire de plus de trois années pouvait laisser escompter ». « Paix amère, paix sans principe » regrettent la plupart des commentateurs. David Owen rappelle dans son ouvrage Balkan Odyssey que : « Le premier projet Vance-Owen de 1993 donnait 43 % de la Bosnie aux Serbes et que l'accord de Dayton patronné par les Etats et fondé sur les mêmes principes de règlement leur en concède 49 %. » Entre-temps c'est selon lui les pressions extrêmement fortes des Etats-Unis qui ont changé la donne. Le professeur Paul Garde démontre que le plan de paix de Dayton consacre pour une large part la victoire de Milosevic et tend à favoriser l'éclatement de la Bosnie-Herzégovine. Il observe, dans Le Monde du 28 novembre 1995 : « Nous avons théoriquement un compromis entre l'unité et le partage mais tout ce qui tend au partage est réel et tout ce qui tend à l'unité est fictif. » Les accords de Dayton sont perçus comme une Pax americana qui satisfait cependant les membres du Groupe de contact car ils mettent fin à la guerre. Pourtant au moment de leur signature l'avenir de la Bosnie-Herzégovine paraît très sombre. En outre les accords de Dayton ont rendu Milosevic fréquentable ce qui pèsera sur l'avenir des Balkans. L'accord de Dayton ne donne pas naissance à une Bosnie-Herzégovine multiconfessionnelle et multiculturelle que la France appelait de ses v_ux, mais à un Etat constitué de deux entités : la Fédération croato-bosniaque et la République serbe de Bosnie (Republika Sprska). Sarajevo réunifiée est la capitale de cet Etat, doté d'un Gouvernement central, d'une Présidence, d'un Parlement et d'une Cour constitutionnelle. Le Gouvernement est responsable de la politique étrangère, du commerce extérieur, de la politique monétaire, de la citoyenneté, de l'immigration... La politique de défense relève, quant à elle, des entités. De plus, chacune des deux entités est autorisée à établir des « relations spéciales » avec les Etats voisins. La Bosnie-Herzégovine actuelle en est issue. C'est un Etat qui fonctionne grâce à la présence et à l'aide internationale comme l'a constaté la Mission d'information. Malgré l'aide extérieure massive, un milliard de dollars par an, l'économie demeure très fragile, la reconstruction est très lente, les traces de la guerre y sont partout visibles. L'ancien Haut Représentant, M. Carl Bildt, avait, dès juin 1997, souligné le caractère formel des institutions bosniaques. D'ailleurs, face à cette situation où aucune des institutions communes (Présidence collégiale, Parlement, Conseil des Ministres) ne fonctionnait vraiment, le rôle de la communauté internationale et notamment du Haut Représentant est passé progressivement de celui d'un facilitateur à celui d'un décideur. La Conférence de mise en oeuvre des accords de paix ministérielle de Bonn des 9 et 10 décembre 1997 a étendu les pouvoirs du Haut Représentant, lui permettant d'adopter des décisions en lieu et place des institutions collégiales, lorsque celles-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord : faute de consensus, c'est donc le Haut Représentant qui assure l'autorité de fait, comme le montre l'organigramme ci-après. L'adoption de décisions majeures, telles les lois sur le passeport unique, sur la citoyenneté, la monnaie, le drapeau, les plaques minéralogiques, les domaines économiques et financiers l'a été au prix d'interventions de plus en plus contraignantes du Haut Représentant. Celui-ci en 2000 a aussi fait usage plus fréquemment de ses compétences pour annuler des décisions et les lois non conformes aux accords de Dayton et pour destituer des personnes faisant obstruction à leur mise en oeuvre. Il faut toute l'autorité de l'actuel Haut Représentant pour assurer une certaine cohésion. Pour la première fois depuis la guerre, les élections générales du 11 novembre 2000 ont permis la constitution de Gouvernements modérés, excluant les partis nationalistes du Gouvernement central ainsi que de celui de la Fédération croato-bosniaque en limitant leur influence en Republika Srpska. Toutefois la formation de ces Gouvernements fut difficile et les nouveaux exécutifs au pouvoir en Fédération croato-bosniaque et au niveau de l'Etat central sont constitués de coalitions très hétérogènes ne disposant que de majorités très étroites. Ils sont confrontés à la résurgence des nationalistes qui, ayant réalisé des scores élevés, n'acceptent pas de se voir écarter du pouvoir, ce qui sape l'autorité du nouvel exécutif. La situation sur le plan militaire paraît stabilisée. Si depuis le printemps 1996 aucun dérapage n'a été enregistré, ce bilan favorable ne doit pas dissimuler que les trois parties continuent d'entretenir un potentiel militaire excessif et coûteux représentant 40 % du budget de la Fédération. La situation humanitaire reste préoccupante notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés. A la signature des accords de Dayton, on comptait 1,2 million de réfugiés et 800 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. A ce jour, le nombre des retours en Bosnie-Herzégovine est évalué par le HCR à 724 000, concernant 335 500 personnes déplacées et 368 500 réfugiés. Parallèlement, 53 000 réfugiés originaires de Croatie et de République fédérale de Yougoslavie ont quitté la Bosnie-Herzégovine. L'année 2000 et les premiers mois de 2001 ont vu une augmentation sensible des retours de réfugiés, même dans des zones qui jusqu'à présent étaient considérées comme dangereuses : 67 500 en 2000, soit une hausse de 64,5 % par rapport à 1999, dont 27 500 en Republika Srpska (y compris Banja Luka, Prijedor et Pale). Pour autant, si l'insécurité semble constituer de moins en moins un facteur dissuasif, la recrudescence de la dissidence nationaliste bosno-croate ainsi que de violents incidents lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Trebinje en Republika Srpska ont alourdi le climat politique. Le retour des réfugiés dépend en grande partie du jugement des criminels de guerre. B - LE RECOURS À LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE : LUTTER CONTRE L'OUBLI ET L'IMPUNITÉ A Srebrenica, le retour des réfugiés est resté problématique, les familles des victimes et les survivants du massacre ont expliqué à la Mission d'information combien il leur était difficile de retourner y vivre. Certains ne reconnaissent plus leur ville désormais peuplée de Serbes, d'autres craignent d'y reconnaître leurs bourreaux ou plus simplement des voisins serbes qui au mieux ne les ont pas aidé au pire les ont dénoncé. Comment envisager le retour sur les lieux de ces familles dont presque tous les hommes ont disparu ? Les victimes attendent de connaître le sort exact des disparus, certaines estiment qu'il y a encore des survivants détenus en Republika Srpska. Le calvaire des mères de Srebrenica est indicible : il évoque la barbarie nazie. Leurs témoignages poignants ont renforcé la conviction déjà bien établie de la Mission d'information qu'il faut absolument que les premiers responsables de ce drame, Mladic et Karadzic, soient arrêtés et déférés devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Cette exigence est d'autant plus forte que Milosevic y est désormais détenu. Des lors l'impunité dont bénéficient les responsables directs des massacres est totalement inacceptable. Ainsi Mme Schehida Abdurahmanovic, membre de l'association « Femmes de Srebrenica » a déclaré à la Mission d'information : « Pour nous, tous ces événements sont encore très douloureux. Cela fait six ans que nous les racontons, sans cesse, mais rien ne se passe. Notre souhait ne se réalise pas. On voit que les criminels de guerre se promènent toujours en liberté. Certes, nous avons été heureuses d'apprendre hier que Milosevic avait été transféré à La Haye. Mais nous, les familles des victimes, savons que tous ces criminels vivent des conditions confortables à La Haye, même si cela nous fait plaisir de les voir sur le banc des accusés et obligés de raconter leurs crimes. » 1) Une obligation morale et une étape nécessaire à la construction de la Bosnie-Herzégovine Le recours à la justice internationale est plus qu'une obligation morale à l'égard des victimes, c'est une nécessité absolue. A défaut toute tentative de réconciliation sera vaine et à plus ou moins long terme vouée à l'échec. La réconciliation ne se bâtit ni sur la négation des crimes commis, ni sur l'impunité. Comme l'a expliqué Henry Jacolin, alors ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine : « Pour moi, il n'y aura véritablement de paix en Bosnie-Herzégovine que le jour où les criminels de guerre seront déférés devant le Tribunal pénal international de La Haye car cela montrera aux populations que quelque chose a changé (...) La population verra à ce moment-là les choses d'un _il tout à fait différent et la Bosnie-Herzégovine pourra vivre à nouveau une vie normale. » a) L'interrogation obsédante des victimes sur les responsabilités Les témoignages insoutenables des victimes soulignent, au-delà de la douleur qu'ils expriment, la faillite et l'impuissance des Nations unies à les protéger. Pour elles, les populations de Srebrenica, enclave désarmée et protégée par l'ONU, ne devaient pas tomber aux mains des Serbes quelle que soit l'issue de la guerre. Les victimes ont le sentiment d'avoir été livrées à leurs bourreaux. Elles ne manquent jamais de rappeler que les hommes qui ont suivi les éléments de l'armée bosniaque avaient plus de chance de survivre que ceux qui s'étaient mis sous l'illusoire protection des Casques bleus. Telle est l'insupportable réalité : la protection des Nations unies était devenue non seulement illusoire mais absolument dangereuse. Dès lors il est indispensable pour elles et pour tous les acteurs de ce drame de savoir la vérité, de déterminer les responsabilités. La Mission d'information a constaté combien la communauté internationale concentrait les ranc_urs des victimes. Censée jouer un rôle protecteur, elle n'a su ni prévoir, ni prévenir ni empêcher le massacre. Aussi les victimes pour lesquelles le système des Nations unies apparaît insaisissable voire opaque et incompréhensible concentrent-elles leur juste ranc_ur non seulement contre les exécuteurs mais aussi contre les représentants de cette communauté internationale qui les a abandonnées. Les soldats hollandais sont accusés au mieux de passivité, au pire de complicité. Leur relation difficile avec la population de Srebrenica a été rappelée, leur obéissance docile aux exigences des Serbes maintes fois soulignée. Ils se sont révélés incapables de tirer une seule balle, se sont laissé désarmer et voler leur uniforme, etc. La responsabilité du général Morillon et du général Janvier a également été mise en cause, le premier parce qu'il n'a pas tenu sa promesse et le deuxième parce qu'il se serait opposé aux frappes aériennes. La Mission d'information en se rendant sur place a été confrontée à une exigence d'explication et de vérité. Comment au XXème siècle un tel crime a pu être commis sous les yeux des Nations unies ? La Mission d'information s'est rendue sur les sites d'exhumation des victimes avec M. Jean Gagnon, l'un des enquêteurs du Tribunal pénal international, qui a décrit le calvaire des victimes. Les lieux parlent d'eux-mêmes. A cet égard, les explications de M. Jean Gagnon et du commissaire Ruez démontrent le caractère organisé du massacre, la présence de fosses secondaires pour effacer les traces, faire totalement disparaître les corps et les preuves du crime. Comme l'écrit le juge Richard Goldstone45 : « La vérité [les membres des familles] veulent savoir exactement ce qui est arrivé à leurs maris, à leurs pères et à leurs fils. Cela les obsède jour et nuit. Ils ne pourront pas faire leur travail de deuil tant qu'ils ne sauront pas la vérité. La plupart - si ce n'est la totalité - des parents des "disparus" éprouvent des difficultés à engager le processus de guérison s'ils ne savent pas où se trouvent leurs êtres chers. Sans cette information, subsiste l'espoir, et peu importe qu'il ne tienne qu'à un fil ou qu'il soit irrationnel, qu'un jour ou l'autre, un mari, une fille, un fils, un père ou une mère vont refaire leur apparition. Grâce aux efforts des experts légistes, on peut aider les familles à comprendre petit à petit pour finalement accepter la réalité ». Le travail des enquêteurs du Tribunal pénal international dans les fosses communes vise à lutter contre l'oubli et le négationnisme, comme le rappelle le juge Goldstone dans l'ouvrage précité : « Le travail des scientifiques fait d'eux des historiens. Grâce à ces hommes, la négation des crimes de guerre devient difficile, si ce n'est impossible. Quand on annonça l'exhumation imminente d'un des charniers près de Srebrenica, l'armée bosno-serbe produisit un communiqué selon lequel les fosses en question renfermaient les corps d'hommes qui avaient été tués au combat. Bien sûr, il s'est trouvé des gens en ex-Yougoslavie et ailleurs pour croire cette affirmation. Le fait est que les corps que les experts exhumèrent des fosses avaient tous les mains attachées derrière le dos et des blessures consécutives à des exécutions collectives. On put de manière concluante démasquer ce qui se cachait derrière ces dénégations : une propagande malhonnête. » La Mission d'information a visité le funérarium où sont entreposés 3 500 corps de victimes pour que les familles puissent les identifier grâce à leurs vêtements ou leurs papiers, leurs objets personnels... ce lieu dit l'indescriptible. L'un des responsables de ce centre a expliqué que les enquêteurs avaient la délicate obligation de prévenir les familles de l'identification d'un proche disparu et de mettre fin à tout espoir de retour, tâche extrêmement pénible. L'espoir de découvrir des rescapés persiste tant que les corps n'ont pas été exhumés et le deuil des survivants est impossible. Un mémorial sera construit à Srebrenica. La première pierre a été posée le 11 juillet dernier lors du pèlerinage qui a lieu chaque année. Mais, comme l'a constaté la Mission d'information, les habitants bosniaques de Srebrenica ne sont pas revenus, même si, conformément à la loi électorale, le maire est bosniaque. c) Le difficile retour des réfugiés Pour faciliter le retour des réfugiés, la loi électorale autorise à voter soit dans le lieu de résidence actuelle, soit dans celui de 1991, avant la « purification ethnique » ; mais les réfugiés ont peur de revenir. La rencontre de la Mission d'information avec M. Sefket Hafizovic, maire de Srebrenica, et les représentants de la communauté internationale, a été éclairante. En 1991, la municipalité de Srebrenica comptait 37 000 personnes ; actuellement, elle compte 10 000 Serbes et 300 Bosniaques. Les retours s'effectuent mal ou pas du tout. Certaines maisons, reconstruites, restent vides alors que, selon le HCR, à Tuzla et Zenica, le nombre de personnes déplacées est considérable. Les victimes rencontrées au cours du déplacement en Bosnie ont souligné que la composition exclusivement serbe de la police ne constituait pas, à leurs yeux, une garantie de sécurité. La reconstruction semble être un long processus, certes dépendant des investissements économiques, mais également du degré de confiance d'une population traumatisée qui attend que les responsables des massacres soient arrêtés et jugés. De plus ces familles dont tous les hommes valides ont disparu peinent à survivre dans une petite ville hostile. Ses familles sont détruites de l'intérieur comme l'avaient prévu les Serbes. Les chefs de famille n'étant plus, elles ne disposent pas du soutien traditionnel. 2) Des résultats limités : la nécessaire arrestation de Ratko Mladic et Radovan Karadzic Le drame de Srebrenica, par son ampleur, entre 7 000 et 8 000 morts, et sa monstruosité, frappe les esprits. Comment une population désarmée protégée par les Nations unies a-t-elle pu être livrée à ses bourreaux au c_ur de l'Europe, à deux heures d'avion de Paris ? Pourquoi n'a-t-on pu la sauver après la chute de l'enclave ? a) La première condamnation pour génocide en Europe depuis le procès de Nuremberg Le 21 août 2001 soit six ans après la tragédie et pour le première fois en Europe depuis la Shoah, un homme est condamné pour génocide à quarante six ans de prison. Cet homme, le général Krstic, a été le bras droit du général Mladic. « Général Krstic, vous êtes coupable d'avoir en toute connaissance de cause participé au transfert forcé des femmes, des enfants et des vieillards qui se trouvaient à Srebrenica lors de l'attaque lancée le 6 juillet 1995. Vous êtes coupable du meurtre de milliers de Musulmans de Bosnie entre le 10 et le 19 juillet 1995. (...) Vous êtes coupable, sachant que les femmes, les enfants et les vieillards de Srebrenica avaient été transférés, d'avoir adhéré au plan d'exécution massive de tous les hommes en âge de combattre. Vous êtes donc coupable de génocide. (...) En juillet 1995, général Krstic, vous avez versé dans le mal. C'est pour cela qu'aujourd'hui cette Chambre vous condamne et prononce à votre encontre la peine de quarante-six ans d'emprisonnement. » Après quatre-vingt-quatorze jours d'audience, cent vingt-huit témoins dont plus d'une centaine à charge, ont abouti à la première condamnation pour génocide jamais prononcée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le juge Almiro Rodrigues a infligé la sentence la plus lourde jamais prononcée par les magistrats de la juridiction internationale C'est bien le terme de génocide, le pire des crimes au regard du droit mais aussi au regard des victimes et de l'Histoire, qui qualifie le massacre perpétré à Srebrenica. La référence à l'article 2 de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide est explicite. En effet, cette disposition, reprise dans les statuts de la Cour pénale internationale, définit ce crime comme les meurtres, atteintes à l'intégrité physique, transferts forcés ... commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux. La spécificité de la tragédie de Srebrenica que le procès du général Krstic a clairement rappelé à la communauté internationale réside dans l'exécution de la décision du général Mladic d'organiser systématiquement la disparition de toute la population non-serbe de l'enclave de Srebrenica. Dès lors, les éléments constitutifs d'un génocide, le crime le plus grave, un crime imprescriptible, sont réunis. Pour importante et solennelle qu'elle soit, cette décision ne peut satisfaire complètement les victimes qui sont en droit de s'interroger sur l'impunité dont jouissent les instigateurs de ce génocide, Radovan Karadzic et le général Mladic. Que sont quarante-six ans au regard de 7 000 à 8 000 morts et de milliers de familles à jamais brisées ? b) Arrêter Radovan Karadzic et le général Ratko Mladic : un devoir La Mission d'information ne comprend absolument pas pourquoi à ce jour Radovan Karadzic et le général Ratko Mladic sont encore en liberté. Lors de son audition, M. François Léotard a d'ailleurs solennellement déclaré : « J'exprime devant la Mission d'information parlementaire, pour avoir à mon initiative rencontré Mme Louise Arbour et le juge Claude Jorda à La Haye, après le mandat que j'ai exercé, la conviction que nous devons tous nous efforcer d'aider le Tribunal dans ses recherches et contribuer à l'arrestation la plus rapide possible par les Etats des criminels de guerre actuellement recherchés. Seule la sanction pénale internationale permettra d'atténuer le sentiment que nous avons tous à propos de Srebrenica d'un formidable échec de la communauté internationale. » Tout au long des auditions auxquelles a procédé la Mission d'information, des questions concernant l'arrestation de Karadzic et du général Mladic ont été posées de manière presque systématique aux responsables politiques, aux militaires et aux diplomates. Les réponses ont paru parfois contradictoires souvent embarrassées. Comme M. François Léotard, les responsables politiques ont souligné la volonté de la France d'arrêter ces criminels. Ainsi M. Charles Millon a-t-il affirmé : « Il est fait état du fait que la France aurait hésité à engager une procédure pour provoquer l'arrestation de MM. Mladic et Karadzic. Je m'inscris en faux contre ces assertions. C'est le Président de la République lui-même qui, un jour, a convoqué les officiers supérieurs chargés de cette opération pour leur demander de tout mettre en oeuvre pour que MM. Mladic et Karadzic soient arrêtés le plus vite possible. (...). A la lecture des rapports confidentiels, j'ai pu constater que tout a été mis en oeuvre pour leur arrestation, mais il est évident qu'ils bénéficient d'une protection réellement extraordinaire. » L'amiral Jacques Lanxade avance quant à lui des raisons techniques quelque peu dépassées : « Il y a un vrai problème à demander aux forces, aux militaires, de faire des actions de justice et de police. A cet égard, il y a probablement un manque, un vide dans le droit international. En effet, quand on prend le contrôle d'une zone de sécurité (...) à quel corps de loi ou de règlement pouvons-nous nous référer pour agir ? C'est extrêmement difficile. (...) On comprend que, très logiquement, il faut aller se saisir des gens, mais s'il y a une erreur ensuite, quelle est la protection juridique des militaires qui interviennent ? Autrement dit, il y aurait lieu pour la communauté internationale d'approfondir cette question. » Ces explications peu convaincantes sont reprises par le général Jean Heinrich qui, répondant à une question du Président François Loncle s'étonnant que l'on ne sache pas où est le général Mladic, a reconnu qu'à certains moments on l'avait localisé mais que le mandat du Tribunal pénal international était aberrant car « ce mandat indiquait qu'on avait le droit d'arrêter les criminels figurant sur la liste donnée par le TPI s'ils venaient à notre contact mais qu'on n'avait pas le droit de faire une action offensive contre eux. » Il a ajouté : « J'aimerais bien que vous regardiez cette liste parce qu'elle contient des photos où je n'aurais pas reconnu mon frère avec, en dessous, une vague indication : il s'appelle comme cela (il n'y avait quelquefois que le prénom), il a habité à tel endroit (...) C'était une directive du TPI. » A une demande de précision du Président François Loncle sur cette liste, le général Jean Heinrich explique : « Je ne sais plus mais je crois que Karadzic et Mladic y figuraient aussi. Les soldats me disaient quelquefois : Mon Général, vous vous rendez compte "de la connerie" ? Je répondais : Oui, mais c'est le Tribunal. Nous en avons arrêté certains parce qu'ils sont allés à notre contact. « Nous les avons arrêtés, parce que je pense qu'ils ont voulu se laisser arrêter, deux personnages (un général et un colonel). Le général s'appelait Domanovic et je ne sais plus le nom du colonel. Qu'en a-t-on fait quand on les a arrêtés ? On les a transférés au Tribunal de La Haye - cela me paraissait logique. De bonnes âmes à Paris m'ont dit : "Vous outrepassez tout à fait vos droits. Ce que vous avez fait est très grave. Certes, vous aviez le droit de les arrêter parce qu'ils étaient à votre contact mais vous n'aviez absolument pas le droit de les transférer au Tribunal". Je leur ai alors posé la question : mais qu'aurais-je dû en faire ? » La suite de l'audition paraît tout à fait surréaliste mais la question extrêmement pertinente ne reçoit aucune réponse digne de ce nom. Si ce n'est que le général Heinrich a paru admettre qu'il n'y avait aucune volonté américaine, ni autre, d'arrêter le général Mladic. « Le Président François Loncle : Confirmez-vous qu'il n'y avait aucune volonté américaine d'arrêter Mladic ? « Général Jean Heinrich : On n'a pas monté d'opération sur lui. Je pense que si on avait voulu... » Analyse que M. Yasushi Akashi a paru partager. A la question du Président François Loncle : « Avez-vous à l'ONU le sentiment que telle ou telle grande puissance ne souhaitait pas qu'on se livre à l'arrestation de ces criminels de guerre ? », il livre les réflexions suivantes : « Si j'ai bien compris, vous voulez contribuer à augmenter ma popularité aux Etats-Unis ! Pour moi aussi, il est intéressant d'observer que l'IFOR ou la SFOR, envoyées par l'OTAN en Bosnie-Herzégovine pour remplacer la FORPRONU avec plus de 60 000 hommes bien armés, semble être aussi prudente que les Casques bleus de l'ONU. Je ne veux faire aucune spéculation. Lorsque j'ai posé cette question à un général américain, il y a une dizaine de jours, il m'a répondu qu'il y avait une certaine hésitation de la part des grands responsables américains dans la mesure où l'on voulait éviter les accrochages inutiles et faire trop de victimes. Il s'agissait donc d'essayer de s'en prendre à des criminels suspects de crimes contre l'humanité. Peut-être aussi rencontraient-ils des difficultés à retrouver ces personnes dans la mesure où elles se déplacent constamment. Mais je comprends et suis d'accord avec votre interrogation. » L'extrême prudence française s'explique peut-être par des instructions anciennes (1995) données par le service juridique du ministère de la Défense à l'époque où la procédure devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie était encore mal connue et mal perçue. Elle ne résiste pas à l'examen aujourd'hui. C'est d'ailleurs la position exprimée par le général Jean Cot à la fin de son audition : « Le Président François Loncle : Avec le recul, Mon Général, comment expliquez-vous qu'on ne l'ait jamais arrêté, y compris ces derniers mois, ces dernières années ? « Général Jean Cot : Cela dépend de quelle conviction on est animé. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de pardon et, a fortiori, pas de réconciliation si les plus grands des criminels ne passent pas devant la justice. La question est de savoir où on met la barre, mais il faut quand même qu'il y ait une barre. Si on n'en est pas convaincu, on a des idées tordues. « Je suis allé en Bosnie-Herzégovine deux ou trois fois après ma démission. De la part de civils internationaux autant que de militaires, y compris de militaires français, j'ai entendu l'argument selon lequel on ne prendra pas de risques pour arrêter Karadzic ou Mladic. Lorsqu'ils ne seront plus au pouvoir et n'auront plus d'influence, on finira, de toute façon, par les oublier et on résoudra peut-être le problème de cette façon. « C'est une mauvaise vue des choses et le courage politique aurait exigé que nous les arrêtions. Je pense que c'était possible et que cela l'est encore. » Après le défèrement, le 28 juin 2001, du Président Milosevic au Tribunal pénal international, la liberté et l'impunité dont jouissent Radovan Karadzic et le général Mladic sont non seulement inacceptables mais insultantes pour les victimes. Les raisons avancées ici et là sur l'impact politique soi-disant désastreux de l'arrestation de ces deux criminels sur les populations bosno-serbes ont peu de poids face à la nécessité de reconstruire la Bosnie-Herzégovine. Les prétendues difficultés que la Force de stabilisation de l'OTAN (SFOR) aurait à les localiser n'expliquent en rien sa passivité. Peut-on se satisfaire de déclarations comme celle du général Dodson, commandant de la SFOR en septembre 2001 : « Je pense que je sais où ils vivent ; je n'ai pas l'intention de le dire ici » en affirmant qu'ils ne se trouvaient pas en Bosnie. Les difficultés que la SFOR semble éprouver pour arrêter le général Mladic et Radovan Karadzic jettent la suspicion sur la réelle volonté d'y procéder. Les déclarations du Monténégro, des dirigeants serbes, et l'adoption, le 2 octobre 2001 par le Parlement de Republika Sprska d'une loi de coopération avec le Tribunal pénal international semblent lever tous les obstacles à l'arrestation de ces deux criminels sauf à imaginer que la volonté politique des Etats dont les troupes sont engagées dans la SFOR fait défaut. La Mission d'information ne s'explique pas comment et pourquoi ces criminels sont encore en liberté. La passivité de la SFOR nourrit d'ailleurs toutes sortes de suspicions, dont la presse se fait périodiquement l'écho. Ils deviennent des sortes d'anti-héros voire pour une jeunesse désemparée de véritables héros. Quant à leur impunité, elle s'explique tour à tour par leur popularité supposée, les appuis cachés dont ils disposeraient voire même par les informations sensibles dont ils seraient détenteurs. Il est plus que nécessaire que soit mis fin à cette situation absurde et intolérable. La Mission d'information est persuadée qu'il est possible d'arrêter ces deux individus. Arrêter le général Mladic et Radovan Karadzic relève de l'urgence absolue. Comment expliquera-t-on aux victimes que l'on utilise les méthodes les plus radicales et sophistiquées et les moyens militaires les plus performants pour traquer Oussama Ben Laden en Afghanistan et que la communauté internationale est dans l'incapacité d'arrêter le général Mladic et Radovan Karadzic alors que chacun des Etats où ils sont susceptibles de résider est près à collaborer avec le Tribunal pénal international. La Mission d'information recommande la collaboration la plus étroite du contingent français de la SFOR avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Tous les interlocuteurs rencontrés au cours de sa visite en Bosnie ont souligné l'importance de cette arrestation. D'ailleurs les experts du Tribunal pénal international se sont fait l'écho du souhait de voir la France communiquer au Tribunal pénal international les éventuelles photographies aériennes et les enregistrements de communications éventuellement faits au moment de la chute de Srebrenica. D'après les renseignements transmis à la Mission d'information, la France ne disposerait pas de cette documentation. La paix reste fragile dans cette région et, contrairement à des analyses politiques à courte vue, l'impunité des principaux responsables des massacres ne saurait constituer un facteur de réconciliation. Elle dessert toutes les populations serbes de Bosnie qui sont perçues comme collectivement responsables et ajoute à la douleur des victimes. C - QUEL RÔLE POUR L'ONU DANS LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES ? L'ensemble des activités des Nations unies en ex-Yougoslavie est marqué par l'échec. Que leur intervention ait abouti à la tragédie de Srebrenica est infamant. Que tout au long des auditions que la Mission d'information a menées la protection des populations civiles soit apparue comme secondaire eu égard à celle des Casques bleus est inadmissible. L'amertume, le mépris et la révolte des victimes sont plus que compréhensibles. Imaginer qu'à la fin du XXème siècle des Casques bleus aient pu être les témoins impuissants d'un génocide relève du cauchemar et pourtant cela fut. La Mission d'information n'a pas pu obtenir malgré son insistance une collaboration pleine et entière de l'ONU, les rares documents transmis étaient déjà publics, M. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de l'ONU à l'époque a refusé d'être entendu, acceptant seulement un entretien informel. Mme Sadako Ogata, alors Haut Commissaire aux réfugiés, était indisponible... Impossible donc de connaître sa version du drame et ses explications sur l'impuissance du HCR lors de la déportation des habitants de Srebrenica. L'audition de M. Yasushi Akashi a permis de cerner, à défaut de la comprendre ou de l'approuver, la logique onusienne qui a amorcé cette spirale d'échec. Son impuissance totale à désigner l'agresseur est frappante, sa volonté d'assurer coûte que coûte la sécurité de la FORPRONU et du personnel des Nations unies est ferme. Ainsi, selon M. Akashi : « Les responsables du maintien de la paix sur le terrain ne disposent pas toujours d'une réponse claire à la question de savoir s'il est sage de bombarder l'une des parties en conflit et d'en faire ainsi un ennemi des Nations unies aujourd'hui, alors qu'ils sont conscients du fait qu'ils auront demain à négocier l'aide humanitaire et le passage de convois des Nations unies sur le territoire de cette partie. Cela revient à dire que les Nations unies n'ont d'autre choix que de continuer à naviguer sur les eaux dangereuses de l'ambiguïté et dans le passage étroit qui sépare le chapitre VI sur le maintien de la paix classique et le chapitre VII sur l'imposition de la paix. » Cette remarque générale qui reflète assez justement la tonalité de l'audition de M. Akashi par la Mission d'information explique la difficulté qu'il éprouvait à réaliser que malgré leur confusion, leurs ambiguïtés, les résolutions 819, 824 et 836 faisaient expressément référence au chapitre VII. La complexité et la diversité des mandats ont largement contribué à entraver l'action de l'ONU. Voici comment l'ambassadeur Jean-Bernard Mérimée les analyse : « Toutes les résolutions du Conseil de sécurité ont force obligatoire, mais simplement celles sous le chapitre VI ne peuvent pas être appliquées par la force s'il y a réticence à les appliquer et celles du chapitre VII peuvent l'être, d'où la gravité de l'invocation du chapitre VII devant le Conseil de sécurité. Cela signifie que, si les parties en question ne veulent pas obéir au Conseil de sécurité, on peut prendre tous les moyens - coercition, blocus, moyens militaires, etc. - pour les amener à résipiscence. Mais la plupart des résolutions passées à l'époque étaient effectivement sous chapitre VI, ou chapitre VII lorsqu'il s'agissait de la sécurité des personnels. Il est exact que cela entraînait un certain flou sur le mandat et ne rendait pas les choses très faciles à gérer. » Les interruptions répétées du pont aérien sur Sarajevo, les détournements d'aide humanitaire, le blocus des enclaves témoignent de l'incapacité des forces onusiennes à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. A cela s'ajoute leur crainte constante et justifiée de participer directement ou indirectement « au nettoyage ethnique » et d'être manipulées ce qui paralysait toute initiative. Il reste que l'acheminement, même imparfait, de l'aide humanitaire a parfois permis de sauver des vies et que la présence des Casques bleus a parfois réduit l'intensité du conflit. La Mission d'information en entendant le témoignage de M. Akashi s'est interrogée sur la capacité d'adaptation de certains des personnels des Nations unies aux conflits nés de l'après-guerre froide. Il lui a semblé que M. Akashi comme son supérieur de l'époque M. Boutros-Ghali étaient les produits d'un système et d'une organisation que les bouleversements de l'Histoire n'avaient véritablement pas atteints. Pour eux le monde n'avait pas évolué, leur approche de négociateurs, de diplomates générateurs de paix s'accommodait fort mal de situation où la volonté de combattre l'emportait sur celle de négocier. L'ONU pâtit également de l'absence de volonté politique des Etats peu enclins à soutenir l'opération qu'ils avaient eux-mêmes créée. La difficulté des Etats membres du Conseil de sécurité à définir clairement leurs objectifs pour mettre en oeuvre une stratégie cohérente et adaptée les a conduit à réagir aux situations sans les anticiper. Ils ont donc délégué à une organisation mal préparée et mal équipée le soin de régler une crise majeure sans lui en donner les moyens. Après le drame de Srebrenica qui entachait gravement son fonctionnement et sa crédibilité, l'ONU a tenté de se réformer. 1) Des lacunes majeures à combler a) Du rapport de Kofi Annan au rapport Brahimi Le 30 novembre 1998 l'Assemblée générale des Nations unies a demandé que soit établi par le Secrétaire général un rapport sur la chute de Srebrenica. Le document rendu public en novembre 1999 est un constat lucide et accablant de la série d'erreurs, de jugements et de dysfonctionnements qui ont rendu possibles le massacre de Srebrenica. Sans complaisance, le Secrétaire général des Nations unies rappelle « qu'il s'agit de savoir à qui incombe la responsabilité comme le montre le constat dressé à la fin du rapport, nous fonctionnaires de l'Organisation, assumons une part de cette responsabilité. » Le Secrétaire général évoque longuement le contexte dans lequel ont été débattues puis adoptées les principales résolutions du Conseil de sécurité concernant Srebrenica, en insistant sur l'absence de réel consensus entre les Etats membres et la répugnance à utiliser la force pour dissuader les attaques contre les zones de sécurité. Après avoir rappelé l'évolution de la politique relative aux zones de sécurité jusqu'à la fin de 1994, les débats sur leur démilitarisation, il dresse un tableau très sombre des événements qui ont précédé la chute de l'enclave « naufrage de l'accord de cessations des hostilités, frappes aériennes sur Sarajevo et crises des otages. » Il cite les termes du rapport du Secrétaire général du 30 mars 1995 : « La question de savoir si la FORPRONU est une opération de maintien de la paix ou de coercition ne peut être éludée (...) rien n'est plus dangereux pour une opération de maintien de la paix que de devoir user de la force lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire en raison même de sa composition, de son armement, de son soutien logistique et de son déploiement. » Il souligne les divergences d'approche entre la Force de paix des Nations unies (FPNU) basée à Zagreb et celle de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine. Le déploiement de Casques bleus à Srebrenica et ses difficultés sont minutieusement retracés comme les différents épisodes ayant entraîné la chute de l'enclave et les massacres. La question de l'emploi de l'appui aérien rapproché fait l'objet de longs développements, ainsi que la confusion qui règne au sein du bataillon de Casques bleus. Le rapport relate les efforts des négociateurs des Nations unies et du HCR pour obtenir la libération des victimes et montre que l'étendue des massacres commence d'être soupçonnée à partir du 16 juillet et connue dès le 20 juillet sans preuve formelle. Le rapport retrace les différentes étapes ayant mené aux accords de Dayton et dresse un bilan lucide et extrêmement sévère de l'action des Nations unies. Il examine l'action du bataillon néerlandais et reconnaît qu'il n'avait pas les moyens de se battre. Il déplore surtout que ce contingent n'ait pas disposé plus rapidement des informations qu'il demandait. La description du dilemme de l'emploi ou du non emploi de la force aérienne souligne combien les Nations unies peinaient à définir l'agresseur et à organiser des représailles à son encontre. La culture de paix de l'Organisation s'y opposant vigoureusement, les paragraphes 480 à 483 du rapport sont éclairant sur ce point. Sur les effets de la prévisibilité de l'attaque et de la tragédie, sur le niveau de réactivité de l'ONU, le pessimisme du Secrétaire général est très inquiétant. « Si l'Organisation des Nations unies avait reçu des informations révélant la monstruosité des desseins des Serbes de Bosnie, il est possible, mais nullement certain, que la tragédie de Srebrenica ait pu être évitée. Toutefois, une telle excuse ne saurait expliquer notre échec à Zepa : dans ce cas précis, les Serbes ont annoncé publiquement leurs intentions. » Sur le rôle du Conseil de sécurité et des Etats membres, le Secrétaire général décrit le piège dans lequel l'ONU s'était laissé conduire. « Nous nous efforcions de maintenir la paix et d'appliquer les règles régissant le maintien de la paix alors qu'il n'y avait aucune paix à maintenir. » « Il est rapidement apparu qu'avec la fin de la guerre froide et l'apparition de forces irrégulières - contrôlées ou incontrôlées - les anciennes règles du jeu ne s'appliquaient plus. » L'absence de compréhension des objectifs serbes semble faire partie intégrante de cette culture de paix chère au Secrétaire général de l'époque, M. Boutros Boutros-Ghali, qui n'a pas accepté de rencontrer l'ensemble des membres de la Mission d'information. M. Kofi Annan conclut dans son rapport qu'une opération de maintien de la paix déployée en lieu et place d'un accord politique a peu de chance de réussir, que les moyens nécessaires à une mission doivent être donnés. Selon lui « la principale leçon de Srebrenica est qu'une tentative délibérée et systématique de terrifier, d'expulser ou d'assassiner un peuple tout entier doit susciter non seulement une réponse décisive mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires, mais aussi la volonté politique de mener cette réponse jusqu'à sa conclusion logique. Dans les Balkans, cette leçon a été donnée non pas une, mais deux fois en une décennie. Dans un cas comme dans l'autre en Bosnie et au Kosovo, la communauté internationale a essayé de négocier un règlement pacifique avec un régime meurtrier et sans scrupules. Dans les deux cas, il a fallu recourir à la force pour mettre un terme aux expulsions et tueries planifiées et systématiques de civils. » Conformément à ses conclusions appelant les Etats à réfléchir sur les principaux défis auxquels l'ONU est confrontée, le Secrétaire général, M. Kofi Annan, a confié à M. Lakhdar Brahimi la présidence d'un groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU qui a rendu son rapport en août 2000. b) Les propositions présentées dans le rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix par M. Lakhdar Brahimi Par son intitulé « Opération de paix », le rapport du groupe d'étude composé de diplomates ayant tous à des degrés divers participé à ce type d'opérations, a pour objectif ambitieux de proposer des réformes concernant l'ensemble des opérations de paix. Tirant les conséquences de l'extension des mandats de l'ONU à des opérations d'imposition ou de reconstruction de la paix, les rapporteurs utilisent tout au long du document le terme « d'opérations de paix », ne spécifiant maintien, imposition, ou construction de la paix que dans les cas où une telle distinction s'avère nécessaire. Le rapport dresse un constat sans complaisance sur les opérations de paix menées par les Nations unies dans la dernière décennie. Il relate et analyse les échecs graves de ces dernières années : la débâcle de Somalie, le génocide du Rwanda, le massacre de Srebrenica. Ce rapport marque un tournant dans l'histoire de l'ONU qui est en phase d'autocritique. La tonalité du rapport de M. Lakhdar Brahimi en témoigne. Il s'ouvre ainsi : « L'Organisation des Nations unies a été fondée, selon la Charte, pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Relever ce défi constitue la fonction la plus importante de l'Organisation (...). Au cours des dix dernières années, l'ONU a connu plusieurs échecs face à ce défi, et elle n'est guère en mesure de faire mieux aujourd'hui. » Ce constat amer est développé tout au long du document comme une exhortation à adopter les mesures proposées par le rapport qui ne craint pas d'inviter le Secrétariat de l'ONU à dire au Conseil de sécurité ce qu'il doit savoir plutôt que ce qu'il veut entendre, à considérer le maintien de la paix non pas comme une « fonction temporaire », mais bien comme une « activité essentielle » et pratiquement permanente de l'Organisation. Le Rapport contient une série impressionnante de recommandations qui tournent autour de trois axes, la clarté et le réalisme des mandats, la réactivité des forces multinationales, le financement des opérations. Le texte formule une exigence : définir « des mandats clairs, crédibles et réalistes » avant d'engager une opération. Le Conseil devrait ainsi s'assurer que l'accord de cessez-le-feu à défendre répond à certaines conditions minimales, concernant notamment sa conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'Homme, la faisabilité des tâches envisagées et les délais prévus. Les Casques bleus doivent pouvoir, « grâce à des règles d'engagement fermes, se défendre et défendre d'autres composantes de la mission. » Il suggère au Conseil de sécurité de garder à l'état de projet les résolutions prévoyant le déploiement d'effectifs assez nombreux jusqu'à ce que le Secrétaire général ait reçu des Etats membres l'assurance qu'ils fourniront les contingents et autres éléments d'appui indispensables. Ainsi le Conseil de sécurité ne pourrait plus « soulager sa conscience » en votant une résolution d'apparence généreuse, mais inapplicable, comme il en avait pris l'habitude contestable. Pour que les forces internationales soient plus efficaces, l'ONU devrait, selon le rapport, pouvoir mettre en place une force d'intervention 30 jours après l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité dans le cas d'une mission classique, et dans un délai de 90 jours dans le cas d'une mission complexe. A cette fin serait dressée une liste régulièrement actualisée de personnels sous astreinte, à savoir une centaine d'officiers pouvant être mis à disposition dans les sept jours pour constituer l'ossature de la force. Pour le reste, les Etats membres seraient incités à constituer des partenariats afin de créer plusieurs forces homogènes de la taille de la brigade. Le même dispositif - une centaine d'officiers - serait retenu pour la mise à disposition d'effectifs en matière de police et d'administration civile. Parallèlement, un groupe de juristes internationaux élaborerait un code pénal destiné à être utilisé de façon temporaire pour les opérations de l'ONU en attendant le rétablissement de l'état de droit et des capacités locales en matière de police. Sur le plan financier, le rapport observe que, dans la mesure où les missions de paix sont désormais une activité essentielle des Nations unies, c'est au budget ordinaire de l'Organisation que devrait être inscrite la plus grande partie des ressources nécessaires. Le rapport Brahimi place les Etats devant leurs responsabilités. Alors que 18 missions de maintien de la paix avaient été engagées de 1945 à 1991, l'ONU est intervenue à 34 reprises entre 1991 et 1999, sans que les moyens financiers et matériels ne soient toujours en adéquation avec le mandat des Casques bleus. En proposant de mettre des unités multinationales et des fonds à la disposition du Secrétariat général, le groupe de travail tente de conjurer la perspective d'un maintien de la paix à deux vitesses, où les grands pays interviendraient à leur convenance en maîtrisant les objectifs et la chaîne de commandement. S'agissant de l'organisation interne, le rapport demande la création d'un Secrétariat à l'information et à l'analyse stratégique et surtout un sérieux renforcement du Département des opérations de maintien de la paix. Cette branche du Secrétariat qui gère les 35 000 soldats déployés actuellement dans 14 pays ou territoires, ne comprend que 32 officiers... De même il n'y a que neuf personnes à New York pour s'occuper des 9 000 policiers employés dans les mêmes missions. Le rapport Brahimi tire indéniablement les leçons du passé. Les réformes qu'il préconise ont été bien accueillies par les Etats membres. Le Conseil de sécurité a adopté le rapport Brahimi le 7 septembre 2000 à l'issue du sommet du Millénaire. Les Etats membres suivront les recommandations qu'il contient. En 1992, l'agenda pour la paix présenté par le Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali prévoyait l'établissement d'une diplomatie de prévention des conflits et la remise en oeuvre de l'article 43 de la Charte des Nations unies, selon lequel l'ONU dispose d'une armée permanente. Approuvé dans l'euphorie de l'après-guerre du Golfe, le texte est rapidement tombé dans l'oubli. En effet quelles que soient les garanties fournies par l'ONU, les Etats tenteront toujours de conserver le contrôle de leurs troupes, ne serait-ce que pour maîtriser la diplomatie qui accompagne toute intervention dans un conflit. La volonté de réforme manifestée par l'ONU a été bien perçue par ceux qui ont vécu de près ou de loin la tragédie de Srebrenica. Voici quelles sont les leçons qu'a tirées de cette tragédie M. Joris Voorhoeve qui fut Ministre hollandais de la Défense : « Je souhaiterais tirer quatre leçons en vue d'opérations de paix futures. « Premièrement, une force de paix qui court le risque d'être confrontée à une violence sérieuse doit pouvoir disposer d'une Force de réaction rapide avec un armement lourd et des hélicoptères armés. « Deuxièmement, une force de paix doit être dirigée par un ou deux membres permanents du Conseil de sécurité. Les Nations unies en tant qu'organisation ne sont pas à même de mettre en place des forces de guerre. Imposer la paix comporte les mêmes ingrédients que la guerre : une force brute, une précision, une rapidité et surtout une capacité à surprendre l'ennemi. Il faut pouvoir agir contre les actions des terroristes menées contre la population civile. Il faut donc une dissuasion politique et militaire. « Troisièmement, il faut un mandat général avec des instructions quant à la violence. « Quatrièmement, cela va de soi, il ne faut pas de position isolée ou indéfendable, encerclée par l'ennemi. » Selon M. Pierre Salignon, Directeur des opérations de Médecins sans frontières, chargé du programme Balkans : « Le rapport Brahimi est un rapport très technique, c'est un enjeu réel que l'on suit de manière attentive en termes de conséquence sur la protection des populations. En effet, aujourd'hui, les discussions prennent en considération les flux de population ou le maintien de la paix ; la protection des populations n'est pas l'objectif prioritaire. » c) Des difficultés de mise en oeuvre Lors du colloque international « pour défendre la paix réformer l'ONU » qui s'est tenu à Paris du 31 janvier au 1er février 2001, à l'initiative des Commissions des Affaires étrangères et de la Défense de l'Assemblée nationale, M. Lakhdar Brahimi a fait le point sur l'état de l'avancement des réformes proposées dans son rapport. Il a relevé que le Conseil de sécurité avait déjà discuté des recommandations du rapport concernant ses méthodes. En revanche l'effort financier consenti par l'Assemblée générale est demeuré insuffisant selon lui et ses arguments ne manquent pas de pertinence. « Premièrement, les Nations unies ont, à l'heure actuelle, quelque 40 000 soldats dans le monde entier. Or, pour concevoir les missions, les préparer, les diriger à partir de New York, le Secrétaire général ne dispose que de 32 officiers. Ce n'est pas sérieux. Deuxièmement, la police. Nous disposons de 7 000 ou 8 000 policiers répartis à travers le monde, venant d'une cinquantaine de pays, avec des formations différentes, des traditions et des cultures de police différentes mais le Secrétaire général ne dispose que de 9 personnes pour les diriger. Il est vrai que l'on nous a donné 6 policiers supplémentaires, ce qui nous amène à 15 personnes, mais ce n'est pas encore suffisant. L'ONU est une organisation importante qui, actuellement, ne remplit pas bien sa tâche. Elle serait pourtant capable de mieux y parvenir si on l'aidait et l'équipait pour ses missions. L'ONU est victime d'un déficit de crédibilité sérieux et notre travail consiste à lui restituer la crédibilité qui lui manque aujourd'hui. » M. Bernard Miyet, ancien Secrétaire général adjoint des Nations unies en charge du Département des opérations de maintien de la paix s'est montré très sceptique sur les possibilités de réformer les Nations unies. Lors de ce colloque, il a évoqué le poids des tensions permanentes existant entre les membres qui interfèrent dans chaque conflit, l'effet CNN, le poids de la presse américaine et l'impact de la politique intérieure des Etats-Unis sur le Conseil de sécurité. Il a dénoncé la logique du « deux poids deux mesures » aux Nations unies s'agissant de sanctions, la tentation de voler des résolutions irréalistes pour se donner bonne conscience et la prise en compte quasi systématique des intérêts stratégiques des grands. Selon lui les réformes préconisées par le rapport Brahimi sont excellentes, encore faudra-t-il une volonté politique de les mettre en oeuvre par des moyens appropriés. Lors du colloque précité les participants se sont accordés sur la teneur d'un manifeste dégageant des principes de réforme, en voici les principaux traits : « Nous demandons aux Etats membres de remplir la totalité de leurs obligations, notamment financières, de manière à garantir à l'ONU les ressources nécessaires à la prévention des conflits, au maintien et à la consolidation de la paix. Nous demandons, pour que le Conseil de sécurité soit en mesure de fonctionner efficacement, que, conformément à la Charte, sa responsabilité principale, en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression, soit pleinement reconnue et loyalement respectée par l'ensemble des Etats membres, afin d'empêcher toute entrave et tout retard injustifié à l'action de la communauté internationale, notamment en présence de violations massives des droits de l'Homme. Nous demandons que l'utilisation du droit de veto soit limitée aux questions impliquant l'emploi de la force et qu'elle soit motivée. Nous demandons que le Conseil de sécurité devienne plus représentatif du monde actuel grâce à l'augmentation du nombre de ses membres permanents et à l'entrée en son sein de puissances émergentes. Nous affirmons que les Nations unies doivent disposer de moyens militaires efficaces, et pour cela nous demandons que l'ONU soit dotée d'une capacité militaire de réaction rapide. Des forces devraient être prédésignées pour être affectées à un corps des Nations unies, avec un préavis de mobilisation de courte durée. Nous demandons que les Casques bleus disposent des moyens nécessaires, notamment d'un mandat clair, pour faire cesser la barbarie à l'encontre des civils. » La série d'échecs et de revers subie par les Nations unies pose la question de leur capacité à faire la guerre pour imposer la paix. 2) L'ONU peut-elle faire la guerre pour imposer la paix ? Il existe une réelle antinomie entre les principes philosophiques qui sont à la base de l'existence de l'ONU et les caractéristiques d'opérations militaires. Autrement dit l'ONU est-elle en mesure de faire la guerre à la guerre par la guerre ? L'ONU n'est pas une organisation de défense collective comme l'OTAN, encore moins une organisation militaire, au mieux elle serait une organisation de prévention des conflits si elle intervenait à temps. a) Les limites de la culture de paix La culture de paix est inhérente à l'Organisation, sa logique est la neutralité donc le dialogue et la non confrontation, ce qui n'est pas vraiment compatible avec la logique militaire. Cette culture de paix s'est développée pendant toute la durée de la guerre froide. Servir la cause de la paix en ayant une position équilibrée, telle fut la posture des hauts fonctionnaires du Secrétariat général des Nations unies pendant toute la durée du conflit en ex-Yougoslavie. La répugnance à définir l'agresseur qui peut devenir selon les propos de M. Akashi, alors Représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie, le partenaire essentiel de la future négociation devenait littéralement paralysante dès que des actions concrètes étaient envisagées. Voici comment M. Yasushi Akashi percevait le rôle de l'ONU : « Tout d'abord, il aurait été impossible ou peut-être injuste de définir d'emblée l'agresseur, dès le début de cette guerre. Il me semble que des guerres civiles aussi complexes ne sont parfois pas aussi civiles que cela. « Les Nations unies ne peuvent rester neutres entre le bien et le mal. La Charte des Nations unies elle-même est une déclaration d'engagement moral. Mais il n'est pas toujours aisé, dans le cours d'une guerre, et plus encore d'une guerre civile, de distinguer entre le bien et le mal. Les forces de maintien de la paix des Nations unies accomplissent fréquemment leur mission dans des conditions d'ambiguïté morale, avec des bons et des mauvais généraux, et des bons et des mauvais soldats, dans tous les camps, même si cela n'est pas dans des proportions égales. « Rétrospectivement, les forces des Nations unies de maintien de la paix en Bosnie avaient peut-être retenu une leçon de trop de l'amère expérience de l'usage de la force, celle qu'avaient subi leurs collègues en Somalie et qui avait abouti à de lourdes pertes et au retrait définitif des Nations unies. "Ne jamais dépasser la ligne de Mogadiscio" devint une devise dans la FORPRONU, ce qui signifiait qu'il ne fallait jamais éveiller l'hostilité d'une des parties en guerre, au point d'en faire un ennemi mortel des Nations unies. » Cette culture de paix adaptée à l'époque de la guerre froide eut des conséquences extrêmement néfastes dès lors qu'il fallait régler les conflits engendrés par l'éclatement des Etats et les poussées ethnico-nationalistes comme au Rwanda et en Bosnie-Herzégovine. « Ne jamais dépasser la ligne de Mogadiscio » conduisit l'administration onusienne à privilégier la protection de son personnel civil et militaire. Les populations civiles censées bénéficier de la protection des Nations unies firent les frais de cette culture. Plus que de l'erreur d'un seul, les victimes de Srebrenica le furent d'un système qui paralysait toute opération militaire digne de ce nom. Ceux des militaires de haut rang qui se montraient inadaptés à cette culture dite de paix ont été rapidement remplacés car ils devenaient gênants. La Mission d'information ne peut que faire sienne « l'amère leçon » que M. Akashi tire des conflits en ex-Yougoslavie : « L'amère leçon que nous tirons de la Bosnie et des autres guerres civiles agitées des années quatre-vingt-dix est que le moyen classique de maintien de la paix conserve encore une utilité dans certaines circonstances, mais ne peut pas même suffire à assurer un minimum de stabilité dans d'autres conditions. De telles circonstances exigent une opération de grande envergure pour imposer la paix, qui peut être confiée à l'OTAN ou à une coalition ad hoc de pays qui disposent de plus de capacité militaire que les Nations unies. » Cependant quelles que soient les modalités, la Mission d'information exige que la sécurité des populations civiles menacées soit au c_ur des préoccupations des intervenants. Leur protection est une exigence absolue. b) Les interventions des organisations régionales : le Kosovo ou l'anti Bosnie La guerre du Kosovo en 1999 marque un changement très net dans les politiques d'utilisation de l'ONU par les grandes puissances occidentales. L'ONU a été délibérément écartée, au profit de l'OTAN, après bien des vicissitudes. Alors que les Etats-Unis, mais aussi le Royaume-Uni plaçaient l'OTAN au centre de la gestion de la crise, la France s'est efforcée de favoriser l'Union européenne et l'ONU et l'Italie souhaitait que la responsabilité première au sujet du Kosovo revienne au Groupe de contact formé par la Russie, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. La Russie de son côté soutenait l'implication de l'OSCE et du Conseil de sécurité de l'ONU pour conduire la gestion de la crise parallèlement au Groupe de contact. Lorsque la crise s'est amplifiée au printemps 1998, le Groupe de contact n'a pas pu trouver d'accord pour exercer des mesures de pression contre Belgrade à cause du refus de la Russie. L'OTAN a pris la responsabilité de gérer la crise pendant l'été 1998. Par l'emploi de menaces, elle a tenté de conduire Belgrade à adopter une attitude de coopération. La tentative de faire reprendre la gestion de la crise par l'ONU a été un échec puisque les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne sont parvenus à un accord que sur la résolution 1199 fin septembre 1998 qui n'a pas impressionné Belgrade. Le Groupe de contact a confié aux Etats-Unis en la personne de son Représentant spécial, M. Richard Holbrooke le soin de négocier avec Belgrade une présence internationale au Kosovo. M. Holbrooke a alors impliqué l'OSCE dans le conflit puisqu'elle devait contrôler des accords passés entre M. Milosevic et M. Holbrooke sur la Mission de vérification du Kosovo. Mais la Mission de vérification a échoué, l'OSCE n'ayant pu y faire face. Une sorte de collaboration confuse entre les organisations internationales s'instaure alors. Mais il revient à l'OTAN d'assumer l'ensemble des opérations militaires pour enrayer la catastrophe humanitaire provoquée par Belgrade sans mandat explicite des Nations unies. Alors que l'OTAN bombardait la République fédérale de Yougoslavie, d'autres organisations s'employaient à la recherche d'une solution pacifique. C'est ainsi qu'un plan de paix de l'Union européenne a été repris par le G8 pour servir de fondement à la résolution 1244 du Conseil de sécurité. Mais les opérations militaires furent conduites par l'OTAN et elle seule, comme l'a souligné M. Jean-Christophe Rufin46 : « (...) L'ONU a mis quelque peu en sourdine son tintamarre humanitaro-militaire. Les doctrines d'emploi américaines et européennes en la matière limitent beaucoup la participation à des aventures mal définies. L'ONU semble devoir se concentrer sur quelques points forts, là où le maintien de la paix s'accompagne d'enjeux stratégiques (Balkans). Le recours à la force n'est plus envisagé de façon confuse et symbolique, mais épaulé désormais par l'OTAN, dont les pratiques offensives s'apparentent plus à la guerre classique qu'au maintien de la paix. « La guerre au Kosovo (...) marque sans doute l'entrée dans une ère nouvelle. La communauté internationale y démontre son souci, par une constante référence négative à la crise bosniaque, de ne pas perdre de temps dans une action floue humanitaire militaire et de régler tout de suite le problème à sa source par des frappes et une politique offensive. Les moyens et la stratégie employés peuvent être contestés, il reste que l'ambiguïté de la période FORPRONU semble bel et bien terminée. » La mise à l'écart de l'ONU entraîne un recours croissant aux organisations régionales. Parallèlement, les grands pays autrefois pourvoyeurs de Casques bleus répugnent à envoyer des contingents sous commandement ONU. Telle est le résultat de « l'amère leçon ». c) Le développement des organisations régionales dans la gestion des crises et ses limites Avec les différentes interventions de l'OTAN conjointement ou pas à l'ONU en ex-Yougoslavie, de l'OSCE en ex-Union soviétique et en ex-Yougoslavie, de l'ECOMOG au Liberia, on constate une régionalisation du maintien de la paix. Cependant l'ONU n'abandonne pas ses compétences en matière de maintien de la paix car elle conserve le monopole exclusif de la création de toute opération par le Conseil de sécurité quel qu'en soit l'exécutant. L'ONU joue alors un rôle de caution juridique légitimant une opération. C'est actuellement le cas pour l'intervention américaine en Afghanistan, les Etats-Unis n'ayant pas souhaité devoir être soumis aux contraintes rigoureuses qui leur ont été imposées par les Européens durant le conflit au Kosovo. Par ailleurs, malgré ses échecs l'ONU jouit d'un certain savoir-faire dans les tâches liées au maintien de la paix et notamment dans la reconstruction des structures étatiques (aide à la mise en place d'institutions, formation de la police locale, supervision de processus électoraux). Elle reste la seule organisation à pouvoir intervenir dans le monde. Ainsi devant l'impossibilité d'arrêter ou d'empêcher à temps les conflits, on tente en revanche de spécialiser l'ONU dans l'organisation d'opérations de secours aux pays dévastés. C'est le cas des missions qui lui ont été confiées au Kosovo et au Timor. Les missions d'intervention dans quelques conflits en cours n'ont pas été pour autant définitivement arrêtées, mais le fait qu'elles soient organisées dans la plupart des cas sans l'aide directe des armées des grandes puissances, contribue à leur inefficacité. Par ailleurs l'exemple récent des mésaventures advenues aux troupes engagées dans l'opération concernant la Sierra Leone (prise d'otages de 500 Casques bleus) est une illustration de ce phénomène de désintérêt. Le risque d'opération de maintien de la paix à deux vitesses est donc réel d'autant que les pays gros contributeurs de troupes bien formées hésitent désormais à les engager sous Casques bleus. C'est le cas de la France qui tout en soutenant l'action de l'ONU dans les opérations de paix n'envoie quasiment plus de contingent sous Casques bleus. D - LA FRANCE ET LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 1) La nécessaire cohérence des objectifs, des mandats et des moyens L'ampleur des dysfonctionnements constatés qui ont permis le drame de Srebrenica, même s'ils ne l'ont pas provoqué, conduit à s'interroger sur la capacité de l'ONU à faire face aux attentes que met en elle la communauté internationale, et en conséquence, sur le degré de participation de notre pays aux missions de maintien de la paix de l'Organisation. A l'évidence, notre participation à des actions collectives militaires d'ampleur ne peut se concevoir que dans un cadre rénové de l'Organisation des Nations unies. Le Secrétaire général actuel, qui avait la responsabilité du Département des opérations de maintien de la paix au moment du génocide au Rwanda et de la tragédie de Srebrenica, est plus que tout autre conscient des lacunes dont a fait preuve l'ONU à ces occasions. Il a, de ce fait, engagé l'Organisation dans une réforme qui sans être achevée - loin s'en faut - va cependant dans le bon sens. Dès lors, plusieurs des propositions que fait la Mission d'information pour éviter le renouvellement du drame de Srebrenica paraîtront d'une consternante banalité à tous ceux qui sont au fait des propositions faites au sein des Nations unies au cours des dernières années notamment de celles qui figurent dans le rapport Brahimi47. La première, c'est une évidence, elle est pour l'Organisation de ne s'engager dans une opération qu'après avoir constaté qu'elle avait les moyens de la mener. Disons le tout net : il n'est pas du tout certain qu'un tel principe élémentaire de bonne gestion soit compatible avec le degré de médiatisation de nos sociétés. La pression de la société civile relayée par les médias ou les grandes ONG sur les décideurs est telle qu'on ne peut être certain que ces derniers résisteront à la tentation de « faire quelque chose » en permettant l'adoption de résolutions du Conseil de sécurité dont la mise en oeuvre risque, une fois de plus, de se révéler très difficile, voire à l'origine de drames. La deuxième, elle est de renforcer encore les capacités du Département des opérations de maintien de la paix qui dirige ces opérations. Cela a déjà été fait, mais on reste loin du compte. On a vu que ce Département avait été quasiment inexistant dans les jours et les heures où s'est joué le drame de Srebrenica. Il faut savoir que celui-ci - malgré le renforcement de ses moyens opéré sous les auspices de l'actuel Secrétaire général - n'a rien à voir en termes de moyens avec l'état-major des armées d'un pays, même de très moyenne puissance. Or, on l'a vu, sa capacité à utiliser les moyens des états-majors des Etats demeure très limitée. Son renforcement demeure une priorité, d'autant que cela reste raisonnable en termes de coût. Doit-on aller plus loin ? La Mission d'information répond à cette question par l'affirmative. Il faut que les Nations unies puissent recourir dans des délais rapides à des forces bien structurées et équipées et non plus à ces contingents dont l'inventaire fait penser à Prévert et qui ont du mal à communiquer entre eux, comme on l'a vu par exemple pour les hélicoptères lourds en Bosnie. C'est un peu cette logique qui a conduit le Président de la République à évoquer une telle mission pour la force européenne en préparation ; mais la même démarche devrait être envisagée pour les autres continents, avec l'aide pour l'entraînement et l'équipement des membres permanents du Conseil de sécurité. On en est encore loin, même en Afrique où de réels efforts sont en cours depuis quelques années. La France doit-elle participer à des forces des Nations unies ? On sait que le ministère des Affaires étrangères y est favorable, les militaires demeurant, pour le moins, réticents. On comprend aisément leur position, compte tenu de leur expérience en Bosnie, où la « détermination sans moyens » a favorisé la tragédie même si elle ne l'a pas provoquée. Si les conditions exigées par le rapport Brahimi étaient remplies, on pourrait s'engager sans risques inconsidérés. Mais le seront-elles ? On peut en douter, du moins dans l'immédiat. Pourtant notre présence - et celle des Britanniques - est essentielle. Au cours de son audition par la Mission d'information, l'ancien Ministre néerlandais de la Défense, M. Voorhoeve, a indiqué, que pour ce qui le concerne, il considère que son pays ne peut s'engager que si un membre permanent du Conseil de sécurité le fait avec ses propres troupes. On ne peut pas attendre grand'chose, de ce point de vue, ni des Américains, ni des Russes, ni des Chinois... Si les Britanniques et les Français ne s'engagent pas, on en reste immanquablement à la relative impuissance des Nations unies qui ne lui permet que de recourir à l'OTAN, dès lors qu'il n'y a pas un accord complet des parties en cause. Elle peut, parfois « maintenir la paix » ; elle ne peut certainement pas « l'établir ». Cela suffit-il à nous faire participer en l'absence de réformes profondes ?. La Mission d'information, après quelques hésitations, pense que oui. Il y va de notre influence dans le monde et de la protection des populations civiles. Mais à plus long terme, seule une évolution vers des forces régionales vraiment efficaces permettra ce saut qualitatif qu'attend la société civile et dont se fait le porte-parole le Secrétaire général des Nations unies. Sur le plan de la gestion interne de nos personnels, il est vraisemblable qu'une communication plus efficace - plus de transparence et moins de langue de bois - aurait évité en Bosnie, comme au Rwanda, des accusations particulièrement graves et souvent infamantes à l'endroit de nos soldats. On peut penser que la tradition qui veut que les chefs militaires ne s'expriment pas publiquement a atteint ses limites : sans doute une certaine liberté de parole - qui restera quoi qu'il en soit toute relative - devrait être acceptée par l'institution. S'agissant du renseignement, il est clair que les Nations unies doivent se doter de moyens de renseignement adéquats, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent créer leur propre service de renseignement, ce qui relève de l'illusion. Mais l'ONU doit reconnaître la légitimité du renseignement, permettant ainsi aux contingents de mieux échanger les informations résultants du renseignement qu'il font malgré l'interdiction de principe. S'agissant de l'information de New York, la question est plus difficile, tant les conditions de fonctionnement du Département des opérations de maintien de la paix sont éloignées de celles d'un véritable état-major. 2) Pour une politique du renseignement à la hauteur des engagements extérieurs de la France Les événements de Srebrenica ont crûment mis en exergue les failles du dispositif de renseignement français, au-delà des carences complètes de l'ONU dans ce domaine. Il est vrai qu'en 1995, la France est à peine en mesure de tirer parti de la vigoureuse politique initiée en matière de renseignement militaire après la guerre du Golfe. D'une part, la Direction du renseignement militaire (DRM), créée en 1992, est encore en période de rodage lorsque la France s'engage dans le conflit yougoslave, qui constitue bel et bien pour elle un baptême du feu. Or, peut-être plus que dans d'autres secteurs, dans le petit - mais complexe - monde du renseignement international, le respect et la confiance se gagnent et ne sont en aucun cas acquis d'avance. D'autre part, d'un point de vue strictement technique, le satellite Helios I A est opérationnel seulement le 11 octobre 1995. Sur ces deux points, force est de reconnaître que les constats de carence dressés au cours du rapport se sont, pour la plupart, largement atténués depuis. Sur le plan technique tout d'abord, qui est le plus facile à évaluer car reposant sur des réalisations concrètes, la France en est à la deuxième génération de satellite avec Helios 2, dont les caractéristiques ont d'ailleurs été définies dès 1994. Il n'y a pas lieu de revenir dans ce rapport sur les multiples péripéties de ce programme qui devrait conduire au lancement du premier exemplaire disponible en mars 2004. Reste que ce programme, qui devait initialement être mené en coopération avec l'Allemagne et l'Italie - qui lui ont finalement préféré l'option de l'observation radar - est révélateur des difficultés de la coopération dans un domaine étroitement lié à la souveraineté et préfigure mal de ce que pourrait être une coopération européenne plus large dans le domaine du renseignement satellitaire, notamment en cas de projection sur un théâtre de capacités européennes dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense. Certes, les aléas du programme Helios 2 n'ont pas tué la coopération européenne dans le domaine spatial militaire puisqu'au lieu d'une mutualisation de la réalisation des moyens satellitaires, on s'oriente vers une mise en commun des capacités et vers un usage opérationnel commun de filières nationales spécialisées. Néanmoins, les pays européens engagés dans la constitution de capacités militaires communes doivent prendre conscience du caractère fondamental de la coordination du renseignement en cas de déploiement sur des théâtres d'opérations : Srebrenica a montré a contrario que, sans structure de renseignement commune, une force multinationale est potentiellement paralysée et amputée d'une partie de ses capacités opérationnelles. S'agissant du dispositif institutionnel français, l'évaluation est plus délicate, notamment du fait que le Parlement ne dispose pas, à ce jour, des moyens d'évaluer le rôle et l'efficacité des services de renseignement français. A cet égard, la Mission d'information estime qu'il serait sans doute utile que des contacts sereins et réguliers soient établis entre le Parlement et les services, afin qu'un dialogue fructueux soit noué et que le rôle des services ne soit pas seulement examiné à l'occasion d'événements mettant en exergue leurs failles ou leurs carences. La forme institutionnelle que prendrait un tel dialogue reste à définir, même si des propositions ont été faites en la matière par la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale qui a approuvé une proposition de loi sur ce sujet, cosignée, à une exception près, par l'ensemble des groupes politiques. Peut-être, alors que les événements du 11 septembre 2001 ont mis en avant la nécessité de disposer de services de renseignement efficaces pour protéger le territoire national, alors que Srebrenica avait montré qu'intervenir sur un théâtre extérieur devait avant tout signifier protéger les populations civiles locales, est-il temps de réfléchir à nouveau à la mise en oeuvre d'un dispositif d'évaluation de l'action des services. Sera-t-il possible un jour de comprendre Srebrenica ? Sans doute pas totalement, dans la mesure où une partie des événements qui s'y sont déroulés échappera toujours aux capacités de compréhension de l'esprit humain. Et pourtant, pour les victimes comme pour les survivants, il n'est pas possible de laisser sans réponse ou de ne pas chercher la réponse aux questions qui hantent la conscience européenne et internationale depuis plus de six ans aujourd'hui. Tel est l'objectif que s'est assigné la Mission d'information : le but de ses membres, de tous ses membres, n'est en effet pas de se poser en procureurs, en juges ou en historiens ; il est, comme c'est leur devoir de parlementaires, de participer autant que possible à la recherche de la vérité et de fournir à nos concitoyens le maximum d'informations sur l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire européenne des cinquante dernières années. * Cette Mission a travaillé pendant neuf mois sans manichéisme ni préjugés : il ne s'agissait pour elle ni d'accuser ni, au contraire, d'exonérer a priori. Les membres de la Mission d'information se sont constamment donné pour tâche de faire la lumière sur ces événements, sur la base de méthodes de travail rigoureuses. Aussi la Mission d'information s'est-elle appuyée sur des documents objectifs (auditions, notes des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, rapports de l'ONU, déclarations publiques et articles de presse de l'époque, etc.), dont beaucoup sont présentés en annexe du présent rapport. Nul doute que les historiens sauront demain en faire usage, afin, notamment, que les questions qui restent sans réponse puissent être un jour résolues. L'honnêteté intellectuelle a pu conduire les membres de la Mission d'information à reconnaître que, sur tel ou tel point, ils n'étaient pas en mesure d'apporter de certitudes absolues. A cet égard, peut-être l'accès à certaines sources, à certains documents, eût-il grandement facilité le travail du Parlement. Tous les membres de la Mission d'information ne peuvent que répéter leurs regrets de n'avoir pas pu auditionner certains témoins, tels que le général Rupert Smith, commandant à l'époque la FORPRONU, ou Mme Sadako Ogata, qui était responsable du HCR, qui ont refusé de venir témoigner. De même, ils estiment que la rétention d'informations dont l'ONU a souvent fait preuve face aux différentes demandes qu'ils ont formulées n'est pas conforme à l'esprit qui avait pourtant guidé cette institution dans le rapport en forme de mea culpa qu'avait fait M. Kofi Annan en 1999. Quant à l'OTAN, elle a systématiquement opposé une fin de non-recevoir aux demandes de la Mission d'information. Au plan national, faut-il redire combien la Mission d'information regrette l'attitude du ministère de la Défense qui a refusé l'audition ouverte de témoins clés et a suivi une ligne plutôt floue dans sa politique de communication des documents ? Si la Mission d'information se réjouit d'avoir obtenu une partie des notes internes du ministère, qu'elle avait demandées, elle s'étonne tout autant d'avoir reçu des documents sans doute de valeur, mais assez peu utiles à ses travaux. Heureusement, ces manques ont pu être palliés, dans certains cas, par la collaboration de certaines organisations non gouvernementales. * Au terme de ses recherches, la Mission d'information est aujourd'hui en mesure d'éclairer la difficile question des responsabilités dans la chute de Srebrenica. Car c'est bien en ces termes que la question se pose : comme l'a rappelé le maire bosniaque de Srebrenica, M. Sefket Hafizovic, avec une justesse et une lucidité qu'il faut saluer au regard de la difficulté de la tâche qui est aujourd'hui la sienne, il faut établir la chaîne et la hiérarchie des responsabilités dans la tragédie de Srebrenica. Non qu'il s'agisse de se réfugier derrière une responsabilité générale qui conduirait à diluer les vraies responsabilités, comme l'a d'ailleurs souligné M. Hafizovic. A cet égard, la Mission d'information souhaite rappeler que le seul fait qu'elle ait été constituée montre que les parlementaires sont pleinement disposés, quand il en est besoin, à examiner la pertinence des choix effectués par notre pays dans la conduite de sa politique étrangère passée. En cela, le travail de la Mission d'information ne s'inscrit nullement dans une démarche d'auto-flagellation, mais dans une tradition de responsabilité qui fait honneur à la patrie des droits de l'Homme et que nous devons aujourd'hui aux victimes de Srebrenica. Car en faisant la lumière sur le rôle de la France dans la tragédie de Srebrenica, le Parlement entend avant tout exprimer sa compassion pour les victimes innocentes, civiles dans leur grande majorité, d'un conflit barbare. Et, de cette barbarie, des responsables Bosno-Serbes sont les coupables. Cette vérité doit être rappelée, à l'heure où le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie vient de condamner le général Krstic pour génocide : à Srebrenica, ce sont des Bosno-Serbes qui ont systématiquement massacré les hommes, Bosniaques musulmans, de Srebrenica. Il ne s'agit pas, conformément au principe qui vient d'être rappelé, de faire porter la responsabilité du massacre de Srebrenica sur tous les Serbes : pour avoir rencontré les membres serbes de l'équipe municipale de Srebrenica, les membres de la Mission d'information peuvent témoigner de leur volonté réelle de redonner vie à cette ville meurtrie de l'Est de la Bosnie. Mais le fait demeure qu'à Srebrenica, l'agresseur était serbe. C'est d'ailleurs quand la France a clairement désigné qui étaient, dans ce conflit, l'agresseur et l'agressé, qu'elle a décidé de se doter des moyens de véritablement riposter, d'abord en créant, puis en modifiant la mission de la Force de réaction rapide, quand la FORPRONU se montrait, pour sa part, pusillanime vis-à-vis des agresseurs. Au-delà de la culpabilité première, comment s'établit la chaîne des responsabilités dans les événements de Srebrenica ? Pour répondre à cette question, il convient de distinguer trois niveaux : les hommes, les structures et, enfin, les Etats qui les font fonctionner. · Qu'en est-il, tout d'abord, de la responsabilité des personnes impliquées dans la gestion de la crise de Srebrenica ? Si la France a été et reste directement visée, c'est notamment à travers celui qui était alors le commandant des Forces de paix des Nations unies (FPNU) en ex-Yougoslavie, le général Bernard Janvier. Etant donné l'horreur des actes perpétrés, qui ne peut comprendre la réaction des survivants qui pointent un doigt accusateur sur tel ou tel, surtout quand ils ne connaîtront probablement jamais le visage de l'homme qui a effectivement assassiné leur père, leur mari, leur fils ou leur frère ? La vertu cathartique du bouc émissaire n'est pas nouvelle. La Mission d'information ne prétend nullement poser en a priori l'infaillibilité d'un général français : il est même de son devoir d'examiner en toute objectivité et en toute rigueur, l'ensemble des accusations portées. Ainsi, elle décrit les erreurs d'appréciation commises par le général Janvier, puisqu'il est aujourd'hui le principal visé. Nul doute que les atermoiements du commandant de la force de l'ONU, l'erreur manifeste du jugement porté à l'égard de son interlocuteur, le général Mladic, ont joué un rôle dans le drame, de même que le rejet par le général Nicolai des demandes d'appui aérien antérieures au 9 juillet, qui ne parviendront jamais jusqu'à Zagreb. Notamment, le 10 juillet au soir, le général Janvier aurait dû déclencher l'appui aérien rapproché puisqu'étaient réunies toutes les conditions, extrêmement restrictives pourtant, posées par les textes au déclenchement de cette procédure. Les Casques bleus avaient été directement attaqués, un ultimatum avait été donné aux Serbes, qui l'ont violé. La majorité des membres de la Mission d'information réfute pour autant la thèse selon laquelle le général Janvier aurait négocié avec le général Mladic l'absence de frappes aériennes contre la libération des otages français détenus par les Serbes. Il y a certes eu négociation pour libérer les otages français - quel Gouvernement ne l'aurait pas fait ? - mais elles ont été menées par un canal différent. En l'occurrence, c'est le général de la Presle qui en fut l'exécutant opérationnel, en dehors de toute chaîne onusienne et dans un cadre strictement national. Mais, répétons-le, la majorité des membres de la Mission d'information a la conviction que le général Janvier n'a pas accédé aux demandes du 4 juin, présentées par Mladic, à Zvornik. En était-il besoin d'ailleurs, quand, de toute façon, l'ONU s'était d'elle-même imposée des restrictions drastiques quant à l'usage de l'arme aérienne ? Par ailleurs, si l'on montre du doigt quelques individus, il faut être exhaustif : le général Janvier était certes à la tête du bras militaire de l'ONU en ex-Yougoslavie mais, d'une part, il n'était pas le seul à exercer des responsabilités opérationnelles, et, d'autre part, dans le système hiérarchique aussi lourd que l'est la structure onusienne, il faut prendre en compte l'ensemble des maillons de la chaîne. Plus encore en vertu du caractère multinational de la force, il serait naïf de croire à l'existence d'une seule chaîne, exclusivement onusienne. Les membres de la Mission d'information ont pu constater l'intervention et l'interaction systématiques des chaînes de commandement nationales, totalement officieuses, mais bel et bien présentes. Comment occulter par conséquent les erreurs commises sur le terrain par le bataillon néerlandais ? Le fait est là, troublant : à aucun moment, le bataillon néerlandais présent à Srebrenica n'a opposé une quelconque résistance aux Serbes. Ce fait a d'ailleurs été relevé par les Néerlandais eux-mêmes qui, aussitôt après les faits, avaient déclenché une enquête pour comprendre les causes de cette débâcle et qui, aujourd'hui, suite aux critiques intérieures adressées à cette première enquête, travaillent encore à élucider, entre autres, cette question. La Mission d'information n'a pas à se prononcer sur les éventuelles insuffisances des soldats du Dutchbat à Srebrenica. Nul doute que l'épuisement et la tension nerveuse de jeunes hommes en sous effectif constant - dont un est tué lors de la chute de l'enclave - sur le point de regagner leur pays devaient être à leur comble. Reste que les soldats néerlandais ont probablement commis une erreur tactique, aux conséquences majeures sur la psychologie des Serbes, en n'opposant absolument aucune résistance, en refusant aux Bosniaques le droit de se battre, voire en démantelant le faible dispositif défensif bosniaque et, enfin, en devenant des otages potentiels, quand ils eurent véritablement le choix de regagner Srebrenica, au lieu d'être faits prisonniers et transférés en dehors de l'enclave. Ces soldats manqueront cruellement quand il s'agira de « contrôler » l'évacuation des réfugiés. Il faut également mentionner l'attitude pour le moins discutable des forces néerlandaises, qui tairont les massacres dont elles furent témoins. Si l'on remonte la chaîne néerlandaise, il faut mentionner par ailleurs ce qu'il faut bien appeler le « cafouillage » des officiers néerlandais à Tuzla. La Mission d'information note en outre l'étonnante absence de deux officiers britanniques à ce moment-clé, le général Rupert Smith, commandant de la FORPRONU, ainsi que l'officier de liaison avec l'OTAN détaché auprès du général Janvier. Notamment, si elle comprend que, le 1er juillet, le général Rupert Smith parte en permission, elle comprend moins bien pourquoi le responsable de la FORPRONU ne se manifeste à aucun moment de la crise. Cette question importante, tous les membres de la Mission d'information auraient souhaité la poser directement à l'intéressé... De même qu'ils auraient aimé lui demander quelle avait été la teneur de ses conversations avec le général Mladic, qu'il rencontre à deux reprises, le 15 et le 19 juillet 1995. Au plus haut de la chaîne onusienne, il faut enfin mentionner la carence de M. Yasushi Akashi, constatée par la quasi-unanimité des témoins auditionnés par la Mission d'information. Ainsi, le compte rendu de situation qu'il fait aux membres du Conseil de sécurité le 10 juillet, est pour le moins contestable, tant il est en retrait par rapport à la situation sur le terrain. Quand il n'est pas tout simplement erroné : lorsqu'il indique que les Bosniaques bombardent un véhicule hollandais, sans corriger immédiatement cette donnée lorsqu'il s'avère que les Néerlandais ont donné une fausse information. De même, la Mission d'information relève l'étonnante inertie des dirigeants du HCR. · Si aucun des protagonistes n'échappe à la critique, tant les erreurs tactiques et opérationnelles se sont multipliées sur le terrain, la Mission d'information n'oublie pas que, derrière les hommes, même derrière ceux qui commandaient, existaient une structure et des Etats ; et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut examiner pour tenter de comprendre ce qui s'est passé en juillet 1995. Même si l'ONU n'est qu'un instrument au service des Etats, il n'en reste pas moins qu'au moment où elle intervient en ex-Yougoslavie, cinquante années d'expérience ont forgé des habitudes, des comportements, en bref, une culture institutionnelle spécifique. Tous les contingents nationaux sur place ont été frappés par la culture très particulière des structures de l'ONU qui, même dans les cas de légitime défense, même face aux provocations patentes des forces serbes bloquant les convois, étaient obsédées par un impératif : rester neutre, ne pas donner l'impression de s'engager en faveur de l'une ou l'autre partie au conflit. Or, cette culture institutionnelle, les responsables civils de l'ONU, les instances représentant les Etats, ne tentèrent à aucun moment de la remettre en cause, en tirant les conséquences d'une situation manifestement inédite qui n'avait rien à voir avec le maintien de la paix traditionnel. Elle fut au contraire constamment revendiquée et rappelée aux responsables militaires qui s'y sont plus ou moins pliés. Si l'on ajoute à cette culture inadaptée au terrain de l'ex-Yougoslavie, une chaîne de commandement et des procédures aussi lourdes que complexes, on comprend dès lors mieux l'absence de réactivité de l'ONU face à une crise rapide comme celle de Srebrenica. Cela dit, comme il a été souligné, cette responsabilité de la structure onusienne trouve rapidement ses limites : l'ONU est un outil actionné par les Etats qui en sont membres. Elle ne fait que mettre en oeuvre ou, en l'occurrence, tenter de le faire, les missions qui lui sont assignées par les Etats, au premier rang d'entre eux les membres du Conseil de sécurité. Or, la politique que les Etats-membres de l'ONU, à commencer par la France et la Grande-Bretagne, lui ont demandé d'appliquer en Bosnie, était marquée par le fléau des ambiguïtés. Pendant plus de trois ans, les Nations unies se sont, en réalité, efforcées d'accomplir une mission impossible : maintenir une paix qui n'existait pas dans une logique strictement humanitaire. Par conséquent, à aucun moment, l'opération de « maintien de la paix » en ex-Yougoslavie n'a eu pour objectif de s'opposer à l'une des parties ou de stopper le conflit, le seul but étant d'en atténuer les conséquences négatives sur les populations. La FORPRONU est intervenue physiquement, mais jamais militairement. Nul besoin de souligner combien l'ambiguïté de cette politique a pesé sur le terrain, les militaires devant, en quelque sorte, traduire clairement sur le plan opérationnel des directives pour le moins floues. C'est au travers de la politique des zones de sécurité que ces carences politiques sont apparues le plus nettement. Le concept des zones de sécurité était-il, en lui-même, voué à l'échec ? En bref, la tragédie de Srebrenica est-elle inscrite dans les résolutions de l'ONU ? A l'issue de ses travaux, la Mission d'information estime que c'est, non pas dans le principe lui-même, mais dans l'application qui en a été faite, et notamment dans les moyens qui ont été refusés aux zones de sécurité, qu'il faut chercher une partie des racines du drame de Srebrenica. Tous les militaires entendus par la Mission d'information ont d'ailleurs soutenu la thèse de l'indéfendabilité des enclaves en l'absence de moyens adéquats. Depuis, à l'initiative du Secrétaire général, l'ONU a tiré les leçons de l'échec de Srebrenica en commençant à mettre en oeuvre les mesures proposées dans le rapport Brahimi. L'échec des Nations unies à Srebrenica est donc avant toute chose l'échec des Etats qui ont pris des engagements, notamment au sein du Conseil de sécurité, qu'ils n'ont pas respectés, faute de s'en donner les moyens. La raison de fond de la chute de Srebrenica est à rechercher dans l'absence de volonté politique affirmée d'intervenir à Srebrenica : de la France, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, des autorités bosniaques de Sarajevo elles-mêmes. L'enchaînement complexe des faits ne doit pas occulter cette réalité très simple : seule la volonté politique des acteurs internationaux, au moins des deux grandes puissances militaires directement impliquées dans la gestion du conflit sur le terrain, à savoir la France et le Royaume-Uni, pouvait véritablement faire basculer l'intervention internationale de l'autodéfense de la FORPRONU à la défense des zones de sécurité. La volonté politique qui a fait défaut à Srebrenica est la même qui a fait défaut aux Gouvernements occidentaux tout au long du conflit yougoslave : les Etats européens sont intervenus en Bosnie-Herzégovine parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas intervenir. Srebrenica représente un concentré de cette action a minima : à défaut d'agir avant, de réagir pendant et de s'entendre sur ce qu'il faut faire après, les Etats européens, notamment la France et le Royaume-Uni, se rabattent sur l'option humanitaire. La chute de Srebrenica n'est-elle toutefois que l'aboutissement, tragique certes mais somme toute logique, d'une politique de demi-mesures ? Ne serait-elle pas au contraire le fruit d'un calcul ô combien politique visant à simplifier la négociation diplomatique en clarifiant la carte ethnique de la Bosnie-Herzégovine ? En un mot, Srebrenica est-elle tombée au nom d'une raison d'Etat qui se serait trouvée à Paris, à Londres, à Washington et même à Sarajevo ? La question est choquante mais l'ignorer le serait plus encore. Il n'est qu'à regarder les cartes de la Bosnie-Herzégovine avant et après le mois de juillet 1995, ainsi que la chronologie des faits : quatre mois après Srebrenica, les frères ennemis parviennent à un accord de partage du territoire bosniaque qui correspond grosso modo aux résultats de leurs victoires militaires. Alimente également cette thèse le fait qu'à peine Srebrenica tombée, alors que les soupçons s'accroissent sur un « nettoyage ethnique » massif à Srebrenica, l'ensemble des chancelleries occidentales fait son deuil de Zepa. « Boulets » en termes opérationnels, car indéfendables selon les militaires, les zones de sécurité représentaient incontestablement des obstacles au plan de paix aux yeux de tous les acteurs. Ces constats ne suffisent cependant pas à nourrir la thèse d'un complot international contre Srebrenica ; mais elles font peser sur les Etats impliqués - France, Royaume-Uni, Etats-Unis et Gouvernement bosniaque - le soupçon du cynisme ou pour le moins d'une forme de renoncement. Certes, aucun d'entre eux n'a activement favorisé la disparition des enclaves mais aucun d'entre eux non plus n'a cherché à empêcher les Serbes d'atteindre ce qu'on savait être des buts de guerre essentiels à leurs yeux. Aucun des Etats impliqués dans le règlement du conflit bosniaque n'a voulu sauver Srebrenica, sans qu'existe pour autant de conspiration. Dans ce contexte, l'attitude des autorités bosniaques suscite quelques questions. Au nombre des multiples interrogations qui entourent la chute de Srebrenica figure celle de savoir si Sarajevo, non seulement n'a pas cherché à aider les combattants de Srebrenica et a, comme les Gouvernements occidentaux, accepté le fait accompli, mais n'a pas également secrètement négocié en amont la chute de l'enclave avec les Serbes. Là encore, la question est détestable, plus encore dans la mesure où les victimes de Srebrenica sont, elles aussi, bosniaques. La Mission d'information se doit néanmoins, à l'instar de M. Kofi Annan d'ailleurs, de la poser, d'autant que cette thèse a été propagée par des Bosniaques eux-mêmes. C'est notamment le fait que le charismatique défenseur de Srebrenica, Naser Oric, a reçu l'ordre de Sarajevo de quitter l'enclave deux mois avant la chute, de même qu'une partie de son état-major, qui n'a pas manqué de nourrir l'hypothèse d'un complot de la part du Gouvernement bosniaque. En effet, celui-ci ne pouvait pas ignorer que cela revenait à décapiter le commandement des troupes de l'enclave, donc à les affaiblir considérablement. Quel aurait été l'intérêt du Gouvernement bosniaque à abandonner Srebrenica ? Selon les partisans de cette thèse, l'enclave orientale aurait fait l'objet d'un échange contre les faubourgs serbes de Sarajevo. D'autres avancent l'argument selon lequel les autorités bosniaques voulaient provoquer une intervention de l'ensemble des pays occidentaux, y compris des Etats-Unis, à leur côté en Bosnie-Herzégovine, ne fût-ce que sous la forme de la levée de l'embargo sur les armes qui signifiait en réalité un soutien américain actif et un retrait de la FORPRONU. Le Président Alija Izetbegovic a nié l'ensemble de ces accusations. En l'absence de preuve, la Mission d'information n'est pas en mesure de trancher sur cette question. · Les analyses relatives à la responsabilité des Etats à travers l'ONU et aux responsabilités particulières de chacun des acteurs de la crise montrent que la France n'est pas moins que le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou les Pays-Bas responsable de la chute tragique de la zone de sécurité de Srebrenica. L'est-elle plus ? Existe-t-il une responsabilité générale des autorités françaises, au-delà de la responsabilité opérationnelle des militaires présents sur le terrain ? Les reproches formulés à l'encontre d'un officier supérieur français ne doivent en effet pas faire oublier qu'in fine, en démocratie, la responsabilité est politique et que les militaires sont au service d'une politique qui est définie par des responsables élus. Au-delà de ces polémiques, le rôle de la France dans les événements de Srebrenica mérite de toute façon un examen spécifique. En effet, dans la mesure où la France a assumé un rôle majeur dans la crise bosniaque, au triple titre de membre du Conseil de sécurité des Nations unies, membre du Groupe de contact et plus gros contributeur de troupes, le bilan global de l'action internationale en ex-Yougoslavie n'est-il pas également celui de la politique française en ce domaine ? Ce bilan, la Mission d'information ne peut pas ne pas en évoquer les points positifs, alors que 56 jeunes soldats français ont perdu la vie dans ce conflit et que des centaines d'entre eux sont à jamais marqués dans leur chair. La France n'a, en effet, jamais adopté la doctrine du zéro mort. Il est indéniable que l'intervention de la France, en dépit de toutes les limites qui ont été soulignées précédemment, a permis de sauver des milliers de vies. Rappelons qu'à l'époque, l'alternative, notamment soutenue par les Etats-Unis, consistait à lever l'embargo et à laisser les protagonistes s'affronter. Le droit d'ingérence n'en finit certes pas de susciter de nombreuses questions, mais personne ne peut nier que, dans ces pays, à cette époque, il a permis de sauver des vies. En outre, même si Srebrenica a signé l'échec de la politique des zones de sécurité, il ne faut pas oublier que les deux zones défendues par des troupes françaises, Bihac et Sarajevo, ont été préservées jusqu'au bout. Cependant, aucun de ces faits ne peut faire oublier Srebrenica. Car, du fait du triple rôle de la France dans le conflit, nul doute que Srebrenica, qui pèse d'un poids très lourd dans le bilan, est aussi un échec de la France. D'emblée, la France ne s'est pas donné tous les moyens de mener à bien sa mission sur le terrain. Certes, la création de la Force de réaction rapide en mai 1995 montre que le Président de la République et les autorités gouvernementales ont pris la mesure de ces insuffisances. Mais au moment de la crise de Srebrenica, alors que la Force de réaction rapide n'est que partiellement opérationnelle, et de toute façon destinée à être déployée à Sarajevo, ce sont les limites du dispositif français de renseignement qui sont apparues. Non seulement la focalisation des moyens sur Sarajevo mais également les lacunes du système en matière de collecte et de transmission du renseignement ont pesé lourd sur le niveau d'information du général Janvier comme des responsables civils et militaires du ministère de la Défense. Ces faiblesses se sont traduites par un décalage permanent entre la réalité des événements sur le terrain et l'information des responsables. Ce sentiment pénible d'un retard permanent des acteurs sur les faits, la Mission d'information l'a éprouvé tout au long de ses travaux. A Srebrenica même, non seulement le contingent néerlandais n'a jamais su anticiper les actions des Serbes, mais plus encore, faute de comprendre ce qui se passait, il était en retard sur l'événement. Ce décalage entre les faits et leur perception s'est répercuté à tous les stades de la chaîne de commandement, en s'amplifiant toujours davantage au fur et à mesure qu'on s'éloignait du théâtre de la crise. Nul besoin de souligner dès lors la médiocrité de l'information reçue à Paris. S'agissant de l'arme aérienne, comment expliquer la réticence du général Janvier à l'engager ? Comme il a été indiqué précédemment, la majorité des membres de la Mission d'information ne croit pas à la thèse d'un marchandage entre les généraux Janvier et Mladic. Reste que réfuter la thèse d'un marchandage « frappes contre otages » ne répond pas à la question de savoir pourquoi le général Janvier n'a pas, comme il aurait dû le faire, déclenché le recours à l'appui aérien défensif dès le 10 juillet. La Mission d'information a bien compris des auditions qu'elle a menées l'extrême complexité technique et opérationnelle de l'emploi de l'arme aérienne. Mais elle est également convaincue, au-delà des questions de procédure, qu'en effectuant des frappes massives sur la route Sud, la seule qui menait à Srebrenica, l'ONU et l'OTAN auraient pu arrêter l'offensive. Elle s'est donc interrogée sur l'existence d'une culture particulière de la France en ce qui concerne le recours à l'arme aérienne. Pour expliquer l'attitude du général Janvier, il semble en effet beaucoup plus pertinent de comprendre qu'en plus de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a commise jusqu'au bout sur l'appréciation des intentions serbes, il a été l'homme d'une culture spécifique, d'une politique, sans avoir pour autant reçu d'instructions en ce sens. Les militaires français n'étaient pas opposés par principe à l'arme aérienne, qu'ils ont d'ailleurs utilisée pendant le conflit yougoslave. Mais, à l'instar d'ailleurs de certains de leurs collègues britanniques, ils y voyaient autant de risques pour les Casques bleus. Or, même sans être influencés par la culture du zéro mort, les responsables militaires français étaient obsédés par la protection de leurs hommes, ce qui est normal, au détriment de celle des populations civiles, ce qui pose problème. Ils étaient enfin d'autant moins favorables à l'arme aérienne que les avions étaient engagés par l'OTAN, c'est-à-dire dans le cadre d'une organisation dominée par un pays qui n'avait pas de troupes au sol car, en vertu de la doctrine du zéro mort, il avait délibérément privilégié la vie de ses soldats au détriment de celle des populations civiles de Bosnie. * La tentation est forte, six années après, de refaire l'Histoire. L'un des objectifs de la Mission d'information a consisté à rétablir les faits. Le lecteur du présent rapport devra les placer dans le contexte de l'époque. Il était difficile de prévoir, en juillet 1995, pour les observateurs, comme pour les responsables politiques ou militaires, l'effroyable et spécifique tragédie de la prise de la zone de sécurité : le massacre organisé, planifié, de tous les hommes musulmans. Comme l'ont rapporté certaines personnalités auditionnées, on pouvait craindre « que des exactions contre les populations civiles puissent être commises. » Des « exactions » qui ont été le quotidien d'une guerre de trois ans qui a fait plus de 200 000 morts. Rappeler les faits, analyser le comportement de la communauté internationale, hiérarchiser les responsabilités sur la chute de Srebrenica, permet d'abord de comprendre ce que fut cette guerre odieuse. Mais les membres de la Mission d'information estiment pour leur part qu'ils avaient un autre devoir : tenter de faire la vérité pour que l'hommage qu'elles méritent soit rendu aux 7 000 à 8 000 victimes de Srebrenica et que les survivants puissent, enfin, essayer de vivre. Car les victimes de Srebrenica méritent la vérité, non la polémique, la démagogie ou le manichéisme. Si l'ONU hier, en lançant une réforme profonde de ses interventions, si la France aujourd'hui, si les Pays-Bas demain veulent participer à l'oeuvre de vérité sur Srebrenica, c'est en effet pour que la ville blessée, sinistrée, puisse panser ses plaies et fonctionner, économiquement, socialement et politiquement, comme une ville normale. Et pour que les habitants de l'enclave puissent enfin commencer l'indispensable travail de deuil. Nul doute que l'inculpation de Milosevic à La Haye va les y aider. Encore faut-il qu'elle soit suivie de celle de Ratko Mladic et Radovan Karadzic dans les plus brefs délais : la Mission d'information exige que Français, Britanniques et Américains, notamment, consacrent les moyens nécessaires à la capture de ces criminels contre l'humanité. La Mission d'information a procédé à l'examen du rapport de MM. François Lamy et René André au cours de ses séances des jeudis 15 et 22 novembre. Le Président François Loncle a souligné la richesse de la documentation réunie par la Mission et dont une partie importante est publiée en annexe. La Mission a entendu 38 témoins au cours de six mois d'auditions en France et en Bosnie. Les auditions seront toutes publiées, y compris celles à huis clos. Malgré l'obligation dans laquelle s'est trouvée la Mission de changer de Rapporteur à la suite de la nomination de M. François Léotard comme Représentant de l'Union européenne en Macédoine, elle a pu mener à bien ses travaux sans interruption. Après l'exposé des Rapporteurs une discussion s'est engagée. Mme Marie-Hélène Aubert et M. Pierre Brana ont observé qu'aucun élément ne permettait d'exclure qu'un accord avait été conclu entre les généraux Janvier et Mladic sur l'absence de frappes aériennes, suite aux propositions présentées par le général Mladic le 4 juin 1995 à Zvornik. Au demeurant, même en l'absence d'un tel accord, il ne peut être exclu qu'un accord ait eu lieu ayant le même objet, entre des responsables français et la partie serbe. En conséquence, ils ne peuvent partager la conviction exprimée par les Rapporteurs. Les Rapporteurs ont estimé qu'à ce stade on ne pouvait affirmer qu'une seule chose, à savoir que le général Janvier n'avait pas accédé aux demandes présentées le 4 juin 1995 par le général Mladic. La majorité des membres de la Mission a approuvé le point de vue des Rapporteurs. Ensuite M. Pierre Brana a regretté que le terme de génocide n'ait pas été explicitement employé à l'encontre de Mladic et Karadzic, alors même que le général Krstic a été condamné par le TPIY pour ce crime le 2 août 2001. Les Rapporteurs ont fait remarquer qu'il appartenait aux tribunaux et à eux seuls de qualifier juridiquement la nature des crimes commis. Au demeurant le génocide est inclus dans la notion de crime contre l'humanité à laquelle se réfère le rapport. Après que de nombreuses modifications eurent été apportées au projet de rapport, la Mission d'information a alors adopté le rapport d'information à l'unanimité et a autorisé sa publication ainsi que de deux lettres complémentaires de membres de la Mission d'information.
ANNEXE I : COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Communiqué du ministère de la Défense en date du 24 janvier 2001 demandant le huis clos pour les auditions des généraux Bernard Janvier et Philippe Morillon Les Commissions des Affaires étrangères et de la Défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale ont décidé de créer une mission d'information parlementaire sur les événements de Srebrenica du mois de juillet 1995. Le Gouvernement a indiqué qu'il apporterait tout son concours au travail de la mission. Tous les agents, civils et militaires, dont l'audition sera demandée, seront ainsi auditionnés par la mission. Certains d'entre eux l'ont déjà été par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La France apporte en effet son plein et entier concours à ce tribunal pour lui permettre de réunir tous les élément nécessaires à sa mission de juger les auteurs de différents crimes atroces commis en ex-Yougoslavie. A cet effet, une trentaine de militaires français dont plusieurs officiers généraux ont déjà été auditionnés, notamment à la demande des équipes du procureur du TPIY. Ces auditions se sont, dans des modalités définies avec le procureur, tenues à huis clos. Elles visent à fournir toute information contre des présumés criminels déjà arrêtés ou contre des personnes faisant l'objet d'acte d'accusation secret. Dans ce cadre, il est nécessaire que les agents publics devant être auditionnés par la mission parlementaire et dont la coopération est requise par le TPIY le soient selon des modalités analogues à celles définies avec le tribunal. C'est pourquoi, le ministère de la Défense a demandé au Président de la mission d'information parlementaire que les auditions des généraux Janvier et Morillon soient faites à huis clos. Ces modalités doivent permettre à la mission d'information de poursuivre ses travaux tout en permettant au TPIY de conduire également son action. La volonté du Gouvernement est de donner à chacune de ces instances les moyens de travailler à la manifestation de la vérité et de la compréhension des événements de Srebrenica. ANNEXE VI : PROGRAMME DU DÉPLACEMENT Mercredi 27 juin 2001 16 h 30 Entretien avec M. Sead Avdic, Président de la Chambre des représentants de Bosnie-Herzégovine 17 h 30 Entretien avec des représentants des associations « Mères de Srebrenica et Podrinje », de « Srebrenica 99 » et de « Mères des enclaves de Srebrenica et Podrinje » 20 h 30 Dîner à la résidence de l'ambassadeur de France, en présence de : - Jacques-Paul Klein, chef de la mission des Nations unies en Bosnie - Robert Beecroft, chef de la mission de l'OSCE en Bosnie-Herzégovine - Général de Goësbriand, commandant adjoint de la SFOR - Jan van Hecke, chef du bureau du TPIY en Bosnie-Herzégovine - Robert van Lanschot, conseiller politique du général Dodson, commandant de la SFOR - John Crews, représentant de l'ICMP (International commission for missing persons) - Celhia de Lavarène, chargée de mission auprès de l'ambassadeur Klein Jeudi 28 juin 2001 8 h 45 Départ en bus pour Srebrenica, en présence de M. Jean Gagnon, enquêteur du TPY 11 h 15 Entretien avec M. Sefket Hafizovic, maire de Srebrenica 12 h 15 Entretien et déjeuner avec des représentants des autorités municipales de Srebrenica et les représentants de la communauté internationale : - M. Sefket Hafizovic, maire de Srebrenica - Mme Milka Rankic, adjointe au maire de Srebrenica - M. Desnica Radjivojevic, président de l'assemblée municipale de Srebrenica - M. Charlie Powell, envoyé spécial du bureau du Haut représentant à Srebrenica - Mme Nan Burns, représentante de la Mission des Nations unies à Srebrenica - M. Philippe Leduc, chef des stations de police de Srebrenica et Bratunac, groupement international de police - Capitaine Charles Bennett, responsable de la zone de Srebrenica, SFOR - M. Andreas Horst, représentant de l'OSCE à Srebrenica - M. Edward Soden, représentant de l'OSCE à Srebrenica - M. Marco Ferrero, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés à Srebrenica - Mme Sarah Rattray, représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés à Srebrenica - M. Jean Gagnon, enquêteur du TPIY - M. James Costello, enquêteur du TPIY 13 h 30 Visite de la zone sud de l'enclave en compagnie des agents du TPIY et du HCR, (lieu-dit Zeleni Jadar), des réfugiés bosniaques à Potocari, et de l'emplacement du monument commémoratif qui sera inauguré le 11 juillet 2001 16 h 30 Sous la direction de M. Jean Gagnon, départ en bus pour Potocari, Bratunac et les autres sites d'exhumation jusqu'à Zvornik et Tuzla (environ 100 km de Srebrenica) 18 h Arrivée à Tuzla. Visite du « Podrinje identification project » (lieu de rassemblement des restes exhumés des charniers autour de Srebrenica et d'identification des corps) Vendredi 29 juin 2001 10 h 30 Rencontre avec des représentants des associations « Femmes de Srebrenica » vers 12 h 30 Retour en hélicoptère à Sarajevo et déjeuner informel 15 h Entretien avec le général Jovan Divjak, général de l'armée régulière bosniaque 16 h 15 Entretien avec le général C_urderoy, commandant du groupement international de police 17 h 30 Entretien avec le Président Alija Izetbegovic 19 h 30 Conférence de presse 20 h 30 Dîner à la résidence de France avec les autorités de Bosnie-Herzégovine Samedi 30 juin 2001 8 h 30 Entretien avec M. Hasan Muratovic, ancien Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine 10 h Visite du musée du tunnel de Sarajevo avec le général Jovan Divjak 12 h Entretien et déjeuner avec M. Smail Cekic, Directeur de l'institut de recherche sur les crimes contre l'humanité et le droit international INDEX Akashi (Yasushi),6, 7, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 72, 94, 95, 98, 101, 117, 131, 133, 134, 140, 141, 146, 167, 169, 170, 176, 177, 186, 297, 322, 338, 341, 344, 381, 385, 393 Albright (Madeleine),43, 56, 57, 106, 112, 115, 147, 150 Annan (Kofi),5, 6, 7, 62, 63, 64, 74, 86, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 106, 111, 112, 113, 114, 136, 146, 149, 170, 172, 183, 188, 322, 341, 344, 381, 385 appui aérien rapproché (CAS),38, 39, 44, 45, 46, 63, 65, 66, 95, 99, 101, 130, 131, 138, 171, 185 Arbour (Louise),165 Arkan (Zeljko Raznjatovic),23, 30, 55 Badinter (Robert),15 Banja Luka,16, 23, 161 Becirovic (Ramiz),36, 89, 98 Bihac,15, 22, 28, 63, 80, 84, 112, 138, 189 Bildt (Carl),7, 36, 133, 156, 157, 159, 393 Blot (Jacques),157 Bonino (Mme Emma),148 Bosnjakovic (Mme Mirsada),50 Boutros-Ghali (Boutros),4, 6, 73, 74, 79, 110, 169, 172, 174, 243 Brahimi (Lakhdar),5, 170, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 187 Branjevo (ferme de),54, 55 Brantz (colonel),39, 71, 99 Bratunac,23, 24, 30, 40, 43, 49, 51, 52, 53, 54, 86, 101, 466, 467 Brcko,114, 156 Brezani (village de),24 Brioni (accords de),14 Briquemont (général Francis),27 Brsko,16 Butler (Richard),85 Casques bleus,17, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 62, 68, 77, 78, 88, 97, 103, 110, 130, 137, 145, 152, 153, 162, 167, 169, 170, 171, 173, 176, 178, 179, 185, 190 Cerska,17, 24, 51, 54 chapitre VI (de la Charte des Nations unies),21, 26, 74, 76, 103, 146, 169 chapitre VII (de la Charte des Nations unies),21, 26, 74, 76, 103, 146, 169 Charette (Hervé de),105, 116, 126, 135 Chirac (Jacques),104, 145, 146, 156 Christopher (Warren),156 CICR (Comité international de la Croix-Rouge),20, 32, 52, 72, 75, 91, 102, 149 Clark (général),134 Clinton (Bill),104, 146, 156 Conseil de sécurité,6, 7, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 45, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 87, 92, 98, 101, 102, 103, 106, 112, 115, 118, 122, 124, 126, 131, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 189, 217, 267, 322, 355 contrôleurs aériens avancés (FAC),47, 128 Cot (général Jean),6, 27, 64, 70, 113, 120, 121, 141, 142, 167, 243 Dayton (accords de),5, 55, 74, 114, 147, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 171 Dejammet (Alain),119 Délégation aux Affaires stratégiques (DAS),6, 7, 76, 77, 89, 138, 259, 315, 331, 417 Deliberate Force,122, 141 Delic (général Rasim),88, 90, 131 Deny Flight (opération),65, 66, 138 DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure),127 Dodson (général),168, 466 Domanovic (général),166 Drina (la rivière),22, 30, 54, 55, 83, 87, 95 Drina corps,34, 55, 87 DRM (Direction du renseignement militaire),72, 108, 126, 128, 181 Dubrovnik,46, 101 Dutchbat (bataillon néerlandais),33, 36, 39, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 116, 132, 136, 186 embargo (sur les armes),15, 77, 114, 122, 137, 139, 146, 154, 156, 189 Etats-Unis,6, 7, 56, 77, 81, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 127, 137, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 167, 175, 177, 178, 179, 187, 188, 189, 207, 419 Fakovici (village de),24 FORPRONU (Force de protection des Nations unies),7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 123, 125, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 152, 153, 167, 169, 171, 177, 178, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 389, 395 FPNU (Force de paix des Nations unies),6, 59, 60, 64, 65, 66, 73, 91, 101, 131, 171, 184, 243, 320 Franken (major Robert),49, 85, 101 frappes aériennes (Air Strike),6, 7, 34, 38, 39, 41, 42, 46, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 76, 77, 79, 85, 88, 99, 100, 106, 122, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 152, 153, 154, 155, 162, 171, 178, 185, 190, 193, 311, 417 FRR (Force de réaction rapide),62, 76, 105, 108, 109, 124, 125, 135, 139, 140, 141, 145, 146, 152, 153, 154, 157, 174, 184, 190 Germanos (général Raymond),87, 90, 108, 135, 140, 151, 153 Gharekan (représentant du Secrétaire général),45 Glogova (village de),24 Gobilliard (général Hervé),6, 36, 39, 40, 44, 45, 71, 133, 336 Gorazde,6, 16, 19, 21, 22, 39, 41, 48, 66, 76, 80, 83, 84, 85, 104, 105, 106, 107, 112, 138, 146, 153, 155, 259 Groupe de contact,10, 107, 118, 119, 124, 155, 158, 177, 178, 189 Halilovic (général Sefer),19, 20, 21, 22, 25 Hasanbegovic (Semsudin),148 HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés),3, 11, 17, 18, 20, 25, 26, 31, 32, 35, 46, 59, 75, 91, 116, 161, 164, 169, 171, 183, 186, 467 Heinrich (Jean),72, 84, 85, 86, 92, 108, 126, 127, 128, 129, 151, 166, 167 Helios (satellite),127 Hertzog (Gilles),94, 111 Holbrooke (Richard),112, 141, 155, 156, 178 Issinger (Wolfgang),157 Izetbegovic (Alija),20, 23, 50, 53, 89, 90, 113, 114, 155, 156, 189, 467 Jackson (Leigh),17 Jacolin (Henry),61, 162 Janvier (général Bernard),3, 6, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 59, 60, 64, 71, 76, 80, 84, 87, 88, 94, 95, 98, 100, 101, 113, 117, 118, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 154, 162, 185, 186, 190, 193, 198, 267, 297, 304, 334 Jorda (Claude),165 Joxe (Pierre),157 Juppé (Alain),63, 104, 108, 111, 120, 123, 124, 125, 135, 141, 145, 147, 155 Karadzic (Radovan),5, 7, 19, 33, 51, 128, 135, 154, 155, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 191, 193, 415 Karremans (colonel Thomas),7, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 71, 73, 83, 85, 86, 87, 89, 93, 98, 99, 100, 132, 142, 149, 350, 376, 379 Kinkel (Klaus),48 Kladanj,117 Knin (zone de),154 Kohl (Helmut),145 Koljevic (professeur Nicola),17, 135 Konjevic Polje,24 Krajina,14, 58, 145, 154, 155 Kravica,53 Krstic (général Radislav),9, 22, 34, 49, 85, 101, 102, 116, 117, 164, 165, 184, 193 La Presle (général Bertrand de),28, 63, 72, 113, 131, 135, 138, 141, 142, 157, 185 Ladsous (Hervé),21 Lanxade (amiral Jacques),61, 68, 93, 105, 108, 111, 121, 122, 124, 129, 141, 142, 151, 155, 166 Leighton Smith (amiral),132, 140, 154 Léotard (François),62, 63, 74, 120, 127, 137, 142, 165, 193 Levitte (Jean-David),104, 124, 126, 134, 145, 146, 152, 153, 155, 156 Livno (vallée de),112 Major (John),104 Mallet (Jean-Claude),60, 63, 71, 80, 85, 92, 94, 108, 115, 129, 130 Markale (marché de),79, 154 Mazowiecki (Tadeusz),7, 29, 149, 150, 415 Medak (poche de),70 Mérimée (Jean-Bernard),146, 147, 150, 169 Milosevic (Slobodan),14, 16, 19, 20, 21, 36, 50, 133, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 168, 178, 191 Misic (Ivan Z.),148 Mitterrand (François),104, 120, 121, 122, 124, 125, 137 Miyet (Bernard),175 Mladic (général Ratko),5, 6, 7, 19, 20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 49, 50, 53, 60, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 101, 108, 113, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 143, 145, 149, 153, 154, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 190, 191, 193, 304, 334, 350, 379, 393, 400 Morillon (général Philippe),3, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 50, 61, 77, 81, 92, 141, 142, 162, 198 MSF (Médecins sans frontières),18, 25, 28, 31, 32, 35, 47, 49, 56, 130, 149, 174, 267, 297, 304, 320, 322, 334, 336, 338, 341, 344, 350, 376, 379, 381, 385, 389, 393, 395, 415, 419, 427 Muratovic (Hasan),467 Neville-Jones (Mme Pauline),157 Nicolai (général Cees),7, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 71, 86, 89, 99, 185, 376 Nova Kasaba,53, 117 Ogata (Mme Sadako),11, 20, 31, 169, 183 ONU (Organisation des Nations unies),3, 4, 5, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 43, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 122, 126, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 149, 157, 162, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 217, 238, 270, 355 Orahovac (école de),53, 55 Oric (colonel Naser),16, 18, 24, 26, 33, 84, 88, 89, 90, 113, 114, 136, 188 otages (crise des),23, 25, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 60, 63, 64, 76, 81, 87, 95, 98, 102, 107, 111, 112, 124, 126, 131, 132, 133, 135, 136, 140, 152, 171, 179, 185, 186, 190 OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord),3, 35, 39, 42, 46, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 77, 79, 87, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 114, 117, 124, 128, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 152, 153, 154, 157, 167, 168, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 186, 190 Owen (Lord David),18, 20, 21, 24, 50, 77, 119, 158 Pale,16, 22, 31, 62, 83, 88, 95, 100, 131, 133, 139, 152, 161 Pays-Bas,7, 10, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 57, 71, 80, 81, 86, 94, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 110, 112, 117, 126, 132, 149, 185, 186, 189, 191, 379 Perisic (général Momcilo),86 Petkovci (école de),53, 54, 55 Pilav (Dr. Eliaz),32 Pilica,54 Posavina (corridor de),112 Post Air Strike Guidance (instructions consécutives aux frappes aériennes),38, 39 poste d'observation néerlandais,34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 96, 179 Potocari,24, 35, 51, 101, 149, 467 Prijedor (camp de concentration),161 Quesnot (général Christian),80, 92, 104, 108, 109, 126, 147 Radinovic (Radovan),22 Rakovici (village de),24 Renssen (Raviv Von),98 Rodrigues (Almiro),165 Rohde (David),48, 146 Rose (général Michael),61, 85, 137, 138, 139, 142 Royaume-Uni,81, 102, 103, 110, 111, 113, 117, 118, 119, 128, 155, 177, 187, 188, 189 Ruez (Jean-René),41, 42, 51, 52, 54, 55, 87, 89, 117, 148, 151, 163, 207 Ruiter (lieutenant-colonel de),7, 376 Salignon (Pierre),25, 32, 149, 174 Sandia (pré de),117 Sandic (lieudit),53 Sarajevo,4, 15, 16, 17, 22, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 63, 65, 66, 71, 75, 76, 79, 80, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 100, 102, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 123, 125, 126, 127, 134, 138, 139, 140, 142, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 170, 171, 187, 188, 189, 190, 467 SAS (commandos spéciaux britanniques),128, 142 Schmitz (Mme Christina),32, 35, 49, 56 Schwerdorfer (général),140 Secrétaire général des Nations unies,6, 10, 20, 25, 26, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 61, 62, 63, 65, 66, 72, 74, 79, 91, 97, 101, 103, 106, 107, 115, 116, 118, 119, 122, 131, 141, 143, 146, 148, 150, 154, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 187, 243, 249, 270 Silajdzic (Haris),114, 149 Smith (général Rupert),6, 7, 11, 36, 37, 38, 41, 44, 47, 57, 64, 76, 80, 86, 95, 116, 128, 133, 134, 139, 183, 186, 297, 393, 400 Srpska (Republika),22, 83, 92, 105, 132, 159, 161 Stoltenberg (Thorvald),7, 61, 157, 393 Storm (opération),154 Tardy (Thierry),71, 74, 75, 77, 78, 79, 110, 122, 153, 158 Tisca (école de),52 Tito (Josip Broz),13 Tolimir (général Dravko),43, 45, 143 TPI (Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie),7, 9, 22, 33, 41, 42, 49, 51, 85, 101, 103, 115, 150, 151, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 184, 422 Tudjman (Franjo),155, 156 Tuzla,7, 19, 21, 22, 27, 29, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 59, 70, 88, 90, 91, 99, 100, 114, 115, 148, 149, 152, 164, 186, 389, 467 Udbina (aérodrome d'),138 Van Mierlo (Hans),48, 73, 90, 97, 105, 116, 148 Vance (Cyrus),20, 77, 119 Vance-Owen (plan),22, 26, 119, 122, 154, 158 Viera de Mello (Sergio),64 Visnjica (village serbe de),34, 83 Vitez,17 Vlasenica,30 Voorhoeve (Joris),47, 57, 64, 80, 88, 90, 97, 99, 116, 131, 148, 174, 181 Vrbanja (pont de),64, 70, 126, 145, 152 VRS (armée bosno-serbe),33, 34 Vukovar,13, 14, 17, 26, 163 Wahlgren (général Lars-Erik),16, 18, 19 Zagreb,3, 7, 27, 34, 36, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 65, 70, 72, 83, 86, 91, 94, 96, 98, 99, 101, 134, 171, 185, 419 Zalazje (village de),24 Zekic (Goran),24 Zenica,164 Zepa,7, 16, 17, 19, 21, 22, 33, 41, 48, 58, 81, 83, 91, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 114, 117, 145, 146, 150, 152, 154, 156, 171, 188, 419 Zivanovic (général Milenko),34 zone de sécurité,3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 126, 128, 130, 131, 136, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 162, 164, 165, 166, 171, 186, 188, 189, 191, 467 Zvornic,57 3413 (Tome I)- Rapport d'information de MM. René André et François Lamy sur les événements de Srebrenica (mission d'information commune) 1 § 27 du rapport de la Mission du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 819 (1993). 2 Eric Stover - Gilles Peress Les Tombes - Srebrenica et Vukovar (p. 121) 3 S1994/1252, § 135 et suivants 4 Kofi Annan, rapport sur le drame de Srebrenica, 15.11.99, § 131. 6 Thierry Tardy, La France et la gestion des conflits yougoslaves (1921-1995), Bruylant, Bruxelles, 1999. 9 Rapport ONU du 15 novembre 1999, § 47. 10 TD Zagreb 800, 7 juin 1995. 11 Rapport ONU, paragraphe 238. 12 Rapport ONU, paragraphe 223. 13 Note DAS, le 11 juillet 1995 14 Rapport ONU, 15.11.99 § 230 15 Rapport ONU, 15 novembre 1999 § 40 16 TD DFRA Genève 1353, 12 juillet 1995 17 TD DFRA Genève 1410, 20 juillet 1995 18 Cité par K. Annan, rapport ONU, 11 novembre 1999, § 249. 19 Cité par K. Annan, rapport ONU, 15 novembre 1999, § 249. 20 Rapport ONU, 15 novembre 1999, § 289 et 291. 25 TD La Haye 988, 1er septembre 1995. 26 Rapport ONU, 15 novembre 1999, § 279. 29 Jugement Krstic, 2 août 2001, § 69. 31 Référence au plan de retrait de la FORPRONU établi par l'OTAN. 32 Télégramme de la Représentation permanente auprès des Nations unies du 13 juillet 1995. 33 Ce sont les rapporteurs qui soulignent. 34 Document du 12 juillet 1995. 35 Rapport ONU, 15 novembre 1999, § 485. 36 Rapport ONU, 15 novembre 1999, § 179. 37 Rapport ONU, 15 novembre 1999, § 115. 38 Cité dans le jugement du général Krstic, TPIY, p. 29. 39 Jugement Krstic, 2 août 2001, §. 19-20. 40 Note EMA/COIA du 13 mars 1995. 41 D'après un document du CNES sur Hélios 1-B, « après déploiement total du satellite et vérification du bon état de marche de toutes les composantes, la première image est réalisée dans les deux jours qui suivent le lancement, si les conditions d'orbite le permettent ». La proximité entre les deux satellites permet de penser qu'il en était à peu près de même pour Hélios 1-A. 42 Cité par le rapport ONU, § 118. 44 Cité par le rapport ONU, §162. 45 Préface de « Les Tombes - Srebrenica et Vukovar » d'Eric Stover et Gilles Peress 47 Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations unies, 21 août 2000, A/55/305 et S/2000/809 |

