


N
° 2666
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 11 décembre 2013 (1)
sur le Proche et Moyen-Orient
Président
M. Jean-Luc REITZER
Rapporteure
Mme Odile SAUGUES
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur le Proche et Moyen-Orient est composée de : M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission ; Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission ; M. Avi Assouly (jusqu’à la clôture de son mandat, le 7 mai 2014) ; M. Jean-Claude Buisine (jusqu’à son départ de la commission, le 28 octobre 2014) ; M. Jean–Louis Destans ; M. Jean Glavany (jusqu’au 11 février 2014) ; M. Serge Janquin (à compter du 10 septembre 2014) ; M. Jean–Philippe Mallé (à compter du 7 mai 2014, jusqu’à la clôture de son mandat le 10 septembre 2014) ; M. Jacques Myard ; M. François Rochebloine ; M. Michel Vauzelle (à compter du 11 février 2014).
SOMMAIRE
___
INTRODUCTION 9
I. LA MONTÉE EN PUISSANCE DE DAESH NE DOIT PAS OCCULTER LA PERSISTANCE D’AUTRES CRISES AU PLAN RÉGIONAL 13
A. UNE ACCUMULATION DE CRISES NON RÉGLÉES AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT 13
1. A ce stade, des « révolutions arabes » presque partout en échec 13
a. L’Egypte, entre la poursuite d’une nouvelle transition démocratique et les craintes d’un retour durable à l’ancien régime 14
b. La Libye : vers un « Etat failli » ? 16
c. Une transition négociée en péril au Yémen 19
d. Au Bahreïn, une situation politique qui reste bloquée 21
e. L’exception tunisienne 22
2. Le conflit syrien et son impact régional 24
a. Le plus grave désastre humanitaire de notre temps 25
b. Une impasse durable au plan militaire 27
c. La tendance à la radicalisation de l’insurrection 31
d. De multiples efforts internationaux, jusque-là sans succès 33
e. Les répercussions sur les pays voisins 36
3. L’échec de la reconstruction de l’Irak post-Saddam Hussein 41
a. L’offensive fulgurante de Daesh en juin 2014 41
b. La politique autoritaire, sectaire et répressive de l’ancien Premier ministre Maliki 42
c. La responsabilité américaine dans la déstabilisation du pays 44
4. La question israélo-palestinienne 45
a. Le conflit n’a rien perdu de sa centralité stratégique ni de son poids symbolique 45
b. Il n’existe pas d’alternative aux pourparlers, dont l’impasse est devenue intenable et dangereuse 46
c. Bien qu’Israéliens et Palestiniens soient ceux qui porteront le poids des négociations, la communauté internationale doit assumer sa part de responsabilité 47
5. La crise du nucléaire iranien 48
a. Des motifs sérieux de préoccupation 48
b. Une crise jusqu’à présent sans solution globale et durable 53
c. L’engagement de négociations sérieuses avec les Iraniens 55
B. LA MONTÉE EN PUISSANCE SPECTACULAIRE DE DAESH 58
1. Un groupe appartenant à la nébuleuse salafiste djihadiste 58
a. De la filiation avec Al-Qaida à la rupture 58
b. Une stratégie spécifique 61
2. Une organisation terroriste d’une puissance inégalée 65
a. Une véritable « armée terroriste » 66
b. Les « combattants étrangers » 67
c. Des moyens financiers considérables 69
3. Une triple menace 70
a. Des violences massives contre les populations civiles, en particulier les minorités religieuses et ethniques 70
b. Une menace sérieuse au plan régional 71
c. Une menace pour notre propre sécurité intérieure 74
4. Les facteurs multiples de l’essor de Daesh 75
a. Un terreau fertile en Irak et en Syrie 75
b. D’autres facteurs structurels 77
II. CONTRE DAESH, COUPLER LA RÉPONSE SÉCURITAIRE À DES SOLUTIONS POLITIQUES GLOBALES ET LOCALES 79
A. LA NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE CONTRE-TERRORISTE GLOBALE ET COHÉRENTE 80
1. Les cinq champs d’action principaux de la coalition contre Daesh 80
a. Apporter un soutien militaire décisif sur le terrain 80
b. Endiguer l’afflux des combattants terroristes étrangers 82
c. Tarir les sources de financement de Daesh 83
d. Etendre le domaine de la lutte à la sphère des idées et des médias 84
e. Traiter les aspects humanitaires de la crise 85
2. Des paris stratégiques à gagner 87
a. Quelles forces locales au sol ? 87
b. Quelle convergence réelle entre les acteurs régionaux ? 90
B. LA LUTTE CONTRE DAESH NE PRODUIRA PAS DE RÉSULTATS SIGNIFICATIFS EN L’ABSENCE DE STRATÉGIES POLITIQUES DURABLES AU PLAN LOCAL 94
1. Quel chemin vers la réconciliation nationale en Irak ? 94
a. Une solution politique indispensable pour lutter contre Daesh 94
b. Un long chemin à parcourir 96
c. Une séparation croissante entre le Kurdistan irakien et le reste du pays 98
2. Après l’Irak, ne pas oublier la crise syrienne 100
a. Les crises en Irak et en Syrie : des conflits indissociables mais distincts 100
b. Quelle stratégie en Syrie ? 101
c. S’engager en faveur d’une solution politique et d’une désescalade régionale 103
3. Les relais locaux : un choix lui aussi stratégique 106
a. Veiller à ne pas alimenter l’antagonisme entre sunnites et chiites 106
b. Ne pas favoriser les scissions et la remise en cause des frontières internationales 108
c. Aider à la consolidation durable des Etats voisins 108
III. DES NÉGOCIATIONS SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN QUI POURRAIENT OUVRIR DES PERSPECTIVES DE DÉTENTE ET DE COOPÉRATION AU PLAN RÉGIONAL 111
A. DES NÉGOCIATIONS SÉRIEUSES, MAIS ENCORE INABOUTIES, SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN 111
1. La conclusion du plan d’action conjoint du 24 novembre 2013 111
a. Les principaux points de l’accord 111
b. Les avancées déjà réalisées grâce au plan d’action conjoint 113
2. A ce stade, plusieurs scénarios peuvent être envisagés 114
a. La signature d’un accord consacrant « une solution globale, durable et acceptée par toutes les parties, qui garantirait que le programme nucléaire de l’Iran sera exclusivement pacifique » 114
b. Un deuxième scénario, préféré par certains acteurs, notamment en Israël et aux Etats-Unis, est celui d’un démantèlement complet du programme nucléaire iranien 115
c. Des scénarios intermédiaires, moins défavorables que le précédent, mais probablement peu durables, peuvent être envisagés 116
B. DE NOMBREUSES DIVERGENCES À RÉSOUDRE 117
1. Un point d’équilibre difficile à trouver ou bien un choix stratégique toujours absent du côté iranien ? 117
2. Les principaux aspects techniques 118
a. La limitation des capacités d’enrichissement de l’Iran 119
b. La transformation des sites les plus problématiques 121
c. La vérification et la transparence, y compris sur les activités passées de l’Iran 121
d. L’ampleur et le calendrier de la levée des sanctions 122
e. La durée d’application de l’accord 123
3. Positions de la mission d’information à l’égard des négociations 124
C. UN ACCORD QUI POURRAIT OUVRIR DES PERSPECTIVES NOMBREUSES, MAIS ENCORE HYPOTHÉTIQUES 129
1. D’un accord sur le nucléaire iranien à une détente régionale : un enchaînement possible 130
a. Un antagonisme profond et ancien entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui se traduit aujourd’hui par une confrontation très vive et s’accompagne de tensions croissantes entre sunnites et chiites 130
b. Une détente envisageable entre l’Arabie saoudite et l’Iran, mais à quelles conditions ? 134
c. Des relations entre l’Iran et Israël peu susceptibles d’évoluer à la suite d’un accord sur le nucléaire iranien 137
2. Des coopérations ou des compromis envisageables sur des sujets régionaux d’intérêt commun en cas de détente des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran 139
a. Prolonger quelques précédents positifs récents au Liban et en Irak ? 139
b. D’importantes incertitudes demeurent 142
3. Vers un rapprochement limité avec les Etats-Unis ? 144
IV. LA QUESTION ISRAÉLO-PALESTINIENNE : UN CONFLIT LANCINANT 147
A. 2014 OU LA MORT D’OSLO : L’IMPASSE DU PROCESSUS DE PAIX EST TOTALE, LE STATU QUO, INTENABLE ET DANGEREUX 147
1. Un processus qui n’a plus de paix que le nom, alors que la solution des deux États s’éloigne plus que jamais 147
a. Le terrible bilan de l’année 2014 : l’ultime échec de la tentative américaine de reprise des pourparlers et la reprise du cycle de la violence 148
b. La perspective d’une solution à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité est chaque jour plus menacée 156
2. La reprise, et le succès, des négociations bilatérales sous l’égide des Américains sont plus qu’hypothétiques 162
a. Les autorités israéliennes ne peuvent seules porter le poids d’une reprise des négociations 162
b. Du côté palestinien, la reprise de la diplomatie onusienne, dont la portée est incertaine, coïncide avec une fragilisation inquiétante et des divisions internes profondes 168
c. Un échec du processus de paix dont la responsabilité est partagée par l’ensemble de la communauté internationale 174
B. 2015 OU LE NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE PARADIGME 180
1. La paix maintenant ou jamais ? Les risques d’un oubli du conflit, l’opportunité de sa résolution, la nécessité d’un changement de paradigme 180
a. Les risques d’un pourrissement du conflit 180
b. La possibilité d’une paix régionale 186
c. La nécessité d’un changement de paradigme des négociations 189
2. Éviter les écueils d’Oslo : remettre le Conseil de sécurité au cœur du règlement du conflit, rééquilibrer les négociations en associant davantage l’Union européenne et s’appuyer sur l’Initiative arabe de paix 192
a. Remettre le droit international et le Conseil de sécurité au cœur de la résolution du conflit 192
b. Réintroduire l’Union européenne aux côtés des États-Unis dans le règlement politique du conflit 194
c. Organiser une conférence internationale réunissant l’ensemble des parties concernées et promouvant une paix globale assise sur l’initiative arabe de paix 198
d. Préparer et garantir les conditions d’une paix durable : l’économie et la sécurité 202
CONCLUSION 209
SYNTHÈSE DES PRINCIPALES PRISES DE POSITION DE LA MISSION 211
EXAMEN EN COMMISSION 221
ANNEXE - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 241
ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 247
ANNEXE N° 1 : CARTE DE L’AFRIQUE DU NORD ET DU MOYEN-ORIENT 249
ANNEXE N° 2 : CARTE DE L’IRAK 251
ANNEXE N° 3 : CARTE DE LA SYRIE 253
ANNEXE N° 4 : CARTE D’ISRAËL 255
ANNEXE N° 5 : CARTE DES TERRITOIRES PALESTINIENS 257
« Le vieux monde se meurt. Le nouveau monde tarde à paraître. Et dans ce clair-obscur les monstres surgissent. » (Antonio Gramsci)
On retient souvent de « l’Orient » qu’il est « compliqué », sans autre forme de procès ou d’analyse. Cette formule – historique – passe aujourd’hui pour un truisme, mais il faut reconnaître que la région n’a jamais été traversée par un tel lacis de lignes de failles. Le Proche et Moyen-Orient est entré dans une phase de mutations et de recompositions profondes, qu’il serait superficiel et dangereux de résumer à un conflit entre sunnites et chiites ou au prisme, tout aussi erroné, d’un « choc des civilisations ».
L’opposition entre sunnites et chiites recouvre une part de réalité, qui est d’ailleurs grandissante depuis 2003 et l’intervention américaine en Irak, mais on ne saurait réduire les conflits qui ensanglantent le Proche et le Moyen-Orient à cet antagonisme, sinon par une facilité de langage. Si elles ont bien une composante religieuse, les divisions sont pour l’essentiel de nature géopolitique. La rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite est ainsi l’un des dossiers maîtres de la région. Selon certains, leur rivalité remonte à la compétition entre l’ancienne Mésopotamie et l’Empire perse, bien avant l’arrivée de l’islam, même si elle s’est ensuite doublée de différences culturelles.
Surtout, l’antagonisme entre sunnites et chiites n’est pas la seule clef de lecture des tensions régionales. La lutte entre les pays pro-Frères musulmans et ceux qui voudraient les éradiquer, autre clivage majeur, révèle les tensions qui animent le monde sunnite, entre puissances du Golfe, comme entre Turquie et Égypte. De nouveaux rapprochements tactiques sont à l’œuvre, mais on ne peut qu’hésiter à les qualifier d’alliances solides et pérennes. Les États arabes demeurent écartelés entre des axes de circonstances.
L’éclipse, totale ou partielle, d’États qui étaient des pivots de la région, pour le meilleur comme pour le pire, en particulier l’Irak, la Syrie, et dans une moindre mesure l’Égypte, est également une source d’incertitudes. Aucun État de la région ne semble capable d’imposer son leadership – leadership trop longtemps découragé par la communauté internationale – et de consolider un quelconque ordre régional.
Alors que ni la Ligue arabe, ni l’ONU, ni l’Europe ne sont en mesure de combler le vide, ni même de s’imposer comme des acteurs capables de peser sur les équilibres de la région, la rivalité renaissante entre la Russie et les États-Unis vient aussi à s’exprimer sur certains dossiers régionaux, en particulier la Syrie.
Quant à la marginalisation stratégique souvent annoncée du Proche et du Moyen-Orient, notamment en raison d’un « désengagement » américain dont l’ampleur est pour l’heure à relativiser, elle a été sévèrement démentie par la multiplication des crises et des conflits qui dévastent la région.
Cette déflagration est aussi le produit d’une succession de conflits antérieurs. Se superposent les effets des crises héritées du XXème siècle – questions kurde et israélo-palestinienne, non réglées, interventions en Irak en 1991, puis en 2003 –, et les répercussions des « révolutions » arabes qui se sont déclenchées en 2011.
Daesh, symptôme le plus radical et le plus violent de la fragilisation et de la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient, de son absence d’horizon politique, de sa déliquescence institutionnelle et du désespoir de sa population, s’ajoute à ces tensions, dont il se nourrit par ailleurs. Il conviendra donc de replacer son irruption dans un panorama plus vaste.
Dans ce contexte régional durablement perturbé, la Mission d’information a fait le choix de s’intéresser aux principales inflexions en cours : la montée en puissance de Daesh et la mise en place d’une vaste coalition internationale contre ce mouvement terroriste ; la reprise de négociations sérieuses mais encore inabouties avec l’Iran sur son programme nucléaire ; la nouvelle explosion de violence à Gaza cet été et la prise de conscience grandissante de l’impasse du processus d’Oslo.
La progression fulgurante de Daesh, en juin 2014, a encore compliqué les crises en Irak et en Syrie. L’effort pour contenir l’avancée de cette organisation, au moyen d’une coalition internationale que l’on pourra juger quelque peu hétéroclite, doit être maintenu à son plus haut niveau. Mais il ne doit reléguer au second plan ni la réponse politique à la déliquescence des États irakien et syrien, dont Daesh est en partie le produit, ni le traitement des graves crises humanitaires en cours dans la région, ni les efforts pour préserver les équilibres fragiles du Liban et de la Jordanie. Enfin, s’il ne faut pas surestimer le risque d’expansion territoriale de Daesh, les risques de dissémination sont réels et le caractère asymétrique de la lutte pourrait bien réduire les puissances à une certaine forme d’impuissance.
Deuxième nœud régional, les négociations sur le programme nucléaire iranien doivent faire l’objet d’un accord politique avant la fin du mois de mars. L’enjeu est immense, car il engage l’avenir du régime de non-prolifération nucléaire, et il porte en lui le risque d’une intervention militaire ou au contraire d’un apaisement régional. La signature d’un accord, et la réintégration de l’Iran dans le jeu international qui pourrait s’en suivre, pourraient ouvrir des perspectives mais renforcent aussi, à ce stade, les incertitudes stratégiques dans la région.
Enfin, l’échec de la reprise des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens, suivi d’une nouvelle crise cet été à Gaza, la troisième et la plus meurtrière en cinq ans, a rappelé que cette question n’avait rien de secondaire. Le consensus est croissant, y compris au sein des opinions israélienne et palestinienne, sur la nécessité d’un changement de paradigme des négociations, pour parvenir à un accord de paix dont les paramètres sont depuis longtemps connus.
Le rapport se propose d’examiner ces trois priorités que sont la lutte contre Daesh, la négociation sur le nucléaire iranien et la question israélo-palestinienne, pour en tirer des lignes de conduite pour la diplomatie française. La Mission est animée par la conviction que la France, en vertu des liens qui l’unissent aux peuples du Proche et du Moyen-Orient, de son histoire, de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et de pays fondateur de l’Union européenne, mais aussi de son génie propre, qui est celui d’être d’une puissance médiatrice, peut contribuer à l’apaisement et promouvoir une paix assise sur un nouvel ordre régional.
La déstabilisation de la région est aujourd’hui très avancée, et le phénomène croissant des combattants terroristes étrangers montre à quel point les effets de cette déstabilisation ne peuvent être traités comme des évènements extérieurs, que nous pourrions regarder en spectateurs. Face à ces menaces stratégiques, dont nul ne peut encore mesurer les conséquences, la réponse reste à élaborer, en faisant preuve de clairvoyance et d’inventivité. De clairvoyance, car rien ne serait pire que d’apparaître comme partie prenante aux luttes intestines entre puissances régionales, ou de souffler sur les braises des divisions religieuses. D’inventivité, car s’il est évident que la lutte contre la violence terroriste doit être sans merci, les conflits en présence ne sont pas, pour la plupart, de type conventionnel. Ils ne peuvent trouver une réponse purement militaire et, surtout, ils se nourrissent du chaos. Après l’échec des interventions en Irak et dans une certaine mesure en Libye, c’est notre crédibilité qui se joue dans la région.
I. LA MONTÉE EN PUISSANCE DE DAESH NE DOIT PAS OCCULTER LA PERSISTANCE D’AUTRES CRISES AU PLAN RÉGIONAL
A. UNE ACCUMULATION DE CRISES NON RÉGLÉES AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT
Les conquêtes territoriales fulgurantes de Daesh au cours de l’été 2014 ont replacé l’Irak au centre des préoccupations internationales, alors que ce pays était très largement sorti des « écrans radar » depuis des années, malgré l’évolution catastrophique de sa situation politique et sécuritaire. De la même manière, si la focalisation actuelle sur Daesh se justifie par l’ampleur de la menace, elle ne doit pas éclipser d’autres crises particulièrement graves et d’autres facteurs de déstabilisation au plan régional – la crise en Syrie, la question israélo-palestinienne, les enjeux considérables des négociations sur le programme nucléaire iranien, ainsi que la situation générale d’échec des « révolutions arabes ».
1. A ce stade, des « révolutions arabes » presque partout en échec
Hormis en Tunisie, qui fait figure d’exemple positif, la situation reste préoccupante dans les principaux foyers des protestations populaires du début de l’année 2011 – en Egypte et en Libye (1), où les anciens dictateurs ont cédé la place, comme au Yémen et au Bahreïn, qui se sont engagés dans des expériences difficiles et inachevées de « dialogue national », après une phase de répression. La crise syrienne, qui revêt une dimension régionale et sectaire croissante, fait l’objet d’une présentation séparée dans la suite du présent rapport.
Il est naturellement encore trop tôt pour porter un jugement d’ensemble sur ces « révolutions arabes ». Comme le soulignait une mission d’information créée en 2013 par la commission des affaires étrangères (2), il s’agit de processus de longue durée, sinueux et différenciés selon les pays. Les événements de 2011 ont d’ailleurs montré que l’échelon national demeurait le meilleur cadre d’analyse. Il existe néanmoins un substrat commun au plan régional : une exigence de « dignité », qui s’enracine dans un rejet de la corruption et du blocage des systèmes politiques, économiques et sociaux en place, ainsi que dans un sentiment très fort d’aliénation et de marginalisation dans tous les domaines.
Les « révolutions arabes » et leurs différents échos dans la région (3) ont permis de mesurer l’ampleur de ces aspirations populaires. Après l’espoir, né en 2011, que le monde arabe reprenait en main son destin en se défaisant de régimes sclérosés et souvent devenus économiquement prédateurs, c’est désormais une impression générale d’échec qui prédomine. Le changement profond qui était attendu paraît remis sine die. Ce vent de désespoir, qu’il faut espérer temporaire, ne peut qu’attiser les frustrations qui étaient à l’origine des « révolutions arabes » et offrir un terreau favorable à des formes d’expression et de contestations plus radicales (4). Comme le note M. Frédéric Charillon, directeur de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (Irsem), il faut néanmoins garder espoir dans le « réveil sociétal » qui s’est manifesté en 2011 (5). Il est difficile d’imaginer qu’il puisse disparaître subitement : l’aspiration à plus de liberté, de justice et de dignité est là, de même que l’expérience de la liberté de parole.
a. L’Egypte, entre la poursuite d’une nouvelle transition démocratique et les craintes d’un retour durable à l’ancien régime
La transition engagée à la chute du président Hosni Moubarak, en février 2011, à la suite d’un mouvement de contestation populaire, a été brutalement interrompue au début du mois de juillet 2013, avec la destitution du président Mohamed Morsi, issu de la Confrérie des Frères musulmans et démocratiquement élu en juin 2012. La gestion catastrophique des Frères musulmans dans tous les domaines – au plan politique, mais aussi en matière économique et sécuritaire – a conduit à un nouveau soulèvement d’une partie de la population égyptienne, désireuse de mettre un coup de frein aux dérives en cours. Ce mouvement dit « Tamarrod » (rébellion) s’est accompagné d’une reprise en main de la situation par « l’Etat profond » qu’incarne en particulier l’armée égyptienne et qui s’est présenté comme le bras armé du peuple et l’exécutant de ses volontés (6).
Le succès du référendum constitutionnel de janvier 2014 (7) a permis de conforter la légitimité démocratique d’un nouveau processus de transition, qui a repris à zéro après la destitution du président Morsi. La nouvelle Constitution égyptienne peut faire l’objet d’une lecture contrastée. Elle comporte des avancées en matière de libertés publiques, de droits des femmes et de liberté de culte, tout en consacrant les prérogatives de l’armée et en renforçant les pouvoirs du Président. Une autre étape de la transition a été franchie au mois de mai dernier, lorsque le maréchal Abdel Fatah al-Sissi a été élu à la Présidence de la République arabe d’Egypte, avec un score plébiscitaire de 96,9 % – qui doit être mis en balance avec le taux de participation de seulement 47,5 %. Le processus de transition démocratique devrait s’achever avec la tenue des élections législatives, initialement prévues entre mars et mai 2015 (8).
Comme le redoutait la mission d’information sur les « révolutions arabes », dans son rapport de novembre 2013 (9), l’Egypte reste engagée dans une spirale de répression et de radicalisation qui renforce la polarisation de la scène politique, compromet la stabilisation nécessaire du pays et alimente les craintes de retour à l’ordre ancien, dans un contexte dégradé. La Confrérie des Frères musulmans est repassée dans la clandestinité après avoir été qualifiée d’organisation terroriste, tandis que son émanation politique, le parti Liberté et Justice, était interdite. La confrontation avec les autorités se serait déjà traduite par au moins 3 000 morts depuis juillet 2013, 40 000 arrestations de sympathisants et 1 000 condamnations à mort. Le principal mouvement des jeunes révolutionnaires de 2011, le « 6 avril », a également été interdit par la justice.
L’Egypte a dû répondre à de multiples critiques lors de son examen périodique universel au Conseil des droits de l’Homme, le 5 novembre dernier, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse. Plusieurs journalistes d’Al-Jazeera ont ainsi été arrêtés et condamnés à des peines de prison pour soutien aux « activités terroristes » des Frères musulmans (10). Les autorités égyptiennes ne nient pas l’existence de difficultés durant la phase actuelle de la transition (11), dont elles considèrent que le premier objectif doit être d’assurer la stabilisation du pays dans tous les domaines, après l’expérience désastreuse des Frères musulmans à la tête de l’Etat. Il faut aussi noter que l’exécutif égyptien n’a pas de prise directe sur le pouvoir judiciaire, dont certaines décisions ont suscité un émoi justifié, notamment des condamnations à mort prononcées en masse contre des Frères musulmans.
La France a décidé de poursuivre un dialogue franc et lucide avec l’Egypte au niveau politique, alors que d’autres pays européens demeurent très réservés. Notre coopération se poursuit, à l’exception des programmes qui pourraient contribuer à la répression interne. La visite officielle du Président al-Sissi en France, du 25 au 27 novembre 2014, et la signature récente d’importants contrats d’armement, prévoyant notamment la fourniture d’avions de combat Rafale, d’une frégate multi-missions et de leur armement, témoignent de la solidité de la relation bilatérale.
Dans le domaine sécuritaire, le pays connaît une forte résurgence de la menace terroriste, en particulier dans le Sinaï, où la situation s’est considérablement dégradée depuis 2011, et à la frontière libyenne. Le Caire a également été touché. En dépit du renforcement de l’action des services de sécurité, ce phénomène reste très difficile à contrôler et l’intensification de la répression risque paradoxalement de renforcer les groupes terroristes en favorisant des ralliements au plan local, notamment dans le Sinaï. Les attentats, visant surtout les forces de sécurité, même si des civils ont été également été ciblés, sont principalement revendiqués par le groupe Ansar Beit Al-Maqdis, qui a officiellement prêté allégeance à Daesh en novembre 2014.
En matière économique, malgré les aides massives apportées par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït, qui permettent de faire face à court terme, les difficultés qui ont contribué à la chute du président Moubarak, en 2011, demeurent et elles se sont même accrues à certains égards. La croissance reste atone, ni le niveau de pauvreté ni celui du chômage n’ont pu être réduits, le tourisme s’est effondré, tandis que l’inflation et les déficits publics restent élevés. Les autorités égyptiennes ont néanmoins engagé des réformes structurelles courageuses, notamment la réduction des subventions sur les carburants, et d’importants projets d’infrastructures ont été annoncés, tels qu’un second canal de Suez, ainsi que des constructions de logements.
b. La Libye : vers un « Etat failli » ?
L’enlisement des « révolutions arabes » n’est nulle part plus visible – et plus déstabilisateur au plan régional – qu’en Libye. Dans son rapport de novembre 2013, la mission d’information précitée de la commission des affaires étrangères avait mis en lumière les principaux obstacles auxquels se heurtait la transition politique en Libye, malgré le succès des élections organisées en 2012 : l’existence de forces centrifuges puissantes et l’absence de traditions et de capacités étatiques. Il n’était malheureusement pas surprenant que la transition s’enraie.
Face à la légitimité des urnes, les milices armées libyennes se prévalent d’une légitimité issue de la révolution de 2011. Solidement ancrées dans les paysages locaux, elles demeurent toutes-puissantes et largement autonomes, malgré de nombreuses tentatives pour les placer sous l’autorité de l’Etat. Le secteur de la sécurité, décapité à la chute de Kadhafi, qui avait marginalisé l’armée et la police à dessein, au profit de commandos dirigés par ses proches, n’a pas pu être restructuré, ce qui place les autorités légales et les institutions de l’Etat dans l’incapacité de s’imposer. Elles sont à la merci des violences qui pèsent sur la vie politique libyenne, comme l’a montré le siège des ministères, en 2013, organisé pour forcer le Congrès général national (CGN) à adopter une loi d’exclusion politique à l’égard des anciens kadhafistes ou présumés tels. En l’absence de dynamique politique intégratrice au plan national, les identités et les intérêts locaux, tribaux et régionaux peuvent jouer à plein.
Depuis la fin de l’année 2013, la tendance à la polarisation du pays, qui avait été relevée par la mission d’information sur les « révolutions arabes », s’est très nettement accentuée. Elle oppose désormais un camp « islamiste » et un autre que l’on pourrait désigner de « nationaliste », faute de meilleurs termes, les factions restant assez composites et agrégeant des intérêts variés. Ces deux camps se sont constitués sous la forme de coalitions de milices, qui s’affrontent désormais ouvertement sur le plan militaire comme sur celui de la légitimité institutionnelle.
D’un côté, la nouvelle Chambre des représentants, élue en juin 2014, s’est réfugiée à Tobrouk, avec le gouvernement légitime qui a réintégré dans l’armée régulière le général Khalifa Hafter (12), considéré comme un « agresseur » par l’autre camp. Le général Hafter s’était engagé à l’été 2014 dans une offensive contre des milices islamistes à Benghazi, avec l’appui d’éléments ralliés de l’armée. De l’autre côté, un gouvernement de salut national, pro-islamiste et non reconnu par la communauté internationale, a été proclamé à Tripoli. Il émane du CGN, qui aurait dû céder la place à la Chambre des représentants. Le CGN a été réactivé lorsque la Cour suprême libyenne a invalidé, en novembre 2014, les élections législatives du 25 juin précédent. Dans le Sud du pays, la confrontation entre le camp de Tobrouk et celui de « l’Aube de la Libye » (« Fajr Libya »), se double d’affrontements entre Toubous et Touaregs, leurs alliés respectifs.
La Libye se rapproche d’un « Etat failli » à plus d’un titre : l’échec des autorités à reconstruire un système de sécurité et de défense nationale efficace ; le poids des milices et des « seigneurs de la guerre » locaux qui ne se sont pas ralliés au processus de transition institutionnelle ; la dégradation de la situation sécuritaire, qui a notamment conduit à évacuer, cet été, les ressortissants français présents en Libye, ainsi que le personnel de notre ambassade ; la perte de confiance dans le processus de transition politique ; enfin, l’incapacité de l’Etat à assurer des services publics de base à la population et à tirer parti des ressources pétrolières du pays. La production a chuté en raison des troubles politiques et sécuritaires, alors que la Libye demeure étroitement dépendante des hydrocarbures.
Cette situation fait peser des risques graves sur la stabilité et la sécurité de l’ensemble de la région, en raison des trafics qui se sont multipliés, notamment la contrebande d’armes, mais aussi le développement de la menace terroriste, divers groupes profitant de l’extrême faiblesse de la Libye pour y renforcer leur présence – al Mourabitoune et AQMI (Al-Qaida au Maghreb islamique) au Sud, Ansar Al Charia au Nord, ainsi que Daesh, qui serait notamment très présent à Derna et à Syrte. La situation actuelle ouvre aussi largement le pays aux interférences régionales, comme l’ont montré les bombardements aériens que les Emirats arabes unis auraient menés l’été dernier contre des milices islamistes, depuis des bases aériennes qui pourraient être égyptiennes (13). Avec la prolongation de sa crise interne, la Libye tend à devenir un nouveau théâtre d’affrontement régional par « proxy », l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats soutenant les autorités de Tobrouk, tandis que le Qatar et la Turquie sont plus proches de l’autre camp.
Le chaos libyen résulte en grande partie de l’impréparation du « jour d’après » lorsque l’intervention militaire aérienne de 2011 a été conduite par la France et le Royaume-Uni, pour l’essentiel. Il s’agissait de protéger les populations civiles des atrocités commises par Mouammar Kadhafi, mais aussi de soutenir la rébellion. Cette intervention a ainsi conduit à la chute du régime, outrepassant le mandat accordé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Surtout, le nécessaire n’a pas été fait pour protéger et organiser la reconstruction de la Libye et de ses institutions. Comme l’a rappelé M. Hubert Védrine, entendu par la mission d’information le 3 décembre 2014, il était pourtant bien naïf de croire que l’on pourrait parvenir à la démocratie dès lors que l’ancien dictateur était renversé, comme s’il suffisait de souffler sur du sable qui l’aurait recouverte.
Alors que les pressions pour une nouvelle intervention militaire s’accroissent, des efforts se poursuivent pour essayer de relancer un processus politique en Libye. La formation d’un gouvernement d’union nationale paraît l’unique moyen de stabiliser le pays, de remédier à sa situation économique désormais très dégradée et de lutter contre les groupes terroristes. Plusieurs réunions de « dialogue national » – à Ghadamès, à Genève et à Rabat (14) – ont donné lieu à des déclarations de principe, sans résultats concrets à ce stade. S’il existe une dynamique positive de dialogue, plusieurs obstacles continuent à se dresser sur le chemin : le très fort morcellement politique et militaire du pays, sa polarisation et la prévalence des intérêts locaux et claniques – la ville d’origine, la tribu ou les allégeances personnelles – sur l’intérêt général.
c. Une transition négociée en péril au Yémen
Le Yémen est un pays fragile, divisé par de nombreux conflits non réglés. Le Nord du pays est à l’origine d’un mouvement de rébellion dit « houthiste » (15), qui se revendique d’une identité confessionnelle minoritaire, le zaydisme (16). Il s’agit d’une branche du chiisme largement distincte du chiisme duodécimain qui est majoritaire en Iran (17). Les autorités iraniennes déclarent n’apporter qu’un soutien « spirituel » à ce mouvement et insistent sur son ancrage proprement yéménite, en dépit d’allégations de soutien financier et sécuritaire de leur part (18). L’implication de l’Iran a d’ailleurs été mise en avant par les autorités yéménites pour justifier une politique de force à l’égard du mouvement houthiste et pour solliciter une aide extérieure. Il existe aussi un mouvement sécessionniste de nouveau très actif au Sud du pays, qui n’a été unifié qu’en 1990. Les tribus du Sud dénoncent en particulier leur mauvaise représentation au niveau central et réclament plus de justice. Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) est par ailleurs très présente au Yémen, où cette organisation disposerait de milliers de militants et conduit des actions de guérilla coordonnées et d’envergure contre les « intérêts étrangers », l’appareil sécuritaire et les bâtiments officiels. AQPA a gagné beaucoup de terrain au Yémen, en particulier dans le Sud du pays, qui connaîtrait la plus forte concentration de combattants qaidistes au monde, devant la zone afghano-pakistanaise et le Sahel. AQPA est d’abord tourné vers le Yémen, mais dispose d’une capacité de projection à l’étranger (19).
En dépit de ces difficultés structurelles multiples, le Yémen a pu faire figure d’exception au sein des « révolutions arabes », pendant un certain temps. Tout d’abord, parce que la mobilisation populaire de février 2011 a eu pour particularité d’être rapidement rejointe par l’opposition traditionnelle, le parti islamiste al-Islah, émanation locale des Frères musulmans, et d’avoir bénéficié de la protection d’une partie de l’armée, sous l’égide du général Ali Mohsen, alors conseiller militaire du président Saleh et commandant de la première division blindée. Ensuite, parce qu’une solution négociée a fini par être concédée par le président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 33 ans. Un accord de sortie de crise garantissant l’immunité du président Saleh et assurant le transfert du pouvoir à son vice-président, M. Abed Rabbo Mansour Hadi, a été signé le 23 novembre 2011, sous l’égide du Conseil de coopération du Golfe et après de nombreuses tergiversations. Le 21 février suivant, M. Hadi a été élu à la présidence pour une durée théorique de deux ans, puis son mandat a été prolongé d’un an.
Comme l’a rappelé M. Laurent Bonnefoy, chercheur au CERI-Sciences Po, lors de son audition du 17 décembre 2014, le Yémen a quasiment connu une « parenthèse enchantée » au regard des autres « révolutions arabes » et des défis structurels propres au pays. Le Yémen, excessivement armé – il pourrait y avoir plus de 50 millions d’armes en circulation, pour environ 27 millions d’habitants – a vu les différentes parties prenantes se réunir, sous l’égide d’acteurs régionaux et avec le soutien de l’ONU, pour mettre en place une transition politique censée permettre aux principaux intéressés de converger et de ne pas perdre la face. Une « conférence de dialogue national », généralement considérée comme très « inclusive », a rassemblé des représentants de toutes les forces yéménites, exception faite d’AQPA. La clôture de ce processus, en janvier 2014, devait ouvrir la voie à l’adoption d’une nouvelle Constitution et à l’organisation d’élections législatives et présidentielles, début 2015.
Le blocage de ce processus de transition est manifeste depuis la prise de la capitale, Sanaa, par des miliciens houthistes au mois de septembre 2014. Les Houthistes se sont imposés sur la scène nationale, alors qu’ils étaient initialement confinés aux gouvernorats du Nord du pays. Après avoir pris le contrôle de régions entières lorsque l’armée s’est repliée vers Sanaa lors des événements de 2011, ils sont passés d’une posture essentiellement défensive à une logique offensive. Leur récente et fulgurante avancée aurait été favorisée par une alliance paradoxale avec l’ancien président Saleh, en dépit des six guerres que ce dernier a menées contre la rébellion houthiste, de 2004 à 2010. L’ancien président yéménite, malgré son retrait officiel du pouvoir, tel qu’il est prévu par l’accord précité de 2011, est resté très présent dans le jeu politique et n’a manifestement pas abandonné la partie.
Un nouvel accord de sortie de crise, signé le 21 septembre 2014 après la prise de Sanaa, prévoyait la nomination d’un nouveau Premier ministre et la formation d’un nouveau gouvernement « de compromis », à forte coloration technocratique. Le volet sécuritaire de l’accord – notamment le retrait des miliciens houthistes hors de Sanaa – n’a pas été respecté et les Houthistes ont poursuivi leur expansion vers le Sud du pays. Le Président Hadi et le Gouvernement, de plus en plus hors-jeu, ont fini par démissionner et ont été assignés à résidence, tandis que la dissolution du Parlement était annoncée, le 6 février dernier, par voie de déclaration constitutionnelle. L’Etat yéménite, qui s’était déjà « rétracté » lors des événements de 2011 et s’est largement discrédité par son incapacité à assurer tant la sécurité que des services de base à la population, semble avoir quasiment disparu. A Sanaa, ce sont les milices qui tiennent les ministères, les casernes et les bâtiments publics. Le président Hadi, qui est revenu sur sa démission, a fui Sanaa pour Aden, l’ancienne capitale du Yémen du Sud, le 22 février dernier. La plupart des pays du Golfe ont annoncé qu’ils allaient y transférer leur ambassade.
Afin d’éviter un effondrement complet du pays, il ne paraît pas y avoir d’autre solution que la reprise d’une transition négociée, sur le triple fondement de l’accord de 2011, de la conférence du dialogue national et de l’accord conclu en septembre dernier. La résolution 2201 (2015) du Conseil de sécurité, adoptée le 15 février dernier, en a rappelé le principe. Bien que cette perspective paraisse dangereusement éloignée, elle reste d’autant plus nécessaire que la dégradation de la situation s’accompagne d’un accroissement préoccupant de la confessionnalisation des conflits, comme l’a rappelé M. François Burgat, entendu par la mission d’information le 29 octobre 2014. M. Laurent Bonnefoy, après avoir insisté sur le renouveau identitaire profond que constitue l’essor du zaydisme, alors qu’une large convergence des identités religieuses s’était auparavant produite au Yémen, a lui aussi relevé que le pays est de plus en plus touché par cette polarisation confessionnelle entre sunnites et chiites qui déchire d’autres pays dans la région, en particulier la Syrie et l’Irak, mais qui était jusque-là assez étrangère à l’histoire du Yémen.
L’ancrage territorial d’AQPA et son essor au Yémen sont tout aussi inquiétants. Ce mouvement profite de la faillite de l’Etat yéménite et de son appareil militaro-sécuritaire pour se déployer et pour renforcer ses bastions au Yémen. La progression rapide de la rébellion houthiste, perçue comme une forme d’expansionnisme chiite, joue en sa faveur dans la mesure où elle peut « galvaniser » les esprits. L’évolution de la situation, qui conforte le Nord du pays par rapport au Sud, majoritairement sunnite, pousse des tribus à s’aligner sur les positions d’AQPA. Le nombre des attaques menées par cette organisation connaîtrait d’ailleurs un pic depuis le mois de septembre dernier et la prise de Sanaa. Parmi les évolutions les plus préoccupantes, il faut également citer le projet d’implantation de Daesh au Yémen, qui paraît susceptible de conduire à une nouvelle spirale de violence, dans une sorte de rivalité avec AQPA.
d. Au Bahreïn, une situation politique qui reste bloquée
Les autorités du Bahreïn ont commencé par répondre par la force aux revendications populaires du printemps 2011. Les manifestations ont été violemment réprimées, avec l’aide matérielle de plusieurs pays du Conseil de coopération du Golfe, qui ont dépêché des renforts sur place. Les autorités bahreïnies dénonçaient alors la main de l’Iran dans des troubles dépeints comme essentiellement fomentés par la population chiite de l’archipel, qui représente entre 50 et 70 % des 1,3 million d’habitants, gouvernés par la dynastie sunnite des Khalifa.
Une commission d’enquête indépendante, créée par le souverain du Bahreïn pour faire la lumière sur les violations des droits de l’Homme commises en février et mars 2011, et présidée par l’Egyptien Cherif Bassiouni, a présenté au mois de novembre 2011 des conclusions et des recommandations qui ont été suivies d’un certain nombre de mesures concrètes. Bien que la situation se soit « normalisée » dans une certaine mesure, le lancement d’un processus de « dialogue national », en février 2013, n’a pas permis d’ouvrir de réelles perspectives et de tourner durablement la page ouverte en 2011.
La question des réformes politiques reste posée, même si le Bahreïn, monarchie parlementaire bicamérale depuis l’adoption de la Constitution de 2002, fait figure d’exception parmi ses voisins – avec le Koweït, qui tient des élections au suffrage universel direct. La majorité chiite de la population du Bahreïn continue à se considérer comme victime de discriminations politiques et socioéconomiques et à exiger des réformes.
Les élections de novembre 2014 ont été boycottées par les principales associations de l’opposition, les partis politiques n’étant pas autorisés au Bahreïn. Ces élections se sont traduites par une accentuation des divergences entre les autorités et l’opposition. Celle-ci dénonçait un redécoupage électoral inéquitable des zones habitées par les chiites et l’absence d’ouverture à l’égard de leurs principales revendications, en particulier un gouvernement élu, une assemblée jouissant de l’ensemble de ses prérogatives législatives et de contrôle, ainsi qu’une plus grande équité dans les domaines de la sécurité et de la justice.
Le respect des droits de l’Homme, en particulier les libertés d’expression et d’opinion, fait partie des sujets de préoccupation pour la France. Ces derniers mois ont notamment vu l’arrestation de Cheikh Ali Salman, secrétaire général de l’association politique Wifaq, principale formation chiite de l’opposition, ou encore celle de Nabil Rajab, défenseur des droits de l’Homme et figure de la contestation depuis 2011 – il a été arrêté pour injure et diffamation des institutions de l’Etat à la suite d’un « tweet ». En juillet 2014, le secrétaire d’Etat adjoint américain pour la démocratie et les droits de l’Homme, Tom Malinowski, a été déclaré « persona non grata » au Bahreïn après avoir rencontré deux responsables du Wifaq.
Au regard de l’évolution de l’Egypte, de la Libye, de la Syrie, du Yémen ou encore du Bahreïn, la Tunisie fait figure d’exemple positif au plan régional, ou du moins de ferment d’espoir – les principaux facteurs d’évolution étant propres à chaque pays, l’effet de mimétisme ne peut être qu’être limité (20). Bien que la transition démocratique en Tunisie ait été relativement lente et passablement heurtée, voire chaotique, depuis la chute de Ben Ali en 2011, plusieurs étapes décisives ont été franchies avec succès en 2014.
En dépit de divergences marquées entre un camp islamo-conservateur incarné par le mouvement Ennahda et un camp « séculier » (21) plus composite, les débats constitutionnels se sont finalement conclus par des compromis qui ont permis l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale en janvier 2014. En dépit de certaines ambiguïtés et même de contradictions qui ouvrent la voie à des pratiques potentiellement très différentes, ce texte est probablement le meilleur possible sur des sujets tels que les droits des femmes, la liberté religieuse et la liberté d’expression. A la différence de l’Egypte, où les Frères musulmans avaient fait passer en force une Constitution décriée par une grande partie des acteurs politiques et de la société civile, la Constitution tunisienne a pu être adoptée dans un esprit de consensus.
Des élections législatives et présidentielles qui ont ensuite été organisées à la fin de l’année 2014, plusieurs conclusions positives peuvent être tirées. La crainte de voir des partis islamistes arriver nécessairement au pouvoir à la faveur des scrutins électoraux, sans intention de céder la place ultérieurement, s’est jusqu’à présent révélée infondée en Tunisie. Ennahda, qui avait obtenu environ 37 % des sièges à l’Assemblée nationale constituante (ANC) en octobre 2011, et qui avait alors formé une « Troïka » avec le parti social-démocrate Ettakatol et avec le Congrès pour la République (CPR) de Moncef Marzouki, a admis sa défaite électorale aux élections législatives de 2014 (22). Ennahda avait déjà montré sa capacité à privilégier le bon déroulement de la transition tunisienne à ses propres intérêts immédiats en acceptant que la « Troïka » cède la place à un gouvernement intérimaire « de compétences », c’est-à-dire non partisan, principalement chargé de conduire le pays aux élections législatives et présidentielles. La transition tunisienne montre que la démocratie peut fonctionner partout dans le monde et qu’elle peut inclure dans le jeu politique des acteurs ayant l’islam pour référence principale et qui constituaient jusque-là des forces contestatrices.
Ces différentes étapes ayant été franchies avec succès, il revient maintenant à la Tunisie de continuer à consolider son Etat de droit et les acquis démocratiques de sa nouvelle Constitution. Le pays doit aussi affronter d’importants défis structurels. En matière économique et sociale, les aspirations qui sont à l’origine de la révolution de 2011 restent à satisfaire. Le taux de croissance est faible, le niveau du chômage demeure élevé, notamment chez les jeunes, les régions intérieures du pays continuent à souffrir d’une absence de perspectives économiques et les réformes structurelles attendues n’ont pas pu être engagées par des autorités tunisiennes jusque-là placées sous le signe du provisoire. La Banque mondiale vient ainsi d’intituler un rapport consacré à la Tunisie : « La révolution inachevée – créer des opportunités, des emplois de qualité et de la richesse pour tous les Tunisiens ». Les heurts violents qui ont eu lieu au mois de février à la frontière avec la Libye, après la saisie d’essence de contrebande en provenance de ce pays, ont replacé le thème du sous-développement régional au centre du débat. Au plan sécuritaire, si des progrès importants ont été réalisés grâce à une mobilisation renforcée de l’Etat et à une coopération avec les voisins de la Tunisie et ses partenaires occidentaux, la lutte contre la menace posée par Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes (23) doit se poursuivre. L’important contingent de djihadistes tunisiens partis en Syrie constitue un défi particulier à relever.
Enfin, la réconciliation nécessaire entre les différences faces du pays – une Tunisie tournée vers l’Europe et plutôt séculière, une autre tournée vers l’Orient et davantage conservatrice, mais aussi la Tunisie côtière, d’un côté, et la Tunisie de l’intérieur, de l’autre – doit encore être réalisée. Le second tour de l’élection présidentielle, au mois de décembre 2014, a été marqué par une polarisation très vive, Beji Caïd Essebsi décrivant son rival Moncef Marzouki comme le candidat des islamistes, tandis que celui-ci le dépeignait comme l’incarnation des élites compromises avec le système Ben Ali et du retour à l’ordre autoritaire. Lors des élections législatives, cette bipolarisation de l’électorat avait trouvé une traduction géographique et sociale marquante, le Nord et la côte urbanisée ayant voté pour Nidaa Tounes, à la différence du Centre et du Sud, qui ont choisi majoritairement Ennahda.
Dans ce contexte, le vote de confiance obtenu le 5 février dernier par un gouvernement reposant sur une large coalition, dominée par Nidaa Tounes mais incluant aussi Ennahda, est à l’évidence un élément positif. La participation de la formation islamiste, représentée par un ministre, en charge de l’emploi et de la formation professionnelle, et par trois secrétaires d’Etat, reste symbolique par rapport à son poids parlementaire, mais Ennahda a obtenu que les ministères régaliens de l’intérieur, de la défense et de la justice soient confiés à des indépendants. Ces derniers représentent un tiers des 26 ministres et 14 secrétaires d’Etat du 1er Gouvernement de la 2e République tunisienne, conduit par M. Habib Essid.
2. Le conflit syrien et son impact régional
Si les « révolutions arabes » paraissent en échec en Egypte, en Libye, au Yémen et au Bahreïn, c’est évidemment en Syrie que l’impasse est la plus dramatique.
La crise a débuté en mars 2011 par des manifestations pacifiques dont les revendications étaient proches de celles que d’autres pays arabes connaissaient à la même époque. Le régime n’y a répondu que par la répression et un déchaînement de violence aveugle, à l’exception de quelques promesses d’ouverture immédiatement démenties par les faits, et la contestation s’est progressivement militarisée. Cet engrenage a été décrit par la mission d’information sur les révolutions arabes dans son rapport de novembre 2013 (24).
La crise en Syrie est entrée dans sa cinquième année au mois de mars. Elle se traduit par une catastrophe toujours plus grave au plan humanitaire et par une impasse militaire sur le terrain, même s’il existe des évolutions dans les rapports de force entre les belligérants. Comme la plupart des conflits internes qui s’inscrivent dans la durée, la crise syrienne s’est progressivement complexifiée. Elle s’accompagne d’une radicalisation de ses acteurs, d’ingérences régionales et de répercussions croissantes sur les pays voisins.
a. Le plus grave désastre humanitaire de notre temps
A la fin du mois de février 2015, le bilan humain de la crise syrienne dépassait 220 000 morts, 3,8 millions de réfugiés enregistrés (25), 7,6 millions de personnes déplacées à l’intérieur du territoire syrien, 4,8 millions de personnes dans des zones difficiles d'accès et 212 000 personnes assiégées et privées de moyens de subsistance – sur une population de 22 millions d’habitants. Au total, près de la moitié de la population syrienne a dû fuir les combats.
Si effroyables qu’ils soient, ces chiffres ne suffisent pas à donner la pleine mesure du drame humain causé par le conflit. Parmi les millions de déplacés internes et de réfugiés, de très nombreux enfants ne sont plus scolarisés. En Syrie, le taux de scolarisation a chuté d’au moins 50 %. Au Liban, seuls 90 000 enfants syriens sont accueillis dans les écoles, sur environ 400 000. De nombreuses ONG s’inquiètent à juste titre des conséquences pour une telle « génération perdue ». Au plan matériel, les combats ont provoqué des destructions considérables qui touchent aussi bien l’habitat urbain que les principales infrastructures du pays. Plus de la moitié des hôpitaux ont été détruits. La désorganisation du système de santé entraîne de graves conséquences pour la population, notamment la réapparition de maladies que l’on croyait éradiquées en Syrie.
Malgré le vote des résolutions humanitaires 2139 et 2165 du Conseil de sécurité des Nations unies, en 2014, il reste particulièrement difficile, voire impossible d’accéder à des millions de personnes qui ont besoin d’aide à l’intérieur de la Syrie et les violations du droit humanitaire se poursuivent à grande échelle. Le Gouvernement syrien continue de bombarder à l’aide de barils d’explosifs des zones densément peuplées et d’assiéger des populations civiles, sans possibilité de distribution d’aide, tandis que Daesh commet des crimes particulièrement graves. Des informations font notamment état de recrutements d’enfants par ce groupe terroriste.
En Syrie et dans les pays voisins qui accueillent des réfugiés, les besoins sont considérables : au mois de décembre dernier, les agences des Nations unies ont lancé un appel de 8,4 milliards de dollars afin d'aider près de 18 millions de personnes en Syrie et dans toute la région. Cette initiative vise à répondre aux besoins humanitaires de 12,2 millions de personnes à l’intérieur de la Syrie, à hauteur de 2,9 milliards de dollars (dans le cadre du « Syria Strategic Response Plan 2015 »), et à financer des opérations humanitaires d’urgence dans les pays voisins, ainsi que des programmes à plus long terme visant à renforcer leur résilience (« Regional Refugee and Resilience Plan »), pour un montant de 5,5 milliards de dollars, à destination de 6 millions de personnes.
Les réfugiés syriens sont principalement accueillis dans les pays voisins : 1,6 million en Turquie, 1,5 million au Liban et de plus de 600 000 en Jordanie (26), l’Egypte accueillant aussi environ 140 000 réfugiés et l’Irak 250 000. Les pays occidentaux n’accueillent qu’une part infime des réfugiés syriens. Au regard des engagements pris par 28 pays, dont la France (27), lors de la conférence ministérielle de Genève du 9 décembre 2014, 100 000 places devraient être disponibles dans le cadre de programmes de réinstallation (28) et d’opérations humanitaires exceptionnelles, dont 62 000 existant déjà. S’il peut paraître logique que les réfugiés syriens soient principalement accueillis à proximité de leur pays d’origine, encore faudrait-il que la communauté internationale apporte une aide suffisante à ces pays pour supporter le poids social, économique et financier qui leur incombe. Ce n’est malheureusement que partiellement le cas : pour l’année 2014, le plan régional de réponse du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) n’a été financé qu’à hauteur de 63 %.
De manière globale, trois évolutions tendent à complexifier encore la question des réfugiés syriens : au fil du temps et en raison d’une concurrence croissante pour l’accès aux ressources, aux services publics et à l’emploi, les tensions augmentent avec les populations locales qui accueillent les réfugiés ; la problématique humanitaire se double non seulement de difficultés économiques et sociales, mais aussi de tensions politiques et sécuritaires dans les pays d’accueil, à mesure que leur stabilité paraît mise en péril par la masse des réfugiés déjà présents et par l’afflux de nouveaux arrivants ; enfin, les contrôles se renforcent aux frontières, parfois fermées de facto.
b. Une impasse durable au plan militaire
Alors que le régime syrien paraissait en difficulté à l’été 2012, la rébellion progressant dans les faubourgs de Damas et à Alep, tandis qu’elle s’était emparée de la plupart des postes-frontières avec la Jordanie, la Turquie et l’Irak, les forces armées régulières et leurs alliés sont parvenus à rétablir et même à inverser la situation depuis la prise de la localité stratégique de Qoussayr, à la frontière libano-syrienne. La contre-offensive s’est concentrée sur la sécurisation du centre de Damas et d’axes clefs en direction de Homs, de Tartous, de Lattaquié et d’Alep, afin de consolider l’emprise territoriale du régime sur une sorte de « Syrie utile », au prix d’un abandon de parties entières du territoire.
La résilience du régime syrien s’explique en grande partie par le soutien décisif qu’il a pu trouver auprès de l’Iran et de la Russie, ainsi que par un afflux de combattants chiites venus du Liban, d’Irak, d’Iran et d’autres pays plus lointains, tels que l’Afghanistan. Selon certaines estimations, leur nombre pourrait aller jusqu’à 35 000 hommes au total, dont 5 000 seraient issus du Hezbollah libanais (29). L’engagement militaire de ce mouvement aux côtés du régime syrien a eu un impact crucial sur l’évolution du conflit – en particulier pour des combats dans la zone frontalière du Liban, mais des effectifs du Hezbollah auraient aussi été déployés à l’Ouest et au Nord du pays.
Pour l’Iran, la Syrie est un allié stratégique de longue date, qui assure une continuité essentielle avec le Hezbollah, son principal relais au Liban. Téhéran a procuré au régime syrien une aide financière importante, ainsi que des fournitures militaires. Le déploiement d’unités issues des Gardiens de la révolution et de la force Al-Qods, corps d’élite tourné vers les opérations à étranger, aurait notamment aidé à la formation des milices pro-gouvernementales et des forces paramilitaires. Celles-ci ont joué un rôle indispensable dans le renforcement des capacités du régime, aux côtés de l’armée régulière, dont les effectifs disponibles et surtout les unités jugées fiables sont en nombre réduit (30). Les forces syriennes supplétives de la « défense nationale », pour l’essentiel issues des groupes minoritaires (alaouites, chrétiens et druzes), sont organisées, payées et équipées par les autorités (31).
Il est également probable que le régime syrien n’aurait pas survécu sans le soutien apporté par la Russie. Au plan militaire, les ventes d’armes et la fourniture de pièces détachées se sont poursuivies au bénéfice des forces armées, majoritairement équipées en armements soviétiques et russes. Au plan diplomatique, la Russie a utilisé son droit de véto au Conseil de sécurité des Nations unies pour éviter à Damas l’adoption de résolutions contraignantes sous le chapitre VII de la Charte. Les raisons du soutien russe sont multiples. Plus que les contrats d’armement avec la Syrie et les possibilités de mouillage dans le port de Tartous pour la flotte russe, les principaux facteurs sont probablement le fait que la Syrie est le principal point d’appui restant à la Russie dans la région – même si les liens se resserrent avec l’Egypte, la relation américano-égyptienne demeure beaucoup plus structurante – et la volonté de s’affirmer comme une puissance avec laquelle il faut compter sur la scène internationale. Les répercussions de la crise ukrainienne sur les relations avec les Etats-Unis sont également un facteur à prendre en compte.
Du côté de l’insurrection, la régionalisation, et même l’internationalisation du conflit, se traduisent par le soutien déterminé de plusieurs Etats sunnites, en particulier l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. Cet appui aux rebelles syriens repose sur des financements, des fournitures d’armes, mais aussi, en ce qui concerne la Turquie, par la porosité de ses zones frontalières. Ces soutiens régionaux restent décidés à obtenir la chute du régime, alors que la politique américaine est perçue par l’opposition syrienne comme se limitant à l’aide strictement nécessaire pour éviter une victoire du régime et pour pousser à des négociations. Les Américains sont également perçus comme faisant obstacle à la fourniture d’armes sophistiquées – dont l’opposition modérée aurait besoin pour empêcher l’aviation du régime de poursuivre ses bombardements –, par crainte de voir ces équipements tomber entre les mains d’autres groupes (32).
De même que le régime a été renforcé par un afflux de combattants chiites, selon une ligne confessionnelle, l’insurrection syrienne bénéficie d’un afflux au moins égal de combattants terroristes étrangers, essentiellement en provenance des pays de la région, mais aussi d’Europe (33).
Malgré les différents soutiens extérieurs dont elle bénéficie, l’opposition syrienne reste fragilisée par une fragmentation persistante. Depuis sa création, la coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution (la CNS) est handicapée par ses divisions entre différentes factions, en compétition pour l’accès aux flux d’armes et aux financements en provenance des acteurs extérieurs, notamment des fondations privées et des réseaux personnels issus des pays du Golfe. La CNS a également souffert de ses difficultés à gagner le soutien de l’opposition syrienne de l’intérieur et celui de l’insurrection armée.
Sur le terrain, celle-ci est divisée en une multitude d’unités combattantes (34), que l’on peut répartir grossièrement en quatre ensembles : l’insurrection dite « modérée » (35), des groupes à la coloration islamiste plus marquée, des groupes salafistes et enfin des groupes djihadistes. L’opposition « modérée », très désunie et concurrencée par la montée en puissance des autres groupes, pourrait ne plus contrôler que 10 % du territoire syrien. Elle est aujourd’hui très menacée à Alep, l’un de ses bastions historiques et stratégiques, le régime et Daesh la prenant en tenaille et menaçant de la couper de son unique ligne d’approvisionnement vers la Turquie.
La création d’un Conseil militaire suprême (CMS), en décembre 2012, devait permettre d’accroître la coordination au sein des groupes « modérés », avec l’appui des pays occidentaux et des soutiens étatiques régionaux de l’insurrection. Cette structure, qui n’a jamais réussi à jouer un rôle déterminant d’impulsion et d’allocation des ressources, ne représente plus aujourd’hui qu’une sorte de « parapluie » pour les groupes qui continuent de s’en réclamer. De nombreuses formations ont quitté le CMS lorsque les Etats-Unis ont renoncé, en septembre 2013, aux frappes dont ils avaient brandi la menace en réaction à l’usage massif d’armes chimiques par le régime syrien.
D’autres regroupements ont vu le jour, selon une approche locale « de bas en haut ». Ces coalitions de circonstances restent très fluctuantes et très composites – trois des sept groupes unis au sein du « Front islamique », constitué fin 2013, relevaient précédemment du CMS, tandis qu’un autre, Ahrar al-Sham, était ouvertement salafiste et connu pour se coordonner étroitement avec Jabhat al-Nosra, l’émanation officielle d’Al-Qaida en Syrie.
La complexification croissante du conflit syrien se caractérise aussi par l’apparition de fronts supplémentaires depuis la montée en puissance de Daesh.
– Tout d’abord, le comportement très hégémonique et particulièrement brutal de Daesh à l’égard des autres groupes syriens a conduit le reste de l’opposition armée, y compris Jabhat al-Nosra, à joindre ses forces pour combattre localement Daesh au début de l’année 2014.
– La collusion établie de longue date entre Daesh et le régime semble également avoir été rompue. Daesh s’est attaqué cet été à des cibles gouvernementales à Homs, Raqqa et Hassakeh, en y faisant d’épouvantables massacres – des vidéos de têtes de soldats syriens plantées sur des piques ont alors circulé. Le régime, quant à lui, a saisi l’aubaine de la constitution d’une coalition internationale contre Daesh (36) pour se présenter désormais comme un adversaire résolu de cette organisation djihadiste.
– Un troisième front s’est ouvert entre Daesh et les Kurdes syriens, qui défendent l’autonomie naissante de leurs enclaves du Nord du pays, depuis que le régime syrien a retiré ses troupes pour les redéployer ailleurs en Syrie. Déjà marqué par des affrontements entre les « comités de protection du peuple kurde », bras armé du parti PYD, proche du PKK, et des forces de Daesh, ce front s’est montré particulièrement actif lorsque ce groupe djihadiste a lancé une offensive contre l’enclave kurde de Kobané au mois de juin dernier. Défendue opiniâtrement par les combattants kurdes, elle a été sauvée par les frappes aériennes menées en Syrie contre Daesh. La Turquie a également assoupli ses frontières pour laisser passer des combattants kurdes venus d’Irak.
Carte des régions à majorité kurde en Syrie 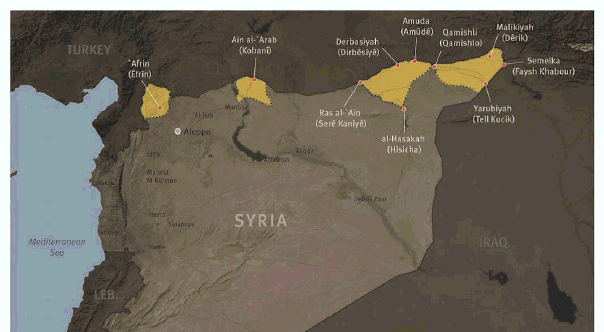
(Source : Human Rights Watch, juillet 2014)
A ce stade du conflit, aucun des belligérants ne paraît en mesure de remporter une victoire militaire définitive en Syrie. A moins d’un renversement significatif des tendances actuelles, ni les forces du régime et leurs alliés, ni les différents groupes de l’insurrection modérée, ni Daesh ne paraissent avoir les effectifs et les capacités militaires nécessaires pour l’emporter de manière décisive. Des évolutions réelles peuvent avoir lieu sur le terrain en faveur de l’une ou l’autre partie, mais les gains diffèrent selon les zones de combat et ils ne sont pas toujours durables. Dans son article précité, Charles Lister évoque donc une « impasse dynamique » (« dynamic stalemate »).
Du côté du régime, bien que la situation ait été rétablie depuis 2013, les forces armées syriennes subissent des taux d’attrition importants, et des milices chiites auraient retraversé la frontière après la débâcle de l’armée irakienne face à Daesh au mois de juin dernier. La Russie et l’Iran, affectés par des sanctions internationales et par la chute du prix du pétrole, tarderaient à répondre aux nouvelles demandes d’aide financière de Damas.
A ce stade, Daesh ne paraît pas significativement bousculé par les frappes aériennes dont il fait l’objet en Syrie. A la demande des autorités irakiennes, les Etats-Unis ont élargi leurs frappes de l’Irak à la Syrie, d’où est partie la fulgurante offensive de Daesh au cours de l’été 2014. Il semblerait que Daesh ait plutôt tendance à se consolider dans les zones qu’il contrôle et à gagner du terrain sur les groupes « modérés » de l’insurrection syrienne. Le risque est que Daesh parvienne à se positionner comme le seul groupe militairement efficace contre le régime, au détriment de l’opposition modérée.
Au sein de l’opposition, les équilibres auraient évolué depuis le début de l’année 2014, car les soutiens régionaux, en particulier l’Arabie saoudite et la Turquie, tourneraient davantage leur aide vers des groupes modérés préalablement approuvés par les Américains. Dans le même temps, on assisterait néanmoins à un affaiblissement global des capacités militaires de l’opposition. Les frappes aériennes contre Jabhat al-Nosra (JAN) (37), en parallèle de celles visant Daesh, alors que le régime est épargné, ont également semé le trouble : JAN est considéré comme un allié dans le combat contre le régime. L’opposition syrienne est en déclin, y compris du point de vue de son moral. Ses positions, déjà fragiles et limitées, se resserrent, en particulier à Alep et dans ses environs.
Il faut aussi prendre en considération la dimension régionale du conflit dans l’impasse « dynamique » actuelle. Comme le faisait observer M. Joseph Maïla, ancien directeur de la prospective au Ministère des affaires étrangères, professeur de sociologie politique et de relations internationales, entendu par la commission des affaires étrangères le 27 janvier 2015, l’Iran ne pourrait pas accepter la victoire de l’opposition syrienne, tandis que les pays sunnites qui la soutiennent ne pourraient pas accepter la victoire de Bachar el-Assad.
c. La tendance à la radicalisation de l’insurrection
Plusieurs facteurs ont participé à la radicalisation d’une partie de l’insurrection, qui s’est traduite par l’infiltration et l’essor de groupes salafistes et de groupes djihadistes (38) s’inspirant d’Al-Qaida, dont les plus importants sont Daesh – le prétendu Etat islamique en Irak et au Levant (39) – et Jabhat Al-Nosra (JAN), son rival djihadiste qui est l’incarnation officielle d’Al-Qaida en Syrie. Les effectifs des principaux groupes djihadistes ont pu être estimés à au moins 20 000 ou 25 000 hommes en Syrie dès la mi-2014, soit environ un quart du nombre total des rebelles à cette époque (40).
Ces chiffres doivent bien sûr être considérés avec précaution, mais ils sont indicatifs d’une tendance lourde et très préoccupante. L’affaiblissement de l’opposition armée non-djihadiste se poursuit en Syrie, où les défections au profit de Jabhat al-Nosra et de Daesh demeurent importantes. L’influence de Jabhat al-Nosra, qui reste un acteur majeur au sein de la rébellion, est notamment croissante au Nord du pays. A Alep, des groupes modérés de combattants rejoindraient des alliances dominées par des groupes islamistes afin de lutter contre le régime et de contenir l’avancée de Daesh.
Une part importante de responsabilité dans cette évolution revient au régime syrien. Bachar el-Assad a facilité la radicalisation de l’opposition en libérant des centaines de combattants djihadistes au début de la crise, afin d’inoculer le virus de l’extrémisme dans les rangs de l’opposition et de la discréditer aux yeux des Syriens et du reste du monde. Cette stratégie s’est prolongée par une cohabitation, voire une collusion opérationnelle avec les groupes les plus radicaux de l’insurrection, qui ont pu prospérer, les opérations militaires du régime ayant largement épargné les territoires sous leur contrôle. Ce n’est qu’au moment où une coalition internationale s’est formée contre Daesh que la capitale des djihadistes, Raqqa, a commencé à être bombardée par l’aviation syrienne. La stratégie cynique consistant à dépeindre l’opposition comme étant composée de terroristes a partiellement fonctionné comme une prophétie auto-réalisatrice.
L’inscription du conflit dans la durée a également joué un rôle dans la montée en puissance des groupes extrémistes, de même que la multiplication des atrocités et des destructions, la volonté de vengeance, le sentiment d’être abandonné par la communauté internationale et celui de ne plus rien avoir à perdre. Si l’opposition modérée s’est trouvée sur une pente déclinante et a perdu des effectifs au profit de groupes plus radicaux, c’est aussi en raison de leur plus grande efficacité sur le terrain, notamment grâce à des financements qui leur permettent de bénéficier du meilleur équipement possible et de verser des soldes attractives. Le renoncement américain à intervenir en Syrie au mois de septembre 2013, après avoir brandi la menace de frappes aériennes dans le contexte de la crise des armes chimiques, aurait également poussé de nombreux groupes à s’éloigner de l’Armée syrienne libre et à rejoindre d’autres rangs.
Comme le montre un récent rapport de l’Institute for the Study of War consacré au mouvement Jabhat al-Nosra (JAN) (41), l’ancrage et l’essor des groupes radicaux dans le paysage syrien peuvent aussi faire appel à des stratégies mêlant alliance avec les autres groupes d’insurgés et construction méthodique d’une popularité sur le terrain. Bien que JAN et Daesh (42) partagent le même objectif de long terme, consistant à établir un régime islamique fondé sur l’application d’une certaine vision de la charia, JAN s’est bien gardé de proclamer un califat dans une perspective de contrôle territorial immédiat (43).
Jabhat al-Nosra a cherché en revanche à se rendre indispensable auprès des populations locales par son action caritative (distribution de pain et d’autres biens nécessaires pour les populations vulnérables) et par la fourniture de services publics (sécurité, fonctionnement des moulins à pain, vaccinations contre la polio) dans des zones contrôlées par l’insurrection et des camps de réfugiés. Ces activités, qui font l’objet d’une médiatisation active, s’accompagnent aussi d’actions de prosélytisme.
Au plan militaire, Jabhat Al-Nosra s’est engagé dans des coopérations avec d’autres groupes de l’insurrection (44). Ses moyens importants et son niveau élevé de « professionnalisme » en ont fait un partenaire de choix pour d’autres groupes qui peuvent être relativement divers – salafistes, islamistes modérés ou affilés à l’ASL. Les protestations au sein de l’opposition « modérée » contre la désignation de JAN comme organisation terroriste par les Etats-Unis, en décembre 2012, ont témoigné du succès de cette stratégie.
d. De multiples efforts internationaux, jusque-là sans succès
Malgré de nombreuses initiatives diplomatiques, la crise syrienne n’a pu être ni résolue ni même atténuée. M. Lakhdar Brahimi, ancien envoyé conjoint des Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie, d’août 2012 à mai 2014, a eu l’occasion d’expliquer qu’aucune des parties, qu’il s’agisse des acteurs syriens du conflit ou de leurs soutiens régionaux, n’a jusqu’à présent souhaité sérieusement des négociations de paix. Tous continuent à proclamer qu’il n’existe pas de « solution militaire », tout en persistant à élaborer des plans de guerre. Le recours à un « troisième cercle » international, formé des Américains et des Russes, n’a pas produit davantage de résultats. Le prédécesseur de M. Brahimi, M. Kofi Annan, avait d’ailleurs attribué l’échec de sa propre médiation au manque de soutien et aux divisions de la communauté internationale.
La Ligue arabe a d’abord tenté de s’interposer en proposant un plan de sortie de crise, adopté le 2 novembre 2011 après de longues négociations avec le régime syrien et formellement accepté par Bachar el-Assad « sans réserve et dans sa totalité ». Ce plan d’action prévoyait l’arrêt des violences commises par toutes les parties, le retrait des forces militaires déployées sur le terrain, la libération des personnes détenues en raison des soulèvements populaires et la libre circulation d’observateurs de la Ligue arabe et de médias étrangers. Ce plan étant resté lettre morte, la Ligue arabe a proposé un nouveau plan de sortie de crise, le 22 janvier 2012. Il prévoyait une délégation de compétences au vice-président syrien et la formation d’un gouvernement d’union nationale, puis la préparation d’élections législatives et présidentielles. Malgré le soutien apporté par la résolution A/RES/66/253 de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), adoptée le 16 février 2012, cette initiative n’a pas donné davantage de résultats. La mission des observateurs de la Ligue arabe, déployée fin décembre 2011 avec l’accord de Damas, a été suspendue dès la fin du mois de janvier suivant, en raison de la recrudescence des violences sur le terrain.
Les secrétaires généraux des Nations unies et de la Ligue arabe ont ensuite nommé M. Kofi Annan, prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général de l’ONU, comme envoyé spécial conjoint, le 23 février 2012. Le « plan en six points » de M. Kofi Annan, que le gouvernement syrien s’est engagé le 25 mars 2012 à appliquer, prévoyait la mise en place d’un « processus politique ouvert, dirigé par les Syriens » et la désignation d’un « interlocuteur disposant des pouvoirs nécessaires », lorsque l'envoyé spécial en ferait la demande ; l’arrêt des offensives gouvernementales et une collaboration pour faire cesser durablement toutes les violences armées, dans le cadre d’un mécanisme de supervision placé sous l’égide de l’ONU ; des mesures permettant l’acheminement effectif de l’aide humanitaire ; un processus de libération des prisonniers ; des garanties pour la libre circulation des journalistes dans tout le pays ; le respect de la liberté d’association et du droit de manifester pacifiquement dans les conditions déterminées par la loi. La résolution 2043 du 21 avril 2012 du Conseil de sécurité a ensuite autorisé le déploiement de 300 observateurs dans le cadre d’une mission de supervision des Nations unies en Syrie, la MISNUS.
Un « groupe d’action » pour la Syrie s’est ensuite réuni à Genève lors d’une conférence pour la paix dite « Genève 1 », le 30 juin 2012, afin d’élaborer un consensus sur les moyens d’appliquer ce plan en six points. Le « groupe d’action », constitué des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, de la Turquie, des secrétaires généraux de l’ONU et de la Ligue arabe, de la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que de l’Irak, du Koweït et du Qatar, dans le cadre des responsabilités qu’ils exerçaient alors au sein de la Ligue arabe, a demandé la formation d’un organe de gouvernement transitoire, doté des pleins pouvoirs exécutifs, sur la base du consentement mutuel (45).
Ni le plan Annan ni les lignes directrices établies lors de la conférence de « Genève 1 » n’ont été suivis d’effet. La proposition d’une résolution du Conseil de sécurité assortissant de sanctions le respect du plan Annan, sous chapitre VII de la charte des Nations unies, s’est d’ailleurs heurtée au véto de la Russie et de la Chine, dès le 19 juillet 2012. La mission d’observation des Nations unies, d’abord suspendue en juin, puis relancée en juillet, a officiellement pris fin au mois d’août du fait de la dégradation des conditions de sécurité. M. Annan a alors choisi de quitter ses fonctions d’envoyé spécial.
Son successeur, M. Lakhdar Brahimi, a concentré ses efforts sur la mise en œuvre du communiqué publié à l’issue de la conférence de « Genève 1 ». Une nouvelle conférence, dite de « Genève 2 », a réuni des représentants du gouvernement syrien et de l’opposition à la fin du mois de janvier 2014, à Montreux, grâce à une initiative russo-américaine, mais sans obtenir le moindre succès. Des négociations directes ont certes été engagées entre les parties au conflit, pour la première fois, mais ces négociations se sont rapidement interrompues, le régime et l’opposition ne parvenant même pas à s’entendre sur un ordre du jour. La délégation du régime insistait sur la lutte contre le terrorisme et l’opposition sur la nécessité d’engager un processus de transition.
M. Brahimi ayant à son tour démissionné, le nouvel envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Staffan de Mistura, nommé en juillet 2014, a travaillé à un plan de gel des hostilités dont il a eu l’occasion d’évoquer les contours devant le Conseil de sécurité, ainsi qu’auprès du gouvernement syrien et de représentants de l’opposition. Cette approche « par le bas », qui concernerait initialement Alep, vise à arrêter la « machine automatique de la guerre » (46). Elle permettrait d’améliorer la situation au plan humanitaire, d’engager le dialogue au plan local et de favoriser la reconstruction, tout en créant une dynamique positive qui pourrait servir de soubassement, par la suite, à un règlement politique de la crise. Un tel « gel des hostilités » serait moins strict qu’un accord de cessez-le-feu et donc plus résistant à des violations ponctuelles.
A ce stade, la proposition de M. de Mistura n’a pas reçu de fin de non-recevoir définitive, mais les conditions d’un accord restent manifestement très difficiles voire impossibles à réunir. Elles font aussi l’objet d’un certain nombre d’interrogations. De précédents accords, conclus à l’issue de sièges menés par les forces armées syriennes, notamment à Homs, se sont en réalité traduits par une reddition des insurgés et par la disparition de combattants entre les mains du régime. Il faudrait également s’assurer qu’un gel localisé des hostilités ne s’accompagne pas de déplacements de forces d’un théâtre à un autre pour y poursuivre les affrontements avec encore plus de violence. L’articulation avec la reprise d’un processus politique reste par ailleurs à définir.
Dans ce domaine, la Russie a pris l’initiative de réunir des représentants du gouvernement et d’une fraction de l’opposition, à la fin du mois de janvier 2015. La conférence de « Moscou 1 », à laquelle seuls quelques membres de la Coalition nationale syrienne ont été invités à titre personnel, n’a pas permis de réaliser d’avancée, hormis un accord pour continuer à négocier et l’adoption de principes généraux tels que le règlement de la crise par des moyens pacifiques et politiques sur la base du communiqué de « Genève 1 ». Une conférence de « Moscou 2 » pourrait être organisée au cours du mois d’avril prochain.
Jusqu’à présent, le seul résultat concret qui ait été obtenu au plan international est le démantèlement de l’arsenal chimique détenu par le gouvernement syrien, après le massacre commis dans le quartier de la Ghouta en août 2013, dans la banlieue de Damas. La résolution 2118 du 27 septembre 2013 est la première résolution adoptée par le Conseil de sécurité pour imposer à la Syrie des obligations assorties d’une perspective de mesures coercitives. Une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a confirmé, mi-2014, que l’ensemble des stocks d’agents chimiques déclarés par le régime a été sorti du pays à cette date. Le rapport intérimaire de la mission de l’OIAC a toutefois confirmé dans le même temps la crédibilité d’allégations d’emploi systématique de gaz au chlore en Syrie. Les massacres se poursuivent également par d’autres moyens, y compris des barils de TNT remplis de pièces métalliques et largués sur des populations civiles depuis des hélicoptères.
Plusieurs résolutions ont également été adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies au sujet de la situation humanitaire, mais sans véritable effet concret sur le terrain. Comme la mission d’information a eu l’occasion de l’indiquer précédemment dans ce rapport, la situation humanitaire reste particulièrement préoccupante en Syrie.
e. Les répercussions sur les pays voisins
– Au Liban, le conflit syrien se traduit notamment par l’accueil d’un nombre considérable de réfugiés. Le HCR en a enregistré 1,1 million, mais ils seraient en réalité près d’1,5 million, soit près d’un tiers de la population libanaise. Selon le président du conseil des ministres du Liban, M. Tammam Salam, reçu par la commission des affaires étrangères le 10 décembre dernier, il s’agit d’un « poids impossible à porter lorsqu’il se traduit en besoins scolaires, soins de santé et services publics divers ». M. Tammam Salam a rappelé que le coût pour le Liban de l’accueil des réfugiés syrien est estimé à 7,5 milliards de dollars par la Banque mondiale.
Leur accueil est rendu plus difficile par les difficultés économiques et sociales que le Liban traverse, notamment du fait de la crise syrienne. Un rapport de la Banque mondiale estimait en 2013 que, durant la période 2012-2014, le conflit syrien était susceptible de ralentir la croissance du PIB réel de 2,9 points de pourcentage chaque année, de faire basculer environ 170 000 Libanais dans la pauvreté – outre le million d’habitants qui vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté –, de doubler le taux du chômage, qui s’établirait à plus de 20 %, et d’amputer les recettes fiscales de l’État de 1,5 milliard de dollars, tout en augmentant parallèlement les dépenses de 1,1 milliard en raison de la forte progression de la demande de services publics, ce qui porterait l’impact total sur le budget libanais à 2,6 milliards de dollars (47).
Les conditions d’entrée sur le territoire libanais ont récemment été durcies, ce qui n’est pas un phénomène propre au Liban, la Jordanie et la Turquie ayant également renforcé le contrôle de leurs frontières. Le 31 décembre dernier, le Gouvernement libanais a déclaré que les Syriens auront désormais besoin d'un visa pour entrer au Liban, pour la première fois depuis la création des deux pays. Cette mesure a généralement été perçue comme une politique visant à limiter les entrées de réfugiés syriens. Elles auraient immédiatement chuté de 80 % à l’annonce de cette nouvelle réglementation.
Au plan sécuritaire, le conflit syrien s’est importé dans la ville de Tripoli, au Nord du pays, secouée par un cycle de violences confessionnelles entre quartiers alaouite et sunnite. Des attentats ont également eu lieu à Beyrouth, contre l’ambassade iranienne et des cibles chiites, probablement en représailles à la forte implication de l’Iran et du Hezbollah dans le conflit syrien – au mépris, pour ce dernier, du pacte dit « de Baabda » souscrit en 2012 par les diverses factions libanaises afin d’interdire toute intervention dans le conflit voisin et de mettre ainsi le Liban à l’abri de la « guerre des axes ». L’extension des opérations de Daesh et de Jabhat al-Nosra au Liban est une autre source d’inquiétude majeure depuis les affrontements d’Ersal, début août, et la prise en otage de soldats et de policiers libanais. Ces groupes extrémistes, qui ont également mené des actions à Tripoli, seraient implantés autour d’Ersal dans le versant libanais du mont Qalamoun. Pour la première fois, le Liban se trouve directement et durablement menacé par des acteurs de la crise syrienne. Un lien commence aussi à être fait entre la présence massive de réfugiés en provenance de Syrie et l’accroissement de la menace terroriste sur le sol libanais.
Dans cette situation de fortes turbulences et alors que le conflit syrien divise la classe politique libanaise (48), l’impossibilité d’élire un nouveau président est une fragilité supplémentaire. Le mandat de Michel Sleimane a pris fin en mai 2014, sans qu’un successeur ait pu être élu. Dans la période actuelle, le Liban aurait plus que jamais besoin de pouvoir compter sur toutes ses forces, en particulier ses institutions. En l’absence de chef de l’Etat, le pays n’a plus de chef constitutionnel des armées, ni de figure d’unité nationale. Le conseil des ministres exerce par défaut les pouvoirs présidentiels, mais la règle d’unanimité qui prévaut est naturellement un facteur de blocage – le Liban a pour ainsi dire 24 présidents.
– La Jordanie accueille plus de 620 000 réfugiés syriens enregistrés – ils seraient en réalité plus proches d’un million –, auxquels se sont joints de nombreux réfugiés irakiens depuis le début de l’année 2014. Malgré l’existence de camps d’accueil, dont les principaux sont ceux de Zaatari (80 000 réfugiés), à 11 kilomètres de la frontière syrienne, et celui d’Azraq (12 000 réfugiés), à 80 kilomètres à l’Est d’Amman, la plupart des réfugiés syriens vivent dans les villes et les villages de Jordanie. Leur impact économique et social était évalué à 4 milliards d’euros en 2013. La présence des réfugiés syriens fait peser un poids important sur les ressources limitées en eau et en énergie du Royaume, ainsi que sur ses infrastructures, notamment en matière d’éducation et de santé.
Même si l’impact sur les équilibres et la stabilité de la Jordanie est probablement moindre qu’au Liban, en raison des différences structurelles entre les deux pays, la Jordanie ayant une structure étatique plus développée, les autorités estiment que le pays a atteint sa capacité maximale. Les Nations unies ont d’ailleurs constaté une réduction très importante des arrivées depuis la fin du mois de septembre 2014 et la présence de nombreux Syriens bloqués à la frontière (49). Même si la Jordanie n’est pas revenue sur sa politique d’accueil des réfugiés syriens, sa frontière serait dans les faits quasiment fermée.
Selon le HCR, un grand nombre de Syriens réfugiés en Jordanie est en train de sombrer dans l'extrême pauvreté à un rythme alarmant en raison de l'ampleur de la crise et de l'insuffisance du soutien de la communauté internationale. Les deux tiers des réfugiés sur le territoire jordanien vivent désormais en dessous du seuil national de pauvreté, et un ménage sur six se trouve dans des conditions d’extrême pauvreté, avec moins de 40 dollars par personne et par mois. La situation économique générale du pays reste dégradée, avec un taux de chômage de 14 % en 2013 et des pénuries régulières en eau et en électricité.
La Jordanie, qui a déjà traversé de nombreuses crises depuis sa création et de nombreux afflux de réfugiés, notamment palestiniens, continue à faire preuve de sa capacité historique de résistance et fait figure d’îlot de stabilité dans le contexte des crises avoisinantes – en Syrie, en Irak, mais aussi à Gaza. Alors que le pays a connu des vagues de contestation populaire à partir de 2011, la monarchie a su engager un processus de réformes politiques destiné à moderniser le pays, et elle apparaît de plus en plus, dans le contexte actuel, comme le garant principal de sa sécurité et de sa stabilité. Le développement de l’islamisme militant dans des villes appauvries et accueillant de nombreux réfugiés, tels que Mafraq et Zarqa, est néanmoins une cause importante de préoccupation. Il y aurait déjà 2 000 Jordaniens engagés en Syrie, ce qui expose à des risques évidents en cas de retour.
– En Turquie, selon l’agence chargée de la gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD), le nombre de réfugiés syriens serait de 1,6 million, dont 1,4 million enregistrés, soit un triplement en un an. La Turquie, qui a notamment connu un afflux massif depuis l’enclave kurde de Kobané, serait devenue le premier pays d’accueil des réfugiés fuyant le conflit syrien. Les autorités turques redoutent de nouveaux afflux massifs si Alep venait à tomber et appellent à la mise en place de zones sûres dans le Nord de la Syrie. Ce dispositif, qui nécessiterait l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne contre l’aviation du régime, permettrait d’accueillir des réfugiés dans la zone frontalière.
Les réfugiés présents en Turquie sont essentiellement concentrés dans les régions frontalières, les provinces du Hatay, de Gaziantep et de Sanliurfa, ainsi qu’à Istanbul. Seuls 20 % d’entre eux vivent dans des camps. Parmi ceux qui résident hors des camps, beaucoup se trouvent dans une situation de grande précarité. Leur installation massive et sur la durée provoque des tensions croissantes, et parfois violentes, avec les populations locales.
Les autorités turques maintiennent leur politique officielle de porte ouverte et ont adopté, en octobre 2014, une directive sur la protection temporaire qui s’applique de manière rétroactive aux réfugiés syriens arrivés depuis 2011. Elle offre un cadre légal plus solide et doit permettre l’adoption de mesures favorisant l’accès aux principaux services de base. Elle confirme ainsi le droit des réfugiés à un accès gratuit au système médical, pour les premiers soins et les soins d’urgence, et confie au ministère de l’éducation la tâche d’intégrer les enfants réfugiés dans le système scolaire. D’après l’UNICEF, seuls 26 % des jeunes Syriens résidant en dehors des camps bénéficient d’une forme d’éducation.
Au plan économique, la situation de la Syrie et de l’Irak affecte l’activité des zones frontalières de la Turquie. Il faut rappeler que le développement du Sud-Est anatolien avait précédemment connu une nouvelle impulsion grâce à la réorientation des échanges commerciaux turcs vers le Proche et le Moyen-Orient. Au plan financier, l’impact des réfugiés est estimé entre 2 et 5 milliards de dollars.
Au plan sécuritaire, les incidents à la frontière turco-syrienne sont restés assez limités, malgré des moments de très forte tension. Lorsque la ville d’Akçakale a été touchée en octobre 2012 par une bombe syrienne, Ankara a ainsi menacé Damas de représailles et fait voter par le Parlement turc une autorisation d’intervention en Syrie, avant d’obtenir le déploiement de batteries de missiles « Patriot », fournies par des membres de l’OTAN. Les tensions ont connu un autre pic en mai 2013, quand un attentat à la voiture piégée a fait une cinquantaine de morts à Reyhanli, dans la province du Hatay (Alexandrette). Les autorités turques ont rapidement pointé du doigt la responsabilité des services syriens, qui auraient manipulé un groupe gauchiste turc, tandis que Damas accusait Ankara d’avoir transformé la région en foyer du terrorisme (50).
La politique attentiste des autorités turques lors du siège de l’enclave kurde syrienne de Kobané, tenue par le PYD, dont Ankara n’apprécie guère la proximité avec le PKK turc, a suscité d’importantes manifestations kurdes dans le Sud-Est du pays, avec des troubles à l’ordre public qui se sont accompagnés de près de quarante morts. Il s’y est ajouté des mises en garde d’Abdullah Öcalan, le leader du PKK, sur les conséquences potentielles pour le processus de paix avec Ankara (51). Les autorités turques ont fini par laisser passer, par leurs frontières, des renforts en provenance du Kurdistan irakien et à destination de Kobané.
– Malgré sa propre crise interne, l’Irak accueille aussi de nombreux réfugiés en provenance de Syrie. Leur nombre s’élevait à près de 250 000 au début de l’année 2015. Environ 95 % d’entre eux se trouveraient dans la région autonome du Kurdistan irakien. Avec l’afflux des réfugiés syriens et celui de nombreux déplacés internes d’origine irakienne – le pays en compte plus de 2 millions –, la population de la région kurde se serait accrue de 30 %. Une telle situation s’accompagne d’inquiétudes croissantes quant aux capacités d’accueil dans cette partie de l’Irak.
La carte ci-dessous présente la répartition des réfugiés syriens au plan régional.
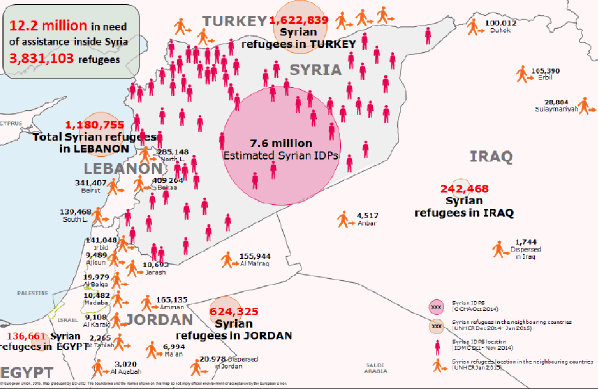
(« IDP » - « Internally Displaced Persons » : déplacés internes).
Situation au 6 mars 2015.
Source : Commission européenne.
3. L’échec de la reconstruction de l’Irak post-Saddam Hussein
a. L’offensive fulgurante de Daesh en juin 2014
La chute de la deuxième plus grande ville d’Irak (52), Mossoul, entre les mains de l’organisation djihadiste Daesh, le 10 juin dernier, a été un choc immense, mais aussi un puissant révélateur. Comme le rappelle un rapport de l’International Crisis Group, publié quelques jours plus tard (53), l’analyse prédominante était alors que l’Irak avançait sur la voie de la reconstruction, lentement mais sûrement, après la destruction de ses institutions et le démantèlement de son armée qui ont suivi l’intervention américaine de 2003 et le renversement de Saddam Hussein.
La chute de Mossoul, qui avait été précédée au moins de janvier 2014 par celle de Fallouja, dans la province d’al-Anbar, a révélé à quel point l’Etat irakien était miné de l’intérieur par la politique sectaire, autoritaire et répressive du Premier ministre de l’époque, Nouri al-Maliki, qui avait aliéné une grande partie de la population sunnite du pays. Sous la poussée des djihadistes, alliés à d’autres groupes, les forces armées irakiennes, considérées comme une armée d’occupation dans les provinces majoritairement sunnites, se sont effondrées comme un château de cartes.
Selon les estimations fournies par M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement international, l’armée irakienne était pourtant forte de 450 000 militaires, auxquels s’ajoutaient entre 600 000 et 650 000 hommes des forces de sécurité. De tels effectifs – théoriques – n’ont pas été en mesure de faire rempart à environ 5 000 hommes déterminés (54).
Après Mossoul, Daesh a continué sa progression vers le Sud du pays, en direction de Bagdad, et s’est implanté dans les provinces du Nord-Est. A la fin du mois d’août 2014, le ministre de la défense, M. Jean-Yves le Drian, estimait que le Gouvernement irakien avait perdu le contrôle de 40 % de son territoire (55). L’avancée de Daesh ne s’est interrompue que lorsqu’elle s’est heurtée à des forces faisant preuve d’une plus grande résistance : des unités chiites appartenant à l’armée irakienne, des milices également chiites et des combattants kurdes, c’est-à-dire des forces défendant ce qu’elles pouvaient considérer comme étant leur propre territoire. Daesh a ainsi échoué aux portes de Bagdad, composé à 80 % de chiites, et d’Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan.
La carte ci-dessous présente l’implantation de Daesh en Irak et en Syrie au début de l’année 2015.

Source : Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’Histoire, de l’occupation étrangère à l’Etat islamique, Vendémiaire, février 2015
b. La politique autoritaire, sectaire et répressive de l’ancien Premier ministre Maliki
Au lieu de respecter l’accord dit « d’Erbil », conclu entre les principales formations politiques irakiennes à l’issue des élections de 2010, afin d’assurer un partage équitable du pouvoir (56), le Premier ministre irakien de l’époque, M. Nouri al-Maliki (57) a mené une politique qui a fini par conduire le pays à sa dislocation. Comme l’a expliqué M. Jean-François Girault au cours de l’audition précitée, M. Maliki s’est employé à « concentrer les pouvoirs, à contourner l’esprit et la lettre de la Constitution, à neutraliser les institutions, à transformer le régime parlementaire en pouvoir personnel, à instrumentaliser la justice, à concentrer dans ses mains l’ensemble des revenus du pays, à prendre un contrôle exclusif sur l’appareil sécuritaire en nommant des proches et à obtenir l’allégeance d’institutions normalement indépendantes comme la banque centrale et la Cour suprême ».
Cette confiscation du pouvoir s’est accompagnée d’un renforcement du sentiment d’exclusion de la population sunnite, minoritaire et dépossédée du pouvoir qui était exercé par des sunnites jusqu’à la chute de Saddam Hussein (58). Malgré des promesses de réintégration dans le jeu institutionnel et dans la société irakienne, M. Maliki a multiplié les signes contraires. Il a notamment refusé d’intégrer dans les forces de sécurité des milices que les Américains avaient réussi à rallier pendant l’insurrection armée du milieu des années 2000 (59) et empêché des adversaires politiques de présenter leur candidature aux élections de 2010, au nom de la débaasification du pays. L’arrestation des gardes du corps du ministre des finances sunnite Rafi al-Issaoui, en décembre 2012, a fini par conduire à une mobilisation populaire massive dans les provinces majoritairement sunnites d’al-Anbar, de Salaheddine, de Ninive, de Kirkouk et de Diyala.
Le recours à la répression comme seule réponse aux protestations populaires, sous couvert de lutte contre le terrorisme, a fait ressurgir la violence à l’échelle de tout le pays. Une nouvelle insurrection s’est rapidement levée, avec une composante salafiste djihadiste incarnée par ce qui est aujourd’hui nommé Daesh. Après l’évacuation par la force de manifestants à Hawiza, au Sud-Est de Kirkouk, en avril 2013, au prix de 20 morts et de 100 blessés (60), des affrontements ont repris entre milices sunnites et chiites. Un décompte effectué par les Nations unies fait état de 7 818 civils et de 1 050 membres des forces de sécurité tués dans les différentes vagues de violence de 2013. Le niveau global reste alors inférieur à celui du milieu des années 2000, mais le nombre des attentats-suicides et des attaques à la voiture piégée commis par l’Etat islamique se rapproche de celui de 2007-2008 (61).
Selon Mme Myriam Benraad, chercheuse au CERI-Sciences Po et analyste au Conseil européen des affaires étrangères (ECFR), entendue le 7 mai 2014, le système politique irakien a été incapable non seulement de produire un accord répondant aux demandes formulées par les sunnites irakiens, mais aussi d’établir des mécanismes de dialogue, de compromis et de résolution des conflits (62). Lors de son audition du 18 juin 2014, M. Jean-François Girault a estimé que cette escalade était délibérée : M. Maliki « a mis le feu aux poudres dans la province d’Al-Anbar, a créé l’insurrection sunnite (…) pour apparaître, in fine, comme le sauveur de la patrie en danger ». Il a ainsi fédéré contre son gouvernement des acteurs aux agendas pourtant très différents : des tribus attendant un partage différent du pouvoir, des clercs religieux hostiles à ceux cooptés par M. Maliki, d’anciens membres du parti Baas et des forces armées, ainsi que d’anciens participants à l’insurrection armée contre les forces américaines (63).
Daesh, dont les forces s’étaient régénérées sur le théâtre syrien voisin, a saisi cette occasion de remonter en puissance en Irak et de lancer une vaste offensive en compagnie d’autres groupes armés qui ne partagent pourtant pas tous ses orientations. Cette alliance hétéroclite inclut notamment Jaysh Rijal al-Tariqah al-Naqshabandia (JRTN) (64) et le Conseil général militaire des révolutionnaires irakiens, nationalistes-séculiers, l’armée islamique d’Irak, islamiste-nationaliste, Jaysh al-Moudjahidin et Ansar al-Islam, salafistes djihadistes (65).
c. La responsabilité américaine dans la déstabilisation du pays
Malgré le départ de leurs troupes en 2011, les Etats-Unis ont une part de responsabilité dans les politiques menées par M. Maliki depuis cette date. Comme les Iraniens, les Américains ont continué à apporter leur soutien aux responsables irakiens, dans la mesure où ils parvenaient à gagner les élections et à donner l’impression – finalement illusoire – qu’ils réussissaient à contenir la menace djihadiste dans le pays.
En outre, si les politiques menées par Nouri al-Maliki ont incontestablement attisé le ressentiment des populations sunnites, la question de leur participation à l’Etat irakien s’est posée dès le renversement de Saddam Hussein. Les premières élections organisées en janvier 2005 ont été largement boycottées dans les provinces majoritairement sunnites d’al-Anbar, de Salaheddine et de Ninive. Au mois d’octobre suivant, le projet de Constitution était rejeté par les deux tiers des voix dans ces deux premières provinces.
Selon M. Peter Harling, directeur de projet à l’International Crisis Group, plusieurs « péchés originels » ont été commis par les Américains : le démantèlement intégral des structures de l’Etat irakien et la criminalisation de ses anciens membres, la mise en place d’un système politique conçu de manière sectaire, la promotion de responsables politiques déconnectés de la société irakienne et la négociation d’une Constitution reflétant essentiellement un accord entre chiites et kurdes, au détriment des sunnites (66). « En projetant une vision rudimentaire de la société (…) et en échafaudant une construction politique fondée sur ces clichés, les Etats-Unis ont fait de l’Irak une parodie de lui-même ». Le message passé à la partie sunnite de la population irakienne était que la « dé-baasification » de l’Etat irakien était synonyme de « dé-sunnisation ».
Les Américains se sont aussi désengagés d’Irak en 2011 sans avoir réglé un seul des problèmes de fond du pays : la question des territoires « disputés » entre le gouvernement fédéral et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) ; la répartition des ressources pétrolières du pays ; le rapport entre le pouvoir central et les provinces irakiennes ; les prérogatives du Premier ministre et l’institution de contre-pouvoirs ; la structure des forces de sécurité (67). Aujourd’hui encore, ces questions restent entières.
4. La question israélo-palestinienne
a. Le conflit n’a rien perdu de sa centralité stratégique ni de son poids symbolique
Selon certains commentateurs, le conflit serait devenu secondaire. Ainsi, selon M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères, entendu par la mission d’information, « l’affirmation que la question israélo-palestinienne n’est pas le problème central de la région est à l’origine une idée israélienne, mais elle a gagné beaucoup de terrain. Le processus de paix au Proche-Orient n’est pas réellement devenu secondaire, comme le montrent les efforts déployés par le Secrétaire d’Etat américain John Kerry, mais il y a tout de même une part de vérité dans cette affirmation. Par ailleurs, même une résolution miraculeuse du problème n’aiderait pas à régler les autres dossiers.»
Certes, le conflit israélo-palestinien n’est pas le plus meurtrier des conflits qui agitent le Proche et Moyen Orient, il n’est pas non plus celui qui suscite la plus grande horreur. Il a perdu de sa centralité stratégique, au profit des questions iranienne, syrienne et irakienne. Mais son impact sur l’opinion publique mondiale va bien au-delà du territoire dans lequel il est à l’œuvre.
En effet, qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, sa force symbolique au carrefour de toutes les secousses telluriques qui ont agité le 20ème siècle – antisémitisme, Génocide du peuple juif en Europe et ses conséquences chez les uns, sentiments d’une décolonisation inachevée, guerres perdues avec pour résultat une sensation d’impuissance et d’humiliation et d’injustice chez les autres – en font la matrice de beaucoup d’autres conflits et même, pourrait-on dire, le nœud gordien, qui tant qu’il n’est pas tranché, justifie toutes les haines et décrédibilise dans la région la parole et l’action d’une « communauté internationale » impuissante à faire accepter une solution pourtant connue de tous.
Comme le souligne M. Alain Dieckhoff, « la lutte des peuples pour la liberté fait obligatoirement ressortir l’état de sujétion dans lequel se trouvent les Palestiniens. Dans une situation de changement global, l’immobilisme palestinien devient d’autant plus dérangeant et rend anachronique la situation d’occupation dans laquelle ils se trouvent encore. On peut aussi noter que la question palestinienne reste très ancrée dans l’imaginaire des peuples de la région même si elle n’a pas joué de rôle moteur dans ces révolutions qui s’expliquent par des raisons internes. » (68)
La question n’est donc en réalité pas tant de savoir si ce conflit est ou non devenu secondaire, ou si son règlement permettrait un déblocage miraculeux d’autres dossiers, ce qui est effectivement peu probable.
Mais il serait coupable de tirer de ce constat la conclusion que la question israélo-palestinienne peut impunément être négligée. Ce conflit se situe au cœur d’un Proche et Moyen-Orient en pleines crises et recompositions, qui peuvent aussi bien entraîner la région dans le chaos le plus total que faciliter un accord de paix entre Israël et la Palestine, qui pourrait s’inscrire dans le cadre d’un accord global avec les pays arabes de la région, et donnerait ainsi un tout autre visage au Proche et au Moyen-Orient.
b. Il n’existe pas d’alternative aux pourparlers, dont l’impasse est devenue intenable et dangereuse
L’urgence d’un règlement négocié du conflit n’a jamais été aussi grande, alors que les positions des parties prenantes sont plus que jamais antagonistes et que la viabilité des deux États est chaque jour plus menacée.
L’échec de la tentative américaine de médiation, suivi de la crise de Gaza, cet été, ont marqué la fin du cycle de négociations ouvert par les accords d’Oslo. Si nous voulons que 2015 ne soit pas une année perdue pour la paix, il faut impérativement que la reprise des négociations s’accompagne d’un changement de méthode. Il serait illusoire et dangereux de compter sur la seule volonté des parties au conflit, tant la défiance est grande dans les deux camps, tant l’absence d’horizon politique pour les deux peuples renforce dangereusement les extrêmes, tant les populations portent un regard sceptique sur le processus de paix, paix à laquelle pourtant elles aspirent. Les deux parties au conflit semblent trop faibles, trop divisées, quand elles ne manquent pas ostensiblement de volonté politique, pour signer seules un accord. Le contexte régional et la menace terroriste constituent une incertitude stratégique qui pèse sur un éventuel retrait israélien. Il n’existe par ailleurs aucune stratégie commune de paix entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, qui peine à faire son retour à Gaza. Enfin, la lassitude, si ce n’est l’attitude velléitaire, des États-Unis est patente, de même que l’absence de l’Europe et des Nations unies, dans le règlement politique de la question.
Le succès d’une énième tentative de relance des négociations selon le format triangulaire traditionnel – discussions bilatérales sous égide américaine – sans garantie par le droit international, sans cadre consensuel, sans orientation politique, est plus qu’hypothétique. Il pourrait même s’avérer contre-productif, s’il se traduisait, à nouveau, par un échec qui finirait d’achever la crédibilité du processus de paix, et éroderait la confiance dans la voie diplomatique et pacifique auprès de populations n’ayant plus rien à perdre.
c. Bien qu’Israéliens et Palestiniens soient ceux qui porteront le poids des négociations, la communauté internationale doit assumer sa part de responsabilité
Shlomo Ben Ami, ancien ministre des affaires étrangères israélien, souligne quant à lui que les Israéliens peinent parfois à comprendre pourquoi « Israël est dénoncé par certains comme un État terroriste, dans des slogans qui mêlent parfois dangereusement la solidarité avec le peuple palestinien et des invectives aux accents antisémites », et éprouvent le sentiment que la conscience européenne semble moins affectée par les conflits syriens et irakiens, « alors que le conflit israélo-palestinien depuis son origine fait moins de victimes que le conflit syrien en trois ans. » Il ne s’agit pas, dit-il, de décliner toute responsabilité israélienne en se livrant à un décompte macabre, mais de comprendre qu’Israël « porte depuis sa naissance les cicatrices » laissées par « le plus grand crime jamais commis sur le sol européen ». Par conséquent, la responsabilité du règlement du conflit repose aussi sur les épaules de l’Europe (69).
Bien qu’Israéliens et Palestiniens soient ceux qui porteront le poids des négociations, la communauté internationale doit assumer sa part de responsabilité dans l’échec des négociations antérieures et se donner les moyens de trouver un terme à ce qui est désormais le plus ancien conflit de la région. Les risques d’engrenage sont réels – la montée des tensions à Jérusalem et en Cisjordanie sur fond de difficultés économiques et sociales profondes et de mécontentement de la population ; la situation humanitaire et sécuritaire critique à Gaza, où les retards pris dans la reconstruction sont de nature à provoquer un nouveau cycle de violence ; enfin, la déstabilisation des pays voisins comme la Jordanie, le Liban ou l’Égypte, est lourd de menace pour Israël comme la Palestine. Le statu quo des négociations est devenu non seulement intenable, mais dangereux, pour la région et pour le monde, tant on sait que le conflit israélo-palestinien est un symbole qui mobilise bien au-delà de ses frontières.
Seule une initiative internationale ferme et concertée, aux objectifs et au calendrier clairement identifiés, fixés par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, est à même de mettre fin à un conflit dont, faut-il le rappeler, les premières victimes sont les peuples Israélien et Palestinien, et dont le non règlement est d’autant plus coupable que les paramètres en sont depuis longtemps connus. La France avec l’Union européenne doit, aux côtés des Américains et des États arabes, y jouer un rôle à la mesure de ses intérêts stratégiques dans la région.
5. La crise du nucléaire iranien
a. Des motifs sérieux de préoccupation
Un grave contentieux international avec l’Iran est né des inquiétudes causées par le développement du programme nucléaire de ce pays. D’une part, l’Iran a mené des activités clandestines significatives (70), qui auraient dû être déclarées à l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) dans le cadre des engagements souscrits par les autorités iraniennes (71). D’autre part, la nature de ces activités est elle-même préoccupante, car elles paraissent difficilement compatibles avec les nécessités et les visées d’un programme nucléaire qui serait exclusivement civil.
– Le premier motif de préoccupation est lié aux activités d’enrichissement de l’uranium. Elles ne paraissent pas correspondre aux besoins actuels et prévisibles du programme nucléaire civil de l’Iran, tant en qui concerne le stock d’uranium enrichi que la qualité de l’enrichissement. Les activités d’enrichissement de l’uranium peuvent en revanche viser à produire les matières fissiles nécessaires pour la fabrication d’une bombe.
Une partie des centrifugeuses iraniennes permet de produire de l’uranium faiblement enrichi (en dessous de 5 %), en théorie comme combustible pour le réacteur de Bushehr, bien que celui-ci soit approvisionné par les Russes. Les Iraniens enrichissent également à 20 %, officiellement pour le réacteur de recherche de Téhéran. Si ce taux d’enrichissement est préoccupant, c’est que 90 % du chemin nécessaire pour arriver à un taux de 90 %, qui permet de fabriquer une bombe, est alors réalisé.
Avec un stock d’environ 8 tonnes d’uranium enrichi à moins de 5 % (72), les Iraniens auraient déjà de quoi fabriquer plusieurs bombes, si la décision était prise de poursuivre encore l’enrichissement. Selon M. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, entendu par la mission d’information le 5 février 2013, il ne faudrait qu’un petit nombre de mois, voire de semaines, pour obtenir la quantité nécessaire de matière fissile (73).
L’Iran dispose de trois sites d’enrichissement d’uranium connus de l’AIEA. Les éléments suivants sont issus du rapport du 7 novembre 2014 au Conseil des gouverneurs de l’AIEA.
– L’installation d’enrichissement de combustible de Natanz, destinée à la production d’uranium faiblement enrichi (UFE) – en dessous de 5 % –, a été mise en service en 2007. Elle comptait 15 420 centrifugeuses IR-1, de première génération, et 1 008 centrifugeuses IR-2m installées à la fin de l’année 2014 (74).
– L’installation pilote d’enrichissement de combustible de Natanz (R-D), mise en service en 2003, comprend une zone désignée par l’Iran pour la production d’uranium enrichi jusqu’à 20 % (328 centrifugeuses IR-1), et une autre zone destinée à des activités de recherche et développement (75).
– L’installation d’enrichissement de combustible de Fordow, mise en service en 2011, est destinée à produire de l’uranium enrichi jusqu’à 5 % et 20 %. Selon l’AIEA, le nombre de centrifugeuses installées était de 2 710 à la fin 2014.
– Un second motif de préoccupation résulte de la construction très avancée d’un réacteur à eau lourde à Arak. Ce réacteur est présenté comme une installation de recherche permettant de produire des isotopes radioactifs utiles dans le domaine médical. Sa nécessité est toutefois remise en cause par l’existence d’un autre réacteur de recherche à Téhéran. Surtout, le réacteur d’Arak est un modèle fortement plutonigène qui permettrait de produire chaque année suffisamment de plutonium pour la fabrication d’une ou deux bombes, une fois ce plutonium retraité. Il existe en effet deux voies d’accès à l’arme nucléaire : d’une part celle de l’uranium enrichi ; d’autre part, celle du plutonium.
Le réacteur IR-40 d’Arak est un réacteur de recherche modéré à l’eau lourde de 40 MW. L’AIEA a constaté qu’aucun des composants majeurs du réacteur qui n’étaient pas encore installés fin 2013, tels que les équipements de la salle de commande, la machine de rechargement et les pompes de refroidissement du réacteur, ne l’avait été en octobre 2014.
– Dans un rapport de novembre 2011 (GOV/2011/65), l’AIEA a présenté une synthèse d’informations laissant penser que l’Iran a pu conduire des activités visant à la mise au point d’un dispositif explosif nucléaire. Selon l’AIEA, ces « possibles dimensions militaires » ont fait l’objet d'un programme structuré avant 2003, et certaines activités pourraient toujours être en cours. L’AIEA n’a pas obtenu de réponses satisfaisantes à toutes ces questions dites « en suspens » (76), en dépit de progrès réalisés grâce à un accord signé en novembre 2013 pour définir un cadre de coopération (« cooperation framework ») spécifique.
L’Iran s’est également engagé dans un important programme balistique qui pourrait servir à transporter une arme nucléaire opérationnelle. En octobre 2011, une précédente mission d’information de la commission des affaires étrangères sur « l’Iran après 2008 » faisait état d’avancées préoccupantes du programme balistique de l’Iran (77). Les développements récents du programme de lanceurs spatiaux sont également un sujet de préoccupation dans la mesure où ils pourraient servir à des travaux utiles pour des missiles intercontinentaux, les technologies employées étant connexes.
Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée les principales étapes nécessaires pour l’obtention d’une arme nucléaire balistique.
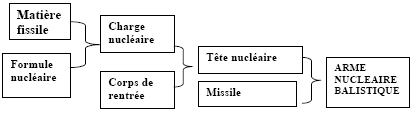
(Source : « Le Moyen-Orient à l'heure nucléaire », rapport d'information de M. Jean FRANÇOIS-PONCET et Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, fait au nom de la commission des affaires étrangères du Sénat, déposé le 25 septembre 2009).
Un rapport rendu public en 2007 par la Direction nationale du renseignement américaine estime que des entités militaires iraniennes ont travaillé sous les ordres du gouvernement pour développer des armes nucléaires jusqu’en mars 2003 (78). Les responsables du renseignement américain ont depuis lors constamment affirmé que les autorités iraniennes n’ont pas pris la décision de construire de telles armes, mais que cette option restait ouverte. Le 3 février 2015, le général Vincent R. Stewart, directeur du renseignement militaire américain, estimait que le but de l’Iran reste de mettre au point les capacités lui permettant de construire des armes nucléaires, délivrables par missile, si une telle décision était prise, et qu’en l’absence de barrière technique insurmontable pour la production d’une arme nucléaire, la question centrale était celle de la décision politique (79). Selon la communauté américaine du renseignement, l’Iran dispose des capacités scientifiques, techniques et industrielles nécessaires pour fabriquer des armes nucléaires (80).
Le comportement iranien ouvre la voie à deux interprétations : soit l’Iran souhaite effectivement disposer de l’arme nucléaire, soit il souhaite disposer de qu’il est convenu d’appeler « l’option japonaise », c’est-à-dire avoir les capacités technologiques permettant de mettre au point, rapidement, l’arme nucléaire. Selon M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, entendu le 12 février 2014 par la mission d’information, le programme nucléaire fait partie de « la défense du pré-carré » iranien : « face à Saddam Hussein qui voulait la bombe, et que les Occidents ne retenaient que modérément, l’Iran avait été pris de court. Il souhaite ne plus jamais se retrouver dans une telle situation ».
M. François Nicoullaud a cependant estimé devant la mission d’information que « les Iraniens ont compris que l’acquisition de l’arme serait impossible à dissimuler, alors qu’ils croyaient leur programme bien caché. Ils ont aussi compris que la possession de l’arme nucléaire leur créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait. La plupart des experts pense que l’ambition iranienne est d’arriver au « seuil », donc sans entrer en contradiction avec le TNP, mais en étant suffisamment près dudit « seuil » pour bénéficier d’un « effet de statut ».
M. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, a appelé l’attention de la mission d’information sur le fait qu’un programme nucléaire a sa propre dynamique et qu’aucun pays n’a investi autant que l’Iran pour s’arrêter finalement au seuil, sans changement de circonstances majeur. M. Bruno Tertrais a également estimé que si le seuil de réaction américain était probablement la fabrication d’un engin nucléaire explosif, celui d’Israël serait plutôt la capacité à fabriquer une arme rapidement.
Les inquiétudes sont en effet particulièrement fortes en Israël. Ceux qui voient l’Iran comme un acteur irrationnel, guidé par des motivations idéologiques, estiment que la dissuasion nucléaire ne fonctionnera pas avec un tel pays. Ceux qui voient en l’Iran un acteur accessible à la raison et qui considèrent que la dissuasion nucléaire pourrait donc fonctionner avec les Iraniens, mettent néanmoins en avant le fait qu’il n’existe pas de risque zéro et que le risque résiduel est de nature existentielle pour Israël, pays de trop petite taille pour survivre à une seule attaque, contrairement à d’autres. Un autre risque serait que l’assurance donnée par l’arme nucléaire ne conduise l’Iran et ses alliés, Hezbollah ou Hamas, à se comporter de manière plus agressive dans la région.
Quelles que soient les intentions réelles des autorités iraniennes et le comportement qu’elles adopteraient si leur pays était doté de l’arme nucléaire, la situation actuelle est une grave source de préoccupation. Même s’il est probable que l’objectif actuel des autorités iraniennes ne consiste qu’à se doter de la capacité d’obtenir une arme nucléaire, M. Emmanuel Bonne, conseiller à la Présidence de la République pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les Nations unies (81), a souligné qu’il n’existait guère de différence, du point de vue de la lutte contre la prolifération nucléaire, avec le fait d’avoir effectivement la bombe.
Au plan régional, le développement du programme nucléaire iranien accroît les tensions, déjà très vives, notamment avec l’Arabie saoudite. Les ambitions nucléaires de l’Iran sont perçues comme un signe supplémentaire des tentations hégémoniques prêtées à ce pays et comme un facteur tendant à renforcer ses capacités d’action. Sans solution durable, les risques de prolifération sont importants. On imagine mal que des puissances voisines telles que l’Arabie saoudite, la Turquie ou encore l’Egypte ne cherchent pas à rétablir une forme d’équilibre (82), pour des raisons de sécurité ou de statut, s’il était établi que l’Iran est en mesure de construire une arme nucléaire fonctionnelle.
En ce qui concerne l’ensemble de la communauté internationale, M. François Nicoullaud a souligné l’importance des négociations avec l’Iran pour la doctrine de la non-prolifération et l’avenir du TNP. Les « E3+3 » (83) voudraient que l’Iran s’écarte du « seuil », ce que le TNP ne demande pas expressément, car « il n’interdit pas de détenir les capacités dont dispose l’Iran, mais seulement de commencer à fabriquer la bombe » (84). Selon M. François Nicoullaud, « le compromis de 1969 qui est à l’origine du TNP n’a pas été pleinement accepté par les grandes puissances. Celles-ci s’efforcent de faire renoncer à leurs ambitions les pays qui voudraient maîtriser des technologies sensibles, en principe d’usage civil, mais qui permettent aussi de fabriquer une bombe ».
b. Une crise jusqu’à présent sans solution globale et durable
Les investigations de l’AIEA sur les révélations concernant le programme nucléaire clandestin des autorités iraniennes ont commencé en 2002. Dans un rapport de l’année suivante (GOV/2003/75), l’AIEA a tiré la conclusion qu’il ne faisait pas de doute que, « dans plusieurs cas et sur une longue période, l’Iran s’est soustrait aux obligations qui lui incombent en vertu de son accord de garanties, à savoir la déclaration des matières nucléaires, de leur traitement et de leur utilisation, ainsi que la déclaration des installations dans lesquelles ces matières sont traitées et entreposées ». L’AIEA a déclaré qu’elle n’avait pas établi définitivement que l’Iran a cherché à obtenir des armes nucléaires, mais qu’elle n’était pas non plus en mesure de conclure que son programme n’avait que des fins pacifiques. Ses investigations se sont donc poursuivies.
Les préoccupations concernant l’ampleur réelle du programme nucléaire iranien n’ont fait que croître – l’existence du site d’enrichissement de Fordow a ainsi été révélée en 2009 –, de même que les préoccupations relatives à « l’existence possible en Iran d’activités liées au nucléaire non divulguées impliquant des organismes relevant du secteur militaire, notamment des activités relatives à la mise au point d’une charge nucléaire utile pour un missile » (rapport de novembre 2011 au Conseil des gouverneurs de l’AIEA). En parallèle, les négociations engagées pour apporter des garanties solides sur les visées du programme nucléaire iranien n’ont abouti à aucun résultat durable jusqu’à présent.
Une première phase de négociations s’est déroulée de 2003 à 2005, sous l’égide de trois pays européens, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (les « E3 »). Fin 2003, l’Iran a accepté de suspendre temporairement ses activités d’enrichissement et de conversion de l’uranium, de coopérer pleinement avec l’AIEA et de conclure avec elle un protocole additionnel qui lui donne des capacités d’investigation plus étendues. Ce protocole a effectivement été signé en décembre 2003 et appliqué par l’Iran, mais sans être ratifié. L’Iran a ainsi provisoirement échappé à la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a ensuite signé en 2004 un accord plus complet sur la nature des activités d’enrichissement suspendues, après la publication d’un nouveau rapport dans lequel l’AIEA faisait part de ses préoccupations. Malgré ces avancées, l’Iran a rejeté l’année suivante une offre d’accord de long terme faite par les « E3 », qui comprenait notamment la fourniture à l’Iran de combustible nucléaire et la mise en place de coopérations politiques et sécuritaires, en échange de la suspension de toute activité d’enrichissement pendant 10 ans. L’Iran a alors repris ses activités d’enrichissement et de conversion de l’uranium.
Après cette première phase infructueuse de négociations, les Etats-Unis, la Russie et la Chine se sont joints aux efforts des « E3 » pour mettre en place une « double approche », reposant sur de nouvelles offres de négociations, toutes rejetées par l’Iran, et l’instauration de pressions croissantes en parallèle.
Le Conseil de sécurité des Nations unies, saisi en 2006 par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, a adopté successivement six résolutions qui demandent à l’Iran de répondre aux préoccupations internationales concernant son programme nucléaire. Quatre de ces résolutions sont assorties de sanctions. La résolution 1929, la plus récente (2010), demande à l’Iran de coopérer pleinement avec l’AIEA, de suspendre ses activités d’enrichissement et la construction du réacteur d’Arak, de ratifier le protocole additionnel de l’AIEA et de s’abstenir de toute activité liée aux missiles balistiques pouvant emporter une arme nucléaire.
L’Union européenne a mis en place des sanctions très contraignantes, qui ont été considérablement renforcées à partir de 2012. Elles concernent principalement le secteur pétrolier et le secteur financier. Les Etats-Unis, qui ont mis en place des sanctions depuis la création de la République islamique d’Iran, les ont renforcées en raison de ses activités nucléaires. Tout commerce entre les Etats-Unis et l’Iran est aujourd’hui quasiment interdit. Les Etats-Unis ont également adopté des mesures ayant une portée extraterritoriale, notamment pour limiter l’importation de pétrole iranien par les Etats consommateurs. Le but de ces sanctions est de « convaincre » les Iraniens de leur intérêt à négocier un accord crédible sur leur programme nucléaire, afin de lever les inquiétudes de la communauté internationale.
Cette « double approche » est restée infructueuse jusqu’à la signature d’un plan d’action conjoint avec l’Iran en novembre 2013.
En dépit de plusieurs offres enrichies par rapport à celle des « E3 » en 2005, les négociateurs se sont durablement heurtés à un mur du côté iranien. M. Gérard Araud, alors représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations unies et ancien « directeur politique » du ministère des affaires étrangères (85), a déclaré en 2010, lors d’une réunion à l’université Columbia, qu’il avait été jusque-là impossible d’entamer de véritables négociations avec les Iraniens, selon les termes des « E3+3 » ou selon leurs propres termes. Les propositions des « E3+3 » auraient été systématiquement rejetées par les responsables iraniens sans même avoir été discutées, ce qui aurait signifié un début de négociation, tandis que les déclarations publiques des Iraniens n’auraient pas été suivies d’effet, voire auraient été discrètement mais immédiatement répudiées auprès des négociateurs des « E3+3 ».
c. L’engagement de négociations sérieuses avec les Iraniens
– Cette impasse a perduré jusqu’à la signature d’un plan d’action conjoint entre les « E3+3 » et l’Iran, le 24 novembre 2013. Il permet de suspendre les activités les plus préoccupantes du programme nucléaire – le temps ne joue donc plus en faveur des Iraniens –, en échange d’un allègement limité et réversible des sanctions à leur encontre (86). Dans le même temps, des négociations sérieuses, selon les déclarations publiques des « E3+3 », ont pu être engagées avec les Iraniens sur un accord global et de long terme.
La montée en puissance des sanctions américaines et européennes a probablement joué un rôle important dans la signature par l’Iran du plan d’action conjoint. Ces sanctions auraient notamment fait reculer les exportations iraniennes de pétrole de 2,5 millions de barils par jour, en 2011, à environ 1 million de barils, alors que ces exportations représentaient une part essentielle du budget de l’Iran. De 2012 à 2013, les pertes de revenus tirés du pétrole et la coupure entre l’Iran et le système bancaire international, en raison des sanctions, ont causé une baisse importante du rial, la monnaie iranienne ; l’inflation a bondi au-delà de 50 % et l’économie iranienne a connu une récession d’environ 5 % en 2013 (87).
Les sanctions n’ont pas arrêté la progression du programme nucléaire iranien – le ministre des affaires étrangères, M. Javad Zarif, a déclaré à Al-Jazeera en décembre 2013 que l’Iran ne possédait que 200 centrifugeuses au début des sanctions, contre 19 000 aujourd’hui. Les difficultés économiques du pays et le mécontentement de la population ont néanmoins poussé l’Iran à négocier. La levée des sanctions était au cœur de la campagne électorale de M. Hassan Rohani, qui a été élu à la Présidence en juin 2013. Si la décision d’engager des négociations sérieuses traduit une aspiration populaire, elle correspond aussi à un choix stratégique validé au plus haut niveau. Selon M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères (88), M. Rohani a été autorisé par le Guide à entrer dans une véritable négociation sur le nucléaire, afin d’alléger le poids des sanctions et de la fermeture des relations avec le monde.
Comme l’a rappelé M. Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, lors de son audition du 29 janvier 2013, « au plan économique, l’Iran n’est pas vaincu, malgré les sanctions ; le pays n’est pas à genoux ». C’est effectivement l’impression qu’une délégation de la mission d’information a retirée de son déplacement à Téhéran et à Ispahan, au mois de juin 2014. Cet élément paraît essentiel pour comprendre la position des Iraniens dans le cadre des négociations. Les sanctions ont affecté l’économie, mais les exportations ne se sont pas totalement effondrées, notamment grâce à la contrebande, via Dubaï, et une « économie de la résistance » s’est développée. Les Iraniens fabriquent leurs propres stylos à bille ou leurs propres voitures, même si la qualité est moindre. Selon M. Bernard Hourcade, « les sanctions renforcent le nationalisme iranien dans sa dimension économique : le pays est assez fort pour se passer des entreprises étrangères, et le rêve d’une industrie nationale, qui était celui du Chah, tend à se réaliser ».
Un choix se présentait aux dirigeants iraniens : soit poursuivre le programme nucléaire sans inflexion, ce qui est possible, mais s’accompagne d’un coût important pour le développement du pays et d’un risque social (89) ; soit accepter de négocier, ce qui implique un risque lié à l’ouverture de l’Iran en cas de succès des négociations et un autre risque politique en cas d’échec des mêmes négociations. Le fait que le Guide, Ali Khamenei, ait choisi de soutenir publiquement les négociateurs tout en faisant part de ses doutes sur l’issue des négociations, peut être interprété de plusieurs manières : soit comme une volonté de se distancier d’emblée des négociations, dans la perspective d’un éventuel échec ; soit comme l’expression d’une réelle divergence avec le choix collectif. Selon M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, le Guide est attentif aux équilibres qui se dégagent au sein des instances consultatives de la République islamique, notamment le Conseil suprême de sécurité nationale. En 2003, la ligne du conseil suprême, dominé par les « Réformateurs » qui cherchaient une solution de compromis sur le nucléaire, ne convenait pas non plus à Khamenei. Il ne croyait pas davantage au succès des négociations à cette époque, mais il ne les a pas entravées comme il aurait pu le faire.
Le président Rohani, quant à lui, n’appartient pas à la même école que son prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad, qui était très extrémiste et dont le prêche et l’invective constituaient les modes d’expression les plus habituels. Selon l’éclairage apporté par M. Jean-François Girault à la mission d’information, M. Rohani se rapproche plutôt de l’ancien président Rafsandjani, par sa vision pragmatique (90), et il a insufflé un style nouveau dans les négociations. Pour lui, l’intérêt de l’Iran passerait d’abord par des relations apaisées avec le reste du monde et par le déblocage du problème nucléaire, qui est le nœud principal dans ce domaine. M. Rohani est par ailleurs un homme du sérail, considéré comme un proche du Guide, qu’il a longtemps représenté au sein du conseil suprême de sécurité nationale. Il s’agit d’un atout, puisqu’il a manifestement la confiance du Guide pour conduire avec autorité les négociations, sans être pour autant le décideur ultime.
M. François Nicoullaud a aussi appelé l’attention de la mission d’information sur l’évolution des positions des « E3+3 ». Ils se disent désormais prêts à ce que les Iraniens conservent un programme limité d’enrichissement de l’uranium par centrifugation – mais la question de son format reste posée. De plus, le plan d’action conjoint ne prévoit plus l’arrêt de l’ensemble du programme nucléaire iranien avant l’engagement des négociations sur un accord de long terme, mais seulement la suspension des activités les plus préoccupantes. Enfin, le plan d’action conjoint définit l’objectif final des négociations, à savoir un programme nucléaire encadré et contrôlé, ce que les Occidentaux se refusaient jusque-là à préciser.
– Malgré ces évolutions importantes, d’un côté comme de l’autre, les négociations n’ont pas encore passé le cap de la première étape prévue par le plan d’action du 24 novembre 2013, à savoir le gel d’un certain nombre d’activités du programme nucléaire iranien, en échange d’une levée très limitée des sanctions. Cette première étape devait être limitée à une durée de six mois, renouvelable par consentement mutuel. Le 20 juillet 2014, l’application de l’accord intérimaire a d’abord été prolongée jusqu’au 24 novembre 2014 ; à cette date, elle a ensuite été prolongée une deuxième fois jusqu’à la fin juin 2015.
Ce nouveau délai se décompose théoriquement en deux phases : la première, jusqu’à la fin du mois de mars 2015, pour parvenir à un accord politique ; la seconde, jusqu’à la fin du mois de juin, pour rédiger les annexes techniques destinées à traduire cet accord (91). Lors de son audition du 25 novembre 2014 devant la commission des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, a déclaré qu’il ne serait « guère étonné que l’ensemble de la négociation se poursuive jusqu’au 30 juin 2015 ».
Peu d’éléments ont été rendus publics sur l’état des négociations, ce qui est positif en soi et plutôt bon signe. Cette discrétion témoigne d’une volonté de ne pas recourir à l’opinion publique pour faire pression sur la partie opposée, comme cela a pu être le cas dans d’autres dossiers, et indique le maintien d’une certaine confiance dans le cadre des négociations. Cela permet aussi de préserver les concessions déjà faites de part et d’autre, en ne les portant pas sur la place publique tant qu’un équilibre global n’a pas été atteint. Des déclarations des « E3+3 » et de l’Iran, on peut retenir que la tonalité des échanges était plutôt positive lorsque l’échéance de novembre dernier a été repoussée et que de nouvelles idées auraient été introduites. L’impression qui en résulte est que le résultat n’était sans doute pas suffisant pour conclure les négociations, mais pas insuffisant au point de les interrompre (92) .
B. LA MONTÉE EN PUISSANCE SPECTACULAIRE DE DAESH
Dans ce panorama d’ensemble particulièrement préoccupant au plan régional, Daesh (93) constitue une menace supplémentaire, qui présente la particularité de se superposer aux autres crises, tout en s’en nourrissant.
1. Un groupe appartenant à la nébuleuse salafiste djihadiste
a. De la filiation avec Al-Qaida à la rupture
Au sein de la mouvance islamiste, on peut définir Daesh comme un mouvement salafiste djihadiste : salafiste parce que prêchant un retour à l’application de principes présentés comme étant ceux de l’islam des origines (les « Salaf Salih » sont les pieux prédécesseurs de l’époque du Prophète) et djihadiste parce que prônant le recours à la force – le « djihad » dans sa conception violente (94) – comme moyen d’atteindre cet objectif.
Quels points communs ?
Au-delà de ce substrat, les différents groupes relevant de la mouvance salafiste djihadiste divergent souvent sur de nombreuses questions :
– l’importance, voire la nécessité, des attaques contre les pays occidentaux et leurs ressortissants ;
– la propension à s’en prendre aussi aux chiites, autre branche de l’islam, et aux civils ;
– l’étendue et la nature de l’Emirat islamique à créer ;
– le degré d’implication dans la mise en place d’une offre sociale ;
– l’application immédiate ou non aux populations locales de mesures draconiennes inspirées par la Charia.
Les origines historiques de Daesh remontent à la période où le Jordanien Abou Moussab al-Zarqawi, chassé d’Afghanistan par l’offensive américaine de 2001, reconstitue ses réseaux en Irak, après la chute de Saddam Hussein en 2003, et parvient à les faire monter en puissance dans le cadre de la lutte contre l’occupation américaine. Sa formation, Jama‛t al-Tawhid wa al-Jihad (« L’Unicité et le Djihad ») (95), fait allégeance à Ben Laden l’année suivante, pour former Al-Qaida en Irak (AQI).
Le groupe est renommé « Etat islamique en Irak » (ISI) en 2006, après la mort de Zarqawi dans un bombardement américain. L’établissement d’un « Etat islamique » était censé marquer un saut qualitatif – du statut de groupe armé à celui d’acteur politico-militaire capable de gouverner un territoire (96). Cette prétention a échoué en raison de la brutalité de l’ISI, qui s’aliène les populations locales, et du succès des milices constituées dans le cadre du mouvement « Sahwa » (réveil) (97), appuyées par les forces de sécurité irakiennes et par les Américains. L’ISI a perdu beaucoup de terrain en Irak à cette époque et aurait dû se replier en Syrie (98). Les djihadistes y ont ensuite largement profité de la crise qui se déclenche en 2011.
Le prétendu « Etat islamique » (99) existe sous son nom actuel depuis juin 2014, lorsque son chef Abou Bakr al-Baghdadi (100) proclame l’avènement d’un « califat », s’étendant de la province d’Alep en Syrie jusqu’à celle de Diyala en Irak. La dénomination précédente, « Etat islamique en Irak et au Levant » (ISIL ou encore Daesh), avait été adoptée en avril 2013 lorsque Baghdadi avait déclaré son intention de fusionner ses forces avec celles du groupe syrien Al-Nosra, en Irak et en Syrie.
A cette occasion, Baghdadi avait revendiqué la paternité de cet autre groupe djihadiste. Selon Baghdadi, Al-Nosra n’aurait été qu’une couverture pour les activités du groupe en Syrie. En réaction, le chef d’Al-Nosra, Abou Mohammed al-Joulani, a certes admis l’existence d’une filiation avec l’organisation de Bagdhadi, mais en rejetant la décision de fusionner les deux organisations. Ayman al-Zawahiri, successeur de Ben Laden à la tête d’Al-Qaida Central, apporte alors son soutien à Joulani contre les prétentions de Daesh.
Zawahiri aurait demandé à Daesh de cesser ses opérations en Syrie pour se concentrer sur l’Irak, ce que Baghdadi aurait refusé. On peut y voir un signe de l’affaiblissement de l’autorité de Zawahiri par rapport à celle qu’exerçait Ben Laden. Alors qu’Al-Qaida était à l’origine un mouvement assez structuré et hiérarchisé, sous une forme pyramidale et avec un serment d’allégeance à Ben Laden, émir incontesté, l’ensemble s’est largement « décentralisé » depuis la chute des Talibans en Afghanistan. Zawahiri a semblé le reconnaître dans un entretien de 2014, où il déclarait : « Al-Qaida est un message avant d’être une organisation ».
Ce que l’on appelle aujourd’hui Al-Qaida correspondrait ainsi à plusieurs cercles distincts (101) :
– « Al-Qaida Central », composé des anciens leaders de l’organisation, lesquels seraient désormais repliés dans les zones tribales du Pakistan ;
– les « franchises » d’Al-Qaida, dont l’allégeance formelle a été acceptée par Al-Qaida Central (Al-Qaida dans la Péninsule arabique – AQPA –, basé au Yémen ; Al-Qaida au Maghreb islamique – AQMI – ; Jabhat al-Nosra, installé en Syrie ; les Shebab somaliens) ;
– des groupes n’ayant pas fait allégeance à Al-Qaida mais susceptibles de conclure des arrangements avec cette organisation et aspirant à établir un « Emirat islamiste » (Ansar al-Sharia en Libye ou Jemaah Islamiya en Indonésie) ;
– enfin, divers groupes et individus inspirés par Al-Qaida, tels que les frères Tsarnaev, auteurs des attentats commis lors du marathon de Boston en 2013.
La rupture entre Daesh et Al-Qaida est consommée en février 2014 lorsque les dirigeants d’Al-Qaida désavouent publiquement Daesh en raison de ses méthodes jugées trop brutales – par d’autres djihadistes ! –, de ses affrontements avec d’autres groupes sunnites, menés pour se développer et pour affirmer son hégémonie sur le terrain (102), et de son conflit territorial persistant avec Jabhat al-Nosra en Syrie. Ce dernier groupe continue, pour sa part, à se revendiquer comme une « filiale » d’Al-Qaida, la seule en Syrie, et à être reconnu comme telle par la « maison-mère » qaidiste (103). Selon Jean-Pierre Filiu, ce que l’on décrit généralement comme une tentative de fusion entre Daesh et Jabhat Al-Nosra est en fait une scission entre le « djihad » en Syrie et un « djihad » plus régional et plus global que promeut Baghdadi (104).
Grâce à la visibilité et au prestige accumulés depuis sa fulgurante offensive dans les zones sunnites d’Irak à l’été 2014, Daesh paraît désormais s’affirmer comme la référence principale du « djihad », au détriment d’Al-Qaida Central.
Il a d’ailleurs été suggéré à la mission d’information que Daesh pourrait avoir mis en scène la décapitation d’otages américains afin de provoquer une intervention militaire internationale et de renforcer sa position au sein des différents mouvements djihadistes. Dans les mois qui ont précédé les premières frappes aériennes contre Daesh, cette organisation aurait atteint un palier, tout en continuant à être perçue comme une sorte de secte marginale et déviante, y compris au sein d’Al-Qaida. En se présentant désormais comme attaqué par des « croisés » (ou « chrétiens »), Daesh aurait tablé sur sa « normalisation » et sur le renforcement de son « attractivité » dans la sphère salafiste djihadiste.
L’affirmation de Daesh comme pôle alternatif à Al-Qaida s’est accompagnée de l’allégeance formelle (« bay’at ») d’un certain nombre de mouvements et de figures individuelles du djihadisme, notamment en Jordanie. A ce stade, il ne s’agirait toutefois que de groupuscules, exception faite d’Ansar Beït al-Maqdess (« les Partisans de Jérusalem »), groupe égyptien implanté dans le Sinaï et se disant jusqu’alors inspiré par Al-Qaida. Ce groupe s’est depuis renommé « wilayat » (province) de Daesh au Sinaï. La branche d’Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA), l’une des plus actives, a en revanche rejeté tout ralliement formel et réaffirmé son soutien à Al-Qaida. Début mars 2015, le chef du groupe terroriste Boko Haram, actif au Nigeria, a quant à lui déclaré avoir fait allégeance à Daesh et « au calife des musulmans », Abou Bakr al-Baghdadi.
Au-delà du débat sur le fait de savoir si Daesh et Al-Qaida s’affaiblissent ou se renforcent mutuellement, leur concurrence est en tant que telle un motif d’inquiétude. Selon M. Stéphane Lacroix, auditionné par la commission des affaires étrangères le 27 janvier 2015, la rivalité opposant Daesh à Al-Qaida et la relative perte de vitesse de cette dernière organisation pourraient renforcer sa détermination à mener de nouvelles attaques spectaculaires dans les pays occidentaux. Même s’il reste encore de très larges zones d’ombre à ce stade de l’enquête, les attentats commis en France au début du mois de janvier dernier pourraient témoigner d’une concurrence entre les deux pôles de la mouvance salafiste djihadiste (105).
Le risque est double : d’une part, des éléments terroristes, attirés et incités par la visibilité actuelle de Daesh, pourraient chercher à s’y rattacher et à s’en revendiquer à l’étranger ; d’autre part, Al-Qaida pourrait chercher à compenser la réduction actuelle de son « aura » dans la sphère djihadiste internationale en commettant aussi de nouveaux actes terroristes spectaculaires à l’étranger.
– Thomas Hegghammer, directeur de la recherche sur le terrorisme à l’Institut norvégien de recherche pour la Défense, rapporte que la proclamation du « califat » par Daesh, le 29 juin 2014, a eu l’effet d’une bombe sur la scène djihadiste internationale (106). Le califat est une forme de gouvernement associée aux premiers temps de l’islam et aux empires qui ont successivement dominé le monde musulman. Une telle notion renvoie donc généralement à l’idée d’une autorité politique exercée sur un territoire par un héritier du Prophète. Selon M. Hegghammer, cette référence était jusque-là considérée comme une sorte d’horizon, une utopie que l’on pourrait comparer à la société communiste dans une perspective marxiste (107). La restauration du califat était certes le but affiché des groupes djihadistes, mais aucun d’entre eux n’avait eu l’audace de la proclamer avant Daesh (108).
L’instauration du califat a immédiatement été dénoncée par la plupart des figures du djihadisme comme prématurée au regard de la jurisprudence islamique. Le calife ayant théoriquement autorité sur l’ensemble des musulmans, la restauration du califat impliquerait en effet le rétablissement d’un degré élevé d’unité au sein de l’Oumma, ce qui devrait se traduire par des allégeances massives à celui qui se fait désormais appeler le « Calife Ibrahim ». Dans une étude consacrée à Daesh, Charles Lister, chercheur invité au centre de Doha du « think tank » américain Brookings, cite un expert de l’islam – et imam à temps partiel – pour qui Daesh aurait pu avoir la légitimité suffisante pour proclamer un « émirat » islamique, à l’instar des Talibans en Afghanistan, ou un simple « Etat islamique », mais certainement pas un « califat » (109).
La déclaration immédiate du califat est à la fois un coup d’éclat, destiné à accroître la visibilité et l’attractivité de Daesh pour de nouvelles recrues, par la référence à un passé politique glorieux, et l’affirmation d’une ambition, le califat étant le symbole suprême de l’aspiration à l’unité jamais achevée du monde musulman. Le même jour, Daesh a mis en ligne des vidéos intitulées : « La destruction des frontières » et « La fin de Sykes-Picot » (110), qui mettent en scène la destruction physique de la frontière entre la Syrie et l’Irak. C’est aussi la traduction d’une dynamique. Thomas Hegghammer, s’interrogeant sur le sens de cette déclaration du califat, note que presque tous les combattants terroristes étrangers qui rejoignent le « djihad » armé se rendent en Syrie, majoritairement dans les rangs de Daesh.
Par la proclamation d’un califat et non d’un simple Emirat islamique, qui serait géographiquement limité, Daesh affirme une vocation globale. Daesh se distingue ainsi des « franchises » d’Al-Qaida, cantonnées à un seul territoire. C’était l’un des principaux enjeux de la tentative de fusion, avortée, entre Daesh et son ancienne filiale syrienne, Jabhat Al-Nosra. Par la voix de son chef Zawahiri, Al-Qaida Central a refusé à Daesh cette prétention globale – qu’Al-Qaida ne paraît plus en mesure d'incarner au regard de l’autonomisation croissante de ses branches régionales.
– Daesh se distingue aussi d’Al-Qaida Central par un renversement de ses priorités stratégiques. Celles-ci ne vont plus à la lutte contre « l’ennemi lointain », c’est-à-dire les Etats-Unis et leurs alliés « croisés », les pays occidentaux, mais à « l’ennemi proche », à savoir les régimes arabes locaux, jugés corrompus et indignes de l’islam (111). Dans la vulgate d’Al-Qaida, l’impossibilité de renverser les régimes arabes est attribuée aux soutiens occidentaux dont ils bénéficient. C’est pourquoi il conviendrait de frapper ces pays étrangers.
La réorientation de Daesh s’inscrit dans le cadre d’une évolution plus générale du mouvement salafiste djihadiste. Depuis la fin des années 2000, les filiales d’Al-Qaida tendent à privilégier le développement de leur implantation locale aux dépens des opérations menées à l’étranger. Le but serait avant tout de consolider et d’étendre leurs bases territoriales, en profitant de l’instabilité régionale, au lieu de combattre d’abord les puissances occidentales. Il s’agirait d’y accumuler des effectifs et des ressources, puis de lancer des attaques de plus grande envergure contre les régimes locaux. Les combattants de Daesh auraient ainsi adopté le mot d’ordre suivant : « durer et s’étendre » (« baqiya wa tatamadad »).
Selon M. Stéphane Lacroix, il est possible de comparer la différence entre Daesh et Al-Qaida à celle qui existait entre Trotski et Lénine. Pour Al-Qaida, il conviendrait de poursuivre l’exportation de la révolution et de lutter contre l’Occident ; Daesh préfèrerait la victoire dans un seul pays, même si les conditions internationales y sont a priori défavorables.
Cette priorité donnée à « l’étranger proche » ne signifie pas la fin des menaces contre « l’ennemi lointain » que nous représentons. « Nous appelons les musulmans en Europe et dans l’Occident infidèle à attaquer les croisés où qu’ils soient (…), nous promettons aux bastions chrétiens qu’ils continueront à vivre dans un Etat de terreur, de peur et d’insécurité », a ainsi déclaré le porte-parole de Daesh dans un message audio diffusé le 26 janvier 2015.
– Une autre singularité de Daesh réside dans son appel ouvert à la violence confessionnelle, contre les chiites, dénoncés comme apostats, et contre les non-musulmans. Les leaders d’Al-Qaida Central, pour leur part, passent pour ne pas avoir commandité d’attaques contre les chiites d’Afghanistan et du Pakistan. Zawahari aurait même écrit à Zarkawi pour le dissuader de tels actes, au motif qu’ils affaibliraient le soutien à Al-Qaida au sein de la communauté musulmane en Irak (112).
Selon M. Stéphane Lacroix, Al-Qaida préfère éviter des contradictions perçues comme « secondaires » au sein de l’islam, afin de se concentrer sur une contradiction « primaire » : la lutte contre les régimes corrompus et l’Occident. C’est pourquoi Jabhat Al-Nosra combat avec d’autres groupes armés en Syrie, y compris l’ASL, et tend à gommer son identité qaidiste. Daesh, à l’inverse, accentue les antagonismes au sein de l’islam, afin de se poser en unique garant de l’orthodoxie religieuse, qu’il considère comme la seule forme d’islam, et fait la guerre contre les musulmans ne partageant pas ses idées, y compris ceux d’Al-Qaida.
– Malgré les différences qui viennent d’être rappelées, c’est principalement la stratégie de « territorialisation » de Daesh, c’est-à-dire la prise de contrôle et la gestion de vastes espaces, qui a fait l’objet du plus grand nombre de commentaires et de la plus forte inquiétude.
Comme M. François Burgat, directeur de recherche à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), et M. Dominique Thomas, chercheur à l’EHESS, l’ont rappelé à la mission d’information, il ne s’agit pas d’un phénomène propre à Daesh. Les Talibans ont également cherché un ancrage territorial en Afghanistan, AQPA s’est enraciné dans certaines régions du Yémen, en particulier dans l’Hadramaout, et la Somalie a connu l’épisode « Shebab ».
Il est vrai, néanmoins, qu’aucun groupe djihadiste n’était jamais parvenu à étendre son emprise sur un territoire aussi vaste. Bien qu’ils soient en grande partie désertiques, les espaces contrôlés par Daesh au Nord-Est de la Syrie et au Nord-Ouest de l’Irak comportent aussi de grands centres urbains et ils seraient aussi étendus que la Grande-Bretagne. Daesh est parvenu à « capter » jusqu’à 8 ou 10 millions de personnes, malgré sa violence paroxystique et la chape de morale religieuse qui s’abat sur les populations.
Comme l’a souligné le ministre de la défense, M. Jean-Yves Le Drian, en septembre dernier, lors du débat au Parlement sur l’engagement des forces armées en Irak, le projet diffère aussi : « avec Ben Laden et Al-Qaida, nous avions affaire à un terrorisme de réseaux, dont l’objectif était de mener un certain nombre d’actions pour déstabiliser à la fois l’Occident et certains pays arabes. Avec Daesh, nous sommes confrontés à un terrorisme qui veut construire à partir d’un territoire, créer des Etats, retrouver l’Oumma des Abbassides ».
– Alors que Daesh n’était à l’origine qu’un petit groupe salafiste-djihadiste, parmi tant d’autres, cette organisation affiche désormais une volonté de se construire comme un Etat, doté d’un souverain, son calife autoproclamé, d’institutions, en particulier un embryon d’armée terroriste (113), et même d’une monnaie.
M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, que la commission des affaires étrangères a entendu le 10 décembre 2014, rapporte que le territoire sous l’emprise de Daesh a été subdivisé en sept administrations provinciales qui chevauchent parfois les frontières des Etats, d’Alep jusqu’à Kirkouk (114). Daesh y a mis en place un pouvoir judiciaire en nommant des juges religieux, les « qadis », secondés par une « police des mœurs » en charge de contrôler la conformité des comportements. En Irak, selon M. Luizard, ces « qadis » sont souvent d’anciens juges et d’anciens responsables religieux passés au service de Daesh. On assisterait ainsi à une « osmose progressive entre ces ex-fonctionnaires baasistes et les insurgés djihadistes ».
Afin de mettre en œuvre son projet à prétention étatique, Daesh combine la répression qui accompagne l’application d’une conception particulièrement dure de la « charia », assortie de crucifixions, de lapidations et d’amputations, la fourniture de services publics de base, tels que l’eau et l’électricité, la mise en place d’une aide sociale et de campagnes de vaccination, un début de régulation économique et sociale (115), ainsi qu’une certaine forme de sécurité. A condition de ne pas violer les interdits proclamés par « le califat islamique », les zones contrôlées par Daesh et ses alliés seraient paradoxalement sûres et les règles applicables relativement prévisibles.
Ce processus de construction étatique s’accompagne de la mise en place d’un système de taxation islamique, en particulier la levée de la « zaqat », l’aumône légale, de la « sadaqa », don volontaire aux nécessiteux, et de la « jizya », impôt prélevé sur les « dhimmis » – les communautés religieuses reconnues comme monothéistes par l’islam et « protégées » à condition d’accepter un statut inégal. Pierre-Jean Luizard rapporte que la mise en place de ce système reposant sur des « prélèvements réguliers, avec des procédures et des barèmes qui se veulent formalisés » (116), permet de verser des salaires, souvent suspendus en Irak sous le gouvernement de Nouri al-Maliki.
2. Une organisation terroriste d’une puissance inégalée
L’une des principales menaces posées par Daesh réside dans sa capacité à exploiter l’instabilité régionale pour s’enraciner dans des territoires en déshérence, aujourd’hui en Irak et en Syrie, pour y faire grossir ses forces et chercher à s’étendre davantage. Daesh compte pour cela sur une véritable « armée terroriste », secondée par un afflux très préoccupant de combattants terroristes étrangers, et sur des moyens financiers considérables.
a. Une véritable « armée terroriste »
Daesh pourrait compter entre 30 000 et 50 000 combattants (117), disposant d’armes sophistiquées. Le ministre de la défense, M. Jean-Yves Le Drian, estimait en septembre dernier que Daesh disposait probablement « de 3 000 4x4 Hummer américains récupérés à Mossoul, de 60 000 armes individuelles, de 50 chars lourds, de 150 blindés légers et de matériel antichar » (118). Daesh et ses alliés seraient parvenus à saisir des quantités significatives d’équipements militaires fournis par les Américains aux forces armées irakiennes. A Alep, Daesh retournerait du matériel américain contre des combattants de l’Armée syrienne libre.
Les forces de Daesh combinent des actions terroristes classiques – en particulier des attaques suicides, utilisées pour percer des brèches dans les défenses adverses, pour intimider et pour déstabiliser (119) –, des actions de guérilla urbaine et des attaques militaires plus conventionnelles, comme pour la prise d’une ville telle que Mossoul. Daesh compte aussi sur sa brutalité extrême pour obtenir l’allégeance de certaines tribus, en pratiquant des massacres de masse (120). Si Daesh est parvenu à réaliser de telles percées, du moins dans un premier temps, ce n’est pas seulement en raison de la faiblesse des forces adverses, mais aussi de l’efficacité de ses propres forces combattantes.
Il est vrai qu’une trentaine ou une cinquantaine de milliers d’hommes est un effectif assez faible pour une organisation militaire, mais cela représente un véritable saut quantitatif et qualitatif pour une organisation terroriste. Selon certaines estimations, Al-Qaida aurait compté moins d’un millier de combattants en Afghanistan dans les années 2000.
Ce chiffre doit aussi être mis en comparaison avec les 8 à 10 millions de personnes qui seraient sous l’emprise de Daesh en Irak et en Syrie. Daesh s’est allié à d’autres acteurs pour mener ses opérations militaires (121). Instruit par l’échec d’Al-Qaida en Irak dans les années 2000, Daesh n’hésiterait pas davantage à confier les clefs des villes conquises à des acteurs locaux, notamment des représentants des tribus et d’anciens baasistes. L’entourage d’Abou Bakr Al-Baghdadi serait d’ailleurs en grande partie composé d’anciens militaires et responsables baasistes, qui apportent leur expérience à Daesh (122).
Selon M. Pierre-Jean Luizard, « dès le lendemain de la victoire, l’Etat islamique organise une passation de pouvoir à des chefs tribaux, des chefs de clan et des leaders de quartier qui sont investis de la responsabilité de gérer la ville à un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, l’allégeance exclusive à l’Etat islamique et l’interdiction de déployer d’autres emblèmes officiels que ceux de l’organisation, ainsi que l’obligation de se plier aux injonctions des djihadistes en matière de mœurs » (123). Cette passation de pouvoir répondrait aux aspirations des populations locales, en particulier en Irak, où l’armée aux ordres de Bagdad passait pour être une force d’occupation, par ailleurs incapable d’assurer un minimum de sécurité.
b. Les « combattants étrangers »
Selon des estimations rendues publiques par la CIA, Daesh comptait au moins 15 000 combattants terroristes étrangers en septembre 2014, originaires de plus de 80 pays. Ils pourraient être aujourd’hui environ 20 000. Cet « appel d’air » est sans précédent : le nombre des combattants étrangers qui se seraient rendus en Syrie et en Irak depuis 2011 serait déjà supérieur aux flux à destination de l’Afghanistan dans les années 1980.
Les ressortissants originaires du Moyen-Orient et du Maghreb, en particulier l’Arabie saoudite, le Maroc et la Tunisie, représenteraient près de 70 % de l’effectif total des djihadistes étrangers dans la zone. Certains d’entre eux viendraient de plus loin, y compris de Chine. Des extrémistes de retour de Syrie, où ils auraient combattu dans les rangs de Daesh, auraient été arrêtés dans la province chinoise du Xinjiang, à majorité musulmane.
En ce qui concerne les ressortissants français ou résidents en France, le ministre de l’intérieur, M. Bernard Cazeneuve, a déclaré à l’Assemblée nationale le 10 février dernier que « la catégorie des combattants étrangers est constituée de près de 1 280 personnes et se décompose de la manière suivante : 580 individus se sont rendus sur le théâtre des opérations ou en sont revenus ; environ 380 individus se trouvent encore en Irak ou en Syrie, tandis que 200 en sont revenus ; 200 personnes ont exprimé le souhait de s’y rendre ».
Le tableau ci-dessous, issu de travaux publiés par le Centre international pour l’étude de la radicalisation (ICSR) du King’s College de Londres, présente la répartition des combattants terroristes partis d’Europe vers l’Irak et la Syrie. Ces chiffres, datant de la seconde moitié de l’année 2014, sont légèrement inférieurs aux dernières estimations qui viennent d’être présentées en ce qui concerne la France. Il s’agit par ailleurs de chiffres globaux, l’ICSR estimant qu’entre 5 et 10 % de ces effectifs ont été tués et qu’entre 10 et 30 % ont quitté la zone de conflit.
Pays |
Estimation |
Proportion * |
Autriche |
100-150 |
17 |
Belgique |
440 |
40 |
Danemark |
100-150 |
27 |
Finlande |
50-70 |
13 |
France |
1 200 |
18 |
Allemagne |
500-600 |
7.5 |
Irlande |
30 |
7 |
Italie |
80 |
1.5 |
Pays-Bas |
200-250 |
14.5 |
Norvège |
60 |
12 |
Espagne |
50-100 |
2 |
Suède |
150-180 |
19 |
Suisse |
40 |
5 |
Royaume |
500-600 |
9.5 |
* Par million d’habitants.
Cet afflux de combattants terroristes étrangers peut s’expliquer par la combinaison de plusieurs facteurs.
– Le théâtre syrien est beaucoup plus aisément accessible que ne l’étaient autrefois d’autres théâtres, notamment l’Afghanistan. De nombreux vols « low cost » permettent de se rendre en Turquie (124), d’où il est ensuite facile de se rendre jusqu’à la frontière avec la Syrie. Celle-ci est généralement considérée comme étant très poreuse, même si les forces armées turques auraient récemment renforcé leurs contrôles. Les autorités auraient également placé sur une « liste noire » d’interdiction d’entrée sur le territoire turc un nombre croissant de personnes – près de 8 000 – et procédé à des refoulements ou à des expulsions. Il faut aussi noter que la perte rapide des zones frontalières par le régime de Damas a contribué à l’afflux des djihadistes étrangers.
– Les gains territoriaux obtenus par Daesh à l’été 2014 ont renforcé sa visibilité et son attractivité dans la sphère djihadiste internationale. Daesh peut d’ailleurs s’appuyer sur une machine à propagande très puissante. Outre la diffusion d’un magazine en langue anglaise, « Dabiq », Daesh investit massivement les réseaux sociaux. Près de 40 000 « Tweets » auraient été envoyés le jour de la prise de Mossoul et de nombreuses vidéos tournées sur le terrain exaltent l’ultra-violence des combattants de Daesh – leurs exactions sont exhibées au grand jour et sous-titrées dans de nombreuses langues. Plusieurs longs métrages de propagande en langue anglaise ont aussi été réalisés et diffusés par les équipes de production de Daesh (125). Internet facilite considérablement la tâche des organisations terroristes. Alors qu’elles devaient autrefois recruter localement, dans les villes et les villages, par des intermédiaires, Daesh dispose d’une « ligne directe ».
– S’agissant plus spécifiquement des djihadistes venus d’Europe, les profils que ces derniers continuent à entretenir sur les réseaux sociaux semblent montrer que leur motivation principale n’est pas religieuse. Leur comportement se nourrirait plutôt d’une sorte de romantisme révolutionnaire, particulièrement dévoyé, d’une culture de l’ultra-violence et d’une fascination pour la mort. Pour Olivier Roy, professeur à l’Institut universitaire de Florence, qui compare les jeunes djihadistes européens aux militants de l’ultra-gauche violente des années 1970, « cette radicalisation d’une partie de la jeunesse s’enracine dans l’idée qu’elle n’a plus de place dans le monde tel qu’il est et que la violence est à la fois inéluctable et positive ». Daesh leur offrirait « le jeu vidéo total dont ils sont nourris » (126).
Enfin, la montée en puissance de Daesh s’est accompagnée d’une forte amplification des flux de « volontaires étrangers non-combattants » – femmes, enfants, familles –, qui rejoignent des zones sous l’emprise des djihadistes pour y vivre selon leurs préceptes ou tout simplement pour y suivre un parent qui s’est enrôlé parmi les combattants terroristes.
c. Des moyens financiers considérables
Selon une étude publiée par l’Agence Reuters à partir de données datant de septembre 2014, les revenus de Daesh pourraient s’élever jusqu’à 2,9 milliards de dollars par an, dont seulement 50 millions proviendraient de dons (127). Daesh serait ainsi devenu une organisation autofinancée, indépendante de donateurs étrangers, et disposerait de ressources considérables pour renforcer ses capacités opérationnelles, pour soudoyer des élites tribales et des autorités provinciales et pour recruter des combattants.
Lors du pillage des banques de Mossoul, Daesh serait parvenu à faire main basse sur un butin de plusieurs centaines de millions de dollars en argent liquide et en or. Selon l’étude précitée, ses principales sources de financement seraient les suivantes : le trafic de pétrole, brut ou semi-raffiné (38 % du total) ; celui du gaz naturel (17 %) ; les taxes prélevées sur l’activité économique, les droits de douane, en particulier sur le transit de camions, et d’autres formes d’extorsion de fonds auprès des populations, notamment les minorités (12 %) (128) ; les produits à base de phosphates (10 %) ; le ciment (10 %) ; les céréales (7 %) ; les rançons payées après les enlèvements (4 %). Selon d’autres sources, le trafic d’antiquités rapporterait aussi des montants non négligeables à Daesh.
a. Des violences massives contre les populations civiles, en particulier les minorités religieuses et ethniques
Les populations musulmanes sunnites d’Irak et de Syrie soumises à l’emprise de Daesh se voient appliquer une loi particulièrement dure, comportant l’application de peines corporelles (« Hudud ») telles que la lapidation et les mutilations, l’interdiction de l’alcool, du tabac, des jeux et de la musique non islamique, ainsi qu’un contrôle strict des tenues vestimentaires. Dès son entrée à Mossoul, Daesh a d’ailleurs édicté une « charte » de 16 articles pour réglementer la vie quotidienne.
Les chrétiens de cette ville ont été soumis à un statut particulier, la « dhimma », qui fait d’eux des citoyens de seconde catégorie, « protégés » dans la mesure où ils acceptent de se soumettre, de payer une taxe spécifique (la « jizya ») et de respecter de nombreux autres interdits – ne pas porter de signes ostensibles de leur foi, ne pas construire de nouveaux lieux de culte, s’abstenir de vendre et de consommer du porc et de l’alcool… L’introduction de ce statut a fait l’objet d’un ultimatum, ceux qui ne l’acceptaient pas ayant le choix entre quitter la ville en 48 heures et périr par l’épée.
Les différentes minorités religieuses et ethniques, qui font toute la richesse et la diversité du tissu humain irakien, sont aujourd’hui très en danger. Selon Flavia Pansieri, Haut-Commissaire adjointe des Nations unies aux droits de l'Homme, l’offensive de Daesh en Irak s’est accompagnée de persécutions particulièrement brutales envers les communautés chrétienne, yézidie, turkmène, shabak, kaka'e, sabéenne et chiite. Daesh conduit une politique d’épuration ethnique et religieuse sous toutes les formes imaginables – exécutions de masse, enlèvements, déplacements de populations. L’avancée de Daesh s’est ainsi traduite par des déplacements massifs – de chrétiens, notamment issus de Qaraqoch, vers le Kurdistan irakien, ou encore de Yézidis qui ont fui Sinjar vers les montagnes accolées à cette ville. Mi-septembre 2014, on comptait environ 1,8 million de déplacés en Irak, dont la moitié dans la zone kurde du pays.
Ces violences à grande échelle touchent aussi bien les non-musulmans que les non-sunnites. Daesh a ainsi commis et revendiqué des exécutions de milliers de soldats et de prisonniers chiites, notamment près de Tikrit. Quant aux Yézidis, une minorité kurdophone non-musulmane, le magazine officiel de Daesh, Dabik, déclare qu’ils doivent être traités comme des polythéistes – les Yézidis ne sont ni musulmans, ni membres d’une « religion du livre » – et comme des adeptes de Satan. Daesh a donc légitimé leur réduction en esclavage, y compris au plan sexuel en ce qui concerne les femmes. Selon Amnesty International, des centaines, voire des milliers de femmes et de jeunes filles yézidies ont été mariées de force, « vendues » ou « offertes » à des combattants ou à des sympathisants de Daesh.
De telles atrocités visent à s’assurer la docilité des populations, en semant la terreur, et elles correspondent aussi à l’agenda extrémiste de Daesh. Comme l’a déclaré le nouveau Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, M. Zeid Ra'ad al-Hussein, au mois de septembre 2014, à l’occasion de la 27e session du Conseil des droits de l’Homme à Genève, Daesh montre « à quoi ressemblerait un Etat takfiri, si ce mouvement essayait de gouverner à l'avenir » : « ce serait une maison sanglante, dure, abusive, qui n'offrirait aucune protection à ceux qui ne sont pas takfiris » (129).
b. Une menace sérieuse au plan régional
Deux types de menace doivent être pris en compte dans la région : d’une part, l’hypothèse d’une poursuite de l’expansion territoriale de Daesh, comme le prévoit son projet de « califat islamique » – la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Liban, la Palestine et Israël ont été explicitement menacés (130) ; d’autre part, les risques de dissémination dans les pays voisins par l’implantation, le développement ou l’allégeance de cellules terroristes se réclamant de cette organisation.
– Les risques d’expansion territoriale de Daesh ne doivent pas être surestimés. Selon M. Stéphane Lacroix, entendu le mardi 2 décembre 2014 par la mission d’information, Daesh n’aurait pas les moyens d’étendre davantage son « califat » en Irak et en Syrie. A Bagdad, peuplé à 80 % de chiites, il y aurait une insurrection populaire contre Daesh, qui ne paraît être en mesure de l’emporter que dans des zones de peuplement sunnite. En Irak, l’expansion de Daesh est donc bloquée au Sud par la présence de populations chiites majoritaires et au Nord par celle des Kurdes. En Syrie, toute la zone tenue par les Alaouites paraît devoir s’opposer à une expansion de Daesh.
Aux frontières de la Syrie et de l’Irak, il est probable que l’Iran et la Turquie, disposant de solides capacités militaires, seraient en mesure de résister efficacement à des assauts de Daesh. Il ne resterait donc que la Jordanie et l’Arabie saoudite, voire le Liban, comme routes potentielles d’expansion. Ces deux premiers pays sont toutefois des alliés majeurs des Etats-Unis au plan régional. Contrairement à d’autres « lignes rouges », comme celle de l’usage des armes chimiques en Syrie, on peut s’attendre à ce que celles-ci soient tenues avec la plus grande fermeté au regard de l’immense déstabilisation régionale qui résulterait de leur violation.
En ce qui concerne le Liban, M. Pierre-Jean Luizard rappelle que Daesh est parvenu à occuper en Syrie des territoires frontaliers jouxtant la Bekaa, la route Damas-Beyrouth et le Nord du Liban, puis à réaliser des incursions spectaculaires en territoire libanais, notamment dans la ville à majorité sunnite d’Ersal, en août 2014 (131). Une occupation durable de territoires libanais lui paraît toutefois peu probable pour plusieurs raisons : la présence des troupes aguerries du Hezbollah chiite, toutefois fragilisées par leur participation au conflit syrien, l’existence d’une communauté chrétienne autrement plus puissante politiquement et militairement au Liban qu’en Irak, même si elle est affaiblie, ainsi qu’une armée libanaise plus efficace qu’autrefois, bien que ses capacités restent encore limitées.
On peut aussi s’interroger sur la base sociale dont bénéficierait Daesh en dehors de l’Irak et du Nord de la Syrie. Au Liban, Daesh ne pourrait probablement attirer qu’une partie des plus pauvres des sunnites, qui ne représentent eux-mêmes qu’une partie de la population (132) ; en Jordanie, seule une partie des masses populaires appauvries autour d’Amman ou à Zarqa pourrait constituer un terreau pour l’expansion de Daesh. Il faut espérer que ce mouvement ait atteint les limites de son « habitat naturel », constitué de terres majoritairement sunnites où les institutions de l’Etat sont effondrées et où la communauté sunnite a des raisons profondes de se sentir marginalisée ou exclue.
– A l’inverse, les risques de dissémination de Daesh ne doivent pas être sous-estimés dans de nombreux pays de la région. Ils peuvent se manifester aussi bien par l’allégeance de groupes locaux préexistants, que par le retour dans leur pays de combattants terroristes étrangers, ou par l’infiltration de cellules djihadistes.
En Egypte, comme la mission d’information a déjà eu l’occasion de le rapporter, le puissant groupe terroriste Ansar Beït Al-Maqdess, qui est implanté au Sinaï, a déjà officiellement prêté allégeance à Daesh. L’objectif pourrait surtout consister à accroître la visibilité du groupe, notamment afin de susciter des ralliements individuels ou ceux de groupuscules actifs en Egypte et d’attirer de nouveaux financements. Depuis le début de l’année 2015, on noterait aussi quelques signes d’évolution dans le mode opératoire d’Ansar Beït Al-Maqdess (133), renommé « Wilayat du Sinaï ». Alors qu’il menait surtout des attaques contre les forces de sécurité égyptiennes et les gazoducs, le groupe commencerait à reprendre à son compte certains aspects de la « gouvernance » pratiquée par Daesh dans les territoires qui se trouvent sous son emprise (134).
En Jordanie, selon un sondage publié au mois de septembre 2014, 65 % de la population voyaient en Daesh la principale menace pour la stabilité du pays (135). Daesh est d’ailleurs le dernier avatar d’un groupe formé par le Jordanien Abou Mousab al-Zarqawi, et près de la moitié des 2 000 Jordaniens combattant en Syrie et en Irak auraient rejoint ses rangs. Afin de lutter plus efficacement contre le phénomène des combattants étrangers, la législation antiterroriste a été renforcée au début de l’année 2014. Il semblerait aussi que le mouvement salafiste-djihadiste gagne du terrain dans le pays (136). Ce mouvement reste toutefois divisé sur la question de Daesh, qui a été publiquement condamné par l’influent Abou Mohammed al-Maqdisi (137) en raison de ses crimes contre d’autres musulmans et de la proclamation d’un califat islamique. La situation est notamment préoccupante dans la ville de Maan, située à 200 kilomètres au Sud d’Amman et connaissant des troubles économique et sociaux récurrents. Un petit groupe de manifestants y aurait arboré le drapeau de Daesh et clamé son soutien à cette organisation.
Daesh dispose probablement d’un terreau favorable en Arabie saoudite, dont les ressortissants seraient très présents dans les rangs djihadistes – il y aurait 3 500 combattants saoudiens en Irak et en Syrie. Malgré le renforcement du cadre légal de la lutte contre le terrorisme, de nombreuses arrestations et la condamnation de l’extrémisme par le grand Mufti d’Arabie saoudite, des réseaux pourraient continuer à lever des recrues et des financements. En novembre dernier, en pleine Achoura (138), une attaque contre un lieu saint chiite a été attribuée par les autorités saoudiennes à des individus liés à Daesh. Gardienne des lieux saints de la Mecque et de Médine, la monarchie saoudienne est une cible de première importance pour Daesh. La proclamation d’un califat islamique remet directement en cause sa légitimité religieuse. Daesh aurait d’ailleurs lancé une campagne contre l’Arabie saoudite intitulée : « Qadimun » (« nous arrivons »).
Daesh maintient manifestement une présence au Liban, où plusieurs opérations ont déjà été menées. Daesh a ainsi revendiqué un attentat suicide qui a fait 11 morts dans un hôtel de Beyrouth en juin 2014. A Ersal, au mois d’août, des éléments de Daesh et de Jabhat al-Nosra, ralliés à Daesh, ont ensuite fait une vingtaine de morts dans les rangs des forces de sécurité et pris des otages. La menace posée par Daesh au Liban n’est pas seulement importée. Comme le rapporte Pierre-Jean Luizard, dans son ouvrage précité, le drapeau noir de Daesh flotterait dans certains quartiers de Tripoli. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la radicalisation préoccupante d’une fraction de la communauté sunnite, à commencer par des raisons économiques. De nombreux sunnites vivent dans des régions moins développées, en particulier dans la Bekaa et dans le Nord du pays. Leurs élites traditionnelles connaissent une certaine perte de vitesse, notamment le Courant du futur, mouvement politique fondé par l’ancien premier ministre Rafic Hariri, mais aussi l’institution religieuse Dar al-Fatwa, affaiblie par des scandales récents, par la montée en puissance d’organisations plus jeunes et plus radicales, qui remettent en cause son autorité, et par la perte de contrôle d’un certain nombre de mosquées (139). A cela s’ajoute une radicalisation provoquée par la montée en puissance du Hezbollah, chiite, au Liban et par son intervention assumée en Syrie et désormais en Irak.
Dans les Territoires palestiniens, les Israéliens ont déclaré avoir arrêté en novembre des Palestiniens d’Hébron se revendiquant de Daesh ; à Gaza, plusieurs groupes djihadistes chercheraient à faire allégeance à Daesh et 200 salafistes portant les drapeaux de cette organisation terroriste ont défilé en janvier dernier devant l’Institut français, après la publication d’une caricature du Prophète par Charlie Hebdo.
En Israël, le Shin Bet a déclaré avoir arrêté en novembre dernier des Arabes israéliens partis combattre en Syrie et sur le point de mener une attaque. Les services israéliens seraient également très attentifs aux risques d’infiltration depuis le Sud Liban et le Golan, ainsi qu’aux résidents ou citoyens européens qui pourraient utiliser leur passeport pour entrer en Israël après s’être rendus en Syrie ou en Irak.
c. Une menace pour notre propre sécurité intérieure
Si les risques posés par Daesh concernent principalement les populations locales et les pays avoisinants, les menaces directes sur notre sécurité intérieure ne doivent pas être sous-estimées. Selon M. Jean-Pierre Filiu, des attentats majeurs auraient pour effet de générer un nouveau cycle de violences et d’alimenter la « machine de la terreur » de Daesh (140). Le blocage de son expansion territoriale dans la région pourrait conduire cette organisation terroriste à s’en prendre davantage à d’autres terrains.
Comme la mission d’information a déjà eu l’occasion de le rappeler, Daesh a clairement annoncé ses intentions et les risques sont probablement accrus par la rivalité avec Al-Qaida (141). Gilles de Kerchove, le coordinateur européen anti-terrorisme, a ainsi déclaré que le Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaida, cherchait des Européens avec des passeports valides afin de commettre des attentats sur le sol européen.
Trois hypothèses doivent être prises en considération : des éléments terroristes envoyés depuis l’étranger pour mener des actions sur notre sol ; le retour de ressortissants nationaux ou de résidents français partis sur des théâtres extérieurs pour combattre dans les rangs d’organisations djihadistes ; des attentats commis par des individus ne s’étant pas rendus préalablement sur un théâtre extérieur et n’ayant pas rejoint formellement les rangs de groupes terroristes, mais « inspirés » par eux – et donc un peu rapidement qualifiés de « loups solitaires ».
Si le phénomène des combattants terroristes étrangers n’est pas nouveau, le nombre des individus concernés est sans précédent (142). Il est vrai que tous ne reviennent pas de Syrie et d’Irak ou n’ont pas, une fois revenus, l’intention de passer à l’acte. Certains seraient précisément de retour après avoir été confrontés à une réalité ne correspondant pas à ce qu’ils avaient imaginé. Des études portant sur les années 1990-2010 (143) suggèrent qu’environ 11 % des combattants étrangers auraient posé une menace de sécurité à leur retour, ce qui reste tout de même très significatif. L’attentat commis par Mehdi Nemmouche en mai 2014, contre le musée juif de Bruxelles, montre la réalité de la menace.
Selon des éléments rendus publics par le ministère de l’intérieur, il faudrait aujourd’hui surveiller près de 1 300 personnes, Français ou étrangers résidant en France, pour leur implication dans des filières terroristes en Syrie et en Irak. Ce nombre était en augmentation de 130 % en 2014. Il s’y ajoute entre 400 et 500 personnes impliquées dans des filières plus anciennes ou concernant d’autres pays, ainsi que les principaux animateurs de la sphère cyberdjihadiste francophone. Il y aurait en tout près de 3 000 personnes à surveiller par les services de renseignement français.
4. Les facteurs multiples de l’essor de Daesh
a. Un terreau fertile en Irak et en Syrie
Bien que Daesh n’ait pas été éradiqué à la fin de la guerre civile irakienne du milieu des années 2000, ses menées terroristes avaient nettement perdu en intensité. Le groupe est remonté en puissance à partir de 2011 (144), à la faveur d’un double vide laissé par le pouvoir central.
En Irak, le vide exploité par Daesh résulte tout d’abord de la politique autoritaire, sectaire et répressive de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, qui a renforcé le sentiment de marginalisation et d’exclusion qui se développait au sein de la population sunnite du pays depuis la chute de Saddam Hussein et l’installation au pouvoir de responsables représentant la communauté chiite, majoritaire. La déconnexion entre les responsables sunnites de Bagdad et la population qu’ils sont censés représenter a également contribué à miner de l’intérieur les institutions irakiennes. M. Maliki s’était employé à saper la représentativité des leaders sunnites en les cooptant, en les soudoyant ou en les jetant en prison si nécessaire.
En Syrie, l’essor de Jabhat Al-Nosra et de Daesh a été facilité par le vide sécuritaire créé par le retrait des forces armées syriennes de vastes espaces au Nord-Est du pays et leur redéploiement à l’Ouest de la Syrie, pour défendre les grands centres urbains. A la différence de l’Irak, même si Daesh a pu rallier des combattants tribaux dans le Nord-Est, ses gains ont en partie résulté de la reddition de groupes locaux ou tribaux et de l’abandon de leurs positions dans la région de Deir Ezzor, après la proclamation du califat et par crainte d’une prise de contrôle par la force (145).
Daesh s’inscrit enfin dans un vide conceptuel et politique. Selon Peter Harling, « un XXe siècle décousu, qui faisait suite à une longue occupation ottomane perçue comme une période de recul, s’est soldé par une série d’échecs : anti-impérialisme, panarabisme, nationalismes, socialisme, diverses formes d’islamisme, capitalisme n’ont débouché que sur des expériences ambiguës et amères. Hormis en Tunisie, les espoirs nés des soulèvements de 2011 ont viré, pour l’instant du moins, au désastre. Vers qui se tourner pour trouver une source d’inspiration, de confiance en soi, de fierté ? Les réactionnaires du Golfe et d’Egypte ? Les Frères musulmans, aujourd’hui laminés ? Le Hamas palestinien, pris au piège d’une sempiternelle impasse dans sa résistance à Israël ? » (146) . Le recours au concept de califat, proclamé en juin 2014 par Daesh, remplit un vide conceptuel après l’échec historique des autres idéologies.
Le facteur tribal, important dans les régions sunnites de l’Irak et dans le Nord-Est de la Syrie, a aussi contribué à la montée en puissance de Daesh. Le Nord Mali et le Yémen avaient déjà montré que les tribus, jamais monolithiques, mais souvent marginalisées ou instrumentalisées par les pouvoirs en place, peuvent monnayer leur allégeance, s’allier à des acteurs susceptibles de promouvoir leurs intérêts ou simplement trouver un « modus vivendi ». Selon M. Dominique Thomas, chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), entendu par la mission d’information le mercredi 10 décembre 2014, l’association du djihadisme et du facteur tribal forme un « cocktail » particulièrement explosif.
Au plan symbolique, la Syrie et l’Irak sont situés au cœur du monde musulman, alors que l’Afghanistan de Ben Laden ne se trouvait qu’à sa périphérie. L’espace situé entre le Sinaï et l’Euphrate forme le « pays de Sham », lieu de « l’Ultime Bataille » de la fin des temps selon un « hadith » très populaire chez les djihadistes. Comme l’indique Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris, le magazine de Daesh est d’ailleurs intitulé « Dabiq », du nom d’une localité située tout au Nord de la Syrie, entre Alep et la Turquie, où une tradition prophétique situe le théâtre de la bataille décisive entre les musulmans et les « Roums » (les Romains, c’est-à-dire les Byzantins à l’époque de Mahomet et aujourd’hui les « Croisés », ou occidentaux, dans la propagande djihadiste).
b. D’autres facteurs structurels
L’afflux d’un tel nombre de terroristes étrangers peut s’expliquer par la fascination qu’exerce le conflit syrien, au confluent de puissantes trames narratives : la lutte contre un régime autoritaire jugé impie, celui des Assad ; le combat contre des minorités présentées comme des apostats, en particulier les Alaouites syriens, alliés des Iraniens, et contre les chiites en général, dans un contexte d’accroissement considérable des tensions confessionnelles au plan régional ; la lutte contre l’Occident – « l’ennemi lointain » dans l’idéologie djihadiste, accusé de soutenir les régimes en place et désormais de mener une agression directe, via les frappes aériennes de la coalition en Irak et en Syrie ; enfin, peut-être, l’idée de constituer une avant-garde dans la lutte contre Israël, présent de l’autre côté de la frontière syrienne. Cette combinaison inédite, autour de Daesh, a pu être qualifiée de « djihadisme cinq étoiles » par le Professeur Peter Neumann, du King’s College de Londres.
Selon M. Dominique Thomas, ce « djihad multicarte » est facilité par le cadre idéologique peu précis de Daesh. Sa rhétorique est nettement moins savante et moins structurée que celle d’Al-Qaida, organisation dogmatique et élitiste. Daesh est plus facile d’accès pour de jeunes recrues très peu lettrées sur le plan religieux, voire converties de fraîche date. Il leur est aisé de se « bricoler » un bagage idéologique à partir du matériel de propagande mis en ligne par Daesh et de rejoindre très vite les rangs de l’organisation. Al-Qaida exigeait au contraire de suivre un parcours quasiment initiatique.
Comme l’a rappelé le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, lors de son audition du mercredi 14 janvier 2015 devant la commission des affaires étrangères, « l'environnement international fournit matière au ressentiment, au discours victimaire et à la logique de représailles », en particulier le conflit israélo-palestinien, qui fait « figure d'abcès de fixation ». Daesh se nourrit de sentiments profonds d’impuissance, d’aliénation et de marginalisation, renforcés par la mise en échec des « révolutions arabes », que la mission d’information a eu l’occasion d’évoquer. En Egypte, on peut penser que le renversement du président Mohamed Morsi, issu de la Confrérie des Frères musulmans et démocratiquement élu en juin 2012, a certes permis d’écarter la menace qui pesait sur l’Egypte, mais qu’il accrédite aussi la thèse centrale de la mouvance djihadiste selon laquelle un changement politique réel ne peut être réalisé que par la force – le « djihad » violent.
Selon Mme Myriam Benraad, chercheuse à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), « deux sentiments partagés, communs mais non moins fondamentaux, ont ainsi joué un rôle de premier ordre dans la radicalisation des Kouachi et de Coulibaly (147), puis leur adhésion au jihad : l’humiliation, perçue comme inscrite au cœur de l’histoire politique contemporaine du monde arabo-musulman, et la revanche, indissociable de cette humiliation et de la réponse qu’elle est supposée engendrer chez ceux qui en font l’expérience douloureuse (…). Le jihad, très tôt justifié au nom d’une revanche des musulmans contre les interférences et l’oppression d’un Occident judéo-chrétien impérialiste et diabolisé, est donc aussi la manifestation d’émotions, au-delà des soubassements plus politiques et des préjugés culturalistes habituels concernant une supposée « prédisposition » de l’islam ou encore de la culture arabe à la violence » (148).
Sur un autre plan, il est vraisemblable que le développement du salafisme a servi de terreau favorable à Daesh (149). Ainsi que l’a rappelé M. Stéphane Lacroix, chercheur et professeur associé au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po Paris (150), les salafistes ont connu un essor considérable et longtemps méconnu dans la région. Ils ont bénéficié de l’appui des régimes autoritaires, de Moubarak à Ben Ali : face à une demande croissante d’islam, ces régimes en ont préféré une version non politique, c’est-à-dire les salafistes plutôt que les Frères musulmans, comme contrefeu à ces derniers. Selon M. Lacroix, c’est par le biais des salafistes, pour qui tous ceux qui n’adhèrent pas à leur orthodoxie sont de mauvais musulmans, que l’anti-chiisme s’est répandu. Tout un travail de redéfinition de l’islam a conduit à l’exclusion des chiites de la communauté des musulmans et une rhétorique ultra-sectaire a pu prendre. Bien que les salafistes soient généralement quiétistes et qu’ils se présentent comme une alternative à Daesh, leur essor a préparé un cadre favorable à d’autres acteurs violents.
II. CONTRE DAESH, COUPLER LA RÉPONSE SÉCURITAIRE À DES SOLUTIONS POLITIQUES GLOBALES ET LOCALES
Devant l’effondrement de l’armée irakienne à Mossoul, en juin dernier, les conquêtes territoriales de Daesh en Irak, la fuite des populations chrétiennes et yézidies, mais aussi les menaces pesant sur Bagdad et sur Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, la France a fait partie des premiers pays à prendre leurs responsabilités, avec les Etats-Unis. Elle a rapidement livré plus de 100 tonnes d’aide humanitaire, tout en fournissant des armes et des munitions aux peshmergas kurdes.
Plusieurs experts auditionnés par la mission d’information ont insisté sur la nécessité de tirer toutes les conséquences de la menace posée par Daesh, qui n’est en rien un « épiphénomène » au regard de ses moyens et de ses ambitions. En organisant à Paris une conférence internationale pour la paix et la sécurité en Irak, le 15 septembre dernier, la France a joué un rôle clef dans la structuration d’une vaste coalition internationale contre Daesh, dont les Etats-Unis ont pris la tête. Elle rassemble aujourd’hui 62 pays (151) et organisations internationales (152).
Le succès de cette coalition dépendra de sa capacité à mobiliser efficacement l’ensemble des acteurs régionaux et à s’appuyer sur des forces locales capables de mener la reconquête territoriale sur le terrain. Il faudra parvenir à séparer Daesh de ses soutiens en privant cette organisation terroriste de son « réservoir » potentiel, à savoir les millions de sunnites maltraités par le régime syrien et par celui de l’ancien Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. L’aide apportée par la coalition internationale est certes utile et nécessaire pour surmonter la menace immédiate qui est posée par Daesh, mais les réponses durables à la crise seront avant tout de nature politique et locale.
A. LA NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE CONTRE-TERRORISTE GLOBALE ET COHÉRENTE
1. Les cinq champs d’action principaux de la coalition contre Daesh
La stratégie de la coalition internationale contre Daesh combine cinq « lignes d’action » complémentaires : fournir un appui militaire à des forces qui combattent Daesh sur le terrain ; entraver l’afflux des combattants terroristes étrangers ; assécher les sources de financement de Daesh ; lutter contre le message diffusé et exploité par cette organisation ; apporter une réponse aux crises humanitaires en cours. Lors de la conférence ministérielle qui s’est tenue le 3 décembre 2014 à Bruxelles, les participants à la coalition se sont engagés à contribuer dans ces cinq domaines, selon leurs capacités et leurs priorités, définies au niveau national.
a. Apporter un soutien militaire décisif sur le terrain
Au plan militaire, l’action de la coalition internationale vise à dégrader la capacité offensive de Daesh. Elle se développe sur trois plans : un appui aérien, qui a été engagé par les Américains dès le 8 août 2014 et auquel la France participe dans le cadre de l’opération « Chammal », lancée par notre pays le 19 septembre suivant ; un soutien logistique aux forces armées irakiennes et aux combattants kurdes, les peshmergas (153) ; une aide à la remontée en puissance des forces engagées contre Daesh sur le terrain, la coalition internationale n’engageant pas de son côté de forces terrestres combattantes (154).
Au regard du droit international, il faut noter que la situation est quelque peu différente en Irak et en Syrie. Alors que les frappes sont conduites sur le territoire irakien à la demande des autorités de ce pays, sur le fondement de l’article 51 de la Charte des Nations Unies (155), qui autorise l’exercice collectif de la légitime défense, les Etats-Unis ont insisté publiquement sur le fait que l’accord des autorités syriennes n’avait pas été demandé. Si les frappes menées en Syrie ont également été justifiées dans le cadre du droit à la légitime défense, c’est donc dans un contexte différent.
Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies, le 23 septembre 2014, les Etats-Unis invoquaient les motifs suivants : les autorités irakiennes ont demandé à la communauté internationale, sous l’égide des Etats-Unis, de frapper Daesh dans les « sanctuaires » qu’il utilise en Syrie pour mener des actions en Irak ; Daesh ne représente pas qu’une menace pour l’Irak, mais aussi pour les Etats-Unis et pour les pays voisins ; enfin, le Gouvernement syrien a montré qu’il n’était ni capable de prévenir l’usage de son territoire par Daesh, ni déterminé à agir (156).
La France a fait le choix de concentrer son action sur l’Irak et ne participe donc pas aux frappes qui sont menées en Syrie par les Etats-Unis et par plusieurs Etats arabes. Elle n’a toutefois contesté ni l’opportunité ni la légalité de telles frappes.
Selon les explications données par le général de corps d’armée Didier Castres, sous-chef d'état-major Opérations, lors d’une audition de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, le 17 décembre 2014, la stratégie militaire de la coalition peut se décomposer en trois phases : briser l'expansion de Daesh ; accélérer la remontée en puissance des forces de sécurité irakiennes et des forces syriennes « modérées » ; conduire des actions décisives pour redonner à ces forces la maîtrise du territoire.
En Irak, la remontée en puissance des forces locales (157) repose sur des programmes d’équipement et de formation au long cours, ainsi que sur des actions de conseil militaire (158). En Syrie, la mission « Train & Equip » conçue par les Etats-Unis, pour un montant de 500 millions de dollars, est destinée à renforcer les capacités de l’insurrection non-djihadiste syrienne, après identification d’interlocuteurs fiables.
Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a indiqué au début de mois de février, lors de la conférence sur la sécurité de Munich, que les forces de la coalition avaient mené plus de 2 000 frappes aériennes. A ce stade, ces frappes ont joué un rôle décisif dans la conduite de certaines opérations, notamment dans l’offensive des peshmergas à Sinjar, en Irak, et dans le coup d’arrêt donné à la progression des djihadistes dans l’enclave kurde de Kobané, en Syrie. Selon John Kerry, la campagne de la coalition internationale avait permis de reprendre 700 km2 au début du mois de février.
Si le rapport de force s’est en partie modifié sur le terrain, il reste à l’inverser durablement et à engager la reconquête des territoires sous l’emprise de Daesh. Les frappes se sont traduites par des pertes réelles en matériel et en combattants – fin décembre 2014, on estimait que Daesh avait perdu près de 2 000 combattants depuis l’été (159) –, mais les djihadistes ne sont pas restés inactifs. Daesh s’est efforcé de consolider ses positions défensives et de conserver l’essentiel de son potentiel militaire. Daesh aurait ainsi continué à se regrouper avec d’autres forces et à exploiter des capacités de recrutement internationales et locales toujours importantes. Selon certaines estimations, ses effectifs pourraient avoir continué à augmenter malgré les frappes.
b. Endiguer l’afflux des combattants terroristes étrangers
La résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en septembre 2014, comporte une définition précise des « combattants étrangers ». Il s’agit « des individus qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessin de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ».
Cette résolution, adoptée à l’initiative des Etats-Unis, sous le chapitre VII de la Charte, précise et complète utilement les obligations incombant à tous les Etats membres des Nations unies :
– elle décide qu’ils doivent prévenir et empêcher les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d'équipement bénéficiant aux combattants terroristes étrangers ;
– elle instaure une obligation, pour tout Etat, de réprimer ses ressortissants qui se rendraient ou tenteraient de se rendre à l’étranger pour participer à des actes de terrorisme, ou qui financeraient ou faciliteraient des voyages organisés dans ce but ;
– elle demande de veiller à empêcher la circulation des terroristes et des groupes terroristes, notamment en effectuant des contrôles efficaces aux frontières, en surveillant de près la délivrance des documents d'identité et de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la falsification de tels documents ;
– elle invite les Etats membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur leur territoire qu'elles communiquent à l'avance aux autorités nationales compétentes des informations sur leurs passagers, afin de détecter les départs de combattants étrangers ou les tentatives d'entrée et de transit de combattants ;
– elle invite aussi les Etats membres à coopérer pour renforcer les échanges d'informations permettant de repérer les combattants terroristes étrangers, et elle encourage notamment Interpol à renforcer ses capacités en la matière ;
– elle encourage l’élaboration de stratégies de lutte contre le discours extrémiste violent, susceptible d’inciter à la commission d'actes terroristes, et la participation des populations locales et des organisations non gouvernementales compétentes.
La lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers implique d’être actif à tous les niveaux, aussi bien dans les pays d’origine que de transit – notamment la Turquie. Il convient d’agir sur tous les tableaux afin de prévenir la radicalisation, de bloquer les candidats au djihad et de retracer, le cas échéant, les mouvements suspects. Des coopérations régionales et internationales renforcées doivent donc être combinées aux réponses adoptées à titre national dans chaque pays (160).
Dans ce cadre, la mission d’information souhaite mettre l’accent sur les impératifs suivants :
– le renforcement des échanges d’informations au plan européen et dans le cadre d’Interpol, par l’extension des coopérations entre les services compétents, qui ont souvent lieu à titre bilatéral ;
– l’amélioration de la coopération judiciaire et pénale au plan international comme au plan régional, afin de réprimer efficacement le phénomène des combattants terroristes étrangers ;
– le soutien à apporter à nos partenaires pour renforcer leurs dispositifs nationaux de lutte contre les combattants étrangers ;
– le partage des retours d’expérience dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, pratiquée depuis plus longtemps dans certains pays, notamment anglo-saxons et scandinaves.
c. Tarir les sources de financement de Daesh
La coalition internationale a fait, à juste titre, de la lutte contre les sources de financement de Daesh une priorité. Il s’agit à la fois de cibler ses ressources en Irak et en Syrie, de restreindre autant que possible son accès au système financier international, de renforcer les contrôles sur les donateurs privés dans la région, en particulier dans le Golfe, et d’adopter des sanctions ciblées sur les dirigeants du groupe, ses facilitateurs et ses intermédiaires au plan international.
Les mesures d’assèchement financier et économique de Daesh s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’une action de long terme. Cela implique en particulier de faire preuve d’une grande vigilance financière sur tout le territoire irakien, en étant conscient qu’il sera difficile de couper toutes les relations commerciales et financières avec les territoires sous l’emprise de Daesh, et de mieux comprendre les circuits de financement de cette organisation.
Les frappes aériennes de la coalition peuvent aussi jouer un rôle dans la lutte financière contre Daesh, notamment par la destruction de points de collecte de pétrole et de raffineries artisanales. Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, a annoncé lors de la conférence sur la sécurité de Munich, au début du mois de février dernier, que les frappes menées par la coalition avaient permis de priver Daesh de 200 installations gazières et pétrolières qui étaient sous son contrôle.
De telles opérations doivent être envisagées avec prudence, selon la Mission, car elles risquent d’avoir un impact destructeur sur les infrastructures de la Syrie et de l’Irak, en cas de frappes très larges et systématiques. Ce serait particulièrement préjudiciable non seulement pour l’avenir des pays concernés, mais aussi pour la légitimité des frappes aériennes du point de vue des populations locales. Daesh tend à présenter ces frappes comme une agression contre les sunnites, au bénéfice de l’Iran et de ses alliés, et il semblerait que cette thèse trouve déjà un certain écho sur les réseaux sociaux.
Bien que Daesh utilise une partie de son pétrole pour ses propres activités, des exportations ont également lieu vers les pays voisins, sous le contrôle d’acteurs privés, du moins en ce qui concerne la Turquie. Afin de compléter les frappes aériennes, il importe d’identifier et de sanctionner les intermédiaires et les établissements bancaires impliqués dans ces marchés parallèles. Comme le rappelle la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, tout échange commercial direct ou indirect avec Daesh peut être considéré comme un appui financier à un groupe terroriste.
d. Etendre le domaine de la lutte à la sphère des idées et des médias
La « communication stratégique » fait également partie des « lignes d’action » de la coalition internationale. La force de Daesh ne résulte pas seulement de son usage massif de la terreur contre tous ceux qui feraient preuve d’hostilité à son égard ou même d’une quelconque réticence à se rallier, de son exploitation habile des divisions et des intérêts au plan local ou encore de la version particulièrement brutale de l’ordre islamique et des services sociaux que cette organisation terroriste s’efforce de déployer sur le terrain. Tous ces éléments comptent. Mais Daesh s’appuie également sur une puissante propagande (161) qui mêle récits historiques, concepts islamiques et griefs très contemporains afin de capitaliser sur le sentiment d’oppression et d’aliénation qui existe au sein des populations sunnites visées.
L’affaiblissement de Daesh passe aussi par la lutte contre la propagande utilisée par cette organisation pour diffuser son message radical et violent, pour attiser dans son propre intérêt les tensions confessionnelles et pour se présenter comme le seul véritable protecteur des sunnites, en vue de gagner des soutiens, en particulier ceux de combattants étrangers supplémentaires. Les efforts pour supprimer, autant que possible, les comptes sociaux utilisés pour répandre les images et les idées de Daesh ne suffiront pas. Outre les efforts portant sur les canaux de diffusion potentiels, il faut s’attaquer directement au message.
Tel était l’objet de la conférence organisée par la coalition au Koweït le 27 octobre 2014. Un consensus s’est dégagé sur plusieurs principes : l’utilité d’une communication coordonnée, utilisant les mêmes canaux que Daesh afin de contrer son image et de contester sa légitimité religieuse et doctrinale ; la nécessité de viser les populations les plus fragiles, en particulier les jeunes, et d’adapter les messages selon les pays et les publics concernés ; l’importance de diffuser en contrepoint un message positif sur l’islam, avec l’aide de personnalités religieuses respectées, afin de ne pas alimenter des tensions qui ne peuvent que profiter à Daesh.
Les prises de position d’un certain nombre d’autorités religieuses musulmanes très respectées, telles que le grand imam de la mosquée d’al-Azhar, au Caire, qui est l’un des grands phares de l’islam sunnite modéré, ont été largement saluées (162). Elles sont positives, pour l’image générale de l’islam, mais on peut néanmoins s’interroger sur l’influence des figures religieuses institutionnelles, proches des pouvoirs en place, sur les populations qui pourraient être sensibles au discours de Daesh, en particulier une jeunesse marginalisée. Au risque de forcer le trait, à quoi bon envoyer l’archevêque de Cantorbéry contre les Davidiens fanatiques de Wako au Texas ? (163) Il ne faudrait pas non plus surestimer le poids de la motivation religieuse par rapport à d’autres facteurs plus économiques, sociaux ou politiques.
Dans cette lutte contre l’offensive médiatique de Daesh, certaines déclarations publiques pourraient avoir un plus grand écho que d’autres, en particulier celles de figures radicales telles que les salafistes jordaniens Abou Qatada et Abou al-Maqdissi, qui ont pris position contre Daesh. Certains pays du Golfe passent aussi pour utiliser des étudiants ayant une connaissance de la jurisprudence islamique afin de contrer Daesh et de semer la division dans les rangs de la communauté djihadiste en ligne. D’autres actions de contre-propagande classique, faisant appel à d’anciens djihadistes repentis, présentent aussi un intérêt manifeste.
e. Traiter les aspects humanitaires de la crise
En parallèle des crises sécuritaires et politiques que la Syrie et l’Irak traversent, la situation humanitaire reste particulièrement préoccupante dans ces deux pays, ainsi que dans les Etats voisins, notamment le Liban, la Jordanie et la Turquie. Les estimations du nombre des réfugiés et des personnes déplacées ont été présentées dans la première partie de ce rapport.
Au regard des enjeux humains de cette crise humanitaire, dont l’échelle est régionale, et des risques de déstabilisation pesant sur les Etats voisins de la Syrie et de l’Irak, un soutien humanitaire massif s’impose, en parallèle des autres « lignes d’action » de la coalition internationale. Ces efforts ont lieu sur un plan quelque peu différent des autres, mais ils n’en sont pas moins essentiels.
La France y a notamment contribué en livrant plus de 100 tonnes d’aide humanitaire en Irak depuis l’été 2014. D’autres pays apportent des financements significatifs, notamment l’Arabie saoudite, qui aurait dégagé une enveloppe d’au moins 500 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire en Irak. Toutefois, comme la mission d’information a eu l’occasion de le rappeler en présentant la situation du Liban, de la Jordanie et de la Turquie, les besoins humanitaires recensés par les Nations unies dans l’ensemble de la région restent gravement sous-financés. En ce qui concerne la Syrie, le Programme alimentaire mondial (PAM) a ainsi dû réviser à la baisse, dans des proportions importantes, son aide destinée aux réfugiés. Il faut espérer que la troisième conférence des donateurs pour la Syrie, qui se tiendra le 31 mars prochain au Koweït, sera l’occasion d’un renforcement significatif de la mobilisation au plan international.
Face à l’urgence et à la situation particulièrement dramatique des minorités présentes en Irak (164), la France a décidé d’accueillir sur son sol un certain nombre de réfugiés, en particulier des Chrétiens d’Orient, qui présentent des liens avec notre pays (165). Cette politique d’accueil répond à une nécessité évidente pour ceux qui n’estiment plus être en mesure de rester dans leur pays ou à proximité de celui-ci. Mais nous devons aussi et surtout œuvrer, dans toute la mesure de nos moyens et de notre influence, pour le rétablissement de conditions permettant aux différentes composantes confessionnelles et ethniques de l’Irak de rester sur leur terre d’origine. Vivre en paix et en sécurité dans son pays est un droit fondamental. Le départ de ces populations serait une victoire complète pour Daesh. La Mission salue l’initiative prise par la France de convoquer le Conseil de sécurité des Nations unies le 27 mars prochain, sous sa présidence, pour une réunion consacrée à la persécution des minorités, en particulier les Chrétiens d’Orient menacés par Daesh.
2. Des paris stratégiques à gagner
La décision de ne pas déployer de forces combattantes pour affronter Daesh au sol (166) a conduit la coalition à la stratégie suivante : d’une part, soutenir des forces locales directement menacées par Daesh et déterminées à combattre cette organisation ; d’autre part, s’appuyer sur des pays voisins qui devraient avoir un intérêt à faire cesser la menace pesant sur leur propre sécurité. Cette stratégie est cohérente, mais elle reste à mette en œuvre pleinement dans ses deux branches.
a. Quelles forces locales au sol ?
Si l’action militaire de la coalition internationale – appui aérien, fourniture d’armes, formations – est nécessaire pour réduire la capacité offensive de Daesh, son élimination des zones peuplées en Syrie et en Irak nécessitera l’intervention de troupes – locales – au sol.
– En Irak, au moins quatre relais sont envisageables pour mener les combats au sol contre Daesh : l’armée régulière irakienne, les milices chiites qui l’épaulent, les peshmergas – combattants kurdes du Nord du pays – et potentiellement les tribus sunnites. A ce stade, la mobilisation de ces différents acteurs demeure problématique.
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’effondrement des forces armées irakiennes, dominées par les chiites, face à Daesh dans les zones sunnites du pays : leur manque d’aguerrissement et leur niveau de corruption, mais aussi le manque de combattivité de leurs éléments chiites pour défendre des zones de peuplement qui n’étaient pas les leurs, comme celui des éléments sunnites pour défendre des intérêts perçus comme chiites. Sans restructuration interne des forces gouvernementales et sans restauration de leur crédibilité, ce qui prendra du temps, les capacités demeureront réduites. Dans la situation actuelle, toute intervention hors des zones chiites, pour reconquérir des territoires sous l’emprise de Daesh, risque même d’être contreproductive. Il faut éviter de conforter le scénario d’une reprise de contrôle par des forces chiites ou considérée comme agissant à leur profit. Dans l’immédiat, il paraît difficile d’envisager que l’armée irakienne puisse assumer seule la reconquête territoriale.
Les forces gouvernementales bénéficient du soutien de milices chiites qui représentent une part importante de leur capacité offensive. Ce serait en particulier le cas pour les opérations en cours contre Daesh à Tikrit, l’ancien fief de Saddam Hussein (167). Ces forces ont joué un rôle utile, à l’appel de l’ayatollah al-Sistani, mais leur mobilisation pour repousser Daesh paraît aussi complexe que celle des forces armées irakiennes à ce stade. Les exactions qui leur sont imputées sur le terrain, et qui sont attestées par des ONG, contribuent à renforcer le clivage entre sunnites et chiites, faisant le jeu de Daesh. Bien que le gouvernement irakien et celui de l’Iran tiennent beaucoup aux milices chiites, notamment en raison de leur apport militaire, il serait préférable d’essayer de réduire leur influence, à mesure que le danger posé par Daesh reculera, au lieu de chercher à s’appuyer sur elles pour mener des combats au sol.
Les peshmergas, héritiers des mouvements de résistance kurdes, coopèrent avec les autorités de Bagdad et ont mené des attaques dans le Nord du pays. Les forces kurdes ont montré leur détermination à défendre leur territoire, mais il n’est pas certain qu’elles iront au-delà et qu’elles puissent constituer une force centrale, hormis dans les zones dites « contestées » entre les Kurdes et le gouvernement central. Les forces kurdes ont ainsi pris l’avantage à Mossoul à la faveur de l’effondrement des forces armées gouvernementales.
Dans ces conditions, la solution la plus efficace et la plus durable pour mener des combats au sol contre Daesh serait de constituer des forces sunnites de résistance. Le réengagement des sunnites dépend du basculement de certaines tribus du bon côté, ce qui reste un défi à ce stade. Malgré la résistance de certaines de ces tribus, qui en ont d’ailleurs payé un prix effroyable (168) , il ne semble pas qu’il y ait de renversement majeur des alliances jusqu’à présent.
D’une certaine manière, tous les acteurs irakiens paraissent avoir retenu la leçon des années 2006-2007 : d’une part Daesh, qui veille à ne pas s’aliéner ses alliés et soutiens potentiels sur le terrain, en constituant des alliances et en laissant une certaine autonomie aux forces locales ; d’autre part les tribus sunnites, qui avaient été ralliées par les Américains contre Al-Qaida au prix de promesses finalement non tenues par le gouvernement chiite de M. Maliki. Une autre différence avec le mouvement « Sahwa » du milieu des années 2000 est que les Américains ne semblent pas prêts à investir autant qu’ils le faisaient à l’époque, aussi bien au plan financier que militairement, par une présence au sol qui témoignerait du sérieux de leur engagement aux côtés des autorités irakiennes.
– En Syrie, Daesh reste principalement combattu au moyen des frappes aériennes menées par la coalition. La conduite d’opérations au sol par des relais locaux paraît au moins aussi problématique sur le théâtre syrien qu’en Irak.
En dépit d’affrontements réels, la lutte contre Daesh n’est manifestement pas le premier objectif de l’opposition non-djihadiste, qui souhaite d’abord la chute du régime. Ce dernier n’a pas non plus pour priorité de combattre Daesh, qu’il a longtemps ménagé, puisqu’il lui sert de repoussoir contre l’opposition « modérée » vis-à-vis de la population syrienne et au plan international. Bashar el-Assad n’a commencé à lutter contre Daesh que récemment, afin de se présenter comme un allié objectif de la coalition et dans l’espoir de bénéficier à terme d’une nouvelle légitimité.
En ce qui concerne la coalition, toute perspective de coopération avec le régime syrien a été vigoureusement rejetée à plusieurs reprises. Les forces « modérées » de l’insurrection constituent donc l’unique relais envisagé à ce stade pour repousser Daesh en Syrie.
L’opposition armée non-djihadiste demeure néanmoins très affaiblie. Un programme a certes été décidé par les Américains pour l’aider à monter en puissance, mais le volume de l’aide envisagée reste faible – 500 millions de dollars. Sa mise en place intervient aussi très tardivement dans le cours de la crise syrienne : l’opposition que nous soutenons et sur laquelle nous souhaitons nous appuyer n’est plus que marginale, voire en grande partie introuvable sur le terrain. Il y aura enfin des délais importants – peut-être jusqu’à 8 mois – avant que les effets de ce programme ne trouvent une éventuelle traduction concrète dans les rapports de force.
Jusqu’à présent, il faut reconnaître que nous avons surtout encouragé l’insurrection syrienne, sans qu’aucun soutien réellement significatif ne lui parvienne de notre part (169). Il ne paraît pas évident, à ce stade, que la priorité donnée à la lutte contre Daesh s’accompagne d’un véritable renversement de tendance.
Cette absence de relais efficaces pour lutter au sol contre Daesh peut conduire à s’interroger sur le soutien qu’il conviendrait d’apporter aux unités combattantes du PYD, qui contrôle les enclaves kurdes au Nord de la Syrie (170). Leur lutte contre Daesh à Kobané a valu au PYD une certaine sympathie au plan international, ainsi qu’un début de reconnaissance (171).
Le PYD pourrait remporter quelques victoires dont l’impact symbolique présenterait un intérêt pour la cause défendue par la coalition. La reprise de l’enclave de Kobané, qui avait été presque entièrement envahie par Daesh, a été un moment important dans l’enrayement de sa dynamique. Il reste que ce moment n’a pas été utilisé autant qu’il aurait pu l’être contre la propagande de Daesh. Surtout, de même que les peshmergas kurdes en Irak, il n’est pas certain que les unités du PYD aillent significativement au-delà de la défense de leurs propres zones en Syrie et qu’elles puissent ainsi contribuer à la libération de territoires aujourd’hui sous l’emprise de Daesh.
La réaction d’Ankara doit aussi être prise en compte. Les autorités turques, bien qu’elles soient évidemment capables d’être pragmatiques, sont d’une extrême sensibilité à l’égard du PYD. Elles considèrent cette organisation comme l’émanation syrienne du PKK, qui ne figure pas sans raison sur les listes d’organisations terroristes (172). Il faut bien prendre la mesure du fait qu’un rapprochement trop marqué avec le PYD pourrait aliéner la Turquie. Son engagement au sein de la coalition contre Daesh est déjà perfectible à certains égards, alors qu’il s’agit d’un acteur essentiel dans la lutte qui est engagée.
b. Quelle convergence réelle entre les acteurs régionaux ?
Tous les acteurs régionaux, du Golfe à la Turquie en passant par l’Iran, semblent avoir pris conscience du danger extrême que fait peser Daesh, à la fois sur la stabilité de la région et sur leurs propres intérêts. L’existence d’objectifs et d’ambitions assez largement divergents continue toutefois à nuire à la cohérence de la coalition internationale qui s’est formée sous l’égide des Etats-Unis.
– La question des otages turcs détenus par Daesh, après la prise de Mossoul, a d’abord entravé la participation ouverte d’Ankara à la coalition internationale. Depuis, les autorités turques se sont engagées plus nettement à ses côtés.
Leur attitude lorsque l’enclave kurde syrienne de Kobané était menacée a toutefois clairement mis en lumière le fait que la question kurde reste prioritaire par rapport à la lutte contre Daesh. Il était difficile pour la Turquie d’aider massivement des Kurdes syriens qu’elle considère comme liés au PKK, à la différence du Gouvernement autonome du Kurdistan irakien – qui bénéficie, pour sa part, d’un soutien clair d’Ankara.
La lutte contre le régime syrien paraît également une priorité plus importante. Les Turcs ont ainsi conditionné leur pleine participation à la coalition, comme le manifestent leurs réticences à mettre à disposition la base aérienne d’Incirlik, à un alignement des priorités américaines sur leurs propres priorités : agir contre Bachar el-Assad, au lieu de s’abstenir de le frapper, ce qui est actuellement la stratégie de la coalition en Syrie, et constituer des « zones sûres », ce qui permettrait de limiter l’afflux des réfugiés et d’offrir une base arrière à l’insurrection syrienne.
La Turquie doit par ailleurs continuer ses efforts pour dissiper les doutes que sa très grande détermination à obtenir le départ de Bachar el-Assad a pu susciter. De nombreux groupes ont bénéficié de son soutien, direct ou indirect, en particulier du fait de la porosité de la frontière avec la Syrie. Comme la mission d’information a eu l’occasion de le rappeler précédemment, l’armée turque y a renforcé ses opérations et les autorités se sont fermement engagées dans la lutte contre l’afflux des djihadistes étrangers. Une « liste noire », manifestement étoffée et actualisée, a été constituée et des reconduites à la frontière ont lieu en conséquence.
– Les pays du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite et le Qatar, ont pu être soupçonnés d’avoir fourni des financements et des armes à des groupes d’opposition radicaux en Syrie, parfois liés à al-Qaida et à Daesh. Telle était notamment l’accusation portée publiquement par le vice-président américain, Joe Biden, en octobre dernier. Cette inquiétude est d’ailleurs assez partagée en Iran. Lorsque la coalition internationale a été mise en place, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a immédiatement mis en doute le « sérieux et la sincérité » de la coalition, au motif que certains pays avaient apporté un soutien aux djihadistes syriens et irakiens.
Le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a déclaré pour sa part et à plusieurs reprises, devant la commission des affaires étrangères, qu’aucune vérification menée par les services français n’a permis d’apporter d’éléments probants en la matière. Il faut aussi admettre qu’il existe une distinction entre la politique menée au nom de l’Etat et celle d’autres acteurs – certains princes, certains individus fortunés ou certaines fondations privées –, qui ont pu apporter, en effet, des financements désordonnés à des groupes combattant le régime syrien. Vue de l’extérieur, la diplomatie des pays du Golfe a parfois plusieurs têtes.
L’essentiel est de se tourner vers le présent et vers l’avenir. Les pays du Golfe ont apporté des réponses concrètes aux accusations dont ils ont fait l’objet. Le Qatar a adopté une législation pour contrôler les activités de ses fondations privées, tandis que le Koweït a créé une unité financière de renseignements. En Arabie saoudite, Daesh et Jabhat al-Nosra ont été désignés comme organisations terroristes en mars 2014. Riyad a adopté une nouvelle loi anti-terroriste et s’est engagé dans la lutte contre les départs des combattants étrangers. Les procès organisés contre des djihadistes ont probablement pour but de démontrer aussi clairement que possible la détermination des autorités saoudiennes.
Au plan militaire, si la contribution des Etats du Golfe n’est pas la plus déterminante (173), la participation d’Etats arabes sunnites était essentielle afin de ne pas accréditer l’idée d’une intervention occidentale menée contre des intérêts sunnites, au profit de l’Iran et des chiites. Cette perception a malheureusement une certaine visibilité dans les médias sociaux. Les Etats du Golfe peuvent aussi jouer un rôle dans les efforts en direction des tribus sunnites, avec lesquelles l’Arabie saoudite et la Jordanie entretiennent des liens historiques. Ces pays peuvent exercer une influence, en particulier grâce à la fourniture ciblée de financements ou d’armes, mais cette influence se mêle aussi à des rivalités et à des intérêts locaux qui prédominent souvent.
S’il existe une convergence avec les pays du Golfe en ce qui concerne la lutte contre Daesh, il semble toutefois que la priorité saoudienne pour la Syrie reste Bachar el-Assad, dans la mesure où son départ est perçu comme la solution la plus directe au problème de l’extrémisme en Syrie et dans la région. La mobilisation contre Daesh s’inscrit aussi dans le cadre d’un agenda interne. L’Arabie, les Emirats arabes unis et l’Egypte se sont engagés en commun dans une politique d’éradication des Frères musulmans et de toute forme d’islamisme politique, que la thèse d’un « continuum » idéologique et opérationnel entre les Frères musulmans et la galaxie djihadiste sert opportunément. Le risque est également que la lutte contre Daesh et la prédominance des réponses sécuritaires ne réduisent la pression en faveur de réformes pourtant nécessaires en matière de gouvernance.
– L’Iran paraît très sérieusement inquiet et concerné par Daesh. Les autorités iraniennes y voient la dernière métastase en date du « takfirisme » qui rongerait, dans leur vision de la situation, la Syrie et l’Irak, mais aussi le Liban et le Golfe. Les événements en Irak se déroulent aussi dans un contexte particulier du point de vue iranien. La situation actuelle renvoie aux scènes primitives de l’islam chiite, notamment la bataille de Kerbala. Les principaux lieux saints du chiisme sont d’ailleurs situés en Irak – le tombeau d’Ali à Nadjaf ou celui de Hussein à Kerbala – et ils constituent probablement des « lignes rouges » pour l’Iran.
Les Iraniens ont mené des frappes aériennes en Irak, d’ampleur limitée du fait de leurs capacités et assez atypiques au regard de leurs modes d’intervention habituels. Ces frappes ont fait l’objet d’interprétations diverses : montrer que les Iraniens restent influents en toile de fond, malgré l’intervention américaine et la constitution d’une coalition internationale à laquelle ils ne participent pas ; envoyer un avertissement aux responsables chiites irakiens et en particulier au nouveau Premier ministre, qui passe pour être avant tout nationaliste, à l’instar de son prédécesseur Maliki, même si ce n’est pas nécessairement l’image principale que nous avions de lui ; faire passer aux Etats du Golfe le message que des coopérations entre l’Iran et les Etats-Unis ne sont pas inenvisageables.
S’il existe une convergence objective avec l’Iran sur le dossier irakien, elle pourrait ne concerner que le volet relatif à la lutte contre Daesh, sans nécessairement donner lieu à une vision commune de l’avenir de l’Irak, à ce stade, ni à une analyse commune des causes de son développement et des remèdes qu’il convient d’apporter. Par ailleurs, dans la mesure où Daesh exploite de manière délibérée et massive l’antagonisme entre sunnites et chiites pour se renforcer et se présenter comme le seul véritable protecteur de la communauté sunnite, on peut s’interroger sur l’opportunité d’une alliance ouverte avec la puissance chiite iranienne contre un acteur sunnite de nature djihadiste.
– Un autre élément de complexité pourrait être lié au positionnement américain au sein de la coalition. Selon certains analystes, les Etats-Unis contribueraient au manque de cohérence globale des acteurs régionaux, par leur incapacité à exercer un leadership au sein de la coalition (174). Cette situation aurait pour origine la faiblesse de leur engagement réel : en refusant par principe tout engagement de troupes au sol, ils affaibliraient leur crédibilité et leur autorité dans la lutte contre Daesh. Selon cette analyse, les Américains ne parviendraient pas à s’imposer et à diriger efficacement la coalition.
Comme M. Jean-Claude Cousseran, secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale, l’a rappelé devant la commission des affaires étrangères, on peut en effet considérer que la région manque de puissance arbitrale. Les Etats-Unis ne jouent plus ce rôle et ne le souhaitent d’ailleurs pas. S’ils ne quittent pas le Proche et le Moyen-Orient, car ils ne peuvent pas lui être indifférents, ils souhaitent tout de même s’en distancier et réduire leur « empreinte au sol ». Malgré le développement du gaz de schiste et l’indépendance énergétique qui pourrait en découler, à terme, les Américains restent directement concernés par la question des approvisionnements en pétrole, qui ont une incidence sur le fonctionnement de l’économie mondiale, dont leur propre croissance dépend, et par la question du nucléaire iranien.
Quant à la principale organisation régionale, la Ligue arabe, souvent très divisée, elle ne parvient pas à s’imposer comme un acteur capable de peser sur les principaux dossiers. Le Conseil de coopération du Golfe, dont l’extension géographique est plus limitée, reste lui aussi traversé par des tensions internes, notamment les suspicions de certains de ses membres à l’égard de l’Arabie saoudite, perçue comme entretenant des velléités hégémoniques, ainsi que les perturbations suscitées par le soutien du Qatar à l’islam politique en général, et aux Frères musulmans en particulier (175). Quant à l’Egypte, cet acteur traditionnellement pacificateur est en train d’effectuer un retour sur la scène régionale, mais il demeure affaibli par sa situation interne et par l’onde de choc des « révolutions arabes » (176)
B. LA LUTTE CONTRE DAESH NE PRODUIRA PAS DE RÉSULTATS SIGNIFICATIFS EN L’ABSENCE DE STRATÉGIES POLITIQUES DURABLES AU PLAN LOCAL
Daesh n’est pas seulement un ennemi qu’il faudrait détruire. Il a prospéré dans le vide qui existe entre Damas et Bagdad, où des millions de sunnites ont l’impression d’être les perdants de l’Histoire. Cela implique de s’attaquer aux causes systémiques de la montée en puissance de Daesh, en Irak comme en Syrie : une gouvernance défaillante et un pouvoir répressif ; une corruption galopante ; un désespoir économique et social.
Il faut réussir là où la stratégie anti-terroriste mise en place par l’administration Bush dans les années 2000 – la guerre au terrorisme ou « War on Terror » – a échoué : Al-Qaida a survécu aux coups, s’est disséminé (177), a muté et son dernier avatar en date, Daesh, est monté en puissance au point d’être quasiment devenu un acteur régional. Comme M. Dominique de Villepin l’a déclaré à la mission d’information, le 11 février 2015, « le terrorisme ne peut pas être vaincu en tranchant le sommet, mais seulement en arrachant les racines ».
1. Quel chemin vers la réconciliation nationale en Irak ?
a. Une solution politique indispensable pour lutter contre Daesh
La dynamique de Daesh a pu être brisée en Irak, à ce stade, grâce à l’action engagée par la coalition internationale. Il paraît toutefois difficile de passer aux étapes suivantes, à savoir le reflux de Daesh et la reconquête territoriale, sans un ralliement significatif de forces sunnites locales. Pour les raisons précédemment évoquées dans ce rapport (178), ces acteurs sont probablement les seuls à être en mesure d’obtenir une défaite complète de Daesh et son éradication. Mais il semble difficile de les « retourner » dans le bon sens sans leur offrir des perspectives d’avenir et des raisons de renouer avec l’Etat irakien, c’est-à-dire sans solution politique crédible.
Il existe bien sûr une autre hypothèse : si le chemin de Daesh ne croise pas celui d’une autre force capable de lui infliger une défaite militaire, il n’est pas impossible que le « phénomène Daesh » se brise de l’intérieur. Les alliances tacitement ou explicitement conclues avec d’autres acteurs pendant la phase de conquête territoriale de Daesh peuvent finir par se dénouer, en raison des divergences sous-jacentes d’objectifs et d’ambitions. Les populations pourraient aussi se retourner contre les djihadistes à cause des violences qui leur sont infligées, même si cela nécessiterait beaucoup de courage au regard du niveau de ces violences.
Même dans l’hypothèse d’une cassure interne, il resterait indispensable de parvenir à un règlement politique durable en Irak afin de stabiliser la situation. Ainsi, alors que l’insurrection sunnite dirigée contre l’occupant américain et le nouveau pouvoir chiite avait fini par être maîtrisée en 2007-2008, par une conjonction de facteurs qui ont été précédemment évoqués, la situation a très vite dégénéré à nouveau et poussé à l’émergence de Daesh. Dans le vocabulaire classique de la contre-insurrection, il faut à la fois « nettoyer », « construire » et « tenir » (« clear, build and hold »). Nul ne sait quelle autre organisation monstrueuse pourrait se lever demain en Irak si Daesh était vaincu sans que les racines profondes de sa croissance aient été traitées.
Il faut également s’interroger sur l’évolution probable de l’Irak si les conditions actuelles ne s’améliorent pas significativement et durablement. En l’absence de consensus sur l’avenir du pays, l’Irak risque de se disloquer en trois parties :
- un Kurdistan au Nord, qui s’est déjà en grande partie séparé, de facto, du reste du pays (179) ;
- un « Sunnistan » potentiellement extrémiste dans les zones actuellement sous l’emprise de Daesh ;
- enfin, un « Chiistan libre » dont le centre de gravité serait probablement iranien compte tenu de l’influence exercée par ce pays.
Selon certains spécialistes de l’Irak, tels que M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CRNS, entendu par la commission des affaires étrangères le 10 décembre 2014, il est même déjà trop tard : il ne servirait plus à rien de chercher à soutenir un Etat irakien qui aurait déjà disparu dans les faits.
La carte ci-dessous présente la répartition des principaux groupes ethniques et religieux sur le territoire irakien.

Source : Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’Histoire, de l’occupation étrangère à l’Etat islamique, Vendémiaire, février 2015
La situation s’est quelque peu stabilisée depuis la nomination d’un nouveau Premier ministre, M. Haïdar al-Abadi, au mois de juin dernier. Un gouvernement de rassemblement, incluant les principales composantes politiques, ethniques et religieuses de l’Irak, a obtenu la confiance du Parlement le 15 août, après d’intenses tractations et des concessions de chacune des parties irakiennes. Les postes clefs de la défense et de l’intérieur, très disputés entre sunnites et chiites, ont finalement pu être attribués, le 18 octobre, respectivement à un sunnite et à un chiite. Un accord a aussi été trouvé au début du mois de décembre entre le Gouvernement central et le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) (180). Il faut aussi noter que M. al-Abadi tient un discours plus « ouvert » que son prédécesseur, M. al-Maliki.
Malgré ces pas en avant, la crise politique irakienne n’est toujours pas réglée. Il reste encore beaucoup à faire pour rétablir l’autorité de l’Etat, restaurer la crédibilité des institutions et convaincre les sunnites qu’ils ont un avenir en Irak. Leurs députés ont notamment boycotté les travaux parlementaires au mois de février, après l’enlèvement et l’assassinat par des miliciens chiites du chef tribal modéré al-Janabi, qui œuvrait pour la réconciliation nationale. M. al-Abadi a par ailleurs déclaré que la débaasification restait d’actualité au regard de l’implication du Baas auprès de Daesh, tout en adoptant une amnistie spéciale qui permet à d’anciens officiers baasistes de participer à l’offensive actuellement engagée autour de Tikrit. Les chantiers sont nombreux : la réforme et la modernisation de l’appareil de sécurité ; la lutte contre la corruption ; la mise en place d’un nouveau cadre fédéral qui garantirait le maintien de l’unité du pays, en permettant une représentation équitable de ses différentes communautés ; la reconstruction économique, en particulier dans les zones les plus touchées par les affrontements avec Daesh.
Au risque de formuler brutalement les enjeux, il faudrait arriver à convaincre les sunnites qu’ils n’ont pas en face d’eux un Etat chiite. Il reste à savoir ce que les chiites eux-mêmes, qui sont majoritaires dans le pays, et leurs dirigeants, sont prêts à accepter. On pourra noter que si l’ancien Premier ministre Maliki a dû quitter son poste, il a été nommé vice-président et continue à jouer un rôle de premier plan. Il rencontre d’ailleurs le président Hassan Rohani et le guide Ali Khamenei lorsqu’il se rend en visite en Iran. Force est de constater aussi que certaines mesures dont l’effet serait pourtant immédiat, telles que l’abrogation des lois de débaasification ou encore de larges amnisties à l’égard d’Irakiens sunnites, n’ont pas été adoptées.
Nous devons encourager et aider les nouvelles autorités irakiennes sur le chemin de la réconciliation, mais il ne nous appartient pas de définir les termes des équilibres et des compromis, en particulier sur des questions telles que la mise en œuvre du principe fédéral déjà prévu par la Constitution irakienne et la répartition des ressources naturelles. L’expérience américaine après l’intervention militaire de 2003 doit nous rappeler que la reconstruction de l’Etat et de la nation en Irak ne doit pas être modelée par des acteurs extérieurs. Il faut aussi accepter l’idée que le rétablissement de la situation prendra du temps, car les conditions de la réintégration des sunnites dans le jeu irakien demeurent complexes.
c. Une séparation croissante entre le Kurdistan irakien et le reste du pays
Les Kurdes d’Irak ont saisi depuis près de 25 ans l’occasion offerte par l’affaiblissement de l’Etat central pour avancer sur le chemin de l’autonomie. Une entité kurde a commencé à se constituer à la faveur de la zone d’exclusion aérienne mise en place en 1991 par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France au Nord du 36e parallèle, à l’issue de la première guerre du Golfe. Le Kurdistan irakien a ensuite continué à se développer dans tous les domaines après la chute de Saddam Hussein, en 2003, faisant figure d’îlot de stabilité en marge du chaos irakien.
Au plan économique, des contrats importants ont été signés avec de grandes entreprises étrangères depuis 2011, en particulier Exxon Mobil, puis Chevron, Total et Gasprom Neft. Ces contrats contribuent non seulement au développement économique de la région kurde, mais aussi à sa visibilité pour les pays d’origine de ces entreprises, ce qui peut constituer une sorte de gage international de sécurité. Les entreprises turques sont également très présentes au Kurdistan irakien. Dans le domaine des hydrocarbures, la Turquie représente en particulier une voie d’acheminement pour le pétrole kurde, tandis que le Kurdistan irakien présente un intérêt pour les approvisionnements turcs.
La nouvelle Constitution de 2005, de type fédéral, a conforté l’autonomie de la région kurde, mais plusieurs différends restent sans solution : le partage des ressources en hydrocarbures, Bagdad souhaitant au moins un droit de regard sur les décisions d’Erbil, la capitale régionale du Kurdistan irakien, qui a signé en mars 2013 un accord sur les exportations de pétrole avec Ankara et mis en service un gazoduc relié au pipeline Kirkouk-Ceyhan ; la question, directement liée, du versement des 17 % du budget irakien qui doivent revenir au gouvernement régional du Kurdistan (GRK) ; le contrôle des territoires « disputés » entre Bagdad et Erbil, notamment Kirkouk, dont les gisements en hydrocarbures représenteraient 10 % des ressources du pays (181).
Un accord a certes été signé entre Bagdad et Erbil pour débloquer la situation sur les deux premiers points, dans le nouveau climat de rassemblement qui prévaut à Bagdad, après le remplacement de M. Maliki, mais cet arrangement ponctuel ne règle rien au fond. L’offensive menée par Daesh cet été dans les zones sunnites du pays s’est d’ailleurs accompagnée de la prise de contrôle de Kirkouk, par les peshmergas.
L’entité kurde qui s’est constituée au Nord de l’Irak paraît sur le chemin de l’indépendance. Un quasi-Etat kurde a vu le jour, très internationalisé, avec des universités, des moyens financiers et militaires, même s’ils restent limités, et des postes-frontières. Il reste à savoir si la patiente construction du Kurdistan irakien, sa politique de faits accomplis sur le terrain et certaines déclarations récentes de ses dirigeants (182) traduisent une réelle volonté d’indépendance à l’égard de l’Irak ou au contraire une simple prise de gages dans la perspective de négocier avec Bagdad une autonomie plus grande et juridiquement sécurisée.
Par ailleurs, si les entités kurde et irakienne divergent de plus en plus, il n’est pas certain que l’actuel Gouvernement régional du Kurdistan ait les moyens de son indépendance. Comme le soulignait M. Hocham Dawod, chercheur au CNRS et ancien responsable de l’antenne de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Erbil, le 10 décembre 2014 devant la commission des affaires étrangères, l’essentiel du budget du Kurdistan ne provient pas de sa propre région, mais du pétrole extrait du Sud du pays.
La réaction des pays voisins, qui abritent d’importantes populations kurdes, est également incertaine. La Turquie s’accommode volontiers d’un Kurdistan irakien où elle exerce une grande influence économique, mais elle pourrait s’inquiéter des conséquences de son indépendance sur sa propre population kurde, avec laquelle un processus de négociations complexe est en cours. L’Iran, qui a connu une situation insurrectionnelle dans son propre Kurdistan, est également très sensible à cette question. Comme le remarquait M. Hocham Dawod, les frontières actuelles peuvent protéger les Kurdes face à leurs voisins, malgré la faiblesse de l’Etat irakien.
Enfin, il peut y avoir de sérieuses raisons de ne pas souhaiter que les frontières actuelles soient remises en cause. De grands blocs plus ou moins homogènes tendraient à se constituer, avec les risques de conflits internes, de déplacements de populations et de phénomènes de « purification » ethnique ou religieuse que cela implique. Le remodelage des frontières, qui ne concerne aujourd’hui que celle entre l’Irak et la Syrie, à l’initiative de Daesh (183) , ne paraît ni nécessaire ni souhaitable.
En dépit de ces considérations, il est vrai que le degré d’autonomie déjà atteint par le Kurdistan irakien pourrait placer cette entité sur une trajectoire la faisant sortir de facto de l’actuel système fédéral. Au regard des risques dont s’accompagnerait une déclaration d’indépendance inconsidérée, d’autres hypothèses sont néanmoins susceptibles d’être envisagées. M. Jean-Claude Cousseran, secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale, a ainsi évoqué devant la commission des affaires étrangères l’hypothèse d’un « fédéralisme faible », consistant en une sorte « d’Etat minimal » à la libanaise, dans un contexte toutefois différent. Des institutions nationales pourraient ainsi survivre afin de préserver un lien entre des structures par ailleurs autonomes.
2. Après l’Irak, ne pas oublier la crise syrienne
L’urgence particulière de la crise en Irak et l’échec des différentes initiatives engagées au plan international pour favoriser une solution politique en Syrie, depuis le début de la crise (184), pourraient contribuer à faire sortir de plus en plus ce dernier pays « du radar », comme s’il fallait se résigner à l’impuissance. Le bilan dramatique du conflit syrien, qui a déjà fait plus de 220 000 morts et poussé des millions de personnes à se réfugier dans les pays voisins ou dans d’autres parties du territoire syrien, doit pourtant nous conduire à rester mobilisés. La Syrie offrant une base arrière à Daesh, il ne suffira pas non plus de lutter contre cette organisation seulement en Irak. Le conflit syrien ne doit pas être laissé de côté, comme la crise politique irakienne l’a trop longtemps été. Nous n’y avons réagi que tardivement, lorsque la montée en puissance de Daesh est devenue évidente, avec toutes les conséquences que l’on mesure aujourd’hui.
a. Les crises en Irak et en Syrie : des conflits indissociables mais distincts
Daesh étant présent en Irak et en Syrie et ayant réussi à établir une continuité territoriale entre les espaces sous son emprise des deux côtés de la frontière (185), il existe d’importants effets de débordement d’une crise à l’autre. Ces débordements sont appelés à se poursuivre, voire à se renforcer.
Affaiblis en Irak après l’inflexion des années 2006-2007, les djihadistes se sont tournés vers la Syrie, où ils se sont puissamment développés lorsque la crise s’est déclenchée dans ce pays en 2011. Des synergies existent aujourd’hui entre les deux théâtres : Daesh a ainsi rapatrié en Syrie une partie du matériel militaire, d’origine américaine, dont il s’est emparé en Irak lorsque les forces armées de ce pays se sont effondrées. Le renforcement de Daesh en Irak lui a donc permis de disposer de capacités offensives supérieures de l’autre côté de la frontière. Maintenant que les djihadistes paraissent être contenus, voire en recul en Irak, ils pourraient chercher à se replier une fois encore en Syrie en y faisant basculer leurs forces.
Malgré ces liens étroits, la Syrie et l’Irak conservent leurs propres dynamiques internes et ne constituent pas deux faces d’une seule et même crise. Le traitement de ces deux questions ne pourra pas être durablement séparé, mais il a néanmoins vocation à rester différencié, les enjeux étant distincts des deux côtés de la frontière.
En Syrie, le conflit a lieu sur plusieurs lignes de front : entre l’opposition armée non-djihadiste et le régime ; entre Daesh et des groupes non-djihadistes, qui s’étaient ligués dès 2014 contre cette organisation terroriste, lui faisant subir d’importants revers territoriaux ; plus récemment encore, entre Daesh et le régime. En Irak, en revanche, c’est un front unique, même s’il comporte divers acteurs, qui oppose aujourd’hui Daesh et ses alliés locaux aux forces armées irakiennes, aux milices chiites qui leur sont associées et aux peshmergas kurdes qui se coordonnent avec Bagdad.
Il est vrai que les crises en Irak et en Syrie ont des origines voisines : de puissantes revendications populaires auxquelles les régimes en place ont fait le choix de répondre en suivant une approche sécuritaire et en faisant appel à une rhétorique anti-terroriste incendiaire, ce qui a transformé le mouvement de contestation en conflit interne. S’il y a dans ces deux pays des acteurs sunnites en rébellion, issus d’une majorité de la population en Syrie et d’une minorité en Irak, leurs griefs et leurs ordres du jour demeurent nationaux. Ils sont tournés tantôt vers Damas, tantôt vers Badgad. Seul Daesh y fait exception, son projet de califat islamique remettant directement en cause la frontière.
b. Quelle stratégie en Syrie ?
Le fait que la coalition internationale ait choisi de conduire des frappes aériennes contre les positions de Daesh en Irak comme en Syrie peut se justifier par la nécessité de combattre Daesh partout avec la même détermination, afin de ne pas lui laisser la possibilité de se constituer un sanctuaire territorial. Ces frappes, à laquelle la France ne participe pas, ne sont pourtant conçues que dans le prolongement de l’action menée en Irak par la coalition (186). La montée en puissance de Daesh a changé l’équation en Syrie (187), mais elle ne s’est pas accompagnée d’une nouvelle donne à l’égard de la crise dans ce pays. Il n’existe pas, à ce stade, d’approche globale et cohérente pour traiter le dossier syrien en tant que tel.
– La question des forces appelées à combattre Daesh sur le terrain est encore plus problématique en Syrie qu’en Irak. Dans les deux cas, en l’absence de forces combattantes déployées au sol, la coalition internationale a pour stratégie de s’appuyer sur des forces locales, dont l’action doit être facilitée par des frappes aériennes et par d’autres formes de soutien militaire – livraison d’armes, formation et conseil. En Syrie, le refus de toute alliance avec Bachar el-Assad conduit à s’appuyer sur une opposition « modérée » qui se trouve pourtant dans une situation de grande faiblesse et que le programme américain de soutien ne permettra vraisemblablement pas de renforcer de manière significative dans un délai court (188).
Un plan dit de « retour en Syrie » (« Back to Syria ») a certes été développé par l’opposition, mais il paraît de plus en plus difficile à réaliser, ne serait-ce qu’en raison du rétrécissement des zones sous son contrôle. Il s’agirait pour l’opposition syrienne d’implanter ses institutions au Nord du pays, dans une zone « libérée » et placée sous la protection d’une force militaire solide, afin d’y mener le combat sur les deux fronts, à la fois contre le régime de Bachar el-Assad et contre Daesh, et d’y ressourcer sa légitimité. Cela impliquerait une aide extérieure considérablement renforcée et probablement une protection aérienne afin d’établir des « zones sûres ». Malgré le soutien affiché par la Turquie, une telle évolution paraît exclue à ce stade du côté américain.
– En ce qui concerne les Etats-Unis, la lutte contre Daesh s’est traduite par une plus grande implication dans la région, à rebours des efforts engagés pour s’en distancier davantage, en faveur d’un rééquilibrage vers l’Asie (189). Mais cette inflexion ne s’est accompagnée d’aucun tournant notable à l’égard de la crise syrienne : l’hypothèse d’une action contre le régime de Bachar el-Assad, envisagée dans le contexte de la crise des armes chimiques de l’été 2013, puis abandonnée, n’a pas été réactivée ; l’hypothèse d’une collaboration avec le régime syrien demeure exclue, les Etats-Unis affirmant qu’il n’existe aucune coordination avec Damas pour les opérations conduites sur le terrain ; enfin, malgré l’annonce d’un plan de soutien pour l’opposition, celle-ci ne paraît pas sur la voie d’un renforcement significatif, probablement en raison des difficultés à identifier des acteurs fiables sur le terrain.
Le président Obama avait publiquement reconnu, au cours de l’été 2014, son absence de stratégie pour la Syrie. S’il existe aujourd’hui une stratégie d’ensemble pour combattre Daesh, telle qu’elle a été précédemment rappelée dans le cadre du présent rapport, cette mission d’information n’a pas le sentiment que le vide stratégique ait été entièrement comblé en ce qui concerne la Syrie. A ce stade, la montée en puissance de Daesh et la mise en place de la coalition contre cette organisation terroriste n’ont pas changé la donne à l’égard de ce pays.
– La faiblesse de l’opposition syrienne « modérée » pousse à s’interroger sur les forces locales réellement disponibles pour lutter contre Daesh en Syrie et, le cas échéant, pour prendre en charge d’éventuelles zones libérées. Pour autant, la question de la place à donner au régime de Bachar el-Assad nous met face à un choix impossible sur le plan moral.
Deux visions s’opposent : d’un côté, la priorité donnée à une lutte efficace contre Daesh pourrait conduire à se demander si le régime syrien n’est pas le moindre de deux maux (190) et à envisager la possibilité de ne plus le traiter uniquement comme une partie du problème, mais aussi potentiellement comme une partie de sa solution ; d’un autre côté, comment se résoudre à s’allier avec un régime qui est coupable d’autant de crimes (191) et dont le seul objectif clairement établi consiste à éliminer l’opposition « modérée » que nous avons fait le choix de soutenir ?
Au-delà de ces considérations morales, qui sont importantes, Bachar el-Assad peut-il être un partenaire utile dans la lutte contre Daesh en Syrie ? On peut en douter au plan militaire, car le régime ne contrôle effectivement qu’une partie limitée du pays, principalement avec l’aide de milices, ses propres forces connaissant une importante « fatigue » militaire. La détermination du régime à lutter sérieusement est également douteuse, au vu de son passif et du rôle très opportun de repoussoir que joue Daesh à l’égard de toute forme d’opposition. Quel serait l’intérêt de Bachar el-Assad de combattre efficacement un ennemi aussi utile pour lui ?
Au plan régional, toute coopération avec Assad aurait de graves conséquences. Elle aliénerait les Etats du Golfe et la Turquie et mettrait en péril leur participation à la coalition contre Daesh. Un tel partenariat serait évidemment perçu comme un retournement d’alliance au détriment de l’opposition non-djihadiste et servirait la propagande de Daesh, qui exploite la représentation d’une coalition occidentale dirigée contre les sunnites, au profit des Iraniens et de leurs alliés chiites ou alaouites.
Ces interrogations sur l’opportunité d’un partenariat sécuritaire contre Daesh, sur le terrain, ne concernent pas l’engagement d’un dialogue avec des éléments du régime dans le cadre d’un processus de transition politique destiné à régler la crise syrienne. Cette hypothèse doit au contraire être privilégiée.
c. S’engager en faveur d’une solution politique et d’une désescalade régionale
– Les réalités du terrain doivent être prises en compte sérieusement, au-delà des déclarations d’intentions. Comme la mission d’information a eu l’occasion de le rappeler précédemment dans le cadre de ce rapport, il n’y a pas de solution militaire qui se dessine sur le terrain. A ce stade, alors que le conflit a causé plus de 220 000 morts et poussé des millions de personnes à se réfugier dans les pays voisins ou dans d’autres parties de la Syrie, il ne semble pas que Bachar el-Assad soit en mesure de rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire, ni que l’opposition, très affaiblie, puisse l’emporter sur le régime. La situation actuelle fait le jeu de Daesh qui a prospéré dans le pays depuis 2011. La plupart des pays qui professent aujourd’hui une « solution politique » continuent pourtant de jouer la carte de l’affrontement militaire.
Plus le temps passe, plus le bilan humain et matériel du conflit s’alourdit, dans des proportions effroyables, et plus on s’éloigne de la Syrie que nous appelons de nos vœux – une Syrie unie, plurielle au plan confessionnel et ethnique, respectueuse des droits de l’Homme et des minorités, voire « laïque » – même si ce terme doit être utilisé avec une certaine prudence dans le contexte régional. Plus la Syrie est meurtrie, plus la diversité de son tissu humain est en danger, plus la radicalisation avance, et plus le pays se rapproche d’un scénario de partition de fait ou de droit qui aurait de graves conséquences. L’hypothèse d’une « cantonalisation » de la Syrie s’accompagne notamment de graves risques de « nettoyage » ethnique et confessionnel. La guerre d’attrition se poursuit néanmoins sur le terrain, avec des conséquences toujours plus graves pour l’avenir. Le temps est donc loin de jouer en faveur d’une résolution de la situation.
– Si une solution politique négociée s’impose en Syrie, malgré toutes les difficultés rencontrées pour y parvenir, ce n’est pas seulement parce qu’il n’existe manifestement pas d’issue militaire au conflit. Il importe aussi de préserver l’Etat syrien, ou ce qu’il en reste à ce stade, et d’essayer de rétablir son autorité sur le territoire, pourvu qu’elle soit acceptée, ce qui implique de s’engager au préalable dans un processus de transition. Après de telles épreuves, on imagine mal quel autre facteur d’unité pourrait permettre aux différentes composantes de la Syrie de continuer à tenir ensemble. L’administration et une partie de l’armée pourraient sans doute être distinguées de Bachar el-Assad et du clan qui cherche à exercer par tous les moyens sa domination sur le pays. Seule une solution politique négociée incluant une partie du régime, celle qui n’est pas directement responsable des crimes commis en Syrie et qui pourrait être acceptable par l’autre partie – des listes de noms existeraient – paraît de nature à sauver le pays du chaos complet vers lequel il se dirige.
– Dans ces conditions, malgré l’échec des précédentes initiatives internationales, qui n’incitent guère à l’optimisme, tout doit être fait concrètement pour soutenir les propositions demeurant sur la table, qu’il s’agisse du plan de « gel des hostilités » auquel a travaillé le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. de Mistura, ou encore de l’initiative russe de dialogue inter-syrien. Ces initiatives ont été présentées dans la première partie du présent rapport (192). Il s’agit d’atténuer le niveau des violences, d’enrayer la dégradation de la situation humanitaire et d’essayer d’avancer vers une solution politique à la crise syrienne.
– Sous réserve du point précédent et dans la mesure où les conditions d’un accord paraissent très difficiles à réunir, dans les deux cas, d’autres hypothèses doivent être explorées en parallèle. La perspective la plus crédible, bien qu’elle paraisse également difficile à mettre en œuvre, est celle d’une désescalade régionale du conflit. Sa poursuite et son aggravation résultent en grande partie du jeu des acteurs extérieurs – Iran, Russie, Turquie, Qatar ou encore Arabie saoudite – qui n’ont pas cessé d’alimenter le feu par le soutien qu’ils apportent aux belligérants. Ces derniers continueront probablement à se battre tant qu’ils bénéficieront de tels soutiens.
Une telle désescalade ne signifierait pas l’arrêt du conflit, car ce sont les acteurs syriens qui détiennent les clefs de toute solution : on peut s’interroger sur leur degré de sensibilité aux pressions extérieures. Une désescalade régionale permettrait néanmoins de réduire le niveau des violences et de pousser les belligérants sur le chemin d’une solution négociée. Ce scénario est complémentaire des efforts engagés dans d’autres cadres en vue d’obtenir un gel local des hostilités et de nouer un dialogue inter-syrien qui serait enfin substantiel.
– L’hypothèse d’une désescalade régionale du conflit en Syrie a pu être qualifiée de « Genève 1,5 » au regard de ses ambitions réduites par rapport à l’application du communiqué du 30 juin 2012, qui vise à mettre en œuvre une solution politique, autour d’un organe de gouvernement transitoire, doté des pleins pouvoirs exécutifs, sur la base d’un consentement mutuel des parties, dans le cadre des négociations dites de « Genève 2 » (193). Une désescalade régionale nécessiterait toutefois des changements stratégiques et des préconditions qui ne sont pas acquis pour l’instant.
Afin qu’une désescalade militaire puisse avoir lieu sur le terrain, il serait probablement nécessaire d’obtenir au préalable un accord régional permettant de préserver mutuellement les intérêts de chacun des acteurs extérieurs impliqués dans le conflit en Syrie et de stabiliser ainsi le pays, par une sorte de « gel » ou de neutralisation de ce théâtre d’affrontement (194).
Il est également probable que le scénario d’une désescalade suppose la conclusion d’un accord complet, crédible et de long terme sur le programme nucléaire iranien, afin d’engager une détente relative entre l’Iran, d’une part, et les pays du Golfe et les pays occidentaux, d’autre part. Cette hypothèse, ses conditions et les perspectives qui pourraient alors s’ouvrir au plan régional sont présentées plus en détail dans la troisième partie du présent rapport.
Il est vrai que nous n’avons pas de prise directe sur la réalisation d’une désescalade régionale du conflit en Syrie, mais nous pouvons certainement activer utilement nos différents canaux avec les acteurs potentiels d’une telle solution, afin de les mobiliser et d’offrir nos bons offices, tout en contribuant par ailleurs à réunir les conditions de possibilité d’une désescalade par la signature d’un accord solide sur le programme nucléaire iranien.
– Une solution politique en Syrie implique aussi de faire preuve d’une disponibilité réelle, c’est-à-dire d’admettre que le départ de Bachar el-Assad ne soit pas nécessairement un préalable, mais plutôt un aboutissement. Cette inflexion risque d’être particulièrement difficile à accepter par une grande partie de l’opposition syrienne et des forces combattant le régime sur le terrain. Elles n’ont d’ailleurs pu être ralliées au processus – infructueux – de Genève que par l’ambiguïté de la formule citée plus haut, laquelle peut être comprise comme permettant le maintien de Bachar el-Assad ou comme impliquant au contraire d’emblée son retrait.
Sans une telle évolution, la transition risque pourtant de continuer à se heurter durablement à un mur en Syrie. Pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, une transition qui ne s’accompagnerait pas du maintien de certains éléments du régime et de la préservation des piliers de l’Etat risquerait par ailleurs de plonger le pays dans un chaos encore plus grand et de déstabiliser encore davantage les pays voisins.
– Cette disponibilité pour une solution politique pourrait s’accompagner d’une réflexion sur l’opportunité d’une réouverture des ambassades européennes qui ont été fermées à Damas, si possible dans un cadre européen, comme certains interlocuteurs de la mission d’information l’ont recommandé. Outre l’intérêt du rétablissement d’un tel canal pour l’approfondissement de notre engagement en faveur d’une solution politique, cette mesure pourrait se justifier par des raisons humanitaires et culturelles – nous avons toujours un lycée français à Damas, qui survit dans des conditions très précaires. Si ce choix était fait, il faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas vécu comme une forme de reconnaissance du régime syrien. La réouverture d’une ambassade ne suppose pas l’envoi d’un ambassadeur et n’exclut pas de continuer à condamner des exactions.
3. Les relais locaux : un choix lui aussi stratégique
Une lutte efficace contre Daesh nécessite une stratégie globale, déclinée par pays dans le cadre de solutions politiques adaptées dans ce cadre. Elle exige aussi une réflexion de long terme sur les acteurs que nous choisissons comme relais, sur la nature du soutien que nous leur apportons et sur les messages que nous leur faisons passer en parallèle.
Sans sous-estimer la menace immédiate que fait peser Daesh, le fait qu’elle paraisse aujourd’hui contenue en Irak et en Syrie, voire en reflux, paraît ouvrir un espace favorable pour engager une telle réflexion. L’impératif d’efficacité à court terme doit être pris en compte, mais il ne doit pas conduire à hypothéquer les chances de succès de solutions politiques durables.
a. Veiller à ne pas alimenter l’antagonisme entre sunnites et chiites
En Irak, la lutte contre Daesh passe inévitablement par une dissociation entre cette organisation terroriste et les alliés locaux sur lesquels elle peut s’appuyer au plan militaire et pour le contrôle des territoires sous son influence, notamment certaines tribus sunnites et d’anciens baasistes. La carte tribale ne doit toutefois être jouée qu’avec une extrême prudence.
On peut ainsi s’interroger sur les conditions dans lesquelles on envisage de rallier des tribus sunnites irakiennes par la création d’une future garde nationale, comme le prévoit un projet de loi adopté par le conseil des ministres irakien le 3 février 2015. L’expérience libyenne de montée en puissance des milices locales, dans un contexte certes différent mais qui doit tout de même inciter à la réflexion, s’est accompagnée d’un échec de toutes les tentatives ultérieures pour associer ces milices au pouvoir central par un rattachement à divers « parapluies » institutionnels. Ces acteurs tribaux et locaux se sont autonomisés en Libye et sont parvenus à écraser un embryon d’Etat central trop faible pour s’imposer. En Irak, l’échec final du mouvement « Sahwa » du milieu des années 2000 a montré à quel point les allégeances pouvaient être changeantes.
Si le diagnostic correct, comme le croit cette mission d’information, est que l’éradication de Daesh nécessite l’établissement d’un Etat acceptable et crédible aux yeux de tous les citoyens irakiens, notamment au regard de sa capacité à assurer l’ordre et la justice, il n’est pas certain que la priorité soit d’armer et de financer des acteurs locaux difficilement contrôlables par les autorités de Bagdad. Il s’agirait plutôt de restructurer en profondeur les forces de sécurité irakiennes.
La constitution d’une garde nationale peut-elle être envisagée dans cette perspective ? Il conviendrait alors de prêter la plus grande attention aux possibilités d’intégration effective des forces sunnites au sein des forces de sécurité gouvernementales et à la réalité du contrôle qui serait établi. Une autre difficulté potentielle réside dans l’asymétrie qui existera probablement entre ces forces sunnites et les puissantes milices chiites qui agissent déjà sur le terrain. Leur intégration dans une hypothétique garde nationale risque de n’être que très théorique, si elle devait être décidée. Les peshmergas kurdes, qui s’inscrivent dans une tradition historique déjà bien affirmée, paraissent eux aussi difficilement « solubles » dans un tel projet.
Notre soutien à la constitution de milices sunnites ralliées contre Daesh au sein d’une garde nationale doit aussi être examiné au regard des risques de lecture confessionnelle de notre politique étrangère. Pour beaucoup d’observateurs, la France aurait fait le choix des Etats sunnites de la région, tels que le Qatar et l’Arabie saoudite, au détriment des chiites, en particulier l’Iran.
Comme l’a rappelé M. Hocham Dawod, ancien responsable de l’antenne de l’IFPO à Erbil, lors de son audition du 10 décembre 2014 devant la commission des affaires étrangères, les acteurs irakiens sont particulièrement sensibles à ce type de lecture partisane. Les sunnites auraient ainsi vu la France se muer d’alliée en adversaire, tandis les chiites irakiens au pouvoir considéreraient notre politique à travers plusieurs prismes : ils constateraient d’abord une absence de rapprochement historique avec les chiites ; ils estimeraient ensuite que notre politique est étroitement dépendante de nos intérêts dans le Golfe ; ils jugeraient enfin que nous parions sur les Kurdes et sur la partition du pays.
b. Ne pas favoriser les scissions et la remise en cause des frontières internationales
Les acteurs kurdes irakiens doivent être soutenus à la fois dans leur résistance à Daesh et dans leurs efforts de plus long terme, déjà en grande partie couronnés de succès, pour constituer un îlot de stabilité au plan régional. Nous avons d’ailleurs tissé des liens utiles avec le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) dans différents domaines, en particulier celui de la formation, grâce à un système de bourses. Tout ce qui peut contribuer au renforcement des institutions kurdes et de leurs capacités mérite d’être soutenu.
Le message que nous faisons passer en parallèle au GRK doit faire cependant l’objet d’une grande attention. Pour les raisons précédemment évoquées dans le cadre de ce rapport, notre soutien ne doit pas pousser les responsables kurdes à un excès d’assurance : il n’est pas certain que les conditions matérielles de l’indépendance du Kurdistan irakien soient aujourd’hui réunies ; il n’est pas exclu qu’une déclaration d’indépendance conduise à une réaction des voisins immédiats, la Turquie et l’Iran ; enfin, même si cette intention ne doit pas être prêtée aux Kurdes eux-mêmes, la remise en cause des frontières internationales risque de pousser à la constitution d’entités ethniquement ou confessionnellement « pures » dans une région où de nombreuses minorités tentent de survivre.
Dans ce contexte incertain, une politique prudente d’engagement avec les acteurs kurdes d’Irak s’impose. Il semble préférable de les encourager à poursuivre dans la voie de la négociation avec le Gouvernement central irakien et à chercher à faire valoir leurs droits et leurs intérêts légitimes dans le cadre d’un système fédéral qui fonctionnerait. Dans le même temps, notre soutien à la reconnaissance des droits culturels et politiques des Kurdes, en Irak comme dans les pays voisins, doit être dépourvu d’ambiguïté. La France doit se montrer à la hauteur de la responsabilité particulière qui est la sienne depuis qu’elle s’est engagée pour la protection des Kurdes irakiens après les massacres perpétrés par le régime de Saddam Hussein au lendemain de la première guerre du Golfe.
c. Aider à la consolidation durable des Etats voisins
Face aux risques d’expansion et de dissémination de Daesh au plan régional (195), des efforts doivent être consentis en faveur des Etats les plus directement exposés, en particulier le Liban et la Jordanie, mais aussi envers tous les pays de la région dont des combattants terroristes étrangers sont issus.
– Les conclusions du Conseil affaires étrangères de l’Union européenne du 9 février 2015 appellent ainsi, à juste titre, à des actions de renforcement des capacités portant sur « la répression, la justice pénale, la réforme du secteur de la sécurité, y compris les infrastructures de crise, la réaction en cas de crise et de situation d'urgence, le contrôle des frontières et la sûreté aérienne, la communication stratégique, la radicalisation, la lutte contre la menace que représentent les combattants terroristes étrangers, le recrutement de terroristes et le financement du terrorisme, dans le plein respect des normes internationales en matière de droits de l'Homme ».
Dans le même temps, il faut veiller à ce qu’un tel soutien à la lutte contre le terrorisme ne soit pas perçu ou exploité comme un quelconque blanc-seing au développement d’un tout-répressif. Ce soutien ne doit pas non plus contribuer à réduire la pression interne ou les incitations internationales à réaliser des réformes nécessaires dans le domaine de la gouvernance. Une telle équation est bien sûr complexe. Le durcissement général des politiques répressives dans certains Etats de la région, à l’égard de toute forme de contestation, est une tendance préoccupante que la mission d’information a eu l’occasion de relever précédemment dans le cadre de ce rapport.
– La problématique est quelque peu différente au Liban, qui souffre particulièrement de l’impact de la crise syrienne (196) et où l’irruption de Daesh a aussi contribué à changer l’équation (197). Dans ce contexte particulièrement troublé et dangereux pour les équilibres fragiles du Liban, nos efforts de soutien aux institutions de ce pays ne doivent pas se relâcher, bien au contraire (198).
La France a annoncé qu’un accord était intervenu pour la mise en œuvre du plan tripartite franco-saoudo-libanais destiné à renforcer les capacités des forces armées libanaises dans leurs missions de défense du territoire et de lutte contre le terrorisme (199). Cette initiative avait été rendue publique dès le mois de décembre 2013, pour un montant de trois milliards de dollars. De nombreux matériels français devraient être livrés – véhicules blindés, bateaux armés, hélicoptères de combat, munitions, moyens de communications – et de multiples formations seront mises en place par les forces françaises au profit de l'armée libanaise. Le ministère de la défense a déclaré que la phase de réalisation du contrat venait de démarrer, à la suite du versement de la première échéance. Les premières livraisons pourraient intervenir dès le mois d'avril 2015.
Ces efforts doivent se doubler d’une action déterminée, dans le cadre des Nations unies et auprès de nos partenaires régionaux qui disposent de capacités financières significatives, pour mobiliser davantage la communauté internationale en faveur des très nombreux réfugiés présents au Liban. Il est tout aussi essentiel d’aider les Libanais à remédier au vide institutionnel qui s’est installé à la Présidence de la République depuis la fin du mandat de Michel Sleimane, le 25 mai 2014. Sans défendre un candidat en particulier, la France doit continuer à jouer un rôle de facilitateur, que les Libanais eux-mêmes appellent de leurs vœux, et à mobiliser tous les acteurs qui peuvent exercer une influence pour débloquer la situation, en particulier l’Iran et l’Arabie saoudite.
III. DES NÉGOCIATIONS SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN QUI POURRAIENT OUVRIR DES PERSPECTIVES DE DÉTENTE ET DE COOPÉRATION AU PLAN RÉGIONAL
Comme la Mission a eu l’occasion de l’indiquer dans la première partie de ce rapport, la reprise de négociations sérieuses avec l’Iran permet d’envisager, pour la première fois depuis l’échec de 2005, un règlement global et de long terme de la crise nucléaire iranienne par une voie pacifique. Malgré la signature d’un plan d’action conjoint qui a permis d’apaiser la situation à la fin de l’année 2013, l’issue de ces négociations, particulièrement complexes, demeure toutefois très incertaine au moment où ce rapport est rédigé.
L’importance cruciale des enjeux doit conduire toutes les parties concernées à faire preuve d’autant de flexibilité que possible. Il en va de l’avenir du régime de non-prolifération nucléaire, de l’évitement d’une intervention militaire évoquée explicitement ou implicitement par les Israéliens et par les Américains (200) afin de mettre un terme aux graves préoccupations causées par le programme nucléaire iranien (201), si aucune solution ne pouvait être obtenue par d’autres moyens, mais aussi de la réintégration de l’Iran dans le jeu international et des perspectives de détente, voire de coopération, qui pourraient alors s’ouvrir avec ce pays pour essayer d’apaiser ou de régler d’autres crises au plan régional.
A. DES NÉGOCIATIONS SÉRIEUSES, MAIS ENCORE INABOUTIES, SUR LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN
1. La conclusion du plan d’action conjoint du 24 novembre 2013
a. Les principaux points de l’accord
Le plan d’action conjoint entre les « E3+3 » et l’Iran est un premier pas en avant. Il empêche l’horloge de continuer à tourner en faveur de l’Iran pendant que des négociations ont lieu pour essayer d’aboutir à une solution d’ensemble et durable à la crise nucléaire iranienne. Il comporte aussi des dispositions permettant de commencer à rétablir la confiance mutuelle.
Entré en application le 20 janvier 2014, le plan d’action conjoint repose sur un équilibre entre des mesures à court terme consenties par les deux parties : d’une part, la suspension des activités les plus préoccupantes du programme nucléaire iranien (202) et des mesures de transparence accrues ; d’autre part, la suspension, très limitée et réversible, d’un certain nombre de sanctions et le déblocage de plusieurs milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés à l’étranger, par tranches successives.
(i). Les mesures mises en œuvre par l’Iran :
– suspendre l’enrichissement d’uranium à plus de 5 % ;
– « neutraliser » le stock d’uranium déjà enrichi jusqu’à 20 %, en conservant la moitié sous forme d’oxyde, en vue de la fabrication de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran, et en diluant le reste à un taux d’enrichissement inférieur à 5 % ;
– ne pas faire avancer davantage les activités dans les installations d’enrichissement de Natanz ou de Fordow (pas d’installation de nouvelles centrifugeuses ; pas de mise en service des centrifugeuses déjà installées mais ne tournant pas ; remplacement éventuel des centrifugeuses existantes par des centrifugeuses de même génération) ;
– ne pas créer de nouveaux emplacements pour des activités d’enrichissement ;
– ne pas faire avancer davantage les activités dans le réacteur plutonigène d’Arak (ne pas le mettre en service ; ne pas installer les composants restants ; ne pas transférer de combustible ou d’eau lourde sur le site du réacteur ; ne pas tester de combustible supplémentaire et ne pas en produire davantage pour le réacteur) ;
– ne pas mettre en œuvre des opérations de retraitement, ni construire une installation capable de retraitement ;
– accepter des mesures de surveillance améliorée, notamment par la communication d’informations à l’AIEA sur les installations nucléaires (plans, description des bâtiments, renseignements descriptifs pour le réacteur d’Arak) ; accès quotidien à des informations sur les installations de Fordow et de Natanz ; accès réglementé des inspecteurs de l’AIEA aux ateliers d’assemblage des combustibles, aux ateliers de production et aux installations d’entreposage de rotors de centrifugeuses, ainsi qu’aux mines et aux installations de traitement de l’uranium.
(ii). Les mesures entreprises par les « E3+3 », en contrepartie :
– ne pas adopter de nouvelles sanctions liées au nucléaire dans le cadre des Nations unies ou aux Etats-Unis ;
– marquer une pause dans les efforts auprès des clients actuels de l’Iran pour réduire encore les ventes de pétrole brut de ce pays et suspendre les sanctions de l’UE et des Etats-Unis sur les services d’assurance et de transport associés ;
– permettre le rapatriement de revenus issus de la vente de pétrole et bloqués à l’étranger, selon des montants convenus entre les parties (203) ;
– suspendre les sanctions de l’UE et des Etats-Unis sur les exportations iraniennes de produits pétrochimiques et les services associés (notamment le transport, l’assurance et les services financiers), ainsi que sur l’or et les métaux précieux (et les services associés) ;
– suspendre les sanctions américaines sur l’industrie automobile iranienne et les services associés ;
– délivrer des autorisations pour la fourniture et l’installation en Iran de pièces détachées pour la sécurité des vols dans l’aviation civile aérienne et les services associés ;
– établir un circuit financier, au moyen des recettes pétrolières de l’Iran détenues à l’étranger, pour faciliter le commerce « humanitaire » (transactions concernant les produits alimentaires et agricoles, les médicaments, le matériel médical et les dépenses médicales encourues à l’étranger), ainsi que le paiement des obligations de l’Iran à l’égard des Nations unies et le paiement direct des frais de scolarité d’étudiants iraniens à l’étranger ;
– relever les seuils d’autorisation de l’UE pour les transactions commerciales non soumises aux sanctions.
b. Les avancées déjà réalisées grâce au plan d’action conjoint
Bien que l’accord conclu entre les « E3+3 » et l’Iran en novembre 2013 ne comporte qu’un certain nombre de mesures transitoires, son bénéfice est réel à plus d’un titre.
– Tant qu’il est appliqué, le plan d’action conjoint permet de réduire considérablement l’avancement du programme nucléaire iranien, en plaçant sous contrôle ses activités les plus préoccupantes. Ce progrès permet « d’arrêter l’horloge » dans une large mesure et d’écarter dans l’immédiat des options militaires.
– L’accord permet d’engager une désescalade dans la crise, grâce à l’arrêt de la spirale dangereuse qui combinait, d’une part, de nouveaux développements préoccupants du programme nucléaire iranien et, d’autre part, des pressions supplémentaires en réponse.
– La bonne application du plan d’action conjoint est régulièrement attestée par l’AIEA, conformément au préambule de l’accord. Il en résulte une amélioration progressive de la confiance mutuelle, ce qui est évidemment un élément favorable pour le succès des négociations sur une solution de long terme.
– L’accord s’est accompagné du rétablissement public d’un canal d’échanges directs entre Américains et Iraniens, pour la première fois depuis 35 ans. Le ton employé a également changé du côté des Iraniens, qui vouaient les Américains aux gémonies sous la présidence de M. Ahmadinejad, alors que les Américains classaient l’Iran dans « l’axe du mal ».
– Enfin, contrairement à certaines craintes, l’édifice des sanctions internationales n’a pas été ébranlé. Les autorités demeurent très vigilantes aux Etats-Unis comme en Europe. En ce qui concerne la France, si des déplacements de délégations économiques ont été l’occasion de renouer des contacts pour l’avenir, dans la perspective où la conclusion d’un accord de long terme permettrait la levée globale des sanctions liées au nucléaire, il n’y a pas eu de tentative de contourner les sanctions. Dans la mesure où les sanctions suspendues sont réversibles et limitées et où les sanctions maintenues ne font pas l’objet de contournement en Europe et aux Etats-Unis, les capacités de pression sur l’Iran ne s’en sont pas trouvées amoindries.
2. A ce stade, plusieurs scénarios peuvent être envisagés
Comme la mission d’information l’a rappelé dans la première partie du présent rapport, ni l’échéance initiale du 20 juillet 2014, ni celle du 24 novembre suivant n’ont pu être respectées. Si l’on en juge d’après les déclarations publiques des « E3+3 » et de l’Iran, il semblerait toutefois que la tonalité et le contenu des négociations aient été jugés suffisamment positifs à ce stade pour que ces négociations puissent se poursuivre. Pour autant, on ne peut pas exclure que les parties aient surtout pris en compte les conséquences très négatives qui pourraient résulter d’un arrêt complet des négociations et de l’application du plan d’action conjoint de novembre 2013.
Dans la situation actuelle, plusieurs hypothèses paraissent devoir être envisagées.
a. La signature d’un accord consacrant « une solution globale, durable et acceptée par toutes les parties, qui garantirait que le programme nucléaire de l’Iran sera exclusivement pacifique »
Tel est l’objectif fixé par le plan d’action conjoint de novembre 2013. Il s’agit évidemment du scénario à privilégier parce qu’il permettrait de régler définitivement la crise nucléaire iranienne. Conformément à l’esquisse qui en est donnée dans le cadre du plan d’action conjoint, cette solution globale, en cours de négociation, reposerait sur les bases suivantes :
(i). Un programme d’enrichissement défini mutuellement, conformément aux « besoins pratiques » de l’Iran, selon des paramètres concernant le niveau et les capacités des activités d’enrichissement que l’Iran aurait le droit de conserver, les lieux où ce programme serait réalisé, ainsi que les stocks d’uranium enrichi détenus, pour une période à convenir ;
(ii). Des préoccupations liées au réacteur plutonigène d’Arak pleinement dissipées (204), étant entendu qu’il n’y aurait notamment ni retraitement du plutonium, ni construction d’une usine capable d’en assurer le retraitement ;
(iii). Des mesures de transparence et de surveillance améliorées, y compris la ratification et l’application du protocole additionnel qui donne des capacités d’investigation supplémentaires à l’AIEA ;
(iv). La levée globale des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions multilatérales et nationales liées au nucléaire, selon un calendrier à convenir d’un commun accord ;
(v). L’octroi à l’Iran d’une coopération nucléaire civile internationale, notamment pour l’acquisition de réacteurs à eau ordinaire et de recherche, ainsi que la fourniture de combustible ;
(vi). La mise en œuvre de cette « solution globale » pendant une durée de long terme, qui est à préciser d’un commun accord et au terme de laquelle, si l’accord a été mis en œuvre avec succès pendant toute sa durée, le programme nucléaire iranien rentrera dans le droit commun de tout Etat partie au TNP non doté d’armes nucléaires.
b. Un deuxième scénario, préféré par certains acteurs, notamment en Israël et aux Etats-Unis, est celui d’un démantèlement complet du programme nucléaire iranien
(i). Il s’agirait d’aller plus loin que la simple perspective d’une limitation du programme nucléaire iranien, mutuellement agréée et de nature transitoire, même si elle serait de long terme, comme l’esquisse le plan d’action conjoint.
(ii). Ce scénario n’est pas envisagé dans le cadre du plan d’action conjoint et il ne pourra pas être obtenu par la négociation dans le contexte actuel. Il ne pourrait être imposé qu’à un pays vaincu, ce qui n’est pas le cas de l’Iran malgré les sanctions économiques, comme la mission d’information a eu l’occasion de l’exposer dans la première partie de ce rapport.
(iii). Le démantèlement des installations nucléaires iraniennes ne pourrait intervenir que par la force, en cas d’échec des négociations en cours. Ce scénario ferait alors appel soit à une intervention militaire israélienne, soit à une intervention américaine, ces deux options pouvant se combiner. Une telle solution doit être repoussée pour plusieurs raisons.
D’abord, parce qu’elle ne permettrait pas d’anéantir les capacités scientifiques iraniennes, à moins d’essayer d’éliminer tous les chercheurs et d’empêcher la diffusion du savoir.
Ensuite, parce qu’elle pousserait probablement l’Iran à faire définitivement le choix de se doter de la bombe, alors que ce choix ne paraît pas établi. La présente Mission a rappelé les estimations américaines selon lesquelles un tel choix n’a pas été fait jusqu’à présent (205).
Enfin, parce qu’une intervention destinée à détruire les installations nucléaires de l’Iran conduirait probablement à des représailles à l’égard des intérêts israéliens et américains dans la région. Leurs conséquences sont difficilement prévisibles, mais elles seraient probablement très graves, y compris pour la stabilité régionale.
c. Des scénarios intermédiaires, moins défavorables que le précédent, mais probablement peu durables, peuvent être envisagés
(i) La prolongation du plan d’action conjoint, pour de nouvelles périodes d’application successives. Il s’agirait de préserver les avancées concrètes et réelles qui ont déjà été réalisées dans ce cadre, même si les concessions nécessaires n’ont pas pu être obtenues des deux côtés pour parvenir à un accord complet et de long terme. Ce scénario a notamment été évoqué comme étant le plus probable par M. Justin Vaïsse, directeur du centre d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère des affaires étrangères, lors de son audition du 19 février 2014.
Comme l’a indiqué M. Vaïsse, ce scénario est néanmoins risqué. Il faudrait parvenir à contenir durablement différents « perturbateurs » : des membres du Congrès américain qui poussent à l’adoption de nouvelles sanctions (206), et que l’Administration pourrait finir par ne plus arriver à dissuader, ainsi que des dirigeants israéliens hostiles à une solution négociée qui ne permettrait pas le démantèlement complet des installations nucléaires iraniennes. On peut également se demander si les Iraniens auraient suffisamment intérêt à reconduire un accord intérimaire qui les empêche de poursuivre leur programme nucléaire sans leur apporter les contreparties économiques et la réintégration internationale qu’ils attendent, grâce à la levée des sanctions.
(ii). Un retour à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du plan d’action conjoint, s’il n’y avait pas de convergence entre les différentes parties directement ou indirectement impliquées – les négociateurs des « E3+3 », les Iraniens, le Congrès américain, les Israéliens et les Saoudiens. Ce scénario conduirait sans doute à la reprise d’une spirale négative et dangereuse avec l’Iran. Il est probable que ce pays relancerait certaines activités de son programme nucléaire qui sont aujourd’hui suspendues et que de nouvelles sanctions, multilatérales ou nationales, seraient adoptées en réaction et pour accroître de nouveau la pression.
On en reviendrait alors à une impasse qui paraît d’autant moins tenable durablement que la perspective d’une résolution par la négociation de la crise nucléaire iranienne aurait perdu sa crédibilité, au moins pour un temps, ce qui réduirait les incitations à faire preuve d’une certaine retenue. Ce retour en arrière ouvrirait la porte, en réalité, à la fois à un risque accru de prolifération nucléaire au plan régional et au risque d’une intervention militaire israélienne et/ou américaine, destinée à régler par la force la crise nucléaire iranienne, avec les graves conséquences qui ont été précédemment évoquées.
La prise en compte de ces différents scénarios alternatifs pousse à tout mettre en œuvre pour qu’un accord global, de long terme et crédible puisse être trouvé avec l’Iran par la voie des négociations.
B. DE NOMBREUSES DIVERGENCES À RÉSOUDRE
Bien que le plan d’action conjoint de novembre 2013 ait permis d’esquisser les contours de ce qui pourrait être un accord complet et de long terme avec l’Iran, à savoir le maintien d’un programme nucléaire limité et sous contrôle, en échange d’une levée complète des sanctions liées au nucléaire, les négociations avec l’Iran ont déjà été prolongées à deux reprises, d’abord en juillet 2014, puis au mois de novembre de la même année.
1. Un point d’équilibre difficile à trouver ou bien un choix stratégique toujours absent du côté iranien ?
La longueur de ces négociations, qui contraste avec la rapidité avec laquelle le plan d’action conjoint de novembre 2013 a été conclu, pourrait s’expliquer par la difficulté à trouver un point d’équilibre permettant à chacune des parties de « vendre » en interne le résultat final. Ce point est d’une importance particulière : les Américains ont besoin d’un accord leur permettant de convaincre le Congrès – et les responsables israéliens – que l’Iran est passé largement sous les fourches caudines ; les négociateurs iraniens, qui font face à une résistance de la part des « durs » dans leur pays, ont besoin d’un accord leur permettant de ne pas perdre la face en public (207).
La multiplicité des questions qui doivent être réglées au plan technique est un facteur particulier de difficulté. Il faut parvenir à placer correctement et en même temps le curseur sur de nombreux sujets : la limitation des capacités d’enrichissement de l’Iran, le stock d’uranium enrichi qui pourrait être conservé ou non par ce pays, la transformation des installations les plus préoccupantes, en particulier le réacteur à eau lourde d’Arak, les mesures de transparence et de vérification portant sur les activités nucléaires de l’Iran, y compris les activités passées, mais aussi le rythme et l’ampleur de la levée des sanctions (208). Les négociateurs font volontiers référence à un « Rubik’s cube » pour décrire la complexité de telles négociations (209). Le préambule du plan d’action conjoint consacre explicitement l’objectif et le principe suivants : aboutir à une « solution globale », qui « constituerait un tout intégré dans le cadre duquel il n’y aurait d’accord sur rien tant qu’il n’y aurait pas d’accord sur tout ».
La mission d’information retient aussi de ses entretiens avec plusieurs hauts responsables français au cours de l’année 2014 que si les Iraniens négocient sérieusement, c’est-à-dire sur des éléments concrets, ils pourraient ne pas encore avoir fait le choix stratégique consistant à renoncer à se doter de l’arme nucléaire. Il paraît clair que le président Rohani souhaite un certain type d’accord, mais il reste à savoir de quel type et ce que le Guide pourrait accepter. Il y aurait bien une volonté de négocier de la part des Iraniens, mais ils pourraient garder en tête « l’option japonaise » qui a été précédemment décrite dans ce rapport. Ils pourraient souhaiter rester au « seuil », afin d’être en mesure de construire l’arme nucléaire très rapidement, si nécessaire. Une telle position, si elle correspondait toujours aux intentions des Iraniens, ce que cette Mission n’est pas en mesure d’évaluer, ne serait pas compatible avec les garanties que nous exigeons sur le caractère exclusivement civil du programme nucléaire iranien, ce qui ne permettrait pas de conclure un accord solide.
2. Les principaux aspects techniques
Le principe fondamental d’un accord global et de long terme avec l’Iran est clairement défini dès le préambule du plan d’action conjoint de novembre 2013, à savoir l’engagement solennel de l’Iran « qu’il ne cherchera en aucun cas à acquérir ni n’élaborera des armes nucléaires ». L’enjeu des négociations en cours est d’en assurer la traduction concrète dans tous les domaines.
Les développements qui suivent ont pour objet de présenter les principaux paramètres des négociations, tels qu’ils sont connus. Au préalable, la Mission estime utile de préciser qu’elle ne fait ici appel qu’à des éléments déjà publics. Il ne lui appartient pas de présenter des données confidentielles sur l’état des négociations, ni de mettre en lumière les contours précis de ce qui pourrait constituer un accord acceptable du point de vue français.
Comme l’a déclaré le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, au lendemain de la dernière prolongation des négociations avec l’Iran (210), « nous devons nous garder d’entrer publiquement dans un débat sur les concessions ou les gains éventuels de telle ou telle partie dans la négociation. Si nous le faisons, les négociateurs iraniens risquent de se retrouver dans une situation impossible vis-à-vis de leur opinion. Il en va de même pour les négociateurs américains vis-à-vis du Congrès ».
A cette occasion, M. Fabius a évoqué cinq sujets principaux devant la commission des affaires étrangères : la limitation des capacités d’enrichissement de l’Iran ; la transformation des installations nucléaires les plus problématiques ; la vérification et la transparence ; la levée des sanctions ; la durée d’application de l’accord final.
a. La limitation des capacités d’enrichissement de l’Iran
Depuis les révélations sur l’existence d’un programme clandestin en Iran au début des années 2000, l’enrichissement de l’uranium est l’un des principaux enjeux du contentieux nucléaire actuel. L’enrichissement de l’uranium jusqu’à une qualité militaire est en effet l’une des voies d’accès à l’arme nucléaire, avec celle du plutonium. L’Iran continue à réclamer la reconnaissance d’un droit à l’enrichissement – pour mener un programme nucléaire civil. Contrairement aux prétentions iraniennes, ce droit n’est pourtant pas consacré par le TNP et les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ont demandé à l’Iran de suspendre toutes ses activités liées à l’enrichissement au regard des graves préoccupations suscitées par son programme nucléaire.
Sans reconnaître explicitement un quelconque droit à l’enrichissement de l’uranium, le plan d’action conjoint de 2013 ouvre la perspective du maintien d’un programme limité dans ce domaine, sans définir à ce stade quelles en seraient les limites. Dans la mesure où la possibilité de produire une arme nucléaire dépend notamment de la disponibilité d’une quantité suffisante de matière fissile de qualité militaire, deux éléments principaux doivent être pris en compte : le nombre de centrifugeuses existant et leurs performances (211); le stock d’uranium enrichi qui est détenu.
S’agissant du stock d’uranium, le ministre des affaires étrangères a déclaré le 25 novembre 2014, lors de son audition par la commission sur la prolongation des négociations avec l’Iran, que « le principe a été retenu qu’il serait traité en Russie, de telle manière qu’il ne puisse pas être utilisé à des fins militaires, le combustible restitué par la Russie étant à usage strictement civil ».
En ce qui concerne les capacités d’enrichissement, deux concepts paraissent au cœur des négociations d’après les éléments qui ont été rendus publics : d’une part, celui des « besoins pratiques » de l’Iran, qui est consacré par le plan d’action conjoint et revendiqué par les autorités iraniennes ; d’autre part, celui du « break-out time », c’est-à-dire le délai nécessaire pour produire suffisamment de matière fissile pour une arme nucléaire, qui servirait de cadre aux « E3+3 ».
La difficulté de la référence aux « besoins pratiques » de l’Iran réside principalement dans le fait que ces besoins font l’objet d’une interprétation divergente entre les parties. A l’heure actuelle, ils se limitent à ceux des trois réacteurs installés en Iran : le réacteur de recherche de Téhéran, qui est alimenté par de l’uranium enrichi à 20 % ; le réacteur de Bushehr, construit par les Russes ; le réacteur à eau lourde d’Arak, en cours de construction.
Selon des éléments rapportés par l’International Crisis Group, l’Iran aurait produit suffisamment d’uranium enrichi à 20 % pour alimenter le réacteur de Téhéran pendant plusieurs années (212) ; en ce qui concerne le réacteur de Bushehr, les Russes se sont engagés à fournir du combustible jusqu’en 2022 et sont disposés à continuer au-delà ; quant au réacteur d’Arak, il utiliserait de l’uranium naturel dans sa conception actuelle.
Pour justifier leurs « besoins pratiques », les Iraniens s’appuient aussi sur des projets de construction de nouveaux réacteurs dans les années à venir et sur leur volonté d’être en mesure d’alimenter de manière autonome le réacteur de Bushehr, si nécessaire. Le Guide suprême a ainsi déclaré que l’Iran avait besoin de 190 000 SWU (« Separative Work Units ») (213) alors que la proposition initiale des Américains aurait été de 1 500 SWU.
La référence à la notion de « break-out time » ne semble pas davantage être de nature à définir de manière simple une approche commune et objective pour encadrer les capacités d’enrichissement que l’Iran pourrait être autorisé à conserver. Le rapport précité de l’International Crisis Group estime que ce délai présente de nombreux aspects discutables.
Tout d’abord, la prise en compte du « break-out time » vise à laisser suffisamment de temps pour détecter une éventuelle violation de l’accord par l’Iran et pour mettre sur pied une riposte, ce qui peut faire l’objet d’évaluations très différentes. Après avoir envisagé un délai de 6 mois, les Américains auraient finalement choisi celui d’un an (214), alors qu’il ne faudrait pas plus de quelques semaines pour monter une intervention militaire (215). Le « break-out time » fait par ailleurs abstraction d’un certain nombre d’aléas, notamment d’éventuelles difficultés dans la militarisation de la charge et la vectorisation (216). Il ignorerait aussi l’effet d’autres paramètres importants de l’accord, tels que l’amélioration des capacités de détection.
b. La transformation des sites les plus problématiques
Lors de son audition du 25 novembre 2014, le ministre des affaires étrangères a précisé que la question de la transformation de certaines installations iraniennes concerne principalement celles de Fordow et d’Arak, qui ont été présentées dans la première partie du présent rapport.
Il paraît difficile d’obtenir des Iraniens qu’ils démantèlent complètement une installation aussi importante et aussi avancée que celle d’Arak – selon le rapport précité de l’International Crisis Group, la construction du réacteur serait achevée à 87 %. Comme l’a indiqué M. Fabius, l’idée retenue consiste à « trouver une méthode pour que le réacteur continue à exister, mais qu’il n’utilise plus une telle technologie à l’eau lourde », productrice de plutonium en grande quantité. Selon le ministre, « plusieurs idées ont été avancées et une solution devrait être trouvée ».
M. Laurent Fabius a présenté le problème posé par l’usine souterraine de Fordow de la manière suivante : « enfouie très profondément dans le sol, elle est protégée contre d’éventuelles frappes. Nous devons nous assurer que les Iraniens n’y mènent pas de travaux de recherche et développement innovants et dangereux, et qu’ils n’y abritent pas de centrifugeuses. Des pistes ont été esquissées sur ce point, mais nous ne disposons pas encore d’un paragraphe rédigé et prêt à être signé. »
c. La vérification et la transparence, y compris sur les activités passées de l’Iran
La question de la vérification et de la transparence est complémentaire des précédentes mesures qui visent à réduire les risques de détournement des activités nucléaires déclarées par l’Iran. L’idée générale est que le comportement passé de l’Iran, à savoir son programme clandestin, justifie des mesures allant au-delà des obligations de droit commun dans le cadre du TNP, y compris l’application et la ratification du protocole additionnel conclu avec l’AIEA. Le ministre des affaires étrangères a déclaré que « la condition sine qua non d’un accord est que l’AIEA ait la possibilité de vérifier tout et partout, y compris de manière inopinée, mais [qu’elle] est très difficile à admettre pour les Iraniens ».
Il paraît également nécessaire que l’Iran fasse toute la lumière sur ses activités passées, en répondant aux questions en suspens sur les « possibles dimensions militaires » de son programme nucléaire (217). Il ne s’agit pas d’humilier l’Iran, mais d’obtenir une transparence complète sur ces activités afin d’avoir la certitude qu’il n’existe pas de programme clandestin et de comprendre d’où il pourrait éventuellement repartir. Cette question concerne donc moins le passé, en réalité, que l’avenir.
d. L’ampleur et le calendrier de la levée des sanctions
Le plan d’action conjoint précise que « l’étape finale » se caractériserait notamment par la levée, « de manière globale », des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions multilatérales et nationales liées au nucléaire, « selon un calendrier à convenir ».
Le ministre des affaires étrangères a ainsi résumé les divergences d’approche : « les Iraniens souhaiteraient que nous levions immédiatement toutes les sanctions – tant celles du Conseil de sécurité de l’ONU, qui visent à empêcher l’Iran de développer un programme nucléaire militaire, que celles des États-Unis et de l’Union européenne, qui ont un caractère essentiellement économique – dès lors qu’un accord serait conclu. En revanche, du point de vue des « 5+1 », il faut que les contrôles soient périodiques et que les sanctions puissent être rétablies immédiatement dans le cas où l’Iran ne respecterait pas l’accord. » Cela permettrait de garder un levier de pression sur l’Iran jusqu’à la fin de l’application de l’accord global.
La question de la levée des sanctions américaines paraît faire l’objet d’une difficulté particulière, dans la mesure où le Président des Etats-Unis ne pourra que suspendre l’application de la majorité d’entre elles, décidées par le Congrès. Au regard de l’approche générale du Congrès à l’égard de la question iranienne (218), la levée en bonne et due forme de l’ensemble des sanctions américaines risque d’être complexe, alors que leur suspension par le Président sera par définition temporaire, ce qui constitue une garantie limitée.
Une lettre ouverte a d’ailleurs été adressée par 47 sénateurs américains aux « dirigeants de la République islamique d’Iran », le 8 mars dernier, pour les prévenir que seul le Congrès dispose du pouvoir de lever définitivement les sanctions américaines adoptées sous forme de loi. Les sénateurs insistaient également sur le fait qu’un accord non soumis au Congrès ne constituerait qu’un « executive agreement » susceptible d’être remis en cause, « d’un simple trait de plume », par le prochain Président américain (219). Ils faisaient aussi remarquer que le Président Obama ne pourrait pas se présenter pour un troisième mandat, alors qu’eux-mêmes étaient susceptibles d’être réélus « pendant des décennies »…
La question est probablement aussi complexifiée par les liens qui existent entre les différents types de sanctions. Dans le domaine financier, les Américains interdisent les transactions en dollars, tandis que les Européens empêchent l’accès au système SWIFT, ce qui coupe l’Iran du système financier international. Dans le domaine pétrolier, l’effet de l’embargo européen est renforcé par les pressions américaines sur les importateurs non occidentaux. On observe par ailleurs que des transactions non interdites, concernant par exemple les médicaments et l’alimentation, ne peuvent pas toujours se réaliser à l’heure actuelle, en raison de blocages au plan financier et des intérêts des acteurs concernés aux Etats-Unis, où ils craignent des sanctions. Il serait donc préférable que les sanctions américaines et européennes puissent être levées de manière coordonnée.
e. La durée d’application de l’accord
Au regard des très fortes préoccupations internationales sur le programme nucléaire de l’Iran, l’accord qui est en cours de négociation a vocation à appliquer à ce pays un régime temporairement – mais probablement durablement – dérogatoire par rapport aux obligations incombant aux autres Etats signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968. Comme l’indique le plan d’action conjoint de novembre 2013, « lorsque l’étape finale de la solution globale aura été mise en œuvre avec succès pour toute sa durée, le programme nucléaire iranien sera traité de la même manière que celui de tout Etat partie au TNP non doté d’armes nucléaires ».
Le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a apporté les éclairages suivants devant la commission : « Pour sa part, l’Iran se dit prêt à respecter cette condition pendant une durée qui reste à déterminer, à condition que l’on considère que, passé ce délai, il sera un État digne de confiance et qu’il sera, à ce moment-là, soumis aux obligations fixées dans les traités généraux, qu’il s’engage à signer entre-temps. La question qui se pose est donc la suivante : à partir de quel moment l’Iran pourrait-il être considéré comme un État « normal » ? À ce stade, elle n’est pas réglée ».
La Mission comprend que l’Iran souhaiterait une durée relativement courte, comparable à celle que l’AIEA peut mettre pour établir le caractère strictement civil du programme nucléaire d’un pays, tandis que les « 5+1 » pourraient envisager une échelle de temps différente. Le président Obama a déclaré au début du mois de mars, à l’occasion d’un entretien avec l’agence Reuters, qu’un accord avec l’Iran devrait s’appliquer pendant une période « à deux chiffres ».
3. Positions de la mission d’information à l’égard des négociations
Ce rapport d’information n’a pas pour vocation d’encadrer les positions des négociateurs français par des paramètres précis au plan technique. Cela reviendrait à empiéter sur les négociations, qui relèvent du pouvoir exécutif. Par ailleurs, on risquerait d’aboutir à un échec si les négociateurs n’avaient plus de marge de manœuvre ou si les paramètres retenus étaient rendus publics avant la fin des négociations, pour les raisons qui ont été exposées en commission par le ministre des affaires étrangères et que la Mission a rappelées précédemment dans ce rapport. Il paraît néanmoins envisageable de fixer un cap politique.
– La Mission estime en premier lieu que notre position doit continuer à être ferme sur le dossier du nucléaire iranien, malgré des difficultés manifestes pour rapprocher les positions, dont témoigne la reconduction à deux reprises du plan d’action conjoint, en l’absence de conclusion d’un accord global et de long terme.
Il faut aller suffisamment loin dans la lutte contre la prolifération pour éloigner l’Iran du « seuil », sans quoi la question ne sera pas traitée durablement et risque de ressurgir à nouveau. Il faut aussi parvenir à « vendre » l’accord aux durs et aux sceptiques au Congrès américain, en Israël et en Arabie saoudite. Enfin, pour qu’une détente et des coopérations puissent être envisagées au plan régional, grâce à la signature d’un accord global et de long terme sur le programme nucléaire iranien (220), ce que la Mission espère, il faut parvenir à apaiser les tensions et les angoisses parfois existentielles qui existent dans un certain nombre de pays voisins.
N’importe quel accord ne suffira donc pas, contrairement à ce que laissent entendre ceux qui auraient voulu régler au plus vite la question, de crainte que les négociations ne se grippent complètement. Il est vrai que plus le temps passe, plus la position des opposants à un accord avec l’Iran risque de se renforcer, en particulier au Congrès américain, et plus la négociation est exposée à des risques de sabotage, tels que l’adoption de sanctions américaines supplémentaires (221). Mais il faut malgré tout parvenir à un « bon accord », c’est-à-dire un accord exigeant et solide, de nature à régler globalement et durablement la crise du nucléaire iranien.
Par conséquent, la Mission souhaite exprimer sa satisfaction à l’égard de la fermeté raisonnée dont la France a su faire preuve pendant la phase de négociation du plan d’action conjoint. Elle comprend en effet que cette fermeté a permis de renforcer l’accord sur plusieurs aspects qui n’étaient pas suffisamment pris en compte dans un premier temps, notamment la question du stock d’uranium enrichi et celle du réacteur plutonigène d’Arak. Cette fermeté a néanmoins été interprétée, dans un premier temps, comme une position de fermeture à l’égard de l’Iran.
– La Mission approuve aussi le choix de maintenir une séparation entre le dossier nucléaire iranien et les autres sujets régionaux, tels que la crise en Syrie.
La non-prolifération est un sujet suffisamment grave et complexe, compte tenu de ses conséquences sur la paix et la sécurité au plan international, ainsi qu’au regard des nombreux paramètres à ajuster avant d’arriver à un accord global (222), pour que l’on ne souhaite pas y mêler d’autres considérations dans le cadre de ce qui pourrait alors s’apparenter à un « grand marchandage » régional.
A la différence du dossier nucléaire, la politique régionale de l’Iran passe d’ailleurs pour ne pas se trouver entre les mains du président Rohani et de ses proches, mais entre celles d’autres acteurs, tels que les Pasdarans, dont la ligne n’est pas de chercher des terrains d’entente avec le reste du monde. On risquerait donc de « polluer » la négociation sur le nucléaire en y mêlant d’autres sujets régionaux d’intérêt commun.
Enfin, bien que l’Iran détienne de nombreuses clefs au niveau régional, la conclusion d’un accord solide sur le nucléaire est elle-même la clef pour faciliter des interactions constructives avec les Iraniens, dans un second temps. Seul un accord suffisamment exigeant et crédible permettra d’ouvrir des perspectives de détente et de coopération sur d’autres sujets (223).
– Sous réserve de ce qu’elle a indiqué plus haut, dans son premier point, Mission considère que la prise en compte des conditions de la négociation avec l’Iran et de ses conséquences potentielles, en cas de succès comme en cas d’échec, doit conduire à écarter des positions maximalistes. Celles-ci pourraient se traduire non seulement par l’exigence d’un démantèlement complet des installations nucléaires iraniennes, ce que le plan d’action commun n’envisage d’ailleurs pas, mais aussi par la volonté de réduire à une proportion symbolique les capacités d’enrichissement laissées à l’Iran.
Malgré l’impact des sanctions, les Iraniens ne sont pas économiquement à genoux et il convient aussi, politiquement, de leur permettre de ne pas perdre la face au plan interne. Eux aussi doivent parvenir à « vendre » un accord global et de long terme, à la fois au Guide suprême, qui a témoigné à plusieurs reprises en public de son scepticisme à l’égard des négociations, et au Madjlès iranien.
Il convient par ailleurs de prendre en considération l’impact économique considérable dont s’accompagnerait l’ouverture de l’Iran au plan international, en particulier pour le secteur de l’automobile et celui des hydrocarbures en France. Les perspectives de détente et de coopération avec l’Iran au plan régional doivent également pousser à éviter de faire preuve d’une intransigeance inconsidérée. Nous avons besoin d’un accord avec l’Iran à la fois pour écarter les risques liés à la prolifération nucléaire et pour saisir tous les bénéfices d’un éventuel rapprochement dans d’autres domaines.
Indépendamment de ces considérations, l’échec des négociations risque de replonger les « 5+1 » et l’Iran dans la spirale négative qui a précédé la conclusion du plan d’action commun, à savoir de nouveaux développements non contrôlés du programme nucléaire iranien, avec les préoccupations croissantes que cela implique, et le renforcement en parallèle des sanctions pour tenter de « convaincre » les Iraniens de leur intérêt à négocier. En l’absence d’accord global et de long terme, l’Iran aurait les coudées plus franches pour avancer sur la voie de la bombe, si tel était son choix. Cette impasse risquerait en réalité d’ouvrir la voie à un règlement non négocié de la crise nucléaire iranienne, sous la forme d’une intervention militaire dont les conséquences pourraient être considérables.
La Mission entend aussi écarter l’idée, parfois avancée, selon laquelle un accord avec l’Iran et la réintégration consécutive de ce pays au plan international constitueraient une concession à l’égard du régime, dont l’effet serait susceptible de le renforcer. Ce sont au contraire la mise à l’écart de l’Iran et les sanctions dont ce pays fait l’objet qui poussent le régime à se rigidifier. Un accord sur le nucléaire faciliterait l’évolution de la société iranienne en favorisant son ouverture au monde. Il s’agit déjà d’une société très « connectée » et beaucoup plus avancée au plan sociétal que celles d’autres pays de la région, par exemple du point de vue du taux de fécondité et de la participation des femmes. La détente des relations avec les pays occidentaux et l’atténuation des craintes de frappes militaires dirigées contre le programme nucléaire pourraient redonner un espace à la société civile.
Sans se prononcer sur les intentions réelles des dirigeants iraniens, la Mission note que le président Rohani a également été élu sur des promesses d’ouverture au plan interne. Ces promesses ne se sont pas traduites par des évolutions significatives, à ce stade, mais il ne paraît pas exclu que le mandat politique accordé par le Guide à M. Rohani puisse être élargi à d’autres domaines que la réintégration économique et internationale de l’Iran en cas de succès des négociations. Cette évolution est encore hypothétique ; en revanche, il est très probable que les « pragmatiques » perdront la main en cas d’échec des négociations.
Enfin, sans renoncer à obtenir l’accord exigeant que la Mission appelle de ses vœux pour régler durablement la crise du nucléaire iranien, la France n’a manifestement pas intérêt à être perçue comme le pays ayant entravé un accord avec l’Iran, au nom de conceptions dogmatiques de la non-prolifération nucléaire, ou à prêter le flanc aux accusations récurrentes d’alignement sur les puissances régionales du Golfe, par choix des sunnites au détriment des chiites. La Mission est confiante dans la capacité et la détermination des négociateurs français à proposer des solutions innovantes pour aboutir à un accord éminemment souhaitable à plus d’un titre.
– Sans vouloir s’ingérer aucunement dans la conduite des négociations, pour les raisons qu’elle a exposées plus haut, la Mission entend mettre l’accent sur deux orientations qui lui paraîtraient positives et sur deux risques à éviter en particulier.
(i). La Mission souhaite insister sur l’intérêt de mesures renforcées de transparence et de vérification parmi les différents paramètres d’un accord. Bien que la question du « break-out time », évoquée plus haut, ait son importance et qu’elle conduise effectivement à s’interroger sur les capacités d’enrichissement qui seront laissées à l’Iran et sur le stock d’uranium enrichi qui pourrait être conservé à l’intérieur du pays, il faut souligner qu’aucun des Etats ayant posé problème au regard de l’application du TNP ne l’a fait en détournant des matières ou des installations nucléaires déclarées à l’AIEA, mais au contraire en conduisant des programmes clandestins – c’est notamment le cas de l’Iran.
Il est légitime de s’interroger sur le temps disponible pour détecter une éventuelle violation de l’accord qui pourrait être signé avec l’Iran et pour y réagir en temps utile, avant qu’une éventuelle arme nucléaire ne soit opérationnelle (224). La Mission se demande toutefois si un engagement significatif de l’Iran dans le domaine de la « détection » ne permettrait pas d’apporter plus de garanties effectives qu’une réduction maximale – et donc très problématique du point de vue iranien – des capacités nucléaires déclarées. James A. Acton, co-directeur du programme sur la politique nucléaire du Carnegie Endowment, appelle ainsi l’attention sur l’intérêt de mesures de détection plus « intrusives » que celles prévues dans le cadre de la conclusion d’un protocole additionnel avec l’AIEA, notamment la possibilité de réaliser des prélèvements environnementaux dans tous les lieux publics, de s’entretenir en tête à tête avec les scientifiques, sans surveillance, et de contrôler un plus grand nombre de matières (225).
(ii). Sans que cela implique de renoncer à obtenir un accord exigeant, là encore, il semble à la Mission qu’un accent particulier mérite d’être mis sur la qualité de l’offre « positive » qui est faite aux Iraniens, notamment en ce qui concerne les coopérations proposées. La Mission constate que le débat sur les négociations est essentiellement orienté sur les garanties à demander aux Iraniens, c’est-à-dire sur les concessions à obtenir, et sur la nécessité de maintenir un levier de pression suffisant en levant de manière intelligente les sanctions. Il importe aussi de conclure un accord suffisamment intéressant pour inciter l’autre partie à ne pas s’en écarter, afin de conserver le bénéfice de ses aspects les plus positifs. Selon Sir Richard Dalton, ancien ambassadeur britannique en Iran, de 2002 à 2006, et M. Peter Jenkins, lui aussi ancien diplomate britannique, la meilleure protection contre une menace nucléaire iranienne viendrait d’une combinaison entre les intérêts bien compris de l’Iran et l’effet dissuasif des vérifications conduites par l’AIEA (226).
(iii). La Mission est parvenue à la conclusion qu’un renforcement des sanctions ferait courir de graves risques sur les négociations. Le Congrès américain paraît toujours déterminé à s’engager dans cette voie, malgré les efforts du président Obama et la menace d’un véto de sa part. Tout d’abord, comme la Mission l’a établi plus haut, il serait faux de croire que seules les sanctions ont poussé l’Iran à la table des négociations et que des sanctions supplémentaires permettraient d’obtenir davantage de concessions en renforçant la pression. Le moment serait au contraire mal choisi, car de telles sanctions achèveraient de convaincre une partie des responsables iraniens, en particulier le Guide, que leurs interlocuteurs manquent de fiabilité. Comme la Mission l’a indiqué précédemment, les Iraniens doutent déjà de la capacité de l’Administration américaine à aller au-delà d’une simple suspension des sanctions, en obtenant du Congrès leur levée effective. Un renforcement des sanctions, à ce stade, serait bien sûr interprété comme un signe particulièrement négatif.
(iv). La Mission souhaite insister sur les risques que ferait courir la tentation de prolonger encore les négociations, après les prochaines échéances prévues en mars et en juin (227). Cette tentation pourrait l’emporter soit dans l’espoir que l’autre partie finira par faire l’ensemble du chemin nécessaire pour aboutir à un accord, si l’on se laisse encore davantage de temps, soit parce que le régime qui résulte actuellement de l’application du plan d’action conjoint paraîtrait suffisant pour contenir à un niveau acceptable les risques liés au programme nucléaire iranien, sans qu’il soit absolument nécessaire de faire les concessions indispensables pour parvenir à conclure un accord global avec l’Iran. La Mission ne peut que réitérer sa conviction que la reconduction du plan d’action conjoint et la prolongation des négociations pourraient ne pas être durables. Plus le temps passe, plus les risques de sabotage par des perturbateurs extérieurs augmentent, et plus on risque d’en revenir à l’impasse antérieure, sans parvenir à engranger un seul des bénéfices qui pourraient résulter d’un accord solide avec l’Iran.
C. UN ACCORD QUI POURRAIT OUVRIR DES PERSPECTIVES NOMBREUSES, MAIS ENCORE HYPOTHÉTIQUES
La conclusion d’un accord global et de long terme sur le programme nucléaire iranien doit être traitée comme un objectif en soi. Une solution crédible et acceptée par les voisins de l’Iran permettrait de régler une crise particulièrement grave, en écartant des options militaires susceptibles d’enflammer encore plus la région, ainsi que des risques de prolifération dans les pays voisins. Plus globalement, un accord conforterait le régime de non-prolifération nucléaire issu du TNP, qui est un des fondements de la paix et de la sécurité au plan international (228).
Sous certaines conditions, un accord avec l’Iran pourrait aussi permettre d’engager une détente des relations avec l’Arabie saoudite, que M. Justin Vaïsse, directeur du centre d’analyse, de prospective et de stratégie au ministère des affaires étrangères a présentées à la mission d’information comme le « dossier-maître » au plan régional (229). L’évolution de l’antagonisme entre l’Arabie saoudite et l’Iran conditionne en grande partie l’avenir de la Syrie, de l’Irak, du Liban, du Yémen ou encore du Bahreïn, où ces deux puissances régionales ont choisi de soutenir des camps opposés.
Dans l’hypothèse d’une détente des relations saoudo-iraniennes, des coopérations ponctuelles pourraient être envisagées sur certains dossiers régionaux, bien que l’enchaînement n’ait rien de mécanique et qu’il se heurte à plusieurs obstacles. Cette hypothèse doit cependant être privilégiée, car de nombreuses crises du Proche et Moyen-Orient sont en réalité très régionalisées. Elles ne pourront être réglées qu’à cette échelle, à la faveur de compromis entre Saoudiens et Iraniens. En ce qui concerne la France, le règlement du différend nucléaire avec l’Iran est la principale prise directe qui s’offre à nous pour tenter d’exercer une influence positive sur la situation au Proche et Moyen-Orient.
1. D’un accord sur le nucléaire iranien à une détente régionale : un enchaînement possible
a. Un antagonisme profond et ancien entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui se traduit aujourd’hui par une confrontation très vive et s’accompagne de tensions croissantes entre sunnites et chiites
Il convient de présenter les origines et les différentes manifestations des tensions actuelles avant d’envisager les perspectives de détente qu’un éventuel accord sur le programme nucléaire iranien pourrait permettre d’ouvrir.
La rivalité entre l’Arabie saoudite et l’Iran est profondément enracinée. Opposant des Arabes à des Perses, des sunnites à des chiites et une monarchie conservatrice à une république islamique, elle a des dimensions historiques, ethniques, confessionnelles et politiques multiples. Les enjeux sont également de nature géopolitique. Comme le rappellent Frederic Wehrey et Karim Sadjadpour (230), chercheurs à la Carnegie Endowment for International Peace, les Saoudiens et les Iraniens s’opposent par leurs prétentions respectives au leadership régional, les premiers au nom de la légitimité religieuse qu’ils tirent de leur statut de gardiens des lieux saints de la Mecque et de Médine, les seconds en vertu de leur légitimité révolutionnaire et de ce qu’ils présentent comme une politique de « résistance » aux Etats-Unis et à Israël. Leur vision de la région diffère aussi. Alors que l’Arabie saoudite voudrait préserver des liens étroits avec les Etats-Unis, dont la présence tutélaire est souhaitée contre ce qui est perçu comme une volonté d’hégémonie à la persane, les Iraniens aspirent à un ordre régional où les Américains n’auraient aucune part.
Depuis l’avènement de la République islamique, en 1979, les Iraniens ont abandonné leur politique d’alliance avec les Etats-Unis, qui faisait d’eux un « gendarme du Golfe » aux côtés de l’Arabie saoudite, en échange de garanties de sécurité et d’un soutien militaire. Ils se sont engagés dans une politique visant à assurer l’indépendance du pays, dont l’histoire est marquée par de nombreuses invasions ou interventions extérieures, grâce à la conquête d’une profondeur stratégique régionale. Elle est constituée de ce que M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères a qualifié de « premier étranger proche » (231) : le Liban, majoritairement chiite (232), qui est le « cœur de cible » de l’Iran et le « centre de sa politique régionale » ; la Syrie, point de passage stratégique vers le Liban et le Hezbollah (233) ; l’Irak, où la chute de Saddam Hussein aurait en quelque sorte été l’occasion de prendre une revanche sur la bataille historique de Kerbala, en 680 (234).
Bien que Téhéran ait largement abandonné sa politique d’exportation de sa propre révolution islamique dans les années 1990 (235), la constitution progressive de cette sphère d’influence a conduit à un sentiment croissant d’encerclement du côté saoudien. Les Iraniens seraient ainsi parvenus à contrôler quatre capitales arabes : Beyrouth, où le Hezbollah est de plus en plus clairement l’acteur dominant ; Damas, où le régime alaouite minoritaire de Bachar el-Assad dépend étroitement du soutien des Iraniens et de diverses milices chiites, en particulier le Hezbollah ; Bagdad, où la majorité chiite est revenue au pouvoir depuis la chute de Saddam Hussein et où les relations se sont améliorées avec la Syrie voisine depuis les événements de 2011, alors que ces deux pays entretenaient des relations détestables (236) ; plus récemment, Sanaa, au Yémen, dont des miliciens houthis ont pris le contrôle. Cette vision d’ensemble doit être nuancée, car tous les acteurs concernés n’ont pas le même degré d’alignement sur Téhéran, qui n’exerce d’ailleurs pas un contrôle sans partage (237). Mais cette succession d’événements a alimenté l’idée d’un « croissant chiite » menaçant. Selon M. Justin Vaïsse, le sentiment saoudien que l’Iran est en train de l’emporter sur tous les fronts a aussi été alimenté par la prise de contrôle du Hamas à Gaza en 2007.
S’il existe une rivalité profonde entre Iraniens et Saoudiens, leur confrontation n’a rien d’inéluctable au plan historique. Comme le rappelle notamment F. Gregory Gause III, chercheur au centre de Doha de la fondation Brookings (238), la fin de la guerre Iran-Irak et la mort de l’ayatollah Khomeini se sont accompagnées d’un réchauffement des relations sous les présidences successives de M. Rafsandjani (1989-1997) et de M. Khatami (1997-2005). Aujourd’hui, c’est pourtant une logique de confrontation qui domine presque partout dans la région. En Syrie, la guerre d’influence entre l’Arabie saoudite et l’Iran va jusqu’à prendre la forme d’un affrontement par acteurs locaux interposés. Selon M. Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, les Saoudiens ont voulu saisir l’occasion offerte par les événements de 2011 pour briser « l’axe chiite » (239). Si la Syrie lui échappait, l’Iran rencontrerait de graves difficultés pour soutenir le Hezbollah libanais, ce qui explique largement le soutien iranien sans faille dont le régime de Bachar el-Assad a jusque-là bénéficié.
Comme le notent Frederic Wehrey et Karim Sadjadpour, dans leur article précité, la confrontation entre l’Iran et l’Arabie saoudite est entretenue par une sorte de cercle vicieux : le fait que ces deux pays soutiennent des camps opposés dans la plupart des crises du Proche et du Moyen-Orient ne fait qu’accroître leur méfiance et leur animosité réciproque, ce qui à son tour exacerbe les conflits au plan régional.
Cette confrontation entre puissances régionales se double d’une aggravation des tensions entre sunnites et chiites. Elles atteignent un niveau très préoccupant là où il existe une diversité confessionnelle significative, en Syrie et en Irak, mais aussi au Liban, au Bahreïn (240) et au Yémen (241), ainsi qu’en Arabie saoudite (242). Plusieurs interlocuteurs de la mission d’information, en particulier M. Justin Vaïsse et M. Pascal Boniface, ont insisté sur la nécessité de ne pas sur-interpréter cette montée des tensions confessionnelles en la considérant comme une nouvelle guerre de religion. Même si le facteur religieux est un trait distinctif et structurant, il existe d’abord un ancrage local des tensions et la lutte d’influence entre l’Iran et l’Arabie saoudite joue aussi un rôle important. Ces deux éléments l’emportent sur toute fatalité religieuse ou historique.
Selon M. Frederic Wehrey, les tensions entre sunnites et chiites sont d’abord ancrées dans des griefs locaux qui concernent les dysfonctionnements de la société et de l’Etat (243). En Arabie saoudite et au Bahreïn, les chiites ont ainsi le sentiment d’être traités comme des citoyens de seconde zone dans tous les domaines – administration, armée, marché du travail ou politique économique. Les tensions avec les sunnites sont de nature sociale et politique avant d’être religieuses. Il faut aussi rappeler que l’appartenance confessionnelle n’est qu’une forme d’identité parmi d’autres dans cette région du monde. La force des liens locaux, familiaux ou tribaux ne doit pas être sous-estimée. Elle explique noatmment la grande diversité des communautés chiites qui, loin d’être toutes axées sur Téhéran, se distinguent par leur histoire singulière et par leurs affiliations religieuses et intellectuelles (244).
Malgré la diversité et la fragmentation des communautés chiites, la généralisation de l’antagonisme avec les sunnites n’en est pas moins une réalité croissante. Plusieurs facteurs récents ont poussé à cette confrontation qui n’est pas une constante historique. Chiites et sunnites ont vécu en paix bien plus souvent qu’en conflit pendant leurs 14 siècles d’histoire commune.
Une première accélération s’est produite lors du basculement de l’Irak du côté chiite, après l’intervention américaine de 2003, et de la restructuration du champ politique et social qui a suivi, selon des lignes communautaires et religieuses. Une seconde accélération a eu lieu à l’occasion des « révolutions arabes » de 2011, qui ont vu certains régimes du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite et le Bahreïn, traiter les demandes de réforme comme des revendications confessionnelles téléguidées par Téhéran. Cette présentation de la réalité permettait de disqualifier les aspirations populaires et d’empêcher la jonction avec les libéraux et réformistes sunnites. L’aggravation du conflit syrien a ensuite marqué un nouveau tournant dans la spirale de la polarisation. De fait, cette crise oppose désormais des acteurs sunnites, du côté de l’insurrection, aux alliés chiites du régime. Dans le même temps, des figures religieuses du Golfe ont voué aux gémonies le régime alaouite syrien et ses alliés chiites, les médias sociaux servant de chambre d’amplification à cette poussée d’exécration mutuelle qui est allée jusqu’à la création de chiites imaginaires (245).
D’après tous les interlocuteurs entendus par la Mission sur ce sujet, les tensions entre l’Arabie saoudite et l’Iran ne sont pas structurées à titre principal par un antagonisme entre sunnites et chiites, mais par une rivalité de puissance plurimillénaire. Frederic Wehrey rapporte d’ailleurs que l’Iran essaie de réduire la dimension chiite dans sa propre rhétorique, au profit d’un discours anti-terroriste, anti-occidental et anti-israélien. Bien que l’Arabie saoudite ne conduise pas une politique étrangère explicitement sunnite, la tonalité confessionnelle anti-chiite est en revanche plus affirmée dans ses appels à « contenir » l’Iran. Ces deux puissances régionales exploitent le facteur confessionnel comme ressource politique dans leur rivalité, afin de mobiliser des acteurs locaux à leur profit.
Les effets sont doubles : d’une part, les tensions entre sunnites et chiites sont aujourd’hui indissociables de la rivalité entre Iran et Arabie saoudite ; d’autre part, la confrontation entre Saoudiens et Iraniens en est elle-même exacerbée. Derrière les chiites arabes, les dirigeants sunnites du Levant et du Golfe voient souvent la main de l’Iran, qui utiliserait les populations chiites présentes sur leur sol comme une sorte de « cinquième colonne » ; de son côté, l’Iran a le sentiment d’entre encerclé par l’Occident et par ses relais sunnites arabes – et pakistanais.
Des Etats du Golfe divisés
L’absence d’homogénéité de ce que l’on pourrait appeler un peu rapidement le « camp chiite », n’est pas sans équivalent du côté du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Ses membres, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et Oman, sont tout d’abord divisés sur la question de l’Egypte et celle du soutien à apporter à l’islam politique, en particulier les Frères musulmans. Le rappel des ambassadeurs d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et du Koweït en poste au Qatar l’a montré au grand jour en mars 2014. En dépit d’un certain apaisement, les tensions demeurent (246).
Il n’existe pas davantage de front uni sur la question de l’Iran, bien que le CCG ait largement été créé en réponse à sa menace, en 1981. Oman, qui entretient historiquement une relation de bon voisinage avec l’Iran, a facilité les négociations secrètes avec les Etats-Unis qui ont conduit à l’accord intérimaire de Genève sur le programme nucléaire. Le Qatar, qui partage avec l’Iran le champ gazier d’où il tire l’essentiel de ses richesses, s’efforce d’entretenir des relations régulières et courtoises, sinon cordiales, avec ce pays. Malgré un différend territorial, les Emirats servent de plaque tournante pour les échanges avec l’Iran, via Dubaï. Les Koweïtiens, quant à eux, sont très attachés au CCG et accueillent une importante base américaine sur leur sol, mais ils ont aussi développé un dialogue global avec l’Iran.
b. Une détente envisageable entre l’Arabie saoudite et l’Iran, mais à quelles conditions ?
Devant l’aggravation des tensions régionales, qui alimente les crises et renforce l’antagonisme entre sunnites et chiites, toute possibilité de détente doit être exploitée.
– Dès son élection, le président iranien Rohani a fait preuve d’un certain esprit d’ouverture en déclarant que l’amélioration des relations avec les pays voisins du Golfe faisait aussi partie de ses priorités. Le président iranien a très vite qualifié l’Arabie saoudite de pays « ami et frère », ce qui tranche singulièrement avec la tonalité de l’ancien président Ahmadinejad. Plusieurs visites importantes ont ensuite paru amorcer un début de rapprochement. Le ministre des affaires étrangères Saud al-Faysal s’est ainsi entretenu avec son homologue Javad Zarif à New-York en septembre 2014, avant de rencontrer à Djeddah le vice-ministre iranien Hossein Amir Abdollahian pour des discussions sur la lutte contre Daesh. A ce stade, pourtant, ce ballet diplomatique ne s’est traduit par aucune avancée visible. Même la montée en puissance d’un ennemi commun, Daesh, qui représente une menace mortelle tant pour le régime iranien que pour celui de l’Arabie saoudite, ne s’est traduite pour l’instant par aucun rapprochement véritable.
– Le règlement du contentieux nucléaire iranien pourrait aider à franchir une étape, en offrant une base pour construire de nouvelles relations au plan bilatéral, ainsi qu’une relation à trois avec les puissances occidentales.
Un accord sur le nucléaire iranien constituerait en effet un premier pas en avant, susceptible de créer une dynamique positive. Il ferait disparaître une cause de tensions dans la région et un abcès de fixation majeur pour ces mêmes tensions. Un accord montrerait aussi que l’Iran est prêt à faire des compromis et à s’engager dans une relation constructive. Une bonne application de l’accord avec l’Iran serait également de nature à rétablir progressivement la confiance.
Qui plus est, un accord sur le nucléaire permettrait d’engager l’Iran dans de nombreux domaines, non seulement en matière de développement économique, mais aussi sur les questions régionales. La Mission ne peut que se réjouir de cette perspective, car elle ne pense pas que l’isolement de l’Iran constitue un facteur de changement positif. Des canaux ont été progressivement rétablis avec les Iraniens (247), mais les échanges et surtout les coopérations restent en grande partie bloqués tant qu’un accord sur le nucléaire n’a pas été conclu.
Sur les principaux dossiers régionaux, il s’agit de donner à l’Iran la possibilité de montrer concrètement qu’il peut jouer un rôle constructif, comme ses dirigeants ne manquent jamais de l’affirmer. Inviter et encourager l’Iran à participer à des solutions régionales aux crises n’est pas un gage de succès, mais ne pas inclure ce pays serait un échec assuré. Du fait de la nature des crises en Syrie, en Irak, au Liban ou encore au Bahreïn, les solutions ne seront que régionales. Le président Rohani a rappelé à juste titre au cours de sa campagne électorale que l’Iran détient de nombreuses clefs. Il convient donc de faire le pari de la participation de l’Iran, s’il y a une raison de penser qu’une disponibilité existe du côté iranien comme du côté saoudien.
A ce titre, il faut rappeler que la France s’était dite ouverte à la participation de l’Iran à la conférence de « Genève 2 » sur la crise syrienne (248), au début de l’année 2014. Mais l’Iran n’avait pas pu confirmer son acceptation du communiqué de Genève, qui était la base des tentatives de négociations. La France n’était pas davantage hostile à une participation iranienne à la conférence de Paris sur l’avenir de l’Irak, organisée en septembre dernier, mais il semblerait que les Saoudiens s’y soient opposés.
– Si le règlement négocié du contentieux nucléaire iranien peut servir de clef pour déverrouiller la relation avec l’Arabie saoudite, l’enchaînement ne sera pas mécanique. Sans un certain nombre de précautions, l’effet pourrait même être inverse.
Du côté saoudien, l’appel téléphonique historique entre les Présidents Obama et Rohani, en septembre 2013, puis l’annonce du plan d’action conjoint sur le programme nucléaire iranien, au mois de novembre suivant, ont manifestement suscité une grande inquiétude. Loin de conduire à une détente, un accord sur le nucléaire pourrait pousser à une crispation supplémentaire. Selon M. François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, les Saoudiens « sont tétanisés à l’idée que l’Iran pourrait sortir de sa cage. Ils redoutent que l’hégémonie politique, stratégique et économique de l’Iran puisse jouer à plein dans la région (249) et que la présence militaire américaine, qui demeurera, par nécessité de garder un pied sur le tuyau de pétrole, ne soit plus à leur service ». L’Arabie saoudite n’a pas de puissance tutélaire de rechange face à ce qu’elle perçoit comme une volonté d’hégémonie iranienne.
Les interrogations sur d’éventuelles réactions négatives au plan régional en cas de succès des négociations avec l’Iran concernent le plus souvent les Israéliens (250). La réaction saoudienne est tout aussi importante, non pas tant pour les chances de succès d’un accord, qui dépendent moins des réactions saoudiennes que de l’attitude d’Israël, que pour les possibilités d’un déblocage relatif de la situation au plan régional.
Un éventuel accord devra s’accompagner de messages et d’engagements très clairs de la part des Américains. Le Président Obama a d’ailleurs présenté sa vision stratégique de manière très prudente : il ne s’agit pas d’opérer un changement d’alliance, mais de chercher un « nouvel équilibre » entre Saoudiens et Iraniens. Il faudra convaincre les premiers que le rapprochement avec l’Iran ne privera pas le Golfe de son rôle de pilier stratégique dans la région, ni de sa place dans les priorités américaines, et que l’on pourra toujours compter sur les Etats-Unis comme allié de sécurité, malgré l’abandon du président égyptien Moubarak, qui a profondément marqué les esprits en 2011, et ce qui est perçu comme une politique de grande faiblesse dans la lutte contre Bachar el-Assad en Syrie.
La responsabilité de rassurer les Saoudiens incombe à titre principal aux Américains, mais la France pourrait utilement faire passer des messages à Washington sur ce sujet. S’il peut être utile d’insister également auprès des Saoudiens sur l’utilité d’un rapprochement avec l’Iran, pour régler ou du moins tenter d’apaiser les crises qui déchirent la région, tout ce qui pourrait être perçu comme un accent sur la nécessité d’une telle conciliation avec l’Iran serait évidemment contreproductif, pour les raisons qui viennent d’être exposées.
Du côté iranien, une détente des relations avec l’Arabie saoudite pourrait surtout se heurter à un obstacle interne. Selon F. Gregory Gause III, dans l’article précité, les Gardiens de la révolution et, bien sûr, le Guide suprême, conservent la haute main sur la politique régionale de l’Iran. Ils restent très attachés à la préservation des gains obtenus par l’Iran dans son voisinage, en particulier par un soutien sans faille au régime de Bachar el-Assad. Cette répartition des dossiers est d’ailleurs une des raisons conduisant à éviter tout lien entre les questions régionales et celle du nucléaire. Comme la Mission l’a indiqué précédemment, il ne faudrait surtout pas « contaminer » la gestion du dossier nucléaire (251).
Comme la Mission l’a précédemment rappelé, le Président Rohani s’est engagé à développer une logique « d’interactions constructives », y compris au plan régional. Encore faudrait-il qu’il y soit autorisé par le Guide. Aujourd’hui, son mandat passe pour se limiter principalement à la réinsertion internationale du pays et à l’amélioration de sa situation économique. Un succès dans les négociations sur le dossier du nucléaire est néanmoins susceptible de renforcer la crédibilité et l’assise du président Rohani au sein du régime, ce qui pourrait permettre d’élargir, dans un second temps, son mandat ou son influence aux questions régionales. Une telle issue n’est évidemment pas acquise à ce stade.
Quelles perspectives pour les relations avec la Turquie ?
En ce qui concerne cette autre puissance régionale sunnite qu’est la Turquie, il faut rappeler qu’un rapprochement s’était déroulé avec l’arrivée au pouvoir de l’AKP en 2002. La politique turque de « zéro problème avec les voisins », qui visait à faciliter l’expansion économique du pays et à accroître son rôle régional, s’appliquait notamment à l’Iran. L’ancien Président Ahmadinejad avait reçu un accueil chaleureux à Istanbul en 2008 et les liens économiques entre les deux pays avaient rapidement crû. Avec le Brésil, la Turquie a également essayé de s’impliquer positivement dans la crise nucléaire iranienne en 2010.
La crise syrienne a profondément divisé l’Iran et la Turquie et affecté leurs relations. Un accord sur le nucléaire iranien et la levée des sanctions pourraient faciliter la relance de relations bilatérales fructueuses sur les questions économiques, mais aussi régionales. Des visites ont déjà eu lieu au niveau des ministres des affaires étrangères, et M. Erdogan s’est rendu à Téhéran dès janvier 2014 pour y rencontrer le Président Rohani, ainsi que le Guide.
c. Des relations entre l’Iran et Israël peu susceptibles d’évoluer à la suite d’un accord sur le nucléaire iranien
Si l’on peut placer des espoirs raisonnables dans une détente entre l’Arabie saoudite et l’Iran, dans l’hypothèse où les négociations relatives au programme nucléaire iranien se termineraient par un accord solide et crédible, les perspectives paraissent singulièrement plus limitées en ce qui concerne les relations entre l’Iran et Israël.
– Du côté iranien, en particulier dans les cercles conservateurs, l’opposition à Israël résulte moins d’une rivalité géopolitique, comme c’est le cas vis-à-vis de l’Arabie saoudite, que d’une hostilité idéologique. Comme le note Alireza Nader dans une évaluation des conséquences potentielles d’un accord avec l’Iran pour les équilibres régionaux (252), cette position fondamentale a peu de chance d’évoluer si un tel accord sur le nucléaire est conclu. A ce stade, il est en particulier bien peu probable que l’Iran cesse de soutenir les acteurs les plus hostiles à Israël, tels que le Hamas et le Hezbollah.
Quelques inflexions peuvent toutefois être notées dans le discours du Président Rohani qui, sans être conciliant, est dépourvu de l’outrance et de l’agressivité qui caractérisaient la rhétorique de son prédécesseur. A la différence de M. Ahmadinejad, M. Rouhani est capable d’utiliser directement le terme d’Israël, à la place de la référence à « l’entité sioniste ». Comme le rapporte Alireza Nader, le président iranien a condamné la Shoah, dont M. Ahmadinejad niait l’existence, et parle de « blessure » à propos de la question israélo-palestinienne, quand son prédécesseur décrivait en Israël un « cancer » régional. Le ministre des affaires étrangères, M. Zarif, a de son côté déclaré à la télévision allemande que Téhéran était prêt à reconnaître l’Etat d’Israël dans l’éventualité d’une paix avec les Palestiniens. Les propos du Guide suprême restent toutefois empreints d’une profonde animosité à l’égard d’Israël.
– Du côté israélien, il faut rappeler que le plan d’action conjoint de novembre 2013 a été accueilli avec la plus grande hostilité. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, « ce qui s’est passé à Genève n’est pas un accord historique, mais une erreur historique ». Depuis son élection, M. Rohani est dépeint comme un « loup déguisé en mouton », plus dangereux encore que son prédécesseur parce que son style et ses prises de position seraient susceptibles de diviser la communauté internationale sur la question iranienne. Dans le même temps, la ligne fondamentale du régime, fixée par le Guide, n’aurait pas changé.
Contrairement à la solution qui est esquissée dans l’accord intérimaire de Genève, les dirigeants israéliens voudraient un démantèlement complet des installations nucléaires iraniennes, considérant que toute autre hypothèse ne ferait que permettre à l’Iran de gagner du temps pour faire avancer silencieusement son programme nucléaire. Il n’est cependant pas inenvisageable qu’Israël accepte un accord à condition que ses paramètres permettent d’écarter suffisamment l’Iran de la bombe.
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés si un accord est conclu avec l’Iran (253). Une première hypothèse verrait Israël s’adapter à un accord pourtant perçu comme imparfait, en renforçant ses capacités de défense anti-missiles et en accroissant la coopération qui existe de facto avec certains Etats de la région. Mais il ne faut pas exclure le scénario d’une dénonciation publique de l’accord, suivie de frappes militaires. Cette hypothèse paraît moins vraisemblable si l’accord est largement accepté au plan international, d’autant que l’institution militaire israélienne passe pour être réservée à l’égard d’une intervention contre les installations nucléaires iraniennes. A défaut de frappes sur l’Iran, une dénonciation de l’accord pourrait s’accompagner d’autres mesures, telles qu’un lobbying intense auprès du Congrès américain pour essayer de faire rejeter un accord qui serait perçu comme dangereux par les dirigeants israéliens.
Dans toutes les hypothèses, des évolutions bien plus significatives qu’un accord sur le programme nucléaire iranien seront probablement nécessaires pour que l’on puisse envisager un changement majeur dans les relations entre l’Iran et Israël.
2. Des coopérations ou des compromis envisageables sur des sujets régionaux d’intérêt commun en cas de détente des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran
Une réintégration de l’Iran au plan international, couplée à un apaisement des tensions régionales, pourrait ouvrir la possibilité d’engager des coopérations et d’aboutir à des compromis ponctuels avec l’Arabie saoudite, afin de régler un certain nombre de dossiers présentant un intérêt commun. Cette perspective paraît encore incertaine, mais la Mission considère qu’elle doit être envisagée avec sérieux et qu’elle mérite de faire l’objet d’un travail de préparation. Il convient de réfléchir au « jour d’après », c’est-à-dire à la manière d’engager l’Iran, sans attendre la conclusion d’un éventuel accord sur son programme nucléaire.
a. Prolonger quelques précédents positifs récents au Liban et en Irak ?
– Plusieurs évolutions récentes, certes limitées mais positives, permettent de penser que des inflexions significatives ne sont pas hors de portée.
Au Liban, une convergence relative s’est dessinée entre l’Arabie saoudite et l’Iran afin d’éviter la déstabilisation complète du pays du fait de la crise syrienne et de la menace posée par Daesh, une telle évolution catastrophique n’étant dans l’intérêt d’aucune des deux parties. Le directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères, M. Jean-François Girault, a très clairement expliqué ces efforts parallèles en direction des principaux camps libanais : « alors que la situation semblait critique à la fin de l’année [2013], l’Iran a pesé sur le Hezbollah pour la formation d’un nouveau Gouvernement et l’Arabie saoudite a permis au mouvement du 14 mars de s’asseoir à la table du Conseil des ministres avec des membres du Hezbollah » (254). Un dialogue officiel entre le Hezbollah et le Courant du futur, soutenu par l’Arabie saoudite, s’est également mis en place. Selon le secrétaire général du Hezbollah, les différentes séances qui ont eu lieu auraient contribué à l’apaisement des tensions confessionnelles et à la maîtrise de soi des différentes factions libanaises.
Une autre inflexion notable s’est produite en Irak, où le départ du Premier ministre Nouri al-Maliki, qui cristallisait les mécontentements et s’était aliéné beaucoup de soutiens dans son propre camp, n’aurait pas été possible sans l’accord de l’Iran, compte tenu de son influence sur de nombreux acteurs chiites. Cette évolution a pour caractéristique de favoriser un déblocage de la situation, même s’il est encore partiel et à confirmer, tout en préservant les intérêts de l’Iran. M. al-Abadi dirige un gouvernement toujours emmené par les chiites et proche de l’Iran, mais moins sectaire et probablement plus efficace dans les efforts contre Daesh.
– Ces deux exemples restent des exceptions, à la portée qui plus est limitée, mais ils tendent à montrer que l’Iran et l’Arabie saoudite sont capables de faire preuve de retenue dans leur rivalité stratégique sur certains théâtres extérieurs, lorsque des intérêts supérieurs les y poussent. Les Saoudiens et les Iraniens ont fait la démonstration qu’ils pouvaient gérer ponctuellement leurs différends, voire tolérer les intérêts de l’autre partie, comme c’est le cas au Liban. Il n’est donc pas inenvisageable qu’une détente bilatérale offre l’occasion de réduire l’intensité d’autres crises, voire de les régler. La rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite est probablement appelée à persister, car elle est profondément ancrée et va très au-delà de la seule crise nucléaire. Mais elle n’est pas nécessairement vouée à prendre la forme d’un affrontement systématique par acteurs locaux interposés.
En Syrie, théâtre de l’affrontement le plus violent entre les deux camps et source de tensions qui rejaillissent sur les autres crises, en les exacerbant, l’Iran et l’Arabie saoudite partagent des objectifs communs de long terme. Malgré de nombreuses divergences, les deux parties souhaitent éviter que le pays ne s’effondre complètement, comme la Libye, et qu’il ne devienne un sanctuaire durable pour les djihadistes, ces derniers étant considérés comme une menace mortelle des deux côtés. Le conflit est par ailleurs très clairement une confrontation non seulement dévastatrice, mais également sans issue et très coûteuse à tous égards.
Différentes hypothèses, nullement exclusives, peuvent donc être envisagées dans ce pays : une désescalade régionale concertée pourrait voir l’Iran et l’Arabie saoudite cesser progressivement d’alimenter le feu, ce qui serait susceptible de pousser les acteurs directs du conflit à essayer de négocier, ou du moins de réduire les conséquences dramatiques des affrontements ; un scénario positif « à la Maliki » ne paraît pas non plus devoir être exclu, c’est-à-dire le remplacement d’un dirigeant qui cristallise le conflit et empêche son règlement, en l’occurrence Bachar el-Assad, dans des conditions qui permettraient de sécuriser les intérêts fondamentaux de l’Iran – conserver une influence sur la Syrie, éviter que le pays ne tombe complètement dans le camp sunnite et préserver un accès au Liban et en particulier au Hezbollah ; si ces différentes mesures pouvaient être appliquées, ne pourrait-on pas même imaginer une sorte de neutralisation de la Syrie, avec des garanties mutuelles destinées à préserver les intérêts de chacune des parties ?
Outre la crise syrienne, il resterait aussi beaucoup à faire ailleurs, notamment au Liban. La convergence entre Saoudiens et Iraniens a certes facilité la formation d’un gouvernement d’unité, mais elle n’a pas encore permis de mettre un terme à l’absence préoccupante d’un Président de la République depuis la fin du mandat de Michel Sleimane. Les pouvoirs du Président libanais sont limités, mais il joue malgré tout un rôle de clef de voûte particulièrement utile dans la période très dangereuse que le Liban traverse. En Irak, les Iraniens pourraient probablement exercer une influence sur certains acteurs chiites afin d’accélérer les réformes nécessaires pour la réconciliation nationale et la réintégration des sunnites dans le jeu irakien (255). Une coopération serait tout aussi nécessaire au Yémen, dont la transition politique négociée et mise en œuvre sous l’égide du Conseil de coopération du Golfe a été brutalement interrompue par l’action des rebelles Houthistes, soutenus par l’Iran (256). Ce pays pourrait faire passer des messages utiles à ceux qui sont susceptibles de les écouter. Quant au Bahreïn, l’Arabie saoudite et l’Iran pourraient contribuer à y apaiser les tensions confessionnelles, alimentées par les accusations de mainmise iranienne proférées par les Saoudiens et par le fait que l’Iran prend la défense de chiites dont les revendications restent locales (257). L’atténuation de ces tensions pourrait favoriser une ouverture plus grande aux réformes.
– La réalisation de tels accommodements dépend au premier chef des parties prenantes. Des acteurs extérieurs, tels que la France, pourraient néanmoins apporter une contribution utile en organisant une large conférence diplomatique consacrée aux questions régionales et ouverte à l’ensemble des acteurs concernés, y compris l’Iran, sur le modèle des Conférences sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui ont été organisées à partir du début des années 1970.
La régionalisation de la plupart des crises du Proche et Moyen-Orient impose de trouver des solutions elles-mêmes régionales, associant toutes les parties, sans exclusive. Un cadre multilatéral plus large, qui pourrait notamment associer les pays du G7, serait de nature à faciliter des discussions visant à éviter la répétition d’un face-à-face dont la stérilité et le coût ne sont hélas plus à démontrer. Enfin, si les solutions que l’on espérer sont probablement appelées à rester ponctuelles et partielles, un cadre d’ensemble peut être utile. La lutte d’influence se joue en effet au plan régional. C’est à cette échelle-là qu’il faut se placer.
Les difficultés précédemment rencontrées pour faire participer l’Iran aux discussions de Genève sur la Syrie et à la conférence sur l’avenir de l’Irak, organisée par la France, laissent entrevoir les obstacles qui pourraient se dresser sur la voie d’une telle conférence régionale. Elle ne pourrait probablement être organisée que s’il existe une réelle perspective de détente entre l’Arabie saoudite et l’Iran, favorisée par un accord sur le nucléaire iranien, lequel ne serait qu’un commencement.
b. D’importantes incertitudes demeurent
La réalisation de telles coopérations, de toute évidence nécessaires mais encore très hypothétiques, dépendra notamment de trois facteurs : la volonté de coopérer de l’Iran, c’est-à-dire la réponse apportée à la question récurrente de ses tentations hégémoniques, que l’Arabie saoudite ne manque pas de dénoncer ; le mandat qui pourrait être accordé au Président Rohani pour la gestion des questions régionales ; mais aussi les ambitions des acteurs locaux par l’intermédiaire desquels l’Iran et l’Arabie saoudite rivalisent aujourd’hui en termes d’influence.
– Depuis l’élection de M. Rohani, les Iraniens répètent à l’envi que le dialogue est nécessaire, ce qui est exact dans la mesure où l’Iran est effectivement un grand pays sans la participation duquel la région ne connaîtra probablement pas d’apaisement. Selon un haut responsable français que la Mission a pu rencontrer, il resterait toutefois à savoir si l’Iran souhaite un tel apaisement et ce qu’on peut lui donner en échange. Comme l’a observé ce même interlocuteur, la situation est catastrophique partout où l’Iran exerce une influence décisive, en Irak, en Syrie comme au Liban.
M. Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, a fait valoir devant la mission d’information que si les Iraniens « ont été une puissance régionale négative jusqu’à présent, c’est parce qu’on ne voulait pas d’eux ». Selon lui, « les Iraniens sont prêts à concéder beaucoup pour leur respectabilité », même s’il reste à gérer « l’héritage du passé : le Hezbollah, le soutien à la Syrie, que les Iraniens ne veulent pas abandonner, et le programme nucléaire pour lequel l’option du démantèlement complet est politiquement impensable en Iran » (258).
Selon M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, de 2001 à 2005, « les Iraniens estiment qu’une place éminente leur est due au plan régional, parce qu’ils sont une vieille nation, chargée de civilisation (on imprime plus de livres en Iran, chaque année, que dans l’ensemble du monde arabe), et parce qu’ils sont dotés d’une masse démographique (environ 75 millions d’habitants) très supérieure à celle de n’importe lequel de leurs voisins. L’Iran n’a pas conduit de guerre depuis le XIXe siècle, hormis l’aide apportée au sultan d’Oman en 1973 pour écraser une rébellion d’obédience communiste. La vision iranienne de son rôle dans la région est plutôt celle d’une « influence naturelle ». Mais les Saoudiens, pris dans une relation du faible au fort, ne voient pas les Iraniens de cette manière, les considérant comme une puissance prête à les écraser et à prendre le contrôle de la péninsule ».
La Mission estime qu’il ne faut pas sous-estimer l’intérêt bien compris des Iraniens à faire preuve d’un comportement constructif afin d’obtenir la reconnaissance du rôle de puissance régionale qu’ils revendiquent et dont ils perçoivent la négation comme une injustice historique. Un comportement responsable, c’est-à-dire coopératif et constructif, est un élément essentiel dans cette perspective. Pour être un acteur respecté, il n’est pas inutile de faire la preuve que l’on est respectable.
– La question du mandat qui pourrait être accordé à M. Rohani pour la gestion de la politique régionale a été abordée précédemment. Elle est essentielle dans la mesure où la plupart des analystes estiment que cette politique est aujourd’hui entre les mains d’acteurs, le Guide et les Pasdarans, dont on peut penser que la pente naturelle ne va nullement vers une approche réelle de compromis (259).
En cas de succès des négociations sur le programme nucléaire, l’hypothèse d’une extension du mandat de M. Rohani n’est pas à exclure. Il s’agirait en quelque sorte d’étendre géographiquement le champ d’application des principes énoncés par M. Rohani pour son « gouvernement de la prudence et de la modération ». Comme la Mission l’a indiqué précédemment, M. Rohani lui-même a évoqué la perspective d’interactions plus constructives au plan régional.
Cette évolution reste à confirmer et elle dépendra étroitement du succès des négociations nucléaires. La conclusion d’un accord dans ce domaine semble donc un point de passage obligé pour ouvrir concrètement la voie à des possibilités de coopération avec l’Iran sur un certain nombre de sujets d’intérêt commun.
– Le fait que la lutte d’influence régionale entre l’Iran et l’Arabie saoudite se déroule par l’intermédiaire de relais locaux conduit enfin à s’interroger sur la détermination de ces acteurs à participer à la mise en oeuvre d’éventuelles solutions coopératives auxquelles pousseraient leurs « parrains » respectifs. En Syrie, par exemple, les groupes armés soutenus par les puissances régionales sunnites ont un ancrage local et un agenda qui leur est propre. Il en est de même au Yémen pour les miliciens Houthistes que l’on dit parrainés par l’Iran, sans qu’il existe probablement de véritable lien de subordination.
Dans la majorité des cas, même s’ils parvenaient à s’entendre, l’Arabie saoudite et l’Iran ne pourraient sans doute qu’exercer une certaine forme d’influence sur le comportement des acteurs qu’ils soutiennent. En Syrie, il reste notamment à savoir quel pourrait être le degré de coopération de Bachar el-Assad dans la mise en œuvre d’une solution de compromis qui ne le maintiendrait que partiellement et temporairement au pouvoir, afin d’éviter un effondrement de l’Etat particulièrement redouté par l’Iran, tout en transférant une partie significative de ses pouvoirs à d’autres membres du régime.
3. Vers un rapprochement limité avec les Etats-Unis ?
L’idée qu’un accord sur le nucléaire iranien pourrait conduire à une évolution significative des relations irano-américaines, au détriment des liens étroits qui unissent les Etats-Unis et leurs alliés régionaux actuels, est une cause profonde de préoccupation dans le Golfe. Elle paraît néanmoins peu justifiée, même si les négociations sur le dossier nucléaire se sont accompagnées du déverrouillage des relations avec l’Iran, fermées à double tour depuis 1979.
Il est vrai que le Président Rohani et son ministre des affaires étrangères, M. Zarif, ont fait part de leur souhait d’améliorer les relations avec les Etats-Unis. Des rapprochements sont envisageables sur certains sujets, notamment l’Afghanistan, où une coopération a déjà eu lieu en 2002, lorsque les Iraniens ont aidé les Américains à établir un nouveau gouvernement à Kaboul. L’Iran a néanmoins été placé l’année suivante dans « l’Axe du mal » par les Américains. Les deux pays partagent une préférence très nette pour un Afghanistan stable, où les Talibans exerceraient aussi peu d’influence que possible. L’extrémisme sunnite est également une menace commune en Irak et en Syrie, en dépit de profondes divergences sur ces deux pays.
Bien que des coopérations ponctuelles et discrètes soient vraisemblables entre les Etats-Unis et l’Iran, dans l’hypothèse d’un accord sur le dossier nucléaire, une normalisation complète des relations ne paraît pas à l’ordre du jour.
– Du côté iranien, le Guide a accepté de soutenir les négociations afin de lever les sanctions et la pression économique sur l’Iran, mais on peut douter qu’il souhaite aller au-delà. Il se satisferait probablement du simple passage d’une « absence dysfonctionnelle de relation » avec les Etats-Unis à une « absence fonctionnelle de relation » avec eux (260). La politique de changement de régime longtemps pratiquée par les Etats-Unis, en dépit des engagements souscrits en 1981 dans le cadre des accords d’Alger, a laissé des traces. Les conservateurs iraniens continuent à voir dans les Etats-Unis une puissance déterminée à renverser ou à saper de l’intérieur le régime et à rétablir un ordre politique pro-américain au plan régional. Ils craignent par ailleurs un déferlement culturel américain perçu comme contraire à la Révolution islamique et comme une menace pour sa pérennité.
Sur le plan des principes, la « résistance » aux Etats-Unis et à l’impérialisme occidental reste un fondement de la République islamique d’Iran, au même titre que le rejet d’Israël. Si l’Iran a largement renoncé à exporter sa révolution, il paraît difficile à ce stade qu’il renonce à ses principes fondateurs en rétablissant des relations normales avec les Américains. Une hostilité maîtrisée servirait davantage les intérêts du régime tels que le Guide suprême et les conservateurs iraniens pourraient les concevoir.
– D’autres obstacles sont à attendre du côté des Etats-Unis, en particulier au Congrès, pour qui le programme nucléaire iranien est loin d’être l’unique motif de préoccupation. Le Congrès a adopté depuis longtemps des sanctions à l’égard de l’Iran en raison de son soutien à des organisations terroristes telles que le Hamas et le Hezbollah, mais aussi pour sa situation en matière de droits de l’Homme.
Un tabou vieux de 35 ans a été brisé avec le rétablissement de contacts publics au plus haut niveau entre les dirigeants américains et iraniens, mais il reste difficile d’imaginer un parallèle avec la normalisation annoncée des relations entre les États-Unis et Cuba. Les différences sont nombreuses : contrairement à l’Iran, Cuba n’est plus perçu comme représentant une menace au plan régional ; par ailleurs, la perte de vitesse du régime castriste n’est certainement pas comparable avec la situation interne de la République islamique d’Iran.
IV. LA QUESTION ISRAÉLO-PALESTINIENNE : UN CONFLIT LANCINANT
L’urgence d’un règlement négocié du conflit n’a jamais été aussi grande, alors que les positions des parties prenantes sont plus que jamais antagonistes et que la viabilité de la solution des deux États est chaque jour plus menacée.
L’échec de la reprise des pourparlers, suivi de la crise de Gaza, cet été, ont marqué la fin du cycle de négociations ouvert par les accords d’Oslo au début des années 1990. D’aucuns évoquent même la fin d’un cycle historique. Le succès d’une énième tentative de médiation américaine selon le format bilatéral étant hypothétique, seule une initiative internationale ferme et concertée, aux objectifs et au calendrier clairement identifiés, est à même de mettre fin à un conflit dont, faut-il le rappeler, les premières victimes sont les peuples israélien et palestinien, et dont le non-règlement est d’autant plus coupable que les paramètres en sont depuis longtemps connus. La France, avec l’Union européenne, doit, aux côtés des Américains et des États arabes, y jouer un rôle à la mesure de ses intérêts stratégiques dans la région.
Si nous voulons que 2015 ne soit pas, à nouveau, une année perdue pour la paix, il faut impérativement que la reprise des négociations s’accompagne d’un changement de méthode : il est illusoire et dangereux de compter sur la seule volonté des parties au conflit, tant la défiance est grande dans les deux camps, tant l’absence d’horizon politique pour les deux peuples renforce dangereusement les extrêmes, tant une part croissante de la population porte un regard sceptique sur le processus de paix, paix à laquelle pourtant elle aspire.
A. 2014 OU LA MORT D’OSLO : L’IMPASSE DU PROCESSUS DE PAIX EST TOTALE, LE STATU QUO, INTENABLE ET DANGEREUX
1. Un processus qui n’a plus de paix que le nom, alors que la solution des deux États s’éloigne plus que jamais
Le rappel des évènements de l’année 2014 offre un condensé des obstacles à la paix, et symbolise l’impasse du « processus » censé mettre fin au conflit depuis les accords d’Oslo (261) : reprise et échec des pourparlers, nouveau conflit avec Gaza, montée des tensions en Cisjordanie et à Jérusalem, poursuite de la colonisation côté israélien, stratégie alternative onusienne et divisions internes côté palestinien.
Or, si statu quo il y a dans les négociations, ce n’est pas le cas sur le terrain, et le temps joue contre la seule solution viable à la question israélo-palestinienne, d’ailleurs principal acquis d’Oslo : la reconnaissance mutuelle de deux États souverains, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Si nous voulons sauver cette option, qui n’a pas d’alternative, il ne faudra donc pas seulement « tenter » de revivifier un processus moribond, mais se donner les moyens d’aboutir à un accord pérenne.
a. Le terrible bilan de l’année 2014 : l’ultime échec de la tentative américaine de reprise des pourparlers et la reprise du cycle de la violence
● L’espoir, certes mesuré, suscité par la reprise des pourparlers de paix, a été rapidement éclipsé par un nouveau conflit, particulièrement meurtrier, à Gaza
Après trois ans d’interruption, le Secrétaire d’État américain, John Kerry, parvient à relancer le dialogue israélo-palestinien le 19 juillet 2013. Le 30 juillet 2013, il justifie la reprise des pourparlers aux côtés de la ministre de la justice israélienne, Tzipi Livni, et du négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, en déclarant qu’« une solution viable à deux États est la seule voie pour résoudre ce conflit. Il ne reste pas beaucoup de temps pour arriver et il n’y a pas d’alternative ».
Un calendrier de neuf mois a été établi pour parvenir à un accord. Aucun compromis formel n’a été trouvé quant aux termes de référence de la négociation, qui reposera donc sur la bonne volonté des parties et l’engagement personnel du Secrétaire d’État, qui multiplie les visites sur place. La reprise des négociations repose cependant sur l’engagement tacite des Israéliens à libérer graduellement 104 prisonniers palestiniens, condamnés en majorité pour des actes de terrorisme avant les accords d’Oslo, contre un engagement palestinien à renoncer à leurs initiatives onusiennes.
La discussion, qui aborde les questions relatives à un accord final que sont les frontières, les réfugiés, Jérusalem, la sécurité et l’eau, bute notamment sur la volonté des autorités israéliennes d’une reconnaissance du caractère juif de l’État d’Israël, que la partie palestinienne refuse, et le statut de Jérusalem, dont Israël récuse la partition. Le refus d’Israël, annoncé fin mars 2014, de procéder à la libération de la dernière vague de prisonniers sera une des raisons contribuant à faire échouer les pourparlers. (262)
Le 23 avril 2014, le Hamas et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) signent un accord de réconciliation en vue de créer un gouvernement d’union nationale. L’initiative, soutenue par les États-Unis et l’Union européenne, provoque la colère du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui déclare qu’« au lieu de choisir la paix avec Israël, Abou Mazen opte pour la paix avec le Hamas ».
L’enlèvement, aux environs de la colonie de Gush Etzion au sud de Jérusalem, de trois jeunes Israéliens, le 12 juin 2014, marque l’avènement d’une nouvelle crise. Les autorités israéliennes réagissent rapidement : l’opération « Gardien de nos frères » est lancée pour tenter de les retrouver. En 48 heures, près de 400 militants du Hamas sont arrêtés en Cisjordanie. Le mouvement islamiste riposte par des tirs de roquette sur Israël, qui entreprend des raids aériens sur Gaza. Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, condamne l’enlèvement, six jours après les faits. Selon lui, « celui qui a enlevé les trois jeunes Israéliens cherche à nous détruire ».
Les adolescents sont retrouvés morts le 30 juin, dans le sud de la Cisjordanie, près de la ville d’Hébron, provoquant un immense choc au sein de la société israélienne. Le pays est divisé sur l’ampleur de la riposte : certains plaident pour la retenue, alors qu’une partie de la droite appelle à la destruction du Hamas. Le Premier ministre israélien promet de « faire payer le Hamas », qui nie être impliqué dans cet acte, mais a salué l’opération.
Quelques jours plus tard, le 1er juillet, un jeune Palestinien est brûlé vif dans une forêt située près de Jérusalem par des Israéliens, révoltant à son tour la presse palestinienne et accélérant l’escalade de la violence. Des émeutes ont lieu à Jérusalem-Est lors des funérailles, qui opposent des centaines de jeunes Palestiniens aux policiers israéliens. Ces heurts gagnent des localités arabes du nord d’Israël. De nombreux manifestants sont arrêtés.
Les tensions s’intensifient et le Hamas envoie plus d’une centaine de roquettes sur Israël le 7 juillet. Le lendemain, Israël engage une offensive aérienne, qu’elle nomme « Bordure protectrice », sur la bande de Gaza. Le pays rappelle 40 000 réservistes et s’engage dans une lutte aérienne, visant principalement les infrastructures militaires et les responsables du Hamas. Dans le même temps, le Hamas est parvenu au lancement de roquettes sur les principales villes israéliennes, dont Tel Aviv et Jérusalem.
Une trêve proposée par l’Égypte est accueillie favorablement par Mahmoud Abbas, invitant dès le 14 juillet au soir les parties à s’y conformer « pour épargner le sang de notre peuple et nos intérêts nationaux supérieurs ». Le Hamas rejette la proposition, suivi par le Jihad islamique, et les tirs de roquettes, qui se sont intensifiés tout au long de la journée et ont visé l’ensemble du territoire israélien, se poursuivent. Dans ce contexte, les bombardements israéliens reprennent, et le 17 juillet, l’offensive terrestre est lancée sur Gaza. Se succéderont ensuite des trêves humanitaires discontinues et entrecoupées d’épisodes de reprises des tirs de roquettes et des bombardements.
Le Premier ministre israélien rejette la responsabilité des morts civiles sur le Hamas, condamnant l’utilisation de « boucliers humains », et assure qu’il continuera de « défendre nos citoyens et de les protéger contre les tirs de roquettes et de démanteler le vaste réseau terroriste de tunnels destiné à pénétrer en territoire israélien ». Khaled Mechaal, chef du bureau politique du Hamas, déclare de son côté : « nous voulons un arrêt de l’agression dès demain, voire aujourd’hui ou en ce moment même. Mais une levée du blocus avec des garanties, et non pas une promesse pour des négociations ultérieures ». Il souhaite « une véritable trêve s’appuyant sur un véritable programme d’assistance pour le peuple de Gaza ».
Le 26 août, un accord en vue d’un cessez-le-feu à Gaza est accepté par les parties, sans limitation de durée. L’Égypte s’engage à en superviser les mécanismes de mise en œuvre. Il prévoit les stipulations suivantes :
– cessation de toutes les hostilités et retour à l’accord de cessez-le-feu établi le 21 novembre 2012 ;
– ouverture de tous les points de passage entre Gaza et Israël et respect de la liberté de circulation des personnes et des biens entre la Cisjordanie et la bande de Gaza ; fin des restrictions sur le mouvement des résidents, sur l’administration d’activités financières et économiques à Gaza et sur l’entrée de l’aide humanitaire ;
– reconstruction de Gaza : réparation des infrastructures, autorisation de l’entrée de matériaux de reconstruction ; extension de la zone de pêche à 6 miles ;
– ouverture de nouvelles négociations sous l’égide de l’Égypte et dont la durée ne devra pas excéder un mois après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Elles porteront sur les sujets de désaccord demeurant entre les parties (port, aéroport, échange des corps) et tout autre sujet que les parties jugeront utile d’aborder.
Au lendemain du cessez-le-feu, chacun revendique la victoire, mais les deux camps sont affaiblis.
Ainsi le 27 août, Benyamin Netanyahou a déclaré : « le Hamas a été frappé durement et n’a obtenu aucune de ses demandes pour signer le cessez-le-feu. Le Hamas exigeait pour signer un cessez-le-feu un port et un aéroport à Gaza, la libération de prisonniers palestiniens, une médiation qatarie puis turque, le paiement des salaires des fonctionnaires, d’autres demandes encore mais il n’a rien obtenu. Nous avons accepté d’aider à la reconstruction du territoire pour des raisons humanitaires mais uniquement sous notre contrôle. »
Cependant, selon un sondage publié par le quotidien Haaretz fin août 2014, réalisé auprès de 464 personnes représentatives de la population israélienne, à la question : « à la suite du cessez-le-feu auquel ont abouti Israël et le Hamas, comment qualifieriez-vous les résultats des combats ?», 54 % des personnes interrogées ont répondu qu’aucune des deux parties ne l’avait emporté; seuls 26 % estimaient qu’Israël avait gagné la bataille, contre 16 % pour le Hamas, le reste étant sans opinion. L’impact de la crise sur l’économie israélienne est aussi largement commenté (263).
Un haut responsable des renseignements militaires israéliens a déclaré, lors d’une rencontre avec la presse à Tel Aviv en septembre 2014, qu’Israël avait sous-estimé la ténacité des combattants palestiniens et n’avait pas prévu que l’offensive lancée dans la bande de Gaza se prolongerait pendant près de 50 jours. Il faut noter que quatre jours seulement après le début de l’opération terrestre à Gaza, l’armée israélienne a subi des pertes plus importantes (13 morts) que pendant chacune des opérations conduites depuis la guerre au Liban de l’été 2006 (« Plomb durci » et « Pilier de Défense »).
De son côté, le Hamas, qui a infligé à l’armée israélienne ses plus lourdes pertes depuis 2006, revendique lui aussi la victoire, assurant avoir défait « la légende de l’armée israélienne qui se dit invincible » et obtenu l’allègement du blocus, principale revendication des Palestiniens. Malgré l’ampleur des pertes humaines et des destructions matérielles, les résultats d’un sondage mené fin août (264) montrent que 79 % des Palestiniens interrogés jugent que le Hamas a remporté la guerre contre Israël. 70 % des sondés en Cisjordanie ont répondu qu’ils soutiendraient la transposition du modèle de résistance armée du Hamas en Cisjordanie. L’Autorité palestinienne n’obtient que 36 % d’opinions positives, contre 88 % pour le Hamas. Si des élections législatives étaient organisées aujourd’hui, 46 % des votants voteraient pour le Hamas, 31 % pour le Fatah et 7 % pour d’autres factions.
● La troisième crise en cinq ans laisse la bande de Gaza dans un état humanitaire et sécuritaire précaire
Après 51 jours d’hostilités, côté israélien, 66 soldats et six civils ont trouvé la mort. Côté palestinien, le nombre de victimes s’élève à près de 2 200 morts, dont 1563 civils et 538 enfants. S’y ajoutent, selon l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), plus d’un demi-million de déplacés durant la crise, dont près de 100 000 n’auraient à ce jour pas encore pu regagner leur domicile.
La bande de Gaza, isolée (265), se trouve dans une situation humanitaire et sécuritaire précaire. 22 000 habitations ont été détruites ou rendues complètement inhabitables (sur les 113 500 endommagées) ; 15 km de canalisations, 15 hôpitaux et 122 écoles ont été endommagés ; la centrale électrique de Gaza a été bombardée et plus de 5 000 entreprises et commerces ont été touchés.
De nombreuses personnes campent toujours dans les ruines de leur maison, dans des abris de fortune ou dans les écoles de l’UNRWA. L’approvisionnement en électricité demeure limité, malgré la remise en état de la centrale thermique de Gaza (cycles de 12 heures d’électricité par jour, 6 heures début janvier). Le système de santé est lui aussi particulièrement atteint selon le Comité international de la Croix Rouge.
Une conférence de donateurs internationaux, coprésidée par la France, a été organisée le 12 octobre 2014 au Caire, afin de financer la reconstruction de la bande de Gaza, la troisième en cinq ans.
Une aide internationale de 5,4 milliards de dollars y a été annoncée (266), dont la moitié en faveur de Gaza – sur les 4,1 milliards de dollars de coûts directs et pertes économiques estimés dans le plan de reconstruction palestinien (267). Un mécanisme des Nations unies (mécanisme « Serry ») visant à faciliter l’importation de matériaux dans Gaza, en tant que première étape vers une levée plus générale du blocus, y a en outre été approuvé.
Cependant, des promesses de dons faites au Caire, quasiment aucune n’a été effectivement versée. Les besoins pour le relogement sont estimés par l’UNRWA à 720 millions de dollars, mais seuls 135 millions ont été formellement annoncés, dont 100 effectivement reçus (notamment 55 millions de l’Arabie Saoudite et 20 millions de l’Allemagne). L’UNRWA a annoncé le 27 janvier 2015 qu’elle cessait, faute de fonds, son aide de transition, en dénonçant le non-respect des promesses internationales tenues au Caire.
L’ONG Oxfam estime quant à elle les besoins à 89 000 logements et 226 nouvelles écoles au minimum. Elle juge en outre que le volume de matériaux de construction entré à Gaza dans les trois mois suivant le cessez-le-feu correspond à moins d’un tiers de ce qui rentrait dans les trois mois précédant le conflit (et à seulement 4 % de ce qui entrait à Gaza avant le blocus).
Le mécanisme « Serry », censé faciliter l’entrée des matériaux de construction à Gaza, est désormais opérationnel, mais mis en œuvre de manière extrêmement lente. Les mesures prises par Israël pour alléger les accès et mouvements (notamment la reprise des exportations vers la Cisjordanie) ne sont pas suffisantes pour accélérer la reconstruction.
Quant aux négociations en vue d’un cessez-le-feu durable, qui devaient reprendre dès le 27 octobre 2014, sous l’égide de l’Égypte, elles ont été reportées sine die.
● La Cisjordanie et Jérusalem ont été le théâtre de violences d’une intensité et d’une nature inédites, qui, bien que semblant s’être apaisées, pourraient réapparaître
Jérusalem et la Cisjordanie ont été le théâtre d’affrontements d’une intensité inédite depuis des années. L’enlèvement à Jérusalem-Est et le meurtre du jeune Palestinien, présenté comme un acte de vengeance après l’enlèvement en juin et le meurtre de trois jeunes Israéliens en Cisjordanie, a marqué le début d’un cycle de violences ininterrompues, qui ont touché tous les quartiers de Jérusalem-Est (268). Le 4 août, l’attaque d’un bus par un Palestinien a causé la mort d’un Israélien. Quatre personnes ont été tuées dans l’attaque d’une synagogue de Har Nof, un quartier de Jérusalem-Ouest. Ziad Abou Ein, responsable palestinien chargé de la colonisation en Cisjordanie, ancien vice-ministre chargé des prisonniers, est mort le 10 décembre après des heurts avec des soldats israéliens au cours d’une manifestation pacifique dans un village palestinien. Certains ont même qualifié la situation d’ « Intifada rampante », la police israélienne n’exerçant plus de fait de contrôle total sur certains quartiers de Jérusalem-Est et l’Autorité palestinienne n’en ayant pas non plus les moyens.
Il faut aussi s’inquiéter de la forte montée des tensions sur l’Esplanade des Mosquées. On sait en effet que toute remise en cause du statut des Lieux saints musulmans à Jérusalem pourrait entraîner de graves troubles et une recrudescence des violences. Rien ne serait pire qu’une transformation de la question israélo-palestinienne en conflit religieux.
A partir de la fin septembre 2014, les restrictions d’accès à l’Esplanade des Mosquées pour les musulmans (interdiction de tranches horaires et exclusion des hommes de moins de cinquante ans), et la multiplication de visites de responsables israéliens proches des mouvements messianiques ont entraîné des affrontements violents. La visite du ministre israélien de la sécurité publique et du ministre du logement le 23 septembre, doublée de la visite de 300 colons sur l’Esplanade, ont encore aggravé les tensions.
Mi-octobre, l’annonce de la fermeture de l’Esplanade pendant une semaine, et la visite de Moshe Feiglin, vice-président de la Knesset, ont provoqué de nouveaux affrontements. Khaled Mechaal avait auparavant exhorté les Palestiniens à voler au secours d’Al-Aqsa le 16 octobre. En écho, Mahmoud Abbas a dénoncé la transformation d’un conflit politique en conflit religieux. Benjamin Netanyahou a alors, en réplique, réaffirmé son attachement à la préservation du statu quo sur l’Esplanade des Mosquées.
Le Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a appelé, en mars 2014, le Conseil de sécurité à « réagir devant la multiplication des incursions par des extrémistes israéliens, des responsables politiques et des représentants du gouvernement de ce pays sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est ». Ces incursions sont, selon le bureau du comité, une provocation contre les Palestiniens et les fidèles musulmans, et elles ont souvent mené à des affrontements durant lesquels des Palestiniens ont été blessés, arrêtés et placés en détention. Le Comité a également dénoncé la proposition de loi au Parlement israélien qui cherche à imposer la souveraineté sur l’esplanade (269).
Comme l’a affirmé Nasser Judeh, ministre des affaires étrangères de Jordanie, le 15 octobre 2014, ces évènements sont particulièrement préoccupants, car ils peuvent « entraîner la région dans un conflit religieux, et attiser l’extrémisme, le terrorisme et la violence dans la région et le monde ». Les autorités jordaniennes, gardiennes des Lieux saints musulmans à Jérusalem, ont exhorté la communauté internationale à faire entendre à Israël le nécessaire respect du statu quo obtenu en 1967 (270), et affirmé que la Jordanie prendrait toutes les mesures politiques et juridiques nécessaires pour imposer le respect de l’accord de paix de 1994.
La France doit fermement exhorter les autorités israéliennes à ne pas laisser perdurer la banalisation d’un discours visant à terme à remettre en cause le statu quo, ainsi que les tensions chroniques entretenues par plusieurs groupes radicaux israéliens sur et aux abords de l’Esplanade des Mosquées. Elles pourraient se traduire par un drame aux répercussions politiques imprévisibles, non pas seulement au Proche-Orient mais dans tout le monde musulman, sensible au destin de ce troisième Lieu saint de l’Islam.
● La poursuite de la colonisation
Depuis le 29 juillet 2013, date du début de la séquence des négociations, environ 21 000 unités de logements dans les colonies ont fait l’objet d’autorisations.
Du 29 juillet 2013 au 24 avril 2014, environ 17 000 unités de logements dans les colonies ont fait l’objet d’autorisations.
A la suite de la formation d’un gouvernement d’entente national palestinien en juin, Israël a publié des appels d’offre pour 1 500 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, a autorisé des projets portant sur 1 084 nouveaux logements en Cisjordanie et a délivré des permis de construire pour 172 logements à Jérusalem-Est.
Suite à l’intervention à Gaza, la colonisation a marqué une nouvelle accélération. Ainsi, après avoir réquisitionné 400 hectares de terres dans le gouvernorat de Bethléem le 31 août 2014, puis avoir autorisé fin octobre la construction de 2 610 nouveaux logements à Givat Hamatos, les autorités israéliennes ont fait avancer la construction d’un nombre important de logements à Jérusalem-Est : 450 à Har Homa, 600 à Ramat Shlomo et 228 à Ramot. Enfin, une nouvelle annonce de constructions a été faite le 24 décembre 2014, portant sur 73 logements à Har Homa et 307 à Ramot (Jérusalem-Est).
Le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a atteint en juin 2014 un total de 382 031 personnes, a annoncé, mardi 16 septembre 2014, le Conseil de Yesha.
● L’engagement de ce que certains qualifient « d’Intifada diplomatique », présentée comme une réponse à l’impasse des négociations, mais dont la portée demeure plus qu’incertaine
Le 26 septembre 2014, Mahmoud Abbas a réclamé, devant l’Assemblée générale des Nations unies, une résolution du Conseil de sécurité qui viserait à « parvenir à la paix en se fixant comme objectifs la fin de l’occupation israélienne et une solution à deux États, avec un calendrier spécifique pour la réalisation de ces objectifs ». Revenant sur la récente crise de Gaza, Mahmoud Abbas a accusé Israël d’y avoir mené « une nouvelle guerre de génocide », promettant de tout faire pour châtier les coupables.
Le lendemain, Nabil Shaath, leader du Fatah, a déclaré que le Président Abbas livrerait « une guerre politique » à Israël, si la réponse à l’initiative palestinienne était négative. En cas de veto américain, Mahmoud Abbas donnerait son feu vert à « la guerre du boycott international d’Israël », et le renverrait devant ses responsabilités, à la Cour pénale internationale notamment.
En réponse, le ministre des affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman a accusé dans un communiqué Mahmoud Abbas de « terrorisme diplomatique », ajoutant : « Mahmoud Abbas ne veut pas et ne peut pas être un partenaire pour un règlement politique du conflit. Tant que Mahmoud Abbas sera président de l’Autorité palestinienne, le conflit continuera ».
Les Palestiniens ont décidé de précipiter, le 30 décembre 2014, le vote de leur projet de résolution au Conseil de sécurité au risque de se heurter à un refus.
Le lendemain du rejet prévisible du projet de résolution (cf. supra), les Palestiniens ont relancé leurs démarches d’adhésion à des conventions internationales, dont le Statut de Rome. Le 7 janvier, le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a accepté la demande d’adhésion. En réaction, les autorités israéliennes ont gelé, dès le 3 janvier, le versement de 106 millions d’euros de taxes et droits de douane collectés pour le compte de l’Autorité palestinienne, qui représentent plus des deux tiers de ses recettes budgétaires propres.
● L’année 2014, véritable parabole du conflit israélo-palestinien
L’année 2014 a commencé dans l’espoir d’une relance du processus de paix. Elle s’est terminée par une série de décisions unilatérales de part et d’autre, dans une course aux gains tactiques de court terme. Elle a surtout été marquée, au cœur de l’été, par une guerre meurtrière qui a creusé un peu plus la défiance des deux parties.
Échec des reprises de pourparlers sous égide américaine ; nouvelle intervention à Gaza, soldée par de lourdes pertes humaines et dégâts matériels ; montée des violences en Cisjordanie et à Jérusalem, et, de manière inédite et particulièrement inquiétante, sur l’Esplanade des Mosquées ; impasse de la réconciliation interpalestinienne ; poursuite de la colonisation par les autorités israéliennes ; lancement d’une « Intifada diplomatique » par l’Autorité palestinienne : l’année 2014 pourrait symboliser à elle seule l’échec total du processus de paix et l’escalade de la violence, dont les responsabilités sont partagées par les dirigeants, et dont les peuples israélien et palestinien continuent de payer le prix. Tout laisse craindre une reprise à court terme des violences, si rien n’est fait, alors même que la solution négociée des deux États s’éloigne de jours en jours.
b. La perspective d’une solution à deux États, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, est chaque jour plus menacée
La viabilité de la solution des deux États, approuvée par les deux parties au conflit, reste plus que jamais le credo de la diplomatie française, comme celui de la communauté internationale. Des deux côtés, il existe encore aujourd’hui – mais pour combien de temps, une majorité en faveur de cette option qui, sur le terrain, est chaque jour davantage mise en péril. En 2012, Robert Serry, envoyé spécial des Nations unies pour le processus de paix au Proche-Orient, estimait que toutes les parties se dirigaient vers un seul État. En 2015, il juge que nous nous trouvons au seuil de cette porte. (271)
● Sur le terrain, la mise en oeuvre d’une paix à deux Etats est chaque jour plus menacée
Il faut tout d’abord souligner la réduction de l’assise territoriale du futur État palestinien.
La poursuite de la colonisation menace chaque jour un peu plus la viabilité d’un accord de paix entre deux États viables. Il faut surtout souligner que la majorité des nouvelles unités de construction en 2013 et 2014 est en effet située à l’Est du tracé du Mur, dont un grand nombre au coeur de la Cisjordanie.
Selon l’ONG israélienne « La Paix maintenant », les 256 unités de logements prévues dans la colonie de Nofei Prat tripleraient quasiment son nombre d’habitations. Des unités de logements sont appelées à être construites dans des colonies de petite taille comptant actuellement moins de 500 habitants. Ainsi, la colonie de Givat Salit, située à l’extrême nord-est de la Cisjordanie, près de la frontière jordanienne, pourrait voir sa population en théorie multipliée par 13, avec la construction de 125 nouvelles unités de logement.
Le gouvernement israélien a approuvé, fin septembre 2014, un plan portant sur la construction de 2 610 logements à Givat Hamatos. Situé au sud de Jérusalem, Givat Hamatos est aujourd’hui encore largement composé de caravanes et de mobile-homes. Toute construction sur ce site ferait donc de Givat Hamatos une nouvelle colonie de Jérusalem-Est, la première depuis Har Homa il y a plus de quinze ans. Cette décision ouvre la voie à la publication d’appels d’offres pour les parcelles de propriétés privées pouvant faire l’objet de permis de construire immédiats, sans publication préalable d’appels d’offres. Qualifié de « mini E1 », Givat Hamatos serait un point de non retour, menaçant directement la solution des deux Etats.
Un projet de funiculaire serait de plus à l’étude à Jérusalem, qui permettrait de désenclaver les colonies israéliennes isolées situées dans le quartier de Silwan, quartier qui a été l’un des foyers des tensions de la fin de l’année 2014, et où le projet municipal de complexe touristique revêt un grand potentiel de déstabilisation, compte tenu de la proximité de l’Esplanade des Mosquées.
Le projet de colonie israélienne de Givat Eitam (Sud-Est de Bethléem) souvent désigné sous le nom de « E2 » compte tenu de son impact critique sur la solution des deux Etats, pourrait s’accélérer. Il s’agit de créer une colonie de 2 500 logements à l’Est de la colonie d’Efrat, au-delà du tracé du Mur de séparation. En achevant l’encerclement de Bethléem au Sud, ce projet favoriserait la constitution d’un nouvel axe transversal Est-Ouest tronçonnant la Cisjordanie.
Toujours selon l’ONG « La Paix maintenant », le 30 janvier 2015, les autorités israéliennes ont rendu public une série d’appels d’offres devant conduire à la construction de 430 nouveaux logements dans quatre colonies de Cisjordanie, et ont ouvert une enquête publique relative à la construction de 93 nouveaux logements dans la colonie de Gilo à Jérusalem-Est.
Certaines études soulignent dès lors le fait que l’imbrication des populations rend de plus en plus difficile le partage du territoire en deux États, car celui-ci ne pourrait créer des zones de peuplement homogènes, à moins de transferts majeurs de populations. L’imbrication porte également sur les ressources naturelles, les réseaux de communication, ou encore la distribution d’énergie.
De plus, malgré l’ampleur de l’aide financière apportée par les principaux bailleurs internationaux, la construction et la consolidation des bases du futur État palestinien sont de plus en plus fragiles.
Les autorités palestiniennes doivent faire face à une nette dégradation de la situation économique, d’autant plus préoccupante qu’elle pèse sur une situation sociale déjà tendue.
En 2014, le PIB a diminué pour la première fois depuis le milieu des années 2000. Selon un rapport récent de la Banque mondiale, en termes réels, le PIB aurait diminué près de 4 % (cette contraction atteindrait 15 % dans la bande de Gaza). Il faut remonter à l’année 2006 – alors que la victoire du Hamas aux élections législatives de Gaza avait conduit à une restriction des aides internationales à la Palestine – pour retrouver une chute comparable de la croissance (272). C’est principalement l’effet de la baisse notable de l’aide internationale en 2014, proche de 14 %. La situation ne devrait pas s’améliorer en 2015 : les services du FMI estimaient au début de l’automne que l’aide extérieure serait ramenée de 1,467 milliard de dollars en 2014 à 1,193 milliard de dollars en 2015, soit une diminution de près de 19 %. Par ailleurs, la dégradation de la situation sécuritaire suite à la crise de l’été dernier et l’absence de perspective offerte par le processus de paix, atteignent la confiance des agents économiques. A Gaza, où de larges pans de l’industrie et de l’agriculture locale ont été détruits, la reconstruction, qui devrait prendre des mois, sinon des années, est freinée par les restrictions d’approvisionnement mais aussi le retard pris par le décaissement de l’aide internationale.
La situation budgétaire est elle aussi critique (273), notamment en raison de la hausse des dépenses due à la nécessaire reconstruction de Gaza. Il n’est de plus pas à exclure que l’aide apportée à Gaza entraîne un effet d’éviction sur le soutien apporté à l’Autorité palestinienne. Surtout, la couverture du déficit résiduel atteint ses limites, et l’augmentation des arriérés de paiement relève d’une « fuite en avant » qui fragilise chaque jour un peu plus la situation financière des fournisseurs de l’Autorité. Israël a annoncé, le 28 janvier 2015, que la compagnie d’électricité israélienne avait commencé à couper l’électricité deux heures par jour dans les zones sous contrôle de l’Autorité palestinienne, en raison de la dette palestinienne auprès de la compagnie (1,8 milliard de shekels).
Il faut aussi noter que le PIB par tête est en diminution constante du fait de la pression démographique. Enfin, touchant 25 % de la population active en 2013, le taux de chômage est en augmentation et pourrait atteindre 30 % de la population active en 2014. (274)
Mais les difficultés ne sont pas uniquement d’ordre économique. Le dernier rapport du Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations unies sur la zone C, partie de la Cisjordanie placée sous contrôle israélien met en lumière les vulnérabilités de ce qui pourrait constituer 62 % du territoire du futur État palestinien: difficultés d’accès à l’électricité et au réseau d’eau, démolitions de logement, restrictions de mouvement. Ce même rapport préconise d’améliorer la protection de ses habitants, en mettant l’accent sur Gaza, la zone C, Jérusalem Est et la seam zone (située entre la ligne verte de 1967 et la barrière de séparation). Il insiste sur le fait que le développement de cette zone doit faire l’objet d’une attention prioritaire pour consolider un futur État palestinien.
● Dans les opinions publiques, la solution des deux États tend à perdre du crédit, érosion d’autant plus inquiétante qu’elle n’a pas d’alternative
Comme le soulignait le chercheur Bruno Tertrais lors de son audition par la mission, « l’idée qu’il y a une alternative à la solution à deux Etats est la plus dangeureuse des illusions», mais elle gagne du terrain, aussi bien dans les cercles palestiniens qu’israéliens.
Côté palestinien, dans la situation inextricable dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, « la jeunesse palestinienne ne voit plus dans l’idée d’État de Palestine un thème mobilisateur », souligne Jean-François Legrain. Comme l’a souligné l’une des personnalités auditionnées par la mission, « personne ne sait ce que la prochaine génération voudra. Elle pourrait être moins marquée par l’affrontement et moins radicale que la génération actuelle, mais on peut aussi envisager le contraire. » Il y a de fait un risque que la stratégie palestinienne établie à partir de 1977, de reconnaissance de deux États, fasse place à un retour à la stratégie antérieure, celle de la cause palestinienne dans toutes ses composantes, y compris les réfugiés, qui n’implique pas l’existence de deux États.
De fait, les revendications de la population sont aujourd’hui plus économiques et sociales que politiques. Certains proposent de remettre la résolution du conflit à plus tard pour se concentrer sur le renforcement des droits des Palestiniens. Ainsi de Sari Nusseibeh, directeur de l’Université Al-Qods, qui dans un ouvrage publié en 2012, prônait l’établissement d’un droit de séjour des Palestiniens vivant sous autorité israélienne (275). Des membres du Fatah se sont également déclarés en faveur d’un État binational. Ahmed Qoreï – ancien Premier ministre de l’Autorité palestinienne et négociateur des Accords d’Oslo – estime que la solution à deux États est morte, et que l’option d’un État binational doit être envisagée (276).
Côté israélien, certains courants au sein de la classe politique prônent l’annexion de la Cisjordanie (277), ce qui placerait Israël dans un réel dilemme existentiel. Selon l’envoyé spécial des États-Unis au Proche-Orient, Martin Indyk, l’annexion de la Cisjordanie, comme le réclame une partie de la droite israélienne, poserait clairement la question du caractère démocratique de l’État d’Israël : « si Israël demeure démocratique, alors les Palestiniens seraient majoritaires. Si Israël reste un État juif, alors les Palestiniens seraient privés de leurs droits » (278). C’est aussi le raisonnement tenu par l’historien et ancien Ambassadeur d’Israël en France, Elie Barnavi, qui estime qu’il en va de la survie même de son pays, qui n’aura, a-t-il déclaré devant les membres de notre commission le 4 février 2015, « bientôt le choix qu’entre la guerre civile et l’apartheid ».
En l’absence de règlement rapide du conflit, la tendance qui se dessine aujourd’hui est bien celle d’une perte de crédit de la solution des deux États auprès de la population, et d’une faillite réelle de sa possibilité même sur le terrain, du fait de l’affaiblissement du futur État palestinien et de la poursuite de la colonisation. La reconnaissance de la Palestine comme État par la communauté internationale n’apporterait d’ailleurs pas de solution miraculeuse au problème si les autorités palestiniennes ne disposaient pas des moyens de le gouverner.
● Une érosion de la paix à deux États d’autant plus inquiétante que cette solution ne connaît pas d’alternative
Le maintien d’un conflit de basse intensité menace la perspective d’une paix entre deux États.
Le scénario d’un statu quo évolutif pourrait en effet aboutir, selon certains, à une solution à trois États (Israël, la Cisjordanie rattachée à la Jordanie et Gaza à l’Égypte), défendue notamment par l’actuel ministre de la défense israélien (279). D’aucuns répondent que cette solution nourrirait frustrations et haines, et ne serait pas sans danger pour Israël à long terme, qu’elle contribuerait à isoler (280). D’autres prônent la fondation d’un État commun, ou binational, arguant du fait qu’il n’existe qu’un seul État qui exerce son pouvoir sur l’ensemble du pays, qui en assure l’administration, en régit la législation civile et militaire, et dont dépend en réalité l’étendue des pouvoirs des autorités palestiniennes. Jean-François Legrain, auditionné par la mission, souligne ainsi le fait que Mahmoud Abbas a lui-même menacé à plusieurs reprises, la dernière fois en 2012, de démanteler l’Autorité palestinienne si les négociations n’avançaient pas. Comme l’a rappelé l’Ambassadeur d’Israël en France, lors de son audition devant la commission du 11 juin 2014, « Israël, considérant que parvenir à deux États pour deux peuples est la seule solution viable au conflit israélo-palestinien, a fait le choix stratégique d’accepter la division du territoire entre deux peuples ». Pourtant, Benyamin Netanyahou, lors de la campagne électorale, est revenu sur sa déclaration de 2009, à l’Université de Bar-Ilan, en affirmant que s’il était désigné Premier ministre, il n’y aurait pas d’État de Palestine, déclaration que la Mission juge particulièrement inquiétante (281).
La France s’est depuis longtemps déclarée favorable à la solution des deux États. Depuis le 29 novembre 1947, lors du vote de l’Assemblée générale des Nations unies sur la création de deux États, où la France apporta sa voix décisive, notre ligne diplomatique n’a pas changé. Elle fut l’une des premières nations à reconnaître l’État d’Israël, qui dut conquérir de haute lutte son droit à l’indépendance. Ce fut la position du Général de Gaulle, de ses successeurs – notamment, dans un discours prononcé à la tribune de la Knesset en 1982, de François Mitterrand, qui reconnut l’aspiration légitime du peuple palestinien à un État (282).
Les alternatives à la solution des deux États sont pour la France inacceptables : un État binational, qui à terme remettrait en cause la nature d’Israël comme foyer du peuple juif, et l’exclusion des populations palestiniennes, aux dépens de nos valeurs et du caractère démocratique de ce pays. Il est donc plus que jamais urgent de trouver le moyen de non pas seulement reprendre les négociations, mais de les voir aboutir.
Comme l’a rappelé Laurent Fabius lors du débat relatif à la proposition de résolution adoptée par l’Assemblée nationale en novembre 2014, en cas d’échec des pourparlers, la France n’aura pas d’autre choix que de reconnaître l’État de Palestine, pour garantir la pérennité de la solution qu’elle a défendue avec constance : le droit égal et souverain des deux peuples à co-exister en paix et en sécurité sur ce territoire.
2. La reprise, et le succès, des négociations bilatérales sous l’égide des Américains sont plus qu’hypothétiques
L’antagonisme, de plus en plus marqué, et l’absence de vision stratégique, des deux parties au conflit se doublent d’une certaine lassitude des Américains, sur fond de tensions entre Israël et les États-Unis. S’y ajoute une certaine fatigue de la population qui, pourtant aspire à la paix. Selon Elie Barnavi, « aucun sursaut ne viendra des Israéliens eux-mêmes, pas plus que des Palestiniens, d’ailleurs. La faiblesse extrême des protagonistes les rend incapables d’aboutir par eux-mêmes à une entente. Les fautes sont partagées, nous négocions depuis vingt ans, sans succès. » Dans ces conditions, la reprise, et l’aboutissement, des négociations selon le format antérieur sont plus qu’hypothétiques. Un consensus se dégage sur l’idée que la méthode de négociation basée sur les accords d’Oslo a fait son temps.
a. Les autorités israéliennes ne peuvent seules porter le poids d’une reprise des négociations
L’équation stratégique régionale dans laquelle se trouve Israël, ainsi que l’évolution de son paysage politique, ne laissent pas présager un retour rapide des autorités israéliennes aux négociations.
● Les crises du voisinage d’Israël obèrent la perspective d’une reprise des négociations et de concessions israéliennes
Selon le chercheur Itamar Rabinovitch (283), la complexité et l’ambiguïté de la relation d’Israël à son voisinage déterminent en grande partie l’agenda politique et sécuritaire de ses dirigeants. Depuis sa création, le pays a su certes « rompre l’hostilité des pays arabes, faire la paix avec deux de ses voisins », mais le débat relatif à l’identité de l’État, de son rôle et de sa place dans la région, et, surtout, au conflit israélo-palestinien, gouverne l’agenda politique du pays.
Même si d’autres préoccupations occupent une place importante dans les débats, les élections de mars 2015 constituent une forme de référendum sur ces sujets. Comme explicité plus loin dans le rapport, le « Camp sioniste » prône une réactivation du processus de paix, mais doit aussi tenir compte d’un indéniable glissement à droite de l’électorat israélien (284). Le chercheur estime que quel que soit le résultat des élections, même une forte volonté politique ne suffira pas à convaincre une population qui, bien qu’aspirant à la paix, regarde les pourparlers avec scepticisme. Pourtant, le Gouvernement élu devra apporter une réponse au conflit et au problème sécuritaire qu’il pose pour Israël.
Du point de vue israélien, les crises du voisinage proche obèrent la perspective d’un retrait des forces israéliennes de Cisjordanie et la signature d’un accord de paix. La prise de pouvoir par le Hamas à Gaza, après le retrait israélien en 2005, résonne encore avec force dans la mémoire de l’opinion publique.
Il est difficile en effet de qualifier aujourd’hui d’ordre régional le voisinage d’Israël. Les « révolutions arabes » dans la région se sont traduites par la fragilisation, lorsque ce n’est pas la disparition, des États syrien, irakien, libyen. L’ombre de la déstabilisation plane aussi sur le Liban et la Jordanie. L’affirmation de la Turquie, mais surtout de l’Iran, au plan régional modifient elles aussi les équilibres de la région. L’accord intérimaire signé avec l’Iran à Genève, le 24 novembre 2013, a été vécu par la diplomatie israélienne, qui considère la menace iranienne comme prioritaire, comme un échec, sinon comme une trahison, américaine. Israël s’inquiète du renforcement de l’influence de l’Iran et du Hezbollah du fait du conflit syrien, ainsi que de l’afflux de réfugiés et de la dégradation de la situation militaire sur le Golan entraînés par cette crise proche. Face à ce qu’elles perçoivent comme une menace immédiate pour leur sécurité, les autorités israéliennes ont le sentiment que, sans parler de retrait, l’intérêt et l’influence des Américains au Proche et Moyen-Orient sont déclinants (refus d’un engagement au sol en Irak, attitude inhibée sur la crise syrienne, difficulté à choisir entre réformistes et islamistes dans le contexte des « révolutions arabes », moindre intérêt stratégique de la région au regard des besoins énergétiques du pays).
Dans ce contexte, et bien que Benyamin Netanyahou se soit prononcé, lors de son discours à l’Université de Bar-Ilan à Tel Aviv, en 2009, en faveur d’une solution des deux États, avant d’adopter une position contraire lors de la récente campagne électorale, toute tentative de reprise des négociations pourrait se heurter à une réponse négative de la part des autorités israéliennes, au motif qu’aucun accord de paix ne peut être signé tant que le problème iranien n’est pas réglé et tant qu’il y a des djihadistes à la frontière.
● La politique actuelle est cependant débattue en Israël : crainte que le non-règlement de la question palestinienne ne provoque un isolement diplomatique du pays, ne remette en cause la solidité du partenariat avec les Américains, et ne menace ses intérêts vitaux
La stratégie à long terme des autorités israéliennes soulève des interrogations, sinon des critiques, y compris en Israël.
Les questions socio-économiques (salaire minimum, pauvreté, logement, coût de la vie, etc.) (285) ont occupé une place importante durant la campagne électorale qui a marqué le début de l’année 2015. Mais la question de l’isolement diplomatique du pays et de la dégradation de la relation avec le partenaire indispensable que sont les États-Unis, a elle aussi été largement débattue par la classe politique.
En septembre 2014, le ministre des finances israélien, Yair Lapid, a vivement critiqué la décision israélienne de confisquer des terres en Cisjordanie au motif qu’elle pouvait créer une crise avec les Américains et nuire au soutien international d’Israël. La ministre de la justice israélienne, Tzipi Livni a estimé que cette appropriation affaiblissait Israël et portait atteinte à sa sécurité. Plus récemment, l’ancien dirigeant du Mossad, Meir Dagan, a fustigé ce qu’il a qualifié de logique de confrontation avec l’administration américaine de la part de l’actuel Premier ministre, considérant qu’elle faisait peser sur Israël le risque de perdre la protection américaine.
Il serait excessif de parler d’isolement diplomatique. Cependant, bien qu’elles reposent sur de solides fondamentaux, les relations entre Israël et les Etats-Unis se sont sinon altérées, du moins tendues cette année, comme en témoignent les attaques publiques dont John Kerry a fait l’objet de la part du ministre de la défense, Moshe Yaalon, ou encore la visite très critiquée de Benyamin Netanyahou au Congrès américain. L’Ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis rappelait récemment dans une interview que le nœud du problème avec les Etats-Unis se trouvait dans une différence d’approche sur le dossier iranien. Selon Martin Indyk (286), envoyé spécial des États-Unis durant les négociations de 2013-2014, la tendance actuelle serait à un soutien moins appuyé des démocrates à Israël, signe que la question devient « partisane », ce qui pourrait altérer la relation bilatérale. Certes, Israël a diversifié ses alliances, en se rapprochant de la Russie, de l’Inde, de la Chine, mais aussi des pays du Golfe, ce qui pourrait peser sur ses futurs choix stratégiques, tandis que sa lutte contre le Hamas et sa guerre déclarée au terrorisme pourraient conduire à une alliance de facto avec les pays arabes. Pourtant, selon le même analyste, « si les Etats-Unis ne sont pas le seul ami d’Israël, ils sont son seul ami fiable ».
D’aucuns estiment que la stratégie actuelle menace à long terme les intérêts vitaux du pays. Ainsi de Shimon Peres, ancien Président d’Israël, qui déclarait récemment : « ceux qui ont renoncé à chercher à faire la paix sont des naïfs, qui vivent dans l’illusion et ne sont pas patriotes. Où est l’initiative de paix israélienne ? (...) Dans le monde le temps joue contre nous. » De fait, le maintien du statu quo dans les négociations, doublé de la poursuite de la colonisation, menacent la pérennité de la solution à deux États, et par conséquent l’avenir d’Israël. Selon Elie Barnavi, « sans État palestinien à nos côtés, c’est l’avenir même d’Israël qui est compromis. » (287)
Selon l’ancien ministre des affaires étrangères israélien, Shlomo Ben Hami, le conflit est devenu un piège dont les autorités israéliennes ne parviennent pas à sortir. L’image d’Israël se dégrade à chaque nouvelle crise. La supériorité militaire se mue en infériorité stratégique, dès lors qu’elle fragilise l’image internationale d’Israël et pourrait accélérer le divorce avec les opinions publiques en Europe et aux États-Unis. Il estime en effet que quelle que soit la supériorité militaire d’Israël et malgré l’ampleur des destructions à Gaza, le Hamas, qui a certes subi des pertes conséquentes, a survécu à l’opération « Bordure protectrice », comme il a survécu aux crises antérieures. Il est donc difficile de savoir si Israël sort vainqueur de cette ultime intervention, d’un point de vue sécuritaire d’abord, car la démilitarisation de Gaza n’a pas avancé. D’un point de vue diplomatique ensuite, d’un point de vue politique, enfin, car le retour cyclique de la violence pourrait sérieusement mettre en doute au sein de la population l’efficacité de l’action gouvernementale.
D’autres pointent la relation paradoxale entretenue avec le Hamas. Selon la chercheure Leila Seurat (288), même si les déclarations du Premier ministre israélien sont hostiles au Hamas, de fait, l’opération « Bordure protectrice » de l’été 2014 tend à accréditer la thèse selon laquelle les autorités israéliennes s’efforcent de contourner la question de la création d’un État palestinien, en encourageant d’une certaine façon l’édification d’une entité autonome à Gaza. Selon un interlocuteur de la mission, « Benyamin Netanyahou est hostile à la solution à deux États. Le Hamas aussi y est hostile. » La dernière tentative de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, en avril 2014, et sa reconnaissance par l’Union européenne et les États-Unis, ont provoqué la colère du Gouvernement israélien. Considérant que Mahmoud Abbas avait choisi le camps de la guerre, en annonçant la formation d’un gouvernement commun, les autorités israéliennes ont pris des mesures immédiates : impossibilité pour les ministres résidant à Gaza de se rendre à Ramallah pour prêter serment, refus de laisser les forces de sécurité de la présidence palestinienne se déployer à la frontière entre Gaza et l’Egypte, non-versement par Mahmoud Abbas du salaire des fonctionnaires de la bande de Gaza qui ne sont pas affiliés au Fatah.
Enfin, pour certains commentateurs, ce qui se joue aujourd’hui en Israël est l’affrontement, et le choix nécessaire, entre deux visions du sionisme : un sionisme pragmatique et séculier, autrefois incarné par les deux grands partis de Gouvernement que sont le Likoud et le parti travailliste, tous deux en crise, et un nouveau sionisme idéologique, qui tend vers le messianisme.
Naftali Bennet incarne cette tendance. Le dirigeant du parti « Foyer Juif », a ainsi déclaré en décembre 2014 (289), que le « sionisme séculier qui avait bâti l’Etat d’Israël avait terminé de jouer son rôle dans l’histoire », et qu’il se déclarait prêt à prendre le relais. Le parti « Foyer juif » s’oppose à la solution à deux États, Naftali Bennett estimant que « nul ne peut occuper sa propre terre ». Selon les sondages, ce parti tend à se constituer comme la troisième force politique du pays. Les partisans d’un sionisme religieux affirmé ne représentent plus une minorité négligeable de la population (77 000 personnes auraient participé aux primaires).
Selon Yitzhak Herzog, chef du parti travailliste, la crise de l’été a laissé Israël dans un « état post-traumatique ». La société israélienne opère un glissement à droite, qui dit-il, est parfaitement logique compte tenu du contexte des dernières années (290). Lors du Saban Forum aux Etats-Unis, il s’est montré cependant optimiste, soulignant que selon lui, les Israéliens ont de plus en plus conscience qu’Israël peut travailler avec des partenaires régionaux tels que la Jordanie, l’Égypte, mais aussi l’Autorité palestinienne pour répondre à des défis communs. Surtout, il souligne la nécessité d’un renouvellement de direction politique, capable d’être plus pro-active et de saisir l’opportunité de la paix. Selon lui, ce dont manque la direction actuelle, c’est d’une vision pour le futur d’Israël.
Benyamin Netanyahou, sans être un pur idéologue, doit donner des gages à l’aile droite de son parti. En témoigne sa proposition, le 1er mai 2014, de promouvoir un projet de loi fondamentale « assurant l’ancrage constitutionnel du statut d’Israël comme État-nation du peuple juif », bien qu’une phrase sur le caractère juif et démocratique de l’Etat apparaisse déjà dans une loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’Homme de 1992. Fortement soutenue à droite, la constitutionnalisation du caractère juif de l’État d’Israël a aussi fait l’objet de vives critiques, notamment de la part de Tzipi Livni, alors ministre de la justice, mais aussi de la gauche israélienne, qui a dénoncé la loi et le paradoxe de la politique conduite par le Premier ministre, conduisant selon elle à l’avènement d’un État binational qui perdrait sa majorité juive.
● Les résultats des élections anticipées du 17 mars 2015 ne devraient pas modifier fondamentalement les données du problème
Les résultats anticipés des élections du 17 mars dernier, donnent la victoire au parti de Benyamin Netanyahou. Il est encore tôt pour en analyser la portée, car la composition du Gouvernement ne sera connue que dans quelques jours.
Les résultats confirment quelques tendances de fond, comme le maintien de la popularité du Premier ministre sortant, le poids relativement limité des deux grands partis, qui autrefois structuraient la vie politique israélienne, bien que l’on constate une forme de retour à un clivage classique gauche-droite. La fragmentation de la vie politique, due à la crise du Likoud et du parti travailliste, et renforcée par le mode de scrutin proportionnel, ne favorise pas l’émergence d’une majorité solide, capable de prises de positions fortes en faveur d’un règlement du conflit.
Cependant, le score du « Camp sioniste » (291), alors même qu’Ythak Herzog n’est pas encore une personnalité jouissant d’une grande notoriété en Israël, traduit une volonté de changement d’une bonne partie de la population.
Le « Foyer juif », centré autour de la personnalité à la fois charismatique et controversée de Naftali Bennet, s’impose désormais comme une force politique incontournable à la Knesset, même si son résultat est inférieur aux pronostiques. Ce parti, dont la campagne active a été axée autour de thèmes nationalistes et identitaires (fierté israélienne, absence de partenaire palestinien, colonisation, refus de « céder aux pressions de la communauté internationale ») tente de se renouveler et d’attirer de nouvelles voix, bien que le cœur de son électorat demeure la droite religieuse.
Le parti « Israël Beitenou » d’Avigdor Liberman, qui demeure une personnalité très influente du paysage politique israélien, a été touché par une affaire de corruption, et apparaît affaibli. Il faut aussi mentionner la liste de l’ancien ministre Moshé Kahlon, qui devrait à l’avenir jouer un rôle clé dans les coalitions gouvernementales. Demeurent le parti « Yesh Atid » de Yaïr Lapid, qui ne cesse de baisser dans les sondages, les deux partis ultra-orthodoxes, et le « Meretz ». Enfin, fait notable, les partis arabes sont pour la première fois parvenus à présenter une liste commune et certains ont évoqué la possibilité de s’allier au « Camps sioniste ». Les résultats anticipés de l’élection en font la troisième force politique du pays, précédent historique dont les effets sont cependant difficilement mesurables en raison notamment du caractère très hétéroclite de cette liste.
Plusieurs scenarii sont possibles, mais dans tous les cas, il est peu probable qu’émerge à l’issue des élections du 17 mars, une large coalition à la fois favorable à une reprise immédiate des négociations et suffisamment unie et puissante pour porter le poids politique de cette décision. Dans l’hypothèse d’un Gouvernement d’union nationale, la capacité de ce dernier à constituer une coalition favorable à une paix juste et équilibrée sera extrêmement limitée. Dans l’hypothèse d’une reconduction de Benjamin Netanyahou, associé à Naftali Bennett, il est à craindre que la politique gouvernementale israélienne durcisse un peu plus encore ses positions. Une coalition comprenant le Likoud, le Foyer juif, Liberman Kahlon et les Ultra-orthodoxes ne modifiera pas non plus la ligne actuelle.
Lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2014, le Premier ministre israélien a insisté sur l’opportunité historique qui se présentait d’un partenariat possible contre la menace islamiste avec les Etats arabes, lequel pourrait faciliter un accord de paix avec les Palestiniens. Il a déclaré que pour réussir la paix, il fallait regarder à Jérusalem et Ramallah, mais aussi au Caire, à Amman, Abou Dhabi, Riyad et ailleurs. Il a rappelé qu’Israël était prêt à des compromis historiques. Mais Benyamin Netanyahou aurait-il l’intention et les moyens de bâtir une paix régionale, il ne peut assumer seul la responsabilité d’une reprise des négociations. Surtout, il a déclaré durant la campagne que s’il occupait le poste de Premier ministre, il n’y aurait pas d’État palestinien.
b. Du côté palestinien, la reprise de la diplomatie onusienne, dont la portée est incertaine, coïncide avec une fragilisation inquiétante et des divisions internes profondes
Côté palestinien, l’année 2015 s’annonce peu propice à une reprise des négociations : la transition politique de l’après-Abbas, désormais ouvertement débattue, pourrait aviver des luttes internes au sein d’une Autorité palestinienne déjà affaiblie, et dont on peut s’inquiéter du manque de popularité croissant auprès de la population. S’y ajoute l’échec patent de la nouvelle tentative, amorcée en avril 2014, du processus de réconciliation inter-palestinienne, renforcé par l’ambiguïté de l’attitude du Hamas. Enfin, un profond scepticisme à l’égard du processus de paix a poussé Mahmoud Abbas à activer une stratégie alternative aux Nations unies, dont les objectifs et les conséquences sont incertains.
● Le privilège accordé à la voie politique depuis les accords d’Oslo est en échec et pousse une Autorité palestinienne affaiblie et divisée au plan interne à une diplomatie onusienne aux conséquences incertaines
L’Autorité palestinienne est prise au piège de sa propre politique depuis les accords d’Oslo, entre nécessité de collaborer avec les autorités israéliennes, notamment en matière de sécurité, et difficulté à justifier cette collaboration auprès de sa propre population.
Par ailleurs, selon le chercheur Jean-François Legrain, auditionné par la mission, « la sclérose de l’Autorité palestinienne, perceptible dès l’ère Arafat, se manifeste par l’absence de renouvellement du leadership. Aucun successeur à Mahmoud Abbas ne semble se dégager, et ce vide est comblé par « des luttes intestines entre personnalités dénuées de soutien populaire » (292).
Alors que commence à se poser la question de l’après-Abbas, l’organisation du septième congrès du Fatah est un rendez-vous important. La tenue du congrès pourrait permettre de renouveler et redonner une forme de légitimité au leadership palestinien, mais pourrait aussi provoquer des désaccords au sein de la direction du mouvement. La question de la représentativité du congrès fait débat : certains membres du Fatah craignent un non renouvellement des idées et des instances du parti ou critiquent le manque de représentation des membres de la société civile.
L’organisation de ce congrès pose le problème de la succession de Mahmoud Abbas, non seulement au Fatah, mais aussi à la tête de l’Autorité palestinienne et de l’OLP. Celui-ci pourrait en effet faire le choix de ne pas se représenter à la tête du parti. Or, à la différence de Yasser Arafat, certains considèrent que Mahmoud Abbas n’a pas l’autorité ou la légitimité suffisante pour désigner son propre successeur.
Il ne s’agit pas seulement de dissensions interpersonnelles, mais aussi de divergences de vues sur la stratégie à mener, d’interrogations, voire de critiques sur la politique menée par Mahmoud Abbas. Certains pointent la multiplication d’initiatives sans hiérarchie ni cohérence (initiatives onusiennes, reconstruction de Gaza, réconciliation inter-palestinienne, recherche de soutiens internationaux, demande de reconnaissance de l’État de Palestine).
En l’absence de perspectives de reprise et d’aboutissement des pourparlers, les Palestiniens qui continuent d’affirmer leur attachement au processus de paix, se sont résolument engagées dans une stratégie alternative en faveur d’une reconnaissance internationale de la Palestine. La démarche palestinienne à l’ONU, qui vise à renforcer leur position dans les négociations et rééquilibrer ce qu’ils considèrent comme un rapport de force asymétrique, recueille une audience croissante auprès de la communauté internationale. La poursuite de la diplomatie onusienne de Mahmoud Abbas pourrait cependant aggraver les tensions si elle ne s’accompagne pas d’une nouvelle initiative de paix.
Selon le chercheur Alain Dieckhoff, « d’un point de vue inter-palestinien, cette stratégie s’inscrit dans le sillage d’une politique mise en place depuis l’été 2009 par le Premier ministre Salam Fayyad, privilégiant la solidification institutionnelle d’un État palestinien à l’enlisement des négociations qui fragilisent l’Autorité palestinienne auprès de sa population. Devant l’échec des négociations avec les Israéliens, les Palestiniens choisissent de déclarer un État en tant que tel et de ré-internationaliser la question palestinienne ».
En novembre 2012, la Palestine a acquis le statut d’État observateur non membre des Nations unies, à une majorité de 138 États, dont la France. Seuls neuf États ont voté contre la demande palestinienne, dont Israël, les États-Unis, le Canada et la République tchèque. Quarante et un pays ont choisi l’abstention, dont une dizaine de pays européens parmi lesquels l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Bulgarie.
L’Autorité palestinienne se prévalait en octobre 2014 de la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant par 135 pays, soit près de 70 % des 193 États membres de l’ONU. Le 30 octobre 2014, la Suède a reconnu l’État de Palestine, et les Parlements britannique, français irlandais, portugais et espagnol ont appelé leur Gouvernement à en faire de même (293). Le Parlement européen a lui aussi, dans une résolution adoptée en décembre 2014, apporté son soutien à la reconnaissance de l’État palestinien. Le ministre des affaires étrangères français, Laurent Fabius, a quant à lui clairement affirmé qu’« en cas de blocage des négociations – ce que nous ne souhaitons pas, nous prendrons nos responsabilités en reconnaissant l’État de Palestine. »
En l’absence de perspective des pourparlers de paix, la direction palestinienne a repris sa diplomatie onusienne en septembre dernier. Un projet de résolution a été déposé par les Palestiniens, le 30 décembre 2014, au Conseil de sécurité demandait notamment un accord de paix d’ici douze mois et le retrait israélien des Territoires occupés avant fin 2017. Il a été rejeté, recueillant 8 voix « pour » (France, Chine, Russie, Jordanie, Chili, Argentine, Tchad, Luxembourg), deux voix « contre » (États-Unis et Australie) et cinq abstentions (Royaume-Uni, Nigeria, Lituanie, Corée du Sud, Rwanda).
Le leadership palestinien est tenté de revenir à la charge et de renouveler sa démarche auprès du Conseil de sécurité, prenant le risque de se heurter à un veto américain et à une crispation des autorités israéliennes. Une nouvelle initiative palestinienne, hors de toute reprise des négociations, pourrait cependant s’avérer prématurée et contre-productive, compte tenu des risques, on y reviendra, de contre-réactions israéliennes et américaines.
● Entre non-renoncement à la violence et efforts pour sortir de l’isolement diplomatique, signature d’un accord de réconciliation mais tentation d’administrer une bande de Gaza autonome, la stratégie du Hamas est marquée du sceau de l’ambiguïté
Le Hamas a essuyé quelques revers dans sa politique d’alliances, ce qui a renforcé son isolement diplomatique. Longtemps proche de l’Iran – de qui il recevait une assistance financière et militaire – le mouvement s’en est éloigné, notamment en raison d’un désaccord sur le conflit syrien. En janvier 2012, le leadership extérieur du Hamas, dont Khaled Mechaal, quitte Damas (294), capitale diplomatique du mouvement, où il était basé depuis son expulsion de Jordanie en 1999. Les rapports avec le Hezbollah libanais – qui est présent militairement en Syrie – se sont également dégradés.
Des formes de dissensions entre le Hamas et l’axe iranien ont coïncidé avec la victoire des Frères musulmans égyptiens aux élections législatives et présidentielles – respectivement en janvier et en juin 2012 (295). Les relations entre le Hamas et l’Égypte étaient mauvaises depuis 2007, lorsque Hosni Moubarak avait imposé un embargo sévère sur la bande de Gaza et l’arrivée au pouvoir des Frères musulmans en Égypte a semblé ouvrir une nouvelle ère. Le leadership extérieur du mouvement s’est installé à Doha, au Qatar, dont le pouvoir soutenait les Frères musulmans. Pourtant, les Frères musulmans, soutiens de la lutte armée contre Israël et favorables au Hamas lorsqu’il était dans l’opposition, ont tempéré leur position et renforcé leurs liens avec le Fatah (296). Ainsi la solidité du soutien apporté au Hamas est-elle peut-être à relativiser.
Ce qui n’empêchera pas la campagne anti-Morsi qui débute au printemps 2013 de toucher également le Hamas. Les nouvelles autorités accusent des activistes du Hamas de prêter main forte aux djihadistes qui multiplient les attentats meurtriers contre les forces de l’ordre dans la péninsule du Sinaï. En mars 2014, l’Égypte a interdit le Hamas et proscrit ses activités sur son sol, ordonnant le gel de ses avoirs. En janvier 2015, la branche militaire du Hamas a été classée comme organisation terroriste par la justice égyptienne. De même, le Qatar, qui tente de se rapprocher du pouvoir égyptien, pourrait reconsidérer sa position vis-à-vis du Hamas (297).
Le Hamas doit aussi faire face à la concurrence d’autres groupes, en premier lieu le Djihad islamique palestinien. Ce dernier refuse toute participation politique au sein de l’Autorité palestinienne, toute reconnaissance du processus d’Oslo et ne présente pas de candidats aux élections (298). Alors que la popularité du Hamas s’érode avec l’exercice du pouvoir, le Djihad islamique et sa branche militaire – la brigade Al-Qods – se renforcent. De plus, le mouvement a des liens anciens avec l’Iran et le Hezbollah, et semble avoir bénéficié d’un report de l’aide iranienne, qui a réduit son soutien au Hamas. En effet, la plupart des fondateurs du Djihad islamique ont pris parti pour la révolution iranienne de 1979 et ont alors été exclus, ce qui explique leur quasi-alignement sur la position iranienne. Pourtant, le mouvement n’est pas encore en mesure de contester la prééminence militaire du Hamas (299).
Certains groupuscules basés à Gaza auraient proclamé leur allégeance à Daesh (300). Pourtant, l’existence d’Al-Qaida ou de Daesh dans la bande de Gaza – si elle existe – demeure minoritaire. Le Hamas semble prendre la menace au sérieux. Ainsi, en 2009 il avait sévèrement réprimé le groupe Djound Ansar Allah, proche d’Al-Qaida, qui avait proclamé l’établissement d’un émirat islamique dans la bande de Gaza.
La crise de l’été 2014 a permis au mouvement islamique de proclamer sa « victoire » et de conforter son soutien populaire – du moins temporairement – au sein de la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Un sondage effectué par le Centre palestinien de recherche et d’études politiques (301) à l’issue de la guerre démontre que 61 % des Palestiniens voteraient pour le Hamas en cas d’élections présidentielles.
L’opération « Bordure protectrice » aurait aussi permis au Hamas de se rapprocher à nouveau de l’Iran et du Hezbollah (302). Ainsi, selon un haut responsable du Hamas, la coopération avec la République islamique aurait repris son cours. La position à tenir sur la crise syrienne divise le mouvement, qui tente désormais de se distancier de la situation en appelant à une solution politique.
Selon Jean-François Legrain, le Hamas « demeure un acteur incontournable sur la scène politique palestinienne ». De fait, il semble impossible de compter sans un mouvement politique dont l’assise sociale est si large. Pourtant, rien n’indique pour l’heure une volonté du Hamas de rentrer dans le jeu politique et de construire l’unité palestinienne (au plan politique et territorial), et on peut se demander si ses efforts de compromis sont davantage motivés par un relatif isolement que par une ferme volonté politique.
● La réconciliation inter-palestinienne, condition sine qua non d’une paix durable, est dans l’impasse
Comme évoqué précédemment dans le rapport, un accord de réconciliation a été signé à Chati, le 23 avril 2014, entre le Hamas et le Fatah (303). Le 2 juin, un cabinet « d’entente », chargé de préparer la tenue d’élections présidentielles et législatives dans les six mois, a prêté serment devant le président Mahmoud Abbas (304). Il faut noter que l’accord ne fixe aucune ligne directrice concernant les potentiels points de désaccords, tels que l’unification des services de sécurité, la structure des institutions nationales. Cette tentative, condition sine qua non de la signature d’un accord de paix crédible, n’est pas la première. Le Hamas et le Fatah ont signé des accords au Caire en mai 2011et à Doha en février 2012.
La réconciliation, soutenue par l’Union européenne et les États-Unis, a certes donné quelques signes d’espoir. Une réunion des ministres du gouvernement d’entente nationale, formé le 2 juin et composé de technocrates, s’est tenue dans la bande de Gaza le 9 octobre 2014, pour la première fois depuis 2007, suite à l’accord signé le 25 septembre entre Fatah et Hamas pour permettre au gouvernement d’exercer son autorité sur Gaza.
Cependant, selon la chercheure Leila Seurat, « plus qu’un témoignage d’un engagement nationaliste, la volonté de réconciliation du Hamas s’explique comme un ultime recours pour sortir de l’impasse. » Ce rapprochement forcé du Hamas avec Ramallah se heurte à une « politique israélienne qui a tout intérêt à voir le mouvement islamiste continuer d’administrer seul la bande de Gaza. » (305) Jean-François Legrain estime pour sa part que l’accord de réconciliation n’est qu’un « simple subterfuge adopté par ses signataires sur la base d’une convergence conjoncturelle d’intérêts organisationnels, mais en l’absence d’un rapprochement politique de fond ou même de la volonté de parvenir à un accord qui ne soit pas le fruit de l’assujettissement de l’autre. » (306) Selon Leïla Seurat, la proposition de cessez-le-feu en dix points présentée par le Hamas et le Djihad islamique, le 16 juillet 2014, aux autorités égyptiennes, qui contient des demandes relatives à la levée du blocus, à la libération des prisonniers et à l’octroi d’une zone de pêche plus étendue, témoigne, par certains aspects, notamment le contrôle des points de passage de manière collégiale avec le Qatar ou la Turquie, d’une certaine intention d’établir une entité politique dans la bande de Gaza auto-administrée, bien que celle-ci doive rester sous domination israélienne.
De fait, la réconciliation a rapidement montré des signes de faiblesse. Une série d’attentats a touché les cadres du Fatah à Gaza le 7 novembre 2014. Depuis lors, Fatah et Hamas échangent accusations et invectives publiques alors que les relations sont de plus en plus tendues entre les deux mouvements. Le 13 janvier 2015, une réunion des ministres à Gaza a été interrompue par une manifestation d’employés recrutés par le gouvernement après 2007. Le non-versement, depuis des mois, par l’Autorité palestinienne, des salaires des 50 000 fonctionnaires recrutés par le Hamas, alors que les 70 000 fonctionnaires recrutés par l’Autorité palestinienne avant 2007 continuent de percevoir leur traitement, envenime les relations et attise les tensions.
Le Hamas pourrait aujourd’hui être tenté de pousser à la rupture du processus de réconciliation.
Selon Jean-François Legrain, l’échec annoncé de l’ultime tentative de réconciliation est en réalité le symptôme de la « dépalestinisation » de la Palestine, processus que l’entente entre le Fatah et le Hamas n’enrayera pas. Il estime en effet que ces dernières années, le recours aux médiations arabes (Arabie saoudite, Égypte, Qatar, Yémen) ou autres (Turquie, Iran), tour à tour ou de manière concomitante, marque le retour à une politique de tuteurs dont les Palestiniens avaient tenté auparavant de se libérer. Ainsi, « le président Abbas et le Fatah, tout entiers dévolus à la pérennisation de « leur » Autorité, accordent leur confiance aux États-Unis ou à l’Égypte de Hosni Moubarak puis à celle d’Abdel Fattah Al-Sissi quand Ismaël Haniyeh, le premier ministre de Gaza leur préfère le Qatar, l’Égypte de Mohamed Morsi et l’Iran » (307). La Palestine redeviendrait ainsi la caisse de résonance des intérêts et des conflits internationaux.
Une véritable réconciliation inter-palestinienne suppose des concessions pour les deux parties, auxquelles leurs dirigeants ne semblent pas prêts. Pourtant, le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza, soutenu par la communauté internationale, n’aura aucun moyen de durer sans une alliance, en conformité avec les principes internationaux, avec le Hamas. Sans faire une confiance aveugle au Hamas, certains dirigeants de l’Autorité palestinienne perçoivent que la guerre contre lui mène aussi à une impasse.
c. Un échec du processus de paix dont la responsabilité est partagée par l’ensemble de la communauté internationale
Selon Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, ancien envoyé spécial de l’Union européenne au Proche-Orient, « bien qu’Israéliens et Palestiniens soient ceux qui porteront le poids des négociations, la communauté internationale ne pourra pas rester les bras croisés et attendre la « fumée blanche » ou « noire » du conclave qui vient de s’engager. Nous sommes nombreux à connaître les raisons de l’échec des négociations antérieures. C’est pourquoi nous devons assumer notre part de responsabilité. » (308) En effet, celle-ci est largement partagée par la communauté internationale, qui navigue entre positions velléitaires, poursuites d’agenda nationaux divergents qui obèrent toute prise de position commune forte sur le conflit, ambiguïtés et contradictions.
● Les États-Unis : attitude « velléitaire » ou lassitude ?
Il faut tout d’abord admettre ce que certains qualifient de « lassitude » américaine, d’autres même, comme Hubert Védrine lors de son audition par la mission, « d’attitude velléitaire » sur ce dossier.
Les quelques espoirs soulevés par le discours du Caire du 4 juin 2009 de Barack Obama, qui avait alors réaffirmé que « la seule solution qui corresponde aux aspirations des deux parties est la création de deux États, où Israéliens et Palestiniens vivront en paix et en sécurité. C’est l’intérêt d’Israël, l’intérêt de la Palestine, l’intérêt de l’Amérique et celui du monde entier », ont été déçus. L’ultime tentative de reprise des négociations, malgré l’implication et les efforts sincères du Secrétaire d’État John Kerry, qui n’ont peut-être pas bénéficié de l’appui nécessaire de la Maison Blanche, s’est soldée, à nouveau, par un échec.
Certains commentateurs pointent à ce titre ce qu’ils qualifient d’« erreurs » américaines dans la conduite des négociations (309).
La première erreur aurait été d’avoir toléré la poursuite de la colonisation, menace mortelle pour l’existence de deux États viables. La deuxième aurait été de ne pas associer suffisamment l’Union européenne aux pourparlers. Ainsi, « faute d’être prêt à corriger l’asymétrie inhérente à toute négociation entre un occupant et un occupé, M. Kerry aurait pu confier la tâche aux Européens. » La troisième erreur aurait consisté à ne pas s’appuyer plus fermement sur le droit international, socle pourtant indispensable d’un accord de paix, et à refuser toute multilatéralisation du règlement du conflit. La dernière erreur américaine aurait été de n’imposer ni date-butoir dans les négociations, ni « contrecoups » en cas d’échec, afin d’inciter les parties à négocier.
John Kerry, dont l’effort de médiation doit cependant être salué, aurait cru pouvoir compter sur la seule bonne volonté des deux parties pour faire aboutir les négociations. Approche qualifiée de naïve par ceux qui rappellent qu’Henry Kissinger n’avait pas hésité à faire pression sur les différents acteurs pour parvenir à un accord avec l’Égypte et la Syrie après la guerre du Kippour en 1973, de même que le Secrétaire d’État James Baker avant la Conférence de Madrid en 1991.
Martin Indyk (310), envoyé spécial des États-Unis durant les négociations de 2013-2014, estime pour sa part que le soutien des Etats-Unis à Israël ne saurait être remis en question. Ainsi, le Président Obama a clairement établi dès le début de son mandat que la coopération en matière de sécurité avec Israël ne saurait, en aucune circonstance, être remise en cause. Martin Indyk considère par ailleurs que les Américains peuvent parfaitement s’accommoder d’une non-résolution du conflit, qui ne figure pas en haut de leur agenda politique.
Cependant, il souligne une véritable lassitude américaine à l’égard du conflit, aggravée par les tensions récurrentes entre gouvernements israélien et américain. Selon lui, seule la force des liens d’amitié avec Israël permettent d’expliquer que les Américains continuent, sans grande conviction, de superviser les discussions bilatérales entre les deux parties au conflit. Mais il devient de plus en plus difficile aux États-Unis d’assumer seuls ce rôle de médiateur.
● L’Europe, premier bailleur du processus de paix, a échoué à parler d’une voix commune et s’est dégagée de toute implication majeure dans le règlement politique du conflit
L’attitude des Européens n’est de son côté pas dénuée d’ambiguïtés ni de contradictions.
L’Union européenne a joué un rôle pionnier dans l’élaboration des termes d’un règlement du conflit (dialogue avec l’OLP, droit des Palestiniens à l’auto-détermination, nécessité de créer un État palestinien), et fait preuve de constance dans ses positions durant les quarante années qui ont suivi la déclaration de Venise de 1980 (311). Elle s’est aussi dotée en 1993 d’un représentant spécial pour le Proche-Orient, qui a participé à la majorité des réunions internationales consacrées au conflit, à la commission présidée par le sénateur américain Georges Mitchell et, officieusement, aux négociations de Taba de 2001. Mais, après 2003, cette fonction a perdu en autorité et en autonomie.
L’Europe s’est ainsi dégagée de toute implication majeure dans le règlement politique du conflit, pour se concentrer sur le plan humanitaire et l’appui économique au processus de paix : à la faveur des accords d’Oslo – à la négociation desquels elle n’avait pas été étroitement associée – et de la reconnaissance mutuelle des deux parties, l’Union européenne s’est engagée, d’une part, à soutenir la construction du futur État palestinien et, d’autre part, à renforcer sa coopération avec Israël. C’est ainsi que l’Union européenne a négocié, dans le cadre du processus de Barcelone lancé en 1995, un accord d’association au profit de l’Autorité palestinienne. La même année, un accord d’association est signé avec Israël.
L’Union européenne a ainsi fait le pari d’établir une relation privilégiée avec les deux parties au conflit, s’appuyant sur des coopérations renforcées, laissant aux États-Unis le soin de négocier le volet politique d’un accord.
Si la pertinence de cette approche était réelle dans la perspective de la signature d’un accord à brève échéance, elle a cependant perdu en lisibilité et en efficacité.
D’une part, l’aide européenne, bien que financièrement substantielle, ne contribue que peu à la consolidation d’un futur État palestinien viable. À Gaza, son action se limite au volet humanitaire. En Cisjordanie, l’action de l’Union européenne vise à soutenir financièrement la perspective d’un État palestinien, on l’a vu, sans résultats très probants.
● Le Quartet : une tentative de multilatéralisation du conflit au bilan déplorable
Le Quartet n’a pas eu le rôle décisif qu’il aurait pu jouer dans le règlement du conflit (312).
Mis en place en 2002, dans le contexte tendu de l’après-Intifada, le Quartet est composé de l’Union européenne, de la Russie, des Nations unies et des États-Unis. L’Union est devenue, au cours des années 1990, le principal bailleur de fonds du processus de paix. La Russie a des liens historiques étroits avec les pays arabes ainsi qu’avec Israël – du fait notamment de la diaspora russe. L’ONU permet d’apporter une légitimité internationale au Quartet, et les Américains demeurent incontournables dans toute recherche de médiation dans le conflit israélo-palestinien.
L’objectif du Quartet était de promouvoir la solution des deux États. Il a également soutenu explicitement l’Initiative arabe de paix de 2002 (cf. rapport page 178). À l’initiative des Américains, le Quartet a surtout adopté en 2003 une « Feuille de route » en trois phases qui devait permettre la création en trois ans d’un État Palestinien. Ce plan prévoyait : un arrêt des violences, la réforme de l’Autorité palestinienne afin d’éradiquer la corruption, le renforcement de l’indépendance de l’autorité judiciaire ou encore la promotion d’élections libres, le gel de la colonisation, la création d’un État palestinien avec des frontières provisoires, enfin, des négociations entre Israéliens et Palestiniens pour finaliser la situation.
Le Quartet a par ailleurs énoncé des « principes » préalables à la reconnaissance d’un futur gouvernement palestinien, dès 2005. Ces principes sont au nombre de trois : abandon de la lutte armée, reconnaissance d’Israël et acceptation de tous les accords précédemment conclus, dont la Feuille de route.
Le Quartet s’est ensuite concentré sur la Cisjordanie – c’est l’approche officieuse dite de la « West Bank first ». Le pari étant qu’en améliorant les conditions de vie en Cisjordanie, par rapport à Gaza, les Gazaouis abandonneraient leur soutien au Hamas. C’est Tony Blair – nouvel émissaire du Quartet, fort peu impliqué dans ses fonctions – qui fut chargé de mener à bien cette tâche, sans succès.
L’impact du Quartet sur la réforme de l’Autorité palestinienne a été plus que mineur. Les étapes de la feuille de route n’ont pas été mises en œuvre. En réalité, les conditions de sa mise en œuvre sont volontairement restées trop vagues. Selon certains, il s’agissait de maintenir un semblant d’efforts diplomatiques en attendant que les États-Unis – après leur intervention en Irak – se réengagent sur la question. Le Quartet n’a jamais eu la volonté de remplacer les États-Unis comme médiateur officiel du conflit.
Selon l’étude de la chercheure Nathalie Tocci, le boycott et l’intransigeance du Quartet, initiée par les Américains, vis-à-vis du Hamas, n’a pas été efficace. Le Quartet aurait pu exercer une pression sur le Hamas, pour l’amener à faire des concessions supplémentaires. Cela a entraîné une perte de crédibilité internationale du Quartet – notamment au sein des populations arabes, qui a également entravé le processus de réconciliation interpalestinienne.
S’y ajoutent les divergences d’intérêts entre les membres du Quartet.
Les États-Unis n’ont jamais exprimé une volonté forte de promouvoir une approche multilatérale dans la médiation du conflit israélo-palestinien. Ils cherchaient davantage à établir un cadre multilatéral international pouvant leur permettre de partager une part de la responsabilité des échecs des négociations ou, en cas de succès, pouvant apporter un soutien financier et politique.
Les Européens étaient à la recherche d’un rôle politique dans le processus de paix. Ayant réalisé qu’ils ne pourraient pas acquérir ce statut indépendamment des Américains, l’Union européenne a espéré pouvoir les influencer à travers le Quartet.
Les Russes et les Nations unies sont restés passifs. Le rôle de la Russie a été mineur et il ne s’agissait pour elle que d’afficher son statut de puissance internationale. La même analyse peut être faite concernant les Nations unies.
● La poursuite d’agendas distincts et l’instrumentalisation de la question palestinienne au plan interne a longtemps fragilisé toute initiative commune crédible des Etats arabes
Quant aux États arabes, il faut certes saluer la main tendue en 2002 avec l’Initiative arabe de paix adoptée à Beyrouth par les membres de la Ligue arabe. Cependant, la question palestinienne a souvent été instrumentalisée à des fins intérieures et a bloqué toute initiative commune crédible.
Jusqu’en 1967 et la défaite égyptienne lors de la guerre des six jours, la question palestinienne n’était pas une question autonome mais faisait partie intégrante de la plus vaste question de l’indépendance arabe.
Malgré l’autonomisation progressive des Palestiniens à l’égard des « pays frères » voulue par Yasser Arafat et le Fatah, le conflit israélo-palestinien continue à être une question de politique intérieure pour l’ensemble des pays du Proche et Moyen Orient. Chaque pays aspirant au leadership dans la région se doit d’avoir une politique palestinienne. Ainsi Fatah, Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) et plus tard Hamas et Djihad Islamique ont toujours su trouver des parrains puissants en Égypte, en Syrie, en Irak, dans le Golfe et même en Iran.
Aujourd’hui encore, les divisions des États arabes qui poursuivent dans la région leur propre agenda tend à complexifier toute initiative de paix. En effet, l’initiative d’une paix globale avec Israël, comme naguère la guerre, ne peut être que le fait d’un pays capable d’entraîner les autres dans son sillage. Il n’est qu’à rappeler l’exclusion de l’Égypte d’Anouar el Sadate de la Ligue arabe et de la rupture de ses relations diplomatiques avec l’ensemble des autres pays arabes, parce qu’elle avait conclu avec Israël une paix séparée, du fait du « cavalier seul » de son Président mais aussi du front du refus qu’il lui fut opposé notamment par la Syrie d’Hafez el-Assad.
A la suite des « révolutions arabes », plusieurs tentatives de prise de leadership, au sein mais aussi en dehors du monde arabe, se sont fait jour dans la région, avec à chaque fois des conséquences sur les Palestiniens.
La Turquie a apporté son soutien au président égyptien issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi, avec comme conséquence un appui, au moins politique, au Hamas. Cette politique a par ailleurs été initiée avant « les révolutions arabes », comme en témoigne l’affaire du Mavi Marmara et de la forte dégradation des relations avec Israël – qui n’a cependant pas affecté les échanges économiques entre les deux pays. La Turquie a trouvé un allié de circonstance avec le Qatar dans son soutien aux Frères musulmans égyptiens et à leur branche palestinienne, le Hamas. En soutenant le Hamas, mouvement qui assume la confrontation avec Israël, ces pays poursuivaient plus des objectifs diplomatiques et de satisfaction de leur opinion publique qu’une quelconque « libération de la Palestine par les armes ». L’Iran, de par son soutien notamment militaire au Hamas comme au Hezbollah, participe à cette même logique. Le cas de l’Égypte est aussi éclairant. À la suite de la chute d’Hosni Moubarak, de l’élection de Mohamed Morsi et de l’arrivée au pouvoir d’une majorité issue des Frères musulmans, le blocus de Gaza a été assoupli puis en partie levé. La bande de Gaza, dominée par le Hamas, a retrouvé pour un temps son lien historique avec l’Égypte, avant d’en être à nouveau coupée avec le changement de régime. Les nouvelles autorités égyptiennes ont renoué avec une politique de méfiance, sinon de lutte, contre l’islamisme politique. La politique égyptienne à l’égard des Palestiniens est donc bien, elle aussi, déterminée par des considérations de politique intérieure.
Selon certains commentateurs, il y aurait eu, avant la crise de cet été, une opportunité d’utiliser l’alignement des intérêts entre Israël et les États arabes comme une base commune pour lancer une initiative similaire à celle de la Conférence de Madrid, en 1991 (un cadre régional plus large qui apporterait son soutien à une négociation bilatérale menée par les États-Unis). Cependant, les crises internes dans les pays arabes ne les ont pas incités à faire preuve de créativité diplomatique.
B. 2015 OU LE NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE PARADIGME
La faillite du processus de paix pourrait aujourd’hui entraîner les parties au conflit dans un terrible engrenage : face à l’impasse des négociations, le développement d’une stratégie alternative par les Palestiniens aux Nations unies semble relever d’une mise en scène internationale du conflit, sans œuvrer concrètement à son règlement. S’y ajoutent les contre-réactions israéliennes, qui pourraient peser sur l’équilibre économique, politique et sécuritaire déjà précaire de la Cisjordanie, mais aussi les tensions induites par la poursuite de la colonisation. Il faut aussi craindre une reprise des violences à Gaza, où la situation humanitaire et sécuritaire se dégrade de jour en jour, dans l’indifférence relative de la communauté internationale. Enfin, une forme de radicalisation d’une population n’ayant plus rien à perdre n’est pas à exclure, ce qui est particulièrement inquiétant dans un contexte de dissémination des groupes terroristes dans la région.
Les paramètres de règlement sont connus et font l’objet d’un consensus international. Pourtant l’enlisement du processus de paix, les ambiguïtés de la communauté internationale, l’isolement et la faiblesse des deux parties font douter d’une reprise efficace des pourparlers.
S’il s’agit, non pas seulement de reprendre les négociations, mais d’aboutir à un accord pérenne, un changement de méthode est nécessaire, ainsi qu’une véritable volonté politique. La logique des accords d’Oslo doit être inversée. Il s’agirait de poser au préalable un cadre clair de négociation et d’engager les parties, sous l’égide de la communauté internationale, sur la voie diplomatique, et non celle de la violence.
La France peut ici jouer un rôle d’appui essentiel, et d’interprète du droit international. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la France peut replacer la question israélo-palestinienne sur la scène onusienne, pour définir un cadre consensuel au niveau international. Entretenant une relation privilégiée aussi bien avec Israël qu’avec les autorités palestiniennes, elle peut rapprocher les vues des différents acteurs, inciter les parties à la négociation et leur offrir des garanties, en matière économique et sécuritaire. La France peut enfin s’appuyer sur les relations privilégiées qu’elle entretient avec certains pays arabes et ses partenaires européens pour promouvoir leur participation plus active à la résolution du conflit.
1. La paix maintenant ou jamais ? Les risques d’un oubli du conflit, l’opportunité de sa résolution, la nécessité d’un changement de paradigme
a. Les risques d’un pourrissement du conflit
● L’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale pourrait entraîner une dangereuse « logique d’engrenage »
On l’a vu, aussi bien pour maintenir la question palestinienne au cœur de l’agenda international que pour des raisons de politique intérieure, l’Autorité palestinienne poursuit une stratégie alternative aux Nations unies.
Or, les derniers développements de cette diplomatie, marqués par l’adhésion de la Palestine au Statut de Rome (313), pourraient envenimer la situation.
L’adhésion ne devrait prendre effet qu’au 1er avril 2015. Cependant, il faut souligner que Mahmoud Abbas a fait le choix de doubler l’adhésion au Statut de Rome d’une déclaration, immédiatement effective, permettant à la Palestine de reconnaître la compétence de la Cour de manière rétroactive, à compter du 13 juin 2014, date du début de l’opération militaire israélienne en Cisjordanie.
La procureure de la CPI a annoncé, le 16 janvier, l’ouverture d’un examen préliminaire sur des crimes de guerre présumés commis depuis le 13 juin 2014 en Palestine (incluant les deux dernières opérations militaires israéliennes en Cisjordanie et à Gaza). La suite de la procédure n’est pas encore connue et la procureure, estimant que l’évolution du dossier dépendra de la coopération d’Israël et de la Palestine, ne peut pour le moment se prononcer sur un calendrier. En vertu du Statut de Rome, la Cour peut enquêter sur tout crime relevant de sa compétence (crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre), commis dans les Territoires palestiniens par un Israélien, ou par tout Palestinien, quel que soit le lieu du crime.
Sous réserve que la procureure juge qu’il existe une base raisonnable, la Cour est compétente pour examiner aussi bien les violations commises lors de l’intervention « Bordure protectrice » de l’été, mais aussi sur la colonisation, tout comme des violations commises par des Palestiniens. Israël n’étant pas partie à la CPI, il n’a en théorie aucune obligation de coopérer.
Les effets de cette stratégie sont incertains, en l’absence de perspective de reprise à court terme des négociations, et pourraient envenimer un peu plus le conflit. Au plan interne, la poursuite par la Cour de Palestiniens, membres ou non du Hamas, pourrait entraîner des tensions non négligeables, qui affaibliraient un peu plus l’unité de la direction palestinienne.
Surtout, il est à craindre que la majorité républicaine du Congrès des États-Unis, hostile à la demande d’adhésion à la CPI, ne vote en faveur d’une réduction de l’aide octroyée à l’Autorité palestinienne.
S’y ajoutent les mesures de rétorsion israéliennes : le gouvernement a d’ores et déjà annoncé la suspension du reversement des droits et taxes perçues pour le compte de l’Autorité palestinienne, et une accélération de la colonisation n’est pas à exclure, non plus que le lancement de procédures judiciaires contre des Palestiniens.
Il faut donc à tout prix, comme l’a rappelé récemment Laurent Fabius, éviter une « logique de l’engrenage ».
● Un risque d’autant plus grand que le contexte régional, marqué par la déstabilisation du voisinage du fait des crises syrienne et irakienne et la montée du terrorisme, a radicalement changé
Le risque d’engrenage est d’autant plus inquiétant que le contexte international a changé : le voisinage est déstabilisé par les crises irakienne et syrienne et la montée de Daech. Surtout, Israël, qui depuis sa création, a été impliqué dans des conflits conventionnels, doit aujourd’hui faire face à des menaces sécuritaires d’un autre ordre : infra et supra-étatiques (314).
Au niveau supra-étatique, le motif principal d’inquiétude est aujourd’hui le dossier nucléaire iranien, évoqué précédemment – l’Irak ayant renoncé à la bombe en 1981, la Syrie en 2007. Israël a marqué son opposition à l’accord intérimaire. Un échec total des négociations aurait pour effet de raviver l’option d’une intervention militaire chez les dirigeants israéliens, option qui fait cependant débat au plan interne, car elle entraînerait la région dans une dangereuse escalade.
Au niveau infra-étatique, la principale menace sécuritaire provient de la frontière Nord et de la bande de Gaza. Depuis 2006, la guerre contre le Hezbollah, et trois guerres à Gaza, ont montré que cette menace stratégique était croissante, les protagonistes de mieux en mieux équipés et capables de frapper les villes israéliennes. Or il est difficile pour une armée conventionnelle de s’opposer à une organisation non étatique : non seulement la victoire militaire n’est pas évidente, mais la confrontation provoque une érosion de l’image internationale d’Israël. Il faut également noter que le soutien de l’Iran et de la Syrie au Hamas, qui n’a pas disparu, inquiète Israël.
Au Nord, la crise syrienne inquiète également : un État hier puissant, stable, en relative bonne relation avec son voisin, est désormais en état de déliquescence, menacé de partition, marqué par la forte présence de groupes djihadistes. Certains estiment en Israël que le maintien de Bachar el-Assad est préférable au chaos, d’autres que son maintien conduirait au renforcement de l’axe Iran-Syrie-Russie-Hezbollah. Israël n’est pas impliqué dans le conflit, à l’exception de raids dans le Golan, de frappes contre le Hezbollah et d’interventions humanitaires, mais l’escalade pourrait être rapide.
La montée des tensions avec le Hezbollah est elle aussi particulièrement préoccupante. Le 18 janvier 2015, six membres du Hezbollah ainsi que six Gardiens de la révolution iraniens ont été tués lors d’un raid israélien sur le Golan syrien. Parmi les victimes figurait Djihad Moughniyeh, fils de l’ancien chef des opérations militaires du mouvement libanais, Imad Moughniyeh (315). Le raid israélien a une forte dimension symbolique. Il s’agit du premier général iranien tué par Israël dans un conflit « ouvert », au moment où les négociations avec l’Iran entrent dans une phase décisive. Le fait que l’attaque ait ciblé à la fois des soldats iraniens et des combattants du Hezbollah, en Syrie, insiste en creux sur l’implication importante des Iraniens dans le conflit syrien (316). Cette attaque pourrait « réactiver » un nouveau front du conflit israélo-arabe : le plateau du Golan.
Deux soldats israéliens ont été tués et sept autres blessés lors d’une série d’attaques près de la frontière libanaise le 28 janvier 2015. Il s’agit de l’attaque la plus grave menée par le mouvement libanais contre des soldats israéliens depuis la guerre de l’été 2006. La riposte de l’armée israélienne a été immédiate et l’artillerie a visé des positions du Hezbollah sur le territoire libanais. Dans ces échanges de tirs, un soldat espagnol de la FINUL a été tué. L’Espagne a réclamé une enquête (317). Des pilotes israéliens ont mené, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 janvier 2015, des raids contre des postes d’artillerie de l’armée syrienne, après des tirs de roquettes sur le territoire israélien, sans que l’on puisse déterminer avec certitude l’origine de ces tirs et leur caractère ou non intentionnel.
La zone est régulièrement touchée par des projectiles venus du côté syrien, où les combats font rage entre l’armée d’un côté et les rebelles et combattants djihadistes de l’autre. Tel-Aviv a en tout cas jugé les frappes délibérées. Le porte-parole de l’armée israélienne a mis en garde les autorités de Damas : « L’armée tient le gouvernement syrien pour responsable de toutes les attaques en provenance de son territoire et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre les citoyens israéliens. »
Des combats sporadiques opposent depuis plusieurs mois l’armée libanaise et le Hezbollah d’un côté aux groupes du Front Al-Nosra et de Daesh de l’autre dans la région de la Bekaa à la frontière avec la Syrie. De nombreuses tentatives d’incursions ont été déjouées mais en cas de conflit avec l’armée israélienne, une intensification de la présence des groupes islamistes radicaux au Liban est à craindre (318). En cas de conflit au Liban, la question se pose de savoir si l’Iran viendrait en soutien au mouvement chiite, faisant peser le risque d’un conflit régional généralisé.
Compte tenu de l’implication militaire du Hezbollah en Syrie et des échéances électorales en Israël, aucun des deux protagonistes ne semble avoir intérêt à une escalade pour le moment. Les Iraniens avaient prévenu, en écho aux déclarations de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qu’il y’aurait des représailles. Le 30 janvier, lors d’un discours, Hassan Nasrallah a indiqué que si le mouvement « était prêt », il ne « voulait pas la guerre ». De même, bien que Benyamin Netanyahou ait affirmé que l’armée était prête à agir « sur tous les fronts », le contexte préélectoral ne l’incite pas à s’engager dans un conflit ouvert avec le Hezbollah (319) : le conflit de l’été 2006 avait paralysé le Nord du pays et le renforcement militaire du Hezbollah depuis ne garantit pas une victoire militaire rapide aux forces israéliennes.
Si le voisinage au Nord est source d’inquiétudes légitimes, il faut prêter la plus grande attention au Sud, où la dégradation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza, doublée de son isolement nourrissent les frustrations et font craindre une reprise des attaques contre Israël, mais surtout une véritable implosion interne.
Le Sinaï est en proie à des luttes violentes entre le régime égyptien et Ansar Bayt al-Maqdis, ayant fait allégeance à Daesh. Les Égyptiens auraient obtenu l’autorisation des Israéliens de faire pénétrer des armes lourdes, en dépit de l’accord de paix de 1979, dans la péninsule, afin de lutter contre le groupe terroriste. Par ailleurs, la ville de Rafah a été évacuée pour créer une zone de sécurité entre Gaza et le Sinaï. Enfin, le 31 janvier, la branche armée du Hamas a été reconnue comme une organisation terroriste par les autorités égyptiennes. (320)
● L’isolement de la bande de Gaza, et l’aggravation de la situation humanitaire, qui se poursuit dans l’indifférence de la communauté internationale, laissent craindre une reprise des violences avec Israël voire une implosion interne
L’isolement de la bande de Gaza se poursuit et constitue une menace, non seulement pour sa population, mais aussi pour l’Égypte et Israël. La gravité de la situation humanitaire, les retards considérables pris dans la reconstruction et l’impasse politique de la direction palestinienne, risquent d’entraîner, à brève échéance, une nouvelle explosion de violence.
Les discussions israélo-palestiniennes, qui devaient se tenir au Caire, ont été reportées sine die, et nul ne semble prêt, ni le Gouvernement israélien, ni le Hamas, ni le Fatah, à les reprendre. Le Hamas poursuit sa propre stratégie d’autonomisation, que de fait le Gouvernement israélien encourage en ne permettant pas une construction suffisamment rapide de la bande de Gaza et en s’opposant aux efforts de réconciliation inter-palestinienne. Il semblerait en effet que le Hamas explore des pistes pour favoriser la formation d’une structure autonome, qui rassemblerait les différents groupes présents à Gaza. Les discussions en cours avec Mohammed Dahlan attestent de la tentation de mettre un point final à la réconciliation inter-palestinienne actée en avril 2014. S’y ajoutent le rapprochement du Hamas et de l’Iran, qui creuse un fossé de plus en plus profond entre la mouvance islamiste et le Fatah.
La situation semble donc reprendre le chemin de ce qu’elle était avant la crise de cet été. Des échanges de tirs de part et d’autre de la barrière de séparation et une multiplication des exercices de tirs de roquettes par les groupes armés à Gaza signalent la possibilité d’une reprise des violences avec Israël. Pour Robert Turner, directeur des opérations de l’UNRWA à Gaza, « la situation étant pire qu’avant le conflit, la population n’a aucune raison de vouloir éviter une nouvelle guerre ».
Surtout, il faut s’inquiéter des risques d’implosion interne. La résilience des habitants de Gaza ne pourra longtemps supporter la dégradation continue des conditions de vie. Le lendemain de l’annonce de la suspension de l’aide de l’UNRWA, le 28 janvier 2015, des manifestants ont pénétré dans les locaux contrôlés par les Nations unies, témoignant de la colère de la population.
L’absence totale d’horizon politique est de nature à pousser une population qui n’a plus rien à perdre à toute forme de violence ou de radicalisation.
La présence de Daesh n’est pour l’heure pas avérée en Cisjordanie ou à Jérusalem, d’une part en raison de la culture de pluralisme et d’ouverture qui caractérise la société palestinienne, d’autre part, car l’Autorité palestinienne parvient à maintenir, de plus en plus difficilement, l’ordre public.
Le pays est cependant exposé au phénomène des combattants terroristes étrangers. Une trentaine d’Arabes israéliens seraient partis combattre en Syrie. Ceux qui sont rentrés en Israël y ont été arrêtés. Le 18 janvier, le Shin Bet a déclaré que 7 d’entre eux, arrêtés en novembre dernier, auraient créé une cellule terroriste liée à Daesh et auraient été sur le point de mener une attaque sur le territoire israélien. Enfin, des actes isolés, mais néanmoins meurtriers ne sont pas à exclure : le 21 janvier 2015, un Palestinien armé d’un couteau a blessé plusieurs civils dans un bus de Tel-Aviv, faisant plusieurs blessés graves.
A Gaza, on peut craindre un renforcement des mouvances salafistes-djihadistes. Le 19 février, une manifestation de près de 200 salafistes portant les drapeaux de Daesh – la première d’ampleur à Gaza – s’est déroulée devant l’Institut français ; le Hamas, qui a toléré l’organisation du rassemblement, l’a toutefois dispersé avant qu’il ne s’approche de l’Institut.
Enfin, il faut souligner que la région n’est pas la seule à être menacée par les effets induits par la perpétuation du conflit israélo-palestinien. Ce conflit, dont il ne faut pas négliger la dimension symbolique, a en effet « une résonance particulière » dans de nombreux pays, y compris le nôtre. Selon Leila Shahid, lors de son audition devant la commission, son non-règlement est de nature à renforcer une violence qui n’aurait plus de frontières.
C’est dans ce contexte que l’Ambassadeur de Palestine en France a fait valoir auprès des membres de la mission les efforts, et les difficultés, de l’Autorité palestinienne, pour défendre la voie pacifique et diplomatique, notamment auprès de jeunes générations qui croient de moins en moins à sa validité. Il a ainsi plaidé pour que la communauté internationale soutienne « cette dynamique d’apaisement et cette stratégie non-violente » et fasse valoir le potentiel immense d’une paix qui ferait du Proche-Orient le « laboratoire » de la stabilité de l’ensemble de la région.
b. La possibilité d’une paix régionale
● La question est moins de savoir si le conflit israélo-palestinien est devenu ou non secondaire que d’identifier les bénéfices de son règlement et les risques de son pourrissement
Comme l’a souligné l’un des interlocuteurs de la mission, « l’affirmation que la question israélo-palestinienne n’est pas le problème central de la région est à l’origine une idée israélienne, mais elle a gagné beaucoup de terrain. Le processus de paix au Proche-Orient n’est pas réellement devenu secondaire, car il y a les efforts de Kerry, mais il y a tout de même une part de vérité dans cette affirmation. Par ailleurs, même une résolution miraculeuse du problème n’aiderait pas à régler les autres dossiers.»
D’autres considèrent au contraire que la puissance symbolique de ce conflit justifie qu’on lui accorde toute notre attention. On peut ainsi citer Alain Gresh, qui juge que « la Palestine est le nom d’une injustice persistante, marquée par une violation permanente du droit international. Enfin, d’une logique de « deux poids, deux mesures », appliquée par les gouvernements, relayée par les Nations unies et théorisée par bon nombre d’intellectuels occidentaux. Au croisement de l’Orient et de l’Occident, du Sud et du Nord, la Palestine symbolise à la fois le monde ancien, marqué par l’hégémonie du Nord, et la gestation d’un monde nouveau fondé sur le principe de l’égalité entre les peuples. » (321)
La question n’est pas en réalité de savoir si ce conflit est ou non devenu secondaire, ou si son règlement permettrait un déblocage miraculeux d’autres dossiers, ce qui est effectivement peu probable.
En revanche, il est essentiel de rappeler que ce conflit se situe au cœur d’un Proche et Moyen-Orient en pleines crises et recompositions. Les mutations à l’œuvre dans cette région, si elles peuvent l’entraîner dans le chaos le plus total, peuvent aussi faciliter un accord de paix entre Israël et la Palestine.
● Des recompositions régionales qui peuvent être favorables au règlement du conflit israélo-palestinien
La disparition en tant qu’acteurs de la Syrie et de l’Irak n’a aucune raison de ne pas toucher d’autres pays et Israël court un véritable risque de se retrouver aux prises avec des groupes de plus en plus violents et de plus en plus proches de ses frontières. De plus, l’hypothèse d’une réintégration de l’Iran dans le jeu des puissances régionales pourrait avoir des conséquences majeures pour les protagonistes du conflit.
En effet, si le dossier du nucléaire iranien disparaît de l’agenda politique, il pourrait ouvrir la possibilité d’une réintégration de l’Iran au sein du leadership régional, aux côtés de puissances sunnites comme l’Arabie saoudite, ce qui pourrait contribuer à la résolution de la crise syrienne. La prochaine étape pourrait alors être un effort coordonné des pays arabes en faveur d’une reconnaissance de l’État de Palestine, fondée sur l’Initiative arabe de paix soutenue par la Ligue arabe.
La paix avec ses voisins arabes, dont un Etat de Palestine, constituerait une assurance pour Israël face aux menaces terroristes qui agitent la région. Cela induirait de plus une redéfinition de la géopolitique régionale en donnant un regain de force à certains États face à la volonté de leadership turc et surtout iranien.
On peut penser que ni les États-Unis, ni l’Europe ne seraient défavorables à un tel accord. Les États-Unis pourraient vouloir s’appuyer sur la convergence objective d’intérêts entre Israël, l’Égypte, la Jordanie et les États du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, pour réduire leur implication directe – le terme de désengagement serait excessif – au Proche et Moyen-Orient. On peut pousser le raisonnement jusqu’à l’hypothèse d’une nouvelle alliance sunnite qui inclurait l’Autorité palestinienne. Ainsi, selon Federica Mogherini, « la situation créée par Daesh va aboutir à tester la volonté politique des pouvoirs en place, y compris ceux de Palestine et d’Israël. »
La Ligue arabe devrait, lors du sommet de Charm-el-Cheikh de mars 2015, réaffirmer et opérationnaliser l’Initiative arabe de paix. Ce sera le premier sommet de la Ligue depuis la mort du roi Abdallah. Une initiative coordonnée de l’Égypte et de l’Arabie saoudite pourrait ainsi être envisagée, aussi bien pour des motifs de politique intérieure que d’intérêts stratégiques.
Rappelons que c’est en effet l’Arabie saoudite qui avait, en 2002, été à l’origine de l’Initiative arabe de paix. Ajoutons que le principal adversaire régional de l’Arabie saoudite, que ce soit en Irak, en Syrie, au Yémen mais aussi sur son propre territoire auprès des 10 % de chiites saoudiens, est l’Iran. Par ailleurs, des liens rétablis avec l’Iran, un début de réconciliation avec le Qatar, et la préservation de liens étroits et d’intérêts sécuritaires communs avec Israël placent également l’Egypte en position de médiateur entre Israël et le monde arabe. Le régime égyptien est de son côté engagé dans une lutte existentielle avec les Frères musulmans dont le Hamas, soutenu par l’Iran, est la branche palestinienne. Une initiative de paix qui marginaliserait le Hamas au profit de l’Autorité palestinienne et du Fatah pourrait trouver un écho favorable auprès des Egyptiens. Lors d’un discours à Davos, en janvier 2015, Abdel Fattah al-Sissi a invoqué le souvenir d’Anouar el-Sadate et plaidé pour un rôle actif de l’Egypte dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Si nous parvenons à un accord de paix, a-t-il déclaré, c’est un nouveau Moyen-Orient qui verra le jour, permettant de mettre fin au terrorisme et de rétablir la stabilité dans la région. (322)
● Israël pourrait compter sur des alliés objectifs dans la région dans le cadre d’un accord global de paix
L’Ambassadeur d’Israël en France, lors de son audition par la mission, estimait qu’il existait « de nombreux motifs d’espérer : la conclusion du traité de paix avec l’Égypte, les bonnes relations que nous entretenons avec la Jordanie, le fait que nous tentions de parvenir à un accord avec les Palestiniens. » Il a plaidé pour que la communauté internationale porte un regard neuf sur le Proche et le Moyen-Orient, où s’affrontent les forces modérées et les mouvements extrémistes.
Selon le journaliste israélien Akiva Eldar, si les résultats des élections marquent une inflexion politique du Gouvernement israélien, celui-ci pourrait découvrir qu’un gel de la colonisation, une levée à certaines conditions du blocus sur Gaza, et le lancement de négociations sérieuses sur la base de l’Initiative arabe de paix pourraient ouvrir les portes d’Israël à l’ensemble du monde arabo-musulman (323).
Un maintien du statu quo des négociations de paix pourrait au contraire renforcer l’isolement d’Israël. Selon Akiva Eldar, les aléas qui ont affecté ces derniers mois la relation entre la Maison Blanche et Benyamin Netanyahou, dont la polémique suscitée par son projet d’allocution devant le Congrès américain à l’invitation de son président John Boehner (324), menacent de placer le Premier ministre israélien en position d’outsider.
Quatre axes régionaux sembleraient se dégager aujourd’hui : l’Iran et sa sphère d’influence, l’Irak, la Syrie et le Hezbollah au Liban ; le Qatar et la Turquie et les soutiens aux Frères musulmans y compris le Hamas à Gaza ; l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe, l’Égypte et la Jordanie ; l’axe djihadiste, composé de Daesh, Al-Qaida et leurs affiliés dans la région.
Selon Itamar Rabonovitch, trois de ces axes peuvent être considérés comme demeurant hostiles à Israël, en premier lieu l’Iran. La Turquie constitue un adversaire critique avec lequel cependant les liens économiques devraient se maintenir. Le Qatar a modéré son soutien aux Frères Musulmans, notamment sous la pression du Conseil de coopération du Golfe. Israël serait à la fois inquiet de ses liens avec le Hamas et désireux de ne pas fermer la porte à un acteur régional malgré tout influent. Surtout, les autorités israéliennes partagent les inquiétudes saoudiennes vis à vis de la volonté d’affirmation de l’Iran, la même crainte d’une montée en puissance des salafistes djihadistes et des Frères musulmans que l’Égypte, et les mêmes intérêts sécuritaires objectifs que la Jordanie, elle-même déstabilisée par la crise syrienne et irakienne. Il souligne par conséquent l’existence d’une alliance objective entre ces pays qu’il qualifie de « conservateurs modérés » et Israël, sur lesquels ce pays pourrait compter dans le cadre d’un accord global de paix.
c. La nécessité d’un changement de paradigme des négociations
● Le paradigme actuel a échoué à régler le plus vieux conflit de la région : le processus est devenu un « obstacle à la paix »
Selon Avraham B. Yehoshua, écrivain israélien, le processus de paix est devenu un « obstacle à la paix », où la rhétorique revêt plus d’importance que l’action, quand elle ne dissimule pas des actes s’opposant clairement à la paix. Le processus, dit-il, « inspire une patience devenue une passivité absolue ». Or rien ne serait plus terrible, pour les Israéliens, comme pour les Palestiniens qu’une perte totale de crédibilité des pourparlers, car seules les négociations permettront d’aboutir à une paix durable.
On ne compte plus les réunions, proclamations solennelles, tentatives diplomatiques, depuis les célèbres accords d’Oslo, qui ont marqué l’acte de naissance officielle de ce processus, comme le rappelle l’encadré présenté ci-dessous.
Le processus de paix israélo-palestinien depuis les accords d’Oslo (1993)
Les accords d’Oslo (13 septembre 1993) : après six mois de négociations secrètes à Oslo, Israël et l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) se reconnaissent mutuellement et signent à Washington une Déclaration de principes sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le Président de l’Autorité palestinienne Yasser Arafat échangent une poignée de main historique.
L’accord d’Oslo II (28 septembre 1995) : signé à Washington, il prévoit une série de retraits israéliens.
L’accord de Wye Plantation (23 octobre 1998) : signé aux États-Unis à Wye Plantation, il prévoit les modalités d’un retrait israélien de 13% de la Cisjordanie.
Le Sommet de Camp David II (11-25 juillet 2000) : aux États-Unis, dans la résidence de Camp David du Président Bill Clinton, le Premier ministre israélien Ehoud Barak et le Président de l’Autorité palestinienne Yasser Arafat sont invités à discuter du problème de Jérusalem et des réfugiés. Les négociations échouent. Deux mois plus tard, la seconde Intifada éclate (2000-2005).
Les discussions de paix à Paris (Octobre 2000) : une réunion entre la secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright, Ehoud Barak et Yasser Arafat est organisée à Paris, mais elle ne permet pas le retour au calme.
Le Sommet de Taba (21 janvier 2001) : Palestiniens et Israéliens entreprennent des négociations à Taba en Egypte pour tenter de parvenir à un accord de paix avant dix jours. Mais Ariel Sharon est élu Premier ministre de l’Etat d’Israël le 6 février et il succède à Ehoud Barak.
Le Sommet arabe de Beyrouth (28 mars 2002) : le sommet adopte l’Initiative de paix saoudienne (normalisation des relations des pays arabes avec Israël en échange d’un retrait des territoires occupés et du règlement de la question des réfugiés palestiniens).
La « Feuille de Route » du Quartet pour le Moyen-Orient (17 septembre 2002) : un plan par étapes devant conduire d'ici 2005 à la création d'un Etat palestinien est élaboré par les Etats-Unis, la Russie, l’Union européenne et les Nations unies. La « Feuille de Route » est remise au Premier ministre israélien Ariel Sharon et au Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas, le 30 avril 2003. Le document demande le gel de la colonisation par Israël et la fin des violences.
Le Projet « La Voix du Peuple » (6 septembre 2003) : Israéliens et Palestiniens présentent au Parlement européen un plan de paix. Le projet baptisé « La Voix du Peuple » reconnaît l'existence de deux Etats pour deux peuples comme base de tout règlement du conflit.
L’Initiative de Genève (12 octobre 2003) : une cinquantaine d'intellectuels, de pacifistes et d'hommes politiques israéliens et palestiniens rédigent en Jordanie un pacte symbolique, baptisé « Initiative de Genève », pour relancer les négociations de paix.
Sommet de Charm El-Cheick (8 février 2005) : en Egypte, Ariel Sharon et Mahmoud Abbas annoncent la fin des violences entre Israël et les Palestiniens. La Jordanie et l'Egypte décident le retour de leur ambassadeur en Israël, après plus de quatre ans d'absence décidée en raison de la répression de l'Intifada.
Le Plan de désengagement (12 septembre 2005) : Israël se retire de la bande de Gaza après 38 ans d’occupation, conformément au plan de désengagement unilatéral du Premier ministre Ariel Sharon.
La Conférence d’Annapolis (27 novembre 2007) : aux Etats-Unis, Israéliens et Palestiniens conviennent de tenter de parvenir à un accord de paix d’ici à la fin 2008.
La reprise des pourparlers indirects (8 mai 2010) : l’Autorité palestinienne accepte le principe de pourparlers indirects avec Israël sous l’égide des Etats-Unis, qui commencent le lendemain (les Palestiniens avaient refusé de poursuivre les négociations suite à l’opération israélienne « Plomb durci » du 27 décembre 2008).
La reprise des pourparlers directs (2 septembre 2010) : Israéliens et Palestiniens reprennent les négociations, lesquelles s'ouvrent « sans conditions préalables » (position voulue par Israël et acceptée par Mahmoud Abbas qui, sous la pression américaine, a renoncé à exiger d'Israël l'acceptation d'un Etat palestinien dans le cadre des frontières de 1967 et l'arrêt total de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est). Israël reprend la colonisation quelques mois plus tard.
La reprise des négociations (juillet 2013): sous l'égide des États-Unis, les discussions directes, gelées depuis trois ans, entre Israéliens et Palestiniens reprennent, et, à nouveau, échouent.
La multiplication de ces initiatives n’a donné aucun résultat, malgré un consensus général sur les paramètres de règlement du plus ancien conflit de la région. Comment expliquer ce paradoxe ? Le processus de paix ne serait-il devenu qu’un simple discours, une rhétorique de paix dans un état de guerre ? Ou bien s’agit-il d’un problème de méthode ?
Il faut accepter le constat, certes difficile, de l’incapacité du processus de paix, tel qu’il était conduit jusqu’à présent, à déboucher sur un règlement effectif de la question.
Ce processus repose sur trois piliers : une négociation bilatérale entre Israéliens et Palestiniens, notamment l’OLP ; une médiation par les États-Unis, perçus comme les seuls à avoir la confiance d’Israël et les leviers sur ce pays ; un financement par des acteurs tiers, dont l’Union européenne, les Nations unies et les pays arabes.
Dans ce schéma, le Conseil de sécurité a été marginalisé par les États-Unis, qui considèrent l’implication de celui-ci comme contradictoire avec le principe selon lequel il revient aux deux parties de négocier, et non de se voir imposer, un accord. L’Union européenne s’est plus ou moins volontairement marginalisée dans le règlement politique du conflit.
Enfin et surtout, la négociation a toujours été menée selon un angle bilatéral, sans prendre en compte le problème de façon globale, comme la partie d’un tout régional à stabiliser.
● Un consensus se dégage sur la nécessité de changer de méthode : fixer le cadre des négociations par une résolution du Conseil de sécurité, multilatéraliser le conflit en associant un Quartet élargi aux pays arabes, inciter les parties à négocier
S’il est évident que la responsabilité des arbitrages ultimes et des concessions historiques revient aux protagonistes du conflit, la communauté internationale doit accompagner le processus de manière active, et, surtout, selon une nouvelle méthode.
Les deux parties auront beaucoup de mal à parvenir à un accord s’ils restent seuls, même avec l’aide des États-Unis. Cette triangulaire a désormais vécu, il faut imaginer un autre format de négociations. Votre rapporteure estime que les États-Unis doivent à tout le moins admettre la nécessité d’inscrire les négociations dans un cadre multilatéral et de remettre le droit international au cœur des pourparlers.
Certes, Israël a une préférence pour la discussion bilatérale, sous égide américaine, et il serait hors de propos de nier le rôle central des États-Unis dans les négociations. Il faudra aussi prendre en compte la méfiance des Palestiniens à l’égard de tout ce qui les diluerait dans un front « arabe » alors que leur autonomisation a été le combat d’une vie pour la génération d’Arafat et d’Abbas. De leur côté, les Américains se sont toujours montrés réticents à un abandon du format classique des négociations, soulignant le risque d’un durcissement des positions des acteurs, craignant peut-être de perdre leur leadership.
Ils pourraient aujourd’hui, cependant, ne pas être défavorables à un changement de paradigme, eux qui, sans faire à ce stade de proposition de relance après les élections israéliennes, ont indiqué leur intention de travailler à un projet de résolution au Conseil de sécurité.
Le 26 janvier 2015, le Quartet a de son côté publié une déclaration appelant à reprendre des négociations et à impliquer étroitement les États arabes.
Enfin, lors d’une réunion extraordinaire tenue le 15 janvier 2015 pour évoquer les suites des démarches palestiniennes à l’ONU, la Ligue arabe a affirmé l’importance de poursuivre des démarches au Conseil de sécurité. Les pays arabes ont toujours affirmé souhaiter une position globale (c’est son cavalier seul qui a été reproché à Sadate en 1977), sans jamais respecter ce principe.
Il semble donc qu’un consensus se dégage sur la nécessité de modifier le paradigme des négociations, en réintroduisant notamment le Conseil de sécurité au cœur de la résolution du conflit et en associant les pays du Quartet et les pays arabes à la reprises des négociations.
On peut estimer qu’il y a une fenêtre d’opportunité, compte tenu du fait que John Kerry et l’Amérique sont échaudés par les échecs répétés des tentatives de médiation du Secrétariat d’État. Il y a de la part de Washington la volonté, dans une certaine mesure, de mutualiser les risques d’une renégociation, ainsi que sa responsabilité. Enfin, Barack Obama, libéré des contraintes électorales, pourrait vouloir laisser sa marque dans l’histoire. Quant aux deux protagonistes, ils sont trop faibles et trop divisés pour parvenir seuls à un accord de paix.
2. Éviter les écueils d’Oslo : remettre le Conseil de sécurité au cœur du règlement du conflit, rééquilibrer les négociations en associant davantage l’Union européenne et s’appuyer sur l’Initiative arabe de paix
a. Remettre le droit international et le Conseil de sécurité au cœur de la résolution du conflit
Comme l’a souligné Laurent Fabius devant le Sénat (325), « une intervention d’un autre ordre est indispensable : une autorité internationale, le Conseil de sécurité des Nations unies, par exemple, doit intervenir. »
Mahmoud Abbas a proposé fin 2014, à New York, un projet de résolution qui avait peu de chance d’être adopté. Avant que les Palestiniens ne reprennent seuls l’initiative d’un texte qui se heurterait au veto américain et provoquerait une crispation israélienne, il est possible de faire une proposition qui pourrait recueillir le consensus. Ce serait là une petite révolution diplomatique et une inversion de la logique d’Oslo : la fixation préalable des paramètres de la négociation, garantie par toute la force du droit international, et toute la légitimité d’une décision collective.
Il faut remettre la question israélo-palestinienne au cœur du Conseil de sécurité, trop marginalisé dans le règlement du conflit. La reprise des négociations doit s’appuyer sur des paramètres clairs – pour la plupart connus et partagés par les parties, et un calendrier précis.
La logique de ce texte, qui pourrait être porté par la France, serait celle d’un accompagnement international des négociations au moyen d’une résolution du Conseil de sécurité, comportant trois éléments clés : la définition au niveau du Conseil des paramètres d’un règlement, qui reprennent largement les paramètres européens ; la relance des négociations dans le cadre d’une méthode renouvelée, impliquant aux côtés des États-Unis les autres membres permanents du Conseil, l’Union européenne et la Ligue arabe ; la recherche ou l’imposition d’un calendrier. La résolution proposée en décembre par les Palestiniens prévoyait un retrait des territoires occupés à échéance de deux ans. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont plus réservés concernant l’introduction d’un délai. La France pourrait proposer une solution équilibrée, prévoyant une fin des négociations deux ans après l’adoption éventuelle d’une résolution.
Ce serait l’honneur de la France que de prendre une telle initiative et de travailler à un texte consensuel. Elle peut le faire, du fait de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, d’un rôle historique de trait d’union entre les mondes, de promoteur du dialogue interculturel et de puissance inclusive. Elle peut aussi le faire au nom de l’amitié profonde qui la lie aux deux peuples israélien et palestinien.
Il y a des raisons d’espérer. Le Conseil est aujourd’hui plus favorable à une initiative et des États comme l’Espagne ou la Nouvelle Zélande sont proches des positions françaises, de même que les représentants européens du Conseil, à commencer par la Grande-Bretagne, qui sont soucieux de trouver une voie de sortie par le Conseil à travers une démarche collective.
Nos partenaires européens peuvent, et doivent, être convaincus de porter la voix singulière de l’Europe au Conseil de sécurité, une position qui devrait être à la hauteur de leur responsabilité historique à l’égard des origines de ce conflit, et de sa perpétuation.
La position des États-Unis pourrait évoluer. Certes, ils craignent d’être dessaisis du dossier israélo-palestinien et sont sensibles à la pression de leurs partenaires israéliens. Mais les Américains ne pourraient opposer leur veto à une proposition consensuelle sans mettre en danger leur relation avec les pays arabes, avec lesquels ils sont engagés dans la lutte contre le terrorisme.
La Jordanie, représentant les pays arabes au Conseil de sécurité, et qui doit ménager ses bonnes relations avec les États-Unis tout en jouant le rôle d’appui attendu des Palestiniens, pourrait soutenir un texte équilibré.
b. Réintroduire l’Union européenne aux côtés des États-Unis dans le règlement politique du conflit
Le rôle de l’Union européenne dans les négociations a été amoindri du fait des divisions entre États membres et d’une certaine incapacité à utiliser les leviers, notamment économiques, dont elle dispose pour inciter les parties au conflit à négocier. Que ce soit par difficulté à s’entendre sur une position commune, du fait de la poursuite d’agendas nationaux différents, ou par manque de volonté politique, l’Europe a laissé les États-Unis assumer seuls la responsabilité de la reprise et de la conduite des négociations.
L’Union européenne tend ainsi à être perçue dans la région au mieux, comme un bailleur de fonds, et au pire, comme un complice de la poursuite illégale de la colonisation dans les territoires palestiniens. Elle peine à être identifiée comme un acteur politique autonome doté d’une ligne claire et d’une aptitude à agir.
L’Europe doit parvenir à s’imposer, aux côtés des États-Unis, comme un interlocuteur crédible dans une région qui lui est proche historiquement et géographiquement, où ses intérêts stratégiques sont immenses, et dont la déstabilisation constitue une menace directe.
L’Union a défini ses propres paramètres de résolution du conflit dans les conclusions du Conseil de décembre 2009 et décembre 2010. Ils convergent largement avec ceux des Américains. Une action concertée des États-Unis et de l’Union européenne peut rééquilibrer le cadre des négociations et faciliter leur reprise en offrant des assurances solides à Israël et à la Palestine. Il ne faudra en effet, non pour reprendre seulement les négociations, mais pour les voir enfin aboutir, rien de moins que la force conjuguée des Etats-Unis et de l’Europe réunis.
L’Europe doit enfin se mette à exister et que ses membres éminents aient le courage de se mettre à parler d’une voix commune. Non seulement l’Union a un intérêt à agir en la matière, mais elle en a aussi les moyens, comme l’a récemment rappelé Federica Mogherini, Haute représentante de l’Union européenne, dont la position sur ce dossier semble être plus volontariste que celle de Catherine Ashton. Elle qui a choisi, symboliquement, de se rendre en Israël et en Palestine après sa nomination, a en effet déclaré que « l’Europe ne peut être éternellement le payeur sans jouer un rôle politique » et ajouté « en réalité, l’important pour moi n’est pas que d’autres États, européens ou non, reconnaissent la Palestine. Je serais heureuse si, au terme de mon mandat, l’État palestinien existait. »
La Haute représentante propose de « forger une stratégie, une vision et une politique communes », d’« utiliser le potentiel politique de l’Union dans cette région pour favoriser une approche concertée, incluant la question de la Palestine et des relations entre le monde arabe et Israël ». Selon elle, plusieurs éléments distincts se mêlent : le processus de paix, l’action de Daesh, les conflits en Irak et en Syrie, la situation du Liban, de la Jordanie, de l’Égypte, voire de la Turquie. L’Union européenne, qui se conçoit désormais comme une puissance régionale, ayant vocation à veiller sur la stabilité de son voisinage, a une vision compréhensive de ces dossiers, et doit davantage s’impliquer dans la résolution du conflit, même si les États-Unis jouent naturellement un rôle.
Certes, le consensus européen est difficile à bâtir. Ainsi, les Allemands traditionnellement plus proches de la position américaine, ont voté contre la proposition de résolution au Conseil de sécurité en décembre 2014, en faveur de laquelle la France s’est exprimée, quand la Grande-Bretagne s’est abstenue.
Le vote conjoint de la France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, en faveur de la résolution de 2011 au Conseil de sécurité, a déjà montré la capacité des Européens à s’entendre. S’y ajoutent le vote de certains Parlements nationaux, précédemment évoqué, en faveur de la reconnaissance d’un État de Palestine et d’une reprise immédiate des négociations. Il existe des points d’accord sur lesquels il est possible de s’appuyer pour parler d’une voix commune.
La France peut contribuer à réintroduire l’Europe dans le jeu diplomatique, œuvrer au rapprochement des positions de ses divers partenaires européens, et nouer un dialogue étroit avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne pour promouvoir un nouveau cadre de négociations, qui s’appuierait sur une résolution du Conseil de sécurité fixant le cadre des pourparlers et associant les États arabes.
L’action conjuguée de l’Europe et des États-Unis peut être cruciale pour inciter les parties à reprendre des pourparlers de paix.
Prise dans son ensemble, l’Union européenne est le premier partenaire commercial d’Israël, devant les États-Unis. L’Europe est le premier exportateur vers Israël, avec près de 30 % de parts de marché, et le premier importateur de produits israéliens – 32 % des exportations. Les échanges commerciaux entre l’Union et Israël s’élevaient à environ 29 milliards d’euros en 2013.
Les relations économiques entre l’Union européenne et Israël n’ont cessé de progresser depuis le premier accord de libre-échange, signé en 1975. En 1995, un accord d’association est signé avec Israël – qui a acquis un « statut spécial » lors du Conseil européen d’Essen, en 1994. Une nouvelle étape a été franchie en 2004 avec la signature du « plan d’action » de l’Union pour Israël dans le cadre de sa politique de voisinage. (326) Ce statut particulier s’exprime aussi dans le secteur scientifique, comme le montre la signature, en juin 2014, de l’accord d’association d’Israël au nouveau cycle Horizon 2020 (327).
Les États-Unis, qui sont liés par un accord de libre-échange avec Israël depuis 1985, sont quant à eux les deuxièmes importateurs (22 %) et exportateurs vers Israël (environ 12 % de parts de marché – en diminution par rapport à 20 % de parts de marché il y a une quinzaine d’années). Mais la majeure partie du soutien américain est aujourd’hui de nature militaire, que ce soit en termes financiers ou de coopération poussée en matière de recherche et développement. Depuis 1945, les États-Unis ont accordé 121 milliards de dollars d’aide à Israël dans le cadre de leur aide bilatérale – ce qui en fait le premier bénéficiaire de l’aide américaine devant l’Égypte. En 2014, l’aide militaire extérieure américaine à Israël s’est élevée à plus de 3 milliards de dollars (328).
En 2007, les deux pays ont conclu un accord pour dix ans, prévoyant une aide militaire de 30 milliards de dollars sur la période 2009-2018. Une partie de cette aide est spécifiquement destinée au développement de projets militaires tels que « Dôme de fer » ou le programme « Fronde de David ». Au-delà de cette aide militaire, les États-Unis fournissent une aide financière à Israël, en se portant garant des prêts israéliens – à hauteur de 3,8 milliards de dollars en 2014. Les Israéliens n’ont pas eu besoin d’utiliser cette garantie depuis 2004 mais le maintien de ce programme renforce la crédibilité financière du pays et améliore ses capacités d’emprunt sur les marchés financiers.
Les États-Unis et l’Union européenne sont également les premiers bailleurs de fonds des autorités palestiniennes. L’aide américaine aux Palestiniens poursuit un triple objectif : empêcher les actions terroristes contre Israël, encourager la stabilité afin d’orienter les Palestiniens vers la solution des deux États et répondre aux besoins humanitaires.
Depuis le milieu des années 1990 (329), le total de l’aide bilatérale cumulée fournie par les Américains aux Palestiniens représente environ 5 milliards de dollars. Cette aide bilatérale comprend chaque année généralement d’un côté 200 millions de dollars prodigués par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), et d’un autre côté 200 millions de dollars versés directement au budget de l’Autorité palestinienne. Enfin, entre 70 et 100 millions de dollars sont destinés à la lutte contre le trafic de drogue. L’aide bilatérale devrait représenter 441 millions de dollars en 2015.
Au-delà de cette aide bilatérale, les États-Unis sont également le plus important contributeur à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA). La contribution américaine à l’UNRWA en 2014 s’est élevée à 251 millions de dollars.
L’Union européenne est quant à elle la première source internationale d’aide humanitaire et économique pour les Territoires palestiniens, auxquels elle a consacré plus de 400 millions d’euros en 2013. Sur cette aide, 170 millions sont versés sous forme d’appui financier direct à l’Autorité palestinienne dans le cadre du mécanisme PEGASE. Ce programme permet notamment à l’Autorité palestinienne de financer le traitement des fonctionnaires et le fonctionnement de services publics essentiels. Une autre partie de cette aide est versée via l’Office de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO), qui a consacré 35 millions d’euros en 2013 à des secteurs tels que la coordination humanitaire, l’aide judiciaire et la réponse d’urgence aux démolitions et aux expulsions.
L’aide versée par les États-Unis à Israël n’a jamais été gelée contrairement à ce qui a pu être le cas pour d’autres pays. Ainsi, l’Égypte a vu son aide militaire « re-calibrée » après la destitution de Mohamed Morsi. Le niveau de soutien apporté à Israël n’est pas lié à l’avancement du processus de paix et n’est pas utilisé ni considéré comme un moyen pouvant favoriser une recherche de solution au conflit. Néanmoins, de fortes tensions ont pu surgir à propos de la garantie sur les prêts israéliens en 1991. Le président Bush avait alors voulu s’assurer que la garantie de prêt de 10 milliards de dollars ne servirait pas à financer des colonies dans les territoires occupés. (330) En revanche, l’aide accordée aux Palestiniens est versée sous conditions. Il est prévu que l’Autorité palestinienne ne pourra plus bénéficier de l’aide américaine si elle obtient un statut équivalent à celui de pays membre - ou si elle devient un pays membre à part entière - aux Nations unies ou dans ses institutions spécialisées si cette adhésion s’effectue en dehors d’un accord négocié avec l’État d’Israël. Cette restriction ne concerne pas l’adhésion palestinienne à l’UNESCO. L’aide à destination de l’Autorité palestinienne risque d’être gelée (331) du fait de l’adhésion palestinienne à la Cour pénale internationale.
Les États-Unis et l’Union européenne peuvent, de manière complémentaire, s’appuyer sur de solides liens historiques et de profondes amitiés nouées avec les deux peuples israélien et palestinien, mais aussi sur des relations économiques et politiques étroites, pour ne pas dire privilégiées, avec les deux parties au conflit, pour les inciter plus fermement à reprendre les négociations.
Il ne s’agit pas ici d’imposer la paix, car la paix ne s’impose pas, mais d’inciter à la négociation d’une part, et, d’autre part, de garantir les conditions de la paix, aussi bien au plan sécuritaire, économique et social que politique.
L’adoption, en juillet 2013, au niveau européen, de lignes directrices relatives à l’éligibilité des entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis 1967, et des activités qu’elles y déploient, aux subventions, prix et instruments financiers financés par l’Union à partir de 2014, a marqué une inflexion. Désormais, les entités israéliennes basées dans les territoires palestiniens, ou qui ont des liens avec eux, sont exclues des programmes d’aide européens et notamment du programme Horizon 2020. C’est une décision inédite, qui permet à Bruxelles de condamner l’occupation.
Surtout, cette décision, ainsi que des fuites faisant état des réflexions engagées par les services de Catherine Ashton relatives à l’étiquetage des produits en provenance des colonies, n’ont pas été étrangères à la reprise des négociations entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou.
Cet épisode a montré que, si les États-Unis demeurent l’épine dorsale des négociations bilatérales entre Israël et la Palestine, l’Union européenne peut elle aussi peser de tout son poids pour convaincre les deux partenaires de reprendre les pourparlers.
La France peut ainsi plaider en faveur d’une action plus ferme de l’Union européenne, aux côtés des États-Unis, en qualité de premier partenaire économique d’Israël et premier pourvoyeur de fonds des territoires palestiniens, pour inciter les deux parties à négocier.
c. Organiser une conférence internationale réunissant l’ensemble des parties concernées et promouvant une paix globale assise sur l’initiative arabe de paix
Laurent Fabius a, en novembre 2014, insisté sur le souhait de la France « d’entraîner à la fois l’Union européenne, la Ligue arabe, les membres permanents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, dans une mobilisation collective en faveur de la paix au Proche-Orient. » Il a ainsi proposé l’organisation d’une conférence internationale, « afin d’appuyer cette dynamique indispensable », et précisé que la France était « disposée à en prendre l’initiative.»
Une conférence internationale peut produire une dynamique nouvelle pour sortir de l’impasse.
Tous les pays concernés doivent y être associés directement : les États-Unis, l’Union européenne, la Russie, les pays arabes et la Turquie, un Quartet renouvelé dans sa composition et ses buts, doivent soutenir avec fermeté et générosité les efforts des négociateurs.
Le Quartet, dont la composition devrait être élargie (Égypte, Arabie Saoudite, Jordanie, mais aussi Qatar et Turquie, ont un rôle à jouer dans la médiation), n’a pas vocation à être un organe décisionnaire. Cependant, dans la perspective de la préparation de cette conférence, il serait utile en tant que groupe de contact, et comme laboratoire permettant de tester les positions internationales.
Il convient surtout d’éviter l’une des erreurs majeures de Camp David : l’absence d’association des pays arabes aux négociations. Il sera, en effet, difficile sinon impossible, de garantir la sécurité d’Israël sans un cadre plus large impliquant les pays arabes, qui semblent prêts à faire ce pas historique.
Une approche régionale du conflit doit être promue, en réactivant l’Initiative arabe de paix de 2002 et en retrouvant, par une négociation globale, l’esprit de la conférence de Madrid de septembre 1991 (332).
L’Initiative arabe de paix, dont le texte figure dans l’encadré ci-dessous, a été approuvée par la Ligue arabe au sommet de Beyrouth en 2002 et réitérée en 2007 au sommet de Riyad.
Elle prévoit la conclusion d’un accord de paix avec Israël, la normalisation des relations d’Israël avec l’ensemble des pays arabes et la reconnaissance de la fin du conflit, en échange d’un retrait des territoires occupés, d’une solution juste et agréée au problème des réfugiés sur la base de la résolution 194 et de la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale du futur État de Palestine.
L’Arabie saoudite en avait été à l’origine. L’Égypte et la Jordanie étaient alors en paix avec Israël. La Syrie vivait encore sur les illusions du « printemps de Damas » à la suite de la mort de Hafez el-Assad et de son remplacement par son fils Bachar. Certes, le contexte régional a changé, mais l’Initiative arabe de paix garde toute sa pertinence et mérite plus que jamais d’être réactivée comme base de travail.
Les paramètres de résolution du conflit mis en avant dans cette initiative ont été précisés en avril 2013, dans la perspective de la relance des négociations par John Kerry. Une délégation de la Ligue Arabe s’est alors rendue à Washington et a réitéré le soutien de la Ligue à la solution des deux Etats, fondée sur les lignes de 1967, tout en admettant pour la première fois des échanges limités de territoires.
La Ligue arabe a encore rappelé son attachement à l’Initiative arabe de paix lors de la Ministérielle du 29 novembre 2014.
Enfin, lors des discussions au Conseil de sécurité, fin 2014, sur le projet de résolution palestinien, le groupe arabe a endossé un projet de résolution comprenant des paramètres de résolution du conflit plus précis et conformes à ceux agréés au niveau européen.
L’Union européenne, qui soutient cette initiative, y a fait plusieurs fois référence dans ses conclusions du Conseil Affaires étrangères. Ainsi, à l’occasion lors du Conseil Affaires étrangères du 22 juillet 2014, l’Union a rappelé qu’une solution durable au conflit israélo-palestinien devait être réalisée sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, des principes de Madrid, de la Feuille de route, des accords précédemment conclus entre les parties et de l’Initiative arabe de paix.
Initiative arabe de paix (2002)
Réaffirmant la décision du Sommet extraordinaire de la Ligue arabe tenu au Caire en juin 1996, selon laquelle une paix juste et globale représente un choix stratégique pour les États arabes, à réaliser dans la légalité internationale et nécessitant un engagement équivalent à cet égard de la part d’Israël,
Ayant entendu l’allocution dans laquelle S.A Royale le Prince Abdullah bin Abdul-Aziz, Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, a présenté son initiative et demandé le retrait intégral d’Israël de tous les territoires arabes occupés depuis 1967 en application des Résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, telles que confirmées par la Conférence de Madrid de 1991, et du principe « terres contre paix », et demandé ainsi qu’Israël accepte l’avènement d’un État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Jérusalem-Est, en contrepartie de l’établissement par les États arabes de relations normales dans le contexte d’une paix globale avec Israël,
Partant de la conviction des États arabes qu’une solution militaire du conflit n’établira pas la paix, pas plus qu’elle n’assurera la sécurité d’aucune des parties,
1. Demande à Israël de réexaminer ses politiques et de pencher vers la paix, et de déclarer qu’une paix juste est aussi son propre choix stratégique ;
2. Demande en outre à Israël :
(a) De se retirer intégralement des territoires arabes occupés, y compris le Golan syrien, jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, et des territoires du Sud-Liban qui sont encore occupés ;
(b) De parvenir à une solution juste et agréée au problème des réfugiés palestiniens conformément à la Résolution 194 (III) de l’Assemblée générale des Nations unies ;
(c) D’accepter la création d’un État palestinien indépendant et souverain dans les territoires palestiniens occupés depuis le 4 juin 1967 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec pour capitale Jérusalem-Est ;
3. S’engage alors à ce que les États arabes ;
(a) Considèrent que le conflit israélo-arabe a pris fin et participent à un accord de paix entre eux et Israël tout en assurant la sécurité de tous les États de la région ;
(b) Établissent des relations normales avec Israël dans le contexte de cette paix globale ;
4. Garantit le rejet de toutes les formes de réinstallation de Palestiniens qui serait incompatible avec la situation particulière dans les pays d’accueil arabes ;
5. Exhorte le gouvernement israélien et tous les Israéliens à accepter l’initiative susmentionnée afin de sauvegarder les perspectives de paix et éviter toute nouvelle effusion de sang, permettant ainsi aux États arabes et à Israël de vivre côte à côte dans la paix et assurant aux générations à venir un avenir sûr dans lequel la stabilité et la prospérité pourront régner ;
6. Invite la communauté internationale et tous les États et organisations qui la composent à appuyer cette initiative ;
7. Prie le Président du Sommet de la Ligue arabe de constituer un comité spécial, composé des États membres intéressés et du Secrétaire général de la Ligue, qui serait chargé d’établir le contact nécessaire pour rallier l’appui en faveur de cette initiative à tous les niveaux, et en particulier l’appui de l’Organisation des Nations unies, du Conseil de sécurité, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, des pays islamiques et de l’Union européenne.
En ouvrant la porte à une intégration pleine et entière d’Israël dans son environnement régional, et en affirmant, ce qui est une première, la reconnaissance des principes de Madrid et des engagements de l’OLP, cette initiative représente, du point de vue de la Ligue arabe et de tous ses membres, un geste significatif en direction d’Israël.
Il s’agissait là d’une main tendue exceptionnelle. Pour autant, cette proposition de paix régionale, endossée dans la feuille de route du Quartet, n’a jamais reçu de réponse officielle et formelle de la part du gouvernement israélien. Le Premier ministre israélien de l’époque, Ariel Sharon, l’avait ignorée. Elle n’a pas non plus reçu de réponse officielle en 2013. Cette même année, 43 députés de la Knesset ont signé un appel au Gouvernement israélien à donner une réponse à l’Initiative arabe de paix, appel dont l’écho a été limité. (333)
Lors de la prochaine réunion de la Ligue Arabe, qui aura lieu fin mars, les États arabes pourraient travailler à une « opérationnalisation » de l’Initiative arabe de paix, qui pourrait être une incitation forte pour Israël.
Il était coutume d’affirmer qu’au Proche-Orient « il n’y a pas de guerre possible sans l’Égypte et pas de paix possible sans la Syrie ». La Syrie et l’Irak ayant disparu de la scène en tant que sujets de droit international, l’Égypte, qui commence à reprendre sa place sur la scène diplomatique, pourrait y travailler avec l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe. Il faut noter cependant que les pays arabes devraient demander des gages de sérieux pour remettre en avant une initiative qui n’est pas sans conséquence pour eux en termes de politique intérieure.
Dans la perspective d’une relance crédible du processus de paix israélo-palestinien, la France peut travailler à impliquer davantage les principaux acteurs du processus de paix parmi les États arabes, parmi lesquels la Jordanie, qui représente les États arabes au Conseil de sécurité des Nations unies, et jouera un rôle privilégié dans l’adoption d’une résolution équilibrée fixant un cadre aux négociations. L’Egypte et l’Arabie saoudite ont évidemment un rôle à jouer. La France, du fait de ses relations privilégiées avec ces deux pays, peut jouer un rôle de proposition. Elle pourrait enfin participer à convaincre Israël d’apporter une réponse à l’Initiative arabe de paix.
d. Préparer et garantir les conditions d’une paix durable : l’économie et la sécurité
Chaque nouvelle tentative qui se solde par un échec renforce un peu plus l’idée que le processus de paix n’est que rhétorique, nourrit l’antagonisme des parties, et fait peser sur la région le risque d’une radicalisation des acteurs et d’une montée des violences. Il ne s’agit donc pas seulement, cette fois-ci, d’essayer, mais d’aboutir.
Or pour aboutir, il faut offrir des garanties solides aux deux parties, en termes de sécurité et de partenariat économique. Il faut aussi rejeter les positions maximalistes pour encourager l’adoption de décisions difficiles et prévenir tout acte de violence qui viendrait remettre en cause l’application d’un accord.
● Faire valoir l’opportunité d’un accord de paix, offrir des garanties en matière de sécurité et de partenariat renforcé
Laurent Fabius rappelait en novembre 2014 à l’Assemblée nationale (334) que « la tradition de la France est d’être l’amie du peuple palestinien et du peuple israélien. Nos seuls ennemis sont les extrémistes, les fanatiques qui se trouvent de chaque côté et entravent la marche vers la paix ». De ce point de vue, les accords d’Oslo ont pêché par l’absence de contrôle international, d’arbitre. Le devenir de ce processus était suspendu à la bonne volonté des parties, qui ont été d’emblée prises en otage par les extrêmes, des deux côtés.
Ici aussi, l’action des Européens aux côtés des États-Unis et des États arabes, peut s’avérer déterminante. La France, au sein de l’Union européenne, peut jouer un rôle d’accompagnement majeur du processus de réconciliation au plan politique, économique, et de sécurité.
Côté israélien, des garanties sérieuses en matière de sécurité et la perspective d’un approfondissement du rapprochement économique peuvent être avancées en contrepartie d’un gel immédiat de la poursuite de la colonisation.
Selon Uri Savir, ancien négociateur israélien des accords d’Oslo (335), deux doctrines sécuritaires, la première tactique et la deuxième stratégique, s’affrontent aujourd’hui en Israël.
Au plan tactique, certains considèrent que le statu quo est préférable car il constitue une moindre prise de risque dans un contexte régional marqué par les crises dans le voisinage immédiat du pays.
De fait, il faut entendre les Israéliens lorsqu’ils disent craindre pour leur sécurité en cas de retrait de leurs troupes. L’expérience du Liban et de Gaza a laissé des marques profondes dans la mémoire de la population, qui ne sauraient être ignorées. Il est évident qu’un plan de paix sérieux devra veiller à la sécurisation des frontières et du territoire, et pour cela le rôle des États-Unis et de l’Union européenne est central. En mai 2011, Benyamin Netanyahou, dans un discours devant le Congrès américain, a ainsi déclaré: « il est vital qu’un État Palestinien soit entièrement démilitarisé, et il est vital de maintenir une présence militaire israélienne de long terme le long du Jourdain. » En outre, la construction d’un mur de séparation le long du Jourdain serait également évoquée (336). Uri Savir estime que le plan de sécurité (comprenant un mécanisme complet de contrôle terrestre et aérien de la Cisjordanie et de la frontière avec la Jordanie, le maintien de forces israéliennes le long du Jourdain) proposé par le général américain John Allen et son équipe aux Israéliens, a été étudié avec sérieux par les négociateurs mais trop vite écarté par les autorités politiques israéliennes. Il met en garde ces autorités contre toute position maximaliste qui serait à long terme défavorable aux intérêts vitaux d’Israël.
En effet, selon certains, au plan stratégique, la meilleure, et peut être la seule véritable garantie de la sécurité d’Israël réside dans un maintien de relations privilégiées avec les États-Unis et l’Europe, la consolidation de ses rapports avec l’Égypte et la Jordanie, une stabilité économique et politique et un accord de paix solide et durable avec les Palestiniens. La question sécuritaire ne peut être traitée uniquement sous l’angle technique, certes crucial car la sécurité d’Israël doit être garantie, mais doit passer par un règlement politique global du conflit.
Côté palestinien, il faut prévenir tout acte de violence qui viendrait remettre en cause les avancées d’un processus de paix. On se souvient que les attentats suicides menés à Jérusalem en 1996 ont grandement participé au sabotage des accords d’Oslo. Pour cela, il convient de renforcer les capacités de l’Autorité palestinienne, de promouvoir une réconciliation palestinienne respectant les principes du Quartet agréés par la communauté internationale, impliquant par conséquent le renoncement du Hamas à la violence, et de participer au développement économique et social de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, afin d’éviter des débordements violents qui annuleraient les efforts de paix.
Enfin, l’Union européenne peut continuer de promouvoir les bénéfices d’une paix négociée pour les deux parties. Il convient de faire valoir l’opportunité d’un accord de paix auprès de nos partenaires et offrir des garanties au plan sécuritaire, économique et politique. L’Union européenne a proposé aux parties, dans ses conclusions du 16 décembre 2013, la mise en place d’un « partenariat privilégié spécial » en cas d’accord de paix, qui n’a malheureusement pas rencontré l’écho attendu.
● Prendre des mesures concrètes lorsqu’une paix négociée entre deux États semble menacée : promouvoir le gel de la colonisation et une réconciliation inter-palestinienne conforme aux principes agréés par la communauté internationale
L’Union européenne doit tenir une position ferme sur le gel de la colonisation, dont la continuation menace elle aussi la solution des deux Etats.
La politique de l’Union européenne, dont la une position constante sur la colonisation, illégale au regard du droit international, a été rappelée dans les conclusions du Conseil Affaires étrangères du 10 décembre 2012, se montre de plus en plus ferme.
Ainsi, les lignes directrices qui visent à garantir que les financements européens ne bénéficieront pas aux colonies israéliennes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014. Une clause de territorialité a été introduite dans plusieurs accords conclus entre l’Union européenne et Israël, excluant les territoires occupés du champ d’application des accords, notamment dans le memorandum d’entente permettant l’association d’Israël au programme de recherche « Horizon 2020 », signé le 16 novembre 2013. Certains États membres appliquent ces dispositions également à titre bilatéral dans leurs accords avec Israël. Les importations de produits des colonies israéliennes ne bénéficient pas du régime douanier préférentiel prévu par l’accord d’association UE-Israël. Par ailleurs, la mission estime qu’en l’absence de volonté claire des autorités israéliennes de geler la poursuite de la colonisation et celle-ci étant de nature à menacer sérieusement une solution à deux États, il faudra poursuivre la réflexion relative à l’étiquetage des produits issus des colonies importées sur le marché communautaire (337).
Côté palestinien, le refus du Hamas d’abandonner la voie du terrorisme doit être fermement condamné. Cependant, il est tout aussi nécessaire de promouvoir, sans complaisance, ni naïveté, un processus de réconciliation inter-palestinienne conforme aux principes agréés par la communauté internationale, dont l’impasse fait peser des risques sur le processus de paix.
La France et l’Union européenne soutiennent, depuis 2007, la perspective d’une réconciliation inter-palestinienne, conduite sous l’égide de Mahmoud Abbas, qui serait conforme aux principes agréés par la communauté internationale (renonciation à la violence armée, reconnaissance d’Israël et respect des accords précédemment signés, notamment les accords d’Oslo).
Cette réconciliation serait la seule à même de redonner une véritable légitimité aux institutions palestiniennes (les dernières élections remontent à 2005 et 2006, le mandat du Président Abbas est terminé depuis 2009) et de promouvoir une amélioration sur le terrain, objectifs que la France soutient de longue date. Surtout, c’est le préalable nécessaire à un accord de paix crédible. C’est en effet la meilleure voie pour promouvoir le renoncement du Hamas à la violence et son acceptation complète des conditions posées par le Quartet (338).
L’accord de réconciliation inter-palestinienne est une réelle opportunité mais présente aussi des défis qu’il faut bien mesurer, le risque principal étant que les élections soient remportées par le Hamas à Ramallah comme en 2006 à Gaza. Il faut faire pression sur le Hamas pour qu’il ne soit pas tenté de faire échouer le processus en vue d’une autonomisation de la bande de Gaza, et convaincre Israël que son intérêt bien compris n’est pas dans l’effondrement complet de l’Autorité palestinienne.
L’Union européenne doit soutenir les efforts de Mahmoud Abbas, qui avance sur un fil ténu, en vue de mener à bien cette réconciliation. Il doit pour cela en avoir les moyens, au plan sécuritaire (l’Union européenne peut plaider en faveur de la réactivation de la mission Eubam), et économique (créer des conditions économiques meilleures favoriserait un contexte plus adéquat pour un accord de paix final). L’Union européenne peut participer à la restauration de la « souveraineté économique des territoires occupés, ce même si la Palestine n’est pas encore en mesure de devenir un État indépendant, car la pauvreté alimente l’extrémisme et l’extrémisme ne peut que nuire aux différents protagonistes » (339).
● Œuvrer à l’amélioration rapide de la situation à Gaza
L’Union européenne doit œuvrer activement à l’amélioration de la situation à Gaza. Il convient certes d’engager les parties à respecter le cessez-le-feu signé en août 2014, et l’Europe doit apporter tout son soutien à la médiation égyptienne. Mais il convient de bâtir une solution durable et non une accalmie précaire avant une nouvelle crise dont les populations civiles seraient les premières victimes.
Au plan sécuritaire, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait des propositions concrètes (340), qui portent à la fois sur le contrôle de la reconstruction, un soutien à l’ouverture de la bande de Gaza et des dispositifs en matière de sécurité. Elles prévoient notamment la participation active de l’Union européenne à la prévention de l’armement et du renforcement du Hamas et des autres organisations terroristes dans la bande de Gaza ; la facilitation d’un contrôle plus important de l’Autorité palestinienne et de son président Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza au plan sécuritaire ; la réhabilitation de la bande de Gaza, en coopération avec la communauté internationale et l’Autorité palestinienne, qui permettrait un transfert de l’aide humanitaire ; la mise en place d’un mécanisme international pour empêcher l’entrée de substances interdites dans la bande et assurer que des matériaux tels que le ciment et le fer n’atteignent pas les organisations terroristes, mais ne seront utilisées que pour la réhabilitation de Gaza ; la mise en place d’une assistance de la Mission de l’Union européenne à la frontière de Rafah, entre Gaza et l’Égypte.
Pour l’heure, les conclusions du Conseil des Affaires étrangères du 15 août 2014 (341) ont permis de préciser les options d’action de l’Union, notamment à travers les missions de PSDC. Ont été évoquées la réactivation et l’extension à d’autres points de passage (Erez, Kerem Shalom) de la mission Eubam de supervision du point de passage de Rafah, et le lancement d’une mission de formation des fonctionnaires de police et des douanes de l’Autorité palestinienne, par le biais d’Eupol-Copps, déjà existante en Cisjordanie peuvent être discutées. Ces conclusions doivent aboutir rapidement à des propositions concrètes.
La sécurité est certes une partie de la réponse, mais une réponse purement sécuritaire au problème de Gaza serait de courte vue. Comme l’énonçaient les conclusions du Conseil Affaires étrangères de l’Union européenne du 15 août 2014, « un retour au statu quo antérieur au dernier conflit à Gaza n’est pas une option ».
Comme le souligne une étude récente (342), la reconstruction de Gaza est prise dans des logiques contradictoires qui en ralentissent le rythme, nourrissent la frustration de la population et rendent inefficace l’action des bailleurs internationaux.
Les deux auteurs de cette étude soulignent que le cycle absurde des destructions-reconstructions successives a non seulement un coût humain considérable, mais un coût financier et politique pour la communauté internationale. Marquée par trois conflits consécutifs en cinq ans, affaiblie par un blocus qui dure depuis sept ans, la bande de Gaza se trouve aujourd’hui dans une situation humanitaire critique qui peut avoir des conséquences sécuritaires majeures.
Le paradigme de la reconstruction de Gaza serait fragilisé par les contradictions suivantes : l’Autorité palestinienne est considérée comme la seule légitime par la communauté internationale, alors que la bande de Gaza est contrôlée de fait par le Hamas dont la popularité ne semble pas véritablement faiblir auprès de la population. Par ailleurs, Israël, puissance occupante selon le droit international, continue de contrôler l’accès des matériaux de reconstruction dans Gaza. La communauté internationale, qui partage les préoccupations sécuritaires d’Israël (crainte que le Hamas n’utilise la reconstruction comme un moyen de se réarmer), craint aussi fortement une désolidarisation accrue de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Ces « craintes combinées, le refus de la communauté internationale d’associer le Hamas à la reconstruction, combiné au manque d’autorité de l’Autorité palestinienne à Gaza ont compliqué et retardé les efforts de reconstruction »
Selon la même étude, la reconstruction de Gaza aurait pu fournir l’occasion, en s’appuyant sur toutes les forces en présence sous supervision internationale, à la re-légitimation de l’Autorité palestinienne à Gaza. En réalité son format actuel contribue à intensifier les tensions entre Fatah et Hamas, aux dépens de la population. L’étude critique également le mécanisme dit « Serry » de supervision de la reconstruction, qui non seulement risque de mettre en danger le personnel des Nations unies employé à cet effet, mais, en ralentissant la reconstruction, nourrit le marché noir. Enfin, le manque de transparence dans l’utilisation des promesses de don de la communauté internationale – les auteurs soulignent le fait que les puissances régionales suivent chacune leur propre agenda et soutiennent leurs « proxys » dans la bande de Gaza, ainsi que l’absence d’association des ONG présentes à Gaza à la définition des besoins ne permettent pas une véritable appropriation du processus de reconstruction par la population.
La reconstruction de Gaza n’est donc pas seulement une urgence humanitaire et un défi sécuritaire auxquels il faut répondre au plus vite, mais un problème plus large qui doit trouver une réponse politique, ce qui rejoint la question précédemment évoquée de la réconciliation inter-palestinienne dans le respect des principes du droit international, du retour à Gaza et du renforcement de l’Autorité palestinienne. La reconstruction de Gaza doit fournir l’occasion de renforcer l’unité palestinienne, sa légitimité et la stabilité sur le terrain. Votre rapporteure souscrit par conséquent à la proposition de l’étude précitée qui préconise la mise en place d’une supervision internationale de la reconstruction de Gaza, de nature politique, qui inclurait à la fois les différentes parties prenantes côté palestinien, les puissances régionales, l’Union européenne et les États-Unis, les Nations unies, la Banque mondiale et les membres de la société civile.
La mission estime que le blocus et les sanctions internationales isolent Gaza et nourrissent les extrémismes ; seul le développement économique, notamment via les exportations, pourrait y mettre un frein. Elle soutient à ce titre les dernières prises de position de l’Union européenne sur le sujet. Tout en rappelant la nécessité d’un désarmement de la bande de Gaza, les membres du Conseil ont, le 15 août 2014, souligné qu’un cessez-le-feu durable doit conduire à une amélioration fondamentale des conditions de vie de la population, qui passe par un desserrement du blocus de Gaza.
À la différence d’autres acteurs jusque-là très présents, en particulier les États-Unis, qui traversent une phase de désengagement relatif du Proche et du Moyen-Orient, en dépit de leur réinvestissement forcé, et volontairement limité, en Irak, après l’offensive fulgurante de Daesh au cours de l’été dernier, et à rebours d’autres pays, notamment européens, qui n’accordent manifestement pas à cette zone une priorité stratégique très affirmée, la France reste active à tous les niveaux, par son engagement politique constant dans la plupart des dossiers régionaux, par ses efforts diplomatiques sur le terrain et dans toutes les enceintes, en particulier à l’ONU, et par des coopérations souvent très denses avec de nombreux partenaires clefs de la région.
Cet engagement mérite d’être salué à sa juste mesure. Il contribue à donner à notre pays une voix et une place singulières qui sont attendues de lui dans cette région du monde. Il s’inscrit dans le cadre des liens étroits que nous entretenons avec de nombreux pays du Proche et du Moyen-Orient, notamment le Liban, la Jordanie, l’Egypte et certains Etats du Golfe. Il participe à la défense de nos intérêts nationaux, à commencer par notre sécurité intérieure, très largement engagée par le phénomène des djihadistes qui partent en Syrie et en Irak pour combattre aux côtés des groupes les plus extrémistes, en particulier Daesh. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la France a aussi un statut particulier au plan international qu’elle doit mériter chaque jour en se montrant l’un des Etats les plus actifs sur tous les fronts (343).
Ce positionnement implique de lourdes responsabilités pour notre pays au Proche et au Moyen-Orient. Comme en Afrique, même si l’équation se pose en des termes différents, les efforts politiques, diplomatiques et matériels pourraient être mieux partagés et relayés au sein de l’Union européenne, grâce à un investissement plus déterminé de nos partenaires. Les différentes réunions interparlementaires auxquels participent des membres de la Commission des affaires étrangères sont souvent l’occasion de constater un intérêt assez limité de nombreux collègues européens pour cette région, largement éclipsée dans les esprits par le voisinage oriental de l’Europe. Le Proche et Moyen-Orient appartient lui aussi à l’environnement immédiat de l’Europe et sa déstabilisation croissante s’accompagne de menaces particulièrement graves pour tous.
Si la réponse sécuritaire à la montée en puissance de Daesh est une priorité pleinement justifiée, elle doit s’accompagner de solutions politiques aux crises que traversent l’Irak et la Syrie, d’une plus grande cohérence dans la mobilisation des principaux partenaires régionaux et d’un soutien renforcé aux plus fragilisés d’entre eux. La crise liée à Daesh ne doit pas non plus détourner l’attention de ses racines profondes. Elle s’inscrit dans le cadre de l’échec global des « révolutions arabes » de 2011 – hormis en Tunisie et même s’il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur ce moment historique. L’essor de Daesh se nourrit des multiples crises non résolues de la région et d’un sentiment répandu de marginalisation, d’humiliation et de dépossession en matière économique et sociale comme sur le plan politique. Dans ce contexte, la question israélo-palestinienne demeure un abcès de fixation particulièrement lancinant, dont la persistance exacerbe d’autres crises. Son impasse totale et la nouvelle flambée de violences qui s’est déroulée à Gaza cet été nécessitent désormais une relance des efforts sur des bases largement revisitées (344).
Au regard de tous ces enjeux, la Mission appelle de ses vœux un suivi régulier de l’ensemble de la situation régionale au sein de la Commission des affaires étrangères, dans la continuité du présent bilan d’étape. Les travaux programmés à ce stade comportent notamment une mission d’information sur le Liban, qui s’intéressera probablement à la crise en Syrie et à son impact sur les pays voisins, un groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme international, qui ne devrait pas manquer de continuer à travailler sur la réponse à Daesh, ainsi qu’une mission d’information consacrée à la Libye, autre foyer majeur de déstabilisation dans la région (345). L’évolution des négociations sur le programme nucléaire iranien et leur impact sur les équilibres régionaux nécessiteront aussi, à l’évidence, un suivi très attentif en Commission, de même que la question israélo-palestinienne.
DES PRINCIPALES PRISES DE POSITION DE LA MISSION
1. Coupler l’action engagée dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh à des solutions politiques au plan local
a. La coalition internationale contre Daesh
– Des frappes contre les infrastructures syriennes et irakiennes à envisager avec une grande prudence. La coalition qui s’est constituée sous l’égide des Etats-Unis a fait du tarissement des sources de financement de Daesh, notamment la contrebande de pétrole, l’une de ses principales priorités. Les frappes aériennes contre les installations gazières et pétrolières risquent néanmoins d’avoir un impact destructeur pour l’avenir et de servir la propagande de Daesh, qui présente l’action de la coalition comme une agression dirigée contre le monde sunnite, au bénéfice de l’Iran et des chiites.
– Améliorer significativement la coordination régionale et internationale contre le phénomène des combattants terroristes étrangers. Au regard des menaces pesant sur notre sécurité intérieure, il est essentiel de renforcer les échanges d’information au plan européen et dans le cadre d’Interpol ; d’améliorer la coopération judiciaire et pénale ; d’aider nos partenaires à renforcer les capacités de leurs dispositifs nationaux ; de partager les retours d’expérience dans le domaine de la lutte contre la radicalisation.
– Des paris stratégiques qui restent à gagner. La décision de ne pas déployer de forces combattantes terrestres a conduit à soutenir des forces locales directement menacées par Daesh et à s’appuyer sur des pays voisins qui devraient avoir un intérêt immédiat à faire cesser la menace pesant sur leur propre sécurité. Cette stratégie est cohérente, mais elle reste à mettre en œuvre pleinement dans ses deux branches.
– Une réflexion nécessaire sur nos relais locaux. Les objectifs propres des acteurs potentiellement mobilisables en Syrie et en Irak, la volonté de ne pas attiser l’antagonisme entre sunnites et chiites et de ne pas favoriser la remise en cause des frontières internationales, ainsi que de nombreux précédents historiques défavorables, plaident pour ne pas soutenir des forces dont l’action ou la montée en puissance pourraient être la source d’une plus grande déstabilisation à l’avenir. En Irak, l’hypothèse privilégiée consisterait à détacher de Daesh ses soutiens locaux sunnites, notamment tribaux. La réalisation de ce scénario dépend toutefois d’une réconciliation nationale sur laquelle nous n’avons pas de prise directe.
– Ne pas se contenter du faible degré actuel de cohésion au sein de la coalition internationale. Le caractère très large de cette coalition s’accompagne d’engagements variables au plan concret et d’agendas divergents, malgré une prise de conscience du danger commun et mortel posé par Daesh. La cohérence et l’efficacité de la lutte contre cette organisation terroriste en sont limitées et cette situation alimente la perception que certains acteurs pourraient jouer, dans une certaine mesure, un double jeu.
b. Pas de résultats durables dans la lutte contre Daesh en l’absence de solutions politiques
– Faire du volet politique une priorité. Daesh n’est pas seulement un ennemi à détruire : il faut s’attaquer aux causes profondes de sa montée en puissance en Irak et en Syrie. Une stratégie uniquement anti-terroriste est vouée à l’échec, à l’instar de la « guerre au terrorisme » menée par les Etats-Unis contre Al-Qaida sous la présidence de George W. Bush.
– En Irak, pousser à la réconciliation nationale. En dépit d’une certaine stabilisation de la situation politique, il reste beaucoup à faire pour rétablir l’autorité de l’Etat, restaurer la crédibilité des institutions et convaincre les sunnites qu’ils ont un avenir en Irak. Il faut encourager et aider les nouvelles autorités irakiennes sur le chemin de la réconciliation, en répondant à leurs demandes de coopération, mais il ne nous appartient pas de définir les termes des équilibres et des compromis à venir. Il faut aussi accepter l’idée que le rétablissement de la situation risque d’être long et complexe.
– Ne pas encourager les Kurdes irakiens à déclarer leur indépendance. Malgré la séparation croissante entre le Kurdistan irakien et le reste du pays, il n’est pas certain que les conditions de l’indépendance soient aujourd’hui réunies, au plan financier comme au regard des réactions possibles des pays voisins. Il faut donc prêter la plus grande attention aux messages que nous faisons passer aux Kurdes en parallèle de notre aide. Dans le même temps, notre soutien à la reconnaissance de leurs droits culturels et politiques, en Irak comme dans les pays voisins, doit être dépourvu d’ambiguïté.
– Malgré tous nos échecs en Syrie, ne pas oublier la crise dans ce pays. Ni les erreurs d’anticipation commises en France à l’égard de la crise syrienne, ni l’échec des différentes initiatives régionales et internationales pour régler le conflit ne justifient d’abandonner ce pays à son processus de destruction déjà très avancé. La Syrie offrant une base arrière à Daesh, ce pays ne doit pas « sortir du radar ». Le bilan humain effroyable du conflit nous place également face à une responsabilité très lourde.
– Soutenir les initiatives politiques qui restent sur la table. Les réalités du terrain doivent être prises en compte sérieusement : il n’y a pas de solution militaire qui se dessine, ni en faveur du régime, ni d’une opposition trop affaiblie et trop divisée pour l’emporter, malgré les perspectives ouvertes par le plan américain de soutien « Train & Equip ». Le plan de « gel des hostilités » présenté par le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies mérite d’être soutenu, de même que l’initiative russe de dialogue inter-syrien, malgré toutes les difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre.
– Privilégier le scénario d’une désescalade régionale. La poursuite et l’aggravation du conflit en Syrie dépendent largement du jeu des acteurs extérieurs, Iran, Russie, Turquie, Qatar ou encore Arabie saoudite, qui n’ont pas cessé d’alimenter le feu par leur soutien aux belligérants. Une désescalade régionale supposerait au préalable un accord entre puissances extérieures et probablement un règlement négocié du différend nucléaire avec l’Iran. Ce scénario ne signifierait vraisemblablement pas l’arrêt du conflit, mais il favoriserait une réduction du niveau des violences et pourrait pousser les belligérants sur le chemin d’une solution négociée.
– Faire preuve d’une disponibilité réelle pour une solution politique, c’est-à-dire accepter que le départ de Bachar el-Assad ne constitue pas nécessairement un préalable, mais plutôt un aboutissement de la transition en Syrie. Cette disponibilité pour une solution politique pourrait s’accompagner d’une réflexion sur l’opportunité d’une réouverture des ambassades européennes qui ont été fermées à Damas, si possible dans un cadre européen, ce qui n’implique ni d’envoyer un ambassadeur en Syrie, ni de cesser de condamner les crimes commis par le régime syrien.
– Apporter des réponses aux menaces qui pèsent sur l’ensemble des minorités de la région. La France a décidé d’accueillir sur son sol un certain nombre de réfugiés irakiens, en particulier des Chrétiens d’Orient qui présentent des liens avec notre pays. Nous devons aussi et surtout œuvrer, dans toute la mesure de nos moyens et de notre influence, pour le rétablissement des conditions politiques et sécuritaires permettant aux différentes composantes confessionnelles et ethniques de la région de rester sur leur terre d’origine. Vivre en paix et en sécurité dans son pays est un droit fondamental. Le départ de ces populations serait une victoire complète pour Daesh.
c. Soutenir les États voisins de l’Irak et de la Syrie
– Contrer les risques d’expansion et de dissémination de Daesh. Si les risques d’expansion territoriale de Daesh ne doivent pas être surestimés, ceux de sa dissémination ne doivent pas être sous-estimés, que ce soit par l’infiltration de cellules terroristes, par des déclarations d’allégeance d’organisations préexistantes ou par le retour de combattants étrangers. La lutte de longue haleine qui est engagée contre Daesh en Irak et en Syrie doit s’accompagner d’efforts tout aussi résolus pour contenir les risques, avérés, de contamination dans le reste de la région.
– Aider les pays voisins à améliorer leurs capacités de lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers. En parallèle de cet effort à destination des Etats directement menacés, il importe de veiller à ce que le soutien à la lutte contre le terrorisme ne soit pas perçu ou exploité comme un quelconque blanc-seing pour le développement d’un tout-répressif et que cela ne contribue pas à réduire la pression interne ou les incitations internationales en faveur de réformes qui restent nécessaires dans le domaine de la gouvernance.
– Renforcer une aide humanitaire qui n’est pas à la hauteur des enjeux. La montée en puissance de Daesh s’est accompagnée d’une nouvelle dégradation de la situation humanitaire en Irak, en Syrie et dans les pays voisins, qui accueillent des millions de réfugiés. Il s’agit d’une des priorités identifiées et mises en œuvre, à juste titre, par la coalition internationale contre Daesh. Les besoins humanitaires recensés par les Nations unies dans l’ensemble de la région demeurent toutefois gravement sous-financés.
– Renforcer notre soutien au Liban. Déjà compliquée par la crise en Syrie, l’équation libanaise l’est également par la menace posée par Daesh. La mise en œuvre rapide et complète du plan d’aide tripartite franco-saoudo-libanais aux forces armées libanaises n’en prend que plus d’importance. Il en est de même de nos efforts pour aider à remédier au vide institutionnel qui s’est instauré depuis la fin du mandat du président Sleimane, en continuant à jouer notre rôle de facilitateur entre les parties et de mobilisation de tous les acteurs qui peuvent exercer une influence sur les deux principaux camps libanais, en particulier l’Iran et l’Arabie saoudite.
2. Favoriser le déblocage des relations avec l’Iran et contribuer à l’apaisement des tensions au plan régional
a. Les négociations sur le programme nucléaire iranien
(i). Sans s’ingérer dans la conduite des négociations avec l’Iran, qui relèvent du pouvoir exécutif, ni les entraver par des prises de position détaillées au plan technique, la Mission estime utile d’insister sur les principes suivants.
– Préserver la séparation actuelle entre le dossier nucléaire et les discussions sur d’autres questions d’intérêt commun, telles que la Syrie. Un « grand marchandage » régional affaiblirait un éventuel accord sur le dossier nucléaire et risquerait de « polluer » les négociations sur ce sujet.
– Éloigner suffisamment l’Iran du « seuil ». Seules des positions suffisamment fermes permettront d’écarter les risques de prolifération au plan régional et d’améliorer les chances qu’un accord avec l’Iran ne soit pas frontalement rejeté par les « durs » et les sceptiques au sein du Congrès américain, comme en Israël. Un accord faible et non crédible ne réglera rien.
– Ne pas faire perdre la face à l’Iran. Les conditions de la négociation ne permettent pas de faire preuve de rigidité face à l’Iran, ni de camper sur des positions maximalistes, le pays n’étant pas à genoux malgré les sanctions. La prise en considération de l’impact des négociations, que leur issue soit négative ou positive, doit conduire à écarter toute forme d’intransigeance, tant du côté iranien que du côté des « 5+1 ».
– Ne pas pénaliser la France. Notre pays aurait en particulier beaucoup à perdre si sa position n’était pas interprétée comme une ligne de fermeté raisonnable, comme ce fut le cas lors des négociations sur l’accord intérimaire de novembre 2013, mais au contraire comme une fermeture de principe à l’égard de l’Iran.
(ii). Plusieurs éléments pourraient notamment permettre de concilier l’impératif de fermeté et celui de flexibilité.
– Un engagement significatif de l’Iran dans le domaine des mesures de transparence et de vérification paraît susceptible d’apporter plus de garanties effectives qu’une réduction maximale – et très problématique du point de vue iranien – des capacités nucléaires déclarées.
– Outre ces mesures de transparence et de vérification, une offre « positive » suffisamment intéressante pour les Iraniens, notamment en termes de coopérations, est certainement une clef pour inciter à respecter un éventuel accord.
(iii). Deux risques paraissent devoir faire l’objet d’une vigilance particulière.
– L’adoption de nouvelles sanctions, telle que l’envisage le Congrès américain, ne renforcerait pas la pression sur l’Iran et sa propension à accepter un accord satisfaisant, mais risquerait au contraire de pousser à l’effondrement des négociations.
– Une nouvelle prolongation, au-delà des échéances prévues en mars et en juin, risque aussi de faire peser de graves risques sur le processus de négociation. Plus le temps passe, plus les risques de sabotage par des « perturbateurs extérieurs » augmentent, et plus on risque d’en revenir à la spirale négative antérieure, marquée par des avancées du programme nucléaire iranien et, en parallèle, par des pressions croissantes de la communauté internationale.
b. Préparer le « jour d’après »
– Essayer de « capitaliser » sur un éventuel accord relatif au programme nucléaire iranien. S’il paraît nécessaire de préserver la séparation actuelle entre le dossier nucléaire et des questions régionales d’intérêt commun, il convient de se préparer dès maintenant aux perspectives qu’un accord avec l’Iran est susceptible d’ouvrir. Il pourrait en résulter un apaisement des tensions au plan régional, en particulier un déverrouillage des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran, puis des coopérations qui pourraient aider à régler certaines crises ou du moins à atténuer leurs conséquences.
– Favoriser les conditions d’une dynamique positive. Un accord sur le nucléaire iranien pourrait être un commencement, mais l’enchaînement ne sera pas mécanique. La perception d’un accord pourrait même être négative du côté saoudien, s’il donne l’impression de laisser désormais les mains libres à l’Iran. Les garanties qui pourraient être données aux Saoudiens sur la prise en compte de leurs intérêts dans la région pourraient jouer un rôle déterminant. A contrario, il convient probablement de ne pas insister auprès des Saoudiens sur la nécessité de construire de nouveaux équilibres régionaux.
– S’engager avec l’Iran si les conditions d’une relation constructive peuvent être réunies. A rebours d’un certain nombre d’acteurs qui n’ont pas d’autre but que de faire reculer l’Iran, ou du moins de contenir ce qui est perçu comme une tentation hégémonique de sa part, la Mission estime que l’isolement de ce pays n’est pas un facteur de changement positif. Il s’agit de donner à l’Iran la possibilité de montrer concrètement qu’il peut jouer un rôle constructif au plan régional, comme ses dirigeants ne manquent jamais de l’affirmer.
– Contribuer aux rapprochements en organisant une conférence sur la sécurité régionale. Le règlement des crises en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen ou encore au Bahreïn dépendra d’abord des puissances régionales et de leur influence sur les acteurs locaux. Une large conférence diplomatique consacrée aux questions régionales et ouverte à l’ensemble des acteurs susceptibles de jouer un rôle, y compris l’Iran, pourrait être de nature à favoriser les rapprochements et les coopérations. Les crises étant de plus en plus régionalisées, c’est probablement à cette échelle que des solutions pourraient s’engager.
– Veiller à ne pas donner l’impression d’être partie prenante dans les oppositions entre sunnites et chiites et dans les rivalités entre puissances régionales. L’extrême polarisation de la région, selon des lignes de failles multiples et complexes, et l’instrumentalisation de ces divers clivages, qu’ils soient de nature politique, culturelle ou religieuse, doit nous inciter à la plus extrême prudence. Rien ne serait pire pour la crédibilité de notre diplomatie que de ne pas adopter une position d’équilibre vis-à-vis des luttes intestines qui affectent la région.
3. Porter un changement rapide et complet du paradigme des négociations et promouvoir l’engagement ferme de la communauté internationale pour dénouer la question israélo-palestinienne
a. La question israélo-palestinienne n’a rien perdu de sa centralité stratégique ni de son poids symbolique
– Le maintien d’un conflit de basse intensité, ponctué d’explosions épisodiques de violences, est devenu intenable. L’échec des reprises de pourparlers sous égide américaine, la nouvelle intervention à Gaza soldée par de lourdes pertes humaines, la montée des violences en Cisjordanie, et, avec une force inédite et particulièrement inquiétante, sur l’Esplanade des Mosquées, l’impasse de la réconciliation inter-palestinienne, la poursuite de la colonisation par le Gouvernement israélien, le lancement d’une « Intifada » dite « diplomatique » par l’Autorité palestinienne : l’année 2014 pourrait symboliser à elle seule l’échec total du processus de paix et l’escalade de la violence, dont les responsabilités sont partagées par les dirigeants et dont les peuples israélien et palestinien continuent de payer le prix.
– En raison de la force symbolique de cette question, l’attitude velléitaire de la communauté internationale décrédibilise l’ensemble de son action au Proche et au Moyen-Orient. L’attentisme, voire l’immobilisme, de la communauté internationale face au non-règlement d’un des plus anciens conflits qui enveniment le Proche-Orient, décrédibilise son discours et ses tentatives de règlement d’autres crises dans la région.
b. Acter la faillite du processus de paix initié par les accords d’Oslo et mesurer les conséquences d’un pourrissement du conflit dans un contexte régional lourd de menaces
– Accepter le constat, certes difficile, de l’incapacité du processus de paix, tel qu’il était conduit jusqu’à présent, à déboucher sur un règlement effectif de la question, en raison de faiblesses structurelles dans sa conduite. Ce processus repose sur trois piliers : une négociation bilatérale entre Israéliens et Palestiniens ; une médiation par les États-Unis, perçus comme les seuls à avoir la confiance d’Israël et des leviers d’influence sur le pays ; un financement par des acteurs tiers, dont l’Union européenne, les Nations unies et les pays arabes. Dans ce schéma, le Conseil de sécurité a été marginalisé par les États-Unis, qui considèrent l’implication de celui-ci comme contradictoire avec le principe selon lequel il revenait aux deux parties de négocier et non de se voir imposer un accord. L’Union européenne a été elle aussi écartée – ou bien s’est-elle plus ou moins volontairement marginalisée – du règlement politique du conflit. Enfin, la négociation a toujours été menée selon un angle bilatéral, sans prendre en compte le problème de façon globale, comme la partie d’un tout régional à stabiliser.
– Assumer la responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale dans l’échec de ce processus et promouvoir un changement de méthode. La reconnaissance mutuelle de deux États, vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité, fait depuis 1993 l’objet d’un accord des deux parties et de l’ensemble de la communauté internationale. Mais la faiblesse, l’antagonisme, de plus en plus marqué, et l’absence de vision stratégique des deux protagonistes au conflit les rend incapables d’aboutir seuls à une entente. S’y ajoute une certaine lassitude américaine. Un consensus se dégage sur l’idée que la méthode de négociation basée sur les accords d’Oslo a fait son temps. Le succès d’une énième tentative de médiation américaine selon le format bilatéral étant hypothétique, seule une initiative internationale ferme et concertée, aux objectifs et au calendrier clairement identifiés, est à même de revivifier un processus de paix moribond.
– Faire entendre aux protagonistes la menace imminente qui pèse sur la solution des deux États, alors qu’elle constitue la seule issue viable et la condition sine qua non d’une paix et d’une sécurité durables pour les deux peuples. Face à l’échec du processus de paix, l’indifférence est coupable, et l’inaction meurtrière. L’idée qu’il y a une alternative à la solution à deux États est la plus dangereuse des illusions, mais en l’absence de perspectives politiques, elle tend à gagner l’opinion et à s’imposer sur le terrain.
– Convaincre nos partenaires israéliens que l’existence de l’État palestinien est la meilleure garantie pour la sécurité d’Israël et faire entendre à nos partenaires palestiniens que la voie de la négociation est inévitable. La paix ne se fera pas par procuration. La France ne doit donc pas ménager ses efforts pour promouvoir un règlement rapide et négocié de la question auprès de ses deux partenaires, et contenir la logique d’engrenage encouragée par l’impasse du processus de paix.
– Faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard du maintien du statu quo quant à l’Esplanade des Mosquées. Les crises actuelles au Moyen-Orient rappellent le danger d’une transformation d’un conflit territorial et politique en conflit confessionnel. La France doit fermement exhorter les autorités israéliennes à ne pas laisser perdurer la banalisation d’un discours visant à terme à remettre en cause le statu quo, ainsi que les tensions chroniques entretenues par plusieurs groupes radicaux sur et aux abords de l’Esplanade des Mosquées.
c. S’appuyer sur une nouvelle équation régionale pour porter une nouvelle initiative de paix, garantie par une résolution du Conseil de sécurité, soutenue par un accord régional avec les États arabes, et consolidée par des garanties offertes par l’Europe et les États-Unis
– S’appuyer sur une nouvelle équation stratégique au Proche et Moyen-Orient pour promouvoir une paix globale, reposant sur de nouveaux équilibres régionaux. Le contexte régional peut être favorable à la signature d’un accord. Un certain nombre de pays arabes dont un État de Palestine vivant en paix avec Israël constituerait une assurance pour Israël face aux menaces terroristes qui agitent la région. Les États-Unis pourraient vouloir s’appuyer sur la convergence objective d’intérêts entre Israël, l’Égypte, la Jordanie et les États du Golfe, notamment l’Arabie saoudite, pour réduire leur implication directe. L’organisation d’une conférence internationale, s’appuyant sur la réactivation et l’opérationnalisation de l’Initiative Arabe de paix de 2002, et retrouvant l’esprit de la conférence de Madrid de 1991 – mêlant discussions bilatérales et négociations globales sur les questions multilatérales, permettrait un rapprochement des vues.
– Replacer le droit international et le Conseil de sécurité des Nations unies au cœur du règlement de la question israélo-palestinienne. Il s’agit de s’appuyer sur le principal acquis des accords d’Oslo, la reconnaissance mutuelle des deux États, tout en évitant ses écueils. L’adoption d’une résolution au Conseil de sécurité des Nations unies marquerait le nécessaire retour au droit international et à la multilatéralisation du conflit. La France peut, aux côtés des États-Unis, et de ses partenaires européens et arabes, porter un texte équilibré qui fixerait les paramètres fondamentaux et le calendrier des négociations.
– Favoriser le retour de l’Union européenne dans le règlement politique de la question. L’Europe est, par sa faute, perçue comme un bailleur de fonds, quand elle n’est pas accusée d’indifférence ou de complicité dans la perpétuation du conflit. La France peut, avec ses partenaires européens, au premier rang desquels la Grande-Bretagne et l’Allemagne, faire entendre la voix singulière de l’Europe sur la question. Le rôle des Parlements nationaux, en lien avec le Parlement européen, peut s’avérer crucial dans l’élaboration et la promotion d’une position européenne plus claire et plus affirmée sur la scène internationale.
– Inciter les parties à négocier et garantir la mise en œuvre d’un accord de paix durable. L’Union européenne doit utiliser tous les leviers politiques et économiques dont elle dispose pour inciter les parties à revenir aux négociations, faire valoir le bénéfice d’une paix négociée, et prendre des mesures concrètes dès que la solution des deux États est remise en cause sur le terrain, que ce soit par des actes de violence ou par la poursuite de la colonisation – sur ce dernier point, la réflexion européenne sur la publication de lignes directrices relatives à l’étiquetage des produits issus des colonies doit avancer.
– Soutenir le processus de réconciliation inter-palestinienne, en conformité avec les principes agréés par la communauté internationale, et consolider les bases du futur État palestinien. Si le refus du Hamas d’abandonner la voie de la violence doit être condamné avec la plus grande fermeté, l’Union européenne peut soutenir, sans complaisance, ni naïveté, les efforts de Mahmoud Abbas en faveur d’un retour de l’Autorité palestinienne à Gaza et d’une réconciliation inter-palestinienne conforme aux principes agréés par la communauté internationale, seule à même de redonner une véritable légitimité aux institutions palestiniennes, et préalable nécessaire à un accord de paix crédible. Il doit pour cela en avoir les moyens, au plan sécuritaire – l’Union peut plaider en faveur de la réactivation de la mission Eubam – et au plan économique.
– Éviter un retour au statu quo antérieur au conflit à Gaza. La reconstruction de Gaza, dont le rythme doit s’accélérer sous peine d’entraîner une recrudescence des violences, n’est pas seulement une urgence humanitaire et un défi sécuritaire auxquels il faut répondre au plus vite, mais un problème plus large qui doit trouver une réponse politique. Conformément aux conclusions du Conseil du 15 août 2014, tout en rappelant la nécessité d’un désarmement de la bande de Gaza, il convient de promouvoir un cessez-le-feu durable conduisant à une amélioration fondamentale des conditions de vie de la population, qui passe par un desserrement du blocus de Gaza.
– En cas d’échec des négociations, la France devra prendre ses responsabilités et reconnaître le droit du peuple palestinien à un État viable et souverain. En raison de son histoire, de ses valeurs, de son amitié pour les peuples du Proche-Orient, mais aussi de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, la France est comptable de la paix et de la stabilité de la région. Notre pays a été l’un des premiers et plus fervents défenseurs de l’entrée d’Israël dans le concert des nations et n’a jamais ménagé ses efforts pour que soit universellement admis son droit à l’existence et à la sécurité. Un nouvel échec des pourparlers impliquera la reconnaissance par la France de l’État de Palestine, conséquence logique de sa promotion d’une solution des deux États.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 18 mars 2015.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Nous entendons aujourd’hui nos collègues Odile Saugues et Jean-Luc Reitzer qui vont nous présenter les grandes lignes du rapport adopté par la mission d’information sur le Proche et Moyen-Orient. Cette mission était composée également de : Jean-Louis Destans, Serge Janquin, Michel Vauzelle, Jacques Myard et François Rochebloine.
Votre rapport témoigne à la fois du travail de la mission d’information et aussi de celui de la commission sur ce sujet. J’ai relevé que la mission avait réalisé une trentaine d’auditions mais que la commission avait également consacré un nombre équivalent de réunions au Proche et au Moyen-Orient.
Depuis la création de la mission, son champ d’investigation s’est élargi à mesure de l’extension des troubles que connaît la région. Vous nous parlerez ainsi des crises syrienne et irakienne, des négociations avec l’Iran et de la question israélo-palestinienne. Votre rapport contient aussi un bilan synthétique des « révolutions arabes ».
Votre rapport constitue une excellente base pour le groupe de travail sur le terrorisme que nous avons créé car il contient des informations très intéressantes sur le terrorisme en Irak et en Syrie et les moyens de le combattre.
Il va nous permettre de débattre de sujets sensibles, au cœur de l’actualité internationale. Votre mission a adopté en effet des prises de position qui vont utilement alimenter notre débat.
Je vous rappelle que nous nous réunissons à huis clos et qu’au terme de notre réunion, la commission sera appelée à se prononcer sur l’autorisation de publier ce rapport et non pas sur le contenu lui-même du rapport.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Nous vous présentons notre rapport sur le Proche et le Moyen-Orient à quelques jours d’une échéance cruciale pour les négociations sur le programme nucléaire iranien. Comme vous le savez, les parties se sont donné jusqu’à la fin du mois de mars pour s’entendre sur le cadre politique d’un accord, dont les aspects techniques sont à régler avant la fin du mois de juin. Un accord avec l’Iran, s’il était signé, aurait évidemment des répercussions importantes sur l’ensemble de la région. Ouvrira-t-il la voie à une détente des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran, ce qui pourrait permettre de débloquer un certain nombre de crises, en particulier en Syrie ? Un éventuel accord conduira-t-il, au contraire, à une crispation supplémentaire, s’il est perçu par l’Arabie saoudite comme étant trop favorable à l’Iran ? Les négociations sur le programme nucléaire iranien et les perspectives qu’un accord pourrait ouvrir dans la région sont l’un des trois principaux axes de notre rapport.
Plus près de nous, au plan temporel, des élections législatives anticipées ont eu lieu hier en Israël. Il va de soi que la composition de la prochaine coalition au pouvoir aura une incidence sur l’évolution de la question israélo-palestinienne. Au-delà de ce facteur politique, le processus d’Oslo se trouve manifestement dans une impasse, au bout de vingt années d’efforts. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens ne pourront être relancées que sur des bases entièrement revisitées. C’est un autre axe structurant de notre rapport.
Dernier fait marquant, la crise syrienne entre ce mois-ci dans sa cinquième année, sans qu’aucune perspective de règlement ne se dessine vraiment, même s’il existe un certain nombre de tentatives en cours. Il s’agit notamment des efforts du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, M. Staffan de Mistura, qui a proposé un gel des hostilités à Alep. Nous avons notamment traité la crise syrienne dans le cadre de la montée en puissance de Daesh et de la constitution d’une vaste coalition internationale contre cette organisation terroriste.
Nous avons tout d’abord choisi de présenter un panorama d’ensemble de la situation au plan régional, en essayant de distinguer les principales inflexions qui se dessinent – je viens de vous les présenter rapidement. Nous sommes bien sûr conscients que l’on peut se trouver assez vite dépassé par les événements, surtout dans cette partie du monde. L’une de ses caractéristiques est en effet de connaître des crises qui paraissent durablement bloquées – celle de la Syrie ou encore la question israélo-palestinienne –, mais aussi des bouleversements rapides et profonds de l’environnement régional. C’était notamment le cas lors du déclenchement des « révolutions arabes », auxquelles notre Commission a consacré une mission d’information, sous la conduite de Jacques Myard et de Jean Glavany. Nous avons d’ailleurs veillé à réaliser une sorte de point d’étape de ces « révolutions arabes ».
Nous avons connu un autre bouleversement de grande ampleur l’année dernière. Daesh et la crise en Irak se sont imposés comme des thèmes majeurs pendant le déroulement de nos travaux. Nous avions initialement prévu de les centrer sur l’Iran en raison des négociations sur son programme nucléaire, mais aussi parce que ce pays est concerné par ce qui se passe en Syrie, au Liban ou dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Nous avons ainsi effectué un déplacement en Iran à la fin de mois de juin dernier. Nous avions aussi choisi de travailler sur le processus de paix au Proche-Orient. L’Irak, qui était très largement sorti des « écrans radar » depuis plusieurs années, malgré l’évolution catastrophique de sa situation politique et sécuritaire, est revenu brutalement au premier plan, avec les conquêtes territoriales fulgurantes de Daesh l’été dernier.
Sur ces trois sujets principaux qui nous paraissent déterminants pour l’évolution de la région – la lutte contre Daesh ; les négociations sur le programme nucléaire iranien ; la question israélo-palestinienne – nous avons élaboré un certain nombre de scénarios, de recommandations et de prises de position, à l’adresse de notre diplomatie. Notre Rapporteure de la mission, Odile Saugues, vous les exposera tout à l’heure.
Pour ma part, je voudrais vous présenter à grands traits les aspects qui nous paraissent les plus déterminants dans l’environnement régional actuel. Première réflexion, parler du Proche et du Moyen-Orient, c’est malheureusement parler d’abord et surtout de ses multiples crises. S’il est admis, depuis une célèbre formule du général de Gaulle, que la complexité est la marque de fabrique de « l’Orient », cette partie du monde n’a jamais été aussi divisée, aussi déstabilisée et aussi meurtrie.
Elle est divisée par des clivages qui se multiplient. Les tensions entre sunnites et chiites, qui n’ont fait que croître depuis 2003, retiennent généralement l’attention, mais les pays du Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe des dynasties sunnites, sont également divisés - entre des pays qui sont résolument hostiles à l’Iran, et à son influence régionale, et d’autres qui sont plus accommodants, pour diverses raisons, mais aussi entre des pays favorables aux Frères musulmans et à l’islam politique comme modèle et d’autres qui sont déterminés à obtenir leur « éradication ».
Quant à la déstabilisation de la région, elle n’a jamais été aussi profonde et multiple. En Irak, la montée du sentiment de marginalisation, de dépossession et d’humiliation des populations sunnites a été très longtemps négligée, et la situation est devenue incontrôlable.
Même s’il est évidemment trop tôt pour porter un regard d’ensemble et définitif sur les « révolutions arabes » de 2011, celles-ci paraissent globalement dans l’impasse. C’est le chaos en Libye et au Yémen. On peut aussi s’interroger sur la situation au Bahreïn. Vous connaissez également la situation en Syrie. En Egypte, malgré la reprise en main par le président actuel, la situation reste difficile et les attentats se multiplient depuis le mois de janvier.
Il en est de même pour la question israélo-palestinienne, qui demeure une plaie ouverte dans la région et un abcès de fixation. Ce serait une erreur de croire qu’elle est devenue une question secondaire.
Je ne reviens pas sur les blessures de la Syrie. Vous connaissez le nombre des victimes, des réfugiés et la situation dramatique des enfants dans le pays.
J’en viens à Daesh. C’est le grand sujet qui préoccupe le monde entier et ce n’est pas un épiphénomène.
Daesh a modifié l’équation de la crise syrienne en faisant apparaître de nouveaux fronts avec l’opposition non-djihadiste, avec les Kurdes syriens au Nord du pays et, dans une certaine mesure, avec le régime lui-même. La montée en puissance de Daesh marque aussi la radicalisation croissante de l’opposition armée. De nombreux groupes se sont ralliés soit à Jabhat al-Nosra, soit à Daesh, souvent par la force ou l’intimidation.
En Irak, les conquêtes territoriales de Daesh peuvent ouvrir la perspective d’une scission du pays en trois entités : un Kurdistan indépendant au Nord, avec une extension potentielle au plan régional que je n’ai pas besoin de présenter ; un « sunnistan » radical qui pourrait notamment déborder sur une partie de la Syrie ; enfin un « chiistan libre », dont le centre de gravité serait probablement iranien.
Ma troisième remarque concerne la coalition internationale qui s’est constituée sous l’égide des Etats-Unis et dans laquelle la France joue un rôle que certains qualifient de premier plan. Son action contre Daesh repose sur un pari stratégique : en l’absence de troupes combattantes au sol, la stratégie de la coalition consiste, d’une part, à soutenir des forces locales directement menacées par Daesh et déterminées à combattre cette organisation et, d’autre part, à s’appuyer sur les pays voisins, qui devraient normalement avoir intérêt à faire cesser une menace pesant directement sur leur propre sécurité. Ce pari est cohérent, mais il reste à gagner.
Il faudrait surtout parvenir à détacher de Daesh des tribus sunnites en Irak. Cela nécessite une véritable politique de réconciliation nationale qui n’est qu’esquissée à ce stade et qui prendra probablement du temps, car les défis sont considérables et le précédent gouvernement avait fortement accru les divisions entre les sunnites et les chiites. En Syrie, dans l’état actuel de l’opposition non-djihadiste et dans la mesure où toute alliance militaire avec Bachar el-Assad est rejetée par les Etats-Unis comme par la France, on peut se demander sur quelles forces locales on pourrait s’appuyer contre Daesh.
Quant aux puissances régionales, la coalition est très large, puisqu’elle regroupe aujourd’hui 62 pays et organisations internationales. Mais il y a beaucoup d’arrière-pensées dans l’engagement des uns et des autres – tout le monde n’accorde pas nécessairement la priorité à la lutte contre Daesh. Beaucoup de questions restent posées. Elles hypothèquent gravement la possibilité de stabiliser la région.
La coalition s’est fixé cinq lignes principales d’action : apporter un soutien militaire à des partenaires locaux ; endiguer l’afflux des combattants terroristes étrangers qui nous pose un vrai problème ; tarir les sources de financement de Daesh, en particulier les différents trafics, tels que celui du pétrole ; étendre le domaine de la lutte à la sphère des idées et aux médias, en combattant la propagande de Daesh ; traiter les aspects humanitaires de la crise.
Tout cela est compliqué et il n’y aura pas de véritable éradication de Daesh sans solutions politiques. Si Daesh devait disparaître demain, soit par fracturation interne, car il s’agit d’une coalition de bric et de broc, soit parce que Daesh était vaincu sur le terrain, qui sait si une autre organisation monstrueuse ne se lèverait pas demain en Irak ou en Syrie ? C’était hier Al-Qaida et aujourd’hui Daesh.
Mes chers collègues, voilà les principales observations dont je souhaitais vous faire part. Avec votre permission, Madame la Présidente, notre rapporteure de la mission, Odile Saugues, va maintenant vous présenter nos principales recommandations et revenir plus en détail sur les négociations avec l’Iran et sur la question israélo-palestinienne.
Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission. Avant de vous présenter nos principales recommandations, permettez-moi de revenir en quelques mots sur la place de la France dans cette région du monde et sur la nécessité de continuer à y rester engagé.
A la différence d’autres acteurs qui étaient jusque-là très présents, notamment les Etats-Unis, mais qui traversent une phase de désengagement relatif du Proche et du Moyen-Orient, malgré un réinvestissement récent et limité en Irak, et à rebours d’autres pays, notamment européens, qui n’accordent manifestement pas à cette zone une priorité stratégique très affirmée, la France reste active à tous les niveaux. Elle le fait par un engagement politique constant dans la plupart des dossiers régionaux, par des efforts diplomatiques intenses sur le terrain et dans toutes les enceintes, en particulier à l’ONU, et par des coopérations souvent très denses avec de nombreux partenaires clefs dans la région.
Cet engagement contribue à donner à notre pays une voix et une place singulières, qui sont attendues de lui dans cette partie du monde. Il participe aussi à la défense de nos intérêts nationaux, à commencer par notre sécurité intérieure. Celle-ci est en effet remise en cause par le phénomène des djihadistes qui partent en Syrie et en Irak pour combattre dans les rangs des groupes les plus extrémistes, en particulier Daesh. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France a aussi un statut particulier au plan international. Elle doit le mériter chaque jour en restant l’un des pays les plus actifs sur les principaux fronts.
Ce positionnement implique de lourdes responsabilités pour notre pays au Proche et au Moyen-Orient. Comme en Afrique, même si l’équation se pose en des termes différents, nos efforts politiques, diplomatiques et matériels pourraient être mieux partagés et relayés au sein de l’Union européenne, grâce à un engagement plus déterminé de nos principaux partenaires. Cette région reste malheureusement assez largement éclipsée par le voisinage oriental de l’Europe. Le Proche et le Moyen-Orient appartient pourtant à l’environnement immédiat de l’Europe et sa déstabilisation croissante, que Jean-Luc Reitzer vient de vous présenter, s’accompagne de menaces particulièrement graves pour tous.
Enfin, cet engagement implique de se positionner par rapport aux principales crises que mon collègue vient d’évoquer. J’en viens donc aux recommandations de notre mission d’information. Une tentation pourrait être de réduire autant que possible notre « empreinte » dans une région aussi troublée. Nous souhaitons au contraire que notre pays reste engagé au Proche et au Moyen-Orient, pour les raisons que je viens de vous présenter brièvement, et que la France continue à y faire entendre une voix singulière.
Je n’aurai pas le temps, en quelques minutes, de vous présenter l’ensemble de nos prises de position. Elles figurent, pour l’essentiel, dans une synthèse annexée au rapport. Je voudrais évoquer en particulier la crise en Syrie, les négociations sur le programme nucléaire iranien, et enfin la question israélo-palestinienne.
En ce qui concerne la Syrie, nous sommes partis d’un double constat. Tout d’abord, aucune solution militaire ne se dessine, du moins dans un avenir proche. Le régime syrien est certes parvenu à rétablir partiellement sa situation, alors que l’on évoquait sa chute comme imminente en 2012, mais il ne paraît pas en mesure de reconquérir l’ensemble du territoire. Quant à l’opposition syrienne dite « modérée », elle se trouve dans une situation de grande faiblesse, en particulier par rapport aux groupes armés les plus extrêmes, et elle ne semble pas davantage être en mesure de l’emporter. Dans le même temps, si tous les acteurs impliqués dans le conflit syrien, de près ou de loin, évoquent, officiellement, la nécessité d’une « solution politique », la « machine automatique de la guerre » se poursuit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reste divisé et les acteurs régionaux continuent à soutenir les différentes parties du conflit dans leurs efforts militaires.
Plus le temps passe, plus le bilan humain et matériel du conflit s’alourdit, dans des proportions effroyables, et plus on s’éloigne de la Syrie que nous continuons tous à appeler de nos vœux : une Syrie unie, plurielle au plan confessionnel et ethnique, respectueuse des droits de l’Homme et des minorités. Seule une solution politique négociée paraît de nature à sauver le pays du chaos complet vers lequel il se dirige.
Dans ces conditions, tout doit être fait pour soutenir les propositions qui restent sur la table, malgré les interrogations qui peuvent exister à leur sujet et même si l’échec de tous les efforts qui ont été engagés au plan international ou régional, jusqu’à présent, ne conduisent pas nécessairement à faire preuve d’un grand optimisme. Il s’agit aujourd’hui du plan de « gel des hostilités » de M. de Mistura et de l’initiative russe de dialogue inter-syrien. Le plan de Staffan de Mistura vise en particulier à atténuer le niveau des violences, à enrayer la dégradation de la situation humanitaire et à essayer d’avancer vers une solution politique négociée, en procédant désormais « de bas en haut ».
S’il convient de favoriser une solution politique en Syrie, car il n’existe pas d’autre issue, cela implique de faire preuve d’une disponibilité réelle. Il nous semble que cela devrait conduire à accepter que le départ de Bachar el-Assad ne soit pas nécessairement un préalable, mais plutôt un aboutissement. Sans une telle inflexion, la transition risque de continuer à se heurter durablement à un mur insurmontable. Par ailleurs, une transition qui ne s’accompagnerait pas du maintien de certains éléments de l’Etat syrien, à définir, risquerait de plonger le pays dans un chaos encore plus grand et de déstabiliser encore davantage les pays voisins.
Cette disponibilité pour une solution politique pourrait s’accompagner d’une réflexion sur l’opportunité de rouvrir les ambassades européennes qui ont été fermées à Damas, si possible dans un cadre européen. Le rétablissement d’un tel canal présenterait non seulement un intérêt pour l’approfondissement de notre engagement en faveur d’une solution politique, mais cette mesure pourrait également se justifier par des raisons humanitaires et culturelles. Si ce choix était fait, il faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas vécu comme une forme de reconnaissance du régime syrien. Du reste, la réouverture d’une ambassade ne suppose pas l’envoi d’un ambassadeur et elle n’exclut pas de continuer à condamner des exactions.
A défaut d’une transition politique négociée, nous nous sommes interrogés sur la possibilité d’une désescalade régionale du conflit syrien. Sa poursuite et son aggravation résultent en grande partie du jeu d’un certain nombre d’acteurs extérieurs – Iran, Russie, Turquie, Qatar ou encore Arabie saoudite –, qui n’ont pas cessé d’alimenter le feu par leur soutien aux belligérants. Tant qu’ils bénéficieront d’une telle aide matérielle extérieure, les belligérants continueront probablement à se battre.
Une désescalade régionale ne signifierait probablement pas l’arrêt du conflit, car ce sont les acteurs syriens qui détiennent les clefs de toute solution. On peut s’interroger sur leur sensibilité à d’éventuelles pressions extérieures. Une désescalade permettrait néanmoins de réduire le niveau des violences et de pousser les belligérants sur le chemin d’une solution négociée. Il va de soi que ce scénario est lui aussi difficile. Il nécessiterait probablement une sorte d’accord régional par lequel les principaux acteurs extérieurs s’entendraient pour préserver mutuellement leurs intérêts en Syrie, a minima, et pour geler ou neutraliser ce terrain d’affrontement.
Nous n’avons pas, de toute évidence, de prise directe sur la réalisation concrète d’un tel scénario. Nous pouvons néanmoins activer nos différents canaux avec ses acteurs potentiels, afin de les mobiliser et d’offrir nos bons offices. Nous pouvons aussi contribuer à réunir les conditions de possibilité d’une désescalade régionale par la conclusion d’un accord solide et crédible sur le programme nucléaire iranien.
Sur ce deuxième sujet, nous n’avons pas adopté de recommandations précises en ce qui concerne les différents paramètres techniques d’un accord, que nous présentons dans notre rapport d’information, pour autant que ces paramètres sont connus et qu’ils peuvent être exposés sur la place publique. Nous n’avons pas souhaité empiéter sur des négociations dont la conduite relève du pouvoir exécutif.
Nous appelons néanmoins l’attention sur l’intérêt particulier de mesures renforcées de transparence et de vérification, dans le cadre d’un accord qui ne devrait pas s’accompagner d’un démantèlement complet des capacités nucléaires déclarées de l’Iran. Les pays qui se sont trouvés en délicatesse avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ne l’ont pas fait à partir de leur programme déclaré, mais à partir d’un programme clandestin. C’est une telle éventualité d’un programme clandestin qu’il importe de pouvoir détecter le plus tôt possible. Nous soulignons aussi l’intérêt d’assortir l’accord d’une offre « positive », comprenant des propositions de coopération suffisamment attractives pour inciter l’Iran à respecter un accord sur son programme nucléaire. La dissuasion nous paraît devoir s’accompagner d’incitations.
Sur le fond, nous avons estimé que notre position devait continuer à rester ferme sur le dossier du nucléaire iranien, malgré les difficultés manifestes à rapprocher les positions, alors que l’échéance de la fin du mois de mars se rapproche. Il faut aller suffisamment loin pour écarter l’Iran du « seuil », sans quoi la question ne sera pas traitée durablement. Elle risquerait de ressurgir à nouveau. Il faudrait également parvenir à « vendre », si j’ose dire, un éventuel accord aux durs et aux sceptiques au Congrès américain, en Israël ou encore en Arabie saoudite. Afin qu’une détente régionale et des coopérations sur des sujets d’intérêt commun puissent être envisagées, notamment sur la crise syrienne, il faut aussi qu’un accord avec l’Iran permette d’apaiser les craintes dans un certain nombre de pays voisins. Il ne faudrait pas qu’ils perçoivent un accord avec l’Iran comme ayant, en réalité, pour effet de renforcer la main de ce pays dans la région, à leur détriment. Il faudra donc un « bon accord », c’est-à-dire un accord solide et crédible. Il pourrait utilement s’accompagner d’un certain nombre de garanties données aux pays voisins sur le fait que leurs intérêts stratégiques continueront à être pris en compte et le cas échéant défendus.
Nous estimons aussi qu’il est nécessaire de maintenir une séparation, à ce stade, entre le dossier nucléaire iranien et les autres sujets régionaux, tels que la crise en Syrie. La non-prolifération est un sujet suffisamment grave et complexe pour que l’on ne souhaite pas inclure d’autres considérations dans la négociation en cours. Elle ne doit pas s’apparenter à un « grand marchandage » régional, aux dépens de la lutte contre la prolifération. Bien que l’Iran détienne de nombreuses clefs au plan régional, il nous semble que la conclusion d’un accord solide sur son programme nucléaire est elle-même la clef pour faciliter des interactions plus constructives, dans un second temps et en conséquence.
Si un accord « solide » est nécessaire, nous ne devons pas chercher à faire perdre la face à l’Iran. Tout d’abord, les conditions de la négociation ne s’y prêtent pas. Les sanctions ont certes contribué à pousser les responsables iraniens à s’engager dans de véritables négociations, mais elles n’ont pas arrêté le programme nucléaire et le pays n’est pas à genoux. Nous avons pu le constater à l’occasion de notre déplacement à Téhéran et à Ispahan. Ensuite, il faut permettre aux responsables iraniens de « vendre », eux aussi, un éventuel accord. Sa perspective est loin de faire l’unanimité dans toutes les sphères de la République islamique d’Iran. Enfin, l’impact des négociations est trop important, que leur issue soit positive ou négative, pour que l’on puisse se permettre de faire preuve d’intransigeance, que ce soit du côté iranien ou du côté des « 5+1 ».
Si les négociations échouent, nous estimons en effet que la reconduction de l’accord intérimaire actuel, qui permet de suspendre les aspects les plus préoccupants du programme nucléaire iranien, ne paraît pas une hypothèse tenable à long terme. On risque d’en revenir à la spirale dangereuse qui prévalait antérieurement. Elle combinait de nouveaux développements du programme nucléaire de l’Iran et des pressions accrues au plan international, avec en toile de fond des menaces voilées ou explicites d’interventions militaires, dont les effets seraient dévastateurs au plan régional.
Enfin, il faut veiller à ne pas pénaliser la France. Notre pays aurait beaucoup à perdre si sa position n’était pas interprétée comme une ligne de fermeté raisonnable, comme ce fut le cas lors des négociations sur l’accord intérimaire de novembre 2013. Nous avons été critiqués, dans un premier temps, pour avoir exigé davantage de garanties, avant que notre position soit bien comprise. Elle ne doit pas être interprétée comme une fermeture de principe à l’égard de l’Iran. La fermeté, oui, si elle est raisonnable, mais pas la fermeture.
J’en viens au dernier foyer de tensions, et non des moindres : la question israélo-palestinienne. Tout a été dit et écrit sur ce conflit, y compris qu’il était devenu secondaire. Cet été, la troisième explosion de violence en cinq ans, la plus meurtrière, nous a douloureusement rappelé qu’il n’avait rien perdu de sa centralité stratégique.
L’année 2014 est le triste symbole de l’impasse d’un processus de paix qui n’en porte plus que le nom, et de l’escalade de la violence, dont les peuples, Israélien et Palestinien, continuent de payer le prix. L’échec de la reprises de pourparlers a été suivi d’une nouvelle intervention à Gaza. La Cisjordanie et Jérusalem-Est ont été le théâtre de violences inédites, au point que certains ont parlé d’Intifada rampante, mais aussi de heurts répétés, particulièrement préoccupants, sur l’Esplanade des Mosquées. Cette année aura aussi été marquée par l’impasse d’une nouvelle tentative de réconciliation palestinienne, par la poursuite de la colonisation, et par le lancement par l’Autorité palestinienne d’une stratégie onusienne dont les effets sont plus qu’incertains. Voilà qui achève de nous convaincre que le maintien d’un conflit de basse intensité, ponctué d’explosions épisodiques de violences, est devenu intenable. Surtout, l’idée qu’il y a une alternative à la solution à deux Etats, peut-être la plus dangereuse des illusions, tend à gagner l’opinion et à s’imposer sur le terrain. Pour reprendre l’expression de Jean-François Girault, c’est le cycle historique, ouvert par la signature des accords d’Oslo en 1993, qui se referme aujourd’hui. Il faut inventer autre chose.
D’abord, comme l’Ambassadeur d’Israël nous y a exhorté lors de son audition, il faut porter un regard neuf sur la question, au regard de la nouvelle équation stratégique de la région. Lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dernier, Benyamin Netanyahou a insisté sur l’opportunité historique d’un partenariat possible contre la menace islamiste avec les Etats arabes, qui pourrait faciliter un accord de paix avec les Palestiniens. Il a déclaré que pour réussir la paix, il fallait regarder à Jérusalem et Ramallah, mais aussi au Caire, à Amman, Abou Dhabi, Riyad et ailleurs. Nous rejoignons ce constat. La paix sera régionale ou ne sera pas. Elle doit s’appuyer sur une Initiative arabe de paix réactivée, portée notamment par l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite, et à laquelle les Israéliens doivent fournir une réponse.
Deuxième point, ne perdons pas de vue qu’il revient aux deux protagonistes de faire la paix. Nous ne croyons pas à une solution imposée, car on ne fait pas la paix par procuration. Pourtant, si les termes d’un accord font l’objet d’un consensus international, et si les peuples y aspirent, les protagonistes sont trop affaiblis pour faire la paix seuls, pour reprendre la formule d’Elie Barnavi.
Le conflit est devenu un piège dont les autorités israéliennes ne parviennent pas à sortir. Selon certains, la supériorité militaire se mue en infériorité stratégique, car l’image d’Israël se dégrade à chaque nouvelle crise et menace le pays d’isolement diplomatique et de difficultés avec ce partenaire indispensable que sont les Etats-Unis. Le nouveau Premier ministre israélien aurait-il l’intention de bâtir une paix régionale, il ne pourrait assumer seul la responsabilité d’une reprise des négociations.
Côté palestinien, 2015 s’annonce peu propice à une reprise des négociations : le privilège accordé à la voie politique depuis les accords d’Oslo est en échec et pousse une Autorité palestinienne affaiblie au plan interne à une diplomatie onusienne aux conséquences incertaines ; la transition politique de l’après-Abbas, qui semble désormais ouvertement débattue, devrait réveiller les luttes internes ; enfin, le processus de réconciliation amorcé en avril dernier est dans l’impasse et le Hamas semble tenté de pousser à la rupture, pour administrer une bande de Gaza devenue autonome.
Par conséquent, bien qu’Israéliens et Palestiniens soient ceux qui porteront le poids des négociations, la communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés. Selon Miguel Ángel Moratinos, ancien envoyé spécial de l’Union européenne au Proche-Orient, « nous sommes nombreux à connaître les raisons de l’échec des négociations antérieures. Nous devons assumer notre part de responsabilité. » Ainsi Hubert Védrine a qualifié l’attitude américaine de velléitaire, nous ne sommes pas loin de partager son point de vue. Les Etats-Unis ne sont en tout cas plus en capacité de résoudre seuls la question. L’Europe a abandonné toute prétention à peser dans le règlement politique de la question. Quant aux Etats arabes, depuis 2011, les révolutions ne les ont pas incités à faire preuve de créativité diplomatique. Il faut accepter le constat, difficile, de l’incapacité du processus de paix tel que conduit actuellement à aboutir à une solution de paix durable. Il faut aussi avoir le courage de dire que cette impuissance décrédibilise l’ensemble de notre action au Proche et au Moyen-Orient. Face à ce constat d’échec, le rapport propose quelques lignes d’action.
Tout d’abord, il s’agit de convaincre nos partenaires Israéliens que l’existence de l’Etat palestinien est la meilleure garantie pour la sécurité d’Israël et de faire entendre à nos partenaires Palestiniens que la voie de la négociation est inévitable.
Deuxièmement, il nous faut remettre, de manière collective, le droit international et le Conseil de sécurité au cœur du règlement de la question, par une résolution qui fixerait un cadre et un calendrier aux négociations. Le Conseil est aujourd’hui plus favorable à une initiative et il serait difficile aux Américains d’opposer leur veto à une proposition consensuelle sans mettre en danger leur relation avec les pays arabes, avec lesquels ils sont engagés dans la lutte contre le terrorisme.
Troisièmement, il faut promouvoir un nouveau format des négociations : l’Union européenne et les Etats arabes doivent être associés plus étroitement au règlement du conflit. L’Europe est, par sa faute, perçue comme un simple bailleur de fonds. Elle doit, comme l’a affirmé la Haute représentante de l’Union, Federica Mogherini, utiliser tous les leviers politiques et économiques dont elle dispose pour inciter les parties à revenir aux négociations, faire valoir le bénéfice d’une paix négociée, et prendre des mesures concrètes dès que la solution des deux Etats est remise en cause sur le terrain. La France peut, avec ses partenaires européens, au premier rang desquels la Grande-Bretagne et l’Allemagne, faire entendre la voix singulière de l’Europe sur la question. Le rôle des Parlements nationaux, en lien avec le Parlement européen, peut s’avérer crucial.
Quatrièmement, il s’agit de soutenir et d’accompagner le processus de réconciliation inter-palestinienne. Le refus du Hamas d’abandonner la voie de la violence doit être condamné avec la plus grande fermeté, et sans ambiguïté. Mais l’Union européenne doit aussi soutenir, sans complaisance, ni naïveté, les efforts de Mahmoud Abbas en faveur d’un retour de l’Autorité palestinienne à Gaza et d’une réconciliation inter-palestinienne conforme aux principes agréés par la communauté internationale, seule à même de redonner une véritable légitimité aux institutions palestiniennes, et préalable nécessaire à un accord de paix crédible. Il doit pour cela en avoir les moyens, au plan sécuritaire - l’Union peut ici plaider en faveur de la réactivation de la mission Eubam - et au plan économique.
Enfin, il faut éviter un retour au statu quo antérieur au conflit à Gaza. La reconstruction de Gaza, dont le rythme doit s’accélérer, n’est pas seulement une urgence humanitaire et sécuritaire, c’est un problème politique qui doit trouver une réponse sous peine d’entraîner une recrudescence des violences. La France ne doit pas ménager ses efforts pour que le désarmement de la bande de Gaza s’accompagne d’un cessez-le-feu durable, conduisant à une amélioration fondamentale des conditions de vie de la population, qui passe par un desserrement du blocus de Gaza.
En cas d’échec des négociations, et comme Laurent Fabius l’a énoncé au cours de la discussion de la résolution parlementaire adoptée en novembre dernier, la France devra prendre ses responsabilités et reconnaître le droit du peuple palestinien à un État viable et souverain. Notre pays a été, et demeure, l’un des premiers et des plus fervents défenseurs de l’entrée d’Israël dans le concert des nations et n’a jamais ménagé ses efforts pour que soit universellement admis son droit à l’existence et à la sécurité. Conséquence logique de sa promotion d’une solution des deux Etats, la France devra aussi tenir les promesses faites au peuple palestinien.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Merci beaucoup, vous vous êtes très bien partagé le travail. M. le président de la mission nous a dressé un panorama très complet des sujets complexes abordés par le rapport et Odile Saugues nous a donné des indications extrêmement précises sur les propositions qui vont certainement nourrir notre débat.
Je partage les prises de position de la mission d’information sur la crise syrienne. En particulier, je pense que vous avez raison de souligner qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles renouer avec Assad ne présenterait pas un grand intérêt dans la mesure où les capacités de l’armée syrienne sont désormais extrêmement réduites. Notre ambassadeur sur la Syrie ainsi que M. Michel Duclos, ancien ambassadeur en poste en Syrie pendant de longues années et qui est maintenant chargé de mission au Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), ont souligné que l’armée de Bachar al-Assad qui comptait entre 350 à 400 000 hommes avant le début des troubles n’en compte plus que 70 000 aujourd’hui. De plus, des dizaines de milliers de sunnites qui font partie de cette armée ne sont jamais envoyés au front pour des raisons évidentes.
Il faut effectivement privilégier une désescalade régionale qui dépend largement du jeu des acteurs extérieurs : Iran, Russie, Turquie, Arabie saoudite. Votre rapport décrit très bien tout l’intérêt et la difficulté qu’il y a à favoriser des rapprochements entre ces puissances régionales, pour la crise syrienne mais aussi pour les autres crises régionales. Le problème, c’est qu’il existe des oppositions entre ces puissances qui ne sont pas uniquement des oppositions religieuses mais qui prennent aussi leurs racines dans des oppositions nationales anciennes et qui sont avivées encore plus par les questions religieuses.
Les souffrances endurées par la population syrienne sont tellement importantes qu’il faut bien sûr donner sa chance au plan de M. de Mistura, l’envoyé spécial des Nations Unies, qui souhaite un gel des hostilités. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit que le régime n’a jamais accepté un tel plan. N’abandonnons pas ce plan mais n’ayons pas non plus la naïveté de croire qu’il va pouvoir tout régler.
Vous avez raison de souligner que c’est une solution politique qui s’impose. D’ailleurs, je partage votre analyse selon laquelle la solution politique ne suppose pas le départ préalable d’Assad ou du moins qu’il ne soit pas demandé comme un préalable, mais plutôt comme un aboutissement d’un processus de transition. Il ne peut pas s’agir d’un préalable car il faut que des éléments du régime participent à la négociation, personne n’a intérêt à un effondrement de l’Etat syrien. Néanmoins, on ne peut pas non plus imaginer que ces négociations aboutissent à son maintien au pouvoir. Un dirigeant qui a commis de tels crimes a perdu la légitimité qui est nécessaire pour assurer l’union nationale, c’est de ça dont il s’agit contre Daesh. Il s’agit là d’une constatation qui relève de la morale mais aussi du réalisme et du bon sens. Voilà pour ceux qui se régalent de pourfendre le droit-de-l’hommisme.
La position que vous exprimez, à laquelle je souscris, me paraît être une solution de bon sens, de réalisme politique. Nous avons reçu – Pierre Lellouche et moi-même – le nouveau président de la coalition nationale syrienne M. Khaled Khodja, accompagné du premier ministre, du général Idriss, ministre de la défense de la coalition et qui a longtemps commandé l’armée syrienne libre, de l’ambassadeur ainsi que des anciens présidents de cette coalition. Ils nous ont dit deux choses intéressantes et nouvelles me semble-t-il. Tout d’abord, eux non plus ne font plus du départ de Bachar el-Assad un préalable, les positions ont donc évolué. Deuxièmement, ils ont conclu un accord avec les représentants de l’opposition modérée tolérés par le régime et basés en Syrie.
Les positions sont actuellement figées, l’ASL dispose de 45 000 hommes, moins à priori que l’armée d’el-Assad, mais militairement elle tient le Sud et les faubourgs Est de Damas ainsi qu’une partie de la région autour d’Alep. Ne passons pas l’ASL par pertes et profits, c’est le minimum que l’on peut faire pour donner une chance à ce que dans ce processus de transition inclusif on puisse peut-être aboutir à quelque chose.
Faut-il en déduire, pour faciliter ce processus, qu’il faudrait rouvrir notre ambassade en Syrie ? Peut-être aurait-il été plus avisé de ne pas la fermer. Mais après quatre ans de fermeture, je crois que vous avez raison de souligner dans votre rapport que cela n’a rien d’évident. Vous proposez d’ouvrir la réflexion sur l’opportunité d’une réouverture des ambassades européennes. Je pense que c’est une proposition sage si cela est fait dans un mouvement collectif. A mon sens, une réouverture de notre ambassade n’est envisageable que si ce geste n’est pas interprété comme un aveu de faiblesse ou comme un changement d’orientation. Il faut demeurer prudent et s’assurer du contexte.
Je partage vos conclusions sur l’Iran. Il faut prendre l’Iran au mot, qu’il nous offre des garanties sérieuses, sans que nous cherchions à lui faire perdre la face. Vous avez résumé cette idée dans une formule à laquelle je souscris : « fermeté mais pas fermeture ».
Nous n’avons aucun intérêt à paraître partie prenante des oppositions entre sunnites et chiites. Les crises actuelles sont toutes des crises où les puissances régionales s’affrontent par milices interposées.
Nous avons intérêt à un accord sur le nucléaire mais il faut que ce soit un bon accord. Il y a autant de risques de prolifération en cas d’absence d’accord qu’en cas de mauvais accord. Si l’accord n’était pas jugé crédible par certains partenaires de la région, par Israël ou par d’autres, naturellement ils seraient incités à se doter de l’arme nucléaire.
Sur la question israélo-palestinienne, comme sur les autres sujets d’ailleurs, vous avez extrêmement bien analysé les choses.
Le président américain ne s’est pas impliqué personnellement dans le processus de paix israélo-palestinien et il a laissé faire M. Kerry qui fait ce qu’il peut compte tenu des dissensions sur le sujet à Washington. A moins que l’on arrive à une évolution dans les semaines qui viennent et alors que les Etats-Unis sont désormais assez en retrait, non pas hors du jeu car, en cas d’accord, les Etats-Unis seront les garants de la sécurité d’Israël, il y a certainement une opportunité pour l’Europe de recommencer à être présente sur le plan politique et non plus uniquement sur le plan financier.
Le Financial Times a annoncé il y a deux jours le retrait de Tony Blair de ses fonctions de chef du Quartet. Le journal souligne que les préoccupations d’affaires ont muselé son action diplomatique. Par ailleurs, l’Union européenne a nommé un nouveau représentant spécial : M. Fernando Gentilini, pour le processus de paix au Moyen-Orient. J’espère qu’il aura le profil de M. Moratinos, dont vous avez souligné tout ce qu’il a apporté.
Les résultats des dernières élections israéliennes vont-elles amener des évolutions ? On ne le sait pas encore. Comment M. Netanyahou, qui est arrivé en tête, va-t-il proposer de former son gouvernement s’il y arrive ? Va-t-il maintenir sa position nouvelle prise pendant la campagne ? En effet il a déclaré avant-hier qu’il ne voulait pas d’un Etat palestinien alors qu’il avait jusqu’à présent maintenu la position opposée. Si M. Netanyahou reste sur cette position de campagne et s’il dirige à nouveau le gouvernement israélien, les perspectives ne sont pas très positives. C’est une raison de plus pour œuvrer, comme vous le préconisez dans le rapport, à l’élargissement du format de la discussion et faire en sorte que l’on puisse au plan européen et international, proposer des évolutions.
Merci encore chers collègues, c’était vraiment un travail tout à fait considérable que nous allons poursuivre dans le groupe de travail sur le terrorisme.
M. Jacques Myard. Merci pour vos commentaires, Madame la Présidente. Votre position n’est pas facile, vous appartenez à une majorité et à un gouvernement. J’ai eu un grand plaisir à travailler avec Mme Saugues et M. Reitzer. J’ai eu aussi la chance d’aller en Iran, et de me rendre plus récemment en Syrie, comme vous le savez.
Tout est complexe dans la région, et surtout il existe de profondes interactions entre tous ces conflits lancinants. Tout se mêle. Le conflit israélo-palestinien est dans l’impasse, et tout est prétexte à accuser l’autre partie. Je trouve les déclarations de M. Netanyahou catastrophiques.
Au sujet de la Syrie, j’ai ici la carte de visite de quelqu’un qui combattait Assad autrefois et qui négocie aujourd’hui avec lui à Moscou. La situation évolue. Je pense que l’ASL n’est pas quelque chose de sérieux. Les Américains ont armé des groupes qui sont passés à Al Nosra avec armes et bagages. Nous mêmes, nous nous sommes racontés une histoire, notamment sur les clivages sunnites/chiites. Le chef des services de renseignements de Bashar, Ali Mambouk, est un sunnite. Il ne faut donc pas dire que tout le monde est alaouite ou chiite dans ce régime. On a parlé de la défection d’un général, mais l’armée syrienne en compte 2000 !
J’ai ici une étude de Denis Bauchard qui rappelle qui a créé Daesh. Ce groupe est né en 2006. Les Etats-Unis ont déclenché le chaos dans cette région où il y avait déjà des conflits.
Il ne faut pas croire que nous sommes maîtres du jeu. Nous ne choisissons pas les gouvernements et c’est une faute stratégique de penser qu’on va changer le gouvernement à Damas, même si Assad n’est pas éternel – je ne suis pas son avocat.
Si la Turquie le voulait, elle pourrait mettre fin à Daesh en lui coupant les vivres. Il y a une connivence.
Je souscris à ce qui a été dit par nos rapporteurs. Il faut aider à rechercher la paix dans cette région, il faut aussi préserver nos intérêts culturels. Tout ceci ne sera possible qu’en ayant une politique indépendante dans la région, sans être suiviste à l’égard des Américains.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Il y a aussi des éléments proches du régime qui ont été condamnés par l’Union européenne pour avoir trafiqué avec Daesh, en achetant par exemple leur pétrole. Il faut avoir une vue plus nuancée de la situation dans cette région complexe. C’est le mérite de ce rapport.
Mme Nicole Ameline. Je salue ce rapport qui est un document de référence. Il contient notamment des analyses d’ensemble tout à fait remarquables. Je suis d’accord avec M. Myard sur l’approvisionnement financier des terroristes. C’est une question clef valable aussi en Libye. Nous devons être plus déterminés. Je voudrais aussi ajouter que les radicalisations et les actes terroristes sont nettement en augmentation. Par ailleurs nos partenaires européens ont une position incompréhensible puisqu’ils préfèrent se focaliser sur l’Ukraine et non sur le Sud. Mme Mogherini, en revanche, a une vraie vision de cette partie du monde. Il faudrait que l’Union européenne s’engage dans une démarche de mutualisation et de responsabilité politique, car il est inacceptable qu’une menace aussi directe à nos frontières ne fasse pas l’objet d’une politique commune. Je voudrais insister sur les formats. L’ONU doit retrouver sa légitimité. Je m’interroge aussi sur l’Union pour la Méditerranée, cette belle idée qui n’a malheureusement pas pris corps. L’arme du développement est une réponse, aux côtés des armes militaires et politiques. N’oublions pas non plus la société civile. Au sujet de l’élection de Netanyahou, je pense que beaucoup d’Israéliens trouvent ces déclarations gravissimes. Ma question est la suivante : pensez-vous que cette idée d’Etat bi-national peut prospérer ?
M. Philippe Cochet. Au sujet de l’Iran, vous avez dit que les Iraniens arrivent à vivre malgré l’embargo. Peut-être dans les villes de Téhéran et d’Ispahan. Mais ailleurs c’est plus compliqué. Si on laisse le peuple iranien souffrir, la situation ne va pas s’améliorer. Ma question est de savoir ce qui va se passer le jour d’après la signature d’un accord sur le nucléaire ? Je reste persuadé que l’on doit travailler avec l’Iran car ce pays a une réponse à apporter aux conflits dans cette région. Je suis aussi surpris de la méconnaissance du Quai d’Orsay sur ce pays et ces dossiers. L’Iran a un rôle à jouer dans la région. Il est temps que la France donne des signes de volonté. Le changement récent du régime va dans le bon sens, mais si nous ne donnons aucun signe, il y a des risques que la population se fatigue.
Mme Chantal Guittet. Que pensez-vous du Conseil de coopération du Golfe, organisation régionale créée par les monarchies sunnites pour travailler à la stabilité économique et à la paix régionales. Le Maroc et la Jordanie y ont été invités, et le Yémen en fera peut-être partie en 2016. Quel rôle lui voyez-vous jouer sur les différents conflits ?
M. Thierry Mariani. Merci pour votre exposé très clair. Vous mettez en valeur les hésitations politiques de l’Europe et on se rend compte qu’on passe son temps à lutter contre ce que nous avons nous-mêmes créé il y a longtemps.
L’UE est un nain politique mais c’est toujours le principal bailleur. Ma suggestion serait que nous envisagions une mission d’information sur les fonds de l’UE en matière d’action extérieure. Je ne mentionnerai que les moyens hallucinants dont disposent les « ambassadeurs » de l’Union européenne par rapport aux nôtres.
L’Egypte, elle, agit. On a vu par exemple les représailles que son armée a lancées après l’assassinat des Chrétiens en Libye, et elle se réarme aussi. Faut-il réviser notre politique vis-à-vis de ce pays et renforcer nos relations avec le nouveau pouvoir ?
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Notre programme de travail est défini pour cette année, mais il nous faudra effectivement faire un bilan du Service Européen d’Action extérieure (SEAE), de ses objectifs, de ses moyens et de ses priorités. Nicole Ameline a raison : il faut se battre.
M. François Rochebloine. Les situations évoluent, je me rappelle que Bachar el-Assad a été reçu à l’Assemblée il y a quelques années. C’était l’époque où l’on avait abandonné, en quelque sorte, le Liban pour la Syrie. J’ai rencontré récemment des responsables chrétiens libanais qui considèrent aujourd'hui, que sans la présence du Hezbollah en Syrie, Daesh aurait pénétré au Liban. Quel est votre sentiment ? Il y a beaucoup de réfugiés au Liban, qui gère la situation, mais on avait reproché au général Michel Aoun une certaine connivence avec le Hezbollah, qu’Hariri avait pourtant fait entrer dans son gouvernement. Quel est son rôle aujourd'hui ? Cela étant, je partage tout à fait l’inquiétude quant à la réélection de Netanyahou. Certains députés le qualifiaient il y a longtemps de danger pour la paix et je suis aujourd'hui moi aussi très inquiet pour l’avenir de cette région.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Comme cela a été dit, il y a des interactions et parfois des doubles jeux, notamment de la part de la Turquie. Il faut avoir cela à l’esprit. Quant à la question syrienne, les positions ont beaucoup évolué sur Bachar el-Assad dont on annonçait la fin il y a quelques mois encore. Il n’y a pas de solution militaire à ce conflit et il n’y aura pas de solution politique sans reprise des contacts avec lui, ou avec des éléments de son régime ; il est impératif de tirer les leçons de la Libye : si Bachar el-Assad est balayé, est-ce que ce sera le chaos ou ira-t-on vers une transition avec les modérés ? Cette opposition modérée pourrait ne contrôler que 10 % du territoire national, le régime résiste bien, et les djihadistes ont également le contrôle d’une partie importante du terrain.
M. François Rochebloine. Combien les modérés seraient-ils encore ?
Mme la présidente Elisabeth Guigou. Environ 45 000.
Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission. Je voudrais rajouter que c’est au peuple syrien de choisir son avenir. Il faut éviter l’effondrement du pays, comme l’Irak en 2003, et tout faire pour une solution politique. Nous devons la préparer mais c’est le peuple qui devra s’exprimer.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Concernant l’Iran, la décision finale appartiendra au guide suprême, dont on dit qu’il est très malade. Veut-il marquer son règne par la conclusion d’un accord équilibré ou au contraire marquer son autorité en montrant qu’il ne veut pas céder à la tentation d’une ouverture ? Une question analogue se pose pour la fin du mandat de Barack Obama. Quelle empreinte voudra-t-il laisser ? Nous le saurons dans les semaines qui viennent, mais il est sûr que l’Iran ne peut plus être ignoré. Il est vrai que la situation est difficile pour la population, que le pays est aux abois et a besoin d’un accord. Mais l’Iran est une grande puissance qui a toujours été importante dans la région, et qui a un rayonnement culturel. Nous sommes de ceux qui veulent que l’Iran ait sa place dans le concert des nations et que s’établisse un équilibre dans la région. Au même titre que l’Égypte, l’Iran est un pivot sur lequel s’appuyer demain pour soutenir l’économie des pays de la région mais aussi exercer une influence positive sur les conflits.
Nous devons soutenir l’Égypte qui fait des efforts considérables pour lutter contre les djihadistes et les Frères musulmans. L’Égypte subit notamment l’effondrement du tourisme. C’est un enjeu que de retrouver un flux touristique qui permette de contrer l’appauvrissement de la population et génère des emplois. Par trois fois, le Général Sissi nous a dit de faire attention lorsque j’ai pu le rencontrer avec certains de nos collègues à l’occasion d’un déplacement en Egypte : quand la porte arrière sera enfoncée (l’Égypte), la porte avant sera enfoncée aussi (l’Europe). Quand on voit la situation en Libye, on se dit qu’il est temps que la France et l’Europe jouent leur rôle, y compris en termes de politique de développement. La pauvreté est un terreau de l’islamisme, les islamistes jouant aussi un rôle social important. On l’a vu avec al-Nosra en Syrie mais aussi avec le Hamas en Palestine et le Hezbollah au Liban.
Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission. J’ai dit dans mon intervention que l’Iran n’est pas à genoux. Mais il y a aussi de graves difficultés auxquelles la population fait face avec beaucoup de dignité. Nous avons du commerce à faire avec ce pays de 80 millions d’habitants. La conclusion d’un accord sur le programme nucléaire et la levée de l’embargo nous rendraient très largement service. Les États-Unis ont déjà entamé des approches commerciales. Nos industries ont intérêt à reprendre le plus rapidement possible leur place en Iran sitôt un accord conclu.
Il est vrai que l’Union pour la Méditerranée pourrait être une solution pour apaiser les sociétés civiles et trouver des solutions. Si cette idée avance peu, elle n’en demeure pas moins riche et porteuse d’espoirs.
Peut-on encore croire à l’établissement d’un État binational en Israël/Palestine ? Il faut le marteler : il n’y a pas d’alternative à la solution à deux Etats. C’est la seule solution qui exclut le risque d’apartheid comme de guerre civile, pour citer Elie Barnavi, que notre commission a auditionné. Pourtant, l’idée d’un seul Etat semble recueillir une certaine audience. Il est vrai que beaucoup de Palestiniens se préoccupent plus de défendre leurs droits que de défendre la création d'un État palestinien. Ils se désintéressent malheureusement des négociations. Une partie de la droite israélienne parle aussi d’annexer la Cisjordanie, ce qui serait redoutable.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Je confirme, s’agissant de l’Iran, que nous avons de grands intérêts économiques. Quand on atterrit à Téhéran, on a l’impression d’être à « Peugeotland ». Peugeot détenait 40 % du marché automobile iranien. Par exemple, l’usine de Vesoul travaillait uniquement à produire des pièces détachées pour l’Iran.
Vous avez posé la question du Conseil de coopération du Golfe. Bien qu’il regroupe des dynasties sunnites, il illustre les divisions qui traversent ces pays. Certains ont des positions dures à l’égard de l’Iran, d’autres sont plus accommodants, certains sont favorables aux Frères musulmans, d'autres à leur éradication. Pour résoudre les conflits, il faut un engagement des pays arabes. Mais il y a beaucoup de doubles jeux. Cette organisation a le mérite d’exister, mais elle réunit des intérêts divergents.
M. Jacques Myard. Il semblerait qu’il y ait un mouvement de reprise des relations diplomatiques de plusieurs pays avec la Syrie. On parle de la Tunisie et de la Roumanie. Concernant l’Iran, je m’interroge toujours sur ce qui s’est passé avec Peugeot. General Motors est entré dans le capital de l’entreprise, Peugeot a mis fin à sa présence en Iran, puis General Motors est sorti du capital. On peut y voir quelque chose de l’ordre de l’instrumentalisation commerciale, quand les Américains ont donné l’autorisation à Boeing de livrer des pièces détachées.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Effectivement, il ne faut pas négliger les intérêts commerciaux. Concernant la Roumanie et la Tunisie, je reviendrai plus tard vers vous avec des précisions. Il me semble néanmoins que la Roumanie n’a jamais fermé son ambassade à Damas. Je rappelle à cette occasion qu’il y a toujours une délégation de l’Union européenne pour la Syrie.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Le départ de Peugeot a été très mal vécu. Je l’ai rappelé aux équipes de PSA au cours d’un déjeuner il y a trois semaines. Elles m’ont dit que l’entreprise reprenait langue avec les Iraniens. Elle doit lever des problèmes d’autorisation de flux financiers et il existe une crainte que l’Iran soit insolvable. Mais l’entreprise est convaincue de la nécessité de revenir en Iran.
Le Hezbollah est un élément important de la lutte contre Daesh qui a fait des incursions au Liban et des attaques à Tripoli.
Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission. Il y a le Hezbollah, mais il n’est pas le seul à lutter. Il y a aussi l’armée libanaise, que nous soutenons. On entend au Liban deux analyses contraires : le Hezbollah serait essentiel pour lutter contre Daesh ; il aurait attiré les djihadistes au Liban par son action en Syrie.
M. Lionnel Luca. A vous entendre, l’Orient compliqué est devenu inextricable : retournements d’alliances, régimes insupportables devenus supportés… Ce qui m’interpelle, c’est le rôle de l’ONU. Nous connaissons les limites de ce qui a pu être qualifié de « machin » dans le cadre des relations interétatiques. Mais que fait l’ONU, face à ces organisations qui échappent à la réalité des États ? Y a-t-il une réflexion conduite en son sein ? Le sentiment d’impuissance atteint une telle proportion que c’est comme si étaient annulées toutes les velléités manifestées au sortir de la deuxième guerre mondiale d’organiser la paix dans le monde.
Mme Odile Saugues, rapporteure de la mission. Nous prônons dans le rapport le retour du Conseil de sécurité dans le règlement du conflit israélo-palestinien. En Syrie, M. de Mistura tente une opération de gel des hostilités à Alep. Il est vrai qu’on n’a pas le sentiment que l’initiative a été efficace, car Alep a été bombardée le jour même de la présentation de son plan devant le Conseil de sécurité.
M. Jean-Luc Reitzer, président de la mission. Il y a eu différentes tentatives de médiations de l’ONU en Syrie. Beaucoup de résolutions ont également été adoptées, particulièrement pour le conflit israélo-palestinien, mais elles ne sont jamais suivies d’effets en l’absence de sanctions.
Mme la présidente Élisabeth Guigou. Heureusement que l’ONU intervient en Afrique, car sinon, nous y serions absolument seuls. Mais il est vrai que sur les grandes questions de paix internationales, lorsqu’il existe des désaccords entre les membres du Conseil de sécurité, l’organisation est paralysée.
Je remercie encore la mission d’information pour ce travail extraordinaire et les remarques de nos collègues enrichiront notre réflexion et nos propositions.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
A. TRAVAUX DE LA MISSION D’INFORMATION
1) A Paris
– M. Thierry Coville, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste de l’Iran (22 janvier 2014) ;
– M. Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l’Iran (29 janvier 2014) ;
– M. Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (5 février 2014) ;
– M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran (12 février 2014) ;
– M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) au Ministère des Affaires étrangères et du développement international (19 février 2014) ;
– M. Didier Billion, directeur-adjoint de l’IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient (26 février 2014) ;
– M. Pascal Boniface, directeur de l’IRIS (9 avril 2014) ;
– Mme Laurence Louër, chargée de recherche au Centre d’Etudes et de Recherches internationales (CERI) de Sciences Po, rédactrice en chef de la revue « Critique internationale », spécialiste du Golfe (16 avril 2014) ;
– M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Ministère des affaires étrangères et du développement international (7 mai 2014) ;
– Mme Myriam Benraad, chercheuse au CERI-Sciences Po et analyste au Conseil européen des affaires étrangères (ECFR), spécialiste de l’Irak (7 mai 2014) ;
– Son Exc. M. Bertrand Besancenot, ambassadeur de France en Arabie saoudite (13 mai 2014) ;
– M. Salam Kawakibi, directeur-adjoint de l’Initiative arabe de réforme, ancien directeur de l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Alep (14 mai 2014) ;
– M. Georges Corm, ancien ministre des finances de la République libanaise, professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (14 mai 2014) ;
– M. François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique (28 mai 2014) ;
– M. Fabrice Balanche, maître de conférences à l’Université de Lyon 2, directeur du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), spécialiste de la Syrie (28 mai 2014) ;
– M. Barah Mikail, directeur de recherche à la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur (FRIDE) de Madrid, ancien directeur de séminaire au Collège interarmées de défense (3 juin 2014) ;
– M. Pascal Marchand, professeur à l’Université de Lyon 2, spécialiste de la géopolitique russe (11 juin 2014) ;
– M. Jean-François Legrain, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Palestine (18 juin 2014) ;
– M. Jean-Paul Chagnollaud, professeur des universités, directeur de l’Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMo) (18 juin 2014) ;
– M. Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste de la question kurde et des minorités au Moyen-Orient (8 juillet 2014) ;
– M. Emmanuel Bonne, conseiller Afrique du Nord, Moyen-Orient et Nations unies, à la Présidence de la République (9 juillet 2014) ;
– M. François Burgat, directeur de recherche à l’Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) (29 octobre 2014) ;
– M. Stéphane Lacroix, professeur associé à l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI-Sciences Po, spécialiste des mouvements islamistes, de l’Arabie saoudite et de l’Egypte (2 décembre 2014) ;
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères (3 décembre 2014) ;
– M. Dominique Thomas, chercheur associé à l'Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman à l’EHESS, spécialiste des mouvements islamistes (10 décembre 2014) ;
– M. Laurent Bonnefoy, chercheur au CERI-Sciences Po, chercheur associé au Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa, spécialiste des mouvements salafistes et de la péninsule arabique (17 décembre 2014) ;
– M. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre (11 février 2015) ;
– Son Exc. M. Hael Al Fahoum, ambassadeur, chef de la mission de la Palestine en France (18 février 2015) ;
– Son Exc. M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France (4 mars 2015).
2) A l’occasion du déplacement en Iran de Mme Odile Saugues, MM. Jean-Luc Reitzer, Jacques Myard et Jean-Philippe Mallé (du 24 au 27 juin 2014)
– Son Exc. M. Bruno Foucher, ambassadeur de France à Téhéran, et ses principaux collaborateurs : M. Sébastien Surun, premier conseiller, M. Olivier Decottignies, deuxième conseiller, M. Philippe Cormier, deuxième conseiller, M. Kevin Magron, premier secrétaire, M. Mathieu Bruchon, conseiller économique, M. Thierry Vielle, conseiller de coopération et d’action culturelle ;
– M. Kazem Jalali, président du centre de recherche du Parlement iranien ;
– Rencontre avec des députés des minorités religieuses ;
– M. Hassan Kamran, député d’Ispahan et Président du groupe d’amitié Iran-France au Parlement ;
– Dr Alaedin Boroujerdi, président de la commission de la sécurité nationale et des affaires étrangères au Parlement iranien ;
– Mme Fatemeh Rahbar, présidente de la faction parlementaire des femmes ;
– M. Majid Takht-Ravanchi, vice-ministre des affaires étrangères pour l’Europe et les Amériques ;
– M. Hossein Amir Abdollahian, vice-ministre des affaires étrangères pour les pays arabes et l’Afrique.
B. AUTRES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES CONSACRES AU PROCHE ET AU MOYEN-ORIENT
(Il n’est pas fait mention des auditions régulières de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, sur la situation internationale. D’autres réunions ne sont pas signalées).
1) Auditions de la Commission
- M. Jacques Audibert, directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères et du développement international (5 février 2011) ;
- M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement international (9 avril 2014) ;
- Table ronde sur la Turquie, en présence de M. Ahmet Insel, économiste et politologue, et de M. Didier Billion, directeur-adjoint de l’IRIS (16 avril 2014) ;
- Son Exc. M. Hael Al-Fahoum, ambassadeur, chef de la mission de Palestine en France (7 mai 2014) ;
- Son Exc. M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France (11 juin 2014) ;
- M. Jean-François Girault, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement international, sur la situation en Irak (18 juin 2014) ;
- M. Amr Moussa, ancien ministre des affaires étrangères de la République arabe d’Egypte, ancien secrétaire général de la Ligue arabe, ancien président du comité constituant égyptien de 2013 (18 juin 2014) ;
- Table ronde sur l’Iran, en présence de M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, et de M. Ahmad Salamatian, ancien député d’Ispahan et ancien vice-ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran (1er juillet 2014) ;
- M. Nicolas de Rivière, directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères et du développement international (23 juillet 2014) ;
- M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, sur la situation en Irak (30 septembre 2014) ;
- Son Exc. M. Laurent Bili, ambassadeur de France en Turquie (22 octobre 2014) ;
- Table ronde sur la situation en Irak, en présence de M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, et de M. Hocham Dawod, chercheur au CNRS, ancien responsable de l’antenne de l’IFPO en Irak (10 décembre 2014) ;
- M. Tammam Salam, président du Conseil des ministres de la République libanaise (10 décembre 2014) ;
- M. François Delattre, ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française près les Nations unies à New York (20 janvier 2015) ;
- M. Jean-Christophe Peaucelle, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères et du développement international, et M. Joseph Maïla, professeur de sociologie politique et de relations internationales, sur la situation des minorités au Moyen-Orient (27 janvier 2015) ;
- M. Stéphane Lacroix, professeur associé au CERI-Sciences Po, et Mme Brigitte Curmi, conseillère des affaires étrangères et chargée de mission au Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère des affaires étrangères et du développement international, sur l’islamisme en Afrique du Nord et au Proche et Moyen-Orient (28 janvier 2015) ;
- M. Elie Barnavi, historien, professeur à l’Université de Tel-Aviv, directeur du comité scientifique du Musée de l’Europe à Bruxelles, et Mme Leïla Shahid, ambassadeur, chef de la mission de la Palestine auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg, sur l'Europe et la question de Palestine (4 février 2015).
2) Petits déjeuners de la Commission
- M. Justin Vaïsse, directeur du Centre d'Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) au ministère des affaires étrangères et du développement international (15 janvier 2014) ;
- Son Exc. M. Patrice Paoli, ambassadeur de France au Liban (29 janvier 2014) ;
- M. Hervé Magro, consul général de France à Jérusalem (12 février 2014) ;
- Son Exc. Mme Caroline Dumas, ambassadrice de France en Jordanie (17 septembre 2014) ;
- M. Xavier Chatel, sous-directeur d’Egypte-Levant au ministère des affaires étrangères et du développement international (5 novembre 2014) ;
- Son Exc. M. Hakki Hakil, ambassadeur de Turquie en France (17 décembre 2014) ;
- M. Jean-Claude Cousseran, secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale (21 janvier 2015) ;
- Mme Bénédicte de Montlaur, sous-directrice d’Afrique du Nord au ministère des affaires étrangères et du développement international (4 février 2015) ;
- Son Exc. M. Franck Gellet, ambassadeur pour la Syrie (18 février).
3) Groupe de travail sur les dossiers suivis par le Conseil de sécurité
- M. Bernard Bajolet, directeur général de la sécurité extérieure (16 avril 2014) ;
- Son Exc. M. Bruno Foucher, ambassadeur de France en Iran (28 mai 2014) ;
- M. Didier Chabert, sous-directeur du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et du développement international (17 septembre 2014).
ANNEXE N° 1 : CARTE DE L’AFRIQUE DU NORD ET DU MOYEN-ORIENT
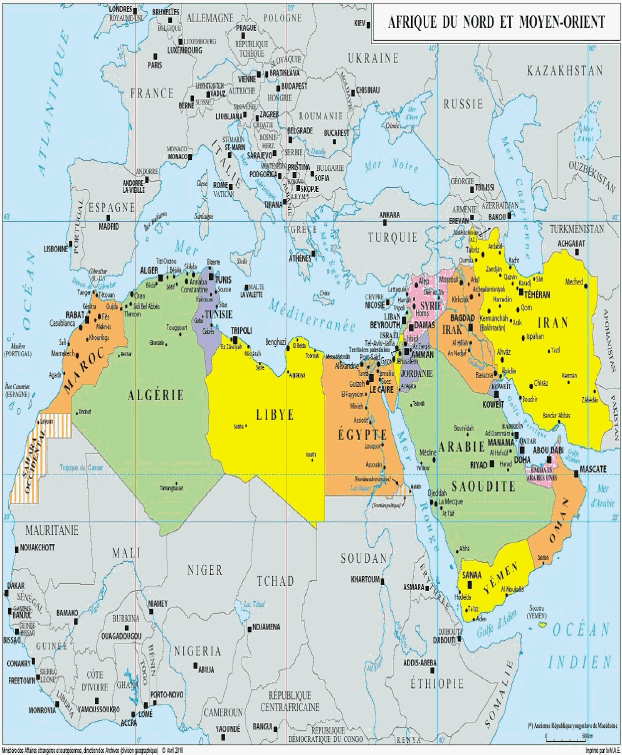

ANNEXE N° 3 : CARTE DE LA SYRIE

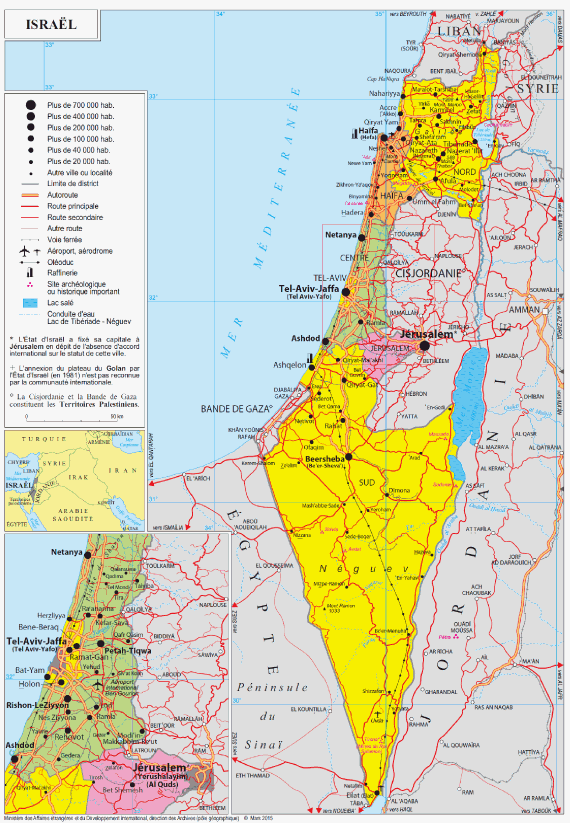
ANNEXE N° 5 : CARTE DES TERRITOIRES PALESTINIENS
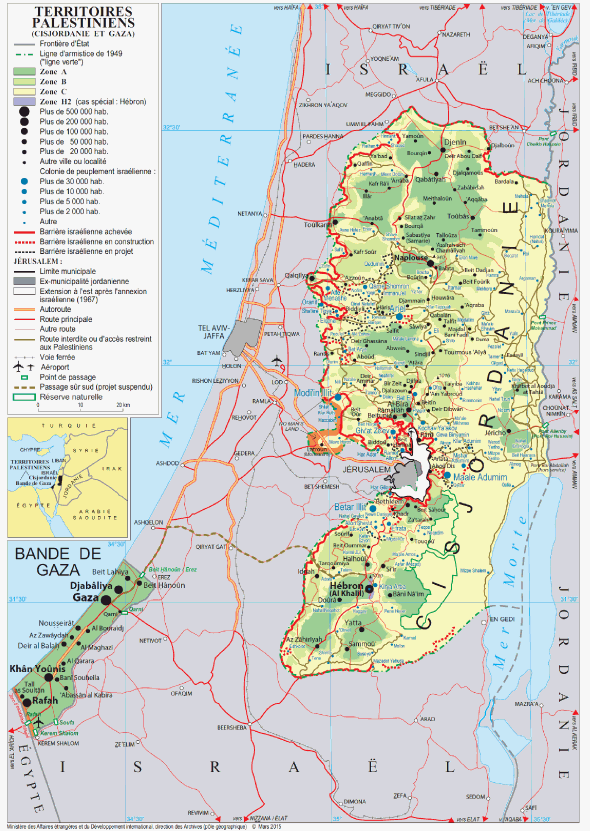
1 () Ni ce pays, ni la Tunisie n’entrent dans le champ géographique de la mission d’information sur le Proche et le Moyen-Orient, stricto sensu, mais il paraît néanmoins utile de les inclure dans cette présentation de la situation régionale.
2 () La mission d’information sur les « révolutions arabes » était composée de : M. Jean Glavany (rapporteur), M. Jacques Myard (président), Mme Sylvie Andrieux, M. Jean-Louis Destans, Mme Marie-Louise Fort, MM. Lionnel Luca, Jean-Philippe Mallé et Michel Vauzelle.
Comme l’avait préconisé le rapporteur de cette mission d’information lors de la présentation en commission de ses conclusions, la présente mission d’information sur le Proche et le Moyen-Orient a veillé à réaliser un point d’étape sur les « révolutions arabes ».
3 () Les événements de 2011 ont principalement affecté la Tunisie, l’Egypte, la Libye, la Syrie, le Bahreïn et le Yémen, mais ils ont aussi trouvé une résonance, atténuée, dans d’autres pays de la région. Seules les monarchies du Golfe sont globalement restées à l’écart de ce mouvement, exception faite du Bahreïn. Certains pays, en particulier le Maroc, mais aussi dans une certaine mesure la Jordanie, ont connu des contestations populaires d’ampleur auxquels ils ont su répondre en annonçant des réformes « par le haut », ce qui a contribué à la stabilisation de leur situation intérieure.
4 () Pour des développements sur les raisons susceptibles d’expliquer la montée en puissance et l’emprise de Daesh, cf. pp.75-78.
5 () Frédéric Charillon, « La fin du rêve démocratique », Afrique du Nord – Moyen-Orient 2014-2015, La Documentation française, 2014.
6 () A moins qu’il ne s’agisse du contraire : un coup d’Etat militaire s’appuyant sur des manifestations de masse.
7 () Le taux d’approbation de la Constitution s’est élevé à 98 % de voix (avec un taux de participation de 38 %).
8 () Elles devraient être reportées en raison d’une récente décision de la Haute Cour constitutionnelle.
9 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1566.asp
10 () Le 1er janvier 2015, la Cour de Cassation a toutefois ordonné un nouveau procès pour l’Australien Peter Greste, l’Egypto-canadien Mohamed Fadel Fahmy et l’Egyptien Baher Mohamed. En vertu d’un décret présidentiel de novembre 2014 qui permet d’expulser des étrangers condamnés à la prison ou en instance de jugement « pour préserver l’image internationale de l’Egypte », M. Peter Greste a été expulsé du territoire égyptien le 1er février 2015.
11 () Le président de la mission a notamment eu l’occasion de rencontrer le président égyptien lors d’un déplacement du groupe d’amitié France-Egypte de l’Assemblée nationale.
12 () Il a même été nommé « commandant général des forces armées » – lesquelles existent essentiellement sur le papier.
13 () L’assassinat de 21 travailleurs égyptiens coptes, revendiqué par Daesh, mi-février, a par ailleurs suscité une réaction militaire égyptienne, sous la forme de bombardements dirigés contre des positions présumées de Daesh, près de Derna.
14 () La réunion qui s’est tenue à Rabat du 5 au 7 mars dernier a réuni, pour la première fois, l’ensemble des partis.
15 () Les « Houthistes » ou « Houthis », du nom de leur ancien chef Hussein Al-Houthi, assassiné en 2004 et ensuite remplacé par d’autres membres de sa famille, appartiennent à un mouvement politico-religieux qui se fait également appeler Ansar Allah (« les partisans de Dieu »). L’histoire de la rébellion houthiste commence en 2004, à l’occasion d’une opération de police qui se heurte à une résistance sur le terrain et finit par conduire à des offensives militaires, tandis que les Houthistes rallient à leur cause un certain nombre de tribus. Ce mouvement repose sur la défense de l’identité zaydite, perçue comme étant en voie de marginalisation, et sur une critique de l’alliance avec les Américains dans le cadre de la lutte contre AQPA. L’essor du mouvement houthiste est également lié au mal-développement au Yémen et à la montée du salafisme (sunnite) dans le pays.
16 () Par référence à un imamat qui a dirigé le Nord du pays pendant mille ans, jusqu’à la révolution de 1962.
17 () Le zaydisme ne reconnaît que 5 imams, successeurs du Prophète, à la différence du chiisme duodécimain – majoritaire en dehors du Yémen – qui en compte 12. Par ailleurs, si les Houthistes sont sensibles à la portée révolutionnaire du régime iranien, ils n’adhèrent pas à sa doctrine du Velayat-e faqhi, le « gouvernement du juriste ».
18 () Selon certaines sources, des Iraniens passent pour assurer la sécurité du chef des Houthistes, et des membres du Hezbollah participeraient à des actions de formation militaire au profit du mouvement.
19 () AQPA a d’ailleurs revendiqué l’attentat du 7 janvier 2015, à Paris, contre la rédaction de Charlie Hebdo.
20 () La mission d’information de 2013 sur les « révolutions arabes » a souligné plusieurs caractéristiques favorables en Tunisie : l’existence d’une classe moyenne importante ; un niveau d’éducation élevé ; des élites en grande partie tournées vers l’Europe ; une société civile très active, notamment une centrale syndicale (l’UGTT) puissante et réformatrice, mais aussi des associations de défense et de promotion des droits des femmes très actives. A ces différents « anticorps », on peut ajouter un mouvement islamiste, Ennahda, ayant une histoire différente de ses équivalents régionaux, notamment les Frères musulmans égyptiens, et une maturité politique manifestement plus grande.
21 () Il paraît préférable de ne pas employer l’expression : « laïque », trop souvent comprise, à tort, comme signifiant « athée » et donc refusée à ce titre dans la région.
22 () Ennahda n’a pas présenté de candidat à l’élection présidentielle qui a suivi, et n’a soutenu publiquement aucun des concurrents parvenus au second tour – Caïd Beji Essebsi, de la formation séculière Nidaa Tounes, et Moncef Marzouki (CPR).
23 () Le jour de la présentation de ce rapport en commission, le 18 mars 2015, le musée du Bardo de Tunis a été frappé par un attentat particulièrement meurtrier qui a été revendiqué par Daesh.
24 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1566.asp.
25 () Les réfugiés syriens sont désormais les plus nombreux au monde, devant les Afghans. Par ailleurs, une personne déplacée sur 5 dans le monde est d’origine syrienne.
26 () De plus amples développements sont consacrés plus loin dans ce rapport aux répercussions de la crise syrienne dans les pays voisins (pp.36-40).
27 () La France a annoncé qu’elle renouvellerait son engagement pris en 2014 d’accueillir 500 réfugiés syriens au titre de la réinstallation, avec 500 autres réfugiés en 2015. Outre l’accueil au titre de la réinstallation, la France a délivré depuis 2013 environ 1 200 visas au titre de l’asile à des ressortissants syriens ayant déjà fui ou souhaitant quitter leur pays ; par ailleurs, plus de 31 000 visas français ont été délivrés à des ressortissants syriens, notamment dans le cadre de bourses étudiantes et de la réunification familiale.
28 () Le HCR estime qu’environ 10 % des réfugiés accueillis dans les pays voisins de la Syrie devraient trouver un autre pays accueil. Il s’agit de réfugiés particulièrement vulnérables, tels que des victimes de torture, des personnes gravement malades ou des femmes avec plusieurs enfants à charge mais sans aucun soutien familial.
29 () Intervention de M. Michel Duclos, ancien ambassadeur à Damas et conseiller au Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du Ministère des affaires étrangères et du développement international, devant la Commission des affaires étrangères, le 4 mars 2015.
30 () Compte tenu des pertes, des blessés et des défections, Charles Lister estimait en 2014 à environ 125 000 hommes les effectifs des forces armées syriennes, les opérations ne reposant par ailleurs que sur quelques unités jugées loyales, telles que la Garde républicaine et les 3e et 4e divisions d’élite (Charles Lister, « Dymanic Stalemate : Surveying Syria’s Military Landscape », Brookings Doha Center, mai 2014). Des évaluations plus récentes font état de 70 000 combattants effectifs, dont des dizaines de milliers de sunnites que le régime se garderait d’envoyer au front.
31 () Elles pourraient compter entre 50 000 et 100 000 hommes.
32 () Au début de l’année 2013, des armes antichars d’origine croate, qui auraient été livrées par l’Arabie saoudite à des groupes modérés dans le Sud du gouvernorat de Deraa, seraient finalement parvenues à des combattants de Jabhat Al-Nosra, puis de Daesh, cette fois en Irak ; à la fin de la même année, la prise des entrepôts d’armes du Conseil militaire suprême de l’Armée syrienne libre, soutenue par les pays occidentaux, a permis au Front islamique de se saisir de stocks de matériel (Charles Lister, « Dymanic Stalemate : Surveying Syria’s Military Landscape », Brookings Doha Center, mai 2014).
33 () Cf. ci-après p. 67.
34 () Dans l’article précité, Charles Lister estime à un millier le nombre des factions armées luttant contre le régime syrien ; selon Jean-Pierre Perrin, il y aurait au moins 2 000 « bataillons » (« Kataëb ») différents (Jean-Pierre Perrin, « Syrie : l’enlisement », Politique internationale, n° 142, hiver 2014).
35 () Que l’on peut définir comme professant des objectifs qui n’entrent pas en contradiction avec des principes tels que le multipartisme et le respect de la diversité ethnique et confessionnelle.
36 () Cf. pp.79-93
37 () Elles viseraient un groupe terroriste qui se serait réfugié en Syrie, aux côtés de JAN. Ce groupe, que les Américains désignent du nom de « Khorassan », aurait pour finalité première de projeter des attentats dans les pays occidentaux.
38 () Pour la distinction entre ces deux tendances, cf. notamment p.58.
39 () Cf. ci-après pp.58-78.
40 () Selon Charles Lister (article précité).
41 () Jennifer Caferella, « Jabhat Al-Nusra in Syria, an Islamic Emirate for Al-Qaeda », Middle East Security Report 25, décembre 2014 (http://www.understandingwar.org/sites/default/files/JN%20Final.pdf).
42 () La montée en puissance de Daesh est présentée dans le B de la présente partie du rapport.
43 () Sans dissimuler son idéologie salafiste, Jabhat al-Nosra a longtemps gommé son affiliation à l’internationale djihadiste d’Al-Qaida et mis l’accent sur son agenda syrien.
44 () A la différence de Daesh, qui se distingue de JAN par son agressivité et sa violence à l’égard des autres groupes.
45 () Cette formule a fait l’objet d’interprétations divergentes : entendue à Washington comme devant écarter l’option d’un maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, elle signifie au contraire pour d’autres, en particulier à Moscou, que cette hypothèse n’est nullement exclue.
46 () Selon une expression employée par M. de Mistura lors d’une réunion au Royal Institute of International Affairs de Londres (« Chatham House »), le 5 mars dernier.
Il a notamment précisé que son initiative visait à combiner deux éléments :
– un gel des attaques aériennes et des tirs d’artillerie lourde dans l’ensemble d’Alep, pendant 6 semaines ;
– un gel complet des hostilités dans un « quartier pilote » où l’ONU acheminerait de l’aide humanitaire et remettrait en marche des services essentiels.
47 () Banque mondiale, « Lebanon - Economic and social impact assessment of the Syrian conflict », 2013 (http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/09/18292074/lebanon-economic-social-impact-assessment-syrian-conflict)
48 () Les deux principaux camps, le « 8 mars » et le « 14 mars », se trouvent pris dans un jeu d’alliances opposées à l’égard du conflit syrien.
49 () Puis autorisés à entrer par vagues ponctuelles.
50 () Dorothée Schmidt, « La Turquie dans l’impasse syrienne », Politique internationale, n° 141, automne 2014.
51 () Une première tentative de réconciliation entre Ankara et le PKK a échoué en 2011. De nouveaux pourparlers ont été engagés avec Öcalan fin 2012. Les termes de l’accord annoncé le 21 mars 2013 n’ont pas été rendus publics et le processus en cours ne semble guère avancer.
52 () Ou bien la troisième grande ville (les estimations variant sur ce point).
53 () International Crisis Group, « Iraq’s Jihadi Jack-in-the Box », Middle East Briefing n°38, 20 juin 2014.
54 () Audition du 18 juin 2014 de la commission des affaires étrangères.
55 () Audition de la commission des affaires étrangères, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, sur la situation en Irak (le 27 août 2014).
56 () En particulier l’association des principales factions par des nominations aux postes à haute responsabilité, notamment dans le domaine de la sécurité, et par la création d’un conseil national de la stratégie politique, destiné à servir de lieu de débat sur les principales orientations. Les Kurdes devaient aussi obtenir des réponses à leurs demandes (loi sur le pétrole et le partage des revenus, référendums dans les territoires « disputés », paiement des peshmergas sur le budget fédéral).
57 () Au pouvoir de 2006 à 2014. Les évolutions politiques depuis la nomination du successeur de M. Maliki, M. Haider al-Abadi, sont présentées dans la partie II du présent rapport (p.95).
58 () Comme le rappelle Pierre-Jean Luizard, « en 1917, les Britanniques s’appuyaient sur les élites arabo-sunnites, relais du pouvoir ottoman. Ils distribuèrent généreusement des titres de propriété à des cheikhs tribaux promus grands propriétaires terriens qui devenaient leurs obligés » (« L’Irak, du premier au second mandat », Le Débat, 4/2003, n°126). En 2003, les Américains ont fait le choix contraire de s’appuyer sur les chiites et les Kurdes, parce que les sunnites étaient minoritaires, qu’ils s’identifiaient à leurs yeux à l’ancien régime baasiste et que leurs élites s’étaient « évaporées » au moment de l’invasion du pays. Les Américains s’en sont remis aux forces en présence, dans une perspective ethnique et confessionnelle.
59 () Les Etats-Unis sont parvenus à enrayer l’insurrection sunnite qui reposait sur diverses factions, islamistes et nationalistes à l’agenda proprement irakien, mouvance salafiste djihadiste et combattants terroristes étrangers, en combinant le ralliement de tribus financées, armées et formées par les Etats-Unis (mouvement dit « Sahwa » ou « réveil ») et des renforts américains substantiels (dans le cadre du « Surge »).
60 () Sinan Adnan et Aaron Reese, « Beyond the Islamic State : Iraq’s Sunni Insurgency », Middle East Security Report 24, Institute for the Study of War, octobre 2014.
61 () « Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community », déclaration de M. James R. Clapper, directeur du renseignement national, devant la Commission du renseignement du Sénat américain, 29 janvier 2014.
62 () Myriam Benraad, « Iraqi Elections and Maliki’s Gamble », European Council on Foreign Relations, 26 mars 2014.
63 () International Crisis Group, « Make or Break : Iraq’s Sunnis and the State », Middle East Report n° 144, 14 août 2013.
64 () Qui serait dirigé par Izzat Ibrahim al-Douri, ancien vice-président irakien à l’époque de Saddam Hussein.
65 () Sinan Adnan et Aaron Reese, « Beyond the Islamic State : Iraq’s Sunni Insurgency », Middle East Security Report 24, Institute for the Study of War, octobre 2014.
66 () Peter Harling, « Dix ans après, que devient l’Irak ? », Le Monde diplomatique, mars 2013.
67 () Ibidem.
68 () MM. Jean-Paul Chagnollaud et Alain Dieckhoff, « La Palestine et l’ONU », compte rendu de la conférence organisée par l’Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, 10 octobre 2011.
69 () Shlomo Ben Ami « Why Israel ? », Project Syndicate, 1er septembre 2014.
70 () Deux sites clandestins ont été révélés au début des années 2000 : une installation secrète d’enrichissement de l’uranium, en voie d’enfouissement, à Natanz, situé entre Ispahan et Kachan ; la mise au point d’une centrale nucléaire dite « à eau lourde » à Arak.
71 () L’Iran a ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 1970 et signé un accord de garanties avec l’AIEA en 1973.
72 () Selon le rapport au Conseil des gouverneurs de l’AIEA du 7 novembre 2014. Le stock d’uranium enrichi en dessous de 20 % doit être « neutralisé » par oxydation ou dilution, conformément au plan d’action conjoint conclu avec l’Iran en novembre 2013 (Cf. IIIe partie du présent rapport).
73 () Le délai d’obtention d’un stock suffisant de matière fissile hautement enrichie pour fabriquer une bombe nucléaire (techniquement qualifié de « break-out time ») a pu être estimé entre deux et trois mois à l’heure actuelle (cf. notamment Greg Thielmann et Robert Wright, « The Trouble With “Breakout Capacity” », American Foreign Policy Project, 18 juin 2014). Ce délai aurait été doublé grâce à l’application du plan d’action conjoint qui est présenté plus loin dans ce rapport. Il faut aussi parvenir à mettre au point une charge nucléaire et à l’intégrer dans un missile.
74 () Elles ne sont pas toutes en activité. Au total, 10 000 des 19 000 centrifugeuses iraniennes pourraient l’être.
75 () La recherche et développement est un aspect important à prendre en compte, car elle peut permettre d’améliorer la performance des centrifugeuses, de limiter leur nombre et de faciliter leur dissimulation éventuelle dans des installations non déclarées.
76 () Les responsables iraniens ont écarté des préoccupations exprimées par l’Agence au motif que « la plupart des questions » figurant dans l’annexe au document GOV/2011/65 sont « de pures allégations et ne méritent pas d’être prises en considération ».
77 () http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3788.asp.
78 () National Intelligence Estimate, « Iran : Nuclear Intentions and Capabilities », novembre 2007.
79 () http://www.dia.mil/News/SpeechesandTestimonies/tabid/7031/Article/13225/worldwide-threat-assessment.aspx.
80 () James Clapper, directeur national du renseignement, « US Intelligence Community Worldwide Threat Assessment », Statement for the record, 29 janvier 2014.
81 () Entretien du 9 juillet 2014 avec le président et la rapporteure de la mission d’information.
82 () La Turquie est toutefois membre de l’OTAN ; l’Arabie saoudite pourrait chercher à obtenir des armes nucléaires du Pakistan ou, plus vraisemblablement, à se placer sous le parapluie nucléaire américain (Colin H. Kahl, Melissa G. Dalton et Matthew Irvine, « Atomic Kingdom, If Iran Builds the Bomb, Will Saudi Arabia Be Next ? », Center for a new Americain Security, février 2013).
83 () France, Allemagne et Royaume-Uni, qui ont négocié avec l’Iran au début des années 2000 et auxquels se sont adjoints les Etats-Unis, la Russie et la Chine (d’où le nom alternatif de « 5+1 », à savoir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et l’Allemagne).
84 () En vertu de l’article 2 du TNP, « tout État non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ».
85 () Il était en charge, ès qualités, des négociations sur le programme nucléaire iranien.
86 () Les mesures prévues dans le cadre du plan d’action conjoint sont présentées plus en détail dans la troisième partie du présent rapport.
87 () L’Iran semble toutefois être sorti de la récession. En octobre 2014, la prévision de croissance du FMI était de 1,5 % pour 2014 et de 2,2 % pour 2015. L’inflation s’était par ailleurs stabilisée à environ 15 %.
88 () Audition du 7 mai 2013.
89 () Selon la Banque centrale iranienne, l’échec des négociations se traduirait par une récession comprise entre 5 et 6 %, leur succès s’accompagnerait d’une forte croissance, de 6 ou 7 %, tandis qu’une simple reconduction du plan d’action conjoint conduirait à une stagnation (entre 0,5 et 1 % de croissance).
90 () Pour autant, M. Rohani ne passe pas pour être un « réformateur ». C’est un mollah proche du Guide et des Pasdarans, mais il est aussi favorable à plus de liberté et moins de morale. Le seul candidat considéré comme un « réformateur », M. Mohamed Reza Aref, s’est retiré en la faveur de M. Rohani quelques jours avant le scrutin de 2013. Les candidats les plus « durs », notamment M. Saïd Jalili, ancien négociateur en chef du nucléaire iranien sous M. Ahmadinejad, n’ont obtenu que de faibles scores. M. Rohani, quant à lui, a été élu dès le premier tour, avec 51 % des voix.
91 () La négociation du plan d’action conjoint aurait pris 3 mois en 2013 et la mise au point des annexes techniques, publiées mi-janvier 2014, environ 2 mois.
92 () Les principaux aspects techniques des négociations, pour autant qu’ils sont publiquement connus, sont présentés à partir de la page 118 du présent rapport.
93 () Acronyme, en langue arabe, d’« Etat islamique en Irak et au Levant ». Il semble préférable d’utiliser le terme de Daesh plutôt que celui d’Etat islamique, afin de ne pas accréditer sa prétention à constituer un Etat représentatif de l’islam.
94 () « Djihad » signifiant, d’une manière générale : effort.
95 () Qui aurait été responsable, dès août 2003, des attentats contre l’ambassade de Jordanie à Bagdad, contre la mission des Nations unies en Irak et contre la mosquée de l’imam Ali à Nadjaf.
96 () Charles Lister, « Profiling the Islamic State », Brookings Doha Center Analysis Paper n°13, novembre 2014.
97 () Cf. supra p.43.
98 () Les précédents avatars de Daesh passent pour avoir depuis longtemps des racines en Syrie. Au milieu des années 2000, les gouvernements irakien et américain déclaraient que la quasi-totalité des terroristes étrangers présents en Irak passaient par la Syrie voisine. Les services de renseignement syriens avaient au demeurant la réputation de faciliter les opérations des réseaux de recrutement.
99 () Qui n’a rien d’un Etat et repose sur un dévoiement de la religion musulmane. D’après des condamnations émanant du monde musulman, en particulier d’autorités religieuses reconnues, cet « Etat » autoproclamé ne serait en rien « islamique ».
100 () Il dirigerait le groupe depuis 2010.
101 () Cf. Seth G. Jones, A Persistent Threat – The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists, Rapport pour le secrétariat américain à la Défense, RAND Corporation, 2014.
102 () En Syrie, Jabhat Al-Nosra a plutôt eu tendance à s’allier à d’autres groupes très divers par leurs agendas.
103 () Comme indiqué précédemment dans ce rapport, la rivalité entre les deux groupes a tourné au conflit ouvert en 2014, lorsque Jabhat al-Nosra a fini par prendre parti contre Daesh dans le conflit opposant en Syrie cette organisation à d’autres groupes armés, islamistes comme modérés.
104 () Jean-Pierre Filiu, « Al-Qaeda is dead, long live Al-Qaeda », Carnegie Endowment for International Peace, 22 avril 2014.
105 () Amedy Coulibaly s’est revendiqué de Daesh, quand les frères Kouachi se sont déclarés mandatés par Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA).
106 () http://www.lawfareblog.com/2014/07/the-foreign-policy-essay-calculated-caliphate/
107 () Comme l’a rappelé le ministre de la défense, M. Jean-Yves le Drian, lors de son audition du 30 septembre 2014 devant la commission des affaires étrangères, Oussama ben Laden s’était paré du titre d’émir, sans revendiquer celui de calife.
108 () Boko Haram a ensuite proclamé un califat islamique au Nord-Ouest du Nigeria.
109 () Charles Lister, « Profiling the Islamic State », Brookings Doha Center Analysis Paper n°13, novembre 2014.
110 () Accords secrets de 1916 qui tracent les grandes lignes du partage des dépouilles de l’empire ottoman, au lendemain de la première guerre mondiale, entre le Royaume-Uni et la France. Bien qu’ils n’aient jamais été appliqués à la lettre, ces accords sont restés dans l’imaginaire collectif comme une sorte de partage de Yalta moyen-oriental.
111 () Sans exclure des menaces à l’égard des Etats-Unis et des pays occidentaux en général (cf. ultra).
112 () Cf. Seth G. Jones, A Persistent Threat – The Evolution of al Qa’ida and Other Salafi Jihadists, RAND Corporation, 2014.
113 () cf. supra.
114 () Pierre-Jean Luizard, Le piège Daesh, l’Etat islamique ou le retour de l’Histoire, La Découverte, janvier 2015.
115 () Selon des échos en provenance des zones contrôlées par Daesh, les prix des loyers auraient été encadrés à Mossoul et un office de protection des consommateurs aurait obtenu la fermeture de boutiques offrant des produits de mauvaise qualité à Raqqa.
116 () Pierre-Jean Luizard, ibidem.
117 () Selon des estimations hautes que l’on peut considérer comme crédibles, mais que la mission d’information n’est pas en mesure de vérifier, Daesh pourrait disposer au début de l’année 2015 de 25 000 combattants en Irak, auxquels s’ajouteraient au moins 15 000 djihadistes étrangers (en Syrie et en Irak), des djihadistes locaux, des combattants du JRTN (mouvement baasiste) et des combattants tribaux ; en Syrie, Daesh compterait entre 5 000 et 9 000 combattants.
118 () Audition conjointe de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.
119 () De telles opérations auraient permis de préparer méthodiquement le terrain avant la prise de la ville de Mossoul, tombée en 24 heures.
120 () En août dernier, la répression contre la tribu Chaïtaat, qui refusait de se soumettre, aurait fait 700 morts et 1 800 disparus dans la région de Deir Ez-Zor (http://www.reuters.com/article/2014/08/26/us-syria-crisis-province-insight-idUSKBN0GQ1G120140826).
121 () Cf. supra p.44.
122 () Charles Lister rapportait en novembre 2014 que les deux adjoints de Baghdadi étaient d’anciens officiers supérieurs de l’armée irakienne. Le chef des opérations militaires en Syrie était un ancien général de l’armée irakienne et celui des opérations en Syrie un ancien officier de renseignement irakien.
123 () Pierre-Jean Luizard, Le piège Daesh, l’Etat islamique ou le retour de l’Histoire, La Découverte, janvier 2015.
124 () Les vols Istanbul-Hatay et Istanbul-Gaziantep ont ainsi été surnommés : « Djihad Express ».
125 () Le film djihadiste « Salil as-Sawarim III » (« le Bruissement des sabres III ») est sorti en janvier 2013.
126 () http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/olivier-roy-chez-jeunes-anti-systeme-djihad-a-remplace-mythe-revolution-18783
127 () http://images.info.accelus.thomsonreuters.biz/Web/ThomsonReutersGRC/%7B1f31f016-55e4-428b-87aa-292c6a1a2039%7D_GRC01830_ISfundingInfographic.pdf
128 () Cf. supra.
129 () Ce terme désigne des extrémistes islamistes, adeptes d'une idéologie violente qui considère les musulmans ne partageant pas leur point de vue comme étant des apostats, et donc des cibles légitimes.
130 () En dehors du champ de cette mission d’information, Daesh a déclaré « annexer » des territoires en Algérie (« Wilayat al-Djazaïr ») et en Libye (« Wilayat Al-Barqah », « Wilayat al-Tarabulus » et « Wilayat al-Fezzan »).
131 () Pierre-Jean Luizard, Le piège Daesh, l’Etat islamique ou le retour de l’Histoire, La Découverte, janvier 2015.
132 () Environ un quart des Libanais seraient sunnites.
133 () Aaron Y. Zelin January, « The Islamic State Model », The Washington Post, 28 janvier 2015.
134 () Début janvier, le groupe aurait ainsi brûlé de la marijuana après avoir capturé des trafiquants de drogue, puis aurait distribué de l’argent à des habitants de Rafah après la destruction de leurs habitations par l’armée égyptienne, dans le cadre de la création d’une zone tampon.
135 () Source : Saleem Haddad, « Jordan combats the Islamic State by addressing domestic grievances », The Islamic State through the Regional Lenses, European Council on Foreign Relations, janvier 2015.
136 () Ibidem.
137 () Quelques jours après sa sortie de prison, au mois de juin 2014.
138 () Qui est une fête religieuse majeure pour les chiites.
139 () Raphaël Lefèvre, « Tackling Sunni Radicalization in Lebanon », Carnegie Middle East Center, 4 décembre 2014.
140 () Jean-Pierre Filiu : « L'État islamique est capable de mille 11 Septembre », Le Figaro, 10 septembre 2014.
141 () Cf. p.61 et p.63.
142 () Cf. p.75.
143 () Thomas Hegghammer, « Should I stay or should I go ? Explaining Variations in Jihadists’ Choice Between Domestic and Foreign Fighting », American Political Science Review, 107, février 2013.
144 () Cf. les déclarations de M. Matthew OLSEN, directeur du centre national de contre-terrorisme (Etats-Unis), le 3 septembre 2014 (http://www.brookings.edu/~/media/events/2014/09/03%20national%20counterterrorism%20center%20threat%20assessment%20isil%20al%20qaeda%20iraq%20syria%20beyond/20140903_isil_syria_transcript.pdf).
145 () Jennifer Cafarella « Resistance Emerges as ISIS Consolidates in Deir ez-Zour », Institute for the Studies of War, 15 juillet 2014.
146 () Peter Harling, « Etat islamique, un monstre providentiel », Le Monde diplomatique, septembre 2014.
147 () Auteurs des attentats commis en France au début du mois de janvier 2015.
148 () Myriam Benraad, « Au commencement du jihad, l’humiliation et la revanche », Libération, 23 janvier 2015.
149 () Très schématiquement, on peut distinguer trois grandes « familles » islamistes :
– la mouvance des Frères musulmans, dont l’ethos est conservateur et qui se tournent vers l’action politique ;
– les salafistes, qui cherchent à travailler la société pour redéfinir la norme religieuse et pour qui l’action politique est généralement secondaire, voire contreproductive ;
– la mouvance salafiste djihadiste, qui s’appuie sur une conception ultra-rigoriste du salafisme en la dotant d’un projet politique mis en œuvre par la violence.
150 () Audition du 2 décembre 2014.
151 () Selon les déclarations du secrétaire d’Etat John Kerry devant le Sénat américain, le 11 mars dernier, la coalition comportait 14 pays contribuant directement aux opérations contre Daesh en Irak ou en Syrie et 16 pays qui se sont engagés à aider les forces de sécurité irakiennes, notamment par des actions de formation.
Une liste des membres de la coalition est publiée sur le site du Département d’Etat à l’adresse suivante : http://www.state.gov/s/seci/index.htm. Elle comprend notamment les pays arabes suivants : l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, ainsi qu’Oman et l’Egypte.
Selon une liste publiée par le ministère de la défense américain, le 4 mars 2015, les pays de la coalition conduisant des frappes aériennes en Irak incluent les Etats-Unis, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les pays conduisant des frappes en Syrie incluent les Etats-Unis, Bahreïn, la Jordanie, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.
152 () La Ligue arabe et l’Union européenne.
153 () La France a ainsi effectué, avec d’autres pays et en accord avec les autorités de Bagdad, des livraisons d’armes au Kurdistan irakien.
154 () Le projet d’autorisation d’usage de la force militaire (« Authorization for the Use of Military Force » ou « AUMF ») qui a été présenté au Congrès américain pour lutter contre Daesh, en février 2015, exclut le déploiement prolongé (« enduring ») de forces terrestres combattantes en Irak ou en Syrie, mais l’Administration a précisé que cela ne ferait pas obstacle à des opérations ponctuelles de sauvetage ou à des actions conduites sur le terrain par les forces spéciales contre des dirigeants de Daesh.
155 () La résolution 2170 du Conseil de sécurité, adoptée le 15 août 2014 en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, demande d’agir contre Daesh dans différents domaines (combattants terroristes étrangers ou encore lutte contre le financement du terrorisme), sans donner pour autant de mandat à une intervention militaire en Irak.
156 () http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_695.pdf
157 () Forces armées irakiennes obéissant à Bagdad ou encore peshmergas kurdes.
158 () Les Américains ont annoncé en novembre 2014 qu’ils portaient à 3 000 le nombre de leurs conseillers militaires en Irak et que ces derniers seraient déployés en dehors de Bagdad et d’Erbil, la capitale régionale du Kurdistan irakien.
159 () Audition précitée du général Didier Castres.
160 () En France, une loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a ainsi été adoptée au mois de novembre 2014. Les principaux objectifs sont les suivants : prévenir et contrarier les départs ; mieux lutter contre la diffusion de la propagande terroriste, notamment sur l’Internet ; prendre en compte les nouveaux modes opératoires des terroristes, notamment ceux qui agissent isolément ; doter la justice et les services de police de moyens d’investigation adaptés à la menace et à ses évolutions. Un plan de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles a par ailleurs été présenté par le ministre de l’Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, en avril 2014. De nouvelles dispositions ont été annoncées pour renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme après les attentats commis au début du mois de janvier 2015.
161 () Cf. p.68.
162 () Il a notamment qualifié, au mois de septembre 2014, les djihadistes de Daesh de « criminels qui souillent l’image de l’islam et des musulmans ». Quant au grand mufti d’Arabie saoudite, lui-même tenant d’un islam ultra-rigoriste, il a qualifié Daesh d’ennemi numéro de l’islam et appelé à combattre ce groupe.
163 () Nathan J. Brown, « Avoiding Old Mistakes in the New Game of Islam Politics », The Washington Post, 22 septembre 2014.
164 () Cf. pp.70-71.
165 () M. Jean-Christophe Peaucelle, conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères, a précisé qu’environ 1 500 demandes avaient été acceptées depuis le mois de septembre 2014, dont plus de 95 % de chrétiens et quelques familles yézidies (audition de la commission des affaires étrangères du 27 janvier 2015).
166 () Pour des raisons qui peuvent notamment tenir à une certaine fatigue militaire (« war fatigue ») aux Etats-Unis, après les engagements militaires en Irak et en Afghanistan sous la présidence de George W. Bush, et notamment au coût de l’intervention de 2003 en Irak et de ses suites (environ 4 500 morts et 4 000 milliards de dollars).
167 () La répartition des effectifs participant à cette bataille illustre bien le poids des milices chiites et la nécessité de restructurer l’armée irakienne pour qu’elle puisse jouer le rôle clef qui devrait lui revenir dans la lutte contre Daesh. Selon le chef d’état-major interarmées américain, le général Dempsey, 20 000 miliciens chiites conduiraient la bataille contre Daesh aux côtés de 3 000 soldats de l’armée irakienne, soit une brigade, et un millier de combattants sunnites.
168 () Cf. la note n°4 p.66.
169 () Certains opposants syriens vont jusqu’à comparer l’aide concrètement apportée à la fourniture de « Red Bull », cette boisson qui n’a pas d’autre effet que de procurer un coup de fouet passager.
170 () Cf. p.30.
171 () Le Président de la République a reçu des représentants du PYD le 8 février dernier, pour les féliciter de la victoire remportée contre Daesh.
172 () L’ambassadeur de Turquie en France a décrit dans les termes suivants les combats de Kobané lors d’une audition par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, le 21 janvier 2015 : « Quand Daesh est arrivé à Kobané, il n’y avait plus là-bas que le PYD, la branche syrienne du PKK. Tous les combats auxquels vous avez pu assister sur vos écrans de télévision se déroulaient en fait entre deux groupes qui essayaient de prendre le contrôle de cette région pour y asseoir leur autorité. Personne ne s’y battait pour les valeurs occidentales ou pour les valeurs démocratiques : il s’agissait seulement de deux groupes terroristes, qui s’affrontaient pour le contrôle de la région ! ».
173 () Bien que l’état-major de la coalition soit situé sur la base aérienne Al-Udeid au Qatar.
174 () « Why the U.S. Can’t Beat an Army the Size of a Junior College », David Rothkopf, Time, 31 octobre 2014.
175 () Cf. p.134.
176 () Cf. pp.14-16.
177 () Alors qu’Al-Qaida n’était implanté qu’en Afghanistan en 2001, l’organisation compte désormais des branches actives dans d’autres parties du monde – Al-Qaida dans la péninsule arabique, Jabhat Al-Nosra en Syrie ou encore Al-Qaida dans le Maghreb islamique. Ces branches paraissent d’ailleurs plus actives que ce que l’on appelle aujourd’hui « Al-Qaida Central » (cf. p.60).
178 () Cf. pp.87-88.
179 () Cf. p.98.
180 () Le GRK doit mettre à la disposition du Gouvernement fédéral 250 000 barils de pétrole par jour, tandis que Bagdad doit débloquer la part dévolue au Gouvernement régional kurde dans le budget national.
181 () M. Didier Billion, « L’improbable Etat kurde unifié », La revue internationale et stratégique, n° 95, automne 2014.
182 () Le président Massoud Barzani a ainsi évoqué la perspective d’un vote sur l’indépendance du Kurdistan vis-à-vis de l’Irak.
183 () Cf. p.62.
184 () Cf. pp.33-36.
185 () Cf. carte p.42.
186 () Cf. p.80.
187 () Cf. pp.29-30.
188 () Cf. p.88.
189 () Cette réorientation a été confirmée par la nouvelle stratégie américaine de sécurité nationale qui a été rendue publique le 6 février 2015. Au Proche et au Moyen-Orient, elle insiste surtout sur la lutte contre le terrorisme, en particulier Daesh, et sur le règlement du problème nucléaire iranien par la voie diplomatique.
190 () Un parallèle troublant a été dressé, devant la mission d’information, avec l’alliance des démocraties occidentales avec Staline contre Hitler pendant la seconde guerre mondiale.
191 () Les crimes et les violations des droits de l’Homme commis par les différentes parties au conflit syrien sont notamment documentés par une Commission d’enquête internationale indépendante créée par le conseil des droits de l’Homme des Nations unies en août 2011. La commission des affaires étrangères a reçu ses membres le 29 mai 2013.
192 () Cf. pp.35-36.
193 () Cf. p.34.
194 () Cette hypothèse est présentée plus en détail p.140.
195 () Cf. pp.71-74.
196 () Cf. pp.36-37.
197 () cf. pp.73-74.
198 () La commission des affaires étrangères a d’ailleurs décidé de créer une mission d’information spécifique sur le Liban en 2015.
199 () Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a annoncé que l’accord franco-libanais relatif à la mise en œuvre de cette initiative a été signé le 15 décembre 2014, à Beyrouth, et que la convention tripartite a été signée par la partie saoudienne le 7 janvier suivant.
200 () Ces derniers rappellent périodiquement que « toutes les options sont sur la table ».
201 () Cf. pp 48-57.
202 () Mais ne concernant pas la question des « possibles dimensions militaires » de ce programme, qui ont été évoquées dans la première partie du présent rapport.
203 () Un total de 7 milliards de dollars au cours de la première année d’application de l’accord – 4,2 milliards du 24 novembre 2013 au 20 juillet 2014, puis 2,8 milliards à compter de cette date. La récente prolongation de 7 mois de l’application de l’accord devrait s’accompagner du déblocage de 4,9 milliards de dollars supplémentaires au profit de l’Iran.
204 () Cf. p.49.
205 () Cf. pp.50-51.
206 () Le projet dit « Kirk-Menendez » (« Nuclear Weapon Free Iran Act of 2015 »), déposé au Sénat le 27 janvier dernier, prévoit notamment des sanctions supplémentaires en matière d’énergie, d’automobile, de mines ou encore de construction, si l’accord avec l’Iran était jugé insuffisant par le Congrès ou s’il n’était pas conclu avant l’échéance du 30 juin prochain. Le principe de telles sanctions serait adopté dès maintenant, mais leurs effets seraient différés.
207 () Plusieurs interlocuteurs de la mission ont souligné le fait que les Iraniens préféreraient toujours l’absence d’un accord, si cela leur permet de ne pas perdre la face, à la conclusion d’un accord qui pourrait être jugé humiliant, bien qu’il soit en réalité plus favorable à leurs intérêts.
208 () Toutes ces questions sont présentées dans la suite du présent rapport.
209 () C’est d’ailleurs le titre d’un récent rapport de l’International Crisis Group : « Iran and the P5+1 : Solving the Nuclear Rubik’s Cube », Middle East Report, n°152, 9 mai 2014.
210 () Audition de la commission des affaires étrangères du 25 novembre 2014.
211 () Ainsi que les activités de recherche et développement. Des avancées dans ce domaine pourraient permettre d’améliorer significativement les capacités des centrifugeuses et ainsi priver de leur sens une partie des engagements attendus de la part de l’Iran.
212 () « Iran and the P5+1 : Solving the Nuclear Rubik’s Cube », Middle East Report, n°152, 9 mai 2014.
213 () Unité de mesure des capacités d’enrichissement, utilisée de préférence au nombre de centrifugeuses, dont les performances sont différentes selon les modèles concernés.
214 () Le président Obama a fait des déclarations publiques en ce sens, au début du mois de mars.
215 () C’est-à-dire au moins l’équivalent du « break-out time » actuel, qui a d’ailleurs été rallongé par l’application du plan d’action conjoint (cf. p.49).
216 () Cf. p.50.
217 () Cf. p.50.
218 () On peut notamment rappeler que le Congrès américain a adopté de nombreuses sanctions non liées à la question nucléaire dès l’avènement de la République islamique d’Iran.
219 () Trois types d’accords internationaux sont à distinguer :
– les traités, soumis au Sénat américain, qui autorise leur ratification à la majorité des deux tiers (traditionnellement en matière de défense mutuelle, de contrôle des armements, de fiscalité, d’extradition ou encore de délimitation des frontières) ;
– les accords « parlementaire-exécutif » (« Congressional Executive Agreements »), soumis à la Chambre et au Sénat pour ratification à la majorité simple, dans les domaines de compétence parlementaire (notamment le commerce) ;
– les accords exécutifs (« Executive Agreements »), non soumis au Congrès et conclus sur la base des pouvoirs propres du Président américain ou d’une loi existante.
Le secrétaire d’Etat John Kerry a indiqué au Sénat, lors de son audition du 25 février dernier, que l’Administration n’envisageait pas de soumettre un accord sur le programme nucléaire iranien à une procédure d’approbation formelle (laquelle n’aurait aucune chance d’aboutir compte tenu de la majorité républicaine dans les deux Chambres).
La voie choisie par l’Administration serait donc celle d’un accord exécutif. Un tel choix peut être contesté devant les tribunaux. Ce type d’accord ne représente aujourd’hui qu’une minorité des textes internationaux agréés par les Etats-Unis, les accords « parlementaire-exécutif » étant la modalité la plus courante.
L’Administration doit transmettre le texte d’un accord exécutif au Congrès dans un délai de soixante jours. Celui-ci peut adopter une loi annulant l’ordre exécutif, sous réserve du droit de véto du Président (qui peut être surmonté à la majorité des deux tiers des votants).
Une proposition dite « Corker-Menendez », du nom de leurs principaux auteurs, a été introduite au Sénat le 27 février sous le titre de « Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015 ». Elle confie notamment au Congrès la compétence de se prononcer en faveur ou contre un éventuel accord avec l’Iran et prévoit un droit de regard continu sur son application, assorti pour l’Administration d’une obligation de rapporter.
220 () Ces perspectives sont présentées plus loin dans ce rapport, pp. 129-145.
221 () Cf. p.116 et p.128.
222 () Cf. supra.
223 () Cf. pp.129-145
224 () C’est le sens de la prise en compte du « break-out time ».
225 () James M. Acton, « Who Cares about an Iranian Nuclear Breakout ? Beware of an Atomic "Sneak-out" », The National Interest, 4 novembre 2014.
226 () Sir Richard Dalton et Peter Jenkins, « Iran’s Nuclear Future », Chatham House, 4 septembre 2014.
227 () Cf. p.57.
228 () Un récent rapport de la Rand Corporation porte un jugement globalement positif mais tout de même nuancé, estimant que l’accord avec l’Iran, tel qu’il se dessine, renforcerait la confiance dans l’effectivité du régime de non-prolifération et pourrait permettre de développer des accords de garanties plus solides avec l’AIEA, mais qu’il créerait aussi un précédent potentiellement négatif par la légitimation a posteriori d’une capacité d’enrichissement développée par l’Iran alors que ce pays ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de l’AIEA (Jeffrey Kaplow et Rebecca Gibbons, « The Days After a Deal with Iran : Implications for the Nuclear Nonproliferation Regime », The Rand Corporation, 2 février 2015).
229 () Audition du 19 février 2014.
230 () Frederic Wehrey et Karim Sadjadpour, « Elusive Equilibrium : America, Iran and Saudi Arabia in a Changing Middle East », Carnegie Endowment for International Peace, 22 mai 2014.
231 () Audition du 7 mai 2014.
232 () Bien que le « compteur » démographique soit officiellement cassé depuis 1932, la communauté chiite est certainement devenue la plus importante au Liban, en raison de sa pente démographique. Représentant entre 30 et 40 % de la population, elle voterait à 90 % pour le Hezbollah, « construction iranienne » des années 1980.
233 () M. Girault a précisé que la relation stratégique avec Damas a été nouée dans les années 1980, sans qu’une quelconque proximité religieuse ait joué. Il y a très peu de chiites en Syrie – environ 1 % de la population – et les Alaouites n’ont que des liens de parenté extrêmement lointains avec le chiisme.
234 () Cette bataille, durant laquelle Hussein, petit-fils du Prophète, est tué, constitue un moment fondateur pour le schisme entre les sunnites et les chiites, qui se joue autour de la succession de Mahomet. Pour les premiers, la légitimité va à ses compagnons, premiers convertis à l’islam, tandis que les seconds privilégient une succession d’ordre familial.
235 () Comme l’a rappelé M. François Nicoullaud, « de la même façon que la révolution française s’était accompagnée de la naissance de clubs des Jacobins en Europe, et que la révolution soviétique avait conduit à la création d’une IIIe Internationale, unissant des partis communistes partout dans le monde, la révolution iranienne s’est efforcée de créer un peu partout des « partis de Dieu » ou Hezbollahs. Mais en fait, seul a prospéré le Hezbollah libanais ».
236 () Bagdad accusait notamment Damas d’aider et d’instrumentaliser des terroristes pour déstabiliser l’Irak.
237 () M. Girault a ainsi observé que la « marja’iyaa » irakienne (direction religieuse) n’est pas adepte du système dit du « juriste théologien », qui est à la base du système iranien, et qu’il existe aussi une défiance traditionnelle entre Arabes et Perses.
238 () F. Gregory Gause III, « Saudi-Iranian Rapprochement ? The Incentives and the Obstacles », Brookings Doha Center, 17 mars 2014.
239 () Audition du 29 janvier 2014.
240 () Cf. p.21.
241 () Cf. p.19.
242 () Où il existe une importante minorité chiite, représentant environ 10 % de la population. Elle est concentrée dans la « province orientale » du Hasa, qui abrite les ressources pétrolières du Royaume.
243 () « Ominous Divide : Shiite Iran v Sunni Gulf », United States Institute for Peace, 18 février 2014.
244 () Une grande majorité des chiites de la région ne reconnaît pas le principe du velayet-e faqih, propre à la République islamique d’Iran, et ne considère pas le Guide suprême iranien en tant que « marja’ ».
245 () En leur amalgamant les Alaouites en Syrie ou encore les Soufis en Egypte.
246 () Après des gestes d’apaisement de la part du Qatar, la crise ouverte semble dépassée – les ambassadeurs sont revenus en novembre dernier à Doha, où un sommet du CCG s’est tenu le mois suivant – mais des approches divergentes demeurent au sujet des Frères musulmans.
247 () En ce qui concerne la France, ces liens vont de la rencontre historique entre le Président Hollande et le Président Rohani en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2013, au dialogue politique que le directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient conduit régulièrement à Téhéran, en passant par des visites de délégations parlementaires, notamment celle que la Mission a pu conduire en Iran.
248 () Cf. p.35.
249 () Avec la levée des sanctions
250 () Cf. ultra.
251 () Cf. p.125.
252 () Alireza Nader, «The Days after a Deal with Iran, Continuity and Change in Iranian Foreign Policy », Rand Corporation, 2014.
253 () Cf. notamment Dalia Dassa Kaye et Jeffrey Martini, « The Days after a Deal with Iran, Regional Responses to a Final Nuclear Agreement », Rand Corporation, 2014.
254 () Audition du 9 avril 2014.
255 () Cf. pp.96-97.
256 () Même si la nature du soutien apporté par l’Iran et l’ampleur de son influence font débat.
257 () Cf. pp.21-22.
258 () Audition du 29 janvier 2014.
259 () La conception de la « flexibilité héroïque » développée par le Guide autorise des changements tactiques pour alléger la pression économique, mais sans reniement des « principes ». On pourra aussi observer que des tests de missiles balistiques ont eu lieu après la signature de l’accord de Genève, en novembre 2013, malgré des appels à la retenue du Président Rohani.
260 () Cf. notamment « Future Direction of Iran’s Domestic and Foreign Policy », Chatham House, 28-29 octobre 2013.
261 () Les accords d’Oslo sont, par facilité de langage, devenus le symbole du processus de paix dont on peut cependant renvoyer la naissance à la Conférence de Madrid du 30 octobre 1991 sur la paix au Moyen-Orient.
262 () Khaled Elgindy, « Programmed for Failure », Foreign Policy, 11 avril 2014.
263 () Estimé à deux milliards d’euros, pour moitié en coûts directs (dépenses militaires et destructions) et pour moitié en coûts indirects (impact global sur l’économie et la croissance), il suscite de vifs commentaires de la part du ministre israélien de l’Économie et du Commerce, Naftali Bennett, qui déclare : « Est-ce que quelqu’un pense encore aujourd’hui que nous pouvons renoncer aux collines qui dominent l’aéroport ? Un obus de mortier par mois et nous n’aurons plus d’économie. »
264 () Le Centre palestinien pour la recherche politique et les études d'opinion (CPRPEO) a conduit une enquête auprès de 1 270 adultes, entre le 26 et le 30 août, en Cisjordanie et à Gaza.
265 () L’Égypte a détruit près de 95 % des tunnels vers Gaza, et a commencé le 7 janvier 2015 des travaux d’extension de la zone-tampon le long des 13km de sa frontière avec Gaza pour empêcher l’infiltration de terroristes depuis la bande.
266 () La France a pour sa part annoncé la mobilisation de 40 millions d’euros en 2014 en soutien au peuple palestinien.
267 () Les annonces de dons les plus importantes sont venues des pays du Golfe (le Qatar a annoncé 1 milliard de dollars, l'Arabie saoudite 500 millions de dollars, le Koweït 280 millions tandis que les Émirats Arabes Unis ont promis de verser 200 millions de dollars. La même somme a été promise par la Turquie. Les États arabes ont globalement prononcé des interventions moins virulentes qu'à Charm el Cheik en 2009. John Kerry a annoncé une aide immédiate de 212 millions de dollars des États-Unis, en plus des 118 millions de dollars d'aide humanitaire versés pendant l'été. Les États-Unis avaient mobilisé plus de 400 millions de dollars pour la Palestine en 2014. Aucune référence n’a été faite aux débats en cours au Congrès. Indiquant une mobilisation de 40 millions d’euros en 2014, la France a annoncé une affectation de 5 millions de projets AFD pour Gaza et une aide projet de 30 millions d’euros jusqu'en 2017. La HRVP a annoncé une aide globale de l’UE et de ses États-membres de 450 millions d’euros. Le Royaume Uni a annoncé 20 millions de livres supplémentaires et l'Italie 18,7 millions d’euros, ainsi que 20 millions d’euros de dons jusqu'en 2017 et 30 millions d’euros de prêts. La Norvège avait mobilisé 136 millions de dollars en 2014 et entendait maintenir son appui. La Russie a annoncé qu’elle verserait 50 millions de dollars. La Suisse a annoncé une aide de 30 millions d’euros annuels pour les 3 prochaines années, l’Autriche une aide de 8,9 millions de dollars, le Japon une aide de 7 millions de dollars (ainsi que 17 millions de dollars en aides-projets), l’Espagne 6 millions de dollars, la Chine 5 millions de dollars, l’Inde 4 millions de dollars et la Corée 2 millions de dollars.
268 () Le rapport 2014 des chefs de mission de l’Union européenne à Jérusalem et Ramallah souligne également le développement des violences de la part des colons contre les Palestiniens et des Palestiniens contre des Israéliens dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est.
269 () Voir l’étude des ONG israéliennes Ir Amim et Keshev « Dangerous Liaison : The Dynamics of the Rise of the Temple Movements and their Implications », mars 2013.
270 () L’administration du Mont du Temple avait été cédée à la Jordanie, la gestion sécuritaire de la zone étant assurée par Israël.
271 () Robert Serry, “Israël-Palestine: “On se dirige vers un seul Etat”, Le Monde, 6 mars 2015.
272 () Economic Monitoring Report, The World Bank, 22 septembre 2014.
273 () Le déficit public, avant prise en compte de l’aide extérieure, serait passé de 13,9 % du PIB en 2013 à 16,6 % du PIB en 2014. Après prise en compte de l’aide, il passerait de 1,8 % à 3,3 % du PIB.
274 () Le taux de chômage est passé de 20,6 % de la population active au second trimestre 2013 à 26,3 % de la population active au second trimestre 2014. Il atteint 44,5% de la population active dans la Bande de Gaza et 16 % de la population active en Cisjordanie.
275 () « Que devons-nous faire dans les circonstances présentes, où le projet des deux États n’est plus une solution envisageable et où il faut s’attendre au maintien prévisible de l’actuel statu quo ? Que devons-nous faire, d’une part, pour réduire les causes de souffrances, donc de mécontentement et d’instabilité éventuelle, d’autre part, pour anticiper un éventuel accord de paix qui pourrait se développer à partir des réalités nouvelles qui ne cessent, inévitablement, de se créer sur le terrain ? (...) L’extension du droit de séjour à tous les Palestiniens vivant sous autorité israélienne sert l’intérêt des deux parties. Israël pourrait même l’instaurer de façon unilatérale. Cela permettrait au moins d’améliorer ledit statu quo. Car laisser les choses en l’état ne peut que conduire à une catastrophe majeure. » Une allumette vaut-elle toute notre philosophie ? Sari Nusseibeh, Flammarion, 2012.
276 () Harriet Sherwood, « Look beyond the Oslo accords, say architects of Middle East peace plan », The Guardian, 24 avril 2014
277 () A titre d’exemple, Ayelet Shaked, qui dirige le groupe parlementaire Foyer juif à la Knesset préconise l’annexion de la zone C et l’octroi de la nationalité israélienne à ses habitants. Les zones A et B disposeraient d’une autonomie et pourraient former une confédération avec la Jordanie.
278 () Uri Freedman, “Martin Indyk Explains the Collapse of the Middle East Peace Process”, The Atlantic.
279 () « Israel should annul the Oslo Accords», The New York Times, 20 septembre 2013.
280 () Denis Bauchard, « L’Etat palestinien en question », Notes de l’IFRI, mars 2010.
281 () Jodi Rudoren, “Netanyahu Says No to Statehood for Palestinians”, New York Times, 16 mars 2015.
282 () « Nous ne ménagerons pas plus qu’hier nos efforts pour que le droit à l’existence d’Israël soit universellement admis sans équivoque et donc pour que soit reconnu du même coup son droit à détenir les moyens de cette existence.(…) Parce qu’on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu’ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort. »
283 () Itamar Rabinovich, « Israel in the changing middle east», Brookings, 29 janvier 2015.
284 () Ibid.
285 () L’économie israélienne, qui montrait déjà des signes de faiblesse avant la crise de l’été 2014, a été fortement impactée par la reprise des violences. Il faut y ajouter un impact budgétaire conséquent. Ainsi, le coût de la crise a entraîné une réduction de 2 % du budget de chaque ministère, à l'exception de la défense, pour la fin de l'année en cours.
286 () Martin Indyk et David Rothkopf, « The U.S.-Israel Relationship arrives at a moment of reckoning », Foreign Policy, 26 août 2014
287 () « Sans État palestinien, l’avenir d’Israël est compromis », l’Humanité, 17 novembre 2014.
288 () Leila Seurat, « Israël choisit le Hamas contre l’Etat Palestinien », Le Monde, 22 juillet 2014.
289 () Ibid.
290 () Saban Forum organisé par l’Institut Brookings, 5-7 décembre 2014.
291 () Pour mémoire, Tzipi Livni, à la tête du parti Hatnua, avait formé le 10 décembre 2014 une liste commune, « le Camp sioniste », avec Yithak Herzog.
292 () Jean-François Legrain, « Un an après son admission à l’ONU, l’Etat Palestinien dans un piège » l’Express, 29 novembre 2013.
293 () Le 30 octobre le gouvernement suédois a reconnu, par décret, l'État de Palestine. Le 13 octobre, le Parlement britannique s’est prononcé pour la reconnaissance d’un État palestinien. Ce vote n’est pas contraignant pour le gouvernement britannique, qui s’est dit ouvert au principe mais souhaite rester maître du calendrier. Le Sénat irlandais a voté par consensus pour reconnaître l'État de Palestine le 22 octobre. Plusieurs partis espagnols ont avancé une proposition au Parlement pour reconnaître la Palestine.
294 () Barah Mikail, « Comment le « Printemps arabe » a-t-il négligé la question palestinienne ? », Confluences Méditerranée, 2013/3 n°86.
295 () Leila Seurat, « La politique étrangère du Hamas 2006-2013 : idéologie, intérêt et processus de décision » - Thèse IEP de Paris - 2014
296 () David D. Kirkpatrick, « Islamist victors in Egypt seeking shift by Hamas », The New York Times, 24 mars 2012
297 () Zvi Bar’el, « As Egypt and Qatar grow closer, Hamas stands to lose », Haaretz, 22 décembre 2014.
298 () Jodi Ruroren, « Islamic Jihad gains new traction in Gaza», The New York Times, 3 mai 2014.
299 () Ibid.
300 () Asma Al-Ghoul “Gaza Salafists pledge allegiance to ISIS”, Al Monitor, 27 février 2014.
301 () Sondage réalisé auprès de 1270 Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza entre le 26 et le 30 août 2014
302 () Harriet Sherwood, « Hamas and Iran rebuilld ties three years after falling out over Syria », The Guardian, 9 janvier 2014.
303 () La division de juin 2007 a donné lieu à l’éclatement de l’Autorité palestinienne intérimaire en deux parties, l’une en charge des parties autonomes de la Cisjordanie avec le soutien de l’OLP et des donateurs internationaux et l’autre, sous l’égide du Hamas, en charge de la bande de Gaza soumise à un blocus israélien, égyptien et international.
304 () Le mandat de Mahmoud Abbas à la tête de l’Autorité intérimaire d’autonomie est arrivé à échéance le 9 janvier 2009 et celui du Conseil législatif palestinien (CLP) le 24 janvier 2010.
305 () Leila Seurat, « Israël choisit le Hamas contre l’État Palestinien », Le Monde, 22 juillet 2014.
306 () Jean-François Legrain, « Le leurre de la « réconciliation » entre le Fatah et le Hamas », Orient XXI, 2 juillet 2014.
307 () Ibid.
308 () « La paz es posible en Oriente Próximo », El País, 30 juillet 2013.
309 () Benjamin Barthe, « Israël-Palestine : les quatre erreurs de John Kerry », Le Monde, 8 avril 2014
310 () « The US-Israel Relationship Arrives at a Moment of Reckoning », Foreign Policy, 26 août 2014.
311 () Réuni à Venise en juin 1980, le Conseil des chefs d’Etats et de gouvernements européens exprime pour la première fois une véritable position commune sur le règlement des conflits au Proche Orient, dont les principes fondamentaux sont restés les mêmes jusqu’à aujourd’hui. La déclaration y affirme à la fois le droit à l’existence et à la sécurité d’Israël et de tous les Etats de la région et le droit légitime à l’autodétermination du peuple palestinien..
312 () Nathalie Tocci, « The EU, the Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism », Mercury, juin 2011.
313 () L’adhésion à la CPI s’est accompagnée d’une adhésion à plusieurs accords relatifs aux ressources naturelles, aux droits de l’Homme et au droit humanitaire, ou encore la Convention contre la criminalité internationale.
314 () Itamar Rabinovich, « Israel in the changing Middle East», Brookings, 29 janvier 2015.
315 () Figure importante du Hezbollah et considéré comme responsable des attentats contre les casernements américain et français à Beyrouth en 1983 - il avait été tué dans un attentat à la voiture piégée à Damas en 2008.
316 () Benedetta Berti, « No Escape from War », Foreign Affairs, 22 janvier 2015
317 () Piotr Smolar, Benjamin Barthe « Deux soldats israéliens ont été tués par le Hezbollah », Le Monde, 29 janvier 2015
318 () Loveday Morris, « Al-Qaeda builds networks in Lebanon as security slips », The Washington Post, 18 mars 2014
319 () Jodi Ruroren, Anne Barnard « Hezbollah Kills 2 Israeli Soldiers near Lebanon », The New York Times, 28 janvier 2015.
320 () Ben Caspit, « Israel reluctantly accepts Hamas rule”, Al Monitor, 3 février 2015.
321 () Alain Gresh, « Gaza avant le Congo ? La Palestine avant la Syrie ? », Nouvelles d’Orient, jeudi 31 juillet 2014.
322 () Amiram Barkat, « El-Sisi : We’re working for Palestinian peace », Globes, 22 janvier 2015
323 () Akiva Eldar, « Netanyahu's Iranian boomerang », Al Monitor, 28 janvier 2015.
324 () Robert Kagan, “Five reasons Netanyahu should not address Congress”, 29 janvier 2015
325 () Audition de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat du 3 décembre 2014.
326 () Caroline du Plessix, « L’Union européenne et Israël », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 31 décembre 2011
327 () « Israel, EU sign Horizon 2020 scientific cooperation agreement », Haaretz, 9 juin 2014
328 () Jeremy M. Sharp, «U.S Foreign Aid to Israel », Congressional Research Service, 11 avril 2014
329 () Jim Zanotti, « U.S Foreign Aid to the Palestinians », Congressional Research Service, 3 juillet 2014.
330 () Thomas L. Friedman, « Israel, Ignoring Bush, Presses for Loan Guarantees », The New York Times, 7 septembre 1991.
331 () Jennifer Rubin, « The ICC red line », The Washington Post, 6 janvier 2015.
332 () La Conférence de Madrid de 1991 reposait sur un double mécanisme : des négociations bilatérales entre Israël et la Syrie, le Liban, la Jordanie et une délégation palestinienne, mais aussi des groupes de travail sur les questions multilatérales (réfugiés, environnement, économie, contrôle des armements, eau).
333 () David Chemla et Gérard Unger, « Israël doit répondre oui à l’initiative arabe de paix », Libération, 12 juin 2013.
334 () Débat du 28 novembre 2014 sur la proposition de résolution relative à la demande de reconnaissance de l’Etat de Palestine par le Gouvernement français.
335 () Uri Savir, « Security issues become tool for delay », Al Monitor, 1er février 2015.
336 () Haviv Rettig Gur, « Israel must have ‘security border’ in Jordan Valley», Times of Israel, 3 novembre 2013.
337 () Treize ministre européens des Affaires étrangères, dont le ministre français, ont, le 12 avril 2013, adressé une lettre conjointe à la Haute représentante demandant la préparation de lignes directrices pour élaborer un code de conduite européen sur l’étiquetage des produits des colonies israéliennes importés sur le marché communautaire. L’initiative reste cependant bloquée au niveau du Conseil en raison de désaccords entre les États membres.
338 () Clara O’Donnell « How the EU Can Help Kerry With Israeli and Palestinian Peace Talks », Brookings,7 août 2013.
339 () Voir « La Feuille de Route économique », 2004 ; « Israël et la Palestine : entre le désengagement et la feuille de route économique » 2005 ; « Les dimensions économiques d’un accord entre Israël et la Palestine » 2006-2007 ; « Les dimensions économiques d’un accord entre Israël et la Palestine », 2010.
340 () Barak Ravid, « EU powers propose : Gaza reconstruction in exchange for Hamas disarmament », Haaretz, 6 août 2014.
341 () Conclusions du Conseil Affaires étrangères de l’Union européenne sur le Moyen-Orient, 15 août 2014.
342 () Sultan Barakat et Omar Shaban, « Back to Gaza, a new approach to reconstruction », Brookings Doha Center, janvier 2015.
343 () M. François Delattre, ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission permanente française près les Nations unies à New York, n’a pas manqué de le rappeler lors de son audition du 20 janvier 2015.
344 () Une synthèse détaillée des principales prises de position de la Mission sur ces différents sujets figure en annexe.
345 () Ce pays d’Afrique du Nord ne faisait pas explicitement partie du champ de la présente mission d’information, centrée sur le Proche et le Moyen-Orient, bien qu’elle y ait consacré des développements dans la première partie de ce rapport.
© Assemblée nationale