 N° 1927 _______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 novembre 2004 RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR L'UNION EUROPÉENNE (1), sur l'enseignement supérieur en Europe ET PRÉSENTÉ par M. Michel HERBILLON, Député. ________________________________________________________________ (1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page. La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre Abelin, René André, Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip, vice-présidents ; MM. François Guillaume, Jean-Claude Lefort, secrétaires ; MM. Alfred Almont, François Calvet, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou, Pierre Lellouche, Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry Mariani, Philippe Martin, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Mme Irène Tharin, MM. René-Paul Victoria, Gérard Voisin. SOMMAIRE _____ Pages RESUME DU RAPPORT 6 PREMIERE PARTIE - LE PROCESSUS DE BOLOGNE : UN OBJECTIF POUR L'EUROPE, UNE CHANCE POUR LA FRANCE 16 I. UN OBJECTIF POUR L'EUROPE 17 A. De la Sorbonne à Berlin : vers la création du « marché intérieur » de l'enseignement supérieur 18 1) La Conférence de la Sorbonne (25 mai 1998) 18 2) La Conférence de Bologne (19 juin 1999) 19 3) La Conférence de Prague (19 mai 2001) 20 4) La Conférence de Berlin (2003) 21 B. Les modalités de mise en œuvre 22 1) L'architecture des études: une organisation essentiellement fondée sur deux phases: pré-licence et post-licence 22 2) L'instauration d'un système de crédits "ECTS" 22 3) Le supplément au diplôme 23 C. La mise en œuvre au sein de l'Union européenne 25 II. UNE CHANCE POUR LA FRANCE 30 A. La mise en œuvre hexagonale du LMD 31 1) Le cadre réglementaire 31 2) Une mise en œuvre progressive 33 B. Les craintes soulevées par le LMD 34 1) Une sélection masquée pour l'obtention du master ? 35 2) Une remise en cause du caractère national des diplômes ? 36 3) Les filières professionnelles menacées ? 37 4) Une augmentation programmée des frais de scolarité ? 38 5) Une "marchandisation" de l'enseignement supérieur ? 41 C. Les défis pour l'enseignement supérieur en France : moderniser les universités pour renforcer leur attractivité 43 1) Investir davantage pour l'enseignement supérieur et la recherche 43 a) "Education et croissance" : le rapport du Conseil d'analyse économique 44 b) "Regards sur l'Education" : le rapport 2004 de l'OCDE 45 2) L'accueil des étudiants étrangers 46 3) La dualité grandes écoles/universités 48 4) Le débat sur l'autonomie des universités 50 DEUXIEME PARTIE - L'ATTRACTIVITE DES UNIVERSITES AMERICAINES : LE VRAI DEFI LANCE A L'EUROPE DE LA CONNAISSANCE 52 I. LES UNIVERSITES SONT UN VECTEUR DE LA PUISSANCE AMERICAINE 53 A. Une logique de concurrence 53 1) L'application des lois du marché 54 2) Attirer les meilleurs étudiants... 56 3) ... et les meilleurs professeurs 61 B. Les trois clés de l'attractivité des universités américaines 64 1) Des moyens financiers importants 64 2) Les conditions de vie et d'étude des étudiants 71 a) Les relations entre étudiants et professeurs 71 b) Les équipements sur les campus 72 c) La vie sociale et sportive 73 3) L'organisation de la recherche et les transferts de technologie 73 a) Le statut des enseignants-chercheurs et l'attractivité des carrières 73 b) Le financement de la recherche : le poids du financement fédéral 73 c) La diffusion de la recherche au service de l'innovation: une mission essentielle des universités 73 II. L'URGENCE D'UNE REPONSE EUROPEENNE 73 A. Les enjeux d'une relance de la stratégie de Lisbonne 73 1) Une économie mondiale de plus en plus tournée vers l'innovation 73 2) Les chiffres du retard européen 73 a) Le sous-financement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe 73 b) L'insuffisante mobilité des étudiants et des enseignants 73 c) Un taux d'accès moindre à l'enseignement supérieur 73 d) Les publications et le nombre de lauréats des Prix Nobel 73 B. Le rôle des universités dans l'Europe de la connaissance 73 a) Abonder le financement des universités 73 b) Créer les conditions de l'excellence 73 c) Ouvrir les universités sur leur environnement local et mondial 73 TROISIEME PARTIE - PROPOSITIONS : UNE METHODE POUR BATIR L'EXCELLENCE DANS LA DIVERSITE 73 I. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS EN EUROPE 73 Proposition n° 1 : Organiser des cursus en anglais pour attirer les meilleurs étudiants étrangers 73 Proposition n° 2 : Créer auprès de chaque pôle universitaire un « guichet unique » pour l'accueil des étudiants étrangers 73 Proposition n° 3 : Créer des fondations universitaires d'académie afin d'abonder le financement de l'enseignement supérieur 73 Proposition n° 4 : Favoriser, autour de labels communs, les rapprochements et les synergies entre les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les entreprises 73 Proposition n° 5 : Etablir un statut d'« université pilote » 73 Proposition n° 6 : Reconstituer un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et des nouvelles technologies, autonome du ministère de l'éducation nationale 73 Proposition n° 7 : Créer une Commission nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur 73 II. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EUROPEEN DANS LE MONDE 73 Proposition n° 8 : Réorienter le budget de l'Union européenne en direction des objectifs politiques fixés par le Conseil européen dans le cadre de la stratégie de Lisbonne 73 Proposition n° 9 : Créer un fonds européen de financement des infrastructures universitaires 73 Proposition n° 10 : Créer un label d'université européenne 73 Proposition n° 11 : Soutenir la création d'une revue scientifique européenne 73 Proposition n° 12 : Créer un statut de « chaire européenne » 73 ANNEXE : Liste des personnes entendues par le rapporteur 73 Le 25 mai 1998, la Conférence de la Sorbonne a lancé le processus européen d'harmonisation des diplômes. De quatre pays (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), le mouvement concerne désormais une quarantaine d'Etats (bien au-delà des seules frontières de l'Union européenne) engagés dans l'édification d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le processus de Bologne : Un objectif pour l'Europe, une chance pour la France Loin de toute idée d'uniformisation, l'objectif poursuivi vise à rendre compatibles les structures d'enseignement supérieur très hétérogènes d'un pays européen à l'autre. Après le marché unique, les Européens entendent réaliser leur marché intérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche et le rendre attractif à l'échelle mondiale. La refonte des cursus repose sur la création de trois cycles principaux : la licence (L), le master (M) et le doctorat (D), d'où l'appellation « LMD ». L'instauration d'un système de crédits capitalisables (crédits « ECTS ») doit permettre de faciliter la mobilité des étudiants sur le territoire européen, tout en assurant une plus grande souplesse des parcours académiques. La création d'un « supplément au diplôme » vise à garantir l'information des universités et des étudiants sur la qualité des enseignements réellement dispensés. Le processus de Bologne engendre, dans la plupart des Etats signataires, des transformations substantielles en terme d'architecture des études supérieures ; dans tous les cas, le mouvement d'harmonisation européenne des diplômes constitue un important levier de réforme des systèmes nationaux. Le rapport propose un éclairage plus particulier sur l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. La France est, pour sa part, le bon élève de la classe. Par anticipation, trois quarts des universités sont déjà entrées dans le LMD et la réforme s'étend désormais aux grandes écoles, au niveau du master. Le mouvement étudiant de l'automne 2003, quoique très minoritaire, a cependant révélé certaines craintes liées à la mise en œuvre du LMD. Des tabous français ont resurgi à cette occasion : sélection masquée, remise en cause du caractère national des diplômes, fragilisation des filières professionnalisées, augmentation programmée des droits de scolarité, marchandisation, privatisation de l'enseignement supérieur... Ces craintes sont le reflet d'une perte de confiance dans notre système universitaire, et d'une difficulté certaine à le soustraire du poids des idéologies. La France a pourtant toutes les cartes en main pour faire face aux défis de demain. Mais elle doit se donner les moyens, notamment financiers, de ses ambitions. Or, notre pays continue de dépenser sensiblement plus pour l'enseignement secondaire que pour l'enseignement supérieur. A ce rythme, nous prenons le risque de n'être plus qu'une économie d'imitation, quand la croissance et les emplois reposent sur l'innovation. Parmi les défis à relever, figure incontestablement l'accueil des étudiants étrangers, qui reste le point faible du système français. Nous ne savons pas attirer les meilleurs étudiants qui préfèrent étudier aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. La dualité entre les grandes écoles et les universités n'est pas toujours bien comprise en dehors de l'hexagone : il faut rapprocher les structures pour tirer le meilleur parti de chacune d'entre elles. Enfin, il faudra bien un jour s'engager dans la voie d'une modernisation des règles de gestion et de gouvernance des universités. La singularité française est de ce point de vue un handicap majeur dans la compétition internationale. L'attractivité des universités américaines : Le vrai défi lancé à l'Europe de la connaissance Pourquoi les universités américaines se sont-elles imposées comme un référent mondial ? Comment l'Europe peut-elle, dans ce domaine, aborder la compétition internationale à armes égales ? L'attractivité du « modèle » américain repose en réalité sur une cinquantaine de grandes universités, publiques ou privées, alors que l'on dénombre environ 4 000 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays. Le système d'enseignement supérieur est la vitrine de l'Amérique, au même titre que Hollywood ; les universités sont un vecteur de la puissance et de la souveraineté des Etats Unis dans le monde. Leur fonctionnement repose sur des règles la plupart du temps étrangères aux universités européennes, à l'exception notable du Royaume-Uni. Les universites sont un vecteur de la puissance americaine : · Concurrence et autonomie Les universités américaines se positionnent les unes par rapport aux autres sur un véritable marché de la connaissance, qui répond à une logique de concurrence. Le marketing y est omniprésent. Marques, labels, réputation : ces mots font partie du vocabulaire courant des dirigeants des grandes universités américaines. Les classements internationaux donnent raison à cette stratégie puisque les premières places y sont systématiquement occupées par des universités anglo-saxonnes. Les universités américaines disposent d'une totale liberté dans le choix de leurs étudiants, et de leurs professeurs. Les cycles d'excellence reposent en grande partie sur les étudiants étrangers, notamment asiatiques. Depuis le 11 septembre 2001, les conditions d'accueil sont toutefois devenues de plus en plus contraignantes, ce qui préoccupe les universitaires. S'agissant des professeurs, la comparaison avec l'Europe est difficile, tant la situation est différente. Les universités n'hésitent pas à surenchérir pour attirer les meilleurs enseignants, et les salaires peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés, dans certains cas jusqu'à 300 000 dollars par an. · Des moyens financiers importants Les universités prestigieuses n'éprouvent pas de difficultés réelles pour se financer. L'échelle des moyens est sans commune mesure avec la situation en Europe. L'excellence attire l'argent. Les fonds propres de Harvard s'élèvent à 22,8 milliards de dollars. Ce capital rapporte chaque année plusieurs centaines de millions de dollars à l'université... Une différence importante provient de la diversité des sources de financement. Faire des études aux Etats-Unis coûte cher : une année d'études à New-York peut atteindre 60 000 dollars, si l'on ajoute aux frais de scolarité (environ 30 000 dollars pour une université privée) les dépenses liées au logement et à la vie courante. Mais le système de bourses et de prêts est beaucoup plus développé qu'en Europe puisque 70% des étudiants en bénéficient à un titre ou à un autre. D'une façon générale, il faut relativiser la distinction entre universités publiques et privées, car même les universités publiques sont majoritairement financées par des fonds privés. Les contributions des anciens élèves (les « alumni ») sont significatives. Il n'est pas rare que les dons atteignent plusieurs dizaines de millions de dollars. · Les conditions de vie et d'étude La qualité des conditions de vie et d'étude est un facteur déterminant de l'attractivité des campus américains. Trois aspects en particulier attirent l'attention : - les relations entre étudiants et professeurs : les professeurs tiennent chaque semaine des « offices hours » pendant lesquelles ils sont à la disposition de leurs étudiants ; - les équipements: bibliothèques ouvertes 7j/7j et parfois 24h/24h, équipement informatique généralisé, infrastructures sportives et culturelles : les universités sont de véritables villes. Par exemple, le stade de Berkeley peut accueillir 80 000 personnes, autant que le stade de France ! - la vie culturelle et sportive : il existe une vraie vie de campus, avec des journaux, des manifestations culturelles et sportives. Les compétitions sportives interuniversitaires font partie intégrante de la vie des campus. · L'organisation de la recherche et les transferts de technologie La part du gouvernement fédéral est déterminante dans le financement de la recherche universitaire, indépendamment du statut public ou privé des universités. Le poids de la R&D exécutée dans les universités américaines (30 à 35 milliards de dollars par an) représente 11% de l'effort national de R&D, et 43% si l'on ne considère que la recherche fondamentale. Le Bayh-Dole Act permet aux universités de gérer et de commercialiser leurs brevets. L'URGENCE D'UNE REPONSE EUROPEENNE : Gouvernance, financement, recherche, conditions de vie et d'études : quelle réponse les Européens peuvent-ils apporter à ce qui restera le standard international tant que nous ne réagirons pas ? Or l'Europe peut aussi se construire et s'approfondir autour des universités, comme elle l'a d'ailleurs fait par le passé. Au printemps 2000, le Conseil européen a fixé à l'Union européenne l'objectif de « devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Dans cette perspective, les Chefs d'Etat ou de gouvernement ont souhaité, lors du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, faire des systèmes européens d'enseignement et de formation une « référence de qualité mondiale » d'ici à 2010. L'Europe doit adapter ses structures et ses politiques à une économie mondiale de plus en plus tournée vers l'innovation. Or elle éprouve des difficultés pour y parvenir, comme en témoigne la persistance du retard européen en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs clés. · Le retard européen Qu'il s'agisse du dépôt de brevets, du nombre de chercheurs, du classement des universités, du nombre de lauréats au prix Nobel ou des citations dans les grandes revues scientifiques, la société européenne de la connaissance reste à la traîne par rapport aux Etats-Unis qui investissent deux fois plus que l'Union européenne dans leurs universités : 2,3% contre 1,3% du PIB. L'écart s'explique principalement par le faible niveau de l'investissement privé dans l'enseignement supérieur : 0,2% du PIB européen, contre 0,6% au Japon et 1,2% aux Etats-Unis. La mobilité des étudiants et des professeurs reste également insuffisante en Europe. Le programme Erasmus, malgré son succès populaire, ne concerne qu'à peine 2% des étudiants et le faible montant des bourses ne permet pas toujours aux moins favorisés d'étudier à l'étranger. Les Européens doivent donc réagir pour entrer de plein pied, avec ambition et réalisme, dans l'économie de la connaissance. Parce qu'elles se situent au croisement de l a recherche, de l'éducation et de l'innovation, les universités contribuent de façon significative aux nombreux objectifs de la stratégie de Lisbonne. Erasmus Mundus : un premier pas dans la bonne direction En lançant le programme Erasmus Mundus, la Commission européenne entend renforcer l'attractivité des universités de l'Union en permettant à plusieurs universités européennes et non européennes de s'associer pour délivrer un master européen commun. L'objectif : attirer en Europe les meilleurs étudiants étrangers en leur offrant une bourse d'étude de 1 600 euros pendant 18 mois. Ce nouveau label « made in Europe » doit contribuer à renforcer la visibilité internationale des diplômes européens. Avec un budget de 230 millions d'euros sur cinq ans, le programme souffre toutefois d'un vrai problème d'échelle et n'est pas en mesure de répondre, à lui seul, aux objectifs fixés. · Les chantiers prioritaires Essentiellement organisé au niveau national et régional, le paysage universitaire européen se caractérise en effet par une importante hétérogénéité - certains parleront de « balkanisation » - qui s'exprime en termes d'organisation, de gouvernance et de conditions de fonctionnement, de même qu'en ce qui concerne le statut et les conditions d'emploi et de recrutement des professeurs et des chercheurs. En revanche, les universités européennes, pour différentes qu'elles soient, sont confrontées à des défis similaires : augmentation de la demande de formation supérieure, internationalisation croissante de l'éducation et de la recherche, nécessité de s'ouvrir sur le « monde réel », en renforçant les liens avec le monde de l'entreprise. Face à ces contraintes communes, la réponse doit plus que jamais s'organiser au niveau européen. Trois chantiers prioritaires peuvent être identifiés : - remédier au sous financement : dans un contexte de restrictions budgétaires dans la plupart des pays membres, l'augmentation du financement des universités devrait résulter d'une diversification des revenus des établissements d'enseignement supérieur ; - créer les conditions de l'excellence : après le défi réussi de la massification de l'accès à l'enseignement supérieur, l'objectif est désormais qualitatif. Projet d'universités d'élite en Allemagne ou tentatives de rapprochement entre grandes écoles en France : la prise de conscience est réelle, mais il faut désormais concrétiser les projets ; - ouvrir davantage les universités sur leur environnement : sortir de la tour d'ivoire pour entrer dans la tour de guet en renforçant les liens avec le monde de l'entreprise et en amplifiant la diffusion des connaissances et des technologies. Sur un plan international, les stratégies d'alliance doivent être encouragées. * 12 propositions pour bâtir l'excellence dans la diversité (ces propositions sont détaillées à la fin du rapport) · L'enseignement supérieur français en Europe 1 - Organiser des cursus en anglais pour attirer les meilleurs étudiants étrangers 2 - Créer auprès de chaque pôle universitaire un « guichet unique » pour l'accueil des étudiants étrangers 3 - Créer des fondations universitaires d'académie afin d'abonder le financement de l'enseignement supérieur 4 -Favoriser, autour de labels communs, les rapprochements et les synergies entre les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les entreprises 5 - Etablir un statut d' « université pilote » 6 - Reconstituer un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et des nouvelles technologies, autonome du ministère de l'Education nationale 7 - Créer une Commission nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur · L'enseignement supérieur européen dans le monde 8 - Réorienter le budget de l'Union européenne en direction des objectifs politiques fixés par le Conseil européen dans le cadre de la stratégie de Lisbonne 9 - Créer un fonds européen de financement des infrastructures universitaires 10 - Créer un label d'université européenne 11 - Soutenir la création d'une revue scientifique européenne 12 - Créer un statut de « chaire européenne » Mesdames, Messieurs, « Il faut quitter la tour d'ivoire pour entrer dans la tour de guet » : c'est en ces termes que le professeur Pierre de Maret, recteur de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), envisage l'avenir des universités en Europe. Nos sociétés sont entrées dans l'ère de la connaissance et les lieux du savoir sont appelés à occuper une place de plus en plus importante et de plus en plus stratégique. L'histoire des pays peut se lire à travers ses universités : les lettres, les sciences, mais aussi leur vie politique. Près de quarante ans après mai 68, l'enseignement supérieur reste en France un sujet brûlant. Nous sommes marqués dans notre culture et aussi dans notre vécu, par un système éducatif qui reflète des valeurs et des ambitions. L'Europe, également, s'est nourrie de ses universités : Bologne, Valence, Oxford, la Sorbonne, Cracovie, Heidelberg... Dès le Moyen-âge, la circulation des idées a contribué au développement d'un sentiment d'appartenance à l'Europe. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle est la situation de l'enseignement supérieur en Europe ? Lancé en 1998 à la Sorbonne, le processus européen d'harmonisation des diplômes a brusquement accéléré les choses. Comme une prise de conscience, un déclic : les Européens ont décidé de bâtir ensemble un espace organisé et unifié d'enseignement supérieur et de recherche qu'ils veulent attractif au niveau mondial. Alors qu'au printemps 2000, les chefs d'Etat ou de gouvernement avaient fixé à l'Union l'objectif de devenir en 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, les universités ont plus que jamais un rôle majeur à jouer dans le cadre de cette stratégie de Lisbonne. Mais encore faut-il leur en donner les moyens. L'Europe universitaire est à un tournant. Dans la compétition mondiale, l'Amérique impose son modèle d'enseignement supérieur et les Européens doivent réagir s'ils veulent exister. Il faudra bien finir par lever un certain nombre de tabous pour appréhender l'avenir avec réalisme mais aussi avec confiance. Par delà les craintes et les peurs, les Européens doivent être fiers de leurs universités comme les Américains sont fiers des leurs. Mais il faut pour cela œuvrer à s'accorder sur une vision et une stratégie communes. Par ses nombreux déplacements effectués, tant en Europe qu'aux Etats-Unis et au Canada, le rapporteur a mesuré le caractère multidimensionnel des questions liées à l'enseignement supérieur, souvent au confluent de problématiques très variées : diversité linguistique, répartition des compétences et organisation des pouvoirs publics, financement, gouvernance, fuite des cerveaux, impact de la communication et du marketing, etc. Dans la course à la séduction des meilleurs étudiants et des meilleurs professeurs, l'Europe doit apporter une réponse à la question de savoir s'il doit exister, ou non, une alternative au « modèle » américain et si elle est mesure d'en proposer une. Comment se positionnent les universités françaises en Europe, et quelle est la place de l'Europe universitaire dans le monde ? S'il est un objectif pour l'Europe, le processus de Bologne est aussi une chance pour la France et pour la modernisation de son système d'enseignement supérieur. Mais au-delà de la seule harmonisation des diplômes, c'est bien l'attractivité des universités américaines qui constitue aujourd'hui le vrai défi lancé à l'Europe de la connaissance. * * * PREMIERE PARTIE Le processus de Bologne résulte d'une série de conférences ministérielles européennes(1) dont l'objet vise à la construction d'un espace européen d'enseignement supérieur d'ici à 2010. Après le marché unique, l'Europe entend réaliser son marché intérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Paradoxalement, le processus de Bologne, dont les prémisses se situent en réalité dans la Déclaration de la Sorbonne (1998) sur l'harmonisation de l'architecture du système d'enseignement supérieur, est une dynamique exclusivement intergouvernementale qui ne reconnaît qu'un rang d'observateur à l'Union européenne. Parce que nos sociétés sont résolument entrées dans l'ère de l'économie de la connaissance, nos schémas nationaux d'enseignement supérieur ne peuvent plus rester cloisonnés les uns par rapport aux autres. Mobilité, compatibilité, échanges, confiance mutuelle : tels sont les mots clés qui doivent contribuer à la renaissance d'une Europe des Lumières, qui peut aussi éclairer l'horizon des universités françaises. Le processus de Bologne(2) poursuit deux objectifs principaux : - faire du continent européen un vaste espace permettant facilement la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs ; - rendre cet espace attractif à l'échelle mondiale. Loin d'imposer l'uniformité, le processus de Bologne doit donc promouvoir la diversité et la flexibilité. Sa particularité tient au fait qu'aucune des déclarations ministérielles successives n'a de valeur juridique contraignante. Les pays signataires ne sont en réalité obligés à rien, et toute la dynamique repose sur la bonne volonté des gouvernements des Etats membres. Contrairement à une idée parfois répandue, les institutions européennes ne sont nullement à l'origine de ce processus exclusivement intergouvernemental dans un domaine où la compétence relève des Etats membres, l'Union européenne n'étant habilitée à intervenir que par des actions d'appui. La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche est une initiative intergouvernementale, initiée par Claude Allègre qui, en 1998, a réuni à la Sorbonne ses collègues ministres de l'éducation de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Fondée, à l'origine, sur une volonté commune de quatre Etats, le processus concerne désormais une quarantaine de pays de la « Grande Europe », bien au-delà des seuls membres de l'Union européenne. Quatre Etats balkaniques occidentaux Cette initiative ne s'est pas produite ex nihilo, mais s'inscrit dans le prolongement de plusieurs rapports d'experts (notamment les rapports Dearing au Royaume-Uni en 1997 et Attali en France en 1998) qui avaient créé un climat propice à une convergence des systèmes européens d'enseignement supérieur. La Conférence de la Sorbonne marque une prise de conscience, au niveau politique, des enjeux de la construction d'un véritable espace européen d'enseignement supérieur. Elle sera suivie de plusieurs conférences ministérielles à Bologne (1999), Prague (2001) et Berlin (2003). La prochaine étape est fixée en Norvège à Bergen, en mai 2005. Tout en préservant le système universitaire propre à chaque pays, la démarche choisie vise à rendre compatibles les architectures nationales. Le processus ambitionne de faire converger les systèmes d'enseignement supérieur en Europe vers un système plus transparent fondé sur trois cycles principaux: la Licence (ou Bachelor), le Master et le Doctorat. 1) La Conférence de la Sorbonne (25 mai 1998) La déclaration de la Sorbonne a été signée en mai 1998 par les ministres français, allemand, italien et britannique de l'enseignement supérieur qui appellent à une action conjointe en faveur de la mobilité, de la reconnaissance des diplômes (domaine où les progrès permis par les initiatives communautaires étaient plus limités et nécessitaient donc une volonté intergouvernementale forte pour avancer), et de l'harmonisation des diplômes vers un modèle commun composé de deux cycles : - un cycle pré-licence, dit « undergraduate » ; - un cycle post-licence ou « graduate » débouchant sur un master puis un doctorat. C'est ainsi qu'à la Sorbonne, les quatre pays signataires ont pris l'engagement de faire évoluer la structure de leur système d'enseignement supérieur pour faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes, tout en respectant les spécificités nationales. Les principaux objectifs sont : - faciliter la mobilité des étudiants dans l'espace européen et leur intégration sur le marché du travail européen ; - introduire plus de fluidité dans les filières d'enseignement supérieur, notamment en favorisant la coopération entre les établissements ; - faciliter la reprise d'études et la reconnaissance de périodes d'études en Europe en instaurant davantage de souplesse ; - accroître au niveau international, la lisibilité des formations européennes d'enseignement supérieur. 2) La Conférence de Bologne (19 juin 1999) En juin 1999, la Conférence de Bologne a débouché sur une nouvelle déclaration qui a élargi le nombre des signataires à 29 pays, à la Commission européenne et aux associations universitaires européennes. La Conférence de Bologne a proposé un schéma de mise en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés un an auparavant à la - un système de grades académiques facilement lisibles et comparables, incluant la mise en œuvre du supplément au diplôme(3) ; - un système essentiellement fondé sur deux cycles : un premier cycle (undergraduate) utilisé pour le marché du travail, d'une durée de trois ans, et un deuxième cycle (graduate) exigeant l'achèvement du premier cycle ; - un système d'accumulation et de transferts de crédits, sur le modèle du système ECTS (« European Credits Transfer System ») déjà utilisé dans le cadre du programme Erasmus ; - la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs ; - un mécanisme d'évaluation permettant de s'assurer de la qualité des formations dispensées ; - la dimension européenne de l'enseignement supérieur. 3) La Conférence de Prague (19 mai 2001) La conférence de Prague s'est tenue le 19 mai 2001, quelques semaines seulement après l'adoption, par plus de 300 institutions européennes d'enseignement supérieur, d'une déclaration commune soulignant la nécessité du processus d'harmonisation des diplômes(4). A Prague, les ministres ont fixé à l'espace européen de l'enseignement supérieur un nouvel objectif : répondre aux besoins de l'éducation tout au long de la vie. Ils ont insisté sur la participation des établissements d'enseignement supérieur et des étudiants au processus ainsi que sur la promotion de l'attractivité de l'espace européen de l'enseignement supérieur vis-à-vis du reste du monde. Les gouvernements ont également appelé à la mise en œuvre de politiques d'évaluation de la qualité dans chaque pays afin d'assurer la confiance mutuelle indispensable à la validation des études effectuées à l'étranger. 4) La Conférence de Berlin (2003) A Berlin, les ministres ont décidé d'accélérer le processus en fixant des objectifs à court terme. Ainsi, d'ici la rentrée 2005, tous les Etats signataires devront : - avoir adopté un système en deux cycles ; - délivrer gratuitement et automatiquement à tous leurs diplômés un supplément au diplôme dans une langue de grande diffusion ; - avoir commencé à mettre en place un système d'assurance de la qualité. En outre, le cycle doctoral sera désormais couvert par les réformes de Bologne, renforçant ainsi l'interaction entre l'espace européen de l'enseignement supérieur et l'espace européen de la recherche. A l'issue de la Conférence, les ministres se sont donné rendez-vous à Bergen, en mai 2005. Les pays du processus de Bologne
1) L'architecture des études: une organisation essentiellement fondée sur deux phases: pré-licence et post-licence L'architecture des études est désormais fondée sur la Licence, le Master et le Doctorat (d'où le nom de réforme « LMD ») qui deviennent les grades universitaires qui fixent les niveaux de référence (à Bac +3, +5 et +8) de l'enseignement supérieur. L'adoption de ce schéma répond avant toute chose à l'exigence d'intégration et d'harmonisation européenne, puisque ces niveaux devront être communs à l'ensemble du continent européen. 2) L'instauration d'un système de crédits "ECTS" Le système ECTS ou « système européen de transfert de crédits », mis en place depuis déjà plusieurs années dans le cadre du programme Erasmus, devient la nouvelle norme de présentation des formations. Désormais, il ne s'agit plus de représenter un enseignement uniquement par le nombre d'heures de cours, mais d'évaluer la quantité globale de travail qu'il nécessite en tenant compte également des heures de laboratoires, des recherches en bibliothèque, du travail personnel... En effet, le système de crédits se définit par rapport au travail à effectuer par l'étudiant comprenant l'ensemble des activités qui lui sont demandées : enseignements quelle qu'en soit la forme, travail personnel, stages, mémoires, projets, etc... ¬ La semestrialisation Chaque cycle de formation comporte un certain nombre de crédits, et les diplômes sont découpés en semestres valant chacun 30 crédits. On valide donc un semestre et non plus une année, ce qui facilite les réorientations en fin de semestre. Un étudiant qui n'aura pas validé un semestre sera autorisé, sous certaines conditions, à s'inscrire dans le semestre suivant. Avec le système ECTS, la licence (bac +3) correspond à l'obtention de 180 crédits, le master (bac +5) correspond à 120 crédits après la licence (soit 300 crédits au total). Quant au doctorat, le plus haut diplôme du LMD, il est délivré après la soutenance d'une thèse. En s'appliquant à tous les diplômes nationaux, l'objectif de ce système de crédits européens vise à favoriser la souplesse des parcours, d'un pays européen à l'autre (les unités d'enseignement sont transférables d'un parcours à l'autre, sous réserve d'acceptation par l'équipe pédagogique, et permettent par exemple de valider des périodes d'études effectuées à l'étranger). Ces ECTS sont également capitalisables puisque toute validation dans un pays signataire est acquise (pour cinq ans) quelle que soit la durée d'un parcours. Plus globalement, la mise en œuvre des crédits doit faciliter tant la validation des acquis de l'expérience qu'une gestion différente du temps de formation désormais rendue plus facile par les technologies de l'information et de la communication et le développement de l'enseignement à distance. En outre, la construction des parcours par une accumulation cohérente de modules créditables permettra plus facilement la mise en œuvre de formations pluridisciplinaires tout en préservant, c'est indispensable, la cohérence des cursus disciplinaires. De nouvelles qualifications se développent partout dans le monde, les structures d'enseignement supérieur et les systèmes de qualification évoluent en permanence sous l'effet de mutations économiques, politiques et technologiques rapides. Or les difficultés de reconnaissance des qualifications constituent un problème général et les informations fournies par les seuls diplômes originaux sont insuffisantes. Il est par conséquent très difficile d'évaluer le niveau et la fonction d'une qualification en l'absence d'informations précises et appropriées. Le supplément au diplôme, tel qu'il est prévu par le décret du 8 avril 2002(5) portant application au système français de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, est un document joint à un diplôme d'études supérieures qui vise à améliorer la transparence internationale et à faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications. L'obligation de délivrer à tous les étudiants un supplément au diplôme va dans le sens de cette « assurance qualité » que les ministres de l'enseignement supérieur ont souhaité voir se développer lors de la conférence de Berlin des 18 et 19 septembre 2003. Concrètement, ce document pourra indiquer le détail des enseignements suivis, le nombre d'heures de cours, les matières obligatoires et les matières à option, etc. Le supplément au diplôme est ainsi un outil au service des étudiants qui pourront plus facilement attester, grâce à ce document descriptif et non évaluatif, de la cohérence et de l'originalité de leur parcours ainsi que des compétences qui en résultent. Il est également un outil au service des universités, dans la mesure où il leur permettra de proposer des innovations dans leur offre de formation. Le supplément au diplôme répond enfin à une demande sociale alors que les besoins en qualifications et en emplois rendent de plus en plus indispensable une formation tout au long de la vie. En effet, tout individu quel que soit son âge, peut se trouver en situation de commencer ou de reprendre des études supérieures, avec ou sans validation des acquis de l'expérience. Dans cette perspective, le supplément au diplôme constitue un dispositif qui favorise une transparence et une capitalisation des compétences universitaires acquises et permet ainsi d'accompagner la mobilité professionnelle. Les mots clés du LMD Crédits ECTS : le système européen de transfert de crédits a d'abord été mis en place dans le cadre du programme communautaire Erasmus-Socrates, avec l'objectif de promouvoir la reconnaissance académique des études poursuivies à l'étranger. L'ECTS évolue à présent vers une utilisation beaucoup plus large en tant qu'élément à part entière de la dimension européenne au sein de l'enseignement supérieur. Le système ECTS doit faciliter la mobilité des étudiants au sein de l'espace européen en permettant une validation rapide et facile des enseignements suivis à l'étranger. Les crédits ECTS représentent, sous la forme d'une valeur numérique affectée à chaque unité de cours, le volume de travail que l'étudiant est supposé fournir pour chacune d'entre elles. Décloisonnement : le décloisonnement des cursus, la transversalité des formations et la souplesse des parcours sont au centre du processus de Bologne. Les établissements d'enseignement supérieur sont invités à établir des passerelles entre les différents Grades : ils fixent les principaux niveaux de référence de l'espace européen de l'enseignement supérieur. En France, les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Supplément au diplôme : c'est un document joint à un diplôme d'études supérieures qui vise à améliorer la transparence internationale et à faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications. Titres : ils fixent les niveaux intermédiaires de l'espace européen de l'enseignement supérieur, entre chaque grade. Il s'agit par exemple du DEUG (deux ans) et de la maîtrise (quatre ans). Le master est à la fois un grade et un titre. Généralement considéré comme irréversible, le processus de Bologne va engendrer, dans la plupart des Etats signataires, des transformations substantielles du système d'enseignement supérieur. Mais les problématiques sont différentes d'un pays à l'autre de l'Union, et le débat sur l'enseignement supérieur reflète bien souvent des particularismes nationaux tels que la répartition des compétences et des financements entre l'Etat fédéral et les Länder en Allemagne ou encore la question linguistique en Belgique. Dans tous les cas, le processus de Bologne apparaît comme un levier de réforme des systèmes nationaux. Le rapport « Trends III »(6) établi en juillet 2003 pour l'Association européenne de l'université souligne que d'importants progrès ont été réalisés sur le plan juridique concernant l'introduction de schémas d'études articulés en deux phases distinctes : undergraduate et graduate. Dans les pays qui ne connaissaient pas par le passé de premier diplôme de type licence (bachelor), on observe une tendance à considérer celui-ci comme un simple tremplin ou une plate-forme d'orientation, plutôt qu'un diplôme à part entière. Dans certains pays, tels que l'Allemagne, le Danemark et de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, le processus de Bologne coïncide avec un processus national de réforme déjà initié avant 1999. Voici un aperçu, dans trois pays de l'Union européenne, de la mise en œuvre du processus de Bologne. L'Allemagne compte plus de 320 établissements d'enseignement supérieur répartis sur l'ensemble du territoire et regroupant des universités, des universités techniques, des Fachhochschulen(7) , des écoles supérieurs des Beaux-arts et des écoles supérieures de musique. Environ 2 millions d'étudiants sont inscrits dans ces divers établissements. La structure de l'enseignement supérieur est régie par la loi-cadre Hochschulrahmengesetz (HGR) du 20 août 1998 dont l'article 19 prévoit que les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des cursus d'études conduisant aux grades de Bachelor et de Master (selon un modèle 3+2 ou 4+1) et délivrer les diplômes correspondants. Les Fachhochschulen pourront également délivrer ces diplômes. La mise en place de ce dispositif s'inscrit dans la volonté d'internationaliser l'enseignement supérieur allemand. La phase de transition doit être accomplie en 2010. Le processus de Bologne constitue une petite révolution outre-Rhin, car le grade de bachelor était jusqu'à présent étranger au système allemand. La durée des études y est généralement plus longue (d'un ou deux ans) en partie car les études universitaires étant fortement axées sur la recherche, les étudiants sont très nombreux à dépasser la durée réglementaire. Le système actuel (avant la mise en œuvre de l'harmonisation européenne des diplômes) repose sur un cursus divisé en deux cycles d'au moins quatre semestres chacun : les études de base (Grundstudium) et les études principales (Haupstudium). Les études de base sont sanctionnées par un examen intermédiaire ou préliminaire (Zwischenprüfung/Diplom-Vorprüfung) et les études principales par un examen de fin d'études de type Diplom, Magister ou « examen d'Etat » (Staatsprüfung). Les structures de l'enseignement supérieur en Europe 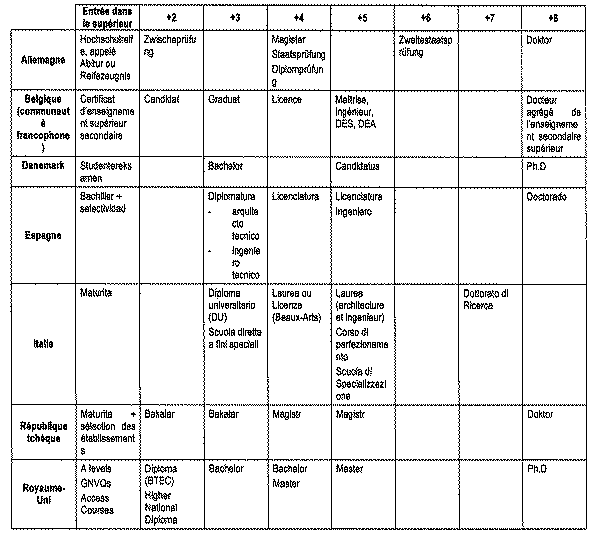 Source : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.sup.adc.education.fr/europedu/french/index.html La décision d'introduire le nouveau système, de conserver l'ancien ou de proposer les deux en parallèle, relève aujourd'hui de chaque établissement, ce qui peut parfois provoquer une certaine confusion chez les étudiants comme, d'ailleurs, auprès des employeurs. L'harmonisation européenne concerne également les Fachhochschulen, des structures d'enseignement professionnalisé(8). 2) En Belgique (Communauté francophone) En Communauté francophone de Belgique, la structure de l'enseignement universitaire est régie par le décret du 5 septembre 1994 et celle de l'enseignement supérieur non universitaire par le décret du 5 août 1995. Un nouveau décret, portant adaptation au processus de Bologne, a été adopté le 23 mars 2004 par le Parlement de la Communauté française. Il a pour objectif d'adapter la dénomination des diplômes et d'instaurer un système de crédits européens, selon lequel les cours dispensés ne se comptent plus en heures de cours mais en crédits, qui, une fois acquis par l'étudiant peuvent être valorisés dans les autres établissements d'enseignement supérieur belges et étrangers impliqués dans le processus de Bologne. Le décret structure l'organisation des études supérieures en trois cycles : baccalauréat ou bachelor pour le premier cycle en trois ans, master pour le deuxième cycle, et doctorat pour le troisième cycle. Des critiques se développent en Belgique sur le rallongement des études engendré par l'harmonisation européenne des diplômes. D'où la perspective de délivrer le titre de master en un an (master 1) ou en deux ans (master 2), comme l'envisagent d'ailleurs également les Pays-Bas. Il est clair qu'un tel fractionnement nuit à la lisibilité internationale du master. Mais force est de constater qu'il n'existe pas, parmi les pays signataires de la déclaration de Bologne, d'unanimité sur la durée des études. On dénombre au Royaume-Uni près de 170 universités (si l'on prend en compte tous les types d'établissements d'enseignement supérieur) qui accueillent 2,3 millions d'étudiants dont environ 280 000 étrangers. En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, la plupart des récents changements au niveau de l'enseignement supérieur sont intervenus en réponse aux recommandations du rapport Dearing publié en 1997 par le National Committee of Inquiry into Higher Education. Les différents niveaux d'enseignement, préexistants au processus de Bologne, sont : - le bachelor (Bachelor of Art -BA ou Bachelor of Science BSc) obtenu en trois ou quatre ans, ce qui correspond au niveau L ; - le master, en douze ou seize mois (après le bachelor), selon les universités ; - le PhD (doctorat) en 3 ans. La spécificité britannique tient dans le fait qu'un nombre significatif d'étudiants accède au marché du travail directement après l'obtention d'un bachelor sans qu'il soit nécessaire de poursuivre son cursus jusqu'au master. Qui plus est, le master est fréquemment délivré en douze ou seize mois, au lieu des deux années supplémentaires après la licence, nécessaires en France. Bien que le Royaume-Uni soit engagé dans le processus de Bologne, les universités britanniques entendent rester maîtres de l'organisation des études dans leurs établissements et demeurent attachées au schéma 3+1+3 (Bachelor + Master + PhD) ; et une grande prudence est observée quant à l'éventualité du passage à un master en deux ans. L'allongement de la durée des études qui pourrait découler de la mise en œuvre du processus de Bologne ne peut en effet être déconnectée de la réforme des droits d'inscription votée en janvier 2004, et qui autorisera les universités à tripler les droits d'inscription du premier cycle (bachelor) à compter de la rentrée 2006. Avec un maximum autorisé de 3 000 livres (4 300 euros) par an, les coûts de scolarité pourraient bien être un frein à l'allongement des études, d'autant que les frais de scolarité du cycle master sont eux totalement libres et déplafonnées ; ils varient entre 8 000 et 20 000 livres par an. L'une des modalités possibles de mise en œuvre du processus de Bologne serait alors de proposer aux étudiants britanniques d'effectuer leur master en un an, en le complétant par une année d'études dans une université étrangère. En tout état de cause, les autorités britanniques entendent préserver l'autonomie académique des établissements d'enseignement supérieur et ne souhaitent pas, à ce stade, que la durée d'obtention d'un diplôme devienne la norme d'évaluation de la qualité. Les Britanniques estiment que leur structure de diplômes est déjà conforme aux standards internationaux et perçoivent mal la réelle valeur ajoutée que pourrait leur apporter le processus de Bologne. Ils ont le sentiment que le schéma LMD est en grande partie inspiré de leur modèle et ils sont davantage préoccupés par la concurrence dans la laquelle ils se trouvent avec les Etats-Unis que par l'harmonisation européenne des diplômes. Il en découle, dans ce contexte, un intérêt plus prononcé pour les stratégies bilatérales ou trilatérales (essentiellement avec la France et l'Allemagne) que pour le multilatéralisme européen. La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur est une chance pour la modernisation des universités françaises. A l'initiative du processus d'harmonisation, la France est en avance dans la mise en œuvre des objectifs européens. Mais au-delà, le processus de Bologne révèle ici, comme ailleurs, des blocages, des craintes, des peurs et des handicaps auxquels il faut répondre par la pédagogie et le dialogue. La France souffre de ses tabous mais l'Europe représente une chance historique pour que l'université retrouve le rang qu'elle mérite dans notre société. La France est en avance dans la mise en œuvre du LMD. Plusieurs décrets et arrêtés (9) ont été pris en avril 2002 afin de rendre compatible l'architecture de l'enseignement supérieur français avec les objectifs définis à la Sorbonne et à Bologne. Parmi les principaux textes de mise en œuvre du schéma LMD, il convient de mentionner plus particulièrement : - le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, qui définit l'espace européen de l'enseignement supérieur dans ses principes. Il fonde le système des crédits qui se substituent aux UV (unités de valeurs) et met l'accent sur une construction de l'offre organisée en parcours de formations flexibles ; - le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, qui précise les notions juridiques de grade, titre et diplôme national en définissant, notamment, comme diplôme national tout diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat. Les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, tandis que les titres fixent les niveaux intermédiaires. Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire et seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. Une circulaire du ministre de l'éducation nationale du 14 novembre 2002 vient préciser les modalités de mise en œuvre du schéma LMD. En outre, des arrêtés pris en avril 2002 ont également prévu la mise en place de comités de suivi(10) pour les grades de licence (générale et professionnelle) et de master. Ces comités sont chargés d'examiner les questions posées par le déploiement des nouvelles formations dans le cadre d'un schéma LMD cohérent au niveau national mais respectueux des politiques d'établissement. La licence correspond à 180 crédits, c'est-à-dire six semestres de 30 crédits, soit Bac +3. Deux dispositifs distincts constituent le cursus licence : le premier ouvre sur la poursuite des études supérieures vers le master, tandis que le second conduit à la licence professionnelle conçue dans un objectif d'insertion à l'emploi. La réforme doit permettre davantage de pluridisciplinarité et les universités pourront proposer des formations selon un système de majeures et de mineures. L'arrêté du 30 avril 2002 prévoit en effet que les parcours peuvent être monodisciplinaires, bi-disciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle(11). Les universités continueront à délivrer dans ce nouveau cadre le diplôme national intermédiaire du DEUG qui correspond à l'obtention de 120 crédits européens, soit deux années après le Baccalauréat. Le master correspond à l'obtention de 120 crédits européens au-delà de la licence, c'est-à-dire deux années d'études supplémentaires qui mènent à Bac+5. Le master est à la fois un grade et un diplôme qui se substitue aux actuels DEA et DESS, mais aussi à certain nombre de diplômes variés délivrés à Bac +5 tels que les MST, MSG, MIAGE, IUP, magistères, etc. Ce cursus, dans un même domaine de formation, permet d'organiser une palette de parcours facilitant l'orientation progressive des étudiants, soit dans une voie à dominante professionnelle débouchant sur un « master professionnel » (anciennement DESS), soit une voie à dominante recherche débouchant sur un « master recherche » (anciennement DEA) Le master est également ouvert aux grandes écoles. Sans modifier en quoi que ce soit leurs filières majeures (diplômes d'ingénieur, diplômes de gestion...), celles-ci pourront créer de nouveaux cursus valorisant leurs compétences au niveau master et susceptibles tout particulièrement d'être attractifs pour les étudiants étrangers. Les universités continueront à délivrer dans ce nouveau cadre le diplôme national intermédiaire de maîtrise qui correspond à l'obtention de 60 crédits européens après la licence. L'obtention d'un master de recherche est une condition pour s'inscrire en doctorat. L'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales prévoit une période minimale de trois ans pour la préparation du doctorat(12), ce qui correspond au niveau « 8 » de l'architecture LMD. 2) Une mise en œuvre progressive Alors que l'objectif d'harmonisation des diplômes a été fixé à 2010 par les pays signataires de la Déclaration de Bologne, la France est en avance sur ses partenaires européens, puisque l'ensemble des universités auront basculé dans le LMD d'ici à la rentrée 2006. Trois universités (Valenciennes, Lille-II et Artois) avaient expérimenté la réforme dès la rentrée 2002-2003 et une douzaine d'autres universités avaient basculé dans le LMD il y a un an, lors de la rentrée 2003. Depuis octobre 2004, ce sont trois quarts des 85 universités qui ont appliqué, par anticipation, la réforme. Seulement 18 universités ne sont pas encore entrées dans le LMD, tandis que la démarche s'étend désormais aux grandes écoles, au niveau du master. Dans son discours prononcé le 21 octobre 2004 devant la Conférence des présidents d'université (CPU), M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a évoqué deux nouveaux chantiers qui concernent d'une part, l'application du LMD aux formations du secteur de la santé et, d'autre part, l'ouverture d'une concertation nationale sur le doctorat. La mise en œuvre progressive du LMD se justifie par la complexité et l'ampleur d'une réforme qui nécessite une concertation avec les différents acteurs de l'enseignement supérieur. A l'initiative de l'UNEF, un mouvement d'opposition à la mise en œuvre du LMD a touché plusieurs universités françaises à l'automne 2003. La contestation est partie de l'université de Rennes II le 5 novembre 2003 et dix-sept universités au total avaient suivi le mouvement. La forte médiatisation de la contestation ne doit toutefois pas masquer le caractère très minoritaire d'un mouvement qui n'a mobilisé qu'environ 30 000 manifestants sur les 2,2 millions d'étudiants que compte notre pays. Qui plus est, il ressort des auditions du rapporteur qu'aucune organisation syndicale - enseignante ou étudiante - ne rejette le LMD dans son principe. L'UNEF, elle-même, partage les objectifs de la réforme, mais en dénonce vivement les modalités de mises en œuvre. Le 27 novembre 2003, la Conférence des présidents d'université a adopté une motion dans laquelle elle considère que « tout retard dans la mise en œuvre du LMD conduirait en France à une université à deux vitesses ». La CPU y affirme son « attachement au caractère national des diplômes » et rappelle que, « sans une université publique forte, les logiques de marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche l'emporteront ». En réalité, à travers la mise en œuvre du LMD, des craintes apparaissent, et le débat se développe sur un certain nombre de tabous de l'enseignement supérieur français. 1) Une sélection masquée pour l'obtention du master ? En France, à l'heure actuelle, les étudiants passent des examens de la première année du DEUG jusqu'à la maîtrise. La sélection - le plus souvent sur dossier - ne s'effectue qu'à la fin de la quatrième année pour l'entrée en DEA ou en DESS. Les étudiants s'interrogent dès lors sur le mode de sélection pour les masters : celle-ci s'opérera-t-elle à la fin de la licence (bac+3) ou à l'issue de la première année du master (bac +4) ? Cette interdiction demeure pour l'accès en première année de master. Sur ce point précis, la circulaire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 14 novembre 2002 maintient clairement le statu quo en précisant que « la mise en œuvre du master ne modifie pas les règles de sélection, ni dans un sens ni dans l'autre. Lorsqu'un programme master intègre en son sein un parcours sélectif, la sélection s'opère de la même façon qu'auparavant : pour un parcours de type MST, MSG, MIAGE, IUP dès l'entrée en master ; pour un parcours de type DEA dès la différenciation en master de recherche ; pour un parcours de type DESS dès la différenciation en master professionnel ». En résumé : le baccalauréat demeure le passeport d'accès à l'université et la licence donne un accès de plein droit au cycle master correspondant à la même spécialité. Les universités n'ont pas le droit d'instaurer une sélection après la licence. Mais il ne faudrait pas, à l'inverse, que l'application du LMD empêche de facto les universités de sélectionner leurs étudiants pour l'entrée en 2e année du master, comme c'est depuis toujours le cas pour l'accès aux anciens 3e cycles (DEA et DESS) particulièrement compétitifs, notamment au regard de certaines formations dispensées dans les grandes écoles, et qui contribuent fortement à la notoriété des universités. La circulaire ajoute toutefois que l'objectif de clarté de l'offre de formation conduit bien évidemment à affirmer que le master a vocation à être, à terme, le mode d'organisation unique et intégrateur des études universitaires post-licence. 2) Une remise en cause du caractère national des diplômes ? Une des principales critiques formulées par l'UNEF porte sur la menace que ferait porter le LMD sur les diplômes nationaux. Le syndicat étudiant estime que, sous couvert d'une souhaitable harmonisation européenne, la réforme LMD remet en cause la valeur des diplômes et l'égalité entre les étudiants. Il est vrai que la réforme LMD introduit une rupture par rapport à l'organisation antérieure des diplômes, en laissant une plus grande liberté aux universités dans la mise en place de leurs diplômes. Les arrêtés de 2002 rompent avec la logique des arrêtés pris par M. François Bayrou en 1997, qui définissaient très précisément les « maquettes » des formations, en particulier le nombre d'heures d'enseignement et leurs contenus. Avec le LMD, le ministère se contente d'insister sur la nécessité de proposer des offres de formation « cohérentes ». Les projets de diplômes des universités devront impérativement être expertisés par le ministère avant d'être proposés aux étudiants. Et des comités de suivi sont chargés de veiller à l'harmonisation des formations. Un diplôme national est avant tout un diplôme que l'Etat garantit et la remise en cause de maquettes nationales rigides ne doit pas altérer la dimension nationale des diplômes, dans le cadre d'une régulation fondée sur l'évaluation. Par ailleurs, au niveau externe, la valeur des diplômes sera renforcée puisqu'elle ne sera non plus seulement nationale mais aussi européenne et internationale. Il faut enfin relativiser la notion de diplôme national, qui s'apparente bien souvent à un pur exercice sémantique. Car en pratique, le diplôme national n'existe ni pour les employeurs privés, qui hiérarchisent les universités entre elles, ni pour l'Etat employeur qui recrute sur concours. 3) Les filières professionnelles menacées ? Le LMD menace-t-il les filières professionnelles ? Sont particulièrement visés le diplôme universitaire de technologie (DUT) et le brevet de technicien supérieur (BTS) qui sont des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur qui attestent d'une qualification professionnelle et sanctionnent un niveau d'études à bac +2. Les DUT et BTS demeureront dans le cadre du LMD. Ils seront toujours préparés en deux ans après le bac, et donneront droit aux 120 crédits nécessaires à une inscription en licence professionnelle. Préparés dans les sections de techniciens supérieurs des lycées, les BTS conserveront leur cursus de deux ans. Toutefois, les élèves de BTS devraient être de plus en plus nombreux à poursuivre en licence professionnelle, et obtenir ainsi un bac + 3 reconnu au niveau européen. S'agissant enfin des Instituts universitaires professionnalisés(13) (IUP), ils pourront proposer une formation jusqu'au niveau master, en étroite liaison avec le monde professionnel. L'exemple allemand des Fachhochschulen En Allemagne, les différences entre les universités et les Fachhochschulen (FH) tendent à s'estomper avec l'application du processus de Bologne. Les FH (au nombre d'environ 150) ont été créées à la fin des années 1960. Leur popularité a crû rapidement puisqu'elles concernent aujourd'hui près d'un tiers des étudiants allemands. Dans certains domaines, comme par exemple les formations d'ingénieur, plus de la moitié des diplômés sont passés par une FH. L'enseignement y est fortement orienté vers la pratique. Les cursus d'études sont strictement organisés, les cours se déroulent en petits groupes, des examens sanctionnent chaque matière et l'éventail des études est fortement influencé par les exigences de la pratique professionnelle : tous ces facteurs rendent possibles des durées d'études moyennes plus courtes qu'à l'université. Il apparaît qu'en Allemagne, le processus de Bologne permet davantage de passerelles entre les universités et les FH. L'harmonisation européenne concerne les FH qui dispensent des cursus plus structurés que ceux des universités, prévoient des stages en entreprise, et bénéficient d'un meilleur taux d'encadrement. 4) Une augmentation programmée des frais de scolarité ? Depuis la rentrée universitaire 2004, les droits de scolarité ont été adaptés à la nouvelle architecture des études, sur le principe d'un tarif unique pour chaque cursus : 150 euros/an pour le cursus licence ; 190 euros/an pour le cursus master et 290 euros/an pour le cursus doctorat. Ces tarifs s'appliquent aussi bien aux formations universitaires générales qu'aux formations professionnalisées. Il faut souligner qu'il devient désormais possible d'acquitter ses droits de scolarité par semestre, conformément à la « semestrialisation » prévue par le processus de Bologne. L'harmonisation européenne des diplômes a-t-elle vocation à se doubler d'une harmonisation des droits d'inscription ? Dès lors que les cursus sont reconnus dans chacun des pays signataires, comment justifier des écarts si importants en ce qui concerne les frais d'inscription ? Sur ce point, les pratiques varient sensiblement d'un pays à l'autre de l'Union. Le pari de Tony Blair : renflouer les caisses des universités britanniques Face aux difficultés financières rencontrées par l'enseignement supérieur britannique, le gouvernement de Tony Blair a fait voter au Parlement, le 27 janvier 2004, une importante réforme des droits de scolarité. Ce projet très controversé n'a été adopté à la chambre des Communes que par cinq voix de majorité. A compter de la rentrée 2006, les frais de scolarité augmenteront sensiblement, en passant de 1 000 à 3 000 livres sterling par an (4 300 euros), jusqu'en licence (bachelor). Toutefois, l'étudiant n'aura rien à dépenser puisqu'il bénéficiera d'un prêt de la « student loan company », compagnie de prêts aux étudiants, qu'il ne commencera à rembourser que lorsqu'il aura trouvé un travail lui procurant un revenu annuel d'au moins 22 000 euros. Quant aux « fees » exigés pour le cursus postgraduate (master et Phd), ils resteront fixés librement et peuvent atteindre 10 000 à 20 000 euros. L'augmentation des droits universitaires pourrait rapporter jusqu'à 1,3 milliard de livres sterling supplémentaires chaque année, au-delà des 800 millions que les universités britanniques retirent des droits actuels. Le gouvernement s'est parallèlement engagé à injecter 10 milliards de livres par an dans l'enseignement supérieur d'ici à la rentrée 2006. Les frais d'inscription dans l'Union européenne
Source : Evolution des structures d'éducation dans l'enseignement supérieur en Europe. Rapport préparé pour la Conférence de Bologne des 18 et 19 juin 1999. En France, la débat sur l'augmentation des droits universitaires n'est pas à l'ordre du jour. Chacun est toutefois conscient du sous-financement des universités françaises et du handicap que cela représente, dans le cadre d'une ouverture internationale de plus en plus grande. En outre, la gratuité est profondément inéquitable, puisqu'elle place à égalité les étudiants fortunés et ceux qui ne le sont pas. L'Institut d'Etudes Politiques de Paris a apporté une réponse convaincante à ce double défi du financement et de l'équité sociale, en réformant les droits d'inscription. Désormais, les étudiants de Sciences Po acquittent des frais d'inscription compris entre 0 et 4000 euros, indexés sur les revenus de leurs familles, au lieu d'un droit d'inscription uniforme de 1 050 euros, jusqu'alors payé par environ 80 % des étudiants. Cette grille de tarifs progressifs (0, 500, 1000, 1750, 2500, 3250 et 4000 euros) s'accompagne d'un projet de relèvement massif des bourses et aides au logement. L'application de la réforme continue d'exonérer de frais d'inscription les 20 % d'étudiants qui n'y étaient jusqu'à présent pas soumis. La réforme de Sciences Po est-elle transposable à l'université ? En favorisant la mobilité des étudiants, le LMD va rendre plus visibles les disparités nationales liées aux montants des droits de scolarité, ce qui pourrait créer une pression à la hausse. Cette question ne pourra indéfiniment être éludée, mais aucune réforme ne sera possible sans consensus. Il en va de l'intérêt des étudiants et des universités. Outre-Atlantique, les études supérieures sont généralement perçues comme un investissement. Une hausse des droits d'inscription ne pourra se faire qu'à la condition de garantir la nécessaire démocratisation de l'enseignement supérieur en France. Mais il ne suffit pas d'accéder à l'université, encore faut-il en sortir diplômé. Or le taux d'échec des étudiants français demeure sensiblement supérieur à la moyenne européenne. 5) Une "marchandisation" de l'enseignement supérieur ? L'éducation - et plus particulièrement l'enseignement supérieur - est-elle un bien public ou un bien marchand ? Le processus de Bologne serait-il un instrument de la marchandisation, voire de la privatisation de l'enseignement supérieur ? Il est vrai que la commercialisation des services éducatifs est un sujet fréquemment évoqué ces dernières années, dans le cadre le l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) , signé en 1994 à Marrakech et entré en vigueur en 1995. Quels sont les services potentiellement concernés par l'AGCS ? Il s'agit de « tous les services de tous les secteurs à l'exception des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services ». A l'exception de certains services régaliens de l'Etat (comme la défense, la police ou la justice), tous les services pourraient en théorie être soumis à l'AGCS. Il faut cependant noter que l'enseignement constitue le deuxième secteur « le moins concerné » par les demandes de négociation après les services de l'énergie. En tout état de cause, la Commission européenne exclut les services d'enseignement de l'offre d'ouverture à la concurrence, de telle sorte que les Etats membres conservent entièrement le droit de décider de l'organisation la plus appropriée pour leur système éducatif. Dans un discours prononcé au Parlement européen, à Strasbourg, le 10 mars 2003, M. Pascal Lamy, alors commissaire européen chargé des négociations à l'OMC, rappelait en ces termes les principes applicables aux négociations commerciales internationales : « Chaque pays est libre de déterminer les secteurs qu'il entend ouvrir à la concurrence internationale, et ceux qu'il veut garder fermés ; et je rappelle qu'à l'OMC les décisions se prennent par consensus (...). Il n'y a pas de réciprocité d'engagements : les Etats-Unis pourraient, par exemple, très bien décider d'ouvrir le secteur de l'enseignement à la concurrence sans que cela oblige d'autres à suivre ». En 2000, les Etats-Unis ont ainsi soumis une proposition de négociations pourtant sur l'enseignement supérieur et la La demande américaine s'explique en grande partie par la place des services d'enseignement supérieur en matière d'exportations. Le Département du Commerce des Etats-Unis souligne ainsi qu'en 1997, l'enseignement supérieur arrivait en cinquième position comme secteur d'exportation le plus porteur pour le pays, engrangeant quelque 8,5 milliards de dollars, plaçant ainsi les Etats-Unis parmi les trois plus grands exportateurs d'enseignement supérieur au monde, devant l'Australie et le Royaume-Uni. Le contexte européen ne peut être ignoré dans la problématique de la marchandisation de l'enseignement. Le processus de Bologne est fondé sur une harmonisation et une transparence souhaitables et le système ECTS pourrait provoquer une concurrence entre opérateurs (certains pouvant être strictement commerciaux) voire entre pays. Toutefois, il faut bien rappeler qu'aucun négociateur à l'OMC ne peut être obligé d'engager, contre son gré, un secteur de services dans un processus de libéralisation. En outre, dans une Déclaration conjointe sur l'enseignement supérieur et l'Accord général sur le commerce des services(15), l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), l'Americain Council on Education (ACE), l'Association européenne de l'université (AEU) et le Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ont rappelé solennellement que la raison d'être de l'enseignement supérieur est de servir l'intérêt public et qu'il ne constitue pas une « marchandise ». Ces organisations demandent à leurs pays respectifs de « ne pas prendre d'engagement en matière de services d'enseignement supérieur ou dans les catégories connexes que sont l'éducation des adultes et les autres services d'éducation ». C. Les défis pour l'enseignement supérieur en France : moderniser les universités pour renforcer leur attractivité 1) Investir davantage pour l'enseignement supérieur et la recherche Deux rapports récents soulignent la faiblesse structurelle de la dépense consacrée en France à l'enseignement supérieur et en analysent l'impact sur la croissance économique. a) " Education et croissance" : le rapport du Conseil d'analyse économique(16) Le rapport de MM. Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS, et Philippe Aghion, professeur à l'université Harvard, publié au début de l'année 2004 par le Conseil d'analyse économique (CAE) souligne le lien qui existe entre le système éducatif, d'une part, et la croissance économique, d'autre part. Les auteurs sont formels : les pays les plus avancés, c'est-à-dire proche de la « frontière technologique » (déterminée en l'espèce par les Etats-Unis), doivent mettre l'accent sur l'innovation, la créativité et la R&D afin de rester dans le peloton de tête et d'affronter les contraintes de concurrence et de compétitivité. Pour ces pays, dont fait partie la France, il est indispensable de privilégier l'enseignement supérieur, et les passerelles entre celui-ci et la recherche. A l'inverse, les pays qui se situent encore loin de la frontière technologique doivent eux préférer l'imitation et le rattrapage, en concentrant leurs efforts et leurs moyens financiers sur l'enseignement primaire et secondaire. Une économie d'imitation doit assurer une large alphabétisation de la population qui peut ainsi s'approprier les outils techniques et productifs qui viennent d'ailleurs. MM. Cohen et Aghion concluent pourtant qu'après une phase de rattrapage, la France est désormais proche de la frontière technologique, mais n'a pas adapté en conséquence son système éducatif. Entre 1945 et 1970, notre pays est parvenu à réduire son retard de productivité par rapport aux Etats-Unis. Mais progressivement, l'importance de l'innovation comme source de croissance, s'est accrue. La France aurait franchi, à la fin des années 1970, « le cap où l'efficacité de l'investissement dans l'enseignement supérieur devenait supérieure à celle de l'investissement dans l'enseignement secondaire ». Or les pouvoirs publics ont continué à privilégier le secondaire, avec comme objectif d'amener 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat. Ceci se fait au détriment de l'investissement public dans le domaine de l'enseignement supérieur, ce qui handicape la croissance économique en France. Ce constat est, dans une large mesure, repris par l'OCDE dans son rapport « Regards sur l'éducation en 2004 ». b) "Regards sur l'Education" : le rapport 2004 de l'OCDE Le rapport de l'OCDE, publié en septembre 2004, souligne que la France occupe un rang médiocre au sein des pays développés en ce qui concerne la part de son PIB consacrée à l'enseignement supérieur : 1,1 % par rapport à une moyenne de 1,4 % dans les pays de l'OCDE. Avec 8 837 euros dépensés par étudiant contre plus de 22 000 aux Etats-Unis, la France fait figure de parent pauvre de l'enseignement supérieur. Pourtant, les dépenses d'éducation publiques et privées cumulées pour l'ensemble des niveaux d'éducation représentent pour la France 6 % du PIB, soit un chiffre plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE qui est de 5,6 %. En revanche, les dépenses effectuées au titre de l'enseignement supérieur représentent 1,1 % du PIB alors qu'elles s'élèvent en moyenne à 1,4 % dans les pays de l'OCDE. Deux éléments caractérisent la situation française : - d'une part, la faible part du financement privé de l'enseignement supérieur. Parmi les pays européens, seuls l'Allemagne et le Royaume-Uni financent leurs systèmes d'éducation par plus de 15 % de dépenses privées ; - d'autre part, un taux d'échec encore élevé enregistré en France dans les premiers cycles universitaires. 59 % des étudiants qui commencent leurs études universitaires parviennent à les terminer, soit 11 points de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Cependant, ce « taux de survie » varie considérablement selon les pays, puisqu'il est supérieur à 80 % en Irlande, au Japon, au Royaume-Uni et en Turquie, et en dessous de 60 % en Autriche, en France, en Italie et en Suède. Le taux d'obtention pour une classe d'âge d'un premier diplôme universitaire du type licence, maîtrise ou diplôme d'ingénieur est pour la France inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. 2) L'accueil des étudiants étrangers Au cours de l'année universitaire 2003-2004, 245 300 étudiants étrangers ont poursuivi des études dans l'enseignement supérieur français, ce qui représentent environ 11 % du nombre total des étudiants inscrits. Depuis 1998, le nombre d'étudiants étrangers augmente chaque année à un rythme plus élevé que celui des étudiants français, ce qui témoigne bien d'un phénomène d'internationalisation incontestable. Sur 100 étudiants étrangers scolarisés dans les pays de l'OCDE(17), 73 choisissent l'Allemagne, l'Australie, les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni, dont 9 la France qui demeure ainsi un lieu d'étude attractif pour les étudiants étrangers, même si la proportion d'étudiants étrangers est plus élevée en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Royaume-Uni et en Suisse. Si les effectifs d'étudiants français poursuivant leurs études à l'étranger sont nettement plus restreints que ceux des étudiants étrangers accueillis en France (le rapport est de un à quatre), la répartition géographique des effectifs souligne des différences particulièrement fortes : - les 52 000 étudiants français inscrits dans les pays membres de l'OCDE ont pour principale destination le Royaume-Uni (24 %), l'Allemagne (12 %) et les Etats-Unis (12 %) ; - en revanche, les étudiants étrangers en France proviennent principalement de pays en développement ou de pays émergents. Plus de la moitié des étudiants étrangers inscrits dans les universités françaises en 2003-2004 sont originaires des pays francophones d'Afrique et en particulier du Maroc et de l'Algérie. Le nombre des étudiants des pays d'Asie (hors Moyen-Orient), d'Amérique centrale, d'Amérique du sud et du Pacifique sud a toutefois beaucoup progressé depuis 1998 avec une augmentation de plus de 70 %. En particulier, les étudiants chinois sont près de huit fois plus nombreux à la rentrée 2003 qu'à la rentrée 1998. Le déséquilibre des échanges franco-britanniques On observe un déséquilibre dans les flux d'étudiants entre les deux pays. Il y a environ 10 ans, 6 000 étudiants français étudiaient au Royaume-Uni chaque année et 3000 étudiants britanniques étudiaient en France ; il y a 5 ans le rapport était de 9 000 pour 3 000, et en 2004, le rapport est de 10 000 pour 2 500(18). Ce déséquilibre semble dû principalement à deux facteurs : l'un linguistique, l'autre culturel. Le facteur linguistique : si un nombre important d'étudiants français (et étrangers en général) ont un niveau d'anglais suffisant pour effectuer des études supérieures dans cette langue, l'inverse n'est pas du tout vrai. Traditionnellement, les Britanniques venant étudier en France étaient des spécialistes du français. L'intérêt pour les langues, considérées comme des matières difficiles et non indispensables dans un système qui permet de choisir ses disciplines à la carte, ne cesse de régresser au Royaume-Uni. L'enseignement d'une langue étrangère n'étant plus obligatoire après 14 ans, il faut s'attendre à assister à des chutes d'inscription dans les départements de langue et littérature françaises (et autres langues étrangères) dans les prochaines années.
Un rapport pour l'Observatoire national de la Vie Etudiante (OVE)(19) publié en mars 2003 fournit des informations utiles sur les conditions de vie des étudiants étrangers en France. Les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants étrangers concernent le logement, le financement des études, les démarches administratives, l'accès aux différents services universitaires et sociaux. Si la gratuité constitue l'une des motivations des étudiants pour choisir la France comme pays d'études, la plupart des enquêtes soulignent les difficultés matérielles importantes auxquelles sont confrontés les étudiants étrangers. Le problème du financement des études se situe en tête des préoccupations. Les ressources financières des étudiants maghrébins sont modestes : un tiers d'entre eux vit avec moins de 300 euros par mois, et les deux tiers avec moins de 450 euros par mois(20). Une enquête réalisée en 1998 sur les étudiants de l'université Paris VIII montre que 62 % des étudiants étrangers travaillent contre 52 % des étudiants français. Autre point noir : celui du logement, en particulier en région parisienne. Chaque démarche est vécue comme un véritable parcours du combattant, en raison de la lourdeur et de la rigidité des procédures. Malheureusement, le parcours du combattant ne concerne pas que l'accès au logement, mais toute une série de paperasseries administratives. L'étudiant est soumis aux pesanteurs de la bureaucratie quand il devrait se consacrer pleinement à ses études. Parce que l'internationalisation de l'enseignement supérieur français va de pair avec la comparaison avec les autres systèmes, l'amélioration des conditions de vie et d'étude est une condition sine qua non à l'attractivité de notre pays auprès des étudiants étrangers. Certes, des efforts importants ont été entrepris, mais le retard français est encore loin d'être comblé. Et la France éprouve des difficultés à attirer les meilleurs étudiants étrangers, en raison de conditions d'accueil souvent précaires et du refus fréquent de dispenser certaines formations en langue anglaise. 3) La dualité grandes écoles/universités La distinction entre les grandes écoles et les universités est une particularité du système français d'enseignement supérieur. La Conférence des Grandes Ecoles, association créée en 1973, réunit 215 membres, dont 187 grandes écoles et 28 universités étrangères, organismes ou institutions de l'enseignement supérieur. Ces établissements ne représentent que 5,4 % des effectifs de l'enseignement supérieur mais forment près de 40 % des diplômés à Bac +5. Avec 16 % d'étudiants étrangers, ils affichent un taux d'internationalisation plus élevé que la moyenne de l'enseignement supérieur français (11 %). Les détracteurs des grandes écoles soulignent généralement l'absence de la dualité écoles/universités à l'étranger. En réalité, la spécificité française est ailleurs : elle provient du fait qu'en France, les formations considérées comme les plus exigeantes et sélectionnant les étudiants les plus brillants sont celles des grandes écoles, contrairement aux autres pays où la voie royale est celle des études longues à l'université. Ceci s'explique essentiellement par l'interdiction qui est faite aux universités de sélectionner leurs étudiants. Le processus de Bologne signifie-t-il la disparition, à terme, des classes préparatoires et des grandes écoles ? A première vue, on peut considérer que le schéma 3/5/8 est inadapté aux classes préparatoires qui conduisent les étudiants à Bac +2. Or, les classes préparatoires ne sont pas en elle-même diplômantes, mais devraient donner droit à des crédits européens ; ajoutons également qu'il existe des passerelles avec l'université que le processus de Bologne ne remet nullement en cause. Un autre argument à l'encontre des grandes écoles est celui de l'absence de « taille critique ». Comme le souligne un document de stratégie de la Conférence des Grandes Ecoles(21), l'université de Harvard accueille 20 000 étudiants, l'université nationale de Mexico 200 000 : laquelle est célèbre ? La question est provocatrice parce que la réponse est évidente. On peut toutefois objecter à la Conférence des Grandes Ecoles qu'il existe un différentiel de taille critique entre des promotions de quelques centaines d'étudiants et les 20 000 inscrits à Harvard. Aussi, il ne faut pas rejeter, a priori, toute réflexion sur d'éventuels rapprochements des grandes écoles entre elles, mais aussi de grandes écoles avec certaines universités. L'enjeu est connu : c'est celui d'une plus grande visibilité externe des grandes écoles françaises qui doivent s'affirmer de plain-pied dans l'espace européen d'enseignement supérieur, car nos grandes écoles représentent incontestablement un atout bien davantage qu'un handicap pour la France. La possibilité est reconnue aux grandes écoles (écoles d'ingénieurs, de commerce et de gestion) de délivrer le diplôme de master. Il s'agit là d'un atout indéniable pour ces grandes écoles qui pourront ainsi se prévaloir des standards universitaires européens. A quelques exceptions près, puisque l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, par exemple, n'est pas autorisé à offrir à ses étudiants une sortie diplômante au grade de licence. Quant à la perspective pour les grandes écoles de délivrer un doctorat, les universités y sont généralement très réticentes, et sont attachées à leurs prérogatives au niveau bac +8. Paris IX Dauphine : fac ou grande école ? L'université de gestion Paris IX- Dauphine n'est plus tout à fait une université comme les autres, depuis qu'elle a obtenu le statut de « grand établissement », en février 2004. Ce changement de statut juridique était la condition nécessaire pour lui permettre de poursuivre la sélection de ses étudiants. Chaque année, près de 5 000 dossiers sont examinés pour 800 places en premier cycle. Or, la loi de 1984 interdit la sélection à l'entrée de l'université. Plébiscitée par le conseil d'administration de Paris IX, la réforme a été rejetée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'avis n'était que consultatif et qui n'a donc pas empêché le ministère de passer outre. 4) Le débat sur l'autonomie des universités Le projet de loi de réforme des universités, proposé par M. Luc Ferry, et finalement retiré de l'agenda gouvernemental à la suite des mouvements étudiants de novembre 2003, devait constituer la plus importante révision législative sur les universités depuis la loi Savary de 1984. L'université française est à un tournant. Après avoir franchi avec succès l'étape de la massification de l'enseignement supérieur (de 1,2 million d'étudiants en 1980 à plus de 2 millions aujourd'hui), le défi est désormais qualitatif. Comment libérer les universités de certaines contraintes de gestion - qui nuisent avant tout aux étudiants - tout en restant fidèle aux principes essentiels du service public de l'enseignement supérieur ? La réforme proposée par le Gouvernement proposait notamment : - l'instauration d'un budget global permettant une plus grande marge de manœuvre dans la gestion financière, alors qu'actuellement chaque euro versé par le ministère doit être affecté à une dépense précise ; - le rapprochement des universités avec les collectivités locales ; - la création d'établissements publics de coopération universitaire. Il est frappant de voir à quel point l'idéologie est présente dans le débat français sur la réforme des universités. Ce qui est un lieu commun dans la plupart des pays apparaît en France comme un tabou, un interdit. Il est urgent de dépassionner le débat tout en prenant en compte, bien évidemment, la particularité de notre système national. Mais il serait contre-productif pour nos universités, comme pour l'ensemble des acteurs du système éducatif et pour les décideurs politiques, de se résigner à l'inaction. Il faut cesser de percevoir la concurrence comme une menace lorsqu'elle peut être un gage d'émulation. Une université n'est pas une administration. Rappelons que le service public de l'éducation est, comme tout service public, soumis au principe d'adaptation et notre pays ne pourra faire plus longtemps l'économie d'une réforme en profondeur. Mais une telle réforme devra s'opérer en pleine concertation avec les acteurs universitaires, selon une méthode et avec des objectifs clairement identifiés : permettre à chacun d'accéder à l'enseignement supérieur, délivrer des diplômes reconnus au plan international, dégager de nouveaux moyens financiers et s'assurer d'une évaluation périodique de la réforme. Plus que jamais, l'édification de l'espace européen d'enseignement supérieur constitue un levier de réforme des universités. Mais pour être un succès, cette réforme doit être portée par celles et ceux qui font l'université. L'université doit redevenir l'image de marque de notre pays et un vecteur d'influence, dans une économie fondée sur la connaissance, et prendre toute sa part au rayonnement d'une nouvelle Europe des Lumières. * * * DEUXIEME PARTIE Pourquoi les universités américaines se sont-elles imposées comme un référent mondial ? Comment l'Europe peut-elle, dans ce domaine, aborder la compétition internationale à armes égales ? L'attractivité du « modèle » américain repose en réalité sur une cinquantaine de grandes universités, publiques ou privées, alors que l'on dénombre environ 4 000 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays. Il est bien évident que le système américain ne se résume pas à Harvard ou à Berkeley. Mais la méthode comparative est toujours riche d'enseignements et c'est la raison pour laquelle le rapporteur a souhaité se faire sa propre idée du fonctionnement concret des meilleures universités américaines ; il s'est également rendu au Québec. Gouvernance, financement, recherche, conditions de vie et d'études : quelle réponse les Européens peuvent-ils apporter à ce qui restera le standard international tant que nous ne réagirons pas ? C'est vrai, l'université reflète un modèle de société, des valeurs, une vision. Or l'Europe peut aussi se construire et s'approfondir autour de ses universités, comme elle l'a d'ailleurs fait par le passé. Le système d'enseignement supérieur est la vitrine de l'Amérique, au même titre que Hollywood ; les universités sont un vecteur de la puissance et de la souveraineté des Etats-Unis dans le monde. Il appartient désormais à l'Europe de se donner les moyens de faire entendre sa voix et ses différences. Selon un récent sondage réalisé en 2003-2004 et publié en août 2004 dans la Chronicle of Higher Education, 93 % des personnes interrogées considèrent que les universités font partie des grandes réussites du système américain. Seulement 28 % des sondés souhaitent que l'université encourage les étudiants à suivre des cursus internationaux afin d'acquérir une expérience internationale. La concurrence universitaire est très forte, mais elle concerne essentiellement les universités américaines entre elles ; au point, que le modèle américain s'est imposé, de facto, comme un standard international. Qu'elles soient publiques ou privées, les universités américaines disposent d'une autonomie totale. Très concurrentiel, le système universitaire est soumis aux lois du marché. Il s'agit pour chaque établissement d'être en mesure d'attirer simultanément les meilleurs étudiants, et les meilleurs professeurs. 1) L'application des lois du marché Marques, labels, réputation, stratégies d'alliance et de conquête : ces mots font partie du vocabulaire courant des dirigeants des grandes universités américaines. Rien n'est laissé au hasard, et ce sont de véritables professionnels du marketing qui entretiennent ces renommées mondiales que sont les noms de Berkeley, Harvard, Stanford, Madison, Yale, Princeton et beaucoup d'autres. Une politique de communication appropriée est vitale pour les universités américaines, dès lors qu'elles sont placées en concurrence les unes avec les autres. Sur le marché du travail, un étudiant se prévaut en effet autant du nom de son établissement que du contenu précis de la formation qu'il a reçue. Les universités américaines disposent d'une image et d'une notoriété internationales qui les placent en situation de référent mondial. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à considérer qu'il n'existe pas de modèle américain d'enseignement supérieur, mais un modèle universel qui est incarné par les universités américaines. En tout état de cause, c'est une réalité aujourd'hui incontestable que les universités américaines se trouvent être en position de leader sur le marché mondial de l'enseignement supérieur. Il est d'ailleurs très significatif de constater leur embarras à identifier d'éventuels concurrents à l'extérieur des Etats-Unis, à l'exception toutefois du Royaume-Uni. S'agissant de l'Europe, et plus particulièrement de la France, la seule réponse est bien souvent convenue : la Sorbonne, parce que c'est le seul nom connu ! Quel paradoxe puisque la Sorbonne n'est pas juridiquement une université, mais seulement un bâtiment - ancien et prestigieux et qui renvoie d'ailleurs à l'Europe des Lumières - qui abrite trois universités : Paris I, Paris III et Paris IV. Quelle injustice aussi, pour d'autres universités et grandes écoles qui ne jouissent pas de la marque « Sorbonne » mais dont les formations dispensées sont pourtant d'un excellent niveau. Il existe donc un décalage entre la notoriété d'une université et son niveau, autrement dit entre la perception et la réalité. Non pas que les meilleures universités américaines ne soient pas au plus haut niveau, mais parce que des établissements peu connus peuvent aussi être d'un très bon niveau. Dans ce cas, le marketing apporte une valeur ajoutée substantielle dont il serait dommage de se priver. Chaque année, l'université de Shanghai établit un classement des 500 meilleures universités au monde. Les premières places sont toutes occupées par des établissements américains puisque l'on trouve en haut du podium Harvard, Stanford et Berkeley. Dans l'édition 2004 du classement, la première université européenne arrive toutefois en troisième position, avec Cambridge(22). Et le premier établissement français est Paris VI à la ... 41e place (qui n'est d'ailleurs pas la Sorbonne !), suivi de près par Paris XI en 48e position. Nos grandes écoles font pâle figure : Normale Sup' est à la 85e place, Polytechnique à la 202e (derrière Bordeaux I et Bordeaux II), l'Ecole des Mines à la 302e place, ex-æquo avec Paris IX Dauphine, pourtant considérée comme la meilleure université française en économie et en gestion. Il n'y a que quatre établissements français dans les cent premières places, et seulement deux dans les cinquante premières. En revanche, 17 universités américaines feraient partie des vingt meilleures au monde. Pourquoi les universités européennes, et en particulier françaises, sont-elles si mal classées dans les palmarès internationaux ? Cela tient en grande partie aux critères retenus pour évaluer chaque établissement : - le nombre de lauréats du prix Nobel ; - le nombre de chercheurs de haut niveau ; - le nombre d'articles publiés dans les revues Nature et Science ; - le nombre de citations des articles publiés. La langue anglaise comme standard international de publication avantage incontestablement les universités anglo-saxonnes. Toutefois, on remarque que les établissements les mieux classés disposent d'un potentiel de recherche significativement supérieur à celui des établissements non classés. On observe également que les universités recensées ont généralement une taille critique comprise entre 10 000 et 30 000 étudiants et un corps d'enseignants chercheurs permanents généralement supérieur à 1 000. Si la méthodologie utilisée pour élaborer ce classement peut se révéler discutable, il faut toutefois être lucide sur les raisons objectives qui conduisent à la mauvaise performance française : l'insuffisance chronique des moyens alloués à la recherche, l'interdiction de sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université, le cloisonnement entre universités et grandes écoles et l'émiettement excessif des universités : quatre pour la seule ville de Bordeaux ! Même si le classement de Shanghai peut paraître injuste à bien des égards, il souligne d'incontestables tendances et valide, a contrario, la stratégie des universités anglo-saxonnes, qui vise à attirer simultanément les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs. 2) Attirer les meilleurs étudiants... Aux Etats-Unis, chaque université est libre de sélectionner ses étudiants. Il n'existe donc aucune garantie pour un étudiant américain d'être accepté dans l'université de son choix et il n'est pas rare d'être obligé de traverser le pays pour s'inscrire à la fac. Après leurs études secondaires, les étudiants postulent auprès de plusieurs universités publiques ou privées qui sélectionnent les candidats en fonction de leurs résultats scolaires. Il existe une batterie de tests fédéraux, dont le plus connu est le SAT, qui évaluent les compétences des postulants. Les universités les plus prestigieuses requièrent des scores très élevés (à partir de 90 ou même 95/100 au SAT pour Harvard, Yale ou l'université de Chicago). Une sélection s'opère ainsi à l'entrée des universités selon leur degré d'exigence, lui-même établi sur leur notoriété. La plupart du temps, il n'est pas seulement tenu compte du niveau académique des candidats, mais aussi plus largement de leur personnalité et de leurs centres d'intérêt, qu'ils soient d'ordre sportif, associatif ou culturel, et de leurs éventuelles réalisations personnelles dans ces domaines. Il existe ainsi un quota d'athlètes de haut niveau qui peuvent s'inscrire dans des universités prestigieuses, alors que leur niveau académique seul ne le leur permettrait pas. A l'université de Columbia, on recense près d'une centaine d'athlètes sur les 1500 étudiants inscrits en premier cycle. En effet, la notoriété d'une université repose aussi sur ses équipes sportives et sur les résultats obtenus lors des compétitions inter universitaires. L'organisation de l'enseignement supérieur aux Etats-Unis Il existe environ 4 200 universités et colleges aux Etats-Unis (dont environ 1 700 publics et 2 500 privés) qui accueillent plus de 14 millions d'étudiants. L'enseignement supérieur emploie environ 2 % de la force de travail des Etats-Unis. Un système décentralisé et diversifié A la différence du système français, l'enseignement supérieur américain est fortement décentralisé. Les établissements universitaires jouissent d'une très large autonomie dans l'organisation des programmes, le choix des méthodes d'enseignement, le recrutement des enseignants et le régime des examens. Le système américain est très diversifié. Les institutions diffèrent selon les objectifs de l'éducation (à but académique ou professionnel), les structures de l'organisation et le mode de financement (public/privé). Il existe des établissements universitaires publics contrôlés par les Etats et des établissements privés parfois dépendants d'églises ou d'associations diverses. Les universités publiques (state universities ou public universities) ont été fondées et sont subventionnées par les gouvernements des différents Etats fédérés (Californie, Michigan, Texas, par exemple) afin d'assurer une éducation abordable aux résidents de l'Etat. Plus des trois quarts des étudiants sont inscrits dans une université publique. Dans le système américain, un college est une institution d'éducation supérieure qui offre des cours dans un domaine spécialisé sur une durée de quatre ans. La plupart des colleges sont indépendants et sanctionnent la scolarité par la délivrance d'un bachelor's degree (Ba, Bs, Bfa). Les étudiants qui ont achevé leurs études secondaires et qui suivent des cours dans un college ou une université sans être encore titulaires d'un diplôme supérieur s'appellent undergraduates. Un programme graduate est un cycle d'études pour les titulaires d'un bachelor's degree. Cependant, pour une large majorité des étudiants, le bachelor est le dernier diplôme de leur formation académique. Une grande université intègre globalement plusieurs undergraduate colleges ou écoles préparant au bachelor's degree, une faculté graduate de lettres et de sciences (graduate schools) et des écoles graduate enseignant les professions libérales (professional schools). Les graduate schools font le plus souvent partie de l'université, mais il arrive qu'elles constituent des établissements séparés. Leurs programmes de deuxième ou troisième cycle préparent au master's degree - (Master of Arts (MA) ou Master of Science (MS) et au doctor of philosophy - Ph.D. ou doctor of education - Ed.D. Le Ph. D. est le diplôme universitaire le plus élevé conféré par une université aux étudiants qui ont effectué au moins trois années d'études graduate après le bachelor's et/ou le master's degree et qui ont fourni la preuve de leur compétence au cours d'examens oraux et écrits, avant de présenter une thèse sur un sujet original exigeant une recherche personnelle. Les professional schools sont des établissements spécialisés dans l'enseignement d'une seule discipline (médecine, dentaire, droit, pharmacie, gestion, etc.), offrant des diplômes spécialisés comme le Master of Business Administration (MBA). La durée des études varie selon les professions et comporte parfois une période d'internat (comme en médecine). Les Community colleges ou junior colleges sont des institutions d'enseignement supérieur publiques ou privées qui délivrent des diplômes très professionnalisés. Ces établissements proposent des cycles d'une durée maximale de deux ans aboutissant à un associate degree en lettres ou en sciences (A.A. ou A.S. - Associate in Arts ou Associate in Science), qui correspond approximativement aux BTS/DUT/DEUG français, ou à un diplôme technique. Le transfert des U.V. dans un établissement préparant au bachelor's degree est généralement possible. Un diplôme d'études secondaires (High school) ou son équivalent est nécessaire pour s'inscrire dans ces Community colleges. Les institutes of technology sont semblables à des universités mais se consacrent à l'étude des sciences et de la technologie uniquement. La réputation est ainsi liée à la forte sélectivité : par exemple, 1 000 places offertes à l'entrée du « college » de Columbia (New-York) pour l5 000 demandes. A Berkeley (université de Californie), seulement 17 % des candidats ont été retenus pour s'inscrire en Graduate studies en 2003-2004. Face au niveau élevé des droits d'inscription, les universités américaines n'hésitent pas à surenchérir pour attirer les meilleurs étudiants en proposant, le cas échéant, des bourses (« grants ») qui permettent une exonération partielle ou totale des frais d'inscription. Les universités américaines recherchent des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Les premiers cycles (undergraduate) sont d'ailleurs sensiblement moins spécialisés qu'en Europe, et les passerelles d'une discipline à l'autre sont facilitées. Au cours du cycle undergraduate, les études demeurent en effet assez générales et permettent aux étudiants américains, d'un niveau moyen généralement moins élevé que les étudiants européens à l'issue des études secondaires, de préciser leur orientation universitaire. Pour avoir observé de près le système universitaire européen, notamment en Allemagne, la doyenne des études de premier cycle du college de Columbia, Mme Kathryn Atrakis, souligne que les étudiants américains sont moins bien formés que les Européens pendant leurs études secondaires, c'est-à-dire au lycée. En revanche, ils rattrapent leur retard académique dans les premiers cycles universitaires américains tandis que les Européens, qui ont pourtant une longueur d'avance sur les étudiants américains au moment de leur entrée dans le supérieur, progressent moins rapidement dans leurs premiers cycles universitaires. b) A la conquête des meilleurs étudiants étrangers Les étudiants étrangers représentent la clé de voûte de la réussite du système américain d'enseignement supérieur. Leur présence concerne essentiellement les graduate studies. Toutefois, le nombre d'étudiants inscrits dans les universités américaines a reculé durant l'année universitaire 2003-2004, pour la première fois depuis 1971-1972, selon une étude de l'Institut de l'enseignement international (IIE)(23). Cette baisse, attribuée partiellement au renforcement des contrôles d'immigration, est évaluée à 2,4 %, portant le nombre d'étudiants étrangers à 572 509. Le nombre d'étudiants d'origine moyen-orientale a continué à reculer de façon importante, de 9 %, après avoir reculé de 10 % l'année précédente. Celui des Européens a baissé de 5 %. Selon les dernières statistiques publiées par la Chronicle of Higher Education le 27 août 2004, 586 323 étudiants étrangers sont inscrits dans les universités américaines, ce qui représente 4,6 % de la population étudiante du pays. Les pays les plus représentés sont l'Inde (74 603 étudiants, en hausse de 11,6 % sur un an), la Chine (64 757), la Corée du Sud (51 519), le Japon (45 960) et Taiwan (28 017). Les diminutions d'effectifs les plus importantes concernent, sans surprise depuis le 11 septembre 2001, les étudiants en provenance des pays musulmans, en raison de contrôles d'entrée extrêmement sévères. Parmi les baisses les plus spectaculaires, il faut mentionner l'Arabie Saoudite (4 175 étudiants 2003, en baisse de 25 %), la Malaisie (6 595 étudiants en 2003, en baisse de 10,8 %) et le Pakistan (8 123 étudiants en 2003, en baisse de 6 %). Les cinq universités qui, en valeur absolue, ont recruté le plus d'étudiants étrangers au cours de l'année 2002-2003, en tenant compte des restrictions d'entrée aux Etats-Unis et du Homeland Security Act sont : 1. University of Southern California (privée) avec 6 270 étudiants étrangers, soit 20 % des effectifs du campus ; 2. NYU (privée) avec 5 454 étrangers, soit 14 % des effectifs du campus ; 3. Columbia (privée) avec 5 148 étrangers, soit 22 % des effectifs ; 4. Purdue à Indianapolis (publique) avec 5 105 étrangers, soit 13 % des effectifs ; 5. University of Texas à Austin (publique) avec 4 926 étrangers, soit 9 % du campus. En valeur relative, le classement est différent. La plupart des centres d'excellence reposent sur l'afflux des meilleurs étudiants de la planète, et plus particulièrement en provenance d'Asie. Ainsi à Stanford, 33 % des étudiants en graduate studies sont étrangers parmi lesquels on dénombre 57 % d'Asiatiques et 17 % d'Européens. Depuis le 11 septembre 2001, les conditions d'accueil des étudiants étrangers sont devenues de plus en plus difficiles. Nombreux sont les cas d'étudiants admis dans une université américaine mais qui n'obtiennent pas de visa d'entrée aux Etats-Unis. Le nombre de demandes de visas étudiants a diminué d'un quart en 2003, passant de 381 000 en 2002 à 289 000. Les universitaires sont préoccupés par cette politique restrictive qui fragilise l'architecture du système. Le classement mondial des Masters of Business Administration (MBA), paru le 22 septembre 2004 dans le Wall Street Journal a confirmé cette crainte : pour la première fois, quatre MBA européens figurent parmi les cinq programmes les plus appréciés des entreprises, le MIT n'arrivant qu'en cinquième position. Autre signe : le nombre de candidats étrangers au GMAT (le test d'admission en MBA) est en baisse de 13 % par rapport au premier semestre 2003. 3) ... et les meilleurs professeurs Les enseignants de l'université sont titulaires ou contractuels. Chaque université recrute ses enseignants-chercheurs par appels d'offres au niveau national ou international. La mobilité des enseignants est encouragée et il est assez mal vu, voire impossible, d'accomplir l'intégralité de sa carrière dans la même université. Il n'existe pas ou peu de titularisation suite à l'embauche d'un enseignant, non associate professor ou full professor, par une université. Les jeunes enseignants en début de carrière doivent faire leurs preuves et la route vers la titularisation est longue et semée d'obstacles. La procédure de titularisation (« tenure ») commence généralement au cours de la sixième année d'emploi à l'université. Le candidat est évalué sur la qualité de son enseignement, de sa recherche et sur le « service », c'est-à-dire notamment sa disponibilité auprès des étudiants et son activité au sein de son département. Des lettres de recommandation de trois à six membres de la communauté universitaire en dehors de l'université sont également requises, évaluant l'impact de la recherche de l'enseignant et la pertinence de sa candidature à la titularisation. Une fois titularisé, le « tenured faculty member » devient un enseignant titulaire à vie. Il peut toutefois être mis fin à la titularisation pour faute grave, incompétence ou harcèlement sexuel (!), mais aussi du simple fait de la fermeture d'un département de recherche. Les différents grades d'enseignants : - Lecturer : il enseigne mais fait peu, ou pas, de recherche. Il n'est en général pas éligible à la titularisation par ses pairs. Toutefois, l'Association américaine des professeurs d'université lui reconnaît en pratique un droit à être éligible à la procédure de titularisation après sept ans. Les universités renouvellent régulièrement leur « lecturers » ou les considèrent comme des permanents avec une titularisation de facto. - Assistant Professor : c'est le premier grade du statut du corps enseignant dans une université. Un Assistant Professor est recruté directement après son doctorat ou après un ou plusieurs séjours post-doctoraux pour un contrat de travail de trois ans renouvelable une fois. Au cours de la sixième année, il est évalué pour la titularisation et la promotion à un poste d'Associate professor, selon le principe promu ou renvoyé (« up or out »). - Associate Professor : deuxième grade du statut du corps enseignant dans une université ; on le devient après avoir été Assistant Professor. L'accession à ce grade est le plus souvent liée à la tenure, mais il se peut qu'un universitaire expérimenté soit engagé comme Associate professor sans titularisation. Dans ce cas, il doit passer par la procédure de titularisation. - Professor ou Full Professor : il s'agit d'un universitaire très qualifié dans son domaine de spécialité. La procédure pour passer de Associate Professor à Full Professor est plus exigeante que pour passer de Assistant Professor à Associate Professor. Les universitaires engagés directement comme Full Professor obtiennent en général la titularisation. ¬ Des salaires fixés librement La réputation et les frais de scolarité ont une influence directe sur les salaires des enseignants. Les salaires particulièrement élevés offerts par les meilleures universités attirent les meilleurs professeurs. Les négociations à l'embauche portent non seulement sur un crédit d'installation, mais aussi sur le salaire et les ressources qui peuvent intervenir ultérieurement dans le cadre de leurs contrats de recherche. Des variations importantes de salaire existent à l'intérieur même d'un établissement donné, qui résultent des politiques des universités ou des campus d'une même université pour attirer et retenir les meilleurs enseignants-chercheurs. Ainsi, à l'université de Columbia, l'échelle des salaires proposés irait, selon les informations du rapporteur, de 60 000 dollars à 300 000 dollars(24), versés sur neuf mois, ce qui correspond à la durée de l'année universitaire. Cela signifie que les enseignants recherchent souvent d'autres enseignements pour les trois mois restants (la période estivale) sur contrats provenant d'une source publique ou privée. Les universités n'hésitent pas à surenchérir pour attirer les meilleurs enseignants, sur un marché totalement concurrentiel. Il n'existe pas d'âge de la retraite pour les enseignants, et M. Henry Pinkham, le doyen des études de troisième cycle de l'université de Columbia, fait remarquer que de nombreux Européens ayant atteint la limite d'âge dans leurs systèmes universitaires nationaux s'installent aux Etats-Unis pour y poursuivre leurs travaux d'enseignement et de recherche. Une autre différence est la possibilité qu'ont les universitaires de prendre une année sabbatique tous les sept ans, au cours de laquelle ils peuvent toucher 50 % de leur salaire. Le palmares des prix nobels 1939 : Ernest O. Lawrence (Physique) : invention et développement du cyclotron 1994 : John C. Harsanyi (Economie) 2001 : George A. Akerlof (Economie) Les principaux facteurs de l'attractivité des universités américaines sont, pour l'essentiel, l'importance des moyens financiers, la qualité des conditions de vie et d'étude ainsi que la performance de l'organisation de la recherche et des transferts de technologie. 1) Des moyens financiers importants a) L'inégalité budgétaire entre les universités Les universités américaines, qu'elles soient publiques ou privées, bénéficient de moyens financiers sensiblement plus importants que ceux dont disposent les universités européennes. Mais il serait périlleux d'essayer de fournir des données générales sur l'équilibre du budget des établissements d'enseignement supérieur américains publics et privés, tant les différences se révèlent grandes d'une université à l'autre. Contrairement à une idée souvent répandue, l'enseignement supérieur américain est dominé par les institutions publiques, tandis que les financements sont, eux, majoritairement privés. Plus des trois-quarts des étudiants américains sont en effet inscrits dans des institutions publiques d'enseignement supérieur qui dépendent de l'Etat, du county ou de la ville. Ces institutions ne dépendent pas du Département de l'Education au niveau fédéral ; il n'existe d'ailleurs pas de budget fédéral de l'enseignement supérieur. S'agissant des universités d'excellence américaines, le montant des budgets est sans commune mesure avec la situation des universités françaises. Les budgets annuels de Harvard et de Stanford (universités privées) sont d'environ 2 milliards de dollars. Celui de Madison (université publique) est de 1,8 milliard tandis que le budget annuel de Berkeley, également publique, est de 1,3 milliard de dollars. Ceci relativise donc la distinction entre le public et le privé. On assiste toutefois depuis quelques années à une diminution sensible du financement public. Alors que les universités publiques étaient jusqu'à présent financées en moyenne à concurrence d'environ 40 % par leur Etat d'appartenance, ces institutions subissent actuellement des coupes budgétaires importantes qui les conduisent à augmenter significativement leurs droits de scolarité(25). Ainsi, l'université de Madison a subi une coupe de 25 % et la part de l'Etat du Wisconsin est ainsi passée sous la barre des 25 %. Berkeley a pour sa part perdu 352 millions de dollars de fonds publics en 2003 et doit de plus en plus se tourner vers des donateurs privés. Les universités précitées sont clairement parmi les mieux dotées des Etats-Unis ; mais c'est bien par rapport à elles que doit se positionner l'Union européenne pour développer des pôles de compétence qui puissent être concurrentiels à l'échelle de la planète. L'analyse des budgets des universités américaines fait rapidement apparaître la diversité des sources de financement, qui conduit à une convergence entre les universités publiques et privées. b) Des sources de financement diversifiées Outre les subventions publiques, on peut distinguer trois sources principales de financement : les frais d'inscription, les dons et les revenus mobiliers. C'est là que réside la vraie différence avec la plupart des pays européens qui pratiquent la quasi-gratuité des études supérieures. Aux Etats-Unis, même dans les universités publiques, les études sont payantes. Cela constitue pour beaucoup la principale limite du modèle américain. Des chiffres moyens sur l'ensemble des établissements publics d'une part et sur tous les établissements privés d'autre part montrent qu'en moyenne, les droits d'inscription représentent environ 20 % des recettes de l'établissement s'il est public et près de 40 % s'il est privé. Pour une année au niveau undergraduate, les frais de scolarité varient considérablement d'un établissement à l'autre, allant de 1 000 dollars à plus de 30 000 dollars par an. A ces frais de scolarité stricto sensu, il faut ajouter des frais annexes (logement, nourriture, fournitures scolaires, etc.) qui représentent des sommes importantes, mais d'un montant relativement variable d'un endroit à l'autre. Pour un étudiant graduate à New York University, il faut compter près de 60 000 dollars par an, tous frais compris. En pratique, il convient néanmoins de préciser que 70 % des étudiants reçoivent d'une façon ou d'une autre une aide financière pour couvrir tout ou partie de leurs frais. Aux Etats-Unis, les aides aux étudiants représentent, toutes universités confondues, près de 68 milliards de dollars par an sous forme de prêts de long terme et à bas taux d'intérêt, ou bien sous forme de bourses obtenues au mérite ou sur critères de sélection variés. Ainsi au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 72 % des étudiants undergraduate ont reçu une aide financière, à un titre ou à un autre, au cours de l'année universitaire 2002-2003. Des emplois existent également au sein même de l'université, qui permettent à un étudiant de travailler pour l'université (à la cafétéria, à la bibliothèque ou encore dans une résidence étudiante) pour réduire le montant de ses droits de scolarité. Dès lors, le système est-il juste ou injuste ? Le montant des droits de scolarité est-il un frein à l'accès à l'enseignement supérieur ? La réponse à ces questions doit être nuancée et argumentée. Il ressort des nombreux entretiens menés par le rapporteur qu'un bon étudiant pourra toujours accéder aux meilleures universités qui prendront en charge, en partie voire en totalité, ses frais de scolarité. Il y a une volonté affichée de permettre à n'importe quel étudiant, quelle que soit sa situation sociale, d'accéder aux meilleures universités, si son niveau scolaire le justifie. En outre, le coût des études n'est pas un frein à la démocratisation puisqu'aux Etats-Unis, selon des données publiées par l'OCDE, 64 % des jeunes ayant l'âge d'entrer à l'université entreprennent des études supérieures dans les filières générales, contre seulement 37% en France. Il faut relever qu'une partie importante des étudiants américains sont inscrits dans les Community Colleges qui proposent des filières courtes professionnalisantes(26). Derrière ces statistiques, il ne faut toutefois pas sous-estimer la dimension sociale qui favorise les étudiants ayant accompli leurs études secondaires dans une High School réputée, souvent privée et donc payante. Il faut également souligner la difficulté que peuvent avoir les étudiants de la classe moyenne qui ne sont souvent pas éligibles aux aides financières. Il est fréquent que les familles contractent, dès la naissance de leur enfant, un prêt pour financer ses futures études supérieures. Toutefois, la comparaison avec la quasi-gratuité du système français doit également être relativisée, dans la mesure où demeure en France un important phénomène de reproduction sociale au sein de l'université. Qui plus est, le principe de sectorisation géographique pour l'entrée à l'université n'incite guère à la mixité sociale. Des droits d'inscription différenciés selon l'origine géographique : l'exemple québécois S'agissant plus particulièrement des universités publiques, un étudiant versera des droits d'inscription plus élevés s'il n'est pas résident dans l'Etat où se situe l'université. Cette modulation tarifaire selon l'origine géographique n'est pas spécifique aux Etats-Unis ; on la retrouve notamment au Québec où il existe trois catégories de droits de scolarité : (2) Les dons : le "fund raising" La levée de fonds est une particularité du système américain. Les réseaux d'anciens - les Alumni -(27) sont très structurés et font partie de la culture américaine(28). Un ancien étudiant est fier de l'université dont il est diplômé, et sera enclin, une fois entré dans la vie active, à contribuer à son financement. D'une certaine façon, il en va de la pérennité de la valeur de son diplôme et de sa « monétisation » sur le marché du travail. Une ou plusieurs fois par an, des réunions d'anciens sont ainsi organisées sur le campus. Ces « welcome back » rassemblent sans difficulté des étudiants diplômés il y a fort longtemps ; ainsi, à Berkeley, la promotion 1954 est-elle venue en nombre pour célébrer festivement son 50e anniversaire. Ce fut aussi l'occasion pour l'université de collecter des fonds. Cette tradition existe aussi au Canada, par exemple, à l'université anglophone McGill, qui organise des événements similaires. En pratique, des fondations se constituent, indépendantes de l'université pour laquelle elles collectent des fonds. A l'université de Madison, par exemple, la Wisconsin Alumni Association a collecté 1,7 milliard de dollars de dons depuis 60 ans, et 145 millions de dollars pour la seule année 2003. 120 personnes sont mobilisées à plein temps dans l'activité de fund raising auxquelles il faut ajouter une quarantaine d'étudiants qui font chaque soir du marketing téléphonique auprès des diplômés de l'université. Environ 14 %(29) des anciens élèves effectuent un don moyen d'une centaine de dollars par an. Les financements proviennent essentiellement de dons particuliers - bien davantage que d'entreprises - et plus particulièrement de quelques dons d'un montant très élevé. Un sénateur du Wisconsin a ainsi offert 60 millions de dollars pour la construction d'une salle de basket. Selon des chiffres publiés par le Council for Aid to Education, les dix universités dont l'activité de levée de fonds a attiré le plus de donations en 2002-2003 sont : Le palmares des donations 2002-2003 1- Harvard University : 555 639 350 dollars Le don privé le plus important depuis 1967 est celui de Bill et Melinda Gates au Gates Millenium Scholars Program : un milliard de dollars, promis en 1999 et en cours de versement. Ce fonds est destiné à offrir une aide financière à de jeunes Américains issus de minorités ethniques, désireux de suivre un cursus undergraduate dans quelque matière que ce soit, ou graduate dans les matières suivantes : mathématiques, sciences de l'ingénieur, sciences de l'éducation ou documentation. Mais il ne s'agit pas de leur unique don, puisqu'ils ont aussi financé Stanford et Cambridge. Les universités américaines disposent d'un capital financier (endowment) qui est placé et produit des intérêts. Pour certaines universités, ce capital atteint un montant considérable. Ainsi, il est évalué à Harvard à plus de 22 milliards de dollars, ce qui produit un revenu annuel d'environ 700 millions de dollars. Le classement des dix premiers fonds 11- Harvard University : 22,8 milliards de dollars 12- Yale University : 11,3 milliards de dollars 13- Princeton University : 8,7 milliards de dollars 14- Texas University : 8,7 milliards de dollars 15- Stanford University : 8,6 milliards de dollars 16- MIT : 5,1 milliards de dollars 17- University of California : 4,3 milliards de dollars 18- Columbia University : 4,3 milliards de dollars 19- Emory University : 4,2 milliards de dollars 20- University of Texas (Austin) : 3,8 milliards de dollars 2) Les conditions de vie et d'étude des étudiants La qualité des conditions de vie et d'études représente un atout considérable. Les campus américains bénéficient d'une notoriété planétaire qui constitue un facteur déterminant de l'attractivité des universités. Trois aspects en particuliers méritent d'être soulignés : les relations entre étudiants et professeurs, les équipements des campus ainsi que la vie sociale et sportive. Il s'agit là d'une contrepartie significative du niveau élevé des frais de scolarité. a) Les relations entre étudiants et professeurs La disponibilité et l'accessibilité des enseignants sont très appréciées des étudiants qui peuvent facilement dialoguer (directement ou par échange de courriers électroniques) avec leurs professeurs. Chaque enseignant doit en effet effectuer des « office hours » (en général, au moins deux heures par semaine) pendant lesquelles les étudiants peuvent venir librement poser des questions ou discuter de leurs projets de recherche. A côté des cours en amphithéâtre, les enseignements sont la plupart du temps dispensés dans le cadre de séminaires interactifs en petit nombre. Les sites web des universités permettent d'accéder à toutes sortes d'informations concernant la faculté, l'organisation de conférences, les curriculum vitae des professeurs, la date des examens, des offres d'emploi, etc. Rendre service aux étudiants et leur éviter de perdre du temps dans les tracasseries administratives : tout est fait pour qu'ils se consacrent à leurs études. Accessible avec un mot de passe, le site Intranet permet également de télécharger les plans de cours et de nombreux documents de travail. b) Les équipements sur les campus Les campus américains sont de véritables villes dans la ville. Ainsi, le campus stricto sensu de l'université de Madison s'étend sur 380 hectares, mais si on y ajoute l'arboretum, la ferme expérimentale et diverses propriétés appartenant à l'université, on atteint 4 300 hectares, soit environ 40 % de la superficie de la ville de Paris ! Les infrastructures sont sans commune mesure avec celles des universités européennes : terrains de sports, piscines, théâtres, cinémas, golfs, bases nautiques, musées, parcs... L'arrivée sur le campus de Stanford fait davantage penser à un club de vacances de luxe qu'à une université. On peut notamment y découvrir la deuxième collection la plus importante aux monde de sculptures de Rodin, après le musée Rodin à Paris. Quant au stade de Berkeley, avec 80 000 places, il est aussi grand que le Stade de France. Sur la côte Est, le MIT a pour sa part récemment inauguré un nouveau bâtiment signé de l'architecte Frank Gehry, lauréat du prix Pritzker, la plus haute récompense mondiale dans le domaine de l'architecture. Les bibliothèques universitaires offrent un cadre d'étude sans équivalent. Dans le classement des bibliothèques de recherche affiliées à l'Association nord-américaine des bibliothèques de recherche, la moins bien classée (Institut de technologie de Géorgie, au 108e rang) possède tout de même 1,8 million d'ouvrages et plus de 11 000 périodiques ! Mais surtout, l'accès y est quasi permanent, avec des horaires d'ouverture de 7h le matin à 23h le soir, et même parfois 24h/24h en période d'examen ...week-end compris. Un étudiant peut sans difficulté s'occuper 24h/24h en restant sur le campus, et les valeurs culturelles et sportives sont très présentes dans la vie quotidienne. Le football américain, le basket-ball ou le base-ball occupent une place prépondérante dans la vie de nombreux étudiants, et les grandes universités américaines, notamment celles de la Ivy League, ont même instauré des quotas pour recruter des athlètes de haut niveau. Car les équipes sportives font la fierté des universités, et les tournois universitaires jouissent d'une notoriété à travers tout le pays. Au niveau culturel, il est frappant d'observer le nombre et la qualité des journaux universitaires, généralement réalisés quotidiennement par des étudiants bénévoles. « The Harvard Crimson », « The Stanford Report », « The Daily Columbia Spectator », « The Badger Herald », etc. : le niveau de professionnalisme de ces publications est un indicateur supplémentaire de la puissance des universités dans la société américaine. D'une façon générale, la vie associative et sportive est facilitée par la notion même de campus, qui nous est moins familière en Europe. Nombre d'universités américaines sont situées à l'extérieur des villes, ce qui permet souvent aux étudiants (et parfois aussi aux professeurs) de vivre au sein d'une même communauté. 3) L'organisation de la recherche et les transferts de technologie a) Le statut des enseignants-chercheurs et l'attractivité des carrières Ainsi que l'indique mon collègue Daniel Garrigue dans son rapport d'information sur les nouveaux enjeux de la recherche publique(30), le statut des chercheurs (doctorants et post-doctorants) se caractérise, outre-Atlantique, par la très forte proportion de contrats à durée déterminée (généralement de trois à cinq ans) et l'accès difficile à un poste de chercheur permanent. Mais l'attractivité des carrières est réelle : autonomie, moyens financiers et techniques importants et rémunérations élevées. Les universités rivalisent pour attirer les meilleurs jeunes chercheurs, notamment étrangers. Par exemple, la plupart des étudiants graduate des grands campus du Midwest bénéficient, en sciences, ingénierie ou agriculture(31), d'un research assistantship ou stipend (rémunération) et d'un tuition waivers (prise en charge des frais élevés d'inscription sur crédits du professeur ou du chercheur avec lequel l'étudiant va travailler). Cela signifie qu'à partir du Master's degree, la préparation d'un diplôme en sciences ou ingénierie peut ne rien coûter à un étudiant prêt à travailler pour un professeur. Au contraire, il reçoit même un salaire. Dans le débat chronique sur la fuite des cerveaux vers les Etats-Unis, c'est l'attractivité des carrières qui est généralement invoquée. Davantage de moyens et beaucoup plus de liberté : voici donc les principales différences qu'analyse M. Eric Feron, polytechnicien et professeur français au MIT depuis douze ans : Quels sont les avantages compétitifs offerts aux Etats-Unis à un chercheur français ? Les avantages que je perçois aux Etats-Unis sont une grande liberté d'entreprendre ce qui semble bon au professeur d'université, sans devoir le soumettre à un examen approfondi et à une approbation par quelque autorité que ce soit (la signature de propositions de recherche reste, néanmoins, sujette à l'approbation du chef de département ou de laboratoire). Sur les cinquante ou soixante propositions de recherche que j'ai écrites, seulement deux (dont ma première proposition) ont fait l'objet de l'examen préalable de leur contenu scientifique par d'autres individus que moi-même, avant soumission auprès des organismes de financement. Il s'agit donc d'un système très décentralisé et compétitif, où l'impression vis-à-vis du chercheur débutant est a priori celle d'un individu responsable et conséquemment très libre de ses choix. En général, le principe organisateur de l'université américaine est très proche de celui des Etats-Unis tout entiers, tels que décrits dans De la démocratie en Amérique par Tocqueville. Ce principe est celui de la délégation des pouvoirs et la décentralisation très forte des responsabilités, cependant que chaque université y apporte des nuances, en fonction de son statut (public ou privé), et de son histoire. Un tel système m'a permis de monter un ensemble d'activités portant sur les technologies de l'information dans le domaine aéronautique assez complexe qu'il m'aurait été probablement très difficile de réaliser hors des Etats-Unis. Un professeur français aux Etats-Unis a-t-il un intérêt à rentrer en France ? Cela dépend des cas. En ce qui me concerne, rentrer en France serait une solution attirante, si le cadre administratif offert était comparable aux Etats-Unis, et s'il était véritablement ouvert à l'ensemble de la collectivité "recherche". Or, il me semble que un retour en France à un niveau professionnel égal se heurterait très probablement à des difficultés administratives sérieuses (mode de fonctionnement différent, mais pas inefficace pour autant - simplement différent) - Ce retour se heurterait aussi très probablement à des difficultés humaines très fortes (complexe du "parachuté"). Le coût du rapatriement réussi de chercheurs français à l'étranger doit donc nécessairement compter le coût d'aplanissement de ces difficultés, qui est probablement très élevé. Je suis avec attention l'initiative française de décerner des bourses d'excellence à des chercheurs français revenant de l'étranger pour venir travailler en France. Un autre frein possible au retour d'un Français des Etats-Unis est la portée sociale et le respect portés au professeur dans le système américain. On a du mal à imaginer un professeur français d'université présider à la destinée d'ensembles administratifs majeurs autres que ceux intimement liés à la recherche (détachements au ministère de l'éducation, par exemple). C'est pourtant ce qui fut le cas au cours des années 1990 aux Etats-Unis (Sheila Widnall, professeur dans le département d'aéronautique et astronautique au MIT, fut aussi le secrétaire de l'Air Force, et John Deutsch, de la même institution, fut directeur de la CIA - L'administrateur actuel de la NASA est aussi issu du monde universitaire). Alors que fort peu de professeurs désirent ou peuvent accéder à de telles fonctions, il est clair qu'une telle présence, continue et dense, dans les sphères les plus élevées de l'Etat confère à la profession un sentiment de fierté, de respect, et de participation à la vie de la nation bien plus fort qu'en France. Ce respect à l'égard des professeurs exerçant aux Etats-Unis vient aussi des médias français! La présence de professeurs français aux Etats-Unis est-elle une chose indésirable? Je crois que non. En effet, cette présence résulte d'un mécanisme concurrentiel très simple, qui permet à son tour aux responsables français d'obtenir des informations précieuses sur le fonctionnement de la recherche dans les pays concurrents. En particulier, je pense que beaucoup de membres français du corps enseignant américain sont très disposés à communiquer leurs expériences à l'étranger. Quelle est votre perception sur la recherche française en comparaison à la recherche américaine dans votre domaine d'activité (aéronautique et astronautique)? Je pense que la recherche française dans ce domaine n'a rien à envier à celle des Etats-Unis. La France dispose d'un complexe de recherche très riche et très performant dans ce domaine, en particulier dans la région toulousaine, la région parisienne mais aussi dans le Lyonnais (Ecole Centrale de Lyon) et ailleurs. Néanmoins, je ne sais pas quelle est la capacité de ces établissements de recherche à prendre des initiatives où le risque et les bénéfices potentiels sont élevés. Malgré l'inertie et la lenteur caractéristique moyennes des recherches sur des sujets aussi sensibles aux problèmes de sécurité que l'aviation ou l'espace, il reste toujours aux Etats-Unis la possibilité de jouer sur des registres très risqués et spéculatifs. b) Le financement de la recherche : le poids du financement fédéral Avec 60 % du financement de la dépense en R&D des universités américaines, la part du gouvernement fédéral est déterminante. Les dépenses de la R&D universitaire sont majoritairement orientées vers la recherche fondamentale (69 %). 24 % sont consacrées à la recherche appliquée et 7 % au développement. Le poids de la R&D exécutée dans les universités américaines (30 à 35 milliards de dollars par an) représente 11 % de l'effort national de R&D. Environ 60 % des dépenses de recherche des universités américaines sont financées par le gouvernement fédéral. Mais la quasi-totalité des crédits fédéraux est concentrée sur seulement 200 universités tandis que 60 % des sommes ainsi versées le sont à des institutions publiques. Toutefois, l'importance de la part des crédits fédéraux dans le financement de la recherche relativise la distinction entre universités publiques et privées, comme l'illustre le tableau ci-après : Part des crédits fédéraux dans le budget total de R&D de quelques universités de renom
En 2002, 117 517 subventions de R&D ont ainsi été attribuées par le gouvernement fédéral. Le secteur académique, moteur important de la recherche américaine Le gouvernement américain n'a pas de ministère de la recherche. Plusieurs agences thématiques exécutent la recherche et le développement (R&D) américains. Certaines comportent des laboratoires fédéraux qui effectuent une recherche orientée (DOE, NASA, NIH, NIST), mais elles fonctionnent aussi comme agences de moyens (NSF, NIH, NASA) et investissent une part importante de leur budget sous forme de financement de projets dans les universités, l'industrie et des organismes de recherche à but non lucratif. Par ailleurs, le secteur académique se divise entre secteur public et secteur privé. La plupart de la R&D étant effectuée par l'industrie, le secteur académique est néanmoins l'acteur principal de la recherche fédérale. En effet une large majorité des recherches dans les universités (surtout publiques mais aussi privées) est financée par l'Etat fédéral, les Etats fédéraux ne consacrant que très peu de moyens à la recherche : le montant total de moyens consacrés à la R&D dans le cadre de l'enseignement supérieur pour l'année 2000 s'élève selon l'OCDE à 30 milliards de dollars, 58,2 % sont versés par l'Etat fédéral, 7,3 % par les gouvernements fédéraux, 7,2 % par l'industrie et 19,7 % par des fonds d'institutions. c) La diffusion de la recherche au service de l'innovation: une mission essentielle des universités La valorisation des résultats de la recherche par le biais de la commercialisation des découvertes technologiques est fortement encouragée aux Etats-Unis. Adopté par le Congrès en 1980, le Bayh-Dole Act(32) permet ainsi aux universités américaines de gérer et de commercialiser leurs brevets. Le nombre des brevets déposés par les universités a ainsi sensiblement augmenté entre 1991 et 2000 (4 049 dépôts en 2000) et représente aujourd'hui environ 2 % du total des brevets pris aux Etats-Unis. Nombre de brevets académiques
Source : NSF, Sciences & Engineering Indicators - 2004. Les licences prises en 2002 ont généré un revenu de 1 190 millions de dollars, soit environ 3 % du budget de R&D des institutions académiques. Très importants en valeur absolue, ces revenus se révèlent marginaux dès lors qu'ils sont rapportés à l'ensemble des ressources des universités. Ainsi, les transferts de technologie ont rapporté 41 millions de dollars à l'université de Stanford, dont le budget en R&D est de l'ordre de 660 millions de dollars. Quant à Harvard, le revenu de ses licences« n'est que » de 12 millions de dollars. Il existe au MIT un service spécialement dédié aux relations avec les entreprises, qui développe un programme de liaison auprès de plus de 170 grandes sociétés, la plupart du temps des multinationales. Ce service de liaison oriente les entreprises vers les centres de recherche qui interviennent dans leur secteur d'activité(33). Il s'agit alors d'identifier et de développer les technologies qui ont un impact direct sur les marchés de ces grandes sociétés. Avec un budget de recherche de 944 millions de dollars, le MIT est l'université américaine qui dépose le plus grand nombre de brevets : 152 pour la seule année 2003. Parce que les entreprises ont un intérêt direct à accéder aux recherches menées dans les universités, il n'est pas rare qu'elles s'acquittent d'un droit (par exemple, d'environ 5 000 dollars par an à l'université de Madison) qui leur permet d'être membre d'un centre de recherche du campus et de pouvoir bénéficier d'informations relatives aux dernières avancées technologiques. C'est d'une certaine façon un droit d'accès à l'information, qui constitue une sorte de veille technologique permanente auprès des laboratoires de recherche universitaire. Chercheurs et étudiants sont encouragés à déposer leurs inventions. Ainsi, à l'université de Madison, une fondation a été créée spécifiquement pour gérer le dépôt et l'exploitation des brevets. La WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation) est un organisme indépendant, installé au sein de l'université et qui est responsable de la gestion financière et administrative des brevets. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif dont les revenus générés par les licences accordées aux industriels sont utilisés pour financer la recherche fondamentale. La WARF est essentiellement financée grâce aux levées de fonds révoltés auprès des anciens élèves (« alumni ») de l'université. Créée en 1925, la WARF a pour mission de financer la recherche scientifique de l'université du Wisconsin à Madison, en brevetant les découvertes de ses scientifiques, en exploitant les brevets et en redistribuant les fonds récoltés aux différents laboratoires. L'exploitation de la licence de la vitamine D (d'ailleurs utilisée par la société Quaker Oats pour fortifier ses céréales) a ainsi généré d'importants revenus pour l'université. La WARF assiste le chercheur dans ses démarches administratives de dépôt de brevet. En échange, l'inventeur lui cède la propriété intellectuelle et la WARF peut alors commencer à prendre des contacts industriels pour l'exploitation du brevet. Les bénéfices réalisés grâce à la vente des licences sont partagés entre les différentes parties : - pour les premiers 100 000 dollars, l'inventeur reçoit 20 %, le laboratoire 70 % et la graduate school 10 % ; - au-delà des 100 000 dollars initiaux, l'inventeur reçoit toujours 20 %, le laboratoire 15 % et la graduate school 65 %. La vente des licences permet aujourd'hui au WARF de verser annuellement près de 50 millions de dollars à l'université, utilisés pour les bourses, les bourses d'études mais aussi pour la construction de bâtiments. L'Europe s'est d'abord construite par ses universités. Après Bologne en 1119 et la Sorbonne en 1198, sont créées Valence en 1209, Oxford en 1214, Cracovie en 1347, Budapest en 1383, mais aussi les universités de Naples, Padoue, Cambridge, Prague, Heidelberg, Aberdeen... Ces villes européennes deviendront ainsi des lieux importants du savoir en Europe. Les universités médiévales peuvent certainement être considérées comme une des premières manifestations d'institutions européennes, sans que la conscience en ait été claire chez leurs initiateurs. Grâce à la pérégrination des professeurs et des étudiants, l'Europe est déjà un village et l'enseignement supérieur un facteur d'unification, du fait de la circulation des idées et des hommes. Face au modèle américain et à l'émergence de nouveaux pôles de connaissance, notamment en Asie, les universités européennes doivent de nouveau être en mesure de faire entendre leur voix. Il est urgent que l'Europe apporte une réponse à la hauteur du défi. C'est le principal enjeu d'une relance de la stratégie de Lisbonne, qui devrait faire des universités un moteur de la société de la connaissance. Au printemps 2000, le Conseil européen a fixé à l'Union européenne l'objectif de « devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Dans cette perspective, les chefs d'Etat ou de gouvernement ont souhaité, lors du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, faire des systèmes européens d'enseignement et de formation une « référence de qualité mondiale » d'ici à 2010. L'Europe doit adapter ses structures et ses politiques à une économie mondiale de plus en plus tournée vers l'innovation. Or elle éprouve des difficultés pour y parvenir, comme en témoigne la persistance du retard européen en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs clés. 1) Une économie mondiale de plus en plus tournée vers l'innovation Entre 1991 et 2000, le taux de croissance annuel moyen a été de 3,6 % aux Etats-Unis contre 2,1 % en Europe. « Les élites n'ont pas intégré que la moitié de la croissance vient de l'innovation », déclarait récemment M. Philippe Busquin, alors commissaire européen chargé de la recherche, dans un entretien accordé au Figaro(34). A Barcelone, au printemps 2002, les chefs d'Etat ou de gouvernement avaient fixé à l'Europe l'objectif de consacrer 3 % de son PIB à la recherche et au développement en 2010. Le risque est en effet que l'Europe perde la maîtrise des technologies clés pour l'avenir en ne les intégrant qu'avec retard dans son processus de production. L'Europe tendrait ainsi à se transformer progressivement en une économie d'imitation ; le partage de la rente de l'innovation - qui est une donnée fondamentale des dynamiques de développement - se ferait dans ces conditions de plus en plus au détriment de l'Europe et au profit des Etats-Unis et de l'Asie. Ce risque est pointé par deux documents récents : le rapport Sapir de juillet 2003 et le rapport Kok publié en novembre 2004. a) Le rapport Sapir (juillet 2003) Remis le 10 juillet 2003, le rapport Sapir souligne que l'Europe a besoin d'une réforme complète et imminente de son modèle économique si elle souhaite poursuivre le processus d'intégration. Les auteurs du rapport préconisent une augmentation sensible des investissements dans la recherche et l'enseignement supérieur, ainsi que la création d'une Agence européenne pour la science et la recherche. Ils constatent qu'en dépit des considérables avancées institutionnelles de l'Union européenne, ses performances économiques restent mitigées, notamment si l'on compare le taux de croissance de l'Europe avec celui des Etats-Unis. L'innovation doit devenir la clé et le premier facteur générateur de croissance économique. Ceci suppose donc que des investissements massifs prennent place au niveau de l'éducation et de la recherche et qu'en conséquence, le budget de l'Union européenne reflète mieux les priorités économiques qu'elle s'est fixées. Dans la perspective des négociations sur les prochaines perspectives financières (2007-2013), le budget européen devrait ainsi se recentrer sur l'objectif qui consiste à faire de l'économie européenne, une économie fondée sur le savoir et l'innovation. S'agissant des politiques qui devraient être menées pour promouvoir la croissance, le rapport Sapir considère que les Etats membres de l'Union européenne devraient investir plus et mieux dans l'enseignement supérieur et la recherche, en orientant davantage (mais pas exclusivement) les financements vers l'excellence. En terme de R&D, l'Europe souffre d'un manque d'investissement du secteur privé, d'une diminution des crédits du secteur public et d'une faible efficacité de ses dépenses. Il faut donc imaginer des mécanismes incitatifs (notamment au niveau fiscal) pour permettre une convergence des recherches publiques et privées au bénéficie de l'excellence et de l'innovation. b) Le rapport Kok (novembre 2004) « Beaucoup reste à faire pour éviter que Lisbonne ne devienne synonyme d'objectifs ratés et de promesses non tenues » : tel est le constat sévère dressé par le groupe d'experts présidé par l'ancien Premier ministre néerlandais Wim Kok et chargé d'évaluer l'état d'avancement de la stratégie de Lisbonne, définie au printemps 2000 pour faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde d'ici à 2010. Quatre ans après la déclaration d'intentions, les résultats sont très mitigés, car aucun pays ne tient les objectifs fixés. Aujourd'hui, seules la Finlande et la Suède parviennent à consacrer 3 % de leur PIB à la recherche. Le rapport Kok a été adopté le 3 novembre 2004 par la Commission européenne puis officiellement remis aux chefs d'Etat ou de gouvernement lors du Conseil européen des 4 et 5 novembre. Il contient plusieurs propositions dont certaines concernent directement la réalisation d'une société de la connaissance. Le rapport pointe que, « selon les estimations, jusqu'à 30 % de la population active travaillera à l'avenir directement à la production et à la diffusion des connaissances aussi bien dans les industries manufacturières que dans les services, dans le secteur financier ou les industries créatives ». Or qu'il s'agisse des demandes de brevets, du nombre de chercheurs scientifiques, du classement des universités au niveau mondial, du nombre de prix Nobel ou des citations dans les revues scientifiques, la société européenne de la connaissance reste à la traîne par rapport aux Etats-Unis. Et le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) ne représente en Europe que 6 % du PIB contre 7 % aux Etats-Unis. Parce que trop de scientifiques quittent encore le territoire européen, l'Union doit se donner les moyens d'attirer et de retenir les meilleurs chercheurs de rang mondial, d'une part en réduisant les obstacles à la mobilité au sein de l'Union et d'autre part, en améliorant leurs conditions de travail. Le rapport Kok recommande que le Conseil européen du printemps 2005 marque son accord sur l'élaboration d'un plan d'action en ce sens, dont la mise en œuvre devrait être effective au printemps 2006. Le rapport préconise également la création rapide d'un Conseil européen de la recherche (CER) autonome, chargé de financer et de coordonner la recherche fondamentale à long terme au niveau européen. Enfin, l'Union européenne devrait adopter sans délai la proposition concernant l'instauration du brevet communautaire, afin de simplifier le régime juridique de la protection de la propriété intellectuelle en Europe et de réduire l'investissement en temps et les coûts engendrés pour les entreprises de l'Union. 2) Les chiffres du retard européen En novembre 2003, la Commission européenne rendait publique une Communication intitulée « Education & formation 2010 » : l'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne dans laquelle on peut lire que « L'Union européenne dans son ensemble est en retard par rapport aux Etats-Unis et au Japon en ce qui concerne le niveau d'investissement dans l'économie et la société de la connaissance, bien que certains Etats membres aient des niveaux similaires ou supérieurs à ces deux pays. Un certain rattrapage a eu lieu dans la seconde moitié des années 90, mais il n'est pas suffisant pour espérer combler les écarts d'ici à 2010. Une partie des retards de l'Union s'explique par certaines faiblesses des systèmes d'éducation et de formation par rapport à ses principaux concurrents ». Plusieurs indicateurs significatifs illustrent ce retard : a) Le sous-financement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe L'Europe perd du terrain, non seulement vis-à-vis des Etats-Unis mais aussi par rapport à l'Asie du Sud-Est, engagée dans une logique de rattrapage. Selon l'OCDE, les Etats-Unis investissent, en part de PIB, deux fois plus que l'Europe dans leur enseignement supérieur : 2,3 % contre 1,2 %. Depuis 2003, la Chine est, derrière les Etats-Unis et le Japon, le troisième pays en termes d'investissements en R&D. Une communication de la Commission européenne intitulée « Le rôle des universités dans l'Europe de la connaissance »(35) souligne que les dépenses pour l'enseignement supérieur n'ont, dans aucun pays membre, augmenté proportionnellement au nombre d'étudiants. En conséquence, un écart important s'est creusé avec les Etats-Unis, qui s'explique principalement par le faible niveau du financement privé de l'enseignement supérieur en Europe : 0,2 % du PIB européen contre 0,6 % au Japon et 1,2 % aux Etats-Unis. La Commission européenne en conclut que « le sous financement grandissant des universités européennes compromet leurs capacités à retenir et à attirer les meilleurs talents, ainsi qu'à renforcer l'excellence de leurs activités de recherche et d'enseignement ». b) L'insuffisante mobilité des étudiants et des enseignants L'espace européen d'enseignement supérieur compte plus de 16 millions d'étudiants. Depuis son lancement en 1987, le programme Erasmus - qui permet de partir étudier de trois mois à un an, dans une université étrangère(36) - a bénéficié à plus d'un million d'étudiants(37) et à environ 12 000 professeurs. C'est une réussite incontestable qui, au-delà de la population étudiante, est un vecteur de popularisation de l'Europe, comme en a témoigné le succès du film de Cédric Klapisch L'Auberge Espagnole. Mais on ne peut toutefois passer sous silence deux limites importantes. La première est relative au nombre d'étudiants concernés : la mobilité dans l'Union élargie ne concerne annuellement que 120 000 étudiants Erasmus(38) (soit 0,8 % de l'effectif total) et 45 000 jeunes en formation (dans le cadre du programme Leonardo da Vinci). En prenant une durée moyenne de cinq années d'études supérieures par étudiant, à peine 10 % d'entre eux intègrent un séjour à l'étranger dans leur cursus. 90 % des étudiants sont donc exclus des programmes de mobilité. La seconde limite est d'ordre social. Les bourses du programme Erasmus ne suffisent pas à elles seules à couvrir les dépenses liées à un cursus à l'étranger. La bourse moyenne allouée aux étudiants est restée inchangée depuis 1993 à 150 euros par mois, ce qui représente une érosion de la valeur en termes réels de 25 %. La Commission envisage certes un relèvement prochain à 250 euros mensuels mais en pratique, ce sont bien les étudiants issus des milieux sociaux les plus favorisés qui profitent de l'opportunité d'un séjour d'étude à l'étranger. Pour changer d'échelle, il ne faut donc pas axer la mobilité étudiante sur le seul programme Erasmus, mais imaginer, au-delà, des programmes intégrés entre universités européennes qui permettent la mise en œuvre de cursus cohérents entre les établissements d'un même réseau, afin que la mobilité ne s'apparente pas à du tourisme académique. L'enjeu vise donc à concilier le défi quantitatif avec une exigence de qualité. c) Un taux d'accès moindre à l'enseignement supérieur Une économie fondée sur la croissance et l'innovation nécessite une main d'œuvre de plus en plus qualifiée. Or, en comparaison avec les Etats-Unis et le Japon, l'Union européenne produit moins de diplômés de l'enseignement supérieur : en moyenne 23 % des hommes et 20 % des femmes âgés de 25 à 64 ans contre 36 % des hommes et 32 % des femmes au Japon et 37 % pour l'ensemble de la population aux Etats-Unis. d) Les publications et le nombre de lauréats des Prix Nobel Les indicateurs traditionnels de performances des systèmes de recherche sont le volume d'articles publiés dans les revues internationales et le taux de citation de ces articles. Une étude de la Commission européenne(39) révèle qu'avec 41,3 % du total mondial contre 31,4 % pour les Etats-Unis, l'Europe arrive en tête. Mais en termes de citations, considérées comme le meilleur indice de la qualité des recherches, elle se situe toutefois derrière les Etats-Unis dans la majorité des disciplines : environ un tiers de citations en plus pour les chercheurs américains. En ce qui concerne les lauréats des Prix Nobel, et plus particulièrement en physiologie/médecine, physique et chimie, on en dénombre 68 pour l'Europe entre 1980 et 2003 contre 154 pour les Etats-Unis au cours de la même période, l'écart s'accentuant avec les années. Néanmoins, il faut souligner qu'un nombre non négligeable de lauréats américains sont en réalité nés et ont été formés en Europe avant de s'expatrier en Amérique. Quand la Chine s'eveille a la compétition mondiale... Avec 3 000 universités et colleges, le système d'enseignement supérieur chinois est l'un des plus grands au monde. On y recense 13 millions d'étudiants, dont 7 millions dans les 1 225 établissements supérieurs d'enseignement général (universités ou instituts), 4,5 millions dans les 686 institutions d'enseignement supérieur pour adultes, et un million dans les 1 202 universités et colleges privés. En 2001, 400 000 étudiants étaient inscrits à des études graduate (contre 162 000 en 1997). Depuis le début des années 90, les autorités chinoises ont conscience que la poursuite des réformes dans un pays aussi vaste et aussi peuplé nécessite une modernisation et un renforcement du système éducatif. Les autorités sont parvenues à la conclusion que le développement économique et social de la Chine au XXIème siècle doit s'appuyer sur le développement des sciences et des technologies ainsi que sur la formation en Chine de diplômés dont la formation sera adaptée à la concurrence internationale. En trois ans, le gouvernement central chinois a doublé les crédits attribués à l'enseignement supérieur de 54,5 milliards de RMB yuan (6,7 milliards de dollars) en 1998 à 111,4 milliards (13,6 milliards de dollars) en 2001. Le budget total pour l'éducation en 1999 s'élevait à 35,5 milliards de dollars. Avec le projet 211, lancé en 1995, le gouvernement chinois souhaite créer un système d'universités d'élite en subventionnant une centaine d'établissements. Parce qu'elles se situent au croisement de la recherche, de l'éducation et de l'innovation, les universités détiennent, à bien des égards, la clé de l'économie et de la société de la connaissance. Les universités contribuent aux nombreux objectifs de la stratégie de Lisbonne, notamment l'emploi et la cohésion sociale, ainsi qu'à l'amélioration du niveau général des études en Europe. Les jeunes Européens sont sensiblement plus nombreux à être diplômés de l'enseignement supérieur que les générations précédentes, et le taux de chômage de ces diplômés est nettement inférieur à celui de la moyenne de la population active. L'éducation - et l'enseignement supérieur en fait partie - n'est pas une compétence de l'Union européenne qui ne peut intervenir qu'en appui de l'action des Etats membres. Il y a là un paradoxe dans la mesure où l'espace européen de la recherche relève en revanche d'une compétence partagée entre l'Union et les Etats membres. En tout état de cause, les institutions européennes entendent agir à leur niveau pour consolider l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la connaissance et le rendre attractif et compétitif au niveau mondial. C'est tout l'enjeu du programme Erasmus Mundus adopté en janvier 2004. 1) Le programme Erasmus Mundus Le programme Erasmus Mundus est une évolution à l'échelle planétaire de programme Erasmus créé en 1987. Il est destiné à contribuer à améliorer le dialogue entre les cultures et à mieux transmettre les valeurs européennes dans le monde. Il permet à trois universités européennes de s'associer pour créer un diplôme commun de master qui sera proposé aux étudiants d'une quatrième université, non européenne. Les masters ainsi délivrés devront déboucher sur l'octroi de diplômes reconnus par les Etats membres et bénéficieront en plus d'une « labellisation » par l'Union européenne. Concrètement, Erasmus Mundus finance des masters de très bonne qualité internationale afin de renforcer l'attractivité internationale des établissements européens d'enseignement supérieur. Des bourses d'études, d'un montant de 1 600 euros pendant 18 mois, seront attribuées tant aux meilleurs étudiants des pays tiers sélectionnés pour venir étudier en Europe qu'aux étudiants européens qui souhaiteraient se former hors d'Europe. Pour être sélectionnés, les projets de masters « Erasmus Mundus » devront prévoir un minimum de places aux étudiants des pays tiers ayant reçu une bourse et prévoir des conditions d'accueil et des structures appropriées d'information et de logement pour les étudiants. Ces masters devront également prévoir l'apprentissage d'au moins deux langues européennes parlées dans les Etats membres où sont situées les universités participantes. Ce programme devrait, d'ici à 2008, soutenir la création d'une centaine de masters(40) et fournir des bourses à environ 5 000 étudiants en provenance des pays tiers et permettre à environ 4 500 Européens d'aller étudier hors d'Europe. 2 000 enseignants devraient également être concernés et bénéficier de bourses mensuelles d'environ 4 000 euros pendant trois mois. Le programme Erasmus Mundus est incontestablement une étape qui va dans la bonne direction. La création d'un véritable label « made in Europe » doit contribuer à améliorer la visibilité internationale d'un enseignement dont la qualité est reconnue par tous. Pour la Commission européenne, l'objectif vise clairement à dynamiser l'enseignement supérieur universitaire européen, essentiellement face à la concurrence des Etats-Unis. Mais doté d'un budget de 230 millions d'euros sur cinq ans, Erasmus Mundus souffre dramatiquement d'un problème d'échelle et n'est pas en mesure, à lui seul, de répondre aux objectifs qu'il s'est fixés. Outre-Atlantique, les bourses Fullbright drainent en effet depuis quarante ans des étudiants venus de partout. Ils y trouvent l'avantage d'une langue unique mais aussi d'un système universitaire homogène. Au contraire de l'Europe, qui entend promouvoir sa diversité linguistique et culturelle et ses nombreuses traditions d'enseignement, ce qui est aussi tout à son honneur. Essentiellement organisé au niveau national et régional, le paysage universitaire européen se caractérise en effet par une importante hétérogénéité - certains parlent même de « balkanisation » - qui s'exprime en termes d'organisation, de gouvernance et de conditions de fonctionnement, y compris en termes de statut et de conditions d'emploi et de recrutement des professeurs et des chercheurs. En revanche, les universités européennes, pour différentes qu'elles soient, sont confrontées à des défis similaires : augmentation de la demande de formation supérieure, internationalisation croissante de l'éducation et de la recherche, nécessité de s'ouvrir sur le « monde réel », en renforçant les liens avec les entreprises. Face à ces contraintes communes, la réponse doit plus que jamais s'organiser au niveau européen. Trois chantiers prioritaires peuvent être identifiés : a) Abonder le financement des universités Dans un contexte de restrictions budgétaires dans la plupart des pays membres, l'augmentation du financement des universités devrait résulter d'une diversification des revenus des établissements d'enseignement supérieur. Il apparaît en effet peu probable que des efforts budgétaires, même significatifs, puissent combler le retard de financement de la plupart des universités européennes. Plusieurs sources de financement peuvent être identifiées. Ainsi aux Etats-Unis, et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, les donations privées contribuent significativement au budget des universités. Or dans la plupart des pays de l'Union européenne, l'absence de mécanisme fiscal incitatif, d'une part, et la faible autonomie des universités et leur organisation actuelle, d'autre part, n'encouragent pas les pratiques philanthropiques. Une autre ressource de financement pourrait résulter des revenus de la vente de services et de l'exploitation des résultats de la recherche. Il faudrait pour cela que les universités, et les chercheurs, puissent tirer directement profit de leurs activités de recherche. Alors que la formation tout au long de la vie est un enjeu de société, les universités doivent prendre toute leur place dans ce marché en pleine expansion qu'est celui des services de la connaissance. Les activités de formation continue, financées par les entreprises, pourraient permettre de dégager des revenus pour abonder le financement de la formation initiale. Ceci doit permettre d'éviter une hausse incontrôlée des frais de scolarité qui ne peut, en l'état, être acceptée et acceptable par les étudiants. b) Créer les conditions de l'excellence L'excellence est une notion qui doit être utilisée avec prudence et discernement pour éviter une dérive, de facto, vers un système d'enseignement supérieur à deux vitesses. Bien au contraire, la philosophie de l'excellence consiste à permettre aux meilleures universités (selon des critères à définir et des résultats à évaluer) de tirer l'ensemble du système vers le haut. La Conférence des Présidents d'Université mène actuellement une réflexion approfondie sur la notion de « Pôle de recherche et d'enseignement supérieur » (PRES) qui puissent offrir un espace de formation, de recherche et d'innovation, cohérent et de qualité et la plus pluridisciplinaire possible, autour d'un certain nombre de domaines d'excellence. Un document sur la structuration de la recherche et de l'enseignement supérieur en France a, dans le cadre de cette réflexion, été adopté en assemblée plénière de la CPU le 21 octobre 2004. Après le défi réussi de la massification de l'accès à l'enseignement supérieur, l'objectif est désormais qualitatif. La démocratisation de l'enseignement supérieur s'est traduite par une expansion considérable de la population estudiantine sans que, parallèlement, les structures et les conditions de vie universitaires n'évoluent. Car le taux élevé d'abandon des études (environ 40 % en moyenne dans l'Union) souligne, dans la pratique, l'existence d'une sélection par l'échec plutôt que par la réussite. Il est urgent d'inverser cette tendance. C'est notamment l'objectif du projet de création d'universités d'élite en Allemagne. Plus largement, c'est également la problématique de la « taille critique » des établissements d'enseignement supérieur. ¬ Le projet d'universités d'élite en Allemagne Des universités ou grandes écoles d'exellence sur le modèle américain, britannique ou français n'existent pas outre-Rhin, mais le gouvernement allemand souhaiterait en établir pour relancer l'innovation. En janvier 2004, le chancelier allemand Gerhard Schröder a brisé un tabou dans son propre parti, le Parti social-démocrate (SPD), en déclarant qu'il « n'avait pas de difficultés » avec le concept d'université d'élite(41), pourvu que l'on entende par élite une « élite de la performance » et non liée à la naissance. La ministre fédérale de l'éducation et de la recherche, Mme Edelgard Bulmahn, a ainsi annoncé la sélection de dix universités de pointe « capables de jouer en première division mondiale », clairement sur le modèle des universités américaines de Harvard ou Stanford. Ce projet d'universités d'élite suscite toutefois d'importantes réserves dans la quasi-totalité des Länder, compétents dans le domaine de l'éducation, qui y voient le moyen pour l'Etat fédéral de contrôler les universités qu'il financera. Au projet fédéral, les Länder préféreraient un « réseau d'excellence » au sein des universités existantes, c'est-à-dire des départements d'élite, avec la création de centres d'excellence et d'écoles doctorales pour soutenir la recherche de pointe. Faute d'accord entre l'Etat fédéral et les Länder, la concertation se poursuit. Le Bund prévoirait une enveloppe financière de 1,9 milliard d'euros entre 2006 et 2010 ; 25 % de cette somme serait à la charge des Länder. Selon des modalités qui restent encore à préciser, ce projet d'universités d'élite devrait toutefois, sous une forme ou sous une autre, voir le jour en 2006. ¬ le débat sur la taille critique : quelles leçons tirer de l'échec de la fusion « Mines-Ponts » ? A la fin de l'année 2002, le mariage entre l'Ecole des Mines et l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées était imminent. Les fleurons des grandes écoles françaises d'ingénieurs allaient mettre en commun leurs atouts et leur réputation pour se donner les moyens de concurrencer les meilleures formations scientifiques au monde(42). L'objectif vise alors à gagner en visibilité en accédant à une taille critique de niveau international et au développement de nombreuses complémentarités. Ces deux écoles sont prestigieuses en France, mais souffrent d'un réel manque de notoriété hors de l'hexagone. Avec des promotions d'une centaine de diplômés au Mines et d'environ 250 au Ponts, ces établissements n'ont pas la « force de frappe » du MIT ou de Stanford. Un test simple est celui du nombre d'occurrences sur « Google »(43), le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet : 3 010 000 pages web pour « Massachusetts Institute of Technology » contre 360 000 pour « Ecole des Mines » et à peine 51 500 pour « Ecole nationale des Ponts et Chaussées » ! Porté par M. Pierre Veltz, alors directeur de l'Ecole des Ponts et Chaussées, le projet s'inscrit dans le prolongement de ParisTech (Paris Institute of Technology), une structure fondée en 1991 et qui fédère onze grandes écoles, dont les Mines et les Ponts, Polytechnique, les Arts et Métiers, le Génie rural des eaux et forêts et les Techniques avancées. Malgré l'accord des conseils d'administration des deux écoles, le projet va finalement échouer au début de l'année 2004, principalement en raison de l'opposition d'une part, de l'amicale des ingénieurs du corps des Mines(44) et d'autre part, des réticences du ministère de l'équipement, qui a la tutelle sur l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées. La volonté de deux directeurs d'école, soutenus par leurs conseils d'administration n'aura donc pas suffi. Les raisons objectives qui plaident en faveur d'un rapprochement (notamment les économies d'échelle et la visibilité du diplôme) n'ont pas eu raison d'un réflexe franco-français qui ne rend service ni aux étudiants et aux professeurs de ces écoles, ni à l'influence française dans le monde. c) Ouvrir les universités sur leur environnement local et mondial « Notre objectif est de trouver une meilleure adéquation entre notre système français et les pratiques internationales. Le standard mondial est précisément centré sur les universités, alors que la France a développé un modèle articulé autour d'une plus grande multiplicité d'acteurs. Ce qu'il faut, c'est offrir à ces acteurs la possibilité de travailler ensemble dans un pôle ou un campus - peu importe le mot, encore qu'il n'y ait pas de campus sans étudiants ! - adossé à une structure universitaire apte à innover en partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales. L'heure n'est donc plus à une compétition stérile entre établissements français sur un même site mais à une coopération sur des bases claires et fédérant les forces existantes les plus dynamiques. La compétition de la science est au moins européenne, sinon mondiale. Dès lors, il faut permettre aux différents acteurs français (Extrait du discours prononcé le 21 octobre 2004 par M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, devant la Conférence des présidents d'université.) L'ouverture des universités doit s'engager simultanément vers l'échelon local et le niveau international. Une attention particulière doit être portée au développement, dans le respect de la liberté académique, des relations avec les entreprises. (1) Renforcer les liens avec les entreprises L'ouverture vers l'environnement local va de pair avec le renforcement des liens avec les entreprises, notamment dans un cadre régional. Il faut renforcer les partenariats public/privé car les écoles et les universités participent pleinement au rayonnement local économique, social et culturel. Elles peuvent en effet, à leur niveau, contribuer au renforcement de la cohésion européenne, par le développement de technopoles et la multiplication des structures de collaboration régionale entre industries et universités. Parce que le transfert des connaissances est une mission fondamentale des universités, il faut aider au développement de leur diffusion. L'enseignement, la recherche et la création sont en effet des activités qui résultent de plus en plus de partenariats entre les chercheurs, les universités et les entreprises. Les découvertes et les créations issues de ces activités contribuent au progrès de la société dans tous les domaines. A cette fin, l'université doit se donner les moyens d'aider les chercheurs qui désirent commercialiser leurs inventions, en protégeant leurs droits et en prévoyant un partage équitable des redevances entre eux et la collectivité universitaire. A cet égard, l'initiative prise par l'université du Québec à Montréal (UQAM) sur la protection de la propriété intellectuelle est très intéressante. La politique de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle de l'UQAM a été formalisée dans un document, sorte de charte contractuelle qui établit les droits et devoirs des parties prenantes. Selon l'UQAM, cette politique se fonde sur « les valeurs fondamentales de l'université que sont la liberté académique, la probité et l'intégrité intellectuelle, l'équité et l'intérêt public ». Les objectifs sont clairement définis : - protéger les intérêts des professeurs et, plus largement, de l'université et de l'ensemble des membres de la communauté universitaire apportant une contribution significative et originale au processus d'enseignement, de recherche et de création ; - encourager et favoriser la diffusion des productions universitaires par voie de publications, de communications scientifiques ou d'œuvres et, dans les cas où cela est pertinent, par la prise de brevet ou par la commercialisation ; - assurer une reconnaissance juste et équitable des droits respectifs de tous les partenaires, incluant les étudiants ayant participé aux productions universitaires. La propriété intellectuelle est intimement liée à la nature même du travail universitaire. Et les règles de propriété intellectuelle qui s'appliquent lors du transfert des résultats de la recherche universitaire se révèlent être des facteurs qui déterminent fortement le développement des collaborations entre les universités et leurs partenaires externes. (2) Promouvoir des stratégies d'alliance Le mouvement d'internationalisation doit se poursuivre et s'amplifier, dans le cadre de stratégies réfléchies plutôt que d'actions ponctuelles et non coordonnées. Les initiatives se multiplient. Ainsi, le 14 mai 2003, neuf universités écossaises et françaises(45) se sont engagées à développer un programme commun conduisant à la création d'un co-diplôme PhD/Doctorat, préparé en trois ans. Pour chaque étudiant autorisé à préparer ce co-diplôme, une université pilote sera désignée comme responsable du travail de l'étudiant et du processus de soutenance. Un diplôme conjoint unique sera délivré et reconnu comme équivalent à chacun des diplômes propres à chaque université (PhD écossais et Doctorat français). Dans le même ordre d'idées, un projet d'arrêté relatif à la cotutelle internationale de thèse dans l'Union européenne est en cours d'examen par le CNESER(46). Les universités européennes doivent se tourner vers l'Europe, mais aussi au-delà, vers l'Asie et l'Amérique. Cette ouverture peut prendre plusieurs formes, comme par exemple, la création de fonds de coopération interuniversitaire, à l'image de ce qui existe déjà aux Etats-Unis à travers, notamment, les fonds MIT-France, France-Stanford, France-Chicago, et France-Berkeley crées par le Ministère des Affaires Etrangères avec de grandes universités américaines. Constitué en décembre 2002, le programme MIT-France est doté d'un fonds de deux millions de dollars (financé à parité par le gouvernement français et le MIT) et joue un rôle moteur dans le lancement et le développement de nouveaux projets susceptibles de conduire, dans les domaines d'excellence du MIT, à la création de réseaux pérennes. L'argent que rapporte le fonds permet de soutenir le lancement d'études et de projets menés conjointement par des étudiants ou professeurs du MIT et leurs homologues français, sur des sujets transversaux considérés comme d'intérêt majeur. Un certain nombre d'universitaires français ont ainsi séjourné au MIT pour des durées de trois à quatre mois au cours desquelles ils ont participé aux activités d'enseignement et/ou contribué à des projets de recherche. De même, une vingtaine d'étudiants du MIT ont depuis deux ans effectué un séjour académique ou suivi une formation diplômante. Des programmes comparables à MIT-France existent avec l'université de Berkeley (Fonds France-Berkeley, crée en 1993), qui a permis de soutenir 145 projets depuis 10 ans, avec l'université de Chicago (fondation universitaire Centre France-Chicago, crée en 2000) et avec l'université Stanford (fondation universitaire Centre France-Stanford, en cours de constitution). * * * TROISIEME PARTIE Le paysage universitaire européen est une mosaïque de traditions, de structures et de compétences qu'il faut utiliser au mieux pour affronter, dans les meilleures conditions possibles, la compétition mondiale du savoir. C'est une compétition pour le progrès et l'Europe ne peut en être absente, dans le contexte de l'édification d'un espace unifié d'enseignement supérieur et de recherche encore en devenir. Les propositions qui suivent sont pragmatiques et poursuivent un objectif ambitieux : concilier la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur avec le développement de pôles de compétence reconnus au niveau mondial. Les idéologies conduisent trop souvent nos universités à s'accrocher au passé lorsqu'elles devraient se tourner vers l'avenir. De façon progressive, et sur un chemin qu'il nous faut tracer collectivement, il est temps d'élaborer une stratégie pour donner des raisons aux Européens d'être fiers de leurs universités. Proposition n° 1 : Organiser des cursus en anglais pour attirer les meilleurs étudiants étrangers L'un des facteurs de l'attractivité d'un système d'enseignement supérieur réside dans sa capacité à attirer les meilleurs étudiants étrangers. D'un point de vue académique, pourquoi la France devrait-elle se priver d'excellents étudiants étrangers au motif qu'ils ne parlent pas notre langue ? Allons-nous renoncer durablement à l'accueil d'étudiants asiatiques qui affluent en nombre dans les universités britanniques et américaines ? La création, pour ces étudiants, de cursus dispensés exclusivement anglais, doit favoriser la venue en France d'étudiants qui ne viendront pas autrement. Elle peut aussi permettre d'attirer des professeurs étrangers. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une telle mesure est très favorable à la francophonie, puisqu'à terme, la communauté francophone s'en trouvera élargie. En effet, un étudiant étranger qui séjourne en France apprendra nécessairement le français, ne serait-ce que par commodité dans sa vie quotidienne. Naturellement, des cours intensifs de français devraient s'ajouter à son cursus en anglais, et donner lieu à terme à un examen de niveau, pourquoi pas identique à l'ensemble des pays francophones, sur le modèle du TOEFL qui existe pour l'anglais. Si des cursus en anglais existent parfois dans certaines grandes écoles, ils sont en revanche absents de l'université. Il faudrait donc, préalablement à leur instauration, s'assurer de la formation des enseignants pour qu'ils soient en mesure de dispenser des cours en anglais. Proposition n° 2 : Créer auprès de chaque pôle universitaire un « guichet unique » pour l'accueil des étudiants étrangers A leur arrivée en France, les étudiants étrangers doivent généralement se soumettre à un véritable parcours du combattant pour effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à leurs inscriptions administrative et pédagogique, à la recherche d'un logement, à l'accomplissement d'un certain nombre de formalités. Or beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas nécessairement bien notre langue, et ne sont pas familiers des rouages de notre administration. C'est pourquoi il est proposé de regrouper au sein d'un guichet unique, auprès de chaque pôle universitaire, l'ensemble des services compétents ( antenne préfectorale, service d'aide sociale, bureau du logement, etc.) pour l'accueil des étudiants étrangers. Proposition n° 3 : Créer des fondations universitaires d'académie afin d'abonder le financement de l'enseignement supérieur L'enseignement supérieur et la recherche doivent rester une priorité du budget de l'Etat. Mais il serait illusoire de prétendre que le financement public peut permettre, à lui seul, de régler le problème du sous financement des universités françaises. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de diversifier les sources de financement pour augmenter significativement les moyens alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche. La création de « fondations universitaires d'académie » pourrait contribuer à cet objectif, en étant habilitées à recevoir des fonds de particuliers, d'entreprises ou de collectivités territoriales. Il ne s'agirait pas, contrairement à ce qui existe aux Etats-Unis, de permettre la création d'une fondation dans chaque université, pour éviter le risque que ne se creuse à terme un fossé entre des universités riches et des universités pauvres. C'est pourquoi de telles fondations devraient être créées au niveau de l'académie, et seraient chargées, sous la direction d'un « Conseil académique » de redistribuer les fonds perçus, selon des critères à définir, entre les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie. Pour qu'un tel système fonctionne, il doit s'accompagner de l'instauration de mécanismes d'incitation fiscale : par exemple, l'extension de « l'amendement Coluche » à l'enseignement supérieur. Il serait également souhaitable de prévoir une évolution des règles de gouvernance des universités afin de permettre une gestion optimale des fonds ainsi distribués. Proposition n° 4 : Favoriser, autour de labels communs, les rapprochements et les synergies entre les universités, les grandes écoles, les organismes de recherche et les entreprises En France, les structures d'enseignement supérieur et de recherche sont éclatées et morcelées, ce qui nuit au fonctionnement général de notre système. La dualité entre les universités et les grandes écoles n'est pas un handicap, pour autant que des rapprochements sont possibles. Il faut multiplier les passerelles et mettre en commun les structures et les compétences pour atteindre la taille critique qui fait souvent défaut. Ni les universités, ni les grandes écoles ne disposent à elles seules de tous les ingrédients du succès. En revanche, ces structures peuvent parfaitement se compléter pour donner naissance à des départements d'excellence de renommée mondiale, associant universités, grandes écoles, départements du CNRS, entreprises, etc. Tout ce qui permet le rapprochement des structures doit être encouragé, à l'image de ParisTech pour les grandes écoles d'ingénieurs. S'agissant des universités, le spectre des fusions d'établissements effraye. Mais quelle logique y a-t-il à avoir deux universités de droit (Paris I et Paris II) dans Paris intra-muros ? Qui, à l'étranger, connaît cette subtile distinction ? De même, on ne dénombre pas moins de quatre universités à Bordeaux. L'avenir n'est pas dans la dispersion mais dans la rationalisation. Afin de conserver un maillage universitaire du territoire, ne serait-il pas judicieux, à l'image de ce qu'a entrepris l'Institut d'Etudes Politiques de Paris en créant des campus en régions, de rattacher des campus à de grandes universités de dimension internationale. C'est le cas, aux Etats-Unis, de l'université de Californie, qui fédère une dizaine de campus dans tout l'Etat. Ceci doit permettre le développement de « labels » internationaux. Aujourd'hui, seule la Sorbonne est connue à l'étranger, alors qu'il ne s'agit que d'un lieu et pas d'une université. D'où l'importance du marketing dans un domaine de plus en plus concurrentiel, qu'on le veuille ou non. Proposition n° 5 : Etablir un statut d'« université pilote » La modernisation de l'enseignement supérieur français doit répondre aux principes de progressivité et de souplesse. Depuis 2003, une révision de la Constitution autorise l'expérimentation. Il est proposé d'appliquer cette méthode à l'enseignement supérieur en reconnaissant à certains établissements qui en feraient la demande le statut d'« université pilote », qui donnerait accès à un statut juridique dérogatoire, pendant une période limitée à quatre ans. Ce statut ne permettrait de déroger ni à l'interdiction de sélection à l'entrée du premier cycle universitaire, ni aux règles nationales de fixation des droits de scolarité. Il autoriserait en revanche un certain nombre d'assouplissements en matière de recrutement des professeurs, de gouvernance et d'autonomie de gestion budgétaire. Au terme de ce délai, un comité serait chargé d'évaluer l'établissement et de proposer, éventuellement, sa pérennisation et/ou son extension. Proposition n° 6 : Reconstituer un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et des nouvelles technologies, autonome du ministère de l'éducation nationale Les questions qui relèvent de l'enseignement primaire et secondaire sont autonomes par rapport aux problématiques posées par l'enseignement supérieur et la recherche. Les exigences liées à l'internationalisation occupent une place de plus en plus importante aux dépens des problématiques exclusivement nationales. Un tel ministère indépendant a déjà existé par le passé, la dernière fois sous le gouvernement de M. Edouard Balladur, en 1993. On remarquera à cet effet, que dans la plupart des Länder allemands compétents en matière d'éducation, il existe des ministres des universités et de la recherche autonomes par rapport à leurs collègues en charge de l'éducation. Proposition n° 7 : Créer une Commission nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur Les difficultés auxquelles est confronté le système français d'enseignement supérieur sont de nature structurelle et touchent à des tabous multiples : diplômes nationaux, droits universitaires, statut des enseignants chercheurs, sélection... Sur ces sujets politiquement très sensibles, aucune réforme n'est possible - ni souhaitable - sans un consensus. Ce qui est aujourd'hui important, c'est d'être en mesure de pouvoir poser les vraies questions, sans préjugés ni arrière-pensées. De même que cela a été fait pour la laïcité (Commission Stasi), l'école (Commission Thelot) et la recherche (Comité d'initiative et de proposition - CIP), il est proposé de créer une Commission nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Cette commission devrait être composée de représentants institutionnels et syndicaux des universités, grandes écoles, organismes de recherche, entreprises, étudiants, enseignants chercheurs. Des personnalités extérieures, françaises et étrangères, devraient également y participer. Présidée par une personnalité indépendante, cette commission serait dans un premier temps chargée d'établir un diagnostic partagé, puis des axes de réformes qui pourraient alors soumis au débat et à la consultation nationale. A travers ses fonctions de formation, de recherche et d'innovation, l'enseignement supérieur est un vecteur important du développement économique et du progrès technologique. Mais au-delà, les universités contribuent aussi à l'émergence d'une véritable citoyenneté européenne, fondée sur des valeurs communes, sur une vision de la société et de l'avenir du monde. C'est souvent dans ces « berceaux d'influence » que naissent les idées et les projets. Proposition n° 8 : Réorienter le budget de l'Union européenne en direction des objectifs politiques fixés par le Conseil européen dans le cadre de la stratégie de Lisbonne Le budget européen (environ 100 milliards d'euros) ne reflète pas les priorités politiques de la stratégie de Lisbonne. Dès lors que les Etats n'entendent pas augmenter significativement leur contribution au budget de l'Union, il faut progressivement réorienter les dépenses pour être cohérent avec les objectifs fixés par l'Union. La politique agricole commune (45 % du budget) et les fonds structurels (38 %) absorbent la majeure partie des crédits communautaires, ne laissant que peu de marges de manœuvre pour les politiques internes, notamment dans le domaine de l'éducation et de la recherche. La négociation qui s'ouvre sur les perspectives financières 2007-2013 doit être l'occasion de débattre d'un financement réaliste de la stratégie de Lisbonne, au service de la croissance et de l'emploi, au moyen notamment de l'édification d'un espace européen de la connaissance et de l'innovation. Proposition n° 9 : Créer un fonds européen de financement des infrastructures universitaires Ce qui différencie généralement les universités européennes des campus américains, c'est la vétusté des bâtiments universitaires. Dans ce domaine, l'Union européenne peut jouer un rôle important en finançant des projets d'infrastructures : salles de cours, bibliothèques, logement étudiant, équipements sportifs et culturels... Alors que l'élargissement de l'Union et la négociation sur les perspectives financières va conduire à négocier l'attribution des fonds structurels, il est proposé de créer un nouveau fonds : le Fonds européen de financement des infrastructures universitaires. Ce fonds serait certes alimenté par le budget européen, mais également par des donations privées, en prévoyant l'instauration d'un mécanisme d'incitation fiscale. Dans le cadre d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche sans frontières, il n'est pas illogique de financer de telles infrastructures sur fonds européens, dès lors qu'elles sont potentiellement mise à la disposition de l'ensemble des étudiants du continent. Proposition n° 10 : Créer un label d'université européenne L'avenir des écoles et des universités réside dans leur capacité à s'intégrer dans des réseaux. Il faut aller au-delà des seuls programmes d'échanges. Beaucoup sont d'ores et déjà engagées dans une stratégie internationale, qui ne se limite d'ailleurs pas au seul continent européen. Ainsi, Sciences Po Paris, la London School of Economics à Londres et le College de l'université de Columbia à New York, ont créé leur propre réseau. De même, l'ESSEC et l'université de Manheim en Allemagne viennent d'opérer un important rapprochement. Le 22 janvier 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du Traité de l'Elysée, le Président français Jacques Chirac et le Chancelier allemand Gerhard Schröder avaient lancé l'idée d'« Airbus universitaires », en référence à la création du consortium de l'entreprise aéronautique. Il s'agit désormais de s'assurer de la mise en œuvre concrète de tels réseaux, que l'Union européenne devrait encourager. Il ne doit aucunement être question d'imposer par le haut la création d'alliances. Bien au contraire, il doit être laissé la plus grande liberté à la création de telles « universités européennes ». L'objectif serait de parvenir (sur le modèle de ce que le programme Erasmus Mundus met en place, mais à une échelle plus grande) à des cursus intégrés entre quelques universités. Il s'agit d'éviter la dispersion, et de permettre au contraire des partenariats réfléchis et stratégiques, sur la base du volontariat, afin de faire émerger une quinzaine de pôles européens de compétence, de dimension internationale. Ce statut d'université européenne rendrait les établissements concernés éligibles (à condition de respecter un cahier des charges) à des financements sur le budget de l'Union, à travers notamment le nouveau fonds européen de financement des infrastructures universitaires. D'un point de vue académique, les étudiants inscrits dans ces « parcours européens » pourraient se voir délivrer, en plus de leur diplôme national, un master européen. Proposition n° 11 : Soutenir la création d'une revue scientifique européenne Les classements internationaux des universités reposent en grande partie sur la publication d'articles dans des revues scientifiques anglo-saxonnes de renommée mondiale telles que Science ou Nature. Or il n'existe pas de publication européenne dont l'impact soit comparable. Il importe de soutenir la création de nouvelles revues européennes de haut niveau tout en développant, parallèlement, celles existantes. Les académies des différents pays de l'Union pourraient ainsi unir leurs notoriétés respectives pour appuyer la création d'une revue européenne dotée d'une autorité scientifique et d'un soutien financier. Proposition n° 12 : Créer un statut de « chaire européenne » La création d'un statut de « chaire européenne » vise à faciliter la mobilité européenne des enseignants chercheurs. Les universités européennes organisées en pôle de compétences pourraient ainsi se voir attribuer des crédits leur permettant de rémunérer les meilleurs professeurs qui se voient aujourd'hui proposer des salaires très attractifs aux Etats-Unis ou, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni. * * * Au terme de ce rapport, il est possible de tirer un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, le processus de Bologne constitue incontestablement un levier de réforme sans précédent qui doit stimuler la modernisation de nos structures d'enseignement supérieur. A cet égard, la France est en avance sur ses partenaires européens, et il faut saluer la capacité d'adaptation de nos grandes écoles et universités. Mais il reste un certain nombre de tabous qui malheureusement nous enferment souvent dans l'immobilisme. Il est temps de dépassionner le débat sur l'enseignement supérieur et de l'affranchir des pesanteurs idéologiques qui ne rendent service à personne et, in fine, desservent notre pays. Car les universités sont des berceaux d'influence et doivent aussi être des outils au service du rayonnement et de la puissance d'une nation. Au-delà de l'hexagone, c'est bien là que réside l'enjeu pour l'Europe : affirmer ses valeurs et sa vision du monde. Les universités du XXIe siècle peuvent contribuer au développement d'une nouvelle Europe des Lumières qui doit marquer de son empreinte la société de la connaissance et de l'innovation. Pour y parvenir, l'Europe a besoin d'une méthode. Loin d'engager le grand soir de l'université, il s'agit de privilégier l'incitation et l'expérimentation ; d'une façon progressive, par petits pas, mais avec détermination, enthousiasme et conviction. * * * La Délégation s'est réunie le mercredi 17 novembre 2004, sous la présidence de M. Pierre Lequiller, Président, pour examiner le présent rapport d'information. L'exposé du rapporteur a été suivi d'un débat. M. Edouard Landrain, après avoir souligné la qualité du rapport, a remarqué que celui-ci conduisait au constat de la disparition de la notion d'université européenne telle qu'elle fut définie au siècle des Lumières. En particulier, le déclin du français est très net. Par ailleurs, la situation des ressources humaines dans le secteur de la connaissance en Europe est très préoccupante. Les étudiants francophones souhaitant être accueillis en France, surtout ceux des pays d'Afrique, connaissent des difficultés pour obtenir un visa. M. Edouard Landrain a interrogé le rapporteur sur l'existence de difficultés similaires aux Etats-Unis. L'autonomie des universités est un sujet de débat en France mais ne se traduit pas par des avancées réelles. Cette autonomie devrait concerner la recherche de financements privés, les collectivités publiques ne pouvant assurer l'ensemble du financement des universités. A ce sujet, M. Edouard Landrain a interrogé le rapporteur sur les relations entre secteurs public et privé dans les universités américaines et sur la mobilité des enseignants à l'extérieur des universités, notamment vers le monde politique. Il a également demandé des précisions sur le statut fiscal des dons privés aux universités américaines. L'éparpillement des universités en France amène à s'interroger sur l'opportunité de favoriser la création de grandes universités offrant de larges choix en matière d'études, de culture et d'activités sportives. La dimension multidisciplinaire de telles universités permettrait en outre un croisement des connaissances très fécond. Cependant, la conduite de réformes dans l'enseignement supérieur paraît particulièrement difficile, du fait des contestations qu'elles provoquent systématiquement. M. Edouard Landrain a interrogé le rapporteur sur la situation dans les pays qu'il a visités. M. Jacques Floch s'est rallié dans l'ensemble aux propositions du rapporteur. Celles-ci sont ambitieuses car le milieu universitaire français est particulièrement opposé aux réformes, même d'ordre matériel. La dispersion universitaire, avec la présence de plusieurs universités dans une même ville, est elle-même un obstacle aux réformes. Elle multiplie les postes et structures de décision. A cet égard, la composition des Conseils d'université devrait permettre une meilleure représentation du monde économique, social, politique et syndical. Les universitaires ne devraient pas pouvoir faire seuls des choix importants, par exemple en matière d'implantation des universités. M. Jacques Floch a jugé satisfaisantes les propositions du rapporteur relatives au rapprochement entre grandes écoles et universités. Citant l'exemple de Nantes, il a souligné les difficultés connues dans le passé pour faire accepter l'implantation de grandes écoles et pour opérer leur rapprochement avec l'université. Celui-ci n'a d'ailleurs reposé que sur des initiatives individuelles. Au-delà de l'admiration que le système universitaire américain peut susciter, il convient de souligner, d'une part, la différence de contexte et, d'autre part, les défauts d'un tel système. Ceux-ci résident principalement dans le corporatisme et le fait que certains postes - notamment dans l'administration fédérale - soient réservés aux diplômés de certaines universités. Cette dérive existe également en France pour les diplômés des grandes écoles. M. Jérôme Lambert, après avoir remercié le rapporteur pour sa présentation instructive, a observé que l'université n'est pas seulement porteuse de savoir et de connaissances, mais aussi d'une culture et d'un modèle de société qui va de pair avec elle. Ainsi l'université américaine est indissociable de la société américaine, de son goût de la compétitivité et de son système économique libéral. Beaucoup d'Européens sont attachés à une autre culture et à un autre modèle de société que le modèle anglo-saxon. L'harmonisation des diplômes a sans doute ses vertus, mais elle découpe en seulement trois niveaux le cycle universitaire, ce qui allonge mécaniquement les étapes à franchir pour qu'un étudiant obtienne un diplôme. Avec cette réforme, un étudiant ne peut espérer obtenir aucune reconnaissance de son travail avant au moins trois ans, alors que l'ancien système permettait l'attribution du DEUG au bout de deux ans. De même, s'inscrire en maîtrise n'engageait l'étudiant que pour un an, alors qu'il lui en faudra désormais deux pour obtenir un master. Pour répondre aux besoins de tous, la possibilité devrait donc être ménagée de suivre des cycles courts grâce auxquels les étudiants pourraient quitter plus tôt l'enseignement supérieur avec un diplôme en poche. L'allongement des cycles a d'autres conséquences pour les étudiants étrangers, qui bénéficient d'un visa qui n'est valable que pour une durée d'un an renouvelable. Alors qu'ils sont engagés dans des études qui dureront plusieurs années, ils doivent régulièrement retourner grossir les files d'attente devant les préfectures. Les Etats-Unis leur réservent un meilleur accueil, en leur accordant des cartes de séjour valables pour toute la durée de la scolarité. M. Jérôme Lambert a estimé que le financement privé pourrait d'autre part mettre en cause l'égalité entre les étudiants. Une péréquation financière entre établissements d'une même académie n'évitera pas que les inégalités se creusent entre établissements appartenant à des académies différentes. Un étudiant de la région Poitou-Charentes doit pouvoir suivre un cursus à Poitiers s'il n'a pas les ressources financières nécessaires pour trouver un logement à Paris et payer ses déplacements jusque-là. Il faut garantir un enseignement supérieur de qualité sur l'ensemble du territoire. Enfin, l'appel à un financement européen reste un vœu pieux si le budget communautaire n'est pas augmenté globalement. A ces observations, le rapporteur a répondu en exposant les éléments suivants : - l'analyse de la situation américaine ne procède pas d'une admiration aveugle. Le système américain ne constitue pas la panacée et ne saurait être imité servilement. Il fournit cependant un point de comparaison susceptible de faire ouvrir les yeux sur la réalité observée. La Conférence des Présidents d'Université, les syndicats d'enseignants et d'étudiants : chacun reconnaît l'urgence à réformer. Le monde universitaire vit trop replié sur lui ; il a besoin de s'ouvrir aux entreprises et aux laboratoires de recherche ; - dans la compétition mondiale qui s'est ouverte, ni la France ni l'Europe ne sont dépourvues d'atouts, comme la qualité de l'enseignement secondaire dispensé ; mais le sous-financement des structures universitaires est patent ; l'Europe a une contribution à apporter, pour mettre en œuvre concrètement la stratégie de Lisbonne ; en France, l'enseignement supérieur doit rester une priorité du budget de l'Etat, mais cela ne doit pas exclure des incitations fiscales au profit des particuliers qui voudraient faire un don à une université de leur choix ; - une réforme expérimentale au sein d'un établissement pilote suffirait dans un premier temps pour donner corps aux propositions envisagées, dans le respect de la gratuité des droits d'inscription et de l'absence de sélection à l'entrée, qui sont deux principes intangibles ; - les visas pour études sont beaucoup plus difficiles à obtenir aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001, mais ils bénéficient encore à 586 000 étrangers, qui sont principalement originaires de l'Inde, de la Chine, de la Corée du sud, du Japon ou de Taiwan ; - environ trois-quarts des donations viennent des particuliers, essentiellement des anciens de l'université. La situation actuelle de l'université française ne permettrait certainement pas d'atteindre une telle mobilisation des dons des particuliers dans notre pays ; - la fuite des cerveaux est un vrai sujet dans la mesure où nos étudiants ont acquis une bonne formation dans le secondaire et vont compléter leur formation supérieure aux Etats-Unis. Ce phénomène souligne que notre enseignement supérieur a réussi le défi du quantitatif mais pas encore celui du qualitatif. Par ailleurs, le rapporteur a déclaré avoir présenté des propositions peut-être ambitieuses, mais surtout concrètes et certainement pas des vœux pieux ; - réformer l'enseignement supérieur est beaucoup plus facile aux Etats-Unis qu'en France parce qu'il existe un consensus sur l'université qu'on ne rencontre pas dans le monde de l'enseignement supérieur français. Comme l'a dit M. Jacques Floch, ce milieu est parfois conservateur, encore trop centré sur lui-même et trop éparpillé pour atteindre une taille critique suffisante. Les cent élèves de la promotion de Polytechnique n'ont pas de notoriété internationale et cet établissement très prestigieux, en France, n'est pas cité parmi les établissements mondialement connus non seulement dans les universités américaines, mais même à Oxford ou à Cambridge ; - ouvrir l'université sur son environnement local, régional, européen et vers les entreprises est une vraie nécessité ; - il existe des coteries d'anciens élèves aux Etats-Unis mais aussi en France, même si elles ne sont pas à la même échelle. Ainsi, l'ancien directeur de l'école des Ponts et Chaussées avait-il eu la bonne idée de proposer un rapprochement entre l'école des Ponts et l'école des Mines, dans le cadre du développement de ParisTech, ce qui aurait donné plus de visibilité à ces deux écoles. La coterie des membres du corps des ingénieurs des Mines a néanmoins réussi à la torpiller ; - il ne s'agit pas d'un rapport libéral en faveur d'un modèle de société, mais simplement de regarder ce qui fonctionne et ne marche pas dans l'enseignement supérieur américain dont l'attractivité mondiale est incontestable. Le rapport ne cache pas que la classe moyenne américaine rencontre des difficultés d'accès aux bourses de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, ses propositions ne touchent absolument pas au DEUG et à la maîtrise, ni à tout le dispositif d'enseignement professionnel des BTS et des DUT ; - en ce qui concerne les différences entre académies, d'abord le tissu économique des entreprises n'est pas uniquement concentré en Ile de France, ensuite des alliances peuvent se nouer entre universités sur tout le territoire. L'important est de créer des fondations par académie et non par université pour éviter précisément le risque de créer des inégalités entre universités plus ou moins riches. Le Président Pierre Lequiller a remarqué que le budget de l'Etat pourrait compenser ces déséquilibres. Le rapporteur a enfin souligné la nécessité de renforcer la mobilité des étudiants en réglant mieux leurs conditions de logement et de ne pas créer partout des universités n'ayant pas la taille critique. A l'issue de ce débat, la Délégation a autorisé la publication du rapport d'information. * * * ANNEXE : I. A PARIS - M. François FILLON, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - M. Jacques ATTALI, président-fondateur de la société de conseil Attali et Associés (A et A) ; - M. Sylvain BROUSSARD, président de la Fédération des associations générales des étudiants (FAGE) ;Annexe-1 - M. Elie COHEN, directeur de recherche au CNRS ; - M. Richard DESCOINGS, administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ; - M. Eric ESPEREL, délégué général de la Conférence des présidents d'université ; - M. Yassir FICHTALI, président de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) ; - M. Eric FROMENT, président de l'Association européenne de l'université (AEU) ; - M. Thomas FURUSTEN, Agence suédoise pour l'enseignement supérieur ; - M. Guillaume HOUZEL, président de l'Observatoire de la vie étudiante (OVE) ; - M. Michel LAURENT, premier vice-président de la Conférence des présidents d'université ; - Mme Michelle LAUTRON, responsable du secteur « Formation supérieure » au Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP) ; - M. Pascal LEVEL, troisième vice-président de la Conférence des présidents d'université ; - Mme Helena MALHER, Agence suédoise pour l'enseignement supérieur ; - M. Christian MARGARIA, président de la Conférence des Grandes écoles ; - Mme Anne MESLIAND, responsable du secteur « Formation supérieure » au Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP) ; - M. Jean-Marc MONTEIL, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - M. Jérôme MOURROUX, président de Promotion et défense des étudiants (PDE) ; - Mme Christine MUSSELIN, chercheuse au CNRS ; - M. Josy REIFFERS, ancien directeur adjoint du cabinet de M. Luc FERRY, ancien ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - Mme Alexandra SJÔSTRAND, Agence suédoise pour l'enseignement supérieur ; - M. Philippe VALERI, ancien membre du cabinet de M. Luc FERRY, ancien ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - M. Pierre VELTZ, ancien directeur de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées ; - M. Olivier VIAL, président de l'Union nationale universitaire (UNI) ; - M. Boris WALBAUM, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, président du Groupe des belles feuilles. II. A BRUXELLES ¬ Commission européenne - Mme Maria FERREIRA LOURENCO, chef de l'unité « Enseignement supérieur » à la Direction générale « Education et Culture ». ¬ Université Libre de Bruxelles (ULB) - M. Pierre de MARET, recteur de l'Université libre de Bruxelles ; - Mme Muriel MOSER, vice-rectrice à la recherche ; - M. Christian PEETERS, vice-recteur aux affaires académiques ; - M. Yves ROGGEMAN, vice-recteur aux relations institutionnelles ; - Mme Chantal ZOLLER, directrice du département des relations internationales, conseillère du recteur pour les questions européennes, présidente de la commission interuniversitaire de relations internationales. III. A BERLIN - Mme DOLEZAL, chef de bureau au ministère fédéral de la formation et de la recherche ; - Prof. GAEHTGENS, président de la Hochschulrektorrenkonferenz (HRK) ; - M. Martin MAYER, député CSU de Bavière ; - M. Jörg TAUSS, député SPD du Bade-Wurtemberg. IV. A LONDRES - M. Yves DJIMI, étudiant à la London School of Economics (LSE) ; - Mlle Ségolène DUFOUR-GENNESON, étudiante à la LSE ; - M. Maurice FRASER, professeur de sciences politiques à la LSE ; - Mme Judy POWELL, responsable de l'enseignement supérieur au British Council ; - M. John REILLY, administrateur de l'université du Kent ; - M. Ray RICHARDSON, vice-président, chargé de l'enseignement à la LSE ; - Prof. Michael WORTON, vice-président de l'University College London (UCL). V. A MONTREAL - M. Michel BRUNET, cadre conseiller à la direction générale des affaires universitaires et collégiales du ministère de l'éducation ; - M. Pierre PARENT, vice-recteur aux affaires publiques et au développement, université du Québec à Montréal (UQAM) ; - Mme Denise PELLETIER, directrice du cabinet du recteur, UQAM ; - Mme Micheline ROBERGE, conseillère à la direction des affaires internationales et canadiennes du ministère de l'éducation ; - M. Nicolas de TAKACSY, vice-principal adjoint, McGill University ; - Mme Hélène THIBAULT, directeur du bureau de liaison pour la recherche et le développement, UQAM. VI. AUX ETATS-UNIS 1) A Boston - M. Philippe AGHION, professeur d'économie, Harvard University ; - M. Sean BUFFINGTON, deputy chief of staff, Havard University ; - Mme Patricia CRAIG, executive director of the Center for European Studies, Havard University ; - M. Eric FERON, professeur au département d'aéronautique et d'astronautique du Massachussetts Institute of Technology (MIT) ; - M. Patrice HIGONNET, professeur d'histoire française, Havard University ; - Mme Ourida MOSTEFAI, professeur au Boston College, department of romance languages and literatures ; - Mme Susan SULEIMAN, professeur à Havard University ; - Mme Rebecca VALETTE, professeur à Havard University, department of romance languages and literatures ; - Mme Marie-Teresa VANDER-SANDE, manager of corporate relations, MIT. 2) A Chicago - M. Dan BERTSCHE, administrateur de la fondation universitaire « centre France Chicago », University of Chicago ; - Mme Pascale-Anne BRAULT, études françaises, DePaul University ; - M. Eric GISLASON, vice-chancellier recherche à l'Université de l'Illinois à Chicago ; - M. John IRELAND, études françaises, University de l'Illinois à Chicago. 3) A Madison - M. Murray CLAYTON, chair university committee, département de statistiques et de pathologie des plantes ; - Mme Karen CROSSLEY, vice-président, UW foundation-alumni fundraising ; - M. Carl GULBRANDSON, WARF ; - M. Charlie HOSLET, special assistant to the chancellor ; - Mme Joan RADUCHA, associate dean, international studies and director international academic programs. 4) à New York - M. Rodrick DIAL, director of alumni relations of the School of international and public affairs, Columbia University ; - M. Nicolas DUBOILLE, étudiant, New York University (NYU) ; - M. Rob GARRIS , associate dean for faculty and curriculum affairs, School of international and public affairs (études niveau master) ; - M. Dean Henry PINKHAM, dean of the Graduate school of arts and sciences, Columbia University ; - M. Pierre-Louis HERIN, étudiant, New York University (NYU) ; - Mme Kathryn YATRAKIS, dean of academic affairs, Columbia College. 5) à San Francisco - M. Bradley BARBER, administrative policy, UC Berkeley ; - M. Gordon EARLE, vice president of Public Affairs, Stanford University ; - M. Arnaud GRUNWALD, étudiant, UC Berkeley ; - Prof. Josh LEVINE, lecturer, music composition, SF State University ; - M. Don McQUADE, vice chancellor of University Relations, UC Berkeley ; - M. Robert PRICE, associate vice chancellor of research, UC Berkeley ; - M. Emmanuel VIEILLARD-BARON, Sun Microsystems. * * * Le rapporteur tient à remercier particulièrement les postes diplomatiques et consulaires en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour leur précieux concours à l'élaboration de ce rapport. 1 () Ces conférences ministérielles réunissent périodiquement les ministres de l'enseignement supérieur des pays participants au processus d'harmonisation européenne des diplômes engagé en 1998 à la Sorbonne. 2 () Si l'on évoque généralement le « processus de Bologne », on devrait plutôt parler du processus de la Sorbonne puisque c'est bien à Paris, à l'occasion du 800e anniversaire de la Sorbonne, qu'a été enclenché le mouvement européen d'harmonisation des diplômes. Mais c'est en effet en Italie, à Bologne, que le nombre des pays signataires a sensiblement augmenté et que l'architecture « LMD » a été véritablement conçue. 3 () Cf. p. 27 du présent rapport. 4 () La Déclaration de Salamanque fixe les principes et les priorités suivants : - accroître la mobilité et renforcer les programmes d'échanges ; - organiser la diversité ; - rendre compatibles les architectures d'enseignement supérieur en développant un cadre commun articulé autour de deux phases ; - généraliser le système de crédits ECTS ; - renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur européen. 5 () La France a ratifié, le 4 octobre 1999, la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur dans la région européenne signée à Lisbonne le 11 avril 1997 - connue sous le nom de « Convention de Lisbonne » - où apparaît pour la première fois la notion de « supplément au diplôme ». 6 () « Trends III » : a European perspective, disponible sur le site Internet de l'Association européenne de l'université (EUA) : www.eua.be. 7 () Cf. également l'encadré p. 42. 8 () Cf. p. 42 du présent rapport. 9 () - Décret n° 2002-480 du 8 avril 2002 modifiant le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de « mastaire » et le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (JO du 10 avril, p. 6323) ; - Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux (JO du 10 avril, p. 6324) ; - Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (JO du 10 avril, p. 6324) - Décret n° 2002-603 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur (JO du 27 avril, p. 7630) - Décret n° 2002-604 du 25 avril 2002 modifiant le décret n° 99-647 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master (JO du 27 avril, p. 7630) - Circulaire du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 14 novembre 2002, « Mise en œuvre du schéma licence-master-doctorat ». 10 () Ces comités de suivi sont composés d'un représentant de chacune des organisations membres du CNESER (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), de représentants des établissements et des secteurs de formation et de personnalités qualifiées. 11 () Cf. article 15 de l'arrêté du 30 avril 2002. 12 () L'arrêté prévoit qu'un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. 13 () Créés en 1992, pour répondre à des besoins spécifiques des entreprises, notamment les petites et les moyennes, les instituts universitaires professionnalisés (IUP), sont destinés à former des cadres occupant des emplois intermédiaires entre ceux de technicien supérieur et d'ingénieur généraliste dans l'industrie, ou de cadre supérieur dans le secteur tertiaire. 14 () Des cinq sous-secteurs relevant de l'éducation (enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, formation pour adultes et autres services d'enseignement), c'est assurément le plus concerné par le commerce international. 15 () Déclaration adoptée le 28 septembre 2001. 16 () Philippe Aghion, Elie Cohen, « Education et Croissance », Les rapports du Conseil d'analyse économique, n° 46, La documentation Française, Paris, 2004. 17 () « Regards sur l'éducation », rapport 2004 de l'OCDE, précité. 18 () Sources : HESA, Higher Education Statistic Agency, MENESR 19 () Alain Coulon et Saeed Paivandi, Les étudiants étrangers en France : l'état des savoirs, rapport pour l'Observatoire de la vie étudiante, mars 2003. Ce rapport est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.ove-national.education.fr. 20 () Cf. Etude de V. Borgogno et L. Vollenweider-Andresen (1998). 21 () Conférence des Grandes Ecoles, Grandes écoles et enseignement supérieur, Eléments de stratégie, septembre 2004. Ce document est disponible sur le site Internet : www.cge.asso.fr. 22 () Hormis Cambridge et Oxford, on trouve d'autres universités européennes dans les 50 premières places : Zurich (25e), Karolinska Institute de Stockholm (39e), Untrecht aux Pays-Bas (40e) et l'université de Munich (48e). 23 () Cette étude annuelle est réalisée avec le soutien du Département d'Etat auprès de 2 700 institutions. 24 () Les variations sont toutefois importantes entre les sciences humaines et les sciences exactes. 25 () Les diminutions continues des subventions accordées par les Etats fédérés conduisent les universités publiques à augmenter progressivement leurs frais de scolarité. Ainsi, la moyenne des droits perçus par les universités publiques ne cesse de s'accroître selon des statistiques du State of Washington Higher Education Coordinating Board 26 () Sur un nombre total d'étudiants de 14,5 millions, 5,6 millions d'entre eux sont inscrits dans des institutions n'offrant que deux ans d'études supérieures débouchant sur des diplômes la plupart du temps très professionnalisés. Sur environ 4 000 institutions d'enseignement supérieur, 1 750 d'entre elles sont des colleges en deux ans (community colleges, junior colleges, technical colleges). 27 () Les Alumni correspondent au corps des anciens élèves. Traditionnellement, les associations d'Alumni sont actives, généreuses de leur temps et des ressources de leurs membres, et particulièrement efficace pour la levée de fonds. 28 () Cela existe également, mais dans une moindre mesure, au Royaume-Uni. 29 () Ce pourcentage est généralement plus élevé parmi les diplômés des universités privés. On estime ainsi que près d'un tiers des anciens élèves de Columbia effectuent un don chaque année. 30 () Daniel Garrigue, « Les nouveaux enjeux de la recherche publique : pilotage et émergence des équipes de chercheurs », Rapport d'information (n° 1885) de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, novembre 2004. 31 () Cela n'est en revanche généralement pas le cas des étudiants en sciences humaines ou sociales, en droit ou en business, qui paient l'intégralité de leurs études de master's degree. 32 () Le Bayh-Dole Act est un ensemble de textes législatifs votés à partir des années 1980 à l'instigation des sénateurs Birch Bayh et Bob Dole. Ces textes règlent les questions de propriété intellectuelle des découvertes faites dans le cadre des programmes soutenus par le gouvernement fédéral. Ils encouragent les établissements bénéficiaires de ces aides à breveter ces découvertes et précisent les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent et doivent bénéficier des revenus tirés de ces découvertes. 33 () On dénombre, en octobre 2004, neuf entreprises françaises qui participent au programme de liaison avec l'industrie du MIT : Air Liquide, Alstom, Aventis, EDF, Essilor International, Michelin, Saint-Gobain, Thales et World Federation of Exchanges. 34 () Edition du 26 octobre 2004. 35 () COM(2003) 58 final du 5 février 2003. 36 () L'étudiant reste rattaché à son université d'origine, qui lui garantit l'intégration de son année d'étude à l'étranger dans son cursus universitaire et la prend en compte pour l'attribution du diplôme final. 37 () L'objectif vise à atteindre au moins trois millions d'étudiants d'ici à 2010. 38 () Source : « Education et formation 2010 : l'urgence des réformes pour réussir la stratégie de Lisbonne », communication de la Commission, COM(2003) 685 final du 11 novembre 2003. 39 () « L'Europe et la recherche fondamentale », Communication de la Commission, COM(2004) 9 final du 14 janvier 2004. 40 () Le programme de master sera en principe sélectionné pour une durée de cinq ans. 41 () A l'origine, cette idée avait été lancée par M. Franz Müntefering, président du groupe parlementaire SPD, dans un entretien accordé au journal Frankfurter Allgeneine Sonntagzeitung. 42 () Au-delà des Mines et des Ponts et Chaussées, le projet de rapprochement concernait également l'ENTC (télécoms) et l'ENSTA (techniques avancées). 43 () www.google.fr (à la date du 12 novembre 2004). 44 () Les écoles des Ponts et Chaussées et des Mines de Paris ont la particularité de former des « ingénieurs civils », qui rejoignent presque tous le secteur privé, et des élèves fonctionnaires, qui intègrent les grands corps de l'Etat. Les ingénieurs civils (une centaine par an aux Mines, près de 250 aux Ponts) sont recrutés à l'issue d'un concours commun ou sur titre. Les ingénieurs du « corps » (une quinzaine par an aux Mines, une trentaine aux Ponts) sont déjà diplômés de Polytechnique ou de l'Ecole normale supérieure. Parmi eux, beaucoup choisissent de quitter le corps ou demandent à être mis en disponibilité pour rejoindre le privé. 45 () Il s'agit des universités écossaises de St Andrews, Glasgow et Edimbourg, et des universités françaises de Provence (Aix-Marseille I), Joseph Fourier (Grenoble I), Sorbonne-Nouvelle (Paris III), Pierre et Marie Curie (Paris VI), Denis Diderot (Paris VII), et François Rabelais (Tours). 46 () Le projet de texte prévoit notamment une formation en alternance dans chacun des pays partenaires, la composition internationale du jury de thèse ainsi que la question de l'utilisation des langues. |

