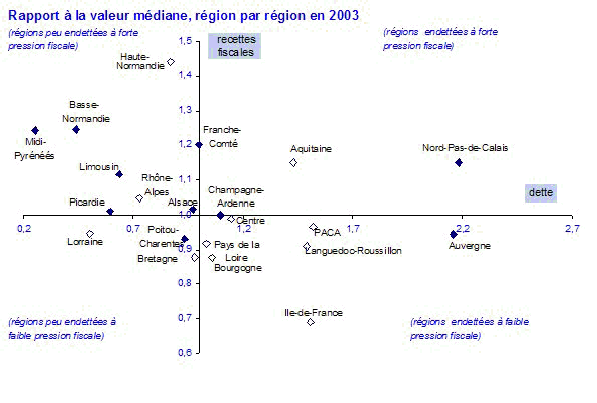Audition de M. Marcel CHARMANT, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président MM. Marcel Charmant, Henri Malcoiffe et Philippe Parlant-Pinet sont introduits. M. le Président : Nous accueillons aujourd'hui M. Marcel Charmant, Président du conseil général de la Nièvre, accompagné de MM. Henri Malcoiffe, Vice-président chargé des finances, et Philippe Parlant-Pinet, Directeur général des services. Nous poursuivons l'audition des présidents de conseils généraux issus des diverses tendances politiques et représentant des départements aux caractéristiques différentes. Le département de la Nièvre n'a pas modifié ses taux d'imposition depuis que vous avez accédé à la présidence du conseil général, en 2001. Nous souhaitons que vous nous expliquiez dans quelle mesure la situation de votre département est particulière et quels ont été vos choix politiques en matière de financement et de recours à l'emprunt. Le conseil général de la Nièvre est à majorité socialiste ; nous avons entendu, le 26 mai dernier, un département de la même sensibilité, la Charente, qui, depuis cinq ans, a fortement augmenté ses taux d'imposition. M. le Président rappelle à MM. Marcel Charmant, Henri Malcoiffe et Philippe Parlant-Pinet que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. À l'invitation du Président, ceux-ci prêtent serment. M. le Président : Je vous donne la parole pour un exposé introductif, après quoi nous vous poserons des questions. M. Marcel CHARMANT : Je vous remercie de nous accueillir ; nous allons tenter d'éclairer votre réflexion. Depuis 2001 - c'est-à-dire depuis l'exercice précédant mon élection au poste de Président du conseil général -, les taux d'imposition de la Nièvre n'ont en effet pas été modifiés. Le département de la Nièvre mesure 6 837 kilomètres carrés et compte 225 000 habitants, 29 % de ses habitants sont âgés de plus de soixante ans, sa population active accusant une baisse constante et représentant 36 %. Nous disposons de trente collèges publics, de 4 233 kilomètres de routes départementales avant transfert d'une partie du réseau routier national, nous dénombrons 3 662 allocataires du RMI et 4 614 bénéficiaires de l'APA. Le taux de chômage atteint 9 % - quand la moyenne régionale est de 8,6 % - et a augmenté de 2,4 % en un an, compte tenu de l'évolution très négative des effectifs des grandes entreprises du secteur concurrentiel. La Nièvre est un département rural, mais porteur d'une forte tradition industrielle. Plus de la moitié de sa superficie est boisée : premier producteur de chêne, la Nièvre est en passe de devenir également le premier producteur de Douglas, du fait de la croissance des plantations du massif du Morvan. L'agriculture y est active, principalement avec l'élevage de charolais - dont le herd-book est tenu à Nevers - et la production céréalière. Nous avions aussi des ressources importantes en minerai de fer, qui ont guidé le développement historique des entreprises sidérurgiques, mais l'industrie, de nos jours, est plutôt en déclin, quoique la production mécanique et automobile reste bien implantée, avec 4 000 salariés. Le budget 2005 du département de la Nièvre s'établit globalement à 253 millions d'euros, sans augmentation des taux d'imposition pour la cinquième année consécutive. Le nombre de contribuables est peu élevé et, de surcroît, leur capacité contributive est faible, tout simplement parce que le niveau de revenu l'est également. Or, malgré l'effort important que nous avons déployé pour ne pas augmenter la fiscalité départementale, la contribution des Nivernais reste légèrement supérieure à la moyenne des autres départements. C'est cette considération première qui a conduit l'assemblée départementale à tenir sa position mais, compte tenu des transferts en cours, je doute qu'elle puisse prévaloir pour les budgets 2006 et 2007. En 2004, le produit de la fiscalité directe et des compensations s'est élevé à 74,15 millions d'euros, soit une baisse de près de 9 %, due à l'intégration de la compensation versée suite à la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle au sein de la DGF. Cette seule mesure, en 2003, représentait la moitié des compensations fiscales totales. Le produit fiscal des quatre taxes a progressé de 2,9 %, sous l'effet des bases. Nous avons perçu 14,75 millions d'euros au titre de la fiscalité indirecte : 11,77 millions avec les droits de mutation, 0,32 million avec la vignette, 2,09 millions avec la taxe sur l'électricité et 0,59 million avec les autres taxes. Depuis 2000, les droits de mutation ont pris une part de plus en plus importante dans la fiscalité indirecte pour atteindre 79,7 % en 2004. Ce phénomène est dû à la suppression de la vignette en 2001 et à l'augmentation des droits de mutation, imputable au dynamisme de l'immobilier. La tendance est légèrement inférieure à celle enregistrée sur l'ensemble des départements, où la hausse des droits d'enregistrement et de publicité foncière a été de 16 % en 2004. À ces taxes s'ajoute la TIPP, dont le produit s'est élevé à 14,11 millions d'euros, montant qui ne couvre pas intégralement les dépenses du RMI de 2004 - le Gouvernement s'est engagé auprès des départements à couvrir ce différentiel après l'adoption des comptes administratifs. S'agissant des dépenses, sur la période 2000-2004, il convient de rappeler quelques événements qui ont bouleversé la structure des dépenses des départements : en 2000, suppression de l'aide médicale gratuite et instauration de la CMU, prise en charge par l'État ; en 2002, instauration de l'APA en remplacement de la PSD ; en 2004, transfert complet de la compétence RMI et généralisation de la norme comptable M52 à l'ensemble des départements. On constate un taux d'évolution moyen des frais de personnel de 6,6 % par an. L'année 2004 marque l'arrêt de la tendance à la baisse de l'annuité de remboursement des emprunts, en raison du montant payé en capital, supérieur de 3,57 % à celui de 2003. Le recours croissant à l'emprunt depuis 2001 explique cette hausse. Cependant, l'emprunt mobilisé en 2004 a été limité au maximum pour maîtriser l'encours de la dette et restreindre la diminution des marges de manœuvre pour les années futures. L'encours de la dette est 488,20 euros par habitant contre 444,80 euros en 2003. Les intérêts payés sur les lignes de trésorerie, en 2004, ont augmenté de 330 % pour atteindre 170 506 euros. Les compétences transférées de 2002 à 2004 concernent des allocations et aides à la personne, ce qui a pour conséquences des décaissements nombreux sur lesquels la collectivité ne peut agir, alors que les recettes ne sont encaissées, au mieux, qu'en cours d'année. En conclusion, sur la section de fonctionnement, les charges évoluent de 10,62 % par an pendant que les recettes progressent seulement de 6,18 %. L'élément le plus notable concerne le poids de charges liées au RMI et au SDIS. Les dépenses d'investissement, depuis 2000, ont évolué irrégulièrement, avec une amplitude allant de 36 975 euros en 2000 à 46 281 euros en 2003. On peut en déduire une moyenne de 70 % de dépenses d'équipement et de 30 % de fonds de concours et de subventions. Le remboursement de la dette, capital et intérêts compris, a peu évolué entre 2000 et 2004. Les dépenses ont davantage augmenté que les recettes, pour les raisons que j'ai déjà exposées. C'est ainsi que l'épargne de gestion et l'épargne nette, sur la période considérée, baissent respectivement de 44 % et de 68 %. Au sein des départements dits « DFM », c'est-à-dire qui percevaient la dotation de fonctionnement minimale, la Nièvre se distingue essentiellement par quatre spécificités : des recettes de fonctionnement correctes, avec un produit des quatre taxes dans la moyenne haute ; des dépenses de fonctionnement par habitant plus élevées : + 6,6 %, ce qui s'explique essentiellement par une action volontariste dans le domaine social, avec pour conséquence des frais de personnel plus importants, notamment en raison de la structure de notre pyramide des âges et de la démarche de territorialisation de notre action médico-sociale ; une épargne disponible plus faible et un encours de dette plus important, tandis que le poids de la dette est plus modéré, l'annuité étant inférieure de 10 % à la moyenne des départements DFM ; des dépenses d'investissement dans la moyenne, mais les grosses opérations programmées devraient modifier la configuration pour les années à venir. M. le Rapporteur : Si vous n'avez pas accru les impôts en 2005, cela signifie-t-il qu'il n'y avait aucune raison de le faire ? M. Marcel CHARMANT : Il y aurait eu matière à augmenter les impôts, je crois vous l'avoir expliqué - je puis vous assurer que je passe quelques nuits blanches pour boucler le budget du département. Mais les taux étaient déjà élevés alors que la capacité contributive des Nivernais est relativement faible. C'est pourquoi nous avons décidé de marquer une pause fiscale et de redistribuer notre budget. Quoi qu'il en soit, le plein effet des mesures de décentralisation et de transfert n'est pas encore complètement connu et les élus de la majorité souhaitent y voir plus clair avant de procéder à des ajustements. M. le Rapporteur : Quel linéaire de routes nationales vous sera transféré ? M. Marcel CHARMANT : Pour l'instant, 119 kilomètres. M. le Rapporteur : Considérez-vous que le transfert des routes nationales, en investissement et en entretien, justifierait une augmentation de l'impôt ? Et le personnel de l'équipement ? Et les TOS des collèges ? M. Marcel CHARMANT : Pour répondre précisément à vos questions, il faudrait que je possède les éléments nécessaires afin de pouvoir mesurer l'impact des transferts. Or je ne connais pas avec précision l'état de ces 119 kilomètres de routes - un diagnostic est en cours, qui doit être rendu le 17 août. La N81 constitue le transfert principal : elle fait 70 kilomètres et relie la première et la troisième plus grandes agglomérations du département, Nevers et Decize, en passant par Imphy, principal site industriel. Or, cette route est dans un état catastrophique et accuse de surcroît un déficit de gabarit : pour parcourir les 30 kilomètres séparant Nevers de Decize, il faut compter en moyenne une heure. M. le Président : Pour quelle raison ? Les ouvrages d'art sont-ils nombreux ? M. Marcel CHARMANT : Oui, de même que les virages et les tronçons étroits. La route traverse beaucoup de villes. La déviation d'Imphy, bassin industriel le plus important du département, est prévue dans le contrat de plan, mais celui-ci est en panne depuis deux ans et les travaux sont interrompus. M. le Président : Ils ont commencé et on les a interrompus ? M. Marcel CHARMANT : Absolument ! M. Jean-Pierre SOISSON : Malgré les aides du conseil régional ! M. le Président : Pourquoi cet abandon ? M. Marcel CHARMANT : Par manque de crédits de l'État, tout simplement. La route nationale traverse Imphy sur 4,5 kilomètres environ et coupe pratiquement l'usine en deux, ce qui rend une déviation indispensable. La ville s'est construite de part et d'autre de l'usine et s'étire en longueur. M. Jean-Pierre SOISSON : Je confirme. M. Marcel CHARMANT : Si l'État a pu résister à la pression de la population et des élus, les conseils généraux et les conseils régionaux, eux, ne pourront pas se le permettre et seront contraints à entreprendre des travaux. Et il ne faut pas oublier les 4 200 kilomètres de routes départementales actuelles. M. le Rapporteur : Même si le contrat de plan accuse un retard d'exécution, toutes les opérations ont vocation à aller jusqu'à leur terme. M. Marcel CHARMANT : Oui, a priori. M. le Président : Jusqu'à expiration des crédits prévus, il importe de le préciser. Par contre, en cas de dépassement... M. Jean-Pierre SOISSON : Les quatre départements s'étaient donné pour priorité la poursuite et l'achèvement de la déviation d'Imphy. M. Marcel CHARMANT : Tout à fait. M. le Rapporteur : Ce transfert vous coûtera donc de l'argent ? M. Marcel CHARMANT : Bien sûr. S'agissant des personnels de la DDE et des TOS, ma réponse est identique. Nous avons trente collèges et quelque 200 TOS. Il est certain que la demande sera très forte car le manque de personnel est évident dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne la DDE, le problème est double. J'ai aujourd'hui le sentiment que le nombre d'ouvriers mis à disposition sera suffisant, mais j'ai un peu moins d'assurance en ce qui concerne le personnel d'encadrement : sur les bases proposées, nous serions dans l'obligation d'en recruter, ce qui nous mettrait dans une situation très délicate. M. le Rapporteur : Nous avions été alertés sur ce problème en amont des auditions, mais la plupart des autres départements se sont finalement montrés moins inquiets. M. Marcel CHARMANT : Tant mieux pour eux ! Pour ma part, je suis très inquiet et la dernière réunion avec le préfet de la Nièvre, il y a huit jours, n'a pas été de nature à m'apaiser : sur plusieurs questions précises, nous n'avons pas obtenu de réponses satisfaisantes. Du reste, j'ai cru ressentir la même insatisfaction à l'Assemblée des départements de France, toutes tendances confondues. M. le Rapporteur : Comment envisagez-vous de faire évoluer le temps de travail des TOS ? M. le Président : Des indications sur leur temps de travail actuel vous ont-elles été fournies par l'inspection d'académie ou le rectorat ? M. le Rapporteur : Pour résumer, les TOS sont mal payés mais travaillent plutôt moins, nous a-t-on dit, que d'autres catégories de personnel. Cela créerait une marge pour définir leur niveau indemnitaire, en contrepartie d'une augmentation de leur temps de travail. Avez-vous engagé une discussion de ce type ou comptez-vous le faire ? M. Marcel CHARMANT : Non. M. le Rapporteur : Venons-en au RMI. M. Marcel CHARMANT : Les avances auxquelles nous avons dû procéder pèsent lourd dans le budget. Le Premier ministre a garanti que, après examen des comptes administratifs, nous recevrions une compensation à l'euro près. J'en accepte l'augure, mais le délai écoulé aura coûté cher à la collectivité départementale. M. le Président : Quel est le différentiel, pour 2004, entre ce que vous avez payé et ce que vous avez reçu au titre du RMI ? M. Philippe PARLANT-PINET : L'écart entre le montant versé au titre du RMI et celui perçu au titre de la TIPP atteint 2,3 millions d'euros entre janvier et mai 2005. M. le Rapporteur : Et sur 2004 ? M. Philippe PARLANT-PINET : 1,2 million d'euros. M. le Rapporteur : Comment expliquer un tel jaillissement en 2005 ? M. le Président : Comment allez-vous compenser le différentiel de 2005 ? M. Marcel CHARMANT : Sur notre trésorerie. J'ai d'ailleurs écrit au préfet de la Nièvre pour lui indiquer ce que ces décalages coûtaient au département et il m'a répondu que nous serions remboursés à l'euro près, mais qu'il ne serait pas tenu compte du coût supporté en raison des avances consenties. M. le Président : La loi ne prévoit aucune compensation pour 2005. M. le Rapporteur : Est-ce une question ou une affirmation ? Et pourquoi l'écart entre 2004 et les premiers mois de 2005 est-il aussi considérable ? M. Philippe PARLANT-PINET : Le cas de la Nièvre n'est pas atypique : le taux de couverture, dans bien d'autres départements, se situe entre 0,65 et 0,72. M. le Président : Avez-vous observé une augmentation du nombre des RMIstes ? M. Philippe PARLANT-PINET : L'évolution a été de l'ordre de 4,5 % l'an dernier, et une nouvelle progression a été enregistrée au cours des six premiers mois de l'année. M. le Rapporteur : Comment vous y prenez-vous pour contenir le nombre des RMIstes dans votre département ? M. Marcel CHARMANT : Présidez-vous un conseil général, M. le Rapporteur ? M. le Rapporteur : Je suis le modeste maire d'une petite ville. M. Marcel CHARMANT : Nous nous efforçons tout simplement, d'une part, de nous occuper des allocataires par le biais de l'insertion et, d'autre part, de faire en sorte que se créent des activités pour les employer. Mais un département comme le nôtre, qui subit des pertes d'emplois importantes, a du mal à résoudre le problème. M. le Rapporteur : Quelles actions menez-vous contre d'éventuels abus ou fraudes ? M. Marcel CHARMANT : Ma nature ne me pousse pas à penser d'emblée que quelqu'un qui sollicite la collectivité pour s'inscrire au RMI est un faussaire. Il n'en demeure pas moins que nous vérifions : des commissions locales réunissent des élus locaux et des responsables associatifs pour étudier chaque dossier ; je ne crois pas que beaucoup passent à travers les mailles de cet examen. M. le Président : Envisagez-vous de faire signer des contrats RMA et des contrats d'avenir ? Le préfet vous a-t-il proposé un objectif à cet égard ? Quelle somme cela coûtera-t-il au département ? M. Marcel CHARMANT : Lorsque le RMA a été institué, le conseil général a organisé des Assises de l'insertion réunissant les organisations syndicales et patronales ainsi que les associations d'insertion et les services de l'État, afin d'examiner les cas dans lesquels le RMA pourrait se développer dans le département. Je dois vous dire que ni les entreprises, ni les individus n'ont été intéressés et que seuls quinze contrats RMA ont été signés. Nous participons à la démarche des contrats d'avenir et, compte tenu des dernières dispositions prises par l'État, qui s'attache davantage à l'aspect qualitatif des contrats qu'à leur nombre, nous n'avons pas non plus fixé d'objectif quantifié ; si l'État nous proposait un volume donné, nous examinerions cette possibilité. Par ailleurs, la région Bourgogne a créé les emplois-tremplins et la Nièvre adhère à cette politique : nous nous sommes inscrits pour 280 emplois-tremplins sur cinq ans. Ce dispositif - propre à la Bourgogne mais qui existe aussi dans d'autres régions - s'ajoute à celui des contrats d'avenir. M. le Rapporteur : Vos dépenses de communication ont augmenté de 120 % entre 1998 et 2003. Je n'ai pas à me prononcer sur l'opportunité politique de vos décisions, mais cela fait tout de même beaucoup. M. Marcel CHARMANT : Le pourcentage est certes élevé, mais le montant reste modeste au regard de ce que font certains autres départements. Dans la Nièvre, nous n'avons pas de revue sur papier glacé. Par contre, nous organisons des réunions cantonales, à la rencontre de la population, au cours desquelles nous distribuons de l'information. Nous avons aussi développé notre site Internet et, depuis 2004, nous retransmettons en ligne les sessions du conseil général. Notre enveloppe de dépenses de communication n'est pas très élevée, mais elle tend à croître pour répondre aux besoins du département. J'ajoute que ce budget inclut notre participation à des opérations comme le Grand Prix de France automobile ou le Bol d'or, à Magny-Cours. M. Alain GEST : J'observe que vous n'avez signé que quinze contrats RMA. Vous dites même que cela n'intéresse ni les entreprises ni les allocataires du RMI. Les artisans eux-mêmes ne sont-ils pas intéressés ? Et comment les allocataires du RMI ne le seraient-ils pas alors qu'une possibilité de réinsertion en entreprise leur est accordée, avec une rémunération plus élevée à la clé ? Ne faut-il pas simplement, comme dans mon département, avoir le souci d'appliquer ce dispositif ? M. Marcel CHARMANT : Je ne pense pas que le département de la Nièvre fasse exception. En Bourgogne, hormis l'Yonne, qui a dû signer de l'ordre de quatre-vingts contrats RMA, la Côte-d'Or se situe dans les mêmes eaux que nous et je ne suis même pas sûr que la Saône-et-Loire en ait conclu un seul. La même réalité pourrait être constatée dans les autres départements de France. Les Assises de l'insertion, qui ont réuni 200 ou 250 personnes, ne se sont pas soldées par un rapprochement entre les allocataires et les entreprises, c'est un fait. M. Alain GEST : Ce sont les conseils généraux qui ont la responsabilité de la mise en œuvre de ces contrats, pas les entreprises. M. Marcel CHARMANT : Je ne vais pas aller chercher un bénéficiaire pour l'imposer à un entrepreneur ! M. Alain GEST : Certes non. M. Marcel CHARMANT : Ce n'est pas dans l'esprit de la loi - dont je ne partage au demeurant pas tout à fait la philosophie. Le conseil général de la Nièvre a joué son rôle d'information en provoquant la tenue d'Assises de l'insertion. Au-delà, que voulez-vous qu'il fasse ? M. Alain GEST : Un RMIste qui signe un contrat RMA a la chance de pouvoir ensuite sortir définitivement du dispositif et donc de représenter une charge moins lourde pour le département. Cela doit tout de même vous intéresser. J'estime que c'est la réticence quasi générale vis-à-vis du dispositif qui est à l'origine de son mauvais fonctionnement. J'en veux pour preuve que, lorsque des contrats aidés du type CES voire contrat temps plein ou contrat d'avenir sont proposés avec détermination, cela marche. À votre avis, que manque-t-il pour que le dispositif des contrats d'avenir soit attractif ? M. le Président : Quel genre de contrats proposez-vous ? Qui prend la formation en charge ? Il faut que vous nous donniez des idées pour que nous proposions des pistes d'amélioration. M. Alain GEST : Exactement ! M. Marcel CHARMANT : Le conseil général de la Nièvre, c'est vrai, n'a pas vu arriver le RMA avec le sourire : mettre de telles personnes à disposition d'entreprises privées n'était guère enthousiasmant. C'est précisément pourquoi nous avons organisé les Assises de l'insertion : dans le but de recueillir le point de vue des bénéficiaires et des entreprises. Si vous parvenez à convaincre les artisans, pourquoi pas ? Il faut également savoir que M. Jean-Louis Borloo a très vite sérieusement modifié les conditions de signature - il a même été question, pendant un moment, de faire disparaître le RMA au profit du contrat d'avenir. Comment voulez-vous que, dans une telle ambiance, le discours soit audible pour les bénéficiaires et les artisans ? Les contrats d'avenir ont été mis en place par M. Jean-Louis Borloo et croyez-moi, entre, d'une part, un emploi-tremplin ou un contrat d'avenir et, d'autre part, un contrat RMA, la marge est sérieuse. Au demeurant, les entreprises, notamment artisanales, recherchent du personnel qualifié, immédiatement opérationnel, plutôt que des RMIstes, même si la durée du RMA permettrait au bout du compte de leur donner une petite formation. M. Alain GEST : Tous les allocataires du RMI ne sont pas dépourvus de qualification. Dois-je conclure de votre position que mettre à disposition d'une entreprise un allocataire du RMI vous choque davantage que lui faire signer un contrat aidé pour le renvoyer ensuite au point de départ et en embaucher un autre sur le même type de contrat ? Cela ne date pas d'hier. C'est ce qui se passe depuis les TUC. M. Marcel CHARMANT : Ce que vous dites n'est pas complètement vrai, en tout cas pas dans la Nièvre : sans remonter aux TUC, nombre d'emplois sous CES, CEC ou contrat emploi-jeune ont été pérennisés, dans les collectivités territoriales comme dans les associations. Pour avoir passé ma vie professionnelle dans le milieu artisanal, je crois avoir de bonnes relations avec la chambre de métiers et la chambre de commerce, mais les artisans que je rencontre attendent un couvreur, un maçon ou un plâtrier peintre qualifié - je ne vous servirai pas le couplet du plombier polonais -, pas un employé sous contrat RMA auprès duquel ils devraient jouer le rôle d'organisme d'insertion. Lors d'une conférence régionale réunissant les présidents du conseil régional et des conseils généraux, j'ai constaté que le seul département à avoir développé des contrats RMA était l'Yonne : il n'y en avait ni en Côte-d'Or, ni en Saône-et-Loire, pas plus que dans la Nièvre. M. Jean-Pierre SOISSON : La situation de l'artisanat nivernais est très particulière, les entreprises artisanales étant difficilement reprises et recherchant du personnel qualifié. Le département se dépeuple et subit une désindustrialisation ; l'artisanat ne fait pas exception et la collectivité publique fait tout pour maintenir les équilibres. Notez tout de même que, de tous les départements bourguignons, la Nièvre est celui qui a le moins augmenté ses taux de fiscalité. Mme Arlette GROSSKOST : Vous expliquez le niveau légèrement plus élevé qu'ailleurs des dépenses de fonctionnement par une volonté politique forte de maintenir les services publics et de solidarité. Pourriez-vous résumer et décrire les axes que vous privilégiez dans le cadre de cette politique ? M. Marcel CHARMANT : Pour que les services publics soient plus présents, nous avons par exemple territorialisé notre action médicosociale par pays, chaque unité territoriale étant implantée dans l'un des trois pays avec une direction locale et plusieurs sites à proximité de la population. C'est ainsi que dans le pays du Nivernais-Morvan, à l'Est du département, la direction est à Château-Chinon, et trois sites ont été définis : Château-Chinon, Moulin-Engilbert - à 16 kilomètres - et Corbigny à une trentaine de kilomètres. Vous voyez que cette multiplication des sites sur un espace réduit accroît notre présence en personnel, mais celle-ci est utile parce que les personnes âgées ou en difficulté, dépourvues de moyens de transport, sont nombreuses. Et c'est aussi une façon de contribuer au maintien d'activité sur le territoire. Le département de l'Allier, pour sa part, ne possède que trois unités territoriales d'action médicosociale. Mme Arlette GROSSKOST : Agissez-vous ainsi eu égard à la densité de population ou parce que les publics concernés ne peuvent pas se rapprocher ? M. Marcel CHARMANT : Notre politique concourt à deux objectifs : apporter un service au plus près de nos concitoyens et maintenir une certaine activité dans des secteurs géographiques en difficulté démographique. Une autre cause du niveau élevé des dépenses de fonctionnement est que nous distribuons des prestations supérieures à celles imposées par la loi. Nous continuons par exemple à assurer le versement de l'APA dès que le dossier est réputé complet, sans tenir compte du délai de deux mois instauré par la modification législative de 2003. M. le Rapporteur : C'est sûrement votre droit. M. Marcel CHARMANT : Je pense bien ! M. le Rapporteur : La modification législative de 2003 avait sans doute des raisons. Or vous avez fait le choix de ne pas en tenir compte. M. Marcel CHARMANT : M. le Rapporteur, la majorité parlementaire a modifié la loi sur plusieurs points essentiels : celui-ci, mais également le montant restant à la charge du bénéficiaire, ce qui s'est traduit par une baisse significative des prestations servies, alors que les populations, eu égard à leur niveau de revenu, ont besoin d'aides plus fortes. C'est pourquoi nous avons pris cette décision - que le préfet de la Nièvre, après examen, avait d'ailleurs fini par valider -, même si elle se traduit par des dépenses de fonctionnement supérieures. De même, nous allons au-delà de nos obligations pour la CMU. M. le Président : Et tout cela sans augmenter les impôts ? M. le Rapporteur : Il existe donc encore de la marge, malgré la décentralisation ! M. Marcel CHARMANT : Nous en reparlerons dans cinq ans... M. le Président : Quel est le taux de compensation de l'APA ? S'est-il amélioré, s'est-il dégradé ou est-il stable ? M. Marcel CHARMANT : Le coût net de l'APA, année après année, est en forte augmentation. Mme Arlette GROSSKOST : Tout à l'heure, vous avez parlé d'un différentiel de trésorerie. M. le Président : Il concernait uniquement le RMI. Mme Arlette GROSSKOST : D'accord. En existe-t-il aussi un en matière d'APA ? M. Marcel CHARMANT : C'est évident. M. le Président : Votre département compte beaucoup de personnes âgées et les bases y sont modestes. Bénéficiez-vous d'une péréquation ? M. Marcel CHARMANT : Oui. Pour revenir à l'APA, le coût horaire des prestations, dans la Nièvre, est légèrement supérieur à celui d'un département voisin comme l'Allier. Il faut dire aussi que le conseil général a encouragé les associations gestionnaires à réévaluer les salaires des professionnels de l'aide à domicile. M. le Rapporteur : Les autres départements n'ont-ils pas fait de même ? M. Marcel CHARMANT : Il existe des écarts. Pour notre part, nous avons considéré que l'APA était une mesure intéressante pour les personnes âgées et représentait, de surcroît, un gisement d'emplois. À l'initiative de M. Christian Paul, nous avons d'ailleurs créé, dans un lycée, une formation d'aides-soignantes. M. le Rapporteur : S'agissant de l'APA, vous nous avez communiqué les données concernant les coûts, mais pas celles relatives aux ressources, aux décalages et à leur origine. M. Marcel CHARMANT : Nous ferons le point sur ces éléments et nous vous fournirons ces informations. M. le Président : Sur l'APA, notre Commission sera fixée lorsqu'elle aura reçu le rapport de l'ADF, qui inclura une comparaison intéressante des dépenses de personnel par habitant, d'un département à l'autre, sur la base des chiffres de 2004. En attendant, je comprends que le président Marcel Charmant ne puisse pas répondre avec précision à toutes vos questions. Mme Arlette GROSSKOST : Vous avez évoqué une limitation des dépenses non obligatoires. Mais de quoi s'agit-il exactement ? M. Marcel CHARMANT : Vous savez que la loi confère des compétences précises aux conseils généraux comme aux autres collectivités, mais que celles-ci peuvent toujours décider de se créer des obligations supplémentaires, par exemple pour financer un emploi d'enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs. Mais, compte tenu de la difficulté à réaliser notre budget, surtout lorsque tous les transferts auront été effectués, nous serons sans doute obligés de revenir sur certaines d'entre elles pour garantir le financement de nos compétences. Mme Arlette GROSSKOST : Dois-je comprendre que les emplois-tremplins constituent des dépenses non obligatoires ? M. Marcel CHARMANT : Cette mesure ne ressortit pas à une compétence obligatoire ; c'est une obligation que nous nous sommes fixée. Les conseillers généraux de la Nièvre disposent, depuis l'an dernier, d'un tableau faisant apparaître, politique par politique, le coût des compétences obligatoires et le surcoût décidé par l'assemblée départementale. M. le Rapporteur : Excellente idée ! Notre Commission d'enquête s'en inspirera volontiers. M. Marcel CHARMANT : En matière agricole, par exemple, hormis l'aménagement foncier, le département n'a aucune compétence obligatoire et nous serons donc amenés à examiner toutes les autres dépenses, en fonction de notre capacité à réaliser le budget. M. le Président : Soit vos actions ne servent à rien, soit elles sont indispensables. Dans ce cas, qui se substituera à vous ? M. le Rapporteur : Le monde ne se dessine pas toujours en noir et blanc... Pourriez-vous nous procurer une maquette de cette présentation ? M. Marcel CHARMANT : D'accord. M. le Président : Vous ne nous avez pas parlé des dépenses liées aux SDIS. Savez-vous ce que vous coûtera, cette année, l'amélioration du statut des sapeurs-pompiers volontaires et quelle compensation vous recevrez de l'État ? M. Marcel CHARMANT : La dernière loi, pour nous, représente 60 000 euros par an en ce qui concerne la formation des officiers sapeurs-pompiers professionnels et 465 000 euros par an en ce qui concerne la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, somme compensée à hauteur de 167 000 euros. M. le Président : Je suppose que ce montant vous a été notifié ? M. Philippe PARLANT-PINET : Absolument. M. Alain GEST : La progression de ces dépenses sera considérable, comme partout. Pour mettre en évidence le coût des services d'incendie et de secours, que penseriez-vous de l'instauration d'une taxe spécifique identifiable parmi les impôts locaux ? Préférez-vous au contraire que ces sommes restent noyées dans le budget des communes et surtout des départements ? M. Marcel CHARMANT : Il est bon que chacun sache ce que coûte le service qu'on lui apporte. Toutefois, le financement des SDIS, qui mutualisent des moyens au profit des populations, doit être inclus dans un budget global de solidarité et j'estime personnellement que la répartition de la solidarité devrait intervenir au niveau national. Quoi qu'il en soit, il faudrait mieux faire ressortir ce que coûte tel ou tel service. C'est pourquoi nous proposons aux Nivernais une présentation budgétaire un peu originale : les dépenses de fonctionnement de la machine administrative sont distinguées des enveloppes mises à la disposition de la Nièvre et des Nivernais, chacun pouvant ainsi voir ce que le département lui consacre. Un conseil de questure que j'ai créé, composé de conseillers de la majorité et de l'opposition, est arrivé aux conclusions suivantes : 86 % des moyens sont dépensés au profit des usagers et 14 % vont au fonctionnement de l'institution. Lors des réunions cantonales, nous organisons une exposition et nous remettons une brochure aux personnes présentes - car nous savons où finissent les papiers que reçoivent les gens dans leur foyer. Et c'est dans le même esprit que nous retransmettons par Internet les sessions du conseil général. M. le Président : Allez-vous devoir accroître les effectifs d'assistantes maternelles ? M. Marcel CHARMANT : Nous dénombrons 300 assistantes maternelles pour 560 enfants placés. La Nièvre a longtemps été en avance sur la législation et le statut, mais les évolutions législatives et réglementaires récentes nous invitent à inscrire une somme d'un peu plus de 200 000 euros supplémentaires. M. le Président : Plusieurs départements éprouvent des difficultés avec les jeunes étrangers. La Nièvre est-elle dans ce cas ? M. Marcel CHARMANT : Nous ne sommes pas concernés par ce problème. M. le Président : Le Directeur général de l'action sociale nous a affirmé que la loi sur le handicap serait mise en œuvre avec une compensation à l'euro près. Qu'en pensez-vous ? M. Marcel CHARMANT : Sur ce chapitre, je suis inquiet car je m'attends à une compensation insuffisante. M. le Rapporteur : Pour quel motif nourrissez-vous cette inquiétude ? Vous est-elle inspirée par vos discussions avec les services de l'État ? Nous avons en effet perçu des craintes chez plusieurs présidents de conseils généraux, que semblent toutefois contredire les précisions assez carrées de l'administration centrale. M. Marcel CHARMANT : Mon impression a tout de même des fondements : quand je compare ce que l'État inscrit en faveur du handicap aux besoins exprimés sur le terrain, il me semble que le compte n'y sera pas. M. le Rapporteur : Comment définissez-vous les besoins ? M. Marcel CHARMANT : En fonction du nombre de bénéficiaires et des degrés de handicap. M. le Président : S'agissant du RMI, estimez-vous que, dans la Nièvre, le personnel de gestion de l'État suffit ? M. Marcel CHARMANT : C'est ce qui nous amène à être très prudents et réservés sur les transferts des agents de la DDE ou des TOS. Lorsque le RMI a été transféré, le 1er janvier 2004, au terme d'une négociation de marchands de tapis, nous sommes parvenus à un total de 7,3 équivalents temps plein et nous avons été dans l'obligation de recruter deux agents supplémentaires. Je ne lâcherai pas prise sur ces deux postes, car je refuse que la gestion du RMI coûte plus cher au conseil général de la Nièvre qu'elle ne coûtait à l'État. Je précise enfin que la caisse d'assurance maladie, jusqu'au 31 décembre 2003, mettait une personne à disposition de l'État et que ce poste n'a pas été compensé ; et je passe sous silence le coût des bureaux et des postes de travail. L'expérience du RMI nous a donc un peu échaudés, d'autant que cela ne jouait que sur 7,3 postes quand les effectifs de la DDE et des TOS atteignent respectivement 300 et 200 personnes. M. le Président : Les transferts réalisés cette année - fonds de solidarité pour le logement, centres locaux d'information et de coordination, fonds d'aide aux jeunes, plans départementaux d'élimination des déchets - donnent-ils lieu à des différends avec l'État ? Font-ils l'objet de compensations ? M. Marcel CHARMANT : Globalement, nous y arrivons. M. le Président : Même s'agissant du personnel ? M. Marcel CHARMANT : Pour le personnel, c'est toujours le même système : pour le plan départemental d'élimination des déchets, le préfet propose 0,15 équivalent temps plein. Admirez la précision du calcul ! M. le Président : Quelles charges cela entraîne-t-il en réalité pour le département ? M. Marcel CHARMANT : Notre plan d'élimination des déchets a été mis en œuvre sous l'autorité de l'État et il était prévu de le réviser avant fin juin 2005. Un problème de site d'enfouissement de déchets n'avait pu être réglé à l'époque. J'hérite bien évidemment de la charge de cette révision, avec seulement 0,15 équivalent temps plein. M. Alain GEST : La loi précédente autorisait les départements à prendre cette compétence, j'attire l'attention de notre Commission sur ce point. Certains ne s'en sont pas privés et ne connaissent par conséquent pas aujourd'hui les mêmes désagréments que la Nièvre. Son cas ne peut donc pas être généralisé. M. le Président : Je constate que la loi transfère désormais cette compétence à tous les départements. Il s'agit donc d'apprécier si l'État compense cette décentralisation. Êtes-vous en mesure d'évaluer ce que représenteront les charges relatives à l'aménagement foncier ? À combien s'élèveront les compensations ? M. Marcel CHARMANT : Sur ce point, je vous avouerai que je suis incapable de vous donner sur-le-champ des éléments de réponse précis. Je vous les ferai parvenir. M. le Président : M. le Président, je vous remercie. Audition de M. Gilles CARREZ, (Un document présenté par M. CARREZ à l'appui de son intervention est reproduit en page 393 du tome III du présent rapport) Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Gilles Carrez est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Gilles Carrez, en tant que Président du Comité des finances locales. M. le Président, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Président du comité des finances locales, vous êtes un observateur privilégié - et engagé - de l'évolution du financement des collectivités territoriales. Vous pourriez notamment nous faire part de votre analyse des causes de l'évolution de la fiscalité locale en insistant plus particulièrement sur l'état des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, mais également de vos appréciations sur la TIPP, la taxe sur les conventions d'assurance et la façon dont les collectivités pourraient faire évoluer leurs taux, ainsi que sur la réforme de la taxe professionnelle. M. le Président rappelle à M. Gilles Carrez que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Gilles CARREZ : Je suis très heureux de pouvoir évoquer plus particulièrement devant vous ce matin la question assez obscure des modalités de concours de l'État aux collectivités territoriales par le biais des compensations fiscales. Si le sujet est peu connu, les enjeux sont considérables : sur la base des comptes de 2003, l'État, c'est-à-dire le contribuable national, se substitue au contribuable local pour 46 à 48 % de la taxe professionnelle, pour 31 ou 32 % de la taxe d'habitation et pour un peu moins de 5 % de l'ensemble des taxes foncières. Qui plus est, cette substitution s'opère par le biais de mécanismes d'une extraordinaire complexité, hermétiques et largement méconnus. Afin de bien faire comprendre la situation et surtout de contrebattre des idées reçues, je prendrai l'exemple de la taxe d'habitation avant d'évoquer la taxe professionnelle et le projet de sa réforme. S'agissant de la taxe d'habitation, on a coutume de dire que plus une collectivité augmente son taux, plus le contribuable national vole au secours du contribuable local. Cela a été vrai, mais ce ne l'est plus aujourd'hui, la mise en place des mécanismes de dégrèvement, d'exonération ou de compensation s'étant progressivement accompagnée de l'introduction du principe dit du « gel des taux ». Le premier ensemble de « compensations » - qui au départ étaient des dégrèvements - concernait les personnes âgées de plus de soixante ans et les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, ou de l'allocation spéciale du fonds de solidarité vieillesse. Introduits voilà déjà vingt ou trente ans, ces dégrèvements ont été transformés en exonérations en 1992 ; depuis cette époque, l'État verse aux collectivités territoriales une compensation, mais seulement à hauteur des taux pratiqués dans lesdites collectivités en 1991. Autrement dit, si le nombre d'allocataires de l'AAH augmente dans une commune, l'assiette va évidemment augmenter, et en temps réel ; en revanche, le niveau de compensation par l'État ne sera multiplié que par le taux de 1991. Plus récemment, a été introduit le système du plafonnement en fonction du revenu, qui joue pour tous les contribuables et représente aujourd'hui une bonne moitié des 4 450 millions d'euros de substitution du contribuable national au contribuable local au titre de la taxe d'habitation. Ce plafonnement fait lui aussi l'objet d'un gel de taux depuis 2001. On ne peut donc pas dire que plus la commune augmente son taux, plus le contribuable national vole à son secours, puisque seule l'assiette évolue, le deuxième élément de la multiplication restant plafonné à son niveau de 2001. En revanche, si le nombre de personnes à faibles revenus, pour lesquelles la taxe d'habitation représentera plus de 4,3 % du revenu, vient à augmenter, l'assiette augmentera mais la compensation restera calculée sur la base du taux 2000. Il n'y a plus, en matière de taxe d'habitation, qu'un seul système totalement « pur », pour lequel on peut vraiment parler de dégrèvement intégral - assiette réelle multipliée par le taux réel : celui qui s'applique aux RMIstes et aux personnes logées en foyer d'hébergement collectif. Aucun ticket modérateur ne pèse alors sur la commune. Reste un point, découlant d'un amendement sénatorial au projet de loi de finances pour 2003, adopté en commission mixte paritaire, et qui répond au souci, partagé par la Représentation nationale et par le Gouvernement, de ne pas encourager l'augmentation des impôts locaux par la substitution systématique du contribuable national : je veux parler des abattements généraux auxquels il était possible de procéder dans le cas de la taxe d'habitation. Bon nombre de villes avaient eu tendance à créer ce type d'abattement, espérant alléger, par ce biais, leur taxe d'habitation. Mais le système s'étant généralisé, elles se sont finalement rendu compte qu'à diminuer ainsi leur taxe d'habitation, elles faisaient moins jouer le mécanisme de prise en charge par l'État. Aussi certaines villes ont-elles fait marche arrière depuis quelques années et supprimé leurs abattements généraux, ceux dont tout le monde profite quel que soit le revenu. L'abattement étant supprimé, le montant de taxe d'habitation augmente ; mais sitôt qu'il dépasse 4,3 % du revenu, il est pris en charge par le contribuable national... Aussi l'amendement proposé par le sénateur Yves Fréville et adopté en loi de finances 2003 a-t-il gelé la situation, en prévoyant que le dégrèvement serait calculé en prenant en compte les abattements tels qu'ils existaient en 2003. Autre illustration de ce souci de maîtrise, la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, intervenue en 2000. En l'espèce, c'est un autre mécanisme qui a joué puisque non seulement l'assiette, mais également les taux ont été gelés à leur niveau de 2000. Ainsi figé, le produit est désormais indexé comme la dotation globale de fonctionnement. Nous sommes dans une mécanique pure de compensation et non plus de dégrèvement. Mais plusieurs régions, ayant eu vent de la suppression prochaine de la part régionale - ce qui fut chose faite avec une loi de finances rectificative adoptée au printemps 2000 -, ont fortement augmenté leur taux 2000 afin de bénéficier d'un niveau de compensation optimal, qui évolue désormais comme la dotation globale de fonctionnement. M. le Président : Il n'y en a pas eu beaucoup. M. Gilles CARREZ : Deux : le Nord-Pas-de-Calais et, si je ne m'abuse, le Limousin. M. René DOSIÈRE : N'était-ce pas plutôt PACA ? M. le Président : Je pensais plutôt à la Lorraine... Quoi qu'il en soit, elles n'étaient pas nombreuses. M. Richard MALLIÉ : Sur 22 régions, cela fait tout de même 10 %... M. René DOSIÈRE : C'est ce qu'on appelle une dotation de précaution... M. Gilles CARREZ : Tout cela montre, en tout cas, que nous devons rester très attentifs à ce que nos mécanismes de compensation et de dégrèvement n'aboutissent pas à récompenser ceux qui augmentent les taux. Mais on ne saurait en déduire que le système encourage le vice et décourage la vertu, comme je l'entends régulièrement dire ; ce n'est plus exact. Dans pratiquement tous les cas - celui des titulaires du RMI excepté -, les taux ont été gelés soit sur leur base 1991, soit sur leur base 2000. Un des tableaux tirés du rapport de M. Yves Fréville10 sur la taxe d'habitation montre la répartition géographique de la substitution du contribuable national au contribuable local en matière de taxe d'habitation. Ce sont le Nord de la France, notamment le Nord et le Pas-de-Calais, et, plus surprenant, tout le pourtour méditerranéen qui bénéficient de la prise en charge la plus élevée de la taxe d'habitation par le contribuable national. Le tableau détaille, en francs par habitant, les montants par département. À un extrême, on trouve les Alpes-Maritimes, dont la taxe d'habitation totale, dégrèvements compris, est de 1 781 francs par habitant, dont 619 francs, soit 34,7 %, sont pris en charge par le contribuable national ; à l'autre extrême, en Lozère, les ressources totales provenant de la taxe d'habitation ne représentent que 535 francs par habitant dont 138 francs, soit 25,7 %, en dégrèvements... Sachant que ces dégrèvements sont censés compenser les disparités de revenus, faut-il en déduire qu'un habitant des Alpes-Maritimes est en moyenne deux fois plus pauvre qu'un Lozérien ? Explication absurde... Quand bien même on a gelé les taux dès le début des années quatre-vingt-dix, l'accumulation du passé a créé des distorsions géographiques considérables. Imaginons que le contribuable national compense partout sur la base du même taux - disons 30 %, le taux moyen - et regardons quels départements toucheraient par habitant soit beaucoup plus, soit beaucoup moins. Toucheraient plus de 50 francs11 de plus que la moyenne : la Corse-du-Sud - 230 francs - , les Pyrénées-Orientales - 197 -, la Haute-Corse - 180 -, l'Hérault - 155 -, le Gard - 153 -, le Vaucluse - 135 -, les Alpes-Maritimes - 96. Avec 69 francs, le Pas-de-Calais vient loin derrière alors que c'est pourtant, objectivement, l'un des départements les plus pauvres de France en termes de revenu par habitant. À l'inverse, les départements qui se situent 35 francs au-dessous de la moyenne, autrement dit qui touchent le moins, sont logiquement Paris, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'Essonne ; mais on y trouve également l'Eure-et-Loir - pourquoi ? -, l'Eure, le Loiret, l'Oise... On voit bien que nos mécanismes de substitution du contribuable national au contribuable local ne sont pas satisfaisants, en dépit de tous les correctifs apportés depuis une douzaine d'années. S'agissant de la taxe professionnelle, je n'ai malheureusement pas pu obtenir pour ce matin, malgré mes demandes renouvelées, la répartition géographique du plafonnement à la valeur ajoutée. Mais je ne désespère pas... Nous pourrions ainsi, comme pour la taxe d'habitation, vérifier s'il existe une corrélation en termes de produit, de bases, de taux et de plafonnement à la valeur ajoutée. N'existe-t-il pas, dans certaines communes, des entreprises plafonnées à la valeur ajoutée tout simplement par le fait que les taux desdites communes sont particulièrement élevés ? Autrement dit, plus on serait riche en bases de taxe professionnelle, plus, dans certains cas, on ferait appel au contribuable national en déclenchant le plafonnement à la valeur ajoutée par une politique de taux excessifs ! Nous sommes là au cœur de la problématique de la réforme de la taxe professionnelle. Deux grandes options s'ouvrent. Il y a d'abord celle du « rapport Fouquet », dont on connaît la complexité : changement d'assiette, réintroduction des salaires à travers la valeur ajoutée, encadrement, « tunnellisation » de taux, etc. Il y en a une autre, évoquée à maintes reprises et notamment par le Président Augustin Bonrepaux, qui part du principe suivant : le problème tient d'abord aux entreprises plafonnées, et particulièrement dans l'industrie. C'est ainsi que nos deux principaux constructeurs automobiles sont, du fait de leur chiffre d'affaires élevé, théoriquement plafonnés à 4 %. Or, ils paient une taxe professionnelle supérieure à ces 4 %, tout simplement parce que le dégrèvement a été gelé sur la base des taux de 1995 ou 1996, depuis une réforme à laquelle nous avons été quelques-uns ici à participer, alors que le taux a pu sensiblement augmenter depuis. Le « cœur de cible » du problème posé n'est-il pas, précisément, les entreprises qui, manifestement, paient trop de taxe professionnelle par rapport à leur valeur ajoutée ? Mais « rétablir la vérité » pour ces entreprises ne conduit-il pas à donner une prime aux collectivités qui ont fortement augmenté leur taux depuis 1996 ? Ne faudrait-il pas alors mettre au point un dispositif en deux articles, le premier disposant qu'aucune entreprise en France ne peut payer plus de 3,5 % de valeur ajoutée et le second qu'à partir du moment où une entreprise paie 3,5 % de sa valeur ajoutée, une augmentation de taux ne s'appliquera pas à l'établissement en question, d'ores et déjà plafonné ? De la sorte, le gisement fiscal constitué par cette entreprise serait rendu inexploitable. Nous introduirions ainsi un mécanisme de responsabilité, ce que nous avions essayé de faire, mais sans réussir, en 1996. Comment parvenir à un système équitable qui n'encourage pas les augmentations de fiscalité locale ? M. le Rapporteur : Dans un esprit de responsabilité et de clarification du rôle des collectivités, le débat s'est ouvert sur la spécialisation de l'impôt. Mais il s'est assez rapidement refermé, semble-t-il, autour de l'idée qu'il serait difficile d'entreprendre cette réforme en même temps que celle de la taxe professionnelle. Or nos travaux ont largement mis en évidence l'intérêt d'une meilleure spécialisation de l'impôt. Quel est l'avis du Président du Comité des finances locales ? Pense-t-il réellement que ces deux défis ne peuvent être relevés en même temps, ou sinon, par quelles voies ? M. Gilles CARREZ : Traiter également de la spécialisation de l'impôt, c'est effectivement conduire une deuxième réforme, autrement dit une opération extrêmement difficile. Ma conviction est que nous devons impérativement réduire le nombre d'échelons responsables en termes de vote de taux de taxe professionnelle. Il ne s'agit pas de raisonner en intégriste de la spécialisation de l'impôt et de s'en tenir à un seul impôt par niveau de collectivité, mais de reconnaître qu'il y a aujourd'hui six niveaux de décision sur la taxe professionnelle : l'État, à travers la cotisation minimale et la cotisation de péréquation, la région, le département, l'intercommunalité à quatre taxes, la commune et les chambres de commerce et d'industrie... Jamais nous ne parviendrons à une véritable responsabilisation avec un impôt éclaté entre six niveaux différents. Simplifier est devenu indispensable. La question reste de savoir s'il faut le faire en même temps que la réforme de l'assiette. Mon sentiment est qu'il faut rester prudent. La réforme de l'assiette est une affaire suffisamment difficile pour ne pas y ajouter une deuxième réforme au risque de nous conduire à un blocage généralisé. Ou alors, on pourrait faire une réforme plus simple - du type de celle que j'envisageais en seconde option, en traitant d'abord du cas des entreprises situées au-delà du plafond théorique de valeur ajoutée -, ce qui permettrait peut-être de greffer dessus une simplification du paysage des bénéficiaires. Mais quelle collectivité enlever ? La région, le département ? J'exclus pour ma part d'enlever les communes et les intercommunalités. La réforme de l'intercommunalité avec la mise en place de la TPU est une bonne réforme, dont nous verrons, à un horizon de moins de dix ans... M. Jean-Pierre BALLIGAND : Les vertus ! M. Gilles CARREZ : ...les effets très positifs sur l'unification de la taxe professionnelle. Certes, on peut, d'un autre côté, regretter que la création d'une nouvelle structure entraîne des complications, voire des doublons. On peut dire beaucoup de choses de l'intercommunalité, mais il y aura autant d'appréciations que d'intercommunalités... On en trouve de très légères en termes de moyens nouveaux, qui ont donné lieu à de véritables redistributions de moyens entre les communes membres et l'établissement de coopération, et d'autres à l'inverse qui ont généré énormément de frais généraux. Je me refuse à porter un jugement global, hormis sur un point : l'intérêt de la TPU, du fait, premièrement, de l'unification du taux, deuxièmement, des mécanismes de solidarité qui, de fait, se mettent en place à travers la dotation de solidarité. Tout cela se met à fonctionner de façon assez souple et réellement décentralisée. Je ne voudrais pas que quelques excès flagrants - recrutements, voitures de fonction ou indemnités - en viennent à masquer l'intérêt profond de la dynamique de la taxe professionnelle unique. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Au demeurant, les excès en question se sont beaucoup calmés. M. le Rapporteur : Venons-en à une question de nature un peu philosophique, qui a déjà fait l'objet d'échanges lors de précédentes auditions. Le système financier qui, venant de l'État, alimente les collectivités territoriales sous forme de dotations ou d'impôts apparaît assez neutre au regard des objectifs que l'État pourrait se donner ou avoir envie de faire partager avec les collectivités territoriales. Sans évidemment déroger aux principes de décentralisation et d'autonomie des collectivités, ne pourrait-on imaginer que les financements de l'État, leur évolution, éventuellement certaines clauses de rendez-vous tiennent compte de priorités politiques que celui-ci exprimerait ? À l'inverse, une telle idée apparaît-elle aux yeux du Président du Comité des finances locales comme attentatoire aux principes d'objectivité, de transparence, d'automaticité, en quelque sorte, de la relation financière qui doit unir l'État et les collectivités territoriales ? J'improvise un exemple assez explicite : celui du transfert du RMI. L'État semble assouplir progressivement la règle initiale pour ce qui concerne l'année et les termes de référence de la compensation. Autrement dit, l'attitude qui prévaut aujourd'hui consiste, en gros, à donner un coup de pouce financier pour calmer le débat, en reconnaissant que la loi est imparfaite et contraignante au regard de la charge réelle des départements - quitte à prendre le risque de devoir recommencer dans deux ou trois ans si les dépenses de RMI augmentent encore. Mais alors, plutôt que d'une réelle décentralisation, il s'agirait d'une délégation de compétence où les départements reviendraient systématiquement vers l'État sitôt que le dispositif coûterait objectivement plus cher. Ne pourrait-on imaginer une autre logique, qui procéderait d'une vision plus rigoureuse, voire rigide, du transfert initial, quitte à ce que les masses se construisent à partir de l'appréciation par l'État de l'efficacité des politiques locales et de la réalisation d'objectifs quantifiés en termes de nombre de sorties du dispositif ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : C'est quoi, ça ? M. le Rapporteur : Pour l'instant, c'est ma question. Cela paraît-il, aux yeux du Président du Comité des finances locales, attentatoire à la décentralisation ? Nous avons actuellement affaire à des transferts très statiques, mais l'État a-t-il réellement une politique des finances locales ? L'État a des engagements, qu'il tient plus ou moins bien en termes de dotations ; de l'autre côté, il y a l'évolution de la fiscalité locale. Ne peut-on imaginer donner à cette dépense, importante, et à son évolution un contenu plus politique ? M. Gilles CARREZ : Question très difficile ! Les concours de l'État aux collectivités territoriales - y compris les dégrèvements, mais hors fiscalité transférée - représentent un total de l'ordre de 61 milliards d'euros. Somme considérable, qui suppose au préalable de poser quelques principes. Premièrement, l'État et les collectivités territoriales sont des acteurs publics qui essaient de conduire le pays dans le sens de l'intérêt général. Un système dans lequel les collectivités ne bénéficieraient pas de la croissance alors qu'elles emploient, qu'elles investissent, qu'elles jouent un rôle économique majeur, ne serait pas acceptable. Or ce point est d'autant plus important que la fiscalité locale reste archaïque, difficilement réformable, extraordinairement fragile et vulnérable - on nous parle un jour de la suppression de la taxe professionnelle, le lendemain de la suppression du foncier non bâti... J'attends le surlendemain ! -, alors que les impôts modernes - impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, TVA - alimentent le budget de l'État. Les collectivités territoriales doivent donc être très fermes sur le principe d'un partage général d'une partie de la recette fiscale « moderne » ; ce partage est exprimé par ce qu'on appelle le contrat de croissance et de solidarité, mis en place voilà une petite dizaine d'années. Cette contractualisation doit absolument être maintenue, avec un lien avec la croissance - un tiers, la moitié ? Les finances de l'État sont dans une situation telle que l'on ne saurait se montrer irresponsable et sans arrêt revenir à la charge. Deuxièmement, ce système contractuel général est d'abord un système de partage et de garantie. Il doit donc être le plus neutre possible ; on ne saurait y greffer une multitude de sous-dotations ou sous-financements aux fins de poursuivre tel ou tel objectif souhaité par l'État. La question reste d'abord celle d'un financement pérenne, assuré, régulier des collectivités territoriales. Celles-ci sont évidemment plus ou moins favorisées en termes de recettes, ou doivent répondre à des besoins de dépense plus ou moins forts selon les cas. Aussi, à côté d'un socle garanti sur une longue durée, qui est essentiel, il me paraît naturel de chercher à développer la péréquation et la solidarité. La réforme globale de la DGF, le souci de prendre en compte des critères de meilleure qualité - ainsi le potentiel financier à la place du potentiel fiscal - me paraissent à cet égard aller dans le bon sens. Faut-il aller plus loin et essayer, à l'occasion notamment de transferts de compétences, de définir des objectifs ? Peut-être, mais cela ne peut se faire qu'à la marge et par une voie contractuelle spécifique, bien distincte de la garantie générale de partage de recettes de l'État au bénéfice des collectivités territoriales. En résumé, voilà comment je vois le dispositif, pour répondre avec précision à votre question : un socle garanti, une part de péréquation qui ira grandissant, doucement mais sur la base de critères très généraux, et enfin l'alimentation, par une démarche contractuelle spécifique, au titre d'objectifs à rechercher en commun entre l'État et telle ou telle catégorie de collectivités. M. René DOSIÈRE : Je souscris aux propos de M. Gilles Carrez sur la taxe d'habitation. La réforme du printemps 2000 - la date est importante - a finalement créé deux systèmes de taxe d'habitation. Pour une moitié des contribuables, la taxe reste celle que l'on connaît depuis longtemps, assise sur la valeur locative et dont les taux sont votés par les collectivités, avec sa dégressivité maintenue - autrement dit, plus on gagne, moins on en paie en proportion. Pour une autre moitié des contribuables, la taxe d'habitation, pratiquement déconnectée des décisions locales, est devenue un impôt sur le revenu qui, certes, va aux collectivités territoriales, mais dont le taux est fixé au niveau national et plafonné à 4,3 % du revenu de référence. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Ce n'est donc pas un impôt local. M. René DOSIÈRE : La coexistence de ces deux systèmes n'est pas sans créer des problèmes. Dans certaines zones géographiques, des villes en particulier, la répartition est loin d'être à 50-50 ; ce peut être parfois 80-20, avec les conséquences que l'on devine. Ne devrait-on pas essayer de supprimer la taxe d'habitation dégressive, en faisant passer dans la deuxième catégorie les contribuables concernés, en modulant au besoin les taux, afin d'aboutir à un impôt plus moderne et qui soit réellement fonction du revenu ? Une observation, enfin, que j'ai tirée de la lecture du rapport sur la réforme de la taxe professionnelle. Selon mes calculs, l'État prend aujourd'hui en charge 75 % de la taxe professionnelle payée par les entreprises - en tout cas de 70 à 75 % dès lors que l'on ajoute aux prises en charge habituelles le montant correspondant à la diminution d'impôt sur les sociétés résultant de la déduction de la TP, ainsi que le coût de la déduction au titre des investissements décidée par le Président de la République. Les chiffres figurent dans le « rapport Fouquet ». Lorsqu'on les additionne, on s'aperçoit que cela fait quand même beaucoup... M. Gilles CARREZ : Le parallélisme est flagrant entre la taxe professionnelle et la taxe d'habitation. Aujourd'hui, la taxe professionnelle est payée pour 50 % sur la base de la valeur ajoutée, en déconnexion totale avec son assiette juridique. M. René DOSIÈRE : 50 % du montant. M. Gilles CARREZ : En effet. Quant à la taxe d'habitation, elle est payée par 50 % des contribuables sur la base du revenu, elle aussi en déconnexion totale avec son assiette juridique ! Il est frappant que, sur ces deux impôts majeurs, on en soit arrivé à la même situation ; cela montre bien la fragilité et le caractère contestable de leurs assiettes. M. René Dosière propose d'aller jusqu'au bout de la démarche, dans la ligne d'une réflexion déjà très ancienne : dès 1990-1991, on envisageait déjà d'asseoir la totalité de la taxe d'habitation départementale sur le revenu. M. Jean-Pierre BALLIGAND : C'était la TDR. M. Gilles CARREZ : La réforme avait été votée, puis suspendue, car on se heurtait exactement au même problème que celui dont je parlais pour la taxe professionnelle : un risque de variations massives entre contribuables. En outre, si l'on devait reprendre cette réforme aujourd'hui, il y aurait une contradiction majeure, frontale, avec la politique de baisse de l'impôt sur le revenu menée depuis 2000. Mais l'idée reste d'autant plus séduisante que nous n'avons toujours pas réussi à mettre en place la réforme des valeurs locatives. Serpent de mer, me dira-t-on ; encore faut-il en parler... Je me prends parfois à rêver à ce que nous aurions pu faire si, voilà quinze ans, plutôt que de chercher à faire « le grand soir », nous nous étions astreints chaque année, comme nous le faisons pour les immeubles neufs, à réviser les valeurs locatives à chaque mutation de propriété. Moyennant une « clause balai » prévoyant une révision obligatoire pour les immeubles n'ayant pas fait l'objet de mutation pendant tout ce temps, nous nous serions retrouvés au bout de dix ou quinze ans avec un système à peu près satisfaisant... Mais même cela, nous ne l'avons pas fait. En l'absence de révision des valeurs locatives, la tentation est grande de généraliser à l'ensemble des contribuables l'assiette « revenu » qui joue pour l'instant sur la moitié d'entre eux à travers les 4,3 % du revenu de référence. Mais je ne vois pas quel gouvernement ou quelle majorité s'y risquerait... M. Jean-Jacques DESCAMPS : Dieu nous en garde ! M. Gilles CARREZ : Chacun a déjà donné, sur ce chapitre ! M. Charles de COURSON : Le Président du Comité des finances locales pose la question de fond : comment trouver un système qui responsabilise les élus locaux, pour ceux en tout cas qui croient en la démocratie locale ? Or nous n'y croyons plus, à voir comment le système a évolué en quinze ans : majorité après majorité - peut-être un peu plus vite à gauche et un peu moins vite à droite et au centre -, nous nous sommes tous ingéniés à mettre en place des systèmes de déresponsabilisation. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Ce ne sont pas des systèmes de déresponsabilisation, mais des systèmes de péréquation... M. Charles de COURSON : Comment rétablir un système de responsabilisation des élus au regard du lien entre la dépense et le niveau de pression fiscale ? Ne pas répondre à cette question, c'est abandonner toute idée de démocratie locale : nous sommes en train d'évoluer vers un système de dotations à la Thatcher. J'avais du reste qualifié M. Dominique Strauss-Kahn de thatchérien lorsqu'il a supprimé la part salaires. Il en a été choqué... M. Jean-Pierre BALLIGAND : Pas tant que cela ! M. Charles de COURSON : Grosso modo, vous êtes les porteurs d'une grande thèse développée par la technostructure du ministère des Finances depuis vingt ans : il faut faire vivre les collectivités territoriales à coup de dotations. Force est de constater que ce phénomène progresse d'année en année : le Président Augustin Bonrepaux lui-même, grand défenseur des libertés locales, ne parvient pas à empêcher ses propres amis d'y céder lorsqu'ils sont dans la majorité. M. Gilles Carrez entrevoit-il la possibilité d'un retour en arrière ou est-ce perdu ? On ne veut pas donner d'impôts modernes aux collectivités territoriales pour mieux les étrangler. Elles seront réduites à vivre de dotations, mais de dotations formidablement inégalitaires dans la mesure où, M. Gilles Carrez aurait pu le montrer pour la taxe professionnelle comme il l'a fait pour la taxe d'habitation, les situations de départ ont été gelées : comme on dit chez moi, « plus que tu es riche, plus que tu en as ! » Comment sortir de cette impasse, et faut-il en sortir ? M. Gilles CARREZ : À défaut d'y mettre un coup d'arrêt, la révision de la Constitution a rendu beaucoup plus difficile la substitution de dotations à des impôts locaux. Certes, je vous concède, cela fera plaisir au Président de votre Commission, que de la TIPP répartie par arrêté interministériel, cela ressemble furieusement à une dotation... M. Charles de COURSON : C'est ce que nous avions dit. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Mais vous l'avez voté. M. Charles de COURSON : Non, justement. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Vous vous êtes abstenu... M. Gilles CARREZ : La question est de savoir de quels impôts locaux modernes, c'est-à-dire efficaces, épousant l'activité économique, pourraient bénéficier les collectivités territoriales. M. René DOSIÈRE : Et les revenus des ménages... M. Gilles CARREZ : Ne tombons pas non plus dans la critique facile de l'archaïsme des impôts locaux. La base foncière est extraordinairement moderne ; on la retrouve dans toutes les collectivités territoriales de tous les pays développés. Nous ne devons pas la négliger. Au risque de paraître ridicule, je maintiens que la révision et l'adaptation des valeurs locatives cadastrales sont indispensables. C'est le seul moyen de sauvegarder nos finances locales. Se pose ensuite la question de l'assiette de la taxe professionnelle. L'assiette limitée aux investissements est insupportable. Nous l'avons tous entendu dire, en privé ou en commission, par le ministre des Finances de l'époque : la suppression de la part salaires n'était que la première étape de la suppression pure et simple de la taxe professionnelle. Pourquoi avoir choisi de commencer par la part salaires ? Parce que les salaires, c'est l'emploi, et aussi par pragmatisme : la part salaires ne représentait qu'un tiers de l'assiette, 60 milliards de francs, sa suppression n'était donc pas budgétairement hors de portée pour l'État, d'autant qu'elle ne lui aura finalement coûté que 40 % de ce montant, disons autour de 25 milliards de francs. Le reste aura été récupéré, d'abord par le biais de la cotisation minimale. L'idée de la cotisation minimale, totalement « brevetée élus locaux » - AMF et Comité des finances locales -, consistait à alimenter un Fonds national de péréquation, redistribué aux collectivités dont les bases étaient insuffisantes. Mais l'État n'a pas voulu la mettre en œuvre, et dès qu'il l'a fait, ce fut pour se l'approprier... M. le Président : Exact ! M. Gilles CARREZ : Qui plus est, le rapport d'exécution 2004 montre que la cotisation minimale s'est véritablement envolée pour atteindre désormais plusieurs milliards d'euros... L'État a donc fait une bonne affaire. Avec le relèvement de la cotisation de péréquation, plus l'effet « impôt sur les sociétés », cette réforme n'aura finalement coûté au budget que 25 milliards de francs sur les 60 milliards annoncés. Et c'est du reste pour cela qu'elle a été possible : nous sommes aujourd'hui budgétairement incapables de supprimer ce qui reste, autrement dit la part investissements. D'où la recherche d'une nouvelle assiette. La décision prise de dégrever - un vrai dégrèvement, total, en assiette et en taux - tous les nouveaux investissements a un immense intérêt : elle ne coûtera qu'à partir de 2006. Mais elle a un immense inconvénient : à partir de 2006, le compteur tournera à toute vitesse - 1,4 milliard d'euros en 2006, 2,8 milliards d'euros, toutes choses égales par ailleurs, en 2007, et ainsi de suite... À ce rythme, au bout de dix ans, il n'y a plus de taxe professionnelle, seulement un dégrèvement généralisé et une compensation par l'État. Nous devons impérativement sortir de ce piège budgétaire. M. Pierre BOURGUIGNON : Vous parlez sous serment et vous êtes tout à la fois le Président du Comité des finances locales et notre Rapporteur général du budget... Lors de la discussion du budget pour 2004, vous aviez demandé le rejet de l'amendement visant à réformer la taxe professionnelle. Pourtant, quelques semaines après, le Président de la République annonçait la réforme de cet impôt... Aviez-vous été informé du projet du Président de la République ? La TIPP est souvent considérée comme une imposition dynamique. Mais comment pouvez-vous concilier cette affirmation avec la position prise par la majorité parlementaire durant le débat budgétaire, qui affirmait que la hausse des prix s'était finalement traduite par de moindres recettes pour l'État du fait d'un ajustement à la baisse des consommations ? Quelle marge de fluctuation pourrait, selon vous, être laissée à chaque région et à quelles différences de prix à la pompe pourrait-elle conduire ? Du coup, que préférez-vous pour les régions ? Une plus grande autonomie ou une moins grande disparité des prix à la pompe ? M. Gilles CARREZ : La réforme de la taxe professionnelle a été annoncée à l'occasion d'un discours du Président de la République, un mardi 5 ou 6 janvier au matin,... M. Jean-Pierre BALLIGAND : Un mardi de vœux... M. Gilles CARREZ : ...et j'en ai été informé sur le coup de midi. La TIPP est objectivement, lorsqu'on la regarde sur une longue période, un impôt dynamique. Elle a certes stagné depuis deux ans, mais les raisons de cette stagnation n'ont rien de structurel ni de permanent. Le phénomène de diésélisation massive du parc est en train de s'achever ; on observe même une légère régression. Pour ce qui est de l'évolution du prix du baril, qui a conduit à des économies d'énergie, il est extraordinairement difficile de dire comment les choses se passeront, mais je vous renvoie à ce qui s'est passé ces trente dernières années : l'explosion du prix du pétrole a toujours été largement compensée par l'évolution des besoins de déplacement et du niveau de motorisation des ménages. Quand bien même celui-ci est désormais largement stabilisé, la consommation d'énergie à travers le déplacement individuel reste un socle, un des piliers de l'évolution économique en général. L'assiette de la TIPP ne me semble en rien vouée à l'anémie, et les deux dernières années ne doivent pas faire oublier les vingt-cinq précédentes. Les collectivités territoriales ne font pas une mauvaise affaire en bénéficiant d'une part de TIPP, à une condition : qu'elles aient une liberté de vote du taux, qu'il s'agisse d'une vraie ressource à laquelle elles soient responsabilisées. Ce n'est pas le cas des départements, pour des raisons techniques, mais ce peut être celui des régions. Bruxelles serait disposé à permettre une variation de plus ou moins 0,15 centime. Ce n'est évidemment pas grand-chose, mais nous devrions pouvoir élargir la brèche ainsi créée. Sur le plan technique, faut-il s'attendre à des effets pervers par la suite ? Les réunions de travail auxquelles j'ai participé en tant que Rapporteur général me rendent assez confiant. Nous pouvons d'ores et déjà observer des variations considérables de prix à la pompe sur un même territoire, entre tel ou tel hypermarché, qui de surcroît fait des promotions, et tel ou tel pompiste indépendant. L'argument selon lequel les prix du Doubs deviendraient sans comparaison avec ceux de la Haute-Marne voisine ne me paraît pas dirimant. M. Jean-Pierre BALLIGAND : M. Gilles Carrez est à peu près honnête intellectuellement... M. Bernard DEROSIER : À peu près ! M. Jean-Pierre BALLIGAND : Je lui reconnais en tout cas cette qualité : elle est assez rare parmi les gens qui assument des responsabilités. Aussi voudrais-je lui parler un peu de philosophie, mais pas comme le Rapporteur. M. le Rapporteur : Cela veut dire quoi ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : Je veux dire : sans tendre des pièges comme vous l'avez fait tout à l'heure à propos du RMI, par exemple. Il s'agit plutôt d'une question de fond à l'adresse du Président du Comité des finances locales. Votre prédécesseur avait essayé, avec d'autres, de réfléchir à l'idée d'un couple de compétences pour les collectivités et d'une spécialisation de l'impôt par couple. Par exemple, le social serait géré par la commune - ou, par délégation, la communauté - et le département. Auquel cas la taxe d'habitation serait allée à ce niveau et pas ailleurs. Malheureusement, l'idée défendue par M. Jean-Pierre Fourcade n'a jamais débouché. Le Comité des finances locales n'aurait-il pas intérêt à faire des propositions, non seulement dans le cadre des équilibres annuels, mais également comme gardien, comme interface entre l'État et les collectivités ? Sinon, la tendance, la pression reste toujours la même, quels que soient les gouvernements. Je me souviens des documents du Conseil national des impôts - un beau rapport sur la TP n'a-t-il pas été commis voilà huit ou dix ans ? L'idée était simple : plus de taux local, ne restait plus qu'un taux national de TP... Cette tentation demeure, quels que soient les gouvernements, pour des raisons macroéconomiques, européennes, nationales et autres. Tant et si bien qu'à un moment donné, on se retrouve dans un nœud de contradictions ingérables. La sémantique a son importance. Nous en sommes toujours à nos « quatre vieilles » pendant que les impôts dynamiques et modernes sont ceux de l'État. Le Comité des finances locales n'aurait-il pas intérêt à être plus qu'une structure de régulation, une sorte de vigile, mais à devenir également « l'intellectuel organique » des finances locales pour les protéger et couper court avec des systèmes déresponsabilisants - votre point de vue ne diffère guère de ceux de MM. René Dosière ou Charles de Courson -, où des impôts dits locaux sont fixés et de plus en plus assumés à l'échelon national ? Cette contradiction majeure finira un jour par faire sauter la banque : non seulement c'est une véritable catastrophe pour la fiscalité nationale, mais ces systèmes mouvants, sans cesse remis en chantier, ces changements d'assiette sans cesse annoncés finissent par jeter le trouble dans toutes les collectivités. On ne peut même plus leur conseiller d'emprunter au moment où les taux sont bas, pour la bonne raison que l'on est incapable de leur assurer des ressources à hauteur des remboursements... On peut évidemment s'en sortir par des discours politiques, comme d'habitude - on en mesure l'impact sur la population -, mais peut-être ferait-on mieux d'émettre un peu plus de propositions. Le CFL, dont le paritarisme politique et la composition sont gages de crédibilité, pourrait être ce lieu de proposition afin d'aboutir à un impôt dynamique et d'éviter les effets pervers liés à des mécanismes de prise en charge et de compensation par l'État qui sont de plus en plus aberrants. M. le Rapporteur : Si le CFL allait dans cette voie, intégrerait-il dans sa démarche le souci de ne pas alourdir la barque globale des prélèvements obligatoires ? On ne trouve guère de lieux où puisse être faite la synthèse du poids de l'impôt local, avec toutes les contradictions que cela peut emporter au regard des programmes triennaux d'évolution de l'impôt, de nos engagements européens et autres. Est-ce vraiment le rôle du CFL ? Je ne sais pas. Reste que nous manquons d'un lieu de ce genre. M. Gilles CARREZ : Certains critiquent le fonctionnement du CFL, qu'ils considèrent comme une annexe de la DGCL et du ministère de l'Intérieur, chargée de gérer à la marge des problèmes de répartition. Il est exact que le CFL travaille par consensus et manie surtout la burette d'huile pour trouver des équilibres subtils atteints par ajustements successifs et par des modifications ténues dans des répartitions de dotations. Cette critique me paraît injuste. Bien que fonctionnant par consensus, le Comité s'est tout de même risqué à des réflexions plus larges : ainsi, les réformes successives de la dotation globale de fonctionnement ont été presque intégralement conçues au sein du CFL, qu'il s'agisse de celle de 1993 ou de la plus récente. Il n'était pourtant pas facile de parvenir à trouver un accord sur ces nouvelles architectures. De même, le CFL avait proposé en 1996 un système pour la révision des valeurs locatives qui avait fait l'unanimité, mais qui n'a malheureusement pas été suivi. En 2001, il a encore produit un rapport qui, dans la foulée de la suppression de la part salaires, proposait un taux quasiment unique pour la taxe professionnelle. Sachant la manière dont travaille le CFL, traditionnellement consensuelle et non partisane, il serait utile d'essayer d'aller plus loin dans des réflexions prospectives et dynamiques ; reste à savoir ce qu'en fera ensuite le Gouvernement... Cela dit, j'aurais tendance à vous renvoyer un peu la question car, ainsi que le président Jean-Pierre Fourcade avait coutume de le répéter, nous ne sommes pas là pour discuter les lois. L'élaboration de la loi revient au Parlement et à lui seul ; le CFL est là pour adapter, gérer, répartir... M. Jean-Pierre BALLIGAND : C'est un peu réducteur... M. Gilles CARREZ : Nous avons fait des exceptions, puisque plusieurs réformes - ainsi celle de la DGF - ont été préparées par le CFL. J'avais prévu de nous réunir le 14 juin - du fait du changement de gouvernement, il va falloir trouver une autre date - avec les deux ministres concernés, finances et intérieur, pour une discussion de fond, sans tabous, sur la réforme de la taxe professionnelle. Cette réunion aura bien lieu, et suffisamment en amont par rapport à l'élaboration d'un éventuel texte de réforme à l'horizon 2006. Je suis donc bien, moyennant les réserves que je viens d'exposer, sur la « ligne Balligand ». M. le Président : S'agissant de la taxe sur les conventions d'assurance, avez-vous une idée ? À en croire un rapport de l'inspection générale des finances, elle ne pourra pas évoluer. Les départements se retrouveront donc avec une part de TIPP et une TSCA sur lesquelles ils ne pourront rien faire... M. Gilles CARREZ : Je n'ai, là-dessus, que des données très contradictoires. Pour ce qui est de l'assurance immobilière ou de l'assurance automobile, il est permis d'envisager une assiette départementalisée avec de vrais votes de taux, sans trop risquer d'effets pervers. Les objections présentées par la Fédération française des sociétés d'assurances devraient pouvoir être contournées. Mais je manque d'éléments précis pour vous répondre plus avant. M. le Président : M. le Président du Comité des finances locales, nous vous remercions. Audition de M. Jean-François COPÉ, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Jean-François Copé est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, je remercie M. Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État, de sa présence parmi nous. Je vous demande de bien vouloir excuser M. Thierry Breton, Ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie, qui a été obligé de repartir, en raison du retard pris à cause du vote sur le projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, nous avons pour mission d'apprécier les causes et les conséquences de l'évolution récente de la fiscalité locale, ainsi que les conditions d'une responsabilité mieux assumée des décideurs locaux et de l'État. Notre Commission a procédé à de nombreuses auditions depuis le début du mois de mars. Elle a adressé des questionnaires écrits aux différents niveaux de collectivités territoriales. Elle a reçu de plusieurs directions de Bercy des informations factuelles et des analyses. Elle a en outre entendu la Directrice de la législation fiscale sur les pistes de réforme de la fiscalité locale. À une semaine du terme de nos travaux, nous souhaitions donc vous entendre, M. le Ministre, sur votre analyse politique des conditions des transferts opérés. Nous avons déjà pu apprécier ce qu'il en a été du RMI : alors qu'on nous avait promis une recette évolutive, on s'aperçoit fin 2004 que le déficit avoisine les 450 millions... Le précédent Gouvernement nous a assuré qu'il serait compensé en 2006 ; il faut croire que le nouveau Gouvernement tiendra cet engagement. Mais quelle sera la base de calcul pour 2005 ? Reprendra-t-on la base de 2003, ou la base 2003 plus les 450 millions 2004 ? Le déficit 2005, au mois de mai, était d'ores et déjà égal à une fois et demie celui de 2004... Rien ne permettant de penser que la situation devrait soudainement s'améliorer, tout porte à croire qu'il sera deux fois plus élevé. Or il n'est pas prévu qu'il soit compensé. À propos de la taxe sur les conventions d'assurance, nous ne savons toujours rien de la façon dont elle pourrait être localisée ni surtout de la façon dont les collectivités pourraient la faire évoluer. Enfin, troisième sujet d'inquiétude : l'évolution du système fiscal local ; en particulier, quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la réforme de la taxe professionnelle ? M. le Président rappelle à M. Jean-François Copé que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Jean-François COPÉ : Je vous prie à mon tour d'excuser M. Thierry Breton, appelé à conclure un colloque important sur les PME. Il reste naturellement, tout comme moi-même, à la disposition de votre Commission d'enquête. En réponse à vos propos introductifs, M. le Président, sur des sujets que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises et notamment à l'occasion du texte sur la décentralisation voici un an, je voudrais brièvement rappeler quelques éléments du raisonnement et de la démarche de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Un engagement a été pris par l'État de rester auprès des collectivités dans ce mouvement de décentralisation, qui s'est traduit, premièrement, par une modification de la Constitution, deuxièmement par une loi organique consacrant l'autonomie financière des collectivités territoriales - évolution majeure, sans doute une des avancées les plus importantes de cette décentralisation, dans la mesure où elle détermine un plancher de ressources propres minimales pour les collectivités territoriales -, et troisièmement par des engagements financiers. Avec des dépenses qui ont représenté en 2004 quelque 11 % du PIB, les collectivités territoriales sont à l'évidence des acteurs de premier plan du développement économique de notre pays. Il est indispensable de nouer des relations de confiance entre l'État et les collectivités territoriales ; or le grand problème tient à la persistance d'une méfiance traditionnelle, de nombreux élus locaux, à quelque bord politique qu'ils appartiennent, se refusant à croire, avec force précédents fâcheux à l'appui, que l'État pourrait tenir ses engagements. Quelles sont donc les responsabilités de l'État s'il entend garantir des relations de confiance ? Première responsabilité : tenir ses engagements en termes de garantie financière. J'ai rappelé à de très nombreuses reprises, en tant que ministre délégué à l'Intérieur, qu'il y aurait une compensation des transferts de compétence à l'euro près, comme le prévoit la nouvelle rédaction de la Constitution. À ce titre, 150 millions d'euros ont été transférés aux départements et 400 aux régions. Ce à quoi vient s'ajouter la reconduction pour 2005 du contrat de croissance et de solidarité : tout en s'imposant de ne pas accroître son propre train de dépenses, l'État a respecté à l'euro près le pacte de croissance des dotations qui ont significativement augmenté : 60 milliards d'euros, dont 37 milliards pour la seule DGF. C'est là un effort substantiel, conformément à un engagement précis. Deuxième responsabilité de l'État : veiller au développement harmonieux de nos territoires. C'est tout le sens de la politique de péréquation. Là encore, une réforme très importante de la DGF vous a été proposée, notamment pour ce qui concerne la DSU et la DSR. Je voudrais maintenant appeler l'attention de votre Commission sur quelques éléments qui, à titre d'introduction, peuvent également éclairer votre réflexion. Tout d'abord, force est de constater que les dépenses des collectivités territoriales connaissent depuis ces dernières années une croissance considérable. Elles augmentent plus vite que celles de l'État, mais également plus vite que le PIB, même en raisonnant à périmètre de compétences constant. Leur rythme de croissance annuel en volume entre 1980 et 2004 est de 3,4 %, soit 1,3 point de plus que les dépenses de l'État sur la même période. Même à périmètre constant, le poids des collectivités territoriales est allé grandissant : 9,7 % du PIB en 2004. Du coup, pour financer ces dépenses en pleine augmentation, les collectivités n'hésitent plus à recourir dans des proportions très importantes à des hausses de la fiscalité locale. Ce risque n'a rien de virtuel : entre 2000 et 2004, toutes taxes et collectivités confondues, les produits ont augmenté de 10 % en moyenne. Vous le voyez, ce mouvement est largement déconnecté de la décentralisation. Ce dynamisme est encore plus fort à structure constante. En 2004 est apparu un élément nouveau : pour la première fois depuis bien longtemps, les collectivités territoriales n'ont pas maintenu l'équilibre de leurs comptes. En clair, les comptes publics locaux sont tombés dans le rouge, affichant pour la première fois un déficit de 0,1 point de PIB. C'est là un élément nouveau pour les collectivités territoriales mais, hélas ! ancien pour l'État, qui ne saurait dans ce domaine leur donner de leçons. S'il tient incontestablement ses engagements quant aux transferts de compétences et aux transferts de ressources, son comportement dans ce domaine n'a rien de très glorieux. Reste que, pour la première fois depuis très longtemps, la forte augmentation des dépenses locales s'est traduite par un déficit des comptes des collectivités territoriales, qui de surcroît intervenait au cours d'une année relativement favorable sur le plan des conditions macro-économiques. Or, au moment où les collectivités accusaient un déficit, l'État a de son côté réduit le sien, améliorant ses comptes de 13 milliards d'euros, tout en assumant pleinement, je le répète, ses responsabilités financières à leur égard. Cela m'amène à appeler avec beaucoup de force votre attention sur le point suivant : s'il nous faut évoquer la situation financière des collectivités territoriales en constatant notamment une envolée sans précédent de la dette publique locale - qui atteint 112 milliards d'euros -, tout en parlant dans le même temps de modération fiscale, alors il faut clairement poser la question de la modération des dépenses publiques locales. Je le dis en conscience, tout en étant, comme membre du Gouvernement, très attentif au respect de la pleine autonomie des collectivités territoriales ; mais dans un contexte marqué par un effort significatif de l'État qui depuis trois ans maintient sa dépense publique en deçà de l'inflation - elle progresse de zéro en volume - il faut poser le problème de la maîtrise de la dépense, du côté des collectivités territoriales. La modération fiscale est à l'ordre du jour pour une raison simple : l'attractivité de nos territoires. On ne peut préconiser au niveau national une politique fiscale adossée à ce qui se pratique dans la moyenne des pays européens - comme je l'ai fait en décidant, par exemple, l'exonération des plus-values de cession des titres de participation pour les sociétés cotées, ou encore des produits de cession des brevets -, sans appeler l'attention sur les difficultés que poseraient des hausses excessives de la fiscalité locale dans certains territoires. Là encore, vous connaissez les chiffres : j'ai mis mon administration à la disposition de votre Commission. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, en dehors de la Corse, de la Guyane et de la Réunion où les taux n'ont pas évolué, l'augmentation va de 1 % en Limousin à 80 % en Languedoc-Roussillon ! Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les taux n'ont pas évolué pour la Corse, la Guyane, la Réunion et le Languedoc-Roussillon ; ailleurs, l'augmentation varie entre 1,8 % en Limousin et 50 % en Bourgogne. Pour ce qui est de la taxe professionnelle, toutes les régions de métropole ont relevé leurs taux, dans une proportion allant de 1,7 % en Limousin à 79 % en Languedoc-Roussillon... Or, je veux le redire ici avec force, il n'y a aucun lien entre ces hausses de fiscalité régionale et l'acte II de la décentralisation, et je suis prêt à vous en refaire la démonstration. Nous avons garanti l'adossement du coût des transferts de compétences aux ressources correspondantes ; j'en veux pour preuve l'exemple du RMI, déjà cité par vous-même, M. le Président. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait annoncé une compensation au titre de 2004 du différentiel constaté entre la TIPP affectée aux départements et les dépenses de RMI, actuellement évalué à environ 450 millions d'euros. Il faut y voir un gage que le Gouvernement a voulu donner aux élus locaux dans le souci d'établir des relations de confiance, et le geste est d'autant plus important qu'il n'était pas prévu à l'origine ; mais le Gouvernement tenait à montrer sa volonté de rester très attentif à l'évolution de ces coûts. Quant à savoir si cette aide est pérenne ou non, je ne peux vous répondre ; cela n'a pas été arbitré. Mais chacun comprend que cette rallonge au titre de 2004, qui sera présentée dans le cadre du collectif pour 2005, s'inscrit tout à fait dans le climat de confiance que nous voulons instaurer. Étant établi qu'il n'y a pas de lien entre les hausses de fiscalité régionale et la décentralisation - celle-ci vient tout juste de commencer, alors que les augmentations d'impôts se sont fait sentir dès cette année -, le fait est que si les taux augmentent, c'est bien parce que les dépenses augmentent. Lorsque l'on s'engage devant l'opinion publique à financer quantité de dépenses nouvelles dans le cadre d'une campagne électorale, chose parfaitement légitime et cohérente avec l'esprit de la démocratie et de la République, on est bien obligé d'appuyer sur le bouton des taux d'imposition, et c'est très exactement ce qui s'est passé. Donc, nous devons nous poser collectivement la question de la maîtrise de la dépense publique locale. À un moment où l'État comme les organismes de sécurité sociale s'astreignent à des efforts de rationalisation et à des réformes de structure en matière d'utilisation des fonds publics, il ne serait pas compréhensible que je n'évoque pas devant vous cette question essentielle. Alors que cette année voit la mise en œuvre de la LOLF pour l'État, que de son côté la sécurité sociale se dote, également par une loi organique, d'instruments de modernisation de sa gestion, ne peut-on penser à adapter quelques principes de la LOLF à la gestion des collectivités territoriales ? J'ai déjà entendu des élus locaux et des représentants d'associations prendre position sur ce sujet ; je ne verrais pour ma part que des avantages à l'organisation d'une conférence des finances locales réunissant tous les partenaires et qui serait l'occasion d'évoquer tous les sujets, sans tabou. Prenons un exemple concret : les évolutions salariales dans la fonction publique. Jusqu'à présent, jamais les collectivités territoriales, directement ou par le biais de leurs associations, n'ont été associées sur cette question. Je suis pour ma part tout à fait partisan de la poser ouvertement et d'associer d'une manière ou d'une autre les collectivités à la définition des évolutions salariales. On peut de la même manière s'interroger sur l'avenir du contrat de croissance pour l'indexation des dotations. Je comprends parfaitement que, du point de vue des élus locaux, le fait de toujours avoir la garantie d'une augmentation aussi significative des dotations soit une bonne chose. Mais je maintiens devant votre Commission que la question mérite que l'on y réfléchisse, alors que l'État tient ses engagements en versant des dotations très importantes et que, dans le même temps, les taux de fiscalité locale, tout comme les dépenses, augmentent de façon très significative. Voilà quelques questions générales que je souhaitais évoquer en introduction. Je suis à votre disposition pour répondre dans le détail. Un point en particulier : vous avez, M. le Président, évoqué la question de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Une interrogation demeure sur la faisabilité technique de la modulation. Aussi avons-nous demandé à l'Inspection générale des finances de rédiger un rapport sur ce sujet, qu'elle vient de nous remettre et qui met en lumière un certain nombre de difficultés techniques posées par la départementalisation. Je souhaite naturellement que cette contribution soit versée à la réflexion du Gouvernement et, bien sûr, de votre Commission. Sitôt que nous aurons tous les éléments, nous vous dirons exactement ce qu'il en est et vous présenterons les différentes options qui nous sont offertes en la matière. Sur le RMI enfin, l'État honorera ses engagements au regard de la règle fixée : toute la règle, rien que la règle, à l'image de ce qui avait été fait au début des années 1980 pour la mise en application de la décentralisation Mauroy. Une rallonge de 450 millions a été décidée, sous forme de « produit d'appel » destiné à compenser les retards. Néanmoins, pour la suite des choses, l'année de référence restera l'année de référence, en application de la loi. Chacun doit bien comprendre que, lorsque nous avons procédé à la décentralisation de la compétence RMI, ce n'était pas pour que la dépense augmente, mais bien dans un souci de cohérence et de bonne gestion : le RMI devrait être beaucoup mieux géré une fois transféré dans son ensemble à une collectivité plutôt que « découpé en tranches » entre l'État et la collectivité territoriale. En clair, s'il y a moins de RMIstes dans un département, celui-ci conservera le même niveau de recettes. Ce pourra donc être, de ce point de vue, une bonne affaire, puisque l'État ne demandera pas à être remboursé. Je tenais à verser cette précision au dossier. M. le Rapporteur : Vous avez appelé notre attention sur les enjeux de maîtrise fiscale et de maîtrise de la dépense en esquissant quelques voies : ainsi l'idée d'une conférence des finances locales, déjà évoquée, ou encore celle, plus nouvelle, d'une réflexion concertée sur l'évolution salariale dans la fonction publique. Mais à partir de quel moment un appel à la maîtrise fiscale vous paraît-il porter atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales ? Pour l'heure, les effets combinés du contrat de croissance et de la compensation de la décentralisation - somme des dotations versées : 60 milliards d'euros - aboutissent à un déclenchement quasi mécanique. Comment l'État peut-il définir une politique de finances locales ? Celle-ci est actuellement définie par stratifications, compensations et engagements. Dès lors que vous souhaitez, et plusieurs d'entre nous peuvent vous rejoindre, une meilleure maîtrise tant de la fiscalité que de la dépense, de quels outils l'État peut-il user pour orienter une politique en la matière ? Question connexe : notre système de fiscalité locale étant ce qu'il est, dans quel sens peut-il évoluer pour inciter à cette maîtrise ? M. Jean-François COPÉ : Ne nous payons pas de mots, M. le Rapporteur : les leviers d'action de l'État sont limités et c'est très bien ainsi. On ne peut prétendre respecter le principe de la libre administration des collectivités territoriales et permettre en même temps à l'État de venir sans cesse contrarier leurs projets - d'autant que ceux-ci s'inscrivent dans la durée et sont adossés au cycle électoral. L'État ne saurait donc venir s'y immiscer. Pour autant, il ne faudrait pas que la dotation versée par l'État aux collectivités territoriales devienne un levier qui permettrait d'aller encore plus haut dans les augmentations d'impôts et de dépenses. Le but est d'apporter une compensation, certains éléments complémentaires, mais en aucun cas un appui pour alourdir la fiscalité. Ainsi que je l'ai dit, les engagements de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales seront honorés à l'euro près, et en suivant une croissance très supérieure à celle que l'État s'autorise pour son propre budget, et qui ne va pas au-delà de l'inflation. Il est en revanche un élément auquel il tient beaucoup : la règle d'évolution des taux des impôts locaux. Je reste pour ma part très attentif au maintien de la liaison des taux, car je considère qu'à défaut, nous ouvririons des vannes très préjudiciables à notre économie du fait qu'elles pourraient se traduire par des taux de fiscalité très lourds pesant sur les entreprises ou sur les ménages. C'est là une règle très importante qu'il est toujours possible de faire évoluer ici ou là, mais dont il est essentiel de préserver l'esprit - on sait qu'il reste des cas de distorsions inadmissibles, qu'il faudrait pouvoir éroder. Sur la maîtrise de la dépense, je crois en toute franchise, tout en respectant l'autonomie des collectivités territoriales, qu'on a le droit de se poser quelques mauvaises questions. Ne pourrait-on pas, par exemple, solliciter les associations d'élus comme j'en ai émis l'idée pour la fonction publique, et de l'autre côté, solliciter les mêmes structures - le Comité des finances locales ou le Parlement pourraient être des instances de débat - pour fixer d'une manière consensuelle une norme d'évolution des dépenses locales, non contraignante, mais qui servirait de point de référence, une manière de benchmarking pour montrer ceux qui dépensent beaucoup et ceux qui dépensent moins - en prenant évidemment en compte les réalités, les héritages, les situations géographiques, etc. On ne peut comparer une ville ayant des quartiers difficiles avec une ville qui n'en a pas, une ville économiquement dynamique avec une ville victime d'un sinistre industriel ; tout doit être pondéré. Reste que l'idée d'intégrer une norme, à l'exemple de ce que font d'autres pays, ne me paraît pas un débat médiocre, compte tenu de la très forte croissance des dépenses publiques locales constatée ces dernières années. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué les compensations à l'euro près, rappelant notamment les calculs successifs auxquels a donné lieu le transfert du RMI, et la majoration au titre de l'année 2004. L'État honora tous ses engagements, mais rien que ses engagements, avez-vous dit. Mais cet ajustement pour 2004, aussi justifié soit-il, ne va-t-il pas déjà au-delà de la loi ? Quelle différence faites-vous entre la compensation d'un transfert de compétence et cette sorte de recompensation liée à l'augmentation, pour des raisons diverses, du nombre et donc du coût des RMIstes ? N'y a-t-il pas là une première entorse, certes généreuse, au principe : « tout le transfert, mais pas plus que le transfert » ? Qui plus est, après cet accès de générosité pour 2004, l'année de référence restera-t-elle 2003 ou deviendra-t-elle 2004 ? M. Jean-François COPÉ : Rappelons d'abord que, pour ce qui concerne le RMI, une « clause de revoyure » avait été prévue en 2004. L'État étant très soucieux d'établir une relation de confiance avec les collectivités territoriales, le Premier ministre avait clairement annoncé ces 450 millions d'euros à titre évaluatif afin de bien prouver qu'il n'entendait pas mettre les départements en difficulté au moment où commençait à leur incomber la gestion du RMI. Reste que la mécanique du transfert de compétence repose sur le transfert d'un impôt dont la propre dynamique doit permettre de financer la politique publique correspondante. Je répète que si, du fait d'une politique efficace en la matière, le nombre de RMIstes dans un département devait baisser, la dotation calculée sur la base de l'année de référence 2003 ne diminuerait pas pour autant : chacun des deux curseurs peut aller dans un sens ou dans l'autre. M. le Rapporteur : Que répondez-vous aux critiques sur les dynamiques divergentes de l'impôt et de la dépense, à propos du transfert de la TIPP, par exemple ? M. Jean-François COPÉ : Je suis moins pessimiste que d'autres sur l'évolution de la TIPP. Certes, c'est un impôt peu dynamique, mais le ralentissement observé tient surtout à la diésélisation du parc automobile ou au mode de conduite plus prudent et plus économe des automobilistes au cours des dernières années. On peut penser que les choses n'évolueront plus considérablement dans ce domaine et que ces facteurs ont déjà produit l'essentiel de leurs effets. En transférant les compétences de manière individualisée aux départements, en y apportant une contribution majeure à travers le plan Borloo - contrat d'avenir, contrat d'insertion et RMA - qui devrait, il faut y insister, favoriser une diminution du nombre de RMIstes, il est permis de penser que les choses devraient s'équilibrer. D'autant que rien n'interdit de faire, comme le Premier ministre l'année dernière, un point précis de la situation chaque année et d'en tirer les conséquences. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué la LOLF. Comment pourrait-elle inspirer le système des finances locales ? Certains préfets de région ont appelé notre attention sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à définir un concept nouveau : celui d'effort de l'État. On a souvent l'habitude de parler de désengagement en mesurant cet effort à travers des prismes assez étroit - l'effort d'investissement sur les contrats de plan, par exemple. Ne peut-on concevoir une approche plus globale en cherchant à chiffrer, dans son ensemble, l'effort de l'État sur un territoire donné ? La préfète de la région Bretagne, notamment, a déjà travaillé sur cette question. On nous a fait observer que la « territorialisation » des financements de l'État pouvait poser une difficulté au regard moins de la LOLF elle-même que de certaines applications informatiques dérivées. Si d'aventure notre Commission d'enquête reprenait à son compte de telles propositions en reconnaissant l'intérêt de tracer l'effort territorial de l'État, encore faudrait-il s'assurer que les systèmes informatiques liés à la mise en place de la LOLF ne l'empêchent pas. M. Jean-François COPÉ : Je suis très ouvert sur cette question. J'ai demandé aux services de Bercy de se montrer suffisamment réactifs pour mettre en place un dispositif, à travers le programme COPERNIC, qui permette de répondre à un certain nombre de questions ; or ce qui est vrai pour COPERNIC l'est également pour beaucoup d'autres choses. Nous devons être suffisamment souples pour anticiper l'avenir. La réforme de l'État fait désormais partie de mes attributions. C'est à mes yeux une étape très importante. Qu'on ne s'y trompe pas : ce n'est pas Bercy qui absorbe la réforme de l'État, mais bien la réforme de l'État qui absorbe Bercy. Autrement dit, je n'imagine pas une seconde que l'on continue, comme si de rien n'était, à n'avoir qu'une vision comptable de la modernisation du service public. Ce serait la pire des erreurs. La modernisation de l'État, c'est la capacité de faire un meilleur service public au même coût, en ayant à l'esprit la notion de performance, d'évaluation, de modernisation. S'agissant plus précisément de la LOLF, il y a beaucoup à inventer dans ce domaine. L'État lui-même est encore en pleine phase de découverte, en pleine aventure : la LOLF est pour nous un rendez-vous considérable et nous travaillons d'arrache-pied pour être à l'heure au rendez-vous du 1er janvier 2006. Nous n'avons pas le choix, il faut vraiment y aller, et donc être extrêmement mobilisés sur les nouvelles techniques à mettre en œuvre. Chaque ministre est désormais son propre ministre des finances : il a sa mission, ses programmes, à l'intérieur desquels il gère ses crédits comme il l'entend, mais il doit assumer et atteindre ses résultats et, sinon, expliquer pourquoi. Que pourrions-nous envisager du point de vue des collectivités territoriales ? Il pourrait être très intéressant de mettre au point - à partir d'une certaine taille, évidemment, pas pour les petites communes - des indicateurs de performance. Autrement dit, sommes-nous capables d'imaginer une nomenclature permettant de prendre la mesure des politiques publiques locales, de l'argent engagé et des résultats obtenus, et en tirer des indicateurs à l'image de ce que nous faisons aujourd'hui pour l'État dans le cadre de la LOLF ? Nous sommes en train d'élaborer une batterie d'indicateurs très fournie, qui va du nombre de dossiers traités dans une préfecture ou un palais de justice jusqu'aux résultats de grandes politiques publiques - lutte contre l'illettrisme, contre la délinquance, etc. - en passant par le nombre de dossiers d'impôts traités grâce à la télédéclaration. Nous pourrions parfaitement décliner des indicateurs de performance similaires pour les collectivités territoriales et, à partir d'une certaine taille, ne plus parler seulement de section de fonctionnement et de section d'investissement, mais de missions et de programmes dans des domaines aussi essentiels que l'aide sociale, l'éducation, le développement économique, la sécurité, la formation professionnelle, autant de sujets sur lesquels il doit être possible de mesurer l'action conduite par les collectivités territoriales, comme on le fera pour l'État d'ici à quelque temps. M. le Rapporteur : Mais que peut être une fiscalité locale plus vertueuse, en termes de maîtrise de son évolution et de maîtrise de la dépense ? Question connexe : quid de la réforme de la TP ? Je crois que le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces ce matin. Pouvez-vous nous apporter des précisions ? M. Jean-François COPÉ : Une bonne fiscalité locale est une fiscalité locale qui baisse, à l'exemple de celle de l'État. Peut-être est-ce un sophisme ; en tout cas, je considère que l'impôt local, pas plus que l'impôt d'État, ne saurait servir de variable d'ajustement pour des dépenses publiques qui augmenteraient indéfiniment. Nous devons nous poser des questions de fond sur notre capacité à maîtriser nos prélèvements obligatoires et à améliorer le service public à coût égal, sinon à moindre coût. C'est pour nous un objectif essentiel. Les contribuables, les citoyens, portent désormais sur l'acteur local, comme sur l'acteur national, un regard assez sévère. En aucun cas l'État ne se substituera aux collectivités territoriales : ce serait la pire des choses, inacceptable et de surcroît contraire au principe de l'autonomie financière. J'appelle l'attention sur le fait que, si nous devions ensemble évoquer une norme consensuelle de dépenses, nous serions tout aussi vigilants sur les taux et sur le principe de leur liaison. En ce qui concerne la taxe professionnelle, rappelons au préalable les données du débat : les dégrèvements pour investissements nouveaux représentent 1,4 milliard d'euros par an. Autrement dit, ils s'accumulent et s'appliqueraient d'ici six à sept ans sur la quasi-totalité des investissements. Il ne resterait plus grand-chose de l'impôt local. La difficulté de cette réforme tient au fait que c'est un jeu à plusieurs acteurs : l'État, les entreprises, les collectivités territoriales. L'État ne doit pas être le premier contribuable local ; or c'est ce qu'il est aujourd'hui, ou quasiment, pour la taxe professionnelle, assumant 17 milliards d'euros sur les 35 que représente son produit total. Les collectivités territoriales doivent retrouver un impôt local, d'autant que celui-ci apparaît à certains égards vertueux, dans la mesure où il incite au développement économique. Les entreprises enfin ne doivent pas être indéfiniment pénalisées, sur l'investissement notamment, la masse salariale étant désormais sortie de l'assiette d'imposition. C'est donc un problème majeur, d'autant que le 1,4 milliard d'euros de dégrèvement d'investissements nouveaux qui va peser sur le budget de l'État à partir de 2006 deviendra 2,8 milliards en 2007, et ainsi de suite. Mon sentiment est qu'il faut prendre des décisions dès cet automne, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, sous peine d'entrer dans des considérations calendaires très compliquées, avec les élections présidentielle et législatives, peu propices au lancement d'une réforme. Cela étant posé, plusieurs options s'offrent à nous. La première consiste à se dire que, ces dégrèvements pour investissements nouveaux soulageant d'autant les entreprises, l'objectif est en partie atteint et nous pourrions en rester là. À ceci près que cela coûte cher à l'État, ce qui nous ramène au débat sur la maîtrise des finances publiques... Je ne suis donc pas certain que cette solution doive être pérennisée. La deuxième option consisterait, en gros, à appliquer les conclusions de la « commission Fouquet ». Plusieurs variantes sont possibles. Premier avantage, le fait de remonter l'assiette au niveau de la valeur ajoutée serait évidemment moins pénalisant pour l'investissement, mais plus pénalisant pour l'emploi, qui bénéficiait jusqu'à présent d'allègements importants. Cela dit, il est permis de penser que les efforts remarquables mis en place dans le cadre du plan Borloo et du programme présenté par M. Dominique de Villepin la semaine dernière rééquilibrent d'une certaine façon les choses ; reste que les opposants à cette réforme pourraient nous le reprocher. En tout état de cause, si cette réforme apporte un plus considérable aux entreprises qui investissent, celles qui n'investissent pas seront à l'évidence pénalisées. Je sens dans le sourire du Président Augustin Bonrepaux une certaine affection à l'égard du pauvre ministre du Budget, en passe de se faire carboniser sur une réforme aussi difficile ! M. Bernard DEROSIER : Il compatit ! M. Jean-François COPÉ : C'est bien ainsi que je l'interprète ! Cela étant, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Il faut savoir ce que l'on veut. Depuis des années, on critique cet impôt. Nous proposons une solution : changer d'assiette. Si nous introduisions la valeur ajoutée pour 80 % -, 540 000 entreprises verraient leur cotisation augmenter de plus de 10 %. Cela fait beaucoup... d'autant qu'à chaque réforme de ce genre, ceux qui en bénéficient réagissent généralement assez peu alors que les autres sont furieux ! On pourrait compenser cette perte et imaginer un dégrèvement, en tout ou en partie, au-delà de 10 %. Mais la réglementation européenne interdit un dégrèvement pérenne ; il faut donc prévoir un rendez-vous périodique, d'ici à cinq, dix ou quinze ans, avec tous les problèmes que cela entraîne. Tout cela est assez complexe et ne peut se concevoir que dans une logique pleinement consensuelle. Il pourrait y avoir une troisième option, qui consisterait à cibler la réforme sur les seules entreprises actuellement imposées au-delà de 3,5 % de leur valeur ajoutée - soit en abaissant le plafond, soit en « rafraîchissant » l'année de référence qui sert de calcul au plafonnement actuel en fonction de la valeur ajoutée. L'année 1995 est en effet un peu désuète. La situation des entreprises qui investissent en serait très significativement améliorée. Je tenais à réserver à votre Commission d'enquête la primeur de cette troisième option, dans laquelle je vois une piste intéressante. Le Premier ministre a demandé à Thierry Breton et à moi-même d'étudier plusieurs options ; nous pourrions imaginer lui présenter celle-ci, et peut-être une quatrième ou une cinquième. M. Pierre BOURGUIGNON : Vous revenez, me semble-t-il, sur les critiques que vous avait inspirées la proposition de loi, présentée il fut un temps par le groupe socialiste, d'un plafonnement de l'actuelle taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, au taux actuel et à produit constant pour l'État grâce à un relèvement de la cotisation minimale... M. le Président : Effectivement, il se trouve que nous avions proposé cette troisième option à M. Alain Lambert en loi de finances, juste avant que le Président de la République annonce son intention de réformer la taxe professionnelle... Remarquons au passage que si la Commission des finances et le Gouvernement nous avaient suivis à l'époque, nous aurions économisé 1,4 milliard, puis 2,8 milliards d'euros, dans la mesure où nous proposions une compensation par le biais d'un relèvement modéré de la cotisation minimale. Quoi qu'il en soit, votre troisième option recueille mon accord, à titre personnel en tout cas, dans la mesure où j'avais déposé une proposition similaire ! Si M. Alain Lambert l'avait acceptée, nul doute que nous nous serions épargné bien du travail, et sans qu'il en coûte quoi que ce soit aux finances de l'État. M. Pierre BOURGUIGNON : Vous persistez à considérer la TIPP comme une recette dynamique en dépit de la faible progression de ses recettes depuis au moins dix ans. La commission ad hoc mise en place par M. Nicolas Sarkozy a elle-même affirmé que les recettes de TIPP ne progressaient pas malgré la hausse des prix ! Comment pouvez-vous donc maintenir de telles affirmations ? À l'inverse, tout porte à croire que les dépenses de RMI ne risquent pas de diminuer, que la conjoncture soit stable ou déprimée. L'effet de ciseaux est patent. Comment, à votre avis, pourrons-nous sortir de cette impasse ? M. Jean-François COPÉ : Je suis heureux d'apprendre que cette option a déjà fait l'objet d'un travail approfondi... Cela dit, sans être opposée, votre proposition n'a pas tout à fait la même histoire : vous parlez d'augmentation de la cotisation minimale là où je vous parle d'une augmentation de l'avantage lié au plafonnement de la valeur ajoutée. Peut-être y a-t-il un lien entre les deux ; on peut du reste l'imaginer. Si, en tout cas, cela vous donne envie de voter notre réforme, je serais le plus heureux des hommes, moi qui rêve depuis si longtemps de réussir à faire voter un texte de loi à l'unanimité... Je n'y étais pas parvenu l'année dernière avec la sécurité civile ; si j'y arrive avec la taxe professionnelle, imaginez ma fierté ! M. Bernard DEROSIER : Encore un petit effort ! M. Jean-François COPÉ : Chacun comprend en tout cas que cette affaire dépasse les clivages politiques. C'est un sujet qui nous ennuie tous lorsque nous sommes élus locaux ; nous savons que c'est un élément majeur de l'attractivité de notre territoire et que toute mesure propre à inciter à l'investissement va dans le bon sens. M. le Rapporteur : Les deux propositions vont bien en sens inverse : nos collègues proposaient d'augmenter le taux, alors que votre option consiste à faire en sorte que des entreprises qui ne bénéficiaient pas du plafonnement, parce que dépassant 3,5 % du fait de l'ancienneté de la référence, puissent désormais en bénéficier. Autrement dit, il y a d'un côté une majoration, de l'autre une minoration. M. Jean-François COPÉ : C'est bien pour cela que j'ai parlé d'une légère différence. Mais peut-être peuvent-elles se compléter. M. le Président : Minoration de l'impôt, certes, mais il faudra bien que quelqu'un la compense ! C'est précisément pour ne pas faire perdre de recettes à l'État que nous proposions de relever la cotisation minimale. Il n'y a donc pas de différence. M. Jean-François COPÉ : L'essentiel est de trouver une bonne formule, qui ne pénalise pas telle ou telle catégorie d'entreprises. Nous n'en sommes qu'au stade des options ; je retiens seulement que ce travail a été engagé. N'oublions pas enfin que M. Alain Lambert attendait de connaître les conclusions du « rapport Fouquet » qu'il avait commandé ; ce qui explique qu'il n'ait pas retenu votre proposition. M. le Président : Notre proposition était bien antérieure, et même antérieure à la volonté exprimée du Président de la République. L'emploi et l'harmonisation de la taxe professionnelle sont depuis longtemps notre préoccupation. M. Jean-François COPÉ : Qu'il s'agisse des retraites, de la sécurité sociale, de la dépendance ou de ce dossier-là, si vous vous en étiez préoccupés avant 2002, nous serions tous tranquilles aujourd'hui ! Je rappelle que la TIPP est une taxe sur le volume consommé ; elle n'a donc rien à voir avec la hausse des prix. Les incitations en faveur des véhicules propres et le comportement plus sage des conducteurs ont évidemment pu jouer sur la consommation et donc sur le dynamisme de la ressource, mais je persiste à croire que ces effets se sont stabilisés et que la courbe est redevenue prévisible. Quant à la commission ad hoc, n'oublions pas que sa raison d'être était d'abord de vérifier que l'État ne s'enrichissait pas aux dépens des Français ; ce n'est pas tout à fait la même démarche. Évitons de mélanger les genres. Quant à l'effet de ciseaux, je répète que nous verrons comment les choses évoluent. Il n'est pas question de mettre les départements sur la paille. Reste que si nous avons décentralisé, c'est bien pour qu'ils soient plus efficaces que l'actuel système dans la gestion du RMI - autrement dit, pour qu'il y ait moins de RMI, l'attention devant être portée sur le « I » et pas seulement sur le « R ». M. Bernard DEROSIER : Vous êtes orfèvre en matière de moyens financiers pour les collectivités territoriales, nous nous en apercevons chaque jour ! L'État, avez-vous dit, a assumé ses responsabilités financières vis-à-vis des collectivités territoriales. Fort de ces paroles gouvernementales, je vous poserai un problème très précis : un grand nombre de fonctionnaires vont être transférés de l'État vers les collectivités territoriales, dans les domaines de l'éducation nationale et de l'équipement. Je ne parle pas du 0,01 équivalent temps plein que l'on se propose de me transférer pour établir le schéma des ordures ménagères, mais de ces milliers de TOS ou d'agents de l'équipement auxquels la loi donne le droit d'opter entre l'intégration ou le détachement. Or, la part de la collectivité employeur au titre de la retraite passe de 27,3 % dans le cas d'un fonctionnaire intégré à 33 % dans le cadre d'un détachement. Soit une dépense de 114 000 euros pour cent fonctionnaires... Tout porte à croire que, sur les quelques milliers que comptera un département, quelques centaines au moins préféreront, pour des raisons personnelles, rester en position de détachement. Les centaines de milliers d'euros qui en résulteront seront-ils compensés à l'euro près ? Et comme vous avez également l'ambition de maîtriser les dépenses des collectivités territoriales, à défaut de compensation, comment les trouver par un autre moyen que l'impôt local ? Comment comptez-vous résoudre cette contradiction ? S'agissant du RMI, autre sujet d'importance, je vous ai entendu dire que, pour 2004, l'affaire est réglée. Mais un problème demeure, celui des agios, ou plus exactement des frais financiers que les collectivités territoriales doivent assumer, dans la mesure où la compensation de 450 millions d'euros promise par M. Jean-Pierre Raffarin n'interviendra pas avant décembre 2005 ou janvier 2006 ; pendant ce temps-là, la différence continuera de courir et il faudra bien trouver ces millions d'euros quelque part. Votre volonté de compenser à l'euro près et d'assumer toutes vos responsabilités va-t-elle jusqu'à prendre en charge ces frais financiers ? Sinon, nous serons bien conduits à augmenter les impôts locaux. Vous avez insisté sur la volonté du Gouvernement d'associer à une dépense nouvelle le transfert d'un impôt. Or, dans le cas présent, il s'agit de transférer non pas un impôt, mais le produit d'un impôt : le département n'a aucune possibilité de jouer sur le taux de cet impôt pour en obtenir davantage de recettes en cas de besoin. Quelle réaction vous inspire cette réalité ? Chacun sait qu'il est bon, en politique, de se fixer des objectifs : vous semblez faire le pari que le nombre des RMIstes diminuera du seul fait que les départements en ont désormais la responsabilité, et qu'en insistant sur le « I » - qu'ils assument du reste depuis 1988 : je vois mal comment il pourrait y avoir des changements de ce côté-là ! - ils devraient pouvoir diminuer le « RM » et donc les dépenses. À ceci près que la conjoncture ne permet guère, hélas ! d'espérer de diminution notable dans les mois qui viennent. Se pose en outre le problème des contrats d'avenir. Les départements sont tenus de verser à l'employeur d'un salarié sous contrat d'avenir la part de revenu minimum à laquelle celui-ci peut prétendre, mais calculée sur la base d'un taux moyen, généralement supérieur à ce que l'intéressé percevrait s'il n'avait pas de contrat d'avenir. Ce différentiel sera-t-il lui aussi pris en compte dans la compensation à la fin de l'année ? S'agissant enfin des discussions salariales dans la fonction publique, si votre collègue M. Renaud Dutreil avait, fin 2004, associé les représentants des employeurs territoriaux à travers le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, c'était précisément pour ne laisser passer aucune augmentation... Et lorsque, en mars ou avril, l'État a décidé d'augmenter les fonctionnaires, il n'a pas consulté les collectivités territoriales. Votre volonté affichée d'associer leurs représentants se bornera-t-elle à les avertir de vos intentions, ce qui ne servirait à rien, ou bien l'État envisage-t-il de compenser ces augmentations salariales qui concernent 1 500 000 fonctionnaires territoriaux ? M. Jean-François COPÉ : J'essaierai de répondre à vos nombreuses questions aussi précisément que possible, mais pour certaines d'entre elles, je ne pourrai pas lire dans la boule de cristal... Commençons par le transfert de personnels TOS et DDE. Je reste toujours très surpris de l'opposition farouche de votre formation politique, alors que nous avions, une fois n'est pas coutume, recopié au mot près... M. Bernard DEROSIER : Pas au mot près. M. Jean-François COPÉ : ...ce que M. Pierre Mauroy, dans son infinie sagesse, avait préconisé dans une commission de travail sur la décentralisation - sans pour autant faire preuve d'une phénoménale originalité, l'évidence et la cohérence du transfert des TOS étant soulignée à longueur de colloques... Et voilà que, sous prétexte que vous êtes dans l'opposition, vous votez contre ! Je trouve cela dommage. Ce processus de transfert représente, pensons-nous, une formidable perspective de valorisation de la carrière et du parcours professionnel de ces agents. Il va de soi que nous serons très attentifs à la compensation financière correspondante. Cela dit, je suis incapable de vous répondre aujourd'hui sur ce qu'il en sera de ceux qui ont choisi l'option du détachement ; attendons qu'ils aient choisi. Nous verrons bien, le moment venu, quelle sera la réalité des choses et s'il faut, le cas échéant, organiser un rendez-vous afin de ne pas pénaliser à l'infini les collectivités territoriales - ce dont certains, dont vous n'êtes pas, pourraient tirer prétexte pour augmenter dès maintenant leurs impôts. Que ceux qui les augmentent aujourd'hui en assument la responsabilité politique, sans chercher à la mettre sur le compte de l'État ! Vous vous interrogez, avec une grande précision, sur les frais financiers liés au retard de paiement du RMI. Pardonnez-moi de vous trouver un peu chiche... Ceux qui connaissent ici l'état des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales savent bien, en toute franchise, que celles-ci n'y sont pas perdantes. M. René Dosière pourrait vous parler de cette fameuse affaire des douzièmes : oserai-je vous rappeler que l'État verse par douzièmes, sous forme d'avances, ce que la collectivité percevra en impôts à la fin de l'année, sans jamais rien réclamer en échange, si ce n'est qu'il ne rémunère pas la trésorerie des petites collectivités territoriales ? Jamais, au demeurant, les grosses collectivités n'ont versé de larmes de solidarité à l'égard des petites... C'est plutôt l'État qui s'en occupe ! Il n'y a donc pas de quoi se stresser pour un département qui gère correctement sa trésorerie et qui encaisse tous les mois ses douzièmes d'avance. Faites preuve d'un peu de générosité et acceptez ce petit surcoût financier : ce sont plutôt les collectivités qui seraient en retard sur ce plan... Plus générale est l'inquiétude que vous inspire la politique d'insertion - et que je rejoins. Mais on ne peut pas, d'un côté, revendiquer des pouvoirs accrus pour les collectivités territoriales, faire des décideurs publics locaux des vrais patrons de politiques publiques, et de l'autre, s'émouvoir du fait qu'elles n'obtiennent pas toutes les mêmes résultats en matière de lutte contre l'insertion ! Osons le dire : la décentralisation permettra également de comparer les collectivités entre elles, leur dynamisme, leurs initiatives, leur capacité à gérer les grands problèmes auxquelles elles sont confrontées. C'est là, du reste, qu'est tout l'intérêt de la fonction de patron d'une collectivité territoriale : le but n'est pas simplement d'avancer à l'ancienneté mais, lorsqu'on est maire d'une ville en difficulté, de la développer en allant chercher les entreprises et, pour un conseil général, de conduire une politique dynamique en matière d'insertion et d'aide sociale. L'État, à l'initiative de ce Gouvernement, a mis en place un dispositif totalement inédit en termes de puissance budgétaire avec le plan de cohésion sociale, les contrats d'avenir, les dispositifs d'accompagnement et de retour à l'emploi, qui viennent se combiner avec la politique du RMI. Vous remarquiez à juste titre que le « I » appartenait déjà au département ; à ceci près que le fait d'avoir dorénavant toute la responsabilité du système donne un tout autre regard sur le fonctionnement des commissions locales d'insertion. La manière dont on suit les dossiers n'est plus du tout la même, du fait qu'on est devenu le décideur de son propre dispositif. M. Bernard DEROSIER : L'État était lié à la commission locale d'insertion... M. Jean-François COPÉ : Sans doute. Reste qu'il y a là une avancée significative et que vous bénéficierez des crédits publics du plan Borloo. Un mot sur l'association des collectivités aux évolutions salariales de la fonction publique territoriale. Nous en définirons évidemment les modalités ensemble ; il ne s'agit à ce stade que d'une piste, mais je suis, vous le savez, un adepte du « gagnant-gagnant ». On ne peut exiger d'être associé aux réflexions sur la politique salariale et refuser toute norme de dépense publique. C'est l'un ou l'autre : ou bien l'on fait un pacte global, ou l'on n'en fait pas. Et si l'on en fait un, cela vaut peut-être la peine d'y réfléchir dans le cadre d'une conférence annuelle qui permettrait de jeter quelques bases. Ce n'est qu'une suggestion de ma part, et votre Commission d'enquête me paraît le lieu idéal pour la faire. M. René DOSIÈRE : M. le Ministre, j'ai bien noté votre souci de respecter l'autonomie des collectivités, mais également votre très fort attachement au principe de la liaison des taux. J'ai en revanche été surpris par la justification que vous en avancez. En substance, on ne saurait renoncer à la liaison des taux - en clair, permettre aux collectivités de fixer le taux de la TP comme elles le veulent par rapport au taux de la TH -, sous peine d'assister à une explosion fiscale. Or, nous n'avons jamais constaté rien de pareil à chaque fois que nous avons relâché - de façon bien modeste - cette liaison entre les taux. Autrement dit, aucune collectivité n'a jamais dérapé lorsque nous leur avons donné un tant soit peu de liberté pour fixer leur taux de taxe professionnelle. Votre raisonnement ne me paraît guère solide sur ce point. J'ai été sensible au souhait de notre Rapporteur de voir l'État s'efforcer de freiner l'augmentation de la pression fiscale. J'en prendrai un exemple particulier, mais qui entre dans un tout : celui des frais d'assiette et de recouvrement, c'est-à-dire la rémunération versée à l'État en contrepartie du travail effectué par ses services dans l'établissement et la perception de l'impôt - le prix du service rendu, en quelque sorte. La tarification pratiquée apparaît quelque peu anormale, puisqu'elle est proportionnelle au montant des impôts alors qu'elle devrait être liée au coût du service. Tant et si bien que l'État se retrouve à percevoir deux fois plus d'argent qu'il n'en dépense... Ne pourrait-il diminuer de moitié le prix de sa prestation, ce qui réduirait d'autant la progression de la fiscalité locale ? Vous souhaitez, ce n'est pas un mystère, que la réforme de la taxe professionnelle entre dans le cadre de la loi de finances et non d'un projet de loi spécifique qui aurait permis une discussion beaucoup plus approfondie qu'une discussion budgétaire dont les délais sont très étroitement encadrés. Je maintiens que cette manière de faire n'est pas de nature à donner un texte parfaitement affiné, aux conséquences pratiques soigneusement pesées - vos propos sur les pistes de réforme montrent à quel point nous avons besoin de simulations approfondies. Seul un texte spécifique, examiné par les commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée, serait à même de rassurer totalement les élus locaux : on sait l'importance que la taxe professionnelle revêt pour les collectivités. Je ne comprends pas la méthode choisie, sauf à vouloir faire une réforme en catimini. M. Jean-François COPÉ : Sur ce dernier point, je voudrais rappeler que les collectivités territoriales seront justement les plus préservées par la réforme. Elles bénéficient d'ores et déjà d'un produit garanti ; le but est de leur donner une plus grande marge de manœuvre, non dans la ventilation des taux, mais dans la part du produit dont elles décident effectivement. N'oublions pas que les allègements massifs - 14 milliards d'euros - décidés par M. Dominique Strauss-Kahn avaient porté un terrible coup de canif au contrat, une atteinte majeure au principe de l'autonomie des collectivités territoriales. Mon problème, à propos de la réforme de la TP, ce ne sont pas les collectivités territoriales - je maintiendrai le cap pour ce qui est de la garantie du produit et de l'adossement au territoire -, mais bien les entreprises, leurs capacités d'investissement et leur compétitivité. Ajoutons que la réforme des dotations dans le cadre de la loi de finances, sur laquelle nous étions pareillement en divergence, s'est finalement fort bien passée, comme vous-même l'avez reconnu. Je vous promets que, même en intégrant la réforme de la TP dans la loi de finances, vous aurez toutes les simulations dont vous aurez besoin et que nous y travaillerons aussi longtemps que vous le souhaitez dans les commissions des assemblées. N'ayez aucune crainte sur ce plan. Le calendrier parlementaire n'est pas extensible, les Français attendent de nombreuses réformes ; nous allons aussi vite que nous pouvons, tout en veillant à ce que le Parlement puisse largement en débattre. Cela suppose des choix, ce qui explique l'introduction de cette réforme dans le calendrier budgétaire. M. René DOSIÈRE : Tant que vous ne recourez pas aux ordonnances sur ce point... M. Jean-François COPÉ : Tout de même pas... Mais ne nous y poussez pas ! M. René DOSIÈRE : C'est évidemment plus rapide ! M. Jean-François COPÉ : S'agissant des frais d'assiette et de recouvrement, j'ai un doute. J'avais plutôt le sentiment que nous faisions payer moins cher que cela ne coûtait... M. René DOSIÈRE : J'avais posé la question voici deux ou trois ans au ministre compétent : d'après les chiffres qu'il m'avait donnés, vous prélevez deux fois plus que cela ne coûte. M. Jean-François COPÉ : Je vérifierai ce point et je tiendrai les chiffres à votre disposition. Sur la liaison des taux enfin, nous avons bel et bien une divergence d'approche. Il y déjà eu des assouplissements ; je ne suis pas certain qu'ils aient toujours joué dans l'intérêt du contribuable... Ils ont parfois donné lieu à des dérives. Quoi qu'il en soit, nous avons atteint un point d'équilibre dont il ne faut plus sortir. Je le dis d'autant plus librement que ma ville avait un taux de taxe professionnelle supérieur de dix points à la moyenne régionale... Heureusement qu'il y a un minimum de liaison des taux : c'était devenu la variable d'ajustement et ce n'est pas tenable dans la durée. Ajoutons que personne ne comprendrait que l'on procède à une déliaison des taux au moment où la taxe professionnelle unique se développe dans les communautés d'agglomération. M. Jean-Jacques DESCAMPS : J'ai été très intéressé de vous entendre dire que les collectivités territoriales devraient se livrer au même effort d'économie et de diminution de dépenses que l'État... Il est vrai que l'on parle rarement des efforts de management et d'organisation que les communes pourraient faire. Cela dit, l'exercice a ses limites et certaines communes ont réellement besoin de bénéficier d'un effort de péréquation. Je m'inquiète à l'idée que l'État se mêle de poser des règles ou que l'on puisse, comme vous le disiez, fixer des normes d'évolution. Recruter un ou deux policiers municipaux supplémentaires dans une petite commune amène rapidement à dépasser les normes habituelles ; c'est pourtant un investissement comme un autre et il est permis d'en prendre la responsabilité. Le problème est de savoir ensuite comment le financer. J'aimerais connaître votre sentiment plus global sur le problème structurel que pose la fiscalité locale. J'en viens à penser, et probablement de nombreux collègues avec moi, que la complexité du système entraîne finalement la hausse de la dépense. Nous n'avons pas encore parlé de la multiplication des niveaux de responsabilités ; reste que la création des communautés de communes a incontestablement fait apparaître de la dépense nouvelle. Faut-il continuer à avancer prudemment ou peut-on aller encore plus vite ? Tout le monde parle d'un niveau de trop. Quel est-il ? Je ne veux pas vous mettre en difficulté devant des présidents de conseils généraux ou de communautés de communes ; chacun d'eux considérera que c'est celui du voisin ! Quoi qu'il en soit, peut-on espérer, à une échéance plus longue que deux ans, une simplification des structures qui permettrait de surcroît une spécialisation générale, verticale ou horizontale, qui encouragerait la transparence et ainsi une plus grande responsabilité dans la dépense ? J'ai beaucoup apprécié que vous ayez estimé que les acteurs territoriaux ne contribuent pas à la décision en matière de gestion de leurs personnels. C'est également mon impression ; en termes de hausse des salaires, on suit l'évolution dans la fonction publique territoriale et on s'incline... Ajoutons que la fonction publique territoriale est terriblement complexe et, en fait, nationalisée. Ne pourrait-on envisager une réflexion sur la décentralisation de la fonction publique territoriale pour essayer, là encore, de faire des économies ? Dans ma commune, j'ai sans doute environ 100 000 euros de dépenses de personnel en trop du simple fait des statuts. M. le Rapporteur : J'ai compris, en entendant votre première question, que vous jugiez difficile de gérer tout à la fois une réforme lourde de la TP et la spécialisation des impôts dont on sait par ailleurs l'intérêt. M. Jean-Jacques DESCAMPS : J'allais y venir. M. le Rapporteur : Si d'aventure la réforme de la taxe professionnelle prenait un chemin plus simple - celui de la troisième option, par exemple -, ne serait-ce pas l'occasion de revenir sur le sujet de la spécialisation ? N'a-t-on pas exagérément excipé de la complexité de la réforme de la TP pour faire un peu trop vite l'impasse sur la possibilité d'y inclure un volet de spécialisation, quitte à ne supprimer qu'une case ? M. Jean-Jacques DESCAMPS : J'irai même plus loin : la déliaison des taux est automatique lorsque l'on est en TPU. Pourquoi obliger les communes à avoir une politique fiscale différente de leur communauté de communes en TPU ? C'est une bonne chose que d'avoir spécialisé la TP sur les communautés de communes, qui ont une compétence en matière de développement économique, les taxes ménage ayant une dimension plus naturellement orientée vers la vie quotidienne. Enfin, parviendra-t-on un jour à une simplification en révisant les valeurs locatives ou en trouvant un autre système ? Les inégalités de valeurs locatives - qui remontent à 1970 - dans ma communauté de communes m'obligent à avoir trois taux de traitement d'ordures ménagères... M. Jean-François COPÉ : M'exprimant sous serment, je tiens à ce que mes mots soient bien compris par tous. Je reconnais que mon idée d'une conférence annuelle des finances publiques, à l'occasion de laquelle on fixerait des normes, consensuelles et non contraignantes, d'évolution de la dépense publique locale, est un peu un ballon d'essai. Mais lorsqu'on voit l'évolution tant des dépenses publiques locales que de la fiscalité des collectivités, alors que dans le même temps la sécurité sociale s'astreint à un énorme travail de réforme structurelle pour maîtriser sa dépense, que l'État depuis trois ans n'augmente pas sa propre dépense au-delà de l'inflation, je ne serais pas dans mon rôle si je ne posais pas cette question. Il est certes des moments où il faut bien se débrouiller, M. Jean-Jacques Descamps, mais comment fait l'État ? Il est exactement dans la même situation. Vous avez pris l'exemple des polices municipales. J'en ai créé une dans ma bonne ville de Meaux et je l'ai énormément développée. Mais dans le même temps, j'ai essayé de faire des économies de gestion ailleurs ; sinon, je ne pouvais pas tenir. Nous sommes tous confrontés à la même problématique. Reste, c'est évident, que l'on ne peut pas l'appliquer pareillement à une petite commune rurale dont le budget est évidemment beaucoup trop faible pour asseoir une gestion globale. Mais pour les autres ? Évoquons le sujet sans tabous. Le seul fait de l'évoquer serait déjà un élément très important, d'autant que, je le rappelle à propos de la péréquation, la DSU a augmenté de 20 % dans la réforme, et la DSR également de 20 %. Nous avons donc affaire à des masses tout à fait significatives. Simplification des structures et spécialisation fiscale : énorme débat, qui, lui aussi, a inspiré les colloques depuis toujours... M. le Rapporteur : Il faut parfois atterrir... M. Jean-François COPÉ : Je veux bien que l'on atterrisse ensemble, quitte à ce que l'on me reproche de poser une mauvaise question... « Il faudrait parvenir à spécialiser l'impôt par catégorie de collectivités », me dit-on, et à juste raison. Sans même parler de supprimer des niveaux - nous n'avancerons pas sur ce sujet, vous le savez comme moi -, comment se traduirait la simplification ? Grosso modo, on donnerait l'impôt économique aux régions et aux départements, qui sinon n'auraient rien. On ne peut pas leur attribuer la taxe d'habitation : ce ne serait pas à l'échelle du problème. On laisserait les impôts ménages aux agglomérations et aux communes. Sinon, il n'y a pas de spécialisation : toutes les collectivités ne peuvent pas bénéficier de la TP. Il y a une contradiction fondamentale entre le fait de revendiquer une spécialisation fiscale et celui d'avoir créé la taxe professionnelle unique. La communauté d'agglomération à TPU est déjà un mouvement de spécialisation fiscale remarquable ; on n'imagine pas, alors que nous sommes en plein mouvement de concentration, devoir dire : « C'est fini, ce n'est plus la peine de continuer à faire vos schémas d'alignement de taux sur dix ans, on vous enlève la TPU pour donner toute la taxe professionnelle aux départements et aux régions. » Je le dis peut-être de manière provocante, mais ce sujet est très important et je cherche en gémissant quelle est la bonne formule... M. Jean-Jacques DESCAMPS : L'économique devrait plutôt revenir aux communautés de communes et aux régions, et la vie quotidienne aux communes et aux départements. M. Jean-François COPÉ : J'aimerais m'assurer que les présidents des conseils généraux sont d'accord... M. le Président : Je ne pense pas ! M. Jean-François COPÉ : Même remarque que pour la taxe professionnelle tout à l'heure : le Président Augustin Bonrepaux s'inquiétait de mon avenir à l'idée que je me lance dans une réforme non consensuelle de la TP... C'est de la petite bière à côté de la question de savoir s'il faut spécialiser en l'enlevant aux départements ! Je le dis d'autant plus aisément que je suis, tout comme vous, malade de cette situation aberrante, unique en Europe, et totalement inadaptée à la réalité d'un pays moderne. Mais c'est ainsi... La « loi Chevènement » a malgré tout permis une réforme majeure de l'intercommunalité. L'agglomération, les communautés de communes, cela a tout de même du sens dans des territoires qui, sinon, seraient restés totalement isolés et en butte à une profonde crise d'identité. Il faut vivre avec, et voir comment faire prospérer la réforme. Reste qu'une communauté d'agglomération, c'est in fine davantage de dépense publique locale, du fait que tout le monde y concourt. C'est encore un problème qu'il faudra bien surmonter d'une manière ou d'une autre. Vous souhaitez la décentralisation de la fonction publique territoriale : c'est vous qui l'avez dit, pas moi... J'ai le sentiment d'être déjà allé très, très loin pour un membre du Gouvernement, en évoquant l'idée d'associer les élus locaux aux grandes réflexions sur la fonction publique territoriale. Je dis seulement que cela doit être donnant-donnant et que cela suppose en même temps une réflexion sur la norme de dépenses publiques. L'un est lié à l'autre ; ou alors, on en reste aux mondanités. Mais aller au-delà, c'est un autre sujet... Sur la simplification des valeurs locatives, je suis d'accord. La situation actuelle est évidemment un scandale, avec des HLM dont la valeur locative est beaucoup plus élevée que celle d'un sympathique pavillon ! Le problème est de trouver ceux qui viendront avec moi pour assumer les transferts de charges, très lourds, qui donneront inévitablement lieu à des polémiques chez ceux qui y perdront, tandis que ceux qui y auront gagné ne diront rien. La seule solution est d'y aller très progressivement, comme on l'a fait pour la taxe professionnelle unique. Je suis en tout cas d'avis d'ouvrir ce chantier et je suis à votre disposition pour y travailler avec vous. M. le Président : Sur la compensation à l'euro près, notre collègue Bernard Derosier n'a pas parlé du financement de l'ANPE, auquel l'État participait jusqu'à présent. Une décentralisation bien comprise voudrait que l'État transfère ses moyens de partenariat ; or il ne le fait pas. Ajoutons que l'État a bien préparé la décentralisation : lorsqu'il s'agit de transférer le FSL, le FAJ ou les CLIC, dont les crédits ont diminué depuis 2002, on compense à la moyenne... Est-ce à dire que la situation de ces publics s'est améliorée ? Je ne le pense pas. L'affaire étant encore en débat à la Commission consultative d'évaluation des charges, j'aimerais, M. le Ministre, que vous en preniez conscience... Il en est de même pour les crédits routiers. Après avoir augmenté d'année en année, ils se sont stabilisés à partir de 2002. On nous compense effectivement à l'euro près, sur une moyenne stabilisée ; cela ne signifie pas pour autant que les dépenses, elles, n'aient pas augmenté... Les collectivités seront bien obligées de faire un effort supplémentaire. On ne peut pas soutenir que la compensation du service se soit effectuée à l'euro près. Une remarque sur la péréquation. Vous avez évoqué la réforme de la péréquation et de la DGF. Remarquons que, pour les départements ruraux notamment, on ne tient pas compte, dans cette péréquation, du fait que l'essentiel des dépenses est désormais constitué non pas de dépenses routières, mais de dépenses sociales : dans mon département, elles représentent plus de 60 % du total. Or le RMI, indépendamment du transfert des dépenses ANPE et du surcoût du RMA, n'est pas pris en compte dans la péréquation. Un rapport sur la dernière réforme, nous dit-on, sera bientôt présenté. Quelle sera votre position ? Pouvons-nous espérer une amélioration ? L'augmentation des taux des régions, avez-vous dit, n'a aucun lien avec la décentralisation. Il conviendrait d'être un peu plus modéré... Le Président du conseil régional d'Alsace lui-même, que l'on ne peut pas qualifier d'excessif, confiait que les taux de sa région devraient progresser de 2 % par an pendant trois ans. Encore la région Alsace a-t-elle eu soin d'augmenter régulièrement ses taux de 2 % environ. Mais durant la même période, deux régions au moins avaient baissé les leurs ; l'augmentation n'y sera que plus importante, d'autant que leurs bases de taxe professionnelle sont deux fois plus faibles, quand bien même elles sont restées étales. M. Alain GEST : Évidemment ; ce n'est qu'un retour à la normale... la moyenne est de 15 % ! M. le Président : On ne saurait évidemment imputer l'intégralité de l'augmentation des taux régionaux à la décentralisation, mais force est de reconnaître que celle-ci aura un impact, modeste mais certain. Ne s'est-il pas non plus produit certains transferts ou désengagements, en matière de formation professionnelle, d'actions en faveur des entreprises ou dans la gestion des trains express régionaux, par exemple ? S'agissant du RMI, vous allez compenser 450 millions supplémentaires pour 2004. Or, fin mai 2005, l'augmentation était déjà une fois et demie ce qu'elle était en 2004 : nous sommes globalement autour de 700 millions... Dans la Nièvre, on en est déjà au double ! Pour 2005, la référence sera-t-elle l'année 2003 plus le complément 2004, auquel cas le déficit sera réduit à 0,5, ou celui-ci restera-t-il entre 1,7 et 1,5 ? C'est certainement la question la plus importante : envisagez-vous une compensation pour 2005 ? Prévoyez-vous au moins d'inclure dans la référence la compensation de 2004 ? Sur la TSCA, votre réponse me laisse dans l'inquiétude : le rapport de l'Inspection générale des finances fait état, dites-vous, de difficultés. Effectivement, il tend à montrer qu'une modulation est pratiquement impossible... Or, on nous a toujours assuré que la recette serait modulable. Le moins que l'on puisse dire est que ces réformes ont été improvisées... Comment compenser intégralement les transferts ainsi qu'on nous l'avait promis ? Il faut inciter, avez-vous dit, les collectivités territoriales à modérer la dépense publique. Mais sa croissance n'est-elle pas due à l'État lui-même ? La réduction en 2003 de 50 % des subventions pour l'eau et l'assainissement n'a-t-elle pas amené les collectivités territoriales à payer la différence ? Et la diminution des crédits d'aménagement du territoire ? On supprime des bureaux de postes en demandant aux communes de financer une agence postale. Que se passera-t-il si elles refusent ? De même, l'installation des médecins est-elle réellement de leur responsabilité ? Pourtant, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux leur enjoint d'aménager des bâtiments pour accueillir les cabinets médicaux ou de prévoir des exonérations de taxe professionnelle - à leurs frais évidemment. Même chose dans la loi de cohésion sociale... C'est finalement l'État qui les incite à dépenser davantage ! Parfois même, l'État - quel que soit le Gouvernement, au demeurant - va plus loin et oblige les collectivités à la dépense : ainsi en a-t-il été de la réforme, au demeurant bienvenue, de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires, qui se traduit par une dépense supplémentaire très partiellement compensée. De même pour la modification du statut des assistantes maternelles : très bien, mais ce sont les collectivités territoriales qui paient ! Troisième exemple, la loi sur le handicap : quand bien même vos services assurent qu'elle sera intégralement compensée, les présidents de conseils généraux estiment qu'elle entraînera des dépenses supplémentaires. Comment voulez-vous modérer la croissance des dépenses dans ces conditions ? Enfin, lorsque l'État se désengage dans le domaine de l'aménagement du territoire, par exemple, qui prendra le risque d'investir pour attirer les entreprises, si les collectivités territoriales ne le font pas ? M. Jean-François COPÉ : Si les moyens de l'ANPE n'ont pas encore été transférés, c'est parce que cette question est encore à l'étude. L'objectif est de rénover le service public de l'emploi où, là encore, la dispersion des structures nuisait à l'efficacité de la lutte contre le chômage ; leur regroupement dans le cadre des fameuses maisons pour l'emploi devrait apporter un plus pour tout le monde. S'agissant de la compensation, soyons clairs entre nous. Premièrement, la Commission consultative d'évaluation des charges - instance paritaire dont j'ai fortement encouragé la constitution une fois que le Comité des finances locales a retrouvé la sérénité qui convenait - doit terminer son travail. Rappelons également que la compensation s'entend par rapport à une date de transfert : on ne peut à la fois revendiquer une autonomie de gestion et demander que l'État compense au-delà de la date de transfert ; sinon, cela signifie que la collectivité devient un service déconcentré, ce qui n'est pas l'objectif. M. Bernard DEROSIER : C'est ce qui se passe. M. Jean-François COPÉ : Mais non ! M. Bernard DEROSIER : Mais si ! C'est la réalité. M. Jean-François COPÉ : Ce n'est pas le sentiment que j'ai dans l'exercice de mon mandat local. Jamais je n'aurais pu faire tout ce que j'ai fait à une époque où tout était fait pour m'en empêcher. La compensation se fait sur la base d'un critère sans ambiguïté : la dépense que l'État consentait avant le transfert. Une fois celui-ci opéré, on fait un calcul arithmétique simple et on transfère l'argent. Libre à la collectivité de dépenser plus, ou moins. C'est exactement ce qui s'est fait en 1982 lors de la décentralisation Mauroy : nous n'avons pas fait œuvre de créativité extrême en la matière... Venons-en aux augmentations de la fiscalité régionale. Il vous arrive de défendre des dossiers plus faciles, M. le Président... Cette affaire est indéfendable. Elle ne peut pas être liée à la décentralisation, qui n'était même pas en vigueur. Quand aux bases, elles ne sont pas plus faibles depuis que les exécutifs ont changé... M. le Président : Dans ma région, les impôts avaient augmenté de 50 % en 1993... D'autres les avaient même relevés de 150 %. Il faut tout dire dans une commission d'enquête ! M. Alain GEST : On peut remonter à 1986, et même à la lampe à huile ! M. Jean-François COPÉ : Sans doute ; reste que ce n'est en rien lié à la décentralisation. S'agissant du RMI, les 450 millions d'euros doivent à ce stade être considérés comme une dotation supplémentaire sur une année. Je ne peux répondre pour les années à venir. M. le Président : La compensation 2005 sera-t-elle calculée sur la base de la fin 2004 ou de la fin 2003 ? Je veux bien que vous ne passiez pas sur le remboursement des avances, mais là, il s'agit d'une affaire de 450 millions d'euros ! Resteront-ils acquis aux collectivités pour les années suivantes ? M. Jean-François COPÉ : Je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. M. le Président : C'est la plus importante ! M. Jean-François COPÉ : Je n'ai pas les comptes administratifs, ni une connaissance suffisamment précise de la situation. M. le Président : Mais sur le principe ? M. Jean-François COPÉ : Le principe, je l'ai rappelé : nous compensons à l'euro près ce que l'État a dépensé au cours de l'année de référence. M. le Président : Autrement dit 2003, ce qui signifie que le déficit du RMI sera encore plus important ! M. Jean-François COPÉ : Je vous trouve bien sévère. L'année de référence est 2003. En 2004, compte tenu des difficultés financières des collectivités territoriales, le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, fait un geste en accordant un abondement de 450 millions. Je pensais que cela allait susciter une certaine satisfaction... Ce n'est pas le cas et je le regrette. Mais pour l'avenir, je ne peux pas répondre à votre question. La référence prévue par la loi, c'est 2003. Nous verrons ce qu'il en sera par la suite ; reconnaissez avec moi que, lorsque nous aurons les comptes administratifs, nous serons plus à l'aise pour savoir exactement la réalité des choses. M. le Président : Comprenez-nous : nous cherchons à savoir pourquoi les départements ont pu augmenter leur fiscalité. Certains, craignant que l'exercice 2005 ne soit pas compensé, ont provisionné une dépense, ce qui explique l'augmentation de leurs impôts locaux. Votre réponse est à cet égard très importante. Cela peut représenter 2 % à 3 % d'augmentation de fiscalité pour certains départements ! M. Jean-François COPÉ : Vous ne pouvez pas utiliser cet argument. Les présidents de conseils généraux ont des approches très variées de cette affaire. Chaque conseil général est unique. M. Alain GEST : Tout à fait ! M. Jean-François COPÉ : La loi prévoyait en toute transparence une année de référence 2003. Nous avons ajouté en 2004 une dotation complémentaire de 450 millions d'euros afin de permettre à chacun de bien vivre dans un contexte encore un peu incertain. Je maintiens, puisque vous ne le dites pas, qu'il s'agissait là d'un geste très élégant de ce Gouvernement. Nous verrons l'année prochaine ce qu'il en est au vu des comptes administratifs. Pour l'heure, il n'est pas question pour moi de vous signer un chèque en blanc au motif que vous me le demandez. M. le Rapporteur : C'était en effet très élégant d'avoir apporté cette somme supplémentaire au-delà de la contrainte légale ; pour autant, on ne peut pas nier que ce geste ait mis l'État dans une position quelque peu piégée dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, ce complément non prévu par la loi finit par être intégré à la compensation. Il sera difficile de ne pas continuer à raisonner dans cette géométrie pour les années qui suivent. M. Jean-François COPÉ : C'est bien pour cela que je me montre aussi précis en vous indiquant que je ne prends aucun engagement sur la pérennité de cette compensation supplémentaire, venue mettre de l'huile dans les rouages. M. le Président : Mais pouvons-nous retenir votre phrase : « Nous verrons l'année prochaine » - c'est-à-dire en 2006 - « ce qu'il en est réellement » ? M. Jean-François COPÉ : Au vu des comptes 2005. M. le Président : Pouvons-nous le retenir ? M. Jean-François COPÉ : Bien sûr. M. Alain GEST : Il parle sous serment ! M. le Président : Je retiens, c'est tout. M. Jean-François COPÉ : M. le Président, l'objectif de la décentralisation, c'est qu'elle réussisse. Je me tue à expliquer depuis un an que je suis attentif à rétablir des relations de confiance. Ces 450 millions d'euros procédaient de ce souci. Mais il ne peut pas s'agir d'un engagement pérenne, du simple fait qu'il ne correspond pas au texte de la loi, mais simplement à une volonté exprimée par le Gouvernement. M. le Rapporteur : Au demeurant, le Président Augustin Bonrepaux est très ambitieux : avant de régler 2006, il faudrait déjà régler la situation 2005 sur la base des comptes administratifs 2004. M. Jean-François COPÉ : C'est bien pourquoi les 450 millions sont une somme évaluative. M. le Président : M. le Rapporteur, c'est l'année 2004 que nous réglons, sur la base des comptes 2004. M. le Ministre vient de nous dire qu'en 2006, nous réglerons l'année 2005 sur la base des comptes 2005. M. Jean-François COPÉ : Je n'ai pas dit « nous réglerons » mais « nous verrons »... Je suggère que cette commission d'enquête ne se transforme pas en lieu de négociation de bas étage ! M. le Président : Puis-je en tout cas reconnaître, M. le Ministre, qu'il y a une avancée dans le langage ? Ce n'est déjà pas mal ? M. Jean-François COPÉ : Si vous pensez qu'il s'agit d'une avancée, je ne vous dirai pas le contraire... Mais ne déformez pas mes propos ! M. Bernard DEROSIER : On avance, même si ce n'est pas une négociation... M. Jean-François COPÉ : Cela commence à y ressembler sérieusement ! M. Bernard DEROSIER : Vous semblez dire, M. le Ministre, qu'il est de la responsabilité des élus locaux de faire en sorte que ces transferts aboutissent à une meilleure gestion. Cela pourrait conduire à penser que si, dans un département, le nombre d'allocataires du RMI augmente, la raison en tient à une mauvaise gestion de l'exécutif départemental... M. Jean-François COPÉ : Je ne dirais pas cela. Lorsque le nombre d'entreprises diminue à tel endroit, est-ce à cause de taux de TP trop élevés, ou parce que la gestion n'est pas bonne ? De mauvais résultats en matière d'insertion peuvent avoir plusieurs sortes d'explications. M. Bernard DEROSIER : Je ne parle pas d'insertion, mais du nombre d'allocataires du RMI. M. Jean-François COPÉ : Nous parlons bien de la même chose. M. Bernard DEROSIER : Non. M. Jean-François COPÉ : C'est un des indicateurs de résultat. M. le Président : Et sur la taxe sur les conventions d'assurance ? M. Jean-François COPÉ : Le rapport de l'Inspection générale des finances fait état de difficultés techniques sans dire pour autant que la chose est impossible. Avec mon collègue ministre de l'Intérieur, nous évoquerons ces questions avec les représentants des départements, afin de voir ensemble les avantages et les inconvénients du système et, au vu de ce qu'il en ressortira, les souhaits des uns et des autres. Je suis, sur ce point, totalement ouvert. S'agissant enfin la maîtrise de la dépense, tout cela me paraît pouvoir entrer dans le cadre de la conférence annuelle de la dépense publique que j'ai proposée. Je suggère donc que cette question y soit examinée dans les meilleures conditions. M. le Président : M. le Ministre, je vous remercie d'avoir répondu avec précision, en faisant même quelques ouvertures... Nous vérifierons si elles seront maintenues dans le compte rendu que nous vous enverrons pour correction... M. Jean-François COPÉ : Je vérifierai surtout s'il reprend bien les termes que j'ai prononcés ! M. le Président : Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres lieux. Quoi qu'il en soit, nous vous remercions de nous avoir donné toutes ces informations. Audition de M. Gilles de ROBIEN, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Gilles de Robien est introduit. M. le Président : Nous poursuivons nos auditions de ce jour en accueillant maintenant M. Gilles de Robien, Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue. Un observateur extérieur pourrait être surpris de votre audition au terme des travaux d'une commission d'enquête sur la fiscalité locale. Vous savez pourtant bien, monsieur le Ministre, que le transfert aux départements et aux régions de 93 000 techniciens, ouvriers et personnels de service - dits TOS - de l'éducation nationale a fait naître beaucoup d'interrogations. Bien qu'applicable en 2006, il a même pu peser dès cette année sur la fiscalité de certaines collectivités territoriales. Notre Commission d'enquête a entendu des recteurs d'académie et, le 11 mai dernier, les deux directeurs d'administration centrale qui vous accompagnent aujourd'hui. Mais, comme certaines inquiétudes demeurent, elle souhaite faire avec vous le point le plus récent sur la préparation du transfert et recueillir l'appréciation politique du Gouvernement. M. le Président rappelle à M. Gilles de Robien que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Gilles de ROBIEN : Je vous remercie de m'accueillir et je suis à votre disposition pour répondre aux questions de la commission d'enquête. M. le Rapporteur : Quoique le transfert des TOS ait probablement été bien préparé sur le plan technique, une grande incertitude pèse sur la réalité de la situation à l'instant t. Nous avons auditionné des recteurs, les directeurs d'administration centrale qui vous entourent, ainsi que des présidents de conseils régionaux et de conseils généraux accompagnés de leurs collaborateurs, et leurs réponses se sont avérées extrêmement variables, en particulier sur la question cruciale du temps de travail. Il semble que la circulaire Lang de février 2002 ne soit pas appliquée en tous lieux. Pour un texte de cette nature juridique, c'est concevable, mais pouvez-vous nous donner votre appréciation sur ce sujet ? Nous avons en effet le sentiment que la gouvernance du système est assez inégale selon les régions, les départements et les établissements : deux recteurs nous ont par exemple déclaré abruptement qu'ils ignoraient le temps de travail de leurs agents. Le ministre peut-il se contenter d'une telle situation ? Je n'ignore pas que vous occupez vos fonctions depuis peu de temps, mais la continuité de l'État doit être garantie. Par conséquent, alors que vous allez engager ce transfert, quel objectif vous donnez-vous afin de connaître la situation ? Pardonnez ma candeur, mais des chefs d'établissement - notamment un président de conseil général, proviseur en activité - nous ont expliqué de bonne foi que la circulaire Lang ne permettait pas partout de compenser le fait que les TOS travaillent moins de 1 607 heures. Je ne vous pose pas cette question dans un souci esthétique, mais animé par trois préoccupations : la bonne gestion de l'État, le désir de savoir ce qui est transféré aux collectivités, la crainte que vous ne disposiez pas de marges d'évolution. Les TOS sont aujourd'hui mal payés, en contrepartie de quoi leur temps de travail est allégé. Toutefois, là où le temps de travail est le plus proche de la norme des 1 607 heures de la fonction publique - y compris territoriale -, il n'existe plus de marge de négociation et la situation politique devient extrêmement délicate. Il ne s'agit pas de pinailler. Le problème est majeur car il porte sur des effectifs extrêmement nombreux. Il nous paraît souhaitable, en tant que parlementaires, de connaître la situation actuelle avec le meilleur degré de certitude possible, ainsi que vos objectifs en amont du processus et la façon dont se passeront les choses sur le terrain. M. René DOSIÈRE : Je n'aurais pas pu mieux formuler toutes ces questions. Mais le ministre pourrait-il nous préciser quel calendrier précis il prévoit pour y répondre ? N'envisage-t-il pas un moratoire pour pouvoir disposer de données fiables, claires et transparentes dans son dialogue avec les collectivités territoriales ? M. le Rapporteur : Je constate que la perspective de la décentralisation est aujourd'hui plutôt bien acceptée par les agents, que les collectivités territoriales l'ont bien intégrée - même si, en raison des attaches partisanes, certaines d'entre elles sont plus avancées que d'autres dans la préparation des conventions avec l'État - et je comprends que le processus est progressif, avec un engagement de bonne fin, comme le rappelait tout à l'heure M. le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, les transferts financiers étant garantis in fine. Ma perplexité ne porte pas sur la conformité des transferts financiers, car ces engagements sont clairs, mais plutôt sur la clarté de la situation actuelle, et davantage pour l'État, pour la mémoire de l'éducation nationale, que pour les collectivités. En effet, lorsque l'éducation nationale n'aura plus la charge de ces questions, nous devrons nous demander si la situation préalable était très heureuse et, dans le premier volet de ma question, le thème du fonctionnement de l'État est au moins autant en cause que celui de la décentralisation. Quant au deuxième volet, il s'agit de connaître le degré de plasticité qu'auront les collectivités pour gérer l'arbitrage entre temps de travail et niveau indemnitaire. M. Gilles de ROBIEN : Quel sera le calendrier ? Quelle règle de temps de travail s'applique ? Comment cela se décline-t-il dans l'éducation nationale ? En somme, quelle est la situation concernant les personnels TOS transférés ? L'exercice 2005 est une année de transition, pendant laquelle les services de l'État agissent pour le compte des collectivités territoriales, et continuent à héberger, à assurer la restauration, l'entretien, etc. Au cours du premier trimestre 2005, quarante-cinq conventions ont été signées entre les représentants de l'État et les exécutifs élus, et, dans les semaines à venir, des arrêtés individuels de mise à disposition seront pris pour chacun des agents de l'État mis à disposition. Lorsque les discussions locales n'ont pas permis d'aboutir à la signature d'une convention, un arrêté interministériel doit être pris, après saisine et avis de la commission de conciliation mixte État-collectivités. Cette instance, installée auprès du ministre délégué aux collectivités territoriales, se réunira le 23 juin. Les arrêtés interministériels seront pris immédiatement après émission de l'avis, après quoi les arrêtés individuels de mise à disposition des agents de l'État seront pris à leur tour, et c'est à la fin de 2005 que sera publié le décret de partition fixant le périmètre définitif. Le transfert s'étalera sur les années 2006 et 2007. Lorsque le décret de partition prendra effet, probablement le 1er janvier 2006, car il n'est pas question d'envisager un moratoire, alors s'ouvrira la période de deux ans ménagée par la loi pour le fameux droit d'option. Les agents exerçant leur activité dans le champ de compétence transféré seront donc définitivement connus et appelés à opter entre l'intégration dans la fonction publique territoriale et le détachement. S'ils attendent avant de choisir, dans la limite de ces deux années, ils seront mis à disposition de la collectivité d'accueil. Pour simplifier la gestion comptable du processus, nous proposons - ce point n'a toutefois pas encore été tranché - que les vœux de chacun soient enregistrés au fur et à mesure, mais que les décisions soient prononcées en deux fois, le 1er janvier 2007 puis le 1er janvier 2008. Les contractuels de droit public transférés dès la publication du décret de partition, c'est-à-dire fin 2005, sont au nombre de 3 700. La durée de travail des TOS est réglementairement de 1 607 heures, cette règle étant commune aux fonctions publiques d'État et territoriale. M. le Président : Cela figurera-t-il dans le statut que vous élaborerez ? M. Gilles de ROBIEN : C'est la situation actuelle. M. le Président : Mais le statut des TOS est-il prêt ? M. Gilles de ROBIEN : Ces 1 607 heures constituent notre point de départ, sachant toutefois que la circulaire Lang du 21 janvier 2002 apportait un certain nombre d'aménagements au principe afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de telle ou telle profession. La circulaire comptabilise comme temps de travail effectif les jours fériés légaux lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé par l'agent, d'une part, et une pause quotidienne de vingt minutes, d'autre part. Les congés annuels sont en outre calculés sur la base de neuf semaines ou quarante-cinq jours ouvrés, et le travail pendant les vacances des élèves ne peut excéder vingt-cinq jours par an. La journée de travail est organisée selon une amplitude maximale de onze heures, la durée hebdomadaire étant comprise entre 35 et 40 heures, avec une marge de fluctuation de 3 heures supplémentaires, et le temps de travail, lorsque les élèves sont présents, est réparti sur cinq jours par semaine. Il existe des équivalences pour les personnels ouvriers chargés de l'accueil logés : 1 730 heures par an et 43 heures par semaine pour les personnels en poste simple ; 1 910 heures et 48 heures pour chacun des personnels en poste double. Pour les personnels ouvriers chargés des fonctions de veilleur de nuit, l'amplitude peut aller jusqu'à la plage de vingt heures à sept heures, avec un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives. En conclusion, la seule référence ayant force de règlement est la durée de 1 607 heures : c'est par conséquent la seule qui s'impose aux collectivités qui vont accueillir de nouveaux personnels. Comme toutes les circulaires, la circulaire Lang interprète les règlements, et c'est sur la base de cette interprétation que s'est stabilisé, depuis 2002, le dialogue social sur le thème éminemment sensible du temps de travail. Du reste, je connais bien, comme vous, la capacité des collectivités territoriales à dialoguer avec leurs agents et je sais que la durée du travail fait souvent l'objet d'interprétations au sein des collectivités territoriales. Je crois par conséquent que les élus régionaux et départementaux, lorsqu'ils accueilleront les TOS, sauront prendre en compte les équilibres sociaux antérieurs. Vous avez fait état d'une « grande incertitude », M. le Rapporteur. La situation reste certes contrastée mais, au fur et à mesure que cette année de transition s'écoulera, les incertitudes s'atténueront progressivement pour disparaître, de même que les contrastes. Chaque chef d'établissement des 8 000 collèges et lycées applique la circulaire Lang avec loyauté, mais aussi avec une marge de manœuvre pour l'adapter aux circonstances particulières à chaque établissement. Il n'en demeure pas moins que le ministère considère que la règle générale concernant le temps de travail est appliquée. M. le Rapporteur : Vous pourriez considérer que la circulaire Lang est modérément conforme à la loi et aux décrets. Mais non : le ministère, pour l'organisation du temps de travail, l'a adoptée comme doctrine. M. Gilles de ROBIEN : La « circulaire Lang », à ma connaissance, n'a pas été attaquée ou, en tout cas, pas été annulée. Elle reste en vigueur, même une fois que le ministre se nomme François Fillon ou Gilles de Robien. Son application risque peut-être de faire l'objet de discussions et d'interprétations au sein de telle ou telle collectivité territoriale, en fonction des besoins ou des particularismes locaux, mais, globalement, elle demeure la ligne directrice du calcul du temps de travail pour les TOS. M. le Président : C'est donc le statut que vous allez transmettre aux départements et aux régions ? M. Gilles de ROBIEN : Je ne sais si le terme de « statut » est adapté. M. le Président : Existera-t-il un statut spécial pour les TOS territoriaux ou bien seront-ils soumis à cette circulaire ? M. Gilles de ROBIEN : La création d'un cadre d'emploi est en cours, mais en tout état de cause, un cadre d'emploi ne traite pas de l'aménagement-réduction du temps de travail. M. René DOSIÈRE : Dans le texte voté par le Parlement figurait une disposition relative à la nécessaire remise à niveau des personnels outre-mer, particulièrement à la Réunion. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition, considérant que la remise à niveau s'imposait de manière encore plus forte dans certains départements métropolitains. Il n'empêche que le problème de l'outre-mer subsiste. Où en sont les réflexions du ministère sur ce point ? M. Gilles de ROBIEN : En effet, c'est l'existant qui est transféré, sans remise à niveau, sur la base de la photographie au 31 décembre 2002 ou au 31 décembre 2004, la situation la plus favorable des deux étant retenue. M. Louis GISCARD d'ESTAING : Certains présidents de conseils régionaux ont fait état devant nous de la question des charges sociales s'appliquant aux TOS dans le cadre d'un éventuel changement de leur statut. Pouvez-vous nous indiquer, M. le Ministre, si le transfert de compétence aura une incidence, dans ce domaine, pour les collectivités territoriales concernées ? M. le Président : En d'autres termes, la compensation sera-t-elle intégrale, pour les agents en détachement et surtout pour ceux qui opteront en faveur du maintien au sein de la collectivité territoriale ? Les crédits transférés sont-ils ceux qui étaient inscrits au budget de l'État ou bien ceux permettant de financer intégralement le coût des agents, sans charge supplémentaire pour le département ? M. Gilles de ROBIEN : Les transferts permettront de financer intégralement le coût des agents, mais je rappelle que la question n'est pas spécifique à l'Éducation nationale : le montant des charges sociales est beaucoup plus faible dans la fonction publique nationale que dans la fonction publique territoriale - de l'ordre respectivement de 15 % et de 45 %. Le Gouvernement s'est engagé à compenser financièrement le transfert au coût que supporteront les collectivités territoriales. S'agissant de l'impact en matière de retraites des personnels transférés, la réponse est identique, mais j'imagine que vous le saviez déjà. M. le Président : C'était un des sujets d'inquiétude qui ont pu donner lieu à des augmentations fiscales de précaution. M. Louis GISCARD d'ESTAING : L'expression « augmentations fiscales de précaution » correspond effectivement à la réalité telle qu'elle ressort de nos auditions. M. le Président : Nous n'obtenons malheureusement de réponse qu'aujourd'hui, alors que les budgets ont été votés en décembre. Si les éclaircissements étaient arrivés plus tôt, l'évolution de la fiscalité locale aurait peut-être été moindre. Quoi qu'il en soit, il convient de se réjouir de toute information positive. M. Gilles de ROBIEN : Je vous rappelle que la mesure ne prendra effet qu'en 2006, M. le Président, pas en 2005. M. le Président : J'ai bien compris. M. René DOSIÈRE : En matière de fiscalité locale, on constate toujours des effets d'anticipation. M. Alain GEST : J'insiste : le ministre l'a souligné à juste titre, la mesure ne prendra effet qu'en 2006, ce qui rend inappropriées les imputations sur les budgets 2005, le DGCL l'a très bien démontré à plusieurs reprises, notamment lors de son audition. Mme Ségolène Royal, lorsque nous l'avons auditionnée, nous a affirmé qu'elle avait dû prendre en compte, dans le budget 2005 du conseil régional de Poitou-Charentes, des dépenses liées au transfert de TOS. Pouvez-vous nous confirmer si des dépenses ont dû être engagées dès 2005 pour faire face à cette mesure ? M. Gilles de ROBIEN : À ma connaissance, ce n'est pas justifié mathématiquement. Mais si Mme la Présidente de la région Poitou-Charentes croit bon d'apporter un plus en matière de rémunérations ou de conditions de travail, elle en est libre, quitte à ce que le conseil régional décide d'accroître les impôts. M. René DOSIÈRE : M. Gest est un bon parlementaire : il pose des questions dont il connaît d'avance les réponses. M. le Rapporteur : Cela vaut toujours mieux que de fournir des réponses en l'absence de question ! M. Alain GEST : J'ai été ébranlé par ces propos émanant d'une présidente de région, qui parlait de surcroît sous serment. M. le Rapporteur : J'ai une question technique qui ne m'était pas venue à l'esprit lors de l'audition des directeurs d'administration centrale. Les TOS du ministère de l'Éducation nationale seront transférés en même temps que ceux du ministère de l'Agriculture, alors que leur gestion actuelle n'est pas identique, en particulier du point de vue indemnitaire. Les ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture ont-ils examiné ce que ce transfert simultané donnera pour les lycées ? Ne risque-t-il pas de compliquer la négociation sociale ? La question, du point de vue quantitatif, n'est pas marginale. M. Gilles de ROBIEN : Les TOS agricoles sont, me semble-t-il, au nombre de 2 000. M. le Rapporteur : ...Sans compter les TOS maritimes, certes moins nombreux, qui relevaient encore il y a peu de votre responsabilité, M. le Ministre. M. Gilles de ROBIEN : Le ministère de l'Agriculture ayant suivi nos réunions techniques, je suppose, sous toutes réserves, qu'il s'est mis en phase avec notre façon de faire. M. le Président : Que prévoyez-vous pour la compensation des contrats emplois solidarité et emplois consolidés ? M. Gilles de ROBIEN : En décembre 2004, les établissements publics d'enseignement employaient environ 25 000 bénéficiaires de contrats aidés, dont 16 500 agents exerçant des fonctions ouvrières et de service. Ceux-ci seront mis à disposition des collectivités territoriales dans le cadre des conventions en cours d'élaboration. Le cabinet du Premier ministre a décidé que les collectivités prendront en charge ces contrats à partir du 1er janvier 2006, soit en assumant directement la part employeur, soit en subventionnant les établissements. Les moyens correspondants seront transférés via le ministère de l'Intérieur, sur la base de la dépense engagée par l'État au cours des trois derniers exercices, soit 19,6 millions en 2002, 37,7 millions en 2003 et 35,9 millions en 2004. M. le Président : Les effectifs des collèges et lycées resteront donc inchangés. M. Gilles de ROBIEN : Absolument. M. le Président : Et qu'en est-il des personnels supports, chargés de la gestion des salaires et des carrières ? Comment les collectivités territoriales pourront-elles vérifier quel volume de personnel était jusqu'à présent utilisé par l'État, afin de s'assurer que le transfert sera bien réalisé à l'agent près ? M. Gilles de ROBIEN : Il s'agit de 750 agents. M. le Président : Mais comment le vérifier ? Un président de conseil général, par exemple, s'est plaint de ne se voir transférer que 0,15 équivalent temps plein, ce qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. M. Gilles de ROBIEN : Les services académiques assurant des fonctions supports ont globalement des effectifs de 750,54 équivalents temps plein physiques. Compte tenu des agents à temps partiel et de ceux affectés à plusieurs missions, les chiffres sont en effet détaillés avec deux décimales. De ce total, 48,77 % sont chargés de la gestion, 12,12 % de la gestion du remplacement, 5,05 % des examens et concours, 7,17 % de la formation, 13,43 % de l'action sociale et de la santé, 3,22 % de l'informatique de gestion, 10,23 % de missions diverses, notamment conseil et contentieux, et 0,01 % de la sectorisation. M. le Président : Mais comment seront-ils transférés ? M. Gilles de ROBIEN : Par catégorie, corps, secteur et académie : cela figure dans le rapport présenté à la Commission consultative d'évaluation des charges. À titre d'exemple, l'académie de Clermont-Ferrand doit ainsi faire l'objet d'une compensation correspondant à 20,64 postes. M. le Président : Pour toute l'académie ? M. Gilles de ROBIEN : Oui. Le transfert va de 6 postes pour la Réunion à 67,95 postes pour Versailles. M. le Président : Pourrions-nous avoir communication du tableau dont sont extraites ces données ? M. Gilles de ROBIEN : Il date de février 2005 et peut encore évoluer. Mais, si votre commission d'enquête le juge utile, je le lui communiquerai bien volontiers une fois que nous l'aurons actualisé. M. le Rapporteur : Quel progrès la décentralisation des TOS induira-t-elle, non seulement pour le ministre de l'Éducation nationale mais aussi pour les collectivités et le système ? Quelle est votre appréciation politique sur ce point ? M. Gilles de ROBIEN : L'élu local et le ministre que je suis ont le même avis : la gestion des écoles maternelles et primaires, grâce à la proximité, est beaucoup plus cohérente. C'est ce qui est attendu de la décentralisation des TOS : cohérence et proximité. M. le Rapporteur : On nous a beaucoup parlé de la « pression citoyenne » qui conduit les élus locaux à prêter une oreille attentive aux demandes d'effectifs supplémentaires. Tel président de conseil général a même postulé que, par principe, il allait recruter un TOS supplémentaire dans chaque collège relevant de sa compétence. M. Gilles de ROBIEN : Je ne puis m'immiscer dans la gestion des collectivités territoriales. De fait, la proximité permet de mieux évaluer les besoins. Et les élus municipaux, départementaux et régionaux éprouvent d'autant plus le désir de bien faire qu'ils sont « à portée de baffes des électeurs », comme disait un Premier ministre récemment en fonctions. Dans le souci de faire plus et mieux, il n'est pas impossible que des élus locaux souhaitent améliorer le service rendu dans les collèges et les lycées, le cas échéant par l'embauche de TOS, en s'appuyant sur des dispositifs de lutte contre le chômage comme les contrats d'avenir, qui bénéficient de l'aide de l'État. M. le Rapporteur : Nous avons aussi entendu parler d'études de référence des rectorats, qui situeraient le « plan d'armement » idéal de chaque établissement et justifieraient les anticipations de départements et de régions concernant la nécessité de procéder à des embauches supplémentaires. Ces schémas existent-ils ? Sont-ils généralisés ou ne concernent-ils qu'un nombre limité de rectorats ? La décentralisation, au fond, permettrait un grand épanouissement : en tant que ministre dépensier, vous êtes soumis à des contraintes budgétaires qui, après la décentralisation, n'existeront plus. La vertu de la décentralisation serait-elle donc de pouvoir dépenser davantage ? M. Gilles de ROBIEN : On peut le dire ainsi, M. le Rapporteur. Pour commencer, aucune analyse des besoins dans l'absolu n'est actuellement disponible, même si des élus locaux émettent des estimations. Des barèmes de répartition font néanmoins apparaître des excédents et des déficits relatifs. J'imagine donc que, au moins dans un premier temps, avant de se lancer dans des recrutements, les nouveaux responsables s'efforceront d'optimiser les moyens transférés. M. Alain GEST : Ils vont optimiser la circulaire Lang... M. le Rapporteur : Un président de conseil général ou de conseil régional constatant un sous-effectif relatif dans un établissement et un sureffectif relatif dans un autre sera-t-il plus à même qu'un recteur de réaffecter les effectifs afin de rétablir l'équilibre ? Cela ne me semble guère vraisemblable. M. Gilles de ROBIEN : Lorsque les moyens sont plus proches des élus locaux, la gestion est généralement plus fine, mieux adaptée et moins rigide - je n'ose employer le terme de « flexibilité ». Cette souplesse supplémentaire provient du regard de l'élu local et aussi de son désir de démontrer à la population que l'argent public est bien dépensé. M. le Président : M. le Ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vos explications rassureront les élus, notamment en ce qui concerne la compensation des charges sociales. M. Gilles de ROBIEN : Les contribuables seront peut-être rassurés, eux aussi... Audition de M. Brice HORTEFEUX, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président MM. Brice Hortefeux et Dominique Schmitt sont introduits. M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons M. Brice Hortefeux, Ministre délégué aux Collectivités territoriales, accompagné par M. Dominique Schmitt, Directeur général des collectivités locales. Monsieur le Ministre, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi que vous le savez, nous avons pour mission d'apprécier les causes et les conséquences de l'évolution récente de la fiscalité locale ainsi que les conditions d'une responsabilité mieux assumée des décideurs locaux et de l'État. Depuis le mois de mars, notre Commission a procédé à de nombreuses auditions ; elle a adressé des questionnaires écrits aux régions, aux départements, à un grand nombre de communes et d'intercommunalités, ainsi qu'à diverses personnalités publiques et organismes concernés par la fiscalité locale ou les transferts de compétences. Par ailleurs, le Directeur général des collectivités locales a été entendu à deux reprises par notre Commission, sans compter de nombreuses réunions techniques avec le Rapporteur et moi-même, ce dont nous lui sommes reconnaissants. D'une façon plus générale, les services de votre ministère nous ont apporté de nombreuses informations. Aussi ai-je été quelque peu surpris de découvrir sur le site Internet du ministère qu'était publiée depuis jeudi dernier l'analyse détaillée des budgets primitifs des régions pour 2005, informations dont on nous avait assuré qu'elles ne seraient pas disponibles avant le mois de juillet ! Il semble que notre Commission d'enquête ait joué un rôle d'aiguillon, et je me réjouis qu'elle ait pu inciter à un effort d'information rapide, contribuant ainsi à dissiper certains malentendus entre l'État et les collectivités. M. le Président rappelle à MM. Brice Hortefeux et Dominique Schmitt que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. À l'invitation du Président, ceux-ci prêtent serment. M. Brice HORTEFEUX : M. le Président, les hasards du calendrier, lui-même conséquence du référendum, font qu'il m'appartient de répondre à votre invitation pratiquement au moment où je prends mes fonctions de ministre délégué aux Collectivités territoriales auprès du ministre d'État, M. Nicolas Sarkozy. L'un au moins de vos collègues sait, pour avoir été ministre, combien la mise en place d'un cabinet ministériel charge la journée et perturbe les nuits... Croyez bien que ma présence aujourd'hui devant vous a été précédée de nuits devenues presque blanches, tant cette audition nécessitait de préparation et de réflexion préalables. J'en suis toutefois sincèrement heureux, étant persuadé que votre Commission d'enquête accomplit un travail essentiel qui avait tout naturellement attiré mon attention, notamment dans le cadre de mon mandat régional. Née dans la polémique en raison des augmentations brutales de la fiscalité d'une partie des régions et des départements, elle permettra, j'en suis convaincu, de faire le point de façon objective et indiscutable. Vous avez déjà entendu le Directeur général des collectivités locales à deux reprises et évoqué la publication récente sur nos sites de données concernant les budgets des régions ; il faut y voir le résultat de la diligence dont vous lui avez demandé de faire preuve. Quoique régulière, leur publication a pu être anticipée grâce précisément aux questions, aux travaux et aux demandes de votre commission d'enquête. Vous avez également auditionné les directeurs des ministères concernés par les transferts de compétences et entendu hier mes collègues chargés du Budget et de l'Éducation nationale. Bien qu'assez clairs, les faits méritent d'être précisés. Au moment où s'est engagé l'acte II de la décentralisation, la situation financière des collectivités territoriales était saine. Et les hausses de fiscalité constatées en 2005 ne sont pas justifiées par les transferts opérés cette même année, dont la compensation est intégrale, comme le prévoit l'article 72-2 de la Constitution. La Commission consultative d'évaluation des charges en est le garant et vous en fera rapport, ainsi que le prévoit la loi de 2004. Je voudrais enfin dégager, à partir des leçons du passé, quelques tendances possibles pour l'avenir de la fiscalité locale. Premier constat : les hausses de fiscalité ne sont pas fondées sur les transferts de compétences de 2005. À la veille de l'acte II de la décentralisation, les collectivités territoriales pouvaient se prévaloir de fondements financiers solides leur permettant de prendre en charge dans de bonnes conditions de nouvelles compétences. 2003 aura été pour elles une année de consolidation de leurs marges de manœuvre financière en vue de relancer l'investissement, et c'est par une hausse de la fiscalité directe qu'elles y sont parvenues. Elles ont également maîtrisé la croissance de leurs dépenses de personnels - +2,4 % pour les communes - et bénéficié de la poursuite de la baisse des frais financiers. Le niveau de l'épargne a donc progressé en 2003, contrastant d'ailleurs avec le tassement des années précédentes. Cela a favorisé la reprise de l'investissement, notamment pour les communes qui se voyaient en phase avec leur propre cycle électoral. Les régions et les départements ont également relancé leurs efforts d'investissement, signe que l'intégration des nouvelles compétences - les TER, par exemple, ainsi qu'une nouvelle part de la formation professionnelle pour les régions ; la montée en charge de l'APA pour les départements - a pu être absorbée sans déséquilibrer leurs budgets ni pénaliser l'investissement. Encore en légère diminution en 2003, la dette des collectivités reste à un niveau très bas : 77 milliards d'euros fin 2003 contre 84 milliards d'euros fin 1984. Les premiers éléments disponibles pour 2004 indiquent, d'une part, un tassement de l'épargne des collectivités sous l'effet incontestable d'une accélération des dépenses de personnels, et d'autre part la persistance d'un niveau élevé d'investissement : +7,2 % pour l'ensemble des collectivités. Cela se traduit à l'évidence par un besoin de financement pour l'ensemble des secteurs des administrations publiques locales et, du coup, par une légère augmentation de leur endettement. Encore faut-il relativiser ce phénomène qui intervient après huit années d'excédents : non seulement ce besoin est strictement lié à l'effort d'investissement - les APUL représentent environ 70 % de l'investissement public en France - mais le recours à l'emprunt accompagne un autofinancement qui reste largement positif, à hauteur de 29,9 milliards d'euros. Ajoutons qu'il intervient dans un contexte financier reconnu comme favorable, les très faibles taux d'intérêt rendant l'endettement plus attractif. Les collectivités ont donc conservé des marges de manœuvre certaines en termes d'endettement. Enfin, le niveau de leur dette a très nettement diminué par rapport à ce qu'il était voici dix ans, rendant la charge de cette dette « soutenable » pour la plupart des collectivités. Ayant ainsi démontré que la situation financière était saine, force est de constater que les hausses des budgets 2005 n'ont pas pour origine la compensation des transferts opérés cette année. Il n'aura échappé à personne que les budgets 2005 des régions sont les premiers budgets votés par les nouvelles assemblées régionales issues du scrutin de 2004 ; ils se caractérisent par de fortes hausses qui touchent la plupart des postes de dépenses et de recettes, notamment fiscales. Les nouvelles équipes élues en 2004 ont décidé d'accroître leurs marges de manœuvre et de renforcer leurs possibilités d'intervention sur leurs principales compétences : ferroviaire, formation professionnelle et lycées. Ce ne sont donc pas les compétences nouvellement transférées en 2005 qui viennent accroître les budgets régionaux. Du reste, cinq régions seulement de métropole semblent avoir prévu dans leurs budgets des crédits afférents aux nouvelles missions qui leur sont dévolues : Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie et Pays de la Loire. Dix régions seulement ont inscrit des recettes au titre de la TIPP, pour un montant le plus souvent inférieur à ce que l'État a décidé de transférer. C'est à l'occasion de décisions modificatives que la plupart des régions procéderont à un ajustement des dépenses et des recettes lié aux nouvelles compétences. Le budget total devrait ainsi évoluer de 13,1 % en 2005 - soit 2,1 milliards d'euros supplémentaires -, taux ramené à 11,9 % si l'on neutralise, ce qui paraît assez logique, les indemnités aux employeurs d'apprentis dont la montée en puissance intervient en fait depuis 2003. Les domaines d'intervention traditionnelle des régions présentent en 2005 des crédits en forte croissance. La formation professionnelle continue et l'apprentissage bénéficient d'une inscription de dépenses totale en hausse de 17,7 %, soit plus de 500 millions d'euros ; les dépenses consacrées aux lycées publics et privés devraient s'accroître de 9,2 % pour s'établir à 425 millions ; celles relatives à la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs devraient atteindre à peu près 300 millions d'euros, soit une progression de 12,9 %. Pour financer leurs actions, les régions ont donc fortement accru leur pression fiscale directe en 2005. À l'exception de la Corse, toutes les régions de métropole ont augmenté leurs taux, mais dans des proportions naturellement très variables, entre 1,7 % pour l'Alsace à 80 % pour le Languedoc-Roussillon. En moyenne, le taux de taxe professionnelle évolue de 21,7 % et celui de la taxe sur le foncier bâti de 19 %. Il faut remonter aux années 1987 et 1989 pour constater d'aussi fortes hausses. M. le Président : Et 1993... M. Brice HORTEFEUX : S'agissant de la carte grise, seul impôt indirect commun à toutes les régions, quinze d'entre elles ont décidé de relever leurs tarifs, en moyenne de 12 %. La capacité d'épargne des régions est en nette amélioration en 2005, les dépenses augmentant un peu moins vite que les recettes de fonctionnement, sans pour autant suffire à financer la totalité des subventions d'équipement, en croissance de 15 % ; ce phénomène, très courant dans les budgets primitifs, est en général infirmé au stade des résultats. Ainsi, sur les 2,7 milliards d'euros d'emprunts qu'elles avaient inscrits dans leurs budgets primitifs 2003, les régions n'en ont réalisé que 1,4 milliard d'euros, soit presque moitié moins. L'emprunt inscrit aux budgets 2005 est encore en hausse ; il résulte à la fois de la forte évolution des subventions d'équipement versées et d'une croissance prévue de 9,2 % de l'investissement direct. Rappelons que l'appel à l'emprunt, devenu au fil des ans une variable d'ajustement des budgets régionaux, est toujours surestimé dans les prévisions. À l'inverse, les rentrées fiscales s'avèrent souvent meilleures que prévu et les investissements, pour des raisons différentes, souvent réalisés en partie seulement. Si l'endettement régional augmente de 10,8 % au 1er janvier 2005, il reste, en valeur absolue, à un niveau comparable à celui de 1998. L'amélioration de la situation financière des régions depuis plusieurs années leur permet d'envisager assez sereinement de nouveaux recours à l'emprunt. La marge de manœuvre financière des régions s'améliore donc depuis 2005. Du côté des départements, et selon nos premières estimations encore incomplètes, les budgets primitifs pour 2005 font apparaître une série de tendances lourdes. Pour commencer, ils sont en augmentation sensible, de 6 à 7 %, soit un rythme supérieur à celui des années précédentes, exception faite naturellement de l'exercice 2004, marqué par le transfert du RMI, mais néanmoins inférieur à celui observé pour les budgets régionaux. Trois postes expliquent à eux seuls la moitié de cette hausse : le RMI, l'APA et les charges de personnels. Non seulement le RMI suit une progression effectivement très marquée - +14 % -, mais les départements ont, à l'évidence, anticipé une poursuite de la hausse du nombre d'allocataires. Les dépenses d'APA connaissent également une hausse significative, quoique un peu plus faible : +7 %. Mais cette hausse est très localisée sur un petit nombre de départements où la montée en charge n'est pas terminée : l'exemple de la Creuse est le plus connu et le plus chargé de symboles. Les dépenses de personnels, enfin, suivent une croissance encore soutenue - 7 % -, un peu supérieure à celle de 2004, qui était de 6 %. Les recettes de fonctionnement affichaient également une forte progression, de l'ordre de 11 %, en raison d'une fiscalité directe en progression plus importante que les dotations, dont la hausse reste de 8 % environ, et une croissance plus sensible - autour de 20 % - des recettes de fiscalité indirecte, TIPP et TSCA. Souvenons-nous que, sur les trois derniers exercices, les réalisations des droits de mutation à titre onéreux ont été supérieures de 1 milliard d'euros aux prévisions, sous l'effet du dynamisme constant des marchés immobiliers ; d'où des recettes nettement supérieures, quoique inégalement réparties. L'épargne nette découlant de ces prévisions de recettes et de dépenses diminuerait légèrement : -1 %. Rappelons toutefois que les prévisions d'épargne des budgets primitifs s'avèrent souvent en deçà des réalisations. Par ailleurs, l'épargne nette était prévue en hausse sensible en 2004, aux alentours de 8 %. Les dépenses d'investissement devraient progresser moins rapidement cette année qu'en 2004 : 3 % environ contre 13 %. Compte tenu du tassement anticipé de l'épargne et de la progression de l'investissement, les départements ont inscrit des recettes d'emprunt en légère progression. Comme pour l'épargne, il convient de nuancer ce point en rappelant que les réalisations d'emprunts sont souvent très nettement inférieures aux prévisions. Les départements anticipent donc une hausse des charges liées à leurs compétences principales - RMI et personnes âgées -, mais n'ont sans doute pas constitué autant de réserves de précaution que les régions. La situation des départements présente certes des analogies avec celle des régions, mais avec un décalage beaucoup moins marqué. Deuxième constat : la compensation des charges est et sera intégrale, loyale, et contrôlée par la Commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) et le Parlement. Rappelons que la Constitution garantit la compensation des transferts de compétence et l'attribution aux collectivités de ressources de nature fiscale. Nous venons de voir que la hausse de la fiscalité, j'y insiste, ne s'explique pas par l'effet des transferts récents, dont l'impact financier pour 2005 est de surcroît modeste : 0,3 % du budget des départements, 2,5 % estimés du budget des régions. Ces transferts sont intégralement compensés. Compensation intégrale : les ressources transférées seront équivalentes aux dépenses effectuées par l'État au titre des compétences transférées. Toutes les dépenses, directes et indirectes, liées à l'exercice des compétences transférées seront prises en compte conformément au principe fixé par la loi du 13 août 2004. Compensation concomitante : les transferts de ressources s'échelonneront sur plusieurs années, au rythme des transferts de compétences. Tout accroissement de charges résultant de ces transferts sera accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. Compensation contrôlée enfin, puisque le montant des accroissements de charges résultant de transferts de compétences sera constaté par arrêté interministériel après avis de la commission consultative, désormais présidée par M. Jean-Pierre Fourcade, dont chacun reconnaît l'expertise en la matière. Cette compensation est conforme à l'objectif constitutionnel d'autonomie financière, puisque, en vertu des dispositions de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, elle s'opérera à titre principal par l'attribution d'impositions de toutes natures - en clair, TIPP pour les régions et TSCA pour les départements. En outre, l'article 119 précité garantit le niveau des ressources transférées au titre de la compensation financière, prévoyant même que, si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compensera cette perte dans des conditions fixées en loi de finances, afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ce « filet de sécurité » n'est d'ailleurs pas demeuré inactif puisqu'il a été utilisé dans la loi de finances rectificative pour 2004, dont l'article 2, du fait d'un moindre dynamisme des recettes de TIPP au cours de cette année, a attribué aux départements une fraction supplémentaire de recettes de l'État. Globalement, pour ce qui concerne l'année 2005, les départements sont attributaires d'une quote-part de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, et les régions d'une fraction de tarif de TIPP pour compenser les transferts décidés et votés dans le cadre de la loi de 2004. Ces dépenses ont été évaluées à 126 millions d'euros pour les départements et à un peu moins de 400 millions d'euros pour les régions. Ce montant est naturellement provisoire : au cours de l'année 2004, les ministères décentralisateurs - pour l'essentiel l'équipement, l'éducation, la cohésion sociale et la santé - ont procédé à l'évaluation provisoire des dépenses qu'ils consacraient jusqu'alors à l'exercice des compétences transférées. Le montant évalué a permis de prendre en loi de finances les dispositions nécessaires ; il sera progressivement ajusté au vu du chiffre définitivement constaté après évaluation par la commission. Les dépenses transférées en 2005 et au titre des années suivantes seront donc intégralement compensées. La CCEC a reconnu la conformité des compensations aux obligations légales. Lors de ses sept premières séances consacrées au débat préalable à la consultation sur les arrêtés, qui interviendra à l'automne, la CCEC a permis de régler un certain nombre de difficultés : le gel des crédits a été neutralisé - le problème se posait notamment en matière de bourses d'étudiants et de formation sociale -, certains droits ont été réajustés dans un sens très satisfaisant - c'était le cas des CLIC, à hauteur de 7 millions d'euros - et les règles d'actualisation des dépenses d'investissement ont donné lieu, après bien des débats, à un accord entre les élus et l'administration sur la base de l'indice représentatif de l'évolution des prix de la FBCF. La CCEC a également permis de préciser les calendriers et les règles de transfert des masses salariales qui interviendront dans les prochaines lois de finances ; elle a du reste clarifié, sous la présidence de M. Augustin Bonrepaux, la question de la compensation des charges sociales après répartition des services, afin de tenir compte des préoccupations que celui-ci avait exprimées à propos notamment du régime des charges des retraites. Certains exécutifs considèrent que la constitution d'une réserve leur permet de faire face à la dérive de charges transférées, présentées tout à la fois comme inévitable et inéluctable. Je ne partage pas cette inquiétude, au moins pour trois raisons. Première raison : la progression structurelle des recettes est intrinsèquement bonne. Indépendamment des ressources fiscales, destinées à compenser en 2005 les transferts, la fiscalité en général et les dotations augmentent plus vite que l'inflation. Les bases de fiscalité progressent en moyenne de 3 % par an, générant une augmentation des produits équivalente sans hausse des taux. Sans parler des droits de mutation à titre onéreux, dynamisés par la hausse que j'ai évoquée tout à l'heure. Quant aux dotations, elles échappent - sans porter de jugement de valeur, je sais que c'est une préoccupation de votre rapporteur - à la rigueur que l'État impose à son budget : celui-ci évolue seulement de 1,8 % alors que la DGF progresse cette année de 3,29 %. Et c'est l'effort de péréquation souhaité sur tous les bancs du Parlement qui amène les seules collectivités les moins défavorisées à ne profiter de cette croissance que dans une moindre mesure. Deuxième raison : le pari - que prend le Gouvernement - d'une meilleure gestion à moyen terme des compétences transférées par l'État. C'était d'ailleurs bien, en matière de RMI, l'intention du législateur, qui souhaitait responsabiliser les départements dans leurs efforts d'insertion. Dans des collectivités se réclamant de la majorité - le Rhône, par exemple, avec Michel Mercier - comme de l'opposition - les Bouches-du-Rhône, avec M. Jean-Noël Guérini -, on observe des engagements tout à la fois fermes et efficaces quant à un meilleur contrôle qu'auparavant des conditions d'attribution et de gestion du RMI. M. Richard MALLIÉ : C'est vrai. M. Brice HORTEFEUX : Les représentants des départements n'ont d'ailleurs pas caché à la Commission qu'ils comptaient faire des efforts de gestion et, dès 2004, ils ont fortement investi dans leurs actions d'insertion. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le volet insertion est passé de 778 millions d'euros de dépenses nettes en 2003 à 861 millions en 2004. Comme l'a remarquablement exposé à la CCEC un représentant des départements, « si le conseil général veut vraiment piloter une véritable politique de refondation sur l'insertion, il doit se repositionner, prendre le manche, travailler avec les autres. On ne peut pas transposer une politique qui a fonctionné pendant des années dans un autre monde et avec d'autres règles. » Cet extrait me semble tout à fait révélateur de l'esprit qui doit désormais régner. Sans vouloir faire preuve d'un optimisme béat, j'observe que les régions et les départements ont montré de grandes capacités de gestion par le passé ; pourquoi ne le feraient-ils pas demain ? Troisième raison : il appartient aux assemblées locales et à leurs exécutifs d'afficher et d'assumer leurs choix. Prenons l'exemple des routes. L'État n'avait pas souhaité mettre certains tronçons à deux fois deux voies ; c'était sa responsabilité. Désormais, c'est devenu celle des départements qui peuvent faire un autre choix, aux dépens d'autres compétences ou non, selon les options fiscales qu'ils se donnent. La démocratie de proximité ne peut qu'en sortir renforcée et l'élu davantage responsabilisé. Votre Commission d'enquête se trouve devant une question implicite difficile, déjà soulevée par le Président de la Commission des finances de votre Assemblée, M. Pierre Méhaignerie, et encore hier après-midi par le ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État : les collectivités dépensent-elles trop ? Pour ma part, je me garderai bien d'adopter une position tranchée et univoque. Permettez-moi seulement de resituer la question en élargissant quelque peu les perspectives. Premièrement, les collectivités territoriales pèsent d'un poids croissant dans l'économie et augmentent logiquement la pression fiscale. Sur les 25 dernières années connues - de 1978 à 2003 -, la croissance des administrations publiques locales (APUL) a été en moyenne de 6,8 % par an, supérieure donc à celle de l'ensemble des administrations publiques - 6,3 % et 5,4 % pour l'État - et à la croissance du PIB : 5,2 %. Les dépenses des administrations publiques locales représentent un peu plus de 10 % du PIB en 2003 : 10,5 %, contre 9,8 % en 1998. De même, la croissance des effectifs des collectivités territoriales est nettement supérieure à celle des effectifs de la fonction publique d'État et à l'évolution moyenne de l'emploi en France : la fonction publique territoriale a augmenté de 38 % entre 1981 et 2001 contre 15 % pour la fonction publique d'État et 13 % pour l'emploi total. Je sais que c'est un sujet de préoccupation de votre Commission. On peut y voir différents effets conjugués, à commencer par celui de la marge d'action et de la gamme des initiatives possibles, qui joue sur les finances comme sur les effectifs. D'une part l'offre des services des collectivités territoriales augmente sous l'effet des transferts de compétences, mais aussi en fonction du choix éventuel des collectivités d'accroître leur niveau de service en allant au-delà de ce que faisait l'État ou en intervenant davantage sur leurs compétences générales. Les collectivités territoriales interviennent ainsi, et de manière croissante, dans des domaines où se manifeste une demande sociale importante et où s'expriment des besoins forts et précis : l'éducation, la formation professionnelle et l'aide sociale. En matière d'éducation, par exemple, la part des collectivités territoriales a progressé de cinq points en seize ans : de 17,3 % à 22,3 %. En matière d'aide sociale, l'effort des collectivités en direction des personnes âgées ou handicapées a crû fortement, accompagnant le vieillissement de la population et la mise en place de dispositifs de protection toujours plus ambitieux. Enfin, les administrations publiques locales prennent une part prépondérante dans l'investissement public de la Nation : près de 70 % en 2003. Pour l'essentiel, il s'agit d'ailleurs d'investissements voulus par les collectivités territoriales et qui, chacun s'accordera à le reconnaître, ont un effet positif sur la croissance. Venons-en maintenant à la place de la fiscalité locale dans la fiscalité levée dans notre pays. D'après les comptes de la Nation, la part des impôts revenant aux administrations publiques locales - environ 5 % du PIB - est trois fois moins élevée que celle des impôts revenant à l'État. La part cumulée de l'État et des APUL est restée globalement stable au cours de ce dernier quart de siècle ; la hausse des prélèvements obligatoires tient en fait à la très forte progression des impôts revenant aux organismes sociaux. À l'intérieur de l'ensemble État+APUL, la part de ces dernières a d'abord régulièrement progressé, accompagnant une stabilisation, puis une diminution de la part de l'État : c'est la conséquence de la décentralisation des années 1980, certains transferts de compétences ayant été compensés par des transferts d'impôts : carte grise, vignette, etc. Puis la part des APUL s'est mise à diminuer à la suite des allégements fiscaux de la période 1999-2003, l'État compensant les pertes correspondantes pour les collectivités territoriales. Les modalités de compensation des récents transferts de compétences auront, j'en suis certain, pour effet d'augmenter dans les années à venir la part relative des APUL au détriment de celle de l'État, par l'effet mécanique de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales - communes, EPCI, départements et régions - ont perçu en 2004 au titre des quatre taxes directes locales un montant de 53,5 milliards d'euros. 34,9 milliards - soit 65 % des recettes fiscales - vont aux communes et à leurs groupements, 15,4 milliards, soit un peu moins de 30 %, aux départements et 3,2 milliards, c'est-à-dire 6 %, aux régions. La part des groupements dans la fiscalité directe est logiquement en forte augmentation, en raison notamment de la progression de la taxe professionnelle unique, que nous devons encourager : les produits de la taxe professionnelle sont désormais levés à hauteur de 69 % par les groupements à fiscalité propre. S'ajoutent aux produits des quatre taxes environ 4 milliards d'euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçus par les communes ou les groupements de communes. Le produit total atteint donc 57,5 milliards d'euros. Pour intéressant qu'il soit, ce chiffre n'est pas représentatif de la pression fiscale réellement supportée par le contribuable local. L'État, donc le contribuable national, a en effet pris en charge une partie de ce produit en 2004, soit près de 10 milliards d'euros de dégrèvements, qui représentent 25 % du total de la taxe professionnelle émise et 30 % de la taxe d'habitation émise. En plus de ces produits votés, l'État compense aux collectivités les exonérations de fiscalité locale qu'il décide de mettre en œuvre, soit de façon sectorielle, soit dans un objectif d'aménagement du territoire, pour un montant de 3,7 milliards d'euros en 2004, dont la moitié correspond à des exonérations de taxe d'habitation, 30 % à des exonérations de taxe professionnelle et 1 % à chacune des deux taxes foncières. Enfin, l'État a pris en charge les allégements fiscaux de la période 1999-2003 sous forme de dotations, désormais quasiment toutes intégrées dans la DGF. Les produits totaux ont donc enregistré une progression assez régulière depuis vingt ans : c'est la principale leçon. La fiscalité locale, notamment celle des départements et des régions, a augmenté de façon continue au cours de ces vingt dernières années, accompagnant d'abord la montée en puissance de la décentralisation et la croissance concomitante des budgets des départements et des régions. Pour ces dernières, la pression a été beaucoup plus forte en début de période, c'est-à-dire durant les années 1984-1994. À la progression des bases s'est ajoutée une hausse régulière et significative des taux qui, c'est vrai, partaient d'un seuil extrêmement bas en 1975. À partir de 1994, date à laquelle la montée en charge des investissements des lycées était pratiquement achevée, la progression des produits a été beaucoup plus lente et fondée essentiellement sur la croissance des bases. Enfin, le produit encaissé par les régions a nettement diminué depuis 1999 sous l'effet de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et, dans une moindre mesure, de la part salaires de la taxe professionnelle. Le transfert de la compétence transports ferroviaires de voyageurs n'a pas eu, semble-t-il, d'effets sur le niveau de la fiscalité régionale. Pour les départements, la croissance a été plus régulière et la progression des taux moins soutenue que celle des bases. Les niveaux de départ étaient plus élevés que ceux des régions, et la seule exception notable pour ces dernières années est l'augmentation marquée, en 2002 et surtout en 2003, de la fiscalité départementale, avec une évolution moyenne de l'ordre de 4 %. Cela peut être lié à l'accroissement de la charge représentée par le transfert de l'APA, ainsi qu'à la croissance des frais de personnels ; encore convient-il de nuancer quelque peu en rappelant que ce phénomène intervient après une très grande modération des taux au cours des années précédentes. Il faut également noter que tous les départements n'ont pas augmenté leurs taux en 2002 ou en 2003 : seize d'entre eux - les Alpes-Maritimes, la Marne, la Nièvre, l'Oise, le Maine-et-Loire, le Calvados, par exemple - ne l'ont fait ni en 2002, ni en 2003. L'évolution des taux de la fiscalité départementale est d'ailleurs plus modérée en 2004 malgré le transfert de la compétence RMI et la poursuite de celui de l'APA. Pour le secteur communal - communes et groupements de communes à fiscalité propre - la progression, moins dynamique que celle des départements sur les sept dernières années, tient davantage à celle des bases qu'à celle des taux. Les groupements à fiscalité propre, dont le nombre a fortement augmenté en dix ans et surtout depuis 1999, prélèvent naturellement une part croissante de la fiscalité du secteur communal : près des deux tiers des bases de TP sont désormais sous le régime de la TPU, devenue la règle dans 70 % des groupements contre 7 % en 1999. L'intercommunalité constitue à mes yeux une véritable réforme, relativement peu coûteuse et pleine de promesses, à la condition naturellement que les communes jouent le jeu, en mettant d'ailleurs à profit le délai d'un an qu'un amendement récent peut laisser espérer pour mieux définir l'intérêt communautaire afin d'éviter des doublons, notamment en matière de charges de fonctionnement. Vous constaterez que la dépense des communes en intercommunalité est plafonnée depuis cinq ans ; et même si l'on constate que la dépense intercommunale a pris le relais, et donc que le total « communes + EPCI » continue de progresser, on peut raisonnablement penser que la dépense ainsi mutualisée est plus efficace et assure un développement local que des communes isolées n'étaient peut-être pas capables d'assumer. Force est toutefois de constater qu'il existe des disparités locales marquées et des politiques pour le moins variées. Le produit cumulé, tous niveaux de collectivités, des impôts locaux varie assez nettement selon les départements. L'écart, de 1 à 1,5 entre les deux plus forts et les dix plus faibles, s'explique tout à la fois par les différences de bases et par les différences de taux. En matière de taux d'imposition, les écarts d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre sont très inférieurs à ce que l'on observe à l'intérieur du secteur communal, lequel reste assez déterminant. Et chacun peut observer que les taux sont élevés là où les bases de TP sont faibles, notamment dans des départements peu industrialisés : ainsi la Creuse, déjà citée, ou la Lozère. Ainsi, les collectivités territoriales ont pleinement joué de leur autonomie et de leur liberté de gestion. Pour mobiliser des ressources nouvelles, certaines préfèrent emprunter et répartir dans le temps la charge du financement ; d'autres choisissent la fiscalité et font porter l'effort sur le contribuable de l'année. A contrario, si elles souhaitent mener une politique de maîtrise des dépenses, cela pourra se traduire par une moindre mobilisation de ces ressources, à l'exemple de ce qu'a fait la région Lorraine au cours des années écoulées. Le Directeur général des collectivités locales vous a présenté une étude sur les régions qui combine la dette par habitant, les recettes fiscales en euros par habitant et le niveau des dépenses. En 2003, les régions qui ont un endettement faible et une fiscalité inférieure à la moyenne dépensent en général moins : c'est le cas de la Lorraine, mais également de la Bretagne. Parmi les régions proches de la moyenne, on retrouve l'Alsace, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes et le Centre. Parmi celles qui dépensent plus que la médiane, certaines, comme Nord-Pas-de-Calais et l'Auvergne, ont clairement choisi l'emprunt, d'autres la pression fiscale : c'est le cas de la Basse-Normandie et de Midi-Pyrénées.
Ajoutons que certains départements avaient décidé d'augmenter leur fiscalité dès 2002 ; d'autres ont attendu 2003, voire 2004. Certains ont étalé la hausse sur deux ou trois années ; d'autres l'ont concentrée sur un seul exercice pour ne procéder qu'à une seule augmentation. Plusieurs départements n'ont pas relevé leurs taux de fiscalité directe, se contentant de la progression des bases. D'autres enfin l'ont brutalement augmentée dès 2002, mais après quinze années de stagnation. Que faut-il en déduire ? Tout simplement qu'il n'y a pas de règle, et que la démonstration de l'autonomie des politiques est faite. Les collectivités territoriales usent pleinement de leur autonomie de décision en fonction des politiques qu'elles entendent mener ou développer et des marges de manœuvre dont elles disposent : capacité d'épargne, pression fiscale, niveau et charge de la dette. Face à cette dynamique de hausse globale - il faut le reconnaître - des impôts locaux, quels sont les outils de régulation à la disposition du législateur ? Du côté des ressources, la réforme constitutionnelle de 2003 nous interdit les coupes franches dans les impôts locaux telles qu'elles ont pu être pratiquées par le passé, non sans justifications parfois. Le principe de l'autonomie financière protège les budgets locaux de toute suppression brutale d'impôt qui ne serait pas remplacée par des impositions de toutes natures. Par ailleurs, les règles de lien entre les taux obligent les assemblées locales à répartir la pression fiscale entre les entreprises et les ménages. Je pense - mais je reste ouvert à la discussion - qu'il convient de conserver ces mécanismes, non seulement parce qu'ils sont sérieux, mais parce qu'ils constituent des facteurs d'équilibre indispensables. En revanche, le principe qui pourrait guider une réflexion dans l'avenir est celui de la spécialisation fiscale. Pour l'heure, à l'exception des régions, qui ne perçoivent plus la taxe d'habitation, et des communes des groupements à TPU, chaque niveau de collectivité perçoit chacune des quatre taxes. Cet empilement est-il toujours justifié ? N'a-t-il pas pour conséquence de brouiller, aux yeux du contribuable que nous côtoyons, structurellement préoccupé, souvent vigilant et parfois vindicatif, les vraies responsabilités des politiques fiscales locales menées par chaque collectivité, favorisant du coup des augmentations dont la responsabilité peut être plus ou moins habilement diluée parmi quatre niveaux d'administration ? De surcroît, si, prise individuellement, chaque augmentation décidée par chacun des acteurs ne représente pas une charge fiscale exagérée, leur cumul peut se révéler lourd à supporter par le contribuable : les règles de plafonnement des taux et de liens entre les évolutions ne valant que pour chacun des niveaux de collectivité, il n'existe à ce jour aucun système limitant la charge globale. Le contribuable local supporte donc l'effet cumulé de décisions fiscales prises par une multitude d'acteurs locaux et s'épuise à rechercher le véritable responsable. Il ne s'agit pas dans mon esprit de faire de la spécialisation un nouveau dogme - je sais que les élus sont généralement attachés à l'existence de plusieurs impôts permettant de répartir les charges et de mieux faire face aux risques ; sur ce point, je peux les comprendre. Mais je crois qu'une certaine dose de spécialisation devra être introduite à l'avenir, au-delà de ce qui est déjà acquis avec la TPU au niveau intercommunal - il s'agit là sans doute d'un cycle qui n'est pas encore achevé. Notons qu'il existe un instrument de régulation : le contrat de croissance, que le Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État aura certainement évoqué hier - je le sais sensible à cette question. Sur 61 milliards d'euros de transferts, 42 milliards d'euros évoluent au rythme des prix, plus un tiers du taux de croissance du PIB, ce qui permet de rétrocéder concrètement aux budgets locaux une partie de la croissance. Votre Commission et le Parlement connaissent le poids de ces transferts : 61 milliards d'euros, c'est 20 % des recettes de l'État qui ne font que transiter du contribuable national vers les collectivités territoriales. Chiffre colossal, qu'il convient de soupeser avec précision et raison lors de chaque loi de finances. Du côté des dépenses, le principe de libre administration paraît difficilement compatible avec la mise en place d'une norme d'évolution des budgets - au demeurant, ceux-ci sont contraints par des règles d'encadrement vertueuses qui interdisent aux collectivités de céder aux facilités que l'État s'accorde généreusement et qui consistent à financer le fonctionnement par la dette... Ce à quoi viennent s'ajouter les mécanismes de contrôle démocratique de la dépense déjà mis en œuvre avec une certaine efficacité et malgré un caractère parfois un peu formel et convenu : je pense au débat d'orientation budgétaire, qui a au moins le mérite d'exister, et à cette batterie d'indicateurs obligatoires qui facilitent, il est vrai, les comparaisons. Ajoutons que les règles relatives à la commande publique sont également protectrices des budgets locaux. Publicité, mise en concurrence, dialogue compétitif : autant d'instrument qu'il convient d'intégrer dans la régulation des dépenses. Certains envisagent la suppression de la compétence générale, la loi limitant en revanche strictement les attributions particulières de chaque niveau. Je ne partage pas, par réalisme, cette quête d'un « jardin à la française », même si je regrette comme vous une certaine confusion des compétences qui pourrait conduire à des financements croisés et à des doublons. À mes yeux, c'est la responsabilité des décideurs locaux qui doit primer, et c'est à eux qu'il appartient d'arbitrer dans les dépenses, de choisir l'impôt d'aujourd'hui ou l'emprunt, autrement dit l'impôt de demain. C'est à eux de procéder aux économies d'échelle que nécessite une bonne répartition des ressources. L'État s'est enfin imposé avec la LOLF des contraintes de meilleure gestion. Les budgets locaux ne sont pas soumis à la LOLF, mais ils sont adoptés sous le contrôle des électeurs ; or je sais que si les élus oublient, les électeurs pardonnent assez rarement. Vous l'avez compris : malgré ma prise de fonctions toute récente, mais fort de mon expérience d'élu régional, je suis animé par trois convictions que je voudrais rapidement résumer. Ma première conviction, c'est que les finances locales étaient, à la veille de l'acte II de la décentralisation, saines et solides et qu'elles le sont encore. Rien ne justifie, sinon peut-être un excès de précaution, les accroissements de pression fiscale constatés cette année. Deuxième conviction : il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de craindre que la nouvelle étape de la décentralisation entraîne une dérive des dépenses locales, que certains présentent à tort comme inéluctable. D'abord parce que les transferts de compétences sont et continueront d'être compensés à l'euro près, conformément aux dispositions constitutionnelles et ainsi que la CCEC l'a déjà constaté - j'entends pour ma part rester vigilant sur ce point. Ensuite parce que les collectivités, assumant l'espace d'autonomie et de liberté qui est le leur, feront preuve demain, j'en suis persuadé, des mêmes capacités d'optimisation de la dépense qu'aujourd'hui. Là est d'ailleurs tout le pari de la décentralisation. Troisième conviction : il n'est certes pas contestable que la décentralisation entraîne une relative perte de pouvoir de l'État sur l'évolution d'une partie de la dépense publique, a fortiori dans la mesure où celle-ci s'exerce dans un cadre constitutionnellement garanti de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Mais il n'est pas davantage contestable que le cadre budgétaire et comptable des collectivités est, dans sa construction même, un cadre vertueux. Ce n'est donc pas du côté des collectivités qu'il faut craindre un dérapage du déficit et de la dette des administrations publiques. Au total et en conclusion, la gestion équilibrée des collectivités territoriales repose sur deux piliers. Le premier, c'est le sens de la responsabilité des élus, une responsabilité encore étendue et renforcée. Le second, c'est le contrôle de nos concitoyens, d'autant plus efficace que ceux-ci seront mieux informés ; ce qui pose naturellement la question de l'information de nos compatriotes. M. le Rapporteur : M. le Ministre, je vous remercie de cette introduction dense, complète, claire, parfois prudente, et qui montre en tout cas combien le ministre responsable a le souci de défendre les collectivités territoriales et les pratiques de leurs élus - pratiques que notre commission d'enquête, avec bien entendu toute la prudence et le respect nécessaires, a parfois tendance à bousculer quelque peu. Première question, très basique : vous avez commencé votre exposé en décrivant les événements de 2005, démontrant que rien ne les justifiait techniquement. Que peut-on imaginer, souhaiter, faire pour ne pas trop risquer de les voir se reproduire ? Certes, grâce à l'information que vous-même avez appelée de vos vœux, au débat, aux travaux des uns et des autres, y compris de notre commission d'enquête, les choses se sont quelque peu régulées d'elles-mêmes. Reste que l'on pouvait craindre voir le train régional de 2005 annoncer un train départemental en 2006, avec le coût fiscal qui en découlerait. D'un côté, il y a évidemment le respect de l'autonomie des collectivités territoriales ; mais de l'autre, on doit rendre compte de ces évolutions aux représentants de la Nation et aux citoyens. Comment faire en sorte que tout cela n'ait pas trop de chances de se reproduire ? M. Brice HORTEFEUX : Vous avez qualifié mon intervention de prudente : dans votre bouche, ce mot pourrait signifier « raisonnable »... Pour l'avenir, il faut une approche globale en ce qui concerne tant les dépenses que les recettes. Si les ressources transférées sont définitivement acquises, les produits des différentes fiscalités peuvent varier en fonction de données économiques par essence délicates à appréhender à moyen terme. En clair, au risque de vous paraître là encore prudent, je suis convaincu qu'il existe, pour l'avenir, des démarches d'autonomie. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué l'intérêt de la spécialisation fiscale ; votre collègue chargé du budget s'est montré hier extrêmement... prudent sur ce point. Qui plus est, les diverses simulations d'évolution de la taxe professionnelle ont laissé pensé à certains qu'une réforme de cet impôt était déjà un défi bien suffisant pour ne pas trop charger la barque en y ajoutant la spécialisation fiscale. Y a-t-il des perspectives de spécialisation fiscale ? Qu'avez-vous envie de promouvoir ? N'est-ce qu'une idée de principe bien venue, mais inatteignable ? A-t-on des chances d'avancer dans cette voie ? Je ne prends pas beaucoup de risques en disant que le sentiment dominant de notre Commission est plutôt favorable à la spécialisation fiscale, mais on semble tenir à nous expliquer qu'il y a bien des raisons de ne pas la faire... M. Brice HORTEFEUX : Si le Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État est chargé de la rédaction du projet de loi portant réforme de la taxe professionnelle, la responsabilité en est partagée avec le ministère délégué aux Collectivités territoriales. Cette réforme est indiscutablement justifiée par le caractère économiquement pénalisant de cet impôt atypique en Europe, beaucoup trop fortement concentré - 1 % des entreprises paient 70 % de la taxe professionnelle - et dont les règles d'assiette pèsent beaucoup trop lourdement sur certains secteurs d'activité à forte intensité capitalistique, en particulier dans l'industrie. Enfin, ses modes de calcul et de gestion sont incroyablement complexes au point que, au cours de ces six derniers jours, malgré toute la compétence du Directeur général, je n'ai pas encore tenté de comprendre dans le menu détail ces mécanismes effroyables ! De surcroît, gardons bien tous en mémoire le fait que l'État est le premier contributeur local... En tant que Ministre délégué aux Collectivités territoriales, j'aurai trois objectifs qui constituent le fil rouge d'un engagement déterminé dans mon domaine de compétence. Première ligne de conduite : la réforme de la taxe professionnelle devra préserver l'autonomie financière des collectivités territoriales. C'est une exigence constitutionnelle, mais je tiens à la rappeler très concrètement. Deuxièmement, la réforme devra veiller à ce que les objectifs d'allégement pour les entreprises n'entraînent aucun bouleversement sur l'équilibre des finances locales, et surtout ne remettent pas en cause le mouvement d'intercommunalité à taxe professionnelle unique. Troisième exigence : il nous faut préserver, et même restaurer, le lien entre l'activité économique des territoires et les ressources qu'en tirent les collectivités, en garantissant une responsabilité réelle, effective, sur les taux, comme l'avait rappelé l'an dernier le Premier ministre au Congrès des maires de France. Au demeurant, si le mécanisme imaginé, qui est intéressant et sans doute efficace pour les entreprises, ne devait pas être balayé d'un revers de main, il n'en présentait pas moins un aspect dangereux. En effet, s'il était très utile et efficace pour les régions aisées, son effet était neutre, dans le meilleur des cas, pour les régions moins favorisées - et je suis volontairement très prudent dans la formulation de mon propos. Voilà les trois axes qui me semblent devoir être pris en compte. Le Premier ministre a demandé que des propositions lui soient faites dans le délai d'un mois ; nous lui transmettrons les nôtres. Sur la spécialisation fiscale, je m'attends à décevoir le Rapporteur, car je ne lui apporterai en aucun cas une réponse immédiate. Si cet axe de réflexion doit être pris en compte à l'avenir, ce sera dans le cadre de réformes beaucoup plus globales et générales. J'espère avoir été précis dans ma première partie ; j'ai conscience d'avoir été beaucoup plus flou dans la seconde ! M. le Rapporteur : Merci en tout cas pour la variété dans l'approche ! Vous avez évoqué le rôle des uns et des autres. Quel doit être celui de votre ministère et des administrations qui travaillent avec vous, et celui des autres, notamment du Budget ? Qui pilote l'ensemble ? Faut-il voir dans le ministère des collectivités territoriales une administration tout entière consacrée à la défense des collectivités territoriales et à la gestion des dotations, cependant que, d'une façon assez étanche, l'approche fiscale ne relèverait que du Budget et de Bercy ? J'ai conscience, en vous présentant les choses de façon aussi caricaturale, de faciliter la réponse... Reste que la question peut être posée. Les deux leviers, dotations et fiscalité, sont-ils pilotés de manière suffisamment reliée ? M. Brice HORTEFEUX : Votre question nécessiterait en fait quinze à vingt minutes d'explications et je serais prêt à vous les donner. Sur le principe, pardonnez-moi d'être obligé de rappeler que l'État ne pilote pas les budgets locaux. M. Bernard DEROSIER : C'est bien de le rappeler de temps en temps ! M. Brice HORTEFEUX : L'État fixe, en relation avec le Parlement, les montants des dotations et les règles de la fiscalité. N'attendez pas de l'État qu'il devienne un pilote qu'il entend ne pas être et qu'il ne veut plus être. Pour le reste, vous soulevez le problème général de la gouvernance des dépenses des autorités locales. Cela aussi nécessiterait un long débat. M. Jean-Yves LE DRIAN : M. le Ministre, je vous remercie pour la qualité de votre exposé, serein et sans polémique. C'est tout à votre honneur et il devrait toujours en être de même dans une commission d'enquête. Après en avoir parlé avec mes collègues présidents de régions, et assez souvent écouté les propos tenus ici, j'en arrive à la conclusion que l'augmentation de la pression fiscale tient à des raisons très diverses et très variables d'une région à l'autre. Je m'inscris en faux contre les prémisses de cette commission d'enquête, qui pouvaient laisser croire à un vaste complot organisé et concerté par les présidents de régions socialistes. Il n'y a pas de généralités, mais des situations particulières, spécifiques - vous-même y avez fait allusion en commentant les tableaux de la DGCL sur les budgets régionaux. Les raisons de l'augmentation sont différentes, mais toutes spectaculaires. Pourquoi ? Parce que l'autonomie fiscale des régions est, on le sait, des plus limitées. De ce fait, on peut afficher des taux élevés et n'en tirer que des ressources très faibles. On a d'ailleurs rappelé à de nombreuses reprises que l'ancien Premier ministre, lorsqu'il était président de la région Poitou-Charentes, avait augmenté les siens de 100 %, pour la bonne raison que ses bases et donc ses capacités d'intervention étaient extrêmement limitées. C'est là un élément central d'une analyse qu'une généralisation des situations ne permet pas de comprendre. Pour ce qui concerne la région que je préside, je n'ai jamais dit - d'autres peut-être, encore conviendrait-il de vérifier - que l'augmentation de la pression fiscale soumise aux délibérations de mon assemblée était due à la décentralisation, qui n'est pas commencée. Jamais je n'ai prononcé de telles paroles. M. Alain GEST : D'autres l'ont dit... M. Jean-Yves LE DRIAN : Moi, jamais. Je vous fournirai les rapports. Pourquoi ai-je été amené à relever la pression fiscale de 15 % ? En raison de l'explosion de notre dette, essentiellement pour rétablir ma capacité nette d'épargne. J'ai ainsi diminué mon appel à l'emprunt sur mon budget 2005. Voilà pourquoi je suis plutôt bien placé sur votre tableau. M. le Rapporteur : C'est l'héritage... M. Jean-Yves LE DRIAN : L'héritage avait amené un triplement de la dette. M. le Rapporteur : Et c'est ce qui permet d'être bien placé. M. Jean-Yves LE DRIAN : Non, c'est parce que j'affecte l'essentiel de la ressource fiscale au rétablissement de l'épargne nette de la région, afin de corriger la situation que j'ai trouvée, où la dette avait été multipliée par trois. M. le Rapporteur : Le tableau reprend votre situation en 2003... M. Jean-Yves LE DRIAN : Je suis au même niveau cette année. La difficulté pour les transferts à venir est la même que pour les transferts antérieurs : à l'euro près, nous sommes d'accord. J'ai d'ailleurs apprécié votre propos sur la réversion intégrale, concomitante et contrôlée : Dieu vous entende ! On ne pouvait dire mieux. À ceci près que lorsqu'une compétence est transférée, y compris avec la validation de la CCEC, la dérive est quasiment inéluctable en raison de la demande de services de la part de la population et de l'état dans lequel on retrouve une partie des éléments transférés. Prenons l'exemple des transports ferroviaires. J'ai trouvé, tout comme nombre de présidents de région, que la manière dont ce transfert s'était opéré était bonne. Le problème est que se sont aussitôt manifestées des demandes de plus en plus fortes, qu'il a bien fallu compenser d'une manière ou d'une autre. C'est notre responsabilité, me direz-vous ; mais avec une marge de manœuvre aussi faible, comment voulez-vous la financer, sinon par un bond des taux d'imposition ? Le problème majeur est bien celui de l'impôt régional futur. Ajoutons qu'il n'était pas prévu que les régions « bénéficient » des transports ferroviaires interrégionaux. Or c'est bien ce qui va venir : la SNCF ne veut plus s'en occuper et l'État pas davantage. Il faudra bien que quelqu'un le fasse pour ne pas laisser les voyageurs sur le quai... Que se diront-ils ? Que les trains, c'est les régions. Alors ils viendront demander aux régions d'assurer les transports interrégionaux. Il y a des dérives inévitables, même lorsque le transfert se fait bien. Ce n'est pas une critique, mais un constat. On va bientôt nous transférer une école de la marine marchande. On va l'évaluer. Elle est en mauvais état. Il n'est pas question de la laisser comme cela ; nous allons nous retrouver dans la même logique que pour les lycées. Pour remédier à cette situation, j'ai créé une « CCEC régionale » où j'invite des collègues, désignés à la proportionnelle, à constater les transferts de compétences, les recettes et les coûts, avec un magistrat indépendant pour garantir la vérité des faits et des documents. Je n'y siège évidemment pas. Mais tout le monde y est représenté, et pourra constater ce qu'est la réalité des transferts dès cette année. Se pose la question de la taxe professionnelle. Cet élément a lui aussi incontestablement joué. Je me suis pour ma part demandé un moment si je n'allais pas augmenter davantage la fiscalité dans le seul but de me prémunir contre les risques d'une compensation de la taxe professionnelle, annoncée par la « commission Fouquet » et par le chef de l'État ! M. le Président : Et il ne l'a pas fait... M. Jean-Yves LE DRIAN : J'avais tendance à le croire et je n'étais pas le seul. J'ai une certaine expérience, pour avoir été maire pendant vingt-sept ans. Il était tentant de mettre le plus haut niveau possible pour bénéficier ensuite de la meilleure compensation qui soit... M. le Rapporteur : Voyez la noirceur du projet ! M. Jean-Yves LE DRIAN : Mais lorsque c'est le Chef de l'État qui le dit, on a tendance à le croire... M. Pascal TERRASSE : Vous êtes bien le seul, et vous avez tort... M. Jean-Yves LE DRIAN : Nous avons failli le faire. Mais finalement, l'opération paraissait si compliquée que nous nous sommes résolus à attendre un peu. Les effets d'annonce ont parfois des conséquences dramatiques, et comme notre marge de manœuvre est faible, on est tenté de se prémunir. Je sais que c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues. Les départements sont mieux lotis sur le plan de l'autonomie fiscale. Mais pour les régions, comment régler à moyen terme le problème de leur capacité d'intervention dans un sens qui respecte leur autonomie ? Sinon, la situation est sans issue. Ma deuxième question a trait à l'expérimentation. La loi de décentralisation n'a pas donné aux régions la responsabilité économique. Je suis convaincu que le précédent Premier ministre avait l'intention de le faire, tout au moins dans son propos de départ. Mais par la suite, la responsabilité économique des régions, qui pendant un temps faisait apparemment consensus, n'est pas devenue pleine et entière. Êtes-vous d'avis d'aller au-delà et de faire que ce qui est aujourd'hui potentiellement expérimental puisse devenir la règle normale pour les régions, à l'instar de toutes leurs homologues européennes ? Avez-vous une position sur l'expérimentation ? M. Brice HORTEFEUX : Je vous remercie d'avoir souligné l'absence de polémique dans mon propos. Et en vous entendant parler de votre augmentation de 15 %, j'aurais presque souhaité vous voir devenir président de ma région, qui a relevé ses impôts de 30 %... Et puis, patatras ! Vous avez tout gâché en expliquant l'augmentation par la situation d'endettement dans lequel se trouvait votre région. Or, sur mon graphique, la région Bretagne se trouvait précisément dans les régions peu endettées à faible pression fiscale. M. Jean-Yves LE DRIAN : C'était en 2003. Or mon prédécesseur a considérablement accru le recours à l'emprunt durant les années qui ont précédé les élections. M. le Rapporteur : Il n'a pu le faire qu'en 2004... M. Brice HORTEFEUX : Sans doute y a-t-il eu une évolution très lourde en 2004, mais pas au point de justifier de telles augmentations... M. Jean-Yves LE DRIAN : Au moins la moitié ! M. Brice HORTEFEUX : Rien de particulier n'obligeait les régions à augmenter leurs impositions en 2005 dans de telles proportions. Rien. Dans nombre de cas, je crois plutôt qu'il s'agissait de constituer des réserves de précaution pour l'avenir. M. Jean-Pierre SOISSON : M. Jean-Yves Le Drian lui-même l'a reconnu... M. Brice HORTEFEUX : Dans cette hypothèse, il est permis d'espérer une stagnation d'ici à 2008. Or quelque chose me dit que ce sera le cas. Ce que vous avez dit sur la taxe professionnelle était intéressant. Je dirai comme vous, mais avec d'autres mots : en fait, vous avez anticipé la réforme pour faire payer cette évolution par l'État. M. Jean-Yves LE DRIAN : Je ne l'ai pas fait. M. Brice HORTEFEUX : Mais c'est ce que vous aviez l'intention de faire. M. Jean-Yves LE DRIAN : C'est ce que j'ai été tenté de faire. M. Brice HORTEFEUX : Voilà. Péché avoué... M. le Président : Finalement, il n'a pas cru le Président de la République. Et il a eu raison... M. Jean-Yves LE DRIAN : Reste que cela aurait été de bonne gestion. M. Brice HORTEFEUX : S'agissant de votre question sur les schémas de développement économique, toutes les régions peuvent expérimenter, mais dans le respect des compétences de chacun. Rappelons que l'intervention économique des collectivités territoriales est assurée à 40 % par les communes, 30 % par les départements et 30 % par les régions. M. Pascal TERRASSE : J'ai tout particulièrement apprécié votre attachement - qui doit être l'article 1er d'un ministre chargé des collectivités territoriales - au principe de leur libre administration. Il ne m'a pas semblé que vos deux prédécesseurs partageaient cette attitude et le changement me paraît total. Après que mon voisin a parlé des régions, j'évoquerai le cas des collectivités départementales, pour lesquelles je ne partage pas forcément votre sentiment s'agissant notamment de la décentralisation, qui peut recouvrir bien des choses. Mes remarques s'appuieront sur une réalité, largement partagée par les présidents de conseils généraux et confirmée par l'étude récemment remise au président de l'Association des départements de France par le cabinet Ernst & Young, dont tout le monde s'accorde à reconnaître l'intégrité et la qualité. J'aurais envie de vous croire lorsque, dans la lignée de vos deux prédécesseurs, vous maintenez que les compensations se feront à l'euro près, en insistant tout particulièrement sur la concomitance des charges transférées, objet d'une note récemment envoyée aux préfets puis transmise aux collectivités territoriales. Peut-on parler de concomitance pour le RMI ? Je ne le crois pas. Deux ans après la mise en place de son transfert, nous attendons toujours les compensations au titre du RMI. On nous promet certes une régularisation dans le cadre d'un collectif budgétaire de fin d'année. Mais au bout de vingt-quatre mois, où est la concomitance ? Parlons de la réalité de tous les jours, vécue par des collectivités de toutes sensibilités politiques. Lorsque, pour les SDIS, l'État décide d'instituer une prestation de fidélisation et de reconnaissance, y a-t-il concomitance ? Je ne le crois pas. Vous savez qu'il manque près de 50 % de son financement. Sur le handicap, et plus particulièrement sur la prestation compensatoire qui se mettra en place prochainement, le directeur de la caisse nationale chargée de collecter le « lundi de Pentecôte » le confirme lui-même : il manquera vraisemblablement plus de 1,2 milliard d'euro sur les 5,8 milliards nécessaires. Que l'on y voie ou non un effet de la décentralisation, toujours est-il qu'ils ne seront pas compensés. Quant à la récente réforme du statut des assistantes maternelles, elle ne donnera pas davantage lieu au moindre centime d'euro transféré au profit des collectivités territoriales... Et pour les contrats d'avenir, les collectivités territoriales seront appelées à financer un tiers du dispositif, contre zéro l'année précédente. S'agit-il là encore d'une compensation à l'euro près ? Et pour ce qui est des routes nationales, si l'entretien préventif donnera vraisemblablement lieu à compensation, ce ne sera pas le cas pour les investissements à venir. On le voit, la situation des collectivités départementales est des plus précaires. Le rapport d'Ernst & Young a bien montré que si les départements souhaitent conserver - pour partie - leurs fondamentaux, ils devront relever, dans le meilleur des scénarios, leur fiscalité de 4 % chaque année au cours des cinq ans à venir. À la lumière des premiers échanges qui se sont tenus dans le cadre de cette Commission, je suis convaincu que les prélèvements obligatoires dans notre pays n'ont structurellement pas été modifiés, pour leur montant en tout cas, depuis quinze ou vingt ans. Il est en revanche avéré que, dès que la contribution de l'État diminue, celle des collectivités territoriales augmente. Le président de l'Association des maires de France avait parlé d'un « big bang fiscal », jugement partagé par l'Association des départements de France et par celle des régions : compte tenu de la déstructuration de ces prélèvements obligatoires, il est devenu indispensable de réformer en profondeur notre fiscalité locale. Quelques tentatives ont été faites dans le passé, sur les valeurs locatives notamment, ou en matière de péréquation entre départements riches et pauvres. Pensez-vous répondre à cette attente, largement répandue sur les bancs de l'Assemblée et encore plus largement par les acteurs en charge des collectivités territoriales ? Enfin, une question très technique : j'ai beaucoup de mal à comprendre certains écarts entre ce que consacrait l'État avant certains transferts et ce qui est réellement compensé aujourd'hui. Pour le fonds social logement, par exemple, les montants qu'accordait l'État au département de l'Essonne ont été rognés de 32 % à l'occasion du transfert. Mais pour le Tarn, ils ont été augmentés de 79 % ! Si le transfert, globalement, au plan macro-économique, s'est effectué à l'euro près, il se traduit par de très fortes disparités d'un département à l'autre, que j'ai bien du mal à comprendre. M. Brice HORTEFEUX : Vous avez évoqué de très nombreux sujets, tantôt généraux, tantôt très précis. Vous avez fait référence à une étude effectivement commandée par l'ADF au cabinet Ernst & Young. Or, nous n'avons pas bien compris la manière dont ce cabinet a répondu à la commande qui lui avait été passée et nous ne pouvons souscrire aux conclusions de ce rapport, du fait que nous sommes en désaccord tant sur la méthode retenue que sur les impacts financiers estimés de la décentralisation. Et comme ce document est largement diffusé, utilisé, repris, peut-être convient-il de bien souligner les très fortes réserves que nous formulons à son égard. Cette étude, réalisée au premier trimestre 2005, donne dans sa conclusion des résultats spectaculaires : baisse de l'autofinancement de 1 milliard d'euros par an et hausse de l'endettement de 3 à 7 milliards d'euros par an... Excusez du peu ! Cela appelle plusieurs remarques sur la méthode. Première remarque, la présentation retenue par ce cabinet est totalement binaire, voire manichéenne. Deux, sinon trois scénarios seulement ont été retenus, aucunement représentatifs de la palette possible : très défavorable et défavorable, à l'exclusion de toute autre possibilité. Il aurait fallu à tout le moins l'élargir quelque peu... Je comprends très bien que l'on retienne un scénario très défavorable, mais la logique et la cohérence auraient voulu que l'on retînt également, par effet miroir, un scénario extrêmement favorable. Deuxième remarque : les projections effectuées n'ont à aucun moment tenu compte des impacts positifs de la décentralisation en matière d'optimisation de la dépense. Comme l'ensemble du Gouvernement, j'en suis convaincu : il faut faire confiance à la capacité de prise de responsabilité des élus. Or, ce n'est absolument jamais pris en compte. Peut-être est-ce justement un aspect sur lequel nous pourrions nous rejoindre. Troisième remarque, ces résultats spectaculaires tiennent à deux choix méthodologiques très contestables : des hypothèses de recettes très prudentes, avec une utilisation a minima des marges de manœuvre fiscales, et un endettement qui progresse moins du fait de la diminution affichée de l'autofinancement que du fait d'un accroissement très important des dépenses d'investissement, sans qu'à un aucun moment le rapport ne vienne justifier ce choix. C'est en tout cas ce qu'indique très clairement l'analyse détaillée que j'ai demandée en prenant mes fonctions. Quant à l'estimation des impacts financiers de la décentralisation, elle souffre d'imprécisions très fortes et de surcroît défavorablement orientées - il conviendrait que le Bureau de l'ADF s'en rende bien compte. Ainsi, sur les rémunérations des personnels transférés, l'étude retient le taux de charges sociales au titre des retraites supporté par l'État et non ceux réellement supportés par les collectivités, autrement dit de la CRNACL. Pourquoi n'avoir choisi qu'un seul taux ? Il aurait au moins fallu se poser la question... Pour ce qui concerne les routes, l'estimation en termes de compensation est limitée à 100 millions d'euros. Les chiffres sont en réalité bien supérieurs. J'espère, M. le Directeur général des collectivités locales, ne pas parler de choses que je ne devrais pas encore dévoiler, mais je le dois à la Commission d'enquête : les hypothèses sur lesquelles le Gouvernement travaille se situent à 200 millions d'euros. Soit une erreur de 100 %... Pourquoi avoir retenu 100 millions ? Sur le handicap enfin, les scénarios du cabinet Ernst & Young anticipent quelque 400 000 bénéficiaires pour la prestation de compensation du handicap. Le Gouvernement table quant à lui sur une hypothèse de 150 000. Comment expliquer une erreur d'appréciation aussi importante ? Cette étude est certainement très intéressante, mais nous ne saurions la faire nôtre dans la mesure où, ni sur la méthode, ni sur les impacts financiers, nous ne pouvons y souscrire. Mais vous avez évoqué d'autres sujets, sur lesquels nous devrions incontestablement nous retrouver : ainsi le cas des SDIS. Trop de textes, trop de dépenses, c'est évident. La Conférence nationale des services d'incendie et de secours, crée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, a été installée en décembre dernier ; son objet est précisément de se concerter sur tous les textes concernant les SDIS. C'est là un réel progrès qui devrait permettre d'assainir, de simplifier et de clarifier une situation sur laquelle aucun élu local ne saurait être en désaccord avec vos propos. Précisons que le financement des SDIS représente tout de même 4,1 % des dépenses de fonctionnement des départements... S'agissant du RMI, la compensation a été totalement concomitante pour l'année 2003 ; en revanche, la clause de rendez-vous propre à la loi RMI permettait de traiter fin 2004 de la compensation à venir pour le RMA. Or le Gouvernement ne s'est pas limité au seul RMA, puisqu'il prendra en charge toute la dépense supportée par les départements, soit 450 millions d'euros - ce qui équivaut, remarquons-le en passant, à 10 % de la marge de manœuvre budgétaire de l'État... La clause de rendez-vous excluant tout paiement au titre de la charge de la trésorerie, il était normal que ces 450 millions soient pris en compte dans la loi de finances rectificative. Sur le FSL... M. Pascal TERRASSE : Je n'ai pris le FSL qu'à titre d'exemple, pour montrer que si, globalement, la compensation se vérifie au niveau macro-économique, elle se traduit par des réalités très différentes d'un département à l'autre. M. le Rapporteur : La question est de savoir où cela passe... M. Pascal TERRASSE : Un transfert peut ainsi se traduire par une augmentation considérable dans tel département - pour le FSL, mais également pour la PIA, par exemple - et par une réduction dans tels autres. D'où le sentiment d'un traitement inégal et peu compréhensible. M. le Rapporteur : La question a déjà été posée pour les routes avec le Directeur des routes. Le transfert est régi par une règle globale, mais la déclinaison de cette règle département par département fait que certains gagnent et que d'autres sont perdants. M. Pascal TERRASSE : Et personne ne comprend la mécanique... M. Brice HORTEFEUX : Le FSL est un cas particulier, où la compensation est faite par référence à la moyenne des trois dernières années. Or l'année 2003 a vu les crédits baisser du fait que l'on avait d'abord utilisé, en bonne gestion, des excédents de trésorerie qu'il était assez sain de faire disparaître. Ce problème a été examiné par la CCEC ; la loi a été appliquée à la lettre, mais la composante « élus » de la commission a sollicité l'arbitrage du Premier ministre - pour faire plus, évidemment - qui n'a pas encore été rendu. Là est l'origine de cette affaire. M. le Président : Sur les routes, le fait est que l'on applique la loi, moyennant évidemment une harmonisation pour éviter de compenser davantage à ceux qui ont beaucoup. Mais quelques problèmes demeurent en suspens : ainsi le cas des routes de haute montagne - bien que n'étant pas directement concerné, je veux plaider pour la Savoie et autres départements similaires - ou celui, plus grave encore, du transfert des tunnels, dont la mise aux normes, désormais obligatoire, entraînera une charge considérable. S'ajoute le cas, comme dans la Nièvre, de routes en très mauvais état et que l'on impose au département d'aménager. C'est la loi, me direz-vous, mais le fait est là. Sur le personnel d'entretien, en revanche, comme sur le personnel de l'éducation nationale, je vous donne acte que l'État a pris un engagement qui va au-delà de la loi, dans la mesure où l'on nous a assuré hier que le transfert vaudrait également pour l'ensemble des charges patronales. Il faut savoir reconnaître une avancée... C'est d'ailleurs ce qu'a constaté la CCEC. M. le Rapporteur : J'ai bien entendu le Directeur des routes ; le problème méthodologique n'est effectivement pas simple. Le transfert se fait globalement de manière impeccable, mais la règle technique de répartition aboutit à créer des situations avantageuses - et donc, symétriquement, d'autres qui le sont moins. Comment résoudre ce genre de difficultés ? Le Directeur des routes nous a expliqué que cela pourrait se négocier, notamment par des compensations portant sur des travaux particuliers. Entrez-vous dans cette logique de modus vivendi ? M. Brice HORTEFEUX : La CCEC a elle-même constaté la parfaite compensation à l'euro près, conformément aux dispositions de la loi. Reste que le souhait a été très clairement exprimé d'en avoir plus. Pour cela, il y a deux méthodes : on peut prendre comme référence la moyenne des trois dernières années - c'est ce qui a finalement été retenu, par un amendement d'origine parlementaire ; mais si la référence la meilleure est celle de la dernière année, c'est naturellement celle-là seulement que l'on veut retenir... C'est ce qui s'appelle jouer sur tous les tableaux, du gagnant-gagnant au sens où les collectivités gagnent dans tous les cas ! S'agissant maintenant de la problématique de la montagne, M. le Président, vous avez, me semble-t-il, raison sur les deux points. Elle a bel et bien été prise en compte dans les ratios, ce qui répond pour partie à votre interrogation ; en revanche, il est vrai qu'il reste au moins un doute pour ce qui touche à la réglementation à venir dans le domaine des tunnels. Je ne voudrais pas être trop prudent, au risque de décevoir le Rapporteur... M. le Rapporteur : Le doute fait partie de la raison... M. Brice HORTEFEUX : J'en resterai donc à cette formulation prudente. Enfin, le décret d'application pour les routes a été, lui aussi, approuvé par la CCEC, dont les conclusions sont diffusées. M. Alain GEST : Il serait bon, me semble-t-il, de préciser à quel moment, à la suite d'un transfert, prend fin la charge qui jusque-là incombait à l'État. Notre collègue Pascal Terrasse a égrené une série de décisions, dont certaines avaient directement trait à la loi de décentralisation et certaines à d'autres textes. À l'entendre, ce transfert avait l'air honnête au départ, mais des évolutions se produisent ensuite... Ayons tous bien à l'esprit qu'une fois le transfert de l'État vers les collectivités territoriales convenablement et honnêtement réalisé, la mise en œuvre et la prise en charge des compétences ainsi transférées incombent totalement aux collectivités. Voyez ce qui s'est produit depuis les lois de décentralisations de 1982 : beaucoup de choses ont considérablement évolué depuis... Les dotations que l'État attribue aux départements et aux régions au titre des équipements scolaires ne représentent plus que le septième ou le huitième des dépenses réellement engagées par les collectivités. On ne peut demander à l'État d'aller au-delà d'un transfert honnête, dûment constaté. Il y a bien une limite à un moment donné, on ne peut pas vouloir gagner sur tous les tableaux. Une fois la compétence attribuée, une fois le transfert honnêtement réalisé, c'est à la collectivité d'assumer les évolutions ultérieures. Notre collègue président de la région Bretagne a, quant à lui, cherché à nous expliquer que l'augmentation de sa fiscalité régionale était liée à un problème d'endettement - votre tableau, M. le Ministre, a parfaitement démontré ce qu'il en était -, mais également au fait qu'un transfert déclenchait inévitablement une augmentation de la demande, d'où une fatalité de la dépense. Est-ce à dire que les responsables des collectivités ne sont pas en mesure d'encadrer la demande, de répondre autre chose que « oui » à la pression locale, déjà cent fois évoquée, et de refuser cette fuite en avant dans la dépense ? Nous avons ainsi constaté, avec le Directeur général des collectivités locales, que les budgets des communes et des intercommunalités, dont vous avez vanté l'évolution favorable, étaient marqués par une considérable inflation des dépenses, communales et intercommunales cumulées, qui amène à s'interroger. Y a-t-il vraiment une fatalité des dépenses ? Et comme de surcroît nous sommes favorables à la libre administration des collectivités territoriales, que pourrions-nous imaginer pour arrêter cet enchaînement terrible ? Sinon, vous vous retrouverez inévitablement avec des responsables de collectivités qui, le matin, protesteront contre la modestie de la protection du pouvoir d'achat des citoyens, et qui, l'après-midi, contribueront à la réduction de ce même pouvoir d'achat en augmentant la fiscalité locale... Que peut-on faire, sinon obliger à la publication de documents - comme cela avait été envisagé un temps dans une formulation disparue en commission mixte paritaire à la demande de nos collègues du Sénat et de l'opposition à l'Assemblée - qui permettraient de suivre valablement l'évolution des choses ? Peut-être un supplément d'information permettrait-il d'éviter cette fatalité de la dépense. Si nous étions incapables de l'empêcher, c'est toute la décentralisation qui deviendrait critiquable à terme. M. Brice HORTEFEUX : Les propos de M. Alain Gest sont empreints de bon sens. Mais je voudrais au préalable répondre au Rapporteur sur les compensations département par département. La règle générale veut effectivement que l'on compense département par département. Mais il est également vrai que les routes doivent faire exception, comme les membres élus de la CCEC eux-mêmes l'ont validé, ne serait-ce que pour ne pas encourager les effets d'aubaine. Là où les routes ont été restaurées par l'État depuis moins de cinq ans, il serait absurde de transférer des moyens supplémentaires à ces départements. M. Alain Gest a remarquablement résumé tout ce que je crois sur ce sujet, et plus particulièrement évoqué l'évolution des dépenses des communes et de leurs groupements, sujet effectivement assez sensible. Le tableau ci-dessous va totalement dans le sens de ses propos. 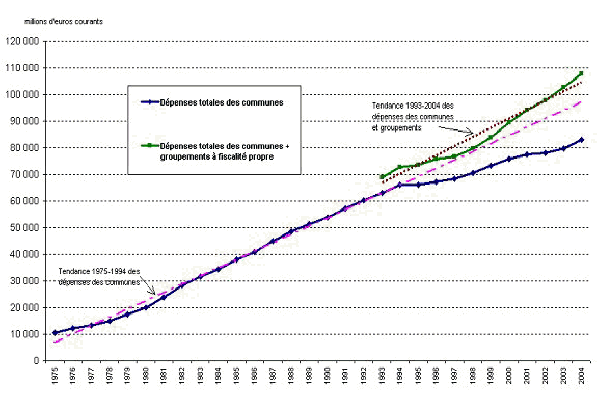 Vous observerez que les dépenses totales des communes ont augmenté ces dernières années à un rythme inférieur à celui de la période 1975-1994. La courbe correspondant au total des dépenses des communes et des groupements à fiscalité propre, qui commence en 1993, s'inscrit pratiquement dans la même tendance de long terme - un peu en deçà en début de période et un peu au-delà dans les dernières années. Par rapport à la tendance 1993-2004 - en pointillés -, l'écart 2004 est de 3,2 milliards d'euros, à rapporter à un total de 107,7 milliards d'euros... En tenant compte de la substitution des groupements aux dépenses des SIVOM et de l'évolution des dépenses au titre des ordures ménagères, l'écart résiduel est de l'ordre de 1 %. Il y a deux manières d'appréhender ce chiffre : on peut considérer que 1 %, ce n'est rien ou, au contraire, que ce n'est pas du tout négligeable. Mon explication, mais peut-être y en a-t-il d'autres, est que l'intercommunalité permet une offre de services beaucoup plus importante, en particulier dans les petites communes rurales qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas les offrir. C'est là un élément qu'il faut intégrer. M. Louis Giscard d'Estaing ne semble pas tout à fait d'accord... M. Louis GISCARD d'ESTAING : Cela vaut également pour les intercommunalités urbaines. M. Brice HORTEFEUX : Sans doute, mais de manière peut-être moins évidente que pour les intercommunalités rurales. M. le Président : Je suis d'accord avec vous, M. le Ministre. Sans les intercommunalités, il n'y aurait pratiquement plus de services publics dans les zones rurales, en tout cas de services équivalents à ceux offerts en zone urbaine. C'est certainement une des raisons de cette augmentation. Faire une crèche, une bibliothèque, du transport à la demande est impossible sans groupement. Lorsque les communes sont groupées, elles peuvent le faire, mais cela coûte cher. M. Alain GEST : Entendons-nous bien : en faisant ce constat, je ne remets aucunement en cause le processus d'intercommunalité. Je constate seulement que, même si ce 1 % peut être considéré comme un progrès, les dépenses des communes continuent d'augmenter, de même évidemment que les dépenses de l'intercommunalité, qui n'existaient pas il y a quinze ans. Nous sommes tout à fait d'accord pour constater que l'intercommunalité permet d'assurer des services qui, sans elles, auraient été inenvisageables ; mais alors, autant clore immédiatement les travaux de cette Commission d'enquête et se contenter de la réponse : « la fiscalité locale augmente parce que nous rendons de plus en plus de services. » M. le Président : Non ! M. Alain GEST : Dans ce cas, rendons-en davantage encore et nous ferons totalement exploser la fiscalité en France ! C'est une évidence que, dans un pays qui compte 36 000 communes, il y a lieu de s'organiser et de se regrouper. C'est également une évidence que l'intercommunalité a fonctionné. Mais ce qui est tout aussi évident, c'est que nous n'avons pas pu stabiliser la fiscalité, contrairement à ce qui nous avait été « vendu » par M. Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Ce qui me ramène à ma question : comment éviter cette progression constante de la fiscalité, certes justifiée par des travaux tout à fait estimables, souvent utiles, quelquefois doublonnés, et couper court à cette fatalité qui fait qu'une collectivité territoriale ne peut plus rien refuser à personne, ce que manifestement l'État pouvait se permettre ? M. Brice HORTEFEUX : M. Alain Gest a tout à fait raison, ce qui n'est en rien incompatible avec ce que j'ai exprimé et que le Président Augustin Bonrepaux a approuvé : l'intercommunalité ne doit pas aboutir à créer des doublons. Si nous nous sommes donnés un an de plus pour définir l'intérêt communautaire, c'est précisément pour en délimiter soigneusement le périmètre, et je serai particulièrement ferme sur cette définition. Cela répondra à votre préoccupation. M. Jean-Yves LE DRIAN : Je vous confirme, M. le Ministre, et je tiens mes documents à la disposition du Président et du Rapporteur, que l'endettement de la région Bretagne a augmenté de 300 % entre 1998 et 2003, passant de 110 millions d'euros à 390 millions d'euros. Ce n'est pas parce que nous sommes en bas à gauche de votre tableau que nous ne pouvions pas être encore plus bas avant... Et cela ne règle pas le problème fiscal. Le président de région que je suis s'est trouvé confronté au problème du financement de cet endettement, alors même que l'épargne nette était passée de 47 % à 36 %. Devais-je continuer dans cette logique ou prendre des remèdes ? J'ai pris des remèdes, et la seule possibilité était de retrouver mon épargne nette. Tant et si bien qu'en 2005, j'emprunte moins que mon prédécesseur. Voilà une raison qui me paraît objective. Il est dans la décentralisation une logique à laquelle il est difficile à un élu d'échapper : le fait d'être décentralisé permet de mieux saisir des besoins que l'on n'identifiait pas auparavant et qui aboutissent, dans un premier temps - mais moins dans un second temps - à des dépenses supplémentaires. M. Alain GEST : Le fait d'être décentralisé permet également de mieux gérer, avez-vous dit... M. Jean-Yves LE DRIAN : L'exemple des chemins de fer est particulièrement éclairant. Que faut-il faire ? La réponse n'est pas simple. Ce sont souvent des besoins réels. M. Louis GISCARD d'ESTAING : Je reviens sur l'évolution des dépenses cumulées des communes et des intercommunalités, dans l'esprit de l'intervention de M. Alain Gest. Si le développement de l'intercommunalité va de pair avec un développement de la mutualisation des moyens existants, l'écart entre la courbe des dépenses cumulées et celle des dépenses nouvelles engendrées par l'intercommunalité devrait être pratiquement inexistant. Lorsque des entreprises se regroupent dans un GIE, elles mettent en commun des moyens et le GIE se fait à dépense constante, voire inférieure. M. le Rapporteur : C'est la révélation de besoins nouveaux... M. Louis GISCARD d'ESTAING : Tel était le sens de la piste de réflexion développée par M. Alain Gest et à laquelle je souscris. Partagez-vous ce point de vue, M. le Ministre ? M. Brice HORTEFEUX : Reprenons le graphique. On voit bien que la courbe correspondant aux dépenses communales, à défaut de baisser, stagne... M. Alain GEST : Progresse moins vite... M. Brice HORTEFEUX : Disons : progresse moins vite. M. Louis GISCARD d'ESTAING : Ce n'est pas pareil ! M. Brice HORTEFEUX : C'est sans doute le signal le plus révélateur de cette évolution. Est-ce totalement satisfaisant ? Évidemment non, vous-même venez de le dire. Mais c'est une tendance et je ne vois pas pourquoi elle s'infirmerait. M. Louis GISCARD d'ESTAING : Il faut qu'elle s'infléchisse davantage. M. Alain GEST : Dans un graphique, présenté le 25 mai par M. le Directeur général des collectivités locales, on voyait l'augmentation des dépenses de l'intercommunalité et celle des communes. La représentation était tellement évidente qu'elle ne pouvait que faire réfléchir. Celui-ci montre incontestablement que l'on a réussi à freiner l'évolution des dépenses des communes ; reste qu'elles continuent d'augmenter alors qu'est apparu un poste totalement nouveau depuis dix ans : l'intercommunalité. M. le Rapporteur : La position du ministre tout à l'heure était raisonnable... M. Louis GISCARD d'ESTAING : Prudente ! M. le Rapporteur : Ce déterminisme de l'augmentation de la dépense locale pose question, quand bien même il est permis de considérer que la nouvelle organisation donne des moyens auxquels on ne pouvait prétendre antérieurement... M. Jean-Yves LE DRIAN : Dans un second temps. M. le Rapporteur :... et que des besoins nouveaux peuvent apparaître au fil du temps. Mais on ne peut éternellement tourner en rond : l'évaluation du besoin réel, en fin du compte, relève du choix politique, de l'autonomie de la collectivité et du contrôle des citoyens sur la collectivité. M. Jean-Yves LE DRIAN : C'est la bonne réponse. M. Brice HORTEFEUX : C'est la réponse que j'aurais faite. On notera au passage que les dépenses des communes isolées sont supérieures de 22 % à celles des communes en intercommunalité. M. Alain GEST : Évidemment ! M. Brice HORTEFEUX : C'est logique, mais c'est un chiffre qu'il convient d'avoir en mémoire. M. Alain GEST : Très respectueusement, M. le Ministre, ce chiffre, pour satisfaisant qu'il soit, n'en montre pas moins que les communes continuent de dépenser davantage. Il est du reste heureux de constater que les communes isolées dépensent encore plus ; ou alors, cela signifierait clairement que l'intercommunalité n'a pris aucune des responsabilités qui jusqu'alors incombaient aux communes... M. Brice HORTEFEUX : C'est bien pourquoi j'ai pris la précaution d'indiquer que l'écart n'était que de 1 %. M. Alain GEST : Tout à fait. Nous avons parlé l'autre jour, avec M. le Directeur général, de la différence qu'il devait y avoir entre les communautés de communes en milieu rural et les communautés d'agglomération. En milieu rural, bon nombre de compétences dévolues au niveau intercommunal - piscines, culture, etc. - ne retirent aucune charge aux communes, et, partant, ne lui permettent pas de baisser sa fiscalité. M. le Président : Je partage totalement ce point de vue. Nous parvenons de temps en temps à nous accorder entre majorité et opposition... Mme Arlette GROSSKOST : Une question pratique : les transferts de nombreux personnels aux départements et aux régions n'auront-ils pas d'importantes conséquences sur les régimes de retraite ? Les a-t-on quantifiées ? M. Brice HORTEFEUX : La question a été posée dès ma prise de fonctions... M. le Président : Une compensation sera-t-elle versée aux collectivités territoriales qui auront à assumer ces retraites ? Contrairement à la question des charges patronales, d'ores et déjà réglées, celle-ci n'a pas encore reçu de réponse. M. Brice HORTEFEUX : Le rapport démographique de la CNRACL ne devrait pas être modifié. Tout semble indiquer que la moyenne d'âge des agents TOS est à peu près équivalente à celle des agents de la fonction publique territoriale : entre 43 et 45 ans. Quant à l'impact financier, il est sans doute un peu prématuré de le chiffrer précisément, tant que les agents concernés n'auront pas opté entre le détachement et l'intégration. Dans le premier cas, l'État conservera la charge de payer les retraites ; dans le second, celle-ci reviendra à la CNRACL. Je crois toutefois que l'impact sur les budgets locaux devrait être nul, dans la mesure où l'État compensera les charges des cotisations employeur. Rappelons enfin que l'article 108 de la loi du 13 août 2004 impose au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement sur les conséquences financières du transfert de ces personnels pour la CNRACL : vous disposerez donc de tous les éléments le moment venu, c'est-à-dire une fois que les intéressés auront exprimé leur choix. M. le Président : Tout comme vos prédécesseurs, mais de façon beaucoup moins polémique, vous avez fait état des augmentations de taux excessives de certaines régions. Mais en remontant à 1993, on aurait pu trouver des taux tout aussi excessifs en Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes et autres. Se focaliser sur les taux n'est guère objectif : il faut considérer l'étroitesse des bases, devenues encore plus étroites depuis la disparition de part régionale de la taxe d'habitation, et tenir compte de la diversité des situations. On a beau jeu de comparer l'Alsace et le Languedoc-Roussillon ; mais c'est oublier que l'Alsace a augmenté, certes modérément et de façon responsable, mais régulière, ses taux pendant six ans alors que Languedoc-Roussillon abaissait les siens ; ajoutons que l'Alsace a des bases de taxe professionnelle presque deux fois plus élevées... Autant d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de porter des jugements ; j'espère que c'est ce que fera la Commission d'enquête. De même, à vous entendre, si les impôts augmentent, l'État n'y est pour rien. Je connais mal la situation des régions, mais j'ai entendu nombre de présidents de régions expliquer qu'ils ne pouvaient que constater le relèvement des bourses ou l'évolution des besoins de formation des personnels médicaux et paramédicaux, et que, tout en s'occupant de leurs TER, ils se voyaient sollicités pour les TGV ou invités par l'État à participer à telle ou telle opération. Cela arrive aussi aux départements. On ne saurait nier dans de telles conditions l'existence d'une certaine responsabilité de l'État. Pour ce qui est des départements, que je connais mieux, les choses sont irréfutables. S'agissant du RMI, passons sur le fait que le déficit est de 435 à 450 millions pour 2004. Il ne sera compensé qu'en 2006. Nous engageons l'année 2005 ; au moment de voter les taux, c'est-à-dire en mars, on s'aperçoit déjà que le déficit 2005 est déjà aussi élevé que celui de 2004 - finalement, il représentera une fois et demie à deux fois celui de l'an dernier, à ceci près qu'aucun engagement n'a été pris pour le compenser... Il faudra pourtant bien le payer. Dans mon département, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice 2004 avec des comptes de fonctionnement au bord du déséquilibre, du fait de l'APA, mais également de l'augmentation de l'aide à l'enfance, dont on ne parle pas, mais qui va de pair avec les difficultés des familles : ce n'est pas pour rien que les dépenses d'aide sociale sont passées de 45 % à plus de 60 % dans les budgets des départements... Tout n'est évidemment pas lié aux transferts, mais force est de reconnaître que la situation a obligé les départements à augmenter leurs taux, non pour se ménager une épargne de précaution, mais tout simplement pour assurer l'équilibre fin 2005. Autre exemple : on nous répète que l'État compense à l'euro près. Ce n'est pas vrai. Jusqu'en 2004, l'État participait au financement de l'ANPE. Il ne le fait plus. Est-ce de la compensation à l'euro près ? Les contrats d'avenir coûtent à peu près 20 % plus cher aux départements. Je veux bien contribuer à la réinsertion ; reste que cela représente une augmentation de notre charge. Je veux bien reconnaître que la CCEC a permis certains progrès, en particulier sur les charges patronales. Reste que plusieurs questions demeurent sans réponse ; et lorsque les élus sont en désaccord avec les représentants de l'État, il est impossible de prendre une décision. Comment s'effectuera la compensation du RMI pour 2005 et les années suivantes ? Y aura-t-il seulement compensation ? M. Alain Gest a très bien défini l'esprit de la loi : une fois le transfert opéré, aux départements et aux régions de se débrouiller. Mais le transfert du RMI se faisait avec une TIPP qui devait être évolutive ; or elle ne l'est pas. Le déficit 2005 sera deux fois plus élevé que le déficit 2004. Quelle est la réponse de l'État ? M. Jean-François Copé ne m'a pas entendu hier. Il a fait cependant une petite ouverture : en 2006, on verra les comptes 2005. Mais ce n'est pas ce que prévoit la loi - tous mes amendements allant dans ce sens avaient été refusés. Le fonds social du logement et le fonds d'aide aux jeunes sont, comme par hasard, compensés sur trois ans. Et comme par hasard, on les voit diminuer d'année en année. En nous compensant sur la moyenne, on dit bien nous traiter ; or nous sommes bel et bien maltraités dans la mesure où les problèmes se sont accrus, et les crédits se sont réduits. Sans parler des routes... On peut difficilement soutenir dans ces conditions que les compensations soient faites à l'euro près. Je reconnais que ces questions ne sont pas encore tranchées. Si je les pose, c'est en espérant une évolution favorable, dans la mesure où nous n'avons obtenu aucune réponse lorsqu'elles ont été exposées lors de la dernière commission consultative. On a le sentiment que, si la décentralisation a été bien préparée par l'État, elle l'est moins bien pour les collectivités territoriales... Voilà la première série de questions que je voulais vous poser, M. le Ministre. M. Brice HORTEFEUX : Vous m'inquiétez beaucoup, M. le Président... Le nombre de questions, importantes, que vous soulevez me paraissait déjà considérable... M. le Président : C'est dire à quel point les problèmes sont nombreux et importants... M. Brice HORTEFEUX : Autant dire que l'annonce d'une deuxième salve me préoccupe ! M. le Président : Elle sera courte. M. Brice HORTEFEUX : Sur la compensation des charges du RMI, il faut être précis. La loi de décembre 2003 a transféré la responsabilité du paiement du RMI, compensée par l'attribution d'une part de la TIPP, calculée sur la base des dépenses assurées par l'État l'année précédant le transfert, autrement dit en 2003. Rappelons qu'une première correction a été effectuée par la loi de finances rectificative de 2004 ; c'est le « filet de sécurité » dont j'ai parlé tout à l'heure et qui joue en cas de réduction de l'assiette de la TIPP. Les départements ont alors fait valoir que les dépenses constatées en 2004 étaient bien supérieures aux ressources transférées, d'autant que le nombre des RMIstes avait augmenté de 8 % sur le plan national. Ils ont donc demandé à faire jouer la clause de rendez-vous prévue par la loi RMI-RMA, en se servant de la référence des comptes administratifs 2004, en cours d'adoption. Le 7 mars dernier, le Premier ministre a annoncé que l'État ferait une interprétation beaucoup plus large de cette clause et irait bien au-delà de l'obligation légale, en apportant une compensation supplémentaire correspondant à la dépense totale des départements, sur la base du montant qu'ils auront eux-mêmes indiqué dans leurs comptes administratifs. Le Parlement sera donc saisi d'une mesure évaluée pour l'instant à 450 millions d'euros, mais dont le montant sera précisé le moment venu. Voilà pour l'historique, qu'il ne faudrait pas passer par pertes et profits. La question que vous posez, et que je comprends fort bien, est en réalité la suivante : cette somme est-elle un solde de tout compte, versé une fois pour toutes, ou sera-t-elle - tel est votre souhait, je le suppose - intégrée en base ? M. le Président : C'est effectivement la question que je pose. M. Brice HORTEFEUX : À cette question intéressante, essentielle, précise et forte, je ne peux naturellement pas répondre, puisque les arbitrages budgétaires n'ont pas encore été effectués. Mais par définition et par construction, je souscris à ce qu'a dit hier le ministre du budget. M. le Président : Vous souscrivez au fait que l'on pourra la revoir en 2006 ? M. Brice HORTEFEUX : Je rappelle, à la demande insistante de M. le Directeur général, que 450 millions représentent 10 % de la marge de manœuvre réelle du budget de l'État... Ajoutons que la compensation au titre du RMI, comme les autres, est définitivement acquise. Or, rien ne dit que la dépense continuera à croître, au contraire : l'objectif de la décentralisation n'est pas d'encourager la croissance de la dépense, mais de réussir l'insertion en ramenant dans la même main le revenu et l'insertion. Ce qui signifie que nous avons collectivement une obligation de réussite. Vous maintenez que l'État jouerait un rôle dans l'augmentation de la fiscalité. Je persiste et je signe : en 2005, la hausse de la fiscalité n'est clairement pas justifiée par les transferts de compétences. M. Jean-Yves LE DRIAN : C'est différent. M. Brice HORTEFEUX : Je maintiens et je confirme. L'ANPE n'a donné lieu à aucune contestation ni à aucune remarque de la part de la commission d'évaluation ; les départements sont libres de choisir leurs prestations. M. le Président : L'année dernière, l'État assumait la charge de la moitié des agents de l'ANPE ; cette année, il ne transfère pas ces crédits aux départements, et se contente de leur dire de faire leur affaire de l'ANPE ! Je reconnais que deux départements se sont résolus à continuer à payer sans demander de compensation. Mais pour ce qui est de la compensation à l'euro près... Reste, je vous en donne acte, que la commission a entériné cette position. M. Brice HORTEFEUX : Reconnaissez avec moi que la majorité des élus l'a entériné. M. le Président : Tout à fait : la majorité de la commission. M. Brice HORTEFEUX : Exactement. Vous avez posé le problème de fond de la nature des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Il y a en réalité deux manières de concevoir les relations financières. La première - le mot pourra vous choquer, mais il résume ce que je pense -, c'est de les concevoir d'une manière « syndicale », où des collectivités territoriales revendiquent en permanence et demandent à l'État de les subventionner systématiquement ; je ne dis pas que cette approche soit la vôtre. La deuxième, celle peut-être que nous pourrions retenir, c'est celle d'une responsabilité collective devant l'importance des charges publiques. Si l'État paie à la place des collectivités, il ponctionne le contribuable national. Je crois sincèrement qu'il nous faut sortir de cette logique, dont les aspects inflationnistes ne vous ont pas échappé. M. le Président : L'exemple des transports d'Île-de-France montre tout de même que cette décentralisation a manqué de préparation. Alors que le transfert est prévu pour le 1er juillet, on ne sait encore rien des compensations... M. Jean-Yves LE DRIAN : Le sanitaire également nous sera transféré dans quinze jours ; or je ne sais rien, ni du nombre d'écoles, ni des effectifs transférés ! Je n'ai été saisi de rien. M. le Président : Le Rapporteur ne cesse de nous dire que les collectivités dépensent trop et qu'il faut trouver un moyen de réguler tout cela. Comment pourrait-il en aller autrement ? Le Fonds national des adductions d'eau a été réduit de 50 %. Ou bien on poursuit la politique d'assainissement et de mise en conformité des installations, ou bien on ne le fait pas. Mais si on le fait, il faudra bien que les consommateurs paient. Même chose pour les services publics : je ne suis pas partisan d'un maintien à toute force, mais dans certains endroits, on demande à la commune de payer l'agence postale... Mieux encore, des collectivités territoriales sont désormais sollicitées par l'Ordre des médecins afin d'aider à l'installation de médecins en zone rurale. Mais est-ce leur rôle de répartir les médecins sur le territoire ? C'est en tout cas une dépense supplémentaire. Dans le domaine du développement économique, il est heureux que l'intercommunalité conduise des projets créateurs d'emplois et de services, faute de quoi nous assisterions à une désertification accrue des zones rurales ! La compétence essentielle de l'intercommunalité est effectivement le développement économique ; cela mériterait qu'on y mette l'accent. Or dès que l'on se tourne vers l'État et, désormais, l'Union européenne, il n'y a plus rien. Si les collectivités territoriales ne le font plus, qui le fera ? Le rapporteur du budget de l'aménagement du territoire nous a expliqué qu'il était de bonne gestion que les crédits soient dépensés à 99 % ; toujours est-il qu'en agissant ainsi, bon nombre de projets ne seront pas financés. Mais il y a une deuxième raison à l'augmentation des dépenses, qui tient aux décisions mêmes de l'État. Ainsi en est-il pour les sapeurs-pompiers : la Conférence nationale des SDIS, avez-vous dit, permettra une certaine régulation. Mais, pour l'instant, la dépense prévue par la loi ne sera même pas financée à 50 % par la recette correspondante... De même pour les assistantes maternelles : on améliore leur statut et c'est très bien. Mais c'est le département qui paie... Et pour ce qui est de la loi sur le handicap, j'attends de voir : les départements sont inquiets. On nous assure que ce sera compensé ; je reste prudent... Autre exemple : on supprime un jour férié. Le département paie 0,3 % de charges sur ses dépenses de personnel. Mais il lui faut également payer un jour supplémentaire de transports scolaires, ce qui représente également à peu près 0,3 % ! On nous avait assuré que la TIPP serait évolutive ; on voit le résultat... On nous avait promis que nous pourrions moduler la TSCA ; mais un rapport de l'Inspection générale des finances, laisse entendre que ce serait très difficile, et M. Jean-François Copé l'a confirmé hier. Quel est votre point de vue ? Quelle sera la marge d'évolution laissée aux collectivités territoriales ? Ces transferts portent sur du personnel ; or les charges de personnel augmentent de plus de 3,5 % par an. Sans une recette capable d'évoluer d'au moins 3,5 % par an, il faudra petit à petit puiser dans les autres impôts locaux. La réponse sur la TSCA - que les départements ne reçoivent pas pour l'instant - sera déterminante. Avant de prévoir la décentralisation, peut-être aurait-on mieux fait de prévoir comment la compenser. M. le Rapporteur : M. Jean-Yves Le Drian a posé la question très concrète des formations sanitaires. Va-t-on réellement les transférer au 1er juillet sans que l'on en connaisse la liste aujourd'hui ? M. Jean-Yves LE DRIAN : Ce n'est pas de la responsabilité du ministre chargé des collectivités territoriales. M. Brice HORTEFEUX : En effet. Vous m'aviez d'ailleurs très gentiment indiqué, M. le Président et M. le Rapporteur, que vous seriez particulièrement indulgents avec moi eu égard au caractère très récent de ma prise de fonctions... Je ne sais pas combien de temps dure l'audition d'un ministre chevronné, mais j'ai été particulièrement gâté ! M. Jean-Yves LE DRIAN : Cela prouve que vous nous intéressez ! M. le Président : C'est peut-être parce que vous répondez très gentiment à nos questions... Sans doute en abusons-nous ! M. Brice HORTEFEUX : Il me semblait que les informations avaient été communiquées. Peut-être s'est-il posé un problème ponctuel pour la région Bretagne, mais je ne saurais m'avancer... M. Jean-Yves LE DRIAN : C'est pareil ailleurs. M. Brice HORTEFEUX : Tout cela aurait normalement dû être communiqué à la région. M. Jean-Yves LE DRIAN : En effet, mais ce n'est pas le cas. M. Brice HORTEFEUX : Votre deuxième salve de questions, M. le Président, aborde également bien des sujets. S'agissant du STIF, j'ai été confronté dès ma prise de fonction à ce sujet assez sensible. Il faut noter que toutes les réponses ont été apportées dans le cadre de la Commission consultative d'évaluation des charges. Se pose le problème du matériel roulant, totalement exclu du droit à compensation et soumis, comme l'avait souhaité la composante « élus », à l'arbitrage du Premier ministre. Pour ce qui est de l'évaluation, les contacts ont été pris notamment avec le préfet Bernard Landrieu pour examiner les souhaits formulés par le président du conseil régional et les possibilités budgétaires de l'État ; il n'est pas encore possible d'avancer un chiffre. Il n'est du reste pas certain qu'une solution soit trouvée dans l'immédiat. Vous avez ensuite évoqué l'impact de la journée de solidarité. Il est vrai qu'en contrepartie de cette journée travaillée non rémunérée, les employeurs territoriaux ont versé la contribution de 0,3 % de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, installée voilà trois semaines. Rapporté à la masse salariale telle qu'elle apparaît dans les budgets primitifs, cela représente environ 100 millions d'euros, sans compter les frais de fonctionnement supplémentaires. Pourquoi ai-je donné ce chiffre ? Pour le comparer aux 35 milliards d'euros consacrés aux rémunérations par les collectivités... Cela donne un ordre de grandeur, et signifie tout simplement que chacun a dû supporter sa part de l'effort. S'agissant de la TSCA, je ne reviens pas sur les dispositions de la loi de finances pour 2005 qui ont attribué aux départements deux fractions de TSCA, la première au titre de l'accompagnement des transferts de compétences, pour 126 millions d'euros, la seconde pour accompagner les départements dans leur effort de financement des SDIS, pour 900 millions d'euros. Remarquons d'abord que cette attribution s'est faite en stricte conformité avec les obligations constitutionnelles et organiques en matière d'autonomie financière des collectivités. De surcroît, en affectant une fraction de taux à chaque département, le législateur a bien respecté le principe de l'attribution d'une ressource propre. L'évolution de cette ressource a été envisagée en visant deux étapes. La première verrait le passage d'un partage du taux sur une assiette nationale à la perception de la TSCA sur une assiette départementalisée ; la deuxième étape serait celle de l'attribution au département, sur cette base, d'un pouvoir de taux. Les conclusions de l'Inspection générale des finances sur ces questions nous ont été remises, et vous ont été transmises, il y a quelques jours. Nous avons donc exactement le même niveau d'information. Ce rapport met en évidence deux difficultés : premièrement, un écart qui pourrait être très important entre la répartition de l'assiette entre les départements et celle des droits à compensation de chacun d'eux ; deuxièmement, une réelle difficulté technique pour les assureurs à localiser l'assiette et, le cas échéant, à gérer la modulation des taux. Nous devons approfondir la réflexion et engager, ainsi qu'a dû certainement vous le dire M. Jean-François Copé hier, des consultations avec les départements pour tenter de déterminer concrètement le dispositif le plus adapté. Vous avez ensuite un vrai sujet qui, ai-je cru comprendre, intéresse également votre Rapporteur - ce qui témoigne de votre cohésion sur cette question : je veux parler de l'aménagement du territoire. Première réflexion : nous serons certainement d'accord pour reconnaître à la région une place essentielle en matière de planification, ainsi que le rôle fondamental des agglomérations en matière de planification urbaine avec les SCOT. Deuxième réflexion : toutes les collectivités - comme c'est d'ailleurs le cas de l'État avec la LOLF - doivent pouvoir engager des politiques territorialisées, affichant des objectifs tout à la fois clairs et compréhensibles par la population. Car, j'en suis convaincu, cette tendance est inéluctable : l'exigence et la vigilance des populations iront croissant. On a bien vu ces dernières semaines que les prescripteurs d'opinion ne prescrivaient rien et que la population s'informait et forgeait elle-même son opinion. Son exigence et sa vigilance seront inévitablement amenées à se renforcer. Troisième réflexion : la déconcentration en tant qu'acte II de la décentralisation nécessite une concertation réciproque, dans le respect des compétences de chacun. Il n'est pas question que chacun essaie de dominer le voisin. Dernière réflexion, qui pourrait, je l'espère en conclusion, faire consensus : plus aucun niveau ne dispose à lui seul des moyens de régler les grands problèmes de société : exclusion, sécurité, aménagement du territoire. Nous devons en prendre acte ; ce qui est valable à l'échelon de l'ensemble européen l'est également, et surtout, à l'échelon national. M. le Président : M. le Ministre, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous voudrez bien nous excuser de vous avoir retenu aussi longtemps, mais le sujet était particulièrement important et vous concernait directement. M. Brice HORTEFEUX : M. le Président, au moment où j'ai pris mes fonctions, le Directeur général des collectivités locales m'avait prévenu que, parmi les étapes lourdes qui s'annonçaient, la plus importante et difficile serait le passage devant votre Commission... Il m'a donc fait beaucoup travailler ! M. Jean-Yves LE DRIAN : Vous aurez une bonne note ! M. le Rapporteur : M. le Ministre, il nous faut également remercier vos services que nous avons entendus à plusieurs reprises, aussi bien lors d'auditions en commission qu'au cours d'entretiens avec le Président ou moi-même. Nous avons eu, à chaque fois, le sentiment qu'il restait beaucoup à découvrir ! Il ne nous reste plus qu'à poursuivre avec vous... M. le Président : Mes chers collègues, la séance est levée. Audition de M. Dominique PERBEN, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Dominique Perben est introduit. M. le Président : Nous achevons la première phase de nos travaux en accueillant aujourd'hui M. Dominique Perben, ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue. Une bonne part de nos travaux a porté sur la question du désengagement de l'État en matière de contrats de plan et sur la compensation des compétences transférées en matière de routes ou de transports régionaux de voyageurs. Nous avons notamment entendu le Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, le Directeur général des routes et le Directeur général de la mer et des transports de votre ministère. Munis des informations qu'ils nous ont apportées, nous souhaiterions savoir dans quelle mesure, à vos yeux, la hausse récente de la fiscalité locale est imputable, soit aux transferts de compétences, soit à un désengagement de l'État. M. le Président rappelle à M. Dominique Perben que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. le Président : Je vous donne la parole pour un exposé introductif, après quoi le Rapporteur et les autres membres de la commission d'enquête vous poseront leurs questions. M. Dominique PERBEN : Vous avez souhaité que je sois entendu par votre commission d'enquête, quelques jours après ma nomination comme ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et je vous en remercie. Vous avez déjà entendu plusieurs des collaborateurs qui m'accompagnent aujourd'hui, notamment sur un ensemble de sujets techniques, essentiels pour que votre vision de la situation soit exacte. Je voudrais aujourd'hui vous donner une vue plus politique sur la situation, tout comme Jean-François Copé a pu le faire il y a quelques jours. À titre de propos liminaire, j'aborderai trois points qui me semblent significatifs du point de vue des fonctions ministérielles que j'exerce, mais aussi en tant que membre du Gouvernement, équipe collégiale : l'importance de la façon dont s'articulent les responsabilités du Gouvernement et celles des collectivités territoriales ; l'utilité des contrats de plan État-région ; la réforme des services du ministère de l'Équipement, laquelle tient pleinement compte de vos préoccupations. Le Gouvernement, vous le savez, souhaite mener à bien le mouvement de décentralisation engagé. Cela suppose que les compétences transférées soient précisément définies et que les moyens nécessaires à leur exercice soient évalués et transférés. Dans le respect de ce principe, les priorités du Gouvernement sont la maîtrise de la dépense publique et la modération fiscale. À cet égard, je puis vous assurer de ma pleine convergence de vues avec votre préoccupation de ne pas créer les conditions d'une augmentation de la fiscalité locale dans certains territoires. Nous faisons donc en sorte qu'il n'y ait aucun lien entre les hausses de fiscalité régionale et la mise en œuvre de la décentralisation. Nous avons garanti l'adossement du coût des transferts de compétences aux ressources correspondantes et nous continuerons de le faire. Vous savez que 40 % des enveloppes des contrats de plan État-région relèvent de la compétence du ministère dont j'ai la responsabilité. Je suis, comme vous, attaché au respect des programmations décidées dans ce cadre. Ce sont des projets importants pour le développement économique local. Ma conviction est que la négociation État-région permet de créer un consensus sur ce qu'il faut faire. Dans un contexte où chacun est responsable d'une partie du réseau, il est en effet utile, en matière de transport, de prendre régulièrement du recul par rapport à la carte globale. C'est, je crois, le principal objectif de ces contrats, et c'est aussi l'occasion de chiffrer les financements nécessaires. Pour être tout aussi clair, je voudrais indiquer que l'exécution de ces contrats de plan se fait de façon globalement satisfaisante : aucune région n'a eu à payer plus que ce qu'elle devait. Je note ainsi que les régions apportent comme prévu les financements attendus, au niveau convenu. Il ne ressort donc aucun impact nouveau sur la fiscalité locale de l'exécution des contrats de plan. Le Gouvernement, pour sa part, apporte les financements dans le cadre de l'exécution des lois de finances. Vous vous souvenez sans doute du plan de relance de 300 millions d'euros décidé par le précédent Gouvernement, l'an passé, pour que les engagements pris soient tenus. Enfin et surtout, je voudrais mentionner la nouvelle et très importante mesure inscrite dans la loi de décentralisation du 13 août 2004 consistant à rendre les fonds de concours des collectivités territoriales éligibles au fonds de compensation de la TVA, à compter du 1er janvier 2005, ce qui allégera de plus de 700 millions d'euros leur charge financière au titre des volets routiers des contrats État-région. Je vous rappelle aussi la détermination du Premier ministre, exprimée il y a deux semaines dans sa déclaration de politique générale, à accélérer le calendrier d'exécution des contrats de plan ; je puis donc vous garantir le volontarisme du Gouvernement à ce sujet. Cela ne doit cependant pas dissimuler la contrainte financière réelle qui pèse sur les finances publiques, contrainte bien connue de l'Assemblée nationale. Nous avons pour ambition de trouver des moyens de concilier ces différentes exigences, notamment à la faveur de la privatisation des sociétés d'autoroute qui vient d'être décidée. Le transfert aux départements d'une partie du réseau routier national, au-delà de la nouvelle avancée de la décentralisation qu'il représente, constitue une opportunité unique de modernisation en profondeur des services de l'équipement. Les services routiers de l'État vont en effet devoir être profondément réorganisés pour permettre une gestion par itinéraires du réseau routier national non concédé. Le regroupement des personnels au niveau régional pour la maîtrise d'ouvrage des investissements routiers et au niveau interrégional pour l'entretien, l'ingénierie et l'exploitation permettra une amélioration du service rendu aux usagers, d'une part, et des gains de productivité, d'autre part. Sur le plan financier, contrairement à une idée trop largement répandue, cette décentralisation n'aura pas de conséquence négative sur les budgets des départements. L'État transférera en effet la totalité des moyens humains et financiers dont il dispose aujourd'hui pour gérer les routes transférées. Je note que le projet de décret fixant les modalités des transferts financiers a reçu un avis favorable de la Commission consultative d'évaluation des charges. Nous continuerons dans cette voie. Je serai particulièrement attaché à la concertation et à la transparence dans l'ensemble du processus. Je suis pleinement convaincu que nous pourrons travailler ensemble, dans l'intérêt de nos concitoyens, sur ce sujet si important pour l'organisation de nos territoires. M. le Rapporteur : J'ai cru comprendre, en écoutant la déclaration de politique générale du Premier ministre, que celui-ci assignait une nouvelle mission à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dans le cadre de la réalisation des contrats de plan. Ai-je bien compris ? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Le rattrapage du retard dans l'exécution de contrats de plan exige de mobiliser des moyens. La privatisation d'autoroutes est-elle susceptible d'y concourir ? M. Dominique PERBEN : Nous avons deux objectifs : soutenir l'emploi et améliorer le niveau d'exécution des contrats de plan. Nous avons tout intérêt, dans une perspective de relance économique, à affecter des moyens financiers complémentaires à des projets existants. S'agissant plus précisément du rôle de l'AFITF, il est trop tôt pour que je puisse vous indiquer quel dispositif technique nous mettrons en œuvre, mais nous y réfléchissons avec le président et l'équipe de l'AFITF. M. le Rapporteur : Ce matin, les membres de la Commission des finances ont examiné un rapport sur la privatisation de sociétés autoroutières et se sont interrogés sur le financement du programme d'infrastructures adopté lors du CIADT du 18 décembre 2003. Si la participation de l'État baisse, il est à craindre que les collectivités territoriales soient plus fortement sollicitées. Êtes-vous en mesure de nous rassurer quant à l'engagement financier de l'État dans le cadre du CIADT ? M. Dominique PERBEN : Il s'agit de concilier le court terme et le long terme. Dans cet esprit, à court terme, un consensus devrait pouvoir être trouvé pour mobiliser une partie des ressources de privatisation au service de la politique de l'emploi, pour accélérer la réalisation des contrats de plan. Dès lors, il faudra, bien entendu, trouver un dispositif de financement de long terme afin de répondre à l'objectif que vous avez rappelé : la réalisation de l'ensemble des infrastructures prévues par le CIADT. C'est pourquoi je n'avais pu répondre de manière complète à votre question précédente : nous travaillons à élaborer un dispositif qui soit satisfaisant pour le long terme comme pour le court terme. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous indiquer où en est le « front » des signatures avec les départements à propos du transfert des routes nationales ? Comment a évolué le linéaire par rapport aux hypothèses de départ ? Quels problèmes vous paraissent les plus délicats ? D'un point de vue politique, quels avantages les citoyens retireront-ils de la départementalisation de certaines routes nationales ? La « pression citoyenne » ne risquera-t-elle pas d'induire un surcroît de dépenses ? Qu'en pensez-vous ? La départementalisation est-elle vraiment positive ? M. Dominique PERBEN : Je crois au principe de subsidiarité : hormis les équipements dont la nature même exige qu'ils soient conçus, gérés et entretenus au niveau national, il est souhaitable que le décideur qui rend les arbitrages se trouve au plus près de l'utilisateur, du citoyen. Conserver 10 000 kilomètres de grands itinéraires dans le giron de l'État et transférer le reste aux départements va forcément dans le sens de la bonne gestion des fonds publics. Au niveau de l'État, les services seront réorganisés car il serait absurde de maintenir la structure de gestion en l'état alors que plus de la moitié de la tâche est transférée. Le ministère de l'Équipement, qui n'en est pas à sa première réforme de structures depuis une trentaine d'années, a engagé une réflexion et un début d'exécution extrêmement intéressants. La qualité des services rendus par le ministère devrait s'en trouver améliorée. J'ai tout récemment fait le point avec M. le Directeur général des routes : à la suite de négociations avec les « départements pauvres » - j'hésite à employer l'expression, car je ne sais pas s'il y a des départements riches -, l'État pourrait conserver 1 740 kilomètres en plus des 9 910 kilomètres prévus dans le projet initial. Sous réserve de quelques vérifications en cours, mon objectif est d'envoyer le projet de décret au Conseil d'État dans les tout prochains jours, de façon à ce que le cadre réglementaire soit fixé à la rentrée. Cela permettra tant aux conseils généraux qu'aux directions de l'équipement de se réorganiser dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne l'accompagnement social des mouvements de personnel, le niveau d'information et la prévisibilité des changements d'affectation. M. le Rapporteur : Le transfert instantané ne pose pas de difficultés financières insurmontables, mais les collectivités départementales ont-elles été rassurées en ce qui concerne les ouvrages ou les sections de voirie nécessitant des travaux de grande ampleur ? Il me semble que c'est le point dur. M. Dominique PERBEN : Vous connaissez la règle : avec les routes, nous transférons les crédits d'entretien correspondants. Au demeurant, pour me déplacer beaucoup sur des réseaux routiers étrangers, je ne pense pas que nous ayons à rougir de notre réseau routier national. M. Bernard DEROSIER : Enfin, cela vaut surtout pour les routes que vous gardez ! M. Dominique PERBEN : Les crédits transférés correspondent aux routes transférées. M. le Rapporteur : Si je comprends bien, l'attribution globale ne prévoit pas de dispositif général prenant en compte l'appréciation de l'état du réseau. Les explications que nous a données le Directeur général de la mer et des transports à propos des TER m'ont paru suffisantes et convaincantes. Reste la question des transports interrégionaux. Les textes prévoient bien un transfert de financement pour couvrir les transferts de compétences ainsi que des extensions de compétences. Mais, d'un point de vue juridique, comment imaginez-vous une éventuelle implication des collectivités régionales dans les transports interrégionaux ? Aujourd'hui, l'autorité organisatrice n'est pas bien définie. S'agit-il de la SNCF ou de l'État ? Une nouvelle autorité sera-t-elle désignée pour sortir de ce flou ? Dès lors que la question centrale du transport interrégional est le besoin financier, quels moyens seront transférés ? Les discussions ont été ouvertes il y a plusieurs mois. Quel cadre général envisagez-vous ? M. Dominique PERBEN : Ce n'est qu'une perspective virtuelle. La SNCF constate que les lignes interrégionales sont déficitaires et parle avec l'État ainsi qu'avec les régions. Nous réfléchissons sur ce sujet mais il n'a pas été inclus dans la décentralisation. M. le Président : Notre commission d'enquête ne se borne pas à la décentralisation ; elle a pour objet de rechercher toutes les causes d'augmentation de la fiscalité. M. Dominique PERBEN : Les collectivités, à ma connaissance, ne financent pas ce type de dépenses. Et elles ne sont pas sollicitées par l'État. M. le Rapporteur : Non, mais par la SNCF. M. Dominique PERBEN : La SNCF sollicite aussi l'État ! M. le Rapporteur : Rassurez-moi, M. le ministre : l'État entretient tout de même quelques liens avec la SNCF ! Qui est aujourd'hui l'autorité organisatrice des transports interrégionaux ? M. Dominique PERBEN : C'est l'État. M. le Rapporteur : Un changement d'autorité organisatrice est-il à l'ordre du jour ? M. Dominique PERBEN : Non. M. le Rapporteur : Cette réponse a le mérite d'être claire. M. le Président : À propos du financement des trains régionaux, la Cour des comptes nous a expliqué, hier matin, que l'augmentation des dépenses des régions en 2004 était due à celle des subventions versées à la SNCF. Je note d'ailleurs que les impôts régionaux n'ont pas augmenté en 2004. J'imagine que vous ne contredirez pas la Cour des comptes, M. le Ministre. Ces subventions ne risquent-elles pas encore d'augmenter ? M. Dominique PERBEN : Le transfert de responsabilités et de moyens a été audité. Si les locations de réseau augmentent, le transfert de l'État vers les régions sera accru. En revanche, si les régions souhaitent créer de nouveaux services, cette décision leur appartient, et le financement aussi, sans quoi la décentralisation ne signifierait plus rien. Une dépense ne peut pas être décidée par une collectivité publique et assumée par une autre : c'est clair dans l'esprit de chacun. M. Bernard DEROSIER : L'État agit pourtant souvent de la sorte ! M. Dominique PERBEN : En l'occurrence, ce n'est pas le cas. M. le Rapporteur : Pourriez-vous faire un petit point de la situation du Syndicat des transports d'Île-de-France ? L'État se contentera-t-il de verser ce qui relève de ses obligations légales ou bien, pour des raisons d'opportunité, s'apprête-t-il à accomplir un effort complémentaire - de l'ordre de 200 millions d'euros, nous dit-on - en s'engageant sur une partie du renouvellement de matériel ? Cette seconde option ne donnerait-elle pas un mauvais exemple ? M. Dominique PERBEN : L'État, à ma connaissance, n'a pas l'intention d'aller au-delà de ce que prévoit la loi. Les recettes transférées accompagnant le transfert de responsabilité comportent deux volets : la partie classique, liée au fonctionnement, et ce qui relève du système propre à la RATP - je n'entrerai pas dans le détail, que je ne connais du reste pas encore très bien. Le total représente 529 millions d'euros. M. le Rapporteur : Je me contente de lire les gazettes. M. Dominique PERBEN : J'ai lu, moi aussi, que des demandes sont émises, mais vous connaissez la réponse. M. le Rapporteur : L'État se bornera donc à couvrir le fonctionnement plus le régime de retraite ? L'État considère-t-il qu'une revendication sur le matériel va au-delà de la loi et a-t-il décidé de ne pas répondre à cette demande de la région ? Cela ne me chagrinerait pas particulièrement, du reste. M. Dominique PERBEN : L'État, à ce jour, n'a pas répondu officiellement, et je n'envisage pas de le faire ici. M. le Président : Si vous ne prenez pas cette demande en considération, cela ne risque-t-il pas de provoquer une augmentation d'impôts en Île-de-France ? M. Dominique PERBEN : Je vous ai donné mon sentiment sur le dossier et je n'ai rien d'autre à vous dire. Une réponse juridique extrêmement claire a d'ailleurs été apportée il y a quelques jours au conseil d'administration du STIF. M. le Rapporteur : Pour que la commission d'enquête soit pleinement informée, pouvez-vous nous affirmer que l'État n'a fait aucune proposition complémentaire à ce jour ? M. Dominique PERBEN : Absolument. M. Pierre BOURGUIGNON : Où en est l'État dans ses discussions avec les autorités des diverses agglomérations, à propos des équipements de transport urbain, en particulier pour les modes de transport en site propre comme le tramway ? Certains dossiers ont avancé. Pourriez-vous nous dire ce que l'État entend réaliser dans ce domaine, ce qui nous permettra ensuite d'apprécier quelles seront les conséquences pour les collectivités territoriales ? M. Dominique PERBEN : Le système de relations que l'État entretient avec les collectivités territoriales est connu. L'État, dans toutes les fonctions qu'il exerce, et pas seulement les transports ou l'équipement, mène des politiques qui prennent des formes différentes au fil du temps, ce qui amène à faire évoluer la répartition des charges financières entre collectivités. Le système de subvention de l'État aux transports publics urbains a été modifié dans la loi de finances pour 2004. Ce changement implique, de la part de l'État, une aide supplémentaire pour les collectivités équivalant à 8 % de la masse globale. Des réflexions sont en cours pour recréer d'autres mécanismes permettant d'accompagner les collectivités organisatrices de transport urbain dans leurs efforts d'investissement, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions. M. Charles de COURSON : Pour le transfert des routes nationales aux conseils généraux, la compensation s'effectue à l'euro près en matière de fonctionnement, sous réserve du délicat problème des retraites. Le vrai problème est que l'investissement n'est pas concerné. Vous partez du principe que la proportion des routes transférées est globalement à peu près équivalente à celle du coût du volet routier des contrats de plan, assumé par les collectivités territoriales, essentiellement les départements et les régions. Cette thèse, M. le ministre, n'est cependant défendable que jusqu'à la fin des contrats de plan, et ce pour deux raisons. Premièrement, plusieurs présidents de région ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils se réservaient des marges de manœuvre et ne prenaient aucun engagement, vu l'état de leurs finances, quant au maintien de leurs aides dans les mêmes proportions après le terme des contrats de plan. Deuxièmement, ces contributions étaient des fonds de concours « librement » consentis - si ce n'est qu'il fallait obligatoirement en passer par là pour obtenir des crédits d'État. Comment voyez-vous l'évolution de la situation à l'issue des contrats de plan en cours, c'est-à-dire dans les quatre ou cinq ans à venir ? Par ailleurs, où en est le transfert de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance ? Où en est la modulation promise par le Gouvernement ? Il conviendrait de légiférer dès la loi de finances 2006. Comment les bases seront-elles évaluées ? Pourriez-vous faire un point technique sur ce sujet ? M. Dominique PERBEN : Trois contributeurs participent au financement des routes : l'État, les régions et les départements. Lors du transfert des routes par l'État, s'est posée la question de prévoir une contribution des régions, mais tel n'a pas été le choix, ce qui peut effectivement laisser planer une incertitude sur le financement ultérieur des routes nationales. En effet, si une région décidait de suspendre son aide, elle enregistrerait un gain net et pourrait réduire sa fiscalité. Il me semble que c'est un élément digne d'intérêt pour votre Commission d'enquête. Je rappelle toutefois que le décroisement va coûter de l'argent à l'État, ce qui constitue une source de préoccupation pour les prochaines lois de finances. De surcroît, l'éligibilité à la TVA, depuis le 1er janvier, va dans le sens des intérêts des collectivités territoriales. Enfin, je ne connais pas suffisamment le dossier de la TSCA pour être en mesure de vous répondre. M. le Président : Je recommande aux collègues intéressés de se mettre en relation avec les services de la commission d'enquête pour prendre connaissance du rapport confidentiel de l'Inspection générale des finances relatif aux conventions d'assurance, qui nous a été transmis à ma demande. M. Bernard DEROSIER : M. le Ministre, le juriste que vous êtes m'autorisera une petite rectification. Vous avez dit que les routes avaient été transférées par la loi. En fait, elle pose le principe et c'est le décret qui va procéder au transfert. Pour ma part, je conteste ce pouvoir régalien de l'État, qui décidera des transferts sans qu'une discussion soit possible. La loi prévoit des transferts de routes nationales accompagnés de crédits. Mais il est difficile de savoir, route nationale par route nationale, ce que l'État a consacré, d'une part, aux routes dont le transfert est envisagé et, de l'autre, à celles qu'il gardera. J'imagine que vous ne pourrez pas nous répondre sur le champ - à moins que les éminents collaborateurs qui vous entourent soient en mesure de vous apporter immédiatement la réponse - mais je souhaiterais que la commission d'enquête soit destinataire de cette information, sur cinq ans. M. le Président : La question est importante. Ce qui manque le plus, dans cette phase de décentralisation, c'est la transparence en matière d'évaluation des charges transférées : nous sommes dans le brouillard. M. le Rapporteur : J'imagine que ces données ont été transmises à la Commission consultative d'évaluation des charges. M. Bernard DEROSIER : Non. J'y siège et M. Augustin Bonrepaux la préside ! M. le Rapporteur : Je n'en savais rien car je n'en fais pas partie. M. Bernard DEROSIER : Eh bien, la réponse est non. M. Dominique PERBEN : Si cela n'a pas été transmis, je souhaite vous le transmettre. Le système de ratios s'applique à l'ensemble des routes, en fonction du trafic. Le calcul est donc parfaitement transparent. M. le Président : Pour le fonctionnement, mais pas pour les investissements. Il faudrait évaluer les investissements réalisés sur les routes transférées et sur celles conservées par l'État. J'ajoute, les chiffres de l'équipement en attestent, que les investissements totaux ont progressé régulièrement jusqu'en 2001, puis qu'une stagnation a été enregistrée de 2001 à 2004. Cela pèse donc sur le niveau de la compensation, puisqu'elle est calculée sur la base des dernières années. M. le Rapporteur : Je compulserai les rapports que j'ai rendus en qualité de Rapporteur spécial du budget des transports, mais je ne me souviens pas avoir observé ce phénomène ni en 2003, ni en 2004, ni en 2005. M. le Président : Je vous renvoie pour ma part au témoignage de la direction générale des routes. M. Dominique PERBEN : La référence choisie porte sur la période de cinq ans la plus favorable aux collectivités territoriales. M. le Président : Si vous le souhaitez, M. le Ministre, je peux faire prêter serment à vos collaborateurs pour qu'ils répondent plus précisément. M. Dominique PERBEN : Je viens de vous répondre. Où est le problème ? M. le Président : On nous a expliqué, en Commission consultative, que le budget des routes avait régulièrement augmenté jusqu'en 2001 puis s'était stabilisé. Certes, les simulations tendent à prouver que le choix retenu est le meilleur. Il n'en demeure pas moins que la façon dont la décentralisation a été préparée et la modification de la Constitution pénalisent les collectivités territoriales. M. Bernard DEROSIER : Très bien ! Le ministère nous fournira-t-il le tableau que nous réclamons ? M. le Rapporteur : Il me semble, M. le Président, que votre affirmation n'est pas exacte, du moins pour la période 2003-2005. Je crois me souvenir, sous réserve de vérification, que l'effort d'investissement de l'État, sur le réseau considéré, a un peu augmenté. Mais M. le Ministre va certainement nous répondre. M. le Président : Je parle des investissements sur les routes transférées. M. Dominique PERBEN : J'ai répondu aux questions qui m'ont été posées sur les montants transférés, donc pour ce qui concerne le fonctionnement. Je n'avais pas à répondre sur l'investissement, qui ne figure pas dans la loi. Il n'y avait pas lieu pour moi de l'évoquer. M. Bernard DEROSIER : Et voilà ! M. Dominique PERBEN : Les crédits d'entretien ont été transférés sur une période de cinq ans, qui était la plus favorable aux collectivités. C'est sur cette base que la loi de la République a été adoptée, puisque la Commission consultative a donné un avis favorable. M. Bernard DEROSIER : Je ne conteste pas ce que vous dites, mais je demande que vous fournissiez à la commission d'enquête un tableau faisant apparaître, sur cinq ans, la répartition des crédits de fonctionnement alloués, d'une part, aux routes conservées et, de l'autre, aux routes transférées. M. le Président : Pourrez-vous nous transmettre ce tableau ? M. Dominique PERBEN : Certainement. M. le Rapporteur : J'ai une dernière question. Êtes-vous favorable au transfert du Fonds d'aménagement de la région Île-de-France à la région elle-même ou au STIF ? J'ai bien compris qu'aucune décision n'est encore prise, mais j'aimerais connaître votre avis. M. Dominique PERBEN : Cette hypothèse est actuellement étudiée au niveau interministériel par le Gouvernement et je ferai connaître la décision lorsqu'elle aura été prise. M. le Président : Nous n'avons guère parlé des contrats de plan. Les régions et, parfois, les départements ont été contraints de procéder à des avances de crédits. Par ailleurs, l'État refuse de prendre en charge les surcoûts qui sont souvent enregistrés. M. Dominique PEERBEN : J'ai évoqué ce point dans mon propos liminaire. Autant il est exact que les régions ont payé plus vite que l'État, autant les régions n'ont jamais payé la part de l'État. M. le Président : Mais elles ont consenti des avances. M. Dominique PERBEN : Pas à ma connaissance ; sauf erreur de ma part, elles n'ont jamais dû prendre en charge des montants excédant leurs quotes-parts. M. Charles de COURSON : Je signale à M. le Ministre que, dans mon département, pour que les délais demandés par l'État ne retardent pas la réalisation de certains équipements, nous avons versé nos fonds de concours par avance, l'État versant son dû dans une seconde phase. Je peux citer à cet égard l'exemple, parmi d'autres, de la déviation de Fère-Champenoise. M. le Président : Et c'est aussi le cas dans d'autres départements. Plusieurs régions nous affirment également que, lorsque les prévisions de coûts sont dépassées, l'État ne participe pas au supplément. M. Dominique PERBEN : Il serait intéressant de se fonder sur des cas précis. En principe, chacun doit payer sa part de surcoûts, y compris l'État. M. le Président : Mais il ne l'a pas fait. M. Dominique PERBEN : Je suis prêt à vous croire... M. Charles de COURSON : La question est très délicate. Nous ne pouvons pas accepter de prendre en charge notre prorata du surcoût car nous n'y sommes pour rien. Le problème, c'est que, dans les contrats de plan, la règle selon laquelle les fonds de concours sont forfaitaires et non révisables n'a jamais été clairement écrite. M. Dominique PERBEN : La bonne pratique consiste à partager les surcoûts au prorata de la clé de répartition, mais les collectivités territoriales peuvent évidemment refuser cette solution logique. M. Charles de COURSON : Des surcoûts de 25 à 30 % sont parfois imputables à des prescriptions fixées par vos services postérieurement à la signature du contrat de plan. Dans de tels cas, il n'est pas sain de faire payer les collectivités. M. Dominique PERBEN : Nous sortons un peu de la thématique des contrats de plan. Les normes relèvent des compétences régaliennes de l'État et leurs conséquences financières n'ont rien à voir avec le débat sur la répartition des charges entre collectivités publiques. Toute décision législative ou réglementaire n'a pas de raison de faire l'objet d'une compensation à l'égard de secteurs économiques, d'entreprises ou de particuliers. Ne mélangeons pas le rôle de l'État investisseur, partenaire des collectivités territoriales, et ses missions régaliennes. M. le Président : Au rythme actuel, le retard dans la réalisation des contrats de plan serait de deux à trois ans pour les routes et de cinq à six ans pour le réseau ferré. Le plan de relance annoncé par le Premier ministre permettra-t-il de réduire ces délais ? Quels moyens lui seront consacrés ? M. Dominique PERBEN : Fin 2004, pour les routes, nous en étions à 50 % d'exécution ; en intégrant les mesures prises dans la loi de finances pour 2005, nous atteignons 58 %. Quel sera l'effet de ce que vous avez appelé le plan de relance ? Nous sommes en train de travailler sur cette question et le Premier ministre, le moment venu, fera connaître ses décisions. M. le Président : Avez-vous une idée de la date à laquelle ce plan de relance verra le jour ? Avant la fin de l'année ? M. Dominique PERBEN : Oui. M. le Président : Les régions affirment être très souvent sollicitées par l'État dans des domaines qui ne relèvent pas de leur compétence, notamment pour la réalisation de lignes TGV. Cela ne contribue-t-il pas à expliquer que les régions augmentent les impôts ? M. Dominique PERBEN : Il y a très peu de cas. Les régions concernées par le TGV-Est se sont en effet engagées. M. Charles de COURSON : J'en témoigne... M. le Président : Pas seulement elles. D'autres régions sont concernées par des études sur des lignes futures. L'État n'utilise-t-il pas ce moyen au risque de provoquer des augmentations d'impôts et de déplorer ensuite que les collectivités territoriales recourent à cet expédient ? M. Dominique PERBEN : Il est rare que l'on augmente les impôts pour financer des études... M. le Président : M. le Ministre, je vous remercie de vos réponses. ---------- N° 24136 -Rapport au nom de la commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale - tome 2 : Auditions (M. Augustin Bonrepaux, Président - M. Hervé Mariton, rapporteur) * * * Liste des auditions du Rapporteur et du Président · M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille · M. Dominique SCHMITT, Directeur général des collectivités locales, accompagné de M. François Lucas, adjoint au Directeur général · M. Vincent MAZAURIC, · Mme Christine BUHL, · M. Jean-Luc TAVERNIER, directeur, · M. Yves MARCHAND, · M. Alain MATHIEU · M. Luc-Alain VERVISCH, · M. Jean HYENNE, · M. Jacques CREYSSEL, · Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, · M. Charles DECONFIN, * * * 10 Rapport d'information n°71 (2003-2004) de Yves FRÉVILLE, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 19 novembre 2003 ; voir copie du tableau jointe, tome III du présent rapport. 11 L'étude a été conduite sur la base des données 2001, établies en francs. © Assemblée nationale |