

![]()
N° 1718
--
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 juillet 2004.
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 4 mars 2004 (1)
sur le traitement de la récidive des infractions pénales,
PRÉSIDENT
M. Pascal CLÉMENT
RAPPORTEUR
M. GÉRARD LÉONARD,
Députés.
--
(1) La mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales est composée de : M. Pascal Clément, président ; M. Gérard Léonard, rapporteur ; MM. Xavier de Roux, Christophe Caresche, Christian Estrosi, Georges Fenech, Jean-Paul Garraud, Guy Geoffroy, Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Lambert, Michel Piron, André Vallini, Michel Vaxès et Jean-Luc Warsmann.
_________________________________________
INTRODUCTION 7
I. - LA RÉCIDIVE : UN RÉGIME JURIDIQUE STRICT, UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À MESURER 10
A. RÉCIDIVE LÉGALE, CONCOURS D'INFRACTIONS, RÉITÉRATION : UNE NÉCESSAIRE
CLARIFICATION DES TERMES DU DÉBAT 10
1. Récidive légale et concours d'infractions : des définitions strictes mais complexes 10
2. La réitération, une notion définie dans le silence de la loi 12
B. LA RÉCIDIVE, UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE SANS PEINE « PLANCHER » : UN CHOIX EUROPÉEN CONFORTÉ PAR DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES 14
1. Les exemples étrangers 14
2. Le respect des principes constitutionnels de nécessité des peines et de séparation des pouvoirs 22
C. LA RÉCIDIVE : UN PHÉNOMÈNE À LA MESURE INCERTAINE 23
1. Des difficultés d'ordre méthodologique 23
a) La récidive : une notion juridique trop étroite que les données statistiques ne peuvent mesurer avec précision 23
b) Le problème de l'effacement automatique du casier judiciaire des fiches concernant les mineurs devenus majeurs 24
2. Une grande disparité des taux de réitération selon la nature des infractions 25
a) Un taux de réitération en augmentation mais un taux de retour en prison stable 26
b) Une corrélation délicate à interpréter entre les modalités de la libération et le taux de réitération 27
c) De fortes disparités selon la nature des infractions 27
II. - LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LA CHAÎNE PÉNALE 30
A. AU STADE DU PRONONCÉ DE LA PEINE : UNE JUSTICE SÉVÈRE MAIS AVEUGLE ? 30
1. Des pratiques judiciaires variables 30
2. Des délais d'inscription au Casier judiciaire préoccupants et des modalités d'accès aux informations inadaptées 34
B. AU STADE DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE : UNE JUSTICE QUI TOURNE À VIDE ? 37
1. Le problème de la non-exécution des courtes peines d'emprisonnement et des mesures alternatives à l'incarcération. 37
2. Une situation en voie d'amélioration à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 41
C. AU STADE DE L'INCARCÉRATION DU CONDAMNÉ : UNE DANGEROSITÉ MÉSESTIMÉE ? 42
1. Une population carcérale qui cumule les difficultés 42
2. Une insuffisante évaluation de la dangerosité des détenus 43
3. Un système judiciaire amnésique 48
4. Une offre de soins psychiatriques insuffisante 49
D. AU STADE DE LA LIBÉRATION OU DU SUIVI DE LA MISE À L'ÉPREUVE : LES SERVICES DE L'APPLICATION DES PEINES OUBLIÉS PAR LA JUSTICE ? 50
1. La misère de l'application des peines 50
2. Les dangers des « sorties sèches » de détention, facteurs de récidive 52
3. Les inconséquences du suivi socio-judiciaire 54
III. - LES PROPOSITIONS DE LA MISSION : 20 MESURES POUR PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE 57
A. SANCTIONNER PLUS SÉVÈREMENT LES RÉCIDIVISTES 57
a) En mettant en place des procédures adaptées 57
1. Prévoir l'incarcération immédiate des récidivistes sexuels ou violents 57
2. Limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve 58
3. Limiter les réductions de peines pour les récidivistes 58
4. Appliquer la récidive à toute réitération de faits commis avec violence 59
5. Autoriser le tribunal correctionnel à relever d'initiative la récidive 59
6. Appeler, par voie de circulaire du Garde des Sceaux, les procureurs de la République à relever de façon systématique la récidive 59
b) En assurant une meilleure information des magistrats 60
7. Moderniser les modalités de consultation du Casier judiciaire en recourant aux nouvelles technologies de l'information 60
8. Adopter un plan d'urgence pour le Casier judiciaire afin de combler le retard dans la saisie et le traitement des jugements 60
9. Définir la réitération pour clarifier le débat public 60
10. Mettre en place un outil statistique permettant une mesure précise de la récidive et de la réitération 61
B. PRÉVENIR PLUS EFFICACEMENT LA RÉCIDIVE 61
a) En faisant de l'application des peines une priorité afin d'éviter les « sorties sèches » de détention 61
11. Offrir 20 % des postes à l'issue de l'E.N.M. au profit des juges de l'application des peines pendant 5 ans 61
12. Revaloriser et renforcer les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation 61
13. Conforter les moyens dédiés aux associations de réinsertion et d'hébergement 62
b) En prévoyant un suivi des détenus les plus dangereux 62
14. Évaluer la dangerosité des détenus et les risques de récidive au cours de la détention 62
15. Engager le débat sur le placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux ayant purgé leur peine 63
16. Augmenter le nombre de médecins psychiatres en pourvoyant les postes vacants dans le secteur public 64
17. Introduire une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle 64
18. Associer les psychologues cliniciens à la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire 64
19. Transférer au juge la compétence pour prononcer l'hospitalisation d'office des prévenus ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits 65
20. Mettre en place un fichier recensant les personnes ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits 65
TRAVAUX DE LA COMMISSION :
· AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES 67
· EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 79
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 83
__________________________________________
31 % de récidivistes et 32 % de peines inexécutées (1)... A elles seules, ces deux données résument les difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif tout comme elles expliquent la préoccupation, voire l'exaspération, parfois manifestée par nos concitoyens. En effet, ceux-ci subissent quotidiennement les conséquences de ces dysfonctionnements, s'interrogent sur leurs causes et s'inquiètent du sentiment d'impunité qu'ils nourrissent chez les délinquants. Cette situation est d'autant plus paradoxale que, depuis deux ans et grâce à l'action déterminée menée par le Gouvernement, la délinquance ne cesse de diminuer dans notre pays, à l'exception des faits de violence qui ont crû de 10 % entre 2003 et 2004.
Aborder la question de la récidive des infractions pénales, c'est donc manifester la volonté d'engager le second acte de la lutte contre l'insécurité en s'attaquant au « noyau dur » de la délinquance, aux personnes qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, perdurent dans leurs habitudes criminelles.
Se saisir de cette question, c'est également faire accéder à la sphère du débat public et démocratique un phénomène peu connu, si ce n'est des seuls magistrats, policiers ou experts en criminologie.
Le mérite de cette initiative revient, sans conteste, à la proposition de loi (2) tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive présentée par notre collègue Christian Estrosi, cosignée par un grand nombre de députés dont MM. Philippe Folliot, Jean-Paul Garraud, Marc Le Fur et votre rapporteur. Injustement caricaturée comme prévoyant uniquement l'automaticité du prononcé de peines d'emprisonnement à l'encontre des récidivistes, puisque le dernier alinéa de son article 2 dispose expressément que le juge peut ne pas ordonner une telle peine lorsque le prévenu présente des garanties sérieuses d'insertion, cette proposition de loi a surtout pour objet de s'assurer de l'effectivité de la peine. Au débat réducteur sur « l'automaticité » du prononcé de la peine, votre rapporteur préfère donc celui portant sur la recherche de la « certitude » de la peine et de son exécution.
En effet, parce qu'elle atteste d'un enracinement dans la délinquance, la récidive signale la dangerosité sociale d'un individu et doit conduire au prononcé de sanctions aggravées mises en œuvre rapidement. Notre code pénal prévoit d'ailleurs le doublement des peines encourues lorsque l'auteur d'un délit se trouve en situation de récidive légale (articles 132-9 et 132-10). Si la plupart des systèmes pénaux s'accordent sur cette nécessaire aggravation des peines, le choix des autorités compétentes pour ce faire est particulièrement divers et changeant. S'agit-il de la loi qui, en encadrant le pouvoir d'appréciation du juge par des peines minimales, garantit l'égalité de traitement des citoyens devant la loi, au détriment de la prise en considération de la situation personnelle de l'auteur des faits et au risque de sanctions disproportionnées ? A cet égard, Benjamin Constant n'estimait-il cependant pas qu' « étendre sur tous les objets la compétence de la loi, c'est organiser la tyrannie » ? (3)
A l'inverse, s'agit-il du juge qui doit apprécier seul la peine la mieux adaptée aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu qui a pu évoluer depuis la commission des faits, au risque de conduire sur l'ensemble du territoire au prononcé de peines différentes pour des faits recevant pourtant la même qualification pénale ? Hanté par le spectre de l'erreur judiciaire, Voltaire écrivait ainsi, dans son dictionnaire philosophique, « que toute loi soit claire, uniforme et précise : l'interpréter, c'est presque toujours la corrompre »(4).
L'histoire de la récidive dans notre code pénal est emblématique de ces hésitations et débats. Circonstance aggravante dans le code pénal de 1810 que le juge pouvait ne pas relever lorsqu'il constatait l'existence de « circonstances atténuantes » (5), la récidive légale fut remplacée en 1885 par la relégation qui était une peine obligatoire, coloniale puisque exécutée en Guyane et perpétuelle, applicable aux seuls multirécidivistes. Par la suite, la loi du 17 juillet 1970 substitua la tutelle pénale à la relégation, dont l'application par le juge était facultative, l'exécution métropolitaine et la durée temporaire. Puis, la loi « sécurité et liberté » du 2 février 1981 supprima la tutelle pénale avant que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, considère de nouveau la récidive comme une circonstance aggravante.
Confrontée à ce débat ancien, complexe mais d'actualité, la mission a procédé avec modestie, méthode et pragmatisme.
Modestie d'abord, car si la question de la récidive est peu connue, elle est surtout mal mesurée par les outils statistiques existants. En effet, la récidive ayant une définition juridique particulièrement stricte, aucune statistique judiciaire ni policière n'est en mesure de l'évaluer avec précision. Rappelons, à cet égard, qu'un condamné pour vol qui, dans les cinq années qui suivent, dégrade volontairement des biens et commet des outrages n'est pas en situation de récidive légale au sens du code pénal puisqu'il ne s'agit pas de la même infraction. Aussi, les nombreuses études statistiques disponibles mesurent-elles davantage la réitération que la récidive légale. Essayer d'obtenir une image précise de la récidive, par catégorie d'infraction, selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit a donc constitué le premier objectif que s'est assignée la mission.
Méthode ensuite, puisque la mission a procédé à près de 25 auditions de personnalités concernées par la question de la récidive, qu'il s'agisse de magistrats, de policiers, d'avocats, de professeurs de droit, d'associations de victimes, de médecins psychiatres ou de directeurs d'établissements pénitentiaires. La mission a ainsi pu établir à chaque étape du procès pénal, de l'audience de jugement au suivi du condamné en milieu ouvert en passant par l'exécution des décisions de justice, un constat précis de la prise en considération de la récidive et de ses difficultés.
Pragmatisme enfin, puisque les propositions de la mission fondées sur ce constat tentent d'apporter des réponses précises et équilibrées à chaque difficulté identifiée en privilégiant le renforcement de la répression des récidivistes tout en prônant l'amélioration de la prévention de la récidive.
I. - LA RÉCIDIVE : UN RÉGIME JURIDIQUE STRICT, UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À MESURER
A. RÉCIDIVE LÉGALE, CONCOURS D'INFRACTIONS, RÉITÉRATION : UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION DES TERMES DU DÉBAT
1. Récidive légale et concours d'infractions : des définitions strictes mais complexes
La commission de plusieurs infractions successives par un même délinquant peut engendrer un certain nombre de situations profondément distinctes les unes des autres en droit bien que, dans les faits, nombre d'observateurs les qualifient indistinctement de « récidive ».
· Ainsi, il y a « concours réel d'infractions » lorsque plusieurs infractions ont été commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu. Tel est le cas, à titre d'exemple, lorsque l'une des condamnations est encore susceptible d'opposition. Dans cette hypothèse, l'auteur de ces infractions multiples ne subira qu'une seule peine : celle qui frappe l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi (articles 132-3 et 132-4 du code pénal).
Cette règle de l'application de la peine la plus forte concerne aussi bien les infractions qui ont été poursuivies en même temps et qui ont fait l'objet d'un jugement unique, que celles ayant fait l'objet de plusieurs poursuites et, partant, de plusieurs jugements. Toutefois, dans le premier cas, les juges saisis pourront au stade du jugement et lors du prononcé de la peine régler les conséquences de la pluralité d'infractions. En revanche, lorsque plusieurs jugements sont intervenus, ces conséquences ne seront en mesure d'être tirées qu'au stade de l'exécution des peines prononcées qui est mise en œuvre par le parquet selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, l'application de cette règle du cumul des peines aboutissant généralement « à un résultat plus sévère que celui auquel aurait abouti le jugement des infractions en concours dans une procédure unique » (6), l'article 132-4 du code pénal autorise, par dérogation, les juridictions à ordonner la confusion des peines. La confusion des peines est le procédé juridique par lequel une peine, qualifiée de peine absorbée, est réputée s'exécuter en même temps qu'une autre peine de même nature mais plus forte, dite absorbante. En outre, le condamné peut également demander la confusion des peines de même nature dans la limite du maximum légal devant toute juridiction ayant prononcé l'une des peines visées par la requête en application des dispositions des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.
· En revanche, il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive (appelée le « premier terme » de la récidive), le délinquant commet une nouvelle infraction (« second terme »). C'est cette nouvelle infraction qui va entraîner l'aggravation de la peine prévue par la loi.
Toutefois, les articles 132-8 et suivants du code pénal, relatifs à la circonstance aggravante en cas de récidive, distinguent plusieurs hypothèses selon la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel elle a été commise :
- Ainsi, lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle commet à nouveau un crime, quelque soit le temps écoulé entre ces deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté, soit à la réclusion à perpétuité, s'il est puni d'une peine de vingt ou trente ans de réclusion, soit à trente ans de réclusion criminelle, s'il est puni d'une peine de quinze ans d'emprisonnement (en application des dispositions de l'article 132-8 dudit code). Cette catégorie de récidive est qualifiée de « générale et perpétuelle » ;
- Pour sa part, l'article 132-9 dispose que le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende encourus est doublé si, après une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet, soit un nouveau délit puni de dix ans d'emprisonnement dans les dix ans suivants l'expiration ou la prescription de la précédente peine, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an dans les cinq ans suivants l'expiration ou la prescription de la précédente peine. Compte tenu de ces délais, cette catégorie de récidive est dénommée « générale et temporaire » ;
- Le quantum des peines d'emprisonnement et d'amende est également doublé si, après une condamnation définitive pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commet, dans les cinq ans suivants l'expiration ou la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est « assimilé » au sens du code pénal (article 132-10). A titre d'exemple, l'article 132-16 dispose que le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés comme une même infraction au regard de la récidive. Cette catégorie de récidive est qualifiée de « spéciale et temporaire ».
- Enfin, en matière contraventionnelle, il n'y a récidive que lorsqu'une personne, après une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe, commet, dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Dans cette hypothèse, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros. Toutefois, la récidive ne peut être prise en compte que si le règlement l'a expressément prévue (article 132-11). Il s'agit donc d'une récidive spéciale, temporaire et expresse. Le tableau suivant récapitule ces différentes hypothèses.
|
TABLEAU DES CAS DE RÉCIDIVE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES |
|||||
|
Nature de la |
Nature de la |
Délai de |
Aggravation |
Article du |
Catégorie de |
|
Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement |
Crime passible de 20 ou 30 ans de réclusion |
Pas de délai |
Réclusion criminelle |
132-8 |
Récidive générale et perpétuelle |
|
Crime passible de 15 ans de réclusion |
30 ans de réclusion |
||||
|
Délit passible de 10 ans d'emprisonnement |
10 ans |
Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue |
132-9, al. 1 |
Récidive générale et temporaire |
|
|
Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an |
5 ans |
132-9, al. 2 |
|||
|
Autres délits |
Délit identique |
5 ans |
132-10 + 132-16, 132-16-1, 132-16-2, 321-5 |
Récidive spéciale |
|
|
Délit assimilé |
|||||
|
Contravention |
Contravention identique |
1 an |
Amende portée |
132-11 |
Récidive spéciale, temporaire et |
|
(1) Calculé à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction. |
|||||
2. La réitération, une notion définie dans le silence de la loi
A la différence des régimes relatifs au concours d'infractions ou à la récidive définis dans le code pénal, la « réitération d'infractions » est une hypothèse dont le régime juridique se déduit dans le silence de la loi, ce qui n'est guère satisfaisant et source de confusion.
· La réitération, une notion judiciaire a contrario
Il y a réitération, au sens judiciaire, lorsque la personne a déjà été condamnée définitivement et qu'elle commet une nouvelle infraction mais dans des conditions ne correspondant pas au cadre de la récidive légale.
La réitération n'en possède pas moins des conséquences juridiques, puisqu'elle autorise le cumul des peines sans limite, sans constituer pour autant une circonstance aggravante à l'instar de la récidive légale.
A titre d'exemple, il peut s'agir d'un délinquant, condamné définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement qui commet :
- une nouvelle infraction au-delà du délai de cinq ans après l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction ;
- une nouvelle infraction qui n'est pas la même que la précédente ;
- une nouvelle infraction qui n'est pas « assimilée » à la première au sens du code pénal, ce qui recouvre de très nombreuses hypothèses.
En effet, les dispositions tendant à l'assimilation d'infractions différentes ne concernent que trois catégories de crimes et délits :
- ceux commis contre les biens qui sont le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance (article 132-16 du code pénal). En revanche, la demande de fonds sous contrainte introduite par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 312-12-1 du code pénal) ne figure pas parmi cette énumération ;
- les délits d'agressions ou d'atteintes sexuelles (article 132-16-1 du même code) ;
- les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule routier et par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence (article 132-16-2 du même code).
Ainsi, un très grand nombre de délits contre les personnes n'entrent pas dans le champ des délits assimilés bien qu'ils possèdent d'évidentes parentés en termes criminologiques, à l'instar du proxénétisme et de la traite des êtres humains. En outre, en dépit de la baisse générale de la délinquance(7), le nombre des violences commises contre les personnes ne cesse de croître (+ 10 % en un an) ce qui plaide pour une réponse pénale ferme et, partant, une réforme des règles de la récidive en cette matière. Dans ces conditions, la mission souhaite, d'une part, compléter la catégorie des délits « assimilés » par une disposition spécifique aux infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains et, d'autre part, assimiler, au sens du droit de la récidive, l'ensemble des infractions commises avec violence volontaire ou avec la circonstance aggravante de violence, qu'il s'agisse de crimes ou de délits contre les personnes ou contre les biens (proposition n° 4).
· La réitération, une notion policière empirique
La réitération possède une acception policière évidente qui ne correspond pas à la définition judiciaire de ce phénomène. En effet, comme l'a indiqué à la mission le directeur général de la police nationale, M. michel Gaudin, il y a réitération au sens des services de police lorsqu'une même personne est signalée à plusieurs reprises comme auteur d'infractions et figure, à ce titre, dans le fichier « stic » (8). Il s'agit donc d'une mesure empirique des délinquants d'habitude, confortée par une connaissance du milieu criminogène local, qui n'a pas de valeur scientifique.
Si dans la pratique la réitération concerne, en premier lieu, les mineurs impliqués dans la délinquance de voie publique, leur part dans la criminalité globale ne peut cependant être précisément mesurée par les outils statistiques à la disposition des services concernés. En effet, l'instrument statistique policier fondé sur « l'état 4001 » recense les faits constatés et leur élucidation sans que les antécédents judiciaires ou policiers de l'auteur n'apparaissent en raison de l'absence de définition juridique de la réitération.
Cette situation n'est pas satisfaisante puisqu'elle ne permet pas aux différents acteurs concernés par la réitération, qu'il s'agisse des policiers ou des magistrats, d'établir un diagnostic partagé fondé sur la mesure d'un phénomène à la définition commune. Une clarification de la définition de la réitération est donc nécessaire et aurait le mérite d'améliorer sa mesure par les instruments statistiques dont disposent les forces de l'ordre (propositions n° 9 et 10).
B. LA RÉCIDIVE, UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE SANS PEINE « PLANCHER » : UN CHOIX EUROPÉEN CONFORTÉ PAR DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES
Parce qu'elle révèle un enracinement dans la délinquance et une dangerosité accrue, la répétition d'infractions par une même personne conduit dans la quasi-totalité des États au prononcé de sanctions accrues mais selon des modalités juridiques variables. En effet, deux grands régimes judiciaires peuvent être distingués selon les fonctions assignées à la peine : ceux prévoyant des peines minimales automatiques (« peines plancher ») et qui s'observent, à titre principal, dans les pays anglo-saxons de common law et ceux, majoritaires en Europe, faisant de la récidive une circonstance aggravante que le juge peut relever en fonction de la personnalité du condamné.
· Les peines planchers automatiques : un dispositif adapté aux pays de Common-Law où la fonction « rétributive » de la peine prévaut
Parce qu'ils privilégient la fonction « rétributive » de la peine, tendant à infliger au délinquant une souffrance « compensant » le mal qu'il a causé à la société, les systèmes anglo-saxons, à l'instar de ceux des États-unis, de l'Australie ou de la Grande-Bretagne, prévoient le prononcé de peines automatiques à l'encontre des récidivistes, sans que le juge du siège saisi puisse retenir une peine inférieure.
Emblématique de cet automatisme, la loi adoptée par l'État de Californie en 1994 oblige le juge a prononcer une peine s'échelonnant de 25 années d'emprisonnement à la réclusion à la perpétuité lorsque la même personne est condamnée pour la troisième fois(9), sans que la nature des infractions ou à la prescription des faits ne soient prises en considération. C'est en application de ces dispositions que, à titre d'exemple, M. Luciano Orozo a été condamné en janvier 1996 à la réclusion perpétuelle assortie d'une mesure de sûreté de 25 ans pour détention de 0,5 gramme d'héroïne, cette infraction ayant été précédée, en 1981 et 1988, de deux condamnations pour vol avec effraction. De même, en 1995, M. René Landa a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 27 ans pour le vol d'une roue de secours précédé, en 1972 et 1986, de deux condamnations pour vol avec effraction.
Par ailleurs, mais au niveau fédéral cette fois, les sanctions prononcées par les juges s'inscrivent également dans un cadre particulièrement contraint puisqu'ils doivent respecter des « recommandations » (10) qui déterminent, pour chaque infraction, la peine applicable en fonction de deux paramètres : celui relatif à la gravité du délit et celui tenant au passé judiciaire du prévenu. Pour ce faire, le juge fédéral américain doit recourir à un tableau où figure, d'une part et horizontalement, le passé pénal du prévenu divisé en six rubriques par ordre de gravité croissante auquel correspond un système de points et, d'autre part et verticalement, des niveaux hiérarchisant la gravité de l'infraction qui sont au nombre de 43. La peine d'emprisonnement « recommandée » se situe à l'intersection de ces deux axes, le juge disposant d'une marge d'appréciation de six mois d'emprisonnement seulement. Toutefois, chaque infraction peut faire l'objet d'ajustements correspondants à l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes ayant pour effet de modifier le niveau de gravité des faits(11).
Sans sombrer dans de telles rigidités, la Grande-Bretagne a récemment adopté une législation (12) prévoyant le prononcé de peines minimales pour certaines infractions particulièrement graves énumérées par la loi. Ainsi, en application des dispositions de l'article 109 de cette loi, le juge doit prononcer une peine de réclusion à perpétuité lorsque la personne a déjà été condamnée une première fois (quelque soit la nature de cette infraction) et qu'elle a ensuite commis une tentative de meurtre, des coups ayant entraîné la mort, un viol ou une tentative de viol. En outre, l'article 110 de cette même loi prévoit qu'une peine minimale de sept années d'emprisonnement doit être prononcée à l'encontre de l'auteur d'un trafic de stupéfiant relevant de la catégorie « A » (héroïne, cocaïne..) qui a déjà été condamné pour des faits similaires à deux reprises. Enfin, une peine de trois ans d'emprisonnement doit sanctionner les auteurs de cambriolage ayant déjà été condamnés pour des faits similaires à deux reprises.
Le juge peut néanmoins renoncer à prononcer ces différentes sanctions par une décision motivée et lorsque des « circonstances exceptionnelles » le justifient. Cette disposition rappelle le droit applicable en France sous l'empire de l'ancien code pénal dans lequel les quantum des peines par infractions étaient enserrés entre un maximum et un minimum auxquels le juge pouvait cependant déroger lorsqu'il constatait des circonstances « atténuantes » de nature à limiter la responsabilité du coupable. De surcroît, et à l'instar des dispositions applicables aux États-Unis, le Gouvernement britannique a initié une réforme de la justice pénale tendant à instaurer des « recommandations » quant à la peine applicable auxquelles les juges devront se conformer.
Somme toute, si le principe des peines automatiques garantit l'égalité des citoyens devant la loi pénale, ce système n'en dispose pas moins d'un important élément de souplesse, à défaut duquel l'automaticité stricte des sanctions conduirait nécessairement au prononcé de peines disproportionnées et iniques. En effet, les systèmes judiciaires prévoyant des peines plancher automatiques sont caractérisés, en particulier aux États-Unis, par la place qu'y occupe le ministère public et par les importantes prérogatives qu'il exerce au cours de la procédure par l'intermédiaire du mécanisme de « plea bargaining ». Dans ce cadre, le ministère public possède une grande marge d'appréciation quant à la qualification pénale des faits retenue dès lors que le prévenu reconnaît sa culpabilité, ce qui permet d'atténuer les conséquences des peines automatiques en retenant une incrimination de moindre gravité. L'existence de telles peines témoigne également d'une relative méfiance du pouvoir législatif à l'égard du pouvoir judiciaire qui ne correspond pas au système prévalant en Europe continentale.
· La récidive, circonstance aggravante : un choix européen privilégiant l'individualisation de la peine
L'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Comme l'a souligné devant la mission M. Jean-Yves Leborgne, président de l'association des avocats pénalistes, le respect de ces dispositions implique la tenue d'un débat contradictoire entre l'accusation et la défense mené sous l'autorité du juge qui ne doit pas être contraint de prononcer une peine déterminée dès lors que la culpabilité du prévenu est établie. A défaut, la notion même de délibéré serait en effet privée de portée et le juge limité au simple rôle de « distributeur » de peines.
A la différence des régimes judiciaires privilégiant la fonction « rétributive » de la sanction, les systèmes fondés sur l'individualisation de la peine prennent en considération, non seulement la nature de l'infraction commise, mais également la personnalité de son auteur. Dès lors, si la récidive conduit, certes, à une aggravation de la peine prononcée, le juge dispose néanmoins d'une certaine latitude pour adapter la sanction au profil et à la situation de chaque condamné qui a vocation, même à long terme, à recouvrer la liberté. Dans ce système, la sanction dépasse son unique fonction rétributive pour tenter de réduire les risques de récidive future en favorisant la réinsertion du condamné. Quand bien même nombre de pays européens, à l'instar de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie ou de la Suède, connaissent des peines plancher pour chaque infraction, celles-ci ne sauraient conduire pour autant au prononcé de peines « automatiques » au sens anglo-saxon en raison du pouvoir d'appréciation dévolu au juge.
LE CAS DE L'ESPAGNE
L'article 22 du code pénal espagnol fait de la récidive une circonstance aggravante qui est constituée si, à l'occasion de la commission d'un acte délictueux, le coupable a déjà été condamné de manière définitive pour une autre infraction de même nature figurant au sein du même titre du code pénal. Ces dispositions ont d'autant plus de portée que l'Espagne est soumise au principe constitutionnel de la légalité des poursuites qui oblige les autorités compétentes à poursuivre toute infraction.
Lorsque la situation de récidive est caractérisée, l'article 66 du code pénal dispose que les juges doivent appliquer la peine prévue « dans la moitié supérieure de la peine fixée par la loi pour l'infraction considérée ». A titre d'exemple, lorsqu'un prévenu a été condamné définitivement pour un vol avec violence et qu'il commet de nouveau les mêmes faits, le juge devra prononcer, non pas une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement prévue par l'article 242-1 du code pénal, mais une peine au moins égale à 3 ans et demi d'emprisonnement sans pouvoir excéder cinq années.
Par ailleurs, lorsque le prévenu cumule la circonstance aggravante de récidive avec trois autres condamnations définitives pour des infractions relevant du même titre du code pénal, l'article 66 précité dispose que le juge peut prononcer « une peine d'un degré supérieur à celui établi par la loi pour l'infraction considérée », ce qui correspondrait, en droit français, au passage d'une qualification délictuelle à une de nature criminelle. Dans l'exemple précité, le prévenu « multirécidiviste » encourrait une peine comprise entre 5 ans et 7 ans et demi d'emprisonnement.
Enfin, la loi organique 11/2003 du 29 septembre 2003, relative aux mesures concrètes en matière de sécurité citoyenne, de violence domestique et d'intégration sociale des étrangers, a modifié le régime juridique de la récidive afin d'apporter, aux termes de l'exposé des motifs du projet, « une réponse pénale à la délinquance d'habitude. » A cette fin, et pour trois infractions contraventionnelles punies de peines d'amende qui sont : les violences légères, les vols simple dont la valeur n'excède pas 400 euros et la subtilisation d'un objet sans l'intention d'appropriation (comme les vélomoteurs), l'auteur ayant commis de tels faits pour la quatrième reprise en l'espace d'une année encourra une peine d'emprisonnement en raison de la « correctionnalisation » de la qualification pénale de ces contraventions. Dans ces hypothèses, le prévenu est passible d'une peine de : 3 ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit des violences légères ; 6 à 18 mois d'emprisonnement en cas de vol ou d'appropriation frauduleuse sans restitution de l'objet subtilisé.
Il ressort de l'analyse de ces dispositions que, si le juge pénal espagnol est contraint de prononcer des peines minimales lorsque la récidive légale est constatée, il n'en demeure pas moins libre de recourir, ou non, à la requalification pénale des délits en crime ou des contraventions en délit lorsqu'il y à « multirécidive », ce qui lui confère un pouvoir d'appréciation certain, gage de l'individualisation de la peine conformément au modèle européen.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 133 du code pénal, le juge italien doit, au moment du prononcé de la peine, évaluer la propension du prévenu à commettre de nouvelles infractions compte tenu des motifs de son action, de son caractère, de ses précédents judiciaires, de sa conduite et ses conditions de vie individuelle. Pour sa part, l'article 41 du code pénal portugais dispose que « l'application des peines et des mesures de sécurité vise la protection des biens juridiques et la réintégration de l'agent dans la société ». En Suède, l'article 7 du code pénal prévoit que le tribunal, « doit conserver spécialement à l'esprit que la sanction doit servir à favoriser l'adaptation sociale du condamné. ». Telle est également l'inspiration de notre système de l'exécution des peines puisque l'article 707 du code de procédure pénale, introduit à l'initiative de notre collègue Jean-Luc Warsmann (13), dispose qu'il « favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ».
La poursuite de ces objectifs procède également de la recommandation n° 92/17 du 19 octobre 1992 du Conseil de l'Europe, relative à la cohérence dans le prononcé des peines. Celle-ci prévoit en effet que « les condamnations antérieures ne devraient jamais, à aucun niveau du système de justice pénale, être considérée automatiquement comme en défaveur du délinquant », la peine devant être « proportionnelle à la gravité de l'infraction ou des infractions en cours de jugement. » Aussi poursuit la recommandation, « toute incidence des antécédents criminels devrait être réduite ou supprimée dans les cas suivants :
- il s'est écoulé un laps de temps important entre des infractions antérieures et l'infraction jugée ; ou
- l'infraction actuelle est mineure, ou les infractions antérieures étaient mineures ; ou
- le délinquant est encore jeune. »
C'est pourquoi, le respect de nos engagements européens ne semble pas compatible avec l'adoption d'une disposition de portée générale prohibant tout recours à des mesures d'aménagement de la peine à l'endroit des récidivistes, nonobstant la nature des infractions commises, la personnalité de l'intéressé ou sa dangerosité. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs développé une importante jurisprudence en matière de droit de la peine.
S'agissant en particulier de mineurs condamnés pour meurtre et détenus « pour la durée qu'il plaira à sa majesté » comme le prévoyait la loi anglaise, la Cour estima que celle-ci ne pouvait être perpétuelle : « pareille durée d'emprisonnement appliquée à des enfants aurait été incompatible avec les instruments des Nations unies et aurait soulevé de graves problèmes sous l'angle de l'article 3 de la Convention. » Poursuivant son raisonnement, la Cour estima, en 1996, que la réclusion à perpétuité pour les mineurs ne pouvait se justifier que « par des arguments fondés sur la nécessité de protéger le public et donc liés à des appréciations de l'évolution mentale et de la maturité du délinquant », ce qui appelait « un contrôle par un tribunal chargé de vérifier qu'il existait toujours des motifs de détention »(14). Plus récemment, elle a considéré que, « dès lors qu'il a été satisfait à l'élément punitif de la sentence, tout maintien en détention doit être motivé, comme dans les affaires concernant des détenus frappés d'une peine perpétuelle discrétionnaire ou des mineurs condamnés pour meurtre, par des considérations de risque et de dangerosité. »(15).
Quand bien même des espèces ne concernent-elles que le Royaume-uni, il en ressort, comme l'a clairement indiqué à la mission le professeur Pierrette Poncela, que la Cour semble estimer que la peine, même perpétuelle, doit pouvoir être révisée de façon périodique afin de tenir compte des évolutions du condamné et de sa dangerosité, ce qui constitue une dimension faiblement prise en considération dans notre propre système pénal et carcéral. Cette incitation au réexamen périodique des situations individuelles ne plaide pas en faveur de l'instauration de peines plancher automatiques qui, en raison même du quantum des peines prononcées, ne permettent pas de prendre en considération la dangerosité du condamné ni son évolution.
· L'individualisation de la peine : un principe autorisant le recours aux mesures de sûreté, y compris postérieurement à la levée d'écrou
L'individualisation des peines ne doit pas être perçue comme conduisant exclusivement au prononcé de décisions favorables et alternatives à l'incarcération mais autorise, bien au contraire, la modulation des mesures en fonction de la personnalité du condamné qui peut requérir un suivi très contraignant, y compris postérieurement à sa levée d'écrou.
Ainsi, l'article 66 du code pénal allemand, qui ne connaît pas de disposition tendant à l'aggravation de la peine en cas de récidive, dispose cependant que le juge doit ordonner l'internement de sûreté, au besoin au sein d'un hôpital psychiatrique ou dans un centre de désintoxication, lorsque le prévenu a déjà été condamné à deux reprises à la même peine et que, « par suite d'une propension à commettre des infractions graves, il présente un danger pour la société. » La décision de recourir à cette mesure de sûreté peut être prononcée à deux étapes de la procédure pénale : ab initio, lors de la condamnation et à titre de peine complémentaire ; pendant la durée de l'incarcération, à condition que le tribunal ait réservé expressément sa décision sur ce point à l'occasion de son premier jugement. Lorsque l'internement de sûreté est ordonné, le condamné ayant exécuté sa peine est interné pour une durée qui n'est pas déterminée a priori par la juridiction compétente, celle-ci devant seulement réexaminer la situation de l'intéressé tous les deux ans. Cette mesure peut donc être indéfiniment prolongée par les autorités judiciaires tant que le condamné présente une dangerosité telle que son maintien en détention paraît nécessaire.
Pour sa part, le droit français connaît ou a connu des mesures de cette nature. Il en fut ainsi de la « relégation » dans les territoires d'outre-mer et en Guyane des multirécidivistes, instaurée à la fin du XIXe siècle afin de neutraliser définitivement leur capacité de nuisance puisque cette mesure était « perpétuelle ». Toutefois, cette mesure ne produisit pas les effets escomptés et la loi du 17 juillet 1970 la remplaça par la tutelle pénale qui fut elle-même supprimée par les articles 68 et 69 de la loi du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
BRÈVE HISTOIRE DE LA TUTELLE PÉNALE
Définie par les articles 58-1 à 58-3 de l'ancien code pénal et mise en œuvre en application des dispositions des articles 728-1 à 728-4 du code de procédure pénale introduits par la loi du 17 juillet 1970, la tutelle pénale se substitua à la relégation dont le régime juridique paraissait inadapté.
La tutelle pénale tendait à « protéger la société contre les agissements des multirécidivistes en offrant à ceux-ci la possibilité de se reclasser au sein de la collectivité ». Son prononcé était facultatif pour le juge et ne concernait plus que les récidivistes pour crime ou délit de droit commun condamnés, au cours d'une période de dix années : soit à deux peines criminelles ; soit à quatre peines d'emprisonnement de plus de six mois dont les auteurs étaient jugés « particulièrement dangereux ».
A la différence de la relégation, la tutelle pénale n'était pas « perpétuelle » puisqu'elle ne pouvait excéder une durée de dix ans à compter de l'expiration de la peine principale. Son prononcé devait être précédée d'une enquête de personnalité et d'un examen médico-psychologique. Son exécution s'effectuait soit au sein d'un établissement pénitentiaire, en principe spécialisé, soit en milieu ouvert.
Comme l'indiquait le rapport de notre collègue M. Jacques Piot sur le projet de loi « sécurité et liberté » (16) supprimant la tutelle pénale, la réussite d'une mesure de cette nature supposait un effort en équipement et en personnel qui n'a jamais été sérieusement engagé. A la fin des années 70, le nombre de personnes placées sous tutelle pénale était inférieur à 500 et, si la moitié d'entre elles étaient incarcérées, toutes ne l'étaient pas dans des établissements spéciaux qui n'étaient qu'au nombre de trois.
De surcroît, poursuivait le rapporteur, « le régime de la tutelle pénale était par ailleurs voué à l'échec si aucun effort sérieux n'était fait pour assurer une véritable réinsertion des multirécidivistes. Or, force est de constater que les établissements pénitentiaires « post pénaux » de Lure et de Besançon peuvent difficilement être considérés comme des centres de réinsertion sociale. A plusieurs reprises, les détenus de ces établissements ont protesté contre un régime qu'ils qualifient de « disciplinaire » ainsi que contre la parcimonie avec laquelle sont accordées les libérations conditionnelles et les permissions de sortir. » On le voit, la tutelle pénale n'a pas apporté les résultats escomptés mais cet échec n'a pas pour autant signifié la fin du recours à des mesures de sûreté post carcérales (17).
Plus récemment, le suivi socio-judiciaire, introduit par la loi du 17 juin 1998 (18) et applicable aux seuls délinquants sexuels, tend également à lutter contre la récidive en enjoignant le condamné à se faire soigner ou en l'astreignant à des mesures de surveillance ou de contrôle au-delà de sa levée d'écrou pendant une période pouvant désormais atteindre vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle(19) sur décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Par ailleurs, la création par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) témoigne de la volonté du législateur de développer le recours aux mesures de sûreté pour les délinquants les plus dangereux. En effet, en application des dispositions de l'article 706-53-5 nouveau du code de procédure pénale, les auteurs d'infractions sexuelles relevant du champ d'application du fijais sont tenus, « au titre de mesure de sûreté » de justifier :
- annuellement de leur adresse et de déclarer tout changement d'adresse dans les quinze jours suivants celui-ci ;
- semestriellement de leur résidence en se présentant auprès des services de la gendarmerie ou de la police nationale de leur domicile pour les seuls condamnés à une peine supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.
De surcroît, ces obligations prennent effet « à compter du jour où l'ensemble des décisions [de justice] ont cessé de produire tout effet » comme le prévoit l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale, donc postérieurement à la levée d'écrou, et pour une durée de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt ans dans les autres cas.
La mission considère que l'usage des mesures de sûreté pour les condamnés les plus dangereux doit être poursuivi et encouragé, notamment grâce au recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (proposition n° 15). A cet égard, votre rapporteur tient à faire état du développement de mesures de surveillance électronique mobile aux États-Unis qui permettent une meilleure réinsertion des condamnés, grâce à une mobilité géographique accrue par rapport aux mesures de surveillance électronique traditionnelles à domicile, tout en autorisant, le cas échéant, une localisation rapide et sûre de la personne concernée.
Ainsi, selon les données communiquées à la mission par M. Jean-Pierre Escarfail, président de l'association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (apacs), l'État de la Floride est parvenu à réduire des deux tiers le taux de récidive des personnes prises en charge par les services de probation grâce à l'adoption de dispositifs électroniques mobiles de surveillance faisant appel à la localisation satellitaire (gsm-gps). Près de 1 000 personnes par an y sont désormais surveillées ce cette manière et le placement sous surveillance électronique à demeure ne concerne plus que 500 personnes par an contre 1 500 au cours des années 1993-1999. D'après une étude statistique menée sur un échantillon de 64 000 personnes placées sous le contrôle des services de probation en Floride entre 1996 et 2000, le taux de récidive des délinquants sexuels soumis à la surveillance électronique mobile satellitaire mesuré sur une période d'une année ne serait que de 2,3 %.
2. Le respect des principes constitutionnels de nécessité des peines et de séparation des pouvoirs
Comme le prévoit l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Appliquant en cette matière sa jurisprudence habituelle selon laquelle « l'article 61 ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement », sous réserve d'une disposition qu'il considère comme « manifestement contraire au principe posé à l'article 8 de la déclaration de 1789 »(20), le Conseil ne se livre pas à l'appréciation de la nécessité des peines. Toutefois, la référence à l'erreur d'appréciation conduit le Conseil à concilier le respect du principe de proportionnalité avec celui de nécessité des peines, sachant que le champ d'application de cette conciliation ne concerne pas uniquement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais également « toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire »(21).
Dans un certain nombre de décisions, le Conseil a tiré du principe de nécessité des peines l'interdiction des peines « automatiques ». Il en est ainsi en matière de reconduite à la frontière puisque le Conseil a considéré que le fait que « tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction d'interdiction de territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée [...] ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la déclaration de 1789. » De même, dans sa décision 99-410 DC du 15 mars 1999, le Conseil a-t-il sanctionné le caractère automatique de la déchéance des droits civils et politiques consécutive à une déclaration de faillite par le juge commercial.
Par ailleurs, le juge constitutionnel a fait usage d'une réserve d'interprétation rendant conforme une disposition qui, à défaut aurait été déclarée contraire à la Constitution du fait de l'automaticité de la peine, en considérant « que les peines prévues par ces articles, qui peuvent être prononcées pour un montant ou une durée inférieure par le juge, ne sont pas entachées de disproportion manifeste. »(22). L'incise du juge constitutionnel, soulignant que le juge conserve la possibilité de prononcer des peines inférieures, mérite d'être relevée et atteste de l'importance que le pouvoir d'appréciation du juge revêt à ses yeux.
Comme l'a indiqué à la mission le professeur Jean Pradel, il ressort de l'analyse de cette jurisprudence que, si l'individualisation des peines ne relève pas explicitement de la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il ne semble pas infondé de considérer qu'elle possède néanmoins une telle valeur tant l'interdiction continue et répétée des peines automatiques par le juge constitutionnel et son attention quant au respect du principe de nécessité et de proportionnalité des peines tendent à s'assurer de l'individualisation de la peine et de son exécution.
Sur le fond, l'adoption de peines « plancher » serait donc conforme à notre Constitution sous l'impérieuse réserve que le juge puisse prononcer une peine inférieure si la personnalité du prévenu ou les circonstances l'exigeait. Il convient de rappeler ici qu'un tel système était celui de l'ancien code pénal qui déterminait les quantum applicables à chaque infraction par une « fourchette », tout en prévoyant la possibilité pour le juge d'y déroger s'il relevait des « circonstances atténuantes ». Or, comme l'avait déjà indiqué le rapporteur de notre assemblée à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif au nouveau code pénal(23), le juge disposait ainsi « d'une large liberté d'appréciation que le législateur a décidé de consacrer dans le nouveau code pénal, en supprimant la notion de peine minimale et, par voie de conséquence, celle de circonstances atténuantes, la liberté du juge restant désormais limitée par les seules peines maximales que la loi prévoit. » Compte tenu de ce qui précède, on perçoit mal l'intérêt pratique et juridique qu'il y aurait à proposer le rétablissement d'un mécanisme supprimé il y a plus de 12 ans précisément parce que le recours particulièrement fréquent des magistrats aux « circonstances atténuantes » avait tendance à priver d'effet les peines plancher.
Au-delà des règles constitutionnelles applicables au droit de la peine, certains spécialistes de droit constitutionnel, à l'instar du professeur Guy Carcassonne, ont estimé devant la mission que l'adoption par le législateur de peines automatiques méconnaîtrait le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, et en particulier les dispositions de l'article 66 de la Constitution(24).
En effet, celui-ci dispose que l'autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle » et qu'elle assure le respect de ce principe « dans les conditions prévues par la loi ». Dès lors, si la loi doit préciser les modalités d'application de ce principe constitutionnel par l'autorité judiciaire, elle ne saurait priver cette dernière de toute appréciation en la contraignant à prononcer certaines peines. A cette aune, l'adoption de dispositions instaurant des peines automatiques conduirait, en quelque sorte, à substituer le législateur au juge méconnaissant ainsi la mission constitutionnelle dévolue à l'autorité judiciaire.
C. LA RÉCIDIVE : UN PHÉNOMÈNE À LA MESURE INCERTAINE
1. Des difficultés d'ordre méthodologique
C'est l'un des enseignements que retire la mission de ses nombreuses auditions : la mesure actuelle de la récidive n'est ni satisfaisante ni incontestable.
a) La récidive : une notion juridique trop étroite que les données statistiques ne peuvent mesurer avec précision
Comme l'indiquait déjà M. Pierre Tournier en 1997 (25) « on ne distingue pas toujours ce qui est mesurable de ce qui ne l'est pas, ce qui a déjà été mesuré de ce qui ne l'a pas encore été. Et quand on dispose de données, de résultats de mesures effectuées avec la rigueur nécessaire, on ne se pose pas trop de questions sur les conditions de la mesure (définition des concepts, mode de collecte, champs d'étude) » alors même que « il ne s'agit jamais, dans les enquêtes, de la récidive légale définie dans le code pénal. »
Ainsi, l'étude sur la « récidive » publiée par Infostat Justice (26) précise que, un condamné est considéré comme récidiviste si l'infraction sanctionnée en 2001 a été commise après une précédente condamnation, « qu'elle soit définitive ou non », l'exploitation du casier judiciaire ne permettant pas de déterminer la date à laquelle une condamnation le devient. En outre, comme l'a indiqué à la mission M. Jean-Claude Marin, directeur des affaires criminelles et des grâces, il existe de nombreuses situations pour lesquelles le caractère définitif de la condamnation n'est pas acquis. Il en est ainsi lorsque le prévenu ne comparaît pas à l'audience et qu'aucun avocat ne se présente pour sa défense parce qu'il ignore la date de convocation devant le tribunal et que la signification du jugement ne lui pas été adressée directement. Dans cette hypothèse, qualifiée de « défaut », l'opposition au jugement n'a pas à être formée dans les dix jours comme le prévoit le droit commun, mais demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine (article 492 du code de procédure pénale), soit cinq ans en matière correctionnelle, ce qui prolonge considérablement le caractère non définitif du jugement. A cet égard, il convient de préciser que, selon les données figurant dans l'annuaire statistique de la justice pour l'année 2003, 24 468 jugements devant les tribunaux correctionnels ont été rendus par défaut en 2001 et plus de 32 400 condamnations ont été signifiées « à parquet », ce qui signifie que la personne concernée était sans domicile ou résidence connue.
De surcroît, l'étude précitée ne retient pas la notion de délit similaire pour caractériser la récidive, ses auteurs considérant que la « partie consacrée à la réitération à l'identique permet de s'en approcher ». C'est la raison pour laquelle, MM. Michaël Janas et Éric Martin, membres de l'association nationale des juges de l'application des peines (anjap) ont souligné, à juste titre, devant la mission que cette étude mesurait la réitération et non la récidive légale.
b) Le problème de l'effacement automatique du casier judiciaire des fiches concernant les mineurs devenus majeurs
La mesure de la récidive des mineurs soulève des difficultés particulières en raison des délais de conservation des informations les concernant par le Casier judiciaire. En effet, l'article 769-2 du code de procédure pénale disposait, jusqu'à l'adoption de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, que les fiches relatives aux mesures éducatives prononcées en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - parmi lesquelles figurent l'admonestation, la remise à parents, le placement, la liberté surveillée - ainsi que les sanctions éducatives, telles que la confiscation de l'objet, ou l'interdiction de paraître dans certains lieux, sont effacées à la date d'expiration de la peine et, en tout cas, lorsque le mineur a atteint l'âge de la majorité. Il en était de même pour les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois.
L'application de ces dispositions introduisait un biais certain, tant en ce qui concerne la prise en compte de la récidive par les autorités judiciaires au stade du prononcé de la peine, qu'en matière de mesure statistique de ce phénomène puisqu'à la majorité du mineur délinquant une grande partie des informations contenues dans le Casier judiciaire disparaissaient. A titre d'exemple, un mineur condamné à un placement à l'age de 15 ou 16 ans et qui commettait un second délit identique à l'âge de 18 ans révolus était considéré comme non récidiviste au sens de la loi. Cette situation ne permettait donc de mesurer la récidive que sur une période particulièrement brève, de l'ordre de deux ou trois ans maximum.
C'est la raison pour laquelle, à l'initiative de notre collègue Thierry Mariani, l'article 201 de la loi du 9 mars 2004 précitée a prévu que les fiches relatives aux mesures et sanctions éducatives sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles ont été prononcées, ce qui permet d'aller au-delà de l'âge de la majorité, si la personne n'a pas, pendant ce délai :
- soit subi une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;
- soit exécuté une composition pénale ;
- soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945.
A défaut, les fiches seront donc désormais conservées dans le casier selon les modalités de droit commun applicable aux majeurs, ce qui devrait permettre d'améliorer la prise en compte de la récidive des mineurs par les juridictions tout en améliorant sa mesure statistique.
2. Une grande disparité des taux de réitération selon la nature des infractions
En dépit de ces difficultés, qui incitent à la prudence, plusieurs études ont été réalisées récemment. Il s'agit, pour ne citer que les principales d'entre elles, de :
- « la mesure de la récidive en France », de Pierre Tournier parue en 1997(27) ;
- « la récidive des crimes et délits sexuels », de Mme Carine Burricand, de décembre 1997 (28)
- « les condamnés de 2001 en état de récidive », de Mme Odile Timbard et M. Claude Lecomte, parue en août 2003 (29) ;
- « la récidive des sortants de prison », de Mme Annie Kensey et M. Pierre Tournier, publiée en mars 2004(30). Il convient de relever que cette dernière étude est la première en France à porter sur un échantillon représentatif de l'ensemble de la population carcérale condamnée.
Au-delà des différences d'ordre méthodologique entre ces nombreux travaux, certains observant le devenir judiciaire des condamnés après une première condamnation, ce qui oblige à se référer à des cohortes de condamnés déjà anciennes (méthode prospective), d'autres se fondant sur l'analyse du passé pénal des condamnés à partir d'une année d'observation déterminée (méthode rétrospective), leurs conclusions convergent :
a) Un taux de réitération en augmentation mais un taux de retour en prison stable
Parmi les 326 053 condamnés pour délits en 2001, 102 127 avaient déjà été condamnés au moins une fois entre 1997, ce qui situe le taux de réitération (31) à 31,3 %. Ce taux est en progression constante depuis 1997, puisqu'il passe de 29,1 % en 1997 à 29,5 % en 1999 pour s'établir au dessus de 30 % en 2000. De même, le taux de réitération criminelle, après avoir diminué entre 1996 et 1998 (de 4,8 % à 4,2 %), croît depuis 2000 pour atteindre 4,7 % en 2001 ainsi que l'illustre le tableau suivant.
|
Taux de réitération des condamnés pour crime ou délit |
||||||
|
Délits |
Crimes |
|||||
|
Nombre de condamnés |
Dont |
Taux de |
Nombre de condamnés |
Dont |
Taux de |
|
|
1996 |
353 982 |
105 625 |
29,8 |
2 755 |
133 |
4,8 |
|
1997 |
374 614 |
109 129 |
29,1 |
3 019 |
139 |
4,6 |
|
1998 |
383 342 |
111 765 |
29,2 |
3 321 |
140 |
4,2 |
|
1999 |
388 734 |
114 842 |
29,5 |
3 439 |
145 |
4,2 |
|
2000 |
382 218 |
117 429 |
30,7 |
3 021 |
117 |
3,9 |
|
2001 |
326 053 |
102 127 |
31,3 |
2 933 |
137 |
4,7 |
S'agissant du taux de réitération des condamnés sortants de prison, 52 % d'entre eux ont commis une nouvelle infraction dans un délai de cinq ans après leur libération. Si l'on souhaite affiner cette analyse en prenant en considération la nature de la nouvelle condamnation prononcée, il ressort que pour 47 % de ces condamnés il s'agit d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis mais que pour 41 % d'entre eux une nouvelle peine ferme privative de liberté est prononcée. Ce « taux de retour en prison » semble relativement stable, puisque selon une étude portant sur la population des condamnés à trois ans d'emprisonnement ou plus libérés en 1973 dont les casiers judiciaires ont été examinés en 1981, il atteignait 43 %(32). Au-delà de cette stabilité, un tel phénomène n'en demeure pas moins décourageant pour les personnels pénitentiaires qui voient revenir en détention les mêmes personnes en dépit des actions de réinsertion précédemment menées ainsi que l'a expliqué à la mission M. Pierre raffin, directeur de la maison d'arrêt de la Santé.
b) Une corrélation délicate à interpréter entre les modalités de la libération et le taux de réitération
L'étude menée sur les condamnés à trois ans d'emprisonnement ou plus libérés en 1973 l'avait déjà démontré, il existe une corrélation positive entre la proportion de temps effectuée en détention et le taux de retour en prison. Ce dernier passe ainsi de 28 % pour les détenus ayant effectué moins de 70 % de la peine en détention à 60 % pour ceux qui ont effectué 90 % de leur peine en détention. Cet ordre de grandeur a été confirmé par l'étude menée sur les condamnés libérés en 1982, puisque le taux de retour en prison de ceux ayant bénéficié d'une libération conditionnelle était de 23 % contre 40 % pour les détenus libérés en fin de peine. Cet écart, du simple au double, doit cependant être interprété avec prudence.
En effet, l'impact de la sélection des détenus dont le profil s'accorde avec la libération conditionnelle contribue d'autant à son succès et se cumule avec les conséquences positives liées aux mesures de suivi et de contrôle prévues par la loi et mises en œuvre par les services pénitentiaires de probation et d'insertion (spip). Il est serait donc délicat de prendre appui sur ces résultats pour plaider en faveur d'une généralisation du recours à la libération conditionnelle pour tous les condamnés, puisque cela risquerait de réduire son efficacité en raison de l'inadéquation de certains profils à cette mesure. De surcroît, et l'ensemble des études convergent sur ce point, le critère déterminant en matière de récidive semble davantage être la nature de l'infraction initiale commise que les modalités de la libération du condamné.
c) De fortes disparités selon la nature des infractions
· Les vols et la conduite en état alcoolique regroupent plus de la moitié des réitérants
Comme l'établit l'étude précitée sur les condamnés pour délits en 2001, le taux de récidive est nettement plus élevé pour les condamnés pour vol (42 %), pour outrage (46,1 %) ou pour port d'armes (41 %) qu'en matière de conduite en état alcoolique (25 %), d'escroquerie (23 %) ou de mœurs (14,6 %).
Au-delà de ces proportions, deux catégories d'infractions regroupent plus de la moitié des réitérants pour délits puisque sur les 102 127 personnes concernées en 2001, 54 051 étaient des réitérants pour vols ou conduite en état alcoolique, soit près de 53 % des cas comme l'illustre le tableau suivant.
|
Taux de réitération par nature de délit |
|||||
|
Nature d'infraction sanctionnée en 2001 |
Nombre de condamnés en 2001 |
Nombre de récidivistes sur les 5 dernières années |
Taux de |
Dont récidivistes |
|
|
Nombre |
% |
||||
|
Tous types de délits |
326 053 |
102 127 |
31,3 |
39 149 |
38,3 |
|
Vol recels |
74 358 |
31 355 |
42,2 |
18 730 |
59,7 |
|
Conduite en état alcoolique |
90 273 |
22 696 |
25,1 |
12 081 |
53,2 |
|
Autres délits routiers |
23 912 |
8 443 |
35,3 |
1 313 |
15,6 |
|
Violences volontaires |
31 695 |
10 594 |
33,4 |
2 185 |
20,6 |
|
Autres atteintes à la personne |
6 169 |
2 161 |
35,0 |
183 |
8,5 |
|
Outrages |
15 181 |
6 992 |
46,1 |
857 |
12,3 |
|
Stupéfiants |
16 788 |
5 304 |
31,6 |
1 299 |
24,5 |
|
Destruction dégradations |
11 682 |
4 122 |
35,3 |
473 |
11,5 |
|
Escroqueries |
10 064 |
2 310 |
23,0 |
283 |
12,3 |
|
Port d'arme |
3 777 |
1 553 |
41,1 |
93 |
6,0 |
|
Police des étrangers |
4 471 |
1 057 |
23,6 |
469 |
44,4 |
|
Mœurs |
6 939 |
1 013 |
14,6 |
357 |
35,2 |
|
Abandon de famille |
5 038 |
703 |
14,0 |
269 |
38,3 |
|
Travail illégal |
5 303 |
564 |
10,6 |
175 |
31,0 |
|
Autres délits |
20 403 |
3 260 |
16,0 |
382 |
11,7 |
|
Lecture : en 2001, sur 326 053 condamnés pour délit, 102 127 soit 31,3 % avaient un antécédent pénal. Parmi ces récidivistes, 39 149 soit 38,3 % ont été condamnés les deux fois pour le même type de délit. |
|||||
S'agissant des condamnés pour crime et récidivistes, qui sont au nombre de 137 pour l'année 2001 (33), 87 d'entre eux (soit 63,5 % du total) l'ont été pour vol aggravé, 28 pour viol et 11 pour homicide. Le taux moyen de récidive criminelle s'établit donc à 4,7 %. Toutefois, comme l'indiquent les auteurs de l'étude d'août 2003 précitée, « le taux de récidive par type de crime varie de 14,7 % pour les vols aggravés à 1,8 % pour les viols. En matière criminelle la récidive à l'identique est fréquente (75,2 %) du fait de l'éventail réduit des types de crimes. Des différences de comportement apparaissent toutefois : près de 80 % des récidivistes condamnés pour viols avaient déjà été condamnés pour viol et 90 % des voleurs avaient déjà commis un vol criminel ».
Si l'on souhaite examiner de façon plus approfondie la question de la récidive en matière sexuelle, l'étude menée en 1997 sur ce sujet démontre que le taux de récidive des condamnés pour viols varient entre 2,5 % et 4 % selon l'année étudiée ce qui est donc légèrement supérieur au résultat obtenu en 2001. Comme l'expliquent les auteurs de cette étude « de tels taux relativisent l'idée selon laquelle la plupart des violeurs récidivent après leur libération. Toutefois, compte tenu du volume annuel élevé des condamnations pour crimes sexuels, les récidives restent trop nombreuses : au cours de chacune des années 1993, 1994 et 1995, entre 15 et 20 condamnés pour viols étaient ainsi des récidivistes ».
Enfin, l'étude menée sur la récidive des sortants de prison publiée en mars 2004 dresse un constat comparable dans ses tendances, bien que différent dans ses proportions, puisque les taux de nouvelles affaires passent de 23 % pour les agressions et les atteintes sexuelles à 75 % pour les vols sans violence. Comme le notent les auteurs « dans l'ensemble, les condamnés pour atteinte aux biens ont un taux de nouvelles affaires nettement supérieur aux condamnés pour atteinte aux personnes ». Le tableau suivant illustre conforte cette analyse.
|
PROPORTIONS DE LIBÉRÉS SANS NOUVELLE AFFAIRE |
||||
|
% de libérés avec nouvelles affaires |
||||
|
Infraction principale pour laquelle le détenu a été libéré |
% de libérés sans nouvelles affaires |
Total |
dont sans emprisonnement ferme |
dont avec |
| Atteintes volontaires contre les personnes Homicide volontaire Violence volontaire, outrage à fonctionnaires ou magistrats Violence volontaire sur adultes Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (crime) Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (délit) ils sauf cession seule ou usage seul Cession de stupéfiants Vol avec violence (délit) |
72 30 39 70 77 66 44 28 |
28 70 61 30 23 34 56 72 |
15 21 17 19 12 12 13 15 |
13 49 44 11 11 22 43 57 |
| Vols - recels Vol (crime) Vol sans violence (délit) Recel |
43 25 40 |
57 75 60 |
25 10 8 |
32 65 52 |
| Escroqueries Escroquerie, filouterie, abus de confiance (délit) Faux et usage de faux documents administratifs (délit) |
58 74 |
42 26 |
13 5 |
29 21 |
| Circulation routière cei sans atteinte involontaire contre les personnes Défaut de pièces administratives, conduites de véhicules |
57 39 |
43 61 |
14 17 |
29 44 |
| Ordre public et réglementation Infraction à la police des étrangers Usage de stupéfiants seul |
70 41 |
30 59 |
2 9 |
28 50 |
| Taux globaux de nouvelles affaires |
48 |
52 |
11 |
41 |
| Source : Administration pénitentiaire | ||||
· Des délais moyens de récidive variables : 15,7 mois pour les délits et 7,2 ans pour les crimes
Établi sur une période de cinq années, le délai moyen entre l'infraction réprimée en 2001 et la précédente condamnation est de 15,7 mois en matière délictuelle et de 7,2 ans en matière criminelle. Là encore, de forte disparités s'observent en fonction de la nature de l'infraction.
Ce délai est supérieur pour les condamnés pour conduite en état alcoolique (22 mois) « ce qui peut s'expliquer par la faible probabilité pour une même personne d'être contrôlée à plusieurs reprises. Si l'on exclut la conduite en état alcoolique, le délai moyen de récidive s'établit à près de 14 mois ». En matière de vols ou de recels délictuels, le délai est inférieur à la moyenne et assez bref (12,8 mois), la moitié des récidives intervenant 9 mois après la première condamnation.
S'agissant de la récidive criminelle, de fortes disparités existent également entre les vols aggravés qui, là aussi, sont commis plus rapidement après la première condamnation (6 ans) et les homicides, pour lesquels ce délai est plus long (9 ans).
Somme toute, il ressort de ces analyses qu'il n'existe pas « une » récidive, contre laquelle une mesure unique serait de nature à lutter efficacement, mais « des » récidives selon des catégories d'infractions clairement identifiées et contre lesquelles des mesures spécifiques doivent être recherchées tout au long de la chaîne pénale.
Il en est ainsi en matière de conduite en état alcoolique pour laquelle l'incarcération prévue à l'article L. 234-1 du code de la route (34) n'est pas toujours la solution la mieux adaptée comme l'a indiqué à la mission Mme Geneviève Jurgensen, présidente de la ligue contre la violence routière. En effet, si la détention doit être prononcée pour les accidents corporels provoqués par l'alcool au volant, a fortiori en état de récidive, l'immobilisation du véhicule, le recours aux stages ou travail d'intérêt général doit être développé dans les autres cas en raison de leur vertu pédagogique et préventive.
D'intéressantes expériences sont menées en cette matière, par exemple dans le département du Morbihan où les accidents liés à l'alcool au volant font 1,3 plus de victimes graves par rapport à la moyenne nationale. Aussi, dès 2001, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a-t-il mis en place un tig « sécurité routière » tendant à prévenir la récidive en sensibilisant la personne aux notions de sécurité routière afin de lui faire prendre conscience des dangers des conduites addictives avant de la faire intervenir auprès d'un public scolaire pour lui faire part de son expérience. Une évaluation sur la récidive des personnes concernées est en cours de réalisation mais les premiers éléments semblent positifs. Toute disposition prévoyant le prononcé d'une peine automatique d'emprisonnement semble donc inadaptée aux spécificités des auteurs d'infractions, la nature de celles-ci et, partant, vouée à une efficacité incertaine en matière de lutte contre la récidive. En revanche, toute infraction doit recevoir une réponse pénale rapide et adaptée, a fortiori lorsqu'il y a récidive. Or, à cette aune, la récidive semble, aux yeux de la mission, insuffisamment prise en compte par l'ensemble de la chaîne pénale.
II. - LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LA CHAÎNE PÉNALE
A. AU STADE DU PRONONCÉ DE LA PEINE : UNE JUSTICE SÉVÈRE MAIS AVEUGLE ?
1. Des pratiques judiciaires variables
Puisque tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit comme l'affirme l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être appliquée de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Or, au vu des nombreux témoignages recueillis par la mission, notamment de la part des représentants du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale (schpfn) et des syndicats Alliance et Synergie Officiers, il semblerait que les pratiques judiciaires en matière de récidive soient variables et que les parquets ne relèvent pas systématiquement cette circonstance aggravante lorsqu'ils saisissent le tribunal. Plusieurs données confirment ces assertions.
Selon l'étude sur « les condamnés de 2001 en état de récidive » précitée, le taux de réitération est de 31,3 % en matière délictuelle et de 4,7 % en matière criminelle. Or, selon les informations communiquées à la mission par les services de la chancellerie, seules 5,3 % des condamnations délictuelles et 2,6 % des condamnations criminelles ont mentionné la circonstance aggravante de récidive en 2002. Certes, ainsi que votre rapporteur l'a déjà démontré, cette étude mesure davantage la réitération que la récidive légale. Il n'en demeure pas moins que cet important différentiel en matière délictuelle laisse accroire que nombre de récidives ne sont pas relevées.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées afin d'expliquer ce phénomène :
- les magistrats en charge des poursuites peuvent avoir délibérément omis de relever la circonstance aggravante de récidive compte tenu des quanta des peines encourues jugés suffisamment élevés. Cette hypothèse, qui laisse en quelque sorte, à chaque parquet le soin de déterminer sa propre politique pénale, n'est pas satisfaisante et peut conduire à une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. La mission souhaite donc que le ministre de la justice fasse usage de ses prérogatives que lui reconnaît la nouvelle rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale (35)qui dispose qu'il conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement, veille à la cohérence de son application sur le territoire national et, qu' « à cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique » (proposition n° 6) ;
- l'orientation de l'affaire par le parquet au profit des procédures de traitement « en temps réel » de la délinquance ne permet pas toujours de relever la récidive. Il en est ainsi lorsque le tribunal correctionnel est saisi dans le cadre de la comparution immédiate (36) puisque, dans cette hypothèse, les magistrats du parquet ne sont pas nécessairement en mesure de rechercher ni d'obtenir dans les délais requis les informations pertinentes de la part du casier judiciaire ;
- les informations figurant au casier judiciaire peuvent ne pas être à jour au moment de la saisine du tribunal. Or, il résulte de plusieurs décisions de la Cour de cassation que les juges correctionnels (37) ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes sans l'accord exprès du prévenu. Lorsque la récidive est connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République, les juges du siège compétents désireux de la relever doivent donc recueillir l'accord du prévenu qui a tout intérêt à s'y opposer compte tenu des peines encourues, ce qui contribue vraisemblablement au faible nombre de condamnations mentionnant la récidive. Autoriser les juges correctionnels à relever d'initiative la récidive, nonobstant le consentement du prévenu, serait donc, aux yeux de la mission, de nature à améliorer la prise en considération de la récidive par le tribunal (proposition n° 5).
Au-delà des ces difficultés d'ordre juridique et matériel, il importe également de savoir si, lorsque la récidive est relevée, les sanctions prononcées par les juridictions sont plus sévères. A cet égard, toutes les études convergent pour attester du substantiel alourdissement des peines prononcées, infirmant ainsi clairement l'idée, trop souvent avancée, selon laquelle la justice serait trop permissive à l'égard des délinquants d'habitude.
En effet, l'étude précitée d'août 2003 d'Infostat Justice indique que l'emprisonnement ferme est appliqué à 39 % des « récidivistes » tandis que cette peine concerne moins de 10 % des primo délinquants. A l'inverse, « l'emprisonnement assorti du sursis total est trois fois moins fréquent lorsqu'il y a récidive que dans le cas contraire. Ce décalage traduit l'influence du passé pénal du prévenu sur la sanction prononcée par les juges, phénomène renforcé par les limites imposées par la loi au prononcé d'un emprisonnement avec sursis simple après un emprisonnement ferme. »
En outre, selon les données communiquées à la mission par les services de la chancellerie, la comparaison entre un lot de condamnations hors récidive et un lot de condamnations en situation de récidive illustre l'impact de cette circonstance aggravante sur les peines prononcées lorsqu'elle est relevée. En matière délictuelle, l'emprisonnement, assorti ou non du sursis, est prononcé dans 65 % des condamnations lorsqu'il n'y à pas récidive mais atteint 88 % dans le cas contraire. Par ailleurs, toujours en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme est prononcé dans 51 % condamnations pour lesquelles il y a récidive et dans 24 % dans le cas contraire.
Bien évidement l'aggravation des peines prononcées varie considérablement selon la nature de l'infraction. Ainsi, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive légale atteint : 100 % pour les vols criminels avec arme, 96 % pour le vol délictuel avec violence et 90 % pour le vol avec effraction mais 58 % pour les exhibitions sexuelles et seulement 31 % pour la conduite en état alcoolique.
S'agissant des violences contre les personnes qui connaissent une inquiétante augmentation, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive n'atteint que 78 % si l'incapacité totale de travail est inférieure à 8 jours mais 90 % dans le cas contraire. Le tableau suivant illustre ces différences.
|
Condamnation en récidive |
Condamnation hors récidive |
% |
Taux
d'emprisonnement |
Taux
d'emprisonnement |
Taux
d'emprisonnement |
Taux
d'emprisonnement |
Tous crimes et délits |
20 439 |
367 302 |
5,0 % |
88 % |
66 % |
51 % |
25 % |
Tous crimes |
82 |
3 035 |
2,6 % |
99 % |
99 % |
98 % |
90 % |
Vols avec arme |
34 |
375 |
8,3 % |
100 % |
100 % |
100 % |
95 % |
Tous délits |
20 357 |
364 267 |
5,3 % |
88 % |
65 % |
51 % |
24 % |
Vol simple |
1 582 |
20 830 |
7,1 % |
90 % |
68 % |
79 % |
33 % |
Vol avec effraction |
409 |
4 673 |
8,0 % |
97 % |
87 % |
90 % |
53 % |
Vol avec violence |
301 |
5 495 |
5,2 % |
99 % |
87 % |
96 % |
53 % |
Vol entraînant destruction/ dégradation |
454 |
6 559 |
6,5 % |
97 % |
79 % |
88 % |
43 % |
Autres vols avec une circonstance aggravante |
618 |
14 181 |
4,2 % |
94 % |
68 % |
83 % |
33 % |
Autres vols avec deux ou trois circonstances aggravantes |
1 098 |
16 077 |
6,4 % |
97 % |
80 % |
87 % |
48 % |
Recel simple |
410 |
10 276 |
3,8 % |
95 % |
70 % |
84 % |
34 % |
Conduite malgré une suspension de permis |
240 |
4 495 |
5,1 % |
88 % |
62 % |
78 % |
37 % |
Coups et violences volontaires (cvv) ayant entraîné une incapacité totale de travail (itt) < 8 jours avec circonstances aggravantes |
571 |
22 161 |
2,5 % |
95 % |
77 % |
78 % |
30 % |
cvv ayant entraîné une itt > 8 jours avec circonstances aggravantes |
142 |
5 581 |
2,5 % |
100 % |
90 % |
90 % |
45 % |
Blessures involontaires dues à une conduite en état alcoolique (cea) ayant entraîné une itt < 3 mois |
192 |
2 927 |
6,2 % |
94 % |
81 % |
43 % |
10 % |
Exhibition sexuelle |
125 |
1 798 |
6,5 % |
90 % |
79 % |
58 % |
11 % |
Détention et acquisition de stupéfiants |
306 |
8 713 |
3,4 % |
92 % |
75 % |
78 % |
35 % |
Usage de stupéfiants |
116 |
4 687 |
2,4 % |
68 % |
60 % |
46 % |
20 % |
Commerce / transport/ emploi de stupéfiants |
138 |
4 094 |
3,3 % |
93 % |
85 % |
86 % |
43 % |
Outrage à agent public |
225 |
14 039 |
1,6 % |
84 % |
49 % |
68 % |
20 % |
Conduite en état alcoolique |
11 883 |
97 860 |
11,0 % |
84 % |
55 % |
31 % |
5 % |
2. Des délais d'inscription au Casier judiciaire préoccupants et des modalités d'accès aux informations inadaptées
Afin d'être en mesure de relever la récidive, il importe au premier chef que les magistrats soient informés en temps utile de son existence. C'est au Casier judiciaire qu'incombe cette tâche mais force est de constater que les informations qu'il contient ne sont pas toujours inscrites dans des délais satisfaisants. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que les magistrats du parquet ou les juges correctionnels saisis ne relèvent pas la récidive puisqu'ils ne sont pas en mesure de constater son existence.
En effet, selon les informations communiquées à la mission par M. Jean-Claude Marin, directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, le délai moyen entre le prononcé du jugement et son enregistrement par le Casier judiciaire s'établissait à 6,4 mois en 2002. Il convient cependant de préciser que le délai d'enregistrement des condamnations pénales par le Casier ne dépend pas que de la diligence de ses propres services mais résulte de la conjonction de deux délais distincts :
- celui nécessaire au traitement et à la saisie du jugement par les services compétents des juridictions ;
- celui relatif au traitement des ces informations par les services du Casier.
Le graphique suivant, qui décompose ces différentes phases, fait clairement apparaître que si le délai de traitement des informations par le Casier est relativement rapide (7 semaines), en revanche, plus de 22 semaines s'écoulent en moyenne entre le prononcé du jugement et l'envoi de la fiche au Casier, ce qui est excessif.
|
DIFFÉRENTES ÉTAPES ENTRE LE PRONONCÉ D'UNE CONDAMNATION (1) PAR UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET SON ENREGISTREMENT AU CASIER JUDICIAIRE NATIONAL AVEC INDICATION DES DÉLAIS DISPONIBLES |
||||||||||||||||
| Jour du prononcé du jugement | Rédaction de la motivation du jugement par le magistrat | Dactylographie du jugement et édition des pièces d'exécution | Lecture
du jugement par le magistrat et signature |
Reprographie des copies de jugement | Saisine
huissier aux fins de signification (2) |
Retour et enregistrement de la signification | Envoi de la fiche au casier | Enregistrement de la fiche par le Casier Judiciaire national | ||||||||
![]()
7 semaines en 2003 (18 semaines en 2000)
![]()
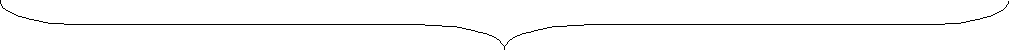
Délai moyen : 6,4 mois
Délai moyen global en 2002 : 6,4 mois
Dont délai moyen entre l'envoi de la fiche au casier et son enregistrement : 7 semaines
(Les délais concernant les autres étapes ne sont pas connus)
(1) : Condamnations tous contentieux confondus et tous modes de jugement
(2) : Dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier ou par défaut
Source : Pôle Études et évaluations (juin 2004)
Ces durées moyennes ne doivent pas occulter les profondes disparités qui existent entre les juridictions puisque les délais de transmission des fiches au Casier s'échelonnement de 13 jours au minimum à 699 jours au maximum. Ainsi, en 2001, ce délai atteignait 18,2 mois au tgi de Senlis, 17,4 mois au tgi de Nantes, 13,4 mois au tgi d'Orléans et 12,9 mois au tgi de Saint-Nazaire mais 8,4 mois au tgi de Nancy pour ne citer que ces quelques exemples. Compte tenu de ce qui précède, la mission considère que le recrutement temporaire de contractuels chargés de la saisie des jugements auprès des juridictions les plus en difficulté devrait être envisagé afin de résorber rapidement le retard accumulé dans la transmission des données au Casier (proposition n° 8).
Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que souscrire aux conclusions de son collègue Jean-Luc Warsmann qui, dans son rapport au ministre de la Justice(38), dénonçait « la justice devenue aveugle » et son « incapacité [à] être renseignée en temps réel sur l'existence des condamnations qu'elle a elle-même prononcées » en indiquant que « cette méconnaissance a des conséquences graves sur la décision que le tribunal sera amené à rendre. Dans l'ignorance d'une ou plusieurs condamnations, non encore parvenues au casier judiciaire, le tribunal n'est pas non plus informé de l'éventuelle récidive commise par le prévenu. Il ne sait pas, en outre, au cas où il prononce une peine d'emprisonnement ferme, si celle-ci révoque des sursis qui ont été précédemment prononcés ».
Par ailleurs, les modalités de consultation du Casier judiciaire souffrent d'un certain archaïsme puisque, si la demande d'extrait du Casier judiciaire peut être effectuée par des moyens informatiques (télématiques en l'occurrence) ou par fax, la transmission de la réponse par les services a lieu par courrier postal ou, dans le meilleur des cas, par fax. De surcroît, cette transmission par les services du Casier judiciaire ne peut avoir lieu le dimanche pour des raisons tenant à l'alimentation du système informatique central, alors même que des permanences sont organisées en juridiction.
À l'heure du développement des nouvelles technologies de l'information et de la libéralisation des moyens de cryptologie(39), la mission souhaite, d'une part et à l'unisson des recommandations du rapport précité de M. Jean-Luc Warsmann, que la transmission des informations au Casier judiciaire ait lieu en temps réel, au stade du prononcé de la condamnation par le greffe dès l'expiration du délai d'appel et, d'autre part, que la dématérialisation de la consultation des informations du Casier soit engagée afin de permettre son accès à tout moment (proposition n° 7). Toutefois, afin d'éviter d'éventuels abus, il conviendrait que cet accès direct soit encadré, réservé à certains magistrats habilités et que la traçabilité des consultations soit garantie à l'instar de ce qui est prévu actuellement pour le stic mis en oeuvre par les services de la police nationale.
En vue d'actualiser et de compléter l'information dont disposent les juges, il semble opportun de leur ouvrir l'accès aux fichiers de police et de gendarmerie nationales et, ce faisant, leur permettre de prendre en considération le caractère réitérant ou non du prévenu. Cette évolution est d'ores et déjà prévue par l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui, tout en donnant un fondement légal au stic, élargit l'accès à ses informations aux magistrats du parquet et aux juges d'instruction pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. Toutefois, l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée, juridiquement, à l'adoption d'un décret en Conseil d'État pris après avis de la cnil qui n'est malheureusement pas encore paru et, pratiquement, à l'existence de connexions dans les juridictions compatibles avec le programme informatique du stic.
Enfin, l'information des magistrats devrait également s'améliorer grâce à la création, par l'article 75 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires regroupant l'ensemble des informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les parquets ou les juges d'instruction ainsi que les suites qui leur sont données. Les données inscrites dans ce fichier seront :
- la date le lieu et la qualification juridique des faits ;
- l'état civil ou la raison sociale des mis en cause ;
- les décisions relatives à l'action publique, au déroulement de l'instruction, au jugement et aux modalités d'exécution de la peine ;
- la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
On le voit, ce fichier devrait permettre de renforcer la lutte contre la récidive en améliorant l'information des magistrats sur la situation judiciaire des personnes mises en cause. Toutefois, là encore, la détermination des modalités d'application de ces dispositions relève d'un décret en Conseil d'État pris après avis de la cnil, sachant que ce fichier ne sera effectif informatiquement que dans certaines juridictions équipées d'applications informatiques particulières et, pour les autres, à la suite de la mise en service du programme « Cassiopée » prévue pour les années 2006 à 2007.
B. AU STADE DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE : UNE JUSTICE QUI TOURNE À VIDE ?
1. Le problème de la non-exécution des courtes peines d'emprisonnement et des mesures alternatives à l'incarcération.
A une question écrite (40) de notre collègue Christian Estrosi sur le nombre de délinquants condamnés par la justice n'ayant pas accompli leur peine, le garde des sceaux, ministre de la justice répondait que, selon une étude menée au début de l'année 2002, « le rapprochement entre le nombre de peines d'emprisonnement ferme et le nombre des incarcérations constatées en 1999 conduit à un taux d'exécution apparent de 71 %. En tenant compte des situations particulières (plusieurs condamnations pour une même personne exécutées en une seule fois ou encore des détentions provisoires subies et non suivies d'une condamnation), ce taux a finalement été évalué à 68 %. L'inexécution de 32 % des peines trouve son origine soit dans l'application de règles juridiques soit dans des difficultés pratiques de mise à exécution. » S'agissant des premières, la réponse du ministre indique que le décret présidentiel de grâces collectives aboutit à ce que « près de 11 % des peines d'emprisonnement [ne sont] pas exécutées de ce fait ». Pour les secondes, « l'absence de domicile connu explique la non-exécution de près de 16 % des peines ».
Dans le cadre de son rapport précité, notre collègue Jean-Luc Warsmann n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer « le scandale des délais d'exécution » des peines, observant que, s'agissant des travaux d'intérêt général, « un nombre non négligeable [...] ne connaissent 18 mois après leurs prononcés qu'un début d'exécution. [...] le délai dans lequel le condamné obtient son premier rendez-vous avec l'agent du service d'insertion et de probation [étant] souvent supérieur à un an », alors même que les tig doivent être exécutés dans un délai maximum de 18 mois. Ces difficultés d'exécution affectent la crédibilité de cette mesure, dont les vertus pédagogiques et préventives en matière de récidive sont pourtant unanimement reconnues. Elles sont vraisemblablement à l'origine du moindre recours des juridictions aux tig puisque 23 541 mesures de cette nature étaient prononcées en 1997 pour seulement 17 658 en 2001 (41) et 17 990 en 2004. En ce qui concerne l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, poursuit notre collègue, il « tourne à l'absurde » et voit « son effectivité ruinée par la lenteur avec laquelle la prise en charge s'effectue » puisque le rythme moyen de convocation devant les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation « serait d'une tous les quatre mois ».
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que, à la différence du sursis simple, le code pénal ne prévoit aucune limitation quant au nombre de sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcé à l'encontre d'une même personne. Dans ces conditions, et afin de crédibiliser le suivi des personnes mises à l'épreuve, la mission considère que le nombre de condamnations assorties d'un sme devrait être limité à deux par grandes catégories d'infractions (proposition n° 2).
Pour leur part, les représentants de l'usm entendus par la mission ont pleinement corroboré ce constat, n'hésitant pas à dénoncer une « justice virtuelle ». En effet, ils ont indiqué que, selon leur estimation, 37 % des peines d'emprisonnement ne sont jamais exécutées, et qu'il s'agit « essentiellement des peines de moins d'un an, c'est-à-dire celles qui pourraient dissuader les récidives de petite délinquance ».
Il est indéniable que plus le retard s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par la victime tout d'abord, qui s'émeut à juste titre de son inexécution, par le condamné ensuite, qui ne comprend pas ces délais qui peuvent conduire à son incarcération plusieurs mois après les faits alors même que sa situation a changé, pour les enquêteurs enfin qui, bien qu'ayant identifié et interpellé l'auteur des fait, n'observent pas de résultat judiciaire de leurs efforts.
Déplorée par l'ensemble des personnes auditionnées par la mission, cette situation contribue à décrédibiliser la justice et nourrit le sentiment d'impunité. En effet, chacun s'accorde a considérer que, pour lutter plus efficacement contre la récidive, il est préférable de prononcer des sanctions immédiatement appliquées dès la première infraction afin de produire un choc psychologique, voire économique, chez le prévenu (42) plutôt que de recourir ultérieurement à des peines alourdies exécutées tardivement, voire aléatoirement. Les représentants de l'Association nationale des juges de l'application des peines (anjap), de l'Union syndicale des magistrats (usm), du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale (schpfn), des syndicats de policiers Alliance et Synergie officiers, des avocats et de la ligue contre la violence routière pour ne citer que ces quelques exemples, ont tous estimé que la première sanction et son exécution rapide constituaient l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la récidive.
Une telle politique pénale n'est pas forcément coûteuse dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de priorités clairement définies ainsi que l'illustre les initiatives menées par le Procureur de la République près le tgi de Douai, M. Luc Frémiot, que la mission a reçu.
QUAND LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AUX PERSONNES DEVIENT UNE VÉRITABLE PRIORITÉ DE POLITIQUE PÉNALE : L'EXEMPLE DE DOUAI
Désireux de lutter contre la récidive en recourrant à de nouvelles méthodes, le parquet de Douai a mis en place un dispositif spécifique en matière de lutte contre les violences conjugales et les comportements dangereux au volant. S'agissant des premières, l'objectif poursuivi est de traiter les comportements violents le plus précocement possible en leur apportant une réponse immédiate. En effet, les violences conjugales font trop souvent l'objet d'un traitement judiciaire tardif, les plaintes ayant généralement été précédées de plusieurs passages à l'acte de l'auteur qui a pu être signalé à différentes reprises auprès des services de police.
Afin de lutter contre cette relative indifférence, le procureur a demandé la suppression de la pratique des « mains courantes » en cette matière, tout en exigeant d'être immédiatement informé par les services de police des cas de violences conjugales.
Sur le fond le dispositif mis en place repose sur une double prise en charge : de l'auteur des faits, qui est immédiatement soustrait du foyer conjugal pour être placé en garde à vue ; de la victime, qui demeure dans son foyer en bénéficiant d'une assistance psychologique et juridique.
Une fois l'intéressé placé en garde à vue, la poursuite de la procédure dépend de la nature des faits commis.
- S'il s'agit de violences matérielles, dégradations ou menaces et qu'aucune violence physique n'a été exercée, les services de police ou de gendarmerie transmettent au procureur un constat de situation complété par des informations relatives à la personnalité du mis en cause permettant de déterminer si d'autres interventions des forces de l'ordre ont déjà eu lieu par le passé (« procédure d'alerte »). Ces différentes données sont consignées dans un rapport d'intervention adressé au parquet, à l'exclusion de toute inscription en main courante et sans délai. Le magistrat du parquet convoque alors le mis en cause pour admonestation, rappel à la loi et éventuelle orientation vers un centre d'hygiène alimentaire ou un service d'alcoologie. Le juge des enfants est éventuellement saisi en cas de risques avérés pour les mineurs résidant au domicile familial.
- S'il s'agit de violences physiques avérées, le mis en cause, à l'issue de sa garde à vue qui peut durer 48 heures, est déféré au parquet qui, dans les cas les plus graves saisit le tribunal correctionnel dans le cadre de la comparution immédiate devant lequel une peine d'emprisonnement sera requise. Dans les cas les plus légers, et en application des dispositions de l'article 137-2 du code de procédure pénale, le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire de l'auteur des faits par le juge des libertés et de la détention. Dans ce cadre, l'auteur doit quitter le domicile conjugal et est placé pendant quinze jours dans un foyer, « les compagnons de l'espoir » qui accueille des personnes sans domicile fixe ayant, pour la plupart d'entre elles, perdu leur logement et leur emploi à la suite de comportements violents provoqués par l'alcoolisme.
Au cours de ce séjour, le mis en cause partage les activités du foyer et dort sur place. Il est suivi par une association ayant pour mission de mettre en œuvre les mesures de contrôle judiciaire mais qui prend également en charge la victime. De surcroît, un suivi psychologique est prévu et le mis en cause est également adressé, lorsqu'il s'agit d'un alcoolique, au centre de cure ambulatoire en alcoologie de Douai où il rencontre un médecin alcoologue.
A l'issue de ce séjour, la procédure peut être classée si le mis en cause a suivi les obligations du contrôle judiciaire et que les éléments recueillis par l'association permettent d'envisager son reclassement. Ainsi que l'a indiqué à la mission M. Luc Frémiot, « le but recherché est de provoquer une prise de conscience, un véritable choc psychologique en soustrayant [l'auteur des faits], dès la commission des violences, de son domicile ». Lorsque le mis en cause retourne chez lui, l'association d'aide aux victimes et de contrôle judiciaire a pour mission de s'assurer qu'il n'exerce aucune pression sur la victime.
Si des poursuites sont engagées, un rapport de comportement est élaboré par cette association et communiqué au tribunal. En fonction du respect des obligations par le mis en cause et de l'évolution de son comportement, les réquisitions sont modulées et tendent, le plus souvent, à une demande de mise à l'épreuve afin de poursuivre ce suivi pendant plusieurs mois.
Débutée en mai 2003, cette expérience semble concluante puisque sur les 143 personnes prises en charge, 20 ont été présentées au tribunal correctionnel en comparution immédiate, 66 ont été placées dans le foyer des compagnons de l'espoir, 20 ont fait l'objet d'un rappel à la loi et 37 ont été placées chez un tiers. Sur les 66 personnes ayant été placées dans le foyer, seules deux ont réitéré et ont été condamnées à des peines d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel qui a été saisi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.
Lorsque la première réponse pénale n'a malheureusement pas suffi, la mission souhaite que l'exécution provisoire soit alors de droit lorsqu'une peine est prononcée à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive légale en matière sexuelle ou pour des faits de violence, la juridiction devant toutefois conserver la faculté d'y déroger par une décision spécialement motivée (proposition n° 1). En effet, il convient de rappeler que les condamnations ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont devenues définitives, c'est-à-dire insusceptibles d'appel. Or, en matière de violence, dont les statistiques attestent de la constante augmentation, il importe de protéger la victime et la société en conférant un effet immédiat aux jugements mettant en cause un récidiviste dangereux.
2. Une situation en voie d'amélioration à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Conscient de ces dysfonctionnements en matière d'exécution des peines, le législateur, grâce à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a entrepris une profonde réforme faisant suite aux travaux notre collègue Jean-Luc Warsmann auxquels il a été déjà fait allusion.
Sans que le présent rapport ait pour objet de présenter en détail l'ensemble de ces mesures qui composent le chapitre V du titre II de la loi (articles 159 à 204), il convient néanmoins de rappeler les dispositions suivantes :
- les aménagements de peines, tels que les placements extérieur, sous surveillance électronique ou en semi-liberté pourront désormais être prononcés dès l'audience du jugement afin de prévenir les effets désocialisants de la prison favorables à la récidive, notamment si l'incarcération provoque la perte d'un emploi ;
- le juge de l'application des peines, et non plus le tribunal correctionnel, pourra substituer une mesure d'aménagement de la peine par une autre afin d'adapter la mesure au profil du condamné et à son évolution (principe de fongibilité des mesures) ;
- le condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an se verra remettre, dès l'issue de l'audience de jugement, une convocation à comparaître devant le jap dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, ce qui devrait considérablement améliorer l'exécution des courtes peines (43) ;
- la juridiction de jugement pourra ordonner le retrait des réductions de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant en cas de nouvelle condamnation pour un crime ou un délit commis par le condamné au cours de la période égale à la durée des réductions de peine dont il a bénéficié ;
- les efforts de réinsertion sociale et professionnelle des condamnés seront davantage pris en considération dans le barème d'octroi des réductions de peine supplémentaires. S'agissant précisément du régime juridique des réductions de peine, la mission considère qu'octroyer un crédit de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, ne tient pas compte de la dangerosité des intéressés et n'est donc pas satisfaisant. C'est pourquoi elle propose de limiter le crédit de peine accordé aux condamnés récidivistes (proposition n° 2) tout en conservant la modulation du barème des réductions de peine supplémentaires en fonction des efforts de réinsertion manifestés par les intéressés.
Somme toute, ces dispositions devraient considérablement améliorer l'exécution des peines, l'accompagnement des sorties de détention et l'individualisation des mesures et, partant, contribuer à la lutte contre la récidive bien que leur entrée en vigueur soit prévue, selon les cas, le 1er octobre 2004, le 1er janvier 2005 voire en 2006 pour certaines d'entre elles.
C. AU STADE DE L'INCARCÉRATION DU CONDAMNÉ : UNE DANGEROSITÉ MÉSESTIMÉE ?
1. Une population carcérale qui cumule les difficultés
Comme l'a indiqué à la mission M. Patrick Molle, directeur de l'administration pénitentiaire, contribuer à la prévention de la récidive suppose un diagnostic des difficultés constituant des obstacles à l'insertion des populations placées sous main de justice. A cette aune, « le chemin à parcourir » est considérable tant la population des détenus cumule les handicaps ainsi que l'attestent les quelques chiffres suivants :
- 60 % des détenus ont un niveau scolaire n'excédant pas celui correspondant à la fin des études primaires ;
- 30 % sont en difficultés de lecture et 20 % sont illettrés. Les personnes en difficulté face à l'écrit seraient trois fois plus nombreuses en détention qu'à l'extérieur ;
- 65 % sont sans activité professionnelle et 15 % déclarent avoir un domicile précaire ou être sans abri ;
- 16 % sont indigents, ce qui signifie qu'ils disposent d'un compte nominatif dont le solde est inférieur à 45 euros ;
- 20 % des détenus sortants de détention avaient moins de 8 euros sur leur pécule de sortie selon un diagnostic établi en 1997 ;
- 40 % des nouveaux détenus n'ont eu aucun contact avec le système de soins dans les 12 mois précédant leur incarcération ;
- 33 % des entrants en détention cumulent des consommations à risque (alcool - tabac - drogue - psychotrope) et 27 % des mineurs déclarent avoir une consommation habituelle de drogue ;
- un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles de la santé mentale. Cette proportion particulièrement élevée a conduit l'administration pénitentiaire a souhaiter approfondir sa connaissance de la santé mentale des détenus afin d'améliorer l'accès à l'offre de soins psychiatriques. A cette fin, une convention a été conclue en 2003 entre le ministère de la Santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à la mise en œuvre d'une étude épidémiologique sur la santé mentale des détenus. Ce projet, portant sur deux années et 1 400 détenus, est cours de réalisation et ses premières conclusions devraient être établies à la fin de l'année. A ce propos, l'augmentation des agressions subies par les personnels pénitentiaires (de 127 en 1996 à 580 en 2002) ainsi que des suicides en détention (59 en 1990 à 122 en 2002) ne sont vraisemblablement pas sans lien avec les troubles mentaux dont souffrent nombre de détenus ;
- 10 % des nouveaux détenus déclarent avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier dans les 12 derniers mois précédant l'incarcération.
Il n'est pas nécessaire de poursuivre plus en avant cet inventaire pour mesurer la difficulté de la mission de réinsertion et de lutte contre la récidive assignée à l'administration pénitentiaire en général et aux services d'insertion et de probation en particulier. A ces différents obstacles à l'insertion professionnelle et sociale des détenus s'ajoute une difficulté d'ordre économique tenant aux disparités considérables entre les revenus issus des trafics illégaux, notamment de stupéfiants, et ceux obtenus dans le cadre d'une activité salariée accessible à un ancien détenu. La puissance de cette désincitation au travail légal a été soulignée devant la mission par de nombreux intervenants, notamment par MM. Michel Duvette, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, et Pierre-Jean Delhomme, directeur de la maison centrale d'Arles.
Pour autant, de nombreuses initiatives sont menées afin de mettre à profit le « temps captif » en matière d'accès aux soins, à l'enseignement, à la formation professionnelle ou au travail pénitentiaire. Ainsi, près de 380 enseignants à temps plein interviennent en milieu pénitentiaire pour un total de 11 800 heures de cours, 13 heures de cours hebdomadaires ont été dispensés aux mineurs incarcérés, 18 300 détenus ont travaillé en 2003, qu'il s'agisse d'une activité menée au sein du service général, dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (riep), du travail en concession ou en placement à l'extérieur.
Toutefois, et c'est l'un des enseignements que la mission retire de ses nombreuses auditions, l'évaluation de la dangerosité sociale des détenus au cours de la période d'incarcération et leur risque de récidive est quasi inexistante, ce qui n'est pas satisfaisant.
2. Une insuffisante évaluation de la dangerosité des détenus
L'évaluation actuelle de la personnalité des détenus privilégie leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion ou de trafics divers) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive). La pratique en vigueur, bien que nécessaire, n'en demeure pas moins partielle et dépourvue de tout caractère prospectif sur la dangerosité du détenu qui est généralement définie comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens. »(44). Or, parce que récidive et comportement dangereux ont partie liée, la mission souhaite la mise en place d'instruments spécifiques tendant à mesurer la dangerosité des détenus toute au long de leur période d'incarcération, notamment lorsqu'il s'agit de délinquants sexuels (proposition n° 14).
Bien évidemment, s'agissant de comportements humains, l'établissement d'une probabilité de cette nature ne peut être certain et doit être le résultat d'une discipline aussi scientifique et sérieuse que possible. Ainsi que l'a précisé le docteur Louis Roure dans le document qu'il a remis à la mission, « lorsque l'on parle de récidivisme, se pose immédiatement la question du pronostic. Celui-ci se confond, dans une très large mesure, avec celui de l'état dangereux. Il s'agit d'une notion extrêmement importante, bien que mal connue en France. Ceci s'explique par le fait que notre pays privilégie toujours la clinique par rapport aux statistiques et à l'évaluation, malgré des efforts trop timides en matière d'épidémiologie. L'état dangereux et son pronostic, ne procèdent pas exclusivement de méthodes cliniques médicales classiques » car « il n'existe aucune méthode en soi, actuellement susceptible d'être totalement fiable dans le repérage de ce que l'on appelle l'état dangereux ».
A titre d'exemple, l'appréciation par les médecins, les magistrats ou les policiers d'un acte exhibitionniste que l'auteur risque de renouveler va être fort diverse, certains ne le considérant pas comme dangereux et contestant l'opportunité de leur intervention sur le sujet, d'autres, à l'inverse, jugeant cet acte comme hautement nuisible sur le plan social et estimant que le risque de renouvellement des faits rend le mise en cause d'autant plus dangereux.
L'appréciation de la dangerosité et la mesure de la probabilité de commission d'une infraction constitue donc un exercice particulièrement délicat qui doit néanmoins être mise en œuvre au travers d'une méthodologie pluridisciplinaire associant des expertises psychiatriques, médico-psychologiques et comportementales du condamné car, « aucun secteur de la médecine ou du domaine social ne saurait rester étranger à la criminologie(45). S'intéresser au récidivisme, c'est s'intéresser à un des aspects principaux des deux disciplines médicales et criminologiques. La récidive c'est, étymologiquement « celui qui tombe ». On parlera de récidivisme sur le plan criminologique et de rechute sur le plan médical »(46). Le schéma suivant (47) représente les différentes disciplines intervenant en matière de criminologie.
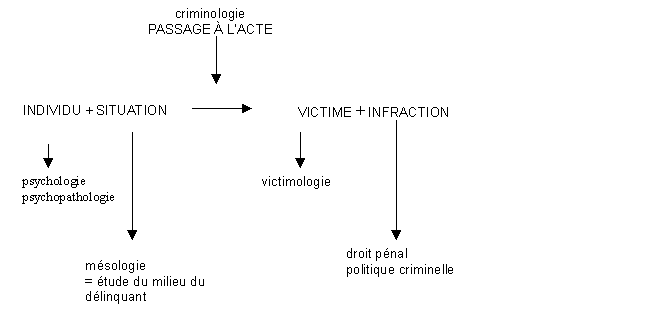
UN EXEMPLE DE MESURE DE LA DANGEROSITÉ : LES PROGRAMMES CORRECTIONNELS CANADIENS
En application des dispositions de l'article 3 de la loi du 18 juin 1992 du Canada régissant le système correctionnel (scc), la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, le scc « vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois »
Parce que tous les condamnés ont donc vocation à recouvrer la liberté et que la majeure partie des détenus bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle après avoir exécuté 40 % de leur peine, le scc a mis en place une offre variée de programmes. Comme le précisent les articles 76 et 77 de la loi du 18 juin 1992 précitée, les programmes tendent « à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale. Le scc doit, notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l'expérience appropriées. »
Ainsi qu'il est indiqué sur le site Internet du scc, il existe une douzaine de grands programmes fédéraux, notamment pour les « Autochtones », les femmes, les victimes, les familles des délinquants ou en matière correctionnelle. Si l'on s'intéresse plus particulièrement à ces derniers, ils consistent en une intervention structurée qui agit sur les facteurs liés directement au comportement criminel du délinquant. Les programmes correctionnels se déclinent donc par « spécialité criminelle » et concernent : la prévention de la violence, la toxicomanie, les délinquants sexuels ou l'acquisition de compétences psychosociale, éducative ou professionnelle. Le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme est particulièrement précis et méthodique.
Une « norme » de programme correctionnel est tout d'abord établie par le gestionnaire national de programmes (gnp) qui doit déterminer sa forme, son processus de validation et d'évaluation en se fondant sur l'analyse des besoins et des pratiques professionnelles. Dans l'élaboration du programme, le gnp doit tenir compte du niveau de risque et des besoins des délinquants afin d'en déduire l'intensité, la durée et le type de groupe du programme. Un guide prévu à cet effet est reproduit ci-après(48).
Guide à suivre pour déterminer l'intensité, la durée et le type de groupe
des programmes correctionnels
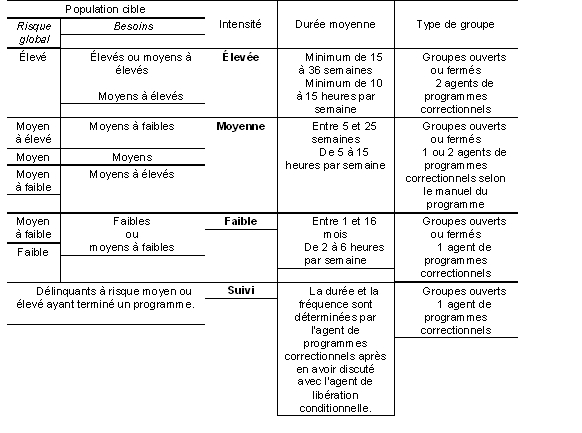
Le gnp doit ensuite procéder à la description du contenu du programme correctionnel qui comporte obligatoirement les éléments suivants :
- les critères de sélection des condamnés ;
- le niveau d'intensité du programme ;
- les facteurs criminogènes ciblés (les champs d'intervention ou cibles du programme) ;
- la fréquence et la durée du programme ;
- les objectifs du programme ;
- les évaluations du programme.
Puis, le programme doit être accrédité par le commissaire adjoint, évaluation du rendement (caer) qui est également responsable de l'accréditation des unités opérationnelles appelées à le mettre en œuvre. L'accréditation est délivrée si le programme répond aux critères suivants :
- un modèle empirique du changement des condamnés ;
- un ciblage de facteurs criminogènes ;
- des méthodes efficaces de prestation comprenant l'énoncé de qualités des postes d'agents de programmes correctionnels ;
- une acquisition de compétences au profit des condamnés concernés ;
- une réceptivité des délinquants au contenu du programme ;
- une intensité modulable du programme garantissant la continuité des interventions ;
- un suivi et une évaluation continus.
Une fois l'accréditation délivrée, un important travail de formation des agents de programmes correctionnels est mis en œuvre sous la responsabilité du gnp. Là aussi, la formation dispensée fait l'objet d'une certification et d'une évaluation.
Au-delà de cette description générale de l'élaboration des programmes, votre rapporteur souhaite citer l'exemple des programmes pour les délinquants sexuels.
Le principal objectif de ces programmes est d'évaluer la personnalité des délinquants sexuels afin d'élaborer des stratégies susceptibles de réduire le risque de récidive. Le condamné est ainsi soumis à une évaluation spécifiquement conçue pour les délinquants sexuels qui embrasse les points suivants :
- l'historique et le développement du comportement sexuel,
- les préférences sexuelles,
- les attitudes et les distorsions cognitives,
- les aptitudes sociales,
- les antécédents médicaux,
- la psychopathologie et les résultats des évaluations et des programmes antérieurs.
A l'issue de cette évaluation, un traitement du délinquant sexuel est entrepris dont le but est de réduire le risque de récidive au moyen d'une maîtrise de soi efficace. Il porte sur les distorsions cognitives, l'excitation et les fantasmes sexuels déviants, les compétences sociales, la gestion de la colère et des émotions.
Ces traitements sont en général conçus selon une approche cognitivo-comportementale et mis en œuvre en groupe avec, le cas échéant, des interventions individuelles. Ils obligent le délinquant à assumer la responsabilité de ses actes, à reconnaître la progression du comportement avant et après les infractions sexuelles et à identifier les situations où il risque de récidiver. A cette fin, ils abordent les attitudes face à la sexualité et aux relations interpersonnelles, l'amélioration de l'empathie et la sensibilisation aux traumatismes des victimes, la gestion de la colère et des émotions, les techniques de réduction ou de maîtrise des pulsions sexuelles déviantes. Les délinquants ayant des besoins modérés ou élevés se trouvant généralement incarcérés, les programmes les concernant sont intensifs et de longue durée. Les délinquants ayant peu de besoins, ou qui présentent un risque de récidive moindre, suivent des programmes d'intensité faible et de courte durée dans des établissements à sécurité minimale, voire même au sein d'une collectivité locale.
Enfin, il convient de souligner que tous les condamnés qui ont participé à un programme pour délinquants sexuels ont l'occasion de participer à un programme de maintien des acquis et des gains thérapeutiques suivi dans les établissements et dans les collectivités locales.
3. Un système judiciaire amnésique
Si notre système pénitentiaire est donc parcellaire en matière d'évaluation de la dangerosité des détenus, notre système judiciaire est, quant à lui, amnésique en ce qui concerne les criminels les plus dangereux reconnus pénalement irresponsables en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits.
En effet, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la personne ayant commis un crime ou un délit est irresponsable pénalement lorsque son discernement a été aboli au moment des faits. Dans cette hypothèse, l'auteur des faits est généralement pris en charge par le préfet qui prononce son hospitalisation d'office (49) pendant une durée moyenne relativement brève, de l'ordre de quelque mois. A l'issue de cette hospitalisation d'office, la personne recouvre la liberté sans aucune forme de suivi par les autorités judiciaires ni même de mémoire des faits commis puisque le casier judiciaire ne recense que les condamnations devenues définitives qui, précisément, font défaut en l'espèce.
Cette situation est d'autant plus paradoxale que, pour des faits identiques commis par un prévenu dont le discernement n'a pas été aboli au moment des faits mais seulement « altéré » (2e alinéa de l'article 122-1 du code pénal), une condamnation peut éventuellement être prononcée et, ce faisant, permettre un suivi judiciaire de la personne. Il résulte donc du droit en vigueur que la mise en place d'un suivi judiciaire pour les prévenus souffrant, ou ayant souffert, des troubles psychiques les moins graves est envisageable mais qu'un tel suivi est impossible pour les prévenus au comportement le plus imprévisible et donc les plus dangereux.
Toutefois, il convient de rappeler que la création du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) par la loi du 9 mars 2004 précitée, prévoit l'inscription dans ce fichier des données relatives aux délinquants sexuels reconnus irresponsables pénalement en raison de l'abolition de leur discernement. (50) La mission souhaite poursuivre dans cette voie et propose la création d'un fichier recensant l'ensemble des personnes reconnues irresponsable pénalement en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits afin de conserver la mémoire judiciaire de leur comportement et donc de leur dangerosité, à l'instar du fichier d'empreintes génétiques allemand (51) (proposition n° 20). En outre, la mission considère que la décision de placement en hôpital psychiatrique des prévenus reconnus pénalement irresponsables doit relever de l'autorité judiciaire qui sera ainsi en mesure d'assurer leur suivi (proposition n° 19).
4. Une offre de soins psychiatriques insuffisante
On le sait, près d'un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles mentaux. Les besoins de prise en charge psychologique et psychiatrique sont donc immenses et croissants alors même que l'offre psychiatrique se fait plus rare.
En effet, ainsi que l'ont indiqué à la mission M. Patrick Molle, directeur de l'administration pénitentiaire et Mme Betty Brahmy, psychiatre et médecin-chef du smpr de la prison de Fleury - Mérogis, près de 800 postes de psychiatres sont vacants dans le secteur public. Il s'agit donc d'une situation de pénurie, voire de crise d'ensemble, dont le secteur pénitentiaire ne fait que pâtir. Une première mesure d'urgence consisterait donc à pourvoir les postes de psychiatres vacants (proposition n° 16).
La prise en charge des pathologies et des troubles mentaux en milieu carcéral repose actuellement sur les smpr (service médico-psychologique régional) dont le nombre est insuffisant et qui se heurtent aux difficultés suivantes :
- les réticences des établissements de santé à recevoir des personnes détenues en hospitalisation d'office en l'absence de garde statique par les forces de l'ordre ;
- l'évolution des méthodes en psychiatrie ayant privilégié les services ouverts au détriment des services fermés, elle a rendu plus difficile l'accueil des personnes détenues en raison des risques d'évasion. Cette situation a souvent conduit à des séjours plus courts en chambre d'isolement, ce qui n'est pas sans affecter la qualité des soins dispensés.
Désireux de remédier à cette situation, l'article 48 de la lopj du 9 septembre 2002 a modifié les conditions d'hospitalisation pour troubles mentaux des personnes détenues en créant des unités hospitalières spécialement aménagées (uhsa). Ces unités permettent l'hospitalisation complète des détenus, avec ou sans leur consentement, mettant ainsi un terme à l'hospitalisation complète en smpr. À cet égard, il convient de souligner l'élargissement des critères conduisant à l'hospitalisation non consentie, puisque la loi prévoit l'application aux personnes détenues des dispositions relatives à l'hospitalisation à la demande d'un tiers applicable au milieu libre.
Cette disposition novatrice devrait favoriser l'offre de soins aux détenus qui ne remplissent pas les conditions permettant leur hospitalisation d'office, dans la mesure où ils ne compromettent pas la sûreté des personnes ni l'ordre public, mais qui nécessitent pourtant une hospitalisation complète qu'ils refusent. Il est notamment escompté de ces dispositions une amélioration de l'offre de soins en direction de détenus que leur discrétion, ou leur effacement, écarte de la prise en charge idoine.
Afin d'évaluer les besoins en lits d'hospitalisation psychiatrique, de définir la configuration du schéma national d'hospitalisation psychiatrique et les conditions de fonctionnement des unités, un groupe de travail interministériel Santé - Justice a été mis en place. La conclusion de ses travaux a été présentée au début de l'année 2004 et l'ouverture des premières uhsa devrait avoir lieu en 2006. En l'attente de la mise en service des uhsa, le dispositif antérieur demeure en fonctionnement.
La création des uhsa, et la disparition corrélative des possibilités d'hospitalisation complète en milieu pénitentiaire (smpr), accentuent d'autant la nécessité de progresser dans l'accompagnement en détention des personnes détenues souffrant de troubles mentaux, mais pour autant n'étant pas hospitalisées. Ainsi les smpr recentreront, à terme, leur mission sur les soins ambulatoires.
Enfin, ainsi que Mme Betty Brahmy l'a indiqué, le nombre des personnes incarcérées présentant des troubles mentaux est également le résultat de l'échec du système psychiatrique français et du démantèlement progressif des capacités d'hospitalisation en milieu ouvert et de suivi à domicile qui ont pour effet d'orienter vers la prison des personnes qui ne devraient pas, de prime abord, s'y retrouver, à l'instar des malades en rupture de soins dont le comportement à, de ce fait, pu devenir constitutif d'une infraction.
D. AU STADE DE LA LIBÉRATION OU DU SUIVI DE LA MISE À L'ÉPREUVE : LES SERVICES DE L'APPLICATION DES PEINES OUBLIÉS PAR LA JUSTICE ?
1. La misère de l'application des peines
Sur les 8 364 emplois de magistrats comptabilisés en 2002(52), les juges de l'application des peines n'étaient que 250, leur nombre devant toutefois atteindre 295 à la fin de l'année selon les informations communiquées à la mission par M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires. Représentant 3,5 % du corps des magistrats, les juges de l'application des peines (jap) sont les grands oubliés de la justice alors même que leurs missions, essentielles en matière de lutte contre la récidive, sont considérablement accrues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Le tableau suivant illustre la constance de cette part minoritaire, certains diraient résiduelle, des jap au sein de la magistrature.
|
ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE |
|||
|
Promotion (1) |
Nombre de postes de J.A.P. offerts |
Nombre d'auditeurs de justice |
Nombre de postes de J.A.P. offerts par rapport au nombre d'auditeurs de justice en % |
|
1992 |
15 |
167 |
8,98 |
|
1993 |
8 |
155 |
5,16 |
|
1994 |
5 |
114 |
4,38 |
|
1995 |
4 |
106 |
3,77 |
|
1996 |
13 |
147 |
8,84 |
|
1997 |
7 |
154 |
4,54 |
|
1998 |
8 |
161 |
4,96 |
|
1999 |
9 |
196 |
4,59 |
|
2000 |
14 |
200 |
7,00 |
|
2001 |
13 |
224 |
5,80 |
|
2002 |
27 |
266 |
10,15 |
|
(1) par application des dispositions de l'article 40 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'École nationale de la magistrature, la durée de la scolarité des auditeurs de justice est de trente et un mois. Ainsi, par exemple, c'est à l'issue de cette période de formation que les auditeurs de justice de la promotion 1992, entrés à l'E.N.M. début 1992, se sont vu offrir les 15 postes de juge d'application des peines ci-dessus indiqués. |
|||
| Source : École nationale de la magistrature. | |||
Cette faiblesse des effectifs des jap est d'autant plus préoccupante qu'ils ont pour vocation de déterminer, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire et, dans les limites prévues par la loi, d'accorder les placements à l'extérieur, sous surveillance électronique, une mesure de semi-liberté, la libération conditionnelle, les permissions de sortir et les réductions de peines pour ne citer que ces quelques exemples. A ce titre, les jap ont prononcé en 2003 :
- 2 733 placements à l'extérieur ;
- 6 261 mesures de semi-liberté ;
- 33 786 permissions de sortir ;
- 5 286 libérations conditionnelles.
Au total, et selon les estimations de l'association nationale des juges de l'application des peines (anjap) communiquées à la mission, près de 170 000 personnes étaient suivies par les 250 jap au 1er juillet 2003 (39 038 détenus et 129 269 personnes en milieu ouvert) soit un ratio moyen de 680 personnes par jap !
Dans de telles conditions, il est illusoire de prétendre mettre en œuvre un suivi personnalisé des condamnés que les juridictions prononcent pourtant massivement, les sursis avec mise à l'épreuve constituant la principale mesure dont les jap ont la charge (105 247 en 2003).
A la faiblesse des effectifs des jap s'ajoute celle, non moins flagrante, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip) sur lesquels ces juges s'appuient. En effet, les effectifs budgétaires des spip atteignaient 2 473 en 2003, ce qui est notoirement insuffisant puisque ces personnels ont pour mission d'assurer le suivi tant des personnes incarcérées que des personnes condamnées exécutant leur peine en milieu ouvert. Il n'est donc guère surprenant de constater que nombre de suivis avec mise à l'épreuve ne sont pas mis en œuvre par les services compétents, faute de moyens, ce qui altère la crédibilité de la sanction pénale et contribue au sentiment d'impunité des délinquants.
Par ailleurs, et comme le notait notre collègue Valérie Pecresse dans son rapport pour avis sur les crédits de la loi de finances pour 2004 consacrés aux services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, « la réforme des services d'insertion et de probation qui a unifié les milieux ouverts (anciennement comité de probation et d'assistance aux libérés) et fermés (services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires), n'a pas été accompagnée de dispositions statutaires prenant en compte l'inflation des mesures de prise en charge et le développement des demandes en matière d'insertion des condamnés. Cette situation n'est pas demeurée sans conséquence, notamment en matière de recrutement : le statut peu attractif des chefs des services d'insertion et de probation (CSIP), au regard de la responsabilité qui leur échoit, rend leur recrutement très difficile à telle enseigne que le nombre de candidats n'atteint pas, depuis trois concours, celui des emplois offerts. Quant au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DSPIP), s'il bénéficie d'une bonification indiciaire, il ne comporte aucun débouché ni perspective d'évolution de carrière »(53).
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, un projet de réforme statutaire est en cours et a précisément pour objet de créer un corps de catégorie A, ce qui devrait permettre de conforter le DSPIP dans son rôle de représentant départemental du service. Quant aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation (CSPIP), ce projet de réforme prévoit une réévaluation statutaire du corps afin de lui rendre une certaine attractivité compte tenu de la pénibilité de leur mission.
Compte tenu de ce qui précède, la mission souhaite que la priorité soit réellement donnée au renforcement des moyens dédiés à l'exécution des peines, gage de la restauration de la crédibilité de la sanction pénale et de la prévention de la récidive. C'est pourquoi, elle propose que le nombre de postes de jap offerts à l'issue de l'E.N.M. atteigne 20 % de l'effectif de chaque promotion de magistrats pendant les cinq prochaines années et que les recrutements des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation soient substantiellement amplifiés (propositions n° 11 et 12).
2. Les dangers des « sorties sèches » de détention, facteurs de récidive
Parce qu'elle est privative de liberté, la prison a également pour effet d'anémier la capacité du détenu à se prendre en charge. Préparer la sortie, c'est donc, avant tout, réapprendre les gestes de l'autonomie et donc lutter contre la récidive. Comme l'a écrit notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son rapport au garde des Sceaux précité, « la sortie de prison, quelle que soit la durée de la peine purgée, est un moment difficile à vivre. La personne libérée sans préparation ni accompagnement risque de se retrouver à nouveau dans un environnement familial ou social néfaste, voire criminogène, ou bien au contraire dans un isolement total, alors qu'elle aurait besoin de soutien pour se réadapter à la vie libre. Tout ceci peut l'amener à la récidive ».
Par ailleurs, la préparation à la sortie doit également embrasser l'ensemble des problématiques auxquelles va être confronté le détenu, notamment en termes sanitaires. En effet, la plupart des détenus n'ont de cesse, dès leur sortie, d'oublier la détention, y compris ce qu'ils ont pu y apprendre, par exemple en matière d'enseignement professionnel ou d'éducation sanitaire. À telle enseigne que dans un rapport de juin 2001, l'igsj et l'igas appelaient de leurs vœux l'amélioration de l'articulation entre services pénitentiaires et services sanitaires pour parvenir à une prise en charge globale de la personne tout en soulignant la nécessité d'assurer la continuité des soins pour les personnes qui sortent de prison, notamment par une concrétisation de l'ouverture de leurs droits sociaux. Au-delà de la prévention de la récidive, la préparation à la sortie des détenus est donc également un enjeu en terme de santé publique qu'il ne faut pas négliger.
Alors même que la nocivité des sorties sèches est désormais clairement établie, force est de constater le faible recours aux dispositifs progressifs de préparation à la sortie : le nombre des libérations conditionnelles va décroissant (5 680 en 2001 contre 5 286 en 2003), les ordonnances de placement à l'extérieur diminuent fortement (3 339 en 2000 contre 2 733 en 2003), les mesures de semi-liberté régressent substantiellement (6 757 en 2000 à 6 261 en 2003).
C'est pourquoi, la loi du 9 mars 2004 précitée a introduit le « sas de sortie » qui organise la libération progressive et accompagnée du condamné. Ainsi, en application des dispositions des articles 723-20 à 723-28 nouveaux du code de procédure pénale, les condamnés détenus pour lesquels il reste trois mois d'emprisonnement à subir (si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure à deux ans) ou six mois de détention à subir (si la peine prononcée est supérieure à deux ans d'emprisonnement et inférieure à cinq ans) doivent bénéficier, « dans le mesure du possible », du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. Il appartient au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (dspip) d'examiner le dossier du condamné afin de déterminer la mesure adéquate. Ceci fait, et sauf refus du condamné, le dspip saisit par requête le jap d'une proposition d'aménagement de peine. S'il choisit de ne pas saisir le jap, le dspip en informe le condamné.
Le jap dispose alors d'un délai de trois semaines pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou non la proposition. A défaut de réponse du jap dans le délai de trois semaines, le dspip peut décider de mettre en œuvre la mesure d'aménagement de peine. On le voit, ce dispositif innovant de remise en liberté progressive et individualisée des condamnés confère aux services pénitentiaires d'insertion et de probation une nouvelle mission délicate mais déterminante en matière de réinsertion et de lutte contre la récidive, ce qui plaide une nouvelle fois pour le renforcement de leurs moyens.
Au-delà des questions de personnel évoquées plus haut, les spip s'appuient également sur de nombreuses associations qui complètent utilement leur travail, notamment en matière d'hébergement, d'insertion professionnelle ou de placement à l'extérieur. Ainsi, selon les informations communiquées à votre rapporteur par l'administration pénitentiaire, près de 300 conventions de placement à l'extérieur ont été conclues entre les spip et des associations ou des collectivités locales et 2,32 millions d'euros ont été dépensés en cette matière. Or, comme l'ont indiqué plusieurs personnalités auditionnées par la mission, en particulier MM. Pierre Raffin et Pierre-Jean Delhomme, directeurs d'établissements pénitentiaires, de très nombreux condamnés à de longues peines sortent de détention dans le dénuement le plus complet, en ayant perdu tout lien avec leur famille. Cet isolement social et affectif constitue un facteur évident de récidive qui est aggravé par les difficultés de logement auxquelles sont confrontées les condamnés sortant de prison.
En dépit de leurs actions, spip et associations ne parviennent pas à répondre aux besoins croissants des condamnés libérés dans un contexte économique particulièrement difficile, notamment en matière d'accès à l'emploi et au logement. Afin de prévenir la récidive, la mission juge essentielle l'augmentation des dotations versées aux associations de réinsertion et d'aide au logement des condamnés libérés (proposition n° 13).
3. Les inconséquences du suivi socio-judiciaire
La délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France. La part des délinquants sexuels au sein de la population des condamnés a crû de 105,6 % entre 1995 et 2003 et concernait 8 109 personnes, excédant de beaucoup les 5 217 condamnés pour coups et blessures dont l'augmentation n'en est pas moins inquiétante (+ 161,2 %). Le tableau suivant illustre ces tendances.
|
EFFECTIFS DE LA POPULATION CARCÉRALE |
||||||||||
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Évolution en % |
|
|
Vol simple |
6 208 |
6 541 |
5 678 |
5 062 |
4 675 |
4 040 |
3 470 |
3 737 |
3 850 |
- 38,0 |
|
Vol qualifié |
2 886 |
3 089 |
3 367 |
3 887 |
4 107 |
4 198 |
3 765 |
3 894 |
3 481 |
20,6 |
|
Recel, escroquerie, abus de confiance |
1 317 |
1 372 |
1 108 |
1 246 |
1 472 |
1 280 |
1 374 |
1 645 |
2 009 |
52,5 |
|
Homicide volontaire : meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement |
3 120 |
3 230 |
3 221 |
3 268 |
3 382 |
3 492 |
3 357 |
3325 |
3 293 |
5,5 |
|
Coups et blessures volontaires (y compris sur mineur) |
1 997 |
2 124 |
2 082 |
2 366 |
2 636 |
2 953 |
3 368 |
4 059 |
5 217 |
161,2 |
|
Infraction à la législation sur les stupéfiants |
6 361 |
6 772 |
6 377 |
5 875 |
5 412 |
4 910 |
4 373 |
3 936 |
4 127 |
- 35,1 |
|
Viol, attentat aux mœurs |
3 945 |
4 759 |
5 218 |
6 044 |
6 760 |
7 499 |
7 895 |
7 779 |
8 109 |
105,6 |
|
Police des étrangers |
1 329 |
1 487 |
1 515 |
1 056 |
965 |
878 |
778 |
896 |
870 |
- 34,5 |
|
Autres |
3 396 |
3 518 |
2 940 |
3 180 |
2 852 |
3 876 |
3 251 |
3 173 |
3 573 |
5,2 |
|
Ensemble |
30 559 |
32 892 |
31 506 |
31 984 |
32 261 |
33 126 |
31 631 |
32 444 |
34 529 |
13,0 |
|
Source : statistique trimestrielle. |
||||||||||
Confronté à ces évolutions, le législateur (54) a mis en place des instruments spécifiques de contrôle des condamnés sexuels à l'instar du suivi socio-judiciaire. Dans ce cadre, et au titre des mesures de surveillance et de contrôle destinées à prévenir la récidive comme le précise l'article 131-36-1 du code pénal, le condamné peut être contraint :
- de s'abstenir de paraître en certains lieux accueillant des mineurs ou de fréquenter certaines personnes ;
- de ne pas exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs.
Par ailleurs, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonctions de soins qui est prononcée par la juridiction de jugement comme le prévoit l'article 131-36-4 du code pénal. Le dispositif de l'injonction de soins est mis en oeuvre par deux médecins, le premier, psychiatre et « coordonnateur », est désigné dans le ressort de chaque tribunal de grande instance par le procureur de la République, le second, médecin traitant étant conseillé au condamné par le coordonnateur.
Bien qu'aucun traitement ne puisse être entrepris sans le consentement de l'intéressé, son refus de s'y soumettre peut entraîner son incarcération. Cette menace, complétée par la durée du suivi socio-judiciaire pouvant désormais atteindre vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle, devrait faire de cet instrument un moyen efficace de lutte contre la récidive. Or, force est de constater que le suivi socio-judiciaire en général, et l'injonction de soins en particulier, se heurte à de nombreuses difficultés et est, de ce fait, peu prononcé et mal appliqué.
· Le nombre des suivis socio-judiciaire (ssj) prononcés demeure particulièrement faible : 5 en 1998, 75 en 1999, 265 en 2000, 421 en 2001 et 645 en 2002, soit moins de 8 % des délinquants sexuels incarcérés. Par ailleurs, ni les services du ministère de la justice ni ceux la santé ne sont en mesure de connaître la proportion de ces suivis assortie d'une injonction de soins, de fournir le nombre des médecins coordonnateurs et de leurs interventions. Pour sa part, la direction de l'administration pénitentiaire (dap) du ministère de la justice ne dispose pas de statistiques sur le nombre de mesures de suivi assorties d'une injonction de soins dont les services pénitentiaires d'insertion et de probation ont pourtant la charge.
Certes, les délinquants sexuels doivent d'abord être considérés comme des criminels devant être châtiés, et non comme des malades souffrant d'une pathologie de nature à expliquer leur comportement, mais il n'en demeure pas moins que cette absence de données illustre la méconnaissance, voire le désintérêt, dont souffrent le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins et atteste de la défaillance de leur pilotage au niveau central.
· D'autres éléments d'information émanant des praticiens consultés par la mission tendent à montrer que ce dispositif est mal appliqué.
Ainsi, le rôle des spip n'est pas défini par le décret pris en application de la loi du 17 juin 1998 précitée(55), alors même que ces services doivent assurer l'accompagnement des condamnés astreints au suivi socio-judiciaire en vue de leur éventuelle démarche vers l'offre de soins.
Par ailleurs, la pénurie de médecins psychiatres dans le secteur public conduit à ce que de nombreux tgi soient dépourvus de médecin coordonnateur, sans que la mission n'ait été en mesure de connaître précisément leur nombre, ce qui est regrettable. En outre, la prise en charge des délinquants sexuels se heurte également à des oppositions doctrinales d'une grande partie de cette profession.
En effet, comme l'a indiqué à la mission Mme Betty Brahmy, une majorité de psychiatres considère que les délinquants sexuels étant des « pervers » au sens clinique du terme, ils ne peuvent, de ce fait, être soignés et ne relèvent donc pas de la psychiatrie à la différence des « schizophrènes ». Cette position de principe, méconnue de l'opinion publique, est d'autant plus difficile à accepter par les élus de la nation que les délinquants sexuels font généralement l'objet d'une prise en charge psychiatrique au cours de leur incarcération. Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi ce qui semble envisageable en milieu carcéral devient impossible en milieu ouvert.
Ce refus de prendre en charge une population, certes éminemment difficile, tient également à sa relative méconnaissance par les psychiatres. En effet, la formation initiale des médecins psychiatres ne comprend aucun enseignement spécifique sur les délinquants sexuels, ce qui ne favorise pas leur investissement en tant que coordonnateur de l'injonction de soins. C'est pourquoi, afin d'améliorer l'application de l'injonction de soins, la mission souhaite que la formation initiale des psychiatres comprenne un enseignement spécifique sur les délinquants sexuels. De même, l'accès à la fonction de médecin traitant dans le cadre de l'injonction de soins devrait être réservée aux médecins ayant bénéficié d'une formation particulière en cette matière (proposition n° 17).
Enfin, une autre source des dysfonctionnements du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins tient au fait que l'article L. 3711-1 du code de la santé publique dispose que la personne en charge du traitement doit être un médecin. Or, cette exigence constitue une véritable entrave à la mise en œuvre de l'injonction de soins tant les postulants médecins sont rares pour exercer cette pénible mission. C'est pourquoi, la mission suggère que les titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie clinique (dess) puissent également être proposés comme responsables du traitement du condamné sexuel par le médecin coordonnateur (proposition n° 18). Ce faisant, il ne s'agit pas d'évincer les médecins de la mise en œuvre de l'injonction de soins mais d'élargir l'offre des intervenants oeuvrant dans ce cadre afin d'en permettre une application satisfaisante qui n'a que trop tardée.
III. - LES PROPOSITIONS DE LA MISSION : 20 MESURES POUR PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE
A. SANCTIONNER PLUS SÉVÈREMENT LES RÉCIDIVISTES
a) En mettant en place des procédures adaptées
1. Prévoir l'incarcération immédiate des récidivistes sexuels ou violents
L'article 708 du code de procédure pénale dispose que l'exécution de la peine a lieu lorsque la condamnation est devenue définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours. Toutefois, il est des hypothèses où la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé, par exemple lorsque la juridiction correctionnelle délivre un mandat de dépôt ou d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 465 du code de procédure pénale) ou même inférieure si le tribunal est saisi dans le cadre de la comparution immédiate (article 397-4 du même code).
On le voit, ces différentes hypothèses d'exécution provisoire des décisions ne distinguent pas si le prévenu est en état de récidive, en particulier s'il fait montre d'un comportement systématiquement violent. Désireuse de renforcer la répression de la récidive en matière de violence contre les personnes en s'assurant de l'exécution rapide des décisions de justice, la mission souhaite que l'exécution provisoire soit de droit lorsqu'une peine est prononcée à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence volontaire ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violence, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
2. Limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve
Le code de procédure pénale ne prévoit aucune limite quant au nombre de condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve (sme). Cette situation permet des dérives certaines au profit de multiréitérants qui cumulent les sme sans subir de véritable contrôle en raison de la faiblesse des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip). Parce que ces condamnations sont perçues comme virtuelles par les délinquants d'habitude, elles contribuent au sentiment d'impunité et décrédibilisent la justice.
C'est pourquoi la mission propose de limiter à deux le nombre de sme pouvant être prononcés par les juridictions par grandes catégories d'infractions. En effet, parce que les délinquants d'habitude commettent leurs méfaits dans certaines « spécialités », par exemple les vols ou les délits routiers, la règle des deux sme ne doit s'appliquer qu'au sein de grandes catégories homogènes de délits. Par souci de simplicité, il est proposé de retenir les catégories d'infractions « assimilées » au sens du droit de la récidive. Rappelons, en effet, que code pénal comprend aujourd'hui trois catégories de crimes et délits « assimilés » : les vols, extorsions, chantages, escroquerie et abus de confiance ; les agressions et atteintes sexuelles et les homicides involontaires ou les atteintes à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
3. Limiter les réductions de peines pour les récidivistes
Les condamnés incarcérés bénéficient désormais d'un « crédit de réduction de peine » calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année puis de deux mois pour les années suivantes (article 721 du code de procédure pénale). A cette réduction de peine ordinaire s'ajoutent les réductions de peines supplémentaires accordées aux condamnés en raison de leurs efforts sérieux de réadaptation sociale, de leur réussite d'un examen scolaire ou de l'indemnisation de la victime (article 721-1 du même code).
Cette situation qui accorde un crédit de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, n'est pas satisfaisante aux yeux de la mission. C'est pourquoi elle propose de limiter le crédit de peine accordé aux condamnés récidivistes à un mois par an au-delà de la première année de détention. Toutefois, la mission ne souhaite pas modifier les règles applicables aux réductions de peines accordées en raison des efforts de réinsertion des condamnés car ceux-ci traduisent une volonté de changement de comportement qui doit être encouragée.
4. Appliquer la récidive à toute réitération de faits commis avec violence
Le code pénal ne comprend que trois catégories de crimes et délits « assimilés » au sens du droit de la récidive. Ainsi, un condamné pour vol avec violence qui commet ultérieurement des violences volontaires seules n'est pas un récidiviste au sens de la loi.
Cette situation n'est pas satisfaisante car elle méconnaît certaines évolutions de la délinquance et, en particulier, le développement du proxénétisme et de la traite des êtres humains par des réseaux organisés d'une part, et l'augmentation des comportements violents d'autre part (+ 10 % de faits constatés par la police et la gendarmerie sur un an).
C'est pourquoi la mission propose :
- d'assimiler la traite des êtres humains et le proxénétisme au sens de la récidive ;
- de considérer que tout délit de violence volontaire ou commis avec violence constitue une même infraction au sens de la récidive, indépendamment de la nature des faits commis. Ce faisant, il s'agit de sanctionner plus sévèrement un comportement dangereux, car violent, et non s'en tenir à la qualification juridique des faits qui distingue s'il s'agit d'une infraction commise contre les personnes ou contre les biens.
5. Autoriser le tribunal correctionnel à relever d'initiative la récidive
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le procureur de la République, par exemple la récidive, sans l'accord exprès du prévenu. Or, compte tenu des délais d'inscription des fiches au Casier judiciaire, il n'est pas rare que la récidive soit connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République. Dans cette hypothèse, les juges du siège compétents sont donc contraints de recueillir l'accord du prévenu pour pouvoir relever la circonstance aggravante de récidive, ce dernier ayant tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues.
Cette « prime » au récidiviste bénéficiant des éventuels dysfonctionnements de la Justice et du Casier judiciaire en particulier n'est pas acceptable. C'est pourquoi la mission propose d'autoriser le tribunal correctionnel à relever d'initiative la récidive sans l'accord du prévenu qui bénéficierait, en contrepartie et à sa demande, d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense.
6. Appeler, par voie de circulaire du Garde des Sceaux, les procureurs de la République à relever de façon systématique la récidive
Ainsi que l'affirme clairement l'article 30 du code de procédure pénale issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, « le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique ».
Dans ce cadre, la mission souhaite que le ministre de la Justice adresse une instruction générale aux parquets les appelant à relever systématiquement la récidive dans leurs réquisitions afin de garantir l'application homogène de la loi sur l'ensemble du territoire et d'apporter une réponse pénale ferme aux récidivistes.
b) En assurant une meilleure information des magistrats
7. Moderniser les modalités de consultation du Casier judiciaire en recourant aux nouvelles technologies de l'information
A l'heure actuelle, les extraits de Casier judiciaire sont communiqués aux magistrats requérant par courrier postal, ou par fax dans le meilleur des cas, et jamais le dimanche où pourtant des permanences sont organisées en juridiction et au parquet en particulier. Cette situation n'est pas satisfaisante car elle entraîne des lourdeurs et des lenteurs de fonctionnement préjudiciables à la réactivité et à l'efficacité de la justice.
Compte tenu des progrès des technologies de la communication et de la cryptologie en particulier, la mission propose de dématérialiser la consultation du Casier judiciaire par intranet et Internet tout en prévoyant une traçabilité des connexions à l'instar du système prévu pour le stic.
8. Adopter un plan d'urgence pour le Casier judiciaire afin de combler le retard dans la saisie et le traitement des jugements
Ainsi que l'a déjà établi le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, les délais de saisie des jugements par les greffes d'une part, et le retard pris dans le traitement des fiches destinées au casier judiciaire par les services de l'exécution des peines d'autre part, provoquent un défaut considérable de pertinence et d'actualisation des informations contenues dans le Casier judiciaire. Or, pour être en mesure de relever la récidive, il importe au premier chef que les magistrats soient informés en temps utile de son existence.
C'est la raison pour la quelle la mission souhaite l'adoption d'un plan d'urgence afin de résorber le retard pris dans la transmission des données au Casier judiciaire : à cette fin elle propose le recours temporaire à des personnels sous contrat qualifiés en matière de saisie dans les juridictions cumulant le retards les plus élevés en cette matière.
9. Définir la réitération pour clarifier le débat public
La réitération est une notion judiciaire définie dans le silence de la loi et une réalité empirique policière évaluée à partir des signalements au stic. Cette absence de définition commune est source de malentendus et ne permet pas d'établir un diagnostic partagé sur ce phénomène. Définir la réitération, à droit constant, clarifierait donc utilement le débat public.
10. Mettre en place un outil statistique permettant une mesure précise de la récidive et de la réitération
Compte tenu des difficultés de mesure de la récidive et de la réitération, il importe de développer un outil statistique performant en cette matière.
A cette fin, la mission propose que les procureurs généraux établissent chaque année un rapport remis au garde des sceaux et détaillant le nombre d'affaires pénales dans lesquelles le prévenu est en situation de récidive ou de réitération ainsi que la nature de la mesure ou de la condamnation prononcée à son endroit.
B. PRÉVENIR PLUS EFFICACEMENT LA RÉCIDIVE
a) En faisant de l'application des peines une priorité afin d'éviter les « sorties sèches » de détention
11. Offrir 20 % des postes à l'issue de l'E.N.M. au profit des juges de l'application des peines pendant 5 ans
Grande oubliée de la Justice, l'application des peines n'a bénéficié, en moyenne, que de 6 % des effectifs de chaque promotion des magistrats issus de l'école nationale de la magistrature (E.N.M.) depuis 1992. Or, compte tenu des missions dévolues aux juges de l'application des peines (jap), missions considérablement renforcées par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il est impérieux d'augmenter rapidement leurs effectifs qui ne représentent que 3,5 % du nombre total de magistrats, afin de s'assurer de la bonne application de la loi et du suivi efficace des personnes placées sous main de justice.
A cette fin, la mission souhaite que, au cours des cinq prochaines années, le nombre des jap issus de l'E.N.M. atteigne 20 % de l'effectif de chaque promotion de magistrats. Cette mesure n'est pas coûteuse car elle concerne une promotion donnée de l'E.N.M. et non un supplément d'effectifs.
12. Revaloriser et renforcer les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip)
Au 1er janvier 2004, 135 721 mesures en milieu ouvert étaient suivies par les spip qui ont également vocation à prendre en charge l'ensemble des détenus, dont le nombre excède 60 000, et ce avec un effectif de 2 473 agents seulement.
En outre, la mise en œuvre de la loi du 9 mars 2004 devrait entraîner un accroissement de leur charge de travail, notamment en raison de l'introduction du « sas de sortie » qui attribue au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation le soin de déterminer la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à la personnalité du condamné n'ayant plus, selon les cas, que trois mois ou six mois à subir en détention
Enfin, la mise en œuvre d'un suivi des condamnés les plus dangereux proposé par la mission constitue une nouvelle mission pour les spip qui doivent bénéficier d'un renforcement de leurs effectifs et de la revalorisation de leur statut. A cette aune, la mission considère que le recrutement de 120 conseillers d'insertion prévu par la loi de finances initiale pour 2004 doit être poursuivi et très largement amplifié en 2005.
13. Conforter les moyens dédiés aux associations de réinsertion et d'hébergement
Au-delà des seuls moyens consacrés aux spip, ceux-ci ont également recours à de nombreuses associations qui complètent utilement leurs initiatives, notamment en matière d'insertion professionnelle, d'accès au logement ou de placement à l'extérieur. Ainsi, et au seul titre du placement extérieur, près de 300 conventions ont été conclues entre les spip et des associations ou des collectivités locales.
Or, comme a pu le constater la mission, les moyens dévolus aux associations ne sont pas à la hauteur des besoins considérables en ces matières et nombre de directeurs d'établissements pénitentiaires souffrent d'un défaut d'interlocuteurs associatifs à même de prendre en charge les détenus libérés qui se retrouvent dans le dénuement le plus complet, propice à la récidive. Dans ces conditions, une augmentation des dotations budgétaires versées aux associations est nécessaire. L'accroissement des crédits prévus à cet effet en loi de finances pour 2004 (+ 5 millions d'euros) doit donc être poursuivi.
b) En prévoyant un suivi des détenus les plus dangereux
14. Évaluer la dangerosité des détenus et les risques de récidive au cours de la détention
L'évaluation actuelle de la personnalité des détenus privilégie leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive).
Or, compte tenu de l'augmentation du nombre des délinquants sexuels incarcérés, ce type de délinquance représentant désormais la première cause d'incarcération, il importe de développer une évaluation de la dangerosité des détenus et de leur risque de récidive.
La mission souhaite donc la mise en place d'instruments spécifiques tendant à mesurer la « dangerosité » des détenus et, en particulier, leur risque de récidive, notamment en matière sexuelle, afin que les juges soient en mesure de prononcer une mesure de contrôle adaptée à leur profil.
Il s'agit de mettre en place une méthodologie pluridisciplinaire associant des expertises psychiatriques, médico-psychologiques et comportementales du condamné afin de détecter son risque de récidive et sa dangerosité sociale à l'instar des pratiques observées au Canada.
15. Engager le débat sur le placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux ayant purgé leur peine
Dix ans après le rapport du sénateur M. Guy Cabanel se prononçant en faveur du développement du placement sous surveillance électronique, la mission est favorable au lancement d'une seconde étape tendant à engager le débat sur la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux ayant purgé leur peine. Cet instrument devrait contribuer à la réinsertion des personnes concernées en facilitant leur mobilité géographique tout en permettant aux services de contrôle de s'assurer, le cas échéant, de la localisation du condamné avec précision et rapidité. A la différence du placement électronique classique, qui est une alternative à l'incarcération tendant à s'assurer de la présence du condamné à son domicile à certaines heures déterminées, la surveillance électronique mobile relève davantage de la mesure de sûreté dont le but est de s'assurer, en cas de besoin, de la localisation géographique du condamné libre par l'intermédiaire de la technique du gps.
Afin d'évaluer pleinement la portée de cette innovation et d'en déterminer sereinement le champ d'application, la mission souhaite qu'un vaste débat national soit engagé sur ce sujet, associant le Parlement et l'ensemble des acteurs concernés, qu'il s'agisse des organismes de défense des droits de l'homme, à l'instar de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (cncdh), des magistrats, des avocats, des policiers ainsi que des associations de victimes.
Bien évidemment, la mise en œuvre d'un tel dispositif devrait être assortie de toutes les garanties nécessaires et strictement contrôlée par le juge.
Ainsi, le placement sous surveillance électronique mobile ne devrait concerner que les condamnés pour crime contre les personnes les plus dangereux et pourrait être prononcé par le tribunal de l'application des peines territorialement compétent, à la demande du juge de l'application des peines ou sur réquisitions du procureur de la République.
La saisine du tribunal de l'application des peines devrait avoir lieu un an avant la levée d'écrou afin de permettre la mise en place de la surveillance électronique mobile dans des conditions matérielles satisfaisantes. Une clause de « rendez-vous » serait prévue, le tribunal compétent devant réexaminer sa décision de placement sous surveillance électronique mobile à intervalle régulier afin d'évaluer l'évolution du condamné.
16. Augmenter le nombre de médecins psychiatres en pourvoyant les postes vacants dans le secteur public
Selon les informations communiquées à la mission, près de 800 postes de psychiatres sont vacants dans le secteur public alors même que plus de 40 % des détenus souffrent de troubles de comportements nécessitant une prise en charge psychiatrique.
La conjonction de ces deux phénomènes n'est pas durablement soutenable et provoque une pénurie de soins en milieu carcéral et en milieu ouvert préjudiciable à la prévention de la récidive. De surcroît, il n'existe pas encore de structures spécifiques dédiées à l'accueil et au traitement de longue durée des délinquants souffrant de troubles psychiatriques graves. C'est pourquoi la mission invite les pouvoirs publics compétents à prendre les mesures d'urgence nécessaires afin, à tout le moins, de pouvoir les postes vacants.
17. Introduire une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle
La délinquance sexuelle représente désormais la première cause d'incarcération en France et c'est pourquoi, le législateur a prévu, avec la loi du 17 juin 1998, la mise en place du suivi socio-judiciaire au titre duquel une injonction de soins peut être prononcée. Cette dernière est mise en œuvre par deux médecins, l'un psychiatre et « coordonnateur », l'autre médecin traitant.
Or, la formation de ces médecins n'est pas adaptée à cette mission puisque aucun enseignement spécifique en matière de délinquance sexuelle ne leur est dispensé au cours de leurs études. Dans ces conditions, et compte tenu de la difficulté et de la pénibilité de cette mission, il n'est guère étonnant de constater l'existence des difficultés dans la mise en œuvre de l'injonction de soins en particulier et du suivi socio-judiciaire en général.
C'est pourquoi la mission propose que la formation initiale et continue des psychiatres et des médecins traitants comprenne obligatoirement un enseignement spécifique sur les délinquants sexuels.
18. Associer les psychologues cliniciens à la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire
L'article L. 3711-1 du code de la santé publique, relatif à l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire, prévoit que le médecin coordonnateur doit être un psychiatre ou un médecin ayant suivi une formation appropriée et que la personne en charge du traitement de l'intéressé doit également être un médecin. Cette dernière exigence constitue une entrave certaine au développement du suivi socio-judiciaire tant les candidats médecins traitants sont peu nombreux pour exercer cette mission délicate.
C'est pourquoi, la mission propose d'ouvrir aux psychologues cliniciens, titulaires d'un dess de psychologie (bac + 5), la possibilité d'être proposés par le médecin coordonnateur comme responsables du traitement du délinquant sexuel astreint à une injonction de soins.
19. Transférer au juge la compétence pour prononcer l'hospitalisation d'office des prévenus ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits
Lorsqu'un prévenu est reconnu irresponsable pénalement en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits en application du 1er alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est généralement pris en charge par le préfet qui prononce son hospitalisation d'office en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Comme a pu le constater la mission, cette hospitalisation est d'une durée moyenne assez brève, de l'ordre de quelque mois, et conduit donc rapidement à la remise en liberté de la personne sans aucune forme de suivi par les autorités judiciaires.
Cette situation est d'autant moins satisfaisante que, pour des faits identiques commis par un prévenu dont le discernement n'a pas été aboli au moment des faits mais seulement « altéré » (2ème alinéa de l'article 122-1 du code pénal), une condamnation peut éventuellement être prononcée et, ce faisant, permettre un suivi judiciaire de la personne. La situation actuelle est donc paradoxale puisqu'elle autorise la mise en place d'un suivi judiciaire pour les condamnés souffrant, ou ayant souffert, des troubles psychiques les moins graves et l'absence totale d'un tel suivi pour les prévenus au comportement le plus imprévisible et donc les plus dangereux.
C'est pourquoi, la mission souhaite que la décision de placement en hôpital psychiatrique des prévenus reconnus pénalement irresponsables relève désormais de l'autorité judiciaire qui sera ainsi en mesure d'assurer leur suivi.
20. Mettre en place un fichier recensant les personnes ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits
Lorsqu'un prévenu est reconnu pénalement irresponsable en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits, il ne figura dans aucun des fichiers de la justice, à l'exception notable du fijais (fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles) crée par la loi du 9 mars 2004 mais qui n'est pas encore entré en vigueur et dont la finalité est circonscrite aux délinquants sexuels. Quant au casier judiciaire, il ne recense que les condamnations comme le prévoit l'article 768 du code de procédure pénale qui, en l'espèce, font précisément défaut.
Or, pour connaître la dangerosité de la personne, établir son éventuelle réitération et prononcer les mesures adaptées, il importe que les autorités judiciaires conservent la mémoire des faits qu'elle a commis. C'est pourquoi, la mission propose la création par la loi d'un fichier national recensant les auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dont les modalités d'application seraient déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la cnil.
La Commission a procédé, le mardi 6 juillet 2004, à l'audition de M. Dominique Perben, garde des Sceaux et ministre de la Justice, et M. Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Le président Pascal Clément a tout d'abord relevé que, plus que jamais, la lutte contre la récidive était au cœur des préoccupations des Français, les affaires récentes démontrant la dimension insupportable prise par ce phénomène. Celles-ci, tout comme le taux moyen de récidive de 31 %, signifient clairement que, en la matière, l'arsenal législatif et la politique pénale sont nettement insuffisants. Dans ces conditions, s'interroger sur les moyens de traiter au mieux la récidive pénale constituait un véritable devoir pour la Représentation nationale car refuser à la police et à la justice les moyens de lutter contre ce fléau reviendrait à les empêcher d'accomplir leur mission de service public.
Certains députés, parmi lesquels MM. Christian Estrosi, Jean-Paul Garraud, Georges Fenech et Gérard Léonard ont souhaité contribuer à cette réflexion, dans le cadre d'un débat riche et ouvert. À partir de leurs travaux, la mission d'information de la commission des Lois s'est engagée dans une étude couvrant la totalité du processus judiciaire, allant des poursuites à la condamnation, puis de la condamnation à l'exécution de la peine et à la libération de l'intéressé. Créée le 7 avril dernier, la mission arrive maintenant au terme de ses travaux, après vingt-cinq auditions, menées sous la direction de son rapporteur, M. Gérard Léonard, qui ont montré que la dangerosité des délinquants et leur propension à la violence doivent être placées au cœur de l'action et de la décision judiciaires. Or, celles-ci sont insuffisamment prises en compte aujourd'hui, comme en attestent la faiblesse du suivi médical et psychiatrique en détention, ou l'absence de suivi de ces délinquants après leur libération.
Un tel constat ne peut que sincèrement inquiéter et appeler des remèdes : c'est dans ce but que la mission d'information proposera vingt mesures pour placer la lutte contre la récidive au cœur de la politique pénale. L'engagement du Gouvernement dans la lutte contre la récidive ne fait aucun doute. Il serait souhaitable qu'il se poursuive maintenant avec la commission des Lois, grâce au travail effectué par tous les parlementaires membres de la mission d'information.
M. Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, en premier lieu, salué la qualité du travail effectué par la mission d'information sur un sujet de préoccupation majeure des Français. La montée des violences, notamment sexuelles, constatée aujourd'hui est intolérable, comme l'illustrent les récents drames en Alsace ou dans les Ardennes. Certes, grâce au travail d'enquête de la police et de la gendarmerie, les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces faits ont été arrêtées, mais, pour les enfants martyrisés et les familles brisées, tout doit être fait pour éviter que de telles tragédies se renouvellent. Récemment, la réunion à Gif-sur-Yvette de près de trente associations de victimes a permis de mesurer les efforts à accomplir collectivement pour mieux prendre en compte les victimes tout au long de la chaîne pénale, que ce soit dans les commissariats, ou lors de la mise en œuvre des réparations prescrites par le juge.
Dans cette perspective, il faut protéger davantage la société, notamment contre la perversité de certains criminels déjà condamnés. Cette tâche difficile, à laquelle divers parlementaires ont contribué, notamment MM. Christian Estrosi, Gérard Léonard ou Jean-Paul Garraud, exige une détermination commune des forces de l'ordre et de la justice. L'audition conjointe du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur témoigne de cette volonté à la fois d'un engagement commun sur le problème de la récidive, et d'une plus grande solidarité de l'ensemble de la chaîne pénale.
La lutte contre la récidive suppose d'abord de lutter plus efficacement contre la délinquance. À cet égard, la mobilisation des forces de l'ordre a permis de continuer de réduire la délinquance, de 3,7 % au premier semestre de cette année. De leur côté, magistrats et fonctionnaires de justice ont permis, avec des moyens constants, une accélération du traitement des dossiers depuis deux ans. Ces résultats devraient pouvoir être encore améliorés, en demandant aux services d'accorder une importance particulière à la qualité des procédures établies, et en tirant les effets attendus de la réforme des corps et carrières de la police nationale, qui devrait permettre de disposer, à terme, de plus de 40 000 officiers de police judiciaire (opj) qualifiés.
Au-delà, les bons résultats doivent s'inscrire dans la durée, en attaquant les « noyaux durs » de la criminalité. Les nouvelles priorités qui viennent d'être assignées aux services vont en ce sens. De même, la récidive doit-elle être traitée véritablement en tant que telle, car plus d'un tiers des délits est commis par des récidivistes, et près de la moitié par des délinquants mineurs. De surcroît, ce taux augmente régulièrement, depuis plusieurs années, attestant de l'inefficacité du dispositif pénal et de son application. L'action à mener doit en conséquence être guidée par trois objectifs : réduire les taux de récidive ; faire reculer le sentiment d'impunité, toutes les infractions devant pouvoir être sanctionnées ; enfin, restaurer l'autorité de l'État pour appuyer la mobilisation des forces de l'ordre.
Pour lutter contre la récidive, il convient naturellement de mieux en appréhender sa réalité, qui doit être abordée sous tous ses aspects : statistiques précises attendues de l'Observatoire de la délinquance ; attention renouvelée à la psychologie des criminels en série et aux hyperviolents, se fondant sur la tradition de la criminologie française, sur les travaux de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure (ihesi) en liaison avec les équipes de recherche du ministère de la Justice et de l'université, sur le système d'analyse des liens de la violence associée au crime (salvac), ou encore sur la comparaison avec les expériences étrangères.
Le ministre a ensuite indiqué que la recherche de l'efficacité commandait l'évolution de certaines pratiques, et sans doute de la loi elle-même, dans le cadre d'une triple exigence de légitimité, qui impose que seul le juge se prononce sur la nécessité et la durée d'une peine d'emprisonnement ; de responsabilité, qui exige que les peines prononcées tiennent mieux compte de la dangerosité des délinquants ; d'équité enfin, qui suppose une gradation de la sanction en fonction de la gravité de la récidive et de la volonté du délinquant de persévérer ou non dans l'erreur.
Ces orientations doivent être suivies, parallèlement avec le ministère de la Justice, selon deux axes : une meilleure politique de traitement et de suivi des grands récidivistes et des délinquants « réitérants », qui devra faire l'objet de mesures prises à l'occasion des prochaines réunions des conférences départementales de sécurité ; la mise en œuvre d'actions plus efficaces, avec l'appui des groupes locaux de traitement de la délinquance (gltd), qui seront de nouveau réunis à cet effet par les procureurs de la République. Même si certaines juridictions souffrent d'une surcharge d'activité incontestable, dans les grandes villes et en Ile-de-France, la rapidité des jugements pour les délinquants récidivistes serait de nature à rassurer les Français et à prévenir ces comportements : aussi la suggestion de la Chancellerie de rendre exécutoires les jugements condamnant les multirécidivistes à des peines d'emprisonnement ferme, malgré un éventuel appel, doit-elle être soutenue.
Puis, le ministre a estimé que l'ensemble de la chaîne pénale devait être renforcé :
- par une meilleure information des magistrats, sur la personnalité des prévenus et leur trajectoire. La démarche du garde des Sceaux, qui souhaite demander aux procureurs de retenir systématiquement l'état de récidive dès qu'ils en sont informés, et de permettre aux juridictions de jugement de pouvoir en tenir compte même si celui-ci n'a pas été visé dans l'acte de poursuite, doit être saluée. Elle suppose toutefois une vigilance accrue des opj sur le passé criminel des suspects lors de leur mise en garde à vue, ainsi que l'amélioration des moyens techniques nécessaires pour accélérer les possibilités de consultation, par les procureurs et les juges d'instruction, des fichiers stic pour la police et judex pour la gendarmerie, indépendamment du casier judiciaire dont l'utilisation semble parfois poser des difficultés. Ainsi pourra être évité l'écueil des peines automatiques, peu conformes à notre tradition juridique et aux principes constitutionnels, tout en permettant de prononcer des peines plus sévères pour les récidivistes ;
- par une application rapide et effective de la loi pénale, fondée sur une coopération intelligente de l'ensemble des acteurs du système répressif, le ministre de l'Intérieur devant légitimement se préoccuper du bon fonctionnement de l'institution judiciaire et pénitentiaire, comme le garde des Sceaux de celui de la police et de la gendarmerie. À cet égard, la qualité du dialogue entre les collaborateurs des ministres ou entre les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales et le directeur des Affaires criminelles et des grâces témoigne de cet esprit ;
- par une concertation accrue, qui permettra de connaître les suites données à l'engagement permanent des policiers et des gendarmes dans leur mission, de comprendre, par exemple, comment les condamnations pour vol ont diminué de 74 % entre 1984 et 2001 alors que les vols eux-mêmes ont augmenté de 10 %, ou d'éviter le risque de voir se développer une justice « privée » pour les contentieux échappant ainsi à la chaîne pénale ;
- par une application des peines rendue plus responsable grâce à la prise en considération de la dangerosité des délinquants. En particulier, le prononcé des peines ne devrait plus pouvoir être assorti, sans limites, de sursis avec mise à l'épreuve, au risque de rendre impossible toute réinsertion, qui exige naturellement des sanctions. A contrario, les primo-délinquants pourront alors bénéficier d'un réel accompagnement de la part des services de probation aujourd'hui surchargés. En conséquence, la révocation du sursis devrait, après répétition d'actes de violences, être automatique. De même, l'octroi automatique des réductions de peines doit être réduit, que ce soit par la prise en compte de la dangerosité des délinquants en matière de libération conditionnelle ou de confusion des peines, par l'exclusion, acceptée, des faits de violence grave de la grâce présidentielle, ou par l'impossibilité de réduction des peines pour les cas les plus dangereux ;
- par une préparation plus adaptée des détenus à leur libération, privilégiant, dans l'intérêt de tous, l'aide à la recherche d'emploi au cours de la période probatoire et par l'intégration, dans les objectifs des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, de l'accompagnement des détenus libérés.
Le ministre a ensuite souligné que la lutte contre la délinquance sexuelle devait constituer une priorité absolue, de nature à répondre aux attentes de l'opinion publique. Dans cette perspective, un fichier des délinquants sexuels a commencé à être mis en place, en collaboration avec la Chancellerie et il pourrait devenir la base d'un nouveau fichier européen géré par Europol, si les pays membres de l'Union en sont d'accord. Dans le même sens, il est urgent que le ministère de la Santé se mobilise pour organiser un véritable suivi psychiatrique des détenus libérés ayant commis des atteintes sexuelles, et que soient prises les dispositions législatives nécessaires pour trouver des solutions alternatives à la prison et à l'hôpital psychiatrique pour l'incarcération des pervers criminels.
Le ministre a conclu son propos en indiquant que le projet de loi sur la prévention de la délinquance comprendrait des dispositions en faveur de la lutte contre la récidive et que la réflexion gouvernementale serait poursuivie pour élaborer les mesures les mieux à même de répondre aux exigences légitimes des citoyens. En tout état de cause, dans des cas graves de récidive de certains mineurs, seule la sanction est efficace, qu'il s'agisse de la rétention ou de l'éloignement dans des établissements aménagés à cet effet, à l'instar de ceux que le ministre de la Justice est en train de mettre en place.
Soulignant l'opportunité d'avoir engagé des réflexions parallèles au sein du Parlement et du Gouvernement sur le traitement de la récidive des infractions pénales et remerciant les membres de la mission d'information pour le travail accompli, M. Dominique Perben, ministre de la justice, garde des Sceaux, a rappelé que l'étude la plus récente sur le taux de récidive l'évaluait à environ 30 % pour l'ensemble des condamnés pour délit, à 45 % pour le sous-ensemble des condamnés à des peines fermes, à 40 % pour les condamnés pour violences et 50 % pour les condamnés pour vol. Très préoccupantes, ces données justifient de privilégier des solutions pragmatiques et efficaces.
En premier lieu, il convient de se donner les moyens de faire en sorte que les peines soient effectivement exécutées pour que le condamné en ressente immédiatement les conséquences. Sur ce point, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité comporte plusieurs dispositions innovantes, qui n'ont pas pu encore donner toute leur mesure compte tenu de leur mise en application récente et qui reprennent les conclusions du rapport de M. Jean-Luc Warsmann rendu en 2003 sur les peines alternatives à la détention, l'exécution des courtes peines et la préparation des détenus à la sortie de prison. Bien que contestée, l'extension de la comparution immédiate constitue un élément important de dissuasion, en assurant le prononcé rapide d'une sanction. Concourent également à l'amélioration de l'effectivité des peines la diversification des sanctions et la mise en place des bureaux d'exécution des peines : ces derniers permettent en effet d'entamer l'exécution de la sanction dès l'audience et devraient être amenés à se développer, au vu des expériences encourageantes qui se sont déroulées à Bordeaux, Nantes et Orléans puisqu'il a été constaté que dans 80 % des cas, la peine a été acceptée par l'intéressé.
En second lieu, et ce point est particulièrement important, il convient d'améliorer la clarté et la cohérence des sanctions infligées par les tribunaux. Il est en effet choquant de constater, pour un même individu, l'accumulation de nombreuses peines de même nature, sans logique, ni portée pédagogique et sans que soit pris en compte son passé ; il est nécessaire à cet égard que les procureurs veillent systématiquement à la cohérence et à l'effet dissuasif des sanctions réclamées. À cette fin, la gamme des modes de poursuite à la disposition des parquets a été étendue pour permettre une réponse plus adaptée par type de contentieux. Ainsi, le développement de la composition pénale, celui de la comparution immédiate ou encore l'institution du « plaider-coupable » doivent permettre de mieux assurer l'effectivité de la peine. Des instructions ont été données aux parquets pour que soient systématiquement vérifiés les antécédents des personnes mises en cause afin d'en tirer les conséquences sur le quantum de peine requis. Il a également été demandé aux parquets de ne plus requérir que des peines fermes contre les personnes qui ont déjà été condamnées à deux reprises au moins. Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites, les parquets devront systématiquement rechercher si cette personne a fait l'objet d'une peine prononcée antérieurement pour que, si tel est le cas, la peine soit immédiatement mise à exécution.
En dernier lieu, il convient de promouvoir une politique pénale volontariste. À ce titre, il est souhaitable de réactiver, à l'échelle des parquets les plus concernés, les groupes locaux de traitement de la délinquance. Associant, pour un temps donné et un objectif déterminé, le procureur, les services de police, le représentant du maire et, le cas échéant, les bailleurs sociaux et les représentants de l'éducation nationale, ils permettent d'assurer un traitement ciblé des délinquants d'habitude.
Le ministre a ensuite rappelé les grandes lignes des dispositions relatives aux périodes de sûreté. En la matière, la loi n° 94-89 du 1er février 1994 a prévu des périodes de sûreté pour certaines infractions, telles que les crimes à caractère sexuel. Leur durée est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans ; elle peut, en outre, être portée jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans ; enfin, en cas d'assassinat d'un mineur de quinze ans et si l'assassinat a été précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la période de sûreté peut être portée à trente ans ou la réclusion criminelle à perpétuité n'être assortie d'aucune mesure d'aménagement, ce qui équivaut à la perpétuité réelle. Adaptées aux cas de crimes les plus odieux, ces dispositions sont régulièrement appliquées, comme en témoignent les jugements rendus contre, par exemple, Guy George ou les frères Jourdain. Face à l'actualité de ces derniers jours, le ministre a fait part de son souhait d'engager, en lien avec les ministres de l'Intérieur et de la Santé, une réflexion sur les relations entre la justice et la psychiatrie, la France n'étant pas en avance sur ces questions et les magistrats pouvant se trouver dans des situations délicates lorsque l'expertise psychiatrique conclut à l'absence de dangerosité de l'individu. Les interrogations en cours portent sur les soins à dispenser en prison et à l'extérieur ainsi que sur l'articulation entre le monde carcéral et les établissements psychiatriques. Certaines personnes ont effet davantage leur place dans ces derniers, car leur incarcération, outre qu'elle est source de perturbation pour le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, ne permet pas de leur dispenser les soins appropriés. À cet égard, un devoir de lucidité impose de reconnaître que la réponse à ce type de délinquants n'est pas dans la prison.
Après avoir indiqué que 800 postes de psychiatres étaient vacants dans le secteur public, alors même que près de 40 % des détenus souffraient de troubles mentaux, le président Pascal Clément a demandé aux ministres quelles étaient les initiatives que le Gouvernement entendait prendre afin de surmonter ces difficultés qui ont, notamment, pour conséquence de rendre inapplicables les mesures de suivi socio-judiciaire ordonnées à l'encontre des délinquants sexuels en application des dispositions des articles 131-36-1 et suivants du code pénal. Il a également interrogé le ministre de la justice sur le calendrier d'entrée en vigueur des unités hospitalières spécialement aménagées (uhsa), dédiées à la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques, dont la création est prévue par l'article 48 de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.
M. Gérard Léonard, rapporteur de la mission d'information, a tout d'abord tenu à saluer la présence conjointe des deux ministres attestant de la volonté du Gouvernement de lutter avec fermeté et détermination contre ce phénomène préoccupant tout en témoignant de l'importance qu'il accorde à la réflexion de la mission dont un grand nombre de ses propositions paraît d'ores et déjà recueillir l'accord du ministre de l'Intérieur.
Après avoir rappelé que le débat sur la question de la récidive avait été engagé à la suite du dépôt de la proposition de loi de M. Christian Estrosi tendant à instaurer des peines minimales en cette matière, il a indiqué que la mission avait procédé à plus de vingt-cinq auditions pendant trois mois et souligné que ses propositions n'étaient donc pas dictées par des considérations liées à l'actualité judiciaire ni avancées dans l'urgence et la précipitation.
Observant que la mesure de la récidive par les instruments statistiques disponibles était imprécise en raison de sa définition juridique particulièrement stricte, il a indiqué que les études réalisées en cette matière s'accordaient néanmoins à considérer que les condamnés pour vol et pour conduite en état alcoolique représentaient la majorité des réitérants. Puis, abordant la question de la prise en compte de la récidive depuis le jugement jusqu'à la libération du condamné, il a jugé celle-ci insuffisante puisque seulement 5,3 % des condamnations délictuelles et 2,6 % des condamnations criminelles avaient mentionné la circonstance aggravante de récidive en 2002 alors même que les taux moyens de récidive atteignaient, respectivement, 31 % et 4,7 %. Il a précisé que cette situation pouvait résulter soit du défaut d'harmonisation des pratiques judiciaires sur l'ensemble du territoire national en raison de l'absence d'une politique pénale claire en cette matière, soit du caractère incomplet des informations figurant au Casier judiciaire, le délai entre le jour du jugement et la saisine des données par le Casier judiciaire pouvant atteindre 18 mois dans certaines juridictions. Regrettant ce défaut d'information des magistrats qui leur interdit de relever la récidive puisqu'ils en ignorent l'existence, il a interrogé les ministres afin de savoir dans quels délais allait entrer en vigueur l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure prévoyant l'accès direct des magistrats aux données figurant dans le fichier « stic ». Observant que les faits de violence commis contre les personnes avaient tendance à augmenter en dépit de la baisse générale de la délinquance constatée depuis deux ans, il s'est demandé si les règles de l'exécution provisoire des condamnations ne devraient pas être modifiées afin de permettre l'incarcération de droit des récidivistes violents, la juridiction saisie conservant toutefois le droit de ne pas ordonner cette mesure par une décision motivée.
Après avoir ensuite rappelé que le code de procédure pénale ne prévoyait aucune limitation quant au nombre de condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve qu'un tribunal pouvait prononcer à l'encontre d'un même condamné, conduisant ainsi à la multiplication des sme sans aucune forme de suivi ce qui décrédibilise les sanctions prononcées et l'autorité de la Justice, il a souhaité savoir si les ministres seraient favorables à une réforme limitant le nombre de sme susceptibles d'être prononcés. Tout en déplorant que la dangerosité des condamnés, dont la récidive est un bon indicateur, soit insuffisamment prise en compte et évaluée dans notre système judiciaire et carcéral, il a évoqué les expériences menées aux États-Unis tendant à placer les condamnés les plus dangereux sous surveillance électronique mobile garantissant, en cas de besoin, la localisation de l'intéressé et a souhaité savoir si les ministres seraient favorables à ce que le débat soit engagé dans notre pays sur la mise en œuvre de dispositifs de surveillance de cette nature. Enfin, après avoir souligné que le traitement des récidivistes les plus violents ne relevait pas seulement de la justice mais également de la santé publique et regretté, à son tour, que 800 postes de psychiatres soient vacants, il a conclu son propos en indiquant que, sous réserve de leur adoption par la mission, les principales propositions qu'elle avançait feraient l'objet d'une proposition de loi.
M. Christian Estrosi a tenu en préambule à remercier le rapporteur de la mission d'information, ainsi que son président, car les travaux de la mission ont su établir un juste équilibre entre le débat, forcément passionnel, sur la récidive, et les contraintes juridiques, permettant ainsi de parvenir à des propositions très concrètes. Il a également exprimé sa satisfaction de voir auditionnés en même temps les deux ministres concernés, car le problème posé par la récidive est justement le bon fonctionnement, d'un bout à l'autre, de la chaîne pénale.
Rappelant les termes de la proposition de loi prévoyant des peines minimales en matière de récidive dont il avait été co-signataire, il a regretté qu'elle ait été trop souvent caricaturée, certains ayant entretenu une confusion délibérée avec les peines planchers dont la constitutionnalité est contestée. Il a jugé, au contraire, que l'instauration des peines minimales ne pose pas de problème constitutionnel, dans la mesure où il est prévu que les magistrats disposent du pouvoir d'écarter l'application d'une peine minimale. Insistant, en conséquence, sur la nécessité de responsabiliser davantage les magistrats dans le prononcé de la peine, il s'est réjoui que les propositions de la mission rejoignent cet objectif et s'est déclaré particulièrement attentif aux propositions législatives annoncées par le ministre de l'Intérieur sur ce thème. Reprenant l'état des lieux dressé par le ministre de la Justice, il a observé que l'ensemble des textes adoptés depuis 2002 avait permis de faire reculer de façon sensible la délinquance, mais déploré que cet arsenal législatif mis en place n'ait pas été suffisant pour s'attaquer au noyau dur que constitue la récidive. Il a plaidé en conséquence pour l'adoption rapide de mesures législatives permettant de lutter efficacement contre la récidive, grande ou petite. S'agissant des cas les plus graves, il a considéré que la condamnation à perpétuité, assortie de durées incompressibles, ne donnait pas satisfaction aujourd'hui puisqu'il était toujours possible de prononcer des mesures de libération conditionnelle, sur simple décision d'une commission composée de magistrats. Il a jugé urgent de proposer des réformes allant dans le sens d'un meilleur contrôle des décisions de libération conditionnelle, et s'est félicité des pistes envisagées par la mission.
M. Jean-Paul Garraud a salué la détermination des ministres dans la lutte engagée contre la récidive, en évoquant l'urgence qu'il y avait désormais à intervenir au vu de l'actualité effrayante de ces dernières semaines. Il a ensuite fait état du postulat actuel qui fonde le prononcé de la peine sur les faits commis, la personnalité du condamné et l'utilité de la peine dans l'optique d'une réinsertion future. Tout en approuvant les termes de ce postulat, il a regretté qu'il fige excessivement les choses en ne permettant pas de prendre en compte l'évolution de la personnalité du condamné lors de sa détention, notamment au regard de sa dangerosité. Dès lors, il a déploré qu'aucune disposition ne permette d'intégrer cette donnée dans la durée de la détention, dans les cas où les mesures adéquates n'auraient pas été prises dès le prononcé de la peine. Il a de même regretté que ne soit prévue aucune mesure d'accompagnement après la sortie de prison, des dispositifs de surveillance et de contrôle étant interdits au motif que l'individu avait payé sa dette à la société. Il a jugé qu'il fallait, au contraire, mettre en place des dispositifs novateurs de surveillance adaptée, en tenant compte de la dangerosité de l'individu.
M. Jérôme Lambert a tout d'abord souligné la qualité des travaux de la mission d'information à laquelle il a participé assidûment et qui lui a donné l'occasion d'entendre des interventions novatrices sur les causes de la récidive. Relevant que, parmi les détenus, 16 % étaient indigents, 20 % étaient analphabètes et un grand nombre nécessitait un traitement psychiatrique lourd, il a avancé qu'une meilleure politique d'insertion sociale de ces populations fragiles permettrait probablement d'en limiter le taux de délinquance. Puis, il a souligné l'importance d'une réponse pénale appropriée dès le premier acte délictueux, en considérant que tant l'absence de punition d'un primo-délinquant qu'une peine trop sévère pouvaient provoquer l'enracinement dans la délinquance. Il a enfin estimé que la question des causes de la récidive devait faire l'objet d'un examen attentif, étant rappelé toutefois que la majorité des délinquants ne récidivait pas.
M. Jean-Luc Warsmann a tout d'abord souligné qu'il était essentiel de permettre aux magistrats de mieux appréhender le passé des délinquants, afin de faire débuter l'exécution de la peine immédiatement après le prononcé de la condamnation et de renforcer le suivi des condamnés libérés. Après avoir évoqué les affaires récentes de crimes sexuels et rappelé que la loi du 17 juin 1998 avait apporté de nouvelles garanties d'exécution de la peine pour les crimes à caractère sexuel commis sur des mineurs, il a ensuite souligné que certains de ces criminels restaient dangereux et risquaient fortement de récidiver une fois leur peine accomplie. Constatant qu'il n'y avait pas de réponse appropriée intermédiaire entre la prison et la liberté, et que des individus étaient souvent remis en liberté après un trop bref séjour en hôpital psychiatrique, faute de place, il a regretté que l'injonction de soins, créée par la loi de 1998 et figurant à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, ne soit pas réellement appliquée faute de moyens.
M. Jean Leonetti a entendu souligner la complexité des rapports entre la médecine et la sanction pénale en précisant qu'il était illusoire, en l'état actuel de la science, d'espérer une guérison psychiatrique des pervers sexuels, le seul moyen de les empêcher de passer à l'acte étant de ne pas les mettre en présence de l'objet de leur désir pervers. Il a en conséquence souhaité qu'une réflexion soit engagée sur les moyens de tenir à l'écart des personnes qui représentent un danger perpétuel. Constatant en outre que la prison favorisait la récidive et ne permettait pas la réinsertion des condamnés, en raison notamment du caractère déshumanisé du monde carcéral, il a souligné la nécessité de rechercher des peines alternatives à l'emprisonnement et s'est prononcé en faveur de sanctions au besoin moins lourdes mais rapides et efficaces.
Soulignant que l'interrogation sur l'utilité de la prison n'était pas nouvelle et que, depuis plusieurs années, la commission des Lois avait tenu un langage responsable sur les questions abordées aujourd'hui, M. Jacques Floch a jugé que la représentation nationale était désormais moralement contrainte de réagir face aux crimes odieux récemment découverts. S'interrogeant sur le sort de ces délinquants, il a précisé que certains récidivistes ont été libérés à la suite d'erreurs de procédure et que, dans le cas de Pierre Bodein, son avocat lui-même avait souligné la nécessité d'assurer son suivi. Appelant à une clarification des responsabilités de chacun, il s'est en conséquence demandé si, face à ces situations, il ne serait pas opportun de reprendre les propositions faites sous la précédente législature en matière de responsabilité des magistrats.
M. Georges Fenech a souligné que la récidive due à des psychopathies n'avait rien à voir avec les autres formes de récidive et qu'elle devait être traitée de façon distincte. Il a jugé que la limitation du recours au sursis avec mise à l'épreuve et l'incitation à des réquisitions plus fermes ne règleraient pas les problèmes posés par les psychopathes qui, lorsqu'ils sont relâchés, sortent du champ judiciaire pour rentrer dans la sphère administrative. Il a estimé que l'opinion publique souhaitait une adaptation de la législation aux personnes qui sont à la fois des délinquants et des malades, en confiant leur suivi aux autorités judiciaires, en créant des établissements qui leur soient adaptés et en développant des solutions concrètes, telles que le bracelet électronique mobile qui a fait ses preuves en Floride.
En réponse aux questions du rapporteur, le ministre de l'Intérieur a apporté les précisions suivantes :
- l'accès des magistrats aux données figurant dans le système de traitement des infractions constatées (stic) constitue un dispositif essentiel devant permettre l'amélioration de l'information des juges et, ce faisant, faciliter la prise en compte du passé pénal du prévenu et donc de sa dangerosité. Ainsi que l'a rappelé le rapporteur, les modalités de cet accès doivent être précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la cnil, et un avant-projet de décret a récemment été transmis au secrétariat général du Gouvernement, ce qui laisse augurer une entrée en vigueur rapide de ces dispositions. Toutefois, la connexion des magistrats aux données du stic se heurte à de nombreuses difficultés d'ordre technique tout d'abord, puisque les systèmes informatiques utilisés de part et d'autre doivent être compatibles et les échanges d'informations sécurisés, d'ordre financier ensuite, puisque l'interopérabilité des systèmes d'informations possèdent un coût certain qu'il convient d'évaluer avec précision.
En réponse aux différents intervenants, le ministre de la Justice a communiqué les informations suivantes :
- la date de création de la première uhsa n'est pas, à ce jour, fixée de façon définitive car la création d'un périmètre de sécurité, autour des quartiers réservés aux détenus souffrant de troubles psychiatriques qui seront accueillis au sein des établissements hospitaliers, nécessite une concertation étroite, actuellement en cours, avec le ministère de la santé. Toutefois, si la prise en charge des condamnés dangereux se heurte, certes, à l'insuffisance des moyens dédiés au suivi en milieu ouvert en général et au manque de psychiatres en particulier, elle soulève également la question, délicate, de la répartition des compétences, et donc des responsabilités, entre le ministère de la Justice et celui de la Santé publique ;
- l'incarcération de droit à l'audience des récidivistes sexuels ou violents constitue une piste de réflexion intéressante, car le droit en vigueur est parcellaire en cette matière, et appelle donc des améliorations confortant l'exécution des peines ;
- le prononcé de plusieurs condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une même personne nuit à la crédibilité des sanctions pénales dès lors qu'aucune mesure de suivi n'est effectivement mise en œuvre par les services compétents. Toutefois, le sursis avec mise à l'épreuve constitue une mesure utile dans la hiérarchie des peines qui s'échelonne du sursis simple au placement en détention. C'est pourquoi, la limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve susceptibles d'être prononcés par les juridictions doit être abordée avec prudence en raison de l'augmentation de la population carcérale qu'elle serait susceptible de provoquer ;
- le Gouvernement est disposé à engager le débat sur la proposition tendant à mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique mobile des condamnés les plus dangereux grâce à la technologie du gps. Il conviendrait cependant de déterminer précisément s'il s'agit d'une mesure alternative à l'incarcération, d'une mesure d'aménagement de la peine ou d'une mesure de sûreté impliquant un suivi du condamné en milieu ouvert. De surcroît, cette proposition soulève des difficultés matérielles considérables, qu'il s'agisse de la question des autorités compétentes pour assurer le suivi du condamné, de la gestion dudit suivi ou de son coût ;
- l'amélioration de l'évaluation de la dangerosité des condamnés constitue une proposition qui ne peut que recueillir l'assentiment de tous mais qui, en pratique, se révèle particulièrement délicate à mettre en œuvre en raison, notamment, des fréquentes divergences d'appréciation entre experts psychiatres qui placent le juge dans la situation, fort délicate, d'arbitrer des querelles de spécialistes ;
- les délais de transmission des condamnations prononcées par les juridictions aux services du casier judiciaire doivent être réduits afin d'améliorer l'information mise à la disposition des magistrats et, partant, leur prise en considération de la récidive. Au-delà de cette question, l'actualité judiciaire récente démontre la nécessité de progresser dans la mise en place d'un casier judiciaire européen. Des négociations ont d'ailleurs été engagées à cette fin avec les autorités judiciaires de l'Allemagne et de l'Espagne afin de permettre la consultation, par les juges compétents de ces États, des données figurant au sein de chacun des « casiers judiciaires » nationaux.
Au cours de sa réunion du mercredi 7 juillet 2004, la Commission a examiné les conclusions de la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales.
Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus.
Après avoir interrogé le président et le rapporteur sur l'articulation entre les propositions de la mission et l'initiative parlementaire annoncée par le Président de l'Assemblée nationale en matière de récidive sexuelle, M. Christophe Caresche s'est félicité, à la lecture des conclusions du rapport, de l'abandon par la majorité de son soutien à la proposition de loi déposé par M. Christian Estrosi tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive. Observant que le rapport de la mission d'information dressait un constat sévère, mais étayé, du fonctionnement de l'appareil judiciaire français, il s'est interrogé sur les suites que le Gouvernement entendait donner aux propositions de la mission, en particulier celles concernant le déficit de psychiatres dans le secteur public et les inconséquences du suivi socio-judiciaire. Abordant les propositions de la mission prévoyant l'incarcération immédiate des récidivistes sexuels ou violents et la limitation à deux du nombre de condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve, il a fait part de ses réserves en soulignant la nécessité de respecter les principes de la présomption d'innocence et d'individualisation des peines qui constitue le meilleur moyen de prévenir la récidive grâce à la mise en place d'un suivi personnalisé du condamné. Considérant que la délinquance sexuelle était d'une nature spécifique, il a approuvé le constat dressé par le rapporteur quant à l'insuffisance de la prise en charge psychiatrique des condamnés et s'est rallié aux propositions avancées par la mission en cette matière.
Le président Pascal Clément a tenu à préciser que la mission n'avait pas pour objet de traiter de l'opportunité d'établir des peines planchers mais tendait à dresser un bilan complet de la récidive et à identifier les éventuelles difficultés en la matière afin d'y apporter des réponses pragmatiques. S'agissant de l'initiative annoncée par le Président de l'Assemblée nationale, il a précisé qu'elle s'inscrivait pleinement dans le cadre des travaux menés par la mission d'information puisqu'elle tendait à rendre effectives ses propositions grâce à la mise en place d'un groupe de travail réunissant des représentants de chaque groupe politique et chargé d'élaborer une proposition de loi dont le président de l'Assemblée demanderait au Gouvernement l'inscription à l'ordre du jour. Puis, il a observé que la proposition de la mission prévoyant l'incarcération immédiate des récidivistes sexuels ou violents ne soulevait aucune difficulté au regard du principe de la présomption d'innocence puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux condamnés, lesquels, par définition, ne sont plus présumés innocents.
Approuvant l'emploi du terme de « faillite » utilisé par le rapporteur et s'interrogeant sur la réalité des actions entreprises depuis maintenant dix ans pour lutter contre la récidive, M. Alain Marsaud a jugé nécessaire de distinguer la récidive d'actes de délinquance sexuelle de la « petite » récidive. Il a observé que la proposition de loi déposée par M. Christian Estrosi s'efforçait de traiter le cas des personnes qui, bien que comparaissant plusieurs fois devant un juge, conservent un casier judiciaire vierge et ne rentrent donc pas dans les dispositifs de lutte contre la récidive. Il a regretté que les conclusions de la mission ne s'orientent pas vers l'institution de peines minimales mais aillent dans le sens de l'individualisation des peines, dont le respect constitue un confort pour le juge qui ne bénéficie pas, pour autant, des moyens garantissant un véritable suivi personnalisé des condamnés. Il a regretté également que la mission ne se soit pas suffisamment intéressée aux lacunes du Casier judiciaire.
Réagissant aux propos tenus par M. Alain Marsaud, M. Gérard Léonard a indiqué que le rapport de la mission ne faisait pas l'impasse sur la question de l'actualisation des données figurant au Casier judiciaire mais, bien au contraire, y consacrait de long développements et proposait plusieurs solutions afin d'améliorer ses modalités de consultation en ayant recours aux nouvelles technologies de l'information tout en garantissant une actualisation plus rapide des informations. S'agissant du principe de l'individualisation des peines critiqué par M. Alain Marsaud, il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel lui conférait une valeur constitutionnelle et que de nombreux instruments juridiques européens obligeant la France, en particulier la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ainsi que plusieurs recommandations émanant du Conseil de l'Europe, proclamaient également leur attachement à ce principe. Après avoir rappelé que tout condamné avait vocation à sortir de détention un jour, quand bien même celui-ci serait-il fort lointain, il a considéré que la proposition de la mission tendant au placement sous surveillance électronique mobile des condamnés les plus dangereux ayant purgé leur peine représentait l'une des solutions garantissant un suivi effectif de l'intéressé et, partant, une réduction du risque de récidive.
Approuvant les propos de M. Marsaud, M. Christian Estrosi a indiqué que sa proposition de loi gardait toute son actualité, soulignant que les cent quatre-vingt cinq députés qui l'avaient signée comptent bien continuer leur « croisade ». Revenant sur le dispositif de sa propre proposition de loi, il a indiqué qu'elle permettait au juge de prononcer une peine minimale ou, au vu des capacités de réinsertion du délinquant, d'y renoncer. Soulignant que, contrairement aux policiers par exemple, les magistrats ne sont aujourd'hui exposés à aucune poursuite ou sanction, il a estimé que sa proposition tendait à responsabiliser les magistrats tout en permettant l'individualisation des peines, ce qui assure la constitutionnalité du dispositif. Soulignant que le rapport de la mission comportait plusieurs propositions innovantes, il a cependant regretté qu'il n'aille pas au-delà et ne traite pas de la question des peines minimales. Il a donc précisé que s'il ne s'opposerait pas aux conclusions de la mission, il souhaitait toujours en revanche l'inscription à l'ordre du jour de sa proposition de loi. Se faisant ensuite l'écho des initiatives qui sont aujourd'hui lancées en matière de répression des actes de délinquance sexuelle, il a indiqué qu'une proposition de loi sur ce sujet qui ne comporterait pas de mesures suffisamment énergiques ne recevrait pas son adhésion. Rappelant qu'un sondage avait révélé que 79 % des Français étaient favorables à des peines minimales, il a considéré que les récents événements feraient sans doute croître ce chiffre. Faisant observer que la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, ainsi que celle du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux nouvelles formes de la criminalité, avaient permis d'élargir le recours au fichier des empreintes génétiques, il a considéré que les individus aux comportements monstrueux devaient être mis hors d'état de nuire. Regrettant que la Représentation nationale et les gouvernements se soient enfermés, depuis maintenant vingt ans, dans une approche de la délinquance n'ayant permis d'apporter aucune réponse concrète à la société, il a jugé indispensable de redoubler de vigilance en cette matière.
Réagissant aux propos de M. Christian Estrosi sur l'absence de responsabilité des magistrats, M. André Vallini a constaté que cette lacune n'était pas imputable à la précédente majorité qui était sur le point d'adopter trois projets de loi - constitutionnelle, organique et ordinaire - sur cette question, quand le chef de l'État a subitement bloqué toute réforme.
Le Président Pascal Clément a considéré que la question de la responsabilité des magistrats ne relevait pas du champ de la mission et souligné que l'inapplication du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins qu'elle avait constatée résultait de la constante insuffisance des moyens consacrés par tous les Gouvernement successifs à la justice en général et au suivi des condamnés en particulier.
M. Christian Decocq, tout en marquant son intérêt pour les travaux de la mission, a souligné que la proposition de loi de M. Christian Estrosi se faisait l'écho d'une situation que les Français n'acceptaient plus. Convenant que les délinquants sexuels étaient des malades, il a cependant déploré les difficultés concrètes de leur suivi psychiatrique et considéré que le traitement particulier dont ils font l'objet, qui les place à l'abri de sanctions, constituait une dérive d'un système dont la réforme s'impose.
Après avoir rappelé que les travaux de la mission, au cours d'auditions passionnantes, avaient permis de dépasser les idées reçues et regretté le terme provocateur de « croisade » utilisé par M. Estrosi, M. Jérôme Lambert a estimé que les propositions présentées constituaient des pistes de réflexion intéressantes mais s'est montré dubitatif quant à la possibilité de les voir effectivement mises en œuvre. Dans ce contexte, il a fait état de l'abstention constructive du groupe socialiste.
Puis, conformément à l'article 145 du Règlement, la Commission a autorisé le dépôt du rapport de la mission d'information en vue de sa publication.
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
Ministère de la Justice :
- M. Jean-Claude Marin, directeur des affaires criminelles et des grâces
- M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire
- M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires
- M. Michel Duvette, directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse
- M. Luc Frémiot, procureur de la République de Douai
- M. Pierre Raffin, directeur de la maison d'arrêt de la Santé
- M. Pierre-Jean Delhomme, directeur de la maison centrale d'Arles
Ministère de l'Intérieur :
- M. Michel Gaudin, préfet, directeur général de la police nationale
- M. Pierre Mutz, directeur général de la gendarmerie nationale
- M. Étienne Apaire, conseiller du ministre
Union syndicale des magistrats (usm) :
- M. Bruno Thouzellier, chargé de mission
- Mme Catherine Vandier, membre du Bureau
Syndicat de la magistrature :
- Mme Aïda Chouk, présidente
Conseil national des barreaux :
- M. Michel Bénichou, président
Conférence des Bâtonniers :
- M. Thierry Wickers, président désigné
Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris :
- M. Jean-Marie Burguburu, président
Gie Conseil national des barreaux, Barreau de Paris, Conférence des Bâtonniers :
- Mme Françoise Louis, conseiller et responsable des relations extérieures
Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale (schfpn) :
- M. Olivier Damien, secrétaire général adjoint
- M. Philippe Lutz, commissaire principal
Syndicat Alliance :
- M. Jean-Claude Delage, secrétaire général adjoint
Synergie Officiers :
- M. Stéphane Berthomet, conseiller technique
Professeurs de droit :
- M. Jean Pradel, professeur de droit à l'université de Poitiers
- M. Guy Carcassonne, professeur de droit à l'université Paris X-Nanterre
- Mme Pierrette Poncela, professeur de droit à l'université Paris X-Nanterre
Médecins :
- Me Betty Brahmy, psychiatre, médecin-chef du smpr de Fleury-Mérogis
- M. Louis Roure, psychiatre, médecin-chef
Association des avocats pénalistes (adap) :
- Maître Jean-Yves Leborgne, Président
Association nationale des juges de l'application des peines (anjap) :
- M. Mickaël Janas, président
- M. Éric Martin, juge d'application des peines
Ligue contre la violence routière :
- Mme Geneviève Jurgensen, présidente
Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (apacs) :
- M. Jean-Pierre Escarfail, président
Association Aide aux parents d'enfants victimes (apev) :
- M. Alain Boulay, président
Institut national d'aide aux victimes et de médiation (inavem) :
- M. Jacques Calmettes, président
- M. Jean-Luc Domenech, directeur
-------
N° 1718 - Rapport d'information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales (M. Pascal Clément, Président - M. Gérard Léonard, rapporteur)
1 () Ces chiffres sont issus, respectivement, de l'étude sur les condamnés de 2001 en état de récidive parue dans le numéro 68 de la revue Infostat Justice d'août 2003 et de la réponse du garde des sceaux à une question écrite parue au Journal officiel questions du 29 décembre 2003, Assemblée nationale, page 9992.
2 () Proposition de loi n° 1399 du 4 février 2004.
3 () Cité par Pierre Rosanvallon, le modèle politique français, Seuil, 2003, page 101.
4 () Article : Loi
5 () Introduites dans le code pénal en 1824.
6 () Cf, Droit pénal général, Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, economica, 10e édition, page 772.
7 () En effet, si la délinquance a baissé de 4,63 % entre avril 2003 et avril 2004, les violences contre les personnes ont, en revanche, augmenté de 10,07 % selon les chiffres publiés par le ministère de l'intérieur.
8 () Système de traitement des infractions constatées, mis en œuvre en application des dispositions du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001.
9 () Cette législation est généralement dénommée : « three strikes and you're out ».
10 () Dites : sentencing guidelines.
11 () Ces éléments de droit comparé ont été fournis par le service des affaires européennes et internationales du ministère de la Justice.
12 () Powers of criminal courts sentencing act 2000.
13 () Introduit par l'article 159 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
14 () Arrêts Hussain c. Royaume-Uni et Singh c. Royaume-Uni du 21 février 1996.
15 () Arrêt Stafford c. Royaume-Uni du 28 mai 2002.
16 () Rapport n° 1785 du 10 juin 1980 fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Tome II, pages 72 et 73.
17 () Notre collègue Jean-Paul Garraud a d'ailleurs saisi le garde des sceaux d'une proposition tendant à la création d'une tutelle judiciaire, héritière de la tutelle pénale.
18 () Loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
19 () L'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire a été introduit par l'article 46 de la loi du 9 mars précitée modifiant l'article 131-36-1 du code pénal.
20 () Décision 127 DC des 19 et 20 janvier 1981 dite « sécurité et liberté ».
21 () Décision 87-237 DC du 30 décembre 1987.
22 () Décision 96-377 DC du 16 juillet 1996.
23 () Rapport n° 2789 du 11 juin 1992 fait au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale par M. Alain Vidalies, page 26.
24 () Cette analyse a également été développée devant la mission par Jean-Yves Leborgne, président de l'association des avocats pénalistes (ADAP).
25 () In Regards sur l'actualité, mars 1997, pages 15 et 16.
26 () Numéro 68 d'août 2003.
27 () In Regards sur l'actualité, mars 1997, pages 15 à 26.
28 () Numéro 50 de décembre 1997 de la revue Infostat Justice.
29 () Numéro 68 d'août 2003 de la revue Infostat Justice.
30 () In les Cahiers de démographie pénitentiaire, n° 15 de mars 2004.
31 () Par souci de rigueur et bien que les études sur lesquelles s'appuient les présents développements portent sur la « récidive », votre rapporteur juge préférable, dans la mesure du possible, de recourir au terme de « réitération ».
32 () Étude citée dans Regards sur l'actualité, op cit, mars 1997.
33 () Sur un total de 2 933 condamnés pour crime.
34 () Deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende.
35 () Cette rédaction est issue de l'article 63 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
36 () Selon les données figurant dans l'annuaire statistique de la Justice 2003, sur les 371 640 poursuites engagées devant les tribunaux correctionnels en 2001, 31 693 l'ont été dans le cadre de la comparution immédiate.
37 () Arrêts des 22 mars 2000 ou 27 avril 2000.
38 () Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison. Avril 2003, la Documentation française.
39 () En application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
40 () Question n° 3203 du 23 septembre 2002 dont la réponse figure au Journal Officiel des questions, Assemblée nationale, 18 novembre 2002, page 4335.
41 () Source : réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la question écrite de M. Jean-Christophe Lagarde, JO questions, Assemblée nationale du 29 décembre 2003, page 9992.
42 () En effet, le choc produit par l'incarcération du prévenu peut également être de nature économique lorsque l'ensemble de sa famille dépend des revenus issus de son activité illégale.
43 () Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2006, cette convocation devant le jap est facultative en application des dispositions du V de l'article 207 de la loi du 9 mars 2004.
44 () Cette définition de M. Debuyst issue du IIe cours international de criminologie de Paris en 1953 a été communiquée à la mission par le docteur Louis Roure, psychiatre des Hôpitaux.
45 () Entendue ici comme l'étude médicale, psychologique et sociale du délinquant dont l'objet est de déterminer les causes de l'acte criminel.
46 () Extrait du document communiqué à la mission par M. Louis Roure.
47 () Schéma issu de l'ouvrage : les comportements violents et dangereux, aspects criminologiques et psychiatriques, par MM. Louis Roure et Philippe Duizabo, édition Masson, 2003, page 29.
48 () Ce guide est accessible sur le site du SCC : www.csc-scc.gc.ca.
49 () En application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
50 () Ce fichier, dont les modalités doivent être déterminées par décret en conseil d'État pris après avis de la cnil, n'est pas encore entré en vigueur à ce jour.
51 () DNA-Identitätsfeststellungsgesetz.
52 () Source : annuaire statistique de la Justice, année 2003, page 15.
53 () Rapport n° 1115 Tome VI du 9 octobre 2003, page 18.
54 () En application de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
55 () Décret n° 2000-412 du 18 mai 2000.