

 N° 1998 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2004. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur la recherche publique et privée en France face au défi international ET PRÉSENTÉ par M. Jean-Pierre DOOR, Député. ___ INTRODUCTION 7 PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN FRANCE 11 I.- PANORAMA DE LA RECHERCHE FRANÇAISE DANS L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 11 A. LA LENTE ÉROSION DE LA POSITION FRANÇAISE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 11 1. Des données statistiques faussement rassurantes 11 2. Des témoignages alarmants 12 3. L'échiquier mondial de la recherche à la veille d'un bouleversement 12 B. UN MODÈLE EN RUPTURE AVEC LE NOUVEAU PARADIGME DE LA RECHERCHE 13 1. Un système de recherche hérité du passé et peu adapté au temps présent 13 2. La fracture entre recherche fondamentale et recherche appliquée, recherche publique et recherche privée 15 3. Le divorce de la recherche et de la notion de progrès 18 II.- LES DIX DÉFIS MAJEURS AUXQUELS LA RECHERCHE FRANÇAISE EST CONFRONTÉE 19 DÉFI N° 1 : LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 19 1. Des moyens insuffisants pour mener une recherche performante 19 2. Quelles sources de financement ? 23 3. Des crédits supplémentaires : pour quoi faire ? 24 DÉFI N° 2 : UN PILOTAGE DE LA RECHERCHE INOPÉRANT 26 1. Une responsabilité fragmentée 27 2. La confusion des rôles 28 DÉFI N° 3 : QUID DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE ? 30 1. Des réalités contrastées 30 2. Des évolutions incertaines 33 DÉFI N° 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 34 1. Un système d'enseignement supérieur français dont la qualité n'est pas reconnue sur la scène internationale 35 2. Une recherche qui n'est pas au centre du dispositif d'enseignement supérieur 37 3. Des structures universitaires inadaptées 38 DÉFI N° 5 : UNE GESTION ADMINISTRATIVE INADAPTÉE À UN ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL 39 DÉFI N° 6 : LES JEUNES ET LA RECHERCHE 41 1. La précarisation de la situation des doctorants 42 2. La difficile entrée dans la carrière 43 3. L'inquiétante fuite des cerveaux : 44 DÉFI N° 7 : LA QUESTION DU PERSONNEL CHERCHEUR 46 1. Des moyens humains insuffisants ? 47 2. Des rémunérations insuffisantes 49 3. Une profession, deux statuts 51 4. Une seule profession, différentes façons de l'exercer 52 DÉFI N° 8 : L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE 55 DÉFI N° 9 : L'INSUFFISANCE DE LA RECHERCHE PRIVÉE 57 1. Les grandes entreprises investissent dans la recherche mais sont trop peu nombreuses 59 2. Des PME privées des moyens nécessaires pour innover 61 3. Une articulation public/privé à renforcer 64 DÉFI N° 10 : LA RECHERCHE ET L'EUROPE 69 1. L'insuffisante intégration de la recherche dans le dispositif communautaire 72 2. La position française dans la politique communautaire de recherche 74 DEUXIÈME PARTIE : DESSINER UN AVENIR À LA RECHERCHE FRANÇAISE 77 I.- OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉFORME 78 A. UN OBJECTIF AMBITIEUX 78 B. DEUX EXEMPLES DE RÉUSSITE 80 1. Les Etats-Unis : le double effet de la taille et du système 80 2. La Finlande : une réussite en dépit d'une taille réduite 81 C. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉFORME 83 1. La vocation universelle de la recherche française 83 2. Un dispositif décentralisé fondé sur la liberté et la responsabilité des acteurs 84 3. Une action lisible et raisonnée 84 4. La nation associée à la politique de recherche 85 II.- TREIZE PROPOSITIONS DE RÉFORME 87 PROPOSITION N° 1 : Renforcer le pilotage stratégique 87 PROPOSITION N° 2 : Encourager le financement sur la base de projets 88 PROPOSITION N° 3 : Assouplir les règles de gestion des établissements publics de recherche 89 PROPOSITION N° 4 : Renforcer le dispositif d'évaluation 90 PROPOSITION N° 5 : Revaloriser l'emploi scientifique 91 PROPOSITION N° 6 : Renforcer l'autonomie des universités 91 PROPOSITION N° 7 : Développer des pôles de compétitivité 92 PROPOSITION N° 8 : Augmenter significativement le financement de la recherche 94 PROPOSITION N° 9 : Mettre en place une véritable politique en direction des jeunes chercheurs 96 PROPOSITION N° 10 : Développer les structures de valorisation de la recherche académique 97 PROPOSITION N° 11 : Encourager la recherche privée 98 PROPOSITION N° 12 : Favoriser l'intégration de la politique de recherche au niveau européen 99 PROPOSITION N° 13 : Rendre la recherche plus attractive 100 TRAVAUX DE LA COMMISSION 101 ANNEXES 105 CONTRIBUTION DE M. YVAN LACHAUD AU NOM DU GROUPE UDF 105 PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION 111 AUDITION DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA RECHERCHE 115 «Longtemps la puissance d'une nation s'est mesurée à celle de son armée. Aujourd'hui, elle s'évalue à son potentiel scientifique 1. » A l'instar de toutes les formules, celle du prix Nobel français de médecine, M. François Jacob, n'échappe pas à une certaine forme de caricature ; elle a toutefois le mérite de poser clairement et sans détour les enjeux soulevés par l'évolution de nos sociétés et par le rôle grandissant qu'y joue le progrès scientifique. La place occupée par les Etats-Unis sur la scène internationale qui concentrent en leurs mains, certes la première armée du monde, mais également les plus forts investissements en recherche et développement (37 % de la dépense mondiale en ce domaine), est là pour valider l'assertion. L'accent volontairement mis par les autorités chinoises sur le développement des activités de recherche dans leur pays - multiplication par deux de l'effort de recherche entre 1996-2001 dans une période de forte croissance économique 2 - renforce encore, si besoin était, la démonstration. Entre ces deux géants, l'Europe, et singulièrement la France, sont à la croisée des chemins. Traditionnellement à la pointe du progrès scientifique, les chercheurs français constatent que leur position est de plus en plus contestée, au point d'éprouver parfois le terrible sentiment de n'avoir même plus, comme l'écrivent quatre parmi les plus éminents scientifiques français 3, auteurs de l'appel Du Nerf ! (Donner un nouvel essor à la recherche), « les moyens de participer à armes égales à la compétition internationale 4». Cette inquiétude, qui procède d'une lente dérive de la recherche française, - quels que soient les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années -, est au cœur du mouvement des chercheurs. La Lettre ouverte au gouvernement, publiée le mercredi 7 janvier 2004 et dont les signataires s'associeront dans le collectif Sauvons la recherche, s'ouvre par ces mots qui expriment un constat lucide : « A l'aube du XXIe siècle, la France a besoin d'une recherche vigoureuse. Cette activité est indispensable aux innovations de demain, au développement économique de notre pays, ainsi qu'à son rayonnement culturel. Dans la conjoncture actuelle, les pays qui ne maintiendront pas un outil de recherche d'excellence seront incapables de suivre l'accélération de l'évolution économique associée à la production des connaissances [et] entreront donc dans une dépendance économique difficilement réversible. » La fronde des chercheurs, dont les prolongements ont abouti à la réunion des états généraux de la recherche à Grenoble au mois d'octobre dernier, s'est ainsi révélée moins comme une lutte corporatiste que comme une alarme salutaire venant rappeler à tous combien l'activité de recherche conditionne et engage à bien des égards l'avenir de la nation toute entière. En effet, si le mécontentement des chercheurs a été, comme l'a souligné M. Christian Cabal, rapporteur spécial pour les crédits de la recherche, dans son rapport d'information sur l'exécution des crédits de la recherche du 23 juillet 2004 (n° 1771), la résultante immédiate des variations de forte amplitude ayant affecté le budget des organismes de recherche en 2002 et en 2003 et la transformation d'emplois titulaires en emplois contractuels, il a été à la fois moins et plus que cela : moins, car la fronde des chercheurs a occulté l'effort de la Nation consenti en faveur de la recherche ces dernières années (augmentation constante et conjointe des budgets et des effectifs affectés à la recherche publique depuis dix ans) ; plus, parce que ce mouvement a témoigné d'un malaise profond sur la place accordée à la recherche et au chercheur en ce début de XXIe siècle. La société française dans son ensemble ne s'est pas trompée quant à l'importance de l'enjeu qui a apporté un soutien massif au mouvement des chercheurs. Soucieux de répondre à l'inquiétude exprimée par une partie de la population et de prendre une part active à un débat fondamental pour l'avenir du pays, la représentation nationale et au premier chef la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, s'est très rapidement saisie de la question. Cette réflexion a tout d'abord pris la forme d'une table ronde intitulée Des idées pour la recherche, réunie à l'initiative du président M. Jean-Michel Dubernard, dès le 4 mars 2004. Conscient qu'une manifestation d'un jour ne permettait pas d'épuiser un débat aussi vaste dont le gouvernement avait annoncé qu'un projet de loi d'orientation et de programmation serait le prolongement naturel, la commission a décidé de poursuivre son travail d'analyse et de proposition en constituant en son sein, le 1er juin 2004, une mission d'information. Composée de onze députés et présidée par M. Jean-Pierre Door, la mission a volontairement décidé d'inscrire ses travaux dans une démarche d'ouverture avec le choix d'un champ d'investigation large - dont le titre retenu pour la mission est l'expression - persuadée que la question ne pouvait s'apprécier que globalement, dans toutes les dimensions de la recherche civile. Dans une économie mondialisée où la concurrence des pays émergents - en raison du développement intensif des moyens de communication - ne fait plus seulement sentir ses conséquences en terme de délocalisation des unités de fabrication des produits manufacturés mais s'étend de plus en plus au secteur des services, il importe en effet que notre pays, s'il veut préserver, comme il en a l'ambition, son modèle social, maintienne un haut niveau de compétitivité et de créativité dans le secteur de la recherche et des hautes technologies. A l'avenir la France ne pourra maintenir son niveau d'exigence sociale qu'au prix d'une politique volontariste d'excellence scientifique, synonyme de développement économique. La recherche est ainsi au confluent de nombreux domaines qu'elle irrigue tous. L'aptitude de la France à maintenir son rang et son influence sur la scène internationale réside en grande partie dans sa capacité sans cesse renouvelée à innover et à compenser, par la création de biens ou de services à forte valeur ajoutée, son handicap par rapport à des pays émergents aux exigences sociales beaucoup moins fortes. Démonstration de ce lien qui unit innovation et croissance économique, une étude menée par Pierre Kopp et Patrice Geoffron, respectivement professeurs d'économie à la Sorbonne et à l'université Paris-Dauphine, a mis en évidence qu'un accroissement de 0,1 % de la part des investissements consacrés par les entreprises à la recherche et au développement rapportée au produit intérieur brut (PIB) conduisait mécaniquement à l'augmentation de 1,2 point par an de la croissance économique 5. Longtemps chasse gardée des pays occidentaux, la recherche et l'innovation se mondialisent à leur tour. La Chine et la Corée du Sud, pour ne prendre que ces deux exemples, ne se contentent plus de fabriquer des produits conçus par d'autres. Ils sont désormais capables de maîtriser toute la chaîne de production depuis l'innovation et la conception - y compris dans les domaines de la haute technologie - jusqu'à la production du produit fini. L'annonce, à deux jours d'intervalle, les 8 et 9 décembre derniers, de l'acquisition de l'activité PC du géant américain IBM par l'entreprise chinoise Lenovo - acquisition qui place désormais le constructeur informatique asiatique sur la troisième marche mondiale des fabricants d'ordinateurs personnels - et, en sens inverse, de la décision du groupe sud-coréen LG de créer un pôle de recherche européen dédié aux téléphones mobiles à Villepinte, au nord de Paris, témoigne, de façon éclatante, de la vigueur asiatique dans le domaine des hautes technologies. De ces observations - le lien évident existant entre capacité à innover et développement économique et l'émergence de nouvelles puissances dans le secteur de la recherche au niveau international - il résulte un constat simple : la France est menacée par la concurrence étrangère jusque dans le secteur de la recherche et, par suite, la préservation de son modèle social et son rang au niveau international - économique, intellectuel, culturel - peuvent à terme être contestés. Il y avait donc urgence à déterminer les moyens propres à favoriser le maintien et le développement d'une recherche performante. Tel était précisément l'objet de la mission d'information. Au terme de plus de six mois d'investigation, après avoir auditionné plus de 50 personnalités représentant aussi bien le monde de la recherche académique que la sphère privée de la recherche, après avoir pris connaissance des nombreux rapports consignant les analyses de groupes de réflexion tout aussi nombreux, les membres de la mission sont parvenus à la conviction suivante : oui la recherche française est en crise, non son déclin n'est ni irréversible, ni irrémédiable. Car, si de toutes parts, des inquiétudes existent qui, pour la plupart sont légitimes, de l'autre, tous les acteurs du monde de la recherche que la mission a pu rencontrer au cours de ses travaux témoignent, en dépit des difficultés qu'ils rencontrent, d'un enthousiasme, d'une volonté de replacer la recherche française à une place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, au sommet de la compétition internationale, comme le montre, exemple parmi d'autres, l'action énergique et volontariste menée par M. Jacques Glowinski, administrateur et président de l'assemblée des professeurs du Collège de France, à la tête d'une institution presque cinq fois centenaire. La mission a également pu constater que, outre la question des moyens de la recherche, bien réelle et qui a d'ores et déjà trouvé, dans le projet de loi de finances pour 2005 voté par l'Assemblée nationale une amorce de résolution, doit se poser la question d'une réforme plus globale de la recherche dans notre pays. Il importe en effet de ne pas inverser les priorités : c'est bien la définition des objectifs qui doit précéder l'attribution des moyens - dont le niveau doit effectivement être augmenté. Le plan du rapport retrace la démarche qui a été celle des membres de la mission, à savoir, dans un premier temps, faire la « radioscopie » de la recherche française afin d'établir un diagnostic puis, dans une seconde phase, formuler des propositions susceptibles de guérir ce que d'aucuns présentent comme le « désenchantement » de la recherche française. PREMIÈRE PARTIE : ÉTAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE EN FRANCE Au fil des auditions, la mission d'information a pu constater qu'en dépit des différents milieux qu'ils représentent et au-delà des clivages naturels et légitimes liés aux diverses positions de chacun dans le monde vaste et hétérogène de la recherche, tous ses interlocuteurs partagent globalement - à l'instar des différents rapports publiés sur le sujet - une vision commune quant à la situation de la recherche française. I.- PANORAMA DE LA RECHERCHE FRANÇAISE DANS L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL La situation de la recherche française doit s'apprécier à l'aune de deux éléments : son environnement international et sa trajectoire historique. A. LA LENTE ÉROSION DE LA POSITION FRANÇAISE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE Sur ce point, tous les témoignages enregistrés par la mission convergent et viennent utilement éclairer des éléments statistiques trompeurs. 1. Des données statistiques faussement rassurantes Ainsi, à s'en tenir aux indicateurs consignés dans l'édition 2004 du rapport de l'Observatoire des sciences et des techniques (OST), la position de la recherche française dans le monde serait globalement stable. La France maintient sa quatrième position mondiale en matière de production technologique (part mondiale des brevets européens), son cinquième rang pour la production scientifique mondiale - établie à partir des publications et des citations dans les revues internationales - et une peu flatteuse douzième place pour ce qui concerne l'indice d'impact à deux ans des travaux menés dans notre pays. Au niveau des indicateurs, l'érosion de la position française ne se mesure qu'au niveau de l'enseignement supérieur où l'OST relève - comme en écho au classement mondial des universités établi par l'université Jia Tong de Shangaï, sur lequel il sera revenu plus loin - une baisse importante du nombre de doctorats obtenus en France par des étudiants étrangers (- 30 %) corrélative à une intensification du nombre d'étudiants français en partance pour aller faire leurs études en Europe. Cette situation - relative stabilité de la position française dans la hiérarchie mondiale mais fragilisation de son influence dans le domaine de la formation « à et par » la recherche - éclaire combien ce qui se joue aujourd'hui est bien l'avenir de la recherche française même si les instruments de mesure du présent ne le laissent qu'assez peu paraître. En la matière, le témoignage vécu des acteurs de terrain est d'autant plus important que certains indicateurs, tel que le nombre des doctorants et des docteurs séjournant à l'étranger, ne sont pas ou plus disponibles depuis que, comme l'a rapporté aux membres de la mission, M. Sylvain Collonge, président de la Confédération des jeunes chercheurs (CJC), le rapport sur les études doctorales a cessé, pour des raisons administratives, de paraître. Or ces témoignages convergent tous pour affirmer que, de ce point de vue, et comme le résume fort bien M. Edouard Brézin, vice-président de l'Académie des sciences, le départ des chercheurs vers l'étranger, dont on ne connaît pas le nombre car ils échappent à tout recensement statistique, correspondent toutefois indéniablement à un déficit qualitatif important pour la recherche française qui risque de peser sur son avenir. Ce constat est d'autant plus manifeste que la recherche est une activité à très fort potentiel humain et n'a de sens que si elle vise l'excellence. Si l'on ne mesure plus la performance de la recherche française dans sa globalité mais à observer les secteurs individuellement on remarque aussi les prémices d'un recul. Aux dires de M. Christian Bréchot, directeur général de l'Inserm, la recherche médicale française se situe désormais derrière la recherche médicale britannique, appréciation corroborée par la décision de la plupart des entreprises pharmaceutiques de déplacer leurs laboratoires français vers l'étranger, comme la firme américaine Pfizer qui vient d'abandonner ses laboratoires de recherche en France pour les installer au Royaume-Uni. Y compris dans les secteurs où elle disposait traditionnellement de positions fortes, comme sur les antibiotiques et sur les vaccins, la recherche médicale française perd du terrain par rapport à ses concurrentes, ainsi que l'a confirmé à la mission M. Jean-François Déhecq, président-directeur général de Sanofi-Aventis. 3. L'échiquier mondial de la recherche à la veille d'un bouleversement Cette situation, dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences, est d'autant plus alarmante que cette fragilisation de la recherche française parmi les pays dont la compétence scientifique est depuis longtemps reconnue intervient à un moment où s'ébauche une redistribution des positions dans la hiérarchie mondiale avec l'émergence, sur le terrain de la recherche, de pays tels que la Chine ou l'Inde qui, compte tenu de leur poids démographique et de leur dynamisme économique et scientifique, sont appelés, dans ce secteur comme dans d'autres, à devenir des acteurs majeurs et incontournables dans les années à venir. Si l'environnement international change, la matière scientifique également évolue au gré des découvertes et contribue à façonner différemment la hiérarchie scientifique mondiale selon que tel ou tel pays a réussi à imposer sa compétence dans des secteurs à fort dynamisme. C'est ainsi qu'au cours des années 1970 et pour contenir l'influence montante d'un Japon en plein essor scientifique et technologique, les Etats-Unis ont su jeter les bases de deux des plus grandes mutations scientifiques et économiques de ce début de XXIe siècle avec l'avènement des technologies de l'information et des biotechnologies. Or, dans ce dernier secteur, promis, selon tous les analystes, à un brillant avenir, et qui introduit, aux dires de M. Marc Vasseur, vice-président des Laboratoires internationaux de recherche (LIR), président-directeur général de Serono France holding, co-fondateur et senior vice-president de Genset, auditionné par la mission, « un changement profond de paradigme scientifique » provoquant une « mutation complète, les travaux réalisés aujourd'hui étant considérés comme de la science-fiction cinq ans auparavant », la France, avec 4,5 % des brevets européens 6 au niveau mondial, accuse un retard certain sur ses partenaires étrangers très loin derrière les Etats-Unis qui à eux seuls en détiennent 47,1 % et derrière l'Allemagne (9,3 %), le Japon (8,2 %), et le Royaume-Uni (6,6 %). C'est aussi que, face à un monde en pleine mutation, la France peine à renouveler ses structures qui, pour le secteur de la recherche, datent, dans leur organisation, de près d'un demi-siècle. B. UN MODÈLE EN RUPTURE AVEC LE NOUVEAU PARADIGME DE LA RECHERCHE Il est un fait qui est apparu nettement aux membres de la mission au fur et à mesure des auditions qu'ils ont menées, c'est que la recherche française, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire telle qu'elle se présente dans l'héritage des propositions du colloque de Caen de 1956, ne répond plus, ni dans son organisation - atypique et où l'université peine à trouver sa place - ni dans son mode de gestion - insuffisamment souple - aux nécessités actuelles de la recherche scientifique dont les déterminants essentiels sont la réactivité et la capacité à mobiliser des ressources humaines et financières. 1. Un système de recherche hérité du passé et peu adapté au temps présent Cette situation a fait l'objet d'une analyse convaincante exposée par les responsables de l'opération FutuRIS (recherche, innovation, société) devant les membres de la mission et reprise avec plus de détail dans leur rapport intitulé Avenirs de la recherche et de l'innovation en France. En préambule, il faut indiquer que, comme il a été rappelé plus haut, l'organisation de la recherche publique en France est, pour l'essentiel, l'héritière des propositions avancées lors du colloque de Caen, en novembre 1956, qui constitue le terme d'une réflexion initiée par Pierre Mendès France lorsqu'il était président du Conseil (juin 1954-février 1955) mais dont il reviendra au général de Gaulle de mettre en œuvre les conclusions. Ainsi, et bien que le CNRS ait été créé en 1939, c'est bien du début de la Ve République que date l'organisation actuelle de la recherche française que l'on pourrait, à gros traits, décrire ainsi : un gouvernement chargé de donner les grandes orientations de la politique de recherche publique, des établissements publics de recherche chargés de les mettre en œuvre, des universités dont la mission d'enseignement prime sur les activités de recherche. Or, comme l'a déclaré devant la mission M. Jacques Lesourne, président du comité d'orientation de l'opération FutuRIS, force est de constater que le contexte dans lequel le système de recherche français a été bâti, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et a obtenu de très bons résultats, n'a plus grand-chose à voir avec l'environnement actuel. Les conditions étaient alors les suivantes : une économie essentiellement fermée privilégiant, devant la nécessité de reconstruction du pays, l'industrie lourde ; des entreprises qui ne consacraient pas une part aussi importante de leurs ressources qu'aujourd'hui à la recherche laissant à l'Etat, c'est-à-dire aux administrations ou aux entreprises nationalisées, le soin de mener cette recherche ; une population globalement favorable à la recherche et à la science jugées sources de progrès économique et social. Qu'observe-t-on aujourd'hui ? L'économie fermée de jadis a laissé la place à une économie ouverte au niveau mondial et intégrée au niveau européen ; privatisées ou sur le point de l'être, les grandes entreprises nationales redéfinissent leur politique de recherche en fonction des contraintes de leur environnement concurrentiel ; le passage d'une société industrielle à une société d'information - où le rôle de l'industrie reste néanmoins central - modifie les thèmes de recherche et la nature des développements technologiques ; enfin, et cela n'est pas l'évolution dont l'impact est le moindre, le regard porté sur la recherche et les sciences a évolué dans un sens plus critique au point que l'obscurantisme de certaines minorités actives est en voie d'empêcher le développement de certaines recherches. Or, face à de tels bouleversements, le système de recherche, dont il serait abusif de dire qu'il n'a pas évolué, n'a pas mué au même rythme. Pour l'essentiel, l'architecture du système repose, un demi-siècle plus tard, sur les mêmes fondamentaux : rôle pivot du CNRS et des organismes publics de recherche tels que le CEA, l'Inserm, l'INRA (pour ne citer que ceux-là), une relative marginalisation de l'université dans la conduite de la recherche académique et l'insuffisance de la recherche privée menée au niveau des entreprises. Sans remettre en cause l'existence même des organismes de recherche - dont la très grande majorité des personnes auditionnées par la mission d'information s'accordent à louer le rôle éminent qu'elles ont joué par le passé dans la constitution d'une communauté scientifique française de qualité reconnue sur la scène internationale et le rôle qu'elles jouent encore dans le présent pour l'affirmation d'une recherche française de haut niveau -, les différentes personnes que la mission a pu rencontrer, qu'elles soient issues des organismes publics de recherche ou proviennent d'autres horizons, partagent la conviction que le système français de recherche tel qu'il existe actuellement, aussi bien dans sa dimension publique que privée, souffre avant tout de deux maux principaux : un manque de souplesse en terme de gestion et un cloisonnement excessif des acteurs. Ces deux problèmes sont indissociables et pour certaines des personnes interrogées constituent même un préalable à l'autre question qui domine le monde de la recherche : le financement. Avant d'aborder point par point, les questions qui animent les chercheurs français, le rapporteur a donc souhaité s'arrêter un instant sur ces deux éléments qui, à la fois, sous-tendent et unifient l'ensemble des autres problématiques auxquelles la recherche française est confrontée. 2. La fracture entre recherche fondamentale et recherche appliquée, recherche publique et recherche privée Le manque de souplesse dans les règles de gestion est en effet dénoncé aussi bien par les chercheurs issus de l'université ou des organismes publics de recherche que par les acteurs de la recherche privée. Les premiers critiquent des règles administratives souvent tatillonnes qui les empêchent d'intervenir avec la réactivité nécessaire dans un monde de la recherche de plus en plus concurrentiel et qui ne leur permettent pas de récompenser les mérites des scientifiques les plus éminents. De l'autre côté, les entreprises pointent du doigt certains éléments d'un système qui ne permet pas à toutes les initiatives de s'épanouir suffisamment rapidement pour jouer un rôle déterminant sur la scène internationale. Pourtant, si public comme privé partagent certaines doléances, force est de constater que, jusqu'à présent en France, ces deux facettes de la recherche, telles les deux faces de Janus, pour être indissociables n'en sont pas moins demeurées hermétiques l'une à l'autre. L'anecdote rapportée aux membres de la mission par M. Alain Risbet, président du réseau des Centres techniques industriels (CTI) est, sur ce point, tristement éclairante. Dans une tribune publiée dans Le Monde du 3 juin 2004 et intitulée Pour sauver la recherche, cinq anciens directeurs généraux du CNRS 7 affirmaient : « Un autre point préoccupant concerne la faiblesse des relations entre les petites et les moyennes entreprises et les universités. Il y aurait beaucoup à apprendre de ce que les Allemands ont réalisé en matière de recherche technologique à leur profit depuis plus de cinquante ans avec leur réseau d'instituts Fraunhofer. » Or ce réseau que les auteurs appellent de leurs vœux est précisément celui présidé par M. Alain Risbet, au demeurant ancien chercheur dans un organisme public de recherche. La méconnaissance des acteurs entre eux, notamment entre personnalités de la recherche privée et personnalités de la recherche publique, empêche ainsi que les nécessaires connexions entre les différents efforts de recherche se fassent, provoquant doublons, redondances et pertes d'énergie à la fois humaines et financières. Là encore, et comme le montre à rebours l'article cité plus haut, on touche à une singularité française née de l'histoire et de la culture qui tend à considérer la recherche académique et fondamentale comme une activité plus « noble » que la recherche appliquée menée dans les entreprises parce que débarrassée de toute finalité pratique. M. Marc Vasseur a ainsi rappelé aux membres de la mission qu'il avait essuyé les critiques les plus vives de ses collègues lorsqu'il avait décidé, en 1989, de quitter l'Inserm pour créer sa propre société, Genset, spécialisée dans les biotechnologies. Dans les faits pourtant, la division est toute théorique et repose bien plus, de l'aveu même des acteurs, sur une ignorance réciproque et ce même si le président de l'Académie des sciences, M. Etienne-Emile Baulieu, n'hésite pas à faire entendre sa voix discordante en qualifiant la recherche en entreprise de « consternante ». Sur ce point aussi, le mouvement des chercheurs a eu des conséquences salutaires en offrant à la communauté toute entière l'occasion de se rencontrer, d'échanger des expériences et ainsi d'apprendre à se connaître. M. Alain Trautmann, porte-parole du collectif « Sauvons la recherche », a ainsi déclaré aux membres de la mission qu'à la faveur du mouvement des chercheurs, la méfiance réciproque des chercheurs et de l'entreprise - les premiers craignant, en recourant au financement privé, de devenir les instruments d'une recherche dont les finalités leur échapperaient, les secondes redoutant, en finançant des programmes de recherche fondamentale, de perdre tout contrôle sur cette recherche - était en train de s'estomper. C'est là une évolution heureuse dans un monde de la recherche où les interconnexions entre recherche publique et recherche privée tendent à devenir de plus en plus intenses au point que la traditionnelle division entre recherche fondamentale - financée quasi exclusivement par le public - et recherche appliquée - historiquement domaine de l'entreprise privée - est en voie d'obsolescence pour se transformer, selon une évolution qu'illustre bien l'expression de M. Michel Callon, sociologue des sciences et professeur à l'Ecole des mines de Paris, en recherche d'exploration et recherche d'exploitation. S'il appartient à l'Etat et qu'il lui appartiendra encore à l'avenir de financer la recherche fondamentale, l'initiative privée n'ayant pas vocation à entreprendre des recherches dont la valorisation ne pourra pas intervenir à court ou moyen terme, on constate en revanche que la frontière entre le domaine réservé de l'un et de l'autre est de plus en plus floue. C'est là une des conséquences de l'importance de plus en plus grande du rôle tenu par les évolutions de la science et des technologies dans la compétition économique, qu'il s'agisse des technologies de l'information ou des biotechnologies. A l'inverse, les organismes publics de recherche n'hésitent plus à valoriser leurs recherches et à mettre en place des partenariats avec les entreprises. C'est notamment le cas de l'Inserm dont l'activité, tournée vers la recherche médicale, l'a très tôt conduit à nouer des liens avec des laboratoires pharmaceutiques puis à créer directement, en 1999, une filiale privée dénommée Inserm-Transfert dans le but de favoriser la création d'entreprises innovantes et le transfert de technologies issues de ses laboratoires. L'intensification des liens entre recherche publique et recherche privée, est également poursuivie par l'établissement emblématique de la recherche fondamentale, le CNRS, avec la volonté affirmée, par la voix de son directeur général, M. Bernard Larrouturou, dans un document intitulé Notre projet pour le CNRS, d'inscrire l'établissement dans un « continuum formation-recherche-innovation » estimant que « les débats opposant la recherche fondamentale et l'innovation technologique sont dépassés ». En leur état actuel, ces initiatives, naissantes ou presque, témoignent plus d'une prise de conscience, nécessaire, que d'une lame de fond suffisamment forte pour entraîner l'ensemble du monde de la recherche et permettre au système d'atteindre un fonctionnement optimal. Pour l'instant, l'efficacité de ces structures est surtout avancée par leurs promoteurs eux-mêmes. A rebours, M. Marc Vasseur n'a pas hésité à déclarer devant la mission que les structures mises en place par le CNRS ou par les universités manquaient de professionnalisme et il a dénoncé le fait qu'en règle générale n'y étaient pas placés, pour des raisons idéologiques, les meilleurs chercheurs, ce qui aboutissait à ce que les services en question fonctionnent mal. Il n'en demeure pas moins, comme ont pu le constater les membres de la mission d'information, qu'en ce domaine comme dans d'autres, les mentalités évoluent et que la fracture entre recherche privée et recherche publique tend à se résorber, l'une comme l'autre sachant désormais que leur intérêt commun est d'unir leurs forces plutôt que de mener leurs travaux dos à dos. 3. Le divorce de la recherche et de la notion de progrès Dernier point enfin de ce tableau général de la recherche française, l'image dégradée qui est celle de la recherche et plus généralement du progrès scientifique dans notre pays. Comme le montre le changement de paradigme évoqué plus haut dans l'analyse de FutuRIS, la France est passée d'une période durant laquelle la recherche était pourvoyeuse de progrès - époque qui correspond grosso modo, et pour s'en tenir à la période de l'après-guerre, aux Trente glorieuses - à la situation actuelle de méfiance de l'opinion publique en direction des sciences souvent envisagées, en raison de l'actualité récente (maladie de Creutzfeldt-Jakob, vaccin contre l'hépatite B, incertitude sur l'innocuité des OGM, etc.), comme une menace plutôt que comme la promesse d'un avenir meilleur. Le succès médiatique rencontré par les menées obscurantistes de certains, qui n'hésitent pas à détruire les produits de la recherche scientifique, n'est qu'un des avatars et le sommet de l'iceberg d'un malaise plus profond qui s'exprime également par la désaffection croissante des jeunes pour les carrières scientifiques. Dans une moindre mesure, la constitutionnalisation du principe de précaution avec l'adoption de la Charte de l'environnement ou l'interdiction du clonage thérapeutique dans la loi bioéthique témoignent des réticences de la France vis-à-vis de la science et, à terme, peuvent créer les conditions d'un environnement législatif et réglementaire peu propice au développement de la recherche dans notre pays. Si de telles tendances à la frilosité se font également jour dans d'autres pays, notamment européens, le mouvement n'est pas général et la France, dans le concert international, exprime là encore une peu satisfaisante singularité. De son expérience d'enseignement aux Etats-Unis, à l'université d'Harvard, M. Edouard Brézin, vice-président de l'Académie des sciences, a ainsi pu retirer qu'en contradiction avec l'évolution pessimiste du monde couramment répandue parmi les jeunes Français, les étudiants des universités américaines - qu'ils soient ou non américains - font encore preuve d'une foi dans l'avenir et dans la science à tel point que les réticences françaises soulèvent chez eux l'incompréhension sinon l'incrédulité. * Il importe d'avoir à l'esprit cette toile de fond pour mettre en perspective chacun des problèmes rencontrés par la recherche française. Ce préalable posé sur l'environnement international du monde de la recherche et sur l'état général de la recherche en France, les points plus précis sur lesquels se fonde la crise de la recherche peuvent être abordés. II.- LES DIX DÉFIS MAJEURS AUXQUELS LA RECHERCHE FRANÇAISE EST CONFRONTÉE Au terme des auditions qu'ils ont menées, les membres de la mission ont pu constater que dix points majeurs posent question au monde de la recherche et sont à la source de la crise qui secoue le milieu des chercheurs. Avant de les aborder un à un, le rapporteur souhaite préciser que ce découpage thématique ne préjuge pas des interactions bien réelles existant entre toutes ces problématiques qui débordent l'une sur l'autre. De la même manière aucun de ces points ne peut ni s'envisager, ni a fortiori se résoudre, hors de la prise en considération du contexte global qui vient d'être exposé. DÉFI N° 1 : LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE Sur ce point, les avis sont unanimes, qu'ils émanent des représentants de la recherche académique ou du secteur privé : le financement de la recherche est insuffisant, très insuffisant. Et si les avis divergent, ce n'est pas sur la masse globale des crédits supplémentaires à apporter à la recherche mais sur l'origine et l'emploi de ces moyens nouveaux. 1. Des moyens insuffisants pour mener une recherche performante D'un côté, le rapport issu des états généraux de la recherche, qui se sont tenus du 27 au 29 octobre dernier à Grenoble, plaide pour une augmentation régulière d'un milliard d'euros par an dans les cinq années qui viennent, seuil en deçà duquel les auteurs estiment qu'une recherche diversifiée et de qualité ne peut être garantie. De l'autre, M. Alain Bugat, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), appelle de ses vœux une augmentation des crédits de la recherche mais, se fondant sur les analyses développées par FutuRIS, juge que l'objectif communautaire des 3 % du PIB consacrés à la recherche à l'horizon 2010 n'est pas réalisable. Enfin, de son côté, M. Emmanuel Leprince, délégué général du Comité Richelieu et président de l'European federation of high techs SME's, estime que la pertinence du chiffre retenu comme l'objectif à atteindre en terme de financement de la recherche importe peu. Selon lui, le mérite essentiel de ce dernier est de créer le débat et de nourrir une dynamique et une ambition pour la recherche. Il faut en effet savoir qu'afin de dynamiser la recherche européenne, les chefs d'Etat réunis au Conseil européen de Lisbonne (2000) se sont fixés comme objectif de faire de l'Europe, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Cette stratégie, dont il faut convenir avec les auteurs de l'opuscule Cinq ans après Lisbonne, comment rendre l'Europe compétitive ? publié par l'Institut Montaigne, qu'elle est très largement dépourvue de leviers au niveau communautaire (cf. défi n° 10), a ensuite été précisée lors du Conseil européen de Barcelone (2002) lequel a chiffré l'objectif antérieurement défini. Sur recommandation de la Commission européenne, suivant en cela les propositions formulées par le Parlement européen et le Comité économique et social, les chefs d'Etats et de gouvernement ont convenu que les investissements en recherche et développement dans l'Union européenne devaient croître en visant à approcher les 3 % du produit intérieur brut (PIB) à l'horizon 2010. Cet objectif s'est doublé d'un autre, le Conseil européen appelant de ses vœux une augmentation du financement par les entreprises de manière à la porter à deux tiers du total des investissements en recherche et développement. Ainsi qu'a pu le constater la mission, l'objectif, ainsi défini puis précisé et décliné, est devenu le pivot autour duquel s'organise toute réflexion sur les moyens de la recherche. Il appelle toutefois plusieurs questions. Premièrement, on peut s'interroger sur la pertinence d'une politique qui n'affiche pas pour ambition de parvenir à des résultats qualitatifs mais se propose, pour tout horizon, d'atteindre un résultat quantitatif. En matière de recherche, l'assignation d'objectifs scientifiques eût peut-être été plus opportune que de céder à une logique financière. Cette réserve faite, il n'en demeure pas moins que le chiffre retenu pour objectif n'a pas été choisi au hasard. En fait, dans un contexte - le tournant du millénaire - où l'Europe peinait à soutenir le rythme exceptionnel de croissance que connaissaient, grâce au développement de l'économie numérique et des nouvelles technologies, les Etats-Unis et le Japon, celle-ci a estimé, en comparant sa situation par rapport à celle de son partenaire outre-Atlantique, qu'une des raisons de la plus faible croissance économique européenne était l'insuffisance de l'investissement en recherche et développement. Poursuivant ce raisonnement, l'Union européenne, dont l'investissement dans le secteur, se situait, en 1999, à 1,8 % du PIB, a donc décidé qu'elle devait aligner ses dépenses de recherche sur celles des Etats-Unis et du Japon, représentant respectivement 2,7 % et 3,1 %. De la même manière, l'équilibre préconisé entre recherche publique et recherche privée est directement calqué sur l'exemple américain qui, pour les dirigeants européens, a fait figure d'exemple à suivre. De telle sorte que, comme l'ont affirmé aux membres de la mission les représentants de l'opération FutuRIS, l'objectif, et surtout son équilibre interne, a peu de sens rapporté à la situation française dont la structure socio-économique qui laisse une plus grande place à l'Etat n'est pas comparable avec le modèle de société anglo-saxon. La Commission européenne a d'ailleurs reconnu, dans une communication datée de 2002, que « la diversité de situations dans les Etats membres et les pays candidats appelle une réponse politique différenciée ». Et il est un fait qu'en dépit de la manière dont il a été conçu, l'objectif correspond aux ambitions nationales précédemment arrêtées par certains Etats membres (Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande et Luxembourg) et qu'il est déjà atteint dans son volume par la Finlande et la Suède et dans son équilibre interne par l'Allemagne, la Belgique, la Finlande et la Suède. L'interrogation sur la structure du financement de la recherche française, sur laquelle il sera revenu plus en détail plus loin, ne doit donc pas masquer le retard pris globalement par la France sur ses partenaires étrangers et notamment européens. Dépenses intérieures de recherche et développement (données 2001)
A n'envisager les données qu'en instantané, la France demeure le deuxième contributeur à la dépense européenne de recherche relativement loin derrière l'Allemagne mais assez nettement devant le Royaume-Uni. Une analyse dynamique montre au contraire que la France, à l'intérieur même d'une Europe qui, au cours de la même période (1996-2001), a connu une croissance de l'effort de recherche (DIRD/PIB) inférieure à celle des Etats-Unis et équivalente à celle du Japon (lequel partait de plus haut), se situe plutôt en queue de peloton. La croissance de sa dépense intérieure de recherche en valeur absolue est la plus faible des quinze. Sur la même période, sa contribution à la dépense globale de l'Union est en retrait, la France se situant en la matière devant l'Italie qui ferme la marche. Enfin, la France est, avec les Pays-Bas et l'Irlande, le seul pays de l'Union qui, entre 1996 et 2001, a connu un reflux de son effort de recherche, sachant, de surcroît, que la situation de l'Irlande s'explique en grande partie par un accroissement important de son PIB puisque, sur la même période, l'effort de recherche a cru de 26 % en valeur absolue. De tels éléments ne sont pas très rassurants et expliquent pour une large part les difficultés auxquels ont été confrontés les laboratoires publics de recherche. Lors de son audition par la mission, M. Bernard Larrouturou, directeur général du CNRS, a ainsi déclaré avoir dû puiser dans les réserves financières de l'établissement pour boucler son budget 2004. Même écho de la part de M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie des sciences, qui a indiqué aux membres de la mission avoir eu recours à des financements américains pour maintenir à leur niveau des années précédentes les recherches du laboratoire Inserm qu'il dirige après que ses crédits de fonctionnement aient été réduits de 30 %. Avertissement similaire enfin de M. Philippe Kourilsky, directeur général de l'Institut Pasteur, qui s'interroge sur la viabilité à long terme de l'institution dont il a la responsabilité si le désengagement de l'Etat, qui a débuté à la fin des années 1980, se poursuit. Les efforts consentis par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2005 voté par l'Assemblée nationale constituent une première forme de réponse avec le relèvement des subventions allouées au CNRS et à l'Inserm - respectivement 7,9 % et 7,4 % - et l'augmentation 5,7 % de la subvention de l'Etat à l'Institut Pasteur. L'augmentation d'un milliard d'euros des crédits de la recherche par rapport à 2004 participe ainsi du redressement de l'effort de recherche français amorcé en 2000 après que celui-ci est régressé continûment depuis 1993. Toutefois l'effort doit absolument être renouvelé dans les années à venir, comme s'y est engagé le gouvernement, pour peser dans les faits. En effet, à PIB constant, c'est 11,36 milliards d'euros qui devraient être injectés dans la recherche pour que la France atteigne l'objectif européen fixé à Barcelone. Quand bien même la proposition du Président de la République, M. Jacques Chirac, qu'il a renouvelée dans le discours prononcé à l'occasion du cinquantième anniversaire du CERN, le 19 octobre 2004, de placer les dépenses publiques de recherche et de développement hors des critères du pacte de stabilité et de croissance deviendrait, et cela serait souhaitable, une réalité, une telle manne ne saurait, à l'évidence, être mobilisée par l'Etat seul. A ce niveau du raisonnement, intervient donc, après la question du niveau de financement celle des sources de ce financement. 2. Quelles sources de financement ? A appliquer strictement les objectifs européens de financement de la recherche, le gouvernement aurait très bien pu s'exonérer d'augmenter les crédits de la recherche. En effet, et aussi étonnant que cela puisse paraître après ce qui a été évoqué plus haut, la France a d'ores et déjà atteint les objectifs européens de financement de la recherche sur un point : la part du financement public de la recherche, fixé à 1 % du PIB. Selon les derniers chiffres disponibles de l'OST, les dépenses nationales de la France en provenance des administrations publiques (DNRDA) atteignaient, en 2001 et en valeur absolue, 14,7 milliards d'euros, soit, en pourcentage du PIB, le seuil des 1 %8 ce qui place cette fois la France dans le peloton de tête des Etats de l'Union aux côtés des pays scandinaves. Par contraste, cet indicateur montre l'insuffisance du financement de la recherche par le secteur privé en France dont les raisons seront analysées plus loin (cf. défi n° 9). Dans le même temps, il conduit à évoquer trois séries de problème. D'une part, certains chercheurs, parmi lesquels M. Alain Trautmann ou M. Edouard Brézin, contestent le mode de calcul de l'indicateur et, par suite, sa validité arguant du fait qu'il prend en compte les crédits destinés au financement des grands projets, notamment spatiaux, lesquels ne relèvent pas strictement, à leurs yeux, du domaine de la recherche. Son périmètre rogné de la sorte, le financement public de la recherche n'atteindrait plus que 0,6 % du PIB. Il s'agit là d'une vision tout à la fois abusive et restrictive de la recherche qui considérerait comme recherche véritable uniquement la recherche fondamentale au sens strict et la recherche menée librement par les chercheurs sans que ceux-ci ne soient en aucune façon « guidés » dans la conduite de leur recherche. Or il apparaît essentiel que la puissance publique ne se borne pas uniquement à financer la recherche la plus fondamentale et participe également, comme elle le fait déjà, au financement de recherches plus finalisées. En outre, du point de vue des principes, il est tout à fait légitime que les recherches qui sont menées grâce à des financements publics et qui engagent dans certains cas l'avenir de la nation toute entière, soient impulsées et suivies par le pouvoir politique, seul dépositaire de l'autorité légitime. En contrepartie, l'objectif européen de 1 % ne doit pas être considéré comme un seuil infranchissable. En effet, comme il a été rappelé plus haut, étant donné la structure socio-économique de la France, c'est-à-dire, pour faire bref, la permanence de l'héritage colbertiste, une application à la lettre des recommandations européennes n'aurait pas de sens. Il serait en effet illusoire de croire que le déficit de financement privé de la recherche française puisse être comblé dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, deux alternatives se présentent à la recherche française : ou bien épouser strictement les objectifs européens - au risque de laisser dériver la science française - ou bien adapter l'objectif à la situation française, alternative reconnue volontiers par la Commission européenne. C'est la voie choisie par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2005. A ce titre, on peut s'interroger sur certaines critiques formulées à l'encontre des arbitrages retenus considérant que l'effort consenti par le gouvernement ne correspondait pas à l'augmentation affichée d'un milliard d'euros, ladite somme n'étant pas en totalité affectée au financement de la recherche publique. Là encore, le raisonnement avancé est abusif. Car, si la France ne doit pas se sentir liée de manière étroite par la déclinaison de l'objectif de Lisbonne entre financement public et financement privé, elle ne doit pas pour autant consacrer tous ses efforts en direction de la recherche publique. Bien au contraire, sans léser en aucune manière cette dernière, il importe de trouver les moyens de développer de manière énergique une mobilisation des entreprises en faveur de la recherche. D'autant plus, et cela constituera le troisième temps du raisonnement, que la frontière entre ces deux modes de financement de la recherche est beaucoup plus floue qu'il n'y paraît. Ainsi, le décalage important que révèlent les chiffres entre une France où les pouvoirs publics assurent 44 % du financement de la DIRD tandis que la proportion tombe à 32,7 % pour les Etats-Unis 9 ne doit pas masquer une réalité beaucoup plus complexe. De l'aveu même de M. Alain Trautmann, si le financement de la recherche américaine est essentiellement d'origine privée, celui-ci est soutenu, dans bien des cas, notamment en ce qui concerne la recherche militaire, par des commandes publiques. De plus, les grands centres de recherche américains sont pour l'essentiel constitués autour d'universités financées pour les deux tiers de leur budget par des ressources publiques. Et M. Alain Trautmann de conclure que le recours aux commandes publiques est sans doute un meilleur moyen d'inciter au développement de la recherche privée que l'actuel crédit d'impôt recherche jugé peu opérationnel. On le voit, les lignes de frontières sont relativement floues. C'est aussi que l'origine des financements dépend des finalités assignées à la recherche. 3. Des crédits supplémentaires : pour quoi faire ? Devant la pénurie de moyens dénoncée par les chercheurs, ce titre pourrait passer pour une provocation. Tout en reconnaissant le caractère sinistré de la recherche française et l'état pathétique de nombreux laboratoires décrit par M. Marc Vasseur qui conduit d'éminents chercheurs à ne plus inviter leurs homologues étrangers dans leurs locaux, le rapporteur estime que la question garde tout son sens. Elle rejoint en effet deux autres préoccupations très largement exprimées au cours des auditions menées par la mission à savoir : éviter la tentation du « saupoudrage » qui aboutit à disperser les moyens et concentrer les financements sur un certain nombre de thématiques prioritaires et sur les meilleures équipes. De fait, il apparaît surréaliste, comme l'a rapporté à la mission M. Philippe Kourilsky, qu'un chercheur de l'envergure de M. Claude Cohen-Tannoudji, dont la valeur a été reconnue en 1997 par l'attribution du prix Nobel de physique, soit contraint de se « battre » pour obtenir quelques dizaines de milliers d'euros nécessaires à la conduite de ses recherches. Poursuivant sa description de ce qu'il qualifie de « paradoxe français » - préférer mener une politique de saupoudrage des moyens plutôt que de les concentrer sur les meilleures équipes -, le directeur général de l'Institut Pasteur a cité l'exemple de l'Institut des hautes études scientifiques (IHES) qui peine à trouver les financements nécessaires à son fonctionnement alors même qu'il constitue une « pépinière » de médailles Fields 10. Ces deux exemples, cités parmi d'autres recueillis par la mission, ont démontré aux membres de la mission combien une augmentation des moyens de la recherche qui ne s'accompagnerait pas d'une réorganisation des structures et d'une révision des modalités d'attribution des crédits serait en fin de compte de peu d'effet. En ce sens, la décision du gouvernement de renforcer le financement de la recherche sur la base de projets et indépendamment du statut de l'opérateur, public ou privé, via la création de l'Agence nationale de la recherche (ANR) va indéniablement dans le bon sens - sans aller jusqu'au « darwinisme » réclamé par M. Philippe Kourilsky - en replaçant les priorités dans un ordre logique : tout d'abord la définition des objectifs ensuite seulement l'attribution des moyens. Les chercheurs rencontrés par la mission ne réclament d'ailleurs pas autre chose comme le montre le crédit qu'ils attribuent à la qualité du travail menée par l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), seule agence de moyens française, ou, comme le résume fort bien le président de l'Académie des sciences, M. Etienne-Emile Baulieu, lorsqu'il déclare qu'il ne faut pas hésiter à mettre en avant les meilleurs chercheurs au mépris d'une égalité de façade. Toutefois, plusieurs limites doivent encadrer cette évolution. Si la voie est étroite, elle ne doit cependant pas être abandonnée. D'une part, les auditions ont montré que l'Etat devra continuer à apporter des financements conséquents à une recherche libre, dépourvue d'objectifs, de type « bottom-up », laquelle est la voie de nombreuses découvertes et dont toutes les personnes auditionnées, qu'elles interviennent au titre de représentants de la recherche publique ou en tant que représentants de la recherche privée, ont indiqué qu'elle était nécessaire au processus de recherche. D'autre part, tous ceux qui se sont prononcés en faveur d'une meilleure prise en compte de la qualité des travaux menés ont rendu à raison cette évolution indissociable de la mise en place d'un système d'évaluation véritablement performant et incontestable, problématique qui sera plus amplement développée plus loin (cf. défi n° 8). Incontestablement l'augmentation des crédits de la recherche est une nécessité et, en raison de l'état de délabrement de la recherche française, un préalable. Elle ne constitue néanmoins pas une fin en soi et ne doit pas exonérer politiques et scientifiques d'une réflexion plus profonde. Ainsi que l'affirme en substance M. Edouard Brézin, l'augmentation des crédits de la recherche doit procéder d'un calcul économique rationnel ; la véritable question est la suivante : quel est le coût d'une recherche performante et quel retour sur investissement peut en être attendu ? En définitive, et comme il l'est très rapidement apparu aux membres de la mission, la question du financement de la recherche est indissociable de la question du pilotage de la recherche. Ainsi que l'indiquait M. Robert Dahan, président d'AstraZeneca France et vice-président des Laboratoires internationaux de recherche (LIR), en matière de recherche, la méthode à suivre est la suivante : définir un objectif puis tâcher d'être le meilleur dans le cadre ainsi défini en y mettant les moyens nécessaires. Or les membres de la mission ont pu constater que la définition des objectifs de recherche pose problème. DÉFI N° 2 : UN PILOTAGE DE LA RECHERCHE INOPÉRANT Là encore une unanimité est très rapidement apparue pour dénoncer le caractère inopérant sinon l'absence totale de pilotage stratégique de la recherche française au niveau national au point que M. Christian Bréchot, directeur général de l'Inserm, a pu affirmer que, selon lui, « la France n'a pas de ministre de la recherche ». La critique porte d'autant plus qu'elle est formulée indépendamment d'une appréciation partisane ou d'un jugement sur les actions entreprises par les différents ministres qui se sont succédés à ce poste ces dernières années dont toutes les personnes auditionnées par la mission s'accordent à reconnaître que globalement ils n'ont pas démérité. De fait, ce qu'ont mis en exergue les interlocuteurs de la mission c'est l'inefficacité d'un système - dont c'est pourtant le rôle - pour définir des priorités et assurer leur réalisation dans le temps. Deux raisons ont majoritairement été avancées pour expliquer de telles déficiences : la fragmentation des responsabilités et la confusion des rôles. De telle sorte que le système cumule les inconvénients d'un système trop centralisés et excessivement fragmenté. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle intervient à l'heure où la science a atteint un tel niveau de précision et de complexité que les moyens financiers et humains à mobiliser pour être performants sont considérables et imposent de faire des choix, y compris pour des pays disposant de ressources étendues tels que les Etats-Unis. 1. Une responsabilité fragmentée Premier point, les personnes auditionnées ont dénoncé l'excessive dispersion de la thématique de la recherche dans l'organigramme gouvernemental laquelle aboutit selon les cas soit à l'émergence de conflits d'intérêt, soit à la non-représentation de certains intérêts ou de certaines problématiques. Le premier cas de figure concerne avant tout les organismes publics de recherche qui, statutairement, sont placés sous la tutelle des ministères dont le champ de compétences recoupe leur champ d'activités. C'est ainsi que les établissements publics scientifiques et techniques (EPST) ou bien des établissements publics industriels et commerciaux de recherche, tels que le CEA, se retrouvent soumis à des tutelles multiples qui rendent difficile une gestion cohérente des établissements. M. Christian Bréchot remarque ainsi que l'absence de coordination entre les deux ministères de tutelle de l'Inserm qu'il dirige, à savoir le ministère de la santé et le ministère de la recherche, nuit à la bonne marche de l'organisme. La situation se complique encore au niveau des laboratoires de recherche. Lorsque ces derniers sont constitués en unités mixtes de recherche (UMR) associant l'université, ce qui est le cas de plus de la moitié des laboratoires, aux tutelles de l'établissement vient s'ajouter celle de l'université, accroissant par là même la fragmentation du pilotage du système et compliquant encore, comme il sera développé plus loin, la gestion administrative des structures. Paradoxalement, tandis que les organismes publics de recherche sont soumis à une profusion de tutelles, d'autres secteurs d'activités de la recherche sont dépourvus de relais au niveau gouvernemental. C'est notamment le cas des PME innovantes dont M. Emmanuel Leprince estime que leur situation, à la confluence de plusieurs attributions ministérielles, les place hors du spectre des préoccupations gouvernementales. Selon lui, le ministère délégué à la recherche envisage uniquement les PME comme les réceptacles de la recherche publique et ne les encourage pas de ce fait à promouvoir leurs propres activités de recherche. Le ministère de l'industrie privilégie quant à lui les actions en faveur des grandes entreprises. Enfin, le ministère en charge des PME concentre ses efforts en direction des PME artisanales au détriment des PME innovantes considérées comme élitistes. A l'évidence, une telle situation n'est pas satisfaisante. Elle l'est d'autant moins que ses conséquences débordent le cadre hexagonal et se font sentir au niveau européen où la fragmentation de la thématique de la recherche entre plusieurs portefeuilles ministériels contribue à amoindrir la voix de la France et à réduire l'influence de notre pays dans les négociations communautaires. M. Alain Risbet, président du réseau des Centres techniques industriels (CTI), rappelle ainsi que le fait que le représentant français à Bruxelles pour la négociation relative à la définition des orientations du Programme-cadre de recherche et de développement de l'Union européenne (PCRD) soit le ministre de la recherche, c'est-à-dire un ministre dont les attributions ne comportent pas le volet industriel de la recherche, ne contribue pas à renforcer la composante économique et commerciale du programme ni à encourager la prise en compte des intérêts des PME françaises dans la politique de recherche européenne. Tant et si bien que la France est le plus mauvais élève européen en ce qui concerne le montant des aides communautaires versées aux PME. La fragmentation de la thématique de la recherche au plus haut niveau de l'Etat se justifie d'autant moins qu'elle aboutit à un chevauchement des compétences qui nuit à la cohérence et à la portée du message gouvernemental et au pilotage politique de l'ensemble. Qui fait quoi ? La dilution des compétences est telle qu'il devient difficile d'identifier précisément les compétences de chacun à la fois entre les ministères, au sein même du ministère de la recherche et entre celui-ci et les organismes dont il a la tutelle. Au terme des réformes initiées à la suite des conclusions du colloque de Caen (1956), la recherche française s'était organisée de la façon suivante : le gouvernement était chargé, via un comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST), animé par une délégation générale (DGRST), de donner les grandes orientations de la politique de recherche publique, charge ensuite pour les établissements de recherche de mettre en œuvre cette politique. Si, pour l'essentiel, l'architecture générale du système n'a pas été remise en cause au cours des cinquante dernières années, les structures de pilotage, c'est-à-dire le ministère et les différents conseils scientifiques chargés de l'éclairer, ont en revanche connu une très forte instabilité qui a nui à l'efficacité du dispositif tout entier. Au fil des années, la dimension interministérielle de la recherche, affirmée avec force en 1958, s'est estompée et la vocation stratégique de la structure chargée de piloter l'ensemble du dispositif avec elle. M. Christian Bréchot ne peut ainsi que constater la dérive progressive d'un ministère de la recherche dont l'action s'est progressivement muée en une simple compétence de gestion des organismes de recherche dont il a tutelle au détriment de son rôle de pilotage. Dans le même temps, les dirigeants des grands organismes de recherche, M. Bernard Larrouturou et M. Alain Bugat en tête, s'inquiètent de la difficulté du ministère, pourtant présent dans les conseils d'administration des établissements, à peser sur la définition des orientations stratégiques de ces derniers. Empêtré dans une gestion au jour le jour, le ministère, dont la structure administrative est moins fournie que celle de nombreux EPST, en oublie sa compétence première, celle de pilote stratégique de la politique de recherche. A tel point que, comme le rapporte l'administrateur général du CEA, il arrive que des questions pourtant mineures soient directement soumises à l'arbitrage du ministre voire du Premier ministre. La confusion est la plus totale. Pourtant, si les témoignages sont accablants, ils recoupent parfaitement les conclusions formulées par la Cour des comptes dans son rapport au Président de la République de 2003 laquelle estimait que le ministère était victime d'une « absorption par la gestion au détriment de l'orientation et de l'impulsion stratégique » et « qu'à l'heure où la priorité est de permettre aux organismes de recherche et aux chercheurs français de prendre une place dans le nouvel espace européen de la recherche, la tête de réseau que doit constituer le ministère de la recherche ne dispose ni de l'autorité politique ni de l'efficacité nécessaire pour agir. » Au final, si la Cour des comptes dénonce l'excessive centralisation du système de recherche français et la tendance du ministère à confondre volontiers la tutelle qu'il exerce sur les établissements publics de recherche avec un pouvoir hiérarchique, il apparaît que cette concentration des attributions - au demeurant assurée par une administration insuffisante en nombre - ne s'est pas traduite par une plus grande lisibilité de l'action en matière de recherche publique. De fait, la description du processus décisionnel aboutissant à la définition des choix stratégiques de la France en matière de recherche puis à leur réalisation faite par M. Pierre-André Périssol, député de l'Allier, dans son rapport pour avis sur les crédits de la recherche pour 2005 (n° 1864 tome 10) conclut au manque de simplicité et d'efficacité. Dépourvu pour l'essentiel des moyens nécessaires pour orienter les recherches menées par les établissements de recherche, lesquels définissent eux-mêmes leur politique, le ministère ne dispose que d'une marge étroite - jusqu'alors représentée par les fonds incitatifs - pour traduire la volonté politique dans les faits. Il est ainsi symptomatique, comme le révèle M. Christian Bréchot, que l'effort financier de la nation en faveur de la biomédecine ne puisse être connu. M. Pierre-André Périssol consigne, dans son rapport, s'être heurté au même constat concernant le cancer pourtant désigné priorité nationale par le Chef de l'Etat. Tandis que prolifèrent les conseils scientifiques chargés d'éclairer le ministre sur les orientations à prendre - et dont le principe n'est pas en cause puisque, à mesure que la science progresse, il est nécessaire que le ministre soit entouré de personnes capables de lui apporter une expertise scientifique -, leur nombre ayant été multiplié par treize depuis le début de la Ve République, la lisibilité de l'action gouvernementale et l'autorité du ministère de la recherche régressent. M. Bernard Larrouturou et M. Christian Bréchot expriment une pensée partagée par l'ensemble des membres de la mission lorsque le premier s'interroge avec la Cour des comptes sur le rôle du ministère de la recherche et le second affirme que la question du pilotage national de la recherche est le point majeur de la réforme à venir. Si, comme on le verra dans la seconde partie de ce rapport, la nouvelle architecture du dispositif de pilotage de la recherche est discutée, tous les témoignages concordent en revanche pour regretter le manque d'autonomie du ministère de la recherche et le poids trop faible qui est le sien dans l'organigramme gouvernemental. Or, comme l'affirme à raison M. Alain Trautmann, une recherche ne peut être forte que si elle est soutenue par une volonté politique forte. DÉFI N° 3 : QUID DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE ? Un classement mondial des grands établissements scientifiques établi par Mme Elena Ritsou, étudiante à l'Ecole des hautes études commerciales (HEC), M. Philippe Pouletty, président du Conseil stratégique de l'innovation (CSI) et de l'association de promotion des biotechnologies France Biotech, et M. Paul-Henri Roméo, co-directeur de l'Institut Cochin, montre que, parmi les quinze premiers, figurent dix instituts américains, cinq instituts européens et aucun institut français - l'Institut Pasteur, le CNRS et l'Inserm se classant respectivement aux 16e, 17e et 21e rang 11. Plus inquiétant, les auteurs de l'étude ont parallèlement montré que les instituts américains dépensent trois à cinq fois moins d'argent que les établissements français pour obtenir une publication dans une revue à fort impact. Le constat n'est guère satisfaisant et témoigne des incertitudes auxquelles sont confrontés les multiples organismes français de recherche. En préambule à ce développement, il importe de préciser que l'expression englobe des établissements très divers aussi bien dans leur statut que par leur taille ou leur mode de fonctionnement. Si l'on retient la définition du code de la recherche, les établissements publics de recherche regroupent les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) - au nombre de sept ils ont un caractère administratif et, dans les faits, sont soumis aux règles de gestion des établissements publics administratifs (EPA) -, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) - une quinzaine - ainsi que des structures de coopérations parmi lesquelles des groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels (CTI). La mission d'information a ainsi auditionné plusieurs personnalités responsables d'établissements qui entrent dans cette catégorie : le CNRS et l'Inserm (EPST) 12, le CEA (EPIC), l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) et l'Observatoire des sciences et des technologies (OST), constitués en GIP, et les centres techniques industriels. Bien qu'il soit constitué en fondation privée à but non lucratif, l'Institut Pasteur, peut être rattaché à cette catégorie dans la mesure où près d'un tiers de son budget est assuré par une subvention publique. La diversité des statuts décrit à elle seule l'hétérogénéité des situations auxquelles sont confrontés les établissements. En la matière, il est donc difficile de procéder par généralité, d'autant plus, que les singularités des établissements débordent le cadre juridique et sont également liées aux disciplines étudiées par chacun. Quelques lignes de force peuvent néanmoins être dégagées. D'une part, l'existence en tant que tels d'organismes publics dont l'activité est entièrement tournée vers l'activité de recherche n'est pas, au sens strict, une originalité française. Ainsi que le rappelle le rapport d'information de M. Daniel Garrigue réalisé à la demande de la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale et intitulé Les Nouveaux enjeux de la recherche publique : pilotage et émergence des équipes de chercheurs (n° 1885), des pays tels que l'Allemagne, la Grande Bretagne ou les Etats-Unis disposent également d'organismes de recherches financés par l'Etat. Toutefois, leur insertion dans le dispositif de recherche est différente. Le système allemand, avec ces quatre grands organismes - Max Planck Gesellschaft (MPG), FraunhoferGesellschaft (FhG), Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) et Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz (WGL) - regroupant 235 centres de recherche, est sans aucun doute le plus proche du système français ; mais la mise en œuvre du principe d'unité de la recherche et de l'enseignement (dit principe « Humboldt ») et, par suite, la prédominance maintenue de l'université dans le dispositif de recherche tout entier interdit toute tentative d'identification des deux systèmes. Les dispositifs anglo-saxons reposent quant à eux sur une logique totalement différente puisque les organismes de recherche, s'ils existent bel et bien, sont constitués en agences de moyens et ne sont donc pas directement - ou seulement pour une très faible part de leurs ressources - opérateurs de recherche. C'est le cas des sept research councils britanniques et des National Institutes of health (NIH) américains, pour n'en citer qu'un parmi les plus connus. En revanche l'influence et le poids relatif de ces organismes dans le dispositif national de recherche - à titre indicatif, le CNRS dispose d'un budget qui dépasse les 2,5 milliards d'euros et emploie plus de 26 000 personnes dont près de 12 000 chercheurs - par rapport à l'université, est une singularité de notre pays. La source en est une nouvelle fois à trouver dans l'histoire. Ainsi que le rappelait le président de l'Académie des sciences, M. Etienne-Emile Baulieu, François Ier souhaitant réformer l'université mais redoutant d'affronter la Sorbonne avait finalement décidé de créer le Collège de France ; de la même manière, désirant dynamiser la recherche française et constatant l'incapacité de l'université à entreprendre une recherche de qualité mais craignant de se heurter à la résistance des professeurs, la IIIe République a-t-elle décidé de créer le CNRS 13, initiative qui fut le prélude à la création d'autres organismes de recherche après guerre - tels que le CEA (1945), l'INRA (1946), l'Inserm (1964), l'INRIA (1967), etc. -, les autorités de l'époque ayant décidé de faire de ces établissements les fers de lance du renouveau de la science française. Si les réussites de la recherche française tout au long des Trente glorieuses, lesquelles sont très largement à mettre au crédit des organismes de recherche, ne sont pas de nature à inciter à revenir sur le principe même de tels organismes, il convient toutefois de remarquer que cette évolution n'a pas contribué à unifier le dispositif de recherche français et ses compétences. Toutefois, il convient d'apporter aussitôt une nuance car les situations sont très diverses. Ainsi, si M. Bernard Larrouturou n'hésite pas à dénoncer l'excessif cloisonnement qui existe entre les huit départements disciplinaires constituant le CNRS qu'il dirige, lequel aboutit à ce que des projets élaborés en liaison avec des universités et mobilisant plusieurs services du CNRS doivent être abandonnés faute de coordination en interne, force est de constater que de nombreux laboratoires sont constitués en unités mixtes associant le centre et l'université, structures (unités dont la création commence dès 1965). De la même façon, des liens organisés existent entre les organismes eux-mêmes. M. Christian Bréchot a ainsi pu déclarer aux membres de la mission que le partenariat entre le CNRS et l'Inserm a pris la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) regrettant toutefois que le financement de la structure reste dual. Des initiatives existent donc et il serait schématique et abusif de décrire un système de recherche français fragmenté entre plusieurs entités hermétiques l'une à l'autre. Comme l'ont montré les auditions, la réalité est fort différente de ce schéma simpliste. Un seul élément suffit à étayer le propos : plus de la moitié des laboratoires de recherche des EPST sont hébergés dans les universités ou dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) (la proportion s'élève à 87 % pour le CNRS et à 80 % pour l'Inserm). Il n'en demeure pas moins que pour mettre en commun et mieux utiliser les forces vives de la recherche française, les bonnes volontés se heurtent souvent à des difficultés qui tiennent pour l'essentiel à l'existence de règles administratives différentes d'une institution à l'autre - touchant à la fois au statut des personnels ou à la gestion des établissements - et dont il est difficile pour les responsables de s'extraire, y compris lorsque l'une des parties en présence dispose, en raison de son statut, de règles de gestion relativement souples. L'administrateur général du CEA, M. Alain Bugat, plaide ainsi lui aussi pour l'assouplissement de règles administratives qui entravent parfois la réalisation de partenariats qu'il souhaiterait mettre en place. A l'évidence, le statut de certains opérateurs, trop contraignant, plus que la discipline qui les occupe ou la façon dont ils sont gérés, est l'élément déterminant qui freine leur développement et nourrit les interrogations quant à leur avenir. Pour preuve, parmi les dirigeants des organismes publics ou semi-publics rencontrés par la mission, seuls les responsables d'EPST ont entrepris de mener des réformes profondes dans leurs établissements. M. Bernard Larrouturou préconise ainsi d'inscrire les activités du CNRS dans un continuum formation-recherche-innovation en associant plus étroitement les recherches menées par le centre avec l'enseignement supérieur effectué au sein des universités. En interne, il tente de promouvoir une réforme assise sur trois principes : déconcentration, réduction du nombre des départements, promotion de l'interdisciplinarité 14. Conscient que la bonne santé actuelle de l'Inserm qu'il dirige ne doit pas l'exonérer d'une réflexion sur une réforme en profondeur d'un organisme qui est malgré tout en voie d'être distancé par ses équivalents anglo-saxons, M. Christian Bréchot va plus loin encore et ambitionne de faire évoluer son établissement vers une structure duale, à la fois opérateur de recherches et agence de moyens dont le champ de compétences irait de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique la plus finalisée, celle-ci étant développée en partenariat - sur le mode contractuel - avec le privé. La mise en place des programmes Avenir et ESPRI (Equipes soutenues par la région et par l'Inserm) constitue les premiers jalons d'une évolution en ce sens. Ajoutons que de telles réformes ne préjugent pas d'une éventuelle révision des frontières de chaque organisme. La question si elle a régulièrement été évoquée devant les membres de la mission, ne l'a été cependant qu'à demi-mot. Seul M. Bernard Larrouturou n'a pas hésité à qualifier une telle réforme d'irréalisable au niveau national. La question reste toutefois ouverte. Quid en effet d'un CNRS dont la concentration des travaux autour de la recherche fondamentale, quelle que soit la discipline, forme l'unité de l'établissement mais nuit dans le même temps à la mise en place d'une véritable politique d'établissement, les disciplines abordées par l'organisme apparaissant parfois comme trop hétérogènes. De la même façon, au fil des ans et au gré des évolutions de la science, certains organismes en sont venus à mener en parallèle des recherches similaires. C'est ainsi que les sciences de la vie sont indifféremment abordées par l'Inserm - dont c'est le « cœur de métier » - mais également par le CNRS et le CEA. On peut se demander dans quelle mesure une concentration des moyens ne serait pas plus efficace et on ne s'étonnera pas que, pour sa part, M. Christian Bréchot plaide pour que l'Inserm embrasse à terme l'ensemble des recherches en santé. La quadrature du cercle n'est pas loin. Entre la volonté exprimée de dynamiser les établissements, les contraintes statutaires et la crainte exprimée par certains que la réforme n'aboutisse en fait qu'à démanteler les structures existantes, la voie est étroite. Mais, comme le déclare à raison M. Christian Bréchot, « il faut absolument combattre l'idée trop répandue que l'évolution des organismes est impossible » au risque de la rendre effectivement impossible. Un point positif : ainsi que le note M. Bernard Larrouturou, un consensus semble désormais se dessiner sur la nécessité de la réforme. Reste à en définir les contours. Pour cela il importe d'avoir au préalable envisagé l'ensemble des questions qui se posent à la recherche française et de définir quel dispositif global la réforme vise à mettre en œuvre. Les organismes de recherche, et au premier chef le CNRS, constituent le centre du dispositif actuel. De la place qui leur sera dévolue demain dépend la nature des réformes à entreprendre et non l'inverse. Pour autant, cela ne signifie pas - comme M. Edouard Brézin, revisitant à rebours l'histoire de la recherche française, le déclarait sous la forme d'une boutade - que le CNRS aura accompli sa mission lorsqu'il aura disparu. DÉFI N° 4 : RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Au classement des organismes de recherche évoqué précédemment en répond un autre, qui a fait beaucoup plus de bruit : le classement mondial des universités établi par l'université Jiao Tong de Shangaï. 1. Un système d'enseignement supérieur français dont la qualité n'est pas reconnue sur la scène internationale Diffusé pour la première fois dans la presse, en mars dernier, il a fait l'effet d'un coup de semonce. La France n'apparaissait qu'à la 65e position avec l'université Pierre-et-Marie Curie (Paris VI), puis à la 72e position avec l'université d'Orsay (Paris XI). Seuls ces deux établissements figuraient parmi les cent meilleures universités du monde. Et la nouvelle mouture du classement chinois, dans lequel les universités françaises font un sérieux bond en avant - l'université Pierre-et-Marie Curie (Paris VI) passant de la 65e à la 41e place, l'université d'Orsay (Paris XI) avançant de la 72e à la 48e place tandis que deux autres institutions françaises font leur entrée parmi les 100 meilleurs établissements du monde - l'université Strasbourg I (82e place) et l'Ecole normale supérieure de Paris (85e place) 15 -, pour être plus satisfaisant, n'est cependant pas de nature à nourrir un optimisme excessif. Au-delà de l'interrogation légitime sur la pertinence des critères retenus pour établir le classement 16, celui-ci donne une idée de la place de l'enseignement supérieur français sur la scène mondiale. A défaut d'offrir une photographie exacte de la réalité il agit comme un révélateur. Sans réelle surprise, le classement entérine l'écrasante domination des universités américaines qui occupent les quatre premières places - Harvard en tête - et figurent au nombre de huit dans les dix premières. Par contre, il est plus étonnant, et par là même plus inquiétant, de constater que cinq universités britanniques devancent la première université française ou que des pays comme le Japon, l'Allemagne, le Canada, la Grande-Bretagne encore, la Suisse, la Suède, les Pays-Bas placent plus d'établissements supérieurs parmi les cent premiers mondiaux que la France. Ce constat est d'autant plus alarmant qu'il intervient dans un contexte mondial de concurrence intellectuelle et scientifique de plus en plus exacerbée - à ce titre, il n'est pas anodin de constater que le classement en question émane d'une université chinoise et que la notion même d'un classement des universités devienne une donnée pertinente et recherchée - et au moment où se met en place « un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche » de plus en plus ouvert avec la généralisation du modèle LMD (Licence Master Doctorat) conformément au processus de Bologne initié en 1999. Or, compte tenu de sa position perfectible à l'intérieur de cet espace - avec un rang qui n'est même pas conforme à sa démographie -, la France ne manquera pas de rencontrer des difficultés pour attirer des étudiants issus des pays de l'Union européenne voire pour retenir sur son propre territoire ses propres étudiants, c'est-à-dire les futures forces vives de la recherche. Quels enseignements tirer de ce classement ? D'une part, globalement les universités françaises n'ont pas atteint une taille suffisante pour s'affirmer sur la scène internationale. Quatre-vingt-deux universités et assimilées pour la seule France métropolitaine, c'est assurément beaucoup sinon trop lorsque tous exercent des activités de recherche, à des niveaux, il est vrai, très inégaux (75 % des crédits versés par le CNRS aux unités mixtes de recherche concernent seulement 15 % des universités). D'autre part les grandes écoles, parce qu'elles renvoient à une réalité trop spécifiquement française, incomprise de nos partenaires étrangers, n'obtiennent pas sur la scène internationale la visibilité et le prestige qui leur est reconnu sur notre territoire par nos compatriotes. Ainsi que l'analyse M. Michel Laurent, premier vice-président de la Conférence des présidents d'universités (CPU), moins que la qualité de l'enseignement professé, c'est l'organisation du dispositif qui pénalise l'enseignement supérieur français et, par suite, la recherche française. L'un et l'autre sont en effet indissociables et c'est précisément du côté du cloisonnement excessif entre la recherche et l'enseignement supérieur et d'un clivage qui traverse l'enseignement supérieur lui-même que sont à rechercher les causes de l'effritement de la position française sur la scène internationale. M. Michel Laurent a ainsi mis en garde les membres de la mission contre ceux qui tenteraient de vouloir dissocier les enjeux rappelant combien le lien entre recherche et enseignement était selon lui évident. Si la crise avait semblé moins affecter l'université que les organismes de recherche, c'est uniquement que le « détonateur » qu'a constitué la suppression de 550 postes de chercheurs avait moins de prise à l'université car celle-ci n'était pas directement touchée, davantage de poste d'enseignants-chercheurs que de postes de chercheurs ayant été créés au cours des dix dernières années. Il n'en demeure pas moins qu'un état de crise larvée existe à l'université. Témoin enfin - et c'est peut-être là un critère d'évaluation plus certain - du manque de visibilité des universités françaises depuis l'étranger : leur manque d'attractivité. Selon les chiffres de l'OST, tandis qu'en 2001, 40 000 étudiants français sont partis poursuivre leurs études dans un pays de l'Union européenne, ils n'étaient que 28 000 étudiants issus des pays membres à venir étudier en France. Si l'on observe maintenant l'origine des étudiants étrangers hors Union européenne inscrits dans les universités françaises, on constate une très forte proportion de jeunes issus de pays en voie de développement, africains dans leur grande majorité, dépourvus de structures d'enseignement supérieur performantes. Le fait de venir dans une université française n'est alors plus un choix mais une nécessité. Ainsi que le résume assez cruellement M. Etienne-Emile Baulieu, aucun étudiant étranger n'est attiré par les universités françaises ; sans même parler des universités américaines, ils préfèrent aller étudier au Royaume-Uni, à Oxford ou à Cambridge, ou bien à Heidelberg, en Allemagne. 2. Une recherche qui n'est pas au centre du dispositif d'enseignement supérieur Deux raisons, qui tiennent toutes deux à l'histoire et à la tradition française, président principalement au retrait de l'enseignement supérieur français sur la scène internationale. En premier lieu, il y a le choix fait par la France dans l'entre-deux-guerres et poursuivi durant les Trente glorieuses d'organiser sa recherche autour de grands organismes de recherche de préférence à l'université. De sorte que si, aux dires de M. Michel Laurent, dans les faits, 80 % du potentiel humain et des structures de recherche français sont concentrés dans l'université, celle-ci pâtit encore d'une image dégradée qui la dessert au niveau national et par suite sur la scène internationale. Deux témoignages consignés par la mission illustrent mieux que de longues démonstrations ce propos. L'expérience accumulée par M. Edouard Brézin au cours de sa carrière lui a montré qu'un jeune chercheur placé devant l'alternative suivante : entrer à l'université ou bien intégrer le CNRS optait quasi systématiquement pour la seconde hypothèse en raison notamment de la plus grande souplesse en matière d'enseignement offerte aux chercheurs du centre. Autre témoignage, celui de M. Michel Laurent, qui constate que ses collègues qui exercent à la fois à l'université et dans un organisme préfèrent signer les articles qu'ils publient dans les grandes revues scientifiques internationales de leur titre de directeur de recherche dans un organisme plutôt que de leur titre de professeur des universités estimant que le premier est le plus prestigieux. Autre gallicanisme, l'université qui ne constitue pas la voie de l'excellence en matière de recherche - du moins dans le domaine des sciences « dures » -, ne constitue pas non plus, comme dans la totalité des autres pays du monde (à l'exception de la Suisse), la voie de l'excellence en matière d'enseignement supérieur puisque ce rôle est dévolu, depuis la Révolution et l'Empire, aux grandes écoles qui ont sur l'université l'avantage déterminant de pouvoir sélectionner les élèves qu'elles accueillent. Handicap ou richesse du système français ? En dépit des critiques formulées par beaucoup qui considèrent qu'il s'agit là d'un cloisonnement supplémentaire et inutile 17, on serait finalement tenté de croire à la seconde hypothèse puisque l'analyse est partagée par les deux parties concernées, la CPU et la Conférence des grandes écoles. Sur ce point il est vrai également, comme le rappelle M. Thierry Weil, directeur de l'équipe projet Futuris, qu'il y a plus de différences entre les petites et les plus prestigieuses des grandes écoles qu'entre les grandes écoles et les meilleures des universités. Toutefois, la question déborde de beaucoup la simple querelle d'institutions puisque la formation assurée par ces deux types d'établissement est très différente sur le plan de la démarche intellectuelle. Tandis que l'université dispense un enseignement par et à la recherche, les grandes écoles et les classes préparatoires qui y conduisent, dirigent plutôt leur enseignement vers l'obtention d'un diplôme de niveau M (master) dans la nouvelle nomenclature des diplômes de l'enseignement supérieur correspondant. De sorte que, dans le schéma français, le diplôme d'ingénieur prime sur celui de docteur en rupture avec la norme internationale qui est celle du PhD - contraction du titre de doctor of philosophy - ce qui ne laisse pas de poser problème pour la reconnaissance des compétences françaises vis-à-vis de l'étranger. Au final, et comme le caricature avec une ironie féroce une personnalité entendue par la mission, le système français aboutit à ce paradoxe que les meilleurs étudiants ne font pas de la recherche et que ceux qui se destinent à la recherche sont parfois incapables de la conduire. Manifestement, la France est ici victime d'un problème de « label », selon l'expression de M. Michel Laurent. Quid en effet d'un chercheur français qui travaille dans les locaux d'une université mais mène ses recherches pour l'Inserm ? Comment doit-il se présenter ? Le problème ne se pose pas pour les étrangers et notamment pour les Américains. Quelle que soit son activité, un chercheur qui travaille sur le campus d'Harvard se présente comme chercheur à Harvard. La multiplication des luttes stériles entre établissements condamne la recherche universitaire française, en dépit de l'existence de certains pôles - certes trop peu nombreux - rassemblant plus de 3500 enseignants-chercheurs, à ne jouer que les seconds rôles sur la scène internationale. A quoi s'ajoutent enfin, selon l'appréciation de M. Edouard Brézin, des interventions législatives hasardeuses et des évolutions culturelles regrettables au nombre desquelles l'uniformisation des universités qui a abouti à disperser les moyens, l'augmentation de la charge de cours des enseignants-chercheurs qui s'est faite au détriment de la recherche, le fait que les sujets de recherche ne sont plus imposés par les nécessités de la recherche mais épousent le désir des étudiants et enfin le fait que les étudiants, dans le choix de leur université, sont moins motivés par le niveau de celle-ci que par la distance qui sépare la faculté du lieu de résidence de leur famille. Au point que les jeunes maîtres de conférences enthousiastes sont rapidement considérés comme des éléments gênants par les présidents d'université car ils réclament des locaux et des moyens supplémentaires que ces derniers ne sont pas en capacité de leur donner. 3. Des structures universitaires inadaptées C'est que l'université française est également victime de difficultés internes qui sont la conjugaison de deux phénomènes : la massification de l'enseignement supérieur et une structure administrative perfectible. L'université étant, aux termes de la loi (article L. 612-3 du code de l'éducation), tenue d'accueillir tous les détenteurs du baccalauréat qui le souhaitent, a connu, plus que toute autre institution d'enseignement supérieur, une augmentation très sensible de ses effectifs : 600 000 étudiants supplémentaires rien que pour les dix années passées. Cette évolution, dont on ne peut que se réjouir puisqu'elle témoigne de l'élévation générale du niveau d'instruction a cependant placé les universités dans une situation financière difficile qui, pour partie, s'est faite au détriment de la recherche. Les chiffres sont en effet peu valorisant pour l'université française. Une étude de l'OCDE place ainsi la France dans le troisième tiers du classement mondial des budgets des universités. Autre statistique, la France est le seul pays au monde qui consacre des crédits plus importants par lycéen (8 400 euros) et même par collégien (7 100 euros) que par étudiant à l'université (6 840 euros). Toutefois, ainsi que le rappelle, M. Michel Laurent, la situation démographique va s'inverser au cours des dix années à venir. L'université doit absolument saisir cette opportunité - renouvellement des personnels et réduction du nombre d'étudiants - pour réaffirmer sa vocation de recherche et réviser ses structures. Car, au-delà de tous les aspects mentionnés ci-dessus, l'université est peut-être avant tout victime d'une certaine sclérose administrative. L'absence de budget global, des structures de direction favorisant l'endogamie plutôt que la mise en œuvre d'une véritable politique d'établissement, un système d'évaluation des personnels de recherche perfectible, un statut d'enseignant-chercheur trop rigide n'autorisant pas assez de flexibilité entre les différentes missions des personnels, une valorisation insuffisante des produits de la recherche universitaire, des règles de gestion administrative tatillonnes et inadaptées à la nécessaire réactivité de la recherche et ne permettant pas de rémunérer à leur juste valeur les meilleurs enseignants-chercheurs, etc. Tous ces éléments qui ont été rapportés à la mission privent à l'évidence l'université d'une réelle autonomie de gestion et d'un outil stratégique de développement. Si certaines structures plus ou moins liées à l'université, tels que le Collège de France ou l'Institut universitaire de France (IUF), constituent des trouées d'azur bienvenues dans un ciel maussade permettant à l'université d'honorer les plus méritants de ses talents en leur offrant des conditions de travail meilleures et plus souples, celles-ci, au regard de l'institution toute entière, sont réservées à une élite. Au moins, ont-elles le mérite d'indiquer la marche à suivre. DÉFI N° 5 : UNE GESTION ADMINISTRATIVE INADAPTÉE À UN ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIEL Les nécessités d'une recherche soumise, en raison d'une concurrence internationale de plus en plus forte, à des évolutions de plus en plus rapides, font apparaître avec plus de netteté l'inadaptation sinon l'archaïsme des règles de gestion administratives des établissements. Les précédents développements ont déjà donné un aperçu des difficultés que pouvaient rencontrer les organismes de recherche à nouer des partenariats avec d'autres organismes de recherche ou avec des universités. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres et il ne servirait à rien de faire un inventaire à la Prévert des doléances enregistrées par les membres de la mission. Le rapport sera donc volontairement bref sur ce point même si à l'évidence il s'agit là de l'un des motifs de mécontentement des chercheurs les plus importants et les plus légitimes lequel constitue une des causes du retrait de la performance française sur la scène internationale. A tous les niveaux, les procédures sont lourdes et distraient en permanence les chercheurs de leur cœur de métier. Ainsi que le dit le proverbe, « le diable est dans les détails », et la recherche s'essouffle à être sans cesse confrontée à des tracasseries administratives. Ainsi qu'il a été rapporté aux membres de la mission, des années sont parfois nécessaires pour se procurer du matériel de recherche performant là où la concurrence internationale est capable, comme la Chine par exemple, pourtant porteuse d'une grande tradition administrative, de mener de bout en bout le projet de création d'un Institut Pasteur en l'espace de six mois comme l'indique le témoignage de M. Philippe Kourilsky. En outre, M. Edouard Brézin dénonce la « vision nombriliste » des établissements dont les responsables ne veulent céder aucune de leurs prérogatives quitte à alourdir un peu plus les circuits de gestion. Ainsi, les unités mixtes de recherche ne sont pas gérées par une tutelle unique mais par l'ensemble de leurs tutelles chacune régie par des règles et des procédures administratives différentes empêchant toute gestion coordonnée de l'ensemble. Toutefois, les mentalités évoluent comme le montre le rapport final des états généraux de la recherche qui pointe « la lourdeur des mécanismes de gestion » qui constituent « un handicap majeur dans l'exercice quotidien de la recherche ». En la matière, la souplesse de gestion conférée aux EPIC, tels que le CEA, est souvent citée en référence comme l'exemple à suivre. Face à la lourdeur de gestion et à la rigidité des EPST, M. Edouard Brézin préconise de les transformer purement et simple en EPIC. Et, de fait, auditionné par la mission, M. Alain Bugat, administrateur général du CEA, a indiqué ne pas rencontrer de difficultés particulières de gestion - y compris en terme de recrutement - sinon précisément lorsqu'il s'agissait de nouer des partenariats avec des EPST ou des universités. Il importe toutefois d'avoir présent à l'esprit que la transformation d'un EPST en EPIC n'est pas neutre quant à la situation des personnels et a pour conséquence de faire passer les contractuels d'un statut de droit public à un statut de droit privé ; en vertu de la jurisprudence France Télécom du Conseil d'Etat (avis du 18 novembre 1993) les personnels qui relèvent du statut de fonctionnaire ne pourront maintenir ce statut que si leurs activités répondent à l'exécution d'une mission de service public. D'ores et déjà, M. Christian Bréchot, a réclamé la mise en œuvre de trois réformes de simplification administrative : - la mise en place d'un contrôle de gestion a posteriori en lieu et place de l'actuel contrôle a priori qui ralentit les procédures et, en bridant l'affectation des crédits, ne permet pas d'attirer les meilleurs chercheurs ; - l'assouplissement des règles de gestion relatives au versement des primes ; - le versement des dotations directement au chef de projet, charge à lui de les répartir ensuite selon ce qu'il estime être les nécessités des projets de recherche : matériel, personnel, frais de déplacement, etc. Ainsi que l'affirme leur auteur, sous des dehors d'ajustements mineurs, ces réformes - dont la vocation est de responsabiliser les acteurs en préfigurant ce que serait une gestion en coûts complets - n'en constituent pas moins une véritable révolution du système de recherche français. Et de fait, la dernière proposition se heurte, pour sa réalisation, au respect des règles budgétaires et comptables en vigueur et à venir puisqu'elle implique une fongibilité totale entre les crédits inscrits au titre III (personnel) de la loi de finances et ceux inscrits au titre VI (fonctionnement) tandis que la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n'autorisera qu'une « fongibilité asymétrique », c'est-à-dire que les gestionnaires pourront redéployer des crédits de rémunérations à d'autres fins, mais pas l'inverse. DÉFI N° 6 : LES JEUNES ET LA RECHERCHE Quelques éléments chiffrés suffisent à comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes chercheurs aujourd'hui. La mise en œuvre, dans les années 1990, d'une politique volontariste visant à favoriser l'entrée des jeunes dans les cursus de la recherche, a abouti à ce que la France compte aujourd'hui environ 70 000 doctorants, c'est-à-dire, peu ou prou, autant que d'enseignants-chercheurs en activité. Selon les statistiques de l'OST, plus de 18 000 étudiants étaient inscrits en doctorat en 2003, soit plus que l'effectif total des chercheurs du CNRS. En terme de flux, un peu moins de 10 000 étudiants ont soutenu une thèse en 2002. Ces chiffres font apparaître deux choses. D'une part, que le taux d'abandon de thèses est très élevé puisqu'il se situe autour de 50 % et atteint de près les deux tiers pour les thèses entreprises en sciences humaines et sociales (SHS) qui représentent à elle seules plus de 40 % des thèses soutenues. D'autre part, que l'insertion des docteurs - dont le nombre est très élevé comparativement aux capacités d'absorption de la recherche académique - n'est pas chose aisée. Si, toujours selon les éléments fournis par l'OST, seuls 6 % des docteurs se déclarent sans emploi un an après l'obtention de leur doctorat, soit un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, la moitié à peine d'entre eux (environ 44 %) exercent une activité directement liée à la recherche dont 24 % sous la forme de contrats post-doctorants, compte non tenu des 18 % intégrés dans le monde de l'entreprise et dont les statistiques ne permettent pas de savoir si leur emploi est lié ou non à des activités de recherche. La difficulté pour les jeunes qui entreprennent de se lancer dans les carrières de la recherche se situe donc à deux niveaux successifs : dès le doctorat et la période de réalisation de la thèse et, une fois la thèse soutenue et le doctorat obtenu, pour obtenir un emploi et un emploi de qualité. 1. La précarisation de la situation des doctorants Ainsi que l'ont affirmé à la mission MM. Sylvain Collonge et Florent Olivier, responsables de la Confédération des jeunes chercheurs (CJC), l'augmentation quasi incontrôlée du nombre des doctorants a eu pour conséquence la précarisation de leur situation. De sorte qu'aujourd'hui, seuls 40 % des doctorants sont rémunérés - c'est-à-dire qu'ils sont détenteurs d'une allocation de recherche publique ou privée ou d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE). A contrario, 10 % d'entre eux ne bénéficient d'aucun financement et sont donc contraints, pour subsister, de travailler « au noir » ou de recourir au système des « libéralités 18» qui ne leur garantit pas de couverture sociale. Grâce aux engagements pris par le gouvernement dans la loi de finances pour 2005 votée par l'Assemblée nationale - création de 4 000 allocations de recherche et de 40 conventions CIFRE supplémentaires et mobilisation de 2 millions d'euros destinés à la lutte contre les libéralités - il devrait rapidement être mis fin à de telles pratiques. Pour autant, ces réformes n'épuisent pas la question. Faute d'avoir été revalorisée, l'allocation de recherche est d'un montant trop faible pour permettre aux doctorants de vivre correctement. Conçue à l'origine pour être une aide attractive, son montant avait été fixé, à sa création, en 1976, à une fois et demie le montant du SMIC. Faute d'avoir été indexée sur le coût de la vie, sa valeur s'est érodée au fil des ans, d'autant plus que devant le nombre de plus en plus important de doctorants, il a été fait le choix d'étendre le versement à un plus grand nombre de personnes au détriment du montant nominal de l'allocation. Les revalorisations récentes - à raison de 5 % par an depuis 2001 - n'ont pas permis de rattraper le retard accumulé et il y a aujourd'hui une déconnexion entre le montant de l'allocation et le montant du SMIC qui, il est vrai, vient d'être fortement revalorisé. Enfin, les problèmes financiers ne sont pas les seules difficultés que rencontrent les jeunes doctorants. Le très fort taux d'abandon de thèses évoqué plus haut - outre qu'il renvoie à la question de l'absence de sélection à l'entrée de l'université - oblige à se poser la question de l'encadrement de la recherche. M. Sylvain Collonge estime que les directeurs de recherche sont habilités à diriger trop de thèses de sorte que certains étudiants se retrouvent dépourvus de tout soutien au cours de leurs travaux. Il préconise donc que les universités soient encouragées à valoriser les écoles doctorales en leur offrant les moyens de renforcer leur potentiel humain et financier. 2. La difficile entrée dans la carrière Compte tenu du nombre très élevé de docteurs produits par le système d'enseignement supérieur et de la capacité d'absorption relativement faible du tissu public de recherche, 80 % d'entre eux doivent trouver un emploi, une fois leur thèse soutenue, hors du dispositif de recherche académique. Dans ce contexte, la solution qui apparaît la plus simple est bien sûr l'augmentation du nombre de postes offerts dans la recherche académique. Compte tenu du statut des chercheurs, il s'agit là d'un engagement lourd qui engage le pays pour les décennies à venir. De ce point de vue, la question rejoint la problématique plus large de la situation générale des personnels qui sera détaillée plus loin (cf. défi n° 7). En réalité, et les représentants de la CJC sont les premiers à le reconnaître, la solution devrait venir d'une augmentation des débouchés hors du secteur public. Or force est de constater qu'en France s'additionne à l'insuffisance de l'effort privé de recherche, qui provoque mécaniquement une diminution des emplois de la recherche, un double malentendu d'ordre culturel entre les chercheurs et l'entreprise. Qu'il s'agisse d'un véritable désir, d'une nécessité, ou que cela soit le fruit des circonstances, les jeunes, ainsi que le confirme M. Michel Laurent, premier vice-président de la CPU, envisagent leur avenir dans le dispositif académique. A leur décharge, il faut dire que, tandis que le PhD, équivalent anglo-saxon du doctorat, est unanimement reconnu par les grandes firmes internationales, les entreprises françaises, y compris les plus importantes, pour des raisons culturelles, préfèrent embaucher des jeunes issus des grandes écoles plutôt que des jeunes ayant suivi une formation de chercheur. M. Jacques Lacambre a ainsi indiqué aux membres de la mission que le groupe Renault dont il dirige le secteur recherche, bien qu'il valorise les thèses en octroyant aux docteurs une surprime à un salaire déjà deux à trois fois supérieur aux standards de la recherche académique, préfère de très loin embaucher des ingénieurs dont il estime que la formation répond mieux que celle des chercheurs au caractère multi-technologique des activités automobiles. Le personnel du service recherche de Renault est ainsi composé à 90 % d'ingénieurs. Plus éclairant encore, interrogé sur ce point par la mission, M. Michel Deviller, directeur technique central d'EADS, numéro deux mondial dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense qui consacre chaque année 5 milliards d'euros aux activités de recherche, prononce un mea culpa lorsqu'il évoque le nombre insuffisant de jeunes docteurs embauchés par son entreprise. Prolongeant la conversation, on s'aperçoit que des personnes comptabilisées comme tels sont en fait des jeunes initialement formés par les grandes écoles. Dans ce cas précis, est-ce la formation à et par la recherche ou bien la formation initiale qui a primé dans la décision d'embauche ? On peut légitimement se poser la question. Il ne s'agit pas là de faire un procès à charge. Selon M. Jacques Lesourne, la formation des chercheurs français est telle qu'ils sont formatés pour travailler dans le secteur public et que, dans ces conditions, leur adaptation au secteur privé est très difficile. Par ailleurs, et comme le rappelle opportunément M. Michel Deviller, les grandes écoles offrent une formation de valeur. De sorte que la posture qui consisterait à privilégier par principe un docteur sur un ingénieur n'aurait pas de sens. Il convient seulement de faire en sorte que la réciproque n'existe pas non plus. Car, ainsi que l'a mis en évidence M. Etienne-Emile Baulieu, la rédaction d'une thèse implique une prise de risque et la nécessité de faire des choix, toutes choses qu'il convient de valoriser. De manière provocante, il pourrait être envisagé, afin de permettre une insertion plus facile des docteurs dans la vie professionnelle, d'instaurer une forme de numerus clausus limitant le nombre de doctorants par directeur de recherche ou le nombre de doctorats délivrés par an pour chacune des disciplines universitaires. Au moment où la recherche s'intensifie partout dans le monde, la mise en œuvre d'une telle politique malthusienne n'est à l'évidence pas une solution viable. En revanche, la solution, présente en filigrane derrière les propos de M. Sylvain Collonge, consistant à renforcer l'accompagnement des étudiants désirant faire une thèse afin de mieux juger leur motivation, de les orienter vers des sujets porteurs et de les dissuader, le cas échéant, de se lancer dans un doctorat qui risquerait de ne pas déboucher sur un emploi, est à envisager. L'exemple des conventions CIFRE montre que des recherches menées en partenariat avec un entrepreneur et qui sont donc en adéquation avec l'offre de travail débouchent sur des emplois. De tels dispositifs sont à encourager, tout en veillant à ce que soit préservée la liberté de la recherche et du chercheur. 3. L'inquiétante fuite des cerveaux : Trop de docteurs, pas assez de postes avec comme conséquence de très nombreux chercheurs qui font partie de ce qui s'apparente, selon l'expression des représentants de la CJC, à un « anneau de stockage » d'où ils ne sortent que pour empiler des postes de post-doc, souvent à l'étranger. Or, s'il ne fait pas de doute qu'une expérience internationale est intéressante et même souhaitable pour les jeunes chercheurs, il est par contre inquiétant de constater que, de plus en plus nombreux, ceux-ci s'expatrient sans désir ou espoir de retour. En l'absence de statistiques fiables, il est difficile de cerner l'ampleur du phénomène. Il est certain par contre qu'il existe et, devant les difficultés rencontrées par les jeunes pour obtenir un emploi et la faible attractivité des carrières, tend à s'amplifier, grevant ainsi fortement le potentiel de recherche français 19. M. Philippe Kourilsy n'hésite pas à affirmer qu'en biologie, discipline où l'écart entre le financement français et le financement américain est parmi les plus importants - le budget des NIH américains est cinquante fois supérieur à celui de l'Inserm, son équivalent français -, la fuite des cerveaux est, selon sa propre expression, une « réalité tangible ». Aux Etats-Unis, qui constituent une des principales terres d'accueil des cerveaux expatriés, plus de la moitié des post-doctorants (55 %) travaillant dans les institutions académiques sont étrangers. Empruntant la métaphore footballistique, M. Edouard Brézin montre que, ce faisant, les Etats-Unis font un excellent calcul économique. En offrant aux chercheurs des salaires un peu plus élevés que la moyenne internationale, ils attirent les meilleurs talents sans avoir à supporter le coût - beaucoup plus important - de leur formation. Comme en football, la France dispose d'excellents centres de formation mais ne parvient pas à retenir les meilleurs éléments lorsqu'ils entrent sur le marché et commencent à devenir productifs. « L'appât du gain », tout relatif, n'est pourtant pas la seule, ni semble-t-il la première, des préoccupations des chercheurs qui décident de quitter la France. Les témoignages qui ont été rapportés à la mission montrent également qu'au-delà de conditions financières plus satisfaisantes pour eux-mêmes, les chercheurs trouvent à l'étranger des opportunités de recherche que la France ne sait pas leur offrir : très jeunes, ils peuvent disposer d'une réelle autonomie et d'un financement conséquent pour mener à bien leurs projets tandis qu'en France les enseignants-chercheurs sont dès le début de leur carrière écrasés par une importante charge de cours qui les empêche de mener à bien leur recherche au moment même où ils sont le plus fécond. En dépit de tout cela, M. Christian Bréchot, estime que la plupart des chercheurs qui travaillent actuellement à l'étranger souhaitent revenir en France. Reste à leur en donner les moyens... Au terme des auditions, une chose est apparue clairement aux membres de la mission, c'est qu'il faut absolument veiller à ne pas décourager les jeunes des carrières de la recherche. Ce phénomène ne constitue pas une exception française. On le retrouve même, avec une ampleur plus grande encore, outre-atlantique 20, où il se nourrit, en partie, des mêmes causes : une reconnaissance en terme de salaire insuffisante. Richard Freeman, économiste à l'université d'Harvard, s'interroge ainsi sur l'attractivité de carrières où l'on est « payé comme un étudiant pendant un quart ou un tiers de [sa] vie de travail et [où l'on attend] d'avoir trente-cinq ans pour avoir un véritable emploi 21». 2 300 euros brut mensuel pour un chargé de recherche, c'est-à-dire un chercheur qui débute sa carrière après au minimum huit années d'études après le baccalauréat, c'est assurément peu, trop peu en tout cas comparativement à d'autres carrières, pour permettre d'attirer les talents. Déjà une certaine désaffection se fait jour. M. Edouard Brézin constate ainsi que les polytechniciens auxquels il fait cours et qui, traditionnellement postulaient nombreux au CNRS, boudent l'institution. D'autres redoutent que les difficultés rencontrées aujourd'hui par les jeunes chercheurs ne dissuadent définitivement les générations futures de s'orienter vers les carrières scientifiques avec, à terme, le risque évoqué par M. Alain Trautmann d'une forme de « colonisation à rebours ». Ainsi que le déclare M. Philippe Kourilsky, le découragement des jeunes chercheurs se transforme de plus en plus en véritable désespérance et se traduit par des revendications statutaires. En fait, d'où qu'on l'envisage, la question des jeunes chercheurs renvoie sans cesse à celle, plus générale, du statut des chercheurs du réseau académique. DÉFI N° 7 : LA QUESTION DU PERSONNEL CHERCHEUR Point de départ du mouvement des chercheurs au mois de janvier de cette année, la question est, malgré la réponse politique qui lui a été apportée, encore au cœur de la réflexion sur l'avenir de la recherche en France. Et ce à un double titre : d'une part parce qu'elle constitue une des revendications des chercheurs à l'issue des états généraux de la recherche lesquels réclament l'adoption d'un « plan pluriannuel pour l'emploi scientifique », d'autre part, parce que les évolutions qui seront apportées au statut des chercheurs rythmeront, par ricochet, l'ampleur qui pourra être donnée à la réforme du système tout entier. 1. Des moyens humains insuffisants ? Selon les données du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le personnel dans le secteur de la recherche et développement se répartissait, en 2002, de la façon suivante, en légère augmentation depuis 2000 (+ 5,1 %) : Personnel de recherche et développement (en équivalent temps plein)
Sur la scène européenne, la France se situe ainsi, selon les statistiques de l'OST, assez loin derrière l'Allemagne qui dispose de 264 000 chercheurs mais devant la Grande-Bretagne et ses 152 000 chercheurs 22. Il est à noter que l'écart entre l'Allemagne et la France est beaucoup plus grand pour les chercheurs en entreprises que pour les chercheurs publics. Si on élargit encore le spectre à l'ensemble de la planète, non compris des nations tels que les pays scandinave, Suède ou Finlande, dont l'effort de recherche est remarquable mais la taille du pays n'est pas comparable à la France, la position française est la suivante : Nombre de chercheurs rapporté à la production de recherche, panorama mondial (source : OST, données 2001)
Si, en terme de publications rapportées au nombre de chercheurs, la France fait encore beaucoup mieux que la Chine, la productivité de la recherche française, autant que le concept puisse faire sens, est en revanche en retrait par rapport aux recherches allemande et britannique. Ainsi les publications scientifiques de l'Allemagne, qui dispose d'un ratio nombre de chercheurs rapporté à la population active similaire à celui de la France, ont un impact supérieur à celles produits par la recherche française. L'écart de productivité ainsi mesuré est encore plus grand avec le Royaume-Uni qui, avec un ratio nombre de chercheurs rapporté à la population active inférieur de plus d'un point à celui de la France, parvient à un résultat de deux points de plus en terme de publications scientifiques lesquelles ont en outre un indice d'impact à deux ans très supérieur. La recherche britannique s'impose ainsi comme la première en Europe et la deuxième des pays de l'OCDE derrière les Etats-Unis en volume et influence de ses publications académiques ou d'obtentions de prix scientifiques internationaux. S'il ne fait pas de doute que l'usage désormais généralisé de l'anglais comme idiome de la science internationale et le fait que les revues scientifiques à plus fort impact - telles que Nature ou Science, dont les citations sont couramment utilisées pour établir les classements mondiaux - sont de langue anglaise constituent des éléments de nature à favoriser les nations dont l'anglais est langue maternelle, il n'en demeure pas moins que la position française est perfectible. En dépit de dépenses en recherche et développement importantes, d'un ratio nombre de chercheurs sur population active dans la moyenne des grands pays européens, la France n'apparaît qu'au douzième rang mondial pour l'impact à deux ans de ses publications scientifiques derrière des pays comme la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, le Canada, la Suède, la Finlande, la Belgique, ou l'Autriche qui, certes concentrent des efforts financiers et humains importants sur la recherche, mais sont toutefois de taille beaucoup plus réduite. Pour ne prendre qu'un exemple, la Finlande, avec ses 5,2 millions d'habitants et ses 39 000 chercheurs, se classe au neuvième rang mondial avec un indice d'impact à deux ans évalué à 0,97. Etrangement, l'insuffisante performance française en terme de notoriété et d'impact de sa recherche renvoie au classement des universités. Devant l'accumulation de telles données, on peut en effet s'interroger sur les raisons du manque de reconnaissance internationale de la recherche française. Comme toutes les activités, la recherche est un savoir-faire mais elle est aussi faire savoir. Or manifestement France pèche de ce côté-là. Avec toutes les réserves mentionnées plus haut - notamment que la performance d'une recherche ne peut se mesurer uniquement à l'aune des publications -, ce préambule montre que, pour qui s'interroge sur la question du personnel chercheur, il ne peut être fait l'économie d'une réflexion conjointe sur la productivité du système français de recherche et donc, dans une activité à très fort potentiel humain, sur la productivité des chercheurs. De sorte que c'est peut-être moins de chercheurs supplémentaires dont la recherche académique française a besoin que de chercheurs véritablement dotés des moyens de travailler et de se concentrer sur leurs activités de recherche plutôt que d'être détournés de leur objectif par des tâches administratives. Ainsi que le déclarait à la mission M. Philippe Kourilsky, en la matière, la solution consiste moins à créer de nouveaux postes qu'à mieux rémunérer les chercheurs en place. 2. Des rémunérations insuffisantes « A l'évidence, il ne sera pas possible d'augmenter significativement les salaires sans maintenir constant, voire diminuer transitoirement, le nombre des chercheurs. La question est déplaisante, mais ne peut pas être éludée : voulons-nous un système diffus constitué d'une pléiade de chercheurs mal payés, ou un dispositif plus concentré, forcément plus élitaire, dans lequel les chercheurs sont mieux payés et plus performants ? La réponse à cette question doit être claire. C'est la deuxième option qui doit être choisie, car c'est elle qui permettra dans un deuxième temps de redéployer quantitativement l'emploi scientifique lorsque le gain qualitatif aura été manifeste. » Ce texte, aussi provocateur soit-il, émane de la communauté des chercheurs elle-même sous la plume des auteurs de l'appel Du nerf !. De fait, l'écart entre les rémunérations pratiquées en France et à l'étranger est considérable. Dans le système public, le salaire mensuel d'un chercheur en début de carrière est de 2 300 euros par mois. En fin de carrière, le traitement, pour un directeur de recherche, atteint 5 600 euros, soit, aux dires de M. Edouard Brézin, une rémunération correspondant à celle versée à un chercheur débutant en Grande Bretagne. L'écart est encore plus considérable avec les salaires pratiqués en Suisse ou aux Etats-Unis dont M. Jean-François Dehecq, président-directeur général de Sanofi-Aventis, estime qu'ils sont, en règle général, cinq fois plus élevés que ceux versés en France. La fuite des cerveaux et la baisse d'attractivité de la recherche française vis-à-vis des générations futures et, au présent, sur la scène internationale se nourrit de cet état de faits. Encore qu'en la matière, il faille, comme on l'a déjà vu plus haut pour les jeunes chercheurs, distinguer deux éléments : le revenu des chercheurs et les moyens mis à leur disposition pour mener leurs travaux. Ce qui nourrit la revendication des chercheurs, ainsi qu'ont pu le constater les membres de la mission, ce n'est pas le désir d'enrichissement - sur ce point, ils ne réclament, à juste titre, qu'une chose : que leur soit attribué un traitement correspondant à leur niveau de compétence, élevé - mais la frustration de ne pas pouvoir disposer des moyens nécessaires pour être compétitif sur la scène internationale. On touche ici à un autre problème : un statut des chercheurs - qu'il s'agisse des chercheurs ou des enseignants-chercheurs - uniformisant qui fait que les meilleurs, connus et reconnus comme tels par leurs pairs, sont impuissants pour traduire cette reconnaissance dans un salaire plus élevé ou des moyens de recherche véritablement meilleurs. Le cas de M. Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 1997, dernier Français à avoir obtenu cette distinction, et qui malgré tout peine encore à financer ses recherches, témoigne d'un système qui, poussé à ses extrémités, confine à l'absurde. On pourrait également évoquer le cas de ce jeune chercheur, considéré par M. Edouard Brézin comme l'un des tous meilleurs physiciens français, qui s'apprête à quitter la France, une université américaine, pour l'attirer, lui ayant fait un pont d'or, auquel les autorités française n'ont pu répondre moins pour des raisons strictement financières d'ailleurs que parce que le système, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ne permet pas de financer les meilleurs à hauteur de leurs mérites. Certes, il existe bien un dispositif de primes mais celui-ci est trop rigide et le niveau des primes insuffisant et marginal pour être véritablement opérationnel. De la même manière, les postes d'accueil de haut niveau dans les EPST constituent certes un bon dispositif mais le nombre de postes offert est très insuffisant. De telle sorte que tous les responsables d'EPST regardent avec envie la souplesse offerte par les règles de gestion applicables à l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) ou aux EPIC, tels que le CEA. M. Alain Bugat, administrateur général du commissariat, reconnaît qu'il dispose ainsi d'un outil de gestion beaucoup mieux adapté à la concurrence internationale : absence de grille de salaires figée, possibilité d'établir des contrats sur mesure pour pourvoir les postes de très haut niveau, etc. Il est d'ailleurs éclairant que de l'aveu même de ce dernier, quasiment seul dans le paysage de la recherche académique français, le CEA ne connaît pas de problème de recrutement. Au point que le CEA va jusqu'à offrir des postes contractuels de conseillers scientifiques à des chercheurs du CNRS lorsque l'établissement qui désire s'adjoindre ou conserver les compétences de tel ou tel chercheur de très haut niveau n'a pas les moyens ni financiers ni statutaires de le rémunérer. Si l'on peut se féliciter de tels partenariats en ce qu'ils démontrent la solidarité interétablissements de la science française, on peut néanmoins s'interroger sur le fait que les organismes de recherche soient contraints de recourir à de tels expédients pour maintenir un haut niveau de compétence de leurs collaborateurs ... La situation n'est pas très différente du côté des enseignants-chercheurs et de la recherche universitaire où l'existence de structures telles que le Collège de France ou bien, plus récemment, l'Institut universitaire de France (IUF), créé en 1991, excellents dans leurs principes, ne suffit pas, faute d'être généralisés, à valoriser les compétences. Aux vues de tels éléments, la citation des auteurs de l'appel Du Nerf ! prend tout son sens. Avant de se lancer dans une fuite en avant consistant à créer de nouveaux emplois statutaires mal rémunérés et ainsi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, sous prétexte de dénouer la crise présente, à créer les conditions d'un malaise et d'un conflit identiques dans le futur, mieux vaut approfondir la réflexion et envisager une réforme profonde du système. Ainsi que le déclarait M. Philippe Kourilsky à la mission, la recherche française ne gagnerait rien à fabriquer de nouveaux fonctionnaires. De fait, plutôt que de nourrir, qui plus est par une politique de saupoudrage, un système qui a atteint ses limites mieux vaut réfléchir aux moyens de le rénover et de le rendre plus performant. Un peu abruptement mais très justement, M. Edouard Brézin affirme qu'en matière de recherche, il n'y a d'autre politique que la suivante : recruter les meilleurs parce que, une fois en place, ils sauront quoi faire. Or il est un fait que ni financièrement, ni statutairement, l'organisation du système académique de recherche français ne semble orienté dans cette direction. Bien au contraire celui-ci semble décourager les meilleurs... ce qui n'est pas loin de l'ineptie dans un secteur particulièrement concurrentiel où il ne sert pas à grand-chose de figurer parmi les bons puisque ne retirent des fruits de leurs travaux sinon les meilleurs du moins les premiers. 3. Une profession, deux statuts Bien que dans leur très grande majorité ils relèvent du statut général de la fonction publique d'Etat - exception faite des personnels contractuels, des chercheurs et enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement -, les chercheurs du secteur académique relèvent dans les faits de deux statuts différents selon qu'ils travaillent dans un EPST ou qu'ils enseignent dans une université. De l'un à l'autre, la différence majeure tient à ce que, outre une activité de gestion administrative, commune aux deux catégories, tandis que les chercheurs exerçant leur activité dans les EPST n'ont d'autre obligation que la recherche - quoique, en théorie, leur statut inclut dans leur mission la participation à la formation initiale et continue -, les enseignants-chercheurs ont, comme leur nom l'indique, l'obligation, à côté de leur activité de recherche, de consacrer au minimum 192 heures par an à l'enseignement auxquels s'ajoute l'obligation de participer à au moins une activité dite d'animation et de responsabilité collective (le montage de programmes internationaux par exemple). Bien que le volume horaire de ce service d'enseignement puisse apparaître relativement léger à des Français qui, dans leur très grande majorité, sont astreints à 151,67 heures par mois d'activité - professionnelle -, conformément à la durée légale inscrite dans le code du travail, il constitue dans les faits une contrainte très lourde pour ceux qui souhaitent s'engager pleinement dans une activité de recherche et notamment pour les jeunes chercheurs qui débutent dans la carrière et sont souvent contraints, étant donné le régime actuel, d'abandonner leurs recherches pour préparer leurs cours. De sorte que, à plusieurs reprises, a été réclamée la fusion de ces deux statuts en un seul, aligné sur celui des enseignants-chercheurs. Les auditions menées par la mission ont montré que cette idée qui réapparaît à intervalles réguliers tel un serpent de mer ne fait pas l'unanimité. Au contraire, on assiste plutôt à un partage équitable entre partisans et réfractaires de cette fusion sachant qu'évidemment les partisans, tel que M. Michel Laurent - qui estime que les enseignants-chercheurs, lesquels comptabilisent les deux tiers des heures travaillées dans les UMR, sont les variables d'ajustement d'un système qui favorise les purs chercheurs, situation qu'il juge inacceptable -, se recrutent majoritairement du côté des enseignants-chercheurs. Si, au final, le principe d'une fusion n'apparaît pas comme la priorité, les auditions menées par la mission ont montré que le rapprochement et l'assouplissement des statuts font en revanche l'objet d'un assez large consensus. 4. Une seule profession, différentes façons de l'exercer En effet, au fil des auditions, la critique principale qui s'est dessinée portait moins sur la coexistence de deux statuts que sur l'existence même de ces statuts par nature uniformisant, faisant fi des différentes facettes du métier de chercheur, et incapables d'épouser dans le temps les aspirations légitimes des chercheurs ou des enseignants-chercheurs à faire évoluer leur carrière. Tel a été notamment le point de vue exprimé par M. Alain Trautmann, porte-parole du collectif Sauvons la recherche, qui a réclamé que soit introduit plus de souplesse, une souplesse qui ne doit toutefois pas être synonyme de précarité. C'est ainsi que, si l'ensemble des interlocuteurs de la mission ont déclaré être favorables à ce que les personnes embauchées disposent de positions permanentes, rares ont été les interlocuteurs arc-boutés sur la défense du statut de fonctionnaire. Ce qui fait débat est en effet moins la position permanente, dont la plupart des interlocuteurs s'accordent à dire qu'elle est nécessaire à l'éclosion des talents, que le double statut tel qu'il existe aujourd'hui. Deux éléments sous-tendent leur position. D'une part, la recherche est le domaine de l'excellence où la médiocrité n'a pas sa place et où les talents doivent s'exprimer. Il faut absolument permettre des différences de traitement là où le statut actuel couplé avec un dispositif d'évaluation imparfait, par le nivellement qu'il opère, ne permet pas de rétribuer chacun à sa juste valeur ni de récompenser pleinement initiatives et talents. D'autre part et dans le même temps, la recherche est un domaine où la sérénité est nécessaire pour obtenir des résultats comme le montre d'ailleurs l'infléchissement de la politique menée outre-Manche. Ainsi que le rappelait aux membres de la mission M. Christian Bréchot, après avoir développé, plus que tout autre pays européen, le nombre de postes temporaires, la Grande-Bretagne a récemment décidé de revenir à plus de postes de permanents. De fait, l'emploi sur une position permanente des chercheurs est à peu près généralisé dans le monde, y compris aux Etats-Unis. Une note de la mission pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux Etats-Unis du mois d'avril 2004 sur le statut des chercheurs outre-atlantique montre que le statut des scientifiques employés dans les laboratoires fédéraux est très proche du statut de fonctionnaire. De la même façon, les professeurs dits tenured disposent d'un emploi permanent à l'université prenant la forme d'un contrat à durée indéterminée. Dans les faits, la singularité française tient aussi à ce que, contrairement à ce qui se passe chez ses partenaires, les chercheurs français obtiennent très rapidement une position permanente, avant même parfois d'avoir pu véritablement faire leurs preuves. Enfin, deux autres points font également l'objet d'un quasi consensus. Premier point : recherche et enseignement ne sont pas dissociables. M. Philippe Jurgensen, ancien président-directeur général de l'Agence française de l'innovation, soutient ce point de vue qui a trouvé en M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie des sciences, son plus ardent défenseur, lequel estime que, nourris des avancées les plus récentes de la recherche, les cours professés par des chercheurs sont très différents de ceux effectués par de simples enseignants. Envisageant la question par l'autre versant, celui de la recherche, M. Edouard Brézin estime que l'exemple du CNRS, qui depuis trente ans, recrute les meilleurs jeunes mais ne produit pas nécessairement les meilleurs chercheurs, montre qu'un chercheur, pour être performant, a besoin d'alterner période de recherche et période d'enseignement. Un tel projet a également rencontré l'assentiment d'une partie des chercheurs des organismes, EPST et EPIC confondus qui dans les faits, et bien qu'ils n'en aient pas l'obligation, donnent des cours à l'université ou dans les grandes écoles. Autre point de convergence, et thème sur lequel les personnes auditionnées par la mission ont le plus insisté, la nécessité de développer des passerelles et d'encourager les mobilités à tous les niveaux : entre les organismes, entre les organismes et les universités, entre la recherche académique et la recherche privée. Malheureusement, sur ce point, déjà largement mis en exergue dans le rapport des députés Pierre Cohen et Jean-Yves Le Déault, membres de la mission, Priorité à la recherche, Quelle recherche pour demain ? (1999), les éléments objectifs sont éloquents, ainsi que le rappelle le rapport récent de M. Daniel Garrigue, membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne : modestie des mobilités depuis l'université vers les organismes pourtant prévues par la loi, quasi-inexistence de mobilité depuis la recherche publique en direction de l'industrie (1 % des effectifs par an), inexistence, sauf participations ponctuelles, de la mobilité du secteur privé vers la recherche académique alors même qu'à l'université (poste de professeur associé à temps partiel), comme dans les organismes (poste de directeur de recherche associé), des dispositifs ont été mis en place à cet effet. De la même façon, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche permet aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs de participer à la création d'une entreprise qui valorise les travaux de recherche. Ils sont alors détachés pour une durée maximale de six ans. La loi autorise également les activités de consultation, la participation au capital ou au conseil d'administration d'une entreprise. Des mesures qui de l'avis de tous vont dans le bon sens mais, faute d'être suffisamment diffusées et valorisées, peu de personnes les sollicitent, 400 chercheurs seulement depuis sa création jusqu'en 2003. Au final, la recherche française souffre de ce cloisonnement qui fait que les acteurs se connaissent mal, mènent des recherches parallèles qui entretiennent une concurrence stérile rendant plus difficile encore la possibilité de nouer des partenariats dont le montage juridique est, compte tenu des règles administratives auxquels certains sont soumis, déjà excessivement complexe. Ainsi que le résume l'appel Du nerf !, « la critique généralement, et parfois injustement, adressée au statut de fonctionnaire doit être dirigée contre l'échelle des salaires, trop basse et trop limitée, et contre son excessive rigidité, non contre la stabilité de l'emploi qu'il procure, pour autant qu'il ne soit pas obtenu trop tôt. Un certain consensus existe autour du fait qu'un emploi scientifique doit être normalement attribué lorsqu'un individu a fait ses preuves d'une façon quasi irréfutable et qui rende sa probabilité de succès dans un système compétitif visant à l'excellence suffisamment élevée. » De sorte qu'emboîtées les unes aux autres, les différentes contributions des personnes auditionnées par les membres de la mission dessinent un dispositif qui distinguerait deux phases à l'intérieur même de la carrière du chercheur. Durant la première, qui correspond à l'entrée dans la carrière, le chercheur doit faire la preuve de sa compétence. A cet effet, des financements conséquents lui sont alloués, via une agence de moyens, pour financer et mener à bien des projets d'une durée de quelques années lesquels sont ensuite évalués. Si l'expérience est concluante, après évaluation a posteriori, un nouveau contrat est offert au jeune chercheur et ce à une ou plusieurs reprises. Deuxième phase : ayant mené à bien plusieurs projets, le chercheur a démontré sa compétences et ses qualités, il peut dès lors être embauché sur une position permanente. Mais, là encore, la souplesse doit être de mise, notamment en ce qui concerne, pour les enseignants-chercheurs, l'équilibre entre leurs deux missions. Ainsi que l'a préconisé devant la mission M. Paul Clavin, administrateur de l'IUF, il pourrait être imaginé que la charge d'enseignement soit modulée, à partir d'une base de 48 heures, pour une période de quelques années, selon les souhaits de chacun et les besoins de l'université sachant que les jeunes enseignants-chercheurs auraient systématiquement une charge de cours réduite et que ceux qui désirent s'investir dans l'enseignement davantage que dans la recherche pourraient dépasser les 192 heures annuelles actuelles. Ainsi que le résume M. Marc Vasseur, ancien chercheur à l'Inserm, « la logique du contrat doit se substituer à la logique du statut. » Enfin, et pour conclure sur ce point, les modalités de recrutement doivent également être revues. Ainsi que l'ont rappelé les représentants de la Confédération des jeunes chercheurs (CJC), celui-ci se fait encore trop souvent, au niveau national, de sorte qu'il est difficile de tenir compte des préoccupations et des besoins réels des équipes dans les laboratoires. Il faut aussi faire en sorte que la compétence des individus constitue le critère à considérer au premier chef lors des recrutements. Il s'agit là d'une évidence mais, à l'aune des témoignages reçus par la mission, il n'apparaît pas inutile de la rappeler... DÉFI N° 8 : L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE « Insuffisant sinon inexistant », ainsi pourrait être résumée l'appréciation communément partagée par les personnalités auditionnées par la mission sur le système d'évaluation de la recherche académique dont la nécessité est pourtant reconnue par tous à l'heure où les acteurs aspirent à ce que les compétences de chacun soient mieux reconnues. A l'image du système de recherche français tout entier, le dispositif d'évaluation dont dispose actuellement la recherche française est complexe et perfectible. La complexité du système tient essentiellement au fait qu'il reprend le découpage de la recherche entre université, grandes écoles et organismes, chacun disposant de son propre système d'évaluation et, à l'intérieur de ce système, de procédures différenciées selon le type d'évaluations à mener (enseignement, recherche, évaluation individuelle, collective, etc.). L'instance la plus connue en la matière est sans nul doute le Comité national de la recherche scientifique, instance d'évaluation du CNRS mais également des organismes et des universités pour les travaux qu'elles effectuent dans le cadre d'unités mixtes comprenant le CNRS. Une autre instance d'évaluation importante est le Conseil national des universités (CNU) qui participe au recrutement et aux promotions des enseignants-chercheurs (mais n'évalue pas les unités de recherche). Trois critiques majeures ont été formulées à l'égard de ces instances. Premièrement, nombreux sont ceux qui stigmatisent l'endogamie du système. Si le « jugement par les pairs » est le mode d'évaluation le plus courant au niveau international, le poids trop important des chercheurs élus dans les dispositifs d'évaluation (les deux tiers des membres du Comité national de la recherche scientifique sont élus ainsi que la totalité des membres du CNU) aboutit, aux dires de M. Bernard Larrouturou lui-même, à ce que la notation ne se fait pas, comme cela devrait être le cas, selon des critères objectifs de qualité scientifique des travaux entrepris, sans autre considération. Plus généralement, M. Philippe Jurgensen considère que le système d'autoévaluation des chercheurs est source de conformisme. Il est vrai qu'une autre conséquence de cette endogamie est l'insuffisante représentation des personnalités internationales dans les instances d'évaluation. Par ailleurs, l'évaluation individuelle des enseignants-chercheurs, réalisée par le CNU est trop irrégulière. Ceux-ci ne sont évalués que lors de leur recrutement, lorsqu'ils demandent une promotion (de grade ou de corps) ou sollicitent une prime d'encadrement doctoral de recherche (PEDR) ou encore lorsqu'ils effectuent des recherches en collaboration avec des EPST où l'évaluation est bisannuelle. Hors de ces cas, l'enseignant-chercheur n'est jamais évalué et il peut donc poursuivre normalement sa carrière sans rendre de comptes puisque l'avancement se fait à l'ancienneté. Enfin, dans le cas où l'évaluation, comme au CNRS par exemple, a lieu à intervalles réguliers et selon des modalités qui pour être perfectibles n'en demeurent pas moins relativement efficaces, celle-ci ne se traduit pas, dans les faits, par des différences de traitement - dans tous les sens du terme - suffisantes entre les chercheurs et les équipes les plus méritants et les autres. Des meilleures équipes notées « A », équipes de niveau international, à celles notées « D », selon la typologie du CNRS, le montant des subventions versées n'excède guère les 10 %, une différence insuffisante pour motiver les meilleurs et leur donner les moyens d'une recherche performante et véritablement ambitieuse. La création par décret n° 317-2003 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) chargée de l'évaluation et de l'expertise, notamment des recherches menées dans le cadre universitaire et des recherches menées sur financements incitatifs du ministère - Fonds national de la science (FNS) et Fonds de la recherche et de la technologie (FRT) qui vont disparaître l'année prochaine au profit de l'Agence nationale de la recherche (ANR) -, constitue certes une évolution satisfaisante vers plus et mieux d'évaluation. La MSTP a d'ores et déjà recours à plus de 1 300 experts et l'internationalisation de ce panel est en cours. Autre point positif, le gouvernement et la MSTP tendent à faire en sorte que l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs soit pris en compte dans leur évaluation. En la matière, la solution consiste aussi, ainsi que le rappelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. François Fillon, à « faire confiance aux acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire aux établissements, en développant en leur sein et à leur initiative une véritable culture de l'évaluation et d'en valider publiquement les bonnes pratiques 23 ». En ce sens, le dispositif d'évaluation et de promotion développé ces dernières années à l'Institut Pasteur et dont l'ambition est de se fonder exclusivement sur le mérite des individus a valeur d'exemple. Afin d'éviter au maximum l'endogamie du système sans toutefois renoncer au principe d'évaluation par les pairs, les compétences des chercheurs sont évaluées par des experts internationaux. Dans le même esprit et afin de décloisonner le plus possible la recherche académique française, M. Philippe Jurgensen propose que l'évaluation des chercheurs soit plus axée sur la capacité qu'ils auront démontrée à valoriser leurs recherches. En conclusion, il apparaît évident que les modalités d'évaluation doivent être revues. Toutefois une telle réforme ne serait que de peu d'effet si, en parallèle, les résultats de cette évaluation ne trouvaient pas à se traduire par des différences de traitement suffisantes pour créer une dynamique de la performance. En la matière, c'est un peu le « serpent qui se mord la queue », et les moyens de rompre ce cycle pour en finir avec l'immobilisme et engager un cercle vertueux doivent être trouvés... DÉFI N° 9 : L'INSUFFISANCE DE LA RECHERCHE PRIVÉE Les chiffres sont là, implacables. Tandis que la France flirte déjà avec l'objectif européen de financement public de la recherche pour 2010, l'effort de recherche des entreprises françaises est, au regard de cet horizon, très nettement insuffisant puisqu'il est inférieur de 40 %, en valeur absolue, à celui attendu et ce malgré une légère progression entre 1998 et 2001. L'écart à combler est tel que certains, parmi lesquels des personnalités qui comptent dans le monde de la recherche privée française comme M. Jean-François Dehecq, président-directeur général de Sanofi-Aventis, président de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT) et de l'opération Futuris, ne se bercent d'ores et déjà plus d'aucune illusion sur la possibilité pour la France d'atteindre l'engagement européen. A lui seul, l'effort privé de recherche allemand est égal à la totalité de la dépense intérieure française en R&D. Appréciée à l'échelon mondial, la situation de la France apparaît toujours aussi singulière, comme le montre le tableau ci-dessous : Financement des dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) par les entreprises (source : OST - données 2001)
Ces données démontrent également que la poursuite de l'objectif européen n'est pas vaine. D'une part, parce que celui-ci correspond à une réalité partout observable dans le monde. D'autre part, parce que la redynamisation du tissu privé de recherche est, à terme, la seule voie raisonnable pour desserrer l'étau financier dans lequel se trouve la recherche française. Etant donné la capacité d'absorption limitée de la recherche académique, le développement de la recherche privée s'avère comme la solution à privilégier pour relever le malaise des chercheurs et notamment offrir aux plus jeunes d'entre eux les débouchés qu'ils méritent. Une telle démarche est d'autant plus envisageable que dans ce secteur existent des marges de progression tandis que la recherche académique et d'ores et déjà très développée. Les deux problématiques sont intimement liées et c'est à dessein que la mission d'information à souhaiter les analyser conjointement. Trois niveaux d'analyse permettent d'appréhender et de comprendre la faiblesse de la recherche en entreprise dans notre pays. 1. Les grandes entreprises investissent dans la recherche mais sont trop peu nombreuses Ainsi que l'a indiqué à la mission M. Emmanuel Leprince, délégué général du Comité Richelieu et président de l'European federation of high techs SME's (Fédération européenne des PME de haute technologie), les grandes entreprises françaises investissent autant que leurs homologues étrangères dans le secteur recherche et développement. A titre d'exemple, Renault, dixième groupe automobile mondial en terme de nombre de véhicules vendus, figure au huitième rang mondial des constructeurs automobiles qui investissent le plus dans la recherche et le développement avec une dépense estimée selon la Technology Review à 1,7 milliard d'euros en 2001. Recherche et développement dans les entreprises françaises (source : OST)
* Evolution 1998/2001. Toutefois, cela ne suffit pas à nourrir un tissu de recherche privé aussi dynamique que dans d'autres pays. D'une part, parce que, la France, comme l'Europe de manière générale, compte peu de grandes entreprises. Tandis qu'on dénombre 208 entreprises de plus de 500 salariés aux Etats-Unis, le Vieux continent n'en compte que 132. D'autre part, parce que les activités de service qui contribuent le plus à la richesse nationale sont également celles qui investissent le moins en recherche et développement 24, ainsi que le montre de manière très éclairante la lecture conjointe des deux graphiques ci-dessous : 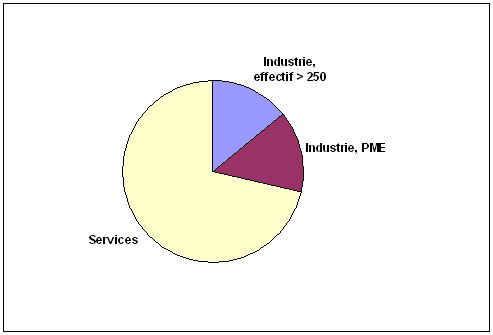 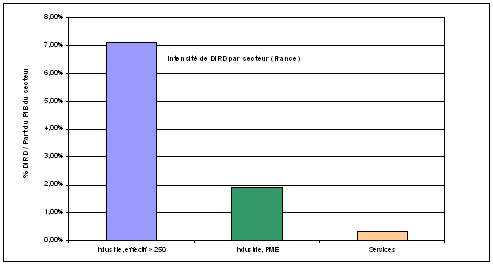 De sorte que la recherche privée française fait l'objet d'une concentration extrême. M. Jacques Lesourne, président du comité d'orientation de l'opération Futuris, a ainsi indiqué à la mission que la moitié de la recherche française en entreprise est réalisée par treize grands groupes industriels. Cette concentration se retrouve également en terme de secteurs d'activités puisque quatre branches - automobile, téléphonie, recherche pharmaceutique et aéronautique - représentent à elles seules plus de la moitié de la dépense en recherche des entreprises. On constate en outre que, comme le précise le rapport 2004 de l'OST, « le critère de dépendance capitalistique des entreprises met en lumière le dynamisme remarquable des firmes appartenant à un groupe étranger ». En effet, si l'on observe l'évolution entre 1998 et 2001 du nombre des chercheurs dans les entreprises ventilées par taille et affiliation, on constate que les entreprises où la croissance est la plus forte, et de très loin, sont les entreprises françaises filiales de groupes étrangers de plus de 2000 salariés (+ 80 %) et surtout celles de moins de 250 salariés (+ 181 %). Autre élément à verser au dossier : la balance Etats-Unis-Europe des investissements en recherche et développement penche en la défaveur de cette dernière. Tandis que les entreprises européennes investissent 40 milliards d'euros aux Etats-Unis, les entreprises américaines ne dépensent, dans le secteur, que 32 milliards d'euros en Europe. Ces données sont à mettre en relation directe avec une sous-spécialisation de la France dans les domaines des biotechnologies et de l'informatique pourtant généralement tenus comme les moteurs des économies fondées sur la connaissance. A tel point que la production technologique française est en recul sur tous les fronts - part mondiale et européenne des brevets déposés - sur la période 1996-2001. A la lumière de ces quelques éléments, il apparaît très vite que les réservoirs de croissance sont de trois ordres : - recentrer les activités des entreprises vers des secteurs à fort potentiel de recherche ou le développement de l'activité de recherche dans des secteurs, tels que les services, où traditionnellement elle est peu présente ; - attirer des entreprises étrangères dont l'activité de recherche est très développée ; - développer la recherche dans les PME. Or, sur le second point, il existe aussi des raisons d'être inquiet puisque l'on constate, ainsi que l'a rapporté à la mission Mme Catherine Lassale, directrice des affaires scientifiques, pharmaceutiques et médicales des Entreprises du médicament (LEEM), que de plus en plus de firmes pharmaceutiques internationales décident de fermer leurs laboratoires de recherche exploratoire situés sur le territoire français pour les implanter à l'étranger, notamment en Grande Bretagne ainsi que l'a fait récemment le leader mondial Pfizer. A l'évidence, la dernière solution offre seul un potentiel de croissance véritable et pérenne ce qui ne signifie pas qu'il faille pour autant négliger les deux autres options d'autant que la première est tout à fait compatible avec la dynamisation de la R&D dans les PME. Telle n'est malheureusement pas la tendance actuelle puisque, ainsi que l'affirme le rapport de l'OST déjà cité, « entre 1998 et 2001, la R&D est devenue, encore un peu plus, une affaire de grandes firmes. » 2. Des PME privées des moyens nécessaires pour innover La situation des PME françaises considérée du point de vue de la recherche est relativement paradoxale. Tandis qu'elles forment le cœur du tissu économique de notre pays tant au niveau de la richesse produite que de la main d'œuvre qu'elles occupent, leur place dans le tissu de la recherche est relativement marginale puisque les entreprises de moins de 250 salariés emploient seulement un quart des chercheurs en entreprise et exécutent 14 % de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE). Si l'on approfondit encore l'analyse, on se rend compte que plus de la moitié des entreprises français sont constituées par des structures de moins de 50 salariés qui contribuent de façon tout à fait marginale à la dépense de recherche (4,8 %). Recherche et développement par taille d'entreprises (données 2002)
(Source : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) L'existence d'un tissu aussi fourni de micro-entreprises distingue notamment la France des Etats-Unis où en moyenne les PME regroupent 19 personnes - contre 6 en France - et explique pour une large part que l'effort de recherche pour ce secteur soit moins important qu'il ne l'est outre-Atlantique. Nombre de ces entreprises sont en fait des entreprises artisanales qui n'investissent pas, ou très peu, dans la recherche. Deuxième élément qui ressort du tableau ci-dessus la position en retrait, à tous les niveaux, des entreprises moyennes, c'est-à-dire regroupant de 250 à 499 salariés. Ces entreprises constituent cet étrange paradoxe d'être moins nombreuses que les entreprises de la catégorie supérieure et d'investir moins dans la recherche que la catégorie inférieure. A tous points de vue, elles forment donc le ventre mou du tissu industriel et de recherche français. Emmanuel Leprince a très bien analysé cette situation - qui tend même à s'accentuer puisque, sur la période 1996-2001, la part des entreprises moyennes en recherche et développement est, selon l'OST, en recul - à laquelle il a apporté une explication fort convaincante. En comparant la structure des entreprises françaises à celle des entreprises américaines, il s'est rendu compte que ce qui marquait véritablement la césure entre les deux économies était la capacité du tissu industriel américain à engendrer de nouvelles entreprises de grande taille. Ainsi, parmi les mille plus grandes entreprises du monde, celles créées depuis 1980 sont au nombre de 88 aux Etats-Unis contre seulement 49 en Europe. L'écart est plus considérable encore et bondit dans un rapport de un à sept au détriment de l'Europe lorsqu'on écarte du recensement les entités nouvelles issues de fusion pour ne conserver que les créations ex nihilo de type Microsoft. Si, comme l'a indiqué M. Marc Vasseur, la généralisation du statut de la société par actions simplifiées (SAS) par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche puis la création du statut de jeune entreprise innovante (JEI) en loi de finances pour 2004, ont permis à la France de rattraper son retard en matière de création d'entreprises innovantes, ces dispositifs n'ont pas permis de lever la principale difficulté rencontrée par les petites entreprises européennes et, a fortiori, françaises : le fait qu'elles ne parviennent pas à grandir. Telle n'est évidemment pas la vocation de toutes les entreprises. Pour reprendre la typologie métaphorique établie par M. Emmanuel Leprince distinguant, d'un côté, les entreprises « naines », c'est-à-dire les entreprises artisanales ou les commerces de proximité, qui n'ont pas vocation à grandir, et, de l'autre, les entreprises « enfants », dont le but est de s'étendre, le problème de la France est que les entreprises « enfants » restent « enfants » et ne parviennent pas à grandir soit qu'elles restent petites ou bien se font absorber par les grands groupes dès qu'elles ont atteint une certaine taille. Plusieurs raisons concourent à ce phénomène parmi lesquels des raisons économiques - la frilosité des investisseurs -, des raisons règlementaires et des raisons culturelles. M. Emmanuel Leprince dénonce tout particulièrement la difficulté que rencontrent les PME pour accéder aux marchés des grands comptes, notamment publics, comme l'un des obstacles majeurs au développement des PME. Le cas des marchés publics passés par le ministère de la défense - premier acheteur de technologie en France qui concentre 70 % du marché national avec un total de commandes de 15 milliards d'euros - est sur ce point très éclairant : 85 % d'entre eux sont attribués sans concurrence faute d'acteurs européens différents capables de répondre aux appels d'offre et seuls 5 % de ces derniers reviennent à des PME. Une telle situation n'est satisfaisante ni pour les entreprises innovantes bien sûr ni pour l'administration qui se retrouve ainsi pieds et poings liés face à quelques grandes entreprises. Prenant exemple sur la réussite des Etats-Unis, il préconise que soit introduit en France une législation similaire au Small business innovation research (SBIR) program américain, réglementation initiée dès les années 1950 et amendée depuis qui réserve, selon le principe de discrimination positive, une part des marchés publics aux PME (40 % dans les domaines technologiques). Grâce à un traitement différencié de la concurrence, le dispositif permet aux PME de survivre et de prospérer. Le dispositif se justifie par le fait même que lui seul permet en réalité de maintenir une véritable concurrence. La réforme des fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) ainsi que l'annonce, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, le 12 octobre dernier, d'un rapprochement au sein d'un holding de l'Agence française de l'innovation (ANVAR) et de la Banque du développement des petites et moyennes entreprises (BDPME), laquelle proposera, entre autres, « une action de mobilisation positive pour permettre aux PME d'accéder aux marchés publics 25 », vont dans ce sens et sont autant de dispositions qui marquent la volonté du gouvernement d'agir avec détermination pour permettre aux PME d'atteindre la taille critique nécessaire à un positionnement international. Il n'en demeure pas moins que, selon les données fournies par M. Emmanuel Leprince à la mission, la France occupe la dernière place européenne pour ce qui est de la part des aides publiques à l'innovation revenant aux PME. Avec un taux de 9 % - filiales des grandes groupes comprises - tandis que le pourcentage est de 15 % en Allemagne, 18 % en Grande-Bretagne, 25 % en Suède, 38 % aux Pays-Bas et 70 % au Portugal (trois derniers pays pour lesquels la comparaison est moins pertinente puisque, en raison de leur taille, ils disposent de moins de grandes entreprises). Paradoxalement donc, en France, plus le chiffres d'affaires d'une entreprise est important, plus elle est susceptible d'obtenir des aides de l'Etat. 3. Une articulation public/privé à renforcer Il serait en effet erroné de croire qu'une recherche privée puissante puisse se développer sans l'appui des moyens publics. Ainsi, si l'on observe les taux d'exécution par les entreprises de recherche et développement sur financement public par aire géographique on constate, assez paradoxalement, que c'est aux Etats-Unis que la part des contrats publics destinés à la recherche et développement est la plus élevée où elle atteignait près de 10 % en 2001 tandis que celle-ci dépasse à peine les 8 % en Europe et en France. Même s'il ne fait pas de doute que l'effort considérable consenti par les Américains en faveur de la recherche militaire - qui contribue pour 52 % à la DIRD - pèse d'un poids très lourd dans ces commandes publiques et que, corrélativement, la faiblesse de la recherche dans ce secteur qui ne représente qu'un sixième de l'effort de recherche de ce côté-ci de l'atlantique est un frein au développement de ce type de financement en Europe. On note également qu'en France les financements publics pour la R&D des entreprises sont dirigés vers quelques secteurs d'activités et, au premier chef, vers l'aéronautique qui absorbe à lui seul près de 50 % des fonds alloués au titre des contrats publics de R&D pour la défense ou les grands programmes et dont 30 % des dépenses de R&D sont couvertes par l'apport public. A l'opposé de toute idée reçue, les Etats-Unis, pays de l'initiative privée et de l'économie libérale, sont donc également le pays qui injecte le plus d'argent public pour soutenir la recherche privée. Pour inciter au développement de la recherche en entreprises, la France a quant à elle mis l'accent sur les aides fiscales de type crédit d'impôt recherche. Dans l'ensemble, ce dispositif est plutôt considéré comme un bon outil d'incitation en direction des entreprises et ce même si certains souhaiteraient voir modifier les conditions nécessaires pour y prétendre, soit, comme le réclame M. Sylvain Collonge pour la CJC afin de favoriser l'emploi des jeunes chercheurs, en subordonnant l'accès au dispositif à l'embauche de docteurs, soit, comme le préconise M. Jean-François Dehcq pour favoriser la recherche dans les grands groupes de l'industrie pharmaceutique, en augmentant son plafond et en prenant en compte les recherches menées hors de l'hexagone dans la mesure où les impôts qu'elles génèrent reviennent à la France. D'autres, tels que M. Philippe Jurgensen, considèrent par contre que ces aides se traduisent par des effets d'aubaine pour les entreprises et ne suffisent donc pas à enraciner véritablement une recherche en entreprise. En la matière, il faut abandonner toute posture idéologique pour privilégier une approche pragmatique. M. Philippe Jurgensen et M. Alain Trautmann se rejoignent ainsi pour demander à ce que le soutien public à l'effort privé de recherche soit redirigé, sur le modèle américain, vers le recours aux commandes publiques plus efficaces à leurs yeux que l'incitation fiscale, notamment parce que les aides directes répondent à la problématique principale des entreprises innovantes qui est la difficulté à collecter des fonds propres. Interrogé par le Figaro - édition du mardi 26 octobre -, l'ex-commissaire européen à la recherche, M. Philippe Busquin, ne dit pas autre chose lorsqu'il déclare : « les commandes publiques ont un effet de masse critique très important pour la R&D, mais elles sont malheureusement très insuffisantes aujourd'hui en Europe notamment par rapport aux Etats-Unis. C'est, à mon avis, l'un des points clés : nous ne soutenons pas suffisamment nos entreprises par grand secteur d'activité. » Au plus haut niveau de l'Etat également la réflexion est en cours puisque le Président de la République a récemment confié à Jean-Louis Beffa, président-directeur général de Saint-Gobain une mission d'analyse et de proposition visant à définir les conditions d'une relance ambitieuse d'une politique de grands programmes scientifiques et technologiques dont les résultats sont attendus pour le 15 janvier 2005. Dans les faits, l'important est donc d'envisager les couples financement public - financement privé et opérateurs publics de recherche - opérateurs privés de recherche dans leurs interactions nécessaires et de trouver les moyens d'augmenter les synergies aussi bien dans le sens public-privé que dans le sens privé-public. Il ne fait pas de doute que, comme le montre l'exemple américain ou, à plus petite échelle, l'exemple finlandais, la clé d'une recherche performante, dans une économie moderne de plus en plus fondée sur la connaissance, se trouve dans la capacité des dispositifs de recherche à mobiliser tous les acteurs autour d'une dynamique et dans un but communs et d'établir, selon l'expression de M. Bernard Larrouturou, un continuum enseignement supérieur-recherche-innovation, c'est-à-dire une chaîne intégrée des différents métiers de la recherche. Or, de ce point de vue, les insuffisances du dispositif français sont patentes et la relation entre les entreprises et les opérateurs de la recherche académique très nettement perfectible. Au delà des frontières culturelles, déjà été évoquées plus haut, qui séparent les deux milieux, jadis hermétiques, aujourd'hui en voie de résorption, dont il ne faut toutefois pas mésestimer le poids qu'elles pèsent dans la difficulté rencontrée par ces deux milieux à travailler en symbiose, il existe des éléments objectifs et réglementaires qui freinent la mise en place de partenariats suivis entre les entreprises et les établissements de la recherche académique. Du côté de cette dernière, il existe indéniablement une faiblesse des structures de valorisation dont les personnes auditionnées s'accordent en général à dire qu'elles fonctionnent mal, exception faite de la structure de valorisation de l'Inserm, Inserm-Transfert, dont les résultats sont reconnus et qui bénéficie ici, à l'évidence, de la longue tradition de partenariats entre les chercheurs en santé et l'industrie pharmaceutique. Dans les autres cas, la valorisation est envisagée comme une activité subalterne à laquelle ne sont pas affectés ni les moyens financiers ni les moyens humains suffisants en nombre et en qualité de telle sorte que ces activités demeurent à l'état embryonnaire. Symptomatique également des difficiles relations entre la recherche académique et l'innovation, la question des brevets auxquels la recherche académique n'a pas suffisamment recours et qui pourtant nourrissent beaucoup d'illusions. En effet, que l'on considère les organismes de recherche ou les universités, la prise de brevets par ces institutions est notoirement insuffisante. Et d'aucuns pensent qu'une politique plus active en la matière est un moyen de financer durablement la recherche de ces établissements dans le futur. Or, l'exemple américain, souvent sollicité lorsqu'il s'agit de montrer à quoi peut ressembler un système de valorisation performant, montre que le revenu des brevets constitue un apport négligeable dans le budget des universités américaines. A l'exception de l'université de Yale où la part des revenus liés aux brevets déposés dans le budget de l'établissement est de 18,8 % - soit 282 millions de dollars -, les gains de transfert de technologie obtenus par les universités et qui ont considérablement crû après l'adoption du Bayh-Dole act (1980) 26, représentent environ 3 % de leur budget recherche et développement et une part négligeable - inférieure à 1 % - de leur budget total 27. L'expérience acquise, au cours des vingt dernières années, par les technology licensing offices (TLO) (bureaux de transferts de technologie) des universités américaines, montre en effet qu'au-dessous d'un certain niveau d'activité de recherche - de l'ordre de 40 millions de dollars par an - le TLO fonctionne à perte et donc que son existence n'est pas justifiée 28. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les brevets, s'ils peuvent générer des recettes importantes sont également générateurs de dépenses et que le ratio entre le nombre de brevets déposés et ceux qui rapportent est extrêmement faible. Ainsi que l'a déclaré aux membres de la mission, M. Pascal Iris, président d'Armines, on est là dans un « effet pépite » et la valorisation par le brevet relève à bien des titres de l'image d'Epinal. Contrairement à une pensée assez répandue, la valorisation n'est pas, loin de là, synonyme de brevets et la position en retrait de la France sur la question des brevets - à la quatrième place mondiale dans les deux systèmes de brevets, européen et américain, mais très loin derrière ses prédécesseurs, les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne - est réellement inquiétante, moins en raison des ressources financières dont se prive ainsi notre recherche académique qu'en ce qu'elle témoigne d'une recherche qui peine à prendre en compte les impératifs économiques. Au demeurant, les entreprises elles-mêmes, surtout celles de petites tailles, n'ont pas intérêt à se lancer dans la course aux brevets. Ainsi que le déclarait à la mission M. Alain Risbet, président du réseau CTI, les PME, dont l'horizon ne stratégique ne dépasse guère, en raison de la férocité des marchés, les deux ans, cherchent moins à déposer des brevets qu'à obtenir une réponse rapide à un problème technique qu'elles rencontrent. Et M. Jacques Lacambre de renchérir en affirmant que le secret est parfois une meilleure arme de défense de l'innovation que le brevet. La liaison public-privé doit dès lors plutôt s'envisager soit sur le mode de la recherche partenariale soit sur le mode de la recherche coopérative. Comme le rappelle M. Emmanuel Leprince, la première, également connue sous le nom de recherche collaborative (car elle associe contractuellement une entreprise et un laboratoire public qui décident de travailler en commun) possède un effet de levier bien plus important que la simple recherche coopérative. Mais elle est aussi la plus difficile à mettre en œuvre, d'autant plus que, comme il a été vu précédemment, la rigidité des règles de gestion de certains établissements publics ne favorise pas l'émergence de telles politiques contractuelles. Ainsi Armines, qui se définit comme une « association de recherche contractuelle partenaire de grandes écoles d'ingénieurs », offre à l'industrie la compétence des ingénieurs issus notamment de l'Ecole des mines de Paris où l'association est hébergée, en contrepartie de quoi les entreprises financent les laboratoires de recherche. Créée en 1967, Armines a ainsi réussi à se développer pour générer aujourd'hui un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros réalisé par cinq cents collaborateurs. Sauf qu'une telle structure, constituée en association de type loi de 1901, faute de cadre législatif et réglementaire précis, est aujourd'hui aux franges de la légalité. Si la loi n° 99-587 sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 a mis en place un statut de « service d'activités industrielle et commerciale (SAIC) », celui-ci est interne à l'université et, parce qu'il est soumis aux règles de la comptabilité publique, il n'est pas de nature à résoudre la problématique évoquée plus haut car il n'offre pas suffisamment de réactivité. De sorte que la législation n'a pas mis en place un cadre régissant la coopération entre les structures de recherche contractuelle de droit privé et les établissements d'enseignement supérieur auxquels elles sont adossées. De ce fait, les conventions qui les lient, organisant en particulier les modalités de la mise en commun de moyens matériels et humains pour la réalisation des travaux relevant de cette forme de recherche, sont juridiquement fragiles et exposent en permanence structures et dirigeants au risque d'être déclarés comptables de fait par les juridictions financières. M. Pascal Iris a particulièrement attiré l'attention de la mission sur ce point auquel, à l'évidence, il convient d'apporter une réponse. Enfin, la création par le gouvernement, en lieu et place des FRT et FNS, d'une agence nationale pour la recherche, et constituée en agence de moyens destinée à financer indifféremment les opérateurs de recherche publics ou privés selon la qualité de leurs projets est indéniablement un élément de nature à créer une plus grande dynamique entre ces deux ensembles. Du côté du secteur privé, les réticences culturelles associées aux freins constitués par une réglementation administrative tatillonne dissuadent beaucoup de bonnes volontés de mettre en place des partenariats avec les établissements publics de recherche. Quelques fondations existent, telles que la Fondation pour la recherche médicale (FRM), dont le fonctionnement est original puisqu'il associe un financement exclusivement d'origine privé et des actions menées uniquement par des opérateurs de la recherche publique, mais leur nombre est encore insuffisant. A ce titre aussi, la volonté affichée du gouvernement d'encourager la création de ce type de structures, sous la forme de « fondations de recherche », est une bonne chose pour inciter à la mise en relation de la recherche privée et de la recherche publique. Force est en effet de constater qu'au contraire de nos voisins les fondations sont encore très insuffisamment développées dans notre pays. Adossées sur la réforme du régime juridique et fiscal des fondations mise en œuvre par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, qui propose un nouveau statut-type de fondation d'utilité publique dotée d'un cadre fiscal incitatif, et plus particulièrement sur le statut type spécifique approuvé par le Conseil d'Etat en faveur des fondations à caractère scientifique ou des fondations de recherche, ces fondations ont vocation à mobiliser les ressources des particuliers ou des entreprises. La création en loi de finances initiale pour 2004 d'un « fonds des priorités de la recherche », abondé, à hauteur de 150 millions d'euros, par les recettes de privatisation via le compte d'affectation spéciale des produits de cessions de titres, parts et droits de société, a parachevé le dispositif en permettant à l'Etat de doter ces fondations, lors de leur création, d'un capital à concurrence de l'apport d'origine privée ou, par la suite, d'accompagner de nouveaux projets de fondations existences qui mobilisent, pour les réaliser, de nouveaux moyens auprès de partenaires privés. Le soutien en capital de l'Etat pourra également émaner de l'Agence nationale pour la recherche nouvellement créée. D'ores et déjà, dix projets de fondations à caractère scientifique suivent une procédure de reconnaissance d'utilité publique, parmi lesquels, ainsi que l'a confirmé à la mission M. Jacques Lacambre, une fondation de la sécurité routière, constituée avec la participation conjointe des groupes automobiles Renault et PSA. Si l'on peut, à l'instar de M. Alain Trautmann, s'interroger sur la validité scientifique de recherches menées avec un tel soutien des industriels concernés - quid en effet de la véracité de recherches sur les dangers sur la santé des ondes électromagnétiques menées par des opérateurs téléphoniques ? - il n'en demeure pas moins que de telles initiatives sont à encourager qu'elles prennent la forme préconisée par le gouvernement où se bornent à être des fondations d'entreprise, comme la fondation EADS. De fait, la création récente, le 4 septembre dernier, de cette fondation par le leader européen de l'aéronautique, témoigne à l'évidence d'un changement de culture dans la façon d'envisager l'articulation entre recherche privée et recherche publique. M. Philippe Camus, président-directeur général du groupe, ne cache d'ailleurs pas l'ambition « sociétale » d'une structure dont il a d'ores et déjà été décidé que 40 % de ses fonds iront au financement de programmes de réalisés par la recherche académique. DÉFI N° 10 : LA RECHERCHE ET L'EUROPE Présente en filigrane à tous les niveaux de la réflexion sur la recherche - qu'il s'agisse d'enseignement supérieur avec la mise en place de l'espace européen de la recherche (EER) ou de la question du financement avec l'objectif de Barcelone et le PCRD - l'Europe est relativement absente de la plupart des propositions formulées pour l'avenir de la recherche française qui concentrent avant tout leurs recommandations sur les aménagements à apporter au système national de recherche sans toujours l'envisager dans un espace plus vaste. Il ne fait pourtant pas de doute que l'avenir de la France passe par une meilleure intégration du dispositif de recherche au niveau européen. Un rapide aperçu des forces en présence sur la scène mondiale de la recherche montre que les impératifs de la compétition ont très largement débordé les ressources du cadre hexagonal. De fait, la France, à elles seule, n'est pas de taille à concurrencer les moyens mobilisés par un pays cinq fois plus peuplé et générateur de six fois plus de richesses, les Etats-Unis ; elle est encore moins de taille à affronter l'expansion annoncée du géant chinois. * Terre de sciences depuis la Grèce Antique jusqu'à la révolution pasteurienne, l'Europe est le berceau de la plupart disciplines dans les sciences dures comme dans les sciences humaines ; avec les universités puis les académies la première elle a créé les structures chargées de la développer ; créatrice du concept de protocole et de démarche scientifique, elle est enfin à l'origine même de la notion de science. Archimède, Pythagore, Copernic, Buffon, Newton, Lavoisier, Darwin, Pasteur etc. la liste est longue des scientifiques européens qui ont fait progresser la science mondiale et la connaissance humaine. Le réseau des universités du Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières... la science, le développement et la circulation des connaissances sont également à la naissance et au cœur même de l'idée européenne. De ce point de vue, ainsi que le rappelait fort opportunément M. Jacques Glowinski, dans une interview au Monde parue la veille de l'ouverture, au Collège de France, d'un colloque atour du thème « Science et conscience européenne », le 26 novembre dernier, « riche de traditions scientifiques et d'écoles de pensée vivaces, l'Europe n'a aucun complexe à avoir, notamment vis-à-vis des Etats-Unis ». Et pourtant, aujourd'hui, l'Europe, dans ses frontières de l'Union, est distancée par les Etats-Unis dans la compétition scientifique mondiale et ce, précisément, parce que le développement scientifique n'est pas au cœur du projet communautaire, parce que l'espace européen de la recherche n'est pas encore devenue une réalité de l'Union. En effet, tant que la Chine ne se sera pas totalement éveillée, l'Europe disposera de tous les moyens objectifs de s'imposer comme le leader mondial de la science. Qu'on regarde les chiffres : En terme de population, de richesse produite, de niveau de formation, l'Union européenne devance les Etats-Unis : 380 millions d'habitants contre 286 ; un PIB de 9 288 milliards d'euros contre un PIB de 8 814 milliards d'euros, enfin 2,14 millions de licenciés et de docteurs formés aux disciplines scientifiques contre 2,07 millions pour les Etats-Unis. Si l'on observe maintenant les indicateurs de la recherche la situation s'inverse quasi symétriquement. Qu'il s'agisse du nombre de chercheurs (1 271 000 aux Etats-Unis, 952 000 dans l'Union européenne), du financement de la recherche (242 milliards d'euros contre 163 milliards d'euros côté européen) ou du nombre de brevets, les Etats-Unis devancent l'Union européenne. Seule exception : la part mondiale de publications scientifiques de l'Union européenne, toutes disciplines confondues (à l'exception de la biologie fondamentale), dépasse celle des Etats-Unis. Conclusion, à quinze membres, déjà, l'Union européenne disposait de plus de ressources que les Etats-Unis ; le problème est qu'elle les mobilise moins. Tel est le paradoxe européen. Un effort de recherche européen qui atteint 2,6 % du PIB cumulé des pays qui composent l'Union et l'Europe ferait jeu égal avec les Etats-Unis. L'objectif de Barcelone de 3 % atteint et l'effort de recherche européen dépasserait de 15 % (36 milliards d'euros) l'effort de recherche américain. Il n'existe donc aucune raison objective pour que l'Europe se retrouve derrière les Etats-Unis et ce d'autant plus que, depuis Albert Einstein jusqu'à M. Finn E. Kydland, Norvégien, prix Nobel d'économie 2004, professeur dans les universités Carnegie-Mellon de Pittsburg et Santa Barbara de Californie, nombre de scientifiques qui font progresser la science américaine sont en vérité des scientifiques européens expatriés. La faute à un dispositif qui n'est pas suffisamment intégré qui conduit à ce que la science française concurrence la science britannique qui elle-même tente de s'imposer face à la science allemande tandis que, dans le même temps, les Etats-Unis disposent d'un dispositif unifié, tout entier et uniquement tendu vers la réussite du pays 29. Nécessaire au progrès la concurrence est ici, à l'évidence, stérile. Plus inquiétant encore, dans cet espace insuffisamment intégré, la France n'occupe pas la place qui devrait être la sienne. 1. L'insuffisante intégration de la recherche dans le dispositif communautaire L'histoire de la recherche européenne connaît une étape importante en 1951 avec la signature du traité de Paris et le lancement du premier programme commun de recherche sur le charbon et l'acier dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), première pierre à l'édifice de la construction européenne. Suivent ensuite de nombreuses coopérations européennes intergouvernementales mais celles-ci restent essentiellement nationales dans leur exécution : création du Conseil européen de recherche nucléaire (CERN) en 1954, institution du traité Euratom et mis en place du centre commun de recherche en 1957, création d'organisations à vocation scientifique et technologique, parmi lesquelles l'European molecular biology organisation (EMBO) en 1965 et l'EMB laboratory (EMBL) en 1969, l'European space agency (ESA) en 1973 et le programme Esprit en 1983. En fait, l'action politique majeure de la Communauté européenne en matière de financement de la recherche et du développement technologique n'a été introduite que tardivement, au milieu des années 1980, face au constat d'un déclin scientifique et technologique de l'Union, en particulier dans les secteurs technologiques de pointe, où sa position au sein de la « triade » - Union européenne, Etats-Unis, Japon - se détériorait progressivement. Le cadre du traité de Rome ne permettant guère à la Commission des communautés européennes d'intervenir dans ce champ, l'Acte unique a élevé la recherche et développement au rang de politique communautaire avec pour objectif « le renforcement des bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne, en vue du développement de sa compétitivité internationale. » 30 Cette politique communautaire s'est traduite par la mise en place d'un mécanisme à deux volets : d'une part un programme-cadre de recherche et de développement (PCRD) fixant, au terme d'une procédure complexe de codécision impliquant à la fois le Conseil européen et le Parlement, pour une période de cinq ans, les grandes lignes d'action, l'ampleur et les modalités de la participation financière de la Communauté européenne à la recherche et développement ; d'autre part, la mise en œuvre de ces programmes par l'intermédiaire de programmes spécifiques, développés à l'intérieur des actions envisagées. Depuis lors, cinq PCRD se sont succédés. A partir du quatrième (1994-1998) les activités communautaires de R&D dans le secteur non nucléaire ont été regroupées dans ce programme-cadre tandis que les activités de recherche et d'enseignement dans le secteur nucléaire étaient intégrées dans un programme-cadre Euratom distinct. Le PCRD actuellement en cours d'exécution est le sixième du nom et couvre la période 2002-2006. Il vise principalement à contribuer, conformément aux engagements pris au conseil européen de Lisbonne, à la création d'un véritable espace européen de la recherche (EER) et, à cette fin, met notamment en place de nouveaux instruments : réseaux d'excellence, projets intégrés, etc. En ce sens, il constitue une rupture par rapport aux programmes-cadres précédents, notamment en mettant en œuvre les dispositions de l'article 169 sur la coopération entre les Etats membres et l'Union européenne afin d'améliorer la coordination entre les différentes initiatives (régionales, nationales, européennes), la simplification des dispositif de mise en œuvre du programme, la décentralisation des procédures et la limitation à un nombre réduit de domaines de recherches prioritaires. Au final, et bien qu'il n'ait cessé de croître au cours des dernières années, le budget recherche et développement représente encore une part réduite du budget total de l'Union européenne, inférieure à 4 %. Avec un montant de 17,5 milliards d'euros pour cinq ans, le budget total du sixième PCRD, actuellement en cours d'exécution, est très loin de la dépense intérieure européenne puisque rapportée sur une année, le montant du PCRD ne représente que 2 % de celle-ci et 5,9 % de la part publique de la DIRD de l'Union européenne. Autre élément de comparaison, le PCRD représente annuellement, pour l'ensemble de l'Union, c'est-à-dire pour quinze pays hier, et vingt-cinq aujourd'hui, guère plus du tiers du budget civil de recherche et développement (BCRD) annuel français. Au-delà de ce principal outil d'intervention de la politique de recherche communautaire, d'autres programmes existent qui débordent le seul cadre de l'Union mais dans lesquels celle-ci joue un rôle important sinon prépondérant : c'est le cas de l'initiative Eurêka. Créée en 1985 par dix-huit Etats européens et la Communauté européenne pour renforcer la coopération entre les entreprises et les instituts de recherche dans le domaine des hautes technologies, celle-ci regroupe aujourd'hui trente quatre pays parmi lesquels tous les membres de l'Union européenne et finance environ 700 projets par an pour une somme totale d'environ 400 millions d'euros. Encore une fois, on constate que si les motifs qui ont conduit l'Union européenne à développer des politiques plus affirmées en matière de recherche puis ont justifié les objectifs ainsi définis sont identiques au constat effectué par les Etats-Unis devant la menace japonaise au cours des années 1970, la réponse européenne, aux vues de ses résultats, est très nettement insuffisante. Tandis que les Etats-Unis ont rapidement affirmé leur leadership en s'emparant des deux avancées technologiques majeurs du tournant du siècle - technologies de l'information et biotechnologies - la position européenne quant à elle demeure toujours fragile pour le présent et pour l'avenir, d'autant plus qu'il apparaît désormais évident que les objectifs de Lisbonne déclinés à Barcelone ne seront jamais atteint en 2010. 2. La position française dans la politique communautaire de recherche De ce fait, il est d'autant plus inquiétant de constater que, dans cet ensemble fragile et perfectible, la France n'occupe pas la place qui devrait être la sienne. Notre pays, deuxième pays de l'Union en terme de dépense intérieure de recherche, devant le Royaume Uni et devant l'Allemagne - pays qui, à eux trois, totalisent les deux tiers des dépenses de R&D des pays de l'Union européenne -n'est que troisième, derrière le Royaume-Uni, pour ce qui est de la participation au programme-cadre communautaire. Participation de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni au 5ème PCRD (1998-2002)
Source : OST Deux types d'explication ont été avancés par les personnes auditionnées par la mission pour expliquer cet état de faits. Tout d'abord, l'orientation des projets retenue par les instances européennes qui ne favoriserait pas la situation française. En la matière, l'analyse doit se faire en deux temps. D'une part, la France, en tant que membre de l'Union européenne, a son mot à dire sur les orientations retenues pour le PCRD. Et sur ce point, ainsi que l'a fait valoir M. Alain Risbet, président du réseau des CTI, il ne fait pas de doute que la fragmentation en interne de la thématique de la recherche au niveau ministériel n'est pas la meilleure façon de faire entendre la voix de la France auprès de nos partenaires européens. Deuxième élément, l'équilibre retenu par le PCRD entre le financement de projets dans les différents secteurs de la recherche qui favoriserait certains acteurs au détriment d'autres. En la matière, il est apparu difficile aux membres de la mission de démêler le faux du vrai tant chacun semble estimer que son domaine d'activité n'est pas assez couvert par le PCRD lorsque d'autres le serait de manière éhontée. A regarder les chiffres, on constate qu'il existe globalement un équilibre entre l'appui aux politiques publiques et l'incitation à l'innovation industrielle avec un petit avantage en faveur de cette dernière. En réalité, la seule certitude que l'on puisse tirer de ces revendications est le désir de tous les acteurs de pouvoir bénéficier de financements européens. Or, un obstacle majeur se dresse devant qui veut profiter de cette manne : la lourdeur excessive des dossiers de candidature, dénoncée par tous les interlocuteurs de la mission, sans exception. De telle sorte que seules les structures - qu'elles soient publiques ou privées - suffisamment grandes pour supporter l'emploi à plein de temps de personnes chargées du suivi de ces dossiers peuvent obtenir des aides - qu'elles obtiennent d'ailleurs in fine en règle générale - tandis que les petites structures, qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre une telle logistique, se découragent rapidement creusant un peu plus, dans le secteur privé, le fossé déjà constaté entre PME et grandes entreprises. Dès lors, il serait opportun, ainsi que le préconise M. Alain Risbet, de réfléchir aux moyens de mettre en œuvre des structures faisant l'interface entre l'Union européenne et les entreprises et les laboratoires sollicitant des aides européennes, sur le modèle de ce qui se fait en Allemagne où, comme le rappelait aux membres de la mission M. Alain Risbet, ont été mis en place des agences privées chargées de « chasser » les subventions lesquelles produisent d'excellents résultats. Plus globalement, et comme il apparaît, à l'évidence, que le niveau européen est le seul permettant d'offrir une masse critique suffisante pour lutter aujourd'hui avec les Etats-Unis et demain avec la Chine, la France, ainsi que l'ont appelés de leurs vœux nombre d'interlocuteurs de la mission, doit promouvoir une intégration plus forte de la politique de recherche au niveau européen. Loin de céder ainsi sa place dans l'échiquier mondial de la recherche, la France, en procédant de la sorte, renforcera sa position : quand bien même elle laisserait à d'autres pays de l'Union le soin, en lieu et place d'elle-même, de se spécialiser dans tel ou tel domaine, elle demeurerait à la fois au cœur du processus de décision - dans lequel il lui appartient de jouer un rôle moteur - et serait naturellement associée aux retombées d'une réussite, tandis qu'en l'état actuel des choses, dans beaucoup de domaines, les choses se décident aux Etats-Unis et au bénéfice des Américains. En ce sens, M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie des sciences a raison lorsqu'il plaide, en collaboration avec la fondation Nobel, pour faire aboutir l'idée de la création d'un conseil européen de la recherche offrant à la recherche européenne un véritable pilotage politique. Cette idée fait l'objet de réflexion au plus haut niveau européen, depuis la remise du rapport du groupe d'experts présidé par M. Federico Mayor (décembre 2003) jusqu'à, plus récemment, la publication par la Commission d'une communication intitulée L'Europe et la recherche fondamentale (janvier 2004) qui évoque la création de ce conseil dans le cadre de ses premières propositions pour le septième PCRD. A raison, comme nous l'a confirmé le ministre délégué à la recherche, M. François d'Aubert, la France encourage cette initiative qui trouve également le soutien de M. Janez Potočnik, nouveau commissaire européen à la science et à la recherche, comme elle avait trouvé celui de son prédécesseur à ce poste, M. Philippe Busquin. Dans les faits et en l'état actuel du projet, le conseil serait aussi une agence de moyens finançant des projets individuels de chercheurs sélectionnés selon une évaluation par les pairs après une mise en concurrence européenne sur le modèle de la National science foundation (NSF) américaine. Outre sa capacité à s'imposer comme un véritable outil d'intégration de la recherche européenne, une telle structure aurait l'avantage de mettre la recherche fondamentale au cœur du projet européen laquelle est pour l'instant quasiment exclue du PCRD dont ce n'est pas la mission. Au final, et comme l'affirme avec vigueur l'ancien et emblématique commissaire européen à la recherche, M. Philippe Busquin : « il faut d'abord croire en nous-mêmes et ne pas jouer perdant. Il faut également avoir une vision beaucoup plus positive, moins frileuse, du progrès scientifique. 31» C'est fort d'une telle conviction, pour l'Europe et pour la France, que les membres de la mission d'information ont formulé les propositions qui suivent. DEUXIÈME PARTIE : DESSINER UN AVENIR À LA RECHERCHE FRANÇAISE Refuser une fatalité qui s'exprime parfois sur le mode d'une « défaite annoncée », selon la formule de M. Christian Bréchot, qui l'utilise pour la dénoncer... La France est porteuse d'une tradition scientifique et pétrie d'atouts qu'absolument il ne faut pas gâcher. Or, si la France dispose à l'heure actuelle d'une position encore enviable dans le monde de la recherche, l'écart qui la sépare de ces devanciers tend à s'accroître tandis que la pression des pays émergeants qui la suivent se fait de plus en plus forte. Comme le rappelle le M. Christian Blanc, député des Yvelines, en ouverture de son rapport remis au Premier ministre en avril 2004 et intitulé Pour un écosystème de la croissance : « la France s'est résignée depuis quelques années à une place moyenne dans l'environnement économique mondial. Elle suit autant qu'elle le peut les impulsions données par les Etats-Unis, s'arrime aux mouvements technologiques qui en partent, y effectue des acquisitions coûteuses mais n'imagine pas pouvoir reprendre avec ses propres forces la maîtrise de son destin économique. » Retarder la réforme c'est donc condamner la recherche française à ne plus jouer à l'avenir sur la scène internationale que le rôle de faire-valoir quand la qualité et la compétence de ses chercheurs autoriseraient, si les moyens appropriés et l'organisation idoine était mis à sa disposition, qu'elle figure en haut de l'affiche. Depuis 1956 et le colloque de Caen, événement dont le souvenir reste très vif dans la mémoire des chercheurs, la communauté scientifique n'avait plus connu de mouvement de l'ampleur de celui qui a abouti à la réunion des états généraux de la recherche. A tous points de vue, la recherche française vit donc une situation historique : historique en raison des mutations de l'environnement international, historique en raison de la configuration nationale. Toutefois, la similitude ne doit pas conduire au mimétisme. Si le colloque de Caen a jeté les bases de l'organisation de la science française de l'après-guerre et permis les grandes réussites des Trente Glorieuses, c'est aussi que les propositions retenues avaient su, dans la mesure où cela s'avérait nécessaire, marquer une rupture avec la situation antérieure. Identité de la méthode, la future loi d'orientation et de programmation sur la recherche, devra savoir, dans une certaine mesure, s'extraire du passé pour adapter les structures, qui ont fait leurs preuves par le passé, dans la nouvelle ère qui s'annonce. Méconnaître cela serait à l'évidence manquer une chance historique. Ainsi que le déclare M. Edouard Brézin, « le côté positif de la crise est qu'elle a fait naître une prise de conscience de l'importance de la recherche pour l'avenir du pays et qu'elle impose de trouver les moyens d'en sortit. » L'urgence est d'autant plus forte et d'autant plus légitime que nous ne sommes pas ici dans l'incantation mais dans le champ du possible. Si, dans la définition du constat, les avis sont partagés, pour les préconisations de réformes, certains points de vue divergent. A l'écoute de tous, la mission d'information, à l'heure de définir des propositions, n'a cherché ni à opposer les uns aux autres ni à s'appuyer sur les uns au détriment des autres. Emanation de la représentation nationale, elle a avant tout cherché la cohésion de l'ensemble et l'émergence de l'intérêt général c'est-à-dire, en l'espèce, une recherche qui puisse assurer le rayonnement intellectuel et culturel du pays et lui offrir les fondements de sa compétitivité économique et les moyens de son indépendance stratégique. Telle est la philosophie du projet. L'ambition est délibérément haute mais s'appuie sur des propositions raisonnables et réalistes. Dessiner un avenir à la recherche française, c'est donc tout d'abord s'interroger sur les objectifs qu'elle doit poursuivre. Si la mission d'information a naturellement vocation à être une force de propositions, elle est entend néanmoins être également porteuse d'une méthode : définir le but à atteindre, s'appuyer sur des principes, envisager enfin les structures et les moyens. I.- OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉFORME Fort de sa tradition d'excellence scientifique, la recherche française a vocation à figurer parmi les toutes premières du monde. En raison de la taille de notre pays - il importe de ne jamais perdre de vue que la France ne concentre que 1 % de la population mondiale et entre 4 et 5 % de la richesse mondiale - et compte tenu de l'environnement international - position dominante des Etats-Unis et émergence rapide de la Chine - une telle ambition ne pourra se réaliser qu'au niveau européen, seul échelon disposant de la taille critique suffisante pour affronter, dans la compétition mondiale, le leader d'aujourd'hui et le géant de demain. C'est là, une condition nécessaire, la première, à laquelle devra répondre l'architecture du système de recherche qui ressortira de la future loi d'orientation et de programmation de la recherche : être euro compatible, c'est-à-dire pouvoir s'inscrire dans un dispositif de la recherche en voie d'intégration au niveau européen et disposer des atouts pour y figurer en meilleure place. Car c'est bien d'une architecture nouvelle dont la recherche française a besoin, comme l'ont démontrées les auditions aux membres de la mission. La crise actuelle et les ambitions pour demain réclament, comme l'ont montrés les états généraux de la recherche, des mesures fortes qui passent par une réflexion globale sur le dispositif de recherche tout entier et n'ont par l'adoption de simples mesures ponctuelles. D'emblée il convient cependant de préciser que ceci ne signifie évidemment pas faire table rase du passé. Bien au contraire, la recherche française doit conserver son héritage dans les réussites qu'il incarne mais également mettre fin aux dysfonctionnements avérés et prendre exemple sur la réussite de ses voisins pour rendre son fonctionnement plus performant. Avant d'évoquer deux exemples de dispositifs étrangers, encore faut-il décliner avec plus de précisions les objectifs qui doivent être ceux de la recherche française. En vérité, ils apparaissent en négatif des maux rencontré actuellement par la recherche française. Au premier rang de ceux-ci, on trouve la difficulté rencontrée par notre pays à assurer une continuité entre l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. La fragmentation joue en fait à deux niveaux successifs : - entre chacun de ces éléments, essentiellement pour des raisons qui tiennent à l'histoire et à la culture et qui font qu'on retrouve cette même fragmentation au plus haut niveau, dans l'organigramme gouvernemental, laquelle ne permet pas au ministre de la recherche de jouer son rôle de pilote stratégique 32 ; - à l'intérieur même de chacun de ces ensembles : l'enseignement supérieur est fragmenté entre les grandes écoles et les universités, la recherche académique est fragmentée entre les universités et les organismes de recherche dans, l'innovation est fragmentée entre PME et grandes entreprises. Tel est sans doute l'enseignement majeur retiré de ces quelques mois d'audition : le manque d'intégration et de fluidité entre tous les éléments qui composent le système de recherche français et le prive à la fois d'une utilisation optimum de ses ressources et, par voie de conséquence, d'une visibilité internationale. Or, précisément, l'exemple montre que les systèmes de recherche les plus performants sont précisément ceux où la liaison entre enseignement supérieur, recherche académique et recherche finalisée en entreprise est la mieux assurée, avec une impulsion forte donnée au plus haut niveau. 1. Les Etats-Unis : le double effet de la taille et du système Le système américain de recherche, le premier du monde, est entièrement tourné vers la réalisation de cet objectif : Au plus haut niveau, pas de ministère de la recherche mais un Office of science and technology policy (Office des politiques scientifiques et technologiques) dont le directeur est aussi conseiller scientifique du Président. Il donne les grandes orientations de la recherche conformément aux vœux présidentiels et sous réserve que le Congrès accepte les orientations ainsi arrêtées. L'unicité de la source de décision permet une traduction quasi immédiate du discours présidentiel dans les faits. Viennent ensuite, au niveau fédéral, des departements (départements ministériels), défense, énergie, etc. et des agences indépendantes - dont les plus connues sont la National science foundation (NSF), les National institutes of health (NIH) ou la National aeronautics and space administration (NASA) - qui constituent ou bien directement les opérateurs de recherche ou bien, dans la très grande majorité des cas, les interfaces entre le gouvernement et les laboratoires, à charge pour elles de distribuer les crédits fédéraux de façon à optimiser la réalisation des objectifs de recherche. Enfin, à l'autre bout du dispositif, on trouve les entreprises et les universités qui constituent les véritables opérateurs de la recherche américaine. Bien qu'elles réalisent 90 % de leurs recherches sur fonds propres les entreprises américaines, qui pourvoient aux deux tiers de l'effort de recherche américain, sont également vigilantes aux orientations impulsées par le pouvoir fédéral qui injecte chaque année vingt milliards de dollars pour la recherche dans le secteur marchand par l'intermédiaire de commandes publiques, notamment dans le secteur de la défense ; allié au Small business innovation research program (SBIR), qui réserve une partie des marchés publics aux PME, ce dispositif en direction des entreprises explique à la fois - outre des questions culturelles qui tiennent à la valorisation de l'initiative privée outre-Atlantique - que la recherche privée se porte bien et surtout qu'elle ne soit pas seulement le fait des grands groupes mais concerne également les PME à qui le système donne les moyens de se développer. L'Etat fédéral finance en revanche les deux tiers de l'effort universitaire de recherche, effort concentré à 96 % sur les établissements les mieux dotés, de sorte que certaines grandes universités reçoivent des subventions annuelles qui excèdent les 500 millions de dollars. Le point le plus original du système est le mode d'attribution des crédits. Les quatre cinquièmes des crédits fédéraux sont en effet distribués sous forme de subventions individuelles (grants) directement aux enseignants-chercheurs après procédure d'appels d'offre dont le cahier des charges a été défini au niveau fédéral. Une fois touchée la subvention, le chercheur est libre de la conduite scientifique et administrative qui fait ensuite l'objet d'un contrôle a posteriori, l'évaluation servant, pour la suite, de base pour le choix de l'attribution ou non des projets aux chercheurs. Le système est construit de telle sorte que le gouvernement fédéral américain dispose des moyens lui permettant d'orienter véritablement la recherche académique. C'est là un avantage comparatif décisif par rapport au système de recherche français tel qu'il existe aujourd'hui. Par ailleurs, le fait que la recherche académique soit concentrée dans un seul type de structure, en l'occurrence l'université, et concentrée dans un petit nombre d'entres elles - deux cents sur les quatre mille établissements d'enseignement supérieur que compte les Etats-Unis au total - est un moyen permettant d'obtenir plus aisément la taille critique nécessaire pour obtenir une visibilité internationale. Enfin, dernier point, outre la plus grande souplesse de gestion à tous les niveaux du système, les liens plus développés entre recherche académique et entreprise privée, notamment grâce à leur proximité géographique sur les campus, qui créé un environnement favorable à la recherche et à la diffusion des savoirs. 2. La Finlande : une réussite en dépit d'une taille réduite Plus près de nous, la Finlande, membre de l'Union européenne, constitue, à l'autre bout de l'échelle, un système intéressant qui montre qu'en dépit de moyens limités en raison de sa taille, un pays peut néanmoins disposer d'une recherche performante au niveau mondial grâce à une mobilisation importante des ressources nationales pour la recherche (le ration DIRD sur PIB est de 3,5 % excédant d'ores et déjà l'objectif de Barcelone) et à un dispositif performant. Ainsi, malgré un neuvième rang européen en terme de dépenses de recherche, la Finlande occupe un flatteur neuvième rang mondial, devant la France (douzième), pour ce qui est de l'impact à deux ans des publications et citations de sa recherche. M. Petteri Kauppinen, chargé de mission au ministère de l'éducation finlandais, a présenté aux membres de la mission le dispositif de recherche finlandais. Il en ressort les éléments suivants. Avant toute chose, il faut avoir à l'esprit que le système tel qu'il existe aujourd'hui résulte pour une large part de réformes qui ont suivi la grave crise qu'a connu la Finlande au milieu des années 1990 et au cours de laquelle le taux de chômage a atteint les 20 %. Preuve à la fois que de la crise peut naître la réforme et que la crise est aussi l'occasion de jeter les bases d'une ambition pour le futur. Tout comme le système américain, le dispositif finlandais ne comporte pas de ministre de la recherche. Au plus haut niveau, les compétences sont partagées entre le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement dispose, principalement via le ministère de l'éducation et celui du commerce et de l'industrie, de leviers importants pour conduire la recherche incarnés par des agences de moyens fonctionnant sur appel d'offres et par des opérateurs de recherche. Ainsi, le ministère de l'éducation a-t-il la tutelle de l'Académie de Finlande, agence de moyens en recherche fondamentale, et la responsabilité des universités tandis que le ministère du commerce et de l'industrie contrôle une agence de moyens pour les technologies, TEKES, et un opérateur de recherche en technologie, VTT. D'autres opérateurs existent qui dépendent d'autres ministères mais leur rôle est de moindre importance. En effet, TEKES et l'Académie de Finlande concentrent 40 % du budget de l'Etat en faveur de la recherche et les ministres de tutelles de ces deux agences sont également les représentants de la Finlande auprès de l'Union européenne pour les questions de recherche. Le gouvernement est assisté dans sa tâche par un conseil de la politique scientifique et technologique, présidé par le Premier ministre et composé de six autres ministres et de dix personnalités du monde de la science et des technologies. Ce conseil joue un rôle très important et ses avis sont généralement suivis par le gouvernement. C'est notamment le conseil qui, en plein marasme économique, a lancé l'idée de la mise en place d'un système d'innovation lequel a aboutit aux succès rencontrés dans les technologies de communication. Le Parlement dispose également d'un rôle très important dans l'orientation de la recherche via le SITRA, fonds pour la recherche et le développement qui a vocation à fournir aux entreprises innovantes le capital nécessaire à leur développement. Financé par les dividendes des actions de l'entreprise Nokia, cédées au fonds lors de sa création il y a une quinzaine d'années, ce fonds est uniquement placé sous la responsabilité du Parlement. Le système repose en outre sur une évaluation rigoureuse. L'Académie de Finlande est ainsi évaluée par un panel de chercheurs internationaux présidé actuellement par un britannique, le Pr. Michel Gibbons. De plus, on constate une volonté affirmée de développer les liens entre la recherche académique et l'innovation technologique. Près de 40 % des crédits de l'agence nationale de la technologie (TEKES) est destiné au financement de projets menés dans le cadre de l'université ou des instituts de recherche. Enfin, troisième trait caractéristique, les universités sont autonomes et les étudiants sont soumis à un examen pour y entrer. Des écoles doctorales ont été mises en place au début des années 1990 et la volonté politique est actuellement de renforcer les liens existant entre ces institutions et les entreprises. D'ores et déjà pourtant 70 % de la dépense intérieure de recherche finlandaise est assurée par les entreprises lesquelles embauchent également la moitié des chercheurs de Finlande. Avec quinze chercheurs pour mille personnes actives, le pays est, de loin, celui au monde qui mobilise le plus les ressources humaines dans l'activité de recherche. Une telle réussite a cependant un revers, c'est le poids que pèse une seule entreprise, Nokia, à la fois dans le dispositif de recherche privé où le constructeur de téléphones mobiles assure la moitié de la dépense de recherche mais également dans le dispositif de recherche tout entier puisque, à elle seule, la compagnie Nokia assure le tiers de la dépenses intérieure de recherche finlandaise. C. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉFORME A l'évidence, certains éléments de ces dispositifs de recherche sont de nature à inspirer la réforme dans notre pays. Pour autant, les changements à venir ne peuvent se limiter au simple décalque de systèmes éprouvés par ailleurs. Dans le domaine de la recherche, tout particulièrement, la France est riche de singularités dont il importe de tenir compte y compris lorsque l'objectif est de les inscrire dans la modernité. De sorte que la réforme à venir ne doit pas simplement s'attacher à poursuivre des objectifs ; elle doit également reposer sur quelques principes. 1. La vocation universelle de la recherche française Premièrement, la recherche française a naturellement vocation a embrasser toutes les disciplines de la science sans exclusive aucune. L'annonce, par le gouvernement, de la création d'une Agence nationale de la recherche (ANR) finançant les activités scientifiques sur la base de projets a pu faire craindre à une partie de la communauté chercheur que le gouvernement entendait désormais privilégier une recherche de type top-down au détriment de la recherche libre. Au-delà du fait que les équilibres financiers entre ces deux types de recherche penchent actuellement - et la mise en place de l'agence au 1er janvier de l'année prochaine n'y changera rien -, et de manière écrasante, en faveur du financement récurent de la recherche, le gouvernement et la représentation nationale sont tout à fait conscient de la nécessité de maintenir vivante et dynamique une recherche de type bottom-up. En effet, si dans une économie de plus en plus fondée sur la connaissance, il importe de développer une recherche dont les développements puissent constituer les fondements de la croissance économique de demain, il importe tout autant de ne pas se laisser enfermer dans une approche restrictive de la recherche qui ne ferait d'elle que la pourvoyeuse de l'économie. Ainsi que le montrent les exemples de l'ANRS ou de l'Institut Pasteur, dont l'action est reprise ou saluée partout dans le monde, la recherche, et notamment la recherche fondamentale, contribue au rayonnement intellectuel et culturel de notre pays. De sorte que ces deux éléments sont indissociables et leur addition nécessaire pour assurer l'indépendance à la fois économique et stratégique du pays. 2. Un dispositif décentralisé fondé sur la liberté et la responsabilité des acteurs Dans cet esprit, la gestion du dispositif de recherche doit reposer sur les deux principes suivants que sont la liberté et la responsabilité des acteurs, l'un et l'autre étant indissociables. Une telle évolution implique que les acteurs de la recherche académique, à tous les niveaux - établissements, laboratoires, équipes -, disposent d'une plus grande autonomie, notamment budgétaire. La gestion décentralisée, au plus près du terrain, doit donc être le mode de gestion privilégié, en contrepartie de quoi des mécanismes puissants de contrôle a posteriori de l'utilisation des fonds publics et d'évaluation de la qualité des recherches menées doivent être mis en place. 3. Une action lisible et raisonnée Par ailleurs, la poursuite d'une ambition universelle et le principe de la liberté de la recherche et des chercheurs ne s'opposent pas à la spécialisation de la recherche dans certains domaines. La science a désormais atteint un tel niveau de développement qu'il n'est plus possible, pour aucun pays, y compris les Etats-Unis, d'être performant dans toutes les disciplines scientifiques. Or, la capacité de notre pays à développer des stratégies, à définir des priorités et à obtenir des résultats semble s'être émoussée avec le temps. De ce point de vue, il est tristement éclairant de constater le décalage entre les priorités retenues lors de la dernière réunion du Comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST), le 1er juin 1999, lesquelles ont vocation à définir les grandes orientations de la recherche française pour le futur, et la réalité des spécialisations françaises dans les faits. Le CIRST avait proposé que la recherche française mette l'accent sur les sciences du vivant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'énergie et le développement durable ; cinq ans plus tard, la recherche française, dans son volet privé, est toujours prioritairement concentrée autour de ses deux traditionnels points forts que sont l'automobile et le bâtiment et les travaux publics. Plus grave encore, dans le domaine des sciences du vivant, et notamment de la recherche médicale, annoncés prioritaires, la France recule et se positionne désormais derrière l'Italie. Au final, la France se prive des ressources que lui procurerait soit directement, soit par ricochet, une position forte dans les domaines de recherche à fort potentiel économique que sont les biotechnologies ou les technologies de l'information et de la communication. Autre conséquence, le défaut de lisibilité de l'action en faveur de la recherche dans notre pays - et M. Pierre-André Périssol, dans son rapport pour avis sur les crédits de la recherche pour 2005 de s'interroger : « est-il plus facile aujourd'hui qu'hier pour le citoyen - et pour les parlementaires - de connaître les priorités de la recherche française, d'être informé des motifs qui ont conduit à choisir celles-ci plutôt que d'autres, du financement qui est alloué à leur réalisation et du calendrier retenu pour leur mise en œuvre ? » - ne favorise pas la mobilisation des citoyens autour de ce qui apparaît pourtant comme une priorité pour l'avenir du pays. 4. La nation associée à la politique de recherche Dernier principe qui doit présider à la réforme, la mobilisation des chercheurs et de la nation toute entière. La consultation des chercheurs qui a été très largement entamée avec le vaste mouvement de réflexion qui a aboutit aux états généraux de la recherche de Grenoble était, et est encore, un préalable nécessaire à l'acceptabilité sociale de la réforme sans quoi celle-ci, quelle qu'elle soit, n'a aucune chance d'aboutir. C'est là un préalable nécessaire mais non suffisant. En effet, dans la mesure où la définition des orientations et de l'organisation de la recherche publique engage les finances de l'Etat - dans un mouvement qui tend à s'accroître - et où, à bien des égards, elle conditionne l'avenir de la nation, elle doit faire l'objet d'un consensus qui déborde le seul cadre de la communauté des chercheurs pour atteindre celui de la communauté nationale toute entière. La bienveillance avec laquelle ils ont accueilli le mouvement des chercheurs en début d'années puis le soutien qu'ils lui ont apporté montre que les Français ne sont pas indifférents à une problématique dont ils cernent très bien l'importance des enjeux qu'elle recouvre. Toutefois, force est de constater, qu'à bien des égards, la science, à quelques exceptions près, suscite aujourd'hui dans notre pays plus de craintes que d'espoirs et que la cause de la science n'est pas toujours la cause des Français. Ainsi que le déplorait le premier des scientifiques français, M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie, « une telle mobilisation n'a jamais eu lieu » et de plaider pour que « quelqu'un fasse pour la recherche ce qu'André Malraux a fait en son temps pour la culture : entraîner tous les Français derrière une ambition commune ». La représentation nationale est prête à assumer ce rôle. II.- TREIZE PROPOSITIONS DE RÉFORME Les semaines qui se sont écoulés depuis le mois de janvier et l'apparition au grand jour de la crise ont été fertiles en propositions de toutes sortes. De multiples instances ont contribué à l'inflation du nombre des rapports sur le sujet. Le Réformoscope, outil de synthèse pour mieux voir où nous mènent les propositions de réformes ainsi que l'affirment leurs auteurs, MM. Bernard David et Rémi Barré, au nom de l'opération FutuRIS, en dénombre pas moins de vingt-trois. Au-delà des éléments qu'elle a pu consigner au cours des auditions qu'elle a menées, la mission, dans son travail de réflexion, a été très attentive à ces propositions et, tout particulièrement, à celles formulées par la communauté des chercheurs réunies dans le rapport issu des états généraux de la recherche. PROPOSITION N° 1 : Renforcer le pilotage stratégique Cette proposition se décline en fait en deux recommandations : - mettre en place un grand ministère de la recherche de plein exercice dont les attributions regrouperaient l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et embrasseraient de la sorte toute la chaîne de la connaissance et de l'innovation. Eu égard à la tradition française en la matière, même s'il apparaît difficile de figer dans la loi le périmètre des attributions ministérielles, il convient de réaliser cette recommandation qui marquerait la priorité accordée par le gouvernement à la recherche et renforcerait la cohésion de l'action publique en la matière notamment vis-à-vis des institutions de l'Union européenne. De plus, une telle organisation limiterait par définition le nombre de tutelles auxquels sont soumis les établissements publics de recherche. Enfin, la mise en place de ce grand ministère aurait l'avantage de mettre en cohérence la responsabilité gouvernementale avec les leviers budgétaires. En effet, aux termes de la maquette de présentation des crédits retenue pour l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 - dont les dispositions entreront en vigueur dès l'année prochaine, pour la préparation et l'adoption du budget 2006 -, la mission interministérielle de la recherche et de l'enseignement supérieur est composé de treize programmes dont six seulement relèvent, à ce jour, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. - créer un Haut conseil de la science et des technologies. Placé auprès du Premier ministre, afin de bien marquer la priorité accordée par la nation aux sciences et à la technologie et d'affirmer le caractère transversal de l'activité de recherche, ce conseil viendrait se substituer aux différents comités et conseils actuellement chargés de conseiller le ministre délégué à la recherche dans son action. Ce conseil serait composé de scientifiques représentant les différents domaines de la science, pour partie nommés par le Premier ministre, pour partie désignés par leurs pairs, de représentants des entreprises innovantes ou des grandes entreprises très investies dans la recherche et le développement, de parlementaires désignés par leurs assemblées respectives, de représentants de la société civile et, afin d'obtenir l'éclairage le plus transparent possible, d'un ou deux chercheurs étrangers dont la voix au conseil serait consultative. Le Premier ministre serait président de droit du conseil dont la vice-présidence reviendrait à un scientifique. Le conseil serait consulté pour avis sur chaque projet de loi de finances ainsi que sur chaque projet de loi intéressant les secteurs de la recherche et de l'innovation. Tous les deux ans, il lui reviendrait de remettre au gouvernement et de présenter au Parlement un rapport sur l'état et les perspectives d'avenir de la recherche française dans lequel il recommanderait des orientations pour la politique de recherche et établirait notamment des éléments de prospective à long terme sur les enjeux stratégiques de la recherche (biotechnologies, nanobiotechnolgies, etc.) en indiquant quelles doivent être les disciplines dont l'étude est à privilégier. Enfin, le conseil disposerait d'un droit d'auto-saisine pour produire un avis sur tout sujet qui lui semblerait bon. PROPOSITION N° 2 : Encourager le financement sur la base de projets Les exemples internationaux, américain ou finlandais, ainsi que l'exemple, sur notre territoire, de l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), dirigée par le Pr. Michel Kazatchkine - dont tout le monde, chercheurs français comme chercheurs étrangers, dans une rare unanimité, s'accorde à louer le travail remarquable qu'elle mène lequel a permis à la France de s'affirmer comme le deuxième pays au monde dans le combat contre le sida -, démontrent combien les agences de moyens constituent une structure efficace pour relayer sur le terrain les orientations de recherche décidées par le pouvoir politique. Organisation administrative à la fois souple et légère, l'agence est une structure idéale pour développer des recherches de qualité. Or, pour l'instant, force est de constater que ce type de structure ainsi que le mode de financement qui l'accompagne est très peu développé dans notre pays et qu'il convient donc de les encourager. La création, en loi de finances initiale pour 2005, d'une Agence nationale de la recherche (ANR) prenant le relais des actions incitatives conduites antérieurement au titre du Fonds de la recherche et de la technologie (FRT) et du Fonds national de la science (FNS) va indéniablement dans le bon sens mais sa dotation, malgré l'effort consenti par le gouvernement, reste encore trop limitée puisqu'elle représente à peine 4 % de l'effort public de recherche. Par ailleurs, en établissant un lien direct entre le donneur d'ordre et l'opérateur de recherche, les agences de moyens permettent de rationaliser l'organisation du dispositif de recherche. Actuellement on constate en effet que des recherches effectuées par des organismes publics de recherche différents se chevauchent. C'est ainsi que l'Inserm, le CEA et le CNRS mènent des travaux concurrents sur des thématiques similaires en biotechnologies, domaine que ne recouvrait pas initialement le champ de recherche des deux premiers établissements mais vers lequel ils se sont néanmoins dirigés pressentant tout le bénéfice qu'ils pouvaient en retirer. De telles concurrences inutiles n'auraient pas lieu avec un système de financement sur projet puisque, ou bien un seul établissement disposerait d'un financement, ou bien les établissements s'associeraient pour remporter l'appel d'offre. Rappelons également qu'in fine le financement sur la base de projets n'a pas vocation à se substituer complètement au financement récurrent de la recherche. Il importe en effet de maintenir un secteur important de recherche dite libre. PROPOSITION N° 3 : Assouplir les règles de gestion des établissements publics de recherche Les règles de gestion et notamment de comptabilité publique auxquelles sont soumises les EPST sont inadaptées à la réactivité désormais nécessaire dans un espace mondial de la recherche de plus en plus concurrentiel. L'article 59 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit qui dispose que « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour ouvrir la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique de déroger au régime budgétaire et comptable qui leur est applicable et présenter leur comptabilité selon les usages du commerce » offre à ce problème une première forme de réponse. Encore faut-il que les établissements saisissent la faculté qui leur est offerte. In fine, il conviendrait de substituer à un contrôle de gestion a priori qui ralentit la recherche et ne constitue pas forcément la meilleure garantie d'une utilisation raisonnée des fonds publics un contrôle a posteriori lequel favorise une plus grande réactivité et, de plus, à l'avantage de responsabiliser les acteurs. De la même manière, il conviendrait de favoriser le fonctionnement des équipes en coût complet avec attribution des financements au directeur de recherche charge à lui de les répartir ensuite selon l'emploi qu'il juge le meilleur. Dans les faits, une telle évolution serait entièrement réalisée par la transformation des EPST en EPIC. Il conviendrait également de donner la possibilité aux établissements constitués en groupements d'intérêt public (GIP), tels que l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) ou la future Agence nationale de la recherche (ANR), qui va être constituée sur le même modèle, de recruter directement leurs employés. Faute de pouvoir disposer de cette faculté, le personnel de l'ANRS est actuellement constitué de personnes mises à disposition par les EPST. C'est là un frein à une gestion réactive pour une structure qui, par ailleurs, est soumise à une réglementation très souple. Enfin, autre simplification administrative, il conviendrait de mettre fin à la pratique des tutelles multiples dans les unités mixtes de recherche (UMR) laquelle n'a d'autre effet que d'alourdir les procédures administratives et les circuits de gestion. En toute logique, la tutelle unique devrait revenir à l'établissement qui est le plus impliqué dans l'unité (en terme de moyens humains, financiers ou de locaux mis à la disposition de l'UMR) sauf si les parties en présence en décident autrement. Dans le même ordre d'idée, certains organismes de recherche disposent de représentations à l'étranger et il arrive que plusieurs organismes disposent chacun d'un bureau dans une même ville. Par souci de rationalisation, il conviendrait d'encourager les organismes à mutualiser leurs ressources. PROPOSITION N° 4 : Renforcer le dispositif d'évaluation La mise en place d'un système d'évaluation est le pendant indispensable au développement du financement de la recherche sur la base de projets et de l'assouplissement des règles de gestion des établissements publics de recherche. Clé de voûte d'un système de recherche performant, l'évaluation doit permettre de distinguer les meilleurs établissements, les meilleures équipes et les meilleurs chercheurs afin qu'ils soient récompensés de leurs efforts. En l'espèce, la mission ne se prononce pas sur la forme que doivent prendre les structures chargées de cette évaluation. Les organismes d'évaluation actuels, tels que le Comité national de la recherche scientifique ou bien le Comité national des universités (CNU), ont naturellement vocation à subsister dans la mesure où ils se réforment pour répondre aux principes suivants : évaluation systématique de tous les personnels à intervalles réguliers (au maximum tous les deux ans), évaluation a posteriori des équipes une fois achevé un projet financé par une agence de moyens, maintien du principe du jugement par les pairs mais réduction de la part des chercheurs élus dans les instances d'évaluation et ouverture de ces instances aux chercheurs étrangers (sur le modèle de ce qui se fait à l'Institut Pasteur ou en Finlande), prise en compte, dans l'évaluation, des activités d'enseignement pour les enseignants-chercheurs et pour tous les chercheurs, de la capacité à valoriser les résultats de la recherche et des mobilités effectuées dans d'autres structures de la recherche académique ou dans le secteur privé. Plutôt que d'imposer de nouvelles structures qui risquent de n'aboutir qu'à plus de bureaucratie mieux vaut en effet privilégier la validation des bonnes pratiques et une évaluation disposant de relais au plus près des laboratoires et de chercheurs. De fait, l'évaluation ne pourra produire ses effets que dans la mesure où la méthode sur laquelle elle se fonde et donc les résultats auxquels elle aboutit sont partagés par tous et perçus comme incontestables. PROPOSITION N° 5 : Revaloriser l'emploi scientifique L'évaluation n'a de sens que dans la mesure où ses résultats se traduisent par un traitement différencié des organismes, des laboratoires et des chercheurs. Il est en effet impératif d'encourager les structures et les chercheurs qui auront fait le plus d'effort ou qui ont le plus de talent et de rompre avec une égalité de façade. Un tel projet doit notamment se traduire par l'attribution des projets de recherche les plus intéressants et de moyens substantiellement supérieurs à ceux qui auront fait preuve de la plus grande compétence de telle sorte que celle-ci soit véritablement encouragée et que les meilleurs chercheurs ne soient pas contraints de s'exiler pour trouver les moyens de conduire leur recherche. Toutefois, une telle évolution se heurte pour l'instant au statut des chercheurs qui ne permet pas un traitement suffisamment différencié des personnes. Il convient donc d'assouplir ce statut afin que des primes conséquentes puissent être versées à ceux qui le méritent et que les établissements qui le désirent puissent proposer à des chercheurs de classe mondiale un salaire aligné sur les tarifs en vigueur au niveau international. De la même manière, la linéarité des carrières ne doit pas être la règle. Il faut encourager les chercheurs et les enseignants-chercheurs à la mobilité, entre organismes et universités, depuis la recherche académique vers l'entreprise et, pour les enseignants-chercheurs, il faudrait mettre en place un système de modulation des charges respective de recherche et de cours dont la clé de répartition tiendrait compte de trois critères : le souhait des chercheurs pour leur évolution de carrières, les besoins respectifs de la recherche et de l'enseignement, les résultats de l'évaluation. Parallèlement, les règles de recrutement doivent être revues et se faire désormais au plus près du terrain par les laboratoires et les directeurs de recherche eux-mêmes de sorte que le personnel recruté corresponde effectivement aux besoins de la recherche en cours, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas aujourd'hui. PROPOSITION N° 6 : Renforcer l'autonomie des universités Une telle politique de recrutement, condition sine qua none au développement de la mise en œuvre d'une véritable politique d'établissement, ne pourra se faire, au niveau de la recherche universitaire, que grâce à une plus grande autonomie administrative des universités lesquelles, en l'état actuel de leur organisation, sont dépourvues de deux leviers primordiaux pour la conduite stratégique de leur établissement : la gestion des personnels et la gestion des locaux. Ainsi que le rappelle M. Michel Herbillon dans le rapport d'information qu'il a rédigé pour la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée nationale 33, « après avoir franchi avec succès l'étape de la massification de l'enseignement supérieur, le défi est désormais qualitatif ». Autant le défi de la massification requerrait un contrôle fort de l'Etat sur l'institution, autant le défi de la qualité requiert une autonomie accrue. La mise en place d'un budget global accompagné de règles de gestion relativement souples permettant à l'université de nouer des partenariats avec d'autres établissements d'enseignements supérieurs, des organismes de recherche (et notamment le CNRS dont les missions, très axées sur la recherche fondamentale, sont les plus proches de celles de l'université) et des entreprises, ainsi que de s'associer plus étroitement avec des universités étrangères sont les conditions nécessaires pour que les universités françaises figurent en bonne place dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se met actuellement en place. Par ailleurs, la mission estime que l'argument, souvent entendu, selon lequel, en l'état actuel de son organisation et de son mode de fonctionnement, l'université n'est pas capable d'affronter une telle réforme n'est pas recevable. D'une part parce que les situations sont différentes d'une université à l'autre et d'autre part parce qu'il ne faut pas infantiliser les établissements. Bien au contraire, il faut mettre les instances universitaires devant leurs responsabilités quitte au besoin à procéder par expérimentation auprès des établissements jugés les plus aptes à recevoir la réforme. D'ores et déjà, la mise en place d'une mesure simple autorisant le renouvellement du mandat des présidents d'université favoriserait l'ébauche d'une politique d'établissement dans les universités. PROPOSITION N° 7 : Développer des pôles de compétitivité A l'évidence, et c'est un des enseignements majeurs du classement mondial des universités réalisé par l'université de Shangaï, la fragmentation du tissu de recherche académique français - partagé entre les organismes publics, les universités et les grandes écoles - ne permet pas à la recherche française d'obtenir la visibilité qui devrait être la sienne sur la scène internationale. En conséquence il apparaît urgent que, sur un territoire donné, les différents acteurs de la recherche, universités, grandes écoles, organismes de recherche, entreprises, collectivités locales s'associent et nouent des liens contractuels - facilités par la réforme des règles de gestion administrative des établissements publics - pour coordonner et concentrer leurs efforts dans quelques domaines de recherche précis. Là encore, la constitution de ces « pôles de compétitivité », pour reprendre l'expression du gouvernement, ou de « pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) », pour reprendre la dénomination issue des états généraux de la recherche, ne doit pas être décidée d'en haut mais là où la nécessité s'en fait sentir et au lieu où les acteurs sont capables de mettre en œuvre des synergies. L'expérience qui, en l'espèce, prend les traits du site de Grenoble, unanimement salué comme la plus grande réussite de constitution d'un campus à la française, montre en effet que la réussite ne se décrète pas. La clé d'un succès durable est la volonté d'hommes et de femmes de travailler ensemble et de bâtir, sur une aire géographique donnée, un projet et une ambition commune. Le campus de Grenoble s'est ainsi constitué à partir de l'après-guerre sous l'impulsion d'un homme, M. Louis Néel, prix Nobel de physique 1970, autour d'une université, de grandes écoles - Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) -, d'organismes de recherche (CEA et CNRS) et d'entreprises de haute technologie (STMicroelectronics). En conséquence, la constitution de ces pôles doit à tout prix se faire hors de tout dogmatisme. Ainsi, là où les circonstances le nécessite, des pôles peuvent être créer autour de grandes écoles plutôt qu'autour d'une université, l'important, en la matière, étant que le lien entre enseignement supérieur et recherche puis entre recherche et innovation soit maintenu. La constitution de ces pôles doit également répondre au souci de la poursuite de l'excellence. Transformer en pôles chacune des 84 universités actuelles irait à l'encontre du but recherché et dénaturerait l'esprit même de la réforme. La mise en place de réseaux interuniversitaires, sur le modèle des communautés de commune, est le moyen de lever la contradiction entre la recherche de l'excellence scientifique et les contraintes de l'aménagement du territoire. Ainsi, afin de ne pas remettre en cause ni le maillage universitaire du territoire ni la double dimension de celle-ci de formation à et par la recherche, il serait envisageable, parallèlement à la mise en place de pôles de compétitivités, de créer des réseaux inter-universités permettant aux « petites » universités de s'associer à des établissements pôles pour le développement de leurs activités de recherche de façon à maintenir l'ancrage local des universités sans obérer leur vocation internationale, notamment leur capacité à nouer des partenariats au niveau européen et à attirer des financements communautaires. Dans ce schéma, un professeur pourrait très bien enseigner dans une université et poursuivre ses recherches dans une autre. L'Etat n'interviendra qu'a posteriori pour valider les projets viables et répondant aux conditions posées ci-dessus. Des mesures d'incitations fiscales et le versement de crédits supplémentaires aux acteurs de la recherche académique qui, naturellement, auront vocation à devenir les premiers destinataires des financements sur projets distribués par l'ANR dans la mesure où ils auront fait la preuve de leur excellence scientifique, compléteront le dispositif en le rendant encore plus attractif. D'ores et déjà, le gouvernement a annoncé, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, que les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans un des pôles de compétitivité labellisés bénéficieront d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties (sous réserve de la décision des collectivités locales), ainsi que d'allégements de cotisations sociales patronales relatives aux rémunérations des salariés affectés aux projets de R&D. Ces derniers seront de 50 % pour les PME et de 25 % pour les autres. Une telle proposition apporte en outre une amorce de réponse aux problèmes rencontrés par les jeunes chercheurs. En favorisant le développement des liens entre l'enseignement supérieur, la recherche et le monde de l'entreprise, les pôles constituent indéniablement un moyen de lutter contre le cloisonnement des acteurs et un moyen de favoriser la reconnaissance du diplôme de docteur. PROPOSITION N° 8 : Augmenter significativement le financement de la recherche Le sous-financement chronique de la recherche et le caractère erratique de ce financement ont constitué, à l'évidence, le creuset de l'effritement de la position de la science française sur la scène internationale et, par suite, ont nourri le malaise des chercheurs. A tous les niveaux, dans les organismes, dans les universités, une augmentation significative et immédiate des crédits est nécessaire au simple maintien de l'activité de recherche. Toutefois, les auditions ont convaincu les membres de la mission que réinjecter massivement des crédits dans le système actuel sans le réformer reviendrait à une simple politique de saupoudrage qui ne parviendrait pas à redresser la situation de la recherche française et ne satisferait pas aux revendications de la communauté des chercheurs. Si, en l'état actuel du dispositif de la recherche, l'augmentation des crédits est un préalable à la réforme, à l'avenir, la réforme des structures est le préalable à une augmentation des crédits. C'est donc à dessein et pour bien marquer la volonté de la mission que le futur projet de loi d'orientation et de programmation ne masque pas, derrière un relèvement des crédits de la recherche, une reconduction en l'état, avec ses faiblesses, du dispositif de recherche, faisant ainsi fi de la volonté de réforme de la communauté des chercheurs et de l'ambition de la France dans ce domaine, que la mission n'a inscrit cette proposition qu'en huitième position. Le relèvement des crédits de la recherche est nécessaire. Il est urgent et doit être significatif mais il doit absolument s'accompagner d'une réforme profonde du système dont les grands traits font l'objet des sept propositions qui précèdent. Concernant le rythme de croissance des crédits, l'effort important consenti par le gouvernement en loi de finances pour 2005 doit être poursuivi au moins au cours des trois années à venir dans son volume - un milliard d'euros supplémentaire par an - mais révisé dans ses modalités. En effet, plutôt qu'un partage par tiers des crédits supplémentaires - un tiers pour le financement récurrent des organismes de recherche, un tiers pour le financement des incitations fiscales en direction des entreprises, un tiers pour le financement sur projets via l'ANR -, il conviendrait d'accentuer davantage le financement sur projet au détriment du financement récurrent. Une telle inflexion n'a pas pour but de déséquilibrer les organismes de recherche puisque, in fine, ils ont vocation à être les destinataires de ces crédits mais de favoriser la généralisation des bonnes pratiques en augmentant avant tout les moyens et les revenus des chercheurs les plus méritants. Par ailleurs, et sans préjuger des conclusions des travaux menés par la mission d'analyse et de proposition visant à définir les conditions d'une relance ambitieuse d'une politique de grands programmes scientifiques et technologiques dont la présidence a été confiée, par le Chef de l'Etat, M. Jacques Chirac, à M. Jean-Louis Beffa, président-directeur général de Saint-Gobain, il convient de réfléchir aux moyens de développer une politique de commandes publiques. L'exemple américain montre en effet qu'il s'agit là d'un outil efficace pour développer la recherche en entreprise. Toutefois, la mise en place de ces aides directes risquerait de se heurter aux règles communautaires du respect de la concurrence. Ainsi que l'a indiqué le ministre délégué à la recherche, M. François d'Aubert, aux membres de la mission qui l'interrogeaient sur ce point, la seule voie pour mettre en place un tel dispositif est sans doute de l'élaborer au niveau européen. D'ores et déjà, les membres de la mission plaide pour que la France encourage l'aboutissement d'une telle négociation auprès des institutions européennes. De la même manière, la mission soutient très fortement la démarche du Président de la République, M. Jacques Chirac, visant à ce que les crédits de la recherche ne soient pas pris en compte pour le calcul du respect des règles du pacte de stabilité. Enfin, sans entrer dans une analyse prospective à long terme, la mission attire toutefois l'attention des futurs gouvernements sur le fait qu'il est absolument nécessaire que les crédits de la recherche, dans la mesure où ils financent une activité qui engage durablement l'avenir de la nation, ne fassent pas l'objet de soubresauts et ne soient pas considérés comme des variables d'ajustement dans lesquels il peut être puisé pour financer des actions conjoncturelles. Ceci est d'autant plus important que la recherche est une activité de longue haleine et qu'une baisse brutale des crédits peut interrompre et réduire à néant, en l'espace de quelques mois, un effort de plusieurs années. En ce sens, les financements versés sur la base de projets via l'agence de moyens devront absolument être sanctuarisés et au fur et à mesure des années - dans le cas d'un projet pluriannuel - correspondre strictement au montant annoncé au début de la recherche. Ce contrat de confiance, entre les chercheurs et l'Etat, est indispensable au développement de ce mode de financement. PROPOSITION N° 9 : Mettre en place une véritable politique en direction des jeunes chercheurs Face à la « désespérance », selon l'expression de M. Philippe Kourilsy, de plus en plus de jeunes chercheurs, il importe de mettre en œuvre une politique énergique. Celle-ci doit intervenir à deux niveaux : au cours du doctorat, pour accompagner le jeune dans la réussite de sa thèse, et, une fois celle-ci obtenue, pour favoriser l'entrée des jeunes chercheurs dans le monde du travail. - Au niveau du doctorat, les moyens des écoles doctorales doivent être renforcées afin de limiter le nombre beaucoup trop important d'abandon de thèses et de favoriser, sans remettre en cause le principe de la liberté de la recherche, le choix par les étudiants de sujets porteurs pour leur avenir et l'avenir de la science française. Les aides financières mises à la disposition des doctorants doivent également faire l'objet de réformes. Le système des bourses, actuellement trop complexe, doit être rationalisé et simplifié. Le montant de l'allocation de recherche doit être revalorisé au niveau du SMIC puis indexé sur l'inflation. Enfin, il doit être mis fin à la pratique des « libéralités » comme le gouvernement s'y est engagé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005. - Une fois que les jeunes chercheurs ont obtenus leur doctorat, il convient de mettre à leur disposition des « packages », c'est-à-dire des contrats courts, d'une durée de deux à quatre ans, correspondant à la durée de la recherche, et financés, de manière conséquente, après appel d'offres, via l'Agence nationale de la recherche (ANR). Une fois qu'ils ont été choisis, les jeunes disposeraient de l'entière maîtrise des crédits et mèneraient la recherche à leur guise. La recherche terminée, le travail effectué serait évalué, les résultats de cette évaluation servant de base pour l'attribution des futurs contrats par l'agence. L'expérience pourrait être renouvelée à plusieurs reprises, le temps nécessaire pour le jeune chercheur de faire ses preuves et d'obtenir une position permanente. En ce qui concerne les enseignants-chercheurs, il est souhaitable que les jeunes maîtres de conférence puissent obtenir un allègement important de leur charge d'enseignement. Trop lourde, celle-ci pénalise actuellement leurs recherches au moment même où ils sont le plus féconds. Enfin, et dans la perspective de lutter contre la « fuite de cerveaux », il importe de trouver les moyens de nature à favoriser la mobilité des doctorants et des post-docs à l'intérieur même de l'Union européenne. PROPOSITION N° 10 : Développer les structures de valorisation de la recherche académique La question de la valorisation de la recherche académique recouvre dans les faits deux aspects différents. Communément, la valorisation de la recherche académique est envisagée comme un moyen de procurer aux établissements publics un surcroît de ressources. C'est là une vision à la fois juste et réductrice. Juste car il est certain que la vente des produits de la recherche est une activité rémunératrice ; réductrice car envisager ainsi la question de la valorisation de la recherche revient souvent à la réduire à une simple course au brevet alors même que la véritable ambition de la valorisation doit être de faire travailler en synergie acteurs publics et acteurs privés de la recherche pour mettre un terme à ce qui demeure encore, selon l'expression de M. Pierre Joly, président de la Fondation pour la recherche médicale (FRM), « la confrontation de deux mondes ». Pour ce faire, prenant acte que, comme le montre l'exemple américain, au-dessous d'une certaine taille un établissement ne peut pas entretenir de manière viable une structure de valorisation, la mission d'information préconise la mise en place de structures communes à différents organismes de recherches et différentes universités, ces structures ayant naturellement vocation à s'intégrer dans les futurs pôles de compétitivité. En outre, afin de favoriser le développement et la qualité de ces structures, la mission d'information propose que la prise en compte de la valorisation des produits de la recherche soit renforcée dans les procédures d'évaluation. Dans le même but, il faut que l'Etat s'engage à ce que les ressources supplémentaires que l'établissement public sera parvenu à dégager de la valorisation de ses recherches ne constituent pas une occasion pour lui de réduire la dotation budgétaire de l'établissement. Au contraire, il serait souhaitable d'envisager dans quelle mesure l'ensemble du personnel de l'établissement pourrait être intéressés aux résultats de la structure de valorisation. Enfin, dans le double but de favoriser la valorisation de la recherche académique et de développer la recherche en entreprise, il convient d'encourager la recherche partenariale. De ce point de vue, il est urgent de sécuriser le statut juridique des structures de gestion de recherche contractuelle de droit privé qui sont adossées à un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche - du type d'Armines - lesquelles sont pour beaucoup, malgré leur réussite, aux frontières de la légalité et donc menacées de disparition. PROPOSITION N° 11 : Encourager la recherche privée La faiblesse de l'investissement privé en recherche et développement est l'une des causes majeures des difficultés rencontrées actuellement par la recherche française. La mission d'information préconise quatre types de solutions pour relever le financement privé de la recherche et notamment la part du financement de la recherche assuré par les PME qui est la plus insuffisante : - Prenant acte de l'effet de levier très important de la recherche collaborative, c'est-à-dire de la recherche associant recherche académique et recherche en entreprise, et tenant compte du fait que les PME rencontrent des difficultés pour développer des activités de recherche et s'associer avec des grandes entreprises, la mission d'information préconise que, dans le cadre de l'actuel crédit d'impôt-recherche, la recherche tripartite entre un établissement public de recherche, une grande entreprise et une PME (qui ne soit pas une filiale de la grande entreprise) soit plus nettement encouragée que la simple recherche entre un organisme et une entreprise. Afin d'inciter les grandes entreprises à s'associer aux petites, il pourrait être envisagé soit le relèvement du plafond du crédit d'impôt de la grande entreprise à hauteur des dépenses de recherches confiées par la PME à l'organisme public, soit la prise en compte des dépenses confiées par la grande entreprise à l'organisme public au triple de leur montant en lieu et place du double dans le dispositif actuel. Participe de la même réflexion l'amélioration du dispositif dans le sens d'une plus grande lisibilité. En effet, à l'heure actuelle, de nombreuses PME qui ont droit au crédit d'impôt-recherche n'y recourent pas craignant de ne pas observer strictement une procédure fiscale extrêmement complexe et, par suite, de s'exposer à un contrôle fiscal. - A l'exemple des Etats-Unis, la France ne doit pas seulement faire reposer son dispositif d'incitation à la recherche privée sur un dispositif d'incitation fiscale. Elle doit également recourir à la commande publique et, dans ce cadre, à l'instar du dispositif SBIR américain, réserver une part des aides publiques à destination exclusive des PME. - La mission propose une mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, et, au premier chef, des établissements bancaires, pour mettre en œuvre, ainsi que le préconise M. Charles D. Wessner, directeur de la technologie et de l'innovation aux National academies américaines, consultant auprès de l'OCDE et observateur avisé des systèmes de recherche américain et français, un véritable « droit à la deuxième chance » en faveur des créateurs d'entreprises innovantes 34. En effet, si la législation française, telle qu'elle existe aujourd'hui, autorise les entrepreneurs faillis à créer une nouvelle entreprise - dans la mesure, évidemment, où aucune gestion frauduleuse de leur part n'a été constatée -, dans les faits, il leur est très difficile de mobiliser les capitaux nécessaires. Faire de cette faculté une réalité, cette préoccupation est au cœur du projet de loi de sauvegarde des entreprises (n° 1596) qui sera prochainement examiné par le Parlement. Reste à faire en sorte que les dispositions qui seront finalement adoptées soient de nature à faire évoluer les mentalités. - Enfin, dernier point, étant donné la difficulté rencontrée par les PME pour remplir les dossiers nécessaires à l'obtention des aides européennes, complexes et lourds, la mission estime souhaitable la création d'une structure constituant une interface entre les PME et l'administration européenne. Afin d'éviter la création de bureaucraties nouvelles, il pourrait être envisagé d'encourager les PME à mutualiser leurs efforts en intégrant dans l'assiette du crédit d'impôt-recherche tout ou partie des sommes - selon un montant plafonné - qu'elles verseraient pour le financement d'une structure dont elles assumeraient collectivement la gestion. PROPOSITION N° 12 : Favoriser l'intégration de la politique de recherche au niveau européen Ainsi qu'il a été dit, l'Europe est victime de ce paradoxe d'être, à l'évidence, le seul échelon territorial pertinent dans une compétition mondiale de plus en plus exacerbée et, dans le même temps, d'être la grande absente de la plupart des débats qui animent la recherche française. Il convient donc que la France use de toute son influence auprès de ses partenaires européens pour favoriser une plus grande intégration de la politique de recherche au niveau communautaire en plaidant, ainsi que le fait le Chef de l'Etat, pour que les dépenses publiques en recherche et développement ne soient pas comptabilisées dans le pacte de stabilité, en déterminant les moyens de favoriser la mobilité des jeunes chercheurs à l'intérieur de l'Union, enfin, et surtout, en préconisant la création d'un conseil européen de la recherche qui serait également une agence de moyens européenne. Ce conseil aurait le double avantage de permettre à la fois à l'Union de disposer d'une autorité suffisamment forte et légitime pour définir des programmes de recherche dans des domaines jugés prioritaires au niveau européen et, via son versant agence de moyens, de renforcer sa capacité à orienter stratégiquement l'effort de recherche en offrant à l'Union les moyens de financer des projets importants et en lui donnant la capacité de répartir globalement l'effort de recherche européen, en évitant autant que possible les doublons et la concurrence stérile que se livrent actuellement certains Etats membres. PROPOSITION N° 13 : Rendre la recherche plus attractive « Attractivité : le mot essentiel », comme le disait fort justement M. Pierre Joly, président de la Fondation pour la recherche médicale (FRM), lors de son audition. Cette dernière proposition est à la fois sans doute la plus fondamentale et la plus difficile à traduire dans les faits. Quel avenir pour la recherche en effet si aucun jeune n'est plus attiré par la science ? En ce sens, les treize premières propositions - qui ont pour objectif de fournir à chaque jeune qui s'engage dans la filière de la recherche une perspective et à la recherche française elle-même un avenir fait d'ambition - apportent indéniablement une première forme de réponse. Toutefois, celle-ci n'est pas totalement satisfaisante, car il s'agit aussi de lutter contre une vision de la recherche qui tendrait à substituer à la science espoir de Pasteur ou de la pénicilline la science coupable d'Hiroshima ou de Tchernobyl. Les membres de la mission d'information ont en effet pu constater que la culture scientifique comme la notion de vocation, hier bien vivantes et porteuses de valeur, étaient aujourd'hui en voie de délitement et n'animaient plus les jeunes comme elles avait pu enthousiasmer les générations précédentes. Sur ce point la mission d'information ne préconise rien d'autre qu'un effort accru de pédagogie en direction des adultes et surtout des jeunes, dès leur plus jeune âge, l'effort devant être poursuivi ensuite à tous les niveaux de la scolarité. Une meilleure communication doit permettre d'encourager une vision sereine et positive des progrès de la science, seule susceptible de susciter des vocations chez les jeunes et de leur dessiner ainsi un avenir professionnel fait de passion et d'ambition. * La mission d'information souhaite que ces propositions puissent être retenues dans le projet de loi d'orientation et de programmation sur la recherche, actuellement en cours de rédaction, et que le Parlement examinera au printemps prochain. Plus qu'un simple catalogue de mesures circonstancielles destinées à répondre, de manière ponctuelle, à une situation de crise, les propositions formulées par la mission - telle est du moins leur ambition - jettent les bases d'une réforme qui aspire à s'inscrire durablement, dans le temps. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent rapport d'information au cours de sa réunion du mardi 21 décembre 2004. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. M. Pierre Morange, président, a remercié M. Jean-Pierre Door pour son excellent rapport, qui montre clairement l'importance des enjeux et l'ampleur de la tâche à accomplir. M. Pierre-Louis Fagniez, après avoir félicité M. Jean-Pierre Door pour son travail et souligné, ayant participé à presque toutes les auditions, combien cette mission avait été bien organisée, est revenu sur le fait que, comme le laisse entendre la conclusion du rapport, aujourd'hui le progrès scientifique fait peur ; ainsi, en sacralisant le principe de précaution, la Charte de l'environnement insiste de fait sur les dangers du progrès et le stigmatise. Il a déclaré que lui-même, en tant que rapporteur du projet de loi sur la bioéthique, avait dans un premier temps dit tout l'intérêt de cette avancée considérable qu'est le clonage thérapeutique avant de demander ensuite à ses collègues de voter contre parce que celui-ci risquait de mener demain au clonage reproductif... Cette peur du progrès est d'autant plus importante qu'elle a des effets sur l'enseignement et sur les jeunes générations puisqu'on constate que les formations scientifiques sont moins recherchées que les études commerciales, juridiques et même psychologiques - ces dernières ne débouchant pourtant sur aucun emploi... Tout cela conduit logiquement à se demander quelle est aujourd'hui la place de l'université. Elle n'est certes plus celle qu'avaient autrefois la Sorbonne ou la faculté de Montpellier, d'autant que, depuis Napoléon, les grandes écoles ont pris leur place et permis des avancées considérables. Reste que, dans le premier classement des meilleures universités du monde établi par l'université de Shanghaï, Paris-VI, la mieux classée des universités françaises, n'arrivait qu'en 65e position. Cela fait quand même un peu honte ! D'ailleurs, à l'étranger, les chercheurs français ne disent pas qu'ils sont de telle ou telle université, Paris-XII ou Paris-VIII, mais ils se présentent comme venant de l'hôpital Henri-Mondor, de l'Inserm ou de l'INRA... On doit donc s'interroger sur le dispositif français d'enseignement et de recherche. Il faut y consacrer plus de moyens, non pas en termes de financements, mais de gestion et d'orientations. Comment s'imaginer qu'en application du principe d'autonomie les 82 universités françaises joueraient un rôle de premier plan et équivalent en matière de recherche ? Il faut donc que quelques grands établissements centralisent l'action, avec, autour d'eux, des EPST qui deviendraient des agences de moyens. C'est par des expérimentations de ce type que l'université retrouvera sa place au cœur du dispositif français de recherche et d'enseignement. Tous ceux que la mission a auditionnés ont par ailleurs observé que, depuis Pierre Mendès France et le général de Gaulle, il n'y avait plus de pilotage stratégique du système de recherche : il n'y a plus d'impulsion, on ne sait plus qui décide quoi. De ce point de vue, l'idée de jumeler enseignement supérieur, recherche et technologie pose problème, car toutes les universités ne sont pas à même de mener de front recherche et enseignement. Tel n'est d'ailleurs pas le cas aux Etats-Unis où la plupart des universités ne font que de l'enseignement et c'est très bien ainsi ! Cela étant, quelles que soient les précautions qu'il faudra prendre, il convient absolument d'aller vers une structure ministérielle forte, où se rencontreront recherche et enseignement supérieur, afin d'éviter le cloisonnement et la rigidité, de repartir sur la bonne voie, de réorienter la recherche, qui a davantage besoin de cela que de plus d'argent. M. Pierre Lasbordes s'est associé aux louanges adressées par M. Pierre-Louis Fagniez à M. Jean-Pierre Door. Il a insisté en premier lieu sur la question de l'évaluation, en observant que le système actuel était très coûteux en hommes comme en temps, qu'il était rarement suivi d'effet et peu ouvert sur l'extérieur et qu'il convenait donc de le revoir entièrement, en procédant sans doute par étapes. On pourrait ainsi s'engager dans la voie, préconisée par le rapport des états généraux, de la création d'une grande agence nationale de l'évaluation, qui travaillerait de façon plus étalée dans le temps afin de se rapprocher du rythme européen d'une évaluation tous les six ans, avec une même évaluation pour l'homme et pour le programme, avec aussi plus d'ouverture vers l'extérieur, et sans l'intervention des syndicats actuellement trop présents dans les structures d'évaluation sans que cette situation ne se justifie réellement. Les maîtres-mots seraient simplification, unification, transparence et homogénéité, afin que les chercheurs disposent, d'où qu'ils viennent, d'un même document d'évaluation. S'agissant de l'organisation du système de recherche, il convient de revoir les périmètres des organismes de recherche car, à force d'en créer de nouvelles, le système manque singulièrement de lisibilité et des thèmes sont traités simultanément dans des organismes différents. Par ailleurs, si l'emploi scientifique doit être revalorisé dans le cadre du plan pluriannuel, on ne pourra pas éviter de mener une réflexion sur le nombre des chercheurs. Il faut notamment faire en sorte que tous ceux qui préparent une thèse n'aient pas pour objectif d'entrer au CNRS, en leur offrant une meilleure gestion des carrières, en développant l'embauche par la recherche privée - qui donne pour l'instant la priorité aux ingénieurs - et en intégrant le diplôme de docteur dans les conventions collectives. Cela semble, ainsi qu'il a été dit, plus important que la question du financement. Enfin, il apparaît que les contacts entre recherches privée et publique demeurent insuffisants. Les pôles de compétitivité sont une réponse, mais pas la seule. M. Jean-Pierre Door, président de la mission d'information, a considéré que ces deux interventions, émanant de membres assidus de la mission, n'appelaient pas de réponse de sa part, et qu'il y aurait lieu d'annexer ces contributions au rapport, comme cela a déjà été fait pour celle que M. Yvan Lachaud a fait parvenir par écrit au nom du groupe UDF. * * * La commission a décidé à l'unanimité, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication. CONTRIBUTION DE M. YVAN LACHAUD AU NOM DU GROUPE UDF Nous sommes aujourd'hui à mi-chemin sur la voie de la réforme de la recherche française : la prise de conscience est à peu près générale, tant au Parlement qu'au gouvernement, sur la nécessité de répondre au malaise - incontestable et profond - des chercheurs, mais il reste encore à avoir le courage de mettre en œuvre une réforme profonde. Pour le groupe UDF, le problème de la recherche en France n'est pas lié au niveau des chercheurs français, qui est bon, mais à un problème de moyens, lui-même sous-tendu par l'absence d'une mobilisation nationale en faveur de la recherche. Les Français ne se sentent pas assez concernés par les enjeux de la recherche, alors que nous avons besoin d'une mobilisation générale autour d'une ambition commune pour le pays. Il y a peu de pays occidentaux qui ont décidé des coupes sombres dans le budget de la recherche, comme l'a fait la France en 2002 et en 2003 ; par là, le gouvernement a accepté que s'accroisse le retard de notre pays par rapport à ses voisins. Notre situation économique le montre bien : la faible compétitivité de la France est due, plus qu'aux handicaps fréquemment évoqués du poids de la fiscalité ou des coûts de production, à son faible positionnement dans le domaine de l'innovation. On peut citer, par exemple, notre retard dans les deux grandes vagues d'innovation que sont les biotechnologies et les technologies de l'information. Aujourd'hui, il nous faut redonner un élan, des moyens et une ambition à la recherche française. Les propositions de l'UDF reposent sur quelques principes simples : avoir le courage de réaliser une réforme profonde ; faire confiance aux chercheurs ; redéfinir l'action de l'Etat et établir un véritable pilotage national de la recherche ; améliorer la situation des enseignants, des chercheurs - en particulier, des jeunes - ; faire des choix et concentrer l'effort national sur quelques domaines de recherche et quelques sites. La voie à suivre nous est, en particulier, indiquée dans le rapport remis par Christian Blanc au Premier ministre : « L'écosystème de la croissance : un nouvel environnement pour la compétitivité des territoires ». Pour l'UDF, le premier objectif est de réformer le système national de la recherche, en le faisant passer d'organisations massives dédiées à la gestion des personnels, à des agences de moyens pour la recherche fondamentale, concentrées sur le financement, la sélection et l'évaluation des projets et des équipes. Une réforme des structures est indispensable ; cela signifie notamment une redéfinition du périmètre des organismes de recherche, cloisonnés, trop nombreux et aux frontières floues. Il s'agit également de mettre fin à l'immobilité des fonds de la recherche, car une masse importante de crédits est stérilisée dans un mécanisme de reconduction à l'identique des financements, selon une logique de financement des personnels permanents. Le CNRS confierait progressivement ses unités mixtes aux universités au fur et à mesure que celles-ci progressent dans leur management ; les laboratoires seraient financés par des contrats pluriannuels sur projets ; l'évaluation et la réallocation des financements seraient dissociées. Enfin, une Agence nationale d'évaluation de la recherche regrouperait les compétences d'évaluation actuelles du CNRS et du Conseil national des universités (CNU) : les projets, les équipes de recherche et les résultats seraient évalués, sur un rythme triannuel ou quinquennal (compte tenu de la durée nécessaire aux travaux de recherche), par des panels ad hoc, internationaux. Cela pose la question du pilotage au niveau national, qui pénalise actuellement la recherche dans la mesure où l'autorité est actuellement dispersée entre différents ministères : recherche, éducation nationale, industrie, défense... Nous proposons de mettre en place un ministère de la recherche de plein exercice, doté d'un réel pouvoir et jouant son rôle de pilote stratégique et disposant d'un champ de compétences élargi à l'enseignement supérieur et à l'innovation, lié également au ministère de l'industrie. Autant la réforme des structures est nécessaire mais illusoire dans ses résultats, autant celle des modes de gestion des établissements (notamment les règles d'attribution des marchés publics) est impérative. Nous proposons de décharger les chercheurs d'une partie de leurs tâches administratives et de mieux employer le personnel administratif ; de réaliser la gestion administrative des établissements de recherche au plus près des équipes de chercheurs, et non plus par l'autorité de tutelle au niveau régional ou national ; de transformer le contrôle administratif de la gestion des établissements en amont en contrôle a posteriori, ce qui permettrait de tenir compte de la nature aléatoire des résultats des activités de recherche. Notre deuxième proposition est de mettre en place des pôles de compétitivité. Il s'agit de concentrer la recherche autour de pôles régionaux, délimités sur un plan géographique et disciplinaire, réunissant autour d'universités importantes les laboratoires de recherche, les grandes écoles et les entreprises innovantes. Une recherche tous azimuts est irréalisable et la France a une ambition trop universelle pour ses moyens, c'est pourquoi l'effort national doit se concentrer sur quelques sites et quelques domaines, en choisissant un petit nombre de secteurs d'excellence scientifique et technologique sur lequel construire l'avenir. Il s'agit de développer une politique de site, sans abandonner une vision nationale de la politique de recherche. Ces pôles seraient capables de tirer un parti maximal des forces scientifiques, technologiques et industrielles existantes. Dans le cadre d'une décentralisation cohérente, les régions assumeraient un rôle accru en matière de recherche, notamment grâce à un transfert de fiscalité. Ainsi seraient mis en synergie un monde de la recherche géographiquement et sociologiquement plus proche des entreprises, une vision territoriale plus claire de la part des pouvoirs publics et des entreprises décidées à un investissement plus fort dans les logiques collectives et la recherche de communauté d'intérêts. En dehors des programmes traditionnels, la recherche publique doit maintenir vivante une « recherche libre » ; en effet, les grandes découvertes sont souvent issues d'une petite équipe de recherche. De même, nous refusons de séparer recherche fondamentale et recherche appliquée : ce serait une grave erreur de faire de la recherche fondamentale une prérogative exclusive de l'Etat et de laisser la recherche appliquée aux entreprises. Il importe donc de faire évoluer les mentalités et d'apprendre aux chercheurs à travailler avec le monde de l'entreprise, d'inciter les universités à faire des efforts en matière de valorisation. Donner à la recherche française les moyens de sa réussite va de pair avec une réforme de l'université, dont les dysfonctionnements évidents handicapent la recherche : les instances dirigeantes des universités manquent de cohérence, d'où une gouvernance difficile des établissements ; une concurrence stérile oppose les universités et les organismes de recherche pour le contrôle de la recherche française ; la dispersion des universités, trop nombreuses, pénalise l'effort de recherche en multipliant les structures et en les empêchant d'atteindre une taille critique leur permettant de peser sur la scène internationale. D'où apparaît la nécessité de mettre en place les pôles de compétitivité, évoqués précédemment : les regroupements, en encourageant les accords de partenariats (comme il en existe entre les trois universités d'Aix-Marseille), à l'exemple des accords d'intercommunalité entre communes, permettront une plus grande lisibilité sur le plan international, sans réduire le nombre d'universités. La recherche française ne sera dynamique que par l'implication et la valorisation de ses chercheurs. La question du statut des enseignants et chercheurs doit désormais être résolue. Pour l'UDF, le problème ne vient pas du statut lui-même, mais de son uniformité : plus de souplesse est nécessaire - ainsi, aux Etats-Unis, la charge de cours des chercheurs est plus ou moins élevée selon les universités. L'UDF souhaite privilégier des recrutements sur des projets précis, avec des moyens suffisants et une rémunération attractive, et donner la possibilité d'alterner entre recherche et enseignement, tout en conservant la connexion entre les deux, et de pouvoir déroger au strict 50/50. Par exemple, les rémunérations des chercheurs seraient accrues à travers des primes sur projets ; des post-doctorants seraient embauchés sur contrats de cinq ans... En particulier, une meilleure articulation entre la recherche et l'enseignement doit permettre aux jeunes chercheurs d'intégrer la recherche ; cela implique de revaloriser les activités d'enseignement. Une attention particulière doit également être portée au système d'évaluation des chercheurs. Cette valorisation des chercheurs passe aussi par une amélioration de la situation des jeunes chercheurs. Cela signifie : mettre fin à la précarité des post-docs, réduire le fort taux d'abandon en cours de thèse, accroître les débouchés et les perspectives pour les docteurs. Le nombre de chercheurs formés est aujourd'hui totalement disproportionné à la capacité d'absorption du tissu économique et au nombre de postes ouverts dans le secteur public. Parce que la solution ne peut venir que de l'augmentation des débouchés hors du secteur public, nous proposons de valoriser davantage le diplôme de docteur dans les entreprises, tout en ouvrant davantage la haute fonction publique aux docteurs. D'autres pistes peuvent être étudiées : adapter le système de recrutement public à la nouvelle norme de l'enseignement supérieur (LMD - Licence Master Doctorat) ; conditionner le bénéfice du crédit d'impôt recherche à l'embauche de docteurs ; étendre le système des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) aux collectivités locales... La question des moyens est évidemment importante, ce qui pose la question du financement budgétaire. En ce sens, compte tenu des critères du pacte de stabilité, nous proposons que les dépenses d'innovation ne soient pas comptabilisées dans le déficit des Etats. Nous voulons faire progresser l'idée que les dépenses de recherche doivent échapper aux critères du pacte de stabilité, car elles participent au développement et donc à la croissance. Cette réflexion sur les moyens financiers fait apparaître l'importance de la dimension européenne de la recherche. Aujourd'hui, la recherche ne peut pas être pensée en dehors de l'échelle européenne. L'Europe de la recherche a considérablement progressé, notamment grâce à un niveau de collaboration accrue entre les Etats membres et à la mise en place du PCRD. Désormais, 60 % des missions du CNRS réalisées à l'étranger le sont en Europe, mais le pourcentage français de retour sur les investissements consentis est insuffisant. Cela signifie, pour nous, la nécessité d'accroître la mobilité en Europe, alors qu'actuellement un départ dans un autre pays européen a les mêmes conséquences en termes de perte de droits sociaux qu'un départ pour un autre pays. L'on pourrait privilégier des mobilités post-recrutement via des collaborations industrielles, ce qui garantirait le retour des chercheurs et la préservation des compétences au niveau national. Parce que nous jugeons le financement européen de la recherche trop faible, nous voulons que l'Europe réalise un effort considérable, pour le montant des financements accordés, le développement de grands programmes de recherche (santé, technologies, industrie, environnement...), la collaboration des scientifiques, la coordination des programmes de recherche nationaux. Une utilisation concertée des ressources et des compétences, au niveau européen, est la condition d'une Europe de la recherche puissante et compétitive. La recherche française a des atouts évidents et nombreux, au premier rang desquels il y a nos chercheurs. Ainsi le principe de toute politique de la recherche doit-il être de faire confiance aux chercheurs. Nous voulons également mettre le citoyen au cœur des politiques de recherche, c'est-à-dire renforcer le dialogue entre la science et la société, pour que les citoyens soient davantage informés et qu'ils participent aux grands débats qui les concernent (sur les OGM, la bioéthique...) ; la diffusion de la culture scientifique est au cœur de cet enjeu. La réussite de la recherche française sera au croisement d'une politique publique et privée concentrée sur des secteurs d'excellence, tout en laissant sa place au hasard de la recherche. C'est du dynamisme de notre recherche que dépendra la capacité de la France à maintenir sa capacité d'innovation, sa compétitivité, un haut niveau d'activité et donc d'emploi. Ainsi est-il de notre responsabilité, même de notre devoir envers nos enfants, de donner à la France et à l'Europe les moyens et les ambitions d'une puissance mondiale. PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION ¬ M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche ¬ M. Alain Trautmann, co-directeur du département de biologie cellulaire à l'Institut Cochin, porte parole du collectif « Sauvons la recherche » ¬ M. Bernard Larrouturou, directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ¬ M. Sylvain Collonge, président de la Confédération des jeunes chercheurs (CJC) et M. Florent Olivier, membre de la CJC ¬ M. Philippe Jurgensen, président-directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), dite Agence française de l'innovation ¬ M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie des sciences, co-président, avec M. Edouard Brézin, du Comité d'initiative et de proposition pour la recherche (CIP) ¬ M. Michel Laurent, premier vice-président de la Conférence des présidents d'université (CPU) en charge de la commission de la recherche ¬ M. Alain Bugat, administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), M. André Syrota, directeur des sciences du vivant au CEA et M. Jean-Pierre Vigouroux, chef de la cellule des affaires publiques du CEA, chargé des relations avec le Parlement ¬ M. Christian Bréchot, directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et M. Victor Demaria-Pesce, chargé des relations avec le Parlement ¬ M. Jacques Lesourne, membre du comité de pilotage et président du comité d'orientation de l'opération FutuRIS (Recherche, innovation, société), membre du conseil de l'Académie des technologies et président de Futuribles international, M. Denis Randet, délégué général de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT), membre du comité d'orientation de FutuRIS, Mme Nadège Bouquin, rapporteure du groupe défi « dynamiques de l'environnement international et national du système français de recherche et d'innovation », chargée de mission à l'ANRT, et M. Thierry Weil, directeur de l'équipe projet FutuRIS ¬ M. Emmanuel Leprince, délégué général du Comité Richelieu, président de l'European federation of high techs SMEs (Fédération européenne des PME de haute technologie) ¬ M. Philippe Kourilsky, directeur général de l'Institut Pasteur, co-auteur de l'appel Du Nerf ! (Donner un nouvel essor à la recherche française), article paru dans la revue Commentaire (n° 106 - été 2004) ¬ M. Edouard Brézin, vice-président de l'Académie des sciences, co-président, avec M. Etienne-Emile Baulieu, du Comité d'initiative et de proposition de la recherche (CIP) ¬ M. Alain Risbet, président du réseau des Centres techniques industriels (CTI), M. Gines Martinez, délégué général du réseau des CTI et M. Didier Salle, consultant du réseau des CTI ¬ M. Pierre Le Sourd, président de Les Entreprises du médicament (LEEM), M. Bernard Lemoine, vice-président délégué du LEEM, Mme Catherine Lassale, directrice des affaires scientifiques pharmaceutiques et médicales du LEEM, et Mme Aline Bessis-Marais, responsable des affaires publiques du LEEM ¬ M. Jacques Lacambre, directeur des avant-projets de la recherche et des prestations de Renault, et Mme Louise d'Harcourt, chargée des relations de Renault avec le Parlement ¬ Mme Brigitte Calles, directeur des Laboratoires internationaux de recherche (LIR), M. Robert Dahan, président-directeur général de AstraZeneca France, président de la commission des affaires pharmaceutiques, scientifiques et médicales du LEEM, et M. Marc Vasseur, président-directeur général de Serono France holding, senior vice-president de Genset, vice-présidents ¬ Pr. Michel Kazatchkine, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) ¬ M. Pascal Iris, directeur d'Armines, président-directeur général de Transvalor ¬ M. Petteri Kauppinen, senior advisor (chargé de mission) au ministère de l'éducation finlandais et M. Seppo Toivonen, conseiller de presse et de culture à l'Ambassade de Finlande en France ¬ M. Paul Clavin, administrateur de l'Institut universitaire de France (IUF), professeur à l'Université d'Aix-Marseille I, et Mme Françoise Chambon, secrétaire générale de l'IUF ¬ M. Yves Drapp, président-directeur général de Medtronic France ¬ M. Daniel Deviller, directeur de la recherche chez EADS (European aeronautic defence and space company), président de la Fondation d'entreprise EADS pour la recherche en France, et M. Olivier Masseret, chargé des relations avec le Parlement ¬ M. Jacques Glowinski, administrateur, président de l'assemblée des professeurs du Collège de France, titulaire de la chaire de neuropharmacologie ¬ M. Benoît Legait, directeur de l'Ecole des mines de Paris, vice-président de la Conférence des grandes écoles, M. Alain Storck, président de la commission recherche et transfert de la conférence, directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon ¬ M. Pierre Joly, président de la Fondation pour la recherche médicale (FRM) ¬ M. Jean-François Dehecq, président-directeur général de Sanofi-Aventis, président de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT) et du comité de pilotage de l'opération FutuRIS (recherche, innovation société), M. Michel Labie, directeur des relations institutionnelles et professionnelles, Mme Véronique Ameye, directrice des affaires publiques de Sanofi-Aventis France, et Mme Florence Vesin, directrice des relations gouvernementales et parlementaires Sanofi-Aventis France ¬ Mme Laurence Esterle, directrice de l'Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) ¬ M. Jean-François Girard, président de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), a fait parvenir à la mission d'information une contribution écrite. AUDITION DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA RECHERCHE La mission d'information sur la recherche publique et privée en France face au défi international a entendu M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche, au cours de sa séance du mardi 7 décembre 2004. Après avoir remercié le ministre délégué de sa présence le président Jean-Pierre Door, a indiqué, qu'au terme des auditions qu'elle avait menées, la mission d'information a pu constater que la recherche française était confrontée à dix défis majeurs : le financement ; le pilotage stratégique ; le devenir des organismes publics de recherche ; l'articulation entre enseignement supérieur et recherche et singulièrement la place de l'université dans le dispositif de recherche ; la gestion administrative des établissements publics de recherche ; l'insertion des jeunes dans le dispositif de recherche ; le personnel chercheur ; l'évaluation ; l'articulation entre recherche publique et recherche privée et, enfin, l'Europe. S'agissant, en premier lieu, du financement, il y a lieu de se demander si l'augmentation des crédits est absolument indispensable et, in fine, quel doit être l'équilibre retenu entre le financement récurrent de la recherche et le financement sur projet. M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche, s'est dit heureux et honoré de venir répondre aux questions de la mission d'information. Il a rappelé que l'effort français de recherche se situe entre 2,22 et 2,23 % du produit intérieur brut (PIB), soit encore très au-dessous de l'objectif de 3 % fixé par le conseil européen de Barcelone en 2002 ; la France consacre à la recherche un effort inférieur à celui de l'Allemagne, plus encore à celui des Etats-Unis et du Japon, et à peine supérieur à la moyenne européenne, laquelle a baissé, il est vrai, depuis le dernier élargissement de telle sorte qu'elle ne constitue pas un point de repère pertinent. De plus, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif des 3 % est exprimé en valeur relative. Or, il convient d'être également attentif à la valeur absolue de l'effort de recherche, ainsi qu'à sa répartition. C'est ainsi que l'effort de la Finlande, par exemple, est un demi point au-dessus des 3 % du PIB mais celui-ci correspond, en valeur absolue à un effort « limité » - 4,8 milliards d'euros -et surtout fragile dans sa répartition - un tiers pour la recherche publique, un tiers pour Nokia et un tiers pour les autres entreprises - puisqu'une seule grande entreprise privée fait un effort véritablement significatif. Au contraire, la France doit se donner pour perspective d'atteindre un bon niveau de recherche dans tous les domaines d'avenir. D'aucuns soutiennent que cet effort devrait se concentrer sur quelques-uns seulement de ces domaines ; ce serait contraire à la tradition française et cela ne correspondrait pas à l'ambition qui doit être celle d'un grand pays scientifique. La recherche française ne doit pas seulement être « touche-à-tout », elle doit se donner les moyens de jouer les tous premiers rôles dans certains domaines dessinant un champ de recherche très large. Ainsi que tous les grands pays dont la recherche rayonne dans le monde - tant il est vrai que la recherche est un outil de rayonnement intellectuel et culturel - la recherche française doit aborder toutes les disciplines ce qui n'est pas contradictoire avec une spécialisation plus spécifique dans quelques unes d'entre elles. Pour ce faire, la continuité de l'effort financier est une nécessité. Il est indispensable que la future loi d'orientation et de programmation assure, sur un nombre d'années qui reste à déterminer, un financement sécurisé, en évitant les à-coups très importants que l'on a connus ces quinze dernières années. De ce point de vue, il est à signaler que la recherche n'a pas fait l'objet de mesures de régulation budgétaire en 2004 ; c'est une bonne habitude à prendre... Il importe également que l'effort de recherche consenti par les entreprises privées augmente de manière significative. A titre de comparaison, celui-ci s'élève à 33 milliards d'euros en Allemagne, soit l'équivalent de l'ensemble de l'effort de recherche français, public et privé confondus. Une entreprise comme Daimler-Benz consacre 6,5 milliards à la recherche-développement, Siemens environ 6 milliards... En France, non seulement le volume de la recherche privée est insuffisant, mais il tend à diminuer et à se délocaliser vers des pays à bas salaires, notamment en Chine, où l'installation d'un centre de développement puis d'un centre de recherche suit très rapidement l'installation des usines. Par ailleurs, le budget de la recherche pour 2005 fait apparaître en filigrane, avec un accroissement des crédits d'un montant d'un milliard d'euros répartis comme suit, ce que pourrait être la répartition de l'augmentation de l'effort français de recherche dans les années qui viennent : un tiers pour la recherche publique, un tiers pour la recherche sur projets, au travers de la future Agence nationale de la recherche (ANR), et un tiers pour la recherche en partenariat et le soutien à l'innovation privée. Afin de ne pas menacer l'équilibre budgétaire des organismes publics de recherche, il est en effet souhaitable qu'un tiers de l'augmentation du budget soit consacré au financement de la recherche publique stricto sensu, c'est-à-dire à l'augmentation des crédits destinés aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Toutefois, il ne doit pas y avoir d'inconvénient à ce que plusieurs catégories de financement soient mobilisées en direction de l'effort de recherche : le financement budgétaire, à travers le budget civil de recherche et développement (BCRD), mais également des ressources extrabudgétaires qui viennent, à hauteur de 350 millions d'euros, abonder l'ANR destinée au financement sur la base de projets. A ceux qui s'interrogent sur la sécurisation et donc la pérennité de ce financement, il faut rappeler que le compte d'affectation spéciale (CAS) de cessions de titres, parts et droits de société, alimenté par les privatisations de l'Etat, peut se comparer avantageusement aux crédits du BCRD qui sont encadrés par le plafond global d'évolution des dépenses du budget de l'Etat, soit la stabilisation en volume à l'horizon 2008. Le troisième tiers de l'augmentation, enfin, est consacré au financement de l'innovation via essentiellement l'outil d'incitation fiscale c'est-à-dire le crédit d'impôt-recherche. Celui-ci doit être affiné, et certainement pas supprimé, comme d'aucuns le proposent. Partout dans le monde en effet, l'outil fiscal est le mode d'incitation privilégié pour élever le niveau de la recherche privée. Parmi les aménagements possibles du crédit d'impôt-recherche, figure notamment l'élargissement de son assiette via sa transformation en un crédit d'impôt-innovation. Il est également possible de cibler le dispositif en direction des PME-PMI qui font en interne un effort d'innovation mais n'osent pas nouer des relations avec la recherche, sans doute faute d'incitations suffisantes. Avant toute réforme du crédit d'impôt-recherche, M. Pierre Lasbordes a souhaité que l'on commence par évaluer l'impact des mesures déjà prises pour améliorer ce dispositif, d'autant que ces mesures avaient répondu à l'essentiel des revendications exprimées par les entreprises. Il a ensuite insisté sur la méfiance des PME-PMI vis-à-vis de l'administration fiscale et donc la nécessité de mettre en place un système simple et de veiller à ce que les inspecteurs des impôts soient mieux formés. Le président Jean-Pierre Door a également plaidé pour une évaluation et une simplification du dispositif de crédit d'impôt-recherche. Le ministre délégué a dit partager ces interrogations et en conséquence souligné que le dispositif doit être élargi et concerner à l'avenir un plus grand nombre d'entreprises. Lorsqu'un inspecteur des impôts effectue un contrôle, il est vrai que l'une des premières choses qu'il vérifie est l'utilisation faite par l'entreprise du crédit d'impôt-recherche. Une formation insuffisante de l'inspecteur peut effectivement être préjudiciable à l'entreprise, comme peut l'être aussi une conception trop étroite de ce qu'est une dépense de recherche. Il arrive par exemple qu'une innovation qui n'est pas directement issue de la recherche mais est fortement corrélée à celle-ci ne soit pas considérée par les inspecteurs comme relevant du dispositif de crédit d'impôt-recherche alors même que certaines entreprises très innovantes se créent à partir d'améliorations ou d'adaptations novatrices de logiciels déjà existants. Une telle démarche relève-t-elle de la recherche ? Doit-elle être considérée comme telle par l'administration fiscale ? A ces deux questions, la réponse doit être oui. Par ailleurs, il ne fait pas de doute qu'une plus grande transparence et une plus grande simplicité seraient également de bons moyens d'améliorer le dispositif. Cela dit, le crédit d'impôt recherche n'est pas le seul moyen de favoriser l'innovation. Il ne faut pas hésiter à avoir recours aux aides directes et indirectes, comme le font tous les pays, y compris les plus libéraux comme les Etats-Unis. Le président Jean-Pierre Door a demandé l'avis du ministre délégué sur un éventuel retour à une politique de commandes publiques visant à renforcer, en complément du dispositif d'incitation fiscale, la recherche financée par les entreprises. Le ministre délégué a répondu qu'il est favorable à un tel dispositif mais la législation européenne fait obstacle à sa mise en œuvre. Toutefois, il y a lieu de préciser que la Grande Bretagne dispose d'ores et déjà d'un dispositif de ce type et que l'Europe, quoiqu'elle n'y soit pas très favorable dans l'ensemble, admet un système de commandes publiques orienté vers les PME-PMI dans le domaine de la défense. Il existe donc des pistes à explorer pour mettre en place un dispositif dont le modèle est indéniablement le Small business innovation and research programm (SBIR), en vigueur aux Etats-Unis, lequel réserve une partie de l'exécution des commandes publiques aux petites et moyennes entreprises. Mais, à l'évidence, sa réalisation doit s'effectuer à l'échelon européen. Parmi les secteurs d'activités où la France peut progresser, il y a évidemment celui de la défense, mais les grands donneurs d'ordre sont assez réticents à l'idée d'aider des entreprises qui ne seront jamais pour eux des sous-traitants. D'autre part, les grands groupes comme EADS ont beaucoup de contraintes internationales concernant la répartition de leurs commandes. Cela dit, il ne faut pas non plus surestimer les obstacles. Il y a également beaucoup de progrès à faire dans le domaine hospitalier où l'on ne peut pas dire qu'il existe pour l'instant une vraie politique de commande publique ; de toute évidence, celle-ci peut être améliorée. Enfin, un secteur tel que l'audiovisuel pourrait être source d'innovation. En dépit de la grande technicité de ce dernier, bien des entreprises innovantes ne se sentent absolument pas soutenues par les chaînes. La haute définition permettra, à n'en pas douter, l'éclosion de beaucoup d'entreprises innovantes, et, dans ce cadre, France Télévisions pourrait jouer un rôle d'impulsion. M. Pierre Lasbordes a demandé quels obstacles s'opposent à la mise en œuvre d'un système analogue au SBIR américain. Le ministre délégué a répondu que le SBIR est un système très autoritaire. La loi américaine prévoit ainsi que chaque ministère, chaque agence doit réserver aux PME une part de ses marchés publics. En l'état actuel de la législation communautaire, un tel système ne pourrait être mis en œuvre qu'au niveau européen mais encore faudrait-il que la Commission évolue vers une conception moins ultralibérale des politiques industrielles. Force est de constater que tous les pays qui ont de fortes ambitions industrielles et qui souhaitent que leur industrie s'appuie sur une recherche de haut niveau font preuve d'un grand volontarisme en la matière et n'hésitent pas à y consacrer de très fortes sommes. Le président Jean-Pierre Door, abordant la question du pilotage, a demandée au ministre délégué son sentiment sur l'idée de créer un grand ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation, et sur le rôle que pourrait jouer, dans le pilotage de la recherche, un Haut conseil, composé notamment de scientifiques, placé sous la tutelle de ce nouveau ministère ou sous celle du Premier ministre. Le ministre délégué a distingué trois aspects à prendre en considération : la structure ministérielle ; l'administration de la recherche ; le Haut conseil. S'agissant de la structure ministérielle, rien n'est tranché. Etant donné la culture française, il n'est pas certain qu'il soit possible d'inscrire dans la loi l'existence d'un grand ministère de la recherche. Actuellement, les ministères concernés par la recherche sont, outre celui de la recherche, ceux de l'enseignement supérieur (hors le volet proprement enseignement), de l'industrie et d'autres encore... le risque étant en effet qu'à vouloir embrasser l'ensemble d'une problématique par nature multidisciplinaire un grand ministère de la recherche n'en vienne à couvrir la moitié de l'administration française. Un rapprochement, au sein d'un même ministère, de l'enseignement supérieur et de la recherche pourrait déjà être une bonne chose et mettrait en conformité l'architecture gouvernementale avec la présentation des crédits retenus par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 qui institue une mission interministérielle de la recherche et de l'enseignement supérieur. A ce propos, il faut souligner que les modalités de répartition des dotations aux universités découlant du système dit « SANREMO » (système d'analyse et de répartition des moyens aux établissements d'enseignement supérieur) incluent d'ores et déjà des critères de recherche qui viennent s'ajouter à ceux inscrits à la ligne « recherche universitaire ». Une remise en ordre serait la bienvenue si l'on voulait renforcer l'effort de recherche dans les universités. Par ailleurs, la part prise par le ministère délégué à la recherche dans le pilotage du dispositif de recherche doit être renforcée mais l'objectif du ministère ne doit pas être d'intervenir de façon autoritaire dans la gestion administrative des établissements dont il a la tutelle. Dans le cadre du futur projet de loi d'orientation et de programmation sur la recherche, il convient donc de recentrer le rôle du ministère sur la définition et le suivi des orientations stratégiques de la recherche. Estimant que le système français de recherche a besoin d'un pilote, le président Jean-Pierre Door a en effet jugé nécessaire que quelqu'un assume un rôle de coordination. Prenant l'exemple des nanotechnologies, le ministre délégué a indiqué que les crédits du ministère sont répartis, assez curieusement, entre la direction de la technologie et celle de la recherche. On peut certes justifier une telle division en disant que la direction de la recherche finance les actions de recherche fondamentale et la direction de la technologie les recherches plus finalisées mais il reste que le système est manifestement trop compliqué et donne l'impression d'une absence de coordination. En la matière, il appartiendra également à la loi d'orientation et de programmation de clarifier et de préciser le rôle du ministère. M. Pierre-Louis Fagniez a rappelé que tous les chercheurs entendus par la mission d'information ont souhaité, non sans quelque nostalgie, un retour à un pilotage centralisé du type de celui qui était en vigueur à l'époque du général de Gaulle. Aujourd'hui, le ministre semble reconnaître que le niveau de coordination laisse à désirer mais sans toutefois considérer comme forcément opportun que la future loi d'orientation et de programmation comporte des dispositions en la matière. Qu'en est-il exactement ? M. François d'Aubert a estimé nécessaire qu'une instance se charge de la prospective et donne des avis au Gouvernement, tout en étant dotée d'une capacité d'autosaisine dans certains domaines bien définis. Ce sera le rôle du Haut conseil. Le ministère doit prendre le relais de ce pilotage en termes de stratégie et d'évaluation des politiques publiques afin de s'imposer comme un ministère « stratège ». Quant à l'ANR, elle sera chargée de veiller au respect de priorités qu'elle n'aura pas définies elle-même. Par exemple, les sciences du vivant, les sciences et techniques de l'information et de la communication (STIC), le développement durable auront été définies comme des priorités par le ministère avant que l'Agence assure la traduction concrète de ce statut de priorité. L'application pratique des priorités retenues est en effet un élément déterminant de la crédibilité de l'action publique et l'expérience passée montre que les annonces ne sont pas toujours suivies d'effets. A titre d'exemple, au moment où M. Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a annoncé sa décision de faire des STIC une priorité de recherche, il y avait 231 allocations de recherche dans ce domaine ; la décision du ministre passée ce nombre n'a jamais excédé 234. Il faudra donc veiller à ce que le pilotage par le ministère soit relayé afin que les priorités affichées se traduisent effectivement par une augmentation des moyens qui leur sont consacrés, ce qui fut pas toujours le cas les années passées. Par ailleurs, la sélection des projets passera par l'Agence, de façon à éviter certains effets d'aubaine. Lorsque la crise de la vache folle a éclaté, seul le laboratoire du professeur M. Dominique Dormont au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) travaillait sur la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Toutefois, en application des règles relatives aux marchés publics, le ministère a lancé un appel d'offres pour que soient menées des études concernant cette pathologie. Celui-ci a suscité quarante réponses... mais il n'est pas absolument certain que les quarante laboratoires en question étaient passionnés par la maladie de Creutzfeldt-Jacob : sans doute certains s'étaient-ils simplement aperçus que l'État était prêt à leur donner de l'argent s'ils travaillaient sur ce thème... Il convient donc, dans un souci d'efficacité, d'adopter une politique de régulation intelligente. Enfin, en liaison avec le Haut conseil, le ministère doit exercer une mission d'observation stratégique ainsi qu'une mission de contrôle de gestion des organismes - lesquels actuellement ne font pas de reporting - en veillant notamment à ce que les priorités retenues par les EPST correspondent bien à celles qui ont été retenues par le ministère. Il faudra éviter, par exemple, que les organismes ne profitent pas de cette nouvelle source de financement pour retirer à certains laboratoires qui auront bénéficié de subvention sur la base de projets leurs crédits récurrents. M. Pierre-André Périssol a demandé, s'agissant de l'utilisation des crédits récurrents, si la présence de représentants du ministère dans les conseils d'administration des EPST permettrait d'éviter que ceux-ci adoptent l'attitude que vient de décrire le ministre délégué. Le ministre délégué a assuré veiller à ce qu'il y ait une cohérence dans la répartition des postes budgétaires. Ce qui relève de la responsabilité des organismes, c'est la façon dont ils gèrent les crédits pour favoriser l'excellence des laboratoires, ce qui est d'ailleurs un art difficile. Il faut une politique plus souple et plus déterminée que celle qui consiste à augmenter un peu les crédits pour les laboratoires jugés très bons, à les maintenir simplement pour ceux qui sont jugés moyens, et à les diminuer légèrement pour ceux qui sont jugés mauvais. D'ores et déjà, l'Inserm applique une modulation plus incitative des crédits récurrents en fonction des résultats de l'évaluation des unités de recherche, c'est là une voie à poursuivre. En écho aux revendications de certains chercheurs qui se plaignent de devoir attendre plusieurs mois avant de connaître et de pouvoir utiliser leurs crédits annuels, M. Pierre Lasbordes a suggéré que les laboratoires puissent disposer de leurs crédits récurrents dès le mois de janvier afin que les personnels soient moins inquiets et plus motivés. Le ministre délégué a objecté que cela ne dépend pas du ministère de tutelle mais des organismes eux-mêmes. M. Pierre Lasbordes a exhorté, dès lors, ledit ministère de tutelle à annoncer clairement que les directeurs d'organismes ont pour mission de faire en sorte que, le 15 janvier, tous les laboratoires aient leurs crédits récurrents... Le ministre délégué a répondu qu'une décision doit être prise au sommet, mais que les procédures internes d'arbitrage entre les différentes directions scientifiques des EPST, nécessaires à une répartition des crédits juste et efficace, ont également tendance à ralentir les choses. Le ministère incitera les établissements à aller dans le sens souhaité. Mais cela ne relève pas du domaine législatif. Le président Jean-Pierre Door a insisté sur l'importance, pour l'avenir de la recherche, de l'existence, dans le dispositif de pilotage stratégique de la recherche, d'un Haut conseil placé sous l'autorité du ministre chargé de la recherche ou du Premier ministre, et a demandé au ministre délégué comment il envisage la composition de ce Haut conseil. Le ministre délégué a dit être justement en train de travailler sur ce sujet. Selon les orientations actuellement envisagées, le Haut conseil serait chargé des missions de prospective ; il serait également chargé de donner un avis en matière de grands programmes et de grands équipements, de rechercher le consensus de la société autour de la recherche et de l'innovation, de conseiller le Gouvernement en matière de politique de recherche internationale et européenne. Il serait placé soit auprès du Président de la République, soit auprès du Premier ministre, soit auprès du ministre chargé de la recherche. Sur ce point, rien n'est encore arrêté. De même, son vice-président pourrait être nommé par le Président de la République, par le Premier ministre ou par le ministre chargé de la recherche. Le Haut conseil devrait se réunir de manière très régulière, c'est-à-dire une fois par mois, et aussi chaque année, avant le vote du budget, sous la présidence du Premier ministre ou du Président de la République, auquel il remettra un rapport, de façon qu'il y ait une relation forte entre l'action du Haut conseil, les orientations retenues par le pouvoir politique et les choix de politique budgétaire. En ce qui concerne la composition de cette instance, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre chargé de la recherche pourrait nommer cinq personnalités choisies en raison de leur qualification et de leur expérience. Huit personnalités pourraient représenter des organismes de recherche ou des établissements publics d'enseignement supérieur. L'Assemblée nationale et le Sénat pourraient nommer chacun deux membres, de même que le Conseil économique et social. En toute hypothèse, ses membres ne devraient pas être trop nombreux, vingt-cinq au maximum, afin que le conseil dispose d'une véritable capacité opérationnelle puisque, en définitive, le but de cet organisme est qu'il donne certes des avis, mais des avis fermes, susceptibles d'exécution, et ayant un poids politique. Le président Jean-Pierre Door a indiqué que les personnes entendues par la mission d'information ont préconisé la présence dans ce Haut conseil de représentants du monde économique ainsi que de scientifiques étrangers de sorte que l'évaluation soit conduite à une échelle plus large. Le ministre délégué a reconnu que cela fait effectivement partie des hypothèses de travail actuellement envisagées. M. Pierre-André Périssol a insisté sur la nécessité d'informer les citoyens afin qu'ils se sentent impliqués dans l'aventure de la recherche. La connaissance des politiques de recherche est en effet un préalable à ce que les citoyens aient une vision positive de la recherche, porteuse de progrès. Or la faiblesse du pilotage stratégique du dispositif renforce le flou ambiant et, dans ces conditions, le divorce entre la population et la science ne peut que s'accroître. Le ministre délégué a souligné qu'une relation apaisée entre la science et les citoyens passe avant tout par la mise en place de mécanismes tendant à améliorer l'acceptabilité des enjeux scientifiques majeurs par l'opinion publique - mécanismes qui manifestement ont fait défaut dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) ; les grands domaines d'exploration actuels ont des implications pour l'homme et suscitent par conséquent de légitimes inquiétudes : il en va ainsi des découvertes sur le génome ou des nanotechnologies, susceptibles, par exemple, de permettre l'implantation dans le corps d'une puce électronique capable de lire ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Ces mécanismes supposent la création d'institutions, comme la future fondation de recherche culturelle et scientifique, à vocation transversale ainsi que de structures de formation et de relais d'opinion et d'action. Certains ont également imaginé un « institut des hautes études de la recherche et de l'innovation ». A l'avenir, tout plan stratégique de recherche doit donc prendre en compte l'acceptabilité par la société des recherches en cours en prévoyant des études simultanées dans le champ des sciences sociales à ce sujet. Le président Jean-Pierre Door, abordant la question du devenir des organismes de recherche, a demandé s'il convient, selon le ministre délégué, de les transformer en agences de moyens ou de programmes, de redessiner leurs frontières comme certains le préconisent et comment doivent évoluer leurs relations avec les universités et les grandes écoles. Le ministre délégué a déclaré que le gouvernement n'est guère enclin à jouer au meccano, à très vaste échelle, avec les structures actuelles de la recherche. Compte tenu de leur histoire, revoir de fond en comble leur construction serait assez compliqué à réaliser, même si certains scénarios, tel celui du rapprochement entre le département « Sciences du vivant » du CNRS et l'Inserm, sont régulièrement évoqués. Il existe cependant des marges de manœuvre à l'intérieur de chacun des organismes ; la réforme actuellement en cours du CNRS prévoit d'ailleurs une diminution du nombre de départements, avec plusieurs regroupements. Il convient également d'améliorer les coordinations entre EPST ainsi qu'avec les universités. En fait, l'idée est d'accroître le financement sur projets par rapport au financement des structures sans toucher aux crédits récurrents des laboratoires : à titre d'exemple, les effectifs du siège du CNRS, depuis son installation rue Michel-Ange il y a dix ans, ont augmenté de 30 % pour atteindre mille agents auxquels il faut ajouter les mille autres qui travaillent dans les délégations régionales ! En conséquence, le ratio entre support logistique et activité de recherche proprement dite est disproportionné par rapport aux organismes étrangers comparables. En tout état de cause, des réorganisations internes s'imposent donc dans le cadre des statuts actuels et par transformations de postes. Par ailleurs, le modèle comptable auquel sont soumis les établissements doit être modernisé et devenir plus responsabilisant, avec, notamment, la suppression du contrôle financier a priori lequel, créé à l'origine pour permettre une saine gestion des deniers publics, aboutit parfois à des absurdités en freinant le travail au quotidien et le développement des laboratoires. Il faut également encourager les organismes à développer leurs ressources propres, via la valorisation des résultats de la recherche, non pas pour remplacer les moyens récurrents des laboratoires, car cette logique finit forcément par décourager les chercheurs, mais au contraire pour inciter ces derniers à obtenir des contrats. Enfin, si tout le monde s'accorde à dire qu'une politique de sites s'impose pour améliorer les liens entre organismes de recherche et enseignement supérieur, il existe des nuances importantes entre les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) proposés par les états généraux de la recherche, les pôles de compétitivité et les projets de l'opération FutuRIS (Recheche, innovation, société) ou ceux envisagés par MM. François Jacob, Philippe Kourilsky, Jean-Marie Lehn et Pierre-Louis Lions, auteurs de l'appel Du Nerf !. Deux éléments émergent d'ores et déjà : il faudra de toute façon procéder à des expérimentations et les pôles de compétitivité ressembleront à des PRES doublés d'un parc de recherche, mêlant laboratoires publics et privés, établissements d'enseignement supérieur, grandes écoles et structures de valorisation, sur le modèle de la Silicon Valley ou de sites similaires en Europe. La démarche des membres du « club » des créateurs du pôle devra être volontaire et la labellisation de ces zones par l'autorité publique devra être subordonnée à la mise en œuvre d'une politique forte en matière de contractualisation, de participation et de valorisation. M. Pierre Lasbordes s'est dit soucieux de prêter la plus grande attention au respect des engagements pris quant à la diminution du nombre de fonctionnaires et à la réforme de l'État. Réformer les structures de recherche est certes compliqué et long mais les obstacles ne doivent pas être éludés. Dans la loi d'orientation et de programmation, il faudra adopter des mesures phares pour modifier les périmètres ou tout du moins interdire la constitution de nouveaux instituts sans murs ou de groupements d'intérêt public (GIP), sous peine de décevoir les Français comme cela a été le cas avec l'avant-projet de loi sur l'école. A ce titre, il convient de mettre de l'ordre dans les pôles de compétitivité d'Ile-de-France tels qu'ils existent aujourd'hui et qui donnent l'impression d'une grande pagaille. De la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), de la direction générale de l'industrie des technologies de l'information et des postes (DIGITIP) du ministère délégué à l'industrie, du ministère de la recherche, qui est le pilote ? On l'ignore. Ne serait-ce que pour faciliter les réponses aux appels d'offres, le gouvernement doit nommer un ministère chef de file, qui serait l'interlocuteur unique. Le président Jean-Pierre Door a demandé s'il est envisageable de faire évoluer le statut de certains établissements de recherche du statut d'EPST vers celui d'EPIC. Le ministre délégué a répondu que la gestion des EPST pourrait en effet connaître quelques assouplissements mais que le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit prévoit déjà que ces établissements puissent glisser vers une structure de type EPIC. S'agissant du rapprochement avec les universités et les établissements de recherche, il apparaît souhaitable d'accorder des décharges de cours pendant deux ou trois ans, aux jeunes maîtres de conférence qui entrent dans la carrière afin qu'ils puissent se consacrer à leurs activités de recherche. Il est vrai qu'un tel dispositif est plus difficile à mettre en œuvre en France que dans le système anglo-saxon car il rejoint le problème plus global de la gouvernance des universités. Il convient également de rapprocher le système d'évaluation des enseignants-chercheurs de celui des chercheurs, sans pour autant le calquer sur celui-ci. De toute façon, la réforme à venir devra faire l'objet d'une concertation car le consensus est indispensable à sa réussite. Actuellement, des résistances apparaissant sur certains points sensibles mais on constate aussi que les chercheurs essaient de sortir des pièges tendus par le corporatisme ou la facilité. Afin de lutter contre le malaise des jeunes chercheurs et la fuite des cerveaux, le président Jean-Pierre Door a évoqué la possibilité de créer, sous la forme de « package », des contrats courts dotés d'un financement convenable permettant aux jeunes chercheurs de mener à bien leurs recherches dans l'attente d'une position permanente. Le ministre délégué a répondu qu'il convient en effet d'accompagner l'étudiant qui choisit de faire de la recherche. Reste à savoir si les allocations de recherche pèchent en premier lieu par leur nombre, par leur montant ou par leur insuffisante modulation au cours du cursus. La coordination avec le monitorat et l'indexation de l'allocation sur l'inflation devront également être examinées. Considérant le nombre d'allocations versées actuellement - environ 12 000 -, il ne serait pas illégitime d'encourager davantage, sur le plan financier, ce qui s'apparent à un emploi qualifié, voire super-qualifié. D'autre part, un système de « package » a d'ores et déjà été amorcé avec le dispositif des « chaires d'excellence ». En plus de son salaire, le titulaire d'une chaire dispose d'un budget pour embaucher une dizaine de chercheurs, thésards, post-doctorants ou chercheurs juniors. La montée en puissance de ce dispositif permettra au système français de lutter à armes égales contre ses concurrents. En effet, pour les grands chercheurs, l'écart d'attractivité entre pays est certes affaire de salaire, mais aussi de budget global pour le recrutement de collaborateurs et l'achat d'équipements. Revenant sur la question des pôles de compétitivité, le ministre délégué a indiqué qu'ils sont actuellement pilotés par le ministère de l'équipement et par la DATAR de sorte que la logique qui préside à leur création et à leur développement est tout autant une logique d'excellence qu'une logique d'aménagement du territoire. Or, à l'évidence, ceux qui parviendront à émerger et à obtenir une visibilité au plan international sont ceux qui regrouperont, dans un même parc de recherche, les unités de recherche, les grandes écoles et les établissements d'enseignement supérieur les plus affirmés, avec, en accompagnement, un dispositif de valorisation. Le point de départ est le club des créateurs, même si celui-ci reste ouvert à d'autres acteurs. Le président Jean-Pierre Door a remercié le ministre délégué et lui a annoncé l'envoi d'autres questions par écrit, concernant notamment le statut des jeunes chercheurs, l'espace européen de la recherche, ou encore l'excessive lourdeur des dossiers à remplir pour obtenir les financements du programme-cadre de recherche et développement (PCRD) européen. * Réponses écrites de M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche, aux questions de la mission d'information Question du président Jean-Pierre Door : Faut-il tenter, sur le modèle international, de mettre l'université au cœur du dispositif de recherche ? Le cas échéant, par quels moyens ? En l'état actuel de leur organisation administrative, les universités sont-elles aptes à jouer ce rôle ? Que pensez-vous de l'idée d'aller vers plus d'autonomie dans la gestion des universités ? Réponse de M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche : Cela dépend de ce que veut dire « mettre l'université au cœur du dispositif de recherche ». L'université contribue déjà de façon essentielle à l'effort public de recherche. Pour autant, il me semble évident qu'il convient de renforcer les liens entre les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) et l'université. Un des moyens de le faire est de créer, comme cela est suggéré dans le rapport du comité d'initiative et de proposition (CIP) à l'issue des états généraux de la recherche, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), adossés à une structure universitaire, apte à innover, en partenariat avec les entreprises et les collectivités territoriales. Un autre moyen de renforcer la recherche universitaire est de permettre aux jeunes maîtres de conférence de faire davantage de recherche lors de leurs premières années, en les faisant bénéficier de décharge de cours voire en les détachant sur des postes d'accueil dans les établissements de recherche. Une plus large autonomie de l'université est souhaitable et les PRES devront fonctionner selon un principe de large autonomie, en particulier financière. Question du président Jean-Pierre Door : Les pôles de compétitivité devront-ils forcément être organisés autour des universités ou bien peut-on imaginer des pôles de compétitivités organisés autour de grandes écoles ou d'organismes publics de recherche ? Comment s'assurer que ces pôles ne seront pas trop nombreux et correspondront bien à la mise en œuvre d'une politique d'excellence ? Réponse du ministre délégué : En toute logique, les pôles de compétitivité devraient se construire en général en association avec les universités ; dans des cas particuliers, il ne peut être exclu qu'ils soient organisés autour de grandes écoles et/ou d'organismes publics de recherche. L'objectif du gouvernement est que dans un premier temps ils ne soient pas trop nombreux et relèvent d'un choix mettant comme premier critère de sélection l'excellence ? C'est en ce sens que l'appel d'offre « pôles de compétitivité » a été rédigé par la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR). Question du président Jean-Pierre Door : Que pensez-vous de l'idée de mettre fin aux tutelles multiples pour la gestion administrative des unités mixtes de recherche (UMR) ? Réponse du ministre délégué : Cette simplification administrative fait partie des mesures d'amélioration de la gestion au quotidien dans les laboratoires que je mets progressivement en place. A ce propos, je souhaite que la pratique du mandat de gestion soit généralisée sans délai pour les UMR. Il sera en général confié à l'organisme qui investit le plus dans l'UMR en personnel, en fonctionnement et en équipement, sauf disposition contraire décidée par les parties. Le mandataire gèrera donc pour le compte des partenaires, les moyens que ceux-ci attribuent à l'unité et qu'ils lui transfèrent annuellement au moment de sa dotation. Question du président Jean-Pierre Door : Une augmentation significative des ressources des jeunes chercheurs est-elle envisageable ? Réponse du ministre délégué : Je suis convaincu qu'il faut améliorer les conditions de travail des jeunes chercheurs à tous les stades de leurs parcours. Dans cette perspective, je propose l'indexation de l'allocation de recherche sur l'inflation. Je suis également favorable à une revalorisation des traitements à l'entrée dans l'appareil de recherche pour les jeunes chercheurs. Par ailleurs, il faut que dès leur entrée, ils puissent bénéficier d'un « package », c'est-à-dire d'un montant de crédits, sécurisé sur un horizon pluriannuel et pouvant être utilisé de façon souple, pour mettre en œuvre leur projet de recherche. Question du président Jean-Pierre Door : Etes vous partisan de la fusion ou du rapprochement des statuts de chercheurs et d'enseignants-chercheurs ainsi que de l'assouplissement de ces statuts ? Que pensez-vous notamment de l'idée de permettre, pour les enseignants-chercheurs, une plus grande modulation, dans le temps de la carrière, entre les charges de recherche et les charges d'enseignement selon les résultats obtenus lors des évaluations ? Réponse du ministre délégué : Je ne pense pas qu'une fusion des statuts de chercheurs et d'enseignants-chercheurs soit une solution miracle. Je crois qu'il faut avant tout améliorer la situation des personnels relevant de ces deux catégories et susciter davantage de synergie. Cela peut passer en effet par des décharges d'heures d'enseignement pour les enseignants-chercheurs afin de leur permettre d'aller en accueil ou demi-accueil dans les établissements de recherche, sur la base d'une évaluation de leur projet de recherche. En matière de décharges d'heures d'enseignement, je pense qu'elles doivent en priorité concerner les jeunes maîtres de conférence. Question du président Jean-Pierre Door : Est-il envisageable de mettre fin au statut de fonctionnaire des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour lui substituer, comme dans les autres pays du monde, des positions contractuelles permanentes ? Réponse du ministre délégué : Je ne pense pas qu'il soit pertinent de mettre fin au statut de fonctionnaire pour les agents de notre appareil public de recherche. C'est un des éléments clef de son attractivité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir aux moyens de rendre notre appareil de recherche plus réactif et compétitif pour accueillir notamment des chercheurs de haut niveau étrangers ou venant de l'industrie. C'est la direction dans laquelle nous sommes allés avec la création dans le budget 2005 de 200 postes d'accueil de haut niveau dans les EPST. Il faudra amplifier rapidement et significativement le dispositif dans les années qui viennent. Question du président Jean-Pierre Door : Comment améliorer l'évaluation de la recherche et des chercheurs ? Comment faire en sorte que la prise en compte des résultats de cette évaluation ne bute pas sur l'impossibilité, pour des raisons administratives, de distinguer significativement les meilleurs ? Réponse du ministre délégué : Je pense qu'il faut enrichir les critères de l'évaluation des chercheurs et des équipes. Les tâches des chercheurs se sont en effet diversifiées et l'évaluation doit s'adapter aux évolutions du métier. Il n'y a aucune raison statutaire qui empêche d'en tirer ensuite des conséquences, positives ou négatives. Je suis à cet égard favorable au développement des rémunérations au mérite et à la modulation des moyens récurrents dont dispose les équipes en fonction de l'évaluation faite du travail accompli. Je souhaite que cette modulation soit aussi significative que possible. Question du président Jean-Pierre Door : Comment développer les structures de valorisation de la recherche académique lesquelles, apparemment, à l'exception de celle de l'Inserm, ne fonctionnent pas très bien ? Réponse du ministre délégué : La valorisation de la recherche publique fait partie intégrante des missions des établissements publics de recherche. Or les moyens humains et matériels attribués à ces actions sont en général trop limités et dispersés. Les structures de valorisation de la recherche des établissements publics atteignent de ce fait rarement la taille critique requise pour avoir une réelle efficacité. En particulier, la mise en place de services d'activités industrielles et commerciales (SAIC) dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) n'a, pour l'heure, pas donné entière satisfaction. Le ministère mène actuellement des réflexions, à partir des résultats d'une mission conduite par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR), pour améliorer leurs modalités d'actions. Plus généralement, indépendamment du statut juridique de la structure de valorisation, des efforts de mutualisation, d'harmonisation des pratiques et de professionnalisation seraient propices, voire indispensables, au renforcement des actions de valorisation des établissements publics de recherche. Dans ce contexte, le ministère chargé de la recherche réfléchit aux dispositifs qui permettront aux établissements publics de recherche d'assurer au mieux leur mission de valorisation, sans qu'elle ne se fasse au détriment de la qualité de leur recherche ou de l'enseignement qu'ils dispensent. En particulier, la mutualisation des moyens de valorisation des établissements situés dans des pôles de recherche sera vigoureusement promue. Question du président Jean-Pierre Door : L'association Armines dont nous avons auditionné le président, M. Pascal Iris, nous a déclaré rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître un statut juridiquement sécurisé ? Avez-vous été saisi du problème ? Avez-vous des solutions à proposer ? Réponse du ministre délégué : Le ministère chargé de la recherche a bien été saisi du problème. En fait, il s'agit d'une question qui dépasse le cadre stricto sensu de l'association Armines. Il concerne l'ensemble des structures de gestion de recherche contractuelle de droit privé - sociétés anonymes (SA), associations loi 1901, etc. - qui sont adossées à un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche (école d'ingénieur, université, EPST, ...). Plusieurs de ces structures, dont l'association Armines, ont fait la preuve de leur capacité à conduire des collaborations de recherche technologique de qualité avec des industriels, en sachant s'adapter aux attentes de ceux-ci tant sur le plan du contenu des travaux de recherche que du montage des partenariats (réactivité, souplesse). Le point délicat consiste pour des établissements publics à confier à des tiers l'accomplissement de tout ou partie des activités de services publics qui leur ont été spécialement attribuées par la loi. C'est ainsi que des interrogations existent sur la robustesse juridique des conventions confiant aux structures de recherche contractuelle la passation et la gestion de contrats de recherche ou de formation continue réalisés, en partie, avec les moyens matériels et humains des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche peuvent légitimement être considérés comme illégaux. Le projet de loi d'orientation et de programmation sur la recherche que prépare le gouvernement comportera un important volet consacré à la recherche partenariale : dans ce cadre, il devrait proposer d'améliorer la sécurité juridique des relations établies entre des établissements publics de recherche et des structures de droit privé, sous réserve du respect d'un certain nombre de critères garantissant le professionnalisme et la transparence de ces actions. Question du président Jean-Pierre Door : Qu'en est-il de la proposition du Président de la République, M. Jacques Chirac, de placer les dépenses publiques de recherche et développement en dehors des critères du pacte de stabilité et de croissance ? A-t-elle réellement une chance d'aboutir ? Réponse du ministre délégué : J'y suis très favorable. Il existe aujourd'hui un large consensus autour de cette question. Nombre de rapports - par exemple le récent rapport du Conseil d'analyse économique de M. Jean Paul Betbèze - le préconisent. Cette idée sera débattue au niveau européen et, dans le cadre d'une réforme globale du pacte de stabilité et de croissance, peut aboutir. Question du président Jean-Pierre Door : Comment la France pourrait-elle intensifier sa participation au programme-cadre de recherche et développement (PCRD) ? Les petites structures, qu'elles soient publiques ou privées, se plaignent de la lourdeur des dossiers à constituer pour prétendre au bénéfice des aides européennes ? A votre avis, serait-il envisageable de mettre en place une structure chargée de les aider dans la constitution de ces dossiers ? Réponse du ministre délégué : Je suis par nature opposé à la création de bureaucraties nouvelles, quand bien même leur objectif de départ est louable. En revanche, je pense que c'est à l'intérieur même des établissements ou des universités qu'il faut développer ces compétences et les mutualiser afin d'aider voire de décharger les unités individuellement de cette surcharge de travail administratif et juridique, qui est parfois dissuasive dans la recherche de financements extérieurs. ---------- N° 1999 - Rapport d'information sur la recherche publique et privée en France face au défi international (M. Jean-Pierre Door) 1 Citation tirée de l'article Recherche : jusqu'où ira le déclin paru dans Le Monde du 4 août 2003. 2 L'effort de recherche d'un pays est le rapport entre la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) et le produit intérieur brut (PIB). 3 M. François Jacob, biologiste, prix Nobel de médecine, M. Philippe Kourilsky, immunologiste, directeur général de l'Institut Pasteur, M. Jean-Marie Lehn, chimiste, prix Nobel de chimie, M. Pierre-Louis Lions mathématicien, décoré de la médaille Fields. Les quatre auteurs sont membres de l'Académie des sciences et professeurs au Collège de France. 4 Texte paru dans la revue Commentaire (n° 106, été 2004). 5 Les conclusions de cette étude ont été publiées dans Le Figaro du 3 juin 2004. 6 Il existe deux normes de brevets au niveau international : le brevet européen et le brevet américain. 7 M. Guy Aubert, Mme Catherine Bréchignac, MM. Robert Chabbal, Jacques Ducuing, Serge Feneuille et Jean-Jacques Payan. 8 Les dépenses exécutées par le secteur public (DIRDA) représentent quant à elles un peu plus de 12 milliards d'euros, soit 0,82 % du PIB. Plus de 94 % de ces dépenses sont financées par les administrations publiques françaises ou étrangères (y compris européennes). 9 Le chiffre est de 36 % pour l'Union européenne (à 15 membres). 10 Equivalent du prix Nobel pour les mathématiques. 11 Etude, dont les résultats sont parus dans Le Figaro du 3 juin 2004, fondée sur le pourcentage des articles publiés par 27 universités et organismes de recherche de premier plan dans les plus grandes revues scientifiques mondiales entre 1999 et 2003. 12 M. Jean-François Girard, président de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), EPST créé en 1944, a également participé aux travaux de la mission d'information en lui faisant parvenir une contribution écrite. 13 Le CNRS a été créé par décret du Président de la République, Albert Lebrun, le 19 octobre 1939. 14 Le détail de ces préconisations est consigné dans un document intitulé Notre projet pour le CNRS publié le 1er mars 2004 et rédigé par M. Bernard Larrouturou, directeur général du CNRS et Bernard Mégié, président du CNRS, décédé le 5 juin 2004. 15 http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500(1-100).pdf 16 Nombre de prix Nobel issus des établissements, présence des chercheurs les plus cités dans 21 grands domaines, nombre d'articles publiés dans les revues Nature et Science, nombre de citations dans les articles de Nature et Science et performance académique par facultés. Ces critères accordent ainsi une place prépondérante aux sciences du vivant et par là lèsent la recherche française qui traditionnellement obtient de meilleurs résultats en mathématiques que dans la recherche sur le vivant. 17 M. Etienne-Emile Baulieu, président de l'Académie des sciences, préconise ainsi que les classes préparatoires aux grandes écoles soient intégrées dans l'université. M. Paul Clavin, administrateur de l'Institut universitaire de France (IUF), qui préconise également un rapprochement des grandes écoles et de l'université, propose que l'exclusivité de la collation des grades revienne à l'université., 18 Sommes versées pour l'accomplissement d'un travail de recherche sans contrat de travail. 19 Mme Laurence Esterle, directrice de l'OST, estime plus inquiétant encore ce qu'elle qualifie de phénomène du « tuyau percé », c'est-à-dire le nombre de jeunes qui quittent la France durant leurs études supérieures à partir du baccalauréat jusqu'au doctorat. Cette inquiétude est corroborée par une étude réalisée en 1999 par le bureau du CNRS à Washington qui montre que 75 % des chercheurs européens ayant obtenu leur doctorat dans une université américaine manifestaient l'intention de rester aux Etats-Unis alors qu'ils n'étaient que la moitié en 1990. 20 En 1975, avec 4 % des jeunes détenteurs d'un diplôme supérieur en sciences, les Etats-Unis se plaçaient juste derrière la Finlande et le Japon et loin devant la France (2 %). La tendance s'est aujourd'hui inversée puisque, en 2000, ce même taux était de 5,7 % pour les Etats-Unis tandis qu'il s'élevait à 11 % pour la France. 21 Mission scientifique pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux Etats-Unis, Les Universités américaines : quelques données, juillet 2004. 22 Comparaison effectuée avec les chiffres 2001, les seuls disponibles actuellement pour les trois pays. En 2001, le nombre des chercheurs français était, selon l'OST, évalué à environ 174 000. 23 Propos tenus le 30 septembre 2004 à l'occasion d'une intervention du ministre lors de la pose de la première pierre de l'université Denis-Diderot - Paris VII. 24 Tandis que l'industrie (grandes entreprises et PME confondues) contribue pour 24,3 % au PIB, sa part relative dans la dépense intérieure de R&D des entreprises est de 89,4 %. 25 Intervention du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Nicolas Sarkozy, à l'occasion du lancement du rapprochement de l'ANVAR et de la BDPME le mardi 12 octobre 2004. 26 Cette législation a accordé aux universités et aux autres établissements à but non lucratif attributaires de crédits fédéraux de R&D la propriété intellectuelle de leurs découvertes effectuées en utilisant ces crédits. 27 Données fournies par la mission pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux Etats-Unis. 28 Rapport de la mission pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux Etats-Unis. 29 A ce titre, il n'est pas inutile de comparer l'effort public de recherche communautaire, incarné par le PCRD (environ 17,5 milliards d'euros par an), et l'effort public de recherche américain (79 milliards d'euros par an), et de constater l'écart considérable qui les sépare au profit de ce dernier. 30 La compétence européenne en matière de recherche figure désormais à l'article 164 du traité CEE qui autorise la mise en œuvre de programmes de recherche, la promotion de la coopération, la diffusion et la valorisation des résultats et la stimulation de la formation et de la mobilité. Et, si la Constitution européenne, fait de la recherche une compétence partagée entre l'Union et les Etats membres, elle ne modifie pas les dispositions du traité relativement au contenu de la politique de recherche. 31 Interview parue dans Le Figaro du mardi 26 octobre 2004. 32 Une fragmentation existe également à l'intérieur même des établissements, selon les disciplines, et notamment entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales (SHS). La faute en revient à un système qui, dès les classes préparatoire aux grandes écoles, institue deux filières étanches : maths sup'-maths spé d'un côté et hypokhâgne-khâgne de l'autre. 33 Les Universités au XXIe siècle : pour une nouvelle Europe des Lumières, novembre 2004 (n° 1927). 34 Propos tenus lors d'une conférence sur le thème « Rebâtir la recherche : comment utiliser le modèle américain pour éclairer les débats français ? - Le couplage privé-public en France et aux Etats-Unis » qui s'est déroulée à l'Institut Pasteur le 23 septembre 2004 à l'initiative de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT) et de la French-American foundation (FAF). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||