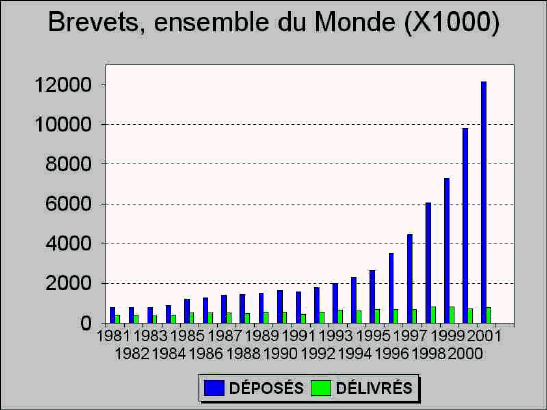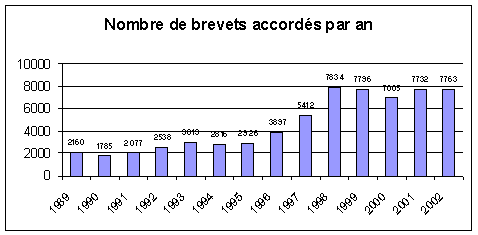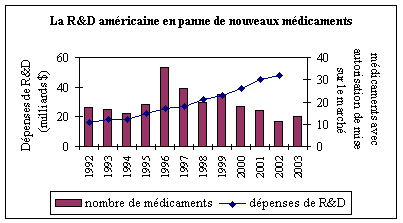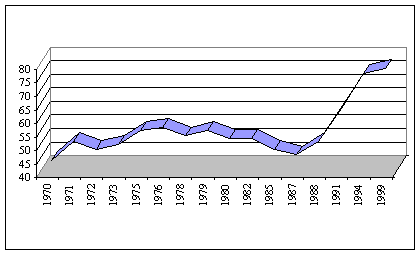OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION ________________________ RAPPORT Par M. Alain Claeys,
Sommaire Pages Introduction 3 Première partie : L'appropriation croissante du vivant 7 1 - Un contexte favorable à l'appropriation du vivant 7 A - Un mouvement général d'appropriation 7 B - La croissance des brevets dans le domaine du vivant 13 C - L'émergence des petites entreprises de biotechnologie 15 2 - L'appropriation du vivant est permise par l'affaiblissement des critères classiques de la brevetabilité 22 A - La nouveauté 22 B - L'inventivité 23 C - L'application industrielle 24 D - Le problème des revendications 26 E - Le débat scientifique des fonctions du gène 27 3 - La galaxie du brevet 30 A - Un milieu fermé 30 B - Les offices de brevet 32 C - Un secteur délaissé par le politique 36 Deuxième partie : Les interrogations face à ce mouvement 38 1- La situation des pays en développement 38 A - Des pays riches en biodiversité et en savoirs traditionnels 39 B - La question de l'accès à la biodiversité et aux savoirs traditionnels 40 C - Les droits des communautés autochtones 47 D - Des pays différents aux approches particulières 49 E - L'interrogation sur la valeur des ressources génétiques pour les pays en développement 55 2 - La dimension éthique et sociale 58 A - L'interrogation éthique : les banques de données biologiques humaines. L'expérience islandaise 58 B - le problème social 65 3 - La question économique 70 A - Appropriation du vivant et incitation à la recherche 70 B - Quelle politique pour les organismes publics de recherche ? 83 C - L'agriculture face à ce mouvement 91 Troisième partie : L'appropriation du vivant ne peut être régulée qu'au niveau international 95 1 - Agir au niveau européen 96 A - Le débat autour de la directive 98/44/CE 96 B - La position de la France 98 C - Renégocier l'article 5 de la directive 100 2 - La négociation internationale 101 A - La réforme de l'article 27 3. b) des A.D.P.I.C. 101 B - La coexistence de la C.D.B. et des A.D.P.I.C. 105 C - Le traitement des problèmes de propriété intellectuelle par deux organismes internationaux : l'O.M.P.I. et l'O.M.C. 110 Examen du rapport par l'Office 127 Personnalités auditionnées 129 En décembre 2001, je présentais devant l'Office un rapport sur «La brevetabilité du vivant » suite à la saisine de la Commission des affaires culturelles et familiales de l'Assemblée nationale. J'avais souhaité alors faire un travail rapide dans la perspective de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi de révision des lois « bioéthique » qui a eu lieu en février 2002. Ce rapport était principalement centré sur l'analyse des dispositions de la directive 98/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. A l'occasion de cet examen j'avais abordé, mais seulement en quelques pages, les conséquences de cette brevetabilité du vivant en matière éthique, économique et sociale. J'avais recommandé que le vivant humain soit écarté de la brevetabilité. J'avais alors été entendu car, à l'occasion de ce débat de 2002, l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité un amendement refusant la brevetabilité des gènes humains. Ce rapport examinait rapidement un certain nombre de sujets, notamment les conséquences pour la recherche, en matière éthique et pour les pays en voie de développement de cette brevetabilité du vivant. La brièveté de son élaboration ne m'avait pas permis d'effectuer de missions à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne alors que j'avais souligné la dimension mondiale de cette question. C'est pourquoi la saisine du Bureau de l'Assemblée nationale demandant d'approfondir la réflexion sur les modes d'appropriation du vivant sur les plans économique, juridique et éthique a été particulièrement opportune. Les termes mêmes de cette saisine invitent à dépasser la brevetabilité stricto sensu pour s'intéresser à toutes les formes d'appropriation du vivant que ce soit le certificat d'obtention végétal (C.O.V.) ou ce qu'on appelle le « biopiratage », terme assez suggestif par lui-même. Cette nouvelle étude ne revient pas sur un certain nombre de points qui ont été traités dans le rapport de décembre 2001. Ainsi n'est pas reprise, par exemple, la présentation du mécanisme du vivant ni celle du brevet ou des dispositions de la directive 98/44/CE. Le présent rapport, conformément à la saisine, est centré sur l'approfondissement des conséquences de cette appropriation du vivant. Pour sa réalisation, j'ai d'abord procédé à l'audition des personnalités qu'il ne m'avait pas été possible de rencontrer pour le précédent rapport. J'ai également effectué quelques missions qui m'ont permis d'évaluer la situation dans ce domaine d'un certain nombre de pays. Ainsi, lors d'un déplacement d'une grande intensité et très enrichissant en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), j'ai pu rencontrer à peu près tout l'éventail des opinions en la matière, que ce soit des industriels, des chercheurs, des représentants des pouvoirs publics ou des associations. Un bref passage au Costa Rica m'a donné l'occasion de mesurer les efforts et les limites de l'action d'un pays en voie de développement riche en biodiversité mais manquant de moyens financiers. Ce pays est très intéressant car il a été, voilà une quinzaine d'années, très en pointe dans la défense de son patrimoine de ressources génétiques. Un rapide déplacement en Islande a été riche d'enseignements sur les problèmes éthiques que, d'ores et déjà, pose cette appropriation du vivant avec la mainmise d'une entreprise privée sur les informations génétiques et sanitaires de toute une population. J'ai également tenu à rendre visite aux grandes organisations internationales, Organisation mondiale du commerce (O.M.C.), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (F.A.O.) qui, à des degrés divers, sont concernées par de nombreux aspects de cette propriété du vivant. J'ai aussi rencontré les membres des cabinets des Commissaires européens concernés par cette question, compte tenu de l'importance fondamentale prise par les textes européens dans ce domaine comme l'a montré le débat autour de la directive 98/44/CE. L'appropriation du vivant est de plus en plus un thème structurant pour un nombre important de domaines : situation des pays en voie de développement, accès aux médicaments, devenir de l'agriculture et de la recherche. De ce point de vue, j'ai été surpris de voir combien le problème de la recherche face à la brevetabilité du vivant pouvait générer de discussions et de controverses dans un pays comme les Etats-Unis que l'on pouvait imaginer a priori plus apaisé et plus unanime sur ce sujet que ne l'est par exemple la France. Les questions éthiques sont également très présentes avec le développement des banques de données génétiques. De ce point de vue l'Islande me semble être tout à fait à l'avant-garde d'une problématique que nous risquons de rencontrer de plus en plus souvent. Enfin je tiens à remercier Mme Marie-Angèle Hermitte qui a bien voulu me faire part de ses réflexions approfondies sur ce thème, dont elle est certainement une des spécialistes français les plus averties, et m'indiquer les personnalités les plus au fait de ces questions à auditionner. L'appropriation croissante du vivant sera d'abord décrite à la fois dans son contexte et en en recherchant les causes avant de voir quelles interrogations elle suscite et de constater qu'elle ne peut être régulée qu'au niveau international. Première partie : L'appropriation croissante du vivant Depuis une vingtaine d'années existe un contexte général favorable à l'appropriation du vivant qui a été rendue possible par l'affaiblissement des critères classiques de la brevetabilité alors que s'est organisée une véritable galaxie du brevet. 1 - Un contexte favorable à l'appropriation du vivant Depuis un certain nombre d'années s'est développé un mouvement général d'appropriation. Cette évolution s'est traduite par une croissance des brevets dans le domaine du vivant due à l'émergence des petites entreprises de biotechnologie. A - Un mouvement général d'appropriation Le brevet est un monopole institué à titre temporaire sur l'usage et la commercialisation d'un produit ou d'un procédé dans le but d'encourager l'innovation technique, sa divulgation et sa mise en œuvre au bénéfice de l'innovation et de l'économie. La période actuelle se caractérise par une augmentation considérable des demandes de brevets tandis que le nombre de délivrances semble quasiment étale. Les demandes et les délivrances de brevets au niveau mondial, tous domaines confondus, sont retracées dans le tableau suivant :
Source : Progexpi.com
On voit que le nombre de demandes de brevet est stable de 1981 à 1984 et commence à augmenter à partir de 1985. L'augmentation des demandes est régulière, mais relativement faible jusqu'en 1993-1994. A partir de cette époque leur nombre croît de façon très importante avec une tendance à l'accélération à partir de 1997. C'est ainsi que les demandes passent de 3,4 millions en 1996 à 5,8 millions en 1998, à 7,3 millions en 1999, à 9,8 millions en 2000 et 12,1 millions en 2001. Le nombre de demandes de brevets a été ainsi multiplié par environ 7 depuis 1981. Il faut cependant, pour apprécier ces chiffres, noter que le nombre de pays concernés est passé dans le même temps de 66 à 106, ce qui traduit l'arrivée sur le marché de l'innovation d'un certain nombre de pays émergents. Cependant malgré ces nouveaux arrivants, la croissance des demandes reste essentiellement due aux pays très industrialisés : Etats-Unis, Japon, Union européenne ainsi que dans une moindre mesure la Corée du Sud. En regard, le nombre des brevets effectivement délivrés, tous domaines confondus apparaît relativement faible. Le tableau suivant élaboré d'après les statistiques trilatérales, c'est-à-dire publiées conjointement par l'Office européen des brevets (O.E.B.), l'Office japonais des brevets (J.P.O., Japan Patent Office) et l'Office américain des brevets (U.S.P.T.O., United States Patent and Trademark Office) montre les brevets accordés par pays ou ensemble de pays d'octroi :
Ces chiffres requièrent quelques observations. En effet le nombre de brevets délivrés ne peut pas être strictement égal au nombre de demandes dans la mesure où certaines de celles-ci sont rejetées, annulées à la suite d'une opposition ou ne sont pas poursuivies par l'auteur. Il faut aussi noter qu'une même invention peut donner lieu à un seul brevet dans son pays d'origine ou à des extensions dans un ou plusieurs pays étrangers, comme c'est le cas par exemple pour les produits pharmaceutiques. On estime que chaque invention donne lieu, de par le monde entier, à trois ou quatre brevets, c'est-à-dire un brevet de base plus trois ou quatre extensions. La tendance est très nette : il y a un accroissement considérable des demandes de brevets. Concernant les délivrances, une certaine stabilisation et même une décroissance peuvent être observées, des spécialistes allant jusqu'à évoquer une « certaine saturation ». Comme l'a estimé M. Dominique Guellec, un certain nombre de raisons peuvent être avancées pour expliquer cette croissance des demandes. Il y a d'abord des raisons économiques tenant à l'augmentation d'environ 10 à 20% des dépenses mondiales de recherche. Cette augmentation est aussi due à la transformation de la structure économique. Celle-ci tend de plus en plus vers la globalisation, la mondialisation et repose de plus en plus sur la connaissance. Ces deux phénomènes sont d'ailleurs liés car les avantages concurrentiels ne tiennent plus à la proximité des marchés de consommation. En effet les pays émergents, et, en premier lieu, la Chine, ainsi que d'autre comme Taïwan, le Brésil, l'Inde... sont devenus des concurrents redoutables des industries des pays développés. Ces derniers, afin de maintenir leur avantage concurrentiel s'orientent de façon croissante vers une économie de la connaissance. Les entreprises développent donc leurs capacités d'innovation pour préserver et accroître leur compétitivité, la valeur de la connaissance étant devenue primordiale par rapport à celle des ressources matérielles. Les brevets protégeant cette connaissance acquièrent une valeur considérable dans ce contexte. Un autre mouvement qui a été moteur dans ce domaine a été le développement des privatisations. M. Dominique Guellec a cité à cet égard l'exemple de l'ancien Centre national d'études des télécommunications (C.N.E.T.) qui brevetait peu dans la mesure où il n'y avait pas ou très peu de concurrence dans les télécommunications. La situation a radicalement changé dans ce domaine avec le développement du téléphone mobile qui a induit une très forte augmentation des demandes de brevets. Le brevet a été, originellement, conçu au XVIIIème siècle pour la mécanique, pour la machine animée par des rouages. Ce brevet ne pouvait être accordé que si la demande répondait à des critères stricts : nouveauté, inventivité, application industrielle. Une évolution très sensible a eu lieu de ce point de vue où, de façon générale, ces critères ont été substantiellement modifiés, comme nous le verrons à propos du vivant, sur l'impulsion, essentiellement des juridictions américaines et de l'Office américain des brevets. La conséquence a été que le champ d'intervention des brevets a été considérablement élargi. On s'est ainsi écarté de l'attribution de brevets portant exclusivement sur des biens matériels à des brevets portant sur des matières qui étaient, de façon classique, non protégeable ou pour lesquelles il existait d'autres moyens de protection comme le droit d'auteur ou le copyright. Le principal facteur qui a précipité ce mouvement est la mutation que nous avons évoquée de l'économie de plus en plus centrée, sur des produits « à valeur intellectuelle ajouté ». Dans cette économie dite « de l'immatériel », le contrôle des idées, des formes, des images et des marques devient un enjeu crucial. La question de la propriété des données brutes et des faits est désormais un nouvel enjeu fondamental du débat sur l'évolution de la propriété intellectuelle. Cette évolution touche des secteurs parfois inattendus : ainsi des propriétaires de curiosités naturelles ou architecturales entendent-ils contrôler et ne diffuser que contre rémunération les photographies de celles-ci. De même des contentieux se développent de plus en plus autour des personnes apparaissant dans des œuvres littéraires, des films de cinéma ou des émissions de télévision. Un certain nombre de domaines étaient traditionnellement exclus de la brevetabilité : les méthodes mathématiques, les modes de présentation d'information, les méthodes commerciales et les créations esthétiques. Une évolution est en cours dans ces domaines : les méthodes commerciales ont été déclarées brevetables en 1988 par la juridiction américaine spécialisée dans les brevets, la Cour d'appel du Circuit fédéral. Par contre la Cour d'appel de Paris l'a refusé encore dans une décision du 10 janvier 2003. Un certain nombre de juristes se sont élevés contre cette décision. On peut penser que les pressions visant à faire reconnaître la brevetabilité des méthodes commerciales iront croissantes, suivant en cela la logique de la mondialisation. De même les logiciels d'ordinateurs étaient également exclus. La situation a changé au terme d'une évolution récente qu'il paraît utile de retracer rapidement tant elle semble caractéristique et similaire au processus qui a abouti à la brevetabilité du vivant. Les logiciels sont des ensembles de programmes (ou sous-programmes) qui interagissent. Ces programmes sont des suites d'instructions écrites dans des langages définis et codant des opérations, des procédés ou des algorithmes s'appliquant à des données, à de l'information. Ils sont devenus brevetables aux Etats-Unis depuis l'arrêt de la Cour suprême Diamond versus Diehr de 1981. On estime qu'il y avait en 2001, aux Etats-Unis, 80 000 brevets portant sur des logiciels, environ 20 000 étant accordés par an. En Europe, en vertu de la directive 91/250 du 14 mai 1991, les logiciels étaient protégés par le droit d'auteur. La Convention sur le brevet européen, plus connue sous le nom de Convention de Munich, de 1973 prévoyait dans ses articles 52-2 et 52-3 l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs « en tant que tels ». Arguant de cette dernière disposition, l'Office européen des brevets (O.E.B.) a accordé depuis 1986, environ trente mille brevets portant sur des logiciels pourvu que ceux-ci aient « un effet technique », c'est-à-dire lorsqu'ils constituent une réponse technique à un problème technique. De façon symétrique à la genèse de la directive 98/44/CE, la Commission européenne a proposé dans ce domaine, en mars 2002, un projet de directive qui entérine de fait la politique suivie par l'Office européen des brevets. Dès sa publication ce texte a suscité des prises de position passionnées. Les partisans de ce projet de directive ont essentiellement mis en avant le problème des coûts croissants de la recherche et la nécessité pour les entreprises informatiques d'obtenir de meilleurs retours sur investissements. Il est évident que, dans cette logique, le seul droit d'auteur ne suffit pas dans la mesure où il ne protège que le programme dans son ensemble. En revanche, le brevet permettrait à l'« inventeur » de revendiquer un droit de propriété sur chaque élément, chaque « brique » élémentaire composant le programme, c'est-à-dire, par exemple, le format informatique, les algorithmes ou les protocoles de communication. Les processus d'innovation dans l'industrie du logiciel se font essentiellement par recombinaison d'éléments de codes ou de « briques » de programmes existant déjà. Si l'accès à chaque élément est payant, la recombinaison risque de devenir extrêmement coûteuse. L'analogie avec le gène est ici particulièrement éclairante : la brevetabilité des séquences géniques impose des péages lorsqu'on veut les recombiner. Les opposants à ce projet de directive ont fait valoir que la brevetabilité des logiciels permettrait aux grands groupes d'accroître leur domination sur le marché et d'amoindrir toute perspective de concurrence sur un marché déjà plutôt concentré. D'un point de vue économique, MM. Dominique Foray et Jacques Mairesse estimaient dans un article paru dans le quotidien « Libération » que « [le projet de la Commission] est malheureusement construit sur des énoncés généraux, affirmés mais non vérifiés, concernant l'efficacité des brevets pour stimuler l'innovation dans les technologies de l'information et de la communication ». Ce texte a fait l'objet d'importants débats depuis la fin de l'année 2002 au sein du Parlement européen au cours desquels un certain nombre d'interventions, dont celles de M. Michel Rocard, ont été décisives. Ils se sont conclus le 24 septembre 2003. Le Parlement européen a introduit des modifications très substantielles au texte de la Commission. Il a ainsi tout d'abord prévu qu'une « invention mise en œuvre par ordinateur » devra donner lieu à une innovation technique indépendante du programme et être « susceptible d'application industrielle », ce qui interdit de breveter des méthodes commerciales ou des algorithmes. Il a été précisé que la seule mise en œuvre isolée d'un logiciel par un ordinateur ne répond pas à cette exigence. Il faut que l'objet du brevet porte sur une invention plus large, pouvant englober la mise en œuvre d'un ordinateur. Le Parlement a également voulu s'écarter de la pratique américaine qui, on l'a vu, permet la délivrance de brevets pour des méthodes commerciales comme par exemple la fameuse affaire de l' « achat en un clic » d'un site Internet de vente de livres. Ces types de méthodes commerciales sont considérés par beaucoup de spécialistes comme n'étant pas des inventions mais plutôt des moyens permettant d'occuper le terrain et de gêner la concurrence. Il a ensuite prévu que l'utilisation d'une technique brevetée pour permettre la communication entre deux réseaux ou systèmes informatiques ne peut pas être considérée comme une contrefaçon. Cette disposition permet une interopérabilité du logiciel, c'est-à-dire son traitement par un autre système ou réseau informatique. Il a enfin décidé que les innovations qui « améliorent l'efficacité de l'utilisation des ressources dans le système de traitement des données » ne peuvent pas être brevetables. On peut estimer que ce texte tel qu'adopté par le Parlement européen encadre strictement la possibilité d'obtenir un brevet en matière de logiciel et assure aux utilisateurs finaux la faculté d'utiliser librement un logiciel notamment en cas de nécessité technique. Ce texte devra être examiné de nouveau par le Conseil des ministres européens. Cette affaire montre à quel point il est difficile de déterminer ce qui est brevetable ou non lorsque l'on quitte le domaine de la technique, du « tangible » et que l'on aborde ceux où les idées sont prépondérantes, comme le vivant où la croissance des brevets a été très importante. B - La croissance des brevets dans le domaine du vivant Cette croissance a été marquée à la fois dans les demandes et dans les délivrances de brevets. a - La croissance des demandes de brevets Les demandes de brevets dans le domaine du vivant sont la conséquence du considérable développement de la génomique mais aussi des techniques de séquençage automatique que j'avais évoqués dans mon précédent rapport. Le tableau suivant extrait d'un article de M. Ken Garber dans la revue américaine Signals donne une idée de l'inflation des demandes de brevets dans ce domaine pour quelques petites entreprises de génomique (chiffres pour l'année 2000) :
Pour sa part, l'Office européen des brevets (O.E.B.) a reçu de 1998 à 2002 30 000 demandes sur des inventions biologiques dont environ 10 000 concernent des « mutations ou des manipulations génétiques ». Environ 40% de ces dernières demandes portent sur des micro-organismes, des plantes ou des animaux et environ 60% sur des séquences d'A.D.N. d'origine humaine ou animale. b - La croissance de la délivrance des brevets en biotechnologie Le graphique suivant donne l'évolution des brevets accordés par année par l'U.S.P.T.O. en biotechnologie de 1989 à 2002 :
Source : U.S.P.T.O. Le nombre de ces brevets est passé de 2 160 en 1989 à 7 763 en 2000, ce qui représente une augmentation considérable. Comme on peut le voir, le nombre de brevets accordés a commencé à croître de façon importante en 1996 pour s'établir à plus de 7 000 par an à partir de 1998. De même le nombre de brevets relatifs à l'A.D.N. délivrés par l'Office des brevets japonais a aussi augmenté :
Source : O.C.D.E. Comme on l'a déjà signalé, un certain nombre de ces brevets délivrés seront considérés comme non valables après une procédure contentieuse. Néanmoins il constitue une indication fiable de l'évolution ce domaine. Cette augmentation du nombre des brevets est due à l'émergence des petites entreprises de biotechnologie. C - L'émergence des petites entreprises de biotechnologie Les petites entreprises de biotechnologie sont nées d'un changement de la politique des brevets aux Etats-Unis au début des années 1980, du développement de la génétique médicale et des difficultés éprouvées dans leur stratégie de recherche par les grandes entreprises pharmaceutiques. Leur développement a ensuite accéléré les demandes de brevet. a - Le changement de la politique des brevets aux Etats-Unis
Avant 1980, aux Etats-Unis, les universités déposaient peu de brevets. Leur but était alors de faire de la recherche qu'elles disséminaient au maximum dans la société. La puissance américaine en matière industrielle suffisait alors à assurer un avantage technologique sur les autres pays du fait de sa masse, de sa réactivité et de sa capacité à incorporer rapidement ces innovations techniques dans les produits manufacturés. Au cours des années 1970, l'économie américaine s'est mise à subir de plein fouet la concurrence japonaise dans de nombreux secteurs industriels. Les Japonais ont en effet bâti la plus grande partie de leur compétitivité sur le savoir américain qui était relativement peu protégé. L'industrie américaine a alors perdu un grand nombre de positions industrielles, ce qui a engendré un chômage important. Cette situation a poussé les responsables politiques américains, d'abord l'Administration Carter, puis celle du Président Reagan, à un réexamen des politiques de propriété intellectuelle et de recherche publique afin d'évaluer leurs rôles dans l'économie. Des groupes d'études (task forces) ont été mis en place et ont conclu à la nécessité de protéger les hautes technologies par une vigoureuse politique de brevetabilité. Dans le domaine des biotechnologies, c'est la décision Diamond vs Chakrabarty du 16 juin 1980, de la Cour Suprême des Etats-Unis décidant qu'une nouvelle bactérie produite par génie génétique est brevetable qui inaugure cette nouvelle politique. C'est cette décision qui étend à l'ensemble du vivant, à l'exception de l'espèce humaine, le champ de la propriété industrielle, qui donne l'impulsion fondamentale au mouvement de brevetabilité du vivant. Des textes législatifs sont ensuite promulgués qui vont établir cette politique de protection des inventions. Les deux principaux sont : - le Stevenson-Wydler Technology Innovation Act du 21 octobre 1980 qui exige des laboratoires fédéraux qu'ils transfèrent la technologie développée par eux vers les entreprises, les gouvernements locaux ou les Etats ; - le Bayh-Dole University and Small Business Patent Act du 12 décembre 1980. C'est le texte le plus connu. Cette loi a un double objet : · accorder aux organismes de recherche à but non lucratif cofinancés par l'Etat fédéral, en particulier les universités et les laboratoires fédéraux, la propriété intellectuelle de leurs découvertes. Ces organismes sont dès lors autorisés à déposer une demande de brevet pour une invention sans avoir à demander l'aval de l'agence fédérale qui a financé ces recherches ; · donner le droit à ces organismes de transférer leurs technologies sur la base de licences exclusives, évidemment très attractives auprès des entreprises privées, en accordant une certaine préférence aux petites entreprises. Il faut insister sur le fait qu'à l'origine cette politique en faveur de la brevetabilité relève de la volonté des pouvoirs publics et non d'une action des entreprises privées. Avant l'intervention du Bayh Dole act, les universités qui avaient reçu des fonds fédéraux devaient restituer au gouvernement le fruit de leurs recherches. Cette obligation était perçue comme imposant des contraintes trop importantes. Les universités souhaitaient donc une simplification des procédures afin de ne pas avoir à demander l'autorisation du gouvernement pour breveter des inventions faites avec l'argent public. Selon le Bayh-Dole act, les inventions appartiennent à l'université et au chercheur même lorsque la recherche a été financée sur fonds publics. Cela donne naturellement une motivation décisive pour protéger leur savoir et l'exploiter avec les partenaires publics ou privés de leur choix. Cette politique des autorités américaines est intervenue dans une situation caractérisée par une croissance sans précédent des connaissances scientifiques relatives aux propriétés des molécules et aux différents états physiologiques et pathologiques. Les jeunes pousses («start up») en biologie commencent à apparaître à cette époque : les sociétés Genentech, Cetus ou Biogen, par exemple, ont été respectivement créées en 1976, 1971 et 1978. Elles sont issues d'essaimage des Universités mais leur expansion considérable commence à partir du début des années 1980. L'aboutissement du décryptage du génome humain a accéléré leur développement dans la mesure où une grande quantité d'informations génétiques de base a été rendue publique. Ces jeunes entreprises sont soutenues au début par un certain nombre de milieux financiers sensibles aux déclarations résolument optimistes de leurs fondateurs qui prévoient un aboutissement rapide de leurs efforts de recherche. Cependant on peut noter que les entreprises pharmaceutiques conservent généralement un prudent quant-à-soi vis-à-vis de ces nouvelles venues qui emploient des technologies complètement différentes des leurs, toujours basées sur la chimie. Les petites entreprises de biotechnologie sont alors apparues comme des structures permettant de mener les recherches dans un cadre plus souple. Comme je l'avais déjà souligné, ces entreprises ne disposent pas de capital financier car elles ont été créées le plus souvent par un chercheur issu de la recherche publique. Pour pouvoir attirer des capitaux nécessaires au financement de leur croissance et de leurs investissements ces sociétés ne possèdent que leur savoir-faire, c'est-à-dire leurs brevets. Pouvoir breveter le vivant est une condition pour trouver des financements à leurs investissements et renforcer par là leur attractivité notamment auprès des entreprises pharmaceutiques. Il est assez révélateur que le marché des valeurs émergentes aux Etats-Unis, le NASDAQ, a supprimé toute obligation de disposer de capital pour une entreprise souhaitant s'y faire coter si celle-ci disposait de brevets. Ces entreprises ont donc été des moteurs très importants du développement des brevets sur le vivant. Cette situation a aussi été favorisée par le développement de la génétique médicale. b - Le développement de la génétique médicale Parallèlement à la réalisation du programme Génome humain, s'est développée la génétique médicale. Elle a permis de réaliser des progrès importants dans la compréhension du rôle des mutations génétiques dans le déclenchement de nombreuses maladies. C'est ainsi que certains états ont été expliqués par des mutations affectant des gènes spécifiques. Les cas les plus clairement établis sont les maladies liées à un gène unique comme, notamment, la maladie de Tay-Sachs1, de Huntington2, la thalassémie3 ou la phénylcétonurie4. Ces progrès ont été par contre accompagnés de deux conséquences négatives. Ainsi s'est d'abord répandue l'illusion que le fait de connaître le gène responsable d'une affection pourrait automatiquement déboucher, et à court terme, sur une amélioration des traitements. Malheureusement cette thérapie génique est encore très largement en devenir à la fois dans ses moyens et ses résultats possibles. Des généralisations très hâtives ont été aussi effectuées dans le domaine des maladies polygéniques dont la compréhension reste encore très limitée. Les connaissances acquises en matière de risques génétiques restent donc très en deçà des perspectives de mise au point de traitements efficaces. Dans ce contexte d'effervescence liée à la découverte du génome, les grandes entreprises pharmaceutiques se sont trouvées confrontées à une conjoncture difficile dans leur stratégie de recherche. c - Les difficultés éprouvées dans leur stratégie de recherche par les grandes entreprises pharmaceutiques. Depuis le début des années 1980, les grandes entreprises pharmaceutiques ont progressivement éprouvé des difficultés croissantes caractérisées par un vieillissement de leurs portefeuilles de produits, une augmentation des coûts de développement et de la durée de recherche et une diminution des mises sur le marché des médicaments innovants. · un vieillissement des portefeuilles de produits On estime que la moitié des cent médicaments les plus vendus dans le monde vont voir la validité de leur brevet expirer dans les années à venir. Un certain nombre sont déjà arrivés à échéance, par exemple, parmi les plus connus, le Prozac d'Eli Lilly (2001), le Cipro de Bayer (2003), la Clarityne D de Schering-Plough (2003). D'autres n'ont plus que peu de temps d'exploitation exclusive : ainsi le Zithromax de Pfizer (2005) ou le Zocor de Merck (2005). Cette situation est d'autant plus grave pour ces entreprises que beaucoup de ces médicaments représentaient un pourcentage considérable de leur chiffre d'affaires. Ainsi la Clarityne D était à la source de 35,1% du chiffre d'affaires de Schering- Plough, et le Cipro de 29,9% de celui de Bayer. · une augmentation des coûts de développement et de la durée de recherche Selon le Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), le coût moyen de développement d'une nouvelle molécule est passée de 138 millions de dollars (soit environ 118,5 millions d'euros) en 1975 à 802 millions de dollars en 2000, soit environ 640,5 millions d'euros. Cette évolution est due à la croissance des coûts des essais cliniques, des matériels de recherche, notamment informatique, et des développements précliniques. La durée moyenne entre les premières recherches et la mise sur le marché était d'environ huit ans dans les années soixante. Ce délai est passé à onze-douze ans dans les années soixante-dix et aux environs de quatorze ans actuellement. Les brevets sur les médicaments n'ont ainsi actuellement, en moyenne, une durée « utile » d'exploitation que de moins d'une dizaine d'années. · une diminution des mises sur le marché des médicaments innovants En moyenne, selon le cabinet spécialisé McKinsey, le nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché par chaque grand groupe est passé de 12,3 sur la période 1991-1995 à 7,2 sur la période 1996 - 2000.
Ainsi aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (F.D.A.) a autorisé la commercialisation de 53 nouveaux produits en 1996 mais seulement 17 en 2002, ces derniers n'étant d'ailleurs pas forcément de nouvelles molécules mais pouvant être des produits affinés ou améliorés. Cette hausse des coûts de recherche et cette diminution des mises sur le marché de nouveaux médicaments se constatent de façon saisissante sur le diagramme suivant :
Source : PhRMA et F.D.A. Dans ces conditions les brevets ont été de plus en plus âprement défendus par ces grandes entreprises dans la mesure où la diminution du rythme de l'innovation médicamenteuse les rend beaucoup plus dépendantes de leurs brevets existants. Certaines essaient même de prolonger un brevet en passe de tomber dans le domaine public par de petites modifications touchant soit la formule elle-même, soit même uniquement la présentation. Pour lutter contre les conséquences de ces évolutions les entreprises pharmaceutiques ont eu tendance à privilégier une augmentation de leur taille critique afin de disposer de plus de moyens tant financiers qu'humains dans des unités de recherche plus vastes. Ainsi un certain nombre de concentrations se sont effectuées : on peut citer comme exemple les rapprochements de Pfizer, Pharmacia et GlaxoSmithKline, et de Novartis et de Roche. L'actuelle tentative de prise de contrôle d'Aventis par SANOFI-SYNTHELABO ressort également de cette logique. Mais ces rapprochements n'ont pas nécessairement engendré des effets favorables car la difficulté de fusionner de façon efficace des équipes de recherche est apparue au grand jour. On s'est également aperçu du fait que l'addition de moyens ne débouchait pas forcément sur une meilleure efficacité. Ces difficultés sont sans doute dues à un changement qualitatif de nature scientifique et technologique. On peut en effet estimer qu'il y a une modification dans la façon d'appréhender la recherche dans le sens d'une approche plus intersectorielle, plus pluridisciplinaire et plus intégrée dans le cadre d'équipes plus restreintes et plus réactives. Face à ces difficultés, la plupart des grands groupes pharmaceutiques se sont tournées vers les petites entreprises de biotechnologie. Après une phase d'observation et d'attente, des alliances, favorisées par la recherche de financements des entreprises de biotechnologie, commencent à se nouer. Une des premières est l'accord, en 1978, entre Eli Lilly et Genentech pour le développement de la première insuline recombinante. Des entreprises européennes, Bayer, Roche, Hoechst adoptent la même politique. Au milieu des années 1980, l'optimisme était de rigueur : les grands groupes pharmaceutiques, voire des entreprises originaires d'autres métiers, investissaient dans la biotechnologie soit directement soit en soutenant des entreprises extérieures. Le nombre des petites sociétés augmentait rapidement, surtout aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Les petites entreprises de biotechnologies ont mené depuis cette époque une vie plutôt agitée. Certaines se sont transformées en petites entreprises pharmaceutiques, comme Celera et Human Genome Science aux Etats-Unis. Elles cherchent, à partir des biotechnologies, à mettre au point des produits pharmaceutiques qui leur permettront de disposer de recettes stables. La réussite n'est cependant pas encore au rendez-vous car elles ne sont pas, pour la plupart, parvenues à s'intégrer et à commercialiser elles-mêmes leurs molécules. Elles sont donc souvent conduites à en céder la licence aux entreprises pharmaceutiques qui disposent à la fois des compétences et des moyens pour mener à bien à la fois les essais cliniques et, ensuite, l'industrialisation et la commercialisation. Ces entreprises subissent aussi les aléas des fluctuations boursières et doivent affronter, en matière de financement, la concurrence d'autres domaines comme ceux liés à l'informatique et à Internet. Un certain nombre d'entre elles ont ainsi été rachetées par des entreprises pharmaceutiques classiques, ou ont dû accepter des prises de participation dans leur capital comme par exemple Roche chez Genentech. Mais il y a eu une évolution sensible du comportement des marchés à l'égard de ces sociétés. Il semble bien qu'il y ait une réticence croissante des détenteurs des capitaux à risques à l'égard de ces sociétés de biotechnologie. En outre la pression pour la rentabilité rapide du capital et la crainte de création de « bulles spéculatives » sont telles que les investisseurs ne souhaitent plus participer au financement de la recherche de base, préférant les entreprises ayant des produits proches de la mise sur le marché. La question reste donc posée de savoir comment s'opérera le financement de la recherche fondamentale. Ainsi les entreprises de biotechnologie sont périodiquement écartelées entre des poussées euphoriques et des remises en question. On peut penser que ce secteur n'a pas encore véritablement accédé au statut de nouveau secteur industriel à part entière comme c'est le cas aujourd'hui pour les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il ne semble pas encore être assez mûr pour pouvoir résister au très fort décalage existant entre les engouements suscités par le génie génétique en matière de santé et les déceptions causées par le peu de résultats tangibles. Cette croissance considérable des biotechnologies a été permise par l'affaiblissement des critères classiques de la brevetabilité appliqués à ce secteur. 2 - L'appropriation du vivant est permise par l'affaiblissement des critères classiques de la brevetabilité On rappellera que, classiquement, les critères de fond de brevetabilité sont au nombre de trois : · la nouveauté : une invention est considérée comme nouvelle si elle n'a pas été divulguée, avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; · l'inventivité : est réputée inventive une invention ne découlant pas, pour un homme de métier, de manière évidente de l'état de la technique ; · l'application industrielle : est considérée comme susceptible d'application industrielle l'invention dont l'objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. L'appréciation des trois critères de fond, ainsi que des revendications, a fait l'objet d'une évolution telle qu'elle a rendu possible l'appropriation du vivant. A - La nouveauté Comme le rappelle le spécialiste du droit des brevets M. Alain Gallochat, dans une note consultée sur le site Internet de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, « une invention est traditionnellement considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ». L'article 54 (2) de la Convention sur le brevet européen dispose que : « L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen.» Selon l'acception courante une invention concerne un objet nouveau, c'est-à-dire qui n'existait pas antérieurement à l'état naturel et dont la création est donc artificielle. La question qui se pose dans ce domaine est de savoir si un gène, ou une protéine, présent dans la nature est ou pas à la disposition du public. Les gènes ne sont naturellement pas directement accessibles et il est évident qu'un travail est nécessaire pour les isoler. Mais est-ce suffisant pour considérer que cela permette de conclure à la nouveauté ? On peut fortement en douter car ce gène préexiste évidemment à toutes les caractérisations. La « solution » des juristes et des offices de brevet a été de rattacher la génomique au génie chimique en établissant une équivalence entre les molécules d'A.D.N. et les molécules chimiques. Cette conception est présente depuis longtemps dans les directives d'examen de l'Office européen des brevets. Celle-ci a été reprise comme je l'avais indiqué dans mon précédent rapport par les dispositions de l'article 3-2 de la directive 98/44/CE qui précise qu'« une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut-être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». Il y a donc une négation du caractère « naturel » des gènes du simple fait de leur isolement. Dans cette acception, l'A.D.N. n'est pas considéré comme de l'information mais une substance biochimique inerte, comme n'importe quel produit chimique. Il est donc potentiellement brevetable à ce titre. La première étape sur la voie de la brevetabilité des gènes était ainsi accomplie. B - L'inventivité L'inventivité renvoie à la capacité d'inventer, d'innover. Elle s'oppose à la découverte. Deux distorsions du sens du mot « invention » sont apparues dans ce domaine du vivant : l'une concerne la distinction entre invention et découverte et l'autre la réalité du travail effectué sous ce vocable. La première distorsion est la conséquence du refus de considérer comme « naturel » un gène à partir du moment où il a été extrait de son environnement. Il y a donc dans ce cas assimilation entre invention et découverte. La notion d'invention a donc été étendue à tout travail d'isolement des choses naturelles qui sont décrites, manipulées, isolées et reproduites. Il semble que la « technique » devienne ainsi la raison ultime de la brevetabilité dans tous les domaines, que ce soit en biotechnologie ou dans le domaine des logiciels. C'est d'ailleurs la situation qui prévaut aux Etats-Unis où M. Bruce Lehman m'a indiqué que c'était la preuve d'un effet fonctionnel qui marquait la différence entre « découverte » et « invention ». Bien plus, Mme Rebecca S. Eisenberg, a souligné qu'aux Etats-Unis il n'y a, finalement, aucune différence entre « découverte » et « invention », les deux mots étant synonymes et interchangeables. Mais il faut noter que cette situation est ancienne et bien antérieure à l'apparition des biotechnologies. C'est la conception de l'Office européen des brevets et de l'article 5-2 de la directive 98/44/CE1. La deuxième distorsion a consisté à assimiler à une activité inventive ce qui est devenu, la plupart du temps, dans ce domaine des biotechnologies une utilisation intensive et en routine de méthodes de séquençage automatique développées par les spécialistes de bio-informatique. J'avais décrit de façon précise ces techniques dans mon rapport précédent. C'est le travail d'interprétation des gènes qui devrait donner lieu à récompense et non le simple travail de décryptage. C'est l'activité routinière qui est ainsi récompensée et non le travail créatif. Il faut d'ailleurs noter à ce propos que l'O.E.B. a estimé dans la décision « ICOS » de la division d'opposition du 20 juin 2001, que la simple identification d'un gène sans que soit indiquée de fonctions particulières relevait d'expérience de routine compte tenu des connaissances générales actuelles. Cette décision est intéressante car elle peut marquer une évolution en direction d'une appréciation plus réaliste des conditions réelles de la recherche en biologie. C - L'application industrielle Depuis le printemps 2001, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) discute, dans le cadre de son Comité permanent du droit des brevets, un projet de traité sur l'harmonisation d'un certain nombre de dispositions du droit des brevets, le Traité sur le droit matériel des brevets que j'évoquerai plus en détail dans la troisième partie de ce rapport. Un travail est ainsi effectué sur la comparaison des critères d' « application industrielle » (utilisé en Europe et au Japon) et d' « utilité » (utilisé notamment aux Etats-Unis et en Australie). Actuellement l'O.M.P.I. a estimé que les différences entre les deux critères sont relativement mineures. C'est ainsi que l'O.E.B., comme il l'a fait dans l'affaire « ICOS » déjà mentionnée, examine si les utilisations potentielles sont spécifiques, concrètes et crédibles pour pouvoir être considérées comme des applications industrielles. L'O.E.B. a ainsi rejoint la position exprimée par les nouvelles règles d'examen de l'U.S.P.T.O. de janvier 2001 qui exigent que soit démontrée pour une invention « une utilité spécifique, substantielle et crédible ». Le terme qui prête à discussion est celui de « crédible ». Il y a un grand débat pour savoir si les séquences génétiques, sous leurs formes variées, peuvent satisfaire le critère d'application industrielle ou d'utilité. Le développement des techniques automatiques ont permis de connaître des quantités de séquences d'A.D.N. sans que l'on sache quelles étaient leurs fonctions. Des brevets n'en ont pas moins été délivrés sur des gènes ou des parties de gènes sans que la moindre information ait été fournie sur leur application ou leur utilité réelles. Cette controverse a eu lieu notamment concernant les fameux marqueurs de séquences exprimées (les E.S.T.) d'un gène. Cela a également été le cas pour les polymorphismes nucléotidiques (en anglais S.N.P. : single nucleotide polymorphism) qui sont des régions du génome caractérisées par une variation de la séquence d'A.D.N. génomique portant sur une seule base. Il semble bien que l'état actuel des connaissances dans le domaine de la génétique ou de la biochimie ne rend pas trop difficile l'indication de fonctions théoriquement plausibles. L'application en question peut ainsi souvent n'être que la fonction biologique de codage d'un récepteur, ce qui n'est finalement que la description d'un fait naturel et non pas une invention. Ce n'est donc pas l'application pratique, industrielle, utilisée dans le sens usuel et classique pour décrire une invention. On peut donc estimer que le critère d'application industrielle (ou d'utilité) en matière de vivant ne semble plus avoir beaucoup d'importance par rapport au critère de la « fonction », au moins tel qu'il est entendu par les offices de brevet. Cette opinion est corroborée par M. Jean-Christophe Galloux, professeur de droit, spécialiste de la propriété industrielle. Celui-ci note en effet dans son ouvrage « Droit de la propriété industrielle » que « l'inventeur [doit] indiquer quelle est la protéine synthétisée par le gène ou préciser quelle fonction elle assure. Cette nouvelle exigence se rattache en réalité davantage à la description de l'invention qu'à la condition de l'application industrielle ». Pour s'opposer à cette dérive des critères classiques de la brevetabilité, il me semble tout à fait indispensable d'entamer une réflexion sur ce sujet, par exemple au sein de l'O.M.P.I. La perspective serait d'introduire le fruit de celle-ci à la fois dans le Traité sur le droit matériel des brevets encore en préparation actuellement ainsi que dans l'article 27 - 1 des A.D.P.I.C. Ce seront des recommandations de ce rapport. D - Le problème des revendications Les revendications contenues dans une demande de brevet sont des éléments très importants. Elles déterminent en effet l'étendue du monopole demandé pour une invention. Elles fixent donc les limites qui ne pourront pas être outrepassées par une activité concurrente sauf autorisation du détenteur du brevet. Comme l'estiment tous les spécialistes, les brevets sur les gènes accordés actuellement sont des « brevets de produits », analogues aux brevets portant sur des produits chimiques. Par conséquent le propriétaire d'un tel gène acquiert le contrôle de toutes ses fonctions et de toutes les applications que permettront ces fonctions même si celles-ci restent pour l'essentiel inconnues au moment où le brevet est accordé. La conséquence est qu'une nouvelle fonction découverte, après la délivrance du brevet, sera considérée comme complètement dépendante du brevet initial. Selon un document de l'Institut national de la propriété industrielle, « si l'invention réside dans une nouvelle protéine thérapeutiquement active, on peut revendiquer, entre autres : - la protéine, - la séquence d'A.D.N codant pour cette protéine - les vecteurs d'expression contenant cette séquence - les cellules hôtes transformées par ces vecteurs - le procédé de purification de cette protéine, - l'utilisation de cette protéine en tant que médicament. » On voit ainsi que le domaine d'appropriation est complètement « bouclé ». La détermination d'une séquence génétique entraîne la propriété complète de toutes ses applications. Cette situation a été illustrée par l'affaire du récepteur CCR5 que j'ai développée dans le précédent rapport.1 Le problème des revendications est rendu très aigu par le besoin pressant qu'ont les petites sociétés de biotechnologie de se faire reconnaître des droits exclusifs et très étendus sur leurs découvertes. C'est ainsi qu'ayant identifié une cible brevetable, c'est-à-dire une protéine jouant un rôle clé dans un processus moléculaire, elles essaient d'étendre les revendications aux molécules pouvant interagir avec cette cible. Cette pratique a été censurée en mars 2003, par un tribunal fédéral de New-York dans une affaire « Université de Rochester contre Searle ». Dans cette affaire l'Université de Rochester estimait qu'un médicament de la société Searle (le Celebrex) violait un brevet qu'elle avait déposé concernant le gène commandant la synthèse de la prostaglandine-2 et les méthodes permettant d'inhiber celle-ci. Le tribunal a estimé que les revendications n'étaient pas valides dans la mesure où ces méthodes n'étaient pas décrites. Si cette jurisprudence devait être confirmée et reprise, elle devrait entraîner une certaine modération dans ce type de revendications mais, par contrecoup, accroître les difficultés des petites entreprises de biotechnologie. Le colloque de l'O.C.D.E. consacré aux « Inventions génétiques, droits de propriété intellectuelle et pratiques d'octroi de licences » qui s'est tenu à Berlin en janvier 2002 a abordé cette question. Il a été ainsi noté dans les actes de ce colloque que « la question de savoir si une protection « absolue » accordée à des inventions génétiques correspond au caractère inventif de l'objet du brevet soulève une forte controverse, même parmi les experts. » Mais limiter le champ des revendications dans le domaine de la génétique poserait certainement des difficultés avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.) dans la mesure où son article 27-1 dispose qu'«un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques ». A ces questions des revendications et de l'application industrielle s'ajoute le débat scientifique des fonctions du gène. E - Le débat scientifique des fonctions du gène Cette question a déjà été évoqué dans mon précédent rapport. Je souhaite y revenir un peu plus en détail dans la mesure où cette fonction est l'argument essentiel de la brevetabilité pour le « considérant » (23) de la directive 98/44/CE : « Considérant qu'une simple séquence d'A.D.N. sans indication de fonction1 ne contient aucun enseignement technique ; qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer une invention brevetable ». Je m'appuierai pour cela à la fois sur l'ouvrage de Mme Evelyn Fox Geller intitulé « Le siècle du gène » ainsi que sur un article de M. Hervé le Guyader paru dans « Le Courrier de l'environnement » de l'I.N.R.A. Il faut remonter au début des années 1940 pour trouver les premiers linéaments de la question de la fonction du gène. C'est en effet en 1941 que les américains George Beadle et Edward Tatum formulent l'hypothèse : « un gène - une enzyme », celle-ci étant une protéine. La découverte de la double hélice de l'A.D.N. par James Watson et Francis Crick en 1953 permet de donner une signification nouvelle à cette hypothèse : on peut alors l'entendre comme la suggestion d'une correspondance directe entre la séquence de nucléotide d'un gène et la séquence d'acide aminé d'une protéine. La conséquence est que par le jeu de la succession des bases azotées, l'information peut être portée sur cette molécule et transmise inchangée de générations en générations. Le gène peut alors passer d'une entité conceptuelle à une entité matérielle. On est ainsi arrivé à un schéma simple : l'A.D.N. était la molécule qui non seulement recelait les secrets de la vie mais qui exécutait aussi ses propres instructions cryptées. C'est à partir de cette époque que l'A.D.N. de la cellule est conçu comme le programme génétique, comme la langue originelle. La métaphore de l'A.D.N. « livre de la vie » est alors devenue une image classique et répétée à l'envie. A la suite des travaux de François Jacob et de Jérôme Monod, la découverte du code génétique permet de postuler que l'information coule de l'A.D.N. vers les protéines via l'A.R.N. messager et la régulation génique permet de mettre en évidence l'existence de séquences d'A.D.N. non traduites jouant un rôle-clé dans l'expression des gènes. L'ambiguïté du concept de gène s'explique alors car une séquence codante n'a de rôle biologique que par le jeu des séquences régulatrices qui reçoivent des signaux de l'environnement immédiat. Le gène ne peut plus alors être une séquence codante seule, mais une séquence codante munie de ses éléments de régulation. Ainsi l'idée qu'un segment particulier d'A.D.N. ne code qu'une seule protéine ne peut plus être soutenu. La structure en mosaïque des gènes remet en cause le concept de gène car, par épissage différentiel, c'est-à-dire par le choix de certains introns parmi ceux disponibles, un même A.R.N. messager peut donner naissance à une famille de protéines. Il n'y a donc pas de relation biunivoque entre protéine et séquence codante. Un même gène peut donc être utilisé pour fabriquer plusieurs protéines différentes. L'expression du gène, c'est-à-dire le « choix » de la (ou des) protéine(s) à produire, est dépendante de sa localisation dans le génome. Elle est de manière générale, sous l'influence de l'ensemble de l'environnement physico-chimique du génome. Le gène ne peut donc être considéré comme un élément isolé de son contexte. A la suite des travaux de biologie moléculaire des vingt dernières années, M. Hervé le Guyader estime qu'il faut admettre que « le gène n'a pas réellement d'autonomie et [...] l'existence physique que certains lui prêtent, [...] ce qui est biologiquement actif, c'est une dynamique du génome en interaction avec son environnement cellulaire1. C'est pourquoi séquencer un génome ne donne certainement pas tout le programme. » Ainsi une définition fonctionnelle du gène doit nécessairement décrire l'ensemble des réactions entre fragments d'A.D.N. et d'autres molécules (A.R.N., protéines) dont l'activité détermine le fonctionnement du gène. Comme le note M. Henri Atlan dans son livre « Les étincelles de hasard », « les premiers résultats des analyses comparatives de génomes d'espèces animales montrent la complexité de rapports entre la structure d'un fragment d'A.D.N. et sa ou ses fonctions génétiques dans l'organisme. Un gène, en tant que fragments d'A.D.N. bien caractérisés par leur séquence de nucléotides, peut avoir des fonctions multiples, différentes d'une espèce à l'autre et suivant les stades du développement ». Si la séquence de l'A.D.N. humain est aujourd'hui connue, peut-on pour autant prétendre que celui-ci est « décrypté », « déchiffré », c'est-à-dire que toute la signification de celle-ci est complètement comprise ? Evidemment non et toute l'annotation des génomes, c'est-à-dire l'attribution de fonctions aux protéines identifiées, reste à faire. Les offices de brevet sont dès lors bien présomptueux de prétendre asseoir la brevetabilité d'un gène ou d'une séquence de gène sur sa ou ses fonctions. Il me semble en réalité qu'il y a dans ce domaine, de façon consciente ou inconsciente, une volonté déterminée de breveter le gène en essayant de respecter les critères normaux de brevetabilité, quitte à les gauchir ou les « adapter » en fonction du résultat souhaité. Ainsi M. Jacques Warcoin, conseiller en propriété industrielle, spécialisé en biotechnologie écrit-il dans le mensuel « La Recherche » de décembre 2001 : « Pour moi un gène c'est tout simplement la séquence d'A.D.N. qui code pour une protéine. C'est une définition utilitaire. Quand on dépose un brevet, on étend évidemment la définition le plus possible pour avoir une protection maximale, y compris parfois à des introns [c'est-à-dire des fragments non codant d'un gène, situé entre deux exxons] qui peuvent servir pour certaines applications biotechnologiques. » 3 - La galaxie du brevet Le domaine du brevet est un milieu fermé au centre duquel se trouvent les offices de brevets. Il a été délaissé par les politiques qui doivent s'interroger sur les moyens de le réformer. A - Un milieu fermé Depuis que je me suis penché sur ce sujet, j'ai été étonné de voir à quel point les débats autour de ce sujet de la brevetabilité sont quasiment uniquement circonscrits aux professions juridiques. Il existe, de fait, ce que l'on pourrait appeler « une communauté du brevet » dont l'action aboutit à construire de façon très largement autonome le droit applicable dans ce domaine. Cette communauté du brevet est composée de toutes les professions qui sont amenées à intervenir à un moment ou à un autre et à un degré ou à un autre dans l'attribution d'un brevet ou dans sa défense contentieuse. Il s'agit essentiellement des conseils en propriété intellectuelle ou industrielle, des avocats spécialisés, des juristes, auteurs de chroniques de doctrine ou de critique de décisions de justice, des offices de brevets et des juridictions. A ces professionnels il faut sans aucun doute ajouter les utilisateurs réguliers de ce système, c'est-à-dire concernant notre sujet, les entreprises, petites et grandes, de biotechnologie, les entreprises chimiques en général, pharmaceutiques et agrochimiques. Celles-ci, en dehors de leur poids économique spécifique et des nécessités de protéger leurs activités, sont parfaitement rompues aux subtilités de la propriété intellectuelle et ont sans aucun doute une parfaite maîtrise de ces dossiers. Il faut se rendre compte que l'ensemble de ces intervenants forme bien une communauté en vertu de leur compétence technique et de leur approche générale a priori favorable au brevet. Il n'est pas besoin de s'appesantir sur l'intérêt des entreprises du secteur chimique au sens large. L'intérêt des cabinets de conseils en propriété industrielle et des avocats spécialisés est aussi largement évident dans la mesure où leur chiffre d'affaires se développe d'autant plus que le nombre de brevets est important. Le développement important des contentieux dans ce domaine, qui sont devenus considérables, notamment aux Etats-Unis, leur est aussi naturellement très profitable. On observe que toutes ces professions juridiques liées aux brevets connaissent un développement très important. A cet égard le graphique suivant représentant l'évolution de 1970 à 2000 du nombre de juristes spécialisés en propriété intellectuelle par milliard de dollars investis en recherche et développement est très suggestif :
Source : J. H. Barton, Science C'est une communauté qui partage très largement des hypothèses, des approches et des conventions communes en matière de brevet. Cette communauté s'étend jusqu'aux organes judicaires appelés à se prononcer sur les contentieux. Ainsi, aux Etats-Unis, il existe une instance judiciaire spécialisée en matière de contentieux de brevets, la Court of Appeals for the Federal Circuit. Si une spécialisation est certainement un gage de compétence, elle participe aussi de l'esprit de communauté qui s'est créé dans ce domaine. Un autre trait fondamental est que les méthodes de cette communauté sont interprétatives. En effet comme je l'ai noté à plusieurs reprises, notamment dans mon rapport précédent où j'avais retracé l'historique de l'établissement de la brevetabilité du vivant, toutes les évolutions scientifiques, économiques et juridiques majeures ont vu le jour aux Etats-Unis qui ont joué un rôle d'avant-garde dans ce domaine. Les Etats-Unis sont un pays de common law. C'est un système juridique bâti essentiellement sur le droit jurisprudentiel par opposition au droit civiliste ou codifié en vigueur dans un certain nombre de pays dont la France. Il s'agit d'un droit élaboré et établi par des juges comportant l'ensemble des jugements se rapportant à une question ou à un type de causes données. Les précédents revêtent donc - en principe et selon une hiérarchisation de la jurisprudence - force obligatoire pour toutes les juridictions. Les décisions judiciaires ont la même valeur que les lois votées par le Parlement. Il s'agit d'un droit empirique et inductif plutôt que déductif tel qu'il existe par exemple en France. Les possibilités d'évolution en la matière étaient juridiquement d'autant plus ouvertes que rien ne s'opposait dans la loi américaine à la brevetabilité du vivant. Certes l'US.P.T.O., avant 1980, refusait systématiquement les demandes de brevets dont les revendications portaient sur du matériel biologique, en considérant qu'il s'agissait de découvertes de produits de la nature. Mais comme le note M. Pierre-Benoît Joly, « la maxime « Nécessité fait loi » a probablement beaucoup pesé dans l'évolution du droit. La révolution des biotechnologies a en effet provoqué l'apparition d'un besoin de protection dans un domaine entièrement nouveau ». Ce qui a certainement été à l'origine de la décision Chakrabarty de la Cour Suprême des Etats-Unis. On ne peut que constater un ralliement progressif de l'Europe à ces décisions américaines notamment par le biais des décisions de l'Office européen des brevets. L'aboutissement de cette évolution a été les dispositions des A.D.P.I.C. et de la directive 98/44/CE. Cette dernière a ainsi avalisé a posteriori toutes les positions prises depuis des années par l'Office européen des brevets. Certes, là encore, « nécessité a fait loi » car les risques de délocalisation des activités de recherche en biotechnologies devenaient très grands du fait du changement d'attitude de la première économie mondiale dans ce domaine. Nous avons vu que cette évolution a été exactement semblables en matière de brevetabilité des logiciels. Dans ces situations, les Etats-Unis, ou, plutôt, les institutions judiciaires des Etats-Unis donnent l'impulsion décisive. Puis ces décisions, tôt ou tard, s'étendent au reste du monde. En matière de biotechnologies, cette application s'est effectuée sans aucune intervention des pouvoirs publics par la prise au coup par coup de mesures « techniques » par les offices de brevet. B - Les offices de brevet Les offices de brevet jouent un rôle central dans la délivrance des brevets puisque ce sont eux qui examinent les demandes. Nous concentrerons nos commentaires sur l'Office européen des brevets dont mon précédent rapport avait décrit le statut et le fonctionnement. On rappellera seulement que l'Office européen des brevets est une organisation intergouvernementale de droit international public dont le contrôle est effectué par les membres de son Conseil d'administration représentant les Etats membres. Actuellement le nombre de ceux-ci est de 27 dans la mesure où l'Organisation européenne des brevets vient récemment d'accueillir sept nouveaux Etats : la République de Bulgarie, la République tchèque, la République d'Estonie et la République slovaque le 1er juillet 2002, la Slovénie le 1er décembre 2002, la Hongrie le 1er janvier 2003 et enfin la République de Roumanie le 1er mars 2003. Concernant le contrôle de l'O.E.B. qui doit être normalement être effectué par son Conseil d'administration, j'avais émis, dans le rapport précédent, les doutes les plus exprès quant à la réalité de ce contrôle quand celui-ci comptait vingt membres. Ces doutes ne peuvent qu'être considérablement renforcés du fait de l'augmentation des Etats membres. A cet égard j'avais recommandé une augmentation des pouvoirs de ce Conseil d'administration. Je pense aujourd'hui que cette recommandation est dépassée car il s'avère, d'après nombre de mes interlocuteurs, que le Conseil d'administration ne joue absolument pas son rôle de contrôle de l'O.E.B. Il faut naturellement rendre responsables de cet état de fait les gouvernements qui semblent ne donner que peu de directives à leurs représentants à ce Conseil d'administration. C'est sans doute un exemple d'un certain désintérêt du politique pour cette matière. Aujourd'hui c'est une refonte profonde du rôle et des fonctions du Conseil d'administration qui sont nécessaires. A cela s'ajoute une autre question car, à l'exception de la Confédération helvétique, les membres de l'Organisation européenne des brevets seront tous bientôt membres de l'Union européenne. Il finira par sembler étrange qu'une telle organisation puisse rester en marge des institutions de l'Union européenne alors que, par ailleurs, comme on le sait, elle applique les directives européennes. De même l'existence de la Convention sur la délivrance de brevets européens (C.B.E.), qui est un traité international, devra sans doute être remise en cause compte tenu du développement des activités de l'Union européenne dans ce domaine. La création du brevet communautaire pourrait être l'occasion d'examiner toutes ces questions. On peut estimer que des solutions adéquates, comme des accords d'association, pourraient sans doute être trouvées pour la Confédération helvétique et les pays qui demeureront à l'extérieur de l'Union européenne. La France devrait pouvoir proposer à ses partenaires qu'une réflexion s'engage dans ces domaines. Ce sera une recommandation de ce rapport. Une autre question fondamentale est le renforcement du contrôle de son action. Ce renforcement est indispensable compte tenu de la politique très largement autonome menée par l'O.E.B. Celui-ci est en fait encore plus indépendant que l'Office des brevets américains (U.S.P.T.O.) car ce dernier, dépendant du Ministère du commerce fait, de façon officielle, partie de l'administration américaine, étant une agence du Département du Commerce des Etats-Unis. A la différence de l'U.S.P.T.O., l'O.E.B. possède également ses propres chambres de recours et d'appel. Le renforcement du contrôle de l'O.E.B. par son Conseil d'administration nécessite que celui-ci tienne à période régulière - une fois par an - une session où y siègeraient, en personne, les ministres chargés de l'industrie des pays membres. Cela permettrait un échange de vues « politiques » sur l'action de l'O.E.B. comparable à la session « ministérielle » de l'O.M.P.I. Ce sera une recommandation de ce rapport. En tout état de cause la politique suivie par l'O.E.B. depuis quelques années dans les secteurs sensibles des biotechnologies et des logiciels doit être modifiée. Est-il convenable, comme je l'avais déjà souligné avec force, que cet organisme ait pu, dans ces deux secteurs, délivrer des brevets alors que la législation s'y opposait ? Est-il convenable que, toujours dans ces deux domaines, les directives européennes se rallient à la politique menée par cet organisme, la justifiant ainsi, après coup ? De ce point de vue, les pouvoirs du président de l'O.E.B. devraient ainsi faire l'objet d'un réexamen approfondi, ce qui semble d'autant plus opportun que celui-ci va bientôt changer, M. Alain Pompidou étant nommé à ce poste pour un mandat de trois ans du 1er juillet 1004 au 30 juin 2007. Il faut souligner que depuis 1983 l'O.E.B, l'U.S.P.T.O. et le J.P.O. se sont engagés dans une coopération réciproque au sein de la Coopération Trilatérale. Les activités de cette Coopération s'établissent notamment dans l'échange d'informations et de points de vue dans l'administration générale des brevets, la documentation et la classification en matière de brevets, les pratiques d'examen des demandes de brevet. Aucun organe de l'Union européenne ni aucun Etat n'interviennent au niveau de cette coopération trilatérale qui reste ainsi sans aucun contrôle. On peut estimer que cette coopération est certainement à la base des très grandes convergences constatées dans les décisions de ces trois offices concernant nombre de domaines et, notamment, en matière de brevetabilité du vivant. Le compte-rendu du colloque organisé par l'O.C.D.E. à Berlin en janvier 2002 confirme ce point de vue : « Dans les faits, l'U.S.P.T.O., l'O.E.B. et l'O.J.B. [Office japonais des brevets] coopèrent et s'efforcent d'harmoniser leurs pratiques d'examen des demandes de brevet dans le domaine des biotechnologies, moyennant une Commission trilatérale qui, en dernière analyse, contribue à rapprocher les pratiques dans leur ensemble » Il ressort donc de cette coopération que les conditions de brevetabilité sont examinées et quasiment décidées en commun entre les trois principaux offices de brevets du monde. C'est une illustration de cette communauté du brevet que nous avons décrite plus haut. Le financement des offices de brevet pose également un problème important. Il n'est pas niable qu'il est assez choquant que les gains financiers de ces organismes soient directement liés au nombre de brevets accordés. Ce système a comme conséquence de pousser l'O.E.B. à se faire le chantre du dépôt d'un maximum de demandes de brevets. On peut considérer que l'augmentation du nombre de brevets en Europe est une bonne chose, mais celui-ci ne doit pas constituer un but en soi dès lors qu'ils ne correspondent pas à de véritables activités inventives. Ce système de financement a aussi le très grand défaut d'encourager les offices à accorder des brevets de façon libérale, ce qui maximise leurs gains financiers. Une réforme de ce système doit donc être envisagée en déconnectant le financement de l'O.E.B. de la délivrance des brevets. Un financement public devrait donc être prévu afin de rendre l'O.E.B. indépendant financièrement des demandeurs de brevets. Ses modalités pourraient être étudiées à l'occasion du réexamen de la C.B.E. compte tenu de la mise en place du brevet communautaire. Ce sera une recommandation de ce rapport. Dans le cadre d'une telle réforme, les demandeurs de brevets s'acquitteraient de taxes d'examen et de délivrance qui pourraient être modulées par les pouvoirs publics communautaires. Ces derniers prendraient alors en charge les dépenses de fonctionnement de l'O.E.B. Cette réforme aurait en outre l'avantage de faire diminuer le coût de délivrance du brevet européen qui est une revendication assez générale. Enfin il convient de noter que les offices de brevet détiennent un pouvoir très important car ils décident souvent en dernier ressort. Certes toutes les décisions de ces organismes sont susceptibles d'appels et leurs décisions peuvent être réformées par le contentieux. Mais il faut bien voir que cette possibilité peut être fort dissuasive. En effet selon les informations que j'ai pu recueillir, une procédure contentieuse peut coûter 50 000 euros en France mais plus de un million de dollars aux Etats-Unis avec, naturellement, un résultat toujours incertain et des délais importants. Ce qui peut inciter à un fort découragement et dissuader un nombre importants d'appels notamment de la part de petites et moyennes entreprises quand elles doivent affronter à cette occasion de grands groupes. Cette politique des offices s'appuyant sur la « communauté du brevet » n'a en fait pu se développer que grâce au fait que le politique a délaissé ce secteur. C - Un secteur délaissé par le politique Dans mon précédent rapport j'avais décrit tout le cheminement qui par des décisions juridiques successives avait abouti à la brevetabilité des gènes humains, toutes ces questions étant résolues au fur et à mesure par ce petit milieu très spécialisé des juristes en propriété intellectuelle. Il ressort ainsi que toute cette évolution s'est ainsi faite sans aucune décision prise par le politique à quelque niveau que ce soit. Comme l'indiquent MM. Claude Henry, Michel Trommetter et Mme Laurence Tubiana dans le rapport établi au sein du Conseil d'analyse économique sur la « Propriété intellectuelle » : « Ces transformations n'ont pas été consciemment voulues par les pays concernés, guère plus aux Etats-Unis qu'au Canada, en Europe ou au Japon. » Après ce constat, ces auteurs continuent : « Pas de débats publics, pas de réformes législatives d'envergure. Tout ou presque s'est passé entre les déposants de brevets qui ont poussé à la roue, les offices [de brevets] qui l'ont fait tourner plus vite et les tribunaux, de plus en plus spécialisés qui n'ont pas rechigné à trouver des raisons de donner leur bénédiction [...] ». Il faut reconnaître, à la décharge des juristes, qu'ils ne sont pas chargés de prendre en compte les répercussions éthiques ou économiques du système de brevet. Cette tâche est celle des politiques qui doivent déterminer si ce système de brevet fonctionne au mieux de l'intérêt général. Ceux-ci, à dire vrai, ne se sont guère intéressés à ce domaine, qu'ils aient été inattentifs aux décisions prises par l'Office européen des brevets ou qu'ils aient été quelque peu rebutés par le caractère passablement compliqué du droit de la propriété intellectuelle. A cet égard on ne peut que se féliciter de la véritable bataille d'amendements menée au Parlement européen par un certain nombre de députés sur la directive concernant la brevetabilité des logiciels. On a réellement assisté à cette occasion à une prise de conscience d'une partie importante des députés européens de la gravité des enjeux représentés par cette affaire. Les débats qui avaient eu lieu au Parlement européen sur la directive relative aux inventions biotechnologiques avaient porté de façon importante sur les problèmes d'éthique, ce qui était fondamental pour ce sujet, mais très peu sur les conséquences économiques. Par contre les débats qui ont eu lieu lors de la première lecture de la directive « logiciels » ont concerné les questions fondamentales : la distinction invention - découverte, un des fondements du droit des brevets, et la question de l'efficacité en terme de concurrence et de progrès économique de l'attribution du monopole temporaire qu'est le brevet. Il est tout à fait nécessaire que le politique se saisisse des problèmes de brevetabilité. Ces perspectives ne semblent pas devoir satisfaire des juristes. En effet, un certain nombre d'entre eux, sans doute insatisfaits des décisions prises, se sont inquiétés des débats qui ont eu lieu au Parlement européen sur le projet de directive « logiciels ». Certains ont ainsi estimé que de tels problèmes ne devraient pas être soumis aux politiques mais être réglés par les spécialistes entre eux. Face à ces réactions, il faut donc que le politique investisse de plus en plus ce domaine afin qu'il puisse y faire prévaloir l'intérêt général qui doit être la seule justification de l'attribution des brevets. La nécessité de l'intervention des politiques a été ainsi marquée par la Cour suprême du Canada dans une décision peut-être pas assez remarquée du 5 décembre 2002. Il s'agissait dans cette affaire de la demande par l'Université de Harvard et Du Pont d'un brevet au Canada pour la fameuse souris dite de « Harvard ». En 1995, le commissaire aux brevets du Canada acceptait de délivrer un brevet pour le gène de susceptibilité au cancer de cette souris mais non pour la souris elle-même et ses descendants. La Cour fédérale du Canada avait maintenu cette décision qui avait été renversée par la Cour d'appel fédérale. Saisie, la Cour suprême du Canada a considéré que la souris n'était pas brevetable au regard de la loi canadienne sur les brevets. Elle a conclu que le brevetage des formes de vie supérieures suscite de graves préoccupations d'ordre pratique, éthique ou environnemental qui sont extrêmement complexes et se situent bien au-delà du domaine judiciaire. Elle a alors indiqué que «seul le législateur est en mesure de répondre aux préoccupations liées à la brevetabilité de toutes les formes de vie supérieures, s'il souhaite le faire1, en créant un régime législatif complexe tel celui applicable aux plantes hybrides, ou en modifiant la Loi sur les brevets». Réaffirmer vigoureusement la primauté du politique est la seule voie pour sauvegarder l'intérêt général et permettre que le brevet continue à promouvoir la diffusion du savoir et des connaissances, clefs du progrès économique. Nous sommes peut-être arrivés à un moment où il faudra choisir entre une approche « anglo-saxonne », où les régulations se font par le droit jurisprudentiel et une autre, plus de tradition « latine », où c'est le politique, comme émanation du peuple, qui effectue cette régulation par l'intermédiaire de la loi. L'action des offices de brevets en matière de vivant s'inscrit de façon évidente dans cette tendance anglo-saxonne qui, au-delà de cette question, semble gagner progressivement du terrain. Il conviendra certainement de réfléchir à cette affaire. Le risque de cette évolution est que se mette en place, dans tous les domaines, le brevet sur la connaissance. L'évolution en cours dans le domaine du logiciel et des biotechnologies donne l'impression que la possibilité de breveter se rapproche de plus en plus du domaine de l'idée ou de la connaissance plutôt que de rester cantonnée dans les applications matérielles. Une réflexion sur la notion d'intérêt général dans le domaine de la connaissance paraît tout à fait nécessaire compte tenu de ces développements de la propriété intellectuelle. Il pourrait être possible de définir ce qu'on pourrait appeler une sorte de domaine public de la connaissance dont le rôle serait de protéger les développements de la recherche et la création de produits... qui, eux, seront bien entendu brevetables. Cette réflexion pourrait avoir lieu dans le cadre de la future loi d'orientation sur la recherche qui a été annoncée par le gouvernement. Ce sera une recommandation de ce rapport. Deuxième partie : les interrogations face à ce mouvement Cette appropriation croissante du vivant conduit à s'interroger sur la situation des pays en voie de développement à cet égard et à évoquer les problèmes éthiques et sociaux. Enfin il faut se poser la très importante question des conséquences économiques de ce mouvement 1 - La situation des pays en développement La situation des pays en voie de développement est caractérisée par une grande richesse à la fois en biodiversité et en savoirs traditionnels dont l'accès est sujet à controverse compte tenu notamment des droits des communautés autochtones. Ces pays ont adopté des méthodes différentes concernant l'appropriation de leurs richesses. Il convient de s'interroger sur leur valeur réelle. A - Des pays riches en biodiversité et en savoirs traditionnels a - La biodiversité La biodiversité peut se définir comme l'ensemble des gènes, espèces et écosystème d'un lieu donné. De façon courante on distingue trois niveaux : - la diversité variétale et génétique ou intraspécifique : elle correspond aux différences des gènes à l'intérieur des espèces. Ce sont les populations distinctes d'une même espèce ou les différenciations génétiques à l'intérieur d'une population, - la diversité spécifique : elle permet de mesurer la variété des espèces à l'intérieur d'une aire donnée. Sa mesure est la plus ancienne, la première tâche des biologistes ayant été de faire l'inventaire des espèces vivantes, - la diversité des écosystèmes : elle peut s'apprécier au niveau soit macroscopique soit microscopique. Actuellement environ 1,5 million d'espèces ont été recensées. On estime généralement qu'il doit y avoir au total de l'ordre de 5 à 10 millions d'espèces vivantes. Cette biodiversité est fondamentale comme réservoir de diversification pour une agriculture dont la base génétique, notamment dans les pays riches, s'amenuise progressivement. De ce fait elle risque de devenir de plus en plus vulnérable aux maladies et aux prédateurs. Cette importance été bien perçue aux Etats-Unis où a été récemment décidée une « Stratégie de conservation de la diversité biologique » visant à assurer un approvisionnement constant de l'industrie américaine en ressources génétiques. Cette « stratégie » est considérée comme faisant partie intégrante de la politique de sécurité nationale des Etats-Unis. b - Les savoirs traditionnels Cette notion de savoirs traditionnels est apparue à la suite de l'attention croissante portée aux questions de préservation de la diversité culturelle et biologique notamment, depuis le sommet de la Terre de Rio-de-Janeiro de juin 1992. Il n'existe pas de définition universellement admise des savoirs traditionnels. Selon les auteurs, ils recouvrent ou sont assimilés à différentes notions tels que « savoirs autochtones » ou « folklore ». Il s'agit le plus souvent, comme l'a noté l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), de connaissances sur divers sujets « fondés sur la tradition ». Mais le fait qu'ils soient « fondés sur la tradition » n'implique pas qu'il s'agisse de savoirs nécessairement anciens ou non techniques. En effet ces savoirs évoluent constamment, selon un processus de création périodique, à mesure que les individus ou les collectivités relèvent les défis de leur environnement social et physique. Ce sont ainsi, le plus souvent, des savoirs tout à fait contemporains ancrés dans des systèmes de savoirs traditionnels que les communautés ont élaborés et entretenus dans leur contexte local. Il s'agit le plus souvent de savoirs collectifs, c'est-à-dire non attribuables à des personnes individualisables. Cela entraîne un certain nombre de difficultés que nous évoquerons plus loin. Ils font aussi généralement l'objet d'une transmission orale entre les générations. Les pays en voie de développement sont particulièrement riches en biodiversité et en savoirs traditionnels dans la mesure où ils sont situés en majorité dans les zones tropicales humides là où, selon les spécialistes, vit plus de la moitié des espèces animales et végétales. Cette biodiversité et ces avoirs traditionnels sont l'enjeu d'une controverse concernant leur accès. B - La question de l'accès à la biodiversité et aux savoirs traditionnels L'accès à la biodiversité et aux savoirs traditionnels des pays en voie de développement a évolué, au niveau international, de la liberté totale à l'affirmation de la souveraineté des pays pendant que se développaient des formes « directes » d'appropriation. Les banques de données des Centres internationaux de recherche agronomique posent de leur côté un problème particulier. a - L'évolution du cadre international : de la liberté totale de l'accès à l'affirmation de la souveraineté nationale Les ressources génétiques ont été de tout temps considérées comme le patrimoine commun de l'humanité c'est-à-dire que leur accès était totalement libre. Cette position n'avait cependant jamais été affirmée dans un texte et n'a pendant très longtemps fait l'objet d'aucun débat. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (F.A.O.) a été créée en octobre 1945 pour améliorer l'état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole et le sort des populations rurales en général. Son action a visé à organiser un Système mondial de conservation et d'utilisation des ressources phytogénétiques au moyen de la coopération internationale. Dans ce cadre ont été créés un certain nombre de centres mondiaux, que nous évoquerons plus loin, pour les principales cultures vivrières et, notamment, le blé, le maïs, le riz, le manioc. Ces centres rassemblent des collections de lignées qui ont été données par différents pays. Leur accès est libre pour tous les utilisateurs. Dans la logique de cette action la Conférence internationale de la F.A.O. a adopté en 1983 l'«Engagement international sur les ressources phytogénétiques ». La particularité de cet Engagement était d'être le premier accord international centré sur les questions de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques utiles à l'agriculture et à l'alimentation. Ce texte était fondé, comme le proclamait son article premier sur « le principe universellement accepté selon lequel les ressources phytogénétiques sont le patrimoine commun de l'humanité et devraient donc être accessibles sans restriction ». Ce concept du libre accès s'étendait alors aux plantes cultivées traditionnellement, sous réserve des dispositions de l'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.) en vigueur dans un certain nombre de pays, et aussi, et surtout, aux espèces végétales sauvages. Il faut cependant noter que cet accès illimité était toutefois nuancé par d'autres dispositions, moins connues, de cet Engagement. Celles-ci mentionnaient diverses façons d'obtenir, gratuitement, des échantillons de ressources génétiques mais sur la base d'un échange mutuel ou de modalités convenues d'un commun accord. Ces dispositions restèrent cependant inaperçues et l'apport essentiel de ce texte fut bien cette notion de ressources génétiques considérées comme patrimoine commun de l'humanité. Une discrète évolution se fit après 1983 avec l'adoption de trois résolutions restreignant encore la portée des dispositions relatives au « libre accès ». Celles-ci visaient à établir un équilibre entre les préoccupations formulées par les pays développés et ceux en développement au moyen de dispositions protégeant à la fois les droits des obtenteurs et ceux des agriculteurs. Pendant ce temps l'interrogation écologique progressait centrée sur la prise de conscience de la fragilité des ressources naturelles. Les biotechnologies quant à elles prenaient leur essor à partir du début des années 1980. Face à ces évolutions, les pays en voie de développement, qui avaient été les promoteurs de la notion de patrimoine commun de l'humanité, étaient devenus particulièrement inquiets compte tenu de la difficulté qu'ils avaient à surveiller leurs territoires. La Charte mondiale de la Nature de 1982 fut suivie par la création en 1987 du groupe de travail du Programme des Nations Unies pour l'environnement (P.N.U.E.) centré sur la conservation de la diversité biologique. L'aboutissement de cette évolution fut la Convention sur la diversité biologique adoptée le 22 mai 1992 à Nairobi. Les négociations de la Convention sont en fait parties de discussions axées sur la conservation des ressources biologiques. Elles sont devenues ensuite un débat sur la conservation de la diversité biologique et son utilisation. Cela créait un lien direct avec les attentes, les préoccupations et les questions sur les biotechnologies exprimées par les nations du Sud. Je n'effectuerai pas une étude exhaustive de cette Convention à laquelle sont « Parties » 188 pays. J'évoquerai uniquement ces dispositions concernant l'appropriation des ressources génétiques. L'abandon du concept de ressources génétiques « patrimoine commun de l'humanité » est la conséquence tout d'abord du préambule de cette Convention. En effet celui-ci affirme seulement que « la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité ». Deux dispositions de ce texte, les alinéas 1 et 5 de l'article 15 expriment le changement de préoccupations : Article 15 - 1. : « Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale. » Article 15 - 5. : « L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie ». En matière de brevetabilité du vivant, la Convention ne touche pas aux droits de propriété à l'égard des ressources génétiques pouvant exister dans un pays. En effet elle prévoit dans son article 16 - 5 que « Les Parties contractantes, reconnaissent que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs. » Il ressort bien de ces dispositions qu'il ne s'agit que d'une confirmation de la compétence des Etats de réglementer ces ressources au même titre que les autres. Une autre disposition, l'article 15-7, prévoit « [...] le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues. » C'est cette disposition, avec le mécanisme de financement1, qui a provoqué l'hostilité des Etats-Unis qui ont signé cette Convention le 4 septembre 1993 mais ne l'ont pas, jusqu'à présent, ratifiée. L'affirmation par cette Convention de la propriété des Etats sur leurs ressources génétiques a suscité et continue à soulever des oppositions de fond. Cela est notamment le cas des entreprises agrochimiques ainsi que me l'a indiqué le représentant de Monsanto au Canada. Cette Convention soulève encore, quatorze ans après son adoption, un grand nombre de controverses. On verra dans la dernière partie de ce rapport qu'il ya entre elle et les A.D.P.I.C. des problèmes de coexistence. Dans le prolongement du mouvement initié par la Convention sur la diversité biologique , la F.A.O. a adopté en novembre 2001 un « Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ». Ce traité est né d'un processus de révision de l'Engagement international de 1983 et s'applique exclusivement à 35 genres ou complexes d'espèces cultivées vivrières et 29 espèces fourragères dénommées en annexe, soit, au total 64 espèces. Il a pour objectif la conservation et l'utilisation durable de ces 64 principales cultures et plantes fourragères et le partage équitable des avantages dérivant de leur utilisation, y compris ceux générés par les échanges commerciaux. Ce Traité est actuellement signé par 78 pays et 34 instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion ont été remis au directeur général de la F.A.O. Une seule disposition de ce traité fait référence aux droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de l'article 12.3 d stipulant que « Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral ». Les différents responsables de la F.A.O. que j'ai rencontrés m'ont indiqué qu'ils considéraient que le Traité était neutre en matière de propriété intellectuelle. Par contre Mme Andrée Sontot estime que ces dispositions sont ambiguës. En effet elle souligne dans une note récente que « plusieurs pays en développement interprètent cette disposition comme une interdiction de brevetabilité des génomes, mais aussi [de leurs] parties ou composantes génétiques, quels que soient l'innovation associée et les critères de brevetabilité applicables en droit national. » Elle indique par ailleurs que « les pays développés ont mentionné [...] qu'ils interprétaient cet article comme autorisant la brevetabilité, selon leur droit national, des parties et composantes génétiques pendant que les pays en développement indiquaient que la négociation n'était pas close [...]. » Il n'entre pas dans mon intention de trancher cette discussion. Cependant, celle-ci montre d'abord combien l'ambiguïté peut régner dans ces situations où, en créant des situations d'incertitude juridique, elle permet des accords que chacun interprète à sa façon. Elle met ensuite l'accent sur une situation où la coexistence de textes internationaux, le plus souvent signés par les mêmes pays, peuvent créer des obligations pouvant apparaître contradictoires. Nous retrouverons cette question dans la dernière partie de ce rapport. b - Les formes « directes » d'appropriation Historiquement tous les voyageurs et explorateurs ont toujours ramené de leurs expéditions des semences, des graines ou même des plantes entières dans leurs pays d'origine. C'est ainsi que Christophe Colomb a ramené le maïs en Europe. On peut penser que c'est de cette façon que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, très largement dépourvus de richesses génétiques, ont acquis progressivement les végétaux qui ont fait, après acclimatation, la richesse de leur agriculture. Cette acquisition a été parfois le fait d'une politique systématique et réfléchie. Ainsi Thomas Jefferson, futur Président des Etats-Unis, a-t-il risqué la peine de mort au XVIIIème siècle pour sortir, de manière frauduleuse, des semences de riz du nord de l'Italie. A la même époque, Benjamin Franklin envoyait régulièrement des semences d'Europe à ses correspondants de Philadelphie. La « bioprospection », définie comme la recherche, l'exploitation, l'extraction et le criblage de la diversité biologique et des connaissances indigènes pour découvrir des ressources génétiques ou biochimiques a donc été de toutes les époques. Elle s'est même organisée de façon systématique après 1945 sous l'égide de la F.A.O. quand prévalait le principe que les plantes faisaient partie du patrimoine de l'humanité et étaient donc librement accessibles à tous. Mais, comme on l'a vu, cette situation a profondément changé. L'ensemble de ces évolutions a abouti à donner une valeur croissante à la fois aux ressources génétiques et aux connaissances et savoirs traditionnels. Un certain nombre d'entreprises et même d'institutions de recherche ont cherché à s'en assurer la propriété sans demander le consentement des pays ou des populations intéressés. Cette situation a donné lieu à la création, par des pays en voie de développement et des organisations les soutenant, du concept de « biopiraterie ». Celle-ci peut se définir comme l'usage non autorisé des ressources génétiques et des savoirs traditionnels. Plusieurs affaires ont, dans les dernières années, illustré cette nouvelle dimension de la valeur des ressources génétiques. Une des premières a concerné le neem, ou margousier, originaire d'Inde qui possède de multiples propriétés insecticides, médicinales et cosmétiques. Une entreprise américaine, W.R. Grace, a obtenu, en 1990, des brevets exploitant ces caractéristiques. Le gouvernement indien a réussi à obtenir, en 2000, de la part de l'O.E.B. la révocation d'un brevet accordé pour un fongicide dérivé des graines de cette plante. D'autres affaires semblables ont eu lieu. Ainsi un brevet a été obtenu par deux chercheurs de l'Université du Colorado sur la quinoa, une céréale originaire des pays andins très riche en protéines, et connue depuis très longtemps. De même le curcuma, une racine originaire d'Inde et possédant des qualités médicinales qui a fait l'objet de demandes de brevet en 1995 par des chercheurs de l'université du Mississippi. Un cas très récent a concerné un maïs à haute teneur en huile et en acide oléique pour lequel un brevet avait été accordé par l'O.E.B. à Du Pont en 2000. Suite à une action en opposition du gouvernement du Mexique, pays d'origine du maïs, et d'un certain nombre d'associations, ce brevet a été révoqué en février 2003 dans la mesure où l'antériorité de la connaissance des propriétés de cette plante a pu être prouvée. Ces affaires sont très connues grâce à la médiatisation importante dont elles ont fait l'objet, mais de telles tentatives de captation de ressources génétiques appartenant à des communautés restent encore rares. Elles posent cependant la question des droits des communautés autochtones que nous allons examiner après avoir évoqué le cas des banques de données des Centres internationaux de recherche agronomique c - Le cas des banques de données des Centres internationaux de recherche agronomique Ces centres internationaux de recherche agronomique (C.I.R.A.) ont été crées au début des années 1970 dans le cadre de la F.A.O. afin de lutter, par la création de collections de plantes cultivées, contre l'érosion génétique des grandes cultures mondiales. Ces centres sont actuellement au nombre de seize répartis dans le monde entier, chacun étant spécialisé dans un certain nombre de plantes. Ils sont gérés par la F.A.O. Les discussions ont été et sont encore vives sur le statut juridique de ces collections constituées avant l'intervention de la Convention sur la diversité biologique. Les responsables de la gestion de ces Centres que j'ai rencontrés à la F.A.O. m'ont indiqué qu'il fallait considérer que ces collections sont données en fiducie1 au Centre compétent par la F.A.O. Elles sont un bien international commun dont l'accès est libre. Mais ces collections se trouvent quelquefois visées par des revendications ou des tentatives d'appropriation. En effet ce patrimoine en accès libre se trouve en situation difficile dans le contexte général de renforcement des régimes de propriété. Ainsi plusieurs pays en voie de développement les revendiquent en s'appuyant sur la Convention sur la diversité biologique et le concept de patrimoine biologique national. Ces demandes posent un problème très difficile. Il faut d'abord se demander si ces pays sont en droit de revendiquer des collections qui ont fait l'objet depuis plus de trente ans d'un très important travail d'entretien au sein de ces Centres. Car des collections de plantes qui ne sont pas régulièrement sélectionnées et replantées, comme cela est fait au sein de ces Centres, perdent rapidement toute valeur. Ensuite risque de se poser, pour chaque plante, la question de savoir qui peut les revendiquer compte tenu du fait que leurs aires naturelles d'origine sont souvent partagées entre plusieurs pays. Compte tenu de leurs richesses, ces collections attirent aussi les convoitises des entreprises. De nombreux cas de tentative de captation ont déjà eu lieu. Ainsi, par exemple, une entreprise américaine a-t-elle tenté de breveter un haricot dont elle avait obtenu une lignée auprès du Centre international d'agriculture tropicale de Colombie qui s'est opposé à cette demande de brevet. Face à ces tentatives d'appropriation une évolution possible serait que ces centres brevettent leurs collections pour protéger ce patrimoine commun mondial. Ce serait ainsi, en quelque sorte, bien que cela apparaisse comme paradoxal, « un brevet pour se protéger du brevet. » C - Les droits des communautés autochtones Il convient d'évoquer la problématique posée par ces droits avant d'examiner le travail en cours à ce sujet au sein de l'O.M.P.I. a - La problématique La Convention sur la diversité biologique énonce un certain nombre de dispositions dont le principe général est posé dans l'article 8 j : « Chaque Partie [...] sous réserve des dispositions de la législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ». Le principe ainsi posé soulève cependant un certain nombre de difficultés. Tout d'abord se pose le problème de la constatation de ces connaissances qui, le plus souvent, sont uniquement orales et ne reposent que très rarement sur un document écrit. Elles ne résultent également pas nécessairement d'un acte individuel et spécifique de découverte. Les variétés qui font l'objet de ce savoir sont sélectionnées la plupart du temps sur leur capacité à s'adapter à un environnement fluctuant et évidemment pas sur les critères définis dans les pays industrialisés par l'U.P.O.V., à savoir nouveauté, distinction, stabilité et uniformité. Ces caractéristiques des savoirs traditionnels peuvent être des obstacles considérables. En effet, comme me l'ont confirmé les responsables de l'U.S.P.T.O., les connaissances traditionnelles doivent être normalement considérées comme n'importe quelle forme d'antériorité. Mais elles doivent permettre à une personne qualifiée de créer la nouveauté en question, et il doit être possible de prouver juridiquement cette antériorité. Ces deux conditions doivent être, la plupart du temps, très difficile à remplir. Un autre problème difficile est de déterminer à qui appartiennent ces connaissances. Celles-ci peuvent être l'apanage d'une seule personne ou d'une communauté dans son ensemble. Dans cette dernière situation, il peut s'agir d'une communauté très étendue qui peut se trouver à cheval sur deux frontières ou plus, comme cela peut être souvent le cas dans nombre de pays en voie de développement. Là encore les questions de preuve juridique peuvent être très difficiles à résoudre. Toutes ces difficultés sont apparues notamment lors des contestations évoquées plus haut de brevets obtenus par des entreprises à partir de connaissances traditionnelles. On peut donc se demander si celles-ci peuvent réellement se couler dans le moule des critères classiques de la brevetabilité qui correspondent en réalité à d'autres conditions culturelles. Les problèmes tenant aux connaissances traditionnelles sont débattus par l'O.M.P.I. b - Les débats en cours au sein de l'O.M.P.I. Les problèmes posés par les connaissances traditionnelles sont examinés au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Il a été créé par l'Assemblée générale de l'O.M.P.I. en octobre 2000. Il a pour mandat de débattre des questions de propriété intellectuelle en rapport avec l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, les savoirs traditionnels et l'innovation, ainsi que la créativité et les expressions culturelles traditionnelles. Ce comité est ouvert à tous les Etats membres de l'O.M.P.I. D'autres Etats membres des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales peuvent y être observateurs. Actuellement 175 de ces organisations participent aux travaux de ce comité. Depuis 2001, il a concentré son attention sur la façon dont les systèmes de propriété intellectuelle peuvent protéger plus efficacement les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles et traiter des aspects de la propriété intellectuelle qui touchent aux ressources génétiques. Selon un document de l'O.M.P.I., ces questions sont abordées sous différents angles: - celui des questions de politique générale ou d'ordre juridique. Il s'agit de déterminer comment promouvoir les intérêts des détenteurs et des gardiens de savoirs traditionnels et d'expressions culturelles traditionnelles au moyen des droits de propriété intellectuelle, soit conventionnels, soit élargis et adaptés, ou encore au moyen de systèmes juridiques sui generis qui ont été créés dans un certain nombre de pays, - celui du partage de données d'expérience pratiques liées à des études, à la collecte de données et à des analyses concernant la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles dans de nombreux pays et dans diverses régions, afin de contribuer concrètement au débat de politique générale, - enfin celui des outils et des mécanismes pratiques de nature à aider les détenteurs de savoirs traditionnels, les gardiens d'expressions culturelles traditionnelles et les communautés autochtones et locales à définir et à promouvoir leurs intérêts en rapport avec le système de la propriété intellectuelle. L'Assemblée générale de l'O.M.P.I. qui s'est réunie du 22 septembre au 1er octobre 2003 a arrêté un mandat élargi pour ce Comité. Il doit accélérer ses travaux et s'intéresser en particulier à la dimension internationale de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Comme le note le document précité, « ce nouveau mandat n'exclut aucune possibilité en ce qui concerne l'issue des travaux du comité, y compris l'élaboration éventuelle d'un ou de plusieurs instruments internationaux en la matière. » Les travaux de ce comité créé depuis trois ans ne semblent pas encore avoir eu un grand retentissement ni de grands prolongements opérationnels. Il conviendra donc d'être attentif aux propositions qui pourraient être faites, notamment concernant ces « nouveaux instruments internationaux ». Il faut cependant convenir que les actions à mener dans ce domaine sont d'autant plus difficiles à établir que les pays en voie de développement différent les uns des autres et que certains mettent en œuvre une politique particulière dans ce domaine. D - Des pays différents aux approches particulières a - Des pays différents Les pays en développement ne forment pas un ensemble homogène. A cet égard il suffit de considérer les pays dits « émergents » comme, par exemple, l'Inde ou le Brésil. Ces derniers possèdent en effet un certain nombre de caractéristiques des pays développés comme par exemple, des structures de recherche publiques et privées développées et des implantations industrielles importantes, ce que ne possède pas la plus grande masse des pays en développement. Une des conséquences est que, comme le note Mme Andrée Sontot, depuis l'adoption de la Convention sur la diversité biologique, « les pays en développement s'expriment désormais plus souvent de façon régionale (groupe « Afrique » en particulier) ou nationale (Brésil, Colombie, Inde) que collectivement en tant que Groupe des 77. » Mais à l'intérieur même des pays qualifiés d'émergents des clivages apparaissent. Ainsi, selon Mme Andrée Sontot, en Inde les débats autour de ces questions sont beaucoup moins conflictuels qu'au Brésil car celle-ci possède de réelles capacités de recherches nationales. Cela n'est pas le cas en Amérique latine, et notamment au Brésil, où ce sont essentiellement des filiales d'entreprises internationales qui sont implantées. Des positions différentes sont adoptées au niveau international par ces pays sur un certain nombre de problèmes. Le Brésil oscille ainsi entre la volonté de se présenter comme un pays nouvellement industrialisé, se rapprochant ainsi de la problématique des pays riches, et comme un pays riche en biodiversité (on estime qu'il recèle environ 20 % de la biodiversité mondiale) ce qui lui permet de revendiquer l'appartenance aux pays pauvres. Ce pays est un de ceux qui défendent le plus activement des positions qui tendent à étendre la souveraineté des « pays d'origine » sur les collections ex situ1de ressources génétiques acquises avant l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Le Brésil est également, avec l'Inde, un des pays le plus sensible au primat des législations et politiques nationales sur les mécanismes internationaux de régulation. D'autres clivages existent comme le montre l'attitude de l'Ethiopie qui définit sa position par le rejet du brevet ou celle de la Colombie qui met plutôt l'accent sur les transferts de technologie. Un certain nombre de pays en développement se sont récemment organisés. Il s'agit du « groupe des pays à mégadiversité » constitué en février 2002 à l'initiative du Mexique et connu sous le vocable de « pays mégadivers » ou « groupe de Cancún ». Il comprend douze pays considérant détenir 70% de la biodiversité mondiale : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Equateur, Inde, Indonésie, Kenya, Mexique, Pérou, Vénézuela. On remarque que l'Afrique ne compte dans ce groupe que deux représentants, le Kenya et l'Afrique du Sud, aucun des pays les plus pauvres de ce continent n'en faisant partie. Ces pays souhaitent créer un régime international d'utilisation et de conservation des ressources biologiques mettant l'accent sur la provenance des matériaux biologiques, l'information préalable et la conclusion d'accords de transfert de matériel. Ils ont aussi un projet de création d'un fonds spécial alimenté par les pays du groupe, les institutions internationales ou des fonds privés. Ce fonds devrait permettre de partager l'information et de renforcer le développement des savoirs traditionnels. Ces actions se feraient à travers des politiques publiques visant à valoriser les connaissances autochtones en innovations par recours au droit des marques ou des appellations d'origine. Ces différences d'approche entre les pays en développement vont peut-être tendre à se réduire dans la mesure où ils acceptent de plus en plus les mécanismes de protection développés par les pays riches. En effet l'adhésion aux A.D.P.I.C. implique la reconnaissance de la protection de la propriété intellectuelle, les pays les moins avancés bénéficiant d'un sursis jusqu'en 2006 pour appliquer ses dispositions. De plus, un nombre croissant de ceux-ci signent des accords bilatéraux avec des pays développés afin d'obtenir soit des accès à des marché soit des aides. En contrepartie il leur est assez systématiquement demandé de mettre en œuvre des régimes de protection intellectuelle, notamment pour les végétaux. Il s'agit alors le plus souvent de l'application immédiate des règles de l'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.). malgré la volonté de certains gouvernements de faire reconnaître les droits des populations autochtones et des agriculteurs. Comme ces pays sont de nouveaux adhérents, ils doivent accepter la version 1991 de l'U.P.O.V., c'est-à-dire la plus stricte1, avec en plus, parfois, l'obligation de l'acceptation de la double protection, c'est-à-dire avec le brevet. Ces conditions ont été ainsi acceptées notamment par le Mexique et l'Equateur à la demande des Etats-Unis, par le Maroc, la Jordanie, la Tunisie à celle de l'Union européenne, le Cambodge, le Vietnam suite à leur adhésion aux accords de libre échange de l'A.S.E.A.N. (Association of South East Asian Nations). Malgré cela, un certain nombre de pays essaient de mettre en place des actions particulières en matière de biodiversité b - Quelques exemples d'actions particulières Nous mentionnerons l'approche de l'Inde, et du Costa Rica avant d'évoquer la « loi-modèle » de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.). . L'Inde L'Inde est un pays possédant une biodiversité très importante puisqu'elle est estimée à environ 6,5% de la faune et de la flore sauvages mondiales. Ce pays a toujours adopté des positions très arrêtées contre l'octroi de brevets restreignant la capacité des pays en développement d'obtenir et d'utiliser des techniques complexes liées à la santé, à l'alimentation ou aux soins médicaux. C'est ainsi que la loi indienne de 1970 sur les brevets interdisait l'octroi de brevets aux substances touchant aux domaines de l'agriculture et de l'horticulture ou visant à guérir ou à améliorer la vie humaine, animale et végétale. L'Inde n'est pas membre de l'U.P.O.V. et a son propre système de protection des obtentions reconnaissant les droits des collectivités. La grande originalité de la politique de ce pays en matière de ressources génétiques est d'être un des premiers pays à avoir mis en place une banque numérisée de données « traditionnelles ». La Traditionnal knowledge digital library a ainsi été inaugurée le 26 mars 2002. Celle-ci contient 35 000 recettes issues des divers systèmes de médecine traditionnelle indiens. Sont ainsi décrites 4 500 plantes avec, pour chacune d'elles, les dosages, les vertus thérapeutiques et quelques milliers de références. Elle doit être complétée dans l'avenir par le recensement des 10 000 espèces de plantes dont 8 000 auraient des vertus médicinales qui n'ont pas encore été recensées. Cette banque a été créee pour servir de références d'antériorités aux examinateurs de brevets du monde entier. Mais, un certain nombre de critiques ont été émises contre l'établissement de telles banques sans que soient établies les modalités financières de leur consultation. · Le Costa Rica Le Costa Rica possédrait entre 5 et 10% des ressources biologiques mondiales. La loi sur la biodiversité n° 7 788 du 23 avril 1998 reprend les termes de la Convention sur la diversité biologique pour établir la souveraineté du pays sur ses ressources génétiques. A partir du début des années 1990, s'est mise en place dans ce pays une politique de développement de la connaissance des ressources génétiques avec comme objectif d'en induire une valorisation économique au bénéfice du pays. C'est donc dans cette perspective qu'a été conclu en 1991 un contrat entre l'Institut national de la diversité biologique (INBio) et la firme pharmaceutique américaine Merck. Ce contrat prévoyait, outre un versement immédiat de un million de dollars, que Merck pouvait évaluer l'intérêt pharmaceutique ou agrochimique de végétaux, insectes ou micro-organismes présents au Costa Rica. En échange, si un ou des produits étaient élaborés et mis sur le marché à partir des échantillons collectés, des redevances étaient versées à l'INBio. Conclu à l'origine pour une durée de deux ans, ce contrat a été renouvelé et a une durée totale de cinq ans. A l'époque ce contrat avait suscité de grands espoirs parmi les pays en développement. Il était devenu le modèle de la coopération entre une grande entreprise pharmaceutique et un pays du Sud. Ses résultats se sont cependant révélés très décevants. En effet aucun produit pharmaceutique ou autre n'a pu être mis au point dans la mesure où aucune découverte fondamentale commercialisable n'a été effectuée en cinq ans Par contre un effet positif a été de faire progresser la connaissance des ressources génétiques présentes au Costa Rica. Après le contrat avec Merck, l'INBio a poursuivi sa politique de collaboration avec divers partenaires, les financements étant dirigés vers la préservation de la biodiversité et la recherche. Cet institut s'est lui-même lancé dans une politique de recherche de principes actifs dans la flore et la faune locales. Il a ainsi fait des efforts importants en se dotant d'installations modernes de recherches. Mais, comme l'a admis son directeur, on ne peut pas imaginer, compte tenu de ses modestes moyens, qu'il puisse aboutir, seul, à l'élaboration d'un produit commercialisable. En effet compte tenu des coûts, de l'ordre de 300 à 400 millions de dollars par exemple pour un médicament, il a une nécessité absolue de pouvoir s'associer avec un partenaire puissant, c'est-à-dire, en fait, une entreprise pharmaceutique multinationale. Les procédures instituées par ce pays pour contrôler l'accès à sa biodiversité y compris pour des recherches sont très compliquées et très contraignantes. On retire l'impression d'une volonté assez rigide de protection des ressources génétiques du pays. C'est ainsi que les chercheurs de l'Université du Costa Rica. ont critiqué cette situation en craignant que ces dispositions n'entravent finalement la recherche, ce qui serait contradictoire avec l'étude et la conservation de la biodiversité. · La loi - modèle de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) L'initiative de l'Organisation de l'unité africaine de développer une « législation modèle sur la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et pour la régulation de l'accès aux ressources biologiques » a pris naissance en 1997. L'O.U.A. a pris cette initiative pour aider les pays africains à remplir leurs obligations envers la Convention sur la diversité biologique et les A.D.P.I.C. Cette loi modèle est bâtie sur le principe que « les brevets sur toute forme de vie et sur les procédés biologiques ne sont pas reconnus ». Ce refus des brevets sur le vivant est suivi par une proposition de l'O.U.A. présentant comme sui generis une législation modèle moins exclusive que celle de l'U.P.O.V. et considérée comme adaptée aux réalités socio-économiques africaines. Cette proposition prévoit la reconnaissance, la protection et la promotion des droits des communautés locales et indigènes sur leurs ressources biologiques. L'accès à ces ressources ainsi qu'aux connaissances technologiques qui y sont liées est réglementé. Les éventuels avantages financiers et technologiques découlant de l'exploitation des ressources en question doivent être équitablement partagés. Enfin cette législation modèle vise à prévenir tous les actes de biopiratage. Ces dispositions n'ont évidemment pas rencontré un accueil très favorable de la part notamment de l'O.M.P.I. et de l'U.P.O.V. Au-delà des critiques de ces organisations, la législation modèle de l'O.U.A. rencontre beaucoup de limites proprement politiques. En effet, alors qu'elle aspire à créer une cohérence entre les législations nationales africaines, une quinzaine de pays francophones africains sont entrés depuis 1999 dans une phase de ratification de la Convention de l'U.P.O.V., dans sa version de 1991, afin de se mettre en conformité avec les A.D.P.I.C. qu'ils devront appliquer en 2006. On peut donc considérer que ce choix de rejoindre l'U.P.O.V. et d'appliquer les A.D.P.I.C. laisse peu de chances à cette législation modèle de rencontrer le succès car elle se rattache à une philosophie par trop différente de celle des pays développés. La loi-modèle de l'O.U.A. se limite aussi au domaine agricole alors que les A.D.P.I.C. concernent tous les secteurs. On ne peut donc guère être optimiste quant à la réalité de l'application de cette loi-modèle. En arrière plan de toutes ces questions touchant les ressources génétiques se trouve la question de leur valeur réelle. E - L'interrogation sur la valeur des ressources génétiques pour les pays en développement On estime généralement que les ressources génétiques de la faune et de la flore sont considérées comme des réserves indispensables pour l'agriculture et pour l'élaboration des produits pharmaceutiques. Mais représentent-elles vraiment pour leurs principaux détenteurs, les pays en développement, des actifs d'une grande richesse analogues au pétrole ? Le développement des techniques du génie génétique a donné l'espoir de pouvoir faire des découvertes sensationnelles dans les domaines de la médecine et de la pharmacie. Cela a été à la base d'un très vif intérêt pour les zones particulièrement riches en biodiversité. Ainsi s'est développée l'idée qu'une « ruée vers l'or vert » était possible avec toutes les conséquences en matière d'enrichissement rapide et facile aussi bien pour les entreprises que pour les pays détenteurs des ressources génétiques. Cet engouement, notamment dans le domaine de la recherche pharmaceutique, remonte à une quinzaine d'années et a été encouragé par l'accord Merck-INBio. Il a probablement aussi eu de l'importance dans la genèse de la Convention sur la diversité biologique qui a mis au centre de ses préoccupations la question des droits de propriété des ressources biologiques. Il convient en fait de faire une distinction entre la bioprospection à but agricole et à but pharmaceutique. a - La bioprospection à but agricole Pour évaluer l'importance que peut avoir la bioprospection à but agricole il faut avoir à l'esprit que l'évolution de l'agriculture dans les pays développés dépend beaucoup plus de la sélection variétale que de la prospection et de la découverte dans les pays tropicaux de variétés complètement nouvelles. Dans les pays développés la mise au point de variétés nouvelles découle du mélange des gènes des variétés déjà connues et de l'habileté du sélectionneur plutôt que de l'acclimatation de variétés exotiques. Le mode de protection de la propriété intellectuelle en vigueur dans ces pays est le modèle de l'U.P.O.V. laissant le gène libre et ne protégeant que le nouveau mélange des gènes. Certes comme l'a rappelé M. Robert Brac de la Perrière, il peut y avoir la nécessité de se « ressourcer » auprès des centres d'origine des plantes utilisées dans les pays développés. Nombre de ces centres se trouvent dans les pays en développement. Cependant, comme on l'a déjà noté, les Centres internationaux de recherche agronomique (C.I.R.A.) détiennent de vastes collections de ressources végétales dont l'accès est libre, ce qui diminue d'autant la nécessité de mener une activité de bioprospection in situ. De façon générale, comme Mme Andrée Sontot l'a fait remarquer, il ne faut pas extrapoler les hautes valeurs ajoutées réalisées dans l'industrie pharmaceutique au secteur agricole et alimentaire b - La bioprospection à but pharmaceutique La bioprospection à but pharmaceutique fait partie de la stratégie des industriels pour découvrir de nouvelles molécules et élaborer de nouveaux médicaments. La première voie consiste dans la construction de molécules qui entrent en interaction avec une cible moléculaire identifiée, le plus souvent une protéine, dont le dysfonctionnement est impliqué dans la maladie. On recherche ensuite dans les banques de molécules celles qui vont présenter les meilleures ressemblances avec cette protéine afin de l'améliorer pour la transformer en médicament actif. La seconde méthode est l'approche aléatoire consistant à passer au crible d'un test biologique le plus grand nombre possible de molécules. Ces nouvelles molécules peuvent être fournies par la chimie combinatoire ou par les substances naturelles. Celles-ci ont déjà fourni un grand nombre de médicaments : on peut citer à cet égard, entre autres, la morphine, l'aspirine, la digitaline, la quinine ou, plus près de nous, en matière de lutte contre les affections cancéreuses, les dérivés de la pervenche de Madagascar et le taxotère. Mais, dans la pratique, le chemin est le plus souvent très long entre la plante et le médicament. Les premières difficultés consistent à trouver physiquement les végétaux adéquats. Pour cela il est possible de recourir au criblage systématique, aux connaissances locales ou à une démarche chimio-taxonomique, c'est-à-dire à une exploration des espèces d'une même famille réputée pour ses substances utiles. Il est ensuite nécessaire de réaliser une extraction et une purification de la matière brute pour recueillir des composés chimiques les plus purs possibles. Il faut ensuite procéder à des tests pour déceler une éventuelle activité biologique. A ce stade la sélection est sévère car on estime généralement que seulement une molécule sur 10 000 est validée pour pouvoir aboutir, notamment après la multitude d'essais nécessaires, à la mise sur le marché d'un médicament. Il est certainement indispensable de donner une rémunération pour la collecte de plantes ou de connaissances qui aboutira à la mise au point d'un médicament. La forme du paiement est cependant difficile à concevoir. En effet on peut d'abord envisager une rémunération forfaitaire, mais qui sera inévitablement comparée aux revenus pouvant être très élevés de l'entreprise pharmaceutique. Un intéressement aux bénéfices peut être possible mais celui-ci ne peut intervenir que dix ou quinze ans, ou plus, après la récolte de la plante ou la communication des savoirs traditionnels. La valeur réelle de la biodiversité des pays en développement est certainement amoindrie par l'existence à travers le monde de collections comme celles des C.I.R.A. ou de nombreuses institutions scientifiques qui détiennent d'importantes banques de ressources génétiques, microbiennes, animales ou humaines. On peut aussi noter qu'il n'est pas toujours nécessaire de se rendre auprès des collectivités traditionnelles pour acquérir leur savoir, celui-ci se trouvant déjà consigné dans de nombreuses publications scientifiques. Enfin il faut tenir compte des possibilités de reproduction des ingrédients actifs qui peuvent être découverts dans des ressources naturelles. En effet, grâce aux progrès scientifiques, une analyse chimique ou génétique n'exige que de très petites quantités de matériel tangible. Cela rend possible la reproduction du, ou des, principe(s) actif(s) soit par chimie combinatoire ou de synthèse soit par remodelage biologique d'un autre organisme par transgenèse. C'est pourquoi les modalités de restriction d'accès physique perdront probablement de leur importance au profit des modalités régissant l'utilisation et le contrôle de l'information proprement dite. Il me semble tout à fait justifié que les pays en développement souhaitent tirer parti des ressources génétiques présentes sur leur territoire comme le font d'autres pays de leurs ressources fossiles. Il ne faut cependant pas qu'ils surestiment les gains qu'ils pourraient en retirer compte tenu des différentes façons de contourner la bioprospection in situ, sans parler du « biopiratage » certainement impossible à éradiquer complètement. C'est pourquoi je pense qu'il serait primordial pour les pays en développement de développer une approche en terme de contrôle des informations intangibles pouvant être recueillies à partir de leurs ressources génétiques. Il serait utile d'étudier la faisabilité d'une telle approche par exemple au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'O.M.P.I. La France pourrait y faire des propositions en ce sens. Ce sera une recommandation de ce rapport. Car le vrai défi pour ces pays est de pouvoir ajouter eux-mêmes de la valeur à leurs ressources génétiques brutes plutôt que de les exporter vers d'autres pays où seront développés les produits finis et, en fin de compte, réalisés les plus importants profits. C'est certainement une très voie difficile mais elle a commencé à être empruntée par un certain nombre de pays comme l'Inde ou, à une plus modeste échelle, le Costa Rica. 2 - la dimension éthique et sociale Les conséquences éthiques et sociales de la brevetabilité de vivant avaient été esquissées dans mon précédent rapport. Dans la présente étude je souhaite revenir sur ces deux thèmes. Dans le domaine éthique j'avais souligné les très importants risques de réification de l'humain induits par les tentations croissantes de commercialisation du corps humain au travers de ses gènes. Ces risques m'avaient fait plaider pour que soit lancée au plus tôt une réflexion sur le statut du vivant dans nos sociétés. Deux ans après on ne peut que constater son inexistence et aussi la persistance de sa nécessité, ce qui m'incite à renouveler cet appel. Dans le présent rapport, je souhaite aborder la question des banques ou collections contenant des données biologiques humaines. Les enjeux sociaux avaient été très brièvement abordés sous l'angle de l'affaire Myriad Genetics et de la question de la fourniture de médicaments anti-sida aux pays africains victimes de cette épidémie. Je souhaite maintenant faire un point un peu plus approfondi dans ce domaine. A - L'interrogation éthique : les banques de données biologiques humaines. L'expérience islandaise Cette interrogation éthique sur les banques de données biologiques dont les projets se sont développés de façon importante ces dernières années, sera plus spécialement centrée sur le projet islandais. Celui-ci m'a en effet paru intéressant à exposer compte tenu à la fois de sa complétude et de son caractère quelquefois mal connu. a - Le développement des banques de données biologiques humaines Les chercheurs en santé humaine peuvent avoir besoin de données génétiques portant sur l'ensemble de la population ou sur un segment de population. Ces informations peuvent servir à l'identification des mutations dans le (ou les) gène(s) responsable(s) de différentes maladies dans l'espoir d'établir des corrélations fiables entre certains allèles1 et la prédisposition ou, au contraire, la résistance aux affections. Elles peuvent également avoir comme but l'étude du polymorphisme, c'est-à-dire la diversité génétique des populations humaines. Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (C.C.N.E.) a récemment consacré un avis2 aux « Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d'information associées : « biobanques », « biothèques ». Cette instance, après avoir noté que « la collection d'échantillons et de données s'est faite de tous temps, et se fait encore comme une composante normale et courante de la pratique médicale » souligne que les collections « prennent de la valeur », cette activité devenant « toujours davantage dépendante pour ses financements de l'industrie du médicament ». Cet avis pose ensuite, à mon sens, le problème de fond de ces collections : « Il faut insister sur le changement d'échelle qu'induit la révolution technologique, ouvrant la perspective d'analyser de vastes ensembles de données à l'aide de techniques de plus en plus performantes. Il est désormais devenu concevable d'entreprendre des analyses génétiques sur de vastes populations. Non seulement les conséquences scientifiques de ce changement sont considérables mais l'irruption du secteur privé tant dans les moyens que dans la collecte, le traitement des échantillons et données est devenu un facteur très important de l'évolution. » Il poursuit plus loin en soulignant : « [...] la recherche [sur les caractéristiques génétiques des patients] implique l'analyse de collections très larges, beaucoup plus importantes que celles constituées jusqu'à présent, nourries d'informations sur la santé des personnes qui ont contribué à les constituer. » Cette analyse de la situation va se trouver illustrée par l'expérience de la banque de données médicales islandaise. Cette banque de données médicales n'est pas la seule au monde. En effet selon l'avis précité du C.C.N.E. et le rapport de la Commission de l'éthique de la science et de la technologie du Québec intitulé « Les enjeux éthiques des banques d'information génétique : pour un encadrement démocratique et responsable » de décembre 2002, la situation dans le monde de ces banques est la suivante, compte non tenu de l'Islande : Banques en activité : - Aux Etats-Unis, on estime le nombre total d'échantillons conservés à la fin de 1998 à 282 000 000 avec, chaque année, l'ajout de vingt millions de nouveaux échantillons. Dans ce pays, 96 000 000 d'échantillons sont conservés dans deux grandes collections : le National Pathology Repository et le D.N.A. Specimen Repository for Remains Identification ; - en France, trois collections existent : Généthon : 46 000 échantillons, Centre d'études du polymorphisme humain : 15 000 échantillons en 2002, Institut biologique de Lille : 15 000 échantillons en 2000 ; - au Royaume Uni, la Police national database compte 350 000 échantillons (fin 1998) ; - en Suède, la collection Eurona Medical/Gemini Genomics compte 3 000 000 d'échantillons et la Umea MedicalBiobank/UmanGenomics 100 000. Au niveau européen ont été réunis de 1993 à 1999 les échantillons de 520 000 personnes pour la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, programme coordonné par le Centre international de recherche sur le cancer de Lyon dépendant de l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) en collaboration avec le Programme contre le cancer de la Commission européenne. Un certain nombre de projets sont soit en projet, soit en début de réalisation. Banques en projet : - Estonie : le projet de rassembler les échantillons de un million de personnes, soit environ les 2/3 de la population de ce pays a démarré à l'automne 2002, l'investissement prévu étant de 150 millions de dollars ; - Lettonie : projet de création d'une banque recueillant les données concernant 60 000 personnes. La loi a été adoptée et les financements, investissement de 1,7 million de dollars, sont recherchés; - Norvège : les échantillons de 200 000 personnes seront collectés pour Conor et de 270 000 personnes pour celui dénommé Moba, éléments centraux du projet Biohealth Norway ; - Royaume-Uni : projet de BioBank UK d'une organisation caritative regroupant le Medical Research Council, le Wellcome Trust et le Department of Health : 500 000 personnes seront concernées, le recrutement devant être complet en 2004 ; l'investissement étant de 66 millions de dollars ; - Québec : projet de réseau de médecine génétique appliquée, « Cart@gène » avec plus de 50 000 échantillons, le financement de 19 millions de dollars étant en cours de recherche ; - Tonga : projet d'inclusion de la totalité de la population, 108 000 personnes, dans le programme de la société Autogen. L'expérience islandaise se situe donc dans un contexte de développement de ces banques mais elle en représente peut-être actuellement le modèle le plus accompli. b - Le projet islandais Le 17 décembre 1998, le Parlement islandais a voté la loi n° 139/1998 autorisant le ministre de la Santé à accorder une licence à une entreprise privée pour élaborer une banque de données rassemblant tous les dossiers médicaux enregistrés dans le cadre du système national de santé. Il convient de donner quelques précisions sur l'environnement de ce projet afin d'en apprécier toute la portée. L'Islande est un pays à la population peu nombreuse : elle compte actuellement environ 270 000 habitants qui n'étaient que 50 000 à la fin du XIXème siècle. De tout temps, compte tenu de ce petit nombre d'habitants, il fut important dans ce pays de connaître exactement sa filiation notamment pour faire valoir ses droits lors des successions ou pour être sûr de ne pas épouser un proche parent. Ces nécessités ont fait naître un grand intérêt des Islandais pour la généalogie qui s'appuie sur des registres d'état-civil remontant parfois très loin dans le passé. De l'isolement relatif où fut ce pays pendant des siècles compte tenu de sa situation géographique, il en a été déduit par certains que les habitants pourraient avoir une « homogénéité génétique » très importante. Cette assertion est en fait sujette à un débat qui n'a pas eu jusqu'à présent de conclusion définitive. En effet, outre que les Islandais pourraient être, selon un certain nombre d'études, aussi hétérogène que le reste de la population européenne, une controverse est engagée entre les scientifiques sur l'avantage supposé que représenterait une population homogène. Une autre caractéristique de l'Islande est l'existence d'un système national de santé bien organisé et gardant ses archives depuis 1915. Cette loi de 1998 sur la base de données médicales a monopolisé l'attention mais il existe deux autres bases de données complétant celle-ci : - la base de données génétiques régie par la loi sur les banques biologiques, la loi sur les droits des patients et la loi sur la protection des données ; - la base de données généalogiques régie par la loi sur la protection des données. Suite au vote de cette loi, qui avait déjà donné lieu à des débats houleux dans le pays et au Parlement, le ministère de la santé a lancé en Islande et dans le monde un appel d'offres pour accorder une licence de gestion de ce fichier. Deux entreprises ont répondu : une société islandaise d'informatique et la société DeCode Genetics. C'est finalement DeCode Genetics qui a été choisi par les pouvoirs publics islandais dans la mesure où cette société a été considérée comme ayant le plus d'expérience et de connaissances. DeCode Genetics a été créée aux Etats-Unis en 1996 avec le soutien de fonds américains de capital-risque et est basée dans ce pays, dans l'Etat du Delaware. Officiellement américaine, DeCode Genetics est en fait une société holding détenant 100% des parts d'une autre société, islandaise cette fois, Íslenk erfdagreining ehf., qui est celle qui opère en Islande. C'est donc cette société qui a obtenu en janvier 2000 le droit d'organiser cette base de données médicales et de la commercialiser en exclusivité pendant douze ans. L'entreprise pharmaceutique Hoffman-La Roche a acquis 10,3% du capital de DeCode Genetics. En février 1998, un important contrat de collaboration a été signé entre les deux entreprises, Hoffman-La Roche s'engageant à verser 200 millions de dollars sur cinq ans au titre d'un programme de recherches sur les gènes de susceptibilité à douze maladies héréditaires. DeCode Genetics a commencé à établir une base de données généalogiques de tous les Islandais en numérisant les archives de l'état-civil islandais. Cette base doit contenir à l'heure actuelle environ les deux tiers de toutes les Islandais ayant vécu depuis 1700, soit environ 700 000 personnes. Ces données sont publiées sur Internet et accessibles à tous gratuitement, les données généalogiques ayant été exclues de la loi islandaise de 1997 sur la protection de la vie privée. DeCode Genetics a enfin obtenu le droit de pouvoir croiser les informations des trois banques de données : médicales, génétiques et généalogiques. Son objectif est alors de proposer à des clients potentiels, entreprises pharmaceutiques ou de biotechnologies, des diagrammes caractérisant des maladies établis à partir du croisement des trois bases. Dans ces conditions il apparaît immédiatement que le point crucial sera la faculté qu'auront ou non ces personnes d'exercer leur liberté de se soustraire à cette entreprise. C'est pour cette raison que l'une des interrogations principales consistait à déterminer les formes du consentement qui devrait être donné avant d'introduire les données médicales dans la base. Les opposants à cette loi estimaient que les données médicales devaient être recueillies sous réserve du consentement « éclairé » du patient, celui-ci devant être informé minutieusement de tous les détails de l'étude spécifique dont il devait faire partie. Après de très vives controverses, le Parlement islandais a finalement décidé que le transfert de données devait être soumis non pas au consentement éclairé et écrit mais au consentement présumé du patient. Cependant, afin de répondre aux critiques suscitées par cette décision, le Parlement a décidé de mettre en place une procédure permettant aux personnes de choisir de ne pas participer au projet en demandant par écrit à ce que leurs renseignements médicaux ne soient pas inclus dans la base de données. Actuellement ce choix a été opéré par environ 22 000 personnes sur une population totale de 280 000 habitants. Un problème non encore résolu concerne les données des personnes décédées et le droit de leurs héritiers à exercer ce choix. Une procédure judiciaire est actuellement en cours à ce propos. A l'heure actuelle cette base de données médicales n'est pas encore opérationnelle car des discussions sont encore en cours entre DeCode et la Commission de la protection vie privée (Persónuvernd), l'équivalent de notre Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur les techniques de cryptage des informations. Il semble d'ailleurs que DeCode ne soit plus aussi enthousiasmé actuellement par ce projet dans la mesure où le personnel affecté à cette tâche a été considérablement réduit. Une des explications à cette situation serait que le nombre de clients potentiels ne serait pas été aussi élevé que prévu. Mais cette entreprise s'est assurée, en dehors de cette base de données médicales et des procédures prévues, la possession d'un certain nombre d'informations concernant des dossiers médicaux et des génotypes. Ces dossiers médicaux actuellement détenus « sur la base du volontariat et avec le consentement éclairé » selon les dires des responsables de l'entreprise, sont au nombre de 100 000. Le président de l'Association des Islandais pour l'éthique en science et en médecine (Mannvernd) m'a indiqué qu'il était notoire que ces dossiers avaient été obtenus auprès de médecins contre rémunération. L'entreprise a également effectué le génotypage de 100 000 personnes adultes en analysant leur sang. A cet égard, la réunion de ces milliers flacons de sang dans un gigantesque réfrigérateur est un spectacle très impressionnant. Cette expérience islandaise pose, de façon fondamentale, la question de savoir si les gènes des personnes humaines sont des matériaux bruts qu'il est loisible de commercialiser, même de façon anonyme, comme n'importe quelle ressource naturelle. C'est ainsi qu'il m'a été expliqué par un parlementaire islandais, opposé à la loi, que l'idée de cette exploitation des éventuelles caractéristiques génétiques des islandais était liée à une volonté de diversification des activités économiques du pays. Les ressources génétiques humaines pourraient ainsi devenir une ressource naturelle parmi d'autres des pays qu'il serait possible de commercialiser comme on le fait pour le pétrole ou le charbon. Ainsi le but du programme letton de collecte d'informations médicales et génétiques est d'attirer dans ce pays les entreprises de pharmaceutiques et de biotechnologies. Il en est de même à Tonga où opère une société australienne de biotechnologies. Ces diverses banques peuvent présenter de nombreux avantages pour la recherche, notamment pour la détection des liens entre les gènes et un certain nombre d'affections, spécialement les affections monogéniques. Mais quelques questions doivent être soulevées. Tout d'abord, et c'est un principe qui doit être absolu, les caractéristiques génétiques des populations ne doivent jamais être considérées comme des ressources naturelles comme les autres. Elles doivent donc être qualifiées de bien commun qui ne doit jamais pouvoir être appropriable tant de manière privative par une entreprise que de manière publique par un Etat. Il faut très fermement refuser de faire de pays entiers, et notamment des plus petits et des plus isolés, des « mondes de souris de laboratoires », selon le terme employé par un député islandais. Les banques de données génétiques ou de données médicales doivent faire l'objet d'une réglementation précise et rigoureuse. La première exigence est de donner aux personnes dont on sollicite la participation une vue la plus claire possible des bénéfices et des inconvénients éventuels à attendre du rassemblement de ces collections. La deuxième exigence est, de la part des pouvoirs publics, de réguler les intérêts commerciaux dont le rôle dans le développement de l'exploitation des connaissances permises par ces collections peut, à juste titre, être inquiétant. On sait que celles-ci intéressent beaucoup les fournisseurs de services médicaux privés, les entreprises d'assurance et les employeurs. Il faut rendre absolument impossible ce que j'avais appelé dans mon précédent rapport la « marchandisation » du corps humain à travers ses gènes. Enfin il faut être extrêmement vigilant sur les questions liées au consentement des personnes participant à la réalisation de ces collections. Le consentement « éclairé » est bien évidemment indispensable. En aucune façon, on ne peut se contenter d'un consentement « présumé ». Néanmoins, il faut reconnaître qu'il est souvent difficile de prévoir par avance les éventuels usages futurs d'une collection. Les donneurs ne peuvent être informés qu'en des termes très généraux sur l'usage des échantillons et des données médicales. Il y a donc besoin d'une évaluation publique et politique des raisons d'utiliser ou non ce type de bases de données. Toute institution rassemblant des échantillons et des données médicales doit donc faire l'objet d'un rigoureux contrôle public continu qui doit s'exercer sur la façon dont non seulement elle traite les donneurs mais aussi dont elle dispose des découvertes qui doivent être apportées à la communauté entière. La diffusion des découvertes, c'est-à-dire la mise au point de traitements et de médicaments, pose le problème social de leur accès. B - Le problème social J'avais abordé de façon assez approfondie cette question dans mon précédent rapport. Il convient maintenant de faire le point sur les trois questions évoquées alors : le problème de l'accès aux médicaments, l'affaire des tests de diagnostic de Myriad Genetics et le renforcement des licences obligatoires dans la loi française. a - Le problème de l'accès aux médicaments Le problème de cet accès se pose aux pays en voie de développement mais aussi dans les pays développés - Les pays en voie de développement Il s'agira ici de faire le point sur les suites de la « déclaration de Doha ». En novembre 2001, à Doha, lors de la conférence de l'O.M.C., avait été adoptée une déclaration sur la relation entre les A.D.P.I.C. et la santé publique pour les pays confrontés à un grave problème de santé, tels que sida, paludisme ou tuberculose et dépourvus des possibilités de disposer des agents thérapeutiques adéquats. Elle prévoyait notamment le droit pour tous ces Etats d'accorder des licences obligatoires sur les produits pharmaceutiques nécessaires, même si ceux-ci étaient brevetés. A certaines conditions, la fabrication de produits génériques était donc admise sans l'autorisation du détenteur du brevet. Mais la question de savoir comment les pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou inexistantes pouvaient recourir à la licence obligatoire était restée sans réponse. En effet selon les dispositions juridiques en vigueur à l'O.M.C., une telle licence obligatoire doit être utilisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. Elle n'avait donc aucune utilité pour un pays ne disposant pas de capacités de fabrication de produits pharmaceutiques. Ce pays ne pouvait pas non plus recourir à l'importation, car les pays tiers ne pouvaient pas émettre de licence obligatoire pour l'exportation. La proposition de pouvoir recourir aux importations de produits génériques a alors rencontré l'opposition des Etats-Unis. En effet les industries pharmaceutiques américaines craignaient qu'une telle dérogation aide les pays producteurs de médicaments génériques comme le Brésil ou l'Inde, à leur prendre des marchés d'exportation. Elles redoutaient également que ces médicaments fassent l'objet de détournements de trafic et soient revendus en contrebande dans les pays développés. Finalement une solution a été trouvée le 30 août dernier à Genève dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de l'O.M.C. qui devait s'ouvrir à Cancún le 10 septembre 2003. Selon cet accord, dans la mesure où un produit pharmaceutique est breveté dans le pays fabricant et le pays importateur, sont autorisées une licence obligatoire de fabrication et d'exportation dans le premier et une licence obligatoire d'importation dans le second. Un certain nombre de mesures ont été décidées afin d'éviter un certain nombre de fraudes : distinction des produits fabriqués dans ce cadre par un emballage spécial et/ou une coloration ou une mise en forme spéciale, adoption de mesures pour empêcher la réexportation des produits importés. Il reste bien sûr à voir comment ces dispositions seront appliquées mais elles semblent, dans leur principe, devoir être approuvées. On pourra quand même regretter qu'il ait fallu attendre presque deux ans que les Etats-Unis acceptent cette solution. Enfin il convient de noter qu'un nouveau délai de 10 ans a été accordé en juin 2002 aux 49 pays les moins avancés, soit jusqu'en 2016 pour qu'ils appliquent les dispositions de l'A.D.P.I.C. en matière de brevets pharmaceutiques. Le problème de l'accès aux technologies brevetées touchant le secteur de la santé ne se pose pas seulement aux pays en développement mais aussi aux pays développés. - Les pays développés L'accès aux médicaments se pose notamment aux Etats-Unis du fait de leur prix très élevé. Confrontés à cette situation, de nombreux citoyens américains et de nombreuses collectivité publiques, des Etats et des villes, ont pris l'habitude de se fournir au Canada. Il est en effet courant qu'existent entre les Etats-Unis et le Canada, des différences de prix pour un même produit pouvant atteindre près de 70%. Cette situation est naturellement due au fait que le Canada pratique, comme la France et les pays d'Europe, un contrôle des prix alors que ceux-ci sont complètement libres aux Etats-Unis. Ces achats au Canada sont naturellement dénoncés par les entreprises pharmaceutiques qui estiment que situation est assimilable à de la contrefaçon et expliquent que les prix élevés sont nécessaires pour financer la recherche et l'innovation. Il faut également noter que beaucoup de ces entreprises mettent aussi en cause la politique de contrôle des prix suivie notamment par l'ensemble des pays européens en arguant que ceux-ci ne prennent pas ainsi leur juste part des coûts de la recherche. b - L'affaire des tests de Myriad Genetics Le marché des tests de diagnostic illustre les difficultés sociales que peut engendrer l'appropriation des gènes humains. Comme on l'a déjà souligné, les entreprises de biotechnologies ont besoin de produits commercialisables relativement rapidement afin de rentabiliser leurs investissements. C'est pourquoi nombre d'entre elles se sont tournées vers les tests de diagnostic dont la mise sur le marché peut se faire beaucoup plus vite que des médicaments. Il s'agit en effet à la différence des médicaments, de techniques peu réglementées, non soumises aux tests de toxicité et d'efficacité et aux longues procédures d'autorisation de mise sur le marché. Ces tests sont généralement considérés comme des réactifs. Les difficultés sont apparues en pleine lumière avec l'affaire des tests de prédisposition au cancer du sein développés par la firme américaine Myriad Genetics dont j'ai retracé l'historique dans mon précédent rapport. J'avais également décrit sa politique consistant à s'associer avec des laboratoires européens pour commercialiser ses tests. C'est ainsi qu'un accord avait été conclu avec une petite compagnie anglaise, Rosgen, puis, après la faillite de celle-ci avec une importante société allemande d'analyses médicales, Bioscientia. Mais parallèlement au développement de ses activités, Myriad Genetics a vu ses brevets contestés à la fois au Canada et en Europe. Au Canada, un certain nombre d'Etats, responsables de la protection sociale, ont engagé, depuis 1998, un mouvement de contestation de ces brevets. Cette fronde a été, à l'origine, principalement le fait de la Colombie Britannique et de l'Alberta qui a lancé son propre test dès 1998. Devant cette situation Myriad Genetics a menacé ces Etats de procès. La Colombie Britannique a ainsi préféré dans un premier temps renoncer à l'affrontement tandis que l'Alberta était sommé de mettre fin à son action dans ce domaine en 2001. Mais en janvier 2003, l'Alberta décidait de passer outre à cette sommation et relançait son test dont le coût est de 650 euros contre plus de 2 000 pour celui de Myriad Genetics. En février 2003, la Colombie Britannique a décidé de reprendre ses propres tests. L'Ontario décidait à son tour en avril 2003 de proposer à ses habitantes un nouveau test lui aussi basé sur les gènes BRCA 1 et 2 mais utilisant une nouvelle méthode qui permettrait d'obtenir de meilleurs résultats que ceux de Myriad Genetics. A l'heure actuelle Myriad Genetics en est resté aux menaces sans entreprendre de poursuites judiciaires. Selon le ministère canadien de la santé, cette abstention serait due au fait que Myriad Genetics ne serait pas très sûre de la validité juridique de son brevet. En Europe, comme on le sait, une opposition a été effectuée aux brevets accordés à Myriad Genetics par l'O.E.B. Cette procédure d'opposition a été engagée le 9 octobre 2001 par l'Institut Curie à laquelle se sont associés l'Institut Gustave-Roussy et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Une démarche similaire a été effectuée par la Société belge de génétique humaine réunissant les centres belges et hollandais de génétique humaine et les sociétés de génétique allemande, danoise et britannique. Ces actions visaient le premier brevet de Myriad Genetics concernant toutes les techniques de diagnostics. Le 22 février 2002, les mêmes parties françaises, soutenus par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et la Fédération hospitalière de France déposaient une opposition au deuxième brevet de Myriad Genetics ayant trait à des mutations spécifiques. La contestation de ce deuxième brevet s'est élargie avec le dépôt d'une nouvelle opposition par les ministères belges et hollandais de la recherche et la Ligue allemande contre le cancer. Une troisième opposition est effectuée le 27 août 2002 par les trois opposants français contre le troisième brevet délivré à Myriad Genetics par l'O.E.B. le 28 novembre 2001 pour le gène BCRA 1 et la protéine correspondante pour des applications qui n'existent pas encore : thérapie génique, criblage de médicaments, fabrication de protéines, animal transgénique...et des « kits » diagnostiques. Là encore une très large opposition d'un grand nombre de sociétés de génétique européennes et d'associations de patients s'est manifestée. Les axes de cette troisième opposition sont, d'après un document de l'Institut Curie, les suivants : - défaut de priorité et absence de nouveauté des séquences de référence de BCRA 1 datant de 1995 à une date où la séquence était disponible dans les bases de données scientifiques ; - défaut d'activité inventive puisqu'il était possible d'isoler le gène déjà connus à la date de dépôt du brevet ; - insuffisance de description des applications thérapeutiques et des méthodes de thérapie génique qui ne sont pas décrites dans la demande de brevet pour être mises en œuvre de façon efficace. La procédure d'opposition est en cours devant l'O.E.B. et une décision ne devrait pas être prise avant 2005 ou 2006. Comme le note l'Institut Curie, ces trois brevets couvrent sans restriction toutes les techniques de diagnostic, les mutations spécifiques et les « kits » diagnostiques, ce qui donne à Myriad Genetics un monopole d'exploitation sur le marché international des tests de prédisposition à cette affection. C'est cette affaire qui a incité le législateur français à étendre les possibilités d'accorder des licences d'office. c - L'extension des possibilités d'accorder des licences d'office Comme je l'avais indiqué dans mon précédent rapport, une licence d'office est un acte de puissance publique. Elle permet à l'Etat d'accorder des licences d'exploitation de brevets lorsque l'intérêt public, défense nationale, économie nationale ou santé publique, notamment, le justifie. Ce type de licence est prévu, à condition des respecter un certain nombre de conditions, par l'article 31 des A.D.P.I.C. Actuellement une telle licence ne peut être accordée que pour des médicaments. Mais le gouvernement de M. Lionel Jospin, alerté par cette affaire Myriad Genetics, avait introduit dans le projet de loi relatif à la bioéthique une extension des possibilités d'octroi d'une licence d'office aux méthodes de diagnostic ex vivo lorsqu'elles font l'objet d'un brevet. Ce qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 22 janvier 2002. A l'occasion de l'examen de ce texte au cours de l'année passée, le Sénat en première lecture, et l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, ont précisé les situations dans lesquelles ces méthodes de diagnostic peuvent être soumises au régime de la licence d'office. La licence d'office n'est possible que lorsque ces méthodes de diagnostic sont mises à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anti-concurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Il faut souligner l'intérêt de retenir le prix anormalement élevé comme une des possibilités ouvrant droit à la délivrance d'une licence d'office. Cette disposition permet de s'opposer à des fixations de prix déraisonnables. 3 - La question économique La question économique est particulièrement importante car d'elle vont dépendre l'incitation à la recherche, la politique à mener dans les organismes publics de recherche ainsi que la situation de l'agriculture. A - Appropriation du vivant et incitation à la recherche Le brevet conçu comme une incitation à la recherche peut devenir dans le domaine du vivant, un obstacle à celle-ci. Cela impose de réaffirmer l'exemption de la recherche et nécessite d'explorer les voies qui permettraient d'éviter le blocage. a - Le brevet est conçu comme une incitation à la recherche Les conséquences économiques de la brevetabilité du vivant font l'objet d'un nombre croissant d'études de par le monde, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Ces études ne sont pas animées, il convient de le souligner, par une hostilité a priori aux brevets. Elles sont mues au contraire par le souci d'évaluer ce que le concept et la pratique classiques du brevet risque de générer comme dysfonctionnements dans l'allocation optimale des ressources dans ce domaine de la recherche. Ces études cherchent donc à déterminer si des améliorations peuvent être apportées au système de protection de la propriété intellectuelle. Celles-ci ont pour but de permettre à l'ensemble du système économique d'être plus efficace et, donc, de favoriser les découvertes. En France, de ce point de vue, il faut particulièrement citer le rapport du 2 avril 2003 établi à la demande de M. Lionel Jospin, alors Premier ministre, par le Conseil d'analyse économique (C.A.E.) sur les instruments économiques de la propriété intellectuelle et intitulé « Propriété intellectuelle ». Je m'appuierai, dans la suite de ce chapitre, sur un certain nombre d'analyses de la partie de ce remarquable rapport consacrée aux biotechnologies due à MM. Claude Henry et Michel Trommetter et Mme Laurence Tubiana. La science économique est souvent invoquée pour légitimer l'attribution de brevets. Comme on le sait, celui-ci donne un monopole temporaire aux auteurs d'inventions en leur permettant d'exclure autrui de leur commercialisation. Il contribue ainsi à rémunérer leurs efforts et leur prise de risque tout en permettant, par la publication, la diffusion des savoirs. Par là il constitue une authentique incitation à l'innovation et aux progrès. Comme le notent MM. Michel Berry et Claude Henry dans le résumé du rapport précité, les théoriciens de l'économie ont montré qu'il est nécessaire d'apporter un certain nombre de nuances selon les types d'innovation et les contextes. C'est ainsi que, d'après ces auteurs, quatre facteurs sont théoriquement et empiriquement favorables à l'innovation : - la concurrence pour réaliser des innovations, - la concurrence ex ante sur les marchés de produits : les entreprises s'efforcent d'échapper à la concurrence directe (« au coude à coude », selon les auteurs), - la diffusion de la connaissance créée par les précédentes inventions, celle-ci devant être considérée comme un bien public et donc devant idéalement être considérée comme librement utilisable, - la limitation de la concurrence ex post sur les marchés des produits issus de l'effort inventif, la perspective d'un marché protégé étant naturellement plus attractive qu'une concurrence vive. Le quatrième facteur est celui qui incite à mettre en place une protection de la propriété intellectuelle, éventuellement sous la forme de brevets. Les trois premières considérations amèneraient plutôt à conférer à la connaissance scientifique et technique un statut de disponibilité aussi large et libre que possible. La difficulté du brevet est qu'en posant une exclusivité des droits, il restreint à la fois l'accès au savoir et son utilisation. Il est donc potentiellement, et malgré l'obligation de publier les termes de l'invention, un élément qui va s'opposer à l'incitation à la recherche, ce qui est pourtant son objectif premier. L'appropriation du croissante vivant par l'intermédiaire du brevet donne lieu au développement d'obstacles à la recherche. b - Le brevet sur le vivant induit des obstacles à la recherche Les principaux obstacles à la recherche recensés dans le domaine du vivant sont liés à l'accumulation de brevets, à l'existence de redevances en cascades, aux brevets larges, à la fragmentation des droits de propriété, et aux revendications sur les inventions en aval. § L'accumulation de brevets L'accumulation de brevets caractérise une situation où de multiples acteurs détiennent de multiples brevets. La recherche et le développement peuvent ainsi être pénalisés compte tenu de la difficulté et du coût d'obtention des droits nécessaires. On peut citer la caractéristique affaire dite du « riz doré » (Golden rice). Celui-ci est un riz modifié génétiquement par adjonction de trois gènes pour augmenter la synthèse du bio-carotène et augmenter sa teneur en vitamine A. Il était destiné aux populations de pays en développement dont cette graminée constitue l'alimentation de base. Outre l'emploi des trois gènes qui appartenaient à des propriétaires différents, la réalisation de cette plante a nécessité l'utilisation d'un certain nombre de vecteurs de transformation, promoteurs, marqueurs de résistance à des antibiotiques qui faisaient tous l'objet de brevets. Il a été ainsi relevé que la fabrication de cette plante faisait intervenir plus de 70 brevets appartenant à une douzaine de propriétaires. Cette multitude de brevets entraîne plusieurs conséquences. Avant de lancer une recherche, il faut d'abord chercher quels brevets ont déjà été accordés dans le domaine envisagé afin de ne pas risquer d'empiéter sur des droits antérieurs. Les droits accordés n'étant pas toujours très précis dans leur délimitations, il n'est pas facile de pendre une décision de lancer une recherche. Quelquefois un domaine d'investigations sera ainsi purement et simplement abandonné si des risques existent d'enfreindre un brevet déjà accordé. Les petites sociétés sont ainsi dissuadées d'entreprendre des recherches dans des domaines où d'autres entreprises ont déjà déposé des brevets. Comme le note M. Dominique Foray, celles-ci s'efforcent d'éviter les secteurs où existent des entreprises ayant une vaste expérience en matière de litiges liés aux brevets. Ce type de comportement fausse donc le choix de nouveaux thèmes de recherches et est de nature à limiter les innovations. Il faut cependant signaler que des moyens existent pour minorer ces difficultés. C'est notamment la possibilité dans le système européen et japonais de s'opposer à une demande de brevets avant l'octroi de droits, dès sa publication. Cette mesure peut permettre d'éviter un conflit une fois les droits de propriété accordés, et donc d'économiser des frais juridiques élevés. Cette disposition n'existant pas aux Etats-Unis, les difficultés se résolvent souvent devant les juridictions spécialisées par des procès dont les coûts peuvent atteindre des millions de dollars. Le risque de devoir affronter de telles situations est certainement très dissuasives pour de nombreuses petites entreprises. § Les redevances en cascade L'utilisation de brevets entraîne la nécessité d'acquitter des redevances à leurs propriétaires. Comme on l'a vu, la brevetabilité s'est étendue, au delà des gènes, à toutes les techniques intervenant dans ce domaine : lignées cellulaires, sondes d'A.D.N., modèles animaux, méthodes d'analyses biologiques, vecteurs divers qui seront employés en thérapie génique...Au-delà de ces brevets portant sur des outils de recherche « amont », il existe d'autres types de brevets portant par exemple sur des composés identifiés par une méthode de dépistage ou pouvant se lier à un enzyme ou récepteur déterminé... Une recherche avancée en biotechnologie implique en général l'emploi de toutes ces techniques. Quand celles-ci sont brevetées, ce qui est devenu la règle pour le plus grand nombre des cas, il faut acquérir une licence d'utilisation auprès de chaque détenteur. Les licences imposent une redevance annuelle fixe ou calculée selon le degré d'utilisation, par exemple le nombre de fois où la technique en question est employée. Les prix demandés peuvent alors être très dissuasifs. Ainsi, comme le rapporte l'étude du Conseil d'analyse économique, l'accès à la banque de données de Celera Genomics est autorisé moyennant 15 millions de dollars par an sans autres contreparties1. Ce prix s'établit par contre à 10 000 dollars pour un laboratoire public mais est subordonné à des conditions que nous évoquerons plus loin. L'O.C.D.E. estime ainsi dans son rapport de 2002 précité que le coût des redevances à payer pour exploiter un produit peut atteindre jusqu'à 20% du prix de ce produit sur le marché. Enfin, outre les coûts, la réalisation d'un programme peut être purement et simplement bloqué par un simple refus d'accorder une licence d'utilisation. Les négociations sur l'accès à des technologies peuvent ainsi être longues et compliquées, entraînant des retards dans les projets de recherche, des difficultés administratives, ou des conflits juridiques. Les brevets larges sont un autre facteur de blocage de la recherche. § Les brevets larges L'exemple-type de brevet large est ceux de Myriad Genetics sur les gènes de prédisposition au cancer du sein évoqués. Un autre exemple est celui du brevet accordé aux Etats-Unis à la société Incyte sur les étiquettes des gènes des kinases1 dont les revendications étaient très étendues. En effet celles-ci couvrent les séquences, l'usage de ces séquences pour identifier ou coder un A.D.N. complet, tout vecteur d'expression contenant ces séquences ainsi que toute méthode de production de polypeptides utilisant une telle cellule. Ce type de brevet réserve ainsi à son titulaire des domaines d'exclusivité extrêmement importants qui contraignent d'éventuels compétiteurs à solliciter des licences de dépendance dont l'octroi n'est jamais automatique ou qui peut se faire à des conditions financières pouvant avoir des caractères léonins. § La fragmentation des droits de propriété Cette situation est caractérisée par l'existence de droits de propriété sur des biens indivisibles. Chaque partie est ainsi propriétaire d'une portion du bien indivisible et a donc le droit d'exclure les autres de sa part. Le résultat final est que personne ne possède le privilège d'utilisation effectif, les droits étant morcelés. C'est une situation connue depuis quelques années sous le nom de « tragédie des anti-commons ». Cette expression a été forgée par deux universitaires américains, M. Michaël Heller et Mme Rebecca Eisenberg, par retournement d'une métaphore économique, connue sous le nom de « tragédie des biens communs » (en anglais : tragedy of the commons) devenue classique en science économique. Cette expression, créée par Garett Hardin en 1968, évoque le fait que les ressources collectives, sans propriétaire attitré, sont souvent surexploitées dans la mesure où il n'existe aucune incitation à les préserver. Selon M. Michaël Heller et Mme Rebecca Eisenberg, la prolifération des droits de propriété caractérisant la génomique pourrait amener à une situation exactement inverse. Celle-ci serait telle que des ressources rares, c'est-à-dire l'information génomique qui est unique, seraient sous-utilisées car les détenteurs de brevets sur les séquences ont le droit de s'en interdire mutuellement l'accès. La multiplication des brevets concurrents portant sur des résultats de plus en plus fondamentaux risque ainsi de bloquer la réalisation de produits de santé en aval. Ces auteurs demandent donc aux pouvoirs publics de limiter la croissance des brevets portant sur des résultats fondamentaux et que soit minimisé le recours aux licences restrictives, c'est-à-dire exclusives, dans le développement des produits de santé. Les brevets sur les outils de recherche donnent de plus en plus lieu à des revendications sur les inventions en aval. § Les revendications sur les inventions en aval Les brevets sur les outils de recherche (marqueurs, tests, récepteurs, animaux transgéniques...) sont de plus en plus souvent assortis de clauses reconnaissant à leurs propriétaires des droits sur les produits élaborés et les résultats trouvés par les outils ou les méthodes brevetées. Dès lors le détenteur des brevets en question est fondé à demander des redevances sur la vente d'un produit mis au point à l'aide de son outil de recherche breveté. Ces revendications se trouvent de plus en souvent imposées pour l'accès aux banques de données. On a vu que Celera Genomics accordait l'accès à sa base de données aux laboratoires publics à un prix préférentiel, mais celui-ci est soumis à l'engagement de verser des redevances en cas d'innovations. De même Monsanto, comme le notent MM. Bernard Teyssendier de la Serve et Michel Trommetter1, donne un accès gratuit à sa base de données. La contrepartie est de lui accorder une licence non exclusive sur tout brevet déposé à partir de ces informations, les redevances devant être négociées. Ce système garantit ainsi à cette firme d'être toujours informée des dernières innovations et de toujours pouvoir y accéder. Les deux auteurs estiment que ce type d'accord « ressemble fort à la mis en œuvre, par contrat, de licences obligatoires.» Ceux-ci évoquent également les conditions mises par Syngenta pour la fourniture de mutants d'insertion1 d'Arabidopsis thaliana. Il me semble utile de les citer, à la suite de ces auteurs pour prendre l'exacte mesure de l'ampleur de ces obligations : «- interdiction au chercheur receveur de travailler en collaboration avec les équipes d'autres organismes ou sociétés, sans l'accord de Syngenta ; - obligation de transmettre, à titre gratuit, au moins une fois par an, à Syngenta tous ses résultats obtenus grâce au mutant sans que cette société soit obligée de préciser selon quelles modalités et avec qui elle les utilisera ; - obligation de soumettre tous ses projets de publications à Syngenta, qui peut en faire supprimer touts les informations confidentielles qu'ils contiendraient ; - possibilités pour Syngenta de breveter tout résultat que le receveur ne souhaiterait pas protéger lui-même ; - obligation au receveur de consentir à Syngenta un droit de premier refus pour toute exploitation commerciale des résultats ». Les auteurs soulignent que cette dernière condition donne « en d'autres termes une priorité pour l'exploitation sous licence. Ceci interdit toute négociation avec une autre société. Le receveur sera obligé de négocier une licence au profit de Syngenta par la suite, exclusive si Syngenta le demande ». Enfin on citera comme dernier exemple l'affaire du système Cre-lox qui permet d'obtenir, pour étudier la fonction des gènes, des souris auxquelles il manque un seul gène dans certaines cellules. Cet outil a été breveté par l'Université d'Harvard qui en a licencié de façon exclusive la filiale pharmaceutique de Du Pont. Cette entreprise a assorti l'autorisation pour les chercheurs du secteur public d'utiliser cet instrument de recherche d'un engagement à lui soumettre leurs articles et de lui reconnaître des droits sur les inventions découlant des expérimentations réalisées sur des animaux ainsi modifiés. Selon l'O.C.D.E., 150 universités et organismes à but non lucratif avaient accepté ces conditions, à l'exception, notamment, des National Institutes of Health (N.I.H.) des Etats-Unis. Ces derniers ont ensuite pu négocier de meilleures modalités d'accès à cette technique. Ces difficultés causées par l'existence de multiples brevets peuvent entraîner, c'est notamment le cas aux Etats-Unis, un développement important des actions judicaires qui sont à la fois coûteuses et génératrices de retards dans les programmes de recherche. La situation est d'ailleurs arrivée à un tel point dans ce pays que des brevets servent uniquement pour susciter des conflits afin d'obtenir des dommages et intérêts soit par entente amiable, soit à la suite de procès. Le rapport du C.A.E. rapporte ainsi l'exemple de brevets qui ne sont pas utilisés pour bloquer le développement de produits qui seraient concurrents de ceux déjà commercialisés par le détenteur. Un autre exemple est donné, celui d'une entreprise d'électronique qui a procédé à un examen de ses brevets dormants pour réactiver ceux qu'elle estimait avoir une bonne chance d'être déclarés enfreints par des juges. Cette entreprise a ensuite entrepris des actions judiciaires pour obtenir des dommages et intérêts de la part des contrevenants ou pour leur vendre des licences au prix fort. Dans ce cas, il s'agit alors du développement de véritables industries de rentes, qui n'ont évidemment plus rien à voir avec la protection des activités de recherche. Afin d'éviter ces inconvénients et de s'exposer à devoir payer des sommes considérables à l'issue de procès, les grandes entreprises préfèrent s'entendre à l'amiable. Cette situation affaiblit naturellement la concurrence et pousse à l'instauration de positions dominantes. Ainsi Monsanto et Du Pont ont-ils conclu des accords bilatéraux pour utiliser leurs brevets respectifs et éviter des conflits. Cela amène à des conséquences tout à fait abusives : ces deux entreprises possèdent ainsi à elles deux 40% des brevets mondiaux en biotechnologies et le monopole des herbicides. Ces deux firmes contrôlent également 70% du marché des semences aux Etats-Unis et 15% du marché international. On risque donc d'arriver à des situations de blocage en matière de recherche. Il est donc crucial que la recherche puisse bénéficier d'une exemption de tous ces droits qui prolifèrent. c - L'exemption de recherche L'exemption de recherche concerne les actes effectués à titre privé et à but non commercial et ceux pratiqués à des fins expérimentales liés à l'objet de l'invention. Ceux-ci sont alors considérés comme ne portant pas atteinte au brevet protégeant l'invention. Cette exception est prévue par les A.D.P.I.C. dans son article 30 qui précise que « Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiées à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.» Les commentateurs de cet article ont souligné le caractère plutôt flou et vague de ces dispositions ce qui n'a pas permis aux Etats membres d'harmoniser leur politique dans ce domaine. Il y a à l'heure actuelle deux approches principales en la matière : celle de l'Europe et celle des Etats-Unis. § L'Europe En Europe, la directive 98/44/CE a prévu dans son article 13 3 b la possibilité de disposer de matière biologique à des fins expérimentales. Tous les pays de l'Union européenne ont ainsi introduit, à l'exception de l'Autriche, un principe général d'exception à l'application des brevets en cas d'usage expérimental. C'est ainsi qu'en France l'article L 613 - 5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : - aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; - aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; [...]. » MM. Bernard Larrouturou et Christian Bréchot m'ont indiqué qu'aucun problème ne se posait à l'heure actuelle en la matière à la recherche française. On peut espérer que cette situation perdure mais il faut craindre que la politique de prise de brevets par les institutions de recherche publiques fasse restreindre ces possibilités d'utilisations d'outils ou de procédés brevetés. C'est ainsi que le rapport de 2002 de l'O.C.D.E. faisait état, sans donner plus de précisions, de cas de pratiques restrictives de la part de quelques titulaires de brevets à l'encontre de la recherche universitaire allemande. M. Alain Weil m'a fait part de son inquiétude à ce propos. Il m'a indiqué que la conception américaine des « licences de recherches »c'est-à-dire une licence pour une simple recherche et des droits sur les résultats ultérieurs commençait à être invoquée par certains juristes spécialistes des brevets. § Les Etats-Unis Aux Etats-Unis, cette exception de recherche n'est prévue par aucun texte. Mais un certain nombre de décisions judiciaires l'avait néanmoins prévue en cas d'utilisation du produit breveté « pour satisfaire la curiosité scientifique, pour vérifier l'exactitude de ses spécifications ou pour l'amusement ». La portée de cette exception a néanmoins été considérée comme devant être « réellement étroite ». Mais comme l'a souligné Mme Rebecca Eisenberg il y avait en fait une sorte de tolérance qui faisait que les scientifiques universitaires pouvaient utiliser tout ce dont ils avaient besoin en matière de techniques ou de produits brevetés sans rémunérer les entreprises détentrices des droits. Celles-ci fermaient en quelque sorte les yeux car attaquer en justice une Université donnerait à coup sûr une mauvaise image de marque à une entreprise. Cependant, dans le même temps, les Universités américaines, qui brevettent beaucoup, ne se privaient pas d'attaquer les entreprises, et notamment, les entreprises pharmaceutiques, qui utilisaient leurs brevets sans accord. C'est ainsi que l'Université de Californie avait obtenu de l'entreprise Genentech une somme de 200 millions de dollars pour contrefaçon de brevet. Mme Rebecca Eisenberg estimait donc qu'il y avait, de ce fait, un déséquilibre. Mais il semble que cette situation est peut-être actuellement en train de se modifier. En effet dans une affaire récente, « Madey v. Duke University », un chercheur poursuit son ancienne université pour violation de brevet dans la mesure où celle-ci a continué, après son départ, à utiliser des appareils qu'il avait fait breveter. La défense de l'Université est que cet usage se fait dans le cadre de ses activités de recherche et ne contrevient donc pas aux brevets. L'affaire est allée jusqu'à la Cour d'Appel du Circuit fédéral qui a donné raison au chercheur contre l'Université. Judiciairement l'affaire en est là, l'Université espérant maintenant une décision de la Cour Suprême. Il semble bien que si le chercheur devait avoir raison contre son ancienne Université, cela pourrait bien sonner le glas de l'exemption de fait en matière de recherche pour les Universités aux Etats-Unis. Il est nécessaire de réexaminer au plan international cette question, fondamentale, de l'exemption de recherche et de poser le principe d'une interprétation libérale pour ne pas risquer que s'accroissent les pressions sur les activités de recherche. Il faut que cette exemption de recherche puisse être prévue de façon explicite dans les A.D.P.I.C. Il conviendrait donc de modifier son article 30 dans ce sens. Ce sera une recommandation de ce rapport. Tous ces obstacles dressés montrent que les brevets sur les gènes sont antiéconomiques. Le rapport du Conseil d'analyse économique note à ce propos : « Que faire alors lorsqu'un gène est breveté et ne fait pas l'objet de licences largement diffusées, c'est-à-dire en termes économiques, lorsqu'il fonctionne comme un monopole incontournable (pas de substitut) ? Pour l'économiste, il constitue alors une infrastructure essentielle, essentielle car indispensable à la poursuite d'activités elles-mêmes socialement essentielles [...] dont l'accès est refusé par celui ou ceux qui la contrôlent ; c'est une forme particulièrement dommageable d'abus de position dominante.» Il convient donc d'explorer un certain nombre de voies pour éviter les blocages de la recherche dus aux brevets. d - Explorer un certain nombre de voies pour éviter le blocage de la recherche Ces voies doivent tendre à faciliter la diffusion de la connaissance et à obvier aux inconvénients des brevets. Plusieurs voies peuvent être explorées : La plus radicale est d'interdire la brevetabilité des gènes. Faute de pouvoir obtenir celle-ci, d'autres voies peuvent permettre de remédier en partie aux défauts constatés de l'actuel régime des brevets sur le vivant : concession de licences à bas prix, facilitation de l'octroi des licences de dépendance, création de communautés de brevets. § Interdire la brevetabilité des gènes Je reprends ici la recommandation n° 11 de mon précédent rapport qui prévoyait l'exclusion de la brevetabilité des séquences génétiques humaines « en tant que telles », des brevets ne pouvant être délivrés dans ce domaine que pour les procédés et les applications. Cette disposition doit bien entendu être adoptée au niveau international, celui des A.D.P.I.C. par la modification dans ce sens de leur article 27. Il faut prévoir pour les gènes humains un régime analogue à celui des certificats d'obtention végétale (C.O.V.) où la base génétique est toujours laissée libre, la protection étant accordée à ce qui est véritablement le résultat du travail humain. Je réitèrerai cette recommandation à la fin du présent rapport. § Concession de licences à bas prix L'exemple de cette politique est celle menée avec succès par l'Université de Stanford (Etats-Unis) concernant le brevet de Herbert Boyer et de Stanley Cohen sur la technique de recombinaison de l'A.D.N. Les licences de ce brevet ont été cédées de façon non exclusive et à prix relativement faible. Cela a ainsi permis à la fois une très large diffusion de cette technique essentielle qui a été à la base de l'essor des biotechnologies modernes. Cette politique a aussi été très favorable à l'Université de Stanford puisqu'elle a recueilli à ce titre des dizaines de millions de dollars de redevances. § Facilitation de l'octroi de licences de dépendance Selon une définition de M. Jean Azéma, l'invention dépendante se définit « comme celle dont l'exploitation suppose la reproduction, en tout ou en partie, des revendications contenues dans un brevet principal considéré pour cette raison comme le brevet principal ». Il est nécessaire de contrôler cette relation car il faut éviter qu'un titulaire de brevet dépendant ne puisse l'exploiter suite à un refus injustifié du propriétaire du brevet dominant. Un article voté le 10 décembre 2003 par l'Assemblée nationale dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique a facilité cet octroi de licences de dépendance. Il est ainsi prévu le principe de l'autorisation mutuelle que doivent s'accorder deux titulaires de brevets en dehors de toute procédure judiciaire. § Création de communautés de brevets La création de communautés de brevets (en anglais patent pools) est une tentative pour remédier aux accumulations de brevets, notamment dans le domaine des biotechnologies, par la mise en commun de brevets. Ces communautés ne sont pas de création récente car elles ont, comme le rappelle M. Jean Tirole dans son introduction au rapport du Conseil d'analyse économique, une longue histoire. En effet la première de celles-ci a été la mise en commun, aux Etats-Unis en 1856, des brevets sur les machines à coudre. Un certain nombre de ces communautés de brevets ont été ensuite créées, toujours aux Etats-Unis dans l'automobile en 1915, les chemins de fer en 1916, 1931 et 1932, l'aviation en 1917, le pétrole à partir de 1929, la télévision ensuite. Après avoir été considérées de façon défavorable par les autorités américaines de la concurrence, ces communautés de brevet ont repris de la vigueur notamment dans les nouvelles techniques de la communication. Il existe ainsi actuellement une telle structure sur la norme de compression vidéonumérique MPEG-2 qui englobe 116 familles de brevets et plus de 490 titulaires de licences dans le monde. Son fonctionnement repose sur l'application d'un taux de redevance égal pour tous les brevets et sur la répartition des redevances de licences entre les membres en fonction du degré d'utilisation des brevets. Les avantages de ces communautés de brevets sont les suivants : - contribuer à associer des techniques complémentaires, - réduire les coûts de transaction, - éviter les coûteuses procédures en contrefaçon, - favoriser la diffusion des techniques. Le problème de l'application dans le domaine des biotechnologies se pose dans la mesure où aucun précédent n'existe dans ce secteur M. Alain Weil m'a fait part d'un projet de création d'une telle communauté dans le domaine des biotechnologies végétales dans le cadre de l'Université de Californie. Il souligne que ce projet, fondé sur une analyse des défaillances du marché, ne remet pas du tout en cause l'architecture du système mondial de la propriété intellectuelle. Les objectifs poursuivis « sans chercher à intervenir dans le champ de la brevetabilité » sont d'améliorer : « - l'incitation à innover pour l'ensemble des acteurs, - le niveau d'investissement de la recherche publique, en particulier pour les applications délaissées par le secteur privé, - l'utilisation effective des résultats acquis, - les retombées économiques et sociales d'intérêt général, avec des références répétées aux pays en voie de développement. » L'Université de Californie, autour de laquelle se sont rassemblées trente universités américaines a ainsi mis en place un système de chambre de compensation (en anglais clearing house) dans le domaine des biotechnologies végétales qui est maintenant opérationnel. Cette structure comprend : - la définition de règles communes en matière de propriété intellectuelle afin d'éviter de trop larges exclusivités ; - la constitution d'une base d'informations avec un seul point d'entrée pour gérer en commun des grappes d'informations. M. Alain Weil m'a indiqué qu'il était en train de réfléchir à créer une telle structure d'abord en France puis, éventuellement, en Europe. Il vient d'ailleurs de se voir confier une mission sur la création d'un système de gestion collective de la propriété intellectuelle en biotechnologie végétale qui s'inspirerait de l'initiative américaine conjointement par M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture et Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. On peut penser que si une telle structure pouvait voir le jour en France et en Europe en matière de biotechnologies végétales, un réseau mondial pourrait peut-être être organisé en coopération avec l'initiative américaine. Une initiative de cet ordre pourrait sans doute être aussi prise en matière de santé humaine en fédérant tous les centre de recherches publics de ce domaine. Ce sera une recommandation de ce rapport. Face à la logique que M. Dominique Foray appelle de façon suggestive « la science I.P.R. » (I.P.R. pour intellectual property rights) c'est-à-dire celle fondée sur la prééminence du brevet, il faut garder un espace de « science ouverte » selon le titre d'un récent rapport de la Royal Society. Les organismes publics de recherche se doivent de se trouver à l'avant -garde de cette volonté de maintenir cette ouverture. Il convient donc maintenant de s'interroger sur leur politique en matière de brevet. B - Quelle politique pour les organismes publics de recherche ? Avant d'aborder la politique menée en matière de brevets par l'I.N.R.A. et l'I.N.S.E.R.M. nous évoquerons l'action en ce domaine des National Institutes of Health des Etats-Unis. Nous nous attacherons ensuite à dénoncer ce qui est parfois apparu comme un véritable mythe : le financement de la recherche publique par les brevets. a - La politique menée par les National Institutes of Health (N.I.H.) Nous nous appuierons pour esquisser à grands traits cette politique à la fois sur l'étude menée en 2002 par l'O.C.D.E. intitulée « Inventions génétiques, droits de propriété intellectuelle et pratiques d'octroi de licences » et sur les entretiens que j'ai eu avec les responsables de cet organisme. Les National Institutes of Health ne sont pas opposés aux brevets dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme un stimulant efficace et positif. Ses responsables estiment qu'il n'y a pas de dissociation entre brevet et intérêt public, y compris en matière de santé publique. Le souci primordial des responsables des N.I.H. est, en effet que les résultats de cette recherche publique arrivent bien à ceux qui en ont besoin. C'est dans cette optique qu'a été développée depuis le début des années 1990, le concept de « pertinence des brevets ». Cette conception amène à affirmer l'utilité de ce brevet comme instrument de transfert au marché des techniques développées dans le cadre de la recherche publique. Mais ces brevets sont considérés comme inutiles en cas de technique prête pour le transfert et ne requérant pas d'investissement supplémentaire. La « pertinence des brevets » signifie également que les revendications correspondent juste à l'objet du brevet sans chercher à les élargir outre mesure. Le brevet doit donc être un moyen d'encourager les chercheurs dans leur mission mais aussi une façon de protéger les résultats de la recherche publique. En effet les N.I.H. brevettent leurs découvertes afin d'empêcher que des entreprises privées à but lucratif ne s'en emparent pour les exploiter à leur seul profit. Il s'agit là, comme l'a noté M. Maurice Cassier, d'«un système de brevet pour contrer le brevet ». La prise d'un brevet permet ainsi de rester maître de la diffusion des connaissances protégées. Les N.I.H. ont donc élaboré une stratégie en matière de licences. Soucieux de favoriser la concurrence et de permettre un accès rapide et au moindre coût du public aux innovations médicales, ils ont adopté une politique d'octroi de licences non exclusives et de limitation des licences cédées aux entreprises à un domaine d'utilisation ou à un territoire déterminés. C'est ainsi qu'en 2002, plus de 80 % des licences accordées par cet organisme l'ont été à titre non exclusif et à plus de 52% à des entreprises petites ou moyennes. Enfin les licences accordées par les N.I.H. contiennent des clauses leur permettant de se réserver le droit d'utiliser l'invention à des fins de recherches non commerciales ainsi que la prescription que de les résultats aussi largement que possible. b - La politique de l'Institut national pour la recherche agronomique (I.N.R.A.) L'I.N.R.A. a été au centre en France de ce que MM. Bertrand Hervieu et Pierre-Benoît Joly appellent, dans leur article paru dans le numéro de décembre 2003 de la revue « Futuribles » consacré à « la marchandisation du vivant », la première révolution verte. L'innovation était considérée comme un bien public. Compte tenu de la faiblesse du financement privé, le problème de l'appropriation privée du vivant ne se posait pas. L'émergence des biotechnologies qui ont fait du brevet le mode de valorisation de leurs activités, notamment dans le domaine des semences a obligé l'I.N.R.A. à faire évoluer sa pratique de valorisation de ses recherches et à adopter une politique de propriété industrielle. Il est toujours difficile pour un organisme public de recherche d'adopter des méthodes utilisées par des entreprises privées car il existe la possibilité de dérives qui risquent de lui faire perdre tout caractère public et, partant, de lui ôter tout légitimité à bénéficier de financements collectifs. Mais, comme cela a été signalé à propos des N.I.H., mettre les résultats de la recherche dans le domaine public revient à les mettre gratuitement à la disposition de tous, et donc aussi à celle des entreprises multinationales concurrentes. Cela reviendrait à leur permettre de développer des innovations qui ne manqueraient pas d'être protégées par brevets. Il y aurait ainsi une captation illégitime des travaux de l'I.N.R.A. Conscient de ces difficultés, cet institut a conduit une réflexion sur ce thème de la portée des brevets dans son action. Cette démarche l'a conduit à solliciter son Comité d'éthique et de précaution (COMEPRA). Celui-ci a adopté un avis sur ce thème le 31 janvier 2002. Le Conseil scientifique de l'I.N.R.A. s'est ensuite prononcé le 9 octobre 2002 sur ce thème et son Conseil d'administration a finalement adopté une Charte de la propriété intellectuelle le 19 juin 2003. Les principaux points de cette charte sont les suivants : - De façon générale, soutien du système du certificat d'obtention végétale (C.O.V.) pour la protection des variétés végétales, - le brevet doit être considéré comme un compromis permettant à la fois la diffusion et la protection des connaissances, - pas de dépôt de brevet couvrant des séquences génétiques sauf quand leur fonction biologique aura été démontrée expérimentalement ; dans ce cas les revendications seront limitées aux applications concrètes et identifiées correspondant aux missions de l'institut, - pas de « brevets de produits » car ils sont considérés comme des monopoles abusifs, - en cas de copropriété de résultats avec un organisme public, définition de cette propriété selon des conventions cadres, - en cas de copropriété de résultats avec des partenaires privés : - principe de la revendication systématique de la pleine propriété des résultats obtenus, les partenaires pouvant bénéficier d'un droit de première information ou d'option de licence - copropriété des résultats pouvant être acceptée si la participation du partenaire le justifie - dévolution entière de la propriété des résultats obtenus qu'à titre tout à fait exceptionnel et seulement possible pour des applications sans caractère générique ou stratégique pour l'Institut. - la concession de licences non exclusives est privilégiée - caractère exceptionnel des licences exclusives dont la durée est limitée, les domaine d'application et géographique bien définis. Il s'agit d'un ensemble bien défini qui semble relever d'une attitude sage et raisonnée. Même si l'on est, comme je le suis, partisan de la non brevetabilité du vivant, il n'est évidemment pas possible de recommander, dans les circonstances actuelles, que les instituts publics de recherche ne brevettent pas dans ce domaine. L'approche de l'I.N.R.A. à travers cette Charte dont il s'est doté me semble équilibrée car on peut noter avec un grand intérêt le principe de la délivrance de licences non exclusives et celui de la propriété des résultats des recherches menées avec des partenaires privés. Bien entendu c'est cette dernière situation qui est la plus délicate car il s'agit tout à la fois de bénéficier des apports des partenaires privés tout en s'efforçant de garantir que les ressources publiques ne seront pas détournées de leurs objectifs. Il faut ainsi réussir à établir une synergie entre les ressources publiques et privées. Dans le domaine végétal, l'I.N.R.A. est ainsi membre d'un regroupement appelé « Génoplante » consacré à la génomique végétale qui a élaboré une politique originale de protection de la propriété intellectuelle. Génoplante a été créé en 1999 pour l'étude des génomes végétaux et la valorisation de ces travaux. Il regroupe des acteurs de la recherche publique (I.N.R.A., C.N.R.S., C.I.R.A.D.1, I.R.D.2) et privée (Biogemma3, Bioplante4 et Bayer CropScience). Comme le notent les auteurs précités sa structure a été réformée en 2001 afin de renforcer le contrôle de la propriété intellectuelle par les acteurs publics, recherche publique et filières agricoles. Afin de mieux garantir notamment le libre accès aux connaissances et l'inaliénabilité de la propriété industrielle, deux entités ont été créées : un groupement d'intérêt scientifique (G.I.S.) « recherche » et une société par actions simplifiées « valorisation » chargée du portage collectif de la propriété industrielle. Cette société détient donc l'ensemble des brevets issus de la recherche menée dans le cadre du G.I.S. Les acteurs de la recherche publique possèdent 50% des droits de vote et les filières professionnelles collectives 15%, ce qui assure à ces deux groupes la majorité pour la prise de décision. Les règles en matière de valorisation de la recherche ont été fixées de la façon suivante : « - les producteurs locaux des pays en voie de développement ont un accès privilégié, voire gratuit, aux résultats des programmes de recherche ; - il n'y a plus aucune exclusivité d'accès aux résultats génériques, c'est-à-dire les résultats concernant les aspects fondamentaux des recherches (en particulier les recherches sur les plantes modèles, riz et Arabidopsis thaliana) ; - l'accès prioritaire des partenaires privés de Génoplante aux résultats appliqués sur les espèces d'intérêt agronomique est limité dans le temps (trois à cinq ans). Au-delà de ce délai, l'accès est ouvert aux tiers ; - les revenus tirés de l'octroi de licences de brevet sont répartis au prorata des efforts de recherche des différents partenaires assurant aux partenaires publics les fruits de leur investissement. » L'effort de mutualisation de la recherche entrepris dans le cadre de Génoplante est tout à fait notable. Il est de nature à concilier à la fois la protection des résultats acquis dans le cadre de la recherche publique et la diffusion des connaissances. Cependant un problème de masse critique se pose certainement comparée aux géants américains du secteur. Une ouverture européenne de ce type de structure serait sans doute souhaitable. Il conviendra aussi d'examiner la place que pourra prendre Génoplante dans le cadre de l'éventuelle création d'une communauté de brevets dont le projet a été entrepris par M. Alain Weil et que nous avons évoqué. On peut d'ailleurs rappeler que sont notamment parties prenantes de ce projet l'I.N.R.A., le CI.R.A.D. et l'I.R.D. C'est peut-être ce projet qui pourrait permettre d'atteindre la nécessaire dimension européenne dans ce domaine. c - La politique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) L'I.N.S.E.R.M. agit naturellement dans un environnement extrêmement compétitif et, dans le contexte actuel, la protection intellectuelle apparaît comme un outil indispensable pour protéger et valoriser ses recherches. La protection par brevet doit être comparée avec d'autres moyens comme le dépôt de matériel biologique dans des collections. Par contre la protection par le secret s'avère difficile pour des chercheurs académiques compte tenu de l'impératif de publication de leurs résultats. Le recours au brevet est donc l'outil de protection privilégié choisi par l'I.N.S.E.R.M. au service de différents objectifs : protection de son patrimoine intellectuel, diffusion de l'information par sa publication, structuration des transferts de technologie. Ceux-ci ont pour but d'apporter une aide concrète à la recherche-développement d'entreprises biomédicales, au développement de nouveaux médicaments, biothérapies ou tests diagnostiques qui se traduiront en progrès médicaux. Actuellement le portefeuille de brevets de l'I.NS.E.R.M. comporte 502 familles de brevets dont 89% en biotechnologies/médicaments et 11% en techniques biomédicales. Ces chiffres sont en augmentation importante : + 8% depuis 2001 et 76% depuis 1996. Ces brevets sont à 71% en copropriété dont 34% en copropriété avec l'industrie et 37% en copropriété avec d'autres organismes publics. M. Christian Bréchot a indiqué que l'I.N.S.E.R.M. accordait 50% de licences exclusives, notamment aux jeunes pousses dotées d'un plan d'activités ainsi qu'aux entreprises pharmaceutiques qui le souhaitent et 50% de licences non exclusives. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'exclusivité sur les matériels transférables, comme, par exemple, les logiciels. L'I.N.S.E.R.M. accompagne sa politique de transferts de licences d'un certain nombre de précautions. C'est ainsi que cet institut est attentif à ce que les droits accordés : - n'inhibent pas les avancées futures de la recherche et permettent les échanges scientifiques. Ainsi les inventions relatives aux outils biologiques, par exemple des récepteurs clonés même brevetés, peuvent circuler librement dans le milieu académique. Celles-ci ne sont pas transférées à titre exclusif aux entreprises, - ne bloquent pas les développements et les exploitations futures. Les contrats de licence sont donc appuyés sur un plan de développement permettant à l'I.NS.E.R.M. d'assurer leur suivi. De la même façon, les droits, exclusifs ou non, accordés à une entreprise sont adaptés à sa capacité de mise en œuvre concrète d'un développement en tenant compte des potentialités de l'invention à court, moyen et long terme ; - ne réduisent pas l'offre d'accès aux soins pour les patients. Ainsi les tests de diagnostics génétiques brevetés sont transférés à des entreprises tout en laissant libre leur réalisation par des services hospitaliers. Malgré cette activité importante en matière de brevets, M. Christian Bréchot a souligné que l'activité de recherche de l'I.N.S.E.R.M. n'était en rien principalement motivée par la quête de brevets, la tâche principale de cet institut restant la recherche publique biomédicale et la promotion d'études cliniques. Il a insisté sur le fait que l'institut devait « rester très en amont comme générateur de connaissances et comme définisseur de concepts ». Le développement de l'utilisation des brevets par les instituts de recherche publics, indispensable dans l'environnement actuel de la recherche, a fait naître l'idée que, selon le schéma des jeunes pousses, ceux-ci pourraient se financer par ce moyen. Il convient maintenant de dénoncer ce véritable mythe du financement de la recherche publique par les brevets. d - Un mythe : le financement de la recherche publique par les brevets C'est un véritable mythe dont la naissance est due à l'établissement du Bayh-Dole act et au fait que l'Université de Californie a gagné quelque 200 millions de dollars grâce au brevet de Herbert Boyer et Stanley Cohen. Nous avons déjà évoqué les circonstances très particulières de cette affaire. Le paradoxe est que ce Bayh-Dole act qui est invoqué de façon récurrente dans ce débat, n'a pas été institué, comme l'a souligné M. Richard Nelson, dans le but de faire gagner de l'argent aux Universités mais pour faciliter les transferts de technologies. Mais il y a eu concomitance entre l'intervention de ce texte et une diminution des fonds publics attribués aux Universités. Cette situation les a beaucoup encouragé à essayer de trouver des ressources supplémentaires par ce biais. Aussi plus de 300 Universités américaines ont-elles créé des bureaux de brevets. Mais il ne semble pas que la rentabilité de ces actions soit réelle. Au cours de ma mission aux Etats-Unis, je me suis rendu à l'Université du Wisconsin à Madison dont les revenus de licences sont gérés par une fondation : Wisconsin Alumni Research Foundation (W.A.R.F.). Le budget annuel de recherche et développement de cette université est de 554 millions de dollars. W.A.R.F. a perçu 45 millions de dollars au titre des redevances dues à l'Université. Sur ces 45 millions de dollars, la moitié provient de placements boursiers de revenus obtenus il y a longtemps au titre de brevets concernant la présence de vitamine D dans le lait. Les redevances associées aux brevets actifs ne représentent donc en fait qu'une somme de 22,5 millions de dollars, ce qui ne constitue que 4% du financement de la recherche et développement de cette Université. Il ne s'agit pas là d'un exemple isolé comme le montrent très clairement les statistiques concernant toutes les universités américaines1. M. Richard Nelson a estimé que sur les plus de 300 universités qui ont mis en place des bureaux de brevets, pas plus de 30 parmi celles-ci couvrent leurs frais. Concernant l'I.N.S.E.R.M., M. Christian Bréchot m'a indiqué que les redevances des brevets représentaient une somme annuelle de l'ordre de 10 millions d'euros à comparer à un budget total de 450 millions d'euros. Ces revenus équivalent donc à 2,2 % du budget annuel total de cet organisme. Ainsi, si l'on ajoute les revenus tirés de contrats par cet organisme, soit 35 millions d'euros par an, on obtient un total de 45 millions d'euros de ressources « propres ». La différence avec le budget total de cet organisme montre bien la nécessité du financement public. Il convient donc de ne pas succomber à ce mythe du financement de la recherche publique par les redevances des brevets. Par contre les questions du transfert et de la valorisation des découvertes de la recherche publique sont, elles, vraiment importantes et il faut s'attacher à les résoudre au mieux des intérêts de la collectivité toute entière. Cette problématique est quelque peu en dehors de l'épure de ce rapport. Mais il convient de souligner que l'apport d'un texte comme le Bayh-Dole act est très controversé aux Etats-Unis mêmes comme j'ai pu m'en rendre compte. En effet il semble bien que les Universités de ce pays n'ont pas attendu ce texte pour transférer depuis plus de cent ans leurs découvertes vers les entreprises et contribuer ainsi à l'innovation dans l'industrie et l'agriculture. On peut donc conclure que la voie du brevet n'est en aucune façon la « voie royale » qui est parfois décrite. Bien entendu elles peuvent obtenir par les redevances de brevet un financement supplémentaire qui ne doit pas être dédaigné. Mais en aucune façon la recherche du brevet, en tant que tel, pour des institutions dont ce n'est ni la vocation ni le but principaux, ne doit être privilégiée. Par contre il me semble important d'attirer l'attention sur la nécessité de maintenir, voire de recréer, un espace public de libre circulation et d'échange des connaissances et des idées. Cette tâche devrait être assumée en premier lieu par toutes les institutions publiques de recherche. C - L'agriculture face à ce mouvement Je n'évoquerais dans ce paragraphe que les aspects concernant l'agriculture des pays développés en rappelant que j'avais traité du problème des rapports entre certificat d'obtention végétale et brevet ainsi que de celui de l'animal dans le rapport précédent1. Le développement de l'appropriation du vivant entraîne pour l'agriculture une transformation du fonctionnement de son régime d'innovation susceptible d'affecter le métier d'agriculteur. a - Une transformation du régime de l'innovation en agriculture Jusqu'au milieu des années 1970, les acteurs de l'innovation en agriculture étaient essentiellement les instituts publics ou parapublics de recherche et des acteurs privés très proches de la production agricole. Les relations entre ces intervenants faisaient intervenir que fort peu les questions de rentabilité financière. L'augmentation de la production était alors prioritaire pour le pays. L'I.N.R.A., principal source de l'innovation dans ce domaine, transférait le plus rapidement possible ses découvertes. C'est ainsi, comme me l'a rappelé M. Guy Paillotin, que l'I.N.R.A. avait purement et simplement donné les hybrides de maïs à Limagrain et qu'il avait beaucoup travaillé avec la firme Vilmorin sur le blé. Cette époque était aussi celle où existait un réel souci de circulation des ressources génétiques dans l'optique de favoriser la mise au point de variétés à rendements élevés. Cette volonté de favoriser l'innovation avait abouti à élaborer le système du certificat d'obtention végétal. La situation a considérablement évolué avec l'entrée des firmes pharmaceutiques sur le marché des semences. Celles-ci maîtrisaient un certain nombre de techniques et notamment celles du génie génétique mais étaient dépourvues de collections variétales. Ces collections, indispensables pour créer de nouvelles variétés, étaient le patrimoine des entreprises semencières, la plupart du temps des sociétés petites ou moyennes. Ces dernières ont donc été progressivement rachetées, avec leurs collections, par ces grandes entreprises de la chimie et de la pharmacie. Certaines de celles-ci se sont alors de cette façon transformées au début des années 1990 en « groupes de science de la vie1 ». Cette appellation était destinée à englober leurs activités pharmaceutiques qu'elles conservaient et leurs nouvelles activités semencières. Mais, ce faisant, ces grandes entreprises introduisirent dans ce secteur semencier le brevet qu'elles avaient l'habitude d'employer dans leurs activités pharmaceutiques. L'application des techniques du génie génétique en agriculture ont entraîné l'utilisation du brevet comme mode de protection de l'innovation dans ce domaine. Le brevet est considéré comme la modalité de protection de la création d'éléments nouveaux alors que le certificat d'obtention végétal, comme le notent avec justesse, MM. Bertrand Hervieu et Pierre-Benoît Joly, « [...] procède d'une représentation du vivant où la différence importante pour laquelle il convient de prodiguer des incitations est la recombinaison d'éléments ». Cela relève ainsi de deux philosophies différentes. Ces deux auteurs ont ainsi synthétisé les transformations du régime de l'innovation agricole dans le tableau suivant extrait de leur article précité de la revue « Futuribles » :
Ces transformations de l'agriculture sont susceptibles d'induire un changement du métier d'agriculteur. b - Un changement du métier d'agriculteur Ces transformations du régime de propriété des ressources végétales induira certainement un changement du métier d'agriculteur. Ces évolutions sont essentiellement dues aux plantes génétiquement transformées dont la culture s'étend actuellement sur 67 millions d'hectares dans le monde dont 47 millions aux Etats-Unis. Les semences de ces plantes sont toutes brevetées. Pour pouvoir bénéficier de celles-ci, les agriculteurs doivent souscrire par contrat un certain nombre d'engagements. Il s'agit le plus souvent d'une licence d'utilisation prévoyant un engagement à ne pas réutiliser les semences d'une année sur l'autre, pour ses propres cultures ou celles d'autres agriculteurs et aussi à employer des produits phytosanitaires de la marque du fournisseur de semences. Celui-ci peut en outre, selon ce type de contrat, effectuer un certain nombre de contrôles. Les agriculteurs deviennent donc des licenciés des entreprises détentrices des brevets des plantes génétiquement transformées. Cette situation a conduit au développement au Canada de ce qu'on a appelé l'affaire « Schmeiser ». M. Percy Schmeiser, fermier canadien, a été l'objet d'un procès de la part de la firme Monsanto en août 1988 qui l'accusait d'avoir illégalement cultivé du colza transgénique breveté résistant à l'herbicide produit par cette firme. M. Schmeiser a été condamné en première instance par la Tribunal fédéral du Canada en mars 2001 puis de nouveau en mai 2002 par la Cour d'appel. Un recours de M. Schmeiser a ensuite été formé devant la Cour suprême canadienne qui ne s'est pas encore prononcée. L'audience a eu lieu le 20 janvier dernier, l'affaire étant actuellement en délibéré. Le représentant de Monsanto que j'ai rencontré au Canada m'a indiqué que d'autres procès étaient en cours en Amérique du Nord contre des agriculteurs pour les mêmes motifs d'emploi non autorisé de semences de plantes génétiquement modifiées. Sans bien entendu se prononcer sur le fond de cette affaire précise, il me semble cependant qu'elle peut être considérée comme révélatrice des nouvelles relations entre les agriculteurs et les firmes semencières. Ceux-ci risquent ainsi de devenir de simples commis de leurs fournisseurs en perdant toute liberté d'agir dans leur activité. D'autres difficultés risquent de se multiplier dans ce domaine. En effet le matériel breveté, végétaux comme animaux, est du matériel vivant qui peut se disséminer seul et se reproduire de façon aléatoire sans impliquer une quelconque action volontaire. Il serait donc sans doute utile de prévoir que soient instaurées des dispositions mettant les contrevenants innocents à l'abri de poursuites pour infraction à un brevet en cas de dissémination accidentelle de graines brevetées ou d'insémination d'un animal par un animal breveté. Ce sera une recommandation de ce rapport. Il faut cependant être conscient que les affaires comme celle opposant Monsanto à M. Percy Schmeiser ou à d'autres agriculteurs nord américains ne doivent pas occulter l'évolution en cours en Europe dans ce domaine. En effet une affaire récente, l'affaire Schulin, montre que l'autonomie des agriculteurs tend aussi à se réduire en Europe. Le règlement n°2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire de la propriété pour les variétés végétales prévoit une exception à ce régime, le « privilège de l'agriculteur ». Cette dérogation a été précisée par le règlement n°1768/95 du 24 juillet 1995 prévoyant que les agriculteurs exerçant ce privilège doivent en informer le titulaire de la variété et lui verser une rémunération. Dans cette affaire le litige opposait une société de gestion des droits des titulaires de titres de protection de variétés végétales à un agriculteur qui refusait de répondre à la question de savoir s'il avait exercé ce privilège. Saisie, la Cour de justice européenne (C.J.E.) a, le 10 avril 2003, décidé que si tous les agriculteurs ne peuvent être tenus de fournir toutes les informations pertinentes aux titulaires des droits, par contre ceux-ci doivent pouvoir demander à un agriculteur s'il a exercé le « privilège de l'agriculteur », dès qu'ils disposent d'un indice. Les relations entre agriculteurs et fournisseurs de semences ne sont pas en Europe ce qu'ils sont devenus en Amérique du Nord. Mais l'introduction de la culture des organismes génétiquement modifiés en Europe pourrait précipiter cette évolution dans la mesure où ceux-ci sont obligatoirement brevetés. Une vigilance importante devra donc être exercée afin de prévenir les excès. On assiste ainsi à une telle mondialisation des évolutions dans ce domaine qu'il ne paraît possible de les réguler qu'au niveau international. Troisième partie : L'appropriation du vivant ne peut être régulée qu'au niveau international La dimension mondiale de cette question nécessite de mener une action au niveau européen et international. Cette dimension mondiale est devenue incontestable à partir de l'entrée en vigueur des A.D.PI.C. qui constituent le cadre obligatoire de l'harmonisation des droits de propriété en général et sur le vivant en particulier. L'Organisation mondiale du commerce compte actuellement 146 membres dont les deux tiers sont des pays en voie de développement. L'adhésion à l'O.M.C. entraîne l'obligation de respecter les A.D.P.I.C. Mais les pays les moins avancés bénéficient, on l'a vu, d'une période de transition pour leur application jusqu'en 2006, période qui peut être prolongée. Cette période de transition est reportée à 2016 pour les médicaments. Nous avons également indiqué que certains pays en développement renoncent à ces délais supplémentaires dans le cadre d'accords avec les pays développés. L'harmonisation des règles de propriété en la matière a été une conséquence de l'ouverture de l'économie mondiale et du développement international des entreprises, celles-ci préférant de façon évidente agir dans un cadre homogène qui permet de réduire les coûts de transaction, notamment ceux liés aux litiges. La régulation de l'appropriation du vivant doit se faire au niveau européen et à celui de la négociation internationale. 1 - Agir au niveau européen Je ferai le point sur le débat autour de la directive 98/44/CE ainsi que sur la situation de la France à l'égard de ce texte avant de réaffirmer la nécessité de renégocier l'article 5 de cette directive. A - Le débat autour de la directive 98/44/CE Nous examinerons l'état des transpositions de cette directive avant d'évoquer le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application des dispositions de la directive. a - La transposition de la directive Comme je l'avais indiqué dans mon précédent rapport, cette directive aurait due être achevée d'être transposée dans les différents pays en juillet 2000 au plus tard. Actuellement, huit pays sur quinze n'ont pas encore procédé à la ratification de cette directive : la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède. Ces Etats ont été les destinataires d'un certain nombre de rappels de la Commission. Celle-ci leur a fait parvenir, depuis 2000, une lettre de mise en demeure de ratifier et, ensuite, un « avis motivé ». Celui-ci est la seconde étape des procédures d'infraction avant, en cas d'absence de réponse satisfaisante, la saisine de la Cour de justice européenne. Devant le manque de réponses des pays concernés, la Commission a décidé, le 10 juillet 2003, cette saisine à l'encontre des huit pays précités. Elle a ainsi engagé le 23 octobre 2003 un recours en manquement à leur égard. Il convient toutefois de noter que la Commission, à chacune de ces étapes, prenait un certain soin de souligner qu'elle entendait néanmoins pouvoir garder des contacts avec les Etats récalcitrants. Comme on le sait, la France a commencé, comme nous le verrons plus loin, à mettre en œuvre cette transposition dans le projet de loi portant révision des lois de bioéthique qui a été examinée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale au mois de décembre 2003. b - Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application des dispositions de la directive L'article 16 c) de la directive prévoit que « [la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil] tous les ans, à compter de la date prévue à l'article 15, paragraphe 1 [30 juillet 2000], un rapport sur l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique. » Le premier rapport prévu par ces dispositions a été publié le 7 octobre 2002, soit avec un retard appréciable par rapport aux dispositions de la directive. C'est actuellement, en ce début d'année 2004, encore le seul. Le deuxième rapport devant être publié au début du mois de mars 2004. Ce document est très décevant. Il est en effet essentiellement constitué du rappel des principales dispositions des considérants et des articles de la directive. Il mentionne également le rejet, le 9 octobre 2001, par la Cour de justice des communautés européennes du recours des Pays-Bas, soutenu par l'Italie et la Norvège. Il rappelle aussi les dernières décisions de l'Office européen des brevets intervenus dans ce domaine. Il ne s'y trouve par contre aucune analyse réelle des conséquences de l'application de cette directive. Le ton général est plutôt celui d'un plaidoyer pro domo. L'article 5 de la directive n'appelle pas, dans ce rapport, d'explications nouvelles, si ce n'est la répétition de la position constante de la Commission selon laquelle il ne contient pas de dispositions contradictoires. Cependant la Commission ne reste pas apparemment insensible à un certain nombre de débats autour de cet article 5 dans la mesure où elle note « [qu'] il apparaît que la portée à conférer à des séquences ou à des séquences partielles de gène reste un sujet d'actualité qui peut donner lieu à des interprétations divergentes. » Elle mentionne aussi le problème des cellules souches d'origine humaine en indiquant que « de même le développement récent et irrésistible de la culture des cellules souches humaines a fait naître certaines interrogations sur les possibilités d'obtenir des brevets sur des inventions développées autour de celles-ci. » Compte tenu de ces interrogations, la Commission se propose « de suivre et d'apprécier les évolutions tant scientifiques que juridiques pouvant être observées dans ce domaine de la technique et les rapporter aux parties intéressées au sein de la Communauté européenne ». Elle indique ensuite qu'elle « favorisera un échange entre scientifiques, juristes et administrateurs de brevets pour analyser et discuter les relations croisées entre les progrès scientifiques et les développements juridiques, en particulier en mettant en place un groupe d'experts. » Ce groupe d'experts, qui devrait assister la Commission dans la rédaction des rapports futurs, travaillera de façon prioritaire sur « deux domaines particulièrement sensibles, identifiés par le rapport, à savoir : - le champ d'application à accorder aux brevets relatifs aux séquences géniques ou aux séquences partielles de gènes isolées du corps humain ; - la possibilité de breveter des cellules souches humaines et des lignées cellulaires obtenues à partir de ces souches. » Les conclusions de ce groupe devraient être présentées à la Commission et prises en compte lors de l'élaboration du prochain rapport qui devrait donc être plus conséquent que celui-ci. Il est très satisfaisant de constater que la Commission admette ainsi, même de manière un peu oblique, la réalité des difficultés présentées par l'article 5. Les critiques de ces dispositions se sentent ainsi quelque peu confortés dans leur position. Il conviendra maintenant de rester attentif aux conclusions du prochain document de la Commission. B - La position de la France En février 2002, l'Assemblée nationale avait voté, à l'unanimité, un amendement dans le cadre du projet de loi de révision de la loi « bioéthique » affirmant le principe qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris lorsqu'il s'agit d'une séquence génique, ne pouvait constituer une invention brevetable. Cette disposition s'opposait clairement aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de la directive. Ce vote était intervenu dans un contexte où le Président de la République et le Premier Ministre de l'époque, M. Lionel Jospin, avaient saisi la Commission européenne sur l'interprétation à donner à cet article 5. Les réponses fournies n'ayant pas été considérées comme satisfaisantes par l'exécutif français, le gouvernement de M. Lionel Jospin avait fait le choix de rédiger un projet de loi de transposition de la directive ne comprenant pas cet article. Après avoir été modifié par le Sénat sur la proposition de l'actuel ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le projet de loi de révision de la loi « bioéthique » a été de nouveau examiné par l'Assemblée nationale en décembre dernier. Celle-ci a adopté un nouvel article L 611 - 18 du code de la propriété intellectuelle. Le premier alinéa de ce nouvel article n'appelle pas de commentaire particulier dans la mesure où il affirme le principe de non brevetabilité du corps humain, ce qui est une transposition exacte du premier alinéa de l'article 5 de la directive. Par contre le second alinéa de ce nouvel article L 611 - 18 précise que « la protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ne couvre cet élément qu'en tant qu'il permet cette application particulière, qui doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet » Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies pour permettre d'inclure un élément du corps humain dans un brevet : - l'invention doit constituer l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ; - l'élément du corps n'est couvert par le brevet qu' « en tant qu'il permet cette application particulière » ; - cette dernière doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Un nouvel article L 613 - 2 - 1 du code de la propriété intellectuelle a également était adopté par l'Assemblée nationale. Cet article limite, selon son premier alinéa, la portée d'une revendication couvrant une séquence génique « à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description » de l'invention. Le deuxième alinéa prévoit que « les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L 611 - 18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence » Les dispositions de cet alinéa ne sont absolument pas réalistes. Elles semblent vouloir ignorer de façon délibérée la signification donnée par l'Office européen des brevets aux brevets de produits. Ceux-ci signifient nécessairement la dépendance des brevets portant sur les applications ultérieures par rapport au brevet initial. . Comme je l'ai dit lors de la discussion à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, on veut ainsi créer de « petits » brevets de produit. Il faut bien se rendre compte que, ainsi que je l'avais souligné dans le rapport précédent, les dispositions de la directive 98/44/CE continueront à s'appliquer en France, malgré tout, par le biais de l'Office européen des brevets ou par le juge français, s'il est saisi. J'ai, à cette occasion, proposé un amendement dont le texte se trouve en annexe du présent rapport. Le texte ainsi adopté ne pourra en aucune manière remédier aux problèmes des revendications trop larges et à la multiplication des brevets dépendants. Il ne pourra donc pas empêcher ces brevets de mettre des obstacles à la recherche. La démarche du précédent gouvernement était, rétrospectivement, la seule susceptible de pouvoir débloquer cette affaire en refusant de transposer l'article 5 de la directive. Cela donnait à la France une position plus forte pour demander la renégociation de cet article. Il faut donc renégocier cet article 5. C - Renégocier l'article 5 de la directive Il faut mener une action déterminée en demandant à nos partenaires d'engager une renégociation de cet article 5. Il ne faut pas se cacher que la renégociation d'une directive sera une entreprise d'autant plus ardue qu'elle est rare et, à ma connaissance, sans précédent. Il faudra convaincre nos partenaires qui ont déjà transposé cette directive que le fait qu'ils restent minoritaires est le signe de l'existence d'un véritable malaise dans ce domaine. La position des commissaires européens est celle d'un refus d'une nouvelle négociation sur cet article 5. A la direction générale III (marché intérieur) l'attitude est que les Etats doivent transposer avant éventuellement d'envisager quelque négociation que ce soit. A la direction générale « Recherche », il m'a été précisé que M. Philippe Busquin, commissaire européen à la recherche, n'a pas été associé à l'élaboration de cette directive. Par contre celui-ci, alerté par un certain nombre de chercheurs, avait néanmoins attiré l'attention de M. Frits Bolkestein sur les difficultés présentées par ce texte. Cette direction générale « Recherche » n'en préconise pas moins également de transposer malgré ces problèmes. Ceux-ci devraient être cependant examinés par un groupe d'experts de ces deux directions. Je ne pense pas qu'une renégociation efficace puisse être effectuée après transposition car nos positions seraient trop faibles, cela pouvant s'avérer même être un marché de dupes. Il aurait certainement fallu refuser, comme le proposait le gouvernement précédent, de transposer, ce qui aurait considérablement renforcé notre position. C'est pourquoi je persiste à recommander de nouveau la renégociation de cet article 5 au nom de la défense de la recherche. Mais cette nécessaire renégociation au niveau européen doit être complétée par une autre au niveau international. 2 - La négociation internationale Cette négociation internationale concerne la réforme de l'article 27 3. b) des A.D.P.I.C. et la coexistence de ces accords avec la C.D.B. En outre se pose le problème de la gestion de la propriété intellectuelle par deux organisations internationales différentes : l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.). A - La réforme de l'article 27 3. b) des A.D.P.I.C. Avant d'aborder la réforme de l'article 27 3. b) des A.D.P.I.C., je rappelle que j'ai proposé dans la première partie de ce rapport une renégociation du premier alinéa de cet article afin que soient précisées les notions de découverte et d'invention. On rappellera brièvement que cet article 27 3. b) précise que pourront être exclus de la brevetabilité les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Cependant les membres devront prévoir la protection des variétés végétales soit par des brevets, soit par un système sui generis efficace ou par une combinaison des deux moyens. Le dernier alinéa de cet article prévoit que ces dispositions devaient être réexaminées quatre ans après l'entrée en vigueur des accords soit en 1999. Ce réexamen a été entrepris mais n'a pas encore eu de conclusion. Au début des travaux du Conseil des A.D.P.I.C., un certain nombre de thèmes ont été examinés : - application des dispositions existantes des accords des A.D.P.I.C. à la question de savoir si les végétaux et les animaux doivent être brevetés, - efficacité de la protection des obtentions végétales ; éventualité de permettre aux agriculteurs de conserver et d'échanger les semences récoltées, - questions morales et éthiques à propos des formes de vie inventées, - traitement des savoirs traditionnels et des matériels génétiques et des droits des communautés dont ils sont issus, - question de la divulgation de la source des matériels génétiques et du partage des avantages quand des droits sont acquis dans un pays à partir de matériel issu d'un autre pays, - compatibilité ou conflit entre les A.D.P.I.C. et la C.D.B. Aucune avancée notable sur ces points n'a été effectuée jusqu'à la Conférence de Doha en novembre 2001. A l'occasion de celle-ci ont été relancé les débats sur la nécessité de tenir pleinement compte de la dimension « développement » de ces questions. A également été à l'ordre du jour, l'étude des relations entre A.D.P.I.C. et C.D.B. et la protection des savoirs traditionnels et du folklore. Depuis Doha, les discussions sur cet article 27 3. b) ont continué au Conseil des A.D.P.I.C. sans que des décisions définitives aient été adoptées. Par contre des pays ou des groupes de pays ont présenté des prises de position sur ces sujets : - l'Union européenne a avancé une proposition pour examiner la possibilité d'obliger les demandeurs de brevets à divulguer l'origine du matériel génétique mais sans conséquence juridique pour la validité des brevets. On relèvera que cette absence de sanction fait douter de la faisabilité de cette proposition ; - la Suisse a proposé une mesure semblable mais le fait que l'origine ne soit pas divulguée pourrait suspendre la délivrance du brevet ou en affecter la validité ; - le Brésil, l'Equateur, Cuba, l'Inde, le Pérou la Thaïlande et le Vénézuela ont développé leurs propositions déjà connues sur la divulgation de l'origine des ressources biologiques et des savoirs traditionnels, le « consentement préalable donné en connaissance de cause » pour l'exploitation d'un brevet et le partage équitable des avantages, - Enfin le Groupe africain souhaite prohiber la protection par brevet de toutes les formes de vie, végétaux, animaux micro-organismes, et est partisan d'un système sui generis de protection des variétés végétales qui préserve les droits des agriculteurs d'utiliser et d'échanger les semences récoltées. Il propose aussi les mêmes mesures de divulgation que le groupe précédent. C'est là la reprise des dispositions de la loi modèle de l'O.U.A. que nous avons déjà évoquées. On a le sentiment que ces discussions sur le réexamen de cet article sont devenus une sorte de dialogue de sourds. En effet toutes les parties répètent, peu ou prou, les mêmes arguments depuis un certain nombre d'années. Ces positions sont d'ailleurs telles qu'il n'y a aucun espoir, actuellement, d'aboutir à un quelconque compromis. Cette situation de blocage est en réalité tout à fait favorable aux pays développés car un véritable chassé-croisé des positions s'est produit sur ce thème du réexamen de l'article 27 3. b). En effet, à l'origine, lors de l'élaboration des A.D.P.I.C., il s'avère que cet article avait été conçu par les pays développés comme une sorte de situation d'attente avant de pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire faire du brevet le seul mode de protection obligatoire dans tous les domaines. Ce n'est un secret pour personne que les Etats-Unis souhaitent la suppression de la clause permettant d'exclure les animaux et les végétaux de la brevetabilité. En attendant de réaliser cet objectif, ils désireraient, dans un premier temps, amoindrir l'option de la protection sui generis. Cela se ferait en supprimant tout recours à un système sui generis autre que celui de l'U.P.O.V. dans sa version 1991. Faute par contre de pouvoir réaliser ces desseins immédiatement, il s'avère que les Etats-Unis s'accommoderaient du maintien du statu quo. La situation s'est ainsi retournée car ce sont maintenant les pays développés qui ne souhaitent plus que les dispositions de cet article soient changées. Dans le même temps, les pays en développement essaient d'introduire dans les A.D.P.I.C. un certain nombre de dispositions, issues de la Convention sur la diversité biologique, comme l'obligation de dévoiler l'origine des matériels génétiques ou le partage des avantages. Ils sont maintenant, à ces conditions, partisans d'une réforme de cet article. L'Union européenne a élaboré un document1 en septembre 2002 sur cette révision de l'article 27 3. b). Elle estime qu'il n'y a « aucune raison de modifier l'article 27 3. b). L'accord sur les A.D.P.I.C. offre aux Membres suffisamment de souplesse pour moduler la protection par brevet en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts ou de leurs normes éthiques. A cet égard, l'article 27 3. b) conjointement avec l'article 27 2. (exclusion de la brevetabilité des inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale pour protéger l'ordre public ou la moralité) et l'article 27 1. (critères de la brevetabilité) offre une marge de manœuvre appréciable. » Ce document note également : « Il convient de rappeler que l'énoncé de l'article 27 3. b) est le fruit d'un équilibre soigneusement négocié : toute demande visant à remettre l'article 27 3. b) sur le métier pour modifier cet équilibre risque de susciter en réaction des demandes de la part d'autres membres tendant à imposer la délivrance d'un brevet pour des catégories d'inventions biotechnologiques plus vastes, y compris pour les plantes et les animaux. Les Communautés européennes et leurs Etats membres préconisent de conserver l'équilibre actuel des A.D.P.I.C. qui laisse aux Membres de l'O.M.C. beaucoup de souplesse en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques, et ne voient donc pas pourquoi il y aurait lieu de modifier le texte actuel de l'article 27 3. b). » Il m'a été confirmé à Bruxelles que telle est toujours la position de la Commission sur cette question afin d'empêcher les Etats-Unis de réclamer l'extension obligatoire du brevet dans tous les domaines. Ces réticences de la Commission à la renégociation de cet article, compte tenu des raisons invoquées, doivent certainement être reçues très sérieusement. La perspective de favoriser des avancées supplémentaires du brevet dans le domaine du vivant, notamment végétal, n'est certainement pas à envisager avec faveur malgré toutes les pressions dans ce sens. Les discussions entre pays développés et pays en développement sont rendues plus difficiles du fait de la coexistence des dispositions de la Convention sur la diversité biologique avec celles des A.D.P.I.C. B - La coexistence de la C.D.B. et des A.D.P.I.C. Un certain nombre de dispositions de la Convention sur la diversité biologique sont invoquées par les pays en développement dans le cadre de la discussion du réexamen de l'article 27 3. b) des A.D.P.I.C. L'objectif de ces pays est de mettre en conformité le régime actuel des droits de propriété intellectuelle contenu dans ces A.D.P.I.C. avec les dispositions de cette Convention afin de faire bénéficier celles-ci des mécanismes de sanction prévu par le système multilatéral des différends prévus par l'Organisation mondiale du commerce. Ce sont ces souhaits auxquels s'opposent de façon générale les pays développés qui sont à la source des questions concernant la comptabilité des deux textes. Ces discussions au sein de l'O.M.C. ont lieu aussi dans le cadre plus général tracé par la Conférence ministérielle de Doha du 14 novembre 2001 au Conseil des A.D.P.I.C. qui avait disposé que celui devra « [...] examiner, entre autres choses, la relation entre l'A.D.P.I.C. et la Convention sur la diversité biologique, la protection des savoirs traditionnels et du folklore [...] ». Ce thème a suscité depuis quelques années une abondante littérature dans laquelle il est difficile parfois de se retrouver car elle donne naturellement bien souvent lieu à des considérations plus « militantes » qu'objectives. On essaiera donc de donner, sans entrer dans les détails juridiques, quelques indications sur ces relations entre ces deux textes. Si ces deux textes sont à la fois indépendants et en interaction, une discussion importante a lieu sur l'existence ou non d'un conflit entre eux. a - Des textes indépendants Ces deux textes sont indépendants au niveau de leurs objectifs et de leur objet et sont de nature différente. - L'indépendance des objectifs Les objectifs de la C.D.B. sont la conservation de la diversité biologique ainsi que son utilisation durable et la répartition juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Les A.D.P.I.C. quant à eux établissent des normes minima de protection de la propriété intellectuelle entre les membres de l'O.M.C. - L'indépendance des objets La C.D.B. se préoccupe de la protection et du contrôle de la diversité biologique et stipule que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources génétiques pour établir les mécanismes de partage juste et équitable des avantages de l'utilisation des ressources génétiques. Les A.D.P.I.C., quant à eux, traitent de la propriété intellectuelle et n'abordent pas la question de la commercialisation des produits protégés. De ce point de vue, les ressources génétiques peuvent servir de base à des inventions susceptibles d'être brevetées ou à de nouvelles variétés végétales pouvant être protégées. La C.D.B. définit en outre le cadre général et les objectifs des politiques permettant aux Etats d'agir afin d'atteindre leurs objectifs. Concernant le partage des avantages, la C.D.B. laisse les Etats libres d'organiser celui-ci de la manière qui leur convient en prescrivant seulement qu'il doit de faire d'un « commun accord ». Par contre les A.D.P.I.C. établissent les normes juridiques minimales, assorties des mécanismes d'application et de sanctions, devant être incorporées dans les droits internes des pays signataires. - La nature différente des deux textes Aucun de ces deux textes ne fait référence à l'autre et notamment pas les A.D.P.I.C. à la C.D.B pourtant antérieure. Les A.D.P.I.C. font seulement quelques allusions au développement dans leur Préambule et leur article 8. Ainsi le Préambule reconnaît-il « [...] aussi les objectifs fondamentaux de politique générale publique des systèmes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et de technologie [...] » Le premier alinéa de l'article 8 prévoit que « Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord. » Malgré cette indépendance, ces deux textes interagissent. b - Des textes qui interagissent Malgré leurs différences de portée, il existe des interactions entre les deux textes. Leur principal domaine d'interaction se trouve dans les conséquences des dispositions de la section 5 de la deuxième partie des A.D.P.I.C. (articles 27 à 34) relative aux brevets. Il semble évident que la mise en place d'une législation en matière de brevet ne peut qu'influer sur la mise en œuvre des dispositions de la C.D.B. Cela est notamment le cas pour une invention s'appuyant sur des ressources génétiques parce que celle-ci constitue un moyen d'exploitation de ces ressources. Cependant la C.D.B., comme on l'a déjà vu, ne s'oppose pas de façon frontale aux brevets et aux droits de propriété intellectuelle en général. Ainsi l'article 16 5., déjà cité, de la C.D.B reconnaît que « [...] les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence [...] » sur son application. Les Etats sont également tenus, toujours selon cet article, de coopérer « [...] pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs. » L'article 16 2. de ce texte prévoit aussi que « Lorsque les transferts de technologie font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont comptables avec leur protection efficace et effective [...].» Il y a donc là une reconnaissance effective et même appuyée des droits de propriété intellectuelle de la part de la C.D.B. c - La discussion sur l'existence ou non d'un conflit entre les deux textes Ces discussions sont marquées du sceau d'une passion certaine, ce qui ne contribue naturellement pas à faciliter d'éventuels compromis. Le secrétariat de l'O.M.C. a fait paraître une note sur les relations entre ces deux textes en août 2002 dans le cadre du mandat confié au Conseil des A.D.P.I.C. Ce texte fait une sorte de recensement des positions des uns et des autres sur cette question. Schématiquement, on peut retenir que le pays se répartissent entre trois positions principales : - existence d'un conflit entre les deux textes, - inexistence de ce conflit, - position médiane réfutant le conflit mais soulignant les interactions. - Existence d'un conflit entre les deux textes Pour le Groupe africain qui défend cette position, le conflit majeur est constitué par le fait que la C.D.B. établit la souveraineté des pays sur leurs ressources génétiques, tandis que les A.D.P.I.C. instaurent leur brevetabilité. Cela permet ainsi leur appropriation privée qui est incompatible avec le droit souverain des pays. Ce groupe argue que la souveraineté nationale signifie que les pays ont le droit d'interdire les droits de propriété intellectuelle, brevets ou protection sui generis, sur ces ressources. Les pays de ce groupe souhaitent que devraient être, au minimum, exclues de la brevetabilité les inventions fondées sur les connaissances traditionnelles ou autochtones et les produits et procédés essentiellement dérivés de ces connaissances. - Inexistence d'un conflit entre les deux textes C'est notamment le point de vue de l'Union européenne, des Etats-Unis et du Japon qui estiment que les deux textes ont des buts et des objets différends, la Convention reconnaissant explicitement, comme on l'a vu, les droits de propriété intellectuelle. Des pays allèguent que des brevets peuvent être refusés, en vertu des A.D.P.I.C., à des inventions contraires à l'ordre public, ce qui comprend les atteintes à l'environnement, ou à la moralité. Comme on l'a déjà noté à propos de la révision de l'article 27 3. b) dez A.D.P.I.C., l'Union européenne estime que la délivrance de brevets pour des inventions faisant appel à du matériel génétique n'est pas contradictoire avec le droit souverain des pays sur leurs ressources biologiques et la nécessité du consentement préalable et le partage des avantages. Dans sa communication du 12 septembre 2002, l'Union européenne indique cependant que « le Conseil des A.D.P.I.C. pourrait s'occuper de la question des mesures préventives visant à éviter l'appropriation illicite des savoirs traditionnels et à encourager le partage des avantages ». L'Union européenne, par ce document, semble marquer une évolution dans la mesure où elle paraît affirmer que l'utilisation des dispositions de l'un et l'autre texte peut les rendre compatibles et les faire se renforcer mutuellement. Elle tendrait par là à se démarquer de pays, comme les Etats-Unis et le Japon, qui estiment qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'un des accords pour tenir compte de l'autre, la mise en œuvre de ces deux textes devant se faire en définitive dans des cadres séparés. L'Union européenne semble ainsi incliner à rejoindre la position médiane déjà défendue par certains pays. - La position médiane réfutant le conflit mais soulignant les interactions Un certain nombre de pays adoptent cette position, parmi lesquels on peut citer : l'Australie, la Chine, le Brésil, ce dernier avec des nuances. Selon ces pays, il faut faire en sorte que ces deux textes soient mis en œuvre de façon complémentaire. Ces pays estiment donc qu'il faut une action internationale renforcée afin que les A.D.P.I.C. soient appliqués de façon à appuyer les dispositions de la C.D.B. Il est difficile de tirer des conclusions définitives de ces débats qui ne semblent pas prêts de se terminer. Ils semblent même depuis quelques années se trouver dans une certaine impasse, à l'image de ce qui se passe pour l'article 27 3. b). Il faut souligner que la C.D.B. semble présenter un certain nombre de difficultés. Un important problème de fond de la C.D.B. réside certainement dans le compromis qu'elle tente de fonder en utilisant la propriété intellectuelle comme outil de réalisation de son objectif de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité pour les pays en développement. Comme le note Mme Sandrine Maljean-Dubois1, « à vouloir tout concilier [la C.D.B.] court à l'échec ». D'autres difficultés sérieuses tiennent d'une part à l'application de ses propres décisions et, d'autre part, au règlement des différends. L'application de ses propres décisions est parfois malaisée. Ainsi en est-il de l'accord trouvé à la Conférence des Parties5 de 2002 prévoyant que soit divulguée l'origine des produits pour obtenir la délivrance d'un brevet. Depuis deux ans, cette décision n'a pu être appliquée car il n'a pas encore été possible de déterminer la faisabilité de cette mesure. La réflexion est ainsi toujours en cours quant au mécanisme qui pourrait aboutir au blocage de la délivrance d'un brevet en cas de non divulgation des sources utilisées. Le règlement des éventuels différends est aussi une faiblesse de cette Convention. En effet son article 27 prévoit un mode de règlement des conflits essentiellement basé sur la négociation, la médiation ou l'arbitrage sans édicter de sanctions précises. On peut à cet égard comparer ce dispositif avec celui des A.D.P.I.C. qui prévoit dans pas moins de vingt et un articles (articles 41 à 61) les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Il existe aussi un mécanisme efficace de règlement des différends au sein de l'O.M.C. avec des possibilités de sanctions qui manque beaucoup à la C.D.B. La controverse sur la compatibilité de ces deux textes ne me semble pas prête de trouver une issue. Il faut bien voir que ces deux textes internationaux sont signés par quasiment les mêmes pays, ce qui ne les empêche pas de comporter des dispositions sinon complètement contradictoires, au moins parfois peu cohérentes. Un des éléments d'explication à ces discordances tient au fait que ces deux textes sont gérés par des administrations différentes au niveau des pays. Ainsi la C.D.B. l'est par les administrations de l'environnement tandis que l'O.M.C. est du ressort des administrations de l'industrie. Il n'est pas besoin de souligner les différences de pouvoirs entre les deux. Il serait fort utile que des mécanismes institutionnels puissent permettre une communication et aussi une harmonisation entre ces départements ministériels afin de supprimer ces discordances qui se révèlent très difficiles à résoudre au plan international. Enfin une nouvelle illustration des difficultés de la C.D.B. vient d'être donnée par la Conférence des Parties qui vient de se réunir à Kuala Lumpur. Les problèmes de brevetabilité ont été encore évoqués sans qu'aucune solution n'ait émergé. C - Le traitement des problèmes de propriété intellectuelle par deux organismes internationaux : l'O.M.P.I. et l'O.M.C. Le système mondial de brevets repose actuellement sur le Traité de coopération en matière brevet (en anglais : P.C.T., Patent Cooperation Treaty) qui donne la possibilité d'enregistrer une demande unique de brevet pour tous les pays membres (122 actuellement). Les brevets sont accordés au niveau national ou régional, par exemple par l'Office européen des brevets, mais les recherches et l'analyse des demandes sont menées au titre de ce traité. Le grand avantage de ce système est de permettre aux utilisateurs de demander une protection par brevet dans plusieurs pays à la fois. Le Traité sur le droit des brevets (en anglais : P.L.T., Patent Law Treaty), signé en juin 2000 harmonise quant à lui un grand nombre de conditions formelles et de procédures requises pour les demandeurs de brevet. Lors de la signature de ce Traité sur le droit des brevets, les pays membres de l'O.M.P.I. ont décidé de progresser sur l'harmonisation des règles de base des brevets. Cette harmonisation pourrait être effectuée par un nouveau texte, le Traité de droit matériel des brevets (en anglais : S.P.L.T., Substantive patent law treaty) qui est actuellement dans une phase préliminaire de discussion au sein de l'O.M.P.I. Tous les champs d'activités seraient concernés par ce nouveau traité, y compris donc le vivant. Les répercussions de ces nouvelles dispositions pourraient être particulièrement importantes dans ce domaine. Ce projet de traité concerne un certain nombre de principes juridiques fondamentaux sur lesquels repose la délivrance des brevets dans différents pays du monde c'est-à-dire, comme le note l'O.M.P.I., « la définition de l'état de la technique, la nouveauté, l'activité inventive (non évidence), la possibilité d'application industrielle (utilité). » L'O.M.P.I. justifie ce projet de nouveau traité par la nécessité : - d'harmoniser davantage les législations en matière de brevets afin de réduire la répétition des activités de recherche et d'examen, - de réduire davantage les divergences entre les résultats obtenus pour l'examen des mêmes demandes de brevet dans des offices différents, - de simplifier le système international des brevets pour les utilisateurs. Autant le dernier point ne peut que recueillir l'accord, autant les deux premiers peuvent poser des problèmes. Il ne faut pas se cacher qu'il s'agit d'une compétition entre deux systèmes qui sont représentés par l'U.S.P.T.O et l'O.E.B., le J.P.O. inclinant plutôt pour la conception européenne dans ces domaines. Le premier de ces points, activité de recherche et d'examen des demandes de brevets, met en jeu la conception européenne qui se caractérise par un très grand sérieux et une grande rigueur. Cette situation est attestée par le fait que 60% des recherches des antériorités au titre du P.C.T. sont confiées à l'O.E.B., contre seulement 20% à l'U.S.P.T.O. J'avais déjà signalé dans le rapport précédent cette très grande compétence de l'O.E.B. dans ce domaine, les recherches d'antériorité faites par l'U.S.P.T.O. étant, de façon notoire, beaucoup moins approfondies. Cette situation est tout à fait cohérente avec le fait que le système américain laisse au juge le soin de confirmer ou non le brevet par la résolution des éventuels litiges. Il est tout à fait indispensable de maintenir cette spécificité du système européen afin de ne pas tomber dans ce système américain du « tout judiciaire » qui est synonyme de considérable augmentation des coûts et d'effets dissuasifs pour la recherche. Le deuxième point, réduire les divergences entre les résultats obtenus pour l'examen des mêmes demandes de brevet dans des offices différents, renvoie au problèmes des critères des brevets. Il s'agit là de points cruciaux comme je l'ai montré dans la première partie de ce rapport. On peut être assez inquiet dans ce domaine tant l'attraction des critères appliqué par l'U.S.P.T.O. semble importante pour l'O.E.B. Les glissements signalés dans l'appréciation des trois conditions classiques de la brevetabilité risquent ainsi d'être retenus au niveau international et s'imposer de ce fait. D'ailleurs l'O.M.P.I. souligne de façon très nette cette situation1 en indiquant que « le paysage international dans le domaine du droit des brevets et de la pratique en la matière est actuellement constitué de régimes juridiques très divers. En conséquence, une demande de brevet peut aboutir à la délivrance d'un brevet dans certains pays alors que dans d'autres, le brevet ne pourra pas être délivré ou pourra être invalidé une fois délivré. » Il est évident que, dans la perspective de l'éventuelle instauration d'un « système de brevet mondial2 » des tentations existent certainement d'adopter, au niveau mondial, les conditions les moins rigoureuses de délivrance des brevets et, ceci, au détriment finalement de la recherche. L'attention devra se porter en outre sur deux points particuliers : - les cas possibles d'exclusion de la brevetabilité prévus par l'article 27 3. 3b des A.D.P.I.C. concernant tant la commercialisation d'une invention allant à l'encontre de l'ordre public que les plantes et animaux, c'est-à-dire la pérennité du système des obtentions végétales, - le souhait d'un certain nombre de pays en développement que figurent dans la demande de brevet l'origine du matériel génétique et une preuve du consentement du fournisseur pour l'acquisition de ce matériel, dispositions issues de la Convention sur la diversité biologique et sur l'attention portée aux travaux du Comité intergouvernemental de l'O.M.P.I. sur les ressources génétiques, le savoir traditionnel et le folklore. De façon plus générale, il sera aussi nécessaire de s'interroger sur le statut, par rapport à ce projet de Traité, des A.D.P.I.C. dans la mesure où ces derniers édictent seulement des normes minimales de brevetabilité. Il y a en effet le risque que ce projet de Traité élève de façon considérable le seuil « minimal » de brevetabilité. Une attention soutenue devra donc être accordée à ce processus et, notamment, comme je l'ai souhaité dans la première partie, de la part des politiques et, plus particulièrement des parlementaires. Ce projet de nouveau traité apparaît aussi emblématique du glissement qui semble se produire pour traiter ces problèmes de propriété intellectuelle de l'O.M.C. vers l'O.M.P.I., organisation qui ne traite que des problèmes techniques de droit. Ce souhait de voir l'O.M.P.I. se charger de ces questions de propriété intellectuelle est le fait des pays industrialisés et notamment des Etats-Unis. Ceux-ci ont maintenant tendance à préférer cette enceinte qui a une attitude plus juridique alors que pour l'O.M.C. la propriété intellectuelle est un aspect, mais un aspect seulement, du commerce. Ainsi, à l'O.M.C., la situation est telle que des marchandages sont possibles et que des politiques d'échanges peuvent être pratiquées. Ce n'est pas du tout le cas à l'O.M.P.I. Ce projet de Traité est ainsi négocié sans possibilité de transaction hors des limites du système de brevet lui-même. C'est pour cette raison que les pays en développement souhaitent maintenant que ce soit l'O.M.C. qui continue à se charger de ces affaires et non l'O.M.P.I., les pays industrialisés interprétant, eux, cette volonté comme une tentative de réduire la portée des accords. Une raison supplémentaire d'accorder une grande attention à cette négociation est, qu'à l'O.M.C., c'est l'Union européenne qui négocie, avec tout son poids, tandis qu'à l'O.M.P.I. ce sont les Etats, isolément, qui interviennent. L'appropriation du vivant ne doit pas être considérée de façon isolée mais comme un puissant révélateur du mouvement de marchandisation généralisée qui affecte dans nos sociétés l'ensemble des valeurs patrimoniales, comme celle du nom, de la vie privée ou de l'image. La conséquence en est l'extension permanente du droit de propriété. L'illustration la plus éclatante de cette évolution est son application dans le domaine des logiciels et du vivant. Cet emploi du brevet y a été rendu possible par ce que j'ai appelé un véritable gauchissement des critères classiques de la brevetabilité : nouveauté, activité inventive, application industrielle. Le corollaire est l'extension du rôle de l'instrument de ce droit de propriété : le brevet. Ce brevet est certes un pouvoir de monopole mais aussi un instrument de diffusion des techniques et du savoir par sa publication. A ce titre il demeure irremplaçable et il n'est pas question de réclamer sa suppression. Le brevet ne représente cependant qu'un des moyens mis en place pour stimuler l'innovation. D'autres structures, comme par exemple le développement de la recherche publique, concourent à cet objectif qui est une nécessité fondamentale. On a malgré tout actuellement l'impression que ce brevet est devenu la voie privilégiée, à l'exclusion croissante des autres, pour protéger le savoir. Il semble aussi devenir, comme l'a noté M. Dominique Foray, un « étalon » de mesure des résultats de la recherche et le fondement des marchés d'échange du savoir. Son rôle dans la diffusion de la connaissance semble ainsi s'estomper de façon progressive. Cet instrument a été conçu pour ce qu'on appelait autrefois « les arts mécaniques ». Mais il est maintenant de plus en plus utilisé dans des domaines pour lesquels il n'a pas été conçu, c'est-à-dire ceux de la connaissance et des idées. On ne peut douter qu'il y a eu de la part des spécialistes du droit des brevets la volonté de faire entrer, à tout prix, le vivant dans le cadre des brevets. Les pressions du secteur des biotechnologies dans un premier temps, puis de l'industrie pharmaceutique, ont été déterminantes de ce point de vue. Mais l'intervention croissante du brevet dans le vivant risque d'avoir des conséquences en termes de recherche, d'éthique et de modèle social. En effet elle risque d'abord de remettre en cause la traditionnelle et nécessaire exemption de recherche dont bénéficie la recherche publique. Elle peut aussi freiner considérablement la recherche des entreprises, ou même la dissuader, compte tenu des coûts, des incertitudes et des risques de procès. Le brevet peut même se transformer en un pur instrument de réalisation de rentes de situation. Ces conséquences sont particulièrement dommageables concernant le vivant humain et non humain. Pour le vivant humain se pose à la fois un problème éthique et social de première importance. La question éthique est celle posée par les banques de données humaines génétiques et médicales. Celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme de simples marchandises, que ce soit par les Etats ou par les entreprises. Il faudra certainement réfléchir au statut à leur donner ainsi qu'à leur mode de constitution, l'exemple islandais étant là pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. La question sociale est celle de la recherche en santé humaine. Jusqu'à des années récentes, la recherche dans ce domaine était de façon presque universelle, financée par des fonds publics. Elle s'inscrivait en effet dans une culture où scientifiques, universités et fondations ne cherchaient pas à retirer de profit financier de découvertes scientifiques fondamentales. C'est ainsi que de grands progrès ont été accomplis en matière de médicaments avec la mise au point des antibiotiques et de nombreux vaccins sans forte demande de protection de la propriété intellectuelle. Ces découvertes ont grandement contribué à l'amélioration de la santé publique et à la qualité de la vie, au moins dans les pays développés. La situation a changé à partir des années 1980. Cette évolution a été matérialisée par l'affaire des médicaments contre le sida qui vient juste de trouver enfin une solution après plusieurs années d'atermoiements. Certes ces médicaments ne sont pas issus de la génomique mais on peut estimer que les thérapeutiques issues des techniques du génie génétique risquent de se heurter aux mêmes types de problèmes. A cet égard l'affaire des tests de Myriad Genetics est amplement démonstrative. Cette question se pose déjà et posera certainement de plus en plus pour les pays en développement. Mais elle concernera aussi les pays développés comme le montre de façon prospective la situation américaine actuelle en matière de coûts des médicaments. Nos pays d'Europe occidentale ne seront certainement pas à l'abri de difficultés de cet ordre dans le contexte actuel de réforme des régimes sociaux. Il convient donc de réaffirmer une ferme opposition à la brevetabilité des gènes humains. Les séquences géniques humaines doivent être non brevetables. Cela permettra certainement un développement très important des applications en aval qui, elles, doivent, rester normalement brevetables si elles remplissent les critères classiques de brevetabilité. De ce point de vue il importe d'insister sur la nécessité de mettre fin à la dérive des pratiques des offices de brevet quant à l'application de ces critères. Pour le vivant non humain, le problème est, à l'heure actuelle, essentiellement celui des gènes végétaux. Dans ce domaine, il faut rappeler avec force l'attachement des pays européens au système des obtentions végétales qui a permis à l'industrie semencière européenne de connaître une réussite remarquable. Il faut donc s'opposer au « tout brevet », préconisé en la matière par les Etats-Unis, à l'O.M.P.I., notamment dans le cadre des négociations du Traité sur le droit matériel des brevets, mais aussi à l'O.M.C. Cette position ne règle pas la situation des pays en développement à l'égard de leurs ressources génétiques. Celle-ci s'avère comme je l'ai montré particulièrement difficile à résoudre, les dispositions de la Convention sur la diversité biologique ne me semblant pas directement et facilement opérationnelles, comme l'ont montré les résultats de la récente conférence de Kuala Lumpur. De façon générale, il faut bien voir que nous sommes à la croisée des chemins sur ces questions de brevetabilité du vivant et que deux types de réponses s'offrent à nous. Une première réponse est d'adopter la politique américaine en matière de propriété intellectuelle avec les risques potentiels en termes de coûts, de dynamisme de l'innovation à moyen et long terme et sur la pérennité de nos modèles sociaux fondés sur la solidarité. Une seconde est d'adopter une position originale de définition rigoureuse et cohérente de la propriété intellectuelle, en excluant la brevetabilité du génome humain et en maintenant le système des obtentions végétales, avec le souci d'atteindre un équilibre entre incitation à court terme et progrès de la connaissance à long terme. Cela nécessite que soient définies à la fois de nouvelles catégories de propriété intellectuelle et ce qu'on pourrait appeler un « domaine public de la connaissance » qui va à l'encontre du désengagement de la puissance publique de la recherche, auquel on assiste actuellement dans un certain nombre de pays européens. Mes préférences vont bien entendu au deuxième terme de l'alternative même si je suis conscient que toute l'évolution actuelle va plutôt dans le sens de la première. C'est donc au politique, par un investissement important dans ce domaine, de contribuer de façon décisive à ce que soient fait des choix qui permettront d'éviter l'appropriation du vivant. Ce domaine pourrait être considéré comme le symbole d'une volonté de bâtir une mondialisation maîtrisée et solidaire. I - Les recommandations au niveau national 1 - Organiser une réflexion sur les problèmes se posant dans le domaine du brevet Cette réflexion sur le brevet ainsi que sur la façon de délimiter un domaine public de la connaissance afin de ne pas bloquer la recherche pourrait être organisée, notamment, à l'occasion du débat sur la future loi d'orientation sur la recherche. 2 - Réfléchir aux critères de brevetabilité dans les domaines « non tangibles » Il s'agit là essentiellement des domaines, dont les exemples sont le vivant et le logiciel, où les innovations concernent de façon principale les idées. Il convient d'éviter d'aboutir au brevet de la connaissance, ce qui entraînerait des risques de blocage de la recherche. 3 - Engager une étude de faisabilité de la création d'un système de gestion collective de la propriété intellectuelle en matière de santé humaine Ce système devrait s'inspirer des résultats de l'étude entreprise en matière de gestion collective de la propriété intellectuelle dans les biotechnologies végétales. Il devrait pouvoir, à terme, être étendu au niveau européen. 4 - Introduire dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions tendant à mettre les contrevenants innocents à l'abri de poursuites pour violation de brevet en cas de dissémination accidentelles de graines brevetées, de matériel génétique breveté ou insémination d'un animal par un animal breveté Ces dispositions sont tout à fait nécessaires dans la perspective de l'utilisation des plantes ou des animaux génétiquement modifiés pour tenir compte du fait qu'il s'agit de matériel vivant qui peut échapper à la surveillance de son utilisateur ou de son propriétaire. II - Les recommandations au niveau européen 5 - Modifier le système de financement de l'Office européen des brevets L'Office européen des brevets doit avoir un financement public et être indépendant financièrement des demandeurs de brevets. Ceux-ci acquitteraient une taxe modulée par les pouvoirs publics pour examen et, éventuellement, délivrance des brevets. Une conséquence serait de rendre le coût d'un brevet moins important qu'actuellement. Cette réforme impliquerait une évolution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Recommandation 6 suivante). 6 - Réfléchir à l'évolution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (C.B.E.) Cette réflexion est nécessitée par le fait que les pays membres de la C.B.E. sont, ou vont être, en très grande majorité également membres de l'Union européenne. Une évolution possible serait de rattacher cette C.B.E. à l'Union européenne en prévoyant un statut spécial pour les pays demeurant à l'extérieur de cette Union. Une telle évolution impliquerait nécessairement la définition des liens entre l'Union européenne et l'O.E.B. 7 - Institution d'une session « ministérielle » annuelle au Conseil d'administration de l'O.E.B. Cette session « ministérielle » annuelle du Conseil d'administration de l'O.E.B. permettrait aux ministres chargés de la protection de la propriété intellectuelle de faire le point de façon périodique sur la politique de l'O.E.B. et d'évoquer son évolution souhaitable. Une session « parlementaire » pourrait aussi être envisagée. 8 - Renégocier l'article 5 de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 Cette renégociation s'avère toujours indispensable à l'heure actuelle. III - Les recommandations au niveau international 9 - Saisir le Conseil des A.D.P.I.C. d'une demande d'interprétation des critères de brevetabilités prévus à l'article 27 - 1 Afin de s'opposer aux dérives des offices de brevet, les formules classiques de « nouveauté », d'« inventivité » et « d'application industrielle » doivent être interprétées et précisées explicitement. Aussi le Conseil des A.D.P.I.C. doit-il engager une concertation avec l'O.M.P.I. afin d'élaborer une interprétation claire de ces critères classiques de la brevetabilité. 10 - Modifier l'article 27 - 2 des A.D.P.I.C. pour exclure le vivant humain de la brevetabilité Il s'agit là de la reprise de la recommandation n°11 de mon précédent rapport. Il s'agit d'exclure de la brevetabilité les gènes humains en les soumettant à un régime analogue à celui du certificat d'obtention végétal (C.O.V.). Ces gènes humains resteraient ainsi toujours libres de droits, seules les inventions élaborées à partir d'eux seraient éventuellement brevetables. 11 - Modifier l'article 30 des A.D.P.I.C pour introduire de façon explicite l'exemption de recherche en faveur de la recherche fondamentale Il s'agit de prévoir explicitement l'exemption de la recherche fondamentale dans un article rédigé actuellement de façon trop générale. 12 - Saisir l'O.M.P.I. d'une proposition de réflexion sur l'appropriation par les pays en développement des informations intangibles pouvant être recueillies à partir de leurs ressources génétiques Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l'O.MP.I. devrait se saisir des modes d'appropriation par les pays en développement des informations intangibles pouvant être recueillies à partir de leurs ressources génétiques. Il devrait également étudier les moyens qui permettraient à ces pays d'en tirer ainsi bénéfice. Amendement (n° 152) présenté le mercredi 10 décembre 2003 par M. Claeys, M. Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste lors de la discussion en deuxième lecture du projet de loi sur la bioéthique Rédiger ainsi l'article 12 bis : A. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : I- L'article L. 611-17 est ainsi rédigé : Art. L. 611-17. - Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. II. - Après l'article L. 611-17, sont insérés trois articles L. 611-18, L. 611-19 et L. 611-20 ainsi rédigés : Art. L. 611-18. - Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet, cette protection ne pouvant couvrir l'élément du corps humain lui-même. L'application est concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet. Ne sont pas notamment brevetables : a) Les procédés de clonage des êtres humains ; b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ; c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales d) Les séquences totales ou partielles d'un gène. Art. L. 611-19. - Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables. « Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. Art. L. 611-20. - Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables. III. - Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 612-12, les mots : "de l'article L. 611-17 sont remplacés par les mots : "des articles L. 611-17 à L. 611-20 et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : "du a de l'article L. 611-17 sont remplacés par les mots : "des articles L. 611-17 et L. 611-18. B. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques et de santé publique de l'application du présent article. Exposé des motifs Le Sénat propose de créer de « petits » brevets de produits, la portée de l'inclusion de la séquence génique dans le brevet étant limitée à la simple application technique d'une seule fonction sans préjudice d'autres applications. Cette proposition méconnaît la signification même d'un brevet de produit qui suppose par elle-même, nécessairement, la dépendance des brevets portant sur les applications ultérieures. La transposition de la directive, telle qu'elle est proposée par le Sénat, ne permettra donc pas de faire l'économie de contentieux. Sur le plan juridique, il faut d'ailleurs relever, que les articles 5 et 9 de la directive retiennent la notion de brevets de produits larges qui par elle-même « génère de la dépendance ». La prétendue reconnaissance, par la Commission européenne, d'une certaine flexibilité dans l'étendue de la protection à conférer à des inventions portant sur des éléments du corps humain ne résiste pas à la réalité des enjeux économiques en cause. Sur le plan scientifique, on peut douter de la pertinence de s'en tenir à une approche réductrice, ne donnant pas sa véritable dimension au rôle tenu par le milieu et aux interactions qu'il crée. Enfin, sur les plans tant de la recherche qu'économique, les revendications trop larges des brevets de produits ne peuvent conduire qu'à des situations de monopole et de rente qui sont sources d'appauvrissement collectif. Il apparaît donc, en l'état, moins onéreux, en termes juridiques et économiques, de placer les séquences géniques en dehors des revendications pour n'accorder que des brevets d'application ou d'utilisation. Article 5 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. 3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Examen du rapport par l'Office L'Office s'est réuni le mercredi 3 mars 2004 pour examiner le rapport de M. Alain Claeys, député. Après la présentation par M. Alain Claeys des grandes lignes de son rapport et de ses recommandations, plusieurs membres de l'Office sont intervenus. M. Claude Birraux, député, Président de l'Office, après avoir remercié M. Alain Claeys de son intervention, a posé des questions sur les brevets que l'on peut qualifier de « négatifs » pour se protéger des concurrents, sur les modes de financements des différents offices de brevets, sur les banques de données, les communautés de brevets et sur les moyens de rétribuer la propriété intellectuelle de la recherche publique, en évoquant l'action dans ce domaine de l'Université de Louvain-la-Neuve. Il a ensuite fait des propositions pour préciser l'articulation entre l'O.M.C. et l'O.M.P.I. en matière de définition des critères de brevetabilité et souhaité qu'une session parlementaire soit organisée à l'O.E.B. Le Rapporteur, a acquiescé aux suggestions de M. Claude Birraux et a souligné que la coordination entre les trois principaux offices de brevets reléguait quelque peu la puissance publique en marge de ce domaine. Il a affirmé sa préférence de voir les problèmes de propriété intellectuelle réglés à l'O.M.C. plutôt qu'à l'O.M.P.I. Il a indiqué que les banques de données étaient d'ores et déjà en phase de réalisation en citant, outre l'Islande, la situation en Lettonie et en Estonie. Il a insisté sur le fait que l'attention devait être fortement mobilisée par ces affaires. Il a estimé que les communautés de brevets devaient être développées afin qu'il n'existe pas de concurrences inutiles qui pourraient nuire à l'innovation. Après avoir considéré que l'expression « brevet négatif » semblait assez appropriée pour qualifier les situations de rente susceptibles de se créer, il a réitéré que le financement issu des brevets était marginal pour les organismes publics de recherche, même aux Etats-Unis. Il s'est demandé de ce point de vue si les fondations de recherche, en projet en France, auraient une incidence dans ce domaine dans la mesure où il est difficile de faire travailler ensemble le public et le privé. M. Claude Saunier, sénateur, a estimé que les petites entreprises avaient de la difficulté à financer des demandes de brevet. Le Rapporteur a noté que le financement de ces demandes de brevets pourrait être revu. Il a ensuite évoqué le problème des licences en soulignant que les pouvoirs publics pouvaient accorder des licences d'office. Il a indiqué que l'affaire des médicaments soulevés à la Conférence de Doha avait trouvé une solution en 2003. M. Daniel Raoul, sénateur, a évoqué la question de la brevetabilité des gènes et de leurs applications. Le Rapporteur a indiqué qu'il était favorable aux brevets d'application mais opposé aux brevets de produits, ce qui impliquait de ne pas breveter le gène et l'application mais l'application seule. L'Office a unanimement approuvé, sous la réserve des suggestions de M. Claude Birraux, les conclusions du rapporteur. FRANCE M. Benoît Battistelli, directeur-adjoint du cabinet de Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie M. Robert Brac de la Perrière, consultant et conseil en ressources génétiques M. Christian Bréchot, directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) Mme Marianne Cantet, chargée de mission « droit international et communautaire » à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) M. Maurice Cassier, chercheur au Centre de recherche médecine, science, santé et société (CERMES - I.N.S.E.R.M./C.N.R.S.) M. François Chrétien, consultant en propriété intellectuelle, mandataire agréé auprès de l'O.E.B., président du groupe de travail « biotechnologies » du Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Mme Jeanne-Hélène di Donato, responsable du département « banques et collecte » à l'Association française contre les myopathies (A.F.M.) M. Dominique Foray, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), administrateur principal de l'O.C.D.E. (en détachement) M. Dominique Guellec, administrateur principal à la Division des analyses économiques et des statistiques de la Direction de la science, de la technologie et de l'industrie de l'O.C.D.E.
M. Claude Henry, directeur de recherche au C.N.R.S., Laboratoire d'économétrie de l'Ecole polytechnique, membre du Conseil d'analyse économique Mme Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) Mme Martine Hiance, directrice générale adjointe de l'Institut national de la propriété industrielle M. Jean-Stéphane Joly, chargé de recherche (systèmes génétiques) à l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) M. Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche à l'I.N.R.A. M. Bernard Larrouturou, directeur général du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) M. Hervé Le Guyader, professeur de biologie évolutive à l'Université Pierre et Marie Curie, membre du comité d'éthique de l'I.N.R.A. et de l'I.F.R.E.M.E.R. M. Eric Molinié, président de l'Association française contre les myopathies (A.F.M.) Mme Anne-Laure Morin, juriste, chargée de mission pour la bioéthique à l'Association française contre les myopathies (A.F.M.)
M. Jean-Philippe Muller, chef du service d'examen en biotechnologies du service des brevets de l'Institut national de la propriété industrielle M. Guy Paillotin, ancien président de l'I.N.R.A. M. Bernard Pau, professeur d'Université, directeur scientifique du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) M. Alain Pompidou, professeur de médecine, député européen honoraire, membre de l'Académie des technologies M. Patrick Schmitt, directeur adjoint à la direction de l'innovation et de la recherche du Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Mme Andrée Sontot, chargée des affaires internationales au Bureau des ressources génétiques (B.R.G.) M. Thierry Sueur, vice-président d'Air Liquide, président du comité de propriété intellectuelle du Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) M. Bernard Teyssendier de la Serve, directeur de recherche à l'I.N.R.A M. Michel Trommetter, chargé de recherche à l'I.N.R.A. M. Boris Walbaum, conseiller technique au cabinet de Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l'industrie M. Alain Weil, chargé de mission à la direction du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.) CANADA Mme Denise Avard, responsable de recherche à l'Université de Montréal M. Terry Boehm, vice-président du Syndicat national des agriculteurs du Canada M. Pierre J. Charest, directeur général, bureau de la biotechnologie et de la science de la Direction générale des produits de santé et des aliments du Ministère de la santé Mme May Chow, analyste de politique commerciale à la Direction des règlements et des obstacles techniques du Ministère des affaires étrangères et du commerce international Mme Catherine M. Dickson, directrice de la politique commerciale sur la propriété intellectuelle, l'information et la technologie du Ministère des affaires étrangères et du commerce international M. John B. Dossetor, vice-président de Monsanto Canada, chargé des relations avec les pouvoirs publics M. Daniel Green, directeur du Sierra Club du Canada M. John F. Herity, directeur, bureau de la Convention sur la diversité biologique du ministère de l'environnement M. Olivier Jalbert, administrateur général, chargé des affaires sociales, économiques et juridiques au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique Mme Michèle S. Jean, conseillère en développement de programmes à l'Université de Montréal, présidente du Comité international de bioéthique de l'U.N.E.S.C.O. Mme Bartha Maria Knoppers, professeur de droit public à l'Université de Montréal M. Jock Langford, conseiller principal en politiques, bureau de la Convention sur la diversité biologique du ministère de l'environnement Mme Sonia Le Bris, analyste principale des politiques à la Direction générale de politique de la santé et des communications du Ministère de la santé M. Robert McDougall, agent de politique commerciale à la Direction de la politique commerciale sur l'information et la technologie du Ministère des affaires étrangères et du commerce international Mme Christine Moran, agente de politique commerciale à la Direction des règlements et des obstacles techniques du Ministère des affaires étrangères et du commerce international
Mme Valérie Normand, administratrice de programme au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique Mme Andrea Peart, chargée de mission (santé et environnement) au Sierra Club du Canada M. René Simard, professeur d'université, membre du Comité consultatif canadien de la biotechnologie, ancien recteur de l'Université de Montréal Mme Sarah Stinson, agente de science et de technologie à la direction de la science et de la technologie du ministère des affaires étrangères et du commerce international M. Thierry Weissenburger, directeur adjoint de la Veille et de la politique de la science et de la technologie du ministère des affaires étrangères et du commerce international COSTA RICA M. Murio Alfaro, membre du Comité de bioéthique M. Primo L. Chavarría, membre de la Commission de la Biodiversité, professeur à l'Université de Costa Rica M. José Joaquín Chaverri, ambassadeur, représentant du ministre des relations extérieures et des cultes M. Federico Valerio de Ford, sous-directeur au ministère du commerce extérieur M. Rodriguo Gámez Lobo, directeur général de l'Instituto nacional de Biodiversidad (INBio) M. Bruno Locatelli, économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.), en poste au Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (C.A.T.I.E.) Mme Ana Lorena Guevara, directrice à l'Instituto nacional de Biodiversidad (INBio) Mme Natalia Hernández, assistante du vice-ministre du commerce extérieur Mme Marta Liliana Jiménez Fernández, directrice exécutive de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) Mme Ana Victoria L. de Macaya, professeur de biologie à l'Université de Costa Rica M. Edgar Ramírez, professeur à l'Université de Costa Rica Mme Ana Sittenfeld, professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université de Costa Rica M. Manuel Á. Solis, membre de l'Institut de recherches sociales M. Ricardo Ulate, directeur des relations internationales au ministère de l'environnement Mme Marta F. Valdez Melara, professeur de génétique et de biotechnologie végétale à l'Université de Costa Rica ETATS-UNIS Mme Jennifer Brant, conseillère en politique du commerce d'Oxfam America Mme Jasemine C. Chambers, directrice du centre de technologie de United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.) M. Mike Cerny, agriculteur, membre du conseil d'administration du Farm Bureau, vice-président des producteurs de soja du Wisconsin Mme R. Alta Charo, professeur de droit à l'Université du Wisconsin à Madison Mme Mariam Daffe, directeur pour l'Afrique de l'Ouest de International Intellectual Property Institute (I.I.P.I.) M. Peter DiMauro, directeur de projet de International Center for Technology Assessment Mme Claire T. Driscoll, directrice, bureau des transferts de technologie des National Institutes of Health (N.I.H.) M. Kenneth J. Eilertsen, vice-président, chargé de la recherche de Infigen, Inc. Mme Rebecca S. Eisenberg, professeur de droit à l'Université du Michigan M. David L. Fitzgerald, avocat à la société d'avocats Sidley Austin Brown & Wood M. Erik J. Forsberg, vice-président, chargé du développement de Infigen, Inc. Mme Barbara P. Fuller, chef du département « Politique et éducation » du bureau des affaires publiques des National Institutes of Health (N.I.H.) M. Robert M. Goodman, professeur à l'Université du Wisconsin à Madison (Collège d'agriculture et de sciences de la vie) M. John F. Hardiman, responsable des licences de Wisconsin Alumni Research Foundation M. William Haseltine, président de Human Genome Science M. Mike E. Jenkins, directeur des opérations commerciales de Gala biotech M. Stephen G. Kunin, directeur adjoint de l'examen des brevets de United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.) M. Bruce A. Lehman, président de International Intellectual Property Institute (I.I.P.I.) M. Richard R. Nelson, professeur d'économie à l'Université de Columbia M. James Packard Love, directeur de Consumer Project on Technology M. Mark A. Pineda, responsable « Asie du Sud et l'Europe occidentale » de la division des affaires internationales des National Institutes of Health (N.I.H.)
M. Brian Z. Renk, directeur du service des brevets et des licences de Wisconsin Alumni Research Foundation M. Mark L. Rohrbaugh, directeur de l'Office de transfert technologique des National Institutes of Health (N.I.H.) M. Theodore J. Roumel, directeur adjoint, bureau des transferts de technologie des National Institutes of Health (N.I.H.) M. Jon P. Santamauro, mandataire de brevet de United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.) M. Walter Simson, président d'Infigen, Inc. M. Robert Streifer, professeur de philosophie à l'Université du Wisconsin à Madison M. Paul M. Weiss, président de Gala biotech M. Richard Wilder, avocat à la société d'avocats Sidley Austin Brown & Wood M. Tom Zinnen, professeur à l'Université du Wisconsin à Madison (Collège d'agriculture et de sciences de la vie) ISLANDE Mme Ólöf Ýrr Atladóttir, directrice de la gestion du Comité national de bioéthique d'Islande Mme Þuríður Backman, députée M. Björn Geirsson, conseiller juridique à la Commission de la protection de la vie privée (Persónuvernd) M. Thoridur Haraldson, juriste à DeCode Genetics M. Pétur Hauksson, président de l'Association des Islandais pour l'éthique en science et en médecine (Mannvernd) M. Ögmunður Jónasson, député M. Kristleifur Kristjansson, directeur des affaires médicales de DeCode Genetics M. Sveinn Magnússon, chef du département Centres de santé, hôpitaux et persoones âgées du ministère de la santé et de la sécurité sociale M. Eirikur Sigurdsson, directeur de l'information de DeCode Genetics M. Össur Skarpheðisson, député M. Rémi Spilliaert, chargé de recherches à DeCode Genetics M. Þórður Sveinsson, conseiller juridique à la Commission de la protection de la vie privée (Persónuvernd) Mme Guðriður Þorsteindóttir, chef du département juridique du ministère de la santé et de la sécurité sociale M. Gudlaugur Þor ÞorÞarsson, député COMMISSION EUROPEENNE M. Olivier Drewes, membre du cabinet de M. Frantz Fischler, commissaire européen chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche M. Thierry Stoll, membre du cabinet de M. Frits Bokelstein, commissaire européen chargé du marché intérieur, de la fiscalité et de l'union douanière M. Nicolas Théry, chef de cabinet de M. Pascal Lamy, commissaire européen chargé du commerce M. Kurt Vandenberghe, membre du cabinet de M. Philippe Busquin, commissaire européen chargé de la recherche M. Jean-Charles Van Eeckhaute, administrateur ORGANISATIONS INTERNATIONALES Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.) M. Jacques Antoine, chef du service de la politique du sol et des plantes M. Devin M. Bartley, chef du service des ressources piscicoles M. David Boerma, chef du service de la biodiversité M. Luis M. Bombín, chef du service des affaires juridiques M. Jean-Pierre Chiarada-Bousquet, juriste principal au Bureau juridique M. Lawrence C. Christy, chef du service du droit et du développement M. José T. Esquinas-Alcazar, secrétaire général de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture Mme Louise O. Fresco, directrice générale adjointe M. Serge M. Garcia, directeur, division des ressources halieutiques M. Hartwig de Haen, sous-directeur général, département économique et social Mme Irène Hoffmann, chef du service des productions animales M. Samuel C. Jutzi, directeur de la division de la production et de la santé animales M. Dietrich E. Leihner, directeur du service « Développement durable » M. Arturo Martinez, chef du service « Semences et ressources phytogénétiques » M. Henry Kanjobe Mwandemere, responsable du département « Recherche et développement » M. Pierre Sigaud, responsable des ressources génétiques forestières M. Mahmoud Solh, directeur, division de la protection des plantes M. Andrea Sonnino, chef du service de la recherche agronomique M. Clive Stannard, chef du service de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture M. Julian A. Thomas, responsable de la réglementation de la nourriture Organisation mondiale du commerce (O.M.C.) M. Adrian Otten, directeur de la division de la propriété intellectuelle Mme Thu-Lang Tran Wasescha, conseillère à la division de la propriété intellectuelle Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) M. Philippe Baerchtold, chef de la section « Brevets » du département des politiques de brevets M. Francis Gurry, sous-directeur général, conseiller juridique M. Antony Taubman, directeur par intérim à la Division des savoirs traditionnels Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) Mme Marie-Charlotte Bouësseau, membre du cabinet du directeur général, chargée des problèmes éthiques et de la santé M. Alexandre Morgan Capron, directeur, chargé de l'éthique et de la santé M. Hans von Hogerzeil, coordinateur pour la politique, l'accès et l'usage des médicaments essentiels M. André Prost, directeur du service des relations avec le secteur privé et les gouvernements __________________ N° 1487 - Rapport : modes d'appropriation du vivant (Alain Claeys) 1 Les E.S.T. (expressed sequences tags) sont de courtes séquences d'A.D.N. (en général de l'A.D.N. complémentaire, A.D.N. c) comportant 100 à 150 nucléotides correspondant à une des extrémités d'un A.R.N. messager (A.R.N.m). Elles servent à « étiqueter » les gènes et à permettre de décoder de longues séquences d'A.D.N. 1 La maladie de Tay-Sachs est une affection héréditaire touchant les enfants en bas âge caractérisée par arrêt complet puis une régression du développement moteur et mental. 2 La maladie (ou chorée) de Huntington est une affection neurodégénérative héréditaire 3 se manifestant par des troubles psychiques évoluant jusqu'à la démence 3 La thalassémie est une anomalie héréditaire de la synthèse de l'hémoglobine. 4 La phénylcétonurie est une affection héréditaire associant une encéphalopathie sévère avec une arrièration mentale et des troubles neurologiques importants. 1 Le texte de l'article 5 de la directive 98/44/CE se trouve en annexe, page 125. 1 Voir pages 73 et 74 1 C'est moi qui souligne. 1 C'est moi qui souligne. 1 C'est moi qui souligne. 1 Ce mécanisme de financement est prévu par l'article 21 de la Convention pour fournir des ressources financières aux Parties, pays en développement. Il n'a pas encore été mis en place. 1 En droit romain, le contrat de fiducie est le contrat par lequel l'acquéreur apparent d'un bien s'engage à le restituer à l'aliénateur lorsque celui-ci aura rempli les obligations qu'il a envers lui. 1 Une collection de végétaux ex situ est une collection conservée hors de leur habitat naturel. Les collections des Centres internationaux de recherche agronomique sont des collections ex situ. 1 Voir à ce sujet mon précédent rapport pages 18 à 20 1 Un allèle est l'une des formes que peut prendre un gène, les différences entre les allèles d'un même gène portant sur des variations dans la séquence des nucléotides. 2 Avis n° 77 du 20 mars 2003 1 Conseil d'analyse économique « Propriété intellectuelle » p 85. 1 Une kinase est une enzyme assurant le transfert d'un phosphate provenant de l'adénosine triphosphate (A.T.P.) vers un récepteur qui est ainsi activé. 1 Génomique et partenariat Les enjeux industriels de la génomique par Bernard Teyssendier de la Serve et Michel Trommetter dans « Dynamique du génome végétal » JF Briat et JF Morot-Gaudry, Editeurs I.N.R.A. 2003 1 Un mutant d'insertion est une séquence d'A.D.N. modifiée par un fragment étranger pour repérer un gène muté et pouvoir découvrir sa fonction. 1 C.I.R.A.D. : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 2 I.R.D. : Institut de recherche pour le développement 3 Biogemma est constitué par les groupes semenciers Limagrain, Pau-Euralis et les filières agricoles Sofiprotéol et Unigrains 4 Bioplante réunit les semenciers Desprez et Serasem 1 Voir les statistiques complètes concernant toutes les Universités américaines dans Association of University Technology Managers, Inc. « Licensing survey : FY 2000 » (2001) pages 31 à 35. 1 Voir les pages 59 à 64 1 Une douzaine d'années plus tard, celles-ci empruntaient le chemin inverse pour séparer nettement leurs activités pharmaceutiques et agrochimiques. 1 Commission européenne Communication du 12 septembre 2002 de la Communauté européenne et des Etats membres au Conseil des A.D.P.I.C. sur la révision de l'article 27.3 (b) ; le rapport entre les A.D.P.I.C. et la Convention sur la diversité biologique et la protection des connaissances et du folklore traditionnel. 5 La Conférence des Parties, institué par l'article 23 de la C.D.B., est l'instance de direction de la Convention. Elle réunit, périodiquement, les 187 (186 pays + l'Union européenne) parties contractantes. 1 Note d'actualité 2001/147 du 12 novembre 2001 2 Selon le titre de la note d'actualité de l'O.M.P.I. 200/14 du 13 novembre 2000 |