

Document mis N° 463 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2002. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 378), relatif au mandat d'arrêt européen. PAR M. XAVIER DE ROUX, Député. -- Justice. INTRODUCTION 5 I. - UNE DÉCISION-CADRE QUI S'INSCRIT DANS LE CHAMP DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EUROPÉENNE 6 A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE 6 1. Le Traité de Maastricht 6 2. Le Traité d'Amsterdam 7 B. LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS DE JUSTICE EN MATIÈRE PÉNALE 8 1. Le Conseil européen de Tampere 8 2. Les conditions d'adoption de la décision-cadre 9 II. - UNE PROCÉDURE DESTINÉE À SE SUBSTITUER AU MÉCANISME TRADITIONNEL DE L'EXTRADITION 10 A. LA PROCÉDURE ACTUELLE D'EXTRADITION 10 1. L'extradition dans l'Union européenne 10 a) La convention d'extradition du 13 décembre 1957 10 b) Les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996 11 2. La procédure applicable en France 12 a) Les conditions de fond de la loi du 10 mars 1927 13 b) Les conditions de forme de la loi du 10 mars 1927 13 B. LES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION-CADRE RELATIVE AU MANDAT D'ARRET EUROPÉEN 14 1. Les conditions de fond 15 a) Le champ d'application du mandat d'arrêt européen 15 b) Les motifs de refus d'exécution 15 2. Les dispositions de procédure 16 a) Les droits de la personne recherchée 17 b) Les délais et les modalités d'exécution du mandat européen 17 c) Les dispositions finales 17 III. - UNE TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS QUI NÉCESSITE UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE PRÉALABLE 18 A. L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 18 1. Le contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé 18 2. La jurisprudence du Conseil d'État en matière d'extradition 20 3. L'analyse du Conseil d'État 22 B. UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE CIBLÉE 25 1. Le choix d'une formulation restrictive 25 2. Un complément à l'article 88-2 de la Constitution 25 DISCUSSION GÉNÉRALE 27 TABLEAU COMPARATIF 29 ANNEXES 31 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 33 Avis du Conseil d'État du 26 septembre 2002 45 MESDAMES, MESSIEURS, Sid Amhed Rézala au Portugal, Rachid Ramda en Angleterre et plus récemment Patrick Henry en Espagne : autant de noms renvoyant à des affaires qui illustrent les difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de la procédure d'extradition au sein de l'Union européenne. Remontant au Moyen Age, avec le Traité signé en 1174 entre Henri II d'Angleterre et Guillaume d'Écosse, la procédure d'extradition est un ensemble de règles complexes où le dernier mot revient au pouvoir politique. Sans doute parce qu'elle parait entrer dans le champ des compétences régaliennes de l'État, il a fallu attendre plus de quarante ans après le début de la construction européenne pour que l'instauration d'une procédure simplifiée d'extradition soit évoquée. Pourtant, dès 1977, M. Valéry Giscard d'Estaing proposait d'organiser, entre les États membres de ce qui était alors la Communauté économique européenne, une extradition automatique applicable à certains types d'infractions et constituant l'un des éléments de cet espace judiciaire en voie de formation. Après la modification apportée par le Traité d'Amsterdam au Traité sur l'Union européenne, qui fait de l'amélioration de l'extradition entre États membres l'un des objectifs de l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a décidé de supprimer la procédure formelle d'extradition entre États membres pour les personnes condamnées et d'accélérer les procédures d'extradition pour les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Les évènements du 11 septembre 2001 et la prise de conscience de la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme ont contribué à accélérer le processus de décision et ont conduit à l'adoption dès 13 juin 2002 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Cette décision-cadre propose de substituer au système actuel de l'extradition une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention du pouvoir politique. Le mandat d'arrêt européen pourra être émis pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an ou lorsque la personne recherchée a été condamnée à une peine d'emprisonnement au mois égale à quatre mois. Pour trente-deux catégories d'infractions limitativement énumérées, le mandat d'arrêt européen devra donner lieu à une remise de la personne recherchée sans contrôle du principe de la double incrimination, selon lequel les faits fondant la poursuite ou la condamnation doivent être constitutifs d'une infraction dans les deux États membres en cause. Les motifs de non exécution du mandat d'arrêt (amnistie, prescription...) sont, par ailleurs, limitativement énumérés. Anticipant sur la date d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, fixée au 1er janvier 2004, la France s'est engagée avec cinq autres États membres à mettre en _uvre le mandat européen dès le premier trimestre 2003. Souhaitant s'assurer qu'il n'existait pas d'obstacle constitutionnel à la transposition de la décision-cadre, le Gouvernement a saisi le Conseil d'État qui, dans un avis du 26 septembre dernier, a considéré que cette transposition nécessitait, au préalable, une révision de la Constitution. La haute juridiction a, en effet, considéré que la décision-cadre n'assurait pas le respect du principe constitutionnel selon lequel l'État doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour les infractions qu'il considère comme des infractions à caractère politique. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé le 14 novembre dernier un projet de loi constitutionnelle qui complète l'article 88-2 de la Constitution par un alinéa précisant que la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen, conformément aux décisions-cadres prises sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, il s'agit de la quatrième révision constitutionnelle, rendue nécessaire par la construction européenne, après celles liées au Traité de Maastricht, aux accords de Schengen et au Traité d'Amsterdam. Mais, à la différence des précédentes, elle ne modifie pas la loi fondamentale pour permettre la ratification d'un traité ou d'un engagement international, mais simplement pour autoriser la transposition législative d'un acte de droit communautaire dérivé. Cette révision constitutionnelle a d'ailleurs conduit la délégation pour l'Union européenne à s'interroger sur les conditions actuelles du contrôle de constitutionnalité de ces actes communautaires dérivés. Ainsi que l'a souligné le Président de la République, la nécessité « de lutter plus efficacement contre la délinquance organisée et le terrorisme » et d'adapter « nos moyens d'action à l'ouverture des frontières de l'Union européenne » justifie néanmoins amplement cette révision constitutionnelle, dont les conséquences seront fondamentales pour la construction d'un espace judiciaire commun. I. - UNE DÉCISION-CADRE QUI S'INSCRIT DANS LE CHAMP DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EUROPÉENNE A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE Le titre VI du Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, a fait de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures le troisième pilier de l'Union européenne. La coopération judiciaire en matière civile et pénale fait partie des questions d'intérêt commun énumérées par le Traité, qui crée par ailleurs l'Office européen de police (Europol). Sur la base de ce texte, plusieurs mesures ont été adoptées afin d'améliorer la transmission des informations entre les membres de l'Union. L'action commune du 26 avril 1996 a ainsi permis l'échange des magistrats de liaison, dont la tâche consiste, notamment, à faciliter le traitement des dossiers d'entraide pénale, comme les demandes d'extradition et les commissions rogatoires internationales. Ces magistrats contribuent également à améliorer les connaissances sur l'organisation judiciaire des pays d'accueil. La France dispose actuellement de sept magistrats de liaison, qui sont en fonctions en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en République tchèque et aux États-Unis. Le réseau judiciaire européen, créé en juin 1998, a pour mission de faciliter l'établissement de contacts entre les autorités judiciaires. Il est constitué de 200 points de contacts nationaux et régionaux. Les membres du réseau, qui se réunissent régulièrement, fournissent des informations juridiques et pratiques sur l'entraide judiciaire et, de manière plus générale, favorise la coordination de la coopération judiciaire entre les États membres. Deux conventions sur l'extradition ont par ailleurs été signées dans le cadre de l'Union européenne en 1995 et 1996, mais elles ne sont pas encore entrées en vigueur, faute d'avoir été ratifiées par l'ensemble des États membres. Il convient, enfin, de mentionner la convention d'application de l'accord de Schengen qui, avec la mise en place du système d'information Schengen (SIS), permet d'améliorer l'information des États membres et de faciliter les contacts entre autorités nationales lors de l'arrestation d'une personne. La coopération judiciaire s'est accélérée avec le Traité d'Amsterdam de 1997, qui a notamment modifié les règles applicables pour l'adoption des textes de coopération en matière pénale, la Commission européenne disposant désormais d'un droit d'initiative dans cette matière. Les modalités d'entrée en vigueur des conventions ont été assouplies, la ratification par la moitié des États membres suffisant à leur entrée en application. Si le Conseil continue à statuer à l'unanimité, les mesures de mise en _uvre des actions communes sont prises à la majorité qualifiée et les mesures d'application des conventions sont arrêtées à la majorité des deux tiers. L'article 34 du Traité sur l'Union européenne autorise désormais le Conseil à prendre des décisions-cadres, qui lient « les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Proposée à l'initiative de la Commission ou d'un État membre et adoptée à l'unanimité, la décision-cadre est utilisée pour rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres. Contrairement au règlement et à la directive, elle ne peut entraîner d'effet direct. Les éventuels différends entre les États membres sur l'interprétation ou l'application de la décision-cadre sont réglés par le Conseil de l'Union européenne, saisi par l'un des États membres. Lorsque ces différends n'ont pu être réglés dans les six mois sur cette saisine, la Cour de justice des communautés européennes devient compétente pour statuer sur ceux-ci. Enfin, l'article 31 du Traité sur l'Union européenne fait de l'accélération de la coopération entre les ministères et les autorités judiciaire en matière d'exécution des décisions de justice un des objectifs de l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, avec la simplification de l'extradition entre les États membres. Le Traité d'Amsterdam a, par ailleurs, transféré dans le titre IV du Traité instituant la Communauté européenne les questions relatives à la coopération judiciaire en matière civile, les intégrant ainsi dans le premier pilier. L'article 65 de ce traité fait de l'amélioration de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale l'un des objectifs cette coopération judiciaire. B. LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS DE JUSTICE EN MATIÈRE PÉNALE 1. Le Conseil européen de Tampere Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a fait de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, qui ne figure pas en tant que tel dans les traités, « la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union ». Ce principe a vocation à s'appliquer aussi bien aux jugements qu'aux autres décisions des autorités judiciaires. Ce Conseil a également décidé la création d'Eurojust, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité organisée. Eurojust a succédé le 28 février 2002 à Pro-Eurojust, qui fonctionnait depuis le 1er mars 2001. Composée de quinze membres, soit un par État membre, qui doivent avoir la qualité de juge, de procureur ou d'officier de police judiciaire, cette structure a pour mission principale de coordonner l'action des autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites. Elle ne peut pas effectuer elle-même des actes d'enquête, mais peut demander aux autorités judiciaires nationales d'entreprendre une enquête ou d'engager des poursuites, de se dessaisir au profit d'une autre autorité ou de mettre en place des équipes communes d'enquête. Les autorités judiciaires nationales conservent néanmoins la maîtrise de l'action publique, puisqu'elles ont toujours la possibilité de rejeter la demande qui leur est adressée. A la suite de la réunion de Tampere, le Conseil a adopté le 22 décembre 2000 un programme de vingt-quatre mesures destinées à mettre en pratique en matière pénale le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Ces mesures reposent toutes sur un mécanisme d'assimilation de la décision étrangère à la décision nationale : toute décision prise dans un autre État membre sera reçue et exécutée par les autorités compétentes de l'État d'exécution comme s'il s'agissait d'une décision rendue par l'autorité judiciaire de leur propre pays. C'est dans ce contexte que s'inscrit la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. 2. Les conditions d'adoption de la décision-cadre Le Conseil européen de Tampere a estimé dans ses conclusions que « la procédure formelle d'extradition devrait être supprimée entre États membres pour les personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive » et remplacée par « un simple transfèrement des personnes, conformément à l'article 6 du Traité sur l'Union européenne », ajoutant qu'il convenait également « d'envisager des procédures accélérées d'extradition sans préjudice du droit à un procès équitable ». La Commission a été invitée à faire des propositions en ce sens. Les évènements du 11 septembre 2001 ont accéléré le processus de décision. Dès le 21 septembre, un Conseil européen extraordinaire se réunissait afin d'analyser la situation internationale à la suite des attentats terroristes aux États-Unis et de donner les impulsions nécessaires aux actions de l'Union européenne. Il rappelait la volonté des États membres d'instaurer un mandat d'arrêt européen, permettant « la remise directe des personnes recherchées d'autorité judiciaire à autorité judiciaire » et demandait au conseil « justice-affaires intérieures » d'en fixer les modalités au plus tard lors de sa réunion des 6 et 7 décembre 2001. Des négociations se sont engagées sur la base d'un projet de la Commission européenne. Les discussions ont principalement porté sur l'abandon de la règle de la double incrimination : alors que la Commission proposait de donner à chaque État la possibilité d'élaborer une liste de faits pour lesquels il pouvait refuser d'exécuter un mandat d'arrêt au motif que cela serait contraire à ses principes fondamentaux (principe de la liste négative), un accord a finalement été trouvé le 11 décembre 2001 sur le principe d'une « liste positive » d'infractions pour lesquelles le mandat européen pourrait être exécuté, la règle de la double incrimination étant donc écartée. Après avoir demandé, par la voix de son président du Conseil, d'écarter les faits de corruption, l'Italie s'est finalement ralliée à la liste des trente-deux catégories d'infractions élaborée. La France, elle, a souhaité que soit précisé que « exceptionnellement, l'État membre peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen s'il a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de [...] ses opinions politiques ». Une formulation de ce type a finalement été retenue dans le préambule du texte adopté, et non dans le dispositif lui-même. L'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure a été fixée au 1er janvier 2004. Le Parlement français a suivi de près ces négociations. La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne s'est ainsi prononcée, dans son rapport d'information sur la proposition de décision-cadre, en faveur de l'établissement d'une liste positive fondée sur l'énumération d'infractions dénommées de façon générique et a souhaité que les exceptions à l'exécution du mandat d'arrêt soient inspirées par le souci d'assurer le respect des garanties fondamentales des droits de l'homme. Le Conseil européen de Laecken des 14 et 15 décembre 2001 a pris acte de l'accord intervenu sur le mandat d'arrêt européen. Lors de la réunion à Saint Jacques de Compostelle, le 14 février dernier, des ministres de la justice et de l'intérieur, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la France, la Belgique et le Luxembourg ont annoncé leur intention d'appliquer la procédure du mandat d'arrêt européen dès le premier trimestre 2003, soit un an avant la date fixée. Enfin, le Conseil a finalisé l'accord intervenu en adoptant le 13 juin 2002 un décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Comme l'a souligné la Commission dans sa proposition de décision-cadre, « tant l'ordre juridique résultant du Traité d'Amsterdam que l'état avancé de la coopération judiciaire entre les États membres justifient la création du mandat d'arrêt européen par une décision-cadre qui [...] lie les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». II. - UNE PROCÉDURE DESTINÉE À SE SUBSTITUER AU MÉCANISME TRADITIONNEL DE L'EXTRADITION Le mandat d'arrêt européen modifie fondamentalement la nature de la coopération judiciaire pénale, puisqu'il permet une remise directe, d'autorité judiciaire à autorité judiciaire, des personnes recherchées. A. LA PROCÉDURE ACTUELLE D'EXTRADITION 1. L'extradition dans l'Union européenne a) La convention d'extradition du 13 décembre 1957 La procédure d'extradition entre les États membres de l'Union est actuellement régie pour l'essentiel par les dispositions de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 signée dans le cadre du Conseil de l'Europe, modifiée par les protocoles additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978. Cette convention a cependant fait l'objet de nombreuses réserves de la part des États membres. Aux termes de cette convention, l'extradition ne peut concerner que des faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise (principe de la double incrimination). Lorsque l'individu n'a pas encore été condamné, la peine encourue doit être au moins égale à un an d'emprisonnement ; dans le cas contraire, la sanction prononcée doit être d'au moins quatre mois d'emprisonnement. La France a émis une réserve afin de fixer à deux ans la peine d'emprisonnement encourue rendant possible l'extradition. La convention précise que l'extradition n'est pas accordée si la partie requise la considère comme une infraction politique ou qu'il s'agit d'une infraction militaire, lorsque l'individu réclamé a déjà été définitivement jugé par la partie requise (règle du non bis in idem) ou lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante ou de la partie requise. L'extradition pourra également être refusée si l'individu réclamé fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits par la partie requise. Si elle prévoit l'extradition de leurs propres ressortissants par les États contractants, la convention leur donne également la possibilité de refuser celle-ci, ce qu'a prévu la France. En application du principe de spécialité, l'individu extradé ne pourra pas être poursuivi, jugé ou détenu pour un fait antérieur à son extradition autre que celui ayant motivé celle-ci, sauf si la partie requise y consent ou lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, l'individu n'a pas quitté le territoire dans les quarante-cinq jours suivant son élargissent ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. Enfin, la convention précise que la réextradition vers un État tiers pour des faits antérieurs à la remise nécessite l'accord de la partie requise. b) Les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996 Afin d'accélérer et de simplifier l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, en éliminant notamment les réserves faites à la convention de 1957, deux conventions ont été élaborées. · La convention du 10 mars 1995 instaure une procédure simplifiée d'extradition lorsque la personne réclamée consent à sa remise. Le consentement à l'extradition doit être donné devant les autorités judiciaires de l'État requis, les États parties devant faire en sorte que « le consentement soit recueilli dans les conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent ». La personne réclamée a le droit de se faire assister par un conseil. Si le consentement accordé est normalement irrévocable, les États peuvent, par le biais d'une déclaration interprétative, déroger à ce principe et prévoir un délai de rétractation. L'État requis doit communiquer à l'État requérant le consentement à l'extradition ou son refus dans un délai de dix jours suivant l'arrestation provisoire. La convention prévoit également que la personne réclamée puisse renoncer au principe de spécialité, ce renoncement pouvant être considéré comme une conséquence du consentement à l'extradition ou faire l'objet d'une déclaration expresse de l'extradé. La France, comme l'Allemagne, le Danemark, la Grèce, la Suède et la Finlande, a choisi la voie de la renonciation expresse. La procédure simplifiée, qui s'applique dès le stade de l'arrestation provisoire, permet de ne pas présenter de demande formelle d'extradition. La décision d'extradition, qui doit être communiquée dans un délai de vingt jours après le consentement, est transmise par les autorités nationales compétentes désignées par les États membres, et non plus par la voie diplomatique, la remise de la personne extradée devant s'effectuer dans les vingt jours suivant cette communication. La convention autorise enfin la réextradition, sans le consentement de l'État requis, de la personne demandée vers un autre État membre, lorsque cette dernière a renoncé au principe spécialité. Les États peuvent toutefois déroger à ce principe par une simple déclaration. · La convention du 27 septembre 1996 modifie les conditions de fond de l'extradition. Elle abaisse ainsi le quantum de la peine d'emprisonnement encourue permettant l'extradition. Si dans l'État requérant les fait doivent être passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins douze mois, ce quantum est fixé à six mois dans l'État requis. Elle précise qu'aucune infraction ne pourra désormais être considérée comme politique, l'État requis ne pouvant refuser l'extradition pour ce motif. Il est toutefois prévu que les États membres puissent, par une déclaration interprétative, limiter cette « dépolitisation » aux infractions de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Les États conserveront cependant la possibilité de refuser l'extradition lorsque celle-ci a été demandée pour des motifs liés à la race, la religion, la nationalité ou l'opinion politique ou lorsque la situation de la personne concernée risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons. Tout en prévoyant l'extradition des ressortissants nationaux, la convention donne aux États la possibilité d'écarter ou de restreindre l'application de ce principe. Elle supprime la règle de la double incrimination pour les associations de malfaiteurs répondant à certains critères et limite les effets du principe de spécialité, en autorisant le jugement de faits antérieurs à l'extradition sans l'accord de l'État requis, lorsque ces faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté, et en prévoyant que la personne extradée peut renoncer à ce principe de spécialité « dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent ». Enfin, la convention supprime l'accord de l'État requis pour la réextradition vers un État tiers, tout en donnant la possibilité aux États membres de maintenir cet accord dans les cas où la personne concernée ne consent pas à sa réextradition ou n'a pas renoncé au principe de spécialité. Ces deux conventions de 1995 et 1996 constituent, malgré les nombreuses réserves formulées par les États membres, une avancée importante en matière de simplification et d'accélération de la procédure d'extradition. Plus de six ans après leur élaboration, elles ne sont cependant toujours pas entrées en vigueur, faute d'avoir été ratifiées par l'ensemble des États signataires (1). 2. La procédure applicable en France La procédure d'extradition française est régie par la convention du 13 décembre 1957 et par les accords bilatéraux signés par la France. La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers s'applique, elle, « en l'absence de traité » (article 1er). Elle constitue le droit commun de l'extradition, applicable aux relations entre la France et les États qui n'ont pas conclu avec elle de traité d'extradition, ainsi qu'un droit supplétif, qui s'applique aux points non réglementés par les conventions. a) Les conditions de fond de la loi du 10 mars 1927 L'extradition est possible lorsque les conditions suivantes sont réunies : - La personne, objet de la demande d'extradition, ne doit pas être un ressortissant français ; - Les faits en cause doivent être punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ; lorsque la personne a déjà été condamnée, la peine prononcée doit être supérieure ou égale à deux mois d'emprisonnement ; - Les faits doivent être punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle (principe de la double incrimination) ; - L'extradition est refusée lorsque l'infraction a un caractère politique ou est demandée dans un but politique, a été commise en France ou y a été définitivement jugée ; - L'extradition est accordée uniquement pour les faits visés dans la demande (principe de spécialité). b) Les conditions de forme de la loi du 10 mars 1927 La procédure d'extradition comporte deux phases, l'une administrative, l'autre judiciaire. · La phase administrative Les demandes d'extradition sont adressées au ministre des Affaires étrangères qui les transmet au ministre de la justice. Après s'être assuré de la régularité de la requête, ce dernier transmet le dossier au procureur de la République du lieu où la personne recherchée a été signalée. La personne est alors soumise à deux interrogatoires successifs, l'un par le procureur de la République du lieu d'arrestation dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci, pour une vérification d'identité, l'autre par le procureur général, après le transfert au chef lieu de la cour d'appel. En cas d'urgence, une demande d'arrestation provisoire peut être formulée directement auprès du ministère de la justice ou même du procureur de la République compétent. La demande officielle d'extradition doit alors parvenir dans des délais relativement brefs (2), le non respect de ces délais entraînant la mise en liberté de la personne. · La phase judiciaire La personne dont l'extradition est demandée doit comparaître dans les huit jours devant la chambre de l'instruction. Un délai supplémentaire de huit jours peut toutefois être accordé. L'audience est publique et l'intéressé peut se faire assister par un avocat et bénéficier d'un interprète. Si la personne consent formellement à son extradition, le dossier est transmis sans délai au ministère de la Justice. Dans le cas contraire, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition. Cet avis ne peut être défavorable que si « les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a erreur évidente » ; il lie alors le Gouvernement. En cas d'avis favorable, le Gouvernement conserve sa liberté d'appréciation et peut accorder ou refuser l'extradition. La Cour de cassation a admis progressivement la formation de pourvoi à l'égard de la décision de la chambre de l'instruction. Lorsque l'extradition est décidée, le ministre de la Justice soumet à la signature du Premier ministre un décret autorisant l'extradition. Ce décret est susceptible de recours devant le Conseil d'État. L'extradé doit être remis dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'État requérant, faute de quoi il est remis en liberté. La procédure d'extradition est donc une procédure longue est complexe, même lorsque la personne recherchée donne son accord (3). Or elle est fréquemment utilisée, puisqu'en 2000, 132 personnes ont été extradées de France, tandis que 145 personnes ont été remises aux autorités françaises. Dans la perspective de la ratification des conventions de 1995 et 1996, le Gouvernement a déposé au Sénat en mai dernier un projet de loi modifiant sensiblement cette procédure. Il prévoit notamment la mise en place d'une procédure courte d'extradition lorsque la personne réclamée consent à sa remise, ces dispositions ayant vocation à s'appliquer aussi bien dans le cadre d'une demande classique d'extradition que dans celui de la procédure simplifiée prévue par la convention du 10 mars 1995, dans laquelle la remise peut être effectuée à partir d'une simple demande d'arrestation provisoire. Le texte proposé instaure également des délais de procédure devant les deux ordres de juridiction concernés : la chambre de l'instruction aurait ainsi trente jours pour examiner la demande d'extradition, ce délai étant ramené à sept jours lorsque la personne consent à sa remise ; le délai de recours pour excès de pouvoir contre les décrets du Premier ministre serait d'un mois, au lieu de deux actuellement. Enfin, le projet de loi supprime la phase politique dans le cadre de la procédure simplifiée en prévoyant que, dans ce cas, la décision judiciaire autorisant la remise vaut titre d'extradition. B. LES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION-CADRE RELATIVE AU MANDAT D'ARRET EUROPÉEN Le mandat d'arrêt européen a pour objet de remplacer le système actuel de l'extradition par un mécanisme qui impose à chaque autorité judiciaire nationale (autorité judiciaire d'exécution) d'accéder, avec des contrôles minimum, à la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre (autorité judiciaire d'émission). Le dispositif proposé, tout en contribuant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, cherche à préserver les droits individuels. La personne recherchée aura ainsi le droit de bénéficier des services d'un avocat et, si nécessaire, d'un interprète dès son arrestation, l'autorité judiciaire d'exécution devant obligatoirement se prononcer sur la nécessité de son maintien en détention en attendant sa remise. L'instauration de délais devrait, par ailleurs, contribuer au respect du délai raisonnable garanti par la Cour européenne des droits de l'homme. Le préambule de la décision-cadre, dans son considérant n° 12, rappelle que « rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ». De même, la décision-cadre ne doit pas empêcher un État membre d'appliquer ses règles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d'association et à la liberté de la presse. Enfin, l'article premier de ce texte rappelle que cette nouvelle procédure ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. a) Le champ d'application du mandat d'arrêt européen Cette procédure pourra être utilisée lorsque la personne recherchée aura fait l'objet soit d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou à une mesure de sûreté d'au moins quatre mois, soit de poursuites pénales pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté d'au moins un an dans l'État membre d'émission (article 2). Le principe de la double incrimination est écarté pour une liste de trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'État d'émission. Parmi ces infractions figurent notamment la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants, la corruption, l'homicide, l'enlèvement, les actes de racisme et de xénophobie et le viol. Cette liste pourra être complétée à tout moment par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Pour les autres infractions, la remise de la personne recherchée pourra être subordonnée à la condition que les faits en cause constituent une infraction au regard de l'État membre. b) Les motifs de refus d'exécution Outre les cas dans lesquels l'autorité judiciaire d'exécution devra refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen (article 3), la décision-cadre énumère les cas dans lesquels ce refus d'exécution sera une simple possibilité (article 4). Dans tous les cas, le refus d'exécution devra être motivé. Les cas de refus obligatoires sont les suivants : - l'infraction est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution ; - un jugement définitif a déjà été rendu par un État membre pour la même infraction contre la même personne (règle du non bis in idem) ; - la personne concernée ne peut pas être considérée comme responsable par l'État membre d'exécution en raison de son âge. Le refus d'exécution sera, en revanche, une simple possibilité lorsque les faits en cause ne constituent pas une infraction dans l'État membre d'exécution, lorsque la personne recherchée est poursuivie pour les mêmes faits dans l'État membre d'exécution, lorsque les autorités judiciaires d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites pour ces faits, d'y mettre fin ou que la personne recherchée fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les même faits, lorsque la peine ou l'action pénale sont prescrites dans l'État membre d'exécution, lorsque la personne recherchée a été jugée pour les mêmes faits par un pays tiers et qu'elle a exécuté ou est en train d'exécuter sa condamnation, lorsque l'État membre s'engage à exécuter la peine à laquelle la personne recherchée a été condamnée ou lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions commises sur le territoire de l'État membre d'exécution ou hors du territoire de l'État membre d'émission. Dans certains cas, l'exécution du mandat d'arrêt européen pourra être subordonnée à l'existence de garanties spécifiques (article 5). Ainsi, lorsque le jugement aura été rendu par défaut, l'autorité judiciaire d'émission devra garantir que la personne aura la possibilité d'être à nouveau jugée en sa présence. De même, lorsque la condamnation aura un caractère perpétuel, l'exécution du mandat d'arrêt pourra être subordonnée à l'existence dans l'État membre d'émission de dispositions permettant la révision de la peine infligée. Enfin, lorsque la personne recherchée sera ressortissante de l'État membre d'exécution, la remise pourra n'être accordée que si la personne, après avoir été entendue, pourra subir la peine qui lui aura été infligée dans l'État d'exécution. La remise des ressortissants nationaux sera donc désormais possible, la seule restriction tenant à la possibilité de subordonner cette remise à la condition que l'intéressé effectue sa peine dans l'État d'exécution. L'existence d'immunités ne constituera plus, en tant que telle, un motif de non exécution du mandat d'arrêt, comme le prévoyait le texte proposé par la Commission européenne. Seule l'impossibilité d'obtenir la levée de l'immunité de la personne recherchée pourra conduire l'autorité judiciaire à ne pas exécuter le mandat d'arrêt européen (article 20). 2. Les dispositions de procédure La décision-cadre prévoit que l'autorité judiciaire d'émission communiquera le mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire d'exécution, le cas échéant avec l'aide d'Interpol, du système d'information Schengen ou du réseau judiciaire européen. a) Les droits de la personne recherchée Lorsqu'une personne recherchée sera arrêtée, elle sera informée du contenu du mandat d'arrêt européen et de la possibilité de consentir à sa remise. Elle aura le droit de bénéficier d'un avocat et d'un interprète. L'autorité judiciaire devra alors décider, conformément au droit en vigueur, si le maintien en détention est nécessaire. La durée de cette éventuelle détention devra être déduite de la durée de privation de liberté infligée dans l'État d'émission. Le consentement à la remise et l'éventuelle renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité devront être donnés devant l'autorité judiciaire, « dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent », cette formulation étant identique à celle figurant dans les conventions de 1995 et 1996 relatives à l'extradition. Ce consentement sera en principe irrévocable, sauf déclaration expresse des États membres (article 13). L'article 27 de la décision-cadre donne également la possibilité aux États membres de décider que le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie ou détenue pour une infraction commise avant sa remise, sauf si l'autorité judiciaire d'exécution en décide autrement. b) Les délais et les modalités d'exécution du mandat européen Lorsque la personne recherchée consentira à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt devra être prise dans un délai de dix jours à compter de ce consentement. Dans les autres cas, la décision définitive devra intervenir dans les soixante jours suivant son arrestation (article 17). Lorsque le mandat d'arrêt ne pourra pas être exécuté dans les délais prévus, ceux-ci pourront être prolongés de trente jours, sur demande motivée de l'autorité judiciaire d'exécution. La décision-cadre fixe par ailleurs à dix jours, à compter de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, le délai dans lequel la personne devra être remise à l'autorité judiciaire d'émission. Toutefois, il est précisé que cette remise pourra être différée pour des « raisons humanitaires sérieuses », comme la mise en danger de la vie ou de la santé de la personne recherchée, ou pour permettre à la personne recherchée d'être poursuivie par l'État membre d'exécution pour des faits autres que ceux visés par le mandat d'arrêt. En présence d'un certain nombre de renseignements (identité de la personne recherchée, nature de l'infraction..), chaque État membre devra autoriser le transit à travers son territoire de la personne recherchée. La décision-cadre remplacera, à compter du 1er janvier 2004, les autres textes existant en la matière, notamment la convention du 13 décembre 1957 et les conventions du 10 mars 1995 et du 27 septembre 1996, les États membres restant toutefois libres d'appliquer ou de conclure des accords facilitant ou simplifiant davantage les procédures de remise. Les États membres ont cependant la possibilité de déclarer qu'ils continueront à appliquer les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux demandes portant sur des faits commis avant une date déterminée. La France a décidé d'utiliser cette disposition et d'appliquer la procédure classique d'extradition aux faits commis avant le 1er novembre 1993, date d'entrée en vigueur du Traité de Maastricht. III. - UNE TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS QUI NÉCESSITE UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE PRÉALABLE La transposition législative de la décision-cadre suppose une révision substantielle de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, qui dépasse largement le projet de loi déposé en mai dernier au Sénat sur cette question. Il convient d'observer, à cet égard, que ce dernier projet de loi, une fois le mandat d'arrêt européen mis en place, n'aura qu'une utilité marginale, s'agissant notamment de ses dispositions d'application des conventions de 1995 et 1996, puisqu'il ne sera applicable qu'aux demandes d'extradition portant sur des faits commis avant le 1er novembre 1993. Saisi par le Gouvernement d'une demande d'avis sur la compatibilité de la transposition de la décision-cadre avec les règles ou principes à valeur constitutionnelle, le Conseil d'État a jugé qu'elle nécessitait, au préalable, une modification de la Constitution. 1. Le contrôle de constitutionnalité du droit communautaire dérivé Le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux revient en priorité au Conseil constitutionnel qui, en vertu de l'article 54 de la Constitution, peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou sénateurs de la constitutionnalité d'un engagement international. Lorsque le juge constitutionnel estime que le traité soumis à son examen comporte une ou plusieurs dispositions contraires à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. C'est ainsi que la haute juridiction s'est prononcée en 1992 sur la constitutionnalité du Traité de Maastricht et en 1997 sur celle du Traité d'Amsterdam. En application de l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'État, le Gouvernement peut également solliciter l'avis de la juridiction administrative sur les problèmes de droit posés par un traité avant la signature de celui-ci. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction administrative peut relever l'incompatibilité de certaines dispositions de l'engagement international avec la Constitution, comme elle l'a fait dans l'avis du 24 septembre 1996 sur la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le contrôle de constitutionnalité des actes de droit communautaire dérivé se pose dans des termes différents. On peut tout d'abord s'interroger sur l'utilité d'un tel contrôle, dans la mesure où ces actes sont élaborés sur la base de traités ratifiés, le cas échéant après révision de la Constitution, et donc supposés conformes à celle-ci. Cette présomption de constitutionnalité se heurte cependant à un problème pratique, les traités ne constituant qu'un cadre pour l'élaboration d'actes communautaires traitant de sujets très variés. Ainsi, la conformité à la Constitution du principe de coopération judiciaire en matière civile et pénale, qui semble découler de la décision du Conseil Constitutionnel du 31 décembre 1997 sur le Traité d'Amsterdam, ne doit pas empêcher de s'interroger sur la constitutionnalité du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, « pierre angulaire » de la coopération judiciaire. Comme le souligne d'ailleurs Olivier B. Dord dans un article consacré au contrôle de constitutionnalité des actes communautaires dérivés (4), la ratification du Traité d'Amsterdam contribue à accroître les risques de confrontation entre Constitution et actes dérivés, les matière concernées par la communautarisation du troisième pilier « relevant par nature des compétences régaliennes des États ». Si la nécessité de s'interroger sur la compatibilité des actes communautaires dérivés avec la Constitution ne semble guère contestable, les modalités de ce contrôle sont plus contestées. Malgré les analyses en ce sens de certains auteurs (5), la saisine du Conseil constitutionnel sur la base de l'article 54 de la Constitution ne semble pas pouvoir être utilisée pour contrôler la constitutionnalité du droit communautaire dérivé, puisque cet article vise expressément les engagements internationaux soumis à ratification ou à approbation, ce qui n'est, à l'évidence, pas le cas des règlements, directives ou décisions-cadres. Si le Conseil constitutionnel s'est estimé compétent pour connaître de recours fondés sur l'article 54 de la Constitution dirigés contre deux « décisions » du Conseil des communautés européennes concernant respectivement l'adoption d'un système de ressources propres et l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, c'est avant tout parce qu'il a considéré que ces « décisions » pouvaient en fait être assimilées à des engagements internationaux , leur entrée en vigueur étant subordonnée à leur adoption par les États membres selon leurs règles propres. Certains parlementaires ont souhaité introduire dans la Constitution un nouvel article prévoyant expressément un contrôle de constitutionnalité préventif des projets d'actes communautaires, qui aurait été exercé par le Conseil constitutionnel (6), mais ces initiatives n'ont pas abouti. Le Conseil constitutionnel pourrait exercer, sur la base de l'article 61 de la Constitution, un contrôle a posteriori des actes communautaires à l'occasion de l'examen d'une loi de transposition. Mais ce contrôle est jusqu'à présent demeuré théorique, la juridiction constitutionnelle n'ayant pas eu l'occasion de se prononcer sur une telle question. C'est en fait au Conseil d'État qu'il revient de contrôler les actes de droit communautaire dérivé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88-4 de la Constitution. Cet article, adopté lors de la révision constitutionnelle de 1992, oblige le Gouvernement à transmettre à l'Assemblée nationale et au Sénat les projets ou propositions d'actes communautaires comportant des dispositions législatives, les assemblées pouvant voter des résolutions sur ces textes. En 1993, le Premier ministre a décidé de saisir le Conseil d'État de l'ensemble des propositions d'actes communautaires, confiant à ce dernier le soin de se prononcer sur leur nature législative ou réglementaire et de soulever toute question de droit utile, notamment celles portant sur leur éventuelle incompatibilité avec la Constitution. Il semble cependant, malgré le nombre d'actes ainsi transmis au Conseil d'État, que celui-ci n'ait relevé qu'une seule fois un problème de constitutionalité, à l'occasion de l'examen du projet de directive sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (7). Le Gouvernement s'est d'ailleurs par la suite prévalu de cet avis pour solliciter la modification de la directive. L'avis du Conseil d'État du 26 septembre 2002 déclarant inconstitutionnelle la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen n'a pas été rendu dans ce cadre. Le Premier ministre a en effet utilisé la possibilité, offerte par l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée, de saisir la haute juridiction administrative d'une question de droit, en lui demandant « si la transposition en droit français, par la voie législative, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est de nature à se heurter à des obstacles tirés de règles ou de principes de valeur constitutionnelle, notamment en ce que ladite décision-cadre exclut que l'État d'exécution du mandat d'arrêt européen puisse se fonder sur le motif tiré du caractère politique de l'infraction pour refuser la remise à l'État d'émission de la personne recherchée ». 2. La jurisprudence du Conseil d'État en matière d'extradition Dans le cadre de son rôle consultatif et de son activité contentieuse, le Conseil d'État a été amené, à plusieurs reprises, à se prononcer sur la valeur constitutionnelle de certains principes fondamentaux du droit de l'extradition. Dans un avis du 24 novembre 1994, il a ainsi considéré que la règle selon laquelle un ressortissant français ne pouvait être extradé ne constituait pas un principe de valeur constitutionnelle, malgré la pratique ininterrompue suivie en la matière, « aucun des droits et libertés du citoyen, tels qu'ils ont été proclamés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le préambule de la Constitution de 1946 [n'impliquant] que les nationaux ne puissent être extradés ». La juridiction administrative a, en revanche, dégagé deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tirés de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, aux termes duquel l'extradition n'est pas accordée lorsque l'infraction revêt un caractère politique ou que l'extradition est demandée dans un but politique. Dans un avis du 9 novembre 1995 portant sur la constitutionnalité d'un projet de convention relatif à l'amélioration de l'extradition entre les États membres de la Communauté, elle a ainsi estimé « qu'eu égard à la constance et à l'ancienneté de la règle exprimée par la loi du 10 mars 1927 et par les conventions signées par la France, le principe selon lequel l'État doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour les infractions qu'il considère comme des infractions à caractère politique constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du préambule de la Constitution de 1946 ». Sans analyser en détail la notion d'infraction politique, qui a donné lieu à une abondante littérature, rappelons simplement que cette notion s'apprécie en fonction de la nature des faits en cause, les atteintes à la sûreté de l'État (trahison, espionnage par exemple) (8) et les délits de presse étant généralement considérés comme des infractions politiques, ou en fonction du mobile qui a guidé leurs auteurs. Ce dernier critère a cependant été remis en cause à la fin des années soixante-dix par les juridictions françaises, qui refusent désormais la qualification d'infraction politique aux infractions de droit commun d'une certaine gravité, quand bien même les motivations de leurs auteurs auraient été politiques. Le caractère démocratique de l'État requérant est également pris en compte dans l'appréciation de la qualification de l'infraction. La valeur constitutionnelle de l'interdiction d'extrader lorsque la demande est formulée dans un but politique a été reconnue au contentieux, dans un arrêt d'assemblée rendu le 3 juillet 1996 (arrêt Moussa Koné). Tout en rejetant la demande d'annulation d'un décret d'extradition, le Conseil d'État a considéré que le principe selon lequel « l'État doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique » constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Certains auteurs n'ont pas manqué de s'interroger sur la compétence du Conseil d'État pour formuler des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment lorsque ce dernier statue au contentieux. En effet, si les avis de 1994 et 1995 avaient pour objet de répondre à des questions précises du Premier ministre et ont été rendus « sous réserve de l'appréciation du Conseil constitutionnel », il n'en n'est pas de même pour l'arrêt du 3 juillet 1996, à l'occasion duquel la juridiction administrative a dégagé de façon prétorienne un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil d'État a, certes, déjà eu l'occasion de consacrer un tel principe, avec l'arrêt « Amicale des Annamites de Paris » qui reconnaît une valeur constitutionnelle à la liberté d'association, mais sa décision date de 1956, à une époque où il n'existait pas de juge constitutionnel. Comme le souligne Xavier Prétot (9), « le Conseil constitutionnel devant désormais veiller à l'application de l'ensemble des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle, on ne saurait tenir pour certaine la compétence des juridictions ordinaires pour formuler des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Et l'auteur d'ajouter : « Il est peu probable, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel rejoigne le Conseil d'État et érige à son tour l'interdiction d'extrader pour motifs politiques au nombre des principes fondamentaux ». Plus généralement, cette compétence peut contribuer à susciter des contradictions de jurisprudence avec la juridiction constitutionnelle, comme le relève d'ailleurs François Julien-Laferrière (10). Par ailleurs, au-delà de ces interrogations de principe, on peut légitimement s'étonner que la juridiction administrative, saisie, dans le cadre de la procédure de l'article 88-4 de la Constitution, de la proposition de décision-cadre de la Commission européenne relative au mandat d'arrêt européen, n'ait pas rappelé au Gouvernement ces deux principes constitutionnels, afin que ceux-ci soient pris en compte lors de l'élaboration du texte final, comme ce fut le cas lors de l'examen de la proposition de directive sur la protection des données à caractère personnel. Or, les observations du Conseil d'État sur la proposition de décision-cadre du 19 septembre 2001 se contentent se « souligner l'importance et le caractère particulièrement délicat [de la proposition] au regard des principes traditionnels du droit de l'extradition ». Si l'interdiction d'une remise formulée dans un but politique figure bien dans le préambule de la décision-cadre adoptée, aucune disposition spécifique ne traite du cas des infractions à caractère politique. Cette lacune n'a pas échappé aux initiateurs de la saisine du Conseil d'État, qui ont ciblé la demande d'avis sur le problème posé par l'impossibilité de refuser de remettre à l'État d'émission l'auteur d'une infraction à caractère politique. 3. L'analyse du Conseil d'État Après avoir décrit brièvement le contenu de la décision-cadre, le Conseil d'État rappelle, dans un paragraphe de principe sur les normes de référence applicables, que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions du préambule de la Constitution de 1946, puisse être transposée en droit interne une décision-cadre ayant pour conséquence de substituer aux relations de coopération classique entre États membres un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale. Il précise toutefois qu'une telle transposition nécessite une révision de la Constitution si la décision-cadre comporte des dispositions « contraires à la Constitution ou à des principes de valeur constitutionnelle, mettant en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». Ces dispositions reprennent, pratiquement au mot près, les considérants de principe figurant dans les décisions du Conseil constitutionnel prises sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, notamment dans celle du 22 janviers 1999 relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale, qui pour la première fois mentionne les « droits et libertés constitutionnellement garantis ». On observera, toutefois, que la référence aux principes de valeur constitutionnelle, parmi lesquels figurent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, est absente des décisions de la juridiction constitutionnelle. Le Conseil d'État examine ensuite différents points de la décision-cadre, qui, selon lui, ne contreviennent pas « à des principes ou à des règles constitutionnelles ». La possibilité d'extrader des nationaux ne soulève pas de difficultés constitutionnelles, la pratique suivie jusqu'à présent par les autorités françaises de refuser dans tels cas l'extradition ne trouvant « pas de fondement dans un principe de valeur constitutionnelle ». De même, la règle de la double incrimination, écartée par la décision-cadre pour trente-deux catégories d'infractions, ne peut « être regardée comme l'expression d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens où l'a entendu le préambule de la Constitution de 1946 ». Si le Conseil d'État considère que la nécessité pour l'État d'émission d'apporter la preuve que l'infraction en cause est punissable en vertu de sa loi nationale « répond à des exigences constitutionnelles », c'est aussitôt pour préciser que la décision-cadre répond à cette exigence, en permettant à l'État d'exécution de s'assurer que l'infraction figure sur la liste « positive » et qu'elle est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. La juridiction administrative relève également que l'amnistie et la prescription constituent un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen, permettant ainsi de respecter les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Il convient, en effet, de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale, avait estimé que le fait d'arrêter et de remettre à cette juridiction une personne à raison faits amnistiés ou prescrits constituait une atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Le Conseil d'État estime, par ailleurs, que la décision-cadre « satisfait aux exigences constitutionnelles en matière d'asile », faisant valoir que son article 1er, qui rappelle qu'elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, suffit à garantir ce droit. Rappelons que l'article 6 de ce traité renvoie aux principes fondamentaux garantis par la convention européenne des droits de l'homme et à ceux résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire. Le considérant n° 12 du préambule de la décision-cadre, qui dispose que « rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire [...] que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons », est cité à l'appui de cette analyse. L'article 1er et le considérant n° 12 du préambule sont également invoqués pour souligner que l'État d'exécution pourra refuser la remise d'une personne lorsqu'il aura des raisons de croire que la demande de remise a été émise dans un but politique, respectant ainsi le principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil d'État. La juridiction administrative estime, en revanche, que la décision-cadre « ne paraît pas assurer le respect du principe [...] selon lequel l'État doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour des infractions qu'il considère comme des infractions politiques ». Le caractère politique de l'infraction ne figure pas, en effet, parmi les motifs de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, si la prohibition de l'extradition pour les délits politiques existe dans certains pays européens, le Conseil d'État estime qu'en l'absence de jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur ce point, il est difficile d'affirmer qu'il existerait en la matière un principe général de l'ordre juridique communautaire s'imposant « comme une règle d'interprétation de la décision-cadre dans un sens garantissant le respect du principe constitutionnel mentionné ci-dessus ». Il convient, à cet égard, de souligner que la France semble être le seul pays, parmi les six États qui se sont engagés à mettre en _uvre le mandat d'arrêt européen dès le début de l'année prochaine, à procéder à une révision de sa loi fondamentale. En effet, bien que l'interdiction de toute extradition pour des délits politiques figure dans les constitutions espagnole (11) et italienne (12), ces deux pays s'apprêtent à transposer en droit interne la décision-cadre sans avoir modifié au préalable leur loi fondamentale. D'après les informations fournies au rapporteur, les autorités concernées, pour justifier l'absence de révision constitutionnelle préalable, s'appuient notamment sur la possibilité de refuser la remise d'une personne poursuivie pour un motif politique, prévue par le considérant n° 12 du préambule de la décision-cadre, ne faisant ainsi pas de distinction entre une remise demandée dans un but politique et une remise pour une infraction politique, contrairement à la jurisprudence française, plus exigeante sur ce point. B. UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE CIBLÉE 1. Le choix d'une formulation restrictive Comme le Conseil Constitutionnel dans ses décisions rendues au titre de l'article 54 de la loi fondamentale, le Conseil d'État s'est contenté de relever les dispositions inconstitutionnelles de la décision-cadre, laissant au pouvoir exécutif le soin de définir les modalités de la révision. Celle-ci aurait pu être l'occasion de constitutionnaliser le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice qui, s'il constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire européenne, ne figure pas en tant que tel dans les traités européens. Le Gouvernement a choisi la voie de la prudence et a retenu une formule restrictive, qui ne mentionne que les règles relatives au mandat d'arrêt européen. Si ce choix est aisément justifiable, notamment parce qu'il n'existe pas pour l'instant, semble-t-il, d'autre application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice susceptible de soulever des difficultés d'ordre constitutionnel, il met en relief l'insuffisance du contrôle préventif exercé sur les propositions d'actes communautaires, ce dernier n'ayant n'a pas permis d'éviter une révision constitutionnelle. Ce point a d'ailleurs été souligné par le président de la délégation pour l'Union européenne qui, dans sa communication du 10 décembre dernier, a notamment suggéré un renforcement du contrôle exercé par le Conseil d'Etat et la mise en place, à l'échelle communautaire, d'un mécanisme d'alerte précoce en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des États membres impliquant la saisine de la Cour de justice. 2. Un complément à l'article 88-2 de la Constitution L'article unique du projet de loi constitutionnelle complète l'article 88-2 de la Constitution. Cet article, créé lors de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Maastricht en 1992, ne comportait à l'origine qu'un alinéa disposant que « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévus par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne ». La loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 a proposé une nouvelle rédaction de l'article 88-2, destinée à permettre la ratification du Traité d'Amsterdam. A cet effet, elle a limité le premier alinéa aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire et complété l'article par un nouvel alinéa disposant que « Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du Traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés », cette formule générale permettant de prendre en compte la question du franchissement des frontières extérieures des États membres. Le présent projet de loi constitutionnelle modifie une nouvelle fois l'article 88-2 en le complétant par un alinéa qui précise que « Sont fixées par la loi les règles relatives au mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions des décisions-cadres prises par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du Traité mentionné au premier alinéa ». Dans la mesure où la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen constitue un acte communautaire dérivé pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne mentionné à l'article 88-2, il semble, en effet, préférable de modifier cet article plutôt que de créer un article spécifique pour cette nouvelle procédure, qui alourdirait inutilement la Constitution. L'absence de référence à la réserve de réciprocité se justifie par la nature même de la décision-cadre, qui, à la différence des traités, s'applique même en l'absence de réciprocité. Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans une décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998 portant sur la loi organique relative au droit de vote des ressortissants européens, la réciprocité doit en effet être appréciée au niveau de la procédure de ratification des traités, et non pas à l'intérieur même des structures européennes, puisque celles-ci prévoient déjà des mesures de sanctions en cas de manquement aux obligations communautaires. Comme pour les révisions précédentes, la formule retenue fait référence à l'ensemble des règles relatives au mandat d'arrêt européen, et non uniquement à celle soulevant des difficultés constitutionnelles. Le renvoi à la pluralité des décisions-cadres permet d'assurer la sécurité juridique de la transposition en droit interne de la décision-cadre du 13 juin 2002, mais également celle des éventuels instruments qui viendraient la modifier ou la compléter. C'est la première fois que le Gouvernement choisit de recourir à une formule élargie permettant de rendre a priori constitutionnelles les éventuelles modifications apportées à l'instrument juridique objet de la révision. Lors de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité créant la Cour pénale internationale, le rapporteur, M Alain Vidalies, avait tenu à rappeler que la formulation retenue par le projet de loi, en faisant référence au Traité signé le 18 juillet 1998, paraissait « écarter une conformité a priori des futurs amendements qui pourraient y être apportés », ajoutant que « toute modification du Traité signé à Rome le 18 juillet 1998 [nécessiterait] donc, le cas échéant, une nouvelle révision constitutionnelle ». Tout en comprenant les motifs qui ont conduit le Gouvernement à retenir cette « présomption de conformité » à la Constitution, on peut s'interroger sur l'opportunité de faire figurer une référence aux décisions-cadres dans la loi fondamentale, à l'heure où les réformes institutionnelles envisagées remettent en cause l'existence de cette procédure. L'ensemble de ces raisons a conduit le rapporteur à proposer à la Commission une nouvelle rédaction de l'article unique du projet de loi constitutionnelle disposant que « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen prises sur le fondement du traité mentionné au premier alinéa ». * Tout en exprimant son accord avec l'évolution des normes européennes, qui contribue à rendre plus effective l'exécution des décisions de justice, le président Pascal Clément s'est interrogé sur l'utilité de la révision constitutionnelle proposée. Il a regretté, à cet égard, que le Conseil d'État érige de nouveaux principes constitutionnels, estimant que la juridiction administrative devait se limiter à appliquer les règles constitutionnelles dégagées par le Conseil constitutionnel. Évoquant la rédaction de l'article unique, il a jugé souhaitable, comme le rapporteur, de faire disparaître toute référence à la procédure de décision-cadre, qui risque de devenir bientôt obsolète, et fait valoir que le projet de loi initial, en renvoyant à la pluralité des décisions-cadres, validait également a priori les modifications qui seraient ultérieurement apportées au mandat d'arrêt européen. M. Gérard Léonard s'est interrogé sur la portée que pouvaient ainsi revêtir les avis du Conseil d'État, estimant que, dans ce cas précis, le législateur n'était pas tenu de suivre les observations de la juridiction administrative, qui ne s'est pas contentée d'appliquer les principes dégagés par le Conseil constitutionnel, mais a examiné un texte au regard de ses propres normes constitutionnelles. Tout en jugeant nécessaire de suivre les évolutions institutionnelles européennes, il a regretté que la loi fondamentale devienne aussi instable, estimant que cette révision constitutionnelle inutile contribuait à cette dérive. Après avoir jugé inadaptée la rédaction initiale de l'article unique, il a approuvé celle proposée par le rapporteur, observant néanmoins qu'elle présentait l'inconvénient de rendre constitutionnelles de futures modifications du dispositif relatif au mandat d'arrêt européen. Tout en déclarant partager certaines réserves exprimées par M. Gérard Léonard, le rapporteur a jugé plus prudent de s'en tenir à l'avis du Conseil d'État. Après avoir rappelé qu'il avait, dans un premier temps, envisagé de faire référence à la seule décision-cadre du 13 juin 2002, il a observé que cette solution, de portée très limitée, n'était pas adaptée à la solennité de la loi fondamentale. La Commission a ensuite rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 présentées par M. Alain Bocquet et les membres du groupe des député-e-s Communistes et Républicains. Puis, elle a adopté l'amendement présenté par le rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article unique. * En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter l'article unique du projet de loi constitutionnel relatif au mandat d'arrêt européen modifié par l'amendement n° 1 figurant au tableau comparatif ci-après . ___
· Avis du Conseil d'État du 26 septembre 2002. 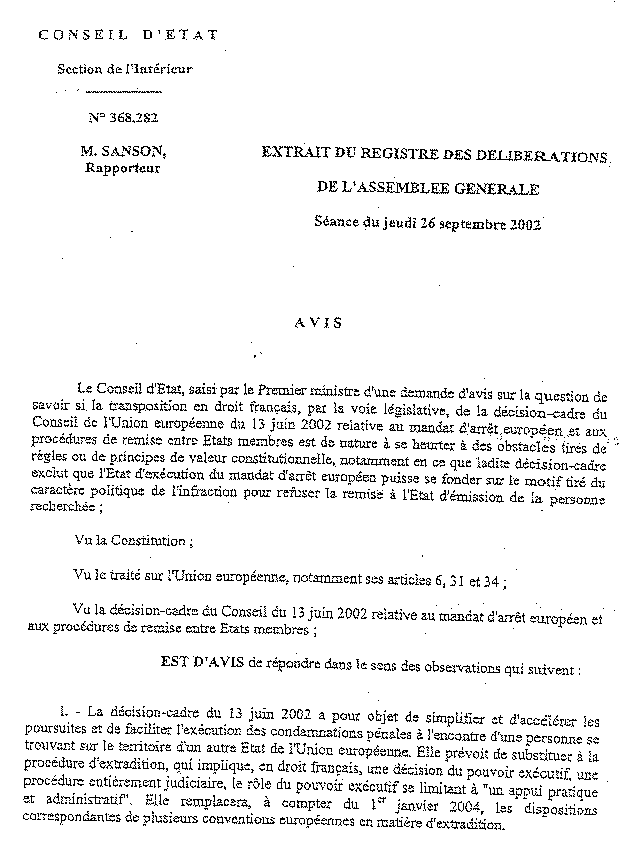 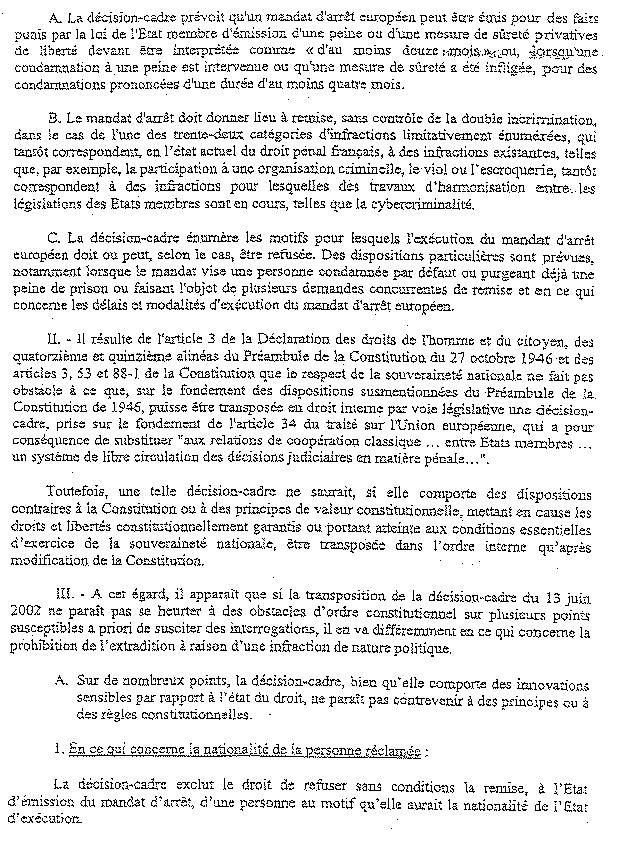 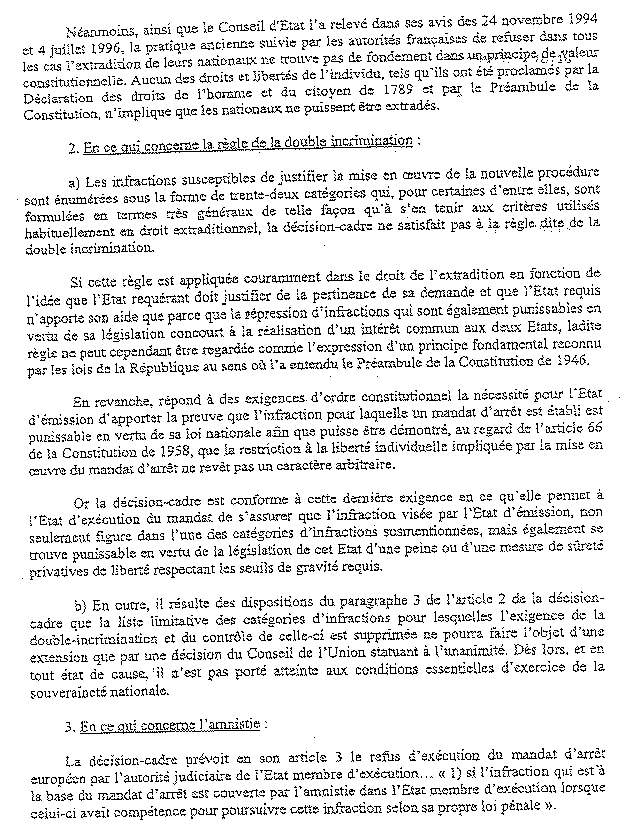 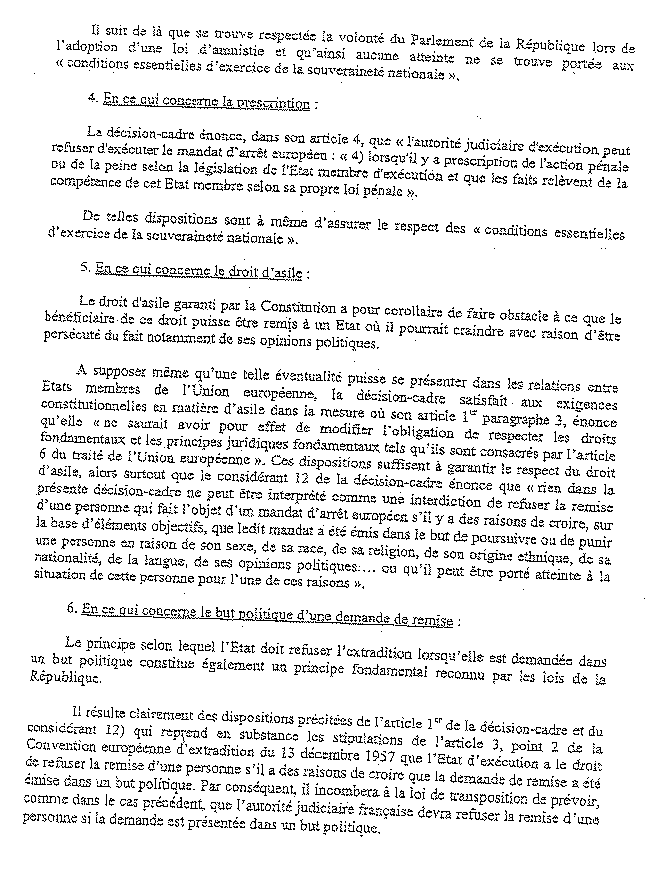 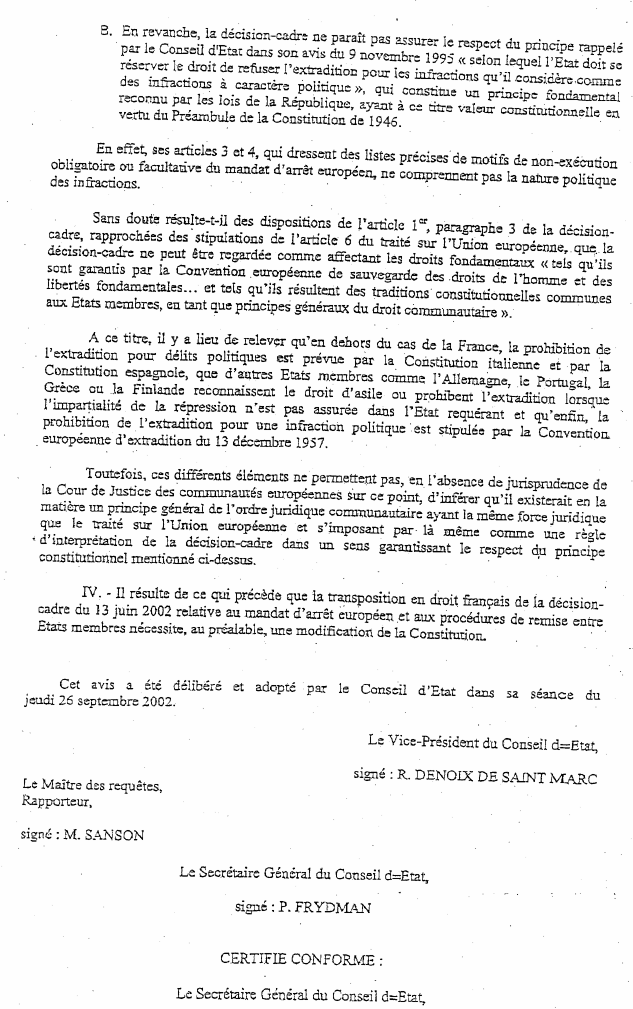 1 () La France est, avec l'Italie, le seul pays à n'avoir pas encore ratifié ces deux conventions. 2 () Vingt jours pour les pays limitrophes, un mois pour les pays européens non limitrophes et trois mois pour les autres. 3 () Le délai moyen d'extradition est alors d'environ six mois. 4 () Cahiers du Conseil constitutionnel n° 4. 5 () L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 6 () Propositions de loi constitutionnelle de MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandraud et de M. Jacques Oudin en mai et juin 1993 ; amendement de Mme Nicole Catala en juin 1992, à l'occasion du débat sur la révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Maastricht. 7 () Voir les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 4. 8 () Le code pénal punit les crimes politiques d'une peine de détention criminelle et les crimes de droit commun d'une peine de réclusion criminelle. 9 () La semaine juridique 1996 n°44-45. 10 () Recueil Dalloz 1996, Jurisprudence p. 509. 11 () L'article 13 de la Constitution espagnole dispose que « Les délits politiques sont exclus de l'extradition », les actes de terrorisme n'étant pas considérés comme tels. 12 () L'article 10 de la Constitution italienne dispose que « L'extradition d'un étranger pour des infractions politiques n'est pas admise ». ------------- N° 0463 - Rapport sur le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d'arrêt européen (M. Xavier de Roux)
© Assemblée nationale |