
N° 3806
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2011.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2012
TOME IX
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VIE ÉTUDIANTE
Par Mme Martine FAURE,
Députée.
___
Voir les numéros : 3775, 3805 (annexe n° 35).
A. UNE AUGMENTATION DES MOYENS À RELATIVISER 7
1. Un engagement présidentiel non tenu 7
2. Un système d’allocation des moyens aux universités « SYMPA » qui saupoudre les crédits 8
B. DES FILIÈRES DE FORMATION QUI RESTENT SOUS-DOTÉES 10
II.- LE « PLAN LICENCE » : UN BILAN CRITIQUE JUSTIFIANT UNE NOUVELLE AMBITION PÉDAGOGIQUE POUR L’UNIVERSITÉ 13
A. UN DISPOSITIF DONT L’EFFICACITÉ N’EST PAS DÉMONTRÉE 14
1. Un taux d’échec trop important à ce niveau d’études 14
2. Un foisonnement de mesures faiblement pilotées 15
3. Une carence structurelle : des méthodes d’enseignement ayant peu évolué 18
4. Une mise en œuvre freinée par le contexte budgétaire et la loi dite « LRU » 19
5. Un nouvel arrêté licence ne comportant pas que des points positifs 20
B. FAIRE DE LA RÉUSSITE EN LICENCE UNE PRIORITÉ 24
1. Préserver les spécificités de la licence 24
2. Mieux orienter les étudiants et multiplier les passerelles 27
3. Augmenter le taux d’encadrement pour révolutionner la pédagogie 32
4. Lutter contre les discriminants sociaux qui freinent la poursuite d’études 37
TRAVAUX DE LA COMMISSION 39
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 73
Le présent rapport pour avis porte sur deux programmes budgétaires de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Intitulés « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante », ils devraient progresser, l’année prochaine, de respectivement 226 millions d’euros (+ 1,84 %) et 86,2 millions d’euros (+ 4,14 %) en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2011.
Ces crédits étant examinés, en détail, par le rapporteur spécial de la Commission des finances, M. Laurent Hénart, la rapporteure pour avis se propose de faire une lecture synthétique et critique du budget de l’enseignement supérieur, avant d’esquisser un bilan de la politique menée par le gouvernement en faveur de la réussite en licence.
Celle-ci a débouché sur l’adoption, à la fin de l’année 2007, d’un « Plan pluriannuel pour la réussite en licence », doté de 750 millions d’euros sur cinq ans, et la rédaction d’un nouvel arrêté relatif au diplôme de licence, publié en août 2011, qui prévoit une augmentation des heures d’enseignement.
Ces mesures ont été prises sur la base d’un constat partagé : les études de licence, souvent choisies « par défaut » par certains bacheliers, sont encore trop souvent un synonyme d’échec. Ainsi, en 2009, d’après les indicateurs du dernier rapport annuel de performances de la mission, la part des licences obtenues en trois ans après une première inscription en L1 dans le total de licenciés n’était que de 36,4 % et la part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante n’était que de 44,3 %.
Au vu de ce contexte préoccupant, le plan pour la réussite en licence aura permis de mobiliser, au moins partiellement, la communauté universitaire autour de cet objectif et d’expérimenter des dispositifs variés d’accompagnement des étudiants.
Cependant, comme l’ont souligné les trente et une personnes entendues par la rapporteure pour avis, le foisonnement des initiatives de terrain ne peut tenir lieu de politique ambitieuse pour ce niveau d’études. Pour produire tous ses effets – en particulier sur le plan de l’efficacité pédagogique –, celle-ci devrait bénéficier de moyens plus conséquents. C’est seulement à cette condition que la licence pourrait rester le premier pilier de l’enseignement supérieur.
L’article 49 de la loi organique du 1er août 2001 fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires. La rapporteure pour avis a demandé que les réponses lui parviennent le 15 septembre 2011. À cette date, 0 % des réponses lui étaient parvenues. À la date butoir, ce pourcentage était de 66,6 %.
I.- UN BUDGET DE CONTINUITÉ : UNE HAUSSE EN TROMPE-L’œIL
L’enseignement supérieur constitue l’une des priorités budgétaires du gouvernement – c’est un fait. Cependant, force est de reconnaître que l’effort engagé en faveur de ce secteur est dispersé et peu lisible, car il s’appuie sur des leviers autres que les seuls crédits budgétaires – partenariats publics privés ou intérêts rapportés par le placement de la cession par l’État d’une partie de sa participation dans le capital d’EDF par exemple. En outre, le projet annuel de performances de la mission (ou « bleu budgétaire »), qui comprend près de 700 pages, ne permet pas de suivre aisément la progression des moyens d’une loi de finances à l’autre. Enfin et surtout, cette progression s’avère, en réalité, nettement moins importante que celle annoncée. De fait, elle ne permettra pas à la France de rattraper son retard en matière de financement des formations supérieures.
Le Président de la République a pris l’engagement d’accroître de cinq milliards d’euros les moyens de l’enseignement supérieur sur cinq ans. Comme le montre le tableau ci-après, cet engagement repose sur des montages budgétaires complexes et ne sera pas tenu, près de 685 millions d’euros manquant à l’appel.
La progression des moyens en faveur de l’enseignement supérieur
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Engagement du Président de la République | ||||
1 milliard d’euros supplémentaires |
1 milliard d’euros supplémentaires |
1 milliard d’euros supplémentaires |
1 milliard d’euros supplémentaires |
1 milliard d’euros supplémentaires |
Budget (en millions d’euros) | ||||
+ 922 dont : – 857 au titre des crédits budgétaires – 85 au titre du financement de l’entreprise Oséo – au titre des dépenses fiscales |
+ 1 154 dont : – 792 au titre des crédits budgétaires – 170 au titre des partenariats publics privés – 157 au titre des produits de cession d’EDF pour financer le plan Campus |
+ 995 dont : – 376 au titre des crédits budgétaires – 420 au titre des partenariats publics privés – 164 au titre des intérêts de l’opération Campus |
+ 706 dont : – 198 au titre des crédits budgétaires – 508 au titre des intérêts de l’opération Campus |
+ 540 dont : – 373 au titre des crédits budgétaires – 167 au titre des intérêts de l’opération Campus |
Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, budgets pour 2009, 2010, 2011 et 2012.
En outre, l’engagement de l’État auprès des établissements, des étudiants et des enseignants-chercheurs est « brouillé » par les investissements d’avenir du grand emprunt. Ouverts par la loi de finances rectificatives du 9 mars 2010, ceux-ci s’élèvent à 10 milliards d’euros au titre de l’enseignement supérieur et de la formation universitaire. Cependant, la majorité de ces crédits, soit 7,7 milliards d’euros, ne bénéficieront qu’à des campus d’excellence, dix au maximum, destinés à réunir, sur un même site, les meilleures universités, écoles et équipes de recherche (1).
Le gouvernement prend ainsi un risque considérable : celui de faire cohabiter, d’un côté, des « champions nationaux » à visibilité mondiale et, de l’autre, des établissements « de proximité », seuls les premiers bénéficiant de financements abondants. Une telle démarche ne peut être, au final, que contreproductive, l’émergence de grands pôles ne pouvant avoir lieu que si elle s’appuie sur un tissu universitaire solide, car dynamisé – et non pas fragilisé – par les arbitrages budgétaires. En outre, l’éligibilité au dispositif des investissements d’excellence étant conditionnée à l’amélioration de la gouvernance des sites « candidats », les établissements pourraient procéder à des rapprochements plus subis que réfléchis ou choisir, au contraire, de rester en retrait, avec la crainte que leur prudence ne soit sanctionnée par l’attribution, de la part du ministère, d’une enveloppe moins généreuse. Ainsi que le relève le comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, les établissements se trouvent, de fait, « confrontées à plusieurs systèmes d’incitations qui coexistent en parallèle », ce qui tend à complexifier les structures d’un système universitaire dont la lecture est jugée « déjà bien difficile » (2).
Dans ces conditions, l’accroissement du financement de l’enseignement supérieur, loin de former un cadre rassurant et structurant pour ses acteurs, peut être perçu, par ceux-ci, comme une source d’iniquité et d’anxiété.
Mis en œuvre pour la première fois en 2009 et servant à calculer la subvention de fonctionnement des universités, le nouveau modèle d’allocation des moyens, appelé SYMPA (3), répartit les emplois et les crédits fixés par la loi de finances en fonction de l’activité et de la performance des établissements.
Ainsi que le montre l’encadré ci-après, ce modèle est complexe et ne peut être considéré comme stabilisé, puisqu’il a été corrigé l’an dernier. D’ailleurs, il n’est même pas appliqué, le ministère de l’enseignement supérieur s’en étant affranchi. Ce dernier, en effet, ainsi que l’avait souligné, à l’époque, la Conférence des présidents d’université, a fait le choix, en janvier 2011, de répartir l’augmentation des crédits de manière uniforme, avec des taux de progression de 1,5 % et de 3 %.
Or ce qui, aux yeux du gouvernement, constitue un traitement équitable, conduit en réalité, non seulement à remettre en cause les principes mêmes du modèle SYMPA, mais à freiner la progression des moyens alloués aux universités : en effet, compte tenu de l’inflation, ceux-ci soit stagnent, soit augmentent de manière marginale.
Ce contexte faussé a pour conséquence, notamment, d’obliger les établissements à différer la mise en œuvre du référentiel national d’équivalences horaires établi par l’arrêté du 7 juillet 2009 alors que celui-ci, en prenant en compte l’ensemble des activités pédagogiques, d’animation et d’encadrement des enseignants-chercheurs, avait pour objectif de revaloriser ces personnels. Ainsi, en 2010, selon la secrétaire générale de Sup’recherche-UNSA, Mme Christine Roland-Lévy, les universités les moins dotées n’ont pas été en mesure de le mettre en œuvre, ce qu’elles ont pu faire en 2011, sans reconnaître pour autant l’ensemble des missions de ces personnels. Quant aux établissements les mieux « servis », ils n’ont pu qu’officialiser leurs pratiques, mais sans pouvoir aller au-delà. Pour ne prendre qu’un exemple, les enseignants-chercheurs de l’université de Metz n’ont perçu que 28 % des sommes auxquelles ils pouvaient prétendre.
Fonctionnement du modèle d’allocation des moyens aux universités
Les crédits disponibles sont répartis en deux enveloppes principales, enseignement et recherche, qui se décomposent, chacune, en deux sous enveloppes « activité » (représentant 80 % des moyens répartis, masse salariale comprise) et « performance » (20 % des moyens).
– Les moyens disponibles dans l’enveloppe activité/enseignement sont distribués au prorata du nombre d’étudiants présents aux examens de licence et de master, pondérés selon leur discipline et en tenant compte du nombre de boursiers. De leur côté, ceux de l’enveloppe activité/recherche sont répartis au prorata du nombre d’enseignants-chercheurs publiants, au sens de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), pondérés selon les domaines de recherche.
– Les moyens disponibles dans l’enveloppe performance/enseignement sont répartis en fonction de la valeur ajoutée des établissements en matière de réussite en licence et en institut universitaire de technologie (IUT) et du nombre de diplômés de master. Les moyens disponibles dans l’enveloppe performance/recherche sont répartis, pour les écoles doctorales, en fonction du nombre de docteurs, pondéré selon les domaines de recherche. Pour les crédits de recherche, hors écoles doctorales, la répartition est réalisée en fonction du nombre de chercheurs produisants pondéré selon les domaines de recherche et selon les cotations des unités mixtes de recherche fixées par l’AERES.
Les principales évolutions apportées au modèle en 2010 ont concerné : le poids respectif des enveloppes licence et master (porté respectivement à 58 % et 42 %) ; la prise en compte de la situation des universités de taille réduite ; enfin, le relèvement des pondérations des licences et masters tertiaires comme de la pondération des IUT.
Même si le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche met en avant la progression – égale, selon lui, à 18 % – de la dépense par étudiant intervenue, depuis 2006, à l’université, celle-ci reste le parent pauvre de l’enseignement supérieur. En effet, en s’appuyant sur la dépense intérieure d’éducation, qui inclut l’ensemble des dépenses pour les établissements publics et privés, les activités liées (bourses, administration, fournitures, etc.) et les coûts de la recherche (pour les seules universités), le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indique que la dépense moyenne par étudiant est une fois et demie plus élevée en classe préparatoire aux grandes écoles qu’à l’université, IUT compris, soit 15 240 euros contre 10 180 euros (aux prix de 2010) (4).
En ce qui concerne les dépenses cumulées par étudiant, la France se situe, par rapport aux autres pays industrialisés, en dessous de la moyenne des membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Dépenses des établissements cumulées par étudiant (y compris recherche)
pendant la durée moyenne de ses études
(en équivalents - dollars 2008)
Suède |
94 625 |
Finlande |
73 621 |
Allemagne |
68 913 |
Royaume-Uni |
66 485 |
Japon |
62 385 |
Espagne |
62 287 |
Moyenne de l’UE à 21 pays |
62 985 |
Moyenne des pays de l’OCDE |
57 775 |
France |
56 597 |
Irlande |
52 760 |
Belgique |
44 911 |
Source : OCDE Regards sur l’éducation, édition 2011
En outre, comme l’a établi un récent rapport du Centre d’analyse stratégique, organisme placé auprès du premier ministre et qui s’est substitué au Commissariat général au plan, notre pays se situe au bas de l’échelle concernant le taux d’encadrement dans l’enseignement supérieur, avec seulement 5 enseignants pour 100 étudiants.
S’agissant des personnels venant en appui des activités pédagogiques ou de recherche – bibliothécaires, administratifs, ingénieurs, ouvriers, etc. –, le sous encadrement de nos établissements est encore plus fragrant : ainsi que le rappelle M. Etienne Boisserie, président du conseil d’administration de Sauvons l’université, le taux d’encadrement n’est que de 1 pour 35 étudiants en France, contre 1 pour 7,5 en moyenne dans l’OCDE.
![]()
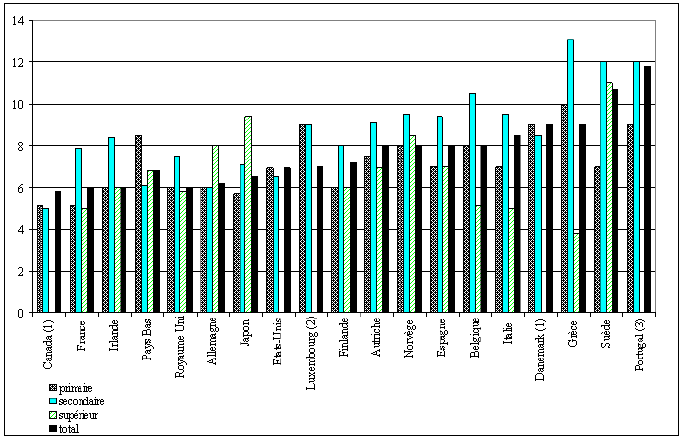
(1) en 2001
(2) en 2003
(3) en 2005
Source : Centre d’analyse stratégique, Tableau de bord de l’emploi public – situation de la France et comparaisons internationales, d’après des calculs établis sur la base des données de l’OCDE, décembre 2010.
La lecture du graphique ci-dessus est d’autant plus instructive qu’elle met en lumière le caractère structurel du retard affectant notre pays, car celui-ci concerne ce que la rapporteure pour avis considère être les pointes avancées du système éducatif : d’une part, les écoles, qui enseignent les « fondamentaux » et d’autre part, les établissements qui forment les élites.
II.- LE « PLAN LICENCE » : UN BILAN CRITIQUE JUSTIFIANT UNE NOUVELLE AMBITION PÉDAGOGIQUE POUR L’UNIVERSITÉ
Ouvert à « tous les titulaires du baccalauréat », conformément à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, le premier cycle universitaire devrait être un vecteur d’ascension sociale. Cependant, si, comme chacun le sait, l’enseignement supérieur s’est massifié, ses filières ne se sont pas démocratisées. La licence générale, surtout, connaît un taux d’échec trop important de ses étudiants, qui sanctionne les bacheliers ne disposant pas des « codes » scolaires et sociaux leur permettant de réussir leur orientation et leurs études universitaires. Par ailleurs, cet échec pèse sur la compétitivité de notre pays : avec seulement 44,6 % d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (5), la France n’atteint pas l’objectif de 50 % fixé à Lisbonne en 2000, un retard qui remet en cause notre contribution à la stratégie de croissance décidée avec nos partenaires européens.
Demandé et obtenu par les organisations étudiantes, le chantier de la réussite en licence a été ouvert par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’alors, Mme Valérie Pécresse, en juin 2007 et s’est traduit par l’annonce, en décembre, d’un plan pluriannuel. S’il obéissait à des considérations tactiques – en donnant des gages aux étudiants afin d’éviter toute contestation massive de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités –, il visait aussi à répondre à un réel besoin d’accompagnement, suscité par le passage, déstabilisant pour de nombreux bacheliers, de l’enseignement secondaire au supérieur.
On observera toutefois que cette politique s’inscrit dans une problématique – celle des enjeux de la formation au premier cycle – propre aux pays développés. À titre d’illustration, l’Association des universités et collèges du Canada a estimé que les établissements de ce pays ont, dans l’ensemble, « manqué à leur mission » : en effet, les universités – ce constat valant aussi pour la France – « ne se consacrent pas suffisamment à ce que l’on peut considérer comme leur mission première : offrir un enseignement et un parcours d’apprentissage de qualité aux étudiants au premier cycle », un accent « excessif » étant mis, depuis quinze ans, sur la recherche (6).
La rénovation du maillon le plus fragile, et aussi le plus fréquenté de l’enseignement supérieur – le cursus de licence ayant accueilli 750 000 étudiants en 2010 à l’université, hors instituts universitaires de technologie –, est-elle engagée ? Après plus de trois années d’application du plan « licence », on peut en douter, les moyens mis en œuvre n’étant pas à la hauteur du défi devant être relevé.
Couvrant les années 2008 à 2012, le plan pluriannuel pour la réussite en licence, qu’on appellera ici plan licence, répond à un double objectif : améliorer les taux de réussite au sein de ce cycle de formation, tout en le rendant plus attractif, et faire de la licence un diplôme doublement qualifiant, tant pour la poursuite d’études que pour l’insertion professionnelle.
Il appuie les initiatives prises à cet effet par les établissements, qui ont été déclinées autour de quatre grands axes : l’orientation et l’accueil des nouveaux étudiants ; le renforcement de l’encadrement pédagogique, notamment avec la mise en place d’enseignants référents, l’augmentation des horaires d’enseignement – avec un objectif de cinq heures de plus par semaine –, la réduction de la taille des groupes de travaux dirigés et la diversification des méthodes pédagogiques ; le suivi des étudiants en difficulté ; enfin, la professionnalisation, par la mise en place de stages, ainsi que par l’acquisition de compétences dites « transversales » – en particulier en langues vivantes étrangères.
Quel bilan peut-on tirer de ces efforts ? Selon l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, même si le plan licence bénéficie « à part quelques universités et unités de formation et de recherche, d’une réelle acceptabilité sociale, il laisse entière, à ce stade, l’interrogation sur son efficacité » (7). De fait, autant son existence est justifiée par le constat du taux d’échec en licence, inacceptable et coûteux sur le plan humain et économique, autant sa mise en œuvre a été partielle et partiale, car elle s’est heurtée à de puissants freins, notamment budgétaires.
L’échec est plus marqué à l’université que dans les autres filières de l’enseignement supérieur. Les enquêtes sur les « panels » étudiants indiquent ainsi que 81 % d’entre eux obtiennent un diplôme d’enseignement supérieur, mais que cette proportion tombe à 64 % pour ceux qui entrent à l’université (8). Cet échec est encore plus marqué lors de la première année d’études, puisque les trois quarts des bacheliers inscrits en licence qui sont entrés l’année du lancement du plan continuaient l’année suivante, mais 52 % seulement se retrouvaient en deuxième année (23 % redoublant, 19 % se réorientant et 6 % arrêtant leurs études). À l’inverse, 77 % des bacheliers inscrits en institut universitaire de technologie passaient en deuxième année (9).
Selon Mme Anne Fraïsse, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, ce phénomène s’explique, en partie du moins, par le caractère d’« année charnière » de la L1, au cours de laquelle l’étudiant découvre des conditions d’encadrement et une pédagogie qui ne sont pas les mêmes qu’au lycée. A contrario, si ce cap est franchi, on constate, le plus souvent, que l’étudiant est engagé, à partir de la deuxième année de licence, dans un parcours de réussite.
Cependant, le choc « pédagogique » que marque cette année de transition ne peut, à lui seul, expliquer l’échec de nombreux étudiants. Selon Mme Anne Fraïsse, certains étudiants, ceux par exemple qui ont une moyenne de 1,5 sur 20, loin d’être des « décrocheurs », n’ont parfois jamais « accroché », leur inscription à l’université pouvant notamment s’expliquer par les avantages liés au statut étudiant. Ce public « flottant », pour lequel un accompagnement pédagogique n’aurait pas de sens, est très difficile à quantifier si un repérage, reposant sur des entretiens, n’est pas mis en place.
D’autres étudiants, en revanche, décrochent car leur parcours antérieur ne les a clairement pas préparés aux exigences d’un parcours universitaire. C’est le cas en particulier des bacheliers technologiques et professionnels qui, outre le fait qu’ils doivent assimiler, par rapport à l’enseignement dispensé au lycée, la pédagogie hypothético-déductive, plus abstraite, de l’université, se sont souvent inscrits par défaut dans cette filière de formation. Pour la moitié de ces étudiants, en effet, la première année de licence n’est qu’une solution d’attente avant la réorientation vers la filière courte – institut universitaire de technologie ou section de technicien supérieur – qu’ils n’ont pu obtenir lors de la phase d’inscription. Comme le note un rapport de M. Christian Demuynck, sénateur, « trois étudiants sur dix s’orientent volontiers vers le L1 universitaire, mais à la fin cinq sur dix s’y trouvent orientés », faute de places dans la filière courte souhaitée. Dès lors, 57,2 % des bacheliers professionnels et 51,5 % des bacheliers technologiques quittent l’université en fin de première année (10).
Au vu de ce constat, le cycle licence devrait connaître des taux d’échec encore plus importants dans un proche avenir. En effet, à la suite de la réforme du lycée professionnel de 2009, le nombre de bacheliers issus de cette voie de formation et, par voie de conséquence, de ceux qui s’inscrivent à l’université devrait augmenter fortement (11). Or, ainsi que l’a rappelé le directeur général pour l’enseignement supérieur, M. Patrick Hetzel, le taux de réussite, en an, des deux premiers semestres de licence de ces jeunes n’est que de 7 %.
Le plan licence a eu, incontestablement, un effet « déclencheur ». Le comité de suivi de la licence a d’ailleurs constaté, lors de ses enquêtes, que toutes les universités avaient mis en place, à des degrés divers, des dispositifs d’accueil, de renforcement de l’encadrement pédagogique et de soutien aux étudiants en difficulté.
Extraits de la synthèse de l’enquête du comité de suivi de la licence
sur le fonctionnement de la licence (mars 2011)
L’enquête a été adressée aux 84 établissements concernés ; 69 d’entre eux y ont répondu, soit un taux de réponses de 83 %.
– Une prérentrée a été assurée par tous les établissements et pour 48 établissements (75 %) la durée consacrée à cette prérentrée a été de 2 à 5 jours. L’accueil personnalisé, sous forme d’entretiens individuels (13 %) ou par petits groupes (18,8 %), reste toutefois peu pratiqué.
– Les tests de positionnement ou d’évaluation sont peu organisés : 18,8 % seulement des établissements les ont généralisés et 60,9 % ne les organisent que pour une partie des étudiants.
– La quasi-totalité (98,5 %) des établissements déclare avoir prévu des dispositifs spécifiques d’accompagnement des étudiants repérés comme « fragiles », les critères les plus fréquemment retenus à cet effet étant les suivants : le type de baccalauréat obtenu (26 établissements) ; les avis donnés dans le cadre de la procédure d’inscription et d’orientation (11 établissements) ; les tests de positionnement ou d’évaluation (45 établissements) ; des entretiens prévus le plus souvent avec l’enseignant référent (16 établissements). Sur la base de ces repérages, ou bien du volontariat de certains étudiants, des enseignements de mise à niveau disciplinaires sont prévus par 93,3 % des établissements pour tous ou partie des étudiants et des enseignements méthodologiques sont organisés par 92,6 % d’entre eux. Le nombre d’étudiants concernés par des enseignements de mise à niveau est très variable selon les établissements : dans la plupart des cas, ils sont plus d’une centaine d’étudiants (28 établissements), voire plus d’un millier (5 établissements).
– Une majorité d’établissements (92,8 %) a mis en place des enseignants référents, pour tous les étudiants de S1 et S2 ou pour une partie : 87 % en totalité (60 établissements), 5,8 % en partie (4 établissements) et 7,2 % (5 établissements) ne l’ont pas prévu. Ils encadrent un nombre variable d’étudiants, le plus souvent entre 10 à 30 étudiants.
– Il apparaît que 95,7 % des établissements ont mis en place, pour tous les étudiants de S1 et S2 ou pour une partie, un tutorat pédagogique. Le tutorat est le plus souvent assuré par des étudiants (97 %) mais souvent également par des enseignants (53,6 %). Pour 79,7 % des établissements, ce tutorat n’est pas obligatoire.
– Un tiers des universités a procédé à une diminution de la taille des groupes de travaux dirigés (TD) dans tous les domaines disciplinaires ; près des deux tiers des établissements ont procédé à cette réduction seulement dans certains domaines disciplinaires. Lorsque cette diminution n’a été appliquée qu’à certains domaines disciplinaires, la réduction des effectifs a été plus ou moins appliquée, nettement plus importante en sciences et technologies de santé/sciences et techniques des activités physiques et sportives (STS/STAPS) (71,4 %) qu’en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales (ALL /SHS) (61,8 %).
– La généralisation pour tous les domaines disciplinaires de cours-TD intégrés, formant des ensembles à effectifs limités en remplacement des cours traditionnellement dispensés en amphithéâtre, reste minoritaire. 20,3 % d’universités ont mis en place ces cours/TD intégrés dans tous les domaines disciplinaires de leurs établissements.
– 78,3 % des universités ont déclaré avoir augmenté le volume horaire global d’enseignement de la licence. En ALL/SHS, sur 32 universités, 18 universités (56 %) déclarent un volume horaire inférieur ou égal à 1 400 heures, 8 universités (25 %) ont un volume horaire inférieur ou égal à 1 500 heures, pour 6 universités (près de 19 %) le volume horaire est supérieur à 1 500 heures.
– 40 universités sur 69, soit 58 %, déclarent avoir mis en place un ou plusieurs parcours renforcés. Il s’agit essentiellement de formations au sein d’un collège du droit, de cursus bidiplômant ou de « bilicence » en droit-économie-gestion, de parcours spécifiques en lettres et sciences humaines et arts, en vue d’intégrer le conservatoire ou sciences politiques, et surtout en sciences et technologies visant l’intégration dans une école d’ingénieurs.
– Seulement 39,7 % des universités ont systématiquement mis en place une unité d’enseignement pré-professionnel et 34,4 % ont systématiquement inclus des périodes de stages.
Cependant, loin d’être totale, cette « mobilisation » est brouillonne :
– dans certains établissements, le plan licence s’est traduit, selon les représentants du Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU, par une « réactivation » de mesures déjà mises en œuvre, parfois depuis les années 1990 qui ont vu la massification de l’enseignement supérieur. Dans les autres, on constate soit qu’« il ne se passe rien » soit que les dispositifs mis en place souffrent d’une extrême « dispersion ». Sur ce dernier point, le chef du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, M. Thierry Bossard, a jugé « très grande » la diversité des mesures adoptées, non seulement d’une université à l’autre, mais aussi entre les composantes et disciplines d’un même établissement. Cette « dispersion » résulte, pour la vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, Mme Anne Fraïsse, de l’absence de coordination des politiques adoptées, faute de « vision globale » de la stratégie à mener au niveau de l’établissement ;
– par ailleurs, les mesures adoptées ne sont ni suivies ni évaluées. Or, selon M. Mathieu Bach, vice-président de Promotion et défense des étudiants, celles-ci souffrent d’un problème récurrent de « ciblage » : pour reprendre le jugement de Mme Anne Fraïsse, « on accueille rarement dans ces dispositifs ceux qu’on voudrait voir ». À titre d’exemple, d’après les représentants de Sauvons l’université, les enseignants référents, au lieu de pouvoir aider les décrocheurs potentiels, seraient plutôt sollicités par les « étudiants moyens », qui ne sont pas vraiment en difficulté, mais ont plutôt besoin d’être rassurés ;
– enfin, sur un point essentiel, le plan licence n’a pas donné satisfaction. Même si, selon l’inspection générale, les universités ne sont pas en mesure, sauf exception, de présenter un état précis de la charge d’enseignement, l’évaluation qu’elle a menée permet d’affirmer que si elle augmenté, notamment à travers le tutorat et l’accompagnement des étudiants, « l’objectif d’offrir cinq heures hebdomadaires d’enseignement supplémentaires à chaque étudiant de L1 n’a pas été atteint » (12).
Force est de constater que le plan licence n’a pas permis d’enclencher la « révolution pédagogique » souhaitée par les organisations étudiantes. Celle-ci a été en effet « empêchée », selon M. Azwaw Djebara, vice-président de l’Union nationale des étudiants de France, par certains « verrous », qui tendent à bloquer les innovations en matière d’enseignement.
D’après M. Bernard Dizambourg, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, si les « autours » de la formation ont évolué, le « processus pédagogique central » n’a, lui, que « plus ou moins changé ». Certes, des parcours différenciés sont parfois proposés au sein d’une même licence, mais les équipes universitaires ont, d’une manière générale, « peu réfléchi » à la mise en œuvre de pédagogies adaptées aux différents publics de ce niveau d’études. Par exemple, la pédagogie de projet, la plus susceptible de motiver les étudiants, occupe, contrairement à ce qui se pratique au lycée, une place qui reste marginale. Par ailleurs, les cours d’amphithéâtre continuent d’être très présents alors que ces derniers pourraient être conçus différemment, afin de solliciter davantage la réflexion et le travail de l’étudiant. Ainsi, au lieu de prévoir, dans une discipline donnée, deux heures de ce type d’enseignement par semaine, il devrait être possible de n’en suivre que deux heures toutes les trois semaines, ce qui donnerait du temps à la préparation en amont, laquelle pourrait être facilitée par la mise en ligne de ressources documentaires et de conférences conçues par les enseignants.
Outre les contraintes budgétaires, qui seront évoquées plus loin, le principal frein à ces développements est, selon plusieurs interlocuteurs de la rapporteure pour avis, le statut des enseignants-chercheurs, qui ne valorise pas assez l’acte pédagogique. Ainsi que l’a rappelé le chef du service de l’inspection générale, M. Thierry Bossard, malgré le référentiel national d’équivalences horaires de 2009, précédemment évoqué, le statut de ces personnels fait que « leur centre d’intérêt, leur carrière et leur évaluation » reposent, pour l’essentiel, sur leur travail de recherche et non sur leur enseignement.
Certes, depuis peu, il semblerait que l’activité d’enseignement ne soit plus « tabou » au sein du Conseil national des universités, l’instance qui se prononce sur les mesures relatives à la carrière des enseignants-chercheurs. Ainsi, cette année, des candidats à une promotion ont présenté devant leurs pairs siégeant au Conseil un diaporama de plan de cours. Toutefois, ces avancées « culturelles » restent trop modestes pour favoriser le recours à des modalités pédagogiques innovantes sur une grande échelle.
Le plan licence représente un effort pour l’État, cumulé sur cinq ans, de 730 millions d’euros. 682 570 000 millions d’euros sont délégués sur la base des effectifs d’inscrits en licence, du taux de bacheliers « en retard », ainsi que de la qualité des projets des établissements. La « montée en puissance » des dotations s’est traduite par la répartition de 30 178 449 millions d’euros en 2008, 92 757 527 millions d’euros en 2009, 159 084 149 millions d’euros en 2010 et 200 276 471 millions d’euros en 2011, cette somme devant être reconduite en 2012 (13).
Cet effort doit être cependant relativisé, la licence ne constituant toujours pas une priorité budgétaire. En effet, selon l’Union nationale des étudiants de France, la progression des moyens reste concentrée sur les autres filières du supérieur, en particulier celle du master. Or, si l’on veut rester diplomate dans l’expression, à l’image de M. Thierry Bossard, chef du service de l’inspection générale, le développement des volumes horaires d’enseignement, la réduction de la taille des groupes et le recours aux enseignants référents ont un coût qui rend « problématique » le « modèle économique » du plan licence. Ce caractère « problématique » est d’autant plus accentué que, selon cet interlocuteur, les investissements d’avenir créent une « tension majeure » avec l’objectif affiché de réussite des étudiants, en poussant les universités à concentrer leurs efforts sur la recherche et non sur le premier cycle.
À ce contexte « économique » défavorable s’ajoutent des contraintes techniques qui freinent la mise en œuvre du plan licence, tout comme son évaluation. Les crédits du plan sont « fléchés », tandis que le budget des établissements ayant accédé aux compétences élargies de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, lui, est « global ». Les universités étant ainsi libres de répartir, entre leurs composantes et leurs filières, les moyens attribués par l’État, ce processus d’allocation est totalement inadapté au financement d’une politique aussi transversale que celle de la réussite en licence, l’absence de comptabilité analytique rendant de surcroît difficile la « traçabilité » des crédits. Ceux-ci ont donc pu être utilisés pour financer d’autres mesures, comme, par exemple, les heures complémentaires des enseignants-chercheurs, la rémunération de vacataires, la mise en place des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle ou… la rénovation du parking d’une université, exemple cité par le vice-président de Promotion et défense des étudiants, M. Mathieu Bach. Au total, selon les représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes-Éducation, les établissements ont été contraints de « bricoler », tandis que, selon l’analyse de l’inspection générale, « le financement des différents dispositifs n’échappe pas, sur la base d’une répartition, le plus souvent, sans véritables objectifs avérés, au risque de saupoudrage » (14).
Un dernier écueil guette le financement du plan licence : sa pérennité, qui est loin d’être assurée. Qu’arrivera-t-il, en effet, après 2012 ? Le nouvel arrêté relatif au diplôme de licence, qui sera commenté plus loin, n’entrera en vigueur, dans sa totalité, qu’en 2014. Or, alors même que la mise en œuvre de certaines de ses dispositions, en particulier celle relative aux 1 500 heures d’enseignement, aura un coût, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon les représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes-Éducation, a indiqué que le financement de cette « nouvelle étape » se ferait à moyens constants et sur la base d’appels à projet, ces perspectives n’étant pas de nature à soutenir, dans les prochaines années, de grandes ambitions pédagogiques pour la licence. Le financement de projets innovants en matière de formation par les investissements d’avenir a certes été évoqué par le Président de la République, en juin dernier, mais quand il a été interrogé sur ce sujet, le directeur général pour l’enseignement supérieur a, selon la Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale-CFDT, indiqué aux membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’il attendait des précisions… (15)
Le 17 décembre 2010, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’alors, Mme Valérie Pécresse, annonçait le lancement de la « deuxième étape » du plan licence. Celle-ci a débouché sur l’adoption de l’arrêté du 1er août 2011 relatif au diplôme de licence, qui abroge celui d’avril 2002.
Cette « nouvelle licence » est loin d’être consensuelle, Mme Anne Fraïsse, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, ayant notamment déclaré à la rapporteure pour avis que ce texte n’était « pas particulièrement utile » car il prévoit des dispositifs pouvant déjà être activés. Au total, si certaines dispositions sont plutôt favorablement accueillies par une partie de la communauté universitaire, d’autres suscitent de réelles inquiétudes.
● Une exigence horaire hors de portée pour certains établissements
Comme auparavant, la licence valide l’obtention de 180 crédits de formation, « transférables » dans l’espace européen de l’enseignement supérieur. Mais elle garantit, désormais, un volume horaire minimal d’enseignement de 1 500 heures (article 6 de l’arrêté).
Cette nouvelle exigence académique doit être saluée, car elle est de nature à renforcer le caractère qualifiant de la formation. Dans le même temps, elle devrait être difficile à satisfaire, à moyens constants, pour certains secteurs de formation, en particulier ceux qui proposent des licences à 850 heures, voire à 350 heures (16).
Par ailleurs, on rappellera que les moyens disponibles dans l’enveloppe activité/enseignement allouée aux universités sont distribués au prorata du nombre d’étudiants présents aux examens de licence et de master, pondérés selon leur discipline, soit 2,4 pour les licences et les masters scientifiques, 4 pour les diplômes universitaires de technologie ou DUT scientifiques, 3 pour les DUT non scientifiques et 1,1 pour toutes les autres formations non scientifiques. Or, ainsi que l’a souligné la vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, Mme Anne Fraïsse, si ces critères de pondération pouvaient encore se comprendre à l’époque où les licences du domaine des humanités étaient à 350 heures par an alors que les licences en sciences étaient à 500 heures par an et les DUT ou les formations d’ingénieurs à 800 heures par an, avec le passage de la licence à 1 500 heures, il n’a, objectivement, plus de sens.
Enfin, les universités spécialisées dans les humanités seront d’autant plus pénalisées qu’elles devraient assurer la même charge d’enseignement avec deux à quatre fois moins de moyens (17).
Le ministère de l’enseignement supérieur a « pris en compte » cette difficulté en prévoyant… un délai, les 1 500 heures d’enseignement devant être mises en place progressivement à compter de la rentrée universitaire 2012 et au plus tard à la rentrée universitaire 2014.
● Un affaiblissement du cadrage national de la formation
Afin d’assurer leur comparabilité et de garantir ainsi le caractère national du diplôme, les formations de licence, qui sont très nombreuses, sont organisées au sein de domaines, dans le cadre de mentions. Ces deux références ont pourtant disparu du nouvel arrêté, ce qui, selon les représentants du Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU, crée un risque de sélection à l’entrée du master. En effet, l’admission en master n’étant possible que lorsque le domaine correspond à celui de la licence obtenue, si ce dernier diplôme devient moins « lisible », il pourrait être tentant, pour certains établissements, d’écarter des étudiants au motif qu’ils n’ont pas le « bon » diplôme.
● De nouveaux droits pour les étudiants à l’application problématique
La nouvelle licence comporte deux types d’avancées pour les étudiants.
D’une part, elle offre un cadre juridique pour la personnalisation des parcours, et ce dès la phase d’orientation, en accordant aux étudiants de nouveaux droits. Leur exercice, s’agissant en particulier des dispositifs d’accompagnement, sera cependant conditionné par les moyens dégagés à cet effet par les universités. Or ces crédits sont, ainsi que cela a déjà été souligné, fortement volatiles.
La personnalisation des parcours dans l’arrêté du 1er août 2011
Pour permettre une orientation et une transition réussies entre le second degré et l’université, la liaison avec le lycée est tout d’abord assurée en amont : tout bachelier doit avoir, préalablement à son entrée à l’université, bénéficié d’une information sur les filières (spécialités, pré-requis nécessaires, taux de réussite et débouchés (article 5 de l’arrêté).
En cours de cursus, l’étudiant bénéficie de dispositifs d’accueil et de soutien destinés à lui permettre d’acquérir une autonomie dans ses apprentissages, une méthode de travail, et, le cas échéant, à prévenir le décrochage ou à l’aider en cas de difficulté. Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant référent (article 8).
Enfin, dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de décrochage, les réorientations sont possibles à tout moment du cursus par l’instauration d’un dispositif de passerelles, de réorientations, d’intégration et d’accompagnement prenant en compte les parcours antérieurs (article 9).
D’autre part, l’arrêté d’août 2011 prévoit une série de nouveaux droits en matière de validation des parcours, qui étaient demandés par les organisations étudiantes : il supprime les notes éliminatoires, met en place une compensation annuelle, réaffirme le droit aux sessions de rattrapage et précise, enfin, que le contrôle continu et régulier fait l’objet d’une application « prioritaire sur l’ensemble du cursus conduisant à la licence ».
Selon certains représentants étudiants entendus par la rapporteure pour avis, ce dernier point devrait être clarifié. Ainsi, pour le vice-président de Promotion et défense des étudiants, M. Mathieu Bach, le contrôle continu devrait être « véritable » et ne pas intervenir la semaine précédant l’examen final : il devrait donc être intégral et appliqué prioritairement en première année. De même, pour le vice-président de l’Union nationale des étudiants de France, M. Azwaw Djebara, cette disposition ne saurait être interprétée comme autorisant les établissements – ce qui est le cas de beaucoup d’entre eux – à limiter le contrôle continu à une évaluation organisée en milieu de semestre. De plus, cet interlocuteur de la rapporteure pour avis a estimé que, d’une marnière générale, les modes d’évaluation des étudiants devraient être diversifiés, car la dissertation, en n’évaluant que des compétences académiques, conduit à pratiquer une forme de sélection sociale.
D’autres acteurs de la communauté universitaire se sont toutefois montrés plus réservés à l’égard de ces évolutions, en particulier s’agissant des dispositions, entrées en vigueur à la rentrée universitaire 2011, qui assouplissent les conditions de compensation. La précision selon laquelle celle-ci est organisée non plus par semestre, comme auparavant, mais entre deux semestres « immédiatement consécutifs » et sur la base des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pourrait, selon le Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU, remettre en cause la cohérence du diplôme. De plus, les modalités de compensation, paramétrées par des logiciels complexes, ayant dû être arrêtées par chaque établissement au plus tard un mois après la rentrée universitaire, une certaine précipitation a été constatée en la matière, ce qui pourrait exposer les établissements à des recours juridiques de la part des étudiants.
● Des référentiels de compétences élaborés dans l’opacité
L’article 3 de l’arrêté du 1er août 2011 dispose que « des référentiels de compétences sont définis pour une discipline ou un ensemble de disciplines à l’initiative du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche envisage ainsi d’élaborer une trentaine de référentiels. Devant correspondre aux principales mentions de licence et fixer les objectifs de la formation, en déclinant les compétences à acquérir, ces documents devraient couvrir l’ensemble des grands domaines de formation (arts, lettres et langues ; droit, économie, gestion ; sciences humaines, sciences et technologies ; sciences et technologies des activités physiques et sportives).
Ces textes, qui en principe devraient être finalisés d’ici la fin de cette année, une échéance jugée irréaliste par plusieurs interlocuteurs de la rapporteure pour avis, devraient comprendre, selon le ministère, d’une part, une partie relative aux compétences transversales et pré-professionnelles que les licenciés d’un même domaine – quelle que soit la mention de licence concernée – devraient avoir acquises et, d’autre part, une partie proprement disciplinaire, spécifique à la mention de licence préparée (18).
C’est dire l’importance des référentiels. Pourtant, leur élaboration ne donne lieu à aucune véritable concertation, menée avec les représentants syndicaux au sein d’une instance officielle, puisque les « rédacteurs » ont été désignés sui generis par le directeur général pour l’enseignement supérieur parmi les acteurs suivants, que mentionne l’arrêté du 1er août 2011 : les conférences regroupant les directeurs d’établissements et les présidents d’universités, les communautés scientifiques, les associations étudiantes et le monde socio-économique (organisations patronales, branches professionnelles, associations de métiers, etc.). Le caractère quelque peu discrétionnaire de cette procédure ne laisse pas d’étonner.
Le plan licence n’est pas parvenu à conforter la filière de formation la plus fragile de l’enseignement supérieur. S’il a permis quelques avancées, il a surtout contribué à créer, faute d’un cadrage national suffisamment clair et de financements appropriés, un relatif climat d’incertitude autour de l’engagement de l’État auprès du premier cycle. Pour cesser d’être une coquille à moitié vide, il devrait changer d’échelle, en s’appuyant sur un diplôme recentré, une procédure d’orientation épaulée par un service public de proximité, une pédagogie universitaire rénovée et de nouveaux moyens en faveur des enseignants et des étudiants.
● Au départ : une continuité à construire avec le lycée
La licence ne saurait être un pur produit universitaire, entièrement détaché de ce qui la précède, à savoir le lycée. Le cursus allant de la classe de seconde à la troisième année de licence devrait donc s’inscrire dans un continuum. Il ne s’agit pas pour autant de « secondariser » l’université – ce serait nier la spécificité du premier cycle (19)–, mais de faire en sorte que tous les élèves de seconde puissent être considérés comme des étudiants potentiels et que la transition du lycée à l’université soit organisée dans de bonnes conditions.
● Une formation généraliste, ayant une double finalité
La finalité de la licence est double : elle doit préparer à la poursuite d’études et permettre une préprofessionalisation.
C’est pourquoi, comme l’a rappelé Mme Anne Fraïsse, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, la licence devrait rester « généraliste », la fonction première de ce diplôme étant de permettre à son titulaire d’entrer en master, le « véritable niveau de sortie professionnalisant ». Il conviendrait donc de cesser d’attribuer à la professionnalisation de la licence ce « caractère magique » qu’on lui attribue trop souvent, pour reprendre les termes de M. Etienne Boisserie, président du conseil d’administration de Sauvons l’université. Cette approche pragmatique serait d’autant plus pertinente que ce diplôme de premier cycle n’est pas reconnu par les conventions collectives.
En revanche, les étudiants en licence devraient bénéficier de « temps de contact » avec le monde professionnel, préparés, encadrés et évalués au regard des objectifs de la formation. La rencontre avec d’autres adultes que les enseignants-chercheurs et les parents, en entreprise, dans les collectivités locales ou les structures associatives ou culturelles, est en effet essentielle pour un jeune, car elle peut l’aider à structurer sa personnalité.
Le stage pourrait donc être une expérience fructueuse pour l’étudiant, à condition de l’organiser au bon moment : pour le directeur général pour l’enseignement supérieur, M. Patrick Hetzel, autant il ne faut pas prévoir un stage systématique en première année, autant son organisation en troisième année de licence devrait s’imposer (20). Ces expériences professionnelles devraient être en outre valorisées par le recours au portefeuille de compétences qui, annexé au diplôme, permet d’identifier l’ensemble des acquis d’un parcours de formation, que ceux-ci résultent des enseignements, des stages ou du travail étudiant.
Parallèlement, la « lisibilité » des compétences des diplômés de licence devrait être facilitée par le recours aux référentiels de formation précédemment évoqués. À une double condition, toutefois :
– d’une part, leur élaboration devrait faire l’objet d’une concertation large et transparente. Cette tâche devrait donc être confiée à un acteur reconnu et légitime, car associant les représentants des enseignants-chercheurs, comme par exemple le comité de suivi de la licence, qui est une émanation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
– d’autre part, ces référentiels devraient impérativement articuler les compétences aux connaissances et s’adosser aux mentions et aux intitulés des licences.
Enfin, les licences professionnelles, lesquelles sont construites avec les entreprises locales pour répondre à des besoins précis de qualification et reconnues par les conventions collectives, devraient conserver leurs atouts. Elles devraient donc être majoritairement portées, comme aujourd’hui, par les instituts universitaires de technologie, la licence généraliste ne devant pas « dériver » en proposant systématiquement, en troisième année, des formations à caractère professionnel. Cette précaution devrait être prise afin de garantir le développement, notamment dans des secteurs non couverts par les licences professionnelles comme la santé ou le social, d’une filière de formation aux résultats remarquables (taux de réussite au diplôme avoisinant les 90 % et insertion professionnelle de ses diplômés à moins de six mois) (21).
● Un diplôme ouvert à tous les titulaires du baccalauréat
Le baccalauréat étant le premier diplôme de l’enseignement supérieur, il ouvre, de droit, l’accès au premier cycle universitaire, notamment aux études de licence. Tout filtre supplémentaire à l’entrée de la licence serait donc inacceptable, tant politiquement que socialement. En effet, s’il peut, à la rigueur, se concevoir pour des filières très précises, en nombre limité – car, aujourd’hui, il est possible de s’inscrire en musicologie sans avoir jamais pratiqué un instrument –, l’établissement de pré-requis devrait être écarté, car il permettrait, ainsi que l’a souligné l’association Sauvons l’université, dans une contribution écrite, « de trier les bacheliers entre ceux jugés dignes d’entrer dans les licences d’« excellence » et les autres, cantonnés dans des "portails pluridisciplinaires" » (22).
● Un cadrage accru des formations
Bien que le nouvel arrêté relatif à la licence fixe un volume minimal d’heures d’enseignement, plusieurs interlocuteurs de la rapporteure pour avis ont estimé que cette disposition ne suffirait pas à garantir la qualité de l’offre de formation. Ce serait particulièrement le cas si cette règle était interprétée comme fixant un plafond global. En effet, dans cette hypothèse, selon l’Union nationale des syndicats autonomes-Éducation, certains établissements budgétairement contraints pourraient être tentés d’atteindre les 1 500 heures en jouant sur des volumes horaires des différentes disciplines – par exemple, par la diminution du nombre d’heures consacrées aux sciences « dures » et l’augmentation de celles consacrées aux lettres et aux sciences humaines. Les 1 500 heures prévues par l’arrêté du 1er août 2011 devraient donc être clairement comprises comme fixant un plancher par cursus.
Par ailleurs, à condition que ce cadrage accru des formations fasse l’objet d’une concertation approfondie entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la communauté universitaire et ses représentants, il pourrait être envisagé d’indiquer dans les référentiels :
– des fourchettes de volumes horaires d’enseignement. Il ne faudrait pas pour autant brider la capacité d’initiative des équipes pédagogiques en déterminant, au niveau central, la part respective des cours magistraux, travaux dirigés et autres formes d’enseignement. En revanche, il pourrait être envisagé de fixer la proportion maximale des cours magistraux dans les cursus, afin d’encourager la mise en place de formes d’enseignement diversifiées ;
– les modalités pédagogiques pouvant être mises en œuvre (recours à des travaux dirigés ou à des projets tutorés, etc.).
L’échec en licence est souvent le résultat d’une mauvaise orientation, qui tend, pour les jeunes les plus fragiles, à être davantage subie que choisie. Ce vice de construction devrait être éliminé, tandis que les passerelles entre les formations universitaires et les autres filières du supérieur devraient être multipliées.
● Un dispositif d’orientation épaulé par un service public de proximité
Malgré les améliorations récemment apportées, en particulier la généralisation du portail « admission post-bac » (23), notre dispositif d’orientation ne fonctionne pas de façon satisfaisante.
Trop souvent encore, il génère du décrochage, ce qui se traduit par la présence d’étudiants inscrits en licence après leur baccalauréat et qui ne se réinscrivent pas l’année suivante, que ce soit dans la même spécialité de licence ou dans une autre. Selon le ministère de l’enseignement supérieur, près de la moitié de ces bacheliers, qui représentent en 2008 un quart des inscrits en L1, « disent ne pas être dans la formation de leur choix. La motivation de ceux qui ne passent qu’un an en licence était faible dès le départ : leur inscription ne répondait ni à un intérêt particulier pour le contenu des études, ni à un projet professionnel précis, et un tiers dit s’être inscrit un peu "par hasard". Leur inscription en L1 correspond dans de nombreux cas à une solution d’attente : 35 % des "décrocheurs" rejoignent une STS, formation que souvent ils souhaitaient initialement et dans laquelle ils n’avaient pas été acceptés. Mais seulement quatre sur dix de ceux qui étaient venus en L1 faute d’avoir pu accéder à une STS réussissent à s’y inscrire l’année suivante ; ceux qui voulaient s’orienter en IUT après leur bac n’y parviennent que très rarement l’année suivante » (24).
Pour remédier aux inscriptions « par hasard » ou « par défaut », il faudrait non seulement traiter le problème des places en section de technicien supérieur (STS) et en institut universitaire de technologie (IUT) – point qui sera abordé plus loin – mais aussi structurer davantage l’information sur l’offre de formation :
– en premier lieu, cette information devrait être délivrée suffisamment en amont aux lycéens pour que le choix effectué en terminale soit le plus éclairé possible. La circulaire du 24 juin 2011, qui généralise le « conseil d’orientation anticipé » en classe de première, auparavant expérimenté dans l’académie de Nantes en 2009-2010, constitue à cet égard une avancée ;
– en deuxième lieu, l’orientation devrait concerner l’ensemble des filières post-bac et ne pas se limiter, ainsi que l’a souligné le délégué général de la Conférence des présidents d’université, M. Alain Abécassis, à « trois ou quatre "tuyaux" ». C’est en effet l’ensemble du cycle licence qui devrait être appréhendé, en y incluant les STS, les IUT, les classes préparatoires, les universités et les établissements hors tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (écoles d’architecture ou des beaux-arts par exemple) ;
– en troisième lieu, cette orientation devrait être « globalisée », comme c’est le cas à Montpellier où les universités proposent aux lycéens une réorientation sur l’ensemble des filières et des sites universitaires de l’académie.
Il conviendrait d’aller plus loin en mettant en place, avec l’appui des régions, un service public d’information et d’orientation facilitant l’accès à une information et un conseil de qualité sur les formations et les métiers et faisant fonctionner en réseau les professionnels de l’éducation nationale, mais aussi ceux des missions locales, de Pôle emploi, des centres et points informations jeunesse, etc.
● Des places plus nombreuses en section de technicien supérieur (STS) et institut universitaire de technologie (IUT)
Le rapport précité du sénateur Christian Demuynck sur le décrochage à l’université rappelle qu’un vœu sur deux formulé dans le cadre de l’admission post-bac pour les formations courtes n’est pas satisfait. De fait, les filières préparant aux métiers du secteur des services – l’admission dans les formations en IUT et STS se faisant, rappelons-le, sur dossier – qui devraient constituer le débouché « naturel » des bacheliers technologiques, voire professionnels, sont de plus en plus occupées par les bacheliers généraux (25).
Les incitations budgétaires mises en place par le gouvernement afin de « récompenser » les IUT accueillant davantage de bacheliers technologiques n’ayant pas produit les effets escomptés, faut-il aller plus loin et instaurer des quotas ? Cette préconisation du rapport de M. Demuynck – avec un minimum de 40 % de bacheliers technologiques ou professionnels devant être respecté dans chaque IUT « services » et 60 % dans chaque BTS « services » – est loin de faire l’unanimité. Ainsi, pour M. Bernard Dizambourg, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, l’efficacité d’un mécanisme qui ne manquerait pas de susciter des phénomènes de « contournement » devrait être mise en doute. En outre, les différences entre les spécialités et les situations des IUT – certains d’entre eux ne parvenant pas à remplir toutes leurs places faute d’un vivier suffisant de bacheliers –, rendent impossible, selon M. Jean-François Mazoin, président de l’Association des directeurs d’IUT, la fixation, au niveau national, de quotas.
D’autres leviers devraient être utilisés, à commencer par l’augmentation des places en STS et IUT. En outre, les instituts, selon M. Mazoin, devraient définir et piloter collectivement leur politique de recrutement des bacheliers technologiques, et non plus individuellement par département de formation. Enfin, des passerelles devraient permettre aux bacheliers technologiques/professionnels, inscrits en licence et en situation de décrochage, de se réorienter.
Deux types de dispositifs devraient être mis en place à cet effet :
– des semestres « tremplins », proposés en fin de premier semestre, afin de mettre ces étudiants à niveau sur le plan disciplinaire et méthodologique et de leur faire découvrir le monde de l’entreprise, pour leur permettre, ensuite, de s’inscrire en IUT avec les meilleures chances de réussite (26) ;
– des « secondes rentrées » afin que ces filières courtes puissent accueillir, en janvier ou février, ces étudiants.
● Un accompagnement personnalisé pour les étudiants en difficulté
Les étudiants en difficulté devraient être accompagnés au cours de leur cursus de licence, à la stricte condition que ce soutien évite toute forme de stigmatisation.
La contractualisation imposée des rapports entre l’étudiant en voie de décrochage et l’université devrait être, pour cette raison, proscrite. Les préconisations du rapport précité de M. Christian Demuynck allant dans ce sens devraient donc être écartées (27). Même si celui-ci prend soin de préciser que de tels contrats ouvriraient à l’étudiant concerné le bénéfice d’un accompagnement renforcé, la quasi-totalité des interlocuteurs de la rapporteure pour avis y ont été hostiles pour des raisons de principe et d’efficacité. Ainsi, pour M. Etienne Boisserie, président du conseil d’administration de Sauvons l’université, cela revient à traiter ces étudiants en « multirécidivistes de la motivation », cette idée étant en outre juridiquement douteuse – en effet, comment s’apprécierait l’exécution ou la non-exécution par chacune des parties de leurs obligations et quelles pourraient en être les conséquences ? Par ailleurs, on constate, selon les représentants de la Fédération des syndicats généraaux de l’éducation nationale-CFDT, que les mesures qui obtiennent de bons résultats sont celles qui ne « flèchent » pas les étudiants, en prédéterminant leur parcours.
Pour cette même raison, la licence en quatre ans, proposée par quelques interlocuteurs comme étant une solution appropriée pour les étudiants les plus faibles – notamment les bacheliers professionnels –, a été majoritairement jugée comme étant comme une « fausse bonne idée ». Selon la vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, Mme Anne Fraïsse, ces étudiants, qui sont socialement fragiles et doivent souvent travailler, ne sont pas « partants », pour des raisons parfaitement compréhensibles, pour suivre un cursus en quatre ans. En outre, un tel dispositif, qui équivaudrait à leur proposer un redoublement, ne saurait, du point de vue psychologique, apporter une réponse adaptée à leurs besoins.
Il convient également d’écarter la solution consistant à établir une année de propédeutique à l’entrée de la licence – dispositif qui a été supprimé en 1968. La Confédération étudiante s’y est certes déclarée très favorable, ne serait-ce que parce qu’une telle mesure permettrait, selon cette organisation, de remettre à niveau les bacheliers professionnels inscrits en première année de licence. Cependant, outre qu’un tel dispositif reviendrait à surcharger les années de L2 ou de L3, sa mise en place prendrait acte de l’échec du système scolaire dans son ensemble, l’université étant ainsi chargée de faire de la remédiation aux bacheliers, qui sont aussi d’anciens écoliers et collégiens.
La bonne solution consisterait, dès lors, à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement diversifiées, à condition de les inscrire, comme cela a déjà été souligné, dans une stratégie cohérente au niveau de l’établissement. La majorité des interlocuteurs de la rapporteure pour avis ont en effet insisté sur le fait qu’il ne fallait pas appliquer, en la matière, de recettes uniformes, mais adopter des politiques variées, tenant compte des publics étudiants et des filières de formation.
Exemples de mesures d’accompagnement mises en œuvre à Bordeaux au titre du plan pour la réussite en licence
Université |
Nombre de |
Mesures |
Caractérisation |
Bordeaux 1 |
1 |
Soutien aux étudiants en difficulté / réorientation |
Mise en place d’un parcours spécifique « rebondir » permettant aux étudiants en situation d’échec (ayant moins de 8/20 aux évaluations des troncs communs) de compléter leurs acquis pour favoriser une réorientation positive conforme aux aspirations professionnelles des étudiants. Ce S2 permet aux étudiants soit de préparer une insertion, soit une autre licence, soit une formation en alternance. Ce semestre peut être également une remise à niveau pour refaire une bonne année ou de se réorienter, y compris vers l’IUT. Ce dispositif est proposé également aux étudiants inscrits en IUT en difficulté. |
Bordeaux 2 |
1 |
Renforcement de l’encadrement pédagogique |
Dispositif de tutorat en première année de Santé (2 000 étudiants, 172 tuteurs). Pour les autres filières, tutorat renforcé en L1 (50 enseignants référents se répartissent les étudiants par groupe avec les tuteurs (3 240 heures de tutorat). Tutorat maintenu en L2 et L3 mais sans caractère obligatoire. |
Source : ministère de l’enseignement supérieur, « Le chantier réussir en licence », 17 décembre 2010
Ainsi des semestres « rebonds » pourraient être mis en place, afin de consolider les acquis des étudiants fragiles, par exemple au cours de l’été, entre le deuxième et le troisième semestre, comme c’est le cas à Montpellier 3. Toutefois, afin de garantir l’efficacité de ce dispositif, son institution devrait être systématiquement précédée d’une réflexion approfondie sur son emplacement – entre les deuxième et troisième semestres ou bien entre les premier et deuxième semestres –, et son public cible. Si ces précautions n’étaient pas prises, en effet, l’étudiant bénéficiaire pourrait avoir, comme l’a fait observer M. Alain Abécassis, délégué général de la Conférence des présidents d’université, le sentiment d’avoir gâché une année. Une attention particulière devrait être également accordée au tutorat étudiant, le soutien par les pairs étant généralement considéré comme très efficace, à condition que celui-ci ne soit pas le monopole de certains profils favorisés pour lesquels, selon M. Julien Blanchet, premier vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes, il sert de bourse déguisée… Par ailleurs, l’enseignant référent devrait être obligatoirement celui ayant en charge les travaux dirigés de première année, celui-ci étant le mieux placé pour repérer les étudiants les plus fragiles.
● Une licence facilitant les passerelles
La spécialisation précoce des licences et leur centrage excessif sur les connaissances disciplinaires sont l’une des causes principales d’échec à ce niveau d’études. Il devrait y être remédié, en ouvrant les horizons disciplinaires.
La création filières adaptées au sein d’une même licence irait à l’encontre d’un tel objectif. En effet, cette solution, notamment proposée par le président du Mouvement des étudiants, M. Antoine Diers, conduirait à réserver les parcours « renforcés » aux bons étudiants, les autres se répartissant entre parcours de « soutien » et parcours « classiques ». Cette « filiérisation » de la licence aboutirait à créer, au sein d’un même niveau d’études, la dichotomie entre grandes écoles et universités, dont en sait qu’elle nuit à la cohérence et à l’efficacité d’ensemble de notre système d’enseignement supérieur.
À l’inverse, les possibilités de réussite seraient augmentées en multipliant les passerelles, à l’intérieur d’une même licence et entre cette filière de formation et les autres.
D’une part, la pluridisciplinarité, qui peut être présentée comme étant une passerelle entre différentes formes de connaissances académiques, devrait être encouragée, car elle faciliterait les réorientations et préparerait les étudiants aux études en master. Les représentants de l’Union nationale des étudiants de France ont souligné à cet égard l’incohérence des parcours de formation bac + 3 et bac + 5, le premier cycle étant spécialisé et précédant un second cycle qui, lui, est plus ouvert. À titre d’illustration, en master d’histoire, l’étudiant est formé à la sociologie et aux sciences politiques, des disciplines qui sont absentes de son cursus de licence. De son côté, Mme Anne Fraïsse, vice-présidente de la Conférence des présidents d’université, a estimé que des parcours proposant un important tronc commun – arts et lettres par exemple –, avec un tiers d’enseignements de spécialisation, seraient profitables aux étudiants, car ils leur permettraient de s’engager progressivement dans une spécialité et leur laisseraient ainsi le temps de changer de voie.
La pluridisciplinarité des parcours devrait donc être reconnue par l’arrêté relatif à la licence, ainsi que par les référentiels de formation. Bien entendu, cette évolution ne devrait pas empêcher les établissements de proposer des doubles formations, inscrites dans des bi-licences (lettres et droit par exemple), car celles-ci, tout en prouvant l’excellence de la formation universitaire, peuvent répondre aux besoins de certains employeurs.
D’autre part, les passerelles entre filières de formation devraient être multipliées, ces dispositifs constituant le meilleur moyen de se prémunir contre la dangereuse tentation des pré requis. Ces passerelles devraient d’ailleurs pouvoir jouer dans plusieurs sens, ainsi que l’a souligné M. Julien Blanchet, premier vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes. À titre d’exemple, il devrait être possible, comme c’est le cas à Toulouse, à un étudiant qui a validé sa première année de santé, mais échoué au concours, d’entrer en deuxième année de droit. Cette multiplication des points d’entrée entre filières permettrait d’éviter qu’un étudiant ayant obtenu son diplôme universitaire de technologie à Laon ne fasse des demandes d’inscription en troisième année de licence auprès de vingt universités avant d’être accepté à Aix-en-Provence, un exemple cité par la Confédération étudiante.
Le gouvernement, à la suite des mouvements de contestation intervenus en 2009 contre la réforme du statut des enseignants-chercheurs, a pris la décision de ne pas appliquer la règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par conséquent, à l’instar des projets de loi de finances pour 2010 et 2011, aucune suppression d’emploi n’est prévue pour 2012.
Ce statu quo en matière de potentiel d’enseignement ne saurait être suffisant pour transformer « l’essai » du plan licence, celui-ci n’ayant pas permis, faute de moyens suffisants, de transformer la pédagogie universitaire.
● Un abandon du modèle « tout amphi » impliquant de recruter
Postulé par le plan licence, l’abandon du modèle « tout amphi » – termes employés par les représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes-Éducation – devrait conduire à des créations de postes supplémentaires. Ces recrutements seraient rendus possibles dès lors que serait fourni l’effort financier –significatif et faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle – qui permettrait au plan licence d’aller au-delà du simple « bricolage ». Parallèlement, le modèle d’allocation des moyens aux universités devrait être réformé afin qu’un rééquilibrage des pondérations entre universités littéraires et scientifiques rende possible la mise en place, dans toutes les formations, d’une licence à 1 500 heures d’enseignement.
Dans de telles conditions, la réduction de la taille des groupes – cours magistraux ou travaux dirigés –, une démarche que l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche jugeait, en 2010, « minoritaire, voire marginale » (28), pourrait être facilitée, tout comme l’investissement des personnels dans les fonctions de tuteur et d’enseignant référent.
Cependant, le levier « taille des groupes » ne pourrait, à lui seul, créer de meilleures conditions d’enseignement. D’abord, parce que les étudiants eux-mêmes peuvent être attachés à cette forme de transmission des savoirs, qui reste un symbole de l’université et sert de « marqueur » de leur autonomie. Ensuite, ainsi que l’ont observé les représentants de Sauvons l’université, des groupes trop petits peuvent poser, selon les disciplines, des problèmes en termes de dynamique des apprentissages ou bien se heurter plus prosaïquement à des contraintes immobilières. Enfin, des travaux dirigés ouverts à plus de soixante étudiants – comme c’est le cas à Dijon ou Reims selon ces interlocuteurs de la rapporteure pour avis –, obtenus à la suite d’une soit disant « réduction » de la taille des groupes, ne peuvent apporter aucune plus-value pédagogique.
La nouvelle licence devrait donc s’attacher – ce point étant essentiel – à créer de nouvelles modalités pédagogiques, qui fassent appel au travail de l’étudiant, tout en proposant des enseignements plus ou moins conceptualisés. En particulier, les universités devraient être capables, selon l’ancien président du comité de suivi de la licence, M. Bernard Dizambourg, de construire des parcours pédagogiques différenciés, qui partent d’éléments concrets pour les étudiants plus à l’aise avec les schémas de raisonnement inductif ou reposent, pour les autres, sur les formes d’enseignement « traditionnelles ». Autrement dit, la pédagogie devrait être naturellement diversifiée à l’université, comme elle peut l’être au lycée. Pour encourager de telles évolutions, la création de départements « licence » devrait être envisagée afin que les universités disposent d’un lieu dédié à la conception et à la mise en œuvre de la politique de formation en premier cycle (29).
Ÿ Une formation à la pédagogie assurée par une structure identifiée
Dans son rapport sur les centres d’initiation à l’enseignement supérieur (CIES), qui assuraient la formation des étudiants bénéficiaires d’une allocation de recherche et se préparant aux fonctions d’enseignant-chercheur dans le cadre d’un monitorat, l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche constatait que « la formation des enseignants dans le supérieur se limite, en règle générale, à la possibilité de suivre des formations en langues ou aux nouvelles technologies de communication. La formation pédagogique est totalement absente. L’hostilité dont a fait preuve une partie du corps universitaire à l’encontre de la mise en place des CIES, l’ignorance de la nature des formations qui y sont dispensées, le fait que les quelques conventions que des universités ont commencé à passer avec des CIES pour assurer la formation de leurs nouveaux enseignants n’aient pas été suivies d’actions concrètes laissent à penser que, chez beaucoup d’universitaires, prévaut encore l’idée que si l’on maîtrise un savoir académique, on est capable de l’enseigner. Si cela peut être vrai au niveau master ou doctorat, il est clair que cela ne l’est pas au niveau de la licence » (30).
De ce point de vue, les 14 CIES, qui ont formé près de 40 000 moniteurs depuis leur création, en 1989, ont fourni un travail remarquable d’initiation à la pédagogie et à l’enseignement.
Leur existence a été remise en cause par le remplacement de l’allocation de recherche et du monitorat par le contrat doctoral, institué par le décret du 23 avril 2009. Celui-ci, contrairement à la situation qui prévalait auparavant pour les moniteurs, n’impose aucune obligation d’enseignement, les activités confiées au doctorant contractuel pouvant être exclusivement consacrées à la recherche. Les centres risquant de ne plus accueillir de « public », le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas souhaité les pérenniser en leur transférant la mission de formation des contrats doctoraux.
Dans ces conditions, ainsi que l’ont souhaité plusieurs interlocuteurs de la rapporteure pour avis, une structure de formation pédagogique, s’appuyant le cas échéant sur les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), devrait être rapidement identifiée. Le président du comité de suivi du master, M. Jean-Michel Jolion, dans un rapport récent, a ainsi considéré que les instituts universitaires de formation des maîtres « pourraient tout à fait, en lien avec les PRES (selon les situations géographiques de congruence entre les périmètres des PRES et des académies) assurer conjointement cette mission de formation au service des établissements employeurs des contrats doctoraux » (31).
Cette mesure devrait être accompagnée par la mise en œuvre – demandée par la Conférence des présidents d’université – de programmes de formation continue des enseignants-chercheurs.
Ÿ Un investissement pédagogique valorisé
Le statut d’enseignant-chercheur associe deux activités « naturellement en tension » pour reprendre les propos de M. Bernard Dizambourg, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche.
Les missions d’enseignement et de recherche selon le décret statutaire
du 23 avril 2009
Autour de la double mission d’enseignement et de recherche, le décret statutaire clarifie les différentes tâches des enseignants-chercheurs par référence au temps de travail de la fonction publique (1607 heures) et à une durée annuelle de référence, soit 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés (TD) ou de travaux pratiques (TP), une heure de travaux dirigés équivalant dorénavant à une heure de travaux pratiques. Le tutorat, le suivi de l’insertion professionnelle des étudiants, l’usage des technologies de l’information et de la communication, l’expertise en matière de recherche peuvent désormais être intégrées dans les obligations de service et par la suite valorisés. Le paiement des heures complémentaires est déclenché à partir de la 193ème heure ou de la première heure au-delà du temps de service défini dans le cadre de la modulation. Avec l’accord de l’enseignant-chercheur, le service d’enseignement peut être en effet modulé à la hausse ou à la baisse dans les conditions définies par le conseil d’administration de l’établissement. En toute hypothèse, l’enseignant-chercheur ne pourra pas faire moins de 42 heures de cours magistral ou de 64 heures de TP ou de TD, et devra pouvoir bénéficier d’un temps significatif pour ses activités de recherche.
Deux dispositifs ont été récemment adoptés pour inciter les enseignants-chercheurs à s’investir dans leur fonction de formation :
– d’une part, grâce au référentiel national d’équivalences horaires, déjà évoqué, l’élaboration et la mise en ligne d’un module d’enseignement ou de formation, la conception et le développement d’enseignements nouveaux ou de pratiques pédagogiques innovantes, la fonction d’enseignant référent (y compris le tutorat) et l’encadrement de projet tutorés sont désormais reconnus et rémunérés sur une base forfaitaire, à condition, bien sûr, que les établissements disposent des ressources pour assumer cette charge ;
– d’autre part, le montant de la prime de responsabilité pédagogique, qui tient compte des différents aspects de la mission d’enseignement (création et encadrement de diplômes, tutorat, coordination d’équipes pédagogiques, difficulté de l’enseignement) a été augmenté significativement, afin de l’aligner sur la prime liée à l’activité de recherche. Alors qu’avant 2009, le montant versé en moyenne variait de 500 à 1 500 euros par an, son taux plancher est désormais de 3 500 euros et son taux plafond annuel de 15 000 euros.
Par ailleurs, les établissements exerçant les compétences élargies prévues par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités peuvent encourager l’investissement dans la pédagogie via leur nouveau pouvoir de création de systèmes de primes, le président étant responsable de leur attribution, selon des règles générales définies par le conseil d’administration (article L. 954-2 du code de l’éducation). C’est sur ce fondement que l’université Pierre et Marie Curie, par exemple, a mis en place une prime d’investissement pédagogique à destination des enseignants acceptant d’enseigner en licence. Ainsi, dès 2009, les commissions disciplinaires de cet établissement avaient accordé 209 primes, d’un montant de 3 500 euros (32).
Cependant, ainsi que l’a observé M. Bernard Dizambourg, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, ces incitations à l’investissement pédagogique ont un caractère individuel, alors que la reconnaissance « collective » du travail d’un enseignant-chercheur, celle qui, sur le plan symbolique et statutaire, compte le plus, car elle est effectuée par les pairs et influe sur la carrière, reste centrée sur son activité de recherche.
Afin de corriger ce déséquilibre, les capacités pédagogiques des enseignants-chercheurs pourraient être évaluées à deux moments clefs de leur carrière :
– au moment de leur titularisation, en organisant par exemple la visite d’un de leurs cours par le comité de sélection qui les a recrutés, une piste qui a été suggérée par M. Alexis Gorlet, porte-parole de Sauvons l’université ;
– au « point nodal » – selon l’expression de M. Dizambourg – que constitue le passage du corps de maître de conférences à celui de professeur des universités.
Par ailleurs, le maintien – indispensable – de corps nationaux d’enseignants-chercheurs devrait être concilié avec la capacité d’initiative devant être laissée aux établissements pour moduler les activités d’enseignement et de recherche et accroître ainsi l’efficacité pédagogique des formations dispensées en licence.
Ÿ Une réflexion à mener sur la place des enseignants-chercheurs en licence
Faut-il que les enseignements de licence, notamment ceux de première année, soient dispensés exclusivement par des enseignants-chercheurs ? Cela n’aurait évidemment guère de sens, ne serait-ce que parce que l’université se priverait ainsi de ressources aujourd’hui indispensables pour son fonctionnement : les professeurs associés, et surtout, les professeurs agrégés du second degré. Ce vivier devrait être en revanche élargi, non par l’éclatement du statut d’enseignant-chercheur, ce qu’induit une proposition du rapport précité du sénateur Christian Demunyck (33), mais par le recours aux flexibilités prévues par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Celle-ci permet en effet de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement.
En outre, les services d’enseignement partagés entre les lycées et les universités devraient être favorisés, ce qui permettrait de rapprocher la culture de ces filières de formation et de faciliter l’orientation des élèves futurs étudiants.
Grâce à ces deux leviers, les établissements pourraient, dès lors que leurs moyens seraient augmentés, « calibrer » de manière optimale le volant des enseignants-chercheurs en licence, afin de confier les enseignements de ce cycle d’études aux plus motivés d’entre eux.
La lutte contre l’échec en licence devrait également s’attaquer aux racines sociales de ce phénomène. Les étudiants les plus fragiles sont souvent aussi ceux qui travaillent, ce qui ne les met pas en situation de réussir. Au total, 35 % des étudiants travaillent – dont 10 % à temps plein – pour financer leurs études ou, plus simplement, subvenir aux dépenses courantes (logement, alimentation, habillement, etc.) (34). En outre, 23 % des étudiants interrogés par l’Observatoire de la vie étudiante déclarent concilier difficilement études et travail, les enfants d’ouvriers étant proportionnellement plus nombreux à travailler à plein-temps que ceux des cadres et membres des professions intellectuelles supérieures (21 contre 15 %) (35).
Or notre système de bourses, malgré les améliorations qui lui ont été apportées récemment – création d’un sixième échelon en 2008 et d’un dixième mois intégralement versé au cours de la présente année universitaire – ne parvient pas à corriger cette inégalité devant la réussite.
Ainsi, le dernier échelon des bourses sur critères sociaux, qui bénéficie aux étudiants des familles les plus modestes, correspond à 4 600 euros sur dix mois et n’est versé qu’à 20 % des étudiants boursiers. Ces inégalités sont en outre confortées par notre fiscalité : comme le rappelle une étude de la Conférence des présidents d’université, les avantages fiscaux procurés aux ménages les plus favorisés le sont dans des proportions comparables aux aides sociales versées aux familles à faibles revenus (36).
Dans le même temps, le taux d’accès à l’enseignement supérieur en France (53 %) est, pour une classe d’âge donnée, inférieur à la moyenne de l’OCDE et surtout à des pays comme les Etats-Unis, les pays nordiques ou la Corée du Sud, leurs taux d’accès étant supérieurs à 60 %.
Pire encore : le taux de poursuite d’études de nos bacheliers dans les filières de l’enseignement supérieur tend à se dégrader, comme l’indique le tableau ci-après.
Taux de poursuite d’études des bacheliers dans les filières de l’enseignement supérieur
Rentrées universitaires | ||||||||
Constat |
Prévisions | |||||||
1990 |
1995 |
2000 |
2008 |
2009 |
2010 |
2014 |
2019 | |
Bacheliers généraux (BG) dans les universités et les établissements assimilés (hors IUT) |
66,6 |
71,6 |
62,4 |
54,7 |
55,0 |
54,4 |
52,5 |
50,0 |
Bacheliers technologiques (BG) dans les universités et les établissements assimilés (hors IUT) |
23,3 |
23,4 |
19,1 |
15,8 |
18,0 |
17,9 |
17,4 |
16,8 |
BG + BT dans les universités et établissements assimilés (hors IUT) |
52,9 |
56,0 |
46,8 |
42,0 |
43,3 |
42,6 |
41,6 |
40,1 |
Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, note d’information n° 10-07, octobre 2010 Nota : IUT : institut universitaire de technologie.
Ce contexte devrait conduire la puissance publique à adopter, rapidement, une mesure d’équité, donnant les mêmes chances de réussite à tous et consistant à verser une allocation, sous condition de ressources, aux jeunes en formation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs études.
En intervenant ainsi dans une période stratégique de la construction de leur parcours, cette aide donnerait aux jeunes les moins favorisés les moyens de conquérir leur autonomie. À ce titre, aux côtés des efforts indispensables à fournir pour rebâtir notre université, elle constituerait un bel investissement d’avenir.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation entend M. Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les crédits pour 2012 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » au cours de sa séance du mardi 18 octobre 2011.
M. Christian Kert, président. Nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois M. Laurent Wauquiez dans ses fonctions de ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour une audition sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour 2012.
M. Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le budget pour 2012 présente deux caractéristiques : il continue d’accorder une forte priorité à l’enseignement supérieur et à la recherche tout en contribuant à l’effort collectif de réduction des déficits.
Il n’y a pas de rigueur aveugle : le Gouvernement a choisi de poursuivre le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui constituent un des principaux moteurs face à la crise et le principal facteur de réponse aux questions d’ascenseur social, de compétitivité de nos entreprises et de capacité à créer à moyen terme les emplois dont nous aurons besoin.
Ce budget est destiné à consolider les réformes engagées, touchant notamment à l’autonomie des universités, à l’amélioration des conditions d’études, en particulier pour les enfants issus des classes moyennes, ou à l’accélération des grands chantiers tendant à stimuler l’excellence de la recherche française.
Plus de 9 milliards d’euros auront bien été investis – hors investissements d’avenir, hors plan de relance et hors opération campus – dans l’enseignement supérieur sur la période 2007-2012, conformément à l’engagement du Président de la République.
De ce fait, l’ensemble des leviers de financement sont mobilisés pour l’enseignement supérieur et la recherche en 2012.
![]()
![]()
D’abord, les autorisations d’engagement progresseront l’an prochain de 428 millions d’euros, soit + 1,7 %.
Deuxièmement, la montée en puissance du crédit d’impôt recherche (CIR) se poursuivra, avec 174 millions d’euros de crédits supplémentaires, notamment parce que nos PME en ont plus bénéficié et y recourent davantage. Ce dispositif favorise aussi le développement de partenariats public-privé (PPP), ce qui est très intéressant en termes d’approche de la recherche et de créations rapides d’emploi.
S’ajoutent, troisièmement, les moyens dédiés à des financements innovants : les intérêts de l’opération campus permettront de réaliser 167 millions d’euros d’investissements supplémentaires en 2012 et d’accélérer ainsi les chantiers, qui se sont multipliés sur les sites universitaires.
Enfin, au titre des investissements d’avenir, 1,2 milliard d’euros de crédits sera effectivement débloqué l’an prochain.
Il en résulte une augmentation de la dépense intérieure d’éducation. Pour l’université, elle s’établit à 10 180 euros par étudiant en 2010 contre 8 619 euros en 2006.
De même, la dépense intérieure de recherche, qui s’élève à 43,6 milliards d’euros, a progressé de 15 % depuis 2006, contre seulement + 10 % entre 2002 et 2006.
Cette politique ne consiste en aucun cas à allouer des moyens supplémentaires sans contrepartie : elle doit s’accompagner d’un certain nombre de réformes tendant à améliorer le fonctionnement de notre système pour le rendre plus opérationnel, plus performant pour nos étudiants, plus autonome, plus réactif pour nos universités, et permettre à l’enseignement supérieur et à la recherche de tisser des liens plus efficaces avec nos territoires.
Concernant l’enseignement supérieur, la première priorité pour 2012 est l’amélioration des conditions d’études.
Les bourses laissaient jusqu’ici de côté les classes moyennes, notamment les plus modestes. Le seuil d’obtention des bourses s’arrêtait, avant le début de ce quinquennat, à environ 2,2 SMIC. L’ensemble des réformes réalisées depuis a permis d’augmenter ce seuil à 3,3 SMIC, ce qui constitue un changement considérable. Parallèlement, nous finalisons l’octroi d’un dixième mois de bourse. Jusqu’ici, alors que les étudiants avaient besoin d’aide dès septembre, nous ne mobilisions les financements qu’en novembre : pour la première fois en France, les étudiants pourront cette année bénéficier de dix mois de bourse pour dix mois d’études. Cette mesure a été soutenue par l’ensemble des organisations étudiantes.
Au total, la politique de la vie étudiante bénéficie d’une augmentation de 91 millions d’euros.
Nous avons par ailleurs mis en place deux dispositifs : l’expérimentation dans deux régions d’un fonds de financement permettant d’aider les étudiants à payer les cautions de logement et le mois de garantie, ainsi qu’un partenariat pour les équipements numériques.
Au total, la revalorisation régulière des plafonds de revenus et des taux a permis d’augmenter de 25,4 % le nombre de boursiers – ce qui est historique – et d’avoir une progression du montant des bourses de 20 % en moyenne sur 2007-2011.
La deuxième priorité pour l’enseignement supérieur est la consolidation de l’autonomie des universités.
Les établissements d’enseignement supérieur verront leurs moyens augmenter de 237 millions d’euros.
En cinq ans, l’État aura fait progresser de 627 millions d’euros les moyens de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur, contre 527 millions au cours des dix années précédentes. Cela traduit un véritable changement de rythme.
Enfin, troisième priorité : la construction des campus de demain, permettant d’offrir à nos étudiants les meilleures conditions d’études. Disposer de centres de e-learning, de salles de réunion interactives, de bibliothèques de haut niveau et fonctionnelles, de couplages avec des laboratoires ou d’équipements sportifs est important pour leur réussite.
Nous accélérerons nos grands chantiers, notamment ceux prévus dans le cadre de l’opération campus ou la rénovation du campus de Jussieu – qui est actuellement à l’avant-garde alors qu’il était emblématique de la paralysie passée.
Je ne sous-estime en rien l’effort demandé aux établissements, mais il faut mesurer aussi l’ampleur de celui consenti par l’État.
S’agissant de la recherche, nous voulons lui donner les moyens d’être compétitive au plus haut niveau mondial.
En 2012, l’État consacrera 214 millions d’euros supplémentaires en sa faveur. Les crédits budgétaires augmenteront de 40 millions.
Les organismes de recherche devront réaliser des efforts de gestion, mais ils bénéficieront d’une augmentation de leur masse salariale et de moyens pour tenir nos engagements sur les très grandes infrastructures de recherche notamment.
Nous souhaitons davantage orienter le CIR sur les PPP, ce qui appuie nos laboratoires et leur permet d’avoir des déclinaisons et des applications techniques rapides. Cela permet également à nos entreprises de prendre de l’avance dans la compétition internationale.
Les chercheurs sont très preneurs de ces partenariats et les ont développés de façon assez soutenue à Bordeaux ou à Strasbourg, qui sont à l’avant-garde à cet égard.
Dans le cadre des investissements d’avenir, 20,6 milliards d’euros – hors opération campus – sont dédiés à la recherche et à l’innovation. 9,6 milliards d’euros sont déjà engagés dans 220 projets. Il s’agit d’une mutation importante : elle a suscité l’enthousiasme de la communauté scientifique, qui a présenté beaucoup de projets. En 2012, les laboratoires bénéficieront de près d’1,3 milliard d’euros de crédits à ce titre.
En conclusion, le budget pour 2012 accorde, dans un contexte d’effort collectif de maîtrise de nos finances publiques, une priorité essentielle à l’enseignement supérieur et à la recherche. D’abord, car ce secteur a été capable de se réformer de façon extraordinaire – il a, au cours de ces cinq dernières années, effectué une révolution culturelle majeure –, mais aussi parce qu’il a montré son aptitude à s’imposer comme principal moteur d’espoir pour notre pays.
M. Olivier Jardé, rapporteur pour avis des crédits de la recherche. La recherche est en effet essentielle pour notre avenir, notamment en cette période de crise.
Le budget de l’Agence nationale de la recherche (ANR) stagne, alors qu’il s’agit d’un opérateur très important pour les investissements d’avenir. Si je suis conscient des efforts nécessités par la maîtrise des déficits, je suis aussi préoccupé par la baisse sensible du taux de réussite moyen des projets qui lui sont soumis, lequel est nettement inférieur à 20 % aujourd’hui, contre 26 % à l’origine. Cela risque de décourager les nouveaux talents, car dans les projets « blancs » laissés à l’initiative des chercheurs, peu de jeunes équipes sont retenues. Pouvez-vous nous éclairer, voire nous rassurer sur ce point ?
Par ailleurs, cinq ans après leur création, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) présentent une grande hétérogénéité. À Strasbourg, une fusion s’est opérée, à Aix-Marseille ou Bordeaux, une transition en ce sens se dessine et, à Sorbonne Universités, on s’oriente vers une fondation, tandis que d’autres PRES se sont révélés infructueux. Le PRES est-il une structure définitive ou évolutive, pouvant aller jusqu’à la fusion ?
Ces pôles sont aussi un facteur de valorisation de la recherche publique, qui, il y a encore quelques années, était peu abordée dans les universités françaises. Une grande révolution culturelle s’est produite chez les chercheurs à cet égard. Ces pôles permettent également d’assimiler notre particularité fondée sur la séparation entre les grandes écoles, de haut niveau mais avec peu de recherche, et les universités, et de créer des passerelles indispensables entre les deux. De plus, certaines universités avaient de petits services de valorisation : la mutualisation de leurs moyens a eu à cet égard un effet positif, alors même que celui-ci n’avait pas été envisagé au départ.
Les auditions réalisées dans les établissements m’ont en outre permis de constater le caractère préoccupant de l’emploi contractuel. Si le Gouvernement envisage une loi sur la titularisation de ces emplois, on assiste parfois, alors qu’aucun texte n’a été adopté, à la suppression prématurée de ceux-ci, conduisant à l’interruption de certaines recherches. C’est le cas notamment à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), où certaines personnes ont vu leur contrat suspendu alors que leur programme de recherche n’était pas terminé. Ce problème doit être distingué de celui des thésards qui prolongent leurs recherches.
Enfin, si l’État fait un effort important pour la recherche, je regrette que l’École normale supérieure (ENS) soit passée de la 71e à la 69e place seulement dans le classement de Shanghai.
Mme Martine Faure, rapporteure pour avis des crédits de l’enseignement supérieur. Conformément aux usages de notre Commission, j’ai choisi un thème d’investigation – le plan licence – auquel l’essentiel de mon avis budgétaire sera consacré, la licence étant pour moi le maillon essentiel de l’enseignement supérieur car le plus fréquenté et le plus fragile.
Sur l’évolution des crédits de l’enseignement supérieur, je ferai simplement quelques remarques. D’abord, l’engagement du président de la République d’augmenter de cinq milliards d’euros en cinq ans le budget de ce secteur ne sera pas tenu.
Par ailleurs, ce budget est peu lisible, car construit sur des montages complexes et « concurrencé » par les investissements d’avenir. Sur ce dernier point, d’un côté, nous aurons quelques grands pôles universitaires et scientifiques choyés – Jussieu, Strasbourg, le pôle de Paris, Bordeaux I et Bordeaux II – ; de l’autre, des universités de proximité, peu gâtées par le modèle d’allocation des moyens qui est loin d’être « sympathique », contrairement à ce que pourrait laisser penser son acronyme SYMPA. Enfin, certains programmes semblent particulièrement mal traités, notamment ceux relatifs au personnel, à la recherche et à la vie étudiante.
En ce qui concerne la licence, les taux d’échec enregistrés frappent les bacheliers, souvent mal orientés.
Doté de 750 millions d’euros sur cinq ans, le plan licence – qui vise à mieux accompagner les étudiants par une meilleure orientation, des heures d’enseignement plus nombreuses, un tutorat et une pédagogie plus différenciée – a été ouvert à la demande des organisations étudiantes. C’est un bel investissement d’avenir mais, hélas, les vingt-huit personnes que j’ai auditionnées m’ont démontré que l’application de ce plan a été partielle et partiale, car freinée pour des raisons à la fois budgétaires et idéologiques.
Je souhaite vous interroger sur cinq points.
Le plan licence n’est-il pas trop soluble dans le budget global des universités aux compétences élargies ? Comment concilier le fléchage de ses crédits et la liberté d’allocation des moyens confiés aux établissements – qui conduit à ce que les crédits soient peu dépensés, saupoudrés et parfois utilisés à de toutes autres fins que la réussite en licence ? Que peut-on faire pour mieux encadrer l’exécution budgétaire de cette politique ?
Une trentaine de référentiels de formation devraient être prêts pour la fin de l’année. Pouvez-vous nous dire combien seront effectivement publiés ? Par ailleurs, il semble que leur élaboration ne soit pas très transparente alors qu’elle aurait pu être confiée au comité licence. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ?
Pour les organisations étudiantes, le point le plus décevant est que ce plan n’a pas révolutionné la pédagogie universitaire. Nous sommes encore, faute de personnels suffisants – je rappelle que la France est située au bas de l’échelle s’agissant du taux d’encadrement dans l’enseignement supérieur –, dans le modèle du « tout amphi ». Nos ambitions en la matière se heurtent également au fait que l’essentiel de la carrière et de l’évaluation des enseignants-chercheurs repose sur leur travail de recherche et non sur leur enseignement. Pourquoi ne pas prévoir des incitations collectives à l’investissement des enseignants-chercheurs dans la pédagogie ? Par ailleurs, les centres d’initiation à l’enseignement supérieur ne pouvant plus assurer leur rôle, ne faudrait-il pas confier la mission essentielle de formation initiale et continue des enseignants-chercheurs aux instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), en lien avec les PRES ?
S’agissant des instituts universitaires de technologie (IUT), la circulaire de 2009 sur leur autonomie de gestion et les contrats d’objectifs et de moyens entre les universités et ces instituts ne semblent pas suffisants pour préserver les spécificités de la filière. N’est-il pas temps de rappeler solennellement le droit aux universités en publiant un décret sur cette autonomie de gestion et en annexant les contrats d’objectifs et de moyens à ceux conclus entre les établissements et l’État ?
Enfin, la lutte contre l’échec en licence doit s’attaquer aux racines sociales de ce phénomène. 35 % des étudiants travaillent pour financer leurs études, les enfants d’ouvriers étant proportionnellement plus nombreux à travailler à plein-temps. Or notre système de bourses, malgré les améliorations apportées récemment, ne parvient pas à corriger cette inégalité devant la réussite. Le taux de poursuite d’études de nos bacheliers dans les filières de l’enseignement supérieur tend par ailleurs à se dégrader. Dans ce contexte très inquiétant, quelles mesures d’équité donnant les mêmes chances de réussite à tous seriez-vous prêt à prendre en urgence ?
M. Gérard Gaudron. Quels sont les exemples de réussite en matière de PPP ?
M. le ministre. Je précise d’emblée que je n’ai pas évoqué les PPP au sens juridique du terme, mais par allusion aux laboratoires de recherche constitués en couplage avec une entreprise pour essayer de développer une synergie rapide. C’est ainsi que sur les nanotechnologies, la France est leader dans le monde, grâce à un partenariat public-privé CNRS-entreprises, avec une start-up qui occupe aujourd’hui 75 % du marché.
Mme Marie-Hélène Amiable. Comme nous l’avons déjà souligné les années précédentes, la présentation de ce budget est trompeuse, car elle mélange les crédits de paiement et ceux du plan campus, du grand emprunt et du CIR.
La hausse affichée couvrira à peine l’inflation et ne semble pas tenir compte du glissement vieillesse-technicité (GVT). Quelles précisions pouvez-vous apporter sur ce point ?
Fin 2007, le Gouvernement a annoncé un effort financier exceptionnel pour remettre notre pays à niveau, mais cet engagement ne sera pas tenu.
Le CIR bénéficie encore cette année d’une augmentation sensible, malgré les critiques de la Cour des comptes, alors que le budget des universités semble le grand perdant.
Les établissements d’enseignement supérieur font de plus en plus part de difficultés après l’annonce d’économies inquiétantes. Ainsi, le président de l’université de Pau, que j’ai rencontré hier, ne voit pas comment il va pouvoir voter un budget en équilibre l’an prochain. Selon lui, cela n’est pas lié à une mauvaise gestion, mais on ressent durement le milliard d’euros manquant dans le budget de fonctionnement des universités. Pour maîtriser le GVT, il est contraint de geler des postes : il dispose d’une vingtaine d’emplois vacants et devra sans doute décider de différer dix recrutements. Il s’interroge aussi sur les marges de manœuvre annoncées et n’a pas caché qu’il serait obligé de prendre d’autres mesures impopulaires pour maintenir l’équilibre : retarder le paiement des heures complémentaires, bloquer la progression des régimes indemnitaires ou diminuer l’offre de formation. Il va aussi demander aux directeurs de laboratoire de faire de nouveaux efforts. Or cette situation de détresse existe dans de nombreuses autres universités.
Nous souhaiterions donc disposer d’informations sur la situation précise de chaque établissement, distinguant les variations liées au plan campus et au grand emprunt, pour nous prononcer en toute connaissance de cause.
Je ne reviens pas sur le plan licence qui vient d’être évoqué, mais les résultats obtenus ne semblent pas satisfaisants en la matière alors qu’il était annoncé comme une priorité.
S’agissant de la vie étudiante et de l’aide sociale, dont vous dites faire aussi une priorité, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) connaissent une baisse de 5,5 % de leurs crédits. Le fonds d’urgence, créé en 2008, est en stagnation et toujours soumis à des critères discrétionnaires. Il doit être plus lisible afin d’en faire un véritable outil d’amélioration de la vie étudiante.
Pouvez-vous confirmer que le financement intégral des dix mois de bourse sera assuré ?
Par ailleurs, on ne peut que s’inquiéter des conséquences du doublement de la taxe sur les mutuelles sur la santé des étudiants.
En outre, les budgets des organismes de recherche publics sont en recul et ceux-ci sont contraints d’externaliser certaines fonctions et de réduire leurs personnels.
Enfin, divers rapports ont montré l’urgence d’une réforme de la formation des enseignants : quelles sont vos propositions à cet égard ? Quelle est leur traduction budgétaire en 2012 ?
M. Alain Marc. Les licences professionnelles donnent de très bons résultats et offrent une formation en adéquation avec le marché du travail. Ainsi, dans des petites villes comme Saint-Affrique, on enregistre sept emplois créés pour un élève. Comment entendez-vous développer ces licences ?
Mme Monique Boulestin. Le financement du dixième mois de bourse sera-t-il pérennisé ?
Je partage les inquiétudes exprimées par nos collègues sur les PRES, qui présentent de fait une grande hétérogénéité. C’est le cas notamment pour celui de Limoges-Poitiers-La Rochelle, pour lequel j’ai beaucoup travaillé et avais souhaité que l’on renforce la mutualisation entre les trois universités : comment voyez-vous son avenir ?
Enfin, à quoi va servir le fonds d’innovation pédagogique dont vous avez annoncé la création en juin dernier dans le cadre du grand emprunt ?
M. Bruno Bourg-Broc. La tendance est au regroupement dans de grands centres universitaires. Quelle est votre position sur l’enseignement supérieur et la place des universités dans les villes moyennes ?
Comment voyez-vous l’avenir des IUFM et quelle en est la traduction dans le budget ?
M. Pascal Deguilhem. On observe un décalage entre les montants annoncés – le Président de la République avait ainsi promis 1 milliard d’euros par an pour l’enseignement supérieur – et la réalité.
Pouvez-vous nous communiquer la liste des chantiers en cours sur les campus universitaires ?
Qu’en est-il des universités de territoires ?
Par ailleurs, tous les présidents d’université s’inquiètent du manque de moyens disponibles. D’autant que s’ajoute la prise en compte de l’arrêté d’août dernier sur la licence.
Une autre question concerne les universités qui, lors de leur passage à l’autonomie, ont été sous-dotées ou avaient effectué de mauvaises évaluations – ce dont on ne peut leur faire grief en raison des nouvelles dépenses engendrées par la réforme.
Enfin, la santé des étudiants, sur laquelle vous avez rédigé un rapport lorsque vous étiez député, pose un problème tant du point de vue des assurances complémentaires santé que de l’accès aux soins.
M. Dominique Le Mèner. On dit que le patrimoine immobilier des universités est utilisé 24 semaines par an. Des réflexions ont été engagées dans ce domaine, notamment sur l’allongement de cette durée : quelles ont été les avancées enregistrées ?
Mme Marietta Karamanli. La conférence des présidents d’université (CPU) n’exclut pas des difficultés pour boucler les budgets des établissements, notamment pour les universités assurant de nouvelles missions, sachant que la dotation qui leur est versée a un caractère global et ne tient pas suffisamment compte des différences démographiques concernant leurs personnels ni des conséquences en termes de GVT. Certaines d’entre elles seront donc pénalisées, et en tout cas dans l’impossibilité de voter un budget global équilibré.
Que ferez-vous si elles n’y parviennent pas ? L’intervention des recteurs pour y remédier ne risque-t-elle pas de conférer à ces établissements une autonomie moindre qu’avant la réforme ?
Certains des crédits de l’action relative à la formation initiale du bac à la licence sont en baisse : il faudrait rajouter 48 millions d’euros pour assurer le niveau souhaité. Quelles sont les raisons de cette baisse, alors que des efforts sont nécessaires dans ce domaine et que l’objectif de 1 500 heures d’enseignement pour chaque étudiant du premier cycle risque d’être difficile à atteindre ?
S’agissant de la santé des étudiants, l’enquête réalisée par les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé met en évidence sa dégradation, un tiers d’entre eux renonçant à des soins. Or les crédits correspondants sont en baisse !
De même, ceux relatifs à l’action sur la recherche dans les sciences de la vie diminuent de 104,9 millions d’euros ou -12 % : pourquoi ?
M. René Couanau. Au-delà des évolutions très positives touchant l’enseignement supérieur, je souhaiterais attirer votre attention sur trois difficultés.
S’agissant des IUT, si je suis favorable à l’autonomie des universités, le fait que certains crédits ne soient plus ciblés en leur faveur entraîne des problèmes d’arbitrage. Or ils donnent de bons résultats et favorisent la création d’emplois. L’université est un tout, qui doit tendre vers l’excellence : les grandes universités doivent disposer de tous les moyens nécessaires pour assurer une certaine masse critique, mais les IUT créés dans les villes moyennes participent à cette excellence, notamment au travers de l’insertion par l’emploi. Que comptez-vous faire pour remédier à ces problèmes sans remettre en cause l’autonomie des établissements ?
Les pôles universitaires de proximité (PUP) lancés par votre prédécesseur, tendant à regrouper les IUT, les établissements universitaires des petites ou moyennes villes et les formations post-bac de l’éducation nationale, se heurtent aujourd’hui à quelques obstacles. C’est le cas notamment à Saint-Malo. Or les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ne semblent pas avoir de doctrine bien définie dans ce domaine. Pourtant, on pourrait tirer des avantages à la constitution de ces pôles et les participations des collectivités locales seraient plus importantes si nous les réussissions.
Enfin, tout concorde à démontrer que la formation des enseignants constitue un échec grave. Nous avons ici un rapport, que je qualifierai de dormant, en ce sens : j’espère qu’il sera bientôt rectifié et publié. Chaque année qui passe engendre des générations de professeurs dont nous savons qu’ils n’auront pas été formés sur le plan pratique. Quand le Gouvernement va-t-il prendre des initiatives énergiques pour inverser ce phénomène ? Il en va du succès des générations à venir : les professeurs nommés aujourd’hui seront en service pendant au moins 35 ans. Certes, l’enseignement supérieur indique prodiguer la formation qu’il faut, mais on n’a pas arrêté avec l’éducation nationale les mesures correctrices nécessaires. Il s’agit d’une question à la fois importante et urgente.
Mme Martine Martinel. Le recours au grand emprunt pour augmenter le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche a entraîné une révision de la carte universitaire, laquelle a conduit à une concentration de l’excellence mais aussi au risque de marginaliser de nombreux établissements. Comment remédier à cet état de fait qui accroît les inégalités entre les régions et parfois à l’intérieur de celles-ci ?
Par ailleurs, selon le dernier numéro du magazine Elle, le coût de la vie étudiante aurait augmenté de 4,1 % par rapport à l’an dernier. De plus, seuls 7 % des 2,3 millions d’étudiants bénéficieront d’un logement étudiant.
Quant au rapport « dormant » sur la formation des maîtres, il ne doit pas être réveillé ! Mais les universités chapeautent les écoles internes ayant remplacé les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) : au moment où l’on prône la nécessité de raffermir les connaissances des élèves, on est en train de sacrifier des générations d’entre eux faute d’enseignants formés et en nombre suffisant !
M. Jean-Louis Touraine. Il existe un contraste entre votre présentation optimiste et la morosité, voire l’angoisse ou la démobilisation de la plupart des chercheurs, dont beaucoup partent à l’étranger. La place de la France dans le monde en matière de recherche ne s’améliore pas, restant en proportion du PIB loin derrière des pays tels que le Japon, les États-Unis ou certains pays émergents.
Deux exemples attestent des difficultés rencontrées.
Le premier a trait à l’inclusion dans le budget de la recherche du CIR, dont la part augmente année après année. Si celui-ci peut être utile – notamment pour aider au développement, soutenir des entreprises en difficulté, appuyer les projets de très grosses structures réparties en filiales multiples pour en bénéficier –, le fait de le faire apparaître comme une contribution significative à la recherche peut avoir des effets pervers, car il n’incite guère à de nouvelles recherches. Ce faisant, il ne satisfait pas les besoins des chercheurs engagés dans la recherche fondamentale ou vraiment innovante.
Le deuxième exemple touche à la recherche universitaire, où une minorité d’établissements est en effet très choyée. Mais, dans l’ensemble, beaucoup de centres souffrent – et davantage que par le passé. De plus, on observe des inégalités de traitement selon les domaines : comment peut-on envisager une réduction aussi significative des crédits consacrés aux sciences de la vie, aux biotechnologies ou à la santé ? Cela est non seulement néfaste pour la santé de nos concitoyens, mais également pour la place de la France dans un domaine où elle avait un certain niveau d’excellence.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) pâtit lui-même de cette situation : si les plus grands laboratoires sont soutenus, il n’en est pas de même des petites ou moyennes unités et les nouvelles équipes sont peu nombreuses à être aidés. C’est pourtant là que réside le potentiel le plus important en termes d’innovation. Les budgets ont trop négligé ces aspects au fil du temps.
M. Jean-Luc Pérat. Dans le Réseau départemental des ruches d’entreprises du département du Nord que je préside, trois présidents d’université participent au conseil d’administration pour développer la création d’entreprises, mais les universités qui s’engagent dans le processus rencontrent des obstacles, liés notamment à la difficulté de susciter une motivation chez les étudiants. Comment entendez-vous inciter ceux-ci à se lancer dans la création d’entreprise – sachant par ailleurs que trop peu de jeunes femmes osent franchir le pas en la matière ?
Enfin, comment mieux faire connaître les universités dans les établissements scolaires, notamment en milieu rural, et démystifier ces dernières aux yeux des élèves pour permettre à ceux qui le peuvent d’aller le plus loin possible dans leurs études ?
M. Régis Juanico. Nous sommes, à la fin de ce quinquennat, à l’heure du bilan. Le Président de la République s’était engagé à accroître le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche d’1,8 milliard d’euros par an : cet engagement sera-t-il tenu ?
On a concentré les moyens sur les pôles d’excellence et les PRES. Or les taux d’insertion professionnelle sont très bons dans certains PUP tels Chambéry, La Rochelle, Chambéry ou Saint-Étienne. Ne pourrait-on accorder un soutien plus important aux universités ayant des projets de petite ou moyenne taille ?
Allez-vous prendre en compte l’évolution de la masse salariale dans les critères d’attribution des dotations accordées aux universités ?
M. le ministre. Monsieur Jardé, le taux de sélection des appels à projets est de 22 %, contre 26 % précédemment. Il faut tenir compte de la fluctuation normale liée aux réponses apportées aux investissements d’avenir et à l’épuisement de projets qui a pu en résulter dans certaines équipes. Nous n’avons pas atteint la cote d’alerte, mais nous devons rester vigilants dans ce domaine : nous en avons d’ailleurs discuté avec l’ANR.
Nous sommes très attachés aux projets « blancs », dont on a besoin et qui mobilisent 50 % des crédits classiques de l’ANR et 80 % des investissements d’avenir. Il faut laisser une marge de manœuvre aux chercheurs – beaucoup d’entre eux, avec lesquels je me suis entretenu, tels Gilles Hoffmann, y insistent – et mixer ce type de projets avec des appels à projet plus cadrés.
Les PRES jouent le rôle de nos communautés d’agglomération ou de communes sur nos territoires. Ils permettent de regrouper des forces dispersées et ont conduit à deux évolutions majeures : d’une part, dépasser l’opposition entre grandes écoles et universités – faiblesse congénitale de notre système – en les faisant travailler ensemble et, d’autre part, remédier à l’autre point noir que constituait le découplage entre l’université et les organismes de recherche. À l’intérieur des PRES, ceux-ci sont très impliqués, les grands laboratoires l’étant à plusieurs titres, d’autres de façon plus ciblée, tel l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier ou l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) qui est membre du PRES Université Paris-Est.
Mais le dispositif doit rester souple, à l’image des communautés d’agglomération ou de communes qui se saisissent de compétences différentes : chaque PRES doit trouver son chemin et le modèle n’est pas nécessairement l’émergence d’une université unique. Le cas de Strasbourg – dont l’université a remarquablement réussi au cours des dernières années – me réjouit parce qu’il est adapté à cette région, mais il n’a pas forcément vocation à s’appliquer aux autres territoires. Il ne faut pas enfermer les PRES dans un carcan !
Néanmoins, il faut éviter que chaque établissement reste dans son coin. Ainsi, à Lyon, l’école de commerce et l’école d’ingénieurs travaillent ensemble en partenariat avec l’université des sciences et, à Toulouse, l’école de commerce s’est rapprochée de la formidable école d’économie rattachée à l’université.
Concernant les questions de contractualisation et l’application du protocole de la fonction publique, l’enseignement supérieur présente des particularités. J’essaie de faire en sorte qu’elles soient prises en compte, au travers de l’élaboration d’une disposition spécifique sur les contrats de chercheurs ou d’ingénieurs et d’un texte permettant de conclure des contrats valables pour la durée d’une convention et renouvelables une fois. Il faut en effet suffisamment de temps pour permettre de réaliser un vrai travail de recherche spécialisé, notamment s’agissant des jeunes thésards.
Au sujet de la place de l’ENS, il faut s’attacher avant tout au baromètre de l’ensemble de notre système, qu’il faut tirer vers le haut, ce qui n’empêche pas d’avoir des vaisseaux amiraux, dont on a besoin.
Je n’aime pas l’expression d’universités de proximité, qui n’a pas de sens et peut être méprisante, dans la mesure où elle les enferme géographiquement. Les universités doivent s’appuyer sur leur territoire pour faire valoir une ambition nationale et internationale.
Madame Faure, 9,4 milliards d’euros auront été investis dans l’enseignement supérieur entre 2007 et 2012, notamment 4,5 milliards de crédits budgétaires, 3,5 milliards de CIR et 0,4 milliard d’intérêts liés à l’opération campus : l’engagement du Président de la République aura donc bien été tenu. Si l’on y ajoute les 730 millions d’euros du plan de relance, les 5 milliards d’euros de l’opération campus et les 11 milliards correspondant aux investissements d’avenir, l’objectif est même largement dépassé ! Sauf à considérer que seules les dépenses de fonctionnement valent et que les investissements ne comptent pas…
Par ailleurs, il ne faut pas confondre les pôles d’excellence et le choix des initiatives d’excellence (IDEX), consistant à faire émerger dix pôles universitaires, auxquels on consent certains moyens spécifiques. Ces initiatives ne doivent pas se limiter à la région parisienne mais concerner tout le territoire. Le jury a d’ailleurs retenu des universités qui n’étaient pas attendues : celle de Bordeaux – qui œuvre à un partenariat sur l’ensemble de la région Aquitaine – ou de Strasbourg – qui travaille étroitement avec Mulhouse et à un partenariat européen – à côté de Paris Sciences et Lettres (PSL).
Je répète que je ne crois pas aux universités de proximité au sens où elles s’enfermeraient. Des universités telles que celles de Clermont-Ferrand, dans le domaine de l’agroalimentaire, de la diversité des espèces ou de l’étude des volcans, de Limoges dans celui de la céramique, de Lorraine dans la résistance des matériaux ou d’Avignon, se sont astucieusement positionnées sur des créneaux, en osmose avec leur territoire, qui doit servir de tremplin à une excellence reconnue au niveau national ou international. On peut citer aussi les pôles universitaires du Grand Ouest sur les métiers de la mer ou de Savoie dans les métiers de la montagne. Tel est le modèle que je défends, qui n’est pas limité à quelques métropoles régionales d’équilibre.
M. René Couanau. Si la proximité ne doit pas enfermer, elle peut aussi élargir. Je ne sais si le terme de proximité était bien choisi, mais je suis convaincu qu’en liaison avec les grands centres universitaires, il n’est pas exclu que les territoires offrent, non seulement aux étudiants de la région, mais à tous, un support universitaire débouchant sur l’emploi. La professionnalisation est aussi un objectif de l’université. Cette question mérite d’être clarifiée, dans la mesure où certaines régions comme la mienne se sont engagées dans cette direction.
M. le ministre. L’université de proximité a été très mal ressentie par les présidents d’université, qui y voient une sorte de division d’honneur. Les universités doivent s’appuyer sur les forces de leur territoire, en partenariat avec les PME et les collectivités locales, pour viser le premier rang au plan national et international.
S’agissant de la vie étudiante, je rappelle que les crédits augmenteront de 91 millions d’euros. Il s’agit pour nous d’une mesure pérenne, qui est financée pour l’année universitaire en cours et la suivante.
Quant au plan pour la réussite en licence, il fait l’objet de crédits ciblés et ne devrait pas donner lieu à des confusions sur le plan budgétaire.
Son principal acquis est d’étendre la durée d’études universitaires et de permettre l’élaboration de plans d’accompagnement de la rentrée universitaire – le nombre d’universités organisant des sessions d’accompagnement a considérablement augmenté et le taux d’échec dans les premières semaines a été, de ce fait, nettement réduit. Il faut assurer cet accompagnement et permettre aux étudiants, par le biais de semestres « rebonds », de changer d’orientation en cours d’année. L’ouverture offerte en médecine en termes de passerelles et de choix me paraît intéressante à cet égard.
L’arrêté sur la licence a fait l’objet d’un soutien unanime de toutes les organisations étudiantes, ce qui ne s’était jamais vu. Il permet de définir des référentiels liés aux débouchés professionnels et d’assurer un niveau minimal de qualité ainsi que de volume horaire, alors que celui-ci allait de 600 à 1 200 heures jusqu’ici. Il permet aussi de faciliter l’accès des boursiers aux études supérieures, même si cela prendra un peu de temps : le dispositif montera progressivement en puissance dans le cadre d’un dialogue avec les universités.
Je suis très attaché à la place des IUT. Pour en avoir un en Haute-Loire, je sais combien ils constituent une chance pour les universités, de même que le fait de les avoir en leur sein. Ils développent de plus en plus des partenariats de recherche avec certains laboratoires. Ainsi, certains IUT spécialisés en imagerie font de la recherche conjointe avec une université de médecine sur l’imagerie médicale, ce qui n’était guère concevable il y a quelques années.
Il est vrai que des frictions existent à certains endroits, où le budget des IUT risque de faire l’objet de variables d’ajustement : j’ai demandé à la direction générale pour l’enseignement supérieur de veiller à ce que leurs moyens soient préservés. Mais il ne faut pas exagérer les difficultés : ces instituts ont globalement trouvé leur place au sein des universités. Il faut cependant rester vigilant à cet égard, car ils constituent un très bon modèle d’insertion professionnelle.
Madame Amiable, je vous remercie d’avoir souligné les progrès enregistrés sur les conditions de vie et d’étude des étudiants.
L’université de Pau m’est également chère : son président me rappelait récemment combien sa situation budgétaire était plus enviable que celle des universités espagnoles, portugaises ou grecques, qui ont subi des amputations de l’ordre de 15 %. Si l’on peut naturellement souhaiter toujours plus de moyens, les investissements consentis par l’État n’en demeurent pas moins importants. Je rappelle que la seule mission relative à l’enseignement supérieur bénéficie de 373 millions d’euros supplémentaires. Je suis conscient des efforts de gestion demandés aux universités, mais ce secteur reste une priorité du Gouvernement.
S’agissant de l’amélioration de la santé des étudiants, qui me préoccupe, j’y travaille avec le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et les mutuelles et organisations étudiantes.
Sur les formations innovantes, nous œuvrons d’arrache-pied. L’excellence ne s’incarne pas uniquement dans des matériels de recherche ou dans des laboratoires : le but est avant tout de faire en sorte que les étudiants réussissent. Cette excellence pédagogique est illustrée par exemple en Bourgogne par la mise en place d’un système de e-learning ou à l’université de Grenoble par l’organisation de cours en petits amphis. De même, les projets prévoyant un système de tutorat plus important sont intéressants. Nous sommes encore en discussion sur le paquet global de mesures, mais nous devrions être en mesure de vous livrer davantage d’informations à cet égard à partir du 26 octobre.
Madame Boulestin, le PRES de Limoges-Poitiers-La Rochelle n’est en effet pas facile à gérer car il est situé sur un territoire très étendu, mais j’y suis très attentif et je crois en lui, de même qu’à la place de l’université de Limoges – j’en parlais encore tout à l’heure avec le recteur.
Par ailleurs, les crédits du fonds national d’urgence ont été rétablis à 40 millions d’euros en 2011-2012.
Monsieur Bourg-Broc, je crois naturellement à la place des villes moyennes dans le réseau des universités. Mais celle-ci ne peut être la même partout. Chaque ville doit trouver en quelque sorte sa carte d’identité appropriée. Mais, dans certaines régions, il faut travailler à améliorer la spécialisation des sites.
Monsieur Deguilhem, il est assez sain de délivrer le même message tout au long d’un quinquennat ! Il serait au contraire suspect d’avoir chaque année un discours différent en matière d’enseignement supérieur ! Ce secteur mérite une action dans la durée : la constance est nécessaire en la matière.
De nombreux chantiers sont en cours sur les campus, que ce soit à l’université de sciences humaines de Bordeaux, en centre ville, à Grenoble, à Jussieu, à Paris II, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg, à Lyon, à Poitiers, qui dispose d’un très beau projet de campus sportif, à Aix-en-Provence pour un projet de belle résidence universitaire, en Avignon qui disposera d’un remarquable campus dans les zones industrielles, ou bien en Lorraine. Je vous invite à venir les voir.
La meilleure réponse à la question de l’utilisation du patrimoine des universités est le recours à la formation continue, qui est un véritable moteur d’ascenseur social et permet d’utiliser les sites dans la durée. On traite aujourd’hui plus de 470 000 dossiers de formation continue, contre moins de 400 000 il y a quelques années. Certaines universités ont une véritable appétence dans ce domaine.
L’autonomie des universités implique que certaines soient bien gérées et que d’autres rencontrent des difficultés financières. Celles-ci peuvent être dues à une sous-dotation initiale, à un impact du GVT lié à des mesures nationales, mais aussi à des mesures de gestion internes. Nous avons avec ces établissements un système partenarial consistant à les accompagner et à essayer, par le biais de missions d’expertise, de leur permettre de retrouver un équilibre. Ils font partie de l’État et cela relève d’un apprentissage naturel de l’autonomie. Mais il ne faut pas que des décisions nationales, y compris en matière de GVT, contrecarrent directement des choix faits par les universités dans le cadre de l’autonomie qui leur a été accordée.
S’agissant de la formation des maîtres, il ne me revient pas d’arrêter les programmes ni le contenu de celle-ci, qui relèvent du ministère de l’éducation nationale. Mon travail consiste à faire en sorte que les universités s’y investissent, de m’assurer qu’on offre la possibilité à nos étudiants d’être confrontés à la réalité du métier d’enseignant avant de passer des concours et de développer les formations en alternance.
Madame Martinel, le logement étudiant est un élément essentiel. Dans le budget des étudiants, le logement a une part importante. C’est d’autant plus le cas pour ceux qui doivent quitter le domicile familial pour poursuivre leurs études.
C’est la raison pour laquelle j’ai eu comme priorité de mettre en place un dispositif expérimental, d’abord à Lyon et Lille, pour prendre en charge la caution solidaire et le mois de garantie. Par ailleurs, nous prévoyons de dépasser pour la première fois les objectifs prévus par le plan Anciaux en termes non seulement de constructions de logements mais de réhabilitations.
J’invite fortement les régions à réaliser des investissements dans ce domaine. Certaines en font beaucoup, comme la région Rhône-Alpes, mais d’autres en font peu voire aucun, comme la région Auvergne, ce qui est regrettable. La mobilisation dans ce domaine doit être générale.
Monsieur Touraine, le CIR peut avoir un véritable effet de levier. Il en est ainsi par exemple pour le projet Wheat-8, portant sur les nouvelles variétés de blé, plus résistantes à la sécheresse et à l’humidité et permettant d’avoir un meilleur rendement, ou le projet de recherche fondamentale en macro-économie de l’école de Toulouse. Le CIR est un facteur de cohésion nationale autour de la recherche, car il permet de sortir de l’image caricaturale et absurde distinguant, d’un côté, des chercheurs enfermés dans leur laboratoire et déconnectés de la réalité, et, de l’autre, des entreprises investies dans la recherche appliquée efficace.
Par ailleurs, il n’y a aucune raison que les crédits de l’action sur la recherche dans le domaine de la santé et des biotechnologies diminuent : je vais m’assurer que ce n’est pas le cas. Nous avons beaucoup investi dans ce domaine, notamment dans le cadre des plans de lutte contre le cancer ou la maladie d’Alzheimer, qu’il s’agisse de la biologie de synthèse ou de la biologie structurale.
Monsieur Pérat, il convient de développer des start-up sur les campus universitaires, comme à Poitiers, et des sociétés d’accélération de transfert de technologies. De même, il faudrait mobiliser davantage les crédits pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour les créations d’entreprise : nous essayons d’avoir des partenariats dans ce domaine, que nous cherchons à décliner aussi sur les campus universitaires.
Tout ce qui permet de faire découvrir le monde de l’université aux lycéens va dans le bon sens. Il est important que les universitaires poussent la porte des lycées : on essaie de les y encourager, y compris dans le cadre du plan réussite en licence. Certaines universités, en Lorraine notamment, ont été très entreprenantes à cet égard.
Enfin, le PUP de Saint-Étienne constitue une excellente réussite. Il a donné lieu à six investissements d’avenir, concernant les laboratoires d’excellence (LABEX) et les équipements d’excellence (EQUIPEX). Il ne faut pas le réduire à l’appellation de pôle de proximité : c’est un très beau pôle, qui s’est appuyé sur un partenariat entre les grandes écoles et les universités en liaison avec le milieu économique ; il est capable d’un large rayonnement.
M. Christian Kert, président. Monsieur le ministre, je vous remercie.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine, pour avis, les crédits pour 2012 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » sur le rapport de M. Olivier Jardé (Recherche) et de Mme Martine Faure (Enseignement supérieur et vie étudiante) au cours de sa séance du mercredi 19 octobre 2011.
M. Christian Kert, président. Nous sommes réunis ce matin pour nous prononcer sur les crédits pour 2012 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». Je vous rappelle que nous avons entendu hier M. Laurent Wauquiez, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a déjà répondu à un nombre important de questions. Je demanderai donc à nos rapporteurs de nous faire une présentation de leur avis, puis nous passerons aux explications de vote et au vote.
M. Olivier Jardé, rapporteur pour avis. La recherche, c’est notre avenir, et d’autant plus en période de crise, puisque d’elle dépendent l’innovation et la valorisation. C’est un budget important et conforme aux engagements qui ont été pris, tant sur le plan financier que sur celui des recrutements. La mission n’étant pas concernée par le non remplacement d’un départ sur deux, les effectifs de la recherche sont complètement maintenus.
Le budget de la recherche représente 14 milliards d’euros, soit près de 5 % du budget de l’État, auquel il convient d’ajouter le crédit d’impôt recherche, qui fait la jonction entre la recherche académique et les entreprises. Il permet aux partenaires de mieux se connaître pour être plus efficaces.
À cela s’ajoutent les dotations du grand emprunt : sur 35 milliards d’euros, les investissements d’avenir dont bénéficie la recherche française atteignent 22 milliards, soit plus de 62 %. En 2012, les laboratoires devraient ainsi disposer de 1,2 milliard de crédits structurants.
Nous sommes devant des moyens consolidés, mais la recherche ne se réduit pas à des chiffres : pour faire partie d’équipes de recherche depuis de nombreuses années, je voudrais souligner que les scientifiques ont besoin d’une certaine reconnaissance de la Nation, en contrepartie de l’honneur d’être chercheur.
Beaucoup de jeunes n’envisagent pas, ou plus, de se diriger vers la recherche et il faut les y inciter. Une Nation a besoin de chercheurs de haut niveau, mais aussi des structures pour les accueillir. Je me réjouis, à cet égard, que des questions qui ont pu se poser naguère, comme le maintien du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en tant que tel, par exemple, ne soient plus d’actualité. Cette grande et ancienne institution a su se réorganiser autour d’instituts qui permettent de mieux articuler des recherches menées, le plus souvent, à la jonction des domaines de la connaissance. Faut-il rappeler que l’IRM n’a pas été conçu en fonction de ses applications pour les diagnostics médicaux, pas plus que le Laser pour son utilisation industrielle ou médicale ?
La jonction entre les équipes de recherche, finalisée sous forme d’alliances prend dès lors une grande importance.
Au-delà des chiffres, donc, il est important qu’existent des structures efficientes et que soit reconnu le travail des chercheurs.
Le maintien des effectifs est d’autant plus appréciable que l’âge des chercheurs devient une des questions cruciales des dix prochaines années. Je serai, comme 50 % des chercheurs, à la retraite dans dix ans. En effet la moitié de nos chercheurs ont entre 50 et 60 ans. Se pose donc un problème de recrutement et de renouvellement des équipes, ce qui renforce le besoin de valoriser le métier de chercheur.
Le crédit d’impôt recherche que j’évoquais en introduction permet des développements à la jonction entre les universités et les entreprises. L’augmentation des activités de recherche et développement des entreprises a dépassé 1 % en 2009 alors que le PIB baissait. Le dispositif a connu un certain nombre d’aménagements dont une meilleure prise en compte de l’emploi des docteurs, ce qui me semble important, la France ne valorisant pas assez ses docteurs par rapport à ses ingénieurs.
La pérennisation du dispositif de remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche est une mesure utile pour les PME. Puisqu’il nous faut tenir compte du classement de Shanghai et des classements internationaux de ce type, le crédit d’impôt recherche donne à la recherche en entreprise en France une réelle attractivité, renforcée par la compétence de nos chercheurs.
En conclusion, le bon budget qui nous est proposé consolide notre capacité de recherche et d’innovation.
La partie thématique de mon avis porte sur les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES. Nous avons voté leur création en 2006, nous sommes en 2011. Cinq ans après, il me semble intéressant d’en faire une évaluation. Le PRES est-il une structure définitive ou intermédiaire ? Certains PRES conduisent à des fusions, après Strasbourg, qui n’est d’ailleurs pas passé par la forme PRES, comme à Aix-Marseille ou à Bordeaux : doit-on généraliser cette évolution ?
Nous avons en France deux niveaux d’enseignement supérieur, les universités et les grandes écoles, de très haut niveau, auxquelles je suis attaché mais qui sont essentiellement professionnalisantes. Elles nous sont très enviées, mais font relativement peu de recherche qui reste surtout universitaire. Le but des PRES était donc de regrouper les forces de recherche et de les recentrer autour de l’université en y associant les grandes écoles. Un étudiant issu d’une grande école française et docteur, diplôme reconnu partout, est évidemment très apprécié sur le plan international.
Je me suis intéressé à deux PRES représentatifs des deux formes qu’ils peuvent prendre : celle d’un établissement public et celle d’une fondation de coopération scientifique.
Le PRES Sorbonne Universités est très dynamique, il regroupe les universités Paris-Assas, Paris-Sorbonne, Pierre et Marie Curie et, plus surprenant, le Muséum d’histoire naturel. Son statut de fondation semble parfaitement adapté.
Le PRES UniverSud, constitué autour de l’université de Paris Sud – Orsay, est directement concerné par le projet du « Plateau de Saclay » et son fonctionnement s’en ressent largement. Le désengagement de ses dirigeants me semble néanmoins regrettable.
Depuis 2010, les PRES peuvent, comme c’était souhaitable, délivrer des diplômes, ce qui n’était possible, jusque-là, qu’aux universités.
La valorisation de la recherche publique n’avait pas été abordée directement dans la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 qui créait les PRES. Elle a un rôle important mais relève souvent de petits services des universités et n’est pas à la mesure des besoins. Faire du PRES le lieu de la valorisation me semble donc une excellente chose qui se met efficacement en place.
Le PRES est ainsi une structure souple bien adaptée à l’harmonisation de nos dispositifs de recherche et d’enseignement supérieur et qui permet toute une série d’actions partagées, allant de la fusion complète à la simple mutualisation de certaines actions, comme dans le domaine de la vie universitaire.
Je conclurai en citant le président du PRES Sorbonne Universités : pour les universités, « le bonheur est dans le PRES ! »
Madame Martine Faure, rapporteure pour avis. L’essentiel de mon avis budgétaire est consacré au plan licence.
Je ferai, quand même, quelques remarques sur le budget 2012, qui devrait augmenter, au total, de 540 millions d’euros.
Certes, l’enseignement supérieur constitue une priorité budgétaire du gouvernement, mais, ainsi que je le montre dans mon avis, l’engagement du Président de la République d’augmenter de un milliard d’euros par an les moyens de ce secteur n’a pas été tenu, quoi qu’en dise avec beaucoup d’assurance le ministre, M. Laurent Wauquiez.
Je rappelle en outre que ce budget ne « délivre » pas que des crédits de paiement, immédiatement consommables. Il repose aussi sur des autorisations d’engagement, étalées sur plusieurs années, et des montages financiers complexes, comme les partenariats public-privé et les intérêts de la cession par l’État d’une partie de sa participation dans EDF, tous deux destinés à financer les programmes immobiliers universitaires.
Je ne m’engagerai pas dans la bataille des chiffres, mais le tableau comparatif figurant dans mon rapport indique que les moyens ont augmenté de 922 millions d’euros en 2008, puis de 1 154 millions en 2009, puis de 995 millions en 2010, puis de 706 millions en 2011.
Ce budget est donc moins généreux qu’il n’y paraît et peu lisible.
Il ne permettra pas à notre pays de rattraper son retard en matière de financement de l’enseignement supérieur. Je rappelle que nos dépenses cumulées par étudiant – soit 56 597 dollars – se situent bien en dessous de la moyenne des pays européens membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) – soit 62 985 dollars. En outre, comme l’a établi un récent rapport du Centre d’analyse stratégique, la France se situe au bas de l’échelle en ce qui concerne le taux d’encadrement dans l’enseignement supérieur, avec seulement 5 enseignants pour 100 étudiants.
Deux derniers chiffres enfin : la dépense par étudiant s’élevait, en 2009, à 14 850 euros en classe préparatoire et à 10 220 euros seulement à l’université.
Venons-en au plan pluriannuel pour la réussite en licence, un chantier ouvert par le ministère de l’enseignement supérieur à la demande des organisations étudiantes.
Je rappellerai au préalable que le cursus de licence a accueilli en 2010 750 000 étudiants, hors instituts universitaires de technologie.
Couvrant les années 2008 à 2012, ce plan appuie les initiatives des universités, déclinées autour de quatre grands axes : l’orientation et l’accueil des nouveaux étudiants ; le renforcement de l’encadrement pédagogique, avec la mise en place d’enseignants référents, l’augmentation des horaires d’enseignement, la réduction de la taille des groupes de travaux dirigés et la diversification des méthodes pédagogiques ; le suivi des étudiants en difficulté ; enfin, la professionnalisation, notamment par la mise en place de stages.
Quel bilan peut-on tirer de tous ces efforts ?
Le plan a eu, incontestablement, un effet « déclencheur ». Mais cette « mobilisation » en faveur de la réussite en licence, loin d’être totale, est, en réalité, très brouillonne, très disparate et très décevante.
Dans certains établissements, elle s’est traduite par la réactivation de mesures déjà mises en œuvre et dans les autres, on constate soit qu’il ne se passe rien soit que les dispositifs mis en place souffrent d’une extrême « dispersion », faute de vision globale de la stratégie à mener au niveau de l’établissement. Par ailleurs, les mesures adoptées ne sont ni suivies ni – c’est plus grave – évaluées.
Par ailleurs, le plan licence n’a pas permis d’enclencher la révolution pédagogique attendue par les étudiants. Par exemple, la pédagogie de projet, la plus susceptible de motiver les étudiants, occupe, contrairement à ce qui se pratique au lycée, une place qui reste marginale. Les cours en amphithéâtre continuent en outre d’être très présents. Outre les contraintes budgétaires, qui seront évoquées plus loin, le principal obstacle à de nouvelles modalités pédagogiques est, selon plusieurs de mes interlocuteurs, le statut des enseignants-chercheurs, qui ne valorise pas assez leur investissement dans l’enseignement. Seule grande réussite à noter à ce niveau d’études, les licences professionnelles, qui sont un vrai sujet de satisfaction.
Sur le plan financier, le plan licence représente un effort pour l’État, cumulé sur cinq ans, de 730 millions d’euros. Cet effort doit être cependant relativisé, la progression des moyens dans l’enseignement supérieur restant concentrée sur les autres filières, en particulier celle du master. Or le développement des volumes horaires d’enseignement, la réduction de la taille des groupes et le recours aux enseignants référents ont un coût qui rend problématique le « modèle économique » du plan licence. À ce contexte budgétaire défavorable s’ajoutent des contraintes techniques. En effet, les crédits du plan sont « fléchés », tandis que le budget des établissements ayant accédé aux compétences élargies de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « LRU », lui, est « global ». Les universités étant ainsi libres de répartir, entre leurs composantes et leurs filières, les moyens attribués par l’État, ce processus d’allocation est inadapté au financement d’une politique aussi transversale que celle de la réussite en licence. L’absence de comptabilité analytique rendant de surcroît difficile la « traçabilité » des crédits, ceux-ci ont pu être utilisés pour financer des heures complémentaires ou… la rénovation du parking d’une université.
Pour que le plan licence soit une réussite, il faudrait donc changer d’échelle, en agissant sur plusieurs leviers, tout en écartant les fausses bonnes idées.
Ainsi, il ne faut surtout pas « secondariser » l’université – ce serait nier la spécificité du premier cycle –, mais faire en sorte que tous les élèves de seconde puissent être considérés comme des étudiants potentiels et que la transition du lycée à l’université soit organisée dans les meilleures conditions. On pense inévitablement au dispositif d’orientation qui nous fait cruellement défaut.
De même, l’établissement de pré-requis, la mise en place d’une année de propédeutique, supprimée en 1968, les contrats d’études imposées aux étudiants décrocheurs et la licence en quatre années devraient être écartés, car ces solutions sont soit stigmatisantes, soit irréalistes.
En revanche, l’orientation devrait commencer dès la classe de première et concerner l’ensemble des filières post-bac. Mais il conviendrait d’aller plus loin en matière d’orientation, en mettant en place, avec l’appui des régions, un service public facilitant l’accès à une information et un conseil de qualité sur les formations et les métiers.
Par ailleurs, l’augmentation des places en section de technicien supérieur (STS) et en institut universitaire de technologie (IUT) est préférable à la fixation, au niveau national, de quotas pour les bacheliers technologiques. Des semestres « tremplins » et des « secondes rentrées » devraient par ailleurs être proposés à ces deniers afin de faciliter leur réorientation entre l’université et les filières courtes.
Quant aux étudiants décrocheurs, des mesures d’accompagnement diversifiées, à condition de les inscrire dans une stratégie cohérente, devraient être mises en œuvre. Des semestres « rebonds » pourraient être notamment institués, afin de consolider les acquis des étudiants fragiles, par exemple au cours de l’été, entre le deuxième et le troisième semestre, mais de telles mesures devraient être concertées et travaillées.
Enfin, la pluridisciplinarité devrait être encouragée en licence, car elle faciliterait les réorientations et préparerait les étudiants aux études en master.
Un dernier mot sur les moyens et la pédagogie. L’abandon du modèle « tout amphi » postulé par le plan licence devrait conduire à des créations de postes supplémentaires, tandis que le système d’allocation des moyens aux universités devrait être réformé afin qu’un rééquilibrage des pondérations entre universités littéraires et scientifiques rende possible la mise en place, dans toutes les formations, d’une licence à 1 500 heures d’enseignement, car nous sommes très loin du compte aujourd’hui.
Surtout, la nouvelle licence devrait s’attacher – ce point étant essentiel – à créer de nouvelles modalités pédagogiques, qui fassent appel au travail de l’étudiant, tout en proposant des enseignements plus ou moins conceptualisés. Ceci suppose de valoriser l’investissement pédagogique des enseignants-chercheurs en évaluant cet aspect de leur travail au moment de leur titularisation et de leur passage du corps de maître de conférences à celui de professeur des universités. Ceci implique également d’identifier, notamment auprès des PRES, des structures de formation des doctorants à la pédagogie qui pourraient être les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), ce travail devant donner lieu à une large concertation.
Enfin, il faudrait lutter contre les racines sociales de l’échec, notamment le travail étudiant, souvent plus subi que choisi, en instaurant une allocation d’études, versée sous conditions de ressources, afin d’aider les jeunes issus de milieux défavorisés à construire leur autonomie.
Ce chantier est urgent, car l’ascenseur social n’est plus en panne mais commence à redescendre. En 2005, M. Laurent Wauquiez, alors député, écrivait dans un rapport que « la vie étudiante n’est pas une parenthèse enchantée ». Aujourd’hui, six ans après, pour certains d’entre eux du moins, la situation s’est dégradée.
Pour toutes ces raisons et d’autres que je n’ai pas voulu développer, je donnerai un avis défavorable à l’adoption des crédits 2012.
M. Christian Kert, président. Nous en venons aux explications de vote.
M. Pascal Deguilhem. Le vote du groupe SRC sera conforme à la position exprimée par Mme Martine Faure. Nous n’avons en effet aucune raison objective d’adopter ce projet de budget qui est le plus drastique, depuis le début du quinquennat, pour l’enseignement supérieur et la recherche. Des efforts ont pu être accomplis en début de législature, peu après l’adoption de la loi « LRU ». Mais il est manifeste – en particulier dans ce projet de budget – qu’on a, depuis, laissé en l’état le chantier de la remise à niveau de l’université.
Se pose un véritable problème d’opacité que nous avons d’ailleurs souligné auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de son audition par la Commission. Opacité des chiffres, en premier lieu : à périmètre budgétaire constant, nous sommes très loin de la progression des crédits dont faisait état le ministre. On peut certes mêler des crédits d’origine diverse en une « mauvaise soupe » pour afficher que les ambitions et les objectifs fixés ont été atteints, mais en réalité, les moyens sont en retrait, qu’il s’agisse des budgets de fonctionnement, essentiels pour assurer les enseignements, ou de la masse salariale. Je confirme donc l’analyse de Mme Martine Faure : les objectifs ambitieux du plan licence ne pourront pas être tenus. Aujourd’hui, près d’une vingtaine d’universités sont incapables de « boucler » leur budget de fonctionnement pour l’année universitaire en cours faute de moyens suffisants ; des négociations sont d’ailleurs en cours avec le ministre. On ne peut donc pas adresser un satisfecit au projet de budget lorsqu’on connaît les données réelles.
En deuxième lieu, je déplorerai l’opacité de la gouvernance, que nous avions déjà dénoncée lors de l’examen de la loi « LRU ». Elle a aujourd’hui pour conséquence une extrême défiance du monde universitaire à l’égard des autorités décisionnaires.
Je souhaite aussi souligner l’opacité des nouvelles structures mises en place. Les PRES ont été évoqués. Mais s’il n’y avait qu’eux… Un nombre incalculable de nouvelles entités ont été créées dans l’enseignement supérieur. Plus personne ne s’y reconnaît !
J’en viens aux moyens consacrés à la vie étudiante, fondamentaux pour que ne s’aggravent pas les déséquilibres dans l’accès à la qualification universitaire. Certes, le dixième mois de bourse a été mis en place et devrait, semble-t-il, disposer de financements dans le projet de budget pour 2012. Mais il demeure insuffisant pour procéder aux rattrapages nécessaires.
Je ferai enfin part d’une forte inquiétude : nous constatons, au plan territorial, une accélération de la concentration du paysage universitaire, très préoccupante quant à l’accès de tous aux formations supérieures.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous émettrons un avis défavorable à l’adoption des crédits de l’enseignement supérieur et de la recherche. Plus encore, nous dénonçons vigoureusement la communication gouvernementale : les chiffres annoncés ne reflètent pas la réalité budgétaire.
M. Jacques Grosperrin. Une fois n’est pas coutume, je citerai Lénine qui a dit je crois : « les faits sont têtus ! » Le groupe UMP salue, pour sa part, les efforts budgétaires consentis en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur. Le groupe Socialiste, radical et citoyen conteste les chiffres du Gouvernement ; mais lors de son audition hier, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a très précisément présenté l’effort consenti en matière de recherche. Nous avons écouté avec satisfaction la présentation des crédits qui y sont consacrés par notre rapporteur pour avis Olivier Jardé. En revanche, le groupe UMP ne partage pas les propos de Mme Martine Faure sur le budget de l’enseignement supérieur, ceux-ci lui semblant reposer sur une analyse inexacte des crédits. Le groupe UMP est donc favorable à l’adoption des crédits de la recherche et de l’enseignement supérieur.
M. Michel Vaxès. Le Gouvernement s’est enorgueilli de présenter cette année un projet de budget en croissance pour l’enseignement supérieur et la recherche. Ce n’est pas tout à fait faux sur un plan formel : les autorisations d’engagement augmenteront de 1,7 % et les crédits de paiement progresseront de 1 %. Mais si l’on neutralise l’opération de transfert progressif à la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur » (MIRES) du paiement des pensions, la croissance annoncée est beaucoup plus modeste : elle n’est plus que de 1 % en autorisations d’engagement et est presque nulle en crédits de paiement puisqu’elle s’élève à 0,008 %.
Les moyens consacrés spécifiquement à la recherche régressent, hors paiement des pensions, de 0,1 % en autorisations d’engagement et de 1,4 % en crédits de paiement. Au total, les moyens de la mission interministérielle auront chuté de plus de 4 % en euros constants ces deux dernières années et se situeront finalement, en 2012, à un niveau inférieur à celui qu’ils atteignaient en 2007.
La situation n’est donc guère reluisante. Aucun emploi statutaire n’a été créé, ce que la France n’avait jamais connu auparavant. Le nombre de contrats de travail à durée déterminée et de contrats précaires a explosé : il est de 15 000 pour la seule Agence nationale de la recherche ! Vous n’avez pas réussi à développer la recherche privée qui reste une des grandes carences de notre pays ; le soutien à la recherche industrielle stratégique diminue d’environ 21 %. Nous déplorons ces orientations, sachant l’état de nos industries et des emplois qui y sont attachés et connaissant la faiblesse des moyens que les entreprises françaises consacrent à la recherche et au développement : ils n’atteignent que 1,3 % de notre produit intérieur brut, à comparer à un taux de 7 % au Japon, de 1,9 % aux États-Unis et de 1,8 % en Allemagne.
Votre politique visant à encourager les laboratoires de recherche publics à devenir des prestataires de services aux entreprises a échoué. Elle a parfois conduit, comme chez Sanofi, à la fermeture des centres de recherche de grandes entreprises privées. Nous retrouvons le même effet d’aubaine dans le crédit d’impôt recherche, niche fiscale qui a coûté à la recherche 5,8 milliards d’euros en 2009 et n’a pas permis le « bond en avant » attendu des moyens consacrés à la recherche et développement. Nous estimons donc que cette mesure doit être mise en cause et remplacée par des subventions favorisant la création d’emplois et les petites et moyennes entreprises innovantes.
La France occupe aujourd’hui le quatorzième rang mondial en termes d’effort de recherche. L’objectif, qui avait été fixé par le Président de la République, de le porter rapidement à 3 % de notre produit intérieur brut n’a aucune chance d’être atteint. Cela supposerait de l’augmenter de 5 % par an pendant dix ans. Ce n’est pas le chemin que vous prenez… La France risque donc d’occuper durablement le vingt-sixième rang – sur trente-deux – pour son budget civil de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Concernant les pôles d’excellence, on constate une croissance des inégalités territoriales. Dans le contexte actuel de dégradation, il est permis de s’interroger sur la pertinence du privilège qui est accordé à ces structures. Une quinzaine de projets devraient être retenus et financés – leur liste a été complétée au printemps dernier pour intégrer des projets portés par des laboratoires de renom de la recherche française –, mais la répartition spatiale des laboratoires pose question. Le président de la Conférence des présidents d’université s’en est ému en avril dernier pour regretter que les lauréats se concentrent essentiellement en région parisienne, en Alsace, en région Rhône-Alpes et, dans une moindre proportion, dans le Sud – au profit de Montpellier et au détriment d’Aix-Marseille.
Le financement de pôles d’excellence par la voie du grand emprunt a, dans les faits, conduit à promouvoir un système universitaire à deux vitesses. Il se traduira par un renforcement des inégalités territoriales et mettra la moitié des universités « sur la touche ». De surcroît, il soumet à une gouvernance rigide et contrainte les universités sélectionnées, en excluant les représentants des personnels et des étudiants du conseil d’administration. Ce n’est pas notre conception de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes favorables à des financements adossés au budget de l’État, en conformité avec les missions de production et de transmission des savoirs de l’université.
Il convient de garantir l’autonomie des universités. Mais l’autonomie que vous préconisez, de même que celle des présidents d’université à l’égard du personnel, signifient en réalité une perte d’autonomie des laboratoires de recherche.
Si nous disons « oui » à l’autonomie des universités, c’est parce que nous disons « non » à la dépendance de la recherche publique, notamment à l’égard des marchés. C’est pourquoi le groupe GDR votera contre l’adoption du projet de budget de la recherche.
Mme Marie-Hélène Amiable. S’agissant de l’enseignement supérieur, le budget des universités semble être le grand perdant du projet de loi de finances. Sa légère augmentation ne couvrira même pas l’inflation. Le ministre nous a fait part, hier, de son plaisir de voir se multiplier les grues sur les campus universitaires. Le tableau est ainsi bien brossé, car à l’exception notable des crédits octroyés aux établissements d’enseignement supérieur privés, les crédits pour l’immobilier et les bibliothèques sont quasiment les seuls à augmenter dans le programme. Il est clair que cette politique est très profitable aux partenariats public-privé, mais moins aux étudiants fréquentant les établissements qui n’ont pas été sélectionnés pour ces chantiers. Je rappelle, sur ce point, que la Cour des comptes avait déploré l’absence d’efficacité et de cohérence de ces dispositifs, tandis que le Conseil constitutionnel avait recommandé que les contrats de partenariat gardent un caractère dérogatoire.
Il est toujours procédé à l’allocation des moyens selon des critères de performance, ce que nous continuons à condamner : ce sont les établissements dont le taux d’échec est le plus élevé qui sont les plus pénalisés. J’ai cité hier M. Jean-Louis Gout, président de l’université de Pau qui témoignait de sa détresse pour maintenir l’équilibre budgétaire ; le ministre a sobrement reconnu des « frictions » dans certains établissements…
Concernant les moyens consacrés à la vie étudiante, le projet de budget est très mauvais. Les œuvres universitaires étudiantes sont encore amputées, avec une baisse de 5,5 % pour les centres régionaux, ce qui est particulièrement inquiétant pour leurs personnels et témoigne d’une volonté de réduire le périmètre de ces structures pour laisser le champ libre à des intervenants extérieurs.
La pérennisation du dixième mois de bourse n’est pas acquise. Les crédits du fonds d’aide d’urgence créé en 2008 stagnent et demeurent soumis à des décisions discrétionnaires.
Enfin, même si ce point ne relève pas directement du budget de l’enseignement supérieur, je souhaite souligner que nous sommes très inquiets du doublement de la taxe qui pèsera sur les mutuelles et donc sur la santé des étudiants, alors que les données concernant leur accès aux soins sont alarmantes.
Pour l’ensemble des raisons que je viens d’évoquer, les membres du groupe GDR voteront contre les crédits de l’enseignement supérieur.
M. Olivier Jardé. Je serai bref en déclarant que les députés du groupe du Nouveau centre émettront, pour leur part, un avis favorable à l’adoption des crédits de l’enseignement supérieur et de la recherche.
M. Marcel Rogemont. M. Pascal Deguilhem a indiqué qu’à périmètre et euros constants, on constatait une diminution des crédits consacrés à la recherche. Le rapporteur pour avis s’est-il livré au même exercice et en a-t-il tiré les mêmes conclusions ? Sinon, la commission ne pourrait-elle procéder aux mêmes calculs pour confirmer – ou infirmer – les propos tenus par notre collègue ?
Par ailleurs, nous observons une croissance importante du nombre d’acronymes dans le domaine de la recherche qui en compte quarante-sept nouveaux… Je citerai à cet égard les propos de M. Jean Picq, président de la troisième chambre de la Cour des comptes : « pour la Cour, le moment est peut-être venu de s’assurer, dans ce paysage très évolutif marqué par une succession d’annonces – il s’agit des quarante-sept acronymes – que la ligne stratégique du Gouvernement est claire ». Le rapporteur pour avis a-t-il établi un bilan de toutes les créations de structures intervenues depuis 2007 ?
Enfin, ma dernière question concerne les pôles d’excellence, qui sont en quelque sorte la « Rolex » des universités. Mais qu’en est-il des autres pôles universitaires ? Sont-ils les pôles de la médiocrité ?
Mme Monique Boulestin. Monsieur le rapporteur pour avis, nous avons, hier, longuement interrogé le ministre sur la constitution et l’évolution des PRES. J’aurais apprécié que la présentation que vous en avez faite soit conforme aux propos qu’il nous a tenus. Il a ainsi déclaré qu’il ne souhaitait pas seulement des fusions d’universités, mais qu’il était aussi favorable à des mutualisations, ne serait-ce que pour assurer un équilibre entre territoires. Je n’ai pas entendu de telles nuances dans vos propos. Je rejoins ainsi M. Marcel Rogemont, puisque dans ses recommandations, la Cour des comptes a indiqué qu’il fallait donner aux PRES un second souffle. Monsieur le rapporteur, quelle est votre position sur ce point ?
Ma deuxième question porte sur les premiers usagers de l’université que sont les étudiants et les enseignants chercheurs. Monsieur le rapporteur pour avis, vous n’avez pas évoqué les « thésards », alors qu’aujourd’hui, le nombre de thèses n’augmente pas. Cela pose question en termes de formation et de statut des enseignants-chercheurs. Celui-ci doit évoluer, notamment pour assurer la survie et l’évolution des PRES. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, pourriez-vous nous indiquer le montant du financement accordé aux centres régionaux des œuvres universitaires ? Leurs moyens sont en baisse de 7,6 %, ce qui pénalise les étudiants en situation de précarité, d’autant qu’au vu des évolutions touchant le secteur des assurances complémentaires santé, leur budget dédié à la santé est dans une situation très préoccupante. Des études récentes montrent en effet que les étudiants sont deux fois plus nombreux que le reste de la population à devoir renoncer à des soins, faute de moyens.
Mme Marie-George Buffet. Mme Martine Faure a évoqué, dans son rapport, les questions relatives à la vie quotidienne des étudiants et propose la mise en place d’une allocation de formation, délivrée sur conditions de ressources.
De nombreux étudiants rencontrent, en effet, de nombreuses difficultés. 35 % d’entre eux doivent travailler pour financer leurs études ; 10 % sont obligés de travailler à temps plein, ce qui emporte évidemment des conséquences sur leur cursus universitaire.
Mme Amiable a souligné la baisse des budgets alloués aux œuvres universitaires. Je voudrai, pour ma part, insister sur le poste logement, particulièrement important. À chaque rentrée universitaire, sont diffusés des reportages télévisés sur la recherche par les étudiants de logements privés. On voit fleurir dans les villes universitaires des résidences étudiantes privées, dans lesquelles les loyers évoluent entre 430 et 800 euros. On voit aussi apparaître de nouvelles initiatives, comme la suggestion de loger des étudiants chez des familles ou des personnes âgées, moyennant la délivrance de services. Mais on ne parle plus du tout des cités universitaires. Or, celles-ci sont synonymes d’accessibilité, même si les loyers commencent à être élevés – 200 à 400 euros par mois. Elles sont aussi le lieu d’une vie sociale importante et d’une vie associative ; elles permettent aux étudiants de se rencontrer et de travailler ensemble ; elles offrent des services sociaux. Or on voit que des cités universitaires, comme celle d’Antony qui accueillait des étudiants célibataires ou en couple et mettait à leur disposition des crèches, sont désormais laissées à l’abandon ; des bâtiments sont même détruits. Je n’ai pas connaissance d’un plan de construction de nouvelles cités pour répondre au besoin de logement ; pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?
M. Régis Juanico. Mme Martine Faure a eu raison de mettre le doigt sur ce qui est aujourd’hui la question principale en matière de vie étudiante, à savoir la création d’une allocation d’études sous conditions de ressources. La situation financière des étudiants et les problèmes de santé et de logement qu’ils rencontrent sont très préoccupants. Comme l’a indiqué Mme Buffet, plus de 30 % d’entre eux doivent travailler pour payer leurs études. La moitié des étudiants vivent avec moins de 400 euros par mois ; un quart ont du mal à « joindre les deux bouts ».
S’agissant de leur santé, l’enquête récemment menée par la mutuelle des étudiants est extrêmement alarmante : aujourd’hui, 20 % des étudiants renoncent à se faire soigner en raison de difficultés financières ; 19 % ne disposent pas d’une assurance complémentaire santé. Une mesure forte est donc nécessaire pour répondre aux besoins.
Ma question portera sur la pratique sportive à l’université : il y a trois ans, a été remis à Mme Valérie Pécresse, alors ministre chargée de l’enseignement supérieur, un très bon rapport de MM. Stéphane Diagana et Gérard Auneau sur le développement du sport à l’université. Il montrait que 70 % des étudiants souhaitaient faire du sport, mais que seulement 20 % avaient effectivement une pratique sportive, cet écart étant imputable au manque d’infrastructures mais aussi à l’absence de réelle volonté politique de faire entrer le sport à l’université et, plus largement, dans l’enseignement supérieur. Madame la rapporteure pour avis, que pensez-vous de la proposition qui consisterait à encourager la pratique sportive à l’université en attribuant aux étudiants des crédits ECTS ?
M. Jean-Louis Touraine. Je pense que nous pouvons saluer les efforts de communication et de prestidigitation visant à faire croire à la population – et parfois aux députés – que les moyens destinés aux universités et à la recherche progresseraient de manière significative. Lorsqu’on interroge les universitaires et les chercheurs, on constate au contraire une profonde dépression.
Le budget qui nous est soumis est en trompe-l’œil ; nous ne pourrons donc pas l’approuver. D’un côté, nous entendons des annonces et l’autosatisfaction ; de l’autre, on constate qu’à périmètre et euros constants, les moyens régressent.
Le crédit d’impôt recherche a certes certaines vertus, mais son champ s’est progressivement étendu pour englober des activités sans lien avec la recherche. Il a été très largement dénoncé par la Cour des comptes. Entend-on tenir compte de ses remarques acerbes et critiques ?
Comme cela a été rappelé, « les chiffres sont têtus ». En voici quelques-uns : la France occupait en 1995 la sixième place en matière d’enseignement et de recherche au sein de l’OCDE ; elle n’occupe plus aujourd’hui que la treizième place. Pour la seule recherche civile, la France ne détient que le vingt-sixième rang, ce qui est franchement humiliant. Je pose donc la question : va-t-on engager une remise à niveau ? Nous ne comptons que 6 enseignants pour 100 étudiants ; la moyenne au sein de l’OCDE se situe entre 8 et 9 enseignants pour 100 étudiants. Il nous faudrait donc au moins un tiers de plus d’enseignants.
Enfin, on constate dans le projet de budget une régression très significative et inquiétante des moyens de la recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé qui sont des domaines clefs. Monsieur le rapporteur pour avis, pouvez-vous le confirmer, ou bien s’agit-il, comme l’a suggéré hier le ministre, d’une erreur de présentation ?
Mme Marietta Karamanli : Je souhaitais compléter la question de M. Touraine concernant le crédit d’impôt recherche. Je ne reviendrai pas sur le fait que le crédit d’impôt recherche témoigne tout particulièrement de l’effort fait en faveur de la recherche – 4,7 milliards d’euros lui étaient consacrés en 2010 –, mais je soulignerai qu’a contrario, les dépenses de recherche-développement des entreprises progressent très modestement – 1 % en 2009. Je rappellerai les deux recommandations que formulait le rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle déposé en juin 2010 par MM. Alain Claeys, Jean-Pierre Gorges et Pierre Lasbordes : d’une part, créer des équipes de contrôle du crédit d’impôt recherche communes aux services fiscaux et aux services du ministère de la recherche tant au niveau central qu’au niveau régional – pour les grandes régions – et, d’autre part, mettre en place des outils qualitatifs de suivi de la performance du crédit d’impôt recherche. En tant que rapporteur de ce budget, avez-vous pu vérifier quelles suites ont été données à ces deux recommandations qui émanent de parlementaires?
Mme Colette Langlade : Mme Martine Faure a insisté sur le recentrage autour de l’université, et notamment sur l’absence de passerelles entre le lycée et l’université. Or, la pluridisciplinarité en tant que passerelle entre les différentes formes de connaissances académiques devrait être encouragée car elle pourrait faciliter les orientations. Qu’en pensez-vous ?
Mme Françoise Imbert : Notre pays compte 2,3 millions d’étudiants. Seuls 20 % d’entre eux bénéficient d’une bourse du sixième échelon alors que trois sur quatre doivent trouver des « petits boulots » pour assumer le coût de leurs études. Le niveau des bourses a augmenté au bénéfice des classes moyennes et défavorisées, mais ce n’est certainement pas suffisant dans la mesure où à Paris et dans nos régions, le logement représente un poste lourd dans le coût des études, les capacités d’accueil en cité universitaire étant toujours très faibles, comme l’ont signalé plusieurs collègues. Le budget consacré à ces postes ne répond toujours pas aux énormes besoins. Nous ne pourrons donc pas le voter mais nous souhaitons connaître les projets du ministère en ce domaine.
Mme Martine Martinel : Ma question porte sur le plan licence. Mme Martine Faure souligne que le plan licence propose une exigence académique, à savoir 1 500 heures. Comment ces heures sont-elles assurées ? Le sont-elles à budget constant ?
Mme Martine Faure, rapporteure pour avis : Je répondrai d’abord à Mme Martine Martinel que la mise en place des 1 500 heures prendra de longues années s’il n’y a pas d’augmentation de crédits permettant de créer des postes. Cette création de postes est pourtant indispensable si l’on veut passer de 450 à 1 500 heures, mais elle est actuellement impossible à budget constant.
Mme Françoise Imbert relève que la vie étudiante est toujours aussi difficile malgré l’augmentation du montant des bourses. C’est la raison pour laquelle il conviendra d’envisager la création d’une allocation d’autonomie car on ne peut pas éternellement constater la panne de l’ascenseur social sans agir.
La question des passerelles a été évoquée par Mme Colette Langlade. Les passerelles constituent à mon sens un outil d’orientation indispensable, qu’il importe de mettre en place si l’on veut prévenir l’échec en licence. Il faut créer des occasions d’échanges voire de travaux communs entre enseignants des lycées et professeurs d’université.
Pour répondre à M. Marcel Rogemont sur les acronymes, je dirai que celui que j’ai trouvé le plus surprenant est celui du modèle d’allocation des moyens aux universités, « SYMPA », parce qu’il est en complet décalage avec sa signification ; il s’agit en effet d’ajouter aux difficultés des universités en mettant l’accent sur les compétences et les résultats.
Comme Mme Marie-George Buffet, je suis préoccupée par les conditions de travail des étudiants, le prix des logements et la vie en cité universitaire dont le caractère déprimant était déjà dénoncé dans le rapport qu’avait rédigé en 2005 M. Laurent Wauquiez, aujourd’hui ministre. On ne s’est toujours pas attaqué à l’heure actuelle au problème structurel que constituent ces conditions faites aux étudiants.
Mme Marie-Hélène Amiable a évoqué le modèle d’allocation des moyens qui n’est pas appliqué et dont l’augmentation demeure en deçà de l’inflation pour beaucoup d’établissements. Je rappellerai en outre que les crédits consacrés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont réduits de 5,5 % dans ce budget, ce qui est consternant ; cela représente une baisse de 80 millions d’euros ! De plus, le dixième mois de bourse, qui n’est pas pérenne, pourra être remis en cause en 2013.
S’agissant de la place du sport à l’université, je partage l’avis de M. Régis Juanico : les étudiants n’ont pas la possibilité de faire du sport à l’intérieur des campus, bien que cela soit essentiel à leur équilibre. Je ne peux donc que préconiser de mettre l’accent à l’avenir sur cet aspect de la vie à l’université.
M. Olivier Jardé, rapporteur pour avis. Monsieur Rogemont, les crédits de la recherche figurent dans les tableaux de mon rapport provisoire qui est en distribution. Effectivement les crédits de paiement à périmètre constant sont en baisse de 80 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2012 par rapport au budget de 2011, sur 14 milliards d’euros je le rappelle. La croissance apparente sur certains documents budgétaires est due à l’intégration de la contribution au compte d’affectation spéciale (CAS) destiné aux pensions.
Les 47 sigles sont développés dans mon rapport lorsqu’ils y figurent, Idex, Labex, Equipex et autres, mais les professionnels et les syndicalistes semblent apparemment s’y retrouver.
S’agissant enfin des pôles d’excellence, il me semble légitime de s’interroger sur la place de la recherche dans l’aménagement du territoire. Les chercheurs doivent d’abord faire de la recherche. La mise en réseau, afin de favoriser la proximité des laboratoires de recherche, est importante, pour autant il ne me semble pas que le premier critère en matière de recherche soit l’aménagement du territoire. Il convient en revanche de développer les laboratoires performants, c’est par exemple le cas à Amiens avec un laboratoire spécialisé dans les cellules pluripotentes dont j’ai favorisé la mise en réseau avec le Professeur Peschanski du Génopôle d’Évry.
Madame Boulestin, comme vous, je regrette la baisse du nombre de thésards et des scientifiques, et pas seulement en France d’ailleurs. De plus, certains étudiants en sciences abandonnent ensuite ce domaine, pour rejoindre les banques, ce qui pose d’autres problèmes… Il faut multiplier les initiatives comme la Fête de la science qui permettent à des jeunes de visiter des laboratoires et suscitent souvent des vocations. Je milite également pour une chaîne de télévision scientifique. On connaît, à cet égard, le succès de la série « Urgences » et son impact sur les vocations d’urgentistes. Des émissions de télévision sont un bon appui au développement des études scientifiques.
Sur les conditions d’études j’avais, à titre personnel, déposé un amendement exonérant les mutuelles étudiantes de taxation. Je regrette qu’il n’ait pas été voté. La santé des étudiants est un problème important. De fait : ils ne se soignent pas.
Monsieur le professeur Touraine et Madame Karamanli, des remarques de la Cour des comptes et de la mission d’évaluation et de contrôle sur le crédit d’impôt recherche ont été prises en compte dans la loi de finances pour 2011, en resserrant certains aspects du dispositif mais les contrôles de son utilisation optimale sont encore perfectibles.
S’agissant des moyens de la recherche en sciences de la vie et en biotechnologies, je ne peux que vous citer le ministre qui estimait hier soir que les chiffres publiés étaient inexacts.
Madame Langlade, la pluridisciplinarité que vous souhaitez à juste titre me semble pouvoir trouver sa place dans les PRES. Elle permet par exemple aux étudiants ayant échoué au concours de fin de première année de médecine, souvent très doués, de poursuivre leurs études dans un autre domaine avec une prise en compte de cette année.
M. Christian Kert, président. Je remercie les rapporteurs et je vous propose de passer au vote de l’avis de la commission sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour 2012. J’ai retenu que notre rapporteur pour avis concernant la recherche donne un avis favorable et que notre rapporteure pour avis sur l’enseignement supérieur et la vie étudiante émet un avis défavorable.
La Commission donne un avis favorable à l’adoption des crédits pour 2012 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. Patrick Hetzel, directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
Ø Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche (Sgen-CFDT) – Mme Colette Guillopé, secrétaire fédérale, professeure à Paris-Est, Mme Brigitte Pradin, enseignant-chercheur, M. Michel Deyme, professeur à Paris-Est, membre des comités de suivi de la licence et du master
Ø M. Bernard Dizambourg, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale
Ø Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Éducation – M. Luc Bentz, secrétaire national, secteur éducation-recherche, et Mme Christine Roland-Lévy, secrétaire générale de Sup’Recherche UNSA, membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ø Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) – M. Marc Champesme, secrétaire national et responsable du secteur formations supérieures, et M. Pierre Duharcourt, membre du bureau national
Ø Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) – M. Thierry Bossard, inspecteur général et chef du service, et M. Jean-Richard Cytermann, inspecteur général
Ø Syndicat national des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur (SNPREES-FO) – M. Bernard Rety, secrétaire général
Ø Union nationale des étudiants de France (UNEF) – M. Azwaw Djebara, vice-président, et M. Yennis Burgat, membre du bureau national
Ø Mouvement des étudiants – M. Antoine Diers, président
Ø Confédération étudiante – Mlles Cindy Pétrieux et Thien-Anh Dang-Vu, secrétaires nationales
Ø Promotion et défense des étudiants (PDE) – M. Mathieu Bach, vice-président, et M. Sébastien Bourasseau, élu au CNSER
Ø Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – M. Julien Blanchet, premier vice-président en charge des affaires académiques
Ø Sauvons l’Université (SLU) – M. Étienne Boisserie, président du conseil d’administration, et M. Alexis Grelois, porte-parole
Ø Université Bordeaux I – M. Alain Boudou, président
Ø Conférence des présidents d’université (CPU) – Mme Anne Fraïsse, vice-présidente, et M. Alain Abécassis, délégué général
Ø Association des directeurs d’instituts universitaires de technologie (ADIUT) – M. Jean-François Mazoin, président, et M. Gilles Broussard, vice-président
Ø Union nationale des présidents d’instituts universitaires de technologie (UNPIUT) – M. Jean-Paul Vidal, président, et M. Jean-Pierre Lacotte, vice-président
Ø Université Bordeaux II – M. Manuel Tunon De Lara, président
Ø Université Bordeaux III – M. Patrice Brun, président
