

______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)
sur l’Union européenne et le G20,
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Christophe Caresche,
Bernard Deflesselles et Robert Lecou,
Députés
——
La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Didier Quentin, Gérard Voisin vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, Patrice Calméjane, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Jean-Yves Cousin, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Pascale Gruny, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Pierre-Alain Muet, Jacques Myard, Michel Piron, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.
SOMMAIRE
___
Pages
RÉSUMÉ DU RAPPORT 15
ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTS 21
SUMMARY OF THE REPORT 27
RIASSUNTO DELLA RELAZIONE 33
INTRODUCTION 39
PREMIERE PARTIE : LE G20, UN CONTRAT INTERNATIONAL IMPLICITE, PRODUIT DE L’HISTOIRE, DONT LA STRUCTURATION ET LE POIDS S’AFFIRMENT AVEC LE TEMPS 45
I. LES « G », UNE SUPERPOSITION DE GROUPES TRANSCONTINENTAUX PLUS OU MOINS ORGANISES 47
A. LES « G » INSTITUTIONNALISÉS, QUI JOUENT UN RÔLE MOTEUR VIS-À-VIS DU RESTE DU MONDE 47
1. Le G8, premier club diplomatique 47
a) En 1975 déjà, la conjoncture économique est anxiogène 47
b) La genèse du G6 au G8 48
2. Le Groupe des Vingt, une révolution conceptuelle 50
a) Le G20 finances 50
(1) Des crises d’un nouveau genre 50
(2) Une réponse pragmatique à la crise financière globale 51
(3) Les thématiques abordées de 1999 à 2008 53
b) Les sommets des chefs d’Etat et de gouvernement du G20 54
(1) La crise de 2007-2008, un choc d’une ampleur sans précédent depuis 1929 54
B. UNE MOSAÏQUE D’AUTRES « G » 60
1. Des « G » outsiders, qui cherchent eux aussi à peser sur la scène mondiale 60
a) Les puissances moyennes : le 3G (Global Governance Group) 60
b) Les grands émergents : les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) 61
(1) Du concept de BRIC à la réalisation 61
(2) Une démarche fructueuse mais qui rencontre des limites 62
c) Les grandes démocraties du Sud : les IBSA (Inde, Brésil et Afrique du Sud) 64
2. Les « G » imaginaires 66
a) Le G2 ou la reconstitution improbable d’un monde bipolaire autour des Etats-Unis et de la Chine 66
b) Le G0 ou la concertation introuvable 68
3. Les « G » des Nations unies, une autre logique 68
II. LE G20, UN CONTRAT INTERNATIONAL IMPLICITE 71
A. UNE STRUCTURE LÉGÈRE ET SOUPLE, AU FONCTIONNEMENT MOUVANT MAIS AUX CONTOURS STABILISÉS 71
1. Le G20, produit de l’histoire 71
2. Les contours géographiques et thématiques du G20 75
a) La carte du G20 est dessinée en fonction des lignes de force mondiales 75
b) Le G20 intervient sur des champs thématiques de plus en plus vastes 77
B. LE DOUBLE DÉFI DE LA CONCERTATION INTERNE ET EXTERNE 79
1. Une approche coopérative : faire avancer au même rythme un groupe hétérogène 79
a) Des sensibilités divergentes, parfois même opposées 79
b) A la recherche d’une culture coopérative 81
2. Une approche inclusive : s’ouvrir sur le reste du monde 82
a) Investir dans le dialogue avec les autres cénacles de concertation 82
(1) Les trois piliers de la coopération multilatérale 82
(2) L’exemple de la présidence française 84
b) Bien choisir et valoriser les invitations 85
DEUXIEME PARTIE : PASSER D’UN G20 DE GESTION DE CRISE A UN G20 DE CONSTRUCTION A MOYEN TERME ET A LONG TERME POUR ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT ECONOMIQUE GLOBAL 89
I. LA CARTE GEOECONOMIQUE DU MONDE EST PROFONDEMENT BOULEVERSEE 91
A. AU NORD, LES « VIEILLES PUISSANCES INDUSTRIELLES » EN DÉCLIN RELATIF 91
1. L’Union européenne, une intégration inachevée mais qui possède les ressorts internes nécessaires pour sortir de la crise actuelle 91
a) Une crise des comptes publics européens 91
(1) Le contrecoup de la récession de 2009 91
(2) Le Mécanisme européen de stabilisation 92
(3) Un test réputationnel déterminant 94
b) L’Union européenne à la croisée des chemins 96
2. Les Etats-Unis, première puissance mondiale en sursis 97
a) Une économie asthénique 97
b) Un contexte politique défavorable à la poursuite de grands desseins 99
3. Le Japon, dépassé par son principal concurrent régional et confronté au défi de la reconstruction 99
4. La Russie, à l’intersection entre les économies avancées et émergentes 101
5. Le Canada, valeur sûre de la régulation mondiale 103
B. AU SUD, LES PLUS GROS GISEMENTS DE CROISSANCE QUI TIRENT L’ÉCONOMIE MONDIALE 104
1. L’Asie-Pacifique, réseau économique et commercial en devenir 105
2. L’Amérique latine, autre fleuron de la croissance mondiale 113
a) Le Brésil 113
3. Le Moyen-Orient, au cœur des problèmes géopolitiques contemporains 118
4. L’Afrique, en quête du développement 120
(1) D’énormes opportunités de croissance à long terme 122
(2) Les potentialités des échanges Sud-Sud 122
c) Asseoir la représentation des organisations régionales africaines dans le G20 123
II. LES SOMMETS PRECEDENTS DU G20 OFFRENT UN BILAN CONTRASTE MAIS ILS ONT CONTRIBUE A FAIRE EVOLUER LES ESPRITS 125
A. LES G20 PRÉCÉDENTS ONT POSÉ DES JALONS UTILES MAIS INSUFFISANTS 125
1. Les grandes orientations des déclarations finales 125
a) Washington, novembre 2008 : se mobiliser pour éteindre le feu sur les marchés financiers et l’économie mondiale 125
b) Londres, avril 2009 : assainir et renforcer le système financier de manière coordonnée 127
c) Pittsburgh, septembre 2009 : consacrer le G20 comme « forum prioritaire » de la coopération économique internationale 130
d) Toronto, juin 2010 : bâtir une croissance forte, durable et équilibrée 132
e) Séoul, novembre 2010 : amorcer la transition du G20 134
2. Une mise en œuvre parfois volontariste mais limitée et inégale 136
a) Les cadres législatifs dans l’Union européenne et aux Etats-Unis 136
b) Les mesures entrées en vigueur dans les réglementations nationales 139
(1) Lutte contre les juridictions non coopératives 139
(2) Encadrement de la rémunération des opérateurs financiers 141
(3) Renforcement de la supervision bancaire et financière 142
(4) Contrôle des agences de notation 144
(5) Régulation des marchés de produits dérivés 145
(6) Renforcement des fonds propres des banques 147
B. LES CONDITIONS SONT RÉUNIES POUR FAIRE PROGRESSER LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE MONDIALE 148
1. Les mentalités sont maintenant ouvertes à la régulation 149
2. L’agenda de la présidence française fait consensus 151
a) Le pari de la confiance 151
(1) Les craintes initiales des partenaires de la France 151
(2) Les dividendes de la proximité et de la crédibilité 151
b) L’ouverture de nouveaux chantiers 153
c) Le précédent du G8 renforce la confiance vis-à-vis de la France 157
(1) Le G8, un club qui conserve une certaine pertinence 157
(2) La ministérielle G8 affaires étrangères 158
(3) L’e-G8 Forum 159
(4) Le sommet de Deauville 160
TROISIEME PARTIE : REGULER LES MARCHES SUR TROIS FRONTS POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES DESEQUILIBRES INTERNATIONAUX ET ENTRAINER LA CROISSANCE MONDIALE 163
I. LE SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL, PARFOIS QUALIFIE DE « NON-SYSTEME », APPELLE UNE REFORME PROFONDE 165
A. UNE ÉPOQUE MARQUÉE PAR DES DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES INSOUTENABLES 165
1. L’absence de système monétaire international organisé 165
a) Les carences du système actuel 165
b) Une période de transition qui entraîne de fortes turbulences 167
2. Le sommet de Cannes, nouveau Londres ou nouveau Bretton Woods ? 168
a) Le précédent fâcheux de la conférence économique mondiale de Londres de 1933 168
b) Les ambitions de Cannes 169
(1) Assurer un nouvel accompagnement international des politiques macroéconomiques et monétaires 169
(2) Répondre à l’urgence soulevée par la situation dans la zone euro 171
B. DEUX ÉTAPES POUR ASSAINIR L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE MONDIALE 172
1. Identifier, suivre et réduire les déséquilibres macroéconomiques 172
a) Le cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée 172
b) L’organisation du suivi des déséquilibres 173
(1) La proposition des Américains à Séoul : corseter les excédents et les déficits commerciaux nationaux 173
(2) Les acquis des réunions ministérielles de 2011 173
c) Les perspectives du processus d’évaluation mutuelle 175
2. Réformer le système monétaire international 176
a) Malgré les antagonismes entre intérêts nationaux, la communauté mondiale est condamnée à coopérer 176
b) Evoluer vers un système monétaire multipolaire, à l’image de l’économie mondiale 177
(1) Stabiliser les flux de capitaux et les taux de change 178
(2) Prévenir les spirales de défiance 179
(3) Elargir le panier de monnaies des droits de tirage spéciaux et développer leur usage 180
(4) Aller vers la convertibilité des monnaies émergentes 182
(5) Moderniser le Fonds monétaire international 182
II. LES SERVICES FINANCIERS RESTENT INSUFFISAMMENT ENCADRES ET CONTROLES 185
A. UN SECTEUR AU POIDS DISPROPORTIONNÉ PAR RAPPORT À L’ÉCONOMIE RÉELLE 185
1. Des flux de plus en plus considérables et des prises de risque excessives 185
2. Des fluctuations boursières qui font vaciller l’économie mondiale 187
B. RÉSISTER À DEUX TENTATIONS 188
a) Une course de lenteur dommageable à l’économie mondiale 189
b) Les tergiversations politiques et techniques autour du Dodd-Frank Act 190
c) L’Union européenne et ses tractations interétatiques et interinstitutionnelles parfois interminables 191
(1) La procédure de codécision 191
(2) Les discussions interétatiques et le lobby de l’industrie financière 193
(3) La responsabilité européenne 194
C. ACHEVER LA TRANSPOSITION EN DROIT DES PROGRÈS RÉALISÉS GRÂCE AUX PRÉCÉDENTS G20 ET OBTENIR DE NOUVELLES AVANCÉES 195
1. Réduire le risque systémique 195
a) Assurer une surveillance globale 195
b) Procéder à des stress tests draconiens 196
c) Compartimenter les activités de financement de l’économie et la spéculation 197
d) Respecter intégralement l’accord de Bâle III 199
(1) La logique des accords de Bâle 199
(2) Une levée de bouclier à considérer avec circonspection 200
e) Conditionner l’acquisition de credit default swaps souverains à la détention d’actifs sous-jacents 201
f) Encadrer les rémunérations variables 202
2. Refroidir les marchés financiers 203
a) Taxer les transactions financières 203
(1) Une priorité franco-allemande 203
(2) Un outil pour assainir les marchés et dégager de nouveaux financements pour relever les grands enjeux planétaires 204
3. Entraver la capacité de nuisance des agences de notation 207
a) Des organismes à la puissance exorbitante 207
b) Plusieurs mesures régulatrices sont possibles 208
III. LA VOLATILITE EXCESSIVE DU PRIX DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES, QUI DESTABILISE L’ECONOMIE MONDIALE, DOIT ETRE CONTENUE 211
A. UNE INSTABILITÉ DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLE EXCESSIVE 211
1. Le poids du secteur agricole 211
2. Un mouvement de yoyo permanent qui remet en cause la pérennité des capacités productives agricoles 212
a) Les conséquences des évolutions de cours erratiques sur les marchés de matières premières 212
b) Les fondamentaux physiques de la volatilité des prix agricoles 215
3. Le mandat du sommet de Séoul 216
B. LA PERSPECTIVE D’UN ACCORD HISTORIQUE À METTRE AU CRÉDIT DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU G20 217
1. La polémique sur les intentions françaises a fait long feu 217
a) De nombreux soutiens internationaux 217
(1) La coalition inter-agences 217
(2) Les initiatives européennes 218
(3) La société civile a pris la parole 219
b) Le volontarisme diplomatique de la présidence française 220
2. La réunion ministérielle prometteuse des 22 et 23 juin 2011 221
a) Stimuler les productions et les rendements agricoles à court et à long terme 221
b) Améliorer l’information des marchés et les rendre plus transparents 222
c) Renforcer la coordination des politiques agricoles nationales 223
d) Réduire les effets de la volatilité des prix pour les plus vulnérables 223
e) Réformer le fonctionnement des marchés dérivés de matières premières 223
3. Perpétuer l’« esprit de club » pour relever trois défis 223
a) Transformer l’essai marqué lors de la ministérielle agriculture 224
b) Limiter la spéculation sur les marchés agricoles 225
c) L’énergie et les minerais 226
QUATRIEME PARTIE : REPENSER LA GOUVERNANCE DU G20, EN L’INSTITUTIONNALISANT PAR LE BIAIS D’UN SECRETARIAT PERMANENT ET EN RENFORCANT LA CAPACITE DE LA REPRESENTATION EUROPEENNE A FAIRE ENTENDRE SA VOIX 229
I. LE G20 A BESOIN D’UNE STRUCTURE DE SECRETARIAT LEGERE MAIS PERMANENTE 231
A. L’IDÉE D’UN SECRÉTARIAT PERMANENT NE FAIT PAS L’UNANIMITÉ 232
1. Un secrétariat permanent du G20 répondrait à une double problématique 232
a) Créer un fil rouge entre présidences 232
b) Exercer une veille sur les politiques nationales 234
2. Des arguments contraires qui méritent d’être entendus 235
B. LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES CONSTITUENT LE BON POINT D’APPUI POUR UN SECRÉTARIAT PERMANENT EFFICACE 235
1. L’Organisation de coopération et de développement économiques, organisation économique pluridisciplinaire 236
a) Une organisation qui plonge ses racines dans l’histoire du XXe siècle 236
b) Les atouts de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour héberger le secrétariat permanent du G20 237
(1) Les points forts de l’Organisation de coopération et de développement économiques 237
(2) Le fait que tous les membres du G20 n’appartiennent pas à l’Organisation de coopération et de développement économiques n’est pas dirimant 238
2. L’articulation avec les autres organisations internationales 240
a) Les institutions financières : Fonds monétaire international et Conseil de stabilité financière 240
(1) Le Fonds monétaire international, organisation internationale spécialisée sur les questions monétaires et macroéconomiques 240
(2) Le Conseil de stabilité financière, rouage de la machinerie du G20 240
b) Une collaboration entre organisations internationales, en étoile, autour de l’Organisation de coopération et de développement économiques 241
II. LA REPRESENTATION EUROPEENNE DANS LE G20 DOIT GAGNER EN CREDIBILITE ET EN FORCE DE PERSUASION 245
A. LA CULTURE DE NÉGOCIATION DANS LES GÈNES DE L’UNION EUROPÉENNE 245
1. Deux démarches présentant une certaine similitude 245
2. L’Union européenne, rompue aux processus décisionnels complexes 246
B. LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LE G20 246
1. Les Etats membres de l’Union européenne n’appartenant pas au G20 attendent davantage de concertation 247
2. Les autres Européens du G20, partenaires privilégiés 248
a) L’Allemagne 248
(1) La locomotive économique de l’Union européenne 248
(2) Les réticences vis-à-vis du Mécanisme européen de stabilisation 249
C. AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE L’EUROPE DANS LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES 250
a) Clarifier le leadership entre institutions européennes 253
(1) Une organisation trop compliquée pour être optimale 253
(2) Fusionner les deux têtes de l’Union européenne pour une plus grande efficacité 254
b) Rééquilibrer progressivement représentation nationale et communautaire 255
TRAVAUX DE LA COMMISSION 257
PROPOSITION DE RESOLUTION EUROPEENNE 267
ANTRAG AUF EINE EUROPÄISCHE ENTSCHLIESSUNG 273
MOTION FOR A EUROPEAN RESOLUTION 281
PROPOSTE DI RISOLUZIONE EUROPEA 287
GLOSSAIRE 293
ANNEXES 301
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 303
ANNEXE 2 : LE CONSEIL DE STABILITE FINANCIERE (CSF) 315
ANNEXE 3 : LA REGULATION AUX ETATS-UNIS 319
ANNEXE 4 : LES PRIORITES FRANCAISES DU G20 321
ANNEXE 5 : LES PRIORITES DE LA PRESIDENCE FRANCAISES DU G8 323
ANNEXE 6 : ARTICLE 219, ALINEAS 1 ET 2, DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPENNE 325
ANNEXE 7 : LA HIÉRARCHIE DES NORMES FINANCIÈRES (DES PRINCIPES DU G20 AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF) 327
ANNEXE 8 : LA PROCEDURE DE CODECISION 329
ANNEXE 9 : CONCLUSIONS DU RAPPORT D’INFORMATION NO 3443 DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES, « L’UNION EUROPEENNE DANS LE G20 : REPONDRE AUX ENJEUX DE LA REGULATION MONDIALE » 331
Alors que les services, les marchandises, les idées et les personnes circulent de plus en plus vite d’un bout à l’autre de la planète, tous les Etats ont conscience que l’isolement serait fatal à leur développement et cherchent à inventer de nouvelles coopérations multipolaires pour lutter contre l’instabilité économique globale. Tel est l’esprit du G20 et plus généralement de la « diplomatie de club ».
Chacune des trois grandes étapes de la construction de cette architecture de régulation économique mondiale a été suscitée par une crise : l’invention du G6, en 1975, pour faire face à la fin du système de Bretton Woods et le premier choc pétrolier ; la création du G20 des ministres des finances, en 1999, après les crises de liquidités en Amérique latine et en Asie du Sud-Est ; le passage du G20 au niveau chefs d’Etat et de gouvernement, après la crise bancaire mondiale de 2008, sans précédent depuis la Grande dépression des années 1930.
Le G20 est un processus empirique et évolutif. Il prend de plus en plus d’importance dans la gouvernance mondiale car il procède d’un mouvement triple : une appropriation de sujets de plus en plus vastes, avec maintenant la réforme du système monétaire, le suivi des marchés agricoles ou encore le socle universel de droits sociaux, et peut-être demain la lutte contre la volatilité des prix de l’énergie ; une prise en compte des problèmes au plus haut niveau, depuis sa mutation en sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, alors que, de 1999 à 2008, seuls se réunissaient les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales ; un cercle de pays de plus en plus important, surtout après la révolution conceptuelle de 1999, qui s’est traduite par l’intégration des grandes économies émergentes.
Car le G20 réunit les vieilles puissances industrielles en déclin économique relatif et les nouvelles puissances du Sud, chez lesquelles se situent dorénavant les principaux gisements de croissance. Les membres de cette instance se sont en quelque sorte cooptés en fonction de critères objectifs fondés sur les performances économiques, la population et la représentation équilibrée des grandes aires régionales et culturelles.
Les mécanismes de concertation autour du G20 sont de plus en plus poussés et sophistiqués, pour faire émerger des propositions « délivrables », acceptées par tous et donc susceptibles d’être déclinées dans les législations partout dans le monde. La concertation est d’abord interne au G20, avec maintenant quatre filières ministérielles placées sous l’autorité des chefs d’Etat et de gouvernement, assistés par leurs sherpas. Mais elle suit également une démarche inclusive vis-à-vis du reste du monde, avec les pays non membres du G20, les coalitions qu’ils nouent entre eux, ainsi que les organisations internationales, en particulier l’Organisation des Nations unies et ses agences spécialisées.
A l’issue de chaque sommet, des principes sont énoncés dans une « déclaration » portant la signature des vingt chefs d’Etat et de Gouvernement participant au G20. Sans créer de « droit dur » opposable aux agents économiques – car le G20 n’est pas un gouvernement mondial –, ils constituent des engagements politiques.
Mais encore faut-il poser des actes. De ce point de vue, le bilan est mitigé : l’application des orientations du G20 est limitée et inégale ; toutes n’ont pas été suivies d’effets concrets et tous les pays n’ont pas progressé au même rythme.
En trois ans, au fil des cinq premiers sommets, des jalons collectifs utiles n’en ont pas moins été posés dans l’œuvre de régulation mondiale, en matière de lutte contre les juridictions non coopératives, d’encadrement de la rémunération des opérateurs financiers, de renforcement de la supervision bancaire et financière, de contrôle des agences de notation, de régulation des marchés de produits dérivés ou encore de renforcement des fonds propres des banques.
Pour la première fois de l’histoire, la présidence du G20 est confiée pour une année complète à un pays et les deux présidences du G20 et du G8 coïncident. Cette opportunité de pilotage unifié de la gouvernance mondiale facilite la tâche de notre pays, d’autant que les mentalités sont plus ouvertes à la régulation qu’elles ne l’étaient naguère et que l’exercice du G8, couronné par le sommet de Deauville de mai 2011, a conforté la confiance de la communauté internationale vis-à-vis de la présidence française.
Pour que la réunion de Cannes s’impose comme un premier sommet de construction des conditions du développement économique à moyen et long terme, elle devra traduire dans l’agenda planétaire les grands enjeux du moment, notamment dans trois domaines : l’amorçage de la réforme du système monétaire international ; la poursuite de l’œuvre de régulation des marchés financiers ; la réduction de la volatilité des prix des matières premières agricoles.
Le système monétaire international est pratiquement devenu un « non-système », incapable de générer une discipline, les grandes puissances et le FMI ne se coordonnant que pour répondre en urgence aux grandes crises qui se succèdent. Force est de constater qu’il est compliqué de concevoir et d’organiser un nouvel ordre monétaire mondial.
La problématique centrale est celle de la confrontation entre le yuan et le dollar, que l’on peut qualifier de « guerre des changes » : les Etats-Unis ont utilisé l’endettement public puis privé pour soutenir leur activité économique, au prix du creusement de leurs comptes publics, tandis que la Chine accumulait des réserves de change colossales.
Il convient dans un premier temps d’organiser le suivi coordonné des déséquilibres macroéconomiques pour s’efforcer de les corriger et de créer les conditions d’une croissance plus vigoureuse, plus stable et plus équilibrée. Ensuite, il s’agira d’évoluer vers un système monétaire multipolaire, à l’image de l’économie mondiale.
Les cinq premiers sommets du G20 ont été essentiellement consacrés au dossier de la régulation financière, qui est donc le plus avancé. Mais le poids de ce secteur est de plus en plus disproportionné par rapport à l’économie réelle et les fluctuations boursières font vaciller le monde.
Il est donc urgent d’améliorer la coordination internationale, notamment transatlantique, en vue d’achever la transposition dans les législations nationales des orientations déjà décidées, mais aussi d’obtenir de nouvelles avancées, en matière de réduction du risque systémique, de refroidissement des marchés financiers et de désintoxication des opérateurs financiers à leur sensibilité aux agences de notation.
La présidence française du G20 a fait de la régulation des marchés agricoles, comme arme contre la volatilité excessive des prix, un thème novateur sur la scène diplomatique internationale.
Sur la base d’un rapport rédigé par dix organisations internationales, les ministres de l’agriculture du G20 ont pris une série de décisions importantes, tendant notamment à stimuler la productivité, à rendre les marchés plus transparents et à assurer une coordination internationale en situation de crise alimentaire. Quoi que devant encore être validées par les chefs d’Etat et de gouvernement, elles ont d’ores et déjà été mises en application. Ces réalisations seront à mettre à l’actif de la présidence française mais doivent encore faire leurs preuves.
En ce qui concerne la gouvernance du G20, l’enjeu, pour l’Union européenne, est double : quelle est la structuration internationale la meilleure pour la protéger convenablement contre les déstabilisations économiques ? comment doit-elle s’organiser pour peser davantage dans les négociations internationales et ainsi être mieux à même de transformer ses préoccupations en décisions politiques mondiales ?
Il semble judicieux de doter le G20 d’un secrétariat permanent, à la fois pour créer un fil rouge entre présidences et pour veiller à l’implémentation de ses impulsions dans les législations nationales. L’OCDE, organisation économique pluridisciplinaire, pourrait héberger cette structure, légère et à vocation technico-administrative.
L’Europe de l’Ouest est la zone géographique la mieux représentée dans le G20. Elle bénéficie d’un savoir-faire unique, acquis depuis plus de soixante ans, en matière de négociations multilatérales, de recherche du consensus et d’organisation d’un marché intérieur. Mais elle pourrait peser davantage dans le G20 si son organisation y était optimisée. A cet effet, la piste de la fusion entre les fonctions de président du Conseil européen et de président de la Commission européenne, proposée par le président Pierre Lequiller et le commissaire européen Michel Barnier, est à considérer avec attention.
La question est d’importance car l’ordre du jour d’un sommet du G20 est lié aux événements du moment et l’Union européenne est plus que jamais au cœur des enjeux de la régulation mondiale. Les dirigeants des principales puissances économiques sont aujourd’hui préoccupés par la crise de l’euro. Inquiets d’une possible contagion, ils auront en tête, les 3 et 4 novembre 2011, de trouver des solutions pour contribuer à ce que l’Union européenne et la zone euro sortent de leurs difficultés actuelles.
In einer Zeit, in der die Dienstleistungen, Waren, Ideen und Personen auf der gesamten Erde immer rascher verkehren, sind sich alle Staaten dessen bewusst, dass eine Isolierung für ihre Entwicklung verhängnisvoll wäre, und suchen daher nach neuen multipolaren Kooperationen, um die globale wirtschaftliche Instabilität zu bekämpfen. Dies entspricht dem Geist der G20 und generell der „Club-Diplomatie“.
Jede der drei großen Etappen beim Aufbau dieser Architektur zur weltweiten Wirtschaftsregulierung wurde durch eine Krise angestoßen: die Gründung der G6 im Jahre 1975, um das Ende des Bretton-Woods-Systems und den ersten Erdölschock zu bewältigen; die Gründung der G20 der Finanzminister 1999 nach den Liquiditätskrisen in Lateinamerika und Südostasien; sowie die Einberufung der G20-Gipfel auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs nach der weltweiten Bankenkrise von 2008, die seit der großen Rezession in der 1930er Jahren ohne gleichen war.
Die G20 stellt einen empirischen und evolutiven Prozess dar. Bei der weltweiten Ordnungspolitik erlangt dieser Prozess zunehmend an Bedeutung, da er einer dreifachen Entwicklung entspringt: der Behandlung von immer umfassenderen Themen mit nunmehr der Reform des Währungssystems, der Überwachung der Agrarmärkte oder auch dem universellen Grundsockel für soziale Rechte sowie morgen vielleicht der Bekämpfung der Volatilität der Energiepreise; einer Berücksichtigung der Probleme auf höchster Ebene seitdem die G20-Tagungen der Staats- und Regierungschefs eingeführt worden sind, während von 1999 bis 2008 lediglich die Finanzminister und Gouverneure der Notenbanken zusammenkamen; einem immer größeren Kreis von Ländern insbesondere nach der konzeptuellen Revolution von 1999, die in der Einbeziehung der wichtigsten Schwellenländer ihren Niederschlag gefunden hat.
Denn die G20 umfasst die alten Industriemächte, die einen relativen wirtschaftlichen Niedergang erfahren, sowie die neuen Mächte des Südens, in denen künftig das größte Wachstumspotenzial vorhanden ist. Die Mitglieder dieses Gremiums werden gewissermaßen durch Kooptation entsprechend objektiver Kriterien bestimmt, die sich nach der Wirtschaftskraft, der Einwohnerzahl und einer ausgewogenen Vertretung der großen regionalen und kulturellen Gebiete richten.
Bei der Absprache in der G20 kommen zunehmend komplexe und ausgeklügelte Mechanismen zur Anwendung, um vermittelbare Vorschläge zu erarbeiten, die von allen akzeptiert und somit in die Rechtsvorschriften auf der ganzen Welt übernommen werden können. Die Absprache in der G20 erfolgt zunächst intern, wobei nunmehr vier ministerielle Fachbereiche unter der Aufsicht der Staats- und Regierungschefs, die von ihren Sherpas unterstützt werden, abgedeckt sind. Verfolgt wird aber auch ein integrativer Ansatz gegenüber der restlichen Welt, die nicht der G20 angehören, den Koalitionen, die sie gegebenenfalls untereinander bilden, insbesondere der Organisation der Vereinten Nationen und ihren Sonderagenturen.
Bei Abschluss jedens Gipfels werden Grundsätze in einer „Erklärung“ veröffentlicht, die die zwanzig Staats- und Regierungschefs der G20 unterzeichnen. Bei ihnen handelt es sich um keine zwingenden und gegenüber den Wirtschaftsakteuren wirksamen Rechtsvorschriften, sondern um politische Verpflichtungen, da die G20 keine Weltregierung darstellt.
Doch gilt es auch, diese umzusetzen. In dieser Hinsicht ist die Bilanz eher mäßig. Denn die Umsetzung der G20-Leitlinien ist begrenzt und ungleich. Nicht alle hatten konkrete Auswirkungen, und nicht alle Länder sind im gleichen Rhythmus vorangekommen.
Innerhalb von drei Jahren wurden im Zuge der ersten fünf Gipfel jedoch nützliche gemeinsame Maßnahmen zur Schaffung einer weltweiten Regulierung ergriffen wie etwa bei der Bekämpfung nicht kooperativer Gebiete, der Regelung der Vergütung der Finanzunternehmen, der Ausweitung der Banken- und Finanzaufsicht, der Kontrolle der Rating-Agenturen, der Regulierung der Märkte für Derivate oder der Aufstockung der Eigenmittel der Banken.
Erstmals in der Geschichte wird der G20-Vorsitz für ein ganzes Jahr einem Land übertragen, so dass die beiden Vorsitze der G20 und der G8 zeitlich zusammenfallen. Dies bietet die Gelegenheit einer einheitlichen Steuerung der weltweiten Ordnungspolitik und erleichtert die Aufgaben unseres Landes, zumal die Einstellungen gegenüber der Regulierung heute offener sind als früher und die Wahrnehmung des G8-Vorsitzes, die auf dem Gipfel von Deauville im Mai 2011 ihren Höhepunkt fand, das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem französischen Vorsitz gestärkt hat.
Damit sich die Tagung in Cannes als erster Gipfel zur Schaffung der Voraussetzungen für die Förderung der mittel- und langfristigen Wirtschaftsentwicklung durchsetzt, muss sie in die weltweite Agenda die derzeit zentralen Anliegen aufnehmen, und zwar vornehmlich in drei Bereichen: Beginn der Reform des internationalen Währungssystems; Fortsetzung der Regulierung der Finanzmärkte; Reduzierung der Volatilität der Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe.
Das internationale Währungssystem ist nahezu zu einem „Non System“ geworden, das unfähig ist, für Disziplin zu sorgen, da sich die großen Mächte und der IWF nicht absprechen, um die wichtigsten sukzessiven Krisen dringend zu bewältigen. Festzuhalten ist, dass die Erarbeitung und die Organisation einer neuen weltweiten Währungsordnung kompliziert sind.
Die zentrale Problematik besteht in der Konfrontation zwischen dem Yuan und dem Dollar, die man auch als „Währungskrieg“ bezeichnen kann. Denn die Vereinigten Staaten haben die öffentliche und danach die private Verschuldung genutzt, um bei Inkaufnahme eines Anstiegs ihrer Staatsverschuldung ihre Wirtschaftstätigkeit zu stützen, wohingegen China kolossale Devisenreserven angehäuft hat.
In einer ersten Zeit gilt es daher, die gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichte auf koordinierte Weise zu überwachen, um diese zu korrigieren und die Voraussetzungen für ein kräftigeres, stabileres und ausgewogeneres Wachstum zu schaffen. Danach muss ein multipolares Währungssystem aufgebaut werden, das den Anforderungen der Weltwirtschaft gerecht wird.
Bei den ersten fünf G20-Gipfeln wurden im Wesentlichen Fragen der Finanzregulierung erörtert, weshalb diese am weitesten fortgeschritten ist. Das Gewicht dieses Sektors ist aber verglichen mit der Realwirtschaft unverhältnismäßig groß, und die Börsenschwankungen bringen die Welt ins Wanken.
Deshalb muss die internationale, insbesondere die transatlantische Koordinierung dringend verbessert werden, um die bereits beschlossenen Leitlinien in nationales Recht vollständig umzusetzen, aber auch um bei der Verminderung des systemischen Risikos, bei der Abkühlung der Finanzmärkte und bei der Bekämpfung der Sensibilität der Finanzunternehmen gegenüber den Einstufungen der Rating-Agenturen neue Fortschritte zu erzielen.
Der französische G20-Vorsitz hat die Regulierung der Agrarmärkte zur Bekämpfung der übermäßigen Preisvolatilität zu einem neuen Thema auf der internationalen Bühne der Diplomatie gemacht.
Auf der Grundlage eines von zehn internationalen Organisationen verfassten Berichts haben die G20-Landwirtschaftminister eine Reihe bedeutender Beschlüsse gefasst, um insbesondere die Produktivität zu steigern, die Märkte transparenter zu gestalten und eine internationale Koordinierung bei Nahrungsmittelkrisen zu gewährleisten. Diese müssen zwar noch von den Staats- und Regierungschefs gebilligt werden, kommen aber bereits zur Anwendung. Diese Maßnahmen gehen auf das Konto des französischen Vorsitzes, müssen sich aber noch bewähren.
Was die G20-Ordungspoltik anbelangt, so hat die Europäische Union zwei entscheidende Fragen zu beantworten: Welche internationale Struktur eignet sich am besten, um sie vor wirtschaftlichen Destabilisierungen angemessen zu schützen? Wie muss sie sich organisieren, um bei den internationalen Verhandlungen ein größeres Gewicht zu haben und somit besser in der Lage zu sein, ihre Anliegen in weltweite politische Beschlüsse einfließen zu lassen?
Zweckmäßig wäre es, die G20 mit einem ständigen Sekretariat auszustatten, um zwischen den einzelnen Vorsitzen einen roten Faden zu schaffen und um dafür zu sorgen, dass ihre Anregungen in nationales Recht Eingang finden. Diese leichte Struktur mit technischen und administrativen Aufgaben könnte bei der OECD, einer multidisziplinären Wirtschaftsorganisation, angesiedelt werden.
Westeuropa stellt das geografische Gebiet dar, das in der G20 am stärksten vertreten ist. Es verfügt über ein einzigartiges und seit über 60 Jahren erworbenes Know-how im Bereich der multilateralen Verhandlungen, der Suche nach einem Konsens und des Aufbaus eines Binnenmarkts. Innerhalb der G20 könnte es jedoch ein größeres Gewicht besitzen, wenn seine Organisation dort optimiert würde. Zu diesem Zweck wird die Verschmelzung der Ämter des Präsidenten des Europäischen Rates und des Präsidenten der Europäischen Kommission, die vom Vorsitzenden Pierre Lequiller und vom Europäischen Kommissar Michel Barnier vorgeschlagen worden ist, mit Aufmerksamkeit geprüft.
Diese Frage ist von Bedeutung, denn die Tagesordnung des G20-Gipfels ist mit den derzeitigen Ereignissen verknüpft und die Europäische Union steht mehr als je zuvor im Mittelpunkt der Herausforderungen der globalen Regulierung. Die Eurokrise beunruhigt die Staats- und Regierungschefs der grössten Wirtschaftsmächte. Angesichts des Risikos eines möglichen Domino-Effekts geht es ihnen am 3. Und 4. November auch darum, Lösungen zu finden, um die Europäische Union und die Eurozone dabei zu unterstützen, ihre gegenwärtigen Schwierigkeiten zu bewältigen.
At a time when services, goods, ideas and people are moving faster and faster across the planet, all States are aware that isolation would be fatal to their development and are seeking to invent new forms of multipolar cooperation to combat global economic instability. This is the spirit of the G20 and more generally of ‘club diplomacy’.
Each of the three main steps of the construction of this world economic regulatory architecture was generated by a crisis: the invention of the G6, in 1975, to cope with the end of the Bretton Woods system and the first oil shock; the creation of the Ministers of Finance G20, in 1999, after the liquidity crises in Latin America and Southeast Asia; and the G20 transition to heads of state or government, after the world banking crisis in 2008, of unprecedented scale since the Great depression of the 1930s.
The G20 is an empirical and evolutive process. It is acquiring ever greater importance in world governance for three reasons: it has taken on board an ever broader range of topics, now extending to reform of the monetary system, monitoring of agricultural markets or also the universal foundation of human rights, and perhaps tomorrow combating energy price volatility; it has factored in problems at the highest level since its changeover to a summit of heads of state or government, whereas, from 1999 to 2008, only ministers for finance and governors of central banks met; it includes an ever greater circle of countries, especially after the conceptual revolution of 1999, which led to the integration of the major emerging economies.
The G20 indeed brings together the old industrial powers in relative economic decline and the new powers of the South where the main sources of growth are now located. The members of this body are in a way coopted on the basis of objective criteria based on economic performances, population and a balanced representation of major regional and cultural areas.
G20-connected concerted action mechanisms are increasingly advanced and sophisticated in order to bring to the fore ‘deliverable’ proposals, accepted by all and thus likely to be implemented in legislations everywhere in the world. Concerted action is first internal to the G20, with now four ministerial lines placed under the authority of heads of state or government assisted by their sherpas. But it is also inclusive vis-a-vis the rest of the world, with non-member countries of the G20 and the coalitions they enter into with each other, as well as international organisations, in particular the United Nations and its specialised agencies.
Following each summit, principles are set forth in a ‘statement’ bearing the signature of the twenty heads of state or government participating in the G20. Without creating ‘hard law’ applicable to economic agents – because the G20 is not a world government – these principles form political commitments.
Concrete action is however required. From this point of view, the outcome is mixed: implementation of G20 guidelines is limited and uneven; not all have been followed with actual effect and not all countries have progressed at the same pace.
In the three years of the first five summits, useful collective milestones have nevertheless been laid to regulate worldwide, as regards fight against uncooperative jurisdictions, pay restraint for financial operators, strengthening of banking and financial supervision, monitoring of credit rating agencies, regulation of derivatives markets and strengthening of bank capital.
For the first time in history, the G20 presidency has been entrusted for a whole year to one country and the G20 and G8 presidencies coincide. This opportunity for a unified steering of world governance facilitates the task of France, all the more so as attitudes have become more open to regulation than before and as the organisation of the G8, crowned by the Deauville summit in May 2011, has strengthened the international community’s confidence in the French presidency.
For the Cannes summit to stand out as a first summit where the conditions for medium and long term economic development were laid, it will have to get the main challenges of our day placed on the global agenda, especially in three fields: starting the reform of the international monetary system; continuing the regulation of financial markets; reducing the price volatility of agricultural commodities.
The international monetary system has become practically a ‘non-system’, incapable of generating discipline, the major powers and the IMF coordinating between themselves only in emergency response to the succession of major crises. Admittedly it is complicated to design and organise a new world monetary order.
The central issue is the confrontation between the yuan and the dollar, which can be called an ‘exchange war’: the United States has used government indebtedness, then private indebtedness, at the price of worsening its public accounts, to support its economic activity, while China was accumulating colossal exchange reserves.
In a first stage, coordinated monitoring of macroeconomic imbalances should be organised in an attempt to correct them and create the conditions for stronger, more stable and more balanced growth. Then, it will be time to evolve towards a multipolar monetary system mirroring the global world economy.
The first five G20 summits were mainly devoted to financial regulation, which is therefore the most advanced issue. However the weight of this sector is increasingly disproportionate with respect to the real economy and stock exchange fluctuations are making the world reel.
International coordination must therefore be improved as a matter of urgency, especially transatlantic coordination, in order to complete the transposition into national legislations of the guidelines already decided and also to obtain new advances regarding a reduction of systemic risk, the cooling of financial markets and a detoxification of financial operators regarding their sensitivity to credit rating agencies.
The French presidency of the G20 has made the regulation of agricultural markets, as a weapon against excessive price volatility, an innovative topic on the international diplomatic scene.
On the basis of a report drafted by ten international organisations, the G20 ministers for agriculture have taken a series of important decisions aimed in particular at stimulating productivity, making markets more transparent and ensuring international coordination in a food crisis situation. Although these decisions still have to be validated by the heads of state or government, they have already been implemented. These achievements will be to be credited to the French presidency but must still prove their worth.
As for G20 governance, the challenge, for the European Union, is twofold: what is the best international structure to protect it suitably against economic destabilisations? How must it organise itself to have greater influence in international negotiations and thus be in a better position to transform its concerns into global political decisions?
It seems wise to provide the G20 with a standing secretariat, both to create a common thread between the presidencies and ensure implementation of its ‘spurring’ in national legislations. The OECD, a pluridisciplinary economic organisation, could host this light structure set up for technical-administrative reasons.
West Europe is the best represented economic area in the G20. Over more than sixty years it has acquired unique know-how in multilateral negotiations, the seeking of consensuses and organisation of the internal market. But it could have more influence in the G20 if its organisation were optimised. Attention should therefore be paid to the possible option of a merging between the duties of president of the European Council and president of the European Commission, as proposed by chairman Pierre Lequiller and European Commissioner Michel Barnier.
The issue is of importance because the agenda of a G20 summit is related to the events of the time and the European Union is more than ever at the heart of the challenges of global regulation. The leaders of the major economic powers are today concerned by the euro crisis. Worried as they are about a possible contagion, they will be focussed, on 3 and 4 November 2011, on finding solutions contributing to getting the European Union and the euro zone out of their present difficulties.
I servizi, le merci, le idee e le persone circolano sempre più velocemente da un lato all’altro del pianeta e tutti gli Stati sono consapevoli che l’isolamento comprometterebbe gravemente lo sviluppo dei Paesi. A tale scopo essi cercano quindi di inventare nuovi tipi di cooperazione multipolare per lottare contro l’instabilità economica globale. Questo è lo spirito del G20 e più in generale della « diplomazia di club ».
Ognuna delle tre grandi tappe della costruzione di quest’architettura di regolazione economica mondiale è nata sulle ceneri di una crisi: l’invenzione del G6, nel 1975, per far fronte alla fine del sistema di Bretton Woods e al primo choc petrolifero; la creazione del G20 dei ministri delle finanze, nel 1999, dopo la crisi di liquidità in America latina e nel Sud-est asiatico; il passaggio del G20 a livello dei capi di Stato e di Governo, dopo la crisi bancaria mondiale del 2008, senza precedenti da quando vi fu la grande depressione degli anni trenta.
Il G20 è un processo empirico ed evolutivo. Prende sempre più importanza nella governance mondiale poiché parte da un triplice movimento: un’appropriazione di sempre maggiori argomenti, accompagnata ora dalla riforma del sistema monetario, l’accompagnamento dei mercati agricoli o ancora la base universale dei diritti sociali, e forse domani la lotta contro la volatilità dei prezzi dell’energia; una presa in considerazione dei problemi al più alto livello, dalla sua trasformazione in Vertice dei Capi di Stato e di Governo, mentre, dal 1999 al 2008, si riunivano unicamente i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali; un circolo di paesi sempre più importante, soprattutto dopo la rivoluzione concettuale del 1999, che si è tradotta con l’integrazione delle grandi economie emergenti.
Poiché il G20 riunisce le vecchie potenze industriali in declino economico relativo e le nuove potenze del Sud che rappresentano ormai i principali bacini di crescita. I membri di questa istanza si sono in qualche modo cooptati sulla base di criteri fondati sui risultati economici, la popolazione e la rappresentanza equilibrata delle grandi zone regionali e culturali.
I meccanismi di concertazione intorno al G20 sono sempre più approfonditi e ricercati, per far emergere proposte « consegnabili », accettate da tutti e quindi possibilmente recepibili nelle legislazioni di tutto il mondo. La concertazione è in primo luogo interna al G20, con ora quattro filiere ministeriali poste sotto l’autorità dei Capi di Stato e di Governo, assistiti dai loro sherpa. Ma essa segue ugualmente un approccio inclusivo nei riguardi del resto del mondo, con i paesi non membri del G20, le coalizioni che si creano e le Organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate.
Alla fine di ogni Vertice, vengono redatti alcuni principi sotto forma di « dichiarazione» con la firma dei venti capi di Stato e di Governo che partecipano al G20. Senza creare un « diritto rigido » opponibile agli agenti economici – poiché il G20 non è un governo mondiale –, essi rappresentano tuttavia un impegno politico.
Ma bisogna ancora passare dalle parole ai fatti. Da questo punto di vista, il risultato è ancora insoddisfacente: l’applicazione degli orientamenti del G20 è limitata e disomogenea; in effetti, non tutte sono state seguite da effetti concreti e non tutti i paesi sono andati avanti allo stesso ritmo.
In tre anni, durante i cinque primi vertici, sono state poste molte pietre miliari nell’opera di regolazione mondiale, in materia di lotta contro le giurisdizioni non cooperative, di inquadramento della remunerazione degli operatori finanziari, di rafforzamento della supervisione bancaria e finanziaria, di controllo delle agenzie di notazione, di regolazione dei mercati di prodotti derivati o ancora di rafforzamento dei fondi propri delle banche.
Per la prima volta nella storia, la presidenza del G20 è stata affidata per un intero anno a un unico Paese e le due presidenze quella del G20 e quella del G8 coincidono. Quest’opportunità di pilotaggio unificato della governance mondiale facilita il compito del nostro Paese, anche perché le mentalità sono ora più aperte alla regolazione di quanto non lo fossero in passato ed inoltre, l’esercizio del G8, coronato dal vertice di Deauville del maggio 2011, ha incentivato la fiducia della comunità internazionale nei riguardi della Presidenza francese.
Perchè la riunione di Cannes possa imporsi come primo Vertice di costruzione delle condizioni di sviluppo economico a medio e lungo termine, sarà necessario che tale riunione riesca a far recepire nell’agenda planetaria i grandi interessi in gioco del momento, in particolare in tre campi: l’avvio della riforma del sistema monetario internazionale; il proseguimento dell’opera di regolazione dei mercati finanziari; la riduzione della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole.
Il sistema monetario internazionale è in pratica diventato un « non sistema », incapace di produrre una disciplina. Le grandi potenze e il FMI si coordinano, in effetti, solo per rispondere d’urgenza alle grandi crisi che si succedono. Tuttavia dobbiamo costatare che è complicato immaginare e organizzare un nuovo ordine monetario mondiale.
La problematica centrale è quella dello scontro tra lo yuan e il dollaro, che si può definire « guerra dei cambi»: gli Stati Uniti hanno utilizzato l’indebitamento pubblico e poi quello privato per sostenere la loro attività economica, mettendo in pericolo i conti pubblici, mentre allo stesso tempo la Cina accumulava riserve di cambio colossali.
Sarebbe utile in un primo tempo organizzare un lavoro coordinato sugli squilibri macroeconomici per tentare di correggerli e per creare le condizioni adeguate per una crescita più forte, più stabile e più equilibrata. Poi, sarà necessario andare nella direzione di un sistema monetario multipolare, che rispecchi l’economia mondiale.
I primi cinque vertici del G20 sono stati essenzialmente dedicati alla regolazione finanziaria, che è quindi l’argomento più trattato. Ma il peso di questo settore è sempre più sbilanciato nei riguardi dell’economia reale e le fluttuazione borsistiche fanno vacillare il mondo.
Vi è allora urgenza di migliorare il coordinamento internazionale, in particolare transatlantico, al fine di completare il recepimento all’interno delle legislazioni nazionali degli orientamenti già decisi, ma anche di compiere nuovi passi in avanti, in materia di riduzione del rischio sistemico, per calmierare i mercati finanziari e « disintossicare » gli operatori finanziari nei riguardi delle agenzie di rating.
La presidenza francese del G20 ha fatto della regolazione dei mercati agricoli, in quanto arma contro l’eccessiva volatività dei prezzi, un tema innovativo sulla scena diplomatica internazionale.
Sulla base di un rapporto redatto da dieci organizzazioni internazionale, i Ministri dell’agricoltura del G20 hanno preso una serie di decisioni importanti, che tendono in particolare a stimolare la produttività, a rendere i mercati più trasparenti e ad assicurare un coordinamento internazionale nei momenti di crisi alimentare. Anche se tali decisioni devono ancora essere convalidate dai capi di Stato e di Governo, esse sono già state messe in applicazione. Queste realizzazioni saranno da considerare all’attivo della Presidenza francese ma devono ancora essere completamente comprovate.
Per quanto riguarda la governance del G20, il interesse in gioco, per l’Unione europea, è duplice: qual è la migliore strutturazione internazionale per proteggerla adeguatamente contro le destabilizzazioni economiche? Come deve inoltre organizzarsi per aver maggior peso nelle negoziazioni internazionali ed essere quindi più atta a trasformare le proprie preoccupazioni in decisioni politiche mondiali?
Sarebbe inoltre importante prevedere la creazione di un segretariato permanente del G20 allo scopo di mantenere un filo rosso nel susseguirsi delle presidenze e poter assicurare il recepimento del lavoro svolto in ambito G20 all’interno delle legislazioni nazionali. Tale struttura potrebbe essere accolta in seno all’OCSE, organizzazione economica pluridisciplinare, leggera e a vocazione tecnico-amministrativa.
L’Europa dell’Ovest è la zona geografica meglio rappresentata del G20. Si avvale di un savoir-faire unico, acquisito in più di sessant’anni, in materia di negoziati multilaterali, di ricerca del consenso e di organizzazione di un mercato interno. Ma potrebbe svolgere un ruolo più preponderante all’interno del G20 se ne venisse ottimata l’organizzazione. A tal riguardo, l’idea di riunire le funzioni di Presidente del Consiglio europeo e di Presidente della Commissione europea, presentata dal Presidente Pierre Lequiller e dal Commissario europeo Michel Bannier è da considerare con attenzione.
E’ un argomento importante poiché l’ordine del giorno del Vertice del G20 viene stabilito in funzione degli eventi presenti e l’Unione europea è più che mai al centro degli interessi della regolazione mondiale. I dirigenti delle principali potenze economiche sono oggi preoccupati dall’ instabilità che prevale sul nostro continente. Allarmati da un possibile contagio, avranno in mente, i 3 e 4 novembre 2011, di trovare delle soluzioni per aiutare l’Unione europea e la zona euro a uscire dalle loro difficoltà presenti.
Mesdames, Messieurs,
L’architecture institutionnelle mondiale née des deux guerres mondiales du XXe siècle, appuyée sur l’Organisation des Nations unies (ONU) et ses agences, conserve sa pertinence et son utilité, notamment pour défendre les droits des peuples et, nécessité extrême, pour légitimer l’usage de la force. Mais le monde a tellement changé depuis 1945 que d’autres mécanismes de régulation sont nécessaires, en parallèle, pour dénouer les crises ou, mieux, les prévenir. Tel est l’objectif du groupe des vingt principales puissances économiques mondiales, le G20, que l’on pourrait qualifier de projet de gouvernance économique multilatérale pour corriger les grands déséquilibres et gérer de façon coordonnée les fluctuations et asymétries de croissance.
La présidence du G20, qui échoit à la France depuis le 12 novembre 2010 et s’achèvera le 31 décembre 2011, se démultiplie en une multitude d’initiatives : des rapports d’experts, des groupes de travail communs à plusieurs organisations internationales, des groupes techniques internationaux de fonctionnaires, des réunions de sherpas, des forums thématiques internationaux, des réunions ministérielles, des rencontres d’organisations non gouvernementales, de chefs d’entreprises, de syndicalistes, d’agriculteurs, de jeunes ou de scientifiques, et, pour finir, le sixième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, qui se tiendra à Cannes les 3 et 4 novembre 2011.
La Commission des affaires européennes nous a confié pour mission, le 21 décembre dernier, de suivre sa préparation. L’objectif est d’analyser les enjeux et d’émettre des recommandations contribuant à améliorer le rôle joué par l’Union européenne (UE) dans le processus décisionnel, à travers ses quatre Etats membres participant aux travaux du G20 – l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie – comme à travers ses instances propres. Rappelons en effet que le G20 est en réalité le groupe des dix-neuf pays les plus développés du monde, représentatifs des grandes aires continentales et culturelles, plus l’UE, qui siège en tant que telle. Forte de son économie intégrée, de ses 500 millions d’habitants et d’un PIB représentant près de 30 % de la production mondiale – davantage que les Etats-Unis –, l’UE peut en effet être considérée comme la première puissance économique de la planète.
*
Le G20 s’inscrit dans une tradition, encore courte mais déjà reconnue sur la scène internationale. Préalablement à l’analyse des enjeux inhérents à la présidence française de 2011, il nous a donc semblé essentiel de revenir sur ce qu’est la diplomatie de club, sur les événements économiques qui ont rendu nécessaire la création du G20 et le cheminement historique qu’il a suivi, sur ses missions – identifier et gérer les risques systémiques, donner des impulsions aux institutions de coopération et de régulation, et assurer une répartition équitable des gains de la mondialisation –, sur ses grands principes d’organisation et de fonctionnement puis sur le bilan des cinq sommets qui se sont succédé de novembre 2008 à novembre 2010.
Mais le G20 est aussi un cercle au sein duquel s’expriment des rapports de force correspondant à la réalité géoéconomique du moment. Des ambitions et des intérêts s’y confrontent. Pour comprendre et anticiper les avancées et les blocages qui s’y manifestent, il convient de procéder à une revue de détail des puissances en présence, en faisant l’effort de décentrer son point de vue pour ne pas raisonner franco-français ou même européo-européen.
Compte tenu de l’étendue des champs thématiques inscrits par le Président de la République à l’agenda de la présidence française du G20, nous avons choisi de nous concentrer sur un aspect, multidimensionnel et sans doute le plus crucial pour le devenir de l’économie mondialisée, la régulation des marchés, avec trois volets :
– la poursuite de l’encadrement des marchés et services financiers engagé depuis le premier sommet du G20, en 2008 ;
– la réforme du système monétaire international, qui en est restée, jusqu’à présent, à ses balbutiements ;
– la lutte contre la volatilité des prix des matières premières agricoles, thème novateur sur la scène diplomatique internationale.
Cependant, au fil des auditions, il nous est aussi apparu incontournable de nous pencher sur le mode de gouvernance du G20.
Parallèlement à notre réflexion, nous avons suivi avec attention les travaux conduits dans le cadre du G8, car les conclusions du sommet de Deauville des 26 et 27 mai derniers seront évidemment sur la table lors des discussions de Cannes, les deux exercices étant imbriqués l’un dans l’autre – surtout cette année, qui se caractérise par une concentration exceptionnelle des deux présidences entre les mains d’un seul pays, la France.
D’autres dossiers de l’agenda de 2011 sont tout aussi structurants pour l’économie mondiale et tout aussi en adéquation avec les compétences et les centres d’intérêt de notre commission : l’établissement d’un socle universel de protection sociale, l’aide au développement, le climat ou encore la sécurité nucléaire. Nous avons toutefois jugé plus raisonnable de circonscrire notre travail ; chacun des thèmes retenus est déjà extrêmement technique et pourrait faire l’objet d’un rapport d’information à lui seul.
*
Le G20 s’est imposé comme un lieu de dialogue essentiel dans la conduite des affaires économiques mondiales, à la fois pour répondre aux urgences et pour effectuer une remise en ordre financière, macroéconomique et monétaire. Pour devenir pleinement utile, il doit passer un nouveau stade et s’imposer comme lieu d’impulsion politique, capable de prescrire des solutions concertées auxquelles chaque Etat, à commencer par ses vingt membres, se sentira contraint de mettre en œuvre dans sa réglementation nationale et sa pratique économique.
La réussite d’un sommet se joue dans une large mesure en amont, selon les résultats obtenus lors des réunions ministérielles organisées au cours des mois précédents. A cet égard, la France a bien géré sa présidence, qui peut d’ores et déjà être considérée comme un triple succès :
– elle a profité de la capacité d’impulsion intéressante que lui conférait ce statut pour inscrire de nouveaux thèmes à l’ordre du jour ;
– elle a convaincu ses partenaires de l’opportunité de ces problématiques, en respectant la règle du jeu implicite qui s’applique à l’exercice, à savoir ne pas prendre des positions trop catégoriques, s’astreindre à une certaine neutralité pour ne pas donner l’impression de vouloir imposer des présupposés tranchés ;
– au fil de l’année, elle a trouvé des consensus autour de « délivrables », propositions susceptibles d’être soumises à l’approbation des chefs d’Etat et de gouvernement lors du sommet.
*
Faire peser des attentes excessives sur la présidence française causerait toutefois immanquablement des déceptions au lendemain du sommet de Cannes. Celui-ci ne sera, au mieux, qu’un pas de plus vers un nouvel ordre multilatéral dont les contours restent incertains mais auquel les grandes puissances économiques aspirent pour assurer une croissance forte, durable et équilibrée.
La crise de l’euro et de la gouvernance européenne sera au cœur des discussions du 3 et du 4 novembre 2011 car le monde entier, inquiet d’une possible contagion, est aujourd’hui préoccupé par l’instabilité qui prévaut sur notre continent. Les grands pays émergents, riches en liquidités, accroissent leurs réserves monétaires libellées en euros, notamment en rachetant des titres de dette souveraine auprès de pays en difficulté. Quant au secrétaire au trésor américain Timothy Geithner, il a accompli le geste spectaculaire – mais sans conséquences positives à ce stade, il faut malheureusement en convenir – de participer à la rencontre informelle des ministres des finances de la zone euro puis de l’Ecofin, les 16 et 17 septembre 2011, à Wroclaw, en Pologne.
Cela dit, nul ne peut prévoir ce qui émergera des discussions. Chaque sommet réunit des dirigeants confrontés à des problématiques domestiques propres et se déroule dans une configuration internationale particulière. Sa dynamique politique éclot au dernier moment, sur place, chaque participant ayant intérêt à conserver certaines cartes en main et à ne les aligner que lorsque la réunion approche de son dénouement. Tout le monde prévoyait que la réunion de Séoul de novembre 2010 serait surtout consacrée à la réforme des quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) ; ce problème a en fait été réglé quelques semaines plus tôt, sous la pression de l’événement à venir. Mais les Américains ont passablement stérilisé le sommet en se concentrant sur les excédents commerciaux chinois et les déséquilibres macroéconomiques qu’ils entraînent.
*
La Commission des affaires européennes est particulièrement qualifiée pour suivre le G20, et pas seulement en raison du poids de l’Europe dans l’économie mondiale. L’UE est en effet l’échelon politique auquel se prennent désormais la majeure partie des décisions de nature financière, commerciale et monétaire engageant les Vingt-sept.
Nous avons auditionné des ministres, des collaborateurs de premier plan du Président de la République, des directeurs et des fonctionnaires d’administration centrale, des membres de cabinets ministériels, des banquiers centraux, des régulateurs financiers ainsi que de nombreux économistes, chercheurs en géopolitique, animateurs de think tanks et socioprofessionnels(2).
Nous nous sommes également rendus dans plusieurs capitales européennes : Bruxelles, où nous avons rencontré des représentants de toutes les institutions communautaires ; Berlin, Londres, Rome, capitales des trois autres pays européens du G20 ; Budapest et Varsovie, la Hongrie et la Pologne ayant successivement assuré la présidence tournante de l’UE en 2011. A travers des entretiens avec des membres des gouvernements locaux, des délégations de parlementaires et de multiples personnalités locales, avec l’appui des ambassadeurs français en poste sur place et de leurs collaborateurs, nous avons pu prendre le pouls de nos partenaires européens pour mesurer leur degré d’implication dans le G20. Il s’agissait aussi d’une démarche de diplomatie parlementaire, pour témoigner du soutien de la représentation nationale aux priorités de la présidence française du G20 et souligner la nécessité de parvenir à des résultats tangibles à Cannes.
Dans le même souci, au-delà des frontières européennes, outre deux déplacements aux Etats-Unis et au Japon, à l’occasion desquels nous avons mesuré les divergences d’appréciation, d’un continent à l’autre, sur les causes de la crise et les mesures de régulation à prendre, nous avons reçu ou visité, à Paris, plusieurs ambassadeurs et hauts fonctionnaires de pays émergents.
Enfin, à Paris, New York et Rome, nous nous sommes entretenus avec des experts de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), du FMI, de la Banque mondiale et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Nous vous avons déjà présenté un rapport d’étape, le 17 mai dernier, « L’Union européenne et le G20 : répondre aux enjeux de la mondialisation », dans lequel nous émettions des recommandations générales sur les grands axes de la présidence française.
*
Dans son discours de voeux aux parlementaires, le 12 janvier 2011, le Président de la République faisait état de sa volonté d’associer les parlementaires à la présidence française du G20, évoquant même, à l’époque, l’éventualité de recourir à l’article 18, alinéa 2, de la Constitution :
« Mesdames et Messieurs, j’aurai l’occasion, dans d’autres enceintes, de parler en détail de la Présidence du G20 et de celle du G8. Je dis simplement que, naturellement, je serai à la disposition du Parlement réuni en Congrès ou non, avec le Premier ministre et les ministres, pour vous informer en détail de l’ordre du jour de la Présidence française dont je ne rappellerai que les têtes de chapitre que sont la réforme de l’ordre monétaire international et la régulation des tarifs du marché des matières premières. Si nous ne faisons rien, on va tout droit à des émeutes de la faim qui auront un coût économique, social et politique bien supérieur que celui d’une action volontariste. Et il y a, bien sûr, la gouvernance mondiale avec, à l’intérieur, la question des financements innovants.
« Les parlementaires seront associés à la Présidence française. Il faudra d’ailleurs réfléchir sans doute à cette idée : pourquoi pas un G20 des parlements que nous pourrions institutionnaliser pour que les parlementaires ne soient pas, dans nos démocraties, décrochés de discussions qui ne sont pas simplement des discussions internationales mais qui ont un impact considérable sur chacune de nos vies nationales ? »
Ces deux options – réunion du Parlement en Congrès et G20 des parlements – n’ont finalement pas été retenues cette année mais elles pourront l’être dans les années à venir car le G20 n’est pas un processus borné dans le temps. Nous pouvons au demeurant témoigner que le pouvoir exécutif a tenu son engagement de tenir les parlementaires informés du déroulement de la négociation, à chacune de ses étapes et de se montrer sensible à leurs préoccupations.
La Conférence des présidents du Parlement européen et des chambres basses des pays du G8 – les Etats-Unis, en cette veille des commémorations des attentats du 11 septembre, qui mobilisaient l’ensemble de la classe politique, étaient représentés par des fonctionnaires parlementaires –, du Brésil et de l’Afrique du Sud, organisée à l’Assemblée nationale par le président Bernard Accoyer les 8, 9 et 10 septembre 2011, a aussi été un rendez-vous important dans le calendrier de la présidence française du G20, d’une part, pour procéder à un échange d’expériences sur les procédures législatives face aux défis contemporains et, d’autre part, pour débattre du rôle des parlements dans l’essor des énergies du futur.
*
Au fil de ces huit mois de travail, dans la diversité de nos positions politiques respectives, nous avons acquis la conviction que le G20, en dépit de ses limites et de ses lenteurs, est devenu indispensable pour atténuer les dérèglements économiques mondiaux – à défaut de pouvoir les résorber complètement – et dissuader les comportements protectionnistes, toujours tentants. La communauté internationale a compris que la mondialisation lui imposait le devoir de porter ce projet de gouvernance économique symétrique à vingt. En 1999, lors de la première réunion ministérielle finances, et il y a trois ans encore, en 2008, lors du premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, les Etats du G20 étaient animés par des philosophies très différentes. Si des différences d’identités nationales, de cultures politiques, de visions stratégiques et d’intérêts économiques subsistent, les positions se rapprochent au fil des ans, sous les effets contraignants de la mondialisation, mais aussi grâce à la lente édification d’une tradition de travail conjoint dénué de tabous.
La radioscopie du G20 que nous nous sommes efforcés d’opérer et les recommandations que nous vous soumettons aujourd’hui, pour leur part, sont dictées par le désir de faire mieux connaître cette toute jeune structure de négociation et d’apporter une contribution des représentants de la nation à l’effort de la France et de l’Europe en faveur de la croissance, de la stabilité et de la paix mondiales.
PREMIERE PARTIE :
LE G20, UN CONTRAT INTERNATIONAL IMPLICITE, PRODUIT DE L’HISTOIRE,
DONT LA STRUCTURATION ET LE POIDS S’AFFIRMENT AVEC LE TEMPS
Forum économique, rendez-vous diplomatique, théâtre médiatique, chaque G20 est désormais un événement, une étape importante dans le dialogue international et la stabilisation d’un monde multipolaire en construction. Vingt ans après la fin de la guerre froide et du partage du monde entre deux superpuissances proposant deux modèles rivaux d’organisation politique, économique et sociale, il est clair qu’aucun pays ni alliance régionale ne possède le faisceau d’atouts militaires, diplomatiques, culturels, démographiques, productifs et monétaires requis pour s’imposer comme hyper puissance mondiale et faire souscrire le reste du monde à son modèle. Bien au contraire, alors que les services, les marchandises, les idées et les personnes circulent de plus en plus vite d’un bout à l’autre de la planète, démultipliant au passage les potentialités de création de richesse, tous les Etats – à quelques exceptions près, statistiquement négligeables – ont conscience que l’isolement serait fatal à leur développement et cherchent pragmatiquement à inventer de nouvelles coopérations multipolaires pour lutter contre l’instabilité économique globale, tout en s’appliquant, naturellement, à conserver leurs avantages comparatifs.
Tel est l’esprit du G20 et plus généralement des différents « G », ces clubs de pays qui se réunissent dans des cadres plus ou moins formels et protocolaires pour tenter de coordonner leurs politiques, dans une logique non pas régionale mais globale.
Si leur histoire a débuté dès 1975 – sous la force motrice, déjà, de la France –, ils jouent un rôle de plus en plus important dans l’organisation du monde.
I. LES « G », UNE SUPERPOSITION
DE GROUPES TRANSCONTINENTAUX PLUS OU MOINS ORGANISES
En 1975, le Président Valéry Giscard d’Estaing prend l’initiative d’inviter les chefs d’Etat et de gouvernement des autres grandes puissances économiques – Allemagne, Etats-Unis, Italie, Japon et Royaume-Uni – pour un sommet à six, organisé à Rambouillet. Cette réunion du « Groupe des Six », ou G6, est destinée à évoquer les grandes questions économiques et financières d’actualité, en pleine période de décomposition du système monétaire de Bretton Woods et deux ans après la première crise pétrolière.
A la fin des Trente Glorieuses, les économistes d’obédience libérale
– en particulier Milton Friedman et ses disciples de l’« école de Chicago » – remettent en cause les bienfaits de l’étalon-or et des parités fixes, fondements des accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944. En effet, paradoxalement, alors même que ce système supposait que la balance des paiements des Etats-Unis fût déficitaire, afin d’alimenter le monde en moyens de règlement internationaux, les besoins importants de l’économie mondiale en dollars contribuèrent à saper la confiance des marchés envers la fiabilité de cette monnaie – c’est le « dilemme de Triffin »(3). En outre, les pays qui exportaient le plus vers les Etats-Unis avaient accumulé d’immenses réserves en dollars, ce qui avait suscité autant d’émissions dans leur propre monnaie, alimentant une inflation de plus en plus inquiétante.
Les Etats-Unis suspendent finalement la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971, le système des taux de change fixes est définitivement abandonné en mars 1973 et les accords de la Jamaïque du 8 janvier 1976 entérinent la fin du rôle légal international de l’or : il n’y a alors plus de système monétaire international organisé.
Pour ne pas subir le contrecoup de la dépréciation de la valeur du dollar consécutive à son flottement, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) indexe le prix du baril sur l’or et non plus sur le dollar. Le surenchérissement du prix du baril, jusqu’alors très stable, débute, mais dans des proportions minimes. Le phénomène prend de l’ampleur avec la guerre du Kippour d’octobre 1973 : les pays du Golfe dopent unilatéralement le prix du baril de 70 % et adoptent un contingentement drastique des quantités exportées. La pénurie crée la panique et, en quelques semaines, le tarif du baril, sur le marché libre, est multiplié par six. Ce mouvement haussier aggrave sensiblement les effets du ralentissement conjoncturel mondial qui commençait à se faire sentir : l’économie mondiale entre en crise pour des décennies.
La déclaration de principes adoptée en conclusion du sommet de Rambouillet, le 17 novembre 1975, est donc essentiellement consacrée aux questions économiques au sens large, principal sujet de préoccupation du « monde libre » : croissance, lutte contre le chômage et l’inflation, échanges commerciaux, système monétaire international, politique énergétique, coopération avec les pays en voie de développement. Elle va toutefois un peu plus loin en prônant « la détente » et « un dialogue » avec les pays de l’Est. Ce texte signe donc, en quelque sorte, dans « un monde marqué par une interdépendance croissante », l’acte de naissance d’une diplomatie politico-économique multilatérale.
Le Canada rejoint le groupe en 1976 pour former le G7 ; puis la Russie y est progressivement incorporée à partir de 1992 et y siège définitivement depuis 1997(4), ce qui donne naissance au G8. Les ministres chargés des finances continuent néanmoins régulièrement de tenir des réunions au format G7, sans la Russie. En effet, bien que tout le champ thématique de l’économie soit couvert, normalement, par le G20, il apparaît utile de maintenir un cadre plus restreint, abordant des points très techniques en l’absence de la Chine et des autres émergents. Ce G7 finances se réunit physiquement(5)voire, en cas d’urgence, par téléconférence, comme ce fut le cas après le séisme japonais, le 16 mars 2011, afin de soutenir les efforts du gouvernement nippon pour contrer le risque d’effondrement des marchés financiers.
Le G8 est présidé à tour de rôle, pour un an, par un de ses membres, chargé de préparer le sommet final, au travers notamment de réunions au niveau ministériel – dans les domaines de l’économie et des finances, de la défense, du développement, de l’énergie, de l’environnement, de l’éducation, de la santé, de la justice ou de la sécurité – et de l’accueillir. La France a succédé au Canada à la présidence du G8 le 1er janvier 2011 et elle passera le témoin aux Etats-Unis le 1er janvier 2012. Elle a par conséquent organisé cette année, les 26 et 27 mai, à Deauville, son sixième sommet, après ceux de Rambouillet en 1975, de Versailles en 1982, de Paris en 1989, de Lyon en 1996 et d’Evian en 2003.
Notons enfin que le G8 est en réalité un G9, dans la mesure où l’UE y est systématiquement représentée intuitu personae, par l’intermédiaire de la présidence tournante du Conseil ou, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de la présidence tournante de l’Union ou du Service européen d’action extérieure (SEAE), selon les configurations des réunions – groupes de travail thématiques, rencontres des sherpas, rendez-vous ministériels ou sommets.
Si les sommets du G6, du G7 et du G8 sont parfois caricaturés comme des rencontres « au bord de la piscine » ou « au coin du feu », ils consacrent un nouveau modèle de concertation internationale. Année après année, à l’échelon des chefs d’Etat et de gouvernement mais aussi aux niveaux ministériel et administratif, s’impose une nouvelle atmosphère de confiance mutuelle, propice à l’édification de repères communs et au traitement des grands dossiers suivants :
– questions financières, monétaires et budgétaires ;
– énergie et climat ;
– sécurité internationale, résolution des conflits régionaux, terrorisme, lutte contre la prolifération nucléaire ;
– aide au développement ;
– santé.
Mais l’on peut aussi y voir une diplomatie de complaisance ou de connivence(6), centrée sur les intérêts et les préoccupations de l’oligarchie mondiale du XXe siècle.
Au milieu des années 1990, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est sont le théâtre de crises économiques inédites.
Après plusieurs années de croissance soutenue, de taux d’intérêt élevés et d’entrées de capitaux massives, la confiance envers le Mexique s’érode, courant 1994, à cause d’une dégradation du climat politique, avec des assassinats de personnalités politiques et le soulèvement populaire du Chiapas. L’emballement économique des années précédentes a également contraint le gouvernement mexicain, soucieux de compenser le creusement de son déficit commercial et de financer ses besoins courants, à émettre des bons du trésor à court terme, dont 80 % sont détenus par des non-résidents, ce qui l’expose au risque de change. Pour faire face à la fuite des capitaux et à la baisse de la devise nationale qui s’ensuit, il puise dans ses réserves de change, sans toutefois que cela suffise à restaurer la confiance des opérateurs de marché. Le 20 décembre 1994, moins d’un mois après sa prise de fonction, le président Ernesto Zedillo décide qu’il est temps de dévaluer le peso, à hauteur de 15 %. Mais cela ne fait que renforcer la panique des marchés et accélérer le rythme de sortie des capitaux : en quelques jours, les réserves de change fondent de 29 à 6 milliards de dollars, le peso dévisse de plus de 50 % et la bourse de Mexico s’écroule. Une réaction en chaîne commence dans toute l’Amérique latine, stoppée par un plan de sauvetage international de 50 milliards de dollars, dont 18 milliards alloués par le FMI, en janvier 1995. L’année 1995 sera terrible pour les Mexicains : le PIB par habitant chutera de près de 8 % et le taux de chômage sera multiplié par trois.
Cette première crise de liquidité est suivie, à partir de juillet 1997, par la crise thaïlandaise, de nature similaire. Alors classée parmi les « tigres », en compagnie de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines et du Vietnam, la Thaïlande vit un boom industriel. Surfant sur un taux de croissance moyen de près de 10 % depuis dix ans, elle attire des capitaux étrangers en grande quantité et a déréglementé ses marchés financiers afin de se conformer aux standards du FMI et de la Banque mondiale. Cependant, à partir du début de 1997, la bulle financière commence à se dégonfler, c’est la fin du « miracle asiatique » : le déficit de la balance des paiements, l’accroissement de l’endettement public à court terme, l’inflation et la surévaluation du baht affolent les spéculateurs, qui retirent massivement leurs capitaux. La banque centrale thaïlandaise injecte 23 milliards de dollars pour essayer de stopper l’hémorragie et le premier ministre Chavalit Yongchaiyudh se résout, le 2 juillet, à laisser flotter le baht par rapport au dollar.
Mais l’effet amplificateur des mouvements de capitaux joue à plein et, malgré l’expérience de la crise mexicaine, la communauté monétaire internationale, inspirée par les dogmes libéraux, tarde encore à réagir pour éviter la contagion. Incapable d’honorer de gros volumes de créances, le système bancaire connaît des faillites en chaîne et la crise se propage à une bonne partie de l’Asie, d’abord à l’Indonésie, à la Malaisie et aux Philippines puis, à l’automne, à la Corée du Sud, à Taiwan, à Hongkong et à Singapour, contraints à tour de rôle de déprécier leurs monnaies respectives. En quelques mois, 600 milliards de dollars sont détruits ; les cours boursiers et l’activité économique réelle dégringolent.
Le FMI débloque finalement 40 milliards pour soutenir le baht thaïlandais, le won coréen et la roupie indonésienne mais, cette fois-ci, la crise devient mondiale : le Brésil, l’Argentine et l’Inde sont eux aussi frappés par la panique des marchés ; durant l’été 2008, la Russie est en situation de cessation de paiement.
C’est dans ce contexte de crise financière globale et d’impuissance de la communauté internationale que le trésor américain, après avoir un temps penché pour une formule de type G10, crée le G22, à l’appel du président Bill Clinton. Le groupe est composé des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale de vingt-deux pays : ceux des membres du G8, de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la Corée du Sud, de Hongkong, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Mexique, de la Pologne, de Singapour et de la Thaïlande. Le G22, qui ne se réunira que deux fois, à Washington(7), en avril et en octobre 1998, aura eu le mérite d’amorcer le partenariat entre économies développées et émergentes, en mettant sur pied trois groupes de travail, consacrés respectivement à la transparence de l’information, au renforcement des systèmes financiers et des structures de marché, et aux partage des charges entre secteur public et secteur privé en cas de crise.
Début 1999, le G7 décide d’élargir significativement le périmètre des séminaires suivants en y intégrant les ministres et gouverneurs de banque centrale de onze pays supplémentaires – Arabie saoudite, Belgique, Chili, Côte d’Ivoire, Egypte, Espagne, Maroc, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie –, pour former le G33. Au cours de ses deux sessions, en mars 1999 puis à Washington en avril 1999, le G33 abordera notamment les sujets suivants :
– l’amélioration de la surveillance prudentielle des marchés financiers ;
– le renforcement des systèmes financiers nationaux ;
– les mesures susceptibles de mieux protéger les plus vulnérables.
Si cette initiative convient évidemment à des puissances moyennes rassurées de ne pas être mises sur la touche de la coopération économique internationale, le nombre des participants s’avère trop élevé pour garantir un dialogue informel, franc et efficace. Sous l’impulsion du Canada, soutenu par l’Allemagne – qui a présidé le sommet du G7 de Cologne de juin 1999 –, le G7 finances, le 25 septembre 1999, à Washington, décide donc de créer, à sa marge, un nouveau forum, le G20 : il sera donc d’une taille plus restreinte que le G33 et comparable à celle du G22, jugée optimale, mais privilégiera un dialogue sans exclusive et permanent plutôt que par groupes de travail thématiques et temporaires.
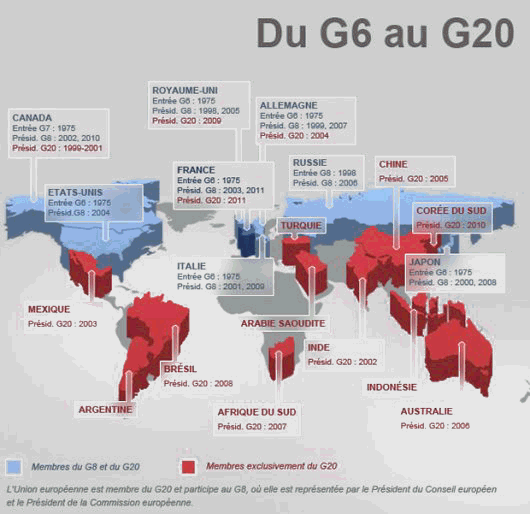
Source : Service d’information du gouvernement (SIG).
Le G20 sera constitué des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales de dix-neuf pays – ceux des membres du G8 et de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de
la Corée du Sud, de l’Inde, de l’Indonésie, du Mexique et de la Turquie(8) – plus la présidence tournante du Conseil européen, le président de la banque centrale européenne (BCE) et, ex officio, les représentants des institutions de Bretton Woods, à savoir le FMI, la Banque mondiale, le Comité du développement(9)et le Comité monétaire et financier international (CMFI)(10).
Sa réunion inaugurale se tient les 15 et 16 décembre 1999, à Berlin. Le communiqué final indique en particulier : « Le G20 a été mis sur pied afin d’établir un nouveau mécanisme de dialogue non formel dans le cadre du système des institutions de Bretton Woods, d’élargir les discussions sur les principaux enjeux économiques et financiers entre les économies importantes d’un point de vue institutionnel et de favoriser la collaboration en vue d’atteindre une croissance économique mondiale stable et durable, qui profite à tous ». Son but est donc de favoriser la stabilité financière internationale grâce au renforcement du dialogue entre pays industrialisés et pays émergents représentatifs des cinq continents, ce que le format du G7 ne permettait pas.
Mais le ministre des finances canadien, Paul Martin, désigné à Berlin président du G20 pour deux ans, trace immédiatement des perspectives plus ambitieuses, qui, douze ans plus tard, apparaissent assez visionnaires : « Le G20 orientera ses travaux sur les moyens de transposer les bénéfices de la mondialisation en revenus plus élevés et en possibilités accrues pour les populations de partout. […] Pratiquement tous les aspects majeurs de l’économie mondiale ou du système financier international seront de la compétence du groupe. »
Jusqu’à sa mutation de 2008, le G20 défrichera les thématiques suivantes, qui, de fait, concordent largement avec celles encore inscrites par le Président de la République à l’agenda de la présidence française de 2011 :
– la prévention et la résolution des crises ;
– les défis de la mondialisation ;
– la lutte contre le financement du terrorisme ;
– l’aide au développement ;
– la limitation des abus du système financier ;
– l’architecture institutionnelle du système financier ;
– la démographie ;
– l’intégration économique régionale ;
– la surveillance des politiques régionales ;
– la réforme des institutions de Bretton Woods ;
– les marchés de matières premières et leur impact économique ;
– la politique budgétaire.
La crise financière de 2008 a pour cause principale l’éclatement de la bulle immobilière américaine constituée autour des fameux subprimes. Ces prêts hypothécaires, à taux variable et ne nécessitant aucun apport initial, ont été souscrits par de très nombreux foyers américains aux revenus modestes ou moyens qui y voyaient une occasion unique de devenir propriétaires, dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas : à la veille de la crise, leur encours total atteignait pas moins de 600 milliards de dollars.
Mais, de 2004 à 2006, pour tenir compte de l’état de la croissance et de l’inflation, la Federal Reserve (Fed) porte son taux directeur de 1 % à plus de 5 %. Les mensualités de remboursement des subprimes vont donc augmenter subitement, provoquant la faillite de milliers de ménages incapables de faire face et la saisie de leurs biens immobiliers : aux Etats-Unis, en 2007, le taux des défauts de paiement atteint 15 %, un niveau record.
La crise se propage rapidement à l’ensemble du système bancaire et financier américain, par le canal des collateralized debt obligation (CDO), produits titrisés complexes adossés sur les subprimes(11). Chaque établissement prenant conscience que ses homologues détiennent des CDO dévalorisés, il s’ensuit une crise de défiance et le crédit interbancaire est complètement gelé : en juillet 2007, les banques refusent de se prêter les unes aux autres et les déposants, anticipant une faillite en chaîne, retirent leurs avoirs. L’établissement financier Bear Stearns, qui jouissait pourtant d’une excellente réputation de fiabilité dans le milieu bancaire et employait 14 000 salariés, paie cash son exposition aux subprimes : l’action perd 80 % de sa valeur et la banque est rachetée par JP Morgan Chase, avec le soutien de la Fed.
Mais la crise prend un caractère vraiment systémique en septembre-octobre 2008 : tous les marchés financiers s’écroulent et plusieurs établissements de premiers ordres font faillite, sont acquis sous la coercition ou mis sous tutelle gouvernementales, à commencer par Lehman Brothers – qui se déclare en faillite le 15 septembre, les autorités américaines ayant refusé de le renflouer –, Merrill Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac et le groupe d’assurance American International Group (AIG). Le FMI estimera la totalité des pertes des banques mondiales à 2 800 milliards de dollars sur la période 2007-2010, dont 1 000 milliards pour les établissements américains et 1 600 milliards pour les établissements européens. La nécessité de secourir le système bancaire, afin de ne pas mettre à terre l’ensemble de l’économie mondiale, provoque une détérioration des déficits budgétaires et un creusement des dettes publiques sans précédent.
Début 2008, le monde subit également une envolée surprise des prix du pétrole, le baril grimpant jusqu’à 147 dollars en juillet 2008, avant de rechuter, début 2009, à 35 dollars. Le prix à la pompe du gazole, carburant le plus vendu en France – il représente 78 % de la consommation – atteint un record historique le 30 mai 2008, à 1,4541 euros le litre. L’ampleur de ces évolutions – auxquels les pays industrialisés, eu égard à leur modèle énergétique, sont particulièrement exposés – prouve combien la spéculation joue un rôle important sur les tarifs des matières premières, même si le dynamisme de la demande en Chine et en Inde pèse lourdement.
L’impact en termes de pouvoir d’achat des consommateurs est direct, sur les factures de carburant et de chauffage, mais aussi indirect, sur les étiquettes des denrées alimentaires, pour lesquelles les produits pétroliers constituent un intrant.
En 2009, le PIB mondial recule pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, au point que l’on parlera de « grande récession », par référence à la Grande dépression des années 1930. Le FMI évalue la baisse globale à 0,6 % mais les pays développés paient le prix fort, avec un repli de 3 à 3,5 %. Les conséquences sont multiformes : diminution du volume du commerce international, contraction de l’offre de crédit, explosion des licenciements industriels, etc. Dans la seule UE, dont plusieurs Etats membres sont frappés par une violente crise de la dette publique, le taux de chômage gagne 4 points entre 2008 et 2010, s’établissant durablement au seuil des 10 %.
Avec le recul, la crise économique de la fin des années 2000 apparaît comme la conséquence de la combinaison de multiples facteurs :
– déséquilibres des balances des paiements ;
– tensions sur les prix des matières premières énergétiques et agricoles ;
– effets de levier excessif pratiqués par le système bancaire et financier ;
– explosion de la bulle spéculative immobilière américaine ;
– lacunes dans la régulation financière.
Elle consacre le « triomphe de la cupidité »(12) et impose aux dirigeants mondiaux de renforcer leur coordination pour tâcher d’éviter qu’un tel cataclysme ne se reproduise, éventuellement en pire.
Après 1999 et la naissance du G20 finances, les chefs d’Etat et de gouvernement ont continué de se réunir à sept, puis à huit, pendant près d’une décennie. Les puissances régionales incontournables que sont la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Brésil et le Mexique sont progressivement associées à la réflexion dès 1995 : leurs points de vue sont pris en compte par les sherpas du G8 et elles sont invitées aux sommets, mais au cas par cas, sur des grands débats comme celui consacré au climat, dans le cadre de ce que l’on appelle alors les « G8+5 ». Cependant, dans les années 2000, des voix se lèvent pour plaider en faveur d’un élargissement permanent du G8 – qui ne représente qu’un peu moins des deux tiers de l’économie mondiale en données brutes et seulement 13,5 % de la population terrestre – à des puissances régionales émergentes, à commencer par la Chine, l’Inde et le Brésil.
Car le monde est en train de subir trois modifications majeures :
– d’abord, les rapports de force ont considérablement évolué, la reprise à deux vitesses est une donnée structurelle, les pays en développement rattrapent progressivement leur retard ;
– ensuite, l’« effet papillon » n’a jamais été aussi puissant, l’interdépendance mondiale est telle que certains déséquilibres monétaires, financiers, agricoles ou énergétiques, c’est-à-dire sur des sujets vitaux, ne peuvent être résolus à trois – Etats-Unis, UE et Japon –, ni même à sept ou huit ;
– enfin, le système international est trop fragmenté, la multipolarité existe mais n’est pas organisée(13).
PIB en dollars de 1990 et en parité de pouvoir d’achat
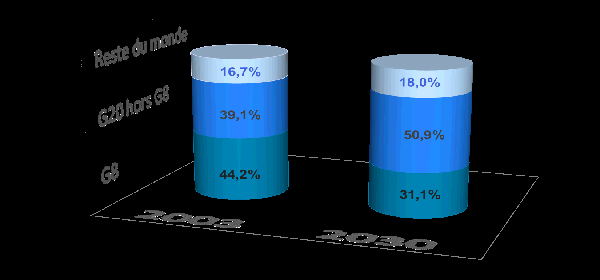
d’après Angus Maddison (2007).
Il faut par conséquent inventer une nouvelle gouvernance en dépassant les différences dans les habitudes de coopération. L’enjeu est d’organiser une compétition à armes égales et régulée.
Tout comme les crises continentales des années 1990 avaient conduit les grandes puissances mondiales à inventer un nouveau lieu de concertation et de réaction – le G20 finances –, la crise mondiale de la fin des années 2000, sans précédent depuis la Grande dépression consécutive au krach boursier de 1929, provoque une prise de conscience parmi les dirigeants du G8 : la gravité des questions économiques, monétaires et financières impose un traitement au plus haut niveau, celui des chefs d’Etat et de gouvernement, mais en élargissant le cercle à d’autres nations.
Dans l’esprit des présidents brésilien et français, Luiz Inacio Lula da Silva et Nicolas Sarkozy, il est tout d’abord question de convoquer un « G8+ », en n’intégrant que la Chine, l’Inde et le Brésil, dont l’on peut considérer que les économies nationales sont peu ou prou du même ordre de grandeur que celles du G8 – de fait, la Chine se situe aujourd’hui au deuxième rang mondial, tandis que le Brésil, classé septième, a dépassé l’Italie, la Russie et le Canada, et que l’Inde apparaît juste derrière, en onzième position. Dans le discours qu’il prononce devant la XVIe Conférence des ambassadeurs, le 27 août 2008, le Président de la République évoque « la transformation du G8 en G13 ou, mieux, en G14 », en pensant alors au Mexique, à l’Afrique du Sud et à l’Egypte.
Mais une évidence s’impose rapidement : l’exclusion de la plupart des puissances économiques moyennes serait incomprise, mal interprétée et augurerait mal de la possibilité, voire de la volonté, de créer une dynamique mondiale. Au final, comme en septembre 1999, c’est par conséquent la logique du G20 qui prévaut. Le président américain, George W. Bush, se fait l’avocat de cette formule, qui présente en outre l’avantage d’intégrer des alliés importants des Etats-Unis : l’Arabie Saoudite, l’Australie, la Corée du Sud et la Turquie.
Mettant à profit la présidence tournante de l’UE que la France exerce au second semestre 2008, le Président Sarkozy entraîne des chefs de gouvernement des trois autres Etats européens majeurs, en particulier du premier ministre britannique Gordon Brown, pour en faire une urgence de l’agenda international. Il s’assure aussi de l’adhésion du Canada lors du sommet de la francophonie de Québec, du 17 au 19 octobre.
Il est finalement décidé, en coordination avec M. Bush, d’organiser le premier grand sommet mondial des chefs d’Etat et de gouvernement en novembre 2008, sous l’étiquette du G20, à Washington, dans l’optique de créer une instance de pilotage économique au plus haut niveau. Outre les Etats participant déjà aux G20 finances, sont conviés le secrétaire général des Nations unies, le directeur général du FMI, le président de la Banque mondiale, le président de la Commission européenne et le président du Forum de stabilité financière (FSF).
Le G20 n’est donc pas une extension concentrique du G8 mais le fruit d’une révolution conceptuelle prenant acte des faits. Les diagrammes circulaires ci-contre, élaborés à partir des indicateurs de développement du monde de la Banque mondiale et des projections du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), rendent compte de l’ampleur du resserrement de la part des vieilles puissances industrielles dans la croissance mondiale et, symétriquement, de l’ampleur du développement des émergents(14).
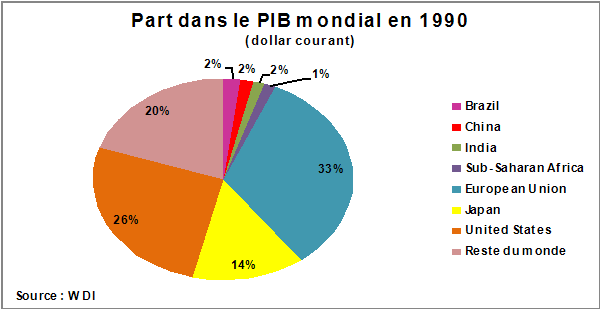
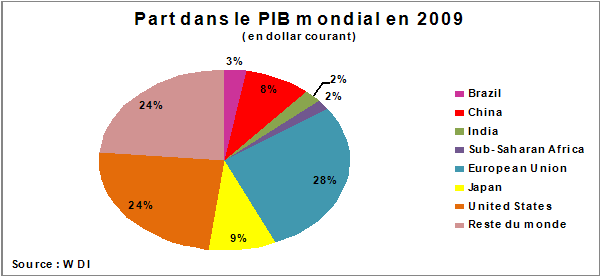
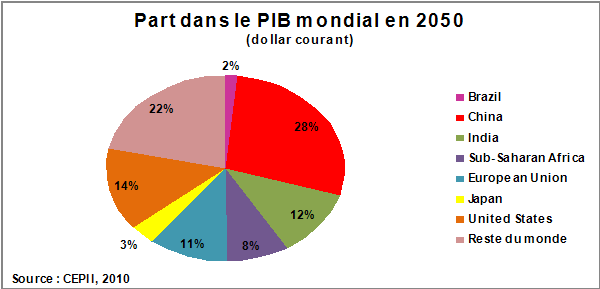
Source : ministère des affaires étrangères et européennes.
En plus du G8 et du G20, qui jouissent aujourd’hui d’une reconnaissance universelle et d’une capacité à entraîner le monde, il existe une galaxie d’autres « G », au poids et à l’effectivité plus ou moins affirmés mais qui constituent une sorte de matrice du monde multipolaire en construction. Précisons que la typologie des « G » se limite aux regroupements transcontinentaux, à l’exclusion des communautés géographiques du type UE, motivées par des objectifs de libre-échange et de coopération régionale.
a) Les puissances moyennes : le 3G (Global Governance Group)(15)
Les pays petits ou moyens, refusant d’être « mis sur la touche » par le G20, souhaitent être associés aux travaux du G20. Conscients de leur incapacité à exister sur la scène internationale s’ils restent isolés, plusieurs d’entre eux s’efforcent de se coordonner, à travers le 3G. Bien qu’il compte aujourd’hui vingt-huit membres(16), il est aussi parfois appelé G27.
Créé en marge du 39e Forum économique mondial de Davos, en janvier 2009, sous la houlette de Singapour – ex-membre du G22 et du G33 qui aspire à rester dans le jeu –, ce petit groupe de pression est considéré, au départ, comme une sorte de syndicat des paradis fiscaux. Mais il se diversifie rapidement, s’étendant aux cinq continents, notamment à des pays à revenus intermédiaires habituellement modérés sur la scène internationale, affirmant sa volonté d’être dépositaire de l’esprit onusien.
Le ministre des affaires étrangères singapourien George Yeo a ainsi expliqué : « Nous participons au processus du 3G afin d’aider le G20 à assumer une meilleure légitimité dans la communauté globale des nations. Il convient d’améliorer l’interaction du G20 avec l’adhésion aux Nations unies, qui à leur tour pourraient mieux soutenir les actions du G20. Il est important que les décisions du G20 prennent en considération les intérêts d’autres pays et que ceux-ci les soutiennent. Le processus du G20 devrait renforcer les Nations unies et les autres organisations internationales, pas les affaiblir »(17).
Les ressorts de cette initiative sont très pragmatiques : quoi que les membres du 3G n’incarnent pas une légitimité politique ou économique évidente, quoi qu’ils présentent de profondes disparités de cultures et d’intérêts, le fait même qu’ils soient parvenus à structurer un lobby transcontinental leur confère une tribune et même un strapontin dans les négociations mondiales, puisque Singapour, pour la seconde fois consécutive, après celui de Séoul, a obtenu le privilège d’être invité au sommet de Cannes.
Pour donner gage de sa volonté de ne pas faire du G20 le cénacle fermé des grandes puissances, la France a en effet décidé de jouer le jeu et d’associer au mieux le 3G, en particulier Singapour, durant toute son année de présidence. Un effort spécifique a été accompli aux Nations unies, que le 3G souhaite privilégier comme enceinte principale des négociations internationales : à chaque fois qu’un ministre français s’est déplacé à New York pour prononcer devant l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) une intervention sur les priorités de la présidence G20 relevant de son portefeuille, il a pris soin de rencontrer la représentation permanente singapourienne.
b) Les grands émergents : les BRICS(18) (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
Le concept de BRIC est une invention des analystes de Goldman Sachs, qui, en 2001, identifient le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine comme les quatre grands pays recélant les plus fortes potentialités de croissance. La banque d’affaire, à l’époque, prévoit qu’ils représenteront 10 % de la production globale à la fin de la décennie 2010 – en réalité, la barre des 20 % est déjà proche –, que leur PIB consolidé équivaudra à celui du G6 à l’horizon 2040 et que chacun d’entre eux sera une puissance économique d’une dimension comparable à celle des Etats-Unis, du Japon ou de l’Allemagne en 2050. Elle estime aussi que ces quatre pays, qui cumulent 42 % de la population mondiale et 30 % de la surface émergée du globe, ont opéré avec succès des transformations structurelles créant des conditions de marché attractives et que leur spécialisation dans la production de biens et de services destinés à l’exportation favorisera la croissance, l’emploi et l’accumulation de réserves de change.
Il faut attendre le 16 juin 2009 pour que le groupe prenne réellement forme, lors du sommet quadripartite d’Ekaterinbourg, à l’issue duquel ses membres appellent à « un nouvel ordre mondial équitable, démocratique et multipolaire ». C’est paradoxalement la Russie qui en est l’instigatrice, alors que ce pays, à plusieurs égards – croissance économique, maîtrise de l’inflation, dynamisme démographie, influence politique, culturelle et diplomatique –, prend plutôt l’ascenseur dans le sens inverse de ses quatre partenaires émergents. La Russie est cependant le seul des cinq membres à faire également partie du G8. Pour ses dirigeants, Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, il s’agissait certes d’ouvrir une concertation mais au moins autant de communiquer vers les autres membres du G20 et surtout du G8, afin de montrer que la Russie, ancien protagoniste de premier plan de la guerre froide, reste une puissance susceptible de rassembler et de mobiliser autour d’elle.
Mais le regroupement des BRIC est aussi sous-tendu par une véritable philosophie du développement et apparaît, de ce fait, comme un légataire du mouvement des non-alignés. Les grands émergents, constatant que les pays développés ont pu concevoir leurs modèles économiques et bâtir leurs structures productives et sociales tranquillement, sur plusieurs décennies, voire sur plusieurs siècles, sans pression extérieure – y compris en exploitant les ressources humaines et naturelles du tiers-monde durant l’ère coloniale –, revendiquent eux aussi de bénéficier d’un temps d’adaptation pour amener leurs peuples à la prospérité, c’est-à-dire, en pratique, d’être exonérés de certaines contraintes démocratiques, sociales et environnementales répondant aux critères occidentaux. Ce raisonnement est en particulier développé à propos du socle universel de protection sociale(19) ou du changement climatique : les émergents considèrent notamment que les contribution nationales d’émissions de gaz à effet de serre ne devraient pas être mesurées en flux de l’année écoulée, mais en stock depuis le début de la révolution industrielle.
Lors de leur troisième sommet, organisé le 14 avril 2011 sur l’île d’Hainan, en Chine, les BRIC, avec l’adhésion officielle de l’Afrique du Sud, se transforment en BRICS. Un pas important a alors été franchi vers un regain de coopération, les participants s’efforçant de taire leurs différences pour mieux souligner leurs points communs et leurs convergences, à commencer par leur appartenance commune au groupe des pays en voie de développement, qu’ils revendiquent. Le président chinois Hu Jintao a ainsi déclaré que « le plus grand déséquilibre de l’économie mondiale est le développement inégal entre le Nord et le Sud, et [que] le problème fondamental est l’insuffisance du développement des pays en voie de développement ».
D’abord, le sommet a été l’occasion d’aborder des thématiques très variées, correspondant aux préoccupations actuelles des cinq Etats membres, dans le champ économique mais aussi politique :
– volonté de se coordonner au sein du G20 comme dans les négociations sur le changement climatique et sur les autres sujets multilatéraux ;
– revendication d’une distribution plus équitable des richesses mondiales ;
– affirmation de la nécessité d’une réforme de l’ONU et de son Conseil de sécurité pour renforcer leur légitimité ;
– demande d’une réforme du système monétaire international et d’une révision de la composition des droits de tirage spéciaux (DTS) ;
– développement soutien appuyé à la Russie, de la part de ses quatre partenaires, pour demander que son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) soit entérinée dès 2011 ;
– constitution d’un groupe de liaison, en vue d’étendre la coopération entre les BRICS ainsi qu’avec les autres pays du Sud.
Cinq mois plus tard, le 22 septembre 2011, en marge d’une réunion du FMI, sous l’impulsion du ministre des finances brésilien Guido Mantega, les BRICS examinaient l’opportunité de d’organiser une initiative conjointe pour contribuer à la stabilisation des marchés européens, par un accroissement de leurs réserves monétaires libellées en euros.
Même si la Corée du Sud, le Mexique ou la Turquie jouent d’ores et déjà un rôle significatif dans les relations économiques internationales et ne peuvent plus être considérés comme des pays en voie de développement, il est peu probable qu’ils rejoignent les BRICS. En effet, la dimension économique n’est pas la seule à entrer en ligne de compte ; il ne faut pas négliger les motivations politiques de ce regroupement, cimenté par la contestation de la prééminence des puissances occidentales et l’opposition systématique de ses membres à toute ingérence de la communauté internationale pour régler les conflits intérieurs. Des pays peu séduits par le tiers-mondisme et proches des Etats-Unis feraient probablement perdre aux BRICS leur capacité à prendre des positions clivantes et donc à exister face au grandes puissances développées(20).
Les BRICS procèdent donc d’un concept de puissance à l’horizon 2050 dont les intéressés commencent à mesurer la portée : ils représentent 42 % de la population de la planète, 18 % du PIB mondial et leurs échanges commerciaux sont en plein boom. L’intégration du regroupement se heurtera cependant à son hétérogénéité : en dépit de leur préoccupation commune pour la croissance, leurs intérêts divergent fondamentalement sur les questions commerciales ou monétaires et ils ne disposent pas de mécanismes de médiation internes durs pour prendre des positions gagnant-gagnant et peser vis-à-vis du reste du monde à des moments clés, d’où leur échec dans la conquête de la fonction de directeur général du FMI, en juillet 2011(21). En outre, la Chine étant désormais le principal partenaire commercial de ses quatre partenaires, ceux-ci se méfient de sa position dominante.
L’exemple des relations entre le Brésil et la Chine est édifiant. Le premier doit ainsi faire face à la réévaluation du real par rapport au dollar quand la seconde profite du niveau maintenu artificiellement bas du yuan pour accumuler des réserves de change. Même si la Chine est devenue son premier partenaire commercial non seulement côté importations mais aussi côté exportations, le Brésil se plaint de la mauvaise qualité des investissements de son partenaire et d’échanges bilatéraux structurellement déséquilibrés, avec essentiellement des matières premières minérales et agricoles dans un sens, des produits manufacturés dans l’autre. Dans un autre registre, compte tenu de son équation régionale compliquée avec le Japon et l’Inde – autre BRICS –, qui en réclament également un, la Chine refuse de soutenir la création d’un siège supplémentaire au Conseil de sécurité des Nations unies au profit du Brésil.
La Chine et la Russie, qui possèdent des frontières communes et ont un lourd passé de rivalité régionale et idéologique, ne sont pas non plus exemptes d’arrière-pensées stratégiques. L’agenda des BRICS en porte d’ailleurs la marque.
Créé le 6 juin 2003 à Brasilia par les ministres des affaires étrangères Celso Amorim, Nkosazana Dlamini Zuma et Yashwant Sinha, IBSA est un « forum de dialogue » réunissant les trois autres BRICS. Il est complètement négligé par le reste du monde, voire méconnu – ses propres membres rechignent du reste à trop communiquer à son sujet, craignant manifestement de le faire apparaître comme une coalition interne au G20 –, mais sa stabilité, son fonctionnement et ses résultats sont riches d’enseignements pour comprendre la façon dont s’organisent aujourd’hui les relations multilatérales et adressent un message politique fort au reste du monde.

Il réunit les principaux pays démocratiques en voie de développement de chaque continent du Sud, qui présentent aussi la caractéristique commune d’être des pays multiethniques et multiculturels. Son objectif est de contribuer à la construction d’une nouvelle architecture internationale en parlant d’une seule voix sur les questions globales et en s’efforçant de dépasser leur statut de puissances moyennes afin de jouer un rôle de chef de file du Sud, en contrepoids du G8 et en contrepoint du G20.
Structure ouverte et flexible, dépourvue de siège social et de secrétariat exécutif permanent, IBSA a toutefois donné naissance à de multiples mécanismes de coordination.
Outre les sommets annuels des chefs d’Etat et de gouvernement, dont la dernière édition s’est tenue le 15 avril 2010 à Brasilia, les ministres des affaires étrangères des trois pays membres se réunissent une fois par an pour présider les commissions thématiques communes. Ces deux types de réunions donnent lieu à des déclarations communes, tout comme certains dossiers débattus en marge de l’AGNU ou d’autres organisations internationales, afin de donner du poids à des positions d’intérêt mutuel.
Une coopération multisectorielle active est conduite à travers seize groupes de travail, couvrant tout le champ des politiques publiques :
– administration publique ;
– administration fiscale ;
– agriculture ;
– habitat ;
– science et technologie ;
– commerce et investissements ;
– culture ;
– défense ;
– société de l’information ;
– développement social ;
– éducation ;
– énergie,
– environnement et changement climatique ;
– santé ;
– transport ;
– tourisme.
A ce jour, douze protocoles sectoriels tripartites couronnant le travail de ces groupes thématiques ont été signés et cinq sont en cours de ratification.
Un fonds pour l’allégement de la pauvreté et de la faim a également été constitué, avec l’ambition de diffuser dans les autres pays en développement de bonnes pratiques pour contribuer aux Objectifs du millénaire pour le développement. Abondé chaque année d’1 million de dollars par chacun des trois membres, il a permis de financer trois programmes, portant sur la collecte des ordures ménagères en Haïti, l’amélioration des techniques agricoles en Guinée Bissau et la santé au Cap-Vert.
Et les initiatives s’étendent au-delà des prérogatives gouvernementales, avec des échanges entre parlementaires, des événements culturels, des séminaires sur la justice constitutionnelle ou encore des rencontres entre acteurs de la société civile – partenaires sociaux, hommes d’affaires, femmes, milieu éducatif, etc. –, ce qui renforce les liens entre les trois Etats membres.
Cette organisation, qui passe presque inaperçue, est pourtant bien rodée : les IBSA préparent désormais de concert tous les sommets du G20 et les séances plénières de l’AGNU.
En janvier 2009, à l’occasion du trentième anniversaire des relations diplomatiques sino-américaines, le diplomate américain Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, promeut l’idée d’un rapprochement stratégique entre la première puissance mondiale et le principal pays émergent. Alors que le G20 balbutiait encore – ses chefs d’Etat et de gouvernement ne s’étaient encore réunis qu’une fois –, la proposition consistait à nouer une relation trans-pacifique bilatérale privilégiée pour éviter des négociations multilatérales compliquées et marginaliser l’UE, incarnation supposée du vieux monde déclinant.
Au sommet du G20 de Londres, en avril, Barack Obama invite les dirigeants chinois à un « dialogue stratégique et économique », qui se tient les 27 et 28 juillet 2009 à Washington, avec une délégation de 150 officiels chinois, conduite par le conseiller d’Etat Dai Bingguo et le vice-premier ministre Wang Qishan. Le président américain déclare franchement que « la relation entre les États-Unis et la Chine va façonner le XXIe siècle ». Il est vrai que ces deux pays ont des intérêts croisés – la Chine finance le déficit public américain grâce à ses réserves de change, constituées pour l’essentiel en dollars, ce qui la rend vulnérable à la conjoncture américaine.
Le rêve d’une « Chinamérique » correspond à une vision bipolaire du monde. Pendant les quarante-cinq années de la Guerre froide, l’impossibilité d’un dialogue entre les Etats-Unis et l’Union soviétique a soumis le monde à un régime d’équilibre de la terreur. Aujourd’hui, le leader occidental naturel et la puissance émergente la plus dynamique arrivent à se parler. Alors pourquoi ne se partageraient-elles pas la conduite de l’économie mondiale ?
Ce dessein se heurte cependant à un obstacle dirimant : la Chine refuse de se laisser enfermer dans cette relation à deux, qui lui semble déséquilibrée, les Etats-Unis lui étant encore supérieurs, et contre-nature, dans la mesure où elle se voit encore comme appartenant à la catégorie des pays en voie de développement. Elle se méfie aussi de la trop grande insistance des Etats-Unis, manifestement animés par la volonté de contenir la montée en puissance chinoise. Les Chinois tiennent beaucoup au multilatéralisme et privilégient délibérément un investissement au sein du groupe des BRICS et plus globalement dans le G20.
Dans un entretien à La Tribune du 15 février 2011(22), l’historien britannique Niall Ferguson va même jusqu’à prédire la fin du partenariat sino-américain entamé en 1972 et emblématique de la fin de la Guerre froide, le jugeant en pleine « désagrégation ».
Du reste, les Etats-Unis reviennent de l’idée qu’ils doivent faire de la Chine leur partenaire privilégié : le sommet de Séoul l’a démontré, ils ont intérêt à nouer un tissu d’alliances avec d’autres partenaires plus proches d’eux culturellement et/ou géographiquement, comme le Brésil – M. Geithner s’est rendu à Brasilia, en février, pour évoquer les problèmes monétaires et la question des matières premières –, sans oublier l’Europe, avec laquelle le maintien d’une bonne entente leur est indispensable pour éviter l’isolement diplomatique.
L’idée de G2 apparaît finalement si irréaliste que le président vénézuélien Hugo Chavez la tournera en ridicule, dans une énième provocation aux grandes puissances, pour caractériser les relations bilatérales entre son pays et l’Iran. Le G20 ayant acquis une légitimité incontestée auprès de l’ensemble de ses membres, l’option du G2 comme directoire des affaires mondiales, encore évoquée lors du sommet de Séoul, ne semble maintenant plus du tout à l’ordre du jour. Il est aujourd’hui évident pour tous que la régulation de l’économie mondiale passe par le multilatéralisme.
Afin d’illustrer l’absence de leadership mondial et la difficulté que rencontrent les Etats pour s’entendre dans les cénacles internationaux, en particulier au G20, des commentateurs usent régulièrement de l’expression « G0 ». Celle-ci tend à accréditer l’idée que les Etats, plutôt que d’ambitionner l’adoption de stratégies gagnant-gagnant et la construction d’un avenir ambitieux, se contentent d’un jeu à somme nulle qui préserve l’essentiel de leurs intérêts particuliers. Ainsi, d’après le professeur d’économie américain Nouriel Roubini, spécialiste des crises, « le G20 s’est transformé en un forum bureaucratique de plus où l’on discute beaucoup sans s’entendre sur grand-chose »(23).
Si le jugement peut paraître excessif, voire peu objectif eu égard aux dynamiques de régulation impulsées par les premiers sommets et à l’agenda fixé par la France pour 2011, en phase avec les grands enjeux actuels, ses Etats membres doivent effectivement veiller à ne pas tomber dans le travers du « G0 », c’est-à-dire du consensus mou et des déclarations d’intention.
La volonté de fonctionner en groupes transcontinentaux n’est certes pas une nouveauté, elle est inhérente au concept même des Nations unies. Plusieurs groupes, qualifiés eux aussi de « G », interviennent dans la sphère des Nations unies, mais leur fonctionnement ne relève pas de la diplomatie de club et suit une logique différente de celle du G20. Il n’est cependant pas inutile de les évoquer car ils interagissent de plus en plus avec lui.
Les Nations unies elles-mêmes sont parfois qualifiées de « G193 ». L’expression signifie que l’ONU, avec son Assemblée générale et ses institutions spécialisées, compte tenu du nombre de ses membres, possède la principale légitimité internationale. En creux, ce nombre sonne aussi comme l’explication de l’impuissance de la machine onusienne à régler certains problèmes, qui requièrent la prise de responsabilité de chefs de file mondiaux possédant le poids économique et les ressources financières nécessaires pour agir efficacement sur les marchés.
Le G77 est une coalition conçue pour promouvoir les intérêts économiques collectifs du Sud(24) et accroître leur capacité de négociation aux Nations unies. En novembre 1963, lors de la 18e session de l’AGNU, les pays non alignés, dans une déclaration commune, préconisent une série de mesures à prendre en considération afin de parvenir à un accord sur la politique commerciale et le développement international. Le G77 émerge officiellement le 15 juin 1964, à Genève, en conclusion de la première Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), dont soixante-dix-sept pays signent la déclaration finale.
Le groupe compte aujourd’hui 131 membres – soit plus des deux tiers des Etats membres des Nations unies –, localisés en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Océanie et dans le Pacifique, et même en Europe, avec la Bosnie-Herzégovine. La présidence, tournante, échoie alternativement à un pays africain, asiatique et latino-américain ou caribéen ; en 2011, elle est assumée par l’Argentine, également membre du G20, ce qui illustre parfaitement l’imbrication entre les « G », dès lors que le G20 a vocation à rassembler des puissances hétérogènes.
L’organe décisionnel suprême du G77 est le sommet du Sud, dont les deux premières éditions se sont tenues à La Havane du 10 au 14 avril 2000 et à Doha du 12 au 16 juin 2005. Les ministres des affaires étrangères se réunissent aussi à New York au début de chaque session régulière de l’AGNU. Des réunions ministérielles sectorielles sont organisées périodiquement, par exemple pour préparer les sessions de la CNUCED ou les conférences générales de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Le G24(25), émanation du G77, a été institué en 1971 pour coordonner la position des pays en développement sur les questions ayant trait au système monétaire et financier international et pour faire valoir leurs intérêts dans les négociations monétaires internationales.

Même si le G24 figure expressément dans la boucle de gouvernance du FMI – au même titre que le G20 et le G7, il « conseille de façon informelle » le conseil des gouverneurs, le conseil d’administration et le directeur général –, force est de constater que ni le G77 ni le G24, dont quelques-uns des membres les plus influents siègent désormais au G20, ne joue de rôle déterminant dans le règlement des problèmes économiques et financiers mondiaux. Cette tâche incombe désormais clairement au G20 et au G7, qui, pour mener leur mission à bien, doivent toutefois prendre en considération l’ensemble des problématiques internationales.
II. LE G20, UN CONTRAT INTERNATIONAL IMPLICITE
Le G20 étant une structure souple, ses contours ne sont pas immuables. C’est ainsi que les champs thématiques sur lesquels il intervient ne cessent de s’élargir depuis sa création. Sa composition et son organisation à trois niveaux – chefs d’Etat et de gouvernement, sherpas et filières ministérielles – semblent en revanche consolidées, car la stabilité dans le temps de l’équilibre qui a été trouvé permet d’asseoir la confiance réciproque entre tous les Etats membres.
Le G20 est un produit de l’histoire. A chacun des grands chocs économiques qui ont secoué le monde depuis la fin des Trente Glorieuses – 1973, fin des années 1990, 2008-2009 –, les principaux pays industrialisés ont pris conscience que les problèmes du moment étaient trop graves pour être résolus par des mesures nationales et qu’une coordination s’imposait pour ne pas mettre durablement en cause la croissance et la stabilité mondiales.
Il est en réalité à la croisée de deux logiques : l’élargissement du périmètre des « grands pays » et l’attribution d’une compétence très étendue à une entité originellement pensée comme un cénacle « économico-économique ».
Premier aspect, le passage du G8 au G20 a pris acte, d’une part, de la montée du multilatéralisme consécutive à la fin du partage du monde entre deux blocs antagonistes et, d’autre part, de l’essor, sur tous les continents, de puissances émergentes inévitables pour mener des négociations internationales faisant sens.
Deuxième aspect, le format chefs d’Etat et de gouvernement n’a que trois ans puisque le premier sommet au plus haut niveau s’est tenu en novembre 2008, avec la volonté affichée de donner un poids politique aux consensus trouvés, afin qu’ils ne restent pas lettre morte.
Le G20 suit donc un processus empirique et évolutif. Ce n’est pas une organisation internationale investie d’un pouvoir normatif contraignant, appuyée par une administration pour le faire respecter et obéissant à des règles de fonctionnement intangibles, mais un forum de dialogue traçant des pistes de réformes et édictant des recommandations aux pouvoirs publics nationaux et aux organisations internationales.
Cela dit, si ses orientations ne sont pas liantes juridiquement, elles le sont politiquement, dans la mesure où les sommets se concluent systématiquement par une déclaration finale commune agréée par consensus, bénéficiant du statut de la parole donnée et faisant l’objet d’un large écho international, surtout depuis 2008.
L’ambition du G20 est de façonner l’agenda international, mais en apportant des réponses pragmatiques et en conservant une structure légère échappant à la bureaucratisation. Son fonctionnement n’est donc régi par aucun traité, accord ou règlement écrit. Il s’est néanmoins rapidement formalisé, en suivant des règles, des pratiques et une terminologie non écrites, héritées dans une large mesure du G20 finances et des sommets du G8.
Lors du sommet, point d’aboutissement d’une présidence au cours duquel les différends se dénouent, les dix-neuf pays membres et l’UE disposent d’une voix chacun et parlent d’égal à égal avec leurs pairs. Pour fluidifier les débats, il est d’usage que les participants s’expriment spontanément et en interaction, sans lire de textes rédigés à l’avance. Cette pratique est totalement intégrée par les dirigeants des pays du G8 mais ceux des pays émergents ont parfois encore tendance à reproduire les usages beaucoup plus formels en cours dans les instances des Nations unies.
Les décisions sont systématiquement prises par consensus, lorsque les chefs d’Etat et de gouvernement, mais aussi les organisations internationales impliquées – notamment le FMI pour ce qui concerne les questions monétaires –, parviennent à un constat partagé. Cette règle ralentit considérablement le rythme auquel le G20 peut engranger les acquis mais elle est essentielle pour garantir le respect de la souveraineté d’Etats qui ne sont nullement engagés dans un processus d’intégration. En pratique, il s’agit de créer un climat de confiance entre protagonistes et de ne pas donner prise à des stratégies de constitution de majorités, qui iraient à l’encontre même de l’esprit du G20 et risqueraient de pousser les Etats exclus à remettre en cause l’ensemble du dispositif.
Alors que les présidences, jusqu’à présent, s’achevaient à l’issue du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, leur durée sera calquée, à partir de cette année, sur le calendrier civil, à l’instar de la présidence du G8. La présidence française, qui a commencé le 12 novembre 2010, durera par conséquent jusqu’au 31 décembre 2011.
En France, où les relations internationales relèvent du « domaine réservé » du Président de la République, ses services sont évidemment au cœur du dispositif. En période de cohabitation, il a toutefois dû composer avec les priorités gouvernementales pour que la France parle d’une seule voix au G8 et accorder une place au premier ministre dans les négociations, mais sans bousculer l’ordre protocolaire : le Président de la République participait seul au dîner inaugural, après quoi le premier ministre se joignait aux discussions. Nos partenaires, conscients de cette spécificité institutionnelle française – lorsque la tête de l’exécutif, pourtant détentrice des prérogatives régaliennes majeures dans le champ international, perd la majorité parlementaire et est contrainte de nommer un opposant au poste de premier ministre –, ont accepté cette dérogation au principe « un pays, une chaise », mais le poids de la France dans les discussions dépend du degré de tension qui règne à cet instant au sommet de l’exécutif. La même logique s’appliquerait pour le G20, dans l’avenir, en cas de nouvelle cohabitation.
Jusqu’à la présidence française, le sommet était le seul échelon de négociation qui produise des orientations, formalisées et actées dans un texte écrit, mais celles-ci n’en étaient pas moins soigneusement préparées, évaluées et négociées durant les mois qui précédaient. Cette phase de préparation a pris une nouvelle dimension cette année. En effet, la réunion des ministres de l’agriculture des 22 et 23 juin 2011 s’est exceptionnellement conclue par la publication d’une « déclaration ministérielle », énumérant des recommandations d’un niveau de précision comparable à celui des déclarations des sommets.
Les sommets sont préparés selon une méthode de travail aujourd’hui bien huilée, assimilée par les administrations nationales :
– faire un constat partagé, y compris avec les organisations internationales, notamment en passant par l’organisation de séminaires thématiques, comme celui qui s’est tenu à Nankin sur le thème du système monétaire international, le 31 mars 2011 ;
– procéder à des échanges d’idées dans des groupes de travail et élaborer des pistes de recommandations ;
– faire émerger, à l’échelon politique des sherpas, des idées susceptibles d’être adoptées par les sommets.
Le portage politique de la stratégie de chaque chef d’Etat ou de gouvernement et la tâche de faire émerger des idées susceptibles d’être adoptées au sommet sont en effet confiés à un sherpa. Quand certains pays font le choix d’un sherpa unique pour le G20 et le G8, le Président Nicolas Sarkozy a désigné un sherpa pour chacun des deux exercices : le secrétaire général de l’Elysée Xavier Musca pour le G20, le conseiller diplomatique Jean-David Levitte pour le G8.
Les sherpas se réunissent généralement tous les trimestres. Pour le G20 sous présidence française, ils se seront rencontrés quatre fois : les 25 et 26 janvier, les 28 et 29 avril, les 21 et 22 juillet, et les 29 et 30 septembre 2011. Ils doivent enfin se retrouver dès la veille de l’ouverture du sommet, à Cannes, le 2 novembre 2011.
Parallèlement au travail des sherpas et sous leur coordination, les négociations s’organisent par filières ministérielles, qui abordent les dossiers sur le plan technique et émettent des recommandations. Avant 2011, il n’y en avait qu’une : la filière finances. Mais, avec l’élargissement du champ de réflexion du G20, la présidence française en a fait germer trois autres : les filières agriculture, travail et développement(26), sur lesquelles nous reviendrons.
Les réunions ministérielles de la filière finances rassemblent les ministres des finances et les gouverneurs de banque centrale des dix-neuf pays membres, plus le commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, le ministre des finances du pays exerçant la présidence tournante de l’Union européenne et le gouverneur de la Banque centrale européenne. En 2011, cette instance s’est déjà réunie trois fois : les 18 et 19 février à Bercy, le 15 avril à Washington – à l’occasion des assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale, et le 22 septembre de nouveau à Washington. Une dernière session aura lieu des 13 et 15 octobre, à la veille du sommet de Cannes, à Bercy.
La préparation de ces réunions est assurée par les suppléants(27), à savoir les directeurs du trésor et les vice-gouverneurs de banque centrale, qui se retrouvent plusieurs fois au cours de l’année, notamment avant les réunions ministérielles. Eux-mêmes sont assistés d’adjoints, issus de leurs administrations respectives(28). Cette année, une équipe ad hoc G20 a été constituée au sein de la direction générale du trésor. Eu égard à la sensibilité des sujets traités, le cabinet du ministre des finances s’intéresse aussi de près à la question.
Au niveau inférieur, des groupes de travail de fonctionnaires sont formés sur tous les sujets du moment puis dissous une fois leur mission accomplie – ce qui constitue une exception dans les relations internationales. Si le dossier n’est pas clos au terme d’une présidence, le groupe de travail est toutefois perpétué sous la présidence suivante. Ces groupes peuvent être décomposés en sous-groupes, selon la complexité des sujets traités.
Notons que les services du FMI et de la Banque mondiale sont associés aux travaux de la filière finances, à tous les niveaux.
(1) Priorité à l’économie(29)
La sélection des Etats membres du G20 n’a pas été opérée sur la base de critères codifiés mais plusieurs considérations plus ou moins objectives ont été retenues. D’abord, n’appartiennent au cénacle que des pays contribuant de manière significative à l’économie mondiale, vue sous l’angle de la production de biens et de services et sous celui des échanges commerciaux. Ensuite, a prévalu un souci d’équilibre relatif, d’une part entre grandes aires géographiques et culturelles – notamment en tenant compte des structures de coopération économique régionales –, d’autre part entre pays développés et émergents.
Le G20 regroupe : dix pays industrialisés développés, ceux du G8, Russie incluse, plus l’Australie et la Corée du Sud ; cinq pays émergents, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, la Chine et l’Inde ; trois pays ateliers, le Mexique, l’Indonésie et la Turquie ; un pays producteur de pétrole, l’Arabie saoudite. Il convient d’adjoindre à ce groupe l’UE, qui, avec un PIB de 16 282 milliards de dollars, devance les Etats-Unis comme première puissance économique mondiale. Si cette classification est trop schématique et réductrice pour rendre fidèlement compte des réalités économiques – les performances économiques de la Turquie, par exemple, en font un émergent de poids –, elle traduit la diversité et la représentativité du G20.
Si l’on se réfère aux PIB nominaux, les dix-neuf Etats membres font tous partie des vingt-huit économies les plus riches mais ni l’Espagne, douzième, ni les Pays-Bas, seizième, ni la Suisse, dix-neuvième, n’en font partie – les deux premiers étant toutefois représentés à travers l’UE, sans compter que l’Espagne jouit du statut d’invité permanent. Les pays du G20 concentrent près de 85 % du produit mondial brut – environ 58 000 milliards de dollars sur 70 000 milliards – et 80 % du commerce mondial.
Le G20 n’est nullement le club des peuples les plus nantis, l’examen des PIB nominaux par habitant le montre. Le premier des Vingt est l’Australie, en septième position, avec 55 590 dollars par habitant et par an ; le dernier est l’Inde, en 138e position, avec 1 265 dollars ; le dixième est l’Arabie Saoudite, en trente-neuvième position, avec 16 996 dollars. Ces chiffres ne tenant pas compte des différences de coût de la vie et fluctuant en fonction des taux de change avec le dollar, ils doivent être relativisés, mais ils rendent compte d’une réalité : le G20 est bien le reflet de la diversité et des déséquilibres économiques du monde actuel.
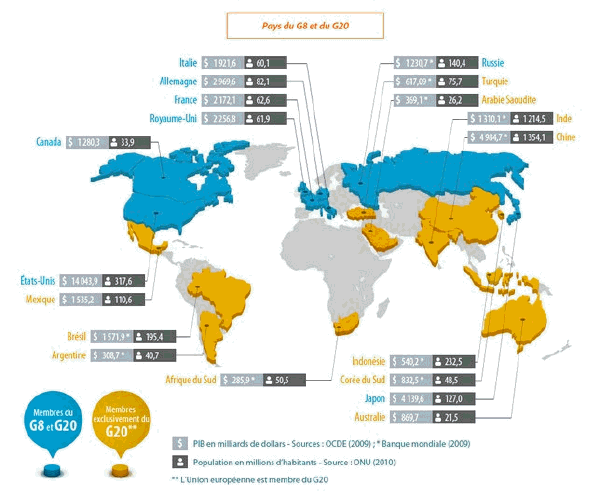
Seules l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et l’Argentine sont membres du G20 sans faire partie des dix-neuf premières puissances économiques mondiales.
Le déploiement continental du G20 est relativement homogène, avec quatre pays européens – plus l’UE et l’Espagne, invitée permanente –, cinq pays américains, dont les trois membres de l’Accord de libre-échange nord-américain(30) (ALENA), cinq pays asiatiques, deux pays moyen-orientaux, un pays africain et un pays océanien.
Le critère démographique entre aussi en considération. Font partie du G20 : les trois pays les plus peuplés d’Asie, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, les deux premiers étant aussi les plus peuplés du monde ; les trois pays les plus peuplés des Amériques, les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique ; les cinq pays les plus peuplés d’Europe, la Russie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie ; le pays le plus peuplé d’Océanie, l’Australie. Le G20 représente environ 4,4 milliards de personnes, soit près des deux tiers de la population mondiale. Il compte dans ses rangs sept des dix pays les plus peuplés du monde et son membre le moins peuplé est l’Australie, qui, avec 21,3 millions d’habitants, pointe au cinquante-quatrième rang mondial.
Le G20 couvre un tout petit peu plus de la moitié des terres émergées, les huit plus grands pays – la Russie, le Canada, les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, l’Australie, l’Inde et l’Argentine –, tous membres du G20, se partageant à eux seuls 46,3 % du territoire mondial. Un simple coup d’œil sur la carte du G20 permet de vérifier que les grandes aires géographiques y sont à peu près uniformément représentées – Afrique exceptée –, en tout cas beaucoup mieux qu’au G8, émanation de l’hémisphère nord.
Rien ne dit que la composition du G20 restera figée – par essence, il devra s’adapter aux réalités économiques – mais tout changement éventuel obéirait à des règles de cooptation similaires.
Consacré aux questions économiques, financières et monétaires, le G20 a trois missions concrètes :
– identifier et gérer les risques systémiques ;
– donner des impulsions aux institutions de coopération et de régulation ;
– assurer une répartition équitable des gains de la mondialisation.
Cela dit, du fait de son caractère informel, ses membres ne sont pas soumis à un programme prédéfini : l’actualité et les besoins mondiaux influencent en majeure partie l’ordre du jour et la teneur des débats. En tout état de cause, à mesure que sa crédibilité grandit et qu’il obtient des résultats tangibles, il est conduit à profiter de cette souplesse pour intervenir sur des champs thématiques de plus en plus vastes.
La présidence française a pris le parti de profiter de cette souplesse, en multipliant les sujets et en ouvrant de nouvelles filières. Ce choix a été dicté par la volonté d’obtenir des résultats concrets et tangibles : en multipliant les domaines d’intervention, l’on multiplie les possibilités d’accords et d’avancées. Si cette stratégie semble payante, elle a été critiquée par certains pays, qui ont éprouvé des difficultés à suivre un tel foisonnement thématique. En outre, la continuité dans le traitement des sujets inscrits à l’ordre du jour de ce G20 ne semble pas garantie.
Les trois nouvelles filières apparues cette année pour creuser les pistes fixées par la présidence française se sont organisées selon un schéma similaire à celui qui prévaut pour la filière finances originelle : des réunions ministérielles préparées par des groupes de travail coordonnés dans chaque pays par un haut fonctionnaire, le deputy, le cabinet suivant de près l’évolution du dossier.
Les deux réunions des ministres de l’agriculture, qui se sont tenues les 19 et 20 mai 2011 à Buenos Aires et les 22 et 23 juin 2011 à Paris, ont été préparées de façon extrêmement méticuleuse, au niveau ministériel comme au niveau des fonctionnaires – le deputy français est le directeur général de l’agriculture et de l’alimentation –, afin de faire de la pédagogie, parmi la communauté internationale, sur la nécessité de réduire la volatilité des prix des matières premières agricoles, idée suscitant au départ de nombreuses préventions(31).
Les ministres du travail se sont quant à eux réunis les 26 et 27 septembre 2011 à Paris autour de la thématique de la constitution d’un socle universel de protection sociale. Si cette filière s’est structurée sous la présidence française, les Etats-Unis l’avaient ébauchée, en préambule au sommet de Pittsburgh, en organisant une réunion ministérielle les 20 et 21 avril 2010 à Washington. L’objectif fixé par la secrétaire au travail américaine Hilda Solis était déjà de « placer l’emploi au centre de la coordination des politiques économiques » en faisant notamment de la lutte contre le travail des enfants et la répression syndicale une cause mondiale, mais l’impact de l’initiative avait été un peu gâchée par la faible participation internationale, en pleine période d’éruption du volcan islandais.
Quant à la filière développement, après une présentation des neuf piliers du « Consensus de Séoul sur le développement pour une croissance partagée »(32) par le deputy français – le directeur de l’économie globale et des stratégies de développement du ministère des affaires étrangères et européennes –, devant l’AGNU, le 9 mars 2011, puis une rencontre de hauts fonctionnaires, du 29 juin au 2 juillet 2011, au Cap, les ministres des finances et du développement se sont retrouvés le 23 septembre 2011, en introduction à l’assemblée générale d’automne de la Banque mondiale, à Washington. Elle est du reste couramment appelée « filière développement-finances ».
Un groupe de travail énergie et matières premières a également été installé, en marge de ces grands axes d’organisation, à la frontière entre les filières finances et agriculture ; directement rattaché aux sherpas, il ne saurait pour l’instant être considéré comme une filière à part entière.
Reste que cette éclosion n’est certainement qu’une étape, qu’elle annonce une densification du réseau organisationnel du G20, en fonction des priorités que fixeront les futures présidences.
Pour être efficace, la concertation doit être menée à deux niveaux : au sein du G20, mais aussi avec le reste de la communauté internationale, en créant un véritable réseau relationnel avec les autres Etats, les associations continentales, les agences onusiennes et les autres organisations internationales. Il en va de l’acceptabilité du G20.
Contrairement au G8, le G20 est par nature hétérogène puisqu’il a précisément pour vocation de rassembler autour d’une table les grandes puissances économiques mondiales dans leur diversité, de façon à ce que soient représentés tous les continents, les aires culturelles et religieuses, et les profils de modèle économique – pays occidentaux développés, grands émergents du Sud, producteurs de pétrole, pays ateliers.
Des tensions se nouent sur la question de la distribution des bénéfices de la gouvernance mondiale, chacun des trois grands du G20 étant animé par une préoccupation centrale :
– la préférence américaine va vers la gestion des risques et la résolution technique des problèmes économiques ;
– l’UE prête une grande importance au pilotage de la gouvernance mondiale ;
– les Chinois sont soucieux d’une répartition plus égale des gains de la mondialisation.
Le chercheur en géopolitique Yves Tiberghien, spécialiste de l’Asie, a établi une schématisation intéressante des centres d’intérêt nationaux tels qu’ils sont apparus depuis le premier sommet du G20(33). Un centre d’intérêt maximum sur un thème donné est noté 1 ; un centre d’intérêt minimal est noté 0. Les résultats concernant les Etats-Unis et la Chine, par exemple, traduisent la confrontation entre ces deux pays : sur tous les items sauf un – climat et énergie –, l’écart qui sépare leurs indices est égal ou supérieur à 0,5.
L’extrapolation consistant à additionner les indices pour chacun des pays, sur un total de 12 points possibles, donnerait les résultats suivants :
– 3,9 pour les Etats-Unis ;
– 6,9 pour la Chine ;
– 10 pour l’UE ;
– 4,5 pour le Japon ;
– 9,2 pour l’Inde ;
– 4,5 pour la Russie ;
– 10,5 pour le Brésil ;
– 4,2 pour le Canada ;
– 6,2 pour la Corée du Sud.
Evaluation des positions prises par les pays clef du G20
(2008-2011)
Etats-Unis |
Chine |
UE |
Japon |
Inde |
Russie |
Brésil |
Canada |
Corée du Sud | |
Régulations bancaires internationales |
1 |
0.2 |
1 |
1 |
0.2 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
Régulations financières |
0.2 |
0.5 |
1 |
0.5 |
1 |
0.5 |
1 |
0 |
0.5 |
Taxe Tobin |
0 |
0.5 |
1 |
0.2 |
1 |
0.5 |
1 |
0 |
0.2 |
Déséquilibres macroéconomiques (Renminbi)(34) |
1 |
0 |
0.2 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
1 |
0.5 |
Système monétaire international (dollar) |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Réduction des déficits et dettes |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.5 |
0.5 |
1 |
0.5 |
Stabilité du financement de la dette |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.5 |
0 |
Commerce prévention du protectionnisme |
0.2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Climat énergie |
0 |
0.2 |
1 |
1 |
1 |
0.3 |
1 |
0 |
0.5 |
Institutionnalisation du G20 |
0 |
0.5 |
1 |
0 |
0.5 |
0 |
1 |
0 |
0.5 |
Droits de vote et gouvernance du SMI (FMI, Banque mondiale, etc.) |
0.5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.5 |
1 |
0 |
1 |
Développement |
0 |
1 |
0.8 |
0.3 |
1 |
0.2 |
1 |
0.2 |
1 |
Source : Yves Tiberghien.
Même si ces chiffres bruts sont sans doute réducteurs, il en ressort que le Brésil et l’UE investiraient le plus d’espoir dans le G20 et y seraient les plus entreprenants, tandis que les Etats-Unis, le Canada, le Japon et le Brésil ne seraient pas autant convaincus par la régulation internationale et interviendraient moins comme forces de proposition au sein du G20.
Pour produire des orientations et des actions collectives à partir de ces sensibilités divergentes – parfois même opposées – et tout en prenant en compte des agendas politiques nationaux susceptibles de « polluer » le positionnement international d’un pays, il est indispensable de conserver en permanence une approche coopérative. Le pays qui assume la présidence ne doit pas donner le sentiment d’être guidé par des idées préconçues mais au contraire poser les problématiques et accompagner, par le dialogue, le mouvement vers le consensus. Cet effort est surtout nécessaire avec les grands émergents, qui ne sont pas encore rompus aux pratiques collaboratives gagnant-gagnant bien rodées au sein du G8. Si la présidence apparaît négligente vis-à-vis des intérêts ou des préoccupations d’un pays, ou encore trop insistante pour imposer ses vues de départ, elle casse le fil fragile de la recherche du consensus.
Si l’approche coopérative est essentielle vis-à-vis des émergents, elle s’impose également entre partenaires de l’ex-G7, notamment entre Européens et Américains : une étroite collaboration entre ces deux pôles majeurs est cruciale pour identifier le champ du possible et faire avancer les dossiers priorisés. C’est ainsi que le Président de la République a consacré une visite officielle à Washington et New York, le 10 janvier 2011, pour évoquer les priorités de la Présidence française du G8 et G20.
De leur côté, les émergents manifestent un intérêt grandissant pour les rapprochements bilatéraux. Des relations se nouent ainsi entre l’Afrique du Sud et l’Australie, la Chine et l’Argentine, ou encore le Mexique et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG)(35).
L’exercice est donc forcément lent et laborieux mais, une fois le consensus recueilli sur une orientation politique donnée, celle-ci intègre une sorte d’« acquis multilatéral » reconnu universellement et il sera délicat, par la suite, de la remettre en cause.
La légitimité du G20 est évidemment interrogée par les pays absents du tour de table, certains lui reprochant de s’être désigné lui-même comme le directoire du monde et lui dénient le droit d’édicter des standards. De fait, être tenu à distance du G20, qui inclut des puissances économiques régionales et pas d’autres, est plus stigmatisant qu’être tenu à l’écart du G7, circonscrit aux seuls grands pays les plus avancés.
La coopération multilatérale repose désormais sur un trépied :
– des associations régionales couvrant essentiellement les champs économiques mais pouvant aller au-delà, avec un degré d’intégration parfois très poussé, à l’instar de l’UE ;
– l’ONU et ses agences, fonctionnant selon le principe « un pays, une voix », garantes de la concertation internationale sur les questions géopolitiques ;
– des groupes de pays possédant la légitimité nécessaire pour être force d’entraînement sur des sujets globaux stratégiques.
Ces trois piliers doivent être considérés comme un ensemble d’éléments utiles les uns aux autres, à condition qu’ils se reconnaissent mutuellement et fonctionnent en réseau. Le G20 étant la principale instance de la troisième catégorie, le pays qui le préside se doit de travailler dans un esprit inclusif pour ne pas se couper des deux autres, notamment de l’ONU. Il est d’autant plus important d’être à l’écoute des attentes du reste du monde que le principe même du G20 reste contesté et que ses membres se sont cooptés mutuellement, en répondant à des critères subjectifs et flexibles – rappelons qu’avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui, il a connu les avatars G22, G33 et G8+5.
Nombre de pays se sentent offensés lorsque le G20 aborde des sujets comme les structures internes au FMI, considérant qu’un club non représentatif prend des décisions sur le sort d’une organisation avec laquelle un cercle international plus large est lié par traité. Ils considèrent que c’est une pratique risquée, qui affaiblit le fonctionnement de l’organisme au moment précis où le monde a besoin d’institutions financières fortes, prêtes à intervenir avec des moyens importants.
La qualité des relations entre la présidence du G20 et les Nations unies – le G193, ou plutôt le groupe des 174 nations exclues du G20, parfois baptisé « G174 », sans oublier le G77, qui compte parmi ses membres certains des pays les plus radicalement anti-occidentaux dans les débats au sein de l’AGNU – est cruciale ; la présidence française, tout au long de l’année, s’est efforcée de systématiser, voire d’institutionnaliser ces relations.
Trop soumises à la rigidité des échanges diplomatiques, les institutions onusiennes se sont avérées inadaptées pour prendre des décisions en phase avec les exigences de l’actualité économique ; cependant, si l’efficacité est du côté du G20, l’ONU est à la source de la légitimité. Il existe par conséquent une seule méthode pour donner une légitimité mondiale aux recommandations du G20 et faire en sorte que les pays tiers, qui n’ont pas participé à leur élaboration, soient enclins à les appliquer : multiplier les consultations en amont puis les explications en aval, à travers les échanges diplomatiques. Les ambassadeurs bilatéraux et les représentants permanents auprès des Nations unies jouent un rôle de contact essentiel pour populariser et faire partager les enjeux et les orientations du G20 dans les autres pays.
Le G20 est toujours perçu avec beaucoup de méfiance, voire d’hostilité, par l’AGNU, qui le voit comme une instance concurrente, mais elle a dû se faire une raison et les efforts d’interaction croissants déployés par les présidences successives, surtout depuis le sommet de Séoul(36), injectent de l’huile dans les rouages du dialogue.
Durant toute son année de présidence, la France a suivi une stratégie de loyauté exemplaire vis-à-vis de l’ONU. Le Président de la République, les membres du gouvernement et les cadres des administrations centrales ont également mis à profit chacune des rencontres avec leurs homologues étrangers et avec des responsables d’organisations internationales pour procéder à des échanges de vues sur le G20. Ainsi, dès le 16 novembre 2010, soit moins d’une semaine après le sommet de Séoul, le sherpa du Président de la République, Jean-David Levitte, présentait les priorités de la présidence française devant l’AGNU.
Le 30 janvier 2011, en marge du sommet de l’Union africaine (UA), à Addis-Abeba, Nicolas Sarkozy a obtenu de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, la confirmation que les Nations unies travailleraient étroitement avec le G20, afin notamment de générer de nouveaux financements innovants en faveur du développement. Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire Bruno Le Maire, et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé Xavier Bertrand, de leur côté, sont intervenus devant l’AGNU pour promouvoir les priorités françaises dans leurs domaines de compétence respectifs(37). La France, enfin, s’est engagée à présenter le bilan de sa présidence, devant l’AGNU, immédiatement après le sommet de Cannes.
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui compte soixante-quinze membres(38) sur les cinq continents, essentiellement des pays en voie de développement, constitue un autre lieu de dialogue privilégié pour la France. Nicolas Sarkozy a profité du XIIIe sommet de la Francophonie, à Montreux, le 23 octobre 2010, pour annoncer que la présidence française escomptait profiter de sa présidence du G20 pour y « ouvrir de nouveaux chantiers ».
Dans le même esprit, l’ensemble des organisations internationales jouent un rôle de plus en plus important dans la préparation des sommets du G20 et sont de plus en plus nombreuses à être associées aux travaux du sommet.
Au sommet de Washington, les Etats-Unis avaient invité le secrétaire général des Nations unies, le secrétaire général du FMI, le président de la Banque mondiale et le président du FSF. Le secrétaire général de l’OMC a été intégré au sommet de Londres. La Confédération syndicale internationale (CSI) s’étant alarmée de l’absence de l’Organisation internationale du travail (OIT), son directeur général a été invité à son tour dès le sommet suivant, à Pittsburgh. L’OCDE est ajoutée à la liste lors du sommet de Toronto. Enfin, la FAO – qui a été une actrice essentielle du dénouement du volet agricole du G20 au fil de l’année 2011 – sera partie prenante du sommet de Cannes.
Et le G20 exploite de plus en plus l’expertise des organisations internationales. Il faisait jusqu’à présent appel à l’OCDE et surtout aux institutions de Bretton Woods. Avec l’extension des champs d’investigation, en 2011, l’OIT a évidemment été sollicitée sur le volet travail. Quant au sujet de la volatilité des prix des matières premières agricoles, il a fait l’objet d’un rapport élaboré en commun par dix institutions(39), sous la conduite de la FAO et de l’OCDE, commandé lors du sommet de Séoul.
Le Président de la République s’était aussi engagé à ce que les agences onusiennes participent à l’ensemble des travaux préparatoires et conclusifs, à tous les niveaux. C’est ainsi que l’administratrice du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a participé pour la première fois aux ministérielles finances – en dépit de la réticence de la direction générale du trésor. Dans le même élan, le directeur général de la FAO a participé à la ministérielle agriculture et celui de l’OIT à la ministérielle travail.
La composition du G20, censée être provisoirement figée, est en réalité à géométrie variable puisque le pays président, depuis le sommet de Londres, a le loisir de lancer des invitations, en fonction des priorités qu’il s’est fixées. Les pays invités, contrairement aux pays membres, n’ont formellement pas droit de veto sur les orientations finales ; toutefois, en vertu du principe cardinal du consensus, leur avis sont pris en compte.
A Londres, Pittsburgh et Toronto, les premiers ministres espagnol et néerlandais – les deux principales puissances économiques mondiales extérieures au G20 – sont présents, renforçant de facto le poids de la représentation européenne : six pays plus l’UE.
A Londres, la pratique tendant à inviter les présidents en exercice d’autres associations régionales est aussi instituée, avec le premier ministre éthiopien pour le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)(40) et le premier ministre thaïlandais pour l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)(41).
A Toronto, l’ASEAN est représentée par le Vietnam, qui en a pris la présidence, et l’UA est intégrée à son tour, à travers le Malawi, qui la préside. Enfin, pour renforcer un peu plus la représentation africaine, une place est faite au Nigeria, pays le plus peuplé et troisième économie du continent derrière l’Afrique du Sud et l’Egypte.
A Séoul, les Pays-Bas quittent le groupe, de même que le Nigeria, au profit de Singapour, pour prendre acte du caractère stratégique de cette place financière en Asie, mais aussi de l’importance numérique, du poids économique et de l’influence politique du 3G.
A l’occasion de ce cinquième sommet, les chefs d’Etat et de gouvernement se mettent d’accord sur des règles : « Conscients de l’importance pour le G20 d’être à la fois représentatif et efficace en tant que principal forum pour notre coopération économique internationale, nous sommes parvenus à un large consensus sur un ensemble de principes régissant les invitations aux sommets adressées aux non-membres. L’un de ces principes est que nous n’inviterons pas plus de cinq non-membres, dont deux au moins seront des pays d’Afrique. »
En 2011, la France convie donc cinq pays, dont deux du continent africain : l’Espagne, qui a conquis ses galons d’invitée permanente ; la Guinée équatoriale, qui préside désormais l’UA(42) ; l’Ethiopie, qui préside toujours le NEPAD ; les Emirats arabes unis, au titre du CCG ; Singapour. Le seul changement est donc l’entrée du CGG. L’ASEAN sera toujours représentée par l’Etat occupant sa présidence – actuellement l’Indonésie, membre permanent du G20 – ainsi que par Singapour.
A travers les invitations, au-delà de l’aspect opérationnel, il s’agit d’émettre des signaux politiques d’ouverture en direction du reste du monde, en valorisant certaines priorités de l’agenda, des pays ou des groupes de pays.
DEUXIEME PARTIE :
PASSER D’UN G20 DE GESTION DE CRISE
A UN G20 DE CONSTRUCTION A MOYEN TERME ET A LONG TERME
POUR ACCOMPAGNER LE MOUVEMENT ECONOMIQUE GLOBAL
Malgré la reprise, plus ou moins soutenue et hésitante selon les pays, nous sommes encore dans une situation de crise globale, pour longtemps, et la carte géoéconomique, profondément bouleversée par la transition d’un monde dominé par une hyperpuissance vers un monde multipolaire, s’articule dorénavant clairement autour de trois pôles aux intérêts à court terme divergents – les Etats-Unis, l’UE et la Chine –, qui doivent en outre composer avec les autres acteurs nationaux et régionaux.
Mais il est frappant de constater que les passages de paliers institutionnels successifs du G8 et du G20 ont tous été directement causés par des crises. Au départ tentative audacieuse de répondre aux enjeux posés par la crise économique mondiale la plus grave depuis celle des années 1930 en prenant acte de la redistribution des cartes économiques et commerciales entre pays du Nord et du Sud, le G20 nouvelle formule, né en 2008, a dorénavant une toute autre ambition : il est devenu la principale enceinte de coopération économique et financière du monde, investie de la responsabilité d’assurer une croissance mondiale fondée sur des bases saines et solides.
Jusqu’à présent, l’entreprise du G20 a été saluée pour être parvenue, après le déclenchement de la dernière grande crise économique, à éviter le pire au monde, c’est-à-dire, comme dans les années 1930, une récession profonde et prolongée doublée d’une détérioration des relations interétatiques conduisant à un terrible conflit mondial. Les cinq G20 qui se sont succédé en deux ans à un rythme semestriel – le 15 novembre 2008 à Washington, les 2 et 3 avril 2009 à Londres, les 24 et 25 septembre 2009 à Pittsburgh, les 26 et 27 juin 2010 à Toronto et les 11 et 12 novembre 2010 à Séoul – ont posé des principes utiles, visant à apporter des réponses collectives, mais dont l’application reste limitée et inégale d’un pays à l’autre et d’un continent à l’autre.
Les conditions semblent réunies pour obtenir de nouvelles avancées, sur la base des propositions formulées par la France depuis janvier 2011, en profitant d’une atmosphère internationale propice à l’interventionnisme économique.
Compte tenu des circonstances, l’ambition déclarée de la présidence française de passer d’un G20 de gestion de crise à un G20 de construction à moyen terme et à long terme apparaît cependant aujourd’hui en décalage avec la réalité ; elle se heurte aux événements économiques inattendus survenus depuis l’été, notamment en Europe, qui réclament des mesures internationales d’urgence.
I. LA CARTE GEOECONOMIQUE DU MONDE
EST PROFONDEMENT BOULEVERSEE(43)
En 1975, les pays du G6 représentaient 64,02 % du PIB mondial. En 1993, la part du G7, avec le Canada, était passée à 68,42 %. En 2010, les « vieilles puissances industrielles » du G8 ont perdu leur suprématie sur l’économie mondiale : leur apport à la production mondiale est tombé à 42,49 %. Les économies des pays à revenu élevé sont devenues le frein principal à la croissance mondiale, avec un creux en 2009 : d’après la Banque mondiale, le taux de contraction de la production de richesse y a alors atteint son maximum, à 3,2 %.
Les contrastes entre les taux de croissance moyens mesurés par la Banque mondiale sur la décennie 2000-2010 sont frappants : plus 1,3 % pour le G7 et 2,8 % pour l’UE, contre 10 % pour la Chine, 7 % pour l’Inde et 6,5 % pour l’ensemble des BRICS. Cette tendance perdurera dans les années à venir : l’OCDE table sur une croissance moyenne de 2,3 % en 2011 et de 2,8 % en 2012 dans les pays riches, soit quelque 2 points de moins que la croissance mondiale, qui sera encore tirée par les grands émergents. D’autres organismes sont plus pessimistes, à l’instar du Centre de prévision de l’Expansion, qui anticipe un taux de croissance de 1,5 % seulement, en 2012, dans les pays industrialisés, contre une moyenne de 2,3 % sur les deux dernières décennies.
1. L’Union européenne(44), une intégration inachevée mais qui possède les ressorts internes nécessaires pour sortir de la crise actuelle
Depuis un an et demi, l’Europe et sa monnaie traversent une crise profonde, contrecoup de la crise financière et de la récession de 2009, qui ont creusé les endettements publics et jeté une lumière crue sur la nécessité de procéder à des réformes structurelles. L’Irlande, le Portugal et surtout la Grèce ont été frappés au premier chef : les agences de notation ont sévèrement dégradé leurs notes à plusieurs reprises, ce qui a renchéri les taux de rémunération exigés par les souscripteurs d’obligations d’Etat, donc alourdi leur charge de remboursement et accru leur risque de faillite.
Si la Grèce, pays le plus fragilisé, devait financer toute seule l’intégralité de sa dette, les marchés la soumettraient à des taux d’intérêt inabordables – début septembre, ils atteignaient 90 % sur les emprunts à un an et 50 % sur les emprunts à deux ans, loin des 5,8 % accordés dans le cadre de la solidarité européenne –, ce qui entraînerait une faillite immédiate, avec un risque non négligeable de contagion à d’autres pays, le Portugal et l’Irlande, mais aussi l’Espagne, l’Italie et la Belgique, dans lesquels les dettes publiques ont aussi dépassé le seuil critique. L’enjeu consiste à afficher la solidarité européenne, afin de calmer les marchés et de sortir au plus vite de ce cercle vicieux, en mobilisant une masse impressionnante de moyens financiers.
D’après les prévisions de la Commission européenne publiées le 5 septembre 2011, l’endettement public des vingt-sept devrait passer de 80,2 % du PIB en 2010 à 82,3 % en 2011 et à 83,3 % en 2012. Pour la zone euro, le creusement de la dette serait similaire, avec des taux de 85,4 % en 2010, de 87,7 % en 2011 et de 88,5 % en 2012. Actuellement, seuls cinq pays de l’UE affichent un déficit budgétaire inférieur au plafond de 3 % du PIB fixé dans le pacte de stabilité et de croissance : le Danemark, l’Estonie, la Finlande, le Luxembourg et la Suède.
A la suite du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro du 7 mai 2010, le Conseil « Ecofin »(45) des 9 et 10 mai 2010 a décidé de mettre en action un dispositif de soutien inédit, baptisé Mécanisme européen de stabilisation (MES), appuyé sur deux outils :
– le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), qui permet à la Commission, après décision du Conseil à la majorité qualifiée, en vertu de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), d’emprunter jusqu’à 60 milliards d’euros ;
– le Fonds européen de stabilité financière (FESF), créé pour l’occasion, doté d’une capacité d’emprunt de 440 milliards d’euros, mobilisable uniquement par un accord unanime des Etats membres y contribuant.
Ce potentiel total de 500 milliards d’euros est complété par 250 milliards susceptibles d’être prêtés par le FMI.
Ce dispositif expirant au 30 juin 2013, les chefs d’Etat et de gouvernement, au terme des sessions du Conseil européen des 24 et 25 mars et des 23 et 24 juin 2011 – qui était essentiellement consacré à cette question – ont mis en chantier une révision du TFUE. Son article 136 serait amendé, afin de créer un mécanisme permanent de stabilité financière.

Source : touteleurope.eu.
Le MES pérennisé présentera les caractéristiques suivantes :
– sa dotation par l’UE sera maintenue à 500 milliards d’euros ;
– il sera « activé d’un commun accord » – c’est-à-dire à l’unanimité des Etats membres participant au vote, les abstentions ne faisant pas obstacle à l’adoption de la décision –, afin d’accorder des prêts ou d’acheter des titres de dette souveraine sur le marché primaire(46) ;
– l’octroi de cette assistance financière « sera subordonné à une stricte conditionnalité » ;
– un prêt du MES bénéficiera du statut de créance privilégiée, « qui ne sera inférieur qu’à celui des prêts du FMI » ;
– un pays jugé insolvable sur la base des analyses de la Commission européenne, du FMI et de la BCE devra négocier un plan de restructuration global avec ses créanciers privés pour revenir à un endettement supportable ;
– sur l’insistance de l’Allemagne, il sera possible de faire participer le secteur privé au mécanisme « sous une forme appropriée et proportionnée » et « au cas par cas ».
La ratification de cette modification n’est cependant pas encore acquise, eu égard aux problèmes d’acceptabilité politique qu’il soulève dans certains pays.
Il n’en demeure pas moins que la solidarité européenne, depuis un an, a été une réalité : l’UE a déjà mobilisé pas moins de 45 milliards d’euros, le 28 novembre 2010, en faveur de l’Irlande et de 52 milliards d’euros, le 15 mai 2011, en faveur du Portugal. La situation de la Grèce est plus problématique, les 110 milliards d’aide internationale en sa faveur dans un premier temps, le 2 mai 2010 – 80 milliards de prêts garantis pour trois ans par les Etats européens et 30 milliards du FMI – ne couvrant guère que la moitié des échéances financières auxquelles le pays devra faire face. Les deux autres Etats sous programme d’aide internationale ne sont pas non plus sortis d’affaire, d’autant que les taux d’intérêt des plans de soutien font peser une lourde charge sur leurs budgets nationaux, en particulier l’Irlande, où la dette publique devrait atteindre son pic en 2014.
Les attaques répétées contre les obligations souveraines de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et plus récemment de Chypre ou de l’Italie, ainsi que les dégradations successives des notes attribuées à ces pays par les agences de notation, ont nécessité l’organisation d’un sommet extraordinaire de l’eurozone, le 21 juillet 2011, au terme duquel une aide supplémentaire de 158 milliards a été accordée à la Grèce pour couvrir intégralement son déficit de financement, avec un mise à contribution du secteur privé, par le biais d’échanges et de rachats de dette. La France est le premier pays de la zone euro à ratifier ce second plan de sauvetage, le 8 septembre 2011, à l’occasion d’une session parlementaire extraordinaire.
L’agenda européen de 2011 comporte aussi un événement important pour l’euro : le changement de gouvernance de la BCE, le 1er novembre 2011. Pour succéder au Français Jean-Claude Trichet, un consensus s’est en définitive dégagé assez facilement en faveur du gouverneur de la Banque d’Italie et président du Conseil de stabilité financière (CSF), Mario Draghi, nommé pour huit ans.
Fin juin, le FMI prévoyait que la croissance européenne atteindrait 2 % en 2011. Cela dit, avec la hausse de l’inflation et la multiplication des plans d’austérité imposés par les circonstances, la consommation devrait être en berne. En outre, les dépenses de construction ont connu un infléchissement au cours de l’année, de même que les investissements des entreprises en nouvelles technologies, du fait de la baisse de leur profitabilité. Le 8 septembre 2011, la BCE a d’ailleurs revu ses propres prévisions de croissance à la baisse : elle devrait se situer dans une fourchette de 1,4 à 1,8 % en 2011 et de 0,4 à 2,2 % en 2012. Sont en cause, la dégradation de la confiance et la persistance de la crise des dettes souveraines.
Même si la crise n’est pas terminée, loin s’en faut, avec notamment les risques de faillite et de sortie de la zone euro qui continue de planer sur la Grèce, l’UE s’est donc donné, dans un premier temps, les moyens de réussir un test réputationnel déterminant. Comme toujours lorsqu’ils se trouvent au pied du mur, ses dirigeants ont su faire preuve d’esprit de responsabilité et de cohésion pour trouver un consensus. Si la situation européenne est tendue – une croissance de seulement 1,8 % est anticipée, au mieux, pour 2011 –, la BCE a tout de même pu prendre le risque, le 7 juillet 2011, de remonter ses taux d’intérêts directeurs de 25 points de base, portant le taux des opérations principales de refinancement à 1,5 %, pour tenter de juguler le rythme d’inflation dans la zone euro, qui tournait autour de 2,5 % en glissement annuel depuis plusieurs mois.
La démarche du « semestre européen », cycle annuel de surveillance coordonnée de la discipline budgétaire dans les Etats membres instauré en 2011, est également de nature à stabiliser l’économie européenne et à consolider la zone euro. La réforme de la gouvernance économique de l’UE(47), à travers le renforcement du Pacte de stabilité et de croissance, qui a été votée par le Parlement européen le 28 septembre 2011 et approuvée par le Conseil « Ecofin » le 4 octobre 2011, poursuit le même objectif.
Le début de panique boursière intervenu durant l’été et l’aggravation ininterrompue de la crise des dettes souveraines ont cependant dégradé les perspectives de l’économie européenne et placé l’UE au cœur des préoccupations des membres du G20, eu égard à l’impact se sa santé sur la croissance mondiale. Le Conseil « Ecofin » des 16 et 17 septembre 2011 s’est pourtant conclu sur un constat de semi-échec, faute de mesures fortes contre la crise financière dans la zone euro et concernant la mise en œuvre du second plan d’aide à la Grèce – la décision de versement de la sixième tranche du premier plan a même été repoussée d’un mois.
Un mois avant le sommet de Cannes, la France se trouve donc dans la situation d’essayer de convaincre le monde d’adopter des mesures de régulation coordonnées anti-crise, alors que l’association continentale à laquelle elle appartient n’est pas encore parvenus à faire émerger des solutions durables pour s’extraire de ses difficultés économiques internes.
Car la défiance des marchés se double d’une crise de confiance interne, au point qu’un débat sur l’abandon de l’euro a émergé dans certaines franges de l’opinion publique européenne. D’après une étude du département de recherche sur l’économie mondiale de la banque UBS(48), une sortie de la zone euro coûterait pourtant aux pays les plus faibles entre 40 et 50 % de leur PIB la première année puis entre 10 et 20 % les années suivantes, tandis que la facture serait de 10 à 25 % du PIB pour les pays les plus riches.
L’élargissement rapide aux pays d’Europe centrale et orientale (PECO) a accru les déséquilibres internes à l’UE – un Luxembourgeois produit près de sept fois plus de richesses qu’un Bulgare – et l’intégration de certains pays d’Europe centrale et orientale pose encore problème, avec notamment comme point de crispation le feu orange à l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen, du fait du retard pris par ces deux pays en matière de lutte contre la corruption et d’indépendance du système judiciaire.
Dans un contexte de scepticisme des responsables politiques et des opinions publiques quant à l’intérêt d’élargir encore l’UE à de nouveaux Etats membres, vingt ans exactement après son indépendance, le processus d’élargissement à la Croatie a touché à son terme plus tôt que prévu : la signature du traité d’adhésion devrait intervenir lors du sommet européen du 19 décembre 2011, à Varsovie, avec pour cible une adhésion au 1er juillet 2013. L’UE continue donc de remplir son engagement moral vis-à-vis des pays de l’ex-Yougoslavie. Instruite par l’expérience, elle a cependant imposé à son partenaire, cette fois-ci, un suivi des réformes intérieures menées jusqu’à la date prévue pour l’entrée en vigueur de l’acte d’adhésion et prévenu que, dans le cas où les conditions posées ne seraient pas remplies – notamment sur les dossiers sensibles de la réforme de la justice, de la lutte contre la corruption, de la défense des libertés fondamentales et de la politique de la concurrence –, le processus de ratification serait interrompu, « à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission ». Il reste que l’UE a pris acte de la collaboration active de Zagreb avec le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye, laquelle démontre une appropriation des principes de droit sous-tendant la construction européenne.
Les questions sur l’avenir de l’UE tiennent aussi aux insuffisances du traité de Lisbonne. Le dispositif institutionnel qui y est imaginé est certes porteur d’améliorations, avec l’apparition d’un président permanent du Conseil européen ainsi que d’un haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, mais il reste insuffisant pour que l’UE puisse passer un nouveau cap et apparaître comme un acteur politique mûr sur la scène diplomatique et géostratégique(49).
Même si le chemin du renforcement de la gouvernance économique de l’UE, notamment de la zone euro, est long, des étapes essentielles, considérées comme hautement improbables il y a encore deux ans – FESF, renforcement du Pacte de stabilité et de croissance, proposition de taxe sur les transactions financières – ont été franchies. Tous les Etats membres, des plus prospères au plus vulnérables, savent ce qu’ils auraient à perdre d’un démantèlement de leur association et ignorent ce qu’ils y gagneraient. Paradoxalement, le passage de l’épreuve en cours peut constituer une opportunité majeure pour l’approfondissement et l’intégration de l’Europe.
Première puissance économique mondiale depuis près d’un siècle et demi – sauf si l’on agrège les résultats des vingt-sept pays de l’UE –, les Etats-Unis possèdent de longue date tous les attributs de puissance, qu’ils soient de nature militaire, diplomatique, commerciale, monétaire ou culturelle. Leur prééminence, même si elle tend à s’amenuiser, conserve un effet psychologique sur certains pays qui, durant la guerre froide, faisaient partie de leur galaxie politique : bien que les préférences sous-jacentes du Japon ou de la Corée du Sud, par exemple, soient souvent proches des positions « régulationnistes » défendues par la France et d’autres Etats européens dans le cadre du G20, les réflexes du passé les incitent à s’aligner assez systématiquement sur les Etats-Unis.
L’économie américaine se caractérise cependant aujourd’hui par une certaine asthénie, voire, dans certains secteurs, par un début de marasme(50), les moyens alloués en 2009 par le Congrès à l’administration Obama dans le cadre du plan de relance arrivant à épuisement. Pour éviter une rupture d’activité, M. Obama a annoncé, le 8 septembre 2011, un nouveau plan de relance de 447 milliards de dollars, conçu dans l’optique de créer 1 million d’emplois(51), comportant un programme d’infrastructure et des allégements de charges au profit des petites entreprises.
Le 22 juin 2011, le comité de politique monétaire de la Fed a revu à la baisse ses prévisions de croissance : elle ne devrait être comprise qu’entre 2,7 et 2,9 % en 2011 puis entre 3,3 et 3,7 % en 2012, soit un demi point en dessous du niveau encore espéré deux mois auparavant. Et des économistes jugent ces prévisions encore trop optimistes, alors que la seule croissance démographique du pays neutralise déjà un point de PIB. C’est ainsi que le FMI, fin juin, tablait plutôt sur un taux de 2,5 % pour 2011 et de 2,7 % pour 2012. Au premier trimestre de 2011, la croissance économique a déjà ralenti, sous les effets conjugués de la flambée des prix de l’énergie et d’un tassement de l’augmentation de la consommation.
Les Etats-Unis ont regagné les deux tiers du terrain perdu à cause de la récession en termes d’utilisation des capacités de production et de durée moyenne du travail des personnes employées. Le plan de relance a permis de créer une moyenne de 240 000 emplois par mois, alors que 150 000 suffisent pour stabiliser le taux de chômage. Le chômage a tout de même dépassé la barre des 9 % de la population active, nettement au-dessus du taux naturel, avec de grandes disparités entre Etats. Et il ne prend pas en compte le sous-emploi – le volant de salariés travaillant à temps partiel contre leur gré et sous-payés ou ayant renoncé à chercher un emploi –, dont les effectifs sont estimés dans une fourchette de 15 à 25 % de la population active. Cette situation est socialement catastrophique : faute de filets de sécurité sociaux, la dégringolade des demandeurs d’emploi est rapide et vertigineuse.
En 2010, les Etats-Unis ont été la première destination pour les investissements français à l’étranger. La France est le septième investisseur étranger en stocks aux Etats-Unis, derrière le Royaume Uni, le Japon, le Canada, les Pays-Bas et l’Allemagne : la part française s’élève à 163 milliards de dollars, soit 7,2 % des investissements directs étrangers. Plus de 2 800 entreprises françaises sont implantées aux Etats-Unis ; elles y génèrent plus de 550 000 emplois et leur chiffre d’affaires cumulé dépasse les 170 milliards de dollars. En sens inverse, les Etats-Unis sont aussi les premiers investisseurs directs étrangers en France, avec 75 milliards de dollars. Selon le département d’Etat, les entreprises américaines emploient plus de 650 000 personnes en France, réparties sur 4 200 implantations.
En matière commerciale, les Etats-Unis sont notre sixième client et notre sixième fournisseur, tandis que nous sommes leur onzième client et leur dixième fournisseur. En 2009, notre déficit commercial avec les Etats-Unis a atteint 5,3 milliards d’euros mais ils demeurent un marché de référence : 24 000 entreprises françaises, dont près de 80 % de PME, exportent vers les Etats-Unis, soit 5 000 de plus que vers l’Allemagne.
Le déficit des administrations publiques n’est censé être ramené que de 10,5 % du PIB en 2010 à 9 % en 2012, un rythme beaucoup trop modéré pour résorber les déséquilibres budgétaires, retenu faute de consensus politique.
Il faut préciser que le contexte est tout à fait défavorable à la poursuite de grands desseins politiques. La cohabitation entre une administration démocrate et une chambre des représentants à majorité républicaine, mise sous pression par le mouvement populiste Tea Party, oblige les protagonistes à rechercher des consensus improbables sur tous les dossiers économiques, en particulier celui du relèvement du plafond légal de la dette publique. D’où le psychodrame de l’été 2011 entre démocrates et républicains, qui s’est conclu par un compromis in extremis, le 2 août, date limite à laquelle l’Etat aurait été en défaut de paiement face à ses créanciers.
Cette situation va s’aggraver dans les mois à venir, pour deux raisons. D’une part, l’élection présidentielle de l’année prochaine commence à mobiliser tous les esprits, en particulier pour la collecte de fonds, qui débute très en amont – la campagne du président Obama devrait être la première à dépasser le milliard de dollars. D’autre part, le renouvellement biennal de la Chambre des représentants pourrait donner aux républicains la majorité dans les deux assemblées, ce qui handicaperait la prise de décision de Barack Obama, à supposer qu’il soit réélu – depuis l’opération réussie contre Oussama Ben Laden, la plupart des sondages d’opinion le donnent gagnant, mais avec une marge d’avance très faible.
Le comportement des Etats-Unis vis-à-vis de la régulation mondiale est ambivalent : ils ont pris conscience, dès 2008, de l’importance du G20 pour stabiliser le système économique mais prennent garde, aujourd’hui, de ne pas accélérer la fin de l’hégémonie américaine afin de conserver leurs avantages comparatifs, notamment dans le secteur financier, dont 50 % reste localisé à la bourse de Wall Street.
3. Le Japon, dépassé par son principal concurrent régional et confronté au défi de la reconstruction
Avec un PIB nominal de 5 474 milliards de dollars en 2010 et malgré une croissance de 3,9 %, taux plus qu’honorable par rapport à de nombreux autres pays développés, le Japon a perdu la place de deuxième économie mondiale, qu’il occupait sans discontinuer depuis quarante-deux ans.
Le séisme du 11 mars 2011, d’une magnitude inédite au Japon, ainsi que le tsunami et les accidents nucléaires qui s’en sont suivis font planer une grande incertitude sur l’économie locale, compte tenu de la différence d’échelle avec les cataclysmes naturels classiques. Les prévisionnistes ne s’attendent cependant pas à une récession trop prononcée en 2011 – elle devrait être contenue sous 0,5 % – puis à une reprise de 2 à 2,5 % en 2012, qui serait une année de rattrapage et de mise en œuvre de travaux de reconstruction dans les secteurs des infrastructures et du bâtiment. La tâche de reconstruction est gigantesque : son coût a été estimé dans une fourchette de 16 000 à 25 000 milliards de yens, soit 140 à 217 milliards d’euros.
Les effets de la catastrophe en chaîne se diffusent largement dans les principales filières productives du monde car le Japon est le quatrième exportateur et le cinquième importateur, avec respectivement 581 milliards et 552 milliards de dollars.
L’endettement public a atteint la barre symbolique du million de milliards de yens, soit 8 700 milliards d’euros, 210 % du PIB. Certes, la dette est détenue à 95 % par les gros investisseurs institutionnels nationaux et son niveau doit être relativisé au regard du volume des actifs étrangers qu’il détient, à commencer par les 880 milliards de dollars de dette américaine(52) – 50 % de plus qu’il y a trois ans –, c’est-à-dire près du quart de l’encours total, un tout petit peu moins que la Chine. Mais le vieillissement de la population – la moyenne d’âge approche les cinquante ans, la natalité est au plus bas et l’immigration insuffisante – provoque une érosion de la capacité d’épargne individuelle. Par surcroît, dans le même temps, avec la mondialisation, les entreprises investissent de plus en plus leurs liquidités à l’étranger, ce qui risque de conduire les créanciers à exiger des rendements supérieurs et par conséquent d’entraîner une hausse du coût de la dette voire une grave crise souveraine. Le 24 août 2011, l’agence de notation financière Moody’s a réduit d’un cran, à Aa3, la note de la dette à long terme japonaise.
Une partie de l’épargne placée à l’étranger – évaluée à environ 60 % du PIB – devrait être rapatriée pour la reconstruction. Ces rentrées de capitaux entraîneront une appréciation du yen et dégraderont la compétitivité des produits japonais, mais provoqueront une poussée inflationniste dans une économie en déflation depuis des années. Un pays comme le Brésil, qui croulait sous les avoirs des fonds de pension japonais, risque d’être déstabilisé.
Le G7 finances, dans la nuit du 17 au 18 mars 2011, s’est coordonné pour enrayer la flambée du yen, qui commençait à se concrétiser. C’était la première intervention conjointe de ce type depuis septembre 2000, lorsque les pays du G7 étaient intervenus de façon concertée sur le marché monétaire afin de faire remonter l’euro, tombé à son plus bas niveau historique.
D’autre part, le report de la consommation énergétique du nucléaire sur le pétrole et le gaz va renchérir leur cours. Autre conséquence globale, le trou d’air dans lequel entre la production japonaise a désorganisé toutes les industries utilisant des composants provenant de l’archipel.
Le Japon est également soumis à des contraintes politiques importantes, en particulier la division verticale de son organisation administrative, qui complique la coordination entre les services pour préparer efficacement les négociations internationales. Le ministère du commerce(53), dispose du pouvoir le plus étendu mais n’a pas pour mandat de coordonner la réflexion des autres départements ministériels et des régulateurs. Quant au pilotage du Kantei(54), il est relativement faible.
Le Japon n’est en vérité pas le membre du G20 qui prend cette instance le plus au sérieux, puisque celle-ci réduit le pouvoir du G8 – où il est le seul à représenter l’Asie – et entérine la montée en puissance de ses rivaux directs, les émergents asiatiques. Donnant l’impression de ne pas suffisamment s’impliquer dans le jeu mondial, le Japon tend à être sous-estimé par ses partenaires historiques et éprouve un douloureux sentiment de dépréciation symbolique, notamment de la part de la France.
En outre, les distractions politiques internes détournent le pays des vrais enjeux : la Diète peine à faire émerger des majorités, notamment pour le vote des budgets, ce qui fait peser un risque de paralysie sur tout le système politique national. La classe politique s’en trouve largement discréditée, ce qui complique l’émergence d’un dirigeant politique fort(55).
La Russie, onzième puissance économique mondiale – elle a reculé d’une place en 2010, au profit de l’Inde –, fait tout de même partie du G8, conséquemment à l’histoire du XXe siècle, mais aussi en considération de l’influence stratégique qu’elle continue d’exercer en Europe et en Asie.
Sur la période 2000-2008, le taux de croissance annuel moyen s’établissait à 7 %, grâce aux revenus des hydrocarbures ; la Russie est en effet le premier producteur mondial de pétrole et le deuxième de gaz. Après une récession de 7,9 % en 2009, le taux de 4 % enregistré en 2010 et les projections à 5 % pour 2011 et 4,5 % pour 2012 sont donc légèrement inférieurs au potentiel à moyen terme de l’économie russe. Il faut dire que la vague de chaleur et les incendies qui ont frappé le pays durant l’été 2010 lui ont coûté au moins 0,6 % de PIB.
La crise financière a mis en évidence les faiblesses de l’économie russe :
– manque de compétitivité à l’export ;
– absence de ressources financières longues en roubles ;
– insuffisance des investissements, qui sont cependant bien repartis, en 2010, avec une progression de 8 % ;
– dépendance excessive aux matières premières.
Même si elle a provoqué la fermeture provisoire des marchés de capitaux, la crise n’a en revanche qu’effleuré les grandes banques russes, peu exposées à l’étranger. Si nombre de petits établissements ont été ruinés, cela a entraîné une consolidation saine du secteur, qui était trop émietté et a renoué avec les profits dès le troisième trimestre 2009.
La Russie effectue la moitié de ses échanges commerciaux avec l’Europe. La Chine est aussi un de ses partenaires très importants, ainsi que les autres BRICS. Le volume des échanges avec la France s’est fortement accrû depuis 2000 : les exportations françaises ont été multipliées par près de quatre et les importations françaises par près de cinq, atteignant respectivement 6,3 milliards et 12,2 milliards d’euros en 2010. La balance commerciale qui en résulte est fortement déficitaire : moins 5,9 milliards. Si nous sommes le sixième fournisseur mondial de la Russie et son deuxième fournisseur européen derrière l’Allemagne, la Russie est notre deuxième fournisseur de pétrole, derrière la Norvège, et notre quatrième fournisseur de gaz, derrière la Norvège, les Pays-Bas et l’Algérie.
La Russie est plongée depuis vingt ans dans une crise démographique, au point que, d’après les chiffres de l’ONU, l’espérance de vie à la naissance y est aujourd’hui inférieure à la moyenne mondiale : 68,9 ans, plus exactement 74,9 ans pour les femmes et 62,8 ans pour les hommes. Sa population devrait encore dégringoler de 140 millions à 116 millions d’habitants entre 2010 et 2050 ; la population active passerait de 72,1 à 60,4 % et la part des plus de 65 ans de 13 à 23,6 %.
Selon le service national des statistiques(56), le nombre de Russes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 4,8 millions de personnes, soit plus 26,5 %, sur les seuls trois premiers mois de 2011. Au total, 16,1 % de la population vit chaque mois avec moins de 6 473 roubles, ou 160 euros.
La Russie manifeste un grand intérêt pour le G20 ; elle a déposé sa candidature pour en exercer la présidence en 2013 et semble tenir la corde. Son désir d’intégration internationale se mesure aussi à l’aune des efforts qu’elle déploie pour être admise à l’OCDE, avec pour ambition d’y parvenir d’ici à 2013.
En Russie aussi, 2012 sera année d’élections : le scrutin présidentiel se tiendra en mars, après des législatives en décembre 2011. Compte tenu de la mainmise du pouvoir central sur le jeu politique à Moscou et en régions, tout suspens a disparu depuis le ralliement officiel du président Medvedev au premier ministre Poutine, le 24 septembre 2011.
L’économie canadienne – la neuvième du monde, avec un PIB de 1 568 milliards de dollars en 2010 – est essentiellement adossée sur le secteur tertiaire. Après une chute du PIB de 2,5 % en 2009, la croissance est repartie sur un rythme de plus 2,5 à plus 3 % par an.
Le Canada est très ouvert sur l’extérieur : les échanges de biens comptent pour près des trois quarts de son PIB. Outre l’ALENA, il a ratifié des accords de libre-échange avec Israël, le Chili, le Costa Rica, l’Association européenne de libre-échange(57) (AELE) et le Pérou, tandis que trois autres accords, avec la Colombie, la Jordanie et Panama, sont en attente de ratification. Des négociations sont aussi en cours avec de nombreux autres pays. S’agissant de l’UE, un round de négociations commerciales a eu lieu du 11 au 15 juillet 2011.
Le Canada est immensément riche en matières premières, qu’il s’agisse d’hydrocarbures, de minerais ou de produits agricoles. Il détient ainsi les troisièmes réserves mondiales de pétrole brut et est le premier exportateur d’uranium.
Son dynamisme économique est aussi favorisé par son voisinage avec la première économie mondiale et leur coopération au sein de l’ALENA : les trois quarts des exportations canadiennes sont destinées au marché américain et les Etats-Unis détiennent plus de la moitié du stock d’investissements directs étrangers au Canada.
Dans les années 1990, l’économie canadienne a renoué avec une croissance soutenue, un taux de chômage et une inflation maîtrisés. La confiance a été retrouvée grâce au rétablissement spectaculaire des finances publiques et au maintien d’une bonne compétitivité. Les finances publiques ont été assainies à la suite d’une décennie d’efforts budgétaires, accompagnés d’une profonde réforme de l’Etat. Sur la période 1998-2008, le Canada a enregistré les meilleurs résultats économiques du G7, avec une croissance moyenne de 3,3 % par an.
Le Canada a été durement touché par la crise mondiale à partir d’octobre 2008 mais a mieux résisté que les autres pays de l’OCDE. Un programme de stimulus de 40 milliards de dollars canadiens a été engagé pour entraîner la relance, ce qui a produit un effet accélérateur sur la croissance fin 2010 et début 2011. L’augmentation tendancielle des cours des matières premières joue également dans ce sens. Après un vif mouvement de déstockage, l’activité manufacturière s’est intensifiée et le niveau d’utilisation des capacités industrielles a augmenté.
En 2010, avec 2,58 milliards d’euros d’exportations vers le Canada, nous avons été son huitième fournisseur et il a été notre trente et unième client. Quant aux importations françaises, elles ont atteint 2,52 milliards d’euros, faisant du Canada notre trente-troisième fournisseur et de nous son onzième client.
Dans les négociations internationales, le Canada, membre éprouvé du G8, apparaît comme un partenaire discret, qui en a parfaitement intégré l’habitus : pour faire passer une conviction et lui donner une chance de prendre corps dans des actes internationaux, il est plus efficace de jouer la carte du dialogue et des propositions constructives que de se poser en opposition au reste du monde en exagérant sa force.
Dans son rapport Perspectives économiques globales 2011, la Banque mondiale estime que les pays émergents ont retrouvé leur dynamisme d’avant-crise : globalement, elle prédit qu’ils devraient afficher des taux de croissance de 7 % en 2010 et 6 % en 2011, contre 3,3 % en moyenne dans le monde, 2,4 % pour les pays avancés et seulement 1,4 % pour la zone euro. La forte croissance des années qui ont précédé la crise était consécutive non seulement au dynamisme des ventes de matières premières et de la demande américaine, mais aussi à l’expansion des marchés intérieurs des émergents. Il est probable que la demande interne, dans les pays en développement, continue de soutenir l’économie mondiale au cours des prochaines années. C’est dans ce contexte que les flux nets de capitaux internationaux privés vers ces pays se sont accrus de 44 % en 2010, à 753,2 milliards de dollars.
En Asie, sur le plan conceptuel, l’agenda français du G20 recueille un soutien académique fort. La Chine est l’acteur asiatique clef pour que les priorités françaises aboutissent, le Japon et la Corée du Sud possédant un fort potentiel de médiation mais hésitant souvent à s’engager pour faire basculer une décision.
Les pays d’Asie-Pacifique sont de plus en plus interdépendants : un quart environ des exportations du Japon, de la Corée du Sud, de Taiwan ou de l’Australie sont maintenant dirigées vers la Chine. Toutefois, le déficit de pilotage commun crée une certaine incertitude. Un processus d’intégration à l’européenne est inenvisageable car le couple franco-allemand n’a pas son équivalent en Asie, la réconciliation entre la Chine et le Japon butant sur les rancoeurs historiques, les contentieux territoriaux et les différends idéologiques. Les deux pays détiennent ensemble près de la moitié de la dette américaine – près de 2 000 milliards de dollars.
Après la crise coréenne, le 6 mai 2000, réunis en Thaïlande, les dix membres de l’ASEAN s’associent à la Chine, à la Corée du Sud et au Japon pour lancer l’Initiative de Chiang Mai, dans l’optique de mettre sur pied un mécanisme précautionnel de réaction monétaire régionale, par le biais d’accords d’échanges de devises. Dans le cadre d’un accord complémentaire entré en vigueur le 24 mars 2010, la cagnotte de l’institution a été portée à 120 milliards de dollars, dont deux enveloppes de 38,4 milliards apportées respectivement par la Chine et le Japon. Ce chiffre, à comparer avec celui du MES, est un indice de la faiblesse de la gouvernance économique asiatique.
La coopération asiatique est conditionnée à l’attitude des quatre géants économiques du continent, qui, quoique prudents, ne restent pas immobiles. La réunion tripartite des ministres des affaires étrangères chinois, japonais et sud-coréens, organisée à Kyoto le 19 mars 2011, avait initialement à son ordre du jour les questions de sécurité entre les deux Corées, mais elle a finalement été l’occasion de débattre des risques de retombées radioactives dans la région et des modalités du soutien au Japon. Quant à l’Inde, elle reste à l’écart du processus de rapprochement issu de l’initiative de Chiang Mai, notamment des sommets et des réunions ministérielles ASEAN+3.
Il n’en reste pas moins que l’intégration régionale par les faits est déjà à l’œuvre autour de la Chine. Le Japon, par exemple, en 2000, envoyait 30 % de ses exportations vers les Etats-Unis et 12 % vers la Chine ; la répartition est aujourd’hui équilibrée entre les deux pays et le rapport sera inversé en 2020. Il en va de même pour la Corée et Taiwan, dont 22 % des exportations sont aujourd’hui happées par la Chine.
L’ASEAN, entend aussi faire profiter l’ensemble de l’aire Asie-Pacifique de son expérience d’intégration économique en contractant des accords extérieurs : quatre zones de libre-échange sont entrées en vigueur le 1er janvier 20120, respectivement avec :
– la Chine ;
– l’Inde ;
– la Corée du Sud ;
– l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Enfin, le Japon a poussé à l’ouverture de négociations en vue de bâtir deux partenariats économiques globaux : le premier le lie aux dix membres de l’ASEAN ; l’autre, géographiquement exhaustif, inclue les treize membres de l’initiative de Chiang Mai plus l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Depuis la fin des années 1990, le poids de la Chine dans l’économie mondiale a plus que doublé. Après avoir détrôné le Japon sur la seconde marche du podium économique mondial, elle semble être irrésistiblement appelée, à moyen terme(58), à devenir la première puissance économique devant les Etats-Unis, dans un mouvement comparable à celui à l’œuvre au milieu du XIXe siècle et qui aboutît, dans les années 1870, au dépassement de l’économie britannique par l’économie américaine.
Alors que le monde se remet laborieusement de la crise financière mondiale, l’économie chinoise paraît en position de force. En 2005, le PIB de la Chine était inférieur de moitié à celui du Japon, mais il ne lui a fallu que cinq ans pour dépasser son concurrent asiatique. Les évolutions comparées entre les PIB de la Chine et de la France sont tout autant éclairantes : en 1991, la France produisait environ trois fois plus que la Chine ; en 2011, le rapport s’est presque inversé.
Année après année, au-delà de la niche des produits manufacturés bon marché, dans l’électronique ou le textile, qui ont déclenché son grand bond en avant des années 2000, elle conquiert une place de leader sur des marchés aussi divers et lucratifs que ceux de la joaillerie, de la maroquinerie et du prêt-à-porter de luxe, des grands vins, de l’art contemporain ou des transports aériens, au point qu’elle a également conquis le statut de premier pays exportateur mondial, devant l’Allemagne – mais elle n’a pas encore dépassé l’UE agrégée.
L’ouverture à l’économie de marché a stimulé l’activité intérieure et tiré les exportations, mais dans le cadre d’un contrôle étatique étroit sur les secteurs structurants de l’économie, des grandes entreprises d’Etat au secteur financier, et au prix du taux de consommation finale le plus bas du monde, à 35 % du PIB – partout ailleurs il excède 65 %.
Mais cette spécificité a aidé la Chine à faire montre d’une grande résilience à la crise. Comme lors de la crise asiatique de 1997, le système financier est apparu relativement protégé, de par la faiblesse de son intégration financière, notamment grâce au maintien du contrôle des changes. Une fois sauvés les établissements américains dans lesquels les investissements chinois étaient le plus exposés, les incertitudes pesant sur de grandes banques ont été partiellement levées.
Au total, la reprise de l’activité économique a surpris par sa rapidité et sa vigueur : la croissance a atteint 9,2 % en 2009, alors que les analystes anticipaient un taux compris entre 6 % et 7 % en début d’année, et même 10,4 % en 2010, portant le PIB à 5 878 milliards de dollars. Au premier trimestre de 2011, elle est tombée à 8,7 % en glissement annuel, à cause du ralentissement de la demande intérieure.
L’inflation suit une pente ascendante, s’établissant aux alentours de 5 % ces derniers mois, les prix des produits alimentaires et de l’essence enregistrant même une hausse à deux chiffres.
Les relations commerciales bilatérales s’appuient sur près de 1 400 entreprises françaises implantées en Chine et sur des grands contrats assortis de programmes de coopération, en particulier dans les secteurs de l’aéronautique, de l’espace, de l’énergie nucléaire et des transports terrestres et ferroviaires.
Après une stabilisation en 2008 et une forte baisse en 2009, les exportations françaises sont reparties à la hausse au premier semestre 2010. La Chine est le pays qui pèse le plus dans notre déficit commercial – 21,8 milliards d’euros –, devant l’Allemagne. Notre part de marché en Chine a reculé légèrement au cours des deux derniers exercices, pour atteindre 1,23 % fin 2010, contre près de 5 % pour l’Allemagne et un peu moins de 1 % pour l’Italie et le Royaume-Uni. La Chine est notre cinquième fournisseur et détient 6,5 % des parts du marché français.
La Chine investit de plus en plus dans les private equities, avec un double objectif :
– accélérer la montée en gamme de son appareil productif en prenant des parts dans des entreprises à fort contenu technologique ou en acquérant des marques ;
– rééquilibrer la balance des capitaux, l’excès de flux entrants exerçant une poussé à la hausse sur le yuan(59).
Le Royaume-Uni et la Chine réfléchissent également à encourager la création de produits financiers en yuan sur la place de Londres.
Dans les négociations internationales, les dirigeants chinois insistent énormément sur leur appartenance au Sud, censée justifier l’altérité de leur mode de développement et conférant à leur pays le statut de porte-parole naturel des émergents. Cette philosophie politique imprègne les propos tenus(60) le 14 mars 2011 par le premier ministre Wen Jiabao, responsable politique de haut rang le plus apprécié parmi la population : « La réforme et la construction de la Chine sont encore en cours. Nous ne considérons pas le développement de la Chine comme un modèle. […] la Chine est aujourd’hui la deuxième puissance économique mondiale, mais nous éprouvons clairement que la Chine possède une population nombreuse, une base économique faible et un déséquilibre de développement. […] La Chine est encore un pays en voie de développement. »
Il n’en demeure pas moins que des préférences objectives communes fortes se dégagent entre la Chine et la France, notamment sur les dossiers du changement climatique et de la régulation financière. Pas une semaine ne passe sans que la presse officielle chinoise – Le Quotidien du peuple, Le Week-end du Sud, l’agence Chine Nouvelle, etc. – ne publie des argumentaires ouverts voire favorables à l’agenda de la présidence française.
Le sixième recensement national, qui s’est achevé il y a deux ans, met en évidence les conséquences de la politique de l’enfant unique : la maîtrise de la courbe des naissances, en réduisant le nombre de bouches à nourrir, a permis d’accroître significativement le revenu par habitant et de faire sortir ce pays-continent du sous-développement, mais il est aujourd’hui menacé par le vieillissement : les plus de soixante ans représentant déjà 13,6 % de la population et, d’ici à quinze ans, ce taux devrait approcher les 25 %, comme en Europe. La population culminera en 2013 et la Chine perdra 60 millions de bras d’ici à 2060. Pour faire face à ce choc démographique, il faudra investir massivement en vue d’accroître la productivité dans des proportions significatives et faire monter les salaires, mais aussi cesser de contenir artificiellement la progression du yuan afin de forcer les entreprises chinoises à être plus efficaces et réduire l’inflation.
La vigueur de l’économie chinoise, préservée malgré la chute de la demande mondiale en 2009, ne doit pas occulter l’importance des défis socioéconomiques domestiques auxquels font face les autorités. Après trente ans de réformes qui ont entraîné la multiplication par huit du revenu moyen par habitant et un allongement sensible de l’espérance de vie, la crise économique et financière a marqué la fin d’un cycle du développement chinois ; il s’agit maintenant de faire évoluer le modèle de croissance, fondé sur des déséquilibres internes considérables.
Le pilotage économique du pays sera plus complexe que jamais car les politiques publiques, fondées sur le tout-investissement, et les plans de relance ont approfondi ces déséquilibres : tout secteur économique présentant un quelconque intérêt stratégique est contrôlé et surprotégé ; l’allocation du capital n’est pas optimale et crée des bulles, notamment dans le secteur de la construction immobilière et des travaux publics ; la rigidité du système de change oblige la banque centrale à convertir en yuan l’afflux de devises étrangères, attisant les tensions inflationnistes.
Un changement de gouvernance est prévu pour la fin de l’année 2012, vraisemblablement en octobre ou novembre, selon un schéma de succession répondant à des règles écrites – notamment d’âge – et dont les grandes lignes sont connues(61). D’autres défis non négligeables attendent le prochain exécutif :
– contention des nationalités ;
– lutte contre la corruption ;
– diffusion de meilleures pratiques dans la gouvernance de collectivités locales surendettées(62) ;
– équilibre entre maintien du contrôle social et ouverture aux normes démocratiques occidentales ;
– gestion sociale des paysans déracinés ;
– accès au logement dans les villes.
Dixième économie mondiale, l’Inde, tout à la fois puissance économique émergente de premier plan et démocratie installée – c’est la plus ancienne du Sud avec le Sri Lanka –, apparaît parfaitement qualifiée pour articuler un discours passerelle. Des cinq BRICS, c’est sans doute le pays le plus enclin à adhérer aux positions occidentales car il a bien digéré l’époque du colonialisme ; il adopte du reste, en général, des positions modérées à l’AGNU. Il ne faut cependant pas négliger les réactions anti-occidentales puissantes qui s’y expriment à l’occasion, lorsque ses intérêts nationaux sont en jeu, notamment lorsqu’il défend sa souveraineté territoriale ou sa capacité nucléaire militaire. La règle d’or du dialogue avec les émergents est de ce fait particulièrement valable avec les Indiens : plutôt que de leur suggérer une solution, un référent, une norme, il est préférable d’exposer la problématique, afin qu’ils se l’approprient, que des échanges s’instaurent et que les solutions s’imposent par la réflexion et le dialogue.
Ces dernières années, la croissance indienne a atteint des niveaux records : de 9 à 9,4 % par an entre 2005 et 2007, puis un léger fléchissement en 2009, avec 6,7 % par an en 2008 et 2009. D’ici à une vingtaine d’années, ce pays devrait devenir l’une des quatre premières économies mondiales. En effet, quoique souvent éclipsée par le succès économique fulgurant de la Chine, l’Inde décentralisée et démocratique ne sera pas confrontée, dans les décennies à venir, à des contradictions internes aussi sévères que l’empire du Milieu.
Son économie, longtemps fondée sur les activités de services à forte intensité de main-d’œuvre qualifiée, est désormais plus diversifiée. Par bien des aspects, l’Inde reste cependant un pays en voie de développement : le PIB par habitant est faible et, aux antipodes d’une classe moyenne dynamique représentant 5 à 10 % de la population, un Indien sur trois vit toujours avec moins de 1 dollar par jour, dans un environnement social obéissant toujours au système des castes.
Après un taux à deux chiffres au début de l’année 2010, la croissance a ralenti pour retrouver au quatrième trimestre de 2010 un rythme plus durable, quoique encore soutenu, portant le PIB à 1 538 milliards de dollars. L’activité économique risque toutefois de pâtir lourdement d’une inflation de plus en plus inquiétante(63), sous l’effet d’une conjonction de phénomènes :
– excès de l’offre par rapport à la demande dans presque tous les secteurs de l’économie ;
– pénurie de travailleurs qualifiés ;
– engorgement des capacités de production ;
– faiblesse des infrastructures de transport ;
– augmentation du prix des carburants.
L’UE est le principal partenaire commercial de l’Inde, avec des échanges en croissance rapide – les flux commerciaux ont doublé depuis 2000 et des négociations sont en cours pour signer un accord de libre-échange –, mais aussi le premier investisseur étranger en Inde, avec environ 20 % des investissements directs étrangers.
L’Inde, au moins officiellement, donne le primat au G20 sur tout autre groupe de pays pour les questions de régulation ; ce club s’impose de lui-même, dans la mesure où aucune autre structure ne serait en capacité de peser sur l’économie mondiale. Elle affirme considérer les rassemblements BRICS et IBSA comme des forums informels, permettant de procéder à des échanges de vues et d’identifier des valeurs partagées, mais n’ayant pas vocation à décider de la mise en œuvre de politiques commune. Elle voit le G20 comme une entité homogène, au sein de laquelle il serait délétère de constituer des sous-groupes d’intérêt, et constate que les pays qui, par le passé, en ont eu la velléité, étaient motivés par le fait de ne pas se sentir suffisamment présents ou écoutés dans les instances internationales.
Quinzième puissance économique mondiale et quatrième d’Asie, la Corée du Sud affichait un PIB en augmentation de 6,2 % en 2010, son taux de croissance le plus élevé depuis 2002 – la production de richesse nationale est passée pour la première fois au-dessus de la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars – et la banque centrale s’attend à une nouvelle hausse de 4,5 % en 2011.
Avec 895 milliards de dollars d’échanges commerciaux – soit un taux d’ouverture proche de 90 % –, la Corée du Sud est l’un des pays les plus exposés au monde.
L’UE, déjà deuxième marché pour les exportateurs coréens, est liée depuis le 1er juillet 2011 à la Corée du Sud par le pacte de libre-échange le plus ambitieux qu’elle ait jamais signé : d’ici à cinq ans, 98,7 % des droits de douane à l’importation appliqués réciproquement, couvrant tous les produits industriels et la plupart des produits agricoles – 11 200 produits coréens et 9 800 produits européens –, seront éliminés. Cet accord devrait entraîner, en vingt ans, d’une part, un doublement du commerce bilatéral – qui s’est élevé à 66,6 milliards d’euros en 2010, au léger avantage de la Corée du Sud – et, d’autre part, une économie annuelle de droits de douane de 1,6 milliard d’euros pour les exportateurs européens. De larges zones d’ombre demeurent cependant quant aux perspectives de mise en œuvre concrètes de cet accord en Corée du Sud, suspendu à l’adoption de décrets d’application nationaux, au point que la France, avec d’autres Etats membres, a dû saisir le Comité de politique commerciale (CPC) de l’UE.
Le premier ministre François Fillon se rendra en Corée du Sud les 22 et 23 octobre 2011, avec l’objectif de signer des partenariats industriels bilatéraux mais aussi pour préparer le sommet de Cannes.
La Corée du Sud a brillamment saisi l’opportunité diplomatique qui lui était offerte avec la présidence du G20 du second semestre 2010, en profitant d’une structure étatique très centralisée. Elle a su jouer un rôle de médiation active, d’une part entre la Chine et les Etats-Unis, d’autres part entre pays développés et émergents. L’opinion publique nationale a été largement sensibilisée à l’événement, avec une grosse couverture médiatique. La cellule constituée autour du président à cette occasion a cependant été dissoute depuis.
En toute logique, la Corée du Sud s’est montrée très attachée à ce que l’action de la présidence française s’inscrive dans la continuité des pistes tracées à Séoul le 12 novembre 2010, particulièrement sur les dossiers de la réforme du système monétaire international et de l’aide au développement. Dans un entretien au Monde, le 17 mai 2011(64), le président Lee Myung-bak mettait en avant cette seconde préoccupation : la Corée du Sud, passée de l’état de bénéficiaire de l’aide internationale à celui de donateur, souhaite que soit respectée la priorité donnée à l’enjeu du développement ; elle se montre particulièrement sensible à la situation de l’Afrique ainsi qu’à la sécurité alimentaire et énergétique des pays en développement.
Plus gros pays musulman du monde, l’Indonésie est la dix-huitième puissance économique mondiale. En 2010, la croissance y a atteint 6,1 %, après avoir fait preuve, en 2008 et 2009, d’une bonne résistance à la crise, grâce en particulier au dynamisme de la demande interne et à la dépendance relativement limitée du pays à la demande mondiale. Plus de la moitié de la population vit cependant avec moins de 2 dollars par jour. L’inflation, devenue un sujet de préoccupation en 2008, sous l’effet notamment des hausses des prix des matières premières et des denrées alimentaires, a été contenue à 2,8 % en 2009, mais a rebondi à près de 7 % en 2010.
Le groupe conjoint de représentants industriels, gouvernementaux et académiques chargé d’examiner la faisabilité d’un accord de libre-échange entre l’UE et l’Indonésie a rendu son rapport le 28 juin 2011. Il suggère une libéralisation, en neuf ans, de 95 % des lignes tarifaires du secteur des services. L’ambassadeur indonésien auprès de l’UE, Arif Havas Oegroseno, a émis le vœu que les négociations commencent dès cette année, en marge des réunions du G20.
Le premier ministre François Fillon s’est rendu à Djakarta les 1er et 2 juillet 2011 afin de conclure un partenariat stratégique initié en 2009. Il a indiqué que la France, seulement treizième fournisseur de l’Indonésie aujourd’hui – avec 1 % de part de marché mais une progression, l’an dernier, de 16 % du commerce bilatéral, à 2,4 milliards d’euros –, avait pour objectif, d’ici à cinq ans, de doubler les échanges bilatéraux avec ce pays de 240 millions d’habitants très courtisé par ses voisins asiatiques, notamment la Chine, la Corée du Sud et Singapour.
En dépit de sa taille, l’Indonésie joue un rôle modeste dans le G20, tandis que Singapour, son petit voisin, autre membre de l’ASEAN et place financière majeure, n’a pas hésité à s’imposer à la table des négociations en organisant autour d’elle le groupe de pression du 3G, avec succès, puisque la présidence française l’a invitée au sommet de Cannes.
D’une superficie quatorze fois supérieure à celle de la France, l’Australie, avec ses 21,4 millions d’habitants, est la treizième économie mondiale. Depuis 1991, la croissance annuelle moyenne y a été de 3,5 %. Elle a bien résisté aux conséquences de la crise mondiale et a même achevé 2009 avec plus 3 % et 2010 avec plus 3,2 %, grâce à trois plans de relance successifs d’un montant total de 36,5 milliards d’euros, débloqués entre octobre 2008 et février 2009. Un taux de croissance de 3,1 % est attendu en 2011, en dépit d’un recul d’1,2 %, au premier semestre, à cause des inondations et du cyclone Yasi.
C’est l’un des pays les plus ouverts aux investissements directs étrangers, qui représentent 34 % du PIB, pour une moyenne de 23 % au sein de l’OCDE, et 2 % des stocks mondiaux. L’UE y est le premier investisseur étranger, à hauteur de 36 %, devant les Etats-Unis, 30 %, et le Japon, 7 %.
En ce qui concerne le commerce international, l’insertion de l’Australie dans la zone Asie-Pacifique tend à s’accentuer. La croissance australienne est par conséquent très dépendante de celle des émergents asiatiques, en particulier de la Chine, qui est devenue son premier fournisseur et son deuxième client, derrière le Japon. Mais les exportations vers la Chine s’accroissent de 25 % chaque année, l’Australie profitant du rendement de ses richesses minières.
En 2010, avec un taux de croissance de 7,5 %, grâce en particulier à l’essor irrésistible de son agriculture, le Brésil a soufflé à l’Italie la place de septième puissance économique mondiale, un an seulement après avoir dépassé la Russie. D’après les estimations gouvernementales, l’économie brésilienne devrait encore croître de 4,5 % à 5,5 % en 2011 et sur un rythme moyen annuel de 5,8 % entre 2012 et 2014.
Le Brésil s’affirme comme la nouvelle ferme du monde : déjà premier producteur et exportateur mondial de sucre, de café et de jus d’orange, ainsi que premier exportateur de bœuf, de soja et de tabac, il devrait devenir le premier producteur mondial de denrées agricoles d’ici à 2025 au plus tard – alors qu’il était encore importateur net cinquante ans plus tôt.
Cette progression, fondée sur l’augmentation de la demande agricole mondiale, s’effectue en optimisant tous les atouts du pays :
– une superficie quinze fois supérieure à celle de la France, avec d’énormes réserves de terres cultivables ;
– une grande variété de climats permettant de diversifier les cultures ;
– une augmentation prononcée de la productivité(65), grâce au niveau élevé des investissements dans la recherche, à l’intensification, à la mécanisation, aux doubles récoltes et au recours important aux herbicides, aux phytosanitaires et aux organismes génétiquement modifiés (OGM).
Le 26 juin 2011, alors que le monde avait les yeux tournés vers la campagne pour la succession de Dominique Strauss-Kahn à la direction générale du FMI, les 190 membres de la FAO – 189 pays plus l’UE – portaient de justesse à sa tête le Brésilien José Graziano da Silva, qui y représentait jusqu’à présent l’Amérique latine et les Caraïbes. Cet ancien ministre de la sécurité alimentaire sous le président Lula a coordonné avec succès la conception et la mise en œuvre, à partir de 2003, d’un programme national destiné à éradiquer la malnutrition au Brésil, baptisé « Faim zéro ».
Mais d’autres facteurs contribuent à la croissance brésilienne, qui portent la marque du président Lula, resté au pouvoir de 2003 et 2011 :
– l’ajustement du marché du travail au cycle économique ;
– la stabilité de l’emploi et du pouvoir d’achat des revenus les plus faibles ;
– la mise en œuvre de politiques contracycliques ;
– la réduction du risque souverain ;
– la stabilité politique, l’héritière désignée de Lula, Dilma Rousseff, ayant été investie le 1er janvier 2011 après avoir remporté le scrutin présidentiel avec 56 % des voix.
Le Brésil, au cours des dernières années, a su rééquilibrer ses débouchés d’exportation en accroissant la part des nouveaux marchés : ses ventes vers la Chine ont été multipliées par quinze en valeur entre 2000 et 2008, avec une progression de 75 % rien qu’en 2008. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Brésil, du côté des exportations comme des importations, avec 13,1 % – sauf si l’on considère l’UE à vingt-sept, qui représente 26,5 % des échanges –, devant les Etats-Unis et l’Argentine.
Fin 2005, les autorités brésiliennes ont remboursé par anticipation 15,6 milliards de dollars de dettes envers le FMI et 2,6 milliards envers le Club de Paris, témoignant de leur souci de crédibilité et de respect des grands équilibres macroéconomiques. Profitant de la forte croissance économique mondiale entre 2005 et 2008, qui a maintenu les prix des matières premières à des niveaux favorables aux pays exportateurs, le Brésil est sorti du piège de la dette externe.
Même s’il reste fragilisé par le poids de sa dette globale intérieure, qui approche 60 % du PIB, le Brésil, qui a fait preuve d’une forte résilience à la dernière crise financière et économique internationale, terminant l’exercice 2009 avec une croissance très légèrement négative de moins 0,6 %, peut miser, pour l’avenir, sur une panoplie d’atouts :
– son dynamisme agricole ;
– ses richesses naturelles, auxquelles se sont ajoutées des gisements de pétrole et de gaz offshore découverts récemment, susceptibles de générer d’importantes ressources ;
– son attractivité pour les investissements étrangers.
Le 30 mars 2011 – le lendemain même d’une dégradation par l’agence de notation Standard & Poor’s de la note des obligations souveraines du Portugal –, la présidente Dilma Rousseff envisageait publiquement que le Brésil rachète une partie de la dette souveraine portugaise. Tout un symbole : un pays émergent se propose de secourir l’ancienne puissance coloniale pour « participer à la reprise de [son] économie ».
La crise européenne et le G20 sont d’ailleurs deux des sujets principaux à l’ordre du jour du 5e sommet UE-Brésil, qui se tient depuis hier soir, 3 octobre 2011, à Bruxelles.
Considérant que le G8 n’est pas représentatif de la réalité mondiale, le Brésil a toujours été très favorable au G20. Il le considère néanmoins comme un instrument provisoire ; l’ONU, qui porte une vision holistique du monde, aurait vocation à prendre le relais lorsqu’elle sera parvenue à se réformer pour gagner en efficacité. Au demeurant, l’agenda de la présidence française a incité le Brésil à s’impliquer fortement dans les discussions préalables au sommet de Cannes, car le dossier des prix des matières premières agricoles l’intéresse au plus haut point.
Quatorzième puissance économique mondiale et membre de l’OCDE, le Mexique assumera la présidence du G20 en 2012(66). C’est l’une des économies les plus ouvertes de la région puisqu’elle est liée par des accords de libre-échange avec une quarantaine de pays, à commencer par les Etats-Unis et le Canada, à travers l’ALENA.
Le Mexique a été le pays latino-américain le plus touché par la crise de 2009 et par les effets de la pandémie grippale, qui lui a fait perdre à elle seule environ 1 point de PIB. Au total, la production de richesses a reculé de 6,1 % en 2009, contre une moyenne latino-américaine de plus 3 %. Le redressement a été manifeste dès 2010, avec un rebond de plus 5,5 %, favorisé par le réveil de la demande américaine, l’amélioration de la confiance des entreprises et la normalisation des conditions financières. Il devrait toutefois se tasser, avec des taux de croissances de 4,5 % en 2011 et de 4 % en 2012.
En 2010, le déficit budgétaire s’élève à 2,8 % du PIB, le solde courant à 0,6 % et la dette publique à 39 %.
Le Mexique est le onzième pays récepteur d’investissements directs étrangers à l’échelon mondial. Il peut se prévaloir d’institutions politiques stables, d’une banque centrale relativement indépendante, d’une politique macroéconomique prudente. C’est aussi le dixième producteur mondial de pétrole et les recettes de ce secteur représentent 40 % des ressources totales de l’Etat ; la chute accusée par les investissements entraîne cependant une diminution de la production.
Le partenariat stratégique conclu par l’UE avec le Mexique en 2008 a été officiellement lancé le 18 mai 2010, à Madrid, lors du sommet UE-Amérique latine et Caraïbes. Son objectif est de stimuler la coopération sur des grands sujets d’intérêt commun comme la lutte contre le changement climatique, la défense des droits de l’homme, les migrations ou les questions de sécurité et de répression des trafics. Il fait du Mexique le seul pays émergent bénéficiant à la fois d’un accord d’association et d’un accord de partenariat stratégique avec l’UE mais il reste à mettre en œuvre.
Les relations bilatérales franco-mexicaines sont toutefois obscurcies par l’affaire Florence Cassez, qui, dans un contexte d’augmentation de la criminalité organisée en lien avec le trafic de cocaïne, mobilise l’opinion publique contre la France et a conduit le président Felipe Calderon à annuler purement et simplement l’année du Mexique en France. Pour préparer le passage de relais entre les présidences de 2011 et de 2012(67), M. Calderon a néanmoins été chargé, avec la chancelière allemande Angela Merkel, de piloter le groupe de travail international préparatoire au sommet de Cannes consacré à la réforme du système monétaire international, qui sera sans nul doute le dossier nodal des années à venir.
L’Argentine n’est que la vingt-septième puissance économique mondiale – son PIB équivaut à la moitié de celui de l’Espagne – mais aussi le second pilier du Marché commun du Sud (MERCOSUR), avec le Brésil. Sa présence au G20 permet d’assurer une représentation équilibrée entre les Amériques et l’Europe, qui disposent chacun de cinq sièges permanents.
Après la crise dévastatrice de 2002, qui avait entraîné une chute du PIB de 10,9 %, l’Argentine a su rétablir une structure macroéconomique satisfaisante. Depuis lors, elle a connu une croissance rapide et stable – 8,5 % en moyenne de 2003 à 2008 et 9 % en 2010 –, grâce à l’augmentation considérable des prix des matières première agricoles, qui représentent 55 % de ses exportations, et à une politique d’accroissement des dépenses publiques pour soutenir la demande interne.
Le solde de sa balance commerciale est positif, avec un surplus de 16,9 milliards de dollars, soit 5,5 % du PIB. Le ratio dette/PIB baisse continuellement grâce à la croissance et à la quasi-stabilisation de l’endettement en valeur absolue. Enfin, les réserves de la banque centrale sont passées de 20 milliards de dollars en 2004 à 48 milliards en 2009. Le seul point négatif de l’économie argentine demeure l’inflation, estimée officiellement à 8 % mais qui, selon des experts indépendants, atteindrait 25 %.
L’Argentine, après la crise de 2002, s’était placée en marge de la communauté financière internationale, mais la situation a évolué en 2010 : les autorités ont réussi à négocier un plan de restructuration de la dette privée, prenant la forme d’un rachat de dette assorti d’une décote de 65 %, qui a été accepté en septembre 2010 par 92 % des créanciers. Par ailleurs, des négociations ont commencé, en décembre 2010, dans le cadre du Club de Paris, pour le remboursement de la dette publique.
Le dialogue bilatéral avec l’UE repose sur un accord cadre de coopération commerciale et économique datant de 1990. L’Argentine souhaiterait pouvoir bénéficier d’un agrément bilatéral incluant des mesures de libéralisation des échanges, mais l’UE le réserve au MERCOSUR.
L’Argentine s’est associée à la préparation du sommet de Cannes à travers l’organisation de deux séminaires d’experts à Buenos Aires : le premier, les 19 et 20 mai 2011, consacré à la volatilité des prix des matières premières ; le second, le 12 juillet 2011, sur les thèmes du travail et de l’emploi.
La présidente Cristina Fernandez de Kirchner remettra son mandat en jeu à la veille du sommet de Cannes – le premier tour du scrutin aura lieu le 23 octobre 2011 – mais sera quoi qu’il en soit présente à Cannes, l’investiture n’ayant lieu que quelques semaines plus tard.
La Turquie, avec un PIB de 742 milliards d’euros, est la dix-septième puissance économique mondiale. Compte tenu du resserrement des conditions du crédit, la croissance, après y avoir avoisiné 9 % en 2010, devrait redescendre à 6,5 % en 2011 et à 5,3 % en 2012.
L’investissement du secteur privé et la consommation des ménages ont été les principaux moteurs de la reprise, alors que la demande publique restait modérée et que les exportations laissaient à désirer. La confiance robuste des entreprises et des consommateurs, ainsi que l’augmentation de la production industrielle et des importations de biens d’équipement, contribuent à un dynamisme persistant en 2011.
Entre les premiers trimestres de 2010 et de 2011, l’inflation a chuté de 9,6 % à 4 %, point bas historique dû à un effet de base favorable et à la modération des prix des services. Mais l’inflation globale est lourdement influencée par la volatilité des prix des denrées alimentaires, dont la reprise devrait peser négativement.
L’année 2009 avait été marquée par une forte chute de l’activité : le PIB s’est effondré de 13,9 % au premier trimestre – la plus forte baisse enregistrée par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale – et de 6 % sur l’ensemble de l’exercice. Mais la récession a eu des effets collatéraux positifs sur deux points traditionnellement faibles de l’économie turque : d’une part, l’inflation a été jugulée à 7,5 % ; d’autre part, le solde négatif de la balance des transactions courantes a baissé de 42 milliards à 11 milliards de dollars, en raison d’une contraction substantielle du déficit de la balance commerciale. En outre, le secteur bancaire turc, assaini après la crise de 2001, a cette fois-ci été épargné.
Malgré ses efforts pour renforcer ses relations avec les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient et du Maghreb(68), la Turquie demeure dépendante commercialement de l’Union européenne, qui attire près de la moitié de ses exportations.
Indice de l’importance qu’elle lui accorde, la Turquie, comme la Russie, a candidaté à la présidence du G20 pour 2013.
Toutefois, après le Mexique, c’est le second membre du G20 avec lequel les relations avec note pays sont contextuellement difficiles. La Turquie reproche à la France l’activisme de certains de ses parlementaires en faveur de la reconnaissance du génocide arménien, notamment par le biais de lois mémorielles, et surtout son opposition à l’adhésion de la Turquie à l’UE. Cela complique les entreprises de coordination franches entre les deux pays, y compris dans le cadre du G20. La visite du Président de la République à Ankara, le 25 février 2011, qui était destinée à trouver des points de convergence avec le président Abdullah Gül et le premier ministre Recep Tayyip Erdogan, a surtout été l’occasion, pour eux, d’exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la France, un mécontentement qui trouve un écho parmi la plupart des mouvements d’opinion du pays, au-delà de l’obédience islamo-conservatrice au pouvoir depuis 2002, qui vient de remporter à nouveau les élections législatives. L’incompréhension réciproque est devenue telle que les autorités turques envisagent désormais de renoncer à leur demande d’adhésion.
L’Arabie saoudite, quoique seulement vingt-troisième puissance économique mondiale avec un PIB de 444 milliards d’euros, est membre du G20, eu égard à sa place centrale vis-à-vis du monde arabo-musulman et de son statut de principal pays producteur et exportateur de pétrole – c’est au demeurant le seul pays arabe et le seul pays de l’OPEP(69) représenté dans le cénacle. De surcroît, les principaux conflits de moyenne intensité à résonance mondiale, qu’il s’agisse de l’Irak, de l’Afghanistan ou de la Libye, étant localisés au Moyen-Orient ou à ses frontières immédiates, cette zone a une importance stratégique ; elle fut d’ailleurs au cœur des discussions du sommet de Deauville du G8(70).
Le niveau des prix du pétrole conditionne largement l’évolution de l’activité économique de l’Arabie saoudite, plutôt favorable depuis le début de l’année 2011. L’Etat devrait donc disposer, cette année, de ressources amplement suffisantes pour poursuivre sa politique de stimulation de l’économie par la dépense publique. Pour autant, il apparaît impératif, pour stabiliser l’économie du pays, de rechercher de nouvelles sources de revenus non pétroliers, ce qui réduirait l’impact budgétaire des variations du prix du baril, mais aussi de poursuivre le processus de « saoudisation » des emplois, de mieux s’insérer dans l’économie mondialisée, d’attirer davantage d’investissements étrangers et de développer l’industrie touristique.
L’Arabie saoudite dispose de la plus grande quantité de réserves pétrolières – 264 milliards de barils, soit un quart du total mondial – et tient de ce fait une place incontournable dans l’approvisionnement des grandes puissances industrielles. Elle assure ainsi près de 10 % des achats de la France.
Avant la crise internationale, l’Arabie saoudite s’est engagée dans un programme d’investissement gigantesque de 500 milliards de dollars à l’horizon 2025, qui s’inscrit dans une démarche de développement économique, social et culturel du royaume, indispensable pour prendre en considération les aspirations d’une population très jeune, comme dans l’ensemble du monde arabe.
Le « printemps arabe » a épargné le pays, sans doute à cause du contrôle social très pointilleux et de la prospérité de la population – tout du moins des citoyens saoudiens, les travailleurs immigrés, qui représentent un tiers de la population, étant cantonnés aux emplois subalternes et ne bénéficiant pas de la manne pétrolière. Il a néanmoins conduit à l’envoi de troupes saoudiennes à Bahreïn, le 14 mars 2011, dans le cadre du CCG, pour aider la dynastie sunnite des Al Khalifa à réprimer violemment le soulèvement de la majorité chiite.
L’économie de l’Arabie saoudite ayant besoin d’un environnement international stable, il est à noter que, dans le cadre du G20, la France peut compter sur elle pour soutenir les propositions régulatrices, concernant les marchés financiers et les prix des matières premières agricoles.
La République d’Afrique du Sud, vingt-huitième puissance économique mondiale avec un PIB de 357 milliards de dollars, est le seul pays d’Afrique siégeant au G20 à titre permanent, mais aussi le seul à siéger actuellement au Conseil de sécurité des Nations unies. Il n’arrive qu’au cinquième rang du continent pour ce qui concerne la population et au neuvième pour ce qui concerne la superficie mais présente le meilleur résultat en matière de PIB – il concentre à lui seul un cinquième du PIB de l’Afrique sub-saharienne – et le quatrième en matière de PIB par habitant, derrière trois tout petits pays, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Botswana. Il a été « repêché » au G20, en quelque sorte, pour que le continent africain n’en soit pas totalement exclu.
Après quelques années de croissance élevée – plus 5,4 % en 2006 et plus 5,1 % en 2007 –, tirée par le dynamisme des investissements et une consommation privée dopée par la croissance du crédit, l’Afrique du Sud a connu le même mouvement que le reste du monde : un net ralentissement dès 2008, avec plus 3,1 %, puis une récession de 1,8 % en 2009. Ce repli n’a toutefois duré que deux trimestres et la croissance s’est située à 2,8 % en 2010. Les prévisions de croissance pour 2011 sont de l’ordre de 3,5 %.
Le secteur financier sud-africain est solide et reste profitable, d’autant que l’exposition directe des banques sud-africaines à la crise a été très limitée, grâce à une régulation stricte.
Nos ventes vers l’Afrique du Sud ont progressé de 31,4 % en 2010, atteignant 1,73 milliard d’euros. L’Afrique du Sud reste notre premier client d’Afrique sub-saharienne, devant le Nigeria et la Côte d’Ivoire, mais nous ne sommes que son neuvième fournisseur – loin derrière l’Allemagne, qui se classe en deuxième position –, avec 3,1 % de part de marché. Nos achats en provenance d’Afrique du Sud, de leur côté, ont augmenté de 24 %, à 1,05 milliard d’euros. Au total, en 2010, la France a donc dégagé un excédent commercial de 686 millions.
Le pays s’apprête à accueillir le 17e sommet sur le climat, du 28 novembre au 9 décembre 2011, à Durban ; le 4e sommet bilatéral UE-Afrique du Sud, qui s’est tenu le 15 septembre 2011 au parc national Kruger, a été largement consacré à ce sujet.
Au final, seule l’Afrique, faisant les frais de son sous-développement, de son émiettement géographique et des problèmes de mauvaise gouvernance et d’instabilité politique qui affectent la plupart de ses grands pays, est sous-représentée au G20. La politique des invitations constamment suivie depuis 2008 et clairement explicitée à Séoul(71) tend cependant à compenser ce déséquilibre.
Dans le même esprit, afin de mettre en lumière le rôle de l’Afrique dans les affaires mondiales, le premier ministre canadien Stephen Harper avait officiellement invité six pays africains – l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Egypte, l’Ethiopie, le Malawi, le Nigeria et le Sénégal – à participer à une réunion spéciale du sommet du G8, les 25 et 26 juin 2010, à Huntsville.
Bien qu’il reste encore à la marge de la scène internationale, le continent le plus pauvre du globe tire profit de la multipolarité.
L’Afrique se dessine comme une destination émergente intéressante pour les investisseurs car, avec plus d’1 milliard de consommateurs et potentiellement plus de 2 milliards à l’horizon de 2050, elle recèle des opportunités énormes de croissance à long terme. La croissance africaine – 6 % par an –, supérieure à la croissance mondiale, est portée par des processus de réformes économiques et politiques, menées à des rythmes différents selon les pays mais suivant une tendance irrésistible. L’augmentation de la consommation atteint même 16 % par an. Avec une croissance interne de plus en plus appuyée sur les secteurs secondaire et tertiaire, le niveau de production de l’Afrique dépend moins des matières premières agricoles et des minerais.
Le mouvement est déjà sensible. Le nombre de nouveaux projets d’investissements directs étrangers a bondi de 338 en 2003 à 633 en 2010. Les premiers investisseurs étrangers sont les émergents asiatiques, tandis que l’Europe et les Etats-Unis se montrent nettement plus timides. Derrière les industries excavatrices – produits pétroliers, or, charbon, etc. –, domaine d’investissement stratégique pour des pays à forte croissance gourmands en matières premières, commencent à émerger d’autres secteurs, comme le tourisme, les produits de consommation courante, le bâtiment et les travaux publics, les télécommunications et les services financiers.
Le facteur démographique est trop souvent négligé dans les analyses, alors qu’il pèse pour environ un tiers de la croissance, la productivité intervenant pour les deux autres tiers. Or la transition démographique n’est nettement engagée qu’au Maghreb, alors que le taux de natalité atteint toujours cinq ou six enfants par femme dans certains pays d’Afrique noire.
Ces potentialités s’accompagnent d’un activisme diplomatique de la part des grands émergents – Chine, Inde, Turquie, Brésil ou encore Corée du Sud –, qui cherchent à sortir de ce que les observateurs ont naguère qualifié d’« aide crapuleuse »(72) et à bâtir des coopérations de longue haleine.
La Chine est très en avance : appuyée sur un réseau diplomatique et économique très offensif, elle a investi 2,5 milliards de dollars par an sur la période 2006-2008, en construisant des infrastructures, notamment des autoroutes, en échange de contrats d’approvisionnements en hydrocarbures ou en matières premières.
L’Inde, misant quant à elle sur la valorisation de son expérience de sortie du sous-développement, a mis sur pied un système en vue de permettre à quarante-sept pays africains d’accéder à son savoir-faire dans les domaines de la santé et de l’enseignement supérieur(73). Elle octroie en outre 20 000 bourses à des étudiants africains pour les faire venir étudier en Inde et elle finance des centres de formation professionnelle en Afrique. Le deuxième sommet Afrique-Inde s’est tenu les 24 et 25 mai 2011, à Addis-Abeba, siège de l’UA, en présence du premier ministre indien Manmohan Singh et d’une quinzaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains.
Quant à la Turquie, qui a multiplié par dix, en dix ans, ses échanges commerciaux avec l’Afrique, elle investit massivement dans la diplomatie à destination de ce continent, en développant de façon exponentielle son réseau d’ambassades et en y participant à cinq missions de maintien de la paix ainsi qu’à la flottille internationale de lutte contre la piraterie. Elle envisage même de constituer une zone de libre-échange avec la Communauté est-africaine(74).
Ce phénomène contribue au développement des échanges Sud-Sud, qui redessinent la carte du commerce international.
Reste que des liens puissants continuent d’unir l’Afrique et l’Europe, au travers du tissu des relations bilatérales – particulièrement entre les anciennes puissances coloniales et leurs dépendances – mais aussi des relations interinstitutionnelles entre la Commission européenne et la Commission de l’UA. Au terme de leur cinquième réunion annuelle commune, les 31 mai et 1er juin 2011 à Bruxelles, elles ont publié une déclaration réaffirmant que, « dans un monde de plus en plus intégré, nos futurs sont inéluctablement liés » et insistant sur les priorités de la croissance et du développement durable, mais aussi de la démocratie, de la liberté et de la justice sociale(75).
Compenser la sous-représentation de l’Afrique dans le G20 par l’admission d’un ou de plusieurs autres Etats serait délicat. En effet, comment sélectionner parmi les nombreux candidats éligibles ? Une solution juste et pleine de sens consisterait à intégrer en bonne et due forme les associations régionales déjà systématiquement invitées aux sommets du G20.

Intégrer au G20 l’Union africaine (UA) et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en tant que membres à part entière.
Le président de la Commission de l’UA et le chef d’Etat ou de gouvernement du pays exerçant la présidence du NEPAD siégeraient en leur nom, au même titre que les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen.
II. LES SOMMETS PRECEDENTS DU G20
OFFRENT UN BILAN CONTRASTE
MAIS ILS ONT CONTRIBUE A FAIRE EVOLUER LES ESPRITS
A l’issue de chaque sommet, des principes sont énoncés dans une « déclaration » portant la signature des vingt chefs d’Etat et de Gouvernement participant au G20. Sans créer de « droit dur » opposable aux agents économiques – car le G20 n’est pas un gouvernement mondial –, ils constituent autant de jalons dans l’œuvre collective de régulation mondiale.
La mise en musique de ces orientations par les autorités nationales étant longue et les sommets s’étant succédé à intervalles rapprochés, il est à noter que, d’un rendez-vous à l’autre, les conclusions sont souvent redondantes. Faut-il y voir la preuve de l’échec de l’exercice ou le signe que le G20, malgré son caractère informel, est déjà un processus continu ?
a) Washington, novembre 2008 : se mobiliser pour éteindre le feu sur les marchés financiers et l’économie mondiale
Le sommet fondateur de Washington a été qualifié abusivement, à l’époque, de « Nouveau Bretton Woods » ou « Bretton Woods II ». Or il n’y a en fait nullement été question de réformer le système monétaire international. Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, il ne débouche sur aucune décision spectaculaire ni même opérationnelle – c’est d’ailleurs une constante, qui tient à l’essence du G20 – mais uniquement sur des orientations. La presse en rend compte, à l’époque, en des termes fort circonspects : « Faute d’initiative majeure, le sommet de Washington a jeté les bases d’une réforme en douceur des institutions financières internationales sur fond de coordination des régulateurs sur la prévention et le règlement des crises »(76).
Les chefs d’Etat et de gouvernement se disent tout de même déterminés, dès le premier alinéa de la déclaration finale, « à renforcer [leur] coopération et à travailler ensemble pour restaurer la croissance mondiale et réaliser les réformes nécessaires dans les systèmes financiers du monde ». Ils tombent d’accord pour identifier les causes premières de la crise et fixent un plan d’action exceptionnel destiné à éviter l’effondrement du système financier et de l’économie mondiale, autour de cinq thèmes :
– remise à plat de la régulation ;
– harmonisation des normes comptables ;
– amélioration de la transparence des marchés ;
– révision des pratiques de rémunération des dirigeants de banque ;
– réforme du mandat et de la gouvernance des institutions financières internationales.
Le G20 cherche d’emblée à s’affirmer comme la première enceinte de coordination des politiques économiques. Son plan d’action se décline en une série de quarante-sept points disparates mais ayant pour point commun de chercher à stabiliser le système financier en crise. Leur réalisation, programmée pour le 31 mars 2009 au plus tard, est confiée aux ministres des finances, aux régulateurs et superviseurs nationaux ainsi qu’aux organisations internationales.
Voici les principales actions prévues :
– relance concertée et coordonnée de la croissance par des mesures fiscales et budgétaires ;
– renforcement de la gouvernance mondiale et de la coordination entre régulateurs nationaux, qui constituent la première ligne de défense contre les instabilités de marché ;
– lutte contre les obstacles à l’investissement et au commerce des biens et des services ;
– arrêt des stimulations des exportations contraires aux règles de l’OMC ;
– renforcement de la coopération transfrontalière ;
– amélioration de la transparence des marchés financiers et bancaires ;
– intensification des efforts pour réduire les risques systémiques liés aux credit default swaps(77) (CDS) et aux transactions de gré à gré sur produits dérivés ;
– gestion effective des risques inhérents aux produits structurés et titrisés ;
– contrôle plus étroit pour protéger les marchés et les investisseurs contre la manipulation des marchés et de la fraude ;
– mise en œuvre d’un programme d’évaluation du secteur financier (PESF) ;
– contraintes renforcées pour améliorer les pratiques des banques en matière de gestion de risque ;
– obligation de faire entrer les transactions dans une base de donnée ;
– recherche d’une conclusion ambitieuse au cycle de Doha.
Sous l’impulsion de la France, qui occupe alors la présidence tournante du Conseil européen, l’UE joue un rôle leader : « C’est de l’Europe qu’est parti le processus de moralisation et de régularisation du système financier international » soulignera quelques jours après le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Les orientations du G20 feront du reste l’objet d’un plan d’action européen, adopté par le Conseil.
Les Américains, pour leur part, insistent pour encadrer strictement la portée du G20, qui ne doit pas empiéter sur la souveraineté nationale, en faisant inscrire, comme premier « principe commun » : « La régulation relève avant tout de la responsabilité des régulateurs nationaux, qui constitue la première ligne de défense contre les instabilités des marchés. »
A Londres, les chefs d’Etat et de gouvernement confirment, sur l’agenda mondial, le renforcement de la régulation et de la supervision du secteur financier. L’objectif est d’améliorer la transparence et l’intégrité des marchés financiers, y compris en développant la coopération internationale en la matière. Ils rendent public un rapport de suivi portant sur les quarante-sept points du plan d’action de Washington ainsi qu’une annexe à la déclaration finale, exclusivement consacrée au « renforcement du système financier ».
Le rétablissement de la croissance passe par l’engagement d’un plan de relance budgétaire sans précédent, qui s’élève à 5 000 milliards de dollars. Les banques centrales s’engagent à poursuivre la politique de réduction des taux d’intérêt déjà entamée dans la plupart des pays du G20.
En ce qui concerne la réglementation prudentielle, les banques devront clarifier leur bilan, les objectifs étant d’adopter progressivement les normes de Bâle II et d’harmoniser les définitions nationales des fonds propres d’ici à la fin 2009. Le Comité de Bâle de contrôle bancaire(78) est chargé, entre-temps, de formuler des recommandations en vue de revoir les exigences minimales à échéance de 2010.
Un cadre mondial tendant à renforcer les réserves de liquidités au sein des institutions financières nationales et transnationales d’ici à fin 2010 est institué. En période de croissance, les banques devront constituer des réserves, dans lesquelles elles pourront puiser en période de crise, facilitant ainsi les opérations de prêt en cas de détérioration de la situation économique.
Le FSF, chargé de mettre en garde contre les risques systémiques se formant sur les marchés, prend l’appellation de Conseil de stabilité financière(79) (CSF). Sa base institutionnelle est solidifiée et sa capacité renforcée. Le CSF collaborera avec le FMI pour être en mesure de donner des alertes précoces sur les risques macroéconomiques. Il rendra compte au CMFI d’une part, aux gouverneurs de banque centrale d’autre part. L’ensemble des membres du G20, la Commission européenne ainsi que l’Espagne seront représentés dans cette nouvelle instance.
Un nouveau régime de surveillance est créé pour les entités non régulées. Les Etats membres devront soumettre les hedge funds à une obligation d’enregistrement et les contraindre à fournir des renseignements sur leur niveau d’endettement afin que soit évalué le risque systémique qu’ils font courir. Le caractère systémique des marchés, des institutions financières et des instruments sera défini par le FMI et le CSF.
Les organismes édictant les normes comptables, en particulier le Bureau des standards comptables internationaux(80) (BSCI), amélioreront celles relatives à la valorisation des instruments financiers, en collaboration avec les superviseurs nationaux, afin d’en réduire la complexité.
Les agences de notation seront mieux surveillées et la qualité de leurs évaluations devra être plus transparente. Elles devront systématiquement être enregistrées auprès des autorités et se mettre en conformité avec le code de bonne conduite de l’Organisation internationale des commissions de valeurs(81) (OICV). Une échelle de notation spécifique est prévue pour les produits complexes. Le Comité de Bâle poursuivra son action de contrôle des notations.
Pour les rémunérations et les bonus, les principes définis par l’ancien FSF sont retenus. Les conseils d’administration joueront désormais un rôle dans la conception, le fonctionnement et l’évaluation des régimes de rémunération. Le versement des bonus devra mieux refléter les risques. Toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires, devront être informées des régimes de rémunération, afin d’exercer un contrôle plus étroit.
Les institutions financières internationales doivent être réformées en profondeur. Cela commence par un triplement des ressources du FMI, à travers de nouveaux accords d’emprunt, et l’élargissement de ses missions. Les nominations des dirigeants et hauts responsables des institutions financières internationales devront suivre un processus de sélection plus transparent. Enfin, pour accroître la liquidité mondiale, une allocation de 250 milliards de dollars de DTS est accordée.
Les pays du G20 réitèrent leur volonté de promouvoir l’investissement et le commerce mondiaux. Ils émettent le vœu que l’OMC aboutisse à une « conclusion ambitieuse et équilibrée du cycle de développement de Doha », ce qui serait censé stimuler l’économie mondiale à hauteur de 150 milliards de dollars par an.
Concernant les juridictions non coopératives – paradis fiscaux et centres financiers offshore(82) –, le G20 souhaite que le temps du secret bancaire soit révolu. Sous l’impulsion de la France et de l’Allemagne, il prend acte de la publication par l’OCDE d’une liste de territoires qui se dispensent de respecter les normes internationales dans le domaine fiscal. Le principe de transparence oblige les Etats à transmettre toute information permettant d’enquêter sur d’éventuelles évasions fiscales. Une série de « contre-mesures » est prévue contre les administrations ne respectant pas les normes internationales de transparence fiscale :
– renforcer les exigences de divulgation visant les contribuables et les institutions financières ;
– retenir à la source des impôts rattachés à un vaste éventail de paiements ;
– refuser d’accorder des déductions se rapportant à des dépenses de bénéficiaires résidents d’une administration non coopérative ;
– réexaminer les politiques en matière de convention fiscale ;
– demander aux institutions internationales et aux banques multilatérales de développement de revoir leurs politiques d’investissement ;
– accorder plus de poids aux principes de transparence fiscale et d’échange d’informations au moment de la conception des programmes d’aide bilatérale.
c) Pittsburgh, septembre 2009 : consacrer le G20 comme « forum prioritaire » de la coopération économique internationale
Le sommet de Pittsburgh marque une étape majeure dans la réforme de la gouvernance mondiale en proclamant que le G20 est le « forum prioritaire de notre coopération économique internationale ». Même si les premiers signes d’embellie de la conjoncture économique apparaissent, avec en particulier une reprise du commerce international, les dirigeants mondiaux, sous l’impulsion des Européens, se mettent d’accord sur la nécessité de poursuivre sur la voie tracée par le plan d’action adopté à Washington, afin de consolider la relance.
Une part importante des débats est consacrée aux questions d’emploi et de formation ; l’OIT est évoquée à plusieurs reprises dans la déclaration finale. Le G20 affiche ainsi sa capacité à s’emparer de l’ensemble des thématiques économiques et sociales, pleinement exploitée, en 2011, par la présidence française.
De nouveaux engagements sont pris pour encadrer les pratiques de rémunération. Les conseils d’administration et les actionnaires sont chargés de la surveillance des rémunérations des cadres dirigeants. Eu égard à la compétition accrue entre les places financières, le G20 appelle à une coordination mondiale pour édicter des règles communes. La France n’obtient pas que le montant des bonus soit limité mais les avancées, en la matière, sont tout de même significatives :
– les bonus garantis sur plusieurs années doivent être évités ;
– une partie significative des rémunérations variables doit être étalée dans le temps, liée aux performances, soumise à un dispositif de malus et versée sous forme d’actions ou de titres similaires ;
– la rémunération des cadres dirigeants et des aux autres employés ayant un impact matériel sur l’exposition de l’établissement aux risques doit être alignée sur les performances et les risques ;
– les politiques et les structures de rémunérations des établissements doivent être rendues transparentes, par le biais d’obligations de publication ;
– la rémunération variable doit être limitée à un pourcentage des revenus nets totaux lorsqu’elle n’est pas compatible avec le maintien d’une base de fonds propres solides ;
– les comités de rémunération doivent agir en toute indépendance.
Tous les contrats portant sur des produits dérivés hors marchés réglementés devront passer sur des plateformes d’échange et faire l’objet d’une notification auprès d’organismes appropriés. Il revient au CSF d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de ces mesures et de déterminer si elles suffisent pour rendre les marchés plus transparents. Il s’agit là encore d’une mesure tendant à atténuer le risque systémique et à assurer une protection contre les abus des marchés.
Le FMI est officiellement chargé de coordonner la relance mondiale : il « doit jouer un rôle crucial pour promouvoir la stabilité financière mondiale et rééquilibrer la croissance » ainsi que pour « aider nos ministres des finances et gouverneurs de banques centrales dans [le] processus d’évaluation mutuelle ». L’institution ne se contentera plus d’être un gardien de l’orthodoxie budgétaire mais jouera désormais un véritable rôle d’évaluation et de régulation dans l’activité économique et financière mondiale. Le FMI devient donc l’arbitre des politiques économiques et le coordinateur de la relance.
Par ailleurs, les Etats membres s’engagent à modifier les quotes-parts du FMI afin que les pays émergents y soient mieux représentés, par un transfert d’au moins 5 %. Ce rééquilibrage, revendiqué avec force par les BRICS, s’avère essentiel pour revenir sur une clé de répartition correspondant à des réalités économiques dépassées : la Chine, avec moins de 4 % des voix, disposait par exemple du même poids que la Belgique au sein du FMI.
S’agissant des règles prudentielles dans le secteur bancaire, les Etats conviennent de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres des banques, afin de décourager des effets de levier excessifs, à travers l’implémentation dans les législations nationales du cadre prudentiel de Bâle II, censé être achevé en 2011.
Le G20 rappelle aussi l’acquis des deux précédentes sessions en matière d’extension du champ de la régulation et de la surveillance applicable à la titrisation, aux agences de notation et aux fonds spéculatifs.
Si le sommet a abordé de nombreuses problématiques essentielles, il ne s’est guère engagé, à l’instar des précédents, en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour résorber les déséquilibres mondiaux. La déclaration finale reste muette, en particulier, à propos de plusieurs questions fondamentales pourtant abordées dans les discussions :
– les options pour sortir de la guerre des monnaies résultant des problèmes de parité monétaire entre le dollar et le yuan ;
– la stratégie de développement à moyen terme des pays exportateurs nets, dont le modèle de croissance se fonde sur le dynamisme de la demande américaine ;
– la nécessité de mettre en place des dispositifs internationaux de compensation pour aider les pays en développement à améliorer la durabilité de leur croissance.
En revanche, il effleure le thème de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en soutenant l’initiative annoncée dans ce domaine en conclusion du sommet du G8 de L’Aquila, le 10 juillet 2009, ainsi que les efforts du GTHN sur la crise alimentaire mondiale, y compris dans l’optique de traiter le problème de la volatilité excessive des prix agricoles.
L’objectif n’est plus de sortir de la crise mais de stabiliser, pérenniser et généraliser une reprise qui reste fragile, incertaine et inégale. Les discussions de ce sommet tournent donc beaucoup autour de la nécessité de renforcer la reprise économique par la stimulation de la croissance et la consolidation de la demande privée, tout en maîtrisant les déficits publics. Les Etats insistent sur l’importance d’une relance du secteur privé en renforçant la gouvernance des entreprises et en investissant dans les infrastructures. Les orientations sont découpées en quatre parties :
– ériger un cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée ;
– réformer le secteur financier ;
– mobiliser les institutions internationales en faveur du développement ;
– abolir le protectionnisme et favoriser le commerce et l’investissement.
En définitive, la déclaration finale de Toronto reprend largement les objectifs fixés lors des sommets précédents, en particulier neuf mois plus tôt à Pittsburgh, ce qui conduit à considérer cette session comme un sommet de consolidation.
Les Etats membres s’engagent à réduire de moitié au moins leurs déficits budgétaires d’ici à 2013 et à stabiliser ou réduire leur endettement public d’ici à 2016, mais aussi à renforcer les filets de sécurité sociale, à accentuer la réforme de la gouvernance des entreprises, à accroître la flexibilité du taux de change dans certains marchés émergents, à utiliser la politique monétaire pour stabiliser les prix et à stimuler l’épargne nationale.
L’objectif de renforcement des fonds propres et de la liquidité bancaire est réaffirmé, avec un appui à l’ajout au dispositif de Bâle II « d’un ratio de levier financier fondé sur le risque ». Lorsque Bâle II, ainsi complété, aura été entièrement mis en œuvre, les banques devraient être en mesure de résister à des chocs systémiques sans faire appel à une aide gouvernementale. Les participants s’entendent sur le fait qu’ils adopteront tous les nouvelles normes, de manière progressive, avant le 1er janvier 2013, en fonction des résultats d’une étude d’impact menée conjointement par le Comité de Bâle et le CSF. Ce dernier sera également appelé à émettre des recommandations sur la manière de réduire l’aléa moral posé par les institutions financières d’importance systémique. Ces discussions sur les normes de Bâle III mettent en évidence des divergences d’approche entre l’Europe et les Etats-Unis, qui n’appliquent toujours pas celles de Bâle II.
Les acteurs du G20 s’engagent par ailleurs, une nouvelle fois, à améliorer la transparence, à l’échelle internationale, des fonds de couverture, des agences de notation et des produits dérivés, ainsi qu’à restreindre les pratiques bancaires à risque.
Le G20 salue la mobilisation du MESF et du FESF, mais aussi la décision de l’UE de rendre publics les résultats des tests de résistance en cours sur les banques européennes et le dépôt du projet de loi Dodd-Frank Act(83) aux Etats-Unis.
Il est décidé d’accélérer la mise en œuvre de mesures solides visant à améliorer la transparence et la surveillance réglementaire des fonds de couverture, des agences de notation et des produits dérivés hors cote, de façon cohérente et non discriminatoire, à l’échelle internationale.
Les pays participants insistent encore sur la nécessité d’établir une série de normes comptables internationales uniformisées.
Les institutions financières internationales sont à nouveau renforcées, avec une réforme des quotes-parts de la Banque mondiale : les droits de vote des pays en développement et en transition seront accrus de 4,59 %, compte tenu d’une hausse de 3,13 % s’ajoutant à celle de 1,46 % convenue lors d’une phase antérieure de réforme.
Malgré la crise, les pays du G20 ont choisi de laisser les marchés ouverts pour ne pas risquer de pénaliser la compétitivité internationale. Les pays du G20 tombent ainsi d’accord pour ne pas rehausser les barrières aux investissement et au commerce de biens ou de services et pour s’interdire de dresser de nouvelles restrictions à l’exportation.
S’agissant du soutien au commerce, les Etats demandent à la Banque mondiale et aux banques multilatérales de développement de relever leurs capacités de prêts et de faciliter les échanges commerciaux.
Ils demandent à l’OCDE, à l’OIT, à la Banque mondiale et à l’OMC de rédiger un rapport « sur les avantages de la libéralisation du commerce pour l’emploi et la croissance », destiné à être présenté au sommet de Séoul.
Le sommet de Séoul, le premier à s’être tenu une fois le monde sorti de la phase la plus aigue de la crise, est considéré, pour sa part, comme un point de transition : il confirme le rôle du G20 comme premier forum de coopération économique mondiale mais permet de sensibiliser la communauté internationale aux nouvelles thématiques monétaires et agricoles qui seront ensuite développées sous présidence française. Le Président de la République a du reste souligné à de nombreuses reprises que l’action de la France, en 2011, s’inscrit dans la continuité de Séoul.
Le sommet a été bien préparé et bien organisé ; la Corée du Sud avait beaucoup misé sur ce rendez-vous pour son prestige et elle a pu s’appuyer sur un appareil d’Etat très centralisé, structuré et coordonné. Rien de déterminant n’a toutefois été décidé à Séoul car le sommet a été pris sous le feu des différends entre les Etats-Unis et la Chine à propos, d’une part, de la rigidité du yuan et, d’autre part, de la limitation des déséquilibres de la balance des paiements au détriment de Washington. La fiction du G2 est définitivement enterrée et l’expression « guerre des changes » fait alors florès.
Le président chinois Hu Jintao refuse de se laisser imposer une réévaluation plus franche du yuan, alors qu’il accuse les Etats-Unis, émetteurs de la monnaie de réserve mondiale, de déprécier volontairement le dollar. Il s’oppose aussi, sans surprise, à la proposition inédite de M. Geithner de limiter à plus ou moins 4 % les excédents et les déficits des comptes courants nationaux.
Mais l’idée d’instaurer des indicateurs macroéconomiques pour « faciliter l’identification précoce des déséquilibres majeurs qui nécessitent de prendre des actions préventives et correctives » est évoquée pour la première fois.
Les dirigeants du G20 adoptent aussi pour la première fois comme objectif de « bâtir un système monétaire international plus stable et plus résilient, notamment en renforçant encore les filets de sécurité financière globaux », et demandent au FMI d’y travailler. Il s’agit de poser la première brique d’un mécanisme de surveillance des déséquilibres économiques, avec pour visée implicite d’aller doucement vers une généralisation de la détermination des taux de change par le marché.
En matière de régulation bancaire, le G20 consacre l’accord de Bâle III, que chaque pays doit transposer dans sa législation nationale et appliquer au plus tard entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019 : « nous mettrons en oeuvre intégralement les nouvelles normes sur les fonds propres et la liquidité des banques ».
Il note la nécessité de « renforcer la régulation et la surveillance du système bancaire parallèle ». L’une des preuves de l’efficacité toute relative des actions entreprises est en effet, jusque alors, le développement du shadow banking, c’est-à-dire la pérennisation des circuits financiers opaques. La lutte contre ce phénomène devrait constituer une des priorités du G20.
Il s’engage aussi à traiter les problèmes liés aux établissements financiers d’importance systémique, ou SIFIs(84), dont la défaillance peut entraîner la chute de l’ensemble du système financier mondial. Le CSF et les autorités nationales sont appelés à en dresser la liste avant mi-2011.
Un système de coopération et d’échange d’informations entre régulateurs prudentiels et superviseurs est institué, sous l’autorité du CSF, avec les missions suivantes :
– mise en conformité des systèmes nationaux au regard de standards mondiaux ;
– imposition de sanctions et possibilité de publier, fin 2010, une liste de juridictions non coopératives ou non conformes dans ce domaine ;
– processus de distinction entre les juridictions les plus coopératives et les autres.
S’agissant de la lutte contre le changement climatique, les pays du G20 expriment leur volonté de contribuer à ce que la conférence de l’ONU sur le climat de Cancun, fin novembre 2010, parvienne à « un résultat satisfaisant et équilibré ».
S’agissant, enfin, de la volatilité du prix des matières premières, mandat est donné aux organisations internationales compétentes, dans le domaine de l’énergie comme celui de l’agriculture, de produire expertises et recommandations en vue de décisions sous présidence française(85).
Trois annexes sont jointes à la déclaration finale, portant respectivement sur :
– le « Consensus de Séoul sur le développement pour une croissance partagée » ;
– un « Plan d’action pluriannuel sur le développement » ;
– un « Plan d’action contre la corruption », appuyé notamment sur le Groupe d’action financière (GAFI).
Mais poser des principes ne suffit pas ; encore faut-il poser des actes. De ce point de vue, le bilan des G20 est mitigé : l’application des orientations n’est pas nulle, loin s’en faut, mais limitée et inégale ; toutes les orientations n’ont pas été suivies d’effets concrets et tous les pays n’ont pas progressé au même rythme, l’absence de solidarité post-sommets étant l’un des principaux handicaps du G20.
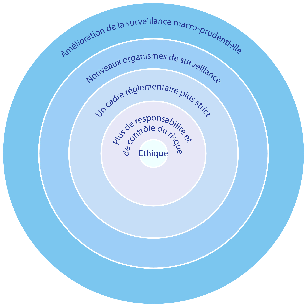
Sous l’impulsion du commissaire français, Michel Barnier, à qui a été confié le portefeuille du marché intérieur et des services, la Commission Barroso II a mis sur les rails un train de réformes prioritaires appliquant les décisions prises par le G20 en matière de régulation financière. Les vingt-cinq mesures clés prévues suivent un fil rouge : résoudre les problèmes les plus aigus du secteur financier afin de « remettre la finance au service de l’économie réelle »(86), en suivant cinq principes concentriques :
– l’éthique ;
– la responsabilité et le contrôle du risque ;
– le renforcement du cadre réglementaire ;
– la création de nouveaux organismes de surveillance ;
– l’amélioration de la surveillance macroprudentielle.
Force est de constater que le chantier était presque vierge, le prédécesseur du commissaire Michel Barnier, l’ancien ministre des finances irlandais Charlie McCreevy, n’ayant rien fait, dans ce domaine, pendant cinq ans, si ce n’est s’efforcer de démanteler le dispositif existant à son entrée en fonction, en 2004.
Le nouveau programme de la Commission suit quatre axes stratégiques :
– la concrétisation de la stratégie globale de la Commission en faveur de la croissance et de l’emploi ;
– la nécessité d’adopter une approche cohérente avec celle des autres grandes puissances économiques mondiales, afin de traduire dans les faits les orientations décidées au G20 pour répondre efficacement à la crise ;
– le souci de ne pas mettre les entreprises européennes en situation de désavantage compétitif ;
– la volonté de conduire une démarche d’ensemble, car « aucun marché, aucun acteur, aucun produit, aucun territoire ne doit désormais échapper à une régulation pertinente et à une surveillance efficace »(87).
Ce programme poursuit quatre grands objectifs :
– développer la réglementation du secteur financier, afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés et des établissements financiers ;
– améliorer sa surveillance, en créant une structure cohérente et efficace pour le contrôle prudentiel des marchés et des opérateurs financiers en Europe ;
– renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs, en particulier pour restaurer la confiance dans le système financier ;
– créer des mécanismes appropriés de gestion des crises, permettant une liquidation ordonnée des banques défaillantes sans répercussions financières sur le contribuable ni perturbations du système financier et de l’économie dans son ensemble.
Force est de constater que sa mise en œuvre est compliquée. En effet, chaque brique de l’édifice ne peut être posée avant que les acteurs du processus de co-décision – le Conseil européen et le Parlement européen – ne se soient mis d’accord en leur sein puis ensemble sur toutes les modalités techniques. L’agenda du commissaire Barnier a donc pris un peu de retard, en particulier durant la présidence hongroise du premier semestre 2011, des réformes importantes restant notamment à mener en matière de résolution bancaire et de changements structurels.
In fine, du fait, notamment, de ces contraintes, les mesures de surveillance et de régulation financière adoptées n’apparaissent pas encore tout à fait à la hauteur des défis. Il est permis de douter de la force de législations comme celles relatives aux fonds propres ou aux agences de notation : elles ont fait l’objet de révisions successives, ce qui semble être la conséquence de leur insuffisance originelle. Même s’il faut saluer les courageux efforts entrepris, il apparaît juste de souligner l’inadéquation qui perdure entre l’ambition des législations en vigueur et l’ampleur des enjeux en cause.
Le Congrès américain a adopté une loi-cadre, le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act(88), qui couvre la plupart des thématiques abordées par les sommets et se voit assigner pour objectifs « de favoriser la stabilité financière des Etats-Unis en améliorant la responsabilité et la transparence dans le système financier, de mettre un terme à la logique du “trop gros pour faire faillite”, de protéger le contribuable en arrêtant de renflouer des établissements bancaires, de protéger les consommateurs des pratiques abusives en matière de services financiers ».
Signé le 21 juillet 2010 par le président Obama, ce texte de 2 300 pages n’est cependant pas d’application immédiate : nos nombreux interlocuteurs américains nous ont inlassablement répété – certains pour regretter les énormes difficultés que cela pose, d’autres pour s’en féliciter – que chacune des mesures qu’il contient doit ensuite faire l’objet d’une implémentation, dans la réglementation sectorielle, par le réseau des régulateurs nationaux(89), à savoir, essentiellement, d’une part, pour les marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), et, d’autre part, pour les banques, la Fed.
Or l’industrie financière américaine, qui se porte mieux aujourd’hui, veut ralentir le processus de régulation mondial et le président Obama, dans le contexte actuel de cohabitation et de campagne électorale, n’a pas les coudées franches vis-à-vis de Wall Street, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier. Les partisans de la régulation financière les plus résolus estiment même que le Dodd-Frank Act est une « loi orpheline », intellectuellement abandonnée par l’administration présidentielle et le secrétaire au trésor. Le texte aurait dû devenir effectif dans son intégralité le 31 juillet 2011 mais les républicains s’efforcent de faire adopter une loi modificative repoussant sa mise en œuvre au 31 janvier 2013, c’est-à-dire au lendemain de l’entrée en fonction du futur président, car ils espèrent alors contrôler les deux chambres du Congrès.
Après le sommet de Londres, l’OCDE a commencé par publier une liste grise et une liste noire, correspondant respectivement aux Etats s’apprêtant à coopérer et à ceux refusant de lever le secret bancaire. Cette publication a déclenché un mouvement sans précédent de signatures d’accords d’échange d’informations fiscales – plus de 500 –, entraînant des progrès significatifs dans une trentaine de pays. Pour aller plus loin, la communauté internationale s’est organisée au sein du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, qui regroupe à ce jour 94 États et territoires.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a progressé, avec le renforcement des mécanismes d’évaluation par les pairs des dispositifs de lutte anti-blanchiment des Etats. Des listes de juridictions non coopératives ont été publiées à partir de février 2010, assorties d’un mécanisme de contre-mesures à l’encontre de ces systèmes nationaux défaillants.
La lutte contre les juridictions non coopératives dans le domaine prudentiel commence à prendre forme, avec pour objectif le respect par tous les pays du monde des standards internationaux en matière de coopération et d’échange d’informations entre régulateurs prudentiels et entre superviseurs. A cette fin, une procédure d’identification des pays non conformes aux standards internationaux est en cours au sein du CSF.
Le 28 avril 2009, la Commission européenne a adopté une communication recensant les mesures à prendre par les Etats membres pour promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, par le biais d’échanges d’informations(90). En effet, comme l’a indiqué à l’époque le commissaire Laszlo Kovacs, qui était chargé de la fiscalité et de l’union douanière : « Les Etats membres de l’UE ne peuvent pas se permettre d’agir seuls lorsqu’ils conçoivent des politiques visant à empêcher le détournement de leurs recettes fiscales vers les paradis fiscaux ou des juridictions non coopératives. S’ils ne coopèrent pas, en particulier au sein des enceintes internationales, les mesures qu’ils prennent pour protéger leurs recettes resteront sans effets. »
En France, l’arrêté du 6 octobre 2009 portant application de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier détermine les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les Etats ou territoires non coopératifs, afin de dissuader par la taxation les flux à destination et en provenance des Etats n’ayant pas signé de convention d’échange d’informations fiscales ou n’appliquant pas celle qu’ils ont signée. La loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 alourdit le dispositif de sanctions fiscales contre les Etats ou territoires non coopératifs et l’arrêté du 12 février 2010 dresse la liste de ceux auxquels des sanctions sont applicables.
En novembre 2009, un arrêté édictant les règles d’encadrement et de transparence des bonus est publié. La loi de régulation bancaire et financière du 23 octobre 2010 confie à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) la mission de contrôler le respect de ces règles et impose la constitution de comités des rémunérations au sein de chaque établissement financier.
Au final, des listes ont certes été créées, impliquant la signature d’accords de coopération, mais « en pratique, toutefois, les résultats sont demeurés modestes »(91). Le volume d’opérations financières transitant dans ces paradis fiscaux ne semble en effet pas s’être réduit. Selon le FMI, subsistent toujours des places à la législation fiscale très dérogatoire – City de Londres, îles anglo-normandes, Delaware, Luxembourg, etc.
Par ailleurs, les conventions fiscales conclues avec la Suisse par le Royaume-Uni et l’Allemagne, dont l’objet est de taxer à la source les comptes ouverts par les exilés fiscaux en échange de la préservation de leur anonymat – c’est-à-dire en échange du cautionnement définitif du secret bancaire –, apparaissent tout à fait condamnables puisqu’elles remettent clairement en cause les efforts entrepris jusqu’ici.
Aux Etats-Unis, le Foreign Account Tax Compliance Act, signé par le président Obama le 18 mars 2010, obligera toute institution financière, à compter du 1er janvier 2013, à obtenir, vérifier et déclarer auprès du trésor des informations types sur tout titulaire de compte, sous peine de se voir soumise à un prélèvement à la source de 30 %.
Ce dossier a fortement avancé durant la présidence suédoise de l’UE, au second semestre 2009, sous l’impulsion de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni.
La directive européenne sur les gestionnaires de fonds alternatifs du 8 juin 2011(92) reprend les recommandations édictées lors du sommet de Pittsburgh, notamment l’interdiction des bonus garantis sur plusieurs années, l’étalement dans le temps d’une partie significative des rémunérations variables, l’introduction de malus et l’alignement de la rémunération des cadres dirigeants sur les performances et les risques.
Par ailleurs, la troisième directive concernant les exigences de fonds propres du 24 novembre 2010(93) impose un cadre strict aux parts variables des banquiers. Au moins 40 % des bonus – et même 60 % pour les plus hautes rémunérations – devront être versés de manière différée sur une durée minimale de trois ans. Au moins 50 % de la rémunération variable devra être versée sous forme d’actions ou d’instruments équivalents. En outre, le pouvoir de l’ACP est renforcé, en ce qu’elle pourra imposer une révision de la politique de rémunération des banques si celle-ci n’est pas compatible « avec une gestion saine et efficace des risques ». Il est toutefois regrettable que la directive CRD III ne limite en aucune façon le montant des primes ; cela illustre encore le succès tout relatif des résultats obtenus dans le cadre du G20.
La France a été le premier pays à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus des opérateurs de marchés définies à Pittsburgh. Depuis le 1er janvier 2011, les règles de rémunération variable ont également changé au Royaume-Uni, la Financial Services Authority (FSA) ayant publié sa réforme du code des rémunérations.
Le Dodd-Frank Act instaure également une série de mesures tendant à encadrer la rémunération des opérateurs financiers, dans le souci d’empêcher les prises de risques inappropriées, susceptibles d’entraîner des pertes financières conséquentes :
– obligation, pour les institutions financières, de rendre publiques des informations détaillant la relation entre le niveau de rémunération et la performance financière ;
– obligation de rendre public le montant du salaire du président-directeur général et le salaire médian de l’ensemble de leur effectif ;
– obligation de procéder, en assemblée générale des actionnaires, à un vote non contraignant, annuel, biennal ou au moins triennal, sur la rémunération de la direction ;
– indépendance des comités de rémunération.
En Chine, en vertu d’un règlement relatif à l’audit de la rémunération des responsables des entreprises financières centrales, publié en février 2010 par le ministère des finances, et des lignes directrices de réglementation de l’indemnisation des banques commerciales fixées par la China Banking Regulatory Commission (CRBC), la rémunération des opérateurs financiers et des dirigeants des banques commerciales doit être fonction des résultats d’exploitation annuels de leur entreprise et, en tout état de cause, ne pas excéder trois fois le salaire de base.
Une nouvelle architecture européenne de supervision financière, sans équivalent parmi les autres membres du G20, a été érigée le 24 novembre 2010 par voie de directive(94). Adaptée à la réalité des groupes financiers transfrontaliers et au degré d’intégration du marché unique et de l’Europe monétaire, elle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2011.
Elle est composée de trois autorités européennes de surveillance (AES) – l’Autorité bancaire européenne(95) (ABE), l’Autorité européenne des marchés financiers(96) (AEMF) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles(97) (AEAPP) – ainsi que d’une structure macroprudentielle, le Comité européen du risque systémique(98) (CERS).
Le CERS est un organe rattaché à la Banque centrale européenne (BCE), chargé d’un rôle macroprudentiel : surveiller la sphère financière tout entière afin d’identifier les risques systémiques complexes, sectoriels ou trans-sectoriels, susceptibles de contribuer au développement d’une crise future. Si nécessaire, il émet des alertes à destination des Etats membres et des trois nouvelles autorités de supervision, il formule des recommandations quant aux mesures à prendre et en vérifie la mise en application.
Les trois autorités de supervision européennes, dotées de la personnalité juridique, interviennent à l’échelon microprudentiel afin de veiller à la solidité financière des établissements financiers et de protéger les utilisateurs de services financiers. Sans se substituer aux autorités nationales – auxquelles il incombe toujours, conformément au principe de subsidiarité, d’exercer la surveillance courante des marchés –, elles travaillent en réseau avec elles. Contrairement aux trois comités de surveillance qu’elles remplacent, elles sont dotées de véritables pouvoirs contraignants, à condition, toutefois, que leurs décisions n’empiètent pas sur la souveraineté budgétaire des Etats membres :
– énoncer des règles spécifiques applicables aux autorités nationales et aux établissements financiers, élaborer des normes techniques, des orientations et des recommandations ;
– vérifier comment les autorités nationales de supervision font appliquer ces règles ;
– agir en cas d’urgence, y compris en limitant transitoirement l’usage de certains produits toxiques ou pratiques à haut risque, voire en les interdisant ;
– assurer l’application homogène du droit communautaire sur tout le territoire de l’UE ;
– arbitrer les différends entre autorités nationales, notamment dans les domaines pour lesquels il est prévu une coopération, une coordination ou une prise de décision commune par les autorités de supervision de plus d’un Etat membre.
En outre, la directive AIMF harmonise le cadre juridique des hedge funds et des private equities en renforçant la transparence, la supervision et la sécurité juridique de ce secteur. Elle oblige en particulier les opérateurs à fournir aux autorités de surveillance des données qui les aideront à détecter les risques systémiques.
Sur le plan national, l’ACP, fondée en janvier 2010 par l’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, a pour mission de veiller « à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». Elle procède de la fusion de la Commission bancaire, de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), du Comité des entreprises d’assurance (CEA) et du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI).
La loi de régulation bancaire et financière crée le Conseil de la régulation financière et de risque systémique (CRFRS), chargé de coordonner le travail de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’ACP et de l’Autorité des normes comptables (ANC).
La supervision financière est l’un des seuls domaines d’ampleur dans lesquels les préconisations du G20 ont déjà été mises en œuvre en Europe. Cependant, la réforme a été trop timide ; si elle s’inspire de l’esprit du rapport Larosière(99), elle reste en deçà des recommandations qu’il avait formulées, les autorités européennes ne disposant pas de réels pouvoirs de contrainte vis-à-vis des autorités nationales. Surtout, l’on ne peut que déplorer, dans cette période trouble, la discrétion du CERS, qui, jusqu’à présent, ne s’est pas exprimé.
Aux Etats-Unis, la loi Dodd-Frank contraint les gestionnaires de fonds alternatifs qui gèrent plus de 150 millions de dollars à s’enregistrer auprès de la SEC et à déclarer toutes leurs pratiques commerciales et d’investissement. Les données récoltées sont transmises au Financial Stability Oversight Council (FSOC), chargé d’identifier et de suivre les risques excessifs susceptibles de déstabiliser l’économie nationale.
En France, la loi de régulation bancaire et financière renforce la responsabilité des agences de notation et dote l’AMF des pouvoirs nécessaires à leur agrément, à leur contrôle et aux sanctions qui leur sont applicables.
En Europe, ces entités, qui ont joué un rôle délétère dans la mauvaise appréciation des risques ayant conduit à la crise de 2008, sont désormais soumises à des exigences d’agrément et à une surveillance plus strictes.
Un premier règlement européen a été adopté, le 16 septembre 2009, pour encadrer l’activité des agences de notation(100).
En décembre 2010, le pouvoir de contrôle et de sanction sur les agences de notation a été transféré à l’AEMF.
Un second règlement(101) a renforcé le dispositif dans les directions suivantes :
– compléter le cadre de régulation et de supervision des agences de notation ;
– renforcer la concurrence dans le secteur ;
– clarifier leur responsabilité civile ;
– réduire la dépendance réglementaire aux notations ;
– évaluer leur modèle de financement ;
– mieux prendre en compte la spécificité de la notation des titres souverains.
Les règles édictées par l’UE « sont toutefois disparates et peu précises »(102). Les agences refusent notamment de rendre publiques leurs méthodes de notation. Par ailleurs, la succession de textes législatifs européens récents sur les agences de notation est moins révélatrice du bien-fondé des mesures qu’ils contiennent que de leur insuffisance au regard des enjeux.
Le Dodd-Frank Act supprime l’obligation, pour les fonds de pension, de se conformer aux notes des agences de notation. Il prévoit la création, au sein de la SEC, d’un office spécialisé sur l’évaluation des taux de crédits, ainsi que la possibilité, pour la SEC, de radier une agence donnant des notes trop systématiquement négatives. Les agences de notation seront obligées de rendre publiques leurs procédures de notation et le bilan de leurs activités. Les émetteurs de titres n’auront plus la possibilité de choisir l’agence qui les notera.
En février 2011, la CRBC a édicté un règlement intimant aux banques commerciales de diminuer leur dépendance aux agences de notation étrangères. L’agence de notation chinoise Dagong Global Credit Rating a élaboré sa propre hiérarchisation mondiale de la solvabilité de cinquante Etats, une première pour une agence non occidentale.
La loi de régulation bancaire et financière accroît les pouvoirs de l’AMF pour lutter contre les abus de marchés dérivés, particulièrement les manipulations de cours. Elle peut également interdire les ventes à découvert en cas de circonstances exceptionnelles et impose une transparence totale sur les instruments financiers.
Deux projets de règlement et un projet de directive de la Commission européenne, portant respectivement sur les produits dérivés négociés de gré à gré(103) et les ventes à découvert(104), sont en cours de discussion au sein des institutions européennes.
Le texte sur les produits dérivés négociés de gré à gré comporte trois volets :
– standardisation des produits dérivés ;
– enregistrement des entités financières actives dans l’UE sur ces marchés ;
– harmonisation des règles encadrant les chambres centrales chargées de compenser les produits dérivés standardisés.
Quant aux transactions sur produits dérivés non standardisés, conformément aux recommandations de Pittsburgh, elles seront soumises à des exigences en capitaux supplémentaires.
Le texte sur la vente à découvert rassemble des mesures de natures très différentes mais ayant pour dénominateur commun l’encadrement de la spéculation à la baisse, notamment sur les dettes souveraines, avec un souci de convergence maximale. L’Europe se caractérise en effet, à ce jour, par la rareté et la disparité des dispositions d’application permanente. Ce second projet de règlement vise trois objectifs majeurs :
– instituer un régime de transparence sur les positions courtes nettes ;
– encadrer les ventes à découvert à nu(105) ;
– donner aux régulateurs nationaux et à l’AEMF, en situation d’urgence, un pouvoir d’interdiction des ventes à découvert et des transactions sur CDS souverains dès lors qu’ils aboutiraient à accroître le risque systémique.
Notons que le ministère allemand des finances et l’autorité allemande des marchés financiers (BAFIN), en mai 2010, ont unilatéralement interdit les ventes à découvert à nu des actions des dix plus importantes institutions financières du pays ainsi que des emprunts d’Etat de la zone euro et les CDS adossés aux obligations émises en contrepartie. Cette décision courageuse a toutefois fait immédiatement dévisser l’euro.
La Commission européenne travaille également, depuis de longs mois, sur un projet de révision de la directive 2004/39/CE relative aux marchés d’instruments financiers(106), dont le dépôt est prévu pour la mi-octobre 2011 et qui devrait suivre quatre orientations :
– renforcer la transparence sur tous les marchés financiers, en particulier les marchés dérivés de matières premières ;
– assurer l’encadrement et la surveillance des opérateurs de marché ;
– rendre possible, pour le régulateur, de fixer des limites de positions pour tous les types de contrats dérivés, qu’ils soient échangés sur des plateformes organisées ou de gré à gré ;
– instituer un temps de latence obligatoire pour les transactions enregistrées sur les carnets d’ordre.
L’adoption de ces trois textes a cependant pris du retard, les modalités techniques devant faire l’objet d’arbitrages politiques extrêmement délicats, d’une part entre Etats membres, d’autre part entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen.
Le Dodd-Frank confère à la SEC et à la CFTC le soin de mettre en application un ensemble complet de règles pour réguler le marché des dérivés négociés de gré à gré, en vue de réduire le risque de contrepartie et d’accroître la transparence. Une compensation centrale serait dorénavant obligatoire pour les sociétés financières et de nouvelles exigences en fonds propres sont imposées aux contreparties centrales.
En Chine, la CRBC a révisé, en janvier 2011, le règlement provisoire sur les produits dérivés des institutions financières, afin de renforcer leur régulation et de créer un système de licences.
Deux ans après la faillite de Lehman Brothers, le 12 septembre 2010, le Comité de Bâle durcit les normes de fonds propres bancaires en relevant le ratio de solvabilité de 2 % à 4,5 %, avec un matelas de protection de 2,5 %. Les fonds propres durs, c’est-à-dire composés uniquement d’actions et de bénéfices mis en réserve, devront par conséquent représenter 7 % des activités de marché ou de crédit des banques, soit une multiplication par 3,5 par rapport à Bâle II, l’augmentation de ce ratio étant censée contribuer à empêcher des prises de risque excessives. Un ratio de liquidité, c’est-à-dire de solvabilité à court terme, est également institué.
Ces mesures doivent théoriquement être mises en application à partir du 1er janvier 2019. Leur mise en œuvre effective reste cependant hypothétique eu égard aux critiques qui visent le dispositif et au fait que les Etats-Unis se sont toujours abstenus d’appliquer Bâle II.
La loi Dodd-Frank prévoit tout de même une hausse des exigences de fonds propres des banques : les grandes banques seront désormais sujettes aux mêmes exigences que les community banks, c’est-à-dire les banques locales.
Le 20 juillet 2011, la Commission a adopté un ensemble de deux propositions tendant à renforcer la réglementation dans le secteur bancaire. Le premier texte, une directive(107), tend à régir l’accès aux activités de collecte de dépôts tandis que le second, un règlement(108), établit les exigences prudentielles que les établissements devront respecter.
Pour la première fois de l’histoire, la présidence du G20 est confiée pour une année complète à un pays – jusqu’à présent, le rythme de passage du relais était semestriel – et les deux présidences du G20 et du G8 coïncident, en raison d’une conjonction de calendriers exceptionnelle. Cette opportunité de pilotage unifié de la gouvernance mondiale pendant un an facilite les synergies et évite la concurrence entre les deux exercices, dans un contexte nettement favorable à la régulation.

Tous les ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, ambassadeurs, banquiers centraux, régulateurs, fonctionnaires, économistes et autres experts étrangers que nous avons rencontrés font un constat identique : l’interdépendance économique est un fait et le monde entier paierait cher l’absence ou l’insuffisance de régulation. La crise financière de 2008 a battu en brèche la théorie jusqu’alors dominante selon laquelle il faut laisser les marchés s’autoréguler pour favoriser la croissance. Ceux-ci ont en effet fait la preuve de leur incapacité à arbitrer en faveur de stratégies à long terme et d’intérêt général mais les obligeant à sacrifier une fraction même minime de leurs profits immédiats.
Depuis la fin de la guerre froide et le partage du monde entre deux superpuissances, même si de nouvelles menaces – terrorisme, prolifération nucléaire, développement des trafics criminels transfrontaliers en tous genres – émergent, même si certaines régions restent en proie à des conflits circonscrits géographiquement, le monde est relativement stable, les relations internationales tendent à s’apaiser. L’équilibre géopolitique est certes précaire, mais c’est peut-être ce qui incite les nations, instruites par les conflits du XXe siècle, à se coordonner pour ne plus avoir à supporter de conflits moralement, humainement et économiquement ruineux.
Ce constat vaut sans doute surtout au niveau européen, notre continent ayant atteint un degré d’intégration économique et politique inégalé ailleurs, même si d’immenses progrès demeurent nécessaires pour passer un nouveau cap.
Mais le reste du monde suit résolument la même logique ; toutes les nations ont tiré les leçons de l’histoire.
La mentalité américaine est historiquement hostile à tout ce qui peut ressemble, de près ou de loin, à de l’interventionnisme économique. Le terme « régulation » revêt d’ailleurs deux acceptions différentes de part et d’autre de l’Atlantique. Aux Etats-Unis, plutôt que de contrôler les marchés et les prix, il s’agit, dans une optique libérale, s’exercer une supervision tendant à garantir le bon exercice de la concurrence par la transparence. Mais cette approche ne passe pas l’épreuve des faits : même aux Etats-Unis, les pouvoirs publics savent qu’elle ne suffit pas pour faire respecter aux marchés des règles du jeu loyales.
Dans ses attendus, le XXIIe plan quinquennal chinois constate « que l’impact de la crise financière mondiale demeure, que la croissance économique mondiale stagne, que la compétition globale s’intensifie, que le protectionnisme émerge et, par conséquent, que l’environnement international devient de plus en plus complexe ». Mais, dans le même temps, il note qu’« il existe encore une tendance globale vers la paix, le développement et la coopération, que cet environnement est globalement bénéfique pour le développement et que, dans un tel contexte, la Chine doit renforcer la compréhension et la confiance du monde extérieur envers elle, notamment grâce à la coopération et aux échanges culturels ».
Quant à l’éminence grise de la classe politique nippone, l’ancien vice-ministre des finances Toyoo Gyohten, il a prononcé, en octobre 2010, un discours en phase avec les préoccupations françaises et qui correspond à l’opinion dominante parmi ses concitoyens experts ou industriels, mais aussi partout dans le monde : « il y a quatre failles dans l’économie mondiale [et] nous ne pouvons pas rétablir la croissance sur une base forte et stable sans traiter ces failles […] : d’abord, modèle insoutenable de croissance ; en second lieu, excès financiers ; troisièmement, système monétaire international instable ; et enfin, décalage de puissance mondiale ».
La crise n’est pas derrière nous ; un relâchement conduisant à un dessaisissement du G20 serait coupable. La reprise est fragile – les événements intervenus depuis le début de l’été 2011 le montrent – et ne se traduit pas par une amélioration sur le terrain de l’emploi, en particulier aux Etats-Unis. Paradoxalement, le fait que le rendez-vous de Cannes ait lieu alors que le monde a le sentiment d’approcher du gouffre sera peut-être salutaire : les dirigeants mondiaux ne seront-ils pas plus enclins à miser sur les résultats du sommet pour redresser l’économie mondiale ?
Un parallèle utile peut être tracé avec les négociations sur le changement climatique : après l’échec de la conférence de Copenhague, en décembre 2009, beaucoup de pays ont voulu remettre en cause la légitimé des Nations unies à piloter les négociations. Par chance, il n’en a finalement rien été et le succès de la conférence de Cancun, un an après, a fait clairement apparaître l’ONU comme la seule instance capable de s’occuper de ce dossier au niveau global : si elle avait été mise de côté, les avancées de Cancun n’auraient jamais été obtenues.
S’agissant du G20, chacun est certes conscient de sa légitimité relative, de ses insuffisances, de ses lenteurs, mais nul n’a trouvé une meilleure organisation pour traiter des problèmes économiques du monde. Au demeurant, quoi qu’ils puissent être emparés d’un certain ressentiment, les pays qui en sont exclus, dans les faits, ne protestent eux-mêmes que mollement contre l’exercice, préférant entrer dans le cercle par le biais d’une invitation ou utilisant les autres cénacles de concertation internationale pour tâcher de faire entendre leur voix par l’intermédiaire des grandes puissances économiques au moment du sommet.
Même si la confrontation sino-américaine du sommet de Séoul a renvoyé conjoncturellement l’UE au second plan, il a permis de glisser dans l’agenda international des thématiques ouvrant de nouvelles perspectives régulatrices pour le G20, notamment en ce qui concerne l’instauration d’indicateurs de suivi des déséquilibres macroéconomiques ou la lutte contre la volatilité des matières premières agricoles.
Au départ, la volonté de la France de diversifier les thèmes à l’ordre du jour fait peur à la plupart de ses partenaires, qui se montrent sceptiques quant à la possibilité, voire à l’intérêt, de traiter de front un tel panel de sujets.
Les émergents ont tendance à craindre, par exemple, que la France ne mette en avant la question des prix agricoles et de la protection sociale que pour mieux protéger ses agriculteurs et ses industries contre le dynamisme des exportations du Sud.
Les deux acteurs de la « guerre des monnaies » refusent de se laisser forcer la main pour faire évoluer le système monétaire international. Nonobstant les déséquilibres qui lui sont inhérents, chacun des deux tire avantage de la situation actuelle et n’est pas certain qu’il gagnerait à abandonner son statut – celui d’émetteur monopolistique de monnaie d’échange internationale pour le premier, de puissance exportatrice accumulant de grandes quantités de devises et détenant de grandes quantités d’obligations souveraines étrangères pour le second.
Par ailleurs, alors que le fléau de la crise semble s’éloigner, les pays de tradition libérale sont de nouveau gagnés par une défiance vis-à-vis de la régulation économique – à commencer par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, où le contexte politique domestique favorise cette évolution.
Le travail de sensibilisation et d’explication(109) mené tout au long de l’année, tant avec les autres Etats membres qu’avec les organisations internationales, aux niveaux des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres comme des administrations(110), a finalement porté ses fruits : la France est parvenue à emmener tous ses partenaires sur les terrains qu’elle avait identifiés comme prioritaires, sans qu’aucun d’entre eux se refusent catégoriquement à aborder telle ou telle problématique, contrairement à ce que les premières réactions laissaient craindre. Le Président de la République s’en est d’ailleurs félicité dans son discours d’ouverture de la XIXe Conférence des ambassadeurs, le 31 août 2011 : « Aujourd’hui, fort heureusement, plus personne ne conteste l’agenda de la présidence française. »
Paradoxalement, alors que l’arrogance française est souvent décriée de par le monde, l’esprit d’initiative dont elle a fait montre, depuis 2008, en faveur de la régulation mondiale, la rend d’emblée légitime au fauteuil de la présidence du G20.
Les témoignages que nous avons recueillis à cet égard convergent, y compris parmi les autorités publiques des pays extra-européens : « la France a toujours eu le courage de poser sur la table les vrais problèmes », « la diplomatie française a toujours été très inventive et suscite beaucoup d’attentes », « la communauté de vision entre nos deux pays est frappante sur plusieurs dossiers », « nous sommes d’accord avec l’attitude de la France, qui cherche à mieux réguler les marchés », « nous sommes très reconnaissants au Président Sarkozy d’avoir retenu tous ces thèmes, qui correspondent vraiment aux enjeux majeurs ». Un officiel américain s’est même écrié, en coulisse : « La présidence française nous épuise ! », signifiant ainsi combien elle s’est montrée active pour faire sauter les verrous de la négociation.
Dès leur première réunion, le 26 janvier 2011, au-delà des différences de cultures, les vingt sherpas s’accordent sur trois constats :
– le niveau d’interdépendance économique n’a jamais été aussi élevé ;
– le monde a besoin de davantage d’action collective ;
– il faut améliorer le système de gouvernance du G20.
Dès lors, ils s’approprient l’agenda de la présidence française, tant pour ce qui concerne le calendrier que les axes politiques, qui correspondent de toute évidence aux grands enjeux du moment.
Sans préjuger des résultats finaux qui seront obtenus à Cannes, la France a en tout cas su démontrer sa capacité à concevoir un agenda pragmatique et adapté aux attentes du monde.
L’actualité de la crise de l’euro risque cependant d’éclipser cet agenda patiemment élaboré. Si les Européens ne sont pas en capacité d’apporter de nouvelles réponses à la crise des dettes souveraines d’ici au sommet de Cannes, nul doute que cette question prendra une place centrale dans les discussions. Les pays européens, en premier lieu la France et l’Allemagne, devront s’expliquer et tenter de rassurer ; plusieurs de nos interlocuteurs nous ont interpellés à ce propos. De fait, l’UE n’est pas dans la position la plus confortable pour prétendre incarner une dynamique de sortie de crise à l’échelle mondiale.
Le changement de nature du G20 d’après-crise a permis aux Etats membres du G20 de regarder loin, vers des enjeux à long terme dépassant les questions de régulation économique, que nous aborderons plus loin. Le programme de la présidence française(111) va donc au-delà des questions purement économiques et financières. Eu égard à l’importance de leurs effets sur l’économie mondiale, la lutte contre le protectionnisme et celle contre le changement climatique ont forcément été abordées au détour des travaux préparatoires, mais pas en tant que volets à part entière du G20, dans la mesure où ces sujets sensibles sont déjà suivis dans des enceintes spécialisées reconnues : respectivement à Genève dans le cadre du cycle de Doha et à l’occasion des grandes conférences internationales ad hoc sur le climat. D’autres points, en revanche, ont fait l’objet de discussions spécifiques, soit au sein de nouvelles filières ministérielles, soit, pour ce qui concerne la sûreté nucléaire, sujet qui s’est imposé en raison de l’actualité, de façon plus urgente et plus ponctuelle.
La dernière crise a entraîné une augmentation de 30 millions du nombre de chômeurs, dans le monde, en deux ans. Par ailleurs, 80 % de la population mondiale n’a pas accès à un système de protection sociale. La présidence française a décidé de ne pas se contenter de traiter les conséquences économiques des excès du capitalisme financier mais de commencer à s’intéresser à ses conséquences sociales.
Poser les fondations d’une croissance durable passe aussi par l’approfondissement de la justice sociale dans tous les pays du G20, à travers trois aspects :
– un socle universel de protection sociale jouerait un rôle d’amortisseur de crise et par conséquent de stabilisateur économique ;
– mieux que le PIB, la reprise de l’emploi constitue le véritable indicateur de sortie de crise et l’OCDE estime à 110 millions le nombre d’emplois à créer d’ici à 2015 pour revenir au taux de chômage d’avant la crise ;
– faute de règles sociales communes, ratifiées et appliquées par l’ensemble des membres du G20, la concurrence mondiale est faussée.
Gilles de Robien, ambassadeur chargé de la promotion de la cohésion sociale, délégué de la France au conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT) s’est vu confier par le Président de la République une mission de coordination de ce volet social. Avec les ministres concernés, il a assuré la promotion de ces principes et la conduite politique des travaux préparatoires au sommet du G20, dans l’optique d’inscrire des avancées concrètes et durables à l’actif de la présidence française.
Cette démarche est engagée en phase avec celle du groupe de travail international chargé de réfléchir à l’édification d’un socle universel de protection sociale, créé en juillet 2010 par l’OIT et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et dont la direction a été confiée à Michelle Bachelet, ancienne présidente socialiste du Chili, aujourd’hui présidente de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).
Mais la 100e Conférence internationale du travail, qui s’est tenue du 1er au 17 juin à Genève, a donné l’occasion aux émergents de plaider contre l’instauration d’un modèle social unique. Le premier ministre russe Vladimir Poutine a ainsi déclaré : « les défis de l’efficacité économique des Etats et leurs intérêts globaux ne correspondent pas toujours aux nécessités du développement social et humain ». Tout autant sur la défensive, le ministre indien du travail et de l’emploi Mallikarjun Kharge a prévenu : « Il ne sera pas possible d’imposer un niveau unique [de protection sociale] à tous les pays, et il ne devra pas non plus y avoir de calendrier de mise en œuvre fixe. Ce socle doit être lié à la richesse du pays considéré, à l’importance de son secteur informel, à ses stratégies pour l’emploi et à ses autres politiques sociales. »
La France n’a pas pour autant renoncé à ses assauts diplomatiques, afin de préparer la réunion des ministres du travail du G20, qui s’est tenue à Paris les 26 et 27 septembre 2011. Un séminaire d’experts a notamment été organisé sur ce thème, à Buenos Aires, le 12 juillet 2011.
Comme sur les autres dossiers, notamment celui des prix agricoles, il s’agit surtout de rassurer des pays qui se méfient légitimement d’un néocolonialisme revisité qui consisterait à freiner leur développement économique en leur imposant des normes inadaptées à leurs spécificités économiques et sociales, conçues sur-mesure pour les pays les plus avancés.
A cet égard, durant toute sa présidence, la France a expliqué qu’il ne s’agit pas de prescrire un modèle unique mais d’instituer un socle minimum, avec des critères différents selon le niveau de richesse dans les différents pays, incluant :
– l’accès à la médecine ;
– l’accès aux soins des personnes âgées ;
– le soutien aux familles et l’éducation ;
– le soutien aux personnes exclues du marché du travail.
Pour désamorcer les préventions, le 23 mai 2011, la France a organisé, à Paris, une conférence internationale de haut niveau, réunissant notamment les ministres du travail des pays du G20, des responsables des organisations internationales concernées – OIT, PNUD, FMI, OMC, Banque mondiale et OCDE – ainsi que des représentants des organisations partenaires sociaux. Dans son allocation introductive, le Président de la République a insisté sur deux impératifs : consacrer la même énergie à l’action en faveur de la justice sociale qu’à celle contre le protectionnisme ; faire aller de pair progrès économique et progrès social.
Xavier Bertrand a aussi confirmé le souhait de la présidence française que deux colloques réunissant respectivement les organisations patronales et les syndicats de salariés des pays du G20(112) soient organisés en marge du sommet.
Quant au groupe de travail international, il a rendu un rapport préparatoire à la réunion ministérielle de septembre 2011(113). Son constat est sans appel : 5,1 milliard de personnes, soit 75 % de la population mondiale, ne sont couvertes par aucun système de sécurité sociale, alors qu’« ils contribuent à renforcer la résistance aux soubresauts de l’économie, amortissent l’impact des crises et favorisent un rééquilibrage de la croissance à long terme ». L’idée maîtresse du rapport est que « personne ne devrait vivre en dessous d’un certain niveau de revenu, et que toute personne devrait pouvoir avoir accès au moins aux services sociaux essentiels ».
Si les désaccords manifestés dès le début subsistent, les travaux ont déjà permis d’entraîner un consensus sur l’idée d’un socle universel de protection sociale. Les conclusions adoptées par les ministres le 27 septembre 2011 prévoient déjà la création d’une task force intergouvernementale chargée d’assurer des « échanges d’expériences réciproques » dans quatre domaines :
– améliorer les politiques actives de l’emploi, notamment pour les jeunes générations et les autres groupes les plus vulnérables ;
– renforcer la protection sociale par la mise en œuvre de socles de protection sociale adaptés à chaque pays ;
– promouvoir l’application effective des droits sociaux et du travail ;
– renforcer la cohérence des politiques économique et sociale.
Alors que ce sujet était traditionnellement l’une des prérogatives du G8 – club des principaux bailleurs de fonds –, le G20, cette année, s’en empare résolument, dans un contexte où les bailleurs tendent à revenir à une logique de recherche d’intérêt pour eux-mêmes plutôt que pour les pays bénéficiaires, en dépit des engagements pris dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement(114).
Malgré le caractère un peu bureaucratique du plan d’action pluriannuel sur le développement défini dans le cadre du « consensus de Séoul »(115), la présidence française s’efforcera d’arriver à Cannes avec des délivrables concrets, en se concentrant sur deux priorités : les infrastructures et la sécurité alimentaire.
S’agissant du premier point, il convient d’identifier un panel d’infrastructures essentielles qu’il sera demandé à la Banque mondiale de financer, en donnant autant que possible la priorité à l’Afrique – ce qui ne coule pas de source, sachant que cinq membres du G20 sont asiatiques. La piste des partenariats public-privé est également à privilégier, à supposer que des progrès sensibles soient réalisés en matière de lutte contre la corruption.
Compte tenu de ces finalités, les travaux de la filière développement s’articulent avec ceux, d’une part, de la filière finances et, d’autre part, de la filière agriculture.
Trois rapports ont aussi été confiés à des personnalités indépendantes.
D’abord, les premiers ministres éthiopien Meles Zenawi et norvégien Jens Stoltenberg, coprésidents du Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique(116), sont chargés de réfléchir au développement des infrastructures dans les pays en développement et aux financements innovants susceptibles de générer des moyens en faveur de la lutte contre le changement climatique.
Tidjane Thiam, ancien ministre ivoirien de la planification et du développement, aujourd’hui patron de Prudential, première compagnie d’assurance britannique, doit travailler sur la question du développement de l’Afrique, avec un panel de haut niveau d’investisseurs publics et privés.
Quant à Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope(117), il est chargé d’étudier les moyens de financer le développement, qui peuvent prendre trois aspects :
– l’aide officielle des Etats et des organisations internationales ;
– l’amélioration du déploiement des budgets domestiques ;
– les financements innovants, notamment la taxe sur les transactions financières, à propos de laquelle nous reviendrons(118).
Les travaux de ces trois groupes de réflexions ont été centralisés lors de la réunion ministérielle qui s’est tenue le 23 septembre 2011 à la Banque mondiale.
La France a clairement choisi de faire du G20 l’enceinte de référence – ce qui n’était pas évident jusqu’à ce qu’elle en prenne la présidence –, pour montrer que la régulation économique mondiale n’est plus l’apanage du club des pays les plus développés et ainsi rassurer les pays émergents et les inciter à y prendre une part active.
Bien que sa disparition ait été annoncée lors de la création du G20, le G8 a continué de se réunir en parallèle, suivant le souhait de plusieurs de ses membres, dont l’Italie. L’exercice G8 conserve en effet une certaine pertinence – à supposer qu’il ne cherche pas à faire en sorte que ses décisions préfigurent celles du G20. Le poids économique de ses membres reste indéniable, en matière de production mais aussi, par exemple, d’aide au développement – leur contribution représente 70 % des financements mondiaux. Leur degré de cohésion est nettement plus élevé qu’entre les membres du G20, pour des raisons tenant tant à leurs intérêts économiques immédiats qu’à la solidité de leurs valeurs communes et à l’ancienneté de leur collaboration. Le G8 continue de représenter un bon baromètre des équilibres politiques mondiaux. Il ne possède certes pas d’administration propre mais une vraie capacité d’impulsion politique, à travers des groupes de travail communs permanents mais aussi des services internationaux comme le GAFI ou le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes (PMG8), qui ne dépendent pas directement de lui mais sur lesquels il s’appuie pour donner corps à ses impulsions politiques.
Outre les questions géopolitiques, stratégiques, sécuritaires et militaires, sur lesquelles il a vocation à garder la main, le G8 est approprié pour aborder, des problématiques ayant trait à l’aide au développement ou à Internet, avec l’idée de mobiliser, plus tard, des groupes de pays élargis. Le G8 permet également d’aborder en profondeur des sujets aux incidences mondiales mais que certains émergents ne veulent pas voir inscrits à l’ordre du jour du G20, comme celui de la sûreté nucléaire. N’oublions pas, enfin, le G7 finances, qui, nous l’avons vu, permet d’aborder des points très techniques.
La France, sous sa présidence, a veillé à centrer le G8 sur son « cœur de compétences », c’est-à-dire les sujets sur lesquels ses membres peuvent avoir un véritable impact, en veillant à ne pas dupliquer l’agenda du G20. Elle a su pleinement exploiter l’atout de la concordance entre la présidence du G20 et celle du G8, en prenant soin d’éviter un écueil : faire apparaître le G20 comme le réceptacle des préoccupations des pays du G8.
Le président Obama avait plaidé, au départ, pour un sommet unique G8-G20. Cela aurait induit une défiance de la part des pays émergents, qui auraient pu légitimement y voir une entreprise de marginalisation du G20, ravalé au statut de chambre d’enregistrement du G8. La séquence en deux temps finalement obtenue par la France a permis à sa double présidence de prendre la dimension attendue.
Les ministres des affaires étrangères, réunis à Paris les 14 et 15 mars 2011, ont présenté leurs condoléances au Japon, qui avait subi, la semaine précédente, le tremblement de terre et le tsunami, et où la sécurité nucléaire commençait à susciter de sérieuses inquiétudes.
Dans un contexte de transition démocratique dans plusieurs pays arabes, ils ont « réaffirmé l’intérêt du processus du G8-BMENA(119), le Partenariat pour le progrès et un avenir commun ».
Ils ont insisté sur la nécessité d’agir pour « le règlement du conflit israélo-palestinien par la négociation et le renforcement de l’intégration d’Israël dans son environnement régional ».
Plusieurs autres questions régionales ont été abordées : l’enjeu du partenariat avec l’Afrique, la situation politique en Côte d’Ivoire, au Soudan, en Somalie et dans la région des Grands lacs ainsi que la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes ; l’Afghanistan et son environnement régional ; la reconstruction et le processus électoral à Haïti.
Ils se sont livrés à un point de situation sur les questions de non-prolifération et le désarmement – suivies de manière permanente dans le cadre du PMG8 –, en dénonçant les activités d’enrichissement de l’uranium nord-coréen et le programme nucléaire iranien.
S’agissant de la menace terroriste, ils « ont demandé au Groupe de Lyon-Rome(120) de préparer un rapport d’étape pour le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de Deauville ».
Ils ont enfin adopté une déclaration conjointe affirmant « un soutien inconditionnel » à la Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxines (CIAB).
Cependant, alors que la rébellion libyenne était en déroute depuis une semaine et que les forces loyales au colonel Kadhafi avaient déjà repris les villes de Zaouïa, à l’Ouest de Tripoli, et de Ben Jawad, Ras Lanouf et Brega, dans le Golfe de Syrte, la France, en dépit du soutien du Royaume-Uni, a échoué à convaincre ses partenaires de l’opportunité de procéder à des frappes militaires ciblées et d’interdire le survol de la Libye. La Russie et surtout l’Allemagne se sont montrées opposées à l’usage de la force, tandis que les Etats-Unis, déjà tellement englués sur les théâtres d’opérations irakien et afghan, hésitaient à s’engager dans un nouveau conflit. Un consensus s’est seulement dessiné pour s’en remettre à une discussion et à une éventuelle résolution au Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui sera chose faite quelques jours plus tard, en dépit de l’abstention de cinq membres du G20(121). Prenant acte de l’impasse, le Royaume-Uni a finalement reconnu que le G8 ne constitue pas « l’instance de décision » pour une action militaire.
En marge du sommet du G8, à Paris, les 24 et 25 mai 2011, dans le cadre d’une initiative baptisée « e-G8 Forum », la présidence française a réuni plus de 1 000 décideurs du Web, dont les dirigeants des principales entreprises du secteur, comme Google, Facebook ou eBay, afin d’aborder les enjeux économiques et sociaux inhérents à ce média. Dans les pays où la pénétration d’Internet est la plus forte, ce secteur contribue désormais davantage à la croissance que l’agriculture ou l’énergie. En outre, comme l’a souligné le Président de la République, Internet, devenu « un vecteur d’une puissance inédite » pour la liberté d’expression, ne saurait s’exonérer « de valeurs minimum, de règles minimum ».
Tous les enjeux liés au développement des nouvelles technologies ont été abordés dans les débats :
– le dilemme entre liberté et sécurité sur Internet ;
– le risque de constitutions de monopoles ;
– la protection des données personnelles et le droit à l’oubli ;
– le respect de la propriété intellectuelle
– la nécessité de lutter contre la cybercriminalité, contre l’accès des enfants à la pornographie et contre la promotion du terrorisme.
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont eu un échange sur ce sujet et ont entériné le fait qu’un tel forum sera dorénavant organisé préalablement à chaque sommet du G8.
Tout en poursuivant les priorités énoncées au début de la présidence française(122), le sommet des 24 et 25 mai 2011 a été résolument placé sous le signe des libertés et de la démocratie, afin, comme il se devait, d’interagir avec l’actualité mondiale.
Les chefs d’Etat et de gouvernement ont d’abord fait passer un message de solidarité avec les nouvelles démocraties africaines et arabes, à travers une session de travail approfondie avec les présidents élus récemment et démocratiquement en Côte d’Ivoire, au Niger et en Guinée, ainsi qu’avec les dirigeants de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Éthiopie et du Sénégal. Cette réunion a renforcé et dynamisé le partenariat du G8 avec le continent africain. Le G8 a ainsi voulu mettre en lumière les avancées de la démocratie et les résultats économiques remarquables de l’Afrique depuis une décennie. Il a rendu compte de façon transparente du suivi de ses engagements en matière d’aide publique au développement, en mettant l’accent sur la santé et la sécurité alimentaire.
En plein « printemps arabe », le G8 a décidé de fonder un partenariat de long terme historique, à la fois politique et économique, avec les pays en transition démocratique, baptisé « Partenariat de Deauville ». Son suivi a été confié à Edouard Balladur jusqu’au terme de la présidence française du G8, le 31 décembre 2011, date à laquelle le relais sera passé à la présidence américaine. Un soutien financier de 40 milliards de dollars à l’Égypte et à la Tunisie a été annoncé pour 2011-2013. S’agissant de la Libye, même si les divergences affichées devant les Nations unies comme lors de la ministérielle affaires étrangères de mars demeurent, le G8 a unanimement et explicitement réclamé le départ de Mouammar Kadhafi.
Trois mois et demi plus tard, le 10 septembre 2010, en marge du G7 finances de Marseille, les ministres, rejoints par leur homologue russe pour une session du G8 finances, ont annoncé, avec neuf organisations internationales, leur intention de doubler leur aide financière au « printemps arabe » pour la porter à 80 milliards de dollars, versables d’ici à 2013.
Le sommet de Deauville du G8 a fait le point sur d’autres sujets politiques majeurs : le processus de paix au Proche-Orient, la situation en Syrie, en Iran, en Afghanistan et au Pakistan.
Il a endossé les conclusions du plan d’action sur les drogues adopté le 10 mai 2011, à Paris, en conclusion de la réunion des ministres de l’intérieur.
Il a appelé à l’extension du mandat de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au sud de la Méditerranée. Pour lancer sans tarder de nouveaux projets, il a décidé la création d’un fonds dédié.
Le G8 a fait part de sa solidarité avec le Japon et a consacré un pan important de ses discussions aux questions de sécurité nucléaire, prenant des engagements en faveur de la finalisation du financement du sarcophage de Tchernobyl et surtout du rehaussement des normes applicables.
Le 28 avril 2011, à Paris, en présence du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Japonais Yukiya Amano, Nicolas Sarkozy avait insisté sur son souhait d’inscrire la question de la sûreté nucléaire à l’ordre du jour du sommet du G8 de Deauville. Lors du sommet, l’AIEA a été invitée à réexaminer ses standards relatifs à la construction et à l’exploitation des centrales nucléaires dans les zones sismiques, en tenant compte de l’impact global d’événements naturels.
Dans la foulée du sommet de Deauville, le 7 juin, trente-trois pays – les membres du G8 et de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) – se sont rassemblés, au niveau ministériel, en vue de s’accorder sur les moyens de renforcer les normes mondiales de sûreté nucléaire et la coopération internationale en matière de contrôles. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui présidait ce séminaire informel, a réitéré la demande faite à l’AIEA « de revoir ses standards de sûreté à la lumière de l’accident de Fukushima et de veiller à leur bonne application ».
Les participants se sont accordés sur la nécessité de renforcer le rôle de l’AIEA mais pas sur le fait de lui conférer des pouvoirs contraignants. Ils ont exprimé une position commune dessinant trois grandes pistes d’action :
– renforcer les dispositifs internationaux, notamment la convention sur la sûreté nucléaire (CSN) et la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, dite « convention commune » ;
– accroître la coopération internationale, en matière de gestion de crise mais aussi d’évaluation des risques – à travers un processus d’évaluation par les pairs – et d’information mutuelle ;
– améliorer la sûreté des installations, en mettant systématiquement en œuvre des examens approfondis du type stress tests(123) et en harmonisant au maximum les protocoles d’autorisation, de contrôle et d’inspection des nouveaux réacteurs.
Les principes énoncés lors de cette réunion ont ensuite été présentés devant la conférence ministérielle de l’AIEA consacrée à la sûreté nucléaire, qui s’est tenue à Vienne le 20 juin 2011, avec la participation de ses 151 Etats membres.
Le G8 a abordé d’autres sujets essentiels comme la situation économique mondiale et les négociations commerciales internationales ou encore, à quelques mois de la conférence de Durban de novembre et décembre 2011, la lutte contre le changement climatique.
TROISIEME PARTIE :
REGULER LES MARCHES SUR TROIS FRONTS
POUR LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LES DESEQUILIBRES INTERNATIONAUX
ET ENTRAINER LA CROISSANCE MONDIALE
Comme l’indiquait le dossier distribué lors de la conférence de presse de lancement de la présidence française, 24 janvier 2011 : « En 2011, le G20 devra achever les chantiers déjà engagés pour s’attaquer aux racines de la crise mais également étendre son agenda à de nouveaux chantiers pour améliorer de façon durable la stabilité et la prospérité mondiales. En effet, seul le G20 dispose du poids, de la légitimité et de la capacité de décision nécessaires pour donner les impulsions indispensables à l’avancement des grands chantiers économiques d’aujourd’hui ».
Pour que la réunion de Cannes s’impose effectivement comme un premier sommet de construction des conditions du développement économique à moyen terme et à long terme, elle devra traduire dans l’agenda planétaire les grands enjeux du moment. Dans le contexte actuel, relativement favorable à la régulation, et dans la foulée du succès du sommet du G8 de Deauville, il s’agit, dans l’intérêt commun de toutes les parties :
– premièrement, de confirmer l’esprit fondateur du G20, à savoir promouvoir la croissance et le libre-échange à l’échelle mondiale(124) ;
– deuxièmement, sur l’ensemble des dossiers abordés lors des précédents sommets, d’aller au-delà des effets d’annonce et de passer à une phase de consolidation des acquis dans les législations nationales ;
– troisièmement, de mettre sur la table de nouveaux sujets, laissés jusqu’à présent de côté car ils étaient soit secondaires au regard de l’urgence qu’il y avait à répondre à la crise, soit si complexes et sujets à contentieux qu’ils auraient risqué de « vampiriser » les premiers sommets.
Pour synthétiser, l’objectif est de bâtir une économie mondiale plus forte, plus stable et plus résiliente. A cet effet, outre les dossiers du socle universel de protection sociale, de l’aide au développement et de la sécurité nucléaire, il conviendra surtout, à Cannes, d’obtenir des résultats dans trois domaines :
– amorcer la réforme du système monétaire international ;
– poursuivre l’ouvrage de régulation des marchés financiers ;
– réduire la volatilité des prix des matières premières agricoles.
Sur les deux premiers points, gageons que les chefs d’Etat et de gouvernement auront le double souci non seulement de rechercher des solutions valides à moyen terme, mais aussi de répondre à l’urgence soulevée par la situation dans la zone euro.
I. LE SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL,
PARFOIS QUALIFIE DE « NON-SYSTEME »,
APPELLE UNE REFORME PROFONDE
Ainsi que nous l’avons relaté plus haut(125), l’abandon du système de taux de change fixes, en mars 1973, a été l’un des événements qui a nécessité le développement de la diplomatie de clubs entre les pays les plus développés économiquement et les plus engagés dans les échanges commerciaux internationaux. Néanmoins, près de quatre décennies plus tard, le système monétaire international est pratiquement devenu un « non-système », incapable de générer une discipline, les grandes puissances et le FMI ne se coordonnant que pour répondre en urgence aux grandes crises qui ont jalonné l’histoire récente, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud-Est au milieu des années 1990, ou encore dans plusieurs pays européens périphériques depuis 2009.
Malgré les déclarations impétueuses annonçant un « nouveau Bretton Woods », entendues avant chaque sommet, force est de constater que la conception et l’organisation d’un nouvel ordre monétaire mondial est plus compliquée que cela. Rappelons que les pays du G20 représentent 85 % de la production de richesses mondiales. Les enjeux de leadership géoéconomique et les divergences d’intérêt sont tels que le processus sera long et devra passer par plusieurs étapes.
Le flottement des monnaies introduit trois dangers nouveaux :
– les produits financiers de plus en plus complexes, opaques, risqués et fragiles qui se développent portent en germe des crises systémiques ;
– la spéculation sur les monnaies génère une explosion des flux financiers, sans commune mesure avec le rythme de croissance des flux de marchandises ;
– la volatilité excessive des taux de change crée de l’incertitude pour les ménages et les entreprises dans leurs décisions économiques(126).
Un groupe de dix-huit experts de haut niveau issus de quinze pays, réunis autour de l’ancien directeur général du FMI Michel Camdessus(127) explique le phénomène ainsi :
« Depuis l’avènement du flottement généralisé en 1973, les taux de change des principales monnaies du système ont largement fluctué, reflétant le jeu de forces spéculatives puissantes et changeantes, souvent sans lien avec les fondamentaux. Les taux de change n’ont pas toujours évolué dans un sens favorable à la résorption des déséquilibres. Ces écarts par rapport aux fondamentaux peuvent découler de politiques budgétaires, monétaires et de change inappropriées, ou du comportement des marchés. Les économies ouvertes de petite taille, en particulier, ont été confrontées à des difficultés. Des fluctuations fortes et durables des monnaies peuvent ainsi entraîner des distorsions sévères dans l’ensemble du système et affecter l’allocation des ressources.
« Alors même que la mondialisation imbrique les économies entre elles et les rend de plus en plus interdépendantes, les politiques économiques et financières menées au niveau national – y compris en matière de changes – ne font l’objet d’aucune mise en cohérence à l’échelle mondiale. Le FMI, censé précisément être le lieu de la coordination monétaire, ne remplit en vérité pas ce rôle :
« Pendant trop longtemps, on a largement admis qu’il serait suffisant – pour garantir la stabilité mondiale – que chaque pays gère convenablement ses propres affaires et évite de manipuler son taux de change. Cette conception d’une fonction auto-équilibrante des marchés et des économies s’est révélée trop optimiste.
« Il n’existe pas de cadre d’analyse largement accepté pour mesurer les effets des politiques menées dans les grands pays sur les autres économies et sur le système financier dans son ensemble.
« Le FMI, au centre du système, a souffert d’un "déficit de légitimité”, lié à la fois à la sous-représentation de certaines économies émergentes et de certaines pays en développement, et à l’inefficacité du processus d’“examen par les pairs” pour influencer les politiques de ses principaux pays membres. »
Quant à l’hypothèse d’une inclusion du yuan dans le panier de devises formant les DTS, elle impliquerait sa libre convertibilité par rapport aux autres monnaies. Pourra-t-on attendre sans rien faire, jusqu’en 2015 ou 2020, un changement de la politique monétaire chinoise ? L’euro fort n’est pas la conséquence de la bonne santé économique de la zone mais le prix de l’inaction et de l’absence de politique de change face à l’activisme monétaire des autres pays(128) ; l’euro est devenu la variable d’ajustement du système monétaire international.
Le SMI n’a certes pas failli pendant la crise mais il n’est plus adapté à l’échelle des forces économiques mondiales ni aux fondamentaux de l’économie réelle : 80 % des transactions commerciales internationales sont libellées en dollars alors que les Etats-Unis ne produisent plus que 25 % de la richesse mondiale(129).
D’après Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Le SMI a fait preuve de résilience pendant la crise, mais il est loin d’être parfait. Les entrées et sorties brutales de capitaux, l’accumulation de réserves de change à un niveau sans précédent dans certains pays, les larges fluctuations des taux de change, mais aussi l’excessive rigidité de certains régimes de change ou des déséquilibres importants et persistants de balance des paiements constituent un risque pour la croissance mondiale. […] En outre, dans un monde caractérisé par l’émergence rapide de certaines économies, qui devient ainsi de plus en plus multipolaire, il faut s’attendre à ce que leurs monnaies – notamment la monnaie chinoise, le renminbi, mais sans doute d’autres, comme le réal brésilien – jouent un rôle croissant. Bien sûr, le rôle des grandes monnaies et en premier lieu du dollar ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le SMI doit accompagner ces changements vers ce monde multipolaire et permettre une transition sans à-coups. »
Les monnaies des puissances économiques émergentes ne sont encore utilisées que marginalement comme devises de transaction internationales, un statut oligopolistique réservé au dollar, à l’euro, au yen et à la livre sterling. Il s’ensuit que ces monnaies internationales, à commencer par le dollar, sont prépondérantes dans les réserves souveraines. La réaffectation des flux commerciaux internationaux vers le Sud et l’explosion des réserves de changes détenues par les émergents rendent le real brésilien, la roupie indienne et plus encore le yuan chinois légitimes pour être employées comme monnaies d’échange. Lors de leur troisième sommet, qui s’est tenu le 14 avril 2011 sur l’île chinoise d’Hainan, les BRICS ont d’ailleurs décidé de développer le règlement en devises nationales de leurs échanges commerciaux.
Même si la crise actuelle plonge aussi ses racines ailleurs, les fortes turbulences économiques que nous traversons sont aggravées par une transition monétaire historique que les autorités publiques nationales n’ont jusqu’à présent pas prise à bras-le-corps.
Du 12 juin au 27 juillet 1933, des représentants de soixante-six pays se réunissent à Londres pour une conférence économique mondiale, en vue de convenir d’une réponse commune à la Grande dépression consécutive au krach boursier d’octobre 1929. Cependant, les rivalités entre grandes puissances sont tellement exacerbées que les délégués se séparent, après un mois et demi de discussions, sans qu’aucun accord ait été trouvé. La Seconde Guerre mondiale éclatera six ans plus tard.
La France et l’Italie, en particulier, défendent le retour à un système fondé sur l’étalon-or mais les Etats-Unis, qui viennent de dévaluer le dollar, s’opposent à tout accord de stabilisation des taux de change. Même le projet de stabilisation des taux de change entre le dollar, la livre sterling et le franc, un moment envisagé, échoue. Les différents pays s’affrontent dès lors à coups de dévaluations compétitives et la crise mondiale est relancée.
Comparaison n’est pas raison. Si la situation économique actuelle n’est pas sans rappeler, par certains aspects, celle de 1933 – crise industrielle, tensions inflationnistes, fragilité boursière, montée du chômage, compétition commerciale exacerbée, tentation du protectionnisme –, l’état des relations internationales, en 2011, n’a rien à voir avec celui qui prévalait à l’époque. Les relations internationales sont désormais imprégnées de la culture de la négociation, qui a pris le pas sur celle de la violence. Elles sont en outre débarrassées des appétits coloniaux et influencées par le fonctionnement égalitariste des Nations unies. Instruites par l’histoire des conséquences que peut entraîner le refus obstiné de s’entendre, les grandes puissances savent toutes ce qu’elles auraient à y perdre.
Selon M. Camdessus, « faute de réforme du système monétaire international, les relations économiques mondiales sont bâties sur du sable ». Le G20 constitue le format idéal pour aborder ces questions mais trois années de « rodage » ont été nécessaires avant d’instaurer un degré de confiance mutuelle suffisant entre partenaires pour permettre de les inscrire expressément à l’ordre du jour.
Le sommet de Séoul s’est caractérisé par un conflit entre pays avancés et pays en voie de développement, en particulier entre Américains et Chinois. Quoique étant étroitement dépendants les uns des autres et ayant un intérêt partagé à une meilleure coordination, les premiers ont jalousement défendu leurs prérogatives monétaires, tandis que les seconds n’étaient manifestement pas encore prêts à endosser des responsabilités mondiales.
La problématique centrale est en effet celle de la confrontation entre le yuan et le dollar, que l’on pourrait presque qualifier de « guerre des changes ».
D’un côté, les Etats-Unis, afin de compenser une croissance faible – en tout cas trop faible au regard des attentes de la société – et favoriser l’emploi, ont utilisé l’endettement public puis privé pour soutenir l’activité économique, à tel point que la dette publique atteint aujourd’hui 14 500 milliards de dollars et dépassera d’ici à quelques mois le PIB du pays. Ils craignent que le sujet soit instrumentalisé pour attaquer le dollar, devise hégémonique en matière de réserves et affirment que le problème ne provient pas du dollar mais du yuan.
De l’autre côté, la Chine, grâce à son modèle économique fondé sur des coûts de production très bas favorisant les exportations et la constitution d’excédents commerciaux, a accumulé des réserves de change colossales, suivant une courbe de progression exponentielle depuis une dizaine d’années, comme en rend compte le graphique ci-dessous. Au total, ces comportements se traduisent par l’injection d’une trop grande quantité de liquidités dans l’économie mondiale, porteuse de déséquilibres macroéconomiques :
– des flux de capitaux internationaux excessifs, notamment à destination des pays émergents, qui alimentent des bulles boursières et immobilières menaçant d’éclater au moindre signe de retournement du marché ;
– des anomalies dans la constitution des taux de change, avec une dépréciation du dollar ;
– des hausses de prix spéculatives sur des actifs comme l’immobilier ou les matières premières ;
– des tensions inflationnistes inquiétantes.
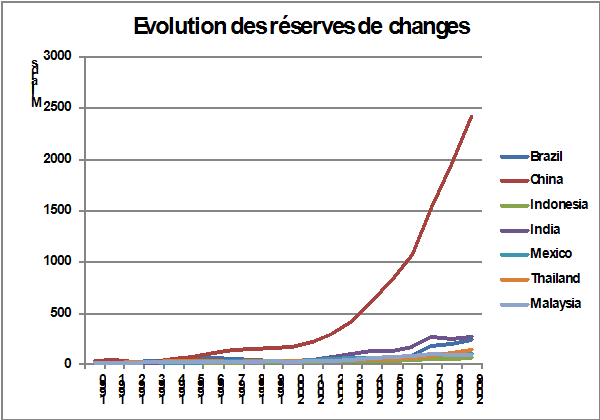
Source : ministère des affaires étrangères et européennes.
La priorité affichée par le Président de la République, le 24 janvier 2011, lors du lancement de la présidence française, ouvre un vaste chantier en prônant « la construction d’un SMI plus stable et plus robuste ». Si ce flou pourrait apparaître, en première analyse, comme un aveu d’impuissance, il nous semble plutôt dicté par le réalisme : trancher d’emblée en faveur d’un mécanisme précis aurait été contraire à la philosophie du G20, qui consiste à progresser par consensus, et aurait hypothéqué la capacité de la France à obtenir de premières avancées. L’ambition, peut-être encore davantage sur ce sujet que sur les autres, reste de toute façon mesurée, tant les enjeux économiques sont immenses et les conséquences d’un changement de système difficiles à mesurer dans leurs différentes dimensions. La France a bordé le cadre conceptuel des négociations : assurer un nouvel accompagnement international des politiques macroéconomiques et monétaires des grandes puissances économiques sans pour autant créer un nouveau serpent monétaire international.
Le Président de la République a confié à Angela Merkel et Felipe Calderon le co-pilotage de cette question. Le choix de la chancelière allemande et du président mexicain démontre l’importance de la thématique. L’Allemagne est le principal partenaire de la France et dispose d’une crédibilité internationale en matière de politique monétaire, eu égard à sa tradition de rigueur. Le Mexique a bien intégré les rouages du FMI – il fut le premier pays émergent, en 2009, à souscrire à la nouvelle ligne de crédit FCL. De plus, il prendra la présidence du G20 en 2012, avec pour mission essentielle de poursuivre l’œuvre de réforme du système monétaire international que le sommet de Cannes est censé ébaucher. L’animation de tous les groupes de travail techniques relevant des problématiques monétaires a été assumée par les hauts fonctionnaires allemands et mexicains.
Pour ouvrir le débat de façon dépassionnée et esquisser des pistes de réflexion avant la ministérielle finances de Washington du 15 avril 2011, le Président de la République a pris l’initiative de proposer un « séminaire de haut niveau » à dominante académique, qui s’est tenu à Nankin, le 31 mars 2011, autour de treize ministres des finances, de huit banquiers centraux, de personnalités internationales et d’universitaires, accueillis par le vice-premier ministre chinois Wang Qishan.
Un deuxième « round technique » sera organisé par l’Allemagne, le 6 octobre 2011, à Berlin.
Ce sont encore les experts de l’Initiative du Palais-Royal qui ont le mieux cerné l’objectif : en conclusion de leur rapport, ils appellent de leurs vœux un système « qui préserve la liberté des échanges commerciaux et des paiements courants et qui permet un meilleur partage des gains liés à une mondialisation financière convenablement régulée [et] dans lequel tous les pays reconnaissent leur rôle dans la stabilité mondiale et acceptent que les objectifs nationaux à court terme puissent, le cas échéant, être subordonnés à l’intérêt commun ».
Le 8 août 2011, les ministres des finances et les gouverneurs de banque centrale du G20 ont publié un communiqué pour signifier aux marchés leur prise de conscience de l’acuité de la crise européenne. Ils y affirment leur « engagement à prendre toutes les initiatives nécessaires de manière coordonnée pour soutenir la stabilité financière et promouvoir une croissance économique plus forte dans un esprit de coopération et de confiance ». Ils s’engagent par ailleurs à rester « en contact étroit au cours des semaines à venir et [à coopérer] en tant que de besoin, en étant prêt à prendre les actions assurant la stabilité financière et la liquidité des marchés financiers ». Enfin, ils prévoient de continuer « à travailler intensément pour obtenir des résultats concrets en faveur d’une croissance forte, durable et équilibrée dans le contexte du Cadre du G20 pour la croissance ».
L’Europe aura d’autant plus de chance de faire avancer ses priorités dans le G20 qu’elle aura déterminé en son sein une position unie sur la question du nouvel ordre monétaire(130). L’euro est devenu une variable d’ajustement dans la bataille des monnaies. Alors que l’UE doit être un catalyseur de la coordination économique au niveau international, elle n’a pas encore été capable, à ce jour, de prendre les mesures durables à la hauteur des enjeux qui se posent à elle. Pourquoi les Etats membres renonceraient-ils à se servir des instruments mis à leur disposition par le traité pour définir en commun une politique monétaire extérieure, par exemple en instituant une véritable politique de change au niveau de la zone euro, comme les y autorise l’article 219, alinéas 1 et 2, du TFUE(131) ? L’UE se donnerait là les moyens d’améliorer la représentation internationale de la monnaie unique et mener de véritables négociations avec la Chine et les Etats-Unis.
Recourir à l’article 219, alinéas 1 et 2, du TFUE afin d’instituer une véritable politique de change au niveau de la zone euro, à travers notamment le renforcement de la gouvernance.
a) Le cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée(132)
Le concept de « cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée » a été imaginé à Pittsburgh et formalisé à Toronto, avec l’instauration des bases d’un processus d’évaluation mutuelle. Il s’agit d’un processus d’évaluation mutuelle des politiques économiques des membres du G20 permettant d’identifier, avec l’appui technique du FMI, les sources de déséquilibres macroéconomiques qui pénalisent la croissance mondiale. Ce processus doit conduire le G20 à recommander des choix de politiques économiques nationales à ses membres afin d’atteindre :
– une croissance forte, ce qui implique que chaque pays du G20 se donne les moyens de converger vers son taux de croissance potentielle, et même de le relever, notamment grâce à la mise en œuvre de réformes structurelles adaptées ;
– une croissance durable, c’est-à-dire compatible avec la soutenabilité des finances publiques, la stabilité des prix et celle du système financier, et assortie de systèmes sociaux et d’un environnement de qualité ;
– une croissance équilibrée, qui s’étend à tous les pays du G20 ainsi qu’à toutes les régions du monde, sans générer de déséquilibres internes ou externes.
(1) La proposition des Américains à Séoul : corseter les excédents et les déficits commerciaux nationaux
Entre 1998 et 2007, la somme des déficits et des excédents des pays du G20 est passée de 580 milliards de dollars à 2 500 milliards de dollars, c’est-à-dire de 2,3 à 5,6 % du PIB du G20. En proportion de la richesse mondiale, les déséquilibres de balance des paiements ont donc été multipliés par près de 2,5.
Au sommet de Séoul, Barack Obama a déclaré : « Nous voulons être certains de stimuler la croissance chez nous, mais aussi à l’étranger, d’une manière stable et responsable. » Dans cet esprit, Timothy Geithner a ensuite proposé que les excédents et déficits commerciaux nationaux soient corsetés dans un tunnel de plus ou moins 4 %. Cette idée, vécue comme une agression par la délégation chinoise – elle remet en cause le dynamisme des exportations de la Chine, fondement de sa croissance –, n’a pas recueilli l’unanimité requise(133). Elle a cependant ouvert la voie à un suivi collectif plus scientifique des déséquilibres macroéconomiques mondiaux, avec l’élaboration d’un tableau de bord fondé sur des indicateurs communs.
Lors de la réunion des ministres des finances du G20 des 19 et 20 février 2011, à Paris, les Etats-Unis ont continué de militer en faveur de cette approche par les déséquilibres macroéconomiques, qui souligne le désavantage comparatif des pays les plus développés en matière de compétitivité prix, en suggérant l’adoption d’indicateurs de suivi. Au terme de délicates tractations méthodologiques qui ont nécessité beaucoup d’énergie de la part de la présidence française, le principe a finalement été acté et trois catégories d’indicateurs ont été retenues :
– la dette et le déficit publics ;
– le taux d’épargne et d’endettement privés ;
– la balance courante(134).
Lors de la réunion ministérielle suivante, le 14 avril 2011, à Washington, les ministres des finances et les gouverneurs de banque centrale confèrent une nouvelle dimension au processus d’évaluation mutuelle en s’entendant sur des lignes directrices indicatives(135) pertinentes pour mesurer chacun de ces indicateurs. Dans le communiqué final, il est précisé que « sans constituer des cibles, ces lignes directrices établissent des valeurs de référence pour chaque indicateur disponible, permettant ainsi d’identifier les pays qui seront soumis à l’évaluation approfondie prévue par la seconde étape du processus ».
Quatre lignes directrices indicatives sont tracées, à partir de quatre méthodes :
– une méthode structurelle, appuyée sur des modèles économiques et fondée sur la théorie économique, consistant à évaluer les membres du G20 à l’aune de chaque indicateur, en tenant compte des circonstances spécifiques, y compris dans les pays gros producteurs de matières premières, par exemple le profil démographique, le solde pétrolier ou la croissance tendancielle ;
– une méthode statistique comparant les pays du G20 sur la base des tendances historiques ;
– une méthode statistique qui compare les indicateurs historiques de chaque pays du G20 à ceux de groupes de pays se trouvant à un stade de développement comparable ;
– une méthode statistique s’appuyant sur des données et comparant les indicateurs de chaque pays du G20 à ceux du G20 pris dans son ensemble.
Il a été décidé que des critères plus rigoureux seraient appliqués aux plus grandes économies, à savoir celles atteignant plus de 5 % du PIB total du G20(136), considérant qu’elles représentent le plus fort potentiel de contagion en direction du reste du monde.
Au total, sept pays ont été identifiés comme présentant des déséquilibres excessifs au regard de ces lignes directrices indicatives : les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. Leur degré d’influence sur l’économie mondiale n’est pas identique – le déséquilibre extérieur de la France, par exemple, ne présente pas de danger pour l’économie mondiale, car il est faible en valeur absolue, et son endettement reste raisonnable par rapport à celui d’autres pays. L’essentiel est que cette liste crée un climat de coresponsabilité et évite de stigmatiser inutilement les Etats-Unis et la Chine.
Cet accord fournit une base concrète à partir de laquelle les vingt grandes puissances économiques mondiales vont pouvoir ouvrir un nouveau cycle de discussions, avec pour nouveaux objectifs d’évaluer leurs politiques économiques respectives, de proposer des mesures correctives face à des déséquilibres susceptibles de provoquer des déstabilisations macroéconomiques et de soutenir les objectifs de croissance du G20.
Il ouvre la voie à la prochaine étape du processus d’évaluation mutuelle, qui portera sur l’étude des progrès de chaque pays vers la viabilité extérieure, compte tenu des circonstances domestiques, à travers deux actions distinctes.
Premièrement, les déséquilibres élevés vont faire l’objet d’une analyse approfondie visant à comprendre leur nature, leurs causes fondamentales et les obstacles à l’ajustement. Pour compléter le travail interne du G20, il sera fait appel à une analyse indépendante des services du FMI, que le G20 sera appelé à approuver.
Deuxièmement, à partir des lignes directives indicatives, l’objectif, à Cannes, est de poursuivre ce processus itératif entrepris durant l’année à travers les réunions des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale.
Adopter un plan d’action ambitieux destiné à corriger les déséquilibres macroéconomiques et à entraîner une croissance mondiale plus vigoureuse, plus stable et plus équilibrée.
Essayer d’en fixer les modalités dès l’ultime réunion du G20 finances, à Paris, les 14 et 15 octobre 2011, afin que le sommet soit en mesure de se prononcer sur des propositions délivrables solides.
A Washington, neuf axes de travail prioritaires ont été définis :
– taux de change ;
– surveillance macroéconomique ;
– en matière de flux de capitaux :
* surveillance des flux de capitaux ;
* développement des marchés locaux de capitaux ;
– en matière de gestion de la liquidité mondiale :
* définition et suivi ;
* élargissement du panier des DTS ;
* discussion sur le niveau optimal des réserves ;
* filets de sécurité financière ;
* articulation entre arrangements financiers régionaux et FMI.
Ces nouveaux progrès dans la régulation économique mondiale sont à mettre au crédit du G20, sans lequel il aurait été impossible d’aller aussi loin dans la concertation et la coordination. L’efficacité du dispositif dépend toutefois de la volonté des Etats membres de fixer des seuils d’alerte.
Fixer des seuils d’alerte, notamment en matière de taux de change effectifs réels, de flux de capitaux et de balance des paiements, au-delà desquels des mesures volontaristes d’amortissement pourront être prises pour réduire les distorsions.
a) Malgré les antagonismes entre intérêts nationaux, la communauté mondiale est condamnée à coopérer
Paradoxalement, malgré des intérêts à court terme antagonistes, tous les acteurs mondiaux conviennent que le statu quo n’est pas tenable, que les déséquilibres monétaires doivent être résorbés. Ils ont pris la mesure de l’interdépendance économique et savent que le monde entier paierait très cher un manque de coordination. La politique monétaire est habituellement employée par les Etats comme un instrument aux mains des Etats pour soutenir leur politique. Le dialogue américano-chinois et la recherche d’un consensus dans le cadre du G20 ne sont-ils pas inéluctables, quand 70 % des réserves chinoises sont libellées en dollars ?
Le 14 avril 2011, à l’occasion du sommet des BRICS, la banque centrale chinoise a annoncé que ses réserves de change avaient augmenté de 24,4 % en un an pour atteindre, fin mars, 3 044 milliards de dollars, avant de dépasser les 3 200 milliards six mois plus tard, dont un tiers placés en bons du trésor américains. Les Chinois cherchent à diversifier progressivement leurs actifs monétaires en se tournant vers d’autres devises, notamment l’euro, en rachetant des bons du trésor de pays européens en difficultés. Conscients de courir actuellement un risque patrimonial élevé lié à la valeur du dollar, ils s’efforcent de ne rien faire qui puisse en accélérer la chute, tout en étant animés par la volonté d’accompagner un rééquilibrage progressif. Le premier ministre chinois a aussi déclaré, le 14 mars 2011, que la Chine continuerait d’augmenter la flexibilité du taux de change du yuan, mais toujours graduellement, afin de prendre en considération la pression sur les entreprises et l’emploi, dans un souci de contrôle de la stabilité sociale. De fait, depuis 1994, le mécanisme de formation du taux de change a été réformé à trois reprises et la monnaie chinoise, non convertible, s’est tout de même appréciée de 57,9 %. Elle reste toutefois sous-évaluée, selon les estimations, de 20 à 50 %.
Le modèle économique chinois, fondé sur un investissement public soutenu massivement par le quantitative easing des banques publiques, n’est plus soutenable. Le pays est prisonnier d’un régime de changes qui le force à intervenir sur les marchés, à créer de la monnaie et à contenir la demande interne. En outre, la rémunération des facteurs de production est complètement déformée : en 2010, 90 % des fruits de la croissance chinoise se sont encore concentrés sur l’investissement.
La Chine revendique cependant d’avancer à son rythme, en invoquant son statut de pays en voie de développement, avec comme souci de ne pas voir sa monnaie suivre la même trajectoire que le yen – sa réévaluation brutale, dans les années 1980, avait considérablement déstabilisé le système productif japonais. Même si sa politique économique n’est pas monolithique – certains pans de son administration résistent encore à toute évolution –, la nouvelle grande puissance asiatique affiche une vision de plus en plus multilatérale des problèmes monétaires mondiaux, sous l’influence, en particulier, de sa banque centrale.
Les Américains ne sont pas hostiles non plus à débattre de nouvelles solutions pour donner de la stabilité au système, M. Obama l’a clairement confirmé au Président de la République, le 10 janvier 2011, à Washington, lors de la rencontre bilatérale destinée à préparer la présidence française. De leur point de vue, compte tenu de la dépréciation tendancielle du dollar, les bons du trésor n’apparaissent plus comme un placement aussi sûr que par le passé et les investisseurs réclament un rendement de plus en plus élevé pour les emprunts d’Etat. Pour la première fois de leur histoire, les Etats-Unis ont perdu leur statut d’emprunteur à risque zéro. L’agence de notation Standard and Poor’s les a du reste durement sanctionnés, le 6 août 2011 : elle a dégradé la note de leurs obligations de AAA à AA+. Les Américains veulent aujourd’hui sortir d’un système qui fait d’eux les seuls pourvoyeurs des réserves de liquidités mondiales, financées par leur déficit.
L’intégration monétaire européenne et l’essor commercial de la Chine ont rendu anachronique le rôle central joué par le dollar dans l’organisation monétaire mondiale. Le système du G20 ne saurait certes être résumé à eux – le dénouement des grandes problématiques mondiales dépend aussi de l’acceptation de leurs partenaires – mais force est de constater qu’il repose tout de même aujourd’hui sur une triade : les Etats-Unis, l’UE et la Chine.
La circulation des capitaux est cruciale pour assurer la liquidité et la croissance de l’économie mondiale mais, avec la mondialisation, le volume de liquidité en circulation augmente plus vite que l’économie réelle. Cette volatilité entraîne des variations exagérées des taux de change, un afflux soudain dans un pays faisant grimper sa monnaie, un reflux la faisant s’écrouler. Les distorsions dans l’allocation des capitaux produisent des effets négatifs en particulier sur des économies ouvertes de dimension moyenne, comme le Brésil, la Corée du Sud ou la Thaïlande, qui, par peur de se retrouver en situation de pénurie, sont enclines à procéder à une accumulation de précaution. Bon nombre de pays émergents détiennent ainsi des niveaux de réserves supérieurs à ceux justifiés par des normes de précaution raisonnables. Pour réduire la vulnérabilité de leur économie, elles seraient mieux avisées de garantir un cadre macroéconomique et prudentiel sain plutôt que d’accumuler des réserves de précaution.
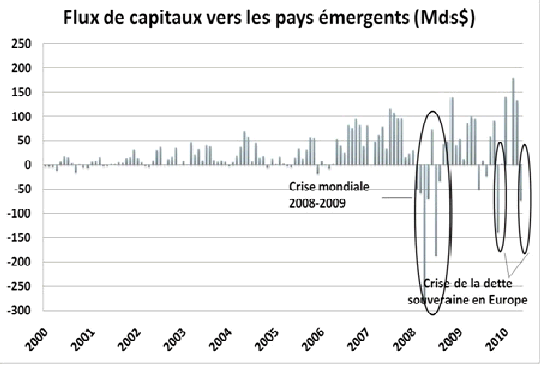
Source : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Aucune instance internationale n’est actuellement investie de la mission de suivre les mouvements de capitaux, qui n’obéissent d’ailleurs, depuis la mort de Bretton Woods, qu’aux règles du marché libre, alors qu’ils ont une grande incidence sur la prospérité des populations. La France, comme les autres Etats membres de l’UE, est liée par le traité de Lisbonne, qui prohibe la restriction des flux de capitaux(137), sauf « circonstances exceptionnelles »(138). Les pays de l’OCDE sont également liés, depuis 1961, par un code commun d’inspiration libérale.
Sans revenir à un système de taux de change fixes ni administrer la liquidité mondiale, il convient de sortir du laisser-faire, ainsi que le préconise l’Initiative du Palais-Royal : « L’un des objectifs essentiels d’un système monétaire international efficace doit être de conduire à des taux de change relativement stables et conformes aux fondamentaux des différentes économies. »
Elaborer un code international de bonne conduite, constitué de « règles douces », pour contrecarrer les tentations nationales non coopératives de manipulation du taux de change ou de fermeture des frontières.
Confier aux organisations financières internationales la mission d’assurer une veille vis-à-vis de l’évolution de la liquidité mondiale.
Procéder à une coordination multilatérale des politiques monétaires.
Des discussions à ce sujet ont déjà eu lieu au sein du CMFI et la présidence française espère que le sommet de Cannes pourra délivrer une décision.
Aucun pays, désormais, n’est indéfiniment à l’abri d’une spirale de défiance comparable à celles qui ont frappé des économies émergentes moyennes et des Etats européens périphériques – entre 1990 et 2010, quarante-deux arrêts brutaux de mouvements de capitaux ont été dénombrés. Cette incertitude face aux marchés est un facteur d’instabilité car elle incite à des comportements de protection irrationnels contre les mouvements massifs de sortie de capitaux : l’accumulation excessive de réserves. Pour préparer une réponse plus efficace aux futures crises de défiance mettant en cause la solvabilité d’un Etat, les événements récents montrent qu’il est indispensable d’agir.
Tisser des filets de sécurité financière, en passant d’une logique de prêts à une logique plus structurée de gestion des chocs systémiques mettant en réseau les dispositifs du FMI et les mécanismes de financement régionaux comme le MESF ou l’initiative de Chiang Mai.
De nombreuses personnalités gouvernementales – comme le ministre des finances japonais, Yoshihiko Noda, le 12 février 2011 – ont préconisé que le G20 de 2011 aboutisse à des mesures de gestion de crise de ce type. L’efficacité de la panoplie d’instruments du FMI, complétée en 2009 par la ligne de crédit flexible(139) et en 2010 par la ligne de crédit de précaution(140), s’en trouverait en effet confortée ; cela renforcerait le rôle du FMI de prêteur en dernier ressort, pour stopper les crises systémiques susceptibles d’emporter un continent tout entier dans la banqueroute. Dans le contexte actuel, la zone euro est concernée au premier chef.
La Chine, compte tenu de ses réserves monétaires, détient l’une des clés du problème. Consciente de sa position dominante, elle tient à obtenir des compensations en contrepartie d’un éventuel investissement coopératif en faveur de l’Europe : le 15 septembre 2011, lors du forum d’été de Davos, Wen Jiabao a déclaré que les dirigeants occidentaux doivent envisager « avec courage leur relation à la Chine d’un point de vue stratégique ». Il attend de l’UE qu’elle accorde à son pays le statut d’économie de marché à part entière – ce sera sans doute l’un des points de débat du sommet annuel UE-Chine du 26 octobre 2011 – et des Américains qu’ils lèvent leurs restrictions sur leurs exportations de technologies sensibles vers la Chine ainsi que sur les investissements directs chinois aux Etats-Unis.
Le régime monétaire international mono-centré sur le dollar a déjà commencé une mutation timide vers un système multipolaire fondé sur trois piliers : le dollar, l’euro et le yuan. La Banque mondiale, dans un rapport rendu public le 17 mai 2011(141), juge cette évolution inéluctable : elle prévoit que ce système tripolaire se substituera à l’hégémonie du dollar avant 2025. L’outil des DTS pourrait être utilisé pour entériner cette évolution et stabiliser le système tout entier.
Le DTS a été créé en 1969 par le FMI pour compléter l’arsenal de réserves monétaires à disposition des Etats et se substituer à l’or monétaire dans les grandes transactions internationales. Le passage au régime de taux de change flottants et le développement des marchés de capitaux internationaux, qui a rendu plus aisé le financement de l’économie, ont cependant réduit son utilité.
La valeur du DTS, déterminée à partir d’un panier de monnaies composé du dollar, de l’euro, de la livre sterling et du yen, est révisée tous les cinq ans par le bureau exécutif du FMI, en fonction du rôle respectif joué par ces quatre devises dans les échanges et les réserves internationaux. Depuis le 1er janvier 2011, les coefficients de pondération en vigueur sont les suivants :
– 41,9 % pour le dollar ;
– 37,4 % pour l’euro ;
– 11,3 % pour la livre sterling ;
– 9,4 % pour le yen(142).
La valeur du DTS varie nettement moins que celle de chacune de ses devises constitutives puisque les mouvements réciproques entre deux d’entre elles s’annulent au sein du panier. Ce lissage réduit considérablement le risque de change.
Les pays émergents, à commencer par la Chine et la Russie, seraient favorables à un recours plus grand aux DTS dans les réserves souveraines et à un élargissement du panier au yuan et à d’autres devises. La remise au goût du jour du véhicule des DTS aurait des conséquences apaisantes de plusieurs ordres sur l’économie mondiale :
– les émergents pourraient échanger leurs pyramides de dollars contre cette monnaie internationale ;
– cela contribuerait à réduire les déséquilibres entre balances des paiements ;
– la volatilité des prix des matières premières agricoles s’en trouverait réduite.
Les rapports de puissance économique actuels imposent donc d’articuler différemment le système, autour d’un actif de réserve qui ne soit pas la monnaie de l’une des économies dominantes.
Diversifier la composition du panier des DTS en y incluant des devises de pays émergents et accroître la part des DTS dans les réserves souveraines permet d’envisager, à un horizon plus lointain, l’émergence d’une unité monétaire de référence stable, déconnectée des vicissitudes des économies et des politiques monétaires nationales.
La coexistence de régimes de changes opposés – soit complètement libéralisés, soit sous contrôle public draconien – au sein du G20 invalide cependant, dans l’immédiat, l’hypothèse du développement des DTS. L’élargissement des DTS est conditionné à un changement définitif de stratégie monétaire de la part de la Chine, ne serait-ce que pour une raison réglementaire : d’après les statuts du FMI, toute monnaie du panier de devises des DTS doit être librement accessible.
Le taux de change insuffisamment élastique, maintenu de façon artificielle, du yuan entraîne des distorsions dans l’allocation internationale de capitaux, privant d’investissements les autres pays.
Amener les grands pays émergents à renforcer progressivement la flexibilité de leurs taux de change et à prendre des engagements fermes quant à leur volonté de parvenir, à terme, à une convertibilité pleine et entière.
Contrairement aux institutions nationales à vocation « législative », c’est-à-dire édictant des normes ou des traités internationaux – à l’instar de l’ONU ou de l’OMC –, le FMI, qui compte 187 Etats membres et 2 700 salariés, a pour mission d’intervenir en urgence pour faire face à des situations de crise. Il n’a donc pas de mandat clair et immuable ; pour jouer efficacement son rôle, il doit exercer une veille permanente lui permettant de comprendre les réalités économiques mondiales et de leur apporter des réponses adaptées. Au demeurant, il est aujourd’hui exclusivement chargé d’intervenir de manière curative, au cas par cas, lorsqu’un pays se trouve en difficulté.
Un rapport du Bureau indépendant d’évaluation du FMI(143) a jugé très sévèrement les performances du FMI en matière de surveillance financière, regrettant qu’il ait « donné peu d’avertissements précis concernant les signes avant-coureurs des risques et des facteurs de vulnérabilité de la crise qui allait éclater ». Il confirme en cela l’appréciation de l’Initiative du Palais-Royal : « Le FMI est chargé d’exercer une “ferme surveillance” sur les politiques de change de tous ses États membres. Ses prises de position sur ce sujet ont été rarement catégoriques et leur impact a été généralement insuffisant, voire inexistant, sur les politiques de ses membres les plus importants. »
Repositionner le mandat du FMI en lui confiant la surveillance stratégique multilatérale des grands équilibres macroéconomiques.
Sous la pression des événements et grâce à l’action du G20, en deux ans, les ressources du FMI ont plus que triplé, passant de 265 milliards à 750 milliards de dollars. De plus, en 2010, sa gouvernance a été rééquilibrée au profit des pays émergents et en développement, avec un transfert de plus de 6 % du capital dès 2012, soit davantage que l’objectif de 5 % fixé lors du sommet de Pittsburgh.
Il n’en demeure pas moins que le FMI se caractérise par un fonctionnement censitaire, régi par les « quotes-parts » financières détenues par ses adhérents. Ainsi, au sein de son conseil d’administration, seuls cinq pays disposent d’une chaise permanente – les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni –, les dix-neuf autres étant élus par des groupes de pays, appelés « circonscriptions ». L’Arabie saoudite, la Chine et la Russie ont le privilège de constituer à elles seules une circonscription chacune. Quant à l’Italie, à l’Inde, au Brésil, aux Pays-Bas, à la Belgique et à la Suisse, elles détiennent un nombre de voix prépondérant dans leur circonscription. Les dix derniers postes d’administrateurs sont tournants.
A l’heure actuelle, en comptant la Suisse et les sièges tournants qui ont été attribués au Danemark et à la Pologne, neuf administrateurs sont des ressortissants européens, alors que notre continent pèse pour 30 % des droits de vote. L’Europe est ainsi, avec les Etats-Unis, seule en mesure d’exercer le droit de veto, fixé à 15 %. Dans le cadre de la réforme qui interviendra en 2012, l’Europe a accepté que son nombre de sièges soit ramené à un total de sept.
Par ailleurs, dès le début de la campagne pour la succession de Dominique Strauss-Kahn, les ministres des finances australien et sud-africain, Wayne Swan et Pravin Gordhan, ont contesté, dans un communiqué commun, la tradition selon laquelle la direction générale du FMI devait automatiquement revenir à un Européen, prônant un choix au mérite : « Depuis trop longtemps, la légitimité du FMI est entamée par un accord qui détermine à partir de la nationalité le choix de sa direction. […] Pour maintenir la confiance, la crédibilité et la légitimité de ses membres, il doit y avoir une règle de sélection transparente qui aboutisse à la nomination de la personne la plus compétente au poste de directeur général, sans tenir compte de sa nationalité. » Cette démarche avait manifestement vocation à préparer le terrain pour Trevor Manuel, ancien ministre des finances sud-africain, également cité parmi les favoris des pays émergents.
Au final, l’incapacité des émergents à s’entendre sur une candidature commune a réduit leurs chances à néant, chacun craignant de voir l’emporter une personnalité d’un autre pays, surtout si elle était venue de la Chine ou du Brésil, qui concourent pour le leadership du groupe. A contrario, le fait qu’il représente un « petit pays » n’a pas permis au ministre des finances singapourien, Tharman Shanmugaratnam, de faire valoir le caractère rassurant de sa candidature.
Les Européens ont semblé dans un premier temps résignés à abandonner la direction générale. L’importance de l’enjeu – le FMI fait désormais figure de quasi-ministère des finances mondial – les a toutefois conduits à faire montre d’une cohésion irrésistible en faveur de la candidature de Christine Lagarde.
Les arrière-pensées nationales ou continentales sont donc prégnantes. Sans passer à un système du type « un Etat, une voix », comme dans les organisations onusiennes, il convient de continuer à moderniser le FMI en limitant l’impact des quotes-parts sur le fonctionnement de l’institution.
Supprimer le droit de veto en vigueur au FMI, fixé à 15 % des quotes-parts, afin d’atténuer le caractère censitaire de son fonctionnement.
II. LES SERVICES FINANCIERS
RESTENT INSUFFISAMMENT ENCADRES ET CONTROLES
Evolution du marché mondial des produits financiers dérivés
(en milliers de milliards de dollars)

Source : Commission européenne.
La Banque des règlements internationaux (BRI) a estimé à pas moins de 700 000 milliards de dollars le volume des transactions financières effectuées en 2007, soit près de douze fois le PIB mondial. Sur longue période, depuis 1950, leur rythme de progression a été cinq fois supérieur à celui du PIB mondial. Sur la seule décennie 1998-2008, le montant total avait pratiquement décuplé.
Malgré un infléchissement en 2008, dû à la crise financière, le volume des dérivés OTC échangés a repris près de 15 % sur la période 2007-2010 et le mouvement s’est encore accéléré en 2011. Rama Cont, mathématicien spécialisé en modélisation économique et directeur du Center for Financial Engineering de l’université Columbia, impute l’essentiel de cette croissance à l’attrait grandissant pour les produits dérivés adossés sur les taux d’intérêt : en trois ans, le montant des transactions opérées à partir de ce sous-jacent a augmenté d’un quart pour approcher les 600 000 milliards de dollars à elles seules, soit 82 % du total des dérivés OTC.
Les dérivés OTC par classes d’actifs
(en milliards de dollars)
Classe d’actifs |
2007 |
2010 |
Matières premières |
8 255 |
3 273 |
Actions |
9 518 |
6 868 |
Devises |
57 604 |
62 933 |
Taux d’intérêts |
381 357 |
478 093 |
Crédits |
51 095 |
31 416 |
Autres |
78 |
72 |
Total |
507 907 |
582 655 |
Source : Rama Cont.
Ces données résultent de la somme des montants bruts échangés ; elles ne prennent donc pas en compte les compensations, alors que la seule façon d’annuler un ordre est parfois d’en passer un autre en sens inverse. Il n’en demeure pas moins que l’ordre de grandeur des transactions financières atteint plusieurs fois le PIB, ce qui donne une idée de leur influence sur l’économie mondiale.
Des taux d’intérêt exceptionnellement faibles, combinés à une concurrence féroce, ont amené la plupart des intervenants sur les marchés financiers, qu’il s’agisse des banques ou des investisseurs, à rechercher des rendements plus élevés, par une augmentation de l’effet de levier, sur bilan et hors bilan, ou par des investissements dans des produits financiers plus risqués. Mais le coût de ce risque n’a pas été correctement calculé. Résultat : pas moins de 125 crises bancaires ont été recensées en quarante ans, avec une accélération rapide ces dernières années, d’une ampleur plus ou moins importante, allant de la crise éclair(144) au krach, comme celui des années 2001-2002, consécutif à l’éclatement de la bulle Internet.
« L’économie mondiale traverse une phase pleine de dangers », a déclaré la directrice générale du FMI, Christine Lagarde en préambule au G7 finances des 9 et 10 septembre 2011. Durant l’été 2011, la situation s’est en effet gravement détériorée, avec des perspectives macroéconomiques dégradées, susceptibles d’impacter les comptes publiques des principales puissances, mais aussi avec un repli de la valorisation des actifs boursiers, en particulier de ceux des établissements bancaires.
Les valeurs bancaires européennes, depuis fin août 2011, ont subi un mouvement de défiance violent, entraînant les indices boursiers à la baisse. Les cinq valeurs financières du CAC 40 – le Crédit agricole, BNP Paribas, la Société générale, Axa et Natixis – ont particulièrement souffert. Le 5 septembre 2011, la Société générale et le Crédit agricole avaient ainsi perdu la moitié de leur capitalisation boursière en respectivement neuf et six mois. Les jours suivants, le mouvement s’amplifiait encore, se transformant en quasi-panique : la Société générale, dans le collimateur des marchés, dévissait encore de 10,58 % le 9 septembre pour atteindre, à 17,44 euros, son plus bas niveau historique. La situation se rétablissait le 15 septembre sur toutes les places boursières européennes, les grandes banques centrales européennes ayant relancé leur coopération pour ouvrir trois fenêtres de refinancement en dollars à trois mois, avant de dévisser de nouveau une semaine plus tard.
Parallèlement, l’Etat américain vient de porter plainte contre dix-sept établissements financiers, dont dix américains et un français, jugés responsables de la crise des subprimes, afin de récupérer les 170 milliards de dollars dépensés à l’époque par le contribuable américain au profit du système. Il est reproché à ces établissements d’avoir dissimulé certaines caractéristiques des titres qu’ils vendaient, notamment de ne pas avoir correctement vérifié la solvabilité des ménages emprunteurs.
Pourtant, il y six mois encore, la crise n’est qu’un mauvais souvenir : le 4 mai 2011, par exemple, le groupe BNP Paribas annonçait triomphalement un bénéfice de 2,6 milliards d’euros sur le seul premier trimestre, en progression de 14,6 % par rapport à la même période de l’exercice 2010. Les banques françaises comme leurs concurrentes européennes ou mondiales, par la voix des fédérations qui représentent leurs intérêts, plaidaient alors avec un certain écho en faveur d’un retour de balancier vers moins de régulation.
Les conséquences des crises financières entraînent, par effet dominos, dans le monde entier, des conséquences sur toute la sphère économique. Au final, ce sont les fondamentaux réels qui s’en ressentent, à commencer par la croissance et l’emploi. Les responsables politiques ne sauraient accepter cette prise en otage de la société. Le nouveau retournement de tendance sur les marchés nous pousse à penser que la régulation du système financier et bancaire, au niveau global, doit se poursuivre. Face à la sophistication des techniques et des instruments, pour mieux protéger les contribuables, les consommateurs et les épargnants – en un mot les citoyens –, il faut renforcer l’intégrité et l’efficacité des marchés financiers.
Les résultats du secteur financier, comme des autres industries, ne doivent pas être obtenus au détriment du reste de l’économie. Au demeurant, il a besoin d’être protégé contre ses propres excès. Le système bancaire irlandais n’a-t-il pas disparu dans la tourmente à cause de l’inanité de son régulateur national ?
Mais, à chaque nouvelle embellie, les bonnes pratiques se perdent, les bonnes résolutions se diluent, « le rapport de force entre les autorités politiques et les marchés se durcit » – pour reprendre la formule du président de l’AMF Jean-Pierre Jouyet – et deux tentations complémentaires réapparaissent : l’autorégulation des marchés et le dumping réglementaire.
Selon la théorie libérale, il est un fait avéré que les acteurs financiers, par peur de la faillite, se disciplinent automatiquement par eux-mêmes en adoptant un comportement auto-régulateur. Toute intervention publique pour modifier les allocations de ressources par la sphère financière est à proscrire : elle entraverait le libre fonctionnement du marché, réputé meilleur garant de croissance et de prospérité pour l’ensemble des acteurs économiques, et, dans le contexte économique actuel, elle casserait tout mouvement de reprise.
Pourtant, depuis 2008-2009, ce sont les Etats, et à travers eux les contribuables, qui ont dû venir au secours des banques en grande difficulté, le dernier cas en date étant celui de l’Irlande. Cela leur confère une légitimité supplémentaire pour avoir un droit de regard sur le fonctionnement des marchés financiers, en contradiction avec le principe d’autorégulation défendu par le secteur, de façon plus ou moins affichée. D’autant que l’argent des marchés financiers provient de l’épargne des mêmes contribuables, notamment à travers les produits d’assurance-vie ou les fonds de pension, usités par de très larges pans de la population.
De surcroît, à la suite de la crise financière de 2008, de gros groupes bancaires ont racheté des établissements en difficulté. D’après une étude du FMI publiée le 9 mars 2011(145), portant sur douze pays – Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Islande, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Ukraine, Royaume Uni et Etats-Unis –, les actifs des cinq plus grandes banques de chacun d’entre eux ont grimpé à 335 % de leur PIB en moyenne, alors qu’ils équivalaient à 307 % avant la crise. Cet accroissement de la concentration bancaire a certes constitué l’une des solutions pour gérer, dans l’urgence, la crise de 2008, mais il est dangereux car il accroît le risque systémique. Le secteur bancaire doit donc plus que jamais être soumis à une surveillance et une régulation pointilleuses.
Tous les dix-huit mois, des think tanks européens mettent en commun leurs moyens d’expertise pour suggérer un programme de travail au « trio présidentiel », c’est-à-dire aux trois pays suivants appelés à occuper la présidence tournante de l’UE. Dans la troisième édition de ce rapport(146), publiée le 15 juin 2011, les organismes contributeurs – parmi lesquelles BRUEGEL, la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) allemande et le Centre for European Reform (CER) britannique, que nous avons tous trois auditionnés – recommandent à la Pologne, au Danemark et à Chypre de s’accorder sur un programme de renforcement de la régulation financière, en particulier de la régulation bancaire. Afin d’éviter de nouvelles crises, ils appellent notamment à davantage de rigueur et de transparence pour les stress tests bancaires, afin d’asseoir sur une base solide la recapitalisation et la restructuration des systèmes bancaires des Etats membres rendues nécessaires par la crise.
La seconde tentation délétère consiste, pour les autorités publiques nationales, à rechercher un avantage comparatif par rapport aux places financières concurrentes, en retardant délibérément la mise en œuvre des orientations prises par le G20 – sur lesquelles elles se sont pourtant engagées et dont elles sont expressément chargées(147) – ou à se renvoyer la balle en dénonçant l’attentisme des autres pays pour donner un prétexte à l’immobilisme.
Le secrétaire américain au trésor Timothy Geithner, le 6 juin 2011, lors d’une conférence de presse, a dénoncé le fait que certains pays conservent une réglementation financière souple pour profiter du renforcement de la régulation des marchés chez leurs concurrents, soulignant que toute mesure de ce type devait être prise à l’échelle mondiale. Le 8 juin 2011, il écrivait au ministre de l’économie nationale hongrois, Matolcsy György, alors président du Conseil « Ecofin », pour souligner la nécessité de faire converger la régulation sur les deux rives de l’Atlantique et lui faire part de la crainte que l’UE n’adopte des dispositifs trop cléments afin de capter davantage d’activités financières, au détriment du marché américain.
Le commissaire européen Michel Barnier s’est précisément rendu à Washington du 1er au 3 juin 2011 pour faire le point avec ses homologues américains sur la mise en œuvre de la feuille de route du G20 des deux côtés de l’Atlantique. Partant du principe que « l’élaboration de règles du jeu équitables doit être une réalité et non un slogan vide », il a souhaité aborder les thèmes suivants :
– réglementation bancaire ;
– encadrement des bonus ;
– produits dérivés ;
– agences de notation ;
– normes comptables internationales.
L’on peut regretter que les autorités américaines et européennes semblent parfois engagées dans une course de lenteur dommageable à l’économie mondiale. Les administrations de Washington comme de Bruxelles étant traversées par des courants politiques d’inclinaisons contradictoires sur la question de la régulation financière, les progrès sont obtenus en fonction du rapport de force politique à chaque étape importante de la construction de l’édifice réglementaire. En effet, même si la résolution des problèmes économiques ne passe pas uniquement par des solutions transatlantiques, la coordination entre les pôles de puissance européen et américain reste essentielle pour orienter l’économie mondiale et donner des impulsions au reste du monde.
Renforcer la coopération transatlantique en matière de réglementation financière, afin de ne pas donner prise aux arbitrages réglementaires des agents économiques et de montrer la voie aux autres membres du G20.
La mise en œuvre du Dodd-Frank Act, nous l’avons vu, repose sur l’adoption par les multiples régulateurs financiers américains de règles d’application dont la majorité aurait dû être prête un an après l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire le 31 juillet 2011. Cependant, confrontés à l’immensité de la tâche, freinés par les conflits d’interprétation d’un texte finalisé dans l’urgence et qui comporte de multiples ambiguïtés, et contraints à procéder à des consultations publiques avant d’acter chaque nouvelle règle, les régulateurs ont pris du retard dans leur adoption. Sur certains sujets, comme la régulation des marchés dérivés de gré à gré(148), ils ont préféré proposer un nouveau calendrier, repoussant de plusieurs mois les dates butoirs initialement prévues par la loi.
La défaite des démocrates aux élections de mi-mandat du 2 novembre 2010 a substantiellement affaibli la dynamique politique qui avait permis l’adoption d’un texte porté essentiellement par le Congrès, l’administration Obama se tenant en retrait(149). Ce contexte politique complique la tâche des régulateurs, soumis désormais à de nombreuses auditions parlementaires chronophages et qui peinent, dans le contexte des débats budgétaires actuels très tendus, à obtenir les moyens supplémentaires que leurs mandats élargis exigent pour mener à bien leurs missions.
En dépit de ces difficultés non négligeables, l’administration démocrate et les régulateurs n’ont pas abdiqué : pour eux, il n’est pas question de revenir sur l’application pleine et entière de la loi Dodd-Frank. Du reste, même si les républicains et l’industrie financière la décrient, ce n’est pas la cible principale du mouvement Tea Party. La régulation financière est particulièrement cruciale dans ce pays compte tenu de l’impact social de la santé de ce secteur, une grande majorité de ménages, notamment parmi les classes moyennes, plaçant de l’argent en prévision de leur retraite.
c) L’Union européenne et ses tractations interétatiques et interinstitutionnelles parfois interminables
La législation européenne suit une procédure complexe, au cours de laquelle doivent être trouvés des compromis à la fois entre Etats membres et entre institutions communautaires.
Sur les questions financières, c’est la procédure législative ordinaire, dite « procédure de co-décision » qui s’applique, selon les modalités définies à l’article 294 du TFUE(150).
La Commission européenne détient le monopole de l’initiative législative. Elle injecte ses propositions dans le processus de codécision après une phase d’évaluation plus ou moins approfondie selon la sensibilité des sujets : mesure de l’impact, consultation d’experts, d’organisations internationales et/ou d’organisations non gouvernementales, publication d’un livre vert ou d’un livre blanc(151), le cas échéant en interpellant aussi le Conseil économique et social européen – ce qui s’impose concernant les textes relatifs à la régulation financière – et/ou le Comité des régions.
Les projets de directive ou de règlement sont ensuite transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, co-législateurs. Un acte européen est adopté une fois voté dans les mêmes termes par le Conseil et le Parlement européen.
En première lecture, le Parlement européen émet un avis à la majorité simple, sur la base d’un rapport préparé par sa commission parlementaire saisie au fond(152). La Commission européenne peut modifier sa proposition pour tenir compte des amendements des parlementaires. Si le Conseil approuve tous les amendements du Parlement ou si celui-ci n’en a proposé aucun, l’acte peut être adopté. Sinon, le Conseil adopte, à la majorité qualifiée, un texte appelé « position commune », à propos duquel la Commission est appelée à se prononcer.
En deuxième lecture, plusieurs options sont possibles : si le Parlement européen accepte telle quelle la position commune du Conseil, l’acte est réputé adopté en ces termes ; si le Parlement rejette la position commune, il est purement et simplement abandonné et la procédure législative est close ; si le Parlement apporte des amendements à la position commune, l’acte retourne vers le Conseil. Dans cette troisième hypothèse, les amendements en question sont préalablement soumis pour avis à la Commission. L’acte est définitivement voté si le Conseil adopte ces amendements, à la majorité qualifiée dans le cas où la Commission les avait approuvés, à l’unanimité dans le cas où la Commission les avait désapprouvés.
En cas de désaccord persistant, le « comité de conciliation » est convoqué dans un délai de six semaines. Ce laps de temps est mis à profit par les trois institutions européennes pour commencer à travailler à la recherche d’un consensus dans le cadre d’un « trilogue informel ». Réunissant des membres du Conseil et du Parlement européen, en présence de la Commission européenne, le comité de conciliation joue un rôle de médiateur. S’il parvient à un compromis, le projet est ensuite soumis au Parlement et au Conseil pour confirmation. En revanche, si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n’est pas parvenu à tomber d’accord sur une rédaction commune, la procédure législative s’achève sur l’abandon du projet.
Un degré de complexité supplémentaire tient aux confrontations politiques internes au Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée(153), voire, dans plusieurs domaines comme la fiscalité, à l’unanimité. Chaque étape de la négociation est donc employée pour ralentir ou édulcorer des textes aux conséquences financières considérables, voir pour remettre en cause leur survie même, les Etats membres ayant toujours tendance à défendre leurs intérêts nationaux, parfois sous l’influence des 3 000 groupes de pression qui ont pignon sur rue à Bruxelles, à travers un enregistrement officiel auprès de la Commission européenne.
Le lobby de l’industrie financière auprès des institutions européennes est l’un des plus actifs et des plus riches d’entre eux : il emploie environ 700 personnes, 500 salariés des entreprises financières et bancaires, plus 200 consultants externes. Ainsi, lors de la préparation de la directive AIFM, dont le rapporteur au Parlement européen était Jean-Paul Gauzès, 193 réunions ont eu lieu avec des représentants de l’industrie financière – par essence hostiles au texte –, aucune avec des partisans de la régulation financière.
Le Dodd-Frank Act comme l’agenda de la Commission européenne ou les projets de réforme britanniques suscitent toujours la même menace suprême, brandie par les groupes de pression de la finance : si la législation est durcie, ils délocaliseront leurs activités. Mais, au final, les mesures régulatrices, aussi coûteuses soient-elles pour le secteur financier, ne le sont jamais suffisamment pour entraîner une fuite organisée des capitaux, car toutes les places bénéficient d’avantages spécifiques, notamment celles des pays les plus développés, où l’environnement économique est de toute façon stimulant. Au demeurant, comme nous l’ont fait observer les économistes du think tank londonien Centre for European Reform, si une banque européenne se faisait domicilier aux Etats-Unis, elle maintiendrait pendant un certain temps l’essentiel de ses opérations en Europe et y serait par conséquent toujours taxée, et vice versa.
Le président-directeur général d’une grande banque d’outre-Atlantique s’est d’ailleurs fait remarquer : quelques mois après avoir assuré aux sénateurs américains qu’il ferait migrer l’ensemble de ses activités vers l’Europe ou l’Asie si le Dodd-Frank Act était adopté, il se ravisait et expliquait devant les parlementaires britanniques qu’il les rapatrierait aux Etats-Unis au cas où les propositions de la commission Vickers(154) seraient retenues…
Par souci de rééquilibrage, pour que la diversité des points émanant de la société civile soit mieux prise en compte, vingt-deux députés européens, membres de cinq des sept groupes politiques, ont décidé, avec le soutien moral et financier de la Commission européenne, de soutenir la création d’une association de défense des intérêts des citoyens face aux excès des marchés financiers. Ce nouveau contrepouvoir(155), Finance Watch, dont l’assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2011 et qui réunit des personnalités indépendantes et des organisations européennes, s’est fixé deux objectifs :
– expertiser la réglementation financière, avec l’ambition de faire preuve d’une exhaustivité et d’un professionnalisme équivalents à ceux de l’industrie bancaire ;
– délivrer des messages en direction de l’opinion publique, des médias et des élus.
L’UE, au niveau international, a toujours été le fer de lance de la régulation financière, car l’interventionnisme fait partie de ses gènes ; elle a adopté ou est en train de le faire plusieurs textes importants(156). Elle pêche néanmoins parfois, comme les autres pôles de puissance économique mondiaux, par manque d’enthousiasme, notamment du côté des Etats membres, dans la mise en application des décisions prises au terme des précédents G20. Il est pourtant dans son intérêt qu’un maximum de règles soient institutionnalisées aujourd’hui, en prévisions des décennies à venir, au cours desquelles son poids relatif dans l’économie mondiale risque de diminuer, ce qui la rendra plus vulnérable aux marchés financiers.
Alors que la situation politique américaine est propice à un certain immobilisme, l’UE, à travers la présidence française, doit assumer ses responsabilités, en se montrant exemplaire vis-à-vis de ses partenaires, par des prises de position en faveur de mesures plus radicales, dans un souci de prévention des risques économiques mais aussi de protection des consommateurs.
Mener à leur terme les programmes législatifs nationaux entamés grâce aux précédents G20, notamment dans l’UE à travers l’agenda de la Commission européenne et aux Etats-Unis à travers le Dodd-Frank Act.
C. Achever la transposition en droit des progrès réalisés grâce aux précédents G20 et obtenir de nouvelles avancées
Le temps des marchés allant beaucoup plus vite que le temps démocratique, il est nécessaire d’être réactif pour ne laisser échapper aucun marché, aucun acteur, aucun produit, aucun territoire à la régulation. Si la première des priorités, comme l’a souligné Michel Barnier, est de mettre en œuvre toutes les décisions prises depuis 2008, beaucoup reste à faire pour assainir le secteur bancaire et financier. Même de hauts responsables de l’industrie financière sont conscients de la nécessité d’agir : Larry Leibowitz, directeur général de NYSE Euronext(157), nous a ainsi fait part de son espoir de voir poursuivi le travail de régulation, allant jusqu’à employer le mot « crimes » pour caractériser les errements du secteur. Cela nous incite à penser que les dispositions réglementaires déjà prises ou envisagées de part et d’autres de l’Atlantique ne sont pas de nature à faire obstacle à la reprise économique.
Il y a vingt ans, pour les pouvoirs publics, l’enjeu consistait à édicter des règles nationales – par exemple concernant le délit d’initié – et à contrôler leur application. Aujourd’hui, il s’agit de contrôler le risque systémique, ce qui est beaucoup plus complexe, le personnel des instances de supervision nationales ayant plutôt un profil juridique que financier et, surtout, les données nécessaires n’étant pas toujours disponibles.
Les institutions financières sont certes interconnectées, mais aucune instance ne connaît les expositions réciproques entre grands établissements, par exemple entre BNP Paribas et la Deutsche Bank, alors qu’une défaillance peut créer une vague destructrice submergeant tout le système. Lors de la chute de Lehman Brothers, l’ACP a dû attendre vingt-quatre heures avant de connaître le degré d’exposition des banques françaises. Quelques rares pays, comme le Brésil et l’Autriche, demandent un reporting quotidien des expositions, mais seulement au niveau national et avec un niveau de granularité assez faible, c’est-à-dire en ne désagrégeant pas les bilans des différentes entités d’un groupe.
Le Dodd-Frank Act a créé l’Office for Financial Research (OFR), sorte d’observatoire national du risque systémique national, qui collectera des données financières et les mettra à la disposition des organisations financières. Le CERS n’a pas non plus une vocation régulatrice – il est d’ailleurs resté étonnamment atone durant la crise de l’été et de la rentrée de 2011.
Créer un observatoire international du risque systémique, couvrant l’ensemble des pays du G20, observatoire auprès duquel sera enregistré le reporting du risque mutuel entre institutions financières.
L’exercice 2010 des tests de résistance européens, révélateur des insuffisances de sept établissements bancaires – cinq espagnols, un allemand et un grec –, avait pourtant été considéré par les marchés comme un fiasco. En effet, quelques mois plus tard, l’Irlande sollicitait l’aide internationale pour secourir deux banques irlandaises qui les avaient pourtant passés sans échec.
En 2011, la nouvelle ABE a donc imposé des critères plus stricts, appliqués à 91 banques de vingt et un pays européens, représentant 56 % des actifs bancaires européens :
– modélisation d’un retournement de conjoncture éventuel encore plus sévère, avec une chute de 0,5 % du PIB de la zone euro ;
– réduction de la marge de manœuvre laissée aux banques pour établir les documents financiers, avec la prise en compte des ratios de solvabilité de Bâle III, applicables seulement d’ici à 2019 ;
– installation d’une équipe d’experts, issus des superviseurs nationaux, de l’ABE et de la BCE, qui révisera pendant un mois les données communiquées.
Rendue publique le 15 juillet 2011, l’étude recale huit établissements : cinq espagnols, deux grecs et un autrichien, qui auraient besoin de 2,5 milliards d’euros pour se renforcer. Elle révèle que les grandes banques européennes sont exposées à la dette souveraine des trois pays de la zone euro sous assistance financière internationale – Grèce, Irlande et Portugal –, à hauteur de quelque 200 milliards d’euros. Il lui est toutefois reproché de ne pas prendre en compte le risque grec, à savoir l’hypothèse d’un défaut de paiement du pays.
Instituer des stress tests communs, appliqués aux principaux établissements bancaires du G20, retenant des critères harmonisés suffisamment exigeants pour identifier les banques trop fragiles pour résister aux chocs.
Le G20, à Séoul, s’est mis d’accord sur un cadre général de traitement des SIFIs, afin de mieux protéger les contribuables et l’économie réelle contre le risque systémique. Il doit désormais fournir des recommandations plus opérationnelles, notamment en matière de résolution de crise. Le risque de contagion systémique est sous-estimé, alors qu’une centaine d’institutions bancaires ont déposé le bilan en 2009.
A l’occasion d’un forum organisé à Madrid par un quotidien économique espagnol, le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, a souligné l’« obligation absolue, pour nous tous, de faire tout ce qui est nécessaire pour renforcer la résistance du système financier », estimant que « nous sommes à la moitié du chemin ». Il a ajouté que « nous devons nous assurer que la fragilité excessive qui a été révélée en 2008 et 2009 soit éliminée » car « nos démocraties ne seraient pas prêtes à fournir les mêmes engagements financiers pour éviter une grande dépression en cas de nouvelle crise de même nature »(158). La crise politique qui agite l’Allemagne depuis le printemps s’explique du reste par cette réticence des contribuables des pays les plus solvables de l’UE à assumer l’assurance du système bancaire et financier en dernier recours.
Les deux pays dans lesquels le passage aux actes a été le plus radical sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Tous deux, bastions traditionnels de la finance déréglementée, ont pris des mesures de sauvegarde qui ressemblent à des tournants dans la gestion des activités financières.
L’une des dispositions phares du Dodd-Frank Act, baptisée Volcker Rule(159), consiste à interdire aux banques d’effectuer des opérations de trading propriétaire, c’est-à-dire pour leur compte propre. L’idée est de ne pas s’exposer à un risque qui obligerait les pouvoirs publics à un nouveau sauvetage du système bancaire, ruineux pour les finances publiques. En effet, lorsque les banques ne se contentent plus d’engager les dépôts de leurs clients mais aussi leurs fonds propres, ceux-ci, en cas de placements malencontreux, peuvent s’évaporer, au détriment des épargnants et, dans un deuxième temps, des contribuables. La Volcker Rule ne sera effective qu’en janvier 2012 mais des banques d’investissement majeures comme Goldman Sachs ont déjà commencé à se restructurer en prévision de cette échéance. La médiation des animateurs de marchés rend cependant incertaine la frontière entre opérations pour compte de tiers et opérations pour compte propre.
Le Royaume-Uni a dû débourser 300 milliards de livres sterling à cause de la crise de la fin des années 2000, dont 37 milliards pour renflouer plusieurs banques majeures comme la Royal Bank of Scotland ou Lloyds Banking Group, dont l’Etat détient aujourd’hui respectivement 84 et 41 % du capital. Dans la foulée, le gouvernement a constitué une commission indépendante sur l’avenir du système bancaire, constituée de cinq économistes assistés de quatorze hauts fonctionnaires, placés sous la présidence de l’économiste John Vickers. Dans son rapport définitif, rendu le 12 septembre 2011, la commission préconise l’obligation de séparer, d’un côté, les activités de dépôt et de crédit, de l’autre, les activités sur titres et valeurs mobilières cotées(160), c’est-à-dire de segmenter le secteur financier entre, d’une part, les opérations de financement direct de l’économie productive et, d’autre part, les opérations spéculatives. Le ministre des finances George Osborne s’est engagé à faire adopter ces mesures durant la législature actuelle, c’est-à-dire d’ici à 2015, afin de les rendre opposables aux groupes bancaires en 2019. Ce délai permettra aux banques de provisionner les 5 à 8 milliards de livres sterling – 4,6 à 8,1 milliards d’euros – de coûts supplémentaires auxquelles elles prévoient de devoir faire face chaque année pour s’adapter à la future législation.
Si de tels pare-feux empêchent les banques universelles de devenir des quasi-hedge funds – leurs bilans respectifs ne présentent pas aujourd’hui de différences structurelles –, pour être pleinement efficaces, ils doivent être assortis d’un meilleur accompagnement des activités de marché.
Afin de protéger les épargnants, ménages et entreprises, interdire ou restreindre les opérations de gestion pour compte propre ou séparer juridiquement et comptablement les activités de détail et d’investissement.
Précisons que la moitié environ du produit net bancaire de BNP Paribas et de la Société générale, les deux poids lourds français dans le secteur des activités de marché, reste concentré sur les service aux particuliers et un tiers environ sur les activités de financement et d’investissement. La France ne fait donc pas partie des pays qui seraient le plus impactés par une telle mesure.
Respecter intégralement l’accord de Bâle III.
Adossé à la BRI, le Comité de Bâle(161) a été créé en 1974 pour assurer la stabilité et la fiabilité du système bancaire et financier. Il s’attache à établir des standards minimaux en matière de contrôle prudentiel, à diffuser les meilleures pratiques bancaires et de surveillance, et à promouvoir la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel.
Son idée de base est de contraindre les banques à réduire leur exposition systémique et à constituer des fonds propres plus profonds et de meilleure qualité, afin d’atténuer leur procyclicité, conformément aux attentes du G20 et du CSF. Sauf que le principal centre financier du monde, qui en est signataire, n’a toujours pas transposé en droit interne le cadre de Bâle II, négocié pendant onze longues années et censé être appliqué partout avant 2011.
L’accord de Bâle II, édicté avant la crise de 2008-2009 et la chute de Lehman Brothers, n’imposait un ratio de solvabilité Tier One(162)que de 2 %, porté à 7 % par Bâle III. Le 25 juin 2011, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des chefs de supervision163 du groupe de Bâle s’est mis d’accord sur des mesures de renforcement de la solidité des banques mondiales d’importance systémique(164). Il a donné une définition claire à partir de cinq critères, dont la taille, l’importance des interconnexions avec le reste du système bancaire, le degré d’internationalisation des activités et le niveau de complexité des opérations. Des exigences de solvabilité plus draconiennes que celles prévues jusqu’à présent leur seront appliquées. Un coussin supplémentaire de capitaux propres dits « durs »(165) de 1 à 2,5 points sera institué pour les banques d’importance systémique. Pour les établissements connaissant une croissance significative, un point supplémentaire pourra même être exigé. Le ratio pourra donc atteindre, au total, jusqu’à 10,5 % des engagements, soit plus de cinq fois les normes de Bâle II.
Bâle III institue aussi un ratio de liquidité à court terme(166), qui exigera des banques internationales la détention d’un stock d’actifs sans risque facilement négociables, afin de résister pendant trente jours en cas de crise, ainsi qu’un ratio de liquidité à long terme(167), qui encouragera les banques à favoriser l’adéquation entre la maturité des prêts qu’elles allouent et celle des ressources qu’elles rassemblent auprès des marchés.
Ces obligations ne deviendront effectives qu’entre 2016 et 2019 mais sont déjà décriées par tous les banquiers du monde, qui jugent leur propre système immunisé contre la crise. Sept Etats membres de l’UE reprochent à la proposition de directive CRD IV – adoptée par la Commission européenne le 20 juillet 2011 –, qui tend à transposer Bâle III en droit communautaire, de suivre une approche trop rigoureuse. De fait, elle ne sera pas uniquement opposable aux principaux établissements de crédits, comme il est prévu de faire aux Etats-Unis, mais à la totalité des 8 200 banques européennes, qui, d’après la Commission, devront en conséquence lever 460 milliards d’euros. D’un autre côté, il peut lui être reproché des règles trop souples pour l’emploi de capital de qualité moyenne, dit « hybride ».
Le secteur bancaire français, en tout cas, bataille contre les ratios de Bâle III, en particulier contre le LCR, affirmant qu’ils vont resserrer le crédit et par conséquent rendre difficile la fonction bancaire de financement de l’économie réelle, notamment des PME. Il regrette que ces règles pénalisent les financements longs non adossés à des ressources stables, comme ceux des collectivités locales et des bailleurs sociaux, dépourvus d’épargne, qui risquent de se trouver en difficulté. Il estime aussi que Bâle III donne un avantage relatif au système d’intermédiation anglo-saxon, fondé sur les dérivés, par rapport au modèle de banque commerciale, propre de l’Europe continentale. Il juge inapproprié que les règles de Bâle s’appliquent à tous de façon non discriminée alors que la structuration du système bancaire français aurait rendu impossible chez nous, par exemple, le déclenchement d’une catastrophe comme celle des subprimes.
M. Noyer a émis un jugement sévère vis-à-vis de Bâle III : « C’est un système extraordinairement rigide et simplificateur. En accordant une trop forte importance aux dépôts, il tuerait l’industrie des SICAV monétaires et une partie de l’assurance-vie, qui devraient être remplacées par des produits de bilan. » Il s’est prononcé en faveur de ratios plus prudents.
En Allemagne, ce sont en particulier les Landesbanken, ces caisses d’épargne de proximité, qui craignent une chute de leur profitabilité : l’ABE refusant de comptabiliser les participations dites « tacites » ou « silencieuses » des Länder au numérateur de leurs ratios, elles risquent de devoir procéder à de vastes recapitalisations.
Une autre critique tient à la nature du risque incriminé par la logique de Bâle : les ratios se concentrant sur le risque interne des opérateurs pris individuellement et nullement sur l’exposition au risque externe, ils ne permettent pas de suivre la constitution des bulles financières et d’anticiper leur explosion.
La commission britannique indépendante sur l’avenir du système bancaire prend ces critiques à contre-pied et propose que les banques se renforcent en portant à 10 % le ratio de leurs, contre 7 % prévus dans la réforme de Bâle III à partir de 2013.
Alors que les marchés financiers sont de nouveau soumis à la tempête et que l’UE est dans l’œil du cyclone, les normes de Bâle III, élaborées, répétons-le, par des experts des banques centrales et des organismes de régulation des vingt-sept pays les plus concernés, constituent un garde-fou sans doute très contraignant et coûteux à court terme, mais de nature à épargner au monde de futures crises systémiques dévastatrices.
Appliquer à la lettre l’intégralité des modalités des accords de Bâle III, dans tous les pays du G20, notamment, pour ce qui concerne l’UE, par le biais de la proposition de la directive CRD IV.
e) Conditionner l’acquisition de credit default swaps souverains à la détention d’actifs sous-jacents
Un CDS est un instrument financier dérivé qui fournit une sorte d’assurance contre le risque de défaillance d’une obligation émise par une société ou un Etat. En échange d’une prime annuelle, le vendeur du CDS protège l’acheteur contre un éventuel défaut de l’entité de référence indiquée dans le contrat. En cas de défaillance de cette dernière, le vendeur indemnise l’acheteur. Cet outil est un cas à part dans le domaine assurantiel : l’opérateur de marché qui souscrit l’assurance contre le risque de défaut d’une valeur n’est contraint de n’en avoir ni la possession ni la jouissance. Un peu comme si l’on pouvait assurer la maison de son voisin, en espérant qu’elle prenne feu pour toucher le montant couvert !
La détention de CDS souverains à nu a manifestement eu, durant la crise de 2008-2009, un effet néfaste sur la tenue des obligations souveraines de la Grèce et d’autres pays en difficulté.
Interdire l’acquisition à nu de CDS souverains, notamment, pour ce qui concerne l’UE, par le biais de la proposition de règlement sur la vente à découvert.
Les salaires et bonus versés aux dirigeants et aux salariés des entreprises du secteur financiers ont été fortement critiqués lors de la crise de 2008. En effet, au-delà même de toute considération éthique, il est apparu que leur montant étaient insuffisamment lié aux perspectives économiques à long terme et incitaient leurs bénéficiaires à prendre des risques inconsidérés. Les scandales Kerviel et Abodoli, qui ont coûté respectivement 4,82 milliards d’euros à la Société générale et 1,67 milliard d’euros à la banque suisse UBS, sont emblématiques de ces comportements déraisonnables.
A Séoul, conformément au souhait de la France, le G20 a continué les actions entreprises en faveur d’un capitalisme pleinement responsable et mieux régulé. Depuis deux ans, des systèmes stricts de surveillance de la rémunération des traders et des paradis fiscaux ont été mis en place.
Dans l’optique de renforcer la discipline de marché sur les rémunérations, le Comité de Bâle a indiqué, dans un rapport rendu public le 1er juillet 2011, qu’il s’apprêtait à demander aux établissements financiers de communiquer, au moins une fois par an, à compter du 1er janvier 2012, des informations quantitatives et qualitatives relatives à leurs pratiques salariales. Devront en particulier être divulgués :
– le nombre de collaborateurs ayant perçu des rémunérations variables ;
– le montant des versements de bonus différés dans le temps, en distinguant les parts en numéraires, en actions et en obligations ;
– les noms et mandats des personnes siégeant au sein de leur comité de surveillance des rémunérations.
Les banques seront en outre priées de s’expliquer sur la façon dont leurs processus de rémunérations prennent en compte les risques potentiels.
Encadrer plus fermement les rémunérations variables à travers des standards internationaux de plafonnement, à un niveau n’encourageant pas les prises de risques excessives.
Un début de renversement des valeurs doit au demeurant être noté : des banques américaines, suivant l’exemple de Goldman Sachs, ont revu de manière très significative leur politique de rémunération car elles se sont rendu compte des conséquences qu’un statu quo aurait sur leur réputation.
L’idée d’une taxe sur les transactions financières chemine depuis maintenant une quarantaine d’années. Elle a certes fait l’objet de quelques mises en application, mais toujours circonscrites à des frontières nationales et souvent sur des segments de marché parcellaires(168). Or, pour être opérante, elle doit être aussi générale que possible ; l’idéal serait même qu’elle soit universelle – du point de vue de l’assiette comme du périmètre géographique –, afin d’éviter que les flux d’investissement ne se reportent vers les produits ou les territoires épargnés.
La France, avec la complicité active de l’Allemagne, a fait de l’instauration de ce prélèvement – qui fut naguère, sous l’appellation de « taxe Tobin »(169), l’apanage des milieux altermondialistes – l’un des chevaux de bataille de sa présidence du G20, et, parallèlement, le combat se mène sur un second front : celui de la législation européenne. Dès sa conférence de presse de lancement de la présidence française, le 24 janvier 2011, le Président de la République déclarait « que cette taxe est morale compte tenu de la crise financière que nous venons de traverser, que cette taxe est utile pour dissuader la spéculation ». Dans une résolution du 8 mars 2011, le Parlement européen s’est également prononcé favorablement au principe d’une taxe dont le taux serait compris entre 0,01 et 0,05 %, destinée à freiner la spéculation.
Au sommet exceptionnel de la zone euro du 12 mars 2011, à Bruxelles, Nicolas Sarkozy, avec l’appui de la chancelière Angela Merkel, a rallié ses partenaires à l’idée de taxer les transactions financières. Les dix sept Etats ont accepté de mettre à l’étude cette proposition, convenant, dans le communiqué final, « de la nécessité de réfléchir à l’introduction d’une taxe sur les transactions financières et de faire avancer les travaux aux niveaux de la zone euro et de l’UE ainsi que sur le plan international ».
Le 9 septembre 2011, les ministres des finances français et allemand, François Baroin et Wolfgang Schaüble, ont adressé aux commissaires européens Michel Barnier et Algirdas Semetaz, chargés du marché intérieur et des services financiers pour le premier, de la fiscalité pour le second, leur proposition relative à la création d’une taxe européenne sur les transactions financières. Celle-ci serait applicable à « toutes les opérations financières et de devises » impliquant « au moins une contrepartie […] basée dans l’UE ». Les institutions financières, banques, bourses et autres fournisseurs de services financiers seraient chargés de collecter la taxe auprès de leurs clients puis d’assurer son paiement.
Le ministre des affaires européennes Jean Leonetti nous a expliqué que la France, en toute logique, est « favorable à l’assiette la plus large possible et au taux le plus réduit possible », afin de ne pas fragiliser les places financières européennes et de faire rentrer de 20 à 40 milliards d’euros pour le FESF. La taxe serait alors à la fois indolore pour les marchés, ce qui minimiserait les réactions d’évasion, et efficace pour aider les pays européens les plus endettés. Les taux envisagés seraient de 0,1 % pour les actions et obligations, et de 0,01 % pour les produits dérivés, ce qui rapporterait des ressources nouvelles évaluées par la Commission à une cinquantaine de milliards d’euros par an, répartissables entre les budgets des Etats membres et celui de l’UE.
Bien que, en matière de fiscalité, l’unanimité soit requise au Conseil européen, le président Barroso, dans son discours sur l’état de l’Union du 28 septembre 2011, a annoncé que la Commission s’apprêtait à déposer une proposition de directive, pour une entrée en vigueur dès 2014 d’une taxe sur la plupart des transactions financières reprenant les modalités suggérées dans l’initiative franco-allemande. La stratégie de l’UE serait de s’appuyer sur ce précédent européen pour mieux défendre son extension au niveau mondial.
(2) Un outil pour assainir les marchés et dégager de nouveaux financements pour relever les grands enjeux planétaires
De nombreuses enceintes internationales se sont en outre emparées du débat, notamment le FMI, qui a validé la faisabilité de plusieurs scénarios, le groupe consultatif de haut niveau des Nations unies sur le financement de la lutte contre les changements climatiques, le groupe pilote sur les financements innovants institué dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement ou encore, plus récemment, l’UNESCO(170). Une taxe de 0,05 % prélevée à l’échelle mondiale dégagerait un produit de l’ordre de 190 milliards d’euros, soit un tiers des bénéfices de l’industrie bancaire.
Mais une taxe de ce type, quelles que soient ses modalités, soulève l’opposition de la plupart des pays du G20, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs grands émergents. Ses détracteurs prétendent que son coût serait répercuté sur le consommateur final, qu’elle affecterait l’efficience des marchés, qu’elle perturberait l’allocation des flux financiers vers les opérateurs économiques et qu’elle entraînerait un report de marché vers le shadow banking.
Il n’en demeure pas moins que les marchés financiers s’en trouveraient assainis et que, en outre, de nouveaux financements seraient obtenus afin d’abonder les fonds nécessaires pour relever les grands enjeux planétaires : aide au développement, lutte contre le changement climatique, voire résorption des dettes publiques.
Au demeurant, si certaines transactions, sans effet positif sur le financement de l’économie réelle et hautement spéculatives, sont évincées des marchés européens, notre continent ne s’en portera que mieux car cela contribuera à sa stabilité financière. La crise de la fin des années 2000 a en effet mis en évidence les conséquences extrêmement lourdes – particulièrement sur les titres souverains – des excès de l’industrie financière, à la recherche de profits de plus en plus élevés, nécessitant des prises de risques inconsidérées, voire irresponsables. En outre, une taxe universelle sur les transactions financières améliorerait la transparence sur les mouvements de capitaux car les pouvoirs publics pourraient alors identifier l’ensemble des opérateurs et la totalité des transactions incluses dans l’assiette.
Il semble aujourd’hui nécessaire, afin d’assainir l’économie mondiale, de sacrifier une partie des sources de profits de l’industrie financière, sur des segments au demeurant peu utiles, voire néfastes pour le secteur productif, avec une taxation « techniquement facile, financièrement productive, économiquement supportable et politiquement juste »(171).
Prendre date en faveur de la création d’une taxe universelle sur les transactions financières, appuyée sur une assiette couvrant l’ensemble des opérations et à un taux suffisamment élevé pour pénaliser les transactions spéculatives et dégager un montant significatif de ressources nouvelles.
L’essor de la régulation financière enregistré grâce au G20 a un effet secondaire : il entraîne une fragmentation de marchés, une surenchère dans l’innovation financière et des comportements de contournement. Les activités à risque se déplacent vers des secteurs moins régulés, animés par des institutions parafinancières, « non-banques » échappant à la vigilance des superviseurs nationaux. Les anglo-saxons et le secteur financier lui-même étant sensibles à ce problème, une orientation politique pourrait aisément être donnée au sommet de Cannes.
Surveiller et réguler les acteurs non pas selon leur statut juridique mais selon leur fonction dans le système financier, en incluant les banques, les compagnies d’assurance, les établissements de crédit et les fonds spéculatifs.
L’innovation technologique conduit au développement de calculateurs logarithmiques de plus en plus perfectionnés et rapides, par l’intermédiaire desquels sont successivement passés plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d’ordres de transactions, prenant effet à la milliseconde – voire, désormais, à la nanoseconde –, sur un même produit, jusqu’à ce que celui-ci atteigne une valeur limite prédéterminée à partir de laquelle la spéculation est jugée non rentable. Ces opérations sont en outre complètement déconnectées de la réalité car tout raisonnement économique, sur une telle durée, n’a aucun sens.
Les régulateurs financiers soupçonnent cette pratique, qui représente un tiers des transactions en actions en Europe et deux tiers aux Etats-Unis, d’accroître l’instabilité des marchés financiers et de servir à des fraudes boursières. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), instance d’autorégulation chargée de surveiller l’ensemble des opérateurs de marchés américains, mène à ce propos une enquête auprès des principaux utilisateurs d’automates. Quant à la Commission européenne, elle envisage d’introduire, dans sa future directive MIF II, des dispositions spécifiques à l’encontre des stratégies de négoce informatisé.
Cette pratique crée une distorsion de concurrence au profit du cartel des détenteurs d’automates : à la bourse de New York, seize opérateurs sur 15 000 concentrent ainsi 50 % du volume des transactions quotidiennes ; en Europe, le trading haute fréquence représente aujourd’hui 40 % des ordres d’achat et de vente, contre 9 % en 2007. Le marché est de moins en moins transparent et ouvert – car les opérateurs traditionnels se retrouvent rejetés du marché –, ce qui dégrade les mécanismes de formation des prix et nuit au financement de l’économie.
Surtout, le trading haute fréquence favorise les fraudes mais aussi l’amplification des opérations de spéculation à la baisse, responsables de l’aggravation de la chute des cours lors de la crise boursière de septembre 2008 ou encore de la crise éclair du 6 mai 2010(172). Un trader a ainsi le loisir d’emprunter un paquet d’actions à un client et d’encaisser automatiquement une multitude de plus-values tant que sa valeur augmente, puis de le lui restituer automatiquement dès que le cours baisse, sans lui faire empocher un sou.
Une interdiction pure et simple du trading haute fréquence serait inappropriée car cette pratique présente malgré tout un intérêt en contribuant à rendre les marchés financiers actifs. Le sénateur démocrate de New York Charles Schumer a cependant proposé de faire peser une taxe sur chaque opération. En tout état de cause, un encadrement effectif s’impose.
Encadrer de façon effective la pratique du trading haute fréquence.
Les agences de notation sont décriées depuis des années pour leur responsabilité dans l’accentuation des comportements moutonniers et procycliques des marchés : s’agissant particulièrement des dettes souveraines, la dégradation d’une note intervient souvent alors que les marchés ont déjà identifié le risque et ne fait qu’attiser la nervosité des investisseurs(173). Et elles se sont encore singularisées pendant l’été 2011.
Le 5 juillet 2011, l’agence américaine Moody’s a dégradé la dette portugaise de quatre crans, à Ba2, la reléguant dans la catégorie des investissements risqués, ce qui a provoqué une chute immédiate des bourses européennes. L’onde de choc a atteint les marchés obligataires des pays périphériques situés dans la ligne de mire des spéculateurs – Portugal, Irlande, Grèce, Espagne et Italie –, faisant battre des records aux rendements de la dette à court terme comme à long terme.
Un mois plus tard, le 6 août 2011, l’agence de notation Standard and Poor’s fait encore plus fort en dégradant la note des bons du trésor américain de AAA à AA+, provoquant une nouvelle levée de boucliers des pouvoirs publics, de part et d’autre de l’Atlantique.
En effet, quoique entités privées non régulées – car ne possédant pas le statut d’institutions financières –, les agences de notation, censées évaluer le risque de défaut représenté par les opérateurs et les produits financiers de manière objective et indépendante, ont eu une influence déterminante sur la crise financière de 2008-2009 et continuent de jouer un rôle clé dans le système financier mondial.
Elles forment un oligopole de droit, dans la mesure où la législation fédérale américaine agrée neuf instituts – dont les majors Moody’s, Standard and Poor’s et Fitch –, seules détentrices du droit de conférer le statut Investment Grade(174) à un instrument financier qui permet aux fonds de pension américain de le détenir. Leur puissance résulte précisément de cette officialisation américaine, relayée dans d’autres pays ainsi que dans les normes de Bale II, qui les désignent comme référence en matière de risque de crédit.
Leur mode de fonctionnement est source d’un conflit d’intérêt manifeste puisque les agences sont évaluées non pas par leurs clients mais par les émetteurs des produits notés. A l’épreuve des faits, il apparaît souvent que leurs appréciations étaient erronées.
Par ailleurs, elles notent sur la même échelle les produits simples et les produits complexes, ce qui est source de confusion pour les investisseurs. En effet, la rémunération d’un produit complexe est beaucoup plus élevée – par exemple 5 % contre 2 % pour un bon du trésor – mais le risque n’est pas identique non plus.
Le ministre des finances allemand Wolfgang Schaüble n’a pas hésité à déclarer qu’il faut « briser l’oligopole des agences de notation » et « limiter leur influence ». Quant à M. Barroso, il avait plaidé, le 8 juillet 2011, pour la création d’une agence européenne et avait accusé les trois agences majeures de « parti pris » contre l’Europe ; il s’est toutefois ravisé et a déclaré, le 6 septembre, n’avoir nullement « l’intention de créer une quelconque agence de notation publique ». Quoi qu’il en soit, la Commission européenne déposera une proposition de règlement européen en novembre, qui devra s’attacher à désintoxiquer les opérateurs financiers de leur sensibilité aux agences de notation.
Bannir tout référencement des agences de notation dans les réglementations financières.
Prohiber les notations souveraines pour les pays suivant un programme de soutien international.
Exiger des échelles de notation différentes pour les produits structurés et les instruments de dette simple.
La création d’une agence de notation européenne, publique mais indépendante, doit aussi être envisagée. Adossée à la Commission européenne, au MES ou à une fondation ad hoc, alimentée financièrement par les budgets nationaux et les entreprises, elles obéirait à trois critères fondamentaux :
– transparence des informations ;
– transparence des méthodes ;
– soutien politique des institutions européennes.
Créer une agence de notation européenne.
III. LA VOLATILITE EXCESSIVE
DU PRIX DES MATIERES PREMIERES AGRICOLES,
QUI DESTABILISE L’ECONOMIE MONDIALE, DOIT ETRE CONTENUE
La présidence française du G20 a fait de la régulation des marchés de matières premières comme arme contre la volatilité excessive des prix un thème novateur sur la scène diplomatique internationale. L’enjeu était double :
– traiter un problème de fond de plus en plus marqué et déséquilibrant pour les économies nationales, notamment celles des pays en voie de développement ;
– accessoirement, investir le G20 d’une mission sur un sujet de préoccupation quotidien pour les gens, afin de renforcer sa visibilité dans les opinions publiques mondiales, qu’elles en comprennent mieux les enjeux et qu’elles adhèrent à la démarche(175).
Parvenir à l’inscrire au programme des réunions préparatoires et du sommet a constitué un tour de force, tant les préventions initiales étaient grandes, en particulier de la part des puissances émergentes, grosses exportatrices nettes de matières premières, qui craignaient que le dessein de la France ne soit de réglementer les prix agricoles. En effet, outre que la hausse tendancielle des cours alimente les excédents de leurs comptes extérieurs, elles mettent en avant ses effets positifs sur la capacité d’investissement des producteurs, dans un contexte où la hausse de la productivité agricole est essentielle pour répondre à la demande mondiale.
Avec 1,3 milliard d’emplois directs, la production agricole est la première activité mondiale. Plus de 40 % de la population active mondiale dépend directement des marchés agricoles. Les produits de l’agriculture représentent 10 % du commerce mondial. L’explosion des prix de la plupart des produits agricoles de base – en particulier des céréales – constatée ces dernières années a donc des effets considérables sur l’économie mondiale. Outre l’insécurité alimentaire frappant les consommateurs des pays en développement, tous les producteurs de la planète sont confrontés aux effets de yoyo sur les marchés et vivent dans une grande incertitude. L’instabilité des marchés agricoles pèse aussi négativement sur les politiques d’aménagement du territoire, qui requièrent une visibilité à long terme.
Les pays du G20 détiennent quelque 54 % des surfaces agricoles et même 65 % des terres arables mondiales. Cette zone concentre 80 % des exportations et importations agroalimentaires en valeur. Pour ce qui concerne plus particulièrement les céréales, en 2008, le G20 était responsable de 77 % de la production mondiale, de 87 % des exportations et de 55 % des importations. Autant de données qui lui confèrent légitimité et capacité à intervenir.
2. Un mouvement de yoyo permanent qui remet en cause la pérennité des capacités productives agricoles
Index mensuel des prix des matières premières
(base 100 : avril 2002)
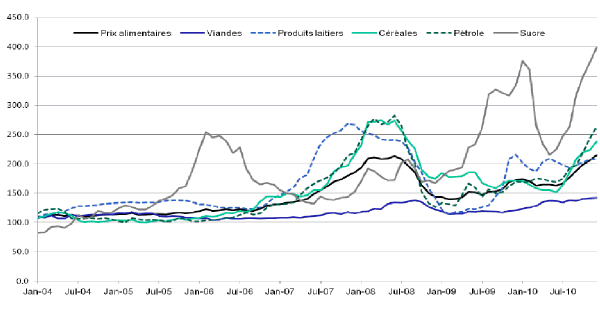
Qu’il s’agisse de l’énergie, des minerais et métaux(176), des produits agricoles ou des denrées alimentaires(177), les cours des produits de base, ces dernières années, ont connu une variabilité sans précédent. En tendance à moyen terme, ils ont suivi une forte hausse en 2007 pour atteindre des pics début 2008, avant de rechuter au second semestre 2008. Entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2011, ils sont repartis à la hausse au point d’atteindre de nouveaux records, puis ont subi à nouveau un brutal mouvement baissier à partir de mars 2011.
Sur le court terme, d’un mois à l’autre voire au jour le jour, les variations peuvent aussi être extrêmement importantes, comme le montrent les deux séries de graphiques suivantes. La série de gauche détaille l’évolution de cinq produits alimentaires de base – céréales, huiles et matières grasses, produits laitiers, viande et sucre – sur un an, entre janvier 2010 et janvier 2011. Le cours du sucre, par exemple, a perdu 45 % au premier quadrimestre 2010 puis a pratiquement doublé au second semestre 2010. La série de droite décrit, année par année, l’évolution mensuelle de l’indice de la FAO agrégeant les prix de l’ensemble des produits alimentaires : il en ressort que la volatilité des prix des produits alimentaires est devenue une constante.
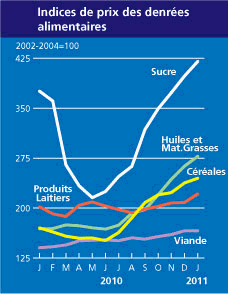
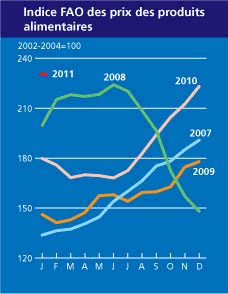
Source : FAO.
Cette instabilité chronique impacte lourdement l’économie mondiale. La flambée structurelle des prix des matières premières, provisoirement enrayée par la crise japonaise, reste une tendance de fond. Or elle rogner le pouvoir d’achat des ménages, dans les pays développés et surtout dans les pays en voie de développement, où les produits de première nécessité sont prépondérants dans le panier de la ménagère – de 50 à 70 % du budget familial leur est consacré.
Lorsque la pression sociale devient trop forte, elle contraint les pouvoirs publics à augmenter la grille des salaires, alimentant une spirale inflationniste, faute de quoi des émeutes de la faim risquent d’éclater. C’est précisément ce qui est survenu, dans une quarantaine de pays d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes, suite à l’explosion des prix des produits de base de 2007-2008, notamment du blé, du riz et du maïs. Quant au « printemps arabe », si son ressort principal était sans aucun doute de nature politique, il a aussi été alimenté, en milieu urbain, par la colère de classes populaires de plus en plus privées des produits de première nécessité et le ressentiment de classes moyennes paupérisées par la hausse des prix agricoles. Ce phénomène est nouveau : il ne s’agit pas de famines – il n’y a pas déficit des disponibilités physiques – mais d’augmentation de prix affectant le pouvoir d’achat des ménages dans des proportions insupportables.
A court terme, les variations de prix se font aussi parfois à la baisse, entraînant des perturbations aussi importantes du côté des producteurs, dont il arrive que le travail perde toute profitabilité. La volatilité frappe alors surtout les exploitants les plus actifs – ceux qui ont investi dans leur exploitation –, avec un risque de faillite à la clé. Ainsi, en dépit de prévisions alarmistes quant aux conséquences sur la production des conditions climatiques – sécheresse en Europe et en Chine, pluviométrie excessive aux Etats-Unis, semis difficiles au Canada –, le cours du blé s’est effondré, le 30 juin 2011, à 6,24 dollars le boisseau, soit moins 36 % par rapport au sommet atteint en février, à 9,69 cents, le blé suivant un mouvement parallèle. La tendance baissière a été confortée par la publication d’un rapport du département américain de l’agriculture(178) confirmant des informations déjà intégrées par les marchés : le fait que les récoltes devraient s’avérer bien meilleures que prévu et la réouverture par la Russie de ses vannes d’exportation, fermées depuis les incendies gigantesques de l’été 2010.
Le problème ne tient pas tant à l’augmentation tendancielle des prix mais à cet effet de yoyo permanent, qui remet en cause la pérennité des capacités productives agricoles et auquel les marchés domestiques sont de plus en plus sensibles. Les tensions qu’il génère sont nocives, à moyen terme, pour toutes les économies, qu’elles soient productrices ou importatrices de produits agricoles.
La volatilité est fondamentalement imputable à des réalités physiques tenant à la démographie et à la productivité, au niveau de l’offre et de la demande, aux aléas climatiques et politiques.
D’abord, l’offre mondiale augmente moins vite que la demande mondiale. La demande progresse au rythme de 2 % par an, portée par la croissance démographique – la terre comptera 9 milliards d’habitants en 2050 –, l’élévation du niveau de vie dans les pays émergents(179) et le développement de la production d’agrocarburants (180). Faute d’investissements productifs et de capacités foncières illimitées, l’offre est moins dynamique. L’augmentation des rendements agricoles est tombée de 3 % dans les années 1960 à 1970 à 1,3 % aujourd’hui ; depuis dix ans, la quantité produite par hectare a même diminué pour le riz et le blé, et elle a stagné pour le maïs et le soja. Les pays en voie de développement, notamment, n’investissent que 5,5 % de leur PIB dans l’agriculture, au lieu des 10 % auxquels ils s’étaient engagés, il y a dix ans, auprès de leurs bailleurs de fonds.
Ensuite, la production comme la consommation sont relativement peu élastiques aux prix, surtout aux hausses de prix : du côté de l’offre, les agriculteurs ne peuvent pas récolter plus que ce qu’ils ont planté et la constitution de stocks est trop coûteuse ; du côté de la demande, la nourriture étant un besoin vital, les variations des prix agricoles n’ont qu’un impact marginal sur la consommation, surtout parmi les populations pauvres. Cette rigidité des comportements ne permet pas au marché de s’ajuster correctement par la confrontation entre les niveaux de l’offre et de la demande.
L’augmentation tendancielle des cours des intrants énergétiques, pétrole en tête – qui subissent aussi, au demeurant, des fluctuations imprévisibles très déstabilisantes pour les exploitants agricoles –, pèse sur les coûts de production et d’acheminement des marchandises, et s’impute sur les tarifs de toute la chaîne de commercialisation.
Par ailleurs, le prix des marchandises étant généralement libellé en dollars, les variations de taux de change provoquent des fluctuations de cours importantes : lorsque le dollar se déprécie, la demande mondiale s’emballe.
Le climat joue évidemment un rôle déterminant dans la constitution des prix, les situations de pénurie consécutives aux catastrophes naturelles tirant les prix à la hausse.
Enfin, du point de vue politique, outre les conflits armés, qui détériorent ou anéantissent les récoltes et les circuits de commercialisation, le processus de libéralisation initié dans les années 1980 contribue à diffuser localement la volatilité des prix et l’ouverture progressive des frontières s’est accompagnée du démantèlement des politiques agricoles de soutien par les prix, notamment dans l’UE, avec pour conséquence une plus grande exposition des agriculteurs aux mouvements de cours erratiques.
Les chefs d’Etat et de gouvernement, au sommet de Séoul, ont mandaté les organisations internationales compétentes sur les questions énergétiques et agricoles pour une réflexion exploratoire au sujet de la volatilité des prix : « Nous nous engageons à […]renforcer la cohérence et la coordination des mesures prises en matière de sécurité alimentaire, augmenter la productivité agricole et la disponibilité des produits alimentaires, notamment en améliorant les mécanismes concrets innovants, en encourageant les investissements responsables dans l’agriculture, en favorisant les petites exploitations agricoles et en invitant les organisations internationales concernées à élaborer, d’ici notre sommet de 2011 en France, des propositions pour mieux gérer et atténuer les risques de volatilité des prix des produits alimentaires sans provoquer de distorsion du marché. »
Même si le changement climatique, qui lui est intimement lié, fait l’objet de sommets internationaux spécifiques, le G20 a vocation, dans l’avenir, à s’emparer du débat sur l’énergie, mais cela ouvrira un chantier de longue haleine couvrant plusieurs sommets et nécessitant un travail de préparation approfondi. En définitive, pour ce qui concerne 2011, hormis quelques déclarations d’intention portant sur les matières premières au sens large, tout le travail s’est donc concentré sur le volet agricole ; la problématique était déjà fort compliquée mais sans doute infiniment moins que celle de l’énergie.
La réflexion de la présidence française a pris appui sur un rapport(181) remis au ministre de l’agriculture Bruno Le Maire, le 22 septembre 2010, à l’occasion d’un colloque intitulé « Demain l’agriculture ». Ses auteurs aboutissent aux conclusions suivantes :
– le contexte international – sensibilité croissante à l’insécurité alimentaire, dynamique internationale favorable à la régulation – est propice à des initiatives pour stabiliser les marchés agricoles ;
– des mesures anti-crises agricoles s’imposent, sur les marchés physiques comme sur les marchés financiers ;
– l’agriculture mondiale souffre d’un défaut de gouvernance qui empêche la prévention des crises.
L’idée d’un G20 agricole n’allait pourtant pas de soi, plusieurs questions de méthodes et de fond se posaient. Premièrement, le G20 est-il l’instance adéquate pour parler d’agriculture, alors que trois agences onusiennes
– la FAO, le PAM et le FIDA –, représentatives de la diversité mondiale, sont spécialistes du sujet ? Deuxièmement, ne convient-il pas au préalable de trancher la polémique académique sur le rôle joué par la spéculation sur la volatilité des prix ? Troisièmement, comment parvenir à faire discuter ensemble des pays dont les intérêts agricoles divergent autant ?
Le rapport commandé à Séoul, Price Volatility in Food and Agricultural Markets : Policy Responses, est soumis aux sherpas le 2 juin 2011 par les dix organisations signataires(182) – qui avaient déjà produit un rapport d’étape, remis le 1er avril à la présidence française et aux vingt deputies. Il comporte trente et une recommandations précises et incisives, coïncidant pour l’essentiel avec les visées françaises, sous dix chapeaux :
– accroître la productivité, la durabilité et la résilience à long terme du système alimentaire et agricole mondial ;
– à partir des mécanismes existants, bâtir un système d’information sur les marchés agricoles ;
– améliorer la transparence des marchés dérivés ;
– renforcer la discipline internationale contre toutes les formes de restrictions aux importations et aux exportations ainsi que contre les programmes internes de soutien à l’agriculture ;
– exempter les acquisitions alimentaires humanitaires de toute restriction aux exportations et de tout impôt extraordinaire ;
– abroger les mesures réglementaires nationales de subventionnement de la production ou de la consommation d’agrocarburants ;
– mieux gérer les stocks nationaux et les réserves alimentaires régionales ;
– constituer des filets de sécurité en prévision des crises futures ;
– soutenir les initiatives de gestion de crise prises au niveau communautaire ou national ;
– systématiser la coordination internationale pour mettre en cohérence les politiques nationales.
Le fait d’avoir mis autour d’une même table dix organisations internationales est déjà un succès pour le G20. Certes, la FAO et l’OCDE collaborent ensemble depuis près d’une décennie et publient chaque année des projections à moyen terme. Plusieurs organisations s’étaient en outre déjà réunies en 2008, mais en urgence, dans une situation de tension exceptionnelle sur les cours : cela avait envoyé un signal négatif aux marchés, qui avait immédiatement pris quelque 10 % supplémentaires. Les organisations internationales ont en réalité saisi l’occasion de remettre les problématiques agricoles et alimentaires, souvent négligées, au cœur du débat international. La FAO, en particulier, militait depuis des années pour que des initiatives internationales soient prises, comme nous l’ont expliqué Hafez Ghanem, directeur général adjoint du département du développement économique et social, et ses collaborateurs. Signalons que la Banque mondiale a activement participé à l’élaboration du rapport, en acceptant le leadership de l’OCDE et surtout de la FAO, ce qui n’était pas acquis au départ.
La présidence française s’est également appuyée sur l’unanimisme européen.
Le 17 février 2011, le Parlement européen a adopté une résolution commune, déposée par six groupes politiques sur sept, relative à « la hausse des prix alimentaires », qui prenait position en faveur de la lutte contre la volatilité des prix agricoles et invitait la Commission à prendre « les mesures nécessaires pour lutter contre les excès de la spéculation sur les marchés des matières premières ».
Lors du Conseil « Agriculture et pêche » du 17 mai 2011, les six ministres qui sont intervenus à ce propos – ceux de l’Irlande, de la Finlande, de la Pologne, du Luxembourg, de l’Autriche et de la Grèce – ont ostensiblement soutenu la démarche française.
En outre, le 23 mai 2011, le Comité économique et social européen (CESE) a organisé une conférence intitulée « De quoi manger pour tous – Vers un contrat planétaire », dont les conclusions, qui constituent la contribution de la société civile aux travaux du G20 sur la sécurité alimentaire, ont été remises à Bruno Le Maire le 22 juin. Le président du CESE, le Suédois Staffan Nilsson, a mis l’accent sur six recommandations :
– la promotion d’une agriculture durable, d’une part en augmentant la part des budgets nationaux réservée à l’agriculture dans les pays en voie de développement, d’autre part en soutenant les politiques agricoles en faveur du développement des marchés locaux et régionaux ;
– le rôle crucial de la société civile, agriculteurs, consommateurs, secteur privé, travailleurs et ONG ;
– la reconnaissance du droit à l’alimentation, au niveau national comme au niveau international, notamment pour favoriser l’accès à la terre et à l’eau ;
– le caractère pluridimensionnel de la sécurité alimentaire, qui appelle la mise en cohérence des politiques ;
– la nécessité d’améliorer le fonctionnement des marchés agricoles en luttant contre l’instabilité des prix et en rendant le marché plus transparent ;
– le besoin de protéger les plus vulnérables et les plus démunis ainsi que de garantir les droits des travailleurs agricoles.
Ce soutien généralisé dans l’UE est aussi le résultat des consultations très poussées, notamment en Allemagne, entamées par M. Le Maire près d’un an avant le début de la présidence française.
Des groupes de travail ont été constitués avec tous les syndicats agricoles – y compris les organisations minoritaires –, les grands négociants, les organisations non gouvernementales actives dans les domaines de l’agriculture et du développement, ainsi que les industries agroalimentaires.
Les 16 et 17 juin 2011, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) a réuni 500 délégués représentant 120 organisations agricoles et paysannes de 75 pays pour un « G120 » sur le thème : « Défi alimentaire : les agriculteurs du monde prennent la parole. » A l’issue de cette rencontre, ils ont adopté une déclaration finale affirmant « le caractère spécifique et prioritaire que doit représenter l’agriculture pour les chefs d’Etat et de gouvernement compte tenu de ses dimensions sociales, économiques, environnementales pour chaque pays dans le cadre de sa souveraineté alimentaire » et insistant sur la nécessité de prendre des dispositions en matière d’incitation à la production, de transparence, de limitation de la spéculation, de viabilisation des activités agricoles et d’accès au foncier.
Le volontarisme diplomatique de la présidence française, en particulier du ministère de l’agriculture, a permis de faire tomber tous ces obstacles pour tracer, dès le mois de juin, des perspectives inespérées. La première étape, et non la moindre, a consisté à rassurer ceux de nos partenaires qui, jaloux de leur souveraineté agricole, s’opposaient à tout débat, notamment le Brésil, l’Argentine, le Canada et l’Australie : le projet français ne consistait pas en une régulation administrative des prix mais en une coordination de la communauté internationale pour créer des conditions de marché stabilisatrices.
Le Président Sarkozy a profité d’une conférence sur les matières premières organisée par la Commission européenne, à Bruxelles, le 14 juin 2011 – c’est-à-dire une semaine avant la réunion à Paris des ministres de l’agriculture –, pour plaider avec vigueur la cause d’une régulation plus étroite des marchés de l’énergie et des matières premières : « Grâce à l’action du G20, nous avons réussi à surmonter la plus grave crise que le monde ait connue depuis un siècle. La croissance est aujourd’hui repartie avec une croissance de l’économie mondiale supérieure à 4 %. Mais nous voyons qu’une des principales menaces qui pèse sur la croissance, c’est la hausse du prix des matières premières. […] Il y a un principe : appliquons au marché des matières premières, la même règle que celle que nous avons tenté d’appliquer aux marchés financiers. Il y a un mot, ce mot n’est pas tabou : c’est le mot régulation. […] Régulation, cela ne veut pas dire contrôle, cela ne veut pas dire protectionnisme, cela ne veut même pas dire fixer des prix administrativement. Qui y penserait ? C’est absurde, cela n’a jamais marché nulle part. Mais sans règle, je le répète, il n’y a pas de marché. »
L’intervention de Bruno Le Maire devant l’AGNU, le 17 février 2011
– préparée un mois auparavant, le 22 janvier, par une rencontre avec quarante-huit ministres de l’agriculture du monde entier, à Berlin, organisée avec son homologue allemand Gerd Müller – avait été très bien accueillie. Doublée de multiples déplacements et contacts internationaux avec tous les membres du G20 mais aussi des puissances régionales comptant à l’ONU, elle a permis de lever une grande partie de la méfiance ressentie par les pays exportateurs nets, et la communauté mondiale s’est progressivement ralliée aux visées de la présidence française et des agences spécialisées. Le 27 avril 2011, à l’occasion d’une rencontre avec Bruno Le Maire, le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, a ainsi salué « la prise en compte par la présidence française du G20 des questions de la régulation des marchés agricoles internationaux, de la sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation ».
Pour la première fois dans la courte histoire du G20, les ministres de l’agriculture se sont réunis les 22 et 23 juin à Paris – seule une réunion sous format G8 avait déjà été organisée, sous présidence italienne, des 18 au 20 avril 2009, à Cison di Valmarino.
En ouverture de la réunion, le Président Sarkozy a plaidé une nouvelle en faveur de son plan d’action et déclaré : « Face à la crise financière, le G20 a démontré sa capacité à relancer l’économie mondiale. Face à la crise agricole, nous devons agir avec la même détermination. »
Cette obstination à asséner les mêmes arguments face aux partisans de l’immobilisme a payé puisque les ministres de l’agriculture, le lendemain, ont rendu publique une déclaration de vingt-six pages, en cinq parties et cinquante-six points, plus six annexes, répondant à l’essentiel des préoccupations exprimées dans le rapport inter-agences.
Intitulée « Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture », elle commence par réaffirmer « le droit de chaque être humain à avoir accès à une nourriture saine, suffisante et nutritive » et la nécessité d’« avancer pour améliorer la disponibilité et l’accès à une alimentation sûre et nutritive pour les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants dans les pays en développement, grâce par exemple à des programmes nationaux de sécurité alimentaire ».
Contre toute attente, dès leur première réunion, les ministres se sont mis d’accord sur un plan d’action ambitieux mais aussi sur des actions concrètes à mener par étapes, avec cinq grands objectifs.
L’incertitude sur les capacités productives agricoles est une cause majeure de la volatilité des prix. Alors que l’agriculture est souvent considérée comme une activité peu productive et en déclin, il s’agit de stopper le mouvement de désinvestissement et de miser sur la recherche et la productivité, afin de préserver le potentiel agricole et de répondre à la demande croissante, notamment dans les pays les moins avancés. Cela permettrait de sortir d’un modèle asymétrique dans lequel les pays riches, très productifs, remplissent les greniers des pays pauvres.
La Banque mondiale et les banques régionales de développement, notamment la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque asiatique de développement (BASD), se sont engagées à financer un plan d’investissement à moyen terme et à long terme dans l’agriculture. Le président de la Banque mondiale a déclaré qu’il convenait de multiplier par quatre le niveau d’investissement en Afrique dans les années à venir.
Un premier acte concret a été posé en matière de recherche avec le lancement, le 15 septembre 2011, d’une expérience de mutualisation du séquençage du blé, l’Initiative internationale de recherche pour l’amélioration du blé(183), avec 120 participants, représentant quarante-trois organisations et centres de recherche, et venant de vingt-trois pays différents.
Le phénomène principalement mis en accusation est l’opacité des marchés agricoles. Un dispositif de croisement des données relatives à la production, à la consommation et aux stocks de céréales(184) – stocks privés inclus – sera constitué pour solidifier les anticipations des gouvernements et des opérateurs économiques. Cette banque de données unique, fiable et partagée, le Système d’information des marchés agricoles(185), s’appuiera sur les outils déjà existants, qui dépendent de la FAO, du PAM, d’autres agences des Nations unies et d’organisations non gouvernementales. Elle répondra aussi à la nécessité d’introduire, sur les questions agricoles, des paradigmes provenant d’autres univers de pensée. La meilleure coordination des marchés qui est attendue devrait lisser les évolutions de cours.
Des observateurs de terrain seront chargés de certifier les informations.
Afin de rassembler la totalité des grands producteurs et consommateurs de céréales du monde, la Thaïlande, le Vietnam, le Bangladesh, le Nigeria et l’Egypte seront associés aux travaux de l’AMIS, en sus des pays du G20. Et un volet de coopération technique a été ajouté pour emporter l’adhésion de la Chine et de l’Inde, qui jugent les données physiques éminemment stratégiques.
L’AMIS a été installée dès le 15 septembre 2011. Elle est hébergée à la FAO et bénéficie de l’expertise de la Banque mondiale, de l’OCDE, du PAM, du FIDA, de l’OMC et de l’IIRPA.
Les restrictions aux exportations, souvent motivées par des considérations domestiques, voire politiciennes, mais dénuées de rationalité économique, jouent beaucoup sur les tensions haussières, comme ce fut le cas, le 5 août 2010, lorsque la Russie décréta un moratoire sur la vente de blé. Conformément à la proposition de la mission Jouyet-Boissieu-Guillon, les ministres des finances du G20 préconisent la création d’un Forum de réaction rapide, sorte de Conseil de sécurité pour les affaires agricoles, visant à éviter des réponses unilatérales à des situations de crise. Rattaché à l’AMIS, il réunit des représentants politiques des ministres, assistés de spécialistes des stocks.
Les ministres de l’agriculture du G20 ont d’ores et déjà décidé de prohiber purement et simplement les restrictions aux exportations humanitaires au profit du PAM, ce qui constitue un geste fort envers le Sud, notamment l’Afrique sub-saharienne.
Le Forum de réaction rapide a été officiellement installé le 15 septembre 2011, concomitamment avec l’AMIS.
Il s’agit d’optimiser la gestion des réserves alimentaires humanitaires en mettant à la disposition des gouvernements, des entreprises et des agriculteurs une boîte à outils de gestion du risque. Le secteur sera ainsi mieux couvert contre les aléas du marché, mieux armé pour faire face aux effets de la volatilité des prix agricoles.
Plutôt que d’affréter des bateaux en cas de famine – au risque d’agir trop tard –, un réseau africain de réserves humanitaires d’urgence prépositionnées sera créé, avec un maillage de mini-centres de stockage, alimentés par la production locale, avec un contrôle anticorruption.
Cet objectif sera poursuivi dans le cadre du dossier de la régulation financière pris en charge par la filière finances, sous l’autorité des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale, lors de l’ultime réunion des 13 au 15 octobre.
La présidence française a obtenu que les dix-neuf ministres de l’agriculture, le commissaire européen et les présidents ou directeurs généraux des dix organisations internationales associées soient présents à la réunion des 22 et 23 juin. Elle est parvenue à créer un véritable « esprit de club » : cette collaboration productive entre le G20 et le cartel des organisations internationales – qui gagnent en crédibilité et en visibilité à mettre leur expertise en commun – est destinée à se perpétuer pour d’autres avancées.
Le Président de la République en a profité, sous couvert de la présidence du G20, pour susciter la convocation d’une réunion d’urgence de la FAO, le 26 juillet 2011, en vue de mobiliser la communauté internationale contre la famine frappant la Corne de l’Afrique.
Mais, sur la question de la volatilité des matières premières, la communauté internationale doit encore relever trois défis.
Certes, la réunion des ministres de l’agriculture a abouti a des délivrables « clé en main », unanimement validés par les ministres de l’agriculture et les organisations internationales, que le sommet n’a plus qu’à entériner. En outre, les orientations prises se sont déjà concrétisées en acte, avec l’installation de l’AMIS et du Forum de réaction rapide – installation à l’occasion de laquelle la présidence des deux organes a été confiée à la France –, ainsi qu’avec la mise sur les rails des premières initiatives de recherche. La présidence française peut donc d’ores et déjà considérer qu’elle a apporté une valeur ajoutée importante en ce qui concerne la lutte contre la volatilité des prix des matières premières agricoles.
Il n’en demeure pas moins que le G20 se caractérise par une gouvernance molle et que l’application de ses décisions est toujours sujette à caution.
Prévoir des clauses de rendez-vous pour sécuriser le programme adopté à la réunion des ministres de l’agriculture des 22 et 23 juin.
Au début de la présidence française, le Président de la République avait confié à Dmitri Medvedev l’animation d’un groupe de travail. Si l’action de la machine politico-administrative française a laissé peu de champ à d’autres initiatives, la Russie n’a pas manqué de soutenir les efforts du Gouvernement français. Au final, une prise de position officielle du président russe, lors du sommet de Cannes, en faveur du volet régulation des marchés agricoles du G20, aurait un impact politique fort, parce que la Russie est en quelque sorte le point de contact entre le G8 et les BRICS, et surtout parce qu’elle avait été montrée du doigt pour sa gestion des incendies de l’été 2010(186).
Tout le monde s’accorde pour reconnaître que la financiarisation est utile pour assurer la liquidité des marchés agricoles et offrir une couverture aux producteurs ; les avis divergent toutefois quant à son influence sur la volatilité des prix. Cette polémique académique et politique a même provoqué un psychodrame européen au début de l’année 2011.
Les autorités françaises considèrent qu’il existe une corrélation directe entre pratiques spéculatives et volatilité des prix. Or, en janvier 2011, la Commission européenne s’apprêtait à publier une communication niant l’existence de tout lien de causalité entre les deux phénomènes et imputant les fluctuations de cours à la seule confrontation entre offre et demande. Le Président de la République a vertement critiqué ce projet de texte, au point que la Commission européenne a revu sa copie.
Dans la communication définitive, intitulée « Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières »(187) – dont la publication avait été reportée au 2 février 2011 pour procéder aux rectifications nécessaires –, elle explique, en une formule certes alambiquée mais ne contredisant pas frontalement les affirmations françaises : « Si, à l’évidence, les positions sur les marchés d’instruments dérivés et les prix au comptant sont étroitement liés, il reste difficile d’apprécier pleinement les interactions et l’incidence que peuvent avoir sur la volatilité des marchés physiques sous-jacents les fluctuations sur les marchés d’instruments dérivés. Il est d’autant plus difficile d’établir ces corrélations que les marchés physiques ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques et que plusieurs dynamiques de marché sont à l’oeuvre dans les différents secteurs concernés. Il convient donc de pousser plus avant les travaux pour mieux comprendre cette évolution. »
Le fait est que les montants de produits dérivés échangés, notamment à la bourse de Chicago, sont astronomiques, sans commune mesure avec le marché réel : ils atteignent jusqu’à quarante-six fois la production annuelle de blé, vingt-quatre fois celle du maïs et, pour ce qui concerne l’énergie, trente-cinq fois celle du pétrole. La croissance des marchés dérivés s’est même accélérée avec la crise de 2008, du fait du transfert de volumes importants d’actifs en provenance du secteur immobilier.
De surcroît, ni les acteurs, ni les produits, ni les moments des transactions ne sont connus des autorités publiques.
Enregistrer toutes les transactions sur produits dérivés négociés de gré à gré, les faire transiter par des chambres de compensation et les soumettre à une autorité de marché.
Les données physiques n’expliquent pas à elles seules l’ampleur ni des augmentations de cours ni des mouvements correctifs à la baisse : lorsqu’ils se rendent compte que les hausses des prix des produits agricoles de base ont été excessives au regard des fondamentaux réels, les spéculateurs liquident massivement leurs positions, quitte à faire volte-face peu de temps après, mus par les mêmes réflexes moutonniers, si les stocks ne se reconstituent pas.
La stratégie la plus pernicieuse, pour de très gros opérateurs, consiste à obtenir une position dominante sur un marché en monopolisant les stocks. Mi-juillet 2010, depuis la bourse de Londres, le fonds d’investissement britannique Armajaro a acquis la quasi-totalité des contrats de cacao disponibles sur le marché – 240 100 tonnes, soit 7 % de la production annuelle mondiale –, prenant ainsi le contrôle de 15 % des stocks mondiaux. Cette opération à près d’1 milliard de dollars, passée en toute légalité dans un contexte de tension sur le marché du cacao et de cours déjà historiquement hauts, avait pour but d’assécher le marché, de provoquer la rareté et d’instiller l’incertitude, afin de faire encore grimper les prix.
Le Dodd-Frank Act oblige déjà les régulateurs américains à établir des limites de position pour les opérateurs, selon le type de marchandise et la valeur du contrat considérés mais les normes que ceux-ci ont édictées sont peu contraignantes : les limites de positions s’appliqueraient à vingt-huit matières premières, à hauteur de 25 % de l’offre sur les contrats livrables dans le mois.
Imposer partout dans le monde des limites de position et des dépôts minimaux au prorata du montant des transactions.
Comme nous l’avons vu, la question des hard commodities a été mise de côté cette année. Or, qu’il s’agisse des hydrocarbures ou des minerais – notamment des métaux et terres rares, qui font l’objet d’une spéculation de plus en plus rude –, la volatilité est tout aussi soutenue et déstabilisante pour l’économie mondiale.
Karel de Gucht, le commissaire européen chargé du commerce, a plaidé, le 16 mars 2011, pour que le G20 convienne rapidement de règles de marché transparentes pour régir l’approvisionnement en matières premières. Les pays fournisseurs de matières premières essentielles privilégient en effet les arrangements bilatéraux plutôt que l’exportation sur un marché mondial ouvert ; la Chine, en particulier, a instauré des quotas sur les exportations de terres rares, dont elle détient 35 % des réserves mondiales connues et 90 % du marché mondial.
Le Conseil européen, dans les conclusions de ses séances du 4 février 2011 et des 24 et 25 mars 2011, a marqué son intérêt tout particulier à l’égard de la lutte contre « la volatilité des prix de l’énergie ».
Initier, à Cannes, la même démarche coopérative, en vue des prochains sommets, pour réduire la volatilité des prix des différentes catégories de matières premières minérales.
QUATRIEME PARTIE :
REPENSER LA GOUVERNANCE DU G20, EN L’INSTITUTIONNALISANT
PAR LE BIAIS D’UN SECRETARIAT PERMANENT
ET EN RENFORCANT LA CAPACITE DE LA REPRESENTATION EUROPEENNE A FAIRE ENTENDRE SA VOIX
Dans leur rapport, les experts de l’« Initiative du Palais-Royal » réunis autour de M. Camdessus constatent l’« absence d’une gouvernance mondiale effective », due, notamment au « déficit de légitimité du FMI ». Le G20 s’étant « imposé de facto comme la principale instance de coopération économique et financière », ils préconisent l’adoption d’une nouvelle gouvernance de ce groupe, fondée sur une architecture intégrée à trois niveaux :
– celui des chefs d’Etat ou de gouvernement ;
– celui des ministres des finances et des gouverneurs de banque centrale ;
– celui des administrateurs contrôlant les travaux du FMI.
Les trois échelons seraient organisés sur la base de circonscriptions géographiques, méthode suivie par le FMI et la Banque mondiale, particulièrement adaptée au cas de l’Europe, aire continentale la plus intégrée politiquement et économiquement. Le pays occupant une chaise régionale tournerait à échéances régulières et serait tenu de consulter ses partenaires et de leur rendre compte.
De son côté, Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, a théorisé la constitution d’un « triangle de cohérence » pour la gouvernance mondiale :
– le G20 fournirait le leadership et les orientations politiques ;
– les organisations internationales élaboreraient les règles et les mécanismes de mise en application et de consolidation des décisions ;
– l’ONU resterait la source principale de légitimité et de responsabilité.
Les deux enjeux, pour l’UE, sont donc bien cernés :
– quelle est la structuration internationale la meilleure pour la protéger convenablement contre les déstabilisations économiques ?
– comment doit-elle s’organiser pour peser davantage dans les négociations internationales et ainsi être mieux à même de transformer ses préoccupations en décisions politiques mondiales ?
Le Président Sarkozy ayant confié au premier ministre britannique, en début de présidence, le soin de réfléchir à la question et d’émettre des propositions, la présidence française est restée relativement discrète sur le sujet. Des pistes devraient cependant être tracées lors du sommet de Cannes, à partir, précisément, du travail de David Cameron.
I. LE G20 A BESOIN D’UNE STRUCTURE DE SECRETARIAT LEGERE MAIS PERMANENTE
De plus en plus de voix proposent que le G20 se dote d’une administration permanente pour transformer ce forum en une véritable instance internationale. L’Australie et l’Inde ont été très tôt désireuses de cette institutionnalisation. Puissances moyennes, non représentées au Conseil de sécurité des Nations unies et relativement isolées – la première eu égard à son insularité et à son éloignement, la seconde aux tensions diplomatiques et territoriales avec ses grands voisins que sont la Chine et le Pakistan –, elles ont tout intérêt à voir le G20 gagner en prérogatives et s’installer dans le paysage mondial.
Le président Sarkozy a évoqué cette hypothèse dès le 25 août 2010, dans son allocution d’ouverture de la XVIIIe Conférence des ambassadeurs : « Le G20 a décidé qu’il serait le “principal forum” mondial pour les questions économiques et financières. Encore faut-il qu’il se donne les moyens de travailler plus efficacement. Ne faut-il pas créer un secrétariat du G20 pour suivre en permanence la mise en œuvre des décisions prises et instruire les dossiers, en liaison avec toutes les organisations internationales concernées ? » Au sommet de Séoul, la Chine et le Brésil ont accueilli positivement cette prise de position, tandis que le Japon et même deux de nos voisins européens, l’Italie et l’Allemagne, émettaient de fortes réserves.
La question, déjà inscrite à l’agenda par la présidence coréenne et évoquée dans la conclusion du sommet de Séoul, est plus encore d’actualité en 2011, mais elle n’en demeure pas moins délicate. En effet, si ce sont bien des considérations avant tout fonctionnelles, relatives à la régulation du système financier, qui ont accompagné la mise en avant du G20, elles ne sauraient occulter les enjeux politiques qu’entraînera nécessairement tout processus d’institutionnalisation, et que dévoile déjà l’évolution de l’agenda du groupe : la légitimité de l’ONU ne saurait être remise en cause et les fragiles équilibres internes du G20 doivent être respectés. L’appétence politique pour un renforcement de la gouvernance du G20 est d’ailleurs très variable d’un pays à l’autre.
Actuellement, un secrétariat éphémère est fourni par la présidence en exercice, dans le cadre d’une troïka où elle est assistée des présidences passée et future. Les administrations des trois pays concernées – notamment celles des ministères des finances, la filière finances étant la plus ancienne et surtout la plus sollicitée – se coordonnent en permanence, à tous les niveaux hiérarchiques, afin de piloter l’élaboration des délivrables susceptibles d’être examinés lors du sommet. Ce système est censé assurer la continuité entre les dossiers suivis et, de fait, jusqu’à présent, il a bien fonctionné.
Mais il échouerait dans l’hypothèse où la troïka serait composée de pays éprouvant des difficultés à travailler ensemble. Les priorités des présidences successives peuvent en effet diverger, par exemple lorsque les pays concernés appartiennent à des continents différents ou lorsqu’il s’agit d’une puissance développée et d’une puissance émergente, surtout si elles sont en forte concurrence directe sur tel ou tel dossier(188). Le directeur général du trésor, Ramon Fernandez, nous a confié qu’il convient d’« assurer la continuité des ordres du jour », d’« éviter que les présidences successives ne sautent d’une “marotte à l’autre” ». Un secrétariat permanent aiderait le G20 à passer définitivement d’une logique du coup par coup, en fonction des urgences contextuelles – comme le G8 – à une logique de continuité, plus conforme au principal besoin de l’économie mondiale : la stabilité.
Le passage de relais entre la Corée du Sud et la France s’était extrêmement bien passé. En dépit du contexte délicat des relations entre la France et le Mexique – qui présidera le G20 en 2012 –, la collaboration administrative entre les deux pays n’a pas rencontré de difficultés, notamment pour ce qui concerne l’animation des équipes internationales qui ont travaillé sur le dossier des déséquilibres macroéconomiques et de la réforme du SMI, pour lequel le Mexique avait été désigné chef de file avec l’Allemagne. Mais qu’en sera-t-il sur un plan purement politique, lorsque le président Calderon sera amené à promouvoir les acquis du G20, notamment de ceux gagnés sous présidence française, au risque de mécontenter son opinion publique, en pleine année électorale(189) ?
A cet égard, la présidence 2012 se déroulera dans un contexte d’incertitude politique globale, la conjonction des calendriers nationaux aboutissant à un renouvellement du leadership dans quatre autres pays : des élections présidentielles et législatives auront lieu aux Etats-Unis et en France, la Russie et la Turquie éliront leur président, et un changement de génération devrait intervenir à la tête de l’Etat chinois. Dans tous ces pays, les marges de manœuvre politique seront réduites et les prises de décisions compliquées, surtout si le contexte de déprime économique devait perdurer.
En outre, comme l’explique Antonio Cabral, conseiller principal et sherpa du président du Conseil européen, le G20 est une opération de plus en plus complexe, du fait non seulement de la lourdeur administrative croissante du procès de préparation des sommets mais aussi de l’élargissement continu du panel de sujets traités.
Les débats du G20 deviennent trop importants et lourds de conséquences pour risquer de connaître des hauts et des bas en fonction du poids politique du pays exerçant la présidence et de l’investissement personnel de son chef d’Etat ou de gouvernement.
Des pays moins rompus que la France aux exercices de ce type n’en seront pas moins amenés automatiquement à présider le G20, par le jeu des présidences tournantes. Or tous ne possèdent pas les trois attributs qui permettent de faire fonctionner le G20 :
– le poids politique ;
– l’expertise technico-administrative ;
– les capacités organisationnelles.
S’agissant du poids politique, il faut être en mesure de convaincre, autrement dit de s’imposer, au début de l’exercice, pour l’établissement de l’agenda, puis à chaque réunion ministérielle de l’année, pour faire sortir des propositions délivrables, et enfin lors du sommet, pour emporter la décision(190).
L’appareil administratif doit faire preuve d’excellence pour piloter les groupes de travail de fonctionnaires et faire émerger des solutions acceptables par tous, utiles pour l’économie mondiale et applicables sur toute la planète. Il doit donc avoir une compétence pluridisciplinaire et une grande expérience des négociations multilatérales.
Enfin, des capacités organisationnelles de grande ampleur sont indispensables pour organiser les grands rendez-vous – notamment les réunions ministérielles – et surtout le sommet. Il convient tout d’abord de disposer de services de sécurité opérationnels, incluant un quadrillage terrestre, des surveillances aériennes et des protections maritimes. Et les infrastructures en hôtellerie et en salles de réunion doivent être suffisantes pour accueillir plusieurs milliers de personnes.
La partie logistique et protocole, cette année, a été prise en charge par un service créé à dessein, placé auprès du premier ministre : le secrétariat général de la présidence française du G20 et du G8. A Deauville, les délégations officielles comptaient 2 500 personnes au total, 3 500 journalistes avaient fait le déplacement et 12 252 personnes étaient mobilisées pour assurer la « sanctuarisation » du sommet. A Cannes, pour accueillir les 1 100 délégués des trente-trois délégations attendues(191), 1 800 personnels techniques et 10 000 personnels des forces de sécurité – police, gendarmerie, pompiers, sécurité civile et armée – sont prévus, sans oublier les 3 000 journalistes qui devraient être accrédités.
Un secrétariat permanent permettrait d’assister les présidences successives, notamment les présidences faibles, dépourvues d’un, de deux ou de ces trois attributs.
Le second enjeu consiste, pour le G20, à être en mesure de suivre les politiques nationales, afin de contrôler la déclinaison juridique des orientations politiques fixées par les sommets, de vérifier que les délais prévus sont appliqués. Un tableau de bord pourrait être tenu point par point et mis à la disposition de la présidence et de la troïka qui pourraient, à chaque réunion ministérielle ou sommet, donner de nouvelles impulsions pour rappeler à l’ordre les pays retardataires et faire avancer les dossiers en souffrance.
Le temps de latence entre les négociations et l’exercice démocratique, nous l’avons vu, peut en effet être long, sous l’influence du jeu politique domestique et des groupes de pression locaux. En l’absence de structure investie d’un pouvoir de contrôle, chaque pays suit les avancées des autres de façon informelle. Cette évaluation par les pairs désordonnée est assez inefficace et source de tensions politiques contreproductives.
François Baroin a parfaitement illustré cet enjeu en nous indiquant qu’il importait de créer une sorte d’« autorité notariale », qui se porterait garante des actes passés sous le seing du G20.
Mais l’idée d’un secrétariat permanent ne fait pas l’unanimité, plusieurs motifs légitimes étant avancés pour la rejeter.
Ses détracteurs objectent que le G20 doit rester un objet politique souple, maniable et informel, qu’un secrétariat permanent le dénaturerait. La ligne de fracture se situe d’ailleurs entre les très grandes puissances et les autres pays. La France, qui milite activement en faveur d’un secrétariat permanent, et dans une moindre mesure la Russie et le Royaume-Uni, font figure d’exceptions. L’Allemagne, le Brésil la Chine, et les Etats-Unis, à des degrés divers, ont fait Etat de leurs réticences ; ils redoutent essentiellement de perdre le contrôle de l’agenda au profit d’un organe où se cristalliseraient des enjeux de pouvoir. De l’autre côté, la Corée du Sud, l’Indonésie ou la Turquie verraient d’un bon œil la reconnaissance institutionnelle d’un cénacle qui leur confère un rang convoité sur la scène mondiale.
Le G20 ayant fait ses preuves grâce à sa légèreté, à sa réactivité aux événements, à son pragmatisme et à l’« esprit de club » qui y prévaut, instituer une instance alourdie par les contingences logistiques, figée, bureaucratique et conflictuelle ne constituerait certes pas un progrès. Comme nous l’a fait observer Isabelle Mateos y Lago, conseillère en chef au département de la stratégie du FMI, la plus mauvaise solution serait donc de créer « une organisation internationale supplémentaire, qui entrerait en concurrence avec celles qui existent déjà ». Cette formule serait étrangère à la nature du G20 ; cela sonnerait tout bonnement la fin du G20 comme cellule de crise globale capable de répondre à l’urgence, et par extension la fin de la régulation mondiale. En outre, du point de vue des deniers publics, cette option ne serait pas défendable auprès des contribuables, quel que soit le pays.
B. Les organisations internationales constituent le bon point d’appui pour un secrétariat permanent efficace
Tout en étant conscients des dérives à éviter, à la lumière des analyses exprimées par les très nombreuses personnalités avec lesquelles nous nous sommes entretenus à ce sujet, nous avons été convaincus par les arguments en faveur de l’instauration d’un secrétariat permanent.
Néanmoins, à supposer que les pays du G20 s’entendent sur le principe, il restera à déterminer ses compétences exactes, son organisation, son fonctionnement et les modalités de ses relations avec les Etats membres.
Sans nous donner de précisions relatives au fond des propositions susceptibles d’être émises au terme de l’exercice, nos interlocuteurs du cabinet du premier ministre britannique nous ont communiqué quelques éléments sur la méthode retenue, qui a été présentée lors de la réunion des sherpas des 28 et 29 avril 2011. Le sherpa britannique a procédé à de multiples concertations auprès des Nations unies et d’autres organisations internationales, des Etats membres du G20 – notamment en se rendant dans plusieurs Etats d’Asie et d’Amérique du Sud – ainsi que des Etats non membres. Puis, début septembre, il était prévu que des notes soient diffusées aux Etats membres du G20.
Comme alternative à une structure classique, la Corée du Sud, au sommet de Séoul, avec l’approbation de la Russie, a suggéré la constitution d’un « cybersecrétariat », entité dématérialisée, par conséquent peu coûteuse, ne risquant pas de se prêter à une inflation bureaucratique et ne favorisant pas les grands pays, ceux qui seraient les plus aptes à héberger les bureaux d’un secrétariat « physique » et à imposer leurs ressortissants aux postes de responsabilité.
1. L’Organisation de coopération et de développement économiques, organisation économique pluridisciplinaire
L’OCDE plonge ses racines dans l’histoire du XXe siècle. Conscients des erreurs commises par la communauté internationale au lendemain de la Première Guerre mondiale, les pays occidentaux victorieux, en 1945, décident non pas de punir les vaincus en leur imposant le règlement de dommages mais au contraire de miser sur la coopération et la reconstruction pour créer les conditions de la réconciliation et de la paix sur un continent européen dévasté. Ainsi naissent, en 1947, le plan Marshall et l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), chargée de son administration.
Le 14 décembre 1960, encouragés par le succès de l’entreprise et animés par la volonté d’étendre ses travaux à l’échelle mondiale, les Etats-Unis et le Canada rejoignent les dix-huit pays membres de l’OECE pour la transformer en une nouvelle organisation internationale, l’OCDE, dont la convention entre en vigueur le 30 septembre 1961. L’ajout du mot « développement » n’est pas anodin : en pleine guerre froide, il s’agit de mettre l’accent sur le dynamisme de l’axe euro-atlantique, qui s’impose alors comme fer de lance de la croissance et du progrès économique au niveau mondial. De fait, en cinq décennies, le produit intérieur brut par habitant – bon indicateur de la prospérité – de la zone OCDE a presque triplé, certains de ses membres connaissant des progressions plus spectaculaires encore.

L’OCDE, qui vient donc de fêter ses cinquante ans, a pour missions de produire des statistiques, d’identifier les problèmes économiques, de les analyser, d’en débattre et de proposer des solutions. Elle compte aujourd’hui trente-quatre membres : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, Israël, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie.
Six membres de l’UE n’en font donc pas partie : la Bulgarie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Roumanie. Huit Etats membres du G20 non plus : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Russie, qui espère être admise d’ici à 2013.
b) Les atouts de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour héberger le secrétariat permanent du G20
Il existe une myriade d’organisations internationales compétentes sur les sujets économiques, financiers, commerciaux, sociaux, agricoles ou de développement. Elles relèvent de statuts différents, certaines d’entre elles étant dotées de la capacité juridique d’émettre des normes et de contribuer à les coordonner, d’autres pas. Dans la mesure où il arrive que des domaines d’expertise ou d’intervention se chevauchent, sans forcément entrer en concurrence, certaines d’entre elles peuvent apparaître comme faisant double emploi. Plutôt que de créer un secrétariat du G20 ex nihilo – c’est-à-dire, de fait, d’ajouter une organisation internationale –, il conviendrait d’appuyer une telle structure sur l’une des organisations existantes.
La solution de l’OCDE consisterait non pas à faire assurer le secrétariat du G20 par l’OCDE elle-même mais à créer une structure administrative légère basée à l’OCDE, la partie politique restant du ressort des filières nationales et, en dernière instance, des chefs d’Etat et de gouvernement.
Si cette solution n’est certes pas la plus communément avancée – l’OCDE, à notre connaissance, n’a d’ailleurs nullement fait acte de candidature –, nous estimons qu’elle présenterait deux atouts déterminants.
D’abord et surtout, l’OCDE est la seule organisation internationale économique pluridisciplinaire ; elle possède les ressources internes pour apporter une expertise sur tous les dossiers déjà été ouverts au G20 ou susceptibles de l’être dans les années à venir, y compris ceux de la croissance verte ou du changement climatique, sur lesquels elle investit beaucoup. Son secrétariat s’appuie sur quelque 2 500 agents, parmi lesquels de nombreux économistes, juristes et scientifiques de haut niveau, faisant référence, sur le plan académique, dans leur spécialité. Le numéro un de l’OCDE, son secrétaire général, est depuis juin 2006 l’économiste et diplomate mexicain Angel Gurría.
Ensuite, le fait que l’OCDE se consacre à l’étude des problèmes économiques, à l’exclusion de tout moyen régalien d’intervention sur la conduite des politiques nationales, conviendrait bien au G20, un secrétariat permanent ayant uniquement vocation à servir de structure de soutien administratif et technique.
L’OCDE présente également l’avantage non négligeable, pour la France, d’être installée à Paris : le siège se situe dans le 16e arrondissement, au château de la Muette, et ses cinq annexes sont à proximité immédiate, trois également dans l’Ouest parisien, une à Boulogne, une à Issy-les-Moulineaux.
(2) Le fait que tous les membres du G20 n’appartiennent pas à l’Organisation de coopération et de développement économiques n’est pas dirimant
La principale objection contre cette option – qu’il ne s’agit pas de minimiser mais qui ne semble pas dirimante –, tient au fait que tous les membres du G20 n’appartiennent pas à l’OCDE.
La personnalité qui a défendu cette hypothèse avec le plus de clarté est du reste l’ambassadeur de Russie en France, dont le pays n’appartient pas à l’OCDE – même s’il espère la rejoindre d’ici à deux ans, les négociations étant ouvertes depuis 2007.
Le 16 mai 2007, le conseil de l’OCDE, dans sa configuration ministérielle, a adopté une résolution tendant à accentuer la coopération de l’OCDE avec l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie, dans le cadre de programmes d’engagement renforcée en vue de leur adhésion éventuelle.
Et puis, l’OCDE peut se prévaloir d’une expérience de pilotage similaire. Lors du Sommet de Heiligendamm des 6 au 8 juin 2007, les treize chefs d’Etat et de gouvernement du G8+5 et le président de la Commission européenne décident d’établir le Processus de dialogue de Heiligendamm (PDH), avec l’objectif politique de renforcer la confiance entre partenaires et de définir un terrain d’entente sur des questions économiques d’importance mondiale, notamment en matière d’investissements et d’énergie. L’OCDE est alors invitée à servir de plateforme au dialogue engagé et, depuis septembre 2007, elle accueille en son sein l’unité de soutien au PDH.
Subsidiairement, l’OCDE anime des groupes de coopération administrative en matière de fiscalité, élargis à des pays non membres, notamment parmi les grands émergents.
Eu égard à son envergure diplomatique et à l’importance des thématiques qui y sont traitées, le G20 est sans commune mesure avec le G8+5, mais ce secrétariat permanent, qui a bien fonctionné, peut être considéré comme une expérience préfiguratrice :
– il préparait les documents de travail utilisés lors des réunions et établissait des délivrables à l’intention des participants ;
– il était soumis aux règles administratives et financières de l’OCDE ;
– il était logé à l’OCDE ;
– des ressortissants d’un pays non membre de l’OCDE pouvaient y être recrutés.
L’OCDE, au gré de ces diverses initiatives, a donc donné des gages de collaboration aux puissances émergentes, qui n’y siègent pas. Quoi qu’il en soit, faire le choix de l’OCDE pour héberger un futur secrétariat permanent du G20 entraînerait une généralisation et une accélération des démarches d’élargissement à tous ses Etats membres, à supposer que ceux-ci se conforment à l’examen détaillé de l’organisation sur ses quelque 200 standards légaux. L’OCDE changerait alors de statut : elle se verrait consacrée comme l’organisation internationale universelle sur les questions de coopération et de développement économique.
Créer un secrétariat permanent, structure légère hébergée par les services de l’OCDE, travaillant en étroite collaboration avec les autres organisations internationales.
Deux autres options – vers lesquelles ne se porte pas notre préférence mais qu’il n’est pas inutile d’évoquer – peuvent être envisagées : celles du FMI et du CSF.
(1) Le Fonds monétaire international, organisation internationale spécialisée sur les questions monétaires et macroéconomiques
Le FMI a aussi été cité comme structure susceptible d’accueillir un éventuel secrétariat permanent du G20. Il bénéficie déjà d’une structuration administrative forte et d’une expérience reconnue en matière d’analyse macroéconomique et de coopération monétaire comme en matière de travail en lien avec le G20, pour contribuer à la mise en œuvre des orientations des sommets.
Le périmètre de ses Etats membres est en décalage par rapport à celui du G20 : si les dix-neuf Etats membres du G20 sont adhérents du FMI, deux d’entre eux, l’Afrique du Sud et la Turquie ne siègent pas au conseil d’administration actuellement et deux autres, la Corée du Sud et l’Indonésie, ne disposent que d’un siège d’administrateur suppléant.
En outre, il serait difficile de mettre en cohérence leurs modes de fonctionnement et leurs moyens d’intervention respectifs : le FMI est gouverné selon des normes dures, à partir d’un calcul de quotes-parts, et dispose de considérables moyens financiers, tandis que le G20 ne suit pas de règles écrites et ne peut compter sur aucun fonds d’intervention propre.
Enfin, le champ de compétence du FMI, comme son nom l’indique, est pratiquement restreint aux questions monétaires et il s’est souvent singularisé, dans le passé, en prescrivant à ses Etats membres des politiques d’austérité draconiennes dont le bien-fondé est aujourd’hui discuté. Installer auprès de lui le secrétariat permanent du G20 ne serait donc pas forcément un bon signal, alors que le G20 a vocation à intervenir sur bien d’autres champs et promeut une croissance équilibrée.
Quant au CSF, il s’agit déjà d’un rouage de la machinerie du G20, en compagnie duquel il est né, en 1999, et en parallèle duquel il a évolué pour prendre sa forme actuelle, en 2009. Dans l’absolu, il pourrait suivre un nouveau processus de mutation et de développement. Il est hébergé par la BRI, à Bâle, ce qui peut constituer un inconvénient si l’on considère que le secrétariat permanent doit être localisé dans un Etat membre du G20, ou au contraire un avantage si l’on considère qu’un terrain neutre serait plus approprié.
A l’instar de l’OCDE, le CSF n’émet aucune norme contraignante et ne dispose pas de moyens d’intervention directs. Il travaille avec les trésors nationaux de vingt-quatre Etats, les banques centrales, les organes de régulation nationaux, six grandes organisations internationales et sept groupes internationaux sectoriels de superviseurs et de régulateurs(192), édicteurs de normes.
Mais le CSF est très spécialisé sur le sujet de la stabilité des marchés financiers et ne possède par exemple aucune expertise en matière de résorption de déséquilibres macroéconomiques, de commerce agricole ou de législation du travail.
b) Une collaboration entre organisations internationales, en étoile, autour de l’Organisation de coopération et de développement économiques
Si l’option OCDE est retenue, le secrétariat permanent devra assurer la préparation des sommets et le suivi des orientations en organisant une collaboration, en étoile, avec toutes les autres organisations internationales, que l’on peut classer en huit catégories distinctes :
– l’ONU et ses agences spécialisées (FAO, PAM, OIT, etc.) ;
– les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) ;
– le CSF et les groupes internationaux de supervision et de régulation ;
– les associations économiques régionales (UE, ASEAN, UA, MERCOSUR, ALENA, etc.) ;
– les fonds régionaux d’intervention financière (MES, Initiative de Chiang Mai) ;
– les banques régionales de développement (BAD, BASD, etc.) ;
– l’OMC ;
– les confédérations professionnelles mondiales (S20, B20, G120).
Dans un monde multilatéral instable, l’une des critiques principales formulées à l’encontre du G20 doit être considérée avec attention : il risque de bouleverser le fragile équilibre international que le système onusien essaie de garantir, de remettre en cause le principe essentiel selon lequel l’ONU est à la source de la légitimité internationale. La Chine, en particulier, refuse que le G20 empiète sur les sujets habituellement traités dans les instances onusiennes, comme le climat ; son ambassadeur, lorsque nous l’avons rencontré, a été catégorique à cet égard.
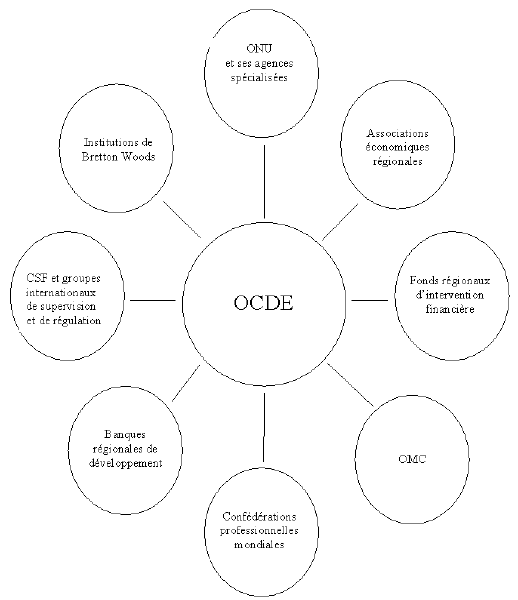
Pour éviter ce piège du « minilatéralisme »(193), le secrétariat permanent, s’il voit le jour, devra travailler en lien permanent avec la galaxie onusienne. De ce point de vue, l’expérience de 2011, qui a vu l’OCDE travailler dans des démarches inter-agences avec la FAO sur le dossier agricole et avec l’OIT sur la question du droit du travail, sera utile.
Les institutions à dominante financière que sont le FMI et le CSF continueront aussi de jouer un rôle particulier. Nous recommandons, rappelons-le, que le FMI se voie confier une mission de suivi et de coordination en matière d’équilibres macroéconomiques et de changes(194). Quant au CSF, l’OCDE siège déjà en son sein dans le collège de six organisations internationales.
Comme l’a dit Jean-Sébastien Conty, de la direction générale de la mondialisation du ministère des affaires étrangères et européennes, qui représentait la France, le 28 juin 2011, à un débat thématique sur la place des Nations unies dans la gouvernance mondiale qu’organisait un groupe de travail de l’AGNU :
« Le multilatéralisme se heurte à deux grands écueils :
« – celui du déficit de représentativité : le système international actuel ne reflète pas de façon adéquate les réalités du XXIe siècle ;
« – celui d’un manque d’efficacité : le système international devient de plus en plus complexe et peu cohérent, donnant souvent lieu à des doublons et à une fragmentation. Il devient illisible pour les citoyens. »
L’enjeu consiste à penser un secrétariat permanent qui puisse contourner ces deux écueils.
II. LA REPRESENTATION EUROPEENNE DANS LE G20
DOIT GAGNER EN CREDIBILITE ET EN FORCE DE PERSUASION
Avec la Commission européenne, le Conseil européen, quatre Etats membres – l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie –, la BCE et l’Espagne, invitée permanente, l’Europe de l’Ouest est la zone géographique la mieux représentée dans le G20. Mais en profite-t-elle réellement pour faire effet de masse ? L’UE s’organise-t-elle correctement pour peser dans le G20 ?
L’Europe est sans doute le continent qui a le plus intérêt à une action collective concertée, premièrement parce qu’il est le plus intégré dans la mondialisation, parce que c’est la principale puissance commerciale mondiale, deuxièmement parce qu’il a l’habitude de la concertation internationale, inscrite dans ses gênes, troisièmement parce qu’il se trouve actuellement à l’épicentre de la crise mondiale. L’expérience acquise en plus de soixante ans de construction européenne constitue effectivement un atout de poids pour évoluer avec aisance dans un cadre comme celui du G20.
Suivant la proposition de Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères, la France, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg fondent la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Le traité instituant cette organisation est signé à Paris le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 23 juillet 1952. C’est le début d’un long processus d’intégration.
Karoline Postel-Vinay, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, dresse un parallèle intéressant entre les prémices de la construction de l’Europe intégrée et du G20 : « Ces deux institutions, dans un premier temps, ont été définies par leur fonction – la gestion du charbon et de l’acier pour la première, la régulation financières pour la seconde – plutôt que par un schéma de distribution du pouvoir, pour déboucher sur une coopération plus générale et systématique. » Ce constat ne doit cependant pas conduire naïvement à croire que le G20 pourrait déboucher sur une organisation aussi intégrée politiquement que l’UE ; l’UE dans le G20, c’est un objet politique unique qui s’imbrique dans un autre objet politique unique.
Quoi qu’il en soit, l’UE, eu égard au savoir-faire qu’elle a acquis depuis plus de soixante ans en matière de négociations multilatérales, de recherche du consensus et d’organisation d’un marché intérieur, est vouée à jouer un rôle central dans le G20. Et cela devrait devenir plus vrai encore lorsque la gouvernance économique européenne aura été renforcée, au terme des travaux en cours dans ce domaine.
L’UE est rompue, notamment, aux processus décisionnels complexes nécessitant des démarches de concertation multiples – entre trois institutions communautaires, entre vingt-sept Etats membres, entre sept groupes politiques représentés au Parlement européens. Pour conserver sa cohésion interne, le principal, dans les négociations du G20, est que les Etats membres et les institutions européennes parviennent à préparer des positions communes en amont, ce qu’elles parviennent très bien à faire :
– avant chaque G20 finances, le Conseil « Ecofin » adopte des « termes de références »(195) débattus âprement et très détaillés, qui ont valeur de parole européenne officielle, préparés par le Comité économique et financier(196) et ses sous-groupes, dont l’un est présidé par le directeur général du trésor ;
– cette méthode, bien rodée, a été déclinée pour les nouvelles filières ministérielles ;
– une position commune synthétisée est insérée dans les conclusions des réunions du Conseil européen précédant chaque sommet du G20.
Pour ce qui concerne le G20 de 2011, l’UE a validé la quasi-totalité des propositions de l’agenda – bon nombre d’entre elles ont d’ailleurs déjà commencé à être mises en œuvre ou sont même déjà en vigueur depuis plus ou moins longtemps à l’échelle communautaire.
L’année 2011 restera dans les mémoires européennes comme un cap difficile. L’Union européenne doit la poursuite de son approfondissement à l’enracinement de ses institutions et à une culture commune : par-delà les conflits ponctuels, les citoyens des Etats membres sont majoritairement très attachés à l’UE, qu’ils considèrent comme un acquis, un bien commun. Il n’en demeure pas moins que ce contexte délicat ne facilite pas les concertations sereines entre partenaires européens ; la tâche de la présidence française s’en trouve compliquée.
1. Les Etats membres de l’Union européenne n’appartenant pas au G20 attendent davantage de concertation
Auditionné par notre Commission des affaires européennes le 27 septembre 2011, l’ambassadeur de Pologne à Paris, M. Tomasz Orlowski, a rappelé que le G20 est « une simple réunion de pays, à peu près représentatifs, qui prennent des engagements dans un certain nombre de domaines d’intérêt général, dans l’espoir que les autres Etats les suivront » et souligné la nécessité « que la présidence française du G20 puisse bénéficier d’un mandat des vingt-sept pays de l’Union pour s’exprimer en leur nom et ainsi peser davantage ».
Nous avions déjà été sensibilisés à cette problématique lors de notre rencontre avec M. Jacek Dominik, sous-secrétaire d’Etat au ministère des finances, qui nous avait tenu le discours de vérité suivant : « La Pologne fait probablement partie des pays membres dans lesquels le taux de soutien de la population à l’UE est le plus élevé ; au-delà des subsides qu’elle reçoit, elle approuve l’organisation de l’Union et les libertés quelle lui confère. Mais ce soutien commence à s’effriter si la société constate que les structures instituées par les traités sont piétinées, en passant par des structures où ne sont représentés que certains pays. Les Polonais sont capables d’accepter toutes les décisions, même les plus difficiles, à condition quelles soient élaborées collégialement, dans le cadre des procédures prévues. Quand il y a un doute, la nervosité s’installe, c’est sans doute lié à notre histoire. »
Pour éviter que cette UE à géométrie variable ne désespère ceux de ses Etats membres qui sont exclus du G20, il importe que les quatre autres Etats membres et les institutions européennes veillent à les consulter à chaque étape.
Les quatorze ou quinze pays concernés – selon que l’on compte ou non l’Espagne – sont parfois sensibles à des thèmes inscrits à l’ordre du jour et ressentent un décalage par rapport aux positions dominantes défendues par les membres « à double appartenance », parfois d’ailleurs pour de mauvais motifs, comme lors du sommet de Londres, lorsque fut abordé le sujet des paradis fiscaux.
L’UE, comme d’habitude, invente un peu en marchant, compte tenu du développement de l’importance croissante du G20, mais tout en respectant les principes énoncés dans la section précédente, sans oublier le débriefing en aval des sommets, qui a systématiquement lieu lors des Conseils européens et qui se généralisera sans doute aux conseils des ministres au fur et à mesure du développement des filières ministérielles.
La France a repris cette philosophie à son compte en affirmant qu’elle voulait faire de sa présidence du G8-G20 une « présidence européenne », avec le souci d’interagir avec les autres pays européens de ces groupes mais aussi avec tous les autres Etats membres de l’UE ainsi qu’avec les représentants des institutions communautaires.
Maintenir une concertation communautaire aussi poussée que possible, pour surmonter tous les désaccords internes et faire en sorte que les messages portés par les Européens siégeant au G20 reflètent pleinement les positions européennes.
La concertation est particulièrement importante lorsqu’un pays non membre du G20 exerce la présidence tournante de l’UE. Outre les échanges diplomatiques classiques(197), elle peut notamment passer par la désignation de diplomates et/ou de hauts fonctionnaires d’échange entre la présidence tournante et les quatre pays européens du G20.
Si ni l’Espagne, invitée permanente, ni les vingt-deux autres Etats membres ne doivent être négligés, la France a trois partenaires européens privilégiés dans le cadre du G20.
L’Allemagne, pays le plus peuplé de l’Union européenne, est également la puissance économique principale de l’Europe et occupe une place pivot, au cœur du vieux continent, entre l’Europe du Nord, l’Europe méridionale et l’Europe centrale et orientale. En 2011-2012, elle occupe un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.
Fin juin 2011, le FMI estimait que l’Allemagne devrait obtenir, cette année, le taux de croissance le plus élevé du G7, avec 3,2 %. En conséquence, les recettes budgétaires gonflent et le déficit fédéral baisse : il devrait atteindre 1,5 % du PIB, contre 4,3 % en 2010. Quant à celui finalement inscrit dans le projet de loi de finances pour 2012, il est légèrement inférieur au niveau prévu il y a un an – 27,2 milliards d’euros au lieu de 31,5 milliards. Et son déficit public, incluant les comptes de l’Etat fédéral, des Etats régionaux et des communes, a été ramené à 0,6 % au premier semestre 2011 – son plus bas niveau depuis le premier semestre 2008 –, contre 5,4 % au second semestre 2010. L’Allemagne reste donc, de loin, le « meilleur élève » de la zone euro et la locomotive économique de l’UE.
L’Allemagne demeure le partenaire le plus proche de la France et les deux pays savent nouer les alliances nécessaires et efficaces pour faire avancer des dossiers – les avancées récentes à propos de la taxe sur les transactions financières le démontrent encore – mais l’année 2011 a été marquée par trois sujets donnant matière à incompréhension.
Le second plan d’aide à la Grèce et l’extension des prérogatives du FESF – abondé à 27 % par l’Allemagne et à 20 % par la France – n’ont pas reçu le même accueil de part et d’autre du Rhin. Alors que les parlementaires français, réunis pour une première session extraordinaire d’automne début septembre 2011, en ont validé le principe et les modalités(198), la situation est plus complexe en Allemagne.
Un groupe de cinq universitaires eurosceptiques, soutenu par le député bavarois chrétien-social Peter Gauweiler, a déposé une plainte devant le Tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe pour violation de la loi fondamentale, arguant que l’UE serait devenue une « union de transferts » entre pays riches et pays pauvres, privant le Bundestag de sa compétence budgétaire, accélérant l’inflation et affectant le droit de propriété des citoyens.
Le 7 septembre 2011, le Tribunal constitutionnel fédéral rejetait cette plainte en jugeant légales les aides de Berlin pour aider la Grèce, mais en demandant, dans le même temps, le renforcement du rôle du parlement : « Il y a atteinte au suffrage universel quand le parlement se dessaisit de sa responsabilité en matière budgétaire d’une façon telle que lui ou le parlement suivant ne puisse plus exercer sa responsabilité en matière budgétaire. […] On ne peut justifier aucun mécanisme durable reposant sur un traité international s’il aboutit à ce qu’un Etat doive répondre de décisions prises par d’autres Etats, surtout quand elles ont des effets difficilement prévisibles. »
Or les dissensions politiques, sur ce sujet, sont très aigues, surtout au sein même des trois partis de la coalition majoritaire, les chrétiens démocrates, les chrétiens sociaux et les libéraux. Le vote du Bundestag, le 29 septembre 2011, était un rendez-vous à haut risque mais la chancelière Merkel est finalement parvenue à convaincre 315 députés de sa majorité de voter pour, soit la majorité absolue à eux seuls : elle n’a donc pas eu besoin des voix de l’opposition. Au total, 523 voix sur 620 se sont portées pour le plan de sauvetage de la Grèce et seulement 85 contre, ce qui constitue une très claire réaffirmation de l’attachement de l’Allemagne à la solidarité européenne.
Ce débat politique intense relaie le sentiment d’une frange importante, voire majoritaire, de l’opinion publique, réticente vis-à-vis du soutien financier aux pays en difficulté de la zone euro. Au point que le parti libéral-démocrate, traditionnellement très pro-européen, semble entreprendre un virage eurosceptique(199).
La crise financière et la récession qui s’en est suivie ont mis un terme à une période ininterrompue de quinze années de croissance, de progression de l’emploi et de stabilité des prix. Mais de sérieux déséquilibres étaient apparus : déficits publics et extérieurs, endettement excessif du secteur financier, prix des logements élevés, écarts de revenus de plus en plus creusés, faible épargne des ménages. Ces déséquilibres ont accentué le repli de l’activité au cours de la récession mondiale et ont contribué à une baisse plus prononcée du PIB, à un déficit budgétaire plus important et à une inflation plus forte que dans la plupart des autres pays de la zone OCDE.
L’Italie traverse une période difficile : son économie est plongée dans une forte récession, principalement due à la crise financière mondiale et à la grande incertitude quant à la vigueur de la reprise et au moment où elle interviendra. En dépit de son système bancaire relativement sain, l’Italie est sensible à la fois à la crise du crédit et à la faiblesse de la demande externe, d’autant plus que l’économie souterraine reste importante, que la productivité du pays est en déclin depuis plus d’une décennie et que sa situation budgétaire est délicate. Les députés ont approuvé le 14 septembre 2011, lors d’un vote de confiance, un plan d’austérité de 54,2 milliards d’euros, destiné à rétablir l’équilibre budgétaire en 2013 et à réduire l’endettement du pays ; toutefois, l’Italie est toujours considérée par les analystes économiques comme étant en deuxième ligne face aux attaques des marchés, derrière les pays faisant l’objet d’un plan de soutien international.
Malgré ces désaccords ponctuels, tous les Etats membres restent attachés à trouver des solutions pour améliorer l’efficacité de l’Europe dans les négociations internationales. Tout comme le pays qui exerce la présidence tournante du Conseil européen, celui à qui il incombe d’assumer la présidence du G20 doit s’efforcer de trouver le consensus. Mais l’exercice est rendu plus délicat compte tenu de la présence de pays extra-européens.
Il ne faut pas donner l’impression à ces derniers :
– que l’Europe est cacophonique, que les cinq ou six sièges européens se contredisent mutuellement ;
– que tous les Européens répètent les mêmes arguments, au risque d’apparaître comme étant surreprésentés ;
– que les représentants des institutions communautaires sont en demi-teinte par rapport aux représentants des Etats membres de l’UE.
L’avant-dernière ministérielle finances avant le sommet de Cannes, le 22 septembre 2011, a mis en évidence l’impuissance de l’UE et de la zone euro à solutionner le problème de la chute de l’euro et des marchés boursiers européens, avec l’envoi de cette lettre solennelle par six membres du G20 et surtout, alors que ce n’était pas prévu, avec la publication d’une déclaration conjointe des Vingt marquée par une tonalité très solidaire. Ils y affirment notamment qu’ils agissent « résolument pour maintenir la stabilité financière, restaurer la confiance et soutenir la croissance », qu’ils sont « déterminés à soutenir la croissance, mettre en œuvre des plans de consolidation budgétaire crédibles et assurer une croissance forte, durable et équilibrée », et qu’ils s’engagent « à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la stabilité des systèmes bancaires et des marchés financiers, en tant que de besoin ».
Ils concluent en rappelant qu’ils « examineront à [leur] prochaine réunion les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements » pris. Entre-temps, se sera tenu le Conseil européen des 17 et 18 octobre 2011, avec à l’ordre du jour la position de l’UE sur le G20. Un « plan d’action collective ambitieux, dans lequel chacun aura son rôle à jouer », devrait ensuite être conçu à Cannes ; il fait d’ores et déjà l’objet d’intenses discussions entre les sherpas et les équipes de fonctionnaires des administrations de la filière finances.
Après des votes favorables à la flexibilisation du FESF dans seize pays de l’eurozone sur dix-sept, la Slovaquie s’est prononcée en dernier : après un premier vote négatif du parlement slovaque le 11 octobre 2011, un accord entre le parti démocrate-chrétien, leader de la coalition gouvernementale, et l’opposition sociale-démocrate a permis, quarante-huit heures après, de dégager une majorité.
Pour renforcer la gouvernance économique de l’UE et répondre à l’insatisfaction de la communauté internationale, qui juge insuffisante la réaction des autorités européennes, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy présentera aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, à la mi-octobre, des propositions qu’il aura conçues en concertation avec le président de la Commission européenne et le président de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker.
De son côté, la majorité des parlementaires européens, d’esprit plus fédéraliste que le Conseil européen, s’oppose à cette logique intergouvernementale et préconise la constitution d’un véritable gouvernement économique pour l’eurozone, avec la nomination d’un « ministre européen des finances », choisi dans le collège des commissaires.
Poursuivre les efforts de l’UE et de la zone euro en vue d’accroître l’intégration économique et financière.
Convaincre les grandes puissances extra-européennes de s’associer avec détermination aux efforts de l’UE et de la zone euro en vue de restaurer la confiance des marchés.
En dépit de ses atouts, l’Europe, dans les négociations internationales, est un continent en position de faiblesse, parce qu’elle n’est pas animée par une logique de puissance et surtout parce que ce n’est pas un Etat mais une association d’Etat qui n’ont pas renoncé à leur souveraineté.
En 2050, le PIB chinois atteindra dix fois celui de l’Allemagne, de la France ou du Royaume-Uni ; mais, consolidé, le PIB européen représentera toujours 15 % de la création mondiale de richesses, face à la Chine et aux Etats-Unis, avec respectivement 25 % et 19 %. Les Européens garderont donc leur mot à dire dans les discussions économiques mondiales, mais à condition de s’exprimer de façon claire et coordonnée.
De ce point de vue, le sommet de Deauville du G8, marqué par une présidence française forte, n’a pas permis à l’UE de s’exprimer, les présidents Barroso et Van Rompuy sont restés très en retrait. L’impuissance politique de l’UE a été éclatante. Comment se comportera-t-elle, par quelle(s) voix s’exprimera-t-elle lorsqu’il lui incombera de prendre son tour de présidence du G20 ?
Une clarification du leadership entre institutions européennes s’impose. Le secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger ironisa, un jour, à propos de l’inexistence d’une autorité forte habilitée à parler au nom de l’UE, en s’interrogeant : « L’Europe ? Quel numéro de téléphone ? » Au G20 comme au G8, cette réalité apparaît en pleine lumière puisque l’UE est le seul membre à disposer de deux chaises autour de la table des négociations. Elle s’exprime donc selon le principe « deux chaises, une voix » :
– au G8, le chef de file est le représentant intergouvernemental, c’est-à-dire, en format sommet, le président du Conseil européen(200) ou, en format ministériel, le ministre des affaires étrangères du pays exerçant la présidence tournante du Conseil, assistés respectivement par le président de la Commission européenne et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ;
– au G20, le chef de file est le représentant communautaire, c’est-à-dire, en format sommet, le président de la Commission européenne(201) ou, en format ministériel, l’un de ses commissaires, assistés respectivement du président du Conseil européen et d’un ministre exerçant la présidence tournante du Conseil.
Car la présidence tournante, en dépit de la nouvelle organisation institutionnelle issue du traité de Lisbonne, joue encore un rôle au G20, même si, semestre après semestre, il s’avère de plus en plus faible. La Pologne, notamment, puissance moyenne non dépourvue d’ambitions internationales, veille scrupuleusement, durant sa présidence, à ne pas être marginalisée dans le processus décisionnel.
Les présidents Barroso et Van Rompuy n’ont d’autres choix que de faire au mieux avec cette organisation trop compliquée pour être optimale : avant le sommet de Séoul, ils ont cosigné une lettre explicative à destination des autres pays du G20 et cette initiative sera sans doute pérennisée. Malgré les dénégations des services de la Commission européenne comme du Conseil, qui s’efforcent de rassurer en prétendant que l’organisation actuelle fonctionne, nous sommes persuadés qu’elle est inadaptée pour donner un poids politique à l’UE dans les négociations, chacune des deux administrations cherchant naturellement à prendre le pas sur l’autre. L’équilibre institutionnel européen repose en définitive sur la façon dont ses deux dirigeants principaux prennent leurs marques l’un vis-à-vis de l’autre, en fonction de leurs personnalités ; il peut donc être bouleversé à chaque nouveau mandat.
Une clarification possible, acceptable pour les Etats membres – qui privilégient naturellement la logique intergouvernementale par rapport à la logique fédérative –, consisterait à investir le président du Conseil européen du primat sur les autres dirigeants européens ; il serait alors assisté par les services de la Commission européenne. Mais celle-ci est farouchement hostile à cette option ; elle met en avant, à juste titre, le passage des commissaires devant le Parlement européen, qui leur confère le statut d’autorité politique(202). Au demeurant, compte tenu des dossiers examinés au G20, le principal acteur est la Commission ; et même pour le G8, c’est en réalité elle qui apporte l’essentiel des expertises, car elle possède une administration nombreuse et solide techniquement.
A l’université Humboldt de Berlin, le 9 mai 2011, jour anniversaire de la déclaration dans laquelle Robert Schuman avait posé les bases de l’Europe politique, le commissaire Michel Barnier a publiquement défendu une idée en faveur de laquelle il s’était prononcé devant notre mission d’information : la constitution d’une « fédération des Etats nations » européens et la création d’un poste de président de l’Union européenne, cumulant « la mission de présider le Conseil européen et la fonction d’animer le collège des commissaires », précisant que « les rédacteurs du traité de Lisbonne ont pris soin de ne pas interdire cette avancée majeure et symbolique ».
Cette option était déjà défendue par Pierre Lequiller, président de la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, et plusieurs membres de la Convention sur l’avenir de l’Europe, chargée, en 2002 et 2003, de préparer le projet de Traité constitutionnel européen (TCE)(203).
Il s’agirait de tirer profit du TFUE – qui laisse en effet la porte ouverte à cette option – en reconnaissant le primat d’un pouvoir politique unifié, appuyée sur l’expertise technique de la Commission.
Fusionner, à terme, les fonctions de président de la Commission européenne et de président permanent du Conseil européen.
L’Initiative du Palais-Royal préconise la représentation au G20 par circonscriptions régionales, solution parfois avancée pour résoudre le conflit de représentativité entre dirigeants des institutions européennes d’une part, chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’autre.
L’Europe, d’un côté, serait avantagée par rapport aux autres grandes aires géographiques car son degré d’intégration est le plus élevé du monde, loin devant les autres associations régionales, notamment américaines et asiatiques. Mais, d’un autre côté, elle aurait à y perdre compte tenu du poids – un quart des sièges – qui est le sien au G20 dans sa configuration actuelle.
Au demeurant, l’UE pèche souvent par impuissance mais rarement par cacophonie. En effet, avant chaque échéance du G20, les Vingt-sept ont l’habitude de se concerter au sein des sommets de l’Eurogroupe, du Conseil européen, des Conseils « Ecofin » et des Conseils « Affaires générales », puis de défendre leurs termes de référence ou leur position commune. Les représentants de la Commission européenne et du Conseil européen comme les hauts fonctionnaires des différents Etats membres que nous avons rencontrés nous ont assuré qu’ils se concertaient systématiquement, pour que l’Europe ne donne pas le sentiment d’être divisée, pour veiller à ce que les désaccords éventuels n’apparaissent pas durant les réunions.
Cette filière de négociation bien rodée permet à l’UE de prendre des positions crédibles. Quand la Commission parle, elle s’exprime au nom des Vingt-sept, après quoi les Etats membres peuvent intervenir, généralement pour confirmer leur accord et apporter une précision, une nuance.
Le principe de réalité s’impose : force est de constater que les Etats, en Europe et sans doute moins encore ailleurs, sur des sujets aussi stratégiques que ceux traités au G20, ne sont pas prêts à se dépouiller de leurs prérogatives de souveraineté. Il n’en demeure pas moins que la piste de la représentation par circonscriptions régionales imaginée par le groupe du Palais-Royal ne doit pas être définitivement abandonnée, car cette formule serait de nature à mieux associer les pays laissés aujourd’hui aux marges de la diplomatie de club. L’appartenance de l’UE en tant que telle au G20 et l’entrée de l’UA et du NEPAD, que nous préconisons(204), vont dans le sens d’un croisement entre les deux logiques.
Maintenir, dans l’immédiat, une représentation nationale au sein du G20, de préférence à un système par circonscription régionale.
La Commission s’est réunie le 4 octobre 2011, sous la présidence de M. Pierre Lequiller, Président, pour examiner le présent rapport d’information.
« M. Michel Herbillon, co-rapporteur. Aux côtés des Nations unies, d’autres mécanismes de régulation s’avèrent nécessaires pour dénouer les crises ou, mieux, les prévenir. Tel est l’objectif du G20, projet de gouvernance économique multilatérale pour corriger les grands déséquilibres et gérer de façon coordonnée les fluctuations et asymétries de croissance.
La présidence du G20, qui échoit à la France depuis le 12 novembre 2010 et s’achèvera le 31 décembre 2011, se démultiplie en un foisonnement d’initiatives, avant le sixième sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, qui se tiendra à Cannes les 3 et 4 novembre 2011.
La Commission des affaires européennes nous a confié pour mission de suivre sa préparation. L’idée est d’analyser les enjeux et d’émettre des recommandations contribuant à améliorer le rôle joué par l’Union européenne dans le processus décisionnel, à travers ses quatre Etats membres participant aux travaux du G20 comme à travers ses instances propres.
La mission du G20 consiste à identifier et à gérer les risques systémiques, à donner des impulsions aux institutions de coopération et à assurer une répartition équitable des gains de la mondialisation. Mais le G20 est aussi un cercle au sein duquel s’expriment des rapports de force correspondant à la réalité géoéconomique à l’instant t.
Compte tenu de l’étendue des champs thématiques inscrits à l’agenda de la présidence française, nous avons choisi de nous concentrer sur l’aspect sans doute le plus crucial pour le devenir de l’économie mondialisée, la régulation des marchés, avec trois volets : la poursuite de l’encadrement des marchés et services financiers engagé depuis le premier sommet du G20 ; la réforme du système monétaire international, qui en est restée, jusqu’à présent, à ses balbutiements ; la lutte contre la volatilité des prix des matières premières agricoles, thème novateur sur la scène diplomatique internationale. Au fil de nos 175 auditions, il nous est aussi apparu incontournable de nous pencher sur le mode de gouvernance du G20.
Le G20 s’est imposé comme un lieu de dialogue essentiel dans la conduite des affaires économiques mondiales. Toutefois, pour devenir pleinement utile, il doit passer un nouveau stade et s’imposer comme lieu d’impulsion politique, capable de prescrire des solutions concertées.
La France a bien géré sa présidence, qui peut d’ores et déjà être considérée comme un triple succès : elle a profité de la capacité d’impulsion intéressante que lui conférait ce statut pour inscrire de nouveaux thèmes à l’ordre du jour ; elle a convaincu ses partenaires de l’opportunité de ces problématiques, en s’astreignant à une certaine neutralité pour ne pas donner l’impression de vouloir imposer des présupposés ; au fil du temps, elle a trouvé des consensus autour de « délivrables », c’est-à-dire de propositions susceptibles d’être soumises à l’approbation des chefs d’Etat et de gouvernement.
Faire peser des attentes excessives sur la présidence française causerait immanquablement des déceptions au lendemain du sommet de Cannes mais celui-ci devrait permettre d’accomplir un pas de plus vers un nouvel ordre multilatéral.
La crise de l’euro et de la gouvernance européenne sera sans aucun doute au cœur des discussions de Cannes car le monde entier, inquiet d’une possible contagion, est aujourd’hui préoccupé par l’instabilité qui règne sur notre continent. Cela dit, nul ne peut prévoir ce qui émergera des discussions, chaque sommet réunissant des dirigeants confrontés à des problématiques domestiques propres et se déroulant dans une configuration internationale particulière.
La Commission des affaires européennes est particulièrement qualifiée pour suivre le G20, en raison du poids de l’Europe dans l’économie mondiale, mais également parce que l’Union européenne est l’échelon politique auquel se prennent désormais la majeure partie des décisions de nature financière, commerciale et monétaire engageant les Vingt-sept.
Nous vous avons déjà adopté à l’unanimité, je vous le rappelle, un rapport d’étape, le 17 mai dernier, intitulé « L’Union européenne et le G20 : répondre aux enjeux de la mondialisation », dans lequel nous émettions des recommandations générales sur les grands axes de la présidence française.
L’engagement du Président de la République d’associer les parlementaires à la présidence française du G20 a été tenu : le pouvoir exécutif nous a informés du déroulement de la négociation, à chacune de ses étapes, même si les idées d’un « G20 des parlements » et d’une convocation du Parlement en Congrès, un temps envisagées, n’ont finalement pas pris corps cette année. Au demeurant, les 8, 9 et 10 septembre 2011, le président de l’Assemblée nationale a réuni une conférence des présidents du Parlement européen et des chambres basses des pays du G8, du Brésil et de l’Afrique du Sud.
Au fil de ces huit mois de travail, au-delà de nos convictions respectives, nous avons acquis la conviction que le G20, en dépit de ses limites, est devenu indispensable pour atténuer les dérèglements économiques mondiaux – à défaut de pouvoir les résorber complètement – et dissuader les comportements protectionnistes. Les positions se rapprochent au fil des ans, sous les effets contraignants de la mondialisation, mais aussi grâce à la lente édification d’une tradition de travail conjoint.
Tous les Etats ont conscience que l’isolement serait fatal à leur développement et cherchent pragmatiquement à inventer de nouvelles coopérations multipolaires pour lutter contre l’instabilité économique globale. Tel est l’esprit du G20 et plus généralement de la « diplomatie de club », qui suit un processus empirique et évolutif.
Chaque grande étape de l’essor de l’architecture de cette régulation mondiale a été suscitée par une crise, les grandes puissances prenant conscience que, dans une économie mondialisée, les réponses isolées sont inopérantes : l’invention du G6, en 1975, pour faire face à la fin du système de Bretton Woods et au premier choc pétrolier ; la création du G20 des ministres des finances, en 1999, après les crises de liquidités en Amérique latine et en Asie du Sud-Est ; le passage du G20 au niveau chefs d’Etat et de gouvernement, en 2008, après la crise bancaire mondiale, consécutive à l’effondrement des subprimes.
Le G20 prend de plus en plus d’importance dans la gouvernance mondiale car il procède d’un mouvement triple : une appropriation de sujets de plus en plus vastes, avec maintenant la réforme du SMI, le suivi des marchés agricoles ou encore le socle universel de droits sociaux ; un cercle de pays de plus en plus important, passant du G6 au G7, au G8, puis, révolution conceptuelle, au G20, qui intègre les puissances émergentes ; une prise en compte des problèmes au plus haut niveau, depuis sa mutation, en 2008, en sommet des chefs d’Etat et de gouvernement.
Les mécanismes de concertation autour du G20 sont de plus en plus poussés et sophistiqués, pour faire émerger des « délivrables » acceptés par tous et donc susceptibles d’être déclinés dans les législations partout dans le monde : concertation interne au G20, avec maintenant quatre filières ministérielles
– finances et développement depuis 1998, agriculture et emploi depuis cette année –, placées sous l’autorité des chefs d’Etat et de gouvernement, assistés par leurs sherpas ; concertation externe, dans une démarche inclusive vis-à-vis du reste du monde, avec les pays non membres du G20, leurs coalitions et les organisations internationales, qu’il s’agisse de l’Organisation des Nations unies (ONU), des institutions de Bretton Woods ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
M. Christophe Caresche, co-rapporteur. S’agissant de la gouvernance mondiale, la présidence française s’est efforcée de modifier le fonctionnement du G20. Les différents « G », jusqu’à présent, avaient été des réunions assez informelles, dans l’idée de se parler en dehors d’un cadre trop bureaucratique ou trop institutionnalisé, pour faire avancer les dossiers. Cette année, la France a évoqué un « G20 de construction », pour en faire une instance de régulation, avec l’ouverture de nombreux chantiers et un travail de préparation considérable. La proposition de création d’un secrétariat permanent va dans le sens de cette institutionnalisation.
Cette conception sera-t-elle partagée par nos partenaires ? Le G20 gardera-t-il sa forme classique ou prendra-t-il une forme préfigurant un gouvernement économique mondial ? C’est l’un des enjeux du G20 de 2011.
La lourde question du système monétaire international a été posée au sommet de Séoul, avec un conflit très fort entre la Chine et les Etats-Unis, le secrétaire au trésor américain ayant proposé d’encadrer les excédents et les déficits commerciaux nationaux dans une fourchette de plus ou moins 4 %. Il s’agissait d’avancer dans le sens du règlement des déséquilibres macroéconomiques. Mais la Chine a combattu très durement cette proposition car elle y a vu une volonté de limiter son expansion commerciale ; bien qu’étant consciente de la nécessité de stimuler sa demande intérieure, elle ne veut pas aller trop vite, afin de préserver ses capacités d’exportation.
La présidence française a remis la question à l’ordre du jour mais le débat reste difficile. Il est envisageable de progresser en élargissant au yuan le panier de monnaies des droits de tirage spéciaux (DTS), émis et gérés par le FMI, ce qui aurait deux conséquences : aboutir, à terme, à la convertibilité de la monnaie chinoise ; préfigurer une sorte de monnaie de référence.
Le chemin sera très long car les Etats-Unis n’ont pas intérêt à ce que le dollar soit réévalué et devraient poursuivre leur politique monétaire expansionniste. Quant à la Chine, elle veut maintenir le yuan au niveau le plus faible possible et par conséquent ne pas le rendre convertible trop vite.
La régulation financière est un autre sujet extrêmement important, qui a été ouvert lors des premiers sommets du G20, notamment sur la question des paradis fiscaux. Les deux zones géographiques les plus concernées sont les Etats-Unis et l’Europe.
Aux Etats-Unis, une volonté régulatrice très forte s’est exprimée à travers la loi Dodd-Frank, qui, en 2 300 pages, vise à encadrer les dérives du système financier et à protéger le consommateur, beaucoup d’Américains
– presque tous – étant présents sur les marchés financiers.
Mais une grande partie des propositions contenues dans ce texte requiert, de la part des régulateurs, des mesures d’application. Or celles-ci sont très longues à adopter et les régulateurs sont parfois tentés de revenir sur le texte initial. En outre, la situation politique a évolué et les républicains s’opposent à une régulation trop forte.
Par ailleurs, les Etats-Unis redoutent la concurrence : ils craignent que des transactions fuient et se réfugient en Europe, notamment au Royaume-Uni. Ils se montrent donc très attentifs à ce qui se fait chez nous, et par conséquent très attentistes : il se refusent à agir tant que l’Europe ne prend pas des mesures analogues aux leurs.
Du côté européen, nous rencontrons également des difficultés. La crainte de la concurrence américaine conduit à un dumping réglementaire – de fait, aux Etats-Unis, il arrive que soient prises des mesures manifestement destinées à affaiblir les banques européennes. L’Union européenne n’en a pas moins engagé plusieurs réformes en matière de régulation financière.
Sur un sujet particulier, le shadow banking – c’est-à-dire toutes les opérations opaques échappant aux régulateurs –, il semblerait que de nouvelles avancées puissent être obtenues cette année. L’objectif est d’amener ces transactions dans des chambres de compensation et de restaurer la transparence.
Pour ce qui nous concerne, nous émettons une série de propositions résolument régulatrices, allant de la séparation des activités de dépôt et des activités de trading à l’application des normes prudentielles de Bâle III, en passant par l’interdiction des credit default swaps (CDS) souverains ou la création d’une agence de notation européenne. Mais ne nous faisons pas trop d’illusions, le processus sera très long.
Enfin, le sujet de la crise économique va s’inviter au sommet et y sera central. La situation en Europe ne renforce pas la position de la présidence française. Il importe que les Européens déblaient certains sujets, notamment celui de la Grèce, afin de ne pas arriver à Cannes dans une situation de mis en accusés. La présence de Timothy Geithner à la réunion des ministres des finances de l’Eurogroupe montre combien certains pays ont intérêt à pointer du doigt la situation européenne pour que le G20 n’aille pas trop loin sur d’autres sujets.
M. Robert Lecou, co-rapporteur. L’agriculture mondiale souffre d’un défaut de gouvernance. Parvenir à inscrire au programme du G20 la volatilité des prix des matières premières agricoles constituait en soi un tour de force, tant les préventions initiales étaient grandes, surtout parmi les puissances émergentes, grosses exportatrices nettes.
La production agricole est la première activité mondiale. Plus de 40 % de la population active mondiale dépend directement des marchés agricoles et les produits de l’agriculture représentent 10 % du commerce mondial. Les pays du G20 détiennent 54 % des surfaces agricoles et 65 % et des terres arables. Ce sont en outre la sécurité alimentaire, la faim dans le monde et la stabilité politique qui sont en jeu : pour satisfaire les besoins mondiaux, il faudrait produire 70 % de plus, et par conséquent produire mieux.
Si la volatilité est d’abord imputable à des fondamentaux physiques – la démographie, la productivité, l’offre et la demande, les aléas climatiques –, elle résulte aussi de décisions politiques brutales, comme celle prise par la Russie l’an dernier.
Cette instabilité débouche sur une pression sociale et des émeutes de la faim, comme ce fut le cas dans une quarantaine de pays d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes à la suite de l’explosion des prix des produits de base en 2007 et 2008. Au début du printemps arabe, la goutte d’eau qui a fait déborder le verre fut la colère des classes populaires, privées de produits de première nécessité, et le ressentiment des classes moyennes, paupérisées par la hausse des prix agricoles.
La variation des prix se fait aussi parfois à la baisse, entraînant des perturbations aussi importantes du côté des producteurs, dont le travail perd parfois toute profitabilité raisonnable.
La polémique sur le dessein de la présidence française a fait long feu et elle a reçu de nombreux soutiens internationaux. Elle s’est notamment appuyée sur l’unanimisme européen – qu’il s’agisse du Conseil européen, du Parlement européen ou du Comité économique et social européen – et le travail de dix organisations internationales, autour de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’OCDE. Quant aux agriculteurs du monde, ils ont pris la parole dans le cadre d’un « G120 » organisé les 16 et 17 juin derniers par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), qui a réuni plus de 500 délégués.
Le volontarisme diplomatique de la présidence française a donc permis de faire tomber tous les obstacles initiaux pour tracer, dès le mois de juin, des perspectives inespérées.
La première étape, et non la moindre, a consisté à rassurer ceux de nos partenaires qui, jaloux de leur souveraineté agricole, s’opposaient à tout débat, notamment le Brésil, l’Argentine, le Canada et l’Australie. Ils ont compris que le projet français ne consistait pas en une régulation administrative des prix mais avait pour objectif de favoriser une coordination de la communauté internationale pour stabiliser le marché.
La réunion ministérielle des 22 et 23 juin derniers a ainsi pu déboucher sur des résultats et des orientations précises : stimuler les productions et rendements agricoles ; améliorer l’information des marchés pour les rendre plus transparents ; renforcer la coordination des politiques agricoles nationales ; réduire les effets de la volatilité des prix pour les plus vulnérables ; réformer le fonctionnement des marchés dérivés des matières premières pour lutter contre la spéculation ; prépositionner des stocks alimentaires d’urgence.
Le sommet n’aura plus qu’à entériner ces « délivrables » clé en main, unanimement validés par les ministres de l’agriculture et les organisations internationales. En outre, les orientations prises se sont déjà concrétisées en acte, avec l’installation du Système d’information sur les marchés agricoles, ou Agricultural Market Information System (AMIS), et du Forum de réaction rapide, les deux organes de collecte des données statistiques et de coordination politique créées en juin.
A ce jour, le volet de l’agenda de la présidence française qui a le plus surpris est certainement celui qui, avant le sommet de Cannes, est le plus avancé.
Il n’en demeure pas moins que le G20 se caractérise par une gouvernance molle et que l’application de ses décisions est toujours sujette à caution. Il convient donc de prévoir des clauses de rendez-vous pour sécuriser le programme adopté à la réunion des ministres de l’agriculture des 22 et 23 juin.
En outre, la réunion des ministres des finances de fin octobre et le sommet de Cannes devront s’atteler à la lutte contre les excès de la spéculation financière adossée aux marchés des produits agricoles.
Enfin, à Cannes, il serait utile que les chefs d’Etat et de gouvernement initient la même démarche coopérative, en vue des prochains sommets, pour réduire la volatilité des prix des différentes catégories de matières premières minérales.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Il s’agit de repenser la gouvernance du G20 car nous avons affaire à un système évoluant de plus en plus vers un gouvernement économique mondial. Dans leur rapport, les experts de l’« Initiative du Palais-Royal » réunis autour de M. Camdessus constataient l’« absence d’une gouvernance mondiale effective ». Le G20 s’étant « imposé de facto comme la principale instance de coopération économique et financière », ils préconisaient l’adoption d’une nouvelle gouvernance de ce groupe.
Deux questions se posent : que faire pour solidifier la gouvernance du G20 ? Comment doit-elle s’organiser dans le G20 ?
A l’heure actuelle, le secrétariat du G20, extrêmement léger, est assuré par le pays hôte, qui change d’un sommet à l’autre. Nous proposons que soit créé un vrai secrétariat permanent. Il ne s’agit pas de doter le G20 d’une couche administrative et bureaucratique mais, d’une part, de créer un lien, un continuum, entre présidences, et, d’autre part, de créer une sorte d’« autorité notariale » pour suivre l’application des décisions des prises. Le problème, actuellement, est que personne ne vérifie ni l’effectivité de leur mise en œuvre ni le respect des calendriers prévus.
Des pays sont moins rompus que les Etats-Unis ou que la France à l’exercice d’une présidence internationale et ne disposent pas forcément de la structuration administrative nécessaire ni d’habitudes de travail suffisantes avec les organisations internationales.
Cette idée n’est pas encore partagée par tous, loin s’en faut. Certains pays nous suivent, comme la Russie oui le Royaume-Uni – M. Cameron a d’ailleurs souhaité travailler sur la question. D’autres y sont beaucoup plus réticents, comme les Etats-Unis, la Chine, voire l’Allemagne.
Comment l’Europe peut-elle négocier ce virage ? Je rappelle qu’elle est bien représentée au G20 : par la Commission européenne, par quatre pays membres – l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie –, par l’Espagne, invitée permanente, et par la Banque centrale européenne. L’Initiative du Palais-Royal avait proposé que la représentation se fasse par circonscriptions régionales, de façon tournante. Certes, mais il serait difficile aux Etats actuellement membres d’abandonner le siège qu’ils occupent intuitu personae ; je ne vois pas comment la France l’accepterait, cela ne me semblerait pas raisonnable, surtout par ces temps de crise mondiale.
Mais l’Europe, en partant dispersée avec plusieurs sièges, risque de ne pas parler d’une même voix. Souvenons-nous de la phrase d’Henry Kissinger : « L’Europe ? Quel numéro de téléphone ? » C’est moins prégnant aujourd’hui mais il nous faut tout de même travailler la question. Une proposition, formulée par le Président Lequiller dans le cadre de la Convention sur l’avenir de l’Europe et reprise par Michel Barnier, nous semble séduisante : il s’agirait de fusionner la présidence du Conseil européen avec la présidence de la Commission européenne, afin de constituer un socle susceptible de recevoir une meilleure reconnaissance internationale.
Le Président Pierre Lequiller. Cette fusion des présidences est une idée que j’avais en effet soutenue lors de la Convention sur l’avenir de l’Europe et que j’ai développée dans un livre intitulé Un Président pour l’Europe. J’estimais en effet que la coexistence de deux présidents les placerait en situation de concurrence.
Au début de la Convention, cette idée ne bénéficiait pas d’un grand soutien. Malgré l’hostilité de Valéry Giscard d’Estaing, elle a peu à peu gagné les esprits, au point que la phrase prévoyant l’interdiction du cumul des fonctions, initialement prévue dans le projet de traité constitutionnel, en a finalement été retirée et n’a pas été rajoutée dans le traité de Lisbonne. La proposition que vous faites aujourd’hui n’aurait donc pas besoin d’une révision du traité.
Mais, en tout état de cause, elle ne pourra à mon sens ne se faire qu’à terme ; il convient de le préciser dans notre résolution.
M. Bernard Deflesselles, co-rapporteur. Nous proposons donc la constitution d’une structure de secrétariat permanent pour le G20, appuyée sur l’OCDE, organisme présentant cinquante ans d’expérience et réunissant trente-quatre pays et avec le FMI. Il serait chargé du suivi de décisions du G20, du lien entre les présidences et du soutien aux pays rencontrant des difficultés pour assurer leur présidence.
S’agissant de l’Union européenne, nous proposons le maintien du système de représentation nationale, plus réaliste, du moins en l’état actuel des choses, qu’un système par circonscriptions régionales, et la fusion, à terme, de la présidence de la Commission européenne et de la présidence permanente du Conseil européen, afin qu’une seule voix s’exprime.
M. Christophe Caresche, co-rapporteur. Dans la résolution, je souhaiterais que l’alinéa consacré à la question du trading à haute fréquence, c’est-à-dire les prises de position automatisées, soit un peu modifié. Dans la mesure où cette pratique, dans certains cas, peut être utile, je préconiserais non pas son « interdiction » mais son « encadrement effectif ». Dans certaines situations, elle peut en effet apporter des contreparties utiles.
Le Président Pierre Lequiller. Les réactions de nombreux acteurs des marchés sont prises par ordinateur, en réaction par exemple, aux décisions des agences de notation. Cette automaticité violente des prises de position a été l’une des causes de la crise.
M. Christophe Caresche, co-rapporteur. Le trading haute fréquence vise aussi à activer le marché.
Le Président Pierre Lequiller. Je remercie les rapporteurs pour la qualité de leur travail, sur un sujet fondamental. »
Puis la Commission a approuvé la proposition de résolution européenne dont le texte figure ci-après.
PROPOSITION DE RESOLUTION EUROPEENNE
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu les déclarations finales du sommet du G20 de Washington du 15 novembre 2008, du sommet du G20 de Londres du 3 avril 2009, du sommet du G20 de Pittsburgh du 25 septembre 2009, du sommet du G20 de Toronto du 27 juin 2010 et du sommet du G20 de Séoul du 12 novembre 2010,
Considérant que l’économie mondialisée requiert une régulation organisée au niveau planétaire ;
Considérant que les cinq premiers sommets du G20 n’ont abordé les questions relatives à la réforme du système monétaire international et à la résorption des déséquilibres macroéconomiques que superficiellement, que la première étape de cette réforme doit être accomplie dès le sommet de Cannes mais qu’elle ne saurait être finalisée avant plusieurs années ;
Considérant que la crise systémique dans laquelle l’économie mondiale est plongée prend des proportions de plus en plus alarmantes et que les orientations adoptées lors des cinq premiers sommets du G20 doivent être pleinement mises en œuvre et complétées dans les délais les plus brefs ;
Considérant que la sécurité alimentaire est un enjeu de premier ordre pour la stabilité mondiale et que la volatilité excessive des prix des matières premières agricoles provoque une incertitude insupportable tant pour les producteurs que pour les consommateurs, particulièrement dans les pays en voie de développement ;
Considérant que l’Union européenne, compte tenu de sa culture régulatrice, de la crise qui la frappe et de l’attribution de la présidence du G20 à l’un de ses Etats membres pour la première fois depuis 2009, est investie, cette année, d’une responsabilité particulière et doit, de ce fait, jouer un rôle d’initiative prépondérant ;
Considérant que la France, qui préside concomitamment le G20 et le G8 en 2011, bénéficie d’une opportunité exceptionnelle pour faire avancer la régulation mondiale ;
1. D’un point de vue général :
a) Prend acte des attentes placées dans le G20 pour prévenir la survenance de nouvelles crises systémiques ;
b) Salue l’engagement politique des grandes puissances mondiales au sein du G20, en particulier de l’Union européenne et de la France, pour prendre résolument en compte des problématiques économiques actuelles et s’efforcer d’apporter des solutions profitables à l’ensemble de la communauté internationale ;
c) Apporte son soutien aux priorités retenues par la présidence française du G20 ;
2. S’agissant des grands équilibres monétaires et macroéconomiques mondiaux :
a) Invite les Etats membres du G20 à adopter un plan d’action ambitieux destiné à corriger les déséquilibres macroéconomiques et à entraîner une croissance mondiale plus vigoureuse, plus stable et plus équilibrée ;
b) Suggère que les modalités de ce plan soient fixées dès l’ultime réunion du G20 finances, les 14 et 15 octobre 2011, afin que le sommet soit en mesure de se prononcer sur des propositions solides ;
c) Juge nécessaire la fixation de seuils d’alerte communs, notamment en matière de taux de change effectifs réels, de flux de capitaux et de balance des paiements, au-delà desquels des mesures volontaristes d’amortissement pourront être prises ;
d) Se prononce pour l’élaboration d’un code international de bonne conduite pour contrecarrer les tentations nationales non coopératives de manipulation du taux de change ou de fermeture des frontières ;
e) Propose que soit confiée aux organisations financières internationales la mission d’assurer une veille vis-à-vis de l’évolution de la liquidité mondiale ;
f) Appelle de ses vœux une coordination multilatérale des politiques monétaires ;
g) Souligne l’exigence de tisser des filets de sécurité financière, en passant d’une logique de prêts à une logique plus structurée de gestion des chocs systémiques mettant en réseau les dispositifs du FMI et les mécanismes de financement régionaux ;
h) Prône, d’une part, la diversification de la composition du panier des DTS en y incluant des devises de pays émergents et, d’autre part, l’accroissement de la part des DTS dans les réserves souveraines afin d’envisager, à un horizon plus lointain, l’émergence d’une unité monétaire de référence stable ;
i) Insiste sur la nécessité d’amener les pays émergents à renforcer progressivement la flexibilité de leurs taux de change et d’obtenir de leur part des engagements fermes quant à leur volonté de parvenir, à terme, à une convertibilité pleine et entière ;
j) Recommande à la communauté internationale de repositionner le mandat du FMI en renforçant son pouvoir de surveillance stratégique multilatérale ;
k) Préconise la suppression du droit de veto en vigueur au FMI, fixé à 15 % des quotes-parts, afin d’atténuer le caractère censitaire de son fonctionnement ;
3. S’agissant de la régulation des marchés et des produits bancaires et financiers :
a) Estime qu’il convient de renforcer la coopération transatlantique en matière de réglementation financière, afin de ne pas donner prise aux arbitrages réglementaires des agents économiques et de montrer la voie aux autres membres du G20 ;
b) Prie les Etats membres du G20 de poursuivre et d’achever les programmes législatifs nationaux entamés grâce aux précédents G20, notamment à travers l’agenda de la Commission européenne, pour ce qui concerne l’Union européenne, et le Dodd-Frank Act, pour ce qui concerne les Etats-Unis ;
c) Appelle à la création d’un observatoire international du risque systémique, couvrant l’ensemble des pays du G20 ;
d) Souhaite l’institution de stress tests communs, appliqués aux principaux établissements bancaires du G20, retenant des critères harmonisés suffisamment exigeants afin d’identifier les banques trop fragiles pour résister aux chocs ;
e) Conseille d’interdire ou de restreindre les opérations de gestion pour compte propre ou bien de séparer juridiquement et comptablement les activités de détail et d’investissement ;
f) Est favorable à l’application à la lettre de l’intégralité des modalités des accords de Bâle III, dans tous les pays du G20 ;
g) Soutient l’idée de l’interdiction d’acquérir à nu des CDS souverains ;
h) Considère que les rémunérations variables doivent être plus fermement encadrées, à travers des standards internationaux de plafonnement, à un niveau n’encourageant pas les prises de risques excessives ;
i) Emet le vœu que le G20 prenne date en faveur de la création d’une taxe universelle sur les transactions financières ;
j) Souligne que les acteurs économiques devraient être surveillés et régulés non pas selon leur statut juridique mais selon leur fonction dans le système financier, en incluant les banques, les compagnies d’assurance, les établissements de crédit et les fonds spéculatifs ;
k) Se déclare favorable à un encadrement effectif de la pratique du trading haute fréquence ;
l) Suggère que soit banni tout référencement des agences de notation dans les réglementations financières ;
m) Préconise que soient prohibées les notations souveraines pour les pays suivant un programme de soutien international ;
n) Appelle les autorités publiques à exiger des échelles de notation différentes pour les produits structurés et les instruments de dette simple ;
o) Invite l’Union européenne à créer une agence de notation européenne ;
4. S’agissant des marchés de matières premières agricoles :
a) Se félicite que la France soit parvenue à convaincre ses partenaires du G20 de la nécessité d’entreprendre une action conjointe pour réduire la volatilité des prix agricoles ;
b) Approuve les dispositions adoptées lors de la réunion des ministres de l’agriculture du G20 des 22 et 23 juin 2011 ;
c) Estime qu’il serait utile de prévoir des clauses de rendez-vous pour sécuriser le programme adopté par les ministres de l’agriculture ;
d) Recommande que toutes les transactions sur produits dérivés négociés de gré à gré soient enregistrées, transitent par des chambres de compensation et soient soumises à une autorité de marché ;
e) Propose que soient imposées des limites de position et des dépôts minimaux au prorata du montant des transactions ;
f) Souhaite que les pays du G20, à Cannes, initient la même démarche coopérative pour réduire la volatilité des prix des différentes catégories de matières premières minérales ;
5. S’agissant des modalités de la gouvernance mondiale :
a) Se déclare partisane de la création d’un secrétariat permanent, structure légère hébergée par les services de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), travaillant en étroite collaboration avec les autres organisations internationales ;
b) Est sensible à l’attente, exprimée par les Etats de l’Union européenne extérieurs au G20, d’une concertation communautaire aussi poussée que possible ;
c) S’associe à l’idée d’une fusion, à terme, des fonctions de président de la Commission européenne et de président permanent du Conseil européen ;
d) Juge réaliste que soit maintenu, dans l’immédiat, une représentation nationale au sein du G20, de préférence à un système par circonscriptions régionales ;
e) Préconise que l’Union africaine et le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique soient intégrés au G20 en tant que membres à part entière ;
6. En ce qui concerne la crise de la zone euro :
a) Encourage vivement l’Union européenne et la zone euro à poursuivre leurs efforts en vue d’accroître l’intégration économique et financière ;
b) Invite les institutions européennes à recourir à l’article 219, alinéas 1 et 2, du TFUE afin d’instituer une véritable politique de change au niveau de la zone euro, à travers notamment le renforcement de la gouvernance ;
c) Attire l’attention sur l’impérieuse nécessité que l’Union européenne convainque les grandes puissances extra-européennes de s’associer à ses efforts et à ceux de la zone euro en vue de restaurer la confiance des marchés.
ANTRAG AUF EINE EUROPÄISCHE ENTSCHLIESSUNG
Die Nationalversammlung,
unter Hinweis auf Artikel 88-4 der Verfassung;
unter Hinweis auf die Schlusserklärungen des G20-Gipfels von Washington am 15. November 2008, des G20-Gipfels von London am 3. April 2009, des G20-Gipfels von Pittsburgh am 25. September 2009, des G20-Gipfels von Toronto am 27. Juni 2010 und des G20-Gipfels von Seoul am 12. November 2010;
in der Erwägung, dass die globalisierte Wirtschaft einer weltweiten organisierten Regulierung bedarf;
in der Erwägung, dass auf den ersten fünf G20-Gipfeln die Fragen betreffend die Reform des internationalen Währungssystems und den Abbau der gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichte lediglich oberflächlich behandelt wurden, dass die erste Phase dieser Reform mit dem Gipfel in Cannes abgeschlossen sein muss, dass sie aber nicht vor mehreren Jahren vollendet sein kann;
in der Erwägung, dass die systemische Krise, in der sich die Weltwirtschaft derzeit befindet, zunehmend Besorgnis erregende Ausmaße erreicht und dass die auf den ersten fünf G20-Gpfeln angenommenen Leitlinien vollständig umgesetzt und möglichst rasch ergänzt werden müssen;
in der Erwägung, dass die Lebensmittelsicherheit für die weltweite Stabilität von zentraler Bedeutung ist und dass die übermäßige Volatilität der Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe eine unzumutbare Unsicherheit für die Erzeuger wie auch für die Verbraucher, insbesondere in den Entwicklungsländern, darstellt;
in der Erwägung, dass die Europäische Union in Anbetracht ihrer Regulierungskultur, der Krise, in der sie sich gegenwärtig befindet, und des Umstands, dass erstmals seit 2009 einem ihrer Mitgliedstaaten der G20-Vorsitz übertragen worden ist, dieses Jahr eine besondere Verantwortung übernommen hat und daher eine herausragende Initiativrolle spielen muss;
in der Erwägung, dass sich Frankreich, das 2011 gleichzeitig den Vorsitz der G20 und der G8 übernommen hat, eine außerordentliche Gelegenheit bietet, um die weltweite Regulierung voranzubringen;
1. Ganz allgemein:
a) nimmt die an die G20 geknüpften Erwartungen zur Kenntnis, um dem Aufkommen neuer systemischen Krisen entgegenzuwirken;
b) begrüßt das politische Engagement der weltweiten Großmächte innerhalb der G20, insbesondere der Europäischen Union und Frankreichs, um mit Entschlossenheit die derzeitigen wirtschaftlichen Problematiken zu berücksichtigen und sich darum zu bemühen, Lösungen zu finden, die der gesamten internationalen Gemeinschaft von Nutzen sind;
c) unterstützt die Prioritäten, die vom französischen G20-Vorsitz festgelegt worden sind;
2. In Bezug auf die großen weltweiten geldpolitischen und gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichte:
a) fordert die G20-Mitgliedstaaten auf, einen ehrgeizigen Aktionsplan anzunehmen, um die gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichte zu beseitigen und ein weltweit stärkeres, stabileres und ausgewogeneres Wachstum zu generieren;
b) schlägt vor, dass die Umsetzungsmodalitäten dieses Plans auf der letzten Sitzung der G20-Finanmisiter am 14. und 15. Oktober 2011 festgelegt werden, um den Gipfel in die Lage zu versetzen, Beschlüsse über solide Vorschläge zu ergreifen;
c) hält die Festsetzung gemeinsamer Warnschwellen hauptsächlich im Bereich der realen effektiven Wechselkurse, der Kapitalflüsse und der Zahlungsbilanz für erforderlich, oberhalb derer voluntaristische Tilgungsmaßnahmen ergriffen werden können;
d) befürwortet die Erarbeitung eines internationalen Verhaltenskodexes zur Bekämpfung der nationalen nicht kooperativen Versuche, die auf die Manipulation des Wechselkurses oder die Schließung von Grenzen ausgerichtet sind;
e) schlägt vor, dass die internationalen Finanzorganisationen mit der Überwachung der weltweiten Liquidität beauftragt werden;
f) spricht sich für eine multilaterale Koordinierung der Geldpolitiken aus;
g) unterstreicht das Erfordernis von finanziellen Sicherheitsnetzen, wobei von einer Logik der Darlehensvergabe zu einer strukturierteren Logik der Bewältigung systemsicher Schocks übergegangen werden muss, indem die IWF-Systeme und die regionalen Finanzierungsmechanismen miteinander verknüpft werden;
h) befürwortet zum einen die Diversifizierung des SZR-Korbs unter Einbeziehung der Währungen der Schwellenländer, sowie zum anderen die Erhöhung des Anteils der SZR an den staatlichen Reserven, um längerfristig die Entstehung einer stabilen Referenz-Währungseinheit ins Auge fassen zu können;
i) betont die Notwendigkeit, die Schwellenländer schrittweise zu einer verstärkten Flexibilisierung ihrer Wechselkurse zu bewegen und von ihnen feste Zusagen im Hinblick auf ihren Willen zu erhalten, damit im Laufe der Zeit eine vollständige Konvertibilität erreicht werden kann;
j) empfiehlt der internationalen Gemeinschaft, den Auftrag des IWF neu zu definieren, um dessen multilaterale strategische Überwachung zu stärken;
k) befürwortet, dass das im IWF geltende Vetorecht, das auf 15 % der Anteile festgesetzt ist, abgeschafft wird, damit er künftig nicht mehr über so viel Entscheidungsbefugnisse verfügt;
3. In Bezug auf die Regulierung der Märkte sowie der Bank- und Finanzprodukte:
a) vertritt die Auffassung, dass die transatlantische Zusammenarbeit im Bereich der Finanzregulierung gestärkt werden muss, damit die Wirtschaftsakteure nicht über die Regulierung bestimmen können und den anderen G20-Mitgliedern der Weg gewiesen werden kann;
b) ersucht die G20-Mitgliedstaaten, die nationalen Gesetzgebungsprogamme, die seit den letzten G20-Gipfeln in die Wege geleitet worden sind, weiterhin umzusetzen und vollzuenden, insbesondere im Rahmen der Agenda der Europäischen Kommission in Bezug auf die Europäische Union und den Dodd-Frank-Act, was die Vereinigten Staaten anbelangt;
c) fordert die Einrichtung einer internationalen Beobachtungsstelle für systemische Risiken, welche die gesamten G20-Länder abdeckt;
d) wünscht die Einführung gemeinsamer Stresstests für die wichtigsten Kreditinstitute der G20-Länder, wobei harmonisierte und ausreichend anspruchsvolle Kriterien festzusetzen sind, damit die allzu anfälligen Banken im Hinblick auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen Schocks identifiziert werden können;
e) empfiehlt, dass die Managementtransaktionen auf eigene Rechnung untersagt oder eingeschränkt werden oder dass die Einzelkundengeschäfte und die Investitionstätigkeiten rechtlich und buchhaltungstechnisch voneinander getrennt werden;
f) befürwortet die buchstabengetreue Umsetzung sämtlicher Modalitäten der Vereinbarungen von Basel III in sämtlichen G20-Ländern;
g) unterstützt den Vorschlag, staatliche Kreditausfallversicherungen (CDS) ohne Garantie zu erwerben;
h) hält es für erforderlich, dass die variablen Vergütungen mittels internationaler Obergrenzen strenger geregelt werden und eine Höhe nicht überschreiten, die die Übernahme allzu hoher Risiken fördert;
i) wünscht, dass sich die G20 für die Einführung einer allgemeinen Abgabe auf die Finanztransaktionen ausspricht;
j) betont, dass die Wirtschaftakteure überwacht und reglementiert werden müssten, nicht nur in Bezug auf ihren Rechtsstatus, sondern auch entsprechend ihrer Funktion im Finanzsystem, einschließlich der Banken, Versicherungsunternehmen, Kreditinstitute und Hedge-Fonds;
k) befürwortet eine effektive Regelung des Hochfrequenzhandels;
l) schlägt vor, dass jede Einstufung durch die Rating-Agenturen in den Vorschriften betreffend den Finanzsektor untersagt werden;
m) befürwortet, dass staatliche Einstufungen für Länder, die ein internationales Unterstützungsprogramm umsetzen, verboten werden;
n) fordert die öffentlichen Behörden auf, für die strukturierten Produkte und die einfachen Schuldenpapiere unterschiedliche Notierungen vorzuschreiben;
o) fordert die Europäische Union auf, eine europäische Rating-Agentur zu gründen;
4. In Bezug auf die landwirtschaftlichen Rohstoffe:
a) begrüßt es, dass Frankreich seine G20-Partner von der Notwendigkeit zu überzeugen vermochte, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um der Volatilität der Rohstoffpreise entgegenzuwirken;
b) billigt die auf dem Gipfel der G20-Landwirtschaftsminister am 22. und 23. Juni 2011 angenommenen Bestimmungen;
c) hält es für zweckdienlich, Überprüfungsklauseln vorzusehen, damit die Umsetzung des von den Landwirtschaftsministern angenommenen Programms gewährleistet wird;
d) empfiehlt, dass sämtliche Transaktionen mit Derivaten am OTC-Markt registriert, über Clearing-Stellen abgewickelt und der Kontrolle durch eine Marktbehörde unterzogen werden;
e) schlägt vor, Positionslimits und Mindesteinlagen anteilsmäßig zum Betrag der Transaktionen vorzuschreiben;
f) wünscht, dass die G20-Länder in Cannes den gleichen kooperativen Ansatz in die Wege leiten, um die Volatilität der Preise der verschiedenen mineralischen Rohstoffe zu verringern;
5. In Bezug auf die Modalitäten der globalen Ordnungspolitik:
a) befürwortet die Einrichtung eines ständigen Sekretariats, d. h. einer einfachen Struktur, die bei den Dienststellen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angesiedelt und mit den anderen internationalen Organisationen eng zusammenarbeiten würde;
b) versteht die Erwartung der Staaten der Europäischen Union, die nicht der G20 angehören, dass auf Gemeinschaftsebene eine möglichst umfassende Abstimmung vorgenommen wird;
c) befürwortet die Idee, im Laufe der Zeit die Ämter des Präsidenten der Europäischen Kommission und des Ständigen Präsidenten des Europäischen Rates miteinander zu verschmelzen;
d) erachtet es als realistisch, dass zurzeit eine nationale Vertretung innerhalb der G20 aufrechterhalten wird, und zwar vorzugsweise mittels eines Systems regionaler Gebiete;
e) spricht sich dafür aus, dass die Afrikanische Union und die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas als vollwertige Mitglieder in die G20 aufgenommen werden;
6. In Bezug auf die Krise des Euro-Raums:
a) ermuntert die Europäische Union und den Euro-Raum nachdrücklich, ihre Anstrengungen zur weiteren wirtschaftlichen und finanziellen Integration fortzusetzen;
b) ersucht die europäischen Institutionen, auf Artikel 219 Absätze 1 und 2 des AEUV zurückzugreifen, um eine wirkliche Wechselkurspolitik auf der Ebene des Euro-Raums sicherzustellen, insbesondere durch eine Stärkung der Ordnungspolitik;
c) weist auf die zwingende Notwendigkeit hin, dass die Europäische Union die großen außereuropäischen Partner davon überzeugt, sich an ihren Anstrengungen und an denjenigen des Euro-Raums zu beteiligen, damit das Vertrauen der Märkte wiedererlangt werden kann.
MOTION FOR A EUROPEAN RESOLUTION
The National Assembly,
In the light of Article 88-4 of the Constitution,
In the light of the final statements of the Washington G20 summit of 15 November 2008, the London G20 summit of 3 April 2009, the Pittsburgh G20 summit of 25 September 2009, the Toronto G20 summit of 27 June 2010 and the Seoul G20 summit of 12 November 2010,
Whereas the global economy requires regulation organised at the global level;
Whereas the first five G20 summits addressed only superficially the issues of reforming the international monetary system and unwinding macroeconomic imbalances, and as the first step of this reform must be accomplished as of the Cannes summit but cannot be completed before several years;
Whereas the systemic crisis in which the world economy is plunged is acquiring increasingly reaching proportions and as the guidelines adopted at the first five G20 summits must be fully implemented and completed as quickly as possible;
Whereas food security is a first-ranking challenge for world security and as excessive price volatility of agricultural commodities is causing unbearable uncertainty for producers and consumers alike, especially in developing countries;
Whereas the European Union, bearing in mind its regulatory culture, the crisis affecting it and the assignment of the G20 presidency to one of its Member States for the first time since 2009, shoulders special responsibility this year and must therefore play a preponderant initiative-taking role;
Whereas France, which is presiding concomitantly the G20 and the G8 in 2011, is afforded an exceptional opportunity to advance world regulation;
1. From a general point of view:
a) Takes note of the expectations placed in the G20 to prevent the occurrence of new systemic crises;
b) Welcomes the political commitment of the major world powers within the G20, especially the European Union and France, to take resolutely into account the current economic issues and strive to provide solutions profitable to the international community as a whole;
c) Provides its support for the priorities set by the French presidency of the G20;
2. Referring to the major world monetary and macroeconomic balances:
a) Invites the G20 member states to adopt an ambitious action plan to correct the macroeconomic imbalances and lead to stronger, more stable and more balanced world growth;
b) Suggests that the details of this plan should be set forth as of the last meeting of the Finance G20, on 14 and 15 October 2011, so that the summit is in a position to reach a decision on sound proposals;
c) Deems it necessary to lay down joint warning thresholds, in particular for real effective exchange rates, and for capital flows and balance of payments, beyond which proactive absorption measures can be taken;
d) Pronounces itself in favour of the elaboration of an international code of good conduct to thwart uncooperative national temptations to manipulate exchange rates or close borders;
e) Proposes that the task of monitoring the evolution of world liquidity should be entrusted to the international financial organisations;
f) Calls for multilateral coordination of monetary policies;
g) Emphasises the need to set in place financial safety nets, by passing from a logic of loans to a more structured logic of managing systemic shocks that networks IMF arrangements and regional funding mechanisms;
h) Advocates, on the one hand, a diversification of the composition of the SDR basket composition by including in it currencies from emerging countries and, on the other hand, an increase in the share of SDRs in sovereign reserves in order to envisage, in a more distant future, the emergence of a stable reference monetary unit;
i) Insists on the need to get emerging countries to progressively strengthen the flexibility of their exchange rates and obtain from them firm commitments as to their determination to reach, at a future date, full and unlimited convertibility;
j) Recommends to the international community to rethink the IMF’s mandate by strengthening its multilateral strategic supervision power;
k) Commends the suppression of the veto right in force at the IMF, set at 15% of the quota shares, so as to lessen the unfair nature of its operation;
3. Referring to the regulation of banking and financial markets and products:
a) Feels that transatlantic cooperation should be strengthened as regards financial regulation so as not to give rise to regulatory arbitrage by economic agents and show the way to other G20 members;
b) Requests the G20 member states to pursue and complete the national legislative programmes started thanks to the previous G20s, in particular via the European Commission agenda, as far as the European Union is concerned, and via the Dodd-Frank Act, as far as the United States is concerned;
c) Calls for the creation of an international systemic risk observatory covering the G20 countries as a whole;
d) Wishes the introduction of common stress tests, applied to the main banking establishments of the G20, based on sufficiently demanding harmonised criteria so as to identify banks too fragile to withstand shocks;
e) Advises banning or restricting own account trading operations or else a legal and accountancy-based separation of retail and investment business;
f) Favours application to the letter of the procedures of the Basel III Accords, in all G20 countries;
g) Supports the idea of barring the naked buying of sovereign CDS;
h) Considers that variable remunerations must be more firmly framed, through international capping standards, at a level that does not encourage excessive risk taking;
i) Expresses the wish that the G20 should set a date for the creation of a universal tax on financial transactions;
j) Emphasises that economic players should be supervised and regulated not according to their legal status but according to their function in the economic system, by including banks, insurance companies, credit establishments and speculative funds;
k) Declares itself in favour of an effective framing of high-frequency trading;
l) Suggests that any reference listing of credit rating agencies in financial regulations should be banned;
m) Recommends that sovereign ratings be banned for countries following an international support programme;
n) Calls on public authorities to demand different rating scales for structured products and simple debt instruments;
o) Invites the European Union to create a European credit rating agency;
4. Referring to agricultural commodity markets:
a) Welcomes the fact that France has managed to convince its G20 partners about the need to undertake joint action to reduce the volatility of agricultural prices;
b) Approves the provisions adopted at the G20 ministers for agriculture meeting on 22 and 23 June 2011;
c) Feels that it would be useful to provide for rendez-vous clauses to safeguard the programme adopted by the ministers for agriculture;
d) Recommends that all transactions in over-the-counter derivatives should be recorded, should transit through compensation chambers and should be submitted to a market authority;
e) Proposes that position limits and minimal deposits be set in proportion to the amount of transactions;
f) Wishes that, in Cannes, the G20 countries should commence the same cooperative approach to reduce the price volatility of the various categories of mineral raw materials;
5. Referring to the procedures of world governance:
a) Declares it is in favour of the creation of a standing secretariat, a light structure hosted by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), working in close cooperation with the other international organisations;
b) Is alive to the expectation, expressed by the European Union Member States outside the G20, for the most advanced possible community concertation;
c) Supports, in turn, the idea of a future merger between the duties of the president of the European Commission and those of the standing president of the European Council;
d) Deems it realistic to maintain, for the time being, a national representation at the G20, rather than a regional constituencies system;
e) Recommends that the African Union and the New Partnership for Africa’s Development should be integrated in the G20 as full members;
6. Referring to the euro zone crisis:
a) Strongly encourages the European Union and the euro zone to pursue their efforts to increase economic and financial integration;
b) Invites the European institutions to make use of Article 219, paragraphs 1 and 2, of the TFEU to set up a genuine exchange policy at the euro zone level, by strengthening governance in particular;
c) Draws attention to the absolute necessity for the European Union to convince major extra-European powers to join in with its efforts and those of the euro zone to restore market confidence.
PROPOSTE DI RISOLUZIONE EUROPEA
L’Assemblea Nazionale,
Visto l’articolo 88-4 della Costituzione,
Viste le dichiarazioni finali del vertice del G20 di Washington del 15 novembre 2008, del vertice del G20 di Londra del 3 aprile 2009, del vertice del G20 di Pittsburgh del 25 settembre 2009, del vertice del G20 di Toronto del 27 giugno 2010 e del vertice del G20 di Seoul del 12 novembre 2010,
Considerando che l’economia globalizzata richiede una regolazione organizzata a livello planetario;
Considerando che i cinque primi vertici del G20 hanno affrontato le questioni relative alla riforma del sistema monetario internazionale e al riassorbimento degli squilibri macroeconomici solo superficialmente, che la prima tappa di questa riforma deve essere compiuta non appena si terrà il vertice di Cannes ma che sarà finalizzata solo dopo alcuni anni;
Considerando che la crisi sistemica in cui si trova l’economia mondiale assume tinte sempre più allarmanti e che gli orientamenti approvati durante i primi cinque vertici del G20 devono essere pienamente attuati e completati in tempi brevi;
Considerando che la sicurezza alimentare è un interesse in gioco di primo ordine per la stabilità mondiale e che l’eccessiva volatilità dei prezzi delle materie prime agricole provoca un’incertezza insopportabile sia per i produttori che per i consumatori, particolarmente nei Paesi in via di sviluppo;
Considerando che l’Unione europea, data la sua cultura regolatrice, con la crisi in corso e l’attribuzione della Presidenza del G20 ad uno degli Stati membri per la prima volta dal 2009, deve, quest’anno, assumere, una responsabilità particolare e, di conseguenza, è chiamata a svolgere un ruolo d’iniziativa importante;
Considerando che la Francia, che nel 2011 presiede in concomitanza sia il G20 che il G8, si avvale di una eccezionale opportunità per mandare avanti la regolazione mondiale;
1. Da un punto di vista generale:
a) Prende atto delle aspettative in direzione del G20 per prevenire la sopravvenuta di nuove crisi sistemiche;
b) Si congratula con l’impegno politico delle grandi potenze mondiali all’interno del G20, in particolare dell’Unione europea e della Francia, per prendere in considerazione le problematiche economiche attuali e sforzarsi di fornire soluzioni utili per tutta la comunità internazionale;
c) Fornisce il proprio sostegno alle priorità scelte dalla Presidenza francese del G20;
2. In materia di grandi equilibri monetari e macroeconomici mondiali:
a) Invita gli Stati membri del G20 ad adottare un piano d’azione ambizioso destinato a correggere gli squilibri macroeconomici e a condurre ad una crescita mondiale più vigorosa, più stabile e più equilibrata;
b) Suggerisce che le modalità di questo piano vengano stabilite al momento dell’ultima riunione del G20 finanze, i 14 e 15 ottobre 2011, permettendo al Vertice di pronunciarsi sulla base di solide proposte;
c) Giudica necessario stabilire soglie d’allarme comuni, in particolare in materia di tassi di cambio effettivi reali, di flussi di capitali e di bilancia dei pagamenti, al di là dei quali potranno essere prese misure volontaristiche di ammortamento;
d) E’ a favore dell’elaborazione di un codice internazionale di buona condotta per controbilanciare eventuali tentazioni nazionali non cooperative nei riguardi del tasso di cambio o di chiusura delle frontiere;
e) Propone che il controllo della liquidità mondiale venga affidato alle organizzazioni finanziarie internazionali;
f) Esprime un forte auspicio riguardante la creazione di un coordinamento multilaterale delle politiche monetarie;
g) Sottolinea l’esigenza di tessere una rete di sicurezza finanziaria, oltrepassando la logica dei prestiti per arrivare ad una logica più strutturata di gestione degli choc sistemici mettendo in rete i dispositivi del FMI e i meccanismi di finanziamento regionali;
h) Incoraggia, da una parte, la diversificazione della composizione del paniere dei Diritti Speciali di Prelievo includendo le divise di paesi emergenti e, dall’altra, l’aumento dei DSP nelle riserve sovrane al fine di prevedere, in un futuro più lontano, la nascita di una stabile unità monetaria di riferimento;
i) Sottolinea la necessità di condurre i paesi emergenti a rafforzare progressivamente la flessibilità del loro tasso di cambio e di ottenere da parte loro un serio impegno in quanto alla loro volontà di arrivare, al termine, ad una piena ed intera convertibilità;
j) Raccomanda alla comunità internazionale di riposizionare il mandato del FMI rafforzando il suo potere di sorveglianza strategica multilaterale;
k) Preconizza la soppressione del diritto di veto in vigore al FMI, attualmente pari al 15 % delle quote di finanziamento, al fine di attenuare il carattere censitario dell’organizzazione;
3. In materia di regolazione dei mercati e di regolazione dei prodotti bancari e finanziari:
a) Reputa che sia utile rafforzare la cooperazione transatlantica in materia di regolamentazione finanziaria, al fine di evitare gli arbitraggi regolamentari degli agenti economici e di aprire il cammino per gli altri membri del G20;
b) Incoraggia gli Stati membri del G20 a continuare e a concludere i programmi legislativi nazionali già avviati grazie ai precedenti G20, in particolare attraverso l’agenda della Commissione europea, per quanto riguarda l’Unione europea e attraverso il Dodd-Frank Act, per quanto riguarda gli Stati Uniti;
c) Chiede la creazione di un osservatorio internazionale del rischio sistemico, che copra l’insieme dei paesi del G20;
d) Auspica l’istituzione di stress test comuni applicati ai principali istituti bancari del G20, scegliendo criteri armonizzati sufficientemente esigenti in modo da identificare le banche troppo fragili in caso di crisi;
e) Consiglia di vietare o di restringere le operazioni di gestione per conto proprio oppure di separare giuridicamente e contabilmente le attività di « retail » da quelle di investimento;
f) E’ favorevole all’applicazione alla lettera di tutte le modalità degli accordi di Basilea III, in tutti i paesi del G20;
g) E’ a favore dell’idea di vietare l’acquisto di CDS sovrani cosiddetti « nudi »;
h) Considera che le remunerazioni variabili devono essere inquadrate in modo più rigido, attraverso standard internazionali massimali costruiti in modo da non incoraggiare rischi eccessivi;
i) Esprime l’auspicio che il G20 annunci in un prossimo futuro la creazione di una tassa universale sulle transazioni finanziarie;
j) Sottolinea che gli operatori economici dovrebbero essere controllati e regolati non in base al loro statuto giuridico ma in base alla funzione che svolgono all’interno del sistema finanziario e questo includerebbe le banche, le compagnie assicurative, gli istituti di credito e i fondi speculativi;
k) Si dichiara favorevole ad un inquadramento effettivo del trading ad alta frequenza (HFT);
l) Suggerisce che venga vietato qualunque tipo di sistema di classifica da parte delle agenzie di rating nei riguardi delle regolamentazioni finanziarie;
m) Raccomanda di vietare le notazioni sovrane nei riguardi di quei Paesi che si avvalgono di un programma di sostegno internazionale;
n) Chiede alle autorità pubbliche di esigere scale di notazione diverse a seconda che si tratti di prodotti strutturati o di strumenti di debito semplice;
o) Invita l’Unione europea a creare un’agenzia di notazione europea;
4. In materia di materie prime agricole:
a) Si rallegra che la Francia sia riuscita a convincere i propri partner del G20 ad intraprendere un’azione congiunta per ridurre la volatilità dei prezzi agricoli;
b) Approva i provvedimenti approvati durante la riunione dei Ministri dell’agricoltura del G20 dei 22 e 23 giugno 2011;
c) Reputa che sarebbe utile prevedere clausole di rendez-vous per rafforzare gli impegni iscritti nel programma dai ministri dell’agricoltura;
d) Raccomanda che tutte le transazioni sui prodotti derivati negoziati di comune accordo siano registrati, transitino attraverso stanze di compensazione e vengano presentati ad un’autorità garante del mercato;
e) Propone che vengano imposti limiti di posizione e limiti di deposito minimo proporzionali all’ammontare delle transazioni;
f) Auspica che i Paesi del G20, a Cannes, continuino nello stesso approccio di collaborazione per ridurre la volatilità dei prezzi delle varie categorie di materie prime minerali;
5. In materia di modalità di governance mondiale:
a) Si dichiara a favore della creazione di un segretariato permanente, una struttura leggera che lavorerebbe all’interno dei servizi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in stretta collaborazione con le altre organizzazioni internazionali;
b) Presta attenzione alle aspettative espresse dagli Stati dell’Unione europea esterni al G20, a favore di una concertazione comunitaria più ampia possibile;
c) E’ a favore di riunire, in futuro, le funzioni di Presidente della Commissione europea con quelle di Presidente permanente del Consiglio europeo;
d) Reputa realistica la possibilità di mantenere, nell’immediato, una rappresentanza nazionale all’interno del G20, da preferire ad un sistema per circoscrizioni regionali;
e) Auspica che l’Unione africana e la Nuova partnership per lo sviluppo dell’Africa entrino a far parte del G20 in quanto membri di pieno diritto;
6. In materia di crisi della zona euro:
a) Incoraggia vivamente l’Unione europea e la zona euro a proseguire i sforzi necessari per accrescire l’integrazione economica e finanziaria;
b) Invita le istituzioni europee a ricorrere all’articolo 219, comma 1 e 2, del TFUE per istituire una vera politica di cambio a livello della zona euro, in particolare attraverso il rafforzamento della governance;
c) Esorta con vigore l’Unione europea a convincere le grandi potenze extra-europee ad associarsi ai propri sforzi e a quelli della zona euro per ripristinare la fiducia dei mercati.
Ø Produits, mécanismes, structures de marché et textes réglementaires relevant des questions financières :
Alternative Investment Fund Managers (AIFM) : Directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs.
Collateralized Debt Obligation (CDO) : Titres structurés complexes, « divisés en tranches » constituées en fonction du degré de risque.
Commodities : Matières premières.
Credit default swaps (CDS) : Contrat d’assurance contre le risque de défaillance.
Capital Requirement Directive (CRD I, CRD II, CRD III et CRD IV) : Quatre directives successives sur les exigences de fonds propres, dont la dernière est à l’état de projet.
Dark pools : Plateformes sur lesquels sont passés, de manière opaque, des ordres de bourse sur des blocs de titre.
Droits de tirage spéciaux (DTS) : Actif de réserve international émis par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres.
European Market Infrastructure Regulation (EMIR) : Projet de règlement européen sur les produits dérivés négociés de gré à gré.
Hedge funds : Fonds de couverture, qui se livrent à des placements de protection contre les fluctuations à la hausse ou à la baisse des marchés. Opaques et souvent implantés dans les paradis fiscaux, ils restent peu ou pas réglementés. Assis dans une large mesure sur des actifs non liquides ou complexes (produits dérivés, ventes à découvert) et bénéficiant d’un effet de levier élevé, ils s’avèrent beaucoup plus risqués que les fonds communs d’investissement destinés au grand public.
Flexible Credit Line (FCL) : Ligne de crédit flexible du FMI, destinée aux pays émergents qui s’illustrent par leur bonne gestion mais sont confrontés au resserrement mondial du crédit.
Global Systemically Important Banks (G-SIBs) : banques mondiales d’importance systémique)
Liquidity Coverage Ratio (LCR) : ratio de liquidité à court terme des normes prudentielles Bâle III.
Marchés réglementés : Se caractérisent par des opérations multilatérales sur des produits standardisés. En France, les principaux marchés réglementés de produits dérivés sont le MATIF et le MONEP.
Marchés de gré à gré ou over the counter (OTC) : Se caractérisent par des opérations bilatérales de gré à gré, selon des règles de fonctionnement fixées contractuellement par les parties.
Net Stable Funding Ratio (NSFR) : Ratio de liquidité à long terme des normes prudentielles Bâle III.
Precautionary Credit Line (PCL) : Ligne de crédit de précaution du FMI, destinée aux pays frappés par de violentes turbulences de marché.
Private equities : Fonds de capital investissement.
Produits dérivés : Outils financiers dont la valeur dépend du prix d’un autre actif, appelé « support sous-jacent », généralement un investissement au comptant (action, obligation, instrument monétaire, matière première ou indice), et fluctue avec lui. Conçus à l’origine, aux Etats-Unis, dans les années 1970, comme des instruments de couverture, les produits dérivés sont désormais utilisés pour prendre des positions spéculatives.
Quantitative easing : Politique monétaire d’assouplissement quantitatif.
Shadow banking : Système bancaire parallèle ou « finance de l’ombre ». Activités ou entités non bancaires d’intermédiation financière, exerçant des activités du même type que les banques mais échappant aux contrôles des autorités financières auxquels celles-ci sont soumises. Le shadow banking inclut les activités hors bilan des banques.
Short selling : Vente à découvert.
Stress test : Test de résistance.
Subprimes : Prêts hypothécaires à risque.
Too big to fail : Littéralement « trop gros pour faire faillite », se dit des établissements que les pouvoirs publics ne peuvent laisser tomber en état de banqueroute compte tenu de l’effet d’entraînement qu’ils ont sur l’ensemble de l’économie financière et réelle. Egalement appelés SIFIs, pour Systemically Important Financial Institutions (établissements financiers d’importance systémique).
Trading haute fréquence ou high speed trading : Echanges informatisés successifs quasi instantanés (prenant effet sous un délai parfois limité à quelques dizaines de microsecondes) en fonction de calculs algorithmiques opérés par des superordinateurs. Ils se font au détriment des petits porteurs, qualifiés d’« investisseurs lents ».
Vente à découvert : Consiste, pour une personne physique ou morale, à céder fictivement des actifs financiers – le plus souvent des actions – qu’elle ne possède pas puis à les racheter, afin de tirer profit d’un mouvement baissier. Il existe deux types de ventes à découvert : la vente à découvert couverte, lorsque le vendeur a emprunté l’actif en question ou au moins pris des dispositions en vue de l’emprunter ; la vente à découvert non couverte, ou a nu – la plus controversée –, lorsque le vendeur n’a pas emprunté l’actif ni même pris de dispositions en vue de l’emprunter.
Ø Organisations internationales, structures et organismes divers :
ABE : Autorité bancaire européenne (ou EBA, European Banking Authority)
ACAM : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM)
ACP : Autorité de contrôle prudentiel
AEAPP : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ou EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority)
AEMF : Autorité européenne des marchés financiers (ou ESMA, European Securities and Markets Authority)
AEN : Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
AGNU : Assemblée générale des Nations unies
AIE : Agence internationale de l’énergie
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
AISA : Association internationale des superviseurs des assurances (ou IAIS, International Association of Insurance Supervisors)
ALENA : Accord de libre-échange nord-américain
AMF : Autorité des marchés financiers
AMIS : Agricultural Market Information System (ou Système d’information sur les marchés agricoles)
ANC : Autorité des normes comptables
BAFIN : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BCBS : Basel Committee on Banking Supervision (ou Comité de Bâle de supervision bancaire)
BCE : Banque centrale européenne
BAD : Banque africaine de développement
BED : Banque eurasiatique de développement
BIT : Bureau international du travail
BM : Banque mondiale
BMENA : Broader Middle East and North Africa (ou GMOAN, Grand Moyen-Orient et Afrique du Nord)
BRI : Banque des règlements internationaux
BRICS : Brazil, Russia, India, China, South Africa (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
BSCI : Bureau des standards comptables internationaux (ou IASB, International Accounting Standards Board)
CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier
CCG : Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe
CAE : Conseil d’analyse économique
CEA : Comité des entreprises d’assurance
CECEI : Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
CERS : Comité européen du risque systémique (ou ESRB, European Systemic Risk Board)
CESE : Comité économique et social européen
CFTC : Commodity Futures Trading Commission
CIAB : Convention d’interdiction des armes biologiques et à toxines
CMFI : Comité monétaire et financier international
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
Convention commune : convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
CPC : Comité de politique commerciale de l’Union européenne
CPSS : Committee on Payment and Settlement Systems (ou Comité des systèmes de paiement et de règlement)
CRBC: China Banking Regulatory Commission
CRFRS : Conseil de la régulation financière et de risque systémique
CSN : convention sur la sûreté nucléaire
CSF : Conseil de stabilité financière (ou FSB, Financial Stability Board)
CSI : Confédération syndicale internationale
EEE : Espace économique européen
Eurostat : Office statistique de l’UE
FAO : Food and Agriculture Organization (ou OAA, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture)
FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation
Fed : Federal Reserve (ou Réserve fédérale)
FESF : Fonds européen de stabilité financière.
FIDA : Fonds international de développement agricole
FMI : Fonds monétaire international
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
FSA : Financial Services Authority
FSF : Forum de stabilité financière
FSOC : Financial Stability Oversight Council
GAFI : Groupe d’action financière (ou FATF, Financial Action Task Force)
GHOS : Governors and Heads of Supervision (groupe des gouverneurs de banque centrale et des chefs de supervision du Comité de Bâle)
GTHN-NU : Groupe de travail de haut niveau des Nations unies sur la crise alimentaire mondiale (ou UN-HLTF, United nations High Level Task Force on Global Food Security)
IBSA : India, Brazil, South Africa (Inde, Brésil, Afrique du Sud)
IFAC : International Federation of Accountants (ou Fédération internationale des comptables)
IIRPA : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (ou IFPRI, International Food Policy Research Institute)
IRIWI : International Research Initiative for Wheat Improvement (Initiative internationale de recherche pour l’amélioration du blé)
JODI : Joint Oil Data Initiative (ou Initiative pour des données communes sur le pétrole)
MAP : Millenium African Plan
MERCOSUR : Marché commun du Sud
MES : Mécanisme européen de stabilisation.
MESF : Mécanisme européen de stabilité financière.
NEPAD : New Partnership for Africa’s Development (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique)
OCC: Office of the Comptroller of the Currency
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OECE : Organisation européenne de coopération économique
OFR : Office for Financial Research
OICV : Organisation internationale des commissions de valeurs (ou IOSCO, International Organization of Securities Commissions)
OIF : Organisation internationale de la francophonie
OIT : Organisation internationale du travail
OMC : Organisation mondiale du commerce
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONU : Organisation des Nations unies
ONUDI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel
ONU Femmes : Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole
PAM : Programme alimentaire mondial
PDH : Processus de dialogue de Heiligendamm
PESF : Programme d’évaluation du secteur financier
PMG8 : Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
SEAE : Service européen d’action extérieure
SEC : Securities and Exchange Commission
UA : Union africaine
UE : Union européenne
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
USDA : United States Department of Agriculture
3G : Global Governance Group (Groupe de gouvernance mondiale ou G27)
ANNEXE 1 :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Les rapporteurs tiennent à témoigner leur gratitude à l’ensemble des personnalités françaises, européennes et étrangères avec lesquelles ils se sont entretenus dans le cadre de la préparation de ce rapport d’information.
1. Autorités publiques françaises
Ø Présidence de la République :
– M. Xavier Musca, secrétaire général, « sherpa » G20 ;
– M. Olivier Colom, conseiller chargé du G20-G8, des Nations unies, des négociations sur le climat, du développement et de la francophonie ;
– Mme Hélène Durand, conseillère technique chargée des affaires économiques.
Ø Premier ministre :
– M. Pierre-Christian Soccoja, secrétaire général adjoint de la présidence française du G20 et du G8
Ø Ministère des affaires étrangères et européennes :
– M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes ;
– M. Bernard Valero, porte-parole ;
– M. Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM), « sous-sherpa » G20-G8 ;
– M. Gérard Araud, représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations unies ;
– M. François Barry Delongchamps, ambassadeur à Varsovie ;
– M. François Delattre, ambassadeur à Washington ;
– M. Bernard Emié, ambassadeur à Londres ;
– M. Philippe Etienne, représentant permanent auprès de l’Union européenne ;
– M. Maurice Gourdault-Montagne, ambassadeur à Berlin ;
– M. Jean-Marc de La Sablière, ambassadeur à Rome ;
– Mme Bérengère Quincy, représentante permanente auprès des institutions des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ;
– M. René Roudaut, ambassadeur à Budapest ;
– M. Roland Galharague, directeur général adjoint des affaires politiques ;
– M. Cyrille Pierre, directeur adjoint de l’économie globale et des stratégies du développement ;
– M. Paul-Bertrand Barets, sous-directeur des affaires économiques internationales ;
– M. Julien Meimon, responsable du pôle partenariats pour le développement et financements innovants ;
– M. Matthieu Peyraud, chargé de mission G20-G8 ;
– M. Falilou Fall, responsable du pôle analyse économique de la mondialisation ;
– M. Jean-Christophe Thiabaud, conseiller presse à l’ambassade de France à Varsovie ;
– Mme Charlotte Montel, conseillère à la mission permanente auprès des Nations unies ;
– M. Xavier Chatel, premier secrétaire à Londres ;
– M. Pierre-Olivier Chotard, stagiaire ENA à l’ambassade à Rome.
Ø Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :
– M. François Baroin, ministre ;
– M. Ramon Fernandez, directeur général du trésor ;
– Mme Delphine d’Amarzit, chef du service des affaires multilatérales et du développement ;
– M. Jean-Claude Bernard, chef du service économique régional de Budapest ;
– M. Jean-François Boittin, chef du service économique régional de Washington ;
– M. Jean-Marie Demange, chef du service économique régional de Berlin ;
– M. Daniel Maître, chef du service économique régional de Varsovie ;
– M. Guillaume Chabert, chef de l’unité de coordination G20 ;
– M. Aymeric Ducrocq, administrateur suppléant pour la France au FMI ;
– M. Fabien Dell, adjoint au chef du service économique régional de Washington ;
– M. Olivier Jonglez, chef du bureau système financier international et préparation des sommets ;
– M. Yann Pouezat, conseiller financier au service économique régional de Londres ;
– Mme Marianne Thiery, conseillère financière au service économique régional de New York ;
– Mme Séverine Suster, adjointe économie et finances au service économique régional de Budapest ;
– M. Nicolas Cochez, attaché sectoriel au service économique régional de Rome ;
– M. Camille Leleu, équipe projet G20.
Ø Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire :
– M. Julien Steimer, directeur de cabinet adjoint ;
– M. Cyril Galy-Dejean, attaché parlementaire.
Ø Banque de France :
– M. Christian Noyer, gouverneur.
Ø Autorité des marchés financiers :
– M. Jean-Pierre Jouyet, président ;
– M. Thierry Francq, secrétaire général.
2. Union européenne
Ø Commission européenne :
– M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services ;
– M. Antonio José Cabral, conseiller et « sherpa » G20-G8 du président Barroso ;
– M. Olivier Guersent, chef de cabinet du commissaire européen chargé du marché intérieur et des services.
Ø Conseil européen :
– Mme Odile Renaud-Basso, chef de cabinet adjointe du président Van Rompuy.
Ø Parlement européen :
– Mme Pervenche Beres, députée européenne, membre de la commission des affaires économiques et monétaires, membre de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale (groupe PSE) ;
– M. Pascal Canfin, député européen, membre de la commission des affaires économiques et monétaires, vice-président de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale (groupe Verts-ALE) ;
– M. Jean-Paul Gauzes, député européen, membre de la commission des affaires économiques et monétaires, membre de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale (groupe PPE).
Ø Banque centrale européenne :
– M. Gilles Noblet, directeur général adjoint des relations internationales et européennes ;
– M. Gabriel Glöckler, adjoint au chef de la division des institutions européennes.
Ø Hongrie (présidence tournante de L’UE au premier semestre 2011) :
– Mme Enikö Gyori, secrétaire d’Etat aux affaires européennes ;
– M. Andras Karman, secrétaire d’Etat aux finances ;
– M. Richard Horcsik, député, président de la commission des affaires européennes de la Maison de la Nation (groupe Fidesz, droite) ;
– M. Matysa Firtl, député, vice-président de la commission des affaires européennes de la Maison de la Nation (groupe KDMP, chrétiens-démocrates) ;
– M. Lajos Mile, député, vice-président de la commission des affaires européennes de la Maison de la Nation (groupe LMP, verts libéraux) ;
– M. Istvan Jozsa, député, vice-président de la commission des affaires économiques et informatiques de la Maison de la Nation (groupe MSZP, sociaux-démocrates) ;
– M. Laszlo Koszorus, député, vice-président de la commission des affaires économiques et informatiques de la Maison de la Nation (groupe Fidesz) ;
– M. Tibor Bana, député, membre de la commission des affaires européennes de la Maison de la Nation (groupe Jobbik, extrême droite) ;
– M. Jozsef Ekes, député, membre de la commission des affaires européennes de la Maison de la Nation (groupe Fidesz).
Ø Pologne (présidence tournante de L’UE au second semestre 2011) :
– M. Jacek Dominik, sous-secrétaire d’Etat au ministère des finances ;
– M. Marcin Korolec, sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’économie ;
– M. Pawel Arndt, député, président de la commission des finances de la Diète (groupe PO, droite libérale) ;
– M. Stanislaw Rakoczy, député, président de la commission des affaires européennes de la Diète (groupe PSL, agrariens) ;
– M. Janusz Rachon, sénateur, vice-président de la commission des affaires européennes du Sénat (groupe PO) ;
– Mme Katarzyna Kacperczyk, directrice adjointe au département politique économique du ministère des affaires étrangères ;
– Mme Eliza Konczyk, conseillère au département politique économique du ministère des affaires étrangères ;
– M. Alexandre Rogalski, conseiller du secrétaire d’Etat aux affaires européennes ;
– M. Andrzej Raczko, membre du directoire de la Banque nationale de Pologne ;
– Mme Agata Lagowska, directrice du département international de la Banque nationale de Pologne ;
– M. Pawel Samecki, conseiller du président de la Banque nationale de Pologne.
Ø Allemagne (membre du G20) :
– Mme Antje Tillmann, députée, vice-présidente de la Commission des finances du Bundestag (groupe CDU-CSU, démocrates-chrétiens) :
– M. Klaus Hagemann, député, président du sous-comité des affaires de l’Union européenne de la commission du budget du Bundestag (groupe SPD, sociaux-démocrates) ;
– M. Diether Dehm, député, membre de la commission des affaires de l’Union européenne du Bundestag (groupe Die Linke, gauche) ;
– Mme Bettina Kudla, députée, membre de la commission des affaires de l’Union européenne et de la commission des finances du Bundestag (groupe CDU-CSU) ;
– M. Richard Pitterle, député, membre de la commission des finances du Bundestag (groupe Die Linke) ;
– M. Axel Schafer, député, membre de la commission des affaires de l’Union européenne du Bundestag (groupe SPD) ;
– M. Gerhard Schick, député, membre de la commission des finances du Bundestag (groupe Bündnis 90–Die Grünen, verts) ;
– M. Martin Schwanholz, député, membre de la commission des affaires de l’Union européenne du Bundestag (groupe SPD) ;
– M. Alexander Ulrich, député, membre de la commission des affaires de l’Union européenne du Bundestag (groupe Die Linke) ;
– M. Viktor Elbling, directeur général des affaires économiques et du développement durable à l’office des affaires étrangères ;
– M. Markus Kerber, directeur général des questions économiques et financières au ministère fédéral des finances ;
– M. Holger Fabig, chef de la division G20 et marchés émergents au ministère fédéral des finances ;
– M. Markus Neimke, adjoint au chef de la division G20 et marchés émergents au ministère fédéral des finances ;
– M. Claus Tigges, directeur de la représentation de la Bundesbank à Berlin.
Ø Royaume-Uni (membre du G20) :
– M. Harold Freeman, directeur adjoint chargé des questions internationales et européennes au Cabinet Office ;
– M. Mark Kent, « sous-sherpa » G20-G8 au Cabinet Office ;
– M. Ben Lyon, adjoint au chef du département diplomatie commerciale et économique au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth ;
– Mme Tiiu Morris, équipe G20-G8 du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth ;
– Mme Vanessa MacDougall, directrice adjointe coordination et stratégie mondiales au trésor de Sa Majesté ;
– Mme Lindsey Whyte, directrice adjointe économie mondiale au trésor de Sa Majesté ;
– Mme Ashleigh Brigden, équipe coordination et stratégie mondiales au trésor de Sa Majesté ;
– Mme Katie Fisher, équipe stratégie des services financiers au trésor de Sa Majesté ;
– Mme Natasha Hughes, équipe coordination et stratégie mondiales au trésor de Sa Majesté ;
– M. John O’Regan, équipe stratégie des services financiers au trésor de Sa Majesté ;
– M. Martin Brooke, chef de la division finance internationale à la Banque d’Angleterre.
Ø Italie (membre du G20) :
– M. Mario Pescante, député, président de la commission des politiques de l’Union européenne de la Chambre des députés (groupe Popolo della Liberta, conservateurs) ;
– M. Lino Duilio, député, membre de la commission du budget, du trésor et de la programmation de la Chambre des députés (groupe Partito Democratico, centre-gauche) ;
– M. Nicola Formichella, député, membre de la commission des politiques de l’Union européenne de la Chambre des députés (groupe Popolo della Liberta) ;
– M. Sandro Gozi, député, membre de la commission des politiques de l’Union européenne de la Chambre des députés (groupe Partito Democratico) ;
– M. Marco Maggioni, député, membre de la commission des politiques de l’Union européenne de la Chambre des députés (groupe Lega Nord Padania, droite régionaliste) ;
– M. Massimiliano Mazzanti, « sous-sherpa » G8-G20 à la présidence du conseil des ministres ;
– M. Marco Canaparo, conseiller pour l’Union européenne à la présidence du conseil des ministres ;
– M. Lorenzo Codogno, chef économiste du département du trésor et directeur général de l’analyse économico-financière au ministère de l’économie et des finances ;
– M. Alessandro Rivera, directeur général du système bancaire et financier au ministère de l’économie et des finances ;
– M. Alessandro Busacca, directeur général adjoint à la direction centrale pour les questions mondiales et pour les processus du G8 et du G20 ;
– M. Filippo Giansante, chef du bureau des relations financières internationales au ministère de l’économie et des finances ;
– M. Giuseppe Forese, chef du bureau réglementation bancaire nationale et communautaire au ministère de l’économie et des finances ;
– M. Ignazio Visco, directeur général adjoint de la Banque d’Italie.
3. Etats extra-européens
Ø Brésil :
– M. José Mauricio Bustani, ambassadeur à Paris ;
– M. Démétrio Bueno Carvalho, ministre conseiller ;
– M. Bruno Luiz dos Santos Cobuccio, conseiller économique chargé des affaires bilatérales et multilatérales ;
– Mme Claudia Vieira Santos, conseillère économique chargée de l’énergie et de l’agriculture.
Ø Chine :
– M. Quan Kong, ambassadeur à Paris ;
– M. Jing Zhu, conseiller de l’ambassadeur.
Ø Etats-Unis :
– M. John Campbell, membre de la commission du budget et de la commission des services financiers (groupe Républicain, conservateurs) ;
– Mme Kathleen Casey, commissaire à la Securities and Exchange Commission (SEC) ;
– Mme Brooksley Born, ancienne présidente de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Ø Inde :
– M. Alok Sheel, secrétaire adjoint au département des affaires économiques du ministère des finances et « sous-sherpa » G20.
Ø Japon :
– M. Ikuo Yamahana, vice-ministre parlementaire des affaires étrangères ;
– M. Hideichi Okada, vice-ministre des affaires internationales au ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie ;
– M. Masanori Yoshida, directeur de la division des organisations internationales et « sous-sherpa » G20 au ministère des finances.
Ø Russie :
– M. Alexandre Orlov, ambassadeur à Paris ;
– M. Igor Noskov, conseiller financier de l’ambassade.
4. Institutions internationales
Ø Banque mondiale :
– Mme Caroline D. Anstey, vice-présidente chargée des affaires extérieures et « sherpa » G20 ;
– M. Jeff Chelsky, chef économiste du groupe politique internationale et partenariats.
Ø Fonds monétaire international :
– M. Olivier Blanchard, chef économiste et directeur du département des études ;
– Mme Isabelle Mateos y Lago, conseillère en chef au département de la stratégie.
Ø Organisation pour l’alimentation et l’agriculture :
– M. Hafez Ghanem, directeur général adjoint du département développement économique et social ;
– M. David Hallam, directeur de la division du commerce et des marchés ;
– M. Abdolreza Abbassian, secrétaire du groupe intergouvernemental sur les céréales.
Ø Organisation de coopération et de développement économiques :
– M. Jonathan Coppel, conseiller économique du secrétaire général ;
– Mme Carmel Cahill, économiste agricole, conseillère principale à la direction des échanges et de l’agriculture ;
– M. Pierre Poret, conseiller à la direction des affaires financières et des entreprises.
5. Experts, économistes, universitaires, socioprofessionnels, lobbyistes
– M. Giovanni Ajassa, chef économiste de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) ;
– M. Andreas Bley, directeur du service économie politique et politique des PME-PMI à la Bundesverband des Deutschen Volksbanken und Raifeisenbanken (BVR, Fédération des banques populaires et mutualistes allemandes) :
– M. François Bourguignon, directeur de l’Ecole d’économie de Paris (EEP), directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ancien premier vice-président de la Banque mondiale ;
– M. Lars Brozus, géopolitologue à la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP, Fondation science et politique) ;
– M. Mark Calabria, directeur des études sur la régulation financière au Cato Institute de Washington ;
– M. Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, gouverneur honoraire de la Banque de France, co-auteur du rapport du groupe d’experts internationaux « Initiative du Palais-Royal : la réforme du système monétaire international, une approche coopérative pour le XXIe siècle » ;
– M. Jean-Paul Caudal, directeur du département supervision bancaire et comptable de la Fédération bancaire française (FBF) ;
– M. Robert Colby, cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell LLP, Washington ;
– M. Rama Cont, mathématicien, directeur de recherche au CNRS, directeur du Center for Financial Engineering de l’université Columbia de New York ;
– M. Heribert Dieter, économiste à la SWP ;
– Mme Susanne Droge, chef de la division de recherche « questions mondiales » à la SWP ;
– M. Michael Engelhard, chargé de mission pour la supervision bancaire à la Deutsche Sparkassen und Giroverband (DSGV, Association des caisses d’épargne et des banques régionales allemandes) ;
– M. Jeffrey Eubank, premier vice-président de NYSE Euronext ;
– M. Michael Greenberger, professeur à l’Université du Maryland, ancien directeur de la division commerce et marchés de la CFTC ;
– M. Christophe Jaffrelot, directeur de recherche ; au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
– M. Lutz Johanning, professeur à l’Ecole de gestion Otto Beisheim de Coblence ;
– M. Peter Konesny, chef du bureau politique des caisses d’épargne et de la supervision bancaire de la DSGV ;
– M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué de la FBF ;
– M. Lawrence Leibowitz, directeur des opérations de NYSE Euronext ;
– Mme Stormy-Annika Mildner, membre du directoire de la SWP ;
– Mme Sarah Miller, présidente de l’Institute of International Bankers (IIB) ;
– Mme Annette Nazareth, cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell LLP ;
– M. Thierry Philipponnat, secrétaire général de Finance Watch ;
– M. Jean Pisani-Ferry, directeur de BRUEGEL (Brussels European and Global Economic Laboratory), professeur associé à l’Université de Paris-Dauphine, membre du Conseil d’analyse économique (CAE) du Premier ministre ;
– Mme Karoline Postel-Vinay, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) de Sciences Po ;
– M. Thorsten Reinicke, chargé de mission pour les affaires juridiques à la BVR ;
– M. Daniele Rossi, directeur de la Fédération italienne de l’industrie alimentaire (Federalimentare) ;
– Mme Bettina Rudloff, économiste à la SWP ;
– M. Phillip Swagel, professeur d’économie internationale à l’université de Maryland, ancien chef économiste du secrétaire au trésor ;
– M. Yves Tiberghien, professeur associé en économie politique à l’Université de Colombie britannique, chercheur associé au Centre d’études européennes de Sciences Po et à Asia Centre ;
– M. Simon Tilford, chef économiste du Centre for European Reform (CER, Centre pour la réforme européennes) ;
– M. John Tuttle, directeur principal de NYSE Euronext, chargé des affaires mondiales et des relations institutionnelles ;
– M. Christian Vollmuth, responsable du département juridique de la Deutscher Derivate Verband (DDV, Fédération allemande des dérivés) ;
– Mme Anja Weinmann, chargée de mission pour les relations avec le Parlement et la politique européenne à la BVR ;
– Mme Kirsten Westphal, économiste à la SWP ;
– M. Philip Whyte, directeur de recherche au CER.
ANNEXE 2 :
LE CONSEIL DE STABILITE FINANCIERE (CSF)
Présentation
Le Conseil de stabilité financière (CSF) coordonne le travail des autorités financières nationales et des organismes internationaux chargés de définir des normes financières, et de développer et promouvoir la mise en œuvre de politiques de régulation et de supervision efficaces. Il rassemble les autorités nationales responsables de la stabilité financière des centres financiers internationaux significatifs, les institutions financières internationales, les groupes internationaux sectoriels de superviseurs et de régulateurs, et les comités d’experts des banques centrales.
Le CSF est présidé par M. Mario Draghi, gouverneur de la Banque d’Italie. Son secrétariat se trouve à Bâle, en Suisse, au siège de la Banque des règlements internationaux (BRI).
Mandat
Le CSF a pour mandat :
– d’évaluer les vulnérabilités affectant le système financier, puis d’identifier et de superviser les actions requises pour y remédier ;
– de promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les autorités responsables de la stabilité financière ;
– de surveiller les développements des marchés et leurs implications pour la régulation, puis d’émettre des recommandations ;
– d’entreprendre des examens stratégiques communs des normes développées par les organismes internationaux afin de s’assurer qu’ils travaillent de concert, se concentrent sur les priorités et répondent aux lacunes ;
– de soutenir la création d’organisations de supervision et d’établir des lignes directrices à cette fin ;
– de superviser la mise au point de plans d’urgence pour la gestion de crises transfrontalières, en particulier en ce qui concerne les sociétés systémiquement importantes ;
– de collaborer avec le Fonds monétaire international (FMI) pour conduire des exercices d’alerte avancée.
Les membres du CSF s’engagent à rechercher le maintien de la stabilité financière, à préserver l’ouverture et la transparence du secteur financier, à appliquer les normes financières internationales (y compris les douze codes et normes internationaux clés) et acceptent de se soumettre à des examens périodiques par leurs pairs, en utilisant notamment les rapports du FMI et de la Banque mondiale sur le Programme d’évaluation du secteur financier (PESF).
Le CSF, à travers ses membres, cherche à donner de l’élan à un agenda multilatéral large pour le renforcement des systèmes financiers et la stabilité des marchés financiers internationaux. Les changements nécessaires sont mis en place par les autorités financières nationales concernées.
L’assemblée plénière du CSF se réunit deux fois par an. Afin d’élargir le cercle des pays travaillant à la promotion de la stabilité financière internationale, le CSF tient également des réunions régionales de sensibilisation (regional outreach meetings) avec des autorités financières non-membres.
Historique
Le CSF a succédé en avril 2009 au Forum de stabilité financière (FSF).
Le FSF avait été créé en 1999 par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G7, suivant les recommandations de M. Hans Tietmeyer, président de la Deutsche Bundesbank, qu’ils avaient chargé de formuler des recommandations pour améliorer la coopération entre les différents organismes de supervision nationaux et internationaux et les institutions financières internationales, afin de favoriser la stabilité du système financier. Les ministres et gouverneurs du G7 ont approuvé la création du FSF, à Bonn, en février 1999.
Le FSF rassemblait :
– les autorités nationales responsables de la stabilité financière des centres financiers internationaux significatifs ;
– les groupes internationaux sectoriels de superviseurs et de régulateurs travaillant au développement de normes et chartes de bonne conduite ;
– les institutions financières internationales chargées de la surveillance des systèmes financiers nationaux et internationaux et du contrôle et de la promotion de l’application des normes ;
– les comités d’experts des banques centrales concernés par l’infrastructure et le fonctionnement des marchés.
La première réunion du FSF s’est tenue à Washington en avril 1999.
En novembre 2008, les dirigeants des pays du G20 ont appelé à un élargissement du FSF. Un large consensus est apparu dans les mois suivants en vue de faire reposer le FSF sur des bases institutionnelles plus solides tout en l’élargissant à de nouveaux membres. Il s’agissait de renforcer son efficacité en tant que mécanisme permettant aux autorités nationales, aux organismes chargés de la définition de standards et aux institutions financières internationales de traiter les vulnérabilités et de développer et mettre en place entre autres des politiques de supervision et de contrôle fortes dans l’intérêt de la stabilité financière.
Comme annoncé lors du Sommet du G20 d’avril 2009, le FSF, ainsi étendu, a été rebaptisé Conseil de stabilité financière (CSF) ou Financial Stability Board (FSB).
Membres
Siègent au CSF :
– vingt-quatre Etats membres (entre parenthèses le nombre de sièges de chacun) : Afrique du Sud (1), Allemagne (3), Arabie Saoudite (1), Argentine (1), Australie (2), Brésil (3), Canada (3), Chine (3), Corée du Sud (2), Espagne (2), Etats-Unis (3), France (3), Hong-Kong (1), Inde (3), Indonésie (1), Italie (3), Japon (3), Mexique (2), Pays-Bas (2), Royaume-Uni (3), Russie (3), Singapour (1), Suisse (2), Turquie (1) ;
– six organisations internationales (BRI, Commission européenne, BCE, FMI, Banque mondiale, OCDE) ;
– six organisations sectorielles chargées d’élaborer des règles financières.
Présidents
Le président est nommé à titre personnel.
Présidents successifs du FSF :
– Andrew Crockett, directeur général de la Banque des règlements internationaux (1999-2003) ;
– Roger W. Ferguson, vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (2003-2006) ;
– Mario Draghi, gouverneur de la Banque d’Italie (2006-2009)
Président du CSF :
– Mario Draghi, gouverneur de la Banque d’Italie (depuis 2009)
Douze standards clés pour des systèmes financiers solides
Le CSF a déterminé douze standards clés ayant une importance particulière pour que les systèmes financiers soient solides et méritant, à ce titre, une application prioritaire en fonction des circonstances nationales. Quoique le degré de reconnaissance internationale de chacun des standards clés varie, ils sont largement reconnus comme représentant des exigences minimales de bonne conduite.
Politique macroéconomique et transparence des données
– Transparence des politiques monétaire et financière
Charte de bonne conduite sur la transparence des politiques monétaires et financières (FMI)
– Transparence de la politique fiscale
Charte de bonne conduite sur la transparence fiscale (FMI)
– Diffusion des données
Standard spécial de diffusion des données/Système spécial de diffusion des données (FMI)
Infrastructure institutionnelle et de marché
– Faillite
Faillite et droits des créditeurs (Banque mondiale)
– Gouvernance d’entreprise
Principes de gouvernance (OCDE)
– Comptabilité
Normes comptables internationales (IASB, International Accounting Standards Board, ou BSCI, Bureau des standards comptables internationaux)
– Audit
Normes internationales d’audit (IFAC, International Federation of Accountants, ou Fédération internationale des comptables)
– Paiement et règlement
Principes essentiels pour les systèmes de paiement systémiquement importants (CPSS, Committee on Payment and Settlement Systems, ou Comité des systèmes de paiement et de règlement)
Recommandations pour les systèmes de règlement des titres financiers (CPSS et IOSCO, International Organization of Securities Commissions, ou Organisation internationale des commissions de valeurs)
– Intégrité de marché
Les quarante recommandations de groupe d’action spécial financier/ 9 recommandations contre le financement du terrorisme (FATF, Financial Action Task Force, ou GAFI, Groupe d’action financière)
Régulation et supervision financière
– Supervision bancaire
Principes essentiels d’une supervision bancaire efficace (BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, ou Comité de Bâle de contrôle bancaire)
– Régulation des marchés financiers
Objectifs et principes de la régulation des titres financiers (IOSCO)
– Supervision assurantielle
Principes essentiels de l’assurance (IAIS, International Association of Insurance Supervisors, ou Association internationale des superviseurs des assurances)
NB :
Les institutions internationales entre parenthèses sont celles qui ont conçu les différents standards clés.
Sources :
- site web du Conseil de stabilité financière
http://www.financialstabilityboard.org/
- site web du Fonds monétaire international
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/groupsf.htm#G5
ANNEXE 3 :
LA REGULATION AUX ETATS-UNIS
Produits dérivés*
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) assure depuis 1860 la régulation des marchés à terme sur les matières premières (blé, puis pétrole, puis obligations à terme et taux de change). Depuis 1974, son périmètre est élargi à l’ensemble des produits dérivés complexes sur les matières premières et les options.
Actions*
La Securities and Exchange Commission (SEC), créée en 1934, est chargée des opérations de bourse sur titres des sociétés cotées et des dérivés d’actions.
Les state attorneys-general (procureurs généraux des Etats fédérés) interviennent parfois pour faire appliquer la réglementation relative aux marchés.
Les state securities regulators (régulateurs des Etats fédérés pour les titres) ont des compétences similaires à celles de la SEC à l’échelle de leur Etat.
La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est un organe d’autorégulation, créé en 2007, chargé de surveiller tous les professionnels des marchés.
Banques
Les Etats-Unis comptent environ 6 000 banques. Outre les « majors », une multitude de petites « community banks » irriguent l’économie en crédit. Le système de régulation est éclaté entre plusieurs autorités.
La Federal reserve (Fed), créée en 1913, s’occupe des plus grosses banques, notamment des holdings.
L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), créé en 1863, qui est responsable des banques de taille moyenne, soit les banques américaines à statut fédéral et 50 branches fédérales de banques étrangères.
La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), créée en 1933, garantit les dépôts dans les petites banques, jusqu’à hauteur de 250 000 dollars par déposant et par banque. Elle intervient donc dans la résolution des faillites.
L’Office of Thrift Supervision (OTS), créé en 1989, est le principal régulateur des caisses d’épargne fédérales.
Le National Credit Union Administration (NCUA), créée en 1934, enregistre et supervise les unions de crédit (petites banques à vocation non commerciale) fédérales ainsi que la plupart de celles des Etats fédérés et fournit une assurance pour l’épargne qui y est placée.
Chaque Etat fédéré a son organisme de régulation, compétent pour les banques enregistrées localement, qu’il s’agisse d’établissements américains ou d’agences de banques étrangères.
Assurances
Le National Association of Insurance Commissioners (NAIC) élabore des règlementations, ensuite soumises à l’approbation par les chambres de chaque Etat.
Il n’y a toutefois pas de régulateur national mais un par Etat fédéré.
* Les prérogatives de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française équivalent à celles de la CFTC et de la SEC.
ANNEXE 4 :
LES PRIORITES FRANCAISES DU G20
Fiche rendue publique le 24 janvier 2011, à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la présidence française.
A ce jour, le G20 a permis d’apporter des réponses collectives efficaces à la crise la plus grave traversée depuis celle des années 1930.
En 2011, le G20 devra achever les chantiers déjà engagés pour s’attaquer aux racines de la crise mais également étendre son agenda à de nouveaux chantiers pour améliorer de façon durable la stabilité et la prospérité mondiales.
En effet, seul le G20 dispose du poids, de la légitimité et de la capacité de décision nécessaires pour donner les impulsions indispensables à l’avancement des grands chantiers économiques d’aujourd’hui à travers les actions suivantes :
1. Réformer le Système monétaire international (SMI)
La période récente a été marquée par une forte volatilité des monnaies, le creusement des déséquilibres et la recherche d’un niveau toujours plus élevé de réserves de change par les pays émergents pouvant être confrontés à des retraits brutaux et massifs des capitaux internationaux.
La présidence française souhaite réformer le système monétaire international pour apporter des réponses collectives à ces dysfonctionnements et accompagner les mutations profondes que connaît l’économie mondiale, avec notamment la montée en puissance des grands émergents. La construction d’un SMI plus stable et plus robuste passe aussi par la réduction des déséquilibres et la coordination accrue des politiques économiques au sein du Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée du G20.
2. Renforcer la régulation financière
La présidence française veillera à la mise en œuvre effective des règles décidées par le G20 pour renforcer durablement le contrôle du secteur financier. Elle s’emploiera aussi à renforcer la régulation financière dans les domaines où elle reste insuffisante, par exemple en matière de régulation du « secteur bancaire fantôme » (activité bancaire parallèle non régulée à ce jour) et d’intégrité et de transparence des marchés financiers.
3. Lutter contre la volatilité excessive des prix des matières premières
Le G20 s’est pour la première fois penché sur la question de la fluctuation excessive des prix des matières premières lors du Sommet de Pittsburgh en septembre 2009 mais peu de mesures concrètes ont été prises à ce jour.
La France souhaite trouver des solutions collectives pour réduire la volatilité excessive des prix des matières premières, notamment agricoles, qui pèse sur la croissance mondiale et menace la sécurité alimentaire des populations. En particulier, les ministres de l’Agriculture se réuniront en juin, afin de proposer des solutions pour renforcer la sécurité alimentaire et développer l’offre agricole.
4. Soutenir l’emploi et renforcer la dimension sociale de la mondialisation
La présidence française du G20 fera avancer 4 objectifs prioritaires dans ce domaine : l’emploi, notamment des jeunes et des plus vulnérables ; la consolidation du socle de protection sociale ; le respect des droits sociaux et du travail ; et une meilleure cohérence des stratégies des organisations internationales. Les ministres du Travail et de l’Emploi se réuniront fin septembre sur cet agenda.
5. Lutter contre la corruption
L’action du G20 en matière de lutte contre la corruption s’inscrit dans une stratégie globale de long terme en faveur d’un assainissement du climat des affaires, de la lutte contre l’évasion fiscale et du renforcement de l’Etat de droit. La présidence française s’assurera que le Plan d’action de lutte contre la corruption adopté à Séoul se traduit par des résultats concrets et des avancées effectives dès 2011.
6. Agir pour le développement
Le G20, qui représente 85 % de l’économie mondiale et les deux tiers de la population de la planète apparaît aujourd’hui comme une enceinte pertinente pour apporter des solutions concrètes aux problématiques du développement. Le Sommet de Séoul de novembre 2010 a marqué une étape décisive avec l’adoption du premier plan d’action du G20 sur le développement.
La présidence française s’attachera en particulier à soutenir le développement des infrastructures et assurer la sécurité alimentaire dans les pays les plus vulnérables. La présidence française portera au G20 le débat sur le financement du développement, au travers des financements innovants, et notamment de la taxe sur les transactions financières.
ANNEXE 5 :
LES PRIORITES DE LA PRESIDENCE FRANCAISES DU G8
Fiche rendue publique le 24 janvier 2011, à l’occasion de la conférence de presse de lancement de la présidence française.
Le Sommet de Pittsburgh, en septembre 2009, a marqué une étape majeure dans la réforme de la gouvernance mondiale en faisant du G20 le « principal forum de coopération économique internationale » afin de refléter les nouveaux équilibres mondiaux et le rôle croissant des pays émergents. Dans ce contexte, le rôle du G8 évolue en veillant à ce que soit préservée l’originalité de ce forum, qui permet des discussions directes et informelles au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement des économies les plus avancées. Pendant sa présidence, la France propose de recentrer ce « nouveau G8 » sur des sujets sur lesquels ses membres peuvent avoir un véritable impact, en veillant à ne pas dupliquer l’agenda du G20.
Les trois priorités retenues sont les sujets d’intérêt commun aux pays du G8, les enjeux de paix et de sécurité internationale et le partenariat avec l’Afrique.
1. Les nouveaux défis communs : Internet et la croissance verte
C’est la première fois qu’un ensemble de sujets liés à Internet seront abordés par les chefs d’Etat et de gouvernement. Nous proposerons une discussion large sur les différents enjeux. Concernant l’innovation et la croissance verte, l’objectif est d’identifier des mesures concrètes pour développer ces relais de croissance et d’emploi essentiels pour nos économies avancées.
2. Le volet « paix et sécurité »
Il constituera un élément essentiel de la présidence française du G8. Au-delà des affaires politiques (Iran, Proche-Orient, Afghanistan Pakistan, non-prolifération, etc.), la présidence française mettra un accent particulier sur les nouvelles routes du trafic de drogue entre les pays de l’Amérique latine, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Europe, ainsi que la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel.
3. Le partenariat avec l’Afrique
Le G8 a joué un rôle majeur dans la mobilisation en faveur du développement, en particulier de l’Afrique. Une session élargie du G8 à des dirigeants africains et quelques représentants d’organisations internationales sera organisée. La discussion portera sur les grands enjeux politiques et de développement. Nous poursuivrons également l’exercice engagé par la présidence canadienne sur le suivi des engagements des pays du G8, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité alimentaire, et dans un esprit de « responsabilité mutuelle » avec les pays africains.
ANNEXE 6 :
ARTICLE 219, ALINEAS 1 ET 2,
DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPENNE
1. Par dérogation à l’article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l’euro vis-à-vis des monnaies d’Etats tiers. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.
2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies d’États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n’affectent pas l’objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
ANNEXE 7 :
LA HIÉRARCHIE DES NORMES FINANCIÈRES
(DES PRINCIPES DU G20 AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF)
Au niveau mondial, les trois premiers échelons de la gouvernance financière sont composés de groupes et d’organisations informels par nature.
- Le G20 se réunit au niveau des chefs d’Etat. Il définit les grands principes et les priorités de la gouvernance financière mondiale.
- Le Conseil de stabilité financière (CSF) décline les décisions du G20 et aiguille, au moyen de rapports et de recommandations, l’action des organisations internationales ou standards setters internationaux.
- Les standards setters (édicteurs de normes), tels que le Comité de Bâle de supervision bancaire ou l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ont pour objet de faciliter la convergence de la régulation et d’améliorer la coopération en matière de supervision. Ils définissent les standards et les méthodologies qui guideront l’action des régulateurs nationaux.
Les principes dégagés par le G20, les recommandations du CSF et les standards définis par l’OICV ou le Comité de Bâle n’ont aucune force contraignante. Il revient à chaque Etat ou entité supranationale (principalement l’UE) de décider de traduire ou non dans sa législation les normes établies par les standard setters internationaux.
Au niveau européen, la traduction des standards fixés par l’OICV ou le Comité de Bâle s’effectue par l’adoption de règlements et de directives, l’élaboration de mesures techniques revenant à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Au niveau national, l’Autorité des marchés financiers (AMF), chargée de veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers, a le pouvoir d’adopter, pour exécuter ces missions, des règles qui sont contenues dans un règlement général, après homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Autorité des marchés financiers (AMF)
ANNEXE 8 :
LA PROCEDURE DE CODECISION
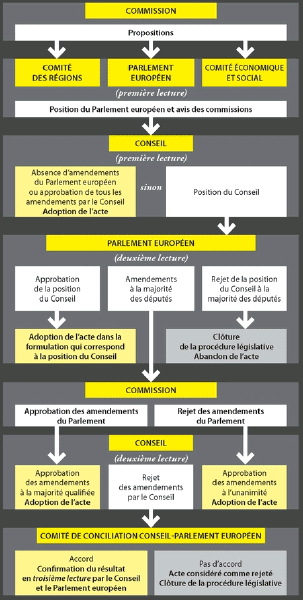
Source : site web de l’Office des publications de l’UE :
http://eur-lex.europa.eu
ANNEXE 9 :
CONCLUSIONS DU RAPPORT D’INFORMATION NO 3443
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,
« L’UNION EUROPEENNE DANS LE G20 :
REPONDRE AUX ENJEUX DE LA REGULATION MONDIALE »
Conclusions adoptées le 17 mai 2011.
La Commission des affaires européennes,
1. Approuve les priorités retenues par la présidence française du G20, en particulier les objectifs de régulation des marchés financiers, de réforme du système monétaire international et de lutte contre la volatilité des matières premières agricoles ;
2. Souhaite que le G20 continue de progresser sur les questions relatives à la régulation bancaire et financière, afin de consolider son bilan dans ce domaine et de rappeler que le monde n’est pas à l’abri d’une nouvelle crise systémique ;
3. Encourage la recherche d’une voie vers un nouveau système monétaire international en vue de résorber progressivement les déséquilibres économiques et commerciaux mondiaux ;
4. Soutient l’objectif de réduction de la volatilité des prix des matières premières, notamment agricoles, nuisible pour les producteurs comme pour les consommateurs ;
5. Emet le vœu que l’Union européenne et ses quatre Etats membres appartenant au G20 se coordonnent davantage pour peser ensemble en faveur d’un renforcement de la régulation mondiale ;
6. Estime nécessaire d’engager une réflexion sur le mode de gouvernance du G20, afin d’améliorer le suivi de la mise en œuvre des orientations fixées dans les déclarations finales des sommets.
1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.
2 () Cf. annexe 1.
3 () Ce mécanisme a été théorisé par l’économiste belgo-américain Robert Triffin (1911-1993).
4 () C’est au sommet de Denver, en juin 1997, que, pour la première fois, le président américain Bill Clinton fait le geste politique de proposer à son homologue russe Boris Eltsine de participer à l’ensemble des travaux en tant que membre et de signer le communiqué final.
5 () Sa dernière session, qui a eu lieu les 9 et 10 septembre 2011, à Marseille, a été consacrée aux réponses à apporter au ralentissement économique global. En cette période marquée par une grande incertitude, la réunion s’est conclue par la publication non pas d’une déclaration commune, mais de « termes de références agréés », dans lesquels les pays riches se sont engagés à travailler « au rééquilibrage de la demande et au renforcement de la croissance mondiale », sans toutefois entrer dans les détails des modalités des actions possibles.
6 () La diplomatie de connivence, de Bertrand Badie (La Découverte, 2011).
7 () Il est aussi appelé « groupe du Willard », en référence à l’hôtel où se déroula sa première session.
8 () Sont donc écartés Hongkong, la Malaisie, la Pologne, Singapour et la Thaïlande, qui faisaient partie du G22, ainsi que la Belgique, le Chili, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Espagne, le Maroc, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, qui faisaient partie du G33, tandis que l’Arabie Saoudite et la Turquie, absentes du G22 mais membres du G33, sont arrimées au groupe.
9 () Structure conjointe entre la Banque mondiale et le FMI, composée de vingt-quatre représentants de leurs Etats membres (essentiellement des ministres des finances ou du développement), le Comité du développement est chargé d’émettre des avis consensuels, à l’intention des conseils des gouverneurs des deux institutions, sur les questions relatives au développement, au commerce et à l’environnement.
10 () Composé de vingt-quatre membres (gouverneurs de banque centrale, ministres ou autres responsables de rang comparable), le CMFI est chargé de donner des avis et de faire rapport au Conseil des gouverneurs du FMI concernant la gestion et l’adaptation du système monétaire et financier international. Il surveille aussi l’évolution de la liquidité à l’échelle mondiale et des transferts de ressources aux pays en développement, examine les propositions du Conseil d’administration visant à modifier les statuts et réagit à des événements qui risqueraient de perturber le système monétaire et financier international.
11 () Le mécanisme est expliqué en détail dans le documentaire Inside Job, de Charles Ferguson, « oscarisé » en février 2011.
12 () Pour reprendre le titre français de l’ouvrage du prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, paru en 2010 aux éditions Les Liens qui Libèrent.
13 () Or il est plus difficile d’organiser un système multipolaire, précisément parce qu’il n’est pas dirigé par une puissance dominatrice, prescriptrice d’orientations auxquelles les autres nations ne peuvent se soustraire.
14 () En dollars courants, la part des Etats-Unis (orange) devrait être divisée par près de deux entre 1990 et 2050, celle de l’UE (bleu) par trois et celle du Japon (jaune) par près de cinq. La part de la Chine (rouge) devrait être multipliée par quatorze entre 1990 et 2050, celle de l’Afrique subsaharienne par huit et celle de l’Inde (vert) par six. En 2050, le poids de l’économie chinoise serait deux fois plus élevé que celui de l’économie américaine.
15 () Groupe de gouvernance mondiale.
16 () Six d’entre eux sont situés en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique (Brunei, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour et le Vietnam), trois au Moyen-Orient (Bahreïn, les Emirats arables unis et le Qatar), trois en Afrique (le Botswana, le Rwanda et le Sénégal), huit en Europe (la Belgique, l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, la Suède, la Suisse et Saint-Marin), deux en Amérique du Sud (le Chili et l’Uruguay) et six en Amérique centrale et dans les Caraïbes (les Bahamas, la Barbade, le Costa Rica, le Guatemala, la Jamaïque et Panama).
17 () Extrait d’un discours prononcé devant le parlement de Singapour le 5 mars 2010.
18 () « S » pour South Africa.
19 () Voir pages 153 et suivantes.
20 () Dans la nuit du 17 mars 2011, l’Inde et le Brésil ont joint leurs voix à celles de la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies – ainsi qu’à celle de l’Allemagne –, pour s’abstenir lors du vote de la résolution 1973, présentée par la France, tendant à autoriser le recours à la force en Libye. Celle-ci a cependant été adoptée par dix voix.
21 () Voir pages 186 et 184.
22 () « Pourquoi la survie à long terme de l’euro est-elle improbable ? ».
23 () Cette théorie, succinctement présentée en France par Nouriel Roubini dans un article des Echos du 21 février 2011 (« Le G20 ? Un “G0” »), est développée dans Foreign Affairs de mars-avril 2011 (« A G-Zero World, The New Economic Club Will Produce Conflict, Not Cooperation »).
24 () Ce groupe est très hétérogène puisqu’il rassemble le Qatar et certains des pays les plus misérables de la planète, en passant par l’Inde, le Brésil, l’Argentine et l’Afrique du Sud, membres du G20.
25 () Officiellement intitulé « Groupe des Vingt-quatre sur les affaires monétaires internationales et le développement », le G24 regroupe l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Argentine, le Brésil, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Gabon, le Ghana, le Guatemala, l’Inde, l’Iran, le Liban, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Sri Lanka, la Syrie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, plus la Chine, qui a le statut d’observateur depuis 1981.
26 () Pour le G8, centré sur les questions de géopolitique et de sécurité, l’essentiel du travail passe par la filière affaires étrangères. Quant au G7, seule sa filière finances a été maintenue ; les ministres des finances et les gouverneurs de banque centrale du groupe se sont encore réunis les 9 et 10 septembre 2011. La cohérence et l’efficacité de l’ensemble de l’appareil de négociation français sont garanties par un comité de pilotage interministériel, au sein duquel le ministère des affaires étrangères et européennes apporte sa compréhension des problématiques internationales et diplomatiques.
27 () « Deputies » ou « Ds » en anglais.
28 () « Deputies of deputies » ou « DDs ».
29 () Les chiffres de cette sous-section sont tirés de la banque de données économiques du FMI pour 2010, mise en ligne en avril 2011 sur le site du Fonds.
30 () Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.
31 () Voir le III de la troisième partie.
32 () Infrastructures, développement des compétences rendant employable, capacité et accès au commerce international, investissements privés, accès aux sources de financement pour les PME, sécurité alimentaire, protection sociale minimum, mobilisation des revenus fiscaux et partage des connaissances pour le développement. Chacun de ses neuf piliers se décline en une série d’actions.
33 () Ce tableau figurera dans un ouvrage à paraître fin octobre 2011 : L’Asie et le Futur du Monde (Presses de Science Po, Collection Nouveaux Débats).
34 () « Monnaie du peuple » : nom officiel du yuan, monnaie de la Chine continentale.
35 () Le CCG réunit l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Qatar.
36 () L’alinéa 72 de la déclaration finale du sommet de Séoul, de ce point de vue, sonne comme un engagement très clair : « Nous reconnaissons, étant donné l’impact et la portée de nos décisions, la nécessité de consulter la communauté internationale dans son ensemble. Nous redoublerons d’efforts pour mener les activités de consultation du G20 de façon plus systématique, en mettant à profit des partenariats constructifs avec des organisations internationales, en particulier l’ONU, des organisations régionales, la société civile, les syndicats et les milieux universitaires. »
37 () Le 17 février 2011 pour le premier, le 3 juin 2011 pour le second.
38 () Cinquante-six de plein exercice et dix-neuf observateurs.
39 () Les trois institutions des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO, Programme alimentaire mondial (PAM) et Fonds international de développement agricole (FIDA) – la Banque mondiale, le FMI, la CNUCED, le Groupe de travail de haut niveau des Nations unies (GTHN) sur la crise alimentaire mondiale, l’OCDE, l’OMC et l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IIRPA, ou IFPRI, International Food Policy Research Institute). Les préconisations de ce rapport sont explicitées dans le III de la troisième partie.
40 () Programme de l’UA, provenant de la fusion, en 2001, du Plan Oméga et du Millenium African Plan (MAP). Il a pour objectif de « placer les pays africains individuellement et collectivement sur la voie du développement et de la croissance durables, et de participer activement à l’économie mondiale ».
41 () Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.
42 () L’UA compte cinquante-trois Etats membres, soit la totalité des pays africains hormis le Maroc, qui s’en est retiré, en 1982, pour protester contre l’adhésion de la République arabe sahraouie démocratique. Quatre de ses membres sont suspendus, conformément à l’article 4 de sa charte, qui interdit les coups d’Etat.
43 () L’essentiel des données chiffrées et des informations factuelles de ce chapitre sont tirées de deux sources : les « fiches pays » du ministère des affaires étrangères et européennes ; le n° 89 des Perspectives économiques de l’OCDE, publié en mai 2011.
44 () L’UA compte cinquante-trois Etats membres, soit la totalité des pays africains hormis le Maroc, qui s’en est retiré, en 1982, pour protester contre l’adhésion de la République arabe sahraouie démocratique. Quatre de ses membres sont suspendus, conformément à l’article 4 de sa charte, qui interdit les coups d’Etat.
45 () Conseil des ministres européens de l’économie et des finances.
46 () C’est-à-dire des titres nouvellement émis.
47 () Le « six pack », un paquet législatif de cinq directives et un règlement.
48 () Euro break-up, the consequences, de Stéphane Deo, 6 septembre 2011.
49 () Voir le IV de la quatrième partie.
50 () Tous les quinze jours en moyenne, une petite banque fait faillite aux Etats-Unis.
51 () American Jobs Act, ou loi pour l’emploi américain.
52 () Chiffres de janvier 2011.
53 () Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).
54 () Le cabinet du Premier ministre.
55 () Le 2 septembre 2011, au terme d’une profonde crise de confiance, Naoto Kan a été remplacé par Yoshihiko Noda au poste de premier ministre ; tous deux sont membres du Parti démocrate du Japon (PDJ), majoritaire à la chambre des représentants depuis 2009. M. Noda est le sixième premier ministre en moins de quatre ans.
56 () Rostat.
57 () Zone incluant aujourd’hui l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège – ces trois pays étant aussi intégrés à l’Espace économique européen (EEE) – ainsi que la Suisse.
58 () Si les tendances actuelles se confirment, sans doute aux alentours de 2035, sachant que le PIB des Etats-Unis, en 2010, restait tout de même 2,5 fois supérieur à celui de la Chine.
59 () En mars, les autorités de la municipalité de Pékin ont ainsi signé un accord de principe avec A-Capital, une structure européenne spécialisée, en vue de constituer un fonds d’investissement libellé en yuan, doté d’une capacité de 330 millions d’euros.
60 () Extrait du discours prononcé lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la séance de clôture de la 4e session de la XIe Assemblée populaire nationale.
61 () Le comité permanent du Bureau politique est composé d’une liste ordonnée de neuf membres. L’actuel n° 6 et vice-président de la République, Xi Jinping, devrait accéder au secrétariat général du Parti communiste chinois et à la présidence de la République.
62 () L’encours de leur dette est officiellement estimé à 1 160 milliards d’euros et atteindrait en réalité les 1 500 milliards.
63 () Au mois de juin 2011, en glissement annuel, la hausse des prix a dépassé les 9 %.
64 () « M. Lee n’exclut pas “de nouvelles tensions avec la Corée du Nord” ».
65 () Elle a été multipliée par près de 2,5 depuis 1990.
66 () Voir le I de la quatrième partie, qui consacre quelques développements au fonctionnement théorique de la « troïka » et à ses limites.
67 () Voir pages 232 et 233.
68 () Du 12 au 15 septembre 2011, M. Erdogan, accompagné de 250 chefs d’entreprise turcs, a effectué une « tournée des printemps arabes », en Egypte, en Tunisie et en Libye.
69 () L’Indonésie, devenue importatrice nette après avoir épuisé l’essentiel de ces ressources pétrolifères, a annoncé son départ de l’OPEP le 28 mai 2008.
70 () Voir la section consacrée au G8, pages 157 et suivantes.
71 () Voir page 86.
72 () Le concept de rogue aid illustre une coopération fondée exclusivement sur la captation des ressources naturelles des pays africains, entraînant mauvaise gouvernance, désindustrialisation ainsi que dumping social et environnemental dans les pays africains.
73 () Dans le cadre du projet Pan-African e-Network.
74 () East African Community, ou EAC, union douanière liant le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda
75 () Dans le quotidien La Croix, le 1er juin 2011, les présidents José Manuel Barroso et Jean Ping ont également publié une tribune commune intitulée « L’Europe et l’Afrique, un partenariat pour la démocratie et la croissance ».
76 () Article de Pierre de Gasquet, paru le 17 novembre 2008 dans Les Echos.
77 () Contrats d’assurance contre le risque de défaillance.
78 () En anglais : Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
79 () Cf. annexe 2.
80 () En anglais : International Accounting Standards Board (IASB).
81 () En anglais : International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Cette instance, qui regroupe les régulateurs des principales bourses dans le monde, compte plus de 190 membres.
82 () Paradis fiscaux réservant leurs prestations aux seules opérations internationales.
83 () Voir pages 138 et 139.
84 () Systemically Important Financial Institutions.
85 () Voir la note 39 et le III de la troisième partie.
86 () Courrier adressé aux parlementaires par M. Barnier le 15 mars 2011.
87 () Propos tenus par M. Barnier lors de son « examen de passage » devant le Parlement européen, le 13 janvier 2011. Il martèle régulièrement cette idée, reprise notamment dans le Livre vert sur l’audit qu’il a présenté à la presse le 13 octobre 2010.
88 () Christopher Dodd, élu du Massachusetts, alors président de la commission des banques du Sénat, et Barney Frank, élu du Connecticut, alors président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, sont tous deux démocrates.
89 () Cf. annexe 3.
90 () Communication COM (2009) 201 final.
91 () « Une meilleure régulation financière au programme du G20 », article de Jacques Le Cacheux paru dans l’ouvrage collectif G20 : les enjeux de la présidence française (La Documentation française, 2011).
92 () Directive 2011/61/UE, dite « AIFM », pour Alternative Investment Fund Managers.
93 () Directive 2010/76/UE, dite « CRD III », pour Capital Requirement Directive III.
94 () Directive 2010/78/UE.
95 () Basée à Londres et présidée par M. Andrea Enria (Italie).
96 () Basée à Paris et présidée par M. Steven Maijoor (Pays-Bas).
97 () Basée à Francfort et présidée par M. Gabriel Bernardino (Portugal).
98 () Basée à Francfort et présidée par le gouverneur de la BCE.
99 () Rapport du groupe de haut niveau sur la supervision financière dans l’UE, remis le 25 février 2009 au président de la Commission européenne.
100 () Règlement (CE) no 1060/2009.
101 () Règlement (UE) no 513/2011.
102 () Jacques Le Cacheux, ibid.
103 () Proposition de règlement COM (2010) 484 final (E5645), dit « EMIR », pour European Market Infrastructure Regulation.
104 () Proposition de règlement COM (2010) 482 final (E 5643).
105 () C’est-à-dire lorsque le vendeur n’a pas emprunté l’actif ni même pris de dispositions en vue de l’emprunter.
106 () Dite « MIF » ou « MIFID », pour Markets in Financial Instruments Directive.
107 () Proposition de directive COM (2011) 453 final (E 6480), dite « CRD IV ».
108 () Proposition de règlement COM (2011) 452 final.
109 () Ou d’outreach, selon le vocable anglais.
110 () Le 24 janvier 2011, devant la presse, le Président de la République avait invoqué une « présidence française collective ».
111 () Cf. annexe 4.
112 () Le B20 et le L20, pour Business 20 et Labour 20.
113 () Le socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive, élaboré par l’OIT et dix-sept autres organisations internationales.
114 () Adoptés le 8 septembre 2000 par l’Assemblée générale des Nations unies, ils fixent pour but global d’éradiquer la pauvreté sur la planète d’ici à 2015.
115 () Voir la note 32.
116 () Emanation des Nations unies créée le 12 février 2010 par Ban Ki-moon, dans la foulée de la conférence internationale de Copenhague.
117 () Sa Fondation Bill et Melinda Gates, spécialisée dans les innovations en matière de santé et d’acquisition des connaissances en faveur des populations des pays en voie de développement, bénéficie de financements supérieurs à ceux de l’OMS.
118 () Voir pages 203 à 205.
119 () Cette initiative, qui date de 2004, tend à renforcer le dialogue entre l’Occident et les pays du grand Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (ou Broader Middle East and North Africa), du Maroc au Pakistan, en vue de favoriser le développement économique et la libéralisation politique dans le monde arabe. Les ministres des affaires étrangères des deux groupes s’étaient réunis à Doha, les 12 et 13 janvier 2011, dans la perspective du sommet de Deauville.
120 () Groupe d’experts du G8 spécialisé dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, du nom des deux sommets qui ont fixé leur feuille de route, celui de Rome, en 1982, et celui de Lyon, en 1996.
121 () Voir la note 20.
122 () Cf. annexe 5.
123 () Tests de résistance.
124 () Comme nous l’a expliqué le directeur général de la mondialisation, « tout le monde a intérêt à ce que la coopération internationale fonctionne car la première des priorités est la lutte contre le protectionnisme ».
125 () Voir page 47.
126 () En juillet 2008, 1 euro valait 1,60 dollar ; il oscille aujourd’hui entre 1,35 et 1,40 dollar, après avoir flirté avec 1,30 dollar. Autre exemple, entre janvier 2009 et janvier 2011, le real brésilien s’est apprécié de 29 % face au dollar.
127 () La réforme du système monétaire international, une approche coopérative pour le XXIe siècle, rapport du groupe d’experts « Initiative du Palais-Royal », remis au Président de la République le 18 janvier 2011.
128 () Cette théorie est défendue par Christian de Boissieu, président du Conseil d’analyse économique (CAE) du Premier ministre.
129 () En 1965 déjà, le général de Gaulle et son ministre des finances Valéry Giscard d’Estaing stigmatisaient le « privilège exorbitant du dollar », permettant aux Etats-Unis d’imposer leur devise au reste de monde en paiement de leur dette.
130 () « L’un des problèmes est qu’il est difficile de demander au monde entier de se mettre d’accord quand on vient de la zone euro, qui ne semble pas être capable de résoudre ses propres problèmes. » Interview d’Alistair Darling, ancien ministre des finances britannique de Gordon Brown, dans Le Temps, 20 septembre 2011.
131 () Cf. annexe 6.
132 () Ou Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth.
133 () Les gros exportateurs – notamment le Japon, la Chine, l’Allemagne et la Russie – auraient été contraints de réduire leurs excédents courants, ce qui se serait traduit, concrètement, par l’ouverture de nouveaux marchés aux entreprises étrangères.
134 () Balance commerciale, flux nets de revenus d’investissement et transferts, en tenant pleinement compte du taux de change et des politiques publiques, notamment budgétaires et monétaires.
135 () Ou indicative guidelines.
136 () Calculé aux taux de change du marché ou aux taux de change en parité de pouvoir d’achat.
137 () L’article 63 du TFUE dispose que « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites » et que « toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et les entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ».
138 () Lorsque des mouvements « en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire », l’article 66 du TFUE autorise le Conseil européen à prendre « des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois ».
139 () Ou Flexible Credit Line (FCL).
140 () Ou Precautionary Credit Line (PCL).
141 () Global Development Horizons 2011 – Multipolarity : the New Global Economy.
142 () Contre respectivement 44 %, 34 %, 11 % et 11 % après le réexamen entré en vigueur au 1er janvier 2006.
143 () Evaluation de l’action du FMI au cours de la période qui a précédé la crise financière et économique mondiale : la surveillance du FMI en 2004-07, 10 janvier 2011.
144 () Dans l’après midi du 6 mai 2010, l’indice Dow Jones chute de quelque 600 points (5,7 %) en quelques minutes avant de les regagner très rapidement. D’autres marchés majeurs subissent des mouvements similaires.
145 () Crisis management and resolution : early lessons from the financial crisis, par Stijn Claessens, Ceyla Pazarbasioglu, Luc Laeven, Marc Dobler, Fabian Valencia, Oana Nedelescu et Katharine Seal.
146 () Think Global, Act European – TGAE, la contribution de 16 think tanks européens au trio des présidences polonaise, danoise et chypriote de l’Union européenne.
147 () Cf. annexe 7.
148 () Ou OTC, pour over the counter, littéralement « sous le comptoir ».
149 () Christopher Dodd a renoncé à se représenter au Sénat. Barney Frank a perdu la présidence de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, au profit d’un élu républicain de l’Alabama qui impute à l’excès d’intervention publique la responsabilité de la crise financière.
150 () Cf. annexe 8.
151 () Un livre vert a pour objet d’initier un débat sur un thème non encore abordé par les politiques européennes. Un livre blanc vise plus spécifiquement à préparer la rédaction d’un texte législatif.
152 () Sur les questions de régulation financière, il s’agit de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), au sein de laquelle plusieurs parlementaires français sont très actifs et reconnus, notamment Mme Pervenche Berès, du groupe du Parti socialiste européen (PSE), M. Pascal Canfin, du groupe Vert, et M. Jean-Paul Gauzès, du groupe du Parti populaire européen (PPE), que nous avons auditionnés.
153 () La majorité qualifiée se calcule en fonction du nombre de voix attribuées à chaque Etat membre, selon sa population. Jusqu’au 1er novembre 2014, 255 voix sur 345, exprimées par au moins la moitié des Etats membres, sont nécessaires pour faire adopter un texte à la majorité qualifiée. En outre, un Etat membre peut demander que le nombre de voix favorables corresponde au moins à 62 % de la population totale de l’UE, faute de quoi la décision est repoussée.
154 () Voir page 198.
155 () Déjà actif aux Etats-Unis, par la voix d’organisations comme Americans for Financial Reform (AFR) ou Better Markets.
156 () Voir pages 136 et suivantes.
157 () Principal groupe mondial de places boursières, qui a procédé de la fusion, en 2000, du New York Stock Exchange et de cinq bourses de valeurs européennes, notamment celle de Paris.
158 () Article paru dans Expansión le 13 mai 2011 : « Trichet : “Los ciudadanos no van a estar dispuestos a aguantar otro rescate bancario con dinero público” » (Les citoyens ne seraient pas disposés à supporter un autre sauvetage bancaire avec les fonds publics).
159 () Ou règle de Volcker, inspirée par Paul Volcker, ancien président de la Fed.
160 () Une mesure similaire, le Glass-Steagall Act, fut en vigueur aux Etats-Unis Sorte de 1933 à 1999.
161 () Les banques centrales et les autorités prudentielles de vingt-sept pays, dont les dix-neuf Etats membres du G20, y sont représentées : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Hongkong, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse et Turquie.
162 () Rapport entre le capital de l’établissement et le total de ses engagements.
163 () Ou GHOS, pour Governors and Heads of Supervision.
164 () Ou G-SIBs, pour global systemically important banks.
165 () C’est-à-dire ne prenant en compte que le noyau de capitaux propres constitué des actifs de très bonne qualité, comme les actions ordinaires et les réserves de liquidités, à l’exclusion des titres hybrides ou complexes.
166 () Ou LCR, pour Liquidity Coverage Ratio.
167 () Ou NSFR, pour Net Stable Funding Ratio.
168 () La Suisse, Taiwan, l’Afrique du Sud, l’Inde, mais aussi dix Etats membres de l’UE appliquent, en ordre dispersé, une taxation parcellaire des transactions financières, sans affecter le marché local. En 2009, la stamp duty reserve tax, cantonnée aux transferts d’actions, a rapporté 3 milliards de livres sterling, soit 3,4 milliards d’euros, au budget britannique. En 2010, son taux a été porté de 4 à 5 %.
169 () Du nom de l’économiste keynésien américain James Tobin (1918-2002), prix Nobel en 1981.
170 ()Le 14 septembre 2011, une coalition d’ONG a présenté, à l’UNESCO, un projet légèrement différent de celui de la France et de l’Allemagne : il consisterait à collecter la taxe au niveau des registres de propriétés mobilières, à chaque opération d’échange de titre, ce qui empêcherait les investisseurs d’échapper au prélèvement en s’abritant derrière des opérateurs étrangers, américains ou autres.
171 () Déclaration de Michel Barnier au Conseil « Ecofin » des 16 et 17 septembre 2011.
172 () Voir la note 144.
173 () Deux études, publiées respectivement en mars 2011 par le FMI et en juin 2011 par la BCE, mettent en évidence le rôle délétère des agences de notation : Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers : Evidence from the European Debt Crisis, par Rabah Arezki, Bertrand Candelon et Amadou N. R. Sy ; Sovereign Credit Ratings and Financial Markets Linkages, Application to European Data, par Antonio Afonso, Davide Furceri et Pedro Gomes.
174 () Catégorie des quatre notes réputées sûres, de AAA à AA- pour Standard and Poor’s et Fitch, de AAA à Aa3 pour Moody’s.
175 () D’après un sondage de l’institut BVA publié le 24 janvier 2011 dans les Echos, 70 % des personnes interrogées doutaient alors que la présidence française puisse être un succès.
176 () Qualifiées d’« hard commodities ».
177 () Qualifiées de « soft commodities ».
178 () United States Department of Agriculture (USDA).
179 () L’augmentation significative de la consommation de viande, notamment, entraîne une concurrence entre alimentation animale et alimentation humaine qui tire les prix à la hausse.
180 () En 2010, environ 35 % de la récolte mondiale de canne à sucre et 15 % de la récolte mondiale de maïs ont été absorbées pour la production d’éthanol. La demande de colza est également lourdement impactée.
181 () Prévenir et gérer l’instabilité des marchés agricoles, par Jean-Pierre Jouyet, ancien ministre, président de l’AMF, Christian de Boissieu, président du CAE et président du Conseil stratégique de l’agriculture et de l’agro-industrie durables, et Serge Guillon, contrôleur général économique et financier.
182 () Voir note 39.
183 () Ou International Research Initiative for Wheat Improvement (IRIWI).
184 () Sur le modèle de celui existant pour le secteur pétrolier, baptisé Joint Oil Data Initiative (JODI), ou Initiative pour des données communes sur le pétrole : mise en commun des bases de données de six organisations internationales – dont la division statistiques des Nations unies, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Eurostat et l’OPEP.
185 () Ou AMIS, pour Agricultural Market Information System.
186 () Le 15 août 2010, elle a prononcé un embargo unilatéral sur les exportations de céréales, demeuré en vigueur jusqu’au 1er juillet 2011.
187 () Communication COM (2011) 25 final.
188 () Voir tableau page 81.
189 () Les élections générales se tiendront le 1er juillet 2012. Le président Calderon, non rééligible, a décidé d’organiser le sommet du G20 au premier semestre 2012, afin d’en assurer la présidence.
190 () Le G8, quoique moins hétérogène, rencontre également la même problématique sur les questions de sécurité internationale, compte tenu du déséquilibre entre nations dans ce domaine : les pays qui possèdent une force de frappe nucléaire, détiennent toute une gamme de moyens de projection susceptibles d’être déployés sur des théâtres d’opérations éloignés et siègent au Conseil de sécurité, portent une responsabilité particulière.
191 () Etats membres et organisations internationales.
192 () Le Comité de Bâle, le BSCI, l’OICV, le GAFI, le CPSS (Committee on Payment and Settlement Systems, ou Comité des systèmes de paiement et de règlement), l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors, ou Association internationale des superviseurs des assurances) et l’IFAC (International Federation of Accountants, ou Fédération internationale des comptables).
193 () Bertrand Badie, ibid.
194 () Voir nos propositions au I de la troisième partie.
195 () Ou TOR, pour terms of reference.
196 () Créé par le traité de Maastricht, il est composé de deux représentants de chacun des Etats membres, de deux représentants de la Commission européenne et de deux représentants de la BCE.
197 () Le 2 mars 2011, le ministre des affaires étrangères et européennes Alain Juppé a rencontré son homologue hongrois Janos Maronyi afin de préparer avec lui les réunions ministérielles du G20 du premier semestre.
198 () La rédaction votée en première lecture par le Sénat a été adoptée conforme par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, le 8 septembre 2011.
199 () En 2011, il n’a pas passé la barre des 5 % lors de cinq des sept élections partielles dans les Länder et se trouve par conséquent exclu des chambres basses régionales.
200 () Antonio Cabral, collaborateur de M. Barroso, est le sherpa G20 de l’UE.
201 () Frans Van Daele, chef de cabinet de M. Van Rompuy, est le sherpa G8 de l’UE.
202 () Le pouvoir de nomination des commissaires incombe au Conseil européen. Toutefois, le Parlement disposant d’un droit de veto vis-à-vis des candidats et pouvant, de ce fait, empêcher la nomination du collège, le Conseil européen et le Parlement européen se consultent au préalable sur le profil des postulants.
203 () Le président Lequiller a écrit un ouvrage, sur ce thème, en 2003 : Un président pour l’Europe (Notes de la Fondation Robert Schuman).
204 () Voir page 124 et la proposition de résolution.
