

N° 1287
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2008.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA MISSION D’ÉVALUATION DE LA LOI N° 2005-370 DU 22 AVRIL 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Jean LEONETTI,
Député.
——
TOME I
RAPPORT
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE : UNE LÉGISLATION MAL APPLIQUÉE 15
Chapitre I Une réglementation ignorée ou mal comprise 15
Chapitre II Une application de la loi contrastée et des interrogations persistantes 21
A. COMMENT LES DÉCISIONS DE LIMITATION OU D’ARRÊT DE TRAITEMENT SONT-ELLES PRISES ? 21
1. L’élaboration de la décision collégiale par l’équipe soignante 21
2. La prise en compte des avis non médicaux 25
a) Les directives anticipées 25
b) La personne de confiance 26
c) La portée des directives anticipées et de l’avis de la personne de confiance 28
d) La famille et les proches 31
3. Qui prend l’initiative de réunir la collégialité ? 32
4. Les situations faisant obstacle à une décision collégiale d’arrêt ou de limitation de traitement 33
B. COMMENT L’OBSTINATION DÉRAISONNABLE EST-ELLE ÉVALUÉE ? 34
1. Un impact de la loi difficile à quantifier 34
2. L’appréciation de l’obstination déraisonnable en réanimation adulte 36
a) Avant la mise en œuvre de la réanimation 36
b) En cours de réanimation 38
3. L’appréciation de l’obstination déraisonnable en néonatologie 39
a) Un questionnement éthique ancien renouvelé par la loi du 22 avril 2005 39
b) La prise en compte de la qualité de la vie future de l’enfant 41
c) Les arrêts de traitement et les arrêts de vie 44
d) Les interruptions médicales de grossesse et les arrêts de traitement 45
4. L’appréciation de l’obstination déraisonnable à l’égard des patients en état végétatif 46
a) La protection des droits du patient en état végétatif 47
b) La fin de vie des patients en état végétatif 49
C. COMMENT LES DÉCISIONS DE LIMITATION OU D’ARRÊT DE TRAITEMENT SONT-ELLES MISES EN œUVRE ? 53
1. Le recours aux soins palliatifs 53
2. L’arrêt de la nutrition et de l’hydratation 55
Chapitre III Des efforts en matière de soins palliatifs réels, mais encore insuffisants 61
A. UNE AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS 62
1. La montée en puissance des soins palliatifs 62
a) La reconnaissance des soins palliatifs par la loi 62
b) La progression de l’offre de soins 63
c) Quels moyens pour les soins palliatifs ? 66
2. Des possibilités de prise en charge inégales 67
a) Les soins palliatifs en établissement de santé : une réponse graduée 67
b) Les carences des soins palliatifs hors des établissements de santé 70
c) L’aide apportée par les associations de bénévoles 73
B. DES INÉGALITÉS ENCORE FORTES ET DES LACUNES IMPORTANTES 75
1. Des inégalités géographiques toujours fortes 75
2. Des inégalités qui frappent en premier les personnes âgées 79
a) Des déficiences évidentes dans les moyen et long séjours ainsi que dans les établissements médico-sociaux 79
b) Les progrès attendus du Programme de développement des soins palliatifs 80
3. Des inégalités entre services révélatrices des limites de la diffusion de la culture palliative 81
a) Les différences entre services 81
b) Le cas spécifique des soins palliatifs pédiatriques 82
C. LE FINANCEMENT ACTUEL DES SOINS PALLIATIFS PERMET-IL LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE PALLIATIVE ? 83
1. Les différents modes de financement des soins palliatifs 83
a) Les financements par la tarification à l’activité (T2A) 83
b) Les financements hors tarification à l’activité 84
2. La T2A est-elle un obstacle à la diffusion de la culture palliative ? 85
a) La T2A a accompagné l’essor des soins palliatifs 85
— Le financement des soins palliatifs par la T2A est en forte croissance 85
— Une croissance moins forte des soins palliatifs que les chiffres ne le laisseraient penser 86
b) La T2A n’est pas toujours compatible avec la démarche des soins palliatifs 87
— Dans certains cas, la T2A peut inciter à l’obstination déraisonnable 88
— La notion de durée moyenne de séjour n’est pas pertinente 92
3. L’exemple britannique et la limitation des effets négatifs de la T2A 95
Chapitre IV Les personnes vulnérables : un accompagnement négligé 97
A. LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 97
1. Un manque presque total d’informations 97
2. Des fins de vie souvent non accompagnées 98
3. Un nombre de personnes âgées dépendantes en hausse continue 99
B. LES AUTRES PERSONNES DÉPENDANTES 99
1. Le manque de structures d’accueil pour les personnes dépendantes 99
2. Les difficultés de la prise en charge de la fin de vie à domicile 102
Chapitre V La formation à l’éthique et aux soins palliatifs : un pan considérable de la culture palliative occulté 102
A. LA FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS : UN DOMAINE EN LENT DÉVELOPPEMENT 103
1. La formation médicale prend trop peu en compte les soins palliatifs 103
a) La formation initiale des médecins aux soins palliatifs 103
b) La formation continue 104
c) Des formations qui restent insuffisantes 104
2. Une recherche peu développée 105
3. Le Programme de développement des soins palliatifs : des avancées réelles mais encore partielles 106
a) La formation en soins palliatifs 107
b) La recherche dans le domaine des soins palliatifs 107
B. LA FORMATION À L’ÉTHIQUE : DES INSUFFISANCES MANIFESTES 107
1. Les carences de la formation initiale des médecins à l’éthique 108
2. Une dimension négligée par le Programme de développement des soins palliatifs 110
Chapitre VI La santé et la justice : entre la crainte et l’incompréhension 110
A. L’APPLICATION PAR LE JUGE DE LA LOI DU 22 AVRIL 2005 110
B. L’APPRÉCIATION PAR LE JUGE DES ACTES D’EUTHANASIE 112
PARTIE II : UN DROIT À LA MORT PEUT-IL ÊTRE LÉGALISÉ ? 115
Chapitre I Quels seraient les fondements d’un droit à mourir ? 116
A. DE QUELLE LIBERTÉ PARLE-T-ON ? 116
B. COMMENT ÉVALUER LA VOLONTÉ DE MOURIR ? 117
C. LA SOCIÉTÉ DOIT-ELLE APPORTER UNE ASSISTANCE AU SUICIDE ? 120
D. LE DROIT À MOURIR SE JUSTIFIE-T-IL PAR L’AUTONOMIE DE L’INDIVIDU ? 122
Chapitre II Quelles seraient les conséquences d’un droit à mourir sur l’éthique médicale ? 123
A. QUE RESTERAIT-IL DU QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE ? 124
B. LE RAPPORT DE CONFIANCE ENTRE LE PATIENT ET SON MÉDECIN SERAIT-IL ALTÉRÉ ? 124
C. LE RECOURS À L’EUTHANASIE TRADUIT-IL UNE COMPÉTENCE MÉDICALE ? 125
D. LE RECOURS À L’EUTHANASIE EST-IL COMPATIBLE AVEC L’ÉTHIQUE DU SOIN ? 127
Chapitre III Quelles leçons tirer des expériences européennes ? 130
A. LES INQUIÉTUDES QUE SUSCITENT LES LÉGISLATIONS ET LES PRATIQUES ISSUES DE LA LÉGALISATION DE L’EUTHANASIE 131
1. Les Pays-Bas 131
a) Le cadre juridique 131
b) La pratique 134
2. La Belgique 137
a) Le cadre juridique 137
b) La pratique 138
3. La Suisse 143
a) Le cadre juridique 143
b) La pratique 145
Chapitre IV Les dispositifs proposés conduisant à une irresponsabilité pénale des auteurs d’actes d’euthanasie sont-ils juridiquement cohérents ? 156
A. UNE PROCÉDURE PÉNALE D’EXCEPTION POURRAIT-ELLE CONSTITUER LA RÉPONSE À DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ? 157
B. LA DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE SERAIT-ELLE COMPATIBLE AVEC NOTRE ORDRE JURIDIQUE ? 160
1. L’instrumentalisation de la notion ambiguë de dignité 160
2. Une procédure susceptible d’engager fortement l’État 162
3. Des incohérences et des garde-fous peu dissuasifs 162
C. LE RECOURS À DES EXPERTS AURAIT-IL UN SENS ? 164
1. Des décisions d’un comité d’experts liant le juge 164
a) Qui serait nommé expert ? 164
b) Une expertise a priori ? 165
c) Une expertise a posteriori ? 166
2. Des experts ès qualités 166
D. LE DROIT EN VIGUEUR INCRIMINE-T-IL L’AIDE AU SUICIDE ? 167
1. La provocation au suicide 167
2. La non-assistance à personne en danger 170
3. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse 170
PARTIE III : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES INTÉRÊTS ET LES DROITS DES MALADES EN FIN DE VIE 173
Chapitre I Mieux faire connaître la loi 173
A. ÉTUDIER ET AMÉLIORER L’APPLICATION DE LA LOI EN CRÉANT UN OBSERVATOIRE DES PRATIQUES MÉDICALES DE LA FIN DE VIE 173
1. Quel statut pour l’observatoire ? 175
2. Comment organiser l’observatoire ? 175
3. Quels moyens attribuer à l’observatoire ? 176
4. Quelles missions pour l’observatoire? 176
B. FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE JUGES ET MÉDECINS 179
Chapitre II Renforcer les droits des malades dans la continuité des lois de 2002 et de 2005 181
A. ÉLARGIR LE DROIT AU RECOURS À LA PROCÉDURE COLLÉGIALE ET MOTIVER LES ÉVENTUELS REFUS OPPOSÉS AUX DIRECTIVES ANTICIPÉES ET À LA PERSONNE DE CONFIANCE 181
B. FAIRE APPEL À DES MÉDECINS RÉFÉRENTS EN SOINS PALLIATIFS DANS LES CAS LITIGIEUX OU LES PLUS COMPLEXES 184
1. Les espaces éthiques et les comités d’éthique : des solutions peu satisfaisantes 184
a) Les espaces éthiques : des espaces de réflexion et non de décision 185
b) Les comités d’éthique : des structures controversées d’aide à la décision 186
c) Les comités d’éthique hospitaliers américains, illustration des inconvénients des comités d’éthique 188
2. L’Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie, un organe d’étude et non de conseil 189
3. Des structures adaptées : les équipes mobiles et les unités de soins palliatifs 190
C. METTRE À L’ÉTUDE L’INSTITUTION D’UN CONGÉ D’ACCOMPA-GNEMENT À TITRE EXPÉRIMENTAL 191
1. La rémunération des périodes d’accompagnement est souhaitable 192
a) Une demande exprimée par tous les accompagnants 192
b) Une humanisation de l’accompagnement de la fin de vie 193
c) Un coût relativement faible 194
2. Les modes de rémunération possibles 195
a) L’allocation 195
b) Le congé payé 196
3. Les évaluations en cours 197
Chapitre III Aider les médecins à mieux répondre aux enjeux éthiques du soin 197
A. MIEUX FORMER LES MÉDECINS À L’ÉTHIQUE ET AUX SOINS PALLIATIFS 198
1. Développer l’enseignement de l’éthique 198
2. Consacrer la place de l’éthique dans les facultés de médecine 200
3. Créer des chaires de soins palliatifs 201
B. PRÉCISER LES MODALITÉS D’APPLICATION DES ARRÊTS DE TRAITEMENT DE SURVIE 204
1. La place des traitements à visée sédative en phase terminale 204
2. La pratique d’un traitement à visée sédative dans certains cas 209
a) La sédation et les personnes en état végétatif 211
b) La sédation en néonatologie 215
c) Le vecteur juridique d’un traitement à visée sédative 215
Chapitre IV Adapter l’organisation du système de soins aux problèmes de la fin de vie 216
A. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS PALLIATIFS 216
1. Dans le court séjour 216
2. Dans les long et le moyen séjours 218
3. À domicile 218
B. RENDRE PLUS EXIGEANTS LES INDICATEURS QUALITATIFS DE SOINS 220
1. Le contenu des indicateurs 220
a) Deux précédents : le Plan Cancer et la lutte contre les infections nosocomiales 221
— Les indicateurs du Plan Cancer 221
— Les indicateurs de prévention des maladies nosocomiales 222
b) Développer les indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs 223
c) Introduire une culture qualitative du soin au-delà des seuls soins palliatifs 227
2. La portée des indicateurs qualitatifs 231
C. AMÉNAGER LE FINANCEMENT DE LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ 233
1. L’inopportunité d’une tarification à la journée 233
2. La nécessité de remédier aux inconvénients du financement par la T2A 233
a) Uniformiser le mode de financement des soins palliatifs 234
b) Lisser les effets de seuil 234
PROPOSITIONS 237
ANNEXES 241
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 295
DÉPLACEMENTS DE LA MISSION À L’ÉTRANGER 301
L’absolue singularité du destin de chaque individu, la diversité et la complexité des peurs et des souhaits de chacun ne rendent-elles pas vaine toute législation portant sur la fin de vie ? Ne serait-il pas présomptueux de prétendre inscrire dans un cadre général une expérience qui par essence ne se partage pas ? Pour autant, parce que ces problèmes renvoient à des choix de société, parce que nos concitoyens sont de plus en plus conscients de la vulnérabilité à laquelle ils sont confrontés avec l’âge, le législateur est impliqué de fait dans les problèmes de la fin de vie. C’est à lui que revient le devoir de créer les conditions d’une nécessaire solidarité entre générations, de favoriser l’accès aux soins, de garantir la prise en charge médicale des plus faibles et d’encourager leur accompagnement.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie s’est attachée à définir les procédures de limitation et d’arrêt de traitement des patients, qu’ils soient ou non en fin de vie et qu’ils puissent ou non exprimer leur volonté. Ce texte a proscrit l’acharnement thérapeutique, exigé transparence et collégialité médicale dans les procédures d’arrêt de traitement et imposé qu’en pareille situation les patients bénéficient des soins palliatifs. Cependant à la suite d’une douloureuse affaire où une femme atteinte d’une tumeur des sinus (1) a demandé à la société une assistance au suicide, des questions se sont fait jour sur la pertinence de cette loi.
Le Premier ministre confiait alors à votre rapporteur, qui avait présidé en 2003-2004 la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie ayant débouché sur la loi du 22 avril 2005, le soin d’évaluer celle-ci. Conjointement le Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer chargeait votre rapporteur d’une mission identique. (2)
Parce que ce débat dépasse tous les clivages politiques et parce que la loi du 22 avril 2005 avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, il est apparu utile d’associer à cette réflexion des députés ayant participé à son élaboration et représentant des sensibilités politiques différentes. C’est ainsi que MM. Gaëtan Gorce pour le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, Olivier Jardé pour le groupe du Nouveau centre et Michel Vaxès pour le groupe Gauche démocrate et républicaine se sont associés à cette mission. Au total 74 personnes ont été auditionnées entre avril et octobre 2008. Les 59 auditions auxquelles il a été procédé ont été retransmises pour la plupart d’entre elles sur la chaîne parlementaire LCP suscitant un intérêt réel, puisqu’elles ont été suivies par deux millions de personnes.
En s’entourant du concours de philosophes, des représentants des religions et des courants de pensée, la précédente mission parlementaire sur l’accompagnement de la fin de vie en 2003-2004 avait replacé la problématique de la fin de vie dans une perspective philosophique, anthropologique, religieuse, sociale et juridique. Souhaitant faire œuvre de pédagogie dans un domaine où la caricature est le plus souvent préférée à l’analyse, la présente mission a décidé de privilégier cette fois-ci des témoignages de terrain. C’est ainsi qu’ont été entendus des malades, des soignants, des médecins, des proches de malades, des représentants d’associations de patients, de bénévoles et de mouvements militant pour la reconnaissance d’un droit à la mort. Il a été fait appel à l’expérience de médecins de soins palliatifs, de médecins réanimateurs, de médecins en néonatologie, de spécialistes de la douleur, d’un responsable de service de soins aux personnes en état végétatif, d’un cancérologue, d’un neurochirurgien, de représentants d’autres spécialités, de cadres infirmiers et d’infirmières. Dans cette démarche qui a fait le choix délibéré du pluralisme et du pragmatisme les aspects économiques et financiers de l’activité médicale n’ont pas été occultés non plus. Des éclairages sur les pratiques étrangères nourries par des déplacements en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse sont venus également alimenter la réflexion des parlementaires.
Ces auditions ont eu le mérite de mettre en lumière la complexité et la multiplicité des enjeux éthiques, philosophiques, médicaux et économiques de cette problématique, en échappant à une vision binaire et stérile qui opposerait les tenants et les adversaires de l’euthanasie.
Si l’on voulait résumer en quelques mots le contenu de cette mission, on serait tenté de dire que le débat autour des droits des malades et de la fin de vie ne saurait se réduire, comme certains voudraient le faire croire, à une réponse simple à une question simple. Les malades ne se ressemblent pas et ils n’ont pas vocation au nom d’un déterminisme simpliste à avoir le même destin. Bien au contraire les auditions ont mis en évidence que chaque cas était unique. Qu’y a-t-il de commun en effet entre un vieillard vivant ses derniers jours, un nouveau-né souffrant de malformations, un malade conscient qui n’est pas en fin de vie, une personne marquée par le début de la maladie d’Alzheimer, un cérébrolésé en phase subaiguë, une personne en état végétatif chronique, un patient victime de sclérose latérale amyotrophique ou présentant un « locked-in-syndrom » ? Peut-on appréhender de la même manière la douleur physique et la souffrance morale de chacune de ces personnes ? Y a-t-il une réponse unique à l’expression de leurs demandes ?
S’il a été rapporté à la mission que médecins et soignants n’étaient pratiquement jamais confrontés à des demandes d’euthanasie, on ne peut cependant ignorer de telles revendications. Toutefois celles-ci apparaissent être le plus souvent l’expression d’un sentiment de détresse, de solitude voire d’abandon. La présence et le dévouement de l’entourage, l’administration de soins palliatifs et le dialogue constituent alors une réponse appropriée à ces demandes et sont de nature à apaiser le patient.
Malgré peut-être ses ambiguïtés, ses imperfections, malgré le retard pris pour développer les soins palliatifs, aucune voix, pas même celle des partisans d’un droit à la mort ne s’est élevée cependant en faveur d’une abrogation ou d’une remise en cause de la loi du 22 avril 2005. Celle-ci a au contraire été saluée pour ses vertus d’équilibre, pour l’éthique de responsabilité médicale qu’elle avait introduite, pour la proscription de l’obstination déraisonnable qu’elle instituait, pour les exigences de transparence et de collégialité qu’elle imposait aux médecins.
Toutefois, les insuffisances des soins palliatifs, les critiques portées sur la prise en charge des patients, l’existence de mauvaises pratiques médicales, les réticences médicales à appliquer la loi à certains patients, les contradictions de la logique financière de la tarification à l’activité avec l’interdit de l’obstination déraisonnable, justifient que l’on ne se contente pas d’un statu quo qui conforterait de mauvaises pratiques et aviverait des discours idéologiques.
Faut-il reconnaître pour autant une impunité systématique à un acte d’euthanasie au motif qu’il serait accompli par compassion ? Notre droit doit-il même aller au-delà de ce qui a été présenté il y a quelques années comme une « exception d’euthanasie » pour définir le cadre juridique d’un droit à la mort ou au suicide assisté ? Confrontée à la maladie, la personne demandant la mort est-elle vouée à persister dans sa revendication ou réclame-t-elle simplement une meilleure prise en charge médicale ? Un droit à la mort peut-il coexister dans ces conditions avec l’obligation de traitement et de soins imposée aux professionnels de santé et avec une législation fondée sur la responsabilité médicale et la solidarité à travers les soins palliatifs ? Si la loi du 22 avril 2005, très consensuelle, est appelée aux dires des praticiens à couvrir la quasi-totalité des cas, a-t-elle vocation à être abrogée, pour satisfaire l’expression de l’ultime liberté d’un être humain appelé à être l’artisan de son destin ?
En tout état de cause, poser ces questions revient à établir un départ entre ce qui relève de la loi de 2005, ce qui ressort exclusivement à l’accès aux soins palliatifs et ce qui a trait à l’aspiration de certains de nos concitoyens à un droit à la mort.
Pour clarifier un débat parfois volontairement obscurci, pour surmonter des malentendus savamment entretenus, pour rétablir des vérités ignorées, la mission parlementaire a essayé de répondre à ces questions.
— Elle a constaté que la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades est méconnue et mal appliquée ;
— Elle se refuse à reconnaître un droit à la mort ;
— Elle préconise de mieux prendre en compte les intérêts et les droits des malades en fin de vie.
PREMIÈRE PARTIE : UNE LÉGISLATION MAL APPLIQUÉE
Chapitre I
Une réglementation ignorée ou mal comprise
En l’absence d’étude nationale, de nombreux témoignages et quelques enquêtes donnent à penser que les principales dispositions de la loi du 22 avril 2005 sont restées peu connues ou mal comprises (3).
Une enquête (4) réalisée auprès des personnels soignants et coordonnée, pour le compte de l’Espace Éthique de l’AP-HP de Paris (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), par Mme Nathalie Vandevelde, cadre infirmier à l’hôpital Saint-Louis, le confirme : « De prime abord, 46 % des personnels soignants ont déclaré connaître la loi. Après une interrogation plus précise, on s’aperçoit qu’il n’y en a que 22 % qui savent qu’il y a interdiction d’obstination déraisonnable, 12 % que la volonté des patients doit être respectée, 9 % qu’est mise en valeur la notion de personne de confiance, 5 % qu’est prônée la collégialité des décisions et seulement 4 % parlent de la possibilité de soulager la douleur en appliquant un traitement pouvant avoir un double effet. » (5) Les médecins ne semblent pas être mieux informés ; une enquête menée par le Panorama du médecin en juin 2008 indiquait que 70 % des médecins de l’Essonne avouaient ne pas connaître la loi du 22 avril 2005. Une étude (6) faite auprès de 127 médecins de Loire-Atlantique révèle que 79,5 % de ces derniers n’en avaient pas non plus connaissance.
Selon le Professeur Daniel Brasnu, chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris, le même constat d’ignorance peut être dressé pour les membres du corps médical exerçant dans des établissements hospitaliers à forte activité cancérologique (7). Cette analyse est partagée par le Professeur François Goldwasser, chef de l’unité médicale d’oncologie du groupe hospitalier Cochin : « […] actuellement, en Ile-de-France, sur 150 cancérologues, trois seulement sont formés aux soins palliatifs. À l’occasion d’un cours à des médecins généralistes sur la douleur, j’ai réalisé que, sur soixante qui étaient intéressés par le sujet et étaient assez motivés pour venir, aucun ne connaissait ni la loi Leonetti ni le principe du double-effet. Une enquête faite auprès de cancérologues m’a révélé que moins de 10 % d’entre eux étaient en mesure d’expliquer la loi Leonetti. » (8) Un sondage effectué auprès de pneumologues par le Docteur Anne Prud’homme, chef du service des maladies respiratoires au Centre hospitalier de Bigorre à Tarbes, laisse à penser que cette spécialité ne bénéficie pas d’une meilleure information. (9)
Mme Marie de Hennezel, psychologue-psychothérapeute, a fait part, au cours de son audition, de la mauvaise compréhension de la loi qu’elle avait constatée chez ses interlocuteurs à l’occasion des soixante-dix forums intra-hospitaliers organisés, entre 2005 et 2007, dans le cadre de sa mission d’évaluation des structures palliatives : « la loi est mal connue, donc mal interprétée et mal appliquée. » (10)
Il semblerait cependant, d’après le Professeur Daniel Brasnu, que les personnels travaillant dans des services de réanimation et de néonatologie aient une meilleure connaissance de la loi et que les personnels soignants – infirmières et cadres de santé – soient généralement plus au fait de la législation relative à la fin de vie que les médecins, les premiers bénéficiant de formations spécifiques. Certaines conclusions de l’enquête RESSENTI, menée à l’initiative du Docteur Édouard Ferrand, praticien hospitalier dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital Tenon, confirme au moins l’existence de perceptions différentes entre personnels de santé ; interrogés sur les critères de qualité de prise en charge des malades en fin de vie – notamment la qualité des décisions de fin de vie et de la réflexion éthique qui l’accompagne « 75 % des médecins jugeaient adéquates les procédures de leurs services alors que 75 % des infirmières les estimaient absolument insatisfaisantes. » (11)
Méconnue des professionnels, la loi l’est encore plus des malades et de leurs familles comme le déplore le milieu associatif. Mme Paulette Le Lann, présidente de la fédération Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) a ainsi souligné, à l’occasion de son audition, que « la loi d’avril 2005 n’est pas davantage connue du public, de nos concitoyens : les peurs prégnantes, exprimées par les personnes que nous rencontrons dans nos permanences d’accueil, dans nos sessions de sensibilisation ou lors de nos conférences témoignent de cette méconnaissance. » (12) M. Alain Monnier, président de l’Association pour le développement des soins palliatifs (ASP) a également souligné le fait que la loi du 22 avril 2005 a été desservie par l’attrait exercé par les positions des défenseurs de la légalisation de l’euthanasie : « [….] la vague palliative s’est transformée en vague euthanasique. […] Ce qui intéresse aujourd'hui l’opinion, c’est l’émotion médiatique qui entoure l’euthanasie. (13) »
A. DES ACTIONS D’INFORMATION ÉPARSES
Les raisons pour lesquelles la loi du 22 avril 2005 n’a pas bénéficié d’une campagne d’information à la hauteur de ses enjeux éthiques et du nombre de personnes qu’elle concerne demeurent difficiles à comprendre.
Il fait peu de doute que l’origine strictement parlementaire de la loi n’a pas favorisé une forte mobilisation des services ministériels intéressés, en particulier ceux du ministère de la santé. Aucune circulaire d’explicitation de la loi à l’intention des établissements hospitaliers n’a été élaborée, aucun programme d’information n’a été mis en place en direction des professionnels de santé, aucune brochure d’information à l’attention du grand public n’a été rédigée. Chargée en 2005 par M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé, d’accompagner la loi en procédant à une évaluation de la démarche palliative et à une sensibilisation à la culture d’accompagnement, Mme Marie de Hennezel a été conduite à s’interroger publiquement sur « la volonté politique » de faire de la pédagogie de la loi une priorité (14).
Cette critique est partagée par le Professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l’espace éthique AP-HP de Paris : « La communication n’a pas été synchrone et l’on n’a pas donné une vraie légitimation politique à la loi de 2005. Où sont les documents du ministère de la santé ? Pour le risque de pandémie grippale de type H5N1, tout le monde a reçu un kit comportant informations et matériel. Pour la loi Leonetti, il s’agissait seulement d’éditer une plaquette ou un cédérom d’information : on n’a pas considéré que c’était une urgence et on ne l’a pas fait. Il en a résulté un vide. » (15) Cette absence d’information trahirait même, selon le Professeur Emmanuel Hirsch, l’existence de « stratégies fatales » menées dans le but de « temporiser avant de créer, demain, les conditions d’une dépénalisation dans une prochaine loi. » (16)
Il est de même à regretter, comme l’a relaté le Professeur Emmanuel Hirsch (17), que le document explicatif rédigé par l’espace éthique AP-HP de Paris en collaboration avec la Fédération hospitalière de France et la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés et non lucratifs n’ait pas reçu l’autorisation d’être diffusé à l’intérieur des établissements relevant de l’assistance publique, au prétexte qu’il avait été édité par l’hebdomadaire La Vie.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater que le seul support de communication de la loi du 22 avril 2005 vers le grand public ait consisté en une plaquette d’information rédigée par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. Comme l’a expliqué le président de cette association, M. Jean-Luc Romero, « [L’ADMD] est la seule à avoir diffusé très largement un document destiné au grand public pour présenter les droits des malades tels qu’ils découlent de la loi. On le retrouve d’ailleurs souvent dans les services hospitaliers parce qu’il est unique en son genre […]. » (18)
En revanche, à la différence des organismes institutionnels, les structures spécialisées dans l’éthique médicale ainsi que les sociétés savantes ont immédiatement perçu les enjeux de la loi du 22 avril 2005. Les espaces éthiques ont organisé de nombreuses réunions d’information, engagé des travaux de réflexion et lancé diverses études sur l’application de la loi (19). Plusieurs sociétés savantes ont pris des initiatives pour faire connaître ces nouvelles dispositions légales et en évaluer l’application dans leurs spécialités respectives(20). La loi a fait l’objet d’un enseignement dans le cadre des cours d’éthique dispensés dans le 1er cycle et le 2nd cycle des études médicales, la présentation des droits des malades étant inscrite au programme de ces initiations (21) ; les préparations aux diplômes universitaires d’éthique médicale et de soins palliatifs (DU) ont permis de sensibiliser un public de professionnels. Les associations de bénévoles (22) ont, elles aussi, organisé des actions d’information et nombreuses ont été les conférences et soirées-débats animées par des médecins ou des philosophes convaincus de l’importance de ce nouveau cadre légal. Votre rapporteur a, pour sa part, eu l’occasion d’exposer le contenu de la loi au cours de plus d’une centaine de débats et conférences à travers toute la France. L’ensemble des travaux menés par la présente mission parlementaire a même fait l’objet d’une thèse de doctorat (23).
Ces actions pour faire connaître la loi du 22 avril 2005 demeurent toutefois dispersées et limitées aux personnes déjà intéressées par le problème. Elles ne sauraient remplacer une communication institutionnelle d’ampleur significative, seule susceptible d’informer le grand public ; elles ne peuvent non plus répondre à ce que M. André Sicard, président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a désigné, au regard de l’importance de cette loi, comme un « impératif de connaissance » (24) qui s’impose à tous les professionnels de santé concernés.
Les déficiences peuvent sans doute s’expliquer par la spécificité du problème et par la difficulté à engager des campagnes de communication sur ce sujet. À ce titre, Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé a exprimé des doutes sur les moyens médiatiques auxquels il pourrait être recouru pour mieux informer le grand public : « Sur ce sujet, je ne crois pas à l’efficacité de grandes campagnes d’opinion comme sur la contraception ou la vaccination. La fin de la vie requiert des approches beaucoup plus subtiles et personnelles. » (25)
B. UNE PROMOTION TARDIVE DE LA LOI
La nécessité d’accompagner l’application de la loi par des actions de communication n’a cependant pas été complètement ignorée. Elle s’est traduite, quelques semaines après le vote de la loi, par l’ouverture, à l’initiative de M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé, de la ligne téléphonique Azur Accompagner la fin de la vie, s’informer, en parler dont la Direction générale de la santé a confié la mise en œuvre au Centre de ressources national soins palliatifs François-Xavier Bagnoud (26). Depuis son inauguration le 19 mai 2005, ce service ne paraît cependant pas avoir bénéficié de la campagne d’information qui aurait été nécessaire pour le faire connaître. Seuls 130 appels par mois ont été reçus en 2006 et 94 en 2007 (27) alors que les ressources financières et le nombre de personnes formées à répondre aux demandes d’information permettraient de prendre en charge 100 appels par jour (28). Cette situation a suscité les interrogations du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie auprès du ministère de la santé et des solidarités ; le 25 janvier 2007, le groupe de travail chargé de l’information du public s’inquiétait ainsi que « l’affiche annonçant le numéro Azur n’[avait] toujours pas été distribuée. Plusieurs milliers d’exemplaires attendent toujours dans les cartons. Le groupe s’interroge sur les raisons pour lesquelles la Direction générale de la santé a décidé de ne pas envoyer ces affiches alors qu’elles sont prêtes depuis longtemps. » (29)Au cours de son audition devant la mission d’information, Mme Marie de Hennezel a commenté cette situation dans les termes suivants : « Je regrette que le numéro Azur – 0811 020 300 – ouvert sur ma proposition par Philippe Douste-Blazy en 2005 n’ait pas bénéficié d’une campagne d’information d’envergure. Depuis trois ans, c’est une véritable gabegie de fonds publics : les écoutants sont formés à informer sur la loi, à orienter vers les structures de soins palliatifs, à écouter les détresses. Ils attendent des appels qui ne viennent pas. Et pour cause : le public ignore l’existence de ce numéro. » (30)
Par circulaire en date du 2 mars 2006, la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a diffusé une version actualisée de la Charte du patient hospitalisé prenant en compte les diverses dispositions portant sur les droits des malades introduites dans la législation depuis 1995. Dans ce cadre, le chapitre 4 de ce document présente le contenu de la loi 22 avril 2005. Certes, la charte est disponible sur le site Internet du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (31) et peut être obtenue, sur demande, au service d’accueil de tout établissement hospitalier. Cependant les 24 pages de ce document divisé en onze chapitres contiennent un texte manifestement trop dense pour constituer un support de communication efficace des dispositions propres à la loi du 22 avril 2005 (32).
Il faut attendre le deuxième trimestre de l’année 2008 pour qu’un document d’information mieux adapté soit conçu et diffusé. Par arrêté du ministère de la santé du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d’accueil des établissements, il est précisé que celui-ci doit faire mention de la possibilité de rédiger des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. En juin 2008, la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins diffuse un guide d’élaboration du livret d’accueil qui propose, à titre d’exemple, des formulations de présentation de ces deux dispositifs introduits par la loi du 22 avril 2005 (33). Cette même direction recommande que soient mises à la disposition du public, « dans la mesure du possible », ces fiches explicatives standard rédigées par le ministère de la santé ; en effet « l’appropriation de ces notions par les personnes hospitalisées n’est pas toujours très aisée. L’uniformisation de ces informations contribuerait sans doute à faciliter cette appropriation. » (34)
Aucun document spécifiquement centré sur la loi du 22 avril 2005 n’a été rédigé à l’intention des professionnels de santé. Seule une plaquette d’information de l’Institut national de Prévention et d’Éducation de la santé (INPES) intitulée « Les patients en fin de vie ; soins palliatifs et accompagnement » et diffusée début 2007 en mentionne les principales dispositions, sans toutefois les expliquer ni les commenter. Là aussi, ce n’est que trois ans après le vote de la loi, en 2008, qu’un effort de communication significatif a été fourni sous la forme d’une « mallette d’information » portant sur les soins palliatifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; mise à la disposition de tous les professionnels concernés elle propose, entre autres, une présentation détaillée de la loi sur les droits des malades et la fin de vie. Il est à souligner que l’élaboration du contenu des formations que contient ce « kit » a été confiée par la Direction générale de la santé à l’intergroupe « soins palliatifs gériatriques » constitué entre la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) et la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) ; une telle collaboration atteste d’une prise de conscience de la complexité des problèmes de la fin de vie et de la nécessité d’en confier la formulation à des spécialistes de santé. Par ailleurs une enquête sur la connaissance par les professionnels de santé de la loi du 22 avril 2005 est en cours de réalisation à l’initiative de l’INPES.
Chapitre II
Une application de la loi contrastée et des interrogations persistantes
Si l’on dispose d’éléments d’appréciation sur la méconnaissance de la loi de la part du corps médical comme du public, il est plus difficile d’évaluer la disparité des pratiques médicales qu’on peut, en conséquence, supposer. Par ailleurs, la loi serait-elle mal appliquée du seul fait qu’elle est mal connue ou parce qu’elle recèlerait des ambiguïtés d’interprétation ? Seules des études menées au niveau national seraient à même de fournir des données précises. En l’absence d’un Observatoire des pratiques de la fin de vie, dont la présente mission parlementaire recommande la création (35), les auditions auxquelles a procédé la mission et les enquêtes qui, à cette occasion, ont été présentées, conduisent cependant à identifier un certain nombre de questions que pose la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005, étant souligné qu’en tout état de cause ses dispositions n’ont été source, à ce jour, d’aucune procédure contentieuse et que le texte est jugé « équilibré » par les professionnels (36).
A. COMMENT LES DÉCISIONS DE LIMITATION OU D’ARRÊT DE TRAITEMENT SONT-ELLES PRISES ?
Le principe qui commande l’ensemble de la procédure de prise de décision d’une limitation ou d’un arrêt de traitement est qu’il s’agit d’une décision d’ordre médical : la décision est l’objet d’une délibération de l’équipe soignante et est prise par le médecin responsable du patient. La spécificité de cette procédure est qu’elle consacre aussi les droits du malade en rendant obligatoire une collégialité particulièrement étendue. La décision prend en effet en compte les souhaits que le patient a pu exprimer dans des directives anticipées, l’avis de la personne de confiance que le patient a pu désigner, l’avis de la famille ou à défaut celui de ses proches. Ce dispositif a pour effet de structurer, selon les termes de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, « la décision médicale, toujours difficile à prendre, toujours collégiale, jamais isolée, jamais désincarnée, jamais mécanique. » (37)
1. L’élaboration de la décision collégiale par l’équipe soignante
Recommandée à titre de bonne pratique par différentes sociétés savantes avant le vote de la loi du 22 avril 2005, la collégialité de la décision d’une limitation ou d’arrêt de traitement intervient obligatoirement, depuis le vote de cette loi, dans deux situations : d’une part, (38) lorsque cette décision est susceptible de mettre en danger la vie d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté ; d’autre part, (39) lorsque la personne est dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable et que la décision collégiale porte sur la limitation ou l’arrêt d’un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de sa vie. Par un décret en date du 6 février 2006 (40), les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont été précisées et introduites dans le code de déontologie médicale à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique. Il est à souligner que la rédaction de cette disposition réglementaire ayant valeur de décret en Conseil d’État a été faite sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins conformément à l’article L. 4127-1 du code de la santé publique.
Partant du principe selon lequel une décision raisonnable se dégage plus probablement d’une discussion que d’un monologue lorsque ses motivations débordent le seul champ du savoir technique, la procédure collégiale suivie par l’équipe médicale consiste, comme l’a caractérisée le Docteur Édouard Ferrand, en un « partage de l’incertitude » (41). La formulation des questions et la mise en commun des doutes constituent la réponse méthodique à apporter devant un risque d’acharnement thérapeutique qui « laisse, constate le Docteur Édouard Ferrand, les chefs de service (…) tout aussi démunis que les autres » (42). Le médecin traitant voit son appréciation de la situation croisée par celle d’un autre médecin et par celle des soignants paramédicaux qui sont au plus proche du malade ; il élabore avec l’ensemble de l’équipe soignante la motivation rationnelle d’une décision médicale dont il demeure responsable. Cette procédure relève d’une stratégie médicale consistant à anticiper, dans la mesure du possible, l’évolution de l’état du patient et à éviter toute décision prise dans la précipitation. Elle rassure en outre la famille du patient toujours inquiète de ce que le sort de leur proche pourrait ne dépendre que des aléas d’une volonté singulière.
Il n’a pas été rapporté à la mission parlementaire de difficultés liées à d’éventuels désaccords persistants entre les membres de l’équipe soignante. L’enquête LATAREAPED, menée récemment dans les services de réanimation pédiatriques (43) fait part d’un taux d’absence de consensus significativement bas sur l’échantillon étudié, de l’ordre de 3,5 %. Un constat de désaccord conduit à poursuivre les orientations thérapeutiques suivies antérieurement. Comme l’explique le Professeur Élie Azoulay, médecin réanimateur à l’hôpital Saint-Louis : « Il faut savoir, à l’issue d’une réunion, ne pas prendre de décision. Si quelqu’un ne se sent pas bien avec une décision thérapeutique, il ne faut pas la prendre. Ce n’est pas rare. » (44) Aucune donnée statistique suffisamment fine ne permet cependant de décrire l’évolution de ces situations de blocage à l’intérieur de l’équipe médicale et la manière dont se positionne chaque intervenant. Les résultats de l’enquête RESSENTI, cités précédemment, laisseraient supposer des différences d’appréciation importantes entre les soignants et les médecins. On ne peut cependant s’appuyer sur aucune étude pour évaluer dans quelle mesure ces divergences d’évaluation se traduisent par des désaccords au moment de la décision collégiale. Aucune information n’est disponible non plus sur le temps qui s’écoule dans la pratique avant qu’une réunion collégiale ne soit de nouveau organisée après un premier constat de désaccord ni sur les cas où un tel désaccord aurait persisté. Il semble cependant que la procédure soit suffisamment « ouverte » pour rendre ces dernières situations exceptionnelles. La réflexion de l’équipe soignante est en effet renforcée par l’avis motivé d’un médecin consultant sans lien hiérarchique avec le médecin traitant.
Mais les limites de l’éthique de la discussion sont connues : comme le rappelle, à propos des services de réanimation, le Professeur Philippe Hubert, chef du service de réanimation pédiatrique polyvalente de l’hôpital Necker-enfants malades : « il ne faut pas minimiser le risque que l’on prenne tous ensemble de mauvaises décisions » (45). Il ressort des auditions menées par la mission parlementaire que la traçabilité de la décision et le recours à un consultant extérieur à l’équipe de soins constituent des éléments d’objectivation de la décision d’une importance toute particulière.
Le décret n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale dispose que : « La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » Le dossier médical n’est pas dans cette procédure le simple recueil des discussions qui se sont tenues oralement. En gardant trace de la participation de chacun il traduit l’engagement de chaque membre de l’équipe médicale, de telle sorte, comme l’explique le Docteur Édouard Ferrand, que : « tout le monde, de l’aide-soignant au chef de service, puisse lire ce qui a été consigné les jours précédents. » (46)Le Professeur Élie Azoulay a insisté sur la nécessité d’aboutir à une décision issue d’une argumentation partagée par chaque membre de l’équipe soignante ; il a décrit dans ces termes l’organisation d’une réunion collégiale : « Les réunions sont formelles. Le médecin le plus jeune raconte l’histoire du malade, qui il était avant, s’il a des enfants, son métier, son histoire, son état. L’infirmière relate l’environnement familial, et l’on aborde les questions de pronostic. Les deux dossiers, médical et paramédical, sont ouverts. Tout se qui est dit est écrit. Nous devons prendre le temps d’organiser cette réunion pour être le plus clair possible à l’égard des plus jeunes. Si l’on est pressé, l’on risque de prendre une décision que pourraient mal percevoir certains membres de l’équipe » (47)
Outre le contenu de la décision et la façon dont on y est arrivé, est inscrite « la manière dont on va mettre en œuvre cette décision. » (48) comme le précise le Docteur Godefroy Hirsch, président de la société française des soins palliatifs (SFAP). La décision collégiale de limitation ou d’arrêt de traitements ne s’apparente ainsi en rien à un abandon du malade qui ferait suite à un constat d’impuissance ; elle est une réorientation des actes de soins conforme à un protocole, argumentée et transparente.
Le risque d’une erreur collective d’appréciation est de plus minoré par la possibilité de faire intervenir un deuxième consultant à la demande du médecin chargé du traitement ou de celui appelé par ce dernier en qualité de premier consultant. L’intervention de ce médecin (49) apporte un point de vue extérieur aux éventuels blocages que connaîtrait la discussion collégiale(50). Il convient cependant de ne pas dévoyer la démarche collégiale, en attribuant au second consultant un imperium d’expert ou de spécialiste en éthique. La décision collégiale ne peut avoir la portée précédemment décrite, à savoir être l’expression d’un engagement responsable et constituer un guide d’action, que si elle est issue effectivement de la collégialité et non seulement appliquée par elle – quitte à miser sur la durée pour que l’équipe soignante fasse sienne l’avis du second consultant, dans l’hypothèse où les conclusions de ce dernier seraient celles qu’elle déciderait finalement de s’approprier. Le législateur n’a en effet, en aucune façon fait le choix d’un cadre rigide, inapte à appréhender la diversité des situations susceptibles de se présenter.
La mise en œuvre de cette procédure resterait à évaluer. Selon le Docteur Édouard Ferrand, la communauté médicale ne s’est pas encore appropriée ce type de démarche : « Une étude sur la traçabilité montre que, un an et demi après l’adoption de la loi Leonetti, dans 50 % des cas, le dossier médical de la personne décédée ne contenait aucune référence au projet thérapeutique ; n’y figurait qu’une accumulation de traitements de complication. Dans 50 % des cas aussi, il n’y avait pas de référence à une décision de fin de vie. La collégialité est nécessaire mais requiert des outils afin que tous les acteurs de soins disposent d’un niveau d’information adéquat. J’ajoute que le recours au médecin consultant n’est pas notifié dans les dossiers médicaux et infirmiers alors que c’est le garde-fou ultime pour la moins mauvaise décision possible. » (51)
2. La prise en compte des avis non médicaux
Introduite par l’article 7 de la loi du 22 avril 2005 et précisée par le décret n° 2006-119 du 6 février 2006, cette procédure est non seulement demeurée méconnue mais elle s’avère également mal comprise de ceux qui y recourent. La rédaction de la directive anticipée garantit au patient, dans le cas où il serait hors d’état d’exprimer sa volonté, que ses souhaits relatifs à sa fin de vie seront pris en compte par le médecin qui l’a en charge. Celui-ci a donc pour obligation de s’enquérir de l’existence de ces directives, d’en vérifier la validité, d’en prendre connaissance et d’inclure les souhaits qui y sont formulés parmi les éléments sur lesquels va s’appuyer sa décision médicale.
Le contenu de la directive anticipée n’est cependant pas opposable au médecin : il s’agit de « souhaits », selon le terme utilisé dans l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, et non de prescriptions. Le thérapeute n’est pas tenu de respecter cette expression indirecte de la volonté – à la différence de la situation où le patient est conscient (52) – s’il estime que cela ne serait pas de l’intérêt du malade tel qu’il l’apprécie au vu de son état. Ainsi, la rédaction des dispositions légales relatives aux directives anticipées exclut, en principe, le danger dénoncé par le Docteur Xavier Mirabel médecin cancérologue radiothérapeute au Centre régional de lutte contre le cancer Oscar-Lambret à Lille : « Prendre au pied de la lettre des directives anticipées, c’est prendre le risque d’un véritable abandon. En un certain sens, il est facile de s’en laver les mains puisque cela a été écrit. » (53)
Le médecin pourra notamment entretenir des doutes sur la constance de la volonté du patient, question qui a été souvent soulevée au cours des auditions(54). Le rapport qu’a un malade avec sa maladie se modifie en effet avec l’évolution de celle-ci et les lignes de partage entre les traitements estimés acceptables et ceux ressentis comme inacceptables sont mouvantes. Les directives anticipées n’ont d’ailleurs, aux termes de l’article R. 1111-18 du code de la santé publique, qu’une validité de trois ans. La prudence a motivé le choix de cette durée, à la différence de la législation belge qui reconnaît à ce document une validité de cinq ans (55).
La rédaction des directives anticipées (56) présente des difficultés certaines du fait qu’elle exige un degré de précision suffisant pour les rendre applicables à l’état futur de la personne. Lorsque celle-ci est bien portante, il lui est difficile d’anticiper toutes les situations et les actes médicaux qui lui sembleraient inacceptables. L’expression de souhaits précis est réservée aux cas des personnes atteintes d’une maladie chronique dont le médecin est capable de décrire l’évolution, ce qui rend alors formulables les limites que souhaite poser le patient à l’action médicale. Même dans cette hypothèse, l’exercice demeure cependant complexe pour le médecin éventuellement consulté. Abordant le cas des malades atteints d’une sclérose latérale amyotrophique, le Professeur Vincent Meininger, chef de service en neurologie au groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, a eu l’occasion de souligner les difficultés qu’il y a à expliquer les conséquences d’un choix thérapeutique sur un état seulement anticipé et dont le « vécu » restera absolument singulier : « […] au fond comment bien « expliquer », « éclairer » lorsqu’il faut expliquer à quelqu’un ce qu’est la vie sous trachéotomie ? Les explications peuvent être bonnes ou mauvaises. Après des années de pratique, je ne sais toujours pas comment présenter à autrui d’une manière neutre ce que représente une vie après trachéotomie, car c’est bien d’une vie dont il est question et c’est cela qui importe.» (57)
La désignation de la personne de confiance est également un dispositif demeuré mal connu. Suggérée dès 1998 par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son avis n°58, cette disposition a été introduite dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Six ans après son institution, la personne de confiance demeure trop souvent confondue avec la personne à prévenir.
L’enquête dont a fait part Mme Nathalie Vandevelde au cours de son audition montre que la personne de confiance était notée dans seulement 58 % des dossiers de soins qui avaient fait l’objet de l’étude : « On est encore loin des 100 % mais on observe une avancée » (58). Cette évaluation est cependant différente suivant les services. En service de réanimation, la désignation d’une personne de confiance, comme l’a constaté le Professeur Louis Puybasset (59), Professeur des universités-praticien hospitalier du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, est particulièrement rare, les hospitalisations des patients n’étant jamais prévues. Selon le Docteur Sylvain Pourchet (60), responsable de l’unité fonctionnelle « soins palliatifs » de l’hôpital Paul-Brousse, cette procédure devient néanmoins plus fréquente dans les services de soins palliatifs.
La fonction de la personne de confiance semble tout aussi mal comprise que l’est celle des directives anticipées. Le CCNE, dans l’avis précité, s’était demandé « jusqu’où [les individus] peuvent déléguer à un proche leur pouvoir de faire des choix, par exemple relatifs au traitement de la douleur ou à leur propre mort ? ». Le choix fait par le législateur en 2002 a été de ne donner au proche désigné qu’un rôle consultatif lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté (61). Le proche ne se substitue pas à la volonté du patient inconscient ; son avis ne s’impose pas au médecin traitant. La désignation d’une personne de confiance ne se confond donc pas avec l’instauration d’une tutelle (62). Dans le cadre de la loi du 22 avril 2005, la personne de confiance est seulement habilitée à donner un avis au médecin et à exiger de lui une information quand une réflexion collégiale portant sur une limitation ou un arrêt de traitement est engagée.
La crainte semble cependant réelle, en particulier dans les services de gériatrie, de voir la personne de confiance sortir de son rôle et prétendre exercer des prérogatives qu’elle n’a pas, en abusant de la faiblesse de personnes fragilisées par la maladie et le grand âge. Comme le constate, de fait, le Docteur Marie-Pierre Hervy, chef de service de gériatrie au CHU de Bicêtre « choisir une personne de confiance n’est pas un acte qui est à considérer en dehors de tout rapport de force. » (63) Ce risque traduit une mauvaise compréhension du rôle légal de la personne de confiance ; elle n’est en rien coresponsable des décisions prises. Il revient au médecin de le lui rappeler et, pour son compte, de ne rien retrancher à sa propre responsabilité.
On peut penser que la récente réforme de la protection juridique des majeurs introduite par la loi du 5 mars 2007 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2009, fera mieux connaître cette procédure. Aux termes de l’article 6 de cette loi (64), toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle pourra en effet charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle serait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (65). Il est précisé que ce mandat, dénommé « mandat de protection future » pourra prévoir que le mandataire exercera les missions confiées à la personne de confiance. Si ce nouveau dispositif de représentation venait à bénéficier d’une large diffusion, la procédure de désignation d’une personne de confiance pourrait gagner en reconnaissance. Son choix en sera en outre élargi (66) ; des personnes morales pourront en effet être désignées pour remplir cette fonction (il s’agit des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs sous curatelle, tutelle ou faisant l’objet d’un accompagnement judiciaire) (67) ainsi que, sous contrôle du juge, des agents relevant d’établissements et de services d’accueils des personnes âgées ou handicapées (68).
c) La portée des directives anticipées et de l’avis de la personne de confiance
Parmi les avis non médicaux dont la décision collégiale a à tenir compte, la rédaction de directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance renvoient à l’exercice d’un droit du patient. Soit en anticipant dans le temps l’expression de sa volonté, soit en confiant à un tiers la charge de l’exprimer, le patient organise sa liberté en prévision d’une situation où il ne pourra plus la faire valoir. Le contenu des directives anticipées et l’avis de la personne de confiance prévalent par conséquent sur les avis de la famille et des proches.
L’existence d’une éventuelle hiérarchie entre la personne de confiance et la directive anticipée a pu faire l’objet d’interrogations(69). Les débats parlementaires n’ont pas en 2005 soulevé cette question et le texte voté n’établit pas explicitement la prévalence d’une procédure sur l’autre. L’article 8 de la loi, introduisant l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, dispose que l’avis de la personne de confiance prévaut sur les avis de la famille ou des proches « à l’exclusion des directives anticipées » ; cela ne signifie pas que les directives anticipées ont une valeur supérieure à la personne de confiance mais que ces deux procédures ne sont pas à placer sur le même rang que les autres avis non médicaux. L’article 9 de la loi, introduisant l’article L. 1111-13 du même code, ne renseigne pas non plus sur une éventuelle hiérarchie entre les deux. L’article R. 4127-37 ne paraît pas plus précis ; certes, l’énumération des avis non médicaux que doit obligatoirement consulter le médecin en charge du malade cite en premier les directives anticipées, mais il n’y est pas dit que cette énumération équivaut à une hiérarchie. Seule la fiche explicative rédigée sur cette question par la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et destinée à aider à la rédaction des livrets d’accueil des personnes hospitalisées présente ces dispositions comme établissant une prévalence des directives anticipées sur la personne de confiance.
Si le texte de la loi comme la disposition réglementaire qui l’accompagne n’apporte pas une telle précision, c’est que la question n’a en réalité pas à se poser au vu de la logique du dispositif légal qui a été adopté. En effet, ces avis n’étant pas contraignants pour le médecin, il serait difficile de définir pour l’un une portée supérieure à l’autre. L’obligation qui s’impose au médecin est de les considérer comme l’expression de ce que souhaite ou souhaiterait le malade. En ce sens, cette prise en compte est différente, sur la forme, du recueil des avis de la famille et des proches qui exposent leur avis au sujet du malade. Mais ce serait une tâche impossible que de demander au médecin d’accorder un crédit différent envers une volonté propre du patient exprimée à distance dans le temps (70) et un avis exprimé présentement par un tiers sur la base d’un lien de confiance passé ; le risque d’une modification dans le temps de la volonté du patient et celui d’une mésinterprétation par la subjectivité de l’intermédiaire sont sensiblement équivalents. Il revient au médecin de prendre en compte ce qui constitue en fait un faisceau d’informations, sans ordre de priorité stricte de l’une sur l’autre, et d’intégrer ce faisceau à l’ensemble des renseignements médicaux dont par ailleurs il dispose – pour, à l’issue d’une délibération collégiale, évaluer au mieux le juste soin à prodiguer.
Le choix n’a pas été fait par le législateur de donner un effet contraignant aux souhaits du malade. Les difficultés qu’entraînerait un tel élargissement de la procédure transparaissent dans les précautions prises par le législateur anglais pour mettre en œuvre la procédure du Mental Capacity Act (71). Introduite dans la législation anglaise le 7 avril 2005 et devenue applicable depuis le 1er avril 2007, celle-ci confère au patient par l’intermédiaire de directives écrites ou d’un mandataire désigné par lui le droit de s’opposer à toute forme de traitement. Ce droit ne peut cependant devenir effectif que si les volontés de la personne sont rédigées avec la plus grande précision. Ainsi, selon un exemple donné par le Conseil national pour les soins palliatifs britannique (72), une directive qui indiquerait que la personne refuse à l’avance tout traitement de support vital pour le cas où elle serait mourante, n’aurait pas de valeur contraignante pour le médecin ; en effet, dans une telle hypothèse, ni les circonstances caractérisant l’état du mourant (sont-ce les dernières semaines de la phase terminale d’une maladie ou les dernières heures de l’agonie qui sont visées ?) ni la nature du traitement refusé (les antibiotiques sont-ils par exemple compris dans cette demande ?) ne sont précisées. Les éventuelles contradictions entre les intervenants doivent aussi être envisagées, dans un tel dispositif, : si le contenu de la directive anticipée n’est pas conforme à ce que les médecins estiment être le choix thérapeutique le plus conforme aux intérêts du malade, les médecins ne peuvent que se contenter de vérifier la validité formelle de la directive ; si le mandataire contredit la demande formulée par la directive, en vertu d’un principe de chronologie des actes, la formalité la plus récente dans le temps prévaut ; si le mandataire demande un retrait de traitement mettant la vie de son mandant en danger en opposition avec l’avis du médecin en charge du malade, le médecin peut faire appel devant une « Cour de protection ».
En Allemagne, par deux décisions, la 12ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’importance et la force obligatoire des directives anticipées (73). L’Ordre des médecins invite également à suivre les directives anticipées des patients, dans la position qu’il a prise sur l’accompagnement des mourants le 7 mai 2004 et dans ses recommandations du 27 mars 2007.
Toutefois, parce qu’une certaine incertitude continuait à caractériser le statut juridique de ces directives anticipées, le législateur dans un projet de loi adopté au Bundestag en première lecture le 26 juin 2008 a décidé de donner force légale à cette jurisprudence en contraignant le médecin en charge du patient à suivre ses directives anticipées, sous réserve qu’elles correspondent aux conditions de vie et de traitement en cause. Le code civil sera modifié en ce sens. S’il n’existe pas de directives anticipées ou si elles ne correspondent ni aux conditions de vie ni aux conditions de traitement en cause, le soignant doit décider en respectant la volonté supposée du patient. Pour identifier celle-ci, il doit s’appuyer sur des témoignages écrits ou oraux, sur les convictions éthiques ou religieuses du malade, sur ses proches et sur une personne de confiance sous réserve que cette consultation ne retarde pas considérablement la décision. (74)
En faisant de la directive anticipée un instrument de l’autodétermination du patient ayant force contraignante, il est possible que se créent ainsi des situations peu favorables à l’établissement de consensus autour de la décision médicale ; en outre, une telle procédure fige la volonté du malade et requiert de lui une capacité d’anticipation peu réaliste. Que la loi du 22 avril 2005 n’ait pas formalisé des modes de résolution des éventuelles contradictions entre les intervenants non médicaux dans la décision de limitation ou d’arrêt de traitement traduit sur le fond une conception très différente des démarches allemande et britannique : la diversité des points de vue s’exprime dans le cours de la délibération collégiale mais la décision demeure toujours celle du médecin. La procédure n’est pas fragmentée entre divers intervenants, l’hypothèse étant bien sûr que le médecin saura faire la part de ses incertitudes et prendre en compte le point de vue des tiers.
Par ailleurs, il relève de l’évidence que dans un contexte de fin de vie ou de maladie grave évolutive, inciter le patient à désigner une personne de confiance et à rédiger des directives anticipées exige un certain sens de la mesure. De même que le code de déontologie dispose qu’un pronostic fatal « ne doit être révélé qu’avec circonspection » (75), de même la présentation des droits du malade en fin de vie, par le médecin comme par les services d’accueil des patients dans les établissements hospitaliers, doit se faire de manière opportune puisqu’elle revient parfois à annoncer au patient qu’il entre dans le stade terminal de sa vie. En tout état de cause, le patient reste libre d’exercer ou non ses droits ; il peut estimer qu’en matière de santé, il lui est préférable de s’en remettre complètement aux décisions éclairées du médecin. Ni la désignation d’une personne de confiance ni la rédaction de directives anticipées ne présentent en conséquence de caractère obligatoire. En aucun cas un médecin, comme ont pu s’en inquiéter le Docteur Xavier Mirabel et le Professeur Vincent Meininger (76) ne peut échapper à ses responsabilités, en imposant au patient encore conscient l’une de ces procédures d’expression indirecte de sa volonté – démarche qui sous entendrait qu’en l’absence de directives anticipées ou de l’avis d’une personne de confiance l’équipe médicale serait incapable de prendre une décision d’importance. En aucun cas, non plus, un service d’accueil hospitalier n’a à lier l’admission d’un malade à l’engagement préalable de ces procédures.
On ne saurait enfin déplorer que ces dispositifs de communication de la volonté du malade soient rares dans certains services comme ceux de réanimation. Il y aurait en effet à s’interroger sur les processus pathologiques à l’œuvre dans une société où chaque membre exprimerait et formaliserait ses craintes de sombrer dans l’inconscience.
Leur rôle est complexe car leur destin et leur histoire sont intimement liés au patient. C’est pourquoi leur intégration dans le processus décisionnel de limitation ou d’arrêt de soins est particulièrement délicate. Le sentiment de culpabilité qui risque d’être ressenti à l’issue d’une décision d’arrêt de traitement est susceptible d’atteindre tous les niveaux générationnels voire transgénérationnels, d’autant que la famille n’exprime pas toujours une unité de vues sur la meilleure décision à prendre pour son proche. Au surplus lorsqu’elle est recomposée, la cellule familiale peut être un facteur supplémentaire de complexité. L’institution des directives anticipées et de la personne de confiance joue, dans ce cas, un rôle de protection. Comme l’a expliqué le Professeur Louis Puybasset « Il s’agit de trouver un juste équilibre au cas par cas. La famille ne peut ni porter la responsabilité de la décision ni en être exclue. Trop d’implication créerait une culpabilité et un risque de deuil pathologique, pas assez serait une tromperie. La seule façon de s’en sortir le moins mal possible est de s’adapter à chaque famille et de réinventer pour chacune la meilleure procédure à appliquer tout en ayant un cadre de réflexion commun à toutes qui permet de justifier nos choix. » (77)
S’adapter à chaque famille consiste aussi à ne pas exclure des dérives intéressées, le « sublime et le sordide » entourant parfois le lit d’un malade.
« La loi Leonetti, a observé le Professeur Élie Azoulay, nous a donné le pouvoir d’être visibles auprès [des] familles et de leur dire que leur proche allait mourir. » (78) Dans la pratique, la consultation prévue par la loi est précédée de plusieurs entretiens ; puis les modalités de la décision de limitation ou d’arrêt de traitements sont présentées : « Plusieurs jours après le début de la réanimation, nous recevons donc à nouveau la famille, et nous essayons de répondre point par point à ce qu’on pense qu’elles souhaiteraient. Nous essayons en général de voir la famille au complet, pour qu’il ne revienne pas à un membre de diffuser au reste de la famille la mauvaise nouvelle, devenant ainsi “ celui qui est responsable de la mort ”. Cet entretien permet de souligner des clés des soins palliatifs. Nous promettons ainsi que le proche ne souffrira pas et nous prenons le temps d’expliquer les modes de prise en charge. » (79)
En aidant la famille à garder à domicile un malade en fin de vie, l’institution d’un congé d’accompagnement, tel qu’il est préconisé par le présent rapport (80), contribuerait à inscrire l’action de la famille dans l’ensemble des procédures médicales liées à la fin de vie.
Bien que l’étude dirigée par le Docteur Édouard Ferrand sur la mort à l’hôpital (MAHO (81)) ait montré que la famille est souvent absente au moment de la mort d’un proche à l’hôpital, elle révèle aussi que l’équipe de soins entre en contact avec au moins un membre de la famille dans plus de 98 % des cas. Dans les cas restants, l’équipe médicale en est réduite à recueillir l’avis de proches dont elle peut avoir du mal à cerner la proximité réelle avec le patient. La personne en fin de vie demeure alors un inconnu.
3. Qui prend l’initiative de réunir la collégialité ?
La proposition de redéfinir les conditions dans lesquelles la discussion collégiale de limitation ou d’arrêt de traitement peut s’engager a été présentée à plusieurs reprises au cours des auditions (82). En l’état actuel des textes, il revient au médecin de déclencher la procédure : le médecin évalue le moment où, au vu de l’état du patient, il convient de discuter d’un changement de stratégie thérapeutique. Cette évaluation du juste soin étant d’ordre médical, elle relève de la responsabilité du thérapeute, de même que la décision collégialement motivée qui suit. Ne serait-il pas envisageable cependant d’étendre l’initiative de la discussion aux non soignants qui entourent le patient (personne de confiance, famille ou proche) ou au patient lui-même par le biais de ses directives anticipées ? On peut en effet concevoir une situation où un médecin se refuserait à engager la procédure de discussion de limitation ou d’arrêt de traitement, alors que la situation du patient requerrait peut-être qu’il soit statué sur une telle décision.
Le droit donné à l’un quelconque des intervenants précités reviendrait à introduire un dispositif destiné à pallier une divergence d’appréciation du médecin pour lequel évaluer le juste soin constitue pourtant une obligation légale et déontologique. Les membres de la mission d’évaluation ont estimé que les procédures de contrôle ordinaires des pratiques médicales ne donnaient pas, dans cette procédure, une garantie effective aux droits du malade et qu’au regard d’une décision qui touche la fin de vie ces droits devaient être renforcés (83).
4. Les situations faisant obstacle à une décision collégiale d’arrêt ou de limitation de traitement
La discussion collégiale exige du temps, ce dont, dans certaines situations, ne dispose pas le médecin. Ainsi, lorsque des soins de réanimation d’urgence sont entrepris, l’appréciation du juste soin est faite par un seul médecin ; comme l’explique le Professeur Élie Azoulay, « Lorsque vous êtes seul à vous occuper d’un malade en arrêt cardiaque, vous ne pouvez pas discuter avec son épouse » (84). Les pédiatres, comme l’a relevé le Professeur Delphine Mitanchez, responsable du service de néonatologie de l’hôpital Armand-Trousseau, sont également exposés à cette situation : « […] en salle de naissance, le pédiatre est très seul : souvent – en particulier pendant les nuits de garde –, il est l’unique réanimateur. Or, même lorsque la situation a fait l’objet avant la naissance d’une discussion et d’une décision collégiale, associant l’équipe et la famille, de ne pas réanimer, cet acte est très difficile à assumer quand on est seul. » (85)
Il est à souligner que l’article L. 1111-4, alinéa 4, du code de la santé publique qui impose que, dans le cas où une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne soit réalisée sans que la personne de confiance ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté, réserve expressément le cas de l’urgence ou de l’impossibilité. À ce propos, le Docteur Michel Legmann, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a rappelé le principe posé dans la première partie de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique ; celui-ci fait obligation au médecin, en toutes circonstances, de s’abstenir de toute obstination déraisonnable et l’autorise à ne pas entreprendre ou à ne pas poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Dans ce contexte, le médecin peut procéder aux choix thérapeutiques qu’il estime les plus raisonnables sans réunir la collégialité si, précisément, les circonstances ne le permettent pas : « on peut penser au SAMU, dans le cas par exemple d’un accident gravissime de la route. » (86)
Les contraintes de temps ne constituent pas les seuls obstacles à la mise en œuvre d’une décision collégiale. Des défaillances dans l’organisation de la chaîne de soins sont parfois en cause. Pour le Professeur Élie Azoulay, ces dysfonctionnements ne doivent pas être négligés. Si « tout est écrit dans le dossier, encore faut-il l’ouvrir. L’information peut être déformée lors de sa transmission à l’équipe de nuit. L’on demande au médecin de garde, en général le médecin de l’équipe qui a pris la décision, de renforcer le message, mais ceux qui ont participé à la réunion ne transmettront pas le même message et n’apporteront pas le même soutien à la famille que ceux qui n’y ont pas assisté. » (87)
Le maintien du patient à domicile, en particulier dans les zones à démographie médicale de faible densité rend également plus complexe l’organisation d’une collégialité de la décision. Comme le fait valoir le Docteur Élizabeth Balladur, médecin coordonnateur de l’hospitalisation à domicile à l’AP-HP : « […] un retour à domicile après un séjour hospitalier induit un flou dans la traçabilité de l’information qui est souvent partiellement partagée. Dans l’évolution de la maladie, le temps de séjour à domicile représente une temporalité bien particulière, où il est souvent bien difficile de rassembler en un même lieu les protagonistes requis pour que l’on puisse parler d’une authentique collégialité » (88). En tenant compte du fait qu’un quart des décès intervient à domicile (89) il serait particulièrement important de disposer de données statistiques précises pour comprendre selon quel protocole sont alors prises les décisions de limitation ou d’arrêt de soins. Selon le témoignage de Mme Martine Nectoux, infirmière clinicienne, il semblerait même, dans le cas des personnes d’un très grand âge, que les termes de la problématique soient à inverser : « Face à l’aggravation de leur état de santé, je constate malheureusement qu’il n’est pas question, dans ce contexte, de risque d’acharnement thérapeutique, mais bien d’abandon de soins. (90)»
Le Docteur Michel Legmann reconnaît la difficulté : « Dans les départements qui connaissent une pénurie médicale, la disponibilité du médecin qui pourrait être appelé comme consultant est évidemment un problème. » (91) Le problème pourrait cependant être partiellement pallié, précise le Docteur Michel Legmann, par une meilleure anticipation médicale : « […] rien n’interdit que la procédure collégiale soit mise en œuvre quelque temps en amont de l’exécution de la décision. S’il n’est pas souhaitable de différer l’analyse d’une situation de fin de vie, il ne s’agit pas non plus, généralement, d’une situation d’urgence. » (92)
B. COMMENT L’OBSTINATION DÉRAISONNABLE EST-ELLE ÉVALUÉE ?
1. Un impact de la loi difficile à quantifier
Une des raisons pour lesquelles la loi du 22 avril 2005 avait fait l’objet d’un consensus tient au fait qu’elle avait proscrit l’obstination déraisonnable. On peut toutefois légitimement se demander si elle n’a fait qu’apporter une sécurité juridique à des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement telles qu’elles se pratiquaient jusque-là sur la seule base des recommandations des sociétés savantes et du code de déontologie médicale ou si elle a aussi eu un effet direct sur les pratiques médicales et l’évaluation de la proportionnalité des traitements.
Les seules données comparatives disponibles portent sur l’activité des services de réanimation. Au vu des études LATAREA - 1 (93) et LATAREA - 2 publiées en 2001 et 2007, le nombre de limitations et d’arrêts des thérapeutiques actives en réanimation adulte a connu une évolution modeste, passant de 53 % des patients décédés à 55,7 %. « Cela signifie, a expliqué le Docteur Édouard Ferrand à l’origine de ces études, que la moitié des malades (94) n’ont pas vu leur projet thérapeutique évoluer vers une stratégie palliative – c’est un signe indirect d’acharnement thérapeutique […]. Dans le reste de l’Europe et les pays anglo-saxons, 80 à 90 % des décès sont prévus et accompagnés (95)». Les résultats de l’étude menée en 2007 dans les services de réanimation pédiatrique (LATAREAPED), présentés à la mission parlementaire par le Docteur Robin Cremer, médecin réanimateur au service de réanimation pédiatrique du CHRU de Lille - Hôpital Jeanne de Flandre, indiquent que sur les 400 décès enregistrés sur le total d’un groupe de 5 000 enfants, moins de la moitié avait fait l’objet d’une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, « ce qui correspond à ce que l’on sait des pratiques en réanimation pédiatrique depuis dix ans. Autrement dit, la publication des “guidelines” comme de la loi ne modifie pas globalement l’incidence des pratiques de limitation et d’arrêt thérapeutique. » (96)
Le manque de données statistiques sur les décisions de limitation ou d’arrêt de traitement dans les autres spécialités médicales est particulièrement regrettable ; ce dispositif central de la loi du 22 avril 2005 ne peut ainsi être suivi dans son application. Il conviendrait en particulier de mieux cerner la fréquence de ces décisions dans les services de cancérologie (97) où, selon le témoignage du Professeur François Goldwasser, l’obstination déraisonnable serait « le mode de fonctionnement habituel ». (98) On ne peut que supposer que le développement de la culture de soins palliatifs, en entraînant une meilleure appréciation de la proportionnalité des traitements thérapeutiques, fera bénéficier à plus de patients des stratégies palliatives dont la loi du 22 avril 2005 donne la méthodologie décisionnelle.
L’ensemble des auditions a fait apparaître un consensus sur la pertinence des procédures introduites par la loi du 22 avril 2005 quand elles ont à s’appliquer aux malades conscients en fin de vie. Les malades atteints de maladies évolutives ainsi que des proches de personnes décédées ont également exprimé leur confiance (99) dans des règles qui imposent au médecin, quel que soit l’état de ces personnes, des approches médicales respectueuses de leur volonté et de leur dignité. Dans tous ces cas, les difficultés d’application de la loi ne relèvent pas d’éventuels défauts de conception du dispositif légal mais avant tout des retards que connaît le développement de la culture des soins palliatifs(100). Aussi les débats conduits par la mission parlementaire se sont-ils concentrés sur la situation des patients hors d’état d’exprimer leur volonté qui se trouvent dans les situations suivantes : patients en réanimation, nouveau-nés en détresse vitale et personnes en état végétatif chronique ou pauci-relationnel. Dans quelle mesure la situation de ces patients dont l’état ne répond pas à la description d’un sujet en fin de vie, au stade terminal d’une maladie grave et incurable – à laquelle s’adosse principalement la loi du 22 avril 2005 – relève-t-elle néanmoins des principes posés par celle-ci ? Quelle est la démarche qui conduira à apprécier l’existence ou non d’une obstination déraisonnable dans ces cas ? Ces questions sont d’autant plus aiguës que les décisions médicales prises en fonction des réponses apportées mettent en jeu non pas la qualité des derniers jours d’une vie qui s’éteint mais des existences entières.
2. L’appréciation de l’obstination déraisonnable en réanimation adulte
Les services de réanimation adulte comptent en France 6 000 lits, ce qui représente 380 000 patients hospitalisés. La mortalité en réanimation est de 18 % et la mortalité hospitalière de 23 %. Dans une unité de neuro-réanimation comme celle du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière qui prend en charge 450 personnes par an, 40 à 50 patients posent la question d’une limitation thérapeutique dans un contexte de dégâts neurologiques majeurs(101).
a) Avant la mise en œuvre de la réanimation
Agissant à la frontière de la vie et de la mort, le neuro-réanimateur est face à des choix thérapeutiques dont les conséquences sont soit le décès immédiat du patient soit son maintien artificiel en vie jusqu’à son éventuel réveil ; intervenant en urgence, il est contraint de prendre seul en un très court laps de temps des décisions sur le sort de patients qu’il ne connaît pas. Le médecin neuro-réanimateur est donc rarement dans les conditions qui lui permettraient d’apprécier le caractère proportionné de son intervention ; il ne peut agir qu’en fonction du principe in dubio pro vita – bénéfice du doute qui conduit à sauver la vie de 70 à 80 % de ses patients.
Cependant, comme l’a recommandé le Docteur Ferrand, une meilleure traçabilité du dossier médical devrait, dans certains cas, conduire à une appréciation plus raisonnée de l’opportunité d’entreprendre une réanimation : « Une étude sur les fins de vie dans les SAMU montre que, par manque d’informations, les équipes réaniment des malades en soins palliatifs mais pour lesquels aucune traçabilité n’existe, ou bien dont elles pensent à tort qu’ils sont en soins palliatifs. Le manque de respect des malades au sens large aboutit à cette prise en charge problématique. Mais le SAMU peut constater que tous les organes vitaux d’un malade pris en charge sont défaillants et juger que tout traitement est déraisonnable, qu’il constitue un gâchis pour tout le monde, même si tous les éléments de la procédure collégiale ne sont pas disponibles. Je crois qu’il faut avancer dans cette démarche. De telles décisions peuvent être prises, mais la traçabilité est le meilleur garde-fou pour adopter une attitude raisonnable. (102)»
Cette mauvaise traçabilité est liée à ce que le Professeur Louis Puybasset a appelé « une fragmentation de la décision médicale » (103) peu propice à une évaluation éclairée. Les gestes techniques sur lesquels se concentrent les réanimateurs et les chirurgiens laissent peu de place à la réflexion éthique. La Professeur Delphine Mitanchez l’a également constaté en réanimation néonatale : « Il est toujours plus difficile de ne rien faire sur le plan technique, de retenir ses gestes, que de décliner les gestes de réanimation. » (104)
Une meilleure prise en charge de la fin de vie devrait contribuer aussi à lutter contre ce que le Professeur Louis Puybasset a appelé des « effets d’évitement d’amont » se traduisant par des refus d’admission en urgence de patients « ayant un risque élevé mais non certain d’évolution neurologique de mauvaise qualité. » (105) De telles pratiques – qu’il resterait à évaluer mais qui semblent exister – reviennent à dévoyer le principe de l’interdiction de l’acharnement thérapeutique, en procédant à une sélection des malades de crainte d’avoir à prendre en charge des patients végétatifs après réanimation ; or l’obstination thérapeutique est un devoir médical, du moment que celle-ci est raisonnable, à savoir tant qu’aucun argument ne permet d’écarter une possibilité de guérison. En outre, selon le Professeur Louis Puybasset, en n’admettant pas ces patients dans les filières de soins spécialisées, le risque est pris « d’aggraver un pronostic qui aurait pu être bon, voire de générer des états végétatifs ou pauci-relationnels chez des patients qui auraient dû, s’ils avaient bénéficié d’une intensité thérapeutique maximale, évoluer avec peu de séquelles […] C’est une des conséquences les plus perverses d’une mauvaise prise en charge de la fin de vie en neuro-réanimation » (106)
L’étude LATAREA - 2, précédemment citée, indique que, dans les 113 centres de réanimation qui avaient fait l’objet de l’enquête, 55,7 % des décès étaient liés à une décision de limitation ou d’arrêt de traitement. L’enquête avait dégagé six facteurs déterminant l’appréciation de l’obstination déraisonnable : la conviction d’une absence de survie, l’absence de marge thérapeutique, la certitude diagnostique, l’absence d’autonomie future, l’absence de qualité de vie future et l’âge – les occurrences de ces facteurs de décision variant de 85 % pour le premier à 46 % pour le dernier. Ces items sont d’une particulière importance. Ils éclairent en effet les fondements sur lesquels se construit la démarche évaluative des soins dans un cadre éthique téléologique. Si certaines de ces motivations, en particulier celle portant sur la « qualité de vie future » renvoient à des problématiques éthiques complexes et disputées, le fait qu’elles soient formulées et discutées collégialement en lien avec la famille apporte à la démarche thérapeutique une rationalité partagée et responsable. Une étude a par ailleurs été lancée en octobre 2008 dans une vingtaine d’unités neurovasculaires françaises qui aura pour but d’évaluer les bénéfices d’une réanimation dans le cas des patients admis pour un accident vasculaire cérébral ; elle permettra de comprendre les déterminants des décisions d’arrêt ou de limitation de traitements dans des situations liées à une mortalité élevée en réanimation et qui représentent la première cause de handicap en France.
Cependant pour certaines catégories de patients, en particulier quand il s’agit de malades cérébro-lésés, des décisions de limitation ou d’arrêt des traitements peuvent difficilement être envisagées à ce stade du fait que, comme l’a expliqué le Docteur Anne-Laure Boch, neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, « […] le pronostic du patient est très incertain. Le malade que l’on réanime peut mourir malgré tous les efforts, guérir avec peu de séquelles, survivre avec de lourdes séquelles, et l’état actuel des connaissances scientifiques ne nous permet pas de le savoir à ce stade. L’obstination thérapeutique à cette phase n’est donc pas déraisonnable, mais plutôt incertaine, reposant sur un espoir mal fondé, probabiliste, plutôt que sur une raison déterministe sûre de son fait. » (107) Le même principe selon lequel le doute profite à la vie conduit dans cette situation à écarter toute décision de limitation ou d’arrêt de traitement, même si à ce stade où la vie du patient est suspendue à des moyens techniques lourds, la décision serait, comme le dit le Docteur Anne-Laure Boch « assez facile à mettre en œuvre »(108).
D’après les explications apportées par le Professeur Louis Puybasset, le progrès des techniques d’imagerie médicale met maintenant à la disposition des médecins de nouveaux outils d’anticipation qui rendent possible d’établir des pronostics fiables beaucoup plus tôt au cours de la réanimation. Le recours à ces techniques reste certes difficile : les algorithmes IRM ne sont pas encore finalisés et les premières études sont en cours de publication ; en outre, des moyens lourds et une grande disponibilité des équipes médicales et neuro-radiologiques sont requis pour réaliser sans risque une IRM d’environ 90 minutes à un patient intubé et ventilé. Mais quand ces techniques peuvent être mises œuvre, il devient possible de prévoir, selon le Professeur Louis Puybasset « pour un certain nombre de patients, trois à cinq semaines après l’accident initial, avec un haut degré de certitude, que le pronostic à long terme sera un handicap très sévère affectant la conscience, c’est-à-dire que tel malade sera à un an dans un état végétatif chronique (EVC) ou dans un état pauci-relationnel (EPR) associé à différentes autres atteintes des fonctions supérieures. (109) »
L’avancée du pronostic dans le temps change profondément les conditions dans lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt de traitement peut être envisagée : « jusqu’à très récemment, souligne le Professeur Louis Puybasset, il n’était pas possible de porter un pronostic alors que le patient était en réanimation. Il ne pouvait être affirmé qu’à un an, une fois établi cliniquement durant ce que l’on appelle la phase de consolidation. » (110) Comme l’explique le Docteur Anne-Laure Boch : « Nous disposons […] d’un petit créneau où le patient dépend encore de la réanimation et où le pronostic peut être précisé.» (111) A mesure que le corps recouvre une part grandissante de sa condition naturelle, le critère de l’artificialité du maintien en vie ne fait plus l’objet du même consensus. En avançant le moment du pronostic, le caractère déraisonnable de la poursuite des soins demeure suffisamment marqué pour motiver, le cas échéant, une décision de retrait thérapeutique ; une décision prise dans ces conditions est accompagnée de moins de souffrance morale pour l’équipe soignante et pour l’entourage du patient.
3. L’appréciation de l’obstination déraisonnable en néonatologie
a) Un questionnement éthique ancien renouvelé par la loi du 22 avril 2005
Les progrès réalisés en néonatologie depuis les années 1980 ont apporté aux médecins des moyens techniques particulièrement performants pour faire survivre les nouveau-nés en détresse à la naissance. 16 000 enfants par an, sur les 800 000 naissances annuelles en France, font ainsi l’objet de prises en charge lourdes dans la période néonatale. Les risques d’escalades thérapeutiques induits par cet environnement technique semblent cependant conjurés, selon le Professeur Umberto Simeoni, président de la commission d’éthique de la société française de néonatologie, par le fait que les néonatologues « ont vite compris (…) que dans certains cas on allait faire plus de mal que de bien. L’idée de s’abstenir de soins intensifs ou de pratiquer un retrait thérapeutique dans le cas où le pronostic fonctionnel est trop défavorable a été d’emblée présente. » (112) Le principe introduit par l’article 1er de la loi du 22 avril 2005 posant que les actes de prévention, d’investigation ou de soins « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » a donc eu à s’appliquer dans une spécialité médicale où les interrogations éthiques sont anciennes et leurs formulations connues par diverses recommandations de bonnes pratiques (113). Ces prises de position éthiques expriment la conscience claire qu’a le néonatologue de sa responsabilité morale envers des nouveau-nés dont la vie future, dans ses modalités physiques et partiellement psychologiques, dépend des gestes médicaux qu’il décide d’entreprendre ; elles reflètent sa conviction que les décisions thérapeutiques sont à évaluer à la lumière du principe hippocratique primum non nocere.
Il apparaît, au travers des auditions menées par la mission parlementaire, que la loi sur les droits des malades et la fin de vie a eu une double conséquence sur les pratiques des néonatologues. En faisant de l’interdiction de l’obstination déraisonnable la limite légale de l’action thérapeutique, cette loi a exclu en premier lieu toute pratique d’euthanasie active et imposé la prise en charge palliative de l’enfant dans les cas où décision est prise de ne pas poursuivre les traitements. Comme l’a souligné le Docteur Pierre Betremieux, chef du service de réanimation pédiatrique et néonatale au centre hospitalier universitaire de Rennes, « La loi de 2005 a fait prendre conscience aux néonatologistes qu’il leur était obligatoire dans certains cas de recourir aux soins palliatifs. Nous ne le savions pas auparavant. Les services de réanimation abordaient les fins de vie sans cette notion. » (114)
Par ailleurs, l’inscription dans la loi de principes qui n’étaient formulés jusqu’alors que par des dispositions du code de déontologie médicale et recommandés par les codes de bonnes pratiques a permis d’asseoir les décisions médicales sur des règles juridiques reconnues et imposées par l’ensemble du corps social. La position du médecin en est renforcée, comme l’a relevé la Professeur Delphine Mitanchez : « Si cette loi a posé une limite aux pratiques de limitation de soins, elle nous donne en revanche une légitimité lorsque nous refusons une réanimation ou la poursuite de soins qui paraissent déraisonnables. » (115). Une décision de limitation ou d’arrêt de traitement n’est plus prise dans le secret de la conscience du médecin ; elle s’appuie sur une argumentation discutée avec l’équipe soignante et la famille. « Nous sommes convaincus, a expliqué le Professeur Umberto Simeoni, que la loi de 2005 a déjà apporté beaucoup : elle place les médecins dans une position bien plus claire, voire plus confortable, pour éviter, en dialogue avec les parents, l’obstination déraisonnable. » (116)
b) La prise en compte de la qualité de la vie future de l’enfant
L’application de la loi du 22 avril 2005 laisse cependant ouvertes de nombreuses questions éthiques propres aux services de néonatologie. La Professeur Delphine Mitanchez fait ainsi remarquer : « Il arrive que l’obstination déraisonnable soit évidente, mais, pour un patient donné, tout le monde n’estime peut-être pas la même chose…» (117) Si le cadre collégial dans lequel s’inscrit cette réflexion doit permettre de faire émerger un accord raisonnable pour évaluer l’opportunité de ne pas entreprendre ou de suspendre des traitements, le questionnement se complique, du fait que la recherche du soin proportionné en pédiatrie en appelle à des considérations de portée différente de celles concernant un patient adulte en fin de vie : d’une part, le souci naturel de la vie future de l’enfant, qui renvoie à la responsabilité qu’a une génération envers celle qui la suit ; d’autre part, la prise en compte de l’avenir de la famille, en particulier celui de la mère de l’enfant et de la fratrie (118). À la différence de l’adulte, cet état à venir est la totalité de la vie de l’enfant, un enfant qui est encore « au seuil de la vie ; l’instant zéro d’un être » selon les termes du Professeur Umberto Simeoni (119). Le mode de raisonnement ainsi mis en œuvre relève du conséquentialisme le plus strict : il s’agit d’anticiper les conséquences de ses actes, en premier lieu sur la durée d’une vie de plusieurs années, mais aussi sur le devenir de la famille de l’enfant sur la même durée voir au-delà (120). Cette anticipation prend son sens dans un jugement de valeur sur la vie : humaine ou inhumaine, bonne ou insupportable, telle qu’elle vaut la peine ou non d’être vécue. Or, une telle anticipation des conséquences est parfois techniquement incertaine et toujours moralement disputée.
Les outils de pronostic issus notamment des techniques d’imagerie médicale ne sont en effet pas à même d’orienter le sens des décisions thérapeutiques. Ainsi, avant la naissance, comme l’explique la Professeur Delphine Mitanchez, dans le cas des agénésies diaphragmatiques « Les équipes obstétricales tentent de déterminer des facteurs pronostiques anténataux fondés sur l’échographie ou l’IRM. Jusqu’à présent, on a établi des relations statistiques entre certains paramètres et le taux de survie. Je considère que ces données ne sont pas applicables individuellement au moment du conseil prénatal. Il faut que l’enfant naisse et que l’on évalue après la naissance ses capacités respiratoires. » (121)
Le recours à des pronostics fondés sur des évolutions statistiques conduisant à instaurer des limites d’âge en deçà desquels une réanimation pourrait être estimée disproportionnée ne semble pas non plus légitime selon le Professeur Umberto Simeoni : « (…) malheureusement ou heureusement, les données de la médecine ne permettent pas de définir un seuil scientifiquement établi. On ne peut déterminer, par exemple, qu’en dessous de mille grammes ou de vingt-six semaines de gestation, l’état d’un enfant sera bien pire. On a affaire à un continuum (…) Nous savons maintenant que le pronostic, pour un enfant prématuré, est multifactoriel et ne saurait se résumer au poids à la naissance ou à la durée de gestation. Comme toujours en médecine, c’est dans la relation singulière entre le médecin et le patient, guidée par les statistiques, que l’on peut tenter de l’établir tout en intégrant les derniers acquis de la science. » (122) Bien que l’Académie nationale de médecine ait, pour sa part, avancé la limite de 25 semaines d’aménorrhée à partir de laquelle « l’expérience médicale et les données de la littérature justifient la mise en œuvre de soins destinés à favoriser la survie du prématuré en salle de naissance puis en unité de néonatologie », elle reconnaît aussi « qu’il paraît encore difficile de fixer une limite arbitraire et irréversible de viabilité. » (123)
En outre, le problème se complique du fait que, comme l’explique le Professeur Umberto Simeoni : « Du point de vue médical, on sait que le nouveau-né est dans une phase critique du développement et que toute agression ou lésion, notamment cérébrale, peut avoir des conséquences plus graves que sur un cerveau développé. En même temps, le nouveau-né possède une grande force de récupération pour ce qui est des principales fonctions vitales autres que neurologiques, si bien que la question de l’arrêt des soins se pose souvent à un moment où le patient n’est plus dépendant des soins intensifs. » (124) Ce problème, déjà soulevé dans le cas des cérébro-lésés adultes, apparaît ainsi plus grave à ce stade de la vie ; l’enfant devenant rapidement viable, une éventuelle décision médicale d’arrêt de traitement ne peut plus être envisagée qu’au vu du diagnostic d’un état futur de l’enfant ayant récupéré l’autonomie de ses grandes fonctions vitales.
Dans le cas des nouveau-nés grands prématurés(125), les résultats de l’étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels (EPIPAGE) menés par l’Inserm (126) étayent les interrogations éthiques soulevées par l’état de santé de ces enfants dont la technique médicale a permis la survie. Il apparaît selon cette enquête (127) que 5 ans après leur naissance un tiers des anciens grands prématurés requiert une prise en charge médicale ou paramédicale spécifique et que 40 % d’entre eux présentent une déficience motrice, sensorielle ou cognitive ; les taux de déficience sont d’autant plus élevés que les enfants sont nés plus prématurément. Le Professeur Umberto Simeoni s’est interrogé sur le sens à donner à ces chiffres : « Il faut certes en tirer des conséquences en termes de prudence, mais l’étude n’indique pas à partir de quand les soins ont un sens et à partir de quand cela devient de l’obstination déraisonnable. Elle a, comme toute étude statistique, son intérêt et ses limites. Elle montre que 10 à 15 % de ces enfants ont des séquelles graves – ce qui signifie que 85 à 90 % n’en ont pas (…) » (128) L’intérêt de ce type d’enquête est, comme l’a commenté le Professeur Guy Moriette, un des auteurs de l’étude, « de montrer qu’il y a des choses à faire pour minimiser les risques » (129), à savoir améliorer les structures d’accueil des enfants handicapés ; aussi l’information statistique selon laquelle, par exemple, 18% des enfants nés à 24-26 semaines de grossesse présentent des handicaps cognitifs sévères à 5 ans ne pourra pas ne pas être prise en compte par une équipe soignante s’interrogeant sur le sens des actes thérapeutiques qu’elle effectue sur un enfant né à cet âge. Ce chiffre se présente cependant comme un facteur de risque et non comme un seuil qui départagerait ce qui est permis de faire de ce qui ne l’est pas.
La question de la qualité de vie future de l’enfant renvoie à celle du handicap acceptable. Ce qui pourrait être acceptable pour l’enfant restant inconnu, les motivations ne reposent que sur ce qui est acceptable pour l’équipe de soins et pour la famille. Les membres de l’équipe de soins appuient leur réflexion sur les descriptifs statistiques dont ils peuvent disposer, avec les réserves précédemment indiquées, et sur leurs propres convictions personnelles. Sur cette seule base, et aussi développée que puisse être la discussion collégiale, les motivations d’un arrêt de traitement paraîtront toujours fragiles.
Ce qui pourrait être acceptable pour la famille est par contre plus aisé à déterminer. Ce constat a été fait par la Professeur Delphine Mitanchez : « Il peut paraître excessif, de la part des néonatologistes, de décider ce que doit être la qualité de vie d’un enfant et de poursuivre ou non, sur ces éléments, une réanimation. Je pense cependant que nous n’avons pas le droit de détruire une famille et la vie de frères et de sœurs en leur imposant la prise en charge d’un enfant lourdement handicapé. Cette prise en charge peut être source de paupérisation : il arrive que les parents ne puissent continuer leur travail et les allocations complémentaires ne peuvent compenser un salaire. Elle peut aussi être source de carences pour la fratrie en raison de l’indisponibilité des parents. (130) » Le contenu des cette analyse est partagé par le Professeur Louis Puybasset : « […] n’est-ce pas à la famille, qui va finalement assumer matériellement les conséquences du handicap, de prendre en partie les décisions et de fixer ce qu’elle définit comme un handicap“ acceptable ”? » (131)
Dans cette recherche de la meilleure décision, l’avis de la famille doit néanmoins être lui-même évalué par l’équipe soignante ; comme l’explique le Professeur Louis Puybasset « Pour certaines familles […] il ne faudrait accepter de continuer les traitements que si le handicap prévisible est modeste. Ceci nous met parfois en position de devoir protéger le patient contre sa famille. » (132)
Cette confrontation des normes renvoie, selon l’analyse du Professeur Umberto Simeoni, « à la tolérance qu’a une société donnée vis-à-vis de l’enfant différent, de l’enfant porteur d’un handicap, surtout lorsqu’il s’agit d’un être dont toute la vie est devant lui. Cette donnée est sans doute le principal déterminant des tensions éthiques et médicales qui se posent dans le domaine de la néonatologie. » (133)
c) Les arrêts de traitement et les arrêts de vie
Le constat qu’une vie peut être pire que la mort a justifié, dans des services de pédiatrie néonatale, des pratiques d’« arrêts de vie » consistant, dans des cas extrêmes, à procéder à un geste létal par lequel la mort est intentionnellement donnée. La culture des soins palliatifs conduit, semble-t-il, les néonatologues à considérer autrement ces situations désespérées pour l’enfant et désespérantes pour la famille comme pour l’équipe soignante. Comme l’a expliqué le Docteur Pierre Betremieux « Depuis plus de deux ans, nous sommes plusieurs confrères à réfléchir à la façon d’appliquer les différents concepts de soins palliatifs à la période néonatale. » (134) Lorsque la vie est pire que la mort, le choix est fait non pas d’anticiper la mort mais d’accompagner, après une décision d’arrêt de traitement, la vie qui se termine. Ainsi, constate le Docteur Pierre Betremieux « […] il existe toute une série de situations où l’on a pu, grâce à la loi d’avril 2005, prodiguer des soins dans une optique humaniste, avec le soutien des parents et des professionnels, de façon à ce que l’issue se produise dans des conditions que chacun reconnaît comme sereines. » (135)
Le choix de privilégier le recours à des soins palliatifs, s’il constitue une réponse moralement souhaitable et légalement obligatoire, est cependant, comme le souligne le Professeur Umberto Simeoni « loin d’être une évidence, car cet arrêt thérapeutique est dicté par la crainte d’une survie. » (136) Les termes de la loi du 22 avril 2005 et la démarche de la culture palliative dans laquelle elle s’inscrit répondent en effet à la situation d’un patient dont l’état, après l’arrêt de traitement, évolue naturellement vers la mort. Mais lorsque le retrait des thérapies n’entraîne pas le décès, des situations particulièrement difficiles peuvent se créer. Prenant l’exemple d’un enfant qui après réanimation présente de très graves lésions cérébrales et qui poursuit « sa vie biologique avec des battements de cœur, des mouvements respiratoires, parfois des mouvements de déglutition alors que le cerveau ne commande plus rien » (137), le Docteur Pierre Betremieux expose les problèmes que rencontre l’équipe soignante : « C’est dans ces cas que l’on va mettre en œuvre des soins palliatifs (..): ces soins sont longs, la mort n’est pas imminente, la maladie est grave et incurable mais elle n’est pas évolutive. On finit par transférer les enfants vers des institutions, dans des conditions souvent assez tristes. Il est parfois nécessaire de pratiquer des gastrostomies et des trachéotomies. L’enfant, qui est dans un état grabataire, finit par mourir un jour d’infection pulmonaire. C’est une situation très difficile à supporter pour l’enfant, pour la famille et pour les professionnels qui s’en sont occupés. » (138) Cette situation, a constaté le Professeur Umberto Simeoni, « a donné lieu et donne probablement encore lieu aujourd’hui mais beaucoup moins, au choix de mettre fin intentionnellement à la vie d’un enfant lorsque le soignant et les parents pensent que, même en interrompant toutes les thérapeutiques curatives, celui-ci risque de survivre dans des conditions qu’ils considèrent comme épouvantables. [Ces attitudes] ne sont pas légales. Néanmoins elles sont considérées comme humaines et sont accompagnées d’un souci de bienfaisance extrême ». (139)
d) Les interruptions médicales de grossesse et les arrêts de traitement
L’interdiction de poursuivre des thérapies par une obstination déraisonnable paraît avoir modifié l’attitude de certaines mères confrontées à une proposition d’interruption médicale de grossesse. L’article L. 2213-1 du code de la santé publique dispose que « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. » Dans cette seconde hypothèse, la Professeur Delphine Mitanchez rapporte que « de nombreux parents renoncent à l’idée initiale d’interrompre la grossesse parce qu’ils savent que nous arrêterons la réanimation si l’état respiratoire de l’enfant paraît incompatible avec une survie de qualité acceptable. C’est un point très important : le fait de pouvoir décider de la survie ou non de l’enfant en période postnatale permet à de nombreux couples de donner une chance de survie – de qualité acceptable – à un enfant alors que la grossesse aurait pu être interrompue. » (140)
Cette attitude semble être un phénomène récent qui « tend à se répandre très rapidement » (141) selon le Docteur Pierre Betremieux, mais dont, en raison de l’absence de données statistiques, il est difficile d’apprécier l’ampleur réelle. Il s’agit, en tout état de cause, d’une approche de la loi du 22 avril 2005 qui n’avait pas été envisagée au moment de sa discussion, et qui n’est pas sans paradoxe : en se posant comme une alternative toujours ouverte à l’action, l’encadrement légal du juste soin et de l’accompagnement du mourant justifie, en amont, un acharnement thérapeutique au sens positif d’une démarche recourant à tous les moyens techniques pour « donner une chance à la vie ».
Pour autant, ce choix ne saurait être compris comme consistant en un simple report de décision qui ferait penser que l’acte létal refusé pendant la grossesse pourrait toujours être entrepris après la naissance dans le cas où ne se serait pas réalisée cette chance donnée à la vie. Le statut de droit de l’enfant se différenciant de celui du fœtus, l’acte létal, possible avant la naissance, constitue un homicide une fois l’enfant né. C’est pourquoi la décision visée à l’article L. 2213-1 relative à l’interruption médicale de grossesse et celle introduite par la loi du 22 avril 2005 relative à l’arrêt de traitement sont distinctes. La première ne se substitue pas à la seconde ; l’une porte, selon l’expression du doyen Carbonnier, sur un sujet de non-droit, l’autre sur un sujet de droit.
Le Professeur Umberto Simeoni a insisté sur la nécessaire mise en garde qu’il convient de faire aux parents dans ce cas : « Il faut que la mère ou le couple soit parfaitement informé du fait que l’intentionnalité change : après la naissance, si l’anomalie n’est pas létale, l’enfant qui en est porteur va survivre. » (142) Le Docteur Betremieux a rappelé la position des néonatologues dans ces situations : « C’est tout le sens de notre démarche auprès des parents dans la phase anténatale. S’ils choisissent de rencontrer leur enfant vivant, il nous appartient, à nous pédiatres, de les informer que cet enfant pourra vivre malgré la gravité de la malformation et qu’il est impossible de livrer un pronostic de durée. Nous accompagnerons bien sûr cet enfant et nous ne proposerons pas de soins disproportionnés ; néanmoins, il est hors de question d’attenter à sa vie. Toutes les équipes, en France, sont très claires sur ce point. » (143)
4. L’appréciation de l’obstination déraisonnable à l’égard des patients en état végétatif
Au nombre de 1 600 en France, les patients plongés dans un état végétatif chronique ou pauci-relationnel ont une espérance de vie diversement évaluée allant de six ans (144) à quinze ans (145).
Le Professeur Louis Puybasset a expliqué que ces patients présentaient les caractères suivants : « L’état végétatif se définit par l’absence de relation avec l’environnement et un retour aux cycles veille-sommeil. Il est très rare à long terme. L’état pauci-relationnel appelé « minimaly conscious state » en anglais est plus fréquent. Il fait souvent suite à l’état végétatif dont il est un mode de sortie fréquent. Il se caractérise par des réponses fluctuantes aux ordres simples, la localisation de la douleur, la poursuite visuelle, l’expression de pleurs et de sourires. Il y a une dépendance totale vis-à-vis de l’entourage et la nutrition est nécessairement artificielle. Le patient a une vie relationnelle extrêmement limitée. » (146)
Dans le cas des enfants, le Docteur Pierrre Betremieux a précisé qu’il s’agissait « de lésions cérébrales majeures entraînant une vie grabataire sans aucun mode relationnel. L’enfant restera sourd, aveugle, généralement tétraplégique. Il devra subir des interventions chirurgicales répétées – ténotomies, notamment – pour éviter que ses articulations ne se luxent. C’est une situation véritablement horrible qu’il ne faut en aucun cas assimiler à du handicap banal. » (147)
Mme Danièle Pierra, mère de Vincent Pierra, a décrit, au cours de son audition, l’état physique dans lequel était son fils : « Notre fils était dans un coma végétatif chronique irréversible depuis huit ans et demi, trachéotomisé et nourri par sonde gastrique. Les seules manifestations de vie étaient de violentes expectorations, dont nous retrouvions souvent les sécrétions sur le mur en face de lui voire au plafond. Ces expectorations entraînaient régulièrement des régurgitations. Son corps se figeait dans l’immobilité et la rigidité ; il n’était plus vraiment vivant et pas vraiment mort. Son squelette adoptait une position fœtale, avec de très importantes déformations – c’est pourquoi il n’était jamais déplacé – et il ne tenait pas sa tête. » (148)
Dans ces situations complexes, la problématique éthique des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement telle que l’encadre la loi du 22 avril 2005 a été clairement résumée par le Docteur Michèle Lévy-Soussan, responsable de l’Unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière : « La loi du 22 avril 2005 n’en a en rien réduit la complexité ni la sensibilité mais elle a donné un cadre permettant d’y réfléchir. Les questionnements qui nous occupent sont nouveaux car, jusqu’à présent, le recours à la technique médicale ne pouvait être que bienfaisant. Ce n’est que récemment que l’on s’interroge sur la pertinence d’une intervention médicale et que l’on en vient à limiter certains supports. » (149)
a) La protection des droits du patient en état végétatif
Dans quelle mesure les médecins peuvent-ils envisager de prendre, dans le cas de patients en état végétatif, des décisions médicales de limitation ou d’arrêt de traitement sur le fondement de la loi du 22 avril 2005 ? Trois difficultés sont en effet avancées : elles ont trait à la définition médicale de ces malades au regard de cette loi, au traitement qui leur est appliqué et à leur statut juridique.
Le patient végétatif chronique n’est pas en fin de vie – il peut vivre plusieurs années – et il n’est pas atteint d’une maladie évolutive. Ce fait a été souligné en particulier par le Docteur Anne-Laure Boch : « Ces malades, souvent jeunes et en bonne santé générale – il faut être assez costaud pour en arriver là –, font rarement des complications impliquant le pronostic vital (150) ». La situation de ces patients rentre-t-elle alors dans le cadre d’une loi consacrée à la fin de vie ? En douter serait méconnaître le dispositif juridique mis en place par la loi du 22 avril 2005. En effet, si ces patients ne relèvent pas, vu leur état, de l’article L. 1111-13 du code de la santé publique où sont définies les modalités de limitation ou d’arrêt de traitement pour les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable », le principe posé à l’article L. 1110-5 qui interdit la poursuite de traitement par une obstination déraisonnable leur est applicable puisqu’il est de portée générale.
La deuxième difficulté vient de ce que le maintien artificiel en vie de ce type de patient ne passe pas par une prise en charge technique lourde mais par des soins de confort et une alimentation artificielle. Cette situation répond-elle aux critères d’une obstination déraisonnable qui porte sur des traitements inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre objet que la prolongation artificielle de la vie ? Cette question renvoie au statut à donner à l’alimentation artificielle ; la problématique est abordée ci-après dans le cadre des modalités d’arrêts de traitement.
Le troisième problème est d’ordre juridique. Une décision de limitation ou d’arrêt de traitement abrégeant la vie d’une personne en état végétatif prise sur la base, par exemple, d’un jugement sur la qualité de vie du patient, respecte-t-elle son statut de sujet de droit ? La Cour d’Appel de Bordeaux avait eu l’occasion de réaffirmer par un arrêt en date du 18 avril 1991, que l’état de droit de la personne dans cette situation demeure inchangé : « A moins de la considérer comme morte civilement et devenue simplement objet de soins assurant son maintien en une vie devenue artificielle, la victime d’atteintes gravissimes et maximales à la conscience doit être respectée dans sa dignité humaine et protégée en tant que personne ; qu’elle demeure sujet de droit, même si, selon les données actuelles de la science médicale, elle est considérée comme privée de conscience, ne possédant plus qu’une vie végétative et se trouvant dans un état estimé irréversible ». Aucun médecin auditionné par la mission parlementaire n’a défendu l’idée que ces patients ne seraient plus qu’un assemblage d’organes placé hors du champ de la reconnaissance et de l’humanité (151). Le Docteur Régis Aubry a rappelé avec vigueur que : « C’est l’honneur d’une démocratie de considérer qu’un individu, fut-il dénué de conscience, est encore une personne. » (152) Mais c’est précisément du fait qu’il est et demeure un sujet de droit (153), que le patient dans un état végétatif ou pauci-relationnel doit se voir reconnaître ses droits de personne malade tels que définis par la législation. La protection que lui apporte la loi contre l’acharnement thérapeutique lui est donc due, comme à tout autre.
b) La fin de vie des patients en état végétatif
L’évaluation des critères de l’acharnement thérapeutique diffère selon que le patient est dans un état végétatif chronique ou dans un état pauci-relationnel.
Dans le cas les plus graves des végétatifs chroniques dont les atteintes cérébrales sont telles que le sujet ne manifeste aucune trace d’une activité psychique, les traitements peuvent être qualifiés d’inutiles et de disproportionnés puisqu’il n’y a plus de conscience au profit de laquelle, même de façon minimale, serait porté le bénéfice éventuel d’actes thérapeutiques(154). En outre, même si les gestes médicaux se limitent à du nursing et à l’apport artificiel de nourriture, leur effet n’est pas de maintenir un certain degré de bien-être mais de prolonger artificiellement la vie d’un corps sans conscience.
Cependant, dans ce cas extrême, il ne saurait être procédé à une application de ces critères sans qu’il ne soit tenu compte, comme le prévoit la loi du 22 avril 2005, de l’avis de la personne de confiance, de la famille, des proches et le cas échéant des souhaits qu’aurait pu manifester le patient dans des directives anticipées. Le Docteur Régis Aubry a ainsi pu rappeler que « Le sens de la vie d’un autre est très difficile à aborder. Pour de nombreuses familles, la vie végétative a un sens, qu’il faut respecter. » (155) Il convient ainsi d’apprécier le contexte particulier dans lequel s’inscrit chaque cas singulier. Une décision de limitation ou d’arrêt de traitement d’un patient en état végétatif chronique demeure une prise de position particulièrement grave pour une équipe soignante amenée à réfléchir sur la finalité de son action et sur le bénéfice de celle-ci pour le patient et son entourage ; cette démarche ne peut se réduire à l’application mécanique de critères légaux.
Plus complexes encore sont les interrogations portant sur les patients en état pauci-relationnel pour lesquels sont attestées des manifestations d’une activité émotionnelle ne relevant pas du réflexe organique. La poursuite des soins et des traitements n’a alors pas pour finalité le seul maintien artificiel de la vie biologique mais la conservation d’un certain pouvoir relationnel. La question de savoir dans quelle mesure ces traces d’activité psychique soumises à l’interprétation de tiers présentent l’unité structurelle nécessaire pour être considérées comme des signes révélateurs d’une vie psychique et caractériser effectivement la présence d’une entité psychique autonome (à la différence des personnes atteintes d’un locked-in-syndrom qui conservent toutes leurs capacités mentales (156)) est très difficile à trancher (157). Il apparaît néanmoins certain que le respect des droits de ces patients doit être garanti et la question du juste soin pouvoir être soulevée.
L’obligation d’évaluer l’état du malade, sans exclure d’envisager une limitation ou un arrêt de traitement, s’impose d’autant plus au médecin que l’hypothèse selon laquelle ces patients peuvent souffrir ne doit pas être écartée. La question est complexe comme l’a expliqué le Docteur Stéphane Donnadieu : « Quel est l’état des voies de transmission et de contrôle de la douleur d’un cérébro-lésé grave ? On sait aujourd'hui que la douleur est la résultante de l’activation des voies de perception de la douleur et des voies de contrôle de la douleur. S’il n’y avait pas ces voies de contrôle de la douleur, on peut penser que l’homme serait naturellement douloureux. » Des travaux récents ont mis en évidence une perception potentielle de la douleur chez les patients pauci-relationnels (158).
Poser la question de la volonté du malade est dans ce cas d’une importance particulière. Il s’agit certes d’une fiction puisque le patient n’a plus de volonté. Mais son statut de sujet de droit lui confère une unité à travers le temps qui légitime qu’on se réfère aux jugements sur la vie que celui-ci avait pu émettre du temps où il était encore conscient. En ce sens, il est ce qu’il a été et non ce qu’il est devenu (159). C’est pourquoi, par exemple, les directives anticipées demeurent valides pour une personne inconsciente « quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. » (art. R. 1111-18 du code de la santé publique). Cette situation où l’état du malade est si grave qu’aucun pronostic laissant espérer un retour d’une activité psychique consciente ne peut être établi, se distingue de beaucoup de celle où des doutes sont entretenus sur la variation de la volonté du malade qui trouvera peut-être supportable ce que, bien portant, il avait déclaré inacceptable. La durée de la survie du patient végétatif est telle qu’elle équivaut à une seconde existence dans laquelle et à propos de laquelle il n’a plus la faculté de formuler une norme de jugement ; la possibilité d’ouvrir un horizon de sens où il pourrait inscrire son existence, même très diminuée, lui est ôtée du fait de son état. Les critères de qualité de vie que le patient avait pu exprimer avant son accident doivent donc être considérés comme valides pour évaluer son état présent. « Aurait-il voulu se voir dans cet état ? » est la seule question qui conserve un sens, aussi anachronique et désespérée soit cette interrogation. (160)
En l’absence ou en complément de ce critère, l’interrogation se formule, comme l’explique le Professeur Louis Puybasset, dans les termes suivants : « faisons-nous le bien pour ce patient en poursuivant l’utilisation de techniques de suppléance artificielle alors que nous savons que le retour à une vie relationnelle est impossible ? » (161). Dans cette approche, le principe éthique de non malfaisance conduit à mettre en avant le critère de « qualité de vie » lui-même caractérisé à la lumière de la notion de « vie relationnelle » : une vie sans relation interhumaine est une vie sans qualité que l’obligation de ne pas nuire interdit au médecin de maintenir.
Cette réponse renvoie à une série de questions : qu’entend-on par vie relationnelle, à savoir à partir de quand y a-t-il relation ou non ? La vie relationnelle épuise-t-elle le champ de ce qui peut être appelé la qualité d’une vie ? La qualité d’une vie peut-elle être définie en dehors d’une perspective subjective et dans ce cas quel sujet aurait la légitimité de faire valoir son appréciation ? La vie a-t-elle à être évaluée du point de vue de sa qualité ? La vie a-t-elle simplement à être évaluée ?
En fonction des réponses apportées, un seuil d’acceptabilité pourra être fixé : l’appréciation éthique à laquelle a abouti l’équipe médicale dirigée par le Professeur Louis Puybasset conduit par exemple à estimer qu’une très haute probabilité de vie végétative sans signe relationnel avéré peut être un critère d’action pour poser la question d’un arrêt de traitement. Cette « barre » sera pour les uns trop basse, pour les autres trop haute ; mais la question du caractère acceptable ou non de la situation dans laquelle est plongé le malade doit être posée.
D’autres médecins ont une approche différente : une expression émotionnelle du patient pauci-relationnel, aussi informe soit-elle, serait déjà un signe relationnel qui fait obligation au médecin de maintenir les traitements de survie. L’état du malade n’est jamais inacceptable. Dans cette dernière perspective, le Docteur François Tasseau chef du service de rééducation post-réanimation au centre médical de l’Argentière, est amené à affirmer qu’« il existe un clivage entre les efforts des professionnels de la rééducation et des familles pour maintenir une relation avec ces personnes et un environnement social qui estime qu’il " vaudrait mieux qu’elles soient mortes" » (162).
Dans un article édité en 1991, Mme Anne Fagot-Largeault, professeur de philosophie au Collège de France, mettait en perspective la diversité des sources morales qui irriguent toujours la réflexion éthique médicale : « notre morale commune est un mélange de conformisme, de bons sentiments, et de bribes de traditions hétérogènes : stoïque, cynique, chrétienne, etc. La morale médicale elle-même est une mixture de préceptes évidemment téléologiques (d’abord ne pas nuire, ensuite tout faire pour que la santé du malade s’améliore, enfin contribuer à l’amélioration de la santé publique), et de préceptes déontologiques (respect de la vie privée, non-discrimination). Est-ce à cause de ce flou théorique, ou malgré ce flou, ou par une sorte d’évidence des situations, ou par un effet régulateur de la communication même infra-discursive, qu’il est en général assez facile de réunir un consensus autour d’un cas concret ? » (163) Si ce consensus a été constaté au cours des auditions dans la majorité des situations qui se présentent en réanimation ainsi que pour les personnes en fin de vie au stade terminal d’une maladie, le cas des malades en état végétatif fait à l’inverse ressortir les contradictions entre différents positionnements moraux.
Mais ce sont précisément ces contradictions qui alimentent le questionnement éthique. Au surplus, l’interdiction légale de l’acharnement thérapeutique contraint le médecin à s’interroger sur le sens qu’il donne à son action. Qu’elle soit motivée par un souci exclusif de bienfaisance rendant inapte à donner sens au principe de non malfaisance, par le simple fatalisme ou par un engagement moral personnel, la loi condamne clairement toute attitude d’attente qui aurait pour conséquence de laisser dépérir pendant de longues années des individus hors d’état d’exprimer leur volonté, sans qu’un argumentaire propre à chaque cas ne soit construit, formulé et communiqué. Cet argumentaire repose sur de nombreux éléments : la volonté passée de la personne si elle s’est exprimée, son état actuel, la douleur qu’elle pourrait ressentir, l’évolution de son état et la prise en compte de son intérêt au regard de cet avenir, la douleur aussi de sa famille et son devenir, les obligations déontologiques du médecin et les contraintes légales, enfin les argumentations développées pendant la discussion collégiale éclairées éventuellement par les avis de la famille et des proches. La réunion de ces faisceaux d’éléments doit conduire à une décision dont le médecin traitant, qui en porte la responsabilité, devra être persuadé qu’elle est la meilleure pour le patient.
Comme l’écrivait Mme Anne Fagot-Largeault, dans l’article précédemment cité : « Lorsque coexistent dans une société démocratique, des personnes ayant des philosophies différentes, les solutions procédurales sont celles qui prévalent s’il faut définir une règle qui s’impose à tous. » Pouvoir rendre compte des choix thérapeutiques effectués selon une rationalité par nature partageable et dans le cadre d’un protocole de réflexion obligatoire sera la garantie que ces choix relèvent d’une évaluation de l’état du patient et non d’un abandon.
C. COMMENT LES DÉCISIONS DE LIMITATION OU D’ARRÊT DE TRAITEMENT SONT-ELLES MISES EN œUVRE ?
1. Le recours aux soins palliatifs
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a rappelé, au cours de son audition que « L’arrêt des traitements […] ne saurait être confondu avec la suspension des soins » (164). Ce principe découle de la loi du 22 avril 2005. La disposition générale (165) qui interdit la poursuite d’actes médicaux par obstination déraisonnable, comme la disposition spécifique (166) introduite par cette même loi relative à l’expression de la volonté des malades en fin de vie, précisent en effet que dans le cas où une décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs. Aux termes de l’article L. 1110-10 de ce code : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. » Obligation légale, ce passage du curatif au palliatif, quand il y a décision de limitation ou d’arrêt de traitement, se heurte à plusieurs difficultés d’application qui ont été exposées par les personnes auditionnées par la mission.
Le changement de culture médicale nécessaire pour procéder à une telle réorientation de la stratégie thérapeutique est en effet profond ; les infirmières en ont en particulier rendu compte. Ainsi, Mme Martine Nectoux, infirmière responsable d’un réseau de soins infirmiers à domicile s’est interrogée sur les réticences de certains médecins à faire appel à des équipes de soins palliatifs : « Pour quelles raisons ? Peur d’être dépossédés de leur engagement au lit du malade ; crainte d’un jugement de valeur sur leurs pratiques ; difficulté à gérer leur disponibilité dans une démarche qui leur semble trop chronophage ; certitude qu’ils font bien et qu’ils n’ont rien à apprendre ; sentiment d’échec et de culpabilité inavouables. » (167) Mme Laure Marmilloud, infirmière dans une unité de soins palliatifs, a également insisté sur la nécessité de concevoir l’approche médicale de la mort à partir d’une pluridisciplinarité qui présuppose que chacun reconnaisse les limites de ses compétences « Il est essentiel, a-t-elle expliqué, pour des équipes de pouvoir faire signe à d’autres lorsqu’elles sont dépassées par une situation, de ne pas se sentir complètement seules – je pense notamment à la solitude des médecins face à la responsabilité de la prescription, en particulier des médecins libéraux – mais cela suppose d’être convaincu que demander de l’aide n’est pas disqualifiant, ce qui n’est pas gagné. (168) »
Bien que les soins palliatifs interviennent, dans la chronologie des actes thérapeutiques, à la suite des soins curatifs, ils ne peuvent être mis en œuvre au moment opportun et avec le savoir-faire suffisant que s’ils ont été correctement anticipés. Selon Mme Martine Nectoux : « l’anticipation contribue à faciliter des initiatives adaptées dans une réactivité efficace, car réfléchie bien avant l’état d’urgence. Elle évite des souffrances inutiles, des scénarios catastrophes, voire des conflits d’équipes […] Souvent, elle se traduit par la mise en place d’une procédure, d’une démarche protocolisée, mais toujours de manière personnalisée car chaque situation est unique. (169)» L’anticipation, et son corollaire qui est la traçabilité du dossier médical, renvoie cependant à une culture médicale apte, selon l’expression du Docteur Régis Aubry, à porter « un regard global sur le soin qui comporte toujours une dimension palliative. » (170). La technicisation de l’art médical étant source d’une spécialisation extrême peu propice à un tel partage de connaissances, les intervenants devant la mission parlementaire ont été unanimes à reconnaître que seule une formation des médecins intégrant l’enseignement des soins palliatifs dans le cursus universitaire et dans la formation continue sera à même de modifier les pratiques (171).
De même que les soins palliatifs n’ont pas assez pénétré la culture médicale, de même l’évaluation et le traitement de la douleur demeurent insuffisants. Or, la douleur éprouvée ou anticipée est la principale raison pour laquelle une personne en fin de vie peut réclamer la mort. La démarche palliative perdrait de son sens et une limitation ou un arrêt de traitement ne pourraient pas être entrepris si l’équipe soignante n’était pas à même de prendre en charge la douleur du patient. Pourtant, selon le Professeur François Goldwasser, l’état des connaissances scientifiques permet, du moins en cancérologie, de garantir au mourant une fin apaisée : « Parmi les rares objectifs que je peux tenir, il y a précisément celui que le patient ne mourra pas dans les souffrances qu’ont endurées ses parents, ou grands-parents, quand l’usage de la morphine était timide, voire nul. Actuellement, la douleur est parmi les champs thérapeutiques où les progrès ont été les plus significatifs. Aujourd'hui, les douleurs réfractaires, strictement incontrôlables, qui nécessitent une sédation pour permettre à la personne de se reposer sont exceptionnelles en cancérologie. Dans le contrat d’objectifs qu’on peut conclure avec une personne qui ne peut pas guérir, il y a celui qu’elle ne souffrira pas. » (172) Encore faut-il que ce champ thérapeutique soit connu des médecins. En effet, comme l’a expliqué le Docteur Stéphane Donnadieu : « En fin de vie, la douleur est un phénomène extrêmement complexe. Elle envahit le cerveau, se projette dans des aires affectives, émotionnelles, comportementales. La douleur est le facteur qui altère le plus la qualité de la fin de vie. Il faut donc apprendre à la dépister, à déjouer les pièges et à la comprendre. […] Il faut connaître tous les moyens thérapeutiques qui sont maintenant à notre disposition et qui évolueront en fonction du progrès médical. » (173)
Ces progrès passeront par une meilleure connaissance des phénomènes de la douleur qu’aucun moyen scientifique ne permet aujourd’hui de quantifier ; les recherches cliniques semblent cependant rares, ce qu’a déploré le Docteur Stéphane Donnadieu : « nous ne voyons presque jamais passer d’essais cliniques […] ils seraient pourtant nécessaires si l’on veut comprendre ce qui se passe chez les patients en fin de vie. » (174)
Le plan national de prise en charge de la douleur 2006-2010 (175) et le plan de développement des soins palliatifs lancé en 2008 devraient contribuer à apporter les moyens nécessaires pour accompagner ces progrès thérapeutiques (176).
La mise en œuvre des soins palliatifs rencontre cependant l’obstacle de la parcellisation de ses champs d’intervention, lourde de conséquences pour les patients en fin de vie. Le Docteur Régis Aubry a ainsi expliqué que les efforts entrepris pour développer les soins palliatifs devaient renverser « la cloison artificielle qui existe entre le champ médical, le champ sanitaire et le champ médico-social […] ; il faudra bien que les équipes de soins palliatifs interviennent dans tout le secteur médico-social – je pense en particulier aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à ceux qui accueillent des personnes lourdement handicapées où la culture de la fin de vie est ignorée. Nous en arrivons en effet aujourd’hui à une situation paradoxale et choquante : ce sont les personnes qui ont le plus besoin de soins palliatifs qui doivent se déplacer parfois très loin pour trouver les compétences qui répondent à leurs besoins. (177)»
2. L’arrêt de la nutrition et de l’hydratation
Suspendre un geste médical ou ne pas l’entreprendre relève aussi de l’art et du devoir du médecin. L’admission de ce principe ne va pas cependant sans de profonds désaccords sur les limites à poser à ce retrait des thérapies actives. L’alimentation artificielle est-elle un traitement que le médecin peut arrêter ou est-ce un soin, comme l’hygiène et le « nursing », dû en toutes circonstances au patient ? L’arrêt d’une nutrition artificielle est-elle la transgression d’un interdit ou l’ultime geste raisonnable ?
S’il devait y avoir contentieux judiciaire, le juge ne pourrait que constater que la loi du 22 avril 2005 précise dans son article 3 que « tout traitement » peut faire l’objet d’un refus de la part du malade et qu’en conséquence aucune thérapie n’est exclue dans l’appréciation du juste soin pour un malade inconscient ; s’il avait à éclairer le sens du terme « traitement » à la lumière des débats parlementaires, le juge ne pourrait aussi que relever qu’au cours des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, la nutrition artificielle a été explicitement considérée comme constituant un traitement et que lors de la discussion du texte au Sénat un amendement soutenant une position différente a été rejeté (178).
Dans la pratique cependant, les attitudes des thérapeutes demeurent très discordantes, une ligne de fracture marquée séparant certaines équipes médicales. Le point de désaccord est tel que la loi du 22 avril 2005 y a trouvé sa critique la plus virulente : elle autoriserait les médecins à faire mourir de faim et de soif leurs patients (179).
On peut regrouper en trois catégories les raisons avancées à l’appui de cette thèse.
Argument technique : la nutrition artificielle ne relèverait pas du même degré d’artifice que les techniques qui peuvent être mises en œuvre pour pallier au fonctionnement d’un organe défaillant. Comme l’explique le Docteur Tasseau pour le cas des végétatifs chroniques, l’atteinte sévère de la déglutition est la seule justification à la pose d’une sonde de nutrition artificielle : « Le terme “ nutrition artificielle ” ne convient donc pas à cette situation car ce n’est pas la fonction de nutrition qui est déficitaire ; il faut plutôt parler de « nutrition administrée artificiellement », afin de souligner que c’est l’introduction des aliments qui nécessite le recours à une technique particulière. » (180)
Argument culturel : il a été unanimement reconnu que la valeur symbolique qui s’attache à l’alimentation rend difficilement acceptable, pour les familles comme pour les personnels soignants, la décision d’arrêter une alimentation. L’obligation alimentaire est une donnée de civilisation.
Représentation religieuse : par une déclaration commune rendue publique le 2 avril 2007, une position critique particulièrement solennelle a été prise par M. David Messas, Grand Rabbin de Paris et le cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris : « Il apparaît clairement, dans nos traditions respectives, que l’apport d’eau et de nutriments destinés à entretenir la vie répond à un besoin élémentaire du malade. L’alimentation et l’hydratation par la voie naturelle doivent donc toujours être maintenues aussi longtemps que possible. En cas de véritable impossibilité, ou de risques de « fausse route » mettant en danger la vie du malade, il convient de recourir à une voie artificielle. Seules des raisons graves dûment reconnues (non assimilation des nutriments par l’organisme, souffrance disproportionnée entraînée par l’apport de ceux-ci, mise en danger de la vie du malade du fait de risques d’infections ou de régurgitation) peuvent conduire dans certains cas à limiter voire suspendre l’apport de nutriments. Une telle limitation ou abstention ne doit jamais devenir un moyen d’abréger la vie. Juifs et catholiques, nous jugeons donc que, en ce qui concerne l’apport de nutriments, la loi du 22 avril 2005 présente une réelle ambiguïté. Il n’y est pas précisé que pour les malades chroniques hors d’état d’exprimer leur volonté l’alimentation et l’hydratation par voie naturelle ou artificielle doivent être maintenues, même lorsque la décision a été prise de limiter les traitements médicaux proprement dits. Il convient que les instances compétentes favorisent et garantissent cette interprétation de la loi. »
La même année 2007, la Congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé l’argumentaire propre à l’Église catholique sur ce sujet : « l’administration de nourriture et d’eau, même par des voies artificielles, est par principe un moyen ordinaire et proportionné de conservation de la vie. Elle est donc obligatoire, dans la mesure où et tant qu’elle atteint son but, qui consiste à procurer l’hydratation et l’alimentation du patient. » En 2008, la communauté catholique italienne s’est à nouveau mobilisée sur cette question à l’occasion de l’affaire Eluana Englaro. (181)
À cet ensemble de raisons (182), s’ajoute l’argumentation développée par les défenseurs de la légalisation de l’euthanasie. Ces derniers dénoncent, eux aussi, « le scandale consistant à faire mourir de faim et de soif des malades ». A partir de ce constat est avancée une conclusion à l’opposé de la position des Églises. Elle consiste à défendre la légitimité de l’euthanasie dont le caractère rapide et humain relèverait de l’évidence au regard de la lenteur et des affres d’une agonie par inanition. Le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt avait défendu cette thèse au Sénat, au cours de la discussion de la loi sur les droits des malades et la fin de vie, le 12 avril 2005, dans les termes suivants : « Nous trouvons critiquable le fait d'interrompre éventuellement l'alimentation. C'est la raison pour laquelle nous proposons des méthodes plus franches. » Le sénateur Jean-Pierre Michel, au cours de la même séance, avait précisé: « En effet, nous estimons que dire qu'il n'existe pas d'autre solution que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielles est la pire des hypocrisies, surtout au vu des souffrances qui seront endurées pendant plusieurs jours par le malade. » La loi du 22 avril 2005 frôlerait la barbarie en instituant un abandon légal du malade ; ainsi, pour M. Vincent Léna, Président de l’association « Faut qu’on s’active », « si la notion de « laisser-mourir » a pu permettre de couvrir juridiquement des pratiques qui existaient, elle nous semble hypocrite, voire contre-productive, barbare, source de souffrance pour les malades que l’on peut cesser d’hydrater ou de nourrir (183)»
Ces critiques n’ont pas convaincu les membres de la mission parlementaires de la nécessité de proposer, sur cette question, des changements à la loi du 22 avril 2005 ni d’en suggérer un nouveau commentaire qui en infléchirait l’interprétation.
Le contexte juridique qui avait justifié le choix opéré par la loi du 22 avril 2005 dans ce domaine n’a pas changé. La jurisprudence britannique (184), mentionnée au cours des débats parlementaires en 2005, a été confirmée à l’occasion d’une autre affaire en décembre 2006 (185). En particulier un jugement prononcé par la Supreme Court of Judicature (186) a reconnu la légalité d’une disposition contenue dans un guide de bonnes pratiques élaboré par le Conseil général de médecine qui était relative à l’arrêt de nutrition (187). En Italie, dans une affaire qui a défrayé la chronique (188), la Cour de cassation a autorisé, le 16 octobre 2007, puis confirmé le 13 novembre 2008, l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition d’une malade en état végétatif depuis 1992 ; cette décision de justice rappelle « qu’il n’y a pas de doute que l’hydratation et l’alimentation artificielles au moyen d’une sonde gastrique constituent un traitement médical » (189) ; elle met en avant le fait que l’hydratation et la nutrition artificielles relèvent d’un savoir scientifique mis en œuvre par des médecins et qu’elles consistent en l’administration de préparations impliquant des moyens technologiques. En France, aucun arrêt médical d’hydratation et de nutrition n’a fait l’objet d’un contentieux judiciaire.
Parce qu’en tout état de cause, la mise en place d’une sonde d’alimentation constitue une technique invasive qui requiert l’autorisation du patient, sa pose comme son retrait n’ont pas à être appréciés au regard d’un principe absolu tel que le caractère sacré de la vie mais au regard des droits du malade ; le recours à cette technique doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation au cas par cas qui respecte la volonté du malade s’il est conscient et, s’il est inconscient, prend en compte ses souhaits ou ceux de ses proches (notamment des parents quand il s’agit d’un enfant).
Que le recours à cette technique, lorsque le patient ne peut pas s’alimenter naturellement, doive être apprécié selon les circonstances, fait d’ailleurs l’objet d’un accord unanime quand il s’agit des personnes en extrême fin de vie ou des personnes démentes. Ainsi le Docteur Xavier Mirabel, particulièrement critique envers la loi du 22 avril 2005, a exposé sa position dans les termes suivants : « mais nous avons aussi pris conscience que la mise en œuvre d’une alimentation ou d’une hydratation artificielle n’était pas toujours efficace pour assurer l’alimentation et la survie et que les méthodes mises en œuvre pouvaient conduire à des effets indésirables parfois graves. (190)». Sondes arrachées chez les personnes démentes, complications infectieuses et inefficacité à améliorer l’état nutritionnel des sujets âgés ou de certains malades en phase avancée (191) obligent à avoir une approche proportionnée de ces techniques.
On peut non seulement s’interroger sur la cohérence qu’il y a à sacraliser la nourriture dans certaines situations et à la désacraliser dans d’autres mais aussi celle qui consiste à différencier cette technique des autres sur la base de la distinction d’origine scolastique entre le recours à des moyens ordinaires et le recours à des moyens extraordinaires. Les Docteurs Bernard Devalois, Laurence Gineston et Arnaud Leys développent en ce sens l’argumentation suivante : « Si on compare les moyens nécessaires à cette NHA (192) entérale à ceux mobilisés par exemple lors d’une ventilation non invasive (VNI), ils semblent plus « extraordinaires » (ou encore moins « ordinaires » ou « de base »). Pour la VNI il n’y a pas de tube dans l’organisme, pas de produits vendus en pharmacie administrés quotidiennement mais un simple appareil, poussant l’air ambiant, via un masque facial, vers les poumons du patient. Peut-on imaginer des questions du type : la ventilation est-elle un traitement ou un soin ? La ventilation est-elle un soin de base ou un moyen ordinaire de se substituer à la défaillance d’un besoin fondamental ? ». La conclusion de ces auteurs est que « la nutrition-hydratation artificielle (NHA) est bien par définition une intervention thérapeutique de soutien d’une fonction vitale défaillante (la fonction nutritive) et entre donc dans le cadre des nécessaires discussions éthiques sur sa non mise en œuvre ou son retrait » (193).
Un raisonnement semblable a été développé par le Professeur Louis Puybasset au cours de son audition : « Quelle différence entre la ventilation, une canule de trachéotomie et la nutrition artificielle quand c’est en réalité la question du devenir neurologique du patient qui est posée ? Pourquoi l’un serait-il plus naturel que l’autre ? Pourquoi pourrait-on stopper l’un et pas l’autre, si ce n’est à cause des représentations que nous avons de l’alimentation ? Mais ne s’agit-il pas là que de projections ? Car pour l’individu inconscient, cela revient au même. […] Il s’agit de faire comprendre la distinction entre des projections de bien-portants et une réalité médicale, qui est très différente. » (194)
Ce serait cependant se méprendre sur le sens de la loi du 22 avril 2005 que de ne pas comprendre que l’obligation de préserver la dignité du patient exclut qu’un arrêt de nutrition et d’hydratation artificielles soit décidé sans que ne soient immédiatement prodigués des soins palliatifs. La préservation du confort du malade auquel a été retirée une sonde d’alimentation – ainsi que le respect pour toutes les significations symboliques attachées à l’alimentation – passe par des gestes de soins destinés à apaiser les éventuelles sensations de soif et de faim conséquentes à l’arrêt d’alimentation, mêmes si celles-ci ne sont qu’hypothétiques(195). Elle consiste aussi à veiller à ce que l’arrêt de nutrition soit couplé avec celui de l’hydratation au risque sinon de prolonger les agonies. Dans l’affaire Eluana Englaro précédemment citée, la nécessité de recourir à ces soins de substitution ont été rappelés par les juges de la cour d’appel de Milan dans leur décision en date du 25 juin 2008 (196).
Les critiques dont a fait l’objet cette disposition de la loi du 22 avril 2005 relèvent ainsi de plusieurs ambiguïtés. Il n’a pas été compris que c’est la recherche constante de l’approche thérapeutique la plus adaptée au malade qui a conduit dans la loi du 22 avril 2005 à n’exclure aucun artefact médical d’une évaluation portant sur le caractère proportionné de sa mise en œuvre. Ainsi, comme le fait remarquer le Docteur Régis Aubry à propos des familles demandant un arrêt d’alimentation : « Ce sont souvent des parents qui ont lutté pour la réanimation de leurs enfants et qui finalement vont lutter pour que l’alimentation cesse. » (197) Attribuer à un artifice médical particulier, comme la sonde d’alimentation, une nécessité qui s’ancrerait dans des considérations dépassant le sort singulier du patient serait priver celui-ci d’un autre soin peut-être plus adapté. Une décision d’arrêt de traitement doit donc s’entendre comme la décision de recourir à un tel soin plus adapté. Cesser d’alimenter un malade va alors de pair avec la mise en place de soins de confort. Est ainsi exclu un double abandon du malade : abandon du malade par inaction du médecin ignorant les soins palliatifs et abandon, dans certains cas, par projection sur le malade d’idéaux reflétant plus une fidélité à des valeurs privées que la recherche objective du meilleur soin.
Chapitre III
Des efforts en matière de soins palliatifs réels, mais encore insuffisants
« L’arrêt des traitements […] ne saurait être confondu avec la suspension des soins. À cet égard, l’expression consacrée « laisser mourir » n’est pas sans équivoque. En l’opposant à l’aide active à mourir, on laisse trop souvent entendre, très malencontreusement, qu’à l’action s’oppose le délaissement. C’est ignorer la réalité de la pratique, et méconnaître l’esprit des soins palliatifs, tout entiers soutenus par une philosophie de l’effort et du dévouement. » (198) Ces quelques phrases, prononcées par Mme Roselyne Bachelot, au cours de son audition, rappellent le lien intime qui unit soins palliatifs et arrêt de traitement. Ce n’est pas parce que certains traitements sont arrêtés que les soins au patient doivent cesser. Au contraire, cet arrêt implique légalement la mise en œuvre de soins palliatifs.
C’est pourquoi la loi du 22 avril 2005 promeut la culture palliative, qui peut être entendue comme « l’ensemble des conditions permettant de continuer à vivre, et d’en éprouver des satisfactions, à l’approche d’une fin inéluctable à brève échéance » (199). C’est dans cet esprit que les articles 1, 4, 6 et 9 (200) de la loi font référence à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, qui définit les soins palliatifs comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ».
D’autres articles de la loi du 22 avril 2005 organisent le développement des soins palliatifs. Ainsi, l’article 11 (201) rend obligatoire dans les contrats pluriannuels, conclus entre les établissements de santé et les agences régionales de l’hospitalisation (ARH), la mention des moyens mis en œuvre au sein de l’établissement pour la diffusion des soins palliatifs. Les établissements publics doivent d’ailleurs introduire dans leur projet médical un volet « activité palliative des services » pour assurer la réalisation du contrat pluriannuel (article 12) (202). Les établissements sociaux ou médico-sociaux sont tenus aux mêmes obligations par les articles 13 et 14 (203) de la loi.
Cette loi comporte donc, vis-à-vis des soins palliatifs, deux aspects indissociables : d’une part, la promotion de la culture palliative et, d’autre part, leur diffusion matérielle la plus large possible, l’une étant la condition de l’autre. M. Axel Kahn, établit d’ailleurs le même parallèle entre la diffusion des moyens techniques de soins palliatifs et la promotion d’une culture centrée sur le patient : « Le développement des unités de soins palliatifs dans notre pays, bien trop rares – hélas –, mais aussi de l’état d’esprit qui anime leurs équipes soignantes, les techniques qu’elles maîtrisent de mieux en mieux sont sans conteste des moyens puissants pour rétablir les conditions d’un choix et d’une véritable liberté d’une personne en fin de vie » (204).
Évaluer l’application de la loi relative aux droits des malades et à la fin de la vie exige par conséquent de dresser un état des lieux des soins palliatifs en France. Ils constituent en effet le maillon essentiel pour garantir les droits des malades en fin de vie et favoriser la diffusion de la culture palliative dans les structures sanitaires et sociales. Or, s’ils se sont incontestablement développés au cours des dernières années, des inégalités d’accès géographiques, générationnelles et sectorielles importantes demeurent. De plus, leur mode de financement est toujours sujet à débat.
A. UNE AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION DES SOINS PALLIATIFS
L’organisation des soins palliatifs a connu un double progrès. D’une part, l’offre globale de soins palliatifs a augmenté et la diffusion de la culture palliative a progressé et, d’autre part, cette offre s’est diversifiée, afin de mieux répondre à la multiplicité des situations des personnes en fin de vie.
1. La montée en puissance des soins palliatifs
Le développement des soins palliatifs s’est traduit par leur reconnaissance juridique et par leur augmentation quantitative.
a) La reconnaissance des soins palliatifs par la loi
L’inscription, à partir des années 1980, des soins palliatifs dans le droit témoigne d’une réflexion médicale croissante sur la fin de vie.
Bien qu’il existât des hospices, accueillant les personnes âgées en fin de vie depuis la fin du XIXe siècle, la thématique des soins palliatifs, en provenance du monde anglo-saxon (205), a émergé, sur la scène publique française, au cours des années 1980 quand les partisans du développement des soins palliatifs s’opposaient à ceux du droit à mourir dans la dignité, comme l’a expliqué le sociologue Patrick Baudry (206).
Le Professeur François Goldwasser a ainsi indiqué devant la mission que la pratique médicale avait enregistré une réelle évolution au cours de ces vingt dernières années : les médecins ont eu, selon lui, trois rapports successifs à la mort et aux patients en fin de vie : « l’abandon, le non-abandon avec la culture médicale enseignée à la fac – celle du médecin tout-puissant qui n’abandonne pas et qui achève son malade par souci de non-abandon, puis, la culture du lien, de la solidarité, de la gestion des symptômes, de l’accueil et de la réponse à la souffrance (207) ». Avec la diffusion progressive de la culture palliative, l’on serait donc passé de la seconde phase, où le médecin, connaissant peu les soins palliatifs, pouvait considérer comme acceptable l’euthanasie de son patient par compassion, à une troisième phase, centrée sur la prise en charge de la douleur et de la souffrance.
François Goldwasser reconnaît qu’avant 1996, et sa formation aux soins palliatifs, il y avait, dans son service de cancérologie, une euthanasie par mois. De même, Mme Nathalie Vandevelde a témoigné du fait que : « Il y a vingt ou trente ans, les DLP, ce qu’on appelle les cocktails lytiques, étaient pratiqués régulièrement dans les structures de soins. Ce n’est plus le cas. Leur usage devient un épiphénomène dans des services où les relations sont difficiles (208) ». Cette évolution vers un recours accru aux soins palliatifs a été facilitée par leur ancrage juridique progressif.
C’est par la circulaire du 26 août 1986, relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale, que les soins palliatifs sont entrés dans l’édifice normatif. En application de ce texte, les premières unités de soins palliatifs (USP) ont été fondées en 1987.
Une étape majeure est franchie en 1999, lorsque la loi du 9 juin 1999 a garanti le droit d’accès aux soins palliatifs. Cette garantie est reprise par la loi du 22 avril 2005 pour le cas du patient refusant tout traitement.
b) La progression de l’offre de soins
Parallèlement à la reconnaissance légale des soins palliatifs et à la diffusion de la culture palliative, les pouvoirs publics se sont efforcés d’accroître les moyens dédiés à ce type de soins. Divers plans se sont succédés, dont le plan triennal de développement des soins palliatifs (1999-2001), qui avait pour but d’augmenter l’offre, de réduire les inégalités régionales, de former les professionnels et d’informer le public, et le programme national de développement des soins palliatifs (2002-2005), qui avait les mêmes ambitions, tout en mettant davantage l’accent sur l’accompagnement à domicile. Une partie de la politique de soins palliatifs avait également été intégrée dans le plan Cancer (2003-2007).
Enfin, le Président de la République a annoncé, le 13 juin 2008, la mise en place d’un programme de développement des soins palliatifs, couvrant la période 2008-2012, qui a pour ambition de doubler le nombre de personnes bénéficiant de soins palliatifs d’ici 2012 (209). Il comporte trois axes principaux.
Le premier objectif est de traduire en moyens « le souhait légitime des Français de pouvoir choisir le lieu de leur fin de vie » (210) en accroissant l’offre de soins palliatifs. Pour ce faire, le plan entend développer les soins palliatifs dans les courts, moyens et longs séjours ainsi que dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) à travers des mesures spécifiques à chaque secteur. En ce qui concerne les soins palliatifs à domicile, il propose de développer les réseaux de soins palliatifs et d’augmenter le nombre de gardes-malades. Il envisage également la mise en œuvre d’un nouveau dispositif, à savoir celui des maisons d’accompagnement, pour accueillir des personnes en fin de vie. Il prévoit enfin d’organiser de façon plus satisfaisante les soins palliatifs pédiatriques.
Le second objectif du plan est de créer une politique ambitieuse de formation et de recherche dans le domaine des soins palliatifs. Pour ce faire, sept millions d’euros seront consacrés à la recherche en cinq ans et l’approche palliative sera introduite dans les formations médicales et paramédicales initiales. De plus, des actions de formation continue seront mises en œuvre à destination des personnels intervenant dans les établissements médico-sociaux.
Enfin, le plan de développement des soins palliatifs propose d’accroître l’aide à destination des accompagnants. À cette fin, les hospitalisations de répit seraient facilitées et davantage de proches et de bénévoles seront formés aux soins palliatifs. De plus, une campagne d’information portant sur l’offre de soins palliatifs sera lancée en direction du grand public et des professionnels.
Ce plan s’inscrit dans une dynamique amorcée dans les années 1990. Si la croissance du nombre d’unité de soins palliatifs (USP) s’est surtout produite dans les années 1990, d’après les auditions, celle des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) date du début des années 2000. S’agissant des lits identifiés (LISP) – dans des services non dédiés aux soins palliatifs, leur progression est postérieure à la loi du 22 avril 2005.
ÉVOLUTION DES CAPACITÉS DE SOINS PALLIATIFS
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
ÉVOLUTION 2001-2007 | |
Nombre de lits d’USP |
742 |
nd |
808 |
834 |
782 |
783 |
825 |
nd |
937 |
+ 26 % |
Nombre de LISP |
nd |
nd |
232 |
316 |
758 |
1281 |
1908 |
nd |
3075 |
+ 1225 % |
Total des lits dédiés aux soins palliatifs |
nd |
nd |
1040 |
1150 |
1540 |
2064 |
2733 |
nd |
4012 |
+ 285 % |
Nombre d’EMSP |
184 |
nd |
265 |
291 |
309 |
317 |
328 |
nd |
340 |
+ 28 % |
Source : Ministère en charge de la santé – DHOS (les données 2007 sont provisoires).
Cette progression s’est traduite par une forte augmentation des taux de couverture des besoins de la population pour lesquels des objectifs avaient été fixés pour la fin 2007 par le Comité de suivi du plan de développement 2002-2005. Le tableau suivant montre dans quelle mesure ils ont été atteints.
DES OBJECTIFS LARGEMENT REMPLIS
Objectif 2007 |
État au 31/12/2007 | |
Unités de soins palliatifs, par région |
1 |
2 régions n’en ont pas encore (211) |
Lits identifiés, pour 100 000 habitants |
5 |
4,88 |
Équipes mobiles de soins palliatifs, pour 200 000 habitants |
1 |
1,08 |
Réseaux de soins palliatifs, pour 400 000 habitants |
1 |
0.8 |
Sources : Ministère en charge de la santé – DHOS.
Les taux de couverture ont donc atteint, au plan national, les objectifs fixés pour 2007. Le taux recommandé par l’OMS est de 5 lits pour 100 000 habitants. Le taux français de lits palliatifs est de 6,37 (lits d’USP et LISP).
TAUX DE COUVERTURE DE LA POPULATION FRANÇAISE EN SOINS PALLIATIFS
Taux au 31 décembre 2007 | |
Nombre de lits d’USP pour 100 000 habitants |
1,49 |
Nombre de lits identifiés (LISP) pour 100 000 habitants |
4,88 |
Nombre total de lits dédiés de soins palliatifs pour 100 000 habitants |
6,37 |
Sources : Ministère chargé de la santé – DHOS.
Les comparaisons avec l’étranger ne sont pas toujours aisées, dans la mesure où la prise en charge des malades en fin de vie et de leurs proches se fait souvent dans le cadre de structures différentes selon les pays. Le tableau suivant met en parallèle les données disponibles (en valeurs absolues et relatives) en France et en Angleterre, concernant les unités, les équipes mobiles et les réseaux de soins palliatifs.
COMPARAISON DE L’OFFRE DE SOINS PALLIATIFS EN ANGLETERRE ET EN FRANCE
Nombre USP |
USP/1 000 000 habitants |
Nombre EMSP |
EMSP/350 000 habitants |
Nombre réseaux |
Réseaux/400 000 habitants | |
Angleterre |
193 (212) |
3,5 |
314 |
2 |
295 |
2,15 |
France |
89 (213) |
1,5 |
340 |
1,9 |
110 |
0,7 |
Source : Conseiller social, ambassade de France à Londres et ministère de la santé.
L’Angleterre, qui a développé plus précocement (dès les années 1990) une politique de soins palliatifs est donc en avance sur la France concernant l’offre de soins dans certains domaines (nombre d’USP, nombre d’EMSP et nombre de réseaux). Mais l’Angleterre, à la différence de la France, n’a pas de lits identifiés.
En revanche, lorsque l’on compare le taux français de lits dédiés aux soins palliatifs pour 100 000 habitants, par rapport à celui de certains de ses voisins, la France affiche des résultats qui supportent aisément la comparaison.
TAUX DE LITS DEDIÉS POUR 100 000 HABITANTS
Taux de lits dédiés pour 100 000 habitants | |
Espagne |
2,5 |
Belgique |
3,5 |
Angleterre |
4,8 |
France |
6,4 |
Pays-Bas |
7,3 |
Source : Ambassades de France.
c) Quels moyens pour les soins palliatifs ?
Il est difficile de comparer les financements globaux qui sont destinés aux soins palliatifs. En effet, ni l’Angleterre, ni la France ne disposent de chiffres d’ensemble en la matière. En ce qui concerne la France, la diversité des modes de financement des soins palliatifs rend en effet délicate toute agrégation de données. Ainsi, le budget des secteurs de soins de suite et de soins de longue durée étant fongible, il n’est pas possible d’individualiser le financement des soins palliatifs. Néanmoins, les chiffres suivants peuvent être avancés pour les secteurs de court séjour qui sont soumis au financement à l’activité (214) : les soins palliatifs représentaient, en 2006, 553 millions d’euros dans le secteur public et 79 millions d’euros dans le secteur privé. Ces budgets sont en forte progression (+ 34 % entre 2005 et 2006 dans le court séjour public). Le programme de développement des soins palliatifs prévoit de consacrer 230 millions d’euros supplémentaires aux soins palliatifs entre 2008 et 2012, soit environ 46 millions d’euros par an. En prenant en compte ce programme, la France consacre environ 10 euros par habitant aux soins palliatifs, contre environ 6 euros par habitant en Belgique, par exemple.
Cependant, l’offre de soins palliatifs est encore bien inférieure aux besoins. En effet, 40 % des décès correspondent à une population requérant des soins palliatifs, et 10 % des fins de vie nécessitent un recours à des équipes spécifiquement formées aux soins palliatifs ; cette proportion augmente à mesure du vieillissement de la population (215). Or, « compte tenu des données de recensement menées par la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) et la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), on peut estimer que les besoins quantitatifs sont insuffisamment satisfaits » (216). L’attente peut donc être importante entre le moment de la demande de soins palliatifs formulée par le patient et celui où il en bénéficie effectivement. Mme Nathalie Vandevelde, infirmière, l’a indiqué au cours de son audition : « Les délais d’attente pour obtenir une nouvelle place en USP ont beau être plus courts que pour les personnes âgées en long séjour, il faut quand même compter entre deux et quatre semaines, ce qui est très long lorsque l’orientation est souhaitée par les malades et les familles. » (217)
2. Des possibilités de prise en charge inégales
Pour répondre aux besoins des patients, une réponse graduée en termes d’offre de soins palliatifs a été mise en place. Leur prise en charge au sein des établissements hospitaliers peut se faire, selon la complexité de leur situation, dans une unité de soins palliatifs, dans un lit identifié au sein d’un service clinique ou grâce à l’intervention d’une équipe mobile de soins palliatifs. De nouvelles formes de prise en charge sont également appelées à se développer, telles que les réseaux de soins palliatifs, l’hospitalisation à domicile et l’accompagnement par des bénévoles.
a) Les soins palliatifs en établissement de santé : une réponse graduée
Au sein des établissements de santé, il existe trois modes d’organisation des soins palliatifs. Les situations les plus complexes sont prises en charge par les unités de soins palliatifs. Dans les autres cas, les soins sont délivrés dans les services cliniques, sur un lit identifié de soins palliatifs et/ou avec l’aide d’une équipe mobile de soins palliatifs.
Une prise en charge assumée de facto par tous les services. Une vision très réductrice de la réalité des soins tendrait à faire croire à l’existence d’un clivage très tranché entre les services curatifs d’un côté et les services de soins palliatifs de l’autre. En fait, les services curatifs n’ignorent pas la prise en charge palliative des patients. Les soins prodigués par exemple en cancérologie ou en gériatrie ont une dimension palliative, rendant artificielle la distinction entre les soins palliatifs et les autres soins. Ainsi que l’indiquait le Docteur Michèle Lévy-Soussan à la mission, les malades en fin de vie ne sont pas forcément envoyés dans des unités de soins palliatifs et cela n’est d’ailleurs pas souhaitable : « la situation médicalement simple est prise en charge dans un environnement non spécialisé, la situation médicalement complexe devant être référée à l’unité de soins palliatifs, considérée comme lieu d’expertise. Mais, si l’on considère que les enjeux de la fin de vie dépassent la réponse médicale, ce schéma me paraît quelque peu critiquable. J’ai observé, dans plusieurs cas, que des patients dont la fin de vie était très complexe pour les professionnels ne souhaitaient pas quitter le lieu où ils avaient été suivis durant le processus de la maladie. Cela aurait été, pour eux, une grande violence. À l’inverse, des patients présentant une fin de vie calme aspiraient à vivre ce temps de leur existence en unité de soins palliatifs, qui représentait pour eux un espace social où la dimension spirituelle n’est pas escamotée. La seule complexité médicale ne devrait pas, selon moi, organiser le recours aux lieux d’accueil et de prise en charge de fin de vie. » (218)
Parce qu’il y a un continuum logique des soins, la médecine palliative ne s’identifie donc pas systématiquement à des lits de soins palliatifs. On estime ainsi que dans un grand établissement de soins parisien, des soins palliatifs sont dispensés sur environ 5 % des lits, mais que ce pourcentage est supérieur à 20 % dans cinq services : oncologie (54 %), néphrologie (23 %), hépato-gastro-entérologie (21 %), neurologie (21 %) et radiothérapie (20 %). Ce que l’on peut regretter, en revanche, c’est que cette culture palliative fasse encore défaut dans certains services de court séjour (219), alors même que l’article L. 1110-9 du code de la santé publique dispose que « toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement », quel que soit le service où elle se trouve.
Si la situation médicale d’un patient requiert une prise en charge plus lourde, il est alors fait recours aux structures de soins palliatifs. On en distingue trois.
Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) sont des structures spécifiquement dédiées aux soins palliatifs, mais non rattachées à un service. Elles interviennent sur demande d’un médecin, lorsque son équipe est confrontée à des situations complexes de fin de vie. Elles ne pratiquent normalement pas d’actes, mais ont un rôle de soutien et de conseil de l’équipe soignante : « Elles sont une oreille tendue aux difficultés et aux doutes des équipes directement impliquées dans la prise en charge des patients en soins palliatifs. De plus, elles donnent, par leur fonctionnement, une idée de l’interdisciplinarité dans une démarche d’accompagnement » (220), expliquait le Docteur Michèle Lévy-Soussan. Comme indiqué ci-dessus, leur intervention nécessite donc l’accord du service concerné. Outre ces activités au chevet du malade, les EMSP assurent aussi le soutien psychologique des proches et mènent des actions de formation et de recherche (221). Avec les USP, les équipes mobiles sont l’un des deux piliers permettant la diffusion de la culture palliative dans les établissements de santé : « Aujourd’hui, a déclaré le Docteur Régis Aubry, des équipes mobiles de soins palliatifs interviennent dans les différents services ou lieux où sont soignées les personnes concernées. Elles aident les acteurs habituels du soin à prendre en charge les questions éthiques et médicales posées dans le champ des soins palliatifs. » (222). Leur création et leur développement ont fait l’objet d’incitations importantes a encore souligné le Docteur Régis Aubry : « Ces équipes se sont largement développées depuis les deux derniers plans triennaux de développement des soins palliatifs. Environ 400 équipes mobiles de soins palliatifs sont financées en France.(223) »
Les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) sont, comme on l’a vu, en forte progression. Implantés dans des services cliniques qui sont fréquemment confrontés à des situations de fin de vie, ils contribuent à diffuser la culture palliative et à assurer la continuité des soins curatifs et palliatifs pour les patients dont la situation ne présente pas de complexité particulière. Ils ont constitué l’une des priorités des politiques de soins palliatifs depuis le début des années 2000. Leur progression, dans les services de court séjour, a été considérable puisque le taux de progression annuel entre 2001 et 2007 est d’environ 50 %, ce qui représente un nombre de LISP multiplié par 13 en six ans. Le mode de financement par la tarification à l’activité en est un facteur essentiel.
Néanmoins, plusieurs professionnels auditionnés par la mission ont émis des réserves quant à la pertinence de la politique des lits identifiés. Certains pensent que les moyens n’ont pas réellement été affectés aux soins palliatifs et d’autres estiment que l’identification de lits au sein d’un service n’entraîne pas automatiquement la diffusion de la culture palliative. C’est ainsi que Mme Nathalie Vandevelde, cadre infirmier à l’hôpital Saint-Louis, a témoigné du fait que certains directeurs refusaient encore l’intervention d’équipes mobiles de soins palliatifs au sein de leur service, bien qu’il comporte des LISP (224), révélant ainsi un manque de culture palliative. De même, compte tenu de ces critiques, le Docteur Michèle Lévy-Soussan, responsable de l’unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, est arrivée à la conclusion que « le dispositif des “ lits identifiés ” ne […] paraît pas de nature à améliorer la fin de vie à l’hôpital dans sa forme actuelle. (225) » Il apparaît que les ressources tirées des lits identifiés ont pu être utilisées pour financer les besoins de financement des établissements de santé (226).
Les unités de soins palliatifs (USP) sont des services spécialisés dans les soins palliatifs. Ils ont de ce fait une triple vocation : « les soins, la formation et la recherche (227) », selon la circulaire relative à l’organisation des soins palliatifs. La complexité des situations des patients qu’elles accueillent peut résulter soit d’une douleur importante du patient (qui peut présenter des symptômes réfractaires), soit de la souffrance qu’il exprime, soit d’une situation particulièrement difficile, nécessitant une réflexion éthique approfondie. La technicité et la spécificité de ces USP ont été ainsi évoquées, devant la mission, par M. Sylvain Pourchet, responsable de l’unité fonctionnelle soins palliatifs de l’hôpital Paul-Brousse : « Les patients que nous prenons en charge présentent cinq caractéristiques communes : une histoire médicale longue et complexe qui nécessite un travail de synthèse pour que son contenu puisse rester accessible ; une situation clinique évolutive d’un jour à l’autre qui nécessite un suivi régulier et une réactivité ; les interventions réitérées de multiples personnes de l’entourage et de professionnels rendant indispensable un travail sur la cohérence ; un besoin de prise en charge « globale » pour cerner leurs attentes et prioriser les actions ; un haut niveau d’exigence vis-à-vis des résultats qui peut s’avérer contre-productif s’il donne l’illusion d’une maîtrise totale des conditions de la mort. (228) »
Les USP doivent, sur la base de cette circulaire, assurer aussi des actions de formation, en animant, par exemple, des formations continues en soins palliatifs et de recherche (notamment dans la perspective pluridisciplinaire qui est la leur).
À travers ces trois missions, les USP constituent le maillon de base de la politique de soins palliatif et un référent pour les responsables de lits identifiés et d’équipes mobiles. Initialement, c’est sous cette forme que se sont développés les soins palliatifs en France, avant que l’accent ne soit mis sur la politique des lits identifiés et sur les équipes mobiles, dans un but de diffusion de la culture palliative dans tous les services. De ce fait, le développement des USP est antérieur à la loi de 1999 et leur nombre n’a que peu progressé depuis. On dénombre actuellement 89 USP en France et 937 lits, soit 1,5 lit pour 100 000 habitants. Toutefois, comme on l’a vu, la portée de ce chiffre doit être relativisée, parce qu’il ne prend pas en compte les lits identifiés.
Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 préconise de créer une USP dans chaque établissement de court séjour où ont lieu plus de 600 décès par an et qui n’en dispose pas déjà (229).
b) Les carences des soins palliatifs hors des établissements de santé
En dehors des établissements de santé, l’offre de soins palliatifs est beaucoup moins développée. Dès 2006, la Cour des comptes recommandait de renforcer l’offre de soins palliatifs à domicile et dans le secteur médico-social (230), soulignant les difficultés qui freinaient leur diffusion. Pourtant, force est de constater que ni les réseaux de soins palliatifs ni les structures d’hospitalisation à domicile ne bénéficient encore de moyens suffisants.
Les réseaux de soins palliatifs assurent, au domicile, une mission similaire à celle que jouent les équipes mobiles au sein des hôpitaux. Ils ont également pour fonction de faciliter la continuité des soins entre le domicile et l’hôpital. Ils sont fortement incités à prendre appui sur les USP ou sur les EMSP existantes. Ils assistent non seulement les malades mais aussi leur famille, ainsi que l’évoquait par exemple, au cours de son audition, M. Claude Évin, ancien ministre, président de la Fédération hospitalière de France, à propos du Réseau « Ville-Hôpital 17 », qui vise à aider les soignants qui accompagnent les malades à domicile (231). On compte actuellement 110 réseaux ayant pour activité principale les soins palliatifs, prenant en charge environ 27 500 patients par an, ce qui est très insuffisant, notamment si l’on compare le nombre de réseaux existant en France et en Grande-Bretagne. La mesure II du programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 traduit la volonté de développer les réseaux ayant une activité de soins palliatifs. Le nombre de patients pris en charge devrait être porté à 50 000 en 2012.
L’hospitalisation à domicile (HAD) concernait, au 1er janvier 2005, près de 3 600 patients en soins palliatifs et, en 2007, plus de 12 000. Elle fait l’objet d’un référentiel qui prévoit que cette forme de soins palliatifs assure la continuité des soins et le maintien à domicile du patient jusqu’à son décès, si telle est sa volonté (232). Néanmoins, si 70 % des Français souhaiteraient finir leur vie à domicile, 75 % d’entre eux meurent à l’hôpital (233) (contre moins de 60 % en Angleterre, preuve qu’une organisation plus développée des soins palliatifs permet un taux de maintien à domicile plus important) (234). Lors de son audition, la ministre de la santé, Mme Roselyne Bachelot, a confirmé vouloir faire de l’hospitalisation à domicile le « support » naturel des soins palliatifs (235). Il existe cependant encore des conditions structurelles faisant que les soins palliatifs peuvent difficilement être pratiqués à domicile de nos jours.
La première difficulté concerne l’application de l’article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale. Voté en 1999, cet article renvoie à un décret la fixation d’un contrat type définissant les modalités de paiement des professionnels libéraux qui effectuent des soins palliatifs à domicile. Or, le décret n°2002-793 du 3 mai 2002 pris en application de cet article a été partiellement annulé en 2004 par le Conseil d’État (236) et aucun autre texte réglementaire n’est venu le remplacer depuis.
De plus, le congé de solidarité familiale, inséré de l’article L. 3142-16 à L. 3142-19 du code du travail par la loi du 9 juin 1999 n’a pas connu un grand succès car il n’est pas rémunéré. Or, la présence d’un proche à domicile est souvent la condition de possibilité du maintien à domicile d’un malade en fin de vie. Ce congé est de droit pour tout salarié s’il vise à lui permettre d’assister un proche (ascendant, descendant ou personne qui partage le domicile) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Un préavis de 15 jours est nécessaire, sauf urgence absolue constatée par le médecin. Il est d’une durée de trois mois renouvelable une fois.
Face à ce manque chronique de moyens à domicile, le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 prévoit un faisceau de mesures. Il s’agit de renforcer la possibilité, pour les personnes en fin de vie, de rester à leur domicile. Pour ce faire, le point VIII recommande d’augmenter le nombre de gardes-malades formés aux soins palliatifs à 1 500. Est également prévu d’évaluer le système des maisons d’accompagnement (point IX), faiblement médicalisées, lieux d’accueil des patients désirant terminer leur vie dans un cadre qui ne soit pas l’hôpital, tout en bénéficiant d’une prise en charge adaptée. La prise en charge temporaire d’une personne âgée en soins palliatifs aux fins de soulager les aidants devrait également être facilitée (mesure XV). Enfin, il est envisagé la mise en place d’un soutien des aidants sous la forme d’une formation aux soins palliatifs (point XIV), chaque aidant pouvant bénéficier d’une formation de deux jours.
Évoquant les conditions financières d’intervention des professionnels libéraux à domicile, Mme Martine Nectoux a mis en doute la pertinence de ces mesures : « Développer la présence des gardes-malades, comme le suggère le futur programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, ne changera pas le problème de fond s’agissant du suivi médical. » (237). En effet, seule une augmentation conséquente des moyens financiers dévolus à la prise en charge en soins palliatifs à domicile pourrait entraîner un développement substantiel de ces soins.
Les soins palliatifs délivrés à domicile se heurtent donc à des entraves structurelles que la mission propose de réduire (238). Mais au-delà de ces raisons, on peut se demander si l’une des causes majeures de la difficulté de prise en charge à domicile des malades ne tient pas aux spécificités de la société actuelle. En effet, le temps où plusieurs générations vivaient sous le même toit, ce qui assurait une solidarité entre celles-ci est révolu. La taille des logements, la dispersion de la famille, le travail de chacun des membres du foyer ne favorisent pas aujourd’hui le maintien à domicile des personnes en fin de vie (239).
c) L’aide apportée par les associations de bénévoles
Il convient également de mentionner les bénévoles qui accompagnent, au sein des établissements de santé, les malades en fin de vie. Ils n’ont pas vocation à se substituer à l’équipe soignante (240) ou aux proches, mais à accompagner, dans la mesure où le patient le souhaite, la fin de vie, selon la formule de la présidente de l’association « Jusqu’à la mort, accompagner la vie » (JALMALV), Mme Paulette Le Lann : « La douleur se traite, la souffrance, elle, s’accompagne » (241). M. Alain Monnier, président de l’ASP explicite ainsi le rôle des bénévoles : « À quoi sert l’accompagnant bénévole ? C’est effectivement une tierce personne qui, sans projet pour le malade, l’accompagne – lui et ses proches – dans les phases où il se sent menacé dans sa vie. La présence et l’écoute de l’accompagnant bénévole auprès du malade témoignent du maintien de sa dignité jusqu’au terme de sa vie. » (242) Ainsi, la charte de l’ASP dispose que « leur rôle est d’écouter et de conforter par leur présence attentive le malade et son entourage, en dehors de tout projet pour lui » (243).
Le rôle des bénévoles a été reconnu dans la circulaire Laroque de 1986 (244), soit quelques années après la naissance des premières associations (JALMALV en 1983 et l’Association pour le développement des soins palliatifs ou ASP en 1984). Ces deux fédérations d’associations regroupent chacune environ un tiers des bénévoles. JALMALV en compte 2 000 et l’ASP 1 700 sur un total d’environ 5 000. Ces deux mouvements sont laïcs. Le troisième tiers agit dans le cadre d’associations plus petites.
Progressivement, les bénévoles se sont fait accepter dans les services des établissements de santé, devenant des acteurs importants de l’accompagnement : « On assiste à une révolution intéressante quant à la place des associations de prise en charge et d’accompagnement des personnes en fin de vie. Il y a vingt ans, les professionnels étaient extrêmement rétifs à l’arrivée de bénévoles dans les structures de soins. L’extériorité était mal perçue. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Les professionnels recherchent – à 90 % – la présence de bénévoles dans les structures de soins » (245), a ainsi indiqué Mme Nathalie Vandevelde au cours de son audition.
Le but de leur activité est fixé par l’annexe 5 de la circulaire de 2008 (246) : « Améliorer les conditions de vie des personnes en souffrance et de leur environnement, confrontés à la maladie grave, au grand âge à la mort et au deuil ». Leur activité est encadrée par l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, qui les oblige à se doter d’une charte, qui comporte obligatoirement « le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins » et qui subordonne la possibilité d’intervenir au lit du patient ou à son domicile à la conclusion d’une convention avec l’établissement concerné.
La durée du bénévolat est en moyenne de cinq ans, après une formation obligatoirement assurée par les associations. À l’ASP, cette activité consiste à se rendre pendant quatre heures par semaine dans un service au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement médico-social. Les représentants d’association de bénévoles auditionnés ont fait état d’une baisse du nombre de personnes intéressées depuis 2004, ce qui a abouti à une diminution du nombre de bénévoles d’environ 40 %. La principale raison avancée par les responsables associatifs est le fait que les médias, après s’être centrés sur les soins palliatifs pendant les années 1990, se focalisent à présent sur l’euthanasie. C’est ce qu’explique M. Alain Monnier : « J’ai constaté, à partir de janvier 2005, une baisse brutale – de l’ordre de 40 % – des appels et des questionnaires renvoyés. La tendance s’est prolongée jusqu’en 2007. Nous sommes, depuis trois ans, à un étiage de 60 % des chiffres des années précédant 2005. Nous avons enregistré en 2008 un certain redressement. Apparemment, toutes les grandes associations de soins palliatifs de la région parisienne enregistrent le même phénomène. En province, les petites associations de création récente sont encore en croissance.
À quoi est-ce dû ? Le premier élément qui vient à l’esprit, c’est que les soins palliatifs ont été portés, pendant les années quatre-vingt-dix, par une importante vague médiatique, qui s’est achevée par le vote de la loi Kouchner. On a beaucoup parlé des soins palliatifs, je vous renvoie aux livres de Marie de Hennezel, et, au cours de cette décennie, nous sommes passés de 100 bénévoles à 250. Mais la vague palliative s’est transformée en vague euthanasique. » (247)
Cette chute du nombre de bénévoles se couple au constat d’un retard de la France en la matière. En effet, dans les pays anglo-saxons, le bénévolat s’est développé de manière plus précoce et plus importante, ainsi que le déclarait récemment le Docteur Jean-Marie Vetel, Président du syndicat national de la gérontologie clinique : « Globalement, il y a très peu de bénévoles dans nos hôpitaux. À l’hôpital de Cambridge (Angleterre), par exemple, il y a 600 bénévoles rien que pour le département de gériatrie » (248).
Afin d’encourager le développement de ces associations, celles-ci peuvent bénéficier de financement de la Caisse nationale d’assurance maladie, par le biais du Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS). C’est ainsi qu’en 2006, 181 associations de bénévoles ont reçu, au total, 1 250 000 euros, dans le but de former de nouveaux bénévoles. Afin d’accroître le nombre de bénévoles formés, l’objectif XVI du programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 prévoit de porter ce financement à 1,5 million d’euros chaque année pendant 5 ans, avec pour objectif de former 7 000 nouveaux bénévoles d’accompagnement par an.
L’une des conséquences de l’apparition de ces associations de bénévoles est que les directions d’établissements de santé inciteraient parfois leur personnel soignant à pratiquer plus d’actes techniques, au détriment de l’écoute et de l’accompagnement, qui sont assurés, de plus en plus, par des bénévoles (249).
Néanmoins, toutes ces formes de soins palliatifs, que ce soit en établissement de santé ou non, ne sont pas également disponibles pour tous les patients. En effet, des différences régionales ou sectorielles très marquées demeurent dans leur répartition.
B. DES INÉGALITÉS ENCORE FORTES ET DES LACUNES IMPORTANTES
L’accès aux soins palliatifs est loin d’être homogène sur le territoire français. À ce titre, les trois types d’inégalités que la Cour des comptes avait relevées dans son rapport annuel en 2006 existent toujours(250).
1. Des inégalités géographiques toujours fortes
«Une […] difficulté tient à la répartition inéquitable des structures d’USP sur le territoire. Certains départements ont répondu ne pas en avoir du tout. Les soignants disent que les temps d’attente sont parfois tellement longs que, malgré un accompagnement au long cours, les malades décèdent dans les unités de soins » (251) alors qu’ils auraient besoin d’une prise en charge spécifique, a indiqué Mme Nathalie Vandevelde au cours de son audition par la mission.
Le tableau ci-dessous illustre les disparités d’accessibilité géographique aux soins palliatifs à l’échelon régional. Il existe encore des régions qui n’ont pas d’unité de soins palliatifs : la Basse-Normandie, le Poitou-Charentes, la Martinique et la Guyane n’en possèdent pas. Le taux de lits dédiés, LISP ou USP, varie de 3,49 pour 100 000 habitants (Franche-Comté) à 14,77 (Limousin). D’une manière générale, les régions où les services de soins palliatifs sont les plus nombreux sont les régions les plus urbanisées. Par exemple, les plus forts taux d’USP par habitant se rencontrent dans le Nord-Pas-de-Calais et en Ile-de-France, qui cumulent la moitié des lits installés. Concernant l’outre-mer, à l’exception de la Guadeloupe, les régions cumulent les retards, que ce soit pour les EMSP, les USP ou les LISP. Il n’y a d’ailleurs aucun moyen de soins palliatifs en Guyane.
À l’échelle départementale, la situation est encore plus contrastée (252). Ainsi, aucun service pouvant délivrer des soins palliatifs (EMSP, USP et LISP) n’existait, au 1er janvier 2008, en Haute-Saône ; on trouve seulement une équipe mobile en Lozère et seules 10 régions sur 22 atteignent l’objectif d’une EMSP pour 200 000 habitants. Ainsi que l’indiquait le Docteur Godefroy Hirsch, « À l’échelon du département, correspondant, globalement, au territoire de santé, c’est-à-dire des ressources au plus près du patient, l’hétérogénéité s’accentue encore. Deux départements n’ont pas encore d’équipe mobile de soins palliatifs. 57 % des départements n’ont pas d’USP. La plus grande partie des départements n’ont pas de lits identifiés correspondant aux objectifs fixés, soit cinq lits pour 100 000 habitants. » (253)
Étant donné que les lits identifiés et les USP se trouvent essentiellement dans les hôpitaux de court séjour et que ceux-ci sont principalement localisés dans les grandes agglomérations, la géographie des soins palliatifs est concentrée dans les centres urbains. Des inégalités d’accès comparables peuvent être constatées en Espagne où la Catalogne dispose d’environ la moitié des capacités de soins palliatifs, qui se trouvent pour l’essentiel dans les grands hôpitaux de Barcelone.
CAPACITÉS ET DENSITÉ DES SOINS PALLIATIFS AU 31 DÉCEMBRE 2007
Dispositifs de soins |
Équipes |
Unités |
Lits identifiés |
Total lits | ||||||
Départements et |
Population |
Nombre d’EMSP |
Taux EMSP |
Nombre d’USP |
Nombre de lits |
Taux lits USP |
Nombre de LISP |
Taux LISP |
Nombre de lits |
Taux total lits |
Alsace |
1 816 995 |
8 |
0,88 |
4 |
31 |
1,71 |
64 |
3,52 |
95 |
5,23 |
Aquitaine |
3 098 991 |
13 |
0,84 |
3 |
41 |
1,32 |
99 |
3,19 |
140 |
4,52 |
Auvergne |
1 332 996 |
6 |
0,90 |
1 |
10 |
0,75 |
65 |
4,88 |
75 |
5,63 |
Bourgogne |
1 623 995 |
10 |
1,23 |
1 |
15 |
0,92 |
83 |
5,11 |
98 |
6,03 |
Bretagne |
3 080 990 |
9 |
0,58 |
10 |
82 |
2,66 |
150 |
4,87 |
232 |
7,53 |
Centre |
2 504 992 |
17 |
1,36 |
1 |
10 |
0,40 |
209 |
8,34 |
219 |
8,74 |
Champagne Ardennes |
1 338 995 |
8 |
1,19 |
1 |
5 |
0,37 |
105 |
7,84 |
110 |
8,22 |
Corse |
279 000 |
1 |
0,72 |
1 |
8 |
2,87 |
11 |
3,94 |
19 |
6,81 |
Franche Comté |
1 145 997 |
7 |
1,22 |
1 |
6 |
0,52 |
34 |
2,97 |
40 |
3,49 |
Île de France |
11 490 968 |
74 |
1,29 |
22 |
339 |
2,95 |
399 |
3,47 |
738 |
6,42 |
Languedoc Roussillon |
2 519 993 |
12 |
0,95 |
1 |
6 |
0,24 |
130 |
5,16 |
136 |
5,40 |
Limousin |
487 499 |
2 |
0,82 |
1 |
5 |
1,03 |
67 |
13,74 |
72 |
14,77 |
Lorraine |
2 338 993 |
17 |
1,45 |
1 |
15 |
0,64 |
183 |
7,82 |
198 |
8,47 |
Midi-Pyrénées |
2 754 992 |
21 |
1,52 |
1 |
10 |
0,36 |
197 |
7,15 |
207 |
7,51 |
Nord Pas-de-Calais |
4 042 989 |
18 |
0,89 |
16 |
148 |
3,66 |
262 |
6,48 |
410 |
10,14 |
Normandie (Basse) |
1 448 996 |
15 |
2,07 |
0 |
0 |
0,00 |
71 |
4,90 |
71 |
4,90 |
Normandie (Haute) |
1 810 994 |
6 |
0,66 |
1 |
5 |
0,28 |
82 |
4,53 |
87 |
4,80 |
PACA |
4 780 986 |
19 |
0,79 |
9 |
85 |
1,78 |
130 |
2,72 |
215 |
4,50 |
Pays de la Loire |
3 425 990 |
23 |
1,34 |
2 |
13 |
0,38 |
245 |
7,15 |
258 |
7,53 |
Picardie |
1 885 994 |
8 |
0,85 |
2 |
14 |
0,74 |
67 |
3,55 |
81 |
4,29 |
Poitou Charentes |
1 712 995 |
14 |
1,63 |
0 |
0 |
0,00 |
94 |
5,49 |
94 |
5,49 |
Rhône Alpes |
6 004 983 |
27 |
0,90 |
8 |
71 |
1,18 |
297 |
4,95 |
363 |
6,13 |
Guadeloupe |
447 002 |
2 |
0,89 |
1 |
12 |
2,68 |
0 |
0,00 |
12 |
2,68 |
Martinique |
399 002 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
2,01 |
8 |
2,01 |
Guyane |
201 996 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
La Réunion |
783 996 |
2 |
0,51 |
1 |
6 |
0,77 |
6 |
0,77 |
12 |
1,53 |
France entière |
62 998 818 |
340 |
1,08 |
89 |
937 |
1,49 |
3 075 |
4,88 |
4 012 |
6,37 |
Source : Programme pour le développement des soins palliatifs 2008-2012 et DHOS.
Les inégalités entre régions concernant les soins palliatifs sont reproduites sur la carte ci-dessous, qui représente par des plages grisées la densité régionale en lits de soins palliatifs (LISP et lits d’USP) pour 100 000 habitants :
NOMBRE TOTAL DE LITS (LISP + LITS USP) ET DENSITÉ DE LITS POUR 100.000 HABITANTS
(AU 31/12/2007)
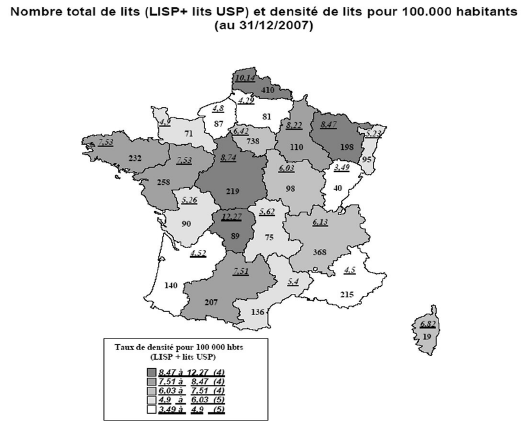
Source : Programme de développement des soins palliatifs, 2008-2012, p. 44.
On ne peut donc qu’approuver le constat fait par le Docteur Godefroy Hirsch : « Le dispositif existe. Il est en augmentation mais, dans sa mise en œuvre territoriale, il est extrêmement variable. » (254)
En vue de réduire une partie de ces disparités inter et intrarégionales, le ministère de la Santé a choisi de créer des EMSP dans les zones qui n’en disposaient pas déjà. À cette fin, il a alloué prioritairement des crédits de mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) aux régions qui présentaient un taux de couverture inférieur à 95 % de l’objectif national, en ce qui concerne les équipes mobiles. Treize EMSP ont ainsi pu être créées dans onze régions.
Dans le même but, la première mesure du programme de développement des soins palliatifs consiste à développer les soins palliatifs dans tous les établissements où sont comptabilisés un certain nombre de décès annuels (255). Cette mesure vise notamment à faire diminuer les inégalités en matière d’offre de soins palliatifs.
Néanmoins, ces mesures ne sont pas suffisantes pour résorber les inégalités régionales. En effet, le programme consacre davantage de moyens au secteur MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), qui se trouve majoritairement en zone urbaine, alors que des besoins importants concernent les zones rurales (256).
2. Des inégalités qui frappent en premier les personnes âgées
Les unités de moyen et de long séjour, ainsi que le secteur médico-social accueillent principalement des personnes âgées. Les lacunes de ces secteurs en matière de soins palliatifs créent donc une inégalité importante au détriment des personnes âgées.
a) Des déficiences évidentes dans les moyen et long séjours ainsi que dans les établissements médico-sociaux
La Cour des comptes relevait déjà, en 2006, que les établissements médico-sociaux, les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou les services de soins de suite ou de réadaptation (SSR) et les unités de soins de longue durée (USLD) accueillent peu d’équipes pratiquant les soins palliatifs, alors même que leurs patients sont, en moyenne, très âgés : « Les moyens et équipements des services de long et moyen séjour sont […] souvent sensiblement inférieurs à ceux d’un service de court séjour et très en dessous des normes minimales de prise en charge en soins palliatifs (257) ». La loi du 22 avril 2005 avait pourtant comme objectif de développer la culture palliative dans les établissements médico-sociaux, notamment en vertu de ses articles 13 et 14, qui introduisent les soins palliatifs dans le projet de l’établissement et la convention pluriannuelle.
Dans les EHPAD, il revient au médecin coordonnateur de mettre en œuvre la démarche palliative au sein de l’établissement. Il est chargé d’élaborer le projet général de soins et le volet soins palliatifs, qui s’intègrent au projet d’établissement, conformément à l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (introduit par la loi du 22 avril 2005) dont les modalités d’application ont été définies par le décret n° 2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d’établissement ou de service social ou médico-social en matière de soins palliatifs. C’est également à lui de coordonner la mise en œuvre de la politique de formation des personnels de santé de l’établissement. De cette absence de moyens découle un manque de sensibilisation aux soins palliatifs. Une étude menée en 2007 à la demande du ministère de la santé par le Centre de recherche pour l’étude des conditions de vie (CREDOC) a montré que, dans la majeure partie des cas, les EHPAD transféraient leurs patients en fin de vie vers les hôpitaux ou faisaient appel à des réseaux ou à des équipes mobiles. De ce fait, la culture palliative est peu présente dans ces établissements, même si, comme il en a déjà été fait mention, un effort de communication a été fourni récemment grâce à l’envoi à tous les établissements d’un « kit » d’information contenant des descriptifs de la loi particulièrement précis.
Mais sur le fond, la situation n’a guère évolué depuis 2005. Ainsi, au 31 décembre 2007, le court séjour représentait 75 % des LISP, contre 21 % pour le moyen séjour et 2 % pour les unités de soins de longue durée. À l’inverse, en Catalogne, selon le Conseiller social près l’Ambassade de France en Espagne, les lits de soins palliatifs de long séjour sont les plus nombreux et représentent près de 70 % du total. Ceci a été confirmé par l’audition de Mme Marie de Hennezel, qui a diagnostiqué le problème : « J’ai aussi été frappée par le fait que l’effort financier en faveur des lits identifiés, prévu au titre de la loi de 2005 afin de valoriser l’activité palliative, a été réservé aux services de médecine, chirurgie, obstétrique de court séjour, dans le cadre du Plan cancer. Il n’y a eu pratiquement aucune aide financière dirigée vers les services de gériatrie, les services de soins de suite et de réadaptation : seulement 147 lits en 2007. Il n’y a évidemment rien eu pour les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et les maisons de retraite, malgré l’article 13 de la loi. (258) » Ceci tient principalement au mode de financement des soins palliatifs dans ces différents secteurs (259).
Ces deux types d’inégalités, géographiques et sectorielles, se combinent et se renforcent. Les personnes âgées habitent en effet plus fréquemment dans les zones rurales ou sont hébergées dans des EHPAD. Dans les deux cas, « nous en arrivons en effet aujourd’hui à une situation paradoxale et choquante : ce sont les personnes qui ont le plus besoin de soins palliatifs qui doivent se déplacer parfois très loin pour trouver les compétences qui répondent à leurs besoins (260) », ainsi que l’a indiqué le Docteur Régis Aubry au cours de son audition.
Les soins palliatifs en établissements médico-sociaux sont donc très insuffisants faute de financements adéquats. Comme l’écrit le Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement dans son rapport de fin d’exercice : « A priori, les besoins sont très importants et les moyens ne sont pas là (261) ».
b) Les progrès attendus du Programme de développement des soins palliatifs
Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 entend faire de la diffusion des soins palliatifs dans ces structures l’un de ses objectifs principaux puisque pas moins de quatre actions y tendent.
Les actions III et V visent respectivement à diffuser les soins palliatifs dans des services où ils étaient peu présents jusqu’à maintenant. Elles prévoient respectivement de « développer la culture palliative dans les unités de soins de longue durée et les hôpitaux locaux » et « d’identifier des lits de soins palliatifs dans les services de soins de suite ». Le but est de former, en dix ans, les personnels des USLD aux soins palliatifs et de quadrupler le nombre de LISP en soins de suite d’ici 2012, pour en porter le nombre à 1200.
Les actions VI et VII tendent à renforcer la présence des soins palliatifs dans les EHPAD, en accroissant les possibilités d’intervention des EMSP en diffusant la culture palliative et en expérimentant la présence d’infirmières de nuit formées aux soins palliatifs dans les EHPAD. Pour ce faire, une convention type doit être élaborée pour permettre l’intervention des EMSP dans ces établissements.
Jusqu’à présent, en dépit de la loi du 22 avril 2005, les EMSP n’intervenaient que peu dans les établissements du secteur médico-social. C’est ainsi que le référentiel régissant les EMSP prévoyait qu’elles pouvaient intervenir dans ces établissements mais ceci constituait l’exception, dans la mesure où ces expérimentations devaient « s’accompagner d’une évaluation rigoureuse (262) ». Leurs interventions avaient donc vocation à rester en nombre restreint. À l’inverse, le plan 2008-2012 prévoit la rédaction d’une convention type permettant la collaboration régulière de l’établissement médico-social et de l’équipe mobile de soins palliatifs.
Enfin, le programme prévoit d’expérimenter, d’ici 2010, la présence d’infirmières de nuit formées aux soins palliatifs, dans les EHPAD, le but étant d’assurer la continuité des soins pour les personnes en fin de vie, en évitant ainsi leur transfert dans des unités de court séjour.
3. Des inégalités entre services révélatrices des limites de la diffusion de la culture palliative
Au sein d’une même région, voire d’un même établissement de santé, la démarche palliative est inégalement présente. Des différences importantes peuvent exister entre les services. En particulier, les services de pédiatrie gagneraient fortement à voir se développer les soins palliatifs.
a) Les différences entre services
« Mon premier constat est celui de l’inégalité d’accès aux soins palliatifs, non seulement d’une région à l’autre, mais surtout d’un service à l’autre (263) », a déclaré Mme Marie de Hennezel devant la mission, en ajoutant : « Plus l’établissement était pointu sur le plan technique, moins le personnel était sensible à l’accompagnement de la fin de vie […]. Plus les établissements sont voués à une culture technocentrée, plus ils sont hermétiques à la démarche palliative, ce qui peut se comprendre puisqu’ils sont dans le déni de la mort et de l’échec ».
Cette différence d’approche entre services a été confirmée par les personnes auditionnées, et notamment par Mme Paulette Le Lann, présidente de la fédération JALMALV : « Malheureusement, notre expérience de terrain nous fait distinguer deux champs différents, deux mondes, au sens sociologique du terme, qui témoignent de deux cultures distinctes » (264), selon que l’équipe médicale et soignante a été formée aux soins palliatifs ou pas.
C’est également ce qu’a indiqué Mme Nathalie Vandevelde : « Certains soignants ont signalé, lors des entretiens, que, dès que les soins curatifs sont arrêtés, des portes restent fermées, c’est-à-dire que les médecins ne rentrent plus dans les chambres […] Ce qu’ils ne font pas dans certains services, c’est la prise en charge précise des patients en continu : les suivis médicaux, les prescriptions, le fait de parler au malade et de ne pas l’abandonner. Les soignants jugent nécessaire d’apprendre aux médecins les bonnes pratiques de fin de vie et l’acceptation de l’échec thérapeutique. Ces derniers doivent arrêter de balancer entre curatif et palliatif. » (265)
Ces comportements ont été mentionnés à plusieurs reprises devant la mission parlementaire, mais ils semblent être en régression à mesure que la formation des équipes médicales et soignantes aux soins palliatifs progresse.
b) Le cas spécifique des soins palliatifs pédiatriques
Une place particulière doit également être faite aux soins palliatifs pédiatriques. Si le nombre d’enfants de moins de 18 ans devant bénéficier chaque année de soins palliatifs est relativement faible (entre 2 000 et 2 500 en France selon les estimations), une prise en charge adaptée s’impose. En effet, selon le Docteur Pierre Betremieux, chef du service de réanimation pédiatrique et néonatale du CHU de Rennes, « les pédiatres estiment que la spécificité est telle que la généralisation des réseaux de soins palliatifs pédiatriques serait très souhaitable » (266).
Or, il n’y a actuellement que peu de structures adaptées pour délivrer des soins palliatifs pédiatriques. Selon le Docteur Pierre Betremieux, il n’existe que deux réseaux de soins palliatifs pédiatriques (à Toulouse et à Rennes), un troisième étant en création en Ile-de-France. De plus, il n’existe pas d’USP dédiée aux soins palliatifs pédiatriques.
Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 prévoit, dans son quatrième point, de mieux organiser ces soins palliatifs. Pour ce faire, il préconise, dans un premier temps, de confier à un groupe d’experts la tâche de dénombrer les cas d’enfants ayant besoin de soins palliatifs, puis d’organiser l’offre de soins sur le plan régional en créant une EMSP pour chaque région et des lits identifiés dans les unités pédiatriques. Il prévoit enfin de créer des lieux de répit, notamment en service de soins de suite et de rééducation pédiatrique (SSR), pour soulager momentanément les aidants.
C. LE FINANCEMENT ACTUEL DES SOINS PALLIATIFS PERMET-IL LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE PALLIATIVE ?
La diffusion de la culture palliative, qui est l’un des objectifs de la loi du 22 avril 2005, implique que les soins palliatifs bénéficient d’un mode de financement adapté qui permette, d’une part, leur diffusion quantitative, mais qui, d’autre part, ne soit pas contraire à leurs spécificités que sont la continuité des soins, la disponibilité des équipes soignantes ou l’interdisciplinarité. En France, les soins palliatifs sont financés de manière diverse, selon le secteur dans lequel ils sont pratiqués.
1. Les différents modes de financement des soins palliatifs
La majeure partie des soins palliatifs est financée selon le système de la tarification hospitalière à l’activité (T2A) qui rémunère forfaitairement les établissements de santé en fonction du nombre de séjours qu’ils accueillent. Mais dans d’autres secteurs, le mode de financement est toujours celui de la dotation générale de fonctionnement.
a) Les financements par la tarification à l’activité (T2A)
Il convient de rappeler que la tarification hospitalière à l’activité, qui concerne à la fois le secteur public et le secteur privé, a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (267) et s’applique aux activités de court séjour dites MCO. Afin de mieux ajuster le budget des établissements de santé à leurs besoins réels, c’est-à-dire à la demande de soins qui leur est adressée, la T2A prévoit une rémunération en fonction du nombre de séjours qu’ils reçoivent. Chaque patient donne donc droit à un versement forfaitaire au profit de l’établissement, dont le montant est fondé sur le coût observé d’un tel séjour dans un panel d’établissements.
Les forfaits versés aux établissements de santé dépendent non pas de la durée du séjour mais de sa nature. Trois cas de figure sont possibles, selon que des seuils sont franchis. Si le séjour dure moins de deux jours, le forfait versé à l’établissement est faible (de l’ordre de 800 euros). Si le séjour dure entre deux et trente-cinq jours, ce qui est le cas général, le forfait standard est versé à l’établissement (dont le détail est donné par le tableau ci-dessous). Ainsi, un séjour de quinze jours rapporte trois fois moins que trois séjours de cinq jours. Enfin, si le séjour excède le 35ème jour, un forfait journalier supplémentaire est versé en plus du forfait de base. Celui-ci est néanmoins inférieur au coût journalier que représente le malade pour l’établissement de santé.
Les séjours sont regroupés en groupes homogènes de séjours (GHS), qui correspondent à des groupes homogènes de malades (GHM). Il existe un GHM « soins palliatifs » qui comprend trois GHS, en fonction de la structure qui accueille le patient.
LES TARIFS DES SÉJOURS DU GHM DE SOINS PALLIATIFS EN 2007
Structure de prise en charge |
Secteur public |
Secteur privé | |
GHS 7956 |
Soins palliatifs sur des lits ordinaires : Tarif de base |
6 569 € |
3 094 € |
GHS 7957 |
Soins palliatifs dans des USP : + 40 %. |
9 196 € |
4 332 € |
GHS 7958 |
Soins palliatifs sur des lits identifiés : + 30 %. |
8 539 € |
4 023 € |
Le tarif dont bénéficient les établissements de santé est donc d’autant plus élevé que la prise en charge du patient est effectuée dans une structure spécialisée dans les soins palliatifs. Ceci est justifié car les patients qui sont pris en charge par des USP sont ceux qui nécessitent une attention et des moyens accrus du fait de la complexité de leur état.
b) Les financements hors tarification à l’activité
La T2A ne s’applique actuellement qu’aux activités de court séjour et à l’hospitalisation à domicile (HAD). Or, de nombreux séjours de soins palliatifs se déroulent dans d’autres secteurs (soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée) et dans des établissements qui n’y sont pas soumis (secteur médico-social maisons de retraite, hôpitaux locaux). Pour ces établissements, les activités de soins palliatifs sont alors financées sur le budget général de l’établissement qui les pratique :
Les établissements qui pratiquent des soins de suite ou de longue durée et les établissements médico-sociaux reçoivent une dotation globale et fongible (dotation annuelle de fonctionnement), dont une partie peut servir au financement des soins palliatifs. En 2007, une enveloppe supplémentaire de 1,8 million d’euros a été accordée pour développer les LISP en secteur SSR, sur la base de 13 000 € par lit, soit 140 lits financés. Le programme de développement des soins palliatifs prévoit le déploiement de 16 millions d’euros supplémentaires sur trois ans, pour créer 1 200 lits.
Les équipes mobiles de soins palliatifs bénéficient des crédits des enveloppes MIGAC (missions d’intérêt général et aide à la contractualisation) (268), qui servent au financement des activités MCO. Ces financements n’entrent pas dans la mécanique de la tarification à l’activité et ne tiennent donc pas compte de la réalité de l’activité, ce qui pénalise les équipes ayant une forte activité ou une activité en développement.
Les réseaux de soins palliatifs sont financés par des fonds nationaux : le Fonds d’action à la qualité des soins de ville (FAQSV) et la Dotation nationale de développement des réseaux de santé (DNDR) ont été remplacés par le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FICQS) (269).
Les bénévoles d’accompagnement peuvent recevoir des crédits du Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS). Ainsi, en 2006, près de 1 350 000 € ont été versés à 181 associations pour la formation de bénévoles.
2. La T2A est-elle un obstacle à la diffusion de la culture palliative ?
Le financement des soins palliatifs par la T2A présente l’avantage de permettre leur plus large diffusion matérielle. En revanche, des discordances sont apparues quant à sa compatibilité avec la culture palliative, qui est fondée sur l’attention portée au patient, alors que la T2A incite à la recherche de rentabilité (270). Ce constat a justifié la saisine du Comité consultatif national d’éthique sur cette question. (271)
a) La T2A a accompagné l’essor des soins palliatifs
Si la T2A a incité les établissements de santé à développer leur offre de soins palliatifs, il n’est pas certain que toutes les déclarations d’ouverture de lits dédiés se soient traduites dans les faits.
— Le financement des soins palliatifs par la T2A est en forte croissance
Afin de favoriser l’accroissement de l’offre de soins palliatifs, les tarifs du GHM de soins palliatifs ont été fixés à un niveau supérieur, d’environ 8 %, par rapport à ceux des GHM dont la durée moyenne de séjour est comparable (entre 16 et 17 jours dans le secteur public). Cette situation a entraîné une incitation financière particulièrement forte, pour les établissements soumis à la T2A, à développer leurs activités de soins palliatifs. Ceci s’est manifesté par l’ouverture massive de lits identifiés (LISP), qui est la forme d’accueil la moins exigeante à mettre en place, puisque ces lits sont installés dans des services ordinaires.
L’ÉVOLUTION DES TARIFS PERÇUS AU TITRE DES SOINS PALLIATIFS ENTRE 2005 ET 2006
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COURT SÉJOUR
Montant des tarifs reçus en 2005 |
Montant des tarifs reçus en 2006 |
Taux de croissance | |
Lits ordinaires (GHS 7956) |
240 598 187 |
264 750 638 |
+ 10 % |
USP (GHS 7957) |
57 683 956 |
67 739 923 |
+ 17 % |
LISP (GHS 7958) |
115 647 758 |
220 687 426 |
+ 91 % |
Total |
413 929 901 |
553 177 988 |
+ 34 % |
Entre 2005 et 2006 (272), le budget des soins palliatifs a progressé, dans le secteur public MCO, de 34 %, celui des LISP doublant presque. La T2A a donc été un levier efficace d’orientation de l’offre de soins, puisque l’on remarque que, dans le même temps, le nombre de LISP dans le secteur des soins de suite, non soumis à la T2A est resté stable. Le changement, prévu en 2011, du mode de financement de ce secteur, avec le passage à la T2A, devrait permettre d’augmenter la capacité d’accueil de ces établissements en soins palliatifs. Or, ces structures se trouvant plus souvent en secteur rural que celles qui ont des activités MCO, l’offre régionale de soins palliatifs devrait être rééquilibrée.
De plus, la T2A a permis d’avoir une connaissance plus fine des activités de soins palliatifs. Alors que le ministère de la santé n’est pas en mesure de savoir combien de crédits ont été affectés aux soins palliatifs dans les activités hors T2A, du fait de la rémunération des établissements sous forme de dotation globale de fonctionnement, des chiffres précis sont désormais disponibles pour le secteur MCO.
— Une croissance moins forte des soins palliatifs que les chiffres ne le laisseraient penser
Il faut néanmoins souligner que le tarif avantageux dont bénéficient les GHS de soins palliatifs a pu conduire les établissements de santé à profiter d’« effets d’aubaine ». C’est ainsi que M. Gérard de Pouvourville, titulaire de la chaire d’économie de la santé à l’ESSEC, estimait, lors de son audition par la mission que : « Le couplage de la politique de lits dédiés et de la T2A a créé un formidable effet d’aubaine pour les établissements hospitaliers publics, dont les plus déficitaires se sont servis pour générer des recettes supplémentaires sans activité palliative supplémentaire. Aujourd'hui, la T2A est une incitation non pas à prodiguer des soins palliatifs, mais à fabriquer statistiquement des soins palliatifs pour faire entrer de l’argent. » (273)
Dans certains établissements, les LISP ne sont pas précisément localisés et les descriptifs des séjours effectués sont établis de telle sorte que davantage de séjours bénéficient de la qualification en GHM soins palliatifs. Ce phénomène existe également dans le système de santé britannique, qui connaît un système de financement proche de la tarification à l’activité, nommé Payment by Results (PbR) (274). Il y est appelé le « gaming » et prend notamment la forme de manipulations du diagnostic afin de faire rentrer le patient dans une catégorie de GHM plus rémunératrice ou de prolongation artificielle de la durée du séjour afin de franchir les seuils les plus rémunérateurs. Certains praticiens, dans le système français ont témoigné devant la mission de tels détournements. Ainsi, Mme Nathalie Vandevelde a-t-elle expliqué : « Déclarer un malade en soins palliatifs ne signifie pas forcément le prendre en charge en soins palliatifs. Les lits identifiés sont aussi un codage qui rapporte de l’argent aux structures hospitalières » (275).
De plus, il n’est pas certain que les recettes tirées des activités de soins palliatifs aient été systématiquement réinvesties dans ces mêmes services, certains praticiens se plaignant de ne pas disposer des moyens qu’ils demandent, alors même que leur activité est fortement rentable pour l’établissement. Il semble que les fonds rapportés par les soins palliatifs soient utilisés pour combler le déficit du pôle auquel ils appartiennent, notamment quand il s’agit de lits identifiés, intégrés dans des services cliniques. Ainsi que l’a souligné le Professeur Louis Puybasset, « La gestion hospitalière par pôle a noyé l’identification de ces financements spécifiques. C’est le pôle à qui appartiennent ces lits qui se voit attribuer leur valorisation alors que ce sont les équipes mobiles de soins palliatifs qui y interviennent à moyens constants » (276).
Pourtant, la tendance est bien à l’augmentation, du fait de la T2A, des capacités de soins pour les personnes en fin de vie. D’ailleurs, Mme Marie de Hennezel rappelait, pour le regretter, que l’essor des soins palliatifs se faisait presque uniquement dans les secteurs soumis à la T2A. Si, sur un plan quantitatif, ce système de financement a permis l’accroissement de l’offre de soins, a-t-il, sur un plan qualitatif, contribué à la diffusion de la démarche palliative ?
b) La T2A n’est pas toujours compatible avec la démarche des soins palliatifs
Dans son avis n° 101, le Comité national consultatif d’éthique a émis des doutes quant à la compatibilité de la T2A avec la culture palliative, jugeant que « [La T2A] s’adapte probablement mal à la prise en charge des […] soins palliatifs » (277), en raison notamment du fait que « d’autres critères prenant en considération les aspects qualitatifs de la santé, comme par exemple le temps passé à l’écoute du patient et à l’information doivent être définis pour évaluer les services non techniques rendus au patient » (278). La même inadéquation, entre T2A et soins palliatifs, avait été soulignée par la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2006, qui pointait les « risques d’effet pervers de la T2A appliquée aux soins palliatifs » (279). Ceci est résumé par le Professeur Louis Puybasset : « Quand la médecine devient plus une affaire d’argent que de soins aux personnes malades, l’accompagnement de la fin de la vie n’est plus un enjeu. C’est cela la réalité aujourd’hui. C’est cela qui explique en partie pourquoi la culture palliative ne se diffuse pas » (280). Ce constat a incité la mission parlementaire à saisir le comité consultatif national d’éthique, comme l’y autorise l’article R. 1412-4 du code de la santé publique. L’objet de cette saisine est de savoir comment un système de financement des soins qui évite l’obstination déraisonnable et facilite les soins palliatifs pourrait être mis en place (281).
Sur le plan pratique, un infirmier témoignait récemment du fait que les contraintes engendrées par la tarification à l’activité rendaient le personnel soignant moins disponible : « Avec l’instauration de la tarification à l’activité, nous sommes désormais obligés de coder tous nos actes de soins. Chaque fois que l’on fait une perfusion, par exemple, on est obligé de se mettre devant un ordinateur pour entrer toute une série de chiffres. C’est normal mais on a un peu l’impression d’être devenus des secrétaires et de ne plus avoir assez de temps auprès des patients. » (282)
Dans le cas des soins palliatifs, une prise en compte excessive des considérations de rentabilité, à laquelle pousse la T2A, pourrait avoir deux effets principaux, qui sont contraires à la culture palliative : l’obstination déraisonnable et la priorité donnée à la notion de durée moyenne de séjour.
— Dans certains cas, la T2A peut inciter à l’obstination déraisonnable
La T2A est parfois critiquée pour favoriser l’obstination déraisonnable. Pour illustrer cet effet possible de la T2A, votre rapporteur a présenté à la mission deux courbes concernant le secteur public hospitalier : l’une plate, retraçant le nombre de chirurgies de l’hypophyse entre 2004 et 2007 ; l’autre recensant le nombre de chirurgies de la vésicule biliaire qui ont augmenté, elles, de 34 000 à 37 000, ce qui suggère que la T2A peut entraîner une multiplication des actes (cf. graphique ci-dessous). Or, aucune donnée scientifique, aucun risque nouveau ne semble justifier une telle évolution des opérations chirurgicales de la vésicule biliaire dans la population. En réponse à une question de votre rapporteur, qui l’interrogeait sur les raisons d’une telle dichotomie, M. Gérard de Pouvourville a indiqué : « s’agissant de la cholécystectomie, vous mettez l’accent sur un phénomène bien connu des économistes, qui concerne des domaines où le prescripteur dispose d’un relatif pouvoir discrétionnaire. S’il est rémunéré à faire de tels actes, il en fait. C’est comme le paiement à l’acte » (283).
OPÉRATIONS DE L’HYPOPHYSE ET DE LA VÉSICULE BILIAIRE
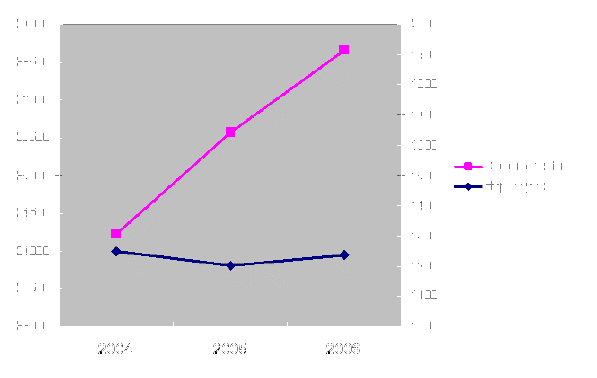
L’échelle de gauche concerne les cholécystectomies et celle de droite, les opérations de l’hypophyse.
Néanmoins, en règle générale, la T2A n’incite pas systématiquement à multiplier les actes, contrairement à ce qu’une approche trop rapide pourrait laisser penser. En effet, en dépit de l’expression tarification à « l’activité », ce sont en fait les séjours qui sont rémunérés. Dans ce cadre, chaque acte effectué au bénéfice d’un patient représente un coût pour l’établissement. Le risque est donc davantage celui d’une sous prise en charge du patient que celui d’une incitation à l’obstination déraisonnable. Néanmoins, dans certains cas précis la T2A peut inciter à l’obstination déraisonnable : il s’agit notamment des effets de seuil liés à la durée du séjour, de l’abus de médicaments onéreux et de la difficulté à qualifier les actes de soins palliatifs.
Les effets de seuil liés à la durée du séjour
Dans le système de la T2A, les séjours qui se terminent avant le deuxième jour à minuit (que l’issue soit la sortie, la mort ou le transfert), ne donnent droit qu’à un tarif relativement faible, d’environ 800 euros, alors que si la durée du séjour excède ce seuil, l’établissement de santé bénéficie des tarifs indiqués précédemment. C’est ce qu’a évoqué votre rapporteur au cours de l’audition de Mme Martine Aoustin, directrice de la mission T2A : « Si le malade qui vient de rentrer décède avant minuit, le financement est de 800 euros ; au bout de quarante-huit heures, comme de quinze jours, il est de 8 400 euros… » (284) De tels effets de seuil ne trouvent pas de justification pratique, dans la mesure où la T2A a pour objectif de refléter le plus fidèlement possible le coût supporté par l’établissement à l’occasion du séjour du patient. Or, celui-ci n’est pas multiplié par dix entre le deuxième et le troisième jour de séjour.
L’abus de médicaments onéreux
De la même manière, les médicaments onéreux, qui sont essentiellement utilisés au cours des chimiothérapies, sont, dans un but d’égalité d’accès, intégralement remboursés, dans le système de la tarification à l’activité, aux établissements de santé, en plus du tarif lié au GHS. Cette possibilité est inscrite à l’article L. 166-22-7 du code de la sécurité sociale. De ce fait et à défaut d’indicateurs qualitatifs, la question de l’opportunité du traitement ne se pose pas. Or, les dépenses liées à la prescription de ces médicaments remboursés à l’euro près devraient croître de plus 750 millions d’euros entre 2006 et 2008, soit une augmentation annuelle de plus de 15 %, malgré les mesures prises par le Gouvernement : « La croissance des dépenses de ces spécialités pharmaceutiques souvent très innovantes est particulièrement dynamique puisque les statistiques de la DREES font état d’une augmentation de 18,4 % entre 2006 et 2007 pour les établissements publics de santé ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO). » (285)
Cette dérive a été fortement soulignée par le Professeur Louis Puybasset durant son audition : « Certains produits sont tellement coûteux qu’on a mis en place en 2004 un système de remboursement « en plus » : celui des médicaments hors GHS – hors groupe homogène de séjour – que la CNAM rembourse à l’euro près. L’industrie l’a très bien compris : la part du marché du médicament dans les hôpitaux est passée en quatre ans, pour ces médicaments hors GHS, de 16 % à 60 %. Cela a créé un effet d’aubaine extraordinaire pour les industriels, qui se sont engouffrés dans ce système, où les remboursements sont automatiques. Cette augmentation de dépenses, en France, entre 2006 et 2008, est de l’ordre de 750 millions d’euros, soit l’équivalent de 8 000 postes d’infirmières temps plein sur ces deux années. Comment comparer les soins prodigués par 8 000 infirmières et l’amélioration de la qualité des soins prodigués par une dépense supplémentaire en médicaments de 750 millions d’euros ? On ne peut pas répondre à cette question, sauf dire l’évidence : quand il s’agit d’accompagner la fin de vie, les infirmières sont plus nécessaires que les médicaments. Encore une fois, le budget de l’ONDAM étant fermé, toute dépense supplémentaire en médicaments est financée par un déremboursement du soin courant au prorata de cette augmentation. D’où ce paradoxe : on va dérembourser un accouchement pour rembourser le cancéreux en fin de vie ! » (286).
Pour prévenir cette forte croissance de la prescription de médicaments onéreux, des contrats de bon usage, conclus entre les établissements et les ARH, ont été mis en place en 2005 (287), en vue de circonscrire à des cas prévus par des référentiels la prescription des molécules particulièrement onéreuses. Des contrôles sont prévus afin de vérifier que la prescription de la molécule a bien eu lieu dans le cadre établi par le référentiel. Comme l’a indiqué Mme Martine Aoustin, directrice de la mission T2A du ministère de la Santé, aux membres de la mission : « si on n’est pas dans le référentiel, le médecin doit expliquer pourquoi il s’en est dégagé ; si ce n’est pas justifié par la pathologie, l’établissement sera sanctionné pour n’avoir pas respecté le contrat de bon usage » (288).
Plus précisément le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 prévoit que l’établissement de santé envoie, chaque année, à l’ARH cocontractante, un rapport relatant les prescriptions de médicaments onéreux qui ont eu lieu l’année en question. En cas de non-transmission, le taux de remboursement de ces médicaments chute à 70 %. Si l’ARH constate que les objectifs du contrat n’ont pas été remplis, elle peut également abaisser le taux de remboursement et le fixer dans une fourchette entre 70 et 100 %. Enfin, afin de suivre les pratiques de prescription au niveau régional, le nouvel article D. 162-16 du code de la sécurité sociale instaure auprès de chaque ARH un observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique. Mme Martine Aoustin a explicité ces mécanismes de contrôle et d’analyse des pratiques : « C’est un contrôle médicalisé. Nous menons par ailleurs le suivi d’un certain nombre de produits au travers des observatoires, pour apprécier la pratique. En cas de déviance, nous revenons vers l’établissement ou vers les établissements pour les interpeller sur leur pratique. Ce suivi porte aujourd’hui sur cinq produits. Il sera bien entendu élargi régulièrement, au fur et à mesure. » (289)
En 2007, sur les 1 385 établissements signataires, 94 % ont bénéficié d’un taux de remboursement de 100 % et 6 % (soit 79 établissements) se sont vu appliquer un taux inférieur, pour un montant financier total de 1,7 million d’euros.
Compte tenu du faible impact de ces contrats de bon usage, le Gouvernement, dans le cadre de l’article 36 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, souhaite fixer un objectif de dépenses concernant ces médicaments onéreux. Ce taux sera décliné à l’échelle régionale, puis à l’échelle des établissements par les ARH. Les établissements qui dépasseront sans justification leur objectif verront le remboursement des molécules onéreuses réduit, et ce d’autant plus que le dépassement sera important si un plan d’action visant à engendrer de meilleures pratiques hospitalières n’est pas mis en œuvre. Cet article du PLFSS comprend également un alinéa obligeant les prescripteurs hospitaliers à s’identifier : « Sur la base de cette analyse nationale, ainsi que des recommandations émises par la Haute autorité de santé (HAS), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et l’Institut national du cancer (INCA), les agences régionales de l’hospitalisation devront conclure avec les établissements présentant un taux d’évolution anormalement élevé sans justification valable et un écart significatif par rapport aux profils de prescription, un plan d’action d’une durée d’un an visant à maîtriser l’évolution des dépenses par l’amélioration des pratiques hospitalières. En cas de refus de le signer ou de non-respect de ce plan, le remboursement de l’assurance maladie à l’établissement sera réduit. Par ailleurs, l’article 36 dispose également qu’à compter de 2012, l’assurance maladie ne prendra plus en charge les factures présentées par l’hôpital au titre des spécialités pharmaceutiques facturées en sus des prestations d’hospitalisation en l’absence du numéro personnel identifiant du médecin. » (290)
Un manque de définition des actes de soins palliatifs
De plus, les actes des médecins, dans le domaine des soins palliatifs, ne sont pas bien identifiés, contrairement aux autres activités médicales, qui donnent lieu à des classifications précises. Les temps d’écoute, de discussion avec le patient et ses proches, le temps consacré à la collégialité – qui est pourtant un facteur de qualité des soins et une source probable de limitation des dépenses liées à des traitements déraisonnables - ne sont pas pris en compte pour sa rémunération, en particulier quand il exerce une activité dans le secteur privé. En effet, dans le secteur privé de court séjour, la rémunération des praticiens est dissociée du forfait T2A : elle est fondée sur les actes qu’il a pratiqués, ce qui pourrait entraîner, à la marge, une multiplication des actes pouvant être assimilés à une « obstination déraisonnable ». Il paraît donc nécessaire de mieux définir ce que sont les actes de soins palliatifs.
— La notion de durée moyenne de séjour n’est pas pertinente
L’absence de pertinence de la notion de « durée moyenne de séjour »
À chaque GHM du système T2A est associée une durée moyenne de séjour (DMS), qui est l’un des fondements principaux du tarif qui est associé au groupe homogène. Cette notion a été introduite avec le double objectif d’allouer les moyens au plus juste des coûts et d’inciter les établissements de santé à réduire la durée moyenne de séjour de leurs patients. C’est ainsi que plus les séjours sont courts et fréquents, plus les tarifs reçus se multiplient. Comme l’indiquait M. Michel Vaxès au cours d’une audition : « pour un lit sur une année, il semblerait que 15 séjours de 21 jours rapportent 15 forfaits séjour tandis que 150 séjours de trois jours en rapportent dix fois plus. La question qui en découle est particulièrement sensible, s’agissant des soins palliatifs » (291). Cependant, il est peu probable que les durées moyennes de séjour soient systématiquement plus fortes dans un établissement que dans un autre.
Néanmoins, plusieurs spécificités des soins palliatifs conduisent à nuancer cette règle générale. D’une part, les durées de séjour en soins palliatifs sont extrêmement variables, allant de quelques heures à plus de 150 jours. D’autre part, les durées extrêmes de séjour sont fortement représentées, puisque plus d’un quart des séjours excèdent 35 jours. Or, la T2A n’est pertinente que pour les activités pour lesquelles la durée de séjour s’écarte peu de la DMS. Ce n’est pas le cas des soins palliatifs, ainsi que l’a rappelé votre rapporteur : « Prenez une courbe de Gauss : si la courbe est très pointue, on peut négliger les deux extrêmes ; mais si la courbe est très étalée, en raison de l’hétérogénéité, il vaut mieux prendre un autre référent que la moyenne générale ; car si celle-ci est statistiquement juste, elle est individuellement erronée. » (292) L’incertitude est donc plus forte pour les établissements qui accueillent un patient en soins palliatifs (alors que dans d’autres secteurs, la durée des séjours est relativement standardisée). Chaque admission peut se traduire par un effet d’aubaine (durée de séjour courte mais supérieure à deux jours) ou par un déficit pour l’établissement (durée de séjour qui s’allonge), sans lien avec « l’efficacité » de l’équipe soignante. Le lissage envisagé des seuils, évoqué par Mme Martine Aoustin devant la mission, par rapport aux durées de séjour et à la gravité des situations, apportera sans doute une partie des solutions à cet aléa.
Mais c’est plus fondamentalement la notion même de durée moyenne de séjour qui trouve difficilement à s’appliquer dans le domaine des soins palliatifs. En effet, l’issue la plus fréquente des séjours de soins palliatifs est la mort du patient. Dans ces circonstances, l’équipe soignante n’a pas de levier d’action pour réduire les durées de séjour ou pour accélérer leur fréquence et les incitations des gestionnaires à accroître l’activité ne font pas sens (293). C’est ainsi qu’il serait contraire à la culture palliative, que promeut la loi du 22 avril 2005, de ne pas respecter de délai de décence entre le décès d’un patient et une nouvelle admission (294) dans la chambre du défunt. Cette prise en compte des durées de séjour peut aussi aboutir à d’autres effets pervers, tels que la sélection des patients ou le fractionnement des séjours.
Les effets de la durée moyenne de séjour (DMS) : la sélection des patients et le fractionnement des séjours
« L’autre risque est la sélection des patients à l’admission, pour éviter les patients âgés, et en mauvais état qui ne permettent pas de rentrer dans les forfaits. » (295), ainsi que l’a indiqué M. Gérard de Pouvourville. La sélection des patients consiste à n’admettre en soins palliatifs que des patients dont l’espérance de vie est jugée faible, tout en étant supérieure à deux jours. Certains établissements reconnaissent, par exemple, ne pas accepter en soins palliatifs les personnes qui sont atteintes d’une tumeur cérébrale (296) ou d’une sclérose latérale amyotrophique. Cet effet d’évitement d’amont est accentué par le fait que la demande de soins palliatifs est bien supérieure à l’offre.
L’incitation au fractionnement des séjours, « source d’une extrême violence pour le patient et la famille » (297) et donc la limitation de leur durée, permettent de percevoir plus fréquemment les recettes liées à la T2A. Ces sorties ainsi favorisées peuvent être réelles (sortie effective de l’établissement, vers le domicile ou vers une autre structure) ou fictives (par exemple, lors d’un changement de service). Les professionnels de santé n’ont pas dissimulé, devant la mission, cette double réalité. C’est ainsi que Mme Nathalie Vandevelde a évoqué le problème des fractionnements de séjour pour des raisons financières en déclarant : « Le premier problème est dû au système de facturation des USP, la valorisation à moins de deux jours et à plus de 35 jours étant moins forte. Certaines structures d’USP n’ayant pas les moyens financiers d’assurer l’aval au-delà de ce temps de 35 jours, les malades reviennent en MCO, ce qui pose un énorme problème de prise en charge (298) » et en poursuivant : « L’application de la T2A entraîne un raccourcissement des durées de séjour. Par exemple, des patients en chimiothérapie qui, avant, passaient une ou deux semaines en soins ne viennent plus qu’une après-midi en hôpital de jour ou deux jours en hôpital de semaine. Il y a un flux de malades très dense et un temps de soins très court » (299). D’autre part, M. Olivier Jardé a estimé que la T2A avait un effet pervers, qui était une incitation à ne pas prolonger les séjours (300). Cet effet peut se coupler avec une sélection accrue des patients. En effet, seront alors systématiquement refusés les patients qui n’ont pas de possibilité de sortie rapide (tels que les SDF). De ce fait, si l’un des principes de la culture palliative est la continuité des soins, le financement par la T2A n’y incite pas.
Mme Martine Aoustin a néanmoins fait observer, lors de son audition par la mission, que la durée moyenne des séjours de soins palliatifs, telle qu’elle est mesurée pour l’élaboration des grilles de la T2A, avait augmenté, depuis 2002 d’un jour (301), ce qui tend à montrer que les établissements ne tentent pas de diminuer la durée des séjours de soins palliatifs. Mais il est également possible que les progrès de la médecine soient un autre facteur d’augmentation des durées de séjour en soins palliatifs, du fait de maladies « chronicisées » que la médecine moderne fabrique (des patients de plus en plus lourds qui vivent de plus en plus longtemps).
3. L’exemple britannique et la limitation des effets négatifs de la T2A
Les autorités britanniques ont tenté de mettre fin à ces effets pervers liés à une tarification à l’activité. Pour ce faire, ils ont employé différentes méthodes :
— La généralisation des contrôles, qui sont encore balbutiants en France. Ces contrôles sont fondés sur des indicateurs de comparaison au plan national, qui permettent de repérer les anomalies dans les codages des établissements et d’engager des procédures de contrôle plus poussées ;
— La rédaction d’une « guidance », ou code de conduite, ayant valeur d’arrêté, que tous les prestataires doivent respecter. Ce document fixe toute la classification des actes, les forfaits, les standards à respecter concernant la définition des données et leur entrée dans le système. Il indique par exemple les pourcentages moyens de recours à tel ou tel traitement pour chaque pathologie. Ainsi, si un établissement de santé se trouve au-dessus de ces pourcentages moyens il devra s’en expliquer ;
— La contractualisation entre hôpitaux et organismes de sécurité sociale, qui permet de mettre en place un contrôle par les quantités via les Service Level Agreements (SLA). Des contrats sont conclus entre chaque hôpital et les caisses de sécurité sociale qui prévoient des volumes d’actes pour une période donnée. Si au cours de cette période l’établissement de santé dépasse ce volume contractuel, il ne peut le prendre en charge que si la caisse y consent. S’il se révèle que la demande de soins a été créée par l’hôpital, la caisse est en droit de ne pas le rémunérer pour ces soins.
Ces méthodes réduisent en grande partie le risque de gaming puisque le contrôle des hôpitaux est généralisé et se produit aussi bien en amont qu’en aval. Par là même les établissements de santé sont conduits à mieux définir les types de séjour des patients qu’ils accueillent.
En France, ces trois formes de contrôle existent ou sont appelées à se développer :
— Les contrôles statistiques afin de détecter les « erreurs » de codage sont pratiqués par la CNAM. Les soins palliatifs constituent d’ailleurs l’une des priorités de contrôle pour l’année 2008 et un document explicitant les critères de classement en GHM « soins palliatifs » a été diffusé auprès des médecins contrôleurs.
— Il existe également des référentiels pour les soins palliatifs. Ils sont détaillés dans la circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs. Les annexes de cette circulaire détaillent les missions et l’organisation de chaque structure de prise en charge en soins palliatifs (USP, EMSP, LISP et réseaux). Elles mentionnent enfin leurs moyens de fonctionnement ainsi que les indicateurs qui doivent servir à évaluer leurs résultats. Mais ces indicateurs n’ont pas de valeur contraignante. Par exemple, pour les lits identifiés, ceux-ci recouvrent le nombre de lits, le pourcentage de séjours dans l’unité de soins dont le motif d’admission est le soin palliatif, le nombre de réunions pluridisciplinaires consacrées aux soins palliatifs et/ou à la douleur au sein du service et la possibilité de recourir à une EMSP interne ou externe (qui est matérialisée par l’existence d’une convention) (302). Il faut noter qu’à la demande du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs, un travail de recherche concernant l’élaboration d’indicateurs d’activité est actuellement mené conjointement par la SFAP et la CNAM, pour avoir des outils d’évaluation et de contrôle validés.
— Enfin, la contractualisation n’a pas la même valeur juridique en France qu’au Royaume-Uni. En effet, si les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), prévus à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique doivent identifier les services au sein desquels des soins palliatifs sont pratiqués, ainsi que les besoins de formation et le nombre de lits qui y sont consacrés, ces contrats n’introduisent pas de contrôle sur les quantités, qui pourrait conduire à un refus de rémunérer les établissements de santé pour les actes pratiqués au-delà de leur objectif.
Il convient néanmoins de ne pas considérer les soins palliatifs uniquement comme faisant peser une charge financière supplémentaire sur les établissements de santé. Le Professeur François Goldwasser, qui a mené une étude au sein de son hôpital, a constaté que les soins palliatifs étaient source d’économie et qu’une prise en charge en amont de la toute fin de vie permettait d’en réduire les coûts, tout en augmentant la qualité de vie du patient : « En ce qui concerne les économies générées par les soins palliatifs, à Cochin, nous avons des données. Du fait de l’existence du staff dont je vous ai parlé, nous avons suivi le devenir des patients. Le premier constat, c’est que, à l’inverse du reste de la population française, 80 % de nos patients décèdent non pas en services d’aigus, mais à domicile ou en soins palliatifs. Cela est dû uniquement à la réponse que nous apportons en termes d’accompagnement : nos patients continuent d’être suivis en cancérologie et ils sont vus exactement au même rythme que quand ils suivent une chimiothérapie. En respectant cette périodicité, on peut anticiper la crise et le moment où il faut trouver un lieu de décès. En n’abandonnant pas, en anticipant, nous avons réussi à inverser la proportion des décès survenant dans les services d’aigus, où les séjours sont plus "onéreux" (303). » De même, dans le cas d’une personne âgée refusant de s’alimenter, il est plus judicieux, et plus économique, qu’une infirmière consacre du temps à essayer de la comprendre et à l’accompagner, plutôt que de vérifier régulièrement qu’elle n’a pas tenté d’arracher la sonde gastrique qu’on lui a posée.
Sur le terrain de la fin de vie, l’éthique peut rejoindre la tactique économique.
Chapitre IV
Les personnes vulnérables : un accompagnement négligé
Les personnes âgées dépendantes, les personnes souffrant de troubles psychiques, les victimes de la maladie d’Alzheimer, les personnes en état végétatif ou pauci-relationnel sont autant de catégories de personnes que la société prend en charge avec difficulté. Les structures d’accueil manquent et là où elles existent la maltraitance n’est parfois pas absente. Dans tous les cas, les données font défaut, notamment en ce qui concerne les soins médicaux prodigués au sein de ces structures.
A. LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Deux facteurs rendent particulièrement nécessaire de disposer d’informations concernant les conditions de la fin de vie dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes : il existe des indices indiquant de possibles maltraitances et l’augmentation du nombre de personnes concernées est continue. Pourtant, aucune étude d’ensemble n’a été réalisée.
1. Un manque presque total d’informations
On relève un déficit de connaissance sur la fin de vie aussi bien dans les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPA) que dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dès lors, bien que la loi du 22 avril 2005 ait instauré, dans ses articles 13 et 14, une obligation de prise en compte de la dimension « soins palliatifs » dans le projet d’établissement des établissements sociaux ou médico-sociaux (en termes notamment de formation et d’identification de LISP), l’évaluation de ces dispositions est difficilement possible. Il existe peu de données portant sur ces établissements, qu’ils aient le statut de maisons de retraite et de logements-foyers (qui relèvent du secteur médico-social) ou d’unités de soins de longue durée (qui relèvent du secteur sanitaire et proposent un accueil fortement médicalisé). Or, au 31 décembre 2003, ces différentes structures, au nombre d’environ 10 500, hébergeaient 640 000 résidents (304), dont plus de 65 % dans des maisons de retraite et 60 % dans le secteur public (305).
Les conditions de la fin de vie dans ces établissements sont donc mal connues. On estime pourtant que 10 % des décès ont lieu en EHPAD chaque année. À défaut de données d’ensemble, des études locales apportent un premier éclairage sur les conditions de la mort en EHPAD. C’est le cas notamment de l’étude L’EHPAD, pour finir de vieillir. Ethnologie comparée de la vie quotidienne en institution gériatrique (306), qui, si elle vise à décrire les pratiques observées dans quelques établissements, ne saurait avoir de valeur générale. C’est donc à une absence de données d’ensemble que la mission s’est heurtée, concernant la fin de vie en EHPAD, ainsi que le rappelait votre rapporteur : « Un article du Monde rappelait récemment que l’on meurt mal en France, notamment dans les maisons de retraite médicalisées. Il serait nécessaire d’avoir une vision globale de la situation. » (307).
2. Des fins de vie souvent non accompagnées
Ce manque d’information est d’autant plus regrettable que la démarche palliative, et, plus largement, la bientraitance ne semblent pas être la règle dans toutes les structures hébergeant des personnes âgées. En témoigne le plan relatif au développement de la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance inscrit dans l’instruction ministérielle de mars 2007 (308). S’il a été estimé nécessaire de développer un tel plan, la démarche palliative sera d’autant plus difficile à introduire dans ce type d’établissement. Dans les « établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou ceux qui accueillent des personnes lourdement handicapées […] la culture de la fin de vie est ignorée. » (309), ainsi que le rappelait le Docteur Régis Aubry. Souvent, lorsque ces personnes sont en fin de vie, elles sont transférées dans un hôpital où elles meurent dans une solitude totale : « les personnes âgées ne meurent pas forcément en maison de retraite », quand bien même le transfert en hôpital n’apporte aucune amélioration en terme médical, ainsi que le disait une proche d’un patient (310).
Ces personnes vivent également dans des conditions de solitude extrêmes, ainsi que l’a indiqué la famille d’un malade qui a été auditionnée : « N’étant jamais entré dans une maison de retraite avant que ma mère n’y soit, j’ai même été très choqué de voir à quel point des patients étaient abandonnés. Seuls 10 à 15 % des malades recevaient la visite de leur famille. » (311). Par comparaison, une étude menée dans un grand établissement parisien indiquait que les patients bénéficiant de soins palliatifs recevaient, pour plus de 55 % d’entre eux, des visites quotidiennes (312).
3. Un nombre de personnes âgées dépendantes en hausse continue
Pour prendre la mesure de ce constat, il faut tenir compte de la progression des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Leur nombre est d’environ 800 000, 100 000 personnes en décédant chaque année. Leurs conditions de vie et de mort sont également mal connues. Ces malades nécessitent néanmoins des conditions de prise en charge spécifiques, que le plan Alzheimer 2008-2012 entend améliorer. Celui-ci envisage de créer, au sein des EHPAD, des unités adaptés aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer (mesure n° 16) et développer des unités spécialisées au sein des services SSR (mesure n° 17).
Afin de pallier les difficultés de prise en charge à domicile et d’aider les aidants, le Plan Alzheimer 2008-2012 prévoit (mesure n° 1) de développer et de diversifier les structures de répit afin « d’offrir sur chaque territoire une palette diversifiée de structures de répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des aidants » (313). Il prévoit par ailleurs de renforcer le soutien à domicile, en favorisant l’intervention de personnels spécialisés. Le plan préconise la création, entre 2009 et 2012, de 500 équipes spécialisées (mesure n° 6). Enfin, il envisage d’améliorer le soutien à domicile grâce aux nouvelles technologies permettant de rendre plus autonomes les personnes victimes de cette maladie (mesure n° 7).
Ce triple constat rend donc crucial le développement de la recherche, en vue de la collecte de données plus précises et plus exhaustives, afin de mieux connaître les conditions de la fin de vie dans ces établissements. Il reviendra au futur Observatoire de mener les études nécessaires pour parvenir à une meilleure connaissance de cette réalité (314).
B. LES AUTRES PERSONNES DÉPENDANTES
Les manques dans l’offre de soin ne concernent pas seulement les soins palliatifs. En effet, de nombreuses personnes, au cours de leur audition, ont souligné les difficultés, pour les personnes atteintes d’affections graves et incurables, à trouver des places dans des services de rééducation adaptés. Celles-ci semblent manquer cruellement. Ce constat est partagé par les soignants et par les malades ou leurs proches. Il s’applique aussi bien aux structures de soins de suite et de réadaptation qu’à la prise en charge à domicile.
1. Le manque de structures d’accueil pour les personnes dépendantes
À la sortie de la réanimation, la chaîne de soins se heurte à des obstacles. En effet, les places en structures de rééducation sont trop peu nombreuses pour les personnes qui sont dépendantes, suite à un accident vasculaire cérébral ou à un autre type de traumatisme. Leur état, qui peut être végétatif, pauci-relationnel ou tout simplement nécessiter une prise en charge médicale, complique leur maintien à domicile. Pourtant, les places dédiées à ces patients dans la structure de soins actuelle sont en nombre insuffisant, du fait que ces patients étaient beaucoup plus rares il y a quelques années : « Grâce aux avancées de la médecine moderne l’espérance de vie des malades augmente. Mais aucun moyen n’a été mis en place pour les besoins de ces « nouveaux » patients victimes d’AVC, qui, il y a encore dix ans, n’auraient pas survécu. » (315) C’est ce qu’a indiqué M. Guy Benamozig, psychanalyste travaillant à l’unité de neuroanesthésie-réanimation du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière, en réponse à une question de votre rapporteur :
« M. Jean Leonetti : Vous avez dit que certaines familles ne rendaient plus visite aux patients dès lors qu’ils sont sortis du service de réanimation. Est-ce souvent le cas ?
M. Guy Benamozig : S’agissant de patients pauci-relationnels ou végétatifs, c’est en effet assez fréquent. On manque d’ailleurs de lieux pour les accueillir. » (316)
Les mêmes constats ont été dressés par des proches de patients dépendants auditionnés par la mission. La mère de l’un d’entre eux évoquait en ces termes les difficultés rencontrées pour trouver une place adaptée pour son fils et l’incompréhension à laquelle elle s’était heurtée : « Malgré notre chagrin, nous nous rendons vite compte que nous devons nous-mêmes faire les recherches afin de trouver un établissement pour accueillir Jean-Michel. Nous effectuons de nombreuses démarches personnelles. Nous transmettons aux équipes soignantes des trois établissements où notre fils a séjourné, toutes les adresses et numéros de téléphone de centres adaptés susceptibles de recevoir notre malade. […] Nous refusons le placement de Jean-Michel dans un établissement de proximité, dit médicalisé, de long séjour pour personnes âgées, inapproprié. Dans ces établissements il n’y a ni médecin à demeure, ni kinésithérapeute pour assurer la kinésithérapie d’entretien. Notre malade ne sera pas mis au fauteuil, pas stimulé, il n’aura aucun soin adapté à son état dispensé par des professionnels formés à la spécificité de son handicap. […] Bien souvent, notre déception frise le désespoir. La prise en charge en milieu médicalisé spécialisé, adapté, n’est pas possible partout ; en Mayenne, par exemple, le département d’origine de mon fils, il n’y a aucun lit dédié. En Sarthe, seule une partie du département est pourvue. […] Aujourd’hui, je pense que des lits en nombre suffisant dans des structures disposant d’un personnel encadré et formé à la spécificité de la pathologie sont nécessaires et éviteraient que des malades soient dirigés vers des établissements non adaptés qui abrègent leur vie par des prises en charge qui ne respectent le cahier des charges. » (317)
Ces patients sont d’ailleurs parfois mal reçus dans les établissements de santé, dont certains membres peuvent considérer qu’un lit est immobilisé sur une longue durée pour un patient qui ne retrouvera jamais sa conscience pleine et entière. C’est ce qu’a indiqué le Docteur Anne-Laure Bloch, neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière : « Que l’on parle de long séjour, de maison d’accueil spécialisée, de centre pour états végétatifs, le but reste de libérer le lit occupé par le malade qui n’en est plus au stade aigu, mais chronique. En effet, le malade chronique, qui « stagne dans nos services », « bloque une place » qui serait tellement mieux occupée par un malade ayant le bon goût d’en être encore au stade aigu ! Dans un grand service de neurochirurgie comme le mien, cinq à dix lits sur 75 sont en permanence occupés par des malades chroniques. » (318) Ceci est encore accentué, dans le court séjour, par le fait que le financement par la T2A désincite totalement à ce genre de séjours.
Lorsque, dans un second temps, des places se libèrent dans des structures d’accueil de longue durée, le transfert devient possible, mais plus celui-ci intervient longtemps après la prise en charge initiale, plus il fragilise le patient. Le Docteur Anne-Laure Bloch l’a indiqué lors de son audition : « On remarque d’ailleurs, sans avoir pu l’expliquer, qu’un malade qui quitte le service où il se trouve depuis plusieurs années pour une nouvelle structure, meurt souvent quelques jours après.
M. Jean Leonetti : Parce qu’il y a eu rupture de soins ?
Mme Anne-Laure Boch : Non, on continue à s’occuper de lui. Mais il s’est passé quelque chose entre ces malades et les personnes qui en ont pris soin, je pense. C’est assez mystérieux… » (319)
Néanmoins, dans certaines régions, les capacités d’accueil sont satisfaisantes et peuvent servir de modèle au niveau national. C’est le cas, par exemple, du Centre médical de l’Argentière, dont le directeur, le Docteur François Tasseau a été entendu par la mission. Au cours de son audition, il a indiqué qu’une prise en charge satisfaisante de ces patients nécessitait, d’une part, une capacité d’accueil adéquate, et, d’autre part, une bonne coordination avec les services de réanimation : « La mise en place de programmes de prise en charge au centre de l’Argentière s’est faite dans le cade d’une filière de soins : après le passage en réanimation et un séjour de deux mois en moyenne dans un SRPR, les patients sont orientés soit vers un service de médecine physique et de réadaptation – MPR – soit vers un lieu d’accueil de longue durée si le diagnostic d’état végétatif ou d’état pauci-relationnel est confirmé. C’est selon ce schéma que l’unité pour patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel a été créée en 1993. La circulaire du 3 mai 2002 relative à la création de telles unités s’est inspirée de son fonctionnement. La région Rhône-Alpes comptait 47 places dédiées à ces patients en 2002. Une centaine de places supplémentaires ont depuis lors été créées, répondant ainsi en grande partie aux besoins évalués à 2,5 places pour 100 000 habitants. » (320)
2. Les difficultés de la prise en charge de la fin de vie à domicile
En outre, Mme Martine Nectoux, infirmière clinicienne a indiqué à la mission, que la prise en charge à domicile d’une personne fortement dépendante était difficile : « Un autre exemple illustre d’autres problèmes bien réels : celui d’une patiente qui, à la suite d’un accident vasculaire cérébral sévère, se trouve profondément dépendante, en fin de vie, et au chevet de laquelle les infirmières libérales passent beaucoup d’heures, dépassant largement le quota journalier autorisé à facturer. Pour assurer une continuité des soins optimale, nous avions choisi de travailler en collaboration avec un relais de notre service de soins infirmiers à domicile dans une activité de nuit. L’ensemble des prestations infirmières a été à notre charge, comme nous l’a rappelé la CPAM, grevant bien sûr notre budget d’une somme colossale, les tutelles me signifiant clairement que je ne devais pas, à l’avenir, m’engager dans de telles prises en charge. Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Dans un secteur d’activité actuellement dépourvu d’hospitalisation à domicile, comment répondre à ce type de demandes ? » (321)
À ces difficultés d’organisation s’ajoutent les difficultés rencontrées par l’entourage de la personne affaiblie par la maladie. L’épuisement des proches n’est pas sans entraîner, parfois, des dérives comme en témoigne M. Bernard Duportet, président de l’Association française pour la bientraitance des aînés et/ou handicapés (AFBAH) : « Le plus souvent, les violences sont perpétrées par un fils, une fille, un conjoint, un aidant familial qui s’épuise et n’arrive plus à s’occuper d’une personne devenue très dépendante ou désorientée » (322).
Il est donc essentiel de mener des études concernant les conditions de fin de vie et de décès de ces personnes vulnérables. Il est nécessaire également de créer des places dans des structures adaptées et d’assurer une meilleure coordination de tous les acteurs (réanimation, SSR, aidants, intervenants à domicile notamment).
Chapitre V
La formation à l’éthique et aux soins palliatifs : un pan considérable de la culture palliative occulté
La formation aux soins palliatifs s’est développée ces dernières années mais les praticiens ne sont pas encore tous armés pour faire face aux situations de fin de vie. Il en va de même pour l’éthique, trop peu abordée dans les études de médecine. Si le programme de développement des soins palliatifs renforce l’enseignement des soins palliatifs, il ne comble que partiellement les lacunes de la formation médicale en éthique.
A. LA FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS : UN DOMAINE EN LENT DÉVELOPPEMENT
Les soins palliatifs, du fait notamment de leur faible reconnaissance universitaire, ne sont que peu présents dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. Le programme de développement des soins palliatifs doit leur donner une plus grande place dans l’enseignement.
1. La formation médicale prend trop peu en compte les soins palliatifs
a) La formation initiale des médecins aux soins palliatifs
Le cursus médical est centré sur les aspects technoscientifiques de la médecine. Il existe donc une « inadéquation entre la formation médicale actuelle et la formation en soins palliatifs » (323). En effet, la formation aux soins palliatifs est obligatoire mais succincte pour les futurs médecins.
La formation des médecins aux soins palliatifs se décompose en un enseignement obligatoire et en de possibles enseignements complémentaires. La formation commune aux soins palliatifs se déroule en deuxième cycle, au sein du module 6, « Douleur, soins palliatifs, anesthésie ». Elle est essentiellement fondée sur l’acquisition de connaissances techniques relatives aux moyens de soulager la douleur et comprend un nombre d’heures variant de 2 à 30 selon les facultés. En revanche, cet enseignement peut ouvrir sur des questionnements éthiques et figure au programme de l’examen classant national (ECN).
Une formation complémentaire aux soins palliatifs peut avoir lieu en troisième cycle. Celle-ci peut prendre deux formes. Il peut s’agir, d’une part, d’un enseignement dans certains diplômes d’étude spécialisée (DES) et diplômes d’études spécialisées complémentaires (DESC) : le DES d’oncologie, le DESC de cancérologie et le DESC II de gériatrie, par exemple. Un DESC spécifique a également vu le jour pour la première fois à la rentrée 2008 (324) : le DESC médecine de la douleur et médecine palliative, organisé sur deux ans et ouvert à toutes les spécialités médicales. C’est ainsi que l’a présenté le Docteur Stéphane Donnadieu : « On va […] créer un diplôme d’études spécialisées complémentaires intitulé « Médecine de la douleur et médecine palliative » qui durera deux ans avec un tronc commun la première année et une spécialisation dans l’une des deux branches la suivante. Il sera destiné à ceux qui souhaitent s’occuper d’une équipe des soins palliatifs ou d’un centre de traitement de la douleur, et sera ouvert aux internes de médecine générale, d’anesthésie, de psychiatrie, de neurologie, de rhumatologie… » (325). Il comprend un tronc commun en première année puis une spécialisation en médecine de la douleur ou en médecine palliative. Des crédits pour 70 postes d’internes « douleur - soins palliatifs » sont prévus pour 2009.
Outre les actions ponctuelles menées par les équipes ayant une activité de soins palliatifs, deux parcours universitaires permettent une formation continue des médecins en soins palliatifs.
Le diplôme universitaire de soins palliatifs et d’accompagnement (DUSP) est une formation d’un an avec examen, stage et mémoire. La formation aborde les aspects techniques, cliniques, psychiques, éthiques et relationnels des soins palliatifs. Neuf facultés délivrent ce diplôme, qui est également accessible aux étudiants en médecine de 3ème cycle et aux professions paramédicales.
Le diplôme interuniversitaire de soins palliatifs et d’accompagnement (DIUSP), auquel on accède suite à la réussite aux examens du DUSP est constitué d’une année de formation complémentaire, centrée sur des objectifs plus larges, tels que les techniques de soins palliatifs, la pluri-professionnalité ou la réflexion éthique. Il se clôture par la soutenance d’un mémoire. Ce diplôme est délivré dans 23 universités.
En 2005, 500 personnes ont suivi ces diplômes universitaires. Au cours de son audition, le Docteur François Tasseau, directeur médical du Centre médical de l’Argentière en a donné un exemple, illustrant le fait que les DU ne sont pas destinés uniquement aux médecins : « Un diplôme d’université, dispensé par l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne et la faculté de médecine, en lien avec l’association France traumatisme crânien et l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens, a permis de former en deux ans 40 personnes, médecins et professionnels paramédicaux. » (326)
c) Des formations qui restent insuffisantes
Les connaissances des médecins concernant les soins palliatifs restent également très limitées. Le Docteur François Goldwasser a indiqué que sur 150 cancérologues exerçant en Ile-de-France, seuls trois avaient été formés aux soins palliatifs (327). Il voit d’ailleurs dans cette incapacité technique l’une des principales raisons du recours à l’euthanasie. De manière générale, ce seraient 80 % des médecins qui n’auraient jamais reçu de formation à la prise en charge de la douleur, ainsi que l’a indiqué le Docteur Stéphane Donnadieu au cours de son audition : « en ce qui concerne les DU, une enquête réalisée en 2003 pour les états généraux de la santé a révélé que 80 % des médecins déclaraient n’avoir jamais suivi de formation à la douleur. À l’époque de leurs études, il n’y avait qu’un vague rappel en pharmacologie sur la morphine et quelques notions d’anatomie sur la transmission de la douleur. » (328). Le module 6 a permis aux futurs médecins de mieux maîtriser la douleur, en s’inscrivant néanmoins dans une approche exclusivement technique.
C’est ce qu’a également constaté Mme Nathalie Vandevelde au cours d’une enquête qu’elle a réalisée concernant les professions paramédicales : « Si les institutions offrent davantage de formations douleur que de formations soins palliatifs, c’est parce qu’elles sont, en raison des normes d’évaluation de la HAS – Haute autorité de santé –, obligées de former à la douleur alors qu’elles ne le sont pas du tout pour les soins palliatifs. C’est un premier axe à retenir : il faudrait que la formation aux soins palliatifs soit rendue obligatoire par la HAS. L’accent mis sur les seules formations douleur est préjudiciable à l’aspect relationnel avec les patients puisque la prise en charge psychologique non seulement des patients mais également des familles et des proches n’y est pas du tout abordée. » (329)
Ce défaut de formation ne doit pas être imputé à un défaut d’intérêt pour l’accompagnement et les soins palliatifs. À l’inverse, c’est souvent par manque de temps que les professionnels de santé ne se forment pas. Mme Martine Nectoux a ainsi indiqué : « Malheureusement, aujourd’hui, bien des formations sont annulées faute de participants, soit par manque de motivation sur le sujet soit, et surtout, pour des raisons de service : absence de personnel, surcharge de travail » (330). À l’inverse, lorsque le temps et les moyens permettent au personnel paramédical de les suivre, ceux-ci leur sont très profitables, ainsi que l’a confirmé le Docteur Stéphane Donnadieu : « Les DU sont très utiles et les infirmières en sont très friandes. Quand ils sont ouverts au personnel infirmier, et que les crédits consacrés le permettent, vous pouvez être sûr qu’ils font le plein. Et, qui plus est, l’auditoire est extrêmement attentif et présent. Le DU est une très bonne formation continue. » (331)
Les mêmes constats ont été faits dans d’autres pays européens. Ainsi, en Angleterre, seuls 39 % des étudiants en médecine se sentent bien préparés pour faire face à des situations qui nécessitent de recourir aux soins palliatifs (332). Des situations similaires existent également aux États-Unis et en Australie.
2. Une recherche peu développée
« En bon universitaire, je considère qu’il n’y a pas d’enseignement sans recherche » (333), a indiqué M. Christian Hervé, professeur à l’Université Paris-Descartes au cours de son audition. La présence d’une recherche universitaire et clinique substantielle est l’une des conditions de l’enclenchement du cercle vertueux qu’a mentionné le Professeur Louis Puybasset au cours de son audition : « recherche clinique – mise en place de structures universitaires – modification des pratiques cliniques » (334), qui est propice à diffuser la culture palliative dans l’ensemble du monde médical. La recherche a en effet d’importantes implications en amont et en aval, que ce soit en termes de modification des pratiques ou de constitution d’un corps enseignant spécialisé. Par exemple, des efforts de recherche portant sur l’amélioration des pronostics pourraient permettre de créer des référentiels qui rendraient possible une décision plus rapide quant à la proportionnalité du traitement à l’état du patient. Comme l’affirmait le Docteur Régis Aubry durant son audition par la mission : « Au total, la recherche doit se situer en amont et s’interroger sur les moyens de ne pas provoquer, en amont, des situations dont on peut penser qu’elles généreront des conflits de valeurs inextricables » (335).
Ceci permettrait également de donner une plus forte légitimité aux soins palliatifs : « Nous avons presque le sentiment que la médecine palliative souffre d’un manque d’autorité dans le champ médical et peut-être dépend-il des professionnels des soins palliatifs de redresser la barre. Ne faudrait-il pas davantage de publications ou d’études qui entrent dans le cadre d’une démarche scientifique ? Des efforts pour diffuser des expertises et faire de la pédagogie sont également nécessaires auprès des infirmiers. » (336), déclarait ainsi Mme Laure Marmilloud, infirmière dans une unité de soins palliatifs.
Or, la recherche dans le domaine des soins palliatifs est peu développée en France. Ceci tient notamment au fait que la recherche en ce domaine touche à différentes spécialités et à différentes disciplines (psychologie, éthique, santé publique, sciences sociales). Alors que la Grande-Bretagne a choisi de créer des chaires de soins palliatifs et de développer les « sciences de l’acte soignant », ni les médecins, ni les infirmières françaises n’ont une activité de recherche suffisante dans le domaine des soins palliatifs.
3. Le Programme de développement des soins palliatifs : des avancées réelles mais encore partielles
Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 consacre pas moins de quatre propositions à la formation et à la recherche dans le domaine des soins palliatifs. Des actions entreprises dès les études médicales devraient constituer des leviers possibles de diffusion de la culture palliative, aussi bien au sein du monde médical que du monde soignant.
a) La formation en soins palliatifs
Le programme propose tout d’abord de développer la formation médicale initiale (proposition XI), mais n’énonce que peu de propositions d’actions pour arriver à cette fin. Il s’agit plutôt d’adapter la formation existante que de la transformer. Ainsi est-il prévu de « maintenir le module 6 » et de faciliter la mise en œuvre du DESC « Médecine de la douleur et médecine palliative » en créant 70 postes d’internes pour rendre la filière incitative.
De plus, la formation paramédicale initiale intégrera, à tous ses niveaux, la formation aux soins palliatifs (proposition XIII). En effet, actuellement, « les soins palliatifs demeurent encore mal connus des professionnels de santé, et ne sont notamment pas toujours perçus comme partie intégrante des activités de soins. » (337) Le référentiel des compétences nécessaires en soins palliatifs sera inclus dans la maquette de formation des infirmiers, qui comprendra à la fois une formation à la lutte contre la douleur mais aussi aux principes éthiques, à la pluriprofessionnalité et à la communication.
Concernant la formation continue des personnels d’EHPAD et des services de soins à domicile, il est prévu de généraliser la formation MOBIQUAL (proposition XII). Cet outil de formation conçu par la Direction générale de la santé et les sociétés savantes de soins palliatifs vise à sensibiliser les personnels de santé à la douleur et à la « bientraitance ».
b) La recherche dans le domaine des soins palliatifs
En ce qui concerne la recherche, le plan prône, comme moyen principal de développement, le maintien de la thématique des soins palliatifs comme thème prioritaire du Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), afin d’en faire l’un des sujets privilégiés des appels à projets nationaux. Actuellement, les soins palliatifs sont l’une des huit thématiques prioritaires (338). Le plan 2008-2012 entend également développer la recherche infirmière et les recherches interdisciplinaires en les faisant figurer dans la rubrique « Soins palliatifs » du futur PHRC.
Néanmoins, le rapport du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement souligne que la solution réelle à ce déficit de recherche dans le domaine des soins palliatifs est la création de poste de professeurs d’université (PUPH) (339).
B. LA FORMATION À L’ÉTHIQUE : DES INSUFFISANCES MANIFESTES
Les manques de la formation à l’éthique et la nécessité de la renforcer ont déjà fait l’objet de nombreuses études. On peut par exemple citer le rapport Éthique et professions de santé de 2003 ou l’avis n° 84 du Comité consultatif national d’éthique, sur la formation à l’éthique médicale.
La formation à l’éthique, diffuse tout au long de la scolarité et fort variable selon les universités, n’est pas suffisante. Selon une enquête menée en 2007 auprès des étudiants en médecine de 6ème année, si 85 % d’entre eux avaient été confrontés à une situation qualifiable « d’impasse thérapeutique », seuls 25 % avaient appris à gérer, lors de leurs études, ce type de situation, alors que 95 % pensaient qu’une telle formation aurait pu leur être utile (340). C’est dire si une formation initiale à l’éthique médicale serait importante. Insistant sur le fait qu’il « est indispensable de concevoir les dispositifs de formations initiales et continues et de valoriser les métiers au service des personnes en assurant l’accès aux meilleures compétences. » (341), le Professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique AP-HP et du département de recherche éthique de l’Université Paris Sud 11 a appelé de ses vœux cette formation.
En se déclarant favorable « au développement dans notre pays d’une formation éthique des personnels médicaux et soignants, formation continue aussi bien qu’initiale » (342), la ministre de la Santé, Mme Roselyne Bachelot a rejoint cette préoccupation des professionnels de santé. Il est donc essentiel, si l’on souhaite que l’application de la loi du 22 avril 2005 se développe, de faire progresser la formation à l’éthique des personnels médicaux et soignants.
1. Les carences de la formation initiale des médecins à l’éthique
La formation à l’éthique est inscrite dans les arrêtés fixant les programmes des études de médecine. Si elle est présente à tous les stades de la formation médicale, sous différentes formes, sa pratique effective est très variable selon les établissements.
Pour le premier cycle, l’arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle prévoit dans son article 8 un enseignement sur l’éthique médicale et la déontologie. Néanmoins, le volume horaire est variable selon les établissements, puisque sa fixation relève de chaque université. L’université Paris VI propose, par exemple, un enseignement d’éthique obligatoire en deuxième année. Cet enseignement est optionnel à la faculté de Dijon et n’existe pas à Lyon I. D’autres enseignements obligatoires peuvent également déboucher sur un questionnement éthique. C’est le cas, notamment des enseignements de sciences humaines et sociales, qui représentent un sixième des heures de première année et des coefficients à l’examen de fin d’année (343). Cependant, moins de 5 % de ces enseignements abordent les questions de fin de vie (344).
Pour le second cycle (à l’exception de sa première année), l’arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle comporte, au sein du module consacré à l’apprentissage de l’exercice médical, un item « Éthique et déontologie médicale : droits du malade ; problèmes liés au diagnostic, au respect de la personne et à la mort » (item n° 7), qui figure au programme de l’examen classant national (ECN) (345). Les étudiants qui souhaitent approfondir leur réflexion peuvent également s’inscrire à un master d’éthique. Néanmoins, Mme Suzanne Rameix, maître de conférences en éthique médicale, a indiqué, concernant l’enseignement de l’éthique : « Il est certain que l’enseignement du module 6 n’est pas du tout suffisant et que l’on ne peut pas, à l’intérieur du module 1, faire réellement le travail nécessaire sur la loi de 2005, sur la loi de 1999 et sur la loi Kouchner. » (346) Cette formation générale à l’éthique est donc insuffisante.
Concernant le troisième cycle, l’éthique appliquée à une spécialité médicale particulière figure dans de nombreux diplômes d’études spécialisées et d’études spécialisées complémentaires (DES et DESC). Elle peut également faire l’objet de travaux de recherche, au niveau du master ou du doctorat. Le Professeur Emmanuel Hirsch a indiqué tout l’intérêt des formations existantes en la matière, au cours de son audition : « Notre département de recherche en éthique forme chaque année en master – faute de capacité d’accueil supplémentaire – soixante-dix personnes au niveau national. Cette action – avec celle de l’Espace éthique de M. Jean-François Mattei à Marseille et celle de l’université de Paris V – contribue à la création d’un réseau de compétences au plus près de la réalité du terrain, sur lequel pourrait s’appuyer l’observatoire. Il existe maintenant des personnes qui ont la compétence pour distinguer ce qu’est un problème éthique, pour le problématiser, pour lui appliquer tel ou tel type d’argumentation. » (347)
Par comparaison, en Angleterre, toutes les facultés de médecine enseignent les soins palliatifs et l’éthique. C’est ce qu’a montré une étude menée en 2001 (348). En Allemagne, un module interdisciplinaire de « Histoire, Théorie et Éthique de la médecine » est obligatoire dans toutes les universités. Il a généralement lieu en deuxième cycle et comporte environ 30 heures. Son contenu varie selon les universités et ne concerne pas toujours la fin de vie. Les étudiants doivent y obtenir la note minimale de « passable ». Par exemple, à l’Université de la Charité à Berlin, qui est la plus grande université de médecine d’Europe, ce module s’effectue au premier semestre du deuxième cycle des études médicales et regroupe 5 heures de séminaires, 9 heures de travaux pratiques et 14 heures de cours magistraux. Divers thèmes sont abordés dans les séminaires comme la psychiatrie et la philosophie ou encore l’interface entre la médecine, le droit et l’éthique. Les cours magistraux traitent de thématiques interdisciplinaires ayant trait à l’éthique, telles que le serment d’Hippocrate, la mort et l’épidémie, la médecine comme science, la médecine à l’époque nazie ou la folie. En premier cycle, a lieu un cours de « psychologie et sociologie médicale », obligatoire lui aussi, qui porte notamment sur l’interaction patient-médecin et peut donc être considéré comme un apprentissage de la réflexion éthique. En revanche, il n’existe pas d’enseignement de l’éthique médicale en troisième cycle. (349)
2. Une dimension négligée par le Programme de développement des soins palliatifs
Alors que le rapport de fin d’exercice du comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement fait, dans son annexe n° 14 de nombreuses propositions concrètes, le programme de développement des soins palliatifs ne mentionne que superficiellement la question de la formation à l’éthique, en n’en reprenant que quelques-unes.
Le plan généralise ainsi au L2 (2ème année) et au L3 (3ème année) l’enseignement de sciences humaines et sociales. Il propose également la mise en place d’un séminaire obligatoire en deuxième cycle intitulé « place et construction de la réflexion éthique dans les situations complexes concernant les personnes en fin de vie et les limites de la médecine » ainsi que le développement des enseignements multidisciplinaires (rapprochant étudiants en médecine, soins infirmiers, droit ou psychologie).
La formation à l’éthique des médecins semble donc être le parent pauvre de ce programme puisqu’aucun objectif précis n’est mentionné alors que le groupe de travail « formation – recherche » du Comité national de développement et de suivi des soins palliatifs proposait de nombreuses mesures (création de départements de sciences humaines et sociales, introduction dans chaque DESC d’une réflexion à l’éthique propre à la discipline, insertion dans le stage infirmier d’un exercice d’écriture concernant une situation qui a choqué l’étudiant…).
Chapitre VI
La santé et la justice : entre la crainte et l’incompréhension
A. L’APPLICATION PAR LE JUGE DE LA LOI DU 22 AVRIL 2005
Prendre des décisions dont on sait qu’une de leurs conséquences sera le décès du patient suscite naturellement la crainte de poursuites pénales. Les hésitations de l’équipe soignante qui a eu en charge Vincent Pierra à l’hôpital de Saumur attestent des interrogations dont pouvait faire l’objet cette loi peu après son entrée en vigueur (350). Le détail de cette affaire laisse penser qu’en un premier temps le procureur n’avait pas non plus cerné la portée du nouveau dispositif juridique.
Une étude évaluant la prise en compte d’un risque judiciaire dans les motivations des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement resterait à faire.
Il semble cependant que dans certaines spécialités telles que la néonatologie ou la réanimation, les médecins ont perçu que les dispositions légales introduites par la loi du 22 avril 2005 leur apportaient un surcroît de légitimité. (351)
L’approche juridique des affaires liées au respect des droits des malades en fin de vie bénéficie aussi de règles plus explicites. Selon Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, « la loi du 22 avril 2005 a facilité la tâche du magistrat […] (352)». Le principe du double effet est en effet circonscrit par des protocoles précis dont il revient au juge, en cas de contentieux, d’apprécier le respect. Il s’agit, a expliqué la Garde des sceaux, pour le magistrat de s’assurer : « – que le devoir d'information du patient a été mis en œuvre : il porte sur les effets seconds de certains traitements qui soulagent la douleur, mais peuvent abréger la vie ;
— que la volonté exprimée par le malade conscient de limiter ou d'arrêter le traitement est inscrite au dossier médical ;
— que la procédure collégiale pour l'arrêt des soins, si le malade est inconscient, a bien été mise en œuvre. Cette procédure prévoit qu'un tiers de confiance ou un membre de la famille soit informé.
Grâce à ces protocoles, le magistrat est en mesure de connaître la volonté du malade et de s'assurer qu’elle a été exprimée clairement. (353) »
La Garde des sceaux a annoncé plusieurs initiatives qui devraient contribuer à mieux faire connaître ces protocoles. Les membres de la mission parlementaire soutenant vivement toutes les actions qui pourraient être entreprises dans le but de favoriser une meilleure compréhension réciproque du monde judiciaire et du monde médical a décidé de reprendre ces propositions dans les conclusions de ses travaux. (354)
B. L’APPRÉCIATION PAR LE JUGE DES ACTES D’EUTHANASIE
Comme l’explique la Garde des sceaux, « La difficulté pour la justice est de savoir si l'intervention médicale ou familiale constitue une atteinte volontaire à la vie ou se situe dans l'accompagnement de la fin de vie » (355). Depuis 1995, seules 28 affaires portant sur des cas potentiels d’homicide en milieu hospitalier ont été signalées à la Chancellerie. Trois d’entre elles auraient pu être évitées si la loi du 22 avril 2005 avait été en vigueur.
M. Jean-Marie Huet, Directeur des affaires criminelles et des grâces, constate que « de façon générale, il y a peu d’intrusion judiciaire dans les situations purement médicales de fin de vie. » (356) Seule l’affaire des cas d’euthanasies dans le service de réanimation du CHU de Besançon a fait l’objet d’une information judiciaire pour empoisonnement, ouverte le 2 juillet 2007, cinq ans après les faits.
Dans l’affaire du suicide M. Rémy Salvat, le parquet de Pontoise, après avoir prononcé une interdiction provisoire d’incinération afin de procéder à des examens toxicologiques, a délivré l’autorisation nécessaire le 27 août 2008. Dans l’affaire du suicide de Mme Chantal Sébire, le parquet de Dijon a annoncé le 15 octobre 2008 son intention de classer sans suite l’enquête pour provocation au suicide. L’affaire Marie Humbert et François Chaussoy s’est close sur un prononcé de non-lieu délivré par le juge d’instruction de Boulogne-sur-Mer le 26 février 2006. Parmi les affaires les plus récentes qui ont été jugées en assises, les verdicts vont de peines de prisons avec sursis à des acquittements(357).
M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation et M. Jean-Marie Huet ont insisté sur la prise en compte par le juge des circonstances propres à chaque affaire. Le procureur et le juge appliquent à chaque cas la règle avec discernement : opportunité des poursuites, existence de faits justificatifs, expertises, respect des protocoles fixés par la loi du 22 avril 2005 sont autant d’instruments juridiques à sa disposition.
Le prononcé de peines d’acquittements a pu cependant susciter des interrogations. L’acquittement ne pouvant être prononcé que si le prévenu est déclaré non coupable (358), le jury est conduit, dans ce type d’affaire, et en l’absence de cause d’irresponsabilité, à ne pas reconnaître l’accusé coupable alors que ce dernier reconnaît, voire même revendique, être l’auteur de l’acte. M. Robert Badinter a rappelé qu’une décision de cour d’assises « est souveraine et n’a pas à être motivée ».
Tandis que la condamnation à une peine de principe (359) paraît constituer une réponse sociale respectueuse des interdits, la question a été posée des conséquences que pourrait avoir la multiplication de telles décisions d’acquittement dans ce genre d’affaire. Ainsi, après la décision d’acquittement prononcée par la cour d’assises du Val d’Oise le 9 avril 2008 en faveur de Mme Lydie Debaine (360), M. Dominique Coujard, président de la cour d’assises de Paris s’était publiquement interrogé sur la portée de cette décision : « Pardonner un acte, c’est intégrer son auteur dans la société, alors que le déclarer innocent c’est dire que l’acte n’a pas eu lieu, qu’il n’existe pas […] Je pense que c’est une décision d’espèce qui est un peu aberrante. Il est à souhaiter qu’elle ne se répande pas. (361) ». Dans la même déclaration, M. Dominique Coujard avait cependant estimé inutile qu’il y ait appel de la décision « pour ne pas lui donner une dimension qu’elle na pas », ce qu’avait souhaité également le procureur de Pontoise, Mme Marie-Thérèse de Givry à l’issue du procès. Le procureur général près la Cour d’appel de Versailles M. Jean-Amédée Lathoud a cependant interjeté appel, en application de l’article 380-2 du code de procédure pénale, expliquant qu’il convenait de protéger l’intérêt général susceptible d’être remis en cause par un verdict qui pourrait « être compris comme un encouragement à l'atteinte volontaire à la vie des handicapés, qui méritent notre protection et notre soutien […] Il m'apparaît que l'acte de Lydie Debaine, s'il justifie une réelle compassion, ne peut être accepté en l'état du droit français, de nos valeurs éthiques et des principes qui fondent la vie en société » (362).
Cependant, le fait même que le procès ait lieu, que l’affaire soit jugée contradictoirement, oralement et publiquement devant un jury populaire a déjà en soi une vertu démonstrative. Comme le souligne M. Robert Badinter : « pour l’auteur d’un acte d’euthanasie, l’audience et son rituel se terminant par un acquittement n’amèneraient-ils pas une catharsis préférable à un non-lieu décidé dans un cabinet d’instruction ? (363) »
*
* *
Évaluer une loi, c’est en analyser les forces et les apports mais aussi en mesurer les éventuelles faiblesses et les limites. Pour compléter les enseignements du tableau ainsi dressé, il est apparu utile à la mission de s’interroger sur les fondements éthiques d’un « droit à la mort », de porter un regard sur les autres voies qui ont été suivies à l’étranger et d’analyser les pistes de réflexion présentées, soit comme des compléments, soit comme des alternatives à la loi du 22 avril 2005.
PARTIE II : UN DROIT À LA MORT PEUT-IL ÊTRE LÉGALISÉ ?
Le décès par suicide de Mme Chantal Sébire a reposé ces derniers mois la question de l’euthanasie. Face à de tels drames, la loi du 22 avril 2005 sur les droits des malades et la fin de vie n’apparaît-elle pas comme trop timorée ? La démarche qu’elle propose offre-t-elle une réponse à toutes les souffrances que peuvent engendrer les situations de fin de vie ? La critique est poussée à l’extrême quand elle s’appuie sur un cas singulier qui semble porter à lui seul toutes les valeurs de l’humanité dans ce qu’elle a de plus expressif – un visage –, de plus volontaire – une détermination sans faille – et de plus désespéré – une mutilation qui repousse les limites de l’humain. L’image devient alors plus forte que la pensée. Quand un combat solitaire est ainsi mené contre des dispositions abstraites qui continuent de faire de l’euthanasie un crime, l’évidence de l’indignation peut gagner chacun. Quand en outre, ce combat solitaire en rencontre d’autres par l’intermédiaire d’une association, et que des mises en image assurent le partage, en direct et même en gros plan, de l’insupportable, paraît se créer une fracture entre le monde réel de ceux qui auraient pris la mesure de la mort et des institutions peu aptes à intégrer dans le jeu social la compassion éprouvée envers la souffrance d’autrui. Quand de plus, les soutiens d’une tragédie singulière peuvent se compter au moyen de sondages (364) et se rassurer sur leur nombre (365) et que les affaires judiciaires sur les cas d’euthanasie conduisent à des acquittements – parce que, comme le dit M. Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, « les jurés sont des citoyens (366) » – l’incompréhension se fait soupçon et plus forte devient la volonté de faire sauter l’obstacle de lois « en décalage » avec « la volonté affirmée des Français (367) ». Quand enfin on constate que des législations autorisant l’euthanasie existent à nos frontières, que là la mort « une coupe de champagne à la main (368) » est possible, que la législation française elle-même s’inscrit dans un cours naturel s’orientant vers une reconnaissance croissante des droits du malade et de l’autodétermination, que le vieillissement de la population, en particulier le développement des maladies neuro-dégénératives, pourrait inéluctablement rendre de plus en plus fréquent les demandes d’euthanasie, les instruments de réflexion éthique de la loi du 22 avril 2005, leur signification et leurs nuances, sont difficilement perçus, emportés qu’ils sont par une demande beaucoup plus large et beaucoup plus simple.
Chapitre I
Quels seraient les fondements d’un droit à mourir ?
Qu’il s’agisse d’une aide au suicide par fourniture à la personne de moyens à l’aide desquels celle-ci peut se tuer, ou d’une euthanasie par un geste létal délibéré sur une personne qui souffre, les défenseurs de la légalisation de l’euthanasie font reposer sur un acte libre et volontaire la demande d’aide à mourir. Cette demande devant faire droit, c’est un droit de mourir, universel et réel, qui est revendiqué. S’il est entendu depuis la Révolution française que chacun dispose de sa propre vie et que le suicide n’a donc pas à faire l’objet d’une incrimination pénale, la demande de la reconnaissance d’un droit à mourir est très différente : elle engage la société, puisque le suicide ne serait alors plus une affaire privée mais une affaire qui se négocierait publiquement par l’appel à des règles garantissant des droits voire par la délivrance par la puissance publique de prestations en ce sens. Mais peut-on faire droit à cette demande à ce niveau de généralité, – qui ferait que ce droit ne pourrait être refusé à personne – alors que les fragilités et la complexité des motivations qui sont à la source d’une demande de mort dénotent plus l’impuissance et le désarroi de l’individu que le pouvoir de choisir son destin ?
A. DE QUELLE LIBERTÉ PARLE-T-ON ?
Face aux contraintes du sort et de la maladie, face aussi aux conséquences des prouesses techniques qui placent parfois les malades dans des situations de dépendance extrême, la reconnaissance d’un droit à mourir reviendrait à faire droit à une liberté entendue comme une autodétermination. La revendication stoïcienne de ne dépendre d’aucune attache au monde, le pouvoir en conséquence de s’en retirer à tout moment, s’interprète comme la marque d’une dignité transcendante qui fait le propre de l’homme. « Cela renvoie, explique M. Axel Kahn, à la volonté de maîtriser son être, ses décisions, rester libre de soi jusqu’à sa mort. Dans cet esprit est né l’idéal de l’ultime liberté : rester maître de soi, de mourir, et ne pas se laisser aller à la décision de tiers. (369) »
Mais une telle maîtrise de son destin n’est possible que sous des conditions si exceptionnelles qu’on peut se demander, comme le fait M. Axel Kahn, si elle ne relèverait pas d’une pure abstraction : « Néanmoins, d’un point de vue philosophique, cette liberté ultime mérite toujours d’être questionnée. La caractéristique de l’ultime liberté est qu’elle reste exceptionnellement une liberté. Par exemple, en sortant de cette réunion, qui se déroule dans une salle agréable, dans un beau quartier, où je parle d’un sujet qui me passionne, je pourrais, plutôt que de retourner à l’université et poursuivre une activité exaltante tout autant, me jeter sous un bus. C’est une vraie liberté. J’ai en effet le choix entre ces deux voies. (370) »
Ces circonstances exceptionnelles, dont l’évocation s’apparente à un jeu de l’imagination, n’ont rien de commun avec les conditions dans lesquelles une demande de mort est exprimée. Dans ce dernier cas, la vie et la mort ne se présentent pas comme deux options également ouvertes, car la vie n’est simplement plus envisagée comme une solution possible au dilemme. La mort s’impose de fait à l’esprit de l’individu ; tout en se croyant libre, il se précipite dans la seule voie qui s’ouvre devant lui. « [La] demande [de mort], poursuit M. Axel Kahn, émane toujours d’une personne pour qui la vie est devenue insupportable, et qui estime qu’elle n’a d’autre choix que de l’interrompre. C’est tout à fait le contraire d’une liberté, et il convient, une fois pour toutes, de tordre le cou à cette idée selon laquelle la demande d’euthanasie serait de ces libertés glorieuses pour lesquelles on est prêt à se battre parce qu’elles sont un idéal de vie. Ce n’est jamais cela. (371) »
Revendiquer un libre et égal accès à la mort en invoquant des principes juridiques fondamentaux n’aurait non plus aucun sens, précise le Professeur Daniel Brasnu, au vu de ce qu’est réellement l’expérience singulière de la mort : « Avancer que le droit à la mort est une liberté individuelle, est un argument qui ne peut me convaincre. On ne peut ajouter un nouveau chapitre relatif à la liberté individuelle du droit à la mort à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un tel ajout serait en opposition avec l’esprit originel de la Déclaration, même si le concept de maîtrise de sa propre mort se fonde sur des principes d’égalité. Nous sommes tous inégaux face à la mort. (372) »
On peut aussi remarquer que la liberté est toujours, dans une certaine mesure, celle de pouvoir changer d’avis alors qu’à l’inverse l’euthanasie est un acte irréversible.
B. COMMENT ÉVALUER LA VOLONTÉ DE MOURIR ?
La liberté du malade qui demande la mort est un leurre. « De manière subreptice, explique le sociologue Patrick Baudry, ou implicite, dans les débats ou dans les constructions des représentations, l’on fait passer certains mots comme s’ils procédaient d’une évidence parfaite. Qui serait contre l’idée d’être indépendant, autonome ? Personne. Mais qu’y a-t-il derrière ? » (373). Derrière cette affirmation d’une autonomie, il y a avant tout la volonté d’un individu solitaire, isolé et abandonné dont les décisions sont plus l’effet du dérèglement des liens sociaux et de la faiblesse de la solidarité que la réalisation d’une aspiration à une puissance individuelle. Les personnels soignants qui ont été auditionnés comme les représentants d’associations ont confirmé ce sentiment d’abandon présent chez les patients réclamant la mort. Le désarroi qui fait suite à cet abandon est toujours, selon le Professeur Patrick Baudry, à l’origine de cette demande : « […] l’être autonome dont il est à la mode aujourd’hui de faire l’éloge, n’est-il pas objectivement démuni ? Faut-il se féliciter du progrès d’une liberté, ou s’inquiéter du déficit de solidarité ? Cet individu libre l’est-il parce qu’une société lui permet de s’affranchir de toutes sortes de contraintes qui pesaient naguère sur lui, ou l’est-il dans le climat d’une sorte de désarroi qui l’oblige à fabriquer ses propres normes ? […] L’« individu roi » – « je fais ce que je veux » – est en même temps un individu déboussolé, pris entre différents courants que, finalement, il ne contrôle pas. Dans ce devoir de fabriquer nos propres rapports aux normes, il n’est pas certain que nous ayons véritablement gagné en autonomie. (374) »
Une demande de mourir n’est jamais formulée dans les termes idéaux d’une volonté qui ne serait contrainte par rien d’extérieur à elle. Elle se révèle au contraire, dans cette situation, la volonté la plus contrainte qui soit, que la déshérence sociale l’ait fragilisée au point de la rendre inapte à opposer à la mort quelque valeur de vie que ce soit, ou que des circonstances aient pesé directement sur elle dans le sens de l’anéantissement. Les données de mortalité par suicide le confirment : évalué à 45 %, le taux de récidive est la reconnaissance du fait que 55 % des personnes ayant fait une tentative de suicide ont, sous l’effet de nouvelles circonstances, préféré définitivement la vie plutôt que la mort.
Auditionnée par la mission parlementaire, Mme Maryannick Pavageau a témoigné que les personnes atteintes, comme elle, d’un locked-in-syndrom, ne formulaient de demandes de mort que dans des moments de détresse. Cette détresse est « à relier à un phénomène de solitude » (375), solitude aggravée, a expliqué M. Joël Pavageau par le fait « que ces personnes se considèrent parfois comme un fardeau pour leur entourage. » (376)
La maladie et la vieillesse sont en effet des états où le caractère influençable de la volonté par des tiers est le plus marqué. Pour les personnes qui s’estiment être une charge pour leur famille ou pour l’équipe médicale qui les prend en charge, le droit de mourir risque d’être interprété comme une obligation morale de disparaître. Écarter ce risque serait méconnaître le pouvoir suggestif qu’a l’entourage sur la volonté des malades en particulier celle des personnes âgées. « Dans la vraie vie, rappelle Mme Suzanne Rameix, il y a des personnes très fragiles qui, à tout moment, pourraient intérioriser le rejet dont elles sont l’objet. Il y aurait alors des demandes d’aide au suicide qui ne seraient pas du tout l’expression d’une liberté, mais l’expression de quantité de pressions, directes – par exemple, maltraitance – ou indirectes – par exemple sentiment que l’on est un poids ou que l’on coûte trop cher, etc. Ce serait très destructeur pour les personnes les plus fragiles. » (377)
Le cours même de la maladie, quand celle-ci atteint le cerveau (378), aggrave en outre la fragilité du patient. L’augmentation du nombre de personnes âgées atteintes de maladies neuro-dégénératives rend particulièrement grave cette question. Comme l’a rappelé le Professeur Daniel Brasnu : « En France, selon le ministère de la santé, 860 000 patients sont atteints de maladie d’Alzheimer, et 165 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La légalisation du suicide assisté pourrait avoir comme dérive la mort de milliers de patients atteints de la maladie à un stade débutant, leur faisant perdre quelques années de vie dans la dignité et la possibilité d’une guérison potentielle en cas de la découverte d’un traitement curatif. » (379)
Le Docteur Marie-Hélène Boucand, coordinateur médical au sein de l’Association Française des Syndromes d’Ehlers-Danlos, a eu l’occasion d’illustrer cette vulnérabilité des patients en exposant l’effet d’entraînement qu’avait eu la demande de mort formulée par Mme Chantal Sébire sur Mme Clara Blanc, jeune femme de trente et un ans, atteinte comme le Docteur Marie-Hélène Boucand, d’un syndrome d’Ehlers-Danlos (380) : « L’association a […] touché du doigt le retentissement involontaire, mais bien réel, de ces demandes de suicide assisté sur les malades souffrant de la même maladie et qui se battent au quotidien pour que la vie soit possible et bonne, ces anonymes, oubliés des médias, qui ont choisi de se battre pour la vie, quel que soit leur niveau de dépendance, de maladie ou de handicap. Je souhaiterais que dans tous nos débats éthiques nous pensions à eux. » (381)
À cette fragilisation de la volonté de la personne risque de s’ajouter une fragilisation de la détermination de son entourage. En effet, une telle obligation « morale » peut également gagner insidieusement le corps social. Selon le Docteur Marie-Hélène Boucand lorsque la souffrance éprouvée par le malade, en vient à désespérer son entourage ou l’institution qui le prend en charge « […] le « je n’en peux plus » devient […] pour le malade et pour ceux qui l’entourent, le « c’est insupportable », la seule issue logique pour la personne souffrante étant alors de disparaître. C’est même un choix qui pourrait progressivement s’imposer à l’entourage et à la société qui, sous couvert de l’argument ambigu de la compassion, en viendraient ainsi à accepter ou à proposer de supprimer la personne pour supprimer sa souffrance, tentation qui permettrait à tous de ne plus avoir affaire avec la souffrance et le souffrant. » (382)
Ces diverses mises en garde faites au cours des auditions sur le profond désarroi dans lequel est plongée la personne en fin de vie et sur la fluctuation de sa volonté rendent, entre autre, très discutable la rédaction de directives sur le modèle de la législation belge dans lesquelles le malade demanderait, de manière anticipée, à être euthanasié sous certaines conditions. C’est avec une extrême prudence qu’il convient de recevoir une demande de mort quand on peut suspecter que ce que dit le patient ne l’est pas de façon volontaire et éclairée. Quelles que soient les circonstances, le soupçon que cette « aide à mourir » n’ait été en réalité que l’assassinat d’une personne vulnérable continuera à peser.
C. LA SOCIÉTÉ DOIT-ELLE APPORTER UNE ASSISTANCE AU SUICIDE ?
Distingué du droit au suicide en tant que liberté personnelle, le droit d’obtenir une aide à mourir est revendiqué par ses défenseurs comme devant être reconnu au même titre que l’est le droit à mourir d’une mort préservée de toute obstination thérapeutique déraisonnable. Mme Suzanne Rameix, maître de conférences au département d’éthique médicale de la faculté de médecine de Créteil, a insisté sur les différences qui pourtant distinguent profondément ces demandes : « Il ne faut pas confondre le fait de refuser un traitement – c’est-à-dire demander que le médecin ne fasse pas ou arrête un traitement – et celui de demander que l’on vous donne une substance mortelle ou qu’on vous l’injecte. Dans les deux cas, la demande semble l’exercice d’une même liberté. Mais il y a en fait une différence fondamentale : dans le premier cas, c’est le refus que quelque chose soit fait par un tiers sur soi-même ; dans le second, c’est la demande que quelque chose soit fait par un tiers sur soi-même. Cette dernière demande ne relèverait pas d’un droit-liberté, mais d’un droit-créance. » (383) En se formulant comme un droit-créance (384), le droit à mourir fait peser sur tous le devoir de rendre effectifs les moyens nécessaires à sa réalisation. Le droit à mourir ferait partie de ces dettes que chacun contracte avec chaque tiers aux termes du contrat social.
Que le contrat social contienne cette clause d’entraide ne serait pas sans paradoxe, sa fin étant la « conservation des contractants » (385). Sur le même plan, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme avaient pu s’interroger sur la cohérence qu’il y a à déduire un droit de cette nature du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme : « l’article 2 ne saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir » (386).
Il convient surtout de mesurer les implications qu’aurait la socialisation d’une telle obligation. Le bénéfice en étant de droit, on peut estimer à plusieurs milliers par an le nombre de demandes qui seraient formulées (387). Minimiser l’obligation d’y répondre, en précisant qu’une clause de conscience serait ouverte à tout médecin n’est d’aucun effet une fois posé le principe d’un droit-créance. L’État, dont ce serait le devoir, aurait à en garantir la prise en compte par l’intermédiaire d’organismes qu’il lui reviendrait de créer ; la réalité d’une administration dédiée aux affaires euthanasiques se déclinerait d’elle-même, avec ses règles, ses compétences, ses fonctionnaires, ses formulaires et son contentieux inévitable (388). Dans l’hypothèse où le corps médical dans sa totalité refuserait de servir de tiers aidant, comme il en va aux États-Unis pour les condamnations à mort par injections (389), il reviendrait à l’État de désigner et de former des individus compétents pour ce faire.
Mme Suzanne Rameix s’est interrogée sur la cohérence entre l’autonomie revendiquée par celui qui veut avoir la maîtrise de sa propre fin et les valeurs communes qui structurent une société. Que reste-t-il de ces dernières si toute question se résout en un problème d’exercice de liberté individuelle et d’égalité des droits ? « […] il ne reste que la gestion de rapports contractuels et des libertés conçues comme des formes d’indépendance, des droits d’avoir et de faire prévaloir des préférences. La liberté est une autodétermination, ce n’est plus une autonomie : on garde le radical « auto » qui veut dire « soi-même » mais il n’y a plus « nomos » c’est-à-dire la loi, ce qui est généralisable, partageable avec les autres, voire universalisable. La dignité elle-même devient l’objet d’une évaluation et d’une convenance personnelles. » (390) Dans l’affaire Diane Pretty précédemment mentionnée, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ont ainsi jugé non fondée la tentative de légitimation juridique d’un tel relativisme en refusant d’admettre que le droit à la vie puisse « créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu le droit de choisir la mort plutôt que la vie. »
De façon plus générale, la revendication de la légalisation de l’euthanasie paraît ignorer singulièrement les thématiques contemporaines de la responsabilité collective. Comme le souligne Mme Suzanne Rameix : « il est impossible de penser maintenant l’exercice des libertés individuelles sans prendre en compte leurs conséquences pour les autres ou pour la nature. ». Quelles seraient les conséquences sur autrui de l’obligation de commettre un homicide ? Celui qui réclame le droit de mourir a-t-il mesuré les effets que sa demande continuera à avoir alors que lui-même ne sera plus là ? Il est de la responsabilité de l’individu de ne pas faire abstraction de la vulnérabilité de la société qu’il veut quitter ni de l’avenir ainsi fragilisé des êtres dont il se sépare.
D. LE DROIT À MOURIR SE JUSTIFIE-T-IL PAR L’AUTONOMIE DE L’INDIVIDU ?
Clôturant son intervention devant les membres de la mission parlementaire, Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a rappelé que « la vie d’autrui n’est à la disposition de personne. » (391) Comme il vient d’en être fait mention, la logique de l’euthanasie voudrait à l’inverse que le patient souhaitant bénéficier d’une aide à mourir remette sa vie à la disposition d’un tiers. Si l’autonomie est la valeur première dont toute personne demande le respect, celle-ci n’est-elle pas alors mieux garantie par la règle qui contraint à respecter la vie plutôt que par celle qui autoriserait à donner la mort ?
En effet, en faisant peser sur tous l’obligation de rendre effectif un droit à mourir revendiqué par quelques-uns, on se trouve, explique Mme Suzanne Rameix, « devant le paradoxe de la revendication d’une liberté qui a besoin de l’autre. » (392) Plus l’autonomie demande des garanties à des tiers, plus ces derniers sont impliqués dans la constitution de cette sphère singulière, auto-normative, dans laquelle se place l’individu. Ce retour du tiers, après sa mise à l’écart au nom de l’autodétermination en un premier temps, peut être interprété de deux manières.
D’une part, il rend fictive l’indépendance réclamée, la liberté de mourir ainsi entendue n’étant que l’expression de l’impuissance de l’individu et l’appel à la puissance d’agir des autres ; aider à mourir fait de la mort une affaire commune et non plus une seule affaire personnelle.
D’autre part, le tiers ainsi convoqué n’étant utilisé que comme un moyen, il est procédé à une réduction brutale de sa valeur d’humanité. De même que la légalisation de l’euthanasie reviendrait à imposer une réponse simple à des questionnements individuels toujours complexes, de même elle simplifierait à l’extrême le rôle de l’autre en le réduisant à la fonction d’un simple instrument de réalisation d’un souhait individuel. Mme Suzanne Rameix avance même l’hypothèse qu’il y a dans ce détournement « probablement une volonté de renverser le pouvoir médical en exerçant à son tour un pouvoir sur le professionnel, en l’instrumentalisant, en l’utilisant comme un prestataire de service pour l’exercice d’une préférence ou une autodétermination individuelle. » (393)
L’autonomie est la liberté de l’individu au milieu des autres. La revendication d’un droit à mourir inverse ces termes : elle rend la personne entièrement dépendante de ce qui n’est pas elle, puisqu’elle remet sa vie aux autres, tout en l’isolant des rapports humains, puisqu’elle instrumentalise les autres hommes pour son seul compte.
Cette demande ne relèverait-elle pas plus profondément d’un déni des conditions d’existence de tout être mortel ? « Il faut prendre conscience, rappelle Mme Suzanne Rameix, que l’homme ne peut vaincre la finitude ; le handicap, la mort, l’angoisse existentielle, le deuil, la vieillesse appartiennent à l’existence humaine. Sauf à tomber dans cette logique de maîtrise qui nous conduirait à supprimer le handicapé, à précipiter la mort, à « gérer » le deuil, à prôner « le vieillissement réussi », etc. Nous n’avons pas à demander à la médecine de produire une forme de surhumanité. » (394) Croire en la possibilité d’une telle surhumanité conduit de fait à des situations de détresse la plus extrême.
Chapitre II
Quelles seraient les conséquences d’un droit à mourir sur l’éthique médicale ?
Aider à mourir, la demande paraît simple. Elle paraît également cohérente ; l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) la présente en effet comme venant à la suite de revendications dont certaines ont déjà obtenu satisfaction : « Lutter contre la douleur, refuser l’acharnement thérapeutique, ces deux revendications de l’ADMD ont été prises en considération et inscrites dans la loi du 4 mars 2002 et dans celle du 22 avril 2005 », peut-on lire sur le site Internet de l’association. Si les deux premières étapes ont été franchies, la troisième ne saurait certainement tarder. Le tout constituerait un ensemble cohérent : un socle de principes garantissant le respect de la dignité de la personne face à sa mort. Selon la même logique, la discussion en cours à la Chambre des députés du Luxembourg rattache une proposition de loi tendant à légaliser l’euthanasie à un projet de loi relatif aux soins palliatifs.
L’illusion est ainsi entretenue qu’un acte euthanasique pourrait venir en complément d’une approche palliative et enrichir l’approche humaniste de la fin de vie. Sans avoir à rappeler que si les tenants de l’euthanasie prétendent inscrire leur action dans les pas des soins palliatifs, on n’a jamais entendu cependant les praticiens des soins palliatifs se réclamer de valeurs communes avec les partisans de l’euthanasie. Les auditions conduites par la mission parlementaire ont permis de mesurer le degré d’artificialité d’un tel rapprochement. L’acte euthanasique paraît en effet en contradiction complète avec la démarche des soins palliatifs sur plusieurs points fondamentaux.
A. QUE RESTERAIT-IL DU QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE ?
S’affranchir, dans des situations de demande de mort, de l’interdit de tuer suscite de nombreuses craintes. L’interdit de tuer a en effet une fonction structurelle dans le raisonnement moral qu’a rappelée Mme Suzanne Rameix : « L’interdit est la source fondamentale de l’imagination et de la créativité morales. S’il n’est plus là, il n’y a plus la recherche acharnée, par les personnes de bonne volonté morale, des meilleures solutions, les plus humaines, les plus ajustées, les plus fines, les plus bienveillantes, etc. à l’égard des problèmes que nous rencontrons […] c’est en travaillant sur l’imagination de ces solutions que l’on construit la conscience morale. » Le ressort des discussions collégiales précédant une décision de limitation ou d’arrêt de traitement tient précisément à la contrainte venant du fait qu’y sont argumentées des intentions d’action qui excluent l’homicide.
Sans une telle exclusion, la solution qui consisterait à donner la mort au patient serait envisagée non seulement comme un choix d’action possible, de même rang que les autres, mais aurait pour effet d’éroder la pertinence de tous les autres choix envisageables. Pourquoi en effet chercher des voies complexes quand un chemin direct s’ouvre devant soi ? Risquerait ainsi d’être réduite à rien cette conscience de la complexité que le sociologue Edgar Morin a pu caractériser comme constituant le propre de la réflexion sur les questions que pose la modernité. « Le maintien de cet interdit est fondamental, explique Mme Suzanne Rameix, parce que nous allons avoir besoin de tous nos moyens de subtilité morale, d’intelligence morale, de conscience de la complexité pour mettre en œuvre ne serait-ce que les trois premiers actes […] : analgésies, limitations et abstentions de traitements vitaux ou arrêts de traitements vitaux. Décisions qui sont extrêmement difficiles et problématiques sur le plan moral puisqu’elles ont un lien avec la mort d’autrui, et qui, pour leur mise en œuvre, nécessitent cette conscience de la complexité et ces capacités d’analyse morale, en particulier dans l’analyse des intentions et de la causalité. » (395)
Rendant plus difficile le questionnement éthique, la légalisation de l’euthanasie mettrait également à mal le rapport de confiance qui lie le patient au médecin.
B. LE RAPPORT DE CONFIANCE ENTRE LE PATIENT ET SON MÉDECIN SERAIT-IL ALTÉRÉ ?
Transgression d’un interdit, la légalisation de l’euthanasie serait en effet en contradiction avec l’éthique de la profession médicale. Comment concilier une telle pratique avec le serment d’Hippocrate, qui fait obligation aux médecins de « protéger (les personnes) si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité » et « de ne pas provoquer délibérément la mort » ? Faut-il rappeler les termes de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, qui fixent les limites infranchissables de la déontologie médicale ? : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » L’appel au principe de bienfaisance pour faire entrer l’euthanasie compassionnelle parmi les finalités possibles de l’acte thérapeutique n’est pas recevable au regard même de l’idée de thérapie. La bienfaisance se manifeste par le recours à des traitements ou à des soins ; elle justifie que tout soit mis en œuvre pour sauver la vie ou pour sauver au moins sa qualité dans un souci de non-malfaisance, mais elle ne conduit pas à anéantir ce qui la justifie, à savoir le sujet même qui est bénéficiaire de cette bienfaisance (396).
À défaut, trois menaces pèseraient sur le corps médical.
La simplicité de la solution euthanasique déresponsabiliserait en premier lieu le médecin dans son devoir de tout mettre en œuvre pour procurer au patient le meilleur soin.
Une fragilisation des exigences morales des médecins serait aussi à craindre ; pour un corps médical qui pourrait traiter la mort comme une option possible, le sens de l’absolue singularité de la vie d’un homme risquerait de disparaître.
Enfin la confiance qui prédomine au rapport entre le médecin et son patient pourrait être ébranlée. C’est en effet sa vie que celui-ci remet entre les mains du premier, non sa mort. Si le médecin se fait le préposé de la mort, les soupçons de dérives intéressées ne manqueront pas d’apparaître quand la mort sera susceptible de présenter un quelconque bénéfice pour le thérapeute. On pourra penser par exemple – danger souligné par M. Axel Kahn – à la recherche d’un soulagement moral devant un patient « qui s’obstine à ne pas mourir (397)», à un souci d’une bonne gestion de l’occupation des lits du service ou encore à des considérations de coût financier pour les structures sanitaires et le système de soins.
C. LE RECOURS À L’EUTHANASIE TRADUIT-IL UNE COMPÉTENCE MÉDICALE ?
« Pendant mon internat, rapporte le Professeur François Goldwasser, il y avait en moyenne, dans le service de cancérologie, une euthanasie par mois. Depuis 1996, en douze années de pratique, je n’ai vu ni pratiqué aucune euthanasie dans mon service. Quelle est la différence entre avant et après ? La seule différence, c’est la compétence médicale acquise, de sorte que, en cancérologie, l’euthanasie est, à mes yeux, un acte d’incompétence. (398)»
L’incompétence professionnelle du médecin qui prétendrait aider à mourir une personne en fin de vie se plaignant de douleurs s’entendrait en premier lieu comme un manque de connaissance médicale en matière de traitement de la douleur. Comme il l’a été mentionné précédemment, les connaissances sont suffisantes pour qu’un médecin compétent puisse apaiser les souffrances du patient. « Dans le contrat d’objectifs qu’on peut conclure avec une personne qui ne peut pas guérir, il y a celui qu’elle ne souffrira pas. », peut affirmer le Professeur François Goldwasser.
L’incompétence se manifeste aussi dans la simplification excessive du problème de la douleur ; celle-ci ne doit pas seulement être évaluée en elle-même mais être mise en rapport avec les autres plaintes du malade. En ce sens, les explications de Mme Laure Marmilloud, infirmière en soins palliatifs, ont apporté un éclairage particulièrement argumenté. « Pourquoi prescrire de la morphine au pousse-seringue à une personne âgée qui ne va pas bien ? S’agit-il réellement d’un problème de douleur ? Comment l’avons-nous évaluée ? Comment avons-nous mesuré le bénéfice escompté après l’injection de la morphine ? L’usage de la morphine n’est pas toujours très rationnel dans un contexte de fin de vie, par manque de lisibilité. Ces pratiques non suffisamment suivies ou évaluées contribuent à maintenir la confusion, et ce n’est sain pour personne. » (399)
Peuvent enfin relever d’une forme d’incompétence des jugements péremptoires prononcés sur le caractère inguérissable de certaines maladies. M. Alain Grimfeld, président du Comité Consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a rappelé que la médecine s’enrichissant constamment de nouvelles découvertes, ne devait jamais s’avouer vaincue. Il a ainsi donné l’exemple d’un jeune homme de 23 ans, atteint d’une tumeur cérébrale responsable de troubles de la parole et de troubles moteurs : « La localisation de la tumeur ne permettait pas d’intervenir. Puis, il s’est avéré que cette tumeur était maligne. Or, les progrès de la chimiothérapie sont tels qu’il est préférable d’être atteint de cette tumeur inopérable, mais sensible à la chimiothérapie, que d’une tumeur opérable mais bénigne et insensible à la chimiothérapie […] Incurable il y a un an, elle l’est aujourd’hui. Si certains avaient pris la décision, a priori, d’un acte d’euthanasie à l’époque, quel serait leur état d’esprit aujourd’hui ? » (400) Certes, il n’y aurait pas de sens à exiger du médecin qu’il anticipe des découvertes médicales non encore faites ou validées. Cependant, le code de déontologie médicale impose au médecin « d’entretenir et perfectionner ses connaissances. » (401) et précise que les soins qu’il délivre « sont fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » (402). Il revient par conséquent au médecin de savoir que tel ou tel domaine médical connaît des évolutions importantes en termes de thérapies et de s’adresser, le cas échéant, à un spécialiste susceptible de l’éclairer. Faute de cette prudence, le pronostic avancé par le médecin risque d’être compris comme un verdict sans appel. Donner la mort, dans cette situation, reviendrait à retirer au patient une chance de guérir, chance en l’occurrence définitivement perdue. Le Professeur Daniel Brasnu a souligné que ce risque est particulièrement important dans le cas des 860 000 patients atteints de la maladie d’Alzheimer (403). Comment serait vécue par le médecin ou par l’entourage l’apparition d’un nouveau traitement peu après des euthanasies pratiquées sur certains de ces patients ?
On peut d’ailleurs s’interroger sur le sens et les conséquences qu’aurait l’acquisition d’une compétence médicale en matière d’euthanasie. Le Conseil d’État luxembourgeois, dans son avis sur la proposition de loi « sur le droit de mourir en dignité », fait remarquer que « les études en médecine ne prévoient pas l’apprentissage de connaissances visant à éliminer des êtres humains. Ceux qui font mourir, à quelque dessein que ce soit, ne sont pas à recruter dans la profession de ceux qui sont à former pour guérir et pour soigner. » (404) Faudrait-il alors introduire une formation à l’euthanasie au sein des études de médecine, organiser en conséquence des stages pratiques, vérifier au moment des concours le niveau des connaissances des étudiants sur cette matière et introduire la justification morale de l’euthanasie dans les cours d’éthique destinés à l’ensemble des personnels soignants ? Ou faudrait-il songer à confier l’euthanasie à des non soignants puisque soigner n’est pas donner la mort ?
D. LE RECOURS À L’EUTHANASIE EST-IL COMPATIBLE AVEC L’ÉTHIQUE DU SOIN ?
L’expérience des personnels soignants montre combien il est nécessaire de comprendre que la rationalité qui commande l’attitude des malades en fin de vie est éloignée de celle d’individus autonomes, gestionnaires de leur vie comme les propriétaires le sont de leurs biens, parties éclairées d’un contrat de soins dont ils contrôleraient la réalisation. La description de ce champ relationnel complexe, parcouru de voies détournées, qui s’instaure entre le patient et le soignant, relève d’une phénoménologie particulièrement fine : « Les personnes rencontrées et soignées dans ce contexte, explique Mme Laure Marmilloud, sont d’abord des personnes en désir de vivre, qui ont bien du mal à se résoudre à mourir et qui ont besoin d’être rassurées sur les conditions de leur fin de vie. Elles demandent à ne pas avoir mal, elles ont peur de souffrir, d’être abandonnées, elles s’affrontent à l’épreuve de la dépendance, elles luttent avec elles-mêmes entre refus et acceptation de l’inéluctable, elles sont en quête d’apaisement, de consolation, de lien, elles ont besoin de calme, mais aussi de vie, de lenteur, de douceur, d’attentions. » (405)
Savoir entourer et accompagner le malade en restant attentif à la complexité de ses demandes est peut-être, avance Mme Laure Marmilloud, « un symbole de résistance par rapport à la tentation de situer la vérité de l’humain du côté de la performance ou de la toute grande autonomie. Oui, nous cherchons à être autonomes, mais nous dépendons aussi les uns des autres, nous avons besoin de faire confiance aux autres, de nous remettre entre les mains d’autrui. La toute grande autonomie est un leurre. (406) » Les soins palliatifs se déploient à partir de la prise en compte de la vulnérabilité du malade et ont pour caractère l’extrême prudence, voire même la retenue, que le soignant doit observer dans toutes ses actions. Même quand le soignant ne peut constater que son impuissance, il reste dans son rôle en maintenant une présence auprès de la personne. Tel est le cas, face au malade qui souffre, non seulement parce qu’il a mal mais parce qu’il constate l’inéluctabilité de sa fin : « s’il y a bien quelque chose qui laisse démuni, c’est la souffrance, souvent extrêmement complexe, multipolaire, impartageable, même si elle appelle une présence, une écoute. (407) » Les soins palliatifs ne consistent ainsi pas seulement à agir sur un corps douloureux en faisant tout pour l’apaiser, mais à affronter, ne serait-ce que par le fait de demeurer à ses côtés, ce sur quoi nul n’a prise, un désespoir moral ou une souffrance indéfinissable ; c’est en quoi, selon l’expression de Mme Laure Marmilloud, « Les soins palliatifs ne sont pas une technique parmi d’autres. » (408)
Cette attention à l’autre comprend aussi la prise en compte de la famille du patient. Des proches de Mme Mireille Coutant, décédée le 18 février 2008, ont témoigné de l’importance de l’aide qu’ils avaient reçue : « L’équipe médicale et soignante a été extraordinaire. Si nous pouvons aujourd’hui vous parler de notre mère et grand-mère, c’est qu’elle nous a aidés, pendant plusieurs mois, à comprendre pourquoi son état se dégradait, pourquoi elle pouvait se montrer agressive, ou indifférente. Nous avons ainsi pu accepter le cheminement vers la mort. Nous ne nous sommes jamais sentis seuls. Nous avons été écoutés, entourés, soutenus, consolés. Nous ne pourrons pas oublier toutes ces personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre progression vers la mort avec elle. » (409)
Une telle éthique du soin apporte aux demandes de mort une réponse qui est à l’opposé de ce que préconisent les tenants de la légalisation de l’euthanasie. Ces derniers proposent inlassablement la même réponse à toutes les situations : la mort, si le patient la demande. Comme l’a expliqué M. Émeric Guillermou, président de l’Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens (UNAFTC), une telle attitude revient à poser la problématique de la souffrance « d’une manière catégorique et systématique – et non pas de façon individualisée –, en d’autres termes [à] systématiser la souffrance. » (410)
Le malade n’est, dans cette perspective, qu’une personne désincarnée qui exprime abstraitement un droit censé appartenir à tout le monde ; son dernier acte de vivant consiste à faire valoir ce droit devant les représentants d’une institution médicale réduite elle aussi à un mécanisme abstrait. Les cas particuliers dont les associations pro-euthanasiques s’emparent n’ont d’ailleurs d’intérêt pour ces dernières qu’en tant qu’ils illustrent une revendication générale. Les patients euthanasiés sont les héros d’une cause qui les dépasse et leur destin n’intéresse qu’en tant qu’il peut nourrir un martyrologe accessible à travers les médias. Mais qu’en est-il du devenir singulier de ces patients, de leurs doutes ou de leur solitude ? Le constat fait par Mme Laure Marmilloud que « chacun, suivant son âge, sa culture, a ses représentations et exprime son désir de mort (411)» s’inscrit dans cette capacité à saisir la singularité de la personne en souffrance qui est le propre des soins palliatifs. Certes « l’écoute » qui constitue la réponse du soignant « n’est pas magique. Ce n’est pas parce que l’on va pouvoir entendre cette demande qu’elle va s’envoler mais il s’est passé quelque chose : on a pu en parler, aborder la peur, le caractère irreprésentable de la mort dont la pensée nous accompagne tous et, à certaines heures obsède. » Le soignant, non plus n’est pas un héros, pas plus qu’un prestataire de service ; il partage la même angoisse de la mort que son patient. C’est parce qu’il y a un tel partage qu’il est capable de cette écoute, c’est-à-dire de cette attention à l’autre.
Le soignant peut alors découvrir que, souvent, la mort ne se désire qu’en première expression et que la réclamer est avant tout un appel qu’il convient de savoir lire. Fait avec attention, ce déchiffrage révèle en effet que les expressions du malade sont presque toujours des antiphrases d’une peur qui n’ose s’avouer. Mme Laure Marmilloud a même été conduite à se demander si « parfois la demande de mort ne vient pas secrètement chercher la réponse négative que nous ne ferons pas de geste euthanasique. L’on ne peut tenir pour nulle cette peur d’être euthanasié, surtout chez les personnes âgées, particulièrement sensibles à ce que disent les médias et qui craignent de devenir un poids et ne plus rien valoir (412) ». L’idéologie et l’activisme des défenseurs de l’euthanasie créeraient ainsi d’eux-mêmes une demande de mort et deviendraient des facteurs supplémentaires de fragilisation des malades.
Toute autre est la reconnaissance par le soignant de la vulnérabilité du patient. Reprenant les termes du philosophe Paul Ricœur, le Docteur Anne-Laure Boch a évoqué cette acceptation de la faiblesse de l’autre qui n’est pas ressentie comme un scandale à arrêter au plus vite mais comme un « donner » procédant de l’autre souffrant « qui n’est précisément plus puisé dans sa puissance d’agir et d’exister, mais dans sa faiblesse même (413) ». Si la réception d’une parole ou d’une présence actuelle venait à être remplacée, au moyen d’un mécanisme de procédure, par l’expression d’une volonté non véritablement assignable et si à la reconnaissance d’une faiblesse en quête d’une aide était substituée la reconnaissance d’une puissance hypothétique assise sur l’autonomie formelle du sujet, l’éthique des soins palliatifs se verrait vidée de son contenu. À la volonté partagée de donner sens à la vie succéderait la décision solitaire d’un patient obligé de se persuader qu’il n’est déjà plus rien, pour autrui comme pour lui-même, avant même de connaître sa propre fin.
L’euthanasie apparaît ainsi comme un geste toujours commis par facilité et ignorance : facilité d’une décision faisant fi de la complexité du questionnement éthique, négligence des rapports de confiance avec le malade, méconnaissance des techniques médicales aptes à alléger les souffrances du malade et ignorance des principes mêmes de l’éthique du soin. L’unique certitude qu’a l’auteur de l’acte d’euthanasie est que son geste entraînera la mort : son pouvoir homicide est son seul savoir.
Mais les termes de ce débat ne sont pas seulement éthiques et médicaux, ils sont également juridiques. À cet égard, les législations en vigueur en Europe montrent les différents choix effectués par certains de nos voisins et ne peuvent que nourrir notre réflexion.
Chapitre III
Quelles leçons tirer des expériences européennes ?
Même si elles s’inscrivent dans un cadre institutionnel et social très différent du nôtre, les législations néerlandaise et belge ainsi que les pratiques suisses sont fréquemment mises en avant par les promoteurs de l’euthanasie et du suicide assisté. Aussi on ne saurait débattre de ces questions sans rappeler l’économie et l’application de ces réglementations et sans se référer à l’expérience suisse. Les Néerlandais sont les premiers à avoir légiféré sur l’euthanasie, la réglementation belge n’ayant au demeurant fait que copier pour une large part la législation néerlandaise. On a dénombré en 2006 près de six euthanasies par jour aux Pays-Bas et une par jour en Belgique. Quant à la Suisse, il s’agit, en l’absence d’une réglementation spécifique, plutôt d’une tolérance. Ces pays dont les exemples sont invoqués par les partisans de l’euthanasie ou du suicide assisté ont une population totale, rappelons-le, légèrement inférieure à 25 millions d’habitants sur les 800 millions d’Européens représentés au Conseil de l’Europe. Il est apparu utile de compléter cet état des lieux par un éclairage des débats en cours au Luxembourg.
En contrepoint de la réglementation du Benelux, la convergence des législations allemande et britannique, où le renforcement de l’autonomie du malade laisse inviolé l’interdit de tuer, mérite d’être citée. Mais l’accent mis ainsi sur les trois États du Benelux ne saurait faire oublier que l’écrasante majorité des États membres des Nations Unies ignore toute législation légalisant l’euthanasie.
A. LES INQUIÉTUDES QUE SUSCITENT LES LÉGISLATIONS ET LES PRATIQUES ISSUES DE LA LÉGALISATION DE L’EUTHANASIE
On ne reviendra pas sur les prémices de la législation néerlandaise qui ont été décrites en 2004 dans le rapport de la Mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie (414). Depuis la loi du 12 avril 2001 relative à l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide, entrée en vigueur le 1er avril 2002 (415), les Pays-Bas disposent d’une législation qui, sans dépénaliser l’euthanasie à proprement parler, encadre celle-ci. En effet, juridiquement l’incitation au suicide, l’euthanasie et l’aide au suicide demeurent des infractions pénales mais la loi introduit une excuse exonératoire de responsabilité pénale au profit du médecin qui respecte des « critères de minutie ».
On peut ramener au nombre de cinq ces critères :
– La demande du patient doit être volontaire et mûrement réfléchie. Le consentement du patient qui n’est plus en état de l’exprimer peut être pris en compte s’il a préalablement établi une déclaration écrite en ce sens et est âgé d’au moins 16 ans ;
– Les souffrances du patient sont insupportables et sans perspective d’amélioration ;
– Le patient doit avoir été pleinement informé de sa situation et des perspectives qui sont les siennes ;
– Le médecin et le patient sont parvenus conjointement à la conclusion qu’il n’existe pas d’autre solution raisonnable ;
– Un autre médecin indépendant doit avoir été consulté et doit avoir donné par écrit son avis sur les critères de minutie. Dans l’hypothèse où la demande d’euthanasie est formulée par un patient souffrant de troubles mentaux, deux médecins indépendants doivent avoir été consultés dont au moins un psychiatre.
Dans le cas des patients mineurs, des conditions supplémentaires doivent être respectées :
– si le mineur a entre 12 et 16 ans et est jugé capable d’apprécier convenablement ses intérêts, le médecin ne peut donner suite à sa demande qu’à condition que le ou les titulaires de l’autorité parentale donnent en outre leur accord ;
– s’il est âgé de 16 à 18 ans, le ou les titulaires de l’autorité parentale doivent avoir été « associés à la décision ».
Le recours à l’euthanasie est donc exclu pour :
– les mineurs de moins de 12 ans ;
– les mineurs de moins de 16 ans dans l’incapacité d’exprimer leur volonté ;
– les mineurs, quel que soit leur âge, jugés incapables d’apprécier convenablement leurs intérêts.
Le contrôle de la légalité de la procédure et du respect des critères de minutie s’opère à quatre niveaux successifs :
– Le médecin légiste communal
Lorsqu’un médecin applique la clause d’excuse pénale, il n’établit pas de certificat de décès mais doit communiquer la cause du décès au médecin légiste communal accompagné d’un rapport circonstancié sur le respect des critères de minutie. L’acte d’euthanasie figure dans la nomenclature des actes médicaux. Il existe un réseau de médecins consultants auprès des médecins pratiquant ces actes (SCEN : Soutien et Consultation pour l’Euthanasie aux Pays-Bas). Si après avoir pratiqué une autopsie, le médecin légiste a la conviction que la mort est intervenue à la suite d’une cause naturelle, il délivre un certificat de décès. En revanche les cas d’euthanasie et d’aide au suicide sont communiqués au Procureur de la Reine de l’arrondissement.
– Le Procureur de la Reine
Le Procureur de la Reine examine alors les conditions du décès et décide ou non de délivrer un permis d’inhumer. Dans l’affirmative, la commission de contrôle est saisie du dossier pour examiner la conformité de la procédure aux critères de rigueur. Si au contraire le Procureur de la Reine estime que les conditions du décès sont suspectes et qu’il ne peut délivrer de certificat de non-opposition à inhumation ou incinération, il fait procéder à une enquête judiciaire sur les causes de la mort. Il en informe le médecin légiste, la Commission régionale de contrôle et le Collège des procureurs généraux.
Si l’enquête judiciaire ne permet de réunir aucune charge à l’encontre du médecin ayant pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide, la commission de contrôle et le Collège des procureurs généraux en sont immédiatement informés. Si au contraire l’enquête aboutit à réunir des charges, le Procureur de la Reine apprécie la suite à donner en concertation avec le collège.
– Les commissions régionales de contrôle
La loi de 2001 a mis en place cinq commissions régionales chargées de contrôler les signalements des cas d’euthanasie et d’aide au suicide, qui fonctionnent effectivement depuis le 1er novembre 1998. Elles comprennent un nombre impair de membres dont un juriste qui assure les fonctions de président et au moins un médecin et un spécialiste des questions d’éthique. Les membres sont nommés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de la santé pour une durée de six ans renouvelable une fois.
La commission régionale se prononce sur le respect des critères de minutie sur la base du rapport du médecin, qu’elle peut lui demander de compléter, ainsi que, le cas échéant, sur la base des éléments fournis par le médecin légiste communal ou d’autres intervenants. Si elle estime que ces critères ont été remplis, la procédure s’achève. Si au contraire elle ne peut parvenir à un avis, ou si elle estime que ces critères n’ont pas été respectés, elle transmet le dossier au Collège des procureurs généraux.
Par ailleurs si la commission de contrôle se déclare incompétente et considère de ce fait que le décès n’est pas intervenu dans le cadre d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide, elle renvoie le dossier au médecin légiste communal, en lui demandant de saisir le procureur de la Reine. Dans ce cas le procureur décidera de la suite à donner en concertation avec le Collège des procureurs généraux.
– Le Collège des procureurs généraux
Il est saisi de tous les cas litigieux détectés soit par le Procureur de la Reine, soit par les commissions de contrôle. En vertu des directives de politique pénale qu’il a édictées en 2003 et 2006, les poursuites ne sont engagées que si les critères de minutie « substantiels » ont été méconnus. Il en va ainsi des critères de souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration, de la demande du patient volontaire et mûrement réfléchie. En revanche un médecin qui pratiquerait une euthanasie sans solliciter de second avis médical est à l’abri de poursuites pénales même si la loi impose cette consultation. D’ailleurs selon un arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas, l’absence de consultation d’un autre médecin ne doit pas nécessairement faire obstacle à l’invocation de l’état de nécessité (416).
Cette situation peut se présenter, lorsque malgré l’absence d’un jugement exprimé par un médecin consultant, il est néanmoins possible d’estimer que les souffrances du patient étaient insupportables et sans perspective d’amélioration. D’une manière plus générale dans les rares affaires où l’on pouvait douter de l’absence de perspective d’amélioration et/ou du caractère insupportable des souffrances du patient, une enquête judiciaire a été ordonnée mais il n’y a pas eu finalement de poursuites. En 2007 il y a eu trois cas dans lesquels la commission a jugé que les critères n’avaient pas été respectés, deux fois à cause du manque d’indépendance du deuxième médecin consulté et une fois à cause de l’existence d’un coma qui faisait que l’on ne pouvait pas parler de souffrance insupportable. Mais dans ces trois cas le parquet n’a pas engagé de poursuites pénales. Il convient d’ajouter que les souffrances « existentielles » ne relèvent pas pour la Cour de cassation hollandaise du champ de cette législation (417).
Si le Collège des procureurs généraux décide qu’il y a lieu d’ouvrir une enquête judiciaire, il en informe par écrit, dans les deux semaines, le procureur en chef concerné, après accord du ministre de la justice, en lui demandant d’y donner suite.
S’il est finalement décidé après enquête judiciaire que le médecin ne sera pas poursuivi, le collège des procureurs généraux en informe le procureur en chef, après accord du ministre de la justice, par écrit et dans les plus brefs délais.
Si le Collège des procureurs généraux décide, après accord du ministre de la justice qu’il y a lieu de classer l’affaire, il informe dans les deux semaines le médecin concerné qu’il ne sera pas poursuivi et l’affaire est close du point de vue pénal.
On constate donc que l’accord du ministre de la justice est requis pour toute décision d’engager des poursuites et toute décision sur le règlement définitif de l’affaire. Lorsqu’une euthanasie ou une aide au suicide est pratiquée par une personne autre qu’un médecin, les décisions sont prises par le parquet concerné et l’accord du ministre de la justice n’est pas requis pour l’engagement des poursuites.
Sur 135 000 décès enregistrés en 2005 aux Pays-Bas, 1,7 % (2 300) l’ont été par suite d’euthanasie, 0,1 % après une aide au suicide, 24 % après des soins et/ou une sédation palliative et 15 % après un renoncement à un prolongement de traitement. Il semblerait que deux tiers des demandes d’euthanasie soient refusés par les médecins (418). On constate en 2007 une légère augmentation du nombre de signalements de cas d’euthanasie et d’aide au suicide. 2 120 signalements ont été dénombrés contre 1 923 en 2006 et 1 933 en 2005. L’écrasante majorité des signalements (1 768) correspond à des patients atteints d’un cancer et à des euthanasies pratiquées au domicile du patient (1 500). Cette stabilisation des euthanasies sur plusieurs années semble devoir être imputable au développement des soins palliatifs après la loi de 2001 et à un recours plus fréquent aux sédations terminales. En effet parallèlement le nombre de sédations terminales est passé de 8 500 en 2001 à 9 700 en 2005. Ces sédations sont pratiquées dans 47 % des cas sur des patients souffrant de cancers ayant une espérance de vie maximale d’une à deux semaines, après un consensus de l’équipe médicale et conformément aux souhaits du patient et/ou des proches.
Si le patient est atteint d’une maladie psychique et que ses souffrances ne sont pas occasionnées au premier chef par une affection physique, les autorités néerlandaises admettent qu’il est difficile de juger objectivement s’il a formulé la demande d’euthanasie volontairement et de façon mûrement réfléchie. Le médecin devra alors consulter non pas un, mais deux experts indépendants, dont au moins un psychiatre, qui devront examiner et interroger eux-mêmes le patient. L’invocation de l’état de nécessité n’est pas exclue, mais sera examinée avec la plus grande réserve. En règle générale, le ministère public entamera des poursuites, laissant au juge le soin de décider s’il y a eu ou non état de nécessité. En 1994, un psychiatre a été condamné pour avoir aidé une patiente atteinte de troubles psychiques à se suicider, mais aucune peine ne lui a été infligée. La Cour suprême a confirmé ce jugement, estimant que si les souffrances d’un patient sont de nature psychique, le juge doit faire preuve de la plus haute circonspection en déterminant s’il y a eu ou non état de nécessité. En avril 1995, le conseil de l’Ordre des médecins s’est prononcé dans le même sens que la Cour suprême dans cette affaire. Le psychiatre s’est vu infliger un blâme.
Il faut savoir par ailleurs que les parquets néerlandais au nombre de onze disposent d’un parquet médical spécialisé. Les procureurs peuvent consulter des experts médicaux. Ce sont eux par exemple qui ont été consultés pour savoir si un malade ressentait une souffrance réellement insupportable.
À ce jour, depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2002, aucune poursuite pénale n’a été exercée à l’encontre d’un médecin sur les fondements des articles 293 (euthanasie) et 294 (aide au suicide assisté) du code pénal. 24 cas litigieux ont été transmis par les commissions de contrôle au Collège des procureurs généraux en 6 ans. Dans la plupart des cas les médecins concernés ont été invités à s’entretenir avec le Procureur de la Reine pour un simple rappel à l’ordre, le parquet, semble-t-il, n’ayant pas été saisi de deux avis de violation de la loi par le même médecin. Par ailleurs le chef du Collège des procureurs généraux a estimé au cours des entretiens avec les parlementaires de la mission que compte tenu de la jurisprudence pénale très douce pratiquée dans son pays, ces rappels à la loi étaient tout aussi efficaces qu’un renvoi des intéressés devant les tribunaux. Enfin le service de l’inspection de la santé publique peut, s’il le juge utile, prendre des sanctions disciplinaires sous réserve que ce même service d’inspection soit saisi par la commission de contrôle. L’inspection a un entretien avec le médecin et peut décider ensuite de porter plainte contre le médecin auprès de l’un des conseils de discipline de la santé publique.
On constate que le taux de signalement des cas d’euthanasie est en augmentation puisqu’il s’élève à 80 % en 2005 contre 60 % en 2003 et 54 % en 2001 (419). Cela signifie en même temps un taux d’euthanasies clandestines de 20 % en 2005, ce qui fragilise les vertus de transparence prêtées à cette législation par ses promoteurs.
Au total l’application de cette loi présente plusieurs caractéristiques : les critères d’évaluation du degré de la souffrance du patient sont flous, l’existence même d’un contrôle a posteriori faisant porter la vérification plus sur le respect de la procédure que sur la réalité des motifs médicaux ; l’appréciation du médecin est subjective et la méconnaissance de la loi n’est pas sanctionnée. Il y a d’ailleurs quelque paradoxe à revendiquer haut et fort un droit à l’autonomie de la personne et à s’en remettre avec cette réglementation à la décision du médecin, cette législation consacrant de fait le pouvoir médical.
Ce qui paraît acquis en revanche, c’est qu’aujourd’hui il n’y a pas de volonté d’élargir le champ de la loi. Il ne faut pas oublier en effet qu’en 2002, le ministre de la santé proposait de considérer le cas des nouveau-nés souffrant de malformations graves, celui des patients atteints de maladie psychiatrique ou de maladie d’Alzheimer et celui des personnes âgées qui souffrent d’être encore en vie, afin de les intégrer à terme dans le champ d’application de la loi (420).
Celle-ci a toujours été présentée comme très consensuelle. Ce consensus doit toutefois être relativisé. L’Ordre des médecins allemands fait état de l’installation croissante de personnes âgées néerlandaises en Allemagne notamment dans le Land voisin de Rhénanie du Nord Westphalie. S’y sont ouverts des établissements pour personnes âgées accueillant des Néerlandais. C’est le cas notamment à Bocholt. Ces personnes craignent en effet que leur entourage ne profite de leur vulnérabilité pour abréger leur vie. N’ayant plus totalement confiance dans les praticiens hollandais, soit elles s’adressent à des médecins allemands, soit elles s’installent en Allemagne. De telles réactions dont la presse allemande s’est fait l’écho démontrent que les pratiques médicales hollandaises sont mal vécues par une partie de la population.
Enfin les médecins néerlandais rencontrés lors du déplacement de la mission aux Pays-Bas ont affirmé que les soins palliatifs se développaient de plus en plus, qu’ils rassuraient les patients en fin de vie et qu’il était moins recouru à l’euthanasie. La pratique de la sédation terminale avait été appliquée à 8,2 % des décès en 2005, chiffre à rapprocher des 1,7 % d’euthanasies. De fait on constate une augmentation considérable de la prescription d’ampoules de Midazolam 5 mg par les pharmacies de ville pour les patients en fin de vie à domicile. Elle est passée de 0 entre 1997 à 4 800 en 2006. Les données dont nous disposons n’apportent pas en revanche d’information sur la prescription de sédatifs en milieu hospitalier et dans les unités de soins palliatifs.
On rappellera que la loi du 28 mai 2002 dépénalise l’euthanasie active en l’encadrant. Le médecin doit s’assurer que le patient majeur ou le mineur émancipé (âgé d’au moins quinze ans), capable et conscient, formule sa demande de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans pression extérieure. Le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Deux situations sont prises en compte par la loi : celles où le décès est prévisible à brève échéance et celles où à l’inverse ce décès n’est pas prévisible à brève échéance. La prévision de l’échéance revient au médecin traitant.
Une commission, la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) examine une fois par mois les formulaires d’enregistrement complétés et communiqués par les médecins qui ont pratiqué une euthanasie et vérifie si les conditions et la procédure prévues par la loi ont été respectées. Le formulaire (421) se compose de deux volets : le premier identifie le patient et le médecin, le second où le médecin décrit le processus d’euthanasie est anonyme. C’est celui qui est examiné par la commission. Sur ce volet, le médecin dispose d’un espace maximal de six lignes pour décrire l’affection grave et incurable dont souffrait le patient. À la question : « Pouvait-on estimer que le patient allait décéder à brève échéance ? », le médecin doit répondre en cochant la case OUI ou la case NON. Pour la commission, un décès attendu dans les jours, semaines ou mois qui viennent, peut être considéré comme prévisible à brève échéance. Un arrêt de traitement n’est pas considéré comme une euthanasie.
La commission se compose de seize membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit, dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux concernés par la problématique des patients atteints d’une maladie incurable.
La loi n’impose pas de technique médicale particulière pour la pratique de l’euthanasie. Par conséquent le suicide assisté entre dans le cadre de la loi sur l’euthanasie pour autant que les dispositions légales aient été respectées. Le patient peut lui-même absorber une potion de barbiturique, dans la mesure où l’acte se déroule sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir jusqu’à ce que le décès soit constaté. Le décès est obtenu dans 90 % des cas par une injection de Penthotal provoquant une inconscience profonde puis par l’injection d’un paralysant neuromusculaire provoquant un arrêt respiratoire. Dans 10 % des cas, l’inconscience est obtenue par administration d’un barbiturique en potion que le malade a lui-même avalé puis dans certains cas un paralysant neuromusculaire est injecté par le médecin après que le patient est devenu inconscient. La commission note que dans la majorité des cas, le décès s’est produit rapidement, sans aucune intervention, et que dans certains cas un paralysant neuromusculaire a été injecté après la perte de conscience.
Le médecin en charge du patient doit obligatoirement faire appel à un ou plusieurs consultants extérieurs. La mission du consultant obligatoire est de s’assurer dans tous les cas que l’affection est incurable et grave et que la souffrance (physique ou psychique) est constante, insupportable et inapaisable. Il prend connaissance du dossier médical, examine le patient et établit un rapport faisant état de ses constatations. Le second consultant intervient dans les cas où le décès n’est pas prévisible à brève échéance. Il vérifie que la souffrance (physique ou psychique) est constante, insupportable et inapaisable et que la demande est volontaire, réfléchie et répétée. Le médecin consultant ne peut avoir avec le patient ou le médecin traitant ni relation hiérarchique de subordination ni relation familiale et il ne doit pas avoir une relation thérapeutique suivie avec le patient.
La loi du 28 mai 2002 prévoit la possibilité pour toute personne majeure ou mineure émancipée de consigner, dans une déclaration écrite, sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si elle n’est plus capable de l’exprimer et se trouve dans un état d’inconscience irréversible. Un arrêté royal du 2 avril 2003 fixe les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, confirmée, révisée ou retirée. Il prévoit la procédure légale de déclaration de fin de vie. Afin de rester valide la déclaration anticipée doit être confirmée tous les cinq ans. La personne concernée peut retirer ou réviser sa déclaration à tout moment. Depuis le 1er septembre 2008, la déclaration peut être enregistrée auprès de l'administration communale pour être connue du médecin traitant. Par ailleurs une loi du 10 novembre 2005 complète la loi du 28 mai 2002. Elle définit le rôle du pharmacien ainsi que l’utilisation des substances euthanasiques. Le pharmacien délivre une substance euthanasique sur la base d’une prescription et doit remettre en main propre ladite substance. Les critères de prudence et les conditions auxquels doit satisfaire la prescription ainsi que les conditions dans lesquelles les substances sont délivrées sont fixés par arrêté royal. Depuis juillet 2008, il existe une banque centrale de données qui est censée contenir les demandes anticipées des patients.
Depuis son entrée en vigueur le 23 septembre 2002, le nombre de cas d’euthanasie a doublé, passant de 249 sur 12 mois en 2002-2003 à 444 en 2006. Ceux-ci dans la plupart des cas (85 %) concernent des patients atteints de cancers généralisés. La majorité des euthanasies a été pratiquée sur une population d’âge moyen, puisque 77 % des cas concernaient la tranche d’âge 40-79 ans. 39 % des euthanasies se pratiquent au domicile du patient, un kit « euthanasie » étant mis à la disposition des praticiens pour ce faire (422). Les cas où le décès était prévisible à brève échéance représentaient 93 % des cas. À l’inverse les euthanasies pratiquées pour des affections dont le décès n’est pas attendu à brève échéance sont rares (7 %). Le rapport 2006-2007 de la commission fait état d’une augmentation des demandes de déclarations anticipées, puisque celles-ci ont été multipliées par deux entre 2004-2005 et 2006-2007. À travers cette dernière évolution la revendication d’un droit à la mort est satisfaite sans doute encore plus nettement.
Dans une brochure éditée à l’intention du corps médical, la commission admet que le caractère insupportable de la souffrance est d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres (423). Neuf cas d’euthanasie pour affection neuro-psychiatrique ont été déclarés dont quatre de dépression majeure. Une association flamande de soutien de dépressifs a qualifié ces euthanasies déclarées en 2004-2005 de « dangereux précédents » car une dépression ne peut être considérée comme incurable.
Une application géographique de la loi très inégale
On relève que 86 % des documents d’enregistrement sont rédigés en langue flamande tandis que 14 % d’entre eux sont écrits en français, ce qui traduit de fortes différences dans l’appréhension de cette législation par les deux communautés flamande et wallonne. Plus précisément l’euthanasie est moins fréquemment pratiquée au domicile du patient et l’euthanasie par déclaration anticipée est moins répandue en Wallonie qu’en Flandre.
Manifestement les témoignages reçus en Belgique par votre rapporteur montrent que cette législation n’a pas mis fin aux pratiques clandestines d’euthanasie. Les cas de refus d’accéder aux demandes d’euthanasie de la part des malades n’étant pas enregistrés, il est difficile par ailleurs de savoir quel est le taux d’acceptation des demandes d’euthanasie, à la différence de la pratique hollandaise où, comme on l’a vu, les deux tiers des demandes sont refusés.
Des fondements fragiles
Saisi d’une demande d’euthanasie le médecin a trois possibilités : proposer au demandeur une thérapeutique, des soins palliatifs ou une euthanasie. Le patient étant par définition dans une situation vulnérable, comment peut-on s’assurer que ces trois options lui seront véritablement proposées ? La présentation de ces options par le seul médecin ne revient-elle pas de fait à remettre tout pouvoir à un médecin, qui remplit simultanément une fonction d’expertise, de décision et d’exécution ? En n’envisageant pas de dialogue médical véritable et donc de contradiction possible, la loi belge s’inscrit dans une logique opposée à celle de la collégialité médicale exigée en France pour la limitation et l’arrêt des traitements. Si l’affection n’est pas évolutive ou très lentement évolutive, elle entraîne une procédure renforcée avec deux consultants dont l’un est un psychiatre ou un spécialiste de l’affection en cause et un mois d’attente après la date de la demande écrite. Dans la mesure où, quelle que soit l’échéance du décès, le critère de la pathologie reste très flou avec un grand degré de subjectivité reconnu au médecin pour apprécier la gravité de la souffrance et son issue, on peut s’interroger sur l’effectivité de la garantie d’un second contrôle médical.
La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie admet en effet elle-même que le critère du caractère insupportable de la souffrance « est en grande partie subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres ». Dans l’esprit de cette législation, c’est à un médecin et à lui seul d’apporter une réponse à une demande d’euthanasie. Cette réglementation est en effet présentée comme étant construite sur les rapports prévalant entre le patient et le médecin. M. Marc Englert, membre rapporteur de la commission fédérale a fait d’ailleurs valoir à votre rapporteur que la loi belge avait résolu un problème médical et non un problème social. Mais ce continuum médical fondé sur un rapport de confiance ne vient-il pas à se fragiliser, lorsqu’en vertu de l’article 14 de la loi, le médecin qui refuse de donner la mort communique le dossier médical à un médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance ? Rien ne garantit en effet que ce nouveau médecin connaît le patient, s’est entretenu avec lui. Que restera-t-il également de ce continuum dès l’instant où le dossier médical du patient est appelé à être lu de manière opposée selon que l’établissement hospitalier accueillant le patient a ou non assis sa réputation sur les pratiques euthanasiques ? Si l’on ajoute que les droits offerts par cette loi sont ouverts aux non résidents disposant par définition de moins de facilités que les résidents pour nouer des contacts réguliers avec un médecin traitant, on peut s’interroger sur la réalité de cette relation thérapeutique privilégiée entre le patient et son médecin que l’on dit être forgée avec le temps.
Des soins palliatifs négligés
Parallèlement à la loi sur l’euthanasie, une loi sur les soins palliatifs était promulguée le 14 juin 2002. Si la concomitance des deux lois peut s’expliquer, leur confrontation montre que ces deux textes n’ont à l’évidence pas fait l’objet de la même attention. Autant en effet la loi relative à l’euthanasie est détaillée, autant la loi relative aux soins palliatifs n’est qu’un énoncé de principes généraux et d’intentions dont la concrétisation est renvoyée à la bonne volonté de l’exécutif. D’ailleurs, la proportion de lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants n’est que de 3,5 en Belgique, contre plus de 6 en France (424). Quant à la formation aux soins palliatifs, elle est totalement négligée. On relève également que pour se démarquer des soins palliatifs, ces derniers sont qualifiés de soins « supportifs » dans les établissements pratiquant les euthanasies et écartant le questionnement éthique. Par là même s’est créée une fracture au sein des professionnels de soins palliatifs. Le point 6 de la Charte des soins palliatifs qui refusait l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie a été supprimé dès 1998, cet exemple montrant une fois de plus que les deux notions ne peuvent être combinées.
Un contrôle qui suscite des interrogations
Même si aux dires des représentants de la commission devant votre rapporteur, il arrive que les dates de naissance des personnes euthanasiées soient omises dans les déclarations, même si un cancer de la prostate a pu être attribué par un médecin à une femme décédée, la commission se félicite dans ses conclusions sur l’application de la loi pour 2006 et 2007 que « dans la très grande majorité des cas, l’euthanasie est pratiquée correctement ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi il faut savoir que la commission n’a transmis aucun dossier à la justice, alors que 1 925 euthanasies dont 321 en Communauté française ont été officiellement effectuées. L’absence totale de saisine judiciaire amène à s’interroger sur la réalité du contrôle a posteriori effectué : soit on est en présence d’un professionnalisme exceptionnel sur un sujet aussi délicat où le questionnement s’impose d’évidence, soit on est conduit à avoir des doutes sur la réalité de ce contrôle.
Un élargissement du champ d’application de la loi revendiqué
Depuis 2003 la question de l’élargissement du champ d’application de la loi est soulevée. Ainsi un intellectuel flamand, M. Étienne Veersch plaide pour l’extension de la loi et souhaite que les maisons de repos qui ne comptent que pour 5 % des euthanasies élaborent obligatoirement une politique d’euthanasie. Un sénateur libéral flamand s’est ému également que cette législation reçoive peu d’écho dans les hôpitaux catholiques. Des socialistes flamands ont demandé l’extension de la loi aux « mineurs capables de discernement », leur demande d’euthanasie pouvant être orale. L’ADMD belge fait écho à cette revendication sur son site Internet : « Par ailleurs, il faudra envisager d'étendre le bénéfice de la loi aux mineurs d'âge, moyennant des précautions à étudier ». Le président de la Commission fédérale estime de son côté que l’euthanasie doit être possible pour les personnes dont les fonctions cérébrales sont diminuées et qui en ont fait la demande au préalable.
À l’inverse une carte de dignité en fin de vie a été lancée en 2008 via l’Institut européen de bioéthique. Elle permet aux personnes qui le souhaitent d’exprimer leur volonté en fin de vie, en privilégiant les soins palliatifs sans acharnement thérapeutique. Elle a pour objectif d’« inviter chacun à la réflexion personnelle » et de confirmer les soignants « dans leur vocation première ; celle de soigner et d’accompagner ».
Des témoignages nuançant le discours officiel
Soucieuse de s’entourer au plus près de témoignages, la mission parlementaire a reçu celui de l’épouse d’un Français atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, qui avait envisagé, un moment, de se voir appliquer la législation belge. Il avait rencontré en Belgique un médecin, chef de service d’une unité de soins palliatifs (USP), président de la commission d’évaluation des actes d’euthanasie. Le médecin lui a indiqué que : « le jour où il en ressentirait le besoin, les choses pourraient se faire rapidement, dans son service […] Nous étions un peu choqués à la sortie. Nous ne nous attendions pas à quelque chose d’aussi « facile ». Il a eu l’air d’accuser le coup. Avoir ce contact si proche avec la mort nous la faisait accepter un peu et nous a donc, en même temps, soulagés. Mais cela faisait froid dans le dos. Cette visite nous a fait reculer parce que cela ne nous paraissait pas normal de toucher la mort d’aussi près ; mais elle nous a permis aussi de commencer à l’apprivoiser, et à accepter celle d’Éric. La « solution belge » était un peu difficile à envisager pour la famille : il était un peu compliqué d’expliquer aux enfants que leur père parte le matin et ne revienne pas le soir. En tout cas, on ne se voyait pas le faire. Ce que l’on voulait transmettre à nos enfants était important. » (425) Finalement l’intéressé reculera et fera le choix de mourir dans une unité française de soins palliatifs, entouré des siens.
Cette impression de précipitation est partagée par des ressortissants belges. L’un d’entre eux a raconté comment il avait été prévenu qu’une infirmière avait trouvé sa mère de 88 ans, qui était dans une maison de retraite, morte dans son lit (426). Le médecin avait laissé ces mots sur la table de la chambre de la vieille dame : « Comme vous savez, votre mère voudrait mourir en dignité par l’euthanasie sans déranger quelqu’un. Comme vous souhaitiez, la date de l’euthanasie serait inconnue pour vous… Je vous présente mes condoléances. » (sic). Cette personne se déplaçait de plus en plus difficilement et ne voulait pas devenir dépendante mais en aucun cas sa maladie ne répondait aux critères de gravité et d’incurabilité exigés par la loi. La justice a été saisie.
La procédure applicable en Belgique est déroutante par sa rapidité. Selon le Docteur Béatrice Figa, le temps nécessaire estimé pour remplir les déclarations d’euthanasie est de 30 minutes (427). Cette facilité a pu être constatée à l’occasion du suicide assisté de l’écrivain Hugo Claus qui, si l’on en croit les médias belges, n’était qu’à la phase débutante de la maladie d’Alzheimer. Dans la mesure où l’intéressé était conscient et où sa situation n’était pas irréversible à ce stade au regard de la science, on est en droit de s’interroger sur la légitimité de l’application de la loi à son endroit.
S’agissant enfin des dons d’organes la Belgique admet que l’on puisse prélever un organe après euthanasie sur un donneur après l’arrêt du cœur. Trois prélèvements ont été enregistrés sur des Flamands et deux sur des Wallons. Si l’impact des pratiques d’euthanasie sur les prélèvements d’organes est modeste à ce jour, on ne peut manquer de s’interroger sur une démarche qui revient à permettre à la collectivité d’utiliser la détresse d’autrui.
La réglementation belge s’avère avoir un champ d’application plus large que celui la législation néerlandaise. À la différence de cette dernière, rien n’indique que des médecins aient rejeté des demandes d’euthanasie des patients. De plus en Belgique la souffrance psychiatrique est admise beaucoup plus facilement comme affection.
In fine, les inquiétudes de certaines fractions de la population, l’absence de contrôle réel d’application de la loi – les commissions existantes n’étant que des chambres d’enregistrement –, les risques de dérives inhérents à ces législations caractérisent les deux législations hollandaise et belge.
La Suisse passe pour être l’un des pays les plus permissifs en termes d’assistance au suicide. Certaines organisations ont en effet exploité une faille du code pénal qui ne condamne l’aide au suicide que si elle est pratiquée dans un but égoïste.
La législation helvétique distingue nettement l’assistance au décès, ou euthanasie et l’assistance au suicide selon que la personne qui tue est également celle qui meurt ou pas.
L’euthanasie
L’euthanasie se définit par le fait que la personne qui tue n’est pas la même personne que celle qui meurt. À ce titre, l’euthanasie est toujours un homicide. Les autorités confédérales distinguent trois types d’euthanasie :
— L’euthanasie active directe survient quand un tiers tue directement et volontairement une personne. Cet acte est punissable en droit suisse (art. 111 du code pénal (428), y compris s’il est pratiqué à la demande expresse de cette personne. Dans ce cas, l’article 114 CP prévoit des peines moins lourdes (trois ans de prison au plus, contre cinq ans au moins pour l’article 111) sous deux conditions : sont nécessaires « une demande sérieuse et instante » et un « mobile honorable, notamment la pitié » ;
— L’euthanasie active indirecte consiste à administrer des substances (par exemple de la morphine) afin de soulager des souffrances même si elles peuvent également écourter la vie. Cette pratique est autorisée, sous le nom de « retrait thérapeutique », par les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (429) (ASSM) car l’élément « intentionnel » (au sens de l’art. 111 CP) en est absent.
— L’euthanasie passive se caractérise par la renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien en vie ou par leur arrêt. Elle est autorisée sous conditions : soit le patient est en mesure d’exprimer sa volonté, qui doit alors être respectée, sous peine de sanctions pénales, soit il ne le peut pas. Dans ce cas, les directives de l’ASSM prescrivent de recourir aux directives anticipées, au « représentant thérapeutique » (430) ou à tout autre indice laissant apparaître la volonté du patient. Si l’urgence prévaut ou qu’aucun des éléments précédents n’éclaire le médecin, « la décision du médecin traitant doit être prise en accord avec les intérêts bien compris du patient » (431).
Le suicide assisté
Le suicide est défini par le fait que l’auteur de l’acte est sa victime. L’incitation et l’assistance au suicide sont régies par l’article 115 du code pénal suisse : « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». L’assistance au suicide n’est donc condamnée qu’en tant qu’elle est fondée sur un motif égoïste. A contrario, elle est parfaitement légale s’il n’y a pas de « mobile égoïste ». Cet article dispense celui qui aide au suicide de l’obligation de protéger la vie d’autrui. En revanche, si la personne n’a pas désiré physiquement (par son geste), et mentalement, mourir, il s’agit d’un homicide par action médiate. Le discernement du patient est donc essentiel dans la qualification de suicide, ce qui exclut l’aide au suicide à des personnes souffrant de certains troubles psychologiques.
Dans un arrêt du 3 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rappelé plusieurs principes qui encadrent les pratiques en vigueur dans la confédération. D’abord il n’existe pas pour la personne qui veut mourir de droit à l’accompagnement lors du suicide ou de droit à bénéficier d’une aide active à mourir lorsque la personne est incapable de décider elle-même de mettre fin à ses jours. Il a affirmé ensuite que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne reconnaissait aucun droit de mourir avec l’aide d’un tiers ou de l’État. Il a considéré enfin qu’on ne peut prétendre à l’achat de certains médicaments provoquant le décès sans prescription médicale. Il a opposé ce principe pour refuser au requérant la délivrance sans prescription médicale de natrium pentobarbital, en se fondant sur les articles 24 et 26 de la loi relative aux produits thérapeutiques et sur les articles 9 et 10, alinéa 1 de la loi relative aux stupéfiants, l’obligation de prescription étant jugée indispensable à la fois pour la protection de la sûreté et de la santé publique et pour le maintien de l’ordre dans l’intérêt public (432). Il est à noter que le pentobarbital est une drogue vétérinaire utilisée en France pour l’euthanasie des animaux.
Selon les directives de l’ASSM (433), les médecins ont le devoir de soulager les souffrances des personnes en fin de vie. Toutefois, un patient ne supportant plus sa situation peut demander à mourir. Le médecin a alors le droit de refuser d’aider le malade à mourir. Toutefois, « dans des situations exceptionnelles », il peut aider cette personne à se suicider, après avoir vérifié que sa fin de vie est proche, que des traitements alternatifs ont été proposés, que le patient est capable de discernement et que son désir est persistant. En aucun cas le dernier geste ne doit être fait par le médecin (ce serait un homicide tombant sous le coup de l’article 114 CP). Le décès doit être déclaré aux autorités comme ayant une cause non naturelle.
Cependant, certains cantons et communes ont adopté des positions plus contraignantes concernant l’assistance au suicide. C’est le cas notamment de la ville de Zürich, qui a interdit en 1987 l’assistance au suicide dans les hôpitaux et les foyers pour personnes âgées de la ville. Néanmoins, depuis 2000, les organisations d’assistance au suicide peuvent à nouveau intervenir dans ces derniers, sauf auprès des personnes atteintes de troubles psychiques. En revanche, les patients des hôpitaux ne peuvent pas bénéficier d’un suicide assisté à l’intérieur de ces établissements.
Le cas particulier des patients souffrants d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée
D’après les directives de l’ASSM, les patients souffrants de telles atteintes qui sont dans une situation cliniquement stable et dont la volonté ne peut pas être connue, ont droit à être nourris et hydratés normalement. Seules des dispositions écrites explicites peuvent autoriser les médecins à stopper ces soins, mais ni la famille ni le médecin n’ont le pouvoir de se substituer à la volonté du patient (434).
Le développement d’organismes assistant au suicide pose un certain nombre de difficultés au gouvernement fédéral suisse.
— Les associations d’aide au suicide
En raison de la relative permissivité de la législation régissant l’aide au suicide, quelques associations ayant pour objet de fournir une assistance au suicide aux personnes le désirant, ont vu le jour. Les principales associations sont Exit et Dignitas. Elles étaient d’ailleurs représentées chacune par leur président au vingt-cinquième anniversaire de l’ADMD française, en 2006.
Exit
Exit Deutsche Schweiz et Exit-ADMD Suisse romande ont été fondées en 1982 et comptent respectivement 54 000 et 15 000 membres. Elles ne prennent en charge que les membres de l’association domiciliés en Suisse, en pleine possession de leurs facultés de discernement et qui sont atteints d’une maladie organique incurable entraînant un pronostic fatal, ou une invalidité complète ou des souffrances intolérables. Ces souffrances peuvent être même prises en compte lorsque la maladie n’est pas à son stade terminal comme en atteste le reportage intitulé « Le choix de Jean » (435) relatant les derniers mois de la vie d’un homme qui se sait atteint d’un cancer.
La demande doit être sérieuse, répétée et manuscrite. Elle doit figurer sur un document qui a la taille d’une carte d’identité. Rédigé en termes très généraux ce texte baptisé « testament biologique » contient le droit de renoncer, à toute mesure de réanimation si le cas du malade est désespéré ou incurable ou si à la suite d’une maladie ou d’un accident la personne se trouve gravement handicapée physiquement ou mentalement. Ce document peut faire état également du droit à bénéficier d’une médication antalgique pour apaiser des souffrances mêmes si celle-ci devait hâter la mort. Exit recommande que ce document soit versé dans le dossier médical.
Soit la personne demande l’intervention d’un représentant de l’association pour apporter la solution létale, soit elle s’adresse directement au médecin traitant qui connaît depuis longtemps le malade et sa volonté, soit la personne préfère agir seule, le geste étant alors qualifié d’auto-délivrance. En cas d’acceptation par l’association, une dose de 15 grammes de natrium pentobarbital (NAP) est fournie gratuitement. Dans la pratique, il est fait appel au médecin traitant dans 50 % des cas et à un médecin d’Exit pour l’autre moitié. La dose entraîne un évanouissement sous 5 minutes et la mort par arrêt respiratoire. Il s’écoule en moyenne trois mois entre la prescription de l’ordonnance et le décès. Exit Suisse romande a été saisi de 236 demandes en 2007 et a effectué 66 assistances. Exit dispose d’un réseau de 20 médecins qui voient le patient deux fois. Le décès à lieu en présence de deux représentants d’Exit quand le patient est seul et d’un représentant d’Exit et des proches dans les autres cas. Les accompagnateurs d’Exit sont des personnes qui reçoivent une formation d’une durée de deux ans. On est donc en présence d’une pratique qui encourage au suicide, sans encadrement juridique et sans sanction.
Dignitas
Dignitas, fondée le 17 mai 1998 par un avocat qui la dirige toujours, M. Ludwig Minelli, compte 4 500 membres dont 500 en Suisse. Comme s’il y avait eu un partage du marché du suicide assisté, Dignitas fournit une assistance au suicide des étrangers (essentiellement des Allemands et des Anglais), alors qu’Exit s’adresse au marché intérieur suisse. Ce sont 868 personnes qui ont été assistées par Dignitas dans leur volonté de se suicider depuis 1998, dont 85 % d’étrangers. Il est d’ailleurs frappant de constater que si l’on assiste à une émigration allemande du suicide vers la Suisse alémanique, aucun mouvement semblable n’est perceptible de la France vers la Belgique.
Le droit d’entrée chez Dignitas s’élève à 125 euros et la cotisation annuelle minimale est de 50 euros. Après un entretien avec un membre de l’association, une dose de NAP est fournie grâce à une ordonnance médicale, moyennant 1 900 euros pour la préparation et les frais administratifs, 300 euros pour les visites médicales, 1 900 euros pour la réalisation de l’acte, 1 000 euros pour les frais de crémation et 950 euros pour les démarches auprès des autorités, soit environ 6 600 euros (436), qui couvrent les frais de l’association, laquelle prétend ne pas avoir de but lucratif, mais aussi son développement. Tous les demandeurs n’utilisent pas la substance qui leur est fournie. Dans une conférence prononcée à Amsterdam, le fondateur de l’association a affirmé que 70 % de ses membres, une fois qu’ils ont demandé à recourir au suicide assisté ne contactent plus l’association, l’essentiel pour eux étant de savoir qu’ils peuvent disposer le cas échéant de cette issue (437). En soulignant le coût économique de la prise en charge de malades pour la société (438), Dignitas ne dissimule pas le raisonnement économique qui justifie à ses yeux le suicide assisté.
Trois conditions, alternatives ou cumulatives, sont requises par les statuts de l’association suisse pour pouvoir accéder au suicide assisté : souffrir d’une maladie mortelle, d’un handicap « excessif » ou d’une douleur non maîtrisable. Dignitas se présente ouvertement comme un prestataire de service dont le professionnalisme est la garantie du sérieux (439). L’association semble retirer quelque profit de cette activité aux dires de son ancien secrétaire général adjoint (440), son fondateur ayant pu prêter parfois directement la main à des euthanasies actives, ce qui lui a valu des poursuites de la part du parquet de Zürich (441).
Les critères avancés par Dignitas sont interprétés très largement. Selon plusieurs médias, M. Ludwig Minelli a ainsi justifié l’euthanasie d’un frère et de sa sœur atteints de schizophrénie parce que leur père était décédé et leur mère placée en institution ; il en est allé de même d’un couple de quinquagénaires britanniques souffrant d’épilepsie et de diabète.
Depuis février 2008, Dignitas propose une autre méthode aux candidats au suicide : elle consiste à fournir à la personne désirant se suicider un sac rempli d’hélium. La personne met alors sa tête dans ce sac et meurt dans un délai pouvant aller jusqu’à dix minutes. Le recours à cette technique s’explique par le refus des médecins sollicités par Dignitas pour prescrire du pentobarbital. Ces pratiques se déroulent sur des parkings d’autoroute ou dans des chambres d’hôtel. M. Gilles Antonowicz, ancien avocat de Mme Chantal Sébire et ancien vice-président de l’ADMD décrit ces situations de la manière suivante : « Je suis en désaccord aussi avec l’attitude de l’ADMD vis-à-vis de l’association suisse Dignitas qui aide à mourir dans des conditions qui n’ont rien à voir avec la dignité de la personne. Il y a des suicides avec des sacs plastiques remplis d’hélium, dans des voitures sur un parking, avec une absence de suivi médical. Ces pratiques doivent être condamnées sans appel. » (442) . Pour sa part l’adjoint du procureur de Zürich, M. Jürg Vollenweider n’a pas dissimulé l’impression que provoquaient ces images : « Nous voyons beaucoup de choses dans notre métier, mais ces images sont parmi les plus remuantes que j’ai vues. On y voit une personne mourir après un long étouffement, il y a des spasmes, c’est vraiment difficile à regarder. » (443) Lors du déplacement de votre rapporteur en Suisse, il a été indiqué qu’en 2006 moins de quatre heures s’étaient écoulées entre la consultation du médecin de Dignitas et le décès d’un étranger.
En plus de l’aide active qu’elle apporte aux personnes désirant se suicider, l’association Dignitas entend promouvoir partout en Europe le suicide assisté. Pour ce faire, les moyens ne manquent pas. Dignitas ne se contente pas de la diffusion sur Internet des images des suicides auxquels elle coopère, elle envoie également à quiconque le demande un DVD expliquant comment se suicider : « Le patron de Dignitas propose d’ailleurs d’envoyer un DVD de démonstration à toute personne intéressée. Qu’elle soit à Paris, Londres, Berlin ou Monaco. » (444), écrit par exemple un journaliste ayant enquêté sur l’association. Selon son président, si l’association fait payer l’aide qu’elle accorde, c’est pour financer la cause qu’elle défend : « nous avons aussi besoin de fonds pour financer notre lutte pas seulement en Suisse, mais aussi à l’étranger. J’aimerais que les suicides assistés deviennent possibles partout en Europe. » (445), déclarait-il ainsi dans un entretien au Monde.
Les tableaux ci-dessous illustrent l’importance du phénomène des suicides assistés par des organisations en Suisse.
NOMBRE DE CAS RECENSÉS PAR AN
1993 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
EXIT DS (446) |
30 |
106 |
108 |
113 |
111 |
96 |
124 |
90 |
131 |
154 |
162 |
DIGNITAS |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
38 |
59 |
91 |
88 |
- (447) |
IMPORTANCE RELATIVE DES SUICIDES ASSISTÉS DANS LES DÉCÈS EN SUISSE
Pour l’année 2003 (448) |
Ensemble de la Suisse |
En % de tous les décès |
En % de tous les suicides |
Décès |
63 070 |
||
Suicides |
1 400 |
2,22 % |
|
- dont suicides accompagnés par des organisations |
272 |
0,43 % |
19,4 % |
- dont suicides accompagnés d’étrangers (DIGNITAS) |
91 |
0,14 % |
6,5 % |
Au total, seuls 0,43 % des décès en Suisse sont des suicides assistés.
Si aucune association n’a jusqu’à présent été condamnée par la justice suisse car le « mobile égoïste » faisait défaut, le développement du « tourisme de la mort » a suscité de nombreuses critiques, des poursuites pénales et des interrogations notamment à la suite de la mise en cause de M. Ludwig Minelli par l’ancienne secrétaire générale adjointe de l’association. La sortie régulière de cercueils d’une maison qui abritait ces pratiques a provoqué de vives critiques de la part du voisinage. Deux communes du canton de Zürich (Maur et Stäfa) ont interdit à Dignitas de s’installer sur leur territoire.
Selon une enquête d’opinion parue en 2008, deux tiers des personnes interrogées étaient en faveur de l’accueil de ces « touristes » dans des structures hospitalières publiques. Si seulement 15 % des Suisses se prononcent pour l’interdiction de l’assistance au suicide, 53 % veulent la restreindre aux situations des personnes atteintes de maladies incurables et 49 % étaient hostiles à toute décision des proches quand la personne concernée était incapable (449). Pour les Suisses, l’aide au suicide doit donc être possible mais encadrée. En France, les partisans de l’euthanasie ne réprouvent pas tous les méthodes de Dignitas. C’est le cas notamment de M. Jean-Luc Romero qui a indiqué lors de son audition : « Aujourd’hui, je n’ai aucune raison de douter de l’honnêteté de cette association. Toutes les familles des personnes qu’elle a accompagnées et que nous connaissons ont été tout à fait satisfaites. Les moments qu’elles ont vécus ont été très touchants. Dans ce domaine, nous n’avons entendu aucune critique et nous connaissons beaucoup de monde » (450), en ajoutant qu’il comptait se rendre en Suisse pour obtenir des informations sur le prix demandé et sur l’utilisation de l’hélium.
D’autres effets de ce tourisme de la mort ont été dénoncés. Il implique une charge pour la collectivité (environ 2 500 euros pour les investigations visant à établir les circonstances de la mort) et peut entraîner une dégradation de l’image de la Suisse.
Le gouvernement fédéral envisage donc de renforcer la législation visant à encadrer l’assistance au suicide (451). Le conseil du canton de Zurich a demandé le 7 mai 2008 qu’il soit mis fin aux activités de Dignitas. Un rapport doit être présenté au gouvernement fédéral au début de l’année 2009, contenant des propositions. Sans remettre en cause l’article 115 du code pénal, plusieurs options sont possibles : l’interdiction de l’organisation, la prohibition du caractère onéreux de ses prestations, l’édiction d’une législation propre aux associations d’assistance au suicide en les soumettant à un régime d’interdiction et de surveillance. Le gouvernement fédéral a bien conscience que définir dans une loi les critères du suicide assisté reviendrait de facto à légitimer les associations de suicide assisté. Par ailleurs, des cantons comme celui d’Argovie ont pris le parti de renforcer les alternatives au suicide assisté.
L’action de la filiale allemande de Dignitas
Une association déclarée « Dignitate-Deutschland » a été créée le 1er novembre 2005 à Hanovre. Par accord passé entre les deux associations les membres de Dignitate–Deutschland bénéficient de l’assistance dispensée par l’association suisse comme s’ils appartenaient à celle-ci. Il faut dire que le fondateur de Dignitas suisse, qui a refusé de rencontrer la mission parlementaire lors de son déplacement en Suisse, est à la fois secrétaire général de l’association suisse et président de l’association sœur allemande.
L’existence d’une filiale allemande de Dignitas a sensibilisé les autorités allemandes sur cette question, d’autant qu’en 2007, elle a donné les moyens à deux Allemands de se suicider à l’hélium, sur un parking, et que 114 personnes sur les 175 dont le suicide a été assisté par Dignitas en 2006 étaient des ressortissants allemands. Ceci laisserait à penser que l’association allemande sert à séduire le public allemand qui ne peut invoquer sur son territoire le bénéfice des facilités d’interprétation de la législation pénale helvétique.
Le Comité d’éthique allemand s’est prononcé clairement contre le suicide assisté le 13 juillet 2006. De son côté l’organisation fédérale des juristes allemands (« Juristentag ») a recommandé de pénaliser le suicide assisté en invoquant en l’espèce l’exploitation d’un abus de faiblesse à des fins commerciales (452). Le parquet d’Augsbourg en Allemagne a ouvert en 2005 une enquête contre deux médecins, l’un allemand, l’autre suisse qui avaient faussement établi un diagnostic irréversible sur une bavaroise âgée de 69 ans à la disposition de laquelle Dignitas avait mis des médicaments mortels. Il est à noter que treize Länder allemands sur les seize qui composent ce pays, avec des gouvernements de sensibilité politique très différente d’un Land à l’autre, ont déposé en juillet 2008 un projet de loi interdisant des pratiques d’aide commerciale au suicide semblables à celles de Dignitas et sanctionnant celles-ci de trois ans de prison (453). Ceci est d’autant plus remarquable qu’une semblable initiative n’avait intéressé que trois Länder en 2006 (454). La police britannique enquête de son côté sur le suicide assisté pratiqué sur un sujet britannique de 23 ans en septembre 2008.
Dans la mesure où Dignitas puise sa clientèle à l’étranger, elle peut être en rapport avec des personnes physiques ou morales hors de Suisse, qui lui adressent des demandeurs. C’est ainsi que le président de l’ADMD, M. Jean-Luc Romero (455) indiquait sur TF1 le 20 septembre 2007, à propos de l’actrice française Maïa Simon, décédée le 19 septembre à Zürich : « Comme nous le faisons en pareil cas, nous avons fait passer Maïa Simon devant notre commission médicale, puis nous l’avons mise en contact avec l’association suisse Dignitas, qui est présidée par un médecin (sic) et assiste les personnes ayant pris une telle décision. » (456)
— Les interrogations sur les pratiques suisses
Des médecins placés dans une situation contradictoire
Les recommandations médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), qui n’ont pas valeur de loi, considèrent que le médecin doit refuser de mettre fin à la vie d’un patient, même sur demande sérieuse et instante. Le meurtre à la demande de la victime est punissable en vertu de l’article 114 du code pénal. Mais ce principe souffre dans les faits de deux tempéraments.
D’abord ces recommandations autorisent le médecin, dans des situations exceptionnelles, à apporter une aide au suicide si trois exigences minimales et plus restrictives que celles d’Exit et de Dignitas sont réunies : la maladie dont souffre le patient permet de considérer que sa fin de vie est proche ; des alternatives de traitements ont été proposées et mises en œuvre, si elles sont souhaitées par le patient ; le patient est capable de discernement. Son désir de mourir est mûrement réfléchi, il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant, cette constance devant être vérifiée par une tierce personne qui ne doit pas être nécessairement médecin.
Ensuite, si le médecin n’accomplit pas lui-même l’acte donnant la mort, il peut prescrire la substance qui tue. Pour ce faire, il doit examiner le patient. L’ordonnance doit contenir le nom, l’adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin prescripteur, le nom, le prénom, l’année de naissance et l’adresse du patient. L’ordonnance doit être datée et comporter le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage ainsi que son mode d’emploi.
Des critères du suicide assisté très larges
Les contours très étendus des critères de la pratique du suicide assisté ont été vérifiés par une étude récente soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Des chercheurs de l’Université de Zurich et de la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ont analysé les cas de décès constatés par l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich entre 2001 et 2004 (457). L’étude prend en compte 274 personnes accompagnées par Dignitas, ainsi que 147 personnes accompagnées par Exit (entre 2001 et 2004). Les chercheurs ont en outre comparé ces données avec une étude antérieure menée sur 149 cas d’assistance au suicide pris en charge par Exit dans la ville de Zurich entre 1990 et 2000. La part de personnes atteintes d’une maladie incurable était plus grande dans le cas de Dignitas : 79 % souffraient d’affections incurables comme le cancer, la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique. Dans le cas d’Exit, cette part était de 67 % entre 2001 et 2004.
Les autres patients ne souffraient pas d’une affection incurable : « Il s’agissait pour la plupart d’entre eux de personnes âgées chez lesquelles plusieurs maladies avaient été diagnostiquées, comme par exemple des affections rhumatismales ou des syndromes de douleurs », explique Susanne Fischer, sociologue et coauteure de l’étude. Celle-ci, également soutenue par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) indique que dans des cas isolés, Exit et Dignitas ont fourni une assistance au suicide à des malades psychiques. Or l’aide au suicide n’est admise que pour des personnes capables de discernement.
Deux facteurs peuvent expliquer cette dérive qui vient contredire la présentation faite par Exit et Dignitas de leur activité : le flou des critères et le fait que ceux-ci soient définis par des associations, comme si la collectivité avait implicitement délégué la détermination des valeurs de la société à un tiers, en l’occurrence une personne privée.
Une sollicitation de l’article 115 du code pénal
La question du mobile égoïste a été soulevée au début du XXe siècle lors de la rédaction de l’avant-projet de code pénal. Cette restriction a été suggérée à l’époque pour éviter de sanctionner des hommes « qui auront par amitié facilité le suicide d’un camarade perdu » et sauver ainsi son honneur (458). Pour illustrer et justifier un tel comportement, on cite l’exemple d’un officier de réserve dont l’entreprise qu’il dirigeait avait fait faillite. Selon l’expression de la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine l’article 115 du code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 1941 se présente aujourd’hui comme une solution intermédiaire entre l’impunité absolue et la répression indistincte. Cependant force est d’admettre que sa genèse et son esprit n’ont plus qu’un lointain rapport avec les patients cancéreux en phase terminale susceptibles de l’invoquer.
Un accès des organisations d’aide au suicide dans les établissements hospitaliers et de personnes âgées contesté
L’expérience de l’accès d’Exit à l’Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV) depuis 2006 mérite d’être évoquée, d’autant qu’elle est à rapprocher de la position diamétralement opposée de l’hôpital universitaire de Bâle qui refuse clairement de collaborer avec des organisations d’assistance au suicide. À Lausanne en 18 mois, 7 demandes de suicide assisté ont été formulées au cours des sept premiers mois, qui furent marqués par la publicité donnée à cette initiative. Une seule demande a été confirmée et réalisée à l’extérieur de l’hôpital. Outre que cet exemple illustre une fois de plus la fluctuation de la volonté des patients, ce droit d’accès de l’association Exit a eu deux effets. Au CHUV de Lausanne, la mise en place de ce dispositif a nécessité la création d’une cellule de soutien psychologique pour les professionnels de santé dès le début de la procédure. Par ailleurs on relève que des établissements pour personnes âgées qui s’étaient engagés dans cette voie, notamment dans le canton de Berne, se sont rétractés avec le temps, compte tenu des conséquences que provoquaient de tels processus sur l’équilibre psychologique des personnes âgées et des personnels soignants. On rappellera que dans les homes publics de la ville de Berne en vertu d’une délibération du conseil municipal du 17 octobre 2001, l’assistance au suicide avait été admise dans le seul cas où l’intéressé n’avait plus de domicile propre, les personnels des établissements ne pouvant participer activement à la préparation ou à l’exécution du suicide.
Comment prévenir les suicides et tolérer les suicides assistés ?
Il y a quelque incohérence à tolérer le suicide assisté d’un côté et à s’inquiéter de l’autre de l’augmentation des suicides dans la population, passés de 1 400 en 2003 à 1 800 en 2007. La pratique des suicides assistés avec un encadrement très lâche n’a-t-elle pas pour effet de créer un climat propice aux suicides ?
B. LE DÉBAT ENGAGÉ AU LUXEMBOURG
Un projet de loi relatif aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement de fin de vie a été déposé le 13 février 2004. Suivant la procédure en vigueur dans le Grand Duché, le texte a fait l’objet, le 4 mai 2004, d’un avis du Conseil d’État qui exerce une fonction consultative. Une proposition de loi « sur le droit de mourir en dignité par l’euthanasie et l’assistance au suicide » a été présentée par M. Jean Huss, député et vice-président de l’ADMD luxembourgeoise ainsi que par Mme Lydie Err. Les deux textes ont été conjointement adoptés, en première lecture, le 19 février dernier. La seconde lecture pourrait avoir lieu à la fin de cette année.
La proposition de loi exonère de faute et de responsabilité le médecin qui a pratiqué une euthanasie sur les personnes suivantes : les patients majeurs ou mineurs émancipés, capables et conscients au moment de leur demande ; les patients mineurs entre 16 et 18 ans ayant demandé l’interruption de leur vie et pouvant se prévaloir de l’autorisation des parents ou de la personne jouissant de l’autorité parentale. La demande doit avoir été formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée et elle ne doit pas résulter d’une pression extérieure. Mettant en garde contre des formulations trop générales, sans entretien préalable, le Conseil d’État préfère au texte de la proposition de loi, le dispositif réglementaire français sur les directives anticipées. De manière générale, le Conseil d’État luxembourgeois se réfère à de nombreuses reprises à la loi française du 22 avril 2005 pour en recommander l’esprit d’équilibre.
Selon le texte adopté en première lecture, le patient doit se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration et indépendamment du fait qu’elle résulte d’une affection accidentelle ou pathologique. Dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, le médecin a l’obligation de consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient. Le médecin qui pratique une euthanasie remet, dans les quatre jours ouvrables, un document d’enregistrement à une commission composée de neuf membres désignés par la Chambre des députés. La commission établit un document de déclaration officielle qui doit être complété par le médecin et adressé à celle-ci chaque fois qu’il pratique une euthanasie. Ce document contient deux volets confidentiels. Le premier porte sur les données concernant le patient et le médecin. Le second porte sur la maladie du patient, l’existence d’un testament de vie, la procédure suivie par le médecin.
On constate, comme le relève le Conseil d’État dans son avis du 7 octobre 2008, que le dispositif luxembourgeois, s’il était adopté définitivement en l’état, irait plus loin que la loi belge. Le champ d’application de la proposition de loi luxembourgeoise inclut en effet les personnes mineures et les personnes démentes. Alors que la loi belge limite la dépénalisation aux situations médicales sans issue, la loi luxembourgeoise l’élargit aux affections graves et incurables. Par ailleurs, si l’article 4 de la loi belge permet l’euthanasie d’un patient inconscient placé dans une situation d’irréversibilité, la proposition luxembourgeoise autorise l’euthanasie de déments ne disposant que d’un certain déficit cognitif. Elle s’aligne en revanche sur la législation néerlandaise pour ne pas exiger que la demande d’euthanasie revête une forme écrite. Plus généralement, le Conseil d’État luxembourgeois considère que l’objectif poursuivi par la proposition de loi sur l’euthanasie peut être atteint par le projet de loi relatif aux soins palliatifs qui avait été déposé en 2004 : « La condition d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration sur laquelle est basée la dépénalisation de l’euthanasie telle que prévue par la proposition de loi peut être efficacement contrée par la mise en route d’une sédation palliative. L’introduction du principe de sédation palliative par le projet de loi retire à la proposition de loi sa principale motivation. » (459)
À travers ces exemples, on voit bien que deux démarches s’opposent. Les législations du Benelux ont fait le choix de privilégier l’autonomie de la personne sur le lien social, sur l’appartenance à une famille, à un groupe. En euthanasiant le patient ou en lui donnant les moyens de se suicider, cette démarche occulte les réactions des proches qui pourraient ne pas supporter les conséquences d’un tel geste. À l’opposé les pays qui refusent de s’engager dans cette voie ou la récusent, comme vient de le faire le 18 septembre dernier la République tchèque, privilégient les valeurs de solidarité et d’accompagnement sur l’autonomie – au demeurant largement fictive – et refusent ainsi d’ouvrir un droit à la mort.
C. LES VOIES SUIVIES PAR L’ALLEMAGNE ET LE ROYAUME-UNI
Bien souvent le discours ambiant tendrait à accréditer l’idée que l’Europe serait en train de suivre les exemples des législations belge et hollandaise qui s’inscriraient dans le sens de l’histoire. Mais outre que certains pays, comme la France en 2005 et la République tchèque en 2008, ont fait le choix de ne pas accepter la transgression de l’interdit de tuer, un examen attentif de certaines législations montre que, plus discrètement, des États comme l’Allemagne et le Royaume-Uni sont en train de s’engager dans une voie assez élaborée qui refuse l’euthanasie et reconnaît au malade un droit au refus de traitement. Comme on l’a vu, le « Mental Capacity Act » de 2005 attribue une force obligatoire aux directives anticipées du malade sous réserve qu’elles soient précises (460). Il en va de même du projet de loi adopté en première lecture par le Bundestag en juin dernier (461). En subordonnant la force obligatoire de ces directives à leur précision et par là même en ne se contentant pas d’indications générales ou de simples projections individuelles dans l’avenir, ces deux pays, à trois ans d’intervalle, s’inscrivent dans une logique de renforcement des droits des malades sans pour autant franchir le pas de l’interdit de l’euthanasie. La loi française de 2005 participe de ce mouvement en faveur d’un accroissement des droits des malades même si au nom d’un certain pragmatisme, elle ne confère pas de force obligatoire aux directives anticipées. Ces trois législations montrent par là même qu’il y a des alternatives au débat entre un droit à mourir et le statu quo.
On constate donc que, sur ces questions, la pertinence d’un clivage culturel entre pays du nord et pays du sud de l’Europe n’est pas vérifiée. Les différences de sensibilités religieuses ne semblent pas être des facteurs d’opposition sur ces problèmes éthiques.
Pour compléter ces données, on rappellera aussi que la Chambre haute de la République tchèque vient de rejeter un projet de loi autorisant l’euthanasie, tandis que la Grèce et l’Ukraine sont engagées dans une réflexion tendant à introduire dans leur législation interne l’équivalent de la loi française du 22 avril 2005.
On ne saurait non plus oublier les initiatives internationales en la matière. C’est ainsi que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avait invité dès 1999 le Comité des ministres à « encourager les États membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants :
— en consacrant et en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à une gamme complète de soins palliatifs.
— en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à l’autodétermination ;
— en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants. » (462)
Chapitre IV
Les dispositifs proposés conduisant à une irresponsabilité pénale des auteurs d’actes d’euthanasie sont-ils juridiquement cohérents ?
Sans doute plus que dans tout autre domaine, dans la mesure où sont en cause les droits de la personne humaine et le respect de la vie, tout projet de dispositif juridique qui instituerait un droit à la mort rencontrerait sur sa route de nombreux obstacles, à la fois de fond et de procédure. La Garde des sceaux a rappelé que l’interdiction de tuer constituait un interdit fondateur et absolu et que la reconnaissance d’un droit à la mort serait la négation de valeurs essentielles de nos sociétés modernes (463). La Cour européenne des droits de l’homme a clairement fait valoir que le droit à la mort n’entrait pas dans le champ d’application du droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme. Le premier Président de la Cour de cassation a d’ailleurs donné raison à cette décision : « En refusant de sanctionner la loi nationale incriminée par la requérante, la Cour européenne des droits de l’homme s’est interdit d’autoriser son suicide assisté et de prêter renfort à une culture de mort qui ne demande qu’à investir toujours davantage le champ social. Cette décision est sage. Décider autrement eût été méconnaître que les réalités sociales et culturelles dont procède la pratique médicale, le système médico-social, sans évoquer les liens avec la religion et la relation à la mort, sont des éléments intimement liés à une identité construite au fil des siècles et des bouleversements qui ont marqué l’histoire de l’Europe. » (464)
Trois pistes s’offriraient au législateur tenté par la reconnaissance d’un droit à la mort : l’exception d’euthanasie, l’euthanasie ou le suicide assisté.
A. UNE PROCÉDURE PÉNALE D’EXCEPTION POURRAIT-ELLE CONSTITUER LA RÉPONSE À DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES ?
Si la vocation de la mission était d’évaluer l’application d’une réglementation, il lui appartenait tout naturellement de se pencher sur la construction juridique d’un dispositif allant dans le sens de l’euthanasie. Or, la reconnaissance d’un droit à l’euthanasie n’est pas sans soulever des difficultés juridiques considérables dont s’était ému en son temps le sénateur Henri Caillavet devant la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie (465). S’interrogeant sur la possibilité pour une loi de définir des exceptions, Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a mis en garde les membres de la mission parlementaire : « La difficulté réside dans une définition des exceptions, la loi ne pouvant, par destination, définir que des principes. L’exception ressortit à l’espèce, non au genre. Vouloir la fixer par avance dans la loi serait risquer de manquer son but ; ce serait d’ailleurs incompatible avec l’idée même de loi. Comment une loi pourrait-elle définir, dans leur singularité radicale, les cas exceptionnels ? À supposer qu’on arrive à le faire, les médecins auront toujours à trancher dans chaque cas singulier soumis à leur appréciation. » (466)
Dans son avis n° 63 du 27 janvier 2000, le Comité consultatif national d’éthique posait le principe de l’interdit de l’euthanasie et admettait en même temps qu’un acte de solidarité puisse être réalisé au cas où la mise en œuvre des soins palliatifs, de l’accompagnement et du refus de l’acharnement thérapeutique se révélait impuissante à offrir une vie supportable. Ce texte, d’une part, recelait une contradiction puisqu’il affirmait un principe – l’interdit de l’euthanasie – tout en autorisant son contraire, fût-ce à titre exceptionnel. Comme le soulignait M. Axel Kahn, « l’exception d’euthanasie est évoquée aussi bien par des partisans d’une légalisation de l’euthanasie « dans des cas exceptionnels » que par ceux qui y sont opposés par principe et proposent de traiter autrement les situations où elle est malgré tout appliquée, de manière transgressive. » (467)
D’autre part, le Comité consultatif national d’éthique présentait comme une exception de procédure ce qui en réalité était une exception de fond. M. Nicolas Aumonier, maître de conférences en histoire et philosophie des sciences à l’Université Joseph Fourier-Grenoble I, avait ainsi décrypté cette proposition : « L’expression exception d’euthanasie paraît reposer sur une imposture juridique et morale. Juridique, parce qu’elle détourne l’expression juridique d’exception de procédure de son sens purement formel, évite de qualifier quant au fond l’acte d’euthanasie dont la gravité se trouve ainsi masquée et passe de l’abstention juridique purement formelle à la décision de qualifier une situation de moralement exceptionnelle. Une exception de procédure (fictive) autorise alors, dans l’esprit de certains, une exception morale (réelle). Une fiction juridique viendrait ainsi, dans certains cas, nous dispenser de morale ordinaire […] La proclamation arbitraire d’une exception juridique infondée autorisant l’abstention morale s’appelle, selon les cas, laxisme ou tyrannie. Justifier ce laxisme ou cette tyrannie par un devoir de compassion est la deuxième imposture de l’exception d’euthanasie : le vocabulaire compassionnel des soins palliatifs est détourné de son contexte et appliqué à celui de l’injection létale. Il semble donc prudent de ne pas employer une telle expression. » (468)
Sur un plan juridique, Mme Dominique Thouvenin, Professeure à l’Université Paris-Diderot Paris VII, ajoute que : « dès lors que l’on accepte une revendication sociale qui est une demande, on doit en fixer les conditions, mais ce n’est plus une exception. » (469)
L’actuel président du Comité consultatif national d’éthique, M. Alain Grimfeld, n’a pas dissimulé que cette position du CCNE ne reflétait pas l’opinion de ses membres aujourd’hui (470).
À l’inverse l’ancien président du CCNE, M. Didier Sicard, a plaidé devant la mission pour cette exception qu’il a qualifiée de solidaire (471). Il convient de bien mesurer les effets, ne serait-ce qu’en termes quantitatifs, de l’introduction dans notre droit pénal d’une telle exception. Comme on l’a vu, à travers les articles 293 et 294 de son code pénal, la loi hollandaise proscrit l’euthanasie et le suicide assisté et institue un régime d’irresponsabilité pénale, une cause absolutoire en quelque sorte pour les médecins satisfaisant aux critères de minutie. Il s’agit donc bien de facto d’une exception d’euthanasie. Mais dans la pratique hollandaise et belge, faute de poursuite des contrevenants à la loi, ce qui est censé être dans ce pays une exception est en réalité la règle. Or transposée en France, une exception du même type pourrait toucher jusqu’à 7 500 personnes par an.
Au surplus s’il n’existe pas d’exception légale d’euthanasie en droit pénal français, on peut néanmoins penser qu’il existe dans les faits une exception que l’on peut être tenté de qualifier de judiciaire. Sur onze décisions de justice recensées depuis 1988 (472), on dénombre en effet huit condamnations à des peines avec sursis, deux acquittements dont un ayant fait l’objet d’un appel par le parquet général et un non-lieu. Par conséquent, la justice est d’ores et déjà en mesure d’utiliser les ressources de la procédure pénale pour absoudre ou juger avec mansuétude en fonction de chaque situation, sans qu’il soit besoin de modifier pour autant la procédure pénale, le code pénal et le code de la santé publique. Le Directeur des affaires criminelles et des grâces, M. Jean-Marie Huet n’a pas manqué de rappeler toutes les armes dont disposaient les magistrats dans ce genre d’affaires (473) :
— la vérification des éléments matériels de l’infraction en tenant compte de chaque situation particulière (état de conscience du malade, nature de l’acte suivant qu’il s’agit d’une abstention, d’un arrêt de traitement, d’un refus du malade, d’un soulagement de la douleur mettant en cause le pronostic vital ou d’actes positifs mortifères) ;
— le principe de l’opportunité des poursuites, qui permet un classement sans suite dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
— l’existence de faits justificatifs, comme l’état de nécessité et la contrainte ;
— l’absence de peines minimales ;
— la difficulté de la preuve de l’existence du consentement du patient ou de ses proches à l’arrêt de traitement.
Le Doyen Bernard Beignier a rejoint le Directeur général des affaires criminelles et des grâces pour constater que tous ces éléments étaient préférables à une exception d’euthanasie qui serait définie par une commission (474). À tous ces facteurs il convient également d’ajouter la capacité de l’institution judiciaire à s’autoréguler par le biais des voies d’appels, même si en la matière, comme l’observait le Premier Président de la Cour de cassation, les décisions des juges du fond, qui en général ne prononcent pas de peines fermes contre les auteurs d’euthanasie ne font pas l’objet de recours (475).
Au surplus, à en juger par les différentes propositions existantes allant en ce sens qui ne sont pas à l’abri d’incohérences juridiques et d’approximations, le législateur le voudrait-il, l’exercice consistant à reconnaître un droit à la mort serait particulièrement complexe et lourd de conséquences.
B. LA DÉPÉNALISATION DE L’EUTHANASIE SERAIT-ELLE COMPATIBLE AVEC NOTRE ORDRE JURIDIQUE ?
L’institution d’un droit à la mort a les faveurs de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle récuse l’exception d’euthanasie et souhaite que les patients en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ou qui se trouvent dans un état incompatible avec leur dignité puissent bénéficier d’une aide active à mourir et ce, même s’ils ont accès aux soins palliatifs (476).
La proposition de loi rédigée par l’Association confie cette aide à mourir au médecin traitant du patient, celui-ci pouvant saisir un confrère indépendant. Les vœux du patient peuvent également être consignés dans des directives anticipées. Il s’écoule un délai de quinze jours entre l’expression de la demande et l’acte létal. Il est institué dans chaque région une commission régionale de contrôle des pratiques en matière d’aide active à mourir. Celle-ci est destinataire d’un rapport d’aide active à mourir transmis par le médecin traitant, une commission nationale pouvant dans un second temps transmettre le dossier au Procureur de la République.
Cette construction qui se veut simple n’est pas sans susciter des questions qui affaiblissent sa logique apparente.
Le premier critère de l’euthanasie retenu par l’ADMD est celui de la phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable issue. Ce critère est objectif, même si les conclusions qu’en tire l’association n’ont rien de commun avec les dispositions de la loi actuelle sur la fin de vie.
En revanche, le second critère relatif à l’image que la personne peut avoir de sa dignité est susceptible de tant d’acceptions que son maniement risque d’être source d’ambiguïtés et de confusion éthique comme l’a montré M. Jacques Ricot (477).
1. L’instrumentalisation de la notion ambiguë de dignité
Dans son avis du 13 juillet 2007 sur la proposition de loi sur le droit de mourir « en dignité » et sur le projet de loi relatif aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, le Conseil d’État luxembourgeois met en garde contre une utilisation abusive de cette notion. Il « insiste sur les aléas cachés et inattendus auxquels conduisent les essais d’une déduction du droit positif à partir d’une notion aussi générale que celle de dignité humaine, véritable boîte de Pandore si elle n’est pas maniée avec prudence et circonspection. Enfin et quelle que soit la définition de la notion de dignité humaine sur laquelle on veuille s’appuyer, celle-ci ne permettra pas d’établir de manière éthique l’équivalence entre laisser mourir et faire mourir. » (478)
Inscrite désormais dans le préambule et l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la dignité est tout le contraire d’une convenance personnelle. Elle est l’affirmation que l’homme est reconnu comme ayant une valeur absolue (479). La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui a consacré son article 1er et, en s’appuyant sur la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel lui a conféré valeur constitutionnelle (480). Pour le premier Président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, la dignité humaine ne réside pas dans la liberté de choisir de vivre ou de mourir mais elle est la condition même de cette liberté. L’être humain ne pouvant y renoncer pour lui-même, ce principe justifie qu’on limite la liberté de l’individu. Le Conseil d’État à propos du lancer de nains et la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont cette même lecture de la dignité (481).
Appréhender la dignité comme le fait l’ADMD, conduit à ne la définir qu’à travers le seul prisme du regard de l’autre, à la faire dépendre de facteurs extérieurs comme l’âge, la santé, la beauté, la productivité. C’est entrer dans une logique subjectiviste qui passe sous silence la dimension ontologique et universelle d’un principe qui sous-tend notre système juridique depuis 1945.
M. Axel Kahn décrit très bien les dérives de l’instrumentalisation de ce concept de dignité : « La dignité en tant que valeur essentielle ne se prête pas à des opérations mathématiques. On n’est pas deux fois plus digne, deux fois moins digne ; on ne multiplie pas sa dignité par 2 ou on ne la divise pas par 3 en fonction d’un handicap, d’une maladie ou d’un âge très avancé. Une personne peut donc craindre de devenir indigne de l’image qu’elle a de la dignité. Mais je pense qu’elle a surtout peur de se voir comme indigne dans les yeux des autres. Ce sont les yeux des autres, souvent, qui donnent son caractère redoutable à la menace d’indignité. » (482)
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a insisté sur le fait que la dignité ne peut être altérée par la vulnérabilité de la personne : « La scandaleuse notion de “ dignité perdue des personnes en fin de vie ” contrarie tout autant les exigences de la morale que les principes du droit. La dignité ne décline pas avec nos forces ; la maladie n’altère pas notre humanité – pas davantage que l’approche de la mort. Le principe du respect dû à notre prochain ne s’effondre pas soudain quand se dégradent ses facultés. Si la force ne fonde aucun droit, c’est que seule notre faiblesse oblige. La vulnérabilité en appelle à notre conscience morale, et c’est pourquoi le droit existe : pour protéger le faible sans anéantir son autonomie. » (483)
Nombreux ont d’ailleurs été les représentants d’associations auditionnés qui se sont émus des effets que pouvait avoir la divulgation d’un discours mortifère sur les personnes handicapées (484). Comme l’a affirmé le Professeur Alain Prothais, « la loi ne peut pas tout faire pour que [le handicapé] puisse vivre mieux et, en même temps, l’aider à mourir. » (485)
2. Une procédure susceptible d’engager fortement l’État
Au-delà même de l’ambiguïté du critère de la dignité, la procédure proposée est sujette à interrogation. Si dans le texte proposé par l’ADMD les médecins peuvent s’abriter derrière une clause de conscience pour ne pas pratiquer d’euthanasie, celle-ci s’avère en même temps très relative. En effet s’ils l’invoquent, ils sont tenus d’ « orienter [le patient] immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande ». La clause de conscience est donc fictive en ce sens que le médecin qui s’en réclamerait serait néanmoins contraint de participer activement à cette procédure puisqu’il lui échoirait de trouver le médecin qui pratiquerait l’euthanasie. En outre, si le médecin ne trouve pas de confrère susceptible de répondre à la demande du malade, reviendra-t-il à la puissance publique d’organiser une structure collective de médecins ayant l’euthanasie comme spécialité ? Cette hypothèse a été envisagée par M. Robert Badinter pour être aussitôt écartée : « [Le droit opposable] signifierait que j’aurais une créance, par définition contre la collectivité, la nation, l’État pour exercer ce que l’on appellerait un droit opposable au suicide, ce qui impliquerait que des dispositions soient prises dans les hôpitaux pour que je puisse m’y rendre et faire part de ma décision d’en finir. Des établissements seraient consacrés à la fin de vie. Je dis : non ! C’est une perspective que je ne veux même pas envisager. » (486) Faudra-t-il que les systèmes hospitaliers se dédoublent en services d’accompagnement des mourants, d’un côté et en services euthanasiques, de l’autre ? Conçu au départ, au nom de l’autonomie de la personne, comme une démarche exclusivement individuelle, le droit à la mort peut donc engendrer des obligations pour l’État, chargé de pallier les refus de professionnels de santé.
3. Des incohérences et des garde-fous peu dissuasifs
En prétendant s’intégrer dans la loi du 22 avril 2005 mais en épousant en réalité une logique très différente de celle-ci, une telle proposition risque d’être également un facteur de confusion. Elle fait en effet de l’aide à la mort un droit qui va bien au-delà de l’affirmation des droits des malades par les lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005.
D’aucuns ne manqueront pas de relever dans cette proposition de texte une contradiction entre, d’un côté, la proclamation d’un droit à l’accès de tous les malades aux soins palliatifs à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique et, de l’autre, une simple information donnée aux patients sur les possibilités offertes sur les soins palliatifs à l’article L. 1111-10-1. Quelle serait la réalité de cette information ? Quel serait le contrôle exercé sur sa délivrance ? Et surtout n’y a-t-il pas contradiction entre une logique consistant à informer le patient ainsi assimilé à un usager d’un service public et les obligations légales et déontologiques qui pèsent sur les médecins ? Si le médecin ne remplissait qu’une fonction d’information et n’était qu’un prestataire de services, l’article R. 4127-38 du code de la santé publique n’exigerait pas de lui qu’il accompagne le mourant jusqu’à ses derniers moments. On retrouve là une des ambiguïtés à faire cheminer côte à côte les soins palliatifs et une revendication d’un droit à la mort. Alors que les premiers véhiculent le questionnement, le doute et en même temps la solidarité et le lien collectif, le droit à la mort invoque une liberté individuelle en rupture avec la société. Sauf à vouloir que les professions médicales cultivent une sorte de clivage schizophrénique, ce sont en réalité deux logiques peu conciliables, deux démarches antinomiques.
Enfin admettre comme le fait ce texte que l’appréciation de la violation de la loi revient à une instance nationale non juridictionnelle a posteriori, c’est ériger des gardes fous bien peu dissuasifs une fois que la personne est décédée. En ne transmettant pas le dossier au parquet, la Commission nationale de contrôle dessaisira de fait la justice de son droit de regard sur l’application de la loi et l’opportunité des poursuites sera dévolue de fait non pas au parquet mais à une simple commission, contrairement à notre tradition juridique.
Les contradictions ne sont pas non plus absentes des propositions élaborées par l’association Faut qu’on s’active ! et présentées par son président, M. Vincent Léna au cours de son audition (487). Celui-ci a considéré qu’un droit à mourir pouvait être ouvert par simple voie d’amendements à la loi du 22 avril 2005 sans s’interroger sur la compatibilité d’un droit à la mort opposable avec la logique de l’accompagnement qui prévaut dans cette dernière. Il est également contradictoire de vouloir créer une exception au moyen d’un droit opposable et universel, qui, au demeurant, ne devrait pas forcément être consigné par écrit, mais pourrait n’être exprimé qu’oralement. Un examen attentif de la « proposition de loi relative au droit de se retirer dans la dignité », rédigée par l’association, révèle aussi l’absence de définition précise des critères permettant de faire droit à une demande d’euthanasie puisque, comme l’a soutenu le président de l’association, ces critères peuvent être fixés par le médecin lui-même. Mais si les critères médicaux de la souffrance ou de la détresse sont définis discrétionnairement, au cas par cas par les médecins et non par un texte, on peut douter de la portée d’un contrôle du respect des conditions posées par la loi.
Au surplus, alors que l’article L. 1110-9 du code de la santé publique reconnaît à toute personne malade dont l’état le requiert le droit à un accès aux soins palliatifs et à un accompagnement, leur bénéfice serait désormais suspendu à la décision d’une commission (488). S’engager dans cette voie, c’est faire reculer le droit aux soins palliatifs.
Sur un plan plus général, on pourrait s'interroger sur la cohérence interne de la démarche suivie par ces associations. La reconnaissance d’un droit à la mort peut-elle s’accompagner de la référence à des critères médicaux qui limitent l’exercice de ce droit ? Sur la base de quelle légitimité l’institution médicale aurait-elle le pouvoir de restreindre une liberté devant être garantie, au motif qu’elle renverrait à la dignité de l’homme ? En encadrant les euthanasies par des conditions médicales les défenseurs des différentes propositions de réforme législative ne semblent pas aller au bout de la revendication dont ils se font pourtant les porte-parole. Cette ambiguïté est peut-être la raison pour laquelle, après analyse, les limites et critères médicaux avancés dans ces propositions de loi sont particulièrement flous et ne protègent pas les personnes vulnérables.
C. LE RECOURS À DES EXPERTS AURAIT-IL UN SENS ?
Une autre piste qui a pu être évoquée consisterait à recourir à une procédure d’expertise. On ne reviendra pas dans ce cadre sur les procédures belges et hollandaises précédemment décrites, celles-ci ne relevant pas formellement du droit de l’expertise. Deux solutions sont alors envisageables. La première consisterait, dans le cadre d’une nouvelle procédure, à faire appel à un comité d’experts qui vérifierait, soit a priori, soit a posteriori, que les conditions fixées pour encadrer l’euthanasie ont été respectées. La seconde serait, dans le cadre de la procédure pénale actuelle, de commissionner des experts ès qualités pour ce type d’affaire.
1. Des décisions d’un comité d’experts liant le juge
Quelles seraient les personnes qui seraient habilitées pour siéger dans ce comité, quels que soient les pouvoirs qui lui seraient dévolus ? Selon quels critères de compétence seraient-elles choisies ? Certains ont pu évoquer, dans cette optique le nouveau Défenseur des droits institué par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (489). Aux Pays-Bas, rappelons-le, il existe cinq commissions régionales, composées d’un médecin, d’un juriste et d’un éthicien. Il est évident que selon les convictions personnelles des membres de ces comités, l’expertise peut être plus ou moins objective. Or, il n’est pas illégitime de penser que n’accepteront de siéger dans de tels comités que des personnes qui sont favorables au principe de l’euthanasie, ce qui obérerait l’impartialité de leur jugement. La garantie d’une transmission au parquet de tout dossier litigieux ne pourrait donc être apportée.
Dans le cas du contrôle a priori, un comité d’experts serait institué pour émettre un avis sur une demande d’euthanasie soit auprès d’un médecin, soit auprès du juge. Quand le président de l’ADMD cite la consultation de la « commission médicale » de l’association préalablement au suicide assisté pratiqué par Dignitas sur l’actrice Maïa Simon, on peut penser à une illustration possible de ce cas de figure (490).
Quelles seraient les relations entre la décision de ce comité et d’éventuelles actions en justice ultérieures ? Par exemple, est-ce que les proches ou l’équipe médicale s’occupant du patient pourraient contester l’expertise et devant quelle juridiction, suivant que l’on est ou non en milieu hospitalier et que l’on se situe sur un terrain quasi délictuel (juge administratif) ou contractuel (juge judiciaire) ? Selon le Directeur des affaires criminelles et des grâces, cette hypothèse n’est pas un cas d’école : « Des membres de la famille pourraient prendre une position différente de l’expertise et, jugeant qu’ils n’ont pas été suffisamment associés ou qu’ils n’ont pas compris la décision, pourraient se constituer partie civile et engager une procédure. Dans les affaires que nous avons étudiées, nous voyons que la position de l’ensemble des membres de la famille est loin d’être homogène. Il y aura forcément du judiciaire, un procureur, un juge. » (491) Il n’est pas concevable en effet que la justice ne puisse pas être saisie d’une mort douteuse. La justice aura donc inévitablement à se prononcer sur des affaires que le comité aurait décidé de ne pas lui transmettre ou sur des appels contestant une décision de ce comité. Encore une fois on ne saurait faire l’économie des procès avec la création de ces comités. Comme l’a relevé avec force le président Robert Badinter, le procès ne disparaîtrait pas, la cour d’assises et le jury apprécieraient toujours souverainement sans que leur décision soit motivée (492).
C’est en effet à la justice de vérifier si les conditions d’une exception ont été remplies, ainsi que le pense Robert Badinter : « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle. À plus forte raison quand il s’agit de la vie d’autrui, il est évident que je ne concevrai pas qu’un comité quelconque puisse apprécier, en dehors de toute décision de justice, qu’une exception d’euthanasie trouve sa place. J’ajoute que je n’ai jamais été amateur de juridiction d’exception, encore moins quand il s’agit des principes fondamentaux. » (493)
c) Une expertise a posteriori ?
Outre les arguments précédemment invoqués, ce type d’expertise proche de la pratique belge ou hollandaise apporterait encore moins de garantie que la précédente puisque la personne serait décédée.
Le recours à des expertises, dans le cadre de l’instruction, est réglé par les articles L. 156 à L. 169-1 du code de procédure pénale. Actuellement, par dérogation au principe selon lequel les experts sont choisis parmi les personnes qui figurent sur liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur les listes dressées par les cours d’appel, la commission d’un expert est possible « à titre exceptionnel » et « par décision motivée » de la juridiction (art. L. 157). De plus, il est possible de confier une expertise à une personne morale (art. L. 157-1).
Le recours à une expertise relève de l’appréciation souveraine des juridictions d’instruction et des juges du fond. Il ne peut être question de demander à un expert de se prononcer sur les intentions ou les mobiles (à l’exception des experts psychiatres), ce qui serait pourtant la fonction principale d’une expertise qui porterait sur l’aspect compassionnel ou non d’un acte.
Si l’on faisait le choix d’insérer ce nouveau type d’expertise dans la procédure pénale actuelle, son intérêt serait faible. Pas plus que l’éthique, la compassion ne relève d’une expertise scientifique, technique et professionnelle, critères qui sont requis par l’article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires pour désigner ces derniers. Dans la matière pénale, une expertise a une vocation essentiellement technique comme en dispose l’article L. 158 du code de procédure pénale. Une procédure de ce type n’est pas compatible avec l’essence même de l’expertise.
Il ne suffirait donc pas de compléter les listes d’experts agréés auprès des cours d’appel ou la liste des experts agréés auprès la Cour de cassation par la seule mention d’une nouvelle catégorie d’experts en euthanasie compassionnelle.
En outre, l’expertise suppose une contre-expertise car l’on ne saurait faire abstraction du respect du principe du contradictoire consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article préliminaire du code de procédure pénale. Or, quelle contradiction pourra être apportée à une appréciation subjective par nature ?
Plus généralement les inconvénients des expertises n’ont pas été dissimulés par le Professeur Alain Prothais : « Cela interférerait de manière excessivement complexe avec les procédures normales existantes qui permettent déjà de résoudre l’immense majorité des cas et qu’il n’y a donc pas lieu de disqualifier. Surtout, cela aurait tendance à dramatiser le problème considéré comme social alors qu’il importe, au contraire, de tout faire pour apaiser les choses et traiter le plus sereinement possible le problème humain individuel. » (494)
D. LE DROIT EN VIGUEUR INCRIMINE-T-IL L’AIDE AU SUICIDE ?
Depuis 1791, le suicide ne constitue plus une infraction. Le Doyen Bernard Beignier a présenté en ces termes cette liberté devant la mission : « On peut refuser le suicide médicalisé sous prétexte que ce n’est pas un droit, il n’en reste pas moins une liberté, et par conséquent une personne qui cherche consciemment à obtenir les moyens de se donner la mort a parfaitement le droit de se les procurer. » (495) À partir de là, comme l’a rappelé avec force le Président Robert Badinter, l’aide au suicide qui ne se manifesterait que par un acte de complicité échapperait à toute poursuite puisque si l’incrimination du suicide n’existe pas, la complicité de suicide n’existe pas non plus (496).
En revanche le fait de donner la mort à un tiers sur sa demande constitue un homicide volontaire (497).
La provocation au suicide est punie par l’article 223-13 du code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ces peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende, lorsque la victime est un mineur de quinze ans.
Lorsque cette dernière incrimination a été introduite en 1987 dans le code pénal, elle visait à réprimer la provocation au suicide contenue dans un ouvrage intitulé Suicide mode d’emploi. Celui-ci précisait dans les moindres détails les moyens infaillibles de s’empoisonner en quelques heures. Un jeune dépressif, après avoir lu ce livre avait écrit à l’un des deux auteurs pour lui demander, en indiquant qu’il avait l’intention de se donner la mort, des précisions sur les produits à utiliser. L’auteur lui avait communiqué les doses mortelles et les conditions d’absorption du produit. Le père de la victime s’était constitué partie civile pour défaut d’assistance à personne en péril et homicide involontaire. Celui des auteurs qui avait répondu aux lettres fut condamné pour refus d’assistance à personne en danger (498). Cette affaire a incité le législateur à incriminer deux comportements, la provocation au suicide et la propagande et la publicité favorisant le suicide, deux infractions régies respectivement désormais par les articles 223-13 et 223-14 du code pénal. Lors des débats parlementaires en 1986 le Garde des sceaux de l’époque, M. Albin Chalandon, avait insisté sur la nécessité d’écarter de la discussion la question de l’aide au suicide qui aurait dérivé sur l’euthanasie. Le Parlement a eu donc eu recouru à la notion de provocation, terme largement utilisé dans le droit pénal (499).
Le critère de la distinction entre l’assistance et la provocation au suicide est la cause déterminante de la mort. Il s’agit de savoir si cette cause est à trouver dans l’individu lui-même – auquel cas il s’agit d’un suicide – ou si cette cause renvoie à l’action d’un tiers – auquel cas il y a provocation au suicide. Lorsque le tiers ne fait que fournir un moyen, ce n’est pas lui qui est la cause déterminante de l’acte qui a donné la mort, lequel, dans ce cas, reste un suicide (500). En d’autres termes, le fait de fournir à quelqu’un qui a la volonté de se suicider les moyens de le faire n’est pas incriminé par la loi (501).
La provocation est constituée si elle a fait naître dans l’esprit du destinataire un projet auquel il ne songeait pas jusque-là. Elle n’est punissable que si elle a été suivie d’effet, c’est-à-dire que le délit n’est constitué que lorsque la personne, objet de la provocation, s’est effectivement donné la mort ou a tenté de le faire. Pour le rapporteur de la proposition de loi devant l’Assemblée nationale, M. Albert Mamy, le délit de provocation au suicide sanctionne le fait d’un tiers qui affecte l’autonomie personnelle de la personne visée en transformant par son action, ses pressions, son influence, une personne libre en victime (502).
Malgré ces distinctions la notion de suicide assisté n’est pas aisée à cerner. M. Robert Badinter, Garde des sceaux, avait précisément, en 1983, attiré l’attention du législateur sur la difficulté à mettre en œuvre la loi, en insistant sur le paramètre du lien de causalité : « Ce lien de causalité, c’est-à-dire le rapport entre l’acte commis et le fait qui a pu le déclencher, demeure, on le sait l’élément le plus difficile, je dirai même le plus souvent impossible à cerner lorsqu’il s’agit de suicide. En effet tous les psychiatres s’accordent à dire qu’entre le facteur déclenchant et la propension au suicide, il est impossible de saisir exactement le cheminement et, quelle que soit la déclaration consciente de celui qui se suicide, le lien de causalité entre l’élément qui a motivé le suicide et l’acte lui-même. L’établissement du moyen utilisé pour consommer le suicide n’établit pas la cause de celui-ci. Si la disposition morbide est dans l’être, l’acte de suicide relève de n’importe quel facteur extérieur, on le dit parfois. À coup sûr, ce n’est pas le moyen qui déclenchera ou qui arrêtera la volonté suicidaire. » (503)
Une affaire jugée par le Tribunal de grande Instance de Lille a interprété très restrictivement la notion de provocation au suicide (504). Il s’agissait d’une jeune fille qui, à l’instant des faits reprochés, était sous l’emprise de la drogue et de l’alcool. Elle avait manifesté à son compagnon l’intention de mettre fin à ses jours. Celui-ci lui remit alors un couteau à cran d’arrêt en lui disant : « Tiens, si tu veux te f… en l’air… » Quelques minutes plus tard, la jeune fille se poignardait devant lui et décédait l’heure suivante à l’hôpital où elle avait été conduite. Son compagnon fut relaxé, au motif, d’une part qu’en lui remettant une arme blanche, il n’avait pas « voulu sérieusement convaincre son amie à se suicider », ce geste pouvant « tout autant avoir pour effet de la dissuader de passer à l’acte ». D’autre part, le juge a fait valoir que l’expression « Tiens, si tu veux te f…. en l’air » ne comporte « aucun caractère contraignant de nature à paralyser la volonté de la jeune fille en ne lui laissant d’autre alternative que la mort pour résoudre ses difficultés. » En exigeant cependant que la provocation revête un caractère contraignant et en prêtant à cette provocation une vertu dissuasive le juge rend très difficile l’application de la loi (505). On peut considérer que la provocation n’est pas de nature à contrarier la volonté en l’empêchant de s’exprimer. A été confirmée par une chambre de l’instruction une ordonnance d’un juge d’instruction décidant d’un non-lieu suite au suicide d’une femme dont le mari fonctionnaire de police avait un comportement violent et avait tendu une corde à sa femme en lui disant de mettre fin à ses jours. En l’espèce les juges ont considéré qu’il n’était pas établi de lien direct entre l’incitation du mari et le suicide de la femme survenue deux jours plus tard et au moyen d’un objet différent (506).
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces a décrit ainsi la procédure utilisée pour identifier une provocation au suicide : « Pour établir une provocation au suicide, le ministère public doit mettre en exergue un décalage entre une personne qui n’a pas cette volonté à l’esprit – même si l’on sait que sa position peut évoluer – et des tiers qui vont conduire son raisonnement. Cela n’est pas qu’un concept. La réalité de la provocation doit être établie à partir de témoignages et de constatations matérielles. Pour difficile que soit l’appréciation de ces situations, le parquet parvient à faire le tri et soumet les cas au juge, auquel il appartient, dans sa sagesse, de décider de condamner ou non en fonction des éléments qui sont portés à sa connaissance. » (507)
Le 22 septembre dernier, quatre ans de prison dont un avec sursis ont été requis par le parquet devant le tribunal correctionnel de Guingamp contre un jeune homme qui avait aidé au suicide une adolescente de 16 ans en lui conseillant l’usage de la morphine. L’internaute de 23 ans à l’époque lui avait expliqué en détail les doses à ingérer et comment se rendre dans un endroit reculé pour que personne ne puisse la sauver (508). Cette attitude a été interprétée comme de la provocation au suicide. Mais où s’arrête l’incitation et où commence l’aide au suicide, comme l’a relevé Mme Rachida Dati, Garde des sceaux devant la mission ? « Y a-t-il si loin du « tu me demandes des médicaments pour t’aider à en finir, je vais te les donner » au « tu souffres tellement ! Si tu veux, je peux te fournir des médicaments… » ? Les dérives seront donc inévitables si on légalise ce droit au suicide, d’autant que de plus en plus de personnes meurent seules : ne faut-il pas les protéger contre les incitations déguisées de « proches » qui n’arrivent souvent qu’à la toute fin de vie ? Le ministère de la justice est bien placé pour savoir que l’assistance peut tourner à la provocation, à l’incitation déguisée. C’est en revanche compliqué à démontrer. » (509)
2. La non-assistance à personne en danger
Si l’incrimination de provocation au suicide est difficile à déterminer, on peut considérer également que la différence entre l’aide au suicide et la non-assistance à personne en danger, punie par l’article 223-6 du code pénal est ténue. Dans quelle mesure toute personne qui ne fait pas obstacle à une tentative de suicide ne commet-elle pas l’infraction de non-assistance à personne en danger ? La frontière entre les deux est franchie, lorsqu’il y a conscience de l’imminence du danger, lorsque l’on est en état d’intervenir immédiatement pour empêcher le suicide, qu’il y a manifestement « volonté de ne pas porter assistance à une personne que l’on sait en danger » (510).
Le délit de provocation au suicide peut se cumuler avec celui de non-assistance à personne en péril s’il suppose la volonté de faire surgir chez autrui la résolution de se donner la mort lorsque les éléments constitutifs de ces deux délits et le moment de leur commission sont distincts (511).
3. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse
Le suicide stoïcien reste une liberté. L’aide au suicide n’est pas pénalisée dans la mesure précisément où l’acte de suicide est une liberté. La qualification de la provocation au suicide et de la non-assistance à personne en danger est, quant à elle, difficile à établir. En revanche l’incrimination de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse peut être invoquée plus facilement à l’encontre d’une personne physique ou morale, qui profiterait de l’état de sujétion psychologique dans lequel se trouverait une personne vulnérable. Mise en avant pour conjurer les manipulations dont peuvent faire l’objet des victimes de mouvements sectaires, la condamnation par notre code pénal de cette exploitation de la vulnérabilité a été rappelée par le Doyen Bernard Beignier devant la mission. Elle est en effet sanctionnée par l’article 223-15-2 du code pénal et a trouvé à s’appliquer en particulier à propos des personnes âgées (512).
Il reste qu’il y a une discordance entre l’article 223-13 sur la provocation au suicide et l’article 223-15-2 du même code sur l’abus de faiblesse. La vulnérabilité par nature des malades les fait tomber non sous le coup de l’article 223-13 mais sous le coup de l’article 223-15-2. On peut considérer à ce titre qu’une malade comme Mme Chantal Sebire souffrant d’un comportement frontal par envahissement tumoral relevait plus de l’article 223-15-2 que de l’article 223-13.
Il est à noter qu’à une époque où le délit d’abus de faiblesse n’existait pas, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait retenu une autre qualification pénale. Elle avait admis la qualification d’empoisonnement contre une personne ayant remis des médicaments mortifères à un camarade faible et naïf sur lequel elle avait pris un ascendant certain et qui avait commis avec elle des escroqueries (513).
*
* *
Si, in fine, les options de l’euthanasie et de l’exception d’euthanasie doivent être écartées, si les législations hollandaises et belges sont contestables dans leurs fondements et porteuses de dérives, la mission parlementaire a fait le choix de proposer des solutions adaptées aux besoins de la société et conformes à ses valeurs éthiques ; ces propositions émanent pour l’essentiel du contenu des témoignages des personnes auditionnées par la mission.
PARTIE III : MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES INTÉRÊTS ET LES DROITS DES MALADES EN FIN DE VIE
La diversité et la richesse des témoignages des personnes auditionnées ont permis d’appréhender la complexité de la problématique qui est à l’origine de la mission. Les enseignements des expériences très concrètes qui étaient ainsi livrées montrent que la réponse à ces questions ne peut être univoque mais doit au contraire emprunter une multitude de voies. Écartant toute législation aboutissant à reconnaître un droit à la mort, la mission a choisi de privilégier des solutions attachées au développement des soins des patients reflétant la complexité des situations de fin de vie.
Au cours des auditions, jamais la structure et l’économie de la loi n’ont été remises en cause. Toutefois, il est apparu que ses objectifs seraient mieux atteints si quatre conditions étaient remplies : la loi de 2005 doit être mieux connue ; les droits des malades doivent être renforcés ; il faut aider les médecins à mieux répondre aux enjeux actuels du soin ; il convient enfin d’adapter l’organisation du système de soins aux problèmes de la fin de vie.
Chapitre I
Mieux faire connaître la loi
La loi est mal connue du monde médical, des malades, mais aussi du monde judiciaire (514). Pour pallier cette difficulté, la mission préconise, d’une part, la création d’un Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie, chargé de diffuser l’information sur la loi et d’en étudier l’application. D’autre part, elle juge important que le monde judiciaire ait une meilleure connaissance des enjeux liés à la fin de vie.
A. ÉTUDIER ET AMÉLIORER L’APPLICATION DE LA LOI EN CRÉANT UN OBSERVATOIRE DES PRATIQUES MÉDICALES DE LA FIN DE VIE
Le traitement médiatique de certaines affaires obéit souvent à un scénario immuable : présentation tronquée de leur contexte, sélection et manipulation de leurs acteurs et mise à l’écart de tout protagoniste qui douterait de la sincérité de la présentation du dossier. Quand elles ne sont pas elles-mêmes à l’origine de la mise en scène, des associations utilisent la tribune qui leur est ainsi offerte et envahissent les écrans pour défendre leur cause militante. La caricature et l’excès sont alors fréquemment préférés à l’analyse et à la nuance, l’imposture devient posture, le débat est sacrifié à une vision schématique et unilatérale, les exigences déontologiques élémentaires du journalisme d’investigation sont récusées. Quand le vacarme médiatique finit par retomber, ceux qui par dignité se sont tus jusque-là, rétablissent la vérité mais il est alors trop tard. L’actualité a changé et l’opinion publique a entre-temps été abusée.
Certaines affaires récentes ayant trait à la fin de vie constituent des exemples de ces pratiques où la réalité est volontairement déformée. S’en remettre périodiquement à l’arbitrage des problèmes de la fin de vie par la télévision, c’est privilégier la tension, c’est opter délibérément pour la dramatisation et l’outrance. Comme l’a relevé le conjoint d’une patiente atteinte d’un locked-in-syndrom : « Par le biais des médias, on transpose une affaire personnelle en affaire de société. Mais cela entraîne indéniablement des dommages « collatéraux » » (515). C’est parce que ce débat sur la fin de vie est confisqué par quelques-uns et que la réalité des pratiques médicales est encore largement ignorée, que praticiens et éthiciens ont été nombreux à revendiquer la création d’un Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie devant la mission. N’est-ce pas le Docteur Régis Aubry qui constatait que « l’actualité est traversée par la médiatisation de situations très particulières et [que] les médias, de ce point de vue, jouent un rôle certes informatif mais aussi « déformatif », voire globalisant, laissant à penser que tout pourrait être généralisé » (516) ? Si M. Gaëtan Gorce avait fort opportunément suggéré une telle structure d’observation lors de l’élaboration de la loi du 22 avril 2005, les contours de la formule envisagée à l’époque n’avaient pas permis à cette idée de prospérer. Mais aujourd’hui ce pas doit être franchi.
Selon les mots du Professeur Daniel Brasnu devant la mission, un observatoire des conditions de mort dans les établissements « pourrait servir à mobiliser les professions de santé ». (517) Il lui reviendrait non seulement de pallier les carences d’un débat instrumentalisé mais aussi d’appréhender la réalité sur des bases objectives en recueillant et en analysant les données de la fin de vie. Celles-ci ne sauraient d’ailleurs se cantonner à leur seul aspect médical. Mais elles doivent être également appréhendées dans leur dimension sociologique et anthropologique. Comme l’admet le Docteur Régis Aubry : « Nombreuses sont les situations où nous ignorons la bonne réponse ; ne conviendrait-il pas de mieux les connaître, de les explorer, en dehors de toute forme de militantisme ? Si l’on met en place un observatoire, il ne doit pas servir les opposants ou les militants, mais ceux qui se posent des questions, qui doutent et sont capables de laisser une trace de leurs doutes. L’observatoire pourrait permettre de collationner toutes les situations, afin de disposer d’une photographie de la complexité du problème (518) ».
Évoquer cet observatoire, c’est tenter de répondre à quatre questions : quel statut convient-il de lui donner ? Comment doit-il être organisé ? Quelles missions est-il appelé à exercer ? Faut-il lui confier une mission d’expertise ?
1. Quel statut pour l’observatoire ?
En dehors de l'administration centrale et des administrations décentralisées, les structures sanitaires autonomes existantes ont des statuts juridiques variés : autorité administrative indépendante, établissement public, comité ou commission. Si l’on s’accorde pour reconnaître que le champ des missions à attribuer à cet observatoire ne justifie pas le statut d’une autorité administrative indépendante, on peut hésiter entre la formule de l’établissement public ou celle du comité. Si l’observatoire ne peut être rattaché à une catégorie existante d’établissements publics, une loi est nécessaire. Or, la spécificité du champ d’investigation de l’observatoire le distingue des établissements publics à vocation sanitaire déjà existants. Le recours à la loi semble cependant être une opération trop lourde par rapport à l’objectif poursuivi. Aussi la formule qui parait la plus adaptée est celle du comité créé par voie réglementaire. Même si le principe entrant dans le champ des compétences de l’Observatoire relève du domaine de la loi, parce qu’il touche à l’état et à la capacité de la personne, une telle structure peut être créée par voie réglementaire selon une jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel. Cet organisme n’aurait en effet pas pour objet de garantir le respect d’un principe fondamental que la Constitution réserve à la loi. Un simple arrêté ministériel suffirait pour le créer. Si l’ambiguïté de ses missions et de son fonctionnement ont fait obstacle à ce que l’observatoire d’éthique clinique de Cochin prospère, sa création par arrêté ministériel du 30 avril 2002 peut d’ailleurs être invoquée formellement en l’espèce comme précédent.
2. Comment organiser l’observatoire ?
Cette difficulté juridique levée, on pourrait imaginer que l’observatoire soit doté d’un conseil d’administration faisant largement appel à des professionnels de santé de terrain sans exclure des représentants du monde associatif et qu’un conseil scientifique présidé par une personnalité médicale faisant autorité en matière de soins palliatifs soit créé parallèlement. Il se reposerait sur une équipe opérationnelle avec un directeur, un ou deux médecins ayant de bonnes compétences sur le sujet, un juriste, un spécialiste en sciences humaines et un informaticien. Une telle structure aurait le mérite de créer des synergies entre professionnels de santé de spécialités différentes et entre ces mêmes professionnels et des chercheurs ne se situant pas dans la mouvance sanitaire.
Parmi les suggestions faites lors des auditions, celle du Professeur Emmanuel Hirsch insiste sur la nécessité que cet observatoire s’appuie : « sur une structure similaire au Centre de ressources national François-Xavier Bagnoud (Fondation de La croix Saint-Simon) en matière de soins palliatifs et sur un dispositif de formation déconcentré. L’observatoire rassemblerait des données précises dans un rapport au Parlement. Sa méthodologie serait à définir avec la Haute autorité de santé. À terme, les données de l’observatoire pourraient servir aussi à l’accréditation des établissements en intégrant la dimension éthique, puisque cet aspect est de plus en plus retenu pour cette procédure. » (519) Il faut rappeler que le centre François-Xavier Bagnoud porte le nom d’un ingénieur suisse décédé dans un accident d’hélicoptère dans le cadre du rallye Paris-Dakar en 1986. Une association a été créée en 1989 et a ouvert en 1997 un centre qui propose un service d’hospitalisation à domicile, un service de soutien aux personnes endeuillées, un centre de formation et de recherche ainsi qu’un centre de documentation et d’information spécialisé dans les soins palliatifs, l’accompagnement de la fin de vie, la mort et le deuil. Ce centre a été désigné par le ministère de la santé en 2002 dans le cadre du Programme de développement des soins palliatifs et l’accompagnement comme « Centre de ressources et de documentation sur les soins palliatifs et de l’accompagnement à vocation nationale ». L’année 2003 a vu l’intégration des activités du Centre François-Xavier Bagnoud à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, fondation reconnue d’utilité publique. C’est à cette fondation que la Direction générale de la santé a confié la mise en œuvre de la ligne de téléphonie sociale « Accompagner la fin de vie » et le Centre de ressources François-Xavier Bagnoud a été inscrit par arrêté du 9 octobre 2006 dans le dispositif des missions d’intérêt général des établissements de soins. Sur un budget d’un peu plus d’un million d’euros, le centre perçoit 800 000 euros dans le cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). Il dispose d’un abondant fonds bibliographique qui pourrait être utilisé par l’observatoire dans le cadre d’un partenariat entre les deux structures.
3. Quels moyens attribuer à l’observatoire ?
On a vu que le Centre François-Xavier Bagnoud bénéficiait d’une dotation MIGAC pour financer la ligne Azur dans le cadre d’une convention passée entre la Direction générale de la santé et la Fondation de la Croix Saint-Simon. Il n’est pas interdit cependant de penser qu’au regard des critères de régularité de la dépense publique, une dotation MIGAC serait plus justifiée pour financer le fonctionnement de l’observatoire que pour financer une ligne téléphonique.
Le Centre François-Xavier Bagnoud garderait dans ce schéma cette fonction d’écoute et continuerait à faire fructifier son fonds bibliographique. Une convention serait passée en ce sens avec l’observatoire. Cinq emplois équivalents temps plein et un emploi de secrétaire à temps plein pourraient être envisagés pour permettre à l’observatoire de remplir ses fonctions d’analyse et d’information. Ce partage des rôles permettrait d’assurer une complémentarité avec le Centre François-Xavier Bagnoud, sans remettre en cause les acquis et générerait des économies de fonctionnement.
4. Quelles missions pour l’observatoire?
Un consensus s’est fait jour au cours des auditions pour confier une double mission d’information et d’évaluation à cet observatoire.
Attribuer une fonction d’information à l’observatoire, c’est tirer les conséquences des défaillances du Ministère de la santé pour faire connaître la loi du 22 avril 2005. Cette enceinte serait le pôle central chargé de faire connaître cette loi et d’en diffuser les bonnes pratiques. Il viserait à cette fin aussi bien le public médical que le grand public. Son action pourrait s’articuler autour de trois axes : la valorisation des soins palliatifs, l’affirmation des droits des malades et le rappel des obligations des professionnels de santé. Pour mener à bien cette mission, il pourrait agir auprès des présidents des conférences médicales d’établissement (CME), des présidents et des directeurs de CHU et des directeurs d’agences régionales d’hospitalisation. Il pourrait conduire cette réflexion avec les sociétés savantes aussi bien dans le champ général des soins palliatifs qu’en cancérologie, en gériatrie, en réanimation ou en néonatologie. Une collaboration avec les espaces éthiques régionaux appelés à voir le jour dans le cadre de l’arrêté d’application de la loi du 6 août 2004 et avec le Comité consultatif national d’éthique est également nécessaire. En outre une coopération avec les équipes de recherche, labellisées ou non et avec les équipes cliniques en particulier dans les CHU serait souhaitable. Enfin ses compétences en matière d’éthique et d’évaluation justifieraient pleinement qu’il soit consulté obligatoirement sur tout projet de texte relatif à la fin de vie. Ce travail d’analyse rationnelle des réalités de la fin de vie en France ne servirait en effet à rien s’il restait purement académique, sans qu’il n’en soit tiré profit sur un plan plus opérationnel.
Qu’il s’agisse de la création d’un site Internet, de la mise en place d’une politique de communication en liaison avec l’INPES, de la relance de la ligne de téléphonie sociale « Accompagner la fin de vie » aux côtés du Centre de ressources national François-Xavier Bagnoud, la liste des vecteurs de communication existants à développer ou à exploiter pour diffuser la loi de 2005 est longue. Elle figure d’ailleurs déjà en bonne place dans les recommandations du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement animé par le Docteur Régis Aubry. C’est précisément parce que ces actions n’ont pas reçu jusqu’ici l’impulsion nécessaire d’une instance nationale dotée de moyens suffisant et faute de volonté politique que la loi de 2005 est méconnue.
S’agissant des droits des malades, l’accent doit être mis par l’observatoire dans ses campagnes d’information sur plusieurs principes contenus dans la loi du 22 avril 2005 : la proscription par la loi de l’obstination déraisonnable ; l’application des procédures de limitation ou d’arrêt de traitement suivant que le patient est ou non conscient ; l’intérêt de la rédaction des directives anticipées et la consultation de la personne de confiance et des proches.
Le second volet de l’action de l’observatoire doit être orienté vers l’évaluation de l’application de la loi de 2005. Cette démarche suppose la collecte de données, la mise en place de réseaux et d’indicateurs. Pour le Professeur Emmanuel Hirsch : « Un observatoire doit s’appuyer sur un réseau d’excellence capable de mener un travail de veille sur des bases et selon des indicateurs qu’il conviendra de définir mais aussi sur une action suscitant au plus près de la réalité les évolutions qui permettront l’intégration du dispositif dans sa complexité. » (520) Cette proposition rejoint celle du Professeur Daniel Brasnu qui lui confère toutefois une dimension encore plus ambitieuse mais a priori : « La mission de l’observatoire consisterait à recenser tous les patients atteints d’une maladie incurable qui arrivent en fin de vie et à étudier les évolutions […] intervenues, contrairement à l’exemple de la Belgique où l’on vérifie a posteriori si l’on est bien resté dans le cadre de la loi. » (521)
Force est de constater qu’aucun relevé systématique des pratiques professionnelles organisé par le Ministère de la santé n’a été entrepris jusqu’à aujourd’hui. Les évaluations disponibles sont le fruit d’initiatives de professionnels de santé, tantôt médecins, tantôt infirmières, qui disposent de compétences méthodologiques pour investir ces champs et doivent solliciter des financements pour réaliser ces recherches. Faute de moyens et de coopération interdisciplinaire, ces travaux sont pour l’essentiel réalisés par des équipes médicales et négligent l’apport des sciences humaines en la matière.
La recherche pourrait porter sur les questions d’ordre éthique, sur l’analyse des situations qualifiées d’extrêmes ainsi que sur la connaissance des pratiques soignantes et médicales en fin de vie à travers la mise en place d’indicateurs. Le Professeur Louis Puybasset a plaidé pour l’introduction de systèmes de suivi à long terme de patients dans des populations bien ciblées : « On ne peut pas travailler sur des cohortes de milliers de patients, mais on peut prendre en compte des patients paradigmatiques des situations auxquelles nous sommes confrontés pour savoir comment ils ont été soignés et ce qu’ils sont devenus, et pour s’assurer que ces filières de soins sont optimales en termes de qualité des soins. » (522)
Dans une logique attachée à garantir une meilleure qualité des soins, l’observatoire pourrait alimenter, par les informations recueillies, la Haute Autorité de Santé (HAS), à qui serait confiée la définition des indicateurs de santé, tant dans le domaine des soins palliatifs, que pour les soins en général. L’observatoire aurait également pour fonction d’étudier les évolutions de l’offre de soins palliatifs et de vérifier que les objectifs fixés en la matière ont bien été atteints.
Enfin, ainsi que la mission l’a indiqué, notre connaissance des conditions de la fin de vie comporte des lacunes très importantes. Il reviendrait à l’observatoire de diriger ou d’encourager des recherches ciblées pour l’améliorer. Parmi les sujets d’études, on peut distinguer, d’une part, ceux qui portent sur les conditions de la fin de vie de certaines catégories de population (telles que les personnes âgées dépendantes dans les établissements les accueillant, les personnes victimes de la maladie d’Alzheimer, les personnes handicapées physiques ou mentales, les nouveau-nés et les personnes atteintes d’un cancer) et, d’autre part, ceux qui concernent la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 (effectivité des prises de décision collégiales, existence des directives anticipées…). Pourraient également faire l’objet d’études des questions plus techniques, telles que le financement des soins palliatifs ou l’adéquation de l’offre de soins à la demande.
Ces études devraient donner lieu à un rapport annuel au Parlement. Celui-ci comprendrait, d’une part, un état des lieux actualisé des connaissances sur la fin de vie en France et, d’autre part, les résultats de recherches thématiques dont les thèmes pourraient être renouvelés chaque année.
B. FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE JUGES ET MÉDECINS
Pour appliquer à des cas particuliers les dispositions de la loi du 22 avril 2005, il convient que les magistrats se familiarisent avec la réalité médicale. En sens inverse, pour que les médecins ne soient pas tentés de pratiquer une certaine forme d’obstination déraisonnable et cultivent au contraire le juste soin, leur sécurité juridique doit être assurée.
Une meilleure information du monde judiciaire
La signature d’une convention entre le parquet général de Besançon et le CHU de Besançon le 17 avril 2008 constitue une première expérience, consistant à organiser des échanges entre praticiens, personnels de santé, juristes et magistrats autour des questions soulevées par l’application de la loi du 22 avril 2005. La Garde des sceaux a informé par dépêche-circulaire datée du 11 juin 2008 l’ensemble des parquets généraux de cette initiative et les a invités à la généraliser. Une concertation plus étroite entre l’autorité judiciaire et les centres hospitaliers contribuera à dégager de bonnes pratiques qui seront moins marquées par des peurs infondées.
La Garde des sceaux a en outre demandé aux procureurs généraux de la tenir informée de la mise en œuvre de ce type de convention. Un parquet général a cependant fait part de ses réticences à s’engager dans une démarche institutionnelle de ce type, les magistrats sollicitant à titre préalable une formation pédagogique sur cette loi et son application ; le procureur général concerné a pris des dispositions en ce sens.
Par ailleurs, la Garde des sceaux a annoncé la rédaction d’une circulaire de politique pénale « pour exposer clairement le cadre de la loi du 22 avril 2005 et sensibiliser les magistrats à ses difficultés d'application. » (523) Cette circulaire, a expliqué M. Jean-Marie Huet, Directeur des affaires criminelles et des grâces, sera rédigée sur la base du retour sur expérience de la loi ; elle exposera « une doctrine d’emploi, tout en prônant […] prudence, circonspection et modestie (524) » et incitera à solliciter l’avis de la Chancellerie en cas de besoin. Cette circulaire ne saurait toutefois avoir pour vocation, a précisé M. Jean-Marie Huet, d’harmoniser les décisions de justice. Mais face aux « disparités extraordinaires entre les juridictions (525) », elle aura pour objectif d’imposer « un niveau d’exigence procédurale identique sur tout le territoire ». (526) La mission parlementaire appelle de ses vœux que cette même circulaire explicitant la doctrine d’emploi de la loi du 22 avril 2005 insiste sur le nécessaire discernement dont doivent faire preuve les magistrats dans ce genre d’affaires, qu’il s’agisse de la vérification des éléments matériels, du choix des outils procéduraux et juridiques et de la valeur des preuves rassemblées. Ce rappel aura à l’évidence à recevoir application au-delà même des professionnels de santé.
Faut-il aller plus loin en créant des pôles spécialisés sur le modèle de ceux existant en matière de santé publique ou de droit économique et financier ? Après avoir envisagé cette possibilité, la mission a écarté cette idée, à la fois parce que le volume du contentieux concerné ne justifie pas une telle organisation et parce que ce contentieux ne revêt pas le caractère technique de celui traité par les pôles précités.
Une formation accrue des magistrats sur ces questions
Les programmes de formation continue des magistrats laisseront plus de place aux questions relatives à la fin de vie. En 2008 ont été proposés aux magistrats une session intitulée « Bioéthique et droit » et un cycle de modules ayant pour sujet « Le juge face aux enjeux bioéthiques ». Une formation « Justice et médecine, un dialogue nécessaire » ainsi qu’un stage collectif de plusieurs jours dans les établissements de santé dépendant de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris ont été organisés. Pour 2009, ces deux actions seront reconduites et une formation spécifiquement dédiée aux questions de la fin de vie sera proposée sous le titre « Le juge et la fin de vie ». D’une durée de trois jours, elle s’adressera à des magistrats, des médecins, des avocats et des magistrats étrangers ; au total, 180 stagiaires pourront y participer.
On pourrait suggérer de développer des partenariats entre les espaces éthiques régionaux, interrégionaux et les cours d’appel sur le modèle des rencontres éthiques du Tribunal de grande instance de Paris organisées avec l’Espace éthique de l’assistance publique de Paris. Ces deux institutions ont organisé entre 2001 et 2006 quatorze conférences à vocation médicale et éthique en direction des personnels de la justice et de la santé (527). Ont été évoqués par exemple dans ce cadre les thèmes de la demande de mort, de la protection des personnes et de la responsabilité médicale. Le vecteur des espaces éthiques semble être le plus adapté pour construire ces passerelles entre la justice et la médecine. On pourrait envisager aussi que les nouvelles possibilités offertes par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités soient mises à profit par les facultés de médecine en direction des magistrats.
Il est à regretter que la formation des auditeurs de justice à l’École nationale de la magistrature ne comprenne aucun module d’enseignement portant sur l’éthique biomédicale et la fin de vie. Même si le volume du contentieux est restreint, l’absence de sensibilisation à ces thèmes peut justifier les appréhensions de certains médecins envers l’institution judiciaire.
M. Vincent Lamanda, premier Président de la Cour de Cassation a insisté sur la nécessité d’instituer de tels échanges entre l’institution judiciaire et le monde médical. À défaut, la défiance accueillera toute procédure judiciaire envers un membre du corps médical et l’incompréhension marquera les décisions de justice : « C’est cette confiance dans la décision des juges que je voudrais voir restaurer. Le monde médical semble avoir une appréhension à l’égard du monde judiciaire qui lui paraît étranger et inquiétant. Il faudrait organiser des échanges sur ces sujets pour que les personnels de santé voient, preuve à l’appui, que, s’il a des plaintes, les résultats sont loin d’être effrayants et sont souvent justifiés par les circonstances. » (528)
La mission estime que toutes ces actions doivent être favorisées. Une meilleure compréhension entre juges et médecins contribuera à apaiser les craintes que les seconds nourrissent envers les premiers.
Chapitre II
Renforcer les droits des malades dans la continuité des lois de 2002 et de 2005
La loi du 22 avril 2005 instaure de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie. Ces progrès ont été largement salués lors des auditions auxquelles la mission a procédé. Pourtant, il est souhaitable d’aller plus loin dans ce domaine, en permettant à la personne de confiance de saisir le collège médical et en prévoyant l’intervention de tiers compétents en matière de soins palliatifs dans les situations les plus complexes. Enfin, la création d’un congé d’accompagnement pourrait être mise à l’étude avant de l’expérimenter.
A. ÉLARGIR LE DROIT AU RECOURS À LA PROCÉDURE COLLÉGIALE ET MOTIVER LES ÉVENTUELS REFUS OPPOSÉS AUX DIRECTIVES ANTICIPÉES ET À LA PERSONNE DE CONFIANCE
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a souligné la spécificité de l’approche des situations de fin de vie et le rôle que, dans cette perspective, il convient de reconnaître aux proches : « Quand le fil qui rattache un être à la vie se fait plus ténu, la singularité et l’unicité de cet être nous apparaissent dans leur lumineuse évidence ; c’est alors que les soins prodigués requièrent une attention plus fine et que les besoins des patients doivent être saisis dans leur globalité. » (529)
Or, dans le cas d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, l’évaluation du moment opportun pour provoquer une délibération collégiale susceptible de conduire à une décision de limitation ou d’arrêt de traitement relève, dans le dispositif légal actuel, de la seule initiative du médecin en charge du malade concerné. Il s’agit en effet d’une évaluation d’ordre médical pouvant conduire à une décision dont seul le médecin portera la responsabilité. Il n’appartient qu’à ce dernier d’initier et de clore le processus décisionnel.
Mais quelles que soient les vertus éthiques attendues de la discussion collégiale d’une décision, encore faut-il que cette discussion soit engagée. Les proches du malade devant être consultés pour que puisse être élaborée en commun la décision, ne pourrait-on pas envisager qu’ils participent aussi à l’initiative de déclencher la réflexion sur des choix thérapeutiques pouvant conduire à abréger la vie de leur parent ? Il ne s’agirait pas qu’ils se substituent à une prérogative du médecin mais qu’au vu de leur propre approche du malade, de leur intimité avec lui, ils puissent alerter l’équipe médicale sur la nécessité de réévaluer l’opportunité des thérapies mises en œuvre.
Si dans la plupart des cas cette intervention ne ferait que précéder de peu celle du médecin, elle serait aussi le moyen de contraindre une équipe médicale à faire au moins le bilan thérapeutique d’un malade, en termes de non-malfaisance, au cas où les médecins tarderaient ou écarteraient l’idée même de remettre en cause les traitements prodigués. De telles situations de blocage verraient ainsi un début de résolution ou, à tout le moins, un début d’éclaircissement pour la famille.
Sans que soit remise en cause la responsabilité du médecin, un rééquilibrage des droits des intervenants serait engagé dans la procédure au profit des proches. La crainte d’un abandon du malade hors d’état d’exprimer sa volonté serait par là même réduite.
Plusieurs personnalités auditionnées par la mission d’information ont estimé qu’il conviendrait de rendre légale une telle extension de la saisine de la collégialité à des intervenants non médicaux. Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, a ainsi proposé que « le renforcement de l’information pourrait s’accompagner d’une implication accrue de la famille et des proches, auxquels pourrait être reconnu le droit de demander la mise en œuvre de la procédure collégiale. » M. Claude Évin, Président de la Fédération hospitalière de France, a pris position dans le même sens : « D’un point de vue juridique et de manière symbolique, je crois que la procédure collégiale prévue par la loi […] pourrait être enclenchée à la demande de la famille du patient et pas seulement à la demande d’un médecin. » (530)
Selon le Docteur Régis Aubry : « il est dommage que le déclenchement de la procédure collégiale soit réservé au médecin. Il conviendrait d’étendre ce pouvoir aux soignants et aux familles. Cela correspond à un besoin. Nous devons pouvoir être incités à discuter collégialement avec les familles. Cette modification, à la marge, pourrait avoir dans certains services des effets considérables. » (531) Au nom de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), le Docteur Godefroy Hirsch partage la même analyse (532).
Convaincus par ces divers arguments, les députés membres de la mission parlementaire estiment aussi qu’il est nécessaire d’ouvrir aux intervenants non médicaux l’initiative de convoquer le collège médical. Cependant, autant une procédure qui consiste à recueillir des avis s’accommode d’une définition large des personnes habilitées à les donner (la famille, les proches), autant une procédure conférant un droit effectif susceptible d’avoir des conséquences sur la vie d’un patient et l’organisation d’un service risquerait d’être source de confusion, tant pour l’équipe médicale que pour les intervenants non médicaux. On peut en effet envisager des conflits internes aux familles, des oppositions entre les proches, ou entre les familles et les proches ; si les uns ou des autres peuvent prétendre à ces droits, l’équipe médicale ne sera pas en mesure d’en apprécier leur bien-fondé ; de même si une demande est formulée par un membre de la famille ou un proche contre l’avis du reste de la famille ou des autres proches, de lourds conflits peuvent se déclencher. M. Jean-Marie Huet, Directeur des affaires criminelles et des grâces n’a pas écarté ce danger de judiciarisation au cours de son audition : « la position de l’ensemble des membres de la famille est loin d’être homogène. » (533)
À l’inverse, réserver l’élargissement de la saisine à la personne de confiance ou au patient lui-même par l’intermédiaire des directives anticipées, permettrait de rattacher cette procédure à une expression des droits propres au malade et de s’inscrire dans la logique de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le tiers détenteur du mandat de confiance que lui a confié le patient est un interlocuteur unique pour l’équipe médicale, investi d’une légitimité précisément identifiée. Les directives anticipées constituent aussi une source claire d’expression de la volonté.
L’article L. 1111-4 du code de la santé publique renvoyant au code de déontologie la définition de la procédure collégiale, c’est dans ce dernier (article R. 4127-37) que cette disposition nouvelle trouverait sa place.
Ce progrès sera d’autant plus significatif que l’effet mécanique de l’élargissement de la saisine de la collégialité sera de contraindre l’équipe médicale à motiver un éventuel refus de limitation ou d’arrêt de traitement. La personne de confiance se verra ainsi expliquer la stratégie thérapeutique suivie par l’équipe médicale et le patient, au moment où il rédige ses directives anticipées, saura que le refus de faire suivre d’effets les souhaits qu’il exprime devra être motivé dans le dossier médical. Ainsi, ce n’est pas seulement une évaluation d’un éventuel retrait des thérapies qui sera l’objet de la réunion collégiale mais aussi la décision de poursuivre des traitements dont la nécessité est contestée par la personne de confiance ou le malade de manière indirecte. Dans ce cas, la décision de faire, comme la décision de ne pas faire, bénéficiera de la même transparence de procédure et de la même évaluation éthique.
La mission s’est attachée à trouver des solutions pour résoudre les difficultés qui peuvent naître dans les relations entre l’équipe médicale d’accueil et la famille. Peu de solutions existent actuellement pour faire face à ces difficultés. C’est pourquoi la mission propose que l’intervention d’un référent de soins palliatifs soit possible dans ces situations.
B. FAIRE APPEL À DES MÉDECINS RÉFÉRENTS EN SOINS PALLIATIFS DANS LES CAS LITIGIEUX OU LES PLUS COMPLEXES
Que faire en cas de conflit entre une équipe soignante et une famille, en particulier à propos de la très délicate question de la nutrition artificielle du patient végétatif ? Cette question ne trouve pas de réponse dans les dispositifs juridiques actuellement en vigueur, en dehors de la voie contentieuse, trop longue pour répondre aux situations d’urgence. Or, il est tout à fait possible que de tels conflits éclatent, à l’occasion d’une décision d’arrêt de traitement. Comment une famille peut-elle faire respecter le droit du patient à la non-obstination déraisonnable ? Que peut-elle faire si l’équipe médicale refuse de mettre fin à un traitement qui a manifestement pour conséquence le maintien artificiel de la vie alors que c’est à cette équipe que revient la décision finale ?
La mission juge que l’intervention d’un tiers constituerait un progrès pour résoudre ce type de conflits. Les douloureuses affaires à l’origine de la mission ont révélé l’utilité de cette fonction. En effet, ce tiers, extérieur à la situation conflictuelle, pourrait apporter un éclairage nouveau et, le cas échéant, conseiller à la famille un transfert du patient vers une autre structure. Mais qui pourrait exercer cette fonction ? Plusieurs solutions sont possibles. On pourrait envisager de confier cette fonction à des instances déjà existantes, telles que les espaces éthiques ou les comités d’éthique. À défaut, il serait possible de s’inspirer des expériences étrangères et notamment des centres d’éthiques hospitaliers américains. Mais votre rapporteur considère que ces solutions présentent des inconvénients importants et qu’il serait préférable de désigner, pour cette fonction, des tiers ayant de fortes compétences en soins palliatifs, qui seraient des responsables locaux de structures de soins palliatifs (USP ou EMSP).
1. Les espaces éthiques et les comités d’éthique : des solutions peu satisfaisantes
Ces structures étant intéressantes à analyser en raison de leur extrême variété, on se reportera en annexe à un échantillon d’entre elles (534) et on en privilégiera ici deux particulièrement actives qui obéissent à deux logiques différentes : l’Espace éthique de l’Assistance publique et le Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin.
a) Les espaces éthiques : des espaces de réflexion et non de décision
L’article L. 1412-6 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique a prévu la création d’espaces éthiques : « Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique ». En outre, « les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ».
Depuis 2004 ces espaces éthiques n’ont pas vu le jour car l’arrêté prévu par la loi n’a pas été pris par le Ministère de la santé, sa parution étant cependant annoncée comme imminente. De fait, à défaut d’avoir un cadre juridique précis sur les espaces éthiques, on a assisté à une éclosion de comités et d’espaces éthiques, sans coordination et sans réflexion d’ensemble.
Tout le monde s’accorde sur la nécessité de développer les espaces éthiques qui remplissent une fonction de formation et d’échange. C’est ainsi que le plan Alzheimer lancé en septembre 2008 incite à la création d’un espace éthique sur cette maladie appelé à débattre des directives anticipées, de la personne de confiance, de la participation volontaire à des études de diagnostic, de pronostic et de thérapeutique. C’est à lui également que revient le soin d’être prêt à animer en urgence un groupe de travail pour toute controverse susceptible de se développer.
Si les pouvoirs publics faisaient le choix de se saisir de ce débat sur la fin de vie pour relancer les espaces éthiques, en en définissant clairement le statut juridique et les fonctions, les préalables suivants devraient être levés : arrêter clairement le champ de leurs compétences et de leur composition ; définir les modalités de leur saisine et la portée de leur avis. À ce titre l’espace éthique de l’AP-HP constitue une expérience qui mérite d’être citée.
Créé par arrêté directorial du 28 octobre 2002, l’Espace éthique de l’AP-HP est un lieu d’échanges, d’enseignements universitaires, de formations, de recherches et de propositions portant sur l’éthique hospitalière et l’éthique du soin. Il possède également une base documentaire importante. L’espace éthique développe principalement ses activités dans l’observation et l’analyse des situations relevant au sein des hôpitaux de considérations éthiques. Il apporte des réponses aux sollicitations des professionnels dans le cadre de leur métier. Il organise des séminaires et des réflexions thématiques, propose des formations universitaires aux professionnels et aux membres d’associations à caractère médico-social et encadre des recherches.
La qualité de sa formation a été reconnue le 1er septembre 2008 par l’Organisation mondiale de la santé qui a délivré à cette structure le titre de « Centre collaborateur OMS pour l’éthique ». En soulignant avec vigueur que cette structure n’avait pas vocation à se substituer aux professionnels de santé dans leurs décisions, son directeur, le Professeur Emmanuel Hirsch, a défini très précisément le cadre de son action : « Il serait invraisemblable, voire indécent que des structures éthiques interviennent dans des prises de décision. Certaines interviennent déjà pour faire de la médiation. C’est à mes yeux désinvestir les professionnels de leurs responsabilités alors que ces responsabilités, notamment en réanimation, constituent un des aspects les plus valorisants de leur métier. Ne pas leur permettre d’assumer ce qui est le sens même de leurs fonctions, c’est créer ces postures ou plutôt ces impostures qui contribuent à la mauvaise intégration de la loi Leonetti. » (535)
b) Les comités d’éthique : des structures controversées d’aide à la décision
L’avis n° 84 du Comité consultatif national d’éthique du 29 avril 2004, portant sur la formation à l’éthique médicale, distingue clairement espaces éthiques et comités d’éthiques. Il propose de renommer ces derniers « comités d’aide éthique à la décision médicale » (536), et d’ajouter que « ces structures d’aide éthique à la décision diffèrent totalement des « Espaces éthiques » par leur objectif de proposer une réponse à une question pratique » (537). Ces derniers n’ont en effet pas pour but principal de former les équipes soignantes à l’éthique, mais de se prononcer sur les aspects éthiques de situations particulières.
Le Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin, par exemple, a été créé en accompagnement de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il s’agit d’une unité fonctionnelle de l’hôpital Cochin qui réunit une équipe pluridisciplinaire : « Nous avons ainsi constitué à l’hôpital Cochin un petit groupe très multidisciplinaire, comprenant également des juristes, des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, des journalistes, des représentants de patients, des économistes. À chaque fois, deux personnes de ce petit groupe essaient de comprendre la situation qui se présente en rencontrant tout le monde ; il y a toujours au moins un médecin et un non médecin. ». (538) Ce centre a pour vocation d’aider et d’accompagner tous ceux qui sont confrontés à des décisions médicales éthiquement difficiles. La consultation d’éthique clinique est à la disposition de tous, soignés comme soignants et accessible 24 heures sur 24 ; le centre peut être joint par tout moyen, toujours à propos d’un cas concret. Au terme de la procédure de consultation, il émet des recommandations qui ne sont que purement consultatives, la décision restant de la responsabilité du médecin en charge du patient.
Rapproché de cet exemple, le commentaire du Professeur Emmanuel Hirsch prend tout son sens. L’intervention de comités construits sur ce modèle aurait pour conséquence de déresponsabiliser l’équipe médicale qui s’occupe du patient et qui le connaît bien. L’échec de l’intervention du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin dans l’affaire Pierra montre d’ailleurs les limites de cette démarche. Me Gilles Antonowicz rapporte qu’une délégation du centre avait émis un avis par téléphone aux parents d’Hervé Pierra, constatant l’hétérogénéité des opinions des membres de l’équipe de soins en place (539). Rappelons que ce même centre était intervenu auprès de Vincent Humbert et de sa mère.
De surcroît, le fait que de tels comités puissent être créés de manière autonome, sans approbation d’une autorité quelconque, présente le risque de voir se « transformer de telles structures en lieux d’idéologie » (540), ce qui aurait pour conséquence de favoriser une inégalité entre les avis rendus par ces comités.
Enfin, ces comités ne sont pas des structures spécialisées dans les soins palliatifs et la fin de vie, mais traitent de tous les aspects éthiques de la pratique médicale.
Épouser la logique des comités, c’est donc courir le risque d’influencer la décision médicale et d’instituer une démarche contraire à la vocation première de l’éthique qui postule par définition le questionnement de celui qui a la responsabilité de prendre cette décision.
Par rapport aux espaces éthiques, le rôle des comités d’éthique est donc beaucoup plus ambigu. Dans la problématique de la fin de vie quel serait le crédit d’éthiciens venus de Paris qui distribueraient bons et mauvais points en quelques heures dans un contexte qu’ils ignorent ? Si l’on peut établir des compétences en matière médicale, qu’en est-il dans une matière comme l’éthique où les consultations dépendent des perceptions de chacun, a fortiori lorsqu’il est fait appel à des non médecins comme des économistes ou des journalistes, qui pourront être accessibles aux influences médiatiques du moment ? Comment appréhender au surplus des situations qui dépendent de variables médicales, humaines, sociales différentes les unes des autres ?
Pour toutes ces raisons, ces comités d’éthique paraissent peu aptes à jouer une fonction de tiers dans des situations complexes de fin de vie. L’expérience américaine des comités d’éthique hospitaliers confirme cette analyse.
c) Les comités d’éthique hospitaliers américains, illustration des inconvénients des comités d’éthique
Les États-Unis ont développé des structures institutionnelles hospitalières à vocation éthique à partir de la fin des années soixante. La mise en œuvre d’un comité d’éthique hospitalier (CEH) n’est pas obligatoire et ne fait l’objet d’aucune réglementation. Néanmoins les financeurs publics du système de santé ainsi que les organismes d’accréditation et d’évaluation de la qualité des soins telle que la Commission nationale d’accréditation des hôpitaux (Joint Commission for Accreditation of Hospital) recommandent que chaque établissement développe des activités portant sur les questions d’éthique médicale. (541)
Les CEH sont chargés de plusieurs missions : élaborer et actualiser les politiques de l’établissement en matière d’éthique médicale liées aux soins des patients ; éduquer les soignants et les usagers sur les questions d’éthique médicale ; fournir des conseils et avis sur les aspects éthiques des décisions prises dans des situations complexes voire conflictuelles de la pratique clinique notamment celles impliquant la fin de vie des patients. Les CEH sont des instances consultatives qui n’ont pas de pouvoir décisionnel. Ils entretiennent des liens actifs avec les Institutionnal Review Boards, chargés d’examiner et de rendre des avis sur les aspects éthiques des protocoles de recherche clinique impliquant des personnes. Les modalités de nomination des membres des CEH sont variables et peu formelles. Le plus souvent, ces membres sont sollicités par la Direction générale de l’établissement et/ou la direction des affaires médicales. Ils ne sont pas rémunérés mais l’administration hospitalière prend en compte le temps consacré par les consultants salariés de l’hôpital au service des consultations d’éthique médicale ainsi que les frais de fonctionnement du comité d’éthique. Les décisions d’arrêt de traitement ont constitué la première thématique de ces comités. Ces derniers ne doivent pas cependant se substituer à un organe de contrôle de la qualité des soins ou d’évaluation des compétences des personnels ni devenir un organisme de conciliation en cas de conflit. Il n’existe pas de structure nationale de coordination des CEH.
Leur fonctionnement s’est heurté rapidement à plusieurs limites. Il est apparu qu’ils n’exerçaient aucune influence sur la qualité de la prise en charge des patients. Ils sont trop bureaucratiques et travaillent de manière hétérogène avec des différences sensibles d’un État à l’autre et d’une équipe à l’autre. Faute d’un partage clairement établi entre la définition d’une fonction incitative et celle d’une fonction directive, leur position s’est avérée ambiguë. Dans certains hôpitaux leur activité reste théorique et repose sur un membre de l’équipe soignante qui rassemble et actualise des recommandations générales en matière d’éthique médicale ou constitue une interface entre les soignants et des consultants extérieurs à l’établissement. Ailleurs notamment au sein des centres hospitalo-universitaires ont été mis en place des services plus opérationnels.
L’absence de procédures légitimées, le manque de disponibilité de ses membres, le défaut de formation spécifique et l’absence d’évaluation de ces structures figurent parmi les reproches fréquemment avancés à l’encontre des pratiques de ces comités dont l’impact sur les formations professionnelles s’avère au demeurant réduit. Selon une enquête réalisée en 2002 et publiée en 2007 (542), portant sur un échantillon de 500 hôpitaux généraux de taille moyenne, les services des CEH sont sous-utilisés : le nombre de consultations d’éthique médicale réalisées par les CEH était en moyenne de trois par an. Les auteurs de l’enquête ont relevé les réticences des médecins cliniciens à utiliser les ressources des CEH, en raison, d’une part, de leur perception de ces services comme un contrôle de leur pratique et de leur décision et, d’autre part, du déficit de formation et d’expérience des professionnels chargés de cette activité dans de nombreux établissements. Selon cette enquête, moins de la moitié des consultants en éthique médicale avaient suivi une formation formelle en bioéthique et seulement 5 % étaient titulaires d’un diplôme.
Devant la mission M. Claude Évin plaidait pour le recours à un « Comité des sages », appelé à « éclairer la situation et à permettre de prendre du recul par rapport à celle-ci » (543) mais si l’idée est séduisante, les précédents du centre clinique de l’hôpital de Cochin et les exemples américains invitent à être réservés sur la dévolution d’un pouvoir opérationnel à de telles structures. L’éthique doit être une volonté et une pratique partagées inhérentes aux soins et ne doit pas être l’apanage d’experts coupés de la réalité.
2. L’Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie, un organe d’étude et non de conseil
Si les futurs espaces éthiques régionaux ou interrégionaux peuvent être appelés à engager utilement des formations sur les questions de fin de vie en liaison avec l’observatoire, on pourrait imaginer que ce dernier se voit confier une mission d’expertise pour traiter de cas litigieux. Toutefois au regard des données évoquées ci-dessus et de ces précédents, l’observatoire ne semble pas constituer la structure la plus adaptée pour résoudre des situations locales. Les mêmes inconvénients dénoncés précédemment à l’encontre des comités d’éthique peuvent lui être opposés : extériorité par rapport à la situation du patient, absence de pouvoir décisionnel effectif, faiblesse du temps à consacrer à chaque cas. Cependant on ne saurait nier pour autant l’opportunité de se doter de médiations destinées à traiter ce type de difficultés.
Il est donc nécessaire d’envisager d’autres solutions. La structure de recours devra présenter trois qualités : être une structure de proximité ; être une structure ayant une compétence forte en matière de soins palliatifs et être enfin, une structure permettant de trouver une issue en cas de persistance du litige. Les équipes mobiles et les unités de soins palliatifs peuvent satisfaire à ces conditions.
3. Des structures adaptées : les équipes mobiles et les unités de soins palliatifs
Les équipes mobiles de soins palliatifs sont des structures de proximité. Les unités de soins palliatifs sont présentes sur tout le territoire métropolitain (544), à l’exception des régions Basse-Normandie et Poitou-Charentes. La mission préconise que des USP soient créées le plus rapidement possible dans les régions où il n’en existe pas. En ce qui concerne les équipes mobiles de soins palliatifs, seuls deux départements métropolitains et deux départements d’outre-mer n’en disposent pas actuellement (545). Il existe donc un véritable maillage territorial permettant de disposer de tiers pour démêler les situations complexes auxquelles pourraient être confrontés des médecins isolés ou des équipes médicales.
Il serait possible de désigner dans chaque région un médecin référent d’une équipe mobile ou d’une unité de soins palliatifs chargée de résoudre les conflits pouvant se présenter entre équipes soignantes et proches d’un malade pour lequel un arrêt de traitement est envisagé.
Ces situations pourraient renvoyer à plusieurs cas de figures : par exemple celui où le médecin référent consulté se déplacerait auprès du patient et rendrait ses conclusions à l’équipe médicale ; celui où le médecin référent se substituerait au médecin traitant ; celui encore où le patient serait transféré à l’unité de soins palliatifs du médecin référent.
Les unités et les équipes mobiles sont dotées de compétences reconnues dans le domaine des soins palliatifs. En plus de leur activité de soins, elles ont également des fonctions de formation et de recherche. Elles ont la responsabilité de la diffusion de la démarche palliative dans les établissements de santé. Leur professionnalisme en la matière est reconnu puisqu’elles s’occupent déjà des situations les plus difficiles. Cette compétence leur confère une autorité qu’un comité d’éthique n’aurait pas. En choisissant cette voie, la décision médicale ne serait pas le fait d’une structure extérieure plus ou moins au fait du contexte médical et familial mais serait prise par une structure médicale de terrain, régulièrement confrontée à ce genre de difficultés.
De surcroît, la connaissance que ces professionnels ont de la loi, leur capacité à évaluer la situation médicale et psychologique du patient et à prendre en compte les souhaits de ses proches ainsi que leur habitude à mener une réflexion éthique les désignent pour jouer un rôle d’écoute, d’expertise voire de médiation dans des situations complexes. Parallèlement, ces missions ponctuelles contribueront à valoriser davantage les activités de soins palliatifs. Dans les situations les plus délicates, les professionnels contactés ne se contenteraient pas de conseils téléphoniques à distance mais se déplaceraient dans l’unité où le malade est hospitalisé pour évaluer précisément sa situation. Il est tout à fait envisageable que cette intervention se déroule également pour les patients à domicile.
Cette prise en charge aurait le mérite d’éviter que ne se reproduisent des situations d’abandon qui nourrissent des positions extrêmes et des débats idéologiques stériles.
Dans l’optique de ne pas laisser de situations conflictuelles sans recours, la médiation pourrait être déclenchée à la demande du patient (s’il est en état d’exprimer sa volonté), de ses proches (la personne de confiance ou la famille) ou des soignants. Les coordonnées du médecin référent régional seraient communiquées par les services en charge du numéro Azur.
Dans un autre ordre d’idée, la création d’un congé d’accompagnement demandée par de nombreuses personnes auditionnées permettrait de garantir une présence des proches du malade en fin de vie. Ce congé d’accompagnement constituerait un droit supplémentaire en faveur du malade.
C. METTRE À L’ÉTUDE L’INSTITUTION D’UN CONGÉ D’ACCOMPA-GNEMENT À TITRE EXPÉRIMENTAL
« Reconnaître ce temps essentiel honorerait notre société, qui montrerait ainsi le sens qu’elle accorde à la vie. » (546) Ainsi s’est exprimé le Docteur Régis Aubry, au cours de son audition par la mission. Ces paroles sont motivées par le délaissement dont sont victimes de nombreux patients qui finissent leurs jours dans une institution médicalisée. Il est essentiel de permettre aux proches d’un mourant de lui consacrer du temps, et, corrélativement, de faire en sorte qu’il puisse achever sa vie là où il l’entend, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, à son domicile.
Il est actuellement possible d’accompagner un proche en fin de vie en bénéficiant du congé de solidarité familiale (art. L. 3142-16 à L. 3142-19 du code du travail). Ce congé d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois entraîne néanmoins l’absence de rémunération pendant la période d’arrêt de travail.
La mise en œuvre d’un congé d’accompagnement rémunéré est une nécessité que nombre de personnes auditionnées par la mission ont réaffirmée. Le financement d’un tel congé avait d’ailleurs été proposé par le rapport du Comité national de suivi mais n’a pas été retenu dans le programme de développement des soins palliatifs. Le coût prévisible d’une telle rémunération pourrait être réduit du fait qu’actuellement les proches d’un malade en fin de vie bénéficient régulièrement d’arrêts maladie.
1. La rémunération des périodes d’accompagnement est souhaitable
Une telle rémunération pourrait avoir un impact symbolique fort, sans être économiquement ruineuse. Elle répondrait de surcroît à une demande sociale importante.
a) Une demande exprimée par tous les accompagnants
Les familles ayant accompagné un proche en fin de vie ont unanimement témoigné, devant la mission, de la nécessité de disposer, durant l’ultime période de la vie d’un malade, de temps à lui consacrer. À défaut de rémunération possible, en l’état actuel du droit, les accompagnants doivent en effet recourir à des solutions individuelles, qui dépendent souvent du bon vouloir de leur employeur. Ainsi, la femme d’un malade décédé des suites d’un cancer à Besançon a-t-elle expliqué : « dès que mon mari est tombé malade, j’ai diminué de moitié mon temps de travail parce que j’en avais la possibilité », avant de conclure : « je ne peux pas m’empêcher de me demander comment font ceux qui n’ont aucun soutien extérieur. » (547) Il est donc essentiel de permettre à chacun de moduler son temps de travail lors de la fin de vie d’un proche.
Les associations travaillant dans le domaine des soins palliatifs ont également proposé la mise en place d’un tel congé rémunéré. C’est le cas par exemple de M. Godefroy Hirsch, président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), qui a plaidé pour un tel droit : « Nous avions demandé un congé d’accompagnement de fin de vie. La porte ne s’est pas fermée avec le programme présenté en juin 2008 mais on nous en a demandé préalablement une évaluation. Ce serait un message fort du monde politique à l’adresse de la société et une reconnaissance de l’investissement de temps et d’énergie des personnes qui accompagnent un malade. Ce temps est reconnu actuellement dans la loi mais il n’est pas indemnisé, ce qui est anormal. » (548)
Le rapport de fin d’exercice du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, présidé par M. Régis Aubry, avait préconisé l’instauration d’un congé rémunéré. Il le décrivait comme un « moyen de solidarité envers les personnes malades ou leurs proches ». (549) Refuser cette prise en charge n’est-ce pas exprimer d’une certaine manière un choix de société ? « Aujourd’hui notre société valorise le temps de la naissance en reconnaissant et en rémunérant le congé maternité et le congé paternité. Le non-financement du congé d’accompagnement de la fin de vie peut matérialiser une forme de dénégation sociétale de la fin de vie et de la mort. » (550)
Il existe donc un réel consensus sur la nécessité de créer un congé d’accompagnement rémunéré. Alors que l’arrivée d’un enfant dans une famille donne droit à des congés payés pour ses deux parents, il semble injustifié de ne pas permettre aux proches d’un malade en fin de vie de lui consacrer du temps, surtout quand on connaît les conditions d’isolement dans lesquelles la majeure partie des personnes mourant à l’hôpital finissent leurs jours. Dans la logique favorable aux soins de son projet de loi, qui le démarque de la proposition de loi parlementaire sur le suicide assisté, le gouvernement luxembourgeois envisageait d’ailleurs la création d’un congé d’accompagnement (551). Il contient en effet une disposition, qui prévoit qu’un congé peut être pris pour accompagner un parent ou un proche en fin de vie. Ce congé ne pourrait excéder cinq jours ouvrables et pourrait être pris à temps partiel et fractionné.
b) Une humanisation de l’accompagnement de la fin de vie
Selon un sondage (552), 47 % des personnes interrogées en 2005 avaient déjà accompagné un proche en fin de vie, pour une durée inférieure à trois mois. Il existe donc un réel besoin de disposer de temps pour effectuer cet accompagnement dans des conditions humaines. Ce besoin est d’autant plus manifeste que trois quarts des patients mourant à l’hôpital sont seuls au moment de leur mort. (553) Il importe donc de permettre à un maximum de personnes en fin de vie de bénéficier de la présence de leurs proches et de pouvoir terminer leurs jours à domicile, si cela est possible et si elles le désirent.
Or, à cet égard, la situation actuelle est insatisfaisante pour deux raisons principales.
Les personnes qui souhaitent accompagner un proche en sont réduites à demander des arrêts maladie de la part de leur médecin, comme l’a confirmé M. Godefroy Hirsch au cours de son audition : « Pendant les onze années où j’ai été médecin généraliste, je n’ai, personnellement, jamais refusé – je vais peut-être me faire taper sur les doigts par la CNAMTS – un arrêt maladie à une personne pour rester auprès d’un proche. Cela me semble le B.A.-BA de l’humanité et du prendre soin. » (554) Ceci entraîne plusieurs conséquences dommageables :
— D’une part, la situation des salariés bénéficiaires de ce congé n’est pas légale. Elle peut entraîner des difficultés avec les employeurs, d’autant plus que les contrôles visant à repérer les « faux » arrêts de travail se multiplient. De plus, cet état de fait ne garantit pas à la personne accompagnante son retour dans l’entreprise dans les mêmes conditions que lorsqu’elle en est partie (contrairement au congé maternité par exemple) ;
— D’autre part, cette situation assimile accompagnement d’un proche en fin de vie et maladie. Il serait plus judicieux de rémunérer la personne cessant son activité au titre de l’accompagnement et non au titre de la maladie. À l’inverse de la situation actuelle, Mme Paulette Le Lann, présidente de la fédération JALMALV, a estimé au cours de son audition que « le financement d’un congé d’accompagnement permettant d’accompagner un parent en fin de vie serait un engagement de notre société et officialiserait l’importance de cet accompagnement. » (555)
L’absence de rémunération liée à l’accompagnement engendre également des inégalités entre les personnes pouvant se permettre de cesser temporairement leur activité et celles qui ne le peuvent pas. Cette inégalité est renforcée par le fait que certaines collectivités (notamment la Ville de Paris, qui verse une allocation d’un montant de 610 euros mensuels) ont déjà mis en place une allocation finançant cet accompagnement, ce qui montre au demeurant que la mise en œuvre de ce congé est réalisable.
Enfin, il est incontestable que cette rémunération serait symboliquement importante pour développer la culture de l’accompagnement, en reconnaissant une place à l’entourage. Elle entre, plus largement dans le développement de l’aide aux aidants. (556)
c) Un coût relativement faible
Face à cette demande sociale et au gain que représenterait pour la collectivité la création d’un congé rémunéré, il est néanmoins nécessaire d’évaluer le coût que pourrait avoir une telle mesure. Plusieurs facteurs incitent à penser que celui-ci serait relativement faible, bien que son coût effectif soit « difficile à mesurer, en raison de très nombreuses incertitudes sur le taux de recours au congé, le montant de la prestation et ses modalités de versement ». (557) Les raisons en sont multiples :
— Comme indiqué précédemment, les personnes désirant accompagner un proche en fin de vie obtiennent un arrêt de travail par le biais d’un congé maladie. Le coût de l’accompagnement est donc déjà réel mais difficilement quantifiable pour la CNAM. La création d’un financement pour l’accompagnement des personnes en fin de vie pourrait donc n’entraîner qu’un report des coûts. C’est ce qu’a souligné M. Godefroy Hirsch devant la mission : « Le congé entraînera certainement un transfert de charges financières. » (558) ;
— Par ailleurs, ce financement faciliterait matériellement l’accompagnement, selon plusieurs personnes entendues par la mission. Mme Martine Nectoux, infirmière clinicienne a ainsi indiqué : « cette notion d’accompagnement de l’entourage est pour l’instant pas ou peu reconnue. Pourtant, vivre 24 heures sur 24 à domicile aux côtés d’un grand malade demande une vigilance de tous les instants. Aujourd’hui, la seule ressource d’un proche qui accompagne un malade en fin de vie est d’être en arrêt maladie. Cela induit que cet accompagnement ne peut se vivre que dans le contexte de la maladie. Le reconnaître et le financer représenterait une charge en moins pour l’entourage, ainsi qu’une reconnaissance de sa place et de son rôle. Je suis intimement convaincue qu’il s’agit d’une démarche de santé publique à l’égard de l’entourage. Aider les proches à accompagner pleinement les patients en fin de vie sans se retrouver en difficulté financière faciliterait aussi leur travail de deuil. » (559) La mise en œuvre d’un congé rémunéré pourrait donc réduire le nombre d’arrêts maladie postérieurs à ces deuils difficiles. Le rapport du Comité de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement dresse le même constat : « Le financement du congé d’accompagnement, en contribuant à la prévention de ces deuils compliqués limitera ces conséquences néfastes » (560) ;
— Enfin, des études ont montré que la présence d’un proche pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie à son domicile (561) pouvait contribuer à éviter des hospitalisations coûteuses. En effet, d’après ces études, le coût d’une hospitalisation serait supérieur à celui de soins palliatifs délivrés à domicile et de la rémunération d’un proche accompagnant le malade.
Pour évaluer le coût du financement de l’accompagnement en fin de vie, il convient donc de prendre en compte ces trois facteurs d’économie, qui laissent penser que la dimension « transfert de charges financières », aura un impact majeur sur celui-ci.
2. Les modes de rémunération possibles
Deux modes de rémunérations principaux peuvent être envisagés : l’allocation et le congé payé. La mission a choisi de privilégier la piste du congé d’accompagnement rémunéré par rapport à l’allocation d’accompagnement pour les raisons suivantes.
Certains pays ont créé des allocations rémunérant l’accompagnement d’un proche en fin de vie. C’est le cas notamment du Canada ou de la Belgique, où une personne peut suspendre ou réduire son activité pendant un mois renouvelable, tout en bénéficiant d’une indemnité forfaitaire. Le médecin traitant doit attester que la personne qui demande l’indemnité est disposée à délivrer des soins palliatifs, concept qui recouvre, au sens de la loi belge, toute forme d’assistance médicale, sociale, administrative, psychologique. La prestation s’élève à 640 euros nets mensuels pour un arrêt complet, somme qui est majorée si l’accompagnant a plus de 50 ans. Le nombre de bénéficiaires, en 2007 était très faible puisque seulement 205 personnes ont reçu une indemnité.
Il est possible que les modalités de demande de cette allocation, ainsi que son montant, découragent les personnes qui pourraient en bénéficier : elles pourraient préférer demander un congé maladie afin de percevoir une rémunération plus importante. Il semble donc que la formule du congé payé soit plus appropriée pour financer l’accompagnement d’un proche en fin de vie.
Un congé payé pourrait permettre d’aider l’accompagnement d’un proche en fin de vie à domicile. En effet, afin de ne pas créer d’effet d’aubaine disproportionné il est souhaitable de ne pas l’étendre à l’accompagnement à l’hôpital. Il pourrait couvrir l’hypothèse où le malade n’a pas été pris en charge à l’hôpital et celle où après un séjour à l’hôpital, il souhaite finir ses jours à son domicile. Ce congé serait de droit sur présentation d’une attestation du médecin traitant du malade. Le périmètre de ce congé pourrait inclure les ascendants, les descendants et les personnes vivant au sein du foyer.
Ce congé payé devrait permettre aux proches de suivre l’évolution de la santé du malade. Il serait donc souhaitable qu’il soit relativement souple et qu’il puisse être fractionné en plusieurs périodes. Sa durée devrait également pouvoir être doublée s’il est pris sous forme de mi-temps. Il pourrait aussi être combiné avec le congé de solidarité familiale. Sa durée reste à déterminer mais pourrait être de quinze jours. La formule du congé payé présente l’avantage de ne pas créer de charge supplémentaire et excessive pour les finances publiques et d’être une modalité de rémunération bien connue des salariés.
À cette fin, plusieurs modifications législatives sont envisageables. Il serait nécessaire d’insérer dans le code du travail, dans la partie concernant les congés payés, après l’article L. 3142-15, une division contenant les modalités du nouveau congé. Dans ce cadre, il conviendrait de modifier les articles L. 3142-16 et suivants du même code, qui portent sur le congé de solidarité familiale, en ajoutant un alinéa indiquant que ce congé peut être transformé en congé d’accompagnement si les conditions pour ce faire sont remplies. De plus, pour que ce congé puisse également bénéficier aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, il devrait être introduit à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le code de la défense devrait également être modifié pour les militaires.
Devant la mission, Mme Roselyne Bachelot a fait état des projections auxquelles avait donné lieu le calcul du montant du congé d’accompagnement : « Suivant la prestation de référence retenue – complément de libre choix d’activité, indemnité journalière d’assurance-maladie, indemnité journalière maternité, allocation journalière de présence parentale –, le coût mensuel d’arrêt d’activité oscille entre 538 et 1 500 euros. Dans l’hypothèse d’un taux de recours de 50 %, d’un congé de quinze jours et d’une indemnisation au niveau de l’assurance-maladie, un tel dispositif représenterait une charge annuelle de 5 à 64 millions d’euros, suivant la cible envisagée. Cela mérite par conséquent une étude approfondie, que le ministre des affaires sociales et la secrétaire d’État chargée de la solidarité, Valérie Létard, sont en train de réaliser. » (562)
Si cette option est effectivement coûteuse, on ne saurait pour autant ignorer l’existence d’une demande réelle en faveur d’un congé d’accompagnement rémunéré. Le taux de recours à ce congé, ainsi que son effet induit sur les dépenses de l’assurance-maladie demeurent difficiles à estimer a priori. Aussi pourrait-on envisager que ce congé d’accompagnement soit introduit, sous forme de congé payé, à titre expérimental sur un territoire donné, comme l’a été, à l’origine, le revenu de solidarité active. Il est en effet tout à fait possible pour une loi de prévoir des dispositions expérimentales, qui ne s’appliquent pas, dans un premier temps à l’ensemble du territoire, conformément à l’article 37-1 de la Constitution. Selon une jurisprudence du Conseil constitutionnel bien établie, une loi comportant des dispositions expérimentales ne peut pas porter sur des libertés fondamentales, mais le cas des dispositions qui institueraient un congé d’accompagnement expérimental ne contrevient pas à ce critère. (563)
Compte tenu cependant de l’écart considérable entre la fourchette basse et la fourchette haute de l’évaluation du coût de la mesure, il est suggéré de procéder en l’état à une étude de faisabilité du dispositif proposé. À l’issue de cette étude, une expérimentation territoriale pourrait être lancée.
Chapitre III
Aider les médecins à mieux répondre aux enjeux éthiques du soin
Afin de mieux garantir les droits des patients, les médecins doivent avoir de nouveaux devoirs, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des malades en cas d’arrêts de traitement. Mais pour les aider à remplir ces nouvelles obligations, il est nécessaire de mieux les former à l’éthique et aux soins palliatifs.
A. MIEUX FORMER LES MÉDECINS À L’ÉTHIQUE ET AUX SOINS PALLIATIFS
« Le médecin de demain va devoir acquérir une véritable compétence en éthique pour aborder la complexité que la médecine moderne implique » (564), ont affirmé six professeurs de médecine faisant autorité dans une tribune de presse le 29 octobre dernier. A fortiori, le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs nécessite, de la part de l’ensemble de l’équipe soignante, une réelle réflexion dans le domaine de l’éthique. Or, le plan de développement des soins palliatifs ne prévoit aucune évolution pédagogique d’ampleur en la matière. Pourtant, dès 2003, le rapport de la commission présidée par M. Alain Cordier identifiait les manques de la formation à l’éthique (565). Le CCNE a d’ailleurs soutenu la majorité de ses remarques et de ses propositions, dans son avis n° 84, sur la formation à l’éthique médicale (566). Il est donc urgent de se pencher sur le problème de la formation à l’éthique et aux soins palliatifs dans les facultés de médecine si l’on souhaite voir se diffuser la culture palliative.
1. Développer l’enseignement de l’éthique
Le rapport de fin d’exercice du Comité de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement préconisait de nombreuses mesures afin d’accroître la quantité et la portée de l’enseignement éthique qui est délivré dans les facultés de médecine. Pour ce faire, le groupe de travail qui était chargé de ce dossier a identifié l’éthique avec les compétences technoscientifiques, relationnelle et de coopération, comme étant l’une des quatre compétences nécessaires à la pratique médicale. Pour faire en sorte que les étudiants acquièrent cette compétence en éthique, huit actions étaient préconisées dont peu ont été retenues par le programme de développement des soins palliatifs. (567) Certaines d’entre elles méritent pourtant d’être mises en œuvre.
Afin de ne pas faire de l’éthique une discipline coupée de la réalité médicale et clinique, il est indispensable d’intégrer la réflexion éthique au sein d’enseignements ou de formes d’enseignement qui constituent le cœur de la formation médicale. C’est ce que préconisait le CCNE, suivant sur ce point le rapport Cordier, en souhaitant un « enseignement de l’éthique en prise directe avec la clinique », pour éviter de « tomber dans le travers d’une éthique par trop théorique » (568). La même préconisation est formulée par la littérature internationale spécialisée, qui suggère que si les connaissances techniques peuvent être facilement apprises, les compétences en éthique doivent être acquises au lit du malade et être fondées sur une réflexion menée par chaque étudiant sur ses propres sentiments (569).
Il est ainsi nécessaire d’inciter les étudiants en médecine à développer une réflexion éthique sur leurs lieux de stage. Le stage infirmier semble donc être le premier moment dans la vie de l’étudiant pour initier une formation à l’éthique au lit du malade. Ceci pourrait déboucher sur la rédaction d’un court mémoire relatant un questionnement qui a trait à une situation dont l’étudiant a été témoin et qui nécessite de mobiliser une réflexion éthique. Plus généralement chaque stage pourrait être l’occasion d’approfondir la réflexion éthique, qui doit devenir l’un des fils rouges de la formation médicale. En effet, « l’objectif de l’initiation à l’éthique ne doit pas être de transmettre un cours didactique à la manière d’un savoir préétabli qui viendrait se juxtaposer aux autres contenus théoriques des études médicales. En la matière, ce ne seront pas les cours magistraux mais les stages hospitaliers qui constitueront les meilleurs vecteurs d’apprentissage à la réflexion éthique » (570).
Des échanges entre étudiants, médecins et équipe soignante pourraient également avoir lieu à l’occasion de ces stages, au sein de séminaires de réflexion éthique (571), afin, d’une part, de mutualiser les expériences et, d’autre part, de former les futurs praticiens à l’interdisciplinarité et à la collégialité. Un séminaire de réflexion éthique durant quelques jours pourrait ainsi voir son existence formalisée. Il se déroulerait pendant l’internat et serait nécessaire à sa validation (572). En effet, actuellement, « il faut convenir que les études de médecine, qui sont la plus longue préparation à un concours dans ce pays, ne permettent pas forcément aux étudiants d’accorder du temps et de la réflexion [éthique] qui n’est pas au programme de l’internat » (573).
De même, chaque module transversal, à partir de la deuxième année, devrait comprendre les grandes problématiques éthiques qui lui sont corrélées et chaque diplôme d’études supérieures (DES) devrait obligatoirement consacrer un temps à la formation à l’éthique propre à la discipline enseignée. De la sorte, ce sont les professeurs eux-mêmes qui pourraient être amenés à évoquer les sujets ayant trait à l’éthique, ce qui aurait le double avantage d’apparaître comme étant partie intégrante du métier de médecin et donc d’intéresser plus directement les futurs praticiens. C’est ce que propose le Docteur Alain Grimfeld : « Aujourd’hui, les études médicales sont très peu axées sur l’éthique ; l’éthique médicale n’est pas enseignée, alors que les étudiants en médecine tout comme l’ensemble des personnels de soins y sont très attachés. Il conviendrait d’introduire ces notions dès la 2ème année de premier cycle, ou au plus tard dans les quatre années qui suivent. » (574)
« Au niveau universitaire, je ne pense pas qu’il y ait une question sur le décès à l’examen classant national » faisait observer le Professeur Christian Hervé, professeur à l’Université Paris Descartes (575). N’étant jamais choisie comme épreuve de sélection, les étudiants ne sont guère incités à s’y intéresser. Ces enseignements, qu’ils soient dispensés à la faculté ou en établissement de santé, devraient être obligatoires et pouvoir faire l’objet de questions lors de l’épreuve classante nationale.
2. Consacrer la place de l’éthique dans les facultés de médecine
Afin de mener à bien toutes les actions de formations préconisées par le programme de développement des soins palliatifs et par le présent rapport, il est nécessaire de former les praticiens à la réflexion éthique. Si l’on veut que des professeurs d’université s’y investissent en l’enseignant, trois solutions peuvent être envisagées :
— Le recrutement de professeurs associés, qui font partager aux étudiants l’expérience professionnelle qu’ils ont acquise. C’est ce que propose, à titre expérimental, le groupe de travail du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs : des enseignants ayant une double compétence, en médecine et en éthique seraient choisis comme référents au sein de chaque faculté de médecine. Ils seraient dédiés à la formation et à la recherche en éthique. Ce mode de recrutement des professeurs ne peut néanmoins qu’être transitoire, dans la mesure où, n’étant pas pérenne, il ne permet pas de faire apparaître de réelles compétences dans le domaine de l’éthique médicale. Il peut être recouru à cette option en attendant que l’une des deux solutions ci-dessous soit appliquée ;
— La création d’une sous-section d’éthique au sein du CNU, qu’elle soit spécifique à l’éthique ou constituée d’une intersection entre plusieurs sous-sections, ce qui permettrait de créer des chaires d’éthique. De telles chaires existent dans les pays anglo-saxons, où certains professeurs sont spécialisés en éthique et où les départements de bioéthique sont souvent indépendants des hôpitaux. Cette solution se heurte cependant à une double difficulté. D’une part, elle présente l’inconvénient majeur d’isoler l’éthique hors de la réalité médicale, alors qu’elle doit, à l’inverse, faire partie intégrante de la pratique médicale. D’autre part, pour obtenir l’ouverture d’une nouvelle sous-section, il est nécessaire de disposer de 14 professeurs d’université-praticiens hospitaliers ayant déjà fait de la recherche et publié (576). Or, il n’existe pas aujourd’hui un tel vivier dans le domaine de l’éthique médicale en France ;
— Le rattachement de l’éthique à une discipline existante. Ce pourrait être une sous-section du CNU. La sous-section existante la mieux adaptée serait la sous-section 46-03, « Médecine légale et droit de la santé », qui serait renommée « Médecine légale, éthique et droit de la santé ». Ceci permettrait à des professeurs venus de spécialités diverses de rejoindre cette sous-section pour y faire leurs recherches.
Il serait également possible de rattacher l’éthique à une nouvelle sous-section du CNU, qui serait créée dans le domaine des soins palliatifs. En effet, les soins palliatifs sont l’une des disciplines où le questionnement éthique est le plus important. Dans ces deux hypothèses, l’éthique serait enseignée, en restant rattachée à la pratique médicale.
Cependant si l’on s’accorde à reconnaître que l’éthique doit être diffusée dans toutes les disciplines et ne pas être l’apanage de l’une d’entre elles, la préférence de la mission va à une autre solution, qui permettrait un enseignement de l’éthique ancré dans la pratique médicale, sans être rattaché spécialement à une discipline ; la coordination de cet enseignement pourrait toutefois être assurée par les enseignants de soins palliatifs.
Parallèlement, les arguments en faveur de la création de chaires autonomes de soins palliatifs ont emporté la conviction de la mission.
3. Créer des chaires de soins palliatifs
Malgré les propositions formulées par le programme de développement des soins palliatifs pour diffuser la culture palliative au sein des études de médecine, celui-ci ne va pas jusqu’à institutionnaliser, dans les universités, les soins palliatifs.
Pourtant, il est essentiel, pour légitimer et diffuser une discipline de lui reconnaître une existence universitaire. Si aujourd’hui les soins palliatifs souffrent d’un déficit d’image dans le milieu médical, c’est parce qu’il n’existe pas de discipline universitaire de soins palliatifs. Or, concernant l’institutionnalisation des soins palliatifs, le programme 2008-2012 ne tranche pas. La proposition en la matière est sibylline : « Développer avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche une politique visant à identifier dans chaque UFR avec l’aide des doyens et des disciplines les plus impliquées les jeunes médecins ayant une activité de soins dans le domaine des soins palliatifs, ainsi qu’une activité d’enseignement et de recherche. Une orientation forte dans ce domaine pourrait être stimulée par l’établissement d’un plan de carrière hospitalo-universitaire. » (577)
Cette mesure figurait pourtant en bonne place dans le rapport du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, qui préconisait que les soins palliatifs soient mieux reconnus sur le plan universitaire. Il proposait, dans un premier temps, de nommer des professeurs associés rattachés à différentes sections du CNU, puis d’envisager la création d’une nouvelle sous-section dans le domaine des soins palliatifs (578).
Comme indiqué précédemment, un appel a même été récemment lancé, dans un quotidien par six professeurs travaillant dans le domaine des soins palliatifs, qui font de la création de chaires de soins palliatifs l’un des « leviers » d’action les plus puissants pour la promotion des soins palliatifs et la diffusion de la culture palliative dans nos hôpitaux (579) : « pour qu’un tel changement s’opère sur le terrain, il est absolument nécessaire d’actionner le levier de la formation et de la recherche et de créer de véritables chaires de médecine palliative, comme il en existe dans les pays anglo-saxons ». En Grande-Bretagne, cet enseignement est aujourd’hui assuré par des médecins et du personnel soignant. Certaines chaires se penchent spécialement sur la fin de vie, d’autres sont rattachées à l’oncologie. Il est indéniable que cet enseignement a fortement contribué à la diffusion de la culture palliative en lui donnant des lettres de noblesse qu’elle n’a pas à ce jour en France.
La création de postes spécifiquement dédiés aux soins palliatifs, par l’instauration de chaires de soins palliatifs présenterait de nombreux avantages.
Tout d’abord, la création de chaires de soins palliatifs donnerait une reconnaissance universitaire aux soins palliatifs. De ce fait, les enseignements dispensés dans ces domaines seraient perçus comme équivalents aux enseignements « classiques », qui sont davantage centrés sur la pratique d’actes médicaux. À travers cette reconnaissance, c’est l’ensemble des soins palliatifs qui seraient considérés comme une discipline médicale comme une autre. Comme l’écrivait M. Didier Sicard : « Il est étrange de laisser la discipline des soins palliatifs hors champ de l’université, comme si l’activité soignante n’était destinée qu’à anesthésier la fin de vie, à rendre acceptable la détresse du mourir […]. Tant que l’université ne considérera pas cette activité médicale comme au cœur de la médecine, cette discipline de soins palliatifs sera réservée à la gestion (mot tragique) de la fin de vie, avec ce mélange de résignation, de compassion et d’abandon » (580). Nommer des professeurs de soins palliatifs revient donc à valoriser symboliquement les soins palliatifs comme une discipline médicale à part entière. Comme l’a déclaré le Professeur Louis Puybasset devant la mission : « La première chose à faire est de rendre universitaires les soins palliatifs. Dans le système hospitalier, les professeurs d’université font un peu la règle. Si l’on veut introduire la culture palliative, il faut donner un poids universitaire, en termes de « force de frappe », aux soins palliatifs » (581).
De plus, compte tenu des besoins importants de formation dans le domaine des soins palliatifs et de l’éthique, l’existence de professeurs d’université spécialisés dans ce domaine semble être particulièrement nécessaire. Ce choix permettrait la « constitution d’enseignements structurés de soins palliatifs » (582), portant tant sur la prise en charge de la douleur que sur « la relation et la communication » (583) et favoriserait une meilleure coordination entre universités et établissements de santé.
La nomination de professeurs de soins palliatifs présenterait également l’avantage de stimuler la recherche dans un domaine, où, « faute de reconnaissance, faute de temps dédié et de compétence méthodologique. » (584) elle est aujourd’hui très lacunaire. Elle rendrait possible la création d’une masse critique de recherches concernant les soins palliatifs, ce qui enclencherait ce cercle vertueux « recherche clinique – mise en place de structures universitaires – modification des pratiques cliniques », évoqué par le Professeur Louis Puybasset au cours de son audition par la mission (585) et repris dans l’appel lancé par des médecins hospitalo-universitaires (586). En effet, les enseignants-chercheurs praticiens pourraient se consacrer à la recherche dans le domaine spécifique des soins palliatifs et coordonner des études mobilisant des chercheurs issus de diverses disciplines. La diffusion de la culture palliative implique, comme on l’a vu à propos de l’observatoire des pratiques médicales de fin de vie, que soient menées des recherches interdisciplinaires, qui nécessitent l’existence d’un coordinateur, qui pourrait être un professeur de soins palliatifs.
Enfin, la création de chaires de soins palliatifs engendrerait également un développement de la réflexion éthique dans les facultés et dans les établissements de santé. L’enseignement des soins palliatifs postule une réflexion éthique, qui porterait aussi bien sur la communication avec le patient et ses proches que sur la connaissance du droit relatif à la fin de vie.
La mission juge donc indispensable d’institutionnaliser les soins palliatifs au sein des facultés de médecine. Il serait souhaitable de créer dès que possible les premiers postes de professeur d’université en soins palliatifs, avec pour objectif, à moyen terme, de disposer d’une dizaine de chaires spécifiques, et à plus long terme, d’une chaire par faculté de médecine.
B. PRÉCISER LES MODALITÉS D’APPLICATION DES ARRÊTS DE TRAITEMENT DE SURVIE
La douleur est le symptôme le plus fréquent en fin de vie. Elle est la négation de la qualité de la vie et constitue la cause première pour laquelle le patient peut ne plus accorder de sens à son existence.
Certes la qualité de la vie est associée à une absence de douleur mais il est des circonstances où, même quand il n’y a pas de manifestation de souffrance, la décision d’arrêt de traitement peut entraîner une détérioration de la qualité de la vie restante.
Soulever cette question, c’est s’interroger sur les pratiques sédatives. Comment s’inscrivent-elles dans le cadre de la loi du 22 avril 2005 ? Peut-on envisager d’appliquer des traitements à visée sédative à des malades qui peut-être ne souffrent pas ou dont on ne peut évaluer la douleur ?
1. La place des traitements à visée sédative en phase terminale
Quelles sont les bonnes pratiques professionnelles existantes en matière de sédation en phase terminale ? Ce terme de sédation en phase terminale est employé aussi bien pour désigner un traitement antalgique que l’induction d’un sommeil. Possible dans des sédations légères, la communication ne l’est plus dans des sédations profondes. La sédation réduit l’activité cérébrale sans altérer de façon majeure les grandes fonctions vitales (587). Pour la Société française de soins palliatifs (588), la sédation pour détresse en phase terminale est la recherche, par des moyens médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à la perte de conscience. L’objectif est de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté par le patient.
Les objectifs de la sédation en phase terminale
Dans la pratique des soins palliatifs, les visées de la sédation peuvent être :
— une somnolence provoquée chez une personne qui reste éveillable à la parole ou tout autre stimulus simple ;
— une perte de conscience provoquée qui peut se décliner en un coma provoqué transitoire (sédation intermittente) ou un coma provoqué non transitoire (sédation prolongée).
Les spécialistes de soins palliatifs ont envisagé l’application de la sédation en fin de vie pour détresse terminale à plusieurs types de situations : les situations aiguës à risque vital immédiat, facilement identifiables ; les situations physiques réfractaires, vécues comme insupportables par le patient et les situations singulières et complexes dont la réponse ne peut se réduire au seul domaine médical.
— Les premières recouvrent par exemple les hémorragies cataclysmiques extériorisées ou les détresses respiratoires asphyxiques. La sédation est une décision médicale d’urgence qui a pour but de soulager le patient de la pénibilité et de l’effroi générés par ces situations ;
— Les deuxièmes renvoient à des symptômes dont le caractère réfractaire et la pénibilité pour le patient plus que le symptôme justifient la sédation. Comme l’a relevé le Docteur Stéphane Donnadieu devant les députés : « Devant les douleurs extrêmement rebelles se pose la question de la sédation, c’est-à-dire de pratiquer, disons-le franchement, une anesthésie […] en administrant des anesthésiques ou des morphiniques à des doses importantes pour que le patient retrouve un certain confort de vie. » (589) Chez les patients souffrant de cancer les douleurs réfractaires sont estimées à 3,5 % malgré un traitement bien conduit. Le même spécialiste constatait que l’on a tort de dire que l’on s’habitue à la douleur : « Au contraire on s’y sensibilise. Les gens qui ont beaucoup souffert, tant physiquement que moralement, sont plus difficiles à calmer après une intervention banale. La douleur mobilise des mécanismes complexes dans lesquels interviennent l’angoisse ou la dépression. […] Bien souvent ces douleurs rebelles n’ont pas une cause unique. Les métastases osseuses, les escarres, les obstructions viscérales méritent d’être prises en compte » (590) ;
— Enfin la dernière catégorie de situations correspond à des cas de détresse persistante, vécue comme insupportable par le patient et comportant parfois une demande d’euthanasie.
Il s’agit bien souvent dans ce dernier cas de situations extrêmes dans lesquelles se trouvent des patients affectés d’une maladie grave aiguë ou chronique relevant des soins palliatifs. Ces situations peuvent survenir soit dès le début de la vie, soit après un accident. Si elles revêtent un caractère extrême, c’est aussi parce que les équipes médicales n’ont pas su ou pas pu les anticiper ou parce que les malades ont refusé eux-mêmes tout traitement ou tout soin palliatif comme Mme Chantal Sébire.
Dans ce domaine sensible les nuances sont importantes, chaque mot doit être employé avec discernement. Les enjeux de la sédation ont été présentés en ces termes par le Docteur Régis Aubry : « Si la sédation accélère la survenue de la mort, l’utilisation de ces médicaments est contrôlée et l’objectif reste de supprimer la souffrance, pas la conscience. « Sédater » une personne ne signifie pas la plonger dans un coma profond, mais adapter un médicament à son inconfort, même si nous accélérons la fin de sa vie. La sédation n’est pas une hypocrisie pour accélérer la fin de vie mais la manifestation de la prise de conscience que le temps est venu d’arrêter ce qui maintenait artificiellement en vie et d’éviter toute forme de souffrance. Mais prenons garde : la souffrance que l’on veut parfois calmer peut être celle des proches ou des soignants, ce qui n’est pas blâmable en soi, mais pas forcément celle de la personne intéressée ; ce qui est blâmable. » (591) Le Professeur Élie Azoulay rejoint cet avis : « Nous prenons bien garde à ce que ne soit pas la douleur de l’infirmière, du médecin ou de la famille que nous calmons par la sédation. » (592)
Interrogée sur la fin de vie en néonatologie, le Professeur Delphine Mitanchez a fait part de sa pratique clinique en considérant que pour elle, ce ne serait pas respecter la personne humaine si on ne pratiquait pas de sédation : « Si l’enfant grimace au moindre soin infirmier, alors même que l’on sait qu’il va décéder, c’est intolérable » (593).
Les conditions du recours aux sédations en phase terminale
Pour appliquer ces sédations lorsqu’elles sont justifiées, plusieurs conditions sont requises : la compétence de l’équipe, son organisation et sa capacité d’anticipation et l’information du patient. Comme l’a souligné le docteur Stéphane Donnadieu, en tout état de cause, la solution de la sédation doit être envisagée dans le dialogue y compris avec le patient (594). En parler à l’entourage, à la personne de confiance, à l’équipe soignante est un préalable indispensable. Cela suppose un dialogue sur la technique utilisée, sur les objectifs poursuivis et sur les risques encourus.
Les termes de la demande de sédation doivent être analysés très attentivement par le médecin en charge du patient, ainsi que l’a indiqué le Docteur Sylvain Pourchet : « Une demande de sédation est à examiner au même titre que n’importe quelle autre demande émanant du malade. Toutefois, si le médecin ou l’équipe soignante est réduit à être un instrument au service des désirs du malade, cela ne lui rend pas service. La tendance à désirer dans le même temps une chose et son contraire, cette ambivalence caractéristique constatée autour de la fin de vie, nous appellerait tour à tour à jouer le rôle de réanimateur ou d’euthanasiste. Le travail d’accompagnement consiste justement à écouter le patient, à recevoir sa parole pour essayer de comprendre, avec lui et ses proches, comment il est opportun de traduire ses demandes en actes. Cet exercice extrêmement difficile requiert du temps, de l’expertise et du travail pluridisciplinaire en équipe. Si un patient demande une sédation, je ne suis pas choqué ; je fais mon travail et j’agis, en concertation avec mes collaborateurs… Lorsque ses douleurs sont incomplètement soulagées, le médecin est face à un dilemme : des deux inconforts, celui de la douleur et celui de la sédation, lequel est le moindre ? La décision résulte d’une discussion avec le patient. Des études montrent que les soignants, encouragés par les familles, ont d’emblée tendance à privilégier la sédation pour faire disparaître le symptôme, tandis que les patients préfèrent endurer un peu plus de douleur mais dormir moins pour sauvegarder la relation familiale. Il est donc essentiel de se montrer très prudent et de s’assurer que les décisions, au final, rendent le meilleur service au patient. En outre, le problème doit être appréhendé dans un processus très dynamique car le patient peut préférer dormir un jour et préférer rester éveillé le lendemain. » (595) Lorsque le consentement éclairé de la personne ne peut être obtenu, aucune intervention ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches du patient n’aient été consultés.
La sédation terminale n’est pas une forme d’euthanasie
D’aucuns ne manqueront pas d’arguer que la différence entre la sédation terminale et l’euthanasie est ténue. Un article consacré à l’application aux Pays-Bas de la sédation palliative, entendue comme sédation terminale, qui s’est essayé à cette comparaison, montre cependant que l’on ne saurait faire d’amalgame entre ces deux pratiques :
SÉDATION PALLIATIVE ET EUTHANASIE : DES DIFFÉRENCES PROFONDES
Sédation profonde sous la forme d’une sédation continue jusqu’au moment du décès |
Euthanasie | |
Objectif |
Soulager la souffrance |
Soulager la souffrance |
Moyen |
En abaissant le niveau de conscience (vigilance) |
En mettant fin à la vie |
Procédure médicale |
Procédure normale |
L’euthanasie n’est pas une procédure normale |
Indications |
Symptômes incurables provoquant des souffrances insupportables |
Souffrances insupportables sans perspective d’amélioration |
Consentement du patient |
Si possible |
Demande mûrement réfléchie |
Consultation d’un médecin indépendant |
Non, sauf en cas de manque d’expérience |
Obligatoire |
Prise de décision |
Si possible, par consensus entre le patient, sa famille et le personnel soignant concerné |
Consentement au premier chef du patient et du médecin |
Médication |
Sédatifs (en particulier benzodiazépines) |
Barbituriques et relaxants musculaires |
Dosage |
Titration de façon à soulager la souffrance |
Surdosage rapide |
Administration |
Médecin et personnel infirmier |
Médecin |
Processus en principe réversible |
Oui |
Non |
Accélération de la fin de vie |
Non |
Oui |
Décès par causes naturelles |
Oui |
Non |
Uniquement aux derniers stades de la vie |
Oui |
Non |
Source : Palliative Sedation in The Netherlands : Starting-points and contents of a National Guideline, European Journal of Health Law 14 (2007) 61-73.
— La sédation doit être réservée aux situations en fin de vie lorsque la mort est attendue dans les heures ou les jours à venir. Elle ne saurait constituer une méthode douce d’euthanasie. La sédation doit être pratiquée à l’initiative des professionnels et acceptée par les malades dans le cadre des douleurs réfractaires. Le Docteur Régis Aubry a tracé les limites de ce que pourrait être une pratique de la sédation terminale : « …Il ne me semble pas illégal de poser l’indication d’une sédation terminale dans une souffrance spirituelle réfractaire, à la condition de ne pas afficher trop vite des autorisations, de développer les démarches palliatives, d’institutionnaliser la procédure collégiale. » (596) Comme l’a rappelé le président de la Société française de soins palliatifs aux membres de la mission, le docteur Godefroy Hirsch : « Il faut avoir des repères clairs en la matière. La sédation n’est pas une solution toute faite, d’application automatique. Cela ne peut que conduire à des dérives et l’on en voit parfois. La sédation prend cœur dans l’action de soigner. » (597) « Cette démarche s’inscrit dans une pratique médicale, entourée par des recommandations, a-t-il ajouté ; elle doit s’intégrer dans un cheminement qui tienne compte de ce qu’a dit le patient, de ce qu’on perçoit de la situation et doit toujours être une dimension du soin. Le plus difficile n’est pas de mettre une sédation mais d’élaborer une réflexion et des actions de soins adaptés jusqu’au bout. La sédation peut paraître une action de soin adaptée dans certains cas et pas dans d’autres, même face à des situations de souffrance. » (598)
— La sédation ne doit pas être pratiquée à la demande du malade pour provoquer la mort, puisque l’interdit fait au médecin de provoquer délibérément la mort, tel qu’il est posé par l’article R. 4127-38 du code de la santé publique demeure bien évidemment. Le précédent belge vient d’ailleurs confirmer cette analyse, puisque l’administration d’analgésiques et de sédatifs à doses élevées n’est considérée comme une euthanasie que si elle fait suite à une demande du patient de mettre fin à ses jours (599).
— À l’inverse du geste létal, la sédation est réversible. C’est ce qu’a confirmé M. Didier Sicard au cours de son audition, au sujet du cas de Mme Chantal Sébire : « Une sédation active réversible aurait pu être en effet envisagée jusqu’au terme de la maladie. » (600) Toutefois, dans le cadre du double effet, cette sédation peut avoir pour conséquence indirecte d’abréger la vie du patient.
— Il s’agit par ailleurs d’une décision médicale assumée collectivement dans un cadre pluridisciplinaire et non d’une décision individuelle comme le geste létal, dans la logique hollandaise ou belge. Faut-il rappeler qu’au sens de l’article 2 de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, cette dernière est « l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci » ? Le document établi en Belgique par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie précise nettement qu’un arrêt de traitement n’entre pas dans le cadre de l’euthanasie ; en dehors de l’hypothèse où à la suite d’un arrêt de traitement vital, une demande claire d’euthanasie est formulée par le patient.
— Enfin le temps des effets de la sédation est plus long à s’écouler alors que le geste létal qui est brutal et violent, détermine le moment de la mort. C’est cette progression dont on ne peut fixer le terme, qui favorise une mort apaisée et la laisse survenir naturellement. Associée à l’arrêt d’une hydratation et d’une nutrition médicalement assistée, la pratique d’une sédation conduit habituellement à la mort dans un délai maximal d’une dizaine de jours. Par là même elle permet à l’entourage d’accompagner le patient et de commencer son deuil.
2. La pratique d’un traitement à visée sédative dans certains cas
L’arrêt des traitements suppose au départ, rappelons-le, l’une des trois conditions suivantes : l’existence d’un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie. Les deux premières conditions ne font pas problème car il est communément admis que tout acte médical doive être proportionné à un bénéfice attendu sinon il n’est pas légitime. Le troisième critère est parfois d’un maniement délicat. Par exemple, l’arrêt d’une nutrition artificielle, peut-il être assumé par les médecins chez un patient cérébrolésé survivant à la neuroréanimation, dans un trouble majeur du retour à la conscience pronostiqué secondairement comme irréversible ? D’après les informations recueillies par la mission, il existerait environ 1 600 personnes dans cette dernière situation actuellement en France. On peut rattacher à ce questionnement celui qui concerne la réponse apportée aux naissances d’enfants très prématurés avec complications neurologiques, polyhandicapés ou anoxiques à la naissance. La moitié des décès qui ont lieu actuellement dans les services français de réanimation néonatale résultent d’une décision médicale d’arrêt de traitement (601).
Un traitement à visée sédative peut être justifié lorsque la nutrition–hydratation présente un caractère inutile, disproportionné. Choisi judicieusement, il peut être une réponse à ces situations agoniques insupportables qui peuvent durer un certain temps et qui ont été illustrées par l’affaire Pierra. Associé à l’arrêt de traitement sur le jeune Hervé Pierra, un traitement par benziodiazépine anti-convulsivante aurait évité à celui-ci les convulsions dont il a souffert pendant six jours après le retrait de sa sonde gastrique. C’est cette mauvaise prise en charge de ce malade par le corps médical, qui a conduit Axel Kahn à estimer que dans ce cas il s’agissait d’une « erreur médicale, en aucune façon d’une insuffisance de la loi Leonetti. » « Que des médecins n’aient pas administré de produits anticonvulsifs ni de calmants, affirme-t-il, est de ce fait incompréhensible et insupportable. L’application de la loi Leonetti, à la demande de la famille, aurait dû consister en la cessation de l’hydratation et de l’alimentation, avec la mise en place concomitante d’une perfusion de substances anticonvulsives et sédatives. Ce garçon qui « dormait » depuis déjà huit ans aurait dormi six jours de plus et serait mort dans le calme. » (602)
À partir du moment où, après une procédure collégiale, le médecin responsable décide d’arrêter des techniques médicales non pas pour faire mourir le malade – même s’il sait que la mort sera la conséquence de cet arrêt – mais parce que ces techniques apparaissent de toute évidence inutiles et disproportionnées, on voit mal comment le médecin en charge du patient échapperait au questionnement éthique. Le médecin, dans une éthique de responsabilité, doit se poser la question des conséquences de sa décision en s’attachant à prévenir et traiter les complications susceptibles de survenir.
Cette thérapie à visée sédative présenterait plusieurs caractères :
— elle serait une contrainte déontologique pour le médecin ;
— elle constituerait une modalité d’accompagnement des conséquences de l’arrêt de traitement, avec une visée à la fois médicale et éthique, à savoir le respect du patient et le confort de l’entourage ; ce faisant elle prendrait en considération la dignité du malade et la dimension de protection des proches conformément à l’article R. 4127-38 du code de la santé publique ;
— elle serait administrée pour éviter au patient des souffrances qui sont difficilement évaluables et qui ne pourraient être soulagées autrement, ce en quoi elle se distinguerait des traitements à visée sédative terminale. Les travaux de Steven Laureys cités par le Professeur Louis Puybasset montrent que la sensation de douleur est respectée dans les états pauci–relationnels et amoindrie mais non abolie chez les patients en état végétatif. Cela justifie d’autant plus la mise en œuvre d’un principe de précaution ;
Devraient en être exclus les malades conscients qui ne sont pas en fin de vie. Cette sédation aurait vocation à s’appliquer de manière privilégiée à deux catégories de patients cérébrolésés très sévères dont la fin de vie ne serait consécutive qu’à un arrêt de traitement, à savoir :
— ceux qui sont pris en charge en réanimation adulte après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une anoxie cérébrale ou tout autre accident responsable d’une lésion cérébrale majeure.
— ceux qui sont en réanimation néonatale pour anoxie cérébrale périnatale ou grande prématurité ou tout autre accident responsable d’une lésion cérébrale majeure.
a) La sédation et les personnes en état végétatif
L’arrêt de traitement pratiqué sur la personne d’Hervé Pierra, qui était plongé dans un état de coma végétatif a suscité de nombreuses questions tout au long des auditions. Ce cas a amené la mission à s’interroger sur l’application de la loi de 2005 à une catégorie de malades ou de personnes présentant un handicap acquis gravissime qui ne sont pas en fin de vie, à savoir, les états végétatifs. La difficulté du sujet justifie que l’on rappelle brièvement les traits caractéristiques de ces patients qui relèvent du critère du maintien artificiel de la vie mis en avant par la loi du 22 avril 2005.
Les caractéristiques de ces malades
La circulaire 2002-288 du 3 mai 2002 relative à la création d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel définit ces personnes. Il s’agit de victimes bien souvent d’un accident de la route ou du travail, d’un accident domestique, d’un accident vasculaire cérébral, d’une anoxie cérébrale ou d’une tentative de suicide. À l’issue d’une période de coma, le patient ouvre les yeux et entre dans une phase végétative. Celle-ci se caractérise par des cycles de veille et de sommeil avec une ouverture des yeux, une ventilation spontanée et l’absence de vie relationnelle. L’évolution éventuelle de cette phase végétative vers un éveil stable et une vie relationnelle est incertaine. « Le malade ne répond pas ou seulement par des relations stéréotypées. Il ne bouge pas spontanément ou seulement par des mouvements plus ou moins réflexes. » (603) Comme le relève le Père Patrick Verspieren, « l’état végétatif est situation déroutante pour tous les acteurs concernés, familles, médecins, infirmières et autres soignants, vu l’incertitude qui l’accompagne, l’incapacité médicale pendant des semaines et même des mois à prédire son issue, l’état paradoxal d’un patient qui a été arraché à la mort pour vivre privé de ce qui apparaît comme la principale richesse de l’existence humaine, la possibilité de communiquer avec autrui. » (604)
La définition du caractère chronique est variable selon la cause de la pathologie. On l’estime de 3 à 6 mois pour les états végétatifs d’origine médicale et de 12 à 18 mois pour les états végétatifs d’origine traumatique, avec un espoir minime d’une évolution vers un retour à la conscience. Un spécialiste de la rééducation fonctionnelle de ces malades a indiqué que leur espérance de vie était en moyenne de six ans (605). Les cas d’éveil au-delà de ces délais sont exceptionnels. Sur le plan de la responsabilité civile, l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (606). Il s’ensuit que la période passée dans le coma est prise en compte dans l’estimation des souffrances endurées (607).
Si la médecine n’est pas responsable de la maladie initiale qu’est l’accident, elle est responsable de la survie du patient (608). En effet ces malades sont dans un coma qui est intervenu après une réanimation initiale sans laquelle ils seraient décédés. Leur réanimation a été engagée au bénéfice du doute car les médecins espéraient leur survie et leur récupération. L’obligation de moyens qui a préexisté au départ se transforme en obligation de résultat pour le médecin. La qualité de la vie à venir est prise en considération par l’entourage. « Dans ce contexte, il s’agit de proposer un projet thérapeutique réel au patient et non de se contenter de traiter les unes après les autres les complications qui vont émailler le parcours en réanimation. » (609) L’évaluation du degré d’atteinte cérébrale va nécessiter l’expertise répétée, durant de nombreux jours, d’une triple équipe médicale composée de neuro–réanimateurs, de neurochirurgiens et de neuro-radiologues (610). Les discussions sur la prise en charge du malade surviennent généralement après la phase la plus aiguë des soins, soit entre 8 et 21 jours après l’accident. Les données de l’IRM et de l’électroencéphalographie révèlent une atteinte majeure des structures cérébrales du malade et soit un pronostic à un an de vie végétative chronique, soit au mieux un état pauci–relationnel. Évaluer l’atteinte cérébrale suppose l’arrêt de la sédation, la réalisation de l’IRM, sachant qu’elle ne doit pas être trop précoce, et des évaluations cliniques, électro-encéphalographiques et biologiques.
C’est à ce stade que se pose la question de la responsabilité médicale : faut-il ou non continuer des soins chez un patient dont on est responsable de la survie mais dont on sait qu’il n’aura aucune vie relationnelle ? Le Professeur Louis Puybasset résume ainsi les termes des interrogations du corps médical à ce moment-là : « Faisons-nous le bien pour ce patient en poursuivant l’utilisation de technique de suppléance artificielle alors que nous savons que le retour à une vie relationnelle est impossible ? Agissons-nous dans l’intérêt du patient ? Mettons-nous notre savoir et nos techniques à son service ? Que connaissons-nous de ses souhaits ? » (611)
Comme déjà indiqué en première analyse (612), l’approche éthique de ces situations n’est pas unanime.
Pour certains on ne peut déduire l’absence de vie humaine de l’absence d’expression de cette même vie : « De la présence chez le patient d’une certaine forme de conscience ou de vie intrapsychique plus ou moins disjointe de cette conscience, on ne peut rien affirmer avec certitude, à partir du seul seuil d’état végétatif. » (613)
Le Docteur François Tasseau a présenté la forme des réactions que pouvaient exprimer ces malades : « Ce sont souvent les familles et les personnels paramédicaux qui ont attiré l’attention des médecins sur la présence de signes attestant une persistance de contact relationnel chez des patients considérés comme étant en état végétatif : manifestations émotionnelles en lien avec des circonstances déterminées, réponses à des demandes simples, attitudes ou gestes dont la signification était compréhensible. » (614) Comme l’a souligné ce même médecin, le diagnostic d’état végétatif repose sur l’observation du patient et sur la réalisation d’examens complémentaires. Cette observation pluridisciplinaire doit se répéter au cours de la journée et de la semaine.
Pour le Docteur Anne-Laure Boch, la présence d’un malade cérébro-lésé dans son service incite le médecin à l’humilité : « Je crains que, privé du retour sur expérience que représente la fréquentation quotidienne de ses catastrophes, le médecin devienne un peu plus un pur technicien qui s’abandonne toujours davantage à l’emballement technique, sans plus de souci pour les conséquences réelles de ses actes… Même s’il est couché, inerte, dans son lit, le patient cérébro-lésé a beaucoup à nous apporter : il nous met face à la quintessence de notre métier » (615).
Une autre approche consiste à se demander toutefois, si au bout d’un certain temps la poursuite de la réanimation ne peut pas être assimilée à de l’acharnement thérapeutique, la nutrition et l’hydratation maintenant la vie végétative de la personne. Le Professeur Louis Puybasset a illustré ainsi les conséquences pour les proches d’une survie en état végétatif ou pauci-relationnel : « Ces états entraînent une souffrance majeure des proches avec très fréquemment une déstructuration de la vie familiale. Les familles n’ont souvent plus que le choix déchirant entre l’abandon de leur malade à des structures sanitaires plus ou moins adaptées ou l’arrêt complet de toute activité professionnelle, l’occupation quasi-exclusive de leur proche. Ceci est particulièrement vrai des mamans, qui le plus souvent, retrouvent instinctivement les comportements qu’elles avaient avec leur nouveau-né. » (616) Au surplus, il faut considérer les conséquences en termes de développement psychoaffectif des jeunes enfants ou adolescents, souvent considérablement perturbés, lorsqu’un de ses parents est dans cet état. (617) Lorsque la famille a l’intime conviction que tous les traitements raisonnables ont été tentés à la phase aiguë, il appartient à l’équipe médicale de trouver un juste équilibre au cas par cas. Il est évident que « la famille ne peut ni porter la responsabilité de la décision ni en être exclue. Trop d’implication créerait une culpabilité et un risque de deuil pathologique, pas assez serait une tromperie ». (618)
Pour certains praticiens, la vie se définit par le retour à une ventilation autonome, et il ne saurait être question d’arrêter la nutrition ou l’hydratation, fussent-elles artificielles. Pour d’autres, la double prise de conscience de l’inutilité de poursuivre le traitement et des conséquences de cet état pour l’entourage peut amener à s’interroger sur l’opportunité de continuer ce traitement alors qu’il n’y a pas de perspective de retour à une vie relationnelle. Cet arrêt de traitement signifie un arrêt progressif de la nutrition et de l’hydratation avec la prescription d’un traitement à visée sédative.
Cet arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles peut intervenir dans la phase aiguë et dans la phase chronique. Pendant la phase aiguë avec un pronostic vital engagé si les traitements actifs sont suspendus, la sédation est justifiée pour éviter la douleur physique résiduelle et les mouvements respiratoires agoniques, les « gasps » (619) pénibles pour le patient et éprouvants pour la famille. En phase chronique, la sédation a pour but de prévenir une souffrance éventuelle secondaire à l’arrêt des traitements.
Les progrès de l’IRM décrits par le Professeur Louis Puybasset devraient permettre de mieux prendre en compte le pronostic sur ces malades. Comme il le relève : « Jusqu’à très récemment, il n’était possible de porter un pronostic d’état végétatif ou pauci–relationnel alors que le patient était encore en réanimation. Il ne pouvait être affirmé qu’à un an, une fois établi cliniquement, durant ce que l’on appelle la phase de consolidation. Ces algorithmes prévisionnels, qui combinent IRM multimodale, biologie, électrophysiologie, sont en cours de développement. Ils sont […] extrêmement performants. Nous pouvons formuler un pronostic au bout de quelques semaines. » (620) La réalisation de l’IRM chez ces malades ne peut se faire qu’après la phase la plus aiguë des soins, puisqu’elle exige que le patient soit parfaitement stabilisé et en particulier qu’il ait passé la phase de l’hypertension intracrânienne. (621)
La sédation conjointe à un arrêt de traitement
Le fait que ces malades n’aient ni capacité cognitive ni expressive, le fait qu’il soit très difficile pour le médecin d’évaluer leur souffrance, expliquent la singularité de la mise en œuvre de la décision d’arrêt de traitement qui peut leur être appliquée. Seule une sédation administrée dans les conditions de transparence et de collégialité requises par la loi permettrait d’avoir la certitude que le patient ne ressentira aucune souffrance.
En réservant ces traitements à visée sédative aux malades hors d’état d’exprimer leur volonté dont on ne peut évaluer la souffrance, on se démarquerait nettement des pratiques hollandaise et belge qui appliquent la sédation aux malades conscients qui en font la demande, hors de tout contexte de limitation ou d’arrêt de traitement.
b) La sédation en néonatologie
Les arguments en faveur de la sédation d’accompagnement en néonatologie ont été avancés par le Docteur Delphine Mitanchez. Elle souligne combien dans le contexte de la conduite et de l’accompagnement de la fin de vie, la sédation a un rôle important et doit revêtir un caractère systématique dans le cadre d’un dialogue avec les parents en incluant les soignants (622). Elle a constaté que si l’équipe sent un inconfort chez l’enfant, la situation devient ingérable pour elle (623). Les recommandations du Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) s’inscrivent dans cette démarche. Elles estiment que l’utilisation de morphiniques pour calmer la douleur et soulager l’inconfort est non seulement justifiée mais constitue un devoir pour tout soignant. Dans des situations de limitation ou d’arrêt de traitements de suppléance d’organes défaillants, il est le plus souvent nécessaire de majorer ces traitements sédatifs et analgésiques « pour lutter de façon responsable et efficace contre la douleur et la souffrance » (624). Cette augmentation doit être adaptée aux modifications de l’état du patient, même si la conséquence, non recherchée mais acceptée, peut être d’avancer le moment de la mort.
c) Le vecteur juridique d’un traitement à visée sédative
Si l’on s’accorde sur l’opportunité de recourir à des thérapies d’accompagnement à visée sédative dans des situations qui n’ont pas été envisagées jusqu’ici par la loi, il n’est pas utile, cependant, de modifier en ce sens la loi du 22 avril 2005.
Ce traitement à visée sédative serait administré en application de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui proscrit l’obstination déraisonnable. Le dispositif proposé s’inscrirait à l’article R. 4127-37 du code. Ce traitement s’appliquerait aux cérébro-lésés adultes et nouveau-nés incapables d’exprimer leur douleur ou leur souffrance. Le président du Conseil national de l’ordre des médecins, entendu par la mission s’est fait l’écho de cette modification rédactionnelle de la partie réglementaire du code de la santé publique issue du code de déontologie médicale : « Le Conseil national de l’Ordre travaille actuellement à une révision du code pour apporter les adaptations nécessaires en fonction de l’évolution des pratiques et modes d’exercice professionnel. Dans ce cadre, il peut envisager, tout en maintenant cette interdiction, de décrire les conditions dans lesquelles le patient sera placé après la prise de décision afin que sa dignité soit respectée, qu’il ne soit pas abandonné et que sa famille soit accompagnée. » (625) Cette précision pourrait être utilement complétée par des recommandations des sociétés savantes concernées qui seraient validées par la Haute autorité de santé, conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3-3, 2° du code de la santé publique.
Cette modification du code pourrait aussi prendre en compte l’élargissement de la saisine de la procédure collégiale et l’obligation pour les médecins de motiver un refus de demande de limitation ou d’arrêt de traitement.
Chapitre IV
Adapter l’organisation du système de soins aux problèmes de la fin de vie
Toutes les garanties que la mission souhaite apporter aux malades ne peuvent être concrétisées que par une adaptation en profondeur de l’organisation des soins. Il est évident que le développement de l’offre de soins palliatifs doit continuer à constituer une priorité des pouvoirs publics. Mais une modification plus profonde de l’organisation du système de soin s’impose. La généralisation des indicateurs qualitatifs de soins et l’aménagement du financement à l’activité y contribueront.
A. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS PALLIATIFS
Les moyens attribués aux soins palliatifs sont incontestablement en augmentation depuis vingt ans (626). Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 s’inscrit dans une longue lignée de plans destinés à améliorer l’offre de soins en la matière. Pourtant, si les moyens dédiés aux soins palliatifs sont en progression constante, d’importantes disparités perdurent, notamment entre secteurs et entre régions (627). L’urgence est donc de remédier à ces inégalités géographiques et sectorielles.
Le programme de développement prévoit, dans sa mesure liminaire, de créer une USP dans chaque établissement de court séjour qui comptabilise plus de 600 décès annuels, et des lits identifiés dans ceux qui en comptent plus de 200. Cette mesure vise à localiser les USP et les LISP dans les zones où les besoins sont les plus importants.
Néanmoins, ce programme ne contribuera pas à réduire complètement les inégalités régionales dans l’offre de soins palliatifs. Il n’est pas acceptable que deux régions de métropole et deux régions d’outre-mer ne disposent pas encore d’unité de soins palliatifs (628), contrairement à l’objectif qui avait été fixé, pour 2007, d’une USP par région. La mise en place d’une USP dans chacune de ces quatre régions devrait être une priorité de l’action de l’État en matière de soins palliatifs.
Ce sont donc sur elles, davantage que sur les lits identifiés, que les efforts budgétaires devraient porter en priorité. Pour M. Gérard de Pouvourville la spécificité des USP par rapport aux services traditionnels est indéniable : « La principale conclusion sur le plan qualitatif, que je voudrais mettre en avant, et qui ressort des entretiens aussi bien avec les soignants qu’avec les familles des malades, c’est la spécificité du modèle de prise en charge. Les unités de soins palliatifs sont bâties sur une philosophie radicalement différente de celle qui fonde les services cliniques. Toute l’organisation de l’unité est centrée sur le patient » (629). Ceci justifie qu’une véritable politique en faveur de la diffusion de la culture palliative se concentre sur elles : « À la lecture de la thèse [de Mme Yaël Tibi-Levy (630)], il ressort que, si la politique de lits dédiés est d’inspiration généreuse, puisqu’elle vise à diffuser la culture palliative pour éviter que le malade pour lequel on ne peut plus rien faire ne soit abandonné, il n’est pas sûr qu’elle puisse apporter le même service, tant le modèle des soins palliatifs centrés sur le patient est difficilement transposable dans un service clinique. » (631). Il est donc urgent de remettre les USP au centre de la politique de soins palliatifs. La présence d’une USP à proximité est en effet, avec l’existence de réseaux et d’équipes mobiles, l’une des conditions de la diffusion de la culture palliative. Ces unités font figure de référence en la matière et permettent de diffuser des techniques et des bonnes pratiques, bien au-delà de ces seuls services. Les effets bénéfiques sur l’ensemble de l’activité de soins liés à la présence d’une USP devraient être recherchés le plus largement possible.
Actuellement, 57 départements ne comportent pas d’unité de soins palliatifs. Pour Mme Marie de Hennezel, cette situation est critiquable : « Il y a certainement eu des progrès entre 2004 et 2007, mais un coup d’arrêt a été porté à la création de nouvelles unités de soins palliatifs au profit des lits identifiés et du renforcement des équipes mobiles. […] On s’est limité à une unité de soins palliatifs par région, ce qui, de l’avis de tous, n’est pas suffisant. L’unité de soins palliatifs, même si elle n’est sollicitée qu’en cas de fin de vie très difficile, est la tête du réseau et il serait souhaitable qu’il y en ait une par département car les lits identifiés ont été créés, je l’ai dit, dans des établissements sans culture palliative. Il faut revoir la direction qui a été prise. » (632)
La mission préconise donc, qu’à court terme, une unité de soins palliatifs soit opérationnelle dans chaque région d’ici au 1er janvier 2010 et que chaque département compte une unité avant le 1er janvier 2013, à l’échéance du programme de développement des soins palliatifs. Elle juge ces actions prioritaires par rapport à l’ouverture de nouveaux lits identifiés.
2. Dans les long et le moyen séjours
Les inégalités géographiques, en matière d’offre de soins palliatifs se redoublent d’inégalités sectorielles. En effet, dans les zones rurales, les seules structures de soin sont souvent des unités de long ou de moyen séjour. De plus, la moyenne d’âge des patients y étant plus élevée que dans le court séjour, la diffusion des soins palliatifs à ces secteurs est d’autant plus cruciale.
À cet égard, deux actions semblent prioritaires. Il est nécessaire de généraliser les conditions de rémunérations qui s’appliquent au court séjour à ces secteurs (633), afin de réduire les distorsions financières entre secteurs. La généralisation de la T2A est prévue pour 2011. Elle devra être réalisée dans des conditions aussi favorables pour les soins palliatifs en long et moyen séjour que celles qui sont en vigueur actuellement pour le court séjour.
Mais on ne saurait attendre cette date pour accroître l’offre de soins palliatifs dans ces secteurs. Il est nécessaire de renforcer dès maintenant les moyens des secteurs de long et de moyen séjours, concernant les soins palliatifs. Des actions de formation menées auprès de 10 % du personnel chaque année, sont à l’ordre du jour, pour le long séjour, dans le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 (action III). Par ailleurs, il est prévu d’identifier des lits dans le secteur SSR (action V).
Néanmoins, les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisants. En 2005, le nombre de LISP dans ce secteur était de 400 pour un total de 90 000 lits et il est stable depuis. Par comparaison, on compte actuellement plus de 4 000 lits identifiés dans le court séjour pour environ 225 000 lits. Un lit sur 225 en SSR et un lit sur 56 en MCO est donc un lit dédié aux soins palliatifs, soit un rapport de un à quatre. Or, le programme de développement des soins palliatifs, bien qu’il envisage la création de 1 200 lits identifiés supplémentaires dans le secteur SSR d’ici 2012, prévoit d’accorder 85 millions d’euros en cinq ans pour développer les soins palliatifs dans le court séjour, contre 16 millions pour le secteur des soins de suite et de réadaptation. Il paraît donc indispensable à la mission de consacrer plus de moyens financiers aux soins palliatifs dans le secteur du moyen et du long séjour, qui sont les parents pauvres des soins palliatifs.
S’il est possible d’envisager la création de structures importantes dans les zones densément peuplées, en revanche, cela est plus difficile dans les zones majoritairement rurales, d’autant plus que le nombre de praticiens y exerçant est en diminution constante. Dans ces conditions, il est indispensable de favoriser l’hospitalisation à domicile, qui est « de toute évidence insuffisamment développée en France (634) » et plus largement, le maintien à domicile des personnes en fin de vie qui ne souhaitent pas être hospitalisées. Elle est de surcroît moins coûteuse et plus adaptée aux attentes des malades.
Pour ce faire, il est essentiel de favoriser la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de soins, qui doivent intervenir pour permettre le maintien à domicile : les proches, les médecins, les infirmiers, les gardes-malades et les structures de soins.
Concernant les proches, qui sont souvent les premiers acteurs de l’aide au malade et du maintien à domicile, la mesure première et essentielle est l’instauration d’un congé d’accompagnement rémunéré, permettant d’accompagner à domicile un proche, durant les derniers jours de sa vie (635).
Actuellement, la délivrance de soins palliatifs à domicile par des médecins et des infirmiers libéraux sans adossement à un réseau de soins palliatifs est très difficile. En effet, le décret qui définit leur rémunération pour ce type d’actes a, comme on l’a vu, été annulé par le Conseil d’État en 2004 et n’a pas été repris depuis dans une nouvelle version. Il est donc nécessaire d’adopter le plus rapidement possible le décret prévu à l’article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale, qui détermine les conditions de rémunération des professionnels de santé pratiquant des soins palliatifs à domicile. Or, le Ministère de la santé a indiqué à la mission parlementaire que ce nouveau décret n’était toujours pas prêt. Il est donc crucial qu’il soit pris dès que possible et qu’il ait comme objectif de rendre particulièrement incitatives les activités de soins palliatifs délivrées à domicile.
Enfin, afin d’aider les aidants, il est indispensable de développer les possibilités d’employer des gardes-malades à domicile et de prévoir des hospitalisations de répit pour soulager les aidants. Le programme de développement des soins palliatifs a prévu de favoriser l’intervention de gardes-malades à domicile (mesure n° VIII). Le but est de former 1 500 gardes-malades par an sur cinq ans. Mais il serait également souhaitable de créer des « centres de répit ou relais accessibles au cours de certains épisodes de la maladie, ou pour permettre aux proches de bénéficier de soutiens transitoires, sur le modèle de l’expérience menée par les Docteurs Sylvain Pourchet et Michèle Salamagne à l’hôpital Paul-Brousse (636) », comme l’a indiqué le Professeur Emmanuel Hirsch à la mission. Il est donc nécessaire d’analyser les expériences qui sont déjà en cours concernant ces centres, afin d’expérimenter à plus large échelle cette pratique. Les hôpitaux locaux et les EHPAD pourraient à terme devenir des lieux d’accueil momentané pour les personnes traversant une maladie longue.
Mais en dehors de l’aspect quantitatif lié à l’accroissement de l’offre de soins palliatifs, il importe également de rendre les indicateurs qualitatifs de soins plus exigeants.
B. RENDRE PLUS EXIGEANTS LES INDICATEURS QUALITATIFS DE SOINS
La définition d’indicateurs qualitatifs de soins relève de la compétence de la Haute autorité de santé. Celle-ci, aux termes de l’article L. 1414-3-3 du code de la santé publique a pour mission :
« – D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
– De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
– D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
– De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients. »
Les indicateurs doivent avoir pour vocation de faire reculer l’obstination déraisonnable à laquelle est tentée de céder, pour des raisons culturelles et pour des raisons économiques, une fraction de la communauté médicale. Ces indicateurs devraient permettre de diffuser une meilleure politique de soins et de favoriser une réallocation des moyens vers les soins palliatifs.
La mise en place de ces indicateurs, suppose que l’on s’interroge au préalable sur leur contenu et sur leur portée. Dans ce domaine, le monde médical ne part pas de rien. Les indicateurs s’inscrivent dans la dynamique de reconnaissance de droits aux malades amorcée en 2002.
L’observatoire, comme on l’a suggéré, aura pour vocation d’alimenter en informations la Haute autorité de santé pour la définition de ces référentiels de qualité des soins. Il serait donc logique que le président de l’observatoire, ou son représentant, siège dans la Commission de certification de la Haute autorité de santé, cinq membres sur les 26 qui la composent y étant désignés au titre de leur expertise.
Que l’on songe à la lutte contre les maladies nosocomiales, à savoir les maladies contractées dans un établissement de santé, ou que l’on tire les leçons du Plan Cancer, la politique des indicateurs n’est pas sans précédents dans le domaine de la santé. Plusieurs expériences étrangères peuvent également être mises à profit pour s’engager plus profondément dans cette voie. Ces différentes contributions sont à même de nourrir une réflexion sur l’élaboration des indicateurs, de nature à introduire plus de variables qualitatives dans notre système de soins, qu’il s’agisse des soins palliatifs en particulier ou des soins hospitaliers en général, cette problématique dépassant le seul cadre des soins palliatifs.
a) Deux précédents : le Plan Cancer et la lutte contre les infections nosocomiales
— Les indicateurs du Plan Cancer
Le Plan Cancer mérite d’être cité comme exemple pour inspirer l’élaboration d’indicateurs qualitatifs. Grâce à un fort engagement politique et un investissement financier élevé, il a été très bien reçu par la communauté médicale et a contribué, de l’avis des praticiens, à modifier des pratiques médicales sur une grande échelle. Ses enseignements gagneraient à être tirés pour être transposés aux soins palliatifs et plus généralement aux activités médicales hospitalières.
Dans ce plan la concertation pluridisciplinaire a constitué une idée-force que le futur Observatoire des pratiques de la fin de vie pourra promouvoir. Il est en effet à mettre à l’actif de la mesure 31 du Plan Cancer d’avoir regroupé les expertises diagnostiques et thérapeutiques, afin de faciliter les échanges d’informations entre les professionnels (637). Les progrès apportés par le Plan Cancer ont été mis en exergue par le Professeur Daniel Brasnu : « tous les dossiers d’un nouveau patient sont examinés en réunion de concertation pluridisciplinaire où doivent intervenir, dans l’évaluation et le traitement du cancer, des spécialistes de tous horizons – médecins spécialistes en imagerie médicale, pathologistes, chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues médicaux,… » (638)
Alors que dans le cas d’une maladie avancée, lorsqu’il y a moins d’urgence, moins de dilemme, le médecin redevient solitaire, la bonne pratique clinique en phase plus aiguë passe par une réunion de concertation pluridisciplinaire obligatoire. Il s’agit d’un enjeu considérable pour la médecine, rappelé avec force par le Professeur Louis Puybasset : « Il nous faut lutter contre la fragmentation de la responsabilité médicale qui est un travers de l’hyperspécialisation de la médecine d’aujourd’hui. C’est aussi cette notion de responsabilité partagée qui fait que la décision prise par le groupe en accord avec la famille doit être suivie par chaque acteur de soins. » (639) Il est à noter qu’aux termes de la circulaire du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs, ce paramètre de la concertation pluridisciplinaire fait d’ores et déjà partie des indicateurs de suivi appelés à être appliqués (mais sans caractère contraignant) aux lits identifiés de soins palliatifs et aux unités de soins palliatifs. Les auditions de la mission ont eu le mérite de mettre en valeur tout l’intérêt de cette pluridisciplinarité. Ses avantages sont en effet doubles.
D’une part, elle favorise une expertise multidisciplinaire. Supposons une concertation entre un cancérologue, un radiologue et un spécialiste de soins palliatifs. Si le cancérologue est absent, le malade risque de partir en soins palliatifs, sans que par exemple la moindre information sur l’arrivée d’une nouvelle molécule susceptible de lui apporter survie ou confort ait pu être portée à la connaissance du spécialiste de soins palliatifs. À l’inverse la présence d’un spécialiste de soins palliatifs permettrait l’accès aux soins palliatifs et au contrôle de la douleur si le cancérologue ne s’en préoccupait pas suffisamment (640).
D’autre part, quand un patient en soins palliatifs est mal soulagé, il est normal que l’équipe de soins palliatifs fasse appel à une équipe plus spécialisée dans le traitement des douleurs rebelles (641). On peut dès lors envisager des réunions de concertation pluridisciplinaire organisées par les médecins de soins palliatifs et les médecins de la douleur. À ce groupe pourraient le cas échéant être associés un psychologue, un oncopsychiatre et une infirmière de soins. Le format de ces réunions pourrait être adapté selon les pathologies abordées. On pourrait imaginer ainsi qu’un oncologue médical, un médecin radiothérapeute, un spécialiste d’organe, un gériatre, un réanimateur y participent.
Dans la catégorie des expériences réussies du Plan Cancer figure également le dispositif d’annonce aux patients, qui a distingué le temps médical de la consultation et le temps paramédical de reformulation et d’écoute des interrogations du patient (642). Comme l’indique le Docteur Michèle Lévy-Soussan, « Le dispositif d’annonce du Plan Cancer – qui devrait s’étendre à d’autres pathologies – en est l’exemple car il prévoit un véritable temps d’échange. L’accueil des familles doit avoir lieu dans un endroit spécifique et non à la volée dans un couloir. » (643)
— Les indicateurs de prévention des maladies nosocomiales
Les établissements de santé produisent quatre indicateurs, qui reflètent le niveau de leur engagement dans la prévention des infections nosocomiales. Ces indicateurs, alimentés par les bilans annuels d’activité des établissements de santé, sont publics et mis à la disposition des usagers. Il s’agit de l’indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN) publié depuis 2004 ; de l’indicateur de consommation de produits ou solutions hydro–alcooliques pour l’hygiène des mains (ICSHA) publié depuis 2004 ; de l’indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du site opératoire (SURVISO) publié depuis 2005 et de l’indice composite de bon usage des antibiotiques (ICATB) publié depuis 2006. La mise en place de ces indicateurs a permis de créer un réseau national d’alerte, d’investigation et de surveillance. En 2006, 2 337 établissements, soit 804 de plus qu’en 2001, représentant 95 % des lits, avaient été ainsi couverts. Cette mesure permet de constater que 72 % des établissements surveillent les infections des sites opératoires, soit un résultat inférieur à l’objectif de 75 % fixé par le Plan 2002-2008.
b) Développer les indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs
Si le système français de soins dispose déjà d’acquis en la matière, leurs effets positifs pourraient être prolongés en s’inspirant des exemples étrangers.
— Les acquis du système français
Tous les établissements de santé font l’objet de procédures de certification par la HAS, la troisième campagne en la matière devant commencer en 2010. Les visites de certification s’effectuent à un rythme d’une tous les quatre ans. Cette procédure a un triple objectif : améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient ; promouvoir des démarches d’évaluation et d’amélioration et renforcer la confiance du public par la communication des résultats. Il existe 87 critères de qualité regroupés en 32 références dans un manuel (Manuel V 2010) contre 138 critères et 44 références dans la version 2007. Ce manuel définit en outre des « pratiques exigibles prioritaires » (PEP), qui ont pour objet de créer un « effet levier » sur la qualité et la sécurité des soins. Ces pratiques exigibles prioritaires touchent à l’organisation générale et à la prise en compte de risques spécifiques, qu’il s’agisse de la lutte contre les infections, de l’organisation des blocs opératoires ou du circuit du médicament. Elles portent également sur le développement de la gouvernance clinique.
Ce sont « des références, critères ou éléments d’appréciation pour lesquels des attentes particulièrement signalées sont exprimées. La vérification de l’atteinte de ces exigences par l’équipe d’expert–visiteur sera systématique et bénéficiera d’une approche standardisée. La sélection de ces pratiques est fondée sur l’identification d’exigences jugées fondamentales pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, par la HAS, les parties prenantes et les experts nationaux et internationaux ainsi que sur la capacité de la certification à générer des changements sur le sujet retenu. La non-atteinte de ces exigences conduira systématiquement à une décision de certification péjorative, voire à une non-certification. » (644) Cette menace semble être toutefois difficile à exécuter, puisqu’aux termes de la procédure de certification adoptée par la HAS le 14 mai 2008 « la décision de non-certification ne peut être prononcée en première intention ». Elle ne peut être prise qu’à l’issue d’un second rapport d’inspection.
Le manuel de certification 2007 des établissements de santé édité par la Haute Autorité de santé tenait peu compte des recommandations de l’ANAES de 2002 et 2004. Il comprenait trois références : la prise en compte de la volonté du patient (référence 38 a); la prise en charge des besoins spécifiques du patient en fin de vie et de son entourage (référence 38 b); l’identification et la prise en considération des besoins d’accompagnement psychologique des professionnels (référence 38 c). Les éléments d’appréciation devant figurer dans la référence 38 a. portaient sur : la procédure de recueil des volontés et des directives anticipées du patient ; le respect de ces volontés ; la traçabilité de la volonté du patient dans le dossier et l’évaluation du respect de cette même volonté. S’agissant de la référence 38 b, les éléments d’appréciation renvoyaient à l’identification et à la prise en charge des besoins spécifiques des patients en fin de vie (matelas anti–escarres, accompagnement psychologique…) ; à la traçabilité dans le dossier du patient de ses besoins spécifiques et à l’identification et à la prise en charge des besoins spécifiques de l’entourage du patient en fin de vie.
Le manuel de certification V 2010 dans sa version « pilote » est plus élaboré. Il introduit des niveaux d’exigence croissants (N1 : réponse minimale ou formalisation incomplète des pratiques ou de l’organisation ; N2 : organisation en place ou formalisation de l’organisation et des pratiques ; N3 : fonctionnement maîtrisé avec implication des professionnels et communication organisée et N4 : démarche évaluée ou amélioration continue).
Mais ces référentiels souffrent aujourd’hui de trois défauts majeurs.
D’abord, comme on l’a vu, ils sont imprécis. Ils pèchent en effet par une approche parcellaire des questions d’accompagnement des patients en fin de vie et de leurs proches et ils ont besoin d’être refondus. Le degré de précision et de contrainte imposé par exemple aux professionnels de santé des soins palliatifs par le critère 14 a « Organisation de la prise en charge des patients en fin de vie » est faible : « Les principes de la démarche palliative sont diffusés aux soignants de l’établissement pouvant être concernés par les situations de fin de vie » (Niveau 2) ; « La démarche palliative est mise en œuvre dans l’établissement et est déployée dans tous les secteurs d’activité » (Niveau 3). Une préoccupation comme celle de la pluridisciplinarité se retrouve dans le niveau 4 du critère 14 a : « La prise en charge des patients en fin de vie fait l’objet d’une évaluation pluriprofessionnelle et en lien avec les structures concernées (comité d’éthique ou équivalent, CRUQ, CME, Commission de soins, etc.). Mais quel professionnel de santé ne souscrirait à de telles bonnes intentions ?
Ensuite, ils obéissent à une vision quantitative et institutionnelle du fonctionnement des soins. Cela ressort clairement de la lecture de la circulaire du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs. Celle-ci définit des indicateurs de suivi, à propos des lits identifiés de soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs et des unités de soins palliatifs. Ces indicateurs recouvrent des données purement quantitatives, telles que le nombre de lits identifiés ou le nombre de lits de l’unité de soins palliatifs, le pourcentage de séjours dans l’unité de soins pour des admissions motivées par les soins palliatifs, le pourcentage d’infirmiers et de soignants formés aux soins palliatifs et/ou à la douleur, le pourcentage de retours à domicile parmi les sorties pour les unités de soins palliatifs.
Enfin, les indicateurs ne s’appliquent qu’aux établissements pour la certification de leur activité et non aux services. Or les indicateurs devraient davantage porter sur ce dernier niveau, car c’est dans les services, qui sont les unités de base, que sont traités les malades. C’est en étant au plus près des malades que les indicateurs présenteront un réel intérêt scientifique. Pour tempérer cette critique, ce reproche de distanciation des indicateurs est, il est vrai, moins justifié pour les EMSP et USP, les référentiels d’organisation des soins prévus par la circulaire du 25 mars 2008 correspondant plus aux structures des soins palliatifs. Ce reproche reste en revanche pertinent pour les autres structures de soins.
— Les expériences étrangères
Des exemples étrangers de politique qualitative des soins pourraient également aider à améliorer nos indicateurs.
La démarche australienne a pour caractéristique de mettre l’accent sur les besoins des patients. Les soins palliatifs australiens s’appuient sur un manuel édité par l’Agence d’accréditation des établissements de santé (Australian Council on healthcare Standards). Les éléments d’appréciation des critères portant sur les situations de fin de vie sont organisés en cinq niveaux gradués. Ils vont de la simple prise de conscience à l’affirmation d’un véritable « leadership » dans le domaine, en passant par la mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration. Les principes de base pour la prise en charge du patient en fin de vie ont trait à la non mise en œuvre et au retrait de traitement, à la collégialité dans la prise de décision, sachant que les décisions doivent être transparentes et inscrites dans le dossier et que les professionnels de santé ne sont pas obligés de fournir les traitements qui n’offrent pas ou peu d’intérêt pour le patient.
Au Canada, le Conseil d’agrément des services de santé (Canadian Council on Health Services Accreditation) a mis en place un manuel qui propose des références communes pour toutes les structures accueillant des patients en fin de vie et des références spécifiques pour les structures spécialisées en soins palliatifs et en soins de fin de vie.
Parmi les éléments de la norme commune, on citera l’obligation faite à l’équipe soignante d’aider les patients à maîtriser leur douleur et leurs symptômes et l’aide apportée aux patients et à leur famille pour se préparer à la mort. Quant à la partie spécifique du manuel canadien, elle présente l’intérêt de proposer un système de mesure contribuant à l’évaluation de la mise en œuvre de normes sous forme d’indicateurs :
LES INDICATEUR CANADIENS
Indicateur n° 1 |
Pourcentage de malades qui ont accès aux soins palliatifs et aux services spécialisés en personne et par téléphone 24 heures par jour, 7 jours sur 7. |
Indicateur n° 2 |
Pourcentage de malades pour lesquels un indicateur d’évaluation de la douleur a été utilisé. |
Indicateur n° 3 |
Pourcentage de malades pour lesquels un plan de soins interdisciplinaire a été élaboré. |
Indicateur n° 3a |
Évaluation et la gestion de la douleur et des symptômes. |
Indicateur n° 3b |
Évaluation et la gestion de la douleur et des symptômes mesurés par l’évaluation de la douleur à l’admission. |
Indicateur n° 4 |
Satisfaction de la famille et des soignants (Indice Famcare allant de très satisfait à très insuffisant). |
Indicateur n° 5 |
Pourcentage de clients pour lesquels les buts du malade et de sa famille sont consignés |
Source : Haute autorité de santé, département de certification.
Le référentiel écossais (NHS Quality Improvment Scotland) en matière de soins palliatifs comprend huit normes :
LES NORMES DU RÉFÉRENTIEL ÉCOSSAIS EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS
Accès aux soins palliatifs |
Éléments-clés de la délivrance des soins palliatifs |
Gestion des personnels et des ressources |
Formation professionnelle |
Communication interprofessionnelle |
Communication avec les patients et l’entourage |
Interventions thérapeutiques |
Activité des patients |
Source : Haute autorité de santé, département de certification.
S’il y a une convergence des approches entre les manuels étrangers et les préoccupations françaises, on remarque que le degré de précision des exigences est très variable et que l’intérêt de cette démarche, à travers les différents exemples, réside moins dans la rédaction de normes générales que dans la définition d’indicateurs, d’outils de mesure permettant une réelle évaluation des pratiques médicales.
— Propositions visant à développer les indicateurs qualitatifs dans le domaine des soins palliatifs
Plusieurs indicateurs relatifs à la prise en charge médicale du malade pourraient être aisément identifiés : le soulagement de la douleur et d’autres symptômes gênant la qualité de la vie du patient ; la prise en charge des souffrances psychiques du patient ; la sauvegarde de sa dignité.
La problématique du respect de la procédure médicale peut également nourrir plusieurs indicateurs. Celle-ci appelle des réponses à plusieurs questions :
– Une personne de confiance a-t-elle été désignée ?
– L’autonomie du patient a-t-elle été évaluée ?
– Ses souhaits ont-ils été analysés ?
– Ses proches ont-ils été consultés ?
– Quel est le contenu du dossier médical ?
– L’accès des proches et des bénévoles d’accompagnement, le cas échéant est-il facilité ? Certains services ont ainsi fait le choix de l’ouverture systématique des visites aux patients (service de réanimation de La Pitié-Salpêtrière, de Saint-Louis, unité de soins palliatifs du CHU de Besançon…). Dans le service d’anesthésie–réanimation du Professeur Louis Puybasset à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, « lorsque le temps de la séparation est venu, les familles sont invitées à rester auprès de leur proche le temps qu’elles souhaitent. Elles peuvent rester la nuit dans une démarche d’accompagnement de celui qui part. C’est un temps très important qui est souvent un temps de vérité durant lequel une partie cruciale de l’histoire familiale s’écrit. C’est lors de ce temps que l’empathie de l’équipe soignante sera vraiment sollicitée, voire testée. » (645)
– Le séjour a-t-il été ou non fractionné ? Le Professeur François Goldwasser a souligné la possibilité de prendre en compte la proportion de patients de soins palliatifs réorientés en dehors de l’hôpital, afin d’éviter les phénomènes de fractionnement des séjours (646).
– Selon quelles modalités a été effectuée l’annonce aux proches ? À ce titre on peut évoquer parmi les bonnes pratiques les dispositifs d’annonce aux proches mis en place à l’Hôpital Saint-Louis et dont le Professeur Élie Azoulay s’est fait l’écho : « L’annonce intervient au cours de l’entretien qui suit la décision de limitation thérapeutique, en moyenne cinq à sept jours après le premier jour de réanimation. Elle ne se fait jamais au premier entretien car il est impossible de voir la famille pour la première fois et de lui annoncer une telle nouvelle » (647).
Il est évident que de telles bonnes pratiques peuvent servir de « benchmarking » et engendrer des cercles vertueux, si elles sont diffusées. Il reviendra au futur observatoire de le constater. Ces critères qualitatifs, qui pourraient moduler le financement reçu au titre de la T2A sont indispensables à la diffusion de la culture palliative. C’est seulement par leur prise en compte que la spécificité qualitative des soins palliatifs peut être encouragée par leur mode de financement.
On ne saurait cantonner toutefois cette problématique aux seuls soins palliatifs. Ces indicateurs ont vocation à concerner tous les établissements de santé dans la mesure où ils s’inscrivent dans une logique globale concernant tous les patients et les personnels soignants sans exclusive.
c) Introduire une culture qualitative du soin au-delà des seuls soins palliatifs
Le dossier médical est un acquis important pour l’introduction de la culture palliative en dehors du seul domaine des soins palliatifs. La mission propose de le faire fructifier en diffusant, plus généralement, les indicateurs qualitatifs.
— L’acquis du dossier médical
Le dossier médical constitué pour chaque patient hospitalisé contient d’ores et déjà, faut-il le rappeler, au moins les éléments figurant dans le tableau suivant.
QUELQUES ÉLÉMENTS DU DOSSIER MÉDICAL
Les informations recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement. |
La lettre du médecin à l’origine de la consultation ou de l’admission ; les motifs de l’hospitalisation. |
La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; les conclusions de l’évaluation clinique initiale. |
Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée. |
La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou des passages aux urgences. |
Les informations, relatives à la prise en charge au cours de l’hospitalisation : état clinique ; soins reçus, les examens para-cliniques, notamment d’imagerie ; les informations sur la démarche médicale adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4. |
Le dossier d’anesthésie. |
Le compte-rendu opératoire ou d’accouchement. |
Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire. |
La mention des actes transfusionnels et des incidents transfusionnels. |
Les éléments relatifs à la prescription médicale ; le dossier de soins infirmiers. |
Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé. |
Les correspondances échangées entre professionnels de santé. |
Les directives anticipées. |
Les informations formalisées établies à la fin du séjour avec notamment le compte rendu d’hospitalisation ; la prescription de sortie ; les modalités de sortie ; la fiche de liaison infirmière. |
Source : art. R. 1112-2 du code de la santé publique.
Le dossier médical intègre donc déjà les données de la loi du 22 avril 2005 avec la référence à la procédure de l’article L. 1111-4, les directives anticipées ou la personne de confiance. Mais, outre qu’elles sont loin d’être respectées à la lecture des conclusions du rapport MAHO (Mort à l’hôpital), ces données gagneraient à être précisées, en s’inspirant notamment de pratiques médicales déjà existantes et d’expériences étrangères.
— L’exemple britannique
Les PCT (Primary Care Trusts), à savoir les financeurs du système britannique de santé et les centres hospitaliers passent des conventions (Service Level Agreements) qui intègrent cette variable qualitative. Un tel système qui n’est actuellement qu’au stade de l’ébauche en Angleterre suppose de construire une batterie d’indicateurs cliniques mesurant des résultats médicaux. Il doit déterminer la proportion d’établissements éligibles à un bonus et les pénalités applicables aux établissements se situant en dessous de la moyenne.
Aussi pour faire avancer la réflexion et la politique qualitative des soins, un nouveau champ d’action pour des indicateurs doit être ouvert aussi bien pour les soins palliatifs que pour les soins hospitaliers en général.
— Propositions visant à développer les indicateurs qualitatifs au-delà du domaine des soins palliatifs
Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour favoriser cette culture qualitative.
Pénaliser les détournements de la tarification à l’activité préjudiciables aux soins
Aujourd’hui il y a détournement manifeste de la tarification à l’activité lorsque des établissements font de l’auto-prescription en dehors des groupes homogènes de séjours, lorsqu’ils comptent par exemple deux fois dans le codage des actes deux gestes pratiqués normalement dans le même temps opératoire.
Il y a également détournement lorsque des médecins pour éviter les effets de seuils de la tarification des soins palliatifs font sortir les malades des unités de soins palliatifs pour les y réadmettre quarante-huit heures plus tard. Il en est de même lorsque des lits identifiés de soins palliatifs ne sont pas utilisés pour les soins palliatifs, alors même que les séjours sont déclarés en soins palliatifs.
Corriger ces dérives suppose la mise en place d’indicateurs très détaillés sur le codage des actes médicaux, sur la durée de séjour en unités de soins palliatifs et sur l’utilisation des lits identifiés de soins palliatifs. Cette politique devrait avoir pour effet de compléter une approche trop axée aujourd’hui sur les structures par une approche plus attentive aux séjours eux-mêmes. Elle permettrait de mieux s’assurer de la validité des codages.
Pour éviter les erreurs ou les fraudes concernant le codage des activités des établissements de santé, dénommées comme on l’a vu « gaming » au Royaume-Uni (648), il est indispensable d’augmenter les contrôles en direction des établissements de santé, faute de quoi, la T2A ne garantit aucunement que la hausse statistique du nombre de lits dédiés correspond effectivement à un développement de l’offre de soins palliatifs.
Il serait également nécessaire, en aval, de garantir qu’une partie au moins des forfaits reçus au titre des soins palliatifs (et notamment des LISP), soit réellement réaffectée aux activités de soins palliatifs. Pour ce faire, il pourrait être souhaitable de définir un pourcentage minimal du forfait reçu devant être réinvesti dans les activités de soins palliatifs (USP et EMSP). En effet, le forfait versé au titre des LISP ne doit pas être une simple ligne budgétaire mais doit être la contrepartie de prestations en faveur des soins palliatifs, qu’il s’agisse de la prise en charge palliative des patients, de la formation des personnels, de l’amélioration des lieux d’accueil et de l’appel systématique aux équipes mobiles de soins palliatifs.
Favoriser la qualité des soins
Pourraient être rangés parmi les nouveaux critères de certification définis par la Haute autorité de santé :
— Les réunions de concertation pluridisciplinaire. Celles-ci seraient imposées. Cette option paraît d’autant plus justifiée que comme le souligne le président de la SFAP, le Docteur Godefroy Hirsch « que l’on tienne, dans une situation complexe, une réunion interdisciplinaire ou deux pour voir comment s’adapter au mieux à un patient ne change rien en termes de T2A (649) » ;
— La justification des actes médicaux. Des indicateurs de non-obstination déraisonnable pourraient être conçus dans la perspective de l’administration d’un juste soin. Ainsi il ne serait pas infondé d’analyser les délais séparant la prescription de certains actes médicaux du décès du patient. Un délai trop rapproché entre une chimiothérapie et le décès permettrait par exemple de conclure à une obstination déraisonnable et par conséquent à une méconnaissance de la loi. Le Professeur François Goldwasser a fourni cet exemple auprès des membres de la mission : « Il est difficile de savoir si une chimiothérapie prescrite trois mois avant le décès était appropriée, ou non, mais une chimiothérapie prescrite une semaine ou quinze jours avant est très vraisemblablement inappropriée. Un indicateur de cette nature inviterait les médecins à réfléchir chaque année à leurs pratiques : si x % des patients sont décédés dans les quinze jours qui ont suivi une chimiothérapie, ils se demanderont peut-être si ces actes médicaux étaient fondés. Avoir pour objectif d’améliorer cet indicateur d’année en année pourrait contribuer à diffuser la réflexion sur l’obstination déraisonnable. » (650)
— La mesure des prescriptions de médicaments hors groupe homogène de séjours, en pourcentage des hors indications médicales reconnues et validées et en pourcentage des prescriptions en fin de vie dans le mois qui précède le décès. Comme le suggère le Professeur Louis Puybasset, « On peut très bien quantifier la prescription de médicaments hors Groupe homogène de séjour dans le dernier mois de la vie. Si par exemple, la moyenne est à 7 % sur le territoire national, un établissement qui fait 45 % de sa prescription hors GHS dans le dernier mois de la vie développe manifestement de l’activité sur de l’acharnement. » (651)
— L’intégration des taux d’infections post-opératoires. Un exemple d’indicateur de ce type a été fourni par le Professeur Louis Puybasset : « Dans une opération du genou, la probabilité d’infection est très faible. Si l’hôpital sort de deux écarts types de la moyenne, il faut le pénaliser : il n’y a pas de raison qu’il soit remboursé de la même façon qu’une autre structure qui aurait de bons résultats en termes d’infections post-opératoires. » (652)
Prendre en compte les situations de précarité
Les situations de précarité sont un paramètre à prendre en considération en particulier dans le secteur hospitalier public. La prise en charge des patients en situation de précarité a en effet pour conséquence d’induire de la non-activité médicale par un gel des lits, ces personnes ne disposant pas de facilités d’hébergement. Dans la mesure où la précarité fait partie de la fonction hospice de l’hôpital (653), cette variable doit être incluse dans les indicateurs d’activité. Mme Roselyne Bachelot s’en est émue devant la mission: « Lors de la prochaine campagne tarifaire, qui démarrera au 1er mars 2009, seront introduits dans la classification V11 un coefficient de sévérité, qui permettra de prendre en compte les soins palliatifs, ainsi qu’un coefficient de précarité, tenant compte du nombre de patients bénéficiaires de la CMU ou de l’AME ; les personnes en situation de précarité étant beaucoup plus lourdes à prendre en charge, je veux que, pour éviter qu’on les refuse, les établissements qui les reçoivent soient rémunérés. » (654)
Prendre en compte la comorbidité
La comorbidité induit également une charge en soin supérieure dans le même groupe homogène de séjours qu’il faut intégrer, puisque plusieurs maladies peuvent être associées en même temps. Les différences de durée moyenne de séjour ou de coût se caractérisent en effet souvent par des situations médicales connexes qui ont tendance à augmenter avec l’âge. Repérées par des pathologies associées, elles constituent des comorbidités. Là encore la prochaine classification V11 devrait intégrer ce paramètre dans la codification des actes médicaux.
De fait plusieurs des préoccupations exprimées devant la mission devraient être satisfaites par la nouvelle classification des séjours V11 à venir. Celle-ci devrait recenser quatre niveaux de sévérité pour compenser l’hétérogénéité actuelle des Groupes homogènes de malades (GHM). Les niveaux 3 et 4 seraient destinés à mieux valoriser des morbidités associées sans rapport avec le diagnostic qui a motivé le séjour et des complications éventuelles. La liste des complications et morbidités associées (CMA) doit être refondue à cet effet.
2. La portée des indicateurs qualitatifs
Certains observateurs ne manqueront pas de critiquer la corrélation ainsi établie entre la qualité des soins et leur coût. Mais on aurait tort d’écarter a priori toute réflexion sur la performance des établissements de soins.
Des études américaines menées dans 266 établissements, durant trois ans, ont révélé que les 10 % d’établissements les plus performants étaient également ceux qui avaient le plus réduit leurs coûts par traitement, leur taux de mortalité, leur taux de complication postopératoire et leur taux de réadmission. Par là même cette étude prouvait que l’amélioration de la qualité des soins est en soi un vecteur de réduction des coûts.
Plaidant pour l’introduction d’indicateurs qualitatifs, M. Jean-Paul Guérin membre du collège de la Haute Autorité de Santé et Président de la Commission chargée de définir la procédure et de délivrer les certifications des établissements de santé, publics et privés milite en faveur d’une démarche plus discriminante que la démarche actuelle : « Il faut que tout le monde s’y retrouve : que les professionnels soient reconnus, que les malades sachent où les établissements en sont. Je ne serais pas choqué que l’on donne aux malades les éléments qui leur permettent de faire un choix qu’il s’agisse des soins palliatifs ou d’autres questions. C’est un des rôles de la certification-accréditation. Son autre rôle est de montrer aux établissements les voies du progrès et de les placer dans une dynamique d’amélioration de la qualité et de comparaison entre eux. Cela donnerait à la certification un caractère plus concret. On sait aujourd’hui, à partir des exemples tirés de l’étranger, qu’un établissement est mal à l’aise lorsqu’il constate que d’autres font beaucoup mieux que lui, et que c’est ainsi que la qualité des soins évolue. » (655)
Craignant que la seule définition d’indicateurs (656) ne soit insuffisante pour modifier les mentalités dans les services, le Professeur François Goldwasser a souhaité devant la mission, que ce dispositif soit assorti de mécanismes d’incitation ou de sanction : « En changeant les règles du jeu budgétaire, les pratiques changent du jour au lendemain. On a bien vu l’impact du programme de médicalisation des systèmes d’information. Si demain on envoie un courrier qui signale que le budget augmentera ou diminuera de 5 % selon que tel ou tel indicateur sera mis en place, tout d’un coup, des gens qui n’ont jamais entendu parler de la loi vont se réveiller et auront à cœur d’être vertueux. C’est la direction à prendre. » (657)
Sans aller jusqu’à manier une carotte et un bâton financier dont on mesurerait difficilement les conséquences, il ne serait pas déraisonnable de conditionner le financement d’une activité à son évaluation préalable. Si l’on constate effectivement que 50 % des chimiothérapies sont réalisées dans les quinze jours qui précèdent les décès des patients, la question du juste traitement mérite d’être posée. Cette question est d’autant plus justifiée qu’un traitement comme la chimiothérapie donne droit à une rémunération forfaitaire en sus du GHM et que si son coût est inférieur au forfait versé, il peut être intéressant de la pratiquer.
Ces indicateurs doivent donc être compris comme participant d’un système de contrôle de la justesse des traitements. Leur développement constituerait l’une des solutions aux effets pervers engendrés par la tarification à l’activité. Néanmoins, même si les indicateurs qualitatifs étaient généralisés, deux d’entre eux, au moins, feraient encore problème. Ils sont engendrés, d’une part, par les différences de mode de tarification entre secteurs de soins et, d’autre part, par les importants effets de seuil provoqués par la T2A.
C. AMÉNAGER LE FINANCEMENT DE LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ
Les effets pervers de la tarification à l’activité, notamment dans le domaine des soins palliatifs, ont été fréquemment dénoncés par les personnes interrogées par la mission. Pourtant il ne semble pas souhaitable de revenir sur le financement par la T2A des activités de soins palliatifs, dans les secteurs MCO (médecine, chirurgie et obstétrique). Il est donc nécessaire de trouver d’autres moyens pour remédier aux inconvénients de ce mode de financement.
1. L’inopportunité d’une tarification à la journée
Certaines personnes auditionnées ont même suggéré de changer de mode de financement et de tarifer les soins palliatifs à la journée et non au séjour. C’est le cas notamment de M. Gérard de Pouvourville qui a indiqué : « Je suis assez favorable à un paiement à la journée parce que ce n’est pas un mécanisme inflationniste. Il permettrait de couvrir les coûts d’un patient en phase terminale en fonction de ses besoins. Certains décèdent très vite, et ils ne coûteront pas très cher, d’autres resteront plus longtemps, et ils coûteront plus cher. Au moins n’y aura-t-il pas d’incitation a priori à les balader d’un endroit à l’autre » (658). Ce système existe déjà pour financer les séjours en réanimation, par exemple. Il aurait pour avantage d’éviter tous les effets pervers engendrés par la prise en compte de la durée du séjour (fort variable et indépendante de la compétence de l’équipe médicale dans le domaine des soins palliatifs) dans la rémunération des établissements de santé. Disparaîtraient ainsi les incitations à la sélection des patients ou au fractionnement des séjours, voire à l’obstination déraisonnable ayant pour but de franchir un seuil plus rémunérateur.
Néanmoins, cette solution présente un inconvénient : elle rend plus difficilement comparable les gains qu’un établissement de santé peut espérer en investissant dans les soins palliatifs et ceux qu’il peut retirer d’une autre activité. En isolant les soins palliatifs hors de la tarification à l’activité, les politiques d’incitation à la création des lits dédiés risquent donc d’être moins efficaces. Or, ce sont elles qui ont permis le développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, depuis 2004. Il peut donc paraître inopportun de risquer de brouiller les signaux envoyés aux établissements de santé, en modifiant la rémunération qu’ils obtiennent par leurs activités de soins palliatifs avec le risque éventuel de désinciter les investissements dans ce domaine, quelque temps après l’introduction de la T2A.
2. La nécessité de remédier aux inconvénients du financement par la T2A
Deux types de mesures pourraient remédier toutefois à la plupart des effets pervers engendrés par le financement au séjour des soins palliatifs.
a) Uniformiser le mode de financement des soins palliatifs
La première mesure, essentielle pour la diffusion des soins palliatifs dans les secteurs où ils sont massivement absents, est d’uniformiser leur mode de financement. Le principal facteur de développement des soins palliatifs dans le secteur MCO a en effet été un financement à l’activité attractif. Or, les distorsions entre secteurs soumis à la T2A et secteurs financés par une dotation globale ont entraîné un manque important de soins palliatifs dans les établissements de moyen ou long séjour et dans les établissements médico-sociaux.
Il semble donc important d’unifier le mode de financement des soins palliatifs afin de rééquilibrer l’offre de soins entre secteurs d’activités. Ainsi que l’a indiqué la Ministre de la santé, la généralisation du financement T2A est d’ailleurs prévue pour les soins de suite en 2011 (659). Cette unification, incitative pour les établissements de santé, constitue un levier majeur pour le développement des soins palliatifs dans les secteurs qui sont le plus concernés par des fins de vie difficiles. La mission l’approuve à la double condition que les tarifs attribués aux soins palliatifs soient aussi incitatifs qu’ils le sont aujourd’hui dans le court séjour et qu’ils dépendent davantage d’indicateurs qualitatifs.
En outre afin de lisser les effets de seuil, et donc d’éviter les sorties fictives ou la sélection des patients, voire l’incitation à l’obstination déraisonnable, il est indispensable de réduire les écarts entre les tarifs qui sont versés selon la durée du séjour.
C’est d’ailleurs la direction que semble emprunter le Ministère de la santé. Au cours de son audition, Mme Martine Aoustin, directrice de la mission T2A, a en effet indiqué que le ministère de la santé allait procéder à un aménagement des grilles tarifaires de la T2A (au sein de la version V11 de la grille T2A) et que ces grilles comprendraient une corrélation plus grande entre les tarifs et les durées de séjour, sans pour autant aller jusqu’à une tarification à la journée : « Les séjours les mieux financés concerneront soit les patients très lourds, qui mobilisent des moyens très importants, même sur des durées moyennes, soit des patients dont le degré de sévérité est moindre, mais qui restent plus longtemps. Ainsi, nous prenons en compte le degré de sévérité de la pathologie prise en charge et de la mobilisation de ressources nécessaires, tout en appliquant des seuils de durée de séjour. » (660) La mission juge essentielle cette meilleure corrélation entre durée du séjour et tarif versé à l’établissement de santé.
*
* *
Le Comité de suivi du programme national de développement des soins palliatifs qui vient d’être créé apparaît être tout désigné pour veiller à la bonne application de l’ensemble de ces propositions.
1. Mieux faire connaitre la loi
– Étudier et améliorer l’application de la loi en créant un Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie
Proposition n° 1
Créer par voie réglementaire un Observatoire des pratiques médicales de la fin de vie, chargé d’une double mission : faire connaître la législation sur les droits des malades et la fin de vie ainsi que la législation sur les soins palliatifs ; mener des études sur la réalité des situations médicales de la fin de vie.
Proposition n° 2
Charger l’Observatoire de fournir à la Haute Autorité de Santé des éléments d’information sur les pratiques médicales de la fin de vie, afin d’alimenter les indicateurs qualitatifs élaborés par la Haute Autorité de Santé.
Proposition n° 3
Demander à l’Observatoire de remettre chaque année un rapport au Parlement faisant état des problèmes liés à la fin de vie en France et comportant des études thématiques.
– Favoriser les échanges entre juges et médecins
Proposition n° 4
Instituer entre les parquets généraux, les espaces éthiques régionaux et interrégionaux et les CHU des conventions destinées à mettre en place des échanges entre praticiens, personnels de santé, juristes et magistrats sur les questions soulevées par la fin de vie.
Proposition n° 5
Adresser une circulaire de politique pénale à l’attention de l’ensemble des parquets rappelant les dispositions de la loi du 22 avril 2005 et la nécessité de choisir avec discernement les outils procéduraux et juridiques à leur disposition.
2. Renforcer les droits des malades dans la continuité
des lois de 2002 et de 2005
– Élargir le droit au recours à la procédure collégiale et motiver les éventuels refus opposés aux directives anticipées et à la personne de confiance
Proposition n° 6
Élargir le recours à la procédure collégiale aux patients, par l’intermédiaire des directives anticipées, et à la personne de confiance.
Proposition n° 7
Motiver les éventuels refus médicaux opposés aux directives anticipées et à la personne de confiance.
– Faire appel à des médecins référents en soins palliatifs dans les cas litigieux ou les plus complexes
Proposition n° 8
Désigner dans chaque région, un médecin référent d’unité ou d’équipe mobile de soins palliatifs, pour apporter sa compétence dans des situations complexes ou conflictuelles entre une équipe soignante, d’une part, et le patient et ses proches, d’autre part. Charger le service de la ligne Azur de communiquer les coordonnées du médecin référent. Celui-ci pourra être saisi par le patient, par ses proches ou par les soignants.
– Mettre à l’étude l’institution d’un congé d’accompagnement à titre expérimental
Proposition n° 9
Engager une étude portant sur l’institution à titre expérimental sur un territoire donné d’un congé d’accompagnement. Ce congé d’une durée de quinze jours serait attribué à un parent accompagnant à domicile un patient en fin de vie.
3. Aider les médecins à mieux répondre aux enjeux Éthiques du soin
– Mieux former les médecins à l’éthique et aux soins palliatifs
Proposition n° 10
Développer l’enseignement de l’éthique en le diffusant dans les études médicales, en développant la réflexion éthique pendant les stages et en imposant des questions d’éthique lors de l’examen classant national.
Proposition n° 11
Créer, pour enseigner et diffuser la culture palliative, des chaires de soins palliatifs, pour disposer, à moyen terme, d’une dizaine de chaires autonomes et à plus long terme, d’une chaire par faculté de médecine.
– Préciser les modalités d’application des arrêts de traitement de survie
Proposition n° 12
Préciser dans le code de déontologie médicale les modalités des traitements à visée sédative qui doivent accompagner les arrêts de traitement de survie lorsque la douleur du patient n’est pas évaluable.
4. Adapter l’organisation du système de soins
aux problèmes de la fin de vie
– Poursuivre le développement de l’offre de soins palliatifs
Proposition n° 13
Créer des unités de soins palliatifs avec pour objectif une unité dans chaque région à compter du 1er janvier 2010 et une unité dans chaque département au 1er janvier 2013.
Proposition n° 14
Développer les lits identifiés de soins palliatifs (LISP) dans les secteurs de moyen et de long séjours, afin que le taux de couverture des LISP soit le même dans les différents secteurs.
Proposition n° 15
Publier le décret d’application de l’article L. 162-1-10 du code de la santé publique relatif à la rémunération des soins palliatifs à domicile.
Proposition n° 16
Développer les structures d’hospitalisation de répit, afin de soulager les proches qui prennent en charge un malade en fin de vie à domicile.
– Rendre plus exigeants les indicateurs qualitatifs de soins
Proposition n° 17
Développer des indicateurs prenant en compte la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé et évaluant les pratiques médicales au regard de la proscription de l’obstination déraisonnable sur la base par exemple des éléments suivants : codage et justification des actes médicaux ; durée de séjour en unité de soins palliatifs ; prise en compte des situations de précarité et de comorbidité.
Proposition n° 18
Affecter une partie significative des tarifs versés au titre des lits identifiés de soins palliatifs, au développement des soins palliatifs.
– Aménager le financement de la tarification à l’activité
Proposition n° 19
Mieux prendre en compte la durée des séjours dans le financement par la tarification à l’activité (T2A).
Proposition n° 20
Généraliser en 2011 la tarification à l’activité, sous la forme recommandée par la mission, aux secteurs de long et moyen séjours.
FRANCE
ANNEXE I : Modifications apportées au code de la santé publique et au code de l’action sociale et des familles par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie 243
ANNEXE II : Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 249
ANNEXE III : Décret n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 253
ANNEXE IV : Articles du code pénal relatifs au suicide et aux personnes vulnérables 255
ANNEXE V : Un modèle de directives anticipées 257
ANNEXE VI : La répartition géographique de l’offre de soins palliatifs par département 261
ANNEXE VII : La lettre de saisine du Comité consultatif national d’éthique par la mission 265
ANNEXE VIII : Quelques exemples de structures éthiques 267
ÉTRANGER
ANNEXE IX : La loi néerlandaise du 12 avril 2001 sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et modification du Code pénal et de la loi sur les pompes funèbres 269
ANNEXE X : La loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 277
ANNEXE XI : Le formulaire belge d’enregistrement des euthanasies 285
ANNEXE XII : Les articles du code pénal suisse relatifs à l’homicide, au meurtre et au suicide 293
FRANCE
ANNEXE I :
Modifications apportées au code de la santé publique
et au code de l’action sociale et des familles par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Les modifications introduites par la loi sont portées en gras.
Code de la santé publique
Art. L. 1110-5. — Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Art. L. 1111-4. — Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Art. L1111-10. — Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Art. L1111-11. — Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
À condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Art. L1111-12. — Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Art. L. 1111-13. — Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Art. L. 6114-2. — Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire.
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements, notamment de retour à l'équilibre financier, donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code.
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. À défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
Lors du renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1, les objectifs quantifiés mentionnés à l'alinéa précédent sont révisés.
Lors du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 6122-10, ou lorsque l'autorisation a fait l'objet de la révision prévue à l'article L. 6121-2 ou à l'article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, relatifs à l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de l'autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l'autorisation.
Art. L. 6143-2-2. — Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 311-8. — Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Art. L. 313-12. — I. — Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre. […]
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie
Art. 15. — En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
ANNEXE II :
Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues
par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1111-11 et L. 1111-13 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 octobre 2005 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1. — Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Expression de la volonté relative à la fin de vie
« Art. R. 1111-17. — Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
« Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
« Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.
« Art. R. 1111-18. — Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17, soit révoquées sans formalité.
« Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.
« Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
« Art. R. 1111-19. — Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.
« À cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
« Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
« Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
« Art. R. 1111-20. — Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui la lui a adressée.
« Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R. 1111-18 sont réunies. »
Art. 2. — Au 1° de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. »
Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
ANNEXE III :
Décret n° 2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1111-4, L. 1111-13 et L. 4127-1 ;
Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 22 septembre 2005 ;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1. — L'article R. 4127-37 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-37. — I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
« II. — Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
« Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
ANNEXE IV :
Articles du code pénal relatifs au suicide et aux personnes vulnérables
Art. 223-13. — Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Art. 223-14. — La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Art. 223-15-2. — Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
ANNEXE V :
Un modèle de directives anticipées
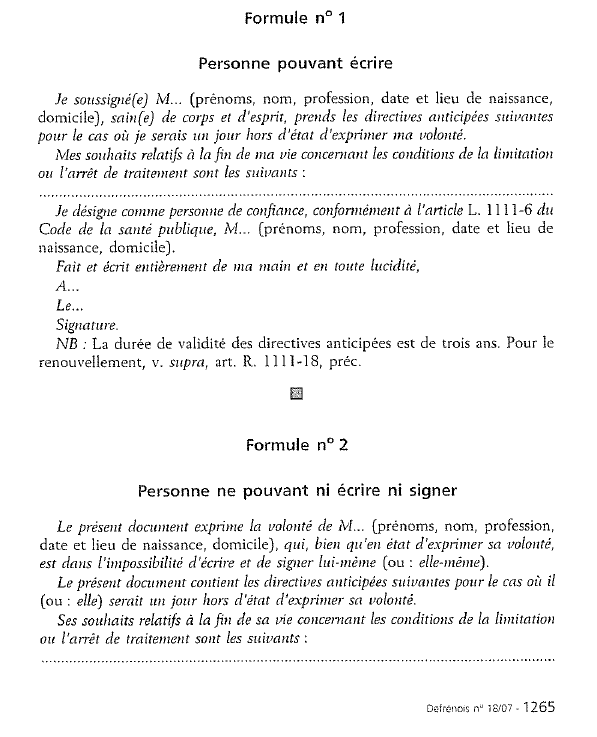
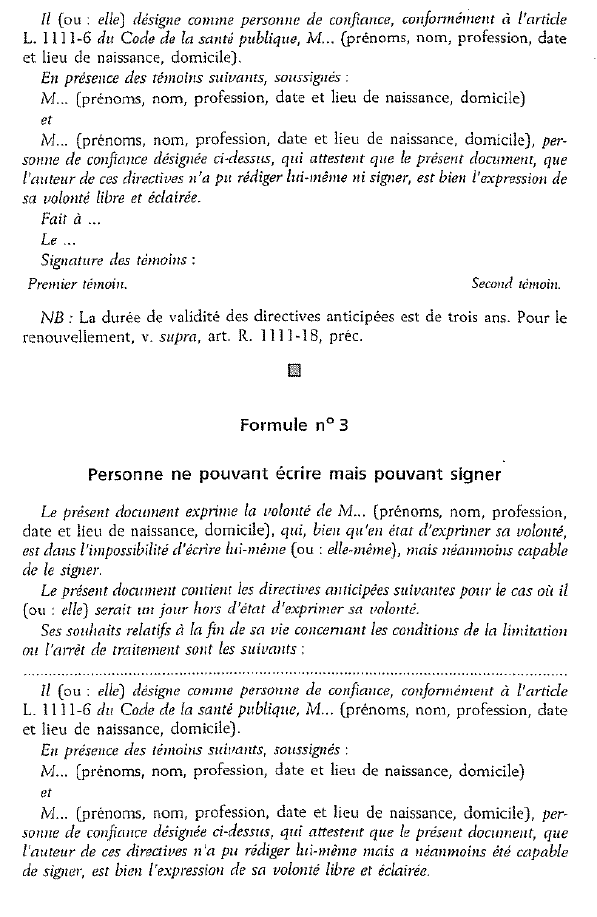
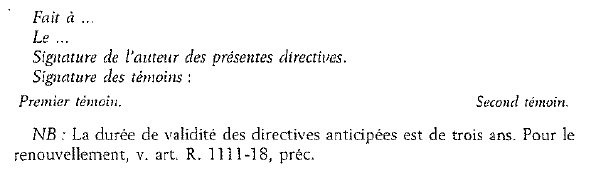
Source : Defrénois, 30 septembre 2007, p. 1262 et suivantes.
ANNEXE VI :
La répartition géographique de l’offre de soins palliatifs par département
Capacités et densité de structures ou de lits de soins palliatifs au 31.12.2007 (équipes mobiles de soins palliatifs, unités de soins palliatifs et lits identiques de soins palliatifs)
Dispositifs de soins |
Équipes |
Unités |
Lits identifiés |
Total lits | ||||||
Départements et |
Population |
Nombre d’EMSP |
Taux EMSP |
Nombre d’USP |
Nombre de lits |
Taux lits USP |
Nombre de LISP |
Taux LISP |
Nombre de lits |
Taux total lits |
Bas-Rhin |
1 076 997 |
5 |
0,93 |
2 |
16 |
1,49 |
31 |
2,88 |
47 |
4,36 |
Haut-Rhin |
739 998 |
3 |
0,81 |
2 |
15 |
2,03 |
33 |
4,46 |
48 |
6,49 |
Total Alsace |
1 816 995 |
8 |
0,88 |
4 |
31 |
1,71 |
64 |
3,52 |
95 |
5,23 |
Dordogne |
402 499 |
1 |
0,50 |
0 |
0 |
0,00 |
5 |
1,24 |
5 |
1,24 |
Gironde |
1 386 996 |
6 |
0,87 |
2 |
21 |
1,51 |
42 |
3,03 |
63 |
4,54 |
Landes |
359 499 |
2 |
1,11 |
0 |
0 |
0,00 |
13 |
3,62 |
13 |
3,62 |
Lot et Garonne |
318 999 |
2 |
1,25 |
0 |
0 |
0,00 |
10 |
3,13 |
10 |
3,13 |
Pyrénées |
630 998 |
2 |
0,63 |
1 |
20 |
3,17 |
29 |
4,60 |
49 |
7,77 |
Total Aquitaine |
3 098 991 |
13 |
0,84 |
3 |
41 |
1,32 |
99 |
3,19 |
140 |
4,52 |
Allier |
341 499 |
2 |
1,17 |
0 |
0 |
0,00 |
12 |
3,51 |
12 |
3,51 |
Cantal |
150 500 |
1 |
1,33 |
0 |
0 |
0,00 |
7 |
4,65 |
7 |
4,65 |
Haute Loire |
217 999 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
6 |
2,75 |
6 |
2,75 |
Puy de Dôme |
622 998 |
3 |
0,96 |
1 |
10 |
1,61 |
40 |
6,42 |
50 |
8,03 |
Total Auvergne |
1 332 996 |
6 |
0,90 |
1 |
10 |
0,75 |
65 |
4,88 |
75 |
5,63 |
Côte d’Or |
513 999 |
3 |
1,17 |
1 |
15 |
2,92 |
34 |
6,61 |
49 |
9,53 |
Nièvre |
221 499 |
2 |
1,81 |
0 |
0 |
0,00 |
11 |
4,97 |
11 |
4,97 |
Saône et Loire |
545 998 |
4 |
1,47 |
0 |
0 |
0,00 |
30 |
5,49 |
30 |
5,49 |
Yonne |
342 499 |
1 |
0,58 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
2,34 |
8 |
2,34 |
Total |
1 623 995 |
10 |
1,23 |
1 |
15 |
0,92 |
83 |
5,11 |
98 |
6,03 |
Côte d’Armor |
569 498 |
1 |
0,35 |
0 |
0 |
0,00 |
35 |
6,15 |
35 |
6,15 |
Finistère |
879 497 |
2 |
0,45 |
2 |
18 |
2,05 |
49 |
5,57 |
67 |
7,62 |
Ille et Vilaine |
938 497 |
3 |
0,64 |
6 |
48 |
5,11 |
33 |
3,52 |
81 |
8,63 |
Morbihan |
693 498 |
3 |
0,87 |
2 |
16 |
2,31 |
33 |
4,76 |
49 |
7,07 |
Total Bretagne |
3 080 990 |
9 |
0,58 |
10 |
82 |
2,66 |
150 |
4,87 |
232 |
7,53 |
Cher |
314 999 |
4 |
2,54 |
0 |
0 |
0,00 |
32 |
10,16 |
32 |
10,16 |
Eure et Loir |
418 999 |
3 |
1,43 |
0 |
0 |
0,00 |
38 |
9,07 |
38 |
9,07 |
Indre |
231 999 |
2 |
1,72 |
0 |
0 |
0,00 |
28 |
12,07 |
28 |
12,07 |
Indre et Loire |
571 498 |
3 |
1,05 |
1 |
10 |
1,75 |
33 |
5,77 |
43 |
7,52 |
Loir et Cher |
322 499 |
3 |
1,86 |
0 |
0 |
0,00 |
40 |
12,40 |
40 |
12,40 |
Loiret |
644 998 |
2 |
0,62 |
0 |
0 |
0,00 |
38 |
5,89 |
38 |
5,89 |
Total Centre |
2 504 992 |
17 |
1,36 |
1 |
10 |
0,40 |
209 |
8,34 |
219 |
8,74 |
Ardennes |
286 499 |
1 |
0,70 |
0 |
0 |
0,00 |
17 |
5,93 |
17 |
5,93 |
Aube |
299 499 |
2 |
1,34 |
1 |
5 |
1,67 |
17 |
5,68 |
22 |
7,35 |
Marne |
566 498 |
3 |
1,06 |
0 |
0 |
0,00 |
65 |
11,47 |
65 |
11,47 |
Haute Marne |
186 499 |
2 |
2,14 |
0 |
0 |
0,00 |
6 |
3,22 |
6 |
3,22 |
Total |
1 338 995 |
8 |
1,19 |
1 |
5 |
0,37 |
105 |
7,84 |
110 |
8,22 |
Corse du Sud |
129 000 |
1 |
1,55 |
1 |
8 |
6,20 |
5 |
3,88 |
13 |
10,08 |
Haute Corse |
150 000 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
6 |
4,00 |
6 |
4,00 |
Total Corse |
279 000 |
1 |
0,72 |
1 |
8 |
2,87 |
11 |
3,94 |
19 |
6,81 |
Doubs |
515 499 |
2 |
0,78 |
1 |
6 |
1,16 |
22 |
4,27 |
28 |
5,43 |
Jura |
255 499 |
3 |
2,35 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
3,13 |
8 |
3,13 |
Haute Saône |
234 999 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Territoire de Belfort |
140 000 |
2 |
2,86 |
0 |
0 |
0,00 |
4 |
2,86 |
4 |
2,86 |
Total |
1 145 997 |
7 |
1,22 |
1 |
6 |
0,52 |
34 |
2,97 |
40 |
3,49 |
Paris |
2 167 994 |
17 |
1,57 |
6 |
164 |
7,56 |
99 |
4,57 |
263 |
12,13 |
Seine et Marne |
1 267 496 |
7 |
1,10 |
0 |
0 |
0,00 |
61 |
4,81 |
61 |
4,81 |
Yvelines |
1 398 496 |
5 |
0,72 |
3 |
31 |
2,22 |
14 |
1,00 |
45 |
3,22 |
Essonne |
1 193 497 |
18 |
3,02 |
5 |
40 |
3,35 |
33 |
2,76 |
73 |
6,12 |
Hauts de Seine |
1 531 996 |
7 |
0,91 |
2 |
43 |
2,81 |
41 |
2,68 |
84 |
5,48 |
Seine St Denis |
1 484 996 |
6 |
0,81 |
2 |
25 |
1,68 |
40 |
2,69 |
65 |
4,38 |
Val de Marne |
1 292 996 |
8 |
1,24 |
3 |
26 |
2,01 |
51 |
3,94 |
77 |
5,96 |
Val d’Oise |
1 153 497 |
6 |
1,04 |
1 |
10 |
0,87 |
60 |
5,20 |
70 |
6,07 |
Total |
11 490 968 |
74 |
1,29 |
22 |
339 |
2,95 |
399 |
3,47 |
738 |
6,42 |
Aude |
339 499 |
3 |
1,77 |
0 |
0 |
0,00 |
19 |
5,60 |
19 |
5,60 |
Gard |
684 998 |
3 |
0,88 |
0 |
0 |
0,00 |
34 |
4,96 |
34 |
4,96 |
Hérault |
992 497 |
4 |
0,81 |
1 |
6 |
0,60 |
58 |
5,84 |
64 |
6,45 |
Lozère |
77 500 |
1 |
2,58 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Pyrénées |
425 499 |
1 |
0,47 |
0 |
0 |
0,00 |
19 |
4,47 |
19 |
4,47 |
Total |
2 519 993 |
12 |
0,95 |
1 |
6 |
0,24 |
130 |
5,16 |
136 |
5,40 |
Creuse |
122 500 |
1 |
1,63 |
0 |
0 |
0,00 |
14 |
11,43 |
14 |
11,43 |
Haute-Vienne |
364 999 |
1 |
0,55 |
1 |
5 |
1,37 |
53 |
14,52 |
58 |
15,89 |
Total |
487 499 |
2 |
0,82 |
1 |
5 |
1,03 |
67 |
13,74 |
72 |
14,77 |
Meurthe-et-Moselle |
723 998 |
6 |
1,66 |
1 |
15 |
2,07 |
78 |
10,77 |
93 |
12,85 |
Meuse |
192 499 |
2 |
2,08 |
0 |
0 |
0,00 |
12 |
6,23 |
12 |
6,23 |
Moselle |
1 039 497 |
4 |
0,77 |
0 |
0 |
0,00 |
74 |
7,12 |
74 |
7,12 |
Vosges |
382 999 |
5 |
2,61 |
0 |
0 |
0,00 |
19 |
4,96 |
19 |
4,96 |
Total Lorraine |
2 338 993 |
17 |
1,45 |
1 |
15 |
0,64 |
183 |
7,82 |
198 |
8,47 |
Ariège |
147 000 |
2 |
2,72 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
5,44 |
8 |
5,44 |
Aveyron |
271 499 |
1 |
0,74 |
0 |
0 |
0,00 |
9 |
3,31 |
9 |
3,31 |
Haute-Garonne |
1 169 497 |
5 |
0,86 |
1 |
10 |
0,86 |
107 |
9,15 |
117 |
10,00 |
Gers |
179 999 |
1 |
1,11 |
0 |
0 |
0,00 |
14 |
7,78 |
14 |
7,78 |
Lot |
168 500 |
2 |
2,37 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
4,75 |
8 |
4,75 |
Hautes-Pyrénées |
230 499 |
4 |
3,47 |
0 |
0 |
0,00 |
29 |
12,58 |
29 |
12,48 |
Tarn |
364 999 |
4 |
2,19 |
0 |
0 |
0,00 |
12 |
3,29 |
12 |
3,29 |
Tarn-et-Garonne |
222 999 |
2 |
1,73 |
0 |
0 |
0,00 |
10 |
4,48 |
10 |
4,48 |
Total |
2 754 992 |
21 |
1,52 |
1 |
10 |
0,36 |
197 |
7,15 |
207 |
7,51 |
Nord |
2 583 493 |
10 |
0,77 |
11 |
104 |
4,03 |
152 |
5,88 |
256 |
9,91 |
Pas-de-Calais |
1 459 496 |
8 |
1,10 |
5 |
44 |
3,01 |
110 |
7,54 |
154 |
10,55 |
Total |
4 042 989 |
18 |
0,89 |
16 |
148 |
3,66 |
262 |
6,48 |
410 |
10,14 |
Calvados |
666 498 |
7 |
2,10 |
0 |
0 |
0,00 |
34 |
5,10 |
34 |
5,10 |
Manche |
489 499 |
4 |
1,63 |
0 |
0 |
0,00 |
27 |
5,52 |
27 |
5,52 |
Orne |
292 999 |
4 |
2,73 |
0 |
0 |
0,00 |
10 |
3,41 |
10 |
3,41 |
Total |
1 448 996 |
15 |
2,07 |
0 |
0 |
0,00 |
71 |
4,90 |
71 |
4,90 |
Eure |
565 498 |
1 |
0,35 |
0 |
0 |
0,00 |
19 |
3,36 |
19 |
3,36 |
Seine-Maritime |
1 245 496 |
5 |
0,80 |
1 |
5 |
0,40 |
63 |
5,06 |
68 |
5,46 |
Total |
1 810 994 |
6 |
0,66 |
1 |
5 |
0,28 |
82 |
4,53 |
87 |
4,80 |
Alpes-de-Haute-Provence |
154 500 |
1 |
1,29 |
0 |
0 |
0,00 |
3 |
1,94 |
3 |
1,94 |
Hautes-Alpes |
133 000 |
1 |
1,50 |
1 |
10 |
7,52 |
4 |
3,01 |
14 |
10,53 |
Alpes-Maritimes |
1 069 997 |
3 |
0,56 |
1 |
6 |
0,56 |
41 |
3,83 |
47 |
4,39 |
Bouches-du-Rhône |
1 916 494 |
8 |
0,83 |
6 |
63 |
3,29 |
23 |
1,20 |
86 |
4,49 |
Var |
973 997 |
3 |
0,62 |
1 |
6 |
0,62 |
21 |
2,16 |
27 |
2,77 |
Vaucluse |
532 998 |
3 |
1,13 |
0 |
0 |
0,00 |
38 |
7,13 |
38 |
7,13 |
Total PACA |
4 780 986 |
19 |
0,79 |
9 |
85 |
1,78 |
130 |
2,72 |
215 |
4,50 |
Loire-Atlantique |
1 219 497 |
6 |
0,98 |
1 |
8 |
0,66 |
61 |
5,00 |
69 |
5,66 |
Maine-et-Loire |
758 998 |
5 |
1,32 |
1 |
5 |
0,66 |
64 |
8,43 |
69 |
9,09 |
Mayenne |
299 499 |
4 |
2,67 |
0 |
0 |
0,00 |
22 |
7,35 |
22 |
7,35 |
Sarthe |
554 998 |
4 |
1,44 |
0 |
0 |
0,00 |
54 |
9,73 |
54 |
9,73 |
Vendée |
592 998 |
4 |
1,35 |
0 |
0 |
0,00 |
44 |
7,42 |
44 |
7,42 |
Total |
3 425 990 |
23 |
1,34 |
2 |
13 |
0,38 |
245 |
7,15 |
258 |
7,53 |
Aisne |
536 498 |
2 |
0,75 |
1 |
5 |
0,93 |
25 |
4,66 |
30 |
5,59 |
Oise |
789 998 |
4 |
1,01 |
1 |
9 |
1,14 |
20 |
2,53 |
29 |
3,67 |
Somme |
559 498 |
2 |
0,71 |
0 |
0 |
0,00 |
22 |
3,93 |
22 |
3,93 |
Total Picardie |
1 885 994 |
8 |
0,85 |
2 |
14 |
0,74 |
67 |
3,55 |
81 |
4,29 |
Charente |
344 499 |
3 |
1,74 |
0 |
0 |
0,00 |
23 |
6,68 |
23 |
6,68 |
Charente-Maritime |
595 998 |
5 |
1,68 |
0 |
0 |
0,00 |
29 |
4,87 |
29 |
4,87 |
Deux-Sèvres |
353 499 |
4 |
2,26 |
0 |
0 |
0,00 |
16 |
4,53 |
16 |
4,53 |
Vienne |
418 999 |
2 |
0,95 |
0 |
0 |
0,00 |
26 |
6,21 |
26 |
6,21 |
Total |
1 712 995 |
14 |
1,63 |
0 |
0 |
0,00 |
94 |
5,49 |
94 |
5,49 |
Ain |
564 998 |
1 |
0,35 |
1 |
10 |
1,77 |
9 |
1,59 |
19 |
3,36 |
Ardèche |
303 999 |
3 |
1,97 |
1 |
6 |
1,97 |
19 |
6,25 |
25 |
3,22 |
Drôme |
466 499 |
4 |
1,71 |
1 |
5 |
1,07 |
16 |
3,43 |
21 |
4,50 |
Isère |
1 171 997 |
4 |
0,68 |
0 |
0 |
0,00 |
55 |
4,69 |
55 |
4,69 |
Loire |
732 998 |
4 |
1,09 |
1 |
8 |
1,09 |
45 |
6,14 |
53 |
7,23 |
Rhône |
1 667 495 |
6 |
0,72 |
3 |
32 |
1,92 |
87 |
5,22 |
119 |
7,14 |
Savoie |
403 499 |
2 |
0,99 |
1 |
10 |
2,48 |
18 |
4,46 |
28 |
6,94 |
Haute-Savoie |
693 498 |
3 |
0,87 |
0 |
0 |
0,00 |
48 |
6,92 |
48 |
6,92 |
Total |
6 004 983 |
27 |
0,90 |
8 |
71 |
1,18 |
297 |
4,95 |
363 |
6,13 |
Guadeloupe |
447 002 |
2 |
0,89 |
1 |
12 |
2,68 |
0 |
0,00 |
12 |
2,68 |
Martinique |
399 002 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
8 |
2,01 |
8 |
2,01 |
Guyane |
201 996 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
La Réunion |
783 996 |
2 |
0,51 |
1 |
6 |
0,77 |
6 |
0,77 |
12 |
1,53 |
France entière |
62 998 818 |
340 |
1,08 |
89 |
937 |
1,49 |
3 075 |
4,88 |
4 012 |
6,37 |
Sources : DHOS (données provisoires) – population : INSEE
ANNEXE VII :
La lettre de saisine du Comité consultatif national d’éthique par la mission
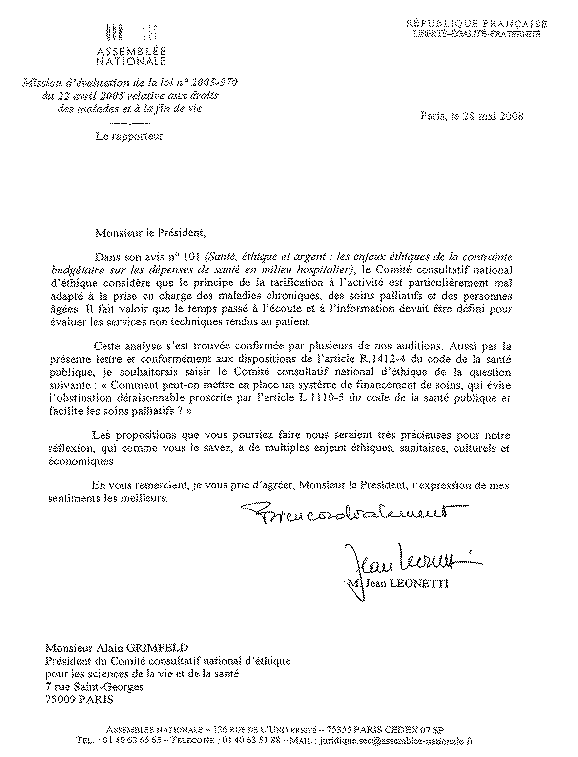
ANNEXE VIII :
Quelques exemples de structures éthiques
Le Comité consultatif lorrain d’éthique médicale (CHU de Nancy) ; créé dans les années 1970, il a pour objectif de répondre aux interrogations de toute équipe soignante ou de toute personne du CHU, administration y compris. Ses membres participent en outre à diverses activités pédagogiques et enseignements, en partenariat avec les universités. Il s’est transformé en 2007 en Comité de réflexion éthique nancéen hospitalo-universitaire (CRENHU).
Le Centre d’éthique médicale de Lille ; ce centre de recherche interdisciplinaire sur les questions éthiques et philosophiques posées par l’évolution des connaissances et des pratiques dans le champ de la santé, de la médecine et de la recherche biomédicale a vu le jour en 1984. Il a été constitué en équipe de recherche en 1988. Ses activités recouvrent trois pôles : un pôle recherche dans lequel le CEM s’attache à observer les pratiques médicales et de recherche en analysant le contexte où se déploient ces pratiques ; un pôle formation et un pôle documentation qui s’attache à recenser le maximum de publications sur la bioéthique. Ce centre semble relever de l’Institut catholique de Lille et ne paraît pas avoir de statut juridique propre.
L’Espace éthique méditerranéen de l’AP-HM (Marseille) est un lieu de rencontres au service des soignants, médecins, chercheurs et de tous les représentants de la société civile qui se sentent concernés par les problèmes d’éthique médicale. Par la voie d’un master « éthique, science, santé et société » ainsi qu’en raison d’autres formations diplômantes, c’est aussi un pôle de recherche universitaire. L’enseignement dispensé par la Faculté de médecine de Marseille, en collaboration avec l’espace éthique, débouche notamment sur l’attribution d’un diplôme universitaire d’éthique médicale et un diplôme interuniversitaire d’éthique et de pratiques médicales. C’est par une décision du 12 juillet 2002 que l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille a reconnu l’Espace éthique méditerranéen comme centre de responsabilité à caractère non médical. Une convention a été signée le 11 juin 2002 entre l’AP-HM et l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2.
L’Espace éthique hospitalier d’Amiens-Picardie reçoit, depuis 2003, les questionnements éthiques des personnes impliquées dans le domaine de la santé de la région Picardie. Outre des travaux de recherche et l’exploitation d’outils bibliographiques, il organise plusieurs cycles de formation par an et travaille aussi bien avec les instituts paramédicaux attachés au CHU qu’avec d’autres instituts de formation et des établissements scolaires. Des réunions mensuelles ont pour objet, à partir d’une saisine, d’examiner une situation clinique ou un questionnement sur un fonctionnement hospitalier ou institutionnel.
L’Espace de réflexion éthique du CHU de Brest, créé en octobre 2004, est une fédération fondée paritairement par le CHU de Brest et la faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de l’Université de Bretagne Occidentale dans le cadre de la convention hospitalo-universitaire prévue par le décret n° 74-369 du 29 avril 1974. Cette fédération est dépourvue de personnalité morale. L’espace a pour ambition d’apporter, à tous les professionnels de santé, en formation ou en activité, quels que soient leur mode et leur lieu d’exercice, des réponses aux besoins de formation et de documentation. Il vise en outre à constituer un lieu de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé, ainsi qu’un observatoire des pratiques au regard de l’éthique.
Certaines structures ont fait le choix de s’insérer dans l’institution hospitalière. Il en va ainsi par exemple du Comité local d’éthique du centre hospitalier d’Avignon, créé en janvier 2005. Il s’agit d’une instance pluridisciplinaire composée de professionnels de santé et des personnes choisies pour leurs compétences ou leur intérêt pour les problèmes d’éthique. Elle a pour mission de prendre connaissance de problèmes d’éthique que l’établissement peut rencontrer. Ses réflexions et ses débats, en toute indépendance et confidentialité, sur des questions concrètes comme sur des thèmes généraux, donnent lieu à des comptes-rendus et des recommandations. Ses avis restent purement consultatifs et informatifs. Les « staffs éthiques » créés au sein des services hospitaliers en particulier dans les disciplines sensibles comme la réanimation ou la périnatalité répondent à l’obligation légale d’organiser une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale (article L. 6111-1 du code de la santé publique).
ÉTRANGER
ANNEXE IX :
La loi néerlandaise du 12 avril 2001 sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et portant modification du code pénal et de la loi sur les pompes funèbres
Sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et modification du code pénal et de la loi sur les pompes funèbres.
Chapitre Ier
Définitions
Art. 1er. — Dans la présente loi, on entend par :
a) Nos ministres : le ministre de la Justice et la ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
b) Aide au suicide : le fait d’aider intentionnellement un autre à se suicider ou de procurer à un autre les moyens à cet effet, visé à l’article 294, paragraphe 2, du code pénal ;
c) Le médecin : le médecin qui, conformément au signalement, a pratiqué l’interruption de la vie sur demande ou l’aide au suicide ;
d) Le conseiller : le médecin consulté lorsqu’un médecin a l’intention de pratiquer l’interruption de la vie sur demande ou l’aide au suicide ;
e) Les intervenants : les intervenants visés à l’article 446, paragraphe 1, du livre 7 du code civil ;
f) la commission : une commission régionale de contrôle comme visé à l’article 3 de la présente loi ;
g) l’inspecteur régional : l’inspecteur régional de la santé du Service national de contrôle de la santé publique.
Chapitre II
Critères de rigueur
Art. 2. —
1° Selon les critères de rigueur visés à l’article 293, paragraphe 2, du code pénal, le médecin doit :
a) Avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie ;
b) Avoir acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans perspective d’amélioration ;
c) Avoir informé le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes ;
d) Conjointement avec le patient, être parvenu à la conviction qu’il n’existait pas d’autre solution raisonnable dans la situation où se trouvait le patient ;
e) Avoir consulté au moins un autre médecin indépendant, qui a vu le patient et a donné par écrit son jugement concernant les critères de rigueur visés aux points a à d ;
f) Avoir pratiqué l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale requise.
2° Si le patient âgé de seize ans ou plus n’est plus capable d’exprimer sa volonté, mais qu’avant d’être dans cet état, il était jugé capable d’apprécier convenablement ses intérêts en la matière et a fait une déclaration écrite dans laquelle il demande l’interruption de la vie, le médecin peut donner suite à cette demande. Les critères de rigueur visés au paragraphe 1 sont applicables par analogie.
3° Si le patient mineur a entre seize ans et dix-huit ans et peut être jugé capable d’apprécier convenablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande d’interruption de la vie ou d’aide au suicide après que le parent ou les parents investis de l’autorité parentale ou le tuteur ont été associés à la décision.
4° Si le patient mineur est âgé entre douze ans et seize ans et peut être jugé capable d’apprécier convenablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande si le parent ou les parents investis de l’autorité parentale ou le tuteur peuvent accepter l’interruption de la vie ou l’aide au suicide. L’article 2 est applicable par analogie.
Chapitre III
Commissions régionales de contrôle de l’interruption
de la vie sur demande et de l’aide au suicide
Paragraphe 1 : Instauration, composition et nomination
Art. 3. —
1° Il existe des commissions régionales chargées de contrôler les signalements de cas d’interruption de la vie sur demande et d’aide au suicide visés respectivement à l’article 293, paragraphe 2, et à l’article 294, paragraphe 2, deuxième phrase, du code pénal.
2° Une telle commission comprend un nombre impair de membres, parmi lesquels au moins un juriste, faisant office de président, un médecin et un spécialiste des questions d’éthique ou philosophiques. En font partie également les suppléants des membres de chacune des catégories citées dans la première phrase.
Art. 4. —
1° Le président, les membres et les suppléants sont nommés par Nos ministres pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois pour une durée de six ans.
2° Les commissions ont un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants, tous juristes, qui sont nommés par Nos ministres. Le secrétaire a voix consultative dans les réunions de la commission.
3° Le secrétaire rend compte exclusivement à la commission de ses travaux pour la commission.
Paragraphe 2 : Démission
Art. 5. — Le président, les membres et les suppléants peuvent à tout moment être démis de leurs fonctions, à leur demande, par Nos ministres.
Art. 6. — Le président, les membres et les membres suppléants peuvent être démis de leurs fonctions par Nos ministres pour incapacité ou incompétence ou pour tout autre motif grave.
Paragraphe 3 : Rémunération
Art. 7. — Il est versé au président, aux membres et aux membres suppléants une vacation ainsi qu’une indemnité de voyage et de séjour conformément aux règlements de l’État, pour autant que ces frais ne leur soient pas remboursés à un autre titre par le Trésor public.
Paragraphe 4 : Tâches et compétences
Art. 8. —
1° La commission juge, en s’appuyant sur le rapport visé à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les pompes funèbres, si le médecin qui a pratiqué l’interruption de la vie sur demande ou l’aide au suicide a agi conformément aux critères de rigueur visés à l’article 2.
2° La commission peut demander au médecin de compléter son rapport, par écrit ou verbalement, si cela est nécessaire pour évaluer correctement ses actes.
3° La commission peut recueillir des informations auprès du médecin légiste de la commune, du conseiller ou des intervenants concernés si cela est nécessaire pour évaluer correctement les actes du médecin.
Art. 9. —
1° La commission communique par écrit son jugement motivé au médecin dans un délai de six semaines à compter de la réception du rapport visé à l’article 8, paragraphe 1.
2° La commission communique son jugement motivé au Collège des procureurs généraux du ministère public et à l’inspecteur régional de la santé :
a) Si elle juge que le médecin n’a pas agi conformément aux critères de rigueur visés à l’article 2 ; ou
b) Dans la situation visée à l’article 12, dernière phrase, de la loi sur les pompes funèbres. La commission en informe le médecin.
3° Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé une fois d’une durée maximale de six semaines. Si tel est le cas, la commission en informe le médecin.
4° La commission est habilitée à expliciter oralement devant le médecin, à sa propre demande ou sur demande du médecin, le jugement formulé par elle.
Art. 10. — La commission est tenue de fournir au procureur de la Reine, sur demande, toutes les informations dont il a besoin :
1° Pour évaluer les actes du médecin dans le cas visé à l’article 9, paragraphe 2 ; ou
2° Aux fins d’une enquête judiciaire.
La commission fait savoir au médecin que des informations ont été communiquées au procureur de la Reine.
Paragraphe 6 : Méthode de travail
Art. 11. — La commission fait enregistrer les cas d’interruption de la vie sur demande ou d’aide au suicide signalés aux fins de contrôle.
Art. 12. —
1° Le jugement est arrêté à la majorité simple des voix.
2° La commission ne peut arrêter son jugement que si tous ses membres ont participé au vote.
Art. 13. — Les présidents des commissions régionales de contrôle se concertent au moins deux fois par ans sur les méthodes et le fonctionnement des commissions. Un représentant du Collège des procureurs généraux et un représentant de l’inspection de la santé du Service national de contrôle de la santé publique sont invités à cette concertation.
Paragraphe 7 : Confidentialité et excuse
Art. 14. — Les membres et les membres suppléants de la commission sont tenus au respect de la confidentialité à l’égard des données portées à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction, sauf si une prescription légale les oblige à les communiquer ou si la nécessité de les communiquer découle de leur tâche.
Art. 15. — Un membre de la commission qui siège à la commission aux fins de l’examen d’une affaire s’excuse et peut être révoqué si des faits ou des circonstances sont susceptibles de nuire à l’impartialité de son jugement.
Art. 16. — Un membre, un membre suppléant et le secrétaire de la commission s’abstiennent de porter un jugement sur l’intention qu’a un médecin de pratiquer l’interruption de la vie sur demande ou l’aide au suicide.
Paragraphe 8 : Rapports
Art. 17—
1° Les commissions adressent tous les ans, avant le 1er avril, à Nos ministres un rapport d’activités pour l’année civile écoulée. Nos ministres arrêtent à cet effet un modèle, par règlement ministériel.
2° Le rapport d’activités visé au paragraphe 1 mentionne dans tous les cas :
a) Le nombre de cas signalés d’interruption de la vie sur demande et d’aide au suicide sur lesquels la commission a porté un jugement ;
b) La nature de ces cas ;
c) Les jugements de la commission et les considérations qui y ont présidé.
Art. 18. — Tous les ans, à l’occasion de la soumission du budget aux États généraux, Nos ministres font un rapport sur le fonctionnement des commissions en se référant au rapport d’activité visé à l’article 17, paragraphe 1.
Art. 19. —
1° Sur proposition de Nos ministres, des règles sont arrêtées par règlements d’administration publique concernant :
a) Le nombre et les compétences relatives, et
b) Le lieu d’établissement des commissions.
Chapitre IV
Modification d’autres lois
Art. 20. — Le code pénal est modifié comme suit :
A) L’article 293 se lit comme suit :
Art. 293. —
1° Celui qui, intentionnellement, ôte la vie à un autre pour répondre à sa demande expresse et sincère, est puni d’un emprisonnement de douze ans au plus ou d’une amende de la cinquième catégorie.
2° Le fait visé au paragraphe 1 n’est pas punissable s’il est commis par un médecin qui respecte les critères de rigueur visés à l’article 2 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et qui le signale au médecin légiste de la commune conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les pompes funèbres.
B) L’article 294 se lit comme suit :
Art. 294. —
1° Celui qui, intentionnellement, incite un autre au suicide est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie.
2° Celui qui, intentionnellement, aide un autre à commettre un suicide ou lui en procure les moyens, est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie. L’article 293, paragraphe 2, est applicable par analogie.
C) Dans l’article 295 sont insérés, après « 295 » les mots « , paragraphe 1, ».
D) Dans l’article 422 sont insérés, après « 293 » les mots « , paragraphe 1, ».
Art. 21. — La loi sur les pompes funèbres est modifiée comme suit :
A) L’article 7 se lit comme suit :
Art. 7. —
1° Celui qui a fait l’autopsie établit un certificat de décès s’il est convaincu que la mort est la conséquence d’une cause naturelle.
2° Si le décès est subséquent à une interruption de la vie sur demande ou à une aide au suicide visées respectivement à l’article 293, paragraphe 2, et à l’article 294, paragraphe 2, deuxième phrase, du code pénal, le médecin traitant n’établit pas de certificat de décès et communique sur-le-champ au médecin légiste ou à un des médecins légistes de la commune la cause du décès, en remplissant un formulaire. Le médecin joint à cette communication un rapport motivé sur le respect des critères de rigueur visés à l’article 2 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide.
3° Si, dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2, le médecin traitant juge qu’il ne peut pas établir de certificat de décès, il le fait savoir sur-le-champ au médecin légiste ou à un des médecins légistes de la commune, en remplissant un formulaire.
B) L’article 9 se lit comme suit :
Art. 9. —
1° La forme et l’organisation des modèles de certificat de décès, à délivrer par le médecin traitant et par le médecin légiste de la commune, sont fixées par un règlement d’administration publique.
2° La forme et l’organisation des modèles de la communication et du rapport visés à l’article 7, paragraphe 2, des modèles de la communication visée à l’article 7, paragraphe 3, et des formulaires visés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, sont fixées par un règlement d’administration publique sur ordre de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, du Bien-Être et des Sports.
C) L’article 10 se lit comme suit :
Art. 10. —
1° Si le médecin légiste de la commune juge qu’il ne peut pas établir de certificat de décès, il en fait rapport sur-le-champ, en remplissant un formulaire, au procureur de la Reine et avertit sur-le-champ le fonctionnaire de l’état civil.
2° Sans préjudice du paragraphe 1, dans le cas d’une communication comme visé à l’article 7, paragraphe 2, le médecin légiste de la commune fait immédiatement rapport, en remplissant un formulaire, à la commission régionale de contrôle visée à l’article 3 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide. Il y joint le rapport motivé visé à l’article 7, paragraphe 2.
D) Une phrase, libellée comme suit, est rajoutée à l’article 12 :
Si le procureur de la Reine, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 2, juge qu’il ne peut pas délivrer de déclaration de non-opposition à l’inhumation ou à l’incinération, il en informe sur-le-champ le médecin légiste de la commune et la commission régionale de contrôle visée à l’article 3 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide.
E) À l’article 81, première partie, les mots « 7, paragraphe 1, » sont remplacés par les mots « 7, paragraphes 1 et 2, ».
Art. 22. — La loi générale sur les procédures administratives est modifiée comme suit :
À l’article 1:6, à la fin du point d, le point est remplacé par un point-virgule et il est rajouté un cinquième point libellé comme suit :
e) des décisions et des actes en vue de l’exécution de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 23. — La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par décret royal.
Article 24. — La présente loi est appelée : loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et sur l’aide au suicide.
Mandons et ordonnons que les présentes soient publiées au Staatsblaad et que tous les départements ministériels, autorités, corps constitués et fonctionnaires concernés veillent à leur stricte exécution.
Le ministre de la Justice,
La ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports
ANNEXE X :
La loi belge du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie
ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 2. — Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci.
CHAPITRE II
Des conditions et de la procédure
Art. 3. —
§ 1er. — Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que :
— le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ;
— la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure ;
— le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
§ 2. — Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas :
1° Informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ;
2° S'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient ;
3° Consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ;
4° S'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci ;
5° Si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne ;
6° S'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
§ 3. — Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit, en outre :
1° Consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation ;
2° Laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.
§ 4. — La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.
Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient.
§ 5. — L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
CHAPITRE III
De la déclaration anticipée
Art. 4. — § 1er— Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate :
— qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
— qu'il est inconscient ;
— et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science.
La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés comme personnes de confiance.
La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s'il échet, par la ou les personnes de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à la déclaration.
La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté.
La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment.
Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins concernés, via les services du Registre national.
§ 2. — Un médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d'une déclaration anticipée, telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient :
— est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
— est inconscient ;
— et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science ;
— et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.
Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention, il doit préalablement :
1° Consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation.
Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée ;
2° S'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci ;
3° Si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la volonté du patient ;
4° Si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne.
La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
CHAPITRE IV
De la déclaration
Art. 5. — Le médecin qui a pratiqué une euthanasie remet, dans les quatre jours ouvrables, le document d'enregistrement visé à l'article 7, dûment complété, à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation visée à l'article 6 de la présente loi.
CHAPITRE V
La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation
Art. 6. — § 1er. — Il est institué une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la présente loi, ci-après dénommée « la commission ».
§ 2. — La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région.
Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique – chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe – et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en laquelle il siège. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président d'expression française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif.
La commission ne peut délibérer valablement qu'à la condition que les deux tiers de ses membres soient présents.
§ 3. — La commission établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 7. — La commission établit un document d'enregistrement qui doit être complété par le médecin chaque fois qu'il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il contient les données suivantes :
1° les nom, prénoms et domicile du patient ;
2° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin traitant ;
3° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'euthanasie ;
4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations ;
5° s'il existait une déclaration anticipée et qu'elle désignait une ou plusieurs personnes de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) intervenue(s).
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne peut être consulté qu'après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir de base à la mission d'évaluation de la commission.
Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes :
1° le sexe et les date et lieu de naissance du patient ;
2° la date, le lieu et l'heure du décès ;
3° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient ;
4° la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ;
5° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable ;
6° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure ;
7° si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ;
8° s'il existe une déclaration de volonté ;
9° la procédure suivie par le médecin ;
10° la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces consultations ;
11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces consultations ;
12° la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés.
Art. 8. — La commission examine le document d'enregistrement dûment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxième volet du document d'enregistrement, si l'euthanasie a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document d'enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l'euthanasie.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient.
Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour l'examen de cette affaire par la commission.
Art. 9. — La commission établit à l'intention des Chambres législatives, la première fois dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans :
a) Un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l'article 8 ;
b) Un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de la présente loi ;
c) Le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la présente loi.
Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l'article 8.
La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts.
Art. 10. — Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions.
Art. 11. — Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions.
Art. 12. — Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l'application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Art. 13. — Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la commission, visés à l'article 9, les Chambres législatives organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de gouvernement ayant la confiance des Chambres législatives.
CHAPITRE VI
Dispositions particulières
Art. 14. — La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante.
Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie.
Aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.
Art. 15. — La personne décédée à la suite d'une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d'assurance.
Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables aux membres de l'équipe soignante visés à l'article 3.
Art. 16. — La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le formulaire belge d’enregistrement des euthanasies
|
Formulaire à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi relative à l’euthanasie dans les quatre jours ouvrables qui suivent l’euthanasie à l’adresse suivante: Commission fédérale de contrôle et d’évaluation (CFCEE) Rue de l’Autonomie 4 1070 Bruxelles |
Les renvois aux articles dans ce document se réfèrent à la loi
relative à l’euthanasie du 28 mai 2002 (Moniteur belge du 22 juin 2002).
Conformément à la loi relative à l’euthanasie, une distinction est faite dans le formulaire d’enregistrement entre une euthanasie pratiquée sur base d’une “demande d’euthanasie” et une euthanasie pratiquée sur base d’une “déclaration anticipée”.
La demande d’euthanasie est une demande faite par un malade qui se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable (art. 3).
Par contre, une déclaration anticipée est une demande d’euthanasie faite à l’avance pour le cas où on se trouverait, à un moment ultérieur de la vie, dans une situation d’inconscience irréversible et qu’on souffrirait d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable (art. 4).
Le texte encadré ci-dessus a été pris en considération (cocher la case) : ☐
VOLET I Informations personnelles relatives au/à la patient(e), au médecin, aux médecins consultés et à d’autres personnes. Ce volet est strictement confidentiel. Il doit être scellé par le médecin et ne peut être ouvert que par décision de la commission. Il ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la commission à l’intention des chambres législatives. |
1. le/la patient(e) 1.1 nom : Encoder ici 1.2 prénoms : 1.3 domicile : |
2. le médecin 2.1 nom : 2.2 prénoms : 2.3 numéro d’enregistrement INAMI : 2.4 domicile : |
3. médecins consultés obligatoirement : 3.1 un autre médecin ( dans tous les cas, art.3, §2, 3° et art.4, §2, 1°) nom : prénom : domicile : numéro d’enregistrement INAMI : date de la consultation : 3.2 si le médecin était d’avis que le décès n’interviendrait manifestement pas à brève échéance, deuxième médecin consulté (art.3, §3, 1°) : nom : prénom : domicile : numéro d’enregistrement INAMI : date de la consultation :
|
4. autres personnes (celles envisagées entre autres à l’art.3 §2, 4°, 5°, 6° et art.4 §2,2°,3°,4°) 4.1 nom : prénom : qualité : domicile : date de la consultation : 4.2 nom : prénom : qualité : domicile : date de la consultation : 4.3 nom : prénom : qualité : domicile : date de la consultation : 4.4 nom : prénom : qualité : domicile : date de la consultation : 4.5 nom : prénom : qualité : domicile : date de la consultation : 4.6 S’il s’agit d’une euthanasie pratiquée sur base d’une déclaration anticipée nom de la 1ère personne de confiance éventuellement désignée : prénom : date de la consultation : nom de la 2e personne de confiance éventuellement désignée : prénom : date de la consultation : : |
DATE, SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN
VOLET II Conditions et procédure à suivre dans le cadre de l’euthanasie Ce volet est également confidentiel ; il servira de base au contrôle de la commission afin de vérifier si l’euthanasie a été effectuée selon les conditions et les procédures prévues par la loi. Il ne doit comporter aucun nom (patient, médecin, institution, etc) |
1. le/la patient(e) (ne pas mentionner son identité) lieu et date de naissance : sexe : |
2. date du décès : (j, m, a) heure du décès : h lieu du décès (cocher la case qui convient) : domicile ☐ maison de repos et de soins ☐ hôpital ☐ autre ☐ |
3. nature de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le/la patient(e) (diagnostic précis) : (en maximum 6 lignes) : |
S’il s’agit d’une euthanasie d’un(e) patient(e) inconscient(e) pratiquée sur base d’une déclaration anticipée antérieurement établie, passer les points 4 à 12 et aller directement au point 13. | |
4. nature et description de la souffrance constante et insupportable : |
|
5. raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d’inapaisable : | |
6. éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure : | |
7. pouvait-on estimer que le/la patient(e) allait décéder à brève échéance ? oui ☐ non ☐ | |
8. procédure suivie par le médecin (art.3) (cocher et compléter si nécessaire) ☐ existence d’une demande d’euthanasie actée par écrit (art.3, §4) ☐ rédigée, datée et signée par le/la patient(e) ou ☐ si le/la patient(e) en était physiquement incapable, actée, en présence du médecin, par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel à son décès les raisons pour lesquelles le/la patient(e) n’était pas en état de formuler sa demande par écrit ni de la signer y sont mentionnées ☐ ☐ information du/de la patient(e) sur son état de santé et sur son espérance de vie (art. 3, §2, 1°) ☐ concertation avec le/la patient(e) sur sa demande d’euthanasie (art. 3, § 2, 1°) ☐ information du/de la patient(e) sur les possibilités thérapeutiques encore envisageables et leurs conséquences (art 3, §2, 1°) ☐ information du/de la patient(e) sur les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences (art.3, §2, 1°) ☐ persistance de la souffrance physique ou psychique du/de la patient(e) (art.3, §2, 2°) ☐ demande réitérée d’euthanasie (art.3, §2, 2°) ☐ entretien avec l’équipe soignante ou les membres de celle-ci au sujet de la demande (art.3, §2, 4°) ☐ entretien avec les proches désignés par le/la patient(e) au sujet de la demande (art.3, §2, 5°) ☐ entretien du/de la patient(e) avec les personnes qu’il/elle souhaitait rencontrer (art.3, §2, 6°) ☐ l’ensemble de la procédure suivie ainsi que les documents écrits sont consignés au dossier médical (art.3, §5) | |
|
9. médecins indépendants à consulter obligatoirement (ne pas mentionner leur identité) : 9.1 un autre médecin (dans tous les cas, art 3, §2, 3°)
qualification du médecin : date de la consultation quant au caractère grave incurable de l’affection et au caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance: avis du médecin consulté sur ces points (selon son rapport écrit) : 9.2 éventuellement un deuxième médecin (dans le cas prévu à l’art. 3, §3, 1°) qualification du médecin : date de la consultation quant au caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et au caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande: avis du médecin consulté sur ces points (selon son rapport écrit) : |
10. autres personnes ou instances consultées (ne pas mentionner leur identité) 10.1 qualité : date de la consultation : 10.2 qualité : date de la consultation : 10.3 qualité : date de la consultation : 10.4 qualité : date de la consultation : 10.5 qualité : date de la consultation : |
11. manière dont l’euthanasie a été pratiquée et moyens utilisés : |
12. informations complémentaires que le médecin souhaiterait donner : |
Les points 13 à 19 ci-dessous concernent une euthanasie d’un(e) patient(e) inconscient(e) pratiquée sur base d’une déclaration anticipée antérieurement établie. |
13. ☐ existence d’une déclaration anticipée établie suivant le modèle défini par l’AR du 2 avril 2003 cocher et compléter si nécessaire : date de cette déclaration : établie par le déclarant lui-même ☐ établie par un tiers majeur qui n’a aucun intérêt matériel au décès du/de la patient(e) si le/la patient(e) était physiquement incapable de le faire ☐ les raisons de cette incapacité sont données ☐ une attestation médicale certifiant cette incapacité est jointe ☐ ☐ une ou plusieurs personnes de confiance sont désignées ☐ l’ensemble de la procédure suivie ainsi que les documents écrits sont consignés au dossier médical (art.4, §2, 4°) |
14. l’inconscience du/de la patient(e) était irréversible ☐ |
15. médecin indépendant consulté (art.4, §2, 1° de la loi) : ☐ qualification du médecin : date de la consultation : avis du médecin consulté quant à l’irréversibilité de la situation médicale du/de la patient(e) |
16. ☐ entretien avec la ou les personne(s) de confiance éventuellement désignée(s) dans la déclaration anticipée (art.4, §2, 3°) ☐ entretien avec l’équipe soignante (art.4, §2, 2°) ☐ entretien avec les proches du/de la patient(e) désignés par la personne de confiance (art.4, §2, 4°)
|
17. autres personnes ou instances consultées (ne pas mentionner leur identité) : 17.1 qualité : date de la consultation : 17.2 qualité : date de la consultation : 17.3 qualité : date de la consultation : 17.4 qualité : date de la consultation : |
18. manière dont l’euthanasie a été pratiquée et moyens utilisés : |
19. informations complémentaires que le médecin souhaiterait donner : |
ANNEXE XII :
Les articles du code pénal suisse relatifs à l’homicide,
au meurtre et au suicide
Art. 111. — Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Art. 112. — Assassinat
Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
Art. 113. — Meurtre passionnel
Si le délinquant a tué alors qu’il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Art. 114. — Meurtre sur la demande de la victime
Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 115. — Incitation et assistance au suicide
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Le 16 avril 2008 : |
M. Axel Kahn, président de l’université Paris V et directeur de recherches à l’INSERM |
M. Patrick Baudry, professeur de sociologie à l’université Michel de Montaigne – Bordeaux III |
Le 30 avril 2008 : |
M. Alain Grimfeld, président du Comité Consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) |
M. Régis Aubry, président du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement |
Mme Marie-Frédérique Bacqué, professeure des universités en psychopathologie clinique |
M. Guy Benamozig, psychanalyste, docteur en anthropologie |
Le 7 mai 2008 : |
Mme Suzanne Rameix, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences, département d’éthique médicale, faculté de médecine de Créteil |
Mme, Mlle et M. Coutant, proches d’un patient décédé (Unité mobile de soins palliatifs de Saint-Quentin) |
Le 22 mai 2008 : |
Proches d’un patient décédé d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) et M. Bernard Devallois, ancien président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) |
Le 28 mai 2008 : |
M. Paul Pierra et Mme Danièle Pierra |
Mme Marie de Hennezel, psychologue, auteur du rapport « La France palliative » |
Le 4 juin 2008 : |
M. Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), Mme Claudine Lassen, vice-présidente de l’ADMD. |
Mme Laure Marmilloud, infirmière dans une unité de soins palliatifs |
Le 11 juin 2008 : |
Proches d’un patient décédé d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA) (centre Roger Duquesne d’Aix-en-Provence) |
Professeur Umberto Simeoni, chef de service de médecine néonatale à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, président de la commission éthique de la société française de néonatologie, et Docteur Pierre Betremieux, chef du service de réanimation pédiatrique et néonatale du CHU de Rennes |
Le 18 juin 2008 : |
Proche d’un patient décédé (unité de soins palliatifs de l’hôpital Jean Minjoz de Besançon) |
Mme Marie Humbert et de M. Vincent Léna, président de l’Association « Faut qu’on s’active ! » |
Le 25 juin 2008 : |
Professeur François Goldwasser, chef de l’unité médicale d’oncologie du groupe hospitalier Cochin |
Docteur Édouard Ferrand, praticien hospitalier au service de réanimation chirurgicale à l’hôpital Henri Mondor |
Docteur Michèle Lévy-Soussan, responsable de l’unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière |
Professeur Élie Azoulay, service de réanimation à l’hôpital Saint-Louis |
Le 1er juillet 2008 : |
Docteur Anne-Laure Boch, neurochirurgien à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière |
Mme Nathalie Vandevelde, cadre infirmier, service de gastroentérologie à l’hôpital Saint-Louis |
Le 2 juillet 2008 : |
Docteur Stéphane Donnadieu, coordonnateur de l’unité d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital Georges Pompidou |
M. Claude Évin, ancien ministre, président de la Fédération Hospitalière de France (FHF) |
Docteur Sylvain Pourchet, responsable de l’unité fonctionnelle Soins palliatifs à l’Hôpital Paul-Brousse |
Mme Monique Faure, présidente de l’Association d’entraide aux malades traumatisés crâniens et autres cérébro-lésés et aux familles (AEMTC) |
Docteur Véronique Fournier, directrice du Centre d’éthique clinique (Groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul) |
Le 9 juillet 2008 : |
Docteur Anne Prud’homme, pneumologue, chef du service des maladies respiratoires au centre hospitalier de Bigorre, membre de la société de pneumologie de langue française |
Professeur Gérard de Pouvourville, titulaire de la chaire d’économie de la santé à l’ESSEC |
Proche d’un patient décédé (unité de soins palliatifs de l’hôpital Jean Minjoz à Besançon) |
Mmes le Docteur Marie-Hélène Boucand, Sylvie Hulin et Geneviève Invernon, représentantes de l’Association Française des Syndromes d’Ehlers-Danlos |
Professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique AP-HP et du département de recherche éthique de l’université Paris Sud 11 |
Le 15 juillet 2008 : |
Professeur Daniel Brasnu, chef de service ORL à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou |
Professeure Dominique Thouvenin, professeure à l’Université Paris 7-Diderot |
M. Jean-Paul Guérin et de M. Raymond Le Moign, Commission de certification des établissements de santé – Haute Autorité de Santé |
Le 16 juillet 2008 : |
Professeure Delphine Mitanchez, néonatologue à l’hôpital Armand-Trousseau |
Mme Paulette Le Lann, présidente de la Fédération Jusqu’à la mort, accompagner la vie (JALMAV) |
Mme Maryannick Pavageau et M. Jacques Ricot, professeur agrégé de philosophie |
Le 9 septembre 2008 : |
M. Godefroy Hirsch, président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) |
Mme Martine Nectoux, infirmière clinicienne |
M. Michel Legmann, président de l’Ordre des médecins |
M. Alain Monnier, président de l’Association pour le développement des soins palliatifs (ASP fondatrice) et Docteur Chantal Millot, présidente de l’association des soins palliatifs de l’hôpital Saint-Philibert (Lyon) |
Le 10 septembre 2008 : |
M. Didier Sicard, ancien Président du Comité Consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) |
Docteur Xavier Mirabel, président de l’association Alliance pour les droits de la vie et docteur Olivier Jonquet, chef du service de réanimation du CHU de Montpellier |
Professeur Christian Hervé, professeur à l’Université Paris Descartes |
Mme Martine Aoustin, docteur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins |
Professeur Philippe Hubert, chef de service de réanimation pédiatrique polyvalente et de néonatologie à l’hôpital Necker enfants malades et Docteur Robin Cremer, docteur en réanimation pédiatrique à l’Hôpital Jeanne de Flandre |
Le 16 septembre 2008 : |
Docteur François Tasseau, réanimateur-rééducateur au Centre médical de l’Argentière |
M. Robert Badinter, sénateur des Hauts-de-Seine, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien Garde des sceaux |
Professeure Isabelle Durand-Zaleski, chef de service à l’hôpital Henri Mondor, professeure des universités et économiste de la santé |
Le 23 septembre 2008 : |
Professeur Alain Prothais, professeur de droit pénal, directeur de l’institut d’études judiciaires et de l’institut des sciences criminelles à l’Université de Lille |
Le 7 octobre 2008 : |
Maître Émeric Guillermou, président de l’Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens (UNAFTC) |
M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation |
M. Jean-Marie Huet, directeur des Affaires criminelles et des grâces |
Le 8 octobre 2008 : |
Professeur Louis Puybasset, professeur des universités, praticien hospitalier, département anesthésie-réanimation de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière |
Professeur Bernard Beignier, Doyen de la Faculté de droit de Toulouse |
Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, ministre de la justice |
Le 14 octobre 2008 : |
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative |
DÉPLACEMENTS DE LA MISSION À L’ÉTRANGER
MISSION DU 3 SEPTEMBRE 2008
Pays-Bas
Maison de soins - Verpleeghuis Van Wijckerslooth / Verpleeghuis Sint Elisabeth Gasthuishof – Table ronde :
M. Rob van der Hoeve, directeur médical de l'établissement de soins
Mme drs van Mansom, médecin
Mme Roelofs, médecin
M. Jack van Kleef, professeur d'anesthésie à l'hôpital universitaire de Leiden
Mme dr A. Vielvoye-Verkerk, anesthésiste / spécialiste de la lutte contre la douleur
M. Nortier, professeur Université de Leyde
M. Lex Peters, Professeur en obstétrique/gynécologie Université de Leyde
M. Mischa Simon, anesthésiste, spécialiste de soins palliatifs à l'hôpital universitaire de Leyde
Mme Dorothea Touwen, professeur d'éthique de l'Université de Leyde
M. Ben van Kampen, directeur de l'administration à la maison de soins
Mme Marieke Koopman, gérontologue
Drs Lisette Geldof van Doorn, chargée de mission pour les relations internationales (questions d'éthique médicale), Ministère de la santé
Drs Judith van den Berg, chargée de mission euthanasie/soins palliatifs au Ministère de la santé
Mme Agnes Reerinh, journaliste au NRC Handelsblad
Milieu médical :
M. Eric van Wijlick, médecin, conseiller KNMG (ordre des médecins)
Mme Verkerk, médecin, UMCG (Centre médical universitaire de Groningue), auteurs de publications dans l'European Journal of Health Law (dont Palliative Sedation in the Netherlands)
M. R. Jonquière, NVVE (association Euthanasie)
Parlement :
Mme van Miltenburg, députée VVD (parti libéral, membre de la Commission de la Santé)
Mme E.E. Wïegman-van Meppelen Schepping, Députée Christen Unie
Ministère de la Justice :
M. Arie Kors, chef du secteur droit pénal et sanctions, direction de la législation
Collège des Procureurs Généraux :
M. Harm Brouwer, président du Collège des Procureurs généraux, accompagné de deux procureurs de la Reine : Mw. mr. Marjolein van Eykelen, procureur médical de Rotterdam (medisch officier van justitie te Rotterdam, werkzaam bij het Expertisecentrum medische zaken van het openbaar ministerie, gevestigd bij het parket Rotterdam), Dhr mr. Dr. Pieter H.S. van Rest, procureur de Groningue (officier van justitie te Groningen, o.a. belast met medische strafzaken).
MISSION DU 17 SEPTEMBRE 2008
Royaume-Uni
Entretiens avec :
Mme Claire Henry, National Programm Director, NHS National End of Life Care Programme
M. Stephen Lock, Policy Manager, End of Life Care, Department of Health
M. Anupama Natarajan, Policy Manager, Payment by Results, Department of Health
Mme Katharina MacDowall, Press Office, Department of Health-
Mme Jane O’Brien, directrice des questions éthiques au General Medical Council. Discussion, notamment sur la refonte en cours des guidances aux professionnels de santé
Mme Sue Thomas, Responsable de l’éthique au Royal College of Nursing (infirmières)
Dr Simon Chapman, Conseiller pour l’éthique au National Council for Palliative Care, et le Dr Teresa Tate, Conseiller médical de Marie Curie Cancer Care UK
MISSION DU 19 NOVEMBRE 2008
Belgique
Entretien avec :
Docteur Catherine Dopchie, cancérologue à Tournai
Réunion avec des membres de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie :
– Docteur Marc Englert, ULB, membre rapporteur de la Commission fédérale ;
– Mme Jacqueline Herremans, présidente de l’ADMD Belgique (Association pour le droit à mourir dans la dignité), avocate, membre de la commission de contrôle et d’évaluation ;
– Docteur Dominique Lossignol, chef de l’unité de soins supportifs et palliatifs à l’Institut des tumeurs de l’ULB.
Entretiens avec :
• M. Alain Schoonvaere, directeur du Foyer Saint François à Namur
• Docteur Marc Nollevaux, vice-président du Conseil national de l’Ordre des médecins
• Mme Bernadette Choteau, responsable des soins palliatifs à l’hôpital Mont-Godinne
• Mme Bernadette Wouters, infirmière en soins palliatifs, professeur à l’école de santé publique à Bruxelles
• M. Dominique Boché, Ambassadeur de France
MISSION DU 27 NOVEMBRE 2008
Suisse
Entretien avec :
M. Bernardo Stadelmann, Vice-Directeur de l’Office fédéral de la justice
Réunion avec : les professeurs Christopher Rehman-Sutter, Carlo Fossa et Georg Bosshard, membres de la Commission nationale d’Ethique (CNE) pour la médecine humaine et de l’Académie suisse des sciences médicales
Entretiens avec :
Mme Ida Glanzmann, Conseillère nationale (démocrate-chrétien, canton de Lucerne)
M. Jürgen Vollenweider, Procureur général adjoint de Zürich
Mme Kristin Rossier Buri, Pasteur - Fédération des églises protestantes
Prof. François-Xavier Putallaz, membre de la Commission d’éthique de la Conférence des évèques catholiques
Mme Soraya Wernli ex membre de DIGNITAS
M. Bernard Sutter, membre du Comité directeur de EXIT deutsche Schweiz
1 () Il s’agissait d’un esthésioneuroblastome.
2 () Conférence des Présidents du 25 mars 2008.
3 () Les articles du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles modifiés par la loi du 22 avril 2005 sont reproduits en annexe du présent rapport.
4 () Enquête réalisée en 2007 et 2008 auprès de 604 professionnels de santé et de 18 bénévoles intervenant en milieu hospitalier.
5 () Audition du 1er juillet 2008.
6 () Thèse de doctorat en sciences de M. Renaud Clément « Que font les médecins face à des demandes de mort de malades en situation de fin de vie ? », soutenue le 17 juin 2008, Université Paris V René Descartes, p. 34.
7 () Audition du 15 juillet 2008.
8 () Audition du 24 juin 2008.
9 () Audition du 9 juillet 2008.
10 () Audition du 28 mai 2008.
11 () Audition du 25 juin 2008.
12 () Audition du 16 juillet 2008.
13 () Audition du 9 septembre 2008.
14 () « Accompagner et laisser mourir », Le Monde, 22 mars 2008.
15 () Audition du 9 juillet 2008.
16 () Audition du 9 juillet 2008.
17 () Audition du 9 juillet 2008.
18 () Audition du 4 juin 2008.
19 () Par exemple, depuis 2005, l’espace éthique de l’AP-HP de Paris a organisé huit débats et colloques publics, publié deux ouvrages collectifs et diffusé trois DVD sur le sujet.
20 () En particulier la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).
21 () Sur les limites de cet enseignement, cf. infra, partie I, chapitre V, du présent rapport.
22 () En particulier JALMALV, les associations pour le développement des soins palliatifs (ASP) et les associations de famille de traumatisés crâniens et cérébrolésés (AFTC).
23 () Thèse de doctorat en médecine soutenue le 18 octobre 2008 par Sophie Van Pradelles de Palmaert à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
24 () Audition du 10 juillet 2008.
25 () Audition du 14 octobre 2008.
26 () Le Centre François-Xavier Bagnoud est intégré à la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon ; cf. infra, partie III-I du présent rapport.
27 () Centre de ressources national soins palliatifs François-Xavier Bagnoud, Rapport d’activité 2007, p. 34.
28 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p.199.
29 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 197. Au cours de la réunion du 15 mars 2007, il a été constaté que la diffusion des affiches mentionnant le numéro Azur avait été faite.
30 () Audition du 28 mai 2008.
31 () http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/charte_patient/doc_pdf/charte_a4_couleur.pdf.
32 () On pourra comparer ce document avec l’approche pédagogique qui caractérise les brochures élaborées en Angleterre par le Conseil National pour les soins palliatifs. Cf., par exemple, la brochure consacrée aux refus de traitement : http://www.endoflifecareforadults.nhs.uk/eolc/files/NHS_NEoLC_ADRT_082008.pdf.
33 () Cf. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/guides_recommandations/recommandations_livret_accueil_fiche1.pdf http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/guides_recommandations/recommandations_livret_accueil_fiche2.pdf.
34 () Cf. Guide d’élaboration du livret d’accueil, 2008, p. 10 et 11.
35 () Cf. infra, partie III du présent rapport.
36 () « Chez les assistants de la mort », Le Nouvel Observateur, 6-12 novembre 2008.
37 () Audition du 14 octobre 2008.
38 () Art. L. 1111-4 du code de la santé publique.
39 () Art. L. 1111-13 du code de la santé publique.
40 () Cf. annexe n° III.
41 () Audition du 25 juin 2008.
42 () Idem.
43 () Enquête présentée à la mission parlementaire par le Docteur Robin Cremer ; cf. audition du 10 septembre 2008.
44 () Audition du 25 juin 2008.
45 () Audition du 10 septembre 2008.
46 () Audition du 25 juin 2008.
47 () Idem.
48 () Audition du 9 septembre 2008.
49 () Compte tenu de la définition que le code de déontologie donne au terme de « consultation » (article R. 4127-60 du code de la santé publique), le second consultant ne peut lui-même qu’être un médecin. Au Luxembourg, la proposition de loi en cours de discussion sur le droit de mourir en dignité par l’euthanasie et l’assistance au suicide évoque la consultation d’un « expert », laissant supposer l’intervention de compétences autres que médicales.
50 () Si aucune donnée n’est disponible sur la fréquence du recours à un second consultant, les interventions que le Docteur Régis Aubry a été amené à faire à ce titre sont de bons exemples de ce que peut être cette procédure.
51 () Audition du 25 juin 2008.
52 () Art. L. 1111-4 du code de la santé publique, deuxième alinéa : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ».
53 () Audition du 10 septembre 2008.
54 () Cf. partie II chapitre I du présent rapport.
55 () Cf. Annexe n° X, loi relative à l’euthanasie, art. 4.
56 () Des modèles ont pu en être proposés ; cf. Répertoire Defrénois, 30 septembre 2007, p.1262 et annexe n° V du présent rapport.
57 () « Droits des malades et fin de vie », conférence –débat organisée le 21 mai 2008 au ministère de la santé, compte rendu mis en ligne sur : www.espace-ethique.org.
58 () Audition du 1er juillet 2008
59 () Audition du 8 octobre 2008.
60 () Audition du 2 juillet 2008.
61 () Art. L. 1111-6 du code de la santé publique.
62 () Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique dispose : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
63 () « Droits des malades et fin de vie », conférence –débat organisée le 21 mai 2008 au ministère de la santé, compte rendu mis en ligne sur : www.espace-ethique.org.
64 () Art. 479 du code civil, version en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
65 () Art. 425 du code civil, version en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
66 () Art. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, version en vigueur à partir du 1er janvier 2009
67 () Cf. 14° de l’art. L. 312-1 code de l’action sociale et des familles, version en vigueur à partir du 1er janvier 2009. On pourrait s’interroger sur l’attribution à une personne morale d’une fonction fondée sur un lien personnel, intuitu personae. Si le patient désigne un des services cités dans cet article, il exprimera certes sa confiance pour l’organisme choisi mais ignorera tout de la personne physique qui, déléguée par ce dernier, sera amenée à apprécier ses souhaits les plus intimes. Ce dispositif peut cependant répondre à des situations de personnes seules, sans famille ni proches.
68 () Art. L. 472-6 et 6° et 7° de l’art. L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, version en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
69 () Audition de M. Jacques Ricot du 16 juillet 2008.
70 () Il est à noter qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 1111-18 du code de la santé publique, « Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. »
71 () Texte disponible sur le site : http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2005/ukpga_20050009_en_1
72 () The National Council for Palliative Care : www.ncpc.org.uk.
73 () BGHZ 154, 205 et BGHZ 163, 195.
74 () § 1901 a Patientenverfügung. Drucksache 16/8442. Deutscher Bundestag.
75 () Art. R. 4127-35 du code de la santé publique.
76 () « Droits des malades et fin de vie », conférence – débat organisée le 21 mai 2008 au ministère de la santé, compte rendu mis en ligne sur : www.espace-ethique.org.
77 () Audition du 8 octobre 2008.
78 () Audition du 25 juin 2008.
79 () Audition du 15 juin 2008.
80 () Cf. infra, partie III du présent rapport.
81 () “Circumstances of death in hospitalized patients and nurses’ perception”, Arch. Intern. Med., 28 avril 2008.
82 () En particulier par Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, M. Claude Évin, le Docteur Régis Aubry et le Docteur Godefroy Hirsch.
83 () Cf. partie III du présent rapport.
84 () Audition du 25 juin 2008.
85 () Audition du 16 juillet 2008.
86 () Audition du 9 septembre 2008.
87 () Audition du 25 juin 2008.
88 () « Droits des malades et fin de vie », conférence –débat organisée le 21 mai 2008 au ministère de la santé, compte rendu mis en ligne sur : www.espace-ethique.org.
89 () En 2006, sur 436 071 décès de personnes âgées du plus de 60 ans, 114 427 sont décédées à leur domicile. Source INSEE http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCV06218.
90 () Audition du 9 septembre 2008.
91 () Idem.
92 () Ibidem.
93 () Limitation des Arrêt et des Thérapeutiques actives en Réanimation Adulte,
94 () Il convient évidemment de comprendre qu’il s’agit des malades décédés, à savoir pour lesquels l’application de thérapies actives se révèle, a posteriori, être un échec.
95 () Audition du 25 juin 2008.
96 () Audition du 10 septembre 2008.
97 () Le nombre de décès par cancer a été estimé à 146 000 en 2005.
98 () Audition du 24 juin 2008.
99 () La possibilité de cesser une alimentation artificielle fait cependant l’objet de désaccords, cf. audition de Mme Marie-Hélène Boucand, présidente de l’association française des Syndromes d’Ehlers-Danlos, audition du 9 juillet 2008.
100 () Cf. infra, partie II du présent rapport.
101 () Cf. audition du Professeur Louis Puybasset du 8 octobre 2008.
102 () Audition du 25 juin 2008.
103 () Audition du 8 octobre 2008.
104 () Audition du 16 juillet 2008.
105 () Audition du 8 octobre 2008.
106 () Idem.
107 () Audition du 1er juillet 2008.
108 () Idem.
109 () Audition du 8 octobre 2008.
110 () Idem.
111 () Audition du 1er juillet 2008.
112 () Audition du 11 juin 2008.
113 () Entre autres : les recommandations sur la prise en charge des nouveau-nés à la naissance de l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR, 1999), l’avis du Comité consultatif national d’éthique (avis n°65 du 14 septembre 2000 « Réflexions éthiques autour de la réanimation néonatale), les recommandations de la Fédération nationale des pédiatres néonatologistes (2001), les travaux du Groupe francophone de réanimation et d’urgences pédiatriques (recommandations 2005) ; postérieurement à la publication de la loi du 22 avril 2005, les travaux de l’Académie nationale de médecine (« Le prématuré de moins de 28 semaines, sa réanimation et son avenir »), les travaux du Groupe de réflexion sur les aspects éthiques de la périnatologie (2007, « Fin de vie en médecine néonatale à la lumière de la loi »).
114 () Audition du 11 juin 2008.
115 () Audition du 16 juillet 2008.
116 () Audition du 11 juin 2008.
117 () Audition du 16 juillet 2008.
118 () Selon le Professeur Louis Puybasset, « des carences affectives des enfants restants de la fratrie peuvent apparaître » dans le cas où des parents se retrouvent contraints de s’occuper presque exclusivement d’un enfant dans un état végétatif au pauci-relationnel. Cf. audition du 8 octobre 2008.
119 () Audition du 11 juin 2008.
120 () D’autres évaluations anticipatives peuvent être avancées, par exemple au regard des choix de santé publique.
121 () Audition 16 juillet 2008.
122 () Audition du 11 juin 2008.
123 () Rapport de l’Académie nationale de médecine, au nom d’un groupe de travail : « Le prématuré de moins de 28 semaines, sa réanimation et son avenir. », 20 juin 2006.
124 () Audition du 11 juin 2008.
125 () Il s’agit d’enfants nés avant 33 semaines de grossesse révolue ; 10 000 enfants naissent grands prématurés chaque année en France.
126 () Cf. The Lancet, 8 mars 2008.
127 () Enquête réalisée sur 2382 enfants nés en 1997 entre 22 et 33 semaines complètes de grossesse et un groupe de référence de 666 enfants nés à terme.
128 () Audition du 11 juin 2008.
129 () Revue Parents, juillet 2008.
130 () Audition du 16 juillet 2008.
131 () Audition du 8 octobre 2008.
132 () Audition du 8 octobre 2008. NB : les propos du Professeur Louis Puybasset portent sur les patients adultes.
133 () Audition du 11 juin 2008.
134 () Idem.
135 () Ibidem.
136 () Ibidem.
137 () Audition du 11 juin 2008.
138 () Idem.
139 () Ibidem.
140 () Audition du 16 juillet 2008.
141 () Audition du 11 juin 2008.
142 () Audition du 11 juin 2008.
143 () Idem.
144 () Audition du Docteur François Tasseau, 16 septembre 2008.
145 () Audition du Docteur Régis Aubry, 30 avril 2008.
146 () Audition du 8 octobre 2008.
147 () Audition du 11 juin 2008.
148 () Audition du 28 mai 2008.
149 () Audition du 25 juin 2008.
150 () Audition du 1er juillet 2008.
151 () Avis n°7 du Comité consultatif national d’éthique sur les expérimentations sur des malades en état végétatif chronique (24 février 1986) : « le Comité manifeste son opposition absolue aux formules du Professeur Milhaud selon lesquelles ces malades seraient "des modèles humains presque parfaits et constitueraient des intermédiaires entre l'animal et l'homme". Ce sont des êtres humains, qui ont d'autant plus droit au respect dû à la personne humaine qu'ils se trouvent en état de grande fragilité. Ils ne sauraient être traités comme un moyen de progrès scientifique, quel que soit l'intérêt ou l'importance de l'expérience qui n'a pas pour objet l'amélioration de leur état. »
152 () Audition du 30 avril 2008.
153 () Même si, médicalement, comme le précise le Docteur Régis Aubry « les personnes en état végétatif chronique ne sont pas des sujets mais des personnes. Le sujet est celui qui peut s’autodéterminer, qui peut dire “ je ” ». Audition du 30 avril 2008.
154 () Il n’y a pas incompatibilité avec le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments (Civ 2°, 22 février 1995) ; on peut en effet reconnaître la réalité d’un préjudice qui relève du droit de la responsabilité, sans reconnaître la possibilité d’un bénéfice médical qui relève de l’appréciation thérapeutique. La notion de « bénéfice pour le patient» est au fondement de la jurisprudence anglaise (affaire citée dans la note infra., page suivante) : le maintien d’un patient dans un état végétatif n’étant d’aucun bénéfice pour lui, il peut être interrompu (une doctrine moins utilitariste s’appuiera de préférence sur le principe de non-malfaisance).
155 () Audition du 30 avril 2008.
156 () M. Émeric Guillermou, président de l’Union nationale des associations des familles de traumatisés crâniens (UNAFTC) a mis en garde sur les risques d’une telle confusion, cf. audition du 7 octobre 2008.
157 () Cf. Affaire Airedale NHS Trust v Bland, 4 février 1993. La Chambre des Lords a autorisé un hôpital public responsable de la survie d’un adolescent en état végétatif à arrêter, sur la demande des parents, sa nutrition et son hydratation artificielle. Lord Mustill apporte la précision suivante dans la conclusion de son jugement : « La poursuite du traitement d’Antony Bland ne peut plus servir à maintenir cette combinaison de diverses caractéristiques que l’on appelle une personnalité […] cela ne veut absolument pas dire que j’en arriverai à la même conclusion dans des cas moins extrêmes quand les lueurs de la conscience peuvent donner au patient un intérêt que l’on ne peut considérer comme nul. » Cette argumentation vise l’état de fait du patient – sa personnalité – et non l’état de droit – sa personne, de même que le Docteur Régis Aubry a pu constater que ces patients ne constituent pas des sujets psychologiques tout en affirmant la nécessité de reconnaître qu’elles demeurent des personnes de droit (cf. note supra).
158 () Étude dirigée par M. Steven Laureys, The Lancet octobre 2008, disponible sur le site : http://www.coma.ulg.ac.be/papers/vs/Pain_MCS_LancetNeuro08.pdf.
159 () Le point de vue du thérapeute est différent : il traite le patient dans son état présent et s’interroge sur son état à venir.
160 () Cf. affaire Cruzan v. Director Missouri Department Health, 25 juin 1990, la Cour Suprême des États-Unis a exigé que soit apportée la preuve formelle que « la patiente n’aurait pas souhaité être maintenue en vie artificiellement » ; le juge compétent accordant finalement aux parents l’autorisation de choisir la date de la mort de leur fille attendu qu’il est « clair et visible que la jeune femme, si elle pouvait s’exprimer, souhaiterait mourir. » Cf. aussi l’affaire Eluana Englaro, 25 juin 2008, les juges de la cour d’appel de Milan ont motivé leur décision sur le respect de la volonté et de « la façon de concevoir la dignité et la vie » qui était celle d’Eluana Englaro du temps où elle était consiente.
161 () Audition du 8 octobre 2008.
162 () Audition 16 septembre 2008.
163 () Cf. Anne Fagot-Largeault, « Réflexions sur la notion de qualité de vie », in Archives de philosophie du droit, droit et science, Tome 36, Ed. Sirey1991.
164 () Audition du 14 octobre 2008.
165 () Art. L. 1110-5 du code de la santé publique.
166 () Art. L. 1111-13 du code de la santé publique.
167 () Audition du 9 septembre 2008.
168 () Audition du 4 juin 2008.
169 () Audition du 9 septembre 2008.
170 () Audition du 30 avril 2008.
171 () Cf. infra, partie III du présent rapport.
172 () Audition du 24 juin 2008.
173 () Audition du 2 juillet 2008.
174 () Idem.
175 () NB : on peut regretter que son comité de suivi n’ait été créé par arrêté qu’en mai 2008 ; cf. Arrêté du 3 avril 2008 relatif aux missions et à la composition du comité de suivi du plan national d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, JO du 15 mai 2008.
176 () Cf. partie II du présent rapport.
177 () Audition du 30 avril 2008.
178 () Amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Mercier, Amoudry, Badré, Biwer, J. Boyer, A. Giraud, Merceron, Vallet, About, Nogrix, Blin, Pozzo di Borgo, Kergueris et Deneux, Mme Morin-Desailly et M. Zocchetto, ainsi libellé : « Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que les soins d'hygiène et le maintien d'une température adéquate, l'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne bénéficiaire le demande avec insistance de manière libre et éclairée (selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4). La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin s'ils n'atteignent pas leur finalité propre, s'ils sont la source d'un danger pour la personne soignée ou si celle-ci est en phase terminale de son existence. » »
179 () Cf. article du Docteur Xavier Mirabel : « Faire mourir de faim et de soif : l’euthanasie à la Française ? » in Liberté politique, n°39, décembre 2007.
180 () Cf. Docteur François Tasseau, « État végétatif et nutrition artificielle : un débat fondamental », in Résurgences, Revue de l’UNAFTC et des AFTC, n° 34 décembre 2006.
181 () Cf. infra page 58.
182 () Par une lettre en date du 6 novembre 2008, rédigée en réponse d’une demande de contribution faite par votre rapporteur, le pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de France, se dit favorable à reconnaître que la nutrition artificielle est un traitement ; il s’interroge cependant sur l’intentionnalité d’un arrêt d’alimentation d’une personne en état végétatif.
183 () Audition du 18 juin 2008.
184 () Affaire Airedale NHS Trust v Bland, 4 février 1993 : la Chambre des Lords a autorisé un hôpital public responsable de la survie d’un adolescent en état végétatif à arrêter, sur la demande des parents, sa nutrition et son hydratation artificielle.
185 () Affaire « J », High Court of Justice, 12 décembre 2006.
186 () Affaire Oliver Leslie Burke v The General Medecine Council, 28 juillet 2005.
187 () A été jugée légale la disposition 81 §4 de ce guide qui prévoyait qu’il pouvait être procédé à un arrêt de la nutrition ou de l’hydratation artificielle dans le cas d’un patient inconscient dont la mort n’est pas imminente s’il était jugé que la condition du patient est telle que son maintien en vie cause de la souffrance ou constitue un fardeau trop lourd (burdensome) par rapport aux bénéfices possibles du traitement. La Cour d’appel a cependant formulé des réserves sur l’imprécision de ces critères et a insisté sur le fait que les circonstances propres à chaque situation interdisaient toute généralisation.
188 () Affaire Eluana Englaro.
189 () Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 16 ottobre 2007, n° 21748, §7-6.
190 () Cf. Docteur Xavier Mirabel, « Faire mourir de faim et de soif : l’euthanasie à la Française ? » in Liberté politique, n°39, décembre 2007.
191 () Le Docteur Xavier Mirabel cite une étude rapportant même une survie inférieure chez des résidents de maisons de retraite alimentés par sonde par rapport à ceux qui ne le sont pas.
192 () Nutrition, Hydratation Artificielle.
193 () Intervention faite au 14ème congrès national de la Société d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP, 19-21 juin 2008 ; texte accessible sur le site : http://www.sfap.org/site_sfap_2008/#pageHead).
194 () Audition du 8 octobre 2008.
195 () Audition du 4 juin 2008 de Mme Laure Marmilloud, infirmière dans une unité de soins palliatifs.
196 () Corte d’Appello di Milano, prima Sezione Civile, procedimento n°88/2008, p. 61.
197 () Audition du 30 avril 2008.
198 () Audition du 14 octobre 2008.
199 () Axel Kahn, L’ultime liberté ?, Paris, Plon, 2008, p. 61.
200 () Qui modifient respectivement les articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-10 et L. 1111-9 du code de la santé publique.
201 () Modifiant l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.
202 () Modifiant l’article L. 6143-2-2 du code de la santé publique.
203 () Modifiant respectivement les articles L 311-8 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
204 () Axel Kahn, L’ultime liberté ?, Paris, Plon, 2008, p. 61.
205 () Pour une chronologie des soins aux mourants en France, cf. Bernard Wary, « Le mouvement palliatif français, petite histoire et évolution », in Revue de la Fédération JALMALV n°69, juin 2002.
206 () Audition du 16 avril 2008.
207 () Audition du 24 juin 2008.
208 () Audition du 1er juillet 2008.
209 () Ce programme est disponible à l’adresse suivante : http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=8&press_id=1499.
210 () Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, p. 4.
211 () Il s’agit du Poitou-Charentes et de la Basse-Normandie.
212 () Seulement un quart de ces unités se trouvent dans le secteur public, le reste étant dans des institutions caritatives.
213 () Il faut tenir compte du fait qu’en France, les nouvelles créations d’USP n’ont pas été encouragées car la priorité était donnée aux lits dédiés.
214 () Cf. infra. C. du présent chapitre pour un exposé d’ensemble des modalités de financement des soins palliatifs dans les différentes structures où ils sont pratiqués.
215 () Source : Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 2008, p. 14.
216 () Idem, p. 14.
217 () Audition du 1er juillet 2008.
218 () Audition du 25 juin 2008.
219 () Pour plus de précisions, voir infra dans le présent chapitre.
220 () Audition du 20 juin 2008.
221 () Ces missions sont exposées dans le référentiel relatif aux EMSP dans la circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe 2.
222 () Audition du 30 avril 2008.
223 () Idem.
224 () Audition de Mme Nathalie Vandevelde, 1er juillet 2008.
225 () Audition du 20 juin 2008. Cf. infra pour les critiques liées au financement des soins palliatifs.
226 () Cf. infra, C du présent chapitre.
227 () Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe n 3, fixant le référentiel d’organisation des soins relatif aux unités de soins palliatifs.
228 () Audition du 2 juillet 2008.
229 () Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, mesure I, p. 6.
230 () Cour des comptes, rapport public annuel 2006, p. 371.
231 () Audition du 2 juillet 2008.
232 () Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe 4.
233 () Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 2008, p. 14.
234 () Source : Conseiller Social près l’Ambassade de France au Royaume-Uni.
235 () Audition du 14 octobre 2008.
236 () Conseil d’État, 1er octobre 2004, Fédération nationale des infirmiers, requête n° 261747.
237 () Audition du 9 septembre 2008.
238 () Cf. infra, Partie III du présent rapport.
239 () Cf. infra, Chapitre IV relatif aux personnes vulnérables.
240 () Conformément à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique.
241 () Audition du 16 juillet 2008.
242 () Audition du 9 septembre 2008.
243 () http://www.aspfondatrice.org/qsn/charte.asp.
244 () Circulaire DGS/3 du 26 août 1986, relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale.
245 () Audition du 1er juillet 2008.
246 () Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe 4.
247 () Audition du 9 septembre 2008.
248 () « À l’hôpital, on n’a plus le temps de prendre la main du patient », La Croix, 13 novembre 2008, p. 3.
249 () La Croix, op. cit.
250 () Cour des comptes, rapport public annuel 2006, p. 364.
251 () Audition du 1er juillet 2008.
252 () Voir tableau en annexe n° VI.
253 () Audition du 9 septembre 2008.
254 () Audition du 9 septembre 2008.
255 () Cf. supra dans le présent chapitre.
256 () Pour une critique plus poussée et les propositions de la mission, voir infra, Partie III.
257 () Cour des comptes, rapport public annuel 2006, p. 365.
258 () Audition du 28 mai 2008.
259 () Seul le court séjour est soumis à la tarification à l’activité, qui incite au développement des soins palliatifs. Cf. infra, C. du présent chapitre.
260 () Audition du 30 avril 2008.
261 () Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 12.
262 () Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe 2.
263 () Audition du 28 mai 2008.
264 () Audition du 16 juillet 2008.
265 () Audition du 1er juillet 2008.
266 () Audition du 11 juin 2008.
267 () Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.
268 () Elles figurent à ce titre à l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale.
269 () Créé par le décret n° 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
270 () Voir l’avis n°101 du Comité national consultatif d’éthique du 28 juin 2007, qui met en lumière cette inadéquation.
271 () Cf. annexe n° VII du présent rapport.
272 () Les chiffres concernant l’année 2007 ne sont pas encore disponibles.
273 () Audition du 9 juillet 2008.
274 () Cette forme de financement s’applique à la totalité du système hospitalier anglais, à l’exception des activités de psychiatrie. Ceci représente environ 60 % du budget des hôpitaux, auxquels s’ajoutent les budgets consacrés à la psychiatrie, aux urgences (où le PbR n’est pas intégral) et aux activités de formation et de recherche.
275 () Audition du 24 juillet 2008.
276 () Louis Puybasset, « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », http://www.espace-ethique.org, octobre 2008.
277 () Op. cit., p. 27.
278 () Op. cit., p. 28.
279 () Rapport annuel de la Cour des comptes, 2006, p. 363.
280 () Louis Puybasset, « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », http://www.espace-ethique.org, octobre 2008.
281 () Cf. Annexe n° VII.
282 () Témoignage publié dans La Croix, 13 novembre 2008, p. 3.
283 () Audition du 9 septembre 2008.
284 () Audition du 10 septembre 2008.
285 () Assemblée Nationale, Rapport n° 1211, 13 octobre 2008.
286 () Audition du 8 octobre 2008.
287 () Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et circulaire n°DHOS/E2/DSS/1C/2006/30 du 19 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
288 () Audition du 10 septembre 2008.
289 () Idem.
290 () Assemblée Nationale, Rapport n° 1211, 13 octobre 2008.
291 () Audition du 10 septembre 2008.
292 () Audition de Mme Martine Aoustin du 10 septembre 2008.
293 () Le Professeur Louis Puybasset mentionne ce type de demande dans son article « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », http://www.espace-ethique.org, octobre 2008.
294 () C’est ce que recommande le référentiel d’organisation des soins relatifs aux lits identifiés de soins palliatifs, qui se trouve en annexe de la circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008, relative à l’organisation des soins palliatifs.
295 () Audition du 9 juillet 2008.
296 () Mme Marie de Hennezel, La France palliative, 2005, p. 14.
297 () Audition de Mme Michèle Lévy-Soussan du 25 juin 2008.
298 () Audition du 24 juillet 2008.
299 () Idem.
300 () Au cours de l’audition de Mme Michèle Lévy-Soussan du 25 juin 2008.
301 () Audition du 10 septembre 2008.
302 () Circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs, annexe 1 Référentiel d’organisation des soins relatif aux lits identifiés de soins palliatifs.
303 () Audition du 24 juin 2008.
304 () Source : DREES, « Les établissements d’hébergement pour les personnes âgées en 2003 : activité et personnel », in Études et résultats, n° 379, février 2005.
305 () L’offre de places est détaillée dans le rapport de la Cour des Comptes, « Les personnes âgées dépendantes » de novembre 2005.
306 () Centre d’analyse stratégique, L’EHPAD, pour finir de vieillir. Ethnologie comparée de la vie quotidienne en institution gériatrique, mars 2006.
307 () Audition du 30 avril 2008.
308 () Instruction ministérielle DGAS/2A n° 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance.
309 () Audition du 30 avril 2008.
310 () Audition du 7 mai 2008.
311 () Idem.
312 () Jérôme Lambert, Clémence Fillol, François Bourdillon, Michèle Lévy-Soussan, Patrick Thominet et Jean-Yves Delattre, « Etude épidémiologique descriptive de l’ensemble des personnes relevant de soins palliatifs dans un centre universitaire français. Comparaison 1997-2004. » in Médecine Palliative, vol. 5, n° 2, avril 2006.
313 () Plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 », présenté le 1er février 2008, p. 15.
314 () Cf. infra, Partie III, chapitre I.
315 () Audition d’une proche d’un patient en état végétatif, du 2 juillet 2008.
316 () Audition du 30 avril 2008.
317 () Audition du 2 juillet 2008.
318 () Audition du 1er juillet 2008.
319 () Idem.
320 () Audition du 16 septembre 2008.
321 () Audition du 9 septembre 2008.
322 () « Les personnes âgées maltraitées sortent du silence », La Croix, 16 octobre 2008, p. 2.
323 () Rapport du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, annexe n°13.
324 () Arrêté du 26 janvier 2007, modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004.
325 () Audition du 2 juillet 2008.
326 () Audition du 16 septembre 2008.
327 () Audition du 24 juin 2008.
328 () Audition du 2 juillet 2008.
329 () Audition du 1er juillet 2008.
330 () Audition du 9 septembre 2008.
331 () Audition du 2 juillet 2008.
332 () D. Oliver, « Training and knowledge of palliative care of junior doctors » in Palliative Medecine, 1998, 12, p. 297-9.
333 () Audition du 10 septembre 2008.
334 () Louis Puybasset, « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », op. cit., et audition du 8 octobre 2008.
335 () Audition du 30 avril 2008.
336 () Audition du 4 juin 2008.
337 () Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, p. 29.
338 () Circulaire n°2007-335 du 14 septembre 2007 relative au programme hospitalier de recherche clinique, 1.8.
339 () Rapport du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, p. 34. Voir partie III.
340 () Rapport du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, p.187.
341 () Audition du 9 juillet 2008.
342 () Audition du 14 octobre 2008.
343 () Arrêté du 18 mars 1992, portant sur l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle d’études médicales.
344 () Rapport du Comité national de suivi et de développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, p. 29.
345 () Il s’agit d’un des 12 items de ce module ; il existe 11 modules.
346 () Audition du 7 mai 2008.
347 () Audition du 9 juillet 2008.
348 () D. Field et B. Wee, “Preparation for palliative care : teaching about death, dying and bereavement in UK medical schools 2000-200” in Medical Education, 2002, 36, p. 561-567.
349 () Source : Conseiller pour la Science et la technologie, Ambassade de France en Allemagne.
350 () Cf. Gilles Antonowicz, Moi Hervé Pierra ayant mis six jours à mourir, 2008, Pascuito éditeur.
351 () Auditions des Professeurs Delphine Mitanchez et Umberto Simeoni et du Docteur Pierre Betremieux, des 16 juillet 2008 et 11 juin 2008.
352 () Audition du 8 octobre 2008.
353 () Idem.
354 () Cf. Partie III du présent rapport.
355 () Audition du 8 octobre 2008.
356 () Audition du 7 octobre 2008.
357 () Affaire Morten Jensen, verdict d’acquittement prononcé par la Cour d’assises d’Angers le 14 juin 2006 ; affaire Léonie Crevel, condamnation à 2 ans d’emprisonnement avec sursis par la Cour d’assises de Seine-Maritime ; affaire Docteur Laurence Tramois et Chantal Chanel, condamnation à un an de prison avec sursis pour le Docteur Laurence Tramois et acquittement pour Mme Chantal Chanel, Cour d’assises de Dordogne le 15 mars 2007 ; affaire Corinne Teyssedou, condamnation à 5 ans de prison avec sursis par la Cour d’assises du Lot le 30 mai 2007 ; affaire Lydie Debaine, acquittement par la Cour d’assises du Val d’Oise le 9 avril 2008.
358 () « Il résulte des dispositions des articles 363 et 367 du code de procédure pénale que, à moins que les faits retenus contre l’accusé ne tombent pas ou ne tombent plus sous l’application de la loi pénale, son acquittement ne peut-être prononcé que s’il a été déclaré non coupable » (Cass. Crim. 11 déc. 1985).
359 () Un jury d’assises peut prononcer une peine minimale qui, dans le cas d’un assassinat est de deux ans d’emprisonnement (art. 132-18 du code pénal) avec sursis.
360 () Mme Lydie Debaine a tué sa fille qui était gravement handicapée et dont l’état de santé se détériorait.
361 () Déclaration faite sur LCI.fr le 11 avril 2008.
362 () Communiqué du 17 avril 2008.
363 () Audition du 16 septembre 2008.
364 () Un sondage Sofres pour Le Nouvel Observateur et la Fondation Jean Jaurès, publié le 15 mars 2008 donne, avec les extrapolations d’usage, les résultats suivants : « 87 % des Français se disent favorables à "la possibilité pour les personnes atteintes de maladies incurables de demander l’euthanasie". Les Français sont en effet 43 % à se dire "tout à fait favorables" à l’euthanasie et 44 % "plutôt favorables". Ils ne sont que 4 % à être "plutôt opposés" et 3% à être "tout à fait opposés". 6 % se disent "sans opinion". »
365 () La proposition de loi rédigée par l’association "Faut qu’on s’active" a, selon ce qu’a rapporté M. Vincent Léna, son Président, « été signée par 400 000 citoyens ». Audition du 18 juin 2008.
366 () Audition du 4 juin 2008.
367 () Idem.
368 () Référence à l’adieu fait à ses amis par le poète et écrivain Hugo Claus mort euthanasié en Belgique à l’âge de 78 ans, le 18 mars 2008.
369 () Audition du 16 avril 2008.
370 () Audition du 16 juillet 2008.
371 () Audition du 16 avril 2008.
372 () Audition du 15 juillet 2008.
373 () Audition du 16 avril 2008.
374 () Audition du 16 avril 2008.
375 () Audition du 16 juillet 2008.
376 () Idem.
377 () Audition du 7 mai 2008.
378 () Ainsi le Professeur Daniel Brasnu a expliqué que dans la maladie dont était atteinte Mme Chantal Sébire « l’extension de la tumeur se fait vers les lobes frontaux du cerveau. Les patients ont alors très souvent un comportement que l’on appelle frontal en neurologie, c’est-à-dire qu’ils sont un peu euphoriques […]. » (Audition du 15 juillet 2008). M. Hervé Messager, kinésithérapeute de Vincent Humbert, a lui aussi souligné la vulnérabilité de son patient : « Vincent, malgré l'intégrité de ses fonctions intellectuelles, présentait un syndrome frontal provoquant des persévérations dans ses choix et son discours en l'empêchant de modifier ses propos et décisions quand ceux-ci manquaient de véritable réflexion. » (cf interview, novembre 2007, http://www.sosfindevie.org/eutha/Humbert-Messager.htm). Le même doute est à porter sur la consistance de la volonté de tout malade souffrant d’une forme de dépression.
379 () Audition du 15 juillet 2008.
380 () Le Dr. Marie-Hélène Boucand a rapporté, avec l’autorisation de Mme Clara Blanc, le contenu de messages personnels que celle-ci lui a envoyés : « Les médias sont de grands manipulateurs et je me suis fait un peu dépasser d’autant que des journaux font leur "une" sans m’avoir ni rencontrée ni parlée… je ne souhaitais pas vraiment parler de la maladie, ni de moi… […] Je n’ai pas une minute pensé ni mesuré l’impact sur les autres… c’est d’un égoïsme terrible, je suis sincèrement navrée pour elles, vraiment. Par contre, je vais très bien, j’apprivoise la maladie et je jongle avec au jour le jour, je prends mes marques tranquillement… » (audition du 9 juillet 2008). Mme Clara Blanc est néanmoins intervenue à la tribune du Congrès mondial des associations pour « le droit à mourir dans la dignité », le 31 octobre 2008. Dans son intervention, elle a, en particulier, demandé l’organisation d’un referendum sur la légalisation de l’euthanasie.
381 () Audition du 9 juillet 2008.
382 () Audition du 9 juillet 2008.
383 () Audition du 7 mai 2008.
384 () Développant l’opposition entre droits formels et droits réels, la distinction entre droits-libertés et droits-créances a été introduite par Wesley Newcomb Hohfeld, en 1919.
385 () Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat Social, II-5.
386 () Affaire Diane Pretty, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 2002.
387 () Entre 2 000 et 7 500 demandes par an si l’on rapporte au nombre annuel de décès en France le nombre d’euthanasies effectuées en Belgique (0,36 % des décès en 2007) et en Hollande (1,4 % des décès en 2006). M. Jean-Luc Romero, président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, a estimé qu’entre 2 500 à 10 000 personnes seraient concernées en France ; cf. audition du 4 juin 2008.
388 () Cf. en annexe n° XI, un exemplaire du formulaire d’euthanasie utilisé en Belgique.
389 () Cf. note infra chapitre II, B de la présente partie.
390 () Audition du 7 mai 2008.
391 () Audition du 14 octobre 2008.
392 () Audition du 7 mai 2008.
393 () Idem.
394 () Audition du 7 mai 2008.
395 () Audition du 7 mai 2008.
396 () Cf. l’argumentation avancée par l’Association médicale américaine (AMA) quand celle-ci a rappelé à ses membres, le 17 juillet 2006, l’interdiction de participer aux exécutions des condamnés à mort par injection létale : une telle participation « viole le serment de protéger la vie et érode la confiance publique envers la profession médicale. Un médecin est un membre d’une profession consacrée à la préservation de la vie tant qu’il y a un espoir de la préserver. L’utilisation du savoir médical et du jugement du médecin pour des buts autres que ceux promouvant la santé et le bien-être de l’individu compromet un fondement éthique premier de la médecine – d’abord, ne pas nuire. » Déclaration de M. William G. Plested, Président de l’Association américaine de médecine, 17 juillet 2006 ; cf. http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/16556.html.
397 () Cf. Axel Kahn, L’ultime liberté, Plon, 2008, p. 32.
398 () Audition du 24 juin 2008.
399 () Audition du 4 juin 2008.
400 () Audition du 30 avril 2008.
401 () Art. R. 4127-11 du code de la santé publique.
402 () Art. R. 4127-32 du code de la santé publique.
403 () Cf. supra B. du chapitre I de la présente partie.
404 () Conseil d’État, Luxembourg, avis du 13 juillet 2007.
405 () Audition du 4 juin 2008.
406 () Idem.
407 () Ibidem.
408 () Ibidem.
409 () Audition du 7 mai 2008.
410 () Audition du 7 octobre 2008.
411 () Audition du 4 juin 2008.
412 () Idem.
413 () Audition du 1er juillet 2008 ; citation tirée de l’ouvrage de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 223.
414 () Respecter la vie, accepter la mort, n° 1708, T. 1, p. 178.
415 () Cf. annexe n° IX.
416 () Nederlands Juristenblad 1989, n° 391.
417 () Respecter la vie, accepter la mort, n° 1708, T. 1, p. 180.
418 () Réponse des services du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas à une question posée dans le cadre d’une « foire aux questions » (FAQ) sur l’euthanasie.
419 () Source : Enquête sur un panel de médecins réalisée dans le cadre de l’évaluation de la loi sur l’euthanasie.
420 () Respecter la vie, accepter la mort, n°1708, T. 1, p. 181.
421 () Annexe n° XI.
422 () Article 2 de la loi du 10 novembre 2005 complétant la loi du 28 mai 2002 : « Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public. »
423 () Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, brochure à l’attention des médecins.
424 () Source : Soins palliatifs.be, La revue de soins palliatifs en Wallonie, n° 1, septembre 2008, p. 19, qui indique que le nombre de lits des unités de soins palliatifs en Belgique est de 366 pour 10,5 millions d’habitants. Cf. supra, Première partie, Chapitre III.
425 () Audition du 22 mai 2008.
426 () L’Express, 24 avril 2008.
427 () La Revue de la médecine générale, n° 230, février 2006, p. 83.
428 () Voir, en annexe n° XII, les articles du code pénal cités.
429 () Académie des sciences médicales, « Prise en charge des patients en fin de vie », 25 novembre 2004, p. 5.
430 (3) Équivalent de la personne de confiance.
431 (4) Académie suisse des sciences médicales, « Prise en charge des patients et patients en fin de vie », 25 novembre 2004, p. 3-4.
432 () Arrêt 2A .48/2006 et 2A.66/2006.
433 () Académie suisse des sciences médicales, « Prise en charge des patients et patients en fin de vie », 25 novembre 2004, p. 3-4.
434 () Académie suisse des sciences médicales, « Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée », 2003, p. 7.
435 () Production Capra presse TV ; le reportage a été diffusé sur France 2, le 20 mai 2005 et le 24 janvier 2008.
436 () Source : Entretien avec Ludwig A. Minelli, « En Suisse, rendez-vous avec la mort », Le Monde, 25 mai 2008.
437 () Ludwig Minelli, Die Funktion des begleitenden Suizids in den Menschenrechten, NVVE Symposium, Amsterdam, 20 mars 2008, p. 9.
438 () Ludwig Minelli, Die Würde des Menschen ist unantastbar, Wirtschaftsklub Rhein-Main e.V. Frankfurt/M , 18 septembre 2008.
439 () Ludwig Minelli, Die Funktion des begleitenden Suizids in den Menschenrechte, NVVE Symposium, Amsterdam, 20 mars 2008, p. 9.
440 () Voir le site de la Radio suisse romande : http://info.rsr.ch/fr/points-forts/Quelle_verite_derriere_la_fondation_Dignitas.html?siteSect=2011&sid=8281889&cKey=1191584560000.
441 () Süd westdeutsche Rundfunk, 04.06.2007.
442 ( Le Figaro, « Je ne veux plus cautionner le suicide assisté », entretien avec Gilles Antonowicz, 26 juin 2008.
443 () Libération, « En Suisse, pas d’interdit pour le suicide assisté », 25 mars 2008, p. 4. Afin de prouver que la personne qui s’est suicidée n’a pas reçu l’aide directe d’un tiers, les scènes d’agonie sont enregistrées et les enregistrements vidéo envoyés au Parquet, qui mène systématiquement une enquête.
444 () Robert Zimmermann, Rue 89, « un nouveau ‘‘kit euthanasie’’ crée l’émoi en Suisse », 28 mars 2008, http://www.rue89.com/2008/03/28/un-nouveau-kit-euthanasie-cree-lemoi-en-suisse.
445 () Le Monde, « En Suisse, rendez-vous avec la mort », entretien avec Ludwig A. Minelli, 26 mai 2008, p. 13.
446 () Exit Deutsche Schweiz.
447 () Données non disponibles. Source : Département fédéral de justice et police, « Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ? », 2006, p. 36.
448 () Source : ibid., p. 37.
449 () Sondages de l’Institut Demoscope pour Le Matin Dimanche et Il Caffe.
450 () Audition du 4 juin 2008.
451 () Une liste des travaux fédéraux sur le cadre légal de la fin de vie est disponible à l’adresse suivante : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/tools/index.encoded-pre%3DA%26sel%3D0091%26wordid%3Ddesc.html
452 () Debatte um aktive Sterbehilfe, MenschenRechtsmagazin , Heft3 /2006.
453 () Bundesrat, Drucksache 436/08.
454 () Bundesrat, Drucksache 230/06.
455 () M. Jean-Luc Romero déclarait récemment : « Nous ne pouvons que dire merci à Dignitas, et nous n’allons pas empêcher nos membres d’entrer en contact avec eux. Bien au contraire » (interview au Nouvel Observateur, 29 mai 2008).
456 () TF1, 20 septembre 2007.
457 () S. Fischer, C.A. Huber, L. Imhof, R. Mahrer Imhof, M. Furter, S.J. Ziegler et G. Bosshard, «Suicide assisted by two Swiss right-to-die organisations», in Journal of Medical Ethics, 2008.
458 () Schweizerisches Strafgesetzbuch, Procès verbal de la deuxième commission d’experts, vol II, septembre/octobre 1912, p. 172
459 () Conseil d’État, n° 47786 et 47259, 13 juillet 2007.
460 () Cf. supra, partie I.
461 () 26 juin 2008 – BT-Plenarprotokoll 16/172, S. 18260 C-18274 D.
462 () Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
463 () Audition du 8 octobre 2008.
464 () Audition du 7 octobre 2008.
465 () Audition du 21 janvier 2004.
466 () Audition du 14 octobre 2008.
467 () Axel Kahn, L’ultime liberté, Plon, 2008, p.76.
468 () Rapport n° 1708, tome 1, Respecter la vie, Accepter la mort, p. 201.
469 () Audition du 15 juillet 2008.
470 () Audition du 30 Avril 2008.
471 () Audition du 10 septembre 2008.
472 () Cf. La Croix, 11 avril 2008
473 () Audition du 7 octobre 2008.
474 () Audition du 8 octobre 2008.
475 () Audition du 7 octobre 2008.
476 () Cf. http://www.admd.net/objectifs/proposition-loi-admd.htm
477 () Rapport n° 1708, Tome I, Respecter la vie, accepter la mort, p. 92.
478 () Conseil d’État, 13 juillet 2007, n° 47 786 et 47 259.
479 () Jacques Ricot, Philosophie et fin de vie, éditions ENSP, p. 27.
480 () Décisions n° 94-343 et 94-344 DC, 27 juillet 1994, Rec. p. 100.
481 () Audition du 7 octobre 2008.
482 () Axel Kahn, L’ultime liberté, Plon, 2008, p. 51.
483 () Audition du 14 octobre 2008.
484 () Audition de Mme le Docteur Marie-Hélène Boucand, de Mme Sylvie Hulin et de Mme Geneviève Invernon, représentants de l’Association française des syndromes d’Ehlers-Danlos.
485 () Audition du 23 septembre 2008.
486 () Audition du 16 septembre 2008.
487 () Audition du 18 juin 2008.
488 () Audition de M. Vincent Léna du 18 juin 2008 : « La commission n’aurait pas pour mission d’autoriser ou non l’aide médicalisée à mourir mais de déterminer si le patient remplit les conditions pour être éligible. La même procédure pourrait s’appliquer à l’accès aux soins palliatifs. »
489 () Audition de M. Alain Prothais du 23 septembre 2008.
490 () TF1, 20 septembre 2007.
491 () Audition du 7 octobre 2008.
492 () Audition du 16 septembre 2008.
493 () Audition du 16 septembre 2008.
494 () Audition du 23 septembre 2008.
495 () Audition du 8 octobre 2008.
496 () Audition du 16 septembre 2008. Cf. annexe n° IV reproduisant les articles du code pénal cités.
497 () CA Toulouse, 9 Août 1973, D. 1974 .452.
498 () Cass. crim., 26 février 1988.
499 () Article 24-6 de la loi du 24 juillet 1880 sur la presse, par exemple, qui condamne la provocation à la haine raciale ; article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.
500 () Audition du Professeur Alain Prothais du 23 septembre 2008.
501 () Audition du Doyen Bernard Beignier du 8 octobre 2008.
502 () Rapport n° 999, Albert Mamy, Doc. AN, session 1987-88, p. 8.
503 () Sénat, 9 juin 1983, p. 1522.
504 () TGI Lille, 5 avril 1990. D. 1993. Somm. 14 ; obs. Azibert ; Dr. pénal 1991.196. ; RSC 1993.325. obs. Levasseur.
505 () I. Lucas-Gallay, « La loi du 31 décembre 1987 relative à la répression de la provocation au suicide et son application dans le temps » Les petites affiches, 26 juillet 1996, n° 90.
506 () CA, chambre de l’instruction,1er février 2005
507 () Audition du 7 octobre 2008.
508 () Affaire mise en délibéré au 8 décembre 2008.
509 () Audition du 8 octobre 2008.
510 () Cass. Crim., 26 avril 1989.
511 () Chambre correctionnelle 11, Section A ,11 janvier 2005.
512 () Article 223-15-2 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité , due à son âge , à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »
513 () Cass. Crim., 8 juin 1993, n° 93-81372, B. 203.
514 () Cf. supra, partie I.
515 () Audition de Mme Maryannick Pavageaux du 16 juillet 2008.
516 () Audition du 30 avril 2008.
517 () Audition du 15 juillet 2008.
518 () Audition du 30 avril 2008.
519 () Audition du 9 juillet 2008.
520 () Audition du 9 juillet 2008.
521 () Audition du 15 juillet 2008.
522 () Audition du 8 octobre 2008.
523 () Audition du 8 octobre 2008.
524 () Audition du 7 octobre 2008.
525 () Idem.
526 () Ibidem.
527 () Éthique, justice et médecine, Paris, Vuibert, 2005.
528 () Audition du 7 octobre 2008.
529 () Audition du 14 octobre 2008.
530 () Audition du 2 juillet 2008.
531 () Audition du 30 avril 2008.
532 () Audition du 9 septembre 2008.
533 () Audition du 7 octobre 2008.
534 () Annexe n° VIII.
535 () Audition du 9 juillet 2008.
536 () CCNE, avis n° 84 sur « la formation à l’éthique médicale », 2004, p. 25.
537 () Idem, p. 27.
538 () Audition du Docteur Véronique Fournier, du 2 juillet 2008.
539 () Gilles Antonowicz, Moi Hervé Pierra ayant mis six jours à mourir, 2008, Pascuito éditeur, p.72.
540 () Alain Cordier, Rapport « Éthique et professions de santé », 2003, p. 43.
541 () Données recueillies auprès du Conseiller scientifique de l’Ambassade de France aux États-Unis.
542 () The American Journal of Bioethics, février 2007.
543 () Audition du 2 juillet 2008.
544 () Cf. supra, partie I, chapitre III.
545 () Voir tableau en annexe n° X.
546 () Audition du 30 avril 2008.
547 () Audition du 18 juin 2008.
548 () Audition du 9 septembre 2008.
549 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 38.
550 () Idem, p. 39.
551 () L’article 9 du projet de loi n° 5584 relatif aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
552 () Repris par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 146.
553 () Enquête nationale « Mort à l’hôpital » du Docteur Édouard Ferrand, cité par Mme Paulette Le Lann au cours de son audition.
554 () Audition du 9 septembre 2008.
555 () Audition du 16 juillet 2008.
556 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 39.
557 () Audition de Mme Roselyne Bachelot du 14 octobre 2008.
558 () Audition du 9 septembre 2008.
559 () Audition du 9 septembre 2008.
560 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 40.
561 () E. Paget Évaluation des coûts des soins palliatifs, Thèse de médecine, Besançon, 00-032, 2000, 148 p., cité in Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 146.
562 () Audition du 14 octobre 2008.
563 () Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994.
564 () La Croix, « Il faut créer des chaires universitaires de soins palliatifs », appel lancé par les professeurs Régis Aubry, Louis Puybasset, Sadek Beloucif, François Goldwasser, Robert Zittoun et Didier Sicard, 29 octobre 2008, p. 1.
565 () Éthique et profession de santé, 19 mai 2003.
566 () CCNE, avis n° 84 sur la formation à l’éthique médicale, 29 avril 2004.
567 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, annexe n° 13 du groupe de travail « Formation – Recherche ».
568 () CCNE, Avis n° 84 sur la formation à l’éthique médicale, 29 avril 2004, p. 8-9.
569 () Voir notamment T. Benton, « Medical education and training in palliative medecine : medical undergraduates », in Palliative Medecine, 1988, 2, p. 139-142.
570 () Idem, p. 9.
571 () Proposition formulée par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, annexe n° 13 du groupe de travail « Formation – Recherche ».
572 () CCNE, Avis n° 84 sur la formation à l’éthique médicale, 29 avril 2004, p. 18, citant le Rapport Cordier, p. 32.
573 () Audition du Docteur Régis Aubry, du 30 avril 2008.
574 () Audition du 30 avril 2008.
575 () Audition du 10 septembre 2008.
576 () Audition du Professeur Christian Hervé du 10 septembre 2008.
577 () p. 26.
578 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 35.
579 () La Croix, op. cit., 29 octobre 2008, p. 1.
580 () Didier Sicard, « Soins palliatifs, pour une inscription universitaire », Revue du praticien, médecine générale, N° 22, 2008, p. 795.
581 () Audition du 8 octobre 2008.
582 () Audition du Docteur Michel Legmann, 9 septembre 2008.
583 () La Croix, op. cit., 29 octobre 2008, p. 1.
584 () Idem. p. 1.
585 () Louis Puybasset, « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », op. cit., et audition du 8 octobre 2008.
586 () La Croix, op. cit., 29 octobre 2008, p. 1.
587 () Docteur Michèle-Hélène Salamagne et Docteur Sylvain Pourchet, Euthanasie, sédation - Aux limites du soin : les situations extrêmes en fin de vie, Face aux fins de vie et à la mort, Espace Éthique, Vuibert 2006, p. 216.
588 () Cf. Blanchet V., Aubry R. and al., La sédation pour détresse en phase terminale - Recommandations de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (Méd Pal 2002 ; n°1).
589 () Audition du 2 juillet 2008.
590 () Idem.
591 () Audition du 30 avril 2008.
592 () Audition du 22 avril 2008.
593 () Audition du 16 juillet 2008.
594 () Audition du 2 juillet 2008.
595 () Audition du 2 juillet 2008.
596 () Audition du 30 avril 2008.
597 () Audition du 9 septembre 2008.
598 () Idem.
599 () Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, Brochure à l’intention du corps médical, p. 14.
600 () Audition du 10 septembre 2008.
601 () J-C Ropert, « Les dilemmes éthiques des décisions de fin de vie en période périnatale », Arch. Pédiatriques 2002 : 9 Suppl 1 :43-8.
602 () Axel Kahn, L’ultime liberté, Plon, 2008, p. 89.
603 () Audition du Docteur Anne-Laure Boch du 1er juillet 2008.
604 () Patrick Verspieren, Situations extrêmes et décision médical. Éthique, médecine et société, p. 699, Collection Espace éthique, Vuibert 2007.
605 () Audition du Docteur François Tasseau du 16 septembre 2008.
606 () Cass. civ., 2ème, 22 février 1995, Bull. civ. n°61.
607 () Audition du Docteur Stéphane Donnadieu du 2 juillet 2008.
608 () Audition du Professeur Louis Puybasset du 8 octobre 2008.
609 () Idem.
610 () Ibidem.
611 () Audition du 8 octobre 2008.
612 () Cf. partie I du présent rapport.
613 () Patrick Verspieren, Situations extrêmes et décision médicale, Éthique, médecine et société, p.699, Collection Espace éthique, Vuibert 2007.
614 () Audition du 16 septembre 2008.
615 () Audition du 1er juillet 2008.
616 () Louis Puybasset, « Droits des malades en fin de vie et neuroéthique », http://www.espace-ethique.org, octobre 2008.
617 () Idem.
618 () Ibidem.
619 () Respiration agonique.
620 () Audition du 8 octobre 2008.
621 () Idem.
622 () Audition du 16 juillet 2008.
623 () Idem.
624 () CCNE, Rapport et recommandations, n° 63, 27 janvier 2000, « Fin de vie, arrêt de vie et euthanasie ».
625 () Audition du 9 septembre 2008.
626 () Voir supra, Partie I, Chapitre III, A.
627 () Voir supra, Partie I, Chapitre III, B.
628 () Voir tableau en annexe n° X.
629 () Audition du 9 juillet 2008.
630 () Y. Tibi-Levy, « Les équipes hospitalières de soins palliatifs dans le processus de rationalisation des soins : entre engagement idéologique et contraintes financières », Paris XI, Faculté de médecine Paris sud, 1er juin 2007.
631 () Audition du 9 juillet 2008.
632 () Audition du 28 mai 2008.
633 () Voir infra, chapitre IV, C.
634 () Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement, Rapport de fin d’exercice, 12 janvier 2008, p. 15.
635 () Voir supra, chapitre I, C.
636 () Audition du 9 juillet 2008.
637 () Auditions du Professeur François Goldwasser du 24 juin 2008 et du Professeur Daniel Brasnu du 15 juillet 2008.
638 () Audition du 15 juillet 2008.
639 () Audition du 8 octobre 2008.
640 () Audition du Professeur François Goldwasser du 24 juin 2008.
641 () Audition du Docteur Stéphane Donnadieu du 2 juillet 2008.
642 () Audition du Professeur François Goldwasser du 24 juin 2008.
643 () Audition du 25 juin 2008.
644 () Extrait du manuel de certification V 2010.
645 () Audition du 8 octobre 2008.
646 () Audition du 24 juin 2008.
647 () Audition du 25 juin 2008.
648 () Cf. Partie I.
649 () Audition du Docteur Godefroy Hirsch, du 9 septembre 2008.
650 () Audition du 24 juin 2008.
651 () Audition du 8 octobre 2008.
652 () Audition du 8 octobre 2008.
653 () Idem.
654 () Audition du 14 octobre 2008.
655 () Audition du 15 juillet 2008.
656 () Par exemple au Canada, qui a développé le système d’indicateurs le plus complet, leur utilisation est recommandée sans valeur obligatoire.
657 () Audition du 24 juin 2008.
658 () Audition du 9 juillet 2008.
659 () Audition du 14 octobre 2008.
660 () Audition du 10 septembre 2008.
© Assemblée nationale