

![]()
N° 1799
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
AU NOM DE LA MISSION D’ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Présidente
Mme Danielle Bousquet,
Rapporteur
M. Guy Geoffroy,
Députés.
——
TOME I
RAPPORT
La mission d’évaluation est composée de :
Mme Danielle Bousquet, Présidente ; M. Guy Geoffroy, rapporteur ; Mmes Martine Billard, Monique Boulestin, Chantal Bourragué, Françoise Branget, Chantal Brunel, Marie-George Buffet, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Arlette Franco, Françoise Guégot, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Guénhaël Huet, Olivier Jardé, Henri Jibrayel, Yvan Lachaud, Mme Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Bernard Lesterlin, Mme Geneviève Levy, M. Daniel Mach, Mme Martine Martinel, MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Luc Pérat, Mme Catherine Quéré, M. Jacques Remiller, Mmes Catherine Vautrin, Marie-Jo Zimmermann.
INTRODUCTION 11
PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA MISSION 13
PREMIÈRE PARTIE : PRENDRE LA MESURE DE LA GRAVITÉ DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 17
Chapitre Ier : Les violences au sein du couple, un phénomène de masse
I. UNE VIOLENCE « BANALE » ET GRAVE 18
A. « 10 % DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DE LEUR COUPLE » : ANATOMIE D’UNE VIOLENCE DE MASSE 19
B. « UNE FEMME DÉCÈDE TOUS LES DEUX JOURS ET DEMI, VICTIME DE SON COMPAGNON OU EX-COMPAGNON » : LES DÉCÈS AU SEIN DU COUPLE 26
C. LES VIOLENCES DE NATURE PSYCHOLOGIQUE, LA FACE CACHÉE DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 30
II. UN PHÉNOMÈNE QUI RESTE MAL CONNU 33
III. DES CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES MAJEURES 40
A. DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES SUR LA SANTÉ DES VICTIMES 40
B. DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ÉVALUÉES À PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS PAR AN 41
Chapitre II : Les violences dans l’espace public ne sont pas celles
que l’on croit
I. LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SPÉCIFIQUES 45
A. LES VICTIMES DE VIOLENCES DANS L’ESPACE PUBLIC NE SONT PAS EN MAJORITÉ DES FEMMES 45
B. L’EXISTENCE D’UNE VIOLENCE DE GENRE DANS L’ESPACE PUBLIC 47
II. L’ESPACE PUBLIC PEUT ETRE PERÇU COMME HOSTILE PAR LES FEMMES 48
A. DE PETITES VIOLENCES QUI EN LAISSENT CRAINDRE DE PLUS IMPORTANTES 48
B. POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DE LA REALITÉ, UNE COMPTABILISATION SEXUÉE DES VIOLENCES EST NÉCESSAIRE 49
Chapitre III : les violences au travail, une réalité qui commence seulement à être reconnue
I. LE CONSTAT : DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL 51
II. DES DONNÉES QUI DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES 57
A. DES ENQUÊTES RÉCENTES À L’ÉTRANGER, AU PLAN EUROPÉEN ET AU PLAN RÉGIONAL 58
B. UNE CONNAISSANCE À APPROFONDIR POUR LEVER UN TABOU QUI PERSISTE 62
Chapitre IV : La connaissance des mutilations sexuelles et des mariages forcés : le jour et la nuit
I. UNE ENQUÊTE PIONNIÈRE EN EUROPE, PERMETTANT DE BIEN CONNAÎTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES 66
A. L’ESTIMATION DU NOMBRE DE CAS DE MUTILATIONS SEXUELLES AUJOURD’HUI EN FRANCE 66
B. UN NOMBRE DE CAS EN RECUL 68
C. DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DES FEMMES 71
D. UNE CONNAISSANCE PLUS FINE DES LOGIQUES QUI CONDUISENT AUX MUTILATIONS SEXUELLES 72
II. LA CONNAISSANCE TRÈS IMPARFAITE DU NOMBRE DE MARIAGES FORCÉS 73
A. LES MARIAGES FORCÉS, UNE RÉALITÉ TRÈS MAL CONNUE 74
B. LES DIFFICULTÉS D'ÉVALUATION DU NOMBRE DE MARIAGES FORCÉS 76
C. DES ÉTUDES QUALITATIVES, QUI PERMETTENT D’ABOUTIR À UNE TYPOLOGIE DES MARIAGES FORCÉS 79
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE : CRÉER UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 81
DEUXIÈME PARTIE : COUPLER ÉTROITEMENT LA PRÉVENTION DES VIOLENCES, LE SUIVI DES ENFANTS TÉMOINS ET CELUI DES AUTEURS 83
Chapitre Ier : La prise en charge des enfants exposés aux violences, première des préventions
I. LES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES : DES CONSÉQUENCES MAJEURES 84
A. DES ENFANTS VICTIMES DES VIOLENCES, MÊME QUAND ELLES NE SONT PAS DIRIGÉES CONTRE EUX 85
B. FAIRE PRÉVALOIR L’INTÉRÊT DE L’ENFANT 88
II. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS TÉMOINS 89
A. SENSIBILISER ET FORMER LES PROFESSIONNELS AU DANGER ENCOURUS PAR CES ENFANTS 90
B. PRENDRE EN CHARGE LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES 90
Chapitre II : Le suivi des auteurs : un impératif pour la prévention des violences au sein du couple
I. DES PROFILS QUI JUSTIFIENT UN SUIVI SYSTÉMATIQUE 92
II. LA LOI ORGANISE LE SUIVI DES AUTEURS 94
A. UN SUIVI POSSIBLE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE 94
B. LES RÉSULTATS DE CES DISPOSITIFS SONT ENCOURAGEANTS 97
C. UN OUTIL À RÉORIENTER VERS L’OBLIGATION DE SOINS 98
III. LE SUIVI DES AUTEURS EST GRAVEMENT COMPROMIS PAR LE MANQUE DE VISIBILITÉ ET DE MOYENS 99
A. UNE PROBLÉMATIQUE SOUFFRANT ENCORE D’UNE FAIBLE VISIBILITÉ 99
B. DES MOYENS LARGEMENT INSUFFISANTS 101
Chapitre III : la mobilisation de tous les acteurs pour une prévention plus systématique des violences faites aux femmes
I. PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS ET LES VIOLENCES SEXISTES DÈS L’ÉCOLE 106
A. DES COMPORTEMENTS PRÉSENTS CHEZ LES JEUNES 106
B. L’ENGAGEMENT DE L’ÉCOLE DANS LA PRÉVENTION DES VIOLENCES 110
II. RENFORCER LA MOBILISATION ET LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 115
A. LE REPÉRAGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 115
B. L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES A L’HÔPITAL 117
C. LA CONSTATATION DES VIOLENCES 118
III. RENDRE PLUS SYSTÉMATIQUE LE REPÉRAGE DES VIOLENCES AU TRAVAIL 120
A. DES ACTEURS NOMBREUX MAIS INSUFFISAMMENT MOBILISÉS 120
B. L’INFORMATION DES SALARIÉES, COROLLAIRE DE LA MOBILISATION AU SEIN DU MILIEU PROFESSIONNEL 123
IV. IMPLIQUER LES MÉDIAS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 125
A. DES STÉRÉOTYPES PERSISTANTS RENDANT NÉCESSAIRE UNE SENSIBILISATION DES MÉDIAS 125
B. RENFORCER LES DISPOSITIFS DE RÉGULATION 127
C. LES MÉDIAS, VECTEURS DE CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALES 131
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE : CRÉER UNE OBLIGATION DE FORMATION DES ACTEURS 134
TROISIÈME PARTIE : FACILITER L’ACCÈS DES VICTIMES AU DROIT 135
Chapitre I : Conseiller la victime et l’orienter vers les bons acteurs
I. LES ASSOCIATIONS JOUENT DEPUIS LONGTEMPS UN RÔLE MAJEUR DANS L’ACCUEIL ET L’ORIENTATION DES FEMMES VICTIMES 136
II. L’ACCUEIL DANS LES COMMISSARIATS ET LES GENDARMERIES S’EST BEAUCOUP AMÉLIORÉ MAIS RESTE PERFECTIBLE 143
A. DE RÉELS PROGRÈS ONT EU LIEU DANS LA FORMATION DES POLICIERS ET DES GENDARMES ET DANS L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL 144
B. L’ORIENTATION DES VICTIMES VERS LES ACTEURS COMPÉTENTS EST À SYSTÉMATISER 150
Chapitre II : Éliminer les freins à l’accès au droit
I. LES DIFFICULTÉS PROCÉDURALES À ACCÉDER AU DROIT 153
II. LES MENACES SPÉCIFIQUES PESANT SUR LES VICTIMES ÉTRANGÈRES, QUI LES RETIENNENT DE DÉPOSER PLAINTE 160
A. LES MESURES PRISES POUR MAINTENIR LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR DOIVENT ÊTRE APPROFONDIES 160
B. LES DIFFICULTÉS DES VICTIMES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE 163
III. LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, « ÉPÉE DE DAMOCLÈS » AU DESSUS DE LA TÊTE DES VICTIMES 165
A. LE DISPOSITIF EXISTANT EST SUSCEPTIBLE DE PORTER PRÉJUDICE AUX VICTIMES 166
B. LE DÉLIT DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE DEVRAIT ÊTRE MODIFIÉ POUR MIEUX CONCILIER AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET PRÉSOMPTION D’INNOCENCE 170
QUATRIÈME PARTIE : MIEUX ASSURER LA PROTECTION ET LE SUIVI DES VICTIMES 173
Chapitre I : Renforcer les dispositifs garantissant la sécurité des victime
I. L’ÉVICTION DU CONJOINT VIOLENT, UNE AVANCÉE QUI PEINE À ÊTRE MISE EN œUVRE 174
A. LA PROCÉDURE D’ÉVICTION DU CONJOINT VIOLENT POSSIBLE AU CIVIL COMME AU PÉNAL 174
B. LES DIFFICULTÉS DE SA MISE EN œUVRE 177
II. LES ENFANTS, VULNÉRABILITÉ DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 183
A. L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE PAR LE PARENT VIOLENT 183
B. PRIVILÉGIER LES RENCONTRES MÉDIATISÉES 186
III. LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES SUR LE SOL FRANÇAIS COMME À L’ÉTRANGER 188
A. LA PROTECTION À L’ÉTRANGER DES FRANÇAISES ET PERSONNES RÉSIDANT DE MANIÈRE HABITUELLE EN FRANCE 188
B. LE DROIT D’ASILE POUR LES FEMMES MENACÉES D’EXCISION ET DE MARIAGE FORCÉ 190
Chapitre II : Assurer l’autonomie des victimes par le logement et l’insertion
I. ORGANISER UN VERITABLE PARCOURS D’INSERTION, DE L’HEBERGEMENT D’URGENCE VERS LE LOGEMENT AUTONOME 194
A. ASSURER SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE UN ACCUEIL D’URGENCE DE QUALITÉ 194
B. REMÉDIER À L’ENGORGEMENT DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT 197
C. FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT PAR LA MOBILISATION DU PARC SOCIAL ET PRIVÉ ET L’ADAPTATION DU DROIT DU BAIL 200
II – SOUTENIR LES VICTIMES DANS LEURS DÉMARCHES DE RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 206
A. DONNER AUX FEMMES VICTIMES LES MOYENS DE SE RECONSTRUIRE 206
B ACCOMPAGNER LES FEMMES VICTIMES DANS LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 209
Chapitre III : L’ordonnance de protection, mesure cardinale pour la protection des victimes
I. UNE MESURE JUDICIAIRE D’URGENCE 213
A. UNE MESURE OFFRANT UNE PROTECTION RAPIDE DE LA VICTIME 213
B. UNE MESURE PRÉSERVANT LES DROITS DE LA DÉFENSE 215
II. CRÉANT DES OBLIGATIONS POUR LES AUTEURS ET OUVRANT DES DROITS AUX VICTIMES 217
CINQUIÈME PARTIE : COMPLÉTER ET SURTOUT MIEUX APPLIQUER L’ARSENAL JURIDIQUE EXISTANT 223
Chapitre I : Des politiques pénales divergentes en rendent l’application disparate
I. LES POLITIQUES PÉNALES MENÉES PAR LES PARQUETS SONT ENCORE DIVERGENTES 224
A. DES DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES IMPORTANTES 225
B. LIÉES À UNE IMPLICATION ET À DES MOYENS VARIABLES 227
II. NÉANMOINS, LES BONNES PRATIQUES TENDENT À SE DIFFUSER DE MANIÈRE CROISSANTE 228
A. DES EXPÉRIENCES MODÈLES 229
B. LA POLITIQUE PÉNALE MENÉE A CONTRIBUÉ À DIFFUSER CES BONNES PRATIQUES 229
III. CES BONNES PRATIQUES DOIVENT ÊTRE ENCOURAGÉES 231
A. LA FORMATION DES MAGISTRATS : UN ENJEU PRIMORDIAL 232
B. LA NÉCESSAIRE DÉSIGNATION D’UN MAGISTRAT RÉFÉRENT AU SEIN DU PARQUET 234
C. LA MÉDIATION PÉNALE N’EST PAS UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX VIOLENCES CONJUGALES 235
Chapitre II : Des délits et des crimes à définir ou à redéfinir
I. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 239
A. IL EST NÉCESSAIRE DE DÉFINIR UN DÉLIT DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 239
B. LA DÉFINITION D’UN DÉLIT DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 243
II. LE MARIAGE FORCÉ 247
A. LA CRÉATION D’UN DÉLIT DE MARIAGE FORCÉ N’A PAS ÉTÉ RETENUE EN 2006 248
B. POURTANT, DES ARGUMENTS MILITENT EN FAVEUR DE LA PÉNALISATION DES MARIAGES FORCÉS 249
C. COMMENT PUNIR LE FAIT DE CONTRAINDRE AUTRUI À SE MARIER ? 251
III. LE HARCÈLEMENT 252
A. LA DÉFINITION JURIDIQUE DU HARCÈLEMENT : UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE 253
B. UNE NOTION DIFFICILE À MOBILISER POUR RÉPRIMER LES COMPORTEMENTS DE HARCÈLEMENT 259
IV. LE VIOL ENTRE ÉPOUX 266
A. LA RECONNAISSANCE DU VIOL ENTRE ÉPOUX PAR LA JURISPRUDENCE PUIS PAR LA LOI EST UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE 266
B. IL FAUT TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES DE CETTE RECONNAISSANCE 267
SIXIÈME PARTIE : SYSTÉMATISER LA COORDINATION DES ACTEURS, EN PARTICULIER AU SEIN DU MONDE JUDICIAIRE 269
I. UN PILOTAGE SOUS L’ÉGIDE DU MINISTRE CHARGÉ DES DROITS DES FEMMES 270
A. LE PILOTAGE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 270
B. LE RÔLE PIVOT DES DÉLÉGUÉES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU SERVICE DES DROITS DES FEMMES 272
II. DÉVELOPPER LES MISES EN RÉSEAU 274
A. LES EFFETS DE LA FUSION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES AU SEIN DES CONSEILS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 274
B. GÉNÉRALISER LES PROTOCOLES DÉPARTEMENTAUX DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 275
C. CONFORTER LES RÉFÉRENTS LOCAUX VIOLENCES CONJUGALES DANS LEUR RÔLE D’INTERFACE 277
D. DÉVELOPPER LES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES AU NIVEAU LOCAL 278
III. COORDONNER LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES AFFAIRES DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 280
A. LA CRÉATION DE JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES N’EST PAS SOUHAITABLE 280
B. UNE COORDINATION DOIT ÊTRE INSTITUTIONNALISÉE SOUS L’IMPULSION D’UN MEMBRE DU PARQUET SPÉCIALISÉ 282
CONCLUSION : CRÉER UN DISPOSITIF-CADRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 285
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION 287
EXAMEN DU RAPPORT 299
DÉPLACEMENTS DE LA MISSION 301
Les violences faites aux femmes sont inacceptables, quelle que soit leur forme. Leurs conséquences sont considérables sur les femmes qui en sont victimes, sur leurs enfants qui en sont témoins, sur la société dans son ensemble.
Les membres de la mission d’évaluation étaient tous portés, dès l’origine de leurs travaux, par cette même conviction. Mais après une quarantaine d’auditions et plus d’une centaine de personnes entendues, ils ont pu mesurer l’ampleur et la diversité de ces formes de violences et la complexité des réponses à leur apporter.
La mission a eu pour double objectif d’évaluer la politique menée en matière de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et de formuler les propositions qui lui apparaîtraient nécessaires.
Ceci rendait indispensable d’aborder cette question dans toutes ses dimensions par une approche d’ensemble comme l’a fait la proposition de loi-cadre élaborée par le Collectif national pour les droits des femmes qui a donné lieu à une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007 par Mmes Marie-George Buffet et Martine Billard (1). Une pétition du Collectif qui avait réuni des milliers de signatures a contribué à l’initiative prise par le Président de l’Assemblée nationale de demander à la Conférence des Présidents la création d’une mission d’évaluation.
Sa conclusion est également double.
D’une part, de nombreux textes pour la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes existent déjà dans le droit français. Ceci ne signifie par, pour autant, que rien ne doive changer dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Au contraire, au-delà des améliorations législatives encore nécessaires, le dispositif devrait être complété pour y intégrer l’ensemble des mesures concourant à cette politique. Celles-ci ne sont pas toutes de nature législative. C’est pourquoi l’adoption d’une loi-cadre, calquée sur celle qui a été votée par le Parlement espagnol en 2005, ne se justifie pas en tant que telle. C’est davantage un dispositif global, cohérent et coordonné, matérialisant la transversalité des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui devrait être mis en place.
D’autre part, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être affirmée comme un des fondements de notre pacte républicain, c'est-à-dire être inscrite dans la Constitution.
De même que le préambule de la Constitution de 1958 mentionne les droits civils et politiques de la déclaration de 1789, les droits économiques et sociaux du préambule de 1946, les droits environnementaux de la charte de l’environnement de 2005, il devrait également être fait référence à la dignité de la personne humaine. Simone Veil n’a pas suggéré autre chose, dans son rapport sur le préambule de la Constitution, quand elle préconise qu’y soit reconnu le principe « d’égale dignité de chacun ».
Mais plutôt qu’un simple principe, c’est une charte de la dignité de la personne humaine qu’il faut introduire dans le préambule de la Constitution, qui devrait comporter une condamnation solennelle des violences de genre.
Bien davantage qu’une loi-cadre, il faut promouvoir un dispositif-cadre. Celui-ci aurait un volet constitutionnel, un aspect législatif, qui reprendrait de nombreux éléments de la proposition de loi-cadre mais également un versant réglementaire et territorial. Ce dispositif-cadre doit englober l’ensemble des politiques publiques qui participent à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il existe déjà largement, les plans triennaux élaborés par le Gouvernement en témoignent, mais il est nécessaire de le renforcer.
Les outils juridiques de ce dispositif-cadre doivent être au service de six grands objectifs autour desquels s’organise le présent rapport : dénombrer les violences de genre, mieux les prévenir, faciliter l’accès des victimes au droit, et les protéger, compléter l’arsenal juridique existant et mieux coordonner les acteurs qui interviennent dans ce champ.
La mission a étudié toutes les formes de violences faites aux femmes, dans leur grande diversité : les violences subies par les femmes au sein du couple, les mutilations sexuelles et les mariages forcés, les violences subies au travail et dans l’espace public. Cependant n’ont pas été abordées les violences liées à la traite des êtres humains, qui constitue un sujet à part entière, ni l’esclavage moderne, qui a fait l’objet d’un précédent rapport (2). Le port de la burqa, apparu récemment dans le débat public, est aussi, à l’évidence, une forme de violence à l’encontre des femmes, qui fera l’objet d’une mission d’information en tant que telle (3).
Enfin, la mission tient à souligner le travail remarquable des acteurs de terrain, notamment associatifs, qu’elle a rencontrés. Sans leur travail quotidien, le constat pourtant alarmant de l’ampleur des violences faites aux femmes serait encore plus accablant.
PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA MISSION
(L’ensemble des propositions est récapitulé p. 287 et suivantes)
Proposition n° I
Introduire dans le préambule de notre loi fondamentale la référence à une charte constitutionnelle de la dignité de la personne humaine comportant une condamnation solennelle des violences faites aux femmes. (cf. p. 12)
Proposition n° II
Promouvoir un dispositif cadre global, cohérent et coordonné regroupant l’ensemble des mesures concourant à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. (cf. p. 12)
Proposition n° III
Généraliser les actions de formations inter-disciplinaires de toutes les professions en contact avec des femmes victimes de violences ou avec des enfants qui en sont témoins.
L’éducation à l’égalité et au respect doit faire partie intégrante des enseignements et de la formation des enseignants. Les magistrats, les policiers, les gendarmes et les professionnels de santé doivent être formés à la spécificité des violences faites aux femmes pour repérer les signes témoignant des violences subies, prendre en charge et orienter les victimes vers les bons acteurs. (cf. p. 106 et suivantes et p. 278 et suivantes)
Proposition n° IV
Instaurer une ordonnance de protection temporaire, au bénéfice des femmes victimes de violences au sein de leur couple, et des enfants si nécessaire, rendue par un juge dans un délai de 24 heures suivant la demande.
Cette ordonnance permettrait de garantir la sécurité des victimes en comportant des obligations provisoires pour l’auteur des violences, telles que l’interdiction de s’approcher du domicile conjugal ou la suspension de l’exercice de l’autorité parentale.
Elle ouvrirait de manière immédiate de nombreux droits à la victime en constituant une preuve de la situation de violence, ouvrant, si nécessaire, un accès immédiat au RSA, facilitant l’obtention d’un titre de séjour et l’accès à l’aide juridictionnelle. Elle serait opposable aux tiers. (cf. p. 213 et suivantes)
Proposition n° V
Affirmer et prendre en compte l’intérêt des enfants dans les situations de violences au sein du couple en garantissant leur protection. (cf. p. 84 et suivantes et p. 183 et suivantes)
Proposition n° VI
Inscrire dans le code pénal un délit de violences psychologiques au sein du couple, en s’inspirant de la définition du harcèlement moral. (cf. p. 239 et suivantes)
Proposition n° VII
Proscrire le recours à la médiation pénale comme réponse aux situations de violences au sein du couple et définir une procédure nouvelle mieux adaptée à ces situations. (cf. p.235 et suivantes)
Proposition n° VIII
Permettre un meilleur accès au droit des femmes étrangères en renouvelant le titre de séjour de celles qui sont victimes de violences au sein de leur couple, en accordant un titre de séjour à celles qui sont en situation irrégulière et qui portent plainte pour violences conjugales et en leur ouvrant droit à l’aide juridictionnelle. (cf. p. 160 et suivantes)
Proposition n° IX
Agir contre les violences faites aux femmes au travail en instaurant des plans de prévention des violences et en formant les acteurs du monde de l’entreprise, notamment les inspecteurs et les médecins du travail. (cf. p. 120 et suivantes)
Proposition n° X
Conserver le rattachement auprès du préfet des chargés de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité. (cf. p. 272 et suivantes)
Proposition n° XI
Désigner, dans chaque TGI, un magistrat du parquet spécialisé dans le suivi des violences de genre.
Institutionnaliser, grâce à cette spécialisation, la circulation de l’information et la coordination entre le parquet, le juge pénal, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales qui ont à connaître des affaires de violences de genre, à commencer par la délivrance de l’ordonnance de protection. (cf. p. 280 et suivantes)
Proposition n° XII
Créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, chargé de coordonner la collecte de données sexuées et d’organiser les enquêtes portant sur les violences faites aux femmes. (cf. p. 81et suivantes)
PREMIÈRE PARTIE : PRENDRE LA MESURE DE LA GRAVITÉ DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
« Respecter les femmes battues, c’est faire des enquêtes. », indiquait M. Pascal Suhard, vice-procureur au TGI d’Albi, au cours de son audition (4).
La nécessité de disposer de données quantitatives et qualitatives concernant les violences faites aux femmes est, en effet, un préalable indispensable à l’action publique. C’est ce qu’avaient souligné les travaux de la conférence internationale de Pékin en 1995, qui a encouragé les États à mieux mesurer les violences faites aux femmes. C’est alors que le Secrétariat d’État aux droits des femmes a décidé de commander l’Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France (ENVEFF), réalisée en 2000, qui constitue encore une source d’information fondamentale.
Depuis 2000, la connaissance des violences conjugales a progressé. Mais si l’on connaît de mieux en mieux les violences commises à l’encontre des femmes au sein du couple, il n’en va pas de même pour toutes les formes de violences. Il faut aussi, en effet, prendre en compte d’autres formes de violences subies par les femmes, du fait de leur sexe : les violences dans l’espace public, les violences au travail ainsi que les violences coutumières. Les deux premières faisaient partie du champ de l’ENVEFF mais leur connaissance doit être approfondie ; en revanche, les données relatives aux violences coutumières que sont les mariages forcés et les mutilations sexuelles sont, elles, très disparates.
Cette classification, qui permet d’identifier et de mettre en évidence les multiples formes que prennent ces violences, ne doit cependant pas masquer le fait que ce sont parfois les mêmes femmes qui les subissent. Tel était l’un des résultats de l’ENVEFF : il existe des « cumuls de violences », notamment entre le lieu de travail et le domicile, qui font que si chacune des violences prises isolément peut sembler peu importante, leur accumulation peut être « totalement insupportable » (5).
Chapitre Ier : Les violences au sein du couple, un phénomène de masse
« L’ENVEFF met en évidence que le huis clos conjugal est l’espace dans lequel les violences physiques à l’encontre des femmes sont les plus nombreuses. » (6) Ce diagnostic a été confirmé depuis par toutes les enquêtes réalisées sur les violences subies par les femmes. Ceci étaye le constat d’une violence à la fois « banale » et grave, mais qui reste encore à mieux cerner faute d’outils statistiques suffisamment adaptés. La mission entend la tenue de couple au sens large, qui inclut les violences commises par les ex.
Pourtant, les conséquences des violences physiques mais aussi psychologiques sur la santé des femmes et l’évaluation de leur coût pour la société (plus d’un milliard d’euros par an) devraient inciter à une meilleure connaissance et à un plus grand volontarisme dans la politique de prévention et de lutte contre ces formes de violences.
I. UNE VIOLENCE « BANALE » ET GRAVE
Afin d’analyser les ressorts des violences au sein du couple, celles-ci doivent, au préalable être distinguées du conflit conjugal. « Il faut éviter de faire des amalgames entre violence et conflit : le conflit est interactif, la violence est univoque. », indiquait ainsi Mme Maryse Jaspard, démographe et directrice scientifique de l’ENVEFF (7).
Pourtant, force est de constater que, même ainsi circonscrite, la violence dont sont victimes les femmes au sein de leur couple est à la fois « banale » et grave : 10 % des femmes sont victimes de violences au sein de leur couple, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, compagnon ou de son ex. Ces deux chiffres ne doivent pas conduire à opposer une violence quotidienne, mais de faible gravité, à une violence rare, mais extrême. Il existe, en effet, souvent un continuum de violences entre celles qui paraissent comme anodines et les plus graves. Une femme est rarement tuée par son compagnon ou ex-compagnon sans qu’aucune violence antérieure n’ait été signalée. Ces deux chiffres sont donc les deux faces d’une même réalité, celle d’une violence grave et ordinaire subie par les femmes au sein du couple.
A. « 10 % DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES AU SEIN DE LEUR COUPLE » : ANATOMIE D’UNE VIOLENCE DE MASSE
1. Des faits de violence, qui toucheraient près de 1,3 million de femmes
Issu de l’ENVEFF, ce chiffre doit être bien interprété : il date de 2000 et porte sur les femmes âgées de 18 à 59 ans vivant en couple. Il synthétise l’ensemble des violences subies par ces femmes au sein de leur couple : « Il en ressortait en effet qu’une femme sur dix était victime de violences physiques et sexuelles mais aussi psychologiques - je classerai à part les violences verbales. Cette proportion est d’autant plus considérable que l’on ne parle là que des femmes vivant en couple. » (8) a précisé Mme Maryse Jaspard. Si l’on extrapole les résultats de l’enquête à la population française, on peut estimer à environ 1,3 million le nombre de femmes qui « vivent chaque jour dans la violence de leur conjoint. » (9) En outre, certaines femmes subissent, au sein de leur couple, plusieurs types de violences simultanément : « la proportion de femmes victimes d’un cumul de violences – physiques, sexuelles et psychologiques – est de quelque 3 %. » (10)
PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉCLARÉ AVOIR SUBI DES VIOLENCES CONJUGALES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS
Type de violence |
Fréquence (en %) |
Insultes et menaces verbales |
4,3 |
dont répétées |
1,8 |
Chantage affectif |
1,8 |
Pressions psychologiques |
37 |
dont répétées |
24,2 |
dont harcèlement moral |
7,7 |
Agressions physiques |
2,5 |
dont répétées |
1,4 |
Viols et autres pratiques sexuelles imposées |
0,9 |
Indice global de violence conjugale (11) |
10 |
Source : Enquête ENVEFF dans INED, « L’enquête nationale sur les violences envers les femmes (ENVEFF) », Population et sociétés, n° 364, janvier 2001.
Les enquêtes ultérieures ne concernent pas spécifiquement les violences faites aux femmes mais, plus généralement, les faits de délinquance. C’est le cas de l’enquête « cadre de vie et sécurité » menée par l’Observatoire national de la délinquance (OND) en 2007. En raison de la nature des questions posées (qui ne prennent en compte que les violences physiques), le nombre de femmes âgées de 18 à 60 ans qui ont subi des violences physiques de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint en 2005 ou 2006 était estimé à 410 000, ce qui représente 2,3 % des femmes interrogées (12).
2. Une violence qui touche tous les milieux sociaux et tous les territoires
a. Les violences faites aux femmes au sein du couple ne sont pas spécifiques à un groupe social particulier
Tous les intervenants entendus par la mission ont confirmé le fait que des situations de violences se rencontraient à tous les niveaux de la société. C’est ce que confirme la sociologue Marylène Lieber à propos des résultats de l’ENVEFF : « les violences conjugales traversent tous les milieux sociaux et […] leurs fréquences n’ont pas de relation directe avec le niveau de formation ou la catégorie professionnelle et sociale de la femme ou de son conjoint. » (13) Une enquête menée sur les arrêts rendus par les cours d’appel de Nîmes et de Montpellier renforce cette analyse : « Notre commentaire sur la profession des prévenus sera bref puisque l’on trouve des maris ou concubins violents dans toutes les catégories socioprofessionnelles. […] Ainsi, dans nos arrêts, le mari violent est aussi bien militaire de carrière, qu’ouvrier d’entretien, œnologue, chef d’entreprise, agriculteur, sous-brigadier de police, routier, kinésithérapeute, gynécologue, plombier ou maçon. » (14)
Cependant, la désaffiliation sociale (au sens de fragilisation des liens professionnels et familiaux (15)) semble être un facteur aggravant. C’est ainsi que Mme Maryse Jaspard a expliqué les écarts constatés entre groupes sociaux dans l’ENVEFF : « les catégories sociales les plus touchées sont les plus désocialisées. » Or, cette désocialisation ne touche pas seulement les catégories les plus défavorisées, mais peut également concerner les femmes des catégories supérieures qui ne travaillent pas : « une femme de notable peut se trouver tout à fait isolée dans sa belle maison, à la ville comme à la campagne, sans arriver à en sortir » (16). Ce lien entre désaffiliation et violences au sein du couple a été confirmé par une étude menée dans le ressort des TGI de Tarn et d’Albi. Selon M. Pascal Suhard, qui en est l’un des auteurs, « ce sont les catégories les plus démunies qui sont les plus touchées. » (17), parce que ce sont les plus désocialisées.
SITUATION DE VIOLENCES CONJUGALES SELON LA SITUATION D’EMPLOI ET LA PROFESSION DE LA VICTIME ET DE L’AUTEUR (EN %)
PCS (18) de la victime |
PCS de l’auteur | |||
Violences graves |
Violences très graves |
Violences graves |
Violences très graves | |
Artisans, commerçants, agriculteurs, chefs d’entreprise |
6,6 |
1,1 |
6,4 |
2,2 |
Cadres |
6,1 |
2,6 |
4,9 |
2,2 |
Professions intermédiaires |
6,8 |
1,5 |
6,9 |
2,9 |
Employés |
6,3 |
2 |
7,5 |
2,2 |
Ouvriers |
4,6 |
3,3 |
6 |
1,9 |
Inactifs ou chômeurs |
7,6 |
2,8 |
8,1 |
2,8 |
dont chômeurs non indemnisés |
9,7 |
4,3 |
8,2 |
8 |
Source : Enquête ENVEFF dans Maryse Jaspard et al., op. cit., Paris, La documentation française, 2003, p. 72.
Lecture : 6,1 % des femmes cadres sont victimes de violences graves au sein de leur couple ; 4,9 % des hommes cadres sont auteurs de violences.
L’importance accordée à la religion, l’âge et le statut matrimonial, selon les résultats de l’ENVEFF, ont également une influence sur le taux de violences subies. De manière générale, les femmes jeunes sont davantage victimes de violences que les femmes plus âgées.
La situation des femmes étrangères ou issues de l’immigration étant apparue spécifique aux auteurs de l’ENVEFF, celle-ci fait l’objet d’un chapitre particulier au sein de l’étude qui en expose les résultats. En effet, ces femmes sont nées et ont vécu leur enfance ou une partie de leur vie adulte dans des sociétés où certaines formes de violences sont acceptées, ces violences contribuant au maintien de certaines valeurs traditionnelles. En général, les femmes immigrées ayant une relation de couple déclarent plus de violences que les autres femmes. La différence n’est significative que pour les femmes originaires du Maghreb ou d’autres pays africains, ce qui s’explique par une pluralité de facteurs : une concentration dans un statut d’emploi favorisant les violences (le taux d’emploi de ces femmes est plus faible que la moyenne) et le fait d’avoir été élevées dans une religion.
Ce constat est d’autant plus important que l’isolement de certaines de ces femmes pour des raisons culturelles, linguistiques, voire de régularité leur séjour, ne fait qu’accroître leurs difficultés à sortir des situations de violences qu’elles peuvent subir.
b. Les différences régionales sont peu significatives
Les résultats de l’ENVEFF démontrent que les disparités entre régions et entre zones rurales et urbaines sont faibles au regard de l’ampleur du phénomène. En revanche, l’accès au droit peut se révéler plus difficile dans les zones rurales : « Il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre milieu urbain et milieu rural, mais les femmes qui vivent à la campagne sont parfois enclavées géographiquement et socialement. Le lieu de travail est un lieu d’échanges. Les femmes qui vivent à la campagne travaillent, bien sûr, mais elles sont souvent isolées, sans insertion sociale. Quelles solutions ont alors les femmes victimes de violences, s’il leur faut parcourir cent kilomètres pour trouver de l’aide ? » (19) a indiqué Mme Maryse Jaspard
Si l’on rapporte néanmoins le nombre de faits constatés de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint au nombre de femmes majeures, le taux national est de 18,7 pour 10 000 femmes majeures. Or, ce taux varie fortement selon les départements, de 6,1 (Creuse) à 50,1 pour 10 000 femmes majeures (Seine-Saint-Denis). Les résultats de ces calculs ont été synthétisés par l’OND dans la carte suivante. Les principaux enseignements sont que :
— les taux les plus élevés se rencontrent dans le Nord de l’Ile-de-France et en Guyane ;
— les taux sont relativement faibles dans les régions de l’Ouest et du Centre de la France et s’accroissent en allant vers le Nord et vers le Sud.
De manière générale, les faits de violences faites aux femmes au sein du couple sont davantage constatés dans les villes.
NOMBRE DE FAITS CONSTATÉS DE VIOLENCES VOLONTAIRES SUR FEMMES MAJEURES PAR CONJOINT EN 2007 POUR 10 000 FEMMES MAJEURES
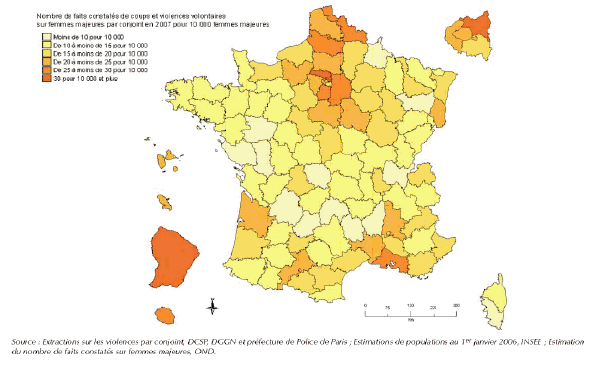
Source : Observatoire national de la délinquance, op. cit., Grand Angle n° 14, juillet 2008, p. 8.
Les données publiées par l’OND sont de deux types. Elles reposent pour une part sur les statistiques de la police et de la gendarmerie et, pour une autre part, sur l’exploitation d’enquêtes de victimation. Mais, ainsi que l’a confirmé M. Christophe Soullez, chef du département de l’Observatoire national de la délinquance (OND) (20) au cours de son audition, la taille de l’échantillon et les moyens consacrés à l’exploitation des enquêtes de victimation de l’OND ne permettent pas de dresser un tableau départemental des violences faites aux femmes. Les données régionales et départementales de l’OND proviennent uniquement des statistiques de la gendarmerie et de la police et enregistrent donc les faits constatés par ces services. De ce fait, on ne peut affirmer que les départements où le taux de violences est le plus élevé sont ceux où le nombre de faits commis est le plus important. En effet, celui-ci peut résulter d’une politique active de lutte contre les violences faites aux femmes, qui aboutit à un accroissement du taux de plainte et donc des faits constatés.
Il est également nécessaire de souligner la spécificité des violences commises à l’encontre des femmes dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. L’ENVEFF, qui a été étendue à la Polynésie et à la Réunion, y a donné des résultats sensiblement différents de ceux obtenus en métropole. Le taux de violences enregistrées y était très supérieur en Polynésie(21) et légèrement supérieur à la Réunion (indice global de violences conjugales de 15 % contre 9 % en métropole). Ces divergences s’expliquent, selon Mme Maryse Jaspard, par un double facteur, tenant d’une part à l’insularité de ces territoires, qui empêche les femmes victimes de s’enfuir, et, d’autre part, à la condition économique et sociale des femmes, qui sont souvent dans une situation de précarité plus grande qu’en métropole (à cause notamment du fort taux de chômage) et qui subissent « un rapport homme-femme au sein du couple […] plus marqué en terme de domination. » (22) Notre connaissance des violences faites aux femmes dans les départements d’outre-mer devrait être complétée par la réalisation, dans le cadre du plan global triennal, d’une enquête de type ENVEFF à la Martinique (objectif n° 1-3 du Plan global 2008-2010 de lutte contre les violences faites aux femmes) (23).
3. Les circonstances de passage à l’acte sont de mieux en mieux connues
Plusieurs moments de la vie de couple sont particulièrement à risque pour la manifestation des violences.
Le premier facteur souvent déterminant dans le déclenchement des violences est celui de la première grossesse. Dans la moitié des cas, la première violence apparaîtrait à cette occasion (24). Ce constat a été dressé, d’une part, par les auteurs de l’ENVEFF en Polynésie (25) et, d’autre part, par Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol : « Très fréquemment la violence physique commence pendant la grossesse et augmente avec son déroulement. » (26)
L’alcool constitue également un élément déterminant du passage à l’acte. En effet, dans près de deux cas sur cinq, l’homme violent a bu lors des faits (27).
Enfin, il est maintenant admis, et la loi en tient compte, que les violences ne cessent pas forcément avec la séparation du couple, au contraire. Les violences commises par les « ex » constituent en effet un nombre non négligeable des faits commis à l’encontre des femmes. 32 % des violences physiques et 19 % des violences sexuelles commises « au sein du couple » sont le fait d’un ex-conjoint, concubin ou compagnon.
L’identification de ces facteurs de risque doit conduire à mettre en place des politiques de dépistage et de prévention adaptées, notamment de la part des professionnels de santé et à l’égard des auteurs.
4. Une flambée des violences conjugales ?
Les indicateurs statistiques concernant les violences subies par les femmes au sein du couple montrent des augmentations très importantes de ces violences. Ceux-ci, portant sur les faits constatés, il ne faut pas en inférer trop rapidement une augmentation aussi forte des faits commis.
a. Des augmentations qui semblent très importantes
Toutes les données disponibles montrent une augmentation importante des faits constatés de violences subies par les femmes au sein du couple. Ceux qui ont été publiés par l’OND et qui retracent les faits constatés par les services de police et de gendarmerie sur les cinq dernières années sont particulièrement éloquents puisque le nombre de faits constatés de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint a augmenté de plus de 30 % entre 2004 et 2007, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.
FAITS CONSTATÉS DE VIOLENCES VOLONTAIRES
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Variation entre 2004 et 2007 | |
NOMBRE DE FAITS CONSTATÉS DE VIOLENCES VOLONTAIRES SUR PERSONNES DE 15 ANS ET PLUS (1) |
144 143 |
156 005 |
171 679 |
184 514 |
+ 28 % | |
VARIATION ANNUELLE |
+ 8,2 % |
+ 10,0 % |
+ 7,5 % |
|||
DONT FAITS CONSTATÉS DE VIOLENCES VOLONTAIRES SUR FEMMES MAJEURES PAR CONJOINT (1) |
36 231 |
36 995 |
41 015 |
47 573 |
+31,3 % | |
VARIATION ANNUELLE |
+ 2,1 % |
+ 10,9 % |
+ 16 % |
+ 5,7 % | ||
PART DE (2) PAR RAPPORT À (1) |
25,1 % |
23,7 % |
23,9 % |
25,6 % |
Source : Observatoire national de la délinquance, « Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu’en 2004 », Grand Angle n° 14, juillet 2008, p. 4 et audition de M. Christophe Soullez.
De même, les affaires de violences conjugales enregistrées par le ministère de la Justice entre 2003 et 2007 sont passées de 39 000 à 58 000, soit une augmentation de presque 50 %.
Considérés selon la nature de l’infraction, les faits constatés sont également en très forte augmentation. Les décès au sein du couple ont fortement augmenté entre 2006 et 2007 (28), ainsi que les condamnations pour viol conjugal qui ont presque doublé entre 2002 et 2007, avec une progression annuelle moyenne de 15,5 %.
NOMBRE DE VIOLS CONJUGAUX
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
329 |
423 |
445 |
591 |
575 |
636 |
Source : OND et Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 19.
b. Des chiffres qu’il faut interpréter
Ces chiffres portent sur les violences constatées. Dès lors, leur évolution peut résulter soit d’une augmentation effective du nombre de faits, soit d’un taux de déclaration croissant des violences. Enfin, les contours du phénomène étudié ont également changé.
— Les changements du périmètre étudié
Depuis la loi du 4 avril 2006, les « ex » entrent dans le champ des violences commises au sein du couple. Selon l’OND, ce changement dans les faits pris en compte a été pour beaucoup dans l’augmentation du nombre des violences subies par les femmes au sein du couple entendu au sens large : « Une partie de ces augmentations est très vraisemblablement la conséquence de l’ajout des faits de violences par ex-conjoint au sein de l’ensemble étudié. (29)»
— L’effet d’une hausse du taux de révélation
De nombreuses personnes interrogées attribuent pour une grande part l’augmentation des faits constatés à une hausse du taux de révélation. C’est ce qu’ont avancé notamment les auteurs du rapport d’évaluation du premier plan global triennal au cours de leur audition : « Le nombre plus important de déclarations expliquerait une part de l’augmentation statistique. Les succès qu’enregistrent les services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les violences intraconjugales se traduisent paradoxalement par une dégradation de leurs indicateurs. » (30)
La ministre de l’Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie a confié au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le préfet Philippe de Lagune, une mission portant sur les violences intrafamiliales. Sa lettre de mission fixe parmi ses objectifs celui d’analyser le système statistique existant afin de déterminer la cause de la hausse du chiffre des violences intrafamiliales constatées. Selon M. Philippe de Lagune, cette augmentation est due, au moins pour partie, à une hausse du taux de plainte, résultant de l’action des pouvoirs publics en matière de sensibilisation et des incitations au dépôt de plainte plutôt qu’à l’enregistrement d’une main courante (31).
Cette analyse peut être corroborée par l’étude des données provenant de Seine-Saint-Denis. En effet, l’augmentation depuis 2007 des faits constatés sur femmes majeures par conjoint y a connu une progression de plus de 87 % (32), soit une des plus fortes de France. Or, une telle augmentation, selon l’OND, est obligatoirement due, au moins pour partie, à une augmentation du taux de plainte grâce notamment aux campagnes importantes de sensibilisation qui ont été menées dans ce département : « Il existe, comme semblent l’indiquer différentes campagnes médiatiques intervenues dans ce département depuis 2004, une politique de sensibilisation, d’accueil, de suivi des victimes de violences encore plus active qu’ailleurs, impliquant à la fois les administrations et les associations et qui aurait eu notamment pour conséquence une augmentation du taux de plainte. » (33)
B. « UNE FEMME DÉCÈDE TOUS LES DEUX JOURS ET DEMI, VICTIME DE SON COMPAGNON OU EX-COMPAGNON » : LES DÉCÈS AU SEIN DU COUPLE
« Les violences conjugales sont une des causes principales de mortalité des femmes. La mort peut être l’issue ultime de la violence qu’il s’agisse de suicides, d’homicides ou de décès dus à des pathologies en lien avec la violence, telles que lésions du foie, ruptures de la rate par exemple. » (34) indiquait en 2001 le rapport élaboré par le professeur Roger Henrion. Des études systématiques ont depuis confirmé cette réalité.
Le meurtre (de la conjointe, de la compagne ou de l’ex) est la forme la plus visible et la plus dramatique des violences subies par les femmes. Or, les données disponibles sont inquiétantes. Ces morts violentes au sein du couple (pris au sens large évoqué ci-dessus) sont mieux connues depuis que la Délégation aux victimes (DAV) (35) publie chaque année, depuis 2006, une Étude nationale des décès au sein du couple, fondée sur les statistiques de la police et de la gendarmerie. Ces données sont essentielles pour comprendre le processus et les circonstances qui conduisent à des meurtres. L’action 1-1 du plan global triennal envisage d’ailleurs d’en diffuser les résultats plus largement.
Il en ressort que le nombre de femmes, qui décèdent sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire est en augmentation : 137 femmes étaient mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon en 2006 (soit une tous les trois jours), contre 166 en 2007 (soit une tous les deux jours et demi). Ces meurtres au sein du couple représentent près de 20 % de l’ensemble des homicides.
NOMBRE DE DÉCÈS AU SEIN DU COUPLE (2006 ET 2007)
2006 |
2007 | |
PERSONNES DÉCÉDÉES AU SEIN DU COUPLE |
168 |
192 |
DONT FEMMES |
137 |
166 |
POURCENTAGE DE FEMMES PARMI LES PERSONNES DÉCÉDÉES AU SEIN DU COUPLE |
82 % |
86,5 % |
FRÉQUENCE DE DÉCÈS DES FEMMES AU SEIN DU COUPLE |
3 JOURS |
2,5 JOURS |
Source : DAV, Étude nationale des décès au sein du couple, 2006 et 2007.
En une seule année, les décès de femmes au sein du couple ont donc augmenté de plus de 20 %. S’il est possible qu’un meilleur décompte soit, pour partie, à l’origine de cette augmentation, en sens inverse, ces statistiques ne tiennent pas compte des suicides qui sont consécutifs à des situations de violence au sein du couple.
Les études de la DAV recensent des victimes « collatérales » de ces meurtres puisque les enfants ou des membres de la famille peuvent également faire l’objet de la violence de l’homme, qui, souvent, retourne ensuite son arme contre lui. 74 personnes sont ainsi mortes en 2007.
2. Des circonstances particulières ?
Ces violences extrêmes ne sont pas statistiquement très différentes des violences conjugales.
Les meurtres au sein du couple ont eu lieu :
— pour moitié au sein de couples mariés ou pacsés ;
— pour 30 % au sein de couples vivant en concubinage ;
— pour 20 % au sein de couples séparés.
Néanmoins, la séparation est l’explication principale du passage à l’acte, selon la DAV (36).
Un exemple de faits relevés dans l’étude des décès au sein du couple illustre cette réalité : « En instance de divorce suite à des viols et des menaces de mort, l’auteur des violences n’accepte pas la séparation. Mis en examen quinze jours auparavant et libéré sous contrôle judiciaire, il agresse son épouse dans la rue et la tue de dix coups de fusil avant de se suicider. » (37) C’est également ce qu’a constaté Mme Maryse Jaspard : « Les femmes tuées par leur conjoint sont le plus souvent celles qui ont voulu s’en séparer ; très souvent, elles sont assassinées après la séparation. […] Statistiquement, il apparaît que c’est lorsqu’une femme a subi pendant des années le contrôle, le dénigrement et les coups de son conjoint et qu’elle décide de partir que l’homme violent la tue, car il ne supporte pas d’en perdre le contrôle. » (38)
Dans de nombreux cas également, le meurtre est l’ultime étape d’un continuum de violences, puisque dans un quart des cas, il existait une violence connue antérieure. Lorsque la femme est auteur du meurtre, elle était d’ailleurs dans un tiers des cas victime de violences conjugales. Là encore, l’exemple suivant est révélateur : « Lors d’une dispute, dans un couple en instance de divorce, le conjoint bat à mort sa compagne. Bien qu’il ne soit pas sous l’emprise de l’alcool au moment des faits, l’auteur reconnaît son intempérance et les violences récurrentes au sein de son couple. Condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis en 2006 pour deux faits antérieurs, il avait interdiction d'approcher sa victime. » (39)
Un groupe de travail de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis a récemment publié un rapport portant sur les 24 « féminicides » qui ont eu lieu dans ce département entre 2005 et 2008, c'est-à-dire sur les 24 meurtres commis sur une femme au sein du couple. Il en ressort que dans deux tiers des cas, il existe des antécédents de violences conjugales, qui sont attestés, également dans deux tiers des cas, par des mains-courantes déposées au commissariat (40).
Enfin, l’exercice du droit de garde ou de visite constitue souvent un moment propice au passage à l’acte violent. Un dernier exemple, tiré de l’étude de la DAV, met en évidence le danger potentiel de ces situations : « Un couple, séparé depuis deux ans, bénéficiait d’une mesure de garde alternée pour leur fille de trois ans. Alors que l’ex-concubine et sa mère venaient amener l’enfant, une dispute éclate sur le palier, vraisemblablement au sujet de la garde. Le compagnon, fou furieux, tue alors les deux femmes de nombreux coups de couteau avant de se suicider. La petite fille était dans les bras de sa mère au moment des faits. » (41)
FACTEUR PRINCIPAL DU PASSAGE À L’ACTE, SELON LA DAV
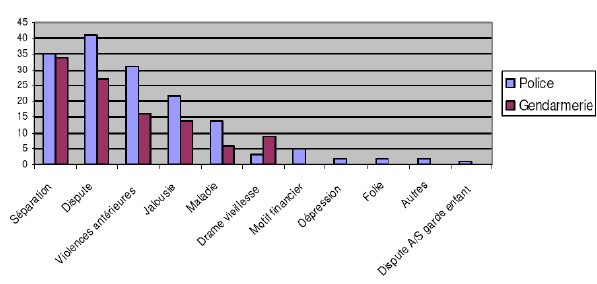
Source : DAV, Étude nationale des décès au sein du couple, 2007, p. 5.
Les facteurs sociologiques ne sont pas non plus très différents dans les situations de meurtres par rapport aux cas de violences conjugales : 59 % des auteurs et 60% des victimes étaient inactifs au moment des faits et dans 44 % des cas, les deux membres du couple étaient en situation d’inactivité. Les départements les plus touchés sont identiques à ceux qui connaissent les plus forts taux de violences conjugales : le Nord (12 cas), le Sud de la France et la Seine-Saint-Denis (8 cas). L’Outre-mer connaît également des taux élevés (avec 12 cas), deux à trois fois supérieurs aux taux métropolitains.
La connaissance, essentielle, des décès liés aux violences au sein du couple, devrait être encore approfondie par la mise en œuvre de l’action 2-2 du plan global triennal 2008-2010, qui prévoit que la réalisation d’une enquête soit confiée à un prestataire, afin de mieux analyser les liens entre meurtres au sein du couple et exercice des droits de visite.
C. LES VIOLENCES DE NATURE PSYCHOLOGIQUE, LA FACE CACHÉE DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE
Le repérage des violences psychologiques est particulièrement difficile dans la mesure où elles se déroulent dans la sphère familiale et donc privée et où, contrairement aux violences physiques, elles ne laissent pas de traces aisément identifiables et médicalement objectivables. Plusieurs tentatives de description des phénomènes de violences psychologiques ont néanmoins été menées, tant sur le plan sociologique et quantitatif, que sur le plan psychologique.
1. L’ampleur des violences psychologiques
L’ENVEFF, qui entendait prendre en compte toutes les formes de violences subies par les femmes, comportait des questions spécifiquement destinées à identifier les formes de violences psychologiques au sein du couple grâce à des questions portant sur des paroles ou des attitudes.
LES QUESTIONS AYANT TRAIT AUX VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES AU SEIN DU COUPLE DANS L’ENVEFF
EMPÊCHER DE RENCONTRER OU DE PARLER AVEC DES AMIS OU MEMBRES DE LA FAMILLE |
CESSER DE PARLER, REFUSER TOTALEMENT DE DISCUTER |
EMPÊCHER DE PARLER À D’AUTRES HOMMES (JALOUSIE) |
EMPÊCHER D’AVOIR ACCÈS À L’ARGENT DU MÉNAGE POUR LES BESOINS COURANTS DE LA VIE QUOTIDIENNE |
CRITIQUER ET/OU DÉVALORISER |
MENACER DE S’EN PRENDRE AUX ENFANTS OU S’EN PRENDRE AUX ENFANTS |
FAIRE DES REMARQUES DÉSAGRÉABLES SUR L’APPARENCE PHYSIQUE |
EMPÊCHER DE RENTRER AU DOMICILE, ENFERMER OU METTRE À LA PORTE, LAISSER SUR LE BORD DE LA ROUTE |
IMPOSER UNE FAÇON DE S’HABILLER, DE SE COIFFER OU DE SE COMPORTER EN PUBLIC |
MENACER DE SE SUICIDER |
NE PAS TENIR COMPTE OU MÉPRISER UNE OPINION |
PROFÉRER DES MENACES DE MORT |
EXIGER DE SAVOIR QUI L’ON RENCONTRE |
Source : Questionnaire de l’ENVEFF.
Un certain nombre de ces comportements pourrait d’ailleurs déjà être sanctionné pénalement si leur matérialité était prouvée (c’est le cas notamment des menaces de mort). Pour chacun de ces comportements, il était demandé à combien de reprises il s’était produit au cours des douze derniers mois, soit à l’aide d’un choix allant de jamais à systématiquement, soit par l’indication d’un chiffre, allant de jamais à tous les jours ou presque. Si aucune occurrence des faits évoqués précédemment n’est acceptable, les auteurs de l’enquête ont distingué deux caractéristiques spécifiques aux situations de « harcèlement psychologique » :
— Le nombre de faits différents qui ont été signalés. La situation de harcèlement psychologique n’est caractérisée qu’à partir du moment où au moins trois des faits ont été subis au cours des douze derniers mois ;
— La fréquence des faits mentionnés. En effet, à cette première condition s’ajoute celle que l’un des faits mentionnés, au moins, se produise fréquemment.
Selon l’enquête, environ 8 % des femmes interrogées étaient au moment de l’enquête en situation de harcèlement psychologique, alors que les agressions physiques concernaient 2,5 % d’entre elles et les agressions sexuelles au sein du couple, 1 % environ. Ces catégories ne sont, bien entendu, en rien exclusives les unes des autres.
Les associations rencontrées par la mission lors de son déplacement à Saint-Brieuc, ont souligné l’importance de ce phénomène. En effet, 60 à 70 % des femmes qu’elles accueillent font état de violences psychologiques, même si ce sont des violences physiques qui les ont conduites à s’adresser à l’association.
Les psychologues et les acteurs de terrain entendus par la mission ont également fait mention de la fréquence des situations de violences psychologiques au sein du couple, qui se caractérisent par leur intensité et leur diversité, aboutissant à constituer un phénomène d’emprise (42).
Marie-France Hirigoyen a détaillé, au cours de son audition, les ressorts des processus de violences psychologiques répétées et durables, notant que « les procédés de violences sont stéréotypés » en distinguant :
— Le contrôle, la possession et la surveillance, qui prennent en général le prétexte de la jalousie. L’une des formes de cette domination est souvent le contrôle financier de la victime, qui bien qu’elle travaille, n’a pas accès à ses revenus ou n’y a accès que par le biais d’une carte à débit limité ;
— L’isolement imposé, vis-à-vis notamment de la famille, des amis et du monde professionnel, la femme étant parfois contrainte d’abandonner son travail. Une description de processus est donnée dans l’enquête réalisée en Polynésie : « En contrôlant ses sorties, ses visites, ses relations, en surveillant ses gestes et ses paroles, en lui interdisant l’accès au monde extérieur, le conjoint dresse autour de sa compagne un mur d’isolement et la coupe de tout lien relationnel. Le domicile conjugal et le couple s’apparentent alors à une « prison » […] Le lent travail d’isolement exercé par le mari ou le concubin mène certaines à une désaffiliation sociale et familiale totale, puisqu’elles sont contraintes à rompre jusqu’aux liens familiaux. » (43) ;
— Les atteintes à l’identité, par le dénigrement, le harcèlement ou l’humiliation. Le docteur Marie-France Hirigoyen a ainsi cité un exemple paroxystique : « Des femmes me décrivent les humiliations qu’elles subissent ; certaines sont telles que j’ose à peine vous les répéter. Ainsi une femme dont le mari est médecin : il lui est arrivé de la pousser dans les toilettes, de la faire tomber et de lui uriner dessus. » (44)
— La menace, qui peut prendre les formes les plus diverses : « menace de coups, menace de représailles sur la famille, menace de laisser la femme sans argent, menace de ne plus la laisser voir ses enfants si elle part, menace de s’en prendre aux enfants eux-mêmes, intimidations en tous genres… ». (45) La menace est d’autant plus efficace que des coups ont été portés par le passé. La peur a alors des effets équivalents à des violences physiques.
Les violences psychologiques peuvent précéder, faire suite, ou accompagner des formes physiques de violences. Elles ont en tout état de cause le même but, qui est la soumission de la femme. Se constitue alors une emprise progressive.
b. Les caractéristiques de l’emprise
Ce phénomène d’emprise se caractérise, sur le plan psychologique, par plusieurs facteurs :
— Une inversion de la culpabilité. La personne qui est sous emprise cherche non pas à la faire cesser en la dénonçant ou en reprochant son comportement à l’auteur des violences, mais recherche ce qui, dans son comportement, est à l’origine des violences qu’elle subit. Le docteur Annie Soussy a, par exemple, indiqué que l’une des femmes victimes de violence qu’elle avait rencontrée allait jusqu’à attribuer l’attitude de son mari à la couleur des vêtements qu’elle portait ;
— La formation progressive d’une incapacité à se rendre compte de la gravité de la situation. C’est ce que le docteur Marie-France Hirigoyen a qualifié, à la suite d’Henri Laborit d’impuissance apprise : « des études menées par la suite ont montré que des personnes subissant des violences aléatoires se trouvent incapables d’imaginer une solution pour en sortir. Si l’on comprend très vite que l’on est pris dans un piège, on peut en sortir au début ; ensuite, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Autant dire que les femmes ne se complaisent pas dans cette situation par masochisme mais parce qu’elles sont piégées et qu’elles subissent une emprise toujours croissante, qui les transforme progressivement et leur fait perdre leur intelligence. » (46) Elle a donné l’exemple d’une magistrate sur qui son mari faisait pression en menaçant de révéler un secret de famille si elle dénonçait la situation. Ce dernier prétendait que s’il ébruitait ce secret, la garde des enfants lui serait retirée. Bien qu’étant magistrate, cette femme s’est laissée impressionner.
Cette emprise progressive n’est pas nécessairement accompagnée de coups, ce qui peut rendre difficile sa caractérisation et sa preuve judiciaire.
II. UN PHÉNOMÈNE QUI RESTE MAL CONNU
Les violences subies par les femmes au sein de leur couple sont difficiles à connaître et à analyser pour deux raisons principales : d’une part, le taux de révélation de ces violences est l’un des plus bas de la statistique criminologique ; d’autre part, les études et les statistiques portant sur ces violences ne fournissent pas encore une vue satisfaisante de l’ampleur de ce phénomène.
A. UN TAUX DE RÉVÉLATION TRÈS BAS
Les statistiques des forces de l’ordre et de la justice ne font qu’enregistrer le « réel connu », par opposition au « réel vécu », selon la distinction de M. Christophe Soullez, chef du département de l’Observatoire national de la délinquance (OND) (47). Or, seule une faible part des infractions réellement commises débouchent sur une plainte, puis sur une condamnation.
C’est pourquoi la détermination du taux de révélation nécessite que soient conduites des enquêtes de victimation. L’ENVEFF constatait déjà que 45 % des femmes qui évoquaient une situation de violences conjugales en parlaient pour la première fois. Lors de l’enquête de surcroît, le taux de signalement auprès des forces de l’ordre était évalué à 13 %, contre près de 32 % pour les violences subies au travail ou 43 % pour les violences subies dans l’espace public (48). Ceci confirmait qu’il existe un « chiffre noir » des violences conjugales, bien supérieur à celui qui est décrit par les statistiques institutionnelles, alimenté par un phénomène de « sous-déclaration » de ces violences.
Les enquêtes de victimation conduites ultérieurement par l’OND ont confirmé le fait que le taux de plainte concernant les violences conjugales est très faible. Ainsi que l’a relevé M. Christophe Soullez, « le taux de plainte est […] très faible puisqu’il est de 8 % en ce qui concerne les femmes victimes de violences physiques de la part de leur conjoint. Ce taux est le plus faible de toutes les infractions répertoriées par l’enquête. Il est, par exemple, de 30 % pour les violences physiques commises hors ménage et de 13 % pour les viols ou tentatives de viol hors ménage. D’ailleurs, il est apparu aux enquêteurs que 25 % des femmes victimes de leur conjoint en parlaient pour la première fois à l’occasion de l’enquête. Parmi les raisons invoquées pour expliquer une telle attitude, sont avancés : la volonté de trouver une autre solution que le dépôt de plainte en raison de ses conséquences, l’inutilité de la démarche, la minimisation des actes commis et, enfin, le souci d’éviter des épreuves supplémentaires. » (49)
Ainsi, avec un taux de plainte compris entre 8 et 9 %, les violences commises par le conjoint constituent l’une des infractions les moins souvent dénoncées. Ceci signifie que « 91 % des affaires restent impunies » (50), selon M. Philippe de Lagune. Il est néanmoins nécessaire de prendre en compte le fait que ce chiffre ne concerne que les femmes qui vivaient encore en couple au moment de l’enquête. En effet, si l’on prend en compte les femmes qui vivaient en couple, au moment des faits, ce taux de plainte s’élève à 13,2 %. De surcroît, si les violences sont commises par un ex-conjoint, celles-ci sont plus facilement signalées aux services de police et de gendarmerie puisque le taux de plainte est alors supérieur à 50 %, selon l’OND (51).
Cette opacité du taux de révélation (et éventuellement sa fluctuation) rend plus difficile toute analyse des faits constatés par la police et la gendarmerie, dans la mesure où le coefficient multiplicateur pour obtenir le chiffre des violences effectives est relativement mal connu.
Les données statistiques portant sur les violences faites aux femmes au sein du couple sont de deux types. Il s’agit, d’une part, des enquêtes menées en population générale et, d’autre part, des statistiques institutionnelles (policières et judiciaires).
1. Les statistiques officielles ne permettent pas de comptabiliser de manière satisfaisante les violences au sein du couple
Si les statistiques judiciaires et policières ne sont pas en mesure de décrire les faits commis, elles doivent permettre de comptabiliser et d’étudier les faits portés à la connaissance des autorités. Or, en ce qui concerne les violences au sein du couple, elles ne remplissent que très imparfaitement cette fonction.
a. Les appareils statistiques existants dans la police et la gendarmerie ne sont pas satisfaisants pour dénombrer les violences conjugales
Les données des forces de l’ordre correspondent aux crimes et aux délits constatés et enregistrés par la police et la gendarmerie dans « l’état 4001 ». Ceux-ci y sont classés, depuis 1972, selon les infractions du code pénal auxquels ils correspondent, au sein de 107 rubriques. L’« état 4001 » contient donc les faits de nature pénale dont la police ou la gendarmerie ont connaissance, les mains-courantes n’étant pas comprises dans ces chiffres. Or, sur les 107 rubriques de l’« état 4001 », seule une fait apparaître le sexe de la victime. Il s’agit des vols avec violence sans arme sur la voie publique. Le fait que la victime soit une femme et que l’auteur soit un conjoint ou un ex-conjoint ne peut donc pas être identifié. C’est ainsi que Mme Marylène Lieber constate que « traitées au même titre que les autres formes de violences, les violences faites aux femmes n’ont aucune raison d’être mises en exergue. » (52) De surcroît, selon M. Christophe Soullez, « l’index 7 de la nomenclature des infractions qui retrace les coups et blessures volontaires criminelles et délictuelles ne permet pas de distinguer les violences commises sur la voie publique de celles relevant de la sphère domestique. » (53)
Afin d’obtenir des statistiques sexuées et circonstanciées, des procédures ont été mises en œuvre par la police et la gendarmerie. La gendarmerie a, depuis mars 2008, créé six typologies dans ses bases de données afin de permettre aux gendarmes de saisir le sexe de l’auteur et de la victime et sa qualité, en se fondant sur la loi du 4 avril 2006 (conjoint ou ex-conjoint, pacsé ou ex-pacsé, concubin ou ex-concubin). La police a, quant à elle, mis en œuvre depuis 2006 un plan national d’enrichissement du fichier STIC (54) afin de pouvoir en extraire neuf types de faits, dont les violences intrafamiliales. Les mêmes informations sont alors saisies (sexe et qualité) que dans les fichiers de gendarmerie. Néanmoins, Mme Maryvonne Chapalain, commandant à la Délégation aux victimes (DAV) a indiqué que ces données ne constituaient pas le reflet exact des faits constatés : « Ce n’est pas un fichier fiable à 100 %, dans la mesure où les personnels ne sont pas forcément formés à cet effet. Les données ne peuvent donc être utilisées qu’à titre indicatif. » (55)
L’impression d’ensemble qui se dégage de l’analyse des statistiques de la police et de la gendarmerie est donc celle d’une incapacité à recenser les violences faites aux femmes au sein du couple. Le Guide de l’action publique lui-même constatait, en 2004, l’inadaptation des statistiques des forces de l’ordre à la mesure des violences faites aux femmes : « Afin d’évaluer l’action de la justice en matière de violences au sein du couple, il paraît essentiel d’améliorer l’outil statistique. En effet, l’insuffisance des données, notamment sexuées, sur les victimes de ce type de violences, contribue à la difficulté d’appréhender l’ampleur et l’évolution du phénomène et, par suite, l’efficacité des interventions publiques en la matière. » (56) Cinq ans plus tard, ce constat a été pour l’essentiel confirmé par Mme Maryvonne Chapalain : « Quoi qu’il en soit, la plupart des phénomènes de délinquance qui touchent les femmes ne sont malheureusement pas répertoriés dans l’état 4001, qui est notre index officiel. » (57) Ce constat est logique car, ainsi que l’a analysé Mme Karine Lejeune, capitaine de gendarmerie, « on demande à un tel outil statistique, créé voilà des années pour permettre un comptage de faits constatés, de faire de l’étude victimologique. » (58) L’ « état 4001 » n’a pas été conçu pour cela.
b. Les statistiques judiciaires ne sont pas non plus satisfaisantes
Le casier judiciaire est actuellement la seule source d’information disponible pour recenser le nombre d’infractions ayant débouché sur une comdamnation. Mais celui-ci n’étant renseigné qu’à l’issue d’un délai important, il ne permet de disposer de données que deux années après la condamnation. Il ne permet donc pas d’orienter et d’évaluer de manière satisfaisante les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. De surcroît, les données issues du ministère de la Justice et celles qui proviennent du ministère de l’Intérieur ne sont pas comparables en raison notamment des différences de traitement informatique employé et de l’absence de traçabilité des affaires entre les deux systèmes.
c. Mais les perspectives d’amélioration sont importantes
Le rapprochement des statistiques issues des services de police et de gendarmerie est en cours, conformément à la recommandation n° 2 du rapport d’évaluation du premier plan global triennal (59). « Jusqu’à présent, tant les données que les logiciels étaient différents, ce qui était un peu archaïque. » (60) a indiqué Mme Maryvonne Chapalain. Or, un rapprochement a été initié entre ces deux sources statistiques concernant les violences intrafamiliales si bien qu’il existera prochainement une indexation commune aux services de police et de gendarmerie : « policiers et gendarmes se sont rapprochés afin d’harmoniser les critères permettant de caractériser la quinzaine d’infractions pénales concernées. Dès le mois de septembre, nous disposerons d’un système statistique unique, qui permettra de comparer les chiffres et de dégager une tendance nationale. » (61), a ainsi indiqué M. Philippe de Lagune, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance.
Ce rapprochement devrait également avoir lieu entre les statistiques des forces de l’ordre et celles de la justice grâce aux changements futurs de système informatique. Ceci devrait permettre de surmonter les discontinuités qui existent entre le dépôt de plainte et le traitement judiciaire et induire une meilleure traçabilité des affaires, ainsi que l’a souligné M. Christophe Soullez au cours de son audition (62). La mise en place du logiciel CASSIOPÉE par le ministère de la Justice devrait également permettre d’accélérer les remontées d’information des TGI concernant les condamnations.
La seconde piste d’amélioration réside dans l’informatisation des procédures et le renouvellement des logiciels utilisés. Le logiciel ARDOISE, qui doit remplacer, vers 2010, le logiciel de rédaction des procédures permettra de disposer de statistiques plus fiables et plus complètes sur les faits constatés.
De manière relativement novatrice et à titre d’exemple, la Préfecture de police de Paris est déjà en mesure de fournir des statistiques sexuées depuis le 1er janvier 2000, ainsi qu’a pu le constater la mission lors de son déplacement à la Préfecture de police (63).
2. L’ENVEFF a été pionnière mais n’a pas été reproduite
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) a été pionnière, mais aucune autre étude comparable n’a été menée depuis. Seules des enquêtes de victimation généralistes ont contribué à la publication régulière de statistiques consacrées aux violences faites aux femmes au sein du couple.
a. L’ENVEFF, une enquête spécialisée et systématique
L’ENVEFF, commandée par le Secrétariat d’État aux Droits des femmes et le Service des droits des femmes, a constitué un véritable révélateur des violences subies par les femmes, dans tous les aspects de la vie sociale. M. Christophe Soullez a souligné, au cours de son audition, le caractère fondamental de cette enquête : « je tiens à rappeler combien l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée en 2000, a constitué un jalon important. » (64) Réalisée par téléphone de mars à juillet 2000 auprès de 6970 femmes âgées de 20 à 59 ans, elle portait sur les violences subies par les femmes au sein de leur couple, dans leur famille mais aussi dans l’espace public et au travail. Elle constitue dans chacun de ces domaines la base de référence indispensable à tout travail portant sur les violences subies par les femmes. Mme Maryse Jaspard, maître de conférence à l’Institut de démographie de Paris I, a évoqué le caractère fondateur et inégalé de cette recherche : « Il n’y a pas eu d’enquête de cette envergure depuis l’an 2000. » (65)
La méthodologie de cette enquête était particulièrement adaptée à la détection des violences recherchées puisque, dans le questionnaire, les violences n’étaient pas désignées en tant que telles : il dresse une liste de faits dont la personne interrogée doit dire si elle en a été victime et à quelle fréquence. Le questionnaire débute par les faits les moins graves pour s’achever sur les plus importants, afin d’instaurer un lien de confiance avec la personne interrogée. Ce travail d’élaboration méthodologique a d’ailleurs largement été repris par les enquêtes ultérieures (66).
Par son existence même et par l’ampleur de ses résultats, elle a contribué à légitimer la problématique des violences faites aux femmes et à en faire un enjeu important pour les politiques publiques. Les chiffres qui en sont issus sont encore ceux qui sont mobilisés dans le débat public portant sur les violences conjugales (notamment celui des 10 % de femmes victimes).
b. Les enquêtes de victimation
Si aucune enquête d’ampleur consacrée spécifiquement aux violences faites aux femmes n’a été menée depuis, les enquêtes de victimation conduite par l’Observatoire national de la délinquance (OND), et notamment l’enquête « cadre de vie et sécurité », conduite à partir de 2007 sur les faits subis en 2005 et en 2006, comportent un volet consacré aux violences intrafamiliales. En effet, ainsi que l’a indiqué M. Christophe Soullez, chef du département de l’OND, « en collaboration avec l’INSEE, l’OND mène […] des enquêtes de victimation en interrogeant chaque année près de 17 000 personnes sur les violences de toutes natures qu’elles auraient subies au cours des deux années précédentes. » (67)
La mission estime que ces enquêtes, dont les résultats ont été présentés ci-dessus, sont nécessaires à deux points de vue. D’une part, elles seules permettent de suivre des indicateurs chaque année et sur le long terme. D’autre part, elles offrent une possibilité d’évaluer régulièrement la qualité des statistiques administratives, en déterminant les contours du « chiffre noir » de la délinquance, et donc des violences faites aux femmes. Elles seules autorisent en effet la comparaison entre les faits enregistrés par la police et la justice et ceux qui sont déclarés par les victimes, qui peuvent ne pas avoir été dénoncés.
Néanmoins, ces enquêtes ne sont pas suffisantes car elles ne peuvent pas fournir les mêmes données qu’une étude centrée sur les violences faites aux femmes.
Tout d’abord, étant générale, elles ne peuvent cerner les violences faites aux femmes de manière aussi précise qu’une enquête spécialisée. Ainsi, le questionnaire de l’ENVEFF comprenait neuf modules et nécessitait en moyenne 45 minutes. Il n’est donc pas envisageable de réaliser une étude de ce type dans le cadre d’une enquête plus vaste. Les enquêtes de l’OND ne comportent pas, par exemple, de questions portant sur les violences de nature psychologique. C’est ce qu’a signalé Mme Maryse Jaspard au cours de son audition : « Ces enquêtes de victimation qui permettent de mesurer des évolutions annuelles n’ont pas pour finalité de cerner les violences conjugales dans leur complexité ; elles mesurent des agressions et ne donnent qu’une image réduite du phénomène des violences conjugales, d’autant plus qu’elles ne peuvent cerner les violences psychologiques. » (68) Le point de vue défendu par Mme Marylène Lieber, sociologue, est identique : « [l]e questionnaire [de l’ENVEFF] large et répétitif fouille chaque sphère de la vie de façon extrêmement minutieuse, ce qui permet de générer des réponses que d’autres enquêtes plus générales de victimation ne parviennent pas à obtenir. » (69)
Par ailleurs, le budget consacré aux enquêtes annuelles ne permet pas d’exploiter la totalité des réponses de l’échantillon. C’est ce qu’a confirmé M. Christophe Soullez, en indiquant que les enquêtes n’étaient exploitées qu’à 20 ou 25 % faute de moyens (70). Il serait d’ailleurs nécessaire, à ce titre, que l’OND signe des conventions avec les équipes universitaires de recherche intéressées, qui seraient en mesure d’exploiter plus en profondeur les résultats de ces enquêtes de victimation.
Proposition n° 1 :
Inciter l’OND et les équipes universitaires de recherche à nouer des partenariats pour exploiter les données fournies par les enquêtes annuelles de victimation.
c. La nécessité d’une nouvelle enquête ENVEFF
Afin de mesurer le chemin accompli, mais aussi celui qu’il reste à parcourir, la mission préconise donc que soit menée une nouvelle enquête consacrée spécifiquement aux violences faites aux femmes, sur le modèle de l’ENVEFF, dont les résultats dateront, l’année prochaine, de dix ans. Le représentant de l’OND interrogé par la mission, M. Christophe Soullez, s’y est dit favorable au cours de son audition : « Nous ne verrions par ailleurs que des avantages à la réalisation d’une nouvelle enquête spécifique sur les violences faites aux femmes – en particulier si elle traite de différents aspects que nous n’aurions pas envisagés – mais je souhaite qu’une véritable collaboration soit alors mise en place. » (71)
Cette nouvelle enquête devrait également permettre de prolonger les résultats de l’enquête de 2000, qui restent contestés, parce qu’uniques, et d’affiner notre connaissance du taux de révélation, ainsi que le préconise le rapport d’évaluation du premier plan global triennal (72).
Proposition n° 2 :
Organiser une nouvelle enquête consacrée aux violences faites aux femmes sur le modèle de l’ENVEFF.
III. DES CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES MAJEURES
Les conséquences des violences subies par les femmes au sein du couple ne doivent pas être sous-estimées : elles sont aussi massives que les violences elles-mêmes.
A. DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES SUR LA SANTÉ DES VICTIMES
Les conséquences des violences sur la vie des femmes victimes sont souvent extrêmement graves et peuvent être objectivées par l’analyse de leur état de santé.
1. Les conséquences des violences physiques
« La violence au sein du couple a une incidence majeure sur la santé des femmes, que ce soit du fait des blessures provoquées ou des affections chroniques qu’elle peut engendrer. Les coups reçus, l’état de tension, de peur et d’angoisse dans lequel sont maintenues par leur agresseur, ont de graves conséquences et sont à l’origine de troubles très variés. » (73), écrivait en 2001 le professeur Roger Henrion. Il ressort en effet de l’ENVEFF que les femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple ont presque cinq fois plus de risques de subir une détresse psychologique élevée et font, en moyenne, onze fois plus de tentatives de suicide que les autres femmes. Ainsi, les dépressions frappent plus de 50 % des femmes victimes de violences conjugales (74).
RELATION ENTRE ÉTAT DE SANTÉ ET EXISTENCE DE VIOLENCES PHYSIQUES OU SEXUELLES AU SEIN DU COUPLE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS
ÉTAT DE SANTÉ |
FEMMES QUI N’ONT PAS ÉTÉ VICTIMES DE VIOLENCES |
FEMMES AYANT ÉTÉ VICTIMES DE VIOLENCES |
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE ÉLEVÉE |
1 |
4,9 |
INDICE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE ÉLEVÉ |
1 |
4,8 |
TENTATIVE DE SUICIDE |
1 |
11,4 |
CONSOMMATION RÉGULIÈRE DE PSYCHOTROPES |
1 |
4,4 |
HOSPITALISATION |
1 |
1,3 |
Source : Enquête ENVEFF dans Maryse Jaspard et al., op. cit., Paris, La documentation française, 2003, p. 267.
Lecture : si le risque de détresse psychologique élevée est fixé à 1 pour les femmes n’ayant subi aucune violence au cours des douze derniers mois, il est estimé à 4,9 pour les femmes qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles au sein de leur couple.
« Une étude de l’OMS montre ainsi que les femmes victimes de violences conjugales perdent une à quatre années de vie en bonne santé. » (75) a ainsi indiqué le Docteur Marie-France Hirigoyen.
2. Les conséquences des violences psychologiques
De nombreux intervenants ont souligné le fait que les séquelles psychologiques étaient souvent plus difficiles à guérir que les blessures physiques. Ainsi, une étude américaine citée par le docteur Marie-France Hirigoyen faisait état du fait que la moitié des femmes hospitalisées dans les services de psychiatrie subissent ou ont subi des maltraitances de la part de leur conjoint. Les violences psychologiques sont donc « dévastatrices (76) » pour la personnalité de la victime, d’autant plus que s’y ajoute la honte de ne pas se sentir capable d’y résister.
Les conséquences sont d’autant plus importantes que s’est installé un sentiment de peur chez la femme victime, qui peut être réactivé y compris si l’auteur n’est pas présent physiquement. Ceci peut prendre la forme d’un harcèlement par intrusion, qui prolonge les harcèlements antérieurs : l’auteur harcèle la victime par des appels téléphoniques incessants, alternant gentillesses et menaces.
Du fait de ses caractéristiques, l’emprise est extrêmement difficile à briser. Ceci tient également au fait que la victime craint de ne pas être crue si elle signale les violences dont elle est l’objet.
B. DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ÉVALUÉES À PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS PAR AN
1. Les répercussions économiques des violences conjugales
Afin de mieux connaître les violences faites aux femmes, le Plan global de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007) prévoyait, dans son action 8 (77), de réaliser une étude pour évaluer le coût économique global des violences conjugales. Cet objectif a été rempli puisqu’une étude de faisabilité a été réalisée en 2006 par le Centre de recherches économiques, sociologiques et de gestion (CRESGE) (78).
Cette étude fait apparaître que le coût annuel des violences conjugales peut être estimé à un milliard d’euros, tout en notant qu’il s’agit là d’une « estimation minimale des répercussions économiques des violences conjugales » (79).
Cette enquête prend en compte à la fois les conséquences des violences physiques commises au sein du couple et entre ex-conjoints. Elle concerne également les violences conjugales subies par les hommes, qui représentent environ 13 % du coût des violences conjugales (80). La méthodologie de cette enquête distingue trois types de coûts :
— Les coûts directs médicaux, qui regroupent l’ensemble des soins nécessaires aux victimes (opérations, consultations, prescription de psychotropes, problèmes liés à la grossesse…). Ces coûts peuvent être chiffrés à environ 383 millions d’euros ;
— Les coûts directs non médicaux, que sont, notamment, les coûts liés à l’hébergement d’urgence, au logement et au traitement policier et judiciaire des affaires de violences conjugales. À titre d’exemple, les activités de police et de justice qui concernent les violences au sein du couple ont un coût d’environ 232 millions d’euros. Le logement et l’hébergement des victimes de violences représentent quant à eux 89 millions d’euros ;
— Les coûts indirects, qui comprennent deux catégories. Il s’agit d’une part des coûts humains qui reflètent les coûts induits par les situations de handicap à la naissance que l’on peut statistiquement imputer aux violences conjugales, par les traumatismes consécutifs aux violences et par les décès évitables. Ils représenteraient 305 millions d’euros. D’autre part, les pertes de revenus consécutives aux violences se chiffrent quant à elles à 83 millions d’euros.
Une étude menée aux États-Unis en 2003 aboutit à un chiffrage similaire puisqu’elle évalue les répercussions économiques des violences conjugales à environ six milliards d’euros, alors que la population américaine est environ cinq fois supérieure à la population française (81).
2. Mais le coût réel de ces violences est sans doute bien supérieur
Les auteurs de l’étude de faisabilité mentionnent à plusieurs reprises le fait que le chiffre d’un milliard d’euros est une estimation minimale. En effet, de nombreux éléments concourant à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes n’ont pas pu être évalués. Par exemple, le lien entre violences conjugales et tentatives de suicide est mal établi. De même les seuls modes d’hébergement des victimes pris en compte concernent les CHRS : les nuitées d’hôtel ne sont donc pas incluses dans cette estimation. Enfin, ni l’impact des violences sur les enfants, ni les conséquences psychologiques des violences n’ont pu être chiffrés.
Afin d’approfondir la connaissance des violences faites aux femmes, une autre estimation a été menée dans le cadre du projet européen Daphné (82). Elle évalue le coût de ces violences à 2,5 milliards d’euros par an. Mme Ernestine Ronai, directrice de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis a indiqué que cette étude analysait les coûts des violences conjugales de la manière suivante : « Les coûts des conséquences sociales directes – logement, RMI, APL, API, etc. – représentent un vingtième, les coûts de justice et de police, deux vingtièmes, les coûts médicaux – urgences, hospitalisations, médicaments – quatre-vingtièmes, soit un total de coûts directs de sept vingtièmes. Dans les coûts indirects, neuf vingtièmes sont dus aux pertes de production, dont six vingtièmes pour cause d’absentéisme ; les coûts humains et préjudices représentent quatre-vingtièmes. » (83) Les différences d’évaluation par rapport à l’étude de faisabilité portent essentiellement sur le chiffrage des coûts liés aux pertes de production conséquentes à des violences subies par les femmes, qui sont évalués à environ un milliard d’euros. De surcroît, cette étude n’estime que les coûts découlant des violences subies par les femmes au sein du couple. Elle ne prend donc pas en compte les violences faites aux femmes dans d’autres contextes. De ce fait, elle constitue là encore une évaluation minimale du coût des violences faites aux femmes.
Surtout, cette étude estime « qu’en augmentant de 1 € le budget des politiques efficaces de prévention des violences conjugales […] nous pouvons économiser jusqu’à 87 € de coût global, dont 30 € de coûts directs. » (84)
Cet argument relatif au coût économique des violences faites aux femmes n’est ni le premier ni le seul, mais il doit être pris en compte dans la mesure où la lutte contre les violences faites aux femmes est souvent analysée uniquement comme une dépense publique, sans que soit bien perçue l’ampleur des économies qui pourraient résulter de la réaffectation des moyens vers des actions de prévention.
3. Il est nécessaire de poursuivre l’effort de quantification
Afin de faire prendre conscience à chacun de l’ampleur des conséquences des violences faites aux femmes, le rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 préconise de mieux faire connaître l’étude du CRESGE et l’estimation minimale d’un milliard d’euros (85). La mission s’associe à cette recommandation, qui pourrait, par exemple, être mise en œuvre dans le cadre de la Grande cause nationale 2010.
Mais il est également nécessaire d’affiner davantage ces estimations économiques et de les étendre à toutes les formes de violences faites aux femmes.
Pour ce qui est des violences conjugales, le CRESGE a souligné le fait que son étude était incomplète du fait du manque de données disponibles. Il préconise, pour disposer de statistiques plus précises, d’améliorer le système statistique de la police et de la gendarmerie, objectif auquel souscrit la mission (86).
En ce qui concerne l’excision, une évaluation de ses conséquences pourrait être fondée sur le rapport récent et très documenté issu du projet Excision et Handicap (87). Il fournit en effet tous les éléments statistiques nécessaires à cette évaluation.
Deux études de faisabilité pourraient également être engagées. L’une porterait sur l’estimation du coût des violences subies par les femmes au travail et l’autre, sur celui des mariages forcés. Ces études pourraient faire partie d’une recherche statistique plus large visant à mieux évaluer ces types de violences (88), la dimension économique n’étant qu’un aspect parmi d’autres.
Dans un second temps, une étude d’ensemble, regroupant les résultats de ces différentes enquêtes pourrait évaluer de manière plus précise l’ensemble des répercussions économiques des violences faites aux femmes. Ceci pourrait conduire à introduire un indicateur économique du coût des violences, ainsi que le propose le rapport d’évaluation du premier plan global triennal (89).
Proposition n° 3 :
— Mieux faire connaître les chiffrages existants, y compris auprès du grand public.
— Étendre l’évaluation des répercussions économiques des violences envers les femmes à toutes les formes de violences subies par les femmes, en vue de disposer d’une évaluation d’ensemble du coût des violences faites aux femmes.
Chapitre II :
Les violences dans l’espace public ne sont pas celles que l’on croit
« À l’image de la « femme battue » qui s’impose au sens commun lorsqu’il est question des violences à l’égard des femmes, s’ajoute fréquemment celle de la femme agressée ou violée dans quelque ruelle sombre ou parking désert. […] C’est surtout l’agression dans l’espace public qui cristallise les peurs parce qu’elle est associée à l’image de l’extérieur et de l’inconnu par rapport au cocon protecteur du foyer. » C’est sur ces phrases que s’ouvrait le chapitre de l’ENVEFF consacré aux violences dans les espaces publics (90).
En effet, alors que l’on identifie de manière générale les femmes aux victimes d’agressions dans l’espace public, les enquêtes statistiques montrent qu’il n’en est rien : les hommes sont davantage victimes de violences hors du domicile. Cela ne signifie pas, néanmoins, que les femmes ne soient pas aussi victimes des violences qui se déroulent dans l’espace public. Elles peuvent en effet être les victimes de violence spécifiques, susceptibles de leur faire percevoir l’espace public comme relativement hostile.
I. LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SPÉCIFIQUES
Si toutes les enquêtes tendent à montrer que les hommes sont davantage victimes de violences dans l’espace public, il est néanmoins nécessaire de prendre en compte la spécificité des violences qui y sont subies par les femmes.
A. LES VICTIMES DE VIOLENCES DANS L’ESPACE PUBLIC NE SONT PAS EN MAJORITÉ DES FEMMES
L’opinion reçue veut que les femmes soient davantage victimes de violences que les hommes dans l’espace public : « la « vulnérabilité » des femmes à l’égard de certains dangers est présentée par tous, chercheurs, politiciens et dans le sens commun, comme allant de soi », écrit ainsi la sociologue Marylène Lieber dans un livre consacré à la prise en compte des violences faites aux femmes dans les politiques de lutte contre la délinquance (91). Pourtant, les victimes de violences dans l’espace public sont en majorité des hommes. C’est ce qu’a indiqué Mme Maryse Jaspard au cours de son audition par la mission : « C’est un fait : les hommes sont les premières victimes de violences dans tous les lieux publics. Les enquêtes annuelles de victimation de l’Insee/OND le montrent. » (92)
En effet, si le nombre de femmes et d’hommes victimes de violences sur deux ans est proche (869 000 femmes pour 810 000 hommes), le type de violences subies diffère fortement : selon l’enquête de victimation de l’OND, « près de 3,4 % des hommes de 18 à 60 ans ont subi au moins un acte de violences physiques hors ménage sur deux ans. Cette part est très significativement supérieure […] à celle des femmes victimes des mêmes atteintes, soit 2,2 % sur deux ans » (93). À l’inverse, les femmes sont davantage victimes de violences au sein du foyer, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.
PROPORTION DE PERSONNES DE 18 À 60 ANS S’ÉTANT DECLARÉES VICTIMES D’UN ACTE DE VIOLENCE PHYSIQUE SUR DEUX ANS
VICTIME D’AU MOINS UN ACTE DE VIOLENCES PHYSIQUES |
DONT VICTIME D’AU MOINS UN ACTE DE VIOLENCES PHYSIQUES HORS MÉNAGE |
DONT VICTIMES D’AU MOINS UN ACTE DE VIOLENCES PHYSIQUES INTRA MÉNAGE | |
TOTAL |
4,8 |
2,8 |
2,3 |
HOMMES |
4,7 |
3,4 |
2,2 |
FEMMES |
4,9 |
1,5 |
3,0 |
Source : Observatoire national de la délinquance, op. cit., p. 112.
Il en ressort que, contrairement aux idées reçues :
— Le domicile est un lieu plus dangereux pour les femmes que l’espace public et le danger vient davantage de personnes connues que d’inconnus. En effet, « toutes les études convergent pour affirmer que les femmes sont principalement susceptibles d’être agressées par des hommes qu’elles connaissent. » (94). De fait, selon les résultats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » publiés par l’OND, quatre femmes victimes sur cinq ont subi des violences d’une personne connue personnellement (95). L’ENVEFF avait déjà mis au jour ce constat, en établissant par exemple que la moitié des viols subis par les femmes sont commis par un conjoint ou un ex-conjoint.
— Au sein de l’espace public, les conditions de temps et de lieu sont peu déterminantes. Alors que l’on associe spontanément les risques de violences dont peuvent être victimes les femmes à un lieu désert et à un horaire tardif, celles-ci sont en fait commises dans tous les types d’espaces publics (96) et à toute heure. En effet, selon les résultats de l’ENVEFF, plus des trois quarts des violences subies par les femmes dans l’espace public, et estimées graves par elles, « se sont produites dans un endroit fréquenté régulièrement ». Elles se produisent essentiellement dans la rue (38 %), en voiture (18 %) et dans les transports en commun (19 %). De même, près des deux tiers de ces agressions se sont produites en plein jour (67 %) et dans un espace alors fréquenté par d’autres personnes (65 %). Ainsi, la proportion des viols qui ont lieu dans la rue est de 12 %.
Cependant, bien que les femmes ne soient pas les principales victimes de violences dans l’espace public, elles subissent des agressions spécifiques.
B. L’EXISTENCE D’UNE VIOLENCE DE GENRE DANS L’ESPACE PUBLIC
Que les femmes ne soient pas les principales victimes de violences dans l’espace public ne doit pas dissimuler les violences dont elles sont victimes. Celles-ci sont en effet fréquentes (l’ENVEFF avait montré que sur un an, près d’une femme sur cinq avait subi une forme de violence dans l’espace public (97)) et fort différentes des formes de violences que subissent les hommes, ainsi que le montre le tableau suivant.
LES VICTIMES DE VIOLENCES EN DEHORS DU MÉNAGE SELON LES SEXES (EN %)
FEMMES |
HOMMES | |
AGRESSIONS PHYSIQUES |
2,5 |
3,3 |
VIOL |
1,5 |
0,5 |
AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES |
||
DONT BAISERS, CARESSES ET AUTRES GESTES DÉPLACÉS |
5,9 |
1,3 |
DONT EXHIBITION SEXUELLE |
3,6 |
1,6 |
VOLS |
||
DONT VOLS AVEC VIOLENCES |
0,8 |
1,4 |
DONT VOLS SANS VIOLENCES |
3,3 |
3,6 |
AGRESSIONS VERBALES |
||
DONT MENACES |
5,5 |
6,9 |
DONT INJURES |
16,9 |
14,6 |
Source : Larraine Tournyol du Clos et Thomas Le Jeannic, « Les violences faites aux femmes », Insee Première, n° 1180, février 2008, p. 1. Le pourcentage le plus important pour chaque catégorie d’infraction figure en gras.
Les femmes sont donc moins victimes de vols, d’agressions physiques ou de menaces mais davantage victimes d’infractions à caractère sexuel (viols et agressions sexuelles) et d’injures. Se dessine donc, au sein de l’espace public, une forme de violence spécifique, une violence de genre.
Afin de décrire ces agressions répétées, souvent considérées comme peu graves, certains sociologues mobilisent la notion de « harcèlement public », qui « rend compte de tous les désagréments quotidiens caractéristiques des lieux publics. » (98). On peut ranger sous cette catégorie diverses sortes de violences qui ont été identifiées par l’ENVEFF, et notamment certaines insultes sexistes, toutes les formes d’atteintes et d’agressions sexuelles (se faire suivre, rencontrer un exhibitionniste, être pelotée ou être agressée sexuellement).
Être une femme expose à ces comportements sexistes, être une jeune femme y surexpose.
L’enquête menée sur les violences sexistes envers les filles en Seine-Saint-Denis dite enquête CSVF, a montré que 60 % des jeunes filles interrogées ont été victimes de ce type de harcèlement public (99). Une enquête menée à Londres a débouché sur le même constat : « le harcèlement et les agressions habituelles, comme le fait d’être suivie, de subir un exhibitionniste ou d’être agressée verbalement sont des expériences extrêmement communes pour les femmes. » (100)
Ce type de harcèlement public perdurerait, voire augmenterait, à en croire Mme Maryse Jaspard : « Je me garderai d’oublier la « violence de rue », une forme de harcèlement très répandue, qui tend, par des sarcasmes à connotation sexuelle, à empêcher les femmes de circuler librement. Ce type de violence à l’encontre des femmes prend aussi de l’ampleur, bien davantage que les crimes de sang, en diminution constante depuis des siècles et qui sont souvent perpétrés par des proches. Il est assez décourageant de constater, au travers des réponses faites par les jeunes filles à nos enquêtes les plus récentes, que l’évolution est faible et que la violence conjugale n’est qu’une des formes de violence auxquelles les femmes sont soumises. » (101)
Tout un ensemble de faits, souvent vus comme peu graves mais répétés, contribue donc à faire de l’espace public non pas un lieu neutre pour les femmes, mais un endroit qui peut être perçu comme hostile.
II. L’ESPACE PUBLIC PEUT ETRE PERÇU COMME HOSTILE PAR LES FEMMES
Ces faits de violence spécifiques, à l’endroit des femmes, qui sont dans la très grande majorité des cas de faible gravité, font que certaines d’entre elles le perçoivent comme dangereux, notamment la nuit.
A. DE PETITES VIOLENCES QUI EN LAISSENT CRAINDRE DE PLUS IMPORTANTES
Si les violences précédemment évoquées, auxquelles sont soumises les femmes dans l’espace public, peuvent sembler relativement anodines, elles sont pourtant à la source d’un sentiment d’insécurité.
Telle est la signification de la notion de « continuum de violences », reprise par Mme Marylène Lieber. Elle désigne le fait que chacune des violences subies (être sifflée, insultée, suivie…) peut être perçue par la femme qui en est victime comme la première étape d’une forme de violence plus grave, qui peut aller jusqu’au viol : « la peur joue […] un rôle non négligeable puisque des types de violences qui peuvent paraître relativement anodins de prime abord renvoient systématiquement à la potentialité de violences jugées plus graves par les personnes concernées. » (102) De ce fait, « les femmes sont […] exposées de façon permanente à une violence potentielle » (103)
Ce sentiment d’insécurité différentiel entre les femmes et les hommes dans l’espace public peut être objectivé par des mesures statistiques. Ainsi, selon les résultats de l’enquête « cadre de vie et sécurité » de 2005 et 2006, 15 % des femmes contre 9 % des hommes de plus de 14 ans ont déclaré se sentir de temps en temps ou souvent en insécurité dans leur quartier. Ce pourcentage est même de 20 % contre 9 % pour les personnes âgées de 15 à 29 ans (104). Il est d’autant plus élevé que la taille de la ville est grande.
De fait, cette perception d’un espace public plus dangereux pour les femmes que pour les hommes est intégrée et diffusée par tous les acteurs, du ministère de l’Intérieur, qui invite les femmes à faire attention la nuit et à « marcher d’un pas énergique et assuré » (105), jusqu’aux femmes elles-mêmes, qui mettent en œuvre diverses stratégies pour ne pas risquer de se retrouver dans des situations à risque (ne pas sortir le soir, s’habiller comme un homme, changer de trottoir (106)…), en passant par la famille, qui dissuade les filles, bien davantage que les garçons, de sortir le soir (107). Cette « peur sexuée », qui est générale et ne vise pas une personne ou un endroit en particulier, par rapport à la « peur préoccupation », selon la distinction opérée par Mme Marylène Lieber (108), toucherait toutes les classes sociales.
Pour reprendre en partie les conclusions de l’ENVEFF sur les violences au sein de l’espace public, on peut affirmer que « l’espace public s’avère [être] un espace sexiste dans la mesure où les femmes y subissent des atteintes d’une gravité variable, mais qui empêchent leur libre circulation en entretenant un climat de peur et de tension, qui les prive de tranquillité et d’assurance. Cette pression est exacerbée dans les grands centres urbains, grandes villes et région parisienne. » (109)
B. POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DE LA REALITÉ, UNE COMPTABILISATION SEXUÉE DES VIOLENCES EST NÉCESSAIRE
Pas plus que les violences intrafamiliales, les violences commises dans l’espace public ne font l’objet d’un décompte sexué. En effet, dans l’état 4001, seule l’infraction de vol avec violence sans arme sur la voie publique fait l’objet de statistiques différenciées selon les sexes. De ce fait, les violences faites aux femmes sont très difficilement identifiables au sein des statistiques générales de la délinquance. Elles sont en effet agrégées dans des catégories plus vastes, telles que les « coups et blessures » ou les « agressions sexuelles ».
Il est donc également important que, en dehors des violences intrafamiliales, les statistiques de la police et de la gendarmerie permettent d’identifier le sexe des victimes d’infraction. Cette meilleure connaissance de la réalité est le préalable indispensable à la mise en œuvre de politiques publiques de prévention de la délinquance qui prennent en compte la dimension sexuée des violences qui se déroulent dans l’espace public.
Proposition n° 4 :
Établir des statistiques sexuées pour les violences commises dans l’espace public.
Chapitre III :
les violences au travail, une réalité qui commence seulement à être reconnue
Les violences faites aux femmes dans leur milieu professionnel ont été reconnues assez récemment en France, il y a une vingtaine, voire une dizaine d’années. Si ce constat est aujourd’hui établi, les données existantes doivent cependant être enrichies.
I. LE CONSTAT : DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
Les travaux attestant l’existence de violences faites aux femmes au travail permettent d’en établir la typologie.
A. UNE RÉALITÉ POURTANT INCONTESTABLE
La question générale des violences au travail n’est pas nouvelle ; elle est liée au développement de la société industrielle et remonte au XIXe siècle. Mais le sujet des violences faites aux femmes dans le milieu professionnel n’est apparu dans le débat public que récemment.
Il est vrai que, sur le long terme, la participation des femmes au marché du travail peut elle-même être considérée comme un phénomène récent : le Bureau international du travail (BIT) a par exemple noté dans un communiqué en date du 11 décembre 2007 que la participation des femmes au marché du travail progresse au plan mondial, même si la plupart d’entre elles continuent d’être victimes de ségrégation professionnelle sur leur lieu de travail et ne parviennent que rarement à briser le fameux « plafond de verre » qui les empêche d’accéder à des postes de directeurs et de spécialistes de haut niveau (110).
La question est rendue complexe par le fait que la notion de « violence » peut être mêlée à celle de « souffrance » qui met l’accent, conformément à la définition qu’en donne le dictionnaire Robert, sur le fait d’endurer, de supporter des actes, cependant que celle de violence insiste davantage sur l’action émanant de l’auteur de cet acte.
En tout état de cause, le décalage entre l’ampleur du phénomène et sa prise de conscience relativement tardive reste peu aisé à expliquer. Les personnalités entendues par la mission sur ce sujet ont pointé ce constat sans véritablement le justifier. Pour autant, les violences faites aux femmes au travail sont aujourd’hui une réalité incontestable.
« Affirmer que la violence n’est pas utilisée comme instrument de pouvoir dans le monde du travail ordinaire ne signifie pas que la violence soit absente », estime le psychanalyste Christophe Dejours. S’agissant plus particulièrement des violences faites envers les femmes, le même auteur ajoute aussitôt : « la violence dans le harcèlement sexuel se retrouve dans de nombreux lieux de travail en France ».
Il existe de fait aujourd’hui en France un certain nombre de données et des témoignages sur ces violences. En particulier, l’action associative a permis de porter à la connaissance de l’opinion et des pouvoirs publics un nombre non négligeable d’éléments de fait. C’est ainsi que l’un des ouvrages ayant précédé l’élaboration d’une première législation en France consacrée à la définition du harcèlement sexuel (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 puis celle n° 92-1179 du 2 novembre de la même année – voir infra la partie relative à la consécration législative de ces notions) a été établi à partir des archives de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT).
Cet ouvrage, centré sur la question du harcèlement sexuel en France (111), souligne qu’« aujourd’hui encore, peu nombreuses sont les données sur la réalité française du harcèlement sexuel ». Son premier chapitre, qui présente des Photographies du harcèlement sexuel, contient des données relatives à la répartition géographique des situations de violences, des chiffres par tranches d’âge ou secteurs professionnels des personnes concernées ou encore les différents types de manifestations du harcèlement sexuel. L’étude montre notamment que le harceleur était le plus souvent un homme, le supérieur hiérarchique de la femme harcelée.
C’est cette même association qui, à l’occasion de ses vingt ans d’existence, a publié un ouvrage faisant une large place aux « Paroles de femmes et de quelques hommes » sur les violences subies (112). Autre exemple de recension de témoignages, en 2000 l’association Santé et médecine au travail a recueilli de très nombreux « récits de la violence ordinaires », récits de femmes qui ne concernent pas seulement des situations de harcèlement (113).
Comme le notent Mmes Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Maryse Jaspard (114), « à partir de 1985, c’est par la question du harcèlement sexuel au travail que le problème des violences envers les femmes à l’âge adulte va émerger dans le débat public ». Le développement juridique de cette notion ne doit cependant pas occulter la réalité d’un phénomène plus large, car la violence au travail peut prendre diverses formes, dont rend compte la typologie suivante.
1. Différents types de violences recensés
Il est possible de distinguer, selon la nature des faits, cinq grandes catégories de violences. C’est le choix effectué par l’Enquête nationale sur les violences faites aux femmes réalisée en 2000 (115), même si d’autres typologies peuvent aussi être retenues (116).
● Les pressions psychologiques
Selon l’ENVEFF, les pressions psychologiques regroupent trois types de faits : « imposer des horaires, des tâches, des services dont personne ne veut » ; formuler des « critiques répétées et injustes » ; « être mise à l’écart ». Ces pressions sont dénoncées par 16,7 % des femmes interrogées et représenteraient les atteintes aux femmes les plus fréquentes dans la sphère professionnelle.
● Les agressions verbales
Cette catégorie inclut les injures et les menaces mais ne se limite pas à elles. On rappelle que le code pénal réprime l’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, de l’amende prévue pour les contraventions de première classe (117). Le code pénal punit en outre la menace de commettre un crime ou un délit contre des personnes (118). Ces agressions concernent, aux termes de l’enquête, 8,5 % des femmes.
● Les agressions physiques
Les agressions physiques comprennent les coups et blessures et menaces avec une arme. Elles concernent, aux termes de l’ENVEFF, 0,6 % des femmes.
● Les destructions du travail et de l’outil de travail qui sont dénoncées dans l’enquête par 2,2 % des femmes interrogées.
● Le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles
L’enquête retient une définition large du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, qui incluent « les avances non désirées ou l’obligation de voir des images pornographiques, le pelotage et l’exhibitionnisme ou le voyeurisme, quel qu’en soit l’auteur, indépendamment de la notion d’autorité introduite par la loi » (119).
Selon les chiffres communiqués, 1,9 % des femmes rapportent des faits de harcèlement d’ordre sexuel (120) et 0,1 % des agressions (attouchements, tentatives de viol et viol) en même temps que de harcèlement.
Le tableau présenté ci-après synthétise ces résultats.
PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉCLARÉ AVOIR SUBI DES VIOLENCES AU TRAVAIL AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS SELON L’ÂGE (EN % DES FEMMES INTERROGÉES)
20-24 ans |
25-34 ans |
35-44 ans |
45-59 ans |
Ensemble | |
(n=335) |
(n=1 409) |
(n=1 596) |
(n=1 408) |
(n=4 748) | |
Insultes et menaces verbales |
11,7 |
10,1 |
8,8 |
6,2 |
8,5 % |
Pressions psychologiques |
20,2 |
18,6 |
15,2 |
15,7 |
16,7 % |
– dont harcèlement moral |
5,2 |
4,7 |
3,6 |
3,1 |
3,9 % |
Destruction du travail, de l’outil de travail |
3,6 |
2,8 |
2,3 |
1,3 |
2,2 % |
Agressions physiques |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 % |
Harcèlement sexuel |
4,3 |
2,8 |
1,9 |
0,7 |
1,9 % |
Source : ENVEFF.
Il existe par ailleurs des données spécifiques relatives à la situation qui prévaut outre-mer. Aux termes de l’ENVEFF, il s’avère qu’à la Réunion, les violences subies par les femmes sur leur lieu de travail prennent le plus souvent la forme de pressions psychologiques (le taux observé est de 16 %, donc voisin de celui qui prévaut en métropole). Les insultes et menaces verbales constituent la deuxième situation de violences dénoncées par les femmes dans le cadre du travail et sont essentiellement le fait des clients et des usagers (45 % des insultes et des menaces, ce taux étant de 49 % en métropole). Les insultes et menaces verbales de la part des collègues représentent 16 % des cas à La Réunion (29 % en métropole) et la part des supérieurs hiérarchiques y est de 10 % (14 % en métropole).
Ces données sont les seules disponibles au plan national. Elles remontent aujourd’hui à près de dix ans mais, en dépit de cette singularité, rendent compte de manière globale de l’état des violences faites aux femmes au travail.
2. Les critères à prendre en considération
Les auteurs de l’ENVEFF (121) ont retenu un certain nombre de critères, à la fois personnels et professionnels, pour tenter d’approcher de manière plus précise ces comportements.
● La prise en compte de caractéristiques personnelles
Un certain nombre de caractéristiques personnelles de la victime peuvent avoir une incidence sur les violences. Ces caractéristiques sont les suivantes :
– L’âge des femmes : il semble que plus les femmes sont jeunes, plus elles seraient atteintes par les différentes catégories de violences (à l’exception des agressions physiques, rares). En effet, l’âge renvoie à un statut professionnel plus précaire, à une situation de débutant. En outre, la « supposée disponibilité » des femmes plus jeunes est évoquée par l’enquête.
– Les difficultés vécues pendant l’enfance : ces difficultés, qui auraient entraîné un départ prématuré de la famille d’origine et un déficit de formation scolaire, engendreraient une situation d’emploi plus précaire. Ces éléments pourraient expliquer que les déclarations des femmes ayant vécu des difficultés pendant leur enfance révèlent davantage de types de violences : le taux de pressions psychologiques passe de 13,3 % en l’absence de difficulté mentionnée à 28,1 % lorsque trois difficultés ou plus ont été déclarées.
– Le mode de vie et la maternité : le tableau présenté ci-après montre, notamment, que les femmes mariées vivant en couple sont les moins touchées, « alors que les divorcées sont les plus atteintes, sauf en ce qui concerne les injures, les agressions et le harcèlement d’ordre sexuel plus pratiqué à l’encontre des célibataires et vivant chez leurs parents, pour qui l’effet « jeune âge » joue également ».
PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉCLARÉ AVOIR SUBI DES VIOLENCES AU TRAVAIL EN FONCTION DU MODE DE VIE (EN % DES FEMMES INTERROGÉES)
Catégorie |
Mode de vie |
Total | ||||||
Mariée ou veuve en couple |
Célibataire en couple |
Divorcée ou séparée en couple |
Autre divorcée ou séparée |
Célibataire chez parents |
Célibataire seule |
Autre | ||
N= |
2 883 |
768 |
66 |
335 |
161 |
310 |
233 |
4 756 |
Pressions |
13,6 |
19,9 |
26,2 |
22,9 |
18,0 |
19,6 |
20,5 |
16,7 |
Injures, menaces verbales |
6,7 |
7,9 |
14,7 |
10,1 |
14,5 |
10,5 |
12,4 |
8,6 |
Agressions |
0,6 |
1,2 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,7 |
0,3 |
0,6 |
Destruction |
1,5 |
2,4 |
5,6 |
3,5 |
3,7 |
3,8 |
2,4 |
2,2 |
Harcèlement et agressions sexuels |
0,9 |
3,3 |
2,9 |
4,0 |
4,5 |
,2,7 |
2,5 |
2,0 |
Source : ENVEFF.
– La question du lien entre violence au travail et violence conjugale : ce lien serait patent, ces deux types de violences étant susceptibles de « s’aggraver réciproquement par le biais du stress, des manifestations de mal-être ou de fragilité, qui exacerbent l’agressivité voire le sadisme de l’autre, conjoint ou relation de travail, d’autant plus qu’il était au départ étranger à cet état de fait ».
– La situation des femmes immigrées ou issues de l’immigration : l’ENVEFF note que l’exposition aux diverses formes de violences peut être accentuée par la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreuses immigrées, plus du tiers des immigrées d’origine africaine et des femmes nées en France ayant deux parents algériens étant en situation d’emploi précaire. Si peu d’immigrées ont déclaré des violences physiques sur le lieu de travail, à l’inverse, les agressions sexuelles sont relativement nombreuses (4 % dans le groupe « autre Europe/Amérique du Nord » et 4 % des femmes travaillant outre-mer ont été victimes de ce type d’agression au travail) ; en outre, les immigrées ont souvent subi des agressions verbales ou des pressions psychologiques sur le lieu de travail au cours de l’année précédant l’enquête.
● La prise en compte de caractéristiques professionnelles
Les caractéristiques professionnelles suivantes font aussi l’objet d’une analyse détaillée par l’ENVEFF :
— Le statut de l’emploi, le type de contrat et les horaires : les femmes travaillant à leur compte paraissent relativement protégées. les salariées du secteur public et du secteur privé semblent plus exposées. Les femmes exerçant une profession libérale sont dans une situation particulière au regard des atteintes sexuelles : elles connaissent le taux le plus élevé d’atteintes (10 % contre 2 % en moyenne), compte tenu notamment des relations de travail fortement personnalisées qui sont les leurs. Les apprenties et les stagiaires sont aussi nettement plus atteintes que les femmes dans d’autres statuts d’emploi. En revanche, il semble que le type de contrat (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, intérim, etc.) et que le type d’horaires (temps plein ou temps partiel) « n’introduisent pas de variations dans les taux de violences parmi les salariées ». Les salariées du secteur public subiraient moins de pressions psychologiques (critiques, brimades, mises à l’écart) que celles du secteur privé mais les taux d’agissements de harcèlement psychologique seraient plus élevés pour les salariées du secteur public, ces particularités pouvant s’expliquer par « la stabilité de l’emploi public et donc la prolongation de situations d’agressivité ».
— La profession ou les conditions de travail : les femmes exerçant une profession indépendante et les ouvrières déclarent moins de violences que les autres salariées, cependant que les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires en déclarent plus. En matière de violences verbales, les infirmières, assistantes sociales, sages-femmes et l’ensemble des femmes exerçant des professions dites intermédiaires de santé et du travail social sont fréquemment injuriées. On peut aussi souligner que l’existence de nombreux contacts avec le public accroît le nombre des agressions verbales et des injures. Enfin, de manière plus générale, les situations de précarité entraînent davantage de faits de violence. Le tableau présenté ci-après synthétise ces différents résultats.
PROPORTION DE FEMMES AYANT DÉCLARÉ AVOIR SUBI DES VIOLENCES AU TRAVAIL EN FONCTION DU MODE DE VIE (EN % DES FEMMES INTERROGÉES)
Catégories professionnelles et sociales |
Effectifs |
Pressions psychologiques |
Injures, menaces verbales |
Agressions physiques |
Destruction du travail |
Harcèlement et agressions sexuels |
Agricultrices |
67 |
5,7 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Indépendantes |
74 |
1,4 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
Cadres |
507 |
19,0 |
11,3 |
0,6 |
3,2 |
2,5 |
Professions intermédiaires |
1 440 |
19,0 |
11,0 |
1,0 |
2,6 |
1,4 |
Employées |
2 065 |
16,1 |
7,9 |
0,7 |
2,4 |
2,3 |
Ouvrières |
367 |
16,0 |
5,3 |
0,2 |
1,4 |
1,3 |
Total |
4 520 |
16,7 |
8,5 |
0,6 |
2,3 |
1,9 |
Source : Enquête ENVEFF.
– La taille de l’entreprise : l’enquête révèle que « le risque d’être confrontée aux injures et violences verbales augmente avec la taille de l’entreprise jusqu’au seuil de 200 employés, et c’est pour les entreprises de taille intermédiaire (50 à 199) que le risque d’être injuriée une fois dans l’année est le plus élevé : 10,7 %, alors qu’il diminue franchement (passant à 5,2 %) dans celles de moins de cinq personnes ».
II. DES DONNÉES QUI DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES
Ces données, établies au plan national et assez approfondies, attestent que la question des violences au travail est désormais prise en considération par les chercheurs et les sociologues. L’ENVEFF remonte cependant désormais à près de dix ans.
Si certaines analyses ont été conduites plus récemment, à l’étranger comme en France, les auditions ont montré que la connaissance de ces faits doit encore être renforcée. L’enquête réalisée en Seine-Saint-Denis en 2007 sur les violences faites aux femmes au travail (voir infra) le précise en introduction : « L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF, 2000), première enquête statistique sur le sujet, dans l’hexagone, a donc chiffré pour la première fois l’ampleur du phénomène. Toutefois, le recueil de statistiques sur les violences sexuelles commises à l’encontre des femmes au travail souffre encore de nombreux manques, alors même que cette connaissance est indispensable pour orienter les politiques publiques et qu’elle constitue une priorité nationale ».
A. DES ENQUÊTES RÉCENTES À L’ÉTRANGER, AU PLAN EUROPÉEN ET AU PLAN RÉGIONAL
Des études ont été conduites récemment sur la question des violences faites aux femmes au travail, tant à l’étranger qu’au plan européen ou, au plan régional, en France.
Au plan international, les institutions communautaires ont, de longue date, souligné l’existence des violences faites aux femmes au travail. En 1987, la Commission européenne avait publié un premier rapport sur la question du harcèlement sexuel (122). Un autre a été publié en 1998, intitulé Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l’Union européenne présentant une synthèse des résultats d’études alors disponibles dans les différents pays. Comme le note l’ENVEFF, les définitions et les contenus des faits de harcèlement sexuel varient cependant de manière considérable selon les États, de même que les méthodologies nationales, ce qui rend plus difficiles les comparaisons internationales. Néanmoins, le rapport souligne alors deux tendances : les femmes les plus jeunes d’une part, les femmes célibataires et divorcées d’autre part, subissent les fréquences de harcèlement sexuel les plus importantes. Enfin, les femmes occupant certains emplois sont plus souvent victimes de harcèlement sexuel : il s’agit des emplois dans la police, de ceux de chauffeur de bus ou de taxi ou encore de ceux de serveuse ou d’infirmière.
Plus récemment, il résulte de la Quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, publiée en 2007, qu’en moyenne, les femmes sont davantage l’objet de harcèlement moral que les hommes (6 % contre 4 %). Les jeunes femmes apparaissent comme les plus exposées (8 % des personnes interrogées de moins de 30 ans). En outre, les salariées sont plus exposées que les indépendantes (respectivement à hauteur de 6 % et 3 %). En revanche, on ne constate aucun écart significatif selon le statut d’emploi.
L’importance des agissements de harcèlement moral varie sensiblement selon la taille de l’entreprise : ce sont les membres du personnel des grands établissements (plus de 250 salariés) qui feraient état du taux le plus élevé de harcèlement (8 %). Le secteur d’activité constitue également une variable importante : les salariés des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, de même que ceux de l’hôtellerie et de la restauration, signalent une fréquence supérieure à la moyenne du phénomène de harcèlement moral.
Comme pour le harcèlement moral, les jeunes femmes (de moins de 30 ans) apparaissent les plus exposées au harcèlement sexuel, puisque le taux de fréquence des agissements atteint 6 % au sein de leur groupe (il est de 2 % tous âges confondus). La fréquence est également plus grande parmi les salariées que parmi les indépendantes et, en termes de statut contractuel, on observe également un taux plus élevé parmi les femmes sous contrat à durée déterminée et les travailleuses intérimaires (5 %) que parmi celles sous contrat à durée indéterminée (2 %).
L’exemple d’une enquête réalisée récemment en Suisse montre l’impact sur les résultats obtenus du choix des méthodologies et des typologies utilisées. Cette étude a été menée en 2006 et 2007 et avait pour objet le risque et l’ampleur du harcèlement sexuel sur le lieu de travail en Suisse alémanique et en Suisse romande. Cette enquête a révélé que plus de la moitié des femmes avaient subi des incidents de nature sexuelle sur leur lieu de travail.
Ce pourcentage important doit cependant être apprécié compte tenu du champ des comportements pris en considération. Comme le souligne l’étude, « les commentaires ou plaisanteries d’ordre général dégradants ou obscènes, le fait de se faire siffler ou dévisager, les gestes ou insinuations obscènes, etc. ainsi que les appels téléphoniques, lettres ou messages électroniques indésirables désobligeants ou obscènes et les commentaires désobligeants ou dégradants visant personnellement les personnes interrogées sont les types de comportement subis le plus fréquemment. Sont moyennement répandus l’exposition à des images pornographiques, les contacts corporels indésirables, les invitations non souhaitées à connotation sexuelle et les histoires imposées à contenu sexuel, suivis par les attouchements ou baisers. Sont les plus rarement mentionnés le chantage sexuel et les abus sexuels ou le viol ». S’agissant du harcèlement sexuel en tant que tel, près d’un tiers des femmes déclaraient s’être senties, au cours de leur vie, sexuellement harcelées.
En France également, certaines études ont été conduites récemment. Une enquête régionale réalisée en 2006 avait spécifiquement pour objet les comportements sexistes et violents envers les jeunes filles (Maryse Jaspard, 2006) (123) : 15 % des personnes interrogées ont dit avoir subi un harcèlement sexuel, 0,4 % une agression sexuelle sur leur lieu de travail.
Plus récemment encore, en 2007, a été conduite une enquête, en Seine-Saint-Denis également, portant de manière plus générale sur les violences faites aux femmes au travail. Cette enquête constitue la première du genre réalisée au sein d’un service de médecine du travail. Elle a été effectuée selon les modalités présentées dans l’encadré suivant.
La démarche suivie pour la mise en œuvre de l’enquête en Seine-Saint-Denis La sous-commission « Prévention du harcèlement sexuel au travail » de la commission départementale d’action contre les violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis (qui regroupe les services de l’État, de conseil général, les associations de défense des droits des femmes, le service de santé au travail) a exprimé le souhait de procéder à un état des lieux des violences faites aux femmes dans le département. Répondant à cette demande, un service interentreprises de santé au travail de Seine-Saint-Denis, l’Association pour la prévention et la médecine du travail (AMET), a proposé d’entreprendre une enquête afin d’établir un constat objectif et chiffré des violences sexuelles subies par les femmes dans le cadre du travail. À cette fin, un groupe de travail a été constitué, comprenant l’AMET, l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité (DDDFE 93), la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP 93), la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) d’Île de France et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Cette enquête, première de ce type en France, s’est déroulée entre le 4 juin et le 13 juillet 2007. Un questionnaire anonyme a été proposé systématiquement aux salariées qui avaient déjà eu une activité professionnelle par les secrétaires médicales ou les médecins, à l’accueil des centres de médecine du travail lors de la visite médicale, quelle que soit sa nature. Au préalable, une information et une formation des secrétaires et médecins du travail avaient été organisées dans le service de santé au travail qui a mené cette enquête, avec la participation de l’Association AVFT et de la DDDFE 93. Parallèlement, ont été mises à disposition dans les salles d’attente des plaquettes d’information avec les adresses des institutions et associations concernées par le sujet dans le département. Au total, 1772 questionnaires ont été recueillis. |
Source : Enquête VSFFT-93.
Deux ensembles de conclusions se dégagent de l’enquête VSFFT 93. D’une part, près de 5 % des salariées de Seine-Saint-Denis auraient subi une violence définie comme une agression sexuelle ou un viol au cours de l’année écoulée : au total, 5 % des femmes travaillant dans le département ont été confrontées à une violence qualifiée par la loi d’agression sexuelle ou de viol (pelotage, coincée pour embrasser, attouchements sexuels ou viol).
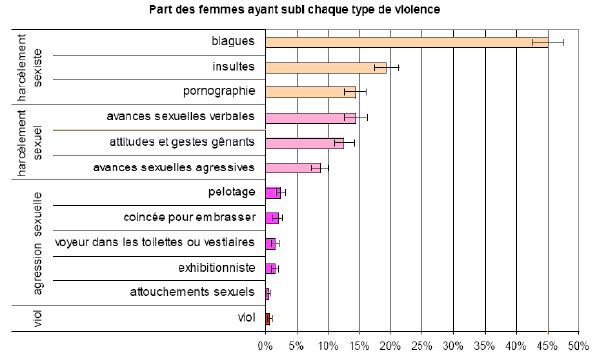
Source : Enquête VSFFT 93.
Le trait noir indique l’intervalle de confiance de la proportion observée.
En prenant également en compte les situations de harcèlement sexuel, 22 % des salariées de Seine-Saint-Denis du secteur concurrentiel auraient été victimes de violences. Enfin, au total, plus de la moitié des salariées (56 %) ont subi un harcèlement sexiste, un harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou un viol au cours de l’année écoulée.
D’autre part, l’enquête a révélé dans quelle proportion les femmes victimes de violences sexuelles ont subi des attouchements ou rapports sexuels non désirés : seize femmes ont déclaré avoir été victimes de telles violences, cinq d’entre elles ayant subi à la fois un viol et des attouchements sexuels (124). L’étude des questionnaires montre aussi que les agressions sexuelles et les viols ne seraient pas des faits isolés, mais le plus souvent précédés d’autres types de violences sexistes et sexuelles ou associés à eux : ce fait attesterait un ensemble de conditions de travail particulièrement délétères.
Les auteurs de l’enquête en viennent à formuler l’hypothèse suivante : certains environnements de travail autoriseraient des comportements violents envers les salariées, voire délictueux ou criminels. Des enquêtes plus importantes devraient permettre de vérifier cette hypothèse.
FRÉQUENCE COMPARÉE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES VICTIMES DE RAPPORTS SEXUELS NON DÉSIRÉS OU D’ATTOUCHEMENTS ET À L’ENSEMBLE DES SALARIÉES
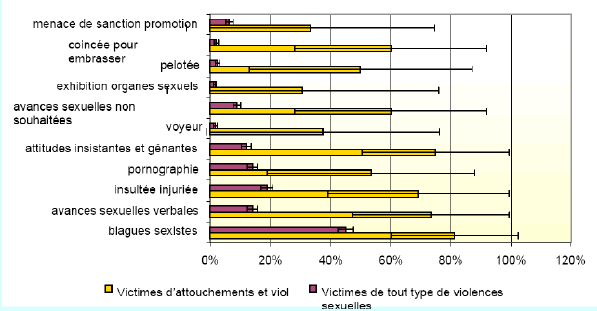
Source : Enquête VSFFT 93.
Le trait noir indique l’intervalle de confiance de la proportion observée.
Commentant ces résultats lors de son audition devant la mission, M. Jean-Michel Sterdyniak, médecin du travail responsable de la mise en œuvre de cette enquête, a estimé que « les résultats de l’enquête sont assez inquiétants et touchent tous les secteurs d’activité. Ils confirment que les personnes les plus exposées sont les femmes jeunes et que le statut marital est protecteur » (125).
En conclusion, les auteurs de l’enquête soulignent qu’« au vu des résultats, les professionnels concernés ont fait le constat de l’ampleur et de la gravité des violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes, et en particulier les très jeunes femmes, même si tous les âges et tous les publics sont touchés. Et pourtant, les victimes en parlent peu et les suites judiciaires sont rares. D’un autre coté les conséquences professionnelles et personnelles (y compris en terme de santé) peuvent être graves. Une telle situation devrait, comme les situations de souffrance au travail, inciter à poser la question de la reconnaissance du lien entre l’atteinte à la santé et le travail et de sa prévention ».
B. UNE CONNAISSANCE À APPROFONDIR POUR LEVER UN TABOU QUI PERSISTE
Si un certain nombre d’enquêtes ont été menées sur la question des violences faites aux femmes au travail, ces travaux restent trop isolés et gagneraient à être développés, comme l’ont mis en évidence les auditions.
Les enquêtes nationales sont rares – on a vu que l’ENVEFF remonte à près de dix ans – et ne portent pas toujours exclusivement sur la question des violences faites aux femmes au travail. Ainsi, l’enquête « Cadre de vie et sécurité », réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance en 2007, chiffre à 4,7 % le nombre des viols commis sur le lieu de travail et 25 % celui des agressions sexuelles les plus fréquentes (caresses, baisers et autres gestes déplacés non désirés) sur le lieu de travail. Mais cette enquête n’a pas pour objet spécifique la question des violences faites aux femmes au travail.
D’autres chiffres existent et doivent être cités, même s’ils ne prétendent pas à l’exhaustivité. L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) a par exemple indiqué intervenir actuellement auprès de 377 personnes dans toute la France. Le nombre de nouveaux dossiers a augmenté de 66 % entre 2006 et 2008. En 2007, sur 100 personnes qui ont saisi l’AVFT, 45 sont victimes d’agression(s) sexuelle(s), 25 % de harcèlement sexuel, 20 % de viol, 5 % de violences physiques et 5 % de discrimination (essentiellement en raison de la maternité). Ces indications sont précieuses mais par définition ne sauraient remplacer des enquêtes plus systématiques.
De fait, comme l’a souligné M. Jean-Michel Sterdyniak lors de son audition par la mission, au moment du lancement de l’enquête, « les études disponibles sur la question étaient rares » (126).
L’enquête VSFFT-93 se présente même comme « première de ce type en France ». Mais les auteurs concluent la présentation des résultats de leur étude par l’observation suivante : « Cette étude se rapporte à un seul département de la région parisienne. Un élargissement de ce travail serait souhaitable à d’autres départements ou régions pour confirmer les résultats obtenus ».
M. Jean-Michel Sterdyniak a confirmé cette nécessité lors de son audition par la mission : « L’enquête a permis de mettre en évidence les problèmes et de sensibiliser les professionnels concernés. Ses résultats sont à confirmer. Un élargissement de ce travail à d’autres départements serait souhaitable. Nous sommes en contact avec un service de santé au travail à Paris qui accepterait éventuellement de reprendre l’étude. J’ai pris contact également dans le Périgord, ce qui permettrait de comparer les situations en milieu urbain et en milieu rural. D’autres études semblent montrer que les phénomènes de violence étaient plus importants dans les régions urbaines que dans les régions rurales » (127).
Il est d’autant plus indispensable de mener des enquêtes complémentaires que des études trop isolées comportent – par hypothèse – certaines limites. M. Jean-Michel Sterdyniak a d’ailleurs clairement évoqué ce point devant la mission lors de son audition (128) : « Parmi les biais et les limites relevés figure, en premier, la taille de l’échantillon. (…) Deuxièmement, les questions sur les auteurs des faits et les suites données à ces faits ont été mal remplies, ce qui empêche de tirer des commentaires autres que les grandes lignes que je vous ai données. Troisièmement, le questionnaire était construit sur un mode déclaratif. Chaque mode d’enquête introduit des biais dont on est incapable de dire dans quels sens ils jouent. (…) Il peut, enfin, y avoir des biais de recrutement ». M. Jean-Michel Sterdyniak a ensuite encore cité d’autres éléments : la réalisation de l’enquête pendant l’été, période où il y a beaucoup d’embauches de jeunes ; la non prise en compte de la situation des grandes entreprises ; l’absence de données sur les chômeuses ; l’insuffisance précision de certaines questions, etc.
La qualité de l’enquête menée n’est naturellement pas en cause, de tels biais étant inhérents à l’exercice. Mais c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles il est essentiel de multiplier de telles analyses, afin de pouvoir confronter des résultats issus de sources différentes.
Plus généralement, il est difficile de ne pas faire le lien entre la relative rareté des données disponibles et la difficulté de reconnaissance de ce phénomène, conformément aux propos de Mme Colette Horel, membre de l’inspection générale de l’administration, lors de son audition par la mission (129) : « Je voudrais parler d’un autre point, celui des violences au travail, qui font encore l’objet d’un tabou très fort : elles ne sont abordées dans le plan 2008-2010 que par le biais de la réalisation d’une étude. Pourtant, selon les enquêtes de l’Observatoire national de la délinquance, un quart des femmes qui déclarent des agressions sexuelles indiquent qu’elles ont eu lieu sur le lieu de travail. L’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), s’en préoccupe ; elle n’a malheureusement pas de relais en région ».
De fait, l’objectif 1 (« Compléter les connaissances statistiques du Plan ») du deuxième plan global triennal (2008-2010) pour combattre les violences faites aux femmes comporte un point 4 au sein d’une partie intitulée fort à propos : « Mesurer pour briser les tabous », rédigé dans les termes suivants : « Engager une enquête sur les violences envers les femmes en milieu de travail. Les comportements violents touchent également les femmes au cours de leur vie professionnelle. Le harcèlement sexuel ou les viols sont dénoncés. Il est nécessaire d’en prendre la mesure afin de trouver les meilleures réponses à apporter à ces conduites inadmissibles avec le monde de l’entreprise ».
La mise en œuvre de cette mesure s’est traduite par la mission que le ministre en charge du travail a confiée à Mme Brigitte Gresy, inspectrice générale des affaires sociales, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui inclut la question particulière des violences faites aux femmes au travail.
2. La question du lien avec l’amélioration des conditions de travail
De manière plus générale, le lien entre la question des violences faites aux femmes au travail et celle des conditions de travail pourrait être systématisé, comme il en va dans le cadre des études menées par l’Union européenne, car le sujet des violences faites aux femmes au travail ne fait pas encore vraiment partie, en France, des préoccupations de ceux qui œuvrent en faveur de l’amélioration des conditions de travail.
Cette question n’est pas passée sous silence par les divers observateurs de l’évolution des conditions de travail en France, mais ceux-ci doivent souvent se contenter de constater la faiblesse de la prise en compte de ces violences. À titre d’exemple, dans leur ouvrage consacré aux conditions de travail en France, MM. Michel Gollac et Serge Volkoff évoquent les contraintes psychologiques du milieu professionnel et consacrent à cette occasion un développement à la question des « harcèlements » (130). Ils notent toutefois : « Harcèlement moral et harcèlement sexuel ne sont pas mesurés dans les enquêtes nationales françaises sur les conditions de travail ».
Il est vrai que l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) s’intéresse à la question du genre et à son lien avec les conditions de travail. Mais ces études gagneraient à être systématisées.
Proposition n° 5 :
— Mener, notamment sur le modèle de l’enquête VSFFT-93, d’autres enquêtes régionales sur la question des violences faites aux femmes au travail ;
— Réaliser une grande enquête au plan national, portant sur les aspects tant quantitatifs que qualitatifs des violences faites aux femmes au travail.
Chapitre IV : La connaissance des mutilations sexuelles et des mariages forcés : le jour et la nuit
La connaissance que nous avons des mutilations sexuelles et des mariages forcés est très différente : autant une enquête récente, menée sur plusieurs années dans un cadre national a permis de bien connaître les mutilations sexuelles, autant les chiffres concernant les mariages forcés sont rares et sujets à caution. Il est donc indispensable, dans un but de prévention, d’accroître le nombre de données disponibles concernant ces derniers.
I. UNE ENQUÊTE PIONNIÈRE EN EUROPE, PERMETTANT DE BIEN CONNAÎTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES
La connaissance des mutilations sexuelles en France a été totalement rénovée par la mise en œuvre du projet Excision et Handicap (ExH) entre 2007 et 2009, « première recherche scientifique réalisée sur le sujet en France », ainsi que l’a précisé Mme Isabelle Gillette-Faye, directrice du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS) (131).
Il comporte trois volets complémentaires qui ont permis une connaissance approfondie des cas de mutilations sexuelles :
— Une estimation nationale du nombre de personnes adultes excisées vivant actuellement en France (132) ;
— Une enquête qualitative, fondée sur des entretiens, visant, dans une optique de prévention, à mieux connaître les raisons qui poussent certaines familles à demander l’excision de leur fille (133) ;
— Une enquête quantitative, dont l’objectif était de cerner les conséquences de l’excision sur la santé des femmes (134).
A. L’ESTIMATION DU NOMBRE DE CAS DE MUTILATIONS SEXUELLES AUJOURD’HUI EN FRANCE
Avant la mise en œuvre de l’enquête ExH, seules deux estimations anciennes du nombre de femmes excisées vivant en France étaient disponibles. Une étude de 1982 estimait « qu’environ 24 000 femmes et fillettes étaient excisées ou menacées de l’être », en France. Une autre, de 1989, établissait à 27 000 personnes « la population féminine à risque » (135). Néanmoins, avec l’accroissement des flux migratoires provenant des pays où l’excision est pratiquée (qui se situent essentiellement en Afrique sub-saharienne, ainsi que le montre la carte suivante), et l’augmentation de la part des femmes parmi les migrants, ces estimations ne sont aujourd’hui plus valables.
PROPORTION DE FEMMES ÂGÉES DE 15 À 49 ANS AYANT SUBI DES MUTILATIONS SEXUELLES (SITUATION EN 2000)
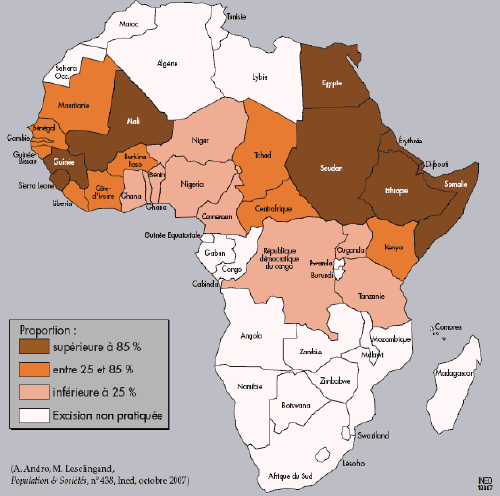
Source : Armelle Andro et Marie Lesclingand, op. cit., p. 3.
C’est pourquoi le premier volet du projet ExH a consisté à estimer le nombre de femmes excisées de 18 ans et plus (136) vivant en France.
L’estimation moyenne conduit au chiffre de 53 000 femmes adultes excisées vivant en France en 2004.
LE NOMBRE DE FEMMES ADULTES EXCISÉES VIVANT EN FRANCE EN 2004
Population considérée |
Estimation |
Femmes nées à l’étranger arrivées en France après l’âge de 15 ans |
42 000 femmes (hypothèse basse) |
Femmes nées à l’étranger dans leur ensemble |
53 000 femmes (hypothèse moyenne) |
Femmes nées à l’étranger ou en France dont les parents sont originaires d’un pays à risque |
61 000 femmes (hypothèse haute) |
Source : Armelle Andro et Marie Lesclingand, op. cit., p. 4.
Selon Mme Isabelle Gillette-Faye, on peut estimer qu’environ 20 % des femmes qui ont été excisées l’a été sur le sol français (137), ce chiffre étant en forte décroissance durant les dernières années : il était de 52 % dans les années 1970, de 33 % dans les années 1980, mais les données manquent après ces dates(138).
De manière générale, il est erroné de conclure, à partir de cette augmentation du nombre de femmes excisées vivant en France, à une augmentation des pratiques d’excision aussi bien en France que dans les pays d’origine.
Selon l’ensemble des personnes auditionnées, le nombre de cas de mutilations sexuelles tend à reculer dans le monde, et, de manière plus importante, pour les familles concernées qui vivent en France.
Ainsi que l’a explicité Mme Armelle Andro, chercheuse à l’INED, la baisse du nombre de cas est une tendance constatée dans les pays africains concernés : « La pratique recule dans la plupart des pays d’Afrique. Certains pays ont mené, ces dernières années, des politiques relativement efficaces. Au Sénégal, par exemple, la pratique a été abandonnée dans des régions entières. Dans d’autres pays, les changements seront très lents, comme au Mali où la proportion de femmes excisées est encore supérieure à 90 %. Cela étant, même dans ce pays, on note une tendance à la diminution puisque le taux est passé de 96 % à 94 %. Des lois existent dans la plupart des pays mais elles ne sont pas toujours appliquées. » (139) Corrélativement, la proportion de femmes excisées parmi celles qui émigrent de ces pays est également en diminution.
Les jeunes filles vivant en France sont également de moins en moins victimes de mutilations sexuelles. La pratique serait en très forte régression en France (140). Toutes les personnes auditionnées ont en effet mentionné cette forte diminution depuis le début des années 1980. C’est le cas de Mme Armelle Andro (141) et de Mme Isabelle Gillette-Faye, qui a indiqué à la mission que « les premiers chiffres ont été donnés par les centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) de Seine-Saint-Denis et des Yvelines : en 1980, selon les centres, entre 40 et 70 % de la population féminine de moins de six ans étaient concernés ; au début des années 1990, avec la première campagne de sensibilisation « Nous protégeons nos petites filles », les constats d’excision par les centres avaient chuté à 1 % par an et ne concernaient que des enfants qui venaient d’arriver d’Afrique subsaharienne. » (142) Néanmoins, cette baisse massive pourrait s’accompagner d’une modification des pratiques, l’excision concernant davantage les fillettes de plus de six ans (afin d’éviter les dépistages dans le cadre de la PMI) et étant davantage pratiquée au pays d’origine (143). Cette évolution a été soulignée par le Docteur Emmanuelle Piet lors de son audition. (144)
Si le nombre de femmes excisées vivant en France augmente mécaniquement (par l’immigration de femmes excisées), la pratique de l’excision y est donc néanmoins en régression.
Les raisons avancées sont triples. Les procès dont ont fait l’objet des exciseuses en France, et notamment celui d’Hawa Gréou au début des années 1990, des années 1980 aux années 2000 ont contribué à faire régresser cette pratique en France. L’application stricte de la législation pénale a donc permis de dissuader un certain nombre de familles de faire exciser leur fille.
Mais cette forte diminution du nombre d’excisions serait également due à une adhésion croissante aux valeurs et aux règles françaises, qui tendent à protéger les femmes, a estimé Mme Armelle Andro au cours de son audition : « Dans de nombreuses familles, la fille aînée a été excisée – souvent parce qu’elle est née dans le pays d’origine – mais les plus jeunes ne le sont pas et, compte tenu de leur âge et du discours de la mère, ne le seront jamais. C’est une appropriation très rapide des valeurs et du droit à l’intégrité physique tel que le conçoit le pays d’accueil. […] Il est maintenant inimaginable pour des jeunes filles nées en France, même excisées, de faire subir un tel traitement à leurs propres filles. Les descendants de migrants abandonnent cette pratique. On voit même que les attitudes changent, en quelques années, au sein d’une même famille. » (145)
Enfin, il faut mentionner le rôle des politiques de prévention des mutilations sexuelles mises en œuvre récemment par de nombreux États africains. Tous se sont d’ailleurs engagés à lutter contre les mutilations sexuelles en 2003, par la signature d’un protocole sous l’égide de l’Union africaine.
Les premières données issues du versant quantitatif de l’enquête ExH apportent quelques chiffres pouvant corroborer ce constat. D’une part, le pourcentage de filles excisées tombe de 45 % à 3 %, selon que la jeune fille est née à l’étranger ou en France, ce qui « atteste d’une tendance à l’abandon de la pratique dans les familles vivant en France. » (146) D’autre part, le pourcentage de filles excisées est en net recul selon leur année de naissance, ainsi que le montre le tableau suivant :
POURCENTAGE DE FILLES EXCISÉES SELON LEUR LIEU ET LEUR ANNÉE DE NAISSANCE
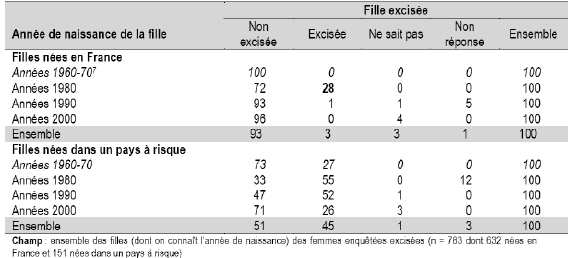
Source : Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, op. cit., p. 61.
De surcroît, seul un très faible nombre de parents envisageaient de faire exciser leur fille (147). Toutes les femmes excisées et les hommes interrogés dans le cadre de l’enquête qualitative se prononcent contre la perpétuation de l’excision.
Ainsi, le fait, pour les femmes excisées, de vivre en France constitue-t-il un facteur protecteur pour leurs filles. Néanmoins, l’on ne dispose pas encore de données sur le nombre de jeunes filles vivant en France qui sont victimes de mutilations sexuelles chaque année. La mise en œuvre d’un protocole de recherche visant à cerner ce chiffre devrait être étudiée.
Proposition n° 6 :
Élaborer un protocole de recherche visant à déterminer le nombre de jeunes filles vivant en France qui sont excisées chaque année.
C. DES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DES FEMMES
Si l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) classe les conséquences des mutilations sexuelles (148) féminines en trois catégories (conséquences médicales à court terme, conséquences médicales à long terme et conséquences sexuelles mentales et sociales), aucune étude n’avait réellement mesuré l’ampleur de ces conséquences. Or, le volet quantitatif de l’enquête ExH a pour objectif de mesurer de façon scientifique l’impact de l’excision sur la santé des femmes qui en sont victimes. Pour ce faire, une enquête nationale, inédite en Europe, a été organisée, au moyen d’un questionnaire qui a concerné 2882 femmes dont 714 femmes excisées (149). Les premiers résultats de cette enquête ont été publiés en mars 2009 (150). Ils établissent que :
— Certains symptômes et certaines maladies sont plus fréquents chez les femmes excisées. Il s’agit notamment des infections uro-génitales, puisqu’au cours des 12 mois précédant l’enquête, 22 % des femmes excisées ont eu des infections urinaires, contre 13 % parmi les femmes non excisées. Par ailleurs, 36 % des femmes excisées ont déjà, au moins une fois, des déchirures lors de leur accouchement, contre 29 % des femmes non excisées (151) ;
— L’excision a un impact important sur la sexualité des femmes qui en sont victimes : « le vécu de la sexualité est bien peu enthousiasmant, et même parfois douloureux » (152), a précisé Mme Armelle Andro. Ainsi, 41 % des femmes excisées jugent leur premier rapport sexuel très douloureux, le pourcentage n’est que de 27 % pour les femmes de l’échantillon témoin. De même, alors que 20 % des femmes de l’échantillon témoin jugent leur vie sexuelle comme désagréable ou indifférente, la proportion est de 44 % chez les femmes excisées (153) ;
— Les femmes victimes imputent souvent à leur excision les problèmes physiologiques qu’elles ressentent, notamment dans leur vie sexuelle. C’est ce que confirme également l’enquête qualitative. Ces femmes sont donc fragilisées psychologiquement, ainsi que l’a expliqué Mme Armelle Andro : « Les questions portant sur la santé mentale ont révélé des différentiels importants entre ces femmes et la population générale. Les états dépressifs sont beaucoup plus fréquents chez ces femmes et elles les associent en partie à leur mutilation. » (154)
Les conséquences de l’excision sur la santé des femmes sont donc beaucoup mieux connues. Elles pourraient servir de base à une évaluation du coût économique des violences faites aux femmes dans le cadre de l’excision (155).
D. UNE CONNAISSANCE PLUS FINE DES LOGIQUES QUI CONDUISENT AUX MUTILATIONS SEXUELLES
Afin de prévenir les mutilations sexuelles, il est nécessaire d’en connaître les facteurs de risque. Tel est le but du volet qualitatif de l’enquête ExH, qui se propose de « mieux définir les politiques de prévention » (156) au moyen d’une analyse fondée sur 27 entretiens réalisés pour partie avec des femmes mutilées (20) et pour partie avec des hommes originaires d’ethnies où l’excision est pratiquée (7).
Selon cette étude, dans les pays d’origine, les mutilations sexuelles font simplement partie de « l’ordre des choses évident à tous » (157). Généralement pratiquée dans la petite enfance ou à la frontière de l’enfance et de l’adolescence, elle constitue un critère de « pureté » de la femme, qui rend possible le mariage. Le facteur causal principal est l’appartenance à certains groupes ethniques.
Compte tenu du rôle de la socialisation et du niveau d’éducation dans la reproduction de cette coutume, il est possible de distinguer les femmes socialisées en France de celles qui l’ont été dans leur pays d’origine. Les secondes sont plus enclines à accepter l’excision de leur fille, même si elles n’en sont généralement pas à l’initiative : des pressions familiales s’exercent sur elles, qui peuvent être particulièrement fortes lors des voyages de la jeune fille au pays d’origine, qui constitue un moment particulièrement risqué.
Dans d’autres situations, rapportées par les associations, l’attachement à la tradition de l’excision est le signe d’un « repli identitaire » (158), alors même que cette pratique tend à décroître dans les pays d’origine. « Dans un village du Mali, alors que les autorités administratives locales et les autorités coutumières étaient d’accord pour décider l’abandon de l’excision, c’est un groupe de migrants venant de France qui s’est élevé contre cette décision au motif qu’il s’était battu en Europe pour maintenir cette pratique. » (159)
De manière générale, les familles subissent des « injonctions contradictoires » du fait de leur double identité, ainsi que l’a indiqué Mme Armelle Andro : « Pour certaines la question de l’excision est liée à celle de l’identité. Être un bon parent dans le pays d’origine, c’est exciser sa fille parce que, si elle n’est pas excisée, elle ne trouvera pas de mari et aura mauvaise réputation. Dans le pays d’installation, être un bon parent, c’est ne pas exciser sa fille. Il est très difficile pour des parents de gérer ces deux injonctions contradictoires, surtout s’ils sont soumis à la pression de la famille d’origine. Parfois, ils se plient à la volonté de la famille. S’opposer à l’excision, les expose souvent à une rupture avec la famille, ce qui est un vécu très violent : leurs filles ne connaîtront pas leur grand-mère et n’iront jamais passer des vacances dans le pays d’origine car ce serait trop risqué. Des jeunes filles, tout en se réjouissant d’avoir gardé leur intégrité physique, ont l’impression d’avoir perdu leurs racines. Psychologiquement, c’est très lourd à porter. » (160)
Il ressort de ces analyses que l’effort de prévention des mutilations sexuelles en France doit essentiellement porter sur la première génération de migrants originaires d’ethnies qui la pratiquent massivement. Étant donné le faible nombre de mutilations qui semblent se dérouler actuellement en France, la période où le risque est grand est celle du retour, notamment pendant les vacances, dans le pays d’origine.
II. LA CONNAISSANCE TRÈS IMPARFAITE DU NOMBRE DE MARIAGES FORCÉS
Il existe une lacune importante dans la connaissance d’un type particulier de violences faites aux femmes : les mariages forcés, qui ne font l’objet que d’estimations, relativement sujettes à caution.
La définition la plus couramment admise du mariage forcé englobe sous cette expression l’ensemble des mariages qui sont conclus sans le consentement de la personne concernée ou avec un consentement contraint (161). Il peut intervenir dès l’âge de 10 à 12 ans et touche essentiellement, selon le Haut Conseil à l’intégration, « les communautés issues du Mali, de la Mauritanie et Sénégal […] mais aussi les populations originaires d’Afrique du Nord, d’Asie et de Turquie. » (162) Si les mariages forcés concernent aussi bien les hommes que les femmes, ces dernières constituent néanmoins la grande majorité des personnes mariées de force (163). En outre, quand on parle de « mariage forcé » on exclut les mariages religieux ou rituels.
Il est impératif, afin de montrer la spécificité des mariages forcés de bien les distinguer d’une part des mariages blancs qui ont un objectif migratoire et, d’autre part, des mariages arrangés, qui s’ils reposent sur des suggestions de la famille, recueillent au final le consentement des intéressés. Seuls seront pris en compte les mariages forcés, c’est-à-dire ceux qui sont conclus sans le consentement de la personne concernée.
A. LES MARIAGES FORCÉS, UNE RÉALITÉ TRÈS MAL CONNUE
1. Quelques enquêtes non spécifiques sont disponibles
Ainsi que l’a exposé Mme Christelle Hamel, chercheuse à l’Institut national des études démographiques (INED), au cours de son audition, trois grandes enquêtes, qui ne comportaient que quelques questions sur les mariages forcés, permettent d’approcher cette réalité :
— L’enquête mobilité géographique et insertion sociale de 1992, qui visait à étudier les parcours d’intégration des immigrés et de leurs enfants. L’enquête porte sur les jeunes nés en France qui ont un père immigré né en Algérie, au Portugal ou au Maroc ;
— L’enquête TIES (The integration of European Second Generation in Europe), menée en Europe en 2007, qui ne concernait que les descendants d’immigrés turcs nés dans les pays d’enquête. En France, 500 jeunes ont été interrogés (164) ;
— L’enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les jeunes filles, réalisée en Seine-Saint-Denis en 2006. Elle portait sur 1600 jeunes femmes âgées de 18 à 21 ans résidant en Seine-Saint-Denis.
Si aucune de ces études n’est spécifiquement consacrée à la question des mariages forcés, l’exploitation de leurs résultats permet de tirer quelques enseignements chiffrés quant à leur fréquence :
— Les situations de mariage forcé sont beaucoup plus fréquentes lorsque le mariage a lieu dans le pays d’origine. C’est ce qui ressortait notamment de l’enquête de 1992 ;
— Les mariages forcés concernant des jeunes filles résidant de manière habituelle en France sont en nombre limité et le taux de mariage forcé est beaucoup plus faible en France que dans les pays d’origine. Selon les résultats de l’enquête TIES, 6 % des descendantes d’immigrés turcs ont subi des pressions incitant au mariage alors qu’elles auraient préféré se marier plus tard ou ont été forcées de se marier. Selon l’enquête menée en Seine-Saint-Denis, sur les 1 600 jeunes filles interrogées, 41 (soit 5,3 % d’entre elles) se sont vues proposer un fiancé par leur famille et 4 ont dû se marier contre leur gré (soit environ 0,5 %) ;
— La pratique du mariage forcé semble être en régression dans les sociétés d’origine. En effet, ceux-ci sont généralement pratiqués sur de très jeunes filles. Or l’âge moyen au mariage a très sensiblement augmenté. En Algérie, il est passé d’environ 18 ans en 1966 à environ 27 ans et demi en 1998.
2. Le nombre de mariages forcés semblerait être en régression, malgré une augmentation des cas signalés
La pratique du mariage forcé a donc beaucoup changé au cours des dernières années, sans que l’on puisse connaître la réalité exacte de ces évolutions.
Le nombre de cas signalé aux associations est en augmentation. C’est par exemple ce qu’a souligné Mme Isabelle Bouclon, de l’association VIFF SOS Femmes, au cours de son audition : « Je tiens aussi à évoquer aussi le cas des jeunes femmes victimes, de la part de leurs frères, oncles ou parents, de violences liées à des choix de vie, notamment aux mariages forcés, dont les statistiques font apparaître une croissance exponentielle. » (165) Le même constat est rapporté par les sociologues qui ont travaillé au contact des associations sur les mariages forcés : « La plupart des associations militantes signalent une augmentation considérable de ces mariages forcés et ce phénomène toucherait toutes les communautés où ces derniers sont pratiqués. » (166)
Cette augmentation résulte, selon Mme Christelle Hamel, de deux facteurs : l’arrivée à l’âge nubile des descendants d’immigrés issus des pays où les mariages forcés sont pratiqués et la meilleure information qu’ont les jeunes filles vivant en France concernant leurs droits. C’est ce qu’elle a expliqué au cours de son audition : « Aujourd’hui, les victimes sont beaucoup plus en mesure que la génération de leurs parents de formuler des recours et de demander de l’aide. Elles sortent du silence, ce qui s’inscrit aussi dans le développement plus général de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la sensibilisation de l’ensemble des femmes, sur le territoire français, à ces questions de violence. Pour autant, on ne peut pas en déduire qu’il y ait une augmentation de la proportion des mariages forcés dans ces populations, mais simplement que les jeunes femmes potentiellement concernées arrivent aujourd’hui à l’âge du mariage et qu’elles sont plus réactives. » (167)
Il est donc probable que la croissance du nombre de cas signalés aux associations ne reflète pas une augmentation généralisée de la pratique des mariages forcés. Les données fondamentales dont on peut disposer (notamment en ce qui concerne l’âge au mariage) laisseraient plutôt penser que leur nombre diminue.
B. LES DIFFICULTES D’ÉVALUATION DU NOMBRE DE MARIAGES FORCÉS
Tous les rapports portant sur les mariages forcés déplorent le manque de données les concernant. Le Haut conseil à l’intégration (HCI) dans son avis de 2003 portant sur Les droits des femmes issues de l’immigration (168) a avancé que : « Selon les chiffres convergents rassemblés par les associations que le HCI a auditionnées, plus de 70 000 adolescentes seraient concernées par des mariages forcés en France. » (169)
Pourtant, ce chiffre ne revêt pas de signification, pour deux raisons. Le terme « concerné » ne précise pas si les adolescentes ont déjà été victimes d’un mariage forcé, si elles sont menacées de l’être ou si elles seraient susceptibles de l’être. D’autre part, il n’est pas précisé si 70 000 personnes sont « concernées » par an ou si 70 000 personnes ont été « concernées » à un moment ou un autre de leur vie.
Par conséquent, ce chiffre dont les fondements sont incertains a contribué à obscurcir le débat. Il a, par exemple, été rapproché à plusieurs reprises du nombre annuel de mariages en France (qui est d’environ 270 000), laissant entendre qu’un mariage sur quatre serait un mariage forcé (170) ! Cette proportion n’est pas réaliste dans la mesure où le nombre de jeunes filles étrangères âgées de 15 à 18 ans est en France de 70 000. Il est donc probable que le chiffre de 70 000 adolescentes concernées par un mariage forcé désigne non pas le nombre de mariages forcés annuels mais l’ensemble des adolescentes qui pourraient être l’objet d’un mariage forcé. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, le nombre de mariages forcés serait compris, selon des articles récents, dans une fourchette allant de plusieurs centaines à un millier par an (171).
La mission d’information a demandé au Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS) de préciser la manière dont ce chiffre avait été construit, afin de pouvoir distinguer plus clairement la réalité à laquelle il se rapporte. La méthode retenue par l’association est exposée ci-dessous.
DESCRIPTION PAR LE GAMS DE LA MÉTHODE UTILISÉE POUR ÉLABORER « L’ESTIMATION DU NOMBRE D’ADOLESCENTES MINEURES ET DE JEUNES MAJEURES MENACÉES OU MARIÉES DE FORCE »
« En France, notamment dans le département des Yvelines, là où il y a une forte concentration d’immigrés d’ethnies Bambara (nationalité et/ou origine : Malienne), Soninké ou Toucouleur (nationalités et/ou origines : Malienne, Mauritanienne et Sénégalaise), toutes les enquêtes ponctuelles et localisées confirment également l’importance numérique des adolescentes subissant des mariages précoces et forcés. Et il ne s’agit pas d’un phénomène marginal qui toucherait quelques familles restaient archaïques.
Si l’on raisonne en terme de probabilité, dans les pays d’origine, pour les adolescentes :
- au Mali : 79 % des femmes âgées de 20 à 24 ans sont mariées avant 18 ans et 46 % sont mères avant leur majorité ;
- au Sénégal : 48 % des femmes âgées de 20 à 24 ans sont mariées avant 18 ans et 34 % sont mères avant leur majorité (1).
La forte probabilité de recenser parmi les adolescentes africaines des jeunes filles mariées de force précocement ou menacées de l’être est sans doute d’autant plus importante. Car, d’une part, l’immigration permet de dégager les ressources nécessaires au paiement des prestations matrimoniales. Et, d’autre part, la pression sociale exercée par la communauté ici et les familles restées au pays vont dans ce sens. Enfin, le fait d’épouser une femme de nationalité française, ce qui est les cas de bon nombre d’adolescentes d’origine africaine, permet à leurs époux d’obtenir des papiers pour résider en France.
À titre d’exemple, dans les Yvelines (78), en 2000, appliqué aux fillettes scolarisées depuis 1992/1993 recensées (avec un sex-ratio de 50 %) et corrigé par l’évolution du nombre moyen d’enfants originaire d’Afrique noire inscrits dans les écoles publiques du 1er degré (en moyenne : de 1981 à 1992 : + 8,3 %), 2 500 adolescentes d’origine africaine noire, âgées de 10 à 18 ans, sont mariées de force précocement ou menacées de l’être dans le département des Yvelines.
Enfin, nous avons choisi de ne traiter que des adolescentes d’Afrique Noire, puisque c’est notre champ d’expertise. Mais, ces chiffres pourraient être étendus aux populations originaires d’Afrique du Nord, d’Asie (Cambodge, Pakistan, Vietnam, etc.) et de Turquie qui résident dans les Yvelines. Donc au total, c’est sans doute 5 000 adolescentes d’origine migrante, âgées de 10 à 18 ans, qui sont mariées de force précocement ou menacées de l’être dans le département des Yvelines.
Soit à l’échelle de l’Ile-de-France, dans les 8 départements, nous pouvons estimer qu’environ 40 000 adolescentes d’origine migrante, âgées de 10 à 18 ans, sont mariées de force précocement ou menacées de l’être. Notamment, pour Paris (arrondissements les plus concernés : 11e, 18e, 19e, 20e) : ce sont 5 000 adolescentes parisiennes, âgées de 10 à 18 ans, qui y sont confrontées.
Soit à l’échelle de la France, dans les 14 départements les plus concernés, nous pouvons estimer qu’environ 70 000 adolescentes d’origine migrante, âgées de 10 à 18 ans, sont mariées de force précocement ou menacées de l’être.
Sachant que l’on pourrait malheureusement élargir ces chiffres aux jeunes majeures. »
La population de référence est donc celle des adolescentes d’origine étrangère âgées de 10 à 18 ans et le chiffre ne porte pas sur un nombre de mariages avérés mais sur l’ensemble des jeunes filles susceptibles (sur un critère d’origine ethnique) d’être concernées par un mariage forcé. Ainsi, le chiffre des 70 000 personnes concernées est une estimation qui peut se lire ainsi : sous les hypothèses énoncées ci-dessus, on peut estimer à environ 8000 (172) le nombre d’adolescentes susceptibles d’être menacées chaque année de mariages forcé.
Cependant, même correctement interprétés, ces chiffres ne revêtent pas de valeur scientifique. C’est ce qu’a indiqué Mme Christelle Hamel, chercheuse à l’INED : « Je ne suis pas en mesure, à partir des enquêtes que j’ai présentées d’estimer le nombre de personnes confrontées à ces violences, je ne peux donner que des proportions. Il faudrait pouvoir rapporter les proportions observées pour les descendants d’immigrés au nombre de descendants d’immigrés présents en France. Or le recensement de la population n’enregistre que le pays de naissance des personnes et non celui de leurs parents. […] Je ne peux pas valider scientifiquement [le chiffre de 70 000 mariages forcés]. » (173) Cette dernière a néanmoins tenu à souligner le fait que cette estimation avait contribué à inscrire la lutte contre les mariages forcés dans le débat public.
Ceci illustre à l’évidence le manque de recherches statistiques portant sur la pratique des mariages forcés. Les autres pays européens ne disposent pas davantage d’estimations, ainsi que le souligne le Conseil de l’Europe, qui évoque « de simples estimations » et des « informations anecdotiques » (174). La difficulté tient au caractère privé du consentement au mariage et au fait que ces situations ne sont que peu souvent dénoncées par les femmes qui les subissent. Ceci peut laisser penser que, compte tenu de « l’aspect souvent non objectivable du caractère « libre et éclairé » de bien des consentements extorqués » (175), toute quantification de cette pratique est impossible. Mais tel était le cas pour les violences conjugales, qui prennent également place dans la sphère privée ou pour les mutilations sexuelles. Or, tous les intervenants auditionnés par la mission s’accordent à dire que l’ENVEFF et l’enquête Excision et Handicap ont permis un progrès considérable dans la connaissance statistique de ces réalités.
Si l’on souhaite mieux connaître les mariages forcés pour mieux pouvoir les combattre, la mise en œuvre d’une étude statistique pouvant déboucher sur des chiffres fiables est donc un préalable indispensable. C’est ce qu’a préconisé Mme Christelle Hamel dans un document transmis à la mission.
Proposition n° 7 :
Engager une étude statistique visant à estimer le nombre de cas annuel de mariages forcés en France, et à l’étranger si les victimes résident de manière habituelle en France, et à décrire les raisons du recours à ces pratiques, de manière à ajuster le dispositif de prévention et d’aide aux victimes.
C. DES ÉTUDES QUALITATIVES, QUI PERMETTENT D’ABOUTIR À UNE TYPOLOGIE DES MARIAGES FORCÉS
Quelques études ponctuelles ont été menées. Ainsi, dans le Val d’Oise, les services de l’Éducation nationale connaissent environ 15 cas par an contre 30 en Seine-Saint-Denis (176). En revanche, un travail qualitatif important a été effectué par les sociologues visant à bâtir des typologies des formes de mariages forcés. Sur le fondement d’entretiens avec des personnes ayant été confrontées à des situations de mariage forcé, trois grands types de parcours peuvent être distingués (177) :
— Dans un premier type de situations, le mariage ou l’union forcé a lieu en France, laissant à la personne mariée contre son gré la possibilité de fuir et de trouver de l’aide auprès des associations et des structures spécialisées ;
— Dans un deuxième cas, la situation se trouve compliquée par le fait que le mariage forcé a eu lieu à l’étranger. L’aide est beaucoup plus difficile à mobiliser et elle repose sur l’intervention des associations françaises, de leurs homologues étrangères et des autorités diplomatiques. Au retour en France (s’il a lieu), se pose également le problème des possibilités d’annulation du mariage ;
— Enfin, dans un troisième type de situation, le mariage forcé, qui a lieu à l’étranger ou en France aboutit à l’arrivée en France d’une femme, qui n’avait, avant son mariage, aucun lien avec la France. Le mariage forcé se couple alors souvent à une situation d’esclavage domestique et de réclusion, « le mariage forcé n’étant qu’un élément dans un continuum de violences » (178). L’absence de titre de séjour et la faible scolarisation compliquent grandement les possibilités de dénonciation des violences subies et l’accès au droit. Certaines associations parlent ainsi de « brus importées ».
Ces trois situations sont regroupées dans le tableau suivant.
TYPOLOGIE DES SITUATIONS DE MARIAGE FORCÉ
VICTIME RÉSIDANT DE MANIÈRE HABITUELLE EN FRANCE |
MARIAGE AYANT LIEU EN FRANCE |
MARIAGE AYANT LIEU À L’ÉTRANGER |
POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL AUX ASSOCIATIONS ET AUX STRUCTURES SPÉCIALISÉES DIFFICULTÉS : HÉBERGEMENT, SUIVI. |
POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL AU CONSULAT DE FRANCE DIFFICULTÉ : MANQUE D’APPUIS SUR PLACE, COMPLEXITÉ DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. | |
VICTIME NE RÉSIDANT PAS DE MANIÈRE HABITUELLE EN FRANCE |
DIFFICULTÉS : FAIBLE MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE, ISOLEMENT DE LA FEMME MARIÉE DE FORCE, TRÈS FAIBLE ACCÈS AU DROIT. | |
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE : CRÉER UN OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La connaissance des violences faites aux femmes s’est incontestablement améliorée. L’ENVEFF, unique étude d’ensemble de ce type de violences, bien qu’elle date désormais de presque dix ans, continue à fournir les données les plus précises sur les violences faites aux femmes. D’autres enquêtes d’ensemble, telle que celle sur les mutilations sexuelles, sur les décès au sein du couple ou sur le coût des violences conjugales constituent également des références au niveau national voire international. Les objectifs du plan 2005-2007, qui étaient novateurs en la matière, ont été remplis.
Cependant des chantiers majeurs demeurent.
La création de statistiques sexuées au sein des différentes administrations, et nomment au ministère de l’Intérieur, en est encore à ses balbutiements. L’élaboration d’indicateurs concernant le sexe des victimes et des auteurs de violences devrait être poursuivie. À ce titre, la mission juge que l’action 2-1 du plan global triennal 2008-2010 est particulièrement importante. Elle prévoit d’inciter les départements ministériels à améliorer le recueil des informations statistiques relatives aux violences faites aux femmes, notamment par une harmonisation des données, à dresser un état des lieux des données disponibles, à identifier les données complémentaires à collecter et à proposer des pistes d’amélioration.
Des pans entiers des violences faites aux femmes demeurent peu connus. Il s’agit des violences subies au travail, que le plan 2008-2010 propose de mieux connaître, des mariages forcés ou des violences commises à l’encontre des jeunes filles. Dans ces différents domaines, des enquêtes pionnières ont vu le jour, souvent sous l’impulsion de l’Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, mais elles ne laissent entrevoir qu’une partie de la réalité et ne sont pas forcément représentatives de l’ensemble des situations de violence subies par les femmes en France.
Afin de coordonner le recueil de données et l’élaboration d’enquêtes portant sur les violences faites aux femmes, il apparaît essentiel à la mission de disposer d’une structure pérenne. Exemple pourrait être pris sur l’Observatoire de Seine-Saint-Denis qui mène une action déterminante de collecte d’informations et de communication mais dont le ressort d’action est départemental. Mme Ernestine Ronai, qui dirige cette structure, en a approuvé l’idée au cours de son audition (179).
Serait donc créé, conformément à l’article 82 de la proposition de loi du CNDF, un Observatoire national des violences faites aux femmes. La composition de son conseil d’orientation devra représenter l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine de la connaissance des violences faites aux femmes (État, universitaires, collectivités territoriales, associations notamment). Il pourrait être placé auprès du ministre chargé du droit des femmes, son secrétariat étant assuré par le SDFE.
Sa mission serait, d’une part, de réaliser ou de commander des enquêtes d’envergure nationale sur les violences faites aux femmes et, d’autre part, d’inciter à la production de statistiques sexuées par les administrations concernées. Pour ce faire, un partenariat étroit pourrait être noué par l’Observatoire national de la délinquance et avec l’INSEE. Les travaux de cet Observatoire pourraient déboucher, à l’instar de ceux de l’Observatoire de la parité, sur le dépôt d’un rapport à l’autorité auprès de laquelle il est rattaché, qui serait également déposé auprès du Parlement.
Proposition n° 8 :
Créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, chargé de coordonner la collecte de données sexuées et d’organiser des enquêtes portant sur les violences faites aux femmes.
DEUXIÈME PARTIE : COUPLER ÉTROITEMENT LA PRÉVENTION DES VIOLENCES, LE SUIVI DES ENFANTS TÉMOINS ET CELUI DES AUTEURS
Sur la trame de fond des violences faites aux femmes et notamment des violences au sein du couple, sont récemment apparues, en plus des femmes victimes, deux préoccupations nouvelles.
La première est celle des enfants témoins des violences. Longtemps a prévalu l’idée qu’un mari violent pouvait être un bon père. Or, par le simple fait d’infliger des violences à la mère de ses enfants, le père violent fait plusieurs victimes : sa femme et ses enfants.
La seconde est celle du suivi de l’auteur des violences. La première préoccupation des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes doit résider dans la prise en charge de la victime. Mais assurer leur prévention, suppose que les efforts doivent se porter aussi sur les auteurs. Des études en nombre croissant montrent que le taux de récidive diminue significativement lorsqu’une prise en charge psychologique, sociale, éducative voire médicale de l’auteur a lieu rapidement.
Or, ces deux domaines commencent seulement à faire l’objet de politiques publiques. La mission propose donc de les mettre au centre de la politique de prévention des violences faites aux femmes.
Il ne faut pas pour autant négliger les autres vecteurs de la prévention et du repérage des violences et la nécessité de former les intervenants aux spécificités des violences faites aux femmes. Il est incontestable que l’école et les médias ont un rôle essentiel à jouer dans cette optique. Mais d’autres lieux et d’autres acteurs doivent également se sentir concernés par cette politique. Il s’agit notamment des professionnels de santé et des acteurs du monde du travail.
Tous ces leviers doivent être actionnés de manière globale et cohérente pour aboutir à une politique d’ensemble, de prévention de ces violences. Les plans triennaux ont posé les bases de ces politiques, qui doivent être poursuivies et approfondies.
Chapitre Ier : La prise en charge des enfants exposés aux violences, première des préventions
I. LES ENFANTS EXPOSÉS AUX VIOLENCES CONJUGALES :
DES CONSÉQUENCES MAJEURES
Les enfants vivant dans un contexte familial de violences conjugales ne sont pas forcément les victimes directes de la violence de leur père ou du compagnon de leur mère. Cependant, témoins des cris, des coups ou des effets de ceux-ci sur leur mère, confrontés au climat de peur et de menaces qui règne dans la famille, ils en sont aussi inévitablement les victimes.
La protection de l’enfance, devant la nécessité absolue de protéger les mineurs des atteintes directes à leur intégrité, a jusqu’à présent été conçue comme la lutte contre la maltraitance et les abus sexuels. En revanche, l’impact des violences conjugales sur les enfants commence seulement depuis quelques années à être pris en compte par les intervenants auprès des femmes victimes, les professionnels de santé et par les services de protection de l’enfance.
Cette préoccupation a été introduite dans le Plan triennal 2008-2010 pour combattre les violences faites aux femmes. L’objectif n° 12 vise à : « mieux mesurer l’exposition des enfants aux violences au sein du couple ; diffuser des recommandations à destination des autorités publiques et des préconisations aux professionnels concernés; s’assurer que la rencontre entre le parent auteur de violence et ses enfants s’effectue en toute sécurité ».
Il n’en reste pas moins, comme le souligne le rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED), dans l’étude qu’il a menée sur ce sujet, en partenariat avec le Service aux droits des femmes, que « l’action des pouvoirs publics n’a pas traité spécifiquement cette problématique du fait notamment d’un cloisonnement des approches (les temporalités et les modalités de prévention et de prise en charge sont par exemple distinctes, s’agissant des politiques menées en matière de protection de l’enfance et de lutte contre les violences au sein du couple) et d’une méconnaissance du phénomène » (180). Plus particulièrement, les intervenants sont partagés entre le souci de protéger l’enfant en l’éloignant du parent violent et la nécessité de maintenir des relations avec lui comme y invite le droit, souligne la Défenseure des enfants. (181)
A. DES ENFANTS VICTIMES DES VIOLENCES, MÊME QUAND ELLES NE SONT PAS DIRIGÉES CONTRE EUX
La confrontation des enfants à la violence au sein du foyer et les conséquences qui en découlent pour eux doivent être prises en compte dans toutes leurs dimensions.
1. Les violences conjugales, un risque supplémentaire que des violences soient exercées contre les enfants
Les auteurs du rapport Henrion avaient identifié que dans 10 % des cas recensés de violences conjugales, les violences s’exerçaient aussi sur les enfants (182). Paul Durning, Directeur de l’ONED a indiqué à la mission que les études soulignent combien la concomitance entre les violences exercées envers la femme et celles exercées envers un ou plusieurs enfants est fréquente : selon les auteurs, le taux serait de 40 à 70 % (183).
De fait, parmi les appels téléphoniques reçus au 119, numéro d’appel de l’enfance maltraitée, 20 % des fiches relevant qu’un enfant encourt un danger, font également état de violences conjugales, élément qui est évoqué spontanément par l’appelant. Au cours des huit derniers mois, cela représente 3 300 appels.
Les répercussions des violences conjugales sont encore à analyser avec précision. Elles représentent un enjeu considérable si l’on sait, comme cela est apparu, par exemple, dans l’enquête Justice et femmes battues, que « 80 % des auteurs de violences conjugales ont des enfants et que la tranche d’âge la plus concernée est celle des 25-45 ans, c'est-à-dire justement celle durant laquelle on les élève. » (184).
2. Les violences au sein du couple peuvent être sources de lourdes conséquences pour les enfants…
Un travail mené en 2004, sur le SNATEM (le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée) avait été conduit à se demander « si le phénomène des violences conjugales était un sujet qui mérite d’être exploré comme faisant partie du phénomène des mauvais traitements à enfants ».
Les effets préjudiciables sur la santé des enfants, leur sécurité, leur comportement, leur développement affectif et social ainsi que sur leurs résultats scolaires sont désormais de plus en plus souvent mis en avant (185). Les violences et les menaces à l’endroit de la mère ayant un effet destructeur sur la figure d’attachement de l’enfant, c'est-à-dire sa mère, celui-ci perd tous ses repères. « … un enfant qui assiste à des violences exercées sur sa mère est en danger. Il est une victime passive et il perçoit, à défaut de comprendre, la volonté de destruction qui s’exerce. (186) » a souligné devant la mission, Mme Maya Surduts, porte-parole du Collectif national pour le droit des femmes.
Le rapport du Professeur Roger Henrion avait déjà mis en avant l’impact des violences conjugales sur la santé des enfants : lésions traumatiques, accidentelles ou pas ; troubles psychologiques ; troubles du comportement et de la conduite ; troubles psychosomatiques découlant soit directement du traumatisme psychologique engendré par les violences, soit du manque de soin. En effet, le conflit entre les parents risque aussi d’engendrer des situations de négligence et de maltraitance.
En réalité, peu d’études, en France, ont encore traité cette question pour précisément apprécier l’impact des violences suivant les situations particulières.
La revue de littérature à laquelle a procédé l’ONED, littérature qui est essentiellement étrangère, souligne que les conséquences des violences conjugales sur l’enfant sont très variables dans leur forme et dans leur gravité sans que le trouble manifesté par l’enfant soit directement corrélé à la gravité des violences subies par sa mère : « Les variables interagissent et l’environnement a une influence forte. Selon les conditions de vie de la famille, à violences conjugales égales, le degré d’exposition de l’enfant varie. Certains enfants peuvent être très perturbés par une simple menace de séparation, même sans violences, même verbales, tandis que d’autres semblent surmonter le vécu de violences extrêmement fortes – même s’il convient d’insister sur leur impact. Tout dépend de la façon dont l’enfant perçoit les risques encourus par lui-même, par sa mère, mais aussi par ses frères et sœurs ». (187)
Le Docteur Maurice Berger, chef du service de psychiatrie de l’enfant au CHU de Saint-Étienne, a souligné devant la mission le facteur de risque significatif que constituait l’exposition à la violence domestique : « Nous nous sommes spécialisés, depuis une vingtaine d'années, dans la prise en charge des enfants très violents. Au début, nous pensions recevoir essentiellement des enfants qui avaient été maltraités, c’est-à-dire battus, négligés. Or nous avons constaté que, pour un certain nombre de ces enfants – parmi les plus violents –, ce n’était pas le cas. Par contre, ces enfants avaient été soumis au spectacle de scènes de violence conjugale extrêmement fortes, et de manière répétée. Cette observation est venue battre en brèche nos théories selon lesquelles l'enfant devait avoir été directement frappé ou négligé corporellement pour être violent. De surcroît, beaucoup de ces violences avaient eu lieu alors que l’enfant avait moins de deux ans. Autrement dit, plus l'exposition à la scène de violence avait eu lieu précocement, plus elle avait d’impact, ce que nous n'imaginions pas. » (188). Pour autant, comme l’a précisé le docteur Berger : « Tous les enfants exposés à des scènes de violence conjugale ne présentent pas des troubles. Nous ne connaissons pas le pourcentage d’enfants qui en souffrent» soulignant ainsi la nécessité de développer les travaux sur ce point.
En outre, l’impact des violences doit aussi être apprécié vis-à-vis de l’enfant à naître. La grossesse est identifiée comme une période à risque en tant que facteur déclenchant ou aggravant des violences conjugales. Or, les violences retentissent à la fois sur la mère et le fœtus et peuvent être à la source d’avortements sous contrainte, de grossesses mal surveillées, d’accouchements prématurés et de retards de croissance in utero.
Interrogé à ce propos par la mission, le docteur Berger a précisé que : « Une quantité importante de travaux montre que le fœtus est sensible au stress éprouvé par la femme pendant la grossesse, ne serait-ce que par des biais hormonaux. En effet, le stress provoque une augmentation du cortisol et de l'adrénaline. Par conséquent, chez une femme enceinte stressée, le fœtus baigne dans cette augmentation de cortisol qui, malheureusement, est une hormone liposoluble, c'est-à-dire qu’elle passe dans le cerveau. Nous avons des traces de ces maltraitances chez l'enfant après la naissance, qui sont le fait de mères très stressées. (189) »
3. …auxquelles s’ajoute le risque de la reproduction des violences
L’enfant n’est jamais extérieur aux violences dans le foyer, car il est un élément des interactions entre ses parents. Le risque est donc réel qu’il ne reproduise les violences auxquelles il a été exposé soit immédiatement à l’égard de sa mère, soit plus tard, dans sa vie de couple, comme victime ou même comme auteur.
Après avoir précisé qu’établir une liaison entre le fait d’avoir victime dans son enfance de sévices et de coups et celui de subir des violences au sein de son couple à l’âge adulte n’infère pas obligatoirement la thèse d’une « reproduction » plus ou moins inconsciente de situations, il est souligné dans l’ENVEFF que « ces atteintes graves peuvent produire une vulnérabilité sociale et relationnelle qui grèvera durablement l’histoire de la vie de la personne. » (190). C’est ainsi que « tandis que 1 % des femmes n’ayant rencontré aucune difficulté notable pendant leur enfance déclare des violences de la part de proches et de parents au cours de l’année ce taux augmente avec l’ampleur des difficultés subies dans l’enfance : de 2,5 % lorsqu’il n’y en a qu’une seule, il passe à 7,9 % lorsqu’il y a eu au moins trois problèmes différents cités. » (191)
Cette répétition est particulièrement forte, souligne l’enquête « lorsque les personnes avec lesquelles la femme vivait à cette époque ont subi des sévices ou lorsqu’elle signale des tensions graves ou un climat de violences entre ses parents. » (192) Cette répétition serait plus forte d’ailleurs, est-il précisé, que lorsque les difficultés ont entraîné une prise en charge institutionnelle éloignant l’enfant de ses parents.
Ce risque a été fréquemment soulevé devant la mission par les associations au contact des victimes. Elles s’inquiètent aussi fortement du risque de reproduction des faits violents à l’égard des femmes à l’âge adulte.
« Les enfants victimes de la violence conjugale apprennent ainsi comment on traite sa femme » souligne le Docteur Emmanuelle Piet : « Je participe à la réparation pénale d’agresseurs sexuels « légers » – qui n’ont en fait de léger que leur âge, car les agressions commises sont graves. Entre 1997 et 2000, nous en avons rencontré 119 en prison : tous avaient subi, avant d’être criminels ou violeurs, des violences sexuelles graves, de la maltraitance ou un abandon grave de la mère, ou venaient d’un pays en crise où ils avaient assisté ou participé à un massacre ou connu une mort violente autour d’eux. En outre, pratiquement tous ont vu leur père frapper leur mère. Quand il n’y a pas de poursuite, ils sont aussi témoin de cette impunité totale. » (193).
Outre les conséquences sur les enfants vivant dans un climat de violences, quand celles-ci deviennent chroniques « l’apprentissage de l’utilisation des violences comme outil de règlement des conflits commence alors à se manifester. » (194). Agir pour protéger et prendre en charge ces enfants de façon précoce est donc un élément essentiel de prévention.
Proposition n° 9 :
Poursuivre et développer les travaux sur l’impact des violences au sein du couple sur les enfants.
B. FAIRE PRÉVALOIR L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Un mauvais mari, au sens d’un mari maltraitant à l’égard de sa femme, ne serait pas forcément un mauvais père…
Au-delà même du fait qu’« un homme qui tape sa femme devant son enfant perd toute préoccupation parentale puisqu'il soumet son enfant à un spectacle particulièrement angoissant. »(195), cette affirmation est apparue à la mission très fortement discutable et potentiellement lourde de conséquences.
En effet, paradoxalement, comme le regrette la Défenseure des enfants, « les propres droits de l’enfant peuvent être masqués par la mise en œuvre de ceux de ses parents (196) » alors que l’intérêt de ce dernier devrait toujours primer. Ce constat a été partagé par les personnes auditionnées lorsque cette question a été évoquée. Mme Évelyne Reguig, Présidente de l’Association VIFF SOS Femmes a notamment précisé que « l’idée selon laquelle un homme pourrait être « mauvais conjoint, mais bon père », encore répandue en France, doit être remise en cause. Au Canada, où l’on a constaté depuis longtemps que les pressions morales et psychiques augmentaient à mesure que la violence physique était interdite et condamnée, un père maltraitant envers la mère de ses enfants est considéré comme un père maltraitant envers les enfants eux-mêmes. » (197)
La mission n’en a pas toutefois tiré la conséquence que les enfants vivant dans un contexte de violences familiales devaient systématiquement relever de la protection de l’enfance parce que, au-delà même de la question de principe, la crainte de la victime de se voir retirer les enfants étant déjà un frein à sa volonté de porter plainte, cela risquerait de devenir alors un obstacle diriment.
Il n’en reste pas moins que l’intérêt de l’enfant devrait prévaloir sur celui des adultes, en l’occurrence ses parents.
L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance dispose désormais que « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. »
Cet article, dans la rédaction qui a été retenue, ne donne donc pas de définition du contenu de l’intérêt de l’enfant sur laquelle le juge pourrait s’appuyer mais renvoie implicitement à la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, qui se réfère à « l'intérêt supérieur de l'enfant ». En outre, cette notion n’a pas été introduite dans le code civil mais dans le code de l’action sociale.
Proposition n° 10 :
Préciser la définition de l’intérêt de l’enfant en affirmant clairement que celui-ci doit guider toute décision le concernant et l’inscrire dans le code civil.
II. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS TÉMOINS
« L’enfant, dans toutes les situations, doit être considéré comme une personne à part entière, sans identifier immédiatement sa situation, sa souffrance et son intérêt à ceux de sa mère. » a indiqué M. Paul Durning, directeur de l’ONED (198).
A. SENSIBILISER ET FORMER LES PROFESSIONNELS AU DANGER ENCOURUS PAR CES ENFANTS
Le Conseil de l’Europe, en 2006 (199), a souligné le danger qu’entraîne la violence au sein du couple pour le bien-être des enfants et la nécessité pour « l’ensemble des organismes de protection de l’enfance (…) d’être instruits de ce problème et de recevoir des orientations claires afin de développer des procédures accordant (…) la priorité aux droits de la personne les plus fondamentaux ». Il est également relevé qu’« aucun des États membres n’a encore traité cette question de manière adéquate ou élaboré des lignes directrices pouvant être mises en œuvre et évaluées ».
Des initiatives comme celle de la FNSF qui a lancé un spot télévisé sur le thème intitulé Les enfants souffrent de la violence faite à leur mère, contribuent à rendre publique cette dimension des violences conjugales. L’Observatoire de Seine Saint-Denis a de même présenté à la mission les affiches réalisées et diffusées sur ce point.
Le groupe de travail piloté par l’ONED et le SDFE consacré aux modalités d’intervention des professionnels de la protection de l’enfance et des associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violence a dressé le constat que ceux-ci sont souvent démunis (voire mettent en œuvre des mécanismes de déni) dans ces situations et s’interrogent sur le rôle qu’ils doivent jouer. Leurs interventions manquent, en outre, de cohérence comme le souligne Paul Durning :« Dans les rapports de suivi de jeunes en AEMO – action éducative en milieu ouvert–, le diagnostic de situation fait souvent état de violences conjugales, mais on n’y voit pas trace d’une action vis-à-vis de ce problème. » (1).
Il convient donc de sensibiliser aux violences faites aux femmes les professionnels de l’enfance, d’une part et, les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ des violences faites aux femmes, aux besoins de l’enfant, d’autre part, pour assurer une prise en charge cohérente.
Proposition n° 11 :
Former les professionnels au facteur de risque que constituent pour les enfants les violences au sein du couple, à leur repérage et aux impératifs de leur prise en charge.
B. PRENDRE EN CHARGE LEURS BESOINS SPÉCIFIQUES
Souvent, pris par des urgences matérielles, les professionnels concernés se voient d’abord contraints à traiter la situation de la mère avant celle des enfants dont les difficultés paraissent, dans un premier temps, moins prioritaires.
Pourtant dans des moments aussi difficiles que l’arrivée au service des urgences ou lorsque la mère quitte le domicile avec ses enfants, un accueil et une prise en charge tournés aussi vers l’enfant s’imposent.
La décision de la mère de partir est pour les enfants un bouleversement profond de leurs conditions de vie, synonyme de rupture et de perte auxquels les enfants ne sont généralement pas préparés. Comme le soulignent M. Charles Heim et Mme Catherine Vasselier-Novelli, « au moment de son arrivée dans le centre d’hébergement, il a perdu aussi l’espoir qu’entre papa et sa maman tout va s’arranger, et qu’il n’y aura plus de violences…. Le seul repère stable reste sa mère, celle qui pourtant a déstabilisé la situation établie et reconnue » (200)
Or, les limites des capacités d’accueil aboutissent encore à ce que des femmes accompagnées d’enfants ne puissent être hébergées dans des structures qui leur sont réservées offrant un accueil adapté aux enfants. Les associations ont souligné que cette question était un des obstacles majeurs : des femmes résolues à quitter le domicile sont parfois contraintes d’y renoncer, malgré les violences, faute d’une solution d’hébergement adaptée pour elles et leurs enfants (201).
Chapitre II : Le suivi des auteurs : un impératif pour la prévention des violences au sein du couple
Le suivi des auteurs est une composante à part entière de la prévention des violences faites aux femmes. « Lorsque nous aidons des gens à ne plus commettre de violence dans leur famille, nous faisons de la prévention « après coup ». (202)
Pourtant, si les pouvoirs publics ont développé le suivi des auteurs de violences sexuelles (203), ils n’ont pris conscience que récemment de l’enjeu que représente le suivi des auteurs dans la politique de lutte contre les violences au sein du couple. Le plan 2005-2007 ne prenait pas en compte cette question. Par conséquent, les moyens qui y sont consacrés sont encore beaucoup trop faibles et les techniques de suivi sont insuffisamment évaluées, faute d’une politique nationale cohérente dans ce domaine.
Il y a donc urgence à développer le suivi des auteurs de violence, pour lutter contre les risques de récidive.
I. DES PROFILS QUI JUSTIFIENT UN SUIVI SYSTÉMATIQUE
Il n’est pas question de dresser un tableau sociologique des auteurs de violences au sein du couple. En effet, il existe des hommes violents à tous les niveaux de la société et les groupes de parole des centres spécialisés dans leur suivi sont généralement composés d’hommes de tous milieux, comme l’ont exposé des participants à la table ronde sur les auteurs de violences (204), ainsi que les éducateurs entendus lors du déplacement de la mission à Marseille.
A. DES PROFILS PSYCHOLOGIQUES DIVERS
Si le profil sociologique n’a pas de conséquence sur le suivi psychologique à mettre en œuvre pour limiter les risques de récidive, le Docteur Roland Coutanceau a, dans son rapport Auteurs de violences au sein du couple. Prise en charge et prévention (205), clairement distingué trois grands profils psychologiques d’hommes violents :
— un profil « à tonalité immaturo-névrotique ». Ces hommes violents sont parfois conscients de leur responsabilité et peuvent éprouver de la souffrance pour leur comportement et pour leur victime. On peut évaluer leur représentation au sein de la catégorie des hommes violents, à environ 20 % d’entre eux (206). Ce profil caractérise la majorité des auteurs de violences au sein du couple ;
— un profil d’hommes égocentriques et mal structurés psychologiquement. Ils banalisent et minimisent les faits et s’inquiètent davantage des conséquences qui peuvent se produire pour eux que pour leur victime. Ces hommes sont sur la défensive et peinent à s’autocritiquer ;
— un profil d’hommes « à la personnalité particulièrement problématique », marquée par un fort égocentrisme et une dimension paranoïaque et mégalomaniaque. Ils tentent de construire une relation d’emprise et décrivent leur femme comme « mythomane, hystérique ou persécutive » (207).
Si seuls 15 % des auteurs souffrent de troubles psychiatriques clairement identifiés (208) (et ceux-ci appartiennent en général au troisième groupe), dans tous les cas, un suivi psychologique des auteurs est nécessaire, bien qu’il puisse être de nature différente selon le profil de l’auteur. En effet, ainsi que le mentionne une synthèse récente sur la question « dans leur grande majorité, les hommes violents ne sont pas des personnalités perverses difficilement accessibles à une thérapie » (209). « Le seul apaisement de la violence consistera donc à trouver, pour chacun, un cheminement, souvent long et difficile, vers un langage vraiment adressé à l’autre. » (210) écrivait de même Mme Liliane Daligand, professeure de médecine légale et présidente du conseil scientifique de l’INAVEM et de l’association VIFF-SOS femmes à Villeurbanne.
B. DES ADDICTIONS QUI JUSTIFIENT UN SUIVI RENFORCÉ
Ces profils psychologiques ne sont que des catégories, susceptibles d’orienter le suivi à mettre en œuvre, avec lesquels d’autres problématiques peuvent s’entrecroiser.
La première est celle de l’alcool qui joue un rôle prépondérant dans les violences conjugales.
Une enquête menée sur les auteurs du ressort d’un grand TGI de région parisienne (211) a montré que 34 % avaient bu lors des faits. Cette proportion est certainement significativement supérieure, dans la mesure où la dénonciation des faits a souvent lieu a posteriori, ce qui rend impossible toute mesure précise du taux d’alcoolémie de l’auteur. Ce taux a néanmoins été confirmé par l’enquête menée sur les auteurs du ressort des TGI d’Albi et de Castres (212). M. Pascal Suhard, vice-procureur au TGI d’Albi a ainsi indiqué que l’alcool était présent dans un tiers des affaires de violences conjugales.
Par ailleurs, 28 % des auteurs de violences seraient des buveurs d’habitude ce qui est bien supérieur à la proportion de ces buveurs d’habitude au sein de la population française (entre 8 et 15 %).
Il est donc incontestable que l’alcool joue un rôle décisif, sur le long terme comme sur le court terme, dans le passage à l’acte des auteurs de violence comme l’ont constaté de nombreuses personnes auditionnées par la mission.
La même remarque peut être faite en ce qui concerne les autres types d’addictions, notamment aux drogues : 6 % des auteurs de violences seraient dépendants à une drogue, alors que le pourcentage de personnes dépendantes à une drogue est inférieur à 1 % dans les grandes villes françaises (213).
Il est donc essentiel, si l’on souhaite prévenir la récidive en matière de violences conjugales, de mieux détecter les addictions des auteurs et d’en assurer le suivi de manière spécifique dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction de soin ordonnée par le tribunal.
II. LA LOI ORGANISE LE SUIVI DES AUTEURS
La justice dispose désormais d’outils pour contraindre les auteurs de violences à être suivis à tous les stades de la procédure judiciaire. Cette contrainte est indispensable car elle fait sensiblement diminuer le taux de récidive. Il est donc nécessaire de généraliser le suivi des auteurs.
A. UN SUIVI POSSIBLE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE
Avant le jugement, le juge des libertés et de la détention peut ordonner un contrôle judiciaire. Au moment du jugement, le tribunal peut prononcer une obligation ou une injonction de soins dans le cadre, par exemple, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un suivi socio-judiciaire.
1. Le suivi de l’auteur avant la décision judiciaire
A la suite de la garde à vue de l’auteur, le procureur peut choisir, si les faits sont particulièrement graves, la procédure de la comparution immédiate. Si les faits sont d’une moindre gravité, le magistrat peut opter pour une convocation par procès-verbal, pour une audience ultérieure, associée à un contrôle judiciaire socio-éducatif ordonné par un juge des libertés et de la détention. L’auteur se voit alors expliciter par le juge les obligations qu’il doit remplir et noue contact avec le contrôleur judiciaire, qui est chargé de son suivi jusqu’au terme de la mesure. En cas de non respect des obligations, les mesures de contrôle judiciaire peuvent être levées et l’auteur incarcéré.
La procédure conduisant à un contrôle judiciaire (214)
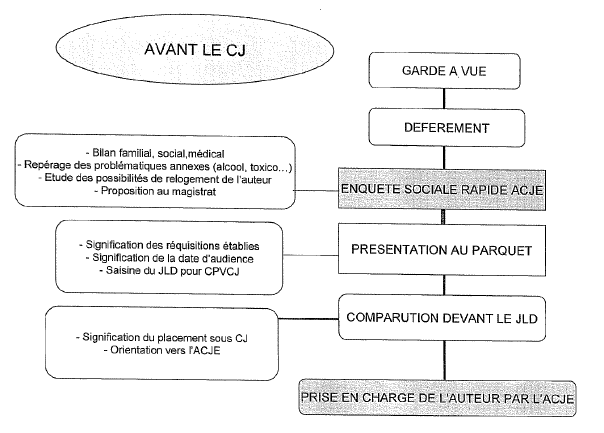
Immédiatement après son entretien avec le juge des libertés et de la détention, l’auteur est reçu par le contrôleur judiciaire, qui peut l’orienter vers une psychologue et vers un lieu de soins spécialisé. La conclusion de conventions entre les différents acteurs (parquet, association de contrôle judiciaire, association de suivi des auteurs de violences conjugales), sur le modèle de la convention signée à Aix-en-Provence (215), permet de faciliter le suivi des auteurs en l’organisant.
L’expérience de l’ACJE (Essonne)
Lors de son déplacement en Essonne, la mission a recueilli l’expérience de l’Association pour le contrôle judiciaire en Essonne (ACJE) qui a établi, en 2005, un programme spécifiquement consacré aux auteurs de violences conjugales.
L’auteur bénéficie pendant les deux mois que dure, en moyenne, son contrôle judiciaire, d’un entretien hebdomadaire au minimum avec un psychologue (de l’association ou à l’extérieur de l’association, au choix du prévenu) et d’un autre rendez-vous avec le contrôleur judiciaire, qui est chargé notamment du suivi social et de la préparation de la phase post-sententielle. Le psychologue et le contrôleur rédigent chacun un rapport, en prévision de l’audience, qui porte sur le déroulement du contrôle judicaire, le comportement de l’auteur, l’évaluation de sa capacité à définir un projet d’insertion et la nécessité de poursuivre le suivi.
Grâce à un partenariat noué avec l’association Médiavipp91, qui prend en charge simultanément la victime, le suivi de l’auteur peut se faire en cohérence avec les souhaits et la situation de cette dernière.
Conformément aux prescriptions légales, ces mesures de contrôle judiciaire sont limitées à deux mois, sauf en cas de renvoi de l’affaire. Dans le cas de l’ACJE, le suivi dure dans 75 % des cas entre un mois et demi et deux mois. Les associations estiment que cette durée est trop courte pour que le travail entrepris porte réellement ses fruits et soulignent la nécessité de poursuivre le suivi en aval du jugement (216).
2. Le suivi de l’auteur après la décision judiciaire
Celui-ci peut être poursuivi si le tribunal prononce une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de suivi socio-judiciaire. L’article 471 du code pénal prévoit alors que la structure chargée du suivi est celle qui l’a commencée dans le cadre du contrôle socio-judiciaire, afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge. En revanche, quand le risque de récidive est écarté (en raison par exemple de la séparation du couple), les tribunaux prononcent fréquemment un sursis simple, ce qui interrompt le suivi de l’auteur.
Il peut également exister une interruption du suivi en cas de condamnation, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) prenant le relais au terme d’un délai « qui peut être long (217) ».
La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a instauré le suivi socio-judiciaire dans le cas d’infractions à caractère sexuel. Il permet de soumettre l’auteur à une surveillance et à une injonction de soins, ayant pour double but de protéger la victime et de suivre l’auteur. Le cadre de ce suivi a été progressivement étendu à d’autres infractions graves, dont les situations de violences conjugales.
Depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la peine de suivi socio-judiciaire a été étendue aux actes de violence contre les personnes commis par le partenaire ou l’ex-partenaire (art. 222-48-1 du code pénal). De surcroît, elle est obligatoire en matière correctionnelle si les violences sont commises de manière habituelle, sauf en cas de sursis avec mise à l’épreuve ou de décision spécialement motivée du tribunal.
À l'inverse du sursis avec mise à l’épreuve, qui comporte une obligation de soins, le suivi socio-judiciaire prévoit une injonction de soins (218). Il peut également comporter des dispositions spécifiques telles que l’interdiction de paraître dans certains lieux ou l’interdiction de rencontrer certaines personnes. Le Ministère de la Justice ne dispose néanmoins pas de statistiques concernant le nombre de mesures de suivi socio-judiciaire qui ont été prononcées en 2008.
B. LES RÉSULTATS DE CES DISPOSITIFS SONT ENCOURAGEANTS
Il n’existe pas de résultats quantitatifs portant sur l’efficacité du suivi entrepris par les structures de suivi des auteurs. Les associations n’ont actuellement pas les moyens de consacrer du temps à l’évaluation de leurs pratiques, compte tenu des faibles budgets dont elles disposent. C’est ce qu’a confirmé M. Alain Legrand qui dirige une de ces associations, lors de son audition (219). Les taux de récidives peuvent fournir un indice de l’efficacité de la prise en charge, mais ils restent souvent inconnus. Au niveau national, le taux de récidive est de 7,9 %, ce qui est plus important que pour les violences en général (5,5 %). Ce taux est moindre dans le ressort des TGI où le Procureur mène une politique incluant le suivi de l’auteur (6 % à Douai ; 2,5 % dans le Tarn). Une évaluation est en cours à Castres et à Albi mais les résultats ne seront pas connus avant deux ou trois ans. (220)
Ce manque d’évaluation des effets du suivi des auteurs de violences transparaît dans le rapport d’évaluation du plan de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007), qui recommande un meilleur suivi des auteurs sur le seul fondement que « cette prise en charge précoce ainsi que les moyens affectés pour éviter la récidive ne peuvent qu’avoir un impact positif dans la lutte contre les violences faites aux femmes. (221) »
Néanmoins, les acteurs associatifs ont constaté qu’une évolution se faisait jour sur le plan psychologique chez de nombreux auteurs pris en charge. Alors que la plupart se considèrent initialement comme des victimes, le travail effectué permet de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités (222).
Ces constatations empiriques et qualitatives ne sont pas suffisantes. Il est donc indispensable de mener des études d’ensemble sur l’impact du suivi des auteurs de violences conjugales. C’est ce que propose l’article 100 de la proposition de loi du CNDF, qui prévoit de mettre en place des programmes de suivi des auteurs qui s’inspirent des expériences étrangères, sans que leur contenu ne soit clairement énoncé. Les acteurs de terrain sont d’ailleurs prêts à mener ces études si les moyens correspondants sont dégagés.
De façon plus générale, de telles études permettront d’adapter les moyens qui doivent être consacrés à cette politique.
De surcroît, il est nécessaire de développer les recherches dans le domaine du suivi des auteurs de violences. En effet, actuellement, aucun guide ou aucun recueil de bonnes pratiques n’a été élaboré en ce domaine.
Proposition n° 12 :
— Évaluer, par une étude d’ensemble, l’impact du suivi des auteurs de violences sur les taux de récidive ;
— Élaborer un guide de bonnes pratiques pour le suivi des auteurs de violences au sein du couple.
C. UN OUTIL À RÉORIENTER VERS L’OBLIGATION DE SOINS
Ces résultats incitent à généraliser les obligations de soins pour les auteurs de violences. En revanche, les injonctions de soins, qui sont beaucoup plus lourdes, sans avoir d’effets réellement différents, devraient être réservées aux auteurs les plus dangereux.
1. Réserver le suivi socio-judiciaire aux auteurs les plus dangereux
Ainsi que l’a expliqué Mme Martine Lebrun, présidente de l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP), les obligations, pour l’auteur des faits sont identiques qu’elles prennent place dans le cadre d’une obligation ou d’une injonction de soins. Néanmoins, dans le cas du suivi socio-judiciaire (et donc d’une injonction de soin), il doit être fait obligatoirement appel à un médecin coordonnateur. Le nombre de ces médecins et leurs capacités de prise en charge étant limités il est essentiel de réserver le suivi socio-judiciaire aux auteurs de faits les plus graves : « D’autre part, la loi du 10 août 2007 tend à paralyser le système en empêchant toute sortie dans le cadre du suivi socio-judiciaire tant qu’un expert ne s’est pas prononcé. Un tel dispositif coûte non seulement très cher en temps et en argent, mais il est en outre très difficile à appliquer aux courtes peines : les experts ne sont pas disponibles à temps, car nous avons besoin d’eux en priorité pour des affaires plus graves. » (223).
2. Systématiser le suivi des auteurs de violences au sein du couple
Dans de nombreux cas, le couple se reforme après un délai plus ou moins long ou l’auteur se remet en couple avec une autre femme. Tous les auteurs de violences conjugales devraient donc pouvoir bénéficier d’un suivi afin de prévenir la récidive et d’un suivi d’une durée suffisante pour être efficace.
Néanmoins, les associations notent que certains magistrats sont réticents à prononcer des obligations de soins pour les auteurs de violences, en dehors des cas de troubles manifestes du comportement ou d’addiction flagrante, notamment à l’alcool (224). Il est donc essentiel d’informer les magistrats de l’importance du suivi des auteurs de violences conjugales, dans le cadre d’une obligation de soins. Cette information pourrait se faire par voie de circulaire.
Proposition n° 13
— Systématiser les obligations de soins pour les auteurs de violences au sein du couple en réduisant le nombre de peines de sursis simple et réserver le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs des violences les plus graves ;
— Inciter les magistrats, par exemple par voie de circulaire, à suivre les auteurs de violences conjugales dans le cadre d’une obligation de soins.
Mais cette réticence peut également provenir du fait que les magistrats savent que les structures d’accueil des auteurs manquent, d’où la nécessité de renforcer les moyens dont elles disposent.
III. LE SUIVI DES AUTEURS EST GRAVEMENT COMPROMIS PAR LE MANQUE DE VISIBILITÉ ET DE MOYENS
Il existe donc des besoins matériels et humains importants pour assurer le suivi des auteurs de violences. Néanmoins, cet enjeu, indispensable dans une perspective de prévention de la récidive, n’a été que très récemment mis en valeur par les pouvoirs publics et ne bénéficie que de moyens extrêmement limités.
A. UNE PROBLÉMATIQUE SOUFFRANT ENCORE D’UNE FAIBLE VISIBILITÉ
Jusqu’à une période récente, le suivi des auteurs était vu comme secondaire par rapport à la nécessité de prendre en charge les victimes. Or, l’écoute et l’accompagnement des victimes qui doivent être assurés dans des conditions optimales, assortis de l’arsenal répressif mis en place par la loi, ne dispensent pas d’un suivi des auteurs, car celui-ci est un élément essentiel de la prévention de la récidive.
1. Un manque de coordination et de visibilité
Ce retard initial des pouvoirs publics se traduit actuellement par un manque de moyens et de coordination entre les différents acteurs. À titre d’exemple, le Canada a établi un répertoire des programmes de traitement pour les hommes violents envers leur conjointe, qui est réactualisé chaque année. À l’inverse, les structures de suivi des auteurs de violences conjugales manquent en France de visibilité. Celle-ci aurait pourtant deux effets positifs :
— Les auteurs pourraient entreprendre un suivi de manière volontaire. Certains d’entre eux, bien que très minoritaires parmi les auteurs pris en charge, effectuent déjà des démarches auprès des associations spécialisées comme l’ont indiqué les responsables de structures entendus par la mission.(225). À Paris, l’association SOS-Violences familiales reçoit pour moitié des personnes sous main de justice et pour moitié des personnes volontaires.
— Les victimes pourraient faire pression sur leur compagnon afin qu’ils contactent une structure compétente, avec la menace, en cas de refus, de déposer plainte. Ceci permettrait de donner un moyen d’action supplémentaire aux femmes qui ne souhaitent pas déposer plainte dans un avenir proche. C’est ce qu’a suggéré le Docteur Roland Coutanceau au cours de son audition : « Je plaide donc pour un accompagnement du système familial, comme au Canada, où les familles utilisent en amont ces consultations pour exercer un chantage affectif sur les auteurs en les menaçant de les dénoncer s’ils ne vont pas se soigner. » (226).
Il est donc nécessaire de renforcer la visibilité des associations de suivi des auteurs. Pour ce faire, le ministère chargé des droits des femmes pourrait se voir confier la mission de dresser la liste des associations œuvrant dans ce domaine, sur le modèle canadien. Cette liste devrait être déclinée au niveau régional et départemental enfin d’identifier les territoires qui manquent de structures. De surcroît, une meilleure coordination avec les associations de femmes victimes et avec les parquets devrait être recherchée.
Proposition n° 14 :
Dresser, mettre à jour annuellement et diffuser, au niveau national, régional et départemental une liste des structures spécialisées dans le suivi des auteurs de violences conjugales.
2. Des efforts récents mais insuffisants
Une fédération nationale des associations et des centres de prise en charge d’auteurs de violences conjugales et familiales (FNACAV) a été constituée en juin 2006. Elle regroupe actuellement plus de 20 structures et contribue à les rendre visibles auprès des partenaires institutionnels, notamment via son site Internet.
Le deuxième plan de lutte contre les violences faites aux femmes (2008-2010) prend en compte la problématique du suivi des auteurs de violences dans son objectif 5 :
— L’action 5-2 préconise la rédaction d’une charte des principes fédérateurs des structures assurant le suivi des hommes auteurs de violences. Cette action a été menée à bien, puisque la FNACAV a approuvé en 2008 une charte (227) comprenant les fondements, les objectifs et les valeurs communes aux structures d’accueil des auteurs de violences. Elle mentionne notamment le fait que l’intervention auprès des auteurs doit se faire en complément de celle auprès des victimes et qu’elle ne saurait se substituer à la sanction judiciaire. Néanmoins, le processus de labellisation des structures, sur la base de l’adhésion à cette charte, ne semble pas avoir débuté ;
— L’action 5-3 prévoit la rédaction d’un document à destination des auteurs, qui serait distribué dans les commissariats, les gendarmeries, les SPIP et les mairies. Ce document a été édité et s’intitule : « Vous pensez l’aimer et pourtant vous êtes violent… ». Il décrit les faits qui constituent des violences (en incluant les violences verbales et psychologiques) et les conséquences judiciaires possibles. Il mentionne enfin que le retrait de la plainte ne met pas fin aux poursuites et que les violences ont des conséquences « très graves » sur les enfants qui en sont témoins.
Des actions ont donc été entreprises pour donner plus de visibilité aux structures d’accueil des auteurs de violences ; elles sont à compléter pour aller plus loin dans ce sens.
B. DES MOYENS LARGEMENT INSUFFISANTS
Les moyens, notamment financiers, faisant largement défaut, le suivi des auteurs reste lacunaire sur le territoire français. De ce fait, et malgré la volonté des associations de suivi des auteurs, la situation n’est pas satisfaisante. Des moyens doivent être rapidement dégagés pour pérenniser les actions existantes et les généraliser.
1. Le nombre de structures de suivi est notablement insuffisant
Le nombre de structures de suivi des auteurs de violences est très faible. La comparaison avec le Canada est à cet égard révélatrice. Le répertoire canadien des programmes de traitement pour les hommes violents envers leur conjointe comprenait, en 2004, 205 programmes pour 32 millions d’habitants, soit un programme pour 15 000 habitants environ.
Le rapport remis au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple fait état du recensement d’une « soixantaine de structures d’accompagnement des auteurs » (228), soit environ une structure pour 100 000 habitants, c'est-à-dire six fois moins qu’au Canada. Ainsi, à Paris, il n’existe que deux centres de suivi des auteurs ! Or, à défaut de prise en charge par des professionnels, le suivi est souvent inefficace (notamment quand il est effectué par un psychologue non spécifiquement formé).
Le même diagnostic a été posé, au cours de son audition par M. Luc Frémiot, Procureur de la République à Douai, qui a mis en œuvre un programme pilote au niveau national pour la lutte contre les violences faites aux femmes : « C’est donc bien de cela que nous manquons : des structures d’accueil pour les auteurs de violences. En dépit de nos efforts, des résultats que nous obtenons, de leur médiatisation, des contacts que nous nouons, on continue à ouvrir indéfiniment des places d’accueil pour les victimes, mais aucune structure n’est créée pour les auteurs. Je l’ai signalé à la Chancellerie, j’en ai discuté avec Mme Létard mais sans résultat. » (229).
2. Par manque de financement
Le principal frein au suivi des auteurs réside dans la faiblesse des moyens qui sont alloués aux structures concernées.
Cet état de fait ne doit pourtant pas conduire à une réallocation de moyens déjà limités destinés à l’aide devant être accordée aux victimes. Ce sont les deux faces de la même volonté de lutter contre les violences envers les femmes. Des partenariats ont d’ailleurs été noués entre les associations qui travaillent avec les victimes et celles qui travaillent avec les auteurs dans un certain nombre de villes (230).
Un exemple : les ressources de SOS-Violences familiales (Paris)
M. Alain Legrand, président de la FNACAV, a détaillé les ressources de l’association SOS-Violences familiales (Paris) dont il est membre. Cette association qui est la seule à intervenir à Paris, avec le centre de médecine légale (consultation du docteur Roland Coutanceau) assure le suivi d’environ 150 personnes par an.
Cette association reçoit 20 000 euros de subventions par an dont 7 000 proviennent du SDFE et 10 000 de la ville de Paris ; quelques milliers d’euros s’y ajoutent au cas par cas, obligeant le responsable de l’association à multiplier les demandes. Les charges fixes (local,…) de l’association sont en effet d’environ 20 000 euros. Le responsable de l’association ne peut par conséquent percevoir de rémunération pour cette partie de son activité.
À ces subventions, s’ajoutent environ 20 000 euros qui rémunèrent le suivi des auteurs envoyés par les SPIP. Néanmoins, cette collaboration ne faisant pas l’objet d’une contractualisation, les ressources qui en proviennent ne sont ni régulières, ni pérennes.
De ce fait, les consultations des psychologues ne peuvent plus être compensées par l’association. Celles-ci sont facturées 25 € aux patients, somme que touchent également les psychologues. Auparavant, l’association parvenait à ajouter une rémunération supplémentaire à ce forfait à hauteur de 45 € par consultation mais ce n’est plus le cas actuellement.
Le manque de ressource ne permet pas non plus à l’association de pratiquer des tarifs moins élevés pour les personnes qui n’auraient pas les moyens de payer le tarif pratiqué par consultation. De ce fait, ainsi que l’explique M. Alain Legrand, il existe un biais financier dans la population suivie par l’association.
Enfin, alors que le projet de développer des antennes dans chaque département francilien n’est plus d’actualité, c’est finalement la survie même de l’association qui est en jeu à échéance d’un an.
Cette situation précaire constitue la norme pour les structures d’accueil des auteurs de violences (231).
Les associations ont, en effet de grandes difficultés à voir leur budget pérennisé d’année en année. Mme Catherine Vasselier, de l’association La Durance, a décrit ces situations au cours de son audition : « Je suis un peu gênée de vous dire qu’à Marseille, nous en avons eu assez de réclamer des financements, de nous inquiéter, tous les ans, de leur éventuelle reconduction et de nous demander si nous allions devoir arrêter les groupes. Cela s’est produit dans certains départements et je trouve cela révoltant. En 2002, nous avons donc fait le choix de ne plus rien demander à personne ; ainsi, ce sont d’autres actions – les actions de formation – qui financent les groupes sur les violences conjugales, quelle que soit d’ailleurs la situation socio-économique de leurs auteurs. Ils ne paient que 10 euros la séance d’une heure et demie, car nous ne voulions pas que l’argent soit un frein pour eux. (232) » Certains de ces crédits proviennent du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et sont affectés sur une base annuelle. C’est le cas notamment dans les Côtes-d’Armor où la mission s’est rendue.
Proposition n° 15 :
Pérenniser les financements des structures de suivi des auteurs, au moyen de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
3. Des moyens doivent être spécifiquement consacrés au suivi des auteurs de violences
Si le plan de lutte contre les violences faites aux femmes (2008-2010) envisage de développer les dispositifs d’accompagnement (action 5-4), aucun budget n’y est mentionné et les associations n’ont pas fait état d’une amélioration récente de leur situation financière.
Pourtant plusieurs arguments laissent penser que les sommes consacrées au suivi des auteurs par des structures spécialisées ne seraient pas vaines (233) :
— À défaut de prise en charge par des professionnels, le suivi est inefficace, voire inexistant. Si elle n’est pas l’œuvre d’une structure spécialisée, l’auteur peut choisir d’être suivi par son médecin généraliste (qui n’est souvent pas compétent pour ce faire), par un psychologue (qui n’est pas forcément formé spécifiquement à cette problématique) ou par un psychiatre (alors que peu de patients relèvent spécifiquement d’un traitement de type psychiatrique). Il est donc essentiel que le suivi soit l’œuvre de professionnels formés à cet effet ;
— L’efficacité de ces actions est potentiellement très importante, notamment par rapport aux actions de prévention, qui nécessitent de cibler un public très large. Il serait peu raisonnable de mener des actions de prévention de très grande ampleur sans prêter, en même temps, une attention particulière aux hommes qui ont déjà été violents au sein de leur couple. Le taux de violences au sein du couple pourrait baisser bien plus fortement pour chaque euro dépensé dans le suivi des auteurs ;
— Le coût pour la collectivité des violences faites aux femmes a été évalué à environ un milliard d’euros chaque année (234). Or, environ 8 % des faits de violence conjugale étaient l’œuvre de récidivistes en 2007 selon le ministère de la Justice (235). Les quelques chiffres disponibles à l’échelon local font état de taux de récidives moindres là où des politiques volontaristes, incluant le suivi des auteurs, sont menées (6 % à Douai ; 2,5 % dans le Tarn). Si le taux de récidive baissait de 8 à 6 % à l’échelon national, environ 300 des 16 000 condamnations annuelles pourraient être évitées, ce qui équivaut à une économie de 20 millions d’euros, sur la base du calcul précédemment évoqué.
Il va de soi, comme cela a déjà été dit, que les moyens qui seraient dégagés pour le suivi des auteurs ne doivent pas venir en déduction des sommes allouées à la prise en charge des victimes. La priorité est incontestablement d’aider les femmes victimes de violences, mais cela implique aussi de mener des actions de prévention ciblées sur les hommes qui en ont le plus besoin.
Proposition n° 16 :
— Identifier les moyens consacrés au suivi des auteurs de violences conjugales ;
— Renforcer ces moyens, pour permettre la création de structures de suivi des auteurs dans chaque département ;
— Accorder des moyens spécifiques à la FNACAV afin de lui permettre d’assurer son rôle de coordination, de représentation et d’évaluation.
Chapitre III : la mobilisation de tous les acteurs pour une prévention plus systématique des violences faites aux femmes
La prévention des violences passe par le repérage des femmes victimes le plus précocement possible, par les professionnels de santé notamment et dans tous les lieux où ces violences peuvent s’exercer, y compris dans l’entreprise.
Mais la prévention nécessite une action encore plus en amont qui mobilise l’Éducation nationale et les médias afin de faire évoluer des comportements et des représentations stéréotypés qui peuvent se révéler sources de violence.
I. PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS ET LES VIOLENCES SEXISTES DÈS L’ÉCOLE
Le premier plan global de lutte contre violences (2005-2007) avait fixé un objectif de prévention en milieu scolaire centré sur l’apprentissage du respect de l’autre et l’éducation à la mixité comme valeur républicaine. Cet objectif, qui incombe à l’Éducation nationale, a été repris par le plan 2008-2010.
Si l’école s’est emparée du sujet, la mobilisation est loin d’être systématique, les initiatives prises ne sont pas généralisées et leur mise en œuvre peine à s’organiser de façon véritablement coordonnée.
A. DES COMPORTEMENTS PRÉSENTS CHEZ LES JEUNES
1. Des violences à l’égard des filles à recenser nationalement
Le recueil des faits de violence survenus dans les établissements scolaires s’opère depuis la rentrée 2007 selon le dispositif dit SIVIS - système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire, qui a remplacé le dispositif SIGNA, opérationnel de 2001 à 2006. Ce dernier, en effet, a été interrompu après que la presse a publié, à partir de données tirées de ce dispositif, un « palmarès » des établissements les plus « dangereux ».
SIVIS recense désormais, auprès d’un échantillon d’un millier d’établissements publics du second degré, parmi les faits de toute nature, les violences les plus graves, c'est-à-dire celles qui ont donné lieu, soit à des soins pour la victime, soit à un dépôt de plainte.
Il en ressort, selon les propos de Mme Nadine Neulat, de la direction générale de l’enseignement scolaire au ministère de l’Éducation nationale, lors de son audition par la mission, que « les faits de violence sont concentrés sur un nombre relativement restreint d’établissements, principalement sur les collèges et les lycées professionnels. […] On voit bien que le passage de l’enfance à l’adolescence est un maillon difficile. Une attention particulière doit être apportée à cette période. Le lycée professionnel, quant à lui, pose une autre problématique. Mais je ne me hasarderai pas à faire des comparaisons. Nous aurons plus de recul dans deux ou trois ans. » (236).
Au-delà de ce constat très général, les données recueillies nationalement ne permettent pas, dans la situation actuelle, d’avoir une vision précise des violences subies par les filles dans les établissements scolaires, ni de leur évolution.
D’une part, les données ne datent que d’une année, elles ne permettent donc pas encore d’effectuer des comparaisons dans le temps. D’autre part, si SIVIS recueille bien des données sexuées, celles-ci ne sont pas pour l’instant exploitées. « Les données recueillies par SIVIS sont sexuées, à la fois pour les auteurs et pour les victimes. Comme ces données n’ont pas encore été exploitées, j’ai demandé, en vue de cette audition, à la direction de l’évaluation et de la prospective – DEP – d’en faire une exploitation sexuée. » a indiqué Mme Nadine Neulat (237).
Cette analyse sexuée n’étant pas disponible, les dernières données connues émanent donc de l’ancienne enquête SIGNA. Celle-ci a fait apparaître que les filles représentaient 30 % des élèves qui sont victimes d’incidents. Elles sont moins exposées que les garçons aux violences physiques avec ou sans armes, mais presque autant aux insultes et aux vols. Les filles sont auteurs d’un acte sur six commis par les élèves, mais sont rarement auteurs d’atteintes physiques à autrui, de dégradations ou de port d’arme. Les faits les plus violents ne leur sont pas imputables (238).
Il faut rappeler que l’objectif n° 4 du plan 2008-2010, action 4.b, comprend « le développement du recensement des violences subies par les filles dans les établissements scolaires ». Or, en l’absence d’une exploitation des données nationales, les seules statistiques sexuées qui pour l’instant ont été effectuées sont celles qui portent sur l’académie de Strasbourg. Cette initiative a été présentée lors des journées académiques tenues sous l’égide de Mme Marie-Jeanne Philippe, présidente du comité de pilotage de la convention interministérielle de 2006, afin d’alerter et de mobiliser les responsables sur cette question.
Proposition n° 17 :
Engager une analyse des violences sexistes et sexuelles entre les jeunes par la production de statistiques sexuées sur les violences recensées dans les établissements scolaires
2. Les violences sexistes entre les jeunes reposent sur des stéréotypes bien ancrés
L’exacerbation des tensions entre les filles et les garçons traduit la persistance de forts stéréotypes sur ce que devraient être un homme et une femme et sur la façon dont il ou elle devrait se comporter.
Il s’agit d’une réalité qui n’est pas facile à cerner car, au-delà du manque de statistiques sexuées déjà évoqué, les violences sexistes, voire sexuelles ne sont pas forcément révélées, par honte, par crainte ou encore parce qu’elles ne sont pas perçues comme telles. « Il y a un déni de la parole des filles sur les violences et un aveuglement face à des violences qui ne sont pas vues comme telles. Mais de toute façon, il existe très peu de travaux sur cette question, ce qui montre en soi le désintérêt et l’invisibilité du phénomène. De manière générale, le sexisme est quand même assez peu pris en compte dans le domaine éducatif et assez peu remis en cause. » (239), selon Sylvia Di-Luzio, sociologue.
a. L’exacerbation des tensions qui peut déboucher sur la violence...
Le constat d’un durcissement des relations entre les filles et les garçons est un sujet d’inquiétude largement partagé. Sans vouloir dresser ici un bilan des violences à l’école, la mission souhaite souligner combien les situations de violences verbales ou physiques à l’égard des jeunes filles s’inscrivent dans des processus qu’il appartient justement à l’école de révéler et de combattre et qui auront des répercussions sur les comportements des uns et des autres une fois devenus adultes.
Les violences entre les garçons sont les plus fréquentes et les plus visibles. Pour autant, celles ayant des filles pour victimes existent bel et bien et semblent être là pour rappeler aux filles leur place dans la hiérarchie de sexes. (240)
Les pires insultes sont toujours liées à une représentation en rapport avec la sexualité (241) et les jeunes filles sont victimes des réputations qui circulent à l’école et à l’extérieur, et qui leur attribuent des rôles leur ôtant toute liberté dans leur comportement.
Relatant son expérience dans les collèges où l’association Paroles de femmes intervient, Mme Olivia Cattan témoigne de ce type de comportements : « Dans une classe de vingt élèves, il y a peut-être une fille en jupe, et encore. Les filles se comportent comme des garçons, parce qu’elles n’ont pas le choix. Les garçons ont envers elles des gestes très violents et indécents. Elles subissent continuellement une sorte de harcèlement psychologique et moral. C’est tout le temps la bagarre entre garçons et filles. » (242)
Ceci peut déboucher sur des faits de violences graves qui ne doivent pas être sous-estimés quand il s’agit de violences sexuelles commises par des mineurs contre d’autres mineurs.
Sur les 14 969 personnes mises en cause pour des violences sexuelles en 2008 – en quasi-totalité des hommes –, 3765 (soit le quart) sont des mineurs (243). Et quand ces violences sexuelles sont commises à l’encontre de mineurs (sans qu’il soit identifié s’il s’agit de garçons ou de filles), plus du tiers des mis en cause sont alors des garçons de moins de dix-huit ans.
b. ...s’appuie sur des stéréotypes bien ancrés
La persistance des stéréotypes « de sexe » dans les représentations que les adolescents ont des relations entre les filles et les garçons servent, trop souvent, de schémas aux rôles assignés que chacun devrait avoir. Ces stéréotypes reposent sur un sentiment de domination perçu comme légitime, aussi bien par les garçons que par les filles, qui tendent à reproduire les rôles tels qu’ils sont répartis au sein de leur famille, entre hommes et femmes, voire entre frères et sœurs.
Cette incorporation, par les filles, de la domination masculine, à travers notamment des stéréotypes, si elle est particulièrement forte dans les territoires prioritaires, comme l’a souligné la représentante de l’association pour l’Accès au Droit des Enfants et des Jeunes (ADEJ) rencontrée par la mission à Marseille, est une réalité largement partagée.
Cette réalité a été soulignée par Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français pour le planning familial (MFPF), à propos des interventions du Planning dans les établissements scolaires : « Nous intervenons aussi en milieu scolaire. À cette occasion ressortent tous les stéréotypes sur la puissance sexuelle : la fille qui dit non mais qui pense oui, le garçon qui a des besoins irrépressibles, les filles qui sont plus dans l’affection et dans l’amour, etc. » et par M. Bernard Bétremieux qui fixe comme objectif aux interventions de l’association « Je, tu, il » auprès des collégiens de : « les amener à « détricoter » les stéréotypes qui les gouvernent et à considérer l’autre comme un sujet et non comme un objet soumis à leurs propres pulsions. C’est ainsi qu’une jeune fille écrit : « Cela ouvre les yeux de certaines personnes de la classe sur la situation des filles et le fait qu’elles ne sont pas un objet qui sourit et qui a la peau douce, qu’elles ne sont pas qu’une enveloppe corporelle » (244)
Tout ne pouvant relever des enseignants eux-mêmes, il est important pour les établissements de développer des partenariats sur lesquels ils pourront s’appuyer pour susciter des actions à même de provoquer une prise de conscience sur ces sujets et d’informer les filles sur leurs droits.
B. L’ENGAGEMENT DE L’ÉCOLE DANS LA PRÉVENTION DES VIOLENCES
Le plan global triennal de lutte contre les violences (2008-2010) a arrêté comme objectif que, dans chaque établissement scolaire, soit préparé un plan de prévention de la violence comportant un volet spécifique de prévention des violences envers les jeunes filles. Il se réfère également à la mise en œuvre de la convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, du 29 juin 2006 qui entend prévenir et combattre les violences sexistes.
Cette convention qui mobilise huit départements ministériels comporte parmi ses priorités : la prévention et la lutte contre les violences sexistes, notamment par la promotion du respect mutuel entre les sexes ; l’information sur les violences spécifiques subies par les filles issues de l’immigration tels que les mariages forcés et les mutilations sexuelles ; le recensement des violences subies par les filles dans l’ensemble des établissements.
L’école a effectivement un rôle primordial à jouer dans la prévention des violences entre les jeunes, dans la lutte contre des comportements sexistes et l’éducation au respect pour éviter que ne s’ancrent à l’âge adulte des comportements de domination qui sont générateurs de violences envers les femmes.
Plus immédiatement, l’école occupe aussi une position privilégiée pour le repérage des enfants victimes de violences, victimes directes mais aussi indirectes au travers des violences dont ils sont témoins.
1. Le repérage des enfants exposés à des violences au sein du couple
Le repérage des enfants en situation de danger relève de la mission de l’ensemble des personnels scolaires et particulièrement des enseignants et des conseillers principaux d’éducation, qui sont en contact quotidien avec les enfants, mais aussi des infirmières scolaires.
Il peut déboucher, le cas échéant, sur un signalement au procureur ou auprès du président du Conseil général.
La circulaire de rentrée pour 2009 rappelle, dans le cadre de la prévention des violences, que les personnels doivent être à même de repérer les signaux qui peuvent laisser penser qu’un enfant est en danger dans sa famille et connaître la conduite à tenir.
Pour aider les personnels enseignants et les personnels sociaux et de santé, il a été indiqué à la mission que les services de l’Éducation nationale projetaient d’élaborer des « grilles de repérage », énumérant les signes qui indiquent qu’un enfant est en souffrance et que sa situation doit être signalée afin que les enseignants sachent ce qu’ils ont à faire quand ils repèrent un enfant qui va mal (245).
Les violences intrafamiliales devraient faire l’objet d’une attention particulière comme l’a précisé Mme Nadine Neulat : « Nous avons travaillé, à la demande du cabinet, sur un certain nombre de mesures à préconiser en cas de violences intrafamiliales, ces dernières ayant des conséquences désastreuses sur les enfants. Elles ont pour but de mieux former les enseignants et les personnels sociaux et de santé au repérage des enfants en souffrance et à leur meilleure prise en charge. Elles tendent également à préciser le rôle des personnels de l’Éducation nationale dans les procédures, prévues par la loi, de signalement des enfants en danger afin de parvenir à une meilleure efficacité. » (246)
2. L’éducation dans un but de prévention des violences, notamment des violences sexistes
a. Des actions à articuler en s’appuyant sur l’éducation sexuelle à l’école…
Une véritable mission d’éducation à la sexualité a été confiée à l’Éducation nationale par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, qui l’a rendue obligatoire aux trois niveaux de scolarité : l’école, le collège et le lycée. Trois séances annuelles d’information doivent y être organisées par groupes d’âge homogènes.
Les objectifs éducatifs poursuivis par les séances d’éducation à la sexualité sont, en principe, plus larges que la seule délivrance d’informations objective et scientifique permettant de connaître et de comprendre la sexualité. Aux termes de la circulaire du 17 février 2003, ces séances doivent, en effet, permettre notamment :
— d’analyser les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits et comprendre l'importance du respect mutuel ;
— de se situer dans la différence des sexes et des générations ;
— de développer l'exercice de l'esprit critique notamment par l'analyse des modèles et des rôles sociaux véhiculés par les médias, en matière de sexualité ;
— de favoriser des attitudes de responsabilité individuelle et collective notamment des comportements de prévention et de protection de soi et de l'autre.
Or ces séances ne font pas l’objet d’une organisation systématique et ne portent pas forcément sur toutes les dimensions évoquées.
En effet, le bilan qui a été tiré de la pratique de ces séances de prévention à l’appui du Plan santé jeune, avait considéré que ces séances ciblées (sur la contraception ou d’autres sujets de santé), de contenu et de qualité inégaux rencontraient de surcroît « des difficultés de mise en œuvre ».
Les associations intervenant dans les établissements scolaires entendues par la mission, en audition ou bien au cours de ses déplacements, ont toutes souligné que leurs interventions en milieu scolaire manifestent l’engagement d’un établissement sur ces questions et dépendent toujours de la « bonne volonté » d’un directeur d’établissement ou d’un professeur. La mise en œuvre de ce type d’actions relève, en effet, de la responsabilité des établissements.
Pourtant la nécessité de traiter ces thématiques est un besoin fortement ressenti pour passer d’une information généraliste sur les moyens de contraception, à des interventions ciblées sur le respect, le machisme, les relations filles-garçons et la violence. Comme le précise Mme Françoise Laurant : « Lors de nos interventions, nous ne leur expliquons pas ce qu’est la sexualité ni la contraception ni l’avortement. Nous les faisons parler des relations entre filles et garçons. […] L’association AIDES peut venir parler du sida, la représente du Droit des Femmes de l’égalité entre hommes et femmes, l’association Solidarité Femmes des victimes de violences conjugales. Mais les jeunes ont besoin, entre eux, de confronter des idées et de se rendre compte qu’il est normal de se poser des questions. » (247)
La mission considère que ces interventions devraient donner lieu à des actions coordonnées et systématiques, avec des outils mutualisés. Tout ne pouvant relever des enseignants eux-mêmes, il est important pour les établissements de développer dans ce but des partenariats sur lesquels ils pourront s’appuyer, avec des structures et des associations dotées de moyens suffisants pour y procéder.
b. …pour déboucher sur un véritable programme d’éducation au respect de l’autre et à l’égalité fille-garçon à inscrire dans le projet d’établissement
Il est temps de parvenir, par une action volontariste organisée et systématique, à dépasser cette situation, à lutter contre les violences se déroulant dans les établissements mais aussi à prévenir les comportements générateurs, à sensibiliser au respect et au caractère inacceptable des violences entre filles et garçons, et plus tard, au sein du couple.
Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) a la charge du pilotage de la politique de prévention de l’établissement sur la base d’un projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence. Il appartient également au CESC d’organiser, le cas échéant, le partenariat pour la mise en œuvre de la politique de prévention des violences.
Mais, comme l’a regretté Mme Anne Rebeyrol, chargée de mission parité hommes/femmes au ministère de l’Éducation nationale, il n’existe pas de CESC dans tous les établissements scolaires (248).
Quoi qu’il en soit, l’implication des établissements sur cette question devrait se manifester au travers de leur projet d’établissement, dans lequel doit figurer l’engagement de toute la communauté éducative en direction de la prévention des violences sexistes et plus largement de l’éducation au respect et à l’égalité entre les filles et les garçons.
Il est également important qu’avec les inspections académiques, les départements et les structures et associations présentes sur le territoire, les délégués aux droits des femmes participent à cette démarche à travers de leur association aux CESC.
En outre, ces actions devraient s’inscrire dans des programmes validés par les académies pour toucher les différentes classes d’âge.
Les séances en milieu scolaire sont centrées, en priorité, sur les classes de quatrième et de troisième, période pendant laquelle les adolescents sont confrontés à la construction de leur identité.
La mission considère que, au moyen d’outils et de méthodes adaptés, ces interventions doivent intervenir le plus en amont possible, c'est-à-dire dès les classes du primaire.
Les associations qui interviennent dans les classes l’ont souligné : « Il faut mener un vrai travail de prévention dans les écoles, dès le CM2, sans attendre le collège. Nous intervenons dans des classes de cinquième, quatrième et troisième, mais c’est déjà très tard. Les élèves sont déjà entrés dans un système de clichés et de relations à l’autre extrêmement violentes, et où l’insulte sexiste ou raciste est totalement banalisée. […] On peut déjà initier les petits à l’égalité hommes-femmes et à l’acceptation de l’autre. » (249).
Un document de cadrage et d’accompagnement adapté à la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité à l’école primaire, en fonction des nouveaux programmes est en cours d’élaboration. Il devrait servir de support pour aborder les questions de mixité, de respect mutuel et de l’acceptation des différences (250).
Ces outils doivent être développés pour permettre dès maintenant ce type d’intervention et des partenariats doivent être conclus.
3. La formation des personnels de l’Éducation nationale dans le contexte de la mastérisation
Bien que le principe d’égalité soit un des principes fondateurs du système éducatif, l’égalité entre les filles et les garçons est encore un objectif à atteindre.
Il doit faire partie intégrante des programmes au travers des enseignements d’histoire ou d’instruction civique, mais doit également « irriguer », de façon transversale, l’ensemble des enseignements. En effet, sans en avoir souvent conscience, les enseignants, en fonction des représentations différenciées qu’ils peuvent avoir des rôles de chacun dans la société et de la place des hommes et des femmes, se conforment à des stéréotypes, s’ils n’y sont pas sensibilisés.
Le recensement des actions de formation des enseignants à l’égalité entre les filles et les garçons conduites dans les IUFM, effectué par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale dans le cadre de ses travaux sur l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif (251) avait fait apparaître une situation variable selon les instituts de formation. Si la plupart des IUFM avait mis en place des formations, celles-ci n’étaient cependant ni systématiques, ni généralisées. Elles reposaient plutôt sur des initiatives « parcellisées, pas toujours continues d’une année sur l’autre et dépendant beaucoup de l’engagement des acteurs sur ce sujet. » (252).
Ce bilan, qui n’était déjà pas satisfaisant, se pose désormais dans un contexte nouveau qui est celui de la réforme de la formation des enseignants. La « mastérisation » de la formation et le principe de l’autonomie pédagogique des universités modifient le cadre dans lequel cet impératif devra être pris en compte.
M. Alain Kurkdjian, adjoint à la directrice du Service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE), a indiqué à la mission qu’il avait demandé que l’on recense les enseignements dispensés dans les universités, afin de travailler en partenariat avec celles-ci et de les convaincre d’intégrer la dimension du genre dans leurs enseignements : « La tâche est certes difficile, mais notre action doit être volontariste si nous voulons des résultats, sans démissionner d’emblée à l’idée que nos interlocuteurs seront difficiles à convaincre. » (253)
Les réunions interacadémiques qui se tiennent pour la mise en œuvre de la convention interministérielle devraient permettre de mobiliser les responsables sur cette nécessité, pour déboucher sur la mise en place de formations à l’égalité entre les filles et les garçons dans le cadre des masters disciplinaires ou de masters dédiés, au moyen de modules spécifiques ou de façon transversale aux enseignements, en fonction du type d’organisation arrêté par chaque université.
Proposition n° 18 :
— Inscrire dans le projet d’établissement les actions à mener pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons et l’éducation au respect ;
— Systématiser ces actions en les inscrivant dans des programmes validés par les académies et permettant de toucher les différentes classes d’âge ;
— Inscrire dans la formation des professeurs l’égalité entre les filles et les garçons comme une compétence devant être évaluée et validée.
II. RENFORCER LA MOBILISATION ET LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Les médecins, généralistes, gynécologues et urgentistes sont souvent les premiers au contact des femmes victimes de violence, qu’ils doivent soigner, mais aussi écouter et orienter. Avec l’ensemble des professionnels de santé, notamment les sages-femmes et les infirmières, leur sensibilisation et leur formation sont donc très importantes tant pour le repérage des violences, que pour l’accueil des victimes et l’établissement des preuves.
A. LE REPÉRAGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Les professionnels de santé assument un rôle essentiel dans le dépistage des violences. Or, deux points évoqués devant la mission sont révélateurs des limites qui peuvent exister.
Le premier concerne l’entretien du 4ème mois de grossesse. Sachant que la grossesse est une période à risque, cet examen systématique doit constituer un moment privilégié du repérage. Or, la circulaire qui en précise le déroulement, mentionne simplement la question des violences, sans les replacer particulièrement dans le contexte de la grossesse et sans qu’une méthodologie particulière ne soit donnée aux médecins.
Le second concerne les mutilations sexuelles qui paradoxalement, sont un sujet tabou chez beaucoup de professionnels de santé. « Certaines femmes nous ont dit avoir changé dix fois de gynécologue dans l’espoir d’en trouver un qui aborde le sujet. » a souligné Mme Armelle Andro, responsable de l’enquête « Excision et handicap »(254).
Si les médecins ne sont pas suffisamment sensibilisés à la spécificité de ces violences, en particulier, en l’absence de lésions visibles qui seraient évocatrices de violences au moment où la femme consulte (ce qui n’exclut ni des violences antérieures, ni des violences psychologiques), des victimes risquent de ne pas trouver auprès d’eux une réponse appropriée. Cette question du repérage a été soulevée de la même façon à l’hôpital, dans les services d’urgence, par le Docteur Pierre Espinoza : « S’agissant plus particulièrement des femmes victimes de violences conjugales, leur prise en charge suppose un certain savoir-faire de la part des médecins urgentistes, déjà confrontés à une très grande diversité de pathologies. Ce qui pose le problème de la formation.(…) Sait-on dépister ces violences dans les services d’urgence ? Je suis très réservé sur ce point. » (255)
Or, selon les informations fournies par le Conseil de l’Ordre il n’existe aucune formation au dépistage des violences conjugales dans le cursus de formation des médecins. Les textes relatifs au programme des études médicales ne prévoient pas d’axe sur la sensibilisation des violences à l’égard des femmes et les UFR de médecine disposent d’une large autonomie dans la détermination des contenus pédagogiques des enseignements.
De même, comme l’ont constaté les inspections générales dans leur rapport d’évaluation du premier plan de lutte contre les violences, la thématique des violences faites aux femmes a été retirée du programme de formation médicale continue : « Ce choix a eu un impact négatif, d’autant plus que des séminaires de formation étaient en cours d’élaboration en lien avec les unions régionales des médecins libéraux. » (256)
Les médecins doivent pourtant être sensibilisés aux facteurs de risque, sans perdre de vue que les violences conjugales se rencontrent dans tous les milieux et que les femmes victimes de violences ont souvent tendance à minimiser ce qu’elles subissent. Ils doivent également être suffisamment informés des possibilités de prise en charge et savoir à qui s’adresser pour orienter au mieux la victime.
Un guide a été édité à leur intention : « Lutter contre la violence au sein du couple : Le rôle des professionnels » déclinant le rôle du médecin sous forme de fiches pratiques (257).
Il n’existe pas de bilan national des destinataires des brochures, mais les inspections ont constaté « qu’une partie non négligeable des professionnels rencontrés ignorait l’existence de ces documents » (258). Effectivement, la mission a pu constater un certain manque de mobilisation des médecins sur cette question. La Déléguée aux droits des femmes des Côtes-d’Armor qui avait mis en place une rencontre avec un correspondant du conseil de l’Ordre sur ce thème n’a a eu aucun retour des médecins qui avaient pourtant tous été sollicités par courrier.
Proposition n° 19 :
Développer l’information des professionnels de santé au travers d’outils comme le bulletin du Conseil de l’Ordre pour sensibiliser et impliquer les médecins.
B. L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES A L’HÔPITAL
Une femme victime de violences, adressée à un service d’urgences médico-judiciaires (UMJ), sur réquisition des services de police ou de gendarmerie, y trouvera une prise en charge adaptée. Les professionnels y sont formés à accueillir les femmes et à les prendre en charge, ainsi qu’à établir les certificats médicaux ou d’incapacité temporaire totale (ITT).
Toutefois, les médecins des UMJ n’interviennent que sur réquisition, ce qui peut conduire des femmes à devoir retourner au commissariat ou à la gendarmerie, avant de revenir dans le service pour les constatations légales. L’intérêt de disposer dans ces services d’une antenne qui permettrait d’éviter des allers-retours, à l’image de ce qui existe dans certains pays étrangers, a été souligné.
En tout état de cause, l’existence de permanences d’association permet, au moins une prise en charge globale. C’est ainsi que dans le cadre du schéma départemental d’aide aux victimes, quatre associations assurent une permanence au sein des UMJ du centre inter-hospitalier de Créteil, ce qui permet, une fois l’examen effectué par le médecin, d’orienter les personnes vers ces associations afin qu’elles leur fournissent les informations dont elles ont besoin.
Si cette organisation reposant sur les UMJ est particulièrement efficiente, elle n’est pas présente partout : il existe sur le territoire une soixantaine d’UMJ. Par ailleurs, ces structures rencontrent des problèmes de financement liés à la répartition de celui-ci entre le ministère de la Justice d’une part et l’assurance maladie d’autre part. Une attention particulière devra donc être portée au rôle que jouent les UMJ dans le cadre de la réflexion en cours sur la réforme de la médecine légale.
Enfin, lorsque les victimes s’adressent à un service d’urgence, le Docteur Pierre Espinoza a souligné devant la mission, le progrès que constituerait la présence d’un référent (un médecin, une infirmière ou une assistante sociale) dans l’hôpital qui pourra leur consacrer le temps nécessaire, ce qu’un médecin urgentiste n’aura le plus souvent pas le temps de faire.
Plus largement, un protocole d’accueil et de prise en charge des victimes de violences devrait être mis en place dans les services d’urgence.
C. LA CONSTATATION DES VIOLENCES
Le certificat médical est un acte authentique par lequel un médecin atteste, par écrit, l’existence de lésions traumatiques ou de symptômes traduisant une souffrance psychologique.
L’absence de certificat médical n’interdit pas les poursuites contre l’auteur des violences, mais elle les rend plus difficiles car manque alors un élément permettant de caractériser objectivement l’infraction. Dans l’enquête menée sur les tribunaux de Castres et d’Albi, il apparaît que dans deux cas sur trois l’absence de certificat a conduit le Parquet à prononcer un classement sans suite (259). Le certificat médical constitue donc un moyen de preuve et une pièce essentielle de la procédure car, en plus de l’éventuelle reconnaissance des faits par le mis en cause et le casier judiciaire de ce dernier, il constitue avec l’évaluation de l’ITT qu’il comporte, un des trois éléments sur lequel le Parquet s’appuie pour orienter la procédure.
En effet, l’évaluation de l’ITT (260) a une incidence directe sur la qualification des faits et sur la peine encourue (même si tous les faits de violence ne donnent pas lieu à une ITT). Les violences ayant entraîné une ITT de moins de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art 222-13 6° du code pénal) et celles ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. 222-12 6° du code pénal).
Or la disparité dans la rédaction des certificats médicaux est un point qui est soulevé de façon récurrente et qui a conduit, en 2005, à recommander dans le plan Violences et santé « d’obtenir un consensus pour définir les bonnes pratiques, notamment […] en matière de détermination de la durée de l’ITT » avant que la mission interministérielle préparatoire à une réforme de la médecine légale menée par l’IGAS et l’IGSJ en janvier 2006, ne souligne « la nécessité d’une harmonisation des pratiques concernant les examens des victimes ».
Ces disparités ne sont pas toujours constatées. L’enquête sur les parquets d’Albi et de Castres montre qu’il ne paraît pas y avoir de surestimation ni de sous-estimation des ITT par les médecins, par rapport aux descriptifs des blessures par les victimes, sachant que dans les cas litigieux le Parquet fait procéder à un examen par le service de médecine légale. Par contre, l’absence d’UMJ dans le département des Côtes-d’Armor, aboutit à une grande inégalité dans la rédaction des certificats médicaux émanant de divers médecins généralistes.
En outre, selon le Conseil de l’Ordre des médecins (CNOM), il persiste dans la pratique de certains médecins une forme de confusion entre le certificat médical proprement dit et le signalement qui doit être effectué en application de l’article 226-4 du code pénal.
Pour améliorer cet état de fait, un modèle de certificat de constatation des violences avait été élaboré par le CNOM avec le concours du Professeur Henrion. Celui-ci a vu sa diffusion retardée dans l’attente des conclusions des travaux de la Haute Autorité de Santé qui a été saisie en 2007, afin de formuler des recommandations pour la rédaction des certificats médicaux constatant des faits de violence et la détermination de l’ITT.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre a participé à la diffusion des fiches pratiques réalisées par le Centre d’information aux droits des femmes (CIDF) et s’est associé à un courrier adressé aux médecins.
La mission considère indispensable de démultiplier ces informations relatives à la rédaction des certificats médicaux que les médecins généralistes appréhendent souvent, en la diffusant largement auprès des praticiens. Le Conseil de l’Ordre devrait être mobilisé pour qu’il sensibilise et informe sur cette question au travers de son bulletin.
Proposition n° 20 :
— Former les médecins et les autres professionnels de santé au repérage et à l’accueil des femmes victimes de violences et développer la diffusion des guides d’aide à la prise en charge des victimes et à la rédaction des certificats médicaux ;
— Sécuriser le financement des unités médico-judiciaires ;
— Mettre en place des référents « violence » dans les services d’urgence et définir des protocoles de prise en charge des victimes. Prévoir, avec les Agences régionales de santé, le maillage entre médecins légistes et services d’urgence.
III. RENDRE PLUS SYSTÉMATIQUE LE REPÉRAGE DES VIOLENCES AU TRAVAIL
Si la question des violences faites aux femmes sur leur lieu de travail est peu à peu reconnue, le repérage et la prévention de ces actes apparaissent encore perfectibles : bien que plusieurs acteurs constituent, en principe, autant de recours pour les victimes de ces violences, leur mobilisation est très insuffisante.
A. DES ACTEURS NOMBREUX MAIS INSUFFISAMMENT MOBILISÉS
1. Le rôle prépondérant de l’employeur
Il faut d’abord rappeler que l’employeur a une obligation de protection et de sécurité vis-à-vis des salariés, qui inclut une obligation de prévention. Plus spécifiquement, en matière de harcèlement sexuel, le code du travail prévoit une double responsabilité civile et pénale de l’employeur si celui-ci s’abstient de prévenir le harcèlement sexuel ou si, informé des faits, il ne prend aucune mesure pour les faire cesser, voire s’il sanctionne la victime (261).
L’employeur doit aussi inclure dans le règlement intérieur de l’entreprise le contenu des dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel (262) et toute entreprise doit produire chaque année une mise à jour d’un « document unique d’évaluation », qui répertorie la totalité des risques qui existent dans l’entreprise. Les risques psychosociaux ainsi que les risques en matière de violences et de harcèlement doivent être intégrés à cette évaluation (263).
La jurisprudence veille à l’application de ces principes, comme le montre la décision de la Cour de cassation qui a jugé qu’une salariée peut prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci lui impose des conditions de travail contraires à sa dignité et à sa santé (264).
Les obligations de l’employeur sont donc importantes et font l’objet d’un encadrement juridique indéniable.
L’ENVEFF a montré que lorsque les violences au travail sont déclarées, les victimes s’adressent prioritairement à leur hiérarchie (dans 51 % des cas), quel que soit le type d’agression subie même si les avances sexuelles déplaisantes, pourtant plus fréquentes, sont rarement signalées.
Pour inciter les employeurs à se saisir de cette question, l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes contient, dans son article 2, une disposition invitant les branches professionnelles et les entreprises à se mobiliser dans la lutte contre le harcèlement sexuel.
2. Les représentants du personnel et les syndicats interlocuteurs des salariés
Les représentants du personnel doivent aussi permettre d’identifier ou de prévenir les actes de violence au sein de l’entreprise, que ce soit les délégués du personnel ou les délégués syndicaux.
Les délégués du personnel peuvent être directement saisis dans le cas de commission d’un acte de violence, par une salariée victime, qui serait réticente à le signaler directement à son employeur. De façon plus générale, en matière de harcèlement sexuel, le code du travail donne la possibilité aux organisations syndicales, si elles sont représentatives dans l’entreprise, d’engager une action à la place de la salariée devant le conseil de prud’hommes et de se porter partie civile devant le juge pénal (265).
Certains observateurs le notent : « l’expérience démontre qu’il est utile de solliciter les représentants du personnel, véritable « mémoire de l’entreprise », afin d’obtenir des informations sur le passé éventuellement récidivant, vis-à-vis d’autres salariées, de l’agresseur. » (266)
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a d’ailleurs compétence pour proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel (267). Mais comme l’a souligné l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, cette disposition semble peu appliquée : « une formation systématique des membres du CHSCT sur le harcèlement sexuel et le rappel au chef d’établissement de la réglementation en vigueur contribueraient à la prévention des violences sexuelles au sein de l’entreprise » (268).
S’il s’avère que l’employeur n’intervient pas, une victime peut, directement ou par l’intermédiaire des délégués du personnel, alerter le CHSCT afin de le rappeler à ses obligations. Le CHSCT a aussi le pouvoir de saisir l’inspection du travail et le médecin inspecteur du travail.
Dans la fonction publique, le comité technique paritaire (CTP), le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière (CHSCT), comme organes de consultation et de concertation, ont un rôle à jouer dans la prévention des violences au travail. En outre, en cas d’actes de violences, le CHS ou le CHSCT peuvent être saisis des faits avant même certaines prises de décision par l’administration. « Bien souvent, ce sont des membres du CHS (ou du CHSCT) qui sont saisis par des agents s’estimant victimes de harcèlement (…) avant l’employeur lui-même ». De même, concernant l’intervention des syndicats dans la fonction publique, « un agent prétendu harcelé s’adresse bien souvent aux représentants syndicaux qui sont saisis des faits et qui accompagnent souvent l’agent dans sa démarche » (269) .
Le corps de l’inspection du travail a pour mission générale de veiller au respect de l’ordre public social, mission pour laquelle les inspecteurs du travail disposent de pouvoirs importants.
En matière de harcèlement sexuel leur intervention peut s’avérer déterminante : « la connaissance globale du fonctionnement de l’entreprise par [l’inspecteur du travail] est extrêmement utile surtout si ce même fonctionnaire avait déjà, dans les années passées, recueilli des déclarations de salariées victimes d’agissements de harcèlement sexuel et ayant quitté l’entreprise sans donner suite à ces agissements » (270).
Elle est cependant perfectible, comme l’a souligné devant la mission Mme Franceline Lepany, avocate au barreau de Paris : « (…) Actuellement, les inspecteurs du travail interrogent de façon anonyme les personnes qui se disent victimes de harcèlement moral et n’entendent que les salariés. Les employeurs font donc valoir devant la juridiction le caractère non contradictoire de l’enquête » (271).
Dans la fonction publique, la prévention des risques constitue l’une des missions premières des agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), véritables agents de veille et d’alerte, même s’ils ne sont pas des agents spécialistes de la prévention en matière de sécurité. En outre, les agents chargés des fonctions d’inspection des règles d’hygiène et de sécurité (ACFI) ont une action « essentielle dans la prévention du harcèlement puisqu’ils jouent un rôle de coordination dans l’élaboration de la politique de prévention et de la sécurité au travail. » (272).
4. La médecine du travail, acteur clef pour l’appréciation de l’impact des violences sur la santé des victimes
Les violences, physiques comme morales, ont le plus souvent des conséquences importantes sur l’état de santé de la victime, générant une souffrance au travail. C’est pourquoi il est important que la personne concernée puisse alerter le médecin du travail.
Celui-ci exerce en effet une fonction de surveillance de l’état de santé des salariés et de prévention s’agissant des conditions de travail. Sa proximité devrait en faire un interlocuteur privilégié du salarié : « informé de l’environnement, du milieu dans lequel évoluent les salarié(e)s, il bénéficie d’une situation privilégiée pour déceler les faits d’atteinte à la santé et à la sécurité et parmi eux les faits de harcèlement sexuel, notamment à l’occasion des visites médicales » (273).
Le code du travail prévoit un certain nombre de dispositions favorisant le recours au médecin du travail par le salarié et le médecin du travail peut interpeller l’employeur afin que celui-ci mette fin aux agissements de l’auteur des actes.
Quoi qu’il en soit, la sensibilisation des médecins du travail aux questions des violences faites aux femmes doit certainement être améliorée. Comme l’a exposé M. Jean-Michel Sterdyniak, responsable de l’enquête sur les violences faites aux femmes au travail en Seine-Saint-Denis, lors de son audition par la mission, « les résultats montrent, à notre grande tristesse, que moins de 1 % des victimes de harcèlements sexuels au travail ont déclaré en avoir parlé au médecin du travail. Cela signifie que ce dernier n’est pas vécu comme un interlocuteur sur ce sujet alors qu’il l’est pour le harcèlement moral. » (274).
Pourtant la mission des médecins du travail recouvre, à l’évidence, les violences faites aux femmes : « Le médecin du travail ayant pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait du travail, la souffrance au travail, qu’elle soit due à du harcèlement moral ou sexuel, entre dans le champ de ses investigations. Depuis l’enquête, j’ai eu davantage de sollicitations à ce propos. Quand le médecin du travail intervient sur cette question, cela permet souvent d’éviter l’aggravation des situations. Nous sommes habilités à en parler » (275).
Au total, les acteurs susceptibles d’être mobilisés pour la prévention et l’identification des violences faites aux femmes au travail sont donc nombreux, mais leur sensibilisation aux violences faites aux femmes doit être accrue.
B. L’INFORMATION DES SALARIÉES, COROLLAIRE DE LA MOBILISATION AU SEIN DU MILIEU PROFESSIONNEL
Parallèlement, il est essentiel d’informer les salariées sur les possibilités de saisine de ces instances. Il convient de saluer le fait que, dès la publication des lois du 22 juillet 1992 et du 2 novembre 1992 relatives au harcèlement sexuel, une brochure consacrée au « harcèlement sexuel dans les relations de travail » ait été publiée (janvier 1993), à l’initiative du ministère du travail et du secrétariat d’État chargé des droits des femmes, de manière à informer les salariées de leurs droits et des instances de recours vers lesquelles elles peuvent se tourner, le cas échéant.
L’action associative doit aussi être mentionnée, car elle contribue à la diffusion de cette information, comme l’a montré la publication du guide pratique précité de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), « Agir contre les violences sexuelles et sexistes dans les relations de travail », qui énumère les voies de recours – on peut seulement regretter que cette publication, qui date de janvier 2002, n’ait pas été actualisée depuis.
Autre exemple, le ministère du travail, sur son site internet, consacre une fiche au harcèlement sexuel, dans laquelle est mentionné le fait que « les salariés victimes ou témoins de harcèlement sexuel peuvent demander conseil à l’inspection du travail, au médecin du travail, aux représentants du personnel dans l’entreprise, à une organisation syndicale et à une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les mœurs ».
Au plan international, la Confédération syndicale internationale a publié en juin 2008 un « Guide syndical » intitulé « Combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail », mettant en évidence le fait que « le harcèlement sexuel constitue une question syndicale ».
Ces actions d’information sont importantes mais force est de constater qu’elles sont centrées sur la question du harcèlement sexuel. Il serait donc souhaitable de les voir étendues à l’ensemble des violences faites aux femmes au travail.
Afin de mieux dépister et prévenir les violences faites aux femmes au travail en mobilisant le monde professionnel, la mission engage le Conseil économique, social et environnemental à mener une étude d’ensemble sur les violences subies par les femmes au travail.
Proposition n° 21 :
— Prévoir une formation et une sensibilisation à la question des violences faites aux femmes au travail des différentes instances de l’entreprise, en particulier des membres des CHSCT, des médecins du travail et des inspecteurs du travail ;
— Obliger les employeurs à mettre en place des plans de préventions des violences au travail ;
— Mener des campagnes d’information pour informer les salariées sur les acteurs mobilisables au sein de leur milieu professionnel en cas de commission d’actes de violence ;
— Engager le Conseil économique, social et environnemental à mener une étude sur les violences subies par les femmes au travail.
IV. IMPLIQUER LES MÉDIAS DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les médias contribuent à la formation des représentations sociales et participent, d’une certaine manière, à la transmission des valeurs de la société par le biais des images et des messages dont ils se font les porteurs. Il ne faut donc pas négliger leur impact potentiel dans le cadre de la prévention des violences faites aux femmes.
A. DES STÉRÉOTYPES PERSISTANTS RENDANT NÉCESSAIRE UNE SENSIBILISATION DES MÉDIAS
1. Les médias continuent de véhiculer des représentations stéréotypées, voire dégradantes des femmes
Comme l’a constaté Mme Michèle Reiser, Présidente de la Commission de réflexion sur l’image de la femme dans les médias « malgré les efforts des professionnels de la publicité, de la presse et de l’audiovisuel, malgré l’adoption de règles déontologiques, certaines images, certains messages ou propos continuent de véhiculer des représentations souvent très stéréotypées, parfois mêmes dégradantes de l’image de la femme. » (276). Ce constat est partagé par Mme Martine Brousse, membre de la commission de classification des œuvres cinématographiques, qui souligne que : « en veillant à protéger les enfants, la commission fait également ressortir à quel point la femme peut être maltraitée dans les films. Au-delà de l’étude de ce que peut transmettre l’image, nous devons travailler à la manière de faire évoluer les mentalités pour montrer une autre image de la femme. Dans les films policiers très violents, de crimes et de mafia, il n’y a pas confusion entre violence et sexe. Pour la femme, si. La violence physique, la sexualité et la dégradation morale, c’est-à-dire les trois dimensions – physique, sexuelle et morale – de la femme, sont toujours liées. C’est un élément qui frappe souvent notre commission. » (277)
C’est pourquoi, la mission se félicite de la création d’une mission permanente d’observation et de suivi des stéréotypes féminins qui pérennise l’action engagée par la mission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias. Il est, en effet, indispensable que soit effectué un travail durable de déconstruction des stéréotypes de sexe dévalorisant l’image des femmes et potentiellement sources de violences à leur encontre.
2. Les médias doivent être parties prenantes de la prévention des violences faites aux femmes
a. Établir des liens étroits entre les acteurs des médias et ceux de la lutte contre les violences faites aux femmes
Les progrès accomplis dans la lutte contre les violences faites aux femmes démontrent la nécessité d’associer tous les acteurs à l’élaboration des actions de sensibilisation et de prévention. Les médias en étant un vecteur incontournable, il convient de favoriser un dialogue pérenne entre ceux-ci et les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes afin qu’une plus grande attention soit prêtée aux images et contenus susceptibles de porter atteinte à l’image des femmes, voire d’inciter à la violence à leur encontre.
Des dispositifs comme ceux créés par France Télévision (médiateurs de la rédaction et des programmes, clubs de téléspectateurs qui recueillent l’avis du public sur la qualité et le contenu des programmes diffusés sur ses antennes) ouvrent un dialogue spontané, mais dans lequel les violences faites aux femmes ne trouvent pas nécessairement leur place. Par ailleurs, cette prise de parole demeure tributaire des modalités arrêtées par chacune des chaînes de télévision, des antennes de radio ou de la presse écrite. De surcroît, comme cela a été souligné dans le rapport sur l’image de la femme dans les médias, il s’avère que le public connaît peu les dispositifs lui permettant d’exprimer un avis sur le contenu des programmes ou de signaler éventuellement un abus.
C’est pourquoi, la mission d’information estime qu’il importe en premier lieu d’inciter à la création de telles instances internes de régulation associant des représentants des associations de défense des droits des femmes ou d’aide aux victimes de violences faites aux femmes.
En deuxième lieu, la visibilité de ces dispositifs devrait être encouragée. Il convient de noter que cette obligation existe déjà pour les fournisseurs d’accès à Internet, ainsi qu’aux hébergeurs en vertu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
S’agissant de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), la mission reprend à son compte la proposition présentée le rapport sur l’image des femmes dans les médias qui préconise d’assurer la participation des associations de défense des droits de la femme au sein du Comité Paritaire de la Publicité où ne siègent actuellement que les associations de consommateurs et les associations environnementales.
Proposition n° 22 :
Inciter les médias à se doter d’instances internes de régulations, associant des représentants des associations de défense des droits des femmes ou d’aide aux victimes et associer celles-ci à certaines instances nationales de régulation des médias.
b. Inciter les médias à accorder une place à la lutte contre les violences faites aux femmes
L’obligation de garantir le respect de la dignité humaine figure parmi les obligations faites aux sociétés audiovisuelles obtenant une autorisation d’émettre sur le territoire national. En effet, ainsi que l’a expliqué Mme Michèle Reiser (278), le Conseil supérieur de l’Audiovisuel impose des stipulations en ce sens dans les clauses des cahiers des charges et des missions, ainsi que dans les conventions qu’il conclut avec les chaînes de radio et de télévision. Le Conseil s’assure de leur respect en convoquant annuellement les responsables des sociétés pour un examen de l’application des conventions signées.
Néanmoins, la persistance des contenus dévalorisant pour les femmes et potentiellement sources de violences incite la mission à recommander l’approfondissement des actions de sensibilisation au sein des médias.
Ceux-ci devraient mener un travail de réflexion sur leurs pratiques. Les auteurs du rapport sur l’image des femmes dans les médias remarquent ainsi la propension des médias à cantonner les femmes dans des rôles de victimes, de témoins silencieux ou de ménagères. Les femmes se voient accorder moins souvent la parole au cours d’un débat et sont rarement présentées dans un rôle d’experte ou comme source d’autorité.
La mission entend souligner l’importance primordiale de mener des actions de sensibilisation tout au long de la formation initiale et de la formation continue reçue par les professionnels des médias afin qu’ils prennent part à la lutte contre les stéréotypes sexistes et les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes.
B. RENFORCER LES DISPOSITIFS DE RÉGULATION
1. Assurer l’efficacité des textes pour lutter contre les violences faites aux femmes
a. Compléter les dispositions destinées à réprimer l’atteinte à la dignité humaine par la mention expresse d’un objectif de lutte contre les violences faites aux femmes
Les textes encadrant l’activité des médias visent les notions d’atteinte à la dignité humaine et d’incitation à la violence.
Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (279) réprime expressément la provocation à la haine ou à la violence ainsi que l’insulte « à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». Il en va de même pour la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse qui réprime expressément les représentations « présentant sous un jour favorable […] la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse » (280) ou revêtant « un caractère licencieux ou pornographique » La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quant à elle, vise à garantir « la protection de l’enfance et de l’adolescence » et le « respect de la dignité de la personne » (281).
Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel exerce un contrôle sur les chaînes de télévisions et les radios publiques et privées avec deux objectifs : la protection de l’enfance et de l’adolescence ainsi que l’interdiction des propos et comportements discriminatoires ou attentatoires au respect de la dignité humaine. C’est à ce titre que, en 2008, le CSA a mis en demeure une radio en raison des propos tenus au cours d’une émission qui présentait les victimes de viols comme ayant une responsabilité dans les agressions.
L’Autorité de Régulation professionnelle de la Publicité a également adopté en octobre 2001 une recommandation relative à « l’Image de la personne humaine » et signé en novembre 2003 une Déclaration commune sur le respect de la personne dans la production publicitaire, valant engagements réciproques sur des objectifs communs avec la Ministre déléguée à la Parité et à l’Égalité professionnelle.
Les pouvoirs dont ces deux instances sont dotées, ainsi que la Commission de classification des œuvres cinématographiques, leur permettent d’exercer un contrôle au regard de la protection de la dignité humaine et de la répression de la provocation à la haine ou à la violence en raison du sexe.
M. Pierre Zisu, chargé du secteur « protection des personnes » à la Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur a indiqué à la mission que ces textes offraient une base légale suffisante pour lutter contre les contenus incitant à la violence contre les femmes, appréciation partagée par les autres intervenants (282). Pourtant, si les outils existent, la question des violences à l’encontre des femmes n’est pas identifiée en tant que telle. Il importe donc d’attirer l’attention des instances de régulation sur la thématique particulière des violences faites aux femmes.
D’ailleurs, comme le constate Mme Martine Brousse à propos de l’activité de la commission de classification des films : « Une réflexion serait sans doute à mener sur le fait qu’on est moins sévère pour des films montrant des femmes battues ou violentées verbalement que pour des films comportant des scènes sexuelles. » (283).
La mission estime donc utile, pour provoquer une prise de conscience, qu’il soit mentionné expressément dans les textes de régulation relatifs aux médias et à la publicité, les violences faites aux femmes, en plus des atteintes à la dignité humaine.
Proposition n° 23 :
Mentionner expressément dans les textes de régulation des médias et de la publicité sanctionnant les atteintes à la dignité humaine, l’incitation aux violences faites aux femmes.
b. Associer les acteurs à la mise en œuvre des procédures de sanction
Il importe que l’attention des instances de régulation soit également attirée sur la thématique particulière de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Le rapport sur l’image des femmes dans les médias constate, de fait, la tendance d’un organisme de régulation tel que le CSA à appréhender la question du traitement de l’image des femmes dans les médias de la même façon que celle des minorités dites « visibles ». Cette approche le conduirait à négliger les spécificités de la lutte contre les stéréotypes sexistes et dégradants pour l’image des femmes pour ne réaliser qu’un contrôle au regard de la diversité.
Pour ces raisons, ainsi que le Collectif national pour les droits des femmes et le rapport sur l’image des femmes dans les médias le proposent, la mission recommande d’accorder aux associations de défense des droits de la femme le droit de saisine du CSA qui pourrait déclencher une procédure de mise en demeure et infliger les sanctions prévues à l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (284).
Proposition n° 24 :
Reconnaître aux associations de défense des droits de la femme le droit de saisine du CSA.
2. Intégrer la question de l’image des femmes dans la réflexion sur les nouveaux médias
Par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le CSA voit sa compétence de contrôle étendue aux services de médias audiovisuels à la demande (essentiellement les services offrant la possibilité de voir des programmes télévisés avec retard ainsi que des vidéos à la demande).
La mission considère qu’il est important que les réflexions à mener sur le contrôle des contenus diffusés sur Internet, qui dépassent en tant que telles largement le champ de la mission, intègrent aussi la dimension de l’image des femmes, des stéréotypes sexistes, des contenus dégradants et incitant à la violence à leur encontre.
En effet, les dispositifs de régulation existants n’assurent qu’imparfaitement la régulation des contenus des nouveaux médias. Il en va ainsi des multiples sites sur Internet, mais également de nouveaux supports tels que les DVD et les jeux vidéos.
Or, ceux-ci exercent une influence considérable sur le jeune public et contribuent à la persistance de stéréotypes sexistes et de représentations avilissantes pour les femmes que ce soit des jeux vidéos offrant des modèles féminins caricaturaux par leur représentation physique (Lara Croft, Guild wars), ou les renvoyant à des rôles stéréotypés en cantonnant les femmes dans la mode, le shopping, la coiffure (« Barby girl on line ») ou la tenue de son intérieur (« Oh my dollz.com »), autant d’exemples mis en évidence par le rapport sur l’image des femmes dans les médias.
Ce rapport attire également l’attention sur des jeux d’une extrême violence à l’égard des femmes tels GTA4, jeu américain interdit aux moins de 18 ans, dans lequel les femmes sont contraintes d’accepter des rapports sexuels contre leur gré.
La proposition de créer d’une autorité administrative indépendante chargée du contrôle des contenus multimédias tels que le DVD, les jeux vidéos et les vidéogrammes qui est avancée par le Collectif national aux droits des femmes a permis de mettre en valeur le manque de régulation pesant sur ces nouveaux secteurs. Cette nouvelle instance de régulation, selon les auteurs de la proposition de loi-cadre, pourrait intégrer la Commission de contrôle des DVD et cassettes vidéos créée en 1998 mais qui ne fonctionnait pas jusque très récemment, faute de désignation de ses membres, et associer à ses travaux les associations de défense des droits des femmes.
Néanmoins, cette solution nécessiterait la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante. Il semble plus judicieux à la mission d’élargir les compétences du CSA, qui possède l’expertise et les moyens nécessaires au contrôle de ces nouveaux modes de communication. Il pourrait être chargé de l’établissement de recommandations et de codes de bonne conduite à l’attention des éditeurs de ces supports. En second lieu, il devrait assurer la régulation du secteur par un contrôle a posteriori des produits mis sur le marché et disposer de procédures de sanction lui permettant d’obtenir le retrait du marché des contenus jugés illicites à la suite de la saisine du juge.
Proposition n° 25 :
Étendre la compétence du CSA au contrôle des nouveaux contenus multimédias.
C. LES MÉDIAS, VECTEURS DE CAMPAGNES DE COMMUNICATION NATIONALES
Les médias sont de puissants vecteurs de diffusion de l’information. L’année 2010, au cours de laquelle la lutte contre les violences faites aux femmes sera érigée en « grande cause nationale » constitue une occasion importante pour promouvoir de nouvelles campagnes de communication.
1. Les médias sont un outil de sensibilisation efficace
Différentes campagnes de communication, essentiellement à destination des femmes victimes, ont été menées depuis que cette problématique est apparue sur la scène publique. Récemment, lors d’une campagne, qui a débuté en octobre 2009, un site Internet a été ouvert, ainsi que l’a indiqué Mme Valérie Létard : « Explicatif, très concret, ce site comporte nombre d’éléments d’information, d’orientation, d’outils territorialisés, permettant à chacun de savoir où trouver un accompagnement, quel que soit l’endroit où il se trouve. » (285).
Le premier effet attendu de ces campagnes est d’inciter les femmes victimes à prendre conscience de l’anormalité des traitements ou des comportements subis et à entreprendre des démarches pour mettre un terme aux violences. C’est ainsi que les représentantes de la Fédération nationale Solidarité Femmes auditionnées ont souligné l’augmentation sensible des appels adressés au 3919 qui a été constatée après la diffusion des campagnes de communication : « Il est important de développer les campagnes de communication pour que les femmes puissent avoir connaissance de l’ensemble des dispositifs : après chaque campagne, on constate que le nombre d’appels et le nombre de femmes qui arrivent dans nos centres augmentent significativement. » (286).
En dehors même de ces campagnes spécifiques, les médias peuvent avoir un impact important sur la révélation des phénomènes de violences. Mme Armelle Andro a ainsi évoqué, l’impact de la diffusion d’émissions télévisées consacrées à l’excision : « Les quelques soirées THEMA qui ont eu lieu sur Arte au cours des dernières années ont été un formidable déclencheur de parole dans les familles – les discussions avaient lieu avec les mères et les sœurs, jamais avec les pères – au point que presque toutes les femmes interrogées étaient capables de citer la date de ces émissions. C’est grâce à elles aussi qu’elles avaient entendu parler de la chirurgie réparatrice. » (287)
Ce constat milite en faveur d’une intensification des campagnes de communication dans les différents médias à des fins de sensibilisation et de prévention.
2. Les violences faites aux femmes seront « grande cause nationale » en 2010
La promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes comme grande cause nationale pour l’année 2010, ce dont la mission se félicite, devrait être l’occasion d’importantes actions de communication.
Si les arbitrages budgétaires sont encore en cours, comme l’a indiqué Mme Valérie Létard (288), la mission estime que des moyens conséquents devraient être mobilisés à cette occasion et de façon régulière pour mener des campagnes de grande ampleur dans tous les domaines des violences faites aux femmes.
3. Les campagnes de communication doivent être diversifiées
Le contenu des campagnes médiatiques destinées à lutter contre les violences doit incontestablement être diversifié afin :
— de ne pas se concentrer exclusivement sur les violences physiques les plus graves ayant lieu au sein du couple comme l’a préconisé le Docteur Marie-France Hirigoyen : « J’aimerais d’abord que, dans les campagnes de prévention, on ne se limite pas à parler des femmes battues et que l’on ne mette pas seulement l’accent sur les femmes qui meurent sous les coups. En effet, la violence physique est un épiphénomène dans une relation violente en elle-même. Il faut parler de la violence conjugale de manière plus globale qu’on ne le fait généralement, en prenant en compte la violence psychologique qui a des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale des femmes. » (289) Tel est déjà le cas avec la diffusion, dans le cadre de la campagne d’intérêt national lancée en 2009, d’un spot de trente secondes intitulé « La Voix » et mettant en scène des violences psychologiques. Cette campagne concerne l’ensemble des chaînes hertziennes et doit donner lieu à la diffusion de ce spot à 550 reprises entre le 10 juin et 1er juillet 2009 ;
— d’engager aussi des campagnes en direction des auteurs des violences. Les membres des associations entendus par la mission ont souligné que la diffusion d’un reportage ou la publication d’un article consacrés aux violences conjugales se traduisait par une arrivée conséquente d’hommes s’adressant volontairement à leurs structures (290). Il est donc nécessaire de communiquer non seulement en direction des victimes ou des témoins, comme cela a été le cas jusqu’ici, mais aussi en direction des auteurs de violences.
Plusieurs pistes ont été évoquées par le Docteur Roland Coutanceau dans son rapport sur le suivi des auteurs, afin de définir le message qui pourrait être diffusé lors de ces campagnes à l’attention des auteurs. Il propose de souligner le caractère inadmissible de la violence ainsi que la possibilité d’aider les auteurs qui se signalent en généralisant une campagne du type de celle lancée en Seine-Saint-Denis, qui a une visée éducative et dont le slogan est « Tu n’es pas un homme si tu la bats » (291).
Proposition n° 26 :
Engager des campagnes de communication de grande ampleur, de façon répétée, en utilisant des supports de large diffusion (audiovisuels notamment) à destination, des victimes et des auteurs de violences.
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE : CRÉER UNE OBLIGATION DE FORMATION DES ACTEURS
La mission considère que pour repérer les violences, pour agir efficacement de façon préventive, pour traiter les situations de violences et pour prendre en charge les victimes de façon adéquate, un effort particulier doit être fait en termes de formation.
Une obligation de formation, initiale et continue, doit être créée à l’égard de tous les intervenants appelés à connaître, à un titre ou à un autre, de la situation de femmes victimes de violences. Elle doit s’étendre aux professionnels de santé, aux magistrats, aux travailleurs sociaux, aux personnels de la police et de la gendarmerie nationale, aux acteurs associatifs, aux agents des services de l’emploi et aux agents d’accueil des collectivités locales.
Cette obligation générale de formation devrait être inscrite dans la loi, comme cela a été fait pour la formation des professionnels dans le domaine de la protection de l'enfance en danger (292).
Les actions de formation, qui pourront être interdisciplinaires, seront organisées selon des modalités fixées par décret. Elles devront être déclinées localement de façon coordonnée (293).
Proposition n° 27 :
Mettre en place des formations obligatoires à destination de tous les professionnels appelés à être en contact avec des femmes de violences et à traiter leur situation : professionnels de santé, magistrats, personnels de la police et de la gendarmerie nationale, travailleurs sociaux, acteurs associatifs, agents des services de l’emploi et agents d’accueil des collectivités locales
TROISIÈME PARTIE : FACILITER L’ACCÈS DES VICTIMES AU DROIT
Souvent, dans le cas des violences au sein du couple ou des violences sexuelles, de longs mois, voire de longues années se sont écoulés avant que la victime ne décide de saisir la justice de sa situation pour faire cesser les violences.
Dans ces conditions, la victime doit être conseillée et orientée vers les bons interlocuteurs. Les associations et les forces de police et de gendarmerie, qui sont souvent en première ligne, ont un rôle déterminant à jouer.
De surcroît, les obstacles juridiques au dépôt de plainte, et, plus largement, à l’accès au droit doivent être levés. Il en existe de nombreux, notamment la peur de perdre le bénéfice du logement familial ou d’être séparée des enfants. Ils relèvent de problématiques plus larges, qui seront abordées plus loin. Certains d’entre eux, de nature strictement juridique, conditionnent l’accès au droit. Seront ainsi examinés les problèmes liés à la main courante, à l’aide juridictionnelle, à la dénonciation calomnieuse et à la situation des femmes étrangères.
Chapitre I : Conseiller la victime et l’orienter vers les bons acteurs
Il existe, pour les victimes, deux points d’entrée principaux dans le système juridique : les associations, qui tiennent des permanences, notamment téléphoniques et les services de police et de gendarmerie.
D’autres acteurs peuvent également orienter et conseiller les femmes victimes. Certains ont déjà été évoqués, dans la partie portant sur la prévention et le repérage. Il s’agit des médecins (notamment les médecins généralistes, les gynécologues ou les médecins du travail) et des acteurs du monde du travail.
D’autres, tels que les avocats spécialisés, interviennent de manière spécifique lorsque la victime entend faire valoir ses droits. Des permanences sont ainsi mises en œuvre dans différents barreaux, notamment celui de Bobigny, qui permettent un accompagnement juridique des victimes.
I. LES ASSOCIATIONS JOUENT DEPUIS LONGTEMPS UN RÔLE MAJEUR DANS L’ACCUEIL ET L’ORIENTATION DES FEMMES VICTIMES
Le rôle moteur des associations dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes n’est plus à démontrer et il est clair que, pour reprendre une forme de Mme Marie-France Hirigoyen, « si l’on parle de ce sujet aujourd’hui, c’est grâce à elles. » (294) Leur rôle a d’ailleurs été spécifiquement reconnu par le guide méthodologique du Service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville intitulé Les associations et la lutte contre les violences au sein du couple (295).
Le champ d’action de ces associations est extrêmement large puisqu’il va de la première écoute, jusqu’à l’assistance juridique et à l’hébergement des victimes. Au niveau national, ce sont également des associations qui gèrent les lignes téléphoniques qui leur sont destinées et qui œuvrent à faire évoluer les lois dans un sens plus favorable aux droits des femmes.
A. UN RÉSEAU IMPORTANT ET POLYVALENT
Dans tous ses déplacements, la mission a systématiquement rencontré les nombreuses associations qui œuvrent localement sur le thème des violences faites aux femmes. Elles ont témoigné de leur action quotidienne en faveur des femmes victimes.
Si les associations parviennent à remplir toutes ces fonctions, c’est grâce à une organisation répondant à une double caractéristique : elles sont structurées en réseaux et en fédérations, qui couvrent l’ensemble du territoire, et elles mènent des actions très diverses.
1. Des réseaux présents sur l’ensemble du territoire
Celles-ci sont généralement membres d’une des grandes fédérations nationales d’associations. On peut notamment citer, parmi les plus importantes, dont le champ d’activité n’est pas toujours uniquement circonscrit à la lutte contre les violences faites aux femmes :
— La Fédération Nationale Solidarité Femmes, créée en 1987, a pour domaine d’action la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ainsi que l’a indiqué sa présidente, Mme Nicole Crepeau, lors de son audition : « La Fédération Nationale Solidarité Femmes regroupe soixante et une associations sur tout le territoire, qui toutes proposent un accueil de jour. Les deux tiers gèrent des foyers d’hébergement, les autres assurent la prévention des comportements sexistes en milieu scolaire. Depuis 2007, la Fédération gère le numéro d’appel 3919. Ces associations assurent le suivi des affaires et accompagnent les femmes lors du dépôt de la plainte. » (296) ;
— Le réseau des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et le Centre national sur l’information des femmes et des familles (CNIDFF) forment un réseau associatif à qui l’État confie une mission d’intérêt général dans le domaine de l’information globale et polyvalente des femmes sur leurs droits, pour favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes. Les CIDFF ont traité en 2008 plus de 800 000 demandes d’informations, dont 42 500 concernaient des violences sexistes, 26 500 portant sur des violences s’étant déroulées au sein du couple ;
— Le Mouvement français pour le planning familial (MFPF), qui a un spectre d’activité bien plus large que les violences faites aux femmes mais qui, par son activité, est également concerné par cette problématique. C’est par exemple le centre de Montpellier qui est pilote dans le domaine de la lutte contre les mariages forcés dans l’Hérault. La confédération nationale rassemble 20 fédérations régionales, regroupant 71 associations départementales et 36 groupes locaux. De surcroît, les centres du planning familial accueillent souvent des permanences d’autres associations, spécialisées sur certains types de violences, comme celles du Collectif féministe contre le viol.
Ces réseaux nationaux, parmi d’autres, fédèrent les énergies et permettent, d’une part, de couvrir l’ensemble du territoire et, d’autre part, de mutualiser les bonnes pratiques et de garantir une représentation au niveau national.
2. Des associations généralistes et spécialisées
Outre ces réseaux polyvalents, des associations se sont spécialisées dans certaines formes de violences ou dans le suivi de certaines catégories de femmes victimes.
En ce qui concerne les violences subies par les femmes au travail, il faut citer le rôle joué par l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), créée en 1985. Ainsi que l’a indiqué sa déléguée générale, Mme Marilyn Baldeck, l’AVFT a trois types de missions : « intervenir auprès des victimes afin qu’elles soient rétablies dans leurs droits, à toutes les étapes de la procédure […], la sensibilisation et l’information de tous les publics, surtout les professionnels concernés, et, parfois, les élus et la veille législative, à savoir l’analyse du droit applicable, la critique des politiques publiques et plus globalement l’étude de toutes les formes de violences commises à l’encontre des femmes. » (297) L’AVFT suit ainsi actuellement les dossiers de plus de 350 personnes.
Le Collectif féministe contre le viol a été créé en 1985. Il mène une quadruple activité d’écoute des femmes victimes, d’animation d’un réseau national, de formation et d’information.
Pour ce qui est des mariages forcés et surtout des mutilations sexuelles, le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS), créé en 1982 , est très actif tant en ce qui concerne la prévention de ces violences que pour l’accompagnement des jeunes filles qui les subissent ou qui en sont menacées. Cette association s’appuie également sur les autres associations existantes, ainsi que l’a indiqué sa directrice, Mme Isabelle Gillette-Faye (298).
Les associations de femmes étrangères sont également fortement mobilisées sur ce thème. Qu’elles fassent partie de structures à vocation plus générale, telle que la Cimade ou le Réseau éducation sans frontières (RESF), ces associations militent, notamment au sein du collectif ADFEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes) pour la reconnaissance des droits des femmes étrangères victimes de violences.
Ces associations, qui ne sont que les plus visibles parmi de nombreuses autres, permettent donc une prise en charge spécifique des femmes victimes de violences (299).
B. UN RÔLE D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION
Les associations sont souvent le premier interlocuteur des femmes victimes de violences. Grâce à leurs permanences, elles offrent en effet une écoute et un accompagnement professionnels. Elles sont alors aptes à diriger les victimes vers les interlocuteurs les mieux à même de pouvoir répondre à leurs difficultés.
1. La gestion de permanences téléphoniques
Des permanences téléphoniques ont progressivement été mises en place, souvent avec le soutien financier de l’État, qui est indispensable à leur survie. La plus importante d’entre elles, en terme de nombre d’appels, est celle qui est consacrée aux violences au sein du couple.
a. Le 3919 et les violences au sein du couple
Créée, en 1992, et organisée par les associations, la plateforme d’écoute téléphonique nationale destinée aux femmes victimes de violences au sein de leur couple est aujourd’hui gérée par la FNSF. Depuis 2007, cette plateforme s’intitule « Violences conjugales infos » et peut être jointe au 3919. Il s’agit d’un numéro gratuit et anonyme, qui n’apparaît pas sur les factures téléphoniques.
Il existe également des plateformes locales, mises en œuvre par des associations de proximité. Celles-ci sont complémentaires avec la plateforme nationale, comme l’a expliqué Mme Françoise Brié, vice-présidente de la FNSF : « Les numéros de proximité sont importants. Les femmes savent qu’elles pourront se rendre immédiatement dans une association proche de leur domicile. » (300)
Le 3919 a un triple rôle: c’est un numéro d’écoute, d’information et d’orientation. Les appels arrivant à cette plateforme constituent souvent la première occasion pour les victimes d’aborder les violences qu’elles subissent : « La moitié des appels proviennent de femmes qui n’ont jamais parlé de cette question. Un grand nombre d’entre elles veulent vérifier si elles sont ou non victimes de violences conjugales, car elles souhaiteraient ne pas être concernées. Nous devons donc distinguer les conflits de couple des violences conjugales et nous donnons aux femmes qui nous appellent quelques clés à cet effet. Nous devons aussi les aider à se reconnaître comme victimes qui ont des droits et peuvent s’en saisir pour engager des démarches. Notre travail se situe donc en amont de celui de la police et des associations et consiste, une fois que la victime sait que des gens peuvent l’aider, que la loi est en sa faveur et qu’elle peut demander de l’aide à la police, à l’orienter vers les associations spécialisées par lesquelles nous savons qu’elle pourra être prise en charge. » (301) Dans 30 % des cas, ce sont des proches (amis, famille, professionnels) qui appellent pour demander des conseils. Souvent, dans un second temps, la victime appelle elle-même.
Néanmoins, les appels reçus n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse statistique. Il serait nécessaire d’y procéder afin de mieux connaître le profil des femmes qui y ont recours.
Le nombre d’appels, par an, est en progression lente mais constante : « De 2003 à 2005, on traitait 15 000 appels par an. Après un fléchissement à 14 000 en 2006, on a atteint 17 700 appels en 2007. La progression s’est tassée en 2008 [année durant laquelle 18 400 appels ont été traités]. », a indiqué Mme Catherine Clamens, directrice de la FNSF (302) sachant qu’un appel dure en moyenne vingt minutes et que chaque campagne dans les médias entraîne une recrudescence du nombre d’appels. Le nombre d’appel redescend ensuite, tout en se situant à un niveau plus élevé que précédemment.
Pour faire face à cette augmentation, les moyens accordés par l’État sont passés de 10 à 11 équivalents temps plein en 2007, à 12 en 2008 et à 12,5 en 2009. Dans le cadre d’une convention triennale 2006-2008, le montant annuel de la subvention du SDFE à la FNSF pour la gestion de la ligne téléphonique a été fixé à 660 000 €, montant qui a été majoré de 160 000 € en 2007 et de 252 500 € en 2008 pour financer le passage au 3919 (303).
Cependant, ces moyens sont insuffisants, ainsi que l’a expliqué Mme Évelyne Réguig, de l’association VIFF SOS femmes : « En termes de moyens, l’écoute téléphonique, qui est l’une des premières possibilités offertes aux femmes d’être entendues et de voir s’ouvrir des portes, n’est pas financée. Les heures que nous consacrons au 3919 sont prises sur l’accompagnement social des personnes hébergées. C’est du bricolage associatif. » (304) En effet, plus de 80 000 appels sont reçus chaque année, ce qui signifie que la FNSF ne peut répondre qu’à environ un quart des appels.
Il serait notamment nécessaire de prévoir un renforcement de ces moyens durant les périodes de campagne nationale de grande ampleur, qui suscitent de nombreux appels.
Proposition n° 28 :
Accorder davantage de moyens au 3919 :
— De manière permanente, afin de faire face à l’augmentation des appels ;
— De manière conjoncturelle, lors des campagnes nationales de sensibilisation ;
— De manière spécifique, afin de mener une étude statistique sur les femmes qui y ont recours.
b. Les permanences portant sur les autres formes de violences faites aux femmes
Pour ce qui est des autres formes de violences subies par les femmes, des plateformes téléphoniques d’écoute et d’information ont également été créées.
La première d’entre elles (créée en 1986 par le Collectif féministe contre le viol, grâce à une subvention du SDFE (305)) est celle qui est consacrée aux victimes de viols ou d’agressions sexuelles. Il s’agit d’un numéro vert (0.800.05.95.95) joignable du lundi au vendredi de 10 h à 19 h. Ce numéro reçoit chaque année entre 3 500 et 4 000 appels de victimes ou de proches (chaque catégorie représentant la moitié des appels) et environ 1 200 appels de professionnels à la recherche d’informations.
De même, les autres associations spécialisées tiennent-elles également des permanences téléphoniques. C’est le cas notamment de l’AVFT en ce qui concerne les violences subies au travail, du GAMS pour les mutilations sexuelles ou encore de l'association Voix de femmes pour les mariages forcés. Dans ce dernier cas, la permanence téléphonique est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit de prévenir des violences davantage que de les dénoncer ; la rapidité de la réponse apportée est donc cruciale.
Une fois ce premier contact téléphonique établi, les victimes sont orientées vers les acteurs compétents ou prises en charge de manière approfondie par l’association qui assure la permanence.
2. Du conseil juridique à l’hébergement, les multiples rôles des associations
Après la phase d’écoute et d’orientation, vient celle d’accès au droit à proprement parler. Là encore, les associations jouent un rôle central dans le suivi juridique et la protection des femmes victimes.
a. Les associations, conseils juridiques et protection des femmes victimes
Le travail d’ensemble réalisé par les acteurs associatifs a été synthétisé ainsi par Mme Nicole Crepeau, présidente de la FNSF : « Notre travail au sein des associations consiste à accueillir les femmes, à les écouter, à leur faire prendre conscience qu’elles sont des victimes et à les aider à se reconstruire. En outre, nous les aidons à effectuer les démarches nécessaires, car nombreuses sont celles qui ont perdu confiance en elles, sont isolées et se sentent incapables de les entreprendre seules. » (306)
De nombreuses associations apportent une expertise juridique aux femmes victimes. C’est le cas en premier lieu de celles qui sont présentes dans les commissariats et les gendarmeries et notamment de l’INAVEM (Institut national d’aide aux victimes et de médiation). Les 150 associations généralistes qui y sont affiliées préparent la plainte et assurent le suivi du dossier juridique de la victime car, ainsi que le mentionnait Mme Sabrina Bellucci, directrice de l’INAVEM, « [Vous] semblez nous dire qu’à partir du moment où la plainte est déposée, tout va bien. Je dirai pour ma part qu’au contraire, tout va mal, car la plainte est le début d’un parcours du combattant ! » (307)
La pratique de l’AVFT, peut être résumée ainsi :
« L’AVFT, BIEN PLUS QU’UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE » - EXTRAITS
« L’AVFT ne peut être vue comme une « permanence téléphonique », car elle n’« absorbe » pas sans agir les témoignages qui lui arrivent. Le téléphone est la porte d’entrée d’un processus complet détaillé ci-après. […]
[L]’activité de l’AVFT consiste en l’avancement des « dossiers » : recueil des récits, premiers rendez-vous, actions sur les institutions, constitutions de partie civile et interventions volontaires, qui constituent les cinq moments-clés de l’accompagnement judiciaire des victimes. […]
[L]e premier rendez-vous est très important, car il est l’occasion de valider la perception des victimes, de les assurer qu’elles ne se sont pas méprises sur ce qui leur est arrivé. […] C’est à ce moment-là que nous nommons les violences et leur donnons leur qualification juridique. […]
Dans un souci d’efficacité, les personnes qui nous saisissent sont le plus rapidement possible placées au centre d’un réseau qui est constitué de professionnel-le-s de santé formé-e-s à la question des violences commises à l’encontre des femmes, d’associations-relais au niveau local, de syndicalistes repérés pour leur compétence en la matière... L’AVFT devient alors l’intermédiaire, ou la structure qui centralise toutes les contributions de ces acteurs qui seront utiles au succès du « dossier ». À leur demande, nous pouvons mettre les victimes en relation avec des avocat-e-s. »
Source : AVFT, 20 ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail, Paris, 2006, p. 50-55.
Dans les situations de grande urgence, les associations vont pouvoir apporter l’aide indispensable. C’est le cas notamment quand la victime cherche à quitter son domicile. Elle peut alors être prise en charge par une association dans un foyer d’hébergement d’urgence. De même, le signalement en amont d’un risque de mariage ou de mutilation sexuelle auprès d’une association peut conduire à la mise en œuvre de stratégies de fuite hors de la famille, avec le soutien d’une association. Des vêtements peuvent être progressivement rassemblés hors du domicile familial et un nouvel hébergement recherché.
Proposition n° 29 :
Pérenniser le financement des associations par la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
b. Des lieux d’accueil de jour à développer
Le premier plan global triennal (2005-2007) prévoyait d’identifier et de labelliser dans chaque département au moins un lieu d’accueil de jour. Le but était que les femmes victimes identifient un lieu où elles pourraient trouver une écoute et des renseignements sur leurs droits. Elles pourraient alors soit préparer leur départ du domicile conjugal sans avoir besoin d’un hébergement temporaire, soit s’informer sur la procédure d’éviction du conjoint violent.
Cette initiative intéressante, qui consiste à regrouper dans une structure de proximité l’ensemble des éléments d’information dont peuvent avoir les femmes victimes, n’a néanmoins guère été suivie d’effets. Ainsi que le relève le rapport d’évaluation du plan, « la procédure d’identification et de labellisation des lieux d’accueil de jour, prévue dans le premier plan, n’a pas abouti, bien que ces structures existent déjà dans certains départements, mais avec des modalités de fonctionnement variables. » (308)
Le deuxième plan global triennal (2008-2010) a réintroduit cette mesure dans son action 11-2, qui prévoit la rédaction d’un cahier des charges conduisant à la labellisation de structures. L’objectif d’une structure par département est réaffirmé, les financements devant venir de l’État.
Afin de faciliter le travail des structures associatives, il est nécessaire, compte tenu de leur rôle central, de pérenniser leur financement, au moyen de conventions pluriannuelles.
II. L’ACCUEIL DANS LES COMMISSARIATS ET LES GENDARMERIES S’EST BEAUCOUP AMÉLIORÉ MAIS RESTE PERFECTIBLE
L’accueil des victimes de violences dans les commissariats est un moment essentiel. En effet, les victimes, en général, ne s’adressent pas aux forces de l’ordre à la suite des premières violences. Ayant enduré plusieurs mois, voire plusieurs années de violences au sein de leur couple, la démarche qu’elles entreprennent est le fruit d’une lente maturation. Il est donc essentiel que leur premier contact avec un policier ou un gendarme se déroule dans les meilleures conditions possibles sans quoi le silence serait, ultérieurement, encore plus difficile à briser.
Le suivi des femmes victimes de violences doit donc faire l’objet d’un protocole spécifique prenant en compte la particularité de leur situation. C’est pourquoi différentes actions ont été engagées ces dernières années qui concernent notamment la formation des policiers et des gendarmes, la désignation de référents ou encore la présence de psychologues et d’associations dans les commissariats et les gendarmeries.
De l’avis unanime des personnes rencontrées par la mission, la prise en charge des victimes s’est améliorée. C’est par exemple ce qu’a indiqué Mme Karine Lejeune, capitaine de gendarmerie, de la Délégation aux victimes : « Grâce à l’information relayée par les collectivités, par les associations, par les médias, les victimes osent enfin briser le silence et se présenter dans des unités ou dans des services sans crainte d’être accueillies par un personnel machiste leur expliquant que ce sont elles qui sont peut-être responsables de ce qui leur arrive. Les réseaux associatifs qui luttent contre les violences faites aux femmes reconnaissent d’ailleurs que la police et la gendarmerie ont vraiment fait un effort très important ; elles nous envoient de plus en plus de victimes, sachant qu’elles seront bien accueillies. » (309)
A. DE RÉELS PROGRÈS ONT EU LIEU DANS LA FORMATION DES POLICIERS ET DES GENDARMES ET DANS L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL
Afin de prendre en compte la spécificité de la prise en charge des femmes victimes de violences, notamment au sein de leur couple, des actions ont été entreprises par la police et par la gendarmerie dans deux directions principales : une formation plus complète et une meilleure organisation. Logiquement, les conditions de la réception des plaintes s’en sont trouvées améliorées.
1. De réels progrès dans la formation
La formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie aux violences au sein du couple est essentielle. Ces formes de violences étant particulièrement fréquentes, « chacun d’entre eux y sera donc confronté un jour ou l’autre » (310).
a. Une formation initiale succincte
Mmes Maryvonne Chapalain, pour la police nationale et Karine Lejeune, pour la gendarmerie, ont indiqué qu’il était difficile, en formation initiale d’aller au-delà d’une initiation aux situations de violences au sein du couple. Les policiers et les gendarmes doivent en effet être formés à de multiples problématiques en un temps relativement bref.
Dans la police nationale, tous les gardiens de la paix reçoivent une formation initiale qui intègre la problématique de l’accueil des victimes. Trois jours sont consacrés à l’apprentissage des interventions dans les situations de violences intrafamiliales. En revanche, Mme Maryvonne Chapalain n’a fait état que d’une « sensibilisation » des officiers à ces questions (311).
Dans les écoles de gendarmerie, seule une demi-journée est consacrée, depuis 2004, aux violences intrafamiliales. Elle se déroule dans le cadre plus large d’une présentation des associations d’aide aux victimes. Les sous-officiers sont mieux formés à ces problématiques puisqu’ils bénéficient d’un module de trente heures portant notamment sur l’accueil du public, la prise en charge des victimes et les violences intrafamiliales. Un autre module, de deux heures, portant spécifiquement sur les violences faites aux femmes est également dispensé. Les officiers sont, depuis 2008, destinataires d’une formation de deux heures, assurée par la Délégation aux victimes, portant sur les violences intrafamiliales.
De tels volumes horaires, relativement réduits ne permettant pas de sensibiliser et de former durablement les policiers et les gendarmes à la spécificité des violences faites aux femmes l’accent est donc mis sur la formation continue.
b. Une formation continue novatrice devrait être généralisée dans la police et la gendarmerie
Ainsi que l’a expliqué Mme Karine Lejeune, la gendarmerie a créé, en 2005, un dispositif de formation continue original, fondé sur un système pyramidal, afin de toucher tous les militaires : « Au niveau de chaque département et groupement de gendarmerie a été désigné un correspondant départemental de lutte contre les violences intrafamiliales et, dans chaque communauté de brigade ou brigade autonome, a été désigné un référent. » (312) Ces correspondants départementaux reçoivent une formation poussée qu’ils relaient ensuite auprès des référents lesquels devront sensibiliser les militaires: « L’objectif est de former tous les militaires des unités territoriales à prendre en charge une victime de violences. » (313)
Parallèlement, des modules de formation continue sont organisés. Les militaires en stage au centre national de formation de la police judiciaire, bénéficient d’une formation d’une demi-journée sur les violences intrafamiliales et d’une autre sur la problématique de la traite des êtres humains. Les commandants de brigade de proximité et les commandants de communauté de brigades, dans le cadre de leur stage au Centre national de formation des gradés de Rochefort, reçoivent une formation de deux heures consacrée à l’assistance aux victimes. Cette formation est assurée par la Délégation aux victimes et comporte l’intervention d’associations. Enfin, les officiers bénéficient d’un séminaire de formation pluridisciplinaire de trois jours où sont invités des procureurs, des psychiatres, des associations et des médecins légistes.
En comparaison, la formation continue dispensée à destination des fonctionnaires de la police nationale apparaît moins systématique. Mme Maryvonne Chapalain l’a décrite ainsi : « Dans la formation complémentaire des policiers, plusieurs cycles ont été mis au point : accueil du public ; audition des mineurs victimes ; aspects techniques et psychologiques des violences conjugales ; assistance aux victimes dans le cadre des enquêtes. Nous essayons de placer des référents un peu partout sur le territoire. » (314) La police forme également des référents afin de diffuser la formation reçue mais de façon moins généralisée que dans la gendarmerie.
Une expérience pilote a été menée à Paris, depuis l’année 2000, avec la désignation de référents dans tous les commissariats. Le fonctionnaire acquiert le statut de « référent violences conjugales » à la suite d’une formation de trois jours consacrée spécifiquement aux violences au sein du couple. Cette formation comprend une partie théorique, durant laquelle des intervenants associatifs expliquent le cycle des violences au sein du couple, et une partie pratique, constituée par la visite de deux centres d’accueil et d’hébergement. Les référents ont alors pour mission de former leurs collègues et de s’informer des évolutions législatives en la matière. Au cours du déplacement de la mission à la préfecture de police, M. Michel Gaudin, préfet de police, a indiqué que 136 référents violences conjugales étaient actuellement en poste dans les commissariats parisiens. Par ailleurs, depuis 2009, un stage est proposé aux fonctionnaires de voie publique afin de leur apprendre à intervenir dans ce genre de situations. Le but est là encore que tous les agents parisiens soient sensibilisés à la spécificité des violences commises au sein du couple.
Ces bonnes pratiques en matière de formation continue devraient être généralisées à l’ensemble des services de la police nationale. C’est ce que recommande le rapport d’application du premier plan global triennal dans sa proposition n° 18 : « promouvoir au sein de la police, sur le modèle de la gendarmerie, des sensibilisations régulières animées par les référents locaux. » (315) Cette recommandation a été explicitée par M. Michel Ribeiro, commissaire divisionnaire, au cours de son audition : « Nous proposons de calquer le dispositif sur celui en vigueur dans la gendarmerie. Des correspondants départementaux y sont formés, qui ensuite démultiplient les formations. Les inconvénients limités de cette solution, notamment la perte de substance et de qualité pédagogique due à des relais plus nombreux, peuvent être facilement palliés en formant spécifiquement un « noyau dur » de personnes au sein de chaque département. Aujourd’hui, la direction de la formation de la police nationale semble intéressée par cette solution. » (316).
Proposition n° 30 :
Former au niveau régional, départemental et local les services de la police et de la gendarmerie à la spécificité des violences au sein du couple.
2. Une organisation mieux à même de prendre en compte la spécificité des violences faites aux femmes
Pour adapter l’organisation de la police et de la gendarmerie, des référents et des brigades spécialisées ont été institués.
a. Les référents ont un rôle majeur à jouer dans la lutte contre les violences au sein du couple
Les référents violences intrafamiliales, pour la police et la gendarmerie, ou violences conjugales, pour la préfecture de police de Paris, jouent un rôle central dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Outre leur mission de formation précédemment évoquée, ils ont également un rôle d’interface avec les associations et les autres acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ils constituent donc l’interlocuteur privilégié pour nouer des partenariats sur ce sujet.
Néanmoins, d’après les personnes auditionnées, le réseau de référents n’est pas encore suffisant pour mailler l’ensemble du territoire français. Il serait nécessaire, à moyen terme, que chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie soit doté d’un référent. Si l’objectif semble avoir été atteint, selon Mme Karine Lejeune (317), pour la gendarmerie, ce n’est pas encore le cas, semble-t-il, pour la police. Mme Maryvonne Chapalain a précisé cet objectif : « Nous essayons d’élargir au maximum les compétences des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, pour que dans chaque unité et dans chaque commissariat soient présents des personnels spécifiquement formés à cet effet. » (318)
Proposition n° 31 :
Désigner et former, dans chaque commissariat et dans chaque brigade de gendarmerie, un référent violences conjugales ou violences intrafamiliales.
b. La création de brigades spécialisées marque une étape supplémentaire dans la lutte contre les violences au sein du couple
La police nationale a créé, dans cinq de ses circonscriptions, des « cellules spécialisées dans les violences intrafamiliales » (319). Récemment, le ministère de l’Intérieur a annoncé le développement de « brigades de protection des familles » dans chaque département, dont la mission sera centrée sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Ces unités qui doivent être déployées dans chaque département, devraient permettre une meilleure prise en compte de la spécificité des violences faites aux femmes, qui constituent l’essentiel des violences intrafamiliales.
3. Les progrès dans la prise des plaintes doivent être approfondis
Ces différentes améliorations, si elles restent incomplètes, ont permis une meilleure écoute des victimes, notamment au moment du dépôt de plainte.
a. Les bonnes pratiques pour le recueil des plaintes sont à généraliser
Pour faire face à la spécificité de la prise en charge, dans les commissariats et les gendarmeries, des femmes victimes de violences au sein du couple, différentes bonnes pratiques, qui doivent être généralisées, ont été adoptées.
Un protocole d’entretien et de dépôt de plainte permettant au policier ou au gendarme de regrouper tous les éléments d’information nécessaire à l’évaluation de la situation de la victime et de sa dangerosité a été établi par le Guide de l’action publique, (320). Il vise notamment à identifier d’autres victimes éventuelles des violences (par exemple les enfants), à recenser les éléments de preuve qui peuvent corroborer la déposition de la victime (témoignages, certificats médicaux, mains courantes antérieures…), et à évaluer la gravité, l’antériorité et la fréquence des faits. Cependant, comme l’a indiqué Mme Nicole Crepeau, présidente de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), « ce document n’est pas toujours utilisé, pourtant il fournit des éléments utiles lorsque les violences se reproduisent » (321). Concernant les violences sexuelles, un mémento a été créé à Paris, à destination des enquêteurs, portant sur les règles à suivre pour l’audition des personnes victimes de violences sexuelles. Des efforts devraient être portés, notamment pendant les phases de formation continue des policiers et des gendarmes, sur une utilisation plus systématique de ces protocoles.
Par ailleurs des consignes ont été données aux forces de l’ordre : obligation pour les policiers et les gendarmes de se déplacer lors des appels d’urgence, de recevoir les plaintes, d’inciter au dépôt de plainte, d’informer la victime de la possibilité de se faire assister par une association et de se constituer partie civile. Ces instructions semblent être de mieux en mieux respectées, selon le rapport d’évaluation du premier plan global triennal (322).
Enfin, selon le Guide de l’action publique, les enquêteurs doivent s’efforcer de dissiper les idées reçues de la victime quant à la plainte en l’informant du fait que celle-ci n’a pas pour conséquence directe et automatique l’incarcération du conjoint ou le placement des enfants (323).
b. Le degré de satisfaction des victimes s’est amélioré mais reste mitigé
Il ressort de ces efforts un bilan en nette amélioration. Plusieurs interlocuteurs, quelles que soient leurs fonctions en ont témoigné. Lors du déplacement de la mission à Marseille, cela a été le cas de M. Olivier Rothe, Procureur de la République à Aix-en-Provence et de Mme Jacqueline Grebert, assistance sociale à l’Unité médico-judiciaire (UMJ) de Marseille, qui a indiqué que les victimes se plaignaient moins de l’accueil dans les commissariats et les gendarmeries. « Dans les commissariats et les gendarmeries, des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières années dans l’accueil des femmes victimes de violences conjugales ; elles y trouvent désormais écoute et conseils, et je n’ai pas eu connaissance de femmes mal reçues. » (324) a également indiqué Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre.
Ce constat doit inciter à la poursuite des efforts dans ce sens, puisque les associations ont également fait remarquer à la mission que si l’accueil des victimes était satisfaisant dans la majorité des cas, il restait parfois encore très mauvais. Ceci concerne en particulier la prise de plainte, certains policiers ou gendarmes refusant encore de prendre les plaintes qui ne sont pas accompagnées d’un certificat médical, ainsi que l’a souligné Mme Nicole Crepeau (325) ou qui ne font pas état de violences physiques (326). Lors de son déplacement à Évry, la mission a également été informée du fait que dans certains commissariats, il était très difficile pour une femme victime de violences au sein de son couple, de déposer plainte. Ces pratiques sont pourtant contraires au Guide de l’action publique.
Un indice global de satisfaction des victimes a été créé par l’Observatoire national de la délinquance. Il traduit une satisfaction mitigée des victimes de violences intrafamiliales. Si la qualité des conseils est plutôt satisfaisante par rapport aux autres crimes et délits, en revanche, le temps d’écoute et la confidentialité laissent à désirer, ainsi que l’illustre le tableau suivant :
TAUX DE SATISFACTION DES VICTIMES
Satisfaction |
Générale |
Violences hors ménage |
Violences dans le ménage |
Temps d’écoute |
74 % |
82 % |
56 % |
Conseils |
50 % |
48 % |
55 % |
Confidentialité |
72 % |
79 % |
56 % |
Source : OND – Rapport 2007 et Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 44.
B. L’ORIENTATION DES VICTIMES VERS LES ACTEURS COMPÉTENTS EST À SYSTÉMATISER
L’orientation des victimes constitue l’une des missions des policiers et des gendarmes. Deux possibilités existent : faire venir des intervenants extérieurs dans les commissariats et les gendarmeries ou orienter de manière systématique les victimes vers des structures spécialisées.
1. La présence d’intervenants extérieurs dans les commissariats et les gendarmeries
La présence d’intervenants extérieurs dans les commissariats et les gendarmeries a constitué un changement important, ainsi que l’a expliqué le capitaine Karine Lejeune : « Pour ce qui est des partenariats associatifs, qui ont constitué une petite révolution au ministère de l’intérieur, le ministère est, depuis 2005, conventionné avec le plus grand réseau national d’aide aux victimes, à savoir l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), pour la mise en place de permanences d’associations dans les services de police et les unités de gendarmerie. » (327)
Deux types principaux d’intervenants peuvent être présents dans les locaux des services d’enquête afin d’assister les victimes :
— Des travailleurs sociaux : 183 travailleurs sociaux exercent dans 73 circonscriptions de police et 47 dans les brigades de gendarmerie ; 16 sont mutualisés police-gendarmerie (328). Ils ont pour tâche de prendre en charge dans l’urgence les victimes qui se trouvent dans une situation matérielle difficile (329) et de les orienter vers le travailleur social de leur secteur. Ces travailleurs sociaux sont en général recrutés par le Conseil général et mis à la disposition des forces de l’ordre. Du fait de cette double dépendance, leur statut est relativement précaire, d’autant plus que les financements sont souvent annuels, qu’ils émanent du Conseil général ou du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Ainsi que l’a indiqué M. Philippe de Lagune, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance : « Tout le monde s’accorde à dire que ce dispositif est une réussite, et nous souhaiterions qu’il monte en puissance. Mais pour cela, il faut une gouvernance à même de déterminer les besoins financiers globaux et une revalorisation du budget consacré au FIPD. » (330) ;
Proposition n° 32 :
Pérenniser les financements des postes de travailleur social intervenant dans les commissariats et les gendarmeries et accroître leur nombre. Rédiger une charte donnant une plus grande lisibilité à leurs fonctions et à leurs carrières.
— Des psychologues : au nombre de 35, uniquement dans les services de police, ils sont chargés selon l’instruction ministérielle du 23 mars 2007 d’intervenir auprès des victimes et des auteurs, de les orienter vers des structures de prise en charge ainsi que de conduire des actions de formation interne pour améliorer les pratiques. Leur recrutement est pris en charge par l’État. La préfecture de police de Paris a indiqué à la mission que quatre postes de psychologue étaient actuellement financés par l’État à Paris, l’objectif étant qu’en 2009, tous les arrondissements disposent d’un poste d’intervenant social ou de psychologue.
Ce dispositif est complété par les permanences des associations d’aide aux victimes, notamment celles du réseau INAVEM (Institut national d’aide aux victimes et de médiation), au nombre de 150 dans les services de police. Ces permanences offrent la possibilité de rencontrer un travailleur social ou un psychologue. Lors de son déplacement à Évry, la mission a ainsi pu constater que trois permanences d’association avaient lieu dans les services de police et de gendarmerie du département.
Les policiers n’ont souvent pas le temps d’accompagner les victimes dans leurs démarches ou de les écouter de manière approfondie. Ainsi que l’a expliqué M. Philippe de Lagune, « pour avoir soutenu leur implantation sur le territoire de Belfort, je peux vous dire combien ces personnes sont utiles. Une étude, réalisée par un cabinet privé, a montré que 60 % des personnes qui venaient exposer un problème étaient inconnues des services sociaux. » (331) Il est donc particulièrement utile que des psychologues ou des travailleurs sociaux, voire des juristes soient présents pour effectuer ce travail préparatoire et consécutif au dépôt de plainte avec la victime. De surcroît, le travail de ces intervenants extérieurs ne se limite pas à la prise en charge des victimes. Ils sont également en mesure d’orienter les auteurs, à l’issue de leur garde à vue, pour permettre un suivi spécialisé.
2. L’orientation des victimes vers les associations et services spécialisés
Afin d’assurer un suivi de la victime qui se rend dans un commissariat ou une gendarmerie, que cette démarche débouche sur une plainte ou sur une main courante, il est indispensable qu’elle puisse être orientée dès le départ vers d’autres acteurs spécialisés.
La possibilité en est ouverte par l’article L. 53-1 du code de procédure pénale, qui dispose que « les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : […] 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes. » et cette préconisation est explicitée, dans le cas des violences commises au sein du couple, par le Guide de l’action publique.
Une première information peut se faire au moyen des plaquettes d’information à destination des victimes et des auteurs qui y sont distribuées. Mais une information plus systématique doit être mise en œuvre, en direction des associations de femmes victimes, des permanences d’avocats, des services médicaux ou des structures d’hébergement. De telles possibilités ne seront effectives que si des partenariats se créent et des contacts se nouent entre ces différents acteurs, dans le cadre d’un réseau local (332).
Chapitre II : Éliminer les freins à l’accès au droit
Les violences subies par les femmes, et les violences conjugales, en particulier, ne sont que peu dénoncées par les victimes. Ce chiffre noir des violences faites aux femmes a été estimé à 91 % dans le cas des violences au sein du couple, le taux de révélation étant particulièrement faible, de l’ordre de 9 % (333). Si cela tient pour partie au caractère intime de ces violences, il ne faut pas négliger les facteurs institutionnels et procéduraux qui pourraient décourager les femmes victimes de signaler les violences qu’elles subissent et éliminer les obstacles qui conduisent les femmes victimes, par impossibilité de faire valoir leurs droits, à garder le silence sur les violences subies.
Les démarches des femmes victimes peuvent se heurter à trois types de difficultés :
— L’impossibilité de défendre leurs droits par manque de ressources (c’est la question de l’aide juridictionnelle) ou parce qu’elles ne peuvent accomplir les démarches conduisant au dépôt d’une plainte ;
— La perspective, pour les femmes étrangères, de se voir retirer leur titre de séjour ou d’être expulsées ;
— La crainte, en cas d’insuffisance de preuves, d’être poursuivies et condamnées pour dénonciation calomnieuse.
I. LES DIFFICULTÉS PROCÉDURALES À ACCÉDER AU DROIT
A. DES CRITÈRES D’OUVERTURE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Outre le cas des personnes étrangères en situation irrégulière qui sera examiné ci-dessous, deux questions se posent :
— Celle du niveau du plafond de ressources à partir duquel la victime n’a plus droit à l’aide juridictionnelle. Fixé à un niveau trop bas il exclurait un nombre trop important de victimes. Il importe de préciser qu’en cas de violences conjugales, seules les ressources de la femme victime sont prises en compte dans le calcul du plafond ;
— Celui du délai pour obtenir l’aide juridictionnelle.
Pour faire face à ces deux difficultés, l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes propose d’accorder automatiquement l’aide juridictionnelle aux femmes victimes de violences « qui ne peuvent matériellement pas assurer leur défense » (334). Les auteurs du rapport d’évaluation du premier plan estiment quant à eux, que le bureau d’aide juridictionnelle qui statue sur les demandes pouvant déroger aux critères de ressources dans des cas exceptionnels, il n’est pas opportun d’accorder automatiquement l’aide juridictionnelle aux victimes de violences au sein du couple sans remettre en cause « le principe d’égalité devant la justice. » (335)
Afin de respecter effectivement ce principe, tout en répondant à la difficulté tenant au délai d’obtention de l’aide juridictionnelle, il serait souhaitable que l’ordonnance de protection des victimes (336) délivrée par le juge ouvre à la victime une saisine, en urgence, du bureau d’aide juridictionnelle.
B. DU BON USAGE DE LA MAIN COURANTE
L’exclusion de la pratique de la main courante en cas de violences conjugales, au profit d’une prise systématique de plainte, a été une question soulevée de façon récurrente tout au long des travaux de la mission.
1. La plainte, la main courante et le procès-verbal de renseignement judiciaire
La plainte est l’acte par lequel une personne porte à la connaissance du procureur de la République, d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie une infraction dont elle s’estime être victime.
L’article 15-3 du code de procédure pénale fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes déposées par les victimes. Depuis 2000 (337), un guichet unique a été instauré, qui oblige tout service ou toute unité, même territorialement incompétent, qui a reçu une plainte de le transmettre au service compétent. Cette possibilité est importante car elle permet aux victimes de se rendre dans le lieu de leur choix pour déposer plainte, sans risquer de rencontrer l’auteur des violences.
Néanmoins, la victime ne souhaite pas toujours déposer plainte. Sa démarche pourra dans ce cas se traduire par :
— Le dépôt d’une main courante, si elle se trouve dans un commissariat. Le Guide de l’action publique la présente ainsi : « La main courante est une simple déclaration qui peut être faite auprès de tout service de la police nationale ; les faits relatés sont consignés sur un registre ou de manière informatisée. En principe, le dépôt d’une main courante ne donne lieu à aucune enquête, ni à aucun suivi judiciaire. Ce procédé sert donc essentiellement à laisser une trace écrite d’un événement que la victime a subi, document susceptible d’être utilisé en cas de procédure judiciaire ultérieure. Il contribuera alors à retracer l’historique des violences au sein du couple. » (338) ;
— L’établissement d’un procès-verbal de renseignement judiciaire si elle se trouve dans une gendarmerie. Le principe est le même que pour le dépôt d’une main courante avec une différence importante : le procès-verbal de renseignement judiciaire est systématiquement transmis à l’autorité judiciaire, c'est-à-dire au parquet.
a. De nombreux arguments militent en faveur de la suppression de la main courante
Depuis de nombreuses années, les associations de femmes souhaitent que le recours à la main courante soit exclu dans les cas de violences conjugales au motif que :
— le dépôt d’une main courante est dépourvu de toute conséquence juridique. Il s’agit d’un simple enregistrement qui n’a pas valeur de preuve.
— les policiers sont parfois tentés de pousser les femmes victimes de violences à ne déposer qu’une main courante, car ils estiment que les faits qu’elles sont subies ne sont pas importants. Mme Anne Jonquet, avocate, a même témoigné du fait que parfois, « les policiers exercent une forme de chantage auprès de la victime en lui disant que si elle porte plainte, son mari ira en prison. Or un conjoint, même réitérant, ne va pas en prison, sauf s’il a commis un acte d’une particulière gravité. Mais la peine encourue étant effectivement une peine d’emprisonnement, cette présentation des conséquences de la plainte est un frein à son dépôt, en raison des enjeux personnels et familiaux. » (339)
— le dépôt d’une main courante serait même susceptible de porter atteinte aux intérêts de la victime. Mme Marie-Christine Leroy, vice-présidente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué à la mission, au cours de son déplacement à Marseille, que les mains courantes semaient le trouble quant à la crédibilité des faits qui y sont rapportés et qui souvent, ne sont pas suffisamment étayés. Ces mains courantes sont d’ailleurs fréquemment utilisées pendant les procédures de divorce, ce qui jette un doute quant au crédit à leur accorder et peut nuire à la femme qui l’a déposée.
Certains parquets comme celui de Douai ont prescrit aux services de police et de gendarmerie de ne plus prendre de main courante : pour chaque infraction, le parquet est informé et une enquête est réalisée.
b. Mais celle-ci peut constituer une étape vers l’accès au droit
Bien que la mission soit fortement sensible à ces arguments, elle considère que la suppression totale de la possibilité de déposer une main courante dans les affaires de violences conjugales n’est pas toujours de nature à servir les intérêts de la victime. Si une victime ne souhaite absolument pas déposer plainte, aucune trace des faits allégués ne sera alors gardée, ainsi que l’a indiqué Mme Maryvonne Chapalain, commandant à la Délégation aux victimes (DAV) : « si nous insistons trop pour que les victimes déposent une plainte sans leur laisser la possibilité de faire une déclaration en main courante, elles risquent de ne rien faire du tout, et aucune trace ne subsistera alors des violences subies ! » (340)
D’une part, le dépôt d’une main courante est souvent la première étape dans la démarche qui conduit une femme victime de violences au sein de son couple à les signaler. « L’inscription sur la main courante est une étape de transition et une femme qui quitte un conjoint violent procède par étapes. Celles-ci sont nécessaires car les femmes sous emprise sont terriblement culpabilisées. » (341) C’est également ce qui ressort d’une enquête mentionnée par M. Christophe Soullez qui en a explicité ainsi les résultats : « Par ailleurs, une étude qualitative en cours sur la main courante informatisée nous a permis de constater qu’un certain nombre de victimes ne tiennent pas d’emblée à porter plainte mais souhaitent simplement qu’il soit pris acte des premières manifestations de violence à leur encontre. » (342)
Il est donc important que les victimes puissent laisser une trace des violences qu’elles ont subies, y compris si elles ne désirent pas déposer plainte. Cette étape pourra être rappelée lors des phases ultérieures, si la victime souhaite ensuite porter plainte. C’est ce que prévoit le Guide de l’action publique, qui incite les procureurs à être plus sévères avec les mis en cause qui présentent des antécédents, dont des signalements par main courante (343).
Par ailleurs, les réticences de certaines femmes pourtant victimes de violence sont telles, qu’elles risquent de ne plus du tout s’adresser aux forces de police et de gendarmerie si leur démarche se traduit par une plainte qu’au fond elles ne souhaitent pas. Si chacun a la possibilité de déposer plainte (et si les forces de l’ordre ont alors l’obligation de la recueillir), il n’en reste pas moins que nul ne peut être forcé à déposer plainte. L’accord de la victime est en effet la voie principale conduisant à l’engagement d’une procédure judiciaire, à l’exception des cas de flagrant délit. Ce principe a été rappelé par M. Serge Portelli, vice-président du TGI de Paris : « c’est un droit de la personne de ne pas déposer plainte. » (344)
2. Un ensemble de bonnes pratiques doit entourer l’exception que doit être le recours à une main courante
a. Des bonnes pratiques indispensables…
S’il faut admettre que la main courante peut parfois servir les intérêts de la victime, des bonnes pratiques doivent absolument encadrer cette procédure.
— Les victimes doivent être systématiquement incitées à déposer plainte.
« Le refus d’entraîner des suites judiciaires doit émaner de leur volonté et non selon de celle d’un fonctionnaire de police » (345). Cette préoccupation de Mme Maryvonne Chapalain doit être centrale dans le dépôt des mains courantes. Si la victime persiste à ne pas vouloir déposer plainte, les policiers et les gendarmes doivent expliciter la différence existant entre les procédures. Il doit être inscrit à la fin de la main courante ou du procès-verbal le fait que la victime ne souhaite pas déposer plainte et qu’elle est consciente qu’aucune poursuite ne sera engagée sur le fondement du document qu’elle signe.
Cette orientation de politique pénale est retenue par le Guide de l’action publique, qui préconise le dépôt de plainte à titre principal et, à titre subsidiaire, la prise d’une main courante (346).
— La main courante doit être systématiquement transmise au magistrat référent du parquet
Plusieurs politiques pénales coexistent quant à la transmission des mains courantes au parquet. Le Guide de l’action publique recommande aux policiers et aux gendarmes de transmettre à la permanence du parquet les mains courantes quand « les faits sont d’une grande gravité » (347), en raison de leur répétition ou de leur nature. D’autres parquets demandent que les mains courantes leur soient systématiquement adressées. C’est le cas notamment du parquet d’Albi, ainsi que l’a indiqué M. Pascal Suhard, qui y est vice-procureur (348).
Comme cela a été dit, les procès-verbaux de renseignement judiciaire, qui sont dressés par la gendarmerie, sont systématiquement transmis à l’autorité judiciaire. La mission recommande de prendre exemple sur cette procédure, en systématisant la transmission des mains courantes au Procureur de la République (ou au magistrat spécialisé du parquet), qui appréciera l’opportunité d’engager des poursuites, en évitant une déperdition d’informations trop importante.
— La prise d’une main courante ou d’un procès-verbal doit systématiquement s’accompagner d’une orientation vers les associations spécialisées
Si la mission préconise le maintien, à titre d’exception, de la main courante, c’est que cette dernière peut constituer une première étape, avant un dépôt de plainte. Il est alors nécessaire de profiter de ce premier passage de la victime dans un commissariat pour l’orienter vers les associations spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes de violences qui pourront l’accompagner pour lui permettre de mettre fin aux violences qu’elle subit.
Cette recommandation ne figure dans le Guide de l’action publique qu’en cas de « souffrance manifeste de la victime » (349). Il est nécessaire de généraliser cette orientation précoce des victimes, quelle que soit la perception de leur situation que puissent avoir les policiers ou les gendarmes.
Elle s’opère selon diverses modalités en fonction des parquets. Le Procureur de la République d’Évry a indiqué à la mission qu’il entendait mettre en place un aiguillage systématique des femmes victimes de violences vers les services sociaux. Dans le Nord, des travailleurs sociaux interviennent en commissariat pour analyser les mains courantes et apprécier si elles montrent des signes de gravité (350). À Vitry-sur-Seine, un psychologue « tourne sur les différents commissariats, il consulte les plaintes et les mains courantes (avec l’accord du Procureur de la République). Il analyse les situations et peut recontacter les victimes. » (351)
— Les policiers doivent reprendre contact avec la victime peu après la prise de la main courante ou du procès-verbal
Pour instaurer un lien de confiance et vérifier que les violences ne se sont pas reproduites, il est de bonne pratique de reprendre contact avec la victime 48 heures après le dépôt de la main courante. Cette procédure est recommandée par les instructions du ministère de l’Intérieur, ainsi que l’a expliqué Mme Maryvonne Chapalain (352), sans être appliquée partout.
Toutes ces bonnes pratiques supposent que policiers et les gendarmes reçoivent une formation adéquate.
Proposition n° 33 :
Encadrer la prise des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire par des règles strictes :
— Les victimes doivent être systématiquement incitées à déposer plainte ;
— La main courante doit être systématiquement transmise au magistrat référent du parquet ;
— Le dépôt d’une main courante ou d’un procès-verbal doit systématiquement s’accompagner d’une orientation vers les associations spécialisées ;
— Les forces de l’ordre doivent reprendre contact avec la victime peu après la prise de la main courante ou du procès-verbal.
b. …qui contribueront à l’augmentation du taux de plainte
Suite aux instructions données par le ministère de l’Intérieur, à une meilleure formation des agents et à la diffusion du Guide de l’action publique, le recours aux mains courantes tend à diminuer au profit d’une augmentation du nombre de plaintes. Cette tendance est particulièrement visible à Paris où les deux courbes se sont croisées en 2004.
NOMBRE DE PLAINTES ET DE MAINS COURANTES ENREGISTRÉES À PARIS DANS DES AFFAIRES DE VIOLENCES CONJUGALES (2000-2007)
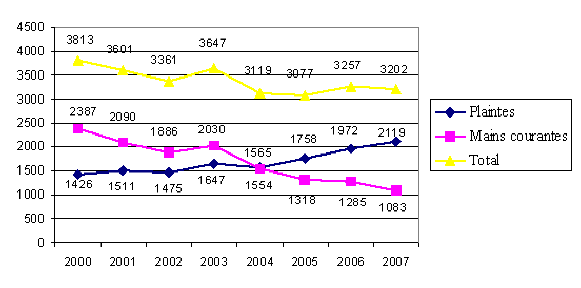
Source : Préfecture de police de Paris
Le rapport d’évaluation du premier plan global triennal note cette tendance dans de nombreux départements (353). Elle doit être encouragée afin que le dépôt de plainte devienne la norme.
II. LES MENACES SPÉCIFIQUES PESANT SUR LES VICTIMES ÉTRANGÈRES, QUI LES RETIENNENT DE DÉPOSER PLAINTE
« Les femmes de nationalité étrangère vivant en France sont particulièrement vulnérables, car elles rencontrent des obstacles pour se libérer des violences en raison de leur situation administrative. […] Ces difficultés sont accentuées car elles sont souvent isolées – en arrivant en France, elles n’ont pas de famille, pas d’ami –, elles ne maîtrisent pas toujours le français, et leur titre de séjour est précaire. » (354) a indiqué Mme Claudie Lesselier du Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE).
À ces éléments qui démultiplient les difficultés que ces femmes rencontrent pour contacter une association, s’adresser à la police, voire quitter le domicile, s’ajoute la crainte pour celles qui ont obtenu leur titre de séjour en raison du regroupement familial, de perdre ce droit en cas de rupture de la cohabitation. Des avancées législatives ont permis de limiter ce risque. En revanche, pour les femmes en situation irrégulière, faire cesser les situations de violences se heurte à de vrais obstacles.
A. LES MESURES PRISES POUR MAINTENIR LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR DOIVENT ÊTRE APPROFONDIES
1. L’accès au droit des femmes étrangères victimes de violences conjugales s’est amélioré
Selon le droit commun des règles de séjour des étrangers en France, le droit au séjour des conjoints de français et des conjoints d’étrangers entrés au titre du regroupement familial peut être remis en cause en cas de rupture de la vie commune. Selon les articles L. 313-12 et L. 314-5-1 (355) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les conjoints de français et, selon l’article L. 431-2 pour les conjoints d’étrangers, le titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré en cas de rupture de la vie commune si l’une des conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existe plus.
Cette réglementation étant totalement inadaptée aux situations de violences conjugales puisque les femmes qui en sont victimes seraient fortement incitées à ne pas saisir la justice, sous la menace d’une obligation de quitter le territoire français, des règles spécifiques visant à faciliter leur accès au droit en tenant compte des situations de violences, ont progressivement été adoptées (356).
Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous, qui croise le statut de la femme victime (un régime spécifique résultant de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968) avec les trois situations possibles que sont la délivrance d’un premier titre de séjour, son renouvellement et son retrait.
VIOLENCES CONJUGALES ET DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR
Première délivrance |
Renouvellement |
Retrait | |
Conjointes de Français |
Obligation de délivrance en cas de violences conjugales (L. 313-12 al. 2) |
Possibilité de renouvellement en cas de violences conjugales (L. 313-12 al. 2) |
Pas de retrait possible (L. 313-12 al. 2 pour une carte temporaire de séjour et L. 314-5-1 pour une carte de résident) |
Conjointes d’étranger |
Obligation de délivrance en cas de violences conjugales (L. 431-2 al. 5). |
Possibilité de renouvellement en cas de violences conjugales (L. 431-2 al. 4) |
Pas de retrait possible (L. 431-2 al. 4 pour une carte temporaire de séjour et L. 431-2 al. 4 pour une carte de résident) |
Femmes relavant de l’accord franco-algérien |
_______ (357) |
Pas de disposition spécifique mais application par analogie des articles ci-dessus demandée par circulaire (358) |
______ (359) |
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative est obligée de délivrer un titre de séjour en cas de violences conjugales antérieures à l’obtention de celui-ci et qu’elle ne peut pas le retirer ou retirer la carte de résident d’une victime de violences conjugales qui se séparerait de son conjoint. En revanche, sa décision n’est pas liée en ce qui concerne son renouvellement. Pour les femmes victimes de mariages forcés ou de répudiation, les circulaires en vigueur incitent les préfets à utiliser leur pouvoir d’appréciation (360).
La situation de ces femmes a également été prise en compte par la pénalisation du vol entre époux, par la loi du 4 avril 2006, qui punit le vol de papiers d’identité. Cette pratique empêchait de nombreuses femmes de déposer plainte.
2. Mais des obstacles demeurent
Les associations de femmes étrangères regroupées au sein du collectif ADFEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes) ont souligné le fait que cette simple possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décohabitation du fait des violences engendrait des différences importantes de traitement entre préfectures.: « Quand nous exprimons notre opposition à l’usage par les préfets de leur pouvoir discrétionnaire, c’est parce qu’il permet trop d’arbitraire, soit d’une préfecture à l’autre, soit d’une personne à une autre. Nous connaissons deux femmes dont la situation est identique : l’une s’est vu renouveler son titre de séjour, l’autre pas. Pourquoi une telle disparité ? Nous souhaitons donc que la loi dispose dorénavant que le préfet « doit », et non pas « peut », renouveler le titre de séjour en cas de violences. » (361)
Dans sa réponse écrite aux questions de la mission, le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire a justifié le fait qu’aucune obligation ne pèse sur les préfets en précisant que : « Le législateur a toutefois entendu ne pas donner à l’autorité administrative une compétence liée dans ce domaine, pour laisser au préfet un pouvoir d’appréciation lui permettant de vérifier si les violences conjugales sont avérées. » Ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer selon les recommandations des différentes circulaires portant sur le renouvellement des titres de séjour et notamment celle du 30 octobre 2004, adressée aux préfets, qui indique : « Vous veillerez à faire une application diligente de ces dispositions, au vu des divers justificatifs qui pourront vous être produits (rapport des services de police, dépôt de plainte, attestations et témoignages issus de représentants d’administrations sociales ou du milieu associatif, certificats médicaux…) » (362).
Il paraîtrait justifié, afin de mettre fin à cette disparité dans le renouvellement des titres de séjour des femmes victimes de violences conjugales, d’aligner les conditions du renouvellement sur celles de la première délivrance et du retrait en transformant la possibilité qu’ont les préfets de renouveler le titre de séjour en obligation, si les violences conjugales sont constituées. Cette recommandation est également présente aux articles 43 et 44 de la proposition de loi-cadre du CNDF.
Proposition n° 34 :
Modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile afin d’accorder, sauf menace pour l’ordre public, le renouvellement du titre de séjour des femmes qui cessent la cohabitation parce qu’elles sont victimes de violences conjugales avérées.
D’autre part, afin de sécuriser la situation juridique de la victime de violences qui souhaite quitter son conjoint, il est nécessaire de lui garantir le plus en amont possible que, si elle prend cette décision, son titre de séjour pourra être renouvelé, au moins temporairement. Ainsi, la présentation en préfecture d’une ordonnance de protection des victimes (363) pourrait être une condition suffisante pour donner accès à la délivrance ou au renouvellement, au moins à titre provisoire, du titre de séjour. En effet, actuellement, aux dires des associations, les pièces demandées sont extrêmement variables d’une préfecture à l’autre. L’opposabilité de l’ordonnance de protection, qui serait délivrée par un juge, constituerait une réponse à cette diversité des appréciations portées sur une même situation.
B. LES DIFFICULTÉS DES VICTIMES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Les femmes victimes de violences qui sont en situation irrégulière ne bénéficient que de façon dérogatoire de l’aide juridictionnelle, la dénonciation des violences ne leur ouvre pas de droit au séjour et, du fait de leur situation, elles n’ont pas accès aux droits sociaux.
1. L’aide juridictionnelle est difficilement accessible
Selon l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont admises à l’aide juridictionnelle les personnes de nationalité étrangère qui résident « habituellement et régulièrement » en France. Les étrangers en situation irrégulière ne sont donc pas admissibles à l’aide juridictionnelle. Ce même article prévoit néanmoins que l’aide juridictionnelle peut leur être accordée si « leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. » Or, dans la procédure de divorce, par exemple, le ministère d’un avocat est obligatoire. Ainsi que l’a expliqué Mme Anne Jonquet, avocate, responsable de la permanence spécialisée du barreau de Bobigny : « Quant aux femmes sans papiers, si elles ont le droit de porter plainte, elles n’ont pas accès à la justice. N’ayant pas droit à l’aide juridictionnelle, elles n’ont pas le droit d’être défendues. J’ai essayé d’intervenir auprès des bureaux d’aide juridictionnelle en déposant des dossiers, qui ont été rejetés. » (364)
Il serait donc nécessaire d’ouvrir le droit à l’aide juridictionnelle à toute victime de violence qui en fait la demande, quelle que soit sa situation au regard de la régularité du séjour. La preuve de la situation de violences, qui permettrait de demander l’aide juridictionnelle pourrait être constituée par la présentation de l’ordonnance de protection. Cette recommandation rejoint l’idée qui sous-tend l’article n° 38 de la proposition de loi-cadre du CNDF.
Proposition n° 35 :
Ouvrir le droit à l’aide juridictionnelle aux femmes en situation irrégulière victimes de violences.
2. Les conséquences de la dénonciation des violences sur la régularité du séjour sont incertaines
Les femmes en situation irrégulière qui sont victimes de violences se trouvent aujourd’hui dans la même situation que les femmes arrivées en France au titre du regroupement familial, avant les lois de 2003, 2006 et 2007 : leurs conditions de séjour constituent un obstacle rédhibitoire au dépôt de plainte puisqu’elles risquent de devoir quitter le territoire français en cas de dénonciation des violences qu’elles subissent.
Aucun dispositif n’étant prévu, elles ne peuvent que demander une mesure humanitaire de la part du préfet, qui est accordée si leur situation est digne d’intérêt, au regard des éléments de situation qu’elles présentent.
La seule situation de violence actuellement prise en compte par la loi est celle des victimes de la traite des êtres humains. En effet, le CESEDA prévoit qu’en cas de dépôt de plainte par une victime de traite des êtres humains, une carte de séjour temporaire lui est délivrée à condition qu’elle coopère avec les autorités de police et de justice. En cas de non-coopération, notamment par peur de représailles, la circulaire du 5 février 2009 demande aux préfets de faire usage de leur pouvoir d’appréciation.
Or, la situation dramatique que vivaient certaines femmes a été soulignée : « Certaines ne portent pas plainte par manque de connaissance de leurs droits, mais elles sont aussi confrontées à certaines pratiques policières. En venant au commissariat ou à la gendarmerie, certaines sont menacées d’interpellation au regard de leur situation, parfois insultées – « comment peut-on déposer plainte contre un ressortissant français ! […] Il est très difficile pour ces femmes d’aller au commissariat, d’être en confiance, d’arriver à expliquer leur situation, de porter plainte contre leur conjoint ou une personne de la famille, ou tout simplement de se voir remettre une photocopie de leur plainte. » (365) a ainsi indiqué Mme Violaine Husson, de la Cimade.
Quelle que soit leur situation à l’égard de la régularité du séjour, il n’est pas normal que des femmes victimes de violences ne puissent les faire cesser et faire valoir leurs droits. La mission propose donc que les victimes de violences au sein du couple puissent bénéficier d’un titre de séjour, au moins provisoire, en cas de dépôt de plainte, l’ordonnance de protection établissant la preuve des violences. Un titre de séjour définitif pourrait être délivré si les violences sont avérées (c'est-à-dire en cas de condamnation définitive).
Proposition n° 36 :
Accorder un titre de séjour aux personnes en situation irrégulière qui portent plainte pour violences au sein du couple.
3. La femme victime risque de perdre son accès aux droits sociaux
« Une femme qui se sépare de son conjoint, concubin ou mari à la suite de violences conjugales, si elle est sans titre de séjour ou se le voit retirer, perd ipso facto tous les droits que lui ouvrait la vie commune, notamment les prestations familiales et l’accueil de ses enfants dans des structures collectives. L’accès à des structures d’hébergement est très limité.» (366) a indiqué Mme Élisabeth Zucker du Réseau Éducation sans Frontières (RESF). En effet, les femmes victimes de violences qui quittent leur conjoint qui se trouvait en situation régulière perdent l’ensemble des droits sociaux qui découlaient de cette situation.
Certaines banques, malgré l’obligation légale, refusent d’ouvrir un compte en banque à ces femmes, les allocations familiales continuent à être versées au conjoint violent et les femmes victimes ont du mal à trouver un logement. Ainsi que l’a expliqué Mme Nicole Blaise, directrice du Relais de Sénart, rien ne fait obstacle à ce que des femmes en situation irrégulière ne soient accueillies dans des structures d’hébergement d’urgence. En revanche, leur relogement est très difficile dans la mesure où les personnes en situation irrégulière n’ont pas accès au logement social. Enfin, une menace pèse aussi sur la garde des enfants : « quand un homme veut se débarrasser de sa femme, non seulement il la met dehors après l’avoir battue, mais il peut la dénoncer à la préfecture ou porter plainte contre elle. Nous connaissons des cas où une enquête sociale a été lancée par l’Aide sociale à l’enfance et, la femme n’ayant pas de ressources ni d’hébergement stable, l’aide sociale à l’enfance a voulu lui retirer ses enfants pour les placer. » a indiqué Mme Élisabeth Zucker. Cette situation a été résumée ainsi par Maître Anne Jonquet : « Ces femmes n’ont droit ni à un logement, ni à un travail ni à des allocations. Sans ressources, elles sont, avec leurs enfants, dans une très grande précarité et n’ont droit qu’au 115, le numéro d'urgence sociale anonyme et gratuit. » (367)
Ces difficultés constituent également un frein important à toute rupture de la vie commune.
III. LA DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, « ÉPÉE DE DAMOCLÈS » AU DESSUS DE LA TÊTE DES VICTIMES
La crainte d’une condamnation pour dénonciation calomnieuse retient, selon les associations entendues, de nombreuses femmes victimes, notamment de violences sexuelles, de déposer plainte. Ce délit constituerait en effet une « épée de Damoclès » suspendue au-dessus de leur tête, selon les termes employés par Maître Anne Jonquet (368). L’AVFT qui demande, de longue date, la modification du délit de dénonciation calomnieuse (369) juge, quant à elle, que son existence « bâillonne les victimes de violences sexuelles » (370).
A. LE DISPOSITIF EXISTANT EST SUSCEPTIBLE DE PORTER PRÉJUDICE AUX VICTIMES
Le délit de dénonciation calomnieuse dans sa rédaction actuelle n’est pas entièrement satisfaisant car il est susceptible de porter préjudice à certaines victimes, notamment victimes de violences sexuelles.
1. Les conditions d’application du délit de dénonciation calomnieuse
Le délit de dénonciation calomnieuse est défini à l’article 226-10 du code pénal, qui comporte trois alinéas. Le premier le décrit et expose les peines encourues : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
Le deuxième et le troisième alinéas précisent ses modalités d’application, selon que la plainte pour dénonciation calomnieuse fait suite à une décision précédente ou pas : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
« En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
a. La nécessité d’un élément matériel et d’un élément moral
La jurisprudence et la doctrine s’accordent pour voir dans le premier aliéna de l’article 226-10 l’exigence de deux conditions pour que soit établi le délit de dénonciation calomnieuse :
— Un élément matériel : la dénonciation doit être spontanée et porter sur un fait inexact ;
— Un élément moral : le dénonciateur doit avoir connaissance de la fausseté du fait qu’il dénonce.
L’élément matériel peut être présumé, en cas de « décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. » Cette présomption portant sur l’élément matériel est irréfragable car la fausseté du fait dénoncé résulte « nécessairement » d’une telle décision.
En revanche, la présomption ne porte pas sur l’élément moral de l’infraction. Les juges du fond sont donc tenus de motiver leur décision au regard de la mauvaise foi de la personne dénonciatrice. C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2003 : « si en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur » (371). Dans tous les cas, y compris si le deuxième alinéa de l’article s’applique, la preuve de la mauvaise foi de la dénonciatrice est nécessaire à sa condamnation pour dénonciation calomnieuse.
b. La présomption de fausseté s’applique-t-elle pour toute décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu ?
Deux hypothèses posent problème : celui des non-lieux fondés sur l’insuffisance de preuves et celui des relaxes au bénéfice du doute.
Plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation estiment que les décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute, suffisent à déclencher la présomption de fausseté du fait dénoncé. Elle a ainsi cassé, en 1993, puis en 1996, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fondé son refus de condamnation pour dénonciation calomnieuse sur le fait que le doute empêchait de considérer que la réalité du fait était établie (372). Ainsi que l’a expliqué M. Didier Guérin, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, « les juges du fond avaient estimé que, comme il y avait doute, la fausseté des faits n’était pas établie. La chambre criminelle a cassé le jugement en retenant une interprétation restrictive. » (373)
Il en va de même des ordonnances de non-lieu pour charges insuffisantes, bien que la Cour de cassation ne se soit pas, semble-t-il, prononcée sur le sujet. C’est ce qu’a jugé le TGI de Melun le 28 juin 2005.
En revanche, le classement sans suite n’établit plus (depuis la réforme du code pénal) la fausseté du fait dénoncé et ne peut donc plus déclencher la présomption.
2. Un délit fortement critiqué par les associations de femmes
Les associations luttant contre les violences faites aux femmes, et en particulier contre les violences sexuelles, dénoncent des situations qui réduisent fortement la détermination des victimes à déposer plainte.
a. Une injustice faite aux victimes, qui remet en cause la présomption d’innocence
En l’état actuel du droit, les femmes victimes de violences subissent une double injustice.
— Les conditions du deuxième alinéa de l’article 226-10 sont différemment interprétées par la jurisprudence
Selon la lettre du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, la présomption de fausseté du fait dénoncé ne devrait jouer que si « la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu » déclare effectivement « que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ». Les décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute et celles de non-lieu pour charges insuffisantes ne devraient donc pas déclencher cette présomption. Selon la doctrine, la chambre criminelle de la Cour de cassation « édulcore », voire « ignore » (374) cette condition qui est pourtant présente à cet alinéa.
— La présomption portant sur l’élément matériel peut induire une présomption portant sur le délit dans son ensemble
Selon la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la présomption ne porte que sur la fausseté des faits dénoncés et non sur la connaissance que peut avoir la personne qui les dénonce de leur fausseté. La preuve de cette connaissance doit ainsi être faite par l’accusation (375).
Cependant, dans certaines circonstances, l’élément moral découle de la nature même des faits en question. Comment une femme qui a dénoncé un viol, qui, de manière irréfragable n’a pas eu lieu (pour peu qu’une décision définitive ait été rendue), peut-elle être considérée comme étant de bonne foi ? Comment peut-elle ne pas avoir eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés ? Cet argument a été soulevé par Mme Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) : « [le fait de distinguer élément matériel et élément moral] est satisfaisant dans le cas d’un harcèlement sexuel qui a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu. Le juge peut motiver sa décision de relaxer l’intéressée sur le chef de la dénonciation calomnieuse en disant qu’elle a porté plainte pour harcèlement sexuel, mais qu’elle a pu se tromper sur la nature des faits, confondant des tentatives de séduction maladroites avec du harcèlement sexuel, et qu’elle était donc de bonne foi lorsqu’elle a déposé plainte. Mais pour un viol, ce n’est plus possible : une femme qui a déposé plainte pour viol n’a pas pu s’être trompée. » (376)
Plusieurs jugements font effectivement découler l’élément intentionnel de la nature des faits en question. Ainsi un arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d’appel de Paris se fonde-t-il sur les considérations suivantes : « Mme K s’est plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, infractions qui touchent directement à la personne et à son intégrité physique. De par la nature même de ces infractions, Mme K ne pouvait se méprendre sur la réalité des faits allégués. » (377). Il en va de même de cet argument, issu d’un jugement du TGI de Melun du 28 juin 2005 : « En l’espèce, il suffit de constater que NR et CM dénonçaient des faits commis directement sur leur personne et que dès lors elles ne pouvaient en ignorer la fausseté. » (378) Cette jurisprudence n’est peut-être pas celle de tous les tribunaux (Maître Anne Jonquet a, par exemple, indiqué que peu de condamnations pour dénonciation calomnieuse étaient prononcées dans le ressort de son tribunal (379)), mais elle existe.
Afin d’illustrer les conséquences que peut engendrer l’enchaînement de ces diverses considérations, Mme Marylin Baldeck a cité l’exemple suivant : « Une femme a déposé une plainte, par exemple pour agression sexuelle. Le Parquet estime avoir suffisamment d’éléments pour renvoyer l’affaire devant le tribunal. Cette femme a été réellement agressée. Mais le tribunal prend une décision de relaxe pour charge insuffisante et au nom de la présomption d’innocence de la personne mise en cause. Cette dernière, non contente d’avoir été relaxée de cette plainte, dépose elle-même une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ce jugement de relaxe, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, sert d’élément matériel duquel découle un élément intentionnel. C’est une grave violation de la présomption d’innocence de la femme alors mise en cause. Il est fondamentalement injuste qu’elle n’en bénéficie pas, au même titre que la personne qu’elle avait mise en cause, et qui en avait bénéficié lors du premier procès. » (380)
Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’article 226-10 était compatible avec les articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), relatifs, respectivement, au procès équitable et à la présomption d’innocence car la décision qui engendre la présomption résulte d’un procès équitable. Par ailleurs, une plaignante a saisi la CEDH, qui devra se prononcer sur la conformité de l’article 226-10 à la convention.
b. Des effets dissuasifs sur la volonté de déposer plainte
Cette règle peut donc constituer un obstacle important au dépôt de plainte. De nombreuses personnes auditionnées par la mission ont souligné le fait que les femmes victimes redoutaient particulièrement d’être, en cas d’échec de leur plainte, poursuivies pour dénonciation calomnieuse.(381) L’impact sur le taux de dépôt de plainte de ce risque est certain ainsi que l’a indiqué Mme Marilyn Baldeck au cours de son audition : « Lorsque nous avons commenté sur notre site Internet l’existence de ce délit et la manière dont le texte était rédigé, notre permanence téléphonique a été submergée d’appels de femmes victimes de violences qui nous ont dit que, dans ces conditions, elles préféraient se taire. Le risque est trop grand et elles ne voulaient pas, en plus d’avoir été violées, être condamnées pour dénonciation calomnieuse. » (382)
B. LE DÉLIT DE DÉNONCIATION CALOMNIEUSE DEVRAIT ÊTRE MODIFIÉ POUR MIEUX CONCILIER AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE ET PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Afin d’éviter les condamnations de femmes victimes qui n’ont pas obtenu gain de cause lors du procès, le doute profitant à l’accusé, et permettre de les inciter un peu plus à porter plainte, il est donc nécessaire de réfléchir à une réécriture du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal. C’est également ce que recommande le rapport d’évaluation du premier plan global triennal : « Une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur l’incrimination de dénonciation calomnieuse qui est de plus en plus souvent utilisée par les auteurs de harcèlement sexuel pour se retourner contre leur victime lorsqu’elle n’a pas pu obtenir gain de cause, faute, par exemple, de preuves jugées suffisantes. » (383)
Cette redéfinition partielle du délit devra concilier autorité de la chose jugée et présomption d’innocence.
1. La suppression du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal remettrait trop en cause l’autorité de la chose jugée
De nombreuses associations et organismes demandent la modification du délit de dénonciation calomnieuse, notamment par la suppression du deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal laissant alors le juge se fonder sur le troisième alinéa qui dispose : « En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » (384) Un amendement en ce sens avait déjà été déposé au Sénat puis retiré par Mme Gisèle Gautier, présidente de la Délégation aux droits des femmes lors de la discussion de la loi du 4 avril 2006.
Il ne semble pas opportun de remettre en cause de manière aussi manifeste l’autorité de la chose jugée. Supprimer complètement le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal reviendrait à pouvoir refaire le procès de la personne mise en cause. De surcroît, dans les cas où la personne initialement accusée est de bonne foi, il est essentiel qu’elle puisse, sans craindre de voir son innocence contestée, engager une action pour dénonciation calomnieuse.
Pour ces raisons de fond, il ne semble pas possible de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de cet article.
2. Le délit de dénonciation calomnieuse doit néanmoins être modifié
Pourtant, il est également indispensable de réaffirmer la présomption d’innocence de la personne qui est visée par une plainte pour dénonciation calomnieuse afin que le doute qui profite au mis en cause qui a bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute ou d’une ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes, lui profite de la même manière.
La mission considère que le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal devrait donc, de manière non équivoque, exclure ces hypothèses du déclenchement de la présomption de fausseté des faits dénoncés. C’est ce qu’a suggéré M. Didier Guérin : « Il faudrait trouver une rédaction qui permette de dire que la présomption de la fausseté des faits n’existe pas lorsque le juge estime qu’il y a doute sur leur réalité. On éviterait, par cette voie, les plaintes systématiques de dénonciation calomnieuse car celui qui a été accusé s’exposerait à un nouveau débat sur la même question. J’y verrais, en tant que membre de la chambre criminelle, un moindre inconvénient et même, à titre personnel, un avantage car je trouverais dommage d’abroger purement et simplement cet alinéa. »
De cette manière, les juges du premier procès pourraient, en relaxant le mis en cause au bénéfice du doute ou en rendant une ordonnance de non-lieu pour défaut de charges, avoir la certitude que leur décision, fondée sur le respect de la présomption d’innocence, ne pourra pas servir de fondement à une présomption d’existence de l’élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse.
Proposition n° 37 :
Modifier la définition du délit de dénonciation calomnieuse afin que le juge puisse apprécier l’élément matériel du délit en cas d’acquittement ou de relaxe au bénéfice du doute, ou de non-lieu prononcé pour insuffisance de charges.
QUATRIÈME PARTIE : MIEUX ASSURER LA PROTECTION ET LE SUIVI DES VICTIMES
La protection des victimes est le corrélatif nécessaire de la répression des violences faites aux femmes, non seulement parce qu’elle doit constituer une priorité pour les autorités publiques, mais aussi parce qu’elle conditionne l’accès au droit. En effet, le fait qu’une victime pense que sa protection ne pourra pas être assurée en cas de dépôt de plainte constitue un frein puissant au signalement des violences.
Des progrès ont été accomplis dans la protection de la sécurité physique et matérielle des victimes à travers des dispositifs tels que l’éviction du conjoint violent.
Néanmoins, certains droits qui peuvent être ouverts aux victimes, notamment en matière de logement ou d’aide juridictionnelle, sont encore difficiles d’accès. La mission propose donc la création d’un document unique, l’ordonnance de protection des victimes, qui serait prise par un juge et qui attesterait, pour une période donnée, de la situation de violences. Ce document serait opposable aux divers acteurs susceptibles d’aider les victimes.
Chapitre I : Renforcer les dispositifs garantissant la sécurité des victimes
La période de la séparation a été identifiée comme étant particulièrement propice aux formes les plus extrêmes de violences.
L’occupation du logement et l’exercice du droit de garde sont deux des occasions principales qui peuvent occasionner de graves violences. L’éviction du conjoint violent et la mise en œuvre de rencontres médiatisées constituent des progrès mais qui peinent à être mis en œuvre faute de moyens.
Enfin, une attention particulière doit être accordée à la protection des femmes menacées dans leur pays d’origine.
I. L’ÉVICTION DU CONJOINT VIOLENT, UNE AVANCÉE QUI PEINE À ÊTRE MISE EN œUVRE
L’éviction du conjoint violent, possible désormais au civil comme au pénal, était une revendication ancienne des associations de femmes. Cette mesure permet à la femme victime de violences de conserver le bénéfice du domicile conjugal en attendant un jugement définitif. Cependant, la mise en œuvre de cette procédure se heurte encore à des obstacles importants.
A. LA PROCÉDURE D’ÉVICTION DU CONJOINT VIOLENT POSSIBLE AU CIVIL COMME AU PÉNAL
La procédure d’éloignement du conjoint violent comporte de nombreuses garanties pour la victime et ses enfants, ce qui a conduit à en généraliser la possibilité, dans la procédure civile et dans la procédure pénale.
1. Les avantages attendus de l’éviction du conjoint violent sont nombreux et importants
L’éviction du conjoint violent permet l’inversion du rapport de force symbolique entre l’auteur et la victime par l’attribution du domicile familial à cette dernière. Il ouvre aussi la possibilité de provoquer un choc psychologique, chez l’auteur des violences.
a. Inverser le rapport de force entre auteur et victime
L’éviction du conjoint violent permet une inversion symbolique du rapport de force entre la victime et l’auteur. Alors que jusqu’en 2004, la victime devait obligatoirement fuir le domicile familial, au moins dans un premier temps, pour mettre fin à la situation de violences, elle peut désormais saisir le juge en urgence pour faire évincer son conjoint et conserver le bénéfice du domicile. Est ainsi évitée « la double peine des violences et de l’errance résidentielle » (385).
Cette faculté de conserver le domicile familial est d’autant plus importante que les possibilités d’hébergement et de relogement sont, dans certains territoires, rares et parfois peu adaptées à l’accueil de la victime et de ses enfants (386). Par ailleurs, évincer le conjoint violent permet de mieux prendre en compte les intérêts des enfants, qui ne se voient pas contraints de changer de domicile et d’école.
b. Initier un processus de suivi de l’auteur
L’éviction du conjoint violent du domicile conjugal doit engendrer, chez l’auteur, un choc psychologique qui lui fasse prendre conscience de la gravité de ses actes. Tel est l’effet recherché par le procureur de la République de Douai, M. Luc Frémiot, qui a initié dans le ressort de son tribunal, cette procédure : « Si [l’auteur] n’a pas déjà été condamné, il est placé dans un foyer de sans domicile fixe, afin de l’éloigner du domicile conjugal. Il est en effet inacceptable que les femmes victimes de violences soient obligées de partir, parfois en pleine nuit et avec leurs enfants, à la recherche d’une solution d’accueil qui de surcroît n’est jamais satisfaisante. Ce sont les agresseurs qui doivent s’en aller. Dans un foyer d’hébergement, ils sont soumis à un choc psychologique qui va leur permettre de se remettre en question. […] Pendant la durée du séjour, les auteurs de violence sont confrontés à la dure vie du foyer. Ceux qui travaillent sont obligés d’y passer la nuit. Ils doivent participer aux tâches ménagères. Bien entendu, ils ont interdiction de communiquer avec la famille. » (387)
Quand elle est prononcée dans le cadre d’une procédure pénale, l’éviction du conjoint violent est donc le moment privilégié pour initier un suivi de l’auteur, dans le cadre, par exemple, d’un contrôle judiciaire. Telle est la pratique qu’a développée M. Luc Frémiot, en couplant systématiquement (dans la mesure du possible (388)) éviction et suivi de l’auteur : « Des éducateurs spécialement formés sont présents, et posent les questions destinées à faire réfléchir les auteurs et à les sortir de leur attitude de déni. […] Pendant la dizaine de jours qu’y dure le placement, les éducateurs amènent ces hommes à prendre conscience de l’écart démesuré qui sépare les conséquences de leurs actes et les circonstances qui les ont amenés. » (389)
2. L’éviction est possible à tous les stades de la procédure
Les possibilités d’éviction du conjoint violent ont été consacrées par la loi et sont désormais nombreuses et possibles à divers moments de la procédure pénale.
a. Une éviction possible au civil…
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a introduit dans le code civil la possibilité d’évincer le conjoint du domicile familial en cas de violences, au moyen d’un « référé-violences » (390).
La victime de violences peut donc saisir en urgence le juge aux affaires familiales, avant même de déposer une requête en divorce si deux conditions sont réunies : l’urgence et la mise en danger du conjoint ou d’enfants. Cette condition peut ne pas être remplie, comme l’a jugé la Cour de cassation, quand l’épouse se trouve « en état de choc à la suite d’une explication entre conjoints » (391).
Cette mesure d’éviction est donc conçue comme une mesure de protection de la victime et des enfants. Dans le cadre de son ordonnance de référé, le juge dispose d’un pouvoir relativement large pour régler de manière provisoire la situation du couple. Il peut en effet :
— Attribuer la jouissance du domicile à l’un des deux époux, qui est, sauf circonstances particulières, la victime des violences. L’exécution de cette attribution est dérogatoire par rapport au droit commun de l’expulsion : conformément à l’article 66-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois accordé à la personne qui doit être expulsée n’est pas applicable, l’expulsion peut avoir lieu durant la période hivernale et l’impossibilité de reloger la personne expulsée ne peut y faire obstacle ;
— Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il pourra ainsi statuer sur les périodes de résidence auprès de chacun des parents ;
— Fixer une contribution aux charges du mariage, afin d’assurer, notamment, l’autonomie financière de la personne victime de violences, en attendant le divorce.
Néanmoins, les pouvoirs ainsi conférés au juge aux affaires familiales, qui rend sa décision dans l’urgence, sont contrebalancés par le caractère temporaire de ses décisions, qui deviennent caduques de plein droit à l’issue d’un délai de quatre mois si aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.
b. …comme au pénal, à tous les stades de la procédure
L’éviction du conjoint, concubin ou ex, auteur de violences, a été introduite dans la procédure pénale par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences commises au sein du couple et contre les mineurs.
Elle est possible à tous les stades de la procédure pénale, dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve et donc de toute autre mesure d’aménagement de peine (392). Cette mesure d’éviction peut également s’accompagner de l’ordre de s'abstenir de paraître au domicile et d’être pris en charge sur le plan sanitaire, sociale ou psychologique.
La mise en œuvre de l’éviction doit se faire dans le cadre des bonnes pratiques mentionnées par le Guide de l’action publique : « Les modalités de récupération par le mis en cause de ses effets personnels au domicile familial doivent également faire l’objet de la plus grande attention, afin que la victime ne soit pas confrontée à son agresseur. Il est ainsi possible de déléguer un tiers à cette tâche, de le faire à un moment où la victime est absente du domicile ou que les forces de l’ordre accompagnent le mis en cause. » (393)
L’arsenal juridique existant est donc satisfaisant et permet, s’il est utilisé, de répondre dans l’urgence à des situations de violences au bénéfice de la victime et de ses enfants.
B. LES DIFFICULTÉS DE SA MISE EN œUVRE
Cependant, de nombreuses personnes auditionnées par la mission ont souligné le fait que la mise en œuvre effective de l’éviction du conjoint violent se heurtait souvent à des difficultés pratiques. Le faible recours à cette procédure, bien qu’elle tende à se développer en témoigne.
1. La procédure d’éviction tend à être davantage appliquée
Grâce à l’article 13 de la loi du 4 avril 2006, qui prévoit que figure dans le rapport remis tous les deux ans au Parlement « le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple », ces données sont récoltées de manière trimestrielle auprès des juridictions (394), qui ne sont néanmoins pas toutes mobilisées sur cette question (le taux de réponse à cette demande d’information aurait diminué de 57 % à 35 % entre 2006 et 2008) (395).
a. Une lente augmentation au plan pénal
Entre le deuxième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2008, l’éviction a été prononcée dans 9,6 % des affaires qui auraient pu y donner lieu. Néanmoins, le prononcé au pénal de cette mesure semble être en augmentation, selon les chiffres mentionnés par la garde des Sceaux au cours de son audition : « instituée par la loi sur la récidive du 12 décembre 2005, l’éviction du conjoint en matière pénale a été prononcée dans 10 % des affaires en 2006, 13 % en 2008 et plus de 18 % depuis le début de l’année 2009. » (396)
Ces mesures sont prononcées dans les cas suivants.
RÉPARTITION DES MESURES D’EVICTION DU CONJOINT VIOLENT SELON LE STADE DE LA PROCÉDURE CONCERNÉ
Contrôle judiciaire |
Mesures alternatives aux poursuites |
Sursis avec mise à l’épreuve | |
Répartition des mesures d’éviction |
45 % |
18 % |
30 % |
Sources : audition de M. Jean-Marie Huet du 27 janvier 2009 et rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple, p. 27. Le total est de 93 % car les autres mesures d’éviction peuvent avoir été prises à d’autres phases de la procédure pénale.
DURÉE DES MESURES D’ELOIGNEMENT DU CONJOINT VIOLENT
Moins de deux mois |
Entre deux et six mois |
Plus de six mois | |
Pourcentage des mesures d’éloignement |
56 % |
16 % |
28 % |
Source : Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 104 et DGAC.
POURCENTAGE D’AFFAIRES DONNANT LIEU À UNE MESURE D’EVICTION SELON LA NATURE DE L’INFRACTION
Meurtre (397) |
Agression sexuelle |
Violences graves |
Violences légères | |
Pourcentage |
68 % |
26 % |
25 % |
8 % |
Sources : audition de M. Jean-Marie Huet du 27 janvier 2009 et rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple, p. 27.
Il est plutôt positif que les mesures d’éloignement du conjoint violent soient davantage prononcées durant la phase de contrôle judiciaire car cette pratique atteste du fait que cette mesure est utilisée principalement pour protéger la victime dans l’urgence. En revanche, le fait qu’elle ne soit prononcée que dans 25 % des cas de violences graves et dans 8 % des cas de violences légères montre qu’il reste une marge d’évolution importante pour parvenir à diffuser à l’ensemble du territoire national une utilisation plus systématique de cette procédure.
b. Une mesure très peu utilisée au civil
Un même constat a été dressé par les personnes interrogées par la mission : très peu de mesure d’évictions sont prononcées au civil. C’est par exemple ce qu’a expliqué Mme Anne Jonquet, responsable de la permanence spécialisée des avocats du barreau de Bobigny : « Je tiens à souligner également que la procédure du « référé violence » (…) est un échec, car elle ne remplit pas son rôle. Considérée à l’origine comme un progrès, elle est très peu utilisée. » (398)
Le même diagnostic a été fait lors des déplacements de la mission à Evry, où Mme Laetitia Muylaert, juge aux affaires familiales, a indiqué que le TGI d’Evry n’avait reçu que six demandes entre septembre 2008 et mars 2009, soit une par mois, dont trois ont effectivement entraîné l’éviction du conjoint violent et à Marseille, où Mme Marie-Christine Leroy, vice-présidente de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a également fait part du faible nombre d’évictions prononcées au civil.
Selon les informations fournies par la chancellerie, seules 469 demandes d’éviction ont été formulées en 2008.
2. Il faut lever les obstacles à son utilisation
De fait, si la mesure d’éloignement du conjoint violent est très peu utilisée au civil et si elle ne se diffuse que lentement au pénal, cela tient à plusieurs raisons, qui en rendent l’utilisation difficile.
a. Le souhait des victimes de quitter le domicile conjugal
La première limite à l’utilisation de cette procédure tient au fait que les victimes ne souhaitent pas toujours rester au domicile familial.
— La victime ne souhaite pas toujours rester sur le lieu des violences. C’est la principale raison expliquant son succès relatif selon l’enquête menée par MM. Pascal Suhard et François Dieu dans le ressort des TGI d’Albi et de Castres : « Alors que nous avions mis en place un dispositif d’éviction des conjoints violents en accordant des moyens à des associations, nous nous sommes demandé pourquoi ce dispositif ne fonctionnait toujours pas au bout de deux ans. L’enquête nous a fourni la réponse : sur 278 cas, un quart des couples avait repris la vie commune et 40 % des infractions n’avaient pas été caractérisées. Et à la question « a-t-on envie de vivre dans un endroit où l’on a été battu ? », il a été répondu « non » à un fort pourcentage, selon la responsable de la maison des femmes lors d’une commission. » (399). Ces situations ont été décrites par Mme Evelyne Reguig, de l’association VIFF SOS femmes : « La majorité des femmes concernées ne souhaitent pas rester dans leur logement, où elles ont vécu des choses difficiles qui continuent à les perturber et où elles subissent le regard des voisins et l’emprise de la famille, ce qui leur rend presque impossible de recommencer une autre vie. En outre, le comportement de l’homme violent, souvent lié à un territoire, peut être exacerbé par la perte de celui-ci. » (400)
— Pour des raisons de sécurité, il n’est pas toujours possible à la victime de rester dans un lieu connu de l’auteur.
Pour ces raisons, il ne saurait être question de systématiser l’éviction du conjoint violent. Cette procédure doit faire partie des possibilités à la disposition des victimes et des magistrats ainsi que l’indique la circulaire relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences (401), chaque situation étant à analyser au cas par cas. Ainsi que l’a indiqué le Docteur Roland Coutanceau, « dans certains cas – il appartient aux magistrats d’en décider – l’éviction n’est pas nécessaire, dans beaucoup d’autres, elle est utile, enfin, dans une troisième catégorie de cas, l’installation de la femme dans un lieu inconnu du conjoint violent est extrêmement adaptée. » (402)
b. Des difficultés dans la mise en œuvre de la procédure civile
Cependant, si l’éviction ne doit pas être systématique, elle doit néanmoins pouvoir être demandée par la victime dans le plus grand nombre de cas possible. Or, divers problèmes y font encore obstacle sur le plan civil :
— La procédure est coûteuse pour la victime, ainsi que l’ont indiqué Mmes Anne Jonquet (403) et Elisabeth Moncany-Perves, avocate et ancienne bâtonnière du barreau de l’Essonne. En effet, en matière de référé, le concours d’un huissier est nécessaire. De surcroît, l’urgence de la situation n’autorise pas le recours à l’aide juridictionnelle ;
— La procédure de l’article 220-1 ne peut pas être mise en œuvre pour les couples qui ne sont pas mariés (404). Il serait nécessaire de la généraliser aux personnes pacsées et aux concubins. Cependant, la mission juge qu’il serait excessif de permettre l’éviction du conjoint violent quand seul l’auteur des violences est titulaire du bail ou propriétaire du logement. Cette éviction serait donc possible dans les cas où la victime est cotitulaire du bail ou copropriétaire.
Proposition n° 38 :
Généraliser la procédure civile d’éviction du conjoint violent aux personnes pacsées et aux concubins copropriétaires du logement ou cotitulaires du bail.
c. Le manque de structures d’hébergement pour les auteurs de violences
Au plan pénal, outre les disparités de politique pénale entre parquets (certains recourant beaucoup plus que d’autres à l’éloignement du conjoint violent (405)), la principale difficulté réside dans le manque de structures permettant, quand cela est nécessaire, d’héberger le conjoint évincé.
— Le manque de places d’hébergement pour les auteurs de violences
Cette difficulté a été fortement soulignée comme étant l’une des principales lacunes du dispositif de lutte contre les violences au sein du couple par M. Luc Frémiot, procureur de la République à Douai : « C’est donc bien de cela que nous manquons : des structures d’accueil pour les auteurs de violences. En dépit de nos efforts, des résultats que nous obtenons, de leur médiatisation, des contacts que nous nouons, on continue à ouvrir indéfiniment des places d’accueil pour les victimes, mais aucune structure n’est créée pour les auteurs. Je l’ai signalé à la Chancellerie, j’en ai discuté avec Mme Létard mais sans résultat. Nous sommes pourtant une juridiction pilote. […] Ce qui nous manque, ce ne sont pas les textes, mais des structures d’accueil pour les auteurs. » Or, a-t-il indiqué, « On s’est aperçu que 90 % des récidivistes étaient des gens ayant échappé au placement dans le foyer Emmaüs. Cela prouve la nécessité de disposer de structures d’accueil. » (406)
Or, nous ne disposons pas de statistiques nationales concernant les possibilités d’hébergement des auteurs de violences. Selon Mme Solange Alidières, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l’exclusion à la direction générale de l’action sociale, « certains départements prévoient de manière systématique l’accueil du conjoint violent en CHRS » (407). Dans la note qu’elle a fait parvenir à la mission, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a également indiqué ne pas disposer de données spécifiques concernant les structures hébergeant des auteurs de violences, bien que cette prise en charge soit en augmentation.
Proposition n° 39 :
Recenser les structures hébergeant des auteurs de violences et le nombre de place qui leur sont consacrées.
Néanmoins, des expériences locales peuvent retenir l’attention. Dans le cadre de la prise en charge des auteurs, l’association de contrôle judiciaire d’Evry (ACJE) dispose de quatre chambres pour les hébergements d’urgence au sein d’une résidence, ceux-ci constituant l’exception. Grâce à ces chambres dédiées, l’ACJE a pu héberger 14 mis en cause en 2006 et 19 en 2007, permettant ainsi à la fois une exécution satisfaisante de la mesure d’éloignement et une prise en charge adéquate du mis en cause.
— La signature de conventions pour prendre en compte cette question
Des moyens substantiels devraient être consacrés à l’ouverture de places d’hébergement pour les auteurs de violences, ainsi que le préconise la recommandation n° 29 du rapport d’évaluation du premier plan global triennal (408). Il est certes exact que certains d’entre eux n’ont pas besoin d’être hébergés, ainsi que l’expose la circulaire relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences : « Il convient […] de ne pas confondre la prise en charge de nature thérapeutique, nécessaire dans la majorité des cas et le recours à un hébergement temporaire financé par des fonds publics qui ne devrait être proposé qu’aux auteurs de violence démunis. » (409) Néanmoins, un séjour de quelques jours dans un CHRS est de nature à provoquer le choc psychologique précédemment mentionné. C’est ce qui ressort de l’expérience pionnière menée par M. Luc Frémiot à Douai : « Ainsi, le foyer dans lequel nous plaçons les auteurs de violences est en principe destiné aux sans domicile fixe : il est donc financé par la DDASS. Mais, bien entendu, nous ne parvenons pas toujours à obtenir des places : en hiver, par exemple, il n’y en a aucune disponible. Dans ces cas-là, l’auteur de violences est placé sous contrôle judiciaire et se voit interdire de revenir au domicile conjugal. Il loge alors à l’hôtel, ou dans sa propre famille, par exemple. Il échappe ainsi à une partie du dispositif, ce qui n’est pas bon, car il n’est alors pas en situation de réfléchir autant qu’il le serait dans une structure spécialisée. S’il est hébergé par ses parents, par exemple, ces derniers risquent de prendre son parti et de relativiser la gravité de ses actes. » (410)
Le déploiement de structures d’hébergement des auteurs pourrait se faire dans le cadre de la signature de protocoles entre les juridictions, les collectivités et les associations d’hébergement des auteurs. D’après le rapport d’évaluation du premier plan global triennal, seuls 36 % des parquets ont conclu une convention sur l’accueil et l’hébergement des auteurs de violences avec les partenaires suivants :
PARTENAIRES AVEC LESQUELS LES PARQUETS ONT CONCLU UNE CONVENTION POUR L’ACCUEIL ET L’HEBERGEMENT DES AUTEURS DE VIOLENCES
Nombre de conventions |
Pourcentage de parquets ayant conclu une convention | |
Associations habilitées |
46 |
25 % |
Municipalités |
10 |
5,5 % |
Préfet |
20 |
11 % |
Services hospitaliers |
6 |
3,3 % |
Conseil général |
11 |
6 % |
Autres |
18 |
10 % |
Source : Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 195.
Il est donc impératif d’inciter les parquets à signer de telles conventions, ainsi que le fait déjà le Guide de l’action publique : « des conventions ou protocoles d’accueil doivent être signés par les chefs de juridiction, le préfet, les représentants des collectivités territoriales, les services sociaux et les associations. » (411)
Proposition n° 40 :
— Inciter les parquets à conclure des conventions pour l’hébergement des auteurs de violences ;
— Consacrer davantage de moyens à l’hébergement des auteurs afin de faciliter l’application de l’éviction du conjoint violent.
II. LES ENFANTS, VULNÉRABILITÉ DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
La séparation des parents ne met pas forcément fin aux violences conjugales. Parfois, au contraire elle les exacerbe. Le législateur a tenu compte de la dangerosité de cette période en étendant les circonstances aggravantes aux faits de violences commis par des « ex » conjoints, pacsés ou concubins mais cette question se pose toujours de façon aiguë quand il s’agit d’assurer la protection des enfants et de garantir celle de leur mère.
A. L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE PAR LE PARENT VIOLENT
Le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce, lors d’une séparation, sur les modalités des relations entre les enfants et leur père et mère « doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »(412).
La nécessité de faire prévaloir l’intérêt de l’enfant a déjà été affirmée par la mission. (413) En effet, cette question doit être posée dans le contexte particulier où le père exerce des violences à l’encontre de la mère.
Sans vouloir mettre en place des mesures dont l’automaticité pourrait aussi être une source de manipulation de la part d’un parent contre l’autre dans le cas de séparation très conflictuelle, des solutions doivent cependant être apportées pour faire face à des situations d’urgence et pour protéger plus systématiquement les enfants et leur mère.
1. L’exercice de l’autorité parentale peut être une source de danger
Le juge aux affaires familiales lors de la séparation des parents organise les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement.
L’autorité parentale est, en principe, exercée en commun par les parents. Cette disposition répond au souci de maintenir les liens entre les parents et leurs enfants après la séparation de leurs parents. Toutefois, dans un contexte de violences conjugales, la question de l’exercice même de l’autorité parentale par le parent violent se pose dans la mesure où elle peut s’avérer facteur de danger.
Il faut préciser toutefois que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents et pour des motifs graves refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement (414).
Le fait que des violences conjugales aient été effectives ne doit pas cependant conduire à des solutions automatiques comme l’a souligné Maitre Valérie Grimaud, présidente de la commission famille du barreau de Seine-Saint-Denis : « Je ne pense pas que ça serait une bonne chose de suspendre ou supprimer l’exercice de l’autorité parentale à l’homme violent car cela revient à opérer une confusion entre la violence faite à la femme et la situation de parent, qui elle va ne va pas cesser avec la séparation » Elle a ensuite souligné que « dans les situations de violences graves entre conjoints, on a très souvent à faire à des pères désinvestis. Supprimer l’exercice de l’autorité parentale, conduirait à davantage enkyster le désinvestissement paternel. L’institution judiciaire ne doit pas relayer le désinvestissement du père car, après la séparation, il faut gérer la vie familiale. » (415)
La mission considère toutefois que la question du retrait de l’autorité parentale par une décision expresse du juge pénal, dans les cas de violence extrême que constitue l’homicide de la mère par le père se pose. Le retrait de l’autorité parentale dans le cadre du jugement pénal, n’est, en effet, possible qu’en cas de violences exercées contre les enfants eux-mêmes aux termes de l’article 222-31-1 du code pénal qui dispose : « Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. » (416)
En outre, il faut pouvoir faire face dans tous les cas, aux situations d’urgence, en protégeant les enfants et leur mère sans avoir à attendre la décision du juge aux affaires familiales.
2. L’ordonnance de protection permettra de faire face aux situations d’urgence
On l’a vu, le « référé violence » (417) par lequel le juge aux affaires familiales peut prononcer l’éviction du conjoint violent, statuer sur l’attribution du domicile et de se prononcer, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale est, en pratique, peu utilisé.
Ce fait constaté par la mission lors de son déplacement à Evry, se traduit par les statistiques du ministère de la Justice. Le nombre annuel des demandes depuis 2005, date de la création de cette mesure, s’est étagé entre 370 et 490 au maximum.
De surcroît, comme l’a souligné Mme Évelyne Reguig, directrice du centre d’hébergement de l’association VIFF SOS Femmes : « La question des enfants devrait être abordée plus systématiquement en cas de référé, lorsque des décisions doivent être prises en urgence pour autoriser une victime de violences à quitter le domicile. De fait, dans l’agglomération lyonnaise, il faut parfois attendre quatre à six mois une décision de la chambre de la famille. »
En outre, ce dispositif ne concerne que les couples mariés.
Enfin, quand le juge aux affaires familiales se prononce sur l’organisation du droit de garde et de résidence, la décision du juge pénal sur les violences pour lesquelles le père est poursuivi n’est le plus souvent pas encore devenue définitive.
Pour faire face rapidement à une situation d’urgence, la mission propose que l’ordonnance de protection temporaire délivrée à la victime puisse, si le magistrat le juge nécessaire, suspendre provisoirement l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent en n’en confiant l’exercice qu’à un seul parent et organiser, pour cette même période, le droit de visite.
Proposition n° 41 :
Permettre au juge, dans le cadre de l’ordonnance de protection, d’organiser les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et d’en suspendre, si nécessaire, provisoirement l’exercice.
B. PRIVILÉGIER LES RENCONTRES MÉDIATISÉES
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. La gravité des motifs est appréciée par le juge, par rapport à la situation de l’enfant. Ils ne peuvent, par exemple, être constitués « par la seule référence au risque de perturbation de l’équilibre psychologique de l’enfant ». (418)
Les associations de défense des droits des femmes soulignent pourtant combien des maris violents ne cherchent à voir leurs enfants que pour avoir, en réalité, accès à leur mère. Le conjoint violent écarté, continuant d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants et disposant d’un droit de visite, en profite pour revenir au domicile, prendre contact avec son ancien conjoint, éventuellement exercer des pressions sur lui.
Ce point a été soulevé par le Docteur Emmanuelle Piet : « Nous avons travaillé sur 16 homicides : dans la moitié des cas, l’assassinat de la femme avait lieu pendant l’exercice d’un droit de garde, devant les enfants ; dans un bon tiers des cas, la situation de violence était déjà connue de la justice et l’assassin avait déjà été jugé et condamné pour des faits de violence – mais il n’en avait pas moins le droit de visite… » (419).
C’est pourquoi, il est très important que dans ces cas de danger le juge organise la protection des rencontres entre le père et ses enfants.
Le Docteur Maurice Berger a souligné l’importance de visites médiatisées pour protéger l’enfant jusqu’à ce qu’il ait pu changer l’image qu’il a de son père : « Si un père n'a pas ces capacités parentales, la question se pose de savoir si l’on doit mettre en place des contacts médiatisés, en présence de professionnels, et selon quelle périodicité, mais aussi de savoir comment est l'enfant. En effet, certains enfants vont mal simplement en revoyant leur père et ils iront donc mal pendant un ou deux mois – c'est ce qu'on appelle les reviviscences hallucinatoires. Les visites médiatisées permettent donc de protéger l'enfant jusqu'à ce qu'il ait pu changer l'image qu'il a de son père. » (420)
Cette possibilité a été consacrée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui l’a inscrite aux articles 373-2-1 et 372-2-9 du code civil : lorsque les parents sont séparés, que l’autorité parentale soit exercée en commun ou bien que son exercice ait été confié à un seul des parents pour des motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales a la possibilité « d’organiser le droit de visite dans un lieu de rencontre désigné à cet effet ».
Le Guide de l’action publique insiste sur la nécessité, dans le cas où le couple est séparé et a fortiori si le conjoint ou le concubin a été évincé du domicile familial, que la préservation du lien parental unissant les enfants au parent évincé se fasse « dans des conditions garantissant leur sécurité et celle du parent victime ».
La mission considère que l’organisation des visites dans un lieu neutre, au sein d’une association, ou à défaut chez un tiers, devrait être systématiquement utilisée par les juges, dès lors que le père est l’auteur de fait de violences commis à l’encontre de la mère.
Encore faut-il que l’organisation de ces visites soit matériellement possible, c'est-à-dire qu’il existe localement un dispositif suffisant pour les assurer.
Mme Valérie Létard, secrétaire d’État à la solidarité, l’a reconnu lors de son audition : « Les lieux sécurisés, des « points rencontre » entre le parent auteur de violence et l'enfant qui ne réside plus avec ce dernier doivent être développés. Les espaces de rencontre financés par le ministère de la justice sont au nombre de 67, et 78 structures ont une activité mixte médiation familiale/espaces de rencontre. » (421)
C’est dire qu’ils peuvent faire cruellement défaut comme le souligne Valérie Grimaud à propos de la Seine-Saint-Denis : « L’autre point à aborder est celui des lieux neutres. Les trois-quarts des associations en Seine-Saint-Denis n’organisent plus de « points rencontres », car elles n’ont plus de subventions pour fonctionner. En pratique, dans des situations dans lesquelles il y a des violences, on cherche un relais familial, quelqu’un de neutre ou même un voisin pour servir d’intermédiaire pour déposer les enfants et les récupérer. Les points neutres encore existants sont réservés aux situations les plus graves et les délais d’attente sont extrêmement longs. » (422)
Proposition n° 42 :
Développer les lieux de rencontre médiatisés entre parents et enfants pour garantir leur protection pendant l’exercice du droit de visite.
III. LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES SUR LE SOL FRANÇAIS COMME À L’ÉTRANGER
Certaines femmes ont besoin d’une protection spécifique. Il s’agit d’une part, des jeunes filles françaises ou résidant de manière habituelle en France qui sont victimes ou menacées de violences (essentiellement de mariage forcé ou de mutilation sexuelle) dans leur pays d’origine. D’autre part, une attention particulière doit être accordée aux femmes étrangères, menacées par des violences de genre dans leur pays, qui demandent l’asile en France.
A. LA PROTECTION À L’ÉTRANGER DES FRANÇAISES ET PERSONNES RÉSIDANT DE MANIÈRE HABITUELLE EN FRANCE
Les séjours à l’étranger sont des périodes particulièrement risquées pour les jeunes filles qui sont susceptibles d’être victimes d’un mariage forcé ou d’une mutilation sexuelle. Leur protection, à l’étranger, a été renforcée récemment mais des progrès demeurent nécessaires.
1. Des avancées législatives importantes
La loi du 4 avril 2006 comportait des dispositions étendant la protection de la loi française aux jeunes filles résidant de manière habituelle en France qui seraient victimes d’une excision dans leur pays d’origine.
Le nouvel article 222-16-2, inséré dans le code pénal, a ainsi pour objectif d'étendre l'application de la loi française, sanctionnant ces pratiques, aux mineures de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l'étranger d'actes de mutilation sexuelle. Parallèlement, les dispositions générales, visées à l'article 113-8 du code pénal qui prévoit que, préalablement à l’engagement de toute poursuite d’un délit commis à l’étranger, une plainte, soit de la victime, soit de ses ayants droit, ou une dénonciation de l’État étranger est nécessaire, ne sont pas applicables pour l’infraction prévue par l'article 222-12 de ce même code, à savoir les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.
Mme Armelle Andro, chercheuse à l’INED, a évoqué, au cours de son audition, les effets positifs de cette règle, qui fournit aux familles de ces jeunes filles opposées à leur excision, un argument supplémentaire : « Ce cadre légal très coercitif est un bouclier derrière lequel les femmes se protègent encore aujourd’hui. Des mères l’invoquent pour intimider les grands-mères restées au pays : « Si ma fille ne revient pas entière de ses vacances au pays, je me retrouverai en prison et tu en seras responsable » ou encore : « Les gendarmes français viendront te chercher au village si tu touches à ta petite fille ! » » (423)
Si la création d’un délit de mariage forcé était retenue (424), les mêmes règles pourraient trouver à l’appliquer.
De surcroît, la même loi a étendu la prévention des mariages forcés en renforçant les possibilités d’audition des jeunes mariés par les officiers d’état civil en poste dans les « pays à risque » et les possibilités de faire annuler les mariages forcés conclus à l’étranger.
Enfin, des guides ont été établis par le ministère des Affaires étrangères (425) et conjointement entre ce dernier et le ministère de la Justice (426) afin d’assister les femmes victimes de violences à l’étranger.
2. Assurer une meilleure prévention des mutilations sexuelles et des mariages forcés
Néanmoins, devant les difficultés importantes soulevées par les associations (protection des femmes binationales, absence de coopération) et sur lesquelles les autorités françaises n’ont que peu de prise, il semble nécessaire de prévenir ces situations de violence le plus en amont possible, c'est-à-dire avant le départ de France. En effet, ainsi que l’a indiqué Mme Christelle Hamel, chercheuse à l’INED et spécialiste des mariages forcés, « [L]es associations, comme les travailleurs sociaux, se heurtent à la multiplicité des interlocuteurs, lorsqu’elles tentent de prévenir le renvoi au pays d’origine, ou de faire revenir une victime qui a déjà été mariée contre son gré à l’étranger et qui y est retenue. Dès lors que la personne a été renvoyée à l’étranger, il devient particulièrement difficile de lui venir en aide. Ce constat invite à imaginer des dispositifs préventifs, avant la sortie du territoire des victimes. » (427)
À cette fin, l’association Voix de femme propose de créer une structure unique et aisément identifiable que toute personne qui a connaissance d’un risque de mariage forcé ou de mutilation sexuelle pourrait saisir. Il s’agirait : « d’une « cellule d’alerte, de veille, d’intervention en faveur des jeunes mineurs et majeurs en danger d’un mariage forcé à l’étranger ». Cette structure interministérielle spécialisée dans la prévention du mariage forcé et l’accompagnement des victimes aurait pour fonction de centraliser, organiser et systématiser les signalements faits par les travailleurs sociaux, les associations et les établissements scolaires. » (428) Cette structure aurait trois objectifs :
— Recenser les interdictions de sortie du territoire demandées par les victimes potentielles elles-mêmes. Aujourd’hui, les interdictions de sortie du territoire des mineurs ne peuvent être prononcées que par un juge des enfants sur la demande des parents. L’association propose que les victimes puissent elles-mêmes demander que cette interdiction de sortie du territoire leur soit appliquée ;
— Gérer un numéro vert auquel des informations sur un risque de mariage forcé ou de mutilation sexuelle pourrait être signalé. « Confrontés à des absences prolongées et non justifiées de jeunes femmes, les établissements scolaires sont souvent démunis et ne savent pas à qui s’adresser pour venir en aide à ces victimes. Ils disposeraient ainsi d’une procédure claire et d’un interlocuteur unique. » (429) ;
— Apporter l’aide de la France aux jeunes filles qui se trouvent à l’étranger : « faciliter et organiser le rapatriement des victimes qui ont été renvoyées dans leur pays ; faciliter la preuve de leur identité pour obtenir leur rapatriement, notamment quand leurs papiers d’identité ont été détruits ou volés par la famille ; faciliter l’obtention des laisser-passer lorsque la victime est française et des visas de retour lorsqu’elle est titulaire d’une carte de séjour. Elle prendrait en charge le coût des billets d’avion des victimes qui dépendent souvent financièrement de leurs parents ou de leur famille. » (430)
Le Royaume-Uni a créé une telle structure, la Forced Marriage Unit, qui recense plus de 1600 signalements de mariage forcé chaque année (431). Unité conjointe du ministère de l’Intérieur et de celui des Affaires étrangères, elle dispose d’un numéro d’urgence et établit des guides à destination de toutes les catégories de personnes susceptibles d’être confrontées à des situations de mariage forcé (victimes, policiers, enseignants notamment). Elle coordonne également l’aide prodiguée aux jeunes filles vivant au Royaume-Uni qui se trouvent à l’étranger.
La mission recommande qu’un tel dispositif soit également mis en place en France.
Proposition n° 43 :
Créer une cellule commune au ministère de l’Intérieur et au ministère des Affaires étrangères chargée de prévenir les situations de mariage forcé et d’excision et d’aider les femmes qui en sont victimes à l’étranger.
B. LE DROIT D’ASILE POUR LES FEMMES MENACÉES D’EXCISION ET DE MARIAGE FORCÉ
Deux catégories principales de femmes victimes ou menacées de violences peuvent prétendre à une protection en France : celles qui sont menacées de mariage forcé ou d’excision.
De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue par la convention de Genève à toute personne dont il a été établi qu’elle avait des craintes de persécution en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité pour un des cinq motifs suivants : religion, nationalité, race, opinion politique, appartenance à « un certain groupe social » (432). Ce statut donne droit à un titre de séjour de dix ans.
Par ailleurs, a été créée en 2003 la protection subsidiaire dont peut bénéficier toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais qui établit être exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe, individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (433). Elle donne droit à la délivrance d’un titre de séjour d’un an renouvelable, permet au titulaire de travailler mais limite l’accès aux droits sociaux.
Le type de protection accordé dépend de la qualification juridique retenue selon les dossiers. Dans les situations de femmes victimes de violences en lien avec les questions de genre, il s’agit donc de savoir si leur cas peut ou non entrer dans « un groupe social ». Dans l’affirmative et si les faits ont été établis, elle obtiendra le statut de réfugié : sinon elle bénéficiera de la protection subsidiaire dans la mesure où elle risquerait d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants.
1. La protection des jeunes filles menacées d’excision a connu des évolutions récentes
S’agissant des femmes menacées de mutilations génitales, la jurisprudence a reconnu en 2001 leur éligibilité à l’asile. En effet, l’arrêt de la Commission des recours des réfugiés (CRR) Sissoko a posé le principe de l’existence d’un groupe social des parents « exposés en raison de leur refus de soumettre leur fille à la pratique de l’excision, tant à des violences dirigées contre leurs personnes qu’au risque que leur enfant soit excisée contre leur volonté ». Cette jurisprudence qui concernait initialement des femmes originaires du Mali a été étendue au Tchad, à la Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, à la Sierra Leone, au Sénégal et à la Guinée.
Cependant, par une décision récente (434), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui a remplacé la CRR, a redéfini la notion de groupe social dans les « affaires excision » en y introduisant un élément de visibilité de l’opposition à l’excision. Ainsi, le groupe social se définit désormais comme suit : « dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté ». Dès lors, en l’absence de transgression, l’appartenance au groupe social tel que défini précédemment n’est pas caractérisée.
Ce changement de jurisprudence entraîne deux conséquences :
— Lorsque ce sont des fillettes qui risquent d’être exposées à l’excision, la CNDA a considéré que « compte tenu de [leur] jeune âge, [elles ne peuvent] manifester [leur] refus de la pratique de l’excision ». Elles ne peuvent donc se prévaloir de leur appartenance au groupe social et partant, de la qualité de réfugiée. Il n’en demeure pas moins que les fillettes dont les parents auraient mis en avant le risque d’excision encouru dans leur pays peuvent prétendre à la protection subsidiaire ;
— Les jeunes filles nées en France où l'excision est pénalement réprimée ne relèvent pas de la convention de Genève mais de la protection subsidiaire.
Cependant, la CNDA a étendu la protection subsidiaire accordée à l’enfant à ses parents en situation irrégulière afin de prévenir tout risque d’éloignement et donc de séparation, au motif que « la mise en œuvre effective de [la protection sous laquelle est placée l’enfant] impose que l’enfant ne soit pas séparée de sa mère ; qu’en l’absence de dispositions législatives octroyant de plein droit un titre de séjour à la mère de l’enfant mineure bénéficiaire de la protection subsidiaire, la même protection doit être étendue à cette dernière. » (435)
2. L’asile peut être accordé aux femmes menacées de mariage forcé
Le même raisonnement peut être mené concernant les femmes menacées de mariage forcé.
Ainsi, le motif d’appartenance à un certain groupe social pour une femme entendant se soustraire à un mariage forcé, justifiant l’octroi du statut de réfugié, est apparu pour la première fois en 2004 (436). Depuis lors, sont regardées comme appartenant à un certain groupe social les femmes « qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou par une partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger ».
Lorsque le comportement des femmes refusant un mariage forcé « n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social », la juridiction considère que leurs cas relèvent des dispositions de la protection subsidiaire car elles « n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants » (437).
3. Des conditions d’accueil à améliorer
La jurisprudence de la CNDA permet donc de garantir la sécurité des jeunes filles menacées d’excision ou de mariage forcé. Cependant, deux des revendications des associations de défense des droits des femmes étrangères doivent être prises en compte :
— Assurer la formation de tous les agents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à la problématique des violences de genre (438) ;
— Identifier au sein de l’OFPRA « une personne référente sur les questions de genre comme c’est le cas en Belgique » (439).
La mission estime que ces deux évolutions permettraient une meilleure prise en compte de la spécificité de la situation des femmes menacées dans leur pays d’origine.
Chapitre II : Assurer l’autonomie des victimes par le logement et l’insertion
La dénonciation des faits de violences représente pour de nombreuses femmes victimes une décision très difficile à prendre. Outre la peur des représailles et la complexité des sentiments qu’elles conservent parfois pour l’auteur des violences, le départ du domicile constitue en effet un véritable saut dans l’inconnu source d’angoisse et d’appréhension pour l’avenir.
La dénonciation des faits de violences ou le départ du domicile relèvent évidemment de décisions personnelles de la victime. Mais dans la prise de ces décisions, des questions d’ordre matériel ne pèsent pas moins lourd qui ont trait l’hébergement dans l’urgence, au logement autonome ainsi qu’à la réinsertion sociale et professionnelle.
I. ORGANISER UN VERITABLE PARCOURS D’INSERTION, DE L’HEBERGEMENT D’URGENCE VERS LE LOGEMENT AUTONOME
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, il est essentiel d’examiner les moyens d’organiser un véritable parcours de l’hébergement d’urgence vers le logement autonome.
A. ASSURER SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE UN ACCUEIL D’URGENCE DE QUALITÉ
Après le départ du domicile, l’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence correspond à une première étape cruciale du parcours des femmes victimes de violence. Ces structures ont été progressivement développées et organisées sur le territoire pour permettre de poser les premiers jalons d’une démarche vers l’autonomie en assurant une prise en charge professionnalisée.
1. Des structures diverses devant apporter sur l’ensemble du territoire une prise en charge de qualité
À l’échelle du territoire national, l’hébergement d’urgence se caractérise par sa diversité. On peut distinguer :
— Les nuitées d’hôtels et les hôtels sociaux. L’État prévoit le financement de 9 152 places en 2009, même si les pouvoirs publics affirment leur volonté de réorienter une partie des crédits correspondants vers le développement de l’intermédiation locative ainsi que vers les places de stabilisation (au nombre de 600 en 2009). En effet, le recours à cette modalité d’hébergement ne peut constituer qu’un expédient pour répondre à une situation d’urgence à défaut de places disponibles dans les structures d’hébergement.
Il faut faire état, en particulier, des difficultés dont la Fédération nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion sociale (FNARS) a témoigné auprès de la mission (440), s’agissant de la sécurité des victimes ainsi que de leur prise en charge efficace favorisant la réinsertion.
Dans ces conditions, la mission insiste sur la nécessité de ne recourir à la location de chambres d’hôtels qu’en cas d’absolue nécessité et de mettre immédiatement en contact les femmes victimes concernées avec les associations.
— Les CHRS qui ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement et le logement, le soutien ou l’accompagnement social, ainsi que l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté ou en situation de détresse (441), accueillent chaque année près de 13.000 femmes victimes de violences.
Ces structures d’hébergement sont les mieux à même d’accueillir des femmes victimes de violences en raison du suivi et de l’aide à la réinsertion dont ces femmes peuvent y bénéficier, ainsi qu’en témoigne l’audition des représentantes du Relais de Sénart (442).
Sur les 2500 CHRS existants gérés par 750 associations, on dénombre environ 60 structures se consacrant spécifiquement à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales. Par ailleurs, selon des données encore lacunaires, le nombre de places réservées à ce public s’élève à 3 673 (443).
2. Un accueil à mieux adapter pour une prise en charge spécifique des victimes
a. La garantie de conditions d’accueil adaptées
Dans le cadre du second plan triennal 2008-2010, l’État s’est efforcé de promouvoir le respect de critères d’accueil en accordant un label attestant de la qualité de l’hébergement des femmes victimes de violences (444).
En effet, les conditions d’hébergement ne garantissent pas toujours un accueil spécifique permettant d’engager une démarche de réinsertion personnalisée ce qui, dans certains cas, peut avoir des effets préjudiciables en termes de stigmatisation et d’enfermement dans une logique d’urgence.
Ainsi, Mme Evelyne Reguig, directrice du centre l’hébergement de l’association VIFF SOS femmes, souligne l’importance d’ « éviter l’effet de ghetto » par l’accueil des femmes dans des structures éclatées en plusieurs lieux et d’ « apporter une réponse complémentaire à celle des structures collectives existantes ».
De surcroît, les risques inhérents à la cohabitation des publics dans les structures généralistes alors que les femmes victimes de violences demeurent souvent vulnérables, ne sont pas négligeables.
Partageant cette analyse, la mission souhaite privilégier les structures d’accueil spécialisées dans l’hébergement des femmes victimes de violences disposant d’équipes pluridisciplinaires formées à cette problématique, et à développer, dans les structures généralistes, la présence d’équipes spécifiquement formées aux violences conjugales.
Proposition n° 44 :
Conforter les structures d’hébergement d’urgence spécialisées dans l’accueil des femmes victimes et former les équipes des centres généralistes au problème des violences conjugales.
b. L’accueil des femmes avec des enfants
Il convient enfin de réfléchir à une adaptation des structures permettant l’hébergement des enfants et évitant l’éclatement de la famille.
Certains CHRS assurent l’accueil de femmes accompagnées d’enfants de moins de trois ans. La prise en charge de la femme et de son enfant relève alors de la compétence du Conseil général. Dans le cas où l’âge de l’enfant dépasse les trois ans, la prise en charge relève de la compétence des DDASS. Au-delà de treize ans, l’enfant peut de se voir placé dans les structures de l’aide sociale à l’enfance.
Afin d’éviter une rupture dans la prise en charge et un éclatement de la cellule familiale, la mission encourage les différents services publics concernés à conclure entre eux et avec les associations concernées des conventions permettant d’assurer la transition entre les différents responsables de la prise en charge.
La coordination des acteurs s’opère notamment dans le cadre des Plans départementaux d’Accès au Logement pour les Personnes défavorisées (PDALPD). Ce plan vise, sous l’autorité du préfet du département, à coordonner les moyens consacrés aux actions de mobilisation en faveur des personnes défavorisées. Le PDALP doit également permettre de faire le point des ressources disponibles en place d’hébergement et de leur localisation.
La conclusion entre la FNARS et le Service aux Droits des femmes et à l’Egalité d’une convention triennale sur la période 2008-2010 doit contribuer à établir un état des lieux du nombre de places disponibles.
Néanmoins, il apparaît indispensable que les femmes victimes de violences soient identifiées comme public spécifique dans le cadre des PDALPD.
Proposition n° 45 :
Identifier les femmes victimes de violences dans les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.
B. REMÉDIER À L’ENGORGEMENT DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
Favoriser l’accès au logement autonome constitue indéniablement le véritable remède à l’engorgement des structures d’urgence.
1. Des moyens limités en dépit des efforts des pouvoirs publics…
La loi de finances 2009 prévoit d’augmenter de 800 le nombre des places offertes, ce qui portera le nombre total des places ouvertes dans les CHRS à 37 467. Néanmoins, il ressort des diverses auditions réalisées par la mission d’information que les structures d’urgence souffrent d’un manque chronique de moyens et de places pour l’accueil des femmes victimes de violences.
Cette situation résulte pour partie d’un phénomène de saturation des centres d’hébergement d’urgence en raison des difficultés d’accès à un logement pérenne qui conduit à un allongement important de la durée de séjour des femmes victimes de violence : « la durée moyenne de séjour dans les centres d’accueil est passée de neuf mois à deux ans voire deux ans et demi » (445). Cette tendance, également constatée par la FNARS, a amené les auteurs du rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales et du Conseil général des Ponts et Chaussées à évoquer le risque d’un « enfermement dans une logique de l’urgence » (446) et de situations dans lesquelles faute de places disponibles, les femmes doivent changer à plusieurs reprises de lieu d’hébergement.
Une meilleure coordination des acteurs et une meilleure orientation des femmes favoriseront une utilisation optimale des places et ressources disponibles. La mise en place par la Préfecture et par les DASS d’un « circuit fluidité » permettant de diriger les femmes hébergées en CHRS vers des résidences sociales puis des logements autonomes doit être encouragée.
2. …à mieux répartir et utiliser sur l’ensemble du territoire…
Les auditions de la mission ont montré la très grande disparité des structures et la nécessité d’assurer un maillage efficace du territoire.
Les structures d’hébergement d’urgence répondent, en effet, inégalement aux besoins selon les départements. L’incapacité de certaines structures à offrir un accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au long de l’année a été relevée par le rapport de l’IGAS et du Conseil général des Ponts et Chaussées. (447)
La gravité de la situation revêt un caractère parfois très aigu selon le département concerné. Ainsi, Mme Nicole Crépeau, présidente de la FNSF a ainsi témoigné de la situation constatée en Île-de-France : « En région parisienne, les centres d’hébergement d’urgence sont saturés. […] À l'exception des Yvelines, tous les départements d’Île-de-France possèdent des structures d’urgence mais celles-ci sont largement insuffisantes » (448). Mme Catherine Wintgens, chef du bureau des politiques sociales du logement au ministère du Développement durable, a réaffirmé la nécessité que « chaque département mette en place un dispositif d’urgence, ouvert la nuit, consacré à l’écoute et à l’hébergement » (449).
Cette situation tient pour partie à la difficulté d’anticiper les besoins faute de statistiques exhaustives et à la limitation des moyens dans le seul cadre départemental.
Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent assurer la prise en charge dans les structures d’hébergement d’urgence d’autres publics qualifiés de prioritaires par la loi sur le droit au logement opposable (dite loi DALO), tels que les personnes sans abri. Dès lors, se créent les conditions de fait d’une « concurrence entre les publics prioritaires » tant pour l’hébergement d’urgence que pour l’obtention d’un logement autonome.
Or, dans la mise en œuvre de la loi DALO, les femmes victimes de violences ne bénéficient pas, pour leur prise en charge, de droits supérieurs à ceux reconnus aux autres publics demandeurs d’un logement ou d’un hébergement, ainsi que l’ont rappelé à la mission Mmes Dominique Dujols et Huberte Weinum, représentantes de l’Union sociale pour l’Habitat (450). Au cours de son audition, Mme Catherine Wintgens a, par ailleurs, illustré la difficulté de sélectionner les dossiers sur le critère de la priorité en rappelant que « 60 % de la population remplit les conditions de ressources pour accéder à un logement » (451) et qu’à la fin du mois de mars 2009, on dénombrait 78 000 recours déposés en application de la loi DALO pour 9 000 relogements seulement.
3. …sans pour autant recourir à des familles d’accueil
Le plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes a lancé une expérimentation visant à l’hébergement des femmes victimes de violences dans des familles d’accueil.
L’hébergement en famille d’accueil a d’abord été expérimenté en 2006 dans les départements de la Drôme, de l’Ardèche et de la Réunion. À la suite des appels à projet lancés en 2008, 15 projets ont été retenus ; ils concernent 11 régions, 15 départements et doivent permettre l’accueil dans plus de 70 familles. Aujourd’hui, d’après le bilan dressé devant les membres de la mission par la secrétaire d’État chargée de la solidarité, cette expérimentation concerne 5 départements (l’Indre-et-Loire, le Lot-et-Garonne, la Drôme, l’Ardèche et l’Isère) et 38 familles d’accueil sont opérationnelles (452).
Dans le cadre de ce mode d’hébergement, les femmes victimes de violences sont accueillies par des familles agréées par les conseils généraux et recrutées par des structures spécialisées (conseils généraux, centres intercommunaux d’action sociale, centres communaux d’action sociale, associations) elles-même choisies après un appel à projet (453). Ces structures recrutent les familles, leur dispensent une formation, les rémunèrent et assurent leur suivi. Le financement incombe à l’État et aux conseils généraux. Un cahier des charges national a été élaboré, « fixant les principes et les exigences qui fondent le développement de ce dispositif » (454). L’objectif est d’atteindre le chiffre d’une famille agréée par département.
Au cours de son audition, Mme Valérie Létard a expliqué l’objectif de développer l’hébergement dans les familles d’accueil d’ici à 2010 par le souci de « diversifier les réponses offertes […] de trouver des solutions nouvelles pour compléter les outils existants et répondre à des réalités différentes […]».
Même si ce mode d’accueil pourrait pallier le manque de structures d’hébergement dans certains départements et d’organiser un maillage du territoire, la mission partage les inquiétudes formulées par les associations quant à la capacité des familles d’accueil à offrir un environnement propice à la reconstruction des femmes victimes de violence.
Se pose, en premier lieu, le problème de la sécurité non seulement des femmes victimes mais également de la famille d’accueil. Mme Marie Bellanger, de la FNSF, a fait remarquer que « la violence des hommes est déjà difficile à gérer dans les centres d’hébergement mais on y dispose au moins de moyens de protection » (455) qui n’existent pas dans une famille qui peut, elle-même, avoir des enfants.
Se pose ensuite la question des compétences des familles à la prise en charge de femmes victimes de violence. Les associations insistent, en particulier, sur le caractère indispensable de mise en place d’un suivi et d’une démarche de réinsertion dès la sortie du domicile et doutent de la possibilité pour les familles d’accueil de mener cette action.
Enfin, on peut craindre que les femmes victimes ne perdent confiance en elles-mêmes en se trouvant « infantilisées » comme pourrait l’être une personne dépendante, en vivant, de surcroît aux côtés d’un modèle familial susceptible de faire apparaître leur histoire personnelle comme un échec.
La mission a bien pris acte de la réaffirmation du caractère expérimental de ce mode d’hébergement ainsi que des garanties que Mme Valérie Létard souhaitait apporter dans sa mise en œuvre : « travailler sur un cahier des charges spécifique, avec des règles du jeu différentes » ; « ne pas déconnecter les familles d’accueil des structures d’hébergement, composés de professionnels avertis, aptes à accompagner les femmes victimes et leurs enfants de façon responsabilisante » (456).
La mission considère cependant que l’hébergement dans des familles d’accueil n’est pas adapté aux femmes victimes de violence conjugale. En revanche, ce mode d’hébergement peut être satisfaisant pour les jeunes filles menacées ou victimes de mariage forcé, ainsi qu’en atteste l’expérience pilote menée dans l’Hérault depuis plus de dix ans.
Proposition n° 46 :
Réserver l’hébergement dans les familles d’accueil aux jeunes filles menacées ou victimes de mariage forcé.
C. FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT PAR LA MOBILISATION DU PARC SOCIAL ET PRIVÉ ET L’ADAPTATION DU DROIT DU BAIL
L’accueil en urgence des femmes victimes est incontournable pour garantir leur protection au départ du domicile. Il reste que la possibilité d’accéder à un logement autonome se révèle déterminante dans la décision de dénoncer les violences, puis dans le processus de reconstruction des femmes victimes.
Ainsi, au cours de son audition, Mme Evelyne Reguig, représentant l’association VIFF SOS Femmes, a indiqué que « si les femmes avaient la garantie d’obtenir un logement, elles dénonceraient bien plus vite les violences, sans avoir peur d’être dans la rue et d’entraîner les enfants dans ces difficultés » (457). Ses propos montrent d’une certaine manière que le prolongement du séjour dans une structure d’hébergement, à défaut de logement, peut être vécu comme une sorte de sanction pour avoir dénoncé des faits de violences.
L’absence chronique d’une offre de logement social à la hauteur des besoins de l’ensemble de la population constitue un obstacle majeur. Malgré ce contexte, il apparaît nécessaire de mobiliser les pouvoirs publics pour trouver des réponses susceptibles de résoudre les problèmes spécifiques se posant aux victimes quand elles ont besoin d’accéder au logement social.
1. Inciter les bailleurs à mettre à la disposition des femmes victimes des logements du parc social et du parc privé
Dans le cadre de la discussion de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, le législateur a expressément accordé aux femmes victimes de violence une place parmi les publics pouvant prétendre à une priorité dans l’attribution d’un logement (458).
Par ailleurs, la loi précitée a consacré le principe selon lequel ne doivent être prises en compte que les ressources de la seule victime pour l’attribution d’un logement.
Malgré ces avancées législatives, il s’avère que les bailleurs tant privés que sociaux sont réticents à louer des logements aux femmes victimes de violences, qui sont perçues comme un « public » fragile.
a. Mobiliser le contingent préfectoral
En vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation (459), complétées par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le préfet jouit, au bénéfice des personnes prioritaires, d’un droit de réservation de logements inoccupés dans le parc des logements sociaux ou des organismes d’habitat à loyer modérés. La part des logements sur lequel le préfet peut exercer ce droit de réservation peut atteindre au maximum 30 % des logements inoccupés dans le parc d’un organisme HLM.
Or, des études récentes relatives à la gestion de ce « contingent préfectoral » (460) mettent en lumière une utilisation relativement modeste de ce pouvoir du préfet : sur l’ensemble du territoire, le nombre de logement attribués annuellement au titre de ce contingent ne correspondrait en réalité qu’au tiers, voire à la moitié de l’effectif des logements sur lesquels les préfets seraient en mesure d’exercer leur droit à la réservation. Cette sous-utilisation résulte souvent d’un manque de connaissance des besoins et des logements disponibles.
La mission recommande que les préfets soient appelés à mobiliser ces logements au bénéfice des femmes victimes.
Proposition n° 47 :
Appeler les préfets à utiliser activement leur contingent de réservation de logements sociaux pour mettre des logements à disposition des femmes victimes de violences.
Par ailleurs, les initiatives prises par certaines collectivités locales tendant à ouvrir aux femmes victimes de violences des logements initialement destinés à leurs propres agents doivent être encouragées. C’est ainsi que le Conseil régional d’Île-de-France a décidé la mise à disposition des femmes victimes résidant dans les centres d’hébergement de 150 à 200 logements qui ne trouvent pas preneurs parmi ceux que la région, en tant qu’employeur, réserve à ses propres agents (461).
b. Soutenir les associations œuvrant dans l’intermédiation locative
Les associations jouent également un rôle essentiel dans les démarches conduisant à l’obtention d’un logement autonome.
Par la conclusion de contrats d’intermédiation locative, elles permettent aux femmes victimes de violences d’obtenir l’accès à un logement autonome, puis de signer elles-mêmes un bail. La circulaire du 5 mars 2009 fait du développement de l’intermédiation locative une mesure prioritaire, les pouvoirs publics ayant fait part de leur ambition de mobiliser 5 000 logements du parc locatif privé en 2009.
Il est essentiel que les associations engagées dans l’intermédiation locative, puissent bénéficier d’un financement pérenne et des aides à la hauteur des charges locatives et des frais de fonctionnement pesant sur elles.
En effet, les associations qui garantissent aux bailleurs le paiement du loyer en cas de défaillance du sous-locataire et prennent souvent à leur charge l’entretien des locaux, sont tributaires des aides financières apportées par l’État, à savoir l’aide au logement temporaire (ALT) ou l’aide à la gestion locative (AGLS).
Des dispositifs impliquant les régions par convention avec la FNARS doivent permettre d’assurer, dans une certaine limite, la couverture financière des risques liés à la location, à la sous-location, aux baux glissants ainsi que des avances de trésorerie destinées à suppléer un financement public dans l’attente de son versement.
Proposition n° 48 :
Assurer aux associations engagées dans l’intermédiation locative, un financement pérenne et des aides à la hauteur des charges locatives et des frais de fonctionnement pesant sur elles, afin d’apporter des garanties aux bailleurs.
De même, la mission invite les pouvoirs publics à donner aux associations les moyens d’assurer un suivi de longue durée des femmes victimes de violences ayant accès à un logement autonome. En effet, le suivi des travailleurs sociaux apporte une garantie aux bailleurs quant au respect des obligations locatives (notamment le paiement des loyers et l’entretien des lieux). La présentation du dossier par une association rend plus crédible la demande d’une femme victime.
À titre d’illustration, l’opération lancée en Seine Saint-Denis, en mars 2005, intitulée « Un toit pour elles » (462), conjointement par le Conseil général et le Maire de Bobigny est un exemple particulièrement intéressant : ce sont les associations qui proposent la candidature des femmes susceptibles d’assumer un logement de façon autonome. Une convention conclue pour trois ans définit les procédures d’attribution et en garantit la transparence.
2. Adapter les règles du bail locatif aux spécificités de la situation des femmes victimes
L’éviction de l’auteur des violences du domicile ne résout pas en soi la question du maintien dans les lieux de la victime ou de son relogement. Ainsi que l’ont expliqué lors de leur audition Mmes Dominique Dujols et Huberte Weinum (463), la mesure d’éviction prise par le juge sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil ne revêt pas un caractère opposable à l’égard du bailleur.
Dans le cas d’une location, la mesure d’éviction ne modifie en rien les relations contractuelles établies entre le bailleur et l’auteur des violences si celui-ci est titulaire ou co-titulaire du bail ; dans le cas d’une copropriété, l’auteur des violences ne saurait être déchu de son droit de propriété.
a. Favoriser l’attribution rapide d’un logement dans le même parc
En premier lieu, il importe de rappeler que l’article 80 de loi du 25 mars 2009 précitée, autorise désormais les bailleurs à accorder, dans leur parc, un nouveau contrat de location à une victime co-titulaire d’un bail.
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié dispose en son troisième alinéa qu’un décret en Conseil d’État fixe les critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit « de personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code ». Ainsi, le statut de co-titulaire d’un bail n’interdit plus l’attribution d’un autre bail.
La mission d’information estime nécessaire que des actions d’information soient réalisées auprès des bailleurs sociaux pour faire appliquer ces nouvelles dispositions et confortent le statut de public prioritaire accordé aux femmes victimes de violences.
En revanche, même si sa logique apparaît compréhensible, la disposition imposant à la victime de produire une décision du juge pour preuve de son statut de victimes de violences peut entraîner des délais préjudiciables à un relogement rapide des victimes de violences.
Pour ces raisons, il importe que l’ordonnance de protection (464) constitue une décision valant preuve de la réalité des violences et permette aux femmes victimes d’obtenir plus rapidement un logement et un bail à leur seul nom.
En second lieu, il est nécessaire d’atténuer, au profit des femmes victimes de violences, le principe de solidarité des membres du couple devant les dettes pour ce qui concerne le paiement du loyer.
Ainsi qu’en ont témoigné de nombreuses associations auditionnées, les femmes victimes de violences ayant quitté leur domicile éprouvent d’extrêmes difficultés à retrouver un logement autonome parce qu’elles doivent s’acquitter de dettes de loyer contractées par leur conjoint. Comme l’ont expliqué Mmes Dominique Dujols et Huberte Weinum, représentantes de l’Union sociale pour l’Habitat (465), la suspicion de dettes antérieures pèse très défavorablement dans l’appréciation de la solvabilité des femmes victimes. Les bailleurs redoutent la survenue tôt ou tard d’un incident de paiement lié à un surendettement.
Afin de répondre à cette situation, la mission préconise que le juge puisse délier les femmes victimes de violence de toute obligation découlant du bail dont elles sont co-titulaire avec l’auteur des violences, dès le constat de séparation établi dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Cette proposition de modification législative devrait utilement compléter les recommandations adressées en 2007 aux bailleurs sociaux et privés afin qu’ils acceptent la levée de la clause de solidarité contenue dans le bail dans le cas où la personne victime de violences quitte son domicile et souhaite donner congé à son bailleur.
Proposition n° 49 :
Autoriser le juge à délier la femme victime des obligations découlant du bail co-signé avec l’auteur des violences dès lors que la séparation est établie par l’ordonnance de protection.
b. Prolonger le maintien dans les lieux des femmes désireuses de conserver le domicile.
Les femmes victimes de violences ne désirent pas nécessairement demeurer au domicile partagé avec l’auteur des violences. « De très nombreuses femmes souhaitent quitter le domicile et ne croient pas à l’éloignement du conjoint violent […] Le déménagement, même s’il ajoute au traumatisme et conduit à un changement d’école qui retentit sur les enfants, permet au moins à la femme et aux enfants de redémarrer dans un nouveau lieu » (466).
Néanmoins, quand une mesure d’éviction du conjoint violent a été prise et que le logement a été attribué à la victime, le maintien dans le domicile ne doit pas se heurter à des obstacles liés aux règles d’occupation des logements sociaux.
La mission recommande qu’une attention particulière soit accordée à la situation des femmes victimes de violences ne justifiant pas de leur maintien dans le logement au regard de leur situation.
La loi du 25 mars 2009 prévoit qu’en cas de sous-occupation du logement, il n’existe pas de droit au maintien dans les lieux (467). En revanche, la loi fait obligation de proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est précisé qu’« à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
Dans ce cadre, la mission recommande de prolonger le délai pendant lequel une femme victime de violences peut demeurer dans les lieux dès lors que le bailleur n’est pas en mesure de lui proposer un autre logement dont le loyer correspond à ses ressources.
II – SOUTENIR LES VICTIMES DANS LEURS DÉMARCHES DE RÉINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Soutenir les femmes victimes de violences qui en ont besoin dans leurs démarches de réinsertion sociale et professionnelle, suppose de leur accorder les moyens moraux et matériels de retrouver estime de soi et dignité, au moment où elles traversent une situation de crise mais aussi, pour celles qui n’ont pas de revenus propres, de les accompagner dans la recherche d’un emploi, facteur indispensable de leur autonomie.
A. DONNER AUX FEMMES VICTIMES LES MOYENS DE SE RECONSTRUIRE
Les « stratégies » suivies par les auteurs de violences ont souvent pour objectif et pour effet de couper les femmes victimes de tout lien social en dehors de la cellule familiale et de les priver de toute estime de soi. Ces stratégies peuvent se traduisent par un dénigrement systématique et des pressions exercées afin que les femmes cessent d’exercer ou réduisent leur activité professionnelle.
Il importe de considérer deux aspects essentiels de la reconstruction des femmes victimes : retrouver l’estime de soi par un travail sur l’image personnelle ; garantir l’accès aux aides de la solidarité nationale.
1. Aider les femmes à surmonter le traumatisme des violences
Les violences physiques s’accompagnent souvent de violences psychologiques pesant lourdement sur la capacité des femmes des femmes victimes à préserver leurs liens avec la société et le monde du travail. Des associations telles que l’INAVEM ou la Fédération nationale Solidarité Femmes citent entre autres maux : l’épuisement, les difficultés de concentration, le sentiment de honte, de culpabilité induit et encouragé par l’auteur des violences, l’isolement, l’enferment. (468)
Le programme « In ProVic » a eu pour objet de valoriser les démarches accomplies et les outils créés dans le cadre Pro Victima, programme développé entre 2005 et 2007 avec le co-financement du Ministère de la Justice dans le cadre du programme européen Equal. Il a pour ambition de permettre aux femmes victimes de violences de parvenir à une autonomie financière et économique par la réinsertion professionnelle.
Un comité de pilotage réunissant l’Institut national d’aide aux victimes (INAVEM), le centre national des droits des femmes et des familles (CNDFF), la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) et la MAIF est chargé du suivi de sa mise en place/
Le programme met l’accent sur la mise en réseaux entre les différents acteurs de la réinsertion et de la recherche d’emplois, notamment des centres d’hébergement, ainsi que sur la réalisation d’un suivi individuel et d’actions collectives présentant une dimension véritablement pédagogique.
À cet égard, deux actions menées dans l’agglomération de Nantes sont particulièrement intéressantes (469) : la première consistait à aider des femmes à la recherche d’un emploi éprouvant des difficultés « à s’estimer en capacité de tenir un poste de travail et à faire valoir leurs savoir-faire lors des entretiens d’embauche ». La seconde devait « amener les femmes à envisager leur rôle de femmes au travail, à se projeter dans un rôle de femme active, à appréhender la notion d’indépendance financière et ce qu’elle procure ». Ailleurs, comme en Seine-et-Marne, des actions sont menées en organisant des groupes de parole permettant aux femmes de s’exprimer, de partager leurs expériences et, en prenant conscience de l’anormalité de leur situation antérieure, de reprendre confiance en elle-même et de rompre l’isolement.
La mission tient à insister sur la nécessité de diffuser de véritables protocoles de prise en charge et de traitement de ces traumatismes et d’en assurer la mise en œuvre dès l’arrivée dans un centre d’hébergement d’urgence et tout au long du suivi des femmes victimes.
Aussi, la mission encourage la poursuite et l’intensification des actions et expérimentations réalisées dans le cadre du programme Pro Victima.
2. Faciliter les démarches nécessaires à l’obtention du revenu de solidarité active et des aides à la mobilité
La situation personnelle des femmes victimes peut les conduire à recourir aux dispositifs de solidarité. D’ailleurs, certaines associations telles que le Relais de Sénart observent une augmentation sensible du nombre des femmes accueillies ne disposant d’aucunes ressources (470).
De l’avis de l’ensemble des associations jouant un rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes, cette insuffisance ou cette absence de revenus affecte la vie quotidienne et entrave également la réinsertion et la recherche d’un emploi.
Dans ces conditions, la mission souhaite que les démarches permettant aux femmes victimes de prétendre au versement du revenu de solidarité active soient facilitées.
Crée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (471) et remplaçant le Revenu minimum d’insertion et l’allocation de parent isolé, le Revenu de Solidarité Active (RSA) peut être versé à toute personne résidant en France de manière stable et effective, âgée de plus de vingt-cinq ans ou assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître, de nationalité française ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler (472).
L’examen de la demande présentée par une femme victime ayant quitté son domicile ne donnera pas lieu à la prise en compte des revenus de l’auteur des violences. D’après les éléments recueillis auprès de la Caisse nationale d’allocations familiales, la femme victime peut attester sur l’honneur de sa situation d’isolement dans le cadre du dossier présenté. Du reste, la mention d’une situation de violences peut constituer une circonstance incitant les caisses à appliquer un traitement prioritaire.
Il convient toutefois de noter que les ressources disponibles prises en compte pour accorder le bénéfice du RSA et en déterminer le montant intègrent, au titre des revenus des capitaux, la valeur du patrimoine immobilier, ce qui peut réduire le montant de l’allocation versée. En effet, si la femme victime occupe un logement dont elle est propriétaire, il sera fait application d’un forfait logement minorant le montant de l’allocation perçue (sur la base de 12,5% de la valeur locative par trimestre). Si le logement dont elle est propriétaire est loué, les loyers perçus seront assimilés à des revenus des capitaux et justifieront une diminution de la valeur de l’allocation.
Les caisses d’allocations familiales devraient donc examiner les demandes de RSA présentées par des femmes victimes copropriétaire, en prenant en considération la longueur des délais nécessaires au partage ou à la liquidation des biens.
Ces règles de traitement des demandes de RSA doivent permettre l’attribution rapide des aides. En application de la convention d’objectif et de gestion conclue avec les pouvoirs publics, les caisses d’allocations familiales doivent en effet traiter les demandes de minima sociaux dans un délai maximal de dix jours. La mission d’information souhaite vivement que les caisses d’allocations familiales accordent un traitement rapide des dossiers de RSA déposés par les femmes victimes de violences.
Enfin, il est possible de former une demande auprès des caisses d’allocations familiales mais également des associations agréées par les conseils généraux aux termes d’une convention. De même, les conseils généraux peuvent conventionnellement déléguer au Pôle Emploi l’instruction de demandes de RSA.
La mission encourage les conseils généraux à organiser avec leurs partenaires (caisses d’allocations familiales, associations agrées, Pôle Emploi) des procédures gages de réactivité dans le traitement des demandes de RSA présentées par les femmes victimes de violences. En particulier, la mission invite les départements à consentir des avances sur le versement de l’allocation en cas de situation d’urgence avérée.
La mise en œuvre de cette recommandation passe par la conclusion de conventions déconcentrant l’exercice des compétences des conseils généraux (notamment par l’agrément des associations) ainsi que par l’établissement de véritables réseaux d’action publique pour la mise en œuvre du RSA.
Par ailleurs, la mission appelle les pouvoirs publics à faciliter l’obtention des aides à la mobilité en faveur des femmes victimes de violence, en particulier par la prise en charge des frais de transports pour suivre une formation, un stage ou une reprise d’activité. De même, il convient de prendre en considération le problème de la garde des enfants.
En tout état de cause, la délivrance d’une ordonnance de protection permettra, si nécessaire, de faciliter les démarches en constituant un moyen de preuve de la situation de la victime et ainsi d’accélérer les procédures
B ACCOMPAGNER LES FEMMES VICTIMES DANS LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
Les femmes victimes de violences dépourvues d’emploi cumulent souvent les difficultés pour retrouver un travail. Ces obstacles procèdent à la fois d’une fragilité personnelle, de démarches manquant d’efficacité et de fausses représentations compromettant la prise de contact et l’embauche par un employeur, ceci dans le contexte d’un marché du travail qui fait que les femmes sont, en tout état de cause, plus affectées par l’emploi précaire et le temps partiel.
Aussi apparaît-il nécessaire, d’une part, d’établir un parcours spécifique et personnalisé de retour à l’emploi pour les femmes victimes dès la sortie des violences et, d’autre part, de sensibiliser le monde économique et de former les services de l’emploi à la spécificité des enjeux de leur insertion professionnelle.
1. Établir un parcours spécifique et personnalisé de retour à l’emploi
La mission appelle les structures d’hébergement et les associations assurant la prise en charge des victimes à engager dès que possible des démarches de réinsertion professionnelle.
Il importe de laisser les femmes victimes de violence le moins longtemps possibles éloignées du marché du travail. Pour des raisons d’efficacité d’abord. Ensuite parce que la reprise d’une activité professionnelle ou l’inscription à une action de formation représente un outil essentiel de resocialisation.
Dans cette optique, les actions réalisées dans le cadre du programme Pro Victima par diverses associations et certains protocoles d’intervention qui ont été mis en place devraient être mieux connus et développés. Par exemple, à Arles, les associations ont assuré l’accompagnement spécifique dans des parcours d’accès à l’emploi d’une trentaine de femmes victimes en menant un travail portant sur l’élaboration d’un portefeuille de compétences, les techniques de recherche d’emploi et la validation des projets professionnels (473). .Dans ce cadre, l’action des associations permet de mieux appréhender toutes les difficultés que les femmes peuvent rencontrer dans leur démarche de réinsertion et de contribuer à la sensibilisation de leurs interlocuteurs.
De ce point de vue, une mise en réseau des savoir-faire et des expériences constitue une démarche indispensable.
2. Sensibiliser le monde économique et former les services de l’emploi
L’une des difficultés à laquelle se heurtent les femmes victimes de violence tient à la persistance de représentations négatives concernant leur aptitude à s’adapter aux exigences du marché du travail. Ceci est démultiplié si ces femmes ont des enfants qu’elles élèvent seules.
De même, de l’avis des associations parties prenantes au programme Pro Victima, la portée exacte des traumatismes provoqués par les violences est mal perçue les employeurs et les services de l’emploi, soit que l’on en néglige l’impact, soit que l’on en exagère le retentissement sur l’aptitude des femmes victimes à se montrer efficaces et compétentes à leur poste.
Aussi, dans le cadre du second plan pluriannuel de lutte contre les violences faîtes aux femmes, la mission recommande en premier lieu la mise en place d’actions de sensibilisation destinées aux employeurs, et d’actions de formations des services sociaux et des agents des Pôle Emploi.
Cette sensibilisation à la situation particulière des femmes victimes de violences peut être réalisée, dans le cadre de la formation professionnelle continue, par le suivi de modules ou par l’organisation de rencontres fréquentes entre professionnels et employeurs. En particulier, il importe d’apporter aux agents du Pôle Emploi ainsi qu’aux services des conseils généraux une connaissance précise des difficultés auxquelles se heurtent les femmes victimes de violence, de sorte qu’ils les accompagnent au mieux dans la recherche d’un emploi. Cette nécessité apparaît également dans la mise en œuvre du RSA qui doit donner lieu à l’établissement d’un parcours personnalisé de réinsertion sociale ou professionnelle avant l’attribution d’une allocation.
Proposition n° 50 :
Former le personnel du Pôle Emploi à la spécificité de la prise en charge des femmes victimes de violences.
De manière générale, il convient que les partenaires sociaux se saisissent pleinement de la question de l’insertion professionnelle et de la lutte contre l’exclusion. Dans cet esprit, la mission se félicite de la reprise par la convention du 19 février 2009 relative à indemnisation du chômage, parmi les causes de démission légitime ouvrant droit aux indemnités de chômage : « le changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République » (474).
Néanmoins, la mission préconise que l’UNEDIC et les partenaires sociaux n’exigent pas la preuve formelle d’un dépôt de plainte mais accordent le même statut à l’ordonnance de protection que la victime peut se voir délivrer par le juge. Par ailleurs, il conviendrait que les partenaires sociaux interprètent assez largement la notion de « violences conjugales » de sorte que soit considérée comme légitime et ouvrant droit à indemnisation la démission présentée par une femme victime de violences qui ne seraient pas seulement infligées par son conjoint, mais aussi par un concubin, un compagnon ou un ex.
En second lieu, il importe que soient organisés de véritables réseaux entre les employeurs, les associations ainsi que le Pôle emploi favorisant l’obtention d’un emploi.
Il s’agit en effet de renforcer la crédibilité des candidatures présentées par les femmes victimes de violences auprès des employeurs parties prenantes de ces réseaux. Par ailleurs, la participation des employeurs et des services de l’emploi à de tels réseaux peut permettre de mieux cibler les postes de travail permettant une réelle insertion des femmes victimes de violences.
Ainsi que le Relais de Sénart en apporte l’exemple en Seine-et-Marne (475), il importe de créer de véritables dynamiques territoriales permettant un échange d’information et une prise en charge globale des femmes victimes de violence reposant sur une culture commune entre les structures chargées de l’accompagnement social et celles chargées de l’accompagnement professionnel. Dans cette optique, la mission d’information encourage le développement des actions de mise en réseau des acteurs de l’emploi expérimentées dans le cadre du programme Pro victima.
Chapitre III : L’ordonnance de protection, mesure cardinale pour la protection des victimes
De nombreux pays européens ont inscrit dans leur législation des dispositifs visant à accorder une protection immédiate et multiforme aux personnes victimes de violences au sein du couple.
C’est le cas de l’Espagne, notamment, qui a créé en 2003 l’ordonnance de protection des victimes de la violence domestique (476). « Il s’agit de la possibilité donnée à une victime, à une personne de son entourage proche ou au ministère public, de demander, lorsqu’il existe des présomptions d’infraction pénale de violence physique ou morale ou d’atteinte à la liberté ou la sécurité créant une situation objective de risque pour la victime, que soient ordonnées diverses mesures immédiates de protection : mesures pénales à l’encontre de l’agresseur, mesures civiles au profit de l’agressée : attribution de l’usufruit du logement familial, prestations alimentaires, mesures de protection du mineur. » (477) « Cette possibilité existe déjà en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays du nord de l’Europe, aux États-Unis et en Espagne. » (478) a indiqué Mme Christine Rostand, magistrate au tribunal de Bobigny.
En Espagne comme au Royaume-Uni, la création d’une ordonnance de protection s’est traduite par des demandes en nombre très important, témoignant de son utilité. En Espagne, entre le 3 août et le 31 décembre 2003, plus de 6 000 mesures de protection ont été accordées par les juges. Au Royaume-Uni, les tribunaux délivrent environ 20 000 ordonnances de protection par an. Ces chiffres contrastent avec le nombre réduit de référés-violences prononcés en France chaque année.
La création d’une telle ordonnance a été appuyée par le CNDF (479) et par le rapport d’évaluation du premier plan global triennal (2005-2007) (480).
La mission soutient la création d’une telle ordonnance de protection. Cette ordonnance, nécessairement provisoire puisque prise en urgence, devrait pouvoir être demandée facilement par la victime et lui garantir que durant cette période de temps, elle se trouvera en sécurité tant d’un point de vue physique que matériel. Doivent pouvoir y figurer les solutions aux obstacles qui peuvent empêcher les victimes de violences de faire cesser cette situation, que ce soit dans le domaine du logement, de l’accès à un revenu, de la garde des enfants ou de sa sécurité physique.
I. UNE MESURE JUDICIAIRE D’URGENCE
Près de 150 femmes sont mortes, en 2007, sous les coups de leur conjoint, de leur compagnon ou de leur ex (481). Or, une grande part de ces décès ont lieu au moment d’une séparation. Ce simple chiffre témoigne des difficultés qu’ont les femmes victimes à faire cesser la situation de violences dans laquelle elles vivent. D’où la nécessité de leur garantir, une fois qu’elles ont pris la décision de partir, la plus grande sécurité possible, dans un délai très bref.
Dans ces circonstances, deux préoccupations doivent être conciliées : mieux protéger les victimes tout en respectant les droits de la défense. Dès lors, s’il est nécessaire que l’ordonnance de protection puisse être demandée par la victime à tout moment et qu’elle soit rendue en urgence, celle-ci ne peut être prise qu’après un débat contradictoire, par un juge, et pour une durée provisoire.
A. UNE MESURE OFFRANT UNE PROTECTION RAPIDE DE LA VICTIME
La première condition de l’efficacité de l’ordonnance de protection réside dans le fait qu’elle peut être prise en urgence, quelle que soit la situation de la victime.
1. Une procédure simple et rapide
Saisi d’une demande d’ordonnance de protection, le juge doit pouvoir donner sa réponse dans un délai très bref, afin de garantir la meilleure protection possible à la victime. La proposition de loi du CNDF prévoit un délai maximal de 24 heures entre la demande et l’audition des protagonistes, ce qui semble acceptable. Le délai qui a cours en Espagne, de 72 heures entre la saisine et la décision (482), semble trop long pour permettre de protéger efficacement la victime.
Cette demande devrait pouvoir être dispensée du ministère d’un avocat. En Espagne, le succès de l’ordonnance de protection tient au fait que celle-ci peut être sollicitée grâce à un simple formulaire disponible auprès d’une pluralité d’acteurs (juge d’instruction de permanence, procureur, services de police et de Guardia Civil, bureaux d’aide aux victimes, services sociaux des administrations, bureau de consultation juridique des barreaux). Les mêmes facilités d’accès au droit devraient être offertes aux victimes en France.
2. Des conditions de délivrance adaptées
Deux paramètres fixent le cadre de l’ordonnance de protection : ses bénéficiaires ainsi que le moment où elle peut être demandée.
a. Les bénéficiaires possibles de l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection a vocation à être délivrée aux personnes qui sont victimes ou gravement menacées au sein de leur couple (au sens large de couple actuel ou ancien). La loi espagnole concerne ainsi les personnes pour lesquelles il existe des présomptions d’infraction pénale de violence physique ou morale ou d’atteinte à la liberté ou la sécurité créant une situation objective de risque pour la victime. Le danger pesant sur la victime doit être objectif. Les mêmes conditions pourraient être retenues dans la législation française. Cette ordonnance aurait donc vocation à bénéficier à toutes les femmes menacées au sein de leur couple, et ceci quelle que soit leur situation au regard de la régularité du séjour.
Il faut préciser que dans la mesure où cette ordonnance ne serait délivrée que pour des faits de violence conjugale, une protection du même type pourrait être envisagée au bénéfice des jeunes filles menacées de mariage forcé ou d’excision. Le Royaume-Uni a créé, en 2007, une ordonnance de protection des victimes à destination des personnes menacées de mariage forcé (483). Elle offre une protection renforcée à ces personnes, en autorisant, par exemple, la saisine des passeports ou en valant mandat d’arrêt en cas de violation de ses prescriptions. Une réflexion devrait être engagée au sujet de la création d’une telle mesure, qui pourrait également profiter aux jeunes filles menacées d’excision.
Proposition n° 51 :
Engager une réflexion sur l’opportunité de créer une ordonnance de protection destinée à prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles.
Outre la victime, il convient de se demander quelles sont les personnes qui pourraient demander que soit prise cette ordonnance. Dans la législation espagnole, la victime, son entourage proche et le ministère public ont la possibilité de la solliciter. Le CNDF a ajouté à cette liste les services d’aide aux victimes et les services sociaux. De surcroît, les associations de défense des victimes pourraient également saisir le juge, « avec l’accord explicite et écrit de la victime. » (484)
Il semble préférable de réserver cette possibilité à la seule victime et au ministère public afin de ne pas risquer que la victime soit séparée de l’auteur contre son gré, ce qui, d’après de nombreuses personnes auditionnées par la mission, peut être contreproductif.
b. Une demande hors de toute procédure comme à toutes les phases d’une procédure
Cette ordonnance de protection devrait pouvoir être sollicitée et délivrée en dehors de toute procédure comme à tous les stades de la procédure pénale.
L’idée qui sous-tend l’instauration d’une ordonnance de protection est de permettre aux victimes de disposer d’une phase de répit durant laquelle leur sécurité physique et matérielle est assurée, et qui peut déboucher sur une procédure judiciaire civile ou pénale. Il est donc nécessaire que la demande d’une ordonnance de protection puisse être faite en amont de toute action en justice. C’est ce qu’a proposé Mme Christine Rostand, coauteur du rapport d’évaluation du premier plan global triennal : « La mission propose un nouveau dispositif : permettre aux victimes de violences conjugales ou intrafamiliales d’obtenir une ordonnance de protection, sur simple constat du danger auquel elles sont exposées. Ainsi, de façon novatrice, la protection de la victime ne serait plus subordonnée au dépôt de plainte. » (485)
En revanche, les possibilités de sollicitation d’une telle mesure ne devraient pas s’y limiter. M. Patrick Poirret, procureur adjoint au tribunal de Bobigny a insisté sur la diversité des situations qui pouvaient motiver la sollicitation d’une ordonnance de protection, y compris au cours d’une procédure judiciaire : « Il y a le cas de l’extrême urgence, par exemple lorsque, à l’issue d’une audience de comparution immédiate le tribunal renvoie l’affaire mais ne place pas le mari en détention provisoire. Il faut permettre à ce juge de prendre tout de suite une ordonnance de placement de la victime sous protection, laquelle lui permettrait, par exemple, de demander, même de nuit, un hébergement d’urgence. Le deuxième cas de figure est celui des sorties dangereuses programmées, c’est-à-dire les fins de peine sans aucun suivi prévu. Un substitut qui a entendu le mari prononcer, à la barre, des menaces de mort contre sa femme, craint forcément qu’il passe à l’acte à sa sortie de détention. Troisième hypothèse : l’homme contre lequel la femme vient déposer plainte est en fuite, la police dit qu’il sera difficile à retrouver et qu’il est très dangereux. » (486)
Une telle mesure devrait pouvoir être demandée au début de la garde à vue du mis en cause pour devenir effective dès sa sortie, s’il est remis en liberté.
B. UNE MESURE PRÉSERVANT LES DROITS DE LA DÉFENSE
Face à la nécessaire urgence qui préside à la délivrance d’une ordonnance de protection, différentes garanties doivent être données à l’auteur éventuel des violences, dans la mesure où celle-ci est susceptible de contenir des dispositions pouvant porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Celles-ci sont au nombre de deux : la décision doit être prise par un juge et elle ne peut valoir que pour une période de temps réduite.
1. Une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire
La première garantie des droits fondamentaux de l’auteur réside dans le fait que la délivrance d’une ordonnance de protection est une procédure judiciaire.
En effet, si les mesures de protection peuvent, dans d’autres pays européens, être prises par l’autorité administrative ou par les forces de l’ordre, au moins dans un premier temps, tous les interlocuteurs de la mission ont souligné le fait que, dans le système juridique français, seul un juge a la légitimité nécessaire à la prise d’une telle décision.
Une telle prérogative pourrait être attribuée au juge des victimes (JUDEVI), récemment créé dans un but de meilleure prise en considération des intérêts des victimes. Une telle solution a été suggérée par Mmes Christine Rostand, magistrate, et Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Cette suggestion peut être retenue. Mais il est également nécessaire de reconnaître la possibilité de décider d’une ordonnance de protection aux magistrats qui interviennent au cours du procès pénal ou civil si le besoin s’en fait sentir.
M. Philippe de Lagune, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance a, au cours de son audition, exprimé des réserves sur le principe d’une ordonnance de protection des victimes dans la mesure où une telle décision lui semblait contraire au principe du contradictoire (487). Dès lors que le magistrat aurait l’obligation d’entendre la victime et l’auteur, assisté, le cas échéant, de son avocat le principe du contradictoire serait bien respecté. « Le juge doit avoir la possibilité d’organiser des auditions séparément lorsque la situation l’exige. La procédure doit se dérouler en chambre du conseil, une telle mesure ne devant évidemment pas faire l’objet d’une publicité. » (488), a expliqué M. Patrick Poirret.
De surcroît, comme toute mesure d’urgence, l’ordonnance de protection ne pourrait qu’être provisoire. Sa durée de validité pourrait être de trente jours, comme en Espagne ou dans la proposition de loi du CNDF, renouvelable une fois. De surcroît, son retrait ou sa modification pourrait être demandé par chacune des parties. Cette durée doit permettre à la victime d’engager les démarches nécessaires pour stabiliser sa situation. En cas d’action civile ou pénale ultérieure, certains des éléments contenus dans l’ordonnance pourraient être repris dans le jugement définitif.
II. CRÉANT DES OBLIGATIONS POUR LES AUTEURS ET OUVRANT DES DROITS AUX VICTIMES
« Cette ordonnance ouvrirait [à la victime] le droit à ce que j’appelle une protection interministérielle, c’est-à-dire lui donnerait un accès privilégié aux prestations, au logement, aux soins… sans justification supplémentaire. » (489) a expliqué Mme Ernestine Ronai. En effet, l’ordonnance doit être la pierre angulaire de la protection des victimes de violence au sein du couple : elle doit, par un document unique, résoudre les difficultés qui peuvent se dresser sur le chemin d’une victime qui décide de quitter l’auteur des violences.
Certains des éléments qui pourraient figurer dans cette ordonnance ont été évoqués dans les parties précédentes et sont ici regroupés de manière synthétique.
Le contenu de l’ordonnance de protection devra être précisément défini notamment pour garantir son articulation avec les procédures déjà existantes. Il est clair que seules des orientations peuvent être dégagées dans le cadre du présent rapport.
A. LES OBLIGATIONS DE L’AUTEUR DES VIOLENCES
Dans le but de protéger la victime potentielle des violences, certaines obligations pourraient être assignées, de manière provisoire, à l’auteur.
1. L’interdiction de prendre contact avec la victime
Prenant exemple sur la loi espagnole, la proposition de loi du CNDF prévoit la possibilité d’évincer le conjoint violent du domicile conjugal et de l’interdire d’approcher de celui-ci et des autres lieux fréquentés par la victime. Un système de bracelet électronique est en expérimentation en Espagne, afin de prévenir automatiquement la victime et les forces de l’ordre en cas de violation par l’auteur de ses obligations.
Ces mesures, dont certaines peuvent déjà être prises par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pourraient être renforcées dans l’ordonnance de protection par la possibilité, par exemple, de « demander à l’Éducation nationale de ne pas communiquer l’adresse des enfants – et donc de la mère –, ou encore [de] faire protéger les lignes téléphoniques ou les données Internet » (490).
2. Les autres obligations pesant sur l’auteur des violences
Dans les situations de grand danger pour la victime, il serait souhaitable que l’ordonnance de protection puisse prévoir la suspension de l’autorisation de détention et de port d’arme.
La création de l’ordonnance de protection devrait également permettre de généraliser de façon plus automatique les bonnes pratiques exposées devant la mission, puisque tous les aspects de la situation de la victime et de sa protection devront être envisagés par le juge: opportunité d’une éviction, et d’une obligation de soins pesant sur l’auteur, aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, par exemple.
La violation par l’auteur des obligations pesant sur lui dans le cadre de l’ordonnance de protection devrait être sanctionnée, afin de permettre une protection judiciaire efficace. En effet, comme l’a indiqué Mme Ernestine Ronai, « les barrières juridiques qui ont été posées ne servent pas à grand-chose : des hommes qui avaient l’interdiction de rencontrer leur femme ou leur famille ne l’ont pas respectée et ont parfois commis un homicide. Il ne suffit pas de prendre de « bonnes » décisions de justice, il faut veiller à leur application. » (491)
B. L’OUVERTURE DE DROITS POUR LA VICTIME
L’ouverture rapide de droits opposables au profit de la victime est l’un des objectifs principaux de l’ordonnance de protection. Elle vise en effet à lui apporter le maximum de garanties quant à sa situation future, lui permettant ainsi d’envisager de se séparer du conjoint violent.
De manière générale, l’ordonnance de protection constituerait une preuve suffisante de la situation de violences, dans l’attente du jugement définitif.
1. Des droits renforcés à propos du logement et des enfants
La procédure de l’article 220-1 du code civil prévoit déjà que le juge puisse se prononcer, à titre provisoire, sur les modalités de garde des enfants et sur l’attribution du domicile conjugal mais elle est très peu appliquée (492). L’ordonnance de protection systématise les mesures qui peuvent être prises par le juge dans ces deux domaines et en facilite l’obtention.
a. La possibilité de suspendre l’autorité parentale
L’article 220-1 du code civil permet au juge aux affaires familiales (JAF) de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Mais, d’une part, comme cela a été dit, des difficultés liées à son utilisation en limitent l’application. D’autre part, au moment où le juge aux affaires familiales se prononce, l’issue des poursuites pénales engagées contre l’auteur n’est souvent pas encore connue. Le juge ne peut donc s’appuyer sur une condamnation définitive.
L’ordonnance de protection pourrait permettre, durant la durée de son applicabilité, une suspension de l’autorité parentale pour l’auteur des violences en attribuant son exercice à l’autre parent.
b. L’opposabilité de l’ordonnance au bailleur
L’accès à un logement peut également constituer un frein important au départ des femmes victimes de violences. Or, en l’état actuel du droit, l’éviction n’est pas opposable au bailleur, qui ne peut donc pas suspendre les obligations et les droits de l’un des deux membres du couple.
Deux situations peuvent se présenter, dans le cas de locataires, auxquelles l’ordonnance de protection apporte deux solutions différentes :
— La victime souhaite conserver le bénéfice du logement conjugal. L’ordonnance de protection peut alors servir de preuve de la réalité des violences et faciliter l’éviction du conjoint violent (493). Si la victime est cotitulaire du bail, l’ordonnance de protection qui est opposable au bailleur, permet de lui transférer le bail, c’est-à-dire de le mettre temporairement à son seul nom ;
— La victime ne souhaite pas conserver le bénéfice du logement conjugal. L’ordonnance de protection peut alors la délier de ses obligations vis-à-vis du bailleur. Elle constitue également une preuve de la situation de violences, au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui permet à la victime de pouvoir disposer d’un second bail dans le parc social. De surcroît, la victime qui quitte son logement pourrait être temporairement déliée de ses obligations à l’égard du bailleur (dont le paiement du loyer).
Si la victime et l’auteur sont copropriétaires et que la victime souhaite bénéficier d’un logement social, ce qui est rendu possible par une proposition de la mission (494), l’ordonnance de protection constitue également une preuve de la situation de violences.
2. Des facilités pour accéder aux droits
La possession d’un revenu, et d’un titre de séjour pour les femmes étrangères, constitue deux des conditions nécessaires à tout départ du domicile conjugal, de même que l’accès à l’aide juridictionnelle.
Les femmes sous emprise, ou, plus largement, celles qui sont victimes de violences au sein du couple, peuvent être dissuadées de quitter l’auteur des violences en raison de la perspective de dénuement matériel qui en découlerait.
La mission propose donc de simplifier les démarches des femmes qui, ayant quitté l’auteur des violences, souhaitent bénéficier du RSA. Actuellement, les revenus pris en compte dans l’éligibilité au RSA et pour son calcul sont ceux du couple (qu’il soit composé de personnes mariées, pacsées ou concubines) au cours des trois derniers mois. Les caisses d’allocations familiales (CAF) demandent une attestation sur l’honneur à la victime pour ne prendre en compte que ses seuls revenus. Le versement du RSA devrait alors avoir lieu dans les dix jours. Néanmoins, dans les cas urgents, certaines CAF traitent le dossier de manière accélérée.
La mission estime donc que l’ordonnance de protection devrait être opposable aux CAF. Sur présentation de cette dernière, les revenus pris en compte ne seraient que ceux de la victime au cours des trois derniers mois et le versement du RSA serait accéléré. Des avances devraient leur être consenties. Par ailleurs, la décote liée au fait d’être propriétaire ne serait pas appliquée si la victime n’occupe plus le logement dont elle est propriétaire.
b. Un accès facilité à un titre de séjour pour les femmes étrangères
Les associations ont fait état de la multiplicité des pièces qui sont demandées par les préfectures pour accorder la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour aux femmes qui rompent la cohabitation en raison des violences de leur conjoint (495). La présentation de l’ordonnance de protection devrait garantir une réponse positive, permettant ainsi d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire.
En ce qui concerne les femmes en situation irrégulière, la présentation de l’ordonnance de protection constituerait un élément qui devrait être pris en compte par le préfet au cours de l’examen du dossier. Elle devrait entraîner la délivrance, au moins à titre temporaire, d’un titre de séjour.
c. Un accès en urgence à l’aide juridictionnelle
Enfin, dans le cadre des propositions de la mission, l’ordonnance de protection devrait servir de preuve de la situation de violences et donc ouvrir la saisine en urgence du bureau d’aide juridictionnelle (496).
En ce qui concerne les victimes en situation irrégulière au regard du séjour, l’ordonnance de protection constituant la preuve des violences subies ou potentielles, celle-ci pourrait leur ouvrir le droit à l’aide juridictionnelle.
Proposition n° 52 :
Instaurer une ordonnance de protection temporaire, au bénéfice des femmes menacées au sein de leur couple, et des enfants si nécessaire, rendue par un juge dans un délai de 24 heures suivant la demande.
Cette ordonnance comporterait des obligations provisoires pour l’auteur des violences, telles que l’interdiction de s’approcher du domicile conjugal ou le retrait du permis de port d’arme, dont la violation serait punie par la loi. Pourrait également y figurer la suspension provisoire de l’autorité parentale de l’auteur des violences.
Elle ouvrirait de manière immédiate de nombreux droits à la victime en constituant une preuve de la situation de violence, ouvrant, si nécessaire, un accès immédiat au RSA, facilitant l’obtention d’un titre de séjour et l’accès à l’aide juridictionnelle. Elle serait opposable aux tiers.
CINQUIÈME PARTIE : COMPLÉTER ET SURTOUT MIEUX APPLIQUER L’ARSENAL JURIDIQUE EXISTANT
L’arsenal juridique français comprend d’ores et déjà de nombreux dispositifs permettant de lutter contre les violences faites aux femmes. Des infractions telles que le viol ou le harcèlement, si elles ne visent pas uniquement à réprimer des violences commises à l’encontre des femmes, ont constitué des étapes majeures dans la lutte contre la violence de genre.
La dernière d’entre elles a été franchie par le vote, à l’unanimité de l’Assemblée nationale et du Sénat, de la loi n° 399-2006 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d'un couple ou commises contre les mineurs. Celle-ci a en effet introduit dans la loi des changements symboliquement forts, tels que la reconnaissance de la possibilité du viol entre époux, l’introduction de la circonstance aggravante de viol au sein du couple et la mention du respect en tête de la liste des devoirs des époux. Elle a également incriminé le vol entre époux.
La loi a aussi défini une circonstance aggravante générale en cas de violences au sein du couple et étendu son champ d’application aux partenaires liés par un PACS et aux « ex ».
Mais cette loi ne se bornait pas à réprimer plus fermement les violences commises au sein du couple, elle visait également les mariages forcés et les mutilations sexuelles.
En portant l’âge légal au mariage de 15 à 18 ans, en rendant obligatoire l’audition des futurs époux par l’officier d’état civil lorsqu’il existe un doute sur la liberté du consentement au mariage, qu’il soit célébré en France ou à l’étranger ou en étendant le délai durant lequel peut prendre place une action en nullité du mariage, cette loi a incontestablement renforcé la prévention des mariages forcés.
Concernant les mutilations sexuelles, la loi a étendu la protection du droit français aux mineurs étrangers résidant habituellement sur le territoire français qui seraient victimes de violences à l’étranger, elle lève le secret professionnel pour ceux qui signalent des cas d’excision et porte à vingt ans le délai de prescription de l’action publique.
Le droit français est donc riche de dispositifs juridiques visant à prévenir et à réprimer les violences faites aux femmes. Cependant, deux limites demeurent : les politiques pénales sont encore divergentes entre les parquets et certaines infractions doivent être mieux définies ou même introduites dans notre droit pénal.
Chapitre I : Des politiques pénales divergentes en rendent l’application disparate
« À notre grand regret, nous constatons que ces évolutions législatives que nous appelions de nos vœux sont malheureusement encore trop peu souvent appliquées dans certaines régions, à tel point que nous nous demandons parfois si nous habitons sur le même territoire national. Sans remettre en question, bien sûr, l’autonomie des procureurs, il est étonnant de constater les disparités qui existent dans l’application de la politique pénale en matière de violences faites aux femmes. Nous allons jusqu’à dire que cela crée des discriminations dans le rapport au droit. » (497) a estimé Mme Annie Guilberteau, directrice générale du centre national d’information pour le droit des femmes et de la famille (CNIDFF).
De fait, malgré la prise en compte renforcée des violences faites aux femmes par la loi, le manque d’unité des politiques pénales menées par les parquets sur le territoire national est régulièrement déploré (498). Effectivement, la mission a pu constater que les parquets menaient des politiques pénales divergentes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ceci constitue un obstacle important à l’application pleine et uniforme de la loi.
Pourtant, le Guide de l’action publique a eu pour ambition d’unifier les politiques pénales en la matière. Il y est partiellement parvenu, au vu des bonnes pratiques suivies par de nombreux parquets et qui sont en voie de diffusion. Mais ces dernières doivent encore être généralisées à l’ensemble du territoire.
I. LES POLITIQUES PÉNALES MENÉES PAR LES PARQUETS SONT ENCORE DIVERGENTES
Les violences au sein du couple ayant longtemps été considérées comme un conflit relevant de la sphère privée, aucune politique pénale (499) spécifique n’était alors mise en œuvre afin de les combattre.
Depuis vingt ans environ, avec la prise en compte progressive de cette question, le ministère de la Justice a fortement incité les Procureurs de la République à mettre en œuvre des politiques volontaristes en la matière. Or force est de constater que les pratiques varient encore d’un parquet à l’autre au sein d’une même région, voire d’un même département. Ce constat a été dressé à de nombreuses reprises par différents intervenants. Il se vérifie aux différentes étapes de la procédure pénale et jusqu’au jugement.
A. DES DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES IMPORTANTES
La première phase de répression des violences commises au sein du couple, qui a déjà été évoquée (500), consiste dans les directives qui sont données aux policiers et aux gendarmes, notamment quant à la prise de plainte. La seconde réside dans la réponse pénale apportée par le parquet à la plainte déposée par la victime ou au signalement qui lui est transmis. Enfin, la dernière phase de la procédure relève de la compétence des juges du siège qui déterminent la sanction.
1. Les disparités dans les réponses pénales
Quand une plainte est déposée, le parquet dispose d’un large éventail de possibilités quant aux suites à lui donner. La solution retenue par le parquet dépend en général du casier judiciaire de l’auteur et de la gravité des blessures de la victime (501). Trois grands types d’action s’offrent à lui :
— Le classement sans suite parce que l’infraction est insuffisamment caractérisée, le plaignant se désiste (502) ou en l’absence d’infraction. En matière de violences au sein du couple, le classement sans suite par pure opportunité est proscrit (503) ;
— Les alternatives aux poursuites. Selon les instructions du ministère de la Justice, « les mesures alternatives aux poursuites […] devront être utilisées avec parcimonie pour des faits isolés, de moindre gravité, commis par un primo-délinquant, et aux cas où la mesure semble de nature à provoquer chez l’auteur des faits une prise de conscience utile. » (504) Lorsqu’une mesure alternative aux poursuites est prononcée et qu’elle est exécutée, la procédure est classée sans suite ;
— Les poursuites.
Il n’existe pas actuellement de statistiques disponibles concernant la politique pénale suivie par les parquets à l’échelle nationale, ainsi que l’a indiqué M. Jean-Marie Huet, directeur des Affaires criminelles et des grâces, au cours de son audition (505). Des données régionales sont néanmoins disponibles. Elles sont exposées dans le tableau ci-dessous.
Celles-ci laissent entrevoir des réponses pénales très variables entre les ressorts des différentes juridictions, constat avait déjà été dressé par le rapport d’évaluation de la loi du 4 avril 2006 qui regrettait « une disparité inacceptable des politiques pénales » (506). La mission a pu, au cours de ses déplacements et de ses auditions, constater que ces disparités perduraient. Tel est le cas notamment dans les Côtes-d’Armor, où un parquet est particulièrement dynamique sur la question des violences au sein du couple, puisqu’il a interdit la médiation pénale, qu’il pratique l’éviction du conjoint violent et que tout signalement des violences est transmis au parquet. À l’inverse, les parquets des deux autres TGI du département, pratiquent la médiation pénale (de façon encadrée) et recourent peu à l’éviction du conjoint violent.
LES SUITES DONNÉES AUX PLAINTES EN ÎLE-DE-FRANCE ET DANS LE RESSORT DES TGI DE CASTRES ET D’ALBI
Juridictions de la région parisienne |
TGI d’Albi et de Castres | |
Classements sans suite |
16 % |
40 % |
Alternative aux poursuites |
41,5 % |
38 % |
Dont : Rappel à la loi et sursis à poursuite |
35 % | |
Injonction thérapeutique |
1,4 % | |
Médiation pénale |
1,1 % | |
Composition pénale |
0 % | |
Poursuites |
42,5 % |
22 % |
Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel |
16 % | |
Citation directe par le parquet |
5 % | |
Comparution immédiate |
1 % | |
Saisine du juge d’instruction |
0,5 % | |
Taux de réponse pénale (alternatives + poursuites) |
84 % |
60 % |
Source : Ministère de la Justice, audition de Mme Rachida Dati, rapport d’évaluation du plan global triennal (2008-2010) et François Dieu et Pascal Suhard, op. cit..
Plusieurs interlocuteurs de la mission ont confirmé ce constat. C’est le cas notamment de M. Luc Frémiot, procureur de la République de Douai et de Mme Karine Lejeune, capitaine de gendarmerie à la délégation aux victimes, qui indiquait : « La disparité des politiques pénales est une difficulté que nous rencontrons, que nous soyons policiers ou gendarmes. » (507) Mme Christine Rostand, a souligné que : « Il est vrai que les réponses pénales apportées dans le ressort du parquet général de Paris diffèrent, alors que ce devrait être un axe phare de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le procureur adjoint de Bobigny, que j’ai interrogé sur ce point, reconnaît que la demande d’une femme habitant Vincennes devrait recevoir le même traitement que celle d’une habitante de Montreuil... » (508)
Cette disparité se rencontre également en ce qui concerne les mesures d’éviction du conjoint violent (509) : « À l’heure actuelle, certains procureurs de la République refusent l’éviction du conjoint violent ; c’est pourtant une prérogative qu’ils ont obtenue par la loi de 2006. » (510)
2. Les disparités dans les peines prononcées
Ces différences entre parquets ne sont pas les seules à avoir un impact sur l’issue de la plainte. Les juridictions ne prononcent pas non plus toutes, pour des faits semblables, des peines du même ordre. Les données sont là aussi lacunaires. Le tableau suivant illustre néanmoins ces différences.
LES DIFFÉRENCES DANS LES CONDAMNATIONS PRONONCÉES ENTRE DEUX COURS D’APPEL DANS LES AFFAIRES DE VIOLENCES CONJUGALES
CA Montpellier |
CA Nîmes | |
Emprisonnement ferme |
29 % |
15 % |
Emprisonnement avec sursis simple |
24 % |
41 % |
Emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve |
22 % |
19 % |
Emprisonnement ferme et sursis simple |
5 % |
0 % |
Emprisonnement ferme et SME |
15 % |
10 % |
Amende |
0 % |
15 % |
Amende avec sursis |
5 % |
0 % |
Source : Yannick Zemrak, « La répression des violences conjugales : contribution du juge pénal à la victoire de Lilith sur Ève », Droit de la famille, juillet-août 2008, p. 18.
B. LIÉES À UNE IMPLICATION ET À DES MOYENS VARIABLES
Les raisons de telles différences sont doubles, selon le rapport d’évaluation du premier plan global triennal : le manque de volonté de certains parquets d’une part, et le fait que ceux-ci s’adaptent, avec les moyens juridiques qui leur sont fournis, aux situations locales et aux moyens dont ils disposent, d’autre part (511).
L’implication du parquet et l’attention qu’il porte à la problématique des violences au sein du couple retentissent pour partie sur les solutions retenues. C’est ce qu’a indiqué M. Luc Frémiot, procureur de la République de Douai, à propos du parquet de Lyon : « Je suis choqué de voir certains de mes collègues considérer ces violences comme des conflits à l’intérieur du couple qui ne les regarderaient pas. […] Le parquet de Lyon ne veut pas mener une action du type de celle que nous menons à Douai. Ce n’est pas par méconnaissance, puisqu’il ne se passe pas un mois sans qu’une émission de télévision n’évoque le sujet : il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas la connaître. C’est une question de volonté. » (512)
Cette réalité peut être mise en lumière lors des changements au sein des parquets, d’où découlent des modifications de politique pénale. Les monographies exposées dans le rapport d’évaluation du premier plan global triennal l’illustrent (513):
— en Seine-Saint-Denis, à la suite de l’arrivée d’un nouveau procureur, « une politique pénale stricte impliquant des référents spécialisés au sein du Parquet a été mise en place depuis 2005 avec des résultats notoires : le taux de classement sans suite est passé de 24 % à 15 %, le recours à la médiation pénale a été interdit. Le traitement de violences faites aux femmes a été formalisé au sein d’un mémento, qui rend homogène les réponses du parquet. »
— à Rouen, où la situation a également changé, ainsi que le note le rapport : « Pour ce qui touche à l’engagement de poursuites, la politique suivie jusqu’à présent connaît un certain décalage avec la doctrine générale. Une médiation pénale « améliorée » a été mise en place en 2003, même si elle n’était pas systématique. Elle tend, avec l’arrivée d’une nouvelle substitute, à être tenue comme pas ou peu adaptée et son recours est moindre depuis 2007. […] une politique plus volontariste semble se faire jour. Les mains courantes sont désormais systématiquement adressées au parquet de Rouen. »
2. Un manque de moyens qui ne facilite pas une réponse pénale efficace
Les possibilités ouvertes aux tribunaux ne permettent pas toujours de mettre en œuvre de façon satisfaisante certaines mesures : ceci est particulièrement vrai pour les procédures d’éviction du conjoint violent, par manque de structures pour héberger les auteurs de violences. Telle est selon M. Luc Frémiot la principale difficulté (514).
Le même constat a été dressé par MM. François Dieu et Pascal Suhard: « S’agissant de l’éloignement de l’auteur présumé, il s’agit d’une mesure qui n’a été utilisée qu’à trois reprises par les parquets d’Albi et de Castres en 2005 et 2006, compte tenu, pour l’essentiel, de difficultés pratiques de mise en œuvre. » (515)
II. NÉANMOINS, LES BONNES PRATIQUES TENDENT À SE DIFFUSER DE MANIÈRE CROISSANTE
On constate cependant, malgré la persistance de divergence une tendance générale à la diffusion des bonnes pratiques d’abord initiées par quelques parquets pilotes, dans un nombre croissant de juridictions. Elles ont été rassemblées dans le Guide de l’action publique.
Le parquet de Douai a mis en œuvre, depuis 2003, une politique pénale volontariste (de « tolérance zéro » (516)), sous l’impulsion du procureur de la République, M. Luc Frémiot :
— La réponse pénale est systématique et précoce. Les services de police et de gendarmerie ne prennent plus de main courante, afin que le parquet soit informé de toutes les infractions commises. Dans la réponse du parquet, aucun seuil n’est fixé, afin de pouvoir intervenir le plus en amont possible. Le but est en effet de faire cesser la situation de violences avant que le processus de violence ne soit « enraciné » : « Le tribunal se saisit donc de toutes les affaires, dès la première gifle » (517);
— Le but consiste à responsabiliser les conjoints violents. Même si l’auteur se voit infliger une sanction pénale pour ses agissements, celle-ci n’est en général pas suffisante pour les faire cesser. Le mis en cause est toujours placé en garde à vue et déféré devant le substitut de permanence. S’il n’a jamais été condamné, il a obligation de quitter le domicile conjugal et de séjourner dans un foyer de sans domicile fixe. « Dans un foyer d’hébergement, ils sont soumis à un choc qui va les remettre en question. » (518) a en effet expliqué M. Luc Frémiot. Ils y sont suivis par des travailleurs sociaux.
— Si les faits sont de moindre gravité, l’affaire est classée après un ferme rappel à la loi et l’auteur a obligation d’entamer un suivi au sein d’un groupe de parole. Si les faits sont de gravité moyenne, l’auteur est également autorisé à revenir au domicile conjugal. Mais après le classement, la vigilance est maintenue sur le conjoint violent. Il est convoqué deux mois plus tard devant le tribunal correctionnel et son épouse est suivie par un travailleur social. Une peine de sursis avec mise à l’épreuve est requise. Celui-ci consiste en un stage de six mois dans une association spécialisée, à raison de trois heures par semaine.
Cet exemple de politique pénale volontariste s’est diffusé depuis à d’autres parquets, avec quelques variations, comme ceux de Paris, de Bobigny ou encore de Saint-Brieuc.
B. LA POLITIQUE PÉNALE MENÉE A CONTRIBUÉ À DIFFUSER CES BONNES PRATIQUES
« Les directives données aux parquets en matière de violences conjugales sont claires, et je les réaffirme lors de mes déplacements et à chaque réunion des procureurs. » (519) a indiqué la garde des Sceaux au cours de son audition. La politique pénale volontariste en matière de violences au sein du couple commence à porter ses fruits.
1. Une politique pénale volontariste
Dans un but de mutualisation des bonnes pratiques, celles-ci ont été regroupées au sein du Guide de l’action publique, en 2004, puis en 2008. Celui-ci se propose en effet d’« exposer ces initiatives individuelles afin que soient systématiquement apportées des réponses à ces faits, tout en harmonisant au plan national la politique pénale, qui se doit d’être ferme et adaptée à la spécificité du contentieux des violences au sein du couple. » (520) La réponse pénale à apporter aux faits de violence fait également l’objet d’une circulaire de politique pénale, qui a été adressée aux parquets suite à la loi du 4 avril 2006(521).
Ces documents donnent de grandes orientations quant à la politique pénale à mener, depuis les directives transmises aux services de police et de gendarmerie jusqu’à la phase post-sententielle. Ils encadrent, par exemple, la médiation pénale dans les affaires de violences au sein du couple, préconisent de privilégier le traitement en temps réel des affaires ou d’ordonner des enquêtes sociales rapides dès que cela est souhaitable.
Les procureurs généraux ont l’obligation, chaque année, de faire parvenir au garde des Sceaux un rapport de politique pénale. L’une des rubriques concerne les violences au sein du couple. La lutte contre les violences conjugales constitue donc l’un des objectifs des parquets, qui est évalué par la Chancellerie. De surcroît, depuis la loi du 4 avril 2006, les parquets doivent dresser un tableau trimestriel de suivi de la mesure d’éviction du conjoint violent.
2. Des bonnes pratiques en voie de diffusion
De nombreuses personnes entendues par la mission ont fait état d’une amélioration du traitement judiciaire des violences au sein du couple, ce qui tend à attester de la diffusion des bonnes pratiques.
Les résultats de l’enquête effectuée par les auteurs du rapport d’évaluation du premier plan global triennal, auprès des 183 TGI tendent à confirmer cette analyse. En effet, selon les réponses données par les TGI, 91 % des procureurs avaient donné des directives pénales aux services de police et de gendarmerie sur le traitement des faits de violence au sein du couple et 74 % ont désigné un magistrat référent. Ces chiffres, qui sont purement déclaratifs, dénotent néanmoins une plus forte implication des parquets(522), qui a d’ailleurs été confirmée par les constatations de la mission d’évaluation du plan, ainsi que l’a exposé Mme Christine Rostand, magistrate au TGI de Bobigny : « Le mouvement est réel ; nous avons pu le constater dans les six départements étudiés. » (523)
De même, parmi les réponses pénales apportées par les parquets dans ces affaires, les trois qui sont employées le plus souvent sont des procédures « en temps réel », ainsi que le préconise la circulaire de politique pénale.
LES RÉPONSES PÉNALES LES PLUS FRÉQUEMMENT APPORTÉES PAR LES PARQUETS
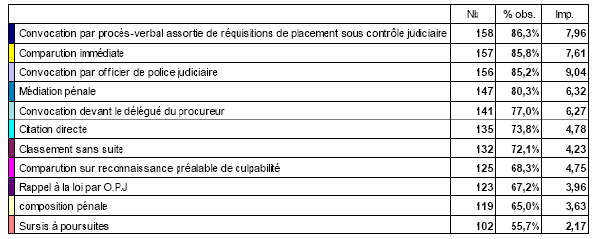
Source : Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 199.
En conséquence, le taux de réponse pénale dans les affaires de violences au sein du couple a également augmenté, passant de 69 % en 2003 à 84 % en 2007 (524) en Île-de-France. Selon cette même enquête, les juridictions seraient également mieux mobilisées dans la lutte contre les violences commises au sein du couple, 76 % des TGI ayant mis en œuvre « une action identifiée au sein de la juridiction » en la matière.
III. CES BONNES PRATIQUES DOIVENT ÊTRE ENCOURAGÉES
Afin de poursuivre l’harmonisation des réponses pénales, la mission considère que des progrès devraient encore être accomplis en matière de formation des magistrats, par la désignation d’un référent au sein du parquet et le recours à la médiation pénale.
De manière générale, la mission préconise de généraliser, par voie de circulaire, le système initié à Douai, en recourant à chaque fois que possible à une réponse ferme couplant éviction du conjoint violent, placement sous contrôle judiciaire et réquisition d’obligations de soins.
Proposition n° 53 :
Inciter tous les parquets, par voie de circulaire, à mettre en œuvre une réponse pénale comprenant, à chaque fois que possible, l’éviction du conjoint violent, son placement dans un foyer et sous contrôle judiciaire, et la réquisition d’obligations de soins.
A. LA FORMATION DES MAGISTRATS : UN ENJEU PRIMORDIAL
La formation des magistrats au contentieux des violences faites aux femmes et, en particulier, à celui des violences conjugales constitue un enjeu primordial aux yeux de la mission.
En premier lieu, parce que ces victimes nécessitent une écoute spécifique pour que leur parole se libère. Ensuite, parce que la complexité de porter plainte contre son conjoint ou son compagnon, avec les conséquences que cela emporte pour la vie de la famille tout entière, n’exclut pas au cours de la procédure des « allers-retours » parfois difficiles à comprendre : des femmes qui cherchent des excuses à leur partenaire ou qui après avoir accompli un long parcours pour déposer plainte, ne veulent ensuite plus qu’une seule chose, que la plainte soit retirée et que leur compagnon n’aille pas en prison.
D’autre part, les violences conjugales constituent un contentieux de masse auquel les juges seront nécessairement confrontés au cours de leur carrière.
La plupart des personnes entendues ont d’ailleurs soulevé ce point en soulignant comme l’a fait M. Serge Portelli, vice-président du TGI de Paris, la difficulté et la spécificité de l’écoute que requiert une victime de violence conjugale surtout si les violences sont psychologiques : « On peut mettre des psychologues dans les commissariats, mais cela ne résoudra pas le problème. La solution réside dans une formation globale du policier de base. Et l’on retrouve exactement la même problématique pour les magistrats…Le juge qui va devoir interroger la femme qui se plaindrait d’un harcèlement psychologique est le même que celui qui va interroger la personne accusée d’un cambriolage ou d’un trafic de stupéfiants […]. Je suis sûr qu’un jour on comprendra que lorsque quelqu’un a pour fonction de s’entretenir pendant 60 % de son temps avec des suspects, des victimes et des témoins, il faut qu’il ait reçu un minimum de formation à cet effet. » (525).
Les magistrats doivent être également formés à ces questions également au cours des sessions de formation continue qui doivent aussi être une occasion de diffusion des bonnes pratiques.
1. Une formation initiale à renforcer…
Selon les informations fournies à la mission par l’École Nationale de la Magistrature (ENM), un module de la formation initiale de 2008 a été consacré à la délinquance sexuelle avec pour objet de comprendre les mécanismes du passage à l’acte, notamment dans le cas de violences sexuelles intrafamiliales et d’identifier les différentes prises en charge judiciaires et médico-psychologiques des auteurs d’infractions sexuelles et des victimes.
Par contre, la problématique des violences conjugales ne fait plus l’objet d’une formation spécifique depuis 2005.
Comme le précise le directeur de l’ENM, cette question est désormais abordée tout au long de la scolarité au cours de directions d’étude et de journées thématiques plus larges consacrées à la fois à l’agresseur et aux victimes. Elle fait également partie des réflexions développées lors des enseignements spécifiques délivrés sur l’enfance en danger et l’intervention du juge en assistance éducative.
D’autre part, un stage extérieur de spécialisation d’une durée de quatre à cinq semaines a remplacé le stage extérieur auprès d’associations, administrations, entreprises ou d’organisations internationales. Cette modification a été regrettée par des associations qui accueillaient des magistrats en stage : « Notre association a été un lieu de stage de découverte de deux mois pour les élèves de l’École nationale de la magistrature. Ce stage a été supprimé et les futurs magistrats n’ont plus désormais affaire, au cours de leur formation, qu’à des dossiers ou, au mieux, à des situations judiciaires dont l’instruction ou l’enquête ont déjà abouti. Avec nous ils passaient deux mois à plein temps sur le terrain et découvraient la réalité à laquelle sont confrontées les victimes de violences ». (526)
2. …et à poursuivre en formation continue
En 2008 et 2009, une session d’une durée de trois jours consacrée aux violences conjugales a été organisée. Cette question est également abordée lors de la session de formation continue dédiée aux violences contemporaines et aux politiques pénales. Une journée est consacrée aux partenariats, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique pénale adaptée en matière de violences au sein du couple. En 2009, une session de formation continue aura pour thème la discrimination et le harcèlement au travail.
Ces formations sont ouvertes à d’autres professionnels : policiers, gendarmes, juges de proximité, avocats, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et membres de l’éducation nationale.
Selon les informations fournies par l’École Nationale de la Magistrature, elles ont été suivies par :
— 58 magistrats en 2008 (120 inscrits pour 2009) pour ce qui concerne les violences conjugales ;
— 31 magistrats en 2007, 28 en 2008 (26 inscrits pour 2009) violences contemporaines et politiques pénales.
La formation des magistrats aux violences au sein du couple est un enjeu majeur. Pourtant la mission n’en a pas tiré argument pour prôner la création de juridictions spécialisées comme l’a demandé le CNDF devant la mission (527). Cette spécialisation permettrait de mobiliser sur des affaires de violences conjugales des magistrats dédiés et donc formés à ce contentieux. Mais les inconvénients d’une telle proposition sont nombreux (528).
B. LA NÉCESSAIRE DÉSIGNATION D’UN MAGISTRAT RÉFÉRENT AU SEIN DU PARQUET
La mission a pu constater, notamment lors de ses déplacements à Évry et à Marseille, que la réponse pénale aux violences au sein du couple était de meilleure qualité quand certains des membres du parquet jouaient le rôle de référent pour ce qui concerne les violences conjugales. Les acteurs associatifs rencontrés par la mission à Saint-Brieuc ont également été unanimes à préconiser la mise en place d’un magistrat référent, au sein du parquet, spécialisé dans les questions de violences au sein du couple.
Actuellement, les directives de politique pénale prévoient seulement que « afin d’améliorer l’exercice de l’action publique en la matière, un magistrat référent centralisant le traitement des procédures de violences survenant au sein d’un couple pourra être désigné. » (529) La même recommandation est reprise dans le Guide de l’action publique, qui préconise également que les parquetiers de permanence transmettent au magistrat référent des fiches relatant les affaires dont ils ont eu connaissance (530). Actuellement, selon l’enquête auprès des TGI menée par la mission d’évaluation du premier plan global triennal, 75 % des parquets ont désigné un magistrat référent pour les violences commises par conjoint, concubin ou ex (531).
La mission préconise que cette désignation devienne obligatoire et qu’elle ne soit plus, de ce fait, limitée à certains parquets. Certaines personnes auditionnées ont fait valoir le fait que la masse de contentieux liée aux violences dans le couple ne justifiait pas, dans certaines juridictions, la désignation d’un membre du parquet. Il n’est, bien entendu, pas indispensable que ce magistrat ne traite que les affaires de violence au sein du couple. La mission juge cependant indispensable que l’un d’entre eux suive ces affaires en priorité (532).
C. LA MÉDIATION PÉNALE N’EST PAS UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX VIOLENCES CONJUGALES
La médiation pénale est une question qui a été soulevée comme un leitmotiv devant la mission, tant au cours de ses auditions que de ses déplacements.
Parmi les parquets les plus impliqués dans la lutte contre les violences au sein du couple, deux pratiques se dessinent : pour les uns, la médiation pénale ne doit jamais être pratiquée dans les situations de violences au sein du couple ; pour les autres, elle trouve parfois sa justification dans des conditions très précises.
Tous s’accordent néanmoins à considérer que la médiation pénale ne saurait en aucun cas être un moyen par défaut de traiter judiciairement les situations de violence au sein du couple. Pour la mission, cette réponse pénale devrait être exclue dans les cas de violences au sein du couple.
1. La médiation pénale, une procédure mal adaptée à la spécificité des violences au sein du couple
Mentionnée à l’article 41-1, 5° du code de procédure pénale, la médiation pénale « constitue une réponse pénale à une infraction caractérisée ». Selon le Guide de l’action publique, elle consiste, « sous l’égide d’un tiers, à mettre en relation l’auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l’infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ». La médiation pénale constitue un engagement de volonté des parties, qui peut, par exemple, conduire à la mise en œuvre d’une thérapie (en cas d’addiction) ou d’un suivi.
Néanmoins, la médiation pénale ne saurait être un mode de règlement par défaut des violences conjugales pour plusieurs raisons :
— Bien que la médiation pénale se distingue de la médiation familiale qui a pour but d’amener les parties à renouer le dialogue, elle conduit à placer sur un pied d’égalité la victime et l’auteur et peut aboutir à un partage de responsabilités dans le déclenchement des violences ;
— Ceci entraîne une double conséquence, pour la victime et pour l’auteur. La victime, qui peut avoir attendu plusieurs mois ou plusieurs années avant de saisir la justice, peut percevoir cette réponse apportée à sa plainte comme un déni de justice. Si les violences recommencent, elle sera d’autant moins encline à déposer à nouveau plainte. L’auteur, quant à lui, peut éprouver un sentiment de toute puissance encore accru devant cette réponse judiciaire qui n’a guère de conséquences pour lui. C’est ce qu’indique le Guide de l’action publique : « ce type particulier de violences traduit en général un rapport de domination et une emprise de l’agresseur sur la victime, qui se trouve privée de son autonomie. Il peut s’en suivre, pour le mis en cause un sentiment de toute puissance peu propice à développer son sens critique et, chez le plaignant, une difficulté à se positionner en tant que victime. [La médiation pénale] suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique. » (533) ;
— De ce fait, la médiation pénale prévient mal le risque de récidive ainsi que l’a expliqué Mme Emmanuelle Latour, secrétaire générale de l’Observatoire de la parité : « La médiation pénale pourrait être justifiée si elle intervenait dès les premiers signes de violences ; or les recours à cette procédure sont souvent tardifs et conduisent à des récidives qui mettent en danger les victimes. » (534)
Actuellement, elle doit donc être circonscrite à des cas résiduels, voire « exceptionnels », ainsi que l’indique le Guide de l’action publique. Le garde des Sceaux a confirmé que son utilisation devait être « la plus restreinte qui soit » (535). M. Jean-Marie Huet, directeur des Affaires criminelles et des grâces, s’est d’ailleurs félicité de la baisse du recours à la médiation pénale dans ces affaires : « Parmi les procédures alternatives, la médiation est en baisse, conformément à la volonté de la garde des Sceaux et à la sensibilité du Parlement sur cette question. » (536)
a. Certains parquets ont interdit le recours à la médiation pénale
Certains parquets ont proscrit, dans les situations de violences au sein du couple, le recours à la médiation pénale. La mission a constaté que tel était le cas à Saint-Brieuc. Le parquet de Bobigny n’y a pas non plus recours, ainsi que l’a expliqué Mme Christine Rostand magistrate dans ce TGI : « Il ne dispose pas dans son ressort d’équipes formées à la médiation pénale et les parquetiers de permanence téléphonique sont jugés trop jeunes pour apprécier, sur la base d’un simple appel de l’officier de police judiciaire, l’opportunité d’une telle mesure. » (537)
Mais les arguments les plus forts à l’encontre de l’utilisation de la médiation pénale dans les situations de violence au sein du couple ont été donnés par M. Luc Frémiot, procureur de la République de Douai, qui la juge inacceptable : « Cela m’amène à l’usage de la médiation pénale en matière de violences intrafamiliales, qui est à mes yeux inacceptable. Tous les spécialistes de la question que j’ai eu l’occasion de rencontrer – je pense notamment aux Québécois, qui travaillent depuis des années sur ce sujet – considèrent qu’il s’agit d’une hérésie : on ne met pas à la même table un auteur de violences et sa victime, pourquoi le ferait-on en matière de violences conjugales. Or certains parquets continuent à recourir à la médiation pénale pour les violences légères. J’ai énormément de difficultés à faire admettre l’idée à la Chancellerie qu’une telle pratique devrait être condamnée. » (538)
La mission estime que compte tenu des risques qui peuvent découler de l’utilisation de la médiation pénale (notamment un sentiment de déni de justice pour la victime), celle-ci doit être proscrite dans les situations de violences au sein du couple.
b. D’autres y ont recours de manière très circonscrite
Mme Rachida Dati a rappelé à la mission son attachement à la possibilité de recourir, de façon marginale, à la médiation pénale dans les conditions prévues par le Guide de l’action publique. Celui-ci établit un protocole strict, qui nécessite que plusieurs éléments soient remplis avant de recourir à cette procédure (539) :
— La victime et le mis en cause doivent consentir à la mesure ;
— Les violences doivent être de moindre gravité ;
— Le mis en cause doit être sans antécédent ;
— Le couple doit vivre sous le même toit et désirer maintenir un lien conjugal, de concubinage ou le PACS ou le couple est séparé avec enfant, les deux membres désirant conserver un lien parental apaisé.
De surcroît, le médiateur doit être spécifiquement formé et rappeler chacun à son rôle, de victime et d’auteur. Il peut encourager à la présence des avocats et signaler tout problème au procureur.
Ce protocole sert de fondement au recours à la médiation pénale dans de nombreux parquets, dont celui de Valenciennes, ainsi que l’a indiqué Mme Christine Rostand : « le procureur de Valenciennes, assisté de trois substituts ayant reçu une formation spécifique et comptant dans son ressort des associations de médiation, a mis en place un recours modélisé à la médiation pénale. » (540)
La mission a été particulièrement attentive à la pratique de la médiation pénale qui est suivie à Évry. La médiation pénale n’est utilisée que si l’auteur est primo-délinquant et reconnaît les faits, si leur preuve est difficile et rend l’action pénale incertaine et si le couple souhaite poursuivre la vie commune. Elle est autorisée par la permanence téléphonique du parquet mais le dossier est ensuite transmis au magistrat référent qui vérifie que le dossier correspond bien aux critères et peut décider d’engager des poursuites si tel n’est pas le cas.
Il semble que la médiation pénale, quand elle est réalisée dans de telles conditions, soit acceptable, mais de tels protocoles ayant été définis dans très peu de parquets, la mission considère que les risques inhérents à une mauvaise utilisation de la médiation pénale sont trop importants pour pouvoir continuer à y avoir recours. En revanche, une autre procédure, mieux adaptée aux situations de violences au sein du couple, pourrait être définie sur la base de ces bonnes pratiques et réservées à ces situations.
Proposition n° 54 :
Proscrire le recours à la médiation pénale comme réponse aux situations de violences au sein du couple et définir une procédure nouvelle mieux adaptée à ces situations.
Chapitre II : Des délits et des crimes à définir ou à redéfinir
La mission s’est interrogée sur l’opportunité de définir ou redéfinir certaines infractions. Il lui est apparu nécessaire d’introduire dans le code pénal la sanction des violences psychologiques et de l’incitation au mariage forcé et de préciser les notions de harcèlement et de viol entre époux.
I. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Le terme de « violences psychologiques » dans le contexte des violences faites aux femmes désigne essentiellement ce que l’on pourrait appeler le harcèlement ou l’emprise, telle que définie précédemment (541), au sein d’un couple. Leur identification repose sur des critères cumulatifs : elles doivent avoir lieu au sein de la famille, être répétées et durables et viser à la création d’une emprise.
A. IL EST NÉCESSAIRE DE DÉFINIR UN DÉLIT DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Les conséquences des violences psychologiques sur les femmes qui en sont victimes sont souvent extrêmement graves. Pourtant cette notion est mal cernée par le droit pénal et son identification juridique devrait permettre de libérer la parole des victimes.
1. Les violences psychologiques sont actuellement mal cernées par le droit
Si le retentissement psychologique des violences est reconnu par la jurisprudence, les violences psychologiques conçues comme emprise ne sont pas définies en tant que telles.
a. Le résultat de la violence peut n’être que psychologique
L’incrimination de violence nécessite, pour être caractérisée, d’avoir un résultat matérialisé qui peut être une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Ainsi, une « déstabilisation psychologique » est une violence au sens du code pénal. Néanmoins, la matérialité de l’infraction ne peut être constituée que si un choc émotionnel ou psychologique est ressenti par la victime et peut être prouvé.
Cette position résulte d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, qui a depuis longtemps étendu la notion de violences aux actes destinés à causer un trouble psychologique. Cette position a été réaffirmée par la chambre criminelle dans un arrêt du 18 mars 2008, énonçant que « le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif. » De même, dans un arrêt du 2 septembre 2005, la chambre criminelle a jugé que : « le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ».
Un choc émotionnel peut donc constituer l’élément matériel des violences. De fait, la jurisprudence a qualifié de violences toutes sortes de comportements, alors qu’aucun coup n’avait été porté à la victime. C’est le cas notamment du fait d’aborder une jeune fille une pierre à la main, pour lui proposer des pratiques obscènes, de menacer une personne avec un revolver, d’envoyer une lettre destinée à choquer la victime.
Le nouveau Guide de l’action publique mentionne d’ailleurs clairement le fait que les violences au sein du couple sont multiples : « physique (coups avec ou sans utilisation d’objet, strangulations, séquestrations), mais aussi verbale (injures, menaces), psychologique (humiliations), sexuelle (agressions sexuelles ou viols), matérielle (dégradations volontaires), économique (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) ou bien encore par la confiscation de documents (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille, carnet de santé, etc.). » (542) Il souligne également le fait que le traumatisme psychologique peut être considérable, en cas de réitération de faits qui, en eux-mêmes, semblent pourtant peu importants.
Il est néanmoins nécessaire de fixer les limites des « chocs émotionnels » qui peuvent constituer l’élément matériel des violences. Comme pour les violences physiques, il faut que le comportement en cause ait provoqué un minimum de perturbation émotive. De simples appels téléphoniques, qui n’ont entraîné qu’un dérangement, alors qu’aucun choc émotionnel particulier ne peut être prouvé, ne sauraient suffire à constituer l’élément matériel d’une violence (TGI Paris, 24 février 1972).
b. Certaines infractions peuvent être constituées sans violence physique
Des infractions spécifiques ne nécessitent pas, pour être caractérisées, de provoquer des dommages physiques. Il s’agit :
— Des menaces aux biens ou aux personnes. Les menaces aux personnes sont mentionnées aux articles 222-17 (543) et R. 623-1 (544) du code pénal. Pour constituer le délit de menaces, il faut que celles-ci soient réitérées ou caractérisées par un écrit ;
— Des appels téléphoniques malveillants. L’article 222-16 du code pénal prévoit que « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Cette qualification prévaut sur celle de violences si elle embrasse tous les aspects de l’action punissable. Il est nécessaire que les appels téléphoniques aient été répétés. A ainsi été déclarée coupable sur le fondement de cet article la personne qui appelle plus de 300 fois en deux mois son ancienne amie, qui ne souhaitait plus communiquer avec elle (TGI Pau, 14 avril 2004) ;
— Du harcèlement. Sont actuellement reconnus deux types de harcèlement : le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, s’il entraîne une dégradation des conditions de travail. Le harcèlement sexuel est spécifique en ce sens qu’il est limité aux actes qui ont pour but d’obtenir des faveurs sexuelles. De même, le harcèlement moral est également cantonné, aux relations de travail.
— Des violences habituelles, définies à l’article 222-14 du code pénal : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies […] ». Les violences habituelles, qui peuvent ne pas être physiques, sont déjà punies de manière aggravée mais seulement si elles sont commises à l’encontre de personnes particulièrement vulnérables (enfant, personne âgée, malade ou handicapée, femme enceinte). Cette notion ne pourrait donc pas s’appliquer aux situations d’emprise au sein du couple.
c. Mais les infractions existantes sont insuffisantes pour caractériser les violences psychologiques
Ni les infractions du code pénal ni la jurisprudence judiciaire ne punissent les violences psychologiques entendues comme un phénomène d’emprise :
— Les quatre infractions du code pénal précédemment mentionnées, si elles peuvent être des éléments des violences psychologiques, ne peuvent les sanctionner de manière satisfaisante car elles ne prennent pas en compte leur diversité des faits (pour les menaces ou pour les appels malveillants) ou ne s’appliquent pas à la sphère domestique (pour le harcèlement).
— La notion de « choc émotionnel » qui peut constituer l’élément matériel du délit de violence, n’est pas non plus satisfaisante pour caractériser les violences psychologiques. En effet, ainsi que l’a expliqué Mme Yaël Mellul, avocate, « une des spécificités des violences conjugales à caractère psychologique [est] qu’elles ne sont pas un délit instantané […] La jurisprudence des chocs émotionnels porte sur les conséquences psychologiques, traumatologiques pour les victimes, mais absolument pas sur les violences psychologiques. Or il faut vraiment faire la distinction entre les deux. »(545). Le propre des violences psychologiques est qu’elles sont répétées et de faible importance prises isolément. Elles sont donc l’exact inverse du choc émotionnel.
— La Cour de cassation avait utilisé dans un arrêt du 1er juin 1999, la notion de comportement persécutoire pour un cas de troubles à la tranquillité d’autrui. La cour approuve le fait que « pour retenir la culpabilité de Josy Z..., les juges relèvent que la victime des courriers et appels téléphoniques malveillants a subi des perturbations du sommeil et des manifestations anxieuses entraînant un traumatisme psychologique ; qu'ils ajoutent que ces faits caractérisent l'infraction de violences avec préméditation, s'agissant d'un "comportement persécutoire" à l'égard de la victime ». Cette notion a été réutilisée plus récemment par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 6 juillet 2007 pour un cas de violences répétées en prison sur un codétenu. Néanmoins, son utilisation est très peu fréquente.
Ainsi, les dispositions pénales actuelles ne permettent pas de réprimer les phénomènes de violences psychologiques conçues comme un phénomène d’emprise, car elles ne rendent pas compte de la globalité de la domination qu’une personne acquiert sur l’autre et de la volonté de destruction qui l’accompagne. Le caractère continu, divers et répété des faits constitutifs de l’emprise n’est mis en évidence dans aucune des infractions du code pénal.
2. Nommer les violences psychologiques pour les combattre
Il est apparu essentiel à la mission de punir ces violences psychologiques pour deux raisons :
— d’abord parce que les violences psychologiques sont souvent la première étape conduisant à des violences physiques comme l’a souligné Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre : « Il faut souligner qu’il n’y a jamais violence physique s’il n’y a pas eu auparavant violence psychologique. Un homme qui frappe sa femme n’a pas pour objectif qu’elle ait un œil au beurre noir ; il veut la soumettre et qu’elle soit docile. En réalité, la violence physique surgit lorsque l’homme perd le contrôle de sa femme. » (546) et M. Luc Frémiot : « Finalement, après des années de laminage psychologique, ces femmes font l’objet de violences très graves. Et souvent, elles ne portent pas plainte. C’est pourquoi il faudrait créer un délit de violence psychologique. »(547)
— ensuite, parce que le fait de nommer les violences psychologiques et d’en faire un délit permettra de faire prendre conscience aux femmes de leur statut de victime. « Définir les violences à caractère psychologique non seulement permettra à l’appareil judiciaire de les qualifier, mais aussi aidera les victimes à nommer ce qu’elles vivent. L’emprise psychologique induit l’impossibilité psychique chez les victimes de faire la distinction entre ce qui est tolérable et intolérable, acceptable et inacceptable. Or, les lois n’aident pas ces femmes à faire cette distinction et à prendre conscience de l’illégalité de la situation dans laquelle elles se trouvent. Une définition légale, claire et précise, le leur permettra : son intérêt fondamental est là. »(548)
B. LA DÉFINITION D’UN DÉLIT DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
Une fois admise la nécessité d’une infraction sanctionnant les violences psychologiques au sein du couple, reste la question de sa définition et, en toile de fond, celle de sa preuve.
La qualification juridique des violences psychologiques devrait comporter les aspects suivants : leur caractère continu et répété, la diversité de leurs manifestations et leur finalité, qui est de contrôler son conjoint, son concubin ou son ex.
a. L’énumération des actes de violence possibles
La première possibilité, pour prendre en compte les violences psychologiques, serait d’énumérer les manifestations de ces violences (sur le modèle, par exemple, des questions qui étaient posées dans l’enquête ENVEFF). Pour M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des grâces, une telle énumération ne devrait pas être retenue : « Il me semble hasardeux de décrire ce que peuvent être les violences psychologiques – d’autant que le législateur n’a pas détaillé les violences physiques. Agressions verbales, privation d’aliments, interdiction d’accès au compte bancaire… la liste pourrait être très longue. Mais surtout, elle ne sera jamais exhaustive et l’évolution des techniques est susceptible de créer de nouvelles souffrances qui ne seront pas reconnues. » (549) Mme Annie Guilberteau, présidente du CNIDFF a exprimé la même crainte : « Par exemple, nous avons à connaître de nombreuses situations où la violence psychologique s’exprime par le fait de rester silencieux, de ne répondre à aucune question, d’ignorer la présence de l’autre, jusqu’à ce que ce dernier craque. Va-t-on considérer que le silence est une forme de violence psychologique, de manipulation ? Oui dans une logique d’emprise, mais le silence en tant que tel ne peut être considéré comme une violence. » (550)
Il est donc nécessaire de trouver une définition synthétique et non pas extensive des violences psychologiques.
b. Une extension de la notion de violences habituelles
La prise en compte des violences psychologiques par l’extension de la notion de violences habituelles n’est pas non plus satisfaisante. En effet, elle reviendrait à considérer implicitement que les femmes sont une catégorie de personnes « vulnérables ». De surcroît, l’inclusion des femmes dans la liste des victimes potentielles des violences habituelles constituerait une entrave inédite au principe d’égalité entre les hommes et les femmes par rapport à la loi pénale.
2. Les propositions de modification législative envisagées
Deux grands types de définition sont avancés, pour mieux prendre en compte les violences psychologiques liées à l’emprise.
a. La proposition du ministère de la Justice : rendre le droit existant plus lisible
Au cours de son audition, M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des grâces, a indiqué qu’une définition des violences psychologiques était envisagée dans un avant-projet de loi, qui introduirait dans le code pénal un nouvel article 222-14-2 ainsi rédigé : « Les violences réprimées par les dispositions de la présente section sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques, qu’elles aient porté atteinte à l’intégrité physique ou à l’intégrité psychique de la victime ».
Les avantages de cette rédaction sont doubles. D’une part, elle est en continuité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui utilise également la formule « atteinte à l’intégrité physique ou à l’intégrité psychique »(551). D’autre part, elle inclut expressément les violences psychologiques, par une incise, comme étant une forme de violence, ce qui permet d’afficher clairement le fait qu’il est possible de condamner un auteur bien qu’il n’ait pas commis de violences physiques. La proposition du ministère maintient donc le droit existant mais en le rendant plus lisible pour les victimes. Selon M. Jean-Marie Huet, les violences psychologiques pourraient être définies plus avant par circulaire : « Il ne paraît pas du niveau de la norme législative que de définir plus avant que nous le proposons la réalité de ce que peuvent être les violences psychologiques susceptibles d’occasionner des conséquences physiques ou psychiques. C’est par circulaire qu’il nous appartiendra de le définir, mais le débat reste ouvert. »(552).
Néanmoins, cette rédaction est insuffisante pour caractériser les phénomènes d’emprise. En effet, si chacun des faits qui conduisent à un phénomène d’emprise peut être de relativement faible importance, c’est bien leur accumulation qui produit des effets destructeurs. En outre, les violences psychologiques ne sont pas nommées en tant que telles. Or, ainsi que l’explique Mme Yael Mellul, « une définition explicite est fondamentale. Pour que les femmes sachent que ce qu’elles vivent est condamnable, elle ne doit pas faire référence uniquement à ce qui existe déjà. Sinon, nous ne serions pas là pour en parler ! » (553)
b. La proposition du CNDF : s’inspirer de la définition du harcèlement
Dans la proposition de loi-cadre, le CNDF envisage, à l’article 88, d’insérer dans le code pénal un nouvel article 222-13-1 ainsi rédigé : « Les violences psychologiques sont définies par le fait de soumettre le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation, à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets et son avenir. Les violences psychologiques réitérées sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Cette définition des violences psychologiques, qui s’inspire grandement des définitions du harcèlement moral :
— ne concerne que les personnes vivant ou ayant vécu en couple, quel que soit le lien juridique qui unissait les deux membres du couple ;
— peut se matérialiser par des agissements ou des paroles répétés par une référence à la « réitération » ;
— mentionne l’objectif des violences, qui donne leur cohérence aux divers actes et paroles. Ces objectifs sont les mêmes que ceux du harcèlement moral, mais dans le contexte de la famille et non pas du travail. Sont ainsi repris la dégradation des conditions de vie (de travail), l’atteinte aux droits et à la dignité, l’altération de la santé physique ou mentale et le fait de compromettre l’avenir (l’avenir professionnel) et les projets de la victime.
Les caractéristiques de la violence résultant d’une emprise sont donc prises en compte, à travers leur répétition, leur diversité (indiquée par le pluriel) et leur finalité. Calquer la définition des violences psychologiques sur celle du harcèlement moral est une proposition pertinente selon M. Didier Guérin, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation : « À titre personnel, je trouve que les cas qui vous occupent entrent plutôt dans le schéma du harcèlement moral. J’ai connu des affaires devant les juges d’instruction qui, à n’en pas douter, en relevaient. » (554) Cependant, les termes exacts de la proposition de loi du CNDF devraient être retravaillés.
3. S’appuyer sur la définition du harcèlement moral pour définir les violences psychologiques
Si l’on s’attache à définir les violences psychologiques de manière analogue au harcèlement moral, deux questions restent néanmoins à trancher : celle des moyens de preuve et celle du quantum de la peine associé à cette nouvelle infraction.
a. Les moyens de preuve mobilisables
L’administration de la preuve est un obstacle soulevé à l’encontre de la possibilité de sanctionner effectivement les violences psychologiques dans la mesure où elles se déroulent dans le huis clos familial. Mais tel est le cas pour d’autres délits et crimes, comme le viol, dans certaines circonstances. Plusieurs éléments peuvent servir de moyens de preuve :
— Des témoignages d’amis ou de membres de la famille, qui peuvent, par exemple, corroborer l’isolement social d’une femme, ainsi que l’a indiqué Mme Yael Mellul (555) ;
— Des certificats médicaux avec des ITT qui peuvent être délivrés y compris en l’absence de traces physiques des violences. Selon le Guide de l’action publique, le certificat doit d’ailleurs systématiquement faire mention du retentissement psychologique subi par la victime ;
— Des expertises médicales. Mme Marie-France Hirigoyen a indiqué qu’« on ne peut simuler la peur, et les professionnels savent la repérer. Ils peuvent aussi repérer que la santé d’une femme se détériore. Pour apprécier tout cela, on dispose d’une liste d’indices de gravité. »(556) ;
— Toute autre preuve matérielle (enregistrement de messages téléphoniques, lettres,…).
La preuve du harcèlement moral peut servir d’exemple pour ce qui est de celle des violences psychologiques. Or, ainsi que l’a indiqué M. Didier Guérin, « [l’incrimination de harcèlement moral] se développe et, même si elle n’est pas très précise, nous arrivons, dans la plupart des cas, à admettre les condamnations. Il y a très peu de cassation pour manque d’éléments constitutifs. » (557)
Pour évaluer la peine qu’il convient d’associer à l’infraction de violences psychologiques, il est nécessaire, afin qu’elle soit proportionnée à la nature de l’infraction, de la comparer avec celles qui punissent les infractions proches.
PEINES EFFECTIVES ET ENVISAGEABLES POUR LES VIOLENCES
Mort |
Mutilation et Infirmité |
ITT > 8 jours |
ITT < 8 jours |
Pas d’ITT | |
Violences simples |
15 ans (222-7) |
10 ans et 150 000 € (222-9) |
3 ans et 45 000 € (222-11) |
Contravention de 5e classe (R. 625-1) |
Contravention de 4e classe (R. 624-2) |
Violences aggravées (cas des violences conjugales) |
20 ans (222-9) |
15 ans (222-10) |
5 ans et 75 000 € (222-12) |
3 ans et 45 000 € (222-13) |
3 ans et 45 000 € (222-13) |
Violences habituelles |
30 ans (222-14) |
20 ans (222-14-1) |
15 ans (222-14-1) |
10 ans et 150 000 € (222-14-1) |
10 ans et 150 000 € (222-14-1) |
Le harcèlement moral (au travail) est, quant à lui, puni à l’article 222-33-2 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Afin d’éviter des déqualifications de violences en violences psychologiques, ainsi que le redoutait Mme Annie Guilberteau au cours de son audition, il conviendrait que les peines pour violences psychologiques ne soient pas trop éloignées de celles des violences (558). Ceci est d’autant plus nécessaire que les conséquences des violences psychologiques définies comme emprise peuvent être bien plus graves que des violences physiques, ainsi que l’a indiqué le docteur Marie-France Hirigoyen(559).
La mission considère nécessaire de fixer une sanction suffisamment dissuasive pour faire prendre conscience du caractère inacceptable du comportement visé.
Proposition n° 55 :
Introduire dans le code pénal un délit de violences psychologiques au sein du couple en se fondant sur la définition du harcèlement moral.
La loi du 4 avril 2006 a constitué une avancée importante dans la lutte contre les mariages forcés, en renforçant les possibilités, sur le plan civil, d’annulation des mariages. Elle a également légalisé l’incrimination du viol entre époux et instauré un délit de vol entre époux, infractions qui peuvent servir de fondement à une condamnation. En revanche, elle n’a pas institué de délit spécifique de contrainte au mariage, visant à punir quiconque force autrui à se marier contre son gré(560). Pourtant, il apparaît à la mission que la création d’une nouvelle infraction pourrait constituer un pas supplémentaire dans cette lutte.
« Le ministère de laJustice travaille aujourd’hui sur un projet visant à renforcer l[a] protection [des femmes]. Son premier volet portera sur les violences liées à un mariage forcé. » (561) a précisé Mme Rachida Dati au cours de son audition.
A. LA CRÉATION D’UN DÉLIT DE MARIAGE FORCÉ N’A PAS ÉTÉ RETENUE EN 2006
Le rapport final de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant préconisait de ne pas créer de délit spécifique de mariage forcé (562) pour des raisons qui ont parfois été également soulevées par les personnes entendues par la mission :
— Les victimes pourraient ne plus dénoncer les mariages forcés dont elles sont victimes par peur de voir leurs parents condamnés pénalement. Cet argument a également été avancé par Mme Christelle Hamel, chercheuse à l’INED, spécialiste des mariages forcés : « il est déjà très difficile pour les victimes de briser le silence et cette pénalisation de leurs parents ne ferait que les renfermer dans leur silence. » (563) ;
— Il existe déjà des sanctions pénales pour punir les parents qui forcent leurs enfants (souvent leurs filles) à se marier. Ce sont les délits de violence, d’agression sexuelle, de menace sous conditions, d’enlèvement ou de séquestration. Les maris peuvent également tomber sous le coup d’infractions déjà existantes, comme celles de séquestration ou de viol, a indiqué M. Patrick Poirret, procureur adjoint au tribunal de Bobigny(564).
— Si les mariages forcés constituent un délit en France, les parents pourraient envoyer leurs enfants dans leur pays d’origine, où serait célébré le mariage forcé, ce qui causerait un tort supplémentaire aux victimes ;
— Les parents ont souvent la conviction de prendre cette décision dans l’intérêt de leur enfant. Les jeunes gens savent en général que leurs parents sont « de bonne foi ». Le fait d’instaurer un délit de mariage forcé entraînerait donc une culpabilisation supplémentaire de leur part.
B. POURTANT, DES ARGUMENTS MILITENT EN FAVEUR DE LA PÉNALISATION DES MARIAGES FORCÉS
1. Les arguments défavorables à la création d’un délit spécifique sont peu convaincants
La mission considère que le raisonnement consistant à estimer que la pénalisation d’un comportement pourrait dissuader les victimes de porter plainte trouve à s’appliquer à de nombreuses infractions figurant dans le code pénal. C’est d’abord le cas de la sanction des violences conjugales elles-mêmes ou de l’incrimination des mutilations sexuelles. En effet, les femmes qui en sont victimes n’ont pas comme but premier de faire sanctionner le comportement de leur conjoint/concubin/ex ou de leurs parents, mais cherchent avant tout à se protéger et à faire cesser ou à éviter les violences. Cependant, le caractère nécessaire de la sanction pénale dans ces circonstances n’est pas contestable.
Les délits pouvant sanctionner le comportement des parents qui tentent de marier leur enfant sans son consentement, ne couvrent pas le cas où aucune violence autre que psychologique n’est commise. Ainsi que le relevait le rapport de la mission sur la famille et les droits de l’enfant, « la création d’un tel délit pallierait l’absence actuelle d’une incrimination parfaitement adaptée à tous les cas de mariages forcés, alors que l’interprétation de la loi pénale est stricte et que, lorsque les pressions au mariage sont exclusivement morales, elles ne relèvent pas d’un délit préexistant. » (565) De surcroît, ainsi que le relève le Conseil de l’Europe, « le fait d’incriminer en tant que tel le mariage forcé permet de punir plus sévèrement cette infraction et d’unifier les peines applicables, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on recourt à des infractions de droit commun. »(566).
Le risque de déplacement du mariage forcé de la France vers le pays d’origine n’est pas nul. Il sera donc nécessaire de coupler l’introduction dans le code pénal de cette nouvelle incrimination à une meilleure prévention des risques de mariage forcé pratiqué à l’étranger qui concerne des jeunes filles vivant de manière habituelle en France (567).
Mais il est important d’indiquer de manière claire quelles sont les pratiques autorisées en France et quelles sont celles qui y sont interdites. C’est ce qu’indiquait déjà la Délégation aux droits des femmes en 2005 dans son étude sur les femmes de l’immigration : « la pénalisation des mariages forcés aurait une portée symbolique forte, celle de signifier aux familles qu’en France, on ne marie pas les filles sans leur consentement. C’est pourquoi la Délégation se prononce en faveur de cette mesure »(568).
2. La lutte contre les mutilations sexuelles s’est appuyée sur une ferme incrimination de cette pratique
Le fait de prévoir une incrimination pénale spécifique permet d’énoncer clairement l’interdit. « [Les mariages forcés] ne sont d’ailleurs pas inscrits dans la loi. Or tant que les délits ne sont pas précisément nommés, il est difficile de s’y référer. » (569)
L’exemple des mutilations sexuelles est, à cet égard, éclairant. Celles-ci sont en effet lourdement punies, puisque l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est sanctionnée par le code pénal de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (570). Or, la pratique de l’excision a fortement diminué en France depuis les grands procès des années 1990(571). Mme Armelle Andro, chercheuse à l’INED, a ainsi expliqué que : « [la] judiciarisation du problème a été très efficace dans l’éradication du phénomène sur le territoire national et la prévention du risque. […] Le cadre légal a été extrêmement efficace. Jusqu’à présent (un procès a eu lieu en Suisse) la France était le seul pays à poursuivre pénalement. Cela a eu des effets puisqu’aucune des jeunes filles que nous avons interrogées n’a été excisée sur le sol français dans les années 1990, alors que cette pratique y avait cours dans les années 1980. L’application de la loi et la médiatisation de plusieurs affaires ont éradiqué le phénomène sur le territoire ». (572)
Enfin, le fait de punir les mutilations sexuelles, qu’elles soient commises en France ou à l’étranger sur des mineurs résidant de manière habituelle en France (573), donne aux jeunes filles qui en sont menacées et à ceux de leurs parents qui les soutiennent un moyen de pression sur le reste de la famille. Cette mécanique a été décrite par Mme Armelle Andro : « Ce cadre légal très coercitif est un bouclier derrière lequel les femmes se protègent encore aujourd’hui. Des mères l’invoquent pour intimider les grands-mères restées au pays : « Si ma fille ne revient pas entière de ses vacances au pays, je me retrouverai en prison et tu en seras responsable » ou encore : « Les gendarmes français viendront te chercher au village si tu touches à ta petite fille ! » » (574)
Il n’y a pas de raison de penser que la création d’un délit de mariage forcé produise des effets diamétralement opposés à ceux qui résultent de l’existence d’une incrimination des mutilations sexuelles, comme le craignent certains.
3. Certains pays européens ont instauré un délit de mariage forcé
En 2005, d’après une étude du Conseil de l’Europe(575), deux pays européens avaient défini une infraction spécifique de mariage forcé :
— La Norvège, dans le cadre d’un programme d’action d’ensemble visant à lutter contre les mariages forcés, a introduit à l’article 222, alinéa 2, de son code pénal un article ainsi rédigé : « Quiconque force quelqu’un à conclure un mariage, en ayant recours à la violence, à la privation de liberté, à des pressions indues ou en ayant un autre comportement illicite ou en menaçant d’avoir un tel comportement est condamné pour mariage forcé. Le mariage forcé est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 ans. Un complice encourt la même peine.» ;
— L’Allemagne punit depuis 2005 les mariages forcés d’une peine de prison pouvant aller de 6 mois à 5 ans.
Le Conseil de l’Europe recommande d’ailleurs aux États membres d’« ajouter dans leur législation pénale une infraction spécifique « mariage forcé » avec des peines tenant compte des circonstances plus ou moins aggravantes. »
C. COMMENT PUNIR LE FAIT DE CONTRAINDRE AUTRUI À SE MARIER ?
Si l’on s’accorde sur la nécessité de sanctionner de manière spécifique les contraintes exercées en vue de forcer autrui à se marier, reste à définir les contours de ce nouveau délit.
1. Un délit spécifique et non une circonstance aggravante
L’hésitation est possible sur la nature de la forme à donner à la répression des mariages forcés : faut-il en faire une circonstance aggravante d’autres infractions (telles que celles de violence) ou un délit autonome ?
Selon M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des grâces, un avant-projet de loi élaboré par le ministère de la Justice « prévoit la création d’une circonstance aggravante des homicides, tortures et violences commis en cas de mariage forcé »(576).
Pourtant, cette solution présente deux inconvénients :
— D’une part, elle ne rend pas visible et immédiatement identifiable cette nouvelle incrimination. Une partie de la portée pédagogique de l’introduction de l’incrimination de la contrainte au mariage forcé dans le code pénal est donc négligée ;
— D’autre part, elle enlève la possibilité de graduer la sanction en fonction des faits et de prévoir des circonstances aggravantes pour ce délit.
Pour ces deux raisons, il serait préférable de créer un délit spécifique plutôt qu’une circonstance aggravante d’autres infractions.
Par ailleurs, la mission soutient l’idée exposée par M. Jean-Marie Huet de prévoir l’application de la loi pénale française « si les faits ont été commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement en France. » (577), à l’image de ce qui est prévu pour les mutilations sexuelles.
2. Une éventuelle extension aux unions forcées
Cette nouvelle infraction pourrait aussi concerner les unions forcées, qu’elles soient religieuses ou coutumières. En ce cas, il pourrait être fait renvoi, pour les définir, à l’article 433-21 du code pénal, qui énonce que « tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Une sanction similaire à celle qui porte sur les mariages forcés pourrait ainsi être prévue pour les unions forcées.
Proposition n° 56 :
Introduire dans le code pénal un délit de contrainte au mariage, applicable aux mariages forcés ayant lieu en France et à l’étranger sur des personnes résidant de manière habituelle en France.
C’est en 1992, il n’y a même pas vingt ans, que le législateur français a défini la notion de harcèlement, d’abord en droit pénal puis en droit du travail, sous l’influence, notamment, du droit communautaire. Le harcèlement constitue donc une notion juridique assez récente, qui a déjà connu un certain nombre d’améliorations. Pour autant, les auditions ont montré à la mission que cette législation reste encore perfectible.
A. LA DÉFINITION JURIDIQUE DU HARCÈLEMENT : UNE ÉLABORATION PROGRESSIVE
1. Une évolution de près de vingt ans
La première loi française à avoir consacré la notion de harcèlement est la loi du 22 juillet 1992 relative au délit de harcèlement sexuel, en partie sous l’influence du droit communautaire.
Le caractère relativement tardif de cette législation est ainsi analysé par un avocat spécialiste des questions de harcèlement : « la difficulté à identifier la violence engendrée par le harcèlement sexuel, identification postérieure aux autres violences commises à l’encontre des femmes, démontre que ce sujet était manifestement « tabou ». L’accroissement du nombre des femmes sur le marché du travail, la fin de la période de plein emploi et la précarisation du statut des salariées constitueront des facteurs incitatifs à l’élaboration de la législation en la matière » (578).
C’est aussi sous l’incitation de la recommandation de la Commission européenne du 27 novembre 1991 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail que cette évolution s’est dessinée. Selon cette recommandation, « tout comportement intempestif à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe, qui affecte la dignité de la femme et de l’homme au travail, que ce comportement soit le fait de supérieurs hiérarchiques ou de collègues, est inacceptable et peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l’égalité de traitement ».
a. La consécration du harcèlement sexuel
● La consécration pénale du harcèlement sexuel
La loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a créé l’article 222-33 du code pénal, consacré au délit de harcèlement sexuel.(579)
Cette première définition, pour importante qu’elle ait été, s’est révélée comporter certaines limites, l’acte de harcèlement ayant pu être accompli sans ordre, menace ni contrainte. Aussi la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a-t-elle supprimé, à l’image, comme on le verra, de ce qu’elle faisait également s’agissant de la définition du code du travail, la référence aux modalités de commission de l’acte.
La nouvelle rédaction de l’article 222-33 du code pénal dispose que « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Cette définition, qui prévaut toujours aujourd’hui, a ouvert une possibilité d’incrimination quelles que soient les modalités du harcèlement. En outre, son champ d’application est particulièrement large au contraire de la définition « sociale » du harcèlement telle qu’elle figure dans le code du travail, qui ne s’applique qu’au milieu professionnel.
● La définition « sociale » du harcèlement dans le code du travail
La loi du 2 novembre 1992 (580) a, quelques mois après la consécration du délit de harcèlement sexuel, défini le harcèlement sexuel en droit du travail.
La portée de cette définition a été progressivement étendue (581), jusqu’à ce que la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, comme elle l’a fait pour le code pénal, ait supprimé toute référence aux modalités de la commission de l’acte de harcèlement. Elle a aussi supprimé l’exigence d’«abus d’autorité» ce qui a conduit à un élargissement important du champ d’application de la notion, notamment en visant le harcèlement entre collègues, voire le harcèlement exercé par un subordonné envers un supérieur hiérarchique. Enfin, sous l’influence du droit communautaire, elle a établi un régime «d’aménagement de la charge de la preuve» plus favorable au demandeur, soumis à la seule obligation de présenter des « éléments de fait » en cas de litige. La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 est ensuite revenue sur ce point en exigeant que la partie demanderesse présente «des faits» de nature à prouver ses allégations en cas de litige (582).
La dernière étape de cette évolution doit être mentionnée, même si elle peut apparaître formelle : la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) relative à la recodification du code du travail, a scindé en deux l’ancien article L. 122-46, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 1153-1 et L. 1153-2 du code du travail, de manière à distinguer la définition de la pratique du harcèlement sexuel, interdite, de son effet, à savoir l’impossibilité de sanctionner ou licencier une personne à raison de tels faits.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, aux termes de l’article L. 1153-1, « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ». L’article L. 1153-2 prévoit quant à lui qu’« aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel » (583).
Cette législation sociale spécifique comporte un volet pénal : aux termes de l’article L. 1155-2 du code du travail, toute infraction aux dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Ainsi, une personne présumée coupable de harcèlement sexuel peut être poursuivie à la fois sur le fondement de l’article 222-23 du code pénal et sur celui de l’article L. 1155-2 du nouveau code du travail.
Le Conseil constitutionnel, amené à statuer sur la coexistence de ces textes incriminant deux fois le même agissement, a considéré qu’« en vertu de l’article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; le principe de proportionnalité qui en découle implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d’un seul et même fait, les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé », principe énoncé à l’article 132-3 du code pénal584. Par conséquent, l’auteur d’un harcèlement sexuel s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 15 000 euros.
● La définition du harcèlement sexuel dans la fonction publique
Si le régime pénal du harcèlement sexuel est applicable aux fonctionnaires, il n’en va pas de même du régime « social ». Aussi le législateur a-t-il souhaité prévoir des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires des trois fonctions publiques (fonctions publiques d’État, hospitalière et territoriale) (585).
C’est ainsi que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a créé un nouvel article 6 ter dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette définition, elle aussi, a été modifiée par la loi de modernisation sociale, comme elle l’avait fait pour le régime social, en supprimant à la fois la notion d’abus d’autorité et l’énumération des modalités mises en œuvre pour désigner les faits de harcèlement comme étant les agissements « de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers »,. Cette même loi a aussi étendu le champ d’application de ce régime aux agents non titulaires de droit public.
Enfin, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a précisé qu’est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé « ou enjoint » de procéder aux agissements de harcèlement sexuel.
b. La consécration du harcèlement sexiste
Le harcèlement sexiste est, en fait, une des formes du harcèlement moral, à savoir le harcèlement moral fondé sur le motif du sexe.
Le droit français n’a pas reconnu le «harcèlement sexiste» en tant que tel mais la loi de modernisation sociale a consacré le régime juridique du harcèlement moral, régime tant pénal que social, respectivement aux articles 222-33-2 du code pénal et aux articles L. 122-49 et suivants du code du travail, en une définition qui est toujours en vigueur. Par ailleurs, elle a aussi prévu des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires.
● Le régime pénal du harcèlement sexiste
Aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal, «le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende». Ce régime, défini en 2002, n’a pas été modifié depuis.
● Le régime social du harcèlement sexiste
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En outre, conformément à l’article L. 1152-2, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »
Comme il en va pour le harcèlement sexuel, le régime social du harcèlement sexiste est puni de sanctions pénales spécifiques : aux termes de l’article L. 1155-2 du code du travail également, toute infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Ce régime est également inchangé depuis 2002.
● Le régime applicable à la fonction publique
Se calquant sur la démarche suivie en matière de harcèlement sexuel, le législateur, lorsqu’il a consacré le harcèlement moral, donc notamment sexiste, en droit du travail, a prévu des dispositions semblables dans le statut général des fonctionnaires par l’introduction d’un article spécifique, l’article 6 quinquies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Au total aujourd’hui, on peut donc parler de harcèlement moral, y compris sexiste, à condition que soient réunis les éléments suivants : des agissements répétés ; une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du fonctionnaire.
Cette longue évolution, multiforme, atteste que, bien qu’apparue récemment, la notion de harcèlement a déjà connu un certain nombre d’évolutions dans le droit français. Un dernier pas a été franchi avec la loi du 27 mai 2008.
Alors que, pour l’essentiel, le régime juridique des infractions de harcèlement sexuel et de harcèlement sexiste était stabilisé depuis la loi de modernisation sociale, sous l’influence du droit communautaire, un pas nouveau a été franchi.
a. Une nouvelle définition sous l’impulsion du droit communautaire
Le droit communautaire distingue entre le « harcèlement » (qui correspond en fait au harcèlement sexiste) et le « harcèlement sexuel » (586). Il en résulte que :
– Le harcèlement est défini comme la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne, dans le cas du harcèlement sexiste, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
– Le harcèlement sexuel est défini, quant à lui, comme la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
b. qui s’ajoute au droit existant
De manière à satisfaire à ces exigences du droit communautaire (587), l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 a transposé en droit français la définition communautaire du harcèlement et du harcèlement sexuel, en l’incluant dans le régime des discriminations. Aux termes de cet article, la discrimination inclut tout agissement lié notamment (588) au sexe et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Ce faisant, le droit français s’aligne sur le droit communautaire :
– le harcèlement moral est défini par référence à des motifs exprès, dont le sexe, ce qui permet de disposer d’une définition précise du harcèlement sexiste ;
– le harcèlement sexiste comme sexuel peut être avéré dans les situations où un seul acte a été commis ;
– l’assimilation de la notion de harcèlement à une discrimination et même, à la suite de la discussion parlementaire, son inclusion dans la catégorie des discriminations, permet par exemple de donner compétence en matière de harcèlement à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), dont les missions sont définies par référence à cette notion. En outre, cette assimilation permet au demandeur, dans un litige concernant un harcèlement, de bénéficier, comme en matière de discrimination, d’un régime plus favorable en matière de preuve (il doit présenter des faits à l’appui de sa demande sans avoir à supporter l’intégralité de la charge de la preuve).
B. UNE NOTION DIFFICILE À MOBILISER POUR RÉPRIMER LES COMPORTEMENTS DE HARCÈLEMENT
Il existe aujourd’hui des interrogations sur la définition du harcèlement sexuel et sexiste en droit français.
Ces réserves sont de deux ordres. Les premières portent sur la définition du harcèlement telle qu’elle figure depuis 2002 dans le corpus juridique français. Les secondes sont liées à la consécration parallèle d’une nouvelle définition du harcèlement par la loi du 27 mai 2008 : l’avancée que représente, sur le fond, la définition de 2008 n’est pas niée mais les critiques portent davantage sur des questions de cohérence et de lisibilité juridique, qui ne sont toutefois pas dépourvues d’incidences sur le fond des dispositions applicables.
1. Des réserves relatives à la définition du harcèlement sexuel issue de la loi du 17 janvier 2002
Ces interrogations portent sur la définition même du harcèlement mais aussi, plus généralement, sur la diversité de concepts aux contours parfois mal définis, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel, sexiste, discriminatoire, etc.
a. La question de la définition du harcèlement sexuel
La définition du harcèlement sexuel consacrée en 2002, telle qu’elle figure dans le code pénal, qui réprime « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », mais également telle qu’elle figure dans le code du travail ou dans le statut général des fonctionnaires appelle plusieurs observations :
– La définition du harcèlement serait en grande partie tautologique. Le texte, en se fondant sur « le fait de harceler », laisse à la jurisprudence le soin de déterminer ces faits. Est retenu de manière générale « tout comportement indélicat caractérisé par des questions portant sur la vie privée, la tenue vestimentaire d’une salariée, les invitations pressantes à déjeuner et les gestes équivoques, provoquant chez elle un profond malaise » (Cassation sociale, 30 septembre 2003).
Lors de son audition par la mission (589), Mme Marylin Baldeck a ainsi fait observer : « (…) s’agissant du harcèlement sexuel, le problème vient bien de la loi elle-même car, notamment, l’article 222-33 du code pénal ne le définit pas. Selon la loi, le harcèlement sexuel est le fait de harceler autrui, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Comme si l’on définissait le vol par le fait de voler ! ».
– La question de la répétition des faits n’est pas toujours aisée à trancher non plus. Le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 évoquent « les » agissements de harcèlement sexuel, le code pénal « le fait de harceler », mais dans aucun cas la condition de répétition ne figure expressément. Lors des débats parlementaires, il a été indiqué que la jurisprudence « devrait saisir que le terme harcèlement sexuel a un effet d’affiche mais que le texte permet que le délit soit constitué même en cas d’acte unique ». Un seul acte de chantage à l’embauche, par exemple, devrait caractériser l’acte de harcèlement (JOAN, 2 décembre 1991).
Toutefois, une analyse des décisions rendues en matière de harcèlement sexuel montre que la notion de durée ou d’actions répétées est assez souvent requise pour caractériser l’acte de harcèlement. En effet, même si, à la différence du harcèlement moral, la loi n’exige pas des « agissements répétés », le verbe harceler implique le renouvellement des sollicitations pour parvenir à ses fins, supposant à tout le moins une forme d’obstination. Certains juges exigent dès lors une pluralité d’actes en faisant une application littérale de la lettre du code du travail qui interdit « les agissements » de harcèlement sexuel (voir par exemple Cour d’appel de Paris, 2 octobre 1996, Cordier c. Sté Chelles Diffusion Presse).
– La référence aux « faveurs de nature sexuelle » a aussi été discutée. Cette notion n’est en effet pas définie, ni dans le code du travail, ni dans le code pénal, ni dans la loi du 13 juillet 1983. Or cette référence aux contours ambigus peut impliquer l’idée d’une forme de consentement mutuel. Dans un arrêt qui remonte au 18 janvier 1996, la Cour d’appel de Paris a estimé que correspond à des faveurs de nature sexuelle « tout acte de nature sexuelle et notamment les simples contacts physiques destinés à assouvir un phantasme d’ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel ; ». Un autre arrêt, de la Cour d’appel de Bordeaux, en date du 1er octobre 1997, rappelait que le harcèlement est essentiellement une agression sexuelle à caractère verbal (propos, injures, invectives), et qu’il suffit que ces termes soient connotés sexuellement directement ou indirectement pour constituer une « provocation sexuelle ».
– La nécessité de prouver que l’acte a été commis « dans le but » d’obtenir de telles faveurs, autrement dit l’intentionnalité, a été aussi mise en question. Il revient en effet à la partie demanderesse d’apporter la preuve de l’intention de l’auteur du harcèlement sexuel d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Lors de son audition par la mission (590), Mme Marylin Baldeck a indiqué : « Par ailleurs, pour que l’infraction soit constituée, il faut que la victime apporte la preuve de l’intentionnalité de l’auteur d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Or ceci est quasiment impossible[…] puisque, bien souvent, le harcèlement sexuel n’a pas cet objectif ; il a pour objectif d’humilier une personne, de la faire partir, d’exercer un pouvoir, certes de nature sexuelle. Il est donc très difficile, pour les magistrats, de retenir des éléments matériels et un élément intentionnel. Voilà pourquoi, entre autres, nous échouons, à réprimer les agissements de harcèlement sexuel. Je précise que ce texte a été voté en violation totale du principe de légalité des délits et des peines. En effet les infractions pénales doivent être très précisément rédigées afin d’être d’application stricte. Cette définition pose donc un problème fondamental de droit ».
En sens contraire, une définition trop restrictive des faits répréhensibles dans le code pénal aurait probablement suscité une réaction qui n’aurait pas été moins vive. De même, s’agissant des « faveurs sexuelles », il faut rappeler que peu importe que celles-ci aient ou non été obtenues : la seule tentative est jugée suffisante pour caractériser l’infraction. En outre, les termes « faveurs sexuelles » sont assez larges et comprennent une assez grande variété de comportements sexuels. Ces remarques ne vident pas pour autant, bien sûr, les observations formulées de toute pertinence.
Enfin l’intervention de la loi du 27 mai 2008, sans annuler la portée des remarques précitées, conduit à les considérer dans une perspective nouvelle.
b. La question de l’existence de notions diverses aux contours parfois flous
Aujourd’hui prévalent en droit français un certain nombre de notions aux contours parfois imprécis.
En droit, ces notions sont certes identifiées. On a vu la distinction entre le harcèlement sexuel et le harcèlement sexiste. Mais en pratique est-elle toujours si tranchée ? Dans l’ouvrage qu’elle a consacré au harcèlement moral dans la vie professionnelle, Mme Marie-France Hirigoyen, en réponse à la question : « le harcèlement moral est-il sexué ? », propose l’élément de réponse suivant : « Non seulement les femmes sont davantage victimes, mais on les harcèle différemment des hommes : les connotations machistes ou sexistes sont souvent présentes. Le harcèlement sexuel n’est qu’un pas de plus dans le harcèlement moral »(591).
D’aucuns évoquent aussi le harcèlement « environnemental », sous l’influence du droit communautaire qui prohibe les pratiques ayant pour objet ou pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Par ailleurs, il convient de distinguer, conformément aux dispositions du code pénal français, entre le harcèlement sexuel et le viol ou les autres agressions sexuelles. L’enjeu n’est pas négligeable, dans la mesure où les agressions sexuelles sont punies d’autres peines que les actes de harcèlement sexuel (une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende).
Si ces différentes notions sont juridiquement assez précisément identifiées, en pratique, leur coexistence peut être à l’origine de pratiques dites de « déqualification ». Lors de leur audition par la mission, les auteurs du rapport des inspections générales sur l’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes ont ainsi souligné que « selon plusieurs associations, le harcèlement moral est le « meilleur ennemi » du harcèlement sexuel : il est plus facile et moins connoté de se plaindre de harcèlement moral. Une sorte de chaîne de déqualification des infractions aboutit à la requalification du viol en agression sexuelle, de l’agression sexuelle en harcèlement sexuel, du harcèlement sexuel en harcèlement moral »(592).
2. Des interrogations nouvelles depuis la loi du 27 mai 2008
La consécration de la définition communautaire du harcèlement et du harcèlement sexuel par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations pose ces questions sous un jour nouveau.
● L’absence de référence expresse à la notion de « harcèlement »
La définition figurant dans la loi du 27 mai 2008 ne fait pas expressément référence ni à la notion de « harcèlement sexuel », ni à celle de « harcèlement sexiste ».
Lors de son audition par la mission, Mme Marylin Baldeck a ainsi rappelé : « la loi du 27 mai 2008 ne comporte même pas le terme de « harcèlement sexuel » ! Cela a par exemple pour conséquence qu’un avocat qui aurait à défendre une cliente victime de harcèlement sexuel, qui ne connaîtrait pas ou peu ce contentieux qui est assez rare, et qui ferait une recherche dans une base de données juridiques pour connaître les textes applicables et la jurisprudence ne la trouverait pas à partir du mot-clé « harcèlement sexuel ». Cette loi échappe ainsi totalement à l’activité juridictionnelle actuelle. Les avocats avec lesquels nous travaillons ne la connaissent d’ailleurs pas non plus ; nous passons beaucoup de temps à les informer de l’existence de ce texte » (593).
De fait, si l’on se réfère au texte de l’article 1er de la loi, « la discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant (…)».
Cette définition ne mentionne donc pas expressément ni la définition de « harcèlement sexiste », ni celle de « harcèlement sexuel », ni d’ailleurs même la seule notion de « harcèlement ». Une personne n’ayant pas connaissance de cette loi et procédant à une recherche dans le corpus législatif français(594) à partir du seul terme « harcèlement » ne pourra donc trouver cette définition.
La définition est, en fait, comme « calée » sur la notion de discrimination. Conformément à la démarche retenue en droit communautaire en effet, le législateur n’a pas opté pour une présentation « classique » consistant à définir directement le harcèlement sexuel mais la notion qui correspond au harcèlement est considérée comme « incluse » dans la notion plus générale de discrimination. Cette assimilation, on l’a vu, présente notamment l’avantage de donner compétence à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), dont la compétence est définie par référence à la notion de discrimination, pour connaître des situations de harcèlement.
● L’absence de codification de cette définition
Un deuxième ensemble d’observations concerne l’absence de codification de la définition figurant à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.
La notion de harcèlement sexuel adoptée avant la loi du 27 mai 2008 figure dans le code du travail s’agissant de sa définition et dans le code pénal s’agissant des sanctions applicables.
Il n’en a pas été de même avec la loi du 27 mai 2008. Les définitions de la discrimination directe et indirecte qu’elle introduit, l’inclusion dans le régime des discriminations des notions de harcèlement ainsi que de l’injonction à pratiquer une discrimination ne sont pas codifiées.
Dans son rapport préparatoire à la discussion, Mme Muguette Dini, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, a soulevé ce point(595). Ces développements ne s’appliquent pas spécifiquement à la notion de harcèlement, mais ils l’incluent : « (…) les cinq premiers articles du projet de loi, qui incluent par exemple la définition de la discrimination directe et indirecte, ne sont pas codifiés. Ce choix est d’autant plus singulier que le code du travail comporte une section « discriminations » susceptible d’accueillir ces dispositions et de former un ensemble homogène de mesures dotées de plus de solennité que si elles demeurent formulées à part dans une loi auquel le code renverra ». Elle mentionne, plus généralement, un problème de lisibilité du projet de loi, qui soulève des enjeux importants : « D’une manière générale, le projet de loi pose donc un problème d’accessibilité du droit : sa forme, indépendamment du fond, rend la législation relative aux discriminations moins compréhensibles pour les citoyens ».
La non-codification de la définition du harcèlement sexuel et sexiste soulève de fait un problème d’accessibilité au droit, le premier réflexe en cas de litige d’ordre professionnel étant de se référer au code du travail. Il reste que l’objectif du projet de loi, comme l’a rappelé Mme Valérie Létard tant devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat, était de répondre aux exigences du droit communautaire en transposant, de la manière la plus fidèle possible, les définitions contenues dans les directives dans le droit français, non de procéder à une refonte d’ensemble du régime des discriminations et du harcèlement.
La non-inscription de la définition communautaire du harcèlement sexuel dans le code du travail a permis de ne pas porter atteinte au droit existant, du code du travail et du code pénal, et donc à la jurisprudence en découlant. Mais par-delà la question de la lisibilité des textes juridiques, ce choix engendre des interrogations de fond.
● La coexistence des définitions civiles
Aujourd’hui coexistent plusieurs définitions du harcèlement sexuel, à commencer par les deux définitions qui figurent respectivement dans la loi du 27 mai 2008 et dans le code du travail.
Le rapport précité de Mme Muguette Dini, est allé, sur cette question, jusqu’à évoquer « des inquiétudes » : « le projet de loi propose une définition du harcèlement, telle qu’issue des directives, sans prévoir qu’elle se substituera à la définition en vigueur actuellement. Il en résultera, au seul niveau civil, que deux notions différentes du harcèlement seront opposables en droit français, au détriment de la sécurité juridique des personnes et de l’égalité des citoyens devant la loi : des individus placés dans des situations semblables pourront se voir appliquer un jugement différent selon que l’une ou l’autre définition sera invoquée par l’avocat et retenue par les magistrats ».
Ce risque de traitement inégalitaire des citoyens doit cependant être nuancé. Comme le rappelle M. Michel Miné dans un article publié sur le site Internet de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, si effectivement deux définitions sont désormais applicables devant le juge civil, le droit interne, selon une jurisprudence communautaire constante, doit être appliqué « à la lumière » du droit communautaire : dès lors, « le maintien de l’ancienne définition dans le code du travail "recodifié" ne pourra pas faire obstacle à l’application de la nouvelle définition de la loi ». Il n’en reste pas moins que la question de la lisibilité et de l’accessibilité au droit subsiste.
● La coexistence des définitions « civiles » et « pénales »
Jusqu’à la loi du 27 mai 2008, la définition du code pénal était calée sur celle du code du travail : l’article L. 1153-1 du code du travail comme l’article 222-33 du code pénal interdit pour le premier et réprime au plan pénal pour le second le harcèlement en ce qu’il a pour « but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».
Cette notion de but a déjà été critiquée par certains observateurs avant la loi du 27 mai 2008 (voir supra) : si en effet une personne agissait non directement pour asseoir son pouvoir ou pour humilier une autre personne, alors elle pourrait se voir d’une certaine manière exonérée de sa responsabilité.
Les réserves déjà manifestées avec d’autant plus de vigueur du fait de la publication de la loi du 27 mai 2008 : la définition prévue à l’article 1er de la loi répond en effet aux objections dans la mesure où elle renvoie à tout agissement « ayant pour objet ou pour effet » de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans la mesure où cette loi n’a pas donné lieu à la modification, en conséquence, de la définition prévue par le code pénal, les faits qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel au regard de la loi du 27 mai 2008 ne sauraient être passibles de sanctions pénales. C’est ce qu’a souligné Mme Marylin Baldeck lors de son audition par la mission (596) : « cette loi ne change rien en matière pénale puisqu’elle n’a pas été codifiée dans le code pénal. Dans celui-ci, la définition pénale du harcèlement sexuel n’a pas été modifiée ».
Face à ces incertitudes, certains juristes se sont interrogés sur l’opportunité du maintien de ces deux règles : « son intérêt réside-t-il dans le fait que le harcèlement puisse aussi exister sans lien avec un motif discriminatoire ? » s’est par exemple interrogée la juriste Mme Marie-Thérèse Lanquetin (597).
Le rapport des inspections générales consacré, en juillet 2008, à l’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes mentionne aussi le fait qu’« une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur la définition du harcèlement sexuel dans le code pénal », compte tenu des définitions contenues dans les directives communautaires.
Proposition n° 57 :
Harmoniser les définitions du harcèlement sexuel prévues dans le code du travail et dans le code pénal, en les alignant sur la définition issue du droit communautaire.
Le viol est défini par la loi du 23 décembre 1980 comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23 du code pénal).
Grâce à cette nouvelle définition du viol puis à la jurisprudence, le viol entre époux a été reconnu, malgré une tradition juridique séculaire affirmant l’existence d’un « devoir conjugal » entre les époux. La loi du 4 avril 2006 a inscrit dans la loi l’incrimination du viol entre époux sans toutefois en tirer toutes les conséquences.
A. LA RECONNAISSANCE DU VIOL ENTRE ÉPOUX PAR LA JURISPRUDENCE PUIS PAR LA LOI EST UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE
Jusqu’au début des années 1990, le viol entre époux n’existait pas. La doctrine considérait alors que le mari « n’emploie la force que pour contraindre sa femme à des relations normales, c'est-à-dire conformes à l’ordre de la nature et ne causant aucune blessure. » (598) À vrai dire, le « devoir conjugal » justifiait l’infraction.
1. La reconnaissance du viol entre époux par la jurisprudence
Une fois le viol défini dans le code pénal, la Cour de cassation a ensuite, au début des années 1990, reconnu la possibilité qu’il existe un viol entre époux :
— Par une décision du 5 septembre 1990, elle a estimé que l’incrimination du viol « n’a d’autre fin que de protéger la liberté de chacun, et n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage, lorsqu’ils sont imposés dans les circonstances prévues par ce texte »(599) ;
— Dans une autre décision, du 11 juin 1992, cassant un arrêt d’une cour d’appel qui estimait que le mariage légitimait les rapports sexuels et qu’une épouse ne pouvait pas invoquer son absence de consentement, la Cour de cassation a affirmé que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire »(600).
2. Son inscription dans la loi, une nouvelle avancée
C’est ce dernier attendu qui a été inscrit dans la loi le 4 avril 2006. En effet, le deuxième alinéa de l’article 222-22 du code pénal tel qu’il résulte de cette loi est ainsi rédigé : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».
La loi du 4 avril 2006, pour tirer définitivement un trait sur la notion de « devoir conjugal », n’a pas seulement légalisé la jurisprudence de la Cour de cassation, mais a fait du viol commis par un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un PACS une circonstance aggravante par l’insertion d’un 11° à l’article 222-24 du code pénal.
De ce fait, la loi offre désormais un arsenal répressif complet pour punir les auteurs de viols au sein du couple.
B. IL FAUT TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES DE CETTE RECONNAISSANCE
Cependant, la formulation retenue qui mentionne la « présomption de consentement des époux à l’acte sexuel » a soulevé des remarques. C’est ce qu’a indiqué Mme Marilyn Baldeck au cours de son audition : « De ce fait, le code pénal inscrit noir sur blanc une présomption de consentement à l’acte sexuel, quel que soit d’ailleurs cet acte – il n’est pas défini – à condition que les personnes soient mariées. Cela pose un problème philosophique de taille. Les associations féministes se battent depuis des années pour que, au contraire, on ne présuppose pas la disponibilité sexuelle des individus, qu’ils soient des hommes ou des femmes et que l’indisponibilité sexuelle soit posée jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption est de notre point de vue inacceptable, même dans le cadre d’un couple marié. »
Ceci va à l’évidence à l’encontre de l’intention du législateur de 2006, qui a entendu reconnaître le viol entre époux et non une « présomption de consentement ».
D’ailleurs, cette phrase semble être sans portée juridique, ainsi que l’a indiqué M. Didier Guérin, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Lorsqu’un époux est accusé d’avoir violé son épouse, il faut que l’accusation établisse les faits. Donc, il n’y a aucune présomption qui joue dans ce cas. » (601) Ainsi, cet alinéa ne semble jamais avoir été invoqué par un mis en cause : « J’étais, il y a deux ans encore, dans une chambre de l’instruction. De nombreuses affaires de viols entre époux y étaient traitées, mais personne n’est venu plaider devant nous la présomption de consentement, d’autant que les plaintes des épouses s’appuyaient sur des violences très graves. Il n’y avait aucun doute. »
Si la reconnaissance par la loi du viol entre époux, accompagnée du vote d’une circonstance aggravante était donc une avancée importante, il faut en tirer les conséquences en supprimant cette phrase de l’article 222-24 du code pénal.
Proposition n° 58 :
Conforter la reconnaissance du viol entre époux en supprimant du code pénal la mention de la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel.
SIXIÈME PARTIE : SYSTÉMATISER LA COORDINATION DES ACTEURS, EN PARTICULIER AU SEIN DU MONDE JUDICIAIRE
La coordination entre les différents acteurs est une condition nécessaire de l’efficacité de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Celle-ci prend place au niveau national comme au niveau local.
Des difficultés spécifiques se posent également au sein du monde judiciaire. En effet, la spécialisation des juges du siège dans des contentieux particuliers ne permet pas toujours de faire le lien entre les divers aspects d’une même situation de violences.
I. UN PILOTAGE SOUS L’ÉGIDE DU MINISTRE CHARGÉ DES DROITS DES FEMMES
Les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes mettent en jeu un nombre considérable d’intervenants que ce soit au niveau ministériel ou au niveau local, comme l’a montré la multiplicité des sujets qui ont retenu l’attention de la mission. Leur bonne coordination est donc un enjeu majeur de l’efficacité des politiques de prévention et de lutte contre les violences.
La coordination et le maillage territorial se sont développés sous l’impulsion notamment des deux plans triennaux de lutte contre les violences. C’est ainsi que le plan triennal 2008-2010 a pour objectif de « coordonner tous les acteurs et relais d’action » en apportant une réponse globale aux femmes victimes de violences et en renforçant la politique partenariale .
A. LE PILOTAGE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
1. La coordination au plan national
La première instance de concertation au niveau national est la Commission nationale contre les violences faites aux femmes créée par décret en 2001 (602), auprès du ministre chargé des droits des femmes avec comme objectif de mettre en place une instance de pilotage articulant les politiques publiques relatives aux violences faites aux femmes. Elle a pour mission d’organiser la concertation des services de l’État avec les organismes et associations concernés, d’animer le réseau des commissions départementales, d’émettre des recommandations, de produire des données et de commander des analyses sur la situation des femmes victimes de violence.
La commission s’appuie sur le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) dont l’organisation fait actuellement l’objet d’importantes évolutions. En effet, celui-ci, dans le cadre de la réforme de l’État et de la Révision Générale des Politiques Publiques, devrait être intégré au sein de la future Direction générale de la cohésion sociale.
Comme l’a précisé la secrétaire d’État à la solidarité, Mme Valérie Létard, la responsable du SDFE sera officiellement nommée déléguée interministérielle et « sera chargée de piloter, d'animer et de coordonner la politique publique, transversale et interministérielle, des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, au niveau national comme au niveau local. Comme aujourd'hui, le service s'appuiera sur le réseau constitué des déléguées régionales – intégrées dans les SGAR – et des chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l'égalité implantées sur le territoire. » (603)
Interrogée sur ce point, la ministre a précisé avoir été très attentive « à ce que l’équipe SDFE reste au complet et soit pilotée par une déléguée interministérielle qui aura toujours cette mission transversale. Elle bénéficiera d’ailleurs de la machine administrative d’une grande direction, qui lui donnera certainement beaucoup plus de moyens de fonctionnement. » (604)
Cette évolution ne doit cependant pas se traduire par une moindre capacité d’action du SDFE sur le plan interministériel. Ce risque a été soulevé par Mme Patricia Vienne, coauteur du rapport des inspections générales sur le plan le premier plan global triennal : « À l’échelon national, si le service des droits des femmes et de l’égalité est fusionné dans une grande direction, telle que la direction de la cohésion sociale, les problématiques qu’il gère risquent aussi de cesser d’être interministérielles. Une vigilance collective est nécessaire pour maintenir et consolider la transversalité. » (605)
Des membres de la mission ont souligné que seul un ministre aux droits des femmes donnerait une visibilité suffisante aux politiques de défense des droits des femmes et d’égalité et serait le garant d’une véritable action coordonnée.
2. Vers un pilotage budgétaire transversal
La lutte contre les violences faites aux femmes et plus généralement les politiques en direction des droits des femmes relevant de politiques publiques interministérielles, leur financement dépend de programmes budgétaires qui n’appartiennent pas une même mission.
À compter de la loi de finances pour 2010, une annexe générale au projet de loi de finances doit récapituler les crédits consacrés aux politiques d’égalité entre les femmes et les hommes par les différents ministères qui sont impliqués (606).
Ce document transversal (607) devra préciser, comme pour les autres documents de politique transversale, la stratégie mise en œuvre, les crédits, les objectifs et les indicateurs concourant à la politique suivie. Il doit comporter également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à cette politique ainsi que les dispositifs mis en place.
Ce document permettra de conforter la dimension transversale, interministérielle et partenariale de la politique de promotion de l’égalité en mettant à la disposition des parlementaires un état récapitulatif qui permettra d’identifier la mobilisation de ces crédits selon leur affectation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Et comme l’a précisé la secrétaire d’État à la solidarité : « Il me paraît très important que cet outil identifie bien l’effort consenti par chaque ministère en faveur des droits des femmes. Il nous sera utile pour travailler sur la question des auteurs de violences avec le ministère de la justice, et aussi avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance – FIPD –, qui a mobilisé des crédits sur les actions de lutte contre toute forme de violences, les violences intrafamiliales étant pour la majeure partie des violences faites aux femmes. Des cofinancements ou des fléchages de crédits peuvent donc être envisagés. Cela fait partie des pistes sur lesquelles nous allons travailler de manière interministérielle. » (608)
B. LE RÔLE PIVOT DES DÉLÉGUÉES RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU SERVICE DES DROITS DES FEMMES
La révision générale des politiques publique (RGPP) a conduit à remodeler également l’organisation des services déconcentrés du SDFE.
Les déléguées régionales qui devaient initialement être intégrées dans les Directions régionales de la cohésion sociale vont finalement être rattachées aux Secrétaires Généraux aux Affaires Régionales (SGAR) des préfectures. La mission se félicite de cette décision qui permet de garantir à ces déléguées une capacité d’action et de coordination à l’échelon local.
En revanche, les chargées de mission départementales devraient être intégrées dans les nouvelles directions départementales de la cohésion sociale.
Les chargées de mission, comme les déléguées, jouent un rôle moteur pour favoriser le maillage territorial, pour organiser des actions de formation interdisciplinaires, pour rassembler et mobiliser les acteurs. La mission a pu constater lors de ses déplacements, combien la mobilisation opérée localement par les déléguées et les chargées de mission était un facteur crucial pour la conduite des politiques en direction des femmes et combien leur capacité à réunir et à mobiliser les multiples intervenants dépendait leur position auprès du préfet.
Des chargées de mission, intégrées au sein des directions de la cohésion sociale, vont se trouver placées à égalité avec les autres structures administratives et perdront leur rôle de coordination.
Elles auront alors plus de difficulté à organiser les actions qui sont par nature interministérielles comme la lutte contre les violences et les politiques d’égalité, au sein d’une organisation, où, en outre, l’échelon administratif que constitue le Directeur départemental à la cohésion sociale, lui-même placé sous l’autorité du préfet, va s’intercaler entre les déléguées régionales placées auprès des SGAR et les chargées de mission sur lesquelles ils auront en principe autorité.
Les répercussions de cette réorganisation doivent donc être bien mesurées, qu’il s’agisse de lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi, plus largement, en matière d’accès à l’emploi, de formation des femmes et de garantie de leurs droits.
C’est pourquoi la mission recommande que les chargées de mission départementales aux droits de femmes restent fonctionnellement rattachées au préfet. Il en va de leur autorité sur l’ensemble des acteurs du partenariat, de leur capacité à rassembler et à mobiliser.
Proposition n° 59 :
Maintenir le rattachement des chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité auprès des préfets.
II. DÉVELOPPER LES MISES EN RÉSEAU
La dimension interministérielle des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes se retrouve de la même façon au niveau local où un maillage territorial des dispositifs et la mobilisation coordonnée des acteurs locaux sont essentiels pour assurer la prise en charge des femmes.
A. LES EFFETS DE LA FUSION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES AU SEIN DES CONSEILS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Créées en 2001 (609), les commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes assuraient le pilotage du plan global triennal de lutte contre les violences au niveau local. Ces commissions présidées par les préfets et animées par les délégués des services déconcentrés aux droits des femmes, constituaient l’instance d’organisation et de coordination des actions locales portant, en particulier sur la formation, l’hébergement et le logement de femmes victimes de violences.
Depuis 2006, les commissions départementales sont intégrées aux Conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (610) (CDPD).
Selon le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple (611), à ce jour, environ 90 CDPD ont été mis en place, avec environ 80 sous-commissions spécifiques couvrant le champ des violences faites aux femmes, en comptant les commissions départementales – ancienne formule – qui continuent de fonctionner, sauf exception, dans les quelques départements où les CDPD n’ont pas été mis en place.
L’animation de ces sous-commissions est assurée par les déléguées régionales et les chargées de mission départementales, ce qui permet de décliner, au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, les violences faites aux femmes. Dans ce but, l’objectif n° 7 du plan violence 2008-2010 prévoit qu’une instruction conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère chargé de la solidarité soit adressée aux préfets pour « que chaque conseil départemental de prévention de la délinquance traite de la problématique des violences faites aux femmes et que celle-ci soit reprise dans le plan départemental de prévention ».
Cependant, cette réforme n’est pas sans conséquence, pour plusieurs raisons.
Les sous-commissions ne sont généralement pas présidées par le préfet, ce qui ne favorise pas la capacité de mobilisation des acteurs et en particulier des services de l’État, alors qu’une forte implication du préfet est un élément déterminant du succès du dispositif.
Il en résulte une perte de visibilité certaine des questions de violences faites aux femmes, qui sont abordées au travers d’un axe plus large qui est celui des violences intra-familiales ou de l’aide aux victimes et dans une logique de prévention de la délinquance, donc avec une approche plus étroitement policière et judiciaire.
En effet, le conseil départemental de prévention de la délinquance doté d’un champ très large, travaille essentiellement sur la base du rapport sur l’état de la délinquance établi par le conseil départemental de sécurité et sur celui relatif aux actions financées par le FIDP.
Ce point a été soulevé par le rapport d’évaluation du premier plan global triennal, qui souligne le risque d’une prise en charge des femmes victimes de plus en plus judiciaire et de moins en moins sociale, comme l’a indiqué à la mission Mme Marie-Grâce Lux, inspectrice de l’administration : « Malgré ses lacunes, la prévention de la délinquance est de plus en plus efficace, qu’elle soit menée sous l’égide des préfets, en relation avec les déléguées, ou sous celle des procureurs. Nous craignons cependant que les aspects sociaux, déjà parfois négligés, soient totalement marginalisés, et que la seule réponse apportée aux violences faites aux femmes soit policière et judiciaire. Ce n’est pas suffisant » (612).
Proposition n° 60 :
Réunir sous l’autorité du préfet des commissions spécifiquement consacrées aux violences faites aux femmes permettant d’identifier cette problématique, en coordination avec les politiques de lutte contre la délinquance.
B. GÉNÉRALISER LES PROTOCOLES DÉPARTEMENTAUX DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La mise en place de protocoles globaux au niveau des départements portant sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes constitue un outil indispensable de formalisation du partenariat et surtout de sa pérennisation.
La mise en place de protocoles locaux était prévue par le plan 2005-2007 et a été explicitée par la circulaire de mise en œuvre du plan du 24 mars 2005.
On en recense aujourd’hui une cinquantaine (613).
Ces protocoles doivent identifier les rôles de chacun, mettre en réseau les différents acteurs locaux, mutualiser leurs actions, fixer des objectifs et évaluer les actions menées au niveau local. Ils ont également un rôle important de diagnostic pour identifier les besoins et leur adéquation aux moyens disponibles.
Ces plans constituent un outil efficace comme la mission a pu le constater lors de ses déplacements. C’est ainsi, par exemple, qu’un protocole relatif à la protection et à l’accompagnement des victimes de violences conjugales et à la prévention de la récidive par le traitement pénal, social et thérapeutique des mis en cause a été conclu entre le préfet des Bouches-du-Rhône, le Président du TGI , le procureur de la République, le Président du Conseil général, le Président du Conseil régional, le service d’insertion et de probation, le maire d’Aix-en-Provence et des associations d’aide aux victimes et de suivi des auteurs de violence.
Il s’agit donc de dispositifs qui doivent être développés mais aussi approfondis notamment par la réalisation de diagnostics locaux et la fixation d’indicateurs chiffrés (614) qui permettent d’assurer un véritable suivi sous le contrôle du préfet.
Ces diagnostics ne sont, en effet, pas toujours réalisés ne serait-ce qu’en matière de recensement et de définition des besoins en structures d’hébergement (615).
Proposition n° 61 :
Généraliser les protocoles départementaux de prévention et de lutte contre les violences.
Ces plans doivent aussi être articulés avec les autres dispositifs locaux de coordination et de prévention. Le plan 2008-2010 prévoit en son objectif n° 7 qu’il sera demandé « aux préfets de veiller à associer l’ensemble des acteurs concernés, de décliner cette question dans les dispositifs locaux que sont les CUCS, les contrats locaux de sécurité, les conseils communaux et intercommunaux de prévention de la délinquance, les programmes régionaux d’intégration et de mobiliser les financements dont ils disposent, notamment ceux du FIPD » et sont indispensables à une plus grande implication des collectivités locales dans les actions de prévention.
En effet, le rôle des collectivités locales devrait être mieux valorisé dans le plan de lutte contre les violences comme l’a souligné le rapport d’évaluation du premier plan global triennal. Le maire, en particulier, a un rôle de pilotage important à jouer quant aux actions de prévention de la délinquance, au travers des contrats locaux de sécurité et des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Cette nécessaire mobilisation a été soulignée par la secrétaire d’État, Mme Valérie Létard : « Il faut que les structures intercommunales de prévention soient le lieu qui permette d’avoir une commission spécifique sur les violences intrafamiliales, qu’elles puissent s’assurer qu’un programme d’action soit mis en place, qu’elles puissent identifier les besoins pour monter des plans d’action annuels en mobilisant les moyens alloués à l’aide aux victimes du ministère de la justice, ceux du FIPD, mais aussi ceux des contrats urbains de cohésion sociale et de l’ensemble des politiques publiques » (616).
C. CONFORTER LES RÉFÉRENTS LOCAUX VIOLENCES CONJUGALES DANS LEUR RÔLE D’INTERFACE
L’objectif 6-3 du plan 2008-2010 prévoit, dans la perspective d’un maillage du territoire, de mettre en place des référents locaux qui s’assurent « de l’accompagnement et du suivi de la personne accueillie, dans un parcours individualisé ».
Ces référents locaux sont appelés à être des « interlocuteurs uniques de proximité » qui orientent et accompagnent dans leurs démarches les femmes victimes de violence au sein du couple afin que celles-ci n’aient pas à rechercher tous les interlocuteurs susceptibles de les aider (617). Ils ont vocation à prendre en charge les situations les plus lourdes et à assurer un accompagnement individuel tout au long du parcours de la victime, jusqu’à la réinsertion.
Comme l’a précisé la secrétaire d’État à la solidarité, ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer aux acteurs existants mais à mieux les coordonner, à faciliter les démarches et à suivre le parcours individualisé de la victime : « Dans des départements comme le Val-d'Oise et la Sarthe, la mise en place de référents s'est accompagnée d'une mobilisation remarquable des acteurs concernés, qui s'est illustrée par des réunions de coordination, de suivi et d'évaluation, ainsi que par la formalisation des procédures existantes.» (618)
Cette circulaire s’accompagne d’un cahier des charges fixant les modalités et le niveau pertinent de l’intervention du référent (à l’échelon infradépartemental), les conditions de sa sélection ainsi que ses missions et ses compétences. C’est ainsi qu’un référent est appelé à suivre de 25 à 50 personnes selon le lieu.
La question du nombre de personnes que peut suivre un même référent a été posée à la mission en soulignant que la désignation d’une structure comme référent plutôt qu’une personne physique serait souhaitable. Mme Nicole Blaise, directrice du Relais de Sénart a ainsi expliqué : « Nous avons été désignés référents violences conjugales pour les territoires de nos deux établissements. Le projet sur les référents violences conjugales parle d’un professionnel référent. Or un professionnel ne peut que s’épuiser sur un sujet aussi compliqué. Il faut choisir des structures et des équipes pluridisciplinaires. Celles qui font partie de notre réseau travaillent sur cette question depuis plus de trente ans. Si notre département a retenu une structure, en l’occurrence Solidarité femmes, ce n’est pas le cas partout et c’est dommage. » (619)
Les référents peuvent être financés par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). Cette possibilité vient d’être effectivement reconduite par la seconde circulaire sur les orientations du FIPD en date du 23 janvier 2009.
Actuellement, 25 référents ont été recrutés et ont effectivement été mis en place dans 19 départements ; 24 projets sont en cours dans 19 autres départements.
Le Premier ministre a indiqué qu’il souhaitait que leur déploiement soit accéléré (620) afin que d’ici à la fin du premier semestre 2009, chaque département soit doté d’un tel référent local.
D. DÉVELOPPER LES FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES AU NIVEAU LOCAL
La mission a affirmé le caractère essentiel que revêt la formation de tous les professionnels en contact avec les femmes victimes de violences à la spécificité de leur repérage, de leur accueil et de leur prise en charge, que ce soit dans le cadre de la formation initiale qu’ils reçoivent ou au cours des actions de formation continue (621).
Ces formations doivent être renouvelées de façon régulière en raison de la mobilité des personnels, qui peut être très importante, particulièrement dans les zones les plus difficiles. En outre, elles devraient concerner au-delà des personnels amenés à être en contact avec les femmes victimes en raison de leurs fonctions, les agents d’accueil qui sont en contact avec le public, par exemple, au sein des services municipaux.
L’efficacité des actions de formations mises en place localement a régulièrement été soulignée devant la mission. Au-delà de la formation stricto sensu, elles permettent, en effet, de mettre les intervenants en contact les uns avec les autres et participent ainsi du travail de mise en réseau.
Cet objectif est partagé par les inspections dans leur rapport d’évaluation qui souligne qu’« il faut (…) renouveler sans cesse les formations. Les formations interdisciplinaires organisées localement sont particulièrement efficaces. Ceux qui les suivent peuvent y apprendre comment travaillent leurs collègues d’autres secteurs et nouer des contacts avec eux. Les réseaux qui se constituent ainsi améliorent l’opérationnalité. » (622). La même démarche est préconisée par le Secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, M. Philippe de Lagune : « Pour les acteurs de terrain, la formation des agents d’accueil est fondamentale. Un effort a été fait sur la formation initiale. Il conviendrait aujourd’hui de mettre en place des formations plus transversales, qui regrouperaient sur un même département les agents de la commune, du conseil général, de la préfecture et du TGI. De telles initiatives pourraient effectivement être financées par le FIPD, mais sous deux réserves : que cela soit inscrit parmi nos priorités annuelles et que le montant alloué au FIPD (…) soit revalorisé, car nos 35 millions annuels n’y suffiront pas ! » (623).
La mission tient, par ailleurs, à souligner le rôle central que jouent les déléguées régionales et les chargées de mission départementales dans l’organisation de ces formations et la nécessité de les appuyer en mobilisant les moyens nécessaires.
Proposition n° 62 :
Développer et encourager localement les formations interdisciplinaires, sous l’impulsion des Déléguées aux droits des femmes.
III. COORDONNER LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES AFFAIRES DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La question de la coordination des procédures civile et pénale est un point régulièrement soulevé, dès lors que sont en jeu la protection de la victime de violence au sein du couple et celle de ses enfants.
Face à ce constat plusieurs solutions peuvent être envisagées. Celle allant le plus loin, compte tenu de l’organisation judiciaire existante, consiste à créer des juridictions spécialisées qui auraient aussi pour objectif de donner une visibilité particulière au contentieux des violences faites aux femmes.
La mission n’a pas souhaité s’engager dans cette voie proposée par le Collectif National aux Droits des Femmes et reprise dans la proposition de loi-cadre contre les violences faites aux femmes (624).
A. LA CRÉATION DE JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES N’EST PAS SOUHAITABLE
Le CNDF propose la création de tribunaux de la violence à l’encontre des femmes, à l’image du dispositif qui a été adopté en Espagne à la suite de la loi globale contre les violences de genre.
Ces tribunaux qui seraient créés dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance auraient à la fois des compétences pénales et civiles. Ils seraient composés d’un juge, le juge de la violence à l’encontre des femmes et deux assesseurs.
Ils seraient compétents, en matière pénale, pour traiter des délits constituant des « atteintes volontaires à l’intégrité morale, physique et sexuelle des femmes commis avec violence, menace contrainte surprise et intimidation » et, en matière civile, des questions de filiation, d’adoption, de mariage, de séparation, de divorce et des relations entre les parents et les enfants, dès lors que l’une des parties au procès civil est « victime des actes de violences à l’encontre des femmes » traitées au pénal, ou , au contraire, dénoncée comme auteur, instigateur ou complice de ces violences.
Sont invoqués à l’appui de cette proposition : le caractère massif des violences faites aux femmes qui occupent une large part du contentieux des tribunaux ; la complexité de ces affaires qui nécessitent une formation particulière et une bonne expérience et qui justifierait donc que des juges soient dédiés à ces questions ; une meilleure articulation entre justice pénale et justice civile en permettant de traiter en même temps la plainte et les modalités d’exercice du droit de garde.
C’est ainsi que les objectifs en ont été présentés à la mission par Mme Suzy Rojtman : « Pourquoi créer de telles juridictions ? Tout d’abord, parce qu’il manque une articulation entre droit civil et droit pénal. Ensuite, parce que les tribunaux sont débordés. On nous reproche de vouloir faire de la justice de genre mais il n’y a pas d’autre solution quand on sait qu’il existe des biais dans le droit et la justice ordinaires. Ainsi, le code civil a longtemps consacré l’infériorité de la femme et les tribunaux pénaux condamnaient pour adultère davantage les femmes que les hommes. Qu’il s’agisse d’une mesure transitoire ou pas, le retard est énorme. Les procureurs sont tentés par le classement sans suite d’affaires toujours délicates. En outre, les magistrats et l’ensemble des personnels devraient être formés à accueillir les femmes victimes ; il semble plus réaliste que ceci relève de certains magistrats spécialement formés. » (625)
Cette proposition soulève cependant des objections difficilement contournables.
Outre que la création de ces tribunaux poserait d’importantes difficultés de délimitation de leur compétence, avec des conséquences sans doute peu cohérentes, leur principe même peut être discuté dans la mesure où ces tribunaux étant saisis en fonction du sexe de la victime, ils aboutiraient à mettre en place des juridictions spécialisées pour les femmes.
Mme Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d’information pour le droit des femmes et de la famille (CNIDFF) (626) a particulièrement soulevé cet aspect : « Certes les violences faites aux femmes ne sont pas des violences comme les autres. Elles marginalisent fortement les victimes. Mais faut-il répondre à la marginalisation par une marginalisation supplémentaire ? Notre réponse est négative. La spécificité des violences faites aux femmes ne peut pas, de notre point de vue, justifier que les victimes fassent, au niveau judiciaire, l’objet d’un traitement spécifique. Elles restent des citoyennes à part entière, titulaires des mêmes droits que n’importe quel autre citoyen. (…). La justice doit être la même pour tous, quel que soit le sexe de la personne poursuivie ou de la victime. » (627)
Enfin, autre élément à prendre en compte, il est difficile de percevoir comment le contentieux dévolu à ces tribunaux s’articulera avec la protection de l’enfance qui relève du droit des mineurs, alors même qu’il s’agit de l’une des raisons qui justifieraient leur création.
Au vu de ces éléments, la mission considère que la création de juridictions spécialisées pour traiter des violences faites aux femmes ne répondrait pas au but recherché tout en générant probablement plus d’inconvénients que d’avantages.
C’est donc vers une autre formule qu’il convient de se tourner.
B. UNE COORDINATION DOIT ÊTRE INSTITUTIONNALISÉE SOUS L’IMPULSION D’UN MEMBRE DU PARQUET SPÉCIALISÉ
Comme l’a précisé Mme Valérie Létard, devant la mission : « Dans le domaine crucial de la coordination (…) les dysfonctionnements viennent souvent de décisions judiciaires qui se superposent et doivent être mises en cohérence. » (628)
L’amélioration de la coordination des magistrats passe moins par une juridiction spécialisée que par une coordination effective et efficace des procédures.
1. L’articulation des procédures judiciaires concernant des faits de violences doit être institutionnalisée…
L’articulation des procédures civiles et pénales et des décisions des juges du siège ayant à connaître d’une même affaire de violences au sein du couple soulève effectivement des difficultés qui peuvent s’avérer préjudiciables aux victimes, voire à leurs enfants
Il n’y a pas, notamment, de coordination entre, d’une part, la décision pénale d’éviction du conjoint violent et, d’autre part, la décision d’attribution de la garde des enfants par le juge aux affaires familiales. Il existe simplement l’obligation d’informer le parquet en cas de « référé violences » pris par le juge aux affaires familiales pour que celui-ci puisse éventuellement engager des poursuites contre l’auteur évincé. (629).
Enfin, quand le juge aux affaires familiales se prononce sur l’organisation du droit de garde et de résidence, la décision du juge pénal sur les violences pour lesquelles le père est poursuivi n’est le plus souvent pas encore devenue définitive. (630)
Ce manque de coordination peut avoir des conséquences importantes : « Notre réseau constate très régulièrement les conséquences sur les femmes victimes de violences au sein du couple et, également, sur les enfants du défaut d’articulation entre les procédures civiles et les procédures pénales. Cette absence de coordination met souvent en jeu la sécurité des victimes et des enfants. » a souligné devant la mission Mme Annie Guilberteau, directrice générale du centre national d’information pour le droit des femmes et de la famille (CNIDFF) (631).
La circulaire du 19 avril 2006 qui contient des éléments de politique pénale relatifs à l’application de la loi du 4 avril 2006 indique que « le parquet doit être attentif au sort réservé aux enfants d’un couple au sein duquel la violence sévit ainsi qu’à leur protection », mais précise simplement que « pour ce faire, selon la taille des juridictions, la coordination, au sein des parquets, d’une part, et entre les magistrats du parquet et du siège, d’autre part, devra être favorisée ».
La circulaire précise ensuite qu’une bonne coordination suppose que « dans les parquets connaissant une section des mineurs, la transmission à celle-ci par la section générale des informations et de la copie de la procédure de violences devra être effectuée dans l’urgence, afin de permettre, le cas échéant, que soit ordonné le placement provisoire des enfants et que le juge des enfants soit saisi. Si une mesure d’assistance éducative a été précédemment ouverte, les magistrats du parquet pourront prendre attache avec le juge des enfants saisi pour évaluer avec lui les décisions les plus adaptées à la situation. En toute hypothèse, ils veilleront à lui transmettre une copie de la procédure pénale. »
Une amélioration des dispositifs vient d’être apportée par le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 qui complète le code de procédure civile pour organiser tant la communication des pièces que des décisions rendues entre les juges chargés de la procédure familiale, à savoir le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles.
2. …grâce à la spécialisation d’un membre du parquet
Toutefois, il convient d’assurer de façon systématique la coordination et la circulation de l’information au sein de la juridiction entre les magistrats ayant à intervenir sur les différents aspects d’une même affaire de violences, tout en respectant les droits des parties.
Cela suppose, par exemple, que soit prévu à l’occasion du dépôt de plainte, le recueil d’informations relatives à une éventuelle saisine du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants afin que le parquet puisse disposer de ces informations dès que la plainte lui est transmise.
Plus généralement la transmission des informations et la coordination des procédures relatives à des faits de violences doivent être institutionnalisées.
C’est bien dans cette optique que la Chancellerie a souhaité que des magistrats dans les juridictions puissent jouer le rôle de référent en matière de violences au sein du couple. Toutefois, la circulaire du 19 avril 2006 relative à l’application de la loi du 4 avril 2006 prévoit simplement qu’« un magistrat référent centralisant le traitement des procédures de violence survenant au sein d’un couple pourra être désigné ». Il est donc laissé aux procureurs le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle désignation.
La ministre de la Justice entendue par la mission l’a rappelé : « Je préfère que, dans les tribunaux où cela est nécessaire, il y ait un magistrat en charge des violences conjugales, et que dans les tribunaux où cela n’est pas nécessaire, car la violence n’est pas la même selon les territoires, des instructions précises soient données, afin que la politique pénale soit ferme et homogène sur l’ensemble du territoire français. » (632)
Or, le parquet a un rôle d’impulsion à jouer, non seulement dans l’harmonisation des réponses pénales (633), mais aussi dans la coordination entre les magistrats du parquet. Sous son impulsion, en liaison avec le président du TGI, une coordination doit également être établie entre le parquet et les magistrats du siège et entre les juges du siège eux-mêmes. Ce rôle doit pouvoir être assuré dans tous les ressorts des tribunaux par un magistrat du parquet qui serait spécialisé dans le suivi des affaires afin d’assurer la cohérence de la lutte contre les violences de genre et les traiter dans tous leurs aspects (634).
Proposition n° 63 :
Désigner, dans chaque TGI, un magistrat du parquet spécialisé dans le suivi des violences de genre.
Proposition n° 64 :
Institutionnaliser, grâce à cette spécialisation, la circulation de l’information et la coordination entre le parquet, le juge pénal, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales qui ont à connaître des affaires de violences de genre, à commencer par la délivrance de l’ordonnance de protection.
CONCLUSION : CRÉER UN DISPOSITIF-CADRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Certaines des propositions de la mission nécessitent une adaptation des textes législatifs actuellement en vigueur. C’est le cas notamment des propositions qui créent l’ordonnance de protection ou le délit de violences psychologiques et de celles qui concernent la définition du viol conjugal ou encore l’adaptation de la définition du harcèlement sexuel.
Pour autant, au-delà des améliorations législatives nécessaires, la lutte contre les violences faites aux femmes passe par tout un ensemble de mesures qui ne relèvent pas de la loi mais de dispositifs de prise en charge et des bonnes pratiques.
C’est pourquoi, davantage qu’une loi-cadre c’est un dispositif-cadre qu’il faut promouvoir.
Ce dispositif global, cohérent et coordonné permettra de formaliser dans un unique document, de rendre visible et accessible l’ensemble des dispositifs, quelle que soit leur nature, qui concourent à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il regrouperait notamment :
— l’affirmation constitutionnelle de la dignité humaine comportant une condamnation solennelle des violences de genre ;
— les sanctions applicables à ces faits de violence ;
— les droits de la victime et les moyens de sa prise en charge ;
— et les modalités d’intervention et de coordination des acteurs mobilisés sur cette question.
Proposition n° 65 :
Promouvoir un dispositif cadre global, cohérent et coordonné regroupant l’ensemble des mesures concourant à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION
Proposition introductive :
Introduire dans le préambule de notre loi fondamentale la référence à une charte constitutionnelle de la dignité de la personne humaine comportant une condamnation solennelle des violences faites aux femmes.
Proposition n° 1 :
Inciter l’OND et les équipes universitaires de recherche à nouer des partenariats pour exploiter les données fournies par les enquêtes annuelles de victimation.
Proposition n° 2 :
Organiser une nouvelle enquête consacrée aux violences faites aux femmes sur le modèle de l’ENVEFF.
Proposition n° 3 :
— Mieux faire connaître les chiffrages existants, y compris auprès du grand public.
— Étendre l’évaluation des répercussions économiques des violences envers les femmes à toutes les formes de violences subies par les femmes, en vue de disposer d’une évaluation d’ensemble du coût des violences faites aux femmes.
Proposition n° 4 :
Établir des statistiques sexuées pour les violences commises dans l’espace public.
Proposition n° 5 :
— Mener, notamment sur le modèle de l’enquête VSFFT-93, d’autres enquêtes régionales sur la question des violences faites aux femmes au travail ;
— Réaliser une grande enquête au plan national, portant sur les aspects tant quantitatifs que qualitatifs des violences faites aux femmes au travail.
Proposition n° 6 :
Élaborer un protocole de recherche visant à déterminer le nombre de jeunes filles vivant en France qui sont excisées chaque année.
Proposition n° 7 :
Engager une étude statistique visant à estimer le nombre de cas annuel de mariages forcés en France, et à l’étranger si les victimes résident de manière habituelle en France, et à décrire les raisons du recours à ces pratiques, de manière à ajuster le dispositif de prévention et d’aide aux victimes.
Proposition n° 8 :
Créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, chargé de coordonner la collecte de données sexuées et d’organiser des enquêtes portant sur les violences faites aux femmes.
Proposition n° 9 :
Poursuivre et développer les travaux sur l’impact des violences au sein du couple sur les enfants.
Proposition n° 10 :
Préciser la définition de l’intérêt de l’enfant en affirmant clairement que celui-ci doit guider toute décision le concernant et l’inscrire dans le code civil.
Proposition n° 11 :
Former les professionnels au facteur de risque que constituent pour les enfants les violences au sein du couple, à leur repérage et aux impératifs de leur prise en charge.
Proposition n° 12 :
— Évaluer, par une étude d’ensemble, l’impact du suivi des auteurs de violences sur les taux de récidive ;
— Élaborer un guide de bonnes pratiques pour le suivi des auteurs de violences au sein du couple.
Proposition n° 13
— Systématiser les obligations de soins pour les auteurs de violences au sein du couple en réduisant le nombre de peines de sursis simple et réserver le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs des violences les plus graves ;
— Inciter les magistrats, par exemple par voie de circulaire, à suivre les auteurs de violences conjugales dans le cadre d’une obligation de soins.
Proposition n° 14 :
Dresser, mettre à jour annuellement et diffuser, au niveau national, régional et départemental une liste des structures spécialisées dans le suivi des auteurs de violences conjugales.
Pérenniser les financements des structures de suivi des auteurs, au moyen de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
Proposition n° 15 :
Pérenniser les financements des structures de suivi des auteurs, au moyen de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
Proposition n° 16 :
— Identifier les moyens consacrés au suivi des auteurs de violences conjugales ;
— Renforcer ces moyens, pour permettre la création de structures de suivi des auteurs dans chaque département ;
— Accorder des moyens spécifiques à la FNACAV afin de lui permettre d’assurer son rôle de coordination, de représentation et d’évaluation.
Proposition n° 17 :
Engager une analyse des violences sexistes et sexuelles entre les jeunes par la production de statistiques sexuées sur les violences recensées dans les établissements scolaires
Proposition n° 18 :
— Inscrire dans le projet d’établissement les actions à mener pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons et l’éducation au respect ;
— Systématiser ces actions en les inscrivant dans des programmes validés par les académies et permettant de toucher les différentes classes d’âge ;
— Inscrire dans la formation des professeurs l’égalité entre les filles et les garçons comme une compétence devant être évaluée et validée.
Proposition n° 19 :
Développer l’information des professionnels de santé au travers d’outils comme le bulletin du Conseil de l’Ordre pour sensibiliser et impliquer les médecins.
Proposition n° 20 :
— Former les médecins et les autres professionnels de santé au repérage et à l’accueil des femmes victimes de violences et développer la diffusion des guides d’aide à la prise en charge des victimes et à la rédaction des certificats médicaux ;
— Sécuriser le financement des unités médico-judiciaires ;
— Mettre en place des référents « violence » dans les services d’urgence et définir des protocoles de prise en charge des victimes. Prévoir, avec les Agences régionales de santé, le maillage entre médecins légistes et services d’urgence.
Proposition n° 21 :
— Prévoir une formation et une sensibilisation à la question des violences faites aux femmes au travail des différentes instances de l’entreprise, en particulier des membres des CHSCT, des médecins du travail et des inspecteurs du travail ;
— Obliger les employeurs à mettre en place des plans de préventions des violences au travail ;
— Mener des campagnes d’information pour informer les salariées sur les acteurs mobilisables au sein de leur milieu professionnel en cas de commission d’actes de violence ;
— Engager le Conseil économique, social et environnemental à mener une étude sur les violences subies par les femmes au travail.
Proposition n° 22 :
Inciter les médias à se doter d’instances internes de régulations, associant des représentants des associations de défense des droits des femmes ou d’aide aux victimes et associer celles-ci à certaines instances nationales de régulation des médias.
Proposition n° 23 :
Mentionner expressément dans les textes de régulation des médias et de la publicité sanctionnant les atteintes à la dignité humaine, l’incitation aux violences faites aux femmes.
Proposition n° 24 :
Reconnaître aux associations de défense des droits de la femme le droit de saisine du CSA.
Proposition n° 25 :
Étendre la compétence du CSA au contrôle des nouveaux contenus multimédias.
Proposition n° 26 :
Engager des campagnes de communication de grande ampleur, de façon répétée, en utilisant des supports de large diffusion (audiovisuels notamment) à destination, des victimes et des auteurs de violences.
Proposition n° 27 :
Mettre en place des formations obligatoires à destination de tous les professionnels appelés à être en contact avec des femmes de violences et à traiter leur situation : professionnels de santé, magistrats, personnels de la police et de la gendarmerie nationale, travailleurs sociaux, acteurs associatifs, agents des services de l’emploi et agents d’accueil des collectivités locales
Proposition n° 28 :
Accorder davantage de moyens au 3919 :
— De manière permanente, afin de faire face à l’augmentation des appels ;
— De manière conjoncturelle, lors des campagnes nationales de sensibilisation ;
— De manière spécifique, afin de mener une étude statistique sur les femmes qui y ont recours.
Proposition n° 29 :
Pérenniser le financement des associations par la signature de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.
Proposition n° 30 :
Former au niveau régional, départemental et local les services de la police et de la gendarmerie à la spécificité des violences au sein du couple.
Proposition n° 31 :
Désigner et former, dans chaque commissariat et dans chaque brigade de gendarmerie, un référent violences conjugales ou violences intrafamiliales.
Proposition n° 32 :
Pérenniser les financements des postes de travailleur social intervenant dans les commissariats et les gendarmeries et accroître leur nombre. Rédiger une charte donnant une plus grande lisibilité à leurs fonctions et à leurs carrières.
Proposition n° 33 :
Encadrer la prise des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire par des règles strictes :
— Les victimes doivent être systématiquement incitées à déposer plainte ;
— La main courante doit être systématiquement transmise au magistrat référent du parquet ;
— Le dépôt d’une main courante ou d’un procès-verbal doit systématiquement s’accompagner d’une orientation vers les associations spécialisées ;
— Les forces de l’ordre doivent reprendre contact avec la victime peu après la prise de la main courante ou du procès-verbal.
Proposition n° 34 :
Modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile afin d’accorder, sauf menace pour l’ordre public, le renouvellement du titre de séjour des femmes qui cessent la cohabitation parce qu’elles sont victimes de violences conjugales avérées.
Proposition n° 35 :
Ouvrir le droit à l’aide juridictionnelle aux femmes en situation irrégulière victimes de violences.
Proposition n° 36 :
Accorder un titre de séjour aux personnes en situation irrégulière qui portent plainte pour violences au sein du couple.
Proposition n° 37 :
Modifier la définition du délit de dénonciation calomnieuse afin que le juge puisse apprécier l’élément matériel du délit en cas d’acquittement ou de relaxe au bénéfice du doute, ou de non-lieu prononcé pour insuffisance de charges.
Proposition n° 38 :
Généraliser la procédure civile d’éviction du conjoint violent aux personnes pacsées et aux concubins copropriétaires du logement ou cotitulaires du bail.
Proposition n° 39 :
Recenser les structures hébergeant des auteurs de violences et le nombre de place qui leur sont consacrées.
Proposition n° 40 :
— Inciter les parquets à conclure des conventions pour l’hébergement des auteurs de violences ;
— Consacrer davantage de moyens à l’hébergement des auteurs afin de faciliter l’application de l’éviction du conjoint violent.
Proposition n° 41 :
Permettre au juge, dans le cadre de l’ordonnance de protection, d’organiser les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et d’en suspendre, si nécessaire, provisoirement l’exercice.
Proposition n° 42 :
Développer les lieux de rencontre médiatisés entre parents et enfants pour garantir leur protection pendant l’exercice du droit de visite.
Proposition n° 43 :
Créer une cellule commune au ministère de l’Intérieur et au ministère des Affaires étrangères chargée de prévenir les situations de mariage forcé et d’excision et d’aider les femmes qui en sont victimes à l’étranger.
Proposition n° 44 :
Conforter les structures d’hébergement d’urgence spécialisées dans l’accueil des femmes victimes et former les équipes des centres généralistes au problème des violences conjugales.
Proposition n° 45 :
Identifier les femmes victimes de violences dans les plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Proposition n° 46 :
Réserver l’hébergement dans les familles d’accueil aux jeunes filles menacées ou victimes de mariage forcé.
Proposition n° 47 :
Appeler les préfets à utiliser activement leur contingent de réservation de logements sociaux pour mettre des logements à disposition des femmes victimes de violences.
Proposition n° 48 :
Assurer aux associations engagées dans l’intermédiation locative, un financement pérenne et des aides à la hauteur des charges locatives et des frais de fonctionnement pesant sur elles afin d’apporter des garanties aux bailleurs.
Proposition n° 49 :
Autoriser le juge à délier la femme victime des obligations découlant du bail co-signé avec l’auteur des violences dès lors que la séparation est établie par l’ordonnance de protection.
Proposition n° 50 :
Former le personnel du Pôle Emploi à la spécificité de la prise en charge des femmes victimes de violences.
Proposition n° 51 :
Engager une réflexion sur l’opportunité de créer une ordonnance de protection destinée à prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles.
Proposition n° 52 :
Instaurer une ordonnance de protection temporaire, au bénéfice des femmes menacées au sein de leur couple, et des enfants si nécessaire, rendue par un juge dans un délai de 24 heures suivant la demande.
Cette ordonnance comporterait des obligations provisoires pour l’auteur des violences, telles que l’interdiction de s’approcher du domicile conjugal ou le retrait du permis de port d’arme, dont la violation serait punie par la loi. Pourrait également y figurer la suspension provisoire de l’autorité parentale de l’auteur des violences.
Elle ouvrirait de manière immédiate de nombreux droits à la victime en constituant une preuve de la situation de violence, ouvrant, si nécessaire, un accès immédiat au RSA, facilitant l’obtention d’un titre de séjour et l’accès à l’aide juridictionnelle. Elle serait opposable aux tiers.
Proposition n° 53 :
Inciter tous les parquets, par voie de circulaire, à mettre en œuvre une réponse pénale comprenant, à chaque fois que possible, l’éviction du conjoint violent, son placement dans un foyer et sous contrôle judiciaire, et la réquisition d’obligations de soins.
Proposition n° 54 :
Proscrire le recours à la médiation pénale comme réponse aux situations de violences au sein du couple et définir une procédure nouvelle mieux adaptée à ces situations.
Proposition n° 55 :
Introduire dans le code pénal un délit de violences psychologiques au sein du couple en se fondant sur la définition du harcèlement moral.
Proposition n° 56 :
Introduire dans le code pénal un délit de contrainte au mariage, applicable aux mariages forcés ayant lieu en France et à l’étranger sur des personnes résidant de manière habituelle en France.
Proposition n° 57 :
Harmoniser les définitions du harcèlement sexuel prévues dans le code du travail et dans le code pénal, en les alignant sur la définition issue du droit communautaire.
Proposition n° 58 :
Conforter la reconnaissance du viol entre époux en supprimant du code pénal la mention de la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel.
Proposition n° 59 :
Maintenir le rattachement des chargées de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité auprès des préfets.
Proposition n° 60 :
Réunir sous l’autorité du préfet des commissions spécifiquement consacrées aux violences faites aux femmes permettant d’identifier cette problématique, en coordination avec les politiques de lutte contre la délinquance.
Proposition n° 61 :
Généraliser les protocoles départementaux de prévention et de lutte contre les violences.
Proposition n° 62 :
Développer et encourager localement les formations interdisciplinaires, sous l’impulsion des Déléguées aux droits des femmes.
Proposition n° 63 :
Désigner, dans chaque TGI, un magistrat du parquet spécialisé dans le suivi des violences de genre.
Proposition n° 64 :
Institutionnaliser, grâce à cette spécialisation, la circulation de l’information et la coordination entre le parquet, le juge pénal, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales qui ont à connaître des affaires de violences de genre, à commencer par la délivrance de l’ordonnance de protection.
Proposition n° 65 :
Promouvoir un dispositif cadre global, cohérent et coordonné regroupant l’ensemble des mesures concourant à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La mission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du 7 juillet 2009 et l’a adopté.
Évry – 18 mars 2009
Table ronde sur le traitement judiciaire des affaires de violences faites aux femmes.
Table ronde sur l’action de l’État et des associations en faveur des femmes victimes de violences.
Marseille – 1er avril 2009
Table ronde sur le traitement judiciaire des affaires de violences faites aux femmes.
Table ronde sur l’hébergement et le logement des victimes et des auteurs de violences.
Table ronde sur les violences subies par les jeunes filles.
Préfecture de police de Paris – 6 mai 2009
Rencontre avec le préfet de police sur le thème des statistiques sexuées, des partenariats associatifs et de la formation des agents de police.
Saint-Brieuc – 10 juin 2009
Table ronde sur le traitement judiciaire des affaires de violences faites aux femmes.
Table ronde sur l’approche territoriale de la lutte contre les violences faites aux femmes.
1 () Proposition de loi-cadre contre les violences faites aux femmes n° 525, déposée le 20 décembre 2007.
2 () Rapport n° 3459, L’esclavage, en France, aujourd’hui, 2001.
3 () Mission créée le 23 juin 2009 par la Conférence des Présidents.
4 () Audition du 27 janvier 2009.
5 () Maryse Jaspard et al., Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France., Paris, La documentation française, 2003, p. 133.
6 () Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, 2008, p. 118.
7 () Audition du 3 mars 2009.
8 () Audition du 3 mars 2009.
9 () Ibid.
10 () Ibid.
11 () Fait d’avoir subi du harcèlement moral ou des insultes répétées, ou du chantage affectif, ou des violences physiques et sexuelles.
12 () Observatoire national de la délinquance, « Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu’en 2004 », Grand Angle n° 14, juillet 2008, p. 8. Sur l’interprétation de ces résultats, voir infra, II du présent chapitre.
13 () Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, 2008, p. 116.
14 () Yannick Zemrak, « La répression des violences conjugales : contribution du juge pénal à la victoire de Lilith sur Ève », Droit de la famille, juillet-août 2008, p. 13.
15 () Cette notion a été élaborée et développée par Robert Castel dans Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 1999.
16 () Audition du 3 mars 2009.
17 () Audition du 27 janvier 2009.
18 () Profession et catégorie socioprofessionnelle.
19 () Audition du 3 mars 2009.
20 () Audition du 17 février 2009.
21 () Mme Maryse Jaspard a indiqué au cours de son audition que les chiffres de l’ENVEFF pour la Polynésie n’avait pas été publiés car ils étaient extrêmement élevés.
22 () ENVEFF Réunion, Extraits du rapport final de décembre 2003, p. 3.
23 () Pour une analyse détaillée des violences faites aux femmes outre-mer, voir Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 85.
24 () Marie-Josèphe, Saurel-Cubizolles, Béatrice Blondel, Nathalie Lelong et Patricia Romito, « Violence conjugale après une naissance », Chronique féministe, n° 64, 1998, p. 15-19.
25 () Les violences envers les femmes en Polynésie française, étude socio-anthropologique, Papeete, 2002, p. 18.
26 () Audition du 10 février 2009.
27 () Cf. infra, Partie II, Chapitre II sur le suivi des auteurs de violences.
28 () Cf. ci-dessous, B.
29 () Audition du 13 janvier 2009
30 () Audition du 17 février 2009.
31 () Audition du 3 juin 2009.
32 () Observatoire national de la délinquance, « Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu’en 2004 », Grand Angle n° 14, juillet 2008, p. 17
33 () Ibid, p. 17.
34 () Roger Henrion, op. cit., Paris, La documentation française, 2001, p. 20.
35 () La Délégation aux victimes est une structure du ministère de l’Intérieur, commune à la police et à la gendarmerie.
36 () DAV, Etude nationale des décès au sein du couple, 2007, p. 5.
37 () Ibid., p. 15.
38 () Audition du 3 mars 2009.
39 () Ibid.
40 () Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, Rapport du groupe de travail sur les homicides en Seine-Saint-Denis (2005-2008), 2009, p. 6.
41 () DAV, Etude nationale des décès au sein du couple, 2007, p. 15.
42 () Voir Marie-France Hirigoyen, Femmes sous emprise, Paris, Odile Jacob, 2005.
43 () Les violences envers les femmes en Polynésie française, étude socio-anthropologique, Papeete, 2002, p. 23.
44 () Audition du 17 février 2009.
45 () Ibid.
46 () Audition du 17 février 2009.
47 () Audition du 13 janvier 2009.
48 () Maryse Jaspard et al., op. cit., Paris, La documentation française, 2003, p. 278.
49 () Audition du 13 janvier 2009.
50 () Audition du 3 juin 2009.
51 () Observatoire national de la délinquance, « Plus de 47 500 faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés par la police et la gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu’en 2004 », Grand Angle n° 14, juillet 2008, p. 2 ; 8.
52 () Marylène Lieber, op. cit., p. 134.
53 () Audition du 13 janvier 2009.
54 () Système de traitement des infractions constatées.
55 () Audition du 26 mai 2009.
56 () Guide de l’action publique, 2004, p. 158.
57 () Audition du 26 mai 2009.
58 () Audition du 26 mai 2009.
59 () Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 21.
60 () Audition du 26 mai 2009.
61 () Audition du 3 juin 2009.
62 () Audition du 13 janvier 2009.
63 () Voir aussi Guide de l’action publique, 2004, p. 158.
64 () Audition du 13 janvier 2009.
65 () Audition du 3 mars 2009.
66 () Voir notamment l’enquête menée sur les violences au travail par le Docteur Jean-Michel Sterdyniak, infra, chapitre III. Le caractère sous-évalué ou surévalué des chiffres issus de l’ENVEFF a donné lieu à de nombreuses polémiques, synthétisées par Mme Marylène Lieber, op. cit., p. 121 et suivantes. Celle-ci conclut qu’« il est difficile de savoir si les chiffres obtenus dans cette première enquête représentative sont sur- ou sous-évalués. »
67 () Audition du 13 janvier 2009.
68 () Audition du 3 mars 2009.
69 () Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, 2008, p. 113.
70 () Audition du 13 janvier 2009.
71 () Audition du 13 janvier 2009.
72 () Plan global de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007), recommandation n° 3.
73 () Roger Henrion, Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé, Paris, La documentation française, 2001, p. 23.
74 () Ibid, p. 26.
75 () Audition du 17 février 2009.
76 () Audition du docteur Marie-France Hirigoyen du 17 février 2009.
77 () Plan global de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007), p. 18.
78 () Jean-Pierre Marissal et Charly Chevalley, Evaluation des répercussions économiques des violences conjugales en France, Paris, La documentation française, 2007.
79 () Ibid., p. 85.
80 () On évolue à environ 10 % la part des hommes parmi les victimes de violences au sein du couple.
81 () Ibid., p. 44-45.
82 () Projet Daphné 2006 « IPV EU_Cost ».
83 () Audition du 12 mai 2009.
84 () Conclusions préliminaires (v. 2.13)
85 () Recommandation n° 5, p. 21.
86 () Cf. supra, 1.
87 () Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, Excision et Handicap (ExH) : Mesure des lésions et traumatismes et évaluation des besoins en chirurgie réparatrice, mars 2009.
88 () Cf. ci-dessus, Chapitre IV.
89 () Recommandation n° 6.
90 () Maryse Jaspard et al., op. cit., Paris, La documentation française, 2003, p. 147.
91 () Marylène Lieber, Genre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question, Paris, Presses de Sciences-Po., 2008, p. 15.
92 () Audition du 3 mars 2009.
93 () Observatoire national de la délinquance, La criminalité en France, Paris, CNRS éditions, novembre 2008, p. 112.
94 () Marylène Lieber, op. cit., p. 21.
95 () Observatoire national de la délinquance, op. cit., p. 114.
96 () Dans la terminologie de l’ENVEFF, la notion d’« espace public » ne recouvre pas seulement la rue mais des « lieux aussi divers que les grands magasins, les clubs de sport, les restaurants ou les discothèques, la plage ou les jardins publics, les transports en commun. » (Maryse Jaspard et al., op. cit.,, p. 147.)
97 () Ibid., p. 149.
98 () Marylène Lieber, op. cit., p. 65.
99 () Enquête sur les comportements sexistes et les violences envers les filles, à l’initiative de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1600 jeunes filles de 18 à 21 ans résidant, étudiant ou travaillant en Seine-Saint-Denis.
100 () Jill Radford, « Policing male violence –Policing women », in Jalna Hanmer et Mary Maynard (eds), Women, violence and social control, p. 35, cité dans Marylène Lieber, op. cit., p. 65.
101 () Audition du 3 mars 2009.
102 () Ibid., p. 46.
103 () Ibid., p. 59.
104 () Zohor Djider et Solveig Vanovermeir, « Des insultes aux coups : hommes et femmes inégaux face à la violence », Insee Première, n° 1124, mars 2007, p. 3-4.
105 () Ministère de l’Intérieur, « Votre sécurité. Conseils aux femmes » (2002), cité dans Marylène Lieber, op. cit., p. 14.
106 () Voir notamment Maryse Jaspard et al., op. cit.,, p. 158.
107 () Ibd, p. 266.
108 () Ibid., p. 205 et suivantes.
109 () Maryse Jaspard et al., op. cit.,, p. 168.
110 (1) Communiqué sur le rapport du BIT intitulé « La promotion des femmes aux postes de direction », 2007.
111 (1) Sylvie Cromer, « Le harcèlement sexuel en France, la levée d’un tabou 1985-1990 », d’après les archives de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes (AVFT), recherche financée par le ministère de la solidarité entre les générations (service des droits des femmes) et le ministère du travail, du dialogue social et de la participation.
112 (2) AVFT, « Vingt ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail », 2006.
113 (3) Eve Semat, Association Santé et médecine du travail, « Femmes au travail, violences vécues », La découverte – Syros, 2000.
114 (1) « La violence, les mots, le corps », Cahiers du genre, n° 35, L’Harmattan, 2003.
115 () Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), Maryse Jaspard, Elizabeth Brown, Stéphanie Condon, Dominique Fougeyrollas-Schwebel, Annik Houel, Brigitte Lhomond, Florence Maillochon, Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles, Marie-Ange Schiltz, La Documentation française, 2003.
116 (3) C’est ainsi par exemple que, dans un « Guide pratique : agir contre les violences sexuelles et sexistes dans les relations de travail » (2002), l’AVFT a énuméré les différentes formes de violences sexistes et sexuelles de manière détaillée, « de A à Z » : agressions sexuelles, bizutage, conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, discrimination, exhibition sexuelle, harcèlement moral et sexuel, harcèlement téléphonique, injures, menaces, pornographie, proxénétisme et infractions assimilées, viol, violences physiques.
117 () Article R. 621-2 du code pénal : « L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1e classe ».
118 (5) Articles 222-17 et 222-18 du code pénal.
119 (1) Les agressions sexuelles sont expressément définies par le code pénal comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 du code pénal).
120 (2) Cette notion est retenue par l’enquête pour la différencier du harcèlement sexuel au sens strict défini par la loi de 1992, compte non tenu des modifications intervenues en 2002 postérieurement à l’enquête.
121 () Se reporter à l’ouvrage précité : « Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, La Documentation française, 2003, pp 123-143, pour une analyse détaillée des résultats de l’enquête.
122 () Rapport de M. Rubenstein (octobre 1987) : « La dignité des femmes dans le monde du travail : rapport sur le problème du harcèlement sexuel dans les États membres de la Communauté européenne ».
123 () Enquête réalisée auprès de 1600 jeunes filles de 18 à 21 ans questionnées entre avril et décembre 2006.
124 (1) Ces résultats ne sont pas pondérés par rapport aux données issues des déclarations annuelles des données sociales (DADS) de 2004, compte tenu du faible nombre de cas observés.
125 (1) Audition du 3 juin 2009.
126 (1) Audition du 3 juin 2009.
127 (2) Audition du 3 juin 2009.
128 (3) Audition du 3 juin 2009.
129 () Audition du mardi 17 février 2009.
130 () Michel Gollac et Serge Volkoff, « Les conditions de travail », La découverte, 2007.
131 () Audition du 17 mars 2009
132 () Armelle Andro et Marie Lesclingand, Les mutilations sexuelles féminines : le point sur la situation en Afrique et en France, Population et sociétés, n° 438, octobre 2007, p. 3.
133 () Armelle Andro, Marie Lesclingand et Dolorès Pourette, Comment orienter la prévention de l’excision chez les filles et les jeunes filles d’origine africaine vivant en France : une étude des déterminants sociaux et familiaux du phénomène, janvier 2009.
134 () Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, Excision et handicap (ExH) : Mesure des lésions et traumatismes et évaluation des besoins en chirurgie réparatrice, mars 2009.
135 () Source : Armelle Andro et Marie Lesclingand, op. cit., p. 3.
136 () Les outils statistiques existants ne permettent pas d’estimer le nombre de jeunes filles de moins de 18 ans qui ont subi une excision.
137 () Audition du 17 mars 2009.
138 () Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, op. cit., mars 2009.
139 () Audition du 19 mai 2009
140 () Audition de Mme Armelle Andro du 19 mai 2009.
141 () Audition du 19 mai 2009.
142 () Audition du 17 mars 2009.
143 () Ibid. et audition de Mme Armelle Andro du 19 mai 2009.
144 () Audition du 10 février 2009.
145 () Audition du 19 mai 2009.
146 () Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, Excision et handicap (ExH) : Mesure des lésions et traumatismes et évaluation des besoins en chirurgie réparatrice, mars 2009, p. 60.
147 () Ibid., p. 62.
148 () Les mutilations sexuelles féminines ne sont pas toutes identiques. L’OMS distingue quatre types de mutilations, la forme de mutilation la plus fréquente en France, compte tenu des pays d’origine des migrants, est la mutilation de type II :
- type I : excision du capuchon, avec ou sans excision partielle ou totale du clitoris ;
- type II : excision du clitoris, avec excision partielle ou totale des petites lèvres ;
- type III : excision partielle ou totale des organes génitaux externes et suture/rétrécissement de l'orifice vaginal (infibulation) ;
- type IV : autre (piqûre, perforation ou incision).
149 () L’échantillon est composé de femmes rencontrées lors de consultations gynécologiques et dans les maternités, migrantes ou nées de parents migrants, majeures et francophones. Cinq régions étaient concernées par l’enquête. Les femmes susceptibles d’être excisées ou de faire partie du groupe témoin étaient indiquées aux enquêteurs par les professionnels de santé.
150 () Armelle Andro, Marie Lesclingand, Emmanuelle Cambois et Christelle Cirbeau, op. cit., mars 2009.
151 () Ibid., p. 43-44 et p. 46-47.
152 () Audition du 19 mai 2009.
153 () Ibid., p. 51 et 54.
154 () Audition du 19 mai 2009.
155 () Cf. ci-dessus, proposition n° 3.
156 () Armelle Andro, Marie Lesclingand et Dolorès Pourette, op. cit., introduction.
157 () Ibid., p. 14
158 () Audition de Mme Isabelle Gillette-Faye du 17 mars 2009.
159 () Ibid.
160 () Audition du 19 mai 2009.
161 () Définition présente notamment dans le guide de la Mairie de Paris à l’usage des élu/es, Prévention des mariages forcés, 2007, p. 8.
162 () Cf. infra, Quatrième partie, chapitre I, III.
163 () La plupart des enquêtes sociologiques sur ce thème ne recueillent que très peu, voire aucun cas de mariage forcés imposés à un homme.
164 () Pour une analyse précise de ces deux premières enquêtes et de leurs résultats, voir Christelle Hamel, « Mesurer les mariages forcés : l’appréhension du consentement dans deux enquêtes qualitatives », in Migrations société, vol. 20, n° 119, septembre-octobre 2008.
165 () Audition du 10 février 2009.
166 () Gérard Neyrand, Abdelhafid Hammouche et Sahra Mekboul, Les mariages forcés. Conflits culturels et réponses sociales, op. cit., p. 32-33.
167 () Audition du 9 juin 2009.
168 () Cet avis a fait l’objet d’une publication : Haut Conseil à l’intégration, Le contrat et l’intégration, La documentation française, 2004.
169 () Haut Conseil à l’intégration, Les droits des femmes issues de l’immigration, op. cit., p. 18.
170 () Voir notamment l’audition du 11 octobre 2005 de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale ainsi que le Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, p. 156 : « Ce chiffre, considérable au regard du nombre de mariages célébrés chaque année […] ».
171 () Source : Conseil de l’Europe, Les mariages forcés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Législation comparée et actions politiques, 2005, p. 26.
172 () Chiffre obtenu en divisant 70 000 par les neuf années qui séparent les jeunes filles de 10 ans de celles de 18 ans. Ce calcul permet d’obtenir un chiffre annuel.
173 () Audition du 9 juin 2009.
174 () Conseil de l’Europe, Les mariages forcés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Législation comparée et actions politiques, 2005, p. 23.
175 () Gérard Neyrand, Abdelhafid Hammouche et Sahra Mekboul, Les mariages forcés. Conflits culturels et réponses sociales, op. cit., p. 32.
176 () Conseil de l’Europe, Les mariages forcés dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Législation comparée et actions politiques, 2005, p. 25.
177 () Typologie reprise du travail de Claudine Philippe, « Recours face à l’inacceptable : itinéraires de femmes refusant un mariage forcé » in Migrations société, vol. 20, n° 119, septembre-octobre 2008, p. 171.
178 () Ibid., p. 177.
179 () Audition 12 mai 2009.
180 () ONED. Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les pouvoirs publics ?
181 () Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles, 2008.
182 () Roger Henrion, Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé, 2001.
183 () Audition du 17 mars 2009.
184 () Audition du 27 janvier 2009 de M. Pascal Subord, coauteur de l’enquête.
185 () Jean-pierre Vouche, Les enfants emportés par le torrent. Novembre 2008. Santé mentale n°132.
186 () Audition du 3 mars 2009.
187 () Audition de Paul Durning, directeur de l’ONED.
188 () Audition du 17 mars 2009.
189 () Audition du 17 mars 2009.
190 () L'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), p 89.
191 () Difficultés subies pendant l’enfance : privations matérielles, placement par la DASS, mesures d’assistance éducative, conflit très grave avec l’un ou l’autre de ses parents, départ du domicile familial à la suite d’un conflit, sévices ou coups répétés, problèmes d’alcoolisme ou de drogue..
192 () Ibid., p 116.
193 () Audition du 10 février 2009.
194 () Catherine Vasselier-Novelli et Charles Heim, Les enfants victimes de violences conjugales. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. n °36, 2006/1
195 () Docteur Maurice Berger, audition du 17 mars 2009.
196 () Rapport de la Défenseure des enfants. Enfants au cœur des séparations conflictuelles. 2008.
197 () Audition du 17 février 2009.
198 () Audition du 17 mars 2009.
199 () Conseil de l’Europe, Combattre la violence à l’égard des femmes, étude du bilan des mesures et actions prises dans les États membres du conseil de l’Europe, 2006.
200 () Catherine Vasselier-Novelli et Charles Heim, Les enfants victimes de violences conjugales. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. n °36, 2006/1
201 () Cf. infra, Quatrième partie, chapitre II, I.
202 () M. Charles Heim, psychologue-psychothérapeute au centre de consultation La Durance, à Marseille, audition du 31 mars 2009.
203 () Il ne sera pas traité ici du suivi des auteurs de violences sexuelles, dont la problématique est spécifique et a suscité de nombreux travaux.
204 () Audition du 31 mars 2009.
205 () Auteurs de violences au sein du couple. Prise en charge et prévention, rapport du groupe de travail animé par le Docteur Roland Coutanceau, mars 2006 et Professeur Roland Coutanceau, « Evaluation et prise en charge du conjoint violent », in Santé mentale, n° 132, novembre 2008.
206 () Ibid., p. 10.
207 () Roland Coutanceau, « Evaluation et prise en charge du conjoint violent », in Santé mentale, n° 132, novembre 2008, p. 64.
208 () Claudine Pérez-Diaz et Marie-Sylvie Huré, « Violences conjugales et alcool : quel traitement judiciaire ? »,, Tendance, n° 55, juillet 2007, p. 3.
209 () Caroline Helfter, Quelle prise en charge pour les auteurs de violences conjugales ? D’un arsenal répressif à un accompagnement dans la durée, Informations sociales 2007/8, n° 144, p. 74-83. Le même constat a été dressé lors de la table ronde sur la prise en charge des auteurs du 31 mars 2009.
210 () Ibid, p. 76.
211 () Claudine Pérez-Diaz et Marie-Sylvie Huré, « Violences conjugales et alcool : quel traitement judiciaire ? »,, Tendance, n° 55, juillet 2007.
212 () François Dieu et Pascal Suhard, Justice et femme battue, enquête sur le traitement judiciaire des violences conjugales, L’Harmattan, 2008.
213 () Claudine Pérez-Diaz et Marie-Sylvie Huré, « Violences conjugales et alcool : quel traitement judiciaire ? »,, Tendance, n° 55, juillet 2007.
214 () Source : Association pour le contrôle judiciaire en Essonne.
215 () Cf. infra, Sixième partie, II.
216 () Cf. Véronique Jonca, « Les réponses avant le jugement » in Violences dans le couple. Réponses judiciaires et socio-éducatives., octobre 2006, p. 40.
217 () Ivan Guitz, Juge des libertés et de la détention, « Les réponses avant le jugement » in Violences dans le couple. Réponses judiciaires et socio-éducatives, octobre 2006, p. 40.
218 () Le sursis avec mise à l’épreuve peut ne comporter qu’une simple obligation de soins.
219 () Audition du 31 mars 2009.
220 () Audition de M. Pascal Suhard du 27 janvier 2009.
221 () Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 52.
222 () Ce processus a été décrit par Nadège Séverac, « Auteurs de violence conjugale : sanction/éducation, deux points d’appui pour sortir de la violence », Empan, n° 73, 2009-1.
223 () Audition du 16 juin 2009.
224 () Ibid., p. 39.
225 () Audition du 31 mars 2009.
226 () Audition du 10 mars 2009.
227 () Voir http://www.fnacav.fr/
228 () Rapport au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple, mars 2009, p. 24.
229 () Audition du 20 janvier 2009. Cf. infra,quatrième partie, chapitre I, I.
() Audition du 31 mars 2009.
() Audition du 31 mars 2009.
() Pour fixer les idées, les subventions accordées par l’Etat aux associations de victimes de violences conjugales sont en 2009 de 2 800 000 € environ. Source : Etat des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes, annexe au PLF pour 2009, p. 57.
() Jean-Pierre Marissal et Charly Chevalley, Evaluation des répercussions économiques des violences conjugales en France, La documentation française, 2007, cf. supra, Première partie.
() Audition de M. Jean-Marie Huet du 27 janvier 2009.
() Audition du 27 mai 2009.
() Ibid.
() Direction de l’Éducation permanente (DEP), « Auteurs et victimes des actes de violence signalés par les établissements publics du second degré », 2004.
() Sylvia Di-Luzio « Violences sexistes : de quoi parle t-on ? Présentation de l’étude Violences sexistes : Compte-rendu d’observations en collège. », 2007.
() Ibid.
() Association Je.tu.il, « Évaluation de l’action menée dans les collèges parisiens 2007-2008. Contribution à la connaissance des représentations des adolescents », 2008.
() Audition du 19 mai 2009.
() Observatoire national de la délinquance, Bulletin statistique, juin 2009.
() Audition du 2 juin 2009.
() Audition du 27 mai 2009.
() Ibid.
() Audition du 16 juin 2009
() Audition du 27 mai 2009.
() Mme Olivia Cattan, audition du 19 juin 2009.
() Audition du 27 mai 2009.
() L’égalité filles-garçons s’apprend dès l’école, rapport n° 1295, décembre 2008.
() Ibid
() Audition du 26 ami 2009.
() Audition du 19 mai 2009.
() Audition du 10 mars 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 36.
() Élaboré par le ministère de l’emploi et de la cohésion sociale et le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité dont Mme Catherine Vautrin avait la charge, en 2005.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 39.
() Pascal Suhard et François Dieu, op. cit.
() Cette notion même est une source d’insatisfaction pour les victimes qui doivent comprendre que l’ITT « totale » n’est le plus souvent pas totale et que l’incapacité de travail ne concerne pas l’activité professionnelle et n’a pas valeur d’arrêt de travail ; Michel Debout, professeur de médecine légale, « L’ITT et la victime de violences », AJDA, 2006.
() Articles L. 1153-5 et suivants du code du travail.
() Article L. 1321-2 du code du travail.
() Articles R. 4121-1 et suivants du code du travail.
() Cass. soc., 30 octobre 2007, Mme Berthier
() Voir l’article L. 1154-2 du code du travail.
() Claude Katz, Victimes de harcèlement sexuel : se défendre, Les éditions le bord de l’eau, 2007.
() Article L. 4612-13 du code du travail.
() « Agir contre les violences sexuelles et sexistes dans les relations de travail », Guide pratique de l’AVFT, 2002.
() Muriel Trémeur et Karim Douedar, « Fonctionnaires : comment réagir face au harcèlement moral ou sexuel ? ».
() Voir l’ouvrage de Claude Katz, précité.
() Audition du mardi 28 avril 2009.
() Voir l’ouvrage de Muriel Trémeur et Karim Douedar, précité.
() Claude Katz, ouvrage précité.
() Audition du 3 juin 2009.
() Ibid.
() Audition du 9 juin 2009.
() Ibid.
() Audition du 9 juin 2009.
() Article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
() Art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949.
() Art.15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.
() Audition du 9 juin 2009.
() Ibid.
() L’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel peut prononcer à l’encontre d’une personne ne se conformant pas à une mise en demeure l’une des sanctions suivantes : la suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois ou plus ; la réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.
() Audition du 9 juin 2009.
() Audition du 2 juin 2009.
() Audition du 19 mai 2009.
() Audition du 9 juin 2009.
() Audition du 17 février 2009.
() Voir notamment l’audition du 31 mars 2009.
() Auteurs de violences au sein du couple. Prise en charge et prévention, rapport du groupe de travail animé par le Docteur Roland Coutanceau, mars 2006, p. 20-21.
() Article L 542-1 du Code de l’Éducation : « Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire ».
() Cf infra. Sixième partie.
() Audition du 17 février 2009.
() Les associations et la lutte contre les violences au sein du couple. Guide méthodologique, 2006.
() Audition du 10 février 2009.
() Audition du 28 avril 2009.
() Audition du 17 mars 2009.
() Il faut également souligner le travail effectué par les associations qui prennent en charge les auteurs de violences Cf. supra., Deuxième partie.
() Audition du 2 juin 2009.
() Ibid.
() Ibid.
() Source : État des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes, annexe au projet de loi de finances pour 2009, p. 58.
() Audition du 10 février 2009.
() Le montant de cette subvention était en 2007 de 300 000 €.
() Audition du 10 février 2009.
() Ibid.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 47.
() Audition du 26 mai 2009.
() Ibid.
() Audition du 26 mai 2009.
() Ibid.
() Ibid.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 37.
() Ibid.
() Audition du 17 février 2009.
() Audition du 26 mai 2009.
() Ibid.
() Source : Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 43. Il s’agit de Toulouse, Lens, Strasbourg, Le Havre et Papeete.
() Voir Guide de l’action publique, p. 13-14.
() Audition du 10 février 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 43.
() Guide de l’action publique, p. 11.
() Audition du 17 février 2009.
() Audition du 10 février 2009.
() Voir l’audition du même jour de Mme Maryvonne Chapalain.
() Audition du 26 mai 2009.
() Ibid.
() Circulaire NOR INT/K/06/30043/J du 1er août 2006 relative à l'extension du dispositif des travailleurs sociaux dans les services de police et de gendarmerie.
() Audition du 3 juin 2009.
() Audition du 3 juin 2009.
() Cf. infra, Sixième partie.
() Cf. ci-dessus, Première partie, chapitre I.
() Observatoire de la Parité, « Faut-il encore faire évoluer les lois concernant les violences à l’égard des femmes au sein du couple ? », 2009
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 45.
() Cf infra. Quatrième partie
() Article 114 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
() Guide de l’action publique, 2008, p. 15.
() Ibid.
() Audition du 10 février 2009.
() Marie-France Hirigoyen. Audition du 17 février 2009.
() Audition du 13 janvier 2009.
() Guide de l’action publique, 2008, p. 39.
() Audition du 12 mai 2009.
() Audition du 10 février 2009.
() Guide de l’action publique, 2008, p. 14.
() Ibid.
() Audition du 27 janvier2009
() Ibid.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 108.
() Ibid., p. 136.
() Audition du 17 février 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 118.
() Audition du 2 juin 2009.
() Portant respectivement sur les cartes de séjour temporaire et les cartes de résident.
() Lois n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, n° 2006-911 du 24 juillet 2006 puis n° 2007-1631 du 20 novembre 2007.
() La preuve de la communauté de vie n’est pas demandé pour la délivrance du premier titre de séjour.
() La circulaire du 31 octobre 2005 indique que « les ressortissants algériens, dont le droit au séjour est régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque vous serez en possession d’éléments attestant que la communauté de vie entre les époux a effectivement cessé à la suite de violences conjugales établies, vous veillerez à faire usage de votre pouvoir d’appréciation selon les mêmes modalités. »
() Il n’existe pas de disposition spécifique sur le retrait du certificat de résident.
() Voir notamment la circulaire du 30 octobre 2004.
() Audition du 2 juin 2009.
() Circulaire du 30 octobre 2004.
() cf. infra, Quatrième partie, chapitre III.
() Audition du 12 mai 2009.
() Audition du 2 juin 2009.
() Audition du 2 juin 2009.
() Audition du 12 mai 2009.
() Ibid
() Cette campagne est décrite dans le livre de l’AVFT, 20 ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail, Paris, 2006, p. 136-137 et sur le site Internet de l’association.
() Ibid., p. 131.
() Bulletin criminel 2003 n° 75 p. 293.
() Cass. Crim., 16 novembre 1993, Bulletin criminel 1993 n° 340 p. 848 et Cass. Crim., 20 février 1996, Bulletin criminel 1996 n° 80 p. 230.
() Audition du 3 juin 2009.
() François Fourment, « Dénonciation calomnieuse », Rép. Pén. Dalloz, janvier 2008, n° 43 et 44.
() Cass. Crim., 7 décembre 2004, Bulletin criminel 2004 n° 307 p. 1144.
() Audition du 28 avril 2009.
() CA Paris, 5 décembre 2001, Mme K contre PP, cité dans AVFT, 20 ans de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail, Paris, 2006, p. 140.
() TGI de Melun, 28 juin 2005, Mmes M et R contre GL, cité dans ibid., p. 140.
() Audition du 12 mai 2009.
() Audition du 28 avril 2009.
() Voir notamment l’audition du 17 février 2009 de Mme Marie-France Hirigoyen ou celle du 10 février 2009 de Mme Emmanuelle Piet, qui indiquait : « J’ai accompagné une femme dans un commissariat parisien, une note affichée sur le bureau de la policière rappelait qu’une dénonciation mensongère était passible de cinq ans de prison ! Je vous garantis que c’est très dissuasif ! Ce point de notre arsenal juridique doit être revu. »
() Audition du 28 avril 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 52.
() Audition du 28 avril 2009.
() Bernard de Korsak et Anne-Marie Léger, Rapport sur l’hébergement et le relogement des femmes victimes de violences, Janvier 2006, p. 17.
() Cf. ci-dessous, chapitre II.
() Audition du 13 janvier 2009.
() Cf. les limites de l’éviction du conjoint violent ci-dessous.
() Audition du 13 janvier 2009.
() Article 220-1 du code civil, troisième alinéa : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »
() Cass., 1ère chambre civile, 6 février 2008.
() Les références des articles concernés figurent dans la circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 19 avril 2006, p. 5 et dans le rapport n° 491 d’application de la loi du 4 avril 2006, p. 14.
() Guide de l’action publique, 2008, p. 32.
() Ce recueil des données concernant les mesures d’éloignement du conjoint violent est demandé par cette même circulaire, p. 6.
() Source : Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple, p. 27.
() Audition du 19 mai 2009.
() On peut s’étonner, ainsi que le fait le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la politique nationale de lutte contre les violences au sein du couple (p. 42) sur « l’opportunité de comptabiliser cette mesure dans ce type d’affaires. »
() Audition du 12 mai 2009.
() M. Pascal Suhard, audition du 27 janvier 2009.
() Audition du 10 février 2009.
() Circulaire interministérielle NSDFE/DPS/DGAS/DGALN n° 2008-260 du 4 août 2008 relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences.
() Audition du 10 mars 2009.
() Audition du 12 mai 2009.
() C’est notamment ce qu’a jugé le TGI de Lille dans un jugement du 21 février 2006.
() Ce point a été mentionné par Mme Karine Lejeune lors de son audition du 26 mai 2009 et a été constaté par la mission lors de son déplacement à Saint-Brieuc : un seul des trois procureurs des Côtes-d’Armor recourt à l’éloignement du conjoint violent de manière systématique.
() Audition du 13 janvier 2009.
() Audition du 27 mai 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 49.
() Circulaire interministérielle NSDFE/DPS/DGAS/DGALN n° 2008-260 du 4 août 2008 relative à l’hébergement et au logement des femmes victimes de violences.
() Audition du 13 janvier 2009.
() Guide de l’action publique, 2008, p. 9.
() Article 373-2-6 du code civil.
() Cf. Deuxième partie II, chapitre I.
() Article 373-2-1 du code civil.
() Audition du 17 juin 2009
() Article 378 du code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les pères et mères condamnés (…) comme auteurs, coauteurs ou complice d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant. »
() Article 220-1, alinéa 3 du code civil
() Casse, 1ère chambre civile, 14 mars 2006
() Docteur Emmanuelle Piet, audition du 10 février 2009.
() Audition du 17 mars 2009.
() Audition du 9 juin 2009.
() Audition du 17 juin 2009.
() Audition du 19 mai 2009.
() Cf. infra, Cinquième partie, chapitre II.
() « Femmes françaises à l’étranger », 2007.
() « Être victime à l’étranger. Quels droits et actions ? Quelles spécificités ? Guide d’information à destination des ressortissants français victimes d’une infraction à l’étranger », 2007.
() Audition du 9 juin 2009.
() Ibid.
() Ibid.
() Ibid.
() http://www.fco.gov.uk/en/fco-in-action/nationals/forced-marriage-unit/
() Article premier de la convention de Genève.
() Article L 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
() CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Diarra épouse Kouyaté et Mlles Kouyaté et CNDA, SR, 12 mars 2009, Mme Fofana et Mlle Darbo.
() Ibid.
() CRR, SR, 15 octobre 2004, Mlle Nazia.
() CNDA, 11 janvier 2007.
() Audition du 2 juin 2009.
() Document transmis par l’ADFEM à la mission.
() Note adressée en mai 2009 à la mission.
() Article L. 312-1, paragraphe 1, 8° du code de l’action sociale et des familles.
() Audition du 26 mai 2009.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250.
() La labellisation et la définition d’un cahier des charges national fixant des objectifs de qualité et faisant référence aux normes du logement décent et celles du logement en foyer visent notamment à la création de petites structures de taille humaine, à la transformation de locaux de logement répondant à un confort standard et permet surtout la définition d’un protocole de suivi personnalisé des femmes victimes de violences.
() Mme Evelyne Reguig, audition du 10 février 2009.
() Bernard de Korsak et Anne-Marie Léger, Rapport sur l’hébergement et le relogement des femmes victimes de violences, Janvier 2006.
() Ibid.
() Audition du 10 février 2009.
() Audition du 27 mai 2009
() Audition du 17 juin 2009.
() Audition du 27 mai 2009.
() Audition du 9 juin 2009.
() Circulaire interministérielle n° DGAS/SDFE/1A/DPS/2008/238 du 18 juillet 2008 relative à l’expérimentation de l’accueil des femmes victimes de violences
() Audition de Mme Valérie Létard du 9 juin 2009.
() Audition du 10 février 2009.
() Audition du 9 juin 2009.
() Audition du 10 février 2009.
() Article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
() Article R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation.
() Cf. Rapport d’information de la Commission des Finances du Sénat consacré à la mise en œuvre du droit au logement opposable, n° 92 du 12 novembre 2008.
() Auditions du 17 février 2009.
() Intervention de Mme Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine Saint- Denis lors de la conférence du 11 octobre 2007 consacrée à l’accès au logement des femmes victimes de violences conjugales.
() Audition du 17 juin 2009.
() Cf. infra, chapitre III.
() Audition du 17 juin 2008.
() Mme Marie Bellanger, audition du 10 février 2009.
() Article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
() Propositions du comité de pilotage In Pro Vic pour favoriser l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences conjugales,présentées à l’issue du séminaire du 24 novembre 2008..
() Étude évaluative et fiches action de l’expérimentation Pro Victima , document de synthèse, octobre 2008 (étude réalisée par le Ministère de la Justice, l’INAVEM, la FNSF, et le CNIDFF)
() Cf. Rapport d’activité 2008 du Relais de Sénart, page 33.
() Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
() Articles L. 262-2, L. 262-4, L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
() Étude évaluative et fiches action de l’expérimentation Pro Victima, document de synthèse (étude réalisée par le Ministère de la Justice, l’INAVEM, la FNSF, et le CNIDFF), présentée à l’issue du séminaire organisé le 24 novembre 2008..
() Accord d’application n° 15 de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage.
() Cf. rapport d’activité 2008, pages 58 à 61.
() Loi 27/2003 du 31 juillet 2003.
() Rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2008, n° 250, p. 55.