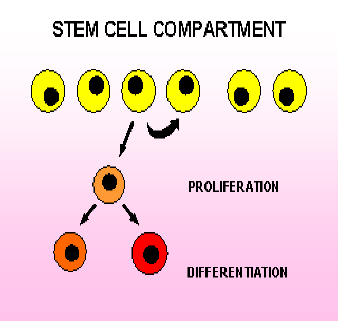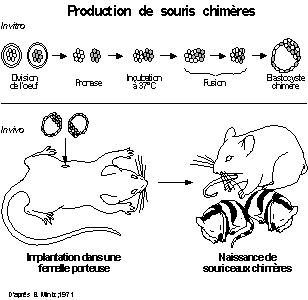SCIENCES DU VIVANT ET SOCIÉTÉ :
LA LOI BIOÉTHIQUE DE DEMAIN
Compte rendu de l'audition publique ouverte à la presse,
du jeudi 29 novembre 2007
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA SéANCE 7
DéFIS SCIENTIFIQUES ET ENJEUX POUR LA SOCIéTé : LA PLACE DE L’ÉTHIQUE 19
DÉBATS 26
8 Mme Nicole QUESTIAUX, Membre de la Commission consultative des droits de l’Homme (CNCDH) 37
8 M. François STEUDLER, Professeur de sociologie, Université Marc Bloch, Strasbourg 42
QUELLES RéGULATIONS POUR LA MéDECINE DE DEMAIN ? 57
Don d’ovocytes, don de gamètes 57
DÉBATS 66
CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES ET CLONAGE THÉRAPEUTIQUE LES PERSPECTIVES 69
LES PERSPECTIVES ENVISAGéES 89
DÉBATS 95
TESTS GÉNÉTIQUES ET MÉDECINE PRÉDICTIVE 97
DÉBATS 105
LES TRAVAUX EN COURS DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES 109
DÉBATS 118
8 M. Didier HOUSSIN, Directeur général de la santé, Ministère de la santé,
de la jeunesse et des sports 125
8 Mme Carine CAMBY, Directrice générale de l’Agence de la biomédecine 127
DÉBATS 137
LES PROPOSITIONS DES JURISTES ET DE LA CITÉ DES SCIENCES 145
8 M. Bertrand MATHIEU, Professeur de droit, Université Paris 1 147
8 Mme Catherine LABRUSSE-RIOU, Professeur de droit, Université Paris 1 148
EXPLORATION DU CERVEAU, NEUROSCIENCES
AVANCÉES SCIENTIFIQUES, ENJEUX ÉTHIQUES
Compte rendu de l'audition publique ouverte à la presse,
du mercredi 26 mars 2008
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 157
8 M. Alain CLAEYS, Député de la Vienne 157
LES DéFIS DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 167
DÉBATS 175
DÉBATS 179
DÉBATS 202
DÉBATS 212
DÉBATS 218
8 M. Jean-Claude AMEISEN, Professeur de médecine, Président
du Comité d’éthique de l’INSERM. 221
8 Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS, Déléguée générale de VivAgora, Journaliste scientifique. 226
DÉBATS 234
PROCRÉATION MEDICALEMENT ASSISTÉE :
ENJEUX ET DÉFIS ÉTHIQUES
Compte rendu de l’audition publique ouverte à la presse
du mardi 10 juin 2008
PROGRÉS SCIENTIFIQUES ET FUTURS ENJEUX ÉTHIQUES 243
DÉBATS 254
ACCÈS Á L’AMP EN FRANCE : BILAN ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES 259
8 M. François THÉPOT, Adjoint au directeur médical et scientifique
de l’Agence de la biomédecine 259
DÉBATS 273
ACCÈS AUX ORIGINES OU ANONYMAT ? 281
8 Mme Carine CAMBY, Ancienne Directrice générale
de l’Agence de la biomédecine 281
DÉBATS 297
GESTATION POUR AUTRUI : INTERDICTION OU AUTORISATION ? 305
DÉBATS 320
SCIENCES DU VIVANT ET SOCIÉTÉ :
COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE
Alain CLAEYS, Député de la Vienne
Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
8 M. Claude BIRRAUX, Député de Haute-Savoie, Premier Vice-Président de l’OPECST
Je vous prie d’abord d’excuser le Président Henri REVOL, Sénateur, qui n’a pu être parmi nous. Je souhaite remercier mes collègues Alain CLAEYS et Jean-Sébastien VIALATTE de m’avoir proposé d’ouvrir cette audition publique consacrée à la bioéthique, organisée dans le cadre de l’évaluation de l’application de la loi du 6 août 2004. Celle-ci confie à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques le soin d’en évaluer l’application dans un délai de quatre ans.
L’étendue du champ d’étude, la complexité des questions posées, les difficultés liées à l’évolution constante des connaissances et des technologies dans ce domaine, les disparités d’approches, tant au niveau international, qu’au sein de notre société, et parfois même de la communauté scientifique, justifient à mes yeux la décision de l’Office d’engager dès maintenant ce travail d’évaluation, en dépit du retard pris par l’élaboration de certaines mesures d’application de la loi.
Par ailleurs, la multiplication des colloques sur les thèmes relevant de la loi de 2004, comme si l’on assistait à l’organisation spontanée d’un « Grenelle de la bioéthique », faisait peser le risque d’une marginalisation des parlementaires de l’Office alors que celui-ci a été investi par le législateur d’une mission d’évaluation dans ce domaine.
L’implication de l’Office aujourd’hui me semble donc tout à fait légitime, et vous savez qu’en ce qui concerne la légitimité du Parlement et des parlementaires, je suis particulièrement pointilleux.
Il me semble également utile de rappeler que le rôle de l’Office est un rôle d’information. Il faut avoir conscience qu’évaluation n’est pas synonyme de décision ou de révision, car c’est précisément pour préparer ce qui doit être organisé en 2009 que nous avons engagé cette étude.
L’évaluation conduite par nos rapporteurs devrait prendre une dimension prospective intégrant non seulement la technique et la technologie, mais également l’homme dans ses aspects physiques, moraux et spirituels. Il s’agit de connaître en quelque sorte la nature véritable de l’homme et, au vu des connaissances nouvelles, de savoir comment appréhender jour après jour la nature la plus profonde et la plus intime de l’homme.
J’évoquerais dans cette introduction la question de la méthodologie. Contrairement aux habitudes en cours au sein de l’Office, les rapporteurs ont souhaité, dès le début de leurs travaux, organiser une audition publique ouverte à la presse alors qu’en règle générale, cette audition intervenait en fin d’étude, et je les en remercie. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des divers travaux conduits par l’Office sur la bioéthique depuis 1992. Elle a été rendue possible aussi par la continuité des études réalisées dans le cadre de l’Office par Alain CLAEYS qui avait, en 1999, avec Claude HURIET, présenté le rapport de l’Office sur l’application de la loi de bioéthique de 1994. Dans le domaine de la bioéthique, qui provoque tellement de débats, voire même d’affrontements dans la société, la formule des auditions publiques contradictoires ouvertes à la presse, initiée par l’Office, est particulièrement bien adaptée.
Je souhaiterais également rendre un grand hommage au travail initial réalisé au sein de cet Office parlementaire en 1992 par feu le sénateur Franck SERUSCLAT, dont le rapport sur « Les sciences de la vie et les droits de l’Homme : bouleversement sans contrôle ou législation à la française ? » symbolise la première incursion de l’Office parlementaire dans le domaine de la bioéthique.
La démarche adoptée par Franck SERUSCLAT me semble tout à fait pertinente. Son rapport comportait une série de fascicules consacrés successivement aux différentes approches en matière de réflexion éthique, à la procréation médicalement assistée, aux premières étapes de la vie et au statut des recherches sur l’embryon, aux diagnostics anténataux et à leurs conséquences, aux conséquences des progrès de la génétique, au statut du corps humain et de la personne humaine, à l’euthanasie et aux soins palliatifs. Ces thèmes retenus, on le voit, gardent toute leur actualité, le sujet n’a pas été entièrement épuisé. Le regroupement de ces différents fascicules portait le nom évocateur suivant : « Questions clés et réponses contradictoires », car l’approche retenue par Franck SERUSCLAT était prudente, le rapport énumérant les questions devant être abordées par le législateur, sans jamais prendre parti.
Quoi qu’il en soit, l’une des recommandations tendait à faire précéder le débat parlementaire de consultations publiques à l’initiative de l’Office parlementaire et, quinze années après, c’est ce que nous organisons aujourd’hui.
Je laisserai les rapporteurs mettre en œuvre cette recommandation et conduire les débats de cette première journée d’audition car il n’y a pas, de la part du Premier Vice-Président de l’Office parlementaire, quelque autorité qui viendrait les contraindre dans leur travail. Je quitterai la présidence après la présentation d’Axel KAHN et retournerai dans la salle, simplement parce que je souhaite assurer mes deux collègues de mon amitié, et de ma totale confiance pour conduire ce débat difficile.
8 M. Alain CLAEYS, Député de la Vienne
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de l’Office parlementaire.
Je voudrais remercier tout particulièrement Claude BIRRAUX qui, avec notre collègue sénateur Henri REVOL, assure la présidence de l’Office parlementaire, avec talent, ce qui, depuis de nombreuses années, a permis à l’Office, et à travers lui au Parlement, d’obtenir une audience aujourd’hui importante sur des sujets concernant la science et la société. Je voudrais saluer aussi l’ensemble des membres du Conseil scientifique, car c’est aussi grâce à eux que cette première table ronde a lieu aujourd’hui, ce qui n’est pas une tradition à l’Office. En principe, les tables rondes ouvertes interviennent à la fin des travaux. Nous avons quelque peu inversé les usages. Les thématiques et les sujets traités étant d’actualité, et très développés dans les médias, il nous est apparu important de pouvoir commencer le travail d’évaluation des lois bioéthiques à travers cette journée d’audition publique.
Je tiens encore une fois à remercier Claude BIRRAUX d’avoir soutenu cette initiative et de nous avoir accompagnés depuis un certain nombre d’années sur ces sujets.
En ce qui concerne la révision des lois bioéthiques, si l’on se souvient ce qui s’est passé en 1998-1999, j’exprime le vœu que l’on ne prenne pas autant de retard qu’alors. Cependant ces retards s’expliquent. Lorsque nous avions commencé nos travaux d’évaluation en 1998, avec Claude HURIET, nous nous étions rendus compte qu’un grand nombre de décrets d’application de la loi de 1994 n’étaient pas encore parus quatre ans après. Heureusement, concernant la loi de 2004, des progrès ont été accomplis, et il ne reste plus que cinq décrets non parus, ce qui est un progrès non négligeable par rapport à la loi de 1994. Cependant, pour ne relever qu’un seul exemple, le décret concernant l’élargissement du diagnostic pré implantatoire n’a été publié qu’en juin 2007 ; c’est toutefois un progrès important.
Pour la future révision de la loi de bioéthique, le calendrier sera contraint, « grâce aux sénateurs » par les dispositions concernant la recherche sur l’embryon. La loi, telle qu’elle a été votée, interdit toute recherche sur l’embryon, mais établit une dérogation qui est valable pour cinq ans. Ceci implique une obligation pour le législateur de revisiter cette disposition avant cinq ans, si l’on souhaite que cette recherche puisse se poursuivre en France. C’est extrêmement important car si tel n’était pas le cas, l’Agence de la biomédecine se trouverait dans une situation extrêmement difficile et ne pourrait pas valider un certain nombre de protocoles de recherche comme elle le fait aujourd’hui. Or, aujourd’hui en France, on compte une trentaine d’équipes qui travaillent sur la recherche sur l’embryon. Cette contrainte liée au texte adopté par le législateur nécessitera donc de travailler rapidement sur ce sujet.
Comment nous situons-nous dans notre travail ? L’Office n’a pas à se substituer au futur travail du législateur. L’Office, composé de députés et de sénateurs, doit évaluer cette loi, expliquer dans quelles conditions elle est appliquée, et vérifier si ses dispositions et les décrets d’application publiés permettent un bon fonctionnement. Dans ce cadre, le travail que nous effectuerons avec l’Agence de la biomédecine et les enseignements qu’elle en tire, est essentiel car, aujourd’hui, l’Agence de la biomédecine constitue véritablement le « bras séculier » de l’application de cette loi. Son regard, son expertise sont totalement indispensables.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé un débat public sur la loi de 2004 qui devrait intervenir en 2009 ou 2010, avant la révision de cette loi. Ce débat public devrait être conduit par l’Agence de la biomédecine. Nous souhaitons, et c’est naturel, y être associés. L’Office prendra aussi un certain nombre d’initiatives. Ce travail, qui se poursuivra tout au long de l’année 2008, est essentiel. Il s’agit pour l’Office parlementaire, comme Claude BIRRAUX l’a rappelé, d’effectuer un travail d’investigation passant par des auditions publiques mais également des auditions privées de toutes les personnes concernées. Nous nous ouvrirons également vers l’extérieur et nous participerons à notre niveau à ce débat public car j’estime que notre démocratie représentative doit aussi se ressourcer à travers l’ensemble de ces débats publics.
À travers les sujets qu’il faut aborder en vue d’une révision de la loi bioéthique, on perçoit la nécessité d’une expertise sur les progrès scientifiques. Que s’est-il passé depuis cinq ans ? Y a-t-il aujourd’hui des avancées scientifiques remettant en cause un certain nombre de nos dispositifs ? Il faut répondre à cette question sans tabou, avec une grande lucidité, en pensant toujours aux malades et en étant très vigilants sur les mots. Il en est un qu’il faudrait parfois bannir de nos interventions, c’est le mot « thérapeutique ». Pour se rassurer, on mentionne toujours « la finalité thérapeutique ». Or il ne faut pas donner de faux espoirs.
Lorsqu’on évoque la différenciation cellulaire, et cherche à comprendre certains processus importants, je considère qu’il ne faut pas avoir honte d’expliquer que cela relève de la recherche fondamentale. Lors de la révision de la loi, c’est un élément que les parlementaires devront avoir à l’esprit pour éviter d’utiliser certains mots pouvant parfois laisser espérer, trop rapidement, des progrès scientifiques.
Sur le don, autre sujet d’importance, j’estime qu’il faudra, au regard de ce que l’on constate au niveau international, et de ce qui peut être qualifié de « dérives », réfléchir à ce que signifie aujourd’hui l’anonymat et la gratuité.
Nous devrons aborder de nouveau ensemble les questions soulevées par la procréation médicalement assistée et également réexaminer les problèmes posés par le diagnostic préimplantatoire. Des interrogations, des demandes pour que la loi s’ouvre sur ce sujet existent, il conviendra de les examiner sans préjugé pour que le législateur puisse être éclairé.
Enfin, il est un sujet qui a fait l’actualité ces dernières semaines, celui des tests génétiques qu’il faudra traiter avec sagesse.
La révision de la loi devrait nous entraîner vers une autre étape. À travers les deux premières lois de bioéthique, on a réfléchi à la question du progrès scientifique et de l’homme. Il me semble qu’il faut réintroduire aujourd’hui une donnée, celle de la société et de ce que j’appellerais « le vivre ensemble ». En quoi ces progrès scientifiques, demain, pourraient-ils modifier nos règles de « vivre ensemble » ? C’est aussi un débat à mener sans tabou dans le cadre de la réflexion de l’Office.
M. Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var
Mesdames et Messieurs, je m’associe aux remerciements qui viennent d’être adressés à toutes celles et ceux qui contribuent aujourd’hui à éclairer le débat sur l’évaluation de la loi de bioéthique. Une évaluation, vous l’avez indiqué, Monsieur le Président, confiée à l’Office dans le cadre de la loi de 2004 avec, comme l’a rappelé Alain CLAEYS, un certain nombre de dates butoirs. Si la date de 2009 paraît un peu difficile à tenir, en revanche celle de 2011 est impérative puisqu’il s’agit de la date limite après laquelle l’Agence de la biomédecine ne pourra plus accorder des autorisations de recherche sur l’embryon.
Pour un parlementaire nouveau venu à l’Office, cette évaluation n’est pas aisée et, paradoxalement, je considère qu’elle se compliquerait presque, en ce qui me concerne, de par mon activité professionnelle de biologiste « praticien de quartier ». Je me trouve, en effet, confronté au quotidien de ceux qui attendent avec anxiété des résultats d’analyses quelquefois banales, mais aussi de tests de dépistage de pathologies plus graves, et confronté aussi aux couples qui attendent la possibilité d’une procréation ou un traitement miracle dont ils ont entendu parler ou lu le compte rendu dans leur quotidien habituel.
Comme le soulignait Alain CLAEYS, il faut être très vigilant. On assiste actuellement à une inflation d’articles destinés au grand public contenant des promesses de plus en plus considérables, et on risque ainsi de créer une grande désillusion dans le public. On comprend bien que certaines équipes de recherche, confrontées à la nécessité, premièrement de trouver des financements, deuxièmement d’acquérir peut-être une notoriété suffisante, fassent des déclarations prématurées, mais j’estime qu’il faut également réfléchir à l’éthique de la publication dans les journaux.
Parfois, en tant que praticien, j’affronte un certain nombre d’attentes déçues que génère l’utilisation de techniques parfois difficiles à supporter comme la procréation médicalement assistée pour les femmes et les hommes qui décident d’y recourir. Il en est de même pour les greffes, où l’attente des patients est quelquefois tellement insupportable qu’elle laisse percevoir parfois un certain désir de mort tant les besoins vitaux pour eux sont pressants.
L’accumulation des découvertes scientifiques et technologiques médiatisées, parfois même avant les essais thérapeutiques chez l’homme, crée des espoirs mais aussi beaucoup de déceptions. Un simple coup d’œil aux affaires très récentes sur les sciences du vivant ainsi que sur la liste des sujets sur lesquels le Comité national consultatif d’éthique a rendu des avis récemment est éclairant. Nous assistons à un bouleversement continu qui rend parfois pensable ce qui relevait, il n’y a pas si longtemps, de la science-fiction, y compris pour un scientifique.
Aussi est-il assez compréhensible que les chercheurs souhaitent une simplification des procédures parfois, il est vrai, inutilement contraignantes. Pour autant ils admettent eux-mêmes que l’on ne connaît pas forcément à l’avance l’impact thérapeutique d’une découverte. Comme le rappelait le Professeur Henri ATLAN, le chercheur avant tout s’efforce de sauvegarder sa liberté de conduire ses travaux pour découvrir. C’est l’un des enjeux de la recherche fondamentale que la loi de 2004 paraît limiter, non sans hypocrisie pour certains.
Dans le même temps je constate comme l’a souligné le Professeur Didier SICARD, Président du Conseil national consultatif d’éthique, que nous avons entendu dernièrement car il ne pouvait pas être présent aujourd’hui, que les biotechnologies enferment l’humanité dans une sorte de « gourmandise technologique ». Le progrès finit par exclure et n’améliore pas toujours la condition de l’homme. Il engendre des inégalités d’accès aux soins entre des régions, entre des personnes, selon leur niveau d’information, et ceci constitue un enjeu éthique d’importance dont nous devons toujours nous soucier.
Par ailleurs, les nouvelles techniques d’investigation fondées sur les nouvelles technologies offrent certes des possibilités de diagnostic rapide, mais posent des problèmes éthiques difficiles à résoudre dans un contexte mondialisé. Le secret médical, l’anonymat, le don, le consentement éclairé, fondement de la loi de bioéthique de 2004 que de nombreux pays nous envient, restent d’actualité. Il est probable que nous n’ayons pas à modifier substantiellement les équilibres auxquels nous étions alors parvenus. Cependant, d’autres questions restent en suspens.
Comment résoudre la question de la gestation pour autrui, certes interdite en France mais autorisée à nos portes ? Comment limiter l’accès par Internet à des tests génétiques de médiocre qualité ou bien encore la vente d’ovocytes ou de gamètes par ce biais car on en manque en France ? Comment préserver la décision de celui qui ne souhaite pas connaître le résultat des tests génétiques dans une famille à risque ? Quel sera le statut de l’homme qui, grâce à des implants cérébraux, verra son comportement modifié ? Quel sera le statut de l’homme réparé, voire augmenté par les nouvelles technologies ?
Les rapports entre la science et la société évoluent, il se crée un climat de méfiance fait d’incompréhension, d’attente et d’espoir mais aussi de désillusions souvent nourries par l’annonce de découvertes « miracles » complaisamment relayées par la presse et/ou par des publicités franchement mensongères. C’est pourquoi Alain CLAEYS et moi-même attendons beaucoup des travaux de ce jour, afin d’être en mesure de contribuer à l’élaboration de la loi de bioéthique de demain par ce premier débat interdisciplinaire.
Je ne crois pas que le législateur doive être « à la remorque » de la science pour toujours adapter la loi aux découvertes en cours. Si la liberté du chercheur existe, le législateur doit, c’est sa vocation, créer le cadre et les conditions du « vivre ensemble» et précéder en quelque sorte, si possible, la science.
Je vous remercie. La parole est à présent à Axel KAHN.
8 M. Axel KAHN, Professeur de médecine, Directeur de l’Institut Cochin, Membre de l’Académie des Sciences, Membre du Conseil scientifique de l’OPECST
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Le sens dans lequel nous étudions l’éthique aujourd’hui et par conséquent celui dans lequel il faudra entendre ce mot lorsque l’on révisera la loi de bioéthique, est une réflexion sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent.
Dans le domaine biologique et médical qui est celui de la bioéthique, cela revient très souvent à se demander si l’application à l’homme et à tout ce qui a de la valeur pour lui, des innovations découlant des avancées scientifiques et des progrès techniques, est ou n’est pas compatible avec l’idée que l’on se fait de ce qui doit être respecté dans la personne.
Puisque l’on traite des valeurs fondant la réflexion éthique, la première question que doit se poser quiconque évoque l’éthique, et notamment le législateur qui devra revisiter la loi, est celle de la nature des valeurs, de leur caractère robuste, de leur permanence ou au contraire de leur totale relativité. Il n’est pas possible de statuer sur une grande diversité de cas, si l’on n’est pas capable de spécifier au nom de quelles valeurs on tâchera de résoudre ces multiples difficultés.
Mon sentiment est qu’il existe une valeur peu susceptible d’être contestée ou remise en cause quelque part au monde et en quelque période. Cette valeur, qui a déjà été mentionnée par Alain CLAEYS et Jean-Sébastien VIALATTE lorsqu’ils ont évoqué la dimension éthique du vivre ensemble, est celle de la réciprocité. Je considère que cette valeur de la réciprocité a une dimension ontologique en ce que s’il n’y avait pas eu, à un moment donné, la prise de conscience de la profonde réciprocité entre deux êtres humains qui s’édifiaient l’un l’autre, qui s’humanisaient l’un l’autre, qui étaient l’un l’autre la condition de leur humanisation respective, il n’y aurait tout simplement pas d’humanité.
Quiconque m’humanise et quiconque est édifié grâce à son contact avec moi, est ainsi, à l’évidence, justifié de se réclamer des valeurs dont je me réclame. Les droits que je revendique en ce qui me concerne doivent être également ses droits.
Lorsque l’on a énoncé ce principe dont je donnerai quelques applications, une question se pose : n’y a-t-il point une contradiction entre, d’une part, la proposition selon laquelle la valeur fondamentale de la réflexion éthique est robuste et non totalement relative, et d’autre part, la volonté du législateur de réviser les lois de bioéthique tous les cinq ans ? En d’autres termes, peut-on considérer que la notion de réciprocité est soluble dans le progrès scientifique ? Le bien est-il soluble dans le vrai ? La morale est-elle soluble dans la science ?
Tout dépendra de ce que l’on entend par la nécessité d’une révision des lois de bioéthique. J’imagine qu’il ne sera pas question de remettre en cause cet élément fondamental que constitue la réciprocité car, en réalité, quand on examine les textes touchant à l’éthique, ceux d’ARISTOTE, de BOÈCE, de PLOTIN, et ceux plus récents, l’on s’aperçoit que les références sont en effet assez stables, et n’ont aucune raison d’être remises en cause, et je ne perçois pas le progrès scientifique et technique qui serait de nature à les remettre en cause. En revanche, les questions qui se posent du respect de cette réciprocité pour certaines d’entre elles ne peuvent être envisagées avant que les connaissances et les techniques ne posent réellement une question particulière.
Un autre conseil que j’aimerais donner à tous ceux qui réfléchissent aux problèmes d’éthique et notamment aux législateurs – mais ai-je des conseils à leur donner ? –, à la lumière de ces quelques réflexions préalables, est qu’il faut à tout prix éviter qu’une loi de bioéthique ne se transforme en un mode d’emploi des pratiques : d’abord, parce que cela ne correspond en aucune manière au sens acceptable du terme d’éthique, ensuite parce que cela amènerait à totalement relativiser la pensée éthique d’un pays par rapport à d’autres dont les pratiques peuvent naturellement être totalement différentes, enfin parce que, danger considérable, on en arriverait, en voulant ne rien oublier, en énumérant toutes les possibilités les plus incongrues, à ce que tout ce qui n’est pas interdit ou organisé, devienne libre d’accès et autorisé. Or l’invention des techniciens et des scientifiques sera toujours plus rapide que celle des législateurs.
La loi de bioéthique se doit par conséquent très clairement, explicitement, d’indiquer ce qu’il revient à la Nation de défendre lorsque l’on traite tel ou tel cas. Les dangers et les pièges, sont multiples. En matière biologique et médicale, l’objet de la réflexion, les sujets de la loi toucheront à des questions de l’ordre de la filiation, de la naissance, de la souffrance, de la maladie, de la mort, de l’identité et de la différence, voire de la valeur des êtres. Il est impossible d’imaginer qu’aborder ces questions puisse se faire sans émotion. Mais qui évoque intégration de la dimension émotive de ces questions, évoque également exigence d’une résistance au caractère morbide de l’émotion, le pathos, qui menace « à tous les coins de rue » lorsque l’on discute des problèmes de bioéthique.
Par ailleurs, il faut naturellement, pour discuter les problèmes de bioéthique, bien comprendre ce dont il s’agit. Les scientifiques et les techniciens, dont le métier est de faire avancer les connaissances et de développer les technologies, sont les mieux à même d’en rendre compte. Ces femmes et ces hommes sont admirables en matière scientifique et technique. L’admiration qui leur est due, ne doit pas forcément s’étendre à une admiration quant à leur appréciation morale et éthique. Comme je vous l’ai expliqué, la morale n’est pas soluble dans la science. Aussi admirables fussent-ils, les scientifiques, les techniciens n’en sont pas moins des femmes et des hommes comme vous autres Mesdames et Messieurs les parlementaires, comme nous autres, avec leurs préférences, leurs préjugés, leurs appréhensions. Si bien que dans les discours, il faudra à chaque fois entendre à la fois, ce que les sciences peuvent expliquer à un moment donné, et ce qui reflète, très logiquement d’ailleurs, les préjugés, les préférences de ces personnes.
En outre, vous devrez en permanence avoir à l’esprit, car ce sera en quelque sorte le moyen de « déclencher la sonnette d’alarme », ce que furent dans le passé les icônes corruptrices de l’éthique médicale. Chacun sait que la médecine a un objet éminemment moral : permettre de rétablir les meilleures conditions de l’autonomie et de l’épanouissement humain lorsque celui-ci est compromis par la détresse, la souffrance, la maladie. Chacun sait également que malgré cela, il y eut de nombreux scandales, de nombreuses dérives de la médecine. Ces icônes corruptrices sont de quatre ordres.
La première icône corruptrice est la passion scientifique qui a toujours sa légitimité mais qui doit être prise en compte, ce que rappelait Charles NICOLLE pour rendre compte d’un épisode au cours duquel son maître, le grand bienfaiteur de l’humanité Louis PASTEUR, ne s’était pas montré à son avantage. Il expliquait que la passion du savant l’emportait sur la conscience de l’homme et parlait de la « folle témérité » que la passion inspire au génie.
La seconde est la négation d’un niveau d’humanité suffisant ou suffisamment prometteur dans l’objet de l’expérience pour retenir le bras de l’expérimentateur. Quand vous entendrez comme argument principal « on peut y aller car ce matériel, cet amas de cellules, ce grumeau, n’a rien d’humain », sachez que dans le passé, au nom de l’humanité insuffisante de l’objet de l’expérience, de nombreuses dérives ont été justifiées.
La troisième est l’alibi ou alors la perspective réelle des bienfaits considérables que l’on peut attendre, si elle réussit, d’une expérience discutable sur le plan éthique. Si bien que lorsque vous entendrez « il faut absolument la faire car grâce à elle les paralytiques remarcheront, les amnésiques retrouveront la mémoire, les cardiaques retrouveront du cœur à l’ouvrage », qu’une « petite sonnette » se déclenche dans votre esprit afin que vous vous rappeliez que ces arguments ont été souvent, bien souvent, utilisés.
La quatrième est bien évidemment celle de l’argent : « il faut le faire car nous avons une place à maintenir et à développer par compétitivité ».
J’illustrerai ces quelques principes généraux et sans d’aucune manière vouloir les régler, à propos des grandes questions que vous aurez à aborder.
La première d’entre elles sera le début de la vie, l’embryon. La réciprocité que j’ai évoquée, a largement progressé dans les dernières décennies, puisque la solidarité envers quiconque, ceux que l’on connaît et ceux que l’on ne connaîtra jamais, l’universalité des droits de l’Homme, sont parvenues à valoir pour les générations qui n’étaient pas encore nées, et à devenir un devoir envers les générations futures. Un embryon est la possibilité d’une personne, il n’en deviendra pas toujours une évidemment, et si c’est un embryon humain, il sera en effet une personne humaine. On peut considérer que ce qu’il pourrait le cas échéant, devenir suffit à marquer, à motiver cette spécificité dont on se demande en permanence comment la respecter.
C’est sur ce point que réside jusqu’à présent l’hésitation du législateur et du peuple français à créer des embryons comme un matériel de recherche car il lui semble alors que la spécificité de ce début possible d’une vie humaine est mal prise en compte. En revanche, cet élément ne saurait en aucune manière remettre en cause une recherche ordonnée sur l’embryon. Même si l’embryon est le début éventuel d’une vie humaine, comme je le rappelle souvent, la médecine progresse grâce à la recherche à tous les âges de la vie humaine, et la nature de potentialité humaine de l’embryon ne saurait être un argument pour ne pas mener de recherches sur lui.
Dans le grand débat sur la technique consistant à transférer des noyaux somatiques dans des ovocytes, que l’on a qualifié du très mauvais terme de « clonage thérapeutique », motivé par des vues bien plus fondées sur du lobbying que sur véritablement la description d’une réalité scientifique, le problème sera posé et vous aurez à déterminer si l’intérêt scientifique incontestable de la technique l’emporte sur les objections que l’on peut lui opposer. En tout état de cause, quoi que vous décidiez, le souci de réciprocité doit vous amener à tout prix, de toutes vos forces, à protéger les femmes. Cette technique telle qu’elle a été mise en œuvre récemment chez des macaques et qu’elle a essayé d’être mise en œuvre chez des personnes en Corée, est terriblement dispendieuse d’ovocytes pris chez des femmes jeunes. Cela constitue un danger tout à fait considérable et quelle que soit votre décision, il me semble que ceci doit être au cœur de vos préoccupations.
En ce qui concerne l’éthique de la génétique qui est une science extraordinaire, elle permet de mieux comprendre la base des programmes, des propriétés matérielles, des propriétés biologiques qui sont la condition sine qua non notamment de l’édification d’une conscience humaine. En d’autres termes, ce qu’il y a de plus spécifique dans l’humain n’est possible que parce que l’humain a hérité d’un génome humain. En comprendre les bases matérielles est d’un intérêt tout à fait considérable. Ceci étant admis, on perçoit ce qu’il y a de totalement ridicule et de profondément négateur de la spécificité de l’humain à s’efforcer de ramener à cette base matérielle la spécificité de ce qui est édifié, à savoir l’humain. On assiste aujourd’hui à une évolution, une dérive, pour moi rétrograde, qui nous ramène à la période bien avant-guerre, quand existait un courant extrêmement important de totale naturalisation de tous les faits humains, sociologiques, psychologiques et autres. Ce courant a été mis entre parenthèses en raison de ce qu’il avait entraîné avant-guerre et surtout pendant la guerre. Or, l’on a l’impression aujourd’hui que s’évanouissent ces parenthèses. Le danger est considérable.
Ramener la spécificité de la famille humaine à sa dimension génétique est régressif. Laisser paraître dans le meilleur journal du monde sans qu’aucun journal, pendant des mois et des mois, ne proteste, des articles indiquant que des gènes s’étaient modifiés après que l’homme eut quitté l’Afrique, expliquant l’amélioration des capacités, cognitives de tous ceux qui ne sont pas noirs, est naturellement abominable. Cela, d’un point de vue législatif, peut mettre le législateur face à un problème majeur : ne va-t-on pas justifier la stigmatisation contre laquelle les lois s’élèvent, en s’appuyant sur une pseudo science ?
Tels sont en quelque sorte, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les lourds défis que vous avez à relever et je vous souhaite bonne chance.
Je laisserai la présidence à mes collègues. J’ajoute que en écoutant Axel KAHN, il me revient en mémoire cette citation de Miguel de UNAMUNO, « la véritable science enseigne par-dessus tout à douter et à être ignorant », et que je me sens de plus en plus ignorant.
DÉFIS SCIENTIFIQUES ET ENJEUX POUR LA SOCIÉTÉ :
LA PLACE DE L’ÉTHIQUE
Sur cette première partie consacrée à la place de l’éthique dans les défis scientifiques et les enjeux pour la société, nous entendrons une série d’interventions. Nous ouvrirons le débat quelques instants avant d’aborder ensuite les enjeux de société avec les autres intervenants. Je vous prie d’excuser Alain FISHER, qui est souffrant et qui ne pourra malheureusement pas être parmi nous. La parole est à M. Jean-Claude AMEISEN.
8 M. Jean-Claude AMEISEN, Professeur de médecine, Université Paris VII, Membre du Comité consultatif national d’éthique, Président du Comité d’éthique de l’INSERM
Je vous remercie. En écoutant Axel KAHN évoquer la réciprocité, je pensais à cette phrase de Paul RICOEUR « On entre en éthique quand, à l’affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l’affirmation que la liberté de l’autre soit : je veux que ta liberté soit », et il inscrivait de cette manière la liberté dans la solidarité et dans la réciprocité. C’est tout le propos d’Axel KAHN sur le caractère au fond universel et intemporel des valeurs de respect de la personne. Cependant à partir du moment où les avancées de la recherche changent le champ des possibles, il est intéressant de repenser la manière de continuer à protéger la dignité humaine et le respect de la personne dans ce qui s’ouvre de nouveau et qui, parfois, était impensé. Cette révision peut être un exercice fécond si elle ne change pas les principes mais la manière de les adapter à un environnement changeant.
Premièrement, en ce qui concerne les défis scientifiques, l’un est ancien mais est en train d’émerger de manière extrêmement puissante, à savoir la réalisation des interactions entre gènes et environnement, autrement dit « l’épigénétique ». Au niveau des cellules, le transfert de noyau, le clonage, a montré qu’il suffisait de placer un noyau dans un environnement différent, en l’occurrence un ovule (sans que l’on sache d’ailleurs pourquoi cet ovule a la propriété de changer la manière d’utiliser les gènes), pour que l’on recommence le chemin de la nature, c'est-à-dire la construction d’un embryon.
Les travaux qui ont commencé il y a un an et demi et qui ont été confirmés chez l’homme, il y a dix jours sont plus intéressants car ils consistent à faire parcourir un chemin à rebours dans le temps, à passer d’une cellule adulte à une cellule ayant des caractéristiques de cellule souche embryonnaire, c’est possible sans passer par la construction d’un embryon. Il ne s’agit donc plus d’imiter la nature, mais de révéler des potentialités cachées de la nature, ce qui ouvre généralement des possibilités de comprendre. Il s’agit là d’une véritable révolution. Actuellement, il existe des cellules souches adultes à potentialité limitée, des cellules souches embryonnaires « naturelles », des cellules où l’on transfère un noyau dans un ovule et des cellules adultes qui sont apparemment capables de se dédifférencier.
C’est un champ des possibles tout à fait extraordinaire qui s’ouvre et qui, à mon sens, montre que penser les possibles dans un état actuel d’avancement de la science est toujours très réducteur, comme on vient de l’expliquer. Cela constitue sans doute l’un des arguments pour repenser un dispositif assez restrictif et très ambigu dans la loi de 2004, qui est de subordonner le développement de recherches sur des cellules aux applications thérapeutiques prévisibles un jour.
La richesse de la recherche fondamentale se révèle actuellement et les applications thérapeutiques ne sont même pas imaginables, à partir du moment où des possibilités s’ouvrent de cette manière. Peut-être ces applications n’auront-elles pas d’incidence sur l’utilisation de ces cellules à visée réparatrice de même que, depuis cinquante ans, toute une série de progrès de la génétique, n’ont pas été liés au remplacement des gènes.
Le deuxième point important, me semble-t-il, que l’on oublie souvent, est la richesse et la fécondité des recherches sur l’animal. Il a fallu quinze ans pour passer des cellules souches embryonnaires de souris aux cellules souches humaines ; il a fallu plus de dix ans pour passer du clonage d’une brebis, à celui d’un primate ; et il a fallu moins d’un an et demi pour passer de la dédifférenciation de cellules de souris, à la dédifférenciation de cellules humaines. J’estime donc que si la recherche sur les cellules humaines est extrêmement importante, il ne faut pas pour autant négliger cette sorte de réservoir à la fois d’imprévu et de compréhension que constitue la recherche animale.
Quant aux relations entre gènes et environnement, un autre élément extrêmement intéressant doit être pris en compte, à savoir que cela dépasse la plasticité cellulaire. Par exemple, sur des expérimentations animales, un certain nombre de formes d’hérédité sont repensées. Il existe des hérédités par transmission de matériels biologiques qui ne sont pas des gènes et il existe des hérédités sans transmission de gènes ou de matériel biologique, qui sont simplement la réinitialisation due à des facteurs de l’environnement. C’est parfois le comportement de la mère vis-à-vis du nouveau-né : une réinitialisation d’une manière particulière d’utiliser les gènes dans certaines régions du corps, en particulier le cerveau, qui produit l’illusion de la transmission de quelque chose alors que c’est en fait la réinitialisation de la même chose.
Il existe une approche de la plasticité et de l’hérédité beaucoup plus ouverte, ce qui, finalement, rend la biologie bien plus intégrative : à la fois focalisée sur l’intérieur et sur l’extérieur. Le généticien Richard LEWONTIN expliquait que l’intérieur et l’extérieur d’un organisme s’interpénètrent et que chaque organisme vivant est à la fois le lieu, l’acteur et le produit de ces interactions. J’estime que penser les apports de la biologie dans un contexte très large est intéressant et j’en donnerai un exemple.
On se focalise à l’intérieur du corps non seulement sur les gènes mais sur les explorations. Des études sont publiées dans les meilleurs journaux du monde depuis plus de dix ans qui indiquent que l’on recherche les gènes du vieillissement alors que la longévité moyenne des personnes dans les administrations anglaises décroît proportionnellement à l’échelon administratif. On note donc que ce n’est pas simplement à l’intérieur du corps que cela se situe. Cela nécessite des recherches sur les interactions entre l’intérieur et l’extérieur permettant d’expliquer comment se construisent la santé, la maladie et le vieillissement.
Cependant demeure le risque que soulignait Axel KAHN, de réduire la personne, le comportement, ce que l’on étudie, à ce que l’on a découvert, lorsque l’on a accès à certaines données (des gènes par exemple) et ce, même avec une grille très précise et des instruments très fins. Ceci aboutit à ce que l’évolutionniste Stephen JAY GOULD appelait « une mal mesure ». C’est toujours « une mal mesure » parce qu’elle réduit la complexité à un seul paramètre.
Par ailleurs, la manière dont on informe est importante. Sachant que l’on se situe dans le domaine de la médecine prédictive : l’explication peut être un dire qui permet de faire. C’est l’examen qui permet la prévention ou le traitement. Le dire peut être simplement un prédire, sans possibilité d’intervenir, et dans ce cas, il est très important de respecter le droit de savoir ou de ne pas savoir parce qu’une mauvaise nouvelle apprise n’est pas forcément un bénéfice, comme cela a été souligné ; la manière de l’annoncer importe grandement. Plus les explorations génétiques s’affirment, et plus elles se traduisent en termes de probabilité : tel résultat signifie qu’il existe 10 % de probabilités de développer un cancer. Il y a deux façons de l’annoncer. On peut dire « nous avons une mauvaise nouvelle, il existe 10 % de probabilités de développer un cancer », ou bien « nous avons une bonne nouvelle, il y a 90 % de probabilités que vous ne soyez jamais malade si le test est positif ». Je crois que la façon non seulement d’informer, ou de ne pas informer, mais aussi la manière d’informer n’est pas neutre, surtout si l’on vise au respect de la personne.
En outre, actuellement, un continent se révèle, il concerne l’exploration des mécanismes cérébraux qui sous-tendent notre mémoire, nos pensées, nos émotions, nos comportements, ce dont traitera Hervé CHNEIWEISS. Dans ce domaine, au caractère extrêmement nouveau et fascinant, on voit poindre une tentative, non pas d’utiliser ces données pour penser la complexité humaine mais de réduire cette complexité à ce que l’on observe. On constate alors que se répètent, dans une sorte d’amnésie, les dérives d’interprétation qui ont été celles de la génétique pendant la première moitié du 20ème siècle. Je pense que ceci est important.
Parmi les défis et les ouvertures, la question des interfaces homme/machine doit être abordée ; en effet les nanotechnologies permettent l’utilisation d’implants cérébraux, mais aussi le pilotage par la pensée d’un ordinateur ou d’une prothèse. Ceci renvoie à la question de l’appropriation par une personne de ces nouveautés pour que celle-ci ne devienne pas prisonnière de telles possibilités mais puisse les utiliser à son profit. On observe dans ce domaine comme dans tous les autres domaines de la pensée biologique, l’émergence, le risque de ce que l’on appelle « l’amélioration » ou « la réalité augmentée ». C'est-à-dire l’utilisation de ces nouveautés non pour corriger une souffrance, mais pour augmenter ses possibilités. Dans ce domaine, le choix des termes est important. Si vous expliquez à quelqu’un que vous voulez l’améliorer, il est peu probable que la personne réponde par la négative. Or de quoi s’agit-il, en réalité ? Il s’agit d’une transformation, mais si l’on utilise le mot transformation, la question de sa réversibilité ou non, celle des risques et des bénéfices commence à apparaître. Le Comité d’éthique de l’INSERM avait rendu l’année dernière un avis à ce sujet, car il est nécessaire de mener une réflexion sur la communication, le langage utilisé pouvant, parfois, induire des difficultés aussi importantes que les applications nouvelles.
Il faut aussi prendre en compte l’affinement, le développement, et l’automatisation des techniques qui deviennent de plus en plus sensibles et exhaustives. On sait qu’à partir d’une cellule embryonnaire, on peut maintenant au titre de la recherche, étudier l’ensemble des chromosomes, séquencer une grande partie des gènes, observer comment les ARN s’expriment, c'est-à-dire comment les gènes sont utilisés, et comment les protéines fonctionnent. On recueille donc de plus en plus de renseignements. Aussi sera-t-il sans doute nécessaire de repenser la notion même de « consentement libre et informé » car si accepter un examen, et recourir aux techniques qui permettent de découvrir ce que l’on cherche, révèlent en même temps quarante données, vous consentez à ce dont vous n’aviez même pas idée que l’on allait vous révéler.
Se posent le problème du consentement informé et la question de repenser la transparence ou non du médecin. Est-ce que le médecin s’efface devant la technique et, va exposer tout ce que la technique révèle, ou est-il le médiateur qui fera la différence entre ce qui a une valeur médicale, qui est important pour la santé, et ce qui est simplement de l’ordre de la singularité ? Actuellement on détecte de petits remaniements chromosomiques montrant qu’une personne est différente d’une autre mais sans avoir aucune idée de leur éventuel impact en termes de santé. Aussi, comment allons-nous procéder pour que la sensibilité des techniques n’entraîne pas des confusions entre ce qui constitue la singularité de chacun et ce qui a une importance en matière de médecine ?
Les problèmes déjà évoqués des mères porteuses, de la gestation pour autrui, comme le don d’organes, posent la question de la limite entre la générosité et l’instrumentalisation d’une personne au profit d’une autre. Tout cela est important car ces avancées doivent toujours remettre la personne au centre des préoccupations, quel que soit ensuite le rôle de cette personne dans « le vivre ensemble ». Il y a toujours eu un risque, qu’évoquait Axel KAHN, d’instrumentaliser certaines personnes au profit d’autres ou au profit d’un plus grand nombre.
Or, l’une des questions majeures dans cette réflexion est que la médecine et la recherche biomédicale placent la personne au centre, même quand se produisent des dérives, même quand on se trompe. C'est-à-dire qu’elles mettent la science au service de la personne et non pas la personne au service de la science. Mais à partir du moment où le but de l’utilisation des avancées et des applications de la biologie n’est plus le soulagement de la souffrance ou la compréhension d’un phénomène, mais un intérêt purement économique, ou judiciaire, ou sécuritaire, l’approche et les risques sont totalement différents.
S’agissant des tests génétiques ou autres, mis en vente sur Internet, doit être traitée la question de l’accompagnement ou plutôt du défaut d’accompagnement, de la validation ou de l’absence de validation. À cela s’ajoute, ce qui est rarement évoqué, le problème du secret médical et de la confidentialité. Les tests de paternité actuellement en vente sur les sites Internet expliquent au père comment il peut prélever quelques cheveux ou de la salive de son enfant à l’insu de ce dernier et de sa mère. Ainsi, l’absence de prescription médicale me permet des investigations à partir d’un échantillon de mes cheveux ou de ma salive mais également offre la possibilité à quelqu’un d’autre d’en faire autant, en envoyant ce prélèvement comme si c’était le sien. Cette augmentation de l’autonomie risque de se faire au détriment du secret médical.
On compte trois avis récents du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) portant sur l’utilisation des progrès de la biologie dans des domaines autres que la recherche ou la médecine : l’un porte sur la tentation de rechercher la délinquance future chez des enfants de trois ans, l’autre sur l’utilisation à visée d’identification de données biologiques au risque de glisser progressivement non pas vers l’identification mais vers la surveillance, le troisième concerne la tentation, lors du regroupement familial, de limiter ou de réduire une famille à ce que la génétique peut en expliquer.
Selon moi, si la société veut ou peut avoir confiance dans le fait que les progrès, les avancées et les applications de la biologie seront toujours respectueux de la personne, il me semble dangereux de créer un hiatus, une dichotomie entre l’extrême précaution que l’on prend dans l’utilisation de ces avancées quand il s’agit de recherche biomédicale ou de médecine, et l’absence de précaution voire l’instrumentalisation qui existe si le domaine d’application est différent.
En d’autres termes, il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises avancées scientifiques. La question éthique se situe dans la manière de les utiliser. Peut-être les lois de bioéthique devraient-elles fixer des principes généraux qui, au fond, réfléchissent à la manière d’utiliser les avancées de la biologie quel que soit le domaine où elles seront appliquées ?
8 M. Claude HURIET, Président de l’Institut Curie, Membre du Comité international de bioéthique de l’UNESCO
J’exprime ma gratitude et mes remerciements aux collègues qui m’ont convié à participer à cette audition publique de l’Office. Beaucoup d’entre eux savent le souvenir marquant que j’ai gardé de ma participation aux travaux de l’Office et c’est pour moi une très grande satisfaction de les retrouver ce jour. Le thème de cette première partie de la matinée est bien cerné, ce sont les défis scientifiques et les enjeux pour la société.
Je traiterai principalement des défis scientifiques. Bien que n’étant pas chercheur moi-même, peut-être suis-je mieux placé que les chercheurs eux-mêmes pour développer quelques réflexions. Il existe à l’évidence une imbrication entre les défis scientifiques et les enjeux pour la société. Or on ne peut pas aborder ces sujets sans avoir défini très clairement quel est le sens des recherches dans le domaine des biosciences en pensant toujours aux malades, cela a été exprimé dès les premières interventions introductives. Ce devrait être essentiellement la recherche des meilleures réponses possibles à l’état de souffrance, à l’inquiétude, à l’angoisse, à la maladie. On doit toujours penser aux malades et je crois, dans la perspective de la révision de la loi de bioéthique, qu’il faut que cette affirmation soit répétée et répétée, et qu’il appartient au législateur, qui craint toujours d’attenter à la liberté du chercheur, de rappeler cette référence constante.
Ces remarques préalables exprimées, j’en arrive au sujet, aux défis des sciences du vivant. Pour être schématique et donc incomplet, je les résumerai en quatre défis qui sont liés pour une large part à l’extension considérable du champ des recherches des sciences du vivant et à leur accélération. On y a déjà fait allusion à l’instant à travers entre autres, les nanotechnologies. Ce double phénomène d’extension du champ et d’accélération entraînera pour la société comme pour le législateur, des interrogations rendant plus difficile la définition des réponses de la loi.
L’extension du champ passe non seulement par des espoirs concernant le traitement des maladies et la prévention, mais également par l’apparition et l’irruption de méthodes de diagnostic, en particulier de l’imagerie. Celle-ci, non seulement a pour objet d’obtenir des images de plus en plus parfaites, mais également, établit des liens entre l’imagerie cérébrale par exemple et le fonctionnement du cerveau. On passe du traitement au diagnostic, de la chimie à la biologie et de là, aux nanotechnologies qui n’apparaissaient pas, je le pense, avec la même prégnance, lorsque la loi de 2004 a été adoptée.
L’accélération, déjà signalée, correspond à deux phénomènes : une demande et une attente d’innovations. Je commencerai par évoquer l’existence d’un droit non explicite, mais qui risque un jour de poser des questions au législateur, un droit à l’innovation sur lequel d’ailleurs la médiatisation n’est pas neutre. Des espoirs quelquefois un peu fous naissent. Ils intéressent d’abord le citoyen et créent ces situations dans lesquelles ceux qui s’interrogent sur le sens de l’innovation et ses limites apparaissent comme des « empêcheurs d’espérer en rond ». Cette accélération amène à s’interroger sur la place réservée à la bioéthique, dont je considère qu’elle est en train de se rétrécir pour différentes raisons qui interviennent dans cette accélération du calendrier.
Le progrès apparaît de plus en plus rapidement, il est vite médiatisé. Le temps consacré à la réflexion est un temps qui se raccourcit au point même de ne plus être considéré comme ayant une fonction d’éclairage des décideurs et des chercheurs, mais davantage comme étant une démarche d’empêchement. Or ce temps de réflexion est indispensable non seulement pour définir le sens même du progrès, mais également pour s’interroger sur le pour et le contre de ses conséquences, sur les relations souvent difficiles entre le respect des valeurs individuelles et le bien commun, ce à quoi tend la démarche éthique. Cette accélération pose problème, car le temps indispensable laissé à la réflexion trouvera de moins en moins sa place au moment de la décision et de la prise de position du chercheur et du législateur. Extension du champ, accélération du rythme, tels sont déjà deux défis auxquels le législateur, mais pas seulement lui, doit réfléchir pour savoir quelles sont les meilleures réponses.
Le troisième défi est celui de l’explosion du marché. À l’évidence, il existe une liaison étroite entre l’accélération et l’explosion du marché. Le développement des biotechnologies en particulier, avec des choix, bien plus dictés par des préoccupations économiques de rentabilité, que par des enjeux de santé publique, et de réponse aux espoirs d’amélioration de la santé des hommes. Quand on aborde ce conflit de plus en plus mal réglé, dans la mesure où la prédominance revient au marché, pour des raisons évidentes, compréhensibles et inquiétantes, un exemple vient à l’esprit, celui du marché du Viagra par rapport à celui des antipaludéens. Cela montre qu’ environ 90 % des crédits consacrés à la recherche dans le monde sont orientés vers des pathologies de pays développés, même si l’on observe par ailleurs le développement progressif des maladies que l’on considérait comme liées à la richesse et à la nutrition, comme le diabète et l’obésité. Néanmoins, l’exemple Viagra/antipaludéens doit être présent dans tous les esprits car il n’est pas le seul qui pose un problème et un défi aux chercheurs eux-mêmes.
Il convient aussi de prendre en compte la solvabilité des marchés et celle des molécules nouvelles, puisque l’on se situe dans une dimension marquée de plus en plus par des considérations économiques. C’est un point qui m’a paru assez original. La solvabilité des marchés rejoint d’une certaine façon le rapport 90 % / 10 % que j’évoquais précédemment. Désormais une obligation de résultat pour la recherche existera, en particulier dans le domaine thérapeutique, avec ces molécules au coût de plus en plus faramineux s’appliquant à des pathologies aussi redoutables et graves que le cancer. De telles molécules conduisent à des difficultés d’accès et de rétraction du marché, notamment avec des perspectives de traitements par molécules ciblées. Une firme pharmaceutique, qui a mis en place une nouvelle molécule grâce à une démarche tout à fait innovante, s’est d’ailleurs engagée (peut-être l’a-t-on poussée à le faire ?) à reconsidérer, voire même à rembourser, – je crois que cela va peut-être un peu loin mais sa démarche est intéressante – le prix de son médicament innovant dans la mesure où il n’aurait pas atteint le but que le promoteur de cette innovation lui avait fixé. C’est un point qui me paraît très intéressant et qui concerne l’un des défis présentés aux chercheurs. Les traitements ciblés introduisent du point de vue des espoirs thérapeutiques, des indications, de l’appréciation nouvelle du bénéfice et du risque, une dimension économique sur laquelle la réflexion doit porter.
Quant à l’inégalité d’accès à l’innovation, y compris dans une dimension économique et en considérant les coûts, on s’aperçoit que tous les patients susceptibles d’en bénéficier, y compris dans des pays développés, ne pourront sans doute pas y accéder, ce qui pose un problème éthique qui ne peut pas laisser insensible le législateur.
Je terminerai par le quatrième défi, celui de la mondialisation de la recherche qui se traduit à la fois par des données économiques et financières dans lesquelles la législation et la réglementation ont leur place. Je citerai quelques chiffres pour la recherche développement en 2006. Sur 27 milliards de dollars investis, 22 l’ont été par des entreprises américaines. C’est une mondialisation avec une concentration qui conduit à des interrogations de nature éthique et législative en raison de l’effet et de l’impact des lois et règlements y compris en matière de stratégie de recherche développement de la part des entreprises.
L’exemple relativement récent, tient aux effets immédiats de certaines décisions du Président des États-Unis, il y a me semble-t-il 18 mois, concernant l’utilisation des cellules souches et des lignées. Cette position du Président des États-Unis, qui n’était pas nouvelle, mais qui avait été renforcée dans son expression et dans le sens d’une limitation d’accès, a entraîné entre autres effets, le transfert d’une équipe de chercheurs d’Harvard vers Singapour parce que les lois et règlements d’encadrement y sont inexistants. Ces pays prennent en compte des considérations économiques dans les perspectives d’orientations et les stratégies de recherche. Singapour a défini parmi les points forts de son développement et de sa prospérité économique le développement des biotechnologies.
Ce qui ne nous éloigne pas du sujet puisque, mes chers collègues, lorsque vous aurez à légiférer, vous serez entre autres écartelés entre d’une part, les considérations éthiques que vous avez évoquées et que vous prenez par là même à votre compte et, d’autre part, les considérations liées au conflit entre les intérêts économiques et les enjeux de santé publique. Je vous souhaite bien du plaisir tout en regrettant de ne pouvoir intervenir directement dans le débat lorsqu’il s’ouvrira.
‚
Avant de donner la parole à la salle pour ouvrir le débat, je voudrais exprimer un regret, c’est qu’en quelque sorte le législateur n’ait pas su en 2004 faire une autre loi que celle qui doit être révisée car l’on ne peut pas envisager que les lois de la bioéthique soient assorties d’une révision permanente : d’une part, parce que comme l’a si bien montré Axel KAHN, ces lois doivent répondre à des principes assez simples et permanents, et d’autre part, parce que comme l’a si bien expliqué Jean-Claude AMEISEN, la somme des possibles est telle que, de toute façon, la loi ne parviendra jamais à résoudre et expliquer tous les problèmes qui se poseront à nous, et enfin, Claude HURIET l’a aussi très bien expliqué, l’on ne peut pas toujours légiférer sous la contrainte, le législateur a besoin de temps, la réflexion nécessite du temps. Or lorsque nous réviserons cette loi, nous avons l’obligation d’élaborer une loi qui ne soit pas révisable dans les années qui suivent. L’éthique n’est pas révisable en permanence.
Certes, il faudra tenir compte de la mondialisation parce que la France n’est pas un îlot indépendant, mais nous pouvons aussi affirmer haut et fort quelques valeurs qui sont les nôtres depuis fort longtemps sans nous « coucher » en permanence devant la science anglo-saxonne qui en demande toujours plus. Quant aux intérêts économiques, on perçoit bien leurs limites et leurs dangers ; je pense en particulier aux déceptions engendrées par la thérapie génique. Il n’y a pas eu de « retour sur investissement » dans ce domaine, ce qui pousse des multinationales à proposer des tests génétiques à bon marché réalisés dans des conditions quelquefois douteuses, dans des pays étrangers, pour essayer d’amortir leurs investissements.
Très globalement, j’estime qu’il faut être extrêmement prudent et essayer d’imaginer une loi « pour une fois », « un peu permanente », car élaborer des lois révisables devient un travers constant du législateur.
Sur ce point, Monsieur le Député, vous aurez plusieurs choix. Certes, il peut être nécessaire à un moment donné de se ressaisir d’un problème. Ce que je n’ai pas très bien compris, c’est que vous aviez le choix d’une Agence de la biomédecine, pouvant attirer l’attention du législateur sur la nécessité éventuelle de penser à l’élaboration d’un nouveau texte, parce qu’un problème était véritablement urgent, avec le recul nécessaire afin de ne pas légiférer dans l’urgence. Cela n’a pas été choisi. Toutefois, il ne s’agit pas de soutenir que la loi est « gravée dans le marbre », d’ailleurs, aucune loi ne l’est jamais, à l’évidence. En revanche, la périodicité obligatoire de la révision apparaît en quelque sorte correspondre à une opinion révisable.
Ce délai de cinq ans, nous l’avions défendu en son temps avec Alain CLAEYS, ce qui était à l’époque une disposition assez inhabituelle, voire exceptionnelle, et qui avait été inscrite dans la loi de 1994. Finalement, malgré nos interventions, le délai a été doublé puisque la révision est intervenue dix ans plus tard.
La position de Jean-Sébastien VIALATTE, est, je le pense, une vision idéale du travail de législateur. On souhaiterait que tout travail législatif, parce que il est une règle commune pour la vie en société, les relations entre l’individu et la société, ne soit pas l’objet de révisions trop rapprochées car une règle ne gagne rien à être modifiée un peu « au gré du vent ». Néanmoins, concernant le champ d’application d’une loi dite « de bioéthique », on doit tenir compte, non pas des évolutions de la société qui sont induites, mais de l’évolution même des connaissances.
Premièrement, l’utilisation des cellules embryonnaires humaines telle qu’elle a été interdite, mais autorisée dans la loi de 2004 est une aberration. En effet, on ne peut pas à la fois l’interdire en s’appuyant, j’imagine, sur des valeurs profondes et intangibles, et l’autoriser à titre dérogatoire pendant une période de cinq ans en habillant ce moratoire de quelques considérations scientifiques ou pseudo scientifiques. Or maintenant que « le coup est parti », il reste à savoir comment vous réagirez, obligés que vous êtes de réviser la loi, sauf à revenir du jour au lendemain à l’interdiction puisque le moratoire serait arrivé à son terme. C’est un vrai problème.
Ceci me conduit à une deuxième réflexion portant sur les récents travaux de Shinya YAMANAKA qu’Axel KAHN a évoqués. En effet, l’absence de perspective de solution alternative avec des bénéfices attendus figure dans les dispositions justifiant le moratoire. Est-ce qu’en l’état actuel des connaissances, avec encore une marge d’incertitude, le législateur va s’appuyer sur ces éléments même s’ils conservent une part d’hypothèse, pour expliquer « nous prorogeons le moratoire jusqu’à connaître quelles sont les solutions alternatives possibles » ? En effet, la position actuelle de Ian WILMUT, que nous avions auditionné dans le cadre du travail que l’Office nous avait confié, m’a beaucoup marqué, et Alain CLAEYS comme moi. J’ai relu ce qu’avait indiqué Ian WILMUT à l’époque ; il avait évoqué ces évidences scientifiques qui peuvent évoluer au cours du temps. « Ian WILMUT abandonne l’embryon », ont titré les unes des médias…
Est-ce que ces données nouvelles à vérifier, auront des traductions législatives dans le sens de la suppression du moratoire, ce qui équivaudrait à supprimer l’interdiction, comme le propose le rapport de Pierre-Louis FAGNIEZ dont j’aimerais savoir ce que vous pensez, même si vous n’êtes pas obligés de l’exprimer en public ? Va-t-on revenir à l’autorisation ? Va-t-on supprimer le moratoire et revenir à l’interdiction ? Il ne fait aucun doute pour moi que les informations scientifiques récentes posent à l’évidence la nécessité d’une révision de la loi. Dans cette situation, la pire des solutions serait, non pas de réviser un texte comme celui-là, mais d’agir par amendements. La réflexion éthique est vraiment trop importante pour que l’on donne l’impression de « mettre des rustines » ou de modifier au gré des événements, par voie d’amendements, inclus, par exemple, dans des projets de lois que l’on appelle «diverses mesures d’ordre social », ceci serait vraiment la caricature du travail législatif. Je plaide donc, tout en le regrettant, pour la nécessité d’une révision programmée des lois de bioéthique.
Je remercie Claude HURIET, et constate qu’il a toujours un temps d’avance, et en est pratiquement au travail du législateur ; il nous interpelle pour savoir sur quoi l’on va trancher. Nous avons un point d’accord : cet article sur le moratoire n’a pas grand sens en l’état. Quant aux interprétations, elles seront tout l’objet du débat parlementaire.
Je souhaiterais vous interpeller tous les trois. Axel KAHN a estimé qu’une loi bioéthique n’est pas un mode d’emploi de pratiques, c’est cela que doit défendre la société. Il est vrai que dans l’avenir, je ne sais s’il faudra réviser régulièrement les lois de bioéthique qui évolueront nécessairement en raison du rôle de l’Agence de la biomédecine. J’estime que l’Agence de la biomédecine pourra conférer beaucoup plus de souplesse à un certain nombre de procédures législatives.
En quoi les enjeux scientifiques tels qu’ils se présentent aujourd’hui, sont-ils différents de ce qu’ils étaient il y a quatre ou cinq ans ? Aujourd’hui, quels sont les quelques défis qu’une loi de bioéthique revisitée doit affronter, quels sont les défis que la Nation doit affronter concernant le progrès scientifique ? Existe-t-il des ruptures aujourd’hui par rapport à quatre ans auparavant, ou sommes-nous dans la continuité des défis scientifiques ? C’est une question sur laquelle le législateur doit disposer d’un certain nombre de réponses de la part des scientifiques comme des personnes qui s’y intéressent car c’est, à mon sens, un point de départ essentiel.
Dans ces lois qui se disent « révisables » et d’ailleurs appliquées tant qu’elles le ne sont pas, je constate, ce qui est intéressant, que l’on vit dans de nombreux domaines, une inflation législative : des lois non appliquées donnent naissance à d’autres lois non appliquées, qui redonnent naissance à d’autres loi. L’idée d’une loi qui se dit « révisable » et qui est appliquée en tant que telle, en attendant, a quelque chose de sain, même s’il est toujours bon d’en ériger le principe car cela évite le caractère incantatoire qu’a souvent me semble-t-il le droit, où la promulgation tient lieu d’application.
Dans les problèmes éthiques, l’interrogation porte souvent sur la nouveauté du problème éthique posé. Cette question a été par exemple posée au Comité consultatif national d’éthique pour les nanosciences et les nanotechnologies. Ce problème éthique est-il nouveau ou bien est-il ancien mais se posant dans un contexte nouveau ? L’accélération évoquée par Claude HURIET, est également une accélération des convergences, à savoir que plusieurs approches différentes, les sciences de l’information, les sciences cognitives, les nanotechnologies, les biotechnologies se réunissent. Ceci produit un glissement de plus en plus grand, en dehors du champ médical, qui est certes très ancien mais qui se passe plus rapidement et différemment.
Il s’agit davantage de modifier le cadre conceptuel sans le transformer radicalement pour prendre en considération une évolution de la réalité. Il convient peut-être de trouver un cadre qui permette de répondre plus vite à des changements rapides, ou de disposer de solutions plus durables indépendamment des changements rapides, comme l’expliquait Claude HURIET. Il me semble plus opportun de fixer précisément le champ d’action d’un certain nombre d’agences indépendantes permettant la validation et l’interrogation sur les pratiques, ce qui fait le plus défaut, plutôt que donner une définition forcément vite obsolète de ce qu’il convient de faire.
Ma préférence, en accord avec Jean-Claude AMEISEN, irait dans le sens d’une loi cadre, qui pose véritablement les principes, qui rentre dans quelques détails (il n’est pas possible de l’éviter) et qui, par ailleurs, installe en effet une série d’agences indépendantes comme l’Agence de la biomédecine, chargées d’un rôle jurisprudentiel, c'est-à-dire d’interpréter l’esprit de la loi en fonction des nouvelles pratiques, et dès que l’on constate le risque d’une dérive jurisprudentielle, c'est-à-dire lorsque la jurisprudence peut devenir contradictoire avec l’esprit de la loi, les agences peuvent demander au législateur de reprendre la main. Cette démarche démocratique me semble être le meilleur système.
Par ailleurs, dans la loi qui sera révisée en 2009, existe-t-il des urgences totalement motivées par l’évolution des sciences et des techniques ? La réponse est positive car la loi a été mal rédigée. Si la loi avait été bien écrite, la réponse eût été négative. La loi est mal rédigée et l’est d’ailleurs depuis 1994. La loi de 1994 sur l’embryon, stipulait par exemple que toute recherche sur l’embryon est interdite, mais que des études sur l’embryon qui ne nuisent pas à son développement sont autorisées. Ce qui était une abomination absolument totale puisque l’interprétation correcte était : on peut effectuer une recherche sur l’embryon humain, mais il faut le remettre dans le ventre d’une femme en espérant qu’il continuera à se développer. Il était évidement urgent de modifier ce texte de loi tellement mal écrit.
Maintenant, lorsque la loi stipule que la recherche sur l’embryon est interdite mais que l’interdiction est levée pour cinq ans, c'est-à-dire qu’on établit un moratoire, non pas sur une autorisation mais sur une interdiction, invention sémantique prodigieuse ! On ne peut pas demeurer dans cette stupidité ! Il est parfaitement clair qu’il faut trancher. Ou bien la recherche sur l’embryon est interdite, ou bien elle est autorisée dans telles ou telles conditions.
Mon sentiment est qu’elle doit être autorisée pour deux raisons : d’abord parce qu’il n’y a pas d’argument moral important pour l’interdire. Deuxièmement parce que même si l’on crée des cellules ayant beaucoup de propriétés des cellules souches embryonnaires par traitements divers de cellules somatiques, telles que des cellules de peau, il n’empêche que l’étude des maladies du développement humain aux premiers âges de la vie fait partie d’une recherche biologique et médicale totalement et complètement légitime. Jamais on ne pourra considérer que la cellule cutanée qui a retrouvé des propriétés de cellule pluripotente grâce à ce traitement, notamment au transfert de gènes ou grâce à d’autres traitements, sera l’équivalent des premiers moments du développement de l’embryon humain. Encore faut-il déterminer les conditions de cette recherche.
S’agissant de la grossesse pour autrui, et notamment, de la mère porteuse, certes, strictement rien dans l’évolution des techniques n’a changé quoi que ce soit aux termes du problème. En revanche, il faut avoir le courage d’affronter les difficultés. D’une part, ce n’est pas parce que cela est autorisé dans les pays voisins qu’il faut le faire chez soi ; d’autre part, ce n’est pas parce qu’on se l’est interdit dans le passé qu’il faut continuer. Il vous faudra donc enfin traiter véritablement ce sujet difficile et trancher.
La première difficulté est que personne ne peut nier le mouvement de solidarité qui poussera une mère, une sœur, une amie très chère à porter pour la sœur, la fille, l’amie qui a une malformation, une maladie telle qu’elle ne peut pas elle-même mener à bien une grossesse. En revanche, personne ne peut nier non plus le risque lié à l’aspect contractuel, et donc financier, de la démarche. Par ailleurs, il vous faudra très clairement nous interroger sur la définition de l’enfant et de la mère ? La mère est-elle la femme qui accouche de l’enfant ou bien, et je sais ce que répondrait M. Thierry MARIANI, les parents sont-ils ceux qui ont donné les gènes ? C’est important et cela entraîne aussi des conséquences considérables car aujourd’hui deux techniques évoluent.
Une première technique concerne les femmes ménopausées qui désirent avoir un enfant, il est difficile de s’y opposer si ce n’est pour des raisons liées à la santé de la mère, et également le souci de l’enfant. Ceci étant dit, personnellement, je ne vois pas de raison de s’y opposer définitivement, mais il ne sera jamais l’enfant biologique de la mère ménopausée, qui est une mère porteuse. Dans ce cas, si l’on évolue, on considérera que la mère est bien cette mère là qui a accouché de l’enfant (et non la mère biologique). En revanche, il ne faudra pas par contradiction absolue considérer que, dans le cas d’une transaction contractuelle préalable, la mère porteuse qui accouche d’un enfant n’a aucun droit sur cet enfant, qu’elle n’est véritablement qu’un utérus loué. Il faudra que vous vous assuriez de la cohérence de la loi, mais cette cohérence est une exigence intellectuelle, elle n’est pas liée à l’évolution de la science. N’attendez pas que la science vous pose des problèmes pour marquer véritablement la richesse de votre analyse !
À propos des points sur lesquels la révision apparaît souhaitable et sans doute indispensable, j’évoquerai la suite de l’intervention d’Axel KAHN sur la recherche sur l’embryon, dont il laisse entrevoir, avec un raisonnement de chercheur et de scientifique, que la solution alternative possible que pourraient ouvrir les travaux de YAMANAKA ne doit pas cependant mettre un terme à l’autorisation d’utiliser l’embryon. En revanche, il insiste sur l’objet de ces recherches qui concernent la connaissance.
Or, vis-à-vis de l’opinion jusqu’à maintenant, ce n’était pas tellement la recherche sur la connaissance qui apportait sa contribution au débat, souvent d’ailleurs avec un élément passionnel, c’était les espoirs thérapeutiques. Autrement dit, cela ne signifie pas que les arguments qu’Axel KAHN a développés sont sans valeur, mais au cours des états généraux de la bioéthique, ce qui pourra intervenir pour justifier le maintien des possibilités de recherche sur l’embryon, ce ne seront pas tellement les considérations liées à la connaissance des débuts de la vie, mais ce sera la confirmation ou pas des enjeux thérapeutiques. Cela change la nature et les arguments du débat.
Dans les modifications nécessaires en raison de l’évolution et du progrès des connaissances en génétique, je voudrai aborder le sujet du diagnostic préimplantatoire (DPI). Les indications du diagnostic préimplantatoire dans la loi de 1994, qui ont été reconduites en 2004, étaient très restrictives. Mais depuis que l’on a progressé dans la connaissance de la détermination des facteurs génétiques de certaines pathologies, on évoluera et on brisera le cadre difficilement fixé initialement par le législateur, car on constate maintenant l’apparition d’une demande d’utilisation du diagnostic préimplantatoire (DPI), non plus pour des pathologies certaines avec des pronostics certainement létaux, mais pour des prédispositions génétiques. Cet exemple montre qu’il est nécessaire non pas de s’adapter ou de « courir après le progrès », parce que ce n’est pas le travail du législateur, mais de tenir compte des évolutions, à défaut de pouvoir les anticiper, pour vérifier si le cadre législatif convient encore, ou s’il doit être modifié.
L’une des questions importantes a été le don d’organes dans la famille qui n’a jamais été pensé pour répondre à la demande d’organes. Est-ce que l’on peut penser à des exceptions autorisées, mais non comme des réponses systématiques à un besoin, car il y a une très grande différence entre autoriser et en faire une solution systématique.
Par ailleurs, la loi de bioéthique de 2004 prévoit que ce n’est pas la donneuse d’ovocyte qui est la mère, mais celle à qui on l’a donné. Or le fait que la contractualisation change les relations humaines comporte toujours un risque d’instrumentalisation.
Un accouchement sous X est considéré comme un abandon car ce n’est pas ce que devrait faire une mère, alors que si une mère porteuse veut garder son enfant, ceci est considéré comme une rupture de contrat. Comment donc penser le lien mère/enfant en fonction du fait que quelqu’un attend ou n’attend pas l’enfant ? Il y a là toute une série de d’interrogations.
Sur ce point, nous sommes en réalité d’accord. Si j’étais député et si je participais au débat, ma position ne serait pas forcément hostile à des cas où le recours à une mère porteuse serait autorisé. En revanche, j’éviterais systématiquement de supprimer tout lien entre la mère et l’enfant parce que le contrat en aurait décidé autrement auparavant. Le contrat n’est pas de nature à modifier la caractéristique d’une relation biologique. L’intimité profonde entre une femme et cet enfant qu’elle porte pendant neuf mois ne peut pas être annihilée derrière les termes d’un contrat. Par conséquent, je pense que la technique qui est utilisée à l’heure actuelle dans de très nombreux pays d’Europe, qui comporte en effet le risque de refus d’accouchement sous X, d’abandon et d’adoption, est selon moi la seule possibilité.
M. Antoine BALAGERI
Médecin clinicien, j’ai été très sensible au discours de M. Claude HURIET. Pour ma part, j’utilise comme éthique le conflit de valeur entre les six ordres de la pensée de Blaise PASCAL. Je n’ai pas trouvé mieux depuis. À mon humble avis, le politique a vocation à veiller farouchement à la non confusion des six ordres de la pensée, économique, politique, etc. Il appartient au médecin ou au prêtre, dans les sociétés civilisées de définir le bien et le mal.
Mme Agnès NOIZET
Je fais partie d’un centre de médecine de la reproduction à Marseille et j’aurais voulu que l’on ne mette pas en balance, en équivalence, le don d’organes et la gestation pour autrui. L’infertilité est une vraie souffrance, mais n’est pas un danger de mort. Cette correspondance est un peu gênante, et je remercie M. Axel KAHN d’avoir fait cette dernière intervention que j’aurais faite sinon. Il ne faut pas non plus oublier que la femme qui portera l’enfant court un risque. C’est un risque qu’elle prendra pour sa sœur, ce que l’on peut peut-être comprendre, mais ce peut être aussi pour de l’argent, et dans ce cas cela devient de l’exploitation de la misère humaine.
Professeur à l’université, mais surtout membre du Comité d’éthique de l’Institut de la recherche et du développement (IRD), je voudrais faire une observation à propos de la quadrature du cercle, évoquée à plusieurs reprises, à savoir une loi générale et par définition rigide face à laquelle on place une science qui avance très vite. Comment concilier ces deux aspects, comment imaginer qu’une loi pourra prévoir l’imprévisible ? Je considère qu’il suffit qu’à l’intérieur de la loi, on prévoit des structures pouvant répondre au cas par cas à des problèmes que l’on ne peut pas imaginer actuellement. Or ces structures existent, il suffit simplement de leur donner les pleins pouvoirs. Je pense aux comités d’éthique et si je prends comme exemple les essais cliniques – et je suis heureux que M Claude HURIET soit présent – un essai clinique ne peut se faire que s’il y a consentement des patients et, surtout, que si l’on a obtenu l’avis positif du Comité national consultatif d’éthique.
À propos de la recherche sur l’embryon et de la recherche sur l’être humain en général, ma question s’adresse au Professeur Axel KAHN qui a indiqué que la recherche sur l’embryon serait souhaitable dans la mesure où la recherche est autorisée actuellement sur l’être humain une fois qu’il est né. Pour les recherches biomédicales, il existe aujourd’hui des lois protégeant la personne. Selon vous, faudrait-il également appliquer une loi de ce type à l’embryon ?
En effet, Madame, il ne m’a pas échappé que la différence importante entre la recherche à l’âge embryonnaire et à l’âge postérieur de la vie, est qu’à l’âge postérieur on essaye de ne pas tuer le patient alors qu’à l’âge embryonnaire, en général, on le détruit. Je ne suis pas assez sot pour masquer cela. Ce que je constate, c’est qu’une partie des embryons conçus ne se développent jamais en êtres humains, et ce quelles que soient les conditions de leur conception, que ce soit par l’étreinte d’un homme et d’une femme ou par fécondation in vitro (sachant qu’il y a à peu près la même proportion). C’est un fait de nature, sur 10 embryons conçus, il y en a 2 ou 3 qui seront des bébés. Les autres ne le seront jamais.
Par conséquent, que ces embryons puissent être utilisés pour un programme scientifique alors qu’ils ne sont pas réclamés par les géniteurs, que les géniteurs y consentent et que l’Agence de la biomédecine considère au cas par cas que la qualité de la recherche le justifie (j’utilise ici un paradoxe dont je ne méconnais pas le potentiel agressif), sont la seule manière de réintroduire cet embryon, qui ne sera jamais un être humain, dans au moins un projet humain, profondément humain, qui a comme but la connaissance ou éventuellement, secondairement, le traitement de l’homme. C’est sur ce point qu’intervient le législateur. J’estime qu’en effet la législation doit très clairement encadrer les conditions dans lesquelles cet état singulier, ce début éventuel d’une personne humaine, peut faire l’objet d’une recherche.
Par ailleurs, moi qui ne fais pas confiance aux médecins pour dire le bien et le mal et qui aime bien les prêtres mais qui ne crois pas au même dieu qu’eux, je crois néanmoins au bien et au mal mais je n’attends pas des prêtres qu’ils m’expliquent ce que c’est. Pour moi, le bien est tout ce qui procède du sentiment que j’ai de ma responsabilité envers l’autre, et le mal est tout ce qui le nie.
Pour reprendre ce que vient d’indiquer Axel KAHN sur l’embryon, ce qui me semble et m’a toujours semblé étrange dans la restriction particulière d’espoir thérapeutique et de retombée thérapeutique prévisible, c’est non seulement cette subordination de la recherche à ses applications prévisibles mais le fait que, dans le cas par exemple des fœtus morts, la recherche, certes encadrée, sur des cellules isolées à partir d’un fœtus mort, n’a jamais fait l’objet d’un pré-requis d’applications particulières. La question est différente de la création d’embryons à visée de recherche, et de l’utilisation pour la recherche de cellules isolées à partir d’un embryon qui sera détruit parce qu’il n’existe plus de projet parental, plus de couple d’accueil et que les parents ont donné un accord pour la recherche.
Il me semble que sur cet aspect, qui est peut-être une tendance de la réflexion bioéthique parfois, la cristallisation sur l’embryon a paradoxalement abouti à créer des exceptions pour l’embryon qui n’existent pas pour le fœtus, voire pour un enfant ou un adulte mort. Parfois, la cristallisation sur les premiers stades de la vie et sur la fin de la vie, tout à fait légitime au demeurant, risque d’obérer les problèmes très importants qui se passent entre ces deux extrêmes et donnent sens à ce début et à cette fin.
En ce qui concerne les mères porteuses, je n’ai jamais voulu assimiler le don d’organes à la gestation pour autrui. J’ai tenté d’expliquer que dans cette ambivalence, dans cette complexité des relations entre l’altruisme, que l’on peut comprendre et encourager en termes d’exception, et la solution systématique qui peut amener à l’instrumentalisation, le don d’organes entre parents est un très bon exemple. On l’autorise parce qu’on le comprend, mais on ne l’encourage pas du tout comme une solution au problème. C’est en cela qu’il y a un rapport avec l’autre.
Enfin, en ce qui concerne les comités d’éthique, que la loi tisse un réseau avec des agences indépendantes, avec des comités d’éthique, avec le Parlement, permet au fond d’anticiper et de construire des réponses à des problèmes inattendus plutôt que de vouloir les prévoir, ce qui s’avère toujours un échec… les comités à mon sens ont un rôle très particulier. Les comités, comme le Comité national consultatif d’éthique (CCNE), sont consultatifs. Ils n’indiquent pas ce qu’il convient de faire. Les agences qui interprètent la loi, peuvent se retourner vers les comités lorsqu’il y a des interrogations, des réflexions à mener. Le comité propose une réflexion, une façon de formuler les choses, et les agences ou le législateur les mettent ensuite en pratique. Cependant, j’estime que conférer à des comités consultatifs d’éthique un rôle de prescripteur revient à faire disparaître le rôle qu’ils jouent de questionnement et d’initiation de la réflexion.
La question du consentement que l’on demande à des parents de donner pour faire des recherches sur l’embryon, entraîne quand même nombre de problèmes.
En ce qui concerne les comités d’éthique, je suis assez d’accord avec ce qu’a expliqué Jean-Claude AMEISEN, d’autant que quand on regarde leur composition, ils sont composés presque exclusivement de scientifiques…
Tel n’est pas le cas.
Alors, il y a une grande majorité de scientifiques, et les juristes y sont sous représentés. Ils y sont à mon avis en minorité.
Si je peux très brièvement donner la composition des 40 membres du Comité consultatif national d’éthique : en dehors des cinq représentants des grandes familles de pensée religieuse ou laïque, ce qui est une spécificité française, nommés directement par le Président de la République, il y a pour moitié des personnes qui sont médecins ou de formation d’origine médicale ou scientifique, ce qui représente donc moins de la moitié, l’autre moitié étant constituée de juristes, d’anthropologues. En sont membres pour moitié des personnes impliquées dans la réflexion éthique venant d’une origine et d’une culture non scientifique et médicale, et une autre moitié vient du monde scientifique ou médical moins les cinq représentants des grandes familles de pensée religieuse ou laïque.
C’est ce qui fait la richesse de la réflexion, à savoir qu’elle est totalement pluridisciplinaire et qu’elle n’a pas justement a priori une orientation que l’on peut retrouver dans d’autres structures de réflexion, qui peuvent avoir des orientations juridiques ou scientifiques plus marquées.
Je suis d’accord avec la réponse d’Axel KAHN concernant le bien et le mal en soulignant le fait que la loi ne dit pas ce qui est bien et ce qui est mal ; c’est un point extrêmement important, la discussion ayant été engagée lors du vote de la loi sur l’interruption médicale de grossesse. Mais surtout, quand on évoque des techniques, en particulier d’assistance médicale à la procréation, une fois de plus, on est très orienté vers la réponse qu’apportent ces techniques à la stérilité d’un couple et à l’attente de l’enfant. Or au cours des débats, et j’espère que ce sera encore le cas dans les débats à venir, on ne doit pas faire l’impasse sur les droits de l’enfant.
Les expériences tragiques que nous avons pu vivre les uns et les autres concernant des enfants nés d’assistance médicale à la procréation, à travers l’insémination artificielle par tiers donneur, montrent que si, le plus souvent ces techniques aboutissent au résultat espéré, il y a hélas des exemples trop souvent ignorés et méconnus montrant la souffrance durable d’un enfant qui ne connaîtra finalement rien des conditions dans lesquelles il a été conçu, ce qui peut être un handicap et un facteur de déséquilibre dont il risque de ne jamais se défaire.
Ce n’est pas du tout pour plaider dans l’autre sens mais, les quelques échanges qui ont eu lieu sur l’assistance à la procréation, ont toujours fait référence au couple, y compris à travers les mères porteuses, et jusqu’à présent, on n’a pas évoqué l’interrogation sur le devenir de l’enfant, ce qui me soucie.
Nous passons au thème suivant : les enjeux de société. Je laisse la parole à Mme Nicole QUESTIAUX.
8 Mme Nicole QUESTIAUX, Membre de la Commission consultative des droits de l’Homme (CNCDH)
Je vous remercie de m’avoir invitée et voudrais d’abord expliquer ce qui a été convenu entre nous. Vous m’avez demandé de venir à cette audition préalable en tant que représentante de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNDH), ce qui peut être intéressant car cette Commission n’est pas un comité d’éthique. Elle est encore l’un de ces groupes de sages que notre République aime tellement, mais ce groupe de sages n’est pas à moitié scientifique et à moitié juriste comme ceux que nous évoquons en termes de bioéthique. C’est essentiellement une Commission qui représente assez largement les grandes organisations non gouvernementales, la société civile, avec quelques-unes de ces personnes qualifiées que l’on ajoute en général à ce genre d’organismes.
La CNCDH s’est prononcée et se prononcera le moment venu sur la révision de la loi de bioéthique, mais elle espère vous être utile, car il se trouve qu’elle aussi a eu l’idée, l’été dernier, de se situer en amont de la révision de manière à pouvoir traiter de ces sujets non pas sur un projet donné, non pas sur des questions ouvertes, mais à partir d’une sorte de regard sur le système créé par cette très importante réflexion bioéthique qui s’est déroulée dans notre pays. En effet force est de constater que le passage de l’éthique au droit que la France a accompli depuis les années 1994 et en 2004, de façon pluri partisane et pluridisciplinaire, est quand même un événement important au plan mondial. Nous avons été assez précurseurs dans cette affaire.
Sachant que le point de vue de la Commission est plus juridique que les instances qui sont intervenues auparavant, les membres de la CNCDH se sont penchés sur ce dossier en se proposant à eux-mêmes le constat suivant : dans cet ensemble des lois de bioéthique, il y a l’idée d’une révision, mais également tout un ensemble qui n’est pas révisable parce que nous avons affirmé des principes.
Le premier point concerne l’importance de ces principes. Les révisions doivent être éventuellement l’occasion de leur consolidation dans le rapport entre le Parlement et l’opinion. Cependant, deuxième constat immédiat, notre impression était que l’application et l’évolution de ces principes ne vont pas du tout de soi, qu’elles sont à certains égards vulnérables.
C’est cette question que je traiterais à partir d’un problème seulement, celui du statut donné par le législateur de 1994 et de 2004 au corps humain, en tentant d’illustrer les difficultés qui se situent à notre avis en amont de la décision importante que prendra le législateur, qui devrait être une nouvelle consolidation avec un ajustement.
L’un des acquis de la loi de 1994 a été évidemment d’inventer ce statut du corps humain, puisque l’on fait figurer, dans l’article 16-1 du Code civil, que chacun a droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable, que le corps humain, ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Ce statut du corps, tel qu’il est défini par le droit français s’appuie donc sur deux principes qui se complètent : il est indisponible et hors du champ du commerce, ainsi que les éléments qui le composent.
Ces principes entraînent des implications extrêmement importantes sur les droits et libertés qui intéressent la CNCDH, puisqu’ils signifient que chacun n’est pas libre de faire tout ce qu’il veut de son corps, et notamment qu’il ne peut le vendre. Tout échange portant sur les éléments du corps humain fera donc référence au don ; l’encadrement de la loi devient nécessaire pour tout ce qui concerne ces échanges ; le statut du corps est organisé en fonction d’une certaine idée des intérêts collectifs en jeu.
Or nous avons doté le corps d’un statut, parce que nous voulions protéger la personne. Il s’agissait de l’aider à préserver l’intégrité de son corps pour la mettre à l’abri des pressions. Cette idée est issue de celle qui prohibe l’esclavage. En d’autres termes, le risque provient du fait que l’on pourrait volontairement, spontanément, au nom d’intérêts qui nous seraient totalement étrangers, par exemple parce que quelqu’un voudrait profiter de notre corps, être convaincu d’abandonner à autrui le contrôle de ce corps. Telle est la raison pour laquelle nos textes ne font pas allusion au libre arbitre de la personne, même si les problèmes touchent à l’intimité.
Cependant, dès que l’on a posé ce principe qui nous paraît finalement très fort, très justifié, que nous voudrions non révisable, nous constatons que nous vivons dans une société qui pose la question suivante : est-on habilité, au nom des droits de l’Homme, à protéger la personne contre elle-même ? Ce thème se fonde sur une autre logique qui prend consistance dans une société dotée d’un goût de l’individualisme que l’on observe tous les jours, et dans laquelle les enjeux médicaux et scientifiques sont de mieux en mieux connus.
Il existe une sorte de débat non clairement exprimé, qui est sous-jacent à l’application des principes. Il oppose des conceptions différentes des droits de la personne, ceux qui sont à l’aise avec nos principes et ceux qui constamment « regimbent » au nom de l’autonomie. Cette opposition fait aussi intervenir le monde des chercheurs et le monde économique, qui s’allient avec les individualistes pour souhaiter que ces contraintes soient distendues, laissent plus de possibilités à des utilisations qui s’éloignent elles-mêmes de plus en plus de l’utilisation intéressant directement la personne.
On observe donc que coexiste, d’une part, l’affirmation des principes, et d’autre part le déphasage entre la solennité de cette affirmation et les pressions insidieuses, mal connues de l’opinion, souvent masquées derrière les débats très stressants, très excitants, sur l’embryon, sur la gestation pour autrui. Mais derrière ces débats se profile tout de même un problème de civilisation.
Notre travail de l’été est une contribution, ce n’est pas un avis, elle est destinée uniquement à demander à tout le monde et en particulier aux parlementaires de réfléchir par avance avant de décider ; j’illustrerai les difficultés qui apparaissent dans cette dialectique.
La première difficulté tient à l’intérêt même que la bioéthique a suscité. Tout le monde manifeste un véritable engouement, notre pays est donc aujourd’hui engagé et partie prenante à un nombre croissant de règles et d’actions inspirées par des obligations éthiques dont on aura de plus en plus de mal à assurer la cohérence.
Deuxièmement, le recours persistant à la recherche de consensus dans l’application des lois de bioéthique aboutit à la théorie du consentement de la personne dont le contenu réel n’est pas vraiment précisé.
Troisièmement, le principe de non commercialisation, auquel nous tenons beaucoup en France, est solennellement affirmé alors que son application concrète dans le comportement des chercheurs est devenue difficile.
Enfin, le tout récent débat sur les tests génétiques démontre que le libre accès aux tests diagnostics et génétiques génère des problèmes.
Nous avons, dans le document de la CNCDH qui est sur le site, tenté un recensement de toutes nos obligations européennes et internationales qui concernent la bioéthique. Vous remarquerez que le sénateur SERUSCLAT n’est plus seul. On observe deux évolutions très intéressantes auxquelles nous n’attachons pas suffisamment d’importance.
L’UNESCO dispose déjà d’une Déclaration comportant des normes universelles sur la bioéthique, c’est très important. Certes ce texte n’a pas la valeur contraignante qu’aurait une convention, mais une déclaration tend à devenir peu à peu une convention. Or qui, en France, se réfère à cette déclaration universelle de l’UNESCO pour vérifier si nous sommes bien d’accord ? Quand on la lit, on retrouve des points sur lesquels on retrouve nos valeurs avec des analyses très fines, mais on s’aperçoit aussi que la connotation individualiste est plus forte que dans nos textes nationaux et que, par exemple, le principe de gratuité n’y figure pas en tant que tel.
Sur la convention d’Oviedo, nous avons été moteurs dans sa rédaction, mais nous ne l’avons pas ratifiée. Or, pendant ce temps, ce texte « a fait des petits », il a des implications, des protocoles additionnels, une jurisprudence et nos propres experts y participent de façon fort efficace puisque nous détenons même des présidences prestigieuses dans ce secteur. Cela me rappelle le Président René CASSIN pleurant autrefois parce que nous ne ratifions pas la Convention européenne des droits de l’Homme.
Or, il faut prendre garde, car ces textes, quand nous les ratifierons, pourraient avoir une valeur supérieure à tous les travaux que vous effectuerez au moment de la révision. Il convient quand même de savoir comment sont combinées nos obligations internationales.
La deuxième interrogation porte sur le consentement, la règle du consentement s’impose à l’esprit, à l’évidence, parce qu’elle provient des règles de la médecine clinique. On est à l’aise, on part de l’idée que l’individu consent à ce que l’on intervienne sur son corps, puis on transpose ce système à la recherche et comme en général les personnes ont parfois du mal à s’entendre sur les conditions éthiques qu’elles souhaitent fixer à telle ou telle initiative, tout le monde se met d’accord, ceux qui croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas, sur le fait que cela est correct à condition que l’intéressé consente. Je vous renvoie simplement aux travaux de l’UNESCO sur le consentement pour vous montrer comment, déjà, les dérives sur cette idée tellement évidente, tellement simple, existent.
Cette garantie peut, en réalité, être privée de toute portée. Quelle est l’information écrite ? C’est ce qui doit éclairer le consentement s’agissant de la recherche. Nous qui pratiquons à l’Agence de la biomédecine, l’examen des dossiers sur les cellules souches, qui doivent être précédés d’un consentement, nous sommes bien obligés de voir que, lorsque l’on importe des cellules souches de l’étranger, les consentements sont donnés à la recherche en général et non pas à la recherche particulière dont nous examinons l’autorisation. Et j’en passe ! Qu’en est-il d’un consentement donné à un moment donné ? Au bout d’un moment, lorsque ce sera passé d’un chercheur à un autre, on s’apercevra que le matériau humain est utilisé pour une recherche qui scandaliserait le donneur initial, par exemple parce qu’il y aurait un aspect discriminatoire ou ethnique. On constate clairement que se développe un régime du consentement minutieusement organisé pour ne rien dire. Il ne manque pas un bouton de guêtre à ces consentements. Cependant la condition réelle que la personne aurait vraiment compris ce qu’on allait effectuer dans la recherche et que son consentement est libre et éclairé, n’est pas réalisée.
En outre, les juristes ont attiré notre attention sur le fait que ce n’est pas parce que l’on a consenti à quelque chose que c’est nécessairement conforme aux droits de l’Homme. Sur ce point, je souhaiterais que l’on réfléchisse car chaque fois que la facilité de recourir au consentement intervient, il faut se demander si le sujet mérite que l’on entre dans cette dialectique. Dans le cas de la gestation pour autrui, par exemple, ce n’est pas simplement un problème de consentement, il faut savoir si l’on passe à ce stade ou non.
Le troisième point concerne le « serpent de mer » de la brevetabilité du vivant. Jamais personne, dans les débats de la bioéthique, ne prend le temps de vous expliquer l’extraordinaire complexité de l’application du principe de non commercialisation lorsqu’il s’agit de brevetabilité du vivant. La situation peut se décrire en termes simplifiés. Il se développe à l’échelle mondiale une brevetabilité du vivant, c’est une réalité qu’il faut regarder en face. Par exemple, nous sommes focalisés sur la manière de concilier cette évolution avec un principe auquel nous croyons, à savoir qu’il vaut mieux ne pas vendre le corps humain ; nous y croyons d’autant plus dur comme fer qu’encore hier, dans Le Figaro, un éminent représentant de la profession médicale s’alarmait des ventes d’organes en provenance des condamnés exécutés chinois. Nous ne sommes pas dans un rêve : la non commercialisation du vivant constitue un problème éthique grave.
Pour le moment, nous disposons de deux rapports parlementaires, celui d’Alain CLAEYS et celui de Pierre-Louis FAGNIEZ qui, sur cette question, sur cette contradiction, nous donnent tous les éléments pour réfléchir mais ne s’orientent pas nécessairement vers la même solution. Ils ne le font pas au nom de présupposés politiques, mais au nom d’analyses honnêtes de leur point de vue. Nous constatons que le Comité d’éthique a rendu un avis sur la commercialisation des cellules souches grosso modo fondé sur l’idée que le matériau lui-même ne pourrait pas être breveté mais que la technique le serait (je grossis au point que c’est presque une caricature). Simplement, chaque fois que j’ai discuté de cela avec des personnalités du monde des offices des brevets, il a été clair que cette distinction n’était pas celle qu’ils opéraient, eux. Dans leurs brevets, ils n’ont pas trouvé de frontière claire, à savoir, là où s’arrêterait la technique inventive et là où commencerait le matériau humain. Ces personnes ne raisonnent donc pas sur le même plan. Bref, si je caricaturais, je soutiendrais qu’il y a des « hypocrites » des deux côtés : des hypocrites scientifiques car, chaque fois qu’ils découvrent un problème de cette nature, ils proposent un découpage ou une définition différente du vivant. On passe de l’agrégat de cellules auquel on donne un nouveau nom, à un processus arrêté à cinq jours etc…
Ils décomposent le problème en éléments, ce qui est le propre d’une démarche scientifique de simplification pour qui craint la transgression. On a le sentiment que plus ils découpent, plus ils la masquent pour expliquer que ce n’est plus du vivant. Quant aux juristes, cela n’est pas plus convaincant, ils se fondent sur la notion de « non brevetabilité du vivant en tant que tel »; le monde entier s’interroge sur ce nouveau critère juridique partageant le bien et le mal et fondé sur le « en tant que tel ».
On ne peut pas exiger d’un malheureux chercheur qui, déjà, a du mal à découvrir quelque chose, qu’il se demande, dans ce fatras, s’il est en infraction ou non, lorsqu’il sollicite un brevet, d’autant plus que son chef de service le sermonnera immédiatement s’il n’a pas demandé ce brevet..
Les scientifiques hypocrites ont une définition différente du vivant, décomposent le problème en éléments mais justifient la transgression. Les juristes hypocrites inventent de nouveaux critères juridiques. On s’engage dans une forme d’impasse. Ne devons-nous pas nous orienter vers un régime du brevet propre au vivant humain, accepté au niveau européen et peser sur la réflexion mondiale ? Ce serait en fin de compte l’issue heureuse de ce qui est une hypocrisie. Il faut rechercher un régime du brevet propre au vivant humain.
Le quatrième point concerne l’expérience des tests génétiques. Nous venons de les évoquer longuement, la société aussi et je ne saisirai pas cette occasion pour expliquer tout le mal que je pense du débat récent. Mais qui sait qu’en France, pour de très bonnes raisons, le législateur restreint considérablement l’usage des tests diagnostics et génétiques ? Pour des raisons importantes développées par le Conseil national du Sida et par le Comité national d’éthique, on vous explique, et à mon avis à raison, qu’il est extrêmement dangereux de mettre entre toutes les mains ces tests sans qu’il y ait de suivi d’un spécialiste qui puisse expliquer et aider la personne à gérer sa propre réception de l’information, sa compréhension par rapport à la prédiction, son droit de savoir ou de ne pas savoir, ses rapports avec sa fratrie et ses proches.
Ces avis limitatifs que le législateur a suivis étaient fondés sur une expérience extrêmement difficile, extrêmement sérieuse des quelques spécialistes très peu nombreux qui connaissent ces questions. Or tout récemment, un colloque organisé par l’Agence de la biomédecine et le Conseil de l’Europe a abondamment éclairé la question : sur Internet, vous accédez comme vous le voulez et de façon payante à ce genre de tests.
En outre, alors que nous débattons du droit des étrangers, pas une seule personne n’a remarqué que l’on discute comme si le libre accès aux tests était une chose évidente alors qu’en France, l’accès aux tests n’est pas libre. Cela montre le degré d’ignorance de la société sur les contraintes que nous nous avons nous-mêmes posées pour des raisons de sécurité et de difficulté de gestion de cette information. On note une contradiction sur ce point également, et c’est sur un sujet comme celui-ci que l’on ressent, comme une sorte d’évidence, la dialectique que j’évoquais au début : à savoir que devant toutes ces propositions de la science, le désir d’autonomie de la personne, son désir de profiter, d’en disposer, vient contredire, contrecarrer le statut protecteur que le législateur a cru bon d’instaurer.
Tels sont donc les éléments que la CNCDH voulait porter à votre attention. Nous considérons que cette dialectique entre protéger la personne, la protéger contre des dérives possibles, et le désir d’autonomie est un élément extrêmement important car le désir d’autonomie est soutenu à l’étranger par des civilisations qui y attachent encore plus de prix que nous. Nous pensons que l’issue qu’il faut trouver, doit être un moyen terme autour d’une notion « d’autonomie solidaire » ou de quelque chose d’intermédiaire, afin de donner satisfaction à ces aspirations sans mettre en cause le fait que le matériau d’origine humaine est un bien commun, et que c’est ainsi que le législateur français l’a pensé ; car il est clair qu’une autonomie dont on abuserait, entraînerait des dérives éthiques.
M. Alain CLAEYS
La parole est à présent à Monsieur François STEUDLER.
8 M. François STEUDLER, Professeur de sociologie, Université Marc Bloch, Strasbourg
Je voudrais vous remercier de m’avoir si aimablement invité à participer à ce débat. Je travaille depuis plusieurs années, notamment sur la médecine prédictive et sur les biotechnologies et j’ai été amené à étudier les enjeux dont il est question aujourd’hui, en essayant de les appréhender du point de vue des relations sociales. Je pense en effet qu’il n’existe pas une seule rationalité mais qu’il y en a plusieurs. C’est en essayant d’analyser les enjeux et les relations sociales, que j’ai essayé d’appréhender cette évolution.
Ces enjeux sont pour moi de trois ordres, et correspondent chacun à une logique technique, sociale et économique que j’ai essayé d’analyser. Je présenterai dans un premier temps ces trois logiques puis j’essaierai de montrer qu’elles sont chacune caractérisées par des limites.
Il y a donc tout d’abord ce que j’appellerai « une logique technique », qui est pour moi impulsée par tous ceux qui, à des titres divers, poussent à l’innovation et à son application donc par tous ceux qui appartiennent au monde de la recherche, les biologistes, les biochimistes, les médecins, les professionnels de santé et les institutions de soins, le public, les médias, la sécurité sociale, qui est aussi concernée, les administrations, les industriels, les structures de recherche. Cette logique se caractérise en particulier par le fait que, comme l’exprime Jeremy RIFKIN, nous sommes entrés dans le monde biotech. La biologie est devenue une véritable technique d’intervention et l’alliance entre les ordinateurs et la génétique a permis des progrès exceptionnels.
Cette logique technique dans le domaine de la génomique se caractérise par des avancées considérables en matière de décryptage du génome et d’identification des gènes, avec des espoirs nouveaux de prévention et de thérapie grâce à ces connaissances dont on dispose.
Dans le domaine de la reproduction, la naissance du premier bébé-éprouvette a été quelque chose de fondamental, la première naissance par injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) aussi. Le couplage fécondation in vitro et transfert d’embryons (FIVETE), ICSI et diagnostic pré implantatoire (DPI), a également constitué une évolution importante et j’estime que tout provient en grande partie de cet « œuf transparent » qu’évoque Jacques TESTART. À partir du moment où l’embryon existe en-dehors du corps des femmes, on peut en quelque sorte opérer un certain nombre de manipulations permettant une rupture du temps, permettant une procréation à la ménopause, permettant de choisir le sexe, permettant donc un certain nombre d’innovations. Quant au don de gamètes, si l’on a constaté que le don avait tendance à disparaître dans nos sociétés marchandes, on observe que dans ce domaine, il prend une place nouvelle. Il y a aussi tous les espoirs placés dans le clonage reproductif, notamment en ce qui concerne les animaux, puisque l’on espère sauver les espèces, puisque le clonage animal permet de cultiver les organes destinés à la transplantation, puisque l’on pense effectivement pouvoir, grâce à ce clonage, obtenir des animaux d’une qualité exceptionnelle.
À cette logique technique s’ajoute une logique sociale qui, elle, est représentée par tous ceux qui trouveront individuellement ou collectivement, dans l’essor des biotechnologies et de toutes les techniques génétiques et biologiques, une amélioration de l’environnement et du mode de vie ainsi que des bienfaits divers. J’aurais tendance à utiliser la distinction formalisée par Paul-Henry CHOMBART de LAUWE entre les « besoins aspirations » et les « besoins obligations ». Des besoins, des aspirations sont satisfaits, cette satisfaction conduisant au fait que ce qui a été demandé devient obligatoire, et que ce sont ensuite d’autres aspirations qui apparaîtront et se transformeront en besoins que l’on estimera indispensables et dont on exigera qu’ils soient satisfaits. Il existe une sorte de cycle besoins aspirations, besoins obligations.
Ensuite, la logique sociale est marquée par une valorisation sociale de la recherche médicale et de ses applications. Sans entrer dans les détails, la plupart des sondages montrent une très forte valorisation de la recherche médicale et en particulier dans le domaine de la génétique, où l’on observe que les réalisations opérées font l’objet d’un avis plutôt favorable de la population.
Les aspirations sont très fortes concernant ce que peuvent apporter les biotechnologies, par exemple dans le domaine de l’amélioration de l’alimentation. Dans le domaine de la reproduction, le désir d’enfant pouvant être satisfait grâce aux nouvelles technologies, on constate l’émergence d’un droit à l’enfant, que l’on peut opposer, comme le disait M Claude HURIET, au droit de l’enfant. Or, effectivement, une revendication se développe de plus en plus du droit à l’enfant. Il existe également tout un mythe de la résurrection à travers le clonage, tous les espoirs placés dans la thérapie cellulaire qui ont mobilisé notamment à l’étranger un certain nombre de groupes. Se développe une sorte d’utopie de la santé parfaite que décrit Lucien SFEZ. On constate une sorte de bouleversement du regard médical entraîné par ces nouvelles données, ce qui me paraît être également un élément important.
À côté de cette logique sociale et de cette logique technique, il existe une logique économique, bien entendu soutenue par tous ceux qui sont concernés par le développement de ces technologies sur le plan économique, c'est-à-dire des entreprises en majorité. D’abord, il existe un immense marché très prometteur ; plus de 50 % des nouveaux médicaments sont issus des biotechnologies, il existe aussi un supermarché de la reproduction avec des commandes en ligne d’ovules et de spermatozoïdes, et également un marché concernant les cellules souches.
La crainte que la France et l’Europe ne voient leur retard économique sur ce point s’accroître par rapport aux États-Unis en particulier, peut expliquer un certain nombre de décisions des instances qui craignent que la France ne subisse les conséquences du rejet d’un certain nombre d’innovations. S’y ajoute le souci de développer les jeunes pousses, les PME qui connaissent des difficultés en matière d’innovation, et toute la réforme portant sur les pôles de compétitivité, et qui est très importante dans ce domaine. Apparaît également toute une logique de réseau, avec un certain nombre d’entreprises pharmaceutiques qui s’appuient sur des sociétés de biotechnologie pour essayer de diffuser leurs innovations. On assiste aujourd’hui à une véritable course aux brevets.
Telles sont donc ces trois logiques que j’ai essayé de dégager. Quels sont les rapports que l’on peut établir entre elles ? J’ai tenté de montrer que l’évolution s’était effectuée en plusieurs étapes.
D’abord, de 1970 jusqu’en 1996 ou 1997, il y aurait eu une tendance à ce que j’appelle l’émergence d’un modèle technico-économique où la logique technique s’associe à la logique économique. À l’intérieur de la première période, on pourrait distinguer deux phases : une première phase qui irait de 1974 à 1990 et qui serait plutôt technocratique et une seconde phase de 1990 à 1997 qui serait plutôt politique, avec notamment le rôle joué par les instances européennes.
Puis à partir de 1996, 1997, et surtout à cause du grand tournant lié notamment aux mouvements qui se sont développés sur les OGM, avec « l’alerte au soja fou » qui faisait le titre de Libération, on a vu la population française changer quelque peu de position. Les revendications sociales se sont développées avec, à ce moment-là, un mouvement de type socio économique, bien que la logique technique soit toujours présente.
Maintenant, ces trois logiques se heurtent à des limites et rencontrent des contradictions. Sur le plan technique, on note effectivement que des inquiétudes apparaissent concernant le brouillage de nos repères. On observe une certaine imprévisibilité décrite par Jeremy RIFKIN.
S’agissant du décryptage du génome, on constate que les retombées sont relativement modestes. La thérapie génique n’en est encore qu’à une phase expérimentale et ses résultats sont limités. La connaissance du génome est également limitée et les manipulations génétiques constituent également une source d’inquiétude.
En ce qui concerne la reproduction, l’assistance médicale à la procréation rencontre des succès réduits, et son usage est lui aussi limité, des risques sont évoqués même si la population, majoritairement, perçoit dans ces techniques une véritable réponse à une demande qui se développe. Il y a donc des nécessités de limitation qui concernent également les embryons implantés, des défis qui sont ceux de la grossesse unique pour la FIV, l’ICSI, la FIVETE. Il existe dans ce domaine des limites définies qui, peut-être, par moments, apparaissent effectivement quelque peu étroites.
En matière de cellules souches, on a déjà évoqué les restrictions, et les problèmes qui existent et qui justifieraient peut-être que l’on aille au-delà de la loi actuelle de bioéthique.
Enfin, il existe des limites sociales et des limites économiques. Sur les limites sociales, je considère qu’il est illusoire de croire que tout s’expliquerait par la génétique. L’utilisation de tests tous azimuts soulève d’importantes questions éthiques, notamment tous les problèmes concernant l’annonce à une personne qu’elle est atteinte d’une maladie génétique. Cela induit chez elle un véritable bouleversement, surtout lorsque cette annonce doit être suivie d’une autre annonce par elle-même à son entourage. Des travaux mériteraient d’être menés sur le sujet, notamment sur le problème de l’information de la famille. La personne chez qui on a découvert une maladie génétique doit-elle informer son entourage ? On sait qu’elle peut ne pas le révéler à son entourage. Pourra-t-on continuer à accepter cette situation lorsqu’il peut y avoir un risque pour l’entourage ?
Il faut citer aussi les critiques qui concernent la dérive vers une sorte de « tout génétique ». Axel KAHN le décrivait ce matin et il ne me paraît pas complètement aberrant d’en parler quand on voit par exemple un Prix Nobel déclarer qu’effectivement, il existe une infériorité génétique des Noirs. Il faut citer également les débats éthiques concernant le diagnostic préimplantatoire. On a pu évoquer les risques d’eugénisme, mais je constate moi ce qui se passe, en particulier à Strasbourg, lorsque le Professeur Israël NISAND se trouve face à des familles qui lui expliquent qu’elles ne voudraient pas avoir un enfant qui aurait tel cancer, etc. Que fait le médecin ? Il est amené à élargir et à accepter que le diagnostic préimplantatoire puisse s’appliquer au cancer. Je considère que l’on ne pourra pas en rester là et qu’il faudra admettre un élargissement mais, avec des garde-fous au niveau de commissions et d’agences, afin que l’on n’aille pas trop loin. C’est là aussi un véritable problème.
Au-delà de cet aspect social, on trouve également les menaces liées à la biométrie, les revendications au sujet des tests ADN et de la connaissance génétique de ses origines. En tant que sociologue, je suis bien obligé de constater qu’existe sociologiquement une reconnaissance, un désir de connaissance de son origine biologique. S’y ajoutent toutes les dérives liées à la FIVETE, le risque que le droit à l’enfant se substitue au droit de l’enfant, et il est important qu’un certain nombre de garde-fous soient fixés. On pourrait également prendre l’exemple de l’accouchement sous X, et montrer à quel point il existe des contradictions mais aussi des revendications. J’estime donc que, de plus en plus, on sera amené à demander, voire réclamer le droit à la connaissance de son origine génétique.
Sur le plan économique, il faudra également tenir compte des problèmes de coût, par exemple dans le cadre de la fécondation in vitro. Jusqu’où pourra-t-on aller au niveau des organismes de financement, de la sécurité sociale ou autre, quelle sera la limite entre la convenance et le besoin justifié médicalement ? Le problème de la marchandisation qui se développe dans notre société devra être traité. Il y a enfin la nécessité de développer une recherche qui permette de répondre à la demande, avec un certain retard et des décisions à prendre.
En conclusion, je constaterai qu’il existe pour moi une diversité des logiques qui peuvent soit se concilier, soit s’affronter. Mais comme l’expliquaient Alain CLAEYS et Axel KAHN, il faut vivre ensemble et accepter la réciprocité. Deux possibilités se présentent donc. Ou bien c’est le conflit des intérêts, et ce serait « l’agir stratégique » au sens utilisé par Jürgen HABERMAS ou, au contraire, le débat que ce dernier propose à savoir « l’agir communicationnel ». Or, selon moi, dans ce cas, c’est plutôt « l’agir communicationnel » qui doit prédominer. C’est pour cela que je crois que dans un domaine aussi complexe, dans lequel s’affrontent des positions très différentes, et dans lequel on ne trouve pas de rationalité unique, il est important qu’un débat ait lieu. C’est pourquoi je crois fortement à cet « agir communicationnel ».
Je vous remercie, Monsieur STEUDLER, et nous passons immédiatement la parole à Madame Anne FAGOT-LARGEAULT, que je remercie d’être parmi nous une nouvelle fois.
8 Mme Anne FAGOT-LARGEAULT, Professeur au Collège de France, chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales
Je vous remercie, Messieurs les Députés. Selon les directives que vous m’aviez fait parvenir, dans cette phase encore exploratoire où vous vous trouvez, vous ne souhaitiez pas que l’on donne des solutions mais plutôt que l’on pose des questions. À l’usage, il semble que notre législation actuelle nécessite d’être repensée ou réfléchie.
Le premier point que je veux signaler concerne la transplantation avec donneur vivant. Je m’appuie sur un travail réalisé par une jeune femme, Valérie GATEAU qui a soutenu son doctorat sur le thème « Enjeux éthiques des transplantations hépatiques avec donneurs vivants». Le doctorat a été soutenu il y a un an et il signale un déficit de la législation actuelle, en ce qui concerne la protection des donneurs et de leurs familles
Le prélèvement d’un rein ou d’un morceau de foie, ou encore d’une moelle chez un donneur, comporte des risques ; les accidents de l’intervention chirurgicale comme les complications, les séquelles possibles, existent, et il ne suffit pas que les frais médicaux soient couverts. Il ne s’agit pas non plus de payer le donneur. Le don doit rester un don. Mais si le donneur, à la suite du prélèvement et des complications médicales consécutives au prélèvement perd son emploi, ne peut plus payer son loyer, devient incapable de subvenir aux besoins de sa famille, il me semble qu’il n’est pas équitable d’inciter les donneurs à donner, ce que fait la loi en son état car l’on a élargi le cercle des donneurs potentiels, et de les laisser seuls assumer les catastrophes personnelles et familiales qui peuvent résulter de ce don. Je sais qu’actuellement le problème est travaillé à l’Académie de médecine et de chirurgie dont nous avons dans la salle un éminent représentant, donc je me contente de signaler ce problème.
Mon second point concerne la recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires et je m’appuie, d’une part, sur mon expérience de participation aux travaux du Collège d’experts « recherches sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires » à l’Agence de la biomédecine et sur des éléments de la littérature, en particulier la lecture du rapport britannique tout récent, d’août 2007, intitulé « Human Tissue and Embryos Draft Bill » de la Commission créée sur ce sujet par la Chambre des Lords. Il s’agit de la préparation d’une modification de la législation britannique, qui, elle aussi, évolue ou s’est résolue à évoluer.
À ce sujet, je voudrais traiter deux points. D’une part, dans l’expérience que j’en ai eue, l’Agence de la biomédecine fonctionne bien. Elle a mis au point des procédures de contrôle à la fois transparentes et raisonnables, et elle a obtenu la confiance et la coopération des chercheurs. Ce système a prouvé sa fiabilité et son efficacité, c’est l’une des grandes vertus de la loi d’avoir accouché de cette Agence de la biomédecine. Et, comme il en était question précédemment, faire confiance à cette Agence, cela permettrait peut-être d’alléger et de rendre la loi plus permanente si l’on s’assure que la loi établisse de grandes vérités générales et qu’on laisse à l’Agence le soin de juger des cas particuliers. Il me semble que cette Agence de la biomédecine constitue un bon modèle actuellement.
Le second point que je voulais évoquer à propos du travail que j’ai pu faire à l’Agence de la biomédecine est que la frontière posée par la loi actuelle entre la recherche sur les cellules souches embryonnaires, issues d’embryons humains abandonnés dans les congélateurs de la procréation médicalement assistée (cette recherche qui est autorisée sous conditions et provisoirement, mais tout de même permise en ce moment), et la recherche sur des cellules embryonnaires que l’on aurait construites artificiellement par transfert de noyaux (interdite, sanctionnée), paraît actuellement paradoxale et obsolète.
Les discussions récentes concernant la production pour la recherche d’embryons hybrides homme/animal, par exemple, d’embryons cybrides résultant du transfert d’un noyau humain dans un ovocyte animal énucléé, ce qui donne un patrimoine génétique presque entièrement humain sauf celui des mitochondries, les discussions récentes également autour des chimères inter-espèces, l’obtention de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires murines, c'est-à-dire de spermatozoïdes et d’ovocytes, qui ont pu donner des embryons artificiels, la technique permettant à partir de cellules humaines adultes d’obtenir des cellules embryonnaires à partir desquelles il serait, peut-être un jour possible, de tirer des lignées aboutissant à la formation de gamètes humaines ; toutes ces évolutions nécessitent, me semble-t-il, une réflexion nouvelle sur la manière de tracer les frontières entre ce que la loi peut ou doit interdire et ce qui pourrait être autorisé et encadré au titre de la recherche et géré par l’Agence de la biomédecine.
Il me semble que la seule ligne de partage vraiment viable est celle qui séparerait ce qui peut être envisagé au titre de la recherche, à condition qu’il n’y ait pas d’implantation dans un utérus ou pas d’utilisation thérapeutique immédiate et directe, et ce qui pourrait éventuellement faire l’objet d’une autorisation dans le cadre de la procréation médicalement assistée ou de la thérapie régénérative. Il me semble que le saut est là ; c’est une suggestion, j’ai posé le problème.
Le troisième problème que je souhaitais soulever est la question, souvent négligée, de l’usage de données personnelles dans les recherches en santé et de ce que l’on appelait jadis « la première loi de bioéthique », celle qui a trait aux travaux de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Étant donné la forte tentation actuelle d’utiliser les technologies de l’information permettant d’enregistrer et de transmettre des données à caractère personnel à des fins de toutes sortes, protection de l’ordre public et aussi fins commerciales, techniques pour filmer les gens dans les rues, pour enregistrer leur passage aux points d’entrée dans les réseaux de transport public, etc., il convient de réfléchir à ce qu’est un vrai projet de recherche, de bonne qualité scientifique, ayant pour objet l’acquisition de connaissances utiles à la protection ou à l’amélioration de la santé, et qui pourrait justifier l’utilisation de données sensibles et personnelles.
Une étude très intéressante a été effectuée par Nicolas LECHOPIER qui elle aussi a donné naissance à un doctorat, soutenu en septembre 2007, sur les travaux du Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé, le CCTIRS, intitulé « Éthique dans la recherche et démarcation. La scientificité de l’épidémiologie à l’épreuve des normes de confidentialité ». Personne ne connaît cette instance intermédiaire qui se réunit au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui réfléchit sur des problèmes très particuliers qui me semblent très importants. Ce comité essaye d’évaluer, en amont de la recherche, la qualité scientifique de projets de recherche et de protocoles, qui donnent, au regard de la loi un droit d’accès à des données sensibles et un droit d’usage de ces données pour la recherche. L’enjeu est la protection de l’espace privé et des libertés, face à l’intérêt stratégique pour la collectivité de mettre en évidence des données de santé publique.
Des questions assez analogues se posent à propos des collections de matériel humain et de leur utilisation pour la recherche. Quels sont les types de protocoles et quelle qualité scientifique faut-il viser pour que les chercheurs soient autorisés à utiliser ces données sensibles ? Tels étaient donc les trois points que je souhaitais signaler.
Je vous remercie beaucoup. Nous poursuivons nos débats, Monsieur Jean-Pierre DUPRAT, vous avez la parole.
8 M. Jean-Pierre DUPRAT, Professeur de droit, Université Bordeaux IV, Expert en légistique auprès d’organisations internationales
Je vous remercie de m’avoir invité à venir soulever un certain nombre de problèmes relatifs à la dimension strictement juridique dans un champ marqué par la complexité.
De manière introductive, le premier aspect sur lequel j’attirerai votre attention est la nécessité de ne pas instrumentaliser le droit et de considérer que le droit est régi par un certain nombre de définitions terminologiques et de catégories qui induisent une certaine unité dans son fonctionnement ; faute de références, on risque d’entretenir une ambiguïté dans les catégories constituées par le législateur. Si le droit n’est pas fait que pour les juristes, il n’empêche que, dans sa construction interne, un certain nombre d’exigences doivent être respectées ; et je souhaiterais que le législateur y soit sensible. Quand on manie la notion de contrat et que l’on oublie que l’on se trouve dans un champ qui est marqué par une situation de droit public, ou par une situation de caractère statutaire, et je me réfère ici au domaine hospitalier, il est bien évident que la notion de contrat n’a pas grand-chose à faire, si ce n’est pour constater le mésusage et parfois même l’usage illicite qui pourrait être fait de l’instrument, dans la relation médecin-patient.
Je souhaiterais également vous signaler que l’entrée dans le champ juridique peut produire des effets nocifs et en particulier la banalisation qu’il faut absolument redouter, dans le champ de la bioéthique. En inscrivant une pratique ou un processus dans le domaine juridique, il existe un risque de les banaliser et donc d’aller à contre-courant de l’attente de la démarche éthique qui, elle, suppose justement le débat et non pas l’application automatique d’un dispositif juridiquement construit.
De même, je ferais observer que la règle de droit n’est pas définie pour protéger une catégorie socioprofessionnelle. Or, bien souvent, la demande de construction d’un dispositif normatif dans cet esprit-là est possible. Mais ce serait incontestablement une dimension assez nocive. Ceci a pour vocation d’attirer votre attention sur les risques que l’intégration au droit peut faire courir. Bien évidemment, le droit est aussi le défenseur d’un certain nombre de valeurs qu’il intègre et sur lesquelles il repose, contrairement à ce qu’une approche positiviste trop étroite pourrait laisser entendre ou nier.
Quant aux évolutions récentes, les valeurs auxquelles se réfère la bioéthique sont des valeurs fort anciennes. On a déjà évoqué ARISTOTE et d’autres encore, et il est certain que ces valeurs s’expriment dans un langage qui apparaît comme étant quasiment immémorial. Cependant, force est de constater que les contextes eux, changent même par rapport à la première loi de bioéthique, à l’évaluation de laquelle l’OPECST a procédé, travaux auxquels, j’ai eu l’honneur de participer.
Dans le contexte scientifique, notamment dans le domaine de la reproduction on pourrait citer le fait qu’au moment même où le législateur votait la loi, un procédé nouveau, l’ICSI n’ayant absolument pas été abordé dans les travaux préparatoires, allait devenir dominant. Cela montre bien la rapidité du progrès scientifique devant être intégrée dans le contexte considéré.
Une autre dimension s’est élargie considérablement, celle liée à la globalisation, comme ceci apparaît au travers des travaux effectués en réponse par des instances internationales notamment à l’UNESCO, et dans le cadre plus limité du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne. À cet égard, je voudrais répondre à l’intervention de Nicole QUESTIAUX qui soulevait le problème, réel, du respect par la France de normes internationales, qu’elle a quelque retard à intégrer dans son ordre national. De manière significative, le Conseil d’Etat, dans le travail qu’il a réalisé sur la loi de bioéthique, a intégré la Convention d’Oviedo, alors même que le texte n’est pas ratifié. C’est un paradoxe, les pouvoirs publics ne vont pas au bout de leur démarche puisque ce texte a été signé, mais n’est toujours pas ratifié par la France, et néanmoins, une instance fort importante intègre cette donnée dans la préparation du projet de loi. C’est un problème, il faudrait certainement que les responsabilités soient assumées pour aller au bout de la démarche, et cela vaut également pour les protocoles, notamment pour le protocole sur la recherche biomédicale adopté en 2005, que la France n’a pas encore signé et, n’est pas, par conséquent, prêt d’être ratifié.
J’insisterais ensuite sur les tensions qui se manifestent actuellement dans le champ de la bioéthique, dans sa confrontation avec l’innovation scientifique. Tensions qui d’ailleurs vont entraîner un certain nombre de conséquences directes sur quelques modèles sociaux qu’exprime le droit. Ce sont d’abord des tensions entre l’individuel et le collectif. Dans notre réflexion éthique, ce n’est pas propre à la France, on la retrouve dans le champ international, dans les différentes instances qui se sont prononcées. Sur ce terrain, on observe l’existence incontestable d’une prépondérance conférée à la dimension individuelle et par conséquent au rattachement à la logique des droits de l’Homme.
Évidemment, de temps à autres des correctifs ont pu être apportés, notamment par la jurisprudence. Quand il s’est agi d’interpréter la notion de dignité, donc le principe de dignité, la jurisprudence a apporté des correctifs salutaires.
Cependant, si encore récemment, la déclaration universelle sur la bioéthique adoptée par l’UNESCO réaffirme cette prépondérance de l’individuel, des droits de la personne sur l’intérêt de la science et l’intérêt de la société, il ne faut pas « se voiler la face ». On assiste incontestablement à une montée en puissance, au travers notamment des préoccupations de santé publique, de ce que l’on appelle dans le rapport annexé à la loi du 9 août 2004 la dimension dite « populationnelle ». Ceci vaut non seulement pour le curatif et le préventif, mais aussi pour la recherche.
Par conséquent, s’installe une tension, qui débouchera sur la valorisation de ce que l’on pourrait appeler « l’idée de responsabilité sociale », entre l’affirmation de droits de la personne et la prise en compte de l’intérêt de la société, ceci évidemment dans un contexte démocratique. On observe une deuxième déclinaison de cette première tension, celle qui existe entre les droits de la personne, et par ailleurs les déterminations économiques et financières qui sont en train de jouer sur l’activité biomédicale et donc dans la manière d’appréhender la bioéthique. Ces aspects sont bien connus. D’ailleurs, il est extrêmement intéressant de remarquer que la jurisprudence comme le Comité consultatif national d’éthique, ont été conduits à se saisir du problème et tout particulièrement de la question de sa dimension sanitaire à travers le fonctionnement du système de santé et de l’hôpital. On retrouve aussi cette problématique avec la brevetabilité.
On pourrait également évoquer à propos des dons, notamment dans le domaine des dons d’ovocytes, un avis extrêmement intéressant émis par l’autorité britannique Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Celle-ci a récemment rendu un avis extrêmement intéressant, favorable à l’utilisation de dons d’ovocytes en faveur de la constitution de lignées de cellules souches, tout en soulevant le problème de l’octroi d’une indemnité et en laissant apparaître que ceci pouvait être un élément attractif pour des populations européennes au niveau de vie extrêmement faible, et qui pourraient ainsi être amenées à devenir des donneuses, en contradiction avec le principe de gratuité.
On pourrait aborder aussi, s’agissant du don d’organes entre vivants, la question de la réalité de la gratuité. Il est bien évident qu’il existe différentes formes de rémunération, pas uniquement matérielles, mais d’assistance, d’affection, qui pourraient intervenir.
Dans le deuxième volet de cette intervention, j’aborderai l’effet pouvant être produit par l’innovation scientifique à l’égard de modèles sociaux ayant aidé à construire des solutions juridiques dans les rapports sociaux.
Le premier volet est évidemment l’identification biologique des personnes et les effets que ceci induira sur des rapports sociaux essentiels à l’organisation sociale, tel que l’établissement du lien de filiation. Un rapport récent, encore, mettait l’accent sur ce point dans le cadre du Comité consultatif national d’éthique. La filiation est établie sur un mode social qui serait prioritaire, selon cet avis. Or l’aspiration à connaître les origines met, elle, l’accent sur la dimension biologique. Incontestablement une contradiction est en train de naître, mettant en cause le problème de l’établissement de la filiation. C’est à quelque trente années d’écart, un écho à la réflexion menée par le Doyen Roger NERSON sur ce phénomène de biologisation du droit. Cette dimension risque de se trouver accentuée.
Pour conclure, je souhaiterais évoquer de manière plus globale le danger de marchandisation du corps humain, sous-jacent au progrès scientifique et dont un certain nombre d’aspects se manifestent déjà à l’heure actuelle. Marchandisation d’abord dans la mesure où, par exemple, la gestation pour le compte d’autrui risque d’être admise, ne serait-ce que de manière indirecte ; car dans des pratiques légales à l’étranger, cette marchandisation intervient. Se pose alors la question de ce que le juge, déjà, dans l’arrêt du 25 octobre 2007 rendu par la Cour d’appel de Paris, a appelé « la reconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant », qui doit primer sur une interdiction, fût-elle au motif du respect de l’ordre public, à savoir dans ce cas l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes. Or le juge a admis le droit de cet enfant à être inscrit sur l’état civil. Un détournement des principes est en cours, il est à prendre en compte. Ceci est incontestablement l’effet direct d’un certain nombre de mécanismes pouvant mettre en cause les conceptions fondamentales qui sont les nôtres. Cette marchandisation est à l’œuvre dans d’autres domaines, et il convient d’être attentif à ne pas s’en tenir uniquement à l’affirmation de principes pouvant être biaisés par des pratiques internes, ou tout simplement inscrites dans le contexte international.
C’est parfait, Monsieur DUPRAT, je vous remercie beaucoup.
8 Mme Hélène GAUMONT-PRAT, Professeur de droit, Université de Paris VIII, Directeur du laboratoire de droit médical et de droit de la santé
Je vous remercie de m’avoir invitée à ce débat. Pour éviter la redondance avec les sujets déjà abordés, je ciblerais deux domaines.
Le premier concerne la brevetabilité du vivant que Nicole QUESTIAUX a déjà évoquée et sur laquelle nous avons tous, au Comité national consultatif d’éthique, beaucoup travaillé. On compte de nombreuses contributions et des rapports très intéressants sur la question. Actuellement, la brevetabilité sur le vivant est toujours débattue sur le plan intellectuel. Il y a les opposants et les partisans mais un point est tout à fait d’actualité, celui de la brevetabilité des inventions tirées des cellules souches embryonnaires. Puisque paradoxalement si l’on accepte totalement l’autorisation de la recherche sur l’embryon, il s’en suivra nécessairement des inventions, des applications industrielles à partir de ces cellules embryonnaires qui, comme toute invention, peuvent être brevetées, puisque les inventions à partir de cellules normales le sont déjà.
Or la source entraîne une incertitude sur la brevetabilité des cellules souches embryonnaires selon que l’on considère qu’il s’agit d’embryons, encore, ou simplement de cellules souches embryonnaires.
La loi est assez claire sur le sujet. La directive de 1998, (CE) n°98/44 du 6 juillet 1998 a été transposée par deux lois en 2004 dont la loi n°2004-800 du 6 août 2004. Maintenant, « la balle est dans le camp » des offices de brevets qui hésitent à se prononcer sur la question. Il nous faut attendre à présent l’interprétation que retiendra l’Office européen des brevets. Il n’est pas forcément du ressort du législateur de donner une indication car il s’agit aussi, pour les offices de brevets, d’appliquer les conditions de brevetabilité.
L’Office européen des brevets évolue-t-il dans sa réflexion, car il y avait un groupe de travail ?
Il évolue mais c’est très lent. Le paradoxe tient au fait que, nous sommes en train d’accepter la recherche sur l’embryon, mais que la directive et également la loi française, prévoient que les embryons ne doivent pas être utilisés à des fins industrielles. Par conséquent, les inventions issues de ces cellules embryonnaires doivent-elles être considérées comme étant toujours l’élément embryon ou l’élément cellule souche embryonnaire ? C’est vraiment ce point qui pose problème.
Le deuxième point que je souhaiterais aborder concerne la gestation pour autrui. La loi française et la jurisprudence l’ont interdite en 1994 et n’ont pas remis en cause cette interdiction lors de la révision du 6 août 2004. L’évaluation de l’interdiction posée par l’article 16-7 du Code Civil selon lequel « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » est une question d’actualité puisque l’arrêt de la Cour d’appel du 25 octobre 2007 semble aller dans un sens contraire, même s’il y a un recours en cassation.
Le questionnement éthique découle précisément des modalités scientifiques ou techniques de la pratique, qui recouvre deux domaines: la gestation pour autrui et la conception pour autrui, suivie de gestation pour autrui
La gestation pour autrui ou « prêt d'utérus » nécessite une fécondation in vitro d'un embryon issu des gamètes du couple destinataire (technique médicalisée que certains considèrent comme un don gestationnel à l’instar du don de gamètes) et la gestation par la mère porteuse. C’est donc nécessairement une technique médicalisée dans laquelle il y aura trois acteurs, le couple demandeur et la mère cependant porteuse. Il existe également d’autres hypothèses plus larges de la maternité pour autrui où toutes sortes de formes peuvent être utilisées. La forme la plus simple que nous connaissons est l’insémination artificielle de la mère porteuse par l’homme du couple demandeur, situation à trois acteurs et technique non médicalisée. Mais l’évolution des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) permet aussi d’autres montages et c’est cela qui est très compliqué. Ce peut être un embryon transféré dans l’utérus de la mère porteuse, qui sera issu par exemple des gamètes d’un tiers donneur, ce qui fait intervenir quatre acteurs. Ce peut être la fécondation in vitro d'un embryon issu des gamètes d'un tiers donneur qui fécondent l'ovocyte d'une tierce donneuse, lequel serait implanté dans l’utérus de la mère porteuse et remis ensuite au couple demandeur, en cas de double incapacité de procréer de ce couple demandeur, ce qui fait intervenir cinq acteurs.
Ces techniques impliquent une situation variable avec trois, quatre ou cinq acteurs dans la procréation, ainsi que l’absence parfois totale d’un lien biologique entre les parents destinataires, et l’enfant. Les deux dernières pratiques étant des techniques médicalisées. La multiplication des acteurs dans le processus de la procréation conduit à une dissociation de la sexualité, du biologique, et du social comme c’est le cas dans l’AMP, mais aussi à une fragmentation de la parenté. Aussi les problèmes éthiques suscités par cette pratique sont-ils nombreux; et nous en avions débattu au sein du Comité d’éthique et cela nous avait paru assez affolant dans la mesure où cinq personnes tout de même pourraient avoir contribué à une naissance. Notre avis à l’époque, en 2006, portait sur l’anonymat et le secret dans les filiations et nous nous étions demandé s’il était bien légitime alors d’envisager de dire la vérité à cet enfant. C’est l’un des aspects que l’on n’envisage pas toujours : quelle sera l’information donnée à l’enfant sur les conditions de sa naissance ? Cette nécessité technique de la maternité pour autrui provoque à mon sens un certain nombre de questions éthiques.
Elle entraîne d’abord la marchandisation et la commercialisation de la procréation. C’est aussi ce que l’on appelle « un contrat ». Aux États-Unis, par exemple, on peut passer un contrat avec une mère porteuse, en prenant une assurance. C’est un acte de cession de l’enfant qui sera envisagé puisqu’il y a contrat, livraison, acte de cession. En France, cela nous choque.
Il y a aussi, l’exploitation matérielle et psychologique de la femme mère porteuse au profit d’autres femmes qui soit ne voudront pas porter l’enfant, soit ne pourront pas le faire. Jean-Claude AMEISEN réfléchissait à cette question en se demandant quelle est la limite, finalement, entre l’altruisme, la générosité et la solidarité au sein d’une famille, qui a certes toujours existé car c’était une pratique d’ordre privé. Or maintenant la généralisation que permettent les techniques d’AMP nous fait finalement tomber dans l’autre processus, celui de la marchandisation et de l’exploitation de cette femme.
On porte aussi atteinte à mon sens, à la dignité de la mère porteuse et de l’enfant et que cette démarche souligne, le désir des adultes de fabriquer une sorte de « droit à l’enfant » allant évidemment à l’encontre du droit des enfants. Par conséquent, il est vrai que nous sommes à un tournant : faut-il lever l’interdiction de l’article 16-7 ? Le Comité Consultatif National d'éthique (CCNE) s'est penché sur ces différentes hypothèses rendant deux avis dans lesquels il émet de fortes réticences.
Dans un premier avis, n° 3 du 23 octobre 1984, portant sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle, il condamne expressément la maternité pour autrui en mettant l'accent sur l'acte de cession de l'enfant : « un tel contrat ou engagement est nul par son objet et est contracté en fraude de la loi relative à l'adoption, telle est la loi et il ne faut pas la changer ».
Le Comité souhaite au contraire « persuader toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette méthode de ne pas chercher à y recourir ». Le CCNE insiste particulièrement sur l'exploitation matérielle et psychologique de la femme, mère porteuse, et sur le fait qu'il est inacceptable qu'une telle opération soit lucrative. L'exploitation matérielle et psychologique des femmes va totalement à l'encontre de la défense de leurs droits. Est passée sous silence la pression exercée sur certaines jeunes femmes qui voient dans cette technique une façon de mieux vivre financièrement.
Dans un second avis, le n° 90 du 26 janvier 2006, relatif à l'accès aux origines, à l'anonymat et au secret de la filiation, le CCNE réitère ses avertissements : « le risque de marchandisation des grossesses par procuration est au centre même de la réflexion éthique. Il est impensable en effet d'envisager de véritables contrats de location, de livraison, avec des clauses de résiliation. Cette marchandisation de fait, qui certainement n'est pas généralisable, interdit probablement de porter à la connaissance de l'enfant les circonstances du marché dont il a été l'objet ».
On assiste à une pression de certaines associations en faveur de la reconnaissance de la maternité pour autrui. Ces quelques exemples renvoient au problème majeur de la commercialisation de la procréation et du risque de marchandisation des grossesses par procuration. La procréation apparaît ainsi soumise à des intervenants multiples. On doit se demander si le désir des adultes exigeant un droit à l’enfant (droit actuellement non reconnu) n’est pas dans ce domaine en opposition avec le droit de l’enfant. Personnellement, je me demande, s’il ne faudrait pas tout simplement dissocier les deux, c'est-à-dire maintenir l’interdiction et, dans certains cas, accepter de donner une filiation à un enfant par le biais de l’adoption, qui est une technique juridique éprouvée, lorsqu’il n’y a pas de trafic de bébé, lorsque l’intérêt de l’enfant est respecté. Dans ce cas, il s’agit d’une tout autre démarche.
Mais institutionnaliser une pratique d’exception parce que cela se fait à l’étranger alors que les enfants risquent d’en souffrir contribue à un mélange qui n’est pas nécessaire à l’heure actuelle. On peut peut-être trouver d’autres remèdes. Il y a une différence éthique entre accompagner des situations en permettant l’établissement juridique de la filiation dans certains cas spécifiques, et institutionnaliser une pratique qui reste d’exception.
Par conséquent, je terminerais en posant la question suivante : tout ce qui est techniquement possible est-il nécessairement légal ?
Je remercie nos cinq intervenants.. Avant de passer au thème des régulations pour la médecine de demain, peut-être y a-t-il quelques questions ? Qui veut prendre la parole ? Je constate qu’il n’y a pas de question. Quoi qu’il en soit, nos invités seront amenés à intervenir de nouveau dans la journée.
QUELLES RÉGULATIONS POUR LA MÉDECINE DE DEMAIN ?
Don d’ovocytes, don de gamètes
8 M. René FRYDMANN, Professeur de médecine, Chef de service de gynécologie obstétrique, Hôpital Antoine Béclère
Je vous remercie de m’avoir invité. Mon propos consistera à essayer de dresser un état des lieux spécifique des activités de don d’ovocyte pendant l’année 2005 après la mise en œuvre du décret du 24 juin 2004 permettant le transfert d’embryons frais à partir d’ovocytes de donneuses, en m’appuyant sur les informations fournies par l’Agence de la biomédecine. La discussion pourra ensuite revenir sur le don de gamètes. La difficulté de réaliser en France, le don d’ovocytes représente sans doute, un des points clés de la réflexion.
À partir du décret de juin 2004, la technique a changé, puisque l’obligation de congeler les embryons qui étaient volontairement destinés au don a été levée. Il s’agissait d’une précaution sanitaire qui était surtout liée en France à la question du sida. Elle a été levée car elle n’avait pas de raison d’être, cela a relancé quelque peu la pratique du don, dans la mesure où il est devenu possible, pour des femmes receveuses qui attendaient un ovocyte, d’éviter six mois supplémentaires de congélation, dans cette longue attente.
Il est interdit de donner des ovocytes à une femme que l’on connaît, et de même d’être rémunéré pour cela. Il s’agit d’un système de croisement anonyme. Il est précisé dans les textes que la femme demandeuse du don d’ovocytes ne doit pas venir avec une donneuse, mais dans la réalité, c’est ainsi que cela se passe. En revanche, la donneuse d’ovocytes donne de façon anonyme, non pas à la personne qu’elle connaît, qui l’a motivée pour le faire, mais à quelqu’un d’autre, de façon anonyme, et gratuitement, selon les termes de la loi. Vingt-cinq centres sont autorisés en France, dont dix-neuf ont eu une activité en 2005. Les données que je vous présente, qui sont fournies par l’Agence de la biomédecine, concernent uniquement l’année 2005.
Il est important de préciser que les indications sont pour l’essentiel médicales, mais certaines sont à la limite de la médecine. Les insuffisances ovariennes concernent les femmes n’ayant jamais de règles (aménorrhée idiopathique), jamais de fonctionnement des ovaires (insuffisances ovariennes), ou ayant une absence de fonctionnement après un geste chirurgical ou thérapeutique à la suite d’un traitement de radiothérapie pour le cancer (aménorrhée post-thérapeutique)
Les troubles génétiques concernent les malformations, dysgénésie gonadique à caryotype normal, syndrome de Turner, les maladies liées à l’X, les maladies mitochondriales ; et tout ce qui a une base génétique aboutissant à un trouble du fonctionnement de l’ovaire, ou à un fonctionnement de celui-ci, mais avec un risque important de transmettre une maladie génétique. Ce sont des données ayant des causes médicales clairement établies.
Une autre partie des dons d’ovocytes concerne les échecs de fécondation in vitro. Il s’agit de femmes qui arrivent à un certain âge ovarien, pour lesquelles plusieurs tentatives qui ont été proposées, n’ont pas abouti. La question se pose alors de la qualité des ovocytes. Bien que nous ne disposions pas aujourd’hui de la possibilité de diagnostiquer précisément cette insuffisance, elle est tout de même corroborée, évaluée et pronostiquée. Se pose alors la question de poursuivre dans ces conditions de mauvais pronostics, ou de faire appel à un don d’ovocytes.
La prise en compte de la situation de femmes qui ont besoin d’une fécondation in vitro dans un cadre de mauvais pronostic est particulière à la France, pour deux raisons. La première, c’est le remboursement de la fécondation in vitro, qui entraîne une ouverture et une demande très importante et facile à réaliser. La seconde raison est la difficulté du don d’ovocytes, qui conduit à se rabattre sur la prise en compte, à nouveau, d’une situation à mauvais pronostic. Cette situation reflète pour une part seulement, les mauvais résultats généraux de la fécondation in vitro dans notre pays.
En ce qui concerne les receveuses, on observe que dans la plupart des centres celles-ci se situent entre 38 et 43 ans, et parfois jusqu’à 45 ans. On est donc dans les termes de la loi, la limite d’âge correspondant à la possibilité naturelle, puisque, après quarante-cinq ans, il y a encore environ trois cents grossesses par an dans notre pays. Tous les centres déclarent fixer une limite d’âge pour les receveuses 35 % des centres acceptent des receveuses de plus de 42 ans.
Pour ce qui est de la limite d’âge des donneuses, il est frappant de constater que la majorité se situe entre 35 et 42 ans. Nous sommes donc confrontés à une situation en France, où les donneuses sont relativement âgées par rapport au bénéfice escompté. En effet, les résultats de la fécondation in vitro sont étroitement liés à l’âge. La limite est fixée à quarante-cinq ans pour quelques centres, et la plupart d’entre eux acceptent des donneuses jusqu’à trente-huit ans, 94 % les récusent après 38 ans, mais pour le don, trente-huit ans c’est déjà tard, étant donné que les résultats à cet âge ne sont pas les mêmes qu’à 25 ans.
La demande est intéressante. Elle a été analysée sur la base du nombre de consultations effectuées : 779 étaient en attente. Les nouvelles consultations de l’année 2005 s’élèvent à 564, parmi lesquelles 36 % des femmes sont venues avec une donneuse. Cela fait plus 1343 demandes. En réalité, ce chiffre est mal évalué, puisque certaines femmes sont immédiatement découragées lorsqu’elles sont informées des délais d’attente, et vont directement à l’étranger. Il convient d’estimer à près de 2000 la demande annuelle. Les données ne permettent pas de déterminer combien de demandes parmi le 564 reçues en consultation ont effectivement conduit à une réelle « inscription » en attente (à noter 206 soit 36,5 % sont venues avec une donneuse). Par ailleurs, on ne peut pas évaluer le nombre de demandes à l’étranger. Au total en 2005, plus de 1340 femmes étaient soit en attente d’un don d’ovocytes ou bien s’étaient présentées à une consultation.
Cette information est apparue comme étant particulièrement compliquée à recueillir pour les centres. La plupart ont essayé de transmettre une fourchette approximative D’après les réponses fournies par les centres, le délai moyen est d’environ de 28 mois, (entre 9-60 mois), soit plus de deux ans. Pour les femmes qui viennent avec une donneuse, le fait d’alimenter le stock, même si elles ne font pas le lien direct, réduit ce délai à 15 mois en moyenne (entre 6-36 mois).
Sur le tableau des donneuses, on constate que 298 donneuses se sont présentées en 2005, 196 ont été acceptées, et 168 ont été effectivement ponctionnées, dont 158 qui venaient exclusivement pour le don. D’autres qui venaient elles-mêmes pour leur propre fécondation in vitro et ont accepté de donner des ovocytes (seulement 8 cas, ce qui est très peu, à la différence de l’Angleterre).
En 2005, la répartition de l’activité du don d’ovocytes en France est très concentrée sur l’Ile-de-France, la Bretagne, voire en Rhône-Alpes, et en Alsace : transferts d’embryons immédiats : 47 % en l’Ile-de-France, 17 % en Bretagne, 22% en Alsace ; transferts d’embryons congelés : 53 % en l’Ile-de-France, 22% en Bretagne, 10% en Rhône-Alpes. Sur le reste du territoire, l’activité est minime
Toutes ces activités tiennent compte, pour l’année 2005, du prélèvement d’ovocytes des donneuses, de la fécondation et du transfert immédiat, mais aussi du transfert des embryons congelés qui subsistaient à ce moment-là (selon la loi, avant 2004). On assiste donc à un « mélange des genres » entre les embryons qui proviennent d’une activité datant au moins de 2004, et ceux qui proviennent d’une activité de 2005.

Sur les résultats, le tableau est divisé en trois colonnes, qui distinguent les tentatives en fécondation in vitro (FIV), injection intra cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) et transfert d’embryons congelés (TEC). Au total, 102 enfants sont nés en 2005.
Compte tenu de la pénurie existante, en effectuant la balance entre l’offre et la demande d’ovocytes, on estime en 2005 qu’il y a eu 779 demandes, dont 564 reçues en consultation, 130 refusées, 434 acceptées. 168 donneuses ont été ponctionnées ce qui crée donc un rapport de un sur sept. Les besoins en 2005 ont été estimés en termes de demandes à 1213, c’est par conséquent important pour répondre à la demande. Il est difficile d’estimer la demande faite à l’étranger. Elle semble toutefois assez importante. Pour couvrir la demande : il faudrait 600 donneuses.
La situation demeure difficile, non pas sur le plan technique, mais vis-à-vis de la prise en charge. Le fonctionnement de notre système, qui s’appuie sur le don anonyme et gratuit, rencontre des difficultés. L’analyse des motivations des donneuses montre que celles-ci effectuent habituellement cette tentative pour quelqu’un, même si c’est en définitive pour quelqu’un de dérivé, et non pour la personne en question directement. En faisant cela, la donneuse peut penser que la personne pour qui elle a un intérêt affectif pourra en bénéficier par la suite. Une autre raison pourrait être une reconnaissance financière. C’est l’un des points à discuter pour savoir s’il convient ou non de modifier cela.
L’estimation des besoins est donc difficile et incomplète, la qualité des données est hétérogène par manque de précision de certains indicateurs. On obtient cependant des résultats, aussi bien par transfert d’embryons immédiat que par transfert d’embryons congelés sans différence entre FIV et ICSI.
Deux problèmes se posent. Premièrement, les Françaises et les Français sont-ils bien informés sur le don d’ovocytes ? On peut répondre de façon négative. En effet, jusqu’à maintenant, l’information reste inexistante, hormis une campagne menée durant le ministère de Bernard KOUCHNER, qui a eu pour conséquence un pic de réponses et de mobilisation altruiste des femmes. Il s’agit de savoir si tout est fait dans le cadre actuel de la loi pour éviter la situation de pénurie bien connue, dans laquelle on conseille à tous les couples ayant des moyens de se rendre à l’étranger pour éviter d’attendre 2 ans, avec un résultat qui tourne en France autour de 25 %, étant donné l’âge des donneuses, et avec peu de réussite au bout. Un projet de campagne d’information de l’Agence de la biomédecine, que Mme Carine CAMBY évoquera, pourrait être réalisé en 2008.
Deuxièmement : Cela sera-il suffisant et convient-il d’attendre les résultats de cette campagne pour se poser les questions ou les traiter d’emblée ? À savoir : est-ce que l’on maintient la gratuité, qui est un principe important de la législation française ? Faut-il envisager un dédommagement, une indemnité, une rémunération à l’instar de certains pays européens ? Tels sont les termes du débat.
Avant de donner la parole à Mme LABROUSSE-RIOU, je note que vous évoquez la remise en cause éventuelle de la gratuité, mais pas de l’anonymat.
Je laisserais Mme LABRUSSE-RIOU traiter ce sujet
J’ai saisi le sujet pour en faire une sorte de transition. Je suis assez choqué par l’existence actuellement dans ce pays, d’un double état civil : un état civil anonyme détenu par le corps médical, et un véritable état civil légal. Est-il légitime que le corps médical détienne dans ses coffres cet état civil ? Ne faut-il pas aller au bout de la démarche et détruire complètement les données, ou bien offrir la possibilité d’avoir recours à la vérité à l’intéressé principal lequel est le fruit de ces travaux?
8 Mme Catherine LABRUSSE-RIOU, Professeur de droit, Université Paris 1
Je vous remercie de m’avoir conviée à revenir sur ce sujet, qui depuis de longues années déjà préoccupe médecins, juristes et tous les cercles de la bioéthique. Je reprendrais les propos de mon collègue Jean-Pierre DUPRAT, rappelant que si le droit est en partie élaboré par le législateur, il ne l’est pas uniquement par lui. Le législateur ne peut pas ne pas tenir compte des structures plus dures, plus profondes et anciennes, et des catégories juridiques à l’intérieur desquelles les règles prennent place, et qui leur donnent sens.
C’est à partir de ce point de vue que je souhaiterais développer quelques observations sur ce que le droit devrait avoir à poser comme questions nouvelles en vue de la révision des lois à propos du don de sperme et d’ovocytes. On peut s’étonner à première vue que les gamètes humains soient, en médecine, comme dans la loi, traités comme d’autres produits ou éléments du corps humain, alors qu’ils disposent d’une fonction bien spécifique. Cette indifférence apparente fait en quelque sorte fi de la nature des choses, même si cela est décrié. C’est une réalité qui, d’une manière ou d’une autre, finit toujours par refaire surface.
On ne peut s’en tenir là, et puisque ces dons ne visent pas à restaurer une fonction biologique d’autrui, mais à engendrer un être humain au bénéfice d’autrui. C’est une spécificité qui, du point de vue juridique, et plus largement du point de vue anthropologique, me paraît poser essentiellement des problèmes de remise en question du système de filiation. Certes tous les aspects médicaux pourraient relever du droit, car on peut imaginer des procès en responsabilité, mais la spécificité des dons de gamètes, consiste en cette dissociation des éléments constitutifs du rapport de filiation, qui est complexe, à la fois biologique, psychique, sociale et juridique, où tout est lié par le droit commun qui se trouve éclaté entre des personnes différentes.
Claude HURIET indiquait tout à l’heure qu’il convenait de ne pas oublier le principal intéressé dans cette affaire, qui n’est pas encore là, mais que l’on espère, à savoir l’enfant. Par l’effet de ces progrès, ou de ces pouvoirs, qui s’exercent sur sa conception et sur sa venue au monde, l’enfant se trouve en quelque sorte sous la puissance des adultes. Ces pouvoirs de la science ou de la technique médicale restaurent d’une manière paradoxalement archaïque, une espèce de puissance parentale ou médicale beaucoup plus forte qu’elle ne l’a jamais été dans le passé, au moment même où l’on affirme que l’autorité parentale, la puissance maternelle, est défunte, que l’autorité parentale se réduit et que les droits de l’enfant s’élèvent. Peut-être s’agit-il simplement d’un déplacement des grandes catégories juridiques sur le temps d’avant la naissance, qui est un pouvoir beaucoup plus difficile à maîtriser et à contenir, parce que l’enfant n’a pas les moyens de se révolter contre l’éducation, éventuellement tyrannique, qu’il aurait pu recevoir de ses parents.
Les juristes sont d’abord forcément conduits à exposer le système de parenté, qui ne se manipule pas impunément au gré des désirs ou des fantasmes des uns et des autres. La très longue histoire humaine nous donne une expérience de la nécessité que les individus aient une identité généalogique, c’est-à-dire soient rattachés à un père et à une mère dont ils dépendent, pour qu’ils puissent tenir debout ensemble. C’est un élément fondamentalement structurant du sujet humain, et aucune société n’échappe à la priorité de la norme, et à un système de parenté, que les anthropologues connaissent bien.
Les risques pour l’enfant, d’ordre psychologique, anthropologique, et de tous ordres, ne sont évidemment pas susceptibles d’être éprouvés par l’expérimentation, puisqu’il n’existe pas de preuves dans ce domaine. On sait cependant une chose : c’est que le système de parenté doit répondre à un souci de cohérence. C’est sur cet aspect logique, mais essentiel pour ne pas devenir fou, que je voudrais faire quelques observations à propos des dons de gamètes.
Je reprendrai la question de la cohérence de l’ordre généalogique qui pourrait être fondamentalement bousculée par la redistribution des gamètes, sous trois angles qui se complètent, avec le souci que le personnage central, dont nous sommes responsables, est l’enfant qui sera engendré, sans que l’on sache a priori quel est son intérêt. En tout cas, on sait que l’intérêt premier de tout individu est d’avoir une identité fixée, et qui est fixée par la loi de façon « indisponible », c’est-à-dire qui est déterminée par une loi hétéronome, et non pas par le libre choix contractuel des individus.
En droit commun, pour la très grande majorité des individus, le lien biologique, le lien de reconnaissance volontaire, la manifestation de volonté et d’engagement à l’égard d’un enfant, et le lien social par ce que le juriste appelle la possession d’état, constituent les trois éléments essentiels – enroulés les uns aux autres –, par lesquels le droit civil consacre le lien juridique, c’est-à-dire le lien de parenté. Est exprimé ainsi qui est qui par rapport à qui. Chacun de ces éléments se conforte mutuellement, se fait présumer l’un l’autre, pour constituer le lien légal selon un système qui vient d’être réformé de façon récente par le législateur autour de la distinction de la maternité et de la paternité, et non plus vis-à-vis de la filiation légitime et naturelle.
Il est nécessaire, la nature l’impose, de distinguer l’établissement de la maternité et celui de la paternité. La maternité est un phénomène plus complexe, puisqu’elle est à la fois génétique et gestationnelle, prouvée et établie par l’accouchement, alors que la paternité, dit-on, pourrait n’être que génétique, ce qui est d’ailleurs faux, puisque dans toute notre tradition, c’est l’engagement du père vis-à-vis de la mère qui constitue également aussi le lien de paternité à l’occasion de la naissance d’un enfant.
Le système de parenté ne peut fonctionner que de façon cohérente. Or il me semble que nous sommes actuellement dans une situation où les principes mêmes mettent en contradiction deux composantes du lien de filiation qui ne me paraissent pas compatibles. On ne peut pas développer les preuves scientifiques de paternité, y compris au travers d’une sorte de libre marché Internet et valoriser de façon peut-être excessive le facteur biologique de la parenté. C’est la raison pour laquelle je suis à titre personnel, très réservée sur l’utilisation de la génétique pour contrôler l’immigration : on ferait mieux d’avoir des systèmes d’état civil plus fiables, même si quelques personnes en bénéficient, dans la mesure où leur système d’état civil local est très défaillant. On ne peut donc pas à la fois valoriser dans l’opinion publique, au risque d’ailleurs de semer la pagaille à l’intérieur des familles, le fantasme du lien du sang, qui est tout de même une réalité, et d’un autre côté, nier ce facteur biologique en le masquant sous couvert de l’anonymat des donneurs de sperme.
Une cohérence dans les références fondamentales, essentielles, du système de parenté est nécessaire. On peut changer beaucoup de choses dans certaines limites. Mais on ne peut pas changer certaines structures au risque de provoquer des désordres impossibles à évaluer à l’intérieur de la population, et des individus. En particulier, on ne peut pas disposer d’un système alternatif au gré des besoins des uns et des autres. Ce point est très général et ne concerne pas simplement le don des gamètes : il met en cause le problème des tests génétiques, que le législateur a eu la sagesse d’encadrer en 1994 de façon assez rigoureuse et justifiée, mais qui déborde maintenant ce cadre, aussi bien en fait qu’en droit. En effet, le Conseil constitutionnel a validé l’accès aux preuves génétiques, certes très restreint, en matière de contrôle de l’immigration.
La seconde question, comme l’a évoqué M. René FRYDMANN, est celle de l’anonymat du don de gamètes. Dès le départ, l’anonymat a constitué la pierre d’achoppement de tout le système des procréations médicalement assistées. Peut-on aujourd’hui, dans l’état actuel du droit, admettre l’accouchement sous X, avec des ouvertures possibles et organisées à la connaissance de la mère, sous réserve de toute une série de conditions, et refuser ce même accès à la connaissance du donneur de sperme ? Peut-on faire fonctionner ensemble, ces deux systèmes? Peut-on interdire l’accès au donneur, et autoriser l’accès sous contrôle à la mère qui a accouché dans le secret ? Il me semble que l’on observe sur ce point l’existence de deux poids, deux mesures qui ne sont pas véritablement justifiés.
Dans un premier temps, lorsque nous avons commencé à travailler ces questions, il y a déjà longtemps, j’avais pensé que le système de l’anonymat était probablement le moins mauvais des systèmes, et qu’il était supportable à une condition, celle de ne pas toucher le système de filiation. Or, le législateur a changé les règles de filiation pour les dons de sperme. Il a créé de ce fait deux catégories d’enfants, en fonction des conditions de leur conception, ce qui, du point de vue du principe d’égalité, provoque quelques interrogations.
J’avais pensé que c’était viable. Le don d’ovocytes ne posait pas vraiment de problème, dès lors qu’on s’en tenait à la définition de la maternité par l’accouchement. Je me rendais bien compte que l’anonymat était un sujet insoluble, une question profondément remuée, et j’ai examiné la question de l’anonymat, de l’absence d’anonymat, dans tous les sens, avec toutes les conséquences en aval pouvant en résulter ; et j’en suis venue à penser qu’il n’existait pas de bonne solution, et qu’il était extrêmement difficile d’admettre la levée de l’anonymat sans pour autant que le donneur ne soit pas considéré par le « bon peuple » comme le père biologique. Il fallait donc trouver une sorte de place, non pas généalogique, mais une qualité, pour ce donneur, et il n’en existait pas dans notre système. Inversement, l’anonymat entraînait également les problèmes d’organisation légale d’un véritable mensonge. Tout en faisant refluer le donneur ou la donneuse dans l’état d’un simple apporteur biologique, pour l’exprimer vulgairement, au rang d’un « étalon ». Cela n’était pas satisfaisant.
Une série d’interrogations provenant d’autres biais est apparue. Faut-il revenir sur le principe de l’anonymat ? Faut-il y revenir de façon générale, c’est-à-dire en admettant que l’enfant pourra, soit pendant sa minorité, en étant représenté par un tuteur ad hoc, accéder à la connaissance de ses origines, soit à sa majorité, accéder à la connaissance du donneur ? La question est ouverte, et devrait être instruite, peut-être à partir de l’expérience des enfants nés d’insémination artificielle avec donneur ou, éventuellement, de don d’ovocytes, qui sont devenus adultes.
On peut prendre une attitude plus prudente, moins risquée, et prévoir que l’anonymat ne pourrait être levé que dans certaines conditions, et à la seule demande de l’enfant ; à la condition, par exemple, que le père « fictif », qui est tout de même le père de l’enfant, ait disparu, soit que son consentement ait été vicié, et que, de ce fait, les règles d’établissement de la paternité, et la filiation, soient contestées. En effet, les règles de filiation sont en pratique, une sorte de « passoire ».
On peut aussi décider d’élargir les conditions d’accès à la procréation assistée, par imitation de pays voisins plus permissifs que le droit français, et admettre par exemple l’insémination de femmes célibataires. Auquel cas, de quel droit priver l’enfant de la connaissance de son ascendance paternelle ? Si cela était admis, ou pratiqué en fait, on pourrait donner un accès à la connaissance du donneur. Je n’ai pas beaucoup de sympathie pour ce système, mais j’estime qu’on ne peut pas priver l’enfant du droit à l’établissement d’une paternité et d’une maternité.
Enfin, se pose également un problème de cohérence au regard du système de parenté : à l’instar du droit belge, espagnol, ou anglais, convient-il d’admettre et d’élargir les cas d’accès à la procréation médicalement assistée, notamment au motif que les personnes qui ne trouvent pas satisfaction à leur désir d’enfant en France, en raison des interdits légaux (qu’il s’agisse de femmes célibataires ou de couples homosexuels, hommes ou femmes), trouvent à l’étranger la possibilité de satisfaire leur désir, grâce à des législations plus tolérantes que la nôtre ? Je ne suis pas séduite par l’imitation dans ce cas, et les phénomènes qui se produisent sont, de fait, des manifestations d’évasion légale. Toutes les règles connaissent cela, et je ne considère pas que ce soit là une justification pour admettre des pratiques qui, ensuite, ne pourront pas trouver place, pour des couples qui reviendront en France avec leur enfant, dans les structures de l’état civil.
C’est ainsi que le problème se pose pour les mères porteuses américaines. À l’office d’état civil de Nantes, on ne peut pas inscrire deux femmes comme mères. C’est impossible. Il n’y a pas de place pour cela. Ces difficultés qui surgissent en raison de la globalisation ou de la libre circulation des personnes, et aussi de la diversité des législations, sont des questions de fait. Aucune loi n’est applicable et respectée à 100 %, même si son efficacité doit être recherchée. Des réponses sont possibles, et il faut laisser aux juges le soin de les apporter le jour où ils seront saisis. De même, il existe des solutions venant du droit international privé souvent méconnues, parce que la matière est très technique, mais qui commencent à être très bien travaillées. Elles ont été présentées hier par une brillante thésarde dans sa thèse de doctorat sur la médecine procréative et la circulation internationale des personnes.
Pour conclure, j’observerais qu’en 1994, le législateur français a choisi, pour ce qui concerne les procréations médicalement assistées, de singer la filiation charnelle, non sans hypocrisie, non sans fiction et sans risques, pour couvrir l’éclatement des fils constitutifs de la corde que représente le rapport de parenté. Je raisonne peut-être avec prudence, mais il me semble que dans des périodes particulièrement instables, comme celle que nous vivons, entraînant une grande instabilité psychique des individus, de grands bouleversements, il n’est pas opportun d’ajouter encore de l’instabilité et de la perte de repères sur cet élément fondamental de détermination du père et de la mère. Par conséquent, je ne suis pas favorable à ce que l’on modifie les critères de la maternité. Je considère que le bon sens populaire s’opposerait complètement à ce que l’on consacre une maternité génétique qui ne soit pas gestationnelle. J’estime qu’en la matière, l’expérience de la totalité des individus ne doit pas être bafouée au point que les femmes et les mères ne se reconnaîtraient plus dans leurs fonctions et nature.
Le don d’ovocytes est donc possible. Cela ne bouscule pas la maternité. Quant à la paternité, elle est fondée essentiellement sur la présomption du lien biologique. Cette présomption peut être invalidée, et elle est alors fondée sur la parole : elle a toujours été fondée sur la présomption par la parole du lien biologique, la parole se manifestant à la fois par la reconnaissance d’enfants naturels, par la reconnaissance de l’enfant, et par l’inscription à l’état civil en qualité de père. C’est une parole sociale, une parole qui vaut engagement, et cela me paraît plus responsable, plus humain, éthique et fondamental pour l’enfant d’être reconnu par l’engagement et la parole que par la simple preuve biologique.
Je vous remercie. Y a-t-il des questions dans la salle à ce sujet ?
‚
Je voudrais faire une remarque au sujet de la présentation de M. René FRYDMANN, qui a donné un bon exemple d’utilitarisme. On aurait pu remplacer le mot « ovocyte » par le mot « pétrole ». Il est assez gênant de considérer les ovocytes et les femmes dans un développement théorique utilitariste. Je sais que ce n’est pas son intention, et qu’il souhaite, comme nous tous, médecins de la reproduction, trouver des solutions pour les femmes infertiles. Cependant on est en train de transgresser, d’utiliser le corps humain, la souffrance d’une femme qui va donner ses ovocytes, qui peut avoir un accident vasculaire, hémorragique ou autre, pour autrui. Comment gérera-t-on le dédommagement, l’assurance ? Imitera-t-on les États-Unis, qui n’ont pas d’âme, et où un contrat complet (mais notre droit ne s’appuie par sur le contrat), avec avocat, assurance, et tout ce qui est nécessaire, est prévu. Chacun est content et chacun y trouve son compte ; mais je ne pense pas qu’en France, nous soyons prêts à aller jusque-là.
Une autre considération importante est de connaître la raison de cette pénurie d’« ovocytes pétrole ». Il faut présenter un constat de l’évolution de notre société : nous faisons des enfants trop tard. C’est la raison pour laquelle les femmes n’y arrivent plus. La plupart des indications montrées, de malformation, d’absence d’ovaires, sont assez rares. Le groupe le plus important, est celui des femmes voulant des enfants après trente-six ou trente-sept ans, n’y arrivant pas, et qui n’ont pas eu d’enfants plus tôt parce qu’elles ont fait leur vie. C’est un problème de société et de politique, qu’il faudrait peut-être résoudre, au lieu de faire des transgressions qui finiront par coûter cher.
Mon discours a pu paraître éloigné de l’humanité, mais ce n’était pas le propos. Si l’on souhaite discuter de la manière dont la procréation médicalement assistée se passe et est ressentie, on organise une autre réunion, et j’y assisterais volontiers. Mais pour une fois, on dispose de données sur une pratique qui pose un certain nombre de problèmes. Mon but n’était pas de réduire qui que ce soit à une quantification, ou à une chosification, mais plutôt de fournir les éléments de la réflexion.
Sur le plan psychique, des suivis ont été mis en place. Sur la base des études qui ont été effectuées, à partir du moment où ces questions ont été travaillées en amont, à travers la préparation à ce don par des entretiens, par une volonté. Le fait de ne pas être pris dans une sorte de contrat, outre celui moral, semble être vécu comme quelque chose de positif. Il faudra questionner de nouveau les psychologues qui ont mené ces études.
Une enquête a été réalisée en 2004 concernant les femmes qui avaient procédé à une FIVETE et qui, dans l’ensemble, étaient relativement satisfaites. Elles acceptaient bien toute la partie administrative, quelques gestes techniques leur apparaissaient comme assez lourds, mais ce qui était le plus mal vécu, c’était le risque d’échec. Y a-t-il de nouvelles données à ce sujet ? Les nouvelles techniques de stimulation ovarienne changent-elles quelque chose ? Existe-t-il des changements au niveau de la perception qu’ont les femmes de la FIVETE ?
Dans les meilleures conditions, le taux de succès est de 50 %, ce qui signifie qu’il y aura toujours des échecs. Il convient de faire passer l’idée que nombre de choses sont possibles, mais que le risque zéro n’existe pas, et qu’il y a toujours des couples qui sont loin du droit à l’enfant. C’est la réalité de tous les jours dans les cabinets de consultation.
Je souhaiterais questionner Mme LABRUSSE-RIOU, avec qui je suis d’ailleurs en accord. Un avis du Comité consultatif national d’éthique, dont Hélène GAUMONT-PRAT était une des rapporteurs, mettait l’enfant au centre de la réflexion : l’enfant projeté comme adulte, qui rétrospectivement s’interrogeait sur ses origines. À une époque, le lien biologique définissait l’illégitimité (le bâtard). Malheureusement, on est tenté aujourd’hui de définir la légitimité par le lien biologique. Vous avez utilisé le terme de mensonge. Or, il me semble que la question de l’anonymat porte davantage sur l’alternative entre la transparence et le secret qu’entre la transparence et le mensonge. À un certain degré, le respect de la vie privée est un respect du secret, et on se situe davantage sur le terrain de la part de secret que la société, ou le législateur, désire préserver dans l’intérêt de chacun, que sur celui du mensonge ou de la vérité. Dès lors qu’on pense en termes en mensonge ou de vérité, la transparence devient une obligation morale.
Je vous remercie de votre observation. J’admets être allée un peu vite en employant ce terme de mensonge. Celui-ci n’a de pertinence que sur un point précis, à savoir que le système légal enferme le père, le compagnon ou le mari de la mère inséminée par un tiers, dans une paternité forcée. Or, ce qu’on appelle la présomption de paternité, qui est liée au mariage ou à la reconnaissance d’enfants naturels, est une présomption de vérité biologique. C’est ce que l’on appelle une présomption déclarative. Mais c’est un acte de parole, qui fait présumer la vérité biologique. Le mensonge se situe dans l’usage de cette présomption : on a utilisé les cadres existants pour couler les dons de sperme dans le moule de la filiation classique. Cela n’est plus une présomption de vérité biologique, et on le sait. On retrouve une forme de manipulation du sens profond de l’institution. De ce fait, tout repose sur le consentement qui, on le sait, est fragile et peut être vicié. Cela conduira donc à des contentieux fondés sur les vices du consentement. C’est la vie, ce n’est pas grave, et l’on peut toujours trouver des solutions. Mais la question du secret est très importante car la levée de l’anonymat est liée à la levée du secret pour l’enfant. C’est un autre problème.
M. Carlos De SOLA, Chef du service de la santé et de la bioéthique, Conseil de l’Europe
Afin d’avoir des indications sur la réalité : À combien estimez-vous le nombre de femmes, ou de couples, qui se rendent à l’étranger ? Avez-vous des estimations ? En outre, comment gérez-vous la pénurie, selon quels critères, et lequel vient en premier, puisqu’il faut choisir une femme sur sept.
Je ne dispose d’aucune donnée réelle. La gestion de la pénurie est tellement difficile. On est entré dans des situations qui sont, pour moi, personnellement invivables. Notre centre a arrêté de pratiquer le don d’ovocytes à cause de cela. On se retrouve finalement dans une situation où l’on conseille aux couples de se rendre à l’étranger, avec le coût que cela implique. Je n’ai pas de solution, en dehors des possibilités de recherche qui ouvrent sur autre chose. Dans le futur, nous disposerons peut-être d’ovocytes congelés qui pourront entrer dans cette réflexion.
CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES ET CLONAGE THÉRAPEUTIQUE
LES PERSPECTIVES
M Alain CLAEYS
Nous abordons maintenant le thème des cellules souches. Madame COULOMBEL, vous avez la parole.
8 Mme Laure COULOMBEL Directrice de recherches à l’INSERM, Directrice adjoint de « médecine sciences »
Je vous remercie de m’avoir invitée. J’interviendrais en tant que scientifique sur l’utilisation des cellules souches embryonnaires. En premier lieu, je voulais souligner que, pour le chercheur, il existe une préoccupation thérapeutique indiscutable. Cependant, il convient d’être prudent, car le plan thérapeutique n’a pas la même contrainte de temps que celui de la compréhension et de la recherche, indiscutablement et probablement plus pour les cellules souches. On constate un décalage entre d’une part la recherche et la compréhension du mécanisme, et d’autre part l’utilisation éventuellement possible de l’outil thérapeutique que représentent les cellules souches.
On ne peut effectivement pas attendre d’une découverte récente une application thérapeutique immédiate. Cela signifie qu’il ne faut pas laisser un laps de temps très important au chercheur pour comprendre le mécanisme et élaborer la thérapeutique, la plus appropriée possible. C’est très important, en particulier dans le cas des cellules souches. Les chercheurs n’anticipent pas une application thérapeutique immédiate, même si dans certains cas, elle peut être très proche.
L’autre point sur lequel j’insisterais concerne la diversité du choix des cellules d’un point de vue thérapeutique. Nous disposons de cellules souches adultes, dont on connaît très bien les limitations, de cellules souches fœtales et de cellules souches embryonnaires. Il est important de préciser qu’il faut tenir compte de cette diversité comme de celle des pathologies auxquelles elles pourraient s’adresser, sachant que pour chacune de ces pathologies, le produit cellulaire sera probablement différent, la stratégie le sera également. On ne se situe pas devant une cellule et une application thérapeutique, mais devant une multiplicité de possibles quant au choix des cellules et à la stratégie de l’application thérapeutique.
Je souhaiterais revenir sur le problème des cellules souches embryonnaires. L’intérêt fondamental des cellules souches embryonnaires, réside d’une part dans leur pluripotence, cette possibilité de produire une extrême diversité de tissus différents, et d’autre part leur immortalité, la possibilité de disposer d’un nombre considérable de ces cellules. À la suite de découvertes très récentes, on est confronté, sur la notion même de cellule embryonnaire, à la signification de ce terme. Qu’entend-on par « cellule souche embryonnaire » ou, désormais, par « cellule souche pluripotente », qui pourrait avoir un intérêt thérapeutique ? Il convient de distinguer deux populations cellulaires complètement différentes.
– D’une part, des cellules souches embryonnaires dérivées à partir d’embryons obtenus après une fécondation in vitro, et donc à la suite d’un don de l’embryon à la recherche. Ces cellules souches embryonnaires, issues d’un processus normal, et non manipulées génétiquement, bénéficient à l’heure actuelle d’un grand recul en termes de travail de recherche, et elles sont normalement impliquées dans le développement embryonnaire. Il s’agit donc d’une entité embryonnaire normale, même si le fait de la cultiver in vitro lui confère des contraintes qui ne sont pas physiologiques.
– D’autre part, nous disposons désormais d’une seconde catégorie, qu’on appelle des « cellules souches adultes », qui sont reprogrammées, et auxquelles on reconfère une capacité de pluripotence qu’elles ne possèdent pas spontanément. Dans cette catégorie, on peut faire entrer les cellules que l’on obtient par transfert nucléaire, et l’on peut depuis très récemment, faire entrer une troisième catégorie de cellules adultes, auxquelles on peut reconférer des propriétés de pluripotence. Dans ces deux cas, on obtient également des lignées de cellules dites « souches pluripotentes ». Nous disposons déjà de plusieurs catégories : l’une comprenant des cellules issues d’un développement normal, ce sont les cellules souches embryonnaires, et une autre catégorie, que l’on peut également amplifier de la même façon, possédant des propriétés très proches, potentiellement très intéressantes d’un point de vue thérapeutique ; il s’agit des cellules obtenues par reprogrammation d’un noyau adulte, auquel on sait maintenant réinduire une capacité de pluripotence. Certaines questions sont communes à ces trois entités que j’ai décrites, du point de vue du mécanisme auquel travaillent actuellement des chercheurs, qui débouchera éventuellement par la suite sur l’utilité thérapeutique.
La première question essentielle est la connaissance du mécanisme de la pluripotence. Pour les chercheurs, il s’agit d’une question fondamentale pour la compréhension de ce qui implique qu’un même patrimoine génétique s’exprimera dans un cas et non dans un autre. En d’autres termes, qu’est-ce qui fait que dans un environnement cellulaire un fibroblaste, des gènes de pluripotence ne s’expriment plus, alors que dans une cellule embryonnaire, ces gènes s’expriment ? Comprendre ces mécanismes est absolument fondamental. Très récemment, on a pu faire ces découvertes fascinantes parce qu’on connaissait le mécanisme de la pluripotence à partir de l’étude des cellules souches embryonnaires murines et humaines. Il faut bien comprendre que la capacité que l’on possède aujourd’hui de conférer à une cellule adulte, des propriétés de pluripotence provient de la connaissance accumulée depuis des années sur les gènes qui contrôlent cette pluripotence chez l’embryon. Le message que j’adresse, est qu’il faut absolument garder l’étude de ces trois entités en parallèle. Il y a une « transfertilisation », si je puis me permettre, de l’étude de ces trois entités cellulaires.
La compréhension du mécanisme de pluripotence est fondamentale parce que, pour le moment, cette pluripotence est spontanée dans les cellules embryonnaires, et induite dans les cellules adultes à l’heure actuelle, par une manipulation génétique qui est un transfert de gènes, avec ce que cela peut comporter de risques, notamment de transformation. Toute une voie de recherche est centrée sur la compréhension du passage d’une induction de pluripotence par des gènes, à une induction qui pourrait être pharmacologique, d’où l’intérêt de décrypter ce mécanisme, pour pouvoir ensuite le modifier, ou l’induire d’une façon qui pourrait être un jour cliniquement acceptable.
Par ailleurs, la compréhension du mécanisme de pluripotence, indépendamment d’une application thérapeutique, peut nous aider à comprendre d’autres pathologies, touchant également le problème de l’activation des gènes, et qui sont des pathologies éventuellement épigénétiques. Il faudra encore quelques années avant de disséquer complètement le mécanisme de pluripotence pour ensuite pouvoir l’utiliser à des fins thérapeutiques.
La seconde question, également essentielle, concerne le travail sur l’efficacité de la différenciation. On sait qu’il existe de multiples potentiels de différenciation de ces cellules embryonnaires, et peut-être maintenant de ces autres cellules ; encore faut-il pouvoir les différencier dans les diverses voies intéressantes de façon efficace. Il ne suffit pas d’avoir une cellule Béta de l’endurance, il faut qu’elle puisse synthétiser suffisamment d’insuline. Il nous faudra encore des recherches de plusieurs années avant de travailler sur l’efficacité de la différenciation, or les cellules souches embryonnaires sont essentielles, par comparaison avec les autres entités que j’ai décrites.
Le troisième point concerne le travail, non seulement sur l’efficacité de la différenciation, mais de l’évitement du risque que ces cellules peuvent éventuellement provoquer. Dans ce travail de recherche, une finalité thérapeutique existe, le remplacement de la cellule est la thérapeutique à laquelle on pense le plus souvent. Aussi insisterais-je sur le fait que la compréhension de ces mécanismes peut conduire à la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques en dehors du remplacement de cellules malades chez un individu ayant une pathologie donnée. Cela peut être une molécule pharmacologique, mais aussi une molécule qui ira ensuite modifier le fonctionnement d’un gène, ce que l’on peut rassembler sous le terme d’épigénétique.
Le quatrième point qu’il est important d’anticiper dans le cadre d’un travail thérapeutique ou médical, est l’organisation préclinique éventuelle de l’utilisation thérapeutique de ces cellules. Cela sort du travail strict du chercheur dans son laboratoire, pour être envisagé dans une stratégie davantage de préclinique. Dans ce cadre, il est très important de discuter, notamment de l’obtention de nouvelles lignées embryonnaires. En effet, les lignées actuelles ne seront pas utilisables dans une application thérapeutique, et il est donc important de pouvoir continuer à dériver de nouvelles lignées, de façon à ce qu’elles le soient dans des conditions qui les rendent d’emblée cliniquement acceptables, ce qui n’est pas du tout facile.
Il faut un grand nombre de recherches et, au-delà de ces recherches, résoudre un problème d’organisation qui, pour le moment, est tout à fait balbutiant, avec éventuellement le problème de banques ou celui d’organisation de conditions dites GMP (« good manufacturing procedure »). Toute cette organisation préclinique est pour le moment balbutiante, et dans ce cadre, la dérivation de nouvelles lignées à partir d’embryons est indispensable.
Un autre point, qui sort un peu du cadre thérapeutique, concerne tout l’intérêt que peut avoir la dérivation de nouvelles lignées à partir d’embryons porteurs de mutations pour la compréhension et la modélisation de pathologies humaines. Il s’agit d’une voie extrêmement importante et qui peut avoir des conséquences essentielles.
Je vous remercie de votre présentation et donne la parole à Mme Nicole LE DOUARIN.
8 Mme Nicole LE DOUARIN, Professeur au Collège de France, Membre de l’Académie des sciences
Biologiste, spécialisée dans le développement de l’embryon, j’ai eu la satisfaction de constater que la plupart des notions dont je souhaitais vous entretenir ont déjà été très largement discutées avec beaucoup d’efficacité par Madame Laure COULOMBEL
On discute beaucoup des cellules souches, mais on met sous ce terme des entités qui ne sont pas toujours identiques. Il serait donc important de disposer d’une définition de ces cellules. Tout d’abord, si les cellules souches existent, c’est parce que, au cours de l’évolution, sont apparus les êtres multicellulaires. Lorsque ceux-ci sont apparus, ils ont tiré avantage de leur multi cellularisme parce qu’ils sont devenus plus efficaces. S’ils sont devenus plus efficaces, c’est parce que leurs cellules se sont différenciées les unes des autres, pour accomplir des tâches avec une plus grande efficacité.
Les trois types de cellules souches des vertébrés sont les suivants :
- les cellules totipotentes de l’embryon précoce (morula, blastocyste). Elles sont à un état transitoire qui peut être capté ;
- les cellules souches restreintes à un lignage déterminé, qui servent à construire l’embryon pendant le développement embryonnaire ;
- les cellules souches adultes qui servent au renouvellement des tissus.
Lorsqu’une cellule se différencie, on s’aperçoit que dans la grande majorité des cas, elle cesse de se multiplier. Elle ne peut plus proliférer. De ce fait, sa durée de vie est limitée. De sorte que, dans les organismes que nous sommes, hautement multicellulaires, avec des tissus hautement différenciés, toutes nos cellules sont destinées à mourir, et à mourir avant même que nous ne mourions. Par conséquent, l’existence d’un système de remplacement des cellules est indispensable. Ce système de remplacement, dans tous les tissus, est assuré par des cellules ayant gardé le souvenir de l’embryon, de leur statut embryonnaire ; ce sont les cellules souches.
|
|
Ces cellules souches sont très peu nombreuses et, d’une manière générale, dans la plupart de nos tissus, leur existence était passée inaperçue. Pourquoi sont-elles peu nombreuses ? Parce qu’elles se divisent très peu, contrairement à ce que l’on croit. Par ailleurs, lorsqu’elles se divisent, elles possèdent une caractéristique : elles ont une division dite asymétrique, et elles ne produisent pas de cellule semblable à elles-mêmes. Elles donnent une cellule semblable à elle-même qui restera cellule souche, et une autre cellule ayant un pouvoir prolifératif considérable, qui donnera de nombreuse cellules, qui possèderont à leur tour la capacité de se différencier en divers types cellulaires. Cela signifie que la cellule souche, par définition, est une cellule douée d’auto renouvellement, et en même temps pluripotente, c’est-à-dire qu’elle produit plusieurs lignées de cellules à partir d’elle-même.
On a compris cela au début des années 1960, en étudiant la manière dont se renouvelle le sang qui est typique à cet égard : les cellules sanguines vivent très peu de temps. Un globule rouge vit cent vingt jours. Nous en possédons cinq millions par millimètre cube, et cinq litres de sang, on peut donc calculer combien il faut de multiplications cellulaires pour obtenir du sang, pour que nous en disposions toujours. Or, nous avons très peu de cellules souches sanguines. Elles sont logées dans la cavité des os, c’est-à-dire dans la moelle osseuse.
D’autres tissus se renouvellent très rapidement dans le corps. Tous les trente jours, nous avons une nouvelle peau ; de même pour les cellules qui recouvrent la paroi de l’intestin intérieur : tous les trois à cinq jours, nous possédons de nouvelles cellules renouvelées. On a découvert quelles étaient les cellules qui renouvellent l’intestin (elles sont très peu nombreuses) et quelles étaient les cellules qui renouvellent la peau. Il s’agit d’une réserve de jeunesse, de jouvence, dont nous disposons. Cela existe-t-il uniquement dans ces tissus qui se renouvellent peu ? L’engouement actuel pour les cellules souches conduit à observer ce qu’il advient dans à peu près tous les organes. Il y avait un organe, le cerveau, dont on affirmait que les cellules, les neurones, étaient particulièrement importantes : on nous expliquait : « Vous les possédez à la naissance, et vous n’en aurez plus jamais d’autres. Vous en perdrez ! » Certes, mais c’est fini. La grande surprise fut la découverte des cellules souches neurales dans le cerveau, et l’existence d’un renouvellement de certains neurones, comme l’hippocampe, qui est le centre de la mémoire, il y a donc de l’espoir ! Nous possédons non seulement des cellules souches dans le système nerveux, mais dans les muscles, dans les tissus osseux, les tissus cartilagineux. Nous disposons donc en nous d’une réserve de jeunesse.
Quelles sont les perspectives offertes par ces cellules souches adultes ? En premier lieu, y en a-t-il ? D’une part, on fait déjà de la thérapie cellulaire grâce à nos cellules souches adultes. C’est la thérapie par les greffes de moelle osseuse. Une fois qu’on a compris le mécanisme du renouvellement du sang, on a utilisé des greffes de moelle osseuse, pour guérir notamment des personnes irradiées, et des personnes souffrant de maladies hématologiques. D’autre part, on fait aussi de la thérapie cellulaire avec les cellules adultes. Il s’agit des greffes de peau. Lorsqu’on est brûlé, on ne peut accepter une greffe de peau que de soi-même. Sinon, le tissu est rejeté immédiatement. Comme il reste toujours un peu de peau, on peut trouver le moyen de provoquer la culture, la croissance, de ces petits fragments de peau, qui contiennent des cellules souches, et on obtient des lambeaux que l’on peut mettre sur des brûlures. On a pu sauver de cette façon beaucoup de vies. Je viens d’écrire un livre sur les cellules souches, que j’ai intitulé : « Cellules souches, porteuses d’immortalité ».
Il existe peut-être des possibilités d’utiliser les cellules souches neurales. On a donc réussi chez la souris à récupérer les cellules souches du cerveau et à les mettre en culture. On s’est aperçu qu’on peut les amener à proliférer et provoquer, sur les souris, des maladies neuro dégénératives, ressemblant beaucoup à celles que nous subissons malheureusement avec l’âge. On arrive à réinjecter ces cellules, et on s’aperçoit qu’elles peuvent remplacer des cellules mortes. Il existe donc un espoir, et des recherches assez importantes sur ces cellules. La souris est toujours à la base de toutes les découvertes, pratiques dans la plupart des cas. Quelquefois, les découvertes théoriques s’adressent à la drosophile, ou à des petits vers, sur lesquels on fait de la génétique, mais les recherches sur la souris restent très importantes ; nous devons tout à la souris !
Les cellules les plus extraordinaires sont les cellules embryonnaires. Ces cellules souches embryonnaires représentent la capture en culture d’une phase, normalement transitoire, du développement où les cellules embryonnaires sont pluripotentes.
C’est encore sur la souris, et grâce à des travaux de recherche fondamentale, que l’on a réussi à obtenir que la fécondation des œufs de mammifères, des ovocytes, puisse se faire in vitro, sur la paillasse du laboratoire, et pas uniquement dans la trompe utérine de la femelle. Une fois qu’on a été capable de mettre au point un milieu pour produire cela, on a aussi été capable de cultiver l’embryon jusqu’au stade dit blastocyste. À ce stade c’est une sorte de sac dans lequel se trouve un petit amas de cellules à partir duquel se formera l’embryon, entouré par une couche qui donnera le placenta. À partir de ce stade, plus question de cultiver l’embryon in vitro. Il faut le remettre dans un utérus pour qu’il puisse s’accrocher à sa paroi et se nourrir de cette façon. Auparavant il a été possible d’effectuer des expériences car la recherche fondamentale est à la base de tout.
On s’est aperçu que jusqu’à ce stade d’implantation, les cellules qui donneront l’embryon savent tout faire. Elles sont capables de produire du cerveau, du foie, de la peau etc, comme l’œuf. Mais elles ne peuvent pas remplacer l’œuf, parce que seul celui-ci a le pouvoir organisateur de faire un individu.
En utilisant le blastocyste d’une souris blanche, et celui d’une souris noire, si on prélève une cellule parmi celles qui donneront l’embryon dans le blastocyste de la souris noire, et qu’on le place dans l’ensemble de l’embryon de la souris blanche, une fois qu’on aura trouvé une mère porteuse pour accueillir ce « monstre », on aura une souris noir et blanc. Cela signifie que sa peau sera chimérique, mais ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas uniquement le cas de sa peau. On a les moyens de savoir que tous les organes sont chimériques, avec une seule cellule, et en prenant n’importe laquelle d’entre elles. Chaque cellule est donc totipotente. On avait découvert cela à la fin des années soixante-dix.
|
|
|
Après quoi, M H KAUFMAN et M EVANS, lequel a reçu le prix Nobel 2007, ont découvert un moyen de mettre ces cellules en culture, ce qui n’était pas très compliqué, mais l’est devenu car ils ont mis ces cellules en culture et se sont débrouillés pour qu’elles restent dans cet état : totipotentes, capables de proliférer. Si on les avait laissées dans l’embryon, elles auraient donné tous les organes et organisé une souris. Elles sont demeurées totipotentes et ont continué à se multiplier. On les transplante d’un récipient de culture à un autre pour changer de milieu, pour qu’elles ne s’empoisonnent pas avec leurs déchets et qu’elles aient de quoi se nourrir, et elles sont « quasi immortelles ». Des dérives doivent exister, aussi faut-il toujours mettre le terme « immortalité » entre guillemets. Qu’est-ce que l’immortalité ? C’est de la philosophie, et je n’entre pas dans ces considérations, mais elles ont une durée de vie très grande. C’est une source extraordinaire de cellules embryonnaires totipotentes.
Pour tous les embryologistes, cela est extraordinaire ; et nous essayons de savoir ce qui se passera entre le stade où tout est totipotent et le stade où se forme de la peau, du cœur. Cela se passe en quelques heures au niveau de l’embryon, et on ne peut pas étudier cela. Mais quand on possède toutes ces cellules qui peuvent tout faire en réserve, on peut jouer avec elles. La science, la recherche, est une sorte de jeu intellectuel.
À la suite de cette réussite, tout le monde était ravi, mais malheureusement, cela ne fonctionnait que sur la souris, et sur une souche de souris, la souche 129. Des essais étaient réalisés sur d’autres animaux, et cela ne marchait pas. En 1998, James THOMSON, aux États-Unis, qui travaillait grâce à des fonds privés, j’insiste sur ce fait, a utilisé des embryons humains qui n’avaient plus d’intérêt pour les parents, et qui ont été donnés à la science, et il a réussi la même expérience. C’est à partir de cette date que le public a entendu parler des cellules souches, alors que les scientifiques nous les connaissions depuis longtemps. Cela changeait évidemment complètement d’intérêt, car c’était une sorte de réserve que nous avions et qui était extraordinaire. Mme Laure COULOMBEL a très bien expliqué l’histoire des fibroblastes, des cellules de peau qu’on transforme en cellules souches,
Cependant un fait concernant les cellules souches de souris publié dans la littérature scientifique n’a pas un grand retentissement, mais je le trouve assez « drôle ». En effectuant certaines manipulations, on s’est aperçu que dans des conditions de culture de cellules souches classiques, dans lesquelles on permet à celles-ci de se différencier, on obtenait non seulement des tissus, comme les muscles, la peau, le foie, qui se développaient, mais aussi des cellules germinales, c’est-à-dire des gamètes. Ceux-ci font la méiose, c’est-à-dire que leur patrimoine génétique se divise en deux, comme pour tous les gamètes. De plus, ils peuvent se différencier en ovocytes, tout à fait convenables, qui se développent par parthénogenèse, dans d’autres cultures, avec d’autres ingrédients, des spermatozoïdes. On arrive donc à obtenir des lignées dites « spermatogoniales », c’est-à-dire des cellules qui sont des précurseurs de spermatozoïdes. On peut les mettre en congélation, revenir dans dix ans et, en ajoutant quelques ingrédients, on peut obtenir de véritables spermatozoïdes. Que fait-on avec ceux-ci ? Lorsqu’on travaille avec la souris, on fait ce que l’on veut. Justement, ils ont pris un ovocyte de souris normale, qui sera blanc par exemple, et ce spermatozoïde, qui n’est pas tout à fait tel, et on met le noyau dans l’ovocyte, on obtient des petites souris viables.
Imaginez que l’on fasse cela avec l’homme ! Il faut avoir de l’imagination. On aurait alors des enfants qui auraient eu comme père quelqu’un qui n’a existé que sous la forme d’une culture de cellules. Par ailleurs, ce patrimoine génétique qui représente ce « père » existe en culture, on le congèle, et dans cent ans, peut-être, pourra-t-on encore avoir des descendants de ce père fictif. C’est une « avancée » des biotechnologies qui nécessite réflexion.... Je m’arrêterai là…
Je vous remercie beaucoup Madame LE DOUARIN, votre exposé était très rafraîchissant, et un peu vertigineux à la fin.
8 M. Hervé CHNEIWEISS, Directeur du laboratoire de plasticité gliale, Centre de Psychiatrie et neurosciences (INSERM), Membre du Conseil scientifique de l’OPECST.
Pour ceux qui ont été enthousiasmés par l’exposé de Nicole LE DOUARIN, toujours aussi didactique et merveilleux, et qui souhaiteraient retrouver les bases de ce qu’elle a expliqué, avec des discussions sur un plan éthique, je recommande dans « Médecine sciences » un certain nombre d’articles qui reprennent ses travaux chez la souris, et un éditorial de René FRYDMANN, du numéro d’août-septembre, sur les questions liées à ces problématiques éthiques.
Nous changeons de sujet, puisque en passant des cellules souches, à un domaine différent, celui des neurosciences. Pourquoi s’y intéresser dans le cadre de la révision des lois bioéthiques ? On a évoqué la notion de réciprocité et la notion d’identité personnelle. Qu’est-ce qui fonde plus notre identité personnelle que l’activité de notre cerveau, dont il est à la fois l’origine et l’expression ? Que voulons-nous ? Pourquoi le voulons-nous ? Ces questions, chargées hier du lourd mystère d’une insondable « nature humaine », constituent aujourd’hui des objets d’études rationnelles, quantifiables, visualisables par des techniques de plus en plus sophistiquées.
En matière de neurosciences, on a assisté à au moins deux ruptures. La première, c’est la notion d’un renouvellement cellulaire, et plus généralement de la plasticité du système nerveux. Non seulement, nous disposons de cinq cents milliards de cellules dont certaines sont capables d’en régénérer d’autres, en permanence, on restructure les contacts (environ cinquante à cinq cent mille contacts pour les cellules de type neurones), mais également, on a découvert que les trois cents ou quatre cents milliards de cellules gliales qui constituent la principale population de notre système nerveux, et dont une sous-population est celle des cellules souches, est capable, également, de communiquer, d’intégrer de l’information et de participer à l’activité cérébrale, qui est permanente. Notre cerveau représente, au mieux, 3 % de notre corps, mais on consomme plus de 25 % de notre métabolisme énergétique pour l’activité de ce cerveau.
Notre constitution, et la charte des droits fondamentaux à l’échelle de l’Europe, consacrent les principes généraux, de dignité, de liberté, d’égalité, de solidarité, de citoyenneté, de justice, d’intégrité, et d’inviolabilité de la personne, en mettant l’accent sur le consentement éclairé, la protection des données à caractère personnel. Ces principes sont déclinés dans nos lois pour ce qui concerne les caractéristiques génétiques d’une personne, et ce que l’on pourrait appeler le « corps numérique » c’est-à-dire les données personnelles informatisées. Nicole QUESTIAUX et Anne FAGOT-LARGEAULT ont déjà expliqué la raison pour laquelle notre corps ne nous appartient pas, pourquoi nous ne pouvons pas en faire n’importe quoi, le consentement éclairé étant nécessaire, mais pas forcément suffisant pour l’utilisation de n’importe quel procédé. Face à une certaine tendance du libéralisme légal, de savoir pourquoi nous n’aurions pas le droit de faire n’importe quoi, d’utiliser n’importe quelle molécule, ou n’importe quel procédé à partir du moment où nous y consentons, nos principes fondamentaux imposent que la société ait un droit de regard sur le corps qui, manifestement, ne nous appartient pas. Mais qu’en est-il des possibilités d’intervention sur les activités cérébrales ?
Les possibilités d’intervention sont aujourd’hui multiples sur le système nerveux, que ce soit avec des molécules chimiques, ou des procédés plus ou moins invasifs, de type imagerie cérébrale, stimulation magnétique trans-crânienne, implants ou neuro-prothèses. Ces interventions surviennent d’une part, dans un contexte médical, comme la révolution qu’a constituée la stimulation à haute fréquence pour des maladies de Parkinson, résistantes au traitement classique, et, d’autre part, dans des circonstances extra médicales, par l’utilisation des psycho-stimulants depuis l’aube de l’humanité, dans des contextes plus ou moins récréatifs et plus ou moins légaux. En effet, l’usage des drogues est considéré par certains anthropologues comme l’une des caractéristiques de l’espèce humaine, même si l’on sait aujourd’hui que les grands singes sont capables de faire macérer des fruits, et de s’enivrer ensuite en consommant le produit alcoolisé qui en a résulté. Manifestement, on élargira l’usage de drogues aux primates. Ces possibilités nouvelles de modification des comportements, qu’ils soient végétatifs comme l’appétit, le sommeil ou la sexualité, ou cognitifs comme l’humeur ou la mémoire, nécessitent une réflexion approfondie car ces types d’interventions ne sont pas explicitement couverts par la législation en vigueur portant sur le respect de la vie privée et la protection des données.
La question fondamentale est celle du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Si au cours des dernières années, dans le champ de la génétique, ou dans celui du « corps numérique », c’est-à-dire toutes les données issues des réseaux et de l’informatique, on a assisté à une extension du champ légal de protection, dans le champ des neurosciences aujourd’hui, on trouve finalement peu d’éléments de protection au regard des possibilités.
L’aspect médical étant relativement bien encadré, je l’aborderai rapidement, sauf, comme pour la génétique, pour souligner la forte disparité existant entre une réglementation extrêmement stricte pour les médicaments, et une réglementation faible, voire inexistante, pour les procédés du type imagerie cérébrale et les dispositifs non invasifs, comme la stimulation magnétique trans-crânienne, voire même actuellement, pour certains implants qui ne sont pas soumis en particulier à une autorisation de mise sur le marché.
Il est impossible d’énumérer les domaines d’application de la neuropharmacologie. Cependant, il convient de prendre en considération le développement de formulations permettant la délivrance de molécules, avec effet, sur une longue durée, supérieure à plusieurs mois et, grâce à des systèmes de patchs ou d’implants, éventuellement à l’insu de la personne. Cela peut être bénéfique dans certains cas, mais soulève des problèmes dans d’autres, vis-à-vis de l’autonomie de la personne.
Parmi les neuro-prothèses permettant de traiter les mouvements anormaux involontaires, pour pallier les déficits sensoriels, la vue ou l’audition, intervenir sur des troubles de l’humeur, ou des troubles répétitifs du comportement, comme les troubles compulsifs, il est essentiel de distinguer, celles qui restent sous le contrôle du patient (lorsque vous installez un stimulateur à haute fréquence, pour un parkinsonien, il peut l’allumer ou l’éteindre quand il le souhaite), de celles qui créent une interaction avec un ordinateur, des données s’échangent alors en permanence avec cet ordinateur. Il s’agit donc de la dépendance avec un capteur externe et un système intégrateur expert soulevant immédiatement la question de la réglementation de l’accès aux données et du risque d’intrusion.
Il va de soi que le consentement éclairé pour un traitement, chimique ou par implant cérébral par exemple, est un pré-requis nécessaire mais ce consentement éclairé n’est nullement suffisant car la puissance publique est garante des principes d’intégrité et d’inviolabilité du corps humain, et c’est bien sur ces principes que nous ne sommes pas libres de faire n’importe quoi de notre corps.
De ce point de vue, il est très important de se rendre compte qu’il y a eu une autre révolution conceptuelle dans le cerveau. Longtemps, on a considéré le cerveau comme un arc réflexe : un stimulus, une perception, et une action en réponse à cette perception. Ce n’est pas du tout ainsi que fonctionne le système nerveux en général et le cerveau en particulier qui est une machine à anticiper le monde, à l’imaginer ; et la perception ne sert qu’à confronter cette anticipation par rapport à la réalité. Nous ne sommes donc pas des boîtes qui perçoivent des mondes, nous vivons à l’intérieur de notre cerveau, le monde. Nous possédons en permanence des systèmes de connexions de cellules, des réseaux, qui incarnent à l’intérieur de nous la scène que nous percevons autour de nous. Le fait que l’image du monde existe en nous, que l’hallucination est simplement une réalité perçue, mais non vraie, par rapport à ce qui existe, change également la conception que nous devons avoir de la protection de ces données personnelles, ou de ces fonctionnements personnels, au regard des procédés qui apparaissent aujourd’hui.
J’avais promis à Paul BENKIMOUN, (journaliste au Monde) de lui montrer une page de la une du Monde, des 11/12 novembre derniers, car elle est révélatrice. Sur la même page, vous trouvez l’annonce de Facebooks, (site de relations sociales, jusqu’à présent gratuit qu’utilisent les adolescents pour participer à des groupes de discussions, ce qui permet à beaucoup de vendre maintenant les profils et les données personnelles de ses utilisateurs), un article rapportant des progrès en cours tant dans le domaine de l’art, puisque c’est une image artistique, que dans le domaine des stimulations, par implant cérébral.
Le législateur devra s’intéresser à ces domaines car nous évoluons dans des sociétés de la performance et de la compétition, qui prônent de façon implicite le libéralisme légal dans lequel chacun serait libre d’utiliser ou de refuser la drogue ou le dispositif de son choix à partir du moment où cela ne nuit pas à autrui. J’indiquais qu’il avait des limites.
À l’appui des propositions libérales, un auteur comme Wrye SENTENTIA met en cause les tentatives de manipulations mentales développées aux États-Unis par l’État fédéral ou ses agences, depuis l’utilisation de certaines substances pour « aider » l’interrogatoire de suspects de crimes, jusqu’au contrôle de populations « à risque » (prisonniers agités, foule se précipitant sur une distribution de nourriture..) ou le projet des cartes de référence des activités cérébrales humaines. Sont mis également en cause le fort coût (19 milliards de dollars annuels) et la faible efficacité (cas de la Prohibition des années 1930, ou de la consommation actuelle de cannabis) de la lutte contre les trafics de drogue
Dès lors qu’un certain nombre de molécules ou de dispositifs sont à disposition, il existera une incitation pour ceux qui savent en user ou comment se les procurer, de pouvoir en faire l’usage. Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si une communauté d’individus réellement libres d’agir selon leur seul libre-arbitre existait. À partir de là, il est évident que nous ne sommes pas libres, non seulement vis-à-vis de la loi, mais aussi parce que le monde marchand se met autour de nous, pour ne pas nous laisser libres de notre choix « vendre du temps de cerveau disponible » à des entreprises commerciales, pour citer un président- directeur général d’une chaîne de télévision.
Aujourd’hui, les possibilités d’influence sont plus directes encore. Il a été démontré qu’une molécule, l’ocytocine, normalement impliquée dans l’éjection du lait chez la jeune mère, l’est également dans les processus d’amélioration de la confiance en soi. Il n’en a pas fallu plus pour qu’une société basée en Suisse mette à disposition un spray nasal à base d’ocytocine pour lutter contre la timidité, ou contre le stress ou l’anxiété de la performance. Je ne sais pas si dans le futur (c’est peut-être déjà vrai aujourd’hui), ce type de spray ne sera pas utilisé dans les négociations commerciales, ou mis en tête de gondole dans les supermarchés, comme on diffuse aujourd’hui une odeur de pain lorsque vous vous approchez du rayon de pain, ou une odeur de fromage pour le rayon correspondant. La question de l’utilisation de ce genre de procédé est importante.
L’amélioration de la performance d’une façon générale ne semble pas condamnable si elle a pour objet d’aider au bonheur et à l’autonomie de l’individu (faire voir les aveugles ou aider les paralytiques), sans en faire payer le prix aux autres. Toute la question est de savoir quel sera le prix social de l’amélioration de la performance ? Comme personne ne le sait, il nous faudrait d’abord évaluer les conséquences du pouvoir que l’amélioration des performances de l’un, peut avoir sur les conditions de vie de l’autre. Comment contrôler l’amélioration de la performance quand il s’agit d’avancement scolaire, de promotion hiérarchique, de pouvoir de subordination intellectuelle, tout en évitant l’injonction du « tous dopés » pour survivre? Ce n’est pas de la science-fiction. Aujourd’hui, trois millions et demi d’enfants d’âge primaire aux États-Unis sont traités par le Méthylphénidate, et on sait que le but majeur de ce traitement consiste à obtenir le calme dans les classes. Il existe une corrélation parfaite entre le niveau de revenus des parents et le taux de médicalisation sous Méthylphénidate des garçons en général.
Il en découle, par conséquent, un autre aspect du coût social qui est du registre de la discrimination. Pour opérer dans un réel environnement de libéralisme cognitif, il faut transformer le procédé d’amélioration en bien public, accessible à tous, dont personne ne puisse être privé, et dont l’usage n’épuise en rien la ressource. Il faut dès lors créer un nouveau garant, une nouvelle instance de régulation, assurant le droit pour tous au procédé d’amélioration. Finalement une Agence Nationale de l’Amélioration Cognitive chargée d’évaluer le procédé, son innocuité, sa réelle efficacité, son accessibilité, etc. De telles agences existent déjà, par exemple dans le domaine de la Santé, ne seraient-elles pas transposables au domaine des performances cérébrales ?
Un problème fondamental réside dans la vision mécanique d’un « cerveau-machine » permettant l’optimisation des variables biologiques et fonctionnelles au fur et à mesure qu’elles sont connues : niveau hormonal, taux de neurotransmetteurs, adaptation du nombre et de la qualité des cellules actives, ajout de circuits complémentaires de soutien ou de secours (les neuroprothèses). Le neurobiologiste se substitue alors au grand horloger de l’univers des conceptions déistes.
Le préjugé est qu’il existe une universalité du temps sur laquelle chaque horloge peut être réglée et toute variation à la norme doit être corrigée. MARX, DARWIN, FREUD et EINSTEIN ont chacun pour sa part, fait voler en éclats le schéma mécanique, de l’humain dans un monde physique social, évolutif et relatif. Or, comme je l’ai signalé, au regard de la conception actuelle du cerveau, anticipateur, nous savons sur des exemples précis qu’il ne suffit pas simplement d’être quantitatif dans le système nerveux, pour être qualitatif.
Nous avons des exemples dans la littérature, tels que la nouvelle de BORGES, « Funes ou la mémoire », où des patients, en particulier le cas de l’un d’entre eux, Shereshevkii, qu’avait rapporté le neurologue russe LURIA. Ces exemples montrent que des individus hypermnésiques, qui retiennent tout, ce que chacun souhaiterait pouvoir faire, puisque 80 % des gens considèrent que leur mémoire est insuffisante, sont incapables d’extraire le moindre sens au monde qui les entoure, tout en s’en rappelant tous les détails. Il a été démontré que lorsqu’on n’extrait pas le sens, l’information pertinente, on devient finalement malheureux et incapable d’agir et de projeter sur le futur. Les expériences récentes sur des patients amnésiques après lésions de l’hippocampe confirment le lien entre souvenir organisé et capacité de projection vers le futur. La mémoire n’est pas uniquement un stockage ; c’est aussi la capacité d’anticipation sur les événements. De ce point de vue, il est très important de ne pas croire qu’il suffit, en matière de neurosciences, d’ajuster la quantité pour avoir la qualité.
Certes, les neurosciences permettent la caractérisation d’associations de plus en plus pertinentes et précises entre des cartes fonctionnelles d’activité cérébrale et des comportements individuels dont l’agressivité, l’impulsivité et la violence. Dans les pays anglo-saxons, les neurosciences sont ainsi déjà convoquées pour caractériser la responsabilité pénale. La demande sécuritaire de plus en plus importante incite les gouvernements à rechercher des indicateurs biologiques de dangerosité de l’individu.
Mais il est également très important, à cause de la plasticité que j’ai évoquée, de réévaluer notre conception dans un certain nombre de domaines, comme celui de la responsabilité légale. Sans m’aventurer sur des terres qui me sont moins familières, deux visions s’opposent : à savoir « il savait à quoi il s’exposait, il en avait la liberté, il l’a fait, donc peine plancher » ou la vision évolutionniste d’un cerveau plastique en constante évolution, qui se demande quelle est la valeur de la peine au regard de la possibilité de réintégration. Cependant, un projet de loi qui vient d’être examiné par le Conseil d’État porte sur la détention préventive de criminels sexuels ou leur internement en milieu fermé, même après l’exécution de la peine à laquelle ils ont été condamnés.
Dans le domaine du prédictif, il serait en effet particulièrement heureux de pouvoir savoir si tel ou tel criminel peut s’avérer demain dangereux. Que faire aujourd’hui ou demain si l’imagerie révèle une faible capacité de l’individu à maîtriser des pulsions violentes ou à réagir de façon inappropriée à une stimulation sexuelle ? Après la bosse du crime issue de la phrénologie, après le chromosome du crime issu de l’observation d’un Y supplémentaire chez certains condamnés, après le gène du crime issu de l’observation de certains variants de la monoamine oxydase A en relation avec un comportement violent, aurons-nous demain l’image cérébrale du crime ? La question est donc bien une nouvelle fois de déterminer la valeur prédictive réelle du test envisagé, et non de valider de manière pseudo scientifique des préjugés sociaux.
On voit apparaître à l’heure actuelle des études qui comparent le profil d’activation en image 3D, et codée en fausse couleur, très belle, d’un sujet normal, par rapport à un sujet dit psychopathe. Dans l’Iowa, les IRM fonctionnels ont été testés pour le tribunal. Des données de neurosciences ont été utilisées pour retarder la peine de mort aux États-Unis, ce qui en soit est positif, en prétextant de l’immaturité cérébrale, pour obtenir que la peine de mort soit repoussée de quinze à dix-huit ans. La question qui apparaîtra, sera celle de savoir ce que ces images signifient. La justice cherche toujours à établir des faits, et en déduit l’idée qu’il existe une vérité neuropsychologique, inscrite au sein des circuits cérébraux.
Comment traiter l’adhésion qu’un sujet témoin d’une scène violente, peut avoir vis à vis d’un souvenir erroné ? Il y croit, et en y croyant, l’image cérébrale sera celle de quelqu’un qui adhère à son souvenir. Mais il n’existe pas d’image cérébrale du vrai. Il n’existe qu’une image cérébrale de quelqu’un qui croit qu’il dit le vrai. L’image cérébrale, si elle s’avère possible, montrera que le sujet ne se ment pas, et ne ment pas au tribunal, mais en aucun cas ne montrera qu’il dit « la » vérité, il exprime seulement « sa » vérité.
Cette vérité serait-elle meilleure si la mémoire était soutenue ? C’est la question de la neuropharmacologie et d’éventuelles techniques permettant d’améliorer la mémoire. Une grande partie de la justice étant basée sur le témoignage, ne serait-il pas heureux en effet de pouvoir bénéficier d’une remémoration plus riche, permettant au témoins ou à l’accusé de relater avec plus de détails le déroulement des faits. Le sous-entendu de cette acceptation est que ces informations obtenues en levant la barrière de la volonté de l’individu, serait plus exactes et permettraient une justice plus efficace, ceci est encore une erreur. La levée d’une inhibition à la remémoration, ou la facilitation de la venue à la conscience d’une image de mémoire ne garantit en rien la validité du témoignage. Le cerveau est une puissante machine à émettre des hypothèses sur le vrai et le faux, et à confronter sa perception du réel à ces hypothèses. Mais il n’existe pas d’image neurale du vrai.
Utilisera-t-on demain des IRM pour débattre au tribunal de discrimination raciale ou sexiste ? Mais qui passera le test : l’accusé, les membres du jury, le juge, les témoins, les policiers ayant mené l’enquête, le juge d’instruction ? Au-delà de ces extensions, qui soulignent la question du coût et de la disponibilité des machines, le problème central reste celui de la nature de l’information apportée par la technique. C’est encore ici la distance entre l’acquisition d’un fait, une image cérébrale, et son interprétation. Pour reprendre Max WEBER, il existe une différence de nature entre les caractéristiques du fait scientifique et celles des valeurs.sociales. Axel KAHN, en citant ARISTOTE, a bien montré que, dans le domaine des valeurs, existait une certaine permanence.
Le paradoxe serait grand de voir la science, vecteur essentiel d’émancipation et d’élargissement du champ des libertés, devenir soudain l’instrument d’un contrôle des consciences et des comportements. Pour qu’une telle perspective reste à distance, nous devons repenser la pensée à l’aune des nouveaux moyens que nous offrent les neurosciences.
Pourtant, le rêve déterministe reste toujours le même : essayer de plaquer des schémas préétablis: établir, par la description anatomique ou anatomo-fonctionnelle, une relation simple, linéaire, permanente entre des gènes, des cellules, des circuits et des comportements. La biologie récente semble servir en première analyse ce projet. D’abord, en ayant fourni le catalogue des gènes exprimés via le décryptage du génome humain. Maintenant, en offrant une analyse de plus en plus fine de la neuro-anatomie et bientôt un schéma d’activité cérébrale de référence.
Mais plus ce projet se complète, plus le rêve déterministe s’éloigne car nous mettons en évidence sans cesse le rôle des interactions entre le biologique et son environnement ; l’occurrence d’événements et l’histoire particulière de l’individu jouent un rôle. Le décryptage du génome a ouvert d’immenses champs de connaissance, et je m’inscris en faux contre le fait que la génétique n’aurait pas apporté énormément de choses. Il fallait six mois pour faire un diagnostic de tuberculose, il y a quinze ans ; il faut une heure aujourd’hui, grâce au décryptage et à la PCR (Réaction en Chaîne par Polymérase) Le marché des biotechnologies, entièrement basé sur les avancées de la génétique, et ensuite de la génomique (le « omique » définissant le passage au très haut débit), a totalement bouleversé la connaissance du vivant et la pratique de la médecine. Y compris la connaissance de la diversité humaine elle-même, avec la publication récemment du génome d’un des pionniers de ce séquençage, Craig VENTER. Alors que nous pensions que nous avions trois millions de différences entre nos chromosomes paternels et maternels, nous découvrons grâce à de nouvelles techniques, que nous en possédons au moins quinze millions. Cela vous donne une idée du champ qu’il reste découvrir pour la pharmaco-génomique ou les traitements.
Dans son avis n° 98 sur la biométrie le CCNE constatait : « le glissement de l'identification à celle des comportements et donc de la personnalité, apparaît comme un risque sinon comme une inclination naturelle. Les trois questions les plus angoissantes sont donc celles du glissement du contrôle de l'identité à celui des conduites, celle de l'interconnexion des données et leur obtention à l'insu des personnes concernées. » Dans son avis n° 20 portant sur les implants, et tout particulièrement les neuro-prothèses, le Groupe européen d’éthique soulignait également des risques d’atteinte à la dignité humaine, évidemment pour des dispositifs implantés à but professionnel ou d’amélioration de la performance pour les militaires par exemple, mais également pour les dispositifs à buts médicaux notamment des implants cochléaires chez les enfants sourds. Il existe des débats sur l’opportunité de poser ou pas chez des enfants sourds des implants cochléaires, en raison de la relation qu’ils entretiennent avec la communauté des sourds, et sur la dépendance à la machine de personnes qui retrouveraient la vision ou la marche, en dépendant de systèmes d’interface homme/machine.
Notre activité cérébrale n’est pas seulement la synthèse de l’activité de nos gènes et la coordination de nos réseaux, même sculptés par notre histoire personnelle. Notre activité cérébrale se développe dans une anticipation des événements de notre environnement ; elle se développe dans une projection anthropologique et socialisée de notre monde. Nous anticipons l’action de l’autre, et la figure de l’autre agit sur notre activité neurale. Axel KAHN a rappelé que le bien est ce qui permet la réciprocité à l’autre. En termes de neurobiologie pure, nous sommes sculptés par le visage de l’autre. Nous n’existons pas en termes neurobiologiques sans la sculpture qu’imprime notre environnement sur notre capacité de penser. Et la pensée elle-même sculpte à son tour notre système nerveux. Dès lors, quelles que soient les contraintes physiques et biologiques bien réelles dans lesquelles se déroulent nos pensées, nous devons prendre en considération la plasticité de notre système nerveux, sa capacité sans cesse à évoluer et admettre que la liberté de pensée est nécessaire à notre capacité de survie en individu social. Nous devons exister avec les autres et nous existons par les autres. Ceci doit nous conduire à placer des garde-fous à la dérive sécuritaire qui conduit aujourd’hui à vouloir rendre pénalement responsables des malades mentaux, à décréter la double peine d’obligation de traitement et d’enfermement à vie de certains criminels.
L’histoire des neurosciences, malheureusement, comme cela a déjà été évoqué pour d’autres domaines de la biologie, a été jalonnée de drames liés aux préjugés sociaux. Je rappelle la stérilisation de masse des malades mentaux en Scandinavie et aux États-Unis avant-guerre, l’usage de la lobotomie par Egas MONIZ, prix Nobel 1949, pour des homosexuels considérés alors comme déviants, l’usage de neuroleptiques dans le goulag de l’ex-Union Soviétique, pour ne pas citer d’autres prisons à l’extérieur du territoire américain.
Face à la croissance rapide des connaissances scientifiques et médicales et celle des progrès technologiques, le Groupe européen d’éthique (GEE) avait de nouveau proposé d’interdire les implants cérébraux pouvant être utilisés comme fondements du « cyber-racisme » pour modifier l’identité, la mémoire, la perception de soi et la perception d’autrui, pour améliorer la capacité fonctionnelle à des fins de domination, pour exercer une coercition sur des personnes qui n’en soit pas dotées.
D’une façon générale, il me semble que les principes éthiques et légaux qui ont guidé l’encadrement des données personnelles issues de la génétique et des échanges informatiques devraient s’appliquer également aux connaissances issues des neurosciences. En outre, il conviendrait d’établir un dispositif d’autorisation de mise sur le marché, assortie d’évaluations ad hoc pour tout procédé ayant comme objectif ou conséquence d’agir sur les capacités cognitives des individus. Dans une société de l’information et de la communication, nous sommes forcément dans une société du cerveau de chacun. On constate toujours cette tension entre la proclamation d’une part, dans la charte, ou dans la constitution, que la société est faite pour l’individu qui doit primer sur tout, et d’autre part, que la société, pour reprendre les termes de Michel FOUCAULT, doit se défendre. Une société de l’information et de la communication est forcément une société dans laquelle le cerveau doit être protégé contre son instrumentalisation. Par ailleurs, les molécules et procédés issus des connaissances en neurosciences doivent être mis au service de la restauration des fonctions perdues, et de l’accroissement des libertés d’agir, et non permettre l’assujettissement à une norme sociale.
Je remercie Hervé CHNEIWEISS d’avoir accepté de conclure cette matinée.
J’accueille le professeur Arnold MUNNICH, qui a la gentillesse de venir nous rencontrer cet après-midi à un double titre : celui de professeur de médecine, connu de tous, et celui de conseiller auprès du Président de la République en matière de recherche, et notamment sur les sciences du vivant. Je lui céderai la parole pour introduire les débats de cet après-midi. Avant d’aborder les travaux en cours dans les enceintes internationales, nous évoquerons les tests génétiques et les médecines prédictives, ce qui s’inscrira dans la suite logique des propos du professeur MUNNICH à qui je donne.
8 M. Arnold MUNNICH, Professeur de médecine, Chef de service, Centre de génétique médicale, Hôpital Necker-Enfants malades, Membre de l’Académie des Sciences
Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très honoré et très heureux d’être parmi vous aujourd’hui. Les quelques mots d’introduction que je présenterai le seront à titre personnel. Vous avez rappelé que j’étais le conseiller du Président de la République pour les questions relatives à la recherche biomédicale et la santé, mais je m’empresse de vous préciser que je ne ferai aujourd’hui aucune annonce, que je ne vous livrerai aucun scoop.
D’ailleurs, je n’en ai pas la qualité puisque les états généraux de la bioéthique sont confiés au ministre de la Santé, de la jeunesse et des sport, et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sous couvert de l’Agence de la biomédecine dirigée par Carine CAMBY, et que ceci est en cours d’élaboration, pour une prise d’effet début 2009, conformément à un calendrier défini. Par conséquent, ce n’est pas à moi qu’il revient de faire de quelconques annonces sur le fond ou sur la forme. Je me garderai donc bien d’empiéter sur les attributions de ces responsables.
Monsieur le Président, vous m’avez demandé de m’exprimer en début de séance, sur la question des perspectives envisagées et je dois admettre que cela m’a fait méditer car je me suis demandé en vérité ce que vous entendiez par là. En effet, à mon avis, les perspectives tournent autour de deux ou trois enjeux majeurs que sont l’extension du diagnostic génétique préimplantatoire, du HLA (antigène leucocytes humain) et ses limites, et surtout de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et le clonage thérapeutique. J’estime que c’est sur ce sujet que les questions risquent d’être les plus délicates et les plus sensibles. Cependant, dans ces deux cas, je pense que les perspectives que nous brosserons ensemble aujourd’hui sont déjà quelque peu dictées par la loi. Cette dernière prévoit, en effet, un débat qui aura lieu en 2009, une réflexion en profondeur avant toute prise de décision, et je crois que les perspectives consistent déjà à tenir collectivement les engagements pris lorsque la loi a été promulguée, et que le moratoire a été mis en route.
S’agissant du clonage thérapeutique et de la recherche sur les cellules souches, vous savez comme moi que la recherche sur l’embryon humain est interdite, en vertu de l’article 25 de la loi du 6 août 2004. Le premier alinéa prévoit toutefois une dérogation, pour une période de cinq ans, à compter de la publication du décret en Conseil d’état : les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative, d’efficacité comparable, dans l’état des connaissances.
Le cadre est fixé par la loi et il existe une disposition dérogatoire, un moratoire de cinq ans au terme duquel le législateur, à la lumière du débat qui aura eu lieu, pourra proposer un certain nombre de choix. Selon moi, trois options s’ouvriront au législateur :
- soit libéraliser et dépénaliser la recherche sur l’embryon, ce qui revient à supprimer toute restriction ;
- soit revenir en arrière, sachant qu’il y a des précédents comme les OGM, et que cela est possible techniquement ;
- soit prolonger le moratoire au terme du débat. J’ignore comment sortir de cette alternative à trois issues : libéraliser, revenir en arrière ou prolonger le moratoire.
En tout état de cause, j’ai confiance dans les institutions de notre pays et suis certain que nous respecterons le jeu du moratoire et que cela donnera lieu à un débat nourri avec une réflexion scientifique, éthique et sociétale. Je fais confiance à Carine CAMBY pour mener les débats de main de maître. Toutefois, conformément à ce qui est prévu dans la loi, l’Agence de la biomédecine devra produire un rapport sur les recherches autorisées et sur les résultats obtenus, et particulièrement sur la confrontation des résultats relatifs aux utilisations des cellules souches dites adultes ou dérivées du liquide amniotique – puisque cela est désormais possible – versus les résultats relatifs aux utilisations de cellules souches embryonnaires. Cet état des lieux est très important pour nous tous.
Cependant, en tant qu’ancien membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, je puis attester de la qualité et de la quantité des travaux de ce dernier. Sous la présidence d’Alain CORDIER et la direction de Carine CAMBY les dossiers ont été examinés sur le fond, en profondeur, des compléments d’informations ont été demandés à de nombreuses reprises ; nous nous sommes souciés de savoir quelle était la question réellement posée, de savoir s’il s’agissait vraiment d’une recherche cognitive, ou si était poursuivie une autre finalité. Des débats se sont déroulés au sujet de la conservation : il s’agissait de conserver des cellules souches embryonnaires ou des embryons non transférés dans le cadre d’un diagnostic préimplantatoire. Dans ce jeu de rôle, j’ai joué au « vilain petit canard », en pointant du doigt cette question de la conservation car j’aimerais savoir ce qu’il convient d’effectuer lorsque l’on conserve des cellules souches embryonnaires, ou des embryons non transférés dans le cadre d’un diagnostic préimplantatoire. La conservation des embryons congelés soulève déjà bien des problèmes, et je me demande ce qu’il adviendra de ces cellules que l’on va congeler au motif qu’elles sont atteintes dans le cadre d’un diagnostic préimplantatoire, et pour quelle raison les conserver.
J’ai donc veillé à demander à mes collègues qu’un projet scientifique soit associé à un projet de conservation. Je sais que l’Agence de la biomédecine, à laquelle je n’appartiens plus pour les raisons évoquées par Alain CLAEYS, sous l’impulsion de Carine CAMBY, réfléchit aux conditions de la conservation de ces cellules embryonnaires, et j’ai confiance en la qualité et la quantité de cette réflexion.
Néanmoins, j’estime que le rapport que produira l’Agence de la biomédecine devra être vraiment approfondi, et déterminer quelles ont été les questions scientifiques, si ces interrogations ont obtenu des réponses. Le fait de savoir si ces cellules embryonnaires sont les seules cellules, sans alternative, qui permettent d’aboutir à des lendemains meilleurs pour les patients, devra donner lieu à un débat contradictoire. Je jouais encore le rôle de « vilain petit canard », Carine CAMBY s’en souvient au sein du comité d’orientation de l’Agence, et demandais à tout moment à mes collègues si nous n’étions pas tombés dans la fascination technologique, si les questions posées étaient pertinentes, et si les réponses attendues étaient prometteuses.
Ce débat contradictoire entre nous a abouti à des autorisations parcimonieuses et à un encadrement de très bonne qualité, je peux en témoigner. Ni les uns ni les autres n’avons à rougir des autorisations données. Je ne voudrais pas que le législateur et l’opinion s’imaginent qu’aujourd’hui, les recherches sont bridées, que des possibilités thérapeutiques scientifiques apparues ne seraient pas totalement exploitées, car ce n’est pas le cas. Le dispositif actuel ne bride en rien l’essor de la connaissance. Je le trouve satisfaisant, les scientifiques ne sont absolument pas sous le boisseau. Les autorisations étaient données quand il était avéré que la question était pertinente, de qualité, et formulée par des scientifiques crédibles en raison de leur qualité, de leurs résultats antérieurs, de leur capacité à produire de la bonne science et des publications de haut niveau. Même si j’ai pu le craindre, je n’ai pas la sensation que nous soyons tombés dans la fascination technologique ou dans la chasse à je ne sais quelle pruderie scientifique qui aurait bridé l’avancée des connaissances. Je souhaitais en porter le témoignage, quand les projets étaient de qualité, les autorisations étaient données et nous avons su ne pas tomber dans la fascination technologique.
Encore faut-il souligner que les promesses faites sur les cellules souches embryonnaires, vous le rappeliez dans votre document Monsieur le Président, comme celles sur la thérapie génique, sont loin d’avoir été tenues. Il faudrait se garder de s’imaginer que si on libéralisait quelque peu les dispositions réglementaires, on obtiendrait, ipso facto, des avancées thérapeutiques insoupçonnées : ce n’est pas vrai. Si on libéralisait le dispositif réglementaire, je ne suis pas certain que cela s’accompagnerait d’un essor des connaissances. Je ne vois pas quel essor scientifique est bridé par le dispositif tel qu’il est.
Quant à la thérapie génique, sur laquelle nous avons aussi tenu des discours grandiloquents, comme ceux d’aujourd’hui, vingt ans après le clonage du gène de la myopathie de Duchenne, nous en sommes au même point : il n’existe toujours pas de thérapie génique. Certes, des progrès formidables ont été réalisés dans le traitement des maladies génétiques, mais comme par hasard, ce n’est pas la thérapie génique qui a permis de progresser. C’est l’avancée des connaissances qui a rendu possibles des scénarios thérapeutiques insoupçonnés si ces gènes n’avaient pas été clonés. Le gène est la cause de la maladie, mais le gène n’est pas forcément la solution, le remède. Sur le plan épistémologique, il convient d’opérer une différence entre les concepts : le gène est bien la cause des maladies génétiques, mais le gène ne constitue pas nécessairement la riposte.
Il convient aussi de sortir de l’idéologie du dogmatisme : ce qui était vrai pour la thérapie génique hier et encore aujourd’hui, l’est, me semble-t-il aussi pour les promesses des thérapies cellulaires. Je ne souhaiterais pas que l’on retombe dans les erreurs du passé et dans la fascination pour une science qui serait bridée par je ne sais quel parlementaire obscurantiste, moyenâgeux. Ce n’est pas le cas.
Par conséquent, si on nous explique que la recherche peut effectuer un bond en avant sans précédent, si on libéralise la recherche sur les cellules souches embryonnaires, il s’agit là d’un discours grandiloquent, non attesté par les faits. En rien le dispositif actuel n’a bridé l’essor des connaissances en matière de recherche cognitive et, ultérieurement, de recherche thérapeutique. Pour autant, ces recherches sont indispensables et la loi précise : « susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs… ». Or, avant d’aboutir à des progrès thérapeutiques majeurs, les recherches doivent être faites.
Ceci explique que, dans sa rédaction, cette loi a peut-être été imprudente en usant trop du terme « thérapeutique »
Vous avez tout à fait raison, car lorsque nous discutions les projets à l’Agence de la biomédecine, nous nous demandions si la finalité thérapeutique était aussi imminente. Or, elle ne peut l’être, dès lors qu’existent un énorme chantier cognitif et un grand enjeu de compréhension des anomalies du développement normal, préalable à tout projet thérapeutique. Vous avez raison, Monsieur le Président, la loi indique : « permettre des projets thérapeutiques majeurs » ; or, il y a les termes « thérapeutiques » et « majeurs » ; cela signifierait-il qu’il y aurait des projets thérapeutiques, éventuellement mineurs ?
Il ne faut pas que l’exécutif et le législateur aient peur du terme « fondamental ». La recherche fondamentale est nécessaire, et il faut pouvoir la revendiquer comme telle.
Effectivement, et vous le formulez mieux que moi. Il n’est pas nécessaire de subordonner la rechercher à quelques chimères finalistes, au premier rang desquelles on trouverait la thérapeutique. Ceci me rappelle une des premières expériences de fécondation in vitro et d’injection de spermatozoïdes dans l’ovocyte maternel qui a été autorisée, sans même l’autorisation de mener les recherches cognitives préalables à l’extension de ce dispositif.
Je me souviens aussi que des demandes d’agrément pour le diagnostic préimplantatoire étaient lancées par le dispositif réglementaire, alors même que les recherches sur l’embryon étaient interdites. Nous devions présenter des arguments pour faire valoir notre compétence en termes de diagnostic préimplantatoire, alors que nous n’avions pas l’autorisation de nous former à ces techniques. C’était là une situation paradoxale, et peut-être aurions-nous pu nous dispenser de cette préoccupation finaliste, ne pas avoir peur des mots et bien comprendre qu’une recherche thérapeutique, est précédée d’une recherche cognitive. Les recherches qui ont été autorisées l’ont été dans d’excellentes conditions ; il s’agit essentiellement de recherches cognitives, plus que thérapeutiques, sachant que la préoccupation thérapeutique est l’objectif à atteindre. En tant que scientifique, mon souci est de faire en sorte que le législateur soit éclairé et ne s’imagine pas que le dispositif actuel bride l’avancée des connaissances.
En outre, je constate que ce débat est très attendu par l’opinion, par toutes les familles de pensée, culturelles et cultuelles. Cette fois-ci, vous avez associé des juristes ; peut-être associerez-vous la prochaine fois des représentants des différentes familles de pensée. En tant que médecin qui accompagne au quotidien des familles atteintes de maladies génétiques, de maladies du développement, je sais que l’opinion au sens large attend ce débat qui ne saurait être limité à quelques éclairés, à quelques experts ; et je me félicite de constater que cette audition publique est suivie par de nombreux journalistes ; les thèmes débattus seront un sujet de communication auquel l’opinion demeure sensible car elle reste, collectivement, très attentive aux dérives en général, aux bêtises commises par les scientifiques dans le passé, et à ce qui pourrait être considéré, à tort ou à raison, comme une instrumentalisation du vivant. Un débat majeur et très attendu de société s’annonce donc sur la loi de bioéthique.
Je considère que l’Agence de la biomédecine et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) doivent jouer pleinement leur rôle de relais et de communicants car les débats internes au conseil d’orientation de l’Agence étaient passionnants et il faudrait trouver les moyens de les porter à la connaissance de l’opinion. L’Agence de la biomédecine comme le CCNE sont attendus au tournant et il est extrêmement important que leurs débats fassent l’objet d’une communication.
Les Français sont impatients, or il a été indiqué que l’année 2008 serait pratiquement une année « blanche » en termes de débats sur la bioéthique, alors qu’en réalité, ici et là, des initiatives, soit culturelles, soit œcuméniques sont prises, des familles de pensée se réunissent pour discuter entre elles. De même, en ce qui concerne l’accès aux origines, nous connaissons la position du législateur. Le secret des origines est fondé sur de très bonnes raisons, car une possibilité d’accès induirait une dissuasion au don de gamète. Cependant, des lobbies essaient d’exiger l’accès à la connaissance de leurs géniteurs biologiques, que l’on soit dans le cadre de l’adoption ou du don de gamète. Les Françaises et les Français sont très impatients de pouvoir débattre de ces sujets.
De ce point de vue là, que 2008 soit une année blanche surprend, alors qu’en réalité, il n’apparaît pas très opportun d’attendre un an et demi. Nous aurions pu commencer à débattre un peu plus tôt, d’autant que la présidence française de l’Union européenne commence en juillet 2008. À ce titre-là, à la fin de l’année, il est prévu un sommet réunissant celles et ceux qui travaillent sur la bioéthique, et c’est une occasion unique pour la France de faire entendre sa différence.
En Europe, la pensée prévalente et prédominante est fondée sur les points de vue utilitaristes des Anglo-Saxons ; j’estime que la présidence française devrait être l’occasion de faire entendre les différences non seulement hexagonales, mais également latines, judéo-chrétiennes, celles de l’Europe du Sud, qui, par timidité, voire pour des raisons linguistiques ou autres, n’a pas encore osé exprimer sa différence. Soyez assurés que mes collègues m’interrogent, qu’ils soient portugais, espagnols, italiens, grecs, et me demandent quand nous allons nous exprimer. Je me demande si, au fond, la présidence française et la réunion à la fin 2008 ne devraient pas être l’occasion d’exprimer haut et fort ce qui constitue notre singularité, et ce sur quoi nous sommes d’accord.
En conclusion, les perspectives consistent surtout à rappeler la méthode définie par la loi qui prévoit de commencer par débattre, d’attendre un rapport de l’Agence de la biomédecine, d’instruire et d’informer les Français, et d’examiner ensuite ce qu’il convient de faire. C’est une question de méthode, de respect des engagements pris et c’est là l’essentiel. Pour reprendre une formule de Frédérique DREYFUS-NETTER : « De la maîtrise de la production de nos lois, dépend la pérennité de nos valeurs. » Je crois qu’il convient d’avancer lentement, l’opinion française souhaite être associée pleinement à ce débat de société. Je ne suis pas sûr que l’utilitarisme soit la seule réponse à apporter aux questions qui soulèvent la passion et l’intérêt de nos concitoyens.
Je vous remercie de vos propos. Comme vous, les parlementaires ne souhaitent pas que l’année 2008 soit une année blanche. En ce qui concerne l’Office Parlementaire, avec mon collègue Jean-Sébastien VIALATTE, nous poursuivrons nos travaux, y compris par des auditions publiques. Mais nous pouvons aussi exprimer le souhait que les débats publics envisagés par l’exécutif, via l’Agence de la biomédecine, puissent commencer le plus tôt possible, et au cours de l’année 2008, si possible. En effet, j’attire votre attention sur la date butoir de cinq ans concernant la dérogation sur la recherche sur l’embryon. Passés ces cinq ans, l’Agence de la biomédecine ne pourra plus fonctionner ; on a donc l’obligation de traiter ce problème avant cette échéance.
Deuxièmement, je crois qu’il ne serait pas souhaitable que le débat public soit trop proche dans le temps de la loi ; un écart, un laps de temps entre ce dernier et la loi est nécessaire. Je me permets d’attirer votre attention sur ce sujet car nous partageons votre souhait d’éviter que l’année 2008 soit une année blanche pour la bioéthique.
Je propose de laisser place aux débats à la suite à l’intervention d’Arnold MUNNICH.
M. Roger GUEDJ
Ce n’est pas une question, mais un commentaire. J’ai été surpris par la phrase suivante : « Le gène est la cause, mais le gène n’est pas la riposte. » Il n’est pas possible de jeter le bébé avec le bain. On estime aujourd’hui que la thérapie génique n’a pas de sens ; or il faut rester dans un juste milieu. Pour donner une idée assez précise, je rappelle qu’un essai clinique a été mené sur la leucodystrophie, et que des résultats encourageants avaient été constatés sur deux enfants, il faut néanmoins attendre en prenant en compte la durée, le nombre de patients, et ne pas espérer des résultats merveilleux de la thérapie génique mais poursuivre les efforts dans ce sens.
J’ai indiqué que le gène est la cause, mais qu’il n’était pas la seule riposte. Permettez-moi de souligner que le bilan de la thérapie génique n’est pas glorieux, mais plutôt minable. On a intoxiqué les Français avec cette idéologie scientifique. Or le dogmatisme et la pensée unique n’ont rien à faire en science. En ce qui concerne les cellules souches embryonnaires ou la thérapie cellulaire, je ne voudrais pas que l’on bascule dans les erreurs du passé. C’est la raison pour laquelle j’ai tenu ce discours. Aujourd’hui, des avancées existent dans le traitement des maladies génétiques, mais on retrouve toujours le même scénario : on comprend un gène, on comprend sa fonction, et de la compréhension de la fonction de ce gène dérivent des idées thérapeutiques innovantes. Le gène est donc la cause, mais n’est pas forcément la seule riposte.
Vous évoquiez l’essai sur la leucodystrophie de mon ami Patrick AUBOURG, je vous rappelle qu’il s’agit d’une communication à un congrès, qui n’a même pas été soumise à publication et qu’on se trouve donc là complètement hors des usages par rapport aux règles de fonctionnement de la communauté scientifique. Cela a certes été annoncé, lors d’un congrès aux Pays-Bas, mais n’a pas été publié, ni validé. Ce n’est pas comme cela que nous fonctionnons.
C’est très bien d’avoir donné des espoirs aux patients mais ne s’agit-il pas de faux espoirs ? Sommes-nous certains de ne pas donner en pâture aux Françaises et aux Français, et en particulier aux malades, des promesses que nous serons incapables de tenir ? Cela fait vingt ans que nous agissons ainsi. Permettez-moi d’appeler à davantage de prudence dans la façon dont on s’exprime et dont on communique avec les patients.
Je me félicite d’entendre que l’accent doit être mis sur une recherche fondamentale qui soit, au moins momentanément, déconnectée des applications possibles qui font rêver et qui peuvent décevoir de façon aussi forte qu’elles ont fait rêver. Je ne crois pas qu’il s’agisse là d’une attitude scientifique, et les cellules de l’espérance portent mal leur nom.
La conséquence juridique de ceci est que la finalité thérapeutique cesse d’être le fait justificatif de pratiques dérogatoires au droit commun et que la fin ne justifie pas les moyens. La conséquence en droit, dans les lois en particulier quand les réalités thérapeutiques sont la justification de ce qui serait par ailleurs illicite, appelle une modification.
Il s’agit là d’une bataille que j’ai menée avec d’autres parlementaires de tous les horizons politiques et je dois avouer qu’elle n’a pas été gagnée. En effet, ceux qui étaient pour le transfert nucléaire et ceux qui étaient contre utilisaient systématiquement le mot: « thérapeutique ». Il n’est pas sérieux d’utiliser ce terme face à des malades en attente de traitement ; c’est plus qu’une erreur : c’est une faute. Je considère que le législateur doit comprendre que l’on peut revendiquer et justifier ces recherches pour faire progresser la recherche fondamentale.
TESTS GÉNÉTIQUES ET MÉDECINE PRÉDICTIVE
M. Alain CLAEYS
Nous traitons à présent des tests génétiques et de la médecine prédictive et je donne la parole à Anne CAMBON-THOMSEN.
8 Mme Anne CAMBON-THOMSEN, Directrice de recherche, CNRS, Professeur de médecine, Université Toulouse III, Membre du Groupe européen d’éthique
Chercheuse dans le domaine de l’immunogénétique, la génétique épidémiologique, je ne suis pas clinicienne, tout en étant docteur en médecine. Les mots qui viennent à l’idée sont prédiction, prévision, prévention et ils ont déjà été évoqués dans certaines des interventions précédentes. La médecine prédictive ou de prévision n’inclut pas seulement la génétique, les propos d’Hervé CHNEIWEISS ont d’ailleurs ouvert des perspectives qui montrent qu’il ne faut pas se tromper de cible : autant convient-il de réguler la génétique dans ce qu’elle apporte, autant un certain nombre de mesures utilisées pour réguler la génétique sont parfaitement adaptées pour d’autres domaines, ce qu’il ne faut pas omettre.
Prédiction, prévision, prévention et anticipation
Je m’exprimerais peu sur la prévention et la médecine anticipative, ce sont des moyens de prendre en compte ce qui est prédit ou prévu. La médecine anticipative conduit à la mise en place de moyens pour faire face le jour où une pathologie se déclare, et qu’un risque se réalise. La prévention conduit à la mise en place d’actions pour empêcher la réalisation d’un risque, la survenance d’une pathologie. La prévision inclut la décision et l’action, pas seulement le «dire » auquel peut se limiter la prédiction. La médecine prédictive ou de prévision n’inclut pas que la génétique, on citera l’imagerie, l’échographie, de nombreux domaines de la biologie. Cependant la génétique peut être considérée comme un exemple type.
Génétique et prédiction/prévision en santé : difficulté de la notion statistique de risque
Il existe différents degrés de capacité prédictive qui correspondent à différentes options prévisionnelles : les diagnostics pré symptomatiques des maladies qui s’appliquent aussi au diagnostic prénatal préimplantatoire. En outre, les dimensions génétiques ont quelque peu évoluées depuis la loi modifiée en 2004. Le risque accru, par rapport à certaines pathologies fréquentes, l’intervention de facteurs génétiques dans la capacité de répondre aux médicaments, la prévision de complications dans certaines maladies et le rejet dans les transplantations, illustrent ces évolutions.
Ces exemples font appel à des notions de risques, plus que de diagnostic. Ils laissent également la perspective de passer d’une dimension individuelle et familiale, attachée à la génétique, à des données sur les populations ou les sous-groupes de population, et donc touchent à la dimension de santé publique. Or il n’est pas question de génétique dans notre loi sur la santé
Il y a différentes catégories de données génétiques, importantes sur le plan médical :
-des données génétiques au niveau individuel, que l’on peut appeler la pharmaco-génétique, la réponse aux médicaments ;
-des données génétiques importantes aux niveaux individuel et familial, comme les maladies monogéniques ;
-des données génétiques importantes au niveau populationnel sur des maladies générées par des facteurs multiples dont certains sont génétiques, et de nombreux autres encore inconnus auxquels s’ajoute l’interaction avec l’environnement restant à explorer.
Enfin, il y a des cas où plusieurs de ces niveaux entrent en jeu et interagissent.
Vision particulière des données génétiques dans la société : à prendre en compte
Le problème avec la génétique, c’est que tout le monde fantasme !
L’exceptionnalisme génétique
Je souhaiterais insister sur les dangers de l’exceptionnalisme génétique. Certes il existe ; certains types de données génétiques et des maladies déjà mentionnées ont certes des impacts majeurs sur la santé, les décisions à prendre concernant non seulement des individus mais aussi des familles, mais il y a aussi d’autres types de données qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Or, est-il important de réguler les tests génétiques parce qu’ils sont génétiques ? Ou bien faut-il considérer les données produites par ces tests selon leur caractère plus ou moins informatif et prédictif, aux niveaux individuel, familial et populationnel et non pas premièrement par leur caractère génétique ?
Conséquences de l’utilisation en santé des tests génétiques : valeurs en jeu et principes
Les valeurs en jeu sont le respect de la personne, le droit à l’information juste mais aussi le droit de ne pas savoir. Lorsqu’on en vient à l’identification de groupes à risques, où se situe la frontière entre le côté positif pour une prise en charge plus adaptée et le côté discriminatoire ? Les capacités prédictives des tests, qu’ils soient génétiques ou non, sont-elles des facteurs de choix et de nouvelles libertés ou des décisions à imposer ? Dans quelle mesure cette information est-elle effectivement protégée, partagée ou ignorée ? Je passerai sur la dimension économique qui est un aspect majeur dans ce contexte précis.
Un certain nombre d’éléments sont à prendre en compte en ce qui concerne le dépistage des caractéristiques génétiques, au niveau des populations, pour pouvoir répondre à ces questions : que dépister, sur qui, dans quelles conditions et pour utiliser l’information à quelles fins ? Il faut des tests probants et fiables, des problèmes de santé graves, des possibilités d’action effective, une prise en compte du système de santé, une régulation adéquate prévenant les usages déviants. Ces conditions ne concernent pas tous les types de tests génétiques et le dépistage de caractéristiques génétiques de ce type n’est pas la seule intrusion de la génétique dans le domaine de la santé publique. D’ailleurs, le dépistage est différent du test.
Génétique/Génomique et santé publique
La loi bioéthique ne mentionne pas la génétique. Ces mots « génomique », « génétique », accolés à « santé publique », font peur car ils suscitent la crainte, pour des raisons historiques, du spectre de la discrimination, de l’eugénisme, de l’empire du déterminisme, autant de termes effectivement pesants, qui empêchent peut-être de prendre en considération un certain nombre d’utilisations de la génétique dans des maladies rares et des maladies fréquentes. Les enjeux sont contradictoires du point de vue de la santé publique et de l’information : accès libre ou contrôlé aux tests.
Or il existe actuellement un projet européen qui est financé par la Commission européenne, dans le cadre de la Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, qui s’appelle Public Health Genomics, et dont la coordination est allemande. Il est symboliquement important de montrer que l’on s’intéresse aux applications de la génétique au niveau des populations et de la santé publique et que l’Allemagne est impliquée dans ce projet.
Tests génétiques : challenges individuels
Les tests génétiques produisent de l’information génétique : pour quoi faire ? Le grand débat actuel porte finalement sur ce droit individuel à l’information, cette autonomie, à partir du moment où la possibilité de connaître l’information existe, l’accès à cette dernière peut faire l’objet d’une revendication. Il faut rappeler que le résultat d’un test est de nature différente de l’interprétation et de la signification individuelle ou plus collective des résultats de ce test. Nous avons déjà insisté sur le contexte, les conséquences de l’information, et l’accompagnement de l’information génétique.
Il y a également les enjeux des tests non-diagnostics, déjà évoqués, sur la pharmaco-génétique, sur les maladies multi-factorielles sur lesquelles, pour l’instant, ces tests n’ont peu ou pas d’utilité clinique. On ne répétera jamais assez que la validation et les tests d’utilité clinique doivent être une condition du recours aux tests. En revanche, on constate une attractivité des individus à l’égard de cette information génétique, toujours considérée comme solide, parce que basée sur des structures. Il faut parvenir à débattre pour mieux cerner ces types de tests qui n’ont pas une utilité clinique immédiate, mais qui existent, à condition qu’ils soient validés.
Que devons-nous en faire ? Devons-nous considérer que cela ne vaut pas la peine, car nous prenons les décisions à la place des individus ? Quel est leur droit individuel à l’information ? En outre l’interprétation et la signification individuelle d’un résultat de tests sont d’une autre nature que le résultat du test. Devons-nous les mettre à disposition ? Quels sont les risques ? Peut-on considérer tout type de test génétique de la même façon ? Est-ce que la différence de niveau des conséquences pour la santé de l’information génétique apportée par les tests doit être prise en considération dans les modalités d’accès ? Quelle sera la dimension familiale de l’information et de la protection de la vie privée, de la confidentialité, liée aux modalités d’accès ? Quel est le degré de poids de l’information génétique parmi d’autres bio marqueurs ? En effet, il n’y a pas que les tests génétiques qui entrent en jeu en termes de prédiction, notamment dans le cadre d’une évolution des pathologies. Le problème de la qualité des tests est majeur, il doit être résolu et il est lié, par ses conséquences, à leur accessibilité.
La discrimination, la stigmatisation sont habituellement attachées aux dérives de la génétique : quel est le degré de risque de ce type de dérive si les tests sont libres d’accès ? Nous avons évoqué leur libre accès sur Internet. Les débats à cet égard font apparaître des vues différentes et il faudrait savoir, dans la population française, quelles sont les positions qui prévalent dans les débats qui seront organisés. La soif d’information biologique sur soi est sans limite. L’enjeu est de savoir sur quoi l’on fonde sa limitation et quel est le rôle de l’information juste. À qui laisse-t-on le soin de concocter l’information accompagnant des tests éventuellement disponibles ?
Tests génétiques : challenges collectifs
Au sein du système de santé, quelle sera la place des tests génétiques ? Comment garantira-t-on l’égalité d’accès aux tests et à quels tests ? On a déjà insisté ce matin sur l’information, sur l’éducation professionnelle, sur l’accompagnement et sur le conseil mais je ne ferai pas l’économie d’évoquer les enjeux de la « génétisation » sous couvert de liberté.
Science et société
Finalement, comment assurer le dialogue ? On a expliqué que l’année 2008 serait une année vide pour la bioéthique, il ne faut pas qu’elle le soit. Comment dynamiser le débat et faire remonter, à vous, qui nous avez sollicités aujourd’hui, au Parlement, les résultats de ces dialogues divers dans le cadre de la préparation de cette révision ?
Perspective
Comment faire pour que les tests génétiques, qui sont des « réducteurs d’incertitude » ou des « révélateurs d’incertitude explicitée », ne deviennent ni des réducteurs de liberté, ni des réducteurs d’espoir selon l’usage qui en est fait? C’est un challenge pour le dialogue sociétal, un challenge de régulation, un challenge pour le système de santé, un challenge au niveau européen, un challenge international pour la santé des populations.
Conclusions
Il convient d’assurer une mutualisation des compétences sur les aspects sociétaux de la génétique à travers une approche multidisciplinaire, de constituer un pont entre le monde de la recherche en génétique et la société dans un double mouvement : d’une part, permettre aux scientifiques de mieux cerner les questions sociétales, notamment éthiques, dans leur activité, en accueillant des interrogations de la société dans une approche multidisciplinaire, et d’autre part aider les citoyens ou les institutions dans leur analyse d’impact sociétal de la génomique, en apportant un éclairage scientifique inséré dans une approche multidisciplinaire.
Je citerais un exemple, l’année 2008 ne sera pas totalement vide. À Toulouse, nous disposons d’une plate-forme sociétale, « génétique et société », que j’ai le bonheur d’animer, et qui exerce un certain nombre d’activités, en ciblant la communauté scientifique dans un cadre ouvert : de nombreux participants peuvent venir, il y a des conférences et les ateliers chercheurs que nous organisons chaque année depuis trois ans sur des thèmes divers. Il se trouve qu’en 2008, indépendamment de cette réunion, le thème choisi est « les enjeux éthiques des usages et des tests génétiques, de l’exception à la banalisation ». Trois après-midi y seront consacrées : la première sur « tests génétiques et santé », la seconde sur « tests génétiques et marché » et la troisième sur « tests génétiques et régulation ». Je me permettrai de vous faire remonter les résultats de ces débats.
Nous accueillons à présent Bertrand MATHIEU, professeur de droit à l’Université Paris I.
8 M. Bertrand MATHIEU, Professeur de droit, Université Paris I
Je vous remercie. La question des tests génétiques a été largement débattue mais, malheureusement, un peu pervertie par les arrières pensées relatives aux droits des étrangers et finalement, on n’a probablement pas fait porter le débat sur le point qui se posait, les uns ayant diabolisé le sort réservé aux étrangers, et les autres ayant considéré, me semble-t-il à juste titre, que pour les étrangers, la situation prévue dans cette loi n’avait rien de dramatique. En revanche, il restait une vraie question qui n’a pas été traitée, c’est probablement celle des tests génétiques ou des empreintes génétiques puisque c’est bien de cela dont il s’agit.
Le principe de réalité impose de considérer que les tests prédictifs devenus fiables seront utilisés. Il s’agit alors de décider, s’il faut admettre que ces tests génétiques s’avèrent sources de discrimination, dans quelle mesure, dans quel domaine et selon quelle logique. En effet, en ce domaine, peut être plus qu’en tout autre, le droit se doit de rendre lisible le système de valeurs sur lequel il est fondé et dont l’éthique provisoire, contingente et casuistique ne rend plus compte. La réglementation des pratiques traduira nécessairement la recherche difficile d’un équilibre entre la protection des individus et la promotion d’intérêts collectifs.
Je ne reviendrai pas sur les différents objectifs des tests qui ont été exposés très clairement. Les tests génétiques peuvent être réalisés sur un individu à plusieurs fins, et peuvent permettre l’identification d’un individu. Il en est ainsi en matière civile (recherche en matière de filiation) ou pénale (identification de l’auteur d’un crime ou d’un délit). Ils peuvent également intervenir comme instrument de diagnostic dans le cadre d’une maladie symptomatique. Ils peuvent enfin intervenir dans un but prédictif pour détecter un risque de développer une maladie, pour laquelle on ne dispose pas nécessairement d’instruments thérapeutiques, ni même de consignes de prévention fiables.
Les différents textes qui s’annoncent au niveau international, et notamment au niveau européen, préparent probablement à l’intervention des tests génétiques dans la vie sociale.
Tests génétiques et sélection des êtres humains
Les tests génétiques prédictifs peuvent être utilisés à la fois pour sélectionner les êtres humains et peuvent également avoir des effets de discrimination entre les personnes.
En ce qui concerne les tests génétiques et la sélection des êtres humains, lorsqu’on observe les règles et les pratiques, on peut admettre que, sans rupture ouverte avec les principes fondamentaux affirmés de manière récurrente, cette sélection est aujourd’hui très largement admise. Elle répond à des considérations diverses, qui peuvent être des exigences compassionnelles, la volonté de répondre à des exigences individuelles ; mais avec bien sûr, à terme, des préoccupations économiques et de santé publique. Il en est bien entendu ainsi, dans le cadre de l’articulation entre diagnostic prénatal et avortement médical, et entre diagnostic préimplantatoire et procréation médicalement assistée.
Dans le premier cas, la dérive tient en fait à l’extension des maladies diagnostiquées et à l’élargissement des groupes de population concernés. C'est pourquoi, dans un avis du 22 juin 1993, le Comité national d'éthique avait condamné le dépistage systématique de la trisomie 21. Cependant, l'évolution du droit, régissant concrètement ces pratiques, ne semble pas aller en ce sens. Ainsi, un arrêté du 23 janvier 1997, repris par un arrêté de février 1999, a modifié la nomenclature des actes de biologie médicale pour rendre effective la prise en charge financière du dépistage et du diagnostic de la trisomie 21, quel que soit l’âge de la femme enceinte. De la même manière, pourront être diagnostiquées des anomalies génétiques dont on ne peut pas prévoir de manière certaine la gravité et la nature des lésions qu'elles sont susceptibles d'entraîner. Il en est de même pour des prédispositions à certaines maladies. Par ailleurs le développement des connaissances relatives au caractère héréditaire de certaines maladies peut conduire au développement des hypothèses où il est recouru au diagnostic prénatal et, conséquemment, à l’avortement.
Il est évident que le droit n’est pas allé dans ce sens. La question est en fait de savoir jusqu’où il convient d’aller dans le diagnostic, quels types d’anomalies prendre en compte et si l’on peut prendre en compte également des éléments prédictifs malgré la réserve que comporte ce terme, à laquelle j’adhère bien entendu.
Deux facteurs joueront en faveur de l’extension du recours à de tels tests. D’une part le renforcement de la fiabilité des tests tendra à établir implicitement des seuils de qualité de la vie humaine et d’autre part, se développe, incontestablement, la revendication à un droit à un enfant « de bonne qualité ». S’agissant des tests préimplantatoires, cette pratique peut conduire à développer un eugénisme positif conduisant à implanter certains embryons en fonction de leurs caractéristiques ou de leurs qualités génétiques. La légalisation de ce que l’on a appelé, probablement à tort, « l’enfant médicament » s’inscrit, quel que soit le jugement que l’on peut porter sur cette pratique, dans cette logique.
Tests génétiques et discrimination entre les personnes
La connaissance des caractéristiques génétiques d’une personne peut engendrer des discriminations, soit que l’on associe telle caractéristique à telle donnée génétique, soit que cette connaissance soit utilisée pour prévenir la survenance possible ou probable de telle maladie.
La réalisation de tests non associés à une action thérapeutique ou de prévention pose un certain nombre de problèmes. D’abord, la révélation d’un pronostic défavorable peut changer la perception par l’individu de son existence, indépendamment de l’imprécision et du caractère aléatoire du pronostic, ensuite elle peut modifier la perception que la société ou que les autres individus se feront de lui. Ainsi indépendamment de son utilisation par des tiers, les tests génétiques présentent certains dangers. Le développement de ces tests rejoint la volonté de s’approprier le maximum d’informations disponibles sur un individu, besoin toujours renforcé par les progrès techniques, notamment en matière d’informatique et de communication. Ainsi l’existence d’une information génétique sur un individu développe nécessairement des revendications relatives à l’appropriation collective de cette information.
S’agissant des tests prédictifs, la question se pose essentiellement en matière d’assurance et d’accès à l’emploi. En matière d’assurance, l’Etat interdit aux assureurs d’utiliser les résultats de tels tests, quelle que soit la manière dont ils sont susceptibles de se les procurer, et la question se pose de savoir pourquoi il convient de réserver un sort particulier à ces tests.
Plusieurs réponses sont possibles : soit, comme cela est le cas aujourd’hui, les informations génétiques sont considérées comme échappant, par nature, au domaine d’informations auquel l’assureur peut avoir accès. Cette solution très protectrice se heurte cependant à un certain nombre d’objections : d’une part elle conduirait à opérer une distinction incertaine entre les maladies génétiques et les autres maladies, d’autre part elle se heurte à un environnement juridique qui est favorable à la communication à l’assureur d’informations relatives à la santé.
Une autre logique consisterait à considérer que les informations sont communicables dès lors qu’elles sont issues d’un test servant à préciser la pathologie dont souffre le malade, mais qu’elles ne le sont pas lorsqu’elles concernent simplement une prédisposition. Ce sont là des questions et des pistes.
En matière d’emploi, l’interdiction de recourir à des tests génétiques, soit qu’ils soient demandés, soit qu’ils soient spontanément fournis par les intéressés, est fondée sur l’interdiction des discriminations opérées à partir des caractéristiques génétiques. Cependant, le recours à de tels tests est susceptible d’être légitimé dans deux hypothèses : d’une part, lorsqu’un test génétique démontrera l’existence d’une prédisposition particulière liée à une maladie elle-même liée à l’environnement de travail ; d’autre part, lorsqu’une prédisposition génétique est susceptible de déceler un risque de danger pour autrui, comme c’est le cas pour les pilotes de ligne, les chauffeurs routiers etc…
Dans ces hypothèses, la connaissance de la prédisposition génétique a pour objet, non pas d’opérer une discrimination entre les individus, mais de protéger les droits de l’individu lui-même ou la vie d’autres individus. Le risque évident est que la légalisation de certains tests permette que soient décelées de manière obreptice, d’autres prédispositions, sources de discriminations moins légitimes. Les réflexions menées au niveau international et dans certains Etats sur cette question illustrent à la fois ce souci et démontrent probablement que nous sommes à la veille de légiférer sur ces questions.
Encore sur ce point, peut-être faudrait-il distinguer les tests visant à diagnostiquer l’existence d’une maladie existante, et qui seraient soumis aux règles générales applicables en matière de médecine du travail, et les tests visant une simple prédisposition qui ne pourraient, eux, être utilisés. En effet, comme cela a très largement été exprimé, ces derniers tests ne s’inscrivent que dans le domaine de simples potentialités et leur prise en compte conduirait à un véritable déterminisme et surtout à retirer à l’individu une liberté fondamentale, celle d’opérer un choix, par exemple, entre l’accès à l’emploi et l’acceptation d’un risque incertain.
Malgré une décision très prudente, notamment sur la démarche, le Conseil Constitutionnel reconnaît, dans sa dernière décision que le recueil et l’utilisation des caractéristiques génétiques, en dehors du domaine médical, sont susceptibles de porter atteinte au principe de dignité de la personne humaine. J’estime qu’il s’agit là d’une question qu’il conviendra d’approfondir en essayant de trouver des critères juridiquement précis entre ce qui est acceptable, et ce qui ne doit pas l’être en la matière.
Je vous remercie Monsieur MATHIEU. Avez-vous des questions sur ce vaste sujet des tests génétiques, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir ?
‚
M. Arnold MUNNICH
Je vous remercie l’un et l’autre de ces exposés qui éclairent vraiment le débat. Il est peut-être une notion que vous n’avez pas suffisamment mise en avant parce que vous êtes juriste et que vous n’êtes pas un professionnel de ces tests, c’est la question du doute, de l’incertitude. Or, ils émaillent notre pratique au quotidien : dans un petit nombre de situations, nous sommes certains de ce que nous avançons ; mais dans la majorité des situations, nous nous taisons parce que nous n’avons rien de solide et de convaincant à exprimer. C’est pourquoi le nombre des situations dans lesquelles les praticiens réalisent des tests génétiques est au fond très limité, au regard de ce qui est techniquement possible.
Tout ce qui est techniquement possible n’est pas nécessairement souhaitable, surtout lorsque tant d’incertitudes existent (variabilité de l’expression d’un gène, gène modificateur, etc…). Tous ces tests sont empreints d’un degré très important d’incertitude, c’est une notion dont on doit absolument s’imprégner et qui, d’ailleurs, en limite l’interprétation. En effet, annoncer à quelqu’un qu’il a un gène de cardiomyopathie et qu’il risque une mort subite ne se fait pas, au motif que la probabilité d’une mort subite quand on est porteur de gène est de l’ordre de 10 %. Par conséquent, le silence est d’or. Il ne faudrait pas imaginer que les généticiens ont la science infuse.
Le critère que vous fixez entre la certitude et l’incertitude est en effet essentiel. Il est vrai que sur le plan juridique, notamment au niveau européen, par exemple pour les pilotes d’avions, on s’est demandé si à partir du moment où existe un risque, même limité de maladie cardiaque, l’on peut considérer qu’il n’aura pas accès à cet emploi. Toutefois, j’estime, vu de l’extérieur, qu’il semble que la réticence à utiliser juridiquement les tests génétiques tient à leur absence de fiabilité. Mais dans l’hypothèse d’une augmentation de cette fiabilité, il conviendra de réfléchir à la question de savoir quels critères seront pris en considération.
J’ignore ce que l’on entend par test génétique. Je prends l’exemple de la réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui est une technique qui a été mise au point dans les années quatre vingt dix qui permet de mesurer une quantité de charge virale sur un individu, grâce à une mesure d’ARN ou d’ADN. S’agit-il là d’un test génétique ? Si tel est le cas, on est alors devant l’obtention d’un résultat certain, et on arrive à avoir une idée de l’évolution d’une maladie.
La technique utilisée fait certes appel à la génétique, mais lorsqu’on évoque les tests génétiques, cela ne concerne pas les tests de virologie comme ceux que vous venez de mentionner, qui certes utilisent une technique génétique pour la révélation de la présence du virus, mais qui ne fourniront aucune information sur la génétique de la personne.
Je souhaiterais simplement revenir sur le sens que l’on donne aux mots. Vous avez prononcé le terme de « fiabilité » et évoqué des pourcentages de 10 %, mais dans des cas de pathologies multi-factorielles, il peut y avoir un risque augmenté de 1,2 fois ou de 1,3 fois.
La question fondamentale demeure le sens, non seulement en termes statistiques, mais aussi pour la personne qui reçoit le test. On pourra réaliser des tests sur quelques centaines ou milliers de gènes, demain, c’est-à-dire dans trois ou cinq ans, il sera alors possible de séquencer un génome à une vitesse assez impressionnante. Nous disposerons donc d’une foultitude d’informations, avec des risques particulièrement faibles mais particulièrement nombreux. Le problème fondamental sera d’éduquer les personnes à comprendre que, premièrement, il n’y a pas grand-chose à comprendre car on vit de toute façon dans un environnement à risques et qu’il s’agit simplement de quantifier ce dernier d’une façon qui ne signifie rien. Il ne s’agit donc pas d’une question de fiabilité car le résultat en termes technique est fiable. En revanche, la signification de cette sorte d’épistémologie débridée dans laquelle on entre, nécessite d’éduquer la population à comprendre le sens de ces tests. À savoir que, même si vous avez quinze fois plus de probabilité que la population générale d’avoir une maladie qui touche une personne sur un million, cela signifie simplement qu’au lieu d’avoir un risque sur un million, vous aurez quinze risques sur un million de l’avoir, ce qui signifie que vous ne l’aurez probablement jamais.
Prenons un exemple concret : un peintre en bâtiment subit un test à l’emploi et on l’informe qu’il a une sensibilité particulière à une molécule contenue dans la peinture. L’employeur pourra-t-il lui demander un test génétique avant de l’embaucher ou pas ? Il sera possible de démontrer que son niveau de risque est un peu supérieur à celui de la moyenne de la population, et cela n’ira pas plus loin. Mais le problème peut surgir et cela s’est déjà produit.
Les propos de Messieurs CHNEIWEISS et MATHIEU relèvent de la science-fiction ! On n’effectue pas de tests génétiques pour les maladies communes ou les prédispositions. Cela ne se fait pas. Pourquoi alors dramatiser une situation déjà si compliquée ? Vous trouvez qu’il n’y a pas suffisamment de problèmes, aujourd’hui, pour imaginer des scénarios catastrophes pour demain ?
Nous allons à présent nous intéresser à ce qui se passe au niveau des enceintes internationales. Nous accueillons Claude HURIET, qui siège au Comité international de bioéthique de l’UNESCO, Jean-Pierre DUPRAT qui siège comme expert dans un certain nombre d’organisations internationales, Madame CAMBON-THOMSEN, qui siège au Groupe européen d’Éthique et Carlos De SOLA qui siège au Conseil de l’Europe.
LES TRAVAUX EN COURS DANS LES ENCEINTES INTERNATIONALES
8 M. Claude HURIET, Président de l’Institut Curie, Membre du Comité international de bioéthique de l’UNESCO
Mon propos ne suscitera pas les mêmes passions que les interventions précédentes. Je commencerai par un rappel historique trop souvent méconnu : le 1er avril 1995, à Madrid, l’Union interparlementaire adoptait, par acclamation, un texte intitulé « la bioéthique, enjeu international pour la protection des droits de la personne. » Pourquoi ai-je rappelé cet événement trop souvent méconnu ? Parce que l’on ne connaît pas assez l’Union interparlementaire, qui est pourtant une vieille dame de plus de cent ans et qui réunit, deux fois par an, dans différents pays du monde, plus de 130 représentants élus des parlements du monde. Il s’agit donc d’une assemblée tout à fait démocratique et assez représentative des préoccupations mondiales à travers les parlements.
Les textes avaient été proposés par la section française et ils avaient été retenus alors que, se réunissant deux fois par an, l’Union interparlementaire ne met à son ordre du jour que deux thèmes, qui doivent être adoptés par consensus. C’était une surprise car lorsque nous nous sommes entretenus avec les collègues du groupe français, beaucoup doutaient que ce thème puisse retenir l’attention des parlements du monde. Cela a été le cas. Je ne vous lirai pas cette déclaration et vous renvoie d’ailleurs au site de l’Union interparlementaire sur lequel vous pouvez en prendre connaissance. Néanmoins, voici l’un des considérants : « La 93ème conférence interparlementaire, estimant que la bioéthique doit permettre de concilier l’impératif de liberté de la recherche avec le primat de la protection de la personne et la sauvegarde de l’humanité… ». Telle est l’origine de la Déclaration universelle de l’UNESCO, qui a été adoptée, par acclamation elle aussi, le 19 octobre 2005, et dont je voudrais maintenant vous livrer très rapidement le contenu.
Je vous conseille auparavant de vous reporter à ce que je considère comme « la Bible », dont le volume ne doit pas vous effrayer, mais je me bornerai à vous en citer seulement huit paragraphes.
[…] Reconnaissant que, fondés sur la liberté de la science et de la recherche, les progrès des sciences et des technologies ont été, et peuvent être, à l’origine de grands bienfaits pour l’humanité, notamment en augmentant l’espérance de vie.
[…] Considérant qu’il est souhaitable de développer de nouvelles approches de la responsabilité sociale pour faire en sorte que le progrès scientifique et technologique aille dans le sens de la justice, de l’équité et de l’intérêt de l’humanité […]
« La présente Déclaration a pour objectifs :
d’offrir un cadre universel de principes et de procédures pour guider les États dans la formulation de leur législation, de leurs politiques ou d’autres instruments en matière de bioéthique ; […]
[…]de reconnaître l’importance de la liberté de la recherche scientifique et des bienfaits découlant des progrès des sciences […]
[…]d’encourager un dialogue pluridisciplinaire et pluraliste […]
[…] de promouvoir un accès équitable aux progrès de la médecine, des sciences et des technologies, […]
En termes de principes, une page et demie est consacrée au consentement. En effet, les travaux du Comité international de Bioéthique (CIB) de l’UNESCO, ont été compliqués car l’on a vu apparaître, à propos du principe d’affirmation du consentement, combien les différences culturelles étaient présentes, non pas pour l’application du principe mais pour les conditions de sa mise en œuvre. Je citerai un seul exemple : si pour nous, il est évident, que le consentement de la personne doit être préférentiellement recueilli par écrit, un certain nombre de cultures considèrent que demander à quelqu’un qui s’engage, une signature, est un signe, non pas de désaveu, mais de méfiance. Ceci signifie que, dans la pratique du consentement, apparaît la nécessité d’affirmer les principes universels, mais également les conditions dans lesquelles ces principes seront explicités.
Dans l’application recommandée par cette Déclaration universelle, qui figure à la page 37, il est fait référence à la notion de débat public, (c’est appliqué en France, même si nous n’avons peut-être pas besoin d’une déclaration de l’UNESCO pour y penser) et à la recommandation forte, faite aux États, de créer des comités d’éthique. Il en existe certes dans plusieurs pays, de génération parfois spontanée, mais il me semble que parmi le mode d’application de cette déclaration universelle, c’est sans doute l’élément le plus important.
En effet, l’UNESCO y affirme non seulement l’utilité de ces instances, mais aussi l’UNESCO doit se préoccuper des conditions dans lesquelles sont constitués ces comités d’éthique, et dans lesquelles ils accomplissent le service d’intérêt général que nous attendons d’eux. Car il n’y a rien de pire que de considérer, comme c’est parfois le cas, ces comités d’éthique qui se multiplient dans certains pays dont le nôtre, comme des lieux non pas de réflexions et d’échanges, mais comme des lieux de pouvoir. Affirmer les principes et les conditions de la mise en œuvre, c’est bien, mais au plan international, avec la dimension de l’UNESCO, et le niveau auquel se situe cette préoccupation, il est indispensable de ne pas se contenter de cette affirmation des principes et de leur mise en œuvre, adoptée par acclamation lors de la réunion plénière. Cependant, il faut que cette affirmation soit garantie par un suivi, telle est la mission la plus importante du Comité international de bioéthique.
Au niveau de la Communauté européenne, combien de pays sont dotés d’un comité consultatif d’éthique ? Est-ce une trentaine ? Je donne la parole à Monsieur Carlos De SOLA, Chef du Service de la Santé et de la Bioéthique au Conseil de l’Europe.
8 M. Carlos De SOLA, Chef du Service de la Santé et de la Bioéthique, Conseil de l’Europe
Comme vous le savez, sur le plan international, il y a deux types de normes : du droit déclaratoire et des textes juridiquement contraignants. Le droit déclaratoire (soft law) est souvent utilisé lorsque, pour des raisons diverses, les normes contraignantes ne sont pas appropriées, soit parce qu’elles seraient prématurées, par exemple pour traiter de questions encore trop émergentes, soit dans le cas d’un accord trop long ou trop difficile à obtenir.
Parmi les textes contraignants du Conseil de l’Europe, nous disposons de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, qui date de 1997, qui a été mentionnée à plusieurs reprises notamment par Nicole QUESTIAUX, et des protocoles élaborés par la suite dont celui portant sur l’interdiction du clonage d’êtres humains de 1997, un protocole portant sur la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine de 2001, un autre encore sur la recherche biomédicale de 2004, et un projet de protocole sur les tests génétiques à finalité médicale qui vient d’être finalisé mais qui est encore en débat à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, avant d’être adopté par le Comité des ministres, courant 2008.
Nous disposons de plusieurs textes de droit déclaratoires : l’un sur la xénotransplantation, datant de 2003, une technique relativement nouvelle et prometteuse, mais nécessitant l’établissement de normes de prudence, sans pour autant nécessairement interdire des avancées dès lors que ces dernières sont encadrées. En 2004, une recommandation sur la santé mentale a été élaborée et contient des dispositions sur les droits individuels et également sur les politiques en matière de santé mentale. Enfin, une recommandation sur la recherche utilisant du matériel biologique d’origine humaine, qui complète le protocole sur la recherche sur les êtres humains, a été faite en 2006.
Je traiterai trois sujets : la recherche sur du matériel biologique, la recherche dans des pays en voie de développement et les tests génétiques en accès libre.
La recherche sur du matériel biologique
Ce type de recherche prend une importance de plus en plus grande et peut aussi, d’une certaine manière, être une alternative à la recherche sur les personnes. Il est donc nécessaire d’encadrer l’utilisation de matériels biologiques à des fins de recherche. On distingue les biobanques, c’est-à-dire les collections établies ou créées dans le but de faire des recherches mais aussi, ce qui est beaucoup plus difficile à réglementer, toutes les collections qui se trouvent dans les hôpitaux, et qui peuvent éventuellement être utilisées à des fins de recherche mais sont beaucoup plus difficiles à utiliser ; les patients se trouvant ailleurs, il est difficile d’obtenir leur consentement a posteriori. La réglementation doit tenir compte de ces problèmes sans détruire le principe du consentement. L’information, de ce fait, devient l’élément clé, encore plus que le consentement et il faudrait commencer à changer la pratique ; en effet, à partir du moment où l’on effectue des prélèvements biologiques, il conviendrait d’informer les patients qu’un jour peut-être ces échantillons pourraient être utilisés à des fins de recherche et savoir s’ils en sont d’accord. Ceci ne représente certes pas la panacée, mais néanmoins, c’est une piste pour appréhender ce problème.
Ce type de recherche doit être soumis à une évaluation indépendante préalable, en quelque sorte devant un comité d’éthique. Il ne s’agit certes pas de recherche sur les êtres humains, mais il y a de nombreux sujets qui peuvent être préoccupants si l’on utilise ces échantillons sans encadrement suffisant et surtout sans avoir vérifié les conditions de mise en œuvre des modalités ayant été définies au préalable. L’évaluation devrait porter sur la protection de la confidentialité de l’information : est-il nécessaire en effet, pour ce projet de recherche, d’utiliser des données nominatives ou quel degré d’anonymisation devrait-on exiger ?
Il est également important de faciliter l’accès des chercheurs aux biobanques. Je me souviens d’un projet qui nous avait été soumis pour avis où il s’agissait de prendre pratiquement l’ensemble des fichiers et un grand nombre d’échantillons biologiques du plus grand hôpital de Roumanie, et de les privatiser. Il est important de souligner, comme le fait la recommandation, que ce qui relève de ces échantillons et de ces collections est, en quelque sorte, un bien public, et qu’il convient, sous réserve d’un certain nombre de conditions, de faciliter l’accès à la recherche, à tous les chercheurs et non pas de les singulariser pour tel ou tel bénéficiaire direct. Le matériel biologique, comme les données personnelles, ne devrait être transférées dans un autre État que si celui-ci garantit un niveau de protection adéquate.
Les recherches menées dans les pays en voie de développement
L’article 29 du Protocole sur les recherches menées dans les États non parties au présent Protocole dispose que « Les promoteurs et les chercheurs relevant de la juridiction d'une Partie au présent Protocole qui projettent d’entreprendre ou de diriger un projet de recherche dans un État qui n'y est pas partie, s’assurent de ce que, sans préjudice des dispositions applicables dans cet État, le projet de recherche respecte les principes qui fondent les dispositions du présent Protocole. Lorsque cela est nécessaire, la Partie prend les mesures appropriées à cette fin ». Cela concerne les promoteurs d’une recherche, les chercheurs dirigeant un projet de recherche dans un pays tiers. Le droit de l’État où la recherche a lieu est applicable ; de plus, promoteurs et chercheurs s’assurent que le projet respecte les principes fondamentaux du Protocole. L’État du promoteur ou du chercheur doit prendre les mesures nécessaires.
Un projet est actuellement envisagé en France, qui consisterait à créer une instance qui examinerait au préalable les projets dans des pays tiers et en particulier dans des pays en voie de développement : une sorte de comité interinstitutionnel serait probablement une piste intéressante.
Les tests génétiques
En ce qui concerne les tests génétiques en accès libre, on a voulu opposer l’autonomie des personnes à la protection du patient. D’un côté, on voudrait permettre l’accès à n’importe quel test, quelle que soit sa nature, au nom de l’autonomie des personnes, et de l’autre, pour protéger les patients, il faudrait rendre obligatoire le passage par la prescription médicale pour n’importe quel test.
D’une certaine manière, l’opposition entre les deux principes est largement artificielle, car la plupart des mesures de sauvegarde visent à permettre, à l’utilisateur, de comprendre les implications du test. Si l’on demande de passer par la prescription médicale, c’est pour lui permettre de mieux exercer son autonomie, dans de bonnes conditions et non pas pour l’en empêcher.
On a également évoqué le fait que l’on pouvait se substituer à quelqu’un, envoyer des échantillons en prétendant qu’ils appartiennent à l’envoyeur alors qu’ils appartiennent à quelqu’un d’autre. Sur ce point aussi, on est en train de défendre l’autonomie de la personne dont proviennent les échantillons. La solution envisagée a été consensuelle avec une seule abstention dans tous les États membres du Conseil de l’Europe. Il a été convenu de partir de la constatation selon laquelle la plupart des tests génétiques, dans le domaine de la santé, ont des implications qui sont difficiles à comprendre sans un conseil médical individualisé, comme cela a déjà été souligné.
L’article 7 paragraphe 1 du protocole énonce donc une règle générale selon laquelle il ne peut être procédé à un test génétique à des fins médicales que si celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un suivi médical individualisé.
Cependant, des exceptions peuvent être prévues par un État et encadrées. La possibilité d’exception est prévue au paragraphe 2 qui prévoit que « Des exceptions à la règle générale figurant au paragraphe 1 peuvent être autorisées par une Partie, sous réserve que des mesures appropriées, compte tenu des conditions de mise en œuvre du test, soient prévues pour donner effet aux autres dispositions du présent Protocole ».
Toutefois, les tests génétiques ayant des implications importantes pour la santé des personnes concernées ou celle des membres de leur famille, ou ayant des implications importantes pour des choix en matière de procréation, ne peuvent faire partie de ces exceptions. Les critères d’exceptions portent sur les tests qui n’ont pas d’implication trop grande pour la personne et que celle-ci peut relativement bien comprendre. S’il s’agit, par exemple, d’un test qui porte sur des caractéristiques génétiques pouvant avoir un rapport avec l’alimentation ou la réaction à certains aliments ou à certaines substances, plutôt que sur un domaine médical proprement dit ; en principe, il ne faut pas nécessairement exclure un libre accès.
On pose en quelque sorte un principe selon lequel la plupart des tests génétiques, dans le domaine médical, devraient passer par la prescription médicale, mais avec des exceptions encadrées par les autorités nationales. Les autorités nationales ont un rôle important à jouer, comme c’est le cas pour l’Agence de la biomédecine en France.
Nouvelles activités
Il est prévu d’élaborer un instrument sur les tests génétiques et les assurances, un guide à l’intention des comités d’éthique de la recherche, un rapport sur le diagnostic préimplantatoire. Parmi les activités envisagées, on comptera le protocole sur la protection des droits fondamentaux dans le cadre des traitements psychiatriques, un guide d’aide à la prise de décision en matière de traitement médical dans les situations de fin de vie et un instrument sur l’accès au dossier médical, et parmi les autres thèmes possibles figure la génétique et comportements humains.
Je passe la parole à Anne CAMBON-THOMSEN, qui intervient maintenant en tant que Membre du Groupe européen d’éthique.
8 Mme Anne CAMBON-THOMSEN, Directrice de recherche, CNRS, Professeur de médecine, Université Toulouse III, Membre du Groupe européen d’éthique
Depuis 2005, je fais partie du Groupe européen d’éthique pour les sciences et les nouvelles technologies (GEE). Ce Groupe a été créé en 1991, pour jouer un rôle de conseiller auprès de la Commission européenne et de son président. Il a évolué et accru le nombre de ses membres au fil des années ; il en compte actuellement quinze, qui n’y sont pas au titre de représentants de leur pays, mais à titre personnel. Ce Groupe occupe une fonction de conseil et est en général saisi par le Président de la Commission à la suite à des demandes émises par les institutions européennes. Les quinze membres actuels proviennent de quatorze pays différents, il y a un équilibre hommes/femmes, on y trouve des philosophes, des juristes et des scientifiques.
Enfin, les travaux actuellement en cours portent sur le clonage animal pour faire de la nourriture, « le beefsteak cloné ! » Il y a eu 22 avis depuis 1991 et cet avis portera le numéro 23. Cette année, l’un portait sur les débats d’aujourd’hui, à savoir sur les conditions d’examen des aspects éthiques des projets financés dans le cadre du 7ème programme-cadre de recherche et de développement de l’Europe (PCRD) concernant l’utilisation de cellules issues d’embryons. Un certain nombre d’entre vous ont dû suivre les débats au niveau du Parlement européen lors du 6ème PCRD ; c’est un sujet emblématique de ce que peut représenter la bioéthique au niveau de l’Union européenne.
La bioéthique et l’éthique en général ne font pas partie des compétences des institutions de l’Union européenne. Pourtant, dans un certain nombre de cas, on ne peut ne pas s’y intéresser. Les programmes cadres de recherche sont un exemple emblématique de cette situation. Comment peut-on utiliser les fonds qui proviennent de tous les États pour abonder les finances européennes, dont une partie ira à la recherche ? Peut-on les utiliser pour des recherches qui, dans certains États de l’Union sont autorisées, tolérées, acceptées, interdites ? Toutes les situations se présentent. Les travaux sur les cellules souches issues d’embryons constituent un exemple particulièrement représentatif du moment où l’on est obligé, au niveau européen, de s’intéresser à des questions d’éthique et de bioéthique.
Dans ce cadre, des avis précédents du Groupe européen d’éthique ont été émis avec d’ailleurs une saisine très spécifique, et pour la première fois très pratique portant sur le fait de savoir comment les panels examinant les aspects éthiques réagiraient sur ce sujet. En effet, une fois que les projets ont été examinés sur le plan scientifique, un panel particulier en examine les aspects éthiques mais ce dernier ne doit pas se substituer à un comité d’éthique et aux procédures nationales ; il n’est pas un comité d’éthique mais doit en même temps donner un avis sur les procédures et la façon dont la réflexion éthique et les conditions éthiques de réalisation de la recherche sont pratiquées. Cet avis numéro 22, cette année, portait sur un certain nombre de recommandations (on l’a d’ailleurs appelé recommandation et non avis) pour ces panels constitués au niveau de la Commission européenne pour savoir comment examiner de tels points,- dans ce type de recherche.
Des avis du GEE ont été émis en 2003, sur les tests génétiques dans le monde du travail, sur les banques de sang de cordon ombilical. Ce sont là des domaines très en rapport avec ce que recouvre la loi de bioéthique. Il est très important, dans les débats qui auront lieu, de prendre en compte ces avis vraiment intéressants parce qu’ils sont abondés par les cultures et les philosophies de différents pays d’Europe. Nous ne pouvons pas en faire l’économie dans les réflexions d’éthique et de bioéthique au plan national.
Au sein de la Commission européenne et en dehors du Groupe européen d’éthique, un département, au niveau de la Direction générale recherche de la Commission, est plus spécifiquement en charge des aspects sociétaux et liés à la recherche et il organise régulièrement des réunions de représentants des comités d’éthiques nationaux des pays de l’Union européenne. En effet, deux fois par an, des représentants de comités d’éthique des États de l’Union européenne se rencontrent et décident entre eux de discuter d’un thème ou d’un autre, en fonction de ce sur quoi ils travaillent, avec cette idée d’échanges entre comités d’éthique des différents pays. C’est une façon de favoriser les débats et les échanges sur ces questions entre pays de l’Union européenne.
De plus, dans le cadre des programmes de recherche, leurs aspects éthiques sont examinés, indépendamment des aspects scientifiques par des panels particuliers non permanents, dépendant des sujets traités, se réunissant après les avis scientifiques pour examiner ces questions. Il existe une véritable préoccupation sur les problèmes éthiques, notamment dans la recherche au niveau de l’Union européenne. Elle est abordée par différents moyens.
Je vous remercie beaucoup, et confirme que lors du débat au Parlement européen sur le dernier PCRD s’était posée la question de savoir si oui ou non le financement européen interviendrait sur les cellules souches embryonnaires. Cela avait soulevé d’énormes problèmes et jusqu’au dernier moment, on ignorait s’il y aurait une majorité sur ce point. Les pays entrants avaient des positions extrêmement arrêtées sur ce sujet. Je crois que, quelle que soit la qualité de nos lois nationales, la dimension internationale est un élément important. Je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre DUPRAT.
Avant de commencer mon propos, je voudrais rappeler que j’interviens sur ce champs de la bioéthique à deux titres un peu extérieurs au thème d’aujourd’hui : je suis en effet Président du Comité de protection des personnes dans la recherche médicale à Bordeaux ; je suis également responsable d’un Master II de droit de la santé et j’interviens dans un contexte qui est un peu différent au plan international, à savoir celui des conditions d’élaboration de la loi et de ce que l’on appelle la légistique. À ce titre, j’ai été conduit à intervenir auprès de deux institutions principalement, et d’une troisième plus récemment : le Conseil de l’Europe, dans un service voisin de celui de Monsieur De SOLA, un service juridique, dans le secteur de la rédaction législative, puis au titre de l’OSCE et désormais pour l’ONU, dans le cadre d’une mission concernant l’élaboration d’un projet de guide de rédaction législative pour l’Afrique.
En préliminaire, je voudrais indiquer qu’il existe naturellement un lien entre les questions de légistique et la bioéthique, dans la mesure où la première est bien souvent appréhendée sous un angle formel, c’est-à-dire, sous l’angle des techniques processuelles et rédactionnelles d’élaboration de la loi, mais naturellement, il y a un support matériel, le contenu normatif du texte impliquant la dimension bioéthique pour le secteur qui nous concerne.
La question de fond à se poser portera sur : comment formuler, dans une norme juridique, un certain nombre de préceptes de nature éthique. Ceci a soulevé des interrogations lorsque s’est produit l’accélération du mouvement normatif dans les années quatre-vingt-dix, en particulier au plan international, et quand on a assisté à une sorte de télescopage entre la réflexion éthique et l’élaboration normative sur le terrain juridique.
En effet, auparavant, on travaillait de manière chronologique, d’abord un stade de réflexion de caractère proprement éthique, avant de passer à l’élaboration du texte juridique. Or, dans ce cas, on note une certaine simultanéité de la démarche avec les instances que sont notamment l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, ce qui aboutit à une traduction juridique en parallèle du cheminement éthique. On peut constater, de temps à autre, des difficultés pour parvenir à l’élaboration formelle du texte, compte tenu de ces conditions d’élaboration et de la diversité culturelle des États.
Trois forums sont intéressants à examiner : le forum universel que constitue l’UNESCO avec le Comité international de bioéthique (CIB) et ses prolongements en direction de l’Assemblée générale de l’ONU qui ne manque pas de s’approprier, certes avec un décalage, les textes élaborés dans le cadre de ce CIB. Les deux autres forums sont le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Les textes produits sont d’une impérativité quelque peu différente : certains sont sous forme de déclarations (soft law) ce qui a été adopté pour accélérer le mouvement. À cet égard, les propos tenus par Madame Noëlle LENOIR sont tout à fait explicites : « nous avons directement opté pour la forme déclaratoire pour être en mesure de hâter le processus et disposer d’un corpus normatif disponible ».
Il s’agit là d’une tendance que nous retrouvons de manière générale, dans le cadre de l’UNESCO, où cette forme déclaratoire est privilégiée. On peut penser, dans un second temps, qu’il serait logique d’aller vers la forme conventionnelle, vers une sorte de consolidation de la norme pour qu’elle reçoive cette portée plus forte s’agissant de la convention internationale, sous réserve toutefois que les acteurs qui accompagnent cette élaboration et adhèrent ainsi à ce texte non seulement le signent mais aussi le ratifient. Sur ce point, je renvoie à la situation un peu singulière de la France dans ce domaine.
L’Union européenne connaît une situation plus particulière : elle peut en effet, rapidement aller de la formulation éthique proposée par son groupe de conseillers, à une formulation contraignante au travers des directives. En ce qui concerne la France, l’impérativité est immédiate puisqu’il faudra transposer ces dispositions au bout d’un certain temps. Nous rappelons qu’un certain nombre de travaux réalisés dans le cadre de l’Union européenne sont eux-mêmes tributaires d’autres sphères. Ce fut notamment le cas de la directive d’avril 2001 concernant les essais cliniques pour les médicaments : la réflexion avait été préparée par les travaux réalisés en amont par la Conférence internationale d’harmonisation qui, elle-même, s’inspirait assez largement de travaux réalisés aux États-Unis par les instances sanitaires. Nous avons donc des positionnements assez différents selon les institutions considérées.
Au-delà de cet aspect procédural, du point de vue de la portée des textes dans leur contenu, ce qui frappe, c’est incontestablement la volonté de se diriger vers une forme d’universalisme et ce, même si nous effectuons une application normative restreinte géographiquement, se situant dans un cadre régional. On retrouve donc incontestablement cette recherche de l’affirmation de normes de caractère universel, même si des tempéraments ou des compromis sont retenus.
Ceci est évident pour l’UNESCO avec, d’ailleurs, cette dialectique extrêmement intéressante rappelée par Claude HURIET, à savoir, à la fois, l’universalité dans l’affirmation et la préoccupation de la traduction ou de l’adaptation à des cultures, et à des milieux culturels différents. Universalisme et applicabilité de la norme sont donc les deux préoccupations du moment.
À ce propos, je voudrais indiquer qu’il existe probablement un certain nombre de secteurs qui mériteraient un renforcement de ce dispositif. Nous avons évoqué l’absence de disposition particulière en matière de recherche qui mériterait un élargissement permettant de guider les différents États, et d’éviter les pratiques inopportunes telles que le détournement d’essais qui seront réalisés dans des pays où les conditions financières sont plus favorables et les conditions réglementaires plus permissives. Il existe là un certain nombre d’éléments méritant d’être pris en compte et qui nécessiteraient l’intervention de normes internationales.
Passé ce cap de l’élaboration de textes généraux, de la recherche de l’universalité dans l’affirmation des normes, qui caractérise d’ailleurs tout à fait les années quatre-vingt-dix, la dernière déclaration adoptée par le CIB en 2005 ne fait que s’inscrire dans cette dynamique, celle du rattachement à la logique des Droits de l’Homme. On se situe dans un courant doctrinal qui prend sa source à la fin de la seconde guerre mondiale et naît du fait du Tribunal militaire américain numéro un, qui se trouve à l’origine des dix principes de Nuremberg, formulés dans le jugement de 1947, puis des différents volets décidés ensuite par d’autres acteurs (déclaration d’Helsinki).
Il me semble qu’actuellement, l’on s’oriente vers un retour aux fondamentaux, Après avoir élaboré ces textes et corpus généraux, nous revenons vers les principes essentiels sur lesquels doit s’appuyer la bioéthique. À cet égard, lors de la session de Nairobi du CIB, il était extrêmement intéressant de constater qu’un rapport important avait été réalisé sur la question du consentement. Il s’agit donc de revenir à ce principe cardinal élaboré en 1947 et sur lequel a finalement été bâti notre droit de la recherche biomédicale.
Les institutions internationales nous invitent à l’heure actuelle à une relecture de ces principes, avec la préoccupation de leur application effective. C’est ce que nous observons dans le cadre des travaux du CIB.
Je vous remercie beaucoup. Je crois qu’il était utile que nous disposions de cet éclairage sur ce qui s’élabore au niveau des enceintes internationales et dans les différents comités consultatifs et comités d’éthique. Y a-t-il des questions ?
‚
Sans vouloir que mon propos soit interprété comme niant l’intérêt pédagogique de ces grands instruments internationaux, j’aimerais simplement relativiser leur portée sur un point : l’universalisme des droits fondamentaux, dont ces textes sont porteurs, est souvent un universalisme nominal.
En effet, on invoque par exemple systématiquement le principe de dignité, alors que personne n’est d’accord sur son contenu et je prendrai l’exemple de la Convention de bioéthique du Conseil de l’Europe qui reconnaît la dignité de l’être humain et les droits fondamentaux de la personne, ce qui, théoriquement, devrait conduire à admettre l’existence d’une différence, mais qui précise dans le rapport explicatif, que la notion d’être humain est renvoyée à la définition des États, ce qui signifie que la norme est en fait dépourvue de substance.
De même, la déclaration de l’UNESCO sur le génome humain, devenue déclaration de l’ONU ensuite, dans laquelle le rapport se félicitait de la reconnaissance du principe du consentement et faisait référence, dans une première version, au consentement représenté ou au consentement du représentant, ce qui était en fait un moyen de nier le principe du consentement. Sans nier l’intérêt de ces textes, il convient donc d’être toujours attentif à leur nominalisme et à leur verbalisme.
Je vous remercie de cette intervention. Monsieur Hervé CHNEIWEISS vous avez la parole.
J’ajouterais aux divers débats qui ont eu lieu dans le cadre de la Communauté européenne, où le Conseil de l’Europe était représenté, une réunion qui a eu lieu au mois de mai dernier dans le but d’examiner les modalités pratiques d’émergence des comités d’éthique dans les différents pays qui n’en étaient pas encore dotés, notamment dans les pays en voie de développement. Ceci avait pour objectif de protéger les populations ainsi que les données cliniques et le matériel biologique issus de ces populations et, finalement, les résultats de la recherche et les soins qui peuvent être apportés à ces dernières.
Parmi les sujets qui mériteraient d’être abordés par le législateur français et, éventuellement, qui mériteraient d’être portés au commun des sujets de la présidence française de l’Union européenne, on peut citer la question, dans le cadre de cette globalisation, de la mise en place d’un coefficient de vulnérabilité des populations. Ceci rafraîchirait nettement la volonté de certains groupes pharmaceutiques de mener des essais cliniques sur des populations vulnérables s’ils savaient qu’il existe un coefficient de vulnérabilité qui viendrait pondérer la valeur de ces essais cliniques. Les comptes rendus de ces débats sont disponibles sur le site de la Communauté européenne.
Je vous remercie. Madame Catherine LABRUSSE-RIOU, vous avez la parole.
Ayant une expérience de terrain, je distinguerai entre le droit déclaratoire et le droit contraignant. Lorsqu’il s’agit de règles internationales, le droit contraignant concerne généralement les États et rarement les particuliers ou les personnes privées. J’ai très souvent observé les montages contractuels que nécessite la mise en place d’un gros contrat de recherche ou d’un gros contrat international multilatéral avec plusieurs parties (publiques, privées etc...) devant s’exécuter éventuellement dans plusieurs pays, notamment dans des pays en voie de développement, et j’ai été frappée de constater que, bien souvent, des exigences éthiques très concrètes, très précises, prenaient force obligatoire par l’intermédiaire des clauses du protocole.
Finalement, le contrat qui est un moyen de s’obliger permettait ainsi de conférer une force contraignante, de par la simple logique de la force obligatoire du contrat, à des prescriptions, des règles ou des recommandations qui, dans leur énoncé général, étaient dépourvues de force obligatoire. On constate par ailleurs, très souvent, que la négociation de ces protocoles conduit les parties, qui ne sont pas forcément en communauté d’intérêts sur tous les points, à défendre leurs propres intérêts comme par exemple la liberté de recherche des investigateurs, ou la liberté de publication des investigateurs qui peut être bridée par les promoteurs etc… Comme dans toute entreprise, il y a des négociations contractuelles et j’ai été frappée de remarquer que des exigences éthiques, (tous les contractants ne sont après tout pas des êtres amoraux), pouvaient ainsi prendre force juridique par le simple jeu du montage contractuel, rendant ainsi la prestation ou le respect de la norme exigible par les États étrangers ou par les sujets d’expérimentation.
Cette voie tout à fait ordinaire du droit commun méritait d’être indiquée. Cela ne fonctionne pas toujours très bien, et j’ai vu des entreprises privées quitter des protocoles uniquement parce que les exigences éthiques de délivrance de médicaments, attestées dans un pays d’Afrique, n’avaient été acceptées que par les entreprises publiques. Même si cela ne marche pas toujours, le biais du contrat n’est pas à négliger dans une économie libérale et contractuelle.
Je vous remercie.
Tout d’abord, en ce qui concerne la nature même de la déclaration de l’UNESCO, le mandat donné par la Conférence générale de l’UNESCO au Comité International de Bioéthique, qui est une instance experte et non une commission de l’UNESCO, portait sur la définition de normes universelles en matière de bioéthique et de droits de l’homme. Très rapidement, nous avons été quelques-uns à contester l’idée de la référence à des normes, considérant tout d’abord que cela était extrêmement difficile de proposer des normes en matière de bioéthique, et à plus forte raison au niveau universel.
Certains juristes ont alors fait savoir qu’il existait des normes non contraignantes ; ceci a alors rouvert le débat qui a finalement été clos car nous considérions que, dans le langage commun en France, évoquer des normes non contraignantes n’apportait pas forcément une garantie de lisibilité.
Deuxièmement, cette Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme s’adresse très clairement aux Etats. Des discussions ont porté sur le shall ou sur le should. Une des propositions précise en effet : « Les États devraient s’employer à faire en sorte que… » et non pas « devront ». Il est intéressant de rappeller cette réflexion car cela montre quelle est la portée de cette Déclaration qui peut d’ailleurs paraître de peu d’intérêt pour certains. C’est une Déclaration qui conseille, qui soutient et qui aide les États mais qui ne leur impose aucune disposition particulière ; ce sont des recommandations qu’il convient de prendre en tant que telles.
Je crois d’ailleurs qu’il en est de même pour les autres structures internationales dont il a été question, sauf quand elles aboutissent à des directives, comme c’est le cas pour l’Union européenne. Ce ne sont donc pas des normes au sens « coutumier » du texte.
Enfin, je rappelle que l’UNESCO concerne les États et s’adresse à ces derniers. On peut certes discuter sur la portée de ses recommandations mais leur approbation en Assemblée plénière peut leur conférer une certaine force. Il reste à l’UNESCO à ne pas se satisfaire seulement de mots et de déclarations et à vérifier, sans outrepasser ses responsabilités, dans quelles conditions les dispositions et les propositions pourront être acceptées et mises en œuvre.
Je vous remercie, Madame CAMBON-THOMSEN vous avez la parole
Nous évoquions tout à l’heure l’année 2008 et le rassemblement des Comités d’éthique à Paris à l’automne prochain au plan international. Par ailleurs, le Groupe européen d’éthique a coutume de tenir une de ses réunions dans le pays qui assure la présidence de l’Union. Il sera donc possible, dans cette actualité de débats en France, de choisir, et de proposer des sujets de bioéthique à débattre ensemble entre Groupe européen, comités nationaux d’éthique et éventuellement d’autres partenaires.
M. Carlos De SOLA vous avez la parole.
J’aimerais réagir rapidement à la remarque du professeur MATHIEU. Il me semble qu’il serait caricatural de considérer que les textes internationaux se réduisent à des notions telles que la dignité, ils contiennent des dispositions très concrètes. Le passage auquel faisait référence le professeur MATHIEU est issu d’une loi française, la loi WEIL. Le problème ne se pose peut-être pas uniquement au niveau européen.
En dehors de cela, si vous pouvez définir ce qu’est un être humain et à partir de quel moment on peut vraiment parler de façon certaine d’un être humain, dites-le nous. Pour le reste, il existe bon nombre de dispositions concrètes : il y a quatre ans, nous nous sommes préoccupés du trafic d’organes et le Conseil de l’Europe a envoyé une lettre demandant aux gouvernements d’indiquer ce qu’il faisait pour prévenir et punir cela. Le pays en cause était la Turquie. Moins d’un an après, cette dernière a ratifié la Convention d’Oviedo qui interdit la commercialisation du corps humain. Aujourd’hui, ces pratiques sont moins fréquentes que par le passé. Nous ne vivons certes pas dans un monde idéal, mais nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons.
Plus concrètement, les 3 et 4 décembre prochains, le Conseil de l’Europe organise, à Strasbourg, un séminaire qui lancera un autre instrument sur les tests génétiques, intitulé prédictivité, tests génétiques et assurances. C’est un domaine complexe que nous voulons aborder sans tabou, et sans trop de craintes. Très peu de pays disposent aujourd’hui d’une réglementation. La France et l’Allemagne étant probablement ceux d’entre eux qui disposent de la législation la plus restrictive en la matière, sachant que la Suisse et les Pays-Bas permettent, dans une certaine mesure, la communication des résultats d’un test génétique. La plupart des pays n’ayant aujourd’hui aucune réglementation sur ce point, c’est le droit commun des assurances qui s’applique et les assurances agissent alors à leur guise.
Je constate que, même la fin de 2007 sera utile ! Jean-Pierre DUPRAT, vous avez la parole.
Mon collègue Bertrand MATHIEU est un peu excessif ! Il est facile de trouver une disposition qui résulte d’un compromis destiné à tenir compte des exigences des Etats, mais globalement, ces textes ont quand même une portée plus importante dans la formation des règles nationales.
C’est ce que j’ai exprimé de manière liminaire.
Je rappelle que la France est très en pointe sur ses lois bioéthiques mais qu’au niveau international, nous n’avons toujours pas ratifié la Convention d’Oviedo. Si cette journée pouvait nous le rappeler à tous, ce serait très utile.
LES ADAPTATIONS SUGGÉRÉES PAR LES INSTITUTIONS NATIONALES
LES PROPOSITIONS DES RESPONSABLES DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
Nous allons nous adresser à toutes les autorités administratives et de régulation pour connaître leur point de vue, l’état de leur réflexion, et comparer le travail de l’exécutif et du législateur. J’appelle donc Didier HOUSSIN, Directeur général de la santé, Carine CAMBY, Directrice générale de l’Agence de biomédecine ainsi que deux représentants de comités d’éthique : Jean-Claude AMEISEN, qui est à la fois Membre du Comité consultatif national d’Éthique et Président du Comité d’éthique de l’INSERM et Roger GUEDJ, qui est Membre du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Je donne la parole à Didier HOUSSIN.
Je vous prie d’excuser Didier SICARD, Président du Comité national d’éthique, en déplacement, qui est représenté aujourd’hui par Jean-Claude AMEISEN. Il n’a pu être présent parmi nous. Mon collègue Jean-Sébastien VIALATTE et moi-même l’avons auditionné la semaine dernière.
8 M. Didier HOUSSIN, Directeur général de la santé, Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Je vous remercie de votre invitation. Quelle est l’évolution de la production réglementaire à la suite de la loi de bioéthique de 2004 ? Sur 27 décrets à prendre, 20 ont été pris ; il en reste donc 7 dont 2 sont en cours d’examen au Conseil d’État : l’un sur l’examen des caractéristiques génétiques et l’autre qui modifie la constitution de l’Agence de la biomédecine ; 4 sont en cours d’élaboration et 2 sont, suspendu pour l’un, et sans objet pour l’autre. Ceci pour observer que la loi de bioéthique est relativement bien appliquée pour l’instant, même s’il reste encore un petit effort à accomplir sur la production de certains textes.
J’indiquerai brièvement la manière dont se profile la révision de la loi de bioéthique, vue du ministère de la Santé. Le ministre Xavier BERTRAND a demandé à l’Agence de la biomédecine de préparer les états généraux de la bioéthique. Madame Roselyne BACHELOT l’a confirmé, en indiquant que l’horizon serait celui de l’année 2009. J’ignore quand les choses vont véritablement débuter.
Il existe un certain nombre de thèmes qui se profilent d’ores et déjà. Un premier thème porte sur la ratification de la Convention d’Oviedo et j’espère que l’on n’attendra pas la révision de la bioéthique pour ratifier cette convention. On se demande parfois si cela n’est pas dû à un problème de stylo, car je crois que tout le monde est d’accord.
Deuxièmement, après une vingtaine d’années, il serait utile de s’interroger sur le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ses missions, ses achèvements etc… Ce peut être l’occasion de se poser la question d’une autorité administrative indépendante de ce type, des leçons que l’on peut en tirer et des améliorations à apporter. La question de l’Agence de la biomédecine sera également abordée car on assiste actuellement à un mouvement de revue générale des politiques publiques qui concerne les Agences, aussi bien dans le champ de la santé que dans celui de la recherche. À n’en pas douter, la question d’une manière générale des agences, et notamment de celle qui est particulièrement engagée dans le champ de la bioéthique, se posera sans qu’aujourd’hui, je ne puisse en dire quoi que ce soit.
Un deuxième thème important est celui de l’embryologie et de la reproduction, avec deux questions qui, aujourd’hui, sont probablement les questions les plus débattues actuellement : celle de la levée du moratoire éventuel sur la recherche portant sur les embryons surnuméraires et les cellules souches embryonnaires, et celle sur le clonage à finalité thérapeutique ou scientifique. Je n’entrerais pas dans les détails des arguments, mais observerai simplement que ces deux questions sont certainement aujourd’hui les plus discutées, et je ne doute pas que, dans le cadre des états généraux, elles resteront un sujet majeur.
Autour de l’assistance médicale à la procréation, le troisième thème, se profilent les questions importantes d’accès à cette assistance des personnes seules et des couples homosexuels, qui est aujourd’hui interdit, la possibilité de transfert d’embryons post mortem, aujourd’hui interdit, le recours éventuel aux maternités de substitution, aujourd’hui interdit, et surtout la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes pour permettre l’accès de l’enfant à naître à la connaissance de ses origines, sujet qui fera certainement l’objet de grandes discussions.
Je terminerai, sur ce chapitre de l’embryologie et de la reproduction, en évoquant le statut du fœtus in vivo. De manière croissante, des demandes sont formulées, en particulier dans le cadre des accidents de la voie publique, à la suite de l’affaire de Saint-Vincent de Paul, sur le statut du fœtus in vivo et sur le problème du fœticide.
L’examen des caractéristiques génétiques fera également l’objet de discussions importantes. Comme vous le savez, la procédure d’information médicale à caractère familial n’a pas pu être mise en place, en raison de difficultés d’application, dont je ne vous dresserai pas la liste. Carine CAMBY en traitera peut-être, mais il y a au moins 6 ou 7 motifs selon lesquels cette procédure n’a pu être mise en œuvre ; le Comité consultatif national d’éthique a d’ailleurs formulé un avis plutôt défavorable à son encontre, le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine ayant, pour sa part, exprimé un avis pour le moins réservé.
On pourrait penser qu’une relative stabilité existe, s’agissant des greffes. Tel n’est pas mon avis car il faut de nouveau s’attendre à des interrogations sur le thème du consentement. Une fois de plus, la question du consentement présumé sera discutée et j’espère que nous en arriverons à la conclusion selon laquelle il faudra le préserver mais cela ne manquera pas d’être débattu. De même que les questions de la gratuité et de l’anonymat seront de nouveau en débat comme c’est le cas dans de nombreux pays, surtout en ce qui concerne l’anonymat. Le sujet de la gratuité sera certainement à l’ordre du jour et il ressurgira sans doute en particulier à propos des banques de sang de cordon ou des options un peu originales visant à construire des banques à finalité privée, qui constitueront peut-être des solutions attirant certains.
En conclusion, j’évoquerai deux sujets : des discussions sur les médicaments dérivés du sang auront lieu, car la France a mis en place un dispositif « éthique », qui nous est reproché par certains voisins européens. Enfin, j’estime que sur les questions de bioéthique, s’accrocheront des thématiques de sécurité sanitaire dans certains domaines.
Je vous remercie Monsieur HOUSSIN pour la clarté de l’exposé des thèmes qui sont importants pour vous, en tant que Directeur général de la Santé. Carine CAMBY, nous nous félicitons de vous accueillir à cette table ronde. La dernière fois, cela n’a pas été possible, nous sommes heureux que vous soyez présente pour présenter le rôle de l’Agence de la biomédecine.
8 Mme Carine CAMBY, Directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Je vais introduire mon propos en donnant quelques informations sur la façon dont l’Agence a conçu sa mission depuis sa création, le 10 mai 2005. Nous étions dans une situation particulière dans la mesure où nous héritions de toute l’expérience de l’Établissement français des greffes, mais ce dernier avait une mission de promotion de la greffe et de qualité des pratiques dans ce domaine. Il n’avait pas de mission d’autorisation, ni d’inspection. Cela a donc impliqué un changement de logique lors du passage à l’Agence de la biomédecine puisque, tout d’un coup, la loi nous confiait la mission de délivrer un certain nombre d’autorisations au nom de l’État.
Deuxièmement, nous nous trouvions dans un champ difficile à définir car il fallait trouver les cohérences entre la greffe, la procréation médicalement assistée (AMP), l’embryologie, la recherche sur l’embryon, la génétique humaine, ce qui n’était pas évident. Dans certains cas, le point commun entre ces éléments est l’utilisation du corps humain à des fins thérapeutiques mais si tel était le cas, pourquoi n’y aurait-il pas aussi le sang ? Nous savons pourquoi, car en France, des raisons historiques l’expliquent, c’est un fait. Enfin, pourquoi y inclurait-on la génétique puisque, finalement, il s’agit d’une technique et non d’une utilisation à proprement parler d’éléments du corps humain comme dans le cas de la greffe, ou des dons de gamètes dans l’AMP ?
Il convenait de trouver des équilibres entre toutes ces disciplines et l’Agence a voulu décider de concilier, autour de ces questions difficiles, réunies par la loi bioéthique, des expertises différentes permettant d’obtenir une approche équilibrée de ces questions. Il s’agissait d’expertises médicales et scientifiques qui existaient auparavant, d’une expertise éthique également. En effet, à travers la création du conseil d’orientation de l’Agence, l’instance qui réfléchit à toutes les questions que je peux être amenée à lui soumettre mais qui donne également un point de vue très opérationnel car sur de nombreuses décisions importantes, il donne systématiquement un avis préalable. Ce conseil d’orientation a développé l’expertise éthique au sein de l’Agence.
Enfin, nous disposons d’une expertise dans le domaine de la communication, car la loi nous confère des missions de communication pour assurer la promotion de la dite loi, du don d’organes, de tissus, de cellules et de gamètes. C’est une mission d’information du grand public, mais aussi des professionnels de santé, dans des domaines dans lesquels ces disciplines sont finalement assez fermées, avec parfois un nombre de praticiens relativement réduit qui interviennent au quotidien dans leurs services, et en ayant peu de contacts entre eux sur des thématiques sur lesquelles les regards croisés sont extrêmement intéressants. Tel est le rôle du conseil médical et scientifique de l’Agence.
Quels sont les sujets sur lesquels nous pourrions avancer, du point de vue de l’Agence qui a désormais presque trois ans de pratique dans le dispositif légal actuel de la loi bioéthique ? De mon point de vue et de celui de nombreuses personnes confrontées à la mise en œuvre de la loi de bioéthique, un énorme effort de simplification et de clarification devrait être opéré. La loi de 2004 est complexe, difficile à comprendre, très détaillée sur certains points, qui entrent d’ailleurs parfois en contradiction les uns avec les autres, et qui comporte aussi des zones d’imprécision, même pour nous qui avons pour rôle de mettre en œuvre ces dispositions.
À mon sens, il convient de montrer à nos concitoyens que la bioéthique ne se résume pas à des techniques médicales sur lesquelles on tente de raisonner avec des concepts éthiques, mais, il s’agit davantage d’un domaine se situant au niveau des principes que l’on peut ensuite décliner dans les matières médicales. Cela représenterait un acquis qui permettrait de mieux organiser le débat sur ces questions.
Après cet effort de clarification, il conviendrait selon moi d’interroger à nouveau les grands principes, ne serait-ce que pour mieux les réaffirmer et les refonder. Je souhaiterais revenir sur l’intervention de Nicole QUESTIAUX concernant ce débat entre, d’un côté, l’autonomie de la personne et de l’autre, le principe de la dignité de la personne humaine et la manière de concilier ces deux principes dans les faits. Cette question se pose quotidiennement, et dans tous les chapitres de la loi de bioéthique, et elle se décline à travers un certain nombre de principes qui feront forcément débat au cours de la révision de la loi à savoir, l’anonymat, la gratuité, et le consentement que nous avons déjà longuement évoqué à travers cet avis passionnant de la CNDH sur ce thème, qui d’ailleurs ne propose aucune solution.
Les deux thèmes de l’anonymat et de la gratuité, selon moi, peuvent être traités ensemble et sont quelque peu indissociables l’un de l’autre. En effet, René FRYDMANN posait la question de l’indemnisation éventuelle des donneuses d’ovocytes et la question de l’anonymat sur l’origine des donneurs avec les gamètes desquels sont conçus des enfants a été soulevée. Il convient d’être extrêmement prudent dans ce domaine car aujourd’hui, ces trois piliers anonymat, consentement et gratuité forment un tout transversal s’appliquant à l’ensemble des domaines couverts par la loi bioéthique. Si l’on commence à faire des concessions sur certains de ces principes, au nom d’une meilleure efficacité et au nom du principe compassionnel selon lequel il faut donner une réponse à des couples ou des patients qui en ont besoin, on risque de détruire le statut du corps que Nicole QUESTIAUX rappelait ce matin, qui s’est édifié dans notre droit et sur lequel nous fonctionnons aujourd’hui.
Dans le domaine de la gratuité par exemple, il existe d’autres façons d’accroître le nombre de donneuses d’ovocytes, en augmentant les moyens dans les centres hospitaliers qui exercent cette activité et qui, de nos jours, ne sont pas en mesure d’accueillir les donneuses d’ovocytes dans des conditions satisfaisantes.
La nécessité de l’information de la population sur cette question et l’impact de la campagne d’information menée en 1998 a été souligné; l’Agence envisage de refaire, l’année prochaine, un effort d’information, de façon neutre et factuelle, dans le domaine du don d’ovocytes et du don de sperme. En effet, si nous n’organisons pas cette information, nous alimentons quelque peu des pratiques non souhaitables dans des pays limitrophes de la France dans lesquels on envoie, implicitement, les femmes ayant besoin de dons d’ovocytes ; car dans le cadre de la réglementation existante, on n’a pas, en France, consenti l’effort de prévoir les moyens nécessaires pour qu’elles disposent de possibilités d’accès à ces techniques qui leur sont offertes normalement.
Une des questions soulevées par la gratuité n’est pas tant de rémunérer ou d’indemniser les donneurs ou les donneuses que d’éviter que ces derniers supportent les frais de leurs dons. Or, aujourd’hui, la réglementation en France, qui devrait permettre la prise en charge des frais des donneurs, est fort mal appliquée, et être donneur aujourd’hui revient non seulement à faire le don d’un organe, ou de cellules de sang, ou de gamètes, mais aussi à consentir à un véritable investissement financier, parfois très mal compensé. Nous l’avons constaté dans des cas dramatiques dans lesquels de plus, était survenu un décès du donneur, une invalidité ou encore un arrêt de travail consécutif au don : ceci n’est pas encore suffisamment bien couvert en France.
Le troisième thème sur le dispositif légal porte sur la simplification, la clarification, le fait de refonder les principes, et d’aller plus loin sur certains points. De nombreux sujets très intéressants ont déjà été cités aujourd’hui : les biobanques, les collections d’échantillons, d’éléments du corps humain ; Hervé CHNEIWEISS a soulevé la question des neurosciences. On observe donc l’existence de nombreux domaines dans lesquels les principes sous-jacents, pas assez bien explicités dans la loi de bioéthique, devraient trouver à s’appliquer. À cet égard, ceci pose en quelque sorte la question des limites de la conception actuelle de la loi de bioéthique dans laquelle on s’intéresse à des secteurs médicaux extrêmement précis et ciblés, en perdant quelque peu la transversalité nécessaire dans laquelle tous les principes de consentement, de protection du donneur, d’information éclairée pourraient trouver à s’appliquer.
Un des sujets sur lesquels, de mon point de vue, il faudra absolument progresser concerne la thérapie cellulaire. Sous ce terme, je regrouperais ce qui porte sur les recherches sur l’embryon, car il s’agit d’une certaine façon de les réintégrer dans une approche plus générale même si, à mon avis, il faut un encadrement particulier pour les cellules embryonnaires. Je pense qu’il faudrait également examiner la question du passage probable à la recherche biomédicale qui, sur le plan de la thérapie cellulaire, n’est pas parfaitement réglée en France aujourd’hui afin d’éviter de se retrouver « au pied du mur » dans deux ou trois ans quand nous recevrons les premières demandes des chercheurs dans ce domaine.
L’expérience de ces trois années fait apparaître des acquis dans la loi de bioéthique qui méritent d’être explicités. L’un d’eux porte sur le fait qu’une agence, comme l’Agence de la biomédecine, qui avait pour mission de mettre en œuvre une grande partie du dispositif de la loi de bioéthique, peut prouver qu’un système d’encadrement permettant de régler des questions difficiles, et de trouver un équilibre entre des exigences forcément contradictoires, de respect de la personne ou de liberté de la recherche par exemple. Les chercheurs se sont en effet beaucoup émus, lors du vote de la loi de bioéthique en 2004, du fait que la liberté de la recherche était mise en cause. Je pense qu’aujourd’hui, ils sont finalement plutôt satisfaits d’avoir ce système d’encadrement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires qui a prouvé qu’il pouvait fonctionner en leur conférant aussi une forme de sécurité, et de garantie du respect global des exigences éthiques.
En effet, seule une Agence indépendante d’eux pouvait garantir ce respect. Il me semble qu’il s’agit là d’un acquis important dont la consolidation passera sans doute par une autre ligne de partage entre la loi et son interprétation, évoquée à plusieurs reprises. Ceci est extrêmement porteur, dans la mesure où la révision de la loi tous les cinq ans est un exercice quasiment impossible car Didier HOUSSIN rappelait que des décrets importants de la loi de bioéthique de 2004 ne sont pas encore publiés.
Par ailleurs, j’estime que le débat public qui s’organisera, je l’espère, au travers des états généraux, et le débat parlementaire doivent disposer de temps pour se réaliser et pour donner, à tous les points de vue, la possibilité de s’exprimer. Par expérience, nous savons que les débats parlementaires sont longs sur ces questions-là, et même si le calendrier parlementaire est mieux maîtrisé que la dernière fois, le temps du débat est un temps incompressible et nécessaire sur des questions difficiles et sûrement insuffisamment expliquées au sein de notre société. Cette façon de trouver un équilibre entre la loi et son interprétation constituera sûrement une possibilité de recentrer la loi sur les principes, de trouver un cadre qui permette à une agence, avec d’autres dispositifs éventuels, d’assurer l’interprétation quotidienne de la loi et sa mise en œuvre, sous le contrôle du ministère de tutelle et du Parlement.
Je vous remercie beaucoup pour cet exposé complet. Il est vrai que, sans préjuger de ce que décidera le législateur, l’existence même de l’Agence, nous conduira à trouver un positionnement pour la loi de demain. Ce débat devra avoir lieu entre le législateur et l’exécutif. La loi est nécessaire, le débat parlementaire est indispensable sur ces sujets, particulièrement à un moment où notre société doute. Il conviendra peut-être de revoir lors de ce débat quel sera le rôle de l’Agence. Selon moi, le rôle de l’Agence de la biomédecine doit consister à davantage s’attacher aux principes plutôt qu’à entrer dans les détails de la loi. De plus, l’Agence de la biomédecine doit faire part de ses observations à l’exécutif, mais aussi au législateur qui pourra ensuite s’en saisir utilement.
Nous allons à présent entendre un représentant du Comité consultatif national d’éthique CCNE sur cette loi. Peut-être pourrez-vous répondre à l’interrogation, sur le fait que ce débat pourrait aussi être l’occasion de s’interroger sur l’évolution du CCNE. Comment vivez-vous cela de l’intérieur, vous qui en êtes membre ?
8 M. Jean-Claude AMEISEN, Professeur de médecine, Université Paris VII, Membre du Comité consultatif national d’éthique, Président du Comité d’éthique de l’INSERM
Comme l’a expliqué Carine CAMBY, il manque ou il pourrait émerger plus de transversalité, moins de segmentation, et éventuellement la construction d’un tissu, d’un réseau permettant d’inventer, au fur et à mesure, l’interprétation au cas par cas de l’esprit de la loi, sous le contrôle du Parlement.
Les déclarations internationales jouent un rôle extrêmement important, il ne faut pas oublier que toute la bioéthique moderne a commencé par le Code Nuremberg en 1947, la déclaration d’Helsinki dans les années soixante etc…C’est seulement à partir de ces pétitions de principe, non contraignantes, que se sont construites à la fois des pratiques et des législations. De même, les publications internationales, les plus grands journaux internationaux scientifiques et médicaux se réfèrent à ces textes en ce qui concerne l’acceptabilité d’une publication et ce malgré leur côté non contraignant. Sachant qu’il n’y a pas de recherche qui ne se publie, les déclarations internationales jouent un rôle extrêmement important. L’Europe s’est construite par déclarations non contraignantes successives qui, ensuite, ont fait l’objet de lois. Je me demande si ce débat n’est pas l’occasion, pour la société française, d’essayer de réfléchir, et de s’approprier la signification de ces déclarations, dans toute leur ambiguïté, mais aussi toute leur ambition. Car c’est très abstrait, même quand la société française connaît certaines lois, elle sait peu de choses de ce contexte qui contribue pourtant à l’émergence de toute l’évolution de la réflexion et de la mise en pratique de l’éthique dans le monde.
Il faut essayer d’énoncer un certain nombre de principes généraux suffisamment transversaux et suffisamment précis pour prendre en compte toutes les applications possibles de la biologie – en termes de principes et non de détails, – pour fixer un certain nombre de limites, même si ces dernières sont évolutives et provisoires : respect de la personne, respect de la vulnérabilité, refus d’instrumentalisation, ce qui conduit au consentement libre et informé, à savoir ne pas faire quelque chose à l’insu ou au détriment d’une personne, respect de la confidentialité, proportionnelle à l’importance qu’aurait une accessibilité sur le net quelque peu inquiétante.
En effet, un test de paternité indique: « l’avantage de notre test en ligne c’est que vous pouvez prélever de l’ADN de votre enfant à l’insu de l’enfant et à l’insu de la mère » ; imaginez maintenant qu’il s’agisse d’un diagnostic de maladie de Huntington : on peut prélever de la salive ou des cheveux d’une personne à son insu : cette illusion d’autonomie s’accompagne d’une absence de réflexion sur le respect du secret médical donné par la prescription. Or, lorsqu’une société commence à craindre de passer par le médecin, le conseil et l’accompagnement, peut-être convient-il de s’interroger sur l’idée qu’elle se fait du meilleur moyen d’accompagner la santé, dans les cas de maladies graves. Ce sont là des questions assez générales.
Quant à l’absence de modes d’application généraux des progrès de la biologie, on observe, en matière de recherche et de médecine, que l’on protège de manière extraordinaire la personne. Or, comme le montrait Hervé CHNEIWEISS dans les domaines commerciaux, de la sécurité etc… on utilise, dans un cadre complètement différent, les mêmes avancées de la biologie, en induisant une vision très ambiguë pour la société. Celle-ci constate alors que n’importe quelle avancée de la biologie risque d’être utilisée dans un contexte dans lequel la protection de la personne ou de la collectivité n’aura pas été examinée.
Cette transversalité, qui consiste à étudier les applications des progrès de la biologie et les applications de la biologie vis-à-vis de son utilisation sur le plan individuel ou collectif, est importante, pour la société française et pour le législateur.
Sur la fixation des limites, il faut faire comprendre à la société qu’à partir du moment où sont respectés des principes communs sur lesquels sont construits la Communauté européenne et le Conseil de l’Europe par exemple, il existe des façons extrêmement variées de les décliner. Au fond, toute limite fixée a un caractère arbitraire et repose sur une incertitude. Il n’existe pas une façon scientifiquement exacte de décider du meilleur moyen de protéger la personne. Comme le rappelait Carine CAMBY, il est important que le corpus général de la loi ne comporte pas de contradictions qui auraient pu être résolues par avance.
En effet, lorsqu’on évoque la loi de bioéthique, on souligne souvent les disparités des lois dans la Communauté européenne, sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires, le transfert de noyau, l’euthanasie, le suicide assisté, l’utilisation de certaines drogues, la prostitution, la commercialisation ou pas des éléments du corps humain, la gestation pour autrui. On s’aperçoit bien qu’à partir d’un respect commun auquel se sont engagés chacun des Etats membres, les façons d’appliquer ces mêmes principes demeurent très variées, pour des raisons culturelles, historiques, et philosophiques. Aucun de nos voisins n’a pourtant l’impression de moins bien appliquer le respect de la dignité humaine ou de la personne que nous et vice-versa. Nous ignorons donc qui a raison et qui se trompe. À un moment, il faut avoir le courage d’assumer, comme l’expliquait Arnold MUNNICH, notre façon de défendre nos valeurs au mieux de ce que nous croyons à un moment donné.
À cet égard, je crois que la confrontation avec les autres pays européens est extrêmement riche car elle permet de nous renforcer dans l’idée que lorsque nous mettons certaines limites que d’autres voisins ne mettent pas, nous savons pourquoi nous le faisons et nous avons compris pourquoi eux ne le font pas et vice-versa.
Il me semble qu’il convient d’éviter ce risque de « plus petit dénominateur commun » qui constitue en général le degré zéro de la réflexion éthique incluant la tendance à interdire, de manière incantatoire. Si l’on pose ce principe comme un principe d’action, l’idée même d’une réflexion éthique n’a pas de sens. Elle doit donc se construire à la fois avec et contre, et il est important de réaliser ce caractère de pari dans lequel la réflexion et la connaissance doivent avoir progressé.
Dans le consentement libre et informé qui est un des piliers de l’éthique, l’information efface au mieux l’ignorance mais n’enlève jamais la noblesse de l’incertitude du choix. Sur le consentement libre et informé, ce qu’expliquait Nicole QUESTIAUX est essentiel et intrinsèque au consentement : car conférer une autonomie à la personne, revient à poser des limites aux dangers qu’elle pourrait faire courir à d’autres, ou à elle-même, il s’agit d’assistance à personne en danger. D’une certaine façon, la reconnaissance collective de l’autonomie de chacun est impossible, sans l’existence, concomitante de limites collectives déterminées. L’équilibre de ces limites, qui varie à travers les époques, doit être formulé et faire l’objet d’une appropriation. Ensuite il est fixé de façon forcément arbitraire dans le consentement libre et informé, surtout lorsque le degré d’information est imparfait. La médiation est importante, qu’elle soit individuelle ou assurée par des agences indépendantes.
À mon sens, les principes sont assez simples : il s’agit de mettre les progrès de la science au service de la personne et non d’instrumentaliser la personne au service de l’utilisation de cette science en sachant comment cela se décline à un moment donné, dans une société donnée.
Quant à la création d’un tissu permettant l’émergence d’un certain nombre de solutions, pas nécessairement pré écrites et prévues à l’avance, ceci demande une rédaction qui ne soit pas excessivement précise et laisse ainsi la possibilité de s’amender. Ce tissu devrait comporter des agences indépendantes (Agence de la biomédecine, Haute Autorité de Santé etc…) non seulement dans le rôle consistant à prendre des décisions au cas par cas, comme le fait l’Agence de la biomédecine, mais aussi dans celui d’être une instance permettant soit de valider (tests), soit de diffuser une information indépendante sur le degré de validation de ce à quoi les personnes ont accès. Plus la biologie devient un marché et plus, pour des raisons économiques, les entreprises souhaitent donner des informations ; au lieu de brider la parole, le fait de conférer à des instances indépendantes une parole audible et accessible à tous revient à exercer un contrepoids et à permettre à chacun de choisir.
J’estime également que des instances indépendantes, consultatives et non opérationnelles comme le sont les agences, constituent des contrepoids intermédiaires intéressants car elles permettent, en amont comme en aval, de réfléchir à la manière dont les agences mettent l’esprit de la loi en pratique.
Dans tous les organismes de recherche, les hôpitaux, les universités, se développent des instances ; la France a créé les Comités de protection des personnes CPP, mais elle a également créé du hors champ. À partir du moment où la recherche n’est pas estimée comme devant passer devant un comité de protection de la personne, elle ne fait l’objet d’aucune réflexion éthique, ce qui pose actuellement des problèmes en matière de publication. En effet, pour un journal médical international, le fait que la recherche puisse se dérouler sans aucune réflexion éthique, en raison de la loi française ou italienne ou allemande n’a strictement aucune importance.
Selon moi, l’idée transversale serait que toute recherche qui s’adresse à la personne et qui peut poser des questions a priori puisse faire l’objet d’une réflexion et d’un avis de la part de comités équivalents aux comités d’évaluation de la recherche, comme cela existe à l’INSERM. Cela signifierait alors que l’ensemble du champ de la recherche et de certaines pratiques médicales fait systématiquement l’objet d’une réflexion éthique. Pour l’instant, on peut se poser la question de savoir si elle doit être contraignante, comme celle d’un CPP, ou consultative et incitative. Il est peut-être possible d’inciter un certain nombre d’institutions à élaborer des structures qui ne seront pas forcément des structures centrales.
Le Comité consultatif national d’éthique, qui a maintenant douze ans, avait émis un avis soulignant l’absence d’examen et de réflexion sur les problèmes éthiques posés par des recherches côté français lorsque les recherches françaises se déroulaient dans des pays en voie de développement, en particulier dans des pays qui n’avaient pas de comité d’éthique. Cet avis est resté lettre morte et l’an dernier, le Comité consultatif national d’éthique a constaté que rien n’avait été fait en ce sens. Imaginer qu’une réflexion soit menée sur la manière dont la recherche des équipes françaises s’engage dans les pays en voie de développement serait un complément utile pour aider ces pays à mettre en place eux-mêmes des structures de protection de la personne.
Je vous remercie beaucoup Jean-Claude AMEISEN. Le dernier intervenant sur ce thème est Roger GUEDJ, qui est Membre du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
8 M. Roger GUEDJ, Membre du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
Je vous remercie de m’avoir invité. Je suis professeur d’université, chimiste à l’interface de la chimie et de la biologie et très impliqué dans la recherche en chimiothérapie antivirale orientée essentiellement contre le VIH, pratiquement depuis l’apparition de l’épidémie du Sida. Directeur d’un laboratoire associé au CNRS, j’ai alors impulsé au milieu des années quatre vingt, ce type de recherche quasiment inexistant en France à cette période, à l’exception de quelques laboratoires dont l’un très performant à l’université de Montpellier. La chimie contre les virus intéressait peu de monde et pourtant, elle est actuellement l’unique réponse partielle à l’infection par VIH, grâce aux trithérapies. Dans ce cas, on assiste à une adaptation de la recherche à l’apparition de l’épidémie.
Ce choix fut en fait un choix égoïste, lié à un drame. En avril 1985, suite à un banal accident de mobylette, ma fille Muriel fut transfusée et infectée par le VIH ; elle nous a quittés en 1993, très peu de temps avant l’apparition des multithérapies. J’ai donc été très tôt sensibilisé à l’infection par le VIH, mais aussi à la bioéthique. Si les règles d’éthique avaient été respectées, nous n’aurions pas eu le drame national du sang contaminé qui reste une tache indélébile sur la médecine française : ne pas perdre de vue l’éthique en médecine. J’ai pour habitude d’expliquer à mes étudiants que si j’écris une équation et que je me trompe, je ne serai pas très intelligent, mais cela n’aura pas de lourdes conséquences. En revanche, un mauvais diagnostic peut effectivement induire des conséquences très graves.
Je suis là en tant que membre du CCDE (Comité consultatif de déontologie et d’éthique) de l’IRD, dont le président est Dominique LECOURT. C’est sous son impulsion qu’a été publié « un guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement », une charte comportant quinze principes que les chercheurs de l’IRD se doivent de respecter.
La mise en œuvre de la loi bioéthique de demain devra, me semble-t-il, prendre en compte un renforcement des structures de veille sur la bioéthique, notamment des comités d’éthiques, dont il serait bon, et c’est là un point de désaccord avec mon ami Jean-Claude AMEISEN, qu’ils soient dotés d’un réel pouvoir décisionnel, à l’image du Comité de protection des personnes (CPP). Pour l’heure, les comités d’éthique ne sont que consultatifs et les consulte qui veut. Outre leurs missions en matière de bioéthique, sur lesquelles je reviendrai, ces structures de veille devront également se préoccuper de l’intégrité en recherche, un peu à l’image de ce qui existe dans les pays comme l’Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon etc... pour prévenir et sanctionner éventuellement les dérives à l’intégrité en recherche que nous pouvons constater ici et là et qui ont pour noms : falsification (modifications de courbes, de spectres), fabrication de publications sans support expérimental ou plagiat. Tout le monde a en mémoire les errements du professeur chercheur coréen HWANG ou du physicien SCHÖN en Allemagne, tous deux nobélisables, ce dernier ayant publié jusqu’à 94 articles en trois ans dans des revues prestigieuses telles que Nature et Science. Il s’agit là d’exemples connus qui ne doivent toutefois pas masquer la réalité des problèmes qui n’épargnent pas les jeunes chercheurs. En vérité, on constate actuellement que la fraude, la misconduct, se trouve essentiellement chez les jeunes chercheurs, les assistants chercheurs, tout simplement parce qu’ils sont dans la démarche publish or perish (publier ou périr).
Pourquoi un renforcement de ces structures de veille sur la bioéthique ? Si l’on se place dans les domaines de la thérapie et du vaccin, (et je m’étonne de n’avoir pas depuis le début de cette audition, entendu une seule fois prononcer le mot « Sida »), les sciences du vivant sont en permanence confrontées à l’émergence de nouvelles maladies, comme le rappelait, dès 1933, Charles NICOLLE que je cite : « Il y aura donc des maladies nouvelles. C’est un fait fatal. Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine ; lorsque nous aurons une notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. » Cette émergence apparaît clairement à travers des maladies anciennes comme la peste noire au 14ème siècle dont les effets sont assimilés à ceux d’un conflit nucléaire, la grippe espagnole, avec comme virus le H1N1 en 1918 (30 millions de morts), le paludisme (10 millions de morts) ou des maladies récentes comme le Sida (20 millions de morts), la fièvre Ebola, la dengue, l’hépatite C, le SRAS, le Chikungunya, la grippe aviaire avec le virus H5N1 etc…
Nous cernons un peu mieux les causes de l’émergence de ces nouvelles maladies, sans pour autant les prévenir. Il y a des causes biologiques, comme le franchissement de la barrière d’espèce, le potentiel évolutif efficace, surtout des virus à ARN, dont les mutations et les combinaisons conduisent à des variantes souvent virulentes, et des causes sociologiques comme la rapidité des échanges, la variation des conditions de vie, la concentration des populations et donc celle des virus, la variation des écosystèmes. Le tour du monde en moins de 80 heures, comparé aux 80 jours de Jules VERNE est évidemment une aubaine pour les agents pathogènes. La diffusion mondiale du SRAS en 2003 à partir d’un hôtel de Hong Kong illustre particulièrement ce phénomène.
Ces émergences mettent d’abord en évidence la nécessité d’observatoires ou de veille sanitaires d’agences sanitaires et d’expertises indépendantes. Souvenons-nous que l’apparition du Sida a été décelée au début des années quatre vingt par l’observatoire américain le Center for Disease Control (CDC) qui avait constaté la réapparition d’une maladie pratiquement disparue, la pneumocystose, qui affectait essentiellement les homosexuels. On observait également une chute du système immunitaire, d’où le terme Sida (Syndrome d’Immuno déficience active). J’avoue préférer le terme : infection par le VIH, au terme Sida.
Pour répondre à ces défis, liés à l’émergence des techniques nouvelles, des concepts nouveaux dans les sciences du vivant apparaîtront forcément. Les structures de veille, grâce à leur flexibilité, pourront répondre au cas par cas et s’assurer que les règles éthiques sont effectivement respectées lorsque les techniques nouvelles et les concepts nouveaux seront appliqués. Une loi générale peut difficilement répondre à ce qui n’est pas toujours prévisible, sauf si elle prévoit des structures pouvant répondre à l’imprévisibilité.
Prenons pour exemple la thérapie génique confrontée au principe de précaution : elle implique le transfert d’un gène considéré comme une très grosse molécule. Je précise qu’il ne s’agit pas de remplacer un gène déficient par un autre gène, ce qui n’aurait aucun sens, mais simplement d’introduire un gène qui aurait pour fonction d’exprimer une protéine. Or, ce gène est une très grosse molécule qui va se heurter à un problème de pénétration et de franchissement de la barrière de la membrane cellulaire et ce, pour atteindre le noyau. Il faudra donc transporter cette énorme molécule à l’aide d’un vecteur vers la cible choisie. Or, il existe deux types de vecteurs : des vecteurs synthétiques non viraux, ne posant a priori pas de réel problème de sécurité, mais dont l’efficacité laisse à désirer dans le transport d’un fragment d’ADN, et des vecteurs viraux, parmi lesquels un vecteur dérivé du vecteur VIH1 modifié pour supprimer, autant que faire se peut, son caractère pathogène.
Selon moi, il faut renforcer les structures de veille, afin de répondre à l’imprévisibilité. En particulier dans l’exemple que je viens de prendre, s’il avait fallu introduire dans la loi l’interrogation suivante : « faut-il permettre l’utilisation de vecteurs viraux de type VIH1 modifié ? », la réponse aurait été à l’évidence négative pour des raisons de sécurité. On se serait alors privés de résultats, certes préliminaires, mais encourageants en tout cas dans quelques essais que l’on connaît. Nous sommes donc dans une situation où nous avons peut-être suffisamment de textes, de supports, mais il faut renforcer les structures de veille.
La loi bioéthique de demain devrait s’attacher à fixer un cadre général définissant les principes alliant l’éthique et les progrès des sciences du vivant. Elle devra prévoir des structures de veille qui auront pour fonction non seulement la prise en compte de l’échec inhérent à toutes recherche bio médicales mais aussi vérifier que les avancées scientifiques et technologiques sont en accord avec l’éthique et les textes officiels de référence que sont la déclaration d’Helsinki, le code de santé publique, la directive européenne, le guide des bonnes pratiques cliniques et le guide des bonnes pratiques de la recherche pour le développement.
J’ajouterais quelques mots sur les essais cliniques en Afrique. Ces derniers sont liés à la difficulté d’accès aux soins. On se trouve alors dans une confusion entre les accès aux soins et les essais cliniques avec tous les risques que cela comporte : les gens se précipitent pour participer aux essais cliniques, sans prendre en compte les risques possibles.
J’ouvre le débat, Mesdames et Messieurs les journalistes sont présents et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez.
‚
Mme Cécile OLIVIER, Agence de presse médicale
Ma question s’adresse plutôt à Madame CAMBY, en ce qui concerne les états généraux. Un calendrier a-t-il déjà été fixé sur l’organisation des états généraux ou sur la communication plus générale relative à la révision de la loi bioéthique d’ici 2009 ?
La réponse est non. Le calendrier n’est pas encore totalement arrêté et le dispositif non plus. A priori, la ministre de la Santé a annoncé les états généraux de la bioéthique pour 2009, sachant que des débats comme celui d’aujourd’hui commencent à être organisés, d’autres ayant d’ailleurs été annoncés au cours de la journée. Cette question est posée mais n’a pas encore trouvé de réponse définitive. Il ne faut pas seulement raisonner en termes de calendrier des états généraux, mais en termes de calendrier de révision de la loi, prendre le temps du débat parlementaire et même de la rédaction d’un projet de loi. Ceci s’additionne et aurait éventuellement pour effet d’avancer un peu le démarrage du débat.
Toutefois, nous ne sommes pas absolument obligés de réviser la loi en 2009 ; la seule date butoir tient au fait qu’à partir du décret d’application qui autorise l’Agence à délivrer des autorisations de recherche sur l’embryon, un délai de cinq ans court, ceci nous amène en février 2011, ce qui signifie une révision de la loi en 2010. Ceci ne change donc pas fondamentalement les données du problème.
M. Nicolas MATET, Professeur de droit
J’aurai une question pour Madame CAMBY concernant les autorisations portant sur l’expérimentation sur l’embryon. Lorsque l’on consulte la loi, on constate qu’il s’agit d’un dispositif tout à fait exceptionnel, justifié par la gravité de l’atteinte portée à l’embryon et lorsque l’on regarde les autorisations telles qu’elles sont publiées, je ne trouve pas de motivation expliquant que l’on s’inscrit bien dans les cadres fixés par la loi. Pouvez-vous m’éclairer et me dire où l’on peut s’assurer que l’Agence respecte bien la loi et motive sa décision au regard des conditions qui ont été déjà rappelées?
Premièrement, toutes ces décisions sont motivées et deuxièmement, toute la procédure qui est transparente et publique a été organisée de telle sorte que toutes les conditions imposées par la loi puissent être vérifiées. Ce point a également été abordé au cours des débats par des intervenants, membres du conseil d’orientation de l’Agence et qui participent à cette décision. Une première phase d’expertise scientifique est importante parce que ce sont des sujets extrêmement pointus sur lesquels l’Agence n’a pas forcément une compétence spécifique ; cette expertise est donc confiée à des experts extérieurs. Ces expertises qui portent sur la pertinence scientifique du projet sont transmises au conseil d’orientation de l’Agence, dont la composition a été décidée par la loi. Cette dernière comporte d’ailleurs des scientifiques de façon très minoritaire ; en effet, sur 25 membres du conseil d’orientation, seuls 6 sont médecins ou scientifiques, les autres étant des représentants de grandes institutions de la République (Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, CCNE etc...), des représentants d’associations de patients ou d’associations familiales (UNAF) et des personnalités qualifiées qui sont généralement représentatives des différentes disciplines des sciences humaines (philosophes, psychanalystes etc...).
Ce conseil d’orientation dispose donc d’une première expertise scientifique et il vérifiera tous les autres aspects : respect des conditions légales et des conditions posées par le décret, notamment en ce qui concerne le financement, la pérennité de l’équipe de recherche, la composition de cette dernière. Un point souvent examiné porte sur le fait de savoir si cette équipe dispose déjà d’une expérience dans le domaine de la manipulation des cellules humaines, ou des cellules souches embryonnaires. Si tel n’est pas le cas, nous exigeons que le demandeur prouve qu’il a envoyé un membre de l’équipe se former à cette compétence particulière, afin d’éviter que la manipulation peu expérimentée de ces cellules conduise finalement à détruire plus d’embryons qu’il ne paraît nécessaire.
Où trouver cette motivation ? En effet, les décisions comportent un visa de rapport mais on ne la voit pas dans les décisions telles qu’elles sont publiées.
Elles sont pourtant bien motivées.
Vous les consulterez et vous les trouverez sur le site de l’Agence de la Biomédecine. En tant que législateur, j’estime que les rapports d’activité de cette Agence et l’instruction des dossiers se font à la satisfaction générale. Y a-t-il une autre question ?
Vous avez raison de conseiller la lecture du rapport du conseil d’orientation. En outre, la loi nous oblige a rédiger un rapport sur cet aspect particulier de nos compétences. C’était la première fois l’an dernier puisque, auparavant, nous ne délivrions pas d’autorisations. Je pense que cette partie du rapport s’enrichira chaque année et c’est en tout cas ce que nous souhaitons.
Y a-t-il une autre question ?
8 Mme Marie-Françoise WITHNEY, MGEN
Ma question s’adresse aux législateurs et à leur mémoire. Je voudrais savoir pourquoi la fin de vie n’est pas une question traitée dans la loi de bioéthique et fait l’objet d’une législation indépendante.
Vous savez que, durant la dernière législature, une loi spécifique a été adoptée à l’unanimité, après un débat fort riche et d’une grande gravité. Il est vrai qu’elle pourrait figurer dans la loi de bioéthique ; tel n’a pas été le choix qui a été fait. Je rappelle le contexte dans lequel cette loi a été discutée au Parlement ; pour le moment, aucune évolution de cette loi qui a fait l’objet d’un consensus n’est envisagée dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. Un point d’équilibre a été, à un moment donné, accepté par le Parlement. Cela n’a pas été simple de discuter de cette question sous la précédente législature et j’ignore si, aujourd’hui, le débat peut être rouvert.
Cette question était judicieuse. En effet, aussi bien en ce qui concerne les cellules embryonnaires que les problèmes de fin de vie, nous touchons là aux franges de la vie. La loi qui a été votée l’a été dans un grand consensus malgré un certain nombre de difficultés. Je ne suis pas certain qu’elle serait revotée dans ces termes aujourd’hui, compte tenu de ce que l’on peut lire dans la presse sur les événements qui nous ont conduits à légiférer. Il convient d’être prudent. C’est une loi assez bonne, qui est certainement imparfaite, mais elle a le mérite d’exister.
Il y a effectivement des lois dont nous percevons bien qu’il serait souhaitable qu’elles soient revues régulièrement parce que les techniques évoluent. Ce sont des lois qui sont fondées sur l’évolution des techniques, je pense à la loi de bioéthique qui est assez caractéristique de ce point de vue là.
En revanche, il y a d’autres lois dont on a au contraire, le sentiment qu’elles essaient surtout de stabiliser des principes ou des comportements, et que nous sommes peut-être moins enclins à remettre sur l’établi fréquemment. Telle est ma perception.
Je suis d’accord avec Didier HOUSSIN. Au fond, nous avons l’illusion qu’il s’agit de début et de fin de vie, mais en fait, c’est tout à fait différent ; dans un cas, la question posée est la suivante : comment se comporte-t-on par rapport à la personne en fin de vie ? Alors que dans le cas présent, c’est : comment la biologie et la recherche se positionnent-elles par rapport à l’utilisation de cellules embryonnaires ? Ce n’est pas en raison de cette image en miroir, qu’il s’agit de la même approche.
Je voudrais répondre à Didier HOUSSIN à titre personnel sur le Comité consultatif national d’éthique : il me semble qu’un des aspects très intéressant serait un rôle plus important du CCNE dans l’animation et l’organisation de débats, de réflexions, d’appropriations de connaissances scientifiques ; la facilitation structurelle ou l’inscription dans les missions seraient utiles. Par ailleurs, de par ses modalités de nomination extrêmement pluridisciplinaires, ce Comité consultatif est sans doute l’un des comités les plus indépendants au monde ; dans de nombreux pays européens, il y a actuellement une tentation de changer, à intervalles réguliers, la composition du comité. Par exemple, le Comité national allemand qui fonctionne à peu près comme le nôtre est brutalement en train d’être modifié et je crois qu’il comptera 80 % de parlementaires. Imaginons que l’on dédouble l’Assemblée Nationale en comités ! L’idée de multi disciplinarité nommée par des structures indépendantes est difficile à mettre en oeuvre, même en Europe.
Je vous remercie.
LES PROPOSITIONS DES JURISTES ET DE LA CITÉ DES SCIENCES
Je donne la parole à Bénédicte De BARITAULT, qui est Chef du département des conférences du Collège de la Cité des Sciences et de l’Industrie. En effet, la Cité des Sciences et de l’Industrie contribue à animer ce débat public et a un programme chargé. L’année 2008 sera utile en ce sens.
8 Mme Bénédicte De BARITAULT, Chef du département des conférences du Collège de la Cité des Sciences et de l’Industrie
Je vous remercie Monsieur le Président. Effectivement, la Cité des Sciences n’aura pas une année blanche en 2008, mais plutôt une année colorée côté loi bioéthique puisque, dès le samedi 19 janvier 2008 et jusqu’au 16 février 2008 nous proposerons chaque samedi à l’occasion du cycle « la loi de bioéthique en questions » cinq conférences qui auront comme objectif de clarifier et de dresser un état des lieux de cette loi. Outre les rapporteurs de l’OPECST qui ont organisé cette réunion de ce jour, et qui interviendront le 19 janvier, Mme Carine CAMBY s’exprimera sur l’anonymat et la gratuité du don d’éléments du corps humain, M. Pierre JOUANNET, chef du service de biologie de la reproduction à l'hôpital Cochin, et Mme Irène THERY, sociologue, directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales débattront sur les « dons de gamètes : biologie et filiation », M Jean-Claude AMEISEN sur les tests génétiques, M Philippe MENASCHE, chirurgien cardiaque à l’hôpital européen Georges Pompidou, s’exprimera sur les enjeux autour des cellules souches.
Comment et pourquoi a-t-on crée ce cycle ?
Ces cinq conférences s’inscrivent dans le partage et la transmission du savoir pour permettre à des citoyens, qui n’ont pas forcément une formation scientifique spécialisée, d’acquérir des connaissances de base sur des sujets qui répondent à leurs curiosités, offrir à tous la possibilité d’entendre et de rencontrer des chercheurs scientifiques, acteurs de l’innovation, donner des repères, et du sens, et créer les conditions pour que chacun puisse se former une opinion éclairée sur les sujets qui le concernent.
La science est vraiment un maillon essentiel dans notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de la santé, de la procréation, de l’environnement. À la Cité des sciences, nous observons que les relations entre science et société se transforment. Il apparaît que ce qui est en jeu aujourd’hui dans le partage du savoir, ce n’est plus seulement la diffusion des connaissances, mais l’acquisition des outils qui permettent de comprendre, d’agir, de participer, de manière instruite, à la réflexion collective et au débat
Aussi, lorsque nous avons appris début 2007 à la suite d’une enquête d'opinion commandée par l'Agence de la biomédecine que les Français avaient une connaissance imprécise de certaines dispositions de la loi de bioéthique, il nous a semblé nécessaire et naturelle de monter un cycle de conférences qui aborde les grandes composantes de cette loi. Un an avant sa révision, il nous paraît important de remettre un peu à plat ces fondamentaux et de laisser la parole aux experts pour permettre à la société de mieux comprendre les enjeux. Pour permettre au plus grand nombre, et plus particulièrement aux personnes ne pouvant venir assister à Paris à nos cycles, nous enregistrons, numérisons et indexons toutes nos conférences : elles sont consultables en ligne.
L’exposition sur les dépistages génétiques en juin 2008
À l’occasion de la modification de la loi sur la bioéthique, la Cité des Sciences proposera également aux visiteurs une exposition sur les dépistages génétiques. Cette exposition dossier explorera l’univers très controversé des tests de dépistage. Tests de diagnostic préimplantatoire sur les premières cellules de l’embryon, tests réalisés au cours de la grossesse, tests de prédisposition génétique à des maladies (graves, voire incurables), tests de dépistage de prétendus qualités ou défauts, techniques d’imagerie pour déceler le plus précocement possible d’éventuelles maladies neuro-dégénératives. L’explosion du marché du dépistage pose de multiples questions sur les risques d’eugénisme, sur l’intrusion de la science tout au long de notre vie, et sur les utilisations à des fins non médicales des résultats de ces tests (sélection à l’embauche, aptitude au travail, assurances…). C’est un sujet assez polémique et nous essaierons de faire se confronter des points de vue de scientifiques variés, de juristes et d’autres intervenants de la société civile, pour faire le point sur ces questions.
Le débat public
En ce qui concerne le débat public, la Cité a plusieurs expériences dans ce domaine et elle peut être l'un des acteurs et des opérateurs de ces consultations. L’Agence de la biomédecine comme l’Office Parlementaire peuvent, le cas échéant, nous solliciter et nous contribuerons à l’organisation de débats publics sur le sujet.
Je vous remercie beaucoup. M Bertrand MATHIEU vous avez la parole.
M. Bertrand MATHIEU, Professeur de droit, Université Paris I
Je voudrais apporter des précisions sur la fabrication du droit. Le droit correspond et renvoie à un système de valeurs constitué de droits, de devoirs et d’intérêts protégés. Le droit exige une cohérence, certes on peut imaginer faire évoluer les systèmes de valeurs mais ceci doit faire l’objet d’un débat qui ne se limite pas aux aspects techniques, en l’occurrence aux aspects scientifiques et médicaux.
Dans le débat juridique, il y a des éléments sur lesquels je voudrais insister. Il y a tout d’abord le problème de la sémantique : il faut éviter de masquer les débats derrière un vocabulaire censé adoucir les problèmes. Il faut au contraire affronter les problèmes avec le vocabulaire qui leur correspond.
Deuxièmement, en ce qui concerne le droit en général, la loi en général et plus encore en bioéthique que dans n’importe quel autre domaine, le débat est souvent manipulé par l’émotionnel. La loi devient très souvent un produit de l’émotion et cela est extrêmement dangereux.
Troisièmement, le débat doit toujours prendre en compte la remise en cause des principes parce que si, pour réaliser des activités que l’on estime souhaitables ou acceptables, on remet en cause un principe qui constitue un verrou, on ne pourra plus ensuite trouver de fondement pour interdire des pratiques qui, elles, seront considérées comme beaucoup moins acceptables. Au nom de l’acceptable ou du souhaitable, il faut faire très attention à ne pas remettre en cause un certain nombre des principes.
Je prendrai un exemple dans lequel on constate un certain flottement à cet égard. J’ai identifié, dans un certain nombre de textes français et internationaux, les fondements de l’interdiction du clonage reproductif et j’ai constaté avec beaucoup d’étonnement qu’en fait, les fondements sont très incertains. Ceci soulève un problème de cohérence. En effet, d’un côté on le définit comme un crime contre l’espèce humaine, on le singularise, comme le crime parfait, ce que je ne critique point, et d’un autre côté, on est très faibles sur les raisons pour lesquelles on l’établit comme tel : on se trouve très fort sur la manière de sanctionner et très faible sur les fondements de la sanction.
Nous avons le choix entre deux logiques entre lesquelles nous naviguons : l’une, utilitariste, qui présente l’avantage d’offrir à la science une grande capacité d’adaptation mais qui s’avère peu productrice et repose sur un consensus fragile et l’autre, qui repose sur des principes plus objectifs. Lorsque l’on prend souvent des exemples anglo-saxons, il ne faut pas oublier que le droit anglo-saxon et la réflexion anglo-saxonne sont culturellement très largement fondés sur l’utilitarisme. C’est une façon de fonctionner sur laquelle je ne porte aucun jugement de valeur, mais ceci signifie que l’on ne peut absolument pas transposer les solutions anglo-saxonnes chez nous parce que le système de référence est un peu différent.
Je vous remercie vraiment. Madame LABRUSSE-RIOU vous avez la parole.
Mme Catherine LABRUSSE-RIOU, Professeur de droit, Université Paris 1
J’aborderai trois points dont deux sont liés l’un à l’autre. Premièrement, dans le cadre de la rédaction de la loi, la question de forme touche bien sûr le fond. Le législateur dispose de la possibilité de s’efforcer d’améliorer le rapport principes/exceptions. Il est pratiquement impossible de faire comprendre qu’une pratique est interdite, mais que toutefois, elle est permise. Il y a une longue tradition selon laquelle tout principe peut supporter des exceptions, mais le maniement et la détermination des exceptions doivent être interprétables. Or, dans l’état actuel des choses, comment voulez-vous interpréter les conditions mêmes de l’exception, la recherche sur l’embryon est topique à cet égard, mais il est bien d’autres exemples où l’on interdit de faire c’est le cas de la recherche sans bénéfice direct sur des personnes incapables de donner un consentement qui est interdite si toutefois on ne peut pas faire autrement?
C’est ainsi que l’on vide les principes de leur substance, en ne définissant pas, de façon rigoureuse, l’exception, et ce, d’une manière qui soit objectivement interprétable, qui ne dépende pas de la pure subjectivité des acteurs. Il est vrai que dans la rédaction des lois, les juristes ont une longue habitude et ont eu pourtant de nombreuses défaillances. Je considère qu’il est nécessaire d’améliorer cela dans un effort de clarification, d’affermissement des principes dans leurs rapports avec les aménagements.
Ceci m’amène à réfléchir à l’harmonie, ou à une manière de maintenir ensemble une normativité forte et ce que l’on appelle la gouvernance ou la régulation, c’est-à-dire la gestion, au cas par cas, des situations confiées notamment à l’Agence de la biomédecine ou, dans le cas de sujets plus terre à terre comme l’expérimentation ou la recherche biomédicale, au Comité de protection des personnes.
Ayant été éduquée dans un système dans lequel on m’a appris que le droit était normatif et qu’il ne se déclinait pas à l’indicatif, ce n’est pas un élément de fait à prendre en considération. J’ai tendance à considérer que le rapport de la casuistique et du principe reste toujours une question extrêmement difficile, et qu’il est important que le principe soit énoncé de façon à ce qu’il soit interprétable à l’intérieur de ses propres limites ; c’est-à-dire que le principe contienne en lui-même la raison des limites à l’intérieur desquelles la casuistique pourra avoir libre cours, et l’interprétation sera possible notamment, dans le cadre de l’Agence de la biomédecine. Il en va de même pour une jurisprudence judiciaire. Si le juge n’avait pas une loi à interpréter, mais une loi qui soit claire sur laquelle il puisse s’appuyer, il n’aurait plus qu’une gestion au cas par cas, c’est-à-dire dans l’arbitraire le plus total. Cela est très important, étant donné l’organisation des institutions et les rôles respectifs que le Parlement et les agences peuvent avoir à cet égard.
Enfin, je pense qu’il y a une question qui est posée mais qui n’a pas été traitée dans la révision des lois bioéthiques, et qui est récurrente, lancinante : il s’agit de la question de la gratuité par rapport à ce que représentent les profits générés à partir des produits du corps humain, notamment dans l’hypothèse où ils sont industrialisés. S’il y a une urgence qui pourrait être une spécificité française, ce serait que soit élaboré un statut des produits d’origine humaine comme cela avait été proposé dans le cadre de la commission BRAIBANT mais sans avoir pu aboutir pour des raisons de pures circonstances. Le problème ne se pose bien sûr pas pour les organes transplantés directement, et il s’agit de s’assurer que les donneurs qui souffrent soient tout de même traités équitablement. Ceci n’est pas un problème économique. Le problème économique procède du constat que le principe de gratuité ne tiendra pas longtemps dès lors que les produits humains sont industrialisés, transformés et revendus dans un système purement commercial qui n’a rien de honteux en lui-même.
L’idée avait été lancée par l’une de mes collègues avec laquelle je travaille depuis longtemps, Madame Marie-Angèle HERMITTE, selon laquelle un produit d’origine humaine pourrait disposer d’un statut spécifique en raison de la part d’humanité qu’il contient en lui-même. On peut assimiler cela à de l’animisme, mais cela a une symbolique. On pourrait imaginer qu’une part des profits réalisés à partir des produits d’origine humaine soit prélevée et redistribuée dans un but d’intérêt commun, par exemple, pour les recherches sur les maladies rares qui ne trouvent pas leur mode de financement par le marché.
Ainsi, dans une certaine mesure, le marché pourrait financer ce qu’il ne finance pas directement. C’est un montage juridique concernant le concept de produit d’origine humaine, qui, sur le plan économique, permettrait d’articuler l’industrialisation, la commercialisation, le profit, mais également une redistribution collective dans un intérêt commun de l’humanité. Pourquoi ? Parce que cela provient de l’humain. À partir de là, la gratuité initiale pourra être acceptée et justifiée. Dans le cas contraire, elle tombera.
Je vous remercie Madame.
8 Mme Hélène GAUMONT-PRAT, Professeur de droit à l'Université Paris VIII, Directeur du laboratoire de droit médical
Pour revenir sur les propos d’Axel Kahn « La morale est-elle soluble dans la science », il nous faut nous demander si face à certaines pratiques ou avancées scientifiques, le droit issu de la réflexion éthique, doit suivre et entériner ou marquer sa résistance ?
Je ne reviendrai pas sur la question du brevet sur le vivant et plus précisément sur la question de la brevetabilité des inventions issues des cellules souches embryonnaires, dont la solution relève de la pratique des offices de brevets.
S’agissant des tests génétiques, je souscris totalement aux propos de mes collègues et j’ajouterai que l’accent doit être mis sur l’information fournie en amont, voire par écrit.
Enfin, je centrerai mon propos sur les maternités de substitution liées aux procréations médicalement assistées qui existent malgré l’interdiction de la loi française, du fait du tourisme « procréatif » car elles sont maintenant autorisées dans un certain nombre de pays étrangers (Californie, Royaume-Uni, Belgique, Russie, Ukraine, Géorgie …). Aux Etats-Unis, il s’agit de véritables contrats conclus, avec obligation pour le couple ayant recours à une mère porteuse de souscrire une assurance.
Les deux situations, « gestation pour autrui » et « maternité pour autrui », sont très différentes puisque dans le premier cas, il s’agira bien de l’enfant biologique du couple, qu’une femme gestatrice a porté, tandis que dans le second cas, la femme s’engage à abandonner son enfant au profit du couple demandeur. En revanche, les conséquences juridiques sont identiques.
La jurisprudence a tout d’abord annulé et dissout les associations qui avaient pour objet de faciliter ces procédés, et leur objet a été déclaré illicite. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991 (Cass. ass. plén, 31 mai 1991, n°90-20.125, JCP éd. G 1991, II, n°21752, note F. Terré), sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, a cassé et annulé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 juin 1990 qui avait prononcé l’adoption d’une fillette par une femme mariée en jugeant que « la convention par laquelle une personne s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes », cela impliquant « un détournement de l’adoption ». La jurisprudence interdit systématiquement (Rennes, 4 juillet 2002, D. 2002; Cass 1ère civ. 23 avril 2003, Cass 1ère civ. 9 déc. 2003, D. 2004, Jur. p. 1998) depuis lors, l’adoption par la femme du père biologique.
Les principes invoqués (l’indisponibilité du corps humain et l’indisponibilité de l’état des personnes) et leur conséquence, « le détournement de l’adoption », tendent à la condamnation de la pratique des mères porteuses et s’inscrivent dans une politique juridique de dissuasion
La pratique des mères porteuses a été expressément interdite par l’article 16-7 du Code civil comme étant une dérive de l’assistance médicale à la procréation.
Des dispositions pénales sanctionnent également la maternité et gestation pour autrui.
- L’article 227-12 al. 3 sanctionne « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre à la naissance » et condamne à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende « le fait dans un but lucratif, de s’entremettre, entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître ».
- L’article 227-13 incrimine la substitution volontaire, la simulation et la dissimulation « ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant », situations punies de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Toutefois, saisie en appel d’un jugement du 13 décembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de Créteil, déclarant le Ministère public irrecevable de sa demande d’annulation de la transcription sur les registres du Service central de l’état civil, des actes de naissance des enfants, la Cour d’appel dans un arrêt du 25 octobre 2007 a confirmé le jugement, montrant ainsi une résistance à la position de la Cour de cassation.
Quant à l'approche sociale, il n'existe pas réellement de retour d'expériences, du fait du faible nombre d'enfants nés de ces techniques ou étant en âge de pouvoir s'exprimer en connaissant la réalité de leur mise au monde. Quelques affaires ont été médiatisées : dans un cas, il s'agit du refus de la mère porteuse de remettre au couple destinataire l'enfant « commandé » ; dans un autre, une mère porteuse décide de recourir à des enchères sur Internet pour que l'enfant soit vendu au plus offrant.
Les pouvoirs publics veulent éviter les trafics d'enfants, et les maternités pour autrui sont le plus souvent associées à des ventes de bébés, puisque dans un certain nombre de cas, les motivations financières des futures mères porteuses ne sont pas absentes.
Quelles solutions pourraient être envisagées ? Il apparaît difficile d’envisager à l’instar de certains pays étrangers, de véritables contrats de location, de livraison, avec des clauses de résiliation, incompatibles avec l’esprit du droit français très protecteur de la dignité humaine comme le montrent les aspects éthiques envisagés au cours de cette audition.
Le problème crucial n’est-il pas celui de la filiation de ces enfants nés « hors norme » ? Les principes régissant la filiation sont une question d’ordre public, construite par la société et reconnue lorsqu’elle correspond à notre modèle social. La notion d’intérêt de l’enfant est différente de celle qui prévaut en matière d’autorité parentale.
Dans le cas présent, la jurisprudence de la Cour de cassation en application pose ainsi le principe que l’enfant sera un tiers par rapport à la femme qui l’élève et joue le rôle de mère (mère génétique ou sociale). Si la mère qui a élevé l’enfant décède, les grands-parents maternels n’ont aucun droit pour réclamer l’enfant à l’Aide sociale à l’enfance si celui-ci lui a été confié, face à la carence du père. L’enfant est en outre totalement dépourvu de toute vocation successorale à l’égard de ses grands- parents maternels. Dans l’hypothèse où son père décède, il devient orphelin et sa mère ne peut exercer l’autorité parentale. L’enfant fait les frais des montages imaginés par les adultes.
En droit de la famille, on a assisté par le passé à une mise en place progressive de l’égalité des filiations des enfants, en dissociant cette question du statut du couple marié/non marié. Ainsi, l’égalité des enfants naturels et légitimes a-t-elle été mise en œuvre bien avant que le code civil reconnaisse une définition du concubinage et du PACS.
D’une manière générale, certains cas de maternité pour autrui ne permettent-ils pas d’envisager l’adoption, après vérification de l’absence de trafic d’enfant et d’intérêt de l’enfant ? Il s’agirait d’accorder au cas par cas une filiation fondée sur l’adoption, création d’une filiation sous couvert de l’autorité judiciaire. Ne peut-on pas envisager de permettre l’adoption plénière des enfants nés de mère porteuse, dès lors qu’aucune filiation maternelle antérieure n’a été revendiquée par la mère porteuse, sans pour autant légaliser la pratique et maintenir les sanctions en vigueur ?
En effet, la dissociation des deux notions éviterait la conséquence visée dans l’arrêt de 1991 : le prétendu « détournement de l’adoption ». Les conditions de fond de l’adoption plénière définie par l’article 353 du code civil ne visent que l’intérêt de l’enfant. N’est-ce pas alors de son intérêt d’accéder à sa filiation maternelle et d’être adopté par la femme qui l’a élevé ? L’article 356 du code civil permet bien l’adoption de l’enfant du conjoint.
8 M. Alain CLAEYS
Au nom de Jean-Sébastien VIALATTE, et en mon nom, je voudrais remercier l’ensemble des intervenants et vous, auditeurs attentifs de cette journée qui, j’en suis conscient, a été longue mais je crois utile. Nous nous étions fixés quatre objectifs dans cette journée et j’estime qu’ils ont été atteints.
Nous voulions identifier les défis que les projets des sciences du vivant lancent à notre société et cela a été le fil conducteur de toutes les interventions d’aujourd’hui.
Nous voulions également, en ce début d’exploration de la loi de 2004, anticiper et révéler les lacunes de cette loi, afin de répondre, de façon équilibrée, aux avancées scientifiques de demain. Je crois que là aussi, toutes les pistes qui ont été énoncées seront utiles à Jean-Sébastien VIALATTE et à moi-même, dans notre réflexion et notre rapport.
Nous voulions mettre en évidence des dysfonctionnements induits par certaines dispositions de cette loi ; vous nous avez aidés à en recenser plusieurs ce qui nous sera aussi très utile.
Enfin, il fallait, à travers cette journée, prendre en considération l’accélération de la mondialisation et ses effets sur l’application de normes juridiques que nous édictons en France. Lorsque l’on évoque les notions de gratuité, d’anonymat, on perçoit bien que ces notions fondamentales dans notre pays, sont confrontées à d’autres pratiques au niveau international et qu’il faudra en tenir compte.
J’ai un souhait : il faut que l’année 2008 soit utile pour ces lois, et nous souhaitons que l’exécutif puisse mettre en place assez rapidement ce débat public confié à l’Agence de la biomédecine.
En effet, la future loi bioéthique sera bonne si elle a été précédée, en amont, par une réflexion de nos concitoyens. L’Office s’inscrira dans ce débat public, telle est sa vocation, sa nature, le Premier Vice-Président Claude BIRRAUX qui a ouvert nos travaux l’a redit. Nous sommes prêts et c’est notre rôle, à préparer la décision du législateur, et à nous inscrire aussi dans un tel débat qui doit se tenir en amont de la loi et non au moment où la loi sera discutée. Or, si l’on ne prend pas un temps suffisamment long pour le débat public, on risque la confusion et la loi sera discutée dans cette confusion.
Je relève un autre acquis de cette audition publique. Pour avoir organisé d’autres tables rondes sur ce sujet dans le cadre de l’Office, je constate qu’aujourd’hui, nous sommes en train de trancher un problème qui peut paraître secondaire pour les spécialistes, mais pas pour celles et ceux qui suivent les lois de bioéthique au Parlement. Il convient de bien faire la distinction entre ce qui doit être considéré comme la recherche fondamentale, et le terme de recherche à visée « thérapeutique » qui, malgré nous, a été utilisé à « toutes les sauces » pendant des années, soit pour justifier telle avancée, soit pour justifier tel statu quo.
Nous devons être vigilants par rapport à l’utilisation de ce terme : vigilants par honnêteté intellectuelle, mais aussi vigilants par respect pour tous les malades et leurs familles. En effet, les annonces faites le matin à la radio ou dans des journaux sont perçues de façons différentes par ceux qui sont malades. Il est de notre responsabilité de législateur d’être attentifs.
Tel est le travail qui nous attend. Je remercie vraiment vous toutes et vous tous d’avoir consacré cette journée au Parlement. Il sert à quelque chose lorsqu’il travaille sur les lois bioéthiques et je vous assure, à titre personnel, qu’il est agréable d’être parlementaire lorsqu’on aborde de tels sujets.
EXPLORATION DU CERVEAU, NEUROSCIENCES :
AVANCÉES SCIENTIFIQUES, ENJEUX ÉTHIQUES
COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE
OUVERTE À LA PRESSE
DU MERCREDI 26 MARS 2008
Alain CLAEYS, Député de la Vienne
Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
___________________________________________________________________
M. Alain CLAEYS, Député de la Vienne.
Permettez-moi tout d’abord de saluer la mémoire de Christian CABAL qui vient de décéder. Christian CABAL était député, membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il a travaillé sur de nombreux sujets, en particulier sur l’espace et la biométrie. J’aimerais que nous ayons une pensée pour lui.
Au nom du président Henri REVOL et des membres de l’Office, je remercie chacun de sa présence, tout particulièrement les personnalités qui ont accepté d’intervenir lors de cette réunion.
Après avoir ouvert le débat sur l’évaluation de la loi de bioéthique par une première audition publique consacrée à un état des lieux liminaire des relations entre les sciences du vivant et la société, nous avons décidé d’organiser une série d’auditions publiques plus ciblées. Plusieurs membres du Conseil scientifique de l’Office avaient appelé notre attention sur la nécessité de cerner l’impact juridique et social des recherches sur le cerveau à la lumière des nouvelles technologies. L’audition publique du 29 novembre dernier nous a convaincus qu’il faudrait prendre en compte ces recherches lors de la révision de la loi de bioéthique, car c’est le cerveau en fonctionnement qui est aujourd’hui scruté par des machines.
L’accélération des recherches en sciences du vivant, dans les domaines des nanotechnologies, des technologies de l’information et des neurosciences induit en même temps une accélération des convergences de ces technologies. Ce double phénomène d’extension du champ des sciences du vivant et d’accélération entraîne, pour la société comme pour le législateur, des interrogations qui rendent plus difficiles les réponses législatives. Cette extension nourrit des espoirs pour le traitement des maladies et la prévention.
Aujourd’hui, un continent se révèle, il concerne l’exploration des mécanismes cérébraux qui sous-tendent la mémoire, les pensées, les émotions, les comportements. Or, les possibilités d’intervention sur le système nerveux sont maintenant multiples, que ce soit avec des molécules chimiques ou des procédés plus ou moins invasifs tels que l’imagerie cérébrale, la stimulation magnétique trans-crânienne, les implants ou les neuroprothèses.
Des questions se posent : que lit-on, que dépiste-t-on, que soigne-t-on ? Peut-on attribuer un sens ou un contenu aux nouvelles techniques d’imagerie, déduire les causes biologiques d’un comportement ou d’une maladie mentale ? Quels sont les diagnostics actuels et à venir de troubles psychiatriques, tels que l’autisme, la schizophrénie ou la dépression ? Quel est leur intérêt médical et social ? Qu’apportent les neurosciences et la génétique au diagnostic des pathologies mentales ? Quel est leur pouvoir prédictif et comment les diagnostics prédictifs pour certains troubles sont-ils reçus par les patients et leurs familles alors qu’aucun traitement n’existe ? Quels sont les effets du dépistage précoce quand il n’y a pas de remède et qu’un risque de stigmatisation existe ?
Doit-on au nom d’impératifs de performance médicaliser certaines conduites et comportements « anormaux » en les désignant comme des pathologies, telle l’hyperactivité chez l’enfant ? Doit-on au contraire « démédicaliser » les pathologies mentales, pour que les patients puissent être insérés dans la société ? Les moyens se multiplient pour aider à la performance physique, intellectuelle, soutenir la mémoire (ou l’oubli), intervenir par neurochirurgie, neurostimulation, neuroappareillage, greffes de cellules ou de nano dispositifs. Risque-t-on de modifier l’humain ? Ces innovations seront-elles accessibles à tous ? Ces recherches suscitent espoirs de guérison mais aussi craintes de manipulation, d’atteintes à l’autonomie de la volonté, à l’intimité de la vie privée.
De surcroît, les neurosciences permettent de caractériser des associations de plus en plus pertinentes et précises entre des cartes fonctionnelles d’activité cérébrale et des comportements individuels comme l’agressivité, l’impulsivité et la violence. Ainsi, dans les pays anglo-saxons, les neurosciences sont déjà sollicitées pour caractériser la responsabilité pénale. La demande sécuritaire de plus en plus forte incite d’ailleurs les gouvernements à rechercher des indicateurs biologiques de dangerosité de l’individu, ce qui pourrait conduire à des dérives inquiétantes.
Aux États-Unis, une réflexion trans-humaniste est menée. Ses visées n’ont rien de thérapeutique puisqu’il s’agit d’accroître les performances, de promouvoir un « humain augmenté ». Si c’est sérieux, comme cela semble être le cas, c’est grave, car il s’agit là d’un dévoiement de la science et de la technique ! C’est un nouveau champ d’investigation éthique que nous ouvrons donc aujourd’hui.
M. Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var.
Je m’associe aux remerciements qui vous ont été adressés par Alain CLAEYS. La loi de bioéthique de 2004 ne traite pas directement des questions éthiques que soulève le développement accéléré des recherches sur le fonctionnement du cerveau. Cependant, les débats de la première audition publique consacrée aux défis des sciences du vivant, comme ceux que l’Office continue de mener sur les nanotechnologies ou les biotechnologies font naître des interrogations, des inquiétudes, et surtout un réel besoin de débattre de l’impact de ces recherches et de ces nouvelles technologies sur notre société. Ils appellent aussi une réflexion interdisciplinaire et interpellent le législateur.
Les articles portant sur le cerveau, la neuroimagerie, les neurosciences se multiplient, et pas uniquement en cette « semaine du cerveau ». Ils véhiculent des espoirs de guérison de maladies neurodégénératives, de tumeurs, de troubles neurologiques et psychiatriques. Ils répondent souvent aux attentes d’un public fasciné par la technologie, aux angoisses des patients et de leurs familles, mais aussi à des craintes diffuses de manipulations, d’atteintes à la vie privée, à l’autonomie de la volonté. On constate une « gourmandise technologique », une exigence de progrès répondant à de réels besoins thérapeutiques, mais aussi un désir de performances, de maîtrise de son corps, de connaissance de ses émotions et de celles d’autrui. Des craintes, des peurs, des angoisses s’expriment, mais aussi des espoirs, parfois suivis de déceptions. Quelles que soient les postures, le besoin d’informations et de débats est immense.
Si nos comportements et nos décisions, peuvent être décortiqués tels des mécanismes biologiques, si les outils diagnostiques aident à prédire les troubles psychiques, leur cause, leur évolution, s’il est possible de manipuler des cerveaux et des comportements par des drogues de l’humeur, de la mémoire, de l’éveil, par des implants cérébraux ou des greffes de cellules, quels en seront les usages et les limites ?
Les techniques d’imagerie nous montrent le cerveau en fonctionnement, mais que représentent ces images ? Peut-on leur donner un sens et en déduire les bases cérébrales, les causes biologiques d’un comportement ou d’une maladie mentale ? Si certaines de ces techniques répondent aux besoins de la clinique, notamment pour les diagnostics et aident à la thérapie, d’autres ne semblent pertinentes que comme outils de recherche et peuvent cependant avoir un impact prédictif de telle ou telle conduite.
Comment limiterons-nous les risques d’utilisation abusive des informations diagnostiquées et leur impact prédictif sur la justice, les compagnies d’assurances ou les services de marketing ? Quels seront les effets sur la société de la neuroéconomie ? Sont-ils conciliables avec notre conception de l’autonomie de la volonté, de la dignité des personnes, de la protection de la vie privée et des données personnelles ?
Par ailleurs, se développe aux États-Unis un courant, certes utopique, semblant relever de la science fiction, mais fondé sur les nouvelles technologies convergentes, nanotechnologies, biotechnologies, informatiques, et sciences cognitives qui, elles, sont utilisées. Ce sont les adeptes du transhumanisme qui se félicitent des résultats de certaines innovations technologiques, des possibilités d’agir sur le cerveau humain, de construire une affectivité et des émotions artificielles à partir d’ordinateurs. Il nous a paru nécessaire d’évoquer cette problématique.
Aussi s’agit-il pour notre mission d’évaluation de dresser un état des lieux, le plus objectif possible, afin de déterminer des pistes de régulation, de savoir si la réglementation actuelle est adaptée, si les instances comme l’Agence de la biomédecine, le Comité national consultatif d’éthique, la Haute autorité de santé, sont en mesure de relever ces défis.
___________________________________________________________________
8 M. Hervé CHNEIWEISS, Directeur du laboratoire de plasticité gliale, Centre de Psychiatrie et neurosciences (INSERM), Membre du Conseil scientifique de l’OPECST.
Je tiens tout d’abord à remercier M. Alain CLAEYS et M. Jean-Sébastien VIALATTE pour l’organisation de cette journée. Je remercie également les participants d’être venus si nombreux.
En quoi les questions éthiques issues des neurosciences sont-elles différentes de celles déjà traitées, en particulier pour la génétique des individus ? Par bien des égards en rien ; aussi convient-il d’appliquer aux neurosciences et à leur usage nombre de principes établis à partir des réflexions sur la génétique, et l’on constatera lors de l’intervention de Thomas BOURGERON que ce n’est pas parce que quelques mutations de l’ADN peuvent être à l’origine de certaines formes d’autisme ou d’autres pathologies psychiatriques qu’il faudrait céder au déterminisme qui fit le lit de l’eugénisme.
Les lois sont encore trop nombreuses, notamment dans le domaine de la bioéthique. Pourquoi vouloir traiter maintenant des neurosciences ? La plupart des principes établis pour la génétique valent pour n’importe quel champ de la recherche sur les sciences du vivant. Le fait que les neurosciences ou les pathologies associées représentent aujourd’hui 30 % des dépenses de santé dans la plupart des pays développés, ou que la population vieillisse ne suffit pas à justifier une réflexion spécifique aux neurosciences.
Il existe toutefois au moins deux domaines spécifiques aux neurosciences : celui de la conscience et celui de la pensée, en ce qu’elle détermine le principe d’autonomie qui fonde toute discussion éthique et donc s’inscrit à l’origine de notre conception de l’individu et constitue le moyen indispensable de toute démarche éthique.
L’activité de notre cerveau est à la fois l’origine et l’émergence de la pensée, de la perception et de l’action, ainsi que l’expression de notre identité personnelle. Les possibilités d’intervention sur le cerveau sont aujourd’hui multiples, qu’elles interviennent grâce à des molécules chimiques ou à des procédés plus ou moins invasifs. Les possibilités nouvelles de modification des comportements, qu’ils soient végétatifs comme l’appétit, le sommeil ou la sexualité, ou cognitifs comme l’humeur ou la mémoire, nécessitent une réflexion approfondie car ces possibilités d’intervention ne sont pas explicitement couvertes par la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données.
Le problème de la conscience est bien mis en valeur par son opposé, l’inconscience ou plus exactement la perte de conscience. Nous l’expérimentons tous les jours lorsque nous nous endormons, mais cet état devient un problème de société lorsque les technologies, notamment celle de la réanimation, permettent de voir de très nombreuses personnes dans des états inconscients. Aux États-Unis, de 112 000 à 250 000 personnes sont aujourd’hui plongées dans un coma réactif ou vigile, et 14 à 35 000 sont dans un état végétatif permanent stable. Transposé en France, cela équivaudrait à 30 000 comas réactifs et 4 000 états végétatifs permanents. Au-delà du problème de la souffrance des familles et des coûts colossaux, la question de l’interruption des soins se pose, d’autant plus que, passées les premières heures, les chances de réveil s’amenuisent, de même que les capacités de récupération. La réponse n’est pas simple.
Les techniques récentes d’imagerie cérébrale ont permis de mettre en évidence des réponses fonctionnelles à des récits verbaux évoquant des événements majeurs de la vie de l’individu, tant pour des patients en coma réactif que pour un patient en état végétatif permanent, l’existence de parties fonctionnelles ne présume pas un cerveau fonctionnel, et l’existence d’un traitement d’une information ne préjuge pas de la capacité de conscience. Stanislas DEHAENE et ses collaborateurs ont bien montré l’influence du traitement inconscient de l’information sur nos décisions apparemment conscientes. Il évoquera avec Denis Le BIHAN et Emmanuel-Alain CABANIS les nouvelles possibilités de comprendre les mécanismes d’activité cérébrale avec l’imagerie fonctionnelle.
Quid, dès lors, des messages subliminaires ? L’on sait que l’on peut influencer de façon inconsciente une décision qui apparaît consciente. Jean-Didier VINCENT reviendra sans doute sur le fait que l’essentiel de l’activité cérébrale est inconsciente et que les émotions nous gouvernent au moins autant que la raison. Le cogito cartésien apparaît aujourd’hui comme un comparateur entre des scénarios rationnels issus du lobe frontal et le « poids » qui leur est attribué par l’expérience et le contexte, tous deux dépendant et générant de l’émotion issue des circuits limbiques, l’amygdale s’inscrivant au carrefour de ces circuits neuraux.
De la conscience il faudra ensuite passer au champ de l’action. François BERGER et Bernard BIOULAC évoqueront alors des neuroprothèses et des nanotechnologies appliquées à l’humain. Des dispositifs médicaux implantés permettent aujourd’hui à des parkinsoniens ne répondant plus aux thérapeutiques classiques de retrouver une vie décente. Ce traitement est élaboré en France par le groupe bordelais de Christian GROSS et Bernard BIOULAC, et le groupe grenoblois de Alim-Louis BENABID et Pierre POLLAK
Cependant, nous découvrons que les circuits dopaminergiques contrôlent les mécanismes de récompense, donc l’addiction à certaines drogues, d’abus, et l’impulsivité. La manipulation des circuits dopaminergiques peut également conduire à influer sur les processus de décision de la personne à son insu. Nous sommes dans des sociétés de la performance et de la compétition qui prônent de façon implicite les principes du libéralisme légal, où chacun serait libre d’utiliser ou de refuser la drogue ou le dispositif de son choix à partir du moment où cela ne nuit pas à autrui.
Or, il va de soi que le consentement éclairé pour un traitement, chimique ou par implant cérébral par exemple, est un pré requis nécessaire, mais ce consentement éclairé n’est nullement suffisant car la puissance publique est garante des principes d’intégrité et d’inviolabilité du corps humain, et c’est bien sur le fondement de ces principes que nous ne sommes pas libres de faire n’importe quoi de notre corps.
L’amélioration de la performance ne semble pas condamnable si elle a pour objet d’aider l’autonomie et le bonheur de l’individu, (permettre aux aveugles de voir, aux paralytiques de marcher) sans en faire payer le prix aux autres. Quel est le prix « social » de l’amélioration de la performance ? Comme personne ne le sait, il nous faudrait d’abord évaluer les conséquences du pouvoir que l’amélioration de l’un peut donner sur les conditions de vie de l’autre : avancement scolaire, promotion hiérarchique, pouvoir de subordination intellectuel… son corollaire est l’obligation subliminaire du « tous dopés » pour survivre. Tel est le problème des 3,5 millions d’enfants traités par le méthyl phénidate aux États-Unis, destinés en grande partie à obtenir des classes calmes dans les quartiers aisés. De même y sont utilisés des micros dispositifs implantés pour améliorer la performance des soldats sur le terrain.
La liberté de l’individu n’est possible qu’autant qu’on l’informe, d’où l’importance d’une telle audition publique. Nous devons démystifier les fantasmes, et informer le public des dernières avancées afin de les encadrer, surtout lorsque les progrès de la science entrent dans le champ social pour l’amélioration des performances, le contrôle du comportement des enfants. Se pose ainsi la question de la maîtrise de ces traitements, surtout quand ils sont remis en cause, comme le furent certains antidépresseurs, utilisés à mauvais escient.
En conséquence un autre aspect du coût social relève du registre de la discrimination. Pour opérer dans un réel environnement de libéralisme cognitif, il faut transformer le procédé d’amélioration en bien public, accessible à tous, dont personne ne puisse être privé et dont l’usage n’épuise en rien la ressource. En outre, de tels dispositifs peuvent être utilisés dans des buts thérapeutiques, ou pour améliorer la performance d’un individu. Il faut dès lors créer un nouveau garant, une Agence nationale de l’amélioration cognitive chargée d’évaluer le procédé, son innocuité, sa réelle efficacité, son accessibilité, etc.
Un autre problème fondamental réside dans la vision mécanique d’un « cerveau machine » permettant d’optimiser des variables biologiques et fonctionnelles au fur et à mesure qu’elles sont connues : niveau hormonal, taux de neurotransmetteurs, adaptation du nombre et de la qualité des cellules actives, ajout de circuits complémentaires de soutien ou de secours. Le neurobiologiste se substitue alors au grand horloger de l’univers des conceptions déistes. On préjuge qu’il existe une universalité du temps sur laquelle chaque horloge peut être réglée et toute variation à la norme doit être corrigée.
MARX, DARWIN, FREUD et EINSTEIN ont tour à tour fait voler en éclat le schéma mécanique, chacun pour sa part de l’humain dans un monde physique, social, évolutif et relatif. L’exemple de la mémoire est à ce titre instructif car il n’est pas possible d’inférer du quantitatif au qualitatif, et plus de mémoire donne plus de capacité d’agir.
La nouvelle de BORGES, Funes ou la mémoire, ou le patient de LURIA, SHERESHEVSKII, montre au contraire des sujets accumulant les souvenirs, mais incapables d’en extraire l’information pertinente et finalement incapable d’agir. Les expériences récentes sur des patients amnésiques après une lésion de l’hippocampe, confirment le lien entre le souvenir organisé et la capacité de projection vers le futur.
La demande sécuritaire de plus en plus importante incite les gouvernements à rechercher des indicateurs biologiques de dangerosité de l’individu. La récente loi sur la rétention de sûreté des criminels sexuels et leur internement en milieu fermé, même après l’exécution de leur peine, conduira certainement à renforcer cette demande. Dans le domaine du prédictif, il serait en effet heureux de savoir si tel criminel peut se révéler dangereux demain. Dès lors, que faire si l’imagerie révèle une faible capacité de l’individu à maîtriser des pulsions violentes ou à réagir de façon inappropriée à une stimulation sexuelle ? Après la bosse du crime issue de la phrénologie, après le chromosome du crime issu de l’observation d’un Y supplémentaire chez certains condamnés, après le gène du crime issu de l’observation de certains variants de la monoamine oxydase A en relation avec un comportement violent, aurons-nous demain l’image cérébrale du crime ? La question est donc bien une nouvelle fois de déterminer la valeur prédictive réelle du test envisagé, et non de valider de manière pseudo scientifique des préjugés sociaux.
Ainsi, après le détecteur de mensonges électriques, le polygraphe, voici venue l’ère du high-tech avec l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), permettant d’aller au plus profond de l’âme. La justice cherche toujours à établir des faits, d’où l’idée qu’il existerait une vérité neurophysiologique inscrite au sein des circuits cérébraux. Mais comment traiter l’adhésion qu’un sujet, témoin par exemple d’une scène violente, peut avoir vis-à-vis d’un souvenir erroné ? L’image cérébrale, si elle s’avère possible, montrera que le sujet ne se ment pas et ne ment pas au tribunal, mais en aucun cas qu’il dit « la » vérité.
Cette vérité serait-elle meilleure si la mémoire était soutenue ? C’est ici la question de la neuropharmacologie et d’éventuelles techniques permettant d’améliorer la mémoire qui est posée. Une grande partie de la justice étant basée sur le témoignage, ne serait-il pas heureux en effet de pouvoir bénéficier d’une remémoration plus riche, permettant aux témoins ou à l’accusé de relater avec plus de détails le déroulement des faits. Le sous-entendu de cette acception implique que ces informations obtenues en levant la barrière de la volonté de l’individu, volonté consciente ou inconsciente, seraient plus exactes et permettraient une justice plus efficace. Or c’est encore une erreur. La levée d’une inhibition à la remémoration, ou la facilitation de la venue à la conscience d’une image de mémoire ne garantit en rien la validité du témoignage. Le cerveau est une puissante machine à émettre des hypothèses sur le vrai et le faux, et à confronter sa perception du réel à ces hypothèses. Mais il n’existe pas d’image neurale du vrai.
Utilisera-t-on demain des IRM pour débattre au tribunal de discrimination raciale ou sexiste ? Mais qui passera le test ? L’accusé, les membres du jury, le juge, les témoins, les policiers ? Ce que je souhaite montrer est qu’il existe une image neurale de l’activité de notre cerveau, mais il n’existe pas d’image neurale du vrai. Pour reprendre les thèses de Max WEBER, il existe une différence de nature entre les caractéristiques du fait scientifique et celles des valeurs sociales.
Dans son avis n°98 sur la biométrie, le Comité national consultatif d’éthique (CCNE) constatait : « Les trois questions les plus angoissantes sont donc celle du glissement du contrôle de l'identité à celui des conduites, celles de l'interconnexion des données et leur obtention à l'insu des personnes concernées. » Dans son avis n°20 portant sur les implants et tout particulièrement les neuroprothèses, le Groupe européen d’éthique (GEE) soulignait également des risques d’atteinte à la dignité humaine, évidents pour des dispositifs implantés à buts professionnels ou d’amélioration de la performance (militaires par exemple), mais également pour les dispositifs à buts médicaux (questions des implants cochléaires unis ou bilatéraux chez les enfants sourds). Le GEE propose d’interdire les implants cérébraux qui pourraient être utilisés « comme fondement d’un cyber- racisme ; pour modifier l’identité, la mémoire, la perception de soi et la perception d’autrui ; pour améliorer la capacité fonctionnelle à des fins de domination ; pour exercer une coercition sur les personnes qui n’en sont pas dotées ».
Notre activité cérébrale n’est pas seulement la synthèse de l’activité de nos gènes et de la coordination de nos réseaux neuraux sculptés par notre histoire personnelle. Elle se développe dans une anticipation des événements de notre environnement, dans une projection anthropologique et socialisée de notre monde. Nous anticipons l’action de l’autre et la figure de l’autre agit sur notre activité neurale. Dès lors, quelles que soient les contraintes physiques et biologiques bien réelles dans lesquelles se déroulent nos pensées, nous devons prendre en considération la plasticité de notre système nerveux, sa capacité à sans cesse évoluer et admettre que la liberté de pensée est nécessaire à notre capacité de survie en individu social. Nous devons exister avec les autres et nous existons par les autres.
D’une façon générale, les principes éthiques et légaux qui ont guidé l’encadrement des données personnelles issues de la génétique et des échanges informatiques devraient aujourd’hui permettre d’encadrer l’utilisation de connaissances issues des neurosciences. Il conviendrait également d’établir un dispositif d’autorisation de mise sur le marché assorti d’évaluations ad hoc pour tout procédé ayant comme objectif ou conséquence d’agir sur les capacités cognitives des individus.
Une société de l’information et de la communication est forcément une société où le cerveau de chaque individu doit être protégé de l’instrumentalisation. Par ailleurs, les molécules et procédés issus des connaissances en neurosciences doivent être mis au service de la restauration des fonctions perdues et de l’accroissement des libertés d’agir, et non permettre l’assujettissement à une norme sociale.
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
Je vous remercie beaucoup pour ces propos introductifs et instructifs. J’appelle maintenant les participants à la première table ronde qui porte sur les défis des sciences et des technologies.
LES DÉFIS DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES
__________________________________________________________________
IMAGERIE DU SYSTÈME NERVEUX, IMPLANTS CÉRÉBRAUX ET COMPORTEMENT : QUE LIT-ON, QUE DÉPISTE-T-ON, QUE SOIGNE T-ON ?
M. Alain CLAEYS.
Je donne la parole à M Denis Le BIHAN qui va présenter les nouvelles technologies d’imagerie.
8 M. Denis Le BIHAN, Directeur de NeuroSpin, CEA, Directeur de l’Institut fédératif de recherche d’imagerie neuro- fonctionnelle, Membre de l’Académie des Sciences.
Messieurs les députés, mes chers confrères, mesdames et messieurs.
C’est un très grand honneur pour moi que d’intervenir cet après-midi pour vous présenter la neuroimagerie et les outils pour comprendre le cerveau. Je resterai le plus factuel possible pour en expliquer les principes et montrer que l’on observe des phénomènes intéressants, mais qu’il existe des limites à ce que l’on peut faire.
S’intéresser au cerveau humain, implique de s’intéresser, non seulement à l’organe lui-même pour aider le neurochirurgien à opérer, mais également s’intéresser à sa place par rapport à la personne, pour comprendre les pathologies, les anomalies du développement cérébral, le vieillissement et le handicap du cerveau, les troubles liés à l’humeur et la psychiatrie.
Pour tenter de comprendre comment nous communiquons, apprenons et inter réagissons avec des machines, l’imagerie est devenue incontournable. Il ne s’agit pas de tout expliquer mais de disposer de notions sur le fonctionnement cérébral qui nous aident à répondre à ces questions.
En effet, le chirurgien français Paul BROCA l’a démontré, le cerveau est organisé en régions. Menant des expériences sur un patient célèbre atteint d’aphasie, Monsieur LEBORGNE, surnommé « Monsieur tan tan » car il répondait ainsi à toute question, il a pratiqué une dissection du cerveau et fait deux découvertes majeures : la lésion se situait du côté gauche du cerveau alors qu’à l’époque, on pensait les hémisphères équivalents et la localisation de la lésion située dans le lobe frontal était la cause du trouble de la parole.
Chaque région du cerveau joue un rôle plus ou moins particulier. Ceci explique l’importance de l’imagerie. Si, pendant 150 ans, la recherche a reposé sur la méthode de la dissection des cerveaux avec des résultats limités, l’apparition du scanner à rayons X dans les années soixante- dix a suscité de nombreuses questions éthiques. Sans avoir besoin de disséquer le cerveau, il devenait possible d’étudier l’intérieur d’un crâne et de localiser une lésion. Le lien entre la localisation cérébrale et les anomalies se précisa alors.
Passer en une vingtaine d’années, de l’imagerie structurale à l’imagerie fonctionnelle, fut une autre révolution, surtout culturelle, en ce qu’il s’agissait alors d’obtenir une image chez un patient normal en train de faire travailler son cerveau pour déterminer les régions cérébrales impliquées, car un des secrets du cerveau réside dans son architecture : fonction et localisation sont étroitement liées à toutes les échelles, ce qui explique l’importance de la neuroimagerie.
La révolution de l’imagerie est née du mariage de la physique et de l’informatique. Nous disposons aujourd’hui de toute une panoplie de méthodes d’imagerie pour étudier l’intérieur du cerveau sans ouvrir le crâne. On peut étudier les signaux électriques du cerveau : c’est l’objet de l’électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie. On a la possibilité d’introduire des molécules partiellement radioactives produites par un cyclotron qui se localiseront dans des zones précises du cerveau en fonction de la présence de récepteurs et obtenir des images avec la caméra à émission de positrons. Nous disposons également de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), technique que j’utilise principalement, en aimantant fortement l’eau qui se trouve dans le cerveau, ce qui permet d’obtenir des images fabuleuses de l’anatomie et de la fonction cérébrale. Un très gros aimant produit un champ magnétique très intense de 15 000 gauss, soit 30 000 fois le champ magnétique de Paris, et l’on peut obtenir, par traitement informatique, des images très précises à partir de la mesure, par ondes radio, des molécules d’eau. On voit la matière blanche, la matière grise, les petits vaisseaux uniquement grâce à l’aimantation de l’eau.
L’imagerie permet de regarder le cerveau depuis l’extérieur et surtout de savoir comment il se fabrique pendant la grossesse, et se développe à tous les stades de celle-ci. Grâce à l’informatique, on extrait virtuellement le cerveau du fœtus, cela permet de voir d’éventuelles anomalies afin de les traiter.
Notre cerveau compte 100 milliards de neurones, produits durant la grossesse au rythme de 250 000 par minute. Ces neurones, fabriqués essentiellement au centre du cerveau, migrent ensuite vers la périphérie. Le cerveau devra alors se plisser pour tous les stocker. Il arrive cependant que des neurones restent coincés lors de leur migration, ce qui peut provoquer certaines pathologies neurologiques comme l’épilepsie, voire des pathologies psychiatriques. De nombreuses évolutions se produisent pendant la grossesse, il n’y a que l’imagerie pour les déceler. Avec des modèles animaux, notamment la souris, il est possible d’observer des relations entre gènes et cerveau.
Nous pouvons actuellement voir fonctionner un cerveau. Quelqu’un regarde une image et on observe des changements de couleur à l’imagerie. En effet, davantage de sang irrigue les zones très actives. Or, le passage du sang, qui contient de l’hémoglobine donc du fer, dans le champ magnétique modifiera l’aimantation de l’eau ; il produira des changements infimes de cette aimantation au voisinage des petits vaisseaux sanguins qu’un ordinateur pourra analyser, ce qui permet de déterminer quelle partie du cerveau travaille.
Il est possible d’aller plus loin. Les régions qui servent à voir le monde réel et celles à imaginer sont-elles les mêmes ? Une personne est allongée dans un cylindre, sans bouger, totalement immobile, on lui donnera l’instruction d’imaginer un chat. Lorsque la personne imagine un chat, la région qui sert à voir le monde réel s’active. Le cerveau utilise donc cette région pendant l’imagerie mentale. L’arrière du cerveau étant organisé de façon très précise : en simplifiant, ce que l’on voit en haut arrive en bas, ce que l’on voit à gauche arrive à droite, ceci se passe comme dans un appareil photo, chacun à sa propre projection, comme un code. Ainsi l’on arrive même à déterminer si une personne volontaire pour une expérience, imagine un objet vertical ou un objet horizontal.
La même étude chez une personne aveugle de naissance montrera qu’elle active les mêmes aires visuelles quand elle lira en braille avec son doigt. Le cerveau s’est réorganisé. Reste à savoir ce qui se passe dans cette région visuelle qui sert aussi bien à voir qu’à lire le braille ce qui n’a rien en commun avec la vision mais est lié à la capacité de gestion de l’espace.
Mais il existe des limites, qui résident notamment dans les conditions à réunir pour obtenir ces résultats. Il est ainsi impossible de forcer quelqu’un à se prêter à cette expérience. Que la personne bouge, ne serait-ce que d’un millimètre, et l’opération est impossible. Elle n’est donc pas réalisable contre la volonté de la personne placée dans l’appareil. De surcroît, l’encadrement législatif permet d’éviter les abus.
M. Alain CLAEYS.
L’encadrement législatif et réglementaire est-il adapté? Ne représente-t-il pas un frein ?
M. Denis Le BIHAN.
En principe non, mais il peut nous gêner dans les modalités pratiques. Ainsi, s’il est normal et utile de demander l’autorisation à un Comité d’éthique de mener ces études, il n’est pas toujours justifié qu’un médecin en soit chargé, ce que la loi impose pourtant. Cette obligation se comprend en cas d’IRM, du fait du champ magnétique et de contre-indications possibles (porteur de pacemaker, d’objet métallique), mais elle n’a plus de raison d’être quand il s’agit de mener des tests neuropsychologiques ne comportant pas de risque médical. Étant médecin, je ne suis pas pénalisé par cette règle, mais peut-être Stanislas DEHAENE, avec lequel je travaille, et qui n’est pas médecin, voudra-t-il expliquer cela.
Les recherches sur le cerveau recouvrent un spectre très large, et certaines relèvent directement de la psychologie. Quand commence la recherche biomédicale ? Pour le législateur ou les Comités d’éthique la frontière n’est pas toujours évidente à tracer, mais je pense à certaines recherches qui devraient être considérées comme des recherches strictement psychologiques et pour lesquelles le cadre légal actuel est inadapté. Ainsi des chercheurs en neurosciences ou en psychologie de l’INSERM ou du CNRS, non médecins, ne sont pas maîtres de leurs propres recherches.
M. Denis Le BIHAN.
Il faut environ dix ans pour qu’une découverte scientifique débouche sur une utilisation en milieu médical. Ceci est le cas pour les patients dont l’une des artères cérébrales est bouchée, ce qui provoque un infarctus cérébral, troisième cause de décès en France, et la première de handicap car la personne qui devient hémiplégique l’est, le plus souvent à vie, ce qui a un important retentissement social et économique. Or, l’on a découvert, dans les années soixante-dix, que dans la région en train de mourir, le mouvement spontané de diffusion des molécules d’eau se ralentit de 30 à 50%. Dans les toutes premières minutes on observe cela à l’imagerie. Grâce à l’imagerie médicale, le médecin peut établir un diagnostic très précoce, dans les six premières heures, et donner au malade un traitement actif qui débouchera l’artère. Parce que ce médicament n’est pas anodin, il faut être certain du diagnostic, ce que l’imagerie permet. Alors qu’un infarctus du myocarde peut être pris en charge dans les deux heures, il n’en va pas du tout de même pour l’infarctus cérébral. Seuls quelques centres en France sont capables d’une telle réactivité.
Il est nécessaire de développer ces méthodes d’imagerie pour observer le mode de fonctionnement des neurones au travail, les connexions neuronales, voir le cerveau se construire, les gènes au travail et étudier la chimie du cerveau. Il faut pousser les limites de l’imagerie au maximum pour explorer le cerveau depuis la souris jusqu’à l’homme, et à cette fin utiliser des champs magnétiques de plus en plus intenses, ce qui peut poser problème. En effet, l’Union européenne projette de réguler l’utilisation de ces champs magnétiques.
À NeuroSpin, centre ouvert il y a plus d’un an au CEA à côté de Saclay, nous sommes complètement impliqués dans ces recherches, au premier rang desquelles figure l’étude des effets biologiques des champs magnétiques sur l’homme ou le petit animal. Explorer et identifier les régions cérébrales, pour établir une architecture fonctionnelle cérébrale, savoir s’il existe un ou plusieurs codes neuraux en établissant des liens avec l’architecture cérébrale, développer des mécanismes de rééducation, découvrir les mécanismes cellulaires et moléculaires des maladies pour les prévenir et établir des diagnostics précoces, tels sont les grands défis que devra relever la neuroimagerie.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie beaucoup de cette présentation très claire et je donne la parole à M. Stanislas DEHAENE
8 M. Stanislas DEHAENE, Directeur de l’unité INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive, Professeur au Collège de France, Membre de l’Académie des sciences.
Je vous remercie beaucoup de me donner l’occasion d’exprimer mes idées sur les liens entre psychologie et cerveau.
L’imagerie cérébrale met à nu le cerveau et dévoile les représentations les plus fines, toutefois des limites existent. Chaque état mental est aussi un état matériel : une configuration de décharges neuronales. Il peut être décrit à différents niveaux de représentation. Nos comportements s’inscrivent dans des états organisés d’activité du cerveau qui peuvent être décrits à un niveau régional et de grand circuit, mais aussi à des niveaux plus microscopiques : colonnes corticales, neurones individuels, synapses et in fine organisation moléculaire du cerveau.
Même si ces différents niveaux de description correspondent à différentes facettes du même objet, cela ne veut pas dire qu’un niveau de description n’est pas meilleur qu’un autre. Certaines épilepsies proviennent d’une mutation très précise d’une sous unité de tel récepteur dans le cerveau, mais d’autres phénomènes relèvent de la psychologie, et ne se laisseront pas réduire si facilement à une représentation à plus bas niveau.
Ainsi, si vous désirez savoir si une personne connaît le prénom de telle actrice, mieux vaut lui poser la question que d’essayer de lire dans son cerveau ! Ces différents niveaux de représentation et d’analyse existent et il ne faut pas oublier qu’il y a une unité des neurosciences. Un coup de projecteur est donné aujourd’hui sur l’imagerie cérébrale, mais ces recherches s’appuient elles-mêmes sur des recherches bien plus fondamentales, chez l’animal, in vivo ou in vitro. Nous avons besoin de toute cette chaîne de travaux.
M. Hervé CHNEIWEISS.
Au nom de l’unité des neurosciences, je me permets d’ajouter qu’à côté des 100 milliards de neurones se trouve une population importante de 300 à 400 milliards de cellules gliales dont l’activité métabolique va être visualisée par l’imagerie. C’était un petit plaidoyer pour une population de cellules un peu oubliée, mais majeure.
M. Stanislas DEHAENE.
Absolument, mais je voudrais moi aussi plaider pour d’autres populations oubliées ; à l’extrême de ce spectre se trouvent la culture et l’éducation qui jouent également un grand rôle. L’effet de l’éducation qu’a reçue une personne se traduit directement par des changements d’organisation de ces circuits. Ce que nous observons en imagerie est le contraire du déterminisme et de l’idée que les bas niveaux déterminent ceux qui sont hauts. Très souvent, nous observons le résultat de contraintes conjointes de la génétique et de l’éducation.
Nous avons mené ces études dans des directions différentes. J’ai choisi l’exemple de la lecture. Lorsque l’on place un mot devant vos yeux, vous parvenez à le lire très rapidement, sans avoir conscience qu’il s’agit du résultat d’un calcul sophistiqué du cerveau, que l’on peut révéler par l’IRM fonctionnel, sous forme d’un circuit activé dont les premières étapes sont non conscientes. Certaines régions jouent un rôle fondamental parce qu’elles sont modifiées par l’apprentissage de la lecture. Elles traduisent par leur degré d’activité, le degré d’expertise du sujet pour la lecture.
On peut suivre les états d’activités en fonction du temps. Sur ces images, on observe la dynamique d’activité cérébrale lorsque l’on présente un mot sur un écran d’ordinateur et que le signal d’activation neuronal se propage depuis les aires visuelles jusqu’à l’arrière du cerveau par la voie visuelle ventrale dans laquelle seront identifiés l’orthographe, la prononciation et le sens des mots
Le travail du psychologue, avec ces nouveaux outils d’imagerie cérébrale, consiste à essayer d’attribuer une organisation, une architecture, à ces activations cérébrales, sous forme de modèle. L’activité de modélisation, d’intégration de ces données dans des modèles théoriques est très importante. Elle permet de considérer que chacune de ces régions apporte sa pierre à une étape de traitement de l’information. Notre travail consiste à concevoir des expériences pour déterminer que telle région s’intéressera à la syntaxe de la phrase, telle autre à l’orthographe.
Ces recherches fondamentales visent à comprendre l’organisation du cerveau et à la mettre en relation avec les aspects psychologiques, mais elles ont aussi une importance capitale dans le domaine de la pathologie, dans celui de la lecture, comme en témoigne par exemple la dyslexie. Sur la base de résultats obtenus dans un cerveau normal, on commence maintenant à pouvoir produire des images compréhensibles de ce qu’il advient dans le cerveau d’un enfant qui connaît des difficultés de lecture. Celles-ci peuvent être mises en relation avec des activations insuffisantes de certaines régions du circuit de la lecture, notamment des régions liées au code phonologique et au code orthographique. Certaines anomalies anatomiques commencent également à être détectées chez ces enfants.
Pendant des années, on n’a pas jugé nécessaire de pratiquer des examens IRM chez des enfants dyslexiques ou souffrant de troubles du développement parce que l’on ne voyait rien. On commence maintenant, grâce à des statistiques un peu plus poussées, avec des imageurs très performants, à observer des anomalies particulières qui se concentrent dans certaines régions de ces circuits de la lecture. Il ne s’agit pas de produire des images de la pathologie et de condamner ces enfants, au contraire ! L’on produit également des images de la rééducation, pour en suivre les progrès. On observe ainsi, la réactivation de nouveaux circuits dans l’hémisphère droit en fonction du degré et du type de rééducation.
S’agissant du décodage cérébral, peut-on utiliser ces images, non seulement pour comprendre le cerveau, mais aussi pour aller y lire des états de pensées cachées du sujet ? À partir du moment où l’on effectue une mise en corrélation d’états psychologiques avec des états cérébraux, il existe une forme de réversibilité ; aussi lorsque l’on peut passer d’un certain stimulus à une activité cérébrale compréhensible, on peut entraîner un logiciel informatique à opérer inversement, en partant d’une activité cérébrale. On peut reconstituer ce que la personne était en train de voir ou d’imaginer en tenant compte d’une grande variabilité individuelle. Une expérience menée par Bertrand THIRION en laboratoire montre que lorsqu’une personne fixe l’écran, elle imagine une forme et en partant de son activation cérébrale, on arrive péniblement à reconstituer une sorte de forme de ce qu’elle imaginait.
Une certaine forme de décodage de l’activité cérébrale est donc possible grâce au développement de nouvelles techniques. On peut s’en inquiéter, mais aussi se demander quelles en seront les applications pratiques. Cette forme de décodage de l’activité cérébrale en temps réel pourrait permettre au sujet de prendre le contrôle de son propre cerveau. En permettant à une personne souffrant de douleurs chroniques inexpliquées et sévères d’observer l’état d’activité de son cortex cingulaire antérieur qui est l’une des régions jouant un rôle essentiel dans la conscience de la douleur, et en lui apprenant à moduler cette activité consciemment, volontairement, on lui permet, après plusieurs semaines de recul, de diminuer considérablement sa douleur. C’est une manière de rééduquer et de restaurer l’autonomie de la personne.
Les capacités de détection sont également très importantes dans certaines pathologies. Il existe des comas végétatifs persistants pour lesquels l’imagerie commence à permettre de rétablir une forme de communication avec le patient ou à tout le moins de détecter ses états mentaux, alors que la personne est paralysée et incapable de communiquer. Selon une publication récente de l’équipe belgo-britannique d’Adrian OWEN de l’université de Cambridge, sur 60 personnes examinées, en état végétatif persistant, l’une d’entre elles a présenté une activité cérébrale quand on lui a demandé d’imaginer qu’elle jouait au tennis ou se promenait dans son appartement. Grâce à l’appareil d'imagerie par résonance magnétique, les chercheurs ont tenté de communiquer avec cette patiente, seulement capable de mouvements réflexes. Selon eux, elle s'est révélée capable de répondre à certaines consignes. L'équipe de chercheurs a fait passer des examens d'imagerie cérébrale à la jeune femme ainsi qu'à des volontaires sains. Or quand on leur demandait de s'imaginer parcourir les pièces de leur maison, les réponses dans diverses zones du cerveau de la patiente et des personnes saines étaient identiques. Cette jeune femme est en train de sortir du coma, et le fait d’avoir détecté chez elle une activité mentale structurée a joué un rôle important dans sa prise en charge. Ce type d’application se développera de plus en plus. Le traitement des états végétatifs et de ceux frontières avec le locked in syndrome, sera abordé par les neurosciences, en s’efforçant de développer la communication par le biais des interfaces homme/machine.
L’imagerie cérébrale se contente d’enregistrer l’activité cérébrale, elle ne manipule pas le cerveau. La publicité n’a d’ailleurs pas attendu l’imagerie cérébrale pour le faire. Doit-on s’inquiéter du fait qu’elle permette de décoder certains états mentaux ? Il faut en avoir conscience et ne pas leurrer le public : l’on sait, d’ores et déjà, décoder des états mentaux, notamment lorsque le code neural est macroscopique, c’est-à-dire à l’échelle du centimètre quand, par exemple, une personne lit ou regarde un visage ; c’est différent dans le cerveau et il est possible de l’observer. Il est également possible de décoder des états à l’échelle du millimètre, mais l’on ne peut pas décoder le « micro code », à savoir ce qui fait la spécificité d’un individu, ses connaissances particulières, son lexique personnel, ses souvenirs. Ce « micro code » reste à un niveau qui continuera de dépasser pendant très longtemps, sinon à jamais, nos capacités de décodage parce qu’il se situe au niveau du neurone unique.
Le décodage, par ailleurs, présente un intérêt pratique en médecine pour la détection d’état de conscience, la communication par interface homme/machine, la rééducation etc… Cependant la sensibilité et la spécificité de ces formes de décodage cérébral restent faibles. L’on est très satisfait en recherche lorsque l’on parvient à faire mieux que le hasard. On ne détectera pas chaque état mental du sujet. Ainsi, le potentiel du détecteur de mensonges paraît très exagéré : si certains états psychologiques peuvent être observés à un niveau neuronal microscopique, d’autres ne se réduiront pas si facilement à des états identifiables. Je ne crois pas qu’il existe un seul état cérébral du mensonge, il existe une telle variété de mensonges que sur ce point, il s’agit de fantasmes.
En outre, tous ces examens d’imagerie requièrent une collaboration parfaite du sujet, qui doit rester immobile à l’échelle du millimètre, se concentrer sur ce qu’on lui demande de faire et ne pas penser à autre chose. En particulier, il est impossible de décoder les pensées d’une personne qui passe sous un portique dans un aéroport. Il convient de rester vigilant, il y aura des applications réelles mais l’on doit éviter de propager des fantasmes qui galopent vite dans ce domaine.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de cette présentation très intéressante. Quelqu’un demande-t-il la parole ? M Hervé CHNEIWEISS souhaite apporter une précision.
‚
M. Hervé CHNEIWEISS.
C’est vrai que ces histoires de portique sont ridicules aux yeux des chercheurs du domaine, mais pas pour la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) aux États-Unis qui a investi des millions de dollars dans au moins deux sociétés chargées de développer ces systèmes. Il convient de démystifier. C’est important.
M. Stanislas DEHAENE.
Les neurosciences progressent en permanence et il est toujours difficile pour un scientifique sceptique par nature de poser les limites, surtout quand elles ne cessent de reculer. Néanmoins, l’on peut affirmer aujourd’hui que l’échelle du neurone est inaccessible chez l’homme avec les mouvements du cerveau qui existent de façon permanente.
Une intervenante dans la salle.
90 % des sourds en France seraient illettrés. Ce chiffre m’a impressionnée. Des travaux sont-ils menés sur l’apprentissage de la lecture par les sourds ?
M. Stanislas DEHAENE.
L’apprentissage de la lecture pose des problèmes particuliers chez les personnes malentendantes parce que les représentations phonologiques, support du code alphabétique que nous utilisons, ne sont pas présentes chez ces personnes, ce qui rend difficile d’apprendre à décoder l’écrit. À ma connaissance, l’imagerie cérébrale n’a pas permis de trouver de solution alternative à ce problème, mais elle permet en tout cas d’aider à comprendre la nature des représentations disponibles, et en particulier que le langage des signes est une vraie langue. L’imagerie cérébrale montre que les régions du langage du cerveau sont concernées comme pour une langue parlée.
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
M. Emmanuel-Alain CABANIS vous allez nous présenter le point de vue du praticien.
6
8 M. Emmanuel-Alain CABANIS, Professeur Université Paris VI, Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze Vingt, Membre associé de l’Académie de médecine.
Il m’est apparu intéressant à propos du défi à relever de répondre aux trois questions figurant dans le programme et concernant l’imagerie à savoir que lit-on, que dépiste-t-on, que soigne-t-on ?
Nous osons relever ce défi car notre expérience a quasiment un quart de siècle et porte sur une cohorte de 200 000 patients environ. Après le scanner à rayon X, nous disposons du système d’imagerie à résonance magnétique qui évolue de 0,15 à 3 Teslas. Comme l’a rappelé Denis Le BIHAN, ce n’est pas considérable en comparaison de l’avenir lorsqu’on atteindra 17 Teslas. L’institution que j’ai l’honneur de servir s’occupe du regard et de la vision, c’est ce centre national des Quinze-Vingt.
Ainsi, si aujourd’hui la routine est l’utilisation d’appareil à 3 Teslas, il faut se souvenir des craintes de nombre de nos collègues à travers le monde, et ne pas oublier que François MESSMER au 18ème siècle auprès de Pierre Jean Georges CABANIS était à l’origine du baquet magnétique ce qui fait qu’un certain nombre de mes chers collègues se sont quelque peu moqués de moi lorsque en 1982, nous commencions à évoquer la résonance magnétique. Ce retour aux sources me semblait important à expliquer avec des mots simples. Dans cette imagerie de l’encéphale, que lit-on, que dépiste-t-on et qui soigne-t-on ?
Question n° 1 : que lit-on ?
Une neuroanatomie du système nerveux normal in vivo, mais que nous avons apprise et enseignée par des dessins cadavériques dont l’origine remonte au 12ème siècle puis au 13ème siècle, moment de la révolution anatomique européenne. Il est intéressant de rappeler qu’aujourd’hui avec ces outils nouveaux l’on se rapproche de dessins datant du 19ème, ceux de Jules DEJERINE qui dessinait ces tractus de substance blanche, dans lesquels nous sommes empêtrés avec notre tractographie.
On lit cette neuroanatomie, pour reconnaître dans un signal, un contraste permettant de distinguer la substance grise de la substance blanche, selon une succession de plans de coupe adjacents inférieurs ou égaux au millimètre d’épaisseur, avec une résolution grâce à laquelle nous découvrons une sémiologie et une anatomie inconnues jusqu’à présent.
L’exemple du lobe temporal est intéressant puisqu’on observe ce que l’on avait appris à dessiner dans le passé, ce corps godronné essentiel en épileptologie et qui apparaît à l’image avec une résolution spatiale intéressante et file le long de la corne temporale. Voici l’hypothalamus qui est un centre vital, visible avec une autre résolution : c’est un ensemble de 2 mm sur lequel notre fonction végétative complète est réunie. Ceci est une imagerie strictement neuve, sans dessin préalable cette fois qui est celle de notre neurotractographie. Vous observez des connexions pontiques d’une partie du tronc cérébral avec le cervelet, et aussi sous le chiasma du nerf optique, vers les deux pédoncules cérébraux.
Dans ces signaux issus d’une technique multiparamétrique, que va-t-on lire ? Des données quelquefois inquiétantes comme ce globe oculaire qui apparaît blanc, puis noir, contrasté, simplement avec le jeu des séquences, ce qui nous conduit avec une immense prudence vers la reconnaissance anatomique de ce qui pourrait être une tumeur cancéreuse de 1 mm d’épaisseur à peine visible.
Que signifie la normalité ? La normalité représente la donnée la plus difficile à cerner quand on dirige un service de neuroimagerie. Elle n’est rien d’autre qu’une statistique de variabilité individuelle, intra ou interindividuelle. Le plus bel exemple dont nous disposions, est la génération du cortex. En routine, plusieurs fois par jour, les coupes anatomiques que vous avez vues précédemment permettent d’avoir une reconstruction volumique du cortex avec une certitude maintenant absolue. Cette image montre le degré d’asymétrie extraordinaire de la sulcation entre l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit chez un même patient, vu sur cette image sous différents angles.
La description de la neuroanatomie est doublée d’une neurophysiologie motrice, vasculaire, circulatoire, macroscopique ou moléculaire et métabolique. Voici in vivo l’hexagone de la base de l’encéphale avec en avant les deux artères sylviennes, les bords latéraux de l’hémisphère, en arrière les artères cérébrales postérieures, présentes à l’animation puis absentes à l’instant. Nous introduisons dans la routine de nos examens, l’approche du cortex visuel par rétinotopie ce qui permet plusieurs images du stimulus visuel.
L’autre physiologie procède de la biochimie dont nous disposons grâce au spectre de l’IRM qui nous montre des pics aussi minces que ceux d’une population axonale dans l’ensemble. Le n-acetyl aspartate ou la créatine pris comme repères nous permettent d’effectuer des analyses biochimiques extrêmement discriminantes, notamment dans les malformations cérébrales de l’enfant. Quoi qu’il en soit, ces signaux, ces formes, doivent être traitées le plus attentivement possible pour séparer la variante individuelle de la variante pathologique. Si on prend l’exemple d’un implant, il est important de pouvoir traduire le véritable variant individuel, de ce qui est la première étape de la pathologie.
Ainsi, sur ce nerf que nous observons pour la première fois en IRM qui est le nerf pathétique permettant de voir le regard du mépris. On baisse vers le bas les yeux d’un regard méprisant. Cet ensemble nous a gênés parce que nous nous demandions si c’était un vaisseau supplémentaire. Nous étions perdus : voir le nerf pathétique ! Cela aurait pu faire naître quelques communications savantes ! Chaque semaine, depuis plusieurs années, nous recevons des patients présentant des retards mentaux. Nous observons certaines anomalies de sulcation qui sont retrouvées de manière strictement inattendue.
Question n° 2 : que dépiste-t-on ?
1) Le danger : il peut provenir d’un corps étranger ferromagnétique inclus. Il y a quelques jours, une jeune fille se présente avec un gonflement facial ; une petite plaie attire brusquement notre attention, nous pratiquons un scanner à rayons X lesquels sont arrêtés par le métal ou par un os dense, nous découvrons de façon réellement inattendue un clou ayant pénétré à l’intérieur de l’orbite à l’insu absolue de cette jeune patiente. Malheureusement aucun des interrogatoires n’aurait permis de le savoir. Or, le cas de l’interrogatoire auquel on ne répond pas ou insuffisamment reste une épée de Damoclès car le clou sorti de l’orbite aurait crevé le globe oculaire. Grâce au diagnostic on évitait de nuire. Ainsi, maintenant dans un certain nombre de situations, nous utilisons le scanner à rayons X avant IRM, ce qui conduit à imposer une irradiation. Ceci risque d’entraîner des conséquences juridiques, en matière d’expertise notamment.
2) Le dépistage de l’anomalie de la forme : Sur cette image on observe une anomalie de la forme anatomique évoquée précédemment, c’est une augmentation ou une réduction de volume, une variation du signal, acquise ou congénitale, notamment au plan cérébral. Une asymétrie très étonnante du nerf optique rétro bulbaire intra orbitaire apparaît. Il est gros. Cette grosseur correspondra à une désorganisation très inattendue en neurotractographie antérieure ce qui n’est pas classique, car elle est présente chez peu de gens.
Ceci montre l’existence d’une interruption, d’une asymétrie de cette disposition axonale correspondant à une maladie de Recklinghausen. L’anomalie de signal est évidente, comme l’a précédemment expliqué Denis LE BIHAN qui par modestie n’a pas rappelé que c’était lui qui en 1985, avait consacré sa recherche et son énergie à imposer la notion de diffusion qui montre que dans les quelques secondes qui suivent un accident vasculaire, le coefficient de diffusion témoin de la mobilité des molécules d’eau dans les tissus varie, ce qui permet de déceler les premiers signes d’un accident vasculaire cérébral étendu. Aucune autre technique ne peut permettre d’effectuer le diagnostic de cette nécrose locale après une ischémie et ceci est tout à fait étonnant et modifie complètement la thérapeutique.
Voici une forme ajoutée, anormale et tumorale, c’est un processus occupant de l’espace, entouré d’œdème cérébral péri lésionnel, les deux provocant un effet de masse. Voici une anomalie de fonction vasculaire qui est une interruption d’une carotide interne du côté droit alors que du côté gauche, le flux circulatoire passe. Cette exploration artériographie s’effectue aujourd’hui sans cathétérismes. Nous observons l’accroche de l’aorte à la partie supérieure du cœur, les artères à destinée céphalique du côté droit et du côté gauche, leur pénétration intracrânienne antérieure et les carotides postérieures vers basilaire. Donc, cette anomalie neurotractographique de stimulation nous apprendra enfin que devant la tumeur évoquée précédemment, deux éléments concorderont, celui de la désorganisation des fibres nerveuses et des axones autour de la lésion.
Neurotractographie, mais aussi refoulement des commandes motrices du fait de la tumeur qui se développe. Ce refoulement est maintenant demandé et exigé en préopératoire par nos collègues neurochirurgiens qui veulent savoir si leur geste salvateur d’exérèse de la tumeur touchera ou pas à cette aire motrice pour éviter que le patient devienne totalement hémiplégique.
Question n° 3 que soigne-t-on ?
On ne soigne pas par l’image seule, on soigne le patient qui peut avoir un tractus cortico spinal asymétrique ou abîmé, la question n’est pas là. Trop de patients ont été opérés de leurs images et l’un des meilleurs exemples n’est pas le cerveau, c’est celui de la colonne lombaire et de la moelle épinière. C’est donc toujours un patient, examiné, informé et demandeur avec des degrés de compréhension difficiles à évaluer et à comparer, qui commande l’action de l’exploration intracrânienne.
Ce journaliste brillant m’avait demandé des images, comme tout le monde, de belles images, comme quelques uns, et de très belles images pour un numéro spécial de journalisme. Je lui ai répondu que les belles images, c’est lui qui me les fournirait car je ne trahirai pas le secret des patients. « Votre secret, c’est votre anatomie. On va vous examiner, ainsi vous aurez le droit d’exploiter votre propre iconographie ». Ce journaliste a vu la reconstruction en 3 dimensions et il a compris ce qu’était son cerveau, en 3 D et les dissections virtuelles.
Conclusions
Sachant que le cadre général du « que soigne-t-on », recouvre toute la médecine, résumée en cinq mots traumatique, vasculaire, tumoral, inflammatoire, ou congénital, voilà les cinq armoires normandes qui font l’exploitation de l’imagerie de la tête car nous n’explorons pas l’encéphale, nous explorons la tête tout entière, région supérieure du corps humain. Voici un exemple de sclérose en plaques : l’IRM fonctionnelle montre l’atténuation des allumages corticaux dans la partie postérieure de l’ensemble. Que lit-on ? L’encéphale mais l’alphabet c’est l’anatomie, il faut l’apprendre. Que dépiste-t-on ? Des anomalies qui sont cliniquement significatives. Que soigne-t-on ? Les cinq grands âges de la vie de l’âge néonatal ou intra-utérin à l’âge avancé ou troisième âge.
‚
M. Hervé CHNEIWEISS.
Que se serait-il passé si le journaliste en question avait été atteint d’une malformation vasculaire ou d’une tumeur naissante qu’il aurait ignorée avant l’examen ?
M. Emmanuel-Alain CABANIS.
La question est d’autant plus intelligente qu’elle nous a été posée exactement seize fois par de généreux volontaires témoins présumés sains. Un interrogatoire très attentif et très neurologique est pour nous un premier devoir. Les témoins volontaires présumés sains sont systématiquement soumis à un interrogatoire neurologique très attentif.
Il est également impératif d’évaluer le comportement de celui qui accepte d’être témoin volontaire présumé sain pour éviter de se trouver dans cette situation. Sans doute grâce à l’examen préalable que nous pratiquons, nous n’avons encore jamais découvert de pathologie lourde de façon inopinée. Nous avons cependant découvert un kyste arachnoïdien, chez une étudiante technicienne paramédicale de 23 ans, volontaire pour contribuer aux travaux de recherche qui se développaient autour d’elle. Ce kyste arachnoïdien était une petite zone de 8 mm de diamètre pleine de liquide cérébrospinal sans aucune conséquence pathologique, ni conséquence grave sur le fonctionnement cérébral et ne justifiant pas d’intervention neurochirurgicale. Il a fallu discuter longuement avec elle.
Dans d’autres situations, la découverte d’une pathologie lourde et grave ne nous est jamais arrivée. Procéder par précaution à un interrogatoire attentif et préalable est efficace et devrait être systématique.
M. Stanislas DEHAENE.
Lorsque l’on pratique, comme c’est le cas dans un centre d’imagerie comme NeuroSpin, des centaines d’examens par an, il n’est pas rare de détecter des anomalies plus ou moins importantes chez des personnes réputées normales. Il s’agit le plus souvent de problèmes mineurs mais il nous est arrivé par deux fois de découvrir des tumeurs infiltrantes du lobe frontal totalement indétectables sur le plan symptomatique. Elles ont été opérées à un stade précoce, ce qui a sauvé la vie de deux personnes.
J’attire votre attention sur le fait que cela fait partie du consentement éclairé, signé par la personne. Elle sait que les images seront lues par un neurologue et que s’il y a détection d’un phénomène pathologique, elle sera informée, son médecin le sera et on lui recommandera une série d’examens d’étapes pour contrôler ce dont il s’agit. Le point le plus important du consentement éclairé est la certitude d’être informé des anomalies éventuelles qui seraient détectées.
M. Olivier OULLIER, Maître de Conférence, Université Aix- Marseille, laboratoire de neurobiologie humaine.
Il m’est arrivé également de découvrir une tache d’allure anormale au cours d’une expérience d’IRM fonctionnelle. Or il est difficile à un non médecin de pratiquer un debriefing de l’expérience avec le sujet. On ne peut pas lui indiquer cette anomalie avant d’avoir recueilli l’avis du neurologue. La participation du médecin au protocole est donc primordiale.
M. Emmanuel-Alain CABANIS.
Non seulement tout protocole doit être médical mais il doit être transversal, collégial et organisé autour d’un personnage incontournable, le neurochirurgien.
C’est de cette façon que nous sommes organisés dans un collège comprenant, un neurologue, un neuroradiologue et un neurochirurgien, très au courant de ces domaines, car il faut connaître le degré et les raisons de la motivation profonde de certains dans cette participation à la recherche. Les motivations profondes de certains volontaires ne sont pas toujours claires.
M. Stanislas DEHAENE.
Il est en effet important d’être bien préparé à ce type de situation et d’avoir prévu à l’avance la conduite à tenir si l’on découvre une anomalie. Ainsi, on ne montre jamais les images d’IRM à la sortie de l’examen. Il existe, selon le degré de gravité de la situation, des procédures permettant d’informer la personne immédiatement en nuançant le degré de gravité que peut présenter la situation. Je crois que cela fait partie de la préparation d’une bonne expérience.
M. Emmanuel-Alain CABANIS.
Permettez-moi de m’inscrire en faux contre cette analyse. Mon expérience au contact de patients présentant un trouble neurologique m’a appris qu’il est essentiel de démystifier tout de suite l’image. Il n’existe pas de conduite générale à adopter : il faut s’adapter à chaque cas individuel. Le fait de laisser un patient partir sans lui expliquer de quoi il souffre et sans le lui montrer peut lui être préjudiciable.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de ces explications. La parole est maintenant à M. Thomas BOURGERON.
6
8 M. Thomas BOURGERON, Professeur, responsable du groupe Génétique humaine et fonction cognitive à l’Institut Pasteur.
Je remercie l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de me permettre de présenter les travaux réalisés à l’Institut Pasteur sur les liens entre génétique et troubles psychiatriques.
Première question, y a-t-il des gènes impliqués dans le développement des fonctions cognitives ? Bien qu’il soit aisé, à mon sens, de répondre par l’affirmative : sans tête ou sans cœur, on imagine mal comment des fonctions cognitives existeraient. Cependant, il n’était guère facile, il n’y a pas si longtemps, de poser cette question en France.
Deuxième question, plus compliquée : des gènes sont-ils spécifiquement impliqués dans le développement des fonctions cognitives, par exemple le langage, les relations sociales, la lecture ? Selon moi, cela est probable. Il existe des gènes qui semblent être spécifiques de telle ou telle fonction. Certains modèles animaux et certaines pathologies humaines montrent que la mutation d’un seul gène ou d’un très petit nombre de gènes risque de venir altérer une ou plusieurs fonctions cognitives. En soi, l’hypothèse de l’existence d’un ou plusieurs gènes du langage, par exemple, ne pose pas de problème éthique.
La difficulté commence avec la troisième question : y a-t-il des variations interindividuelles dans les gènes spécifiquement impliqués dans les fonctions cognitives ? Selon moi, c’est probablement le cas : je ne vois pas pourquoi ces gènes échapperaient à la variabilité du génome humain. Dès lors, il m’arrive souvent de me demander s’il faut identifier ces variations interindividuelles. Si je poursuis ma recherche, c’est pour comprendre le fonctionnement du cerveau et pour tenter de remédier à certaines atteintes des fonctions cognitives. Cependant, si l’on identifie les variations interindividuelles, il est tout à fait loisible d’opérer une discrimination que je supporte mal entre les « bons » et les « mauvais » gènes du langage, et de supprimer ou d’augmenter la fréquence de ces variations.
Chacune de nos cellules renferme deux mètres d’ADN dans nos cellules que l’on peut compacter et séquencer. Le génome humain comporte environ trois milliards de « lettres » A, C, G, T (adénine, cytosine, guanine et thymine). C’est la variabilité que l’on recherche. La variabilité entre deux personnes prises au hasard dans le monde se traduit par environ une lettre différente sur 1 200.
Il existe d’autres variations que l’on appelle des polymorphismes de simples nucléotides qui jouent un rôle important : 3 millions de variations entre individu. C’est en Afrique que la variabilité génétique humaine est la plus importante. Parmi les variations génétiques, certains chercheurs s’emploient à établir celles qui sont à l’origine de notre résistance ou, au contraire, de notre vulnérabilité à des agents infectieux, ou encore celles qui déterminent notre réponse aux médicaments.
Les variants du génome peuvent être répartis en trois grandes classes : ceux dont la fréquence est très faible, voire absents dans la population mais dont l’impact, en termes de troubles psychiatriques, est très fort ; ceux dont la fréquence est faible dans la population et qui sont associés à un risque modéré ; enfin, ceux qui se rencontrent fréquemment dans la population et qui sont associés à un risque faible. Le dogme voudrait que les maladies fréquentes, comme le syndrome bipolaire, la psychose maniaco-dépressive, la schizophrénie, soient dues à la combinaison de plusieurs de ces variants faibles, ainsi qu’à des facteurs épigénétiques.
Les gènes codent des protéines qui jouent un rôle très important dans la différenciation des neurones, dans leur migration et dans la phase primordiale qu’est la synaptogénèse, au cours de laquelle les neurones entrent en contact. Cette phase du développement neuronale se déroule entre zéro et trois ans ; durant cette étape, un nombre considérable de contacts neuronaux s’effectue.
Mon travail consiste à détecter les altérations susceptibles d’entraîner, par exemple, des troubles autistiques. L’autisme a été décrit pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale par un psychiatre autrichien exilé aux États-Unis, Léo KANNER, à partir d’un groupe de quatre garçons et une fille présentant des troubles de l’interaction sociale, des troubles du langage et des « stéréotypies », c'est-à-dire des intérêts et des gestes restreints et répétitifs. Un autre psychiatre autrichien, Hans ASPERGER a décrit, à partir d’un groupe de huit garçons et une fille, un syndrome très proche de l’autisme mais qui s’en différencie par l’absence de troubles du langage. L’augmentation de la prévalence de l’autisme aux États-Unis s’explique probablement par l’élargissement des critères diagnostiques retenus par les psychiatres, qui ne s’inspirent plus des classifications de KANNER. D’un enfant sur mille, on est passé à un enfant sur deux cents.
On connaît depuis dix ou vingt ans certains gènes impliqués dans des syndromes génétiques augmentant le risque d’autisme : syndrome de l’X fragile, syndrome de Rett, sclérose tubéreuse de Bourneville. Ils nous renseignent sur une partie du trouble autistique. Cependant, pour 85 % des enfants atteints, les connaissances sont plus limitées : il existe des « gènes candidats » sur lesquels les chercheurs concentrent leurs travaux, mais dont on ne dispose pas de la preuve formelle de leur implication dans l’autisme.
C’est à ce stade qu’intervient un important problème éthique. Certains scientifiques ou certaines entreprises pharmaceutiques annoncent qu’ils ont trouvé tel ou tel nombre de gènes impliqués dans l’autisme et proposent des diagnostics génétiques pour déterminer statistiquement le risque d’avoir un enfant autiste, bien que l’implication de ces gènes ne soit nullement prouvée.
L’étude de la transmission d’anomalies génétiques dans des familles atteintes par l’autisme ou le syndrome d’Asperger a permis d’identifier certaines mutations qui étaient apparues sur la mère. Nous avons travaillé et identifié les trois premiers gènes impliqués dans des syndromes autistiques, gènes sur l’X. Ces informations ont conduit à l’identification d’autres gènes, sachant qu’une mutation sur un seul gène qui casse la protéine en deux, peut se traduire par un tableau clinique très sévère. On a constaté que la mère avait la mutation dans ses ovocytes, mais pas dans son sang, ni ses cellules buccales.
Lorsque j’ai commencé ces études, il m’a été opposé qu’il était inutile de rechercher des gènes impliqués dans l’autisme car il n’y en avait pas. Puis, les mêmes personnes m’ont affirmé qu’il était inutile de rechercher ces gènes parce qu’il y en avait trop ! Pourtant, il apparaît maintenant que ces mutations ont un rôle fonctionnel au niveau des réseaux neuronaux de la voie synaptique impliquée dans l’autisme. Une expérience in vivo a montré qu’une souris dont un gène spécifique a été supprimé ne présente aucune préférence selon qu’on lui présente un objet ou une autre souris et émet des sons beaucoup moins variés que les souris normales.
De même, on a identifié récemment des mutations dans la synthèse de la mélatonine qui intervient dans la régulation du sommeil. Comme environ 50 % des enfants atteints d’autisme présentent un taux bas de cette hormone, on peut considérer qu’il s’agit là d’un variant à risque.
On peut actuellement utiliser des puces sur lesquelles on dépose 1 million de ces variations et on les compare.
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
Je vous remercie de cet exposé très intéressant. La parole est à M. François BERGER.
6
8 M. François BERGER, Professeur de médecine, Institut des neurosciences de Grenoble, équipe nano médecine et cerveau (INSERM- CEA).
Je vous remercie, mesdames et messieurs les parlementaires, de me donner l’occasion de présenter cette courte synthèse sur les développements technologiques liés aux implants cérébraux. Le retard considérable que l’on constate dans la compréhension et le traitement des maladies neurologiques, malgré leur fort impact socio-économique, tient en partie au fait que le cerveau est un organe inaccessible. La nouvelle technologie des implants permet de pénétrer les structures cérébrales pour dispenser un traitement local aux perturbations du réseau neuronal, par opposition aux thérapies médicamenteuses systémiques. À terme, on vise à disposer d’implants multifonctionnels qui diagnostiquent, traitent et surveillent l’efficacité du traitement.
L’ère moderne des implants cérébraux débute en 1987 par une découverte du professeur Alim-Louis BENABID. À l’époque, les tremblements résistant aux traitements médicamenteux étaient traités par électrocoagulation du noyau ventral intermédiaire (VIM) du thalamus. Le professeur BENABID a observé qu’une neurostimulation à haute fréquence entraînait la disparition du tremblement chez le patient. La voie était ouverte à une thérapeutique fonctionnelle non lésionnelle au moyen d’implants délivrant du courant à haute fréquence dans le cerveau. L’efficacité de cette approche s’est encore accrue par l’intégration des données d’autres équipes de recherche en neurosciences, notamment celles de Bordeaux.
Vingt ans après, nous disposons donc d’une sorte de « pacemaker cérébral ». Presque 350 000 patients ont été implantés depuis 1995. Il s’agit d’une thérapeutique validée et remboursée par la sécurité sociale, reconnue par la Food and Drug Administration. En ciblant d’autres noyaux, comme le noyau sous-thalamique, on a pu étendre cette stratégie à tous les symptômes de la maladie de Parkinson et à d’autres pathologies, notamment dans les dystonies. L’efficacité du traitement est donc considérée comme majeure, dans un contexte de handicap très lourd. Quant aux effets secondaires, on constate qu’un peu moins de 1 % des patients ainsi traités ont eu une hémorragie intracérébrale, il existe un contrat informant le malade des risques. Une mauvaise localisation de l’électrode risque aussi de provoquer des rires ou, au contraire, des états de tristesse, mais ces effets sont réversibles.
La recherche clinique ouvre sur d’autres indications, notamment psychiatriques. Il existe un protocole de traitement des troubles obsessionnels car des structures dopaminergiques sont impliquées dans ce type de pathologie. Alors que de nombreuses équipes de par le monde commençaient des essais quelque peu incontrôlés en matière d’applications psychiatriques, le professeur BENABID a demandé l’avis du Comité national consultatif d’éthique, ce qui a amené ensuite un contrôle des essais thérapeutiques au niveau international. L’équipe du professeur Andres LOZANO a démontré l’existence d’une hyperactivité de l’aire 25 chez des patients atteints de dépression résistant à toute thérapeutique. La stimulation de cette aire a produit des résultats remarquables.
Au-delà de ces traitements symptomatiques, des données obtenues dans des modèles de maladie de Parkinson chez le rat et le singe laissent à penser que l’utilisation d’implants serait susceptible de s’inscrire aussi dans une stratégie de médecine régénérative. L’effet de la neurostimulation au niveau du noyau sous-thalamique pourrait entraîner un ralentissement du processus dégénératif. L’indication de neurostimulation devrait alors être beaucoup plus précoce, peut-être pré clinique, dans l’hypothèse où l’on disposerait de bio marqueurs, ce qui ne manquerait pas de poser des problèmes éthiques.
L’apport des micros et nanotechnologies consiste à rendre ces dispositifs de moins en moins invasifs, plus efficaces, multifonctionnels, voire plus intégrés à la physiologie cérébrale. Une expérience de stimulation en trois dimensions est en cours à Grenoble, elle permet d’optimiser les sites de stimulation en fonction de la neuroanatomie d’un patient spécifique.
L’un des gros problèmes du traitement des pathologies cérébrales tient à l’impossibilité d’accéder au tissu pathologique et d’en réaliser le décryptage moléculaire. Or il a été montré que l’on pouvait détecter des traces de molécules sur les électrodes implantées dans un cerveau parkinsonien. C’est ce qui a conduit à l’élaboration d’un implant en silicium permettant d’effectuer des biopsies de protéines ou de molécules sans prélever de fragment de tissu. Ces mêmes dispositifs pourront servir à la délivrance localisée de médicaments, si l’on intègre dans les électrodes des éléments de micro fluidique.
Enfin, il apparaît désormais possible de mettre le cerveau en interface avec des ordinateurs. Dans un article publié il y a un an, l’université du Michigan montre qu’un patient paraplégique sur lequel on a implanté un micro réseau d’électrodes a la possibilité d’apprendre à induire une activité cérébrale pour commander un objet à distance. Parvenir à commander un exosquelette pour compenser le déficit moteur, telle serait la perspective, pour les personnes atteintes de ce type d’handicap.
À plus long terme encore, plusieurs laboratoires travaillent à modéliser les circuits cérébraux et à les transposer dans un dispositif électronique susceptible d’être inséré dans un cerveau lésé par un accident vasculaire ou par la maladie d’Alzheimer.
Les quelques essais cliniques d’implantation d’une interface homme/cerveau ont révélé un problème majeur de rejet des microélectrodes. Une voie possible est d’insérer des nanostructures sur ces électrodes pour améliorer leur action sur les structures neuronales, des analyses toxicologiques sont en cours.
Une dernière perspective se rapproche de la science-fiction, de l’apparition d’un nouvel homme hybride : des nanoparticules magnétiques non invasives que l’on pourrait guider dans le cerveau. Comme la stimulation magnétique a des effets équivalents à la stimulation électrique, il est permis d’imaginer une telle technologie, qui permettrait un diagnostic, une thérapeutique et un ciblage.
Les enjeux éthiques de ces travaux ont été soulignés très tôt. À Grenoble, les critiques des développements technologiques possibles, nous ont conduits à « entrer dans l’arène ». À l’évidence, les citoyens ont peur, d’autant qu’il existe dans l’histoire des erreurs graves : la lobotomie par exemple, qui ne constituait une indication thérapeutique que pour très peu de malades, a connu une diffusion incontrôlée et totalement dépourvue d’évaluation.
M. Alain CLAEYS.
Avez-vous pris des initiatives pour organiser ce débat éthique ?
M. François BERGER.
Nous y avons été amenés non seulement en raison de la peur des citoyens, mais aussi du fait de la contestation de nos travaux par des organisations à la limite du débat démocratique. Les discussions dans des assemblées ouvertes ont vite pris une tournure « café du commerce ». Selon moi, c’est un échec total. En revanche, des « conférences de citoyens » organisées en Île-de-France depuis un an et plus récemment en Rhône-Alpes ont donné aux chercheurs la possibilité d’éduquer des citoyens. Il s’y est réalisé un travail impressionnant qui a débouché sur des avis éthiques.
Il convient de bien distinguer l’état des lieux, qui résulte de vingt ans de procédures très laborieuses avec, à chaque fois, une information du patient et une mise en balance des risques et des bénéfices, et les perspectives et les fantasmes que la recherche peut engendrer et sur lesquels il ne faut pas se focaliser.
Il est également apparu nécessaire de tenir un débat éthique avec des professionnels des sciences sociales. Au plan européen, ce débat a été organisé depuis trois ans dans le cadre du réseau d’excellence Nano2Life et de NanoBio RAISE (Nanobiotechnology: Responsible Action on Issues in Society and Ethics). Les échanges ont d’abord été vifs car la plupart des spécialistes de sciences humaines partaient du postulat que le cerveau est un sanctuaire et que l’on ne saurait le pénétrer ou le modifier sans modifier l’humanité elle-même. Cependant, grâce à une approche pragmatique permettant à ces spécialistes d’assister à ce qui se passait dans le bloc opératoire, il a été possible de conclure que, dans l’état actuel de la médecine, le sanctuaire que représente le cerveau est respecté même si l’on y place des implants.
Pour le chercheur, le questionnement éthique est obligatoire. Il doit être précoce et pragmatique et associer des professionnels des sciences humaines. Le clinicien que je suis ne peut cependant que lancer un cri d’alarme : attention au principe de précaution. Trop de régulation tue l’innovation thérapeutique. L’histoire de la neurostimulation montre qu’il est possible, dans une société régulée et démocratique comme la nôtre, d’instituer un accompagnement et une surveillance efficaces, lesquels sont indispensables. À Grenoble, nous mettons en place un nouveau projet, Clinatec, (clinique expérimentale utilisant les nanotechnologies au bénéfice des neurosciences), qui sera un site spécifique de validation des technologies implantées, du diagnostic à la thérapeutique. L’objectif est d’accélérer l’innovation et les preuves de concept dans les meilleures conditions de sécurité.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de cette présentation, et j’appelle maintenant les participants de la deuxième partie de cette table ronde.
6
L’HOMME AUGMENTÉ : LES TRANS-HUMAINS, MYTHE OU RÉALITÉ ? LA NEUROÉCONOMIE : UNE NOUVELLE DISCIPLINE ?
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
Je remercie les participants de cette deuxième table ronde et je donne la parole à M Jean-Didier VINCENT qui traitera de la question de l’homme augmenté.
6
8 M. Jean-Didier VINCENT, Professeur à l’université de Paris Sud-Orsay, Directeur de l’Institut de neurologie Alfred Fessard, Membre de l’Académie des sciences.
Qu’auraient révélé les images du centre NeuroSpin si l’on y avait placé les auteurs des Champs magnétiques, André BRETON et Philippe SOUPAULT ? Il est heureux, finalement, que ces deux poètes soient morts à temps. Je ne vous parlerai pas des neurosciences. Les dommages considérables que subit, au fil des ans, mon cortex préfrontal ont provoqué une levée des inhibitions : je ne cherche plus à passer pour savant et je me laisse aller à des fantaisies de plus en plus répréhensibles. D’ailleurs, ayant dépassé la date de péremption, je n’ai plus accès à aucun laboratoire.
C’est pourquoi je me suis tourné vers l’anticipation et le futur. J’ai passé quelque temps dans la Silicon Valley, j’ai rencontré tous les gourous du trans-humanisme ainsi que d’autres personnages de moindre intérêt comme Michel HOUELLEBECQ, et d’autres qui me paraissent être les vrais prophètes de l’avenir. Après que j’eus rencontré, en compagnie de François BERGER, James HUGUES, un des papes du trans-humanisme, j’ai eu droit à un papier du Canard enchaîné insinuant que j’étais devenu moi-même un trans-humaniste !
Le cerveau est considéré comme le dernier continent inexploré. La découverte, somme toute récente, de l’Amérique a représenté un bouleversement pour l’humanité, et a été payée de millions de morts, de grandes souffrances, de la disparition de civilisations entières ... La découverte du cerveau, quant à elle, reste à faire : les images qui nous ont été présentées sont merveilleuses, mais cela ne nous avance pas tellement de savoir que telle zone se colore en vert ou en rouge quand nous aspirons à Dieu, avec la « neurothéologie », ou à la richesse, avec la neuroéconomie. Il n’est cependant pas trop tôt pour y réfléchir et je vous remercie les rapporteurs de l’Office d’avoir mentionné ces questions dans leur exposé tout à fait informé. Nous ne pouvons plus nous contenter de cette éthique au jour le jour, certes politiquement correcte mais qui ne prévoit rien hormis un principe de précaution à la fois superflu et paralysant.
L’homme est parvenu à un tournant radical de son histoire où il prend conscience qu’il ne réalisera jamais le rêve cartésien d’être maître et possesseur de la nature. Il est devenu l’esclave d’une nouvelle nature une nature artificielle, qu’il a lui-même produite, une nature supérieure à la misérable natura naturans dont nous sommes les produits naturels. Il cherche aujourd'hui à échapper à cette calamité en alignant son corps sur ses instruments. Grâce à l’engineering de l’humain, extrême perversion de l’offre et de la demande, nous imitons les objets que nous avons fabriqués. Longtemps, l’homme a été le modèle de la machine ; aujourd'hui, la machine est le modèle de l’homme. L’enjeu n’est donc plus d’imiter la nature mais de créer une nouvelle nature.
Quelle doit être la place de l’Europe dans cette course, ou plutôt dans cette fuite en avant animée par un principe « d’immaîtrise » que l’on pourrait par antiphrase appeler, avec Hans JONAS, principe d’irresponsabilité ? En effet, cette nouvelle nature dont l’homme est responsable, n’est efficace que dans la mesure où elle n’est pas vraiment maîtrisée, ce qui invalide d’emblée le principe de précaution dans ce domaine. Le vaste programme de recherche consacré à la convergence des technologies, engagé en 2002 principalement aux États-Unis, vise à la mise en œuvre systématique de la convergence, dont on sait qu’elle est aussi un des processus majeurs de l’évolution du vivant. L’Europe ne doit ni concurrencer ce programme, ni le suivre aveuglément, mais affirmer sa place de foyer original pour tout ce qui concerne l’évolution de l’homme.
Le programme américain comprend quatre voies technologiques convergentes vers le « post-humain », qui permettra à l’homme de faire mieux que ce que la nature a su faire. Les biotechnologies seraient les premières à ouvrir la porte de la post-humanité. Les nanotechnologies tireraient l’attelage, complétées par les technologies de l’information et les sciences cognitives. Le gouvernement fédéral des États-Unis a doté ce programme couramment appelé NBIC – nano, bio, info, cogno – de plusieurs milliards de dollars. On peut considérer le projet comme la première pierre officielle de ce que ses adeptes conviennent de nommer trans-humanisme et qui n’est rien d’autre qu’un état intermédiaire vers le post-humanisme.
C’est dans le domaine des biotechnologies que les menaces pour le futur de l’espèce humaine sont le plus visibles et que les débats éthiques sont le plus étendus. Les avancées connues et spectaculaires ne sont que la partie visible d’une science plus avancée que le public ne le pense, dans la révélation des mystères de la vie. S’agissant du triage des embryons : leur amélioration, leur fabrication avec contrôle de qualité, leur incubation dans une matière médicalisée seront bientôt à la portée d’une société disposant d’assez de moyens pour en assurer le coût. D’emblée, on observe que le prix de ces technologies implique qu’elles ne seront pas réservées à tout le monde.
Le clonage reproductif des mammifères par transfert in vitro d’un noyau d’une cellule adulte dans un ovocyte énucléé, suivi d’une implantation in vivo, technique inaugurée par la naissance royale de la brebis Dolly, a constitué sous le regard impavide des savants ayant doctement déclaré la chose impossible, le début d’une procession de lapins, chevaux, vaches, cochons, couvée, chats, etc., qui évoque la file d’attente des animaux à l’entrée de l’arche de Noé. L’alibi médical laisse augurer la mise en œuvre prochaine du clonage thérapeutique, avec l’intention louable d’améliorer le sort de l’humanité en soignant, réparant, et soulageant les souffrances.
On peut toutefois se demander si la science résistera longtemps à l’orgueilleuse tentation de réaliser un clonage reproductif. D’ores et déjà, les biotechnologies se proposent non seulement de soigner, mais aussi d’augmenter les capacités « enhancement » de l’homme. Le dernier rapport du United States presidential council of bioethics s’intitule d’ailleurs Beyond therapy : au-delà de la thérapie. La convergence des technologies s’annonce dans ce domaine d’une redoutable efficacité. « Quand les technologies du xxie siècle convergeront, l’humanité pourra enfin atteindre, grâce à elles, un état marqué par la paix mondiale, la prospérité universelle et la marche vers un degré supérieur de compassion et d’accompagnement. » Ces mots figurent dans le document officiel de l’autorité fédérale américaine, la National Science Foundation, qui a lancé en 2002 le programme interdisciplinaire doté de plusieurs milliards de dollars et dûment signé par le président George W. BUSH.
Les nanotechnologies forment l’ossature du projet. Elles ont déjà connu, dans les deux dernières décennies, des avancées considérables, au premier rang desquelles la mise au point des microscopes à effet tunnel et des microscopes à force atomique, qui permettent de voir les atomes et de les manipuler un à un pour assembler et construire des engins à l’échelle du milliardième de mètre. Le projet, tel qu’il est défini au départ par Kim Eric DREXLER au Massuchussetts institute of technology (MIT) en 1980, prétend que ces machines rivaliseront avec la nature : ce que celle-ci a fait, l’homme, avec son intelligence, doit pouvoir le faire. Les nanoengins construits sur des modèles vivants comme les ribosomes fabriqueront des machines capables d’assembler à partir d’atomes, grâce à des bras mobiles, des ensembles moléculaires autorépliquants et économes en ressources, aussi bien sur le plan de l’énergie que sur celui des matériaux.
L’alliance déjà ancienne, notamment sur le plan idéologique, des sciences cognitives et des sciences de l’information se poursuit par exemple dans l’augmentation exponentielle des capacités des ordinateurs : on peut ainsi extrapoler la loi de MOORE et l’utilisation de machines hybrides combinant neurones humains et éléments électroniques, parallèlement à une connaissance à haute résolution de l’architecture du cerveau.
Tout cela nous promet un avenir qui chante. Le rapport de la National Science Foundation (NSF) américaine sur la convergence des technologies pour améliorer les performances humaines (Converging technologies for improving human performance) reste cependant prudent lorsqu’il conjoncture que l’humanité pourrait devenir comme un cerveau unique dont les éléments seraient distribués par des liens nouveaux parcourant les sociétés.
J’ai rencontré Nick BOSTROM, professeur à Oxford ou du moins se faisant passer pour tel car, grâce à une personne qu’il a pu congeler, il a obtenu un milliard qu’il a donné à cette université, laquelle, peu prudente, a accepté de créer un département de philosophie hébergeant ce redoutable utopiste. Cela crée un malaise. Le vice-président de la National Science Foundation, que j’ai rencontré également, ne fait pas mystère de ses liens avec le mouvement trans-humaniste, qui ne vise pas moins qu’une amélioration de l’espèce humaine et, à terme, l’immortalité. Il s’agit non seulement de prolonger la vie, mais de la prolonger en bon état et d’aller, tant qu’on y est, jusqu’au point où l’on s’ennuiera sur terre. Mais tous ces programmes n’intègrent pas la dimension de l’ennui…
J’avoue avoir été sidéré par ma rencontre avec un homme qui fait de la sociologie sur ordinateur, William Sim BAINBRIDGE car mon interlocuteur, un petit Écossais roux et ventru, une sorte de Hobbit, m’a mis tout de suite en présence de son avatar, un homme très mince vêtu comme on l’était dans les phalanstères utopiques. J’ai passé trois heures avec ce dernier sur un ordinateur. Nous avons ainsi discuté d’une sociologie future résultant de l’intégration dans les cerveaux humains d’éléments fabriqués. Je me suis aussi entretenu, dans la Silicon Valley, avec un merveilleux allumé, un prophète qui travaille sur des algorithmes avec lesquels il espère implémenter et interconnecter plusieurs cerveaux humains et préparer ainsi une nouvelle humanité.
Une fois que nous serons immortels ou clonés, la question sera de savoir comment transmettre la mémoire. Y aura-t-il une mémoire d’espèce ? Le clone n’emporte pas avec lui ce que l’individu détient dans sa mémoire. Il faudrait donc envisager des systèmes de translation ou d’implémentation des cerveaux après reproduction. Quoi qu’il en soit, ces évolutions signifieraient la disparition de l’espèce humaine, ou sa démultiplication : il y aurait les laissés pour compte – mais il y en a déjà : le changement ne serait donc pas considérable – et ceux qui pourraient être clonés. Les conséquences sur l’héritage seraient catastrophiques. Quel intérêt aurait-on à cloner son père si l’on espère une succession qu’« il » risque de venir réclamer par la suite ? Les problèmes éthiques seront considérables ! Si le sujet se prête à la plaisanterie, il n’en est pas moins sérieux. L’échéance est inférieure à un siècle. Une personne très écoutée aux États-Unis, Raymond KURZWEIL, a proposé le concept de singularité, selon lequel les développements technologiques pourraient être si rapides que la courbe des progrès deviendrait presque verticale.
Les propos de savants devenus prophètes, abolissant les frontières entre utopie et projet scientifiques, ne doivent pas faire oublier le sérieux d’une entreprise que pourrait résumer la devise : « Rendre l’impossible possible, et l’impensable pensable. » Pour Danny HILLIS, un grand architecte d’ordinateurs, de Palo Alto « la négation de l’animalité de l’homme aboutira à l’abolition de la mort imputable à notre être charnel. L’adversaire d’une telle entreprise est la religion sous toutes ses formes. Aucune divinité ne devrait plus polluer une nature artificielle qui tient sa création de l’homme seul et de l’utilisation d’une intelligence augmentée, tout aussi artificielle, permettant de franchir les limites imposées par les techniques actuelles grâce à des supports artificiels produits par la bioélectronique. »
Tel est l’avenir qui nous est réservé. J’espère que mes descendants appartiendront à la bonne espèce ou que s’ils sont dans des espèces secondaires, il pourront peut être essayer d’en sortir…Cela se mettra en place Voyez ce qui s’est passé en Amérique : on a détruit toutes les civilisations qui y existaient, or aujourd'hui la grande Amérique civilisatrice apporte la paix et la démocratie à l’ensemble du monde. Pour ma part, je crois qu’une pensée européenne cohérente, issue de nos traditions humanistes et à l’abri de toute tentation conservatrice, est le rempart le plus sûr contre les menaces idéologiques et les excès dans lesquels la recherche forcenée de crédits pourrait entraîner les chercheurs.
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
Je vous remercie de cet exposé fort instructif. *
M. Alain CLAEYS.
Je crois qu’avec votre conclusion, nous pourrons encore cheminer et nous interroger. M. Bernard BIOULAC que je suis heureux d’accueillir vous avez la parole.
6
8 M. Bernard BIOULAC, Directeur scientifique neurosciences et cognition du CNRS, Directeur de l’Institut des neurosciences de Bordeaux.
Je suis très gêné d’intervenir après mon maître car mon propos sera beaucoup plus prosaïque. Il portera sur la stimulation cérébrale profonde qui a permis de réaliser des progrès importants dans le traitement de certaines pathologies, au premier rang desquelles la maladie de Parkinson, mais qui peut poser des questions éthiques.
Dans cette approche, on est passé d’une logique de maladie sensori-motrice à des troubles plus compliqués – dystonie, dyskinésie –, puis on a commencé à aborder des aspects psychomoteurs, dont le type pourrait être le syndrome de Gilles de la Tourette, avant de se diriger vers des maladies plus psychiatriques : la dépression, avec les stimulations du cortex préfrontal, et les troubles obsessionnels compulsifs. On a donc suivi, comme souvent, une sorte de continuum allant du plus simple au plus complexe, qui m’interroge.
La question rémanente est de savoir ce que l’on fait exactement : comment l’écoulement du courant électrique intervient-il dans le système nerveux central ? L’électrochoc produit encore de bons résultats dans le traitement de certaines formes de dépression mais on sait mal comment cela agit. Dans la stimulation cérébrale profonde, on opère de façon plus ponctuelle, on maîtrise mieux les paramètres. Mais il est important de disposer de bons modèles animaux nécessitant une recherche fondamentale de qualité, pour savoir ce que l’on fait, car on implante l’homme. Cela est déjà difficile à obtenir pour les maladies motrices, mais pour les maladies mentales, les modèles de rongeurs ou de primates que l’on utilise, suscitent de graves interrogations de la part de nos collègues psychiatres. Il faut pourtant avancer et comprendre ce qui se passe au niveau élémentaire, avant de procéder à des implantations sur l’homme.
Si, dans le traitement des tremblements, l’on est passé du thalamus au noyau sous thalamique, c’est parce qu’on s’est appuyé sur des données d’une autre nature, fondées sur une meilleure compréhension de l’organisation cortico sous corticale du système nerveux, sinon cette petite structure n’aurait pas été visée. Une rupture dans le raisonnement s’est produite. On a alors décidé de contrecarrer par la stimulation cérébrale profonde l’activité anormale apparaissant au niveau du noyau sous thalamique chez le parkinsonien ou dans le modèle de maladie de Parkinson chez le singe. La question est cependant plus complexe : des travaux sur des tranches de cerveau qui respectent la circuiterie sous corticale montrent que, au-delà d’une activité anormale ponctuelle, le dysfonctionnement atteint tout un réseau.
Par la stimulation, nous savons que nous interagissons sur la dynamique du réseau mais, je le répète, nous ignorons ce qui se passe exactement. Il faut approfondir les connaissances par la recherche fondamentale avec des modèles et des préparations simplifiées pour arriver à une meilleure compréhension de l’écoulement du courrant électrique dans les réseaux du système nerveux. Le courant est vraisemblablement distribué parallèlement dans l’ensemble du système nerveux, agissant de façon prévalente sur un réseau particulier mais agissant également ailleurs. Cette question me préoccupe beaucoup, elle a obligatoirement des interférences éthiques et bioéthiques. Il est important de comprendre ce que l’on fait lorsque l’on accomplit des progrès dans le traitement de l’humain. Comment ces éléments expliquent-ils les progrès ?
Aujourd'hui, face à l’amélioration clinique considérable, il est malaisé de dresser le tableau de la réalité explicative et mécaniste du phénomène. Peut-être les avancées de la recherche sur la dynamique des synapses, que l’on peut observer par imagerie bi photonique, permettront-elles de saisir enfin le phénomène premier de cet écoulement dans l’organisation et le réseau synaptique et comment elle s’exprimera au niveau clinique.
Ceci a des conséquences éthiques car on traite depuis 1993 des patients au niveau du noyau sous thalamique. Jusqu’ici apparemment tout se passe bien malgré quelques vilaines déconvenues, mais on agit sur tout le système nerveux, et il est important de savoir ce que l’on y fait.
M. Jean-Didier VINCENT.
Dans les années 1958-1960, avec Michel JOUVET, nous avons posé des électrodes sur des chats et des lapins éveillés et libres de leur comportement, mais nous avons vite buté sur une difficulté : comment explorer les fonctions alors que le courant passe un peu partout ? Nous ne savions pas si nous stimulions des fibres de passage ou des relais synaptiques. Certains pionniers, comme Walter Rudolf HESS, avaient déjà pratiqué la stimulation par électrodes.
Ensuite, on a effectué des enregistrements à l’intérieur du cerveau avec des électrodes isolées, notamment dans des régions de l’hypothalamus et dans des zones sous corticales. Bernard BIOULAC et moi-même avons cru que nous étions parvenus à nos fins, on a observé des neurones pendant des comportements élémentaires de boisson etc.., avant de nous apercevoir que beaucoup de chemin restait à parcourir. On croit toujours s’approcher de la réalité et celle-ci ne cesse de reculer. Il en ira de même avec toutes les techniques.
Il ne faut donc pas rêver : si révolutions il y a, elles seront de l’ordre de celles que proposent les trans-humanistes, c'est-à-dire des révolutions radicales qui tourneront le dos au passé et aux technologies anciennes. Sans vouloir doucher les enthousiasmes des scientifiques ici présents, je considère que, contrairement à la génétique où les progrès sont sans conteste considérables, la physiologie est en retard : nous manquons de modèles et l’homme n’est pas manipulable à l’infini. On ne peut pas poser des électrodes partout.
L’exemple du traitement par électrochocs est à cet égard significatif. En mai 1968, on condamnait violemment les psychiatres qui le pratiquaient, alors que c’est la seule façon de calmer les souffrances immenses de certains patients déprimés et suicidaires. À l’époque on ignorait la façon dont cela agissait, quelques hypothèses étaient avancées. Aujourd'hui, on commence à savoir à quel niveau de transduction, quels enzymes et quels gènes sont sollicités. La neurogénèse du cerveau offre aussi une explication.
Ceci met en évidence des dérives considérables. Toute la neuropharmacologie a été construite sur la synapse, et c’est à ce niveau que l’on expliquait l’action des psychotropes, ce qui est inexact car la synapse fonctionne quasi instantanément, alors que les substances produisent généralement leurs effets au bout de trois semaines. Pourquoi ? On ne s’est jamais interrogé sur le délai d’action des substances agissant sur les synapses. La vraie cible thérapeutique n’est donc pas où l’on croit. Cela n’a pas empêché les visiteurs médicaux d’expliquer aux psychiatres pendant des années qu’il suffisait d’inhiber la recapture de la sérotonine pour guérir la dépression, et ce sans connaître les récepteurs qu’ils fallait bloquer. Cela n’expliquait rien.
Ces lacunes dans la connaissance ont des bons côtés : tant qu’on ne trouve pas grand-chose, on ne risque rien, hormis quelques dérives momentanées. Or les tentations ont existé. Mais il est probable que la science arrivera à un stade que nous ne pouvons pas concevoir actuellement et où l’on disposera de moyens d’intervention sur le cerveau dont nous ne pouvons avoir l’idée. C’est alors qu’il faudra faire très attention à ce qu’il adviendra.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de ces interventions qui soulèvent des problématiques fort intéressantes. Je donne la parole à M. Olivier OULLIER qui nous présentera sa vision de la neuroéconomie.
8 M. Olivier OULLIER, Maître de Conférence, Université Aix- Marseille, laboratoire de neurobiologie humaine
Mesdames et messieurs les Parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs. Je voudrais en tout premier lieu remercier particulièrement Messieurs les députés CLAEYS et VIALATTE, Hervé CHNEIWEISS ainsi que l’ensemble de l’Office pour cette invitation. Si le scientifique que je suis est honoré de pouvoir s’exprimer parmi vous, le jeune scientifique l’est encore plus.
N’ayant pas la grande carrière et la renommée des experts invités aujourd’hui à cette tribune, permettez-moi de très brièvement me présenter. Je ne surprendrai personne en vous disant que je suis un enseignant-chercheur en neurosciences n’ayant que peu de vécu au sein d’une institution française. J’ai en effet d’abord travaillé aux Etats-Unis avant aujourd’hui de faire partie de ceux qui ont préféré revenir en France pour y exercer leur métier, principalement par passion. Cette décision de travailler dans le monde académique français vous montre que, malgré l’objet de mon intervention sur les neurosciences des décisions économiques, mon but premier n’était pas l’appât du gain financier.
Mes travaux de recherche et mes enseignements portent sur les neurosciences des interactions sociales : comment notre corps et notre cerveau se comportent lorsque nous interagissons avec autrui. Plus particulièrement, avec mes collaborateurs nous menons des travaux dans le domaine de la neuroéconomie sociale, discipline dont je vais plus précisément vous parler aujourd’hui.
Neuroéconomie. Que cache donc ce néologisme ? Il s’agit d’un nouveau champ scientifique interdisciplinaire au sein duquel collaborent notamment chercheurs en neurosciences, sciences cognitives, psychologie, sociologie et sciences économiques. Son objet d’étude est de mieux comprendre les mécanismes comportementaux et cérébraux qui sous-tendent la décision économique. Donner, vendre, investir, acheter, prêter, punir, évaluer, aimer, rejeter, sont parmi les processus qui scandent notre quotidien. Si le mariage entre neurosciences et économie peut paraître improbable, il offre aujourd’hui la possibilité d’étudier la dynamique comportementale et cérébrale d’un ou plusieurs individus en interaction dans des situations de plus en plus réalistes et écologiques. Cette discipline universitaire permet aussi d’affiner les théories économiques néo-classiques basées principalement sur l’idée d’un agent purement rationnel en explorant le rôle des émotions dans les décisions économiques et morales. Elle est une superbe illustration de la multidisciplinarité.
C’est un euphémisme de dire que la neuroéconomie, et les neurosciences en général, suscitent de nos jours l’intérêt et ont une portée en dehors des laboratoires de recherche publics. Dans les milieux industriels, politiques, éducatifs, sportifs et financiers, pour ne citer que les plus investigués, la nécessité d’une meilleure compréhension du cerveau de l’individu semble devenue une priorité. Les premières applications que nous observons aujourd’hui au sein de la société laissent présager des bouleversements majeurs dans l’appréhension des sciences comportementales et leurs conséquences voire dans la vision de l’humain et de la société. La réflexion éthique sur l’utilisation, effective ou potentielle, des sciences du cerveau hors des laboratoires de recherche médicale et scientifique est aujourd’hui incontournable. Cette audition est d’ailleurs un signal extrêmement fort dans ce sens. Ainsi, les sciences du cerveau sont de plus en plus visibles dans notre quotidien, qu’il s’agisse de faire élire un candidat à l’élection présidentielle américaine, de nous vendre une voiture, de lutter contre le terrorisme, de détecter les mensonges, voire de créer les ordinateurs et les jeux vidéo de demain, les faits sont là. Si vous me pardonnez l’expression, « On nous sert les neurosciences à toutes les sauces ». C’est pourquoi lorsque nous avons développé à Marseille en 2005 le premier cours universitaire de neuroéconomie en France, il était inconcevable qu’il ne soit couplé avec un cours de neuroéthique. Il est en effet nécessaire de réfléchir, en amont, à l’attrait nouveau pour les neurosciences de secteurs qui n’avaient a priori que peu de lien avec cette discipline et aux éventuelles applications en cours ou à venir.
Le cerveau nous intéresse. Par « nous », j’entends les chercheurs et les médecins, car nous essayons de comprendre comment certaines pathologies, le développement ou le vieillissement améliorent ou altèrent le fonctionnement de notre cerveau. Les neurosciences servant la médecine, et la médecine se servant des neurosciences, ce n’est pas une information très originale. Cela reste toutefois notre but premier. Il n’est jamais inutile de le rappeler, surtout à l’heure où quelques uns essayent de les détourner de leur objectif premier de recherche et de soin. Notre cerveau les intéresse. Ces « les », ce sont toutes ces professions aux objectifs qui, de prime abord seulement, n’ont pas vraiment de lien direct avec les neurosciences. Mais en y regardant d’un peu plus près, il devient évident que ces métiers peuvent tous tirer de grands bénéfices d’une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau du citoyen lambda. Ils voient dans les neurosciences les promesses d’une fenêtre sur notre futur grâce à de nouvelles méthodes pour soi-disant prédire nos choix, tout autant que pour justifier les leurs. Alors, grâce aux neurosciences, leurs lendemains s’annoncent-ils de plus en plus fructueux et les nôtres de plus en plus prédictibles ? Et face à une telle perspective, peut-on vraiment se permettre de ne pas réfléchir aux conséquences des recherches en sciences du cerveau et à leur utilisation tout autant qu’aux fausses promesses qui peuvent être véhiculées par les non-scientifiques ?
Ainsi, aujourd’hui j’aimerais porter l’attention de l’Office sur deux éléments interdépendants : l’avancée des recherches neurosciences de la décision et leur commercialisation. Deux domaines qui s’ils peuvent se télescoper dans l’opinion publique se développent dans deux milieux et à travers deux perspectives distincts. C’est pourquoi j’insiste sur le fait que la neuroéconomie en tant que discipline universitaire mondialement reconnue ne doit en aucun cas être confondue avec les dérives commerciales qu’une poignée essaie de développer bien souvent à l’insu de la communauté neuroscientifique et encore plus souvent sans que les neurosciences ne soient vraiment utilisées. Cet intérêt est lié à deux facteurs principaux :
- tout d’abord les promesses et autres fantasmes de décryptage de l’esprit pour améliorer la prédiction du comportement humain ;
- ensuite l’image séductrice et de plus en plus populaire du cerveau.
C’est en effet dans la prédiction (vérifiée ou non), en tant que projection dans le futur, que se situent certains des enjeux les plus importants de notre société qui supporte de moins en moins l’incertitude. Si l’on ouvre un dictionnaire, à prédire, l’on peut lire : « annoncer ce qui doit arriver, soit par intuition, par conjecture, soit par des règles certaines ». Les neurosciences vont-elles vraiment nous fournir ces « règles certaines » sur nos comportements ou bien juste des éléments pour affiner nos intuitions ? Aujourd’hui quiconque affirmerait pouvoir, grâce aux seules neurosciences, proposer des règles certaines du comportement humain, dans le meilleur des cas se trompe, dans le pire est un charlatan. Aucun scientifique digne de ce nom ne s’y risquerait car ce serait vite oublier qu’un cerveau seul ne sert pas à grand-chose. Le cerveau se trouve dans un corps, ce corps interagit avec d’autres corps dans un environnement, physique et social, qui change en permanence et qui, comme lui, a un vécu, des expériences donc une histoire. De par son fonctionnement et ses interactions qui interviennent à de multiples niveaux, le cerveau est un système auto-organisé, le plus complexe connu et étudié par l’homme. De fait, associer de manière directe et univoque un comportement social complexe à quelques millimètres cubes de matière cérébrale est une démarche erronée et réductionniste voire dangereuse, d’un point de vue scientifique comme sociétal. Mais souvenons-nous des leçon de l’histoire : le fait qu’une technique fonctionne ou non ne l’a jamais empêchée d’être commercialisée et n’a jamais empêché des individus (crédules et/ou avides) de vouloir se l’approprier. Les neurosciences et certaines de leurs applications (effectives ou fantasmatiques) n’échappent malheureusement pas à cet état de fait.
Pour que les promesses de « neuro-prédictions » puissent émerger, il ne suffit pas de pouvoir enregistrer le cerveau en train de fonctionner, il faut aussi pouvoir le montrer. Nous disposons aujourd’hui de plusieurs méthodes qui permettent d’y arriver. L’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf), originellement développée pour la recherche médicale, est la technique la plus médiatisée. Pourquoi ? Parce qu’elle permet de produire les fascinantes images tridimensionnelles du cerveau en activité dont se délectent les médias, le public et, avouons-le, une grande partie de la communauté scientifique. L’IRMf a grandement participé à l’engouement du grand public et des médias pour les neurosciences. Ces dernières n’échappent donc pas au pouvoir de l’image. L’image du cerveau en activité procure aussi l’illusion de la compréhension absolue du fonctionnement du cerveau pour le grand public. On non seulement toute sa complexité mais surtout que l’image du cerveau d’un individu est aussi personnelle et intime qu’un test ADN, une analyse sanguine ou des empreintes digitales. Si l’on mettait ces trois derniers exemples dans un article l’on crierait au scandale à la violation de vie privée. Ce n’est malheureusement pas le cas pour le cerveau.
Il y a encore quelques années, les enregistrements de l’activité du cerveau n’étaient que successions de courbes peu attrayantes d’un point du vue visuel que seule une poignée d’initiés pouvaient interpréter. A partir du moment où l’image est devenue tridimensionnelle, agrémentée d’une « tâche jaune » pour localiser l’activité cérébrale, le cerveau est devenu commercialisable, « bankable » dirait-on dans le milieux industriel, on la retrouve en unes de magazines comme dans beaucoup d’émissions de télévision. Comme le disait Picasso : « Certains artistes représentent le soleil à l’aide d’une tâche jaune, et d’autres transforment une simple tâche jaune en soleil ». Aujourd’hui cette tâche jaune censée représenter une activité cérébrale certains la transforment en dollars. Ce sont eux les neuropportunistes : ultra-minoritaires certes mais diablement efficaces d’un point de vue financier.
Pourtant, cette neuro-imagerie, outil indispensable au progrès en neuroscience et en médecine illustre une nouvelle fois la pensée ô combien pertinente d’Alfred Korzybski : « Une carte n’est pas le territoire ». Aussi belles soient-elles, une image figée ou une animation en trois dimensions, ne suffisent pas à résumer à elle seule le fonctionnement de notre organe le plus complexe … et encore moins nos comportements. Une carte cérébrale n’est donc pas un lexique comportemental. L’enregistrement du cerveau en train de penser, rêver ou décider n’est en aucun cas un enregistrement de la pensée du rêve ou de la décision. Ces mots ont souvent été prononcés mais certains ont tendance à trop vite l’oublier. Mais tout cela, mes estimés collègues vous l’ont déjà dit ou vous le diront souvent mieux que moi. Alors pourquoi écouter l’avis d’un jeune enseignant chercheur de 33 ans ? Peut-être parce que je fais partie de la génération qui est arrivée alors que les machines d’imagerie cérébrale étaient déjà opérationnelles. Une génération qui bénéficie du travail phénoménal accompli par ses prédécesseurs, certains présents aujourd’hui, qui nous ont servi sur un plateau des théories et des outils pour étudier le cerveau que certains scientifiques ont attendu leur vie durant. Une génération qui si elle n’est pas privilégiée par les salaires et les moyens financiers en ce moment, l’est certainement au niveau de la connaissance et des outils pour explorer le cerveau. Une génération qui est de plus en plus sollicitée afin de profiter de son expertise en imagerie cérébrale dans des domaines autres que la recherche et la santé. C’est donc à nous que revient la lourde tâche de ne pas dévoyer les avancées scientifiques et d’anticiper ce que sera le futur des neurosciences. A nous aussi de reconnaître qu’une partie de la communauté scientifique a des œillères. Sous prétexte que scientifiquement certaines des applications des neurosciences proposées hors des laboratoires ne seraient pas scientifiquement vérifiées, il faudrait ne pas s’en préoccuper ? C’était en tout cas la posture jusqu’à très récemment. Mais que faire alors des promesses incertaines ou tout simplement erronées qui sont véhiculées et souvent vendues ? Ces promesses irréalisables pour certaines peuvent causer un tort énorme. Et une poignée d’opportuniste pourrait ainsi nuire au domaine scientifique et médical des sciences du cerveau qui a plus que jamais besoin de soutien pour continuer à se développer
Alors oui, il y a quelques charlatans qui essayent de profiter des découvertes en neurosciences. Mais leurs attentes et leurs désirs ne sont pas sans fondements. 2007 a été une année charnière dans ce sens. Des signes forts en faveur d’une généralisation de l’utilisation des neurosciences dans le monde de la publicité ou de la finance par exemple ont eu lieu. Si je suis ici aujourd’hui c’est en partie grâce ou à cause d’un article que j’ai écrit il y cinq ans alors que je travaillais encore à plein temps outre-Atlantique. Son sujet était le neuromarketing et son envol aux Etats-Unis. Le neuromarketing est un commerce qui vise à améliorer l’impact des campagnes publicitaires ou de communication grâce aux neurosciences. Publié dans un grand quotidien français, les réactions à l’époque ont été contrastées. Le privé a sollicité des avis pour connaître l’éventuelle faisabilité du neuromarketing et le monde académique a trop souvent balayé d’un revers de la main ce neuromarketing considéré alors comme du vent sans vraiment se préoccuper des éventuels problèmes qu’il pose. Je tiens toutefois à rendre hommage au Comité Consultatif National d’Éthique pour son écoute, nos échanges sur ces thématiques depuis cette période et son soutien dans ma démarche de réflexion et d’enseignement de la neuroéthique.
Les choses ont rapidement évolué rapidement depuis. Dans un monde où les dépenses publicitaires annuelles se chiffrent en centaines de milliards de dollars, tout ce qui permettrait d’étayer l’arsenal publicitaire mérite l’attention de cette industrie. Aujourd’hui, ce sont plus de dix entreprises qui proposent ce service en France. A titre indicatif, j’ai encore été contacté il y a deux jours par un incubateur public afin d’expertiser une demande de création de cabinet dans ce secteur. Début 2007, un étude a été publiée dans laquelle des individus dans une situation proche de l’achat en ligne devaient acheter ou non, à leur convenance, un ou plusieurs parmi plusieurs dizaines de produits aussi divers que des chocolats des vêtement ou des DVD. L’on aurait réussi, en se concentrant sur un réseau d’activité cérébrale, à prédire si oui ou non les gens allaient acheter, indépendamment du produit. A la même époque, Omnicom, n°1 mondial de la communication qui annonce plusieurs milliards de dollars de chiffre d’affaire annuels a investi dans le domaine des neurosciences. Il s’agit d’un des signes les plus forts à ce jour de l’intérêt du monde la publicité et de la communication pour les neurosciences. Ajoutez à cela l’évaluation de l’efficacité et de l’impact des publicités du superbowl ou des spots de campagne des candidats Obama et Clinton à l’aide de l’imagerie cérébrale qui s’affichent en une du New York Times et il devient difficile d’ignorer le marché du neuromarketing. Aujourd’hui les véritables victimes de ces pratiques sont les dirigeants d’entreprises qui sont surfacturés sous prétexte d’une prétendue amélioration de leurs techniques de recrutement ou de vente grâce à l’utilisation de l’imagerie cérébrale.
Si le marché du neuromarketing existe, il ne faut absolument pas, et je n’insisterai jamais assez là-dessus, faire l’amalgame avec la neuroéconomie qui est une discipline universitaire rigoureuse dont les finalités ne sont nullement commerciales. Mieux comprendre comment nos émotions peuvent intervenir dans les décisions économiques et morales peut avoir un impact positif y compris pour vaincre les mécanismes d’addiction, par exemple, afin de savoir pourquoi les gens prennent la décision de replonger. Dans une autre perspective, des équipes canadiennes utilisent les techniques dites de neurosciences afin de tester l’impact sur la prise de décision des consommateurs de messages comme « fumer tue » ou d’images de poumons atteints de cancer sur les paquets de cigarette. Si ces techniques permettent un jour d’améliorer les campagnes publicitaires, alors elles doivent être prises en compte par les pouvoirs publics pour promouvoir au mieux les campagnes de sensibilisation et d’intérêt général. C’est dans cette optique qu’un de nos programmes de recherche explore aujourd’hui les méfaits de l’esthétisation des emballages de produits dangereux. L’idée est d’élaborer une signalétique multi-sensorielle plus efficace qui permettrait d’éviter aux enfants et aux personnes âgées notamment de s’empoisonner avec des produits comme l’eau de javel.
Les institutions publiques, notamment dans le management des risques et des crises, (financiers ou autres) ne sont pas en reste. Face à l’émergence de nouveaux risques, aux choix stratégiques et souvent moraux qui impliquent les vies de citoyens auxquels sont confrontés nos dirigeants, de nouveaux paradigmes de gestion de crise sont en train d’être élaborés. Aux Etats-Unis, les neuroéconomistes font désormais partie des panels d’experts qui contribuent à ces travaux et la neuroéconomie a fait son entrée dans la formation comme les MBAs.
En conclusion, l’entreprise dans laquelle nous sommes impliqués aujourd’hui est délicate. Trop tirer la sonnette d’alarme sur les activités des neuropportunistes d’une certaine façon légitimerait leur existence. Après tout : pourquoi aurait-on peur de quelque chose qui ne fonctionne pas ? Cela pourrait aussi desservir les neurosciences. Le grand public, s’il identifie neurosciences à « intrusion dans le cerveau » à des fins mercantilistes et/ou manipulatrice s’opposera à ce que des fonds publics soient consacrés à nos recherche. Et c’est bien la dernière chose que nous souhaitons. D’autant que nous parlons d’une minorité qui ne pratique même pas les neurosciences et essaie simplement de tirer partie de l’attrait actuel pour le cerveau. D’un autre côté, ignorer ce monde parallèle autour des neurosciences serait à mon sens une erreur.
L’imagerie cérébrale est un outil formidable et notre pays est sous équipé par rapport à nos voisins européens, sans parler des Etats-Unis. Cet outil a permis et permettra encore d’en apprendre toujours plus sur le fonctionnement du cerveau et de mieux le soigner. La recherche en neurosciences est nécessaire, et doit continuer de recevoir un soutien fort des autorités. Dans mon domaine d’intérêt, il faut donc bien faire la différence entre le neuromarketing qui est un commerce, en plein développement certes, mais qui reste un commerce et la neuroéconomie qui est une discipline de recherche scientifique pratiquée dans les institutions publiques qui doit continuer à se développer car nous sommes à la traîne. La freiner serait dès lors une erreur grave. Je reste persuadé que la connaissance, son développement et sa diffusion restent la meilleure arme contre les dérives. Pour qu’elles puissent se faire dans la sérénité il convient donc de donner aux enseignants, aux chercheurs et aux médecins les moyens conséquents, qu’il s’agisse de budgets de recherche, de salaires et d’incitatifs à la réflexion neuroéthique.
Je vous remercie de votre attention et serais heureux de répondre à vos questions.
‚
M. Alain CLAEYS.
Avant d’introduire la deuxième table ronde, je vais demander à Hervé CHNEIWEISS de faire une synthèse, ce qui suscitera peut-être des questions.
M. Hervé CHNEIWEISS.
Je retiendrai essentiellement deux aspects de table ronde. Le premier a été soulevé par Jean-Didier VINCENT et je m’inscris en faux contre ses propos. S’il est un domaine des sciences de la vie dans lequel les découvertes ont entraîné des progrès extraordinaires, c’est bien celui des neurosciences. Pour la maladie de Parkinson, par exemple, on est passé de la description anatomique d’un défaut au niveau des neurones dopaminergiques à un traitement substitutif. Comme l’a rappelé François BERGER, des traitements avec des implants permettent à des milliers de patients gravement handicapés non pas, malheureusement, de vivre normalement mais, dans la plupart des cas, de retrouver une autonomie et une vie sociale importantes.
Les neurosciences apportent des connaissances fondamentales, qui permettent d’observer de façon nouvelle, par exemple, les mécanismes d’apprentissage, ce qui est important pour l’éducation de nos enfants, qu’ils soient handicapés ou normaux, puisqu’on découvre des propriétés naturelles du cerveau concernant ce dénombrement, voire la reconnaissance de certains caractères, ou encore la cognition à la fin de la vie, puisqu’on sait aujourd’hui que faire faire des exercices qui stimulent le cerveau à des patients qui commencent un Alzheimer retarde leur entrée dans la maladie.
Le deuxième aspect a trait à cette extraordinaire avancée scientifique et les abus éventuels qu’elle pourrait induire à l’insu et au détriment des personnes qui suscitent, il est vrai, des questions sur l’usage thérapeutique et le progrès. L’homme a toujours su utiliser des prothèses pour aller plus loin, plus haut et plus vite ; cela fait partie de l’humain de dépasser la nature. Des éléments de la neuroéconomie et du transhumanisme montrent que des dérives sont possibles. Elles sont actuellement complètement fantasmatiques mais l’importance des sommes investies peut conduire un certain nombre de personnes à y croire et être à la base de certaines idéologies.
Il est important de distinguer entre ce qui relève de l’ordre du fait scientifique et ce qui demeure de l’ordre d’une certaine vision idéologique. Dans le cadre des travaux sur la bioéthique, des réflexions ont déjà été menées pour améliorer le contexte des recherches en psychologie et celui des essais cliniques, ainsi que l’encadrement des tests. Thomas BOURGERON reviendra peut-être sur la nécessité d’obtenir, pour les tests de dépistage de certaines pathologies, une autorisation de mise sur le marché beaucoup plus sérieuse qu’elle ne l’est aujourd’hui et de ne pas laisser des firmes expliquer tout et n’importe quoi. Une réflexion plus générale et à plus long terme devra aussi être menée sur les abus que peuvent entraîner ces connaissances.
M. Stanislas DEHAENE.
Je proposerai quelques réflexions en soutien de ce qu’a très bien expliqué Hervé CHNEIWEISS, la diversité des exposés de la première partie ayant peut-être semé un peu le trouble sur ce que sont réellement les neurosciences. Un certain nombre d’exposés étaient factuels et fournissaient les dernières connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Les avancées de la génétique des fonctions cognitives sont considérables et les applications bénéficient aux patients.
Il est extrêmement important que 35 000 patients parkinsoniens aient pu être traités et que 4 000 personnes en état végétatif soient en attente d’un traitement car l’on sait que, dans dix ans, on pourra améliorer l’état de certaines d’entre elles. Dans le domaine de l’éducation, les avancées sont également réelles. Une autre série d’exposés a alerté le législateur sur les fantasmes, proches de la science-fiction, générés par les neurosciences. Il ne faut pas tout confondre. Cela ne fait pas partie des neurosciences. Le neuromarketing est un mouvement publicitaire qui a peut-être une certaine ampleur mais il n’existe pas de science du neuromarketing. C’est un peu comme si on jugeait les sciences de la terre, la géologie, à l’aune de l’affaire des avions renifleurs. Notre travail est de séparer les choses et de parvenir à expliquer au public ce qui est de l’ordre du fantasme et ce qui ne l’est pas. Le législateur ferait une erreur de s’attarder trop sur ce qui a jusqu’ici relevé du fantasme dans la discussion et qui ne paraît pas pour l’instant très réaliste.
M. Jean-Michel BESNIER, Professeur de philosophie à l’Université Paris IV-Sorbonne, Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), CNRS, École polytechnique.
Le flou qui entoure les neurosciences fait partie du problème éthique posé précisément par le développement des sciences du cerveau. Il n’y a guère de problème éthique en mathématiques. Avec les neurosciences, nous avons affaire à un flou qui est aussi de votre responsabilité. Vous avez donc conclu très pertinemment en appelant à la vigilance pour éviter les rumeurs et les fantasmes.
M. Bertrand MATHIEU, Professeur à l’Université Paris I, Président de l’Association française de Droit constitutionnel.
Il est nécessaire pour les juristes de réfléchir en amont des développements de la science. Dès lors que l’on raisonne sur un système de valeurs et sur un encadrement, on ne peut pas simplement chercher à s’adapter au plus juste aux évolutions de la science. En matière d’implants, par exemple, comment pourra-t-on, matériellement, établir une frontière entre des actions de rétablissement et d’amélioration des fonctions ? En tant que juriste, je suis incompétent en la matière mais on perçoit bien la possibilité d’entrer dans une logique d’eugénisme, c’est-à-dire d’amélioration de l’espèce humaine, qui pose également un problème d’égalité d’accès à ces techniques, au risque que l’inégalité sociale naturelle se transforme en une inégalité touchant à l’exercice des fonctions.
Certes, nous sommes en démocratie. Mais qui décidera de la frontière entre le rétablissement et l’amélioration ? Les scientifiques ? Le législateur ? Sur quels critères ? L’analyse de Jean-Didier VINCENT est intéressante à ce sujet. On raisonne fréquemment en micro-éthique, c’est-à-dire au cas par cas. Or il y a là un problème de macro-éthique, notamment sur la portée du principe d’égalité. La science est totalement indifférente à la formule selon laquelle les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais que ce soit scientifiquement vrai ou faux n’a aucune importance puisque c’est un postulat social. Les questions qu’il convient dès lors de se poser sont : peut-il y avoir rupture avec ce postulat ? Dans quelles conditions ? Sous quel contrôle ?
M. Hervé CHNEIWEISS.
Vous avez tout à fait raison. En même temps, il faudrait demander à tous les participants au débat d’aujourd’hui qui portent des lunettes de les enlever. Dix dixièmes n’est pas la vision maximale mais une moyenne. Des personnes ont davantage, naturellement. D’autres souhaitent obtenir plus avec la chirurgie de la cornée. La compétitivité et l’amélioration de la performance sont donc un problème général des sociétés.
LES ENJEUX ÉTHIQUES, PHILOSOPHIQUES, CLINIQUES PSYCHOLOGIQUES, SOCIAUX, JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES
__________________________________________________________________
M. Alain CLAEYS.
Nous en venons à la deuxième table ronde. La parole est à M. Alain EHRENBERG
6
8 M. Alain EHRENBERG, Sociologue, Directeur du Centre de recherches psychotropes, santé mentale, société CNRS–INSERM et Université Paris-Descartes.
Permettez-moi, tout d’abord, de réagir brièvement à ce qui vient d’être dit. Premièrement, la différenciation prônée par Hervé CHNEIWEISS entre fait scientifique et idéologie n’est pas simple. Deuxièmement, la question de la frontière entre rétablissement et amélioration doit être posée dans le contexte d’aujourd’hui : nous assistons à des transformations de grande ampleur des relations entre le normal et le pathologique, dues à une modification des normes sociales et, d’une manière plus générale, à des transformations dans les rapports maladie/santé/société. Par ailleurs, les neurosciences ne changent rien à la question de l’égalité de droit.
Le menu des tables rondes d’aujourd’hui est presque indigeste tant le domaine de l’exploration du cerveau et des neurosciences est vaste et hétéroclite. Le spectre d’action des neurosciences va en effet, au-delà de la neurologie et de la neuropsychologie traditionnelles, de l’autisme et des schizophrénies, aux émotions et aux sentiments moraux normaux. Elles portent donc sur l’expérience subjective (l’esprit sain et malade) et la sociabilité humaine. De plus, comme cela a été déjà expliqué, les neurosciences prétendent être aujourd’hui des neurosciences sociales.
Deux raisons conduisent le sociologue à s’intéresser aux neurosciences. Premièrement les neurosciences, les sciences cognitives et, plus généralement, le naturalisme réductionniste connaissent une diffusion inédite. Les relations cerveau, esprit, société sont sorties des discussions entre spécialistes pour devenir un sujet commun de préoccupation via la souffrance psychique et la santé mentale. Les réflexions non seulement scientifiques mais aussi métaphysiques sont désormais dans la rue.
La seconde raison est que la subjectivité, les émotions, les sentiments moraux sont aujourd’hui à la fois une question transversale, thème traditionnel à la philosophie, à la biologie et à la sociologie et un thème stratégique : on pense y trouver le secret de la socialité. Les émotions deviennent alors des concepts magiques. Le cerveau a acquis une valeur sociale qui n’existait pas il y a encore peu. Ce succès repose sur l’idée qu’une authentique biologie de l’esprit serait à portée de main. Par « biologie de l’esprit », il faut comprendre une biologie de l’homme total, pensant et agissant, et par « authentique », que l’on n’est plus dans la spéculation mais sur le terrain de la démonstration expérimentale en laboratoire.
En général, le débat se situe souvent trop directement sur un plan moral : va-t-on pouvoir manipuler les esprits ? Il faut d’abord le situer sur les plans épistémologique et pratique, afin de distinguer entre les questions morales qui ne se poseront pas – on se fabrique souvent de fausses peurs – et celles qui seront réellement soulevées, en remarquant que cela nest pas décidé d’avance.
Dans le temps qui m’est imparti, j’introduirai quelques distinctions qui me semblent souvent absentes du débat à travers quatre remarques.
1- Je propose de distinguer, dans l’ensemble assez hétéroclite formé par les neurosciences, entre deux programmes ou conceptions : un programme que j’appelle modéré et un autre que je qualifie de grandiose. Le programme grandiose identifie connaissance du cerveau et connaissance de soi-même et, sur le plan pratique, c’est-à-dire clinique, prétend pouvoir fusionner neurologie et psychiatrie, c’est-à-dire, in fine, traiter les psychopathologies comme des neuropathologies. De très nombreuses synthèses présentent d’ailleurs l’état de l’art en plaçant, sans justifications logiques suffisantes, l’Alzheimer et les schizophrénies dans le même concept de maladie. Le programme raisonnable vise à progresser dans le traitement des maladies neurologiques (Parkinson, Alzheimer) et à découvrir d’éventuels aspects neuro- pathologiques dans les maladies mentales, mais sans les prétentions philosophiques et pratiques du programme grandiose.
Précisons que la distinction entre programme grandiose et programme modéré n’est pas nécessairement donnée d’avance, du fait de la multitude de cas limites qui font toute la difficulté et l’intérêt des questions mentales, à savoir l’intrication de la mécanique physico-chimique et des raisons sociales et psychologiques.
2- Le programme grandiose repose sur un fondement purement métaphysique, à savoir le dualisme fait/valeur. Les faits sont objectifs et relèvent donc de la science et les valeurs étant subjectives, relèvent de l’opinion. Or la caractéristique du fait social est précisément que l’opinion n’est pas extérieure à l’objet, mais en est bien au contraire une propriété. Par exemple, quand nous évoquons l’absence de culpabilité dans le trouble des conduites ou, au contraire, l’excès de culpabilité dans la mélancolie, et nous avons d’excellentes raisons d’opérer ainsi, ne faisons-nous pas une évaluation, ne jugeons-nous pas, n’accordons-nous pas à un fait une valeur sans laquelle il n’y aurait aucun fait ?
Si l’on n’évoquait pas l’excès de culpabilité dans la mélancolie ou l’absence de culpabilité dans le trouble des conduites, ni le fait mélancolique, ni celui du trouble des conduites n’existerait. Si l’on ne sait rien des mœurs, des usages d’une société, on ne peut pas comprendre ce qu’un jugement comme « cet enfant est mauvais » signifie. Dans une société de type lignagère qui se reconnaît dans des ancêtres communs, comme les sociétés traditionnelles d’Afrique noire, cela signifie « il est possédé par une force », un ancêtre ou un sorcier ; et dans notre société individualiste, cela signifie « il manque d’empathie ». Dans le premier cas, on se trouve dans un monde où la persécution régule les relations interindividuelles, le mal venant du dehors, tandis que, dans le second cas, la culpabilité laisse chacun en face de sa responsabilité d’agent réel ou potentiel du mal. Le grand défaut des neurosciences de l’expérience subjective et des neurosciences sociales est qu’elles n’intègrent pas le contexte, ce qui grève nombre de résultats
3- Ma troisième remarque porte précisément sur le contexte. Quand on prétend faire une neuroanatomie du deuil par imagerie cérébrale – et de nombreux articles paraissent à ce sujet –, on ne tient pas compte du caractère relationnel et contextuel du deuil. Si ma femme meurt et que j’en suis encore très amoureux est-ce la même chose que si je ne souhaite que la quitter pour épouser ma maîtresse ? La neuroanatomie du deuil ne s’embarrasse pas de ces distinctions contextuelles qui sont pourtant essentielles. Le deuil est toujours le deuil de quelqu’un, ce qui suppose un monde commun avec l’endeuillé.
Je citerai un autre exemple, sur la sympathie et l’empathie, tiré des travaux de Jean DECETY et de son équipe. Le dispositif expérimental est le suivant : des acteurs racontent à la première personne six courtes histoires dont le contenu est soit triste, soit neutre – soit deux facteurs narratifs – et doivent montrer trois expressions : heureuse, triste ou neutre – soit trois facteurs d’expression motrice des émotions. Les histoires sont présentées à des sujets qui doivent noter si l’histoire est crédible et si l’expression faciale des émotions est congruente avec le contenu. L’hypothèse est que le sentiment d’empathie et de sympathie est détruit s’il y a une distorsion entre l’expression émotionnelle de l’acteur et le contenu du récit. Ce qui est mesuré est le degré de cohérence ou de distorsion entre contenus narratifs et expressions des émotions. Par exemple, une histoire triste accompagnée d’une expression joyeuse est une distorsion dans l’expérience.
Quand le neuroscientifique écrit cela, il ne dit pas quelque chose de faux, mais quelque chose de vide. Raconter une histoire triste arrivée à votre ennemi intime avec une expression joyeuse, voilà bien un acte tout à fait cohérent. L’incompréhension d’une telle possibilité, et de bien d’autres, comme la taquinerie affectueuse, le second degré, montre qu’on ne démontre rien de réel. C’est de la pure démonstration de laboratoire.
On peut parfaitement accepter les résultats de ces expériences – on observe que telle aire cérébrale est activée – mais en contester les conclusions sociologiques ou philosophiques. Par exemple, quand les chercheurs écrivent que ces études montrent le « rôle du cortex pariétal inférieur dans la distinction entre soi et autrui », que représente l’opération désignée par le mot « rôle » ? Cette aire cérébrale est-elle l’agent causal ? Est-elle le mécanisme neurophysiologique impliqué, dérivé, nécessaire pour éprouver la distinction entre soi et autrui ? Est-elle simplement une condition biologique générale ? Alors que les méthodes sont décrites le plus précisément possible, les mots employés par les chercheurs pour en rendre compte sont vagues : rôle, implication , sous-tendus, base, reposer sur, sont à valeur interprétative et donc vont donner le sens des résultats.
Le niveau de la réflexion conceptuelle est des plus faibles. Quand on évoque, par exemple, des corrélats anatomiques de la conscience, ces derniers ne sont pas la conscience. Ce ne sont que des corrélats. Qui plus est, on n’a découvert aucun mécanisme physiologique pour produire expérimentalement de la sympathie ou de l’empathie : ce sont des corrélations, mais non des mécanismes. Or, des corrélations, la recherche en trouve tous les jours. Le constat d’une corrélation ne lève pas l’ambiguïté entre « quand je fais X, mon cerveau est dans l’état E » et « si je fais X, c’est parce que mon cerveau est dans l’état E », c’est-à-dire entre quelque chose qui se passe dans mon cerveau quand je fais une action et quelque chose que je fais quand j’agis parce que mon cerveau en est la cause. Or, cette distinction est fondamentale.
4- Dans tous ces travaux visant à naturaliser les émotions et les sentiments moraux, on confond deux types de conditionnement distingués par le philosophe Ludwig WITTGENSTEIN : le conditionnement causal « si tu mets ta main sur la plaque chauffante, tu te brûles »; c’est une expérience, et le conditionnement logique : « tu ne dois pas coucher avec ton frère »: c’est un argument d’autorité qui précède toute explication et toute expérience personnelle. On n’a pas besoin de définir ce qu’est se brûler, alors qu’il est nécessaire de définir ce qu’est un frère, avant de pouvoir interdire ou permettre quoi que ce soit. Or un frère ne peut être défini que dans et par un système de relations, la parenté, selon une règle qui rend le système signifiant pour tous ceux qui vivent dans la société X ou Y. C’est seulement lorsque l’on a d’abord défini ce qu’est un frère, ce qu’est un don, ce qu’est un meurtre etc… que l’on peut formuler ce que l’on permet et ce que l’on interdit.
Stanley CAVELL a magnifiquement résumé ce conditionnement logique par le langage : « En apprenant le langage, vous n’apprenez pas seulement la prononciation des sons et leur ordre grammatical, mais aussi les formes de vies ». Pour qu’il y ait un fait, il faut donc qu’il y ait préalablement un consensus sur les valeurs. C’est la grande erreur des partisans du programme grandiose en neurosciences que d’assimiler la relation sociale à un ressenti intérieur, par exemple d’empathie ou de sympathie, l’empathie étant là considérée comme la clé du social.
Conclusion
Dans The Conscious Brain, le neurobiologiste et psychiatre Steven ROSE a lancé en 1973 ce qui semble une mise en garde : « les cliniciens sont comme les collectionneurs de timbres de la biologie ; ils sont condamnés à l’être, car nous n’avons pas grand-chose de mieux à leur offrir », que ces procédés « désordonnés, complexes, équivoques dans leur interprétation […] qui, au cours des vingt dernières années, a conduit à l’analyse de l’urine ou des tissus de malades des hôpitaux psychiatriques, pour presque chaque enzyme en vogue et chaque métabolite au goût du jour dans la communauté scientifique ». Et de conclure : « chez aucun malade « mental », autre que ceux qui souffrent de désordres neurologiques spécifiques […], on n’a pu détecter d’anomalie significative de l’anatomie, de la physiologie et de la biochimie du cerveau ».
Malgré les progrès des outils et des méthodes, le jugement de Rose devrait rester à l’esprit de chacun car, surtout en ce qui concerne les pathologies mentales, la situation a peu changé en termes de résultats réels pour les patients. Peut-on se contenter de développer des méthodes et de parier sur les outils en abandonnant le travail conceptuel sur la nature des phénomènes sur lesquels on veut agir ? La réification des outils – c’est-à-dire penser qu’ils ont une application générale – n’a qu’une seule conséquence : de nombreuses démonstrations sont destinées à rester des démonstrations de laboratoire.
Ma conclusion est que le programme grandiose est une théorie magique de la science qui confond la généralisation avec la théorie, François JACOB emploie une formule semblable, et ne débouche que sur des banalités. Dans une éblouissante Revue de littérature scientifique que Georges PEREC avait consacrée à « La démonstration expérimentale de l’organisation du lancer de tomates chez les sopranos », il concluait que « plus on lance de tomates sur la soprano, plus elle crie ». A-t-on vraiment besoin de publier des milliers d’articles pour savoir que les émotions affectent la cognition ou la rationalité ?
Le plus grand reproche que l’on peut faire au programme grandiose est qu’en psychologie et en sociologie, il ne nous permet même pas d’utiliser ce que nous savons déjà. C’est pourquoi je n’aurai, aujourd’hui du moins, qu’une seule petite recommandation que je tire d’un article publié par RACINE, BAR-ILAN et ILLES dans Nature Neuroscience en 2005, fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) in the Public Eye : « Étant donné que les neurosciences cognitives intègrent de plus en plus les domaines des sciences sociales, […] la compréhension de l’intérêt et des limites de l’intégration des niveaux d’analyse est un souci majeur. Il sera nécessaire de pourvoir les neuroscientifiques » –auxquels j’ajouterai les journalistes – « avec une meilleure éducation sur les enjeux des recherches sur les phénomènes sociaux pour s’assurer de la validité de leurs recherches et pour promouvoir une interprétation des résultats compétente, responsable et sensible. »
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie beaucoup, je constate que votre exposé suscite des interventions. M. BOURGERON vous avez la parole.
6
M. Thomas BOURGERON.
Je suis d’accord avec la majeure partie de votre analyse mais cela me gêne que l’on explique qu’il n’y a pas de gènes impliqués, par exemple dans l’autisme, au motif qu’on ne les a pas tous découverts mais qu’on en a seulement trouvé quelques-uns chez certains individus. On considère, dès lors, que nous n’avons rien montré. Penser qu’il y aurait une théorie unique de ce trouble psychiatrique est faux. Il faut accepter l’hétérogénéité des causes et le travail progressif des chercheurs.
M. Alain EHRENBERG.
Vous m’avez mal compris. Je ne conteste pas du tout que nous ayons un corps constitué de molécules et de gènes très divers, et je n’ai qu’une envie, c’est d’en savoir plus sur les gènes de l’autisme que vous avez découverts. Je ne vois pas du tout où, dans mon exposé, vous avez trouvé la promotion d’une théorie unique du trouble psychiatrique. Mon propos était plutôt, par rapport à ce que WITTGENSTEIN appelle la pulsion de généralisation, d’essayer, très rapidement, d’établir quelques distinctions logiques, telles que celle entre « je fais quelque chose et ça se voit dans mon cerveau » et « je fais quelque chose parce que mon cerveau en est la cause » – qu’on ne peut pas résoudre simplement par une méthode scientifique.
Cela étant, je ne conteste pas du tout la nécessité de la recherche, y compris pour les maladies psychiatriques. D’ailleurs, dans le spectre autistique, il y a de nombreux cas limites. C’est pourquoi j’ai indiqué, dans ma première remarque, que la distinction entre programme grandiose et programme modéré n’est pas donnée d’avance.
M. Stanislas DEHAENE.
Cela vous surprendra peut-être mais je suis en accord avec nombre de vos observations. Vous avez tout à fait raison : on peut contester les conclusions des programmes de recherche et le niveau de la réflexion conceptuelle n’est pas très avancé. Nous souffrons dans notre discipline d’une certaine confusion des genres. Certaines recherches tentent des sauts conceptuels extrêmement rapides en passant tous les niveaux de complexité du cerveau, y compris le cerveau social, tandis que d’autres sont plus sérieuses.
Cela étant, je pense que vous-même pratiquez un glissement entre une vision grandiose et une vision modérée. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Dans un certain nombre de cas, des phénomènes qui relèvent après tout des sciences sociales ou du cerveau social surviennent. Vous avez raison de souligner qu’il s’agit très souvent de corrélations, phénomènes avec lesquels il faut être très prudent. Mais, outre le bénéfice des électrodes implantées dans la maladie de Parkinson, une expérience sur une patiente ayant une électrode dans le noyau sous-thalamique, montre que la stimulation de ce noyau la plonge, en dix secondes, dans une dépression profonde. L’effet, immédiat, reproductible et, fort heureusement, réversible présente toutes les caractéristiques de causalité souhaitables.
Il existe un certain nombre de cas où des programmes que l’on peut qualifier de réductionnistes fonctionnent. Je considère comme vous qu’existe une grande naïveté en ce domaine. Nos collègues en science sociale, en particulier, ont tendance à penser que l’imagerie va apporter une réponse immédiate. Ce n’est évidemment pas le cas. Le travail conceptuel, comme vous l’avez souligné, est très important. La construction de théories qui intègrent ce que vous avez appelé le contexte me paraît tout à fait essentiel.
M. Alain EHRENBERG.
Dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde, on observe des avancées très intéressantes, laissant entrevoir des applications dans les maladies psychiatriques. Un de mes étudiants fait une thèse sur ce sujet. Pour balayer devant ma porte, je précise que la distinction entre programmes forts et programmes modérés n’est pas un monopole des neuroscientifiques. Elle existe partout, notamment, en sociologie, où elle s’appelle le sociologisme. On oppose, par exemple, nature et culture et on va jusqu’à soutenir que, quand ce n’est pas naturel, c’est que tout est construit. Tout cela n’est pas sérieux !
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de cet échange et donne la parole au deuxième orateur de cette table ronde, M. Jean-Michel BESNIER.
6
8 M. Jean-Michel BESNIER, Professeur de philosophie, Université de Paris IV-Sorbonne, Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), CNRS, Ecole polytechnique.
Je note une certaine progression de la réflexion. En début d’après-midi, on aurait pu penser que les neurosciences produisaient essentiellement des images. Les neurosciences produisent des représentations de l’homme et elles contribuent à élaborer des conceptions du monde, des idéologies qu’il faut interroger. Le philosophe peut tenter de le faire, depuis un poste d’observation qui le met au plus près du sens commun. La leçon que je tire de ma fréquentation des neurosciences est que la réaction du sens commun est souhaitable. Le philosophe se retrouve, dès lors, dans la posture d’épauler, pour une fois, celui-ci.
Je me suis attaché à tenter de répondre à la demande qui nous a été faite, donc de proposer moins des réflexions d’ordre épistémologique qu’un état des lieux pour essayer d’identifier quelques impacts éthiques des neurosciences, du point de vue, comme je l’ai indiqué, du sens commun. Je propose un état des lieux des interrogations les plus récurrentes, afin d’identifier quelques impacts éthiques des neurosciences avec lesquels le législateur devrait compter.
Les neurosciences interrogent le philosophe et, par delà, bousculent certaines représentations auxquelles le sens commun est attaché. En règle générale, on met très vite en avant le problème du statut de la conscience et de la pensée. Sont-elles une simple production du cerveau ou quelque chose d’autre qu’on appelait jadis l’âme ? Si l’on souhaite être un peu plus précis, on se demande si les neuroscientifiques ne sont pas tentés de confondre une condition nécessaire avec une condition suffisante en réduisant la conscience au cerveau ou, pour reprendre la formule d’Alain EHRENBERG, s’ils ne sont pas tentés de confondre une simple corrélation avec une causalité. Ces questions de nature épistémologique tournent toutes autour de celle de savoir si l’imagerie ou la démarche des neurosciences résout le vieux problème philosophique du statut de la conscience et de la pensée.
Les neurosciences posent aussi la question de la responsabilité et du libre arbitre. Sommes-nous ce que notre cerveau nous dicte ou avons-nous le pouvoir de décider et d’agir de manière autonome ? La réflexion épistémologique qu’elles suscitent s’inscrit dans le cadre d’une critique du réductionnisme : en rappelant l’évidence que la conscience est liée au cerveau et en concluant qu’elle en traduit le fonctionnement, ne confond-on pas une condition nécessaire avec une condition suffisante, une simple corrélation avec une causalité ? Reste que les valeurs sur lesquelles repose la morale sont engagées par les découvertes faites sur le cerveau.
Dès qu’on prend un peu de hauteur et qu’on essaie de comprendre les choses d’un point de vue historique, les neurosciences apparaissent comme l’un des derniers avatars de ce qu’on appelle parfois la mécanisation de l’esprit, mouvement que l’on repère dès le XVIIIe siècle. Les sciences cognitives contribuent depuis longtemps, surtout après la cybernétique des années 1940-1950, à décrire la vie mentale par référence aux machines algorithmiques dont nous connaissons surtout l’efficacité aujourd’hui grâce au moteur d’inférence qui tourne sur Internet. La mécanisation de l’esprit équivaut, à n’en pas douter, à une simplification équivalant elle-même, pour le philosophe, à une sorte de désenchantement.
Les neurosciences contribuent à l’évidence à changer certaines de nos représentations, à modifier notre vision du monde, donc à transformer nos jugements et nos décisions. Bon nombre des convictions qui constituaient traditionnellement le fondement de l’humanisme ont été bousculées par la possibilité d’identifier dans le cortex frontal le lieu d’origine de nos facultés morales, l’aptitude à se projeter, à planifier une action comme l’a montré le cas emblématique de Phinéas GAGE qui a permis d’identifier le rôle de cette zone du cerveau ainsi que la découverte des neurones miroirs qui justifient les comportements d’imitation, par conséquent, les conduites altruistes et l’aptitude à se mettre à la place de l’autre.
Qu’est-ce donc que l’esprit ? Si l’on devait en croire certaines explications offertes par les sciences cognitives, ce ne serait qu’un simple logiciel, qu’un agencement de routines gérant des informations, des inputs que des modèles connexionnistes peuvent simuler, sinon implémenter sur des robots capables d’incarner ces modèles. Les neurosciences se sont laissées imposer ce paradigme explicatif qui justifie les fantasmes d’un remodelage de l’homme, d’une optimisation de son fonctionnement tel qu’il pourrait se mettre à la hauteur des machines qu’il a produites.
Je crois que les neurosciences dans la version publique, vulgaire qui en est donnée, se sont laissées imposer ce paradigme de la mécanisation de l’esprit, qui justifie que l’on puisse vouloir aujourd’hui, comme le rappelait Jean-Didier VINCENT, remodeler l’humain, l’optimiser pour le mettre à la hauteur de ce que peuvent réaliser nos machines. Il a souligné le fait que : « nous imitons aujourd’hui les objets que nous avons fabriqués. » Günther ANDERS, philosophe que l’on redécouvre, a nommé cela la « honte prométhéenne ». Dès les années 1950, il a mis en garde contre le fait que nous sommes dans la posture de jalouser les machines qui sont bien plus performantes et durables que nous.
L’idée de réaliser une conscience artificielle ne paraît plus guère incongrue aujourd’hui. Des chercheurs, comme Alain CARDON en France, font métier de développer des modèles de conscience artificielle. Plus simplement, le projet de manipuler l’humeur grâce à des implants électroniques qui interviendront sur les boucles de rétroaction des circuits synaptiques est parfaitement admis.
Les neurosciences – et c’est ce sur quoi j’aimerais insister – ont la vertu d’être rapidement assimilées par l’esprit de nos contemporains. On ne s’étonne presque plus des conséquences que l’on peut en tirer. On est frappé de voir à quel point les effets d’annonce, qui sont fréquents en matière de neurobiologie, pénètrent très facilement le grand public. La pathologisation de la turbulence des enfants qui requièrent des amphétamines du type de la ritaline, n’a pas suscité les débats auxquels on aurait pu s’attendre (voir Le Monde du 23 septembre 2005).
Les idées émises ici et là sur la nécessité de restaurer l’école unisexe au motif que le cerveau des garçons et celui des filles ne fonctionneraient pas de la même façon n’ont pas fait l’objet de discussions. On peut encore citer le scientisme d’un ministre récent de l’éducation qui entendait fonder la légitimité de la méthode syllabique sur les découvertes des neuroscientifiques. L’une des caractéristiques des neurosciences est d’être admises au pied de la lettre.
Jadis, les nouveaux savoirs, associés à des techniques nouvelles, suscitaient des réserves, voire l’effroi, avant de se banaliser. La première transplantation cardiaque du professeur BARNARD avait donné lieu à de nombreux débats. Aujourd’hui, tout se passe comme si, la médiatisation aidant, les neurosciences avaient la vertu de se banaliser très rapidement et de mettre en porte à faux les scientifiques eux-mêmes, qui se trouvent confrontés aux drôles de lièvres qu’ils ont eux-mêmes levés nolens, volens. Cette divulgation des neurosciences produit des effets d’occultation.
Il en résulte que l’on glisse sans s’en apercevoir de l’idée d’une science médicale réparatrice à l’idéal d’une amélioration de la nature humaine. Les neurosciences sont de plus en plus perçues dans le public, non seulement comme la promesse de guérison des troubles neurodégénératifs ou des traumatismes facteurs de tétraplégie, mais aussi comme l’instrument de performances accrues, d’une modification de l’humeur, d’une augmentation de la réalité perçue, etc… Bref, on se laisse aller à consentir à une manière d’eugénisme positif que, si l’on était vigilant, on refuserait ou, au moins, on mettrait en débat.
Autre point qui me frappe lorsque je dresse l’état des lieux de la réception des neurosciences dans le public, c’est que ces dernières accréditent facilement sur le terrain de ce que les philosophes nomment la raison pratique, l’idée d’une dépossession de l’initiative, qui pourrait avoir des conséquences graves sur le plan de la vie collective. En s’aventurant à considérer la conscience comme l’effet émergent du fonctionnement des neurones, on peut, en effet, en déduire que la volonté est une illusion et qu’il vaut bien mieux s’abandonner au cours des choses.
Quand on ajoute à cela que notre époque est volontiers fascinée par des modèles de sagesses fatalistes, par des spiritualités négatrices de l’individu, on peut être inquiet. Il y a là un symptôme, renforcé par l’enseignement des neurosciences, de cette disposition à abdiquer la volonté, laquelle était au fondement d’une vision du monde interventionniste, sinon prométhéenne.
Ce qu’a expliqué Jean-Didier VINCENT à propos du trans-humanisme est au cœur de cette approche. Celui-ci s’inscrit sur la base d’une sorte de désaffection pour l’interventionnisme cartésien qui nous voulait maîtres et possesseurs de la nature. Aujourd’hui, on est, tout au contraire, disposé à agir sur les conditions initiales des systèmes qui nous définissent et qui nous entourent et prêts à laisser à une sorte de sélection naturelle le soin d’opter pour ce qui pourrait en résulter. Raymond KURZWEIL développe ces thèmes dans la théorie de la « singularité technologique ». Pour prendre un exemple souvent convoqué par les philosophes à propos des travaux des neurobiologistes ou des neuroscientifiques, quelles autres conséquences tirer de l’idée qu’un potentiel évoqué signalerait qu’une décision consciente est toujours prise auparavant par le cerveau ? Que faire de cette idée ? Comment le libre-arbitre ne se verrait-il pas remis en question ? Les expériences de Benjamin LIBET sont un cas d’école, sinon un pont aux ânes, dans ce domaine.
On met souvent en avant aujourd’hui la plasticité neuronale, qui laisse entrevoir la possibilité d’évoluer tout au long de la vie. Il est vrai qu’il y a là matière à être optimiste. Les neurosciences paraissent bien illustrer la capacité offerte à la vie de tirer profit des erreurs et d’inventer continuellement ses normes. Et qu’est-ce que la santé sinon l’invention continuelle des normes ? La contrepartie est que l’on donne du poids à l’épigenèse dans les apprentissages et aux facteurs environnementaux dans les acquisitions. Ce qui pourrait sembler positif tourne assez facilement au négatif quand on y aperçoit la dimension de conditionnement et de déterminisme qui pèse sur les itinéraires individuels.
Des extrapolations que l’on confond souvent trop vite avec la science-fiction, donnent à imaginer la possibilité d’implémenter le contenu de la conscience sur un autre support que le cerveau humain. C’est ce qu’on appelle le cloading, le téléchargement de la conscience sur des puces de silicium, par exemple. L’esprit étant apparenté à un logiciel d’ordinateur, il est susceptible, en tant que logiciel, d’être installé sur divers supports. On en conclut à la possibilité que la vie elle-même trouvera à se développer sur un autre support que l’organisme, par exemple sur du minéral, comme l’ont montré les fantasmes trans-humanistes évoqués précédemment. Cette idéologie trans - et post - humaniste se développe, et trouve des justifications à ces fameuses sectes qui misent sur la convergence des nanotechnologies, des sciences cognitives, des technologies d’information et de la biologie (NBIC). Relayée par les médias, romans, cinéma, Internet, elle est potentiellement dangereuse car elle anesthésie le sens commun – pour lequel je milite – et elle augmente la confusion entre le réel et le virtuel qui nous invite à confondre la carte et le territoire.
Une interrogation sur les neurosciences doit prendre au sérieux les extrapolations et non pas les balayer d’un revers de manche ; elle doit exiger des scientifiques qu’ils fassent la part de la réalité dans les horizons qu’ils révèlent et essaient de contrôler les fantasmes qu’ils génèrent, qu’ils le veuillent ou non.
En conclusion, à plus d’un titre, les neurosciences posent le grave problème de l’amélioration de la nature humaine et, plus généralement, celui de la prétention à éliminer ce qui fait de nous des hommes, à savoir le hasard de la naissance, de l’évolution, dans l’identification des maladies auxquelles nous sommes en but, de la mort, etc… Les neurosciences apparaissent, dans l’esprit du public, comme une machine de guerre contre la finitude humaine et contre ce qui donne sens à l’existence : par exemple, le libre arbitre, les valeurs de responsabilité, la dimension symbolique des êtres de langage que nous sommes, dimension fort peu évoquée au cours de cette audition.
En ce sens, les neurosciences sont, bel et bien, un facteur de bouleversements dans nos manières de penser, dans nos manières de nous penser, et d’affronter notre condition. La réflexion éthique doit permettre d’amortir cet effet de bouleversement et de prévenir la banalisation des fantasmes que les neurosciences produisent.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de cet exposé et donne pour quelques commentaires la parole à la salle.
6
M. Hervé CHNEIWEISS.
Tout en étant d’accord sur la conclusion, je remarque cependant que les faits sont têtus. Que cela bouleverse éventuellement certaines réflexions, il n’en demeure pas moins qu’il existe des neurones miroirs, une plasticité des cellules souches et même une possibilité de régénération de certaines cellules chez l’homme. On peut ensuite critiquer l’instrumentalisation qui en est faite, mais cela existe. On peut également discuter de la manière de concevoir des notions comme l’empathie. Cela étant, le fait d’avoir une conception ancienne du cerveau – considéré comme simple boîte réactive à son environnement, ou une conception de celui-ci comme un organe au sein duquel se déroule l’activité mentale, qu’elle soit réelle ou imaginée, n’est neutre ni pour l’activité au quotidien, ni pour un certain nombre de pathologies et de troubles des relations humaines.
L’invitation à repenser des questions, même entérinées par des réflexions millénaires, peut aussi s’articuler sur des faits. Je citerai, pour terminer, la réponse du Dalaï Lama à un reporter de Nature lors d’une conférence qu’il organise chaque année à Dharamsala et qui réunit des moines et des neuroscientifiques. : « Et si la religion avait tort ? » – sous-entendu au regard des neurosciences – lui avait-on demandé, et le Dalaï Lama avait répondu : « Il faudrait repenser la religion. »
M. Jean-Michel BESNIER.
Les faits, j’en suis tout à fait d’accord, sont têtus et il faut s’y attacher. Ce que je conteste, c’est le passage des faits aux valeurs. Des faits, on ne peut pas déduire les valeurs. En ce sens, pour moi, le cerveau n’est pas une boîte réactive à son environnement. Il est également une machine qui rétroagit, et connaît la rétro propagation. J’ai apprécié, dans l’exposé de Stanislas DEHAENE, l’insistance qu’il a mise sur la culture et l’éducation, qui peuvent très bien rétroagir sur les faits. Mon invitation consiste à viser à ce que les faits et les valeurs soient en boucle et à ce qu’on évite ce réductionnisme facile, que l’on appelle scientisme, qui voudrait fonder les valeurs sur les faits.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie, nous poursuivons notre table ronde avec le président SICARD.
8 M. Didier SICARD, Professeur de médecine, Président d’honneur du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
J’articulerai mon propos en cinq points.
Premièrement, je suis frappé par la rapidité avec laquelle les neurosciences surgissent non seulement dans les sciences sociales mais également dans la vie quotidienne. Cette rapidité de transfert est totalement décalée par rapport à la prudence des neuroscientifiques eux-mêmes. J’ai été surpris, par exemple, d’entendre le ministre de l’éducation nationale déclarer vouloir changer l’enseignement des langues en fonction de ce que nous avons appris de l’imagerie fonctionnelle. Il y a une certaine naïveté à croire que la vérité dépend de l’imagerie fonctionnelle.
Les neurosciences exercent aussi une certaine fascination sur la justice et François MATHIEU a bien fait d’insister sur la nécessité de garder une certaine raison. De la même façon que j’ai été effrayé par l’irruption de la génétique dans le droit, je considère que les neurosciences risquent de bouleverser totalement les juristes qui, n’aimant pas, au fond, les incertitudes, seraient plutôt tentés de demander à l’expertise des neurosciences, non pas la vérité, mais une aide qui serait interprétée par le corps social comme une vérité. La prudence prônée dans l’emploi des détecteurs de mensonge me paraît sans rapport avec leur utilisation aux États-Unis, avec de nouveaux moyens très sophistiqués. On peut imaginer qu’à Guantanamo ou, peut-être, dans le futur par une nouvelle loi, on puisse arriver à une sorte de mécanisation, de banalisation de la responsabilité, qui serait tout à fait effrayante sur le plan éthique.
Deuxième point : l’utilisation perverse du principe de précaution me paraît atteindre son acmé dans la foetopathologie. Denis LE BIHAN nous a montré des cerveaux à huit, douze, seize semaines. Ces images étaient passionnantes mais la moindre anomalie, dont on ne sait rien et dont on ne saura jamais rien parce qu’on ne pourra ou ne voudra pas faire d’expériences sur le vivant aboutit, par prudence, à partir de cette expertise, à s’orienter d’emblée vers des non naissances, ce qui pose une véritable question éthique.
Mon troisième point porte sur la recherche et la notion de consentement éclairé. On sait déjà qu’en matière de psychiatrie, il est le concept le plus difficile qui soit. On peut imaginer que le consentement éclairé à partir d’une image de soi projetée à l’extérieur finisse par être invalide et qu’il faille repenser totalement cette conception. Il a été question des neurostimulations, pour lesquelles le Comité consultatif national d’éthique a été saisi et a donné un avis. Il continue d’ailleurs à suivre le projet. Lors d’une réunion à laquelle participait également Alain EHRENBERG, j’ai été frappé de constater que, lorsqu’un malade qui tremble ou qui a un trouble obsessionnel est délivré de son trouble, il n’est pas nécessairement heureux. La guérison d’un symptôme par une telle stimulation est source d’un bénéfice considérable pour un grand nombre de personnes mais peut créer des états dépressifs chez d’autres. Autrement dit, il faut se méfier d’une sorte de réparation générale de tous les symptômes qui serait toujours suivi d’un réel soulagement. Il est même étrange qu’un symptôme psychiatrique puisse combler un vide angoissant, que sa disparition viendrait révéler. Si, pour les troubles moteurs, on peut imaginer qu’on est dans la bienfaisance, quand on approche de la psychiatrie, cela s’avère toujours plus compliqué.
Mon quatrième point a trait à la prédiction. Notre société ne supportant plus l’incertitude, demandera de plus en plus de certitude aux neurosciences, que ce soit de l’ordre de l’imagerie ou de la génétique. Il a été observé avec raison qu’on demande trop à la génétique, ou qu’on la refoule. En même temps, le discours n’est pas neutre car, quand des gènes existent, même si ce sont des gènes de prédisposition et qu’ils présentent une part d’incertitude, la tentation immédiate est de les breveter et de faire des tests de dépistage. Comment une société peut-elle résister au réel fourni par la neuroscience qui fascine l’opinion ?
Enfin, le plus important pour moi est la notion de dépendance. Quel que soit le discours, permissif ou critique, que l’on tient, depuis vingt ans, sur les psychotropes, on ne peut pas s’empêcher de penser que notre société est « psychotropée ». La ritaline n’est pas très importante en France mais il y a une surconsommation de psychotropes, en particulier des benzodiazépines, dénoncée par Édouard ZARIFIAN. N’étant ni psychiatre ni neurologue et ne portant pas de jugement moral sur leur usage, je sais simplement que, quand on a commencé à en prendre, on risque d’en devenir dépendant.
À partir du moment où le marché pharmaceutique étend son territoire à des drogues qui doivent être prises durant toute la vie, on peut imaginer qu’un jour, des facilitateurs de mémoire, confirmés par telle ou telle imagerie et des médicaments permettant une plus grande sérénité finissent par combler bien plus le marché que les personnes. Cette notion anglaise intraduisible en Français de « enhancement » a nécessairement pour contrepartie la dépendance. Le dopage d’un sportif n’offre pas une vision très éthique de l’existence. Comment le fait de combler un cerveau par un logiciel y parviendrait-il ? Lors de la dernière campagne présidentielle, j’ai été frappé de constater que les candidats rivalisaient dans l’emploi du mot « logiciel », ce qui donne une image de l’introduction dans le cerveau d’une extériorité.
J’ai le sentiment que, si l’on naît homme, on devient humain. Le problème, c’est que les neurosciences s’intéressent plus à l’homme qu’à l’humain.
M. Jean-Sébastien VIALATTE.
Je vous remercie pour cette intervention très précise, Monsieur le Président et donne la parole à M Jean-Claude AMEISEN.
6
8 M. Jean-Claude AMEISEN, Professeur de médecine, Président du Comité d’éthique de l’INSERM.
Les avancées des neurosciences sont fascinantes et permettent, comme l’a souligné Jean-Michel BESNIER, de repenser des questions ancestrales : déterminisme, libre arbitre, émotions, raison, etc… Je suis étonné d’observer que les représentations nouvelles du vivant, de nous-mêmes et des autres possèdent le pouvoir de changer nos conduites et nos valeurs. C’est intrinsèque à la démarche scientifique et au rôle que jouent les avancées de la connaissance scientifique dans la société et au développement de la réflexion éthique.
Au fond, il n’y a pas d’essence de ce que nous sommes hors de ce que nous découvrons que nous sommes devenus. Cela transforme des formes de dualisme, des frontières considérées comme qualitativement infranchissables -entre la vie et la matière, entre l’animal et l’homme, entre le corps et l’esprit – en des seuils, des transitions, des phénomènes progressifs. La science progresse dans sa compréhension du monde et dans sa manipulation du monde lorsque, d’une certaine façon, elle fait abstraction de toute une série de singularités. C’est quand elle est capable, dans ses modes les plus efficaces, de transformer la singularité de ce qu’elle étudie en un point sur une courbe – ce qui correspond à un phénomène de réification abstrait – qu’elle est la plus efficace à comprendre et à manipuler une partie de la réalité.
Quand ce qui sera efficacement décrit ou manipulé concerne ce que nous possédons de plus intime, notre vie intérieure, notre conscience, notre mémoire, nos comportements, il y aura forcément un problème entre ce qui est décrit de l’extérieur comme un objet d’étude et ce qui nous donne le sentiment d’être un acteur et un sujet de notre vie. En d’autres termes, c’est un récit à la troisième personne du singulier de ce que nous vivons à la première personne du singulier. Plus on se rapproche de ce qui concerne notre vie intérieure, qui définit la personne humaine et plus apparaît un conflit ou une difficulté à s’approprier les deux. La définition légale de la mort repose sur la détection de ce qui semble traduire la disparition d’une vie intérieure.
Un des éléments de la réflexion éthique consiste à penser la capacité de se réapproprier ce que nous apprenons sur nous-mêmes comme objet d’étude de l’extérieur. La question est de savoir comment on peut se le réapproprier ? Est-ce que ce que nous apprenons augmente le champ de nos possibles, nous enrichit ou, au contraire le restreint et nous appauvrit. Le consentement libre et informé, avec toutes les ambiguïtés que Didier SICARD évoquait, qui est le pilier ambigu mais fondamental de la démarche politique depuis soixante ans, explique quelque peu le statut de la connaissance par rapport à la personne. Il place la connaissance au service de la personne, mais pas la personne au service des avancées de la connaissance.
La spécificité des neurosciences est qu’en étudiant les mécanismes mêmes de la pensée, elles examinent au fond les mécanismes biologiques de la démarche scientifique elle-même et les déterminants de la démarche éthique. La réflexion éthique s’interroge, quant à elle, sur les implications de ces résultats et avancées. Une co-évolution est nécessaire : l’environnement changeant des avancées des connaissances pose de nouvelles questions éthiques quant à l’appropriation, et les avancées de la réflexion éthique changent l’interprétation des avancées des connaissances. La réflexivité, qui est un des éléments de notre vie intérieure, est importante dans le dialogue entre science et société.
Au fond, il s’agit de savoir si nous sommes capables d’une certaine distance et d’un certain retrait quand nous souhaitons placer un certain nombre de résultats d’avancées dans un contexte plus large. De cela procède l’idée que le respect de la dignité humaine et les droits de l’homme, repose sur un postulat toujours changeant, puisque la science avance, et que ce qui définit la dignité humaine et l’égalité est ce qui ne peut pas être mesuré. Tout ce qu’on peut mesurer d’une personne n’en rend compte qu’en partie. Donc une personne est forcément plus que ce qu’on peut mesurer. Dès lors, comment replace-t-on cette idée que ce qu’on décrit, qui est moins que la personne entière, est remis au service de la personne ?
Toute une série de questions d’éthique qui se posent en neurosciences, n’ont rien de spécifiques à ce domaine. Une information sur une maladie comme l’Alzheimer qui serait obtenue à l’aide de tests génétiques ferait l’objet d’un processus de consentement : droit de ne pas savoir, possibilité de savoir. Si elle était obtenue par un test de mémoire ou par de l’imagerie, il n’y aurait pas ce processus. Il est important de réfléchir à cela. En médecine, c’est la gravité de l’annonce et de ses implications qui compte, pas l’outil utilisé pour la révéler.
Des questions se posent également sur le rôle de l’inné et de l’acquis, de l’environnement et des gènes, avec une tendance, comme dans d’autres domaines, à essayer de conférer une prédominance à l’un plutôt qu’à l’autre, sans penser qu’il s’agit de boucles de causalité en spirales, ce que PASCAL appelait des choses à la fois causantes et causées, qu’il faut construire.
Didier SICARD a évoqué la prédiction, cependant dans la plupart des cas, sauf quand la contrainte est telle que l’inévitable va se produire, toute prédiction est fondée sur des probabilités. Il faut donc réfléchir en permanence au risque d’enfermer un individu singulier dans une probabilité qui concerne le groupe auquel on l’a rattaché parce qu’il partage certaines caractéristiques communes avec celui-ci. L’histoire informe sur la tentation parfois très grande, de la société d’instrumentaliser les progrès de la connaissance au détriment des personnes. Il suffit de lire « La malmesure de l’homme » de l’évolutionniste Stephan Jay GOULD, qui raconte les dérives de l’adaptation de la théorie de l’évolution et de la génétique un siècle après la publication de « L’origine des espèces », pour réaliser que la plus grande dérive éthique, c’est de se servir d’avancées de la connaissance ou de moyens de manipuler la réalité pour les inscrire dans des concepts culturels préexistants : racisme, sexisme, discrimination sociale et culturelle. Ce n’est pas la science qui crée ces discriminations, mais elle devient un argument de la société pour renforcer une idée préexistante ou pour changer des représentations concernant ces différences.
La volonté de mesurer de la science, si l’on n’y prête pas garde, conduit à la tentation de hiérarchiser en fonction de ce qu’indique la mesure qui, souvent, est quantitative. Dès qu’une hiérarchisation ou tentation de hiérarchisation existe, il y a risque de discrimination et de stigmatisation. Être capable d’apprécier les corrélations des mécanismes de causalité sur une portion de la vie intérieure, l’identité ou le devenir d’une personne, risque de l’enfermer dans ce qu’on a découvert, qui peut être tout à fait vrai mais n’est qu’une des identités multiples qui se construiront à partir de cette personne. C’est ce que rappelle le dernier livre d’Amartya SEN intitulé « Identité et violence, l’illusion du destin ».
La problématique de l’homme transformé touche toutes les branches de la médecine mais se pose de manière plus aiguë en neurosciences. Si on demande à quelqu’un s’il veut être augmenté ou amélioré, il y a peu de chances que la réponse soit non. Si on lui demande, en revanche, s’il veut être modifié, la question devient : quels seront les avantages, les risques, les bénéfices ? Le langage n’est pas neutre. Parler de modification induit la question de la réversibilité, de la dépendance, des bénéfices et des risques, qui est toujours une question contextuelle, changeante. Les mots utilisés sont importants.
L’autre interrogation porte sur : « qui manipule qui ? » Les interfaces homme/machine sont fascinantes : piloter un ordinateur par la pensée, manier une prothèse et ressentir ce qu’elle envoie comme sensation est extraordinaire. Il y a vraiment des avancées fantastiques dès qu’on interconnecte et que la pensée peut directement avoir un effet moteur. Mais il faut être sûr que c’est l’autonomie de la personne qui est aux commandes et non la personne qui est contrôlée de l’extérieur. Poser la question à la fois de la réversibilité, des bénéfices, des risques et du respect de l’autonomie de la personne fait qu’on peut concevoir toutes ces modifications comme étant mises à la disposition de la personne et non pas comme la restreignant.
Autre point qui me paraît important, c’est que, dès qu’on touche au comportement, à la vie intérieure, qui est quelque chose de très humain, de très dépendant de la culture, du temps, de la société, les définitions deviennent floues. Les définitions des comportements normaux et pathologiques, des maladies, des handicaps, sont mouvantes. Rechercher des causes, proposer des traitements impose donc de prendre en compte ce caractère relatif. Cela ne veut pas dire que des événements ne sont pas observables de manière objective mais que le contexte est relatif. Le seuil de la dépression a changé en quelques années. L’homosexualité était jadis classée par l’OMS comme une pathologie mentale. Il faut toujours mener une réflexion sur ce qui paraît évident car cela peut poser un problème.
Quand on passe dans le champ social, dire n’est jamais neutre. Il y a un risque, quand on décrit une personne et que celle-ci essaie de s’approprier cette description, qu’elle se conforme à ce qui se dit d’elle, ceci risque d’avoir une valeur prédictive. Si les personnes se sont appropriées ce qui était dit d’elles au point d’effectuer ce qu’elles croient qu’on a découvert qu’elles faisaient, elles le feront. Il existe à la fois une distance et une réflexivité. Il faut observer en quoi on se borne à décrire, à nommer et à dire, et en quoi on met des renseignements à la disposition de la personne. Le risque de normalisation est évident.
On a évoqué la ritaline. Faut-il changer l’école, changer l’éducation ou traiter les enfants qui ne s’adaptent pas ? On a parlé aussi du dépistage de la délinquance à trois ans. Il faut se demander si on aide l’enfant ou si on essaie de le rendre conforme à ce qu’on attend de son comportement. C’est très ambigu. Toute culture formate d’une certaine façon. C’est le principe même de l’éducation et de la vie culturelle. La question d’apporter quelque chose tout en développant l’autonomie et la liberté se pose toujours. La discrimination est un champ qui dépasse les neurosciences mais qui, parfois, ne me semble pas pris en compte. Une discrimination sur une prédiction statistique, même quand la probabilité est faible, semble possible: si quelqu’un appartient à un groupe dans lequel 10 % de personnes aura tel avenir et que l’on ne sait pas si cette personne aura cet avenir là, une école, un employeur ou un assureur peut très bien décider de la discriminer parce que, statistiquement, quoi qu’il lui arrive, c’est efficace. Ne pas enfermer ces personnes est important.
Quant à la justice, il existe deux questions distinctes. La première consiste à se demander jusqu’où l’imagerie ou d’autres approches peuvent traduire le mensonge, le non-mensonge, la culpabilité, le non-sentiment de culpabilité. La seconde est : quel que soit le résultat, quel statut donne-t-on aux informations fournies par les neurosciences dans une démarche judiciaire, dans laquelle le secret, la confidentialité ont été considérés pendant des siècles comme partie intégrante d’un procès juste? En d’autres termes, si je peux lire dans la tête de quelqu’un, y a-t-il un sens à vouloir utiliser obligatoirement ce qui d’un seul coup devient disponible, par rapport à son droit au secret et à la confidentialité de ses discussions avec son avocat, comme si on estimait qu’à partir du moment où l’on dispose de micros miniatures, écouter les conversations de cette personne avec son avocat devient normal puisque c’est possible ? Il faut réfléchir à la frontière entre le possible et le souhaitable dans la construction de toute une série de démarches.
Les manipulations du comportement existent depuis que le monde existe. Certaines sont souhaitées : la fiction, les livres, les films, le théâtre, les jeux vidéos sont des manipulations du comportement, de la vie intérieure, avec l’assentiment de la personne. Le problème n’est pas la manipulation ou le fait qu’elle soit intrinsèquement bonne ou mauvaise, mais l’existence ou non d’un consentement informé de la société, à savoir l’information donnée ou non sur le fait qu’une manipulation existe. Lorsqu’il s’agit de modifier les comportements, comme pour la conduite routière, on trouve que la manipulation est souhaitable, mais on en est informé ; elle n’est pas subliminale, elle n’est pas effectuée sans qu’on ait réfléchi à son propos.
Le langage scientifique s’est voulu le plus objectif possible. Cela pose parfois des questions intéressantes dans lesquelles le chercheur s’abstrait de la description qu’il est en train de donner. Il y a des articles sur le libre arbitre qui concluent que celui-ci n’existe pas dans des situations restreintes. Je n’ai jamais vu, dans la discussion de ces articles, les signataires expliquer : « c’est la première fois qu’un article scientifique est écrit par des scientifiques qui ont découvert que le libre arbitre n’existait pas. Cela change-t-il quelque chose à la valeur de l’article ? Est-ce que la réflexivité que l’on a ensuite implique que nous assumons librement les conclusions ?» C’est comme si ceux qui décrivent le fait qu’on a découvert que le libre arbitre n’existait pas, étaient d’une certaine façon exemptés de cette description.
On trouve également des situations intéressantes, sur la corrélation causalité/signification : en quoi la description la plus précise du corrélat d’une vie intérieure peut-il se substituer à ce qui est incommunicable et qui est le fait de vivre cette vie intérieure ? KEATS disait que rien ne devient jamais réel tant qu’on ne l’a pas ressenti. Comment rentrer dans la réalité du ressenti ? Le fait que des études chez un tout petit nombre de personnes en état végétatif, indique qu’ils réagissent à des noms, des paroles, des demandes de la même façon que des personnes conscientes est, pour nombre de neuroscientifiques, plus une question qu’une réponse. La question devient : est-ce que ces corrélats sont nécessaires et suffisants pour qu’il y ait conscience ou ne sont-ils que nécessaires et pas suffisants ? Souvent, quand elle est féconde, la recherche apporte autant de questions que de réponses, en déplaçant le questionnement vers des interrogations plus larges.
Il est essentiel de toujours mieux comprendre, donc de continuer les avancées. Il faut, par conséquent, permettre la poursuite et le développement des recherches sur le cerveau. Ce qui a été explicité sur l’information est essentiel pour éviter une certaine fascination naïve devant les neurosciences, et aussi la propension des personnes, malgré les efforts des neuroscientifiques, à se conformer à ce qu’elles croient apprendre sur elles-mêmes. Il importe de les protéger contre des utilisations à leur détriment : instrumentalisation, discrimination, stigmatisation, respect de la vie privée et de la vulnérabilité; le législateur peut sans doute jouer un rôle important en cela.
Quoi que nous explique la science, elle ne nous dit jamais si la conclusion que nous devons tirer est d’accompagner ou d’isoler, d’insérer ou d’abandonner. Or le développement de la connaissance sur nous-mêmes doit s’accompagner du développement de ce qui fait souvent défaut, à savoir l’accompagnement, l’insertion dans la société, qui sont le plus grand contre-feu aux dérives qui pourraient surgir d’une mauvaise application et d’une mauvaise compréhension des avancées des neurosciences.
M. Alain CLAEYS.
Je vous remercie de cet exposé, la parole est à Madame BENOIT- BROWAEYS.
8 Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS, Déléguée générale de VivAgora, Journaliste scientifique.
Je vous remercie de m’avoir invitée au titre de VivAgora, association que j’ai fondée afin qu’elle soit une plate-forme de veille, d’information et de concertation pour une contribution citoyenne aux choix scientifiques et techniques, étant moi-même, depuis une vingtaine d’années, journaliste scientifique spécialisée dans le champ du vivant et des biotechnologies. VivAgora considère que les technologies sont faites pour l’homme et non l’inverse.
Dès lors, l’association interroge les usages, l’impact et les sens des technologies. VivAgora dispose d’une vision des nano-bio-info-cogno-sciences, assez vaste à la suite des douze débats menés à Paris et à Grenoble en 2006 sur les nanotechnologies et des six débats organisés à Paris en 2007 sur les neurosciences. VivAgora a constaté que les maladies mentales et des souffrances psychiques touchent 1/5 de la population. Parallèlement, les neurosciences sont un objet d’espoirs et obtiennent des financements importants. À quelle demande sociale répondent-ils? Doivent-elles sortir de leur justification thérapeutique systématique pour recueillir des fonds? Quel est leur objet d’étude : le cerveau ou la santé mentale ? Qui pilote les priorités ? Quelles sont les logiques des acteurs? Quelle est la place des demandes sociales?
Je dois avouer que je n’ai pas compris quel était l’objet exact de l’audition. Est-ce le cerveau ou la santé mentale ? Les neurosciences sont-elles pilotées par une logique de compréhension du cerveau ou par une logique de soins et par une démarche de service public à destination des malades ou des bien-portants qui ont besoin d’aide ?
Alain CLAEYS a demandé à François BERGER si des débats à propos des implants cérébraux avaient eu lieu. Ils se sont tenus dans le cadre de Nanoviv. François BERGER a estimé qu’ils ressemblaient à des discussions de café du commerce ; peut-être. En tout état de cause, la société civile a pu être présente et s’exprimer sur le sujet. Il a également expliqué que le dopage ne faisait pas partie de la médecine. Cela m’amène à poser tout de suite une question qui me paraît essentielle : est-ce que le flou dont parlait Jean-Michel BESNIER et les dérives comme le dopage sont forcément en dehors de la responsabilité des scientifiques, des médecins, des cliniciens, des accompagnants et de la communauté des personnes impliquées dans les soins auprès des malades mentaux.
Dans le processus de débats publics de VivAgora, auxquels a participé pratiquement la moitié des personnes présentes à cette audition, nous avons voulu écouter la demande de la société. Sur les questions qui nous occupent aujourd’hui, on assiste à une véritable guerre de pouvoir, d’argent, de pilotage, d’arbitrage. Au terme des six débats de l’année dernière, l’équipe de VivAgora a été particulièrement surprise de la discordance entre les acteurs du soin et les acteurs de la recherche.
Comment sont menés les débats organisés par VivAgora ? Quand on organise des discussions, il est important d’informer, mais les journalistes à l’origine de VivAgora préfèrent que l’information n’encombre pas les débats, d’autant que cela pose l’expert en autorité, ce qui ne facilite pas le dialogue. Nous distribuons en préalable des fiches repères pour que le débat soit le moment de la confrontation, de la mise en évidence des conflits d’intérêt.
Pour questionner les acteurs, leurs intérêts et ceux des malades, la méthode consiste en la mise en place d’un comité de pilotage pluraliste, la distribution de fiches repères contenant un état des lieux : logiques des acteurs, l’intérêt général etc… Nous n’avons pas, en France, la culture du débat et il existe un certain tabou à regarder en face les divergences entre industriels, universitaires et cliniciens. Nous prenons le temps de permettre à ces divergences et à ces conflits de s’exprimer.
Les six débats de 2007 sur le thème « Cerveau et santé mentale » ont débouché sur la proposition de quatre axes de vigilance.
Le premier insiste sur l’importance de rééquilibrer les investissements en neurosciences et en psycho-sciences. Une sorte d’automatisme s’est institué, certainement en raison du côté fascinatoire des neurosciences qui font croire à une certaine puissance et à une certaine compréhension des maladies, ce qui incite la société à voir dans la traduction organique de la maladie psychique la clé ou l’origine unique du mal. Je soulignerai, comme Jean-Claude AMEISEN l’a fait pour les médias, l’importance de l’imaginaire lié au cerveau dans la société.
Les visions déterministes véhiculées par les médias ne sont pas le fait uniquement des journalistes. Dans le champ des publications scientifiques, des argumentaires très fournis donnent à penser, ne serait-ce que pour obtenir des financements, qu’en poussant plus loin les recherches, on trouvera les rouages. Cela donne une vision très mécanistique du cerveau, entraînant des dégâts dans la société. C’est un point important auquel ne s’intéressent pas beaucoup les scientifiques.
En 2005, j’ai écrit avec Catherine VIDAL un livre intitulé Cerveau, sexe et pouvoir. Nous avons été très étonnées de constater que les neurobiologistes étaient peu enclins à monter au créneau face à de telles dérives dans les médias. Ce premier axe de vigilance insiste sur la nécessité de dépasser le réductionnisme, considéré comme une sorte de maladie infantile des neurosciences. Il est important que le contexte soit valorisé et que le cerveau soit mis en lien avec l’environnement. La santé mentale environnementale pourrait être une discipline à développer. Il convient également d’opérer une distinction entre expliquer et soigner.
L’argument selon lequel tels travaux sont réalisés parce qu’ils aideront à soigner est parfois assez fallacieux. Il est aussi nécessaire de préciser la portée de l’expertise biologique et ses limites. On connaît les dérives de ces expertises qui font croire que le cadre de pensée des neurosciences est le seul qui permette de définir les priorités, surtout en politique.
La deuxième préconisation consiste à placer la recherche davantage au service des maladies que de la performance. Il s’agit de se consacrer davantage à l’ « homme diminué » (ou malade) qu’à l’« homme augmenté » et de guérir des maladies avérées avant de dépister des maladies potentielles. On rétorquera certainement qu’il est vain de faire une telle demande dans une société de compétitivité comme la nôtre. Mais quand on observe ce qui se passe dans le domaine de l’environnement, il n’est pas certain que notre société ait envie de poursuivre la fuite en avant actuelle. Il serait peut-être bon de réfléchir à une évolution, à un aménagement, pouvant se produire prochainement, en mettant l’accent sur le soin plutôt que sur la guérison.
Le troisième point invite à questionner les « pathologies » du système social. Il importe de résister au système social qui ne valorise que la performance et l’autonomie. D’autres visions de l’usage des neurosciences sont possibles. La société formule peut-être d’autres demandes. Les questions de la finitude et de la vulnérabilité, par exemple, occupent tout un chacun. Il convient de protéger les individus plutôt que de les doper, et d’aborder les maladies du vieillissement de façon spécifique. Nos débats se sont d’ailleurs souvent focalisés sur la question, cruciale en politique, de l’arbitrage des priorités du point de vue du vieillissement des populations.
Le quatrième axe invite à construire collectivement les choix en matière de santé psychique. Il n’y a pas d’organisation, pas d’organe dans des instances universitaires ou auprès de centres de recherche, pas de rendez-vous pour traiter ces questions et véritablement articuler demande sociale et logique des neurosciences. Il est important de développer la discussion publique sur la santé mentale, en mettant en place des procédures de démocratie participative en mesure de moduler nos pouvoirs et de décanter les fantasmes.
Il s’agit de peser la demande de soins et d’accompagnement des populations par rapport aux logiques industrielles ou de compétition de la recherche. Il convient de surveiller les processus normatifs (les enfants sont en première ligne), d’élaborer la dimension éthique de la cause politique fondés sur des principes de solidarité, de finalité, et de proportionnalité. Il faut, en outre mobiliser la discussion publique sur la santé mentale en contrant la vision mécaniste des comportements, informer sur les priorités de recherche, et réfléchir à la manipulation des ambivalences.
Conclusion
Il convient d’interroger les priorités financières et la gouvernance des choix. En France, la consommation des psychotropes est deux fois plus élévée que dans le reste de l'Union Européenne. 85 % des prescriptions de psychotropes sont faites par des médecins généralistes (avec information des visiteurs médicaux missionnés par les industriels).
Plusieurs questions se posent : quelle est l’évaluation du plan santé mentale 2005-2008 ? Comment s’est décidé l’investissement de NeuroSpin (51 millions d’euros)? Qui décide de la mise en œuvre de Clinatec (20 millions d’euros dans l’enceinte de Minatec)? Quel a été l’impact du rapport réalisé par l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS) publié en mai 2006.
Il convient également de s’interroger sur les bénéfices et finalités et pour cela d’ouvrir les comités d’orientation stratégiques (Universités, CEA, INSERM…) à des acteurs associatifs, de créer des structures à 5 collèges (Etat, industriels, acteurs sociaux et associatifs, académiques, personnalités qualifiées) pour préciser les objectifs et évaluer les programmes et de mobiliser des principes de finalité et de proportionnalité comme dans le champ de la CNIL.
M Jean-Sébastien VIALATTE.
Je vous remercie Madame. Madame BERNARDIS vous avez la parole.
8 Mme Marie-Agnès BERNARDIS, Coordinatrice de Meeting of Minds, Cité des sciences et de l’industrie.
Je remercie messieurs Alain CLAEYS et Jean-Sébastien VIALATTE, députés et membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de m’avoir invitée à présenter la délibération des citoyens européens sur les enjeux du développement des neurosciences, Meeting of Minds. La diffusion des conclusions des travaux du panel des citoyens est très importante. Le lien avec la décision politique constitue l’un des enjeux de la mise en œuvre des procédures participatives impliquant des citoyens profanes dans l’évaluation des sciences et des technologies. La délibération citoyenne Meeting of Minds, organisée à l’échelle européenne, a porté sur les enjeux éthiques, juridiques et sociaux du développement des neurosciences. Achevée au printemps 2006, elle a concerné 126 citoyens de 9 pays parlant 8 langues qui ont travaillé ensemble pendant plus d’un an, dans un contexte multiculturel et multilinguistique ; ce fut un véritable défi. La consultation européenne de citoyens avait pour objectifs : de mettre la question des sciences du cerveau à l’ordre du jour de l’agenda politique, de formuler des recommandations à l’intention de la communauté des scientifiques et de la recherche, au niveau européen et au niveau national, et de mettre en place une méthode pour des débats transnationaux publics dans d’autres domaines.
Cette consultation de citoyens à l’échelle européenne a été le premier débat public européen sur les neurosciences. Ce projet pilote, cofinancé par la Commission européenne et la fondation belge Roi Baudouin, a été porté par 12 institutions partenaires (musées des sciences, conseils d’évaluation des sciences et des technologies, fondations publiques ou privées, universités). Quelque 150 experts y ont été associés. Plusieurs personnes présentes à cette audition publique y ont participé et le Comité consultatif national d’éthique l’a soutenue. Pour la première fois, on a demandé à un panel de citoyens européens d’exprimer leur avis, de faire état de leurs réflexions, de formuler des recommandations dans un domaine très important des avancées scientifiques, les neurosciences.
Ce sujet avait été choisi parce qu’il concerne chacun d’entre nous, qu’il s’agisse de la compréhension des pathologies comme les maladies mentales, les maladies neurodégénératives, l’hyperactivité des enfants, ou bien de la connaissance du fonctionnement du cerveau, des mécanismes de la mémoire, des émotions, de la conscience, des comportements. Des interrogations sur la possibilité de doper et d’augmenter les performances, d’agir sur les comportements, sur la volonté, le libre arbitre étaient encore émergentes au moment où le projet a été lancé, en 2004. Il n’y avait pas de controverses publiques hormis le débat suscité, en France en septembre 2005, par la publication de expertise de l’INSERM relative à l’identification des troubles de conduite chez les jeunes enfants.
Les questions soumises aux citoyens étaient : « Comment allons-nous utiliser au mieux les nouvelles connaissances obtenues dans le domaine des neurosciences ? Quels sont les enjeux éthiques et sociaux de leur développement ? » Ils les ont prises très au sérieux et ont travaillé en cinq étapes : trois étapes nationales qui suivaient une méthodologie de conférence de consensus et deux conventions européennes où ont été mêlées différentes méthodes participatives.
Dans chaque panel national, les citoyens ont commencé à discuter entre eux à partir de questions concrètes (proposées dans une même brochure d’information traduite en différentes langues) : est-ce qu’il faut traiter un enfant hyperactif avec de la ritaline, est-ce qu’il faut annoncer un diagnostic précoce d’Alzheimer ? Qu’est-ce qui se passe quand on soigne un patient atteint de la maladie de Gilles de la Tourette en implantant des électrodes dans le cerveau ? Est-ce que l’on peut augmenter ses performances cérébrales, comment ?
Puis le panel européen a défini lui-même les 6 thèmes de son questionnement : normalité et diversité, réglementation et contrôle, information du public et communication, pression des intérêts économiques, égalité d’accès aux soins, liberté de choix. Ces thèmes ont été débattus au niveau national, lors de débats publics et contradictoires à partir des questions élaborées par chaque panel et soumises aux « experts » : chercheurs, responsables d’instances de réflexion éthique, cliniciens, représentants de parties prenantes comme les laboratoires scientifiques, associations de patients, responsables politiques. Cette initiative a abouti à la rédaction de deux rapports : un rapport national puis, après discussion de tous les rapports nationaux, un rapport européen.
Les conclusions de cette délibération européenne. Il ne faut pas s’arrêter aux seules recommandations des panels nationaux (30 pour le panel français) et du panel des 126 citoyens européens (37). Elles ne reflètent qu’une partie de leurs travaux délibératifs dont l’intérêt réside tout particulièrement dans les échanges, les discussions, les débats parfois contradictoires au sein du groupe lui-même et les experts auditionnés.
Les échanges ont été vifs avec des représentants de l’industrie pharmaceutique sur les classifications du DSM 4 (Diagnostic and Statistical Manual - Revision 4) et les prescriptions de médicaments ou avec des responsables politiques à propos des politiques de santé publiques et de la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales neurodégénératives.
Les recommandations étaient destinées à être transmises à des décideurs afin de fournir des pistes et des éclairages. Le but était d’enrichir la démocratie représentative et non de s’y substituer. En cela, les panels de citoyens – 14 dans chaque pays – ne sont pas du tout représentatifs d’une population nationale ou européenne. Ils regroupaient simplement des profanes, de façon équilibrée en genre, âge, niveau d’éducation et provenance géographique.
Je n’énumérerai pas toutes les recommandations, d’autant qu’elles ne résument pas ce qui reste de ces consultations.
Quelques recommandations du panel européen :
Sur la dimension recherche et développement : il a été recommandé : d’accroître les financements de l’Union européenne en matière de recherche fondamentale et de base sur des cerveaux sains et malades, de consacrer une partie des budgets de la recherche à la communication des résultats au public, d’affecter une partie des fonds globaux alloués à la recherche sur le cerveau à l’étude de l’interaction entre les caractéristiques neurologiques et les facteurs environnementaux d’ordre social et culturel dans le but de réduire les troubles liés au cerveau, de promouvoir la recherche visant à mieux définir la normalité et les états qui devraient être qualifiés d’anormaux afin d’éviter les traitements superflus et réduire la tendance actuelle à soigner avec des médicaments tout état qui s’écarte de la norme.
Dans tous les pays, les panels ont souligné l’importance de la recherche fondamentale et la nécessité d’accroître son financement.
Pour la dimension « Éthique des sciences et de la recherche », il a été préconisé : d’instaurer des procédures obligatoires de consentement informé pour toutes les techniques d’imagerie du cerveau, d’interdire l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale par la police, les services de la justice et de la sûreté, de créer un comité paneuropéen de conseil juridique et éthique pour établir des lignes de conduite en matière de recherche sur le cerveau.
Sur la dimension « Produits pharmaceutiques et médicaux », il a été suggéré : d’encourager les entreprises pharmaceutiques à s’engager dans des recherches sur le cerveau peu rentables et dans des recherches sur les conséquences à long terme de la médicalisation et d’autres traitements.
Sur la dimension « Soins de santé », il a été proposé d’établir des lignes de conduite européennes pour que l’assistance médicale dans les États membres assure dignité et qualité de vie aux personnes souffrant de troubles mentaux, de procurer aux patients des soins multidisciplinaires dans une atmosphère familiale ou à domicile Le panel européen a manifesté une grande attention à l’égalité d’accès aux soins. On notera que sur des questions éthiques assez nouvelles comme « l’homme augmenté » par les médicaments, les implants de puces, les citoyens ont établi une distinction nette entre soigner, réparer, traiter des dysfonctionnements. Ils ont mis en garde contre la tentation d’augmenter les performances de l’homme surtout dans une société qui valorise les performances individuelles.
Quelques recommandations du panel français : une partie du débat français a porté sur la prise en charge des maladies neurodégénératives et les politiques ont été interpellés sur la continuité des plans ou sur la manière dont a été utilisé l’argent public. Plusieurs des recommandations du panel français ont d’ailleurs concerné les problèmes soulevés par la maladie d’Alzheimer notamment. Elles sont en phase avec celles du rapport de la commission présidée par le professeur Joël MENARD, remis au président de la République en novembre 2007.
Ces recommandations portent sur l’annonce du diagnostic au cas par cas et le droit du patient de ne pas savoir, dans le cas d’un diagnostic précoce, l’accompagnement du patient et de son entourage, un meilleur accès à des structures de soin, une meilleure répartition des centres de diagnostic, la création de structures de vie plus humaines, plus familiales, la revalorisation de la médecine gériatrique et la formation.
D’autres recommandations concernent l’utilisation de données de l’imagerie cérébrale : ne pas catégoriser les individus à partir des informations recueillies grâce au progrès des neurosciences ; une information obtenue en imagerie cérébrale ne devant pas conduire à une interprétation réductrice, éviter les dérives d’utilisation des données de l’imagerie dans le monde professionnel et social, dans les recrutements, l’assurance, la formation. Il est nécessaire d’être vigilant sur les outils pouvant provenir des progrès des neurosciences et susceptibles d’être utilisés par des acteurs du monde judiciaire qui doivent être de formés aux questions éthiques posées.
Les citoyens avaient bien identifié la différence entre intervenir sur un handicap et augmenter les possibilités de l’homme. Dans le panel français, ils avaient inscrit la nécessité d’ouvrir la réflexion sur l’évolution de la relation homme/médicament et de la course au bien-être à tout prix, ainsi que de sensibiliser les élèves des écoles à l’usage des médicaments et à leurs éventuels effets secondaires.
Tout un débat a porté sur le traitement des enfants hyperactifs par la ritaline. De nombreuses questions ont tourné autour de la « normalité » et de la « diversité », au moment où paraissait, en France, l’expertise de l’INSERM sur l’identification précoce des troubles de conduite. Le panel français a souligné la nécessité de soutenir des sources d’informations indépendantes des laboratoires pharmaceutiques et a préconisé que la formation continue des médecins soit également indépendante.
Le panel européen comme le panel français a souligné avec force la nécessité que l’on investisse dans la recherche fondamentale sur le cerveau sain comme sur le cerveau malade. Dans les auditions qui ont eu lieu cet automne, le danger d’utiliser des avancées thérapeutiques encore très incertaines et très lointaines pour faire passer un certain nombre de recherches a été souligné.
Conclusions
Cette expérience a montré qu’une délibération à l’échelle européenne est possible et que cette manière d’impliquer des citoyens est importante pour la gouvernance de la recherche. On peut souhaiter que les débats et les états généraux de la bioéthique feront une grande place aux citoyens et que le débat public s’ouvrira largement à leur participation, à leur réflexion et à leurs contributions.
Parmi les recommandations du panel français, comme du panel européen, figurait en effet le renforcement de la participation citoyenne aux niveaux régional, national et européen.
Au moment de la révision de la loi de bioéthique, l’un de nos espoirs est que l’on organise la participation de citoyens profanes dans des enceintes de débat parce qu’ils représentent une certaine idée du bien commun. Ils n’appartiennent ni à des lobbies, ni à des groupes de pression. Quand ils échangent, ils arrivent à définir quelque chose qui est de l’ordre du bien commun et non pas de l’intérêt particulier. C’est une autre manière d’envisager la communication scientifique. On est sorti de cette période durant laquelle on faisait du Public Understanding of Science. On juge désormais important de développer d’autres voies de dialogue, de discussion, voire de controverse, avec des représentants non seulement du monde scientifique, mais également du monde politique et du monde associatif.
6
M. Alain CLAEYS.
Nous suivrons cette recommandation : un débat public est prévu dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, et nous avons fait savoir que l’Office parlementaire voulait s’y inscrire.
M. François BERGER.
Permettez-moi un mot de synthèse. Ce serait une catastrophe de sortir de cette réunion en pensant que les données des neurosciences sont des outils de réductionnisme. Elles sont, au contraire, des outils de liberté et de complexité. Ce qui émerge plutôt, c’est la difficulté à comprendre la complexité et à discuter autour de celle-ci, puis de décider – ce sera une tâche difficile pour les politiques.
Ce qui ressort des débats citoyens dont il vient d’être question est une très belle leçon de démocratie. J’y étais plus ou moins opposé. Or les recommandations sont très rigoureuses. Elles ont réussi à intégrer la complexité du sujet et à se démarquer des lobbies et des discussions habituelles. J’ai l’impression que, lorsqu’un sociologue ou un philosophe discute avec un représentant des neurosciences, ils n’arrivent pas à communiquer. Or le citoyen a complètement résolu le problème. Ceci doit nous rendre vraiment optimistes.
M. Alain CLAEYS.
Je remercie chaleureusement tous les intervenants à cette audition publique.
PROCRÉATION MEDICALEMENT ASSISTÉE :
ENJEUX ET DÉFIS ÉTHIQUES
COMPTE RENDU DE L’AUDITION PUBLIQUE
OUVERTE À LA PRESSE
DU MARDI 10 JUIN 2008
Alain CLAEYS, Député de la Vienne
Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var
La séance est ouverte à 14 heures 10 sous la présidence de Monsieur Alain CLAEYS, Député de la Vienne.
8 M. Alain CLAEYS, Député de la Vienne
Au nom de Claude BIRRAUX, Président de l’Office parlementaire, et de Jean-Sébastien VIALATTE, je vous souhaite la bienvenue à l’Assemblée nationale pour cette troisième audition publique sur l’évaluation de la loi bioéthique de 2004.
Avant de revenir sur le sujet de cette audition, je voudrais resituer les débats que nous aurons aujourd’hui. La loi prévoit, depuis 1994, que l’Office parlementaire se saisisse, tous les quatre ans pour l’évaluer et, éventuellement, suggérer des révisions. Dans le même temps, le Premier Ministre a saisi le Conseil d’État sur cette question. Il peut également saisir le Comité national consultatif national d’éthique. Cette année, il semblerait qu’un dispositif complémentaire vienne s’ajouter à cet ensemble : l’organisation d’États généraux.
À l’évidence, la représentation nationale ne s’opposera pas à ce principe de consultation des citoyens. Néanmoins, sur un sujet aussi difficile, cette consultation nécessite que certaines précautions soient prises. Je suis convaincu que l’exécutif, qui sera en charge de ces États généraux, saura les prendre. Nous souhaitons que le Parlement soit totalement associé à cette démarche. La loi prévoit que l’Office rende un rapport, sur cette question, pour éclairer le Parlement. Nous effectuerons ce travail. L’organisation des États généraux exigera une bonne coordination avec le Parlement.
L’audition de ce jour porte sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) dont le cadre législatif a été peu modifié en 2004. Elle constitue une étape essentielle dans notre évaluation. En 2004, nous avons très peu évoqué ce sujet puisque, à l’époque, le débat portait sur la recherche et, particulièrement, sur la recherche sur les cellules souches. Déjà, lors de notre première audition publique, les problèmes anciens et plus récents que soulève l’assistance médicale à la procréation ont été mis en évidence par de nombreux intervenants dont certains nous font le plaisir d’être, de nouveau, présents aujourd’hui.
Depuis 1994, voire depuis 2004, des évolutions de tous ordres se sont produites, conduisant à des interrogations sur le bien-fondé de certaines dispositions de nos lois successives de bioéthique. Au niveau scientifique, des progrès ont été accomplis grâce à la technique de l’injection intra cytoplasmique de spermatozoïdes (l’ICSI) qui permet de combattre certaines stérilités masculines. Or, ce n’est qu’en 1994 qu’un premier bébé est né grâce à cette technique, dont l’utilisation s’est progressivement généralisée depuis. En 1994, quand le législateur a examiné la loi, l’impact de la technique de l’ICSI n’a pas pu être étudié.
Par ailleurs, les pays voisins du nôtre se sont dotés de lois de bioéthique, plus ou moins contraignantes. Ceci a bouleversé le paysage juridique et suscité un tourisme procréatif que notre réglementation n’interdit pas, voire est susceptible de favoriser. Parallèlement, les sites Internet concernant la procréation fleurissent et se spécialisent. On y trouve le pire et le meilleur. L’utilisation généralisée de cet outil a transformé le recours et l’usage, par nos concitoyens, des techniques de procréation.
La naissance d’Amandine nous paraît, aujourd’hui, bien lointaine. Les émerveillements et espoirs suscités par les promesses de cette victoire contre la stérilité se mêlent encore à l’inquiétude devant la toute puissance technique. À partir du moment où les gamètes peuvent se rencontrer hors du corps humain, toutes sortes de combinaisons deviennent imaginables.
Symétrie du don de sperme, le don d’ovocyte voit le jour à la fin des années quatre-vingt. L’enfant, issu de ce don féminin, aura un père biologique et social et deux mères, l’une génétique, l’autre légale. En cas de stérilité des deux côtés, un don d’embryon peut être effectué par un couple ayant subi, lui-même, des traitements et bénéficiant d’embryons en surnombre. L’enfant aura, alors, quatre parents : deux biologiques et deux sociaux. Certains pays permettent le recours aux mères porteuses qui accueillent, le temps d’une gestation, l’embryon d’un couple dans lequel la femme, privée d’utérus, mais ayant des ovocytes, ne peut conduire, elle-même, sa grossesse. L’enfant aura, alors, un père génétique et deux mères, l’une étant génétique et sociale, l’autre étant gestatrice. Parenté sociale et parenté biologique ne coïncident plus obligatoirement.
Au milieu des années quatre-vingt, un processus de concertation est entamé en vue de l’élaboration de législations adaptées. Il débouche, en 1994, sur l’adoption de la loi de bioéthique. Cette loi interdit la gestation pour autrui, ferme l’accès de l’AMP aux célibataires et aux homosexuels et instaure un régime de don anonyme et gratuit des gamètes. La révision de cette loi, en 2004, ne remet pratiquement pas en cause les dispositions concernant l’AMP. Aujourd’hui, nous nous penchons, de nouveau, sur ce sujet. Les États généraux de la bioéthique, prévus – nous a-t-on dit – pour le premier semestre de 2009, aborderont, sans nul doute, ce thème. Les choix qui, en 1994 et en 2004, ont fait l’unanimité seront-ils, de nouveau, entérinés ou bien faudra-t-il, à la lumière des transformations de notre société et des évolutions que connaissent les législations des pays voisins, les remettre en question ?
Pour ma part, en tant que co-rapporteur de l’Office, je soutiens les avancées scientifiques et techniques qui permettent d’accroître les chances de palier ou de guérir la stérilité. Toutefois, mes positions sont connues. Je m’opposerai, avec la plus grande fermeté, à toute dérive impliquant une marchandisation du corps des femmes. Si évolutions il y a, celles-ci devront se faire dans le respect des droits de tous les intervenants : droits de l’enfant à une identité et une filiation clairement établies ; droits du donneur ou de la donneuse au respect de son intégrité physique et de son consentement éclairé ; droits des femmes et des hommes stériles à une information précise sur les centres auxquels ils s’adressent et à un accès plus équitable à ces centres ; enfin, si le législateur l’admettait, un encadrement extrêmement strict de la gestation pour autrui, assorti d’une protection rigoureuse des éventuelles mères porteuses.
La quête de l’enfant à tout prix émeut. Parallèlement, l’absence fréquente de réponse des couples sur le devenir de leurs embryons surnuméraires inquiète. Quel est le projet parental d’un couple introuvable, qui a changé d’adresse et ne se prononce pas ? La réflexion sur la procréation médicalement assistée ne peut, ni ne doit, être disjointe de l’ensemble de l’évaluation de la loi de bioéthique. Il ne s’agit pas de légiférer par petites touches, au gré des procédures en cours ou des modèles législatifs des pays anglo-saxons. Il convient de s’interroger sur la dissociation entre sexualité et procréation et sur les raisons de la quête de leurs origines biologiques menée, en France comme à l’étranger, par certaines personnes nées grâce à un don anonyme.
Plus généralement, je me demande ce que signifie, pour une société, cette « biologisation » des rapports humains, cette fascination pour la génétique qu’implique, dans certains cas, le recours à la procréation médicalement assistée alors que, paradoxalement, les familles recomposées tendent à devenir une norme et que de nombreux enfants ne sont pas élevés par leurs parents biologiques.
La croyance en la science censée répondre à tous les désirs, est inquiétante et illusoire. Elle conduit à des désillusions et rend les échecs amers. Même si les progrès sont encore possibles, le droit à l’enfant n’est pas garanti par la science, et l’information sur ce point est capitale. En outre, ce qui est scientifiquement possible est-il moralement, juridiquement et socialement acceptable ? J’espère que le débat de cet après-midi permettra d’éclairer notre réflexion de législateur sur ces sujets. Je donne la parole à Jean-Sébastien VIALATTE.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE, Député du Var
Je m’associe aux remerciements formulés par Alain CLAEYS et souhaite prolonger ses propos liminaires par une réflexion que m’inspirent à la fois mon rôle de législateur et mon activité de biologiste praticien de quartier. Cette activité me met en contact avec des couples infertiles. Je connais parfaitement bien le drame que ces couples vivent et le poids de la quête d’un enfant. Je mesure surtout l’impact physique et psychique des traitements que doivent supporter les femmes. En définitive, ce sont elles qui subissent la plus lourde charge.
Au cours des auditions que nous avons menées auprès de différentes personnalités et des associations, dont certaines sont présentes aujourd’hui, nous avons entendus des discours et perçu des attentes contradictoires. Nos lois de bioéthique sont fondées sur plusieurs principes (le consentement, l’anonymat et la gratuité) tirés de la réglementation du don du sang en France. Ces principes ont été appliqués, dès l’origine, par les centres de conservation et d’étude des œufs et du sperme humain (CECOS) et ont inspiré le législateur de 1994, comme celui de 2004. Toutefois, selon les interlocuteurs que nous avons rencontrés, ce qui semble justifié pour le don du sang ou le don d’organes ne va pas forcément de soi pour le don de gamètes. Je m’interrogerai, avec vous, sur ce point. La question du suivi et de l’indemnisation des donneuses d’ovocytes doit être posée. Ce don n’est pas anodin. Il comporte des risques et de multiples contraintes.
Si j’attends de nombreuses réponses, de nos experts que sont Henri ATLAN et Axel KAHN, sur le futur de l’AMP, je contemple le présent. Que constate-t-on en France ? L’accès à l’assistance médicale à la procréation paraît inégalitaire selon les régions. Certains centres obtiennent de meilleurs résultats que d’autres. Cependant, ces résultats n’étant pas publiés centre par centre, seul le bouche à oreilles renseigne. Ce n’est pas une solution convenable.
Certains spécialistes considèrent que les résultats de l’AMP, en France, ne sont pas bons, comparés à ceux obtenus en Espagne ou au Royaume-Uni, en raison, notamment, de l’âge des donneuses d’ovocytes. Par ailleurs, les délais d’attente sont longs et décourageants. Devant la pénurie de gamètes et notamment, d’ovocytes, la pratique de la double liste semble s’être généralisée. On raccourcit le délai d’attente de celles et ceux qui viennent avec un donneur ou une donneuse. Certes, la loi n’est pas détournée puisque le don est croisé. Cependant, quels sont les rapports entre la donneuse, qui devra subir anesthésie et stimulation, et le couple en projet parental, qui a évoqué le problème avec elle ?
Le principe de l’anonymat constitue une autre problématique. Pour l’instant, je reste attaché à ce principe. En même temps, je comprends mal que les CECOS aient la responsabilité d’une sorte d’état civil parallèle dont l’accès est réservé aux seuls médecins. Ceux-ci sont, de ce fait, condamnés à une forme de toute puissance. D’un côté, on incite les parents d’intention à expliquer à leurs enfants les conditions de leur naissance ; de l’autre, ils ne peuvent rien dire de plus que ce qu’ils savent du donneur ou de la donneuse, c’est-à-dire rien. Il est nécessaire de réfléchir ensemble à ce paradoxe qui conduit certains parents à conserver un secret qui peut être à tout moment, découvert par l’enfant et lui être préjudiciable.
Si comme vous tous, je suis ému par la détresse des femmes atteintes de malformation de l’utérus ou condamnées, par la maladie, à ne pas pouvoir mener une grossesse alors qu’elles ont des ovocytes, je ne suis pas convaincu par le recours à la maternité de substitution pour l’instant. Ce système pourrait selon moi, conduire à des dérives mercantiles. Il comporte des risques pour la mère porteuse et des facteurs de déception pour les couples qui tentent cette aventure. Je n’énumèrerai pas les diverses affaires qui ont défrayé la chronique sur ce point ici et ailleurs.
Quand on analyse les législations qui encadrent cette pratique dans certains pays voisins, on constate que, si les droits de la mère porteuse sur l’enfant qu’elle porte pour autrui sont garantis, ceux des parents ne le sont pas toujours et inversement. Le vivant n’est pas une marchandise. Les spécialistes présents évoqueront cette délicate question. S’ils parvenaient à me convaincre, je serais prêt à revenir sur la position qui est la mienne, à condition, bien sûr, que les dispositions prises s’inscrivent dans un très strict encadrement.
Je m’interroge également sur l’existence de collections d’embryons surnuméraires et sur le silence, souvent prolongé, des couples. Cela engendre un malaise dont je souhaiterais débattre.
Nous pressentons bien que, contrairement au débat de 2004 qui a manifestement porté sur les cellules souches embryonnaires, celui de 2010 traitera, en grande partie, des problèmes de procréation. Notre discussion de ce jour nous permettra de progresser dans notre réflexion et de cerner, avec plus de précisions, les enjeux présents et futurs.
PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET FUTURS ENJEUX ÉTHIQUES
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Je donne la parole au Professeur ATLAN que chacun connaît. Le Professeur ATLAN a accepté de participer à notre Comité de pilotage et, avant de lui donner la parole, je souhaiterais connaître sa position sur l’utilisation des embryons surnuméraires, même si ce n’est pas tout à fait le thème du débat de ce jour, et qu’il évoque l’utérus artificiel : est ce une métaphore ou la réalité du futur ?
8 M. Henri ATLAN, Professeur à l’École des hautes études en sciences sociales
Je vous remercie. Je n’évoquerai pas l’utérus artificiel, mais d’un certain nombre de points que j’ai essayé d’expliquer dans ce livre intitulé « U.A. Utérus Artificiel ».
Comme vous le savez, les procréations médicalement assistées permettent de soulager de nombreuses souffrances liées à des infertilités. Cependant, la pratique a créé des situations et des problèmes nouveaux. Alain CLAEYS a déjà évoqué les situations nouvelles engendrées par la dissociation de la procréation et de la sexualité. La sexualité sans procréation a toujours existé. C’est même un des signes distinctifs de l’espèce humaine. En revanche, la procréation sans sexualité constitue une nouveauté radicale dans l’histoire de l’humanité. Évidemment, j’évoque ici la sexualité macroscopique puisqu’il y a toujours pour le moment, la sexualité microscopique des gamètes.
Je voudrais mettre en évidence une interrogation nouvelle : qui décide de faire des enfants ? Autrefois, cette question ne se posait pas. Les enfants venaient, sans être planifiés, dès qu’un couple se constituait, et celui-ci les recevait comme il le pouvait. Avec la contraception, qui a permis le contrôle des naissances et le planning familial, nous avons commencé à décider d’avoir ou non un enfant. Cette décision était celle de la femme et cette décision ne sortait pas de l’intimité du couple. Je vous rappelle l’expression : « un enfant si je veux, quand je veux ».
La situation a complètement changé avec la pratique des procréations médicalement assistées. La décision implique, désormais, l’intervention d’un tiers, en l’occurrence la société par le biais de l’équipe médicale qui met en œuvre la technique. Dans ce cadre, qui décide de l’application d’une technique lourde et coûteuse ? Qui a le droit d’accéder à cette technique ?
Face à ces questions, un éventail de réponses législatives existe et, dans cet éventail, deux extrêmes. L’un est celui qui a cours aux États-Unis, pays dans lequel la valeur suprême est celle de la liberté individuelle. La décision appartient à l’individu quel qu’il soit : homme, femme, couple, hétérosexuel, homosexuel. À l’autre extrême, se trouve la position de la France où c’est la société qui décide qui a accès aux techniques, et la loi prévoit que cet accès est réservé aux couples hétérosexuels stables.
Ces deux positions extrêmes ont chacune des avantages et des inconvénients. La position individualiste respecte le désir de chacun en toutes circonstances, mais crée une inégalité par l’argent puisque chacun doit supporter le coût financier de l’opération. En revanche la position française peut se prévaloir de l’avantage de l’égalité, au moins dans le principe puisque les frais sont pris en charge par la société. Cependant elle implique ce que certains considèrent comme une intrusion insupportable dans la vie privée.
Par ailleurs, la question du désir individuel se pose de façon nouvelle. Le désir d’enfant n’est pas toujours libre. Il peut être aliéné et comme le soulignait Claire BRISSET, il est parfois éphémère. Sur ce sujet aussi, la pratique des procréations médicalement assistées a engendré des modifications car la nature du désir d’enfant a changé. Dans la procréation non médicalement assistée, le désir est relativement passif. Il s’agit de laisser faire la nature en ne s’opposant ni à la conception par des contraceptifs, ni à la grossesse par une interruption volontaire de grossesse. Dans la pratique des procréations médicalement assistées, le désir est actif au travers de la mise en œuvre de la technique. Il change de nature du fait de l’intervention de tiers et de techniques complexes. Il se décourage parfois ou se renforce, notamment face aux obstacles et à la frustration et plus encore si les obstacles sont légaux. Ce désir tend alors à se transformer et sa satisfaction peut être revendiquée comme un droit à l’enfant, dont on peut se demander de quelle sorte de droit il s’agit.
Je voudrais surtout souligner le caractère paradoxal de ce désir d’enfant biologique qui aboutit grâce aux techniques, à multiplier les options de filiation. Celles-ci ne sont plus que partiellement biologiques et sont de plus en plus socialement construites. Autrefois, l’on distinguait l’enfant légitime né d’un mariage et l’enfant naturel né en dehors du mariage. L’enfant légitime n’était évidemment pas moins naturel. Cependant, son statut social était attaché au mariage fondement légal de la famille. Cette distinction a pratiquement disparu et tend à être remplacée par une distinction entre enfant biologique et enfant non biologique ou social dont le modèle est l’adoption.
Il existe une ambiguïté que recouvre la notion même de « biologique » qui peut s’entendre comme naturelle, en tant que liée au fonctionnement du corps, ou comme artificielle, en tant que produite par des techniques dérivées des sciences biologiques et médicales. Entre parenthèses, on retrouve cette même ambiguïté à propos de l’agriculture dite «biologique» qui se veut naturelle, mais qui s’oppose en cela à des techniques tout à fait biologiques, telles que celles des organismes génétiquement modifiés par exemple.
Dans le cas de la procréation, cette ambiguïté se traduit par le fait que la satisfaction du désir d’enfant biologique, associée à l’effacement des structures familiales traditionnelles, multiplie les options et les possibilités de choix pouvant conduire à des filiations éclatées entre trois, quatre, voire plus de parents, partiellement biologiques et partiellement sociaux. C’est dans ce domaine que la législation intervient nécessairement, dans la mesure où elle doit définir les droits de la famille et les structures de filiation.
Les lois sont différentes d’un pays à l’autre. On peut le déplorer dans ce monde où les échanges et la circulation des personnes se multiplient. Cependant, ce n’est pas forcément un désavantage. Souvent, on met en avant les différences de lois selon les pays pour tendre à une forme d’uniformisation. C’est peut-être une erreur. En effet, les nouvelles structures familiales qui se mettent en place constituent autant d’expérimentations sociales en temps réel.
Tout le monde est très sensible à l’expérimentation biologique sur l’homme et à ses dangers pourtant, actuellement, assez bien encadrés. L’expérimentation sociale, quant à elle, n’est pas dénuée de danger. Le fait que plusieurs sociétés différentes essaient des structures diverses peut constituer un avantage d’un point de vue comparatif. Je suppose que nous aurons l’occasion de revenir sur ces problèmes au cours des débats, notamment à propos des gestations pour autrui.
J’aborderai maintenant un point qui n’est pas tout à fait de l’ordre de l’assistance médicale à la procréation, mais qui malheureusement, lui est souvent associé dans une confusion qu’il faudrait pourtant parvenir à clarifier. Il s’agit de la problématique des lignées de cellules souches embryonnaires que l’on utilise, en laboratoire, dans un but de recherche fondamentale ou de thérapie cellulaire possible, sans qu’il ne soit jamais question d’implantation utérine ou de grossesse, donc en dehors de toute technique de procréation.
Historiquement, la confusion est venue de ce que les premières lignées de cellules souches embryonnaires, notamment chez l’animal, ont été obtenues à partir d’embryons avortés ou d’embryons produits par fécondation in vitro. Transposée à l’espèce humaine, cette technique est apparue comme un détournement de la procréation, une utilisation d’embryons à d’autres fins que leur développement en bébés ; ce que l’on a appelé une « instrumentalisation » de l’embryon, qu’une partie de l’opinion et certains courants religieux considèrent comme une offense à la dignité humaine. En fait, les sources de confusion, en ce domaine, sont encore plus profondes. Elles tiennent à une terminologie ancienne, rendue inadéquate du fait des découvertes de la biologie actuelle, en particulier de la biologie moléculaire et de la biologie post-génomique ou biologie des systèmes qui se développe actuellement.
Ce n’est pas comme on l’explique parfois, une simple question de mots car ceux-ci véhiculent des représentations. Les progrès de la biologie ont créé un écart de plus en plus grand, entre les représentations traditionnelles de la vie et de la mort, et des représentations nouvelles qui naissent des découvertes et des performances effectuées dans les laboratoires. Une confusion importante a été entretenue par un va-et-vient incessant entre des notions relativement récentes introduites par les sciences biologiques (gènes, cellules, évolutions génératrices d’espèces animales etc.), et des notions plus anciennes qui ne les recouvrent pas (vie, embryon, conscience, humanité, etc.). Les définitions anciennes ne sont plus pertinentes et les définitions nouvelles sont évolutives et, en outre, problématiques suivant l’état des connaissances qui se modifient sans cesse.
Ceci provient entre autre du fait que, pour la première fois, la science biologique permet de construire des artefacts. Autrefois seules la physique et la chimie permettaient de fabriquer des objets artificiels, la biologie était surtout une science d’observation. Elle est devenue, aujourd’hui, biotechnologie en fabriquant des objets artificiels vivants. C’est l’objectif explicite de ce que l’on dénomme biologie de synthèse. Il existe déjà des animaux transgéniques, créés à partir du transfert d’un gène d’une espèce dans une autre. Sur ce point, de nouveau, on doit prendre garde au vocabulaire employé. Certains, notamment des biologistes, emportés par l’enthousiasme devant ces souris synthétisant des protéines humaines parce qu’on leur a transféré des gènes humains, les nomment à tort « souris humanisées », comme si le gène transportait avec lui, une partie d’on ne sait quelle forme de l’homme, en oubliant qu’il n’est qu’un fragment d’ADN, c’est-à-dire de molécule.
Un exemple spectaculaire démontre comment la biologie actuelle provoque l’éclatement des définitions traditionnelles ; il concerne justement la notion d’embryon. Il ne s’agit évidemment pas de la question ancienne visant à déterminer à partir de quand un embryon est une personne humaine, mais plus en amont de celle qui consiste à savoir à partir de quand une cellule ou un groupe de cellules doit être considéré comme un embryon. C’est là une question nouvelle. Autrefois, la réponse évidente était : à partir de la fécondation. Cependant, quand c’est un ovule transformé sans fécondation, par transfert de noyau adulte, il n’y a pas de raison, a priori, de considérer cet artefact de laboratoire comme un embryon.
Il est vrai qu’après la naissance de Dolly et la preuve qu’il était possible de faire se développer un organisme à partir de transfert nucléaire donc sans fécondation, on a dénommé l’ovule transformé « embryon ». On voyait notamment dans son génome, l’organisme futur, contenu tout entier en puissance, avec toutes ses possibilités de développement. Cette conception est, aujourd’hui, de plus en plus reconnue comme étant erronée. De plus, cette problématique se trouve désormais dans un contexte scientifique nouveau du point de vue de la biologie fondamentale. Les retombées théoriques du clonage de mammifère, considéré comme impossible pendant très longtemps, ne sont pas pour rien dans ce renouvellement de la biologie que nous dénommons biologie post-génomique ou biologie des systèmes.
Très schématiquement, aux XVIIIème et XIXème siècles, deux conceptions s’opposaient, sur les mécanismes du développement. Selon le préformationnisme, l’œuf contient un organisme en miniature appelé homonculus, dans lequel tout est déjà présent. Le développement n’est alors qu’un accroissement. Au contraire, dans l’épigenèse, les structures de l’organisme apparaissent nouvelles au fur et à mesure du développement. Alors même que personne ne croyait plus vraiment à l’homonculus, la génétique moléculaire a institué, pendant quelques décennies, un néo-préformationnisme prétendant que tout était déjà présent dans le génome. Ce dernier était considéré comme un programme de développement n’ayant plus qu’à être exécuté. La notion même d’épigenèse avait totalement disparu des manuels de biologie. Or, l’importance de cette notion est de plus en plus reconnue, du fait de la découverte d’une plasticité cellulaire, insoupçonnée, dans les mécanismes moléculaires de régulation de l’activité des gènes.
Ceci explique l’importance de ce que l’on appelle désormais, l’épigénétique. Robin HOLLIDAY qui avait dès 1990 décrit la méthylation de l’ADN comme l’un des mécanismes moléculaires de l’héritabilité épigénétique en donnait la définition suivante : « La génétique classique a révélé les mécanismes de transmission des gènes d’une génération à une autre. Mais, le rôle des gènes dans le déroulement du programme de développement reste obscur. L’épigénétique consiste en l’étude des mécanismes qui permettent le contrôle, dans le temps et dans l’espace, de l’activité de tous les gènes requis pour le développement d’un organisme complexe, du zygote à l’adulte ».
Ainsi, contrairement à ce que l’on entend trop souvent, toutes les possibilités de développement ne se trouvent pas d’emblée dans la cellule initiale. Des possibilités nouvelles s’ajoutent, les unes et aux autres, au fur et à mesure du développement. Évidemment, une implantation réussie dans un utérus est une condition sine qua non pour que l’on puisse parler véritablement d’embryon.
Dans le cas de la fécondation in vitro, on parle « d’embryon pré-implantation » et l’on peut se demander s’il s’agit alors d’un embryon. Mais, dans les cas de transferts nucléaires, on perçoit bien que l’artefact n’est pas encore un embryon. Nous avons proposé, avec Mireille DELMAS-MARTY, de le dénommer « pseudo-embryon », bien qu’il puisse devenir sous certaines conditions, d’implantation utérine, un embryon. J’imagine que ce type de raisonnement n’est pas familier de tous. Néanmoins, ce gradualisme, observé tant dans le développement que dans l’évolution, conduit à abandonner des définitions essentialistes pour des définitions évolutives. L’essence de l’arbre n’est pas dans le germe. Ce qui n’est pas un arbre peut devenir un arbre ; ce qui n’est pas un homme peut devenir un homme ; ce qui n’est pas un embryon peut devenir un embryon.
Cela risque d’être encore plus évident dans un avenir, peut-être plus proche qu’on ne le croit. En activant certains gènes, des chercheurs américains et japonais ont réussi, en 2006, à dédifférencier des cellules de peau humaine et à les transformer en cellules souches pluripotentes semblables à des cellules souches embryonnaires et susceptibles de se développer et de se différencier à nouveau en produisant des cellules de tous tissus. C’est un exemple de plus, spectaculaire, de la plasticité cellulaire que j’évoquais précédemment. Cette découverte a été accueillie comme une panacée future, puisqu’elle dispense de l’utilisation d’embryons et même de pseudo-embryons.
Cependant, la situation risque de se complexifier si nous parvenons demain à dédifférencier un peu plus des cellules adultes pour en faire des cellules non seulement pluripotentes, mais aussi totipotentes, c’est-à-dire susceptibles de produire des organismes et de se développer comme si elles étaient des embryons. Ceci reviendrait à réaliser, chez les mammifères, l’équivalent du bouturage chez les végétaux, c’est à dire le développement d’un arbre à partir de cellules adultes d’un autre arbre. Cela signifiera-t-il que chaque cellule de la peau devra être considérée comme un embryon puisqu’elle pourra potentiellement se comporter comme tel ? La même question se poserait si, demain ou après-demain, des recherches sur la parthénogenèse aboutissaient à faire naître des organismes de mammifères par parthénogenèse, par stimulation adéquate de l’ovule et sans transfert de celui-ci. Cela signifiera-t-il qu’un ovule non fécondé devra être considéré comme un embryon ?
Quant à ce qui a déclenché un nouveau débat : le transfert nucléaire interspécifique, tel le transfert d’un noyau de cellule adulte humaine dans un ovule énucléé de lapine. Cette voie nouvelle pour fabriquer des cellules souches embryonnaires a été inaugurée en Chine, il y a quelques années, et récemment reprise au Royaume-Uni, malgré l’opposition d’une partie de l’opinion qui y voyait une utilisation de chimères ou d’embryons chimériques appelés encore ainsi malheureusement.
De nouveau, c’est une terminologie malheureuse qui est à l’origine, en grande partie, d’un faux débat car, dans ce cas de figure, il ne s’agit ni d’un embryon, ni d’une chimère. D’une part, il n’y a aucune chance que des organismes se développent à partir de ces cellules doublement artificielles. D’autre part, la dénomination de chimère est encore plus trompeuse, les chimères sont des organismes dont toutes les cellules n’ont pas les mêmes gènes. Il en existe de différentes sortes, dont certaines sont naturelles et d’autres sont fabriquées en laboratoire.
Des chimères particulièrement spectaculaires ont ainsi, été fabriquées, il y a plus de trente ans, en fusionnant deux embryons d’espèces voisines, à savoir l’un de mouton et l’autre de chèvre, et en les faisant se développer jusqu’à obtenir un organisme adulte en partie mouton, en partie chèvre. La possibilité de fabriquer des chimères homme chimpanzé avait immédiatement été évoquée. C’est précisément cela que la loi de 1994 a interdit de manière explicite. Dans les artefacts produits par transfert nucléaire homme lapine par exemple, il ne s’agit absolument pas de cela. Les cellules souches fabriquées ont les propriétés génétiques des cellules humaines d’où a été prélevé le noyau avec son génome totalement humain, identique à celui chez qui le prélèvement a été effectué. Quant aux ADN des mitochondries du cytoplasme animal, il est probable que nous parviendrons à les faire disparaître et à les remplacer par la reproduction de mitochondries humaines prélevées en même temps que le noyau. En outre, évoquer à ce propos, la transgression de la barrière des espèces est abusif car ce n’est pas plus une transgression que l’utilisation d’une prothèse animale.
On constate combien il est important d’utiliser une terminologie adéquate et rigoureuse pour évoquer ces réalités nouvelles. Ceci est, d’abord, de la responsabilité des chercheurs. La biologiste chinoise, Mme HUI-ZHEN SHENG, qui, la première, a publié ces résultats en 2003, ne s’est jamais permise d’appeler ces constructions cellulaires autrement que sous le terme « unité de transfert cellulaire interspécifique ». Les chercheurs anglais ont été embarrassés lorsqu’ils ont cherché des dénominations plus courtes. Ils ont imaginé le terme « cybrid », contraction de « cytoplasmic hybrid ». Certains ont proposé le terme « pseudo-hybride », la pire proposition ayant été « embryon chimérique » dont on vient de montrer à quel point ce terme est inadapté et crée des réactions parfaitement injustifiées.
Il en va aussi, et peut-être surtout, de la responsabilité des médias qui reprennent et amplifient telle ou telle terminologie. Ils détiennent la responsabilité d’orienter le débat public dans le sens d’un débat sur les termes, plutôt que dans celui d’un débat sur le fond des procédures. Je suppose que des journalistes sont présents ici, et j’en termine par cet appel à leur rigueur et à leur responsabilité, compte tenu de l’importance du rôle critique qu’ils sont susceptibles de jouer dans la transmission de l’information au public non spécialisé.
8 M. Alain CLAEYS
Je vous remercie. Avant de donner la parole à Axel KAHN et d’ouvrir le débat, je tiens à saluer Claude BIRRAUX qui est le Président de l’Office parlementaire et qui a la gentillesse de venir participer à une partie de ces discussions.
8 M. Axel KAHN, Président de l’université Paris V- Descartes, membre de l’Académie des sciences, membre du Conseil scientifique de l’OPECST
Je traiterai de l’assistance médicale à la procréation, non pas principalement en tant que biologiste quoique j’entrerai dans le détail des techniques qui devront être débattues par les parlementaires, mais en tant que personne s’interrogeant sur les bases, stables, évolutives, voire dépendantes de l’évolution des sciences, de la réflexion éthique quant à la légitimité des pratiques. Ayant explicité cela, j’essaierai d’utiliser les quelques éléments proposés pour analyser les pratiques dont vous aurez à discuter. J’exposerai ce que j’en pense, de ce point de vue, sachant que le législateur agira comme bon lui semble, après en avoir discuté sans faux semblant.
Je fais partie de ceux qui, en quelque sorte, sont partisans d’un nouveau fondationnisme moral. Je suis opposé à la pseudo évidence du relativisme moral et je considère – je ne redévelopperai pas toute mon argumentation à ce propos, celle-ci étant présentée dans différents ouvrages – que la réciprocité entre les êtres est une condition essentielle pour que des êtres biologiques, ayant un génome humain, aient émergé à l’humanité. Elle constitue la base de toute approche morale des actions ou des desseins.
C’est une manière de présenter les choses comme vous l’avez fait, M. CLAEYS, lorsque vous vous êtes interrogé sur les droits des protagonistes. Quels sont les droits de l’homme, de la femme, des partenaires homosexuels, de l’enfant lorsque l’on propose que soient utilisées des techniques innovantes liées à l’AMP ? S’il y a réciprocité entre les partenaires, toute incertitude qui semblerait inacceptable, concernant l’acteur de l’action n’est pas moralement légitime. La réciprocité est l’élément essentiel de l’appréciation de la légitimité morale des actions, y compris dans ce domaine.
Ces quelques bases étant rappelées, demandons-nous si l’utilisation de l’assistance médicale à la procréation est légitime. Y a-t-il véritablement, un phénomène totalement nouveau dans l’utilisation de la biologie moderne pour permettre à des hommes et à des femmes, qui rencontrent quelques difficultés à parvenir à avoir des enfants par les procédés traditionnels? Je ne le crois pas. Je n’argumenterai pas quant au concept de droit à l’enfant. Il s’agit là d’un autre débat, d’ailleurs tout à fait passionnant.
Il est évident que pour des couples désirant un enfant, l’impossibilité d’en avoir a toujours été vécue comme une épreuve épouvantable. Jadis, suivant les périodes et les civilisations, on appelait le chamane qui faisait des grigris sur le ventre de la femme ; la femme frottait son ventre contre une statue censée permettre aux femmes stériles d’avoir un enfant ; on disait une neuvaine ; on trempait son ventre dans l’eau bénite ; que sais-je encore ? En réalité, depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes, qui ne parvenaient pas à avoir des enfants, ont eu recours à mille procédés appartenant à la magie, pour atteindre ce but avant que la science ne s’en mêlât.
L’efficacité incertaine des pratiques magiques s’étant révélée, celles-ci ont été progressivement remplacées par des pratiques biologiques dont l’efficacité est avérée. C’est ce qui a effectivement profondément changé. On considère qu’il s’agit de moyens modernes utilisés pour parvenir au même résultat, celui de trouver une solution à la douleur de n’être pas mère, de n’être pas père quand on désirerait l’être. En conséquence, je ne pense pas qu’une modification considérable soit survenue au niveau du désir des couples. Cependant, le pouvoir de leur permettre d’exaucer ce désir a, lui, évolué. De ce point de vue, l’intervention des tiers est tout à fait importante.
À partir de ces prémices, il faut analyser les différentes étapes de l’AMP. Chacune de ces étapes a été débattue par le passé, et pourra de nouveau, faire l’objet de discussions et de propositions d’évolutions. Commençons par le début, à savoir le don de gamètes qui constitue, souvent, la première étape de l’AMP. Dans ce cadre, se pose la question importante de la compatibilité entre l’anonymat et le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines, reconnu par certaines conventions internationales. On pourrait entièrement consacrer ce débat à cette question.
Il faudrait parvenir à éliminer les faux-semblants et les fausses évidences en la matière. Personne ne peut nier la douleur, voire la détresse, d’un enfant qui sait que ses origines et le mode de sa conception posent problème, qui désire en savoir plus, mais qui n’a pas la possibilité d’accéder à certaines informations qui lui sont masquées. Il se trouve, alors, dans l’attente douloureuse d’une vérité qui lui échappe alors qu’il est en quête de celle-ci. En revanche, dans d’autres cas – et nous en connaissons tous le lien entre l’enfant qui regarde un homme et une femme comme ses parents, et cet homme et cette femme qui le regardent comme leur enfant n’a rien à voir avec la parenté génétique des uns et des autres.
Je rappelle encore qu’aujourd’hui, entre 3 % et 4 % des paternités sont erronées, ce que tout le monde sait et qui vient d’être confirmé par une enquête de grande ampleur, alors même que les tests de paternité se développent. Certes, le recours à la contraception a fait diminuer ces chiffres. L’évidence selon laquelle il serait impératif pour le bien-être de l’enfant, de lui asséner la vérité de ses origines m’a toujours semblée curieuse d’autant plus qu’elle entre en résonance étroite avec la « biologisation » croissante de la parentalité ; être parents dans l’espèce humaine, c’est l’être par les gènes, comme pour toute espèce vivante sexuée, et l’être aussi par l’affection, par le cœur, par la tendresse, par le désir de coopérer, si couple il y a, dans l’édification, la croissance et l’éducation d’un enfant. On connaît des situations dans lesquelles une dissociation existe entre les deux.
Or, aujourd’hui, à travers certains dispositifs législatifs, comme notamment la loi HORTEFEUX, nous parvenons à remettre en avant cette évidence selon laquelle, hors de la paternité biologique, il n’y a point de salut. Elle seule mériterait d’être considérée comme une filiation à part entière. Qui ne voit qu’une cohérence se profile entre la loi HORTEFEUX et la mise en avant de la vérité sur les origines. Celle-ci devient tellement essentielle que, hors de la connaissance de la vérité sur ses origines, il n’y aurait pas, y compris sur le plan légal, de paternité à part entière ou bien celle-ci serait menacée. D’ailleurs, la loi HORTEFEUX a sans doute pour résultat d’aboutir à une remise en cause, de plus en plus évidente, de la loi de 1994. Cette dernière indique qu’en matière de paternité, l’utilisation de tests ADN de filiation doit faire l’objet d’une saisine judiciaire, étant donné que la filiation sociale dans l’espèce humaine n’est pas réductible à la filiation génétique.
Si donner son sperme ne demande pas un effort considérable, le don d’ovocytes pose un problème particulier car ce don n’est ni anodin, ni totalement dénué de risques, et demande également une motivation de la part des femmes. Celle-ci est parfois généreuse mais l’on sait aussi que ce peut être la contrainte économique qui conduit certaines jeunes femmes, malgré l’inconfort et les risques encourus, à donner leurs ovocytes. Vous devrez être très attentifs à ce point, le moyen terme, dans ce domaine, étant incontestablement d’une extrême complexité. Or, il faut des ovocytes pour répondre à la demande de nombreux couples. Il convient de s’assurer qu’une femme qui s’engage dans une démarche de don d’ovocytes puisse être normalement dédommagée et protégée, ce qui est difficile. J’ai connu des personnes qui ne donnaient leur sang que pour le sandwich qu’on leur offrait après.
Les couples homosexuels, quant à eux, s’aiment d’un amour que personne n’ira contester. Deux femmes peuvent avoir des enfants de différentes manières, par procréation médicalement assistée ou accouplement naturel dans l’assentiment de leur couple. Les hommes doivent non seulement, faire appel à une procréation médicalement assistée, mais également à une mère porteuse. Ils doivent ensuite adopter l’enfant. Comment aborder cette question ? On l’abordera comme vous l’avez proposé M. CLAEYS, soit en examinant les droits et les intérêts des différents protagonistes. Personne ne conteste la profondeur des sentiments des partenaires du couple. Par conséquent, personne ne veut connoter moralement et négativement leur désir que ce couple soit sanctionné par un enfant.
Toutefois, si le désir d’avoir un enfant est fondamental, il existe un autre élément essentiel qui est l’enfant lui-même. Or, aujourd’hui, personne ne peut prédire à coup sûr si pour cet enfant, le fait d’avoir des parents du même sexe constituera plutôt un obstacle supplémentaire ou si, grâce à l’extraordinaire capacité de résilience de l’enfant, celui-ci s’adaptera très bien à cette situation. Réellement, je ne sais pas répondre à cette question, mais j’estime qu’il est légitime de la poser. De ce point de vue, il convient d’être très prudent face à tous les intégrismes. Ceux qui consistent à dire « C’est mon droit, je le veux ! ». Certes, mais la République s’intéresse à l’enfant qui va naître, et elle demande des éléments d’appréciation. Et, au contraire ceux qui consistent à dire : « Quelle horreur ! Jamais ! ». Pour quelles raisons ? Est-ce que l’attachement, l’affection de ce couple n’est pas sincère ?
De plus en plus fréquemment, des femmes désirent un enfant une fois passée la période de l’activité procréatrice. C’est la problématique des grossesses de femmes ménopausées qui, n’ayant plus d’ovulation, recourent à un don d’ovocyte et à un don de sperme, ce qui permet d’obtenir un embryon in vitro par procréation médicalement assistée. Cet embryon est alors placé dans les voies génitales de la femme qui a été hormonalement préparée, afin qu’une grossesse survienne. Il convient aussi de traiter cette problématique comme nous l’avons fait précédemment, sans référence à la tradition du droit.
Les femmes qui ont 55 ans aujourd’hui sont belles, actives et ont une espérance de vie de trente-cinq à quarante ans. Leur demande d’enfants n’est-elle pas légitime quand un homme de 60 ans ou de 70 ans peut en avoir un ? Honnêtement, on ne voit pas comment il serait possible de connoter ce désir négativement d’un point de vue moral. Néanmoins, la légitimité de ce désir ne règle tous les problèmes. D’une part, le médecin a-t-il raison, sachant ce qu’il sait, de faire prendre un risque inconsidéré et dans certains cas un risque cardiovasculaire, à cette femme ? D’autre part, même si nous connaissons des exemples qui permettent de répondre négativement à cette question, est-ce un cadeau à faire à un enfant que de faire en sorte qu’au lieu de pouvoir montrer, à la sortie de l’école, sa jolie maman, il ne puisse montrer que sa jolie grand-mère ? Évidemment, il y a tant d’enfants, élevés par leurs grands parents, qui sont heureux que j’avance ces propos avec beaucoup de prudence. Tout schématisme doit être écarté.
Quant au problème des femmes sans utérus et la gestation pour autrui, cela mérite également d’être examiné en évitant les stéréotypes. Deux dangers peuvent être identifiés. Naturellement, on peut imaginer le cas de deux amies très chères ou de deux sœurs. L’une d’entre elles rêve d’avoir un enfant. Elle a des ovocytes normaux, mais ne peut pas porter en raison d’une malformation utérine. La seconde lui propose dans un mouvement de solidarité de porter son enfant. C’est bien une manifestation réelle de solidarité.
Mais, il serait extrêmement naïf de ne pas percevoir que dans l’immense majorité des cas, dans d’autres pays que le nôtre, il s’agit d’une activité commerciale dans laquelle s’engagent, notamment, des femmes qui se trouvent dans une situation économique difficile et qui trouvent, dans la location momentanée de leur ventre, un moyen de répondre à cette situation extrêmement dégradée. Quoi que vous fassiez, vous devrez prendre en compte cette réalité.
De plus, si vous avancez dans le sens d’une autorisation de cette pratique, vous serez confronté à un problème majeur : celui du statut de l’enfant. J’ai rapproché le cas de la femme ménopausée enceinte et celui de la gestation pour autrui à dessein. En effet, dans les deux cas, il s’agit de mères porteuses. La femme ménopausée est clairement une mère porteuse. Pourtant, elle considère comme totalement évident que l’enfant dont elle va accoucher est son enfant. Elle n’imagine pas qu’on lui dénie la maternité de cet enfant qu’elle a porté.
Or, dans certains pays, par convention, la mère porteuse n’est pas la mère de l’enfant. Pour autant, la nature des liens tissés par la mère porteuse avec le fœtus ne peut pas être liée au caractère contractuel d’une convention. C’est impossible. Par ailleurs, considérer qu’une femme qui porte un enfant pendant neuf mois et en accouche n’est qu’un utérus, l’ayant transitoirement accueilli sans qu’aucun lien affectif ne puisse s’établir, est une méconnaissance, voire une violence faite contre la femme, qu’il me semble impossible d’inscrire dans la loi.
Je serais donc très surpris, voire assez choqué, si les députés s’orientaient vers une solution qui consisterait à autoriser un type de convention contractuelle stipulant que les vrais parents sont définitivement les géniteurs et que la femme, considérée comme une simple prêteuse momentanée d’utérus, n’a pas d’autre possibilité. Si vous décidiez de vous orienter dans cette voie, et un jour ou l’autre vous y viendrez, la seule solution plausible, certes à risque, serait de conserver la loi actuelle qui considère qu’une femme est la mère de l’enfant dont elle accouche. Cette femme peut abandonner cet enfant qui sera alors adopté dans certaines conditions, avec le risque qu’elle n’accepte pas l’abandon du fait du lien affectif qu’elle a tissé. C’est le risque à prendre pour que la dignité des uns et des autres, me semble-t-il, soit respectée.
Pour l’avenir, de graves problèmes se poseront dans cinq ans ou dix ans. Aujourd’hui, comme M. Henri ATLAN l’a expliqué, il est assez facile de fabriquer des cellules souches embryonnaires à partir de tissus somatiques. C’est difficile et plus guère utile par transfert somatique de noyau. La méthode de M. YAMANAKA est maîtrisée dans plusieurs laboratoires. Ces cellules peuvent passer dans la lignée germinale, et contribuer à la fabrication d’ovocytes et de spermatozoïdes in vivo. Un jour viendra où il sera possible d’envisager de faire des enfants à partir de la peau d’hommes et de femmes totalement stériles. Nous pourrons faire bien plus, puisque ces cellules d’un homme ou d’une femmes peuvent être orientées vers une différenciation mâle ou femelle. En d’autre termes, un homme comme une femme pourront donner des ovocytes et des spermatozoïdes. On imagine la multiplicité des situations face auxquelles on se trouvera.
Vous aurez, alors, à résoudre plusieurs questions. L’une d’entre elles est la suivante. Puisque, à l’arrivée, l’on souhaite faire des sujets au sein de la communauté des citoyens, est-il bien légitime si la méthode n’est pas maîtrisée, de prendre des risques incroyables pour ces personnes? La question des artefacts a été mentionnée. Il y a la notion d’artefact pour produire un enfant et il y a la notion d’un enfant totalement « artefactualisé ». La transition entre les deux est, sans doute, ce à quoi vous aurez à faire face dans l’avenir.
8 M. Alain CLAEYS
Je vous remercie beaucoup ; nous aurons à répondre aux questions d’Axel KAHN dans quelques années. Je constate cependant que ces deux interventions ont suscité quelques questions.
‚
8 Mme Irène THÉRY, Sociologue, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Les commentaires sur les jolies mamans, expliquent les légers mouvements de réprobation dans l’auditoire. Par ailleurs, je souhaiterais indiquer ma surprise face à l’association des revendications en matière de droit à la connaissance des origines à l’idée d’une « biologisation » de la filiation, par MM. CLAEYS et KAHN. Ce n’est absolument pas comme cela que j’entends ces revendications, que ce soit chez des enfants adoptés ou chez des enfants nés par procréation médicalement assistée. Vous avez raison de rappeler que la tentation de la «biologisation » de la filiation existe. Celle-ci vise à identifier les pères au travers de tests génétiques.
Ce n’est pas ce que nous entendons de la part des nouvelles générations qui s’adressent à nous. Au contraire, les enfants refusent cette alternative. Ils expliquent qu’ils ont été engendrés et qu’ils ont été élevés. Ils considèrent que les parents qui les élèvent sont leurs parents, ce qui n’empêche pas qu’ils aient une place dans leur vie et, peut-être, dans leur cœur, pour ceux qui ont permis leur existence. Faites attention à ne pas ramener du côté de la « biologisation » et, a fortiori, du côté des propositions de M. HORTEFEUX sur l’ADN, des revendications qui, au contraire, contestent cette réduction biologisante.
8 M. Axel KAHN
Nous sommes totalement d’accord sur le fait que la quête de ses origines, par un enfant qui a un doute sur ce point, est une souffrance si celui-ci ne peut pas parvenir à une réponse satisfaisante. Il convient de lui apporter tous les éléments lui permettant de s’édifier lui-même. En revanche, il ne me semble pas totalement évident qu’il soit indispensable d’expliquer à un enfant conçu, par exemple, par don de sperme ce qu’il en est, si les parents sont à l’aise avec ce type de procréation et si l’enfant n’a aucune suspicion sur un mode de procréation ou de gestation différent le concernant. En d’autres termes, lorsque la question survient, la quête est légitime. En revanche, faut-il inciter un enfant, qui n’a pas de tels objectifs, à effectuer cette recherche en lui indiquant son mode de conception ? Cela me semble moins évident.
8 M. Patrick VESPIREN, Directeur du département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de Paris
J’ai été surpris par les propos de M. Henri ATLAN concernant les embryons qui ne sont pas encore des embryons, mais qui le deviennent car ils n’ont pas au départ tout ce qui est nécessaire pour se développer comme être humain. Depuis trente-six ans, vous écrivez que tout n’est pas dans l’ADN, que tout n’est évidemment pas dans la première cellule, et qu’il y aura un développement épigénétique. Ce n’est pas parce que tout n’est pas présent au départ qu’il faut user de catégories différentes. La notion de pseudo-embryon rejoint quelque peu le pré-embryon anglais.
8 M. Claude HURIET, Président de l’Institut Curie
Au début de son propos, Axel KAHN a fait référence au concept de légitimité morale. Peut-il développer ce point ? Je ne perçois pas très clairement de quoi il peut s’agir.
8 M. Dominique MENNESSON, Co-président du Comité de soutien pour la légalisation de la gestation pour autrui et l'aide à la reproduction assistée (CLARA)
Axel Kahn a évoqué la réciprocité et a établi un parallèle entre la gestation pour autrui (GPA) et le cas de la femme faisant appel à un don d’ovocyte. Ce raisonnement me semble infondé. Si nous appliquons la réciprocité pour l’homme, aucun homme ne serait un père.
Par ailleurs, vous affirmez que l’immense majorité des conventions de GPA est de type commercial et fixe la filiation. Ce n’est pas ce que nous constatons sur le terrain. Je vous rappelle qu’une convention de GPA, en droit, consiste en une description d’un protocole et que la filiation est édictée par la loi, même dans les pays où les GPA sont autorisées.
Ce point est extrêmement important puisqu’un protocole médical est basé sur le consentement éclairé et compatible avec toutes les autres lois en termes de liberté individuelle. Enfin, je ne perçois pas clairement la réciprocité entre le droit de l’enfant qui, quand il est à l’état d’embryon, ne peut pas s’exprimer, et l’intérêt d’une mère.
8 M. Henri ATLAN
Nous avons besoin de catégories différentes à cause du gradualisme que nous observons de plus en plus, en raison de la plasticité cellulaire. Effectivement, dans le cas des embryons produits par fécondation in vitro – la seule différence avec ce qui se passe naturellement étant que la fécondation s’effectue dans ce cas en laboratoire, au lieu du ventre d’une femme – je ne veux pas me prononcer sur la question de savoir s’ils doivent être considérés comme des pré-embryons ou comme des embryons préimplantatoires.
Il ne s’agit pas d’une question biologique, mais d’une interrogation liée à la question métaphysique de savoir à partir de quand un embryon humain devient une personne humaine. Chacun a une opinion contrastée sur ce sujet. Je fais partie de ceux qui considèrent que l’embryon devient une personne humaine beaucoup plus tard. Mais ce n’est pas ce sur quoi je m’interroge ici. L’interrogation porte sur des artefacts, soit des cellules produites sans fécondation et qui, sous certaines conditions, pourraient peut-être se développer et se comporter ensuite comme des embryons produits par fécondation. Je considère que dans la fabrication de ces artefacts, on observe un gradualisme encore plus grand qui aboutit ou aboutira, dans un avenir plus ou moins proche, à des situations exigeant un changement de catégories.
Par exemple, dans le cas du transfert nucléaire entre homme et lapine, on n’a aucune raison de considérer le résultat comme un embryon, même si l’on fabrique, à partir de celui-ci, des cellules embryonnaires qui disposent apparemment de toutes les propriétés des cellules embryonnaires humaines, ou pourraient les avoir. Si, au cours de leur développement, il est possible que ces constructions cellulaires artificielles présentent certaines propriétés des embryons, elles ne les présenteront pas toutes. D’ailleurs, les essais d’implantation utérine de ces constructions produites par transfert nucléaire inter spécifique chez l’animal n’ont abouti qu’à des avortements.
Dans l’avenir, on risquerait de se retrouver dans une situation où n’importe quelle cellule adulte humaine pourrait être considérée comme un embryon si on parvient à la déprogrammer et à la reprogrammer pour la conduire à repartir vers un état de totipotence. L’on n’est pas encore parvenu à ce résultat, mais l’on sait déjà déprogrammer et reprogrammer des cellules pour en faire des cellules pluripotentes.
8 M. Axel KAHN
J’ai fait remarquer que la situation biologique de deux femmes qui se font transférer dans les voies génitales, l’ovocyte d’une autre femme fécondé par un donneur, est identique, même si l’une est une femme ménopausée et l’autre une femme plus jeune ayant passé une convention avec un couple géniteur. Elles sont toutes deux biologiquement des mères porteuses. C’est une évidence, je crois. J’en ai conclu qu’il était difficile que les conventions concernant l’enfant soient radicalement différentes dans un cas et dans l’autre. Je fonde cette proposition sur l’argument suivant : une convention, de quelque nature qu’elle soit, ne peut annihiler totalement les liens affectifs qui se développent entre la femme et l’enfant qu’elle a porté et dont elle accouche. Cela me choque.
Concernant la légitimité morale, j’explique, dans mon dernier ouvrage ce que sont, pour moi, le bien et le mal. J’ai également mentionné la réciprocité. Simplement, est bien tout ce qui manifeste l’évidence du respect dû à l’autre et mal l’inverse. Quand je parle de légitimité morale, j’évoque sur ces bases, une action qui constitue une chance d’épanouissement et une chance de diminution de la détresse et de la souffrance d’autrui. Une telle action fondée sur des bases qui pour moi sont robustes, dispose d’une certaine légitimité morale.
ACCÈS Á L’AMP EN FRANCE :
BILAN ET ÉVOLUTIONS POSSIBLES
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Je propose que nous ouvrions les travaux de la première table ronde dont le thème est l’accès à l’AMP en France : bilan et évolutions possibles. Nous accueillons, dans ce cadre, M. François THÉPOT, M. Pierre JOUANNET et Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER.
8 M. François THÉPOT, Adjoint au directeur médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine
J’essayerai de vous présenter, un état des lieux de la pratique médicale à une échelle macroscopique. Nous disposons, en France, d’une définition très précise de l’assistance médicale à la procréation (AMP) qu’il faudra, je pense, pouvoir parfois relativiser. L’AMP s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel… » (Article L. 2141-1 du Code de la santé publique -CSP-)
Cette définition ne recouvre pas toutes les techniques pouvant prendre en charge l’infertilité (infécondité) ou la stérilité. Elle exclut des stimulations ovariennes responsables de 80% des grossesses multiples de haut rang.
Tous les moyens d’obtenir un enfant ne font pas forcément partie de l’AMP. Par exemple, toutes les stimulations ovariennes n’entrent pas dans le cadre défini dans le CSP. Tout démontre que l’AMP est un traitement efficace de la fécondité, décisif dans de nombreuses situations. Certes, il est relatif dans sans doute 50 % des cas, mais nous avons tous une durée de vie limitée et le temps entre dans la décision de recourir ou pas à cette pratique. Dans tous les cas, il s’agit d’un traitement palliatif qui ne restaure pas la fertilité dont il convient de privilégier le rétablissement quand il est possible.
La spécificité et les pratiques en France
Deux voies d’approche sont possibles pour l’AMP : en faire un traitement de l’infertilité ou utiliser ses propriétés pour en faire un nouveau mode de procréation. La spécificité française consiste à considérer l’AMP comme appartenant à la première catégorie, et non à la seconde, ce qui explique le dispositif contraignant (couple formé d’un homme et d’une femme, durée d’infertilité suffisante, éléments démontrant la réalité de l’infertilité). Sur la base de cette définition, l’AMP représente selon les données de 2006, en France, 2,4 % des naissances (environ 1/40). Un couple sur 20 y a recours (un sur 5 consultera pour « difficulté à procréer »).
La population qui a recours à ces pratiques est relativement stable depuis cinq ans, mais avec une augmentation des techniques plus sophistiquées (ex. ICSI, environ 60% en 2006). Nous constatons, chaque année, une hausse du taux de grossesses et une baisse du taux de grossesses multiples. Enfin, jusqu’à présent, aucun effet délétère n’a été complètement prouvé, ni sur les enfants, ni sur les femmes. Il faut néanmoins rester prudent sur ce sujet.


L’AMP est donc un traitement médical utilisé pour traiter l’infertilité ou pour éviter la transmission d’une maladie. Les statistiques démontrent qu’aucune de ces techniques ne permet d’avoir un enfant à chaque fois. Au bout de 8 tentatives, nous aboutissons à des taux cumulatifs situés entre 60 % et 70 %. En conséquence, environ 30 % des couples repartiront, en fin de démarche d’assistance médicale à la procréation et après un parcours souvent difficile, sans enfant.
Enfants nés après AMP selon la technique et l’origine des gamètes | |
Type d’AMP |
Enfants nés vivants (nb : 20 043) |
Insémination intra-utérine intraconjugale |
5169 |
FIV hors ICSI intraconjugale |
4473 |
ICSI intraconjugale |
7174 |
TEC intraconjugale |
1988 |
AMP avec spermatozoïdes de donneur |
1123 |
AMP avec don d'ovocytes |
106 |
Accueil d’embryons |
10 |
Données : Agence de la biomédecine
La demande est stable, sachant que l’Agence de la biomédecine effectue un recueil exclusif et exhaustif de tous les centres d’assistance médicale à la procréation. Les perspectives d’amélioration portent plus sur la qualité de cette prise en charge, que sur la quantité. Ainsi, nous favorisons les systèmes d’information et mettons en place des protocoles qui permettent une sensibilisation sur les grossesses multiples. Par ailleurs, il ne faut pas confondre les 5 000 enfants qui sont issus annuellement de pratique d’insémination avec les 15 000 enfants environ, issus des techniques de fécondation in vitro, avec ou sans utilisation d’un tiers donneur. Enfin, en 2006, l’accueil d’embryons sans projet parental a commencé.
Quelles pratiques dans le monde
Les éléments de comparaison qui restent à traiter tournent autour de trois thématiques : la qualité et les risques pour les personnes, notamment la responsabilité, la transparence des résultats, l’accès équitable aux soins et le remboursement.
La France se situe dans la moyenne des pays à système de santé comparable. Par millions d’habitants, 2 000 cycles sont enregistrés au Danemark, contre 663 cycles au Royaume-Uni et 750 cycles en Allemagne. Au Danemark, 4,2 % des enfants sont issus de la fécondation in vitro, ce taux représentant 1,6 % dans les deux autres pays.
ART* in those countries where all clinics reported to the national register in 2004 | |||||||
Country |
Cycles |
Population |
Cycles/ million |
ART deliveries |
ART infants |
National births |
ART infants (%) |
Denmark |
11 518 |
5 413 392 |
2 128 |
2 152 |
2 616 |
62 741 |
4,2 |
France |
69 746 |
60 424 213 |
1 154 |
10 460 |
12 664 |
745 634 |
1,7 |
Germany |
56 813 |
75 212 900 |
755 |
8 458 |
10 270 |
643 822 |
1,6 |
UK |
39 981 |
60 270 708 |
663 |
8 338 |
10 301 |
655 745 |
1,6 |
* Data refer to IVF, ICSI, FER and ED combined D'après ESHRE Human Reprod. 2008 | |||||||
Ces statistiques peuvent laisser suspecter que la France ne se situe pas parmi pas parmi les pays les plus en pointe sur l’AMP ; elles doivent, néanmoins, être relativisées.
Résultats par technique en grossesses échographiques par tentative | ||
|
Maximum |
Minimum |
Inséminations |
18,2% (IIU-D) |
12,2% (IIU) |
FIV hors ICSI |
33,6% (DO) |
24,2% (FIV-D) |
ICSI |
28,8% (ICSI-D) |
25,8% (ICSI) |
TEC |
24,6% (AE) |
17,4% (TEC) |
Données Agence de la biomédecine France 2006 (publication 2008) | ||
Ainsi, selon des éléments assez récents et contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, une des spécificités françaises serait la répartition relativement homogène des centres et des résultats, contrairement à ce qui a été souligné.
8 M Alain CLAEYS
Cela nous a été explique au cours de plusieurs auditions.
8 M. François THÉPOT
Il semble donc qu’existe un problème d’information sur ce point et j’essayerai de le démontrer. Les données sont récentes car l’Agence est elle aussi récente. Certes, il existe un problème d’information.
En termes de nombre de centres d’AMP, le Danemark en compte 21, la France 104, l’Allemagne 120 et le Royaume-Uni 74. Par ailleurs, nous pouvons atteindre 20 % de taux de grossesses par insémination lorsque nous sommes dans un système de donneurs fertiles. En revanche, le taux tombe à 12 % pour les inséminations avec des spermes de couples qui n’arrivent pas à avoir d’enfant. Il faut tenir compte de ces données pour pouvoir effectuer une analyse par centre. Or, les structures étant plus ou moins spécialisées, la comparaison est difficile. Au niveau des dons d’ovocyte, nous obtenons 33 % de taux de grossesses. Enfin, le plus mauvais résultat en FIV avec sperme de donneur se situe à 24 % de taux de grossesses.
En France, il existe bien un accès égalitaire et équitable à l’AMP en tant que traitement et une véritable protection des femmes, puisque des systèmes de consentement sont prévus. On essaie d’optimiser l’utilisation des embryons et le principe de la gratuité reste, pour nous, un principe essentiel de régulation. Effectivement, on fait face à la question de l’enfant à tout prix comme cela a déjà été mentionné, le business procréatif est présent sur Internet.
Or, il convient de faire la différence entre les pays ayant pris une option libérale et les pays se concentrant sur une AMP traitement, et faire la part entre l’AMP intra-couple, et l’ouverture, au niveau international, de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Un article récent, d’une page entière, dans « Libération » vante les centres espagnols. Dans le centre mentionné, un cinquième des patientes sont françaises, 80 % viennent d’un autre pays. Les cas concernent, en général, des recours à tiers donneur du fait de la législation française ou des délais.
En termes de questions en suspens, il faut absolument réfléchir à la problématique de la qualité et des risques. Ce dernier point est d’autant plus important que, si nous ouvrons le business procréatif en France, l’on se retrouvera confronter à un problème de responsabilité au niveau de la naissance. La transparence des résultats pose également des difficultés et il faut traiter l’accès équitable aux soins dans toutes les techniques.
Je tiens à vous démontrer, au travers d’un petit exemple, que le problème n’est pas seulement médical. Si une insuffisance ovarienne constitue une pathologie à 30 ans, elle est considérée comme pratiquement naturelle à 40 ans et, à 45 ans, il faut se rendre en Espagne. De la même manière, une insuffisance spermatique est pathologique à 30 ans, à 50 ans, elle est relativement normale et on fait subir, à la femme, une ICSI. À 60 ans, on estime que l’homme est peut-être un peu vieux, et à 80 ans, on le considère comme trop vieux. Sur ces points, nous ne sommes pas confrontés à un problème médical, mais à un problème de société auquel il faut réfléchir.
L’offre internationale s’accélère. Faut-il, dans ce cadre, jouer la complémentarité ou l’homogénéité ? Le dispositif national constitue un ensemble pertinent. Il a, sans doute, des atouts, mais il peut certainement être amélioré. Enfin, les choix stratégiques nationaux ne reposent pas forcément sur des prérogatives médicales. Les choix de société conditionnent donc tout le dispositif. Des aménagements sont sûrement possibles dans des cas spécifiques. Cependant, ils doivent être limités car le fait de changer un élément remettra en cause l’ensemble. Si nous décidons de remettre l’ensemble en cause, nous devons savoir où nous souhaitons aller.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Vous avez mentionné l’exemple espagnol. D’après nos informations, les Espagnols acceptent les dons multiples d’ovocytes, certaines femmes passant ainsi, de centre en centre, pour donner leurs ovocytes. Compte tenu de l’ampleur que ce business a prise, ils sont obligés d’« importer » des donneuses d’Europe Centrale. L’on se trouve vraiment dans un cas de marchandisation complète du corps de la femme. Je ne pense pas que ce soit ce type de dérives que l’on souhaite pour notre pays.
Par ailleurs, je ne suis pas certain que l’orientation vers une homogénéisation de l’offre internationale soit une nécessité. Les Pays-Bas ont dépénalisé le cannabis ; nous n’avons pas forcément envie de les imiter en France. Certains pays ont maintenu la peine de mort ; devons-nous revenir sur ce principe ? L’on ne peut pas toujours regarder ce qui se passe chez les autres pour prendre des décisions qui nous concernent.
8 M. François THÉPOT
Ce n’était qu’une question.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Je vous remercie et donne la parole à M. Pierre JOUANNET, Vice-président du Comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine.
8 M. Pierre JOUANNET, Vice-président du Comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine, médecin à l’hôpital Cochin, membre correspondant de l’Académie de médecine
Dans le titre de cette table ronde, vous évoquez le bilan et les évolutions possibles de l’accès à l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP). Dans le bilan, il faut citer la création, par la loi de 2004, de l’Agence de la biomédecine qui nous permet, aujourd’hui, de disposer d’éléments sur lesquels fonder notre réflexion et nos discussions. Sous l’impulsion de Carine CAMBY, cette Agence a réalisé un travail très important depuis trois ans. Nous ne pouvons que souhaiter que l’Agence perdure et qu’elle dispose d’encore plus de moyens pour travailler.
En matière de bilan, il convient aussi d’examiner comment la loi et les choix que la société a fait à cette occasion ont été mis en œuvre. Sur ce sujet, je voudrais évoquer deux points : les difficultés de la mise en œuvre des techniques d’AMP prévues par la loi, en prenant l’exemple du don d’ovocyte, et l’amélioration des performances et de la qualité de ces techniques.
Bien sûr on pourrait estimer que la société n’a pas à s’occuper de l’AMP et que l’absence d’enfant n’est pas un problème, comme l’a suggéré Axel Kahn. Cette opinion, tout à fait respectable, ne correspond cependant ni à celle des personnes en frustration d’enfants, ni à la situation mondiale. Dans tous les pays du monde, y compris ceux dont les politiques démographiques sont les plus restrictives comme la Chine, l’AMP existe. Aussi, ne peut-on ignorer les questions relatives à la qualité et à la performance des techniques d’AMP.
Activité du don d’ovocyte en France
En matière de don d’ovocyte, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement en France. Nous ne connaissons même pas le niveau exact de la demande. L’Agence de la biomédecine estime que, en 2005, il y avait environ 1 300 couples demandeurs de don d’ovocyte. Nous ignorons le nombre de femmes qui seraient volontaires pour être donneuses. Nous savons que, en 2005, 168 prélèvements d’ovocytes ont été effectués qui ont permis 281 cycles de fécondation in vitro (FIV), 212 transferts d’embryons congelés, 118 grossesses cliniques et 90 accouchements, qui ont conduit à la naissances de 100 enfants.
En France, 25 centres sont autorisés à procéder à des dons d’ovocyte mais seulement 19 étaient actifs en 2005. Dans 9 régions, il n’y avait aucune activité et 6 régions ont enregistré moins de 10 FIV avec don d’ovocytes en 2005. Cette année là, près des deux tiers de l’activité a été concentrée sur l’Ile-de-France et la Bretagne ( figure 1 ).
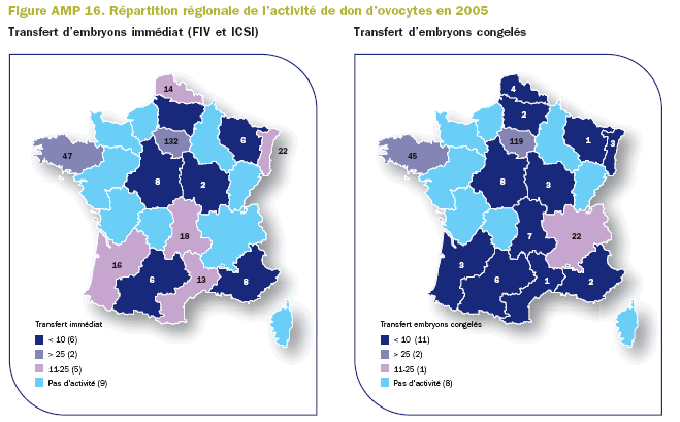
Figure 1 : Bilan régional de l’activité de don d’ovocyte en France en 2005 (d’après le bilan réalisé par l’Agence de la Biomédecine)
Ceci s’explique en grande partie par le fait que les administrations hospitalières et les pouvoirs publics n’ont donné aucun moyen spécifique pour que cette activité puisse être menée dans de bonnes conditions. Selon moi, ceci constitue un réel problème. Le don d’ovocyte est possible depuis 1994, mais sa mise en œuvre dans les établissements est restée confidentielle, voire inexistante et n’est absolument pas adaptée aux choix et aux besoins de la société.
Les difficultés du don d’ovocyte en France s’expliquent aussi par une réglementation longtemps inappropriée. Pour des raisons de sécurité sanitaire mal comprises, on ne pouvait transférer les embryons qu’après une quarantaine de 6 mois pendant laquelle ils étaient conservés congelés. C’était complexe et inefficace. Heureusement, la réglementation a changé en 2004. Enfin, aucune action d’information et de sensibilisation des donneuses potentielles n’a été conduite avant le mois de mai 2008. Grâce à la campagne entreprise par l’Agence de la Biomédecine à partir de cette date, on peut espérer une amélioration du recrutement si les centres disposent par ailleurs des moyens nécessaires pour prendre en charge les femmes qui seraient volontaires.
J’aurais pu prendre d’autres exemples de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi. Mais au-delà de ces défaillances et avant de savoir si la loi devrait prévoir un élargissement de l’accès à l’AMP, il me semble nécessaire d’envisager comment les pratiques existantes pourraient être améliorées.
Évolution de la procréation médicalisée
Peut-on réduire les contraintes et les risques liés à l’AMP ? Les contraintes sont celles que subissent en général les femmes qui reçoivent des traitements pour une fécondation in vitro et dont les tentatives se répèteront si les taux de succès sont trop faibles. Les risques concernent les femmes mais aussi les enfants qui naissent de ces traitements.
Il devrait être possible de développer des techniques plus adaptées à la diversité des gamètes et des embryons afin d’améliorer les taux de succès, en identifiant mieux les gamètes et les embryons susceptibles de donner naissance à un enfant en bonne santé.
Par ailleurs, faire évoluer les stratégies de transfert embryonnaire pour réduire les risques des grossesses multiples devrait être une priorité. En effet, aujourd’hui le principal risque de ces techniques, pour la santé des enfants, est lié aux grossesses multiples qui se terminent souvent par une naissance prématurée. Le souci de diminuer l’incidence des grossesses multiples après AMP a incité plusieurs pays européens à mener des actions coordonnées au plan national en matière du transfert embryonnaire.
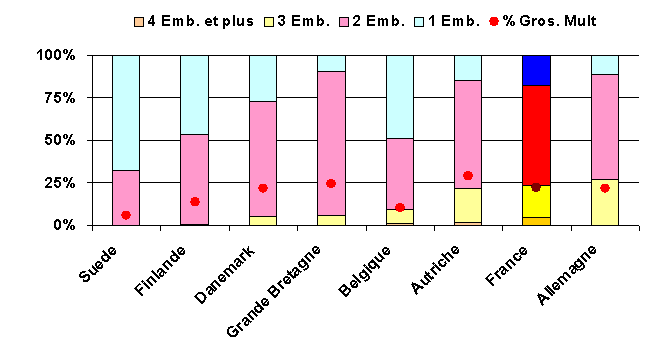
Figure 2 : proportion de transferts réalisés avec 1, 2, 3 ou 4 embryons ou plus après fécondation in vitro dans différents pays européens en 2004 et taux de grossesses multiples (d’après Andersen et al., Hum. Reprod., 23, 756-71, 2008)
Le dernier bilan européen publié récemment montre que les stratégies de transfert embryonnaire sont variables d’un pays à l’autre. Dans certains pays, comme la Suède et la Finlande, plus aucun transfert ne s’effectue avec trois embryons et dans leur majorité, les transferts concernent un embryon. La Belgique a également mis en place une politique nationale dans ce domaine. En revanche, la France n’a pas vraiment mis en oeuvre de stratégie. La proportion de transfert d’un embryon est minime, comme en Allemagne et en Autriche et les transferts de trois embryons et plus sont nombreux dans ces trois pays. Il existe clairement un lien entre les stratégies de transfert embryonnaire et le risque de grossesses multiples. En 2004, plus de 20 % des grossesses obtenues après FIV étaient gémellaires ou triples dans tous les pays qui n’avaient pas développé de politique de transfert d’un embryon. Elles étaient deux fois moins nombreuses en Belgique et quatre fois moins nombreuses en Suède ( figure 2 et tableau 1).
Allemagne |
Belgique |
France |
Suède | |
Proportion de femmes de ≥ 35 ans |
||||
traitées en FIV (%) |
43 |
41 |
49 |
52 |
traitées en ICSI (%) |
41 |
39 |
38 |
48 |
Proportion de cycles avec transfert |
||||
de 1 embryon (%) |
12 |
49 |
17 |
67 |
de ≥ 3 embryons (%) |
27 |
9 |
23 |
0 |
Grossesses cliniques/ponction |
||||
après FIV (%) |
25.7 |
21.5 |
22.7 |
30.2 |
après ICSI (%) |
26.7 |
20.0 |
23.8 |
27.0 |
Naissances multiples (%) |
21.8 |
10.4 |
22.4 |
5.6 |
Tableau 1: Age des femmes traitées, politique de transfert embryonnaire, taux de grossesses cliniques et taux de naissances multiples dans différents pays européens en 2004 (d’après Andersen et al., Hum. Reprod., 23, 756-71, 2008)
8 M. Alain CLAEYS
Comment expliquez-vous, d’un point de vue médical, la position française ?
8 M. Pierre JOUANNET
Le mouvement vers la réduction du nombre d’embryons transférés existe dans tous les pays, notamment, en France où, cependant, je pense que le travail d’information auprès des couples et des médecins a été insuffisant sur ce sujet. En Belgique, les pouvoir publics ont proposé que le remboursement des actes soit conditionné par le fait qu’un seul embryon soit transféré lors de la première tentative chez les femmes de moins de 36 ans. En Suède, la disposition a fait l’objet d’un consensus au sein de la profession avant d’être précisée dans la réglementation.
Comme on le voit sur le tableau 1, en 2004, 67 % des transferts ont été effectués avec un seul embryon en Suède, contre 17 % en France et 12 % en Allemagne. La proportion des transferts de trois embryons et plus a été nulle en Suède cette année là, pratiquement nulle en Belgique et plus élevée en France et en Allemagne. Les taux de grossesses multiples atteignaient 20 % en France et en Allemagne, 10 % en Belgique et 5 % en Suède. On pourrait objecter que les résultats de ces différents pays ne sont pas comparables car les populations traitées sont différentes. Pourtant, la proportion de femmes de plus de 35 ans qui étaient traitées, était plus élevée en Suède qu’en France. Or, les taux de grossesse globaux sont meilleurs dans le premier pays que dans le second (tableau 1). Il serait intéressant de comprendre pourquoi afin d’améliorer les résultats en France.
Il est aussi intéressant d’analyser l’évolution des pratiques dans un pays comme la Suède (figure 3). Dans ce pays, au début des années quatre-vingt-dix, près de 80 % des transferts étaient effectués avec trois embryons et seulement 10 % avec un embryon. A cette époque, le taux de grossesses multiples était de 30% environ. Les Suédois ont, alors, modifié leur politique de transfert et, dans la plupart des cas, seulement 2 embryons ont été transférés. Les taux de grossesses sont demeurés inchangés et les grossesses multiples étaient pratiquement toujours aussi nombreuses. C’est à partir du début des années 2000, que la décision a été prise de préconiser à tout prix le transfert d’un seul embryon et à partir de là, l’incidence des grossesses multiples a chuté considérablement. Cet exemple démontre qu’il est possible à l’échelle d’un pays de diminuer de manière très importante l’incidence des grossesses multiples avec tout leur cortège de complication associées tout en maintenant de très bon résultats.

Figure 3 : Evolution du taux de naissance (birth rate) et du taux de naissances multiples (MBR) en fonction de la proportion de transfert de trois (TET) et d’un seul (SET) embryon après FIV en Suède (d’après Karlström et Bergh, Hum. Reprod., 22, 2202-7, 2007) .
Connaissance de l’embryon, efficacité de l’AMP et évolutions envisageables
Une modification de la politique de transfert embryonnaire n’est envisageable que si les taux de succès sont élevés et que si nous connaissons mieux les caractéristiques de l’embryon qui conduira à la naissance d’un enfant en bonne santé.
La qualité des embryons, c'est-à-dire leur aptitude à un développement normal, peut être appréciée selon 3 types de critères : morphologiques, métaboliques et génétique. Actuellement, seuls les premiers sont utilisés en pratique courante. Dans les heures et les jours qui suivent la fécondation, on mesure le nombre de cellules qui constituent l’embryon et leur intégrité. Les chances d’implantation sont maximum si l’embryon est au stade de 4 cellules, 2 jours après la fécondation. S’il y a moins de cellules, c'est-à-dire s’il est en retard dans son développement, ou au contraire s’il y a plus de cellules, c'est-à-dire s’il est en avance, les taux d’implantation sont diminués. Il en est de même si les cellules sont fragmentées. L’état de l’embryon dès le 2ème jour influence donc ses capacités d’implantation mais aussi, comme cela a été montré récemment, son développement après l’implantation.
En utilisant ce type de critères et d’autres comme la qualité nucléaire à ce stade du développement, il est possible d’obtenir d’excellents taux de grossesse après transfert d’un seul embryon au moins chez les femmes les plus fertiles et en supprimant tout risque de grossesse multiple.
Demain, d’autres critères devraient pouvoir être utilisés pour apprécier avant l’implantation l’aptitude des embryons à donner naissance à un enfant en bonne santé. Récemment, des chercheurs australiens et grecs ont réalisés une expérience très intéressante. Sur des blastocystes, c'est-à-dire sur des embryons âgés de 5 jours, ils ont prélevés avant l’implantation quelques cellules du trophectoderme, celles qui formeront le placenta, et ils ont analysés l’expression des gènes. Ensuite, les blastocystes ont été transférés. Les chercheurs ont trouvé que les blastocystes qui se développaient pour faire un enfant exprimaient un grand nombre de gènes que les autres blastocystes, pourtant morphologiquement identiques, n’exprimaient pas. Il s’agit d’une première approche qui devrait permettre dans l’avenir de mettre au point des outils moléculaires pour mieux identifier encore les embryons les plus aptes au développement. Cette recherche, très intéressante, n’aurait pas été possible en France, d’une part parce que les financements pour ce type de recherche sont inexistants, d’autre part parce qu’il est interdit de transférer un embryon sur lequel une recherche a été réalisée. Il faut que cette situation change si l’on souhaite mieux lutter contre la stérilité et améliorer les performances des techniques d’AMP

Figure 4 : analyse de cellules de blastocyste humain pour analyse moléculaire avant transfert dans l’utérus (d’après Jones et al, Hum. Reprod., 23, 1748-59, 2008)
D’après le bilan de l’Agence de la Biomédecine en 2005, en France, 50 287 tentatives de FIV et d’ICSI ont été réalisées, qui ont abouti à la création de 233 563 embryons. 40 % de ces embryons ont été écartés d’emblée car ils étaient jugés inaptes à se développer. Sur les 88 868 embryons transférés immédiatement, seuls 10 928 embryons (12. %) ont donné un enfant (tableau 2).
Ovocytes recueillis |
471118 |
|
Embryons |
233563 |
(49.6% des ovocytes) |
Congelés |
51298 |
----- 140166 (60 % des embryons) |
Transférés |
88868 |
|
Enfants |
10928 |
(12.3% des embryons transférés) |
Tableau 2 : Nombre d’ovocytes traités et d’embryons créés dans l’ensemble des centres d’AMP en France en 2005 (d’après le bilan de l’Agence de la Biomédecine)
L’efficacité de nos techniques est donc très limitée et la plupart des embryons créés dans les laboratoires de FIV n’ont aucun avenir. Si l’on souhaite que cette situation change, il serait essentiel de développer des recherches sur l’embryon pour les embryons.
Ne pourrait-on accepter que la recherche biomédicale soit possible à cette période de la vie comme elle est possible à tous les autres âges de la vie ?
‚
8 M. Alain CLAEYS
Pour ouvrir le débat, je pose une première question : la loi de 1994 est-elle utile, juste et cohérente ?
8 Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER
Elle est certainement utile et, probablement, elle peut être améliorée sur le plan de l’utilité. Elle était juste dans un système de valeur de 1994. Tout dépend si l’on considère la justice dans un sens absolu, moral et universel ou dans un sens de justice sociale. Dans ce dernier cas, certains points ne sont plus adaptés. Quant aux incohérences, je pourrai les lister ultérieurement. Que le double don soit interdit, mais pas l’accueil d’embryon ne constitue pas une incohérence car cela était perçu comme un sauvetage des embryons au moment du vote de la loi. L’adoption est possible par un couple marié ou une personne seule, tandis que l’AMP n’exige pas de mariage et, en revanche, n’est pas accessible aux femmes seules, voila un exemple d’incohérence.
8 Mme Dominique MEHL, Sociologue, Directrice de recherches au CNRS
Cette table ronde s’intitule : « L’accès à la AMP». Je pensais donc que nous discuterions de l’article qui définit les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée, à savoir être un couple marié, en concubinage reconnu et stable depuis deux ans, de sexes différents, stérile, en âge de procréer et vivant. Cela fait six conditions qui, les unes après les autres, vacillent sur leur socle du fait de l’évolution des pratiques et des mentalités, ainsi que des mouvements qui se manifestent dans la société. J’évoquerai, notamment, la revendication de couples du même sexe à l’accès à la procréation médicalement assistée dont je n’ai pas entendu parler, sauf au travers de cet arrêt européen, et par la reconnaissance provisoire par la Cour d’appel d’un de ces couples.
Certaines conditions d’accès, comme le concubinage notoire depuis deux ans, sont déjà caduques. Certains médecins admettent que ces certificats ne servent à rien car ils s’obtiennent très facilement. Un certain nombre de questions se pose comme la définition de la stérilité ou l’ouverture de l’AMP aux personnes de même sexe et aux célibataires, l’adoption étant déjà ouverte à ces derniers. Les personnes de même sexe demandent que la stérilité soit définie par les conditions sociales dans lesquelles se situent les couples. Il me semble que les définitions des conditions conjugales d’accès à l’AMP sont à interroger. Or, je n’ai pas entendu grand-chose sur ce sujet.
8 M. François THÉPOT
J’ai cru essayer de vous démontrer que le système français était orienté vers la démonstration de l’infertilité. Les conditions que vous mentionnez sont établies à partir de ce principe fondateur. Ainsi, en matière de certificat de concubinage, les deux ans exigés correspondent d’un point de vue médical, au temps pendant lequel un couple doit être exposé à la grossesse pour prouver l’infertilité. Le système peut paraître cohérent sur la base de cette option, mais vous pouvez en discuter une autre. Je pensais, en tout cas, avoir fondé mon exposé sur ce point. Je n’ai peut-être pas été clair.
8 M. Pierre JOUANNET
Chercher à élargir par voie législative les conditions d’accès à l’AMP sans faire le bilan de ce qui a été réalisé depuis 1994, sans comprendre pourquoi certains actes comme le don d’ovocyte ou l’accueil d’embryon ont tant de mal à être mis en œuvre, sans chercher à savoir comment les modalités de prise en charge pourraient être améliorées, ce serait une grave erreur. Le risque serait grand que l’accès devienne alors plus difficile pour tous ou que tout le socle des valeurs très justement rappelé par Mme DREIFUSS-NETTER vole en éclat.
La question est de savoir si l’accès à une technologie médicale comme l’AMP doit être libre selon la conscience de chacun ou s’il s’agit d’un champs dans lequel on doit inscrire des limites. En 1994 et 2004, le législateur a fait un choix, celui de réserver l’accès de l’AMP aux situations où l’absence de procréation naturelle était liée à un problème médical. D’autres choix sont possibles, ils ont été faits par d’autres pays. Mais franchir cette limite, c’est franchir un seuil qui correspond à un bond qualitatif dont les enjeux et les conséquences doivent être appréciés. Une femme seule ou une femme homosexuelle n’a pas un problème médical d’infertilité ou de risque de transmission d’une maladie grave. Son désir de recourir à une AMP pour devenir mère n’est pas motivé par une pathologie. En répondant à sa demande, on franchit un seuil au-delà duquel doit-on définir d’autres limites ? Il s’agit de même si l’on envisage le transfert d’embryon ou l’insémination artificielle après la mort de l’homme. On franchit un autre seuil. Réfléchir aux conséquences et aux enjeux de créer délibérément un enfant à partir des spermatozoïdes ou des embryons d’un homme décédé n’est pas une question médicale. C’est pourquoi je pense que je n’ai pas à prendre position sur ces sujets en tant que médecin même si je pense comme Madame Frédérique DREIFUSS-NETTER qu’il serait souhaitable de faire des choix utiles (ou réalisables) justes et cohérents en la matière.
Concernant les conditions d’accès à l’AMP des couples hétérosexuels dans le cadre de la réglementation actuelle, je ne pense pas qu’il y ait de difficultés majeures.
8 M. Alain CLAEYS
Nous avons eu ces discussions en 2004 et nous les aurons de nouveau. Je prends un simple exemple. L’implantation post mortem a donné lieu à un débat en première lecture en 2002. Le législateur avait alors décidé de l’autoriser. Puis, en deuxième lecture, en 2004, il l’a interdite. Le législateur devra effectivement décider s’il revient sur le principe qu’il a retenu pour caractériser la procréation médicalement assistée.
8 Mme Dominique DESCHAMPS-MINI, juriste
Je suis juriste et immergée, depuis plusieurs années, dans la pratique. Contrairement à ce que le Professeur JOUANNET vient d’indiquer, les différentes situations liées au statut du couple engendrent réellement des problèmes. Je suis régulièrement consultée par des membres de couples mariés, notamment des femmes, qui se présentent avec un autre partenaire. Lorsqu’on confronte ces situations avec le droit de la filiation et, en particulier, la présomption de paternité, nous rencontrerons des soucis pratiques d’accès à l’assistance médicale à la procréation.
Par ailleurs, si les problématiques d’anonymat et de gestation pour autrui doivent peut-être être centrales, il ne faut pas oublier ce qui peut entraîner des problèmes pratiques en termes d’application de la loi comme, par exemple, les stimulations ovariennes hors assistance médicale à la procréation qui s’effectuent parfois n’importe comment. Il existe des prises en charge très tardives avec des stimulations initiées après 50 ans.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Ces sujets relèvent peut-être plus des bonnes pratiques médicales que du rôle du législateur. Celui-ci ne pourra pas régler, au cas par cas, tous les problèmes qui se présenteront. Pour ma part, je suis un peu surpris que nous soyons obligés de réviser des lois de bioéthique à intervalle aussi régulier. Le législateur a-t-il à courir, en permanence, derrière l’évolution des mœurs ? Ne doit-il pas fixer certains grands principes, relativement intangibles, et charger ensuite des agences, comme l’Agence de la biomédecine de les adapter ?
8 M. Alain CLAEYS
C’est un débat que nous devrons trancher.
8 M. Pierre JOUANNET
La loi actuelle me semble inutilement très tatillonne. Toute une série de considérations techniques doivent ainsi être réglées par arrêté ministériel alors que l’Agence de la biomédecine devrait les prendre en charge. Il est absolument anormal qu’un guide de bonnes pratiques soit édicté par arrêté ministériel. Ceci devient un handicap car le guide des bonnes pratiques de l’AMP a mis trois ans à être publié. La lourdeur administrative finit quelquefois par être quelquefois un handicap important pour l’efficacité et la qualité des activités.
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL, Psychanalyste
Je voudrais féliciter Frédérique DREIFUSS-NETTER d’avoir abordé le vif du sujet et je suis entièrement de l’avis de Dominique MEHL. Je pensais que nous évoquerions l’accès à l’AMP qui représente un sujet absolument central. Or, au début de cette table ronde, nous avions l’impression d’assister à un congrès médical.
8 M. Alain CLAEYS
La loi de bioéthique n’est réservée ni aux scientifiques, ni aux experts. Si nous voulons être utiles, il faut que chacun puisse s’exprimer dans une table ronde comme celle-ci. Les propos de MM. THÉPOT et JOUANNET ont été parfaitement utiles.
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL
C’est certain. Mme DREIFUSS-NETTER a, cependant, abordé les questions centrales selon moi. Toutefois, un point me gêne un peu. Vous avez expliqué que certains principes, qui apparaissaient dans le Code Civil, étaient, de ce fait, gravés dans le marbre. Le principe d’anonymat, si j’ai bien compris, en est un. Dans la suite de votre exposé, vous avez été plus souple sur ce point. Vous avez également indiqué que peu de sujets émergeaient, mais vous en avez listés beaucoup. J’aimerais que vous précisiez votre position sur la question de l’anonymat.
8 Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER
Je n’ai absolument pas exprimé une opinion personnelle. J’ai expliqué qu’il résultait des travaux parlementaires que nous avions choisi, en 1994, de promulguer deux lois datées du même jour. La première porte sur le corps humain et fixe des principes généraux qui ont été inscrits dans le Code Civil avec une intention affichée de permanence. Ces principes ont, ensuite, été déclinés dans le Code de la Santé publique. C’est cette loi dont la révision est techniquement prévue. Cependant, rien n’empêche le Parlement de se saisir et de réviser la totalité des dispositions, y compris les principes inclus dans le Code Civil. Je n’y suis pas opposée mais dès le début cette volonté de distinguer existait.
8 M. Henri ATLAN
Je voudrais revenir sur la question de ce qui peut et devrait être renouvelé. À mon avis, il s’agit de tout ce qui concerne la recherche fondamentale en biologie. Une erreur fréquente, conséquence du néo-préformationnisme que j’évoquais précédemment, consiste à confondre biologique et génétique alors que la biologie est bien plus large que la génétique.
D’ailleurs, cette prégnance de la génétique explique, à mon avis, certaines représentations sociales curieuses et le fait que certaines personnes pensent que, si elles ne transmettent pas leurs gènes à leur descendance, il ne s’agit plus de leur descendance alors que toutes les acrobaties sociales sont permises pour réaliser ce but. En recherche fondamentale, il existe nombre de possibilités avec, comme toujours, des retombées positives et des retombées négatives.
Pour reprendre l’exemple de M. JOUANNET sur la difficulté d’obtenir des ovocytes, si nous développons la recherche visant à fabriquer des ovocyte, en laboratoire, à partir de cellules souches embryonnaires, nous réglons la question des dons d’ovocyte et tous les problèmes que ceux-ci engendrent. À cela, nous entendons des objections, naturalistes ou essentialistes, estimant que la fabrication d’ovocytes artificiels ne constitue pas une bonne solution. Axel KAHN nous a même mis en garde, précédemment, contre la fabrication de sujets artefacts, et non plus de cellules artefacts. C’est absolument faux !
Si nous parvenions à faire se différencier les cellules souches en ovocytes normaux, les sujets qui naîtraient, par fécondation in vitro, d’un tel ovocyte et d’un spermatozoïde ne seraient pas plus artificiels que les sujets qui naissent actuellement par fécondation in vitro. On se trouve là de nouveau face à une difficulté à appréhender le gradualisme que je mentionnais précédemment. Il n’y a pas d’essence de l’ovocyte, qu’il soit naturel ou artificiel.
Ceci implique aussi que la technique, en elle-même, n’est pas un bien ou un mal. Tout dépend du contexte social, familial, culturel dans lequel elle s’applique. C’est la difficulté à laquelle le législateur est confronté. Il n’a pas à décider si une technique est bonne ou mauvaise, mais dans quelles circonstances elle est acceptable et dans quelles circonstances elle est à proscrire.
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL
Je souhaitais également évoquer la question du double don. Parmi les indications à l’AMP, une alternative devrait être possible entre accueil d’embryon et double don de gamète étant donné que la loi française admet à la fois le don d’ovocyte et le don de sperme. Ce point n’a pas été abordé. Par ailleurs, vous avez employé l’expression « couple d’accueil », ce qui, je pense, a fait frémir mes voisins que je connais bien et qui ont eu des jumelles aux États-Unis. Il faut prendre garde aux mots. Ils ne sont pas un couple d’accueil, mais sont les vrais parents de leurs enfants, le père étant le vrai père, au sens même de la biologie, le père d’intention et le père légal. Le terme « couple d’accueil » est donc choquant.
8 Arthur de KERMALVEZEN, Association Procréation Médicalement Anonyme (PMA)
Je suis Arthur, de la première génération des individus qu’on appelle toujours « enfants conçus par Insémination avec donneur IAD ». Si nous révisons la loi, M. VIALATTE, c’est parce que j’ai grandi. L’inertie est une forme de violence et nous sommes ici car nous voulons de l’action. Il se trouve que les droits de l’enfant que j’étais, n’ont pas été respectés. Or, nous savons bien que ces droits sont le respect de l’adulte que l’enfant sera plus tard.
Les lois de bioéthique sont faites pour protéger les plus faibles. J’ai fait un effort, grâce à l’association Procréation Médicalement Anonyme (PMA), pour me faire comprendre. Mes parents sont bien les miens. Je ne me vis pas comme un enfant de la génétique ou de la biologie ; je ne me pose même pas la question, car mes parents m’ont permis de penser ma vie et de m’exprimer. C’est ce que j’essaie de faire ici. En attendant, donner la vie a un prix et les donneurs sont des humains. Nous évoquons les gamètes, les cellules, mais nous ne donnons pas la parole aux donneurs.
8 M. Dominique MENNESSON, co-président de l’Association CLARA
Je remercie Mme DREIFUSS-NETTER pour son exposé. L’indisponibilité du corps humain n’existe pas dans la loi. La Convention d’Oviedo définit parfaitement les droits humains et les droits de la bioéthique. Elle part du principe du respect du corps humain, ainsi que du principe d’autonomie, et fixe une troisième notion, celle de l’équité, le tout dans un cadre de non-profit. Ce texte me paraît magnifique pour mettre tout le monde d’accord. Puisqu’il a été signé par la France en 1997 et qu’il est applicable depuis 1999, pourquoi ne l’avons-nous pas ratifié en 2004 ? Cette question sera-t-elle abordée dans le cadre de la révision ?
8 M. Alain CLAEYS
Je ne comprends ni ce retard, ni que nous n’ayons pas pu ratifier la convention d’Oviedo dans le cadre de la révision de 2004. On me signale quelques problèmes juridiques, mais d’autres pays ont trouvé le moyen de ratifier le texte. Je souhaite donc que nous le fassions le plus rapidement possible.
De la salle
Je voudrais revenir sur les conditions d’accès à l’AMP. Puisqu’il s’agit d’un traitement palliatif de l’infertilité, et non d’un mode de procréation, je me pose la question suivante. En quoi le recours à un don de sperme par un couple dont l’homme est complètement infertile est-il différent d’un recours à un don de sperme par un couple infertile car il est constitué de deux femmes ? Ne s’agit-il pas là, plutôt, d’un choix de société au travers duquel nous considérons que ceux qui sont les parents doivent pouvoir passer pour les géniteurs et qu’une famille doit, avant tout, être constituée d’un père et d’une mère ?
8 M. François THÉPOT
Vous résumez très bien ma dernière diapositive.
8 Mme Frédérique DREIFUSS-NETTER
Je suis d’accord avec vous. C’est là un choix de société.
8 M. Pierre JOUANNET
L’homme stérile a généralement des altérations importantes dans sa fonction de reproduction, il s’agit d’une pathologie médicale. Le fait qu’un couple de femmes homosexuelles souhaite un enfant représente autre chose. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une pathologie médicale. Doit-on confondre les 2 types de situations ?
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Nous vous remercions, nous appelons les participants de la deuxième table ronde.
ACCÈS AUX ORIGINES OU ANONYMAT ?
8 M. Alain CLAEYS
Je donne la parole, sur le thème important de l’accès aux origines, à Mme Carine CAMBY. Je voudrais publiquement saluer le travail formidable qu’elle-même et son équipe de l’Agence de la biomédecine ont effectué. C’était nouveau en France.
8 Mme Carine CAMBY, Ancienne Directrice générale de l’Agence de la biomédecine
Cette table ronde est consacrée à un sujet sensible qui a été identifié, dès le début, comme l’un des sujets majeurs de discussion dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique. J’essayerai de démontrer que l’on se trouve confronté, à travers cette thématique sur laquelle de nombreuses positions se sont exprimées, à une certaine façon de concevoir la loi de bioéthique.
Comme Frédérique DREIFUSS-NETTER l’a très justement rappelé, cette loi est fondée sur différentes valeurs, dont la principale est le respect de la dignité de la personne humaine. Nous avons cherché à décliner cette valeur dans le texte de la loi de bioéthique et dans le Code Civil en un certain nombre de principes qui, jusqu’à présent, étaient considérés comme intangibles. Ces principes sont la non patrimonialité et l’anonymat, lequel est toujours apparu comme une manière d’assurer la non patrimonialité. En effet, il permet de garantir effectivement qu’il n’y aura pas de développement de trafic sur les éléments du corps humain. Cet aspect est toujours vrai. En levant le principe de l’anonymat, il faudra donc, sans doute, réfléchir à un renforcement du principe de non patrimonialité, pour autant qu’on souhaite aussi le conserver.
Par ailleurs, le principe d’anonymat a été retenu afin d’assurer une protection du donneur et une protection du receveur. La première a souvent été mise en avant, notamment par les personnes qui sont à l’origine de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Il faut garantir le donneur contre certains risques juridiques, mais également psychologiques. Celui-ci n’aura pas forcément envie de voir se présenter, dix-huit ou vingt ans après les faits, les enfants issus de son don. La protection du receveur et celle du couple qui a souhaité un enfant et fait appel au don de gamète ont été garanties par l’anonymat.
Or, dans cet aspect de l’application de la loi de bioéthique, l’on se trouve confronté au cas particulier de la présence d’un tiers. Ce tiers, qui est important et qui s’exprime aujourd’hui, est l’enfant né de la technique d’AMP avec tiers donneur. Aujourd’hui, on fait face à l’émergence de cette parole qui, d’une certaine façon, avait été mise sous le boisseau. L’on avait peut-être méconnu la situation qui résulterait de l’arrivée à l’âge adulte de ces enfants et de leur volonté d’exprimer des demandes, d’ailleurs très diverses de connaître ou pas le donneur. En effet, chacun – parents receveurs, enfant, donneur – vit cette situation de manière différente.
Peut-être est-il intéressant de se mettre à la place de ces trois types de personnes ? Quelle est la position de chacun ? Si nous allions vers une ouverture, sur cette question, dans la future loi de bioéthique, quels seraient les aspects à traiter pour que cette ouverture ne se traduise pas par des effets négatifs dont la prévention serait utile ?
Toutes les personnes qui recourent à l’AMP avec tiers donneur ne sont pas forcément désireuses d’autoriser l’enfant à connaître le donneur, voire même de lui révéler le mode de sa conception. Une réflexion, menée sur ce sujet par le Comité consultatif national d’étique tendait plutôt vers la recommandation de levée du secret sur le mode de la conception, sans aller jusqu’à la levée de l’anonymat du donneur. Les deux étapes ont bien été distinguées.
Dans les pays qui ont procédé à ce type de modifications de la réglementation, on a constaté une chute importante du nombre de donneurs dans un premier temps, comme dans tout changement de situation une insécurité doit être levée dans l’esprit des donneurs potentiels. Une légère reprise a, ensuite, été enregistrée avec un changement du profil des donneurs. En effet, l’anonymat garantit au donneur que l’enfant ne se présentera pas devant lui. Psychologiquement, ce n’est pas la même chose que d’imaginer qu’un jour, cet enfant puisse effectivement se présenter à lui, lui poser un certain nombre de questions ou être demandeur d’une relation affective avec lui. À ce titre, je rappelle qu’en France, les donneurs de gamètes doivent déjà avoir eu des enfants. C’est un point important et je ne pense pas qu’une levée ou un assouplissement éventuel des règles d’anonymat puisse forcément conduire à lever cette autre condition.
Par ailleurs, la levée de l’anonymat peut accroître les risques de trafic. Il est clair que la levée de l’anonymat encourage le développement de relations entre les donneurs et les receveurs. Si ceci est particulièrement vrai dans le don d’organe, c’est sans doute moins vrai dans le don de gamète car, dans les dispositifs qu’on imagine et que les pays voisins ont mis en place, l’enfant ne peut se tourner vers le donneur qu’à sa majorité. Cela a le moins d’impact possible, en termes de contractualisation ou de monétarisation du don, au moment de la conception.
Il faut noter que la loi de bioéthique a été conçue autour de principes s’appliquant à tous les types de don. Si l’on s’orientait dans la voie de l’assouplissement ou de la levée de l’anonymat, l’on renoncerait à cette disposition et l’on se trouverait certainement, à un moment donné, confronté à des demandes reconventionnelles sur d’autres types de don pour lesquelles il conviendra d’argumenter que ce ne sont pas les mêmes types de dons. C’est une question qu’il nous faut anticiper.
Nous avons souvent constaté, face aux revendications des droits de l’enfant, une réaction de rejet immédiat, notamment de la part des professionnels qui mettent l’AMP en œuvre depuis de longues années, sur la base d’un consensus social faisant de l’anonymat un pilier important du dispositif. Il convient d’identifier ce qu’on inclut dans le droit de l’enfant à connaître ses origines et jusqu’où l’on peut aller dans ce domaine. La possibilité de rencontrer le donneur a été envisagée. Certaines associations évoquent la possibilité d’obtenir des informations non identifiantes sur le donneur. Certains pays ont choisi des dispositifs pouvant être engagés à la majorité de l’enfant et ont évidemment opté pour la non rétroactivité de la levée de l’anonymat, comme au Royaume-Uni.
Ces configurations présentent des risques et doivent donc être pesées. D’une part, des couples pourraient renoncer à la procréation avec tiers donneur par peur de devoir gérer le tiers qui fait intrusion dans la famille traditionnelle. Cela peut être assez angoissant pour le couple receveur. D’autre part, ces dispositions pourraient aller à l’encontre de la levée du secret sur le mode de procréation : « Si je ne dis pas à mon enfant qu’il a été conçu avec un don de gamète, il ne demandera pas à connaître le donneur ». Je ne reviens pas sur ce débat qui a été, très largement, exploré par le Comité consultatif national d’éthique. Néanmoins, il faut garder ceci à l’esprit.
Finalement, je n’ai pas de réponse absolue à la question de savoir comment traiter le problème. Je constate que la situation évolue, et pour être honnête, de nombreux acteurs sont un peu ennuyés face à ces évolutions. La revendication de ces jeunes est légitime et, dans le même temps, nous ne savons pas bien comment la traiter dans le contexte actuel.
Pour autant, mieux vaudrait éviter un certain nombre de questions ou de difficultés tel le recours à un double guichet évoqué, il y a quelques années, et qui devait permettre, selon la volonté du donneur, un accès de l’enfant à certaines informations. Cette situation me semble très difficile à vivre pour les enfants. Certains d’entre eux auraient accès à l’information à leur majorité parce que le donneur y a consenti au moment du don et d’autres ne pourraient pas y accéder en raison du refus du donneur. Cette situation serait ingérable.
Ceci soulève une deuxième question : si un choix doit être effectué dans ce domaine, qui doit le faire ? Est-ce l’enfant à sa majorité, comme c’est le cas dans certains pays ? Le donneur a-t-il son mot à dire, c’est le cas du double guichet ? Les parents d’intention doivent-ils également s’exprimer sur cette question ?
Par ailleurs, quel type d’information pourrait être communiqué ? Seraient-ce des informations identifiantes ou non identifiantes ? Enfin, dans un certain nombre de services, les informations sont détenues, mais ne sont pas livrées. Faut-il que les centres d’AMP qui ont reçu les parents continuent à conserver des informations, pour des raisons de sécurité sanitaire, alors même qu’ils n’auront jamais à les communiquer à qui que ce soit ? Je réponds clairement par la négative et, si nous décidons de maintenir l’anonymat, nous devrons régler cette question. Dans ce cas, il n’y a pas de raison de conserver les informations, leur conservation n’étant pas médicalement justifiée.
En définitive, la difficulté majeure a été très justement évoquée par Frédérique DREIFUSS-NETTER. Il s’agit de déterminer dans quel modèle de famille on souhaite se retrouver. On a eu de grandes difficultés, dans l’ensemble de la discussion sur la loi de bioéthique et sur les techniques d’AMP, à imaginer la famille autrement que comme des parents et un enfant. On ne parvient pas à trouver une place pour les tiers. Or, ceux-ci peuvent être nombreux, jusqu’à cinq personnes.
Il faudra réfléchir à la question du statut des tiers car elle a des applications dans d’autres domaines et, notamment, dans la gestation pour autrui. Dans ce cas de figure, quel sera le statut de la mère porteuse ? Une convention entre les parents et la mère porteuse devra-t-elle être conclue ? Dans ces problématiques, la règle de l’anonymat n’a plus aucun sens et n’est dans l’intérêt de personne. La mère porteuse sera connue du couple qui souhaite avoir un enfant et de l’enfant. Pour autant, la situation sera-t-elle traumatisante pour la famille ? Cela dépendra des cas.
Dans certaines familles, des situations très banales sont traumatisantes et, dans d’autres, des situations complexes sont bien vécues. Il est difficile de répondre, d’emblée, à cette question. En tout état de cause, la problématique relative au statut du tiers se pose autant dans le cadre de la gestation pour autrui, que sur la question de la levée éventuelle de l’anonymat du don de gamète. Jusqu’où ira-t-on dans la reconnaissance de cette personne ?
Tel est de mon point de vue la façon dont les questions se posent. Comme beaucoup d’autres, je suis quelque peu embarrassée quant aux réponses à y apporter. Je redoute des effets de tâche d’huile sur l’ensemble des dons d’éléments du corps humain ou des répercussions en termes de privation d’une parole familiale sur ces questions. Toutefois, je crois que c’est un des débats essentiels sur lesquels vous aurez à trancher d’ici deux ans.
8 M. Alain CLAEYS
Je vous remercie beaucoup. C’est en effet une question délicate et importante.
8 Mme Hélène GAUMONT-PRAT, Professeur de droit à l’université Paris-VIII, Directrice du laboratoire « droit médical et droit de la santé », ancien membre du Comité consultatif national d’éthique
J’évoquerai les aspects juridiques de l’anonymat et d’emblée, mon sentiment est qu’il faut éviter l’affrontement binaire. Doit-on être pour ou contre l’accès aux origines ? Des arguments sont légitimes de part et d’autre. Il me semble donc important de privilégier deux idées : la cohérence du droit de la famille et l’équilibre de l’enfant au sein de la famille.
I. Le principe de l’anonymat et sa finalité
Le principe de l’anonymat, tel qu’il a été inscrit dans les lois de bioéthique, trouve son fondement dans l’article 16-8 du Code Civil issu de la loi 94-653 du 29 juillet 1994 et non remis en cause lors de la révision de 2004, qui instaure la règle de l’anonymat, de manière générale, dans les relations entre donneurs et receveurs et qui se trouve décliné dans le Code de la Santé Publique CSP. Ce principe a trouvé application en matière d’AMP avec tiers donneur, ou dans l’hypothèse du don d’embryon. Une dérogation est prévue en faveur des médecins en cas de nécessité thérapeutique (art. L. 1244-6 CSP), pour l’accès à des informations médicales non identifiantes.
L’AMP avec tiers donneur, est une technique à visée médicale destinée à remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Cette technique utilise du matériel biologique humain et concerne le don de sperme et d’ovocyte. L’application du principe d’anonymat implique l’interdiction du don dirigé.
L’anonymat est absolu et réciproque entre le receveur et le donneur. Il est relatif à l’égard de l’institution médicale, tiers instruit, puisque les CECOS détiennent les dossiers (les impératifs de sécurité sanitaire imposent l’identification et la sélection des donneurs). L’institution médicale est garante d’un double secret : celui du couple qui souffre de stérilité ou d’une maladie génétique telle qu’elle remet en cause la procréation charnelle, et celui de l’anonymat du donneur.
Ce dispositif permet un effacement du donneur et revient à assimiler la circulation des gamètes à une circulation de matériel biologique, dépersonnalisé, sorte de « produits de santé » destinés à remédier à la stérilité. Ceci favorise, effectivement, l’instauration de la famille en tant qu’entité constituée par un trio : le couple receveur et l’enfant. Il s’agit là d’un choix de société fait en 1994 et non remis en cause en 2004.
Le don d’embryon est visé, de la même façon, par le principe d’anonymat (article L. 2141-5 CSP et L. 2141-6 C.S.P). L’article L. 2141-5 CSP prévoit que les deux membres du couple à l’origine de sa conception peuvent consentir à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple, dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6 C.S.P. qui réitère les obligations d’anonymat de gratuité et de sécurité sanitaire, outre les exigences relatives au consentement écrit des donneurs et receveurs et de l’autorisation judiciaire. Le principe d’anonymat est réaffirmé : « Le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives ». Afin que l'anonymat ne nuise pas à la santé de l'enfant à naître, la loi prévoit également qu’en «cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.»
Aujourd’hui, le principe de l’anonymat fait l’objet, dans sa généralité d’attaques diverses. Cela tient à des raisons multiples. Les raisons médicales liées à l’importance donnée à la connaissance des données génétiques, à une volonté d’accès à la traçabilité génétique, et aux difficultés rencontrées pour l’obtention d’ovocytes. Cela tient aussi à des raisons socio-juridiques, soit parce que la connaissance de l’évolution des législations étrangères permet une réflexion comparatiste, soit à cause des pressions émanant de certains courants psychanalytiques, soit enfin pour des raisons sociétales dans l’hypothèse où l’on s’orienterait vers une nouvelle forme de famille fondée sur la « parentalité », ce qui supposerait qu’une place soit conférée à un tiers, voir à plusieurs, si la pratique envisagée le requiert. C’est le cas de la mère porteuse avec cinq acteurs, par exemple. On remplacerait le terme de « parents » qui suppose un père et une mère seulement.
II. Le souci de cohérence
Le souci de cohérence est selon moi important. Les lois de bioéthique ne doivent absolument pas être traitées de manière séparée. Dans la mesure où elles touchent à l’enfant et à l’intérêt de l’enfant, elles doivent être articulées au droit de la famille. Il me semble essentiel de maintenir cette articulation, car on ne manipule pas impunément le système de parenté pour répondre aux demandes des uns ou des autres à un instant donné, d’autant que les règles organisant la filiation sont d’ordre public. Ceci concerne la question des conditions d’accès à l’AMP, le principe de l’anonymat et les règles du droit de la filiation. Ces problématiques forment un ensemble et, si on modifie un des éléments de cet ensemble, on touche forcément l’ensemble.
Actuellement, l’enfant est rattaché, par un lien de filiation, à son père et à sa mère, que ce soit dans la procréation classique ou dans la procréation médicalement assistée et, selon l’article 311-20 du Code Civil, que les parents soient mariés ou non. L’article 311-19 du Code Civil précise, en matière d’AMP, qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant. L’AMP, calquée en 1994 sur la procréation classique, est réservée à un couple marié ou non auquel sera rattaché l’enfant, qui bénéficiera comme l’enfant issu de la procréation charnelle, d’un père et d’une mère.
Imaginons maintenant une modification des possibilités d’accès à ces techniques. Par exemple, si, demain, nous décidons que celles-ci sont accessibles à une femme célibataire, le principe de l’anonymat pourrait être mis en cause. En effet, l’enfant doit avoir un accès à la connaissance du donneur puisqu’il n’a pas de père et que ce donneur est aussi son géniteur. Auquel cas, cela pourrait entraîner un glissement entre la notion de géniteur et celle de père, notamment dans l’esprit de l’enfant. Dans cette perspective, on pourrait revenir sur l’article 311-19 qui interdit ce lien de filiation. À partir de ce cas précis, il est possible d’imaginer une extension à l’ensemble de l’AMP et envisager une suppression de l’article 311-19 qui, pour l’instant, constitue un barrage très fort.
Ceci reviendrait à donner un statut au donneur géniteur, comme nous l’avons donné à l’amant dans le cadre de la filiation classique lors de la révision des textes sur la filiation légitime, en 2005. L’Ordonnance de juillet 2005 sur la réforme de la filiation permet de détruire la filiation d’un enfant qui dispose du titre et de la possession d’état, pendant cinq ans, puisque selon l’article 333 du Code Civil « nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance ». Nous avons effectivement supprimé les termes « filiation légitime » et « filiation naturelle ».
Le titre et la possession d’état d’un enfant issu d’un couple marié protégeaient cet enfant de l’intrusion de l’amant. Auparavant, l’amant ne pouvait jamais détruire la filiation du mari de la mère. Depuis 2005, un délai de cinq ans a été fixé pour la possession d’état et, dans ce laps de temps, l’intrusion de l’amant dans le couple est possible, ce qui fragilise la stabilité du lien de filiation. Souhaite-t-on donner, au donneur géniteur, le statut donné à l’amant dans le cadre de la filiation classique ? C’est une question que je pose, qui de nouveau, nous oblige à nous interroger sur les objectifs du législateur et de la société en la matière.
Pour conclure, je reviendrai sur l’avis n° 90 du 24 novembre 2005 du Comité national consultatif d’éthique puisque, à l’époque, j’étais co-rapporteur sur cette question. Cet avis, comme vous le savez tous, était très prudent et nuancé. Il avait surtout mis en évidence les différences entre anonymat et secret en les illustrant par différentes situations (accouchement sous X, adoption ou procréation médicalement assistée). Nous avions, alors, estimé que le secret autour des conditions de procréation, plus que l’anonymat, était délétère. L’anonymat, après tout, permettait de garantir un certain équilibre.
S’agissant de l’AMP avec tiers donneur, l’avis précité propose de respecter l’anonymat des donneurs et receveurs. « La rupture de l’anonymat comporte probablement plus d’éléments perturbants que la rupture du secret. Ici encore, les gamètes ne sont pas des parents. ». Il suggère de permettre que l’enfant ait accès à des informations non identifiantes en maintenant le principe de l’anonymat des donneurs.
Quant aux particularités liées à l’accueil d’embryon, il préconise le renforcement de la discrétion et l’aménagement de l’enquête par les services sociaux, en souhaitant que la décision d’information sur les modalités de la procréation demeure entre les mains du couple d’accueil, sans que des divulgations soient à craindre de la part des multiples intervenants, sociaux ou judiciaires.
Il préconise le maintien de l’anonymat du couple d’origine ou, éventuellement, dans cette situation qui comporte quelques analogies avec l’adoption (adoption prénatale), la création d’une extension du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) chargé de la recherche des origines des enfants issus de cet accueil, bien entendu sous la condition de l’accord des géniteurs.
Pour conclure, il me semble utile de privilégier la levée du secret sur les modes de procréation. L’anonymat, tel qu’il apparaît dans les dispositions légales sur l’AMP, est souvent décrit comme porteur d’un mensonge. La question de l’anonymat porte plus sur l’alternative entre la transparence et le secret, que sur celle entre la transparence et le mensonge. Or, l’accès aux origines passe d’abord par l’accès à des données non identifiantes et par le récit, l’histoire. Je terminerai sur cet avis du Comité d’éthique en mettant en perspective les termes « transparence », « anonymat » et « secret ».
8 M. Alain CLAEYS
Je vous remercie et donne la parole à Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL, Psychanalyste
Je m’exprime ici sans institution à défendre, mais au nom de mes trente ans d’écoute de cette clinique et de débat avec le législateur. Quand la pratique de l’IAD a commencé à prendre de l’importance, le Professeur Georges David a organisé un séminaire au centre Sèvres, un centre jésuite. Dans ce cadre, nous avons, avec quatre ou cinq autres psychanalystes, débattu de la question de savoir si la règle de l’anonymat protégeait, de manière satisfaisante, le couple vivant l’épreuve de la stérilité masculine et, surtout, le père. Le devenir des enfants conçus avait aussi été évoqué, mais dans une moindre mesure. Le souci prioritaire de l’époque était effectivement orienté autour de la protection du père stérile.
Trente ans après, la société a évolué et une nouvelle grille de lecture semble nécessaire pour évaluer l’innocuité ou non de l’anonymat du donneur de sperme, non seulement vis-à-vis des parents qui ont eu recours à l’insémination avec donneur (IAD), mais aussi vis-à-vis des jeunes adultes ayant été conçus avec cette technique et, dans bon nombre de cas, vis-à-vis des donneurs qui s’expriment.
Je n’insisterai pas sur les évolutions sociales, toutefois, je citerai deux lois : la loi sur les archives de 1978 et la création en 2002, du CNAOP, dans le cadre de l’abandon anonyme d’enfant, dit accouchement sous X. Cette démarche a démontré que l’accès aux origines personnelles était sans effet sur l’état civil ni sur la filiation.
Cette loi prend également acte du fait que l’individu peut évoluer au cours de sa vie et qu’une décision prise à vingt ou trente ans peut prendre un autre sens en fonction des éléments de la vie future. En ce qui concerne spécifiquement l’AMP, la procréation avec don, on a la chance de bénéficier, aujourd’hui, du recul d’une génération. Les parents, les enfants et les donneurs s’expriment. Il m’arrive même de recevoir des parents que j’avais reçus lors des entretiens pré IAD, demandés par le CECOS, il y a environ vingt-cinq ans. Je reçois également des couples de parents d’adolescents qui viennent évoquer la question de la levée du secret. Quand ? Comment ? D’autres me rencontrent à l’occasion d’un divorce, sachant que les divorces et séparations sont plus nombreux dans les couples ayant conçu par IAD Sur 24 couples que j’ai suivis, 18 ont divorcé, cette proportion semble assez fréquente.
Depuis quelques années, j’accueille également de jeunes adultes issus d’IAD qui se posent des questions sur eux et sur leurs enfants actuels et à venir. Parmi eux, peu s’adressent au CECOS car ils savent, mieux que personne, qu’on ne pourra rien leur dire sur leurs dossiers de conception. Leurs parents leur ont évidemment parlé et ils connaissent la règle de l’anonymat. La révélation leur a été faite à des âges très variables, dès l’enfance chez certains, à l’adolescence ou à l’âge adulte pour d’autres. Presque tous regrettent que l’institution n’ait jamais opéré de suivi et n’ait jamais pris de leurs nouvelles.
Ils éprouvent souvent un sentiment d’injustice, notamment lorsqu’ils se comparent aux enfants adoptés, ce qui peut conduire à faire flamber, chez eux, des revendications qui n’auraient peut-être pas existé si la transparence avait régné. Certains ont des mots très frappants. En dépit de leur réussite professionnelle brillante, ils ont toujours le sentiment d’être des imposteurs. Par ailleurs, contrairement à ce que l’on entend souvent, ils n’évoquent pas de problème particulier avec leur père, ce qui ne signifie pas que la question du géniteur anonyme soit anodine. Leur malaise se situe plus généralement vis-à-vis de leur mère qu’ils rendent responsables des conflits du couple. Ils la perçoivent comme écrasée par le poids du secret, parfois manipulatrice, faisant des chantages à la révélation. Ce n’est donc pas forcément ou pas seulement l’absence d’identité du donneur de sperme qui les fait souffrir. D’ailleurs, certains souhaiteraient simplement connaître le nom du donneur, mais d’autres désireraient tout savoir de l’histoire de celui-ci, de ses motivations, sauf son nom.
J’insiste sur un point qui est souvent source de malentendus. Il est clair qu’il n’existe, dans nos sociétés, qu’une seule filiation, celle que la loi institue. La clinique de l’IAD confirme, de manière probante, la solidité de cette représentation. Pour tous les protagonistes, le père est le conjoint de la mère, celui qui a consenti à l’IAD. Le terme « père biologique » est trompeur. C’est un lapsus qu’au fond, nous rencontrons davantage chez les professionnels, dans les congrès notamment, que chez les intéressés. Les enfants nés par IAD, loin de chercher un père dans le donneur, semblent surtout curieux de lui (demande de photo, de situation de famille, existence d’enfants), cette demande constituant pour eux, me semble-t-il, un moyen de mieux se comprendre et d’étayer leur sentiment d’identité de façon plus stable.
Je tiens à souligner une contradiction inhérente au dogme français de l’anonymat. Si nous considérons que la vérité biologique est peu importante, pourquoi la cacher de manière aussi obsessionnelle ? Si à l’inverse, elle est si importante pour le devenir de l’enfant, pourquoi chercher à en effacer la trace ? Nous savons que nier quelque chose ne fait qu’accentuer le poids de ce que l’on cache. La psychanalyse a montré, pour sa part, qu’un dispositif qui reconnaît le statut de quelqu’un pour l’annuler dans le même temps s’appelle le déni, mécanisme psychopathologique bien connu comme l’est, par exemple, le déni de grossesse. Pour moi, c’est donc l’anonymat entretenu sur l’identité de l’homme qui a donné du sperme qui confère à celui-ci une place considérable, et non le contraire. Dans certains cas malheureux, les intéressés, parfois le père lui-même, finissent par penser que le donneur est le vrai père et que c’est pour cette raison que son identité est cachée. Dans ce sens, l’anonymat est complètement contreproductif, il idéalise le géniteur, protége de façon illusoire l’enfant et infantilise injustement le parent.
Le principe d’anonymat, en proclamant l’indifférence et l’interchangeabilité des gamètes, prive l’enfant, non seulement d’une partie de son histoire, mais aussi d’une partie d’humanité. Ces sujets sont bien nés de géniteurs et de génitrices identifiés. À ce titre, il faut rendre hommage à la loi française qui à la différence de la loi espagnole par exemple, accueille des donneurs qui, sont déjà des parents.
Tout cela m’amène à penser qu’une troisième voie est possible, entre « le tout biologique » et « le tout volonté », pour penser le lien familial dans une famille composée avec des dons de gamètes. On ne peut faire comme si l’ascendance biologique ou génétique ne comptait pour rien dans la vérité biographique d’un individu. Un projet parental moderne ne peut se comprendre que s’il prend en compte la composante volontaire, mais aussi charnelle, du lien entre parents et enfants. Ce projet doit être capable d’inclure le « don d’hérédité » dont ces enfants ont bénéficié. L’expression « don d’hérédité » revient au doyen CARBONNIER qui l’avait précisément employée pour les dons de sperme.
Ainsi, en termes contemporains, le débat sur l’origine et l’anonymat se pose bien plus en termes d’histoire qu’en termes d’origine, l’expression « droit aux origines » souffrant, selon moi, d’une assimilation erronée au registre biologiste. La vérité sur les origines est loin de se résumer à la levée d’un cache sur un nom. Ce n’est pas seulement le nom du donneur qui intéresse.
J’en viens, ainsi, à ce que Paul RICOEUR appelait l’« identité narrative ». Ce concept montre qu’il s’agit toujours, pour un sujet, d’une vérité à construire, d’une co-narrativité. Loin de se cantonner à une vérité biologique, la co-narrativité participe de l’histoire de chacun. L’identité d’une personne se construit par la capacité de cette personne à mettre « en intrique » son passé et à traduire son histoire sous forme de récit. Encore faut-il, pour cela, que l’histoire ait un début !
Une troisième voie est parfaitement réalisable. J’ai cité, à dessein, la possibilité d’un conservatoire des origines, à l’instar du CNAOP. Cependant, il existe d’autres voies, telles que celle utilisée par la loi fédérale suisse. Cette dernière stipule que « tout sujet conçu grâce à un don de sperme pourra obtenir, à partir de sa majorité ou plus tôt avec l’accord de ses parents, l’identité complète de l’homme qui a donné du sperme ». Le préambule de cette même loi inscrit le principe suivant : « La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant ». Je pense que c’est bien de l’intérêt de l’enfant dont la loi française devrait maintenant se soucier en priorité, et pas simplement de celui des adultes.
Dans la plupart des pays du monde qui pratiquent l’AMP, l’anonymat constitue une question discutée et évolutive. Au terme de trois décennies de pratique de l’IAD, il me semble important que la France parvienne à historiciser cette clinique et à l’envisager selon une approche neuve et qui permette au législateur de reconsidérer le principe de l’anonymat du don de gamète adopté en 1994, et jamais réexaminer par la suite.
Pour conclure, je souhaite qu’il ne soit plus nécessaire, à l’avenir, de faire l’impasse sur l’existence des donneurs, d’accumuler des fictions sur des actes de naissance afin de donner une apparence de normalité à la parenté. Dans une société pluraliste, le débat éthique doit rester ouvert. Jean-Pierre CHANGEUX a employé l’expression « innovation éthique ». Celle-ci me semble extrêmement juste et doit pouvoir se manifester au cours de discussions éclairées et je sais gré, à l’Office parlementaire, d’avoir organisé ce débat.
8 M Alain CLAEYS
Je vous remercie de cet exposé et donne la parole à Mme Irène THÉRY
8 Mme Irène THÉRY, Sociologue, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Je vous remercie de m’avoir invitée à cette table ronde qui, pour moi, prolonge un dialogue que j’ai entamé, depuis de nombreuses années déjà, avec Pierre JOUANNET. Je fais une légère allusion à ce dialogue afin de démontrer que nous n’avons pas à figer les positions en faveur ou en défaveur de l’anonymat de façon trop simple, bien que, en tant que législateur, vous devrez vous prononcer. Toutefois, il conviendra d’éviter de figer deux positions prétendument irréconciliables au plan des valeurs. Dans mon dialogue ancien avec Pierre JOUANNET, j’ai appris à entendre, de la part d’une personne directement impliquée dans l’action, l’importance d’avoir pu, au moment de la création des CECOS, se doter de principes dans le silence de la société. De ce point de vue, j’ai amélioré ma compréhension des raisons pour lesquelles les CECOS se sont inspirés des lois sur l’anonymat des dons de sang. Il faut conserver le sens de l’histoire et du contexte si nous souhaitons éviter de figer de fausses alternatives.
À travers la problématique de l’anonymat des dons d’engendrement, la question posée n’est pas de même nature que celle posée dans le cadre des dons de sang. Je rappelle, à ce titre, que tous les dons ne sont pas anonymes, à l’instar des dons d’organes entre vivants. La question posée est celle de notre conception de la filiation et de l’identité. Comme Geneviève DELAISI de PARSEVAL vient d’y faire allusion, les jeunes gens qui revendiquent leur droit à connaître leurs origines cherchent à savoir qui ils sont. Est-ce une question d’identité narrative pour laquelle – je cite RICOEUR – « répondre à la question « qui ? » c’est raconter une histoire » ou est-ce une question d’identité substantielle, ce qu’Henri ATLAN évoquait précédemment ? Dans ce cas, répondre à la question « qui? » reviendrait à aligner des caractères ou des propriétés génétiques.
Il me semble bien que, dans la revendication d’un droit à connaître ses origines, nous devons entendre une revendication d’identité narrative, ce qui soulève le problème du blanc dans l’histoire de la conception et de l’engendrement qui a été créé par l’effet de la loi. Des actions et des relations sont effacées. Des donneurs, bien concrets, et des dons, bien concrets et chargés de sens et de valeurs, sont effacés pour fabriquer un matériau de reproduction. C’est autour de cette question que nous débattons aujourd’hui.
Dans cette assemblée, je n’interviens pas comme spécialiste des AMP, bien que je travaille depuis sept ans avec les centres d’AMP de Marseille et, en particulier, participe à leurs groupes de réflexion éthique. J’interviens comme sociologue et anthropologue de la famille, et des transformations de la parenté, en général. Mon intervention sera donc complémentaire de celles qu’ont effectuées des spécialistes du domaine.
S’il est logique que les débats sur les AMP tendent à particulariser ces formes d’engendrement, on ne doit pas oublier que le principal changement ne concerne pas les techniques, en elles-mêmes, mais l’évolution de nos sociétés dans leur rapport à la filiation et à leur système de parenté indépendamment de l’AMP. On connaît actuellement des métamorphoses majeures de ce système de parenté qui interroge le législateur sur des questions de responsabilité nouvelles. Ce contexte doit être l’horizon dans lequel s’inscriront nos débats sur la loi de bioéthique.
Nous sommes héritiers d’un système de parenté cognatique et matrimonial. Le terme « cognatique » signifie que l’enfant est inscrit, par principe, dans deux lignées dont aucune n’est privilégiée pour définir la descendance, c’est-à-dire l’appartenance au groupe. Dans les systèmes patrilinéaires ou matrilinéaires l’enfant s’inscrit dans deux lignées dont l’une a la prééminence sur l’autre pour définir la descendance. Notre système cognatique est donc fondé sur l’égale implication des deux sexes dans l’appartenance de l’enfant au groupe. Il a longtemps basé la filiation « complète » sur le mariage. Souvent, seul l’enfant dont les deux parents étaient mariés possédait pleinement une lignée et était pleinement inscrit dans l’héritage trans-générationnel. L’enfant dit naturel avait, en général, un lien à sa mère, mais, sauf exception, n’en avait pas à son père. Il n’avait aucun lien à ses grands-parents dont il n’héritait pas.
Contrairement à ce que l’on entend généralement, nous ne sommes en aucun cas, héritiers d’une conception biologique de la parenté et de la filiation. Si tel était le cas, nous n’aurions pas interdit la recherche en paternité, au nom de la paix des familles, pendant aussi longtemps. Nous sommes héritiers d’une conception matrimoniale de la filiation. Celle-ci a donné une valeur particulière à un modèle précis de filiation, celui dans lequel toutes les composantes de la filiation sont rassemblées sur une seule tête masculine et une seule tête féminine. Le père est donc censé être à la fois le géniteur, celui qui éduque et celui que le droit reconnaît comme tel à travers le mariage. Le mariage lie donc l’homme à son épouse, mais aussi aux enfants que celle-ci mettra au monde, par la présomption de paternité.
Cette conception matrimoniale reconnaîssait donc une asymétrie entre le mâle et la femelle humains parce que le mâle – pour reprendre la formule d’ARISTOTE – est « ce qui engendre hors de soi » et la femelle « ce qui engendre en soi ». Le lien entre le père et l’enfant a donc toujours été médié par la relation conjugale qui lie les époux et le jeu de la présomption de paternité. Il n’existait pas de symétrie entre la fabrication de la filiation maternelle et celle de la filiation paternelle Aujourd’hui, cette conception matrimoniale de la filiation qui avait creusé un abîme entre filiation légitime et filiation naturelle est mise en discussion. Nous avons si bien comblé l’abîme entre la filiation légitime et la filiation naturelle que nous avons effacé ce qui était le jour et la nuit, l’honneur et la honte, en termes de filiation.
Nous sommes dans une situation où la transformation de nos conceptions de la filiation est entamée, mais inachevée. Le contexte dans lequel vous allez réfléchir à une refondation, une transformation ou une actualisation de la loi de bioéthique est celui d’une redéfinition inachevée de la filiation. Nous sommes, en quelque sorte, au milieu du gué, ce qui engendre une grande confusion et une profonde inquiétude. En effet, cela exacerbe une alternative entre le biologique et le social, alors même que l’expérience sociale démontre que cela n’a pas de sens de demander à un enfant de construire une alternative entre ceux qui ont contribué à sa conception, à son éducation ou à sa biographie.
La question posée est celle d’une pluri-parentalité, évidemment ordonnée, qui ne place pas les personnes impliquées dans des situations de rivalité et qui ne crée pas une insécurité juridique. Or ? nous n’arrivons pas réellement poser la question de la pluri-parentalité. En effet, au cours des dernières années, le droit de la parenté a échappé à une conception étroitement matrimoniale de la filiation. Nous avons voulu unifier les droits des enfants, indépendamment de la situation de leurs parents. Nous avons décidé d’unifier la filiation au nom de l’égalité entre enfants, et l’avons fait principalement sur le modèle de la filiation légitime. Celle-ci, dont la plénitude était autrefois réservée aux enfants d’un couple marié non séparé, a été étendue. Les liens de filiation ne devaient pas être affectés, même si les parents se séparaient, et la filiation était acquise, même si les parents n’étaient pas mariés. Cet élargissement constitue certainement un progrès du point de vue de l’égalité entre enfants.
Cependant, dans le même mouvement, notre société a organisé une diversité des parcours biographiques des enfants en organisant, notamment, l’adoption. En instituant l’adoption en 1966, en particulier l’adoption internationale, elle admet des parcours biographiques dans lesquels les personnes qui ont engendré les enfants ne sont pas celles qui les élèvent. Elle organise également cette diversité de parcours au niveau de l’engendrement. Dans les cas d’AMP avec tiers donneurs, par exemple, il y a plus d’un homme et plus d’une femme impliqués dans l’engendrement.
À travers la fréquence des recompositions familiales, après séparation ou divorce, notre société a également favorisé la diversité des parcours. De plus en plus d’enfants ont, au-delà d’un père et d’une mère, un beau-père et/ou une belle-mère qui s’occupent d’eux au quotidien. Comment pourrions-nous reconnaître cette diversité des itinéraires biographiques, en conservant des valeurs communes, un système de parenté commun ? Comment construire un système de parenté commun et pluraliste alors qu’aujourd’hui, il apparaît que le système est amené, pour être commun, à dénier la pluralité des situations que nous organisons. L’on se situe dans un modèle assimilationniste, en organisant des adoptions à un prix très lourd qui consiste à faire passer les parents adoptifs pour les parents engendreurs. Ainsi, dans le livret de famille, l’enfant adopté est dit né de ses parents adoptifs impliquant un effacement d’un pan de l’histoire des enfants.
De même avec les AMP, le couple receveur de don passe, aux yeux de la loi, pour un couple engendreur alors qu’il ne fait que participer à l’engendrement. On peut certainement avancer vers une conception de la filiation commune et pluraliste, sans rien céder ni du besoin de valeurs communes de référence, ni de la valeur de la pluralité des biographies organisées au nom de la liberté individuelle. Il convient d’éviter d’avoir un unique modèle de famille obligeant à considérer les autres modèles comme des formes de déviance.
La notion d’identité narrative peut y aider car elle ne part pas de propriétés (le biologique ou le social), mais d’actions, d’événements et de relations, ces éléments construisant une vie humaine à l’intérieur d’un itinéraire biographique. Ces actions ou ces événements sont les suivants. Tout enfant est, d’abord, engendré. Puis, il est soigné, introduit au monde humain par ceux qui prendront en charge sa dépendance dès ses premiers jours de vie. Il est éduqué à occuper un ou des rôles sociaux, et à apprendre ? à prendre sa place dans la société, comme futur adulte. Cela n’est pas systématiquement assuré par les mêmes personnes.
Dans ce cadre, on pourrait reconnaître que les situations de pluri-parentalités liées à la procréation médicalement assistée et celles liées à l’adoption ont de nombreux points communs. Il n’est d’ailleurs pas étonnant d’entendre, aussi bien de la part des enfants adoptés que de la part des enfants nés de procréation médicalement assistée, ce même questionnement sur le blanc juridique fabriqué au niveau de leur histoire.
Reconnaître une certaine pluralité des liens de la filiation ou des liens de la parentalité constituerait une première avancée. Ceci est possible à la condition que cette pluralité de la parentalité soit ordonnée, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas une menace pour les personnes concernées. De ce point de vue, j’ai bien entendu ce que les associations qui réclament le droit à la connaissance des origines dans le cadre des AMP ont énoncé. Dans leurs revendications, on ne trouve aucune contestation du fait que celui que le droit désigne comme le père ou la mère d’un enfant, inscrit ce dernier dans la plénitude des liens de filiation.
La connaissance des origines, à savoir la levée de l’anonymat des dons d’engendrement, ne transforme pas les donneurs d’engendrement en parents. Elle confère une place sociale à des actions et des individus auxquels nous reconnaissons une valeur. Ce problème a, d’après moi, été insuffisamment soulevé. Les donneurs d’engendrement sont animés par un certain nombre de valeurs. Nous ne pouvons pas reconnaître le sens de ces actions si nous effaçons et les personnes, et les actes.
Effectivement, la levée de l’anonymat n’est pas une simple question d’étiquette, comme cela a été indiqué. En fait, plusieurs interrogations majeures seront soulevées, dans le cadre de la réflexion sur la loi de bioéthique, autour de cette problématique.
La première consiste à savoir comment se définit l’engendrement. Peut-on considérer que l’engendrement chez les humains soit défini comme un acte biologique ? Il a, évidemment, une dimension physique, mais il est simultanément moral et mental. C’est ce que nous apprend l’anthropologie de l’engendrement. Dans son livre « Les métamorphoses de la parenté », Maurice GODELIER emploie une formule qui paraît un peu simpliste : « Dans aucune société, un homme et une femme ne suffisent à faire un enfant ». Il explique que, dans toute société, outre un mâle et une femelle humains, quelque chose d’autre (les esprits, les dieux, le spirituel etc.) est présent dans la représentation de l’engendrement. Cette dimension spirituelle concerne également les sociétés laïques car elle rappelle que l’action physique de la reproduction est mise en signification, ce qui explique que l’engendrement n’est pas réduit à un acte biologique ; il est toujours signifiant à travers le système de parenté.
La deuxième réflexion porte sur la conception de la personne sur laquelle s’appuie l’opposition entre le biologique et le social. Selon cette conception dualiste, une personne serait composée d’un moi et d’un corps. Ce dualisme est loin d’aller de soi et mériterait une discussion sur les conceptions implicites de la personne. Je rappelle que ce dualisme n’appartient à aucune tradition religieuse et a plutôt été créé par les philosophies modernes de la conscience.
Par ailleurs, nous discutons d’un droit à connaître ses origines. En accord – je crois – avec Geneviève DELAISI de PARSEVAL, dont j’apprécie beaucoup les travaux, j’évoquerai plutôt un droit à ne pas être privé de l’accès à son histoire et à son identité narrative. J’entends les revendications sur ce sujet, bien que je pense que nous devrions réfléchir à la notion d’origine. Dans la souffrance évoquée par certains enfants privés de l’accès à la connaissance d’une partie de leur histoire et dans cette notion d’origine, j’entends un souhait de revenir vers la condition commune.
Ces enfants sont mis en situation difficile car ils vivent dans un monde dans lequel l’engendrement a beaucoup d’importance. Quand, tous les jours, ils sont confrontés au témoignage de cette importance, comment peuvent-ils s’entendre signifier que, pour eux, ce n’est pas l’engendrement qui compte, mais le fait d’être aimé ? Ces enfants estiment qu’on ne peut pas les couper de la condition commune à ce point. Ils ont, eux aussi, été engendrés. Ils sont, eux aussi, des corps mortels. Or, ils sont privés de la possibilité d’inscrire leur mortalité dans leur naissance. Nous faisons d’eux une espèce à part et, même si cela n’a pas été voulu comme tel, nous devons entendre que cela est ressenti comme tel.
Enfin, le dernier point est celui de l’homoparentalité. Plus nous serons en mesure de rompre le secret sur l’histoire de l’engendrement et de l’éducation des enfants, plus nous serons en mesure de comprendre que les revendications portées au nom de l’homoparentalité ne sont pas des revendications en faveur de l’engendrement des enfants par l’esprit ou la pure volonté. Elles ne constituent pas un déni de la différence entre les corps masculins et féminins. La question qu’elles révèlent est, justement, le « pot-aux-roses » que représentent les situations d’adoption ou d’AMP dans lesquelles les couples receveurs passent pour des couples engendreurs.
L’homoparentalité fait sauter cette fiction car elle révèle, au travers des couples constitués de deux hommes ou de deux femmes, que le couple receveur n’est justement pas le couple engendreur. Si nous accédions à la demande de droit à l’histoire et à la pluralité des personnes qui ont participé aux engendrements complexes, les revendications d’homoparentalité apparaîtraient comme étant beaucoup moins particulières et susciteraient beaucoup moins de passions qu’à l’heure actuelle.
8 M. Jean Sébastien VIALATTE
Je vous remercie beaucoup et ouvre le débat.
‚
8 Mme Pauline TIBERGHIEN, Présidente de l’association PMA, (Procréation Médicalement Anonyme)
J’appartiens à l’association PMA qui souhaite que la loi change et que chaque personne issue d’un don de gamète, en France, puisse accéder à toutes ses racines, sans mensonge et sans manipulation. Aujourd’hui, nous avons effectivement trente ans de recul et il est grand temps d’admettre que la recherche des origines est une quête universelle. Quatorze pays, avant nous, l’ont déjà fait.
Il existe une fédération internationale qui regroupe toutes les associations défendant la même cause que PMA, c’est-à-dire la liberté de choix, le choix, pour une personne issue d’un don, de savoir ou de ne pas savoir. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de simplement reprendre ce qui se fait à l’étranger, mais de se servir de l’expérience des autres pays pour ne pas tomber dans les mêmes écueils.
Les interventions qui viennent d’être effectuées m’amènent à quatre réflexions. Il est regrettable qu’on nous resserve comme chaque fois, la question de l’amant ou les 3 % d’enfants issus d’adultère. Nous ne traitons pas de la même chose. Nous demandons la possibilité de livrer des informations détenues par le corps médical, et non des secrets de famille.
Par ailleurs, j’ai bien compris que l’anonymat était inscrit dans le marbre de notre Code Civil, en tant que principe établi pour tous les produits du corps humain. J’ai également compris le contexte dans lequel ces dispositions ont été prises. Toutefois, nous pourrions peut-être, aujourd’hui, essayer de différencier les situations. Le don de gamète n’est pas un don de cellules ordinaires ou le don d’un produit de santé comme un autre. Il s’agit d’un don d’hérédité qui pourrait imposer de revoir certains articles de loi. Pour moi, ceci est parfaitement possible car la loi est celle des hommes et doit évoluer.
Que se passerait-il, pour les trois protagonistes, si l’accès aux origines était autorisé ? L’enfant serait respecté dans sa dignité humaine et ne se verrait pas confisqué, sciemment, arbitrairement, médicalement et légalement, un morceau du puzzle de son identité. Ses parents devraient effectivement digérer leur infertilité et être capables d’en parler.
Nous accueillons, au sein de l’association PMA, des donneurs et tous ont à peu près le même discours. Ils expliquent que s’ils ne tiennent pas réellement à connaître les personnes issues de leur don, ils trouvent insupportable de savoir que celles-ci souffrent. Ce n’était pas le but de leur geste !
Enfin, j’ai cru comprendre, de l’intervention de Mme CAMBY, que celle-ci préfèrerait presque, à la levée de l’anonymat, des dons totalement non répertoriés. Ai-je mal compris quand vous avez expliqué qu’il serait préférable qu’il n’y ait pas de données du tout ?
8 Mme Carine CAMBY
J’ai expliqué qu’il était difficile, pour les médecins qui détiennent les données, de refuser les demandes d’accès à celles-ci. Existe-t-il, aujourd’hui, une raison médicale avérée de conserver ces informations dans les centres d’assistance médicale à la procréation ? Je n’en suis pas certaine.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Nous pouvons peut-être dégager, sur ce sujet, une position commune. Nous déciderions que, si l’anonymat est maintenu, il n’y a aucune raison de conserver les données.
8 Mme Pauline TIBERGHIEN
C’est bien ce que j’avais compris ; ces données ne seraient plus détenues par les médecins et je trouve cette perspective très choquante. Je crois que nous en saurons bientôt plus sur la traçabilité du bœuf vendu dans vos supermarchés que sur les enfants nés par IAD. Je souhaite donc finir mon intervention par cette question. Demain, vous rencontrez votre mère qui vous explique que vous êtes issu d’un don de sperme anonyme ? Que ressentez-vous ?
8 M. Alain CLAEYS
Madame, nous comprenons votre demande. Il est normal que, dans une réunion comme celle-ci, nous abordions l’ensemble des sujets. Vous devez l’accepter. Pour replacer les propos de Mme CAMBY dans leur contexte, sachez que, même si le législateur décide de revenir sur le principe d’anonymat, la loi ne sera pas rétroactive et les données détenues par les médecins ne seront pas utilisables.
Nous avons reçu un certain nombre d’associations en audition privée. La présente audition est publique et nous abordons l’ensemble des aspects de la problématique ; il est normal que nous ne soyons pas d’accord sur tous les sujets. Nous allons écouter toutes les réactions, je vous demande simplement d’être brefs afin que nos intervenants puissent répondre.
8 Mme Ginette GUIBERT, Gynécologue
Je suis gynécologue dans un centre d’aide médicale à la procréation. Je voulais apporter quelques précisions issues de l’expérience pratique et quotidienne dans ces structures.
D’une part, comment peut-on réellement évoquer la toute puissance de la génétique dans la demande d’une personne à connaître un des êtres humains à l’origine de son existence, lorsque cet autre être humain est une femme et a vécu ce qu’on peut vivre dans le cadre d’un don d’ovocyte? À ce titre, je voudrais attirer votre attention sur la différence importante entre le don d’ovocyte et le don de sperme. Si nous avions réfléchi dans l’autre sens, de l’un à l’autre, nous n’aurions peut-être pas abouti aux mêmes conclusions.
D’autre part, il a été indiqué, à plusieurs reprises, que l’anonymat pouvait préserver les relations entre le donneur et le receveur et, de ce fait, limiter les trafics. Il faut sortir d’une certaine langue de bois à ce sujet. Le trafic existe en France. Des pressions sont exercées par l’intermédiaire du système du don croisé. Ces pratiques sont très choquantes pour les professionnels qui travaillent, au quotidien, au contact des donneuses et des receveuses. Il existe des cas de marchandisation entre donneuses et receveuses. Je n’évoque pas, ici, la pratique de la double liste dont nous pourrions, d’ailleurs, également débattre.
8 Mme Carine CAMBY
Faites-vous allusion aux femmes qui bénéficient plus facilement d’un don ?
8 Mme Ginette GUIBERT
Récemment, Dominique MEHL a publié un livre dans lequel elle raconte comment des personnes qui souhaiteraient donner spontanément se mettent en contact avec des femmes pour les faire passer plus vite. Le don spontané est donc inhibé. Par ailleurs, il existe des pressions entre donneuses et receveuses. Nous recevons des femmes qui sont les employées de celle qui a besoin d’ovocytes ou qui sont en tractation financière avec elle. Il existe réellement un phénomène de marchandisation et l’anonymat ne préserve absolument pas de cela.
La cohérence du droit n’est pas l’homogénéité des pratiques. Le fait que nous puissions revenir sur l’anonymat en ce qui concerne le don de gamète n’est pas, en soi, incohérent avec l’anonymat dans le don d’organe ou le don de sang. D’ailleurs, cela n’a posé de problème à personne que le don d’organe entre vifs n’entre naturellement pas dans la règle de l’anonymat.
8 Mme Jacqueline MANDELBAUM, Membre du Comité consultatif national d’éthique, responsable du laboratoire de fécondation in vitro de l’hôpital Tenon
Je suis, depuis fort longtemps, médecin dans le secteur de l’assistance médicale à la procréation. J’ai entendu Geneviève DELAISI de PARSEVAL et Irène THERY et j’ai été très sensible à leur argumentation. Vous avez défini une manière de concevoir ces procréations à acteurs multiples en adulte, qui doit être comparée à une conception un peu infantile qui serait celle qui existe actuellement.
Néanmoins, je m’interroge sur le retour d’expérience issu des pays qui ont levé l’anonymat. Nous ne disposons pas de séries de données indiquant comment cela est vécu. Je me suis laissé dire et ne sais si c’est exact, que cette situation était due au fait que les parents n’expliquaient plus à leur enfant le mode de leur conception. La levée de l’anonymat se produirait donc dans un moment où l’espèce humaine n’est pas suffisamment adulte pour cela. Pouvez-vous commenter ce point ?
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Nous avons effectivement entendu cet argument au cours de nos auditions. La levée de l’anonymat aurait généré le secret des parents. Quand, auparavant, ceux-ci expliquaient le don de gamète, ils se mettaient à le taire de peur de l’intrusion d’un tiers dans la famille.
Dans un certain nombre de cas où il y a eu levée de l’anonymat, les parents ont cessé d’expliquer le mode de conception. En Allemagne, par exemple, le législateur est allé très loin. Dès lors que l’enfant a la connaissance de ses origines biologiques, il peut demander, par voie de justice, la répudiation de son père et l’adoption par son père biologique. C’est pourquoi certains parents se taisent.
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL
L’expérience la plus riche que je connaisse est celle de la Nouvelle Zélande qui a voté la levée de l’anonymat à la fin de 2004. Une étude récente sur les familles construites par IAD démontre que 84 % des parents ont parlé à leurs enfants des circonstances de leur conception ou ont l’intention de le faire, comme si le personnage supplémentaire du donneur était perçu comme non ambivalent, donc digne d’être nommé.
Sur ces sujets, nous ne nous situons pas sur des grandes séries, mais sur des éléments qualitatifs. Nous avons la chance d’accueillir, ici, des représentants de l’association PMA et de bénéficier du recul d’une génération. Ces personnes viennent témoigner de leur histoire. Ce n’est pas simplement le nom du donneur qu’elles cherchent. Elles expriment une revendication d’histoire et nous offrent, de ce fait, une nouvelle grille de lecture. Il faut les écouter.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Nous sommes là pour les écouter et l’avons fait, à plusieurs reprises, en privé et en public. J’entends parfaitement bien leurs revendications. Je regrette quand même que les CECOS n’aient pas effectué de suivi. De ce fait, nous ne connaissons pas la proportion des enfants nés par ces méthodes qui demandent à connaître leurs origines. De plus, je redoute des problèmes de cohérence avec notre droit de la filiation. Je crains que, un jour ou l’autre, la revendication à la connaissance des origines soit poussée plus loin et que certains commencent à demander une véritable filiation.
Nous devons donc réfléchir très précisément à ces sujets avant de prendre une décision. Nous ne pouvons prendre celle-ci sur la simple revendication de ces jeunes gens, même si cette revendication est très importante. Certaines conséquences sur notre système de droit civil ou notre système de filiation pourraient être inévitables.
8 Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL
Ces personnes donnent des choses à comprendre, plus qu’elles ne portent de revendications.
8 Mme Dominique LENFANT, Présidente de l’Association Pauline et Adrien
Toutes les personnes ne portent pas les même demandes et revendications.
8 M. Alain CLAEYS
Je souhaite intervenir sur l’organisation de cette table ronde. Je comprends la pression que soulève ce sujet très important, je vous demande simplement d’être raisonnables et responsables. Il nous reste une table ronde à organiser. Je vais passer la parole à l’un d’entre vous avant de laisser les intervenants répondre. Comprenez notre état d’esprit sur ce sujet. Il ne serait pas honnête de notre part de vous répondre ce soir. Nous mettons ce sujet en débat car il devra l’être au niveau de la représentation nationale. Je ne sais pas sur quoi cette discussion débouchera, mais elle aura bien lieu. On ne déforme pas votre revendication.
8 M. Arthur de KERMALVEZEN, Association PMA
L’anonymat encourage le secret de famille. Je vous en donne un exemple. À cinq ans, une grand-tante se penche vers moi, me pince la joue et me dit : « Qu’est-ce que tu ressembles à ton papa ! », ce qui, d’ailleurs, est sûrement vrai dans la gestuelle. Cependant, je n’étais pas en âge de comprendre et j’ai vécu un premier grand moment de solitude. Évidemment, la liste de ceux qui ont suivi est longue.
Vous avez également évoqué l’implantation post mortem. Étant donné que je ne sais rien sur l’homme qui m’a transmis ses gènes et que les gamètes mâles se conservent pendant un certain temps, je ne sais absolument pas s’il était mort ou pas. Pour vous, ce n’est peut-être pas important, mais c’est une question qu’on peut se poser. On pourrait supposer qu’à travers la levée de l’anonymat, je cherche un autre nom de famille. Je tiens à vous dire que je suis très fier de porter le nom de mon père et que je n’en changerai pour rien au monde.
L’association PMA est pour l’anonymat, mais contre l’anonymat à perpétuité. En d’autres termes, l’anonymat est utile à condition qu’à la demande de l’enfant et uniquement à la demande de l’enfant, le géniteur puisse être identifié par l’enfant s’il le souhaite. Mes parents ont reçu un cadeau qui a permis que je sois là et c’est moi qui, en premier lieu, en profite. Cependant, ce cadeau est un peu comme un bouquet de fleurs sur lequel serait apposée une jolie carte marquée anonyme. Au bout d’un moment, vous ne profitez plus des fleurs. Certains commencent à mener une enquête pour essayer de savoir d’où ils proviennent, d’autres vont décider de jeter le bouquet à la poubelle, etc.
Je regrette de constater que, dans le cadre de l’insémination artificielle avec donneur qui pallie l’infertilité de mon père, l’anonymat fait glisser l’infertilité que celui-ci a rencontrée vers une infertilité dans les mots, pour moi-même et dans ce que je vais transmettre à mes futurs enfants.
8 Mme Irène THÉRY
Vous semblez considérer que la revendication du droit à connaître son histoire, ou plutôt à ne pas être privé juridiquement et administrativement de son histoire, reposerait sur une forme de « biologisation ». Vous avez notamment exprimé la crainte qu’en commençant par répondre à ces revendications, nous aboutissions à la situation allemande. Encore une fois, j’ai amplement développé la thématique des transformations de la parenté parce que, dans le cas des procréations médicalement assistées comme des adoptions, je n’entends aucune revendication selon laquelle le vrai parent serait le donneur ou le parent de naissance.
Ce qu’il faut entendre, c’est plutôt le refus de cette éternelle alternative. Qui est le vrai parent quand on a eu plus d’un homme et plus d’une femme dans sa conception ? Pourquoi notre société, qui organise concrètement la pluri-parentalité, ne peut-elle pas l’instituer en droit ? C’est la question qui est soulevée et qui renvoie une partie des enfants en dehors de valeurs considérées comme fondamentales par le plus grand nombre. Vous ne pouvez pas, vous qui connaissez votre père et votre mère, aller expliquer à ces enfants qu’ils ont une approche biologisante quand ils veulent savoir d’où ils viennent. Ce n’est pas acceptable !
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
En début de séance, on nous a encouragés à aller examiner ce qui se passait à l’étranger. Maintenant, on me reproche le contraire. Le législateur, au moment où il entrouvre une porte, doit essayer de mesurer toutes les conséquences de cet acte. Je vous défie de savoir quelle est ma position personnelle, aujourd’hui, sur ce sujet. Je me suis bien gardé d’en exprimer une. Je nous invite simplement à prendre garde.
8 M. Pierre JOUANNET
Je voudrais témoigner de mon expérience de médecin qui s’occupe de ce type de situations depuis très longtemps. Depuis plus de trente ans, les médecins se trouvent dans l’interrogation. De plus, tout choix, en matière d’éthique, est souvent un compromis avec avantage et inconvénient. Il faut donc bien réfléchir à ces questions. J’ai rencontré un certain nombre de parents et d’enfants et j’ai aussi entendu des personnes qui exprimaient un autre point de vue que celui décrit par Geneviève DELAISI de PARSEVAL. En particulier, j’ai rencontré des personnes qui n’étaient pas en souffrance. C’est complexe.
Je crois qu’Irène THÉRY a tout à fait raison. C’est notre conception des liens de filiation et des liens d’engendrement qui est en jeu. Pour avoir discuté de ces questions avec de nombreux couples, il me semble que votre présentation de l’engendrement n’est pas tout à fait exacte. Vous semblez éliminer le fait que le couple stérile puisse être procréateur. Or, dans les situations que nous rencontrons, il n’y a pas qu’une intervention de l’esprit. Le couple intervient aussi avec ses tripes, ses émotions, son amour, son désir et l’aide d’un donneur.
En ce sens, ce que vous évoquez en matière de pluri-parentalité est très intéressant. En effet, si nous levons l’anonymat, il risque fort de se passer la chose suivante. Les couples iront choisir les donneurs sur Internet. La pluri-parentalité n’existera pas à dix-huit ans, mais dès la naissance de l’enfant. Notre société est-elle prête à organiser des liens de filiation dans ce sens ? C’est possible, mais il ne faut pas perdre de vue que ces situations sont complexes.
Vous évoquez, par exemple, la situation des pays étrangers. La Nouvelle Zélande n’a fait évoluer son dispositif que depuis quatre ans. Nous ne pouvons donc pas tirer grand-chose de cette expérience. Des informations existent pour un pays, les États-Unis. Certains de mes collègues américains qui gèrent des banques de sperme proposent à l’enfant, non seulement un lien avec le donneur, mais également une relation avec ses frères et ses sœurs, soit les autres enfants conçus à partir du sperme du donneur. Nous voyons ainsi apparaître, dans les journaux, des photos de familles reconstituées à partir des frères et des sœurs issus d’un même donneur et présentées comme un idéal de bonheur et d’épanouissement. Je ne suis pas contre ces évolutions, mais il faut bien mesurer leurs conséquences en matière de liens de parenté. Qu’elle sorte de pluri-parentalité cela donne-t-il ?
8 M. Henri ATLAN
Je suis très impressionné par l’intervention d’Irène THÉRY. Toutefois, je suis moins optimiste qu’elle sur les voies de sortie. Dans votre intervention, vous demandez pourquoi cette société, qui organise la pluri-parentalité, n’arrive pas à intégrer un modèle commun. La réponse me semble très simple. En fait, si la société organise bien cette pluri-parentalité, elle le fait de manière très désordonnée et indépendamment de toute question médicale ou biologique du fait des familles éclatée. D’après vous, nous serions au milieu du gué. Le problème, c’est que personne ne sait dans quel sens ira le gué ! Vous évoquez la nécessité d’un système de parenté commun. Encore faut-il que celui-ci existe ! Or, il n’existe pas puisque justement, au contraire, la société moderne détruit tous ces systèmes.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Nous passons à la table ronde suivante, dont le sujet est la gestation pour autrui.
GESTATION POUR AUTRUI :
INTERDICTION OU AUTORISATION ?
8 M. Alain CLAEYS
Le sujet de la gestation pour autrui est dense, il suscite des débats passionnés. Je donne la parole à Israël NISAND
8 M. Israël NISAND, Gynécologue obstétricien, chef de service aux hôpitaux de Hautepierre (Strasbourg)
Je souhaite en préalable remercier Messieurs les députés de m’avoir invité à donner un avis sur un sujet difficile qui touche à la fois la filiation, la famille et l’engendrement. Pour s’en rendre compte, il suffit de laisser courir à ce sujet une interrogation autour de la table familiale pour ressentir immédiatement la lourdeur des enjeux éthiques et la diversité des avis. L’éthique est ici bousculée par la technique.
Depuis des années, je suis confronté, à titre personnel et professionnel, aux demandes de couples en mal d’enfant et j’ai pu découvrir des contextes cliniques fort difficiles. Au fil du temps, ils m’ont conduit à mener une réflexion éthique et juridique sur la grossesse pour autrui. Bien que les affects éprouvés par un médecin ne fournissent pas une bonne assise pour l’écriture de la loi, car souvent marqués d’un sceau compassionnel, le fait d’être témoin de ces demandes force l’entendement et la recherche du sens. Je suis donc devant vous en tant que médecin, chanceux d’avoir été stimulé à la réflexion par des couples très divers, pour vous livrer mes interrogations et mes hésitations avec toute leur complexité au regard des valeurs morales qui sont les miennes.
La législation actuelle est d’un certain confort : elle interdit tout. Cette position, qui a le mérite de la clarté, ne dispense pas de dire ce que le droit français protège par cet interdit ; elle ne dispense pas d’expliciter la philosophie du droit et oblige à dire comment la France gère les problèmes de filiation induits par cette pratique lorsqu’elle est mise en œuvre à l’étranger.
Avant de vous présenter deux vignettes cliniques récentes, choisies à dessein parce qu’elles montrent deux situations totalement opposées, je voudrais me servir du bagage mythique de l’Occident sur cette question pour déceler ce qui nous agit un peu par-devers nous.
Saraï, épouse d’Avram, était stérile. Par générosité et compréhension pour son mari, décidée à lui accorder une descendance, elle lui proposa d’avoir des rapports avec sa servante, Agar. Cette union donna naissance à Ismaël. Après le rituel de la couvade, Ismaël devint l’enfant de Saraï et d’Avram. Agar, la servante, est donc la première mère porteuse connue de notre culture occidentale. Peut-être s’agissait-il d’une stérilité psychogène ou d’un coup du sort, mais Saraï, peu après, tomba enceinte des œuvres d’Avram et donna naissance à Isaac.
Par un juste retour des choses - comme à l’accoutumée chez les humains - les relations entre Sarah (qui a changé de nom quand elle est devenue mère, de même qu’Avram qui devient Abraham) et Agar se détériorèrent et Sarah renvoya Agar et son fils Ismaël dans le désert. Peut-être portons-nous tous encore aujourd'hui le poids mythique de ce conflit encore inachevé, mais toujours est-il qu’Agar, la première mère porteuse du monde occidental, était bel et bien la servante de Saraï.
Au centre du débat éthique sur les GPA, se trouve donc la relation de subordination d’une femme vis-à-vis d’une autre et son instrumentalisation possible. Et la question la plus délicate à traiter : l’indisponibilité du corps humain et la répulsion à le faire entrer dans le champ des biens et des contrats. Au centre du débat éthique, se trouvent aussi posés le sort de l’enfant ainsi conçu et les conséquences négatives qui peuvent l’atteindre, voire altérer ses droits, lui qui n’est responsable en rien de ces montages compliqués. En effet, l’instabilité juridique issue de ces pratiques à l’étranger peut confiner au drame lorsque l’enfant n’a toujours pas d’état civil validé après plusieurs années de vie.
Permettez-moi de vous citer deux exemples. Voici le premier. Adeline et son mari Mathieu, âgés de 28 ans, consultent en septembre 2007 à l’issue de l’histoire suivante. En août 2006, l’accouchement de son premier enfant, après une grossesse normale, se déroule mal. L’obstétricien, au demeurant fort compétent, se trouve confronté à une difficulté d’extraction totalement inattendue et inédite. Il finit par avoir gain de cause après une manœuvre d’extraction lourde et périlleuse. Adeline peut enfin prendre son enfant dans les bras et le mettre au sein. Après dix minutes de bonheur et de découverte mutuelle, elle est victime d’un malaise et la sage-femme s’aperçoit qu’elle perd beaucoup de sang. L’obstétricien se fait aider par un collègue chevronné et opère assez vite la patiente qui présente une pathologie exceptionnelle, une inversion utérine.
Le geste chirurgical est terminé avec succès. La mère est installée ensuite au service de réanimation de la clinique. Deux heures plus tard, les saignements reprennent si sévèrement que l’on décide de la transférer au CHU de mon service. Pendant le transfert, elle fait un premier arrêt cardiaque rattrapé grâce à l’expérience des urgentistes du SAMU. Elle en fait un second en arrivant au CHU. La seule solution pour lui sauver la vie est de pratiquer de toute urgence une hystérectomie sans savoir si au réveil il y aura des séquelles liées aux deux arrêts cardiaques. Pendant ce temps, son enfant décède d’un épanchement sanguin au niveau de la tête lié aux manœuvres d’extraction. Adeline apprend la dramatique nouvelle à son réveil, deux jours plus tard. Elle n’a pas de séquelles.
Une année d’abattement et de dépression assez grave se passe. Elle n’a vu son enfant que dix minutes et se retrouve sans utérus. Sur son lieu de travail, plusieurs de ses collègues, très émues par l’accident survenu à leur attachante collègue, se proposent de porter son enfant à venir car tout le monde autour d’elle estime que l’on ne peut en rester là. Même sa soeur aînée propose de porter pour sa sœur un enfant. C’est ainsi que la demande d’aide est formulée auprès des médecins un peu plus d’un an après le drame.
À la proposition d’adopter un enfant que je leur fais, le couple n’émet pas de refus catégorique en attendant que la loi de la France leur permette d’avoir un enfant issu des ovules d’Adeline et du sperme de son mari. Et si la loi ne changeait pas, ils me répondent : « nous irions à l’étranger », même si financièrement ce serait difficile pour les deux petits salaires.
À l’opposé, voici Stéphanie qui, à l’appel de son nom dans la salle d’attente début janvier 2008, se lève avec deux autres personnes qui l’accompagnent, un homme de 45 ans et une femme de 35 ans, manifestement à terme de sa grossesse. Stéphanie a 53 ans et son histoire est longue et compliquée. Elle a eu deux enfants lors d’un premier mariage, il y a 30 ans, et trouve un nouveau compagnon au moment même où une intervention chirurgicale la prive, d’ailleurs indûment, de son utérus. Son compagnon, quant à lui, n’a pas d’enfant et en souhaite très vivement. Adopter est hors de question et d’ailleurs quasiment impossible à leurs âges.
Commencent alors de longues et coûteuses tentatives mais les moyens ne comptent pas pour ce couple. Ils en ont et sont prêts à s’en servir pour un objectif qu’ils estiment légitime : donner un enfant au mari. Plusieurs mois auprès d’une agence à San Diego se soldent par un échec ainsi que plusieurs mois à Bruxelles auprès d’un centre privé. Échec, sauf en ce qui concerne les dépenses. C’est alors que celle qui se dit être sa meilleure amie, Dominique, de 18 ans sa cadette, se propose spontanément de porter leur enfant. Elle vit seule et les hasards de la vie, dit-elle, ne l’ont pas conduite à souhaiter un enfant. Mais pour rendre ce service à son amie, c’est oui. On achète des ovules à Barcelone, au prix de 8 000 euros, qui sont fécondés avec le sperme du conjoint avant que l’embryon ne soit réimplanté dans l’utérus de Dominique qui atteint le terme de sa grossesse au début du mois de février 2008.
C’est alors que le couple commence à se poser des questions sur la filiation, en janvier, un mois avant la naissance de l’enfant. Le père l’a reconnu en période prénatale. L’accouchement sous X, pour qu’il n’y ait pas de filiation avec la mère porteuse, implique le séjour de l’enfant à la DDASS mais le couple veut absolument l’éviter. L’accouchement simple ne peut donner, au mieux, qu’une adoption simple et pose des problèmes infinis en cas de conflit ou en cas de décès de l’une des parties. L’accouchement n’a pas encore eu lieu que, déjà, des nuages s’amoncèlent sur la tête de cet enfant qui n’est pour rien dans les tractations échevelées qui ont conduit à sa conception.
Pourtant cet enfant a des droits même si ses parents ont eu un comportement pour le moins primesautier au regard de leurs responsabilités filiatives. En outre, il s’avère, après contact avec l’avocat de cette famille, que la mère porteuse est rémunérée par le couple. Ici, les deux conséquences négatives de la GPA apparaissent dans toute leur intensité : l’instrumentalisation d’une femme par une autre et les conséquences négatives pour l’enfant qui ne porte aucune responsabilité dans les démarches hasardeuses de ses parents.
La juxtaposition de ces deux cas illustre les contrastes qui peuvent apparaître dans la mise en œuvre d’une même technique médicale. Une nouvelle technique existe. C’est bien sûr à la société et à ses représentants de décider par la loi, si cette nouvelle technique doit être utilisée, et si c’est le cas, avec quelles restrictions. On a bien limité le recours à l’AMP aux hétérosexuels mariés capables de démontrer leur vie commune depuis deux ans.
Mais le législateur se trouve confronté à une extrême hétérogénéité des situations. Pour certaines, comme celle d’Adeline et de Mathieu, nous pourrions être tentés de considérer qu’il existe une réelle légitimité à aider ce couple. Pour d’autres, comme celle de Stéphanie et de Dominique, nous pourrions convenir que de nombreux arguments moraux viennent s’opposer à ce type de démarches et la loi peut fonder son interdit sur des valeurs communes.
Cette configuration éthique, avec des différences, rappelle ce qu’il s’est passé pour le diagnostic prénatal. S’il existe une malformation d’une particulière gravité incurable au moment du diagnostic, le couple peut demander, quel que soit l’âge gestationnel, une interruption médicale de grossesse (IMG) qui ne pourra être effectuée que si deux médecins membres d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal attestent de la gravité et de l’incurabilité de la situation. Ce cas par cas proposé par le législateur en 1994 couvre l’analyse annuelle de 10 000 dossiers qui conduisent à 6 000 interruptions médicales de grossesse chaque année.
L’Agence de la biomédecine étudie chaque année les bilans motivés de 48 centres en France. Les décisions y sont homogènes et cohérentes. La loi est respectée et le contour exact des décisions tient compte de l’extrême diversité des situations cliniques. Ce système qui n’a pas encore dix ans de fonctionnement, a prouvé son efficacité dans un domaine plus que délicat et les contrôles externes ne montrent pas de dérapage, ni d’IMG acceptée pour des malformations bénignes ou curables. Le cas par cas n’a pas été dévoyé par un laisser-faire qui serait totalement inacceptable quand il s’agit de traiter de la vie et de la mort de fœtus.
Les demandes de GPA, si l’on sortait de l’interdit complet et total dans lequel nous nous trouvons actuellement, pourraient être analysées de manière similaire. Il ne s’agit pas de décrire ici le fonctionnement d’un tel système, mais il devrait être composé, comme les comités de protection des personnes, d’une parité de représentants (professionnels et non-professionnels, femmes et hommes, personnalités compétentes sur le plan du droit de la famille).
Ces centres régionaux pourraient prendre le temps d’instruire les demandes sur une année, afin de dire si la GPA proposée respecte bien les droits de l’enfant et les droits de la mère porteuse quant à l’indisponibilité de son corps. Des médecins pourraient y être auditionnés en tant qu’experts techniques. Il pourrait même apparaître prudent que l’autorisation finale ne soit pas donnée de manière régionale mais de manière nationale, après un avis de la commission régionale. Le nombre de demandes annuelles est vraisemblablement compatible avec une centralisation nationale qui aurait le mérite de diminuer la variabilité des décisions due à la diversité des subjectivités.
En 1985, avant la loi qui interdit toute GPA, j’avais en vue de proposer ce genre de traitement et j’avais donc constitué une liste d’une dizaine de femmes de ma ville, candidates pour des procédures de mère porteuse. La moitié d’entre elles avait une motivation essentiellement financière ; l’autre moitié était constituée de femmes qui disaient en substance ceci : « J’ai la chance d’être entière et de pouvoir donner le jour à des enfants. Le propre de l’humain, c’est de pouvoir s’entraider. Je suis d’ailleurs donneuse de sang et de moelle. J’aime être enceinte. J’aime donner le jour à un enfant et ma famille est déjà constituée. Ce serait une très grande chance pour moi de pouvoir me sentir utile à ce point en rendant un service aussi important à une autre femme dépourvue de son utérus. ».
Cette générosité existe, je l’ai rencontrée. L’entretien avec une telle femme, prolongé au besoin par la rencontre avec des psychologues, permet avec une grande probabilité d’identifier les motivations des mères porteuses et de s’assurer de leur intégrité décisionnelle et de leur indépendance, y compris au regard d’une rémunération possible. Les associations de femmes cherchant à rendre ce service peuvent d’ailleurs constituer un filtre supplémentaire. Ce modèle existe depuis dix ans à Londres et le recul qui y est disponible est plutôt rassurant.
Quant à l’implication des femmes de la famille, les problèmes de dettes impayables qui font des ravages sur le plan psychologique me conduisent à considérer qu’il n’est pas souhaitable que ce soit la mère de la femme qui porte l’enfant pour sa fille. Une sœur, pourquoi pas, à la condition d’être assuré, par des entretiens itératifs, que des pressions intrafamiliales ne se sont pas exercées sur la mère porteuse pour qu’elle accepte. Au moindre doute, il faut refuser.
La loi dont s’est dotée la France interdit tout à ce jour, ce qui interdit également la discussion et l’analyse au cas par cas de dossiers au demeurant très différents. S’autoriser parfois à dire « oui » dans telle ou telle circonstance, après s’être assuré que la femme n’est pas Agar et que l’enfant ne va pas subir un mauvais sort, c’est assurément prendre des risques, mais ce n’est pas plus risqué que de continuer à tout interdire au détriment des enfants à naître après des « bricolages » à l’étranger. Continuer de tout interdire c’est risqué qu’un jour, au hasard de promesses électorales, on se mette à tout autoriser d’un seul coup, ce qui ne serait pas mieux.
La technique bouscule même la structure de la famille et de la parenté. Notre époque est privilégiée car elle nous permet d’observer, à l’échelle d’une seule génération, dans les mœurs de l’homme occidental, des changements rapides et risqués. L’humanité est embarquée à vive allure et le vertige est bien sûr au rendez-vous. Défendre avec ténacité tout ce qu’il y a d’humain dans l’homme pourrait constituer une sorte de guide pour l’écriture de cette nouvelle morale laïque. Des valeurs font en effet consensus dans notre société : non-exploitation des humains les uns par les autres, gratuité, égalité d’accès aux soins, droit de l’enfant à naître dans un milieu familial adapté comportant un père et une mère en âge de se reproduire, origine claire des gamètes, restriction de la procédure quand la mère porteuse est aussi donneuse de ses ovocytes.
Il est possible que les valeurs essentielles auxquelles nous tenons tous collectivement puissent être bel et bien respectées dans le cadre de la GPA, à condition de l’encadrer correctement. C’est un magnifique travail à venir pour le législateur.
8 M. Alain CLAEYS
Je vous remercie de cet exposé très clair et donne la parole à Mme Dominique MEHL, Sociologue, Directrice de recherches au CNRS
8 Mme Dominique MEHL, Sociologue, Directrice de recherches au CNRS
Je souhaiterai porter une parole un peu particulière, m’en faire l’écho, le porte-parole, l’interprète et la verser au débat public. C’est pour l’essentiel une parole interdite car elle accompagne des pratiques illégales, à savoir les pratiques de gestation pour autrui. Cette parole, que je souhaite vous restituer à partir de témoignages que j’ai recueillis, est une parole qui a une valeur qualitative. Je n’ai pas mené une enquête représentative ni dans le milieu des mères porteuses ni dans celui des parents d’intention. En revanche, j’ai accompagné, écouté, entendu, relancé, contredit et fait explorer leur expérience par des personnes qui ont pris le risque, dans la situation législative française, de faire appel à une mère porteuse.
J’insisterai sur quelques points.
Le premier a été mis en exergue au cours d’une table ronde précédente par Frédérique DREIFUSS-NETTER à propos des dérives. Je pense qu’il est parfaitement inconvenant, aux deux sens du terme, c’est-à-dire qu’il ne convient pas et, qu’à la limite, il est diffamatoire de parler de convenance concernant la gestation pour autrui. Je tiens les mêmes propos pour la procréation médicalement assistée car quiconque a subi des prélèvements quotidiens, un suivi strict des courbes de température, des échographies répétées, l’attente puis la survenue des règles sait pertinemment qu’il s’agit d’un parcours du combattant. Les demandes de GPA sont des cas gravissimes au niveau des situations médicales ; elles conduisent pourtant ces couples à s’adresser aux médecins en France, à entendre une fin de non-recevoir de leur part. Au mieux, ils leur conseillent de s’adresser à l’étranger, et parfois ces personnes nouent elles – mêmes ce contact.
Il existe pourtant des situations médicales dramatiques, tel le syndrome MRKH, maladie génétique où les jeunes femmes naissent sans utérus et sans vagin ou avec un utérus et un vagin tellement atrophié et dysfontionnel que la gestation est impensable, même lorsqu’une vie sexuelle est envisageable. Il s’agit aussi de traitements contre le cancer qui ont rendu l’utérus non opérationnel ou encore de premières grossesses qui se sont terminées de manière catastrophique par des hémorragies de la délivrance et des ablations de l’utérus. À chaque fois, on se trouve en situation de non-existence de la capacité gestationnelle par atteinte ou disparition de l’utérus.
Si on ne dispose pas de statistiques en France où la pratique est illégale, on peut en revanche se référer aux statistiques britanniques. En 2003, dans un grand centre anglais pratiquant la gestation pour autrui, 27 % des patientes avaient subi une chirurgie consécutive à un cancer, 16 % souffraient d’une absence congénitale d’utérus, 16 % avaient été victimes d’une hystérectomie post-partum, 16 % avaient connu des échecs répétés de FIV et 13 % des fausses couches récurrentes. Dans ce panorama d’un pays dans lequel cette pratique est encadrée, ce qui prouve que cela est possible, ne figure aucune wonder woman qui aurait choisi cette option pour ne pas voir sa taille épaissir ou qui aurait refusé de passer 3 ou 4 mois en arrêt de travail. Ces chiffres doivent inciter à bannir la problématique de la convenance et à s’interroger sur la légitimité de recourir à une tierce personne pour prendre en charge des pathologies avérées.
Deuxième point, en interdisant, on produit bien pire que ce que l’on voulait éviter car l’interdiction conduit les demandeurs à se précipiter vers des pays marqués parfois par des pratiques non éthiques, par la concurrence commerciale, par une pratique médicale qui manque de limpidité ou qui, pour le moins, demeure opaque pour des Français. Ces pratiques ont, en outre, pour conséquences dramatiques que les enfants reviennent sur le territoire sans état civil français. En interdisant, nous créons une situation d’inégalité totale, car ce sont les couples dotés de moyens financiers ou ceux qui « se saignent » qui pourront satisfaire leur désir d’enfant. On les livre par ailleurs à des systèmes médico-juridiques, à des systèmes légaux et à des agences dont les pratiques sont à mettre en cause. Enfin, on se retrouve avec des enfants qui constituent une nouvelle population de « sans-papiers » sur le territoire.
Troisième point : je souhaite partager les témoignages, les vécus que j’ai entendus de la part des parents intentionnels, des gestatrices étrangères et les résultats d’enquêtes menées à l’étranger. Pour étayer mes propos, je ne pourrais malheureusement pas évoquer le vécu des mères porteuses françaises, qui existent pourtant, mais qui n’ont pas souhaité s’exprimer, même auprès de quelqu’un leur promettant le secret.
La demande de GPA du côté des futurs parents, est une demande que l’on ne peut envisager d’éradiquer. Un certain nombre de ces femmes ont découvert leur absence d’utérus avant que la loi interdisant la GPA ne soit votée et leurs médecins leur avaient alors indiqué que la solution passerait par la GPA. Ces femmes ont donc fait le deuil de la grossesse sans faire le deuil de devenir parents d’un enfant qui viendrait un peu d’elles- mêmes et de leurs propres gènes. Elles savent que la GPA est la seule solution pour aller au bout de leur capacité corporelle d’avoir un enfant. En outre, aujourd'hui, avec le développement d’Internet, il est très facile de savoir que cette pratique existe et se fait ailleurs. Cela induit une connaissance des pratiques et des systèmes juridiques étrangers. Ainsi, le besoin de ces femmes d’avoir un enfant ne peut disparaître du simple fait de la parution de la loi qui interdit la GPA.
Ces personnes ne se vivent pas comme stériles. Elles considèrent qu’elles sont dépourvues d’une part de leur capacité corporelle à faire des enfants mais qu’une autre part fonctionne. Elles tiennent un discours inverse de celui qui est entendu de la part des personnes en demande de don d’ovules qui considèrent qu’une part de leur fertilité leur est enlevée. En d’autres termes, et de manière imagée, les unes disent qu’elles ont la « graine » mais pas la « terre » tandis que les autres disent le contraire. Ce sont des images qui explicitent leur volonté de ne pas faire le deuil d’un enfant avec leur participation corporelle. C’est donc une thématique de l’infertilité, non de la stérilité, qui les conduit sur le chemin de la grossesse assistée et non une thématique de l’impossibilité à enfanter. Ces femmes ne comprennent pas que le législateur entérine la « loi du ventre », c'est-à-dire qu’il ne reconnaît la maternité que si elle est liée à la gestation et qu’il refuse la « loi du gamète ».
La GPA a toujours existé, comme la démonstration vient d’en être faite par Israël NISAND. Elle continue à exister hors du cadre médical entre sœurs, au sein des familles, avec des accouchements sous identité dissimulée. Cette réalité existe et la loi, si elle évolue, ne viendra peut-être même pas changer ces situations. En revanche, la médecine provoque un bouleversement en dissociant la maternité en deux, ce qui était impensable autrefois quand on définissait la maternité par l’accouchement. Dans ce paysage, où plusieurs acteurs de la procréation et de la gestation interviennent, la technique vient dissocier la maternité. Si elle ne l’est pas sur le plan légal, elle l’est dans le vécu des personnes.
Quatrième point : la gestation pour autrui soulève également le primat du diktat de la génétique. On pourrait croire que ces femmes, qui disposent de leurs gamètes, sont obsédées par la transmission de leur patrimoine génétique. Lorsque l’on discute avec ces personnes, on se rend vite compte que celles-ci ont mûrement réfléchi avant de faire appel à une tierce personne pour avoir un enfant. Elles ont une large connaissance de la génétique. Elles savent pertinemment que le patrimoine ne fait pas l’identité, ce qu’est l’épigenèse, que certains gènes sont silencieux, que tous les gènes ne se combinent pas, que les conditions de la gestation peuvent modifier l’apport génétique initial. Elles reconnaissent l’impact de l’apport culturel etc. Pour ces personnes, l’essentiel n’est pas de transmettre une hérédité ou un patrimoine, mais d’avoir une participation corporelle qui induit, même si elle est aléatoire, la question de la ressemblance physique qui d’ailleurs envahit la procréation en général. Les demandeurs souhaitent pouvoir se reconnaître dans leurs enfants et que leurs enfants se reconnaissent dans les traits physiques de leurs parents.
Cinquième point : dans la mesure où je n’ai pas pu recueillir le témoignage de gestatrices, je souhaite évoquer avec vous les conclusions des études anglo-saxonnes, et ce même si les femmes sondées lors de ces enquêtes ne l’ont pas été de manière aussi approfondie que dans les enquêtes qualitatives que j’ai moi-même menées. J’évoquerai également ce que m’ont dit tous les parents intentionnels que j’ai rencontrés à propos de la gestatrice de leur enfant. Comme dans tous les cas de dons, pour de nombreuses femmes gestatrices, une situation de stérilité existe dans l’entourage, elles ont été témoins d’une souffrance liée à la stérilité. Ces femmes affirment aussi que cette grossesse pour autrui leur donne un sentiment d’accomplissement personnel, voire de puissance personnelle. Elles expriment aussi le fait que cette grossesse vient rehausser leur estime d’elles-mêmes. Parmi les témoignages que j’ai pu recueillir, la motivation financière des gestatrices n’est pas la motivation première, je ne nie pas que cela puisse exister ailleurs.
Les rapports entre les parents et la gestatrice peuvent être qualifiés de rapports de distance mais aussi de rapports de proximité : ni trop près, ni trop loin. De nombreux parents intentionnels renoncent à la proposition d’une sœur, de peur d’une intrusion dans l’exercice de la parenté. Ils craignent également qu’une donneuse d’ovocytes trop proche, réclame un droit de regard sur la manière d’élever l’enfant. Ceci explique que de nombreux parents privilégient le recrutement de mères porteuses via Internet. Ils souhaitent ainsi faire appel à une personne qu’ils connaîtront, car Internet permet un contact et brise l’anonymat. Ce canal permet d’engager une longue procédure de discussions, de rencontres, d’échanges et de choix mutuels.
Certains se rendent compte à cette occasion qu’ils partagent les mêmes loisirs et les mêmes goûts musicaux. Mais ce canal offre aussi la possibilité de maintenir une certaine distance. Les relations sont alors ni impersonnelles, ni par trop personnelles. Ce vécu se retrouve aussi dans le terme choisi le plus souvent pour qualifier la gestatrice. Quasi toutes refusent le terme de « mère porteuse », refusant ainsi d’être affublées d’une qualification maternelle. Le plus souvent, le terme de « nounou » est employé, c'est-à-dire qu’elles se considèrent les gardiennes, l’espace d’un moment, d’un enfant qu’elles vont ensuite confier à leurs parents. Ce terme de « nounou » illustre aussi parfaitement le désir de préserver à la fois une certaine distance et l’envie de partager une certaine proximité. On se situe dans une sorte de famille élargie mais non dans une famille restreinte. Ceci rejoint le constat d’ Irène THÉRY.
En effet, dès lors que l’on considère que l’intervention de plusieurs contributeurs à l’entrée en parenté est légitime, il faut absolument différencier les notions de filiation, de parenté et de parentalité. La filiation est la parenté légale, fixée par la loi et qui ne peut être défaite que par la loi. La filiation inscrit dans une généalogie et transmet le nom de famille et est irréversible sauf jugement. La parenté ou la parentalité, c’est la présence en tant qu’une des figures ayant permis la venue au monde ou en tant qu’une des figures permettant que les enfants soient élevés au quotidien. La concordance entre parenté légale, parenté sociale, parenté éducative et parenté biologique ne coïncide pas nécessairement dans la même personne.
On se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entre une réalité mise à nu par les techniques médicales mais qui existe déjà en dehors de ces techniques. On constate que plusieurs adultes interviennent dans la venue au monde et l’éducation des enfants mais que la filiation doit rester intangible. La question est alors de déterminer comment reconnaître ou ne pas reconnaître des figures ou des rôles ou des statuts à ces autres personnes dans le paysage parental de ces enfants.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Je vous remercie beaucoup de cette présentation et donne la parole au Professeur Jacqueline MANDELBAUM, Membre du Comité consultatif national d’éthique, responsable du laboratoire de fécondation in vitro de l’hôpital Tenon, qui s’exprimera au nom du Comité national consultatif d’éthique.
8 Mme Jacqueline MANDELBAUM, Membre du Comité consultatif national d’éthique, responsable du laboratoire de fécondation in vitro de l’hôpital Tenon
Vous m’avez invitée en tant que membre du CCNE, et je rappellerai quelle était sa position.
La gestation pour autrui et le CCNE
L’avis n°3 du Comité consultatif national d’éthique a été rendu le 23 octobre 1984, au début de la FIV. À l’époque, le recours aux mères porteuses impliquait une insémination in vivo et par voie de conséquence, la participation des ovocytes de la mère porteuse. Le Comité avait alors affirmé que le recours à cette pratique, dans l’état du droit, réalisait la cession d’un enfant. « Le recours à cette pratique est, en l’état du droit, illicite. Elle réalise la cession d’un enfant… Telle est la loi, il ne faut pas la changer. Le Comité souhaite, au contraire, persuader toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette méthode de ne pas chercher à y avoir recours. »
Le Comité réaffirmait le risque d’exploitation matérielle ou psychologique de la femme qui envisage de donner son enfant. Il remarquait que si le CCNE évoquait ces conditions d’accès à la procréation, il risquait de cristalliser les inquiétudes et l’hostilité. Il soulignait le risque de glissement vers l’acharnement thérapeutique pour les couples demandeurs. Le Comité invitait par ailleurs les pouvoirs publics à organiser une consultation sur un problème de société suscité par les progrès scientifiques.
Dans un deuxième avis n° 90 du 26 janvier 2006, anonymat ou secret, le Comité insistait de nouveau sur le risque de marchandisation. « Le risque de marchandisation des grossesses par procuration est au centre même de la réflexion éthique. Il est impensable en effet d’envisager de véritables contrats de location, de livraison, avec des clauses de résiliation. Cette marchandisation de fait, qui certainement n’est pas réalisable, interdit probablement de porter à la connaissance de l’enfant les circonstances de ce marché dont il a été l’objet »
Il ajoute toutefois ceci : « Cependant, la pratique de la GPA dans d’autres pays et son caractère légal dans différents pays étrangers justifie la poursuite de la réflexion dans notre pays. L’incertitude concernant la filiation des enfants issus d’une telle maternité initiée à l’étranger pose problème. Ce n’est pas pour autant que l’on dénie la valeur des arguments éthiques qui ont conduit le Parlement à refuser la création de telles situations. Assimiler une grossesse de 9 mois à un don de gamètes est pour le moins léger ; même si le don d’ovocytes représente une plus grande transgression génétique que la gestation pour autrui. C’est faire peu de cas de l’attachement de la femme à l’enfant qu’elle porte et de l’aliénation d’elle-même qu’elle subira, même de façon consentante, et le risque de voir s’établir un marché et une exploitation commerciale des mères porteuses reste évident ».
Le troisième avis du Comité est en cours d’élaboration. Je ne peux en faire état puisqu’il n’est pas achevé. Je vous ferai donc part de réflexions qui n’engagent que ma personne.
La légitimité de la demande des femmes infertiles à demander la gestation pour autrui.
Le débat me semble actuellement très centré sur ce point. Selon moi, dès lors qu’il y a absence d’utérus ou pathologie utérine incurable entraînant une stérilité, il est légitime de vouloir dépasser ce handicap par un traitement palliatif ou substitutif. On pratique légalement en France le don de sperme, le don d’ovocytes et l’accueil d’embryons. Le moyen palliatif serait ici le prêt d’un utérus, et c’est sur ce point que réside le problème, car cet utérus ne peut pas se désolidariser du corps de la personne donneuse comme cela est le cas pour les gamètes. Il s’agit donc du prêt de son corps par une femme, non pas pendant quelques jours mais durant 9 mois. Si l’on inclut les suites de couches, cette période représente près d’une année de vie.
Il y a et il y aura toujours des histoires singulières qui seront faites d’amour, de désintéressement ou d’un arrangement entre adultes consentants, et ces transgressions à la loi et à l’usage, dans la mesure où il n’y a pas exploitation de personnes, peuvent être les pores qui permettent au tissu social de respirer. Le risque de la légalisation de ces pratiques est justement l’inscription de ce particularisme dans le marbre du Code civil.
Nous savons, cependant, comment les différents éléments biologiques qui fondent la parenté sont tantôt valorisés ou tantôt minimisés pour redessiner le roman familial que nous sommes obligés de construire de toutes pièces, puisque la biologie de la reproduction humaine est ici en panne.
Le problème majeur qui est posé touche à la filiation des enfants. Ce problème peut être résolu en apportant des solutions ponctuelles et équitables pour ne pas les pénaliser. Les couples en demande d’enfants sont en souffrance et la GPA leur apparaît comme la seule solution leur permettant de réparer la blessure de leur infertilité. Nous savons comment les différents éléments biologiques qui fondent la parenté sont tantôt valorisés ou tantôt minimisés pour redessiner le roman familial que nous sommes obligés de construire de toutes pièces, puisque la biologie de la reproduction humaine est ici en panne.
Permettez-moi de vous donner un exemple tiré de mon expérience d’AMP. Je suivais un couple dont le mari avait un sperme fortement déficient. Après plusieurs mois de traitement puis d’insémination avec le sperme du mari, le couple désespéré envisage de se tourner vers le don, car l’ICSI ne se pratiquait pas encore à l’époque. La situation, douloureuse pour le mari, l’était encore plus pour la femme qui sanglotait. Alors que je rappelai à cette femme qu’elle devait aider son mari à faire le deuil de sa paternité génétique, elle me répondit ceci : « Regardez-le. Il est beau. Il est intelligent, je l’aime. C’est un enfant de lui que je veux et pas celui d’un donneur ! ».
Du temps passe et ce couple se résout finalement à une insémination avec du sperme de donneur. Ils ont un petit garçon. Deux ans plus tard, cette femme me rappelle pour m’informer qu’elle est enceinte de son mari. Au lieu de s’en réjouir, elle me fait partager son inquiétude, craignant de faire évoluer sa grossesse alors que les spermatozoïdes de son mari sont de mauvaise qualité. Elle précise que son petit garçon, désormais âgé de deux ans, est « le plus beau et le plus intelligent du monde ». Je réussis à la rassurer. Cependant, cet appel est aussi troublant car il démontre que l’affect et l’esprit humain a d’immenses capacités de résilience et de sublimation des grandes souffrances et des grandes frustrations.
Dans la maternité pour autrui avec insémination, c’est l’importance du spermatozoïde qui était mise en avant. Avec la grossesse pour autrui, c’est l’ovocyte qui est devenu l’élément central. C’est l’enfant génétique de la femme stérile que porte la « nounou ». L’utérus est d’ailleurs souvent qualifié par les deux parties de « simple four » qui permet à la « bonne cuisine gamétique » de réussir. Lorsque l’on a besoin d’un don d’ovocytes complémentaire, voire d’un don des deux gamètes, l’accent est mis sur l’importance de la grossesse que l’on veut suivre et qui permet cette appropriation de l’enfant qui se faisant au rythme du ventre qui s’arrondit.
Si l’on ne connaît pas la mère porteuse et si la gestation pour autrui se déroule dans un lieu éloigné empêchant d’entretenir des relations suivies, l’important sera l’enfant qu’on reçoit et qui n’est guère différent de l’enfant obtenu par adoption. Il ne semble donc pas illégitime de se demander si l’enjeu de la GPA vaut les risques pris par les femmes qui auront accepté d’être des « donneuses de vie », comme elles le disent souvent.
Les risques pour la gestatrice
Les risques physiques encourus par ces femmes peuvent être illustrés par les conclusions d’une étude californienne menée en 1999 par l’équipe de Parkinson. (Human Reproduction, 14 : 671). D’après cette étude, il faut en moyenne trois transferts pour obtenir une grossesse. En moyenne, quatre embryons étaient transférés (heureusement, ce chiffre a été réduit aujourd’hui, en général, à deux), augmentant le risque de grossesses multiples. Vingt pour cent de fausses couches et quelques grossesses extra-utérines ont été recensées comme cela se produit dans d’autres circonstances. Cette étude rapporte une grande série de 95 accouchements de 128 enfants. Parmi ces 95 accouchements, on comptabilise la naissance de 27 paires de jumeaux, de deux groupes de triplés, et cinq réductions à deux fœtus de trois grossesses quadruples et de deux triples. On recense aussi 40 % de menaces d’accouchement prématuré lorsque l’accouchement est gémellaire, entraînant un alitement prolongé. Des hypertensions sont comptabilisées dans quelques cas, des saignements gênants dans 5 % des cas, un diabète dans 2 % des cas. Le taux de césarienne y est de 20 % et de 56 % dans le cas d’une grossesse multiple. Quelques complications du post-partum sont constatées (6 %), ainsi que 5 baby blues. Les résultats de cette étude montrent que les risques existent et qu’ils ne sont pas anodins.
Dans un monde où la pauvreté croît, comment ne pas penser que ce dédommagement puisse représenter un appoint voire un travail temporaire ?
D’autres risques notamment d’instrumentalisation sont à souligner. Dans un film dans lequel un couple de parents rencontrait l’éventuelle gestatrice de leur enfant, ceux-ci lui demandaient pourquoi elle avait eu l’idée de prêter son utérus. La réponse avait alors fusé : « C’est mon mari qui me l’a suggéré ! ». Ces propos m’ont interloquée car je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux 10 000 ou 15 000 euros qui viendraient dédommager cette gestation pour autrui, somme qui avait pu donner des idées au compagnon de cette femme. Dans un monde où la pauvreté croît, comment ne pas penser que ce dédommagement puisse représenter un appoint voire un travail temporaire ?
L’évaluation du risque psychologique est difficile. Certaines femmes rapportent certes des histoires altruistes où l’argent tient peu de place et où le bénéfice de cette expérience est réel car permettant une valorisation de soi et un lien fort instauré avec le couple demandeur. Cependant, les études sont rarement menées de façon systématique et dépassent rarement l’époque du post-partum. Citons ici le travail mené par le Professeur Olga Van Den AKKER en Angleterre dans un pays ayant autorisé la GPA, mais où la loi est très restrictive et protectrice vis-à-vis des mères porteuses. 61 % d’entre elles ont volontairement accepté de répondre aux questionnaires envoyés pendant la grossesse (au premier, deuxième et troisième trimestre puis pendant le post-partum à 6 jours, 6 semaines et 6 mois après l’accouchement). 66 % des femmes contactées ont répondu au premier questionnaire d’inclusion, mais seules 25 % ont répondu au suivant. Il est donc difficile de généraliser ces réponses. L’impression générale est cependant rassurante. Les mères porteuses sont peu anxieuses, ne s’autorisent aucun attachement au bébé et sont plus nombreuses à penser que cette expérience a été positive que celles qui ont le sentiment d’avoir été exploitées.
Toutefois, quand on les compare aux femmes demandeuses, elles disent être moins aidées par leur entourage (compagnon, parents, amis) et avouent connaître des dysfonctionnements dans leur couple. Qu’en est-il du ressenti du compagnon de cette femme porteuse, de ses enfants et de ses parents lorsque toute une famille est emmenée dans cette aventure et pourra en ressentir les effets ? Il est difficile de répondre, car aucune étude n’existe à ce jour. La femme porteuse doit aussi affronter le regard des autres, celui des collègues de travail, des commerçants, etc. Faut-il autoriser la GPA ou accepter une exception à l’interdiction en encadrant fortement les indications et les pratiques pour éviter les dérives ? Faut-il limiter les risques en réaffirmant la gratuité puisque les mères porteuses en France pourraient bénéficier de la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement par l’assurance-maladie comme toute femme enceinte ?
Les indications de la GPA
On entend dire que les indications de GPA représenteraient 40 à 50 cas par an en France. Heureusement, les absences d’utérus, les malformations d’appareils génitaux et les hystérectomies chez la femme jeune sont rares. De plus, toutes les patientes ne souhaitent pas avoir recours à la GPA. Il faut néanmoins être conscient qu’un cadre très étroit des indications ne satisfera pas toutes les demandes. Dans la littérature, la GPA est proposée également devant d’autres pathologies utérines plus fréquentes (polymyomatoses, synéchies, adénomyoses), pour des fausses couches à répétition, pour des interdictions à la grossesse mettant en jeu la santé ou la vie de la mère, et des échecs d’AMP sans pathologie avérée des gamètes. Ces situations représentent environ 50 % des indications dans les publications internationales.
On change donc ici de registre. Environ 25 000 couples ont recours chaque année à une AMP lourde (FIV ou ICSI), dont 40 % n’obtiendront pas le succès escompté au terme des quatre tentatives remboursées par la Sécurité Sociale. 10 000 couples seraient potentiellement demandeurs. Si seulement 1 % d’entre eux souhaitaient recourir à la GPA, ce serait 100 demandes annuelles potentielles à satisfaire. Il serait alors difficile de s’en tenir à un cadre légal très strict de la GPA d’exception.
Si l’on maintient un cadre d’application très ciblé, le tourisme procréatif se poursuivra. Si l’on élargit les indications, le nombre de femmes volontaires pour prêter leur utérus dans un cadre protecteur sera peut-être insuffisant. Alors, on évoquera la pénurie, le dédommagement bien compris et le cycle de la marchandisation se mettra en marche.
On pourrait aussi s’orienter vers une campagne de promotion pour susciter des vocations de gestatrice mais cela serait difficilement conciliable avec l’absence d’instrumentalisation. L’on pourrait aussi laisser les couples demandeurs se débrouiller seuls comme c’est le cas au Royaume-Uni. Mais, comment alors maintenir l’anonymat ? Le sera-t-il toujours ? L’anonymat ne privera-t-il pas les couples de l’un des avantages mis en avant dans le prêt d’utérus, à savoir la possibilité d’accompagner la lente gestation de l’enfant et la possibilité d’entretenir un lien entre les parents et la gestatrice ? Faut-il, comme certains l’ont suggéré, accompagner des situations difficiles en régularisant l’établissement de la filiation des enfants, sans pour autant légaliser la pratique de la GPA ? Est-ce une manière, comme le souhaitait il y a longtemps le CCNE, de persuader toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour cette méthode de ne pas chercher à y recourir ?
Le CCNE avait souhaité en 1984 une vaste consultation publique. Sans doute pensait-il normal qu’une décision concernant la manière de faire les enfants soit réfléchie collectivement. C’est ce qui est presque à l’œuvre actuellement dans les nombreux débats suscités par la révision des lois de bioéthique. C’est ce que vous faites aujourd'hui.
On entend dire que 53 % des Français seraient favorables, d’après une enquête de l’Agence de la biomédecine, à la légalisation de la GPA. Est-ce qu’une réponse à un questionnaire est suffisamment éclairée. Peut-être qu’une convention de citoyens, comme Jacques TESTART, Marie-Angèle HERMITTE et d’autres l’ont proposé, permettrait de recueillir l’avis des Français avec pertinence. En tout cas, dans l’histoire des mères porteuses, le recours à la FIV a banalisé le rôle de la femme qui prête son utérus, qui aime être enceinte – même si je n’aime pas cette expression – et qui, dédommagée, devient une simple nourrice.
Je voulais remettre au premier plan cette femme dite maintenant gestatrice. Lui faire prendre un risque inconsidéré, attenter à sa dignité serait intentatoire à l’image de toutes les femmes. Cela doit peser dans toute orientation nouvelle que prendrait la révision de la loi.
8 M. Jean-Sébastien VIALATTE
Je vous remercie de cet exposé, j’ouvre le débat.
‚
8 M. Dominique MENNESSON, Co-président de l’Association CLARA
Vous faites état d’une étude menée en 1999, alors que nous sommes aujourd'hui en 2008. Vous affirmez aussi que nous manquons d’études comportementales, ce qui est faux. Après avoir pris vos coordonnées, je vous enverrai une synthèse des 200 dernières études menées dans le monde à ce sujet ; des enquêtes sont disponibles sur le vécu après une GPA à cinq, dix ou quinze ans. Par ailleurs, dans notre association, une jeune fille de 19 ans pourrait vous parler de son vécu.
Il serait donc utile de changer les grilles de lecture. Nous ne cessons de répéter qu’il s’agit d’une atteinte à la dignité et que ce sont des pratiques à risque, tout en sachant que le risque zéro n’existe pas. Or, la question n’est pas de savoir s’il faut tout interdire parce qu’existe un risque, mais de déterminer ce que nous devons faire pour maîtriser le risque et permettre de vivre dans la dignité.
Je peux présenter quelques chiffres que vous semblez méconnaître : l’indication pour la GPA de pure infertilité utérine, c’est 18 % de l’infertilité féminine. Si nous rapportons ce chiffre au nombre de personnes qui consultent pour une AMP , nous obtenons un chiffre de 2 000 demandes par an. Ce nombre est fort éloigné de celui que vous avez annoncé.
Je pense ensuite, quand vous parlez de limites franchissables, que nous pouvons respecter un cadre. Les couples infertiles ne sont pas en demande de la mise en place d’un encadrement facile ; ils demandent simplement qu’un encadrement soit prévu et ils s’y plieront. C’est ce que je voulais vous dire, et qui est contraire à ce que vous avez énoncé.
8 Mme Jacqueline MANDELBAUM
J’ai choisi volontairement de présenter ce qui était publié dans des revues scientifiques. J’ai signalé clairement que l’étude de 1999 était ancienne mais elle illustre néanmoins tous les risques naturels de toute gestation qui sont tous survenus à un moment donné. Vous ne pouvez pas en faire l’économie et réagir comme si ces risques n’existaient pas. Les fausses couches existent, le taux de césarienne constaté est une réalité. Or, il n’est pas forcément agréable de subir une césarienne. Les grossesses gémellaires sont aussi plus difficiles à vivre, surtout lorsque l’on ne les vit pas pour soi.
Par ailleurs, je n’ai jamais prétendu qu’il n’y avait pas d’études menées mais j’ai simplement fait le point sur tout ce qui était publié dans la littérature. Le dernier travail que j’ai présenté concernant le Royaume-Uni est récent puisqu’il date de 2007.
En outre, le chiffre de 40 à 50 demandes n’est pas un chiffre que j’avance personnellement, mais celui qui a été estimé par plusieurs instances qui ont réfléchi au sujet. Je pense pour ma part, que ce nombre est largement sous-estimé car bien plus de personnes pensent qu’elles devraient légitimement avoir accès à ces traitements d’infertilité, estimant qu’elles ont des raisons tout aussi légitimes d’y avoir recours que les femmes n’ayant plus d’utérus. Que ces situations soient plus nombreuses ne fait que poser un problème supplémentaire.
8 M. Serge BLISKO, Député de Paris
Ma remarque vous étonnera peut-être. Il me semble que ces mêmes questions de filiation et de parentalité sont aussi débattues par les parents d’enfants adoptifs car les risques existent aussi dans ces circonstances. Ainsi, on sait tous que des enfants venant de Russie présentent souvent un syndrome alcoolique fœtal. Sans revenir sur les risques biologiques, ni sur les difficultés de la parentalité et de la filiation, les risques existent partout et nos pratiques doivent tenter de les limiter. Dans le cadre de l’adoption, nous essayons de moraliser les pays ayant des pratiques discutables. Ne croyons donc pas que nous sommes face à un cas très particulier et très propre à la GPA.
J’aurais souhaité que nous disposions de davantage de temps pour débattre de ces sujets passionnants. Nous avons écouté ces interventions avec grande attention et humanité, d’autant que toutes les décisions que nous serons amenés à prendre engageront l’homme dans son humanité. Ce débat mérite donc beaucoup d’écoute et de prudence. Chaque fois que nous entrouvrons une fenêtre, s’engouffre un grand courant d’air avec des conséquences que nous devons absolument mesurer pour maîtriser l’avenir de la société que nous souhaitons construire.
J’ai peine à imaginer comment nous pourrons construire une société alors que j’entends parler de co-parentalité ou de parentalité partagée. Je ne sais pas comment le législateur pourra écrire un Code Civil avec ces notions qui, selon moi, conduisent à une régression et nous ramènent vers une société un peu primitive. Nous devons aborder ces sujets avec humilité et prendre le temps du débat même s’il est difficile car passionné. En se qui me concerne, plus les auditions avancent et plus je me trouve dans le brouillard.
C’est une qualité. Je vous remercie à tous chaleureusement de votre présence et de votre participation à cette audition publique.
© Assemblée nationale